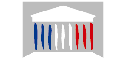______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 septembre 2016
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur les
conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français
Président
M. Olivier FALORNI
Rapporteur
M. Jean-Yves CAULLET
Députés
——
TOME II
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
La commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français est composée de : M. Olivier Falorni, président ; M. Jean-Yves Caullet, rapporteur ; Mmes Françoise Dubois, MM. François Rochebloine, Fabrice Verdier et Philippe Vitel, vice-présidents ; Mme Laurence Abeille, MM. André Chassaigne, Guillaume Chevrollier et Mme Annick Le Loch, secrétaires ; M. Élie Aboud, Mme Sylviane Alaux, MM. Jean-Luc Bleunven, Christophe Bouillon, Mmes Valérie Boyer, Isabelle Bruneau, MM. Yves Censi, Yves Daniel, Nicolas Dhuicq, William Dumas, Mme Geneviève Gaillard, MM. Jacques Lamblin, Thierry Lazaro, Philippe Le Ray, Pierre Morel-À-L’Huissier, Hervé Pellois, François Pupponi, Alain Rodet, Arnaud Viala et Mme Paola Zanetti.
SOMMAIRE
___
Pages
1. Audition, ouverte à la presse, de M. Antoine Comiti, président de l’association L214 éthique et animaux, et de Mme Brigitte Gothière, porte-parole. 7
2. Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Pierre Kiefer, président de l’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) et de M. Frédéric Freund, directeur, en charge des missions de visites des abattoirs. 25
3. Audition, ouverte à la presse, de M. Jack Pagès, directeur de l’abattoir d’Alès, et de M. Max Roustan, maire d’Alès. 37
4. Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Kauffmann, directeur de l’abattoir du Vigan, et de M. Roland Canayer, président de la Communauté des communes du Pays Viganais. 50
5. Audition, ouverte à la presse, de M. Gérard Clemente, directeur de l’abattoir du Pays de Soule et de M. Michel Etchebest, maire de Mauléon-Licharre. 62
6. Audition, ouverte à la presse, de M. Patrick Dehaumont, directeur général de l’alimentation, de Mme Emmanuelle Soubeyran, cheffe du service de l’alimentation, de Mme Sylvie Vareille, adjointe de la sous-directrice de la sécurité sanitaire des aliments et de M. Jérôme Languille, chef du bureau de la protection animale à la Direction générale de l’alimentation (DGAL). 75
7. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des représentants des syndicats d’abattoirs, avec la participation de M. Éric Barnay, président, et de M. André Eloi, directeur de la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services (FNEAP), de M. Mathieu Pecqueur, directeur général adjoint de Culture viande et de M. Henri Thébault, membre du conseil d’administration de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce en gros des viandes (FNICGV). 90
8. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des représentants d’associations de protection animale, avec la participation de M. Christophe Marie, directeur du pôle protection animale et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, M. Ghislain Zuccolo, directeur général de l’association Welfarm–Protection mondiale des animaux de ferme, Mme Agathe Gignoux, responsable affaires publiques de l’association Compassion in world farming (CIWF) France et Mme Caroline Brousseaud, cofondatrice et présidente de l’association en faveur de l’abattage des animaux dans la dignité (AFAAD). 104
9. Audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Langlois, président de l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV). 124
10. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant chercheurs et instituts techniques, avec la participation de Mme Claudia Terlouw, chercheuse à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), M. Pierre Le Neindre, ancien chercheur de l’INRA, M. Pierre Frotin, ingénieur développement coordination et promotion services et produits à l’Institut de la filière porcine (IFIP) et M. Luc Mirabito, chef de projet « bien-être animal » à l’Institut de l’élevage. 137
11. Audition, ouverte à la presse, de M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. 153
12. Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Lasne, président, et Mme Sylvie Pupulin, secrétaire générale du Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV), de M. Stéphane Touzet, secrétaire général adjoint du Syndicat national des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture (SNTMA-FO) et de Mme Alexandra Taillandier, secrétaire départementale SNTMA-FO du Tarn. 175
13. Audition, ouverte à la presse, de M. Christian Le Lann, président de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT). 193
14. Audition, ouverte à la presse, de M. Thierry Gregory, directeur des affaires scientifiques et techniques de la Fédération française des charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT). 199
15. Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Van Goethem, directeur, et de M. Denis Simonin, administrateur en charge du bien-être animal à la direction-générale santé et sécurité alimentaire de la Commission européenne 204
16. Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Delzescaux, directeur de l’interprofession nationale porcine (INAPORC). 220
17. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des syndicats d’employés du secteur agro-alimentaire, avec la participation de M. Michel Kerling, secrétaire fédéral de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière (FGTA-FO), M. Pascal Eve, conseiller fédéral de la Confédération française des travailleurs chrétiens Agriculture (CFTC-AGRI), M. Michel Le Goff, membre du comité exécutif fédéral de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail (FNAF-CGT) et M. Alain Bariller, délégué syndical central du groupe Socopa de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC). 231
18. Audition, ouverte à la presse, de Mme Karine Guillaume, directrice, M. Jean-Blaise Davaine, directeur adjoint et Mme Marie-Claude Boucher, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, de la Brigade nationale d’enquête vétérinaire et phytosanitaire à la Direction générale de l’alimentation (DGAL) 253
19. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des universitaires spécialistes de l’abattage rituel, avec la participation de M. Mohammed Hocine Benhkeira, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, titulaire de la chaire d’histoire des sciences légales en islam, de Mme Anne-Marie Brisebarre, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), membre du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, et de Mme Sophie Nizard, chercheuse en sociologie et en anthropologie du judaïsme, associée au CéSor (Centre d’Études en Sciences Sociales du Religieux-CNRS-EHESS). 263
20. Audition, ouverte à la presse, de Mme Maria Celia Potdevin, chargée de mission alimentation et agriculture de l’association de consommateurs Consommation logement et cadre de vie (CLCV) 279
21. Audition, ouverte à la presse, de M. Michel Baussier, président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires de France (CNOV) et de M. Laurent Perrin, administrateur de la fédération des syndicats vétérinaires de France (FSVF) et secrétaire général du Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) 288
22. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant Mme Florence Burgat, philosophe et directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), M. Jean-Pierre Marguénaud, professeur à l’Université de Limoges et Mme Catherine Rémy, chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 299
23. Audition, ouverte à la presse, de M. Pierre Hinard, auteur du livre « Omerta sur la viande » et de Mme Anne de Loisy, auteure du livre « Bon appétit, quand l’industrie de la viande nous mène en barquette » 318
24. Audition, ouverte à la presse, de M. Stéphane Geffroy, auteur du livre « À l’abattoir » 335
25. Audition, ouverte à la presse, de M. François Hochereau, sociologue à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et M. Félix Jourdan, sociologue, auteurs du rapport « Abattage et bien-être animal » 348
26. Table ronde, ouverte à la presse, sur la filière avicole, avec la participation de M. Paul Lopez, 1er vice-président, et Mme Julie Mayot, responsable technique et réglementaire, de la Fédération des industries avicoles (FIA), de M. Roland Tonarelli, représentant des interprofessions dinde, poulet et canard à rôtir, de M. Jean-Michel Schaeffer, président de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI) et de M. Dominique Ramon, administrateur du Comité national des abattoirs et ateliers de découpe de volailles, lapins et chevreaux (CNADEV) 359
27. Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Paul Bigard, président du directoire du groupe Bigard 377
28. Audition, ouverte à la presse, de Mme Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), et M. Stéphane Dinard, agriculteur, représentants du Collectif « Quand l’abattoir vient à la ferme » 392
29. Audition, ouverte à la presse, de M. Dalil Boubakeur, recteur de la Grande mosquée de Paris, M. Kamel Kabtane, recteur de la Grande mosquée de Lyon, de M. Haïm Korsia, grand rabbin de France, et de M. Bruno Fiszon, grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller de M. le grand rabbin de France et de M. le président du consistoire central, membre de l'académie vétérinaire de France 408
30. Audition, ouverte à la presse, de M. Raphaël Girardot, réalisateur du documentaire « Saigneurs », et de Mme Manuella Frésil, réalisatrice, et M. Philippe Hagué, chargé de la distribution, du documentaire « Entrée du personnel ». 432
31. Table ronde, ouverte à la presse, sur la vidéo-surveillance, avec la participation de M. Grégoire Loiseau, professeur à l’Université Paris-1, de M. Frédéric Géa, professeur à la Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy-Université de Lorraine, et de M. Paul Hébert, directeur-adjoint, et Mme Wafae El Boujemaoui, chef du service des questions sociales et ressources humaines, à la Direction de la conformité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 445
32. Audition, ouverte à la presse, de M. Anouar Kbibech, président du Conseil français du culte musulman (CFCM) et de M. Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de France. 459
33. Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Poulet, directeur du pôle animal de Coop de France, et de M. Philippe Dumas, président de Sicarev-Aveyron 476
34. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des représentants d’associations de protection animale, avec la participation de M. Alain Pittion, docteur vétérinaire, membre du conseil d’administration de la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France (CNSPA), de M. David Chauvet, juriste, membre fondateur de l'association « Droits des Animaux », de M. Arnauld Lhomme, responsable des enquêtes de la Fondation 30 millions d’amis, de Mme Anne-Claire Chauvancy, responsable protection animale de la Fondation assistance aux animaux (FAA), et de M. Jean-Claude Nouët, professeur et vice-président de la Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA) 488
35. Audition, ouverte à la presse, de M. Arnaud Schaumasse, chef du Bureau central des cultes au ministère de l’Intérieur 505
36. Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Luc Daub, auteur de « Ces bêtes qu’on abat, journal d’un enquêteur dans les abattoirs français » 519
37. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des syndicats agricoles, avec la participation de Mme Christiane Lambert, première vice-présidente de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), de M. Bertrand Venteau, président de la Coordination rurale de la Haute-Vienne et membre de la section viande de la Coordination rurale (CRUN), de M. Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne et de M. Jacky Tixier, président du Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF) de la Creuse 535
38. Audition, ouverte à la presse, de M. Franck Ribière, réalisateur du film « Steak (R)évolution » et fondateur de la société « Le bœuf éthique » 558
1. Audition, ouverte à la presse, de M. Antoine Comiti, président de l’association L214 éthique et animaux, et de Mme Brigitte Gothière, porte-parole.
(Séance du mercredi 27 avril 2016)
La séance est ouverte à seize heures quinze.
M. le président Olivier Falorni. Nous commençons les travaux de cette commission d’enquête en entendant, dans le cadre de notre première audition, M. Antoine Comiti, président de l’association L214 Éthique et animaux, et Mme Brigitte Gothière, porte-parole de cette association. C’est vous, madame, monsieur, qui avez mis en ligne trois vidéos montrant la réalité de trois abattoirs français, dont nous entendrons d’ailleurs demain les responsables.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Antoine Comiti et Mme Brigitte Gothière prêtent serment.)
M. Antoine Comiti, président de l’association L214 Éthique et animaux. Nous vous remercions d’avoir organisé cette commission d’enquête, et de nous avoir invités à vous présenter notre travail.
Avant de revenir sur les faits révélés par les vidéos de l’association, et d’avancer quelques propositions, je présenterai brièvement notre association et les principes qui nous guident.
L’association L214 a été créée en 2008 par quelques-uns d’entre nous, choqués, déjà, par des vidéos montrant les conditions de vie, mais aussi d’abattage, d’animaux d’élevage. Nous avons eu envie d’en savoir plus et engagé une démarche personnelle : petit à petit, nous avons commencé à militer pour l’intérêt des animaux d’élevage, dont le nombre est considérable – plus d’un milliard d’entre eux, animaux de boucherie mais aussi oiseaux, sans parler des poissons, sont envoyés chaque année à l’abattoir. C’est à ces animaux destinés à être consommés que notre association se consacre.
Notre objectif est de susciter un débat sur les abattoirs, la viande, les pratiques d’élevage, en témoignant des pratiques constatées soit par des vidéos, des images ou des rapports.
Nos concitoyens comme nous-mêmes sont très peu informés sur ce qui se passe dans les abattoirs, probablement parce que nous n’avons pas très envie de le savoir : il s’agit de mettre à mort un nombre énorme d’animaux, ce qui est déjà difficile à regarder ; de plus, dès lors qu’on se doute qu’il n’y a pas toujours de solution simple, on préfère souvent ne pas savoir.
Le travail de l’association consiste donc pour une large part à révéler des pratiques qui ne sont pas toujours, loin s’en faut, le fait d’employés déficients qui ne suivraient pas la réglementation et se livreraient dans le dos de leur employeur à des pratiques condamnables. Les abattoirs par eux-mêmes posent un problème structurel ; on ne le résoudra pas en blâmant des employés et en faisant simplement respecter la réglementation.
Notre association compte 14 000 adhérents ; 230 000 personnes sont abonnées à notre lettre d’information et, dans quelques jours, 500 000 personnes suivront nos actualités sur Facebook. Notre budget s’élevait l’an dernier à environ 1 million d’euros. Ces chiffres doublent chaque année depuis plusieurs années, ce qui nous semble révélateur d’un intérêt croissant de nos concitoyens pour la question animale en général, et pour la question des animaux d’élevage en particulier.
Le nom de l’association, L214, fait référence à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reconnaît que les animaux sont des « êtres sensibles ». Si nous sommes réunis aujourd’hui pour parler des conditions d’abattage des animaux de boucherie, c’est bien parce que nous pensons que les animaux ressentent ce qui leur arrive – si ce n’est peut-être pas le cas de tous les animaux, c’est très certainement vrai pour les animaux de boucherie. Chiens et chats peuvent souffrir, ressentir de la tristesse ou de la joie – comme celle du chien qui retrouve son maître ; il n’y a aucune raison de penser qu’il n’en va pas de même des vaches ou des cochons.
Une idée nous semble fausse : celle qui tend à considérer que dès lors que ce sont des animaux destinés à être mangés, leur souffrance ou leur bonne vie compterait moins que celle d’un animal familier. Ce « spécisme » semble profondément erroné, et injuste.
Or, notre société établit des différences absolument criantes entre la façon dont elle traite les animaux qui nous sont proches, qui lorsqu’ils approchent de la mort sont souvent euthanasiés aussi doucement que possible, et celle dont elle traite des animaux qui ont seulement la malchance d’appartenir à une autre espèce. Il ne nous semble pas juste d’avoir infiniment moins d’égards pour un cochon que pour un chien.
Ces considérations éthiques posent un problème juridique qui n’a jamais, nous semble-t-il, été traité jusqu’à maintenant. La loi établit en effet des différences de nature entre les animaux que l’on chasse, les animaux que l’on mange et les animaux familiers.
Mme Brigitte Gothière, porte-parole de l’association L214. Je vous remercie également d’avoir mis en place cette commission d’enquête.
Les animaux souffrent toujours de leurs conditions d’abattage, que celui-ci soit fait conformément à la réglementation ou pas. Les lieux d’abattage, par essence, sont des lieux violents et cruels. Les associations ne sont pas les seules à le dire ; le préambule du règlement européen sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort reconnaît que « la mise à mort des animaux peut provoquer chez eux de la douleur, de la détresse, de la peur ou d’autres formes de souffrance, même dans les meilleures conditions techniques existantes. Certaines opérations liées à la mise à mort peuvent être génératrices de stress, et toute technique d’étourdissement présente des inconvénients. » Auditionnée par une mission d’information du Sénat réunie en 2013, Mme Anne-Marie Vanelle, présidente de la section alimentation et santé du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), a également déclaré que « malgré toutes [les] précautions [prises], on ne peut cependant jamais éviter complètement le stress et la souffrance des animaux ».
La commission d’enquête porte, je crois, sur les animaux de boucherie et donc sur 263 abattoirs. Il ne faudrait pas oublier les quelque 600 abattoirs de volaille et lagomorphes, autrement dit de lapins. Il faut également se poser la question de la mise à mort des poissons, désormais également reconnus comme doués de sensibilité, et qui ne bénéficient même pas de l’étourdissement.
Je vais m’attacher ici à détailler le non-respect de la réglementation, qui entraîne des souffrances supplémentaires. Aujourd’hui, dans les abattoirs, les contrôles sont insuffisants et le suivi est trop faible pour enrayer les dysfonctionnements. Il n’y a pas de surveillance continue au poste d’abattage, alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation réglementaire : l’article 9 de l’arrêté du 12 décembre 1997 précise en effet que « les opérations d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux sont placées sous la surveillance continue des agents du service d’inspection qui s’assurent notamment de l’absence de défectuosité des matériels utilisés et de l’utilisation conforme de ces matériels par le personnel ».
Autrement dit, un représentant des services vétérinaires devrait donc surveiller en permanence la mise à mort des animaux, ce qui n’est absolument pas le cas dans les abattoirs sur lesquels nous avons pu recueillir des témoignages. C’est un poste qui n’est pas considéré comme prioritaire dans la mesure où il ne répond pas à une préoccupation sanitaire : les souffrances des animaux n’ont de conséquences que lorsqu’une caméra est placée au bon endroit.
Le syndicat national des inspecteurs vétérinaires tire la sonnette d’alarme depuis de nombreuses années : les inspecteurs ne sont pas assez nombreux, et ce ne sont pas les soixante créations de postes annuelles promises par M. Le Foll qui compenseront ces insuffisances. J’ai vu circuler le chiffre de 2 155 agents, répartis sur les 263 abattoirs d’animaux de boucherie. Mais je répète qu’il y a sur notre territoire 800 à 900 abattoirs… Il serait donc bon de prêter l’oreille aux revendications des inspecteurs vétérinaires.
Qui plus est, les pouvoirs de ces inspecteurs sont insuffisants : Martial Albar, ex-inspecteur assermenté des services vétérinaires, qui nous a contactés à la suite de notre diffusion d’images de l’abattoir d’Alès pour nous raconter son expérience, nous a précisé avoir essayé d’agir, mais sans succès. Il pourrait être intéressant pour vous d’entendre son témoignage.
Enfin, les sanctions sont rares, et même le suivi est souvent inexistant. Ainsi, en 2013 et 2014, aucune sanction pénale n’a été prise, comme le souligne l’Office alimentaire et vétérinaire européen (OAV).
Les images que nous avons révélées montrent des insuffisances qui ont déjà été signalées, et donc parfaitement connues.
J’ai déjà cité le rapport de la mission menée en 2013 par le Sénat. La Cour des comptes, dans un rapport de février 2014, s’est également alarmée de la situation dans les abattoirs : « Au total, écrit-elle, l’absence de contrôle à un niveau significatif et l’absence de sanctions suffisantes mettent en lumière des anomalies graves ». Enfin, les rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire, dont le dernier date d’avril 2015, montrent les lacunes des contrôles effectués.
J’en viens aux réponses apportées par les gouvernements successifs. En 2009, nous avions montré des images tournées dans un abattoir Charal à Metz : Bruno Le Maire, alors ministre de l’agriculture, avait assuré dans une lettre à la Fondation Brigitte Bardot que cette question était pour lui une priorité ; il promettait un audit interne et des améliorations réglementaires, notamment la possibilité pour le préfet de retirer des agréments. Quelques années plus tard, nos images peuvent amener à s’interroger : s’est-il vraiment passé quelque chose ?
Aux observations du rapport de l’OAV que j’ai cité tout à l’heure, soulignant l’insuffisance du nombre de vétérinaires en poste dans les abattoirs, Jean-Luc Angot, alors directeur général de l’alimentation, répondait benoîtement : « Oui, nos effectifs sont inférieurs aux normes européennes, qu’on considère trop élevées. On assume. L’abattoir est prioritaire et nos effectifs correspondent aux besoins : on a plus de mille personnes dans nos 250 abattoirs ». Cette inspection de l’D portait pourtant sur les abattoirs de volailles
– plus de 600, je le rappelle – et non sur les 263 abattoirs d’animaux de boucherie.
La réponse, aujourd’hui, de Stéphane Le Foll, promettant soixante postes supplémentaires par an, des inspections partout au cours d’avril – inspections qui n’auront donc rien d’inopiné –, et des représentants de la protection animale dans les abattoirs, ne fait finalement que reprendre celle de Bruno Le Maire.
Les vidéos dont nous disposons ne résultent pas de dénonciations, mais d’opportunités : il n’y avait pas forcément de signalements de maltraitance dans ces abattoirs. Nos images prouvent simplement l’existence d’infractions déjà documentées par ailleurs
– c’est le cas des trois abattoirs d’Alès, du Vigan et de Mauléon, mais aussi de celui de Metz et d’autres abattoirs de volailles et de lapins. Vous allez recevoir l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir (OABA) et la Fondation Brigitte Bardot, qui auront également l’occasion de s’exprimer là-dessus.
Nos images montrent des actes de routine ; aucune personne étrangère à l’abattoir n’est présente : ce que nous voyons, c’est le quotidien, et non une mise en scène adaptée à un observateur potentiel – contrairement, par exemple, à ce qui se passe lorsqu’un inspecteur est là.
Nous avons observé différentes techniques d’abattage, avec et sans étourdissement.
L’étourdissement préalable est utilisé pour que le cœur des animaux fonctionne encore lorsqu’ils sont vidés de leur sang. Ce n’est pas un phénomène doux, mais déjà très violent. Il peut être fait d’au moins trois façons différentes. Le pistolet à tige perforante sert à détruire une partie du cerveau en perforant le crâne. On utilise également des décharges électriques, censées rendre les animaux inconscients – mais qui ne font parfois que les tétaniser, comme l’a observé l’OAV – et le dioxyde de carbone (CO2), utilisé à l’abattoir d’Ales ; or le CO2 est reconnu par l’EFSA (European Food Safety Authority, Autorité européenne de sécurité des aliments) et même dans le préambule du règlement européen comme un gaz très aversif pour les animaux et qui devrait être abandonné.
Dans toutes les images que nous avons réalisées, nous avons vu de nombreux étourdissements inefficaces. Parfois, il s’agit des ratés – intensité de courant mal ajustée, pistolet mal placé ou chargé avec une cartouche inadaptée, exposition au gaz insuffisante –, parfois, les animaux ont repris conscience par la suite. On voit notamment des animaux qui bougent alors qu’ils sont déjà suspendus sur les chaînes : ce sont des images très impressionnantes. On voit aussi des animaux qui réagissent au couteau au moment de l’égorgement, ce qui témoigne de leur état de conscience.
L’intervalle entre l’étourdissement et la saignée est souvent long, ce qui explique les reprises de conscience. En ce qui concerne notamment les volailles, les abattages d’urgence ne sont quasiment jamais réalisés en cas d’arrêt de la chaîne – parfois tout à fait routinier, pour un changement d’outil, par exemple. Les animaux étourdis en passant dans le bain électrifié ont donc souvent pu reprendre conscience au moment où ils passent sous la lame. Dans nos images, on voyait même des animaux qui arrivaient à se désengager du cône d’amenée, échappaient ainsi à la lame et n’étaient donc pas saignés : ils arrivaient dans le bac d’échaudage encore vivants.
Aucune mesure corrective n’est prise : nous voyons très souvent des animaux conscients sur la chaîne d’abattage et, dans ce cas, un étourdissement d’urgence devrait être réalisé : dans la plupart des cas, ce n’est pas fait.
Il n’y a pas de tests de conscience. Nos images montrent des tests de conscience au pied – on donne de petits coups de pied pour voir si les animaux réagissent – mais ce n’est pas un test de conscience reconnu par la réglementation : il s’agit plutôt de tester la dangerosité d’animaux avant de les attraper par la patte pour les suspendre à la chaîne.
Mais on pratique aussi des abattages sans étourdissement, dans des abattoirs pérennes ou temporaires.
Dans les abattages sans étourdissement, le matériel est souvent inadapté. Nous l’avons montré notamment pour l’abattoir d’Alès comme pour des abattoirs provisoires. À Alès, le box destiné à des bovins adultes était utilisé aussi pour les veaux qui, du coup, peuvent se retourner. Un des veaux n’était égorgé qu’à moitié et a mis plusieurs minutes à mourir, alors qu’il était déjà relâché… La mentonnière est souvent mal ajustée. Dans le cas des moutons, de même, le matériel d’immobilisation est fréquemment inadapté.
Les égorgements sont souvent faits par un geste de cisaillement, alors que la réglementation impose un geste précis et unique. Or le cisaillement dans une plaie est extrêmement douloureux. Souvent, les animaux sont relâchés dès qu’ils ont été égorgés, sans test de conscience : cela va plus vite, cela ne perturbe pas la cadence… On voit fréquemment des tissus qui se touchent, ce qui est très douloureux et empêche le sang de s’écouler, donc la mort de survenir rapidement.
Je reviens sur les équipements et les aménagements d’abattoir : souvent, rien n’est prévu pour que les animaux ne voient pas leurs congénères mourir. Un reportage de France 3 sur les contrôles actuellement diligentés par le ministère montrait de simples bâches en plastiques, à l’évidence rajoutées à la hâte pour les inspections.
Les pièges sont souvent inadaptés, qu’il y ait étourdissement avant l’abattage ou pas.
Dans les différentes affaires que nous avons mises au jour, les salariés sont devenus des boucs émissaires faciles. Mais on leur demande l’impossible : tuer à la chaîne avec empathie. Peut-on vraiment tuer dans la dignité et le respect ? On leur demande de tuer sans nécessité, ce qui est réprimé par le code pénal ! Quelle est leur formation ? Quelles cadences leur impose-t-on ? Les images de l’abattoir de Mauléon que nous avons montrées ont été prises juste avant Pâques, au moment où il y avait beaucoup d’agneaux à tuer et moins de personnel. Comment sont réparties les responsabilités ? Quels contrôles sont menés ?
Mme Anne-Marie Vanelle, que j’ai déjà citée, déclarait au Sénat que « ces personnels sont soumis à une souffrance à la fois psychique et physique en raison de leurs conditions de travail qui impliquent la réalisation de gestes répétitifs, qui entraînent des troubles musculo-squelettiques, dans un environnement froid et humide ».
Pour nous, il est impossible que les directions et les services vétérinaires n’aient pas été au courant de ces actes. Il suffit de passer une fois dans l’abattoir pour s’apercevoir que le matériel n’est pas conforme. Un vétérinaire ne peut pas ne pas remarquer des animaux qui reprennent conscience alors qu’ils sont suspendus aux chaînes d’abattage. Dans le reportage réalisé par France 3 à l’abattoir de Sisteron il y a quelques jours, on ne voit aucun mouton bouger sur les chaînes : cela ne correspond absolument pas aux images que nous avons prises nous-mêmes.
J’en viens à nos propositions d’actions à engager immédiatement. Nous demandons d’abord plus de transparence, avec notamment des caméras dans les abattoirs. Les ONG doivent avoir accès non seulement aux abattoirs, mais aussi aux documents administratifs les concernant. Nous demandons également un étiquetage des viandes.
Il faut également protéger les lanceurs d’alerte.
Une mesure ambitieuse pourrait consister à cesser de confier la question du bien-être animal au ministère de l’agriculture, dont les conflits d’intérêts sont évidents.
Il est regrettable que les associations ne puissent pas se porter partie civile lorsque des infractions sont commises par des professionnels.
Certaines formes d’abattage sont très discutables, notamment les abattages sans étourdissement, comme l’ont souligné l’EFSA, organisme scientifique de l’Union européenne, mais aussi la Fédération des vétérinaires européens (Federation of Veterinarians of Europe) et l’Ordre des vétérinaires français. Tous trois, comme les ONG, demandent l’interdiction des abattages sans étourdissement.
L’étourdissement par le CO2 est également mis sur la sellette depuis longtemps, notamment par l’EFSA et plusieurs ONG internationales.
Pour effectuer des contrôles, il faut davantage de personnel. Le rapport de la Cour de comptes de 2014 souligne que le règlement européen autorise les États membres à percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts des contrôles officiels, en fixant un taux minimal, mais qu’en France la plupart des abattoirs – 69 % des abattoirs de volailles et 74 % des abattoirs de boucherie – bénéficient d’une modulation qui leur permet de payer une taxe inférieure au niveau minimal fixé par ce même règlement ! Selon la Cour, « en 2012, le produit des redevances sanitaires d’abattage et de découpage a été de 48 millions d’euros alors que les seules dépenses de personnel d’inspection dans les abattoirs s’élevaient à 71,2 millions d’euros ».
M. Antoine Comiti. Voilà ce que l’on peut dire si l’on continue d’accepter l’idée qu’il faut continuer de tuer autant d’animaux chaque année, avec des méthodes industrielles. Mais est-il possible de tuer autant d’animaux à de telles cadences – encore une fois, plus d’un milliard d’animaux terrestres meurent dans les abattoirs de France chaque année – en tenant réellement compte de leurs intérêts, en prenant les précautions que l’on prendrait pour un animal familier ? Et je n’évoque ici que la mort elle-même, et non tout ce qui précède – le transport, l’attente…
Pourquoi les méthodes utilisées par les vétérinaires pour les animaux familiers ne sont-elles pas utilisées dans les abattoirs ? Hélas, on connaît la réponse : au rythme auquel il faut tuer ces animaux pour produire la viande au prix où elle peut être achetée, ce n’est pas possible. Mais la question se pose. On est bien loin de maltraitances individuelles qui seraient le fait d’employés déficients : il y a bel et bien une question structurelle, liée à la consommation de la viande.
Permettez-moi d’évoquer pendant quelques minutes la question des alternatives aux abattoirs. Certains jugeront peut-être que je m’éloigne de l’objet de votre commission d’enquête, mais je ne le crois pas : imagine-t-on qu’une commission d’enquête sur la mortalité routière ne puisse s’intéresser au transport par le train, par exemple, ou une commission sur le cancer du poumon s’interdise de se pencher sur les alternatives à la cigarette ?
Au sein de notre association, nous sommes presque tous végétariens, comme quelques centaines de milliers de Français. Si l’on pense, comme nous, que le nombre d’animaux abattus chaque année en France pose un problème structurel et qu’il n’est pas possible de tuer humainement tant de bêtes, alors il faut penser à consommer moins de viande, voire ne plus en consommer du tout. D’autres considérations, d’ordre écologique et même parfois sanitaire, conduisent à la même conclusion.
Il faudrait donc promouvoir les alternatives végétales, ainsi que la viande issue d’animaux abattus dans les moins mauvaises conditions, par l’étiquetage mais aussi par des mesures concernant la restauration collective, à l’instar de ce qui se fait pour promouvoir l’agriculture biologique. Une proposition de loi d’Yves Jégo vise à rendre obligatoire dans les cantines la proposition d’un repas végétarien. Un décret concernant les cantines impose, sans aucune justification, la consommation de produits animaux : il devrait être révisé.
Enfin, beaucoup s’inquiètent des conséquences sur l’emploi dans la filière d’une éventuelle diminution de la consommation de viande, et donc d’une diminution du nombre d’abattages. Mais il faudra bien toujours se nourrir : les métiers liés à l’alimentation continueront d’exister… Et rappelons que ces filières de production ont connu des réductions d’emplois drastiques au cours des dernières années, non pas en raison de l’action des militants végétariens que nous sommes, mais simplement parce que l’élevage s’est industrialisé.
Nous invitons toute la société à se projeter dans l’avenir. Les producteurs d’œufs se plaignent d’avoir très récemment encore été invités à investir dans des cages d’élevage des poules en batterie, alors que la consommation de ces produits diminue très fortement, les gens préférant de plus en plus les œufs de poules élevées en plein air. Les mêmes questions se posent pour la viande – à propos des méthodes d’abattage, mais pas seulement.
Merci encore de prendre au sérieux les intérêts des animaux, ce qui n’est pas évident dans le contexte politique actuel, malgré la popularité de la question dans l’opinion.
M. le président Olivier Falorni. S’agissant des contrôles, que pensez-vous de l’intervention des services vétérinaires dans les abattoirs ? Sont-ils efficaces ?
Notre dispositif pénal est-il à votre avis suffisant ? Que pensez-vous des déclarations récentes du Gouvernement sur la responsabilité pénale des directeurs d’abattoirs ? Pouvez-vous revenir sur l’impossibilité de vous porter partie civile lorsque des procès ont lieu ?
Que savez-vous des pratiques dans les abattoirs étrangers ? Certains pays sont-ils plus attentifs à la souffrance animale ?
Enfin, disposez-vous d’autres vidéos semblables à celles que vous avez récemment diffusées ?
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Merci de cet exposé liminaire. Je m’interrogeais sur la valeur statistique des alertes que vous avez lancées ; vous avez en partie répondu par avance. À votre sens, quel est l’arbre des causes ? Vous avez parlé de l’inadaptation des matériels, de leur utilisation non conforme, des cadences, etc. Quelles sont les causes principales des situations que vous avez constatées ? La règle n’est pas parfaite, sans doute, et l’on peut bien sûr, comme vous le faites, embrasser la question de façon plus vaste. Mais il y a bel et bien des écarts à la règle, et il faut à tout le moins la faire respecter.
Vous avez souvent évoqué les cadences imposées dans les abattoirs. Il faut poser la question de l’enjeu économique. Savez-vous quelle est la part de ces cadences dans la formation du prix – dont la formation n’est certainement pas assez transparente par ailleurs ? Quelle serait l’incidence sur le coût final d’une cadence deux fois moindre, par exemple ?
Vous avez en particulier évoqué les salariés des abattoirs. Pouvez-vous évoquer la formation de tous ceux qui travaillent dans la filière viande ? L’abattage et le stade de la mise à mort est-il assez enseigné, y compris aux bouchers ou aux éleveurs ? Une information précise me paraîtrait indispensable, puisque l’animal – à nouveau, je n’entre pas dans les problèmes éthiques que vous avez soulevés – est élevé pour être consommé.
Enfin, avez-vous travaillé sur les dysfonctionnements et donc les souffrances qui se produiraient en amont du stade de l’abattoir – transport, attente, abreuvement… ?
M. François Rochebloine. Merci de cet exposé très complet. J’ai apprécié la comparaison que vous avez établie avec les animaux de compagnie. Cette commission d’enquête permettra, je l’espère, d’améliorer la situation.
Si on ne peut que féliciter votre association de son travail remarquable pour appeler l’attention des médias et du Parlement sur ces tristes situations, je ne vous rejoins pas lorsque vous abordez la question végétarienne. Chacun a le droit d’être végétarien, bien sûr, mais la commission n’a rien à voir avec cela. Ce qui se passe dans les abattoirs est inadmissible, inacceptable, et tout comme mes collègues je le dénonce fortement ; nous devons tout faire pour améliorer les conditions « d’accompagnement à la mort », si je puis dire, de ces animaux. Mais je ne pense pas qu’il faille pour autant devenir tous végétariens ! Notre agriculture souffre déjà suffisamment… Pour ma part, j’entends bien continuer à manger de la viande.
Quelle formation reçoivent les personnels ? Des qualifications particulières sont-elles exigées ?
Parmi les 263 abattoirs d’animaux de boucherie, combien selon vous fonctionnent normalement ?
M. Thierry Lazaro. Merci de votre action : les images choquantes sont parfois utiles.
Comme François Rochebloine, je suis plutôt un bon mangeur, mais j’aime les animaux ! Élu rural, je rencontre dans ma circonscription beaucoup d’éleveurs très soucieux du bien-être de leurs bêtes – pour des raisons diverses d’ailleurs. Mais il y a des excès, des abus, des erreurs, qu’il faut corriger. Il faut tout faire pour le bien-être de l’animal, jusqu’à la phase ultime.
La question du végétarisme est différente ; elle est de nature économique, cela vient d’être dit, mais surtout culturelle. Si une centaine de milliers de nos compatriotes sont végétariens, une grande majorité ne l’est pas. À mon sens en tout cas, notre rôle est de trouver un équilibre pour que les animaux souffrent le moins possible et vivent aussi bien que possible.
Comment verriez-vous la reconversion de la filière de l’élevage, puisque c’est au fond ce que vous défendez ? Vous avez parlé de transparence et d’étiquetage : pouvez-vous aller plus loin sur ce sujet ? On peut en effet penser qu’il revient au consommateur final de prendre la décision, en toute connaissance de cause.
Je rejoins enfin notre rapporteur sur la formation : dans ce domaine comme dans d’autres, c’est sans doute le meilleur moyen d’éviter les dérapages que vous avez mis en évidence.
M. Jacques Lamblin. À propos des images scandaleuses que vous avez diffusées, à juste titre, vous avez parlé, madame Gothière, de routine, en précisant qu’il n’y avait aucune mise en scène, les opérateurs ignorant que vous les observiez. Quelle est la proportion de ces images scandaleuses par rapport au volume filmé ? Autrement dit, quelle est la proportion d’événements anormaux dans le travail de ces établissements ?
Ces séquences particulièrement odieuses ont-elles été filmées lorsque se pratiquait un abattage sans étourdissement, autrement dit un abattage rituel ?
Mme Brigitte Gothière. Avons-nous d’autres vidéos ? C’est une question difficile… Nous avons montré des vidéos avant celles-ci ; elles montraient déjà des dysfonctionnements. Nous continuons de travailler à montrer la réalité des abattoirs – que cela se passe bien ou mal d’ailleurs : pour nous, cela ne se passe de toute façon jamais bien pour les animaux…
M. le président Olivier Falorni. Vous n’avez donc pas actuellement de nouvelles vidéos tournées clandestinement qui montreraient les mêmes pratiques que dans les trois abattoirs déjà mis en cause.
M. Antoine Comiti. D’autres images sont en notre possession et montrent des pratiques qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui restent tout aussi choquantes. Nous sommes de plus en plus sollicités par des personnes travaillant dans la filière, ou qui en sont proches ; jusqu’à maintenant, nos mondes étaient assez éloignés, mais elles nous contactent désormais pour nous aider à nous procurer des informations ou des images. Il y aura donc, je pense, malheureusement, beaucoup d’autres images.
S’agissant des abattoirs étrangers, les pratiques sont à peu près semblables dans l’ensemble des pays européens. Certains pays proscrivent des méthodes comme l’étourdissement au CO2, ou interdisent l’abattage sans étourdissement. Pour le reste, la réglementation est similaire, et le travail d’autres associations ou de l’OAV montre que les pratiques sont comparables.
S’agissant des formations, je ne me sens guère compétent pour vous répondre. Il n’y a pas, me semble-t-il, grand-chose sur le sujet. Certains organismes en proposent. Mais il nous semble que ces formations restent très légères.
Mme Brigitte Gothière. Sur ce dernier point, les professionnels vous répondront plus précisément que nous. Il existe bien une formation, notamment sur les postes de tueurs.
Lorsque nous avions demandé à visiter l’abattoir de Metz, les responsables nous avaient assuré être particulièrement attentifs au bien-être animal ; ils nous ont affirmé que le personnel était formé, que les services vétérinaires exerçaient des contrôles, mais qu’il n’était pas question de nous laisser rentrer pour venir constater tout cela.
En ce qui concerne le dispositif judiciaire, les associations ne peuvent se porter partie civile que dans certains cas ; elles ne le peuvent pas lorsque l’infraction a été commise par des professionnels. Le dispositif pénal n’est pas utilisé : aucune sanction pénale n’a été prononcée alors que des infractions « moyennement graves » ont été relevées. Je vous renvoie au rapport de l’OAV.
En ce qui concerne le volume filmé, pour l’abattoir d’Alès, plus de cinquante heures de rushes nous sont arrivées, ce qui est énorme. Si nous n’avons pas tout montré, c’est parce qu’il faut flouter les visages pour que les employés ne soient pas reconnaissables. Sur notre site, vous trouverez une heure et demie d’images.
À vrai dire, notre idéal serait d’avoir des caméras qui fonctionnent en permanence : chacun pourrait ainsi regarder ce qui se passe en temps réel.
On ne voit pas, dans cet abattoir d’Alès, d’actes de sadisme, mais des actes routiniers. Les cisaillements lors d’abattages sans étourdissement, les animaux qui reprennent conscience sur la chaîne d’abattage, les cochons qui reprennent conscience après être passés dans le puits de CO2… Autant d’incidents qui n’ont rien d’exceptionnel. Je ne peux pas vous donner de pourcentage, mais ces pratiques sont représentatives.
À l’abattoir du Vigan, c’est une matinée qui a été filmée, avec une scène particulièrement perturbante où l’on voit un employé qui n’arrive pasà conduire les moutons vers le couloir d’amenée : cela montre qu’il ne sait vraiment pas s’y prendre, ou qu’il est ce jour-là vraiment dans un état second.
M. Antoine Comiti. Même si ces dysfonctionnements ne concernaient que 1 % des animaux abattus, cela ferait tout de même 10 millions d’animaux affectés par ces horreurs
– soit l’équivalent du nombre de chiens ou de chats sur notre territoire, je crois.
Mme Brigitte Gothière. Les abattages sans étourdissement ne sont absolument pas les seuls concernés. Nous n’en avons montré que dans l’abattoir d’Alès, et même dans ce cas précis l’abattage sans étourdissement ne concentre pas tous les problèmes : nous avons bien séparé les deux cas. Au Vigan, les abattages de bovins et de moutons que nous avons montrés se font avec étourdissement – je vous rappelle la scène de cet employé qui s’amuse à donner des décharges avec sa pince électrique. À Mauléon enfin, il n’y a aucun abattage sans étourdissement dans les images que nous avons montrées.
M. Antoine Comiti. Vous nous interrogiez également sur l’efficacité des contrôles des services vétérinaires. Il nous semble que le problème va au-delà : le problème, c’est plutôt le peu d’attention porté par notre société à la part du travail des vétérinaires qui concerne le bien-être des animaux. Leur hiérarchie des priorités ne fait que refléter celle de notre société : le bien-être des animaux passe après les tâches d’ordre sanitaire, notamment. Globalement, nous ne voulons pas voir ce qui se passe dans les abattoirs : même lorsque le travail est bien fait, ce n’est jamais très agréable.
Plus la société s’intéressera au bien-être animal, plus les inspecteurs vétérinaires auront le pouvoir de consacrer le temps nécessaire – malgré leurs effectifs réduits – à cette question.
Mme Brigitte Gothière. Les rapports de l’OAV, je l’ai dit, soulignent les lacunes des contrôles vétérinaires dans les abattoirs. L’OAV joue le rôle d’une police des polices et relève les manquements des services vétérinaires français. Ainsi, certains manquements ne sont pas détectés – tonneau de contention non conforme à la réglementation, obligations non respectées… Le rapport de 2015 prend également l’exemple d’un tonneau de contention utilisé pour des bovins adultes mais aussi pour des bovins de plus petit gabarit : cela a été signalé par les services vétérinaires, mais le tonneau n’a pas été changé – et cet état de fait dure depuis des années.
Les caractéristiques techniques et les conseils d’utilisation doivent, selon la réglementation, être fournis en même temps que le matériel : ainsi, si un box d’immobilisation est destiné à des bovins adultes, cela doit être inscrit sur la fiche – mais en réalité, ce n’est pas noté. L’OAV relève que la France n’oblige pas les fabricants de matériel à respecter cette obligation.
Vous entendrez les services vétérinaires, qui vous diront eux-mêmes qu’ils ne sont pas assez nombreux. Une personne de ces services devrait être affectée au poste d’abattage, ce qui n’est pas le cas : le vétérinaire privilégie les inspections ante et post mortem, qui, si elles n’étaient pas effectuées, auraient des incidences immédiates sur le plan de la sécurité alimentaire.
M. Antoine Comiti. Monsieur le rapporteur, vous nous interrogez sur les causes. Il nous semble tout à fait évident que les cadences constituent un problème – ces abattoirs sont des usines, et la chaîne est un problème. Il faut tenir une cadence, mais les animaux ne sont pas des objets : ils bougent, ils ne sont pas d’accord, ils s’affolent… Si l’on ne veut pas stopper la chaîne, il faut donc les brutaliser – non par méchanceté ou par sadisme, mais par nécessité. N’importe lequel d’entre nous placé dans une telle situation, fatigué, en fin de journée, alors qu’il reste cinquante animaux à abattre, aurait du mal à rester zen, si vous me permettez l’expression – surtout s’il savait que prendre le temps nécessaire risquerait de poser un problème économique à son entreprise. Les cadences constituent un problème, c’est sûr.
En revanche, nous n’avons pas la moindre idée de leurs conséquences directes sur le prix de la viande. C’est une question que peu de gens se sont posée, ce qui est sans doute le signe d’un problème plus profond ; c’est un point à éclaircir. L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) pourrait sans doute s’en saisir.
Vous avez évoqué l’importance de la transparence : si tout était plus visible, il me paraît évident que les choses se passeraient mieux.
De même, si l’étiquetage permettait au consommateur de connaître le mode d’abattage des animaux, si les consommateurs étaient informés, sans doute achèterait-on moins de ces produits-là. Il est vrai que nous ne sommes pas toujours cohérents, et que nous achetons parfois des produits peu chers dont nous savons qu’ils ne sont pas les meilleurs – tout le monde trouve très bien d’acheter les produits biologiques, mais l’on n’achète pas que cela… Mais un étiquetage spécifique serait malgré tout facteur de progrès : au moins, il provoquerait un débat. Les questions sur les méthodes d’abattage peuvent apparaître techniques, mais ne le sont pas : il serait bon que le Parlement et les citoyens s’en saisissent.
Mme Brigitte Gothière. Je voudrais revenir sur la question du coût de la viande : aujourd’hui, le consommateur ne paye pas le coût réel de ces produits. Des aides sont en effet apportées à l’élevage, au fourrage… Les aides directes et indirectes sont très nombreuses. Les externalités ne sont pas prises en compte : pensons aux algues vertes, dont le coût très élevé est pris en charge par la collectivité, et non par ceux qui sont à l’origine de cette pollution.
Si le consommateur payait le vrai prix de la viande, la production serait sans doute beaucoup moins élevée.
M. Antoine Comiti. Le coût des éventuelles mesures inspirées par votre commission – augmentation du nombre d’inspecteurs, obligation d’adopter des méthodes d’abattage moins rapides, par exemple – devrait être répercuté sur le prix de la viande : si ce coût est pris en charge par la collectivité, les consommateurs ne s’aperçoivent de rien. En revanche, si le coût est répercuté et la méthode d’abattage expliquée, le consommateur se rendra compte du vrai prix de la viande, dans tous les sens du terme, et ce sera facteur de progrès.
Mme Brigitte Gothière. Monsieur le rapporteur, vous évoquez la question de ce qui se passe avant l’arrivée à l’abattoir : nous-mêmes ou d’autres associations avons documenté les conditions d’élevage mais aussi de transport. Les rapports de l’OAV portent également sur ces questions, qui sont importantes. Là aussi, le bien-être des animaux est mal pris en considération.
S’agissant de la question de la consommation de la viande et du végétarisme, elle est à notre sens centrale : si ces images nous choquent, ce n’est pas seulement parce qu’elles montrent des infractions à la réglementation ; c’est aussi parce qu’elles nous obligent à voir que nos choix de consommation impliquent la mise à mort d’animaux, dans des conditions absolument abominables. Certaines de nos vidéos montrent des abattages menés dans le respect de la réglementation, et les commentaires des internautes ne sont pas différents – ils estiment ces scènes épouvantables, inadmissibles. Personne ne supporte de voir les couteaux se planter dans la gorge des animaux.
À la télévision, dans les reportages sur les abattoirs et les inspections, le moment de la mise à mort est d’ailleurs souvent escamoté : on n’ose pas montrer cette étape qui est pourtant incontournable pour obtenir de la viande.
M. Antoine Comiti. S’agissant de la reconversion, nous le regrettons, mais nous ne serons pas tous végétariens demain : ce sont des évolutions qui se font sur un temps long – ce sont des évolutions culturelles, vous avez entièrement raison, monsieur Lazaro. Et bien manger est important, c’est une évidence… Les personnes qui travaillent aujourd’hui dans ces filières seront depuis bien longtemps à la retraite quand les changements que nous appelons de nos vœux – j’entends bien que vous ne partagez pas ces choix – se produiront.
Encore une fois, les dernières décennies ont vu des changements autrement plus violents avec l’industrialisation de l’élevage : le nombre de personnes qui travaillent dans les filières d’élevage a déjà été drastiquement réduit.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je me félicite moi aussi de la mise en place de cette commission, qui a pour but d’apporter de l’objectivité et de la vérité.
Mais qui êtes-vous exactement ? Vous demandez la transparence, vous devez faire preuve de transparence à votre tour. Vous vous définissez comme militants végétariens, mais au-delà de cela, qui êtes-vous et qui vous finance ?
Vous avez enquêté, et vos vidéos ont blessé et interpellé nos concitoyens. Depuis 2008, vous êtes-vous limités à ces actions ? Avez-vous obtenu des réponses de l’administration, ou à l’inverse des refus vous ont-ils été opposés ? Quid de tout ce que vous avez pu récupérer ? Pouvez-vous dire que vous vous êtes heurtés à une omerta administrative, et accusez-vous l’administration française de ne pas faire son travail ?
Mme Sylviane Alaux. Merci de ces alertes. Consommer ou pas de la viande est l’affaire de chacun ; ce n’est assurément pas l’objet de cette commission d’enquête. Les conséquences de la surconsommation de viande sur la santé mais aussi sur l’environnement sont néanmoins de plus en plus évidentes : à l’occasion du sommet de Copenhague, un appel avait été lancé pour l’instauration d’une journée hebdomadaire sans viande.
S’agissant des salariés, je plaide pour un examen sérieux de leurs conditions de travail, particulièrement dures. Comment se fait la sélection du personnel ? Elle doit être rigoureuse, même si les candidats ne se bousculent sans doute pas au portillon. Nous devons aussi nous pencher sur la formation et sur l’encadrement – dont vos enregistrements montrent les lacunes.
La traçabilité s’arrête aujourd’hui à la porte de l’abattoir ; or le consommateur est en droit de savoir. Pourriez-vous préciser vos préconisations sur ce point ?
En ce qui concerne précisément l’abattoir de Mauléon, situé dans le département dont je suis l’élue, de combien d’heures d’enregistrement disposez-vous ? Pouvez-vous revenir sur la question de l’abattage sans étourdissement ?
M. Hervé Pellois. Ces alertes sont utiles à la société, et je vous en remercie. Nous avons tous une éthique, et j’imagine que voir souffrir les animaux ne réjouit pas ceux qui travaillent avec le monde animal.
Pouvez-vous répondre plus précisément à la question du rapporteur sur les causes majeures des dysfonctionnements que vous dénoncez ? Vous avez beaucoup parlé des cadences. N’y a-t-il pas plutôt un problème d’organisation des chaînes d’abattage ? La maltraitance est sans doute plus répandue dans les petits abattoirs, mal adaptés à un abattage standardisé, que dans les grands. Je défends pourtant l’idée d’installer de petits abattoirs locaux, au plus près des producteurs, mais il est beaucoup plus difficile pour un petit d’abattoir d’être fonctionnel et efficace.
S’agissant de la formation, je crois qu’il existe plusieurs instituts spécialisés dans ce domaine.
Mme Laurence Abeille. Je salue moi aussi la création de cette commission d’enquête sur ce sujet essentiel.
Peut-on travailler toute sa vie dans un abattoir ? Ce métier est fait d’actes d’une telle violence que l’on doit se poser cette question. D’autres auditions nous permettront certainement de revenir sur cette question centrale de la formation.
S’agissant des cadences et de la standardisation, tout le problème est justement que les animaux ne sont pas standardisés ! C’est l’obstacle rencontré pour utiliser des tonneaux de contention, par exemple. Tous les animaux ne peuvent pas avoir le même poids, la même taille, la même forme… Ne peut-on pas essayer de s’adapter aux animaux au lieu d’adapter les animaux à des cadences et à des matériels ?
Vous n’avez pas abordé la question des animaux qui arrivent déjà morts à l’abattoir. J’ai reçu des témoignages sur ce point : en avez-vous également ? Ce sont des questions graves.
Il n’y a pas d’abattoir « bio », contrairement à ce qui est dit dans les vidéos. C’est une mauvaise façon de parler du sujet ; il y a des animaux issus de l’agriculture biologique, qui sont abattus. Pouvez-vous là encore revenir sur ce point et sur les problèmes spécifiques qui peuvent se poser – notamment en raison de la moindre standardisation de ces bêtes ?
Enfin, vous évoquez la souffrance obligatoire liée à la mise à mort. Les conditions d’étourdissement ne peuvent-elles pas évoluer afin de minimiser cette souffrance, même si celle-ci demeure inévitable ?
M. Yves Daniel. Il me paraît important de bien définir les objectifs et les limites de cette commission d’enquête.
En tant qu’agriculteur, éleveur de vaches laitières et de porcs, je peux témoigner de ce que nous, éleveurs, aimons nos animaux ; nous savons bien aussi que leur bien-être et leur confort contribuent beaucoup à la performance. Tous les acteurs, mais aussi tous nos concitoyens, tous les consommateurs, doivent pouvoir débattre de leurs rapports avec les animaux. Nous avons tous envie de lutter contre la souffrance, tout au long du processus d’élevage ; mais nous raisonnons en tant qu’êtres humains – nous sommes humains, ils sont animaux.
Notre société confond la sensibilité de l’animal et le sentiment humain : il y a là une dérive. Des êtres humains finissent par être plus attachés à leur animal domestique qu’à leurs semblables ! Nous devons nous interroger, sur notre société et sur nous-mêmes.
Il faut aussi être précis en utilisant les apports de la science, mais aussi ceux des recherches pratico-pratiques : la souffrance aussi se mesure. Je pourrais vous donner l’exemple de la castration des porcelets, que l’on peut réaliser en diminuant la souffrance.
Quel est votre point de vue sur ces questions ? Nous devons demeurer prudents et faire la part des choses. Vous dites qu’il faudrait retirer au ministère de l’agriculture la charge de veiller au bien-être animal. Je n’en suis pas convaincu ; il faudrait plutôt l’intégrer dans le fonctionnement de notre société.
M. William Dumas. Je voudrais revenir sur le cas de l’abattoir du Vigan, situé dans ma circonscription. Je ne pense pas que les cadences y soient en cause. Ils travaillent beaucoup pour de petits producteurs, pour des circuits courts. Les volumes sont bien moins importants qu’à Alès, par exemple.
Vous avez mis des caméras un peu partout. De combien d’heures de vidéos disposez-vous, par rapport à ce que vous avez montré ?
Vous avez dit que le consommateur ne paie pas le vrai prix de la viande. En agriculture, on a l’habitude de crises liées à ce problème. Mais vous avez aussi dit que les autres abattoirs européens sont dans une situation similaire : si l’on prend des mesures chez nous, des problèmes de concurrence se poseront, car nos prix augmenteront. On connaît les paradoxes qui ont mené à faire abattre à la frontière allemande des cochons bretons par des ouvriers polonais… Il me paraît nécessaire de réfléchir à l’échelle européenne.
M. Guillaume Chevrollier. Vous êtes lanceurs d’alerte et vous jouez beaucoup sur l’émotion. Vous avez, je crois, trop vite généralisé en parlant de dysfonctionnements dans « les » abattoirs – il faut parler de dysfonctionnements dans « des » abattoirs. J’ai pu visiter des établissements où l’administration était présente, où les salariés travaillaient consciencieusement, même si l’acte d’abattage est nécessairement un moment difficile.
Vous vous dites vous-même pro-végétariens, et l’on sent que vous essayez d’instrumentaliser les choses à des fins militantes. Je n’approuve pas vos propositions, sur la transparence ou l’accès des ONG : l’État est tout de même là pour veiller et contrôler.
La fonction de responsable de la protection animale existe dans les abattoirs : quand le RPA est là, cela fonctionne bien, et il faut le préciser.
M. Christophe Bouillon. Je salue également le rôle de lanceur d’alerte de votre association. Pouvez-vous préciser votre point de vue sur les règles européennes sur le bien-être animal ? Quelles sont les pistes d’amélioration ?
Avez-vous des relations avec d’autres ONG européennes ? Existe-t-il un réseau, des échanges ? Des vidéos similaires ont-elles été diffusées dans d’autres pays ? Sur ces sujets, comment se situe la France par rapport au reste de l’Europe ?
Depuis la diffusion de vos vidéos, avez-vous eu l’occasion de parler à des responsables d’abattoirs ? Certains d’entre eux ont-ils demandé à vous rencontrer ?
Mme Françoise Dubois. Je rejoins Yves Daniel, qui sait de quoi il parle. Pour avoir discuté avec les éleveurs de ma circonscription, je sais combien ils sont attachés à leurs animaux. D’ailleurs, un animal bien traité fournit une meilleure viande. À l’inverse, le stress au moment affecte immédiatement la qualité de la viande : si l’abattage est mal conduit, c’est finalement le travail des éleveurs qui est remis en cause.
Pour cette raison même, ne pourrait-on pas leur permettre – ils ne demandent pas mieux – de suivre de près l’abattage de leurs bêtes ?
M. Antoine Comiti. Merci à nouveau de ces nombreuses questions.
Les éleveurs sont évidemment proches de leurs animaux, et nombre d’articles de la presse quotidienne régionale montrent qu’ils sont parmi les plus choqués de ce qu’ils ont vu de la réalité dans les abattoirs. Ils ne deviendront pas végétariens comme nous, mais ils sont comme nous et comme vous tout à fait atterrés.
Monsieur Dumas, la question du bien-être des animaux de ferme relève de l’Union européenne, qui a été un grand facteur de progrès en France : la plupart des améliorations juridiques visant à mieux prendre en considération le bien-être des animaux, à tous les stades de la chaîne de production, sont dues à des directives européennes – à l’origine desquelles se trouvaient souvent des pays nordiques, et que la France a tout fait pour affaiblir. Nous avons rarement été un fer de lance dans ce domaine… Rien n’interdit pour autant de faires mieux que le droit européen dans notre pays.
En outre, les règles du commerce international comme celles de l’Union permettent à un pays, dans certaines situations, d’interdire l’entrée d’une marchandise sur son territoire : il est donc tout à fait imaginable d’interdire l’importation de viandes produites selon des normes que nous jugerions inacceptables. Cela a été fait pour les cosmétiques : une directive européenne a ainsi interdit l’importation de cosmétiques testés sur les animaux, et cette interdiction prévaut désormais.
Mme Brigitte Gothière. Pour Alès, nous disposons d’une cinquantaine d’heures de vidéos ; pour Le Vigan, les vidéos ont été tournées sur une dizaine de jours, mais avec des interruptions ; pour Mauléon, elles ont été tournées sur une semaine, chaque jour de fonctionnement de l’abattoir.
Mme Sylviane Alaux. Et les dysfonctionnements, les abus se sont répétés ?
Mme Brigitte Gothière. Oui. Les reprises de conscience ou l’utilisation du crochet pour achever d’étourdir les animaux sont des phénomènes que l’on voit tous les jours. C’est vraiment routinier. De la même façon, l’utilisation d’un box d’immobilisation prévu pour un seul bovin pour deux ou trois veaux est tout à fait habituelle. Les « pétages de plomb » des ouvriers sont heureusement moins fréquents : un ouvrier qui, comme au Vigan, s’amuse avec les pinces électriques, cela n’est arrivé qu’une fois.
Quant à la question européenne, d’autres enquêtes similaires existent. Au Royaume-Uni se déroule actuellement une grande campagne en faveur de l’installation de caméras dans les abattoirs : Say Yes To Slaughterhouse CCTV. Une grande enquête a également été publiée en Autriche, en novembre 2015 : on y observe, comme chez nous, des pratiques non réglementaires et d’autres, tout à fait réglementaires, mais absolument choquantes.
M. Morel-A-L’Huissier nous demande qui nous sommes et qui nous finance. Nous sommes un ensemble de personnes très différentes… Le « noyau dur » de L214 compte aujourd’hui une vingtaine de personnes ; nous devions être une dizaine de fondateurs. Nous avons, je l’ai dit, environ 14 000 adhérents. Nous venons d’horizons très divers : j’étais professeur d’électricité.
M. Antoine Comiti. Quant à moi, je suis informaticien.
Notre association compte aujourd’hui une grosse quinzaine de salariés, tous au SMIC. Je suis pour ma part bénévole.
Mme Brigitte Gothière. Nous sommes financés pour l’essentiel par des donateurs particuliers. Quelques fondations nous apportent leur aide, mais cela représente peu de chose – 34 000 euros l’an dernier, je crois. Au total, les dons reçus l’an dernier s’élèvent à environ 1 million d’euros. Nous ne sommes pas reconnus d’utilité publique, mais seulement une association d’intérêt général.
Vous nous interrogez également sur notre expérience depuis 2008. Nous avons montré, je l’ai dit, d’autres vidéos. Nous nous adressons également aux distributeurs pour leur demander de modifier les produits proposés à la vente : nous menons ainsi une campagne visant à bannir de France les élevages de poules en batterie.
Nous avons en effet essuyé des refus de documents, notamment des rapports des services des inspections vétérinaires ; on nous oppose en particulier le risque de préjudice aux éleveurs. Certaines de nos vidéos ont également été supprimées. Nous ne pouvons donc pas accéder à certains documents, dont il nous semblerait pourtant souhaitable qu’ils soient à la disposition de tout un chacun.
Quant aux inspections des services vétérinaires, souvent, elles ne portent pas sur le bien-être ou la protection des animaux. Les témoignages que nous recueillons auprès de personnes qui travaillent au sein même des établissements ne concordent pas toujours avec les rapports des services vétérinaires.
M. Antoine Comiti. Il existe aujourd’hui au ministère de l’agriculture un Bureau de la protection animale – ce n’est pas une direction. Il nous semble que la position de ce bureau ne lui permet pas vraiment de défendre le bien-être des animaux : trop d’impératifs, notamment économiques, entrent en contradiction avec cet objectif. On veut produire vite, on veut produire en masse… Autant de préoccupations qui prédominent au sein du ministère.
Encore une fois, je pense que c’est là le reflet de l’état de la société, qui n’a pas assez débattu de cette question. Néanmoins, une externalisation serait une bonne chose : cela a été fait en Belgique récemment, et les effets sur la protection des animaux dans divers domaines sont très intéressants et très rapides.
À entendre M. Chevrollier, l’administration fait son travail. Il nous semble que si notre association existe, si elle est utile, c’est justement parce que l’État ne joue pas suffisamment son rôle de veille à ce sujet, et que ceux qui ont ce sujet en charge n’ont pas assez de pouvoir pour imposer qu’il soit vraiment pris en considération.
M. Guillaume Chevrollier. J’ai seulement voulu dire que vous dénonciez une certaine omerta des services.
Mme Brigitte Gothière. Vous dites aussi, monsieur Chevrollier, que nous jouons sur l’émotion. Les personnes qui ont fondé cette association ne sont pas végétariennes ou vegan de naissance : à un moment, dans notre parcours, nous avons fait un pas de côté. La volonté de lutter contre la souffrance animale nous a amenés à nous interroger sur notre propre rapport avec les animaux et les humains.
Vous avez fait une distinction, monsieur Daniel, entre la sensibilité et les sentiments des animaux. Aujourd’hui, il est reconnu que les animaux sont doués de conscience et éprouvent des sentiments : je vous renvoie à la Déclaration de Cambridge sur la conscience, signée par d’éminents scientifiques, en présence de Stephen Hawking. La plupart des animaux, et notamment ceux qui sont élevés pour être mangés, ont les substrats neurologiques qui permettent la conscience.
Il y a quelques années, nous ne disposions pas de toutes ces connaissances en éthologie, en sciences cognitives, qui nous permettent d’affirmer aujourd’hui que les animaux sont doués d’émotions. Je rappelle que les animaux ont été reconnus comme doués de sensibilité par le Parlement il y a un an.
On méconnaît donc encore largement ce qu’éprouvent les animaux, et nous voudrions mettre à disposition du public tous les faits scientifiques qui montrent la sensibilité et les sentiments des animaux.
M. Yves Daniel. La sensibilité, oui, les sentiments, non !
Mme Brigitte Gothière. Je suis désolée, mais les publications scientifiques disent le contraire !
Les connaissances dans le domaine de la nutrition humaine ont également fait d’énormes progrès, et l’on sait maintenant qu’il n’est absolument pas nécessaire de consommer des produits d’origine animale pour être en bonne santé. Cela pose vraiment la question de la légitimité de continuer de mettre à mort un milliard d’animaux chaque année dans les abattoirs français. Ce doit être l’affaire de chacun – mais c’est aussi un problème collectif, puisque la préservation de notre environnement doit nous amener à réduire au moins notre consommation de viande.
Nous aimerions donc provoquer un débat.
Monsieur Bouillon, nous avons eu un contact avec le directeur de l’abattoir de Mauléon juste avant de diffuser nos images. Il nous a appelés en disant qu’il tombait des nues : cela nous semble difficile à croire… S’il va dans son abattoir, il voit forcément des animaux qui reprennent conscience sur la chaîne : leur système d’étourdissement n’est pas au point – il était parfois placé sur les épaules des animaux et non sur la tête… Il s’y pose à l’évidence un problème structurel.
Madame Alaux a posé la question de la sélection, de la formation, de l’encadrement, et Mme Abeille demandait si l’on pouvait en faire le métier d’une vie. Ce sont vraiment des questions essentielles. Les conditions de travail sont de toute façon dures
– froid, humidité, sans oublier l’odeur… Psychologiquement, donner la mort, ce n’est pas rien. Pour ces raisons, le turnover dans les abattoirs est important : c’est un travail insupportable, au fond.
Je reviens à la question des causes et des cadences. L’abattoir du Vigan est tout petit, et les cadences n’y sont pas particulièrement élevées. Celles-ci ne sont pas nécessairement au cœur du problème. Je ne dirais pas pour autant que les dysfonctionnements sont principalement le fait des petits abattoirs. Les premières images que nous avons montrées venaient plutôt d’abattoirs importants, et l’on y voit les mêmes problèmes qu’ailleurs : des étourdissements inefficaces, mal faits, etc. Quant au fait que les animaux soient mal maintenus, il s’agit d’un problème économique : il ne faut pas perdre de temps. Ils sont égorgés, et immédiatement relâchés du piège, alors qu’ils devraient y rester jusqu’à ce qu’ils aient perdu conscience ; or le contrôle de l’inconscience n’est jamais fait. La taille de l’abattoir n’est pas en cause.
Il n’y a en effet pas d’abattoirs bio, mais des abattoirs certifiés bio. Les animaux issus de l’agriculture biologique sont encore moins standardisés que les autres, mais les animaux sont de toute façon très différents les uns des autres : on a affaire à des individus, pas à des briques Lego.
Madame Abeille, les premières enquêtes que j’avais réalisées portaient sur les animaux non ambulatoires : ceux qui arrivent blessés, qui ne peuvent plus se déplacer seuls, et qui étaient pourtant encore emmenés dans les abattoirs où ils n’étaient pas traités immédiatement. Non seulement ils étaient transportés alors qu’ils n’auraient pas dû l’être ; mais souvent, les animaux mis de côté ne sont pas traités en premier, conformément à la réglementation, mais en dernier, pour ne pas infecter la chaîne d’abattage, semble-t-il. Le problème que vous soulevez est tout à fait réel. Le rapport de l’OAV, de ce que j’en ai lu, l’évoque également.
S’agissant du représentant de la protection animale dans les abattoirs, c’est une obligation réglementaire européenne pour les établissements les plus grands. Mais ce représentant se heurte à un problème de loyauté vis-à-vis de ses collègues : doit-il rapporter les abus et les problèmes aux services vétérinaires, à son directeur ? Que fait ce dernier de ce qui lui est raconté ?
Pierre Hinard, ancien directeur qualité chez Castel Viandes, a fait des révélations qui lui ont du reste valu d’être viré… Son témoignage, qui ne se limite pas forcément à la protection des animaux et aux mesures visant à réduire leur souffrance, est intéressant. Il a justement voulu dénoncer à sa direction des pratiques illégales qu’ils avaient découvertes : c’est lui qui a été licencié.
M. le président Olivier Falorni. Il est prévu que nous l’entendions.
Mme Brigitte Gothière. Les représentants de la protection animale, même s’ils bénéficient de la protection accordée aux lanceurs d’alerte, rencontreront ces mêmes obstacles : il est forcément difficile de dénoncer un collègue qui fait mal son travail.
Monsieur Bouillon, vous nous interrogez aussi sur nos relations avec d’autres ONG européennes. L214 a intégré il y a deux ans Eurogroup for Animals, qui regroupent différentes associations européennes de protection animale. Mais nous n’avons pas encore eu beaucoup le temps de participer à leurs travaux. D’autres vidéos sont publiées dans d’autres pays. Comme en France, ce genre de témoignage reste néanmoins l’exception.
Enfin, monsieur Chevrollier, vous dites que ce que nous montrons ne survient que dans quelques abattoirs, et pas dans tous. Les conclusions de l’OAV, de la Cour des comptes, des syndicats vétérinaires, des associations, etc., vont dans le sens contraire. Vous entendrez juste après nous l’OABA, qui mène des enquêtes depuis très longtemps. Je pense que ces auditions finiront par vous convaincre que le problème est d’ampleur, et non limité à trois abattoirs isolés.
Quant à l’idée que les animaux bien traités donnent une meilleure viande, je ne crois pas que les gens qui ont mangé les agneaux tués à Mauléon à Pâques – en partie destinés pourtant à des tables prestigieuses, à des « connaisseurs » – se soient plaints de la mauvaise qualité de la viande. L’idée que l’on puisse détecter le stress des animaux au goût de la viande me paraît une idée reçue.
Madame Dubois, les abattoirs refusent souvent que les éleveurs soient présents au moment de la mise à mort des animaux ; certains éleveurs, inversement, refusent d’assister à cet instant terrible pour eux. L’attachement de certains éleveurs à leurs animaux a été rappelé – ce n’est pas le cas de tous : j’estime qu’un élevage de plusieurs centaines de milliers de poules au même endroit ne témoigne pas nécessairement d’un attachement très fort du propriétaire à ses animaux. Mais ceux qui sont effectivement attachés à leurs animaux sont très mal à l’aise au moment de les faire tuer ; ils sont prisonniers d’une logique économique.
Les questions que nous posons sont éthiques ; nous appelons à une transition dans notre modèle agricole et économique, qui peut-être dépasse le cadre de cette commission d’enquête. Notre société évolue ; nous devons élargir notre sphère de considération morale, et le Parlement doit se saisir de ces questions.
M. le président Olivier Falorni. Merci de ces réponses précises.
La séance est levée à dix-huit heures vingt-cinq.
——fpfp——
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Pierre Kiefer, président de l’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) et de M. Frédéric Freund, directeur, en charge des missions de visites des abattoirs.
(Séance du mercredi 27 avril 2016)
La séance est ouverte à dix-huit heures trente.
M. le président Olivier Falorni. Nous recevons à présent deux responsables de l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir (OABA) : M. Jean-Pierre Kieffer, son président, et M. Frédéric Freund, son directeur, en charge des missions de visites des abattoirs.
Avant de vous donner la parole pour un exposé liminaire, messieurs, je vous informe que cette audition, ouverte à la presse, est également retransmise sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale, où elle pourra être consultée pendant plusieurs mois. La Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu de cette audition.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter serment en jurant de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Kieffer et M. Freund prêtent successivement serment.)
M. Jean-Pierre Kieffer président de l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir (OABA). L’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir que je préside existe depuis 1961 et a été reconnue d’utilité publique en 1965, voilà un peu plus de cinquante ans. Cette association a été la première à être spécialisée dans la protection des animaux de boucherie. Elle a pendant longtemps été la seule à s’en préoccuper et nous nous réjouissons que d’autres organisations se soucient désormais de la protection des animaux que l’homme destine à sa consommation.
Nos actions couvrent la protection des animaux de l’élevage jusqu’à l’abattage. Et nous menons notamment une mission très particulière : le sauvetage des animaux maltraités ou en abandon de soins dans les fermes, tâche qui n’a fait que s’accroître avec la crise agricole. En 2015, nous avons ainsi pu sauver, à la suite de saisies effectuées par les services vétérinaires, 1 386 animaux, dont 986 bovins. Cela a représenté un budget de 750 000 euros pour notre association qui n’a reçu d’aides ni des pouvoirs publics, ni d’autres associations, ni des professionnels de l’élevage. Je tiens à le souligner, car en l’absence d’interventions de notre part, les animaux seraient promis à une mort certaine, crèveraient de faim ou de souffrance, et les services vétérinaires savent malheureusement de plus en plus faire appel à nous. Ce rôle nous est cher car nous avons toujours accordé beaucoup d’importance à la protection de terrain : nous privilégions ces opérations de sauvetage par rapport à la communication, notamment sur internet.
C’est grâce à l’action de la fondatrice de l’OABA, Mme Gilardoni, qu’a été publié en 1964 un décret rendant obligatoire l’étourdissement – avec une dérogation bien connue pour l’abattage rituel.
L’OABA a mené depuis les années soixante-dix une mission de visites des abattoirs, mettant à profit la présence traditionnellement forte de vétérinaires parmi ses membres, qu’il s’agisse d’enseignants des écoles vétérinaires, de vétérinaires praticiens, voire de vétérinaires de l’administration. Depuis quelques années, elle rencontre toutefois des difficultés pour la mener à bien – j’y reviendrai plus loin.
Ces visites se font toujours après avoir pris rendez-vous avec le directeur de l’abattoir concerné et les services vétérinaires en charge du contrôle de cet abattoir : il n’est pas possible pour une association de venir à l’improviste pour voir ce qu’il s’y passe. Précisons que nos audits portent sur la seule protection des animaux et non sur l’aspect sanitaire. Sur place, nous adressons des remarques au directeur et aux professionnels sur les problèmes que nous relevons. Nous faisons même corriger les mauvaises pratiques en montrant les bons gestes, puisque nos enquêteurs sont soit des vétérinaires soit des professionnels des abattoirs à la retraite, doués d’une réelle compétence en matière de manipulation des animaux et d’utilisation du matériel. Nos visites font systématiquement l’objet d’un rapport remis au directeur, éventuellement au maire lorsqu’il s’agit d’un abattoir municipal, aux services vétérinaires préfectoraux – direction départementale des services vétérinaires (DDSV) autrefois, direction départementale de la protection des populations (DDPP) à présent – mais aussi, en cas de problèmes sérieux, au bureau de la protection animale de la direction générale de l’alimentation (DGAL) du ministère de l’agriculture.
Notons que jusqu’au début des années 2000, il y avait une réactivité très forte de la part des abattoirs, des services vétérinaires et du bureau de la protection animale. Lorsque nous constations une infraction qui aurait dû être relevée par le vétérinaire inspecteur, le bureau de la protection animale envoyait une note de service à l’abattoir concerné rappelant la réglementation – dont il pouvait arriver à mes confrères d’ignorer certains points. Nous avons même reçu des lettres d’encouragement de la part de certains ministres de l’agriculture comme Dominique Bussereau ou Bruno Le Maire. Mais depuis, cette réactivité s’est peu à peu affaiblie : lorsque nous revenions six mois ou un an plus tard visiter un abattoir dont nous avions signalé les manquements à la réglementation, nous constations une persistance des dysfonctionnements.
En 2011, nous avons été sollicités par la journaliste Anne de Loisy qui souhaitait faire une enquête en caméra cachée dans les abattoirs à la suite du rapport de la Cour des comptes épinglant des problèmes sanitaires. Nous avons étudié la possibilité de l’aider à entrer dans certains abattoirs mal équipés ou souffrant de dysfonctionnements, notamment un abattoir appartenant à la catégorie 4 – la pire, celle qui ne devrait plus exister. Son reportage, qui comportait des images très choquantes, a été diffusé en 2012 dans le cadre de l’émission Envoyé spécial sur France 2 et a été vu par près de 4 millions de téléspectateurs. Il mettait au jour des pratiques inacceptables – un directeur notamment indiquait que les visites ante mortem dans son abattoir étaient effectuées par la caissière de son établissement !
Cette émission a eu un impact politique à quelques mois des élections présidentielles
– certains partis se sont emparés de la question, parfois en la détournant de son contexte. Malheureusement, elle a eu aussi des répercussions directes pour l’OABA car certains directeurs d’abattoir ont considéré que notre association avait trahi leur confiance. C’est une attitude regrettable : les professionnels auraient mieux fait de considérer qu’il leur fallait balayer devant leur porte, car nous n’avions dénoncé que de très, très mauvais élèves, et empêcher que les dysfonctionnements dénoncés à travers des cas extrêmes ne se reproduisent.
Nous avons donc ensuite connu des difficultés pour entrer dans les abattoirs et la situation ne s’est pas arrangée par la suite. Patrick Dehaumont, directeur général de l’alimentation, toujours en fonction, a en effet adressé à tous les abattoirs une note de service indiquant que toute personne entrant dans un abattoir devait obtenir l’autorisation de son directeur. Ce qui était tout à fait logique, à ceci près qu’on laissait entendre que l’OABA n’était pas la bienvenue…
Précisons que le rôle de l’OABA n’est pas seulement de dénoncer les mauvaises pratiques mais aussi d’encourager les améliorations. Dans cette optique, nous mettons au point des guides de bonnes pratiques illustrés : celui consacré aux ruminants a été validé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), celui dédié aux ovins est à l’étude et celui relatif aux porcs est en cours de rédaction.
Nous participons également à des travaux scientifiques avec l’Institut national de recherche agronomique (INRA), l’ANSES, et les écoles vétérinaires afin d’améliorer les analyses des conditions de la perte de conscience. Il faut savoir que beaucoup de mauvaises pratiques proviennent de non-vérification de la perte de conscience. Du coup, des animaux sont hissés sur la chaîne d’abattage et découpés alors qu’ils sont encore sensibles. Ces actes de cruauté sont très difficiles à supporter pour le vétérinaire que je suis. Les vidéos de l’association L214 ont eu l’avantage de montrer ces pratiques dans certains abattoirs.
Nous continuons de visiter un certain nombre d’abattoirs. Sur les deux cent cinquante abattoirs d’animaux solipèdes – munis de sabots –, quatre-vingts continuent à nous ouvrir leurs portes sans difficulté.
Lors de la réunion du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) du 5 avril dernier, j’ai eu l’occasion de demander au ministre de l’agriculture s’il comptait renforcer le contrôle du poste d’abattage. Il m’a immédiatement répondu qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour recruter les 500 équivalents-temps plein nécessaires pour combler la perte d’agents de contrôle intervenue entre 2004 et 2014. Ce à quoi, me doutant de sa réponse, j’ai répliqué que, dans ces conditions, il devait accepter que des associations participent au contrôle du poste d’abattage, proposition qu’à ma surprise, il a acceptée. Le directeur général de l’alimentation, Patrick Dehaumont – celui-là même qui avait transmis une note de service incitant les directeurs d’abattoir à ne plus recevoir l’OABA – m’a appelé pour me dire que cette solution serait étudiée et que, dans le cadre de conventions, il pourrait être envisagé que les associations de protection animale participent à ces visites de contrôle du poste d’abattage.
M. le président Olivier Falorni. Mes questions porteront sur quatre thèmes.
S’agissant tout d’abord de la formation, quelles sont pour vous les principales difficultés rencontrées dans les abattoirs ? Pensez-vous que le personnel est suffisamment formé ? Quelle est votre position sur l’encadrement dans les abattoirs ?
S’agissant des contrôles, quel regard portez-vous sur l’intervention des services vétérinaires au sein des abattoirs ? Les contrôles sont-ils selon vous efficaces ? Êtes-vous favorable à la généralisation de la vidéosurveillance ?
S’agissant des sanctions, le dispositif pénal vous semble-t-il aujourd’hui suffisant ? Pouvez-vous vous porter partie civile dans toutes les situations ? Que pensez-vous des annonces récentes du Gouvernement sur la responsabilité pénale des directeurs d’abattoir ?
Enfin, avez-vous une bonne connaissance des pratiques d’abattage à l’étranger ? Il est toujours bon de se comparer à d’autres : quand on se regarde, on se désole ; quand on se compare, on se console… Y a-t-il matière à se consoler ? Certains pays vous semblent-ils plus attentifs à la souffrance animale que le nôtre ?
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Je vous remercie pour votre exposé liminaire. Votre audition sera complémentaire de celle de l’association lanceuse d’alerte, L214, dont l’action a conduit à la création de cette commission d’enquête.
L’alerte a montré que dans certains abattoirs, la réglementation n’était pas respectée, ce qui a abouti à des situations que tout le monde s’accorde à qualifier d’inacceptables – ce qui tient sans doute de l’understatement. Mais, au-delà, pouvez-vous estimer la proportion d’abattoirs où les règles ne sont pas respectées ? Est-ce systématique, rare, plutôt fréquent ? L’une des missions de notre commission est aussi de quantifier le nombre de dysfonctionnements et de déterminer leur degré de gravité.
Peut-on préciser les causes des mauvaises pratiques ? Sont-elles liées à la formation, aux cadences imposées par les contraintes économiques, à la vétusté des équipements, à leur conception même ?
Quelle part des dysfonctionnements concerne les étapes qui se situent en amont de l’abattage : transport, stockage, période d’attente ?
Quand on est confronté à une multiplicité de problèmes, il y a parfois une ou deux choses simples à faire qui permettent de résoudre une bonne partie des difficultés. Est-ce possible pour la question qui nous occupe ?
Enfin, qu’en est-il de la démarche de certification ? L’intervention d’un tiers certificateur pourrait-elle être envisagée en complément du processus de contrôle ?
M. Élie Aboud. Grâce à votre association, reconnue d’utilité publique, le décret rendant obligatoire l’étourdissement a vu le jour. Je suis surpris que plus d’un demi-siècle plus tard, il n’y ait toujours pas de procédures de vérification de la perte de conscience. Pouvez-vous nous en dire davantage, en tant que vétérinaire et militant associatif ?
L’association L214 défend pour sa part la cause végétarienne. Travaillez-vous avec elle ? Partagez-vous les mêmes objectifs ? Votre association est-elle aussi marquée par ce militantisme végétarien ?
M. Hervé Pellois. Vous avez évoqué une grille d’appréciations des abattoirs, avec des catégories allant de 1 à 4. Pouvez-vous nous donner des précisions à ce sujet ? Comment se répartissent les abattoirs entre ces quatre catégories ?
Par ailleurs, le fait que vous élaboriez des guides de bonnes pratiques implique-t-il que les instituts techniques ne font pas ce travail ? Quels sont vos rapports avec ceux-ci et avec l’INRA ?
Êtes-vous d’accord pour considérer que la non-spécialisation des abattoirs constitue l’une des principales difficultés aujourd’hui ?
M. Thierry Lazaro. Vous avez parlé de la cause animale avec beaucoup de cœur, une compétence certaine et la fermeté nécessaire. Le site internet de l’OABA n’a pas la même tonalité militante que celui de l’association L214. Parmi ses rubriques, on trouve les transports, les spectacles – en tant qu’élu du Nord, je sais les passions que déchaînent les combats de coq –, les abattoirs mais aussi l’abattage rituel. Sans avoir d’a priori, on ne peut pas ne pas se poser de questions sur les conditions cette forme d’abattage. Quelle est votre position sur ce point ?
M. Jacques Lamblin. L’étourdissement obligatoire est une victoire de votre association qui remonte à 1964. Il permet de faire perdre conscience à l’animal qui va être sacrifié. Les dispositifs existants connaissent-ils des dysfonctionnements ? Si oui, sont-ils ou non fréquents ?
Nous le savons, il existe des dérogations à cette obligation, la principale concernant l’abattage rituel. Est-il possible de concilier l’absence d’étourdissement et l’absence de souffrance des animaux pendant l’abattage ?
M. Jean-Pierre Kieffer. Je commencerai par la question relative au végétarisme. Les statuts de l’OABA ne prévoient nullement qu’il faille prôner le végétarisme. Son intitulé même – Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir – reconnaît l’existence des abattoirs. Chacun de ses membres, à titre personnel, prend ses responsabilités. Il est certain que face à la souffrance dont nous sommes témoins dans les abattoirs, il peut être difficile dans l’immédiat de consommer de la viande ; mais c’est l’affaire de chacun. Qui plus est, mes responsabilités professionnelles me conduisent à considérer avec respect les éleveurs qui font bien leur métier. Certains sont eux-mêmes choqués des conditions dans lesquelles leurs bêtes sont parfois véritablement massacrées. Lors de l’une de nos dernières assemblées générales, une éleveuse nous a dit quel choc a été pour elle le fait de découvrir que ses vaches laitières étaient tuées dans un abattoir qui ne pratiquait pas l’étourdissement alors qu’elle leur avait donné à chacune un prénom – Marguerite ou autre – et les avaient entourées de soins pendant sept ans. Il faut savoir que l’agonie d’une vache égorgée à vif peut durer jusqu’à cinq minutes : c’est une vision insupportable, je peux en témoigner.
J’ajoute une précision : nous n’avons aucun lien avec quelque sensibilité politique que ce soit. Dès qu’il est question d’abattage rituel, il y a des risques de récupération à craindre de la part de certains mouvements auxquels nous ne donnons aucun crédit.
La question de la formation est essentielle. Sur certains sites de recrutement, on voit des petites annonces ainsi rédigées : « Recrutons opérateur d’abattoir. Formation professionnelle souhaitée mais non obligatoire ». Lors de certains pics d’activité – ce qui a certainement été le cas à l’abattoir de Mauléon à l’approche des fêtes pascales –, des responsables tendent à embaucher des personnes sans la formation nécessaire.
La formation est pourtant obligatoire depuis que le règlement européen de 2009 est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Toutefois, elle n’est que théorique. Elle s’effectue sous forme de questionnaires à choix multiples. Nous souhaitons qu’elle soit également pratique. Il n’est pas pensable que le maniement d’appareils dangereux, y compris pour la sécurité de personnel, puisse être confié à des personnes non formées à leur utilisation. Nous appelons à une formation pratique des personnels travaillant sur ce poste particulier de mise à mort.
M. Frédéric Freund, directeur de l’OABA. À l’évidence, les contrôles sont insuffisants et inefficaces. Il n’y a pas que les ONG de protection animale qui le soulignent : les services de Commission européenne dressent le même constat. Plusieurs rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) ont épinglé la France pour l’insuffisance des contrôles : les vétérinaires inspecteurs ne sont pas assez présents aux postes d’abattage et lorsqu’ils le sont, ils ne remédient pas assez souvent aux situations de maltraitance avérée.
Dans ces conditions, la question de la vidéosurveillance se pose. À la suite de la diffusion des vidéos de L214, les ONG de protection animale, dans une lettre commune adressée tout d’abord au ministre de l’agriculture puis au Premier ministre, ont appelé à une surveillance continue du poste d’abattage ; cette demande a d’ailleurs été reprise par les quatre fédérations nationales d’abattage dans un communiqué de presse unique – le fait est assez rare pour être noté. Lors de la réunion du CNOPSAV du 5 avril, le directeur général de l’alimentation a reconnu qu’une telle surveillance nécessitait de recruter 500 personnes. Le ministre de l’agriculture s’est empressé de dire qu’il n’avait pas les moyens budgétaires de le faire.
En l’absence de moyens humains, comment répondre à l’attente des professionnels, des ONG et du public ? En installant des dispositifs de vidéosurveillance. Au Royaume-Uni, plus de la moitié des abattoirs en sont équipés, sur la base du volontariat. Rien n’empêche les responsables d’abattoirs français d’en faire autant. Leurs fédérations elles-mêmes en ont fait la demande ; il leur appartient de passer à l’action. Certains, du reste, ont déjà installé des caméras, principalement pour les quais de déchargement. Il faudrait les généraliser aux couloirs d’amenée et aux postes d’abattage.
Le dispositif de sanctions nous paraît-il suffisant ? Il repose principalement sur la partie réglementaire du code rural, précisément sur l’article R. 215-8 qui punit, entre autres, le fait d’avoir recours à un matériel d’immobilisation non conforme, de suspendre des animaux encore conscients, de ne pas étourdir l’animal. Seules des contraventions de quatrième classe sont appliquées : ces pratiques ne sont pas considérées comme des délits. Cela explique que le ministre de l’agriculture ait parlé de créer un délit de maltraitance pour les professionnels de l’abattage. Il suffirait pour cela d’étendre le champ de l’article L. 215-11 du code rural qui punit d’ores et déjà de six ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende les actes de maltraitance commis par des professionnels de l’élevage, avec une interdiction professionnelle limitée à cinq ans. Passer d’une peine contraventionnelle de quelques centaines d’euros à une peine délictuelle me paraît incontournable.
Pour bien connaître le fonctionnement des parquets – il m’est arrivé d’être auditeur lorsque j’étais chargé de travaux dirigés à la faculté de droit de Nancy –, je sais qu’un procureur submergé de dossiers d’agressions sexuelles, de vols à main armée, de trafics de stupéfiants, d’infractions économiques aura tendance à ne pas prêter grande attention à une contravention de quatrième classe pour deux ou trois moutons mal étourdis. Il n’en sera pas de même pour une procédure d’ordre délictuel portant sur les mêmes faits : il lui sera beaucoup plus difficile de décider de la classer. L’élévation dans le degré des sanctions pour les maltraitances commises au sein des abattoirs nous apparaît nécessaire.
Vous avez posé une excellente question à propos de la possibilité pour les associations de protection animale de se porter partie civile : aujourd’hui, elles peuvent le faire – je vous renvoie à l’article 2-13 du code de procédure pénale – uniquement pour les infractions qui relèvent du code pénal, et non du code rural. Vous avez donc devant vous une association reconnue d’utilité publique spécialisée dans la protection animale, de l’élevage à l’abattage, qui ne peut légalement se constituer partie civile pour toutes les infractions relatives aux règles d’élevage, de transport et d’abattage contenues dans le code rural…
Dans le cadre de l’examen de la loi d’avenir pour l’agriculture, il avait été envisagé d’élargir par voie d’ordonnance l’article 2-13 aux infractions prévues par le code rural. La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) s’est opposée à cette disposition, estimant qu’elle encouragerait les associations à déposer des plaintes à tout va. C’est confondre deux choses. Aujourd’hui, point n’est besoin de se porter partie civile pour déposer plainte : tout le monde peut le faire. Dans 99 % des cas, la constitution de partie civile pour les associations de protection animale se fait à partir de citations délivrées par le parquet. Je ne vois donc pas où est le risque d’une inflation de procédures. Si le parquet est inactif, une association de protection animale peut initier l’action publique, soit devant le doyen des juges d’instruction, soit par citation directe, mais dans les deux cas, elle doit verser une certaine somme au titre de la consignation. Si la procédure est considérée comme abusive, cette provision peut être confisquée et une amende civile prononcée : la procédure est donc suffisamment bordée. Rien n’empêche donc à mon sens que le code de procédure pénale soit modifié pour permettre aux associations de protection animale de se porter partie civile pour les infractions prévues par le code rural.
Pour ce qui est de la comparaison avec l’étranger, je vous rassure : on ne peut pas dire que la France est le vilain petit canard de l’Union européenne. Nous nous référons aux rapports de la Commission européenne qui portent chaque année sur des audits menés dans certains pays soit sur l’élevage, soit sur le transport, soit sur l’abattage. Les dernières études de l’OAV, qui portent sur la Grèce, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, ne montrent pas dans ces pays une situation meilleure que la France. Les pays les plus attentifs au bien-être animal sont surtout ceux d’Europe du Nord : le Danemark, la Suède et les Pays-Bas.
Comment quantifier les dysfonctionnements dans les abattoirs, nous avez-vous demandé. Il s’agit d’une tâche extrêmement difficile car cela nécessite de disposer d’une grille d’analyse bâtie sur des critères objectifs. Nous avons mené une étude au sein de l’OABA durant les années 2011 et 2012 portant sur cent vingt visites d’abattoirs : nous avons constaté que dans 5 % des cas, les abattoirs respectaient parfaitement la réglementation « protection animale » ; pour les 95 % restants, on relevait 55 % d’irrégularités mineures et 45 % d’irrégularités majeures. Exemple d’irrégularité mineure : la coupure de l’eau dans les zones d’attente pour éviter le gel, problème qui peut pourtant être aisément résolu en en mettant des bassines ou des seaux dans les parcs pour donner à boire aux animaux. Et si les animaux les renversent, il suffit de les mettre dans de vieux pneus, qui ne coûtent rien… Les dysfonctionnements majeurs concernent les animaux mal étourdis ou les animaux suspendus alors qu’ils sont encore conscients.
M. Jean-Pierre Kieffer. Lorsqu’ils ont découvert la vidéo de l’abattoir d’Alès, certains responsables du ministère de l’agriculture et des professionnels ont soutenu qu’il s’agissait d’un cas isolé. Malheureusement, deux autres vidéos ont montré que des pratiques encore plus cruelles avaient lieu dans d’autres abattoirs.
Le ministre de l’agriculture a indiqué qu’au cours de l’année 2014, sur les deux cent cinquante abattoirs, cent quatre avaient fait l’objet d’un avertissement, soixante d’une mise en demeure et deux d’une suspension d’agrément. Autrement dit, moins de 35 % seulement ont échappé à tout reproche, ce qui a de quoi inquiéter.
J’aimerais revenir à la vidéosurveillance, qui me paraît très importante. Bien sûr, l’installation de tels dispositifs pose des questions en matière de droit du travail et de protection des salariés. Toutefois, elle est le seul moyen de garantir une surveillance continue, car il est impossible pour les services vétérinaires et les associations de protection animale de l’exercer. Et quand bien même un vétérinaire inspecteur serait est présent en permanence sur le poste d’abattage, il est en blouse blanche, à visage découvert, au vu et au su de tous ; or si les caméras cachées de L214 ont pu mettre au jour des pratiques inacceptables, c’est parce que le personnel ne se savait pas surveillé. Pour empêcher que des situations aussi dramatiques ne se reproduisent, la vidéosurveillance s’impose. Elle permettra en outre d’assurer la sécurité du personnel. Le pistolet d’abattage de type Matador, par exemple, est d’un maniement très dangereux : la tige métallique que l’explosion d’une cartouche fait sortir du fût pour pénétrer dans la boîte crânienne de l’animal peut tout aussi bien arracher une main. Il en va de même pour la pince à électronarcose. Je vous transmettrai un document relatif à la vidéosurveillance au Royaume-Uni.
Pour ce qui est de l’évaluation et la quantification des dysfonctionnements, le problème est que les grilles d’appréciation sont très succinctes et ne sont remplies que tous les deux ans. Elles ne permettent pas une surveillance adaptée.
M. Frédéric Freund. Le responsable d’un abattoir de Lozère, dans les jours qui ont suivi la diffusion de ces vidéos, a déclaré qu’il n’avait rien à cacher et s’est dit prêt à accueillir qui le voulait. Saisissant la balle au bond, nous l’avons contacté, mais lorsque nous avons précisé qui nous étions, il a fait volte-face et a refusé de nous recevoir : « Vous pouvez toujours écrire au préfet, je n’en ai rien à faire » nous a-t-il répondu – vous imaginez qu’il a employé des termes moins policés. Nous avons alors demandé au préfet de nous transmettre les derniers rapports d’inspection portant sur la protection animale : au mois de novembre 2015, nous avons reçu par l’intermédiaire de la DDPP deux rapports, l’un datant de juin 2015, l’autre remontant à septembre 2013, alors qu’il s’agit de simples grilles de quatre pages avec des cases à cocher que l’on peut remplir en cinq minutes. On entend dire que les abattoirs sont régulièrement surveillés, c’est surtout vrai d’un point de vue sanitaire – les alertes fonctionnent plutôt bien en ce domaine ; en matière de protection animale, en revanche, la surveillance accuse un énorme retard.
Une question a porté sur les catégories du classement des abattoirs. Il y en avait quatre, il y en a aujourd’hui trois, sachant qu’il ne devrait plus y en avoir que deux. La catégorie 1 correspond aux établissements qui se conforment en tout point à la réglementation ; la catégorie 2 aux établissements où il y a quelques points à améliorer ; la catégorie 3 aux établissements présentant de très nombreux défauts ; quant à la catégorie 4, c’était l’horreur… Mais attention, il s’agit d’un classement fondé sur des critères exclusivement sanitaires qui ne prend aucunement en compte la protection animale.
Dans la continuité des contrôles sanitaires, il serait intéressant de certifier les abattoirs selon leur score en matière de protection animale. L’OABA travaille avec un groupe sur un tel outil d’évaluation qui pourrait être généralisé par l’intermédiaire de la direction générale de l’alimentation. Cela serait de nature à rassurer le consommateur qui ne se soucie plus seulement, comme ce fut longtemps le cas, de la qualité de la viande, mais aussi de la manière dont les animaux sont traités.
J’en viens aux causes des différentes maltraitances. Est-ce un problème de matériel, de formation, de conception ? En fait, il y a des trois. Certains abattoirs sont mal conçus, avec, par exemple, des couloirs d’amenée trop larges, conçus pour faire passer des gros taureaux, mais dans lesquels les petits veaux font sans cesse demi-tour. Cela vire au rodéo, le personnel s’énerve, on prend le bâton à choc électrique, pourtant interdit sur les veaux, mais il n’y a pas moyen de faire autrement, ou on tape dessus… Le matériel est parfois vétuste – avec un risque d’arc électrique, donc de sécurité pour le personnel – ou alors, quand il fonctionne bien, il est mal utilisé par des personnels peu formés. La pince à électronarcose utilisée pour l’abattage des porcs suppose de choisir une intensité précise selon la taille de l’animal à abattre : si vous mettez la position « porcelet » pour une coche ou un porc charcutier, cela chatouillera l’animal sans l’étourdir ; inversement, si vous mettez la position « coche », soit 350 ou 400 volts, pour un porcelet, vous allez le griller ! Ajoutons à cela des notices parfois plus ou moins fantaisistes : ce problème a été relevé par la DGAL et la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le but est d’éviter que les fabricants écrivent n’importe quoi.
Vous m’avez demandé selon quelle fréquence on constatait des dysfonctionnements dans les dispositifs actuels d’étourdissement. Les rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et ceux de l’Académie vétérinaire de France considèrent que les dispositifs d’étourdissement mécanique – pistolets à tige perforante – ou électriques – pinces à électronarcose – fonctionnent bien lorsqu’ils sont correctement utilisés et les paramètres correctement appliqués : ils entraînent une perte de conscience immédiate et durable chez l’animal, s’ils sont appliqués suffisamment longtemps, avec une intensité électrique adaptée pour la pince électrique et une cartouche adéquate pour le pistolet – On utilise des cartouches différentes, avec un code couleur, selon qu’il s’agit d’une tête de veau ou d’une tête de gros bovin ou de bison. Certains soutiennent que le pistolet à tige perforante n’est pas performant, ce qui est faux. Cela étant, des problèmes peuvent survenir en cas d’absence d’immobilisation de la tête du bovin : si l’animal est en mesure de bouger sa tête, l’opérateur peut rater son coup et la tige pénétrer dans l’œil et non dans le cortex cérébral. Quand nous nous sommes rendus à l’abattoir de Cholet, qui applique une immobilisation systématique, nous n’avons constaté aucun loupé durant notre observation d’une demi-heure. Et puis, disons-le, il y a des bons tueurs et d’autres moins doués…
M. Jean-Pierre Kieffer. Dans la vidéo de l’abattoir de Mauléon, on voit clairement que l’appareil d’électronarcose ne fonctionnant pas, l’opérateur assomme les moutons avec un crochet métallique. On ne voit ni vétérinaire inspecteur ni représentant de la protection animale (RPA) présent. L’opérateur ne se conforme pas à l’obligation réglementaire selon laquelle la chaîne d’abattage doit être arrêtée en cas de panne de l’appareil d’étourdissement. Sans doute contraint par les très fortes cadences propres à la veille des fêtes pascales, il se retrouve un peu dans la situation de Charlie Chaplin dans Les Temps modernes, à ceci près les boulons sont des moutons ; la solution qu’il choisit, c’est de les assommer avec un crochet métallique… La question a été posée de la responsabilité des opérateurs. Dans ce cas précis, ils font ce qu’ils peuvent, dans des conditions de travail inacceptables du fait des fortes cadences, la panne de la pince à électronarcose et l’absence de contrôle.
Des problèmes se posent aussi avant l’arrivée des animaux à l’abattoir. Il faut savoir que les abattoirs commencent leurs activités très tôt, à quatre heures du matin ; du coup, beaucoup de transporteurs préfèrent venir à la fermeture la veille : les animaux sont alors laissés dans les camions jusqu’au lendemain, après plusieurs heures de transport sans abreuvement. C’est une réalité qu’il ne faut pas oublier. Une réglementation existe en matière de transportabilité des animaux, mais il arrive que des animaux hors d’état d’être transportés parce qu’ils souffrent de fractures, de renversement de matrice, d’abcès ou de cachexie soient tout de même conduits à l’abattoir où ils seront le plus souvent saisis et envoyés à l’équarrissage.
M. Frédéric Freund. Une question a porté sur le type d’abattoirs plus particulièrement concernés par les dysfonctionnements. La taille n’est pas le critère pertinent. On en rencontre dans des petits comme dans des grands. Lors de ma visite à la Cooperl, où sont abattus 750 porcs chaque heure, je m’attendais à voir des horreurs mais la réalité m’a surpris : procédures très bien maîtrisées, personnel bien formé, présence de deux RPA sans attendre l’entrée en vigueur du règlement européen. Autrement dit, il ne faut pas noircir le tableau : certains professionnels ont compris depuis longtemps que le bon traitement d’un animal assurait une viande de qualité. C’est cela aussi qui en jeu : ce n’est pas un hasard si le responsable de la protection animale est souvent aussi le responsable qualité.
Ce qui est déterminant, c’est la spécialisation ou non des abattoirs. Il est bien évident que dans un abattoir spécialisé dans l’abattage des bovins ou des porcins, il y a moins de risques de voir se produire les actes de cruauté que les vidéos ont révélés. Le personnel a l’habitude de traiter un certain type d’animaux et dispose d’un matériel spécifique. Dans un abattoir multi-espèces, les équipements sont difficilement adaptables à toutes les espèces. Par exemple, les mêmes boxes de contention servent aux porcs et aux moutons, ou aux bovins et aux chevaux. Le personnel ayant à traiter plusieurs espèces différentes a du mal à se spécialiser. Il n’est pas étonnant d’ailleurs que les dernières vidéos concernent des abattoirs multi-espèces.
M. Jean-Pierre Kieffer. S’agissant de nos liens avec les instituts scientifiques, je soulignerai que nous collaborons avec l’ANSES, qui nous a consultés plusieurs fois sur des questions relatives à l’abattage. Un groupe de travail consacré à la perte de conscience des porcs va débuter ses travaux la semaine prochaine. La perte de conscience est une question essentielle. S’il n’y a pas de procédures de vérification, si l’abattoir n’adapte pas sa cadence en fonction de l’étourdissement de chaque animal, les problèmes comme ceux montrés dans les vidéos ne peuvent manquer de se produire.
Venons-en à présent à l’abattage dit « rituel ». Nous préférons parler d’abattage avec ou sans étourdissement, car il existe des abattages rituels qui se font avec étourdissement
– tout le monde connaît l’exemple de l’abattoir de Sisteron, spécialisé dans les ovins. Par ailleurs, on observe une dérive dans certains abattoirs qui pratiquent l’abattage sans étourdissement aux bêtes non spécifiquement destinées à la consommation halal ou casher, car il apparaît plus simple de n’utiliser qu’une seule chaîne et une seule procédure pour tous les animaux à abattre. Au-delà de cette généralisation de la souffrance animale, il y a une tromperie du consommateur qui consomme sans le savoir – et surtout sans le vouloir – de la viande provenant d’animaux abattus sans étourdissement.
On ne peut nier la souffrance animale lorsqu’on ne pratique pas l’étourdissement. Assister à un abattage sans étourdissement, surtout lorsqu’il s’agit d’une vache laitière, qui mettra beaucoup plus de temps qu’un gros Charolais à mourir après un égorgement à vif provoque un choc à vie : la gorge tranchée – peau, muscles, œsophage, trachée entaillée –, donc à moitié décapité, l’animal tombe, se relève, retombe, se relève, pousse des cris cependant que l’air qui passe fait des bulles dans le sang. C’est une image atroce.
L’abattage sans étourdissement, rituel ou pas, est pour nous inacceptable au XXIe siècle. Obtenir à travers une réglementation ou une loi l’extension de l’obligation de l’étourdissement avant la saignée serait une grande avancée. Il existe des méthodes d’étourdissement réversibles, acceptées par un grand nombre de chefs religieux. La Nouvelle-Zélande ou l’Australie produisent de la viande certifiée halal provenant d’animaux préalablement étourdis.
M. Frédéric Freund. J’ai levé la main droite et j’ai juré de dire la vérité, je la dis : certains défendent l’abattage rituel pour des raisons davantage économiques que religieuses, plus intéressés par l’argent du halal ou du casher que par le halal ou le casher en eux-mêmes. Ce sont ceux-là qui aimeraient nous faire croire que lorsqu’un animal est égorgé sans être étourdi, il perd conscience dans la seconde qui suit parce que son cerveau, dit-on, implose. Il faut arrêter de dire n’importe quoi et de nous ressortir les thèses des années quatre-vingt ! Une étude récente de l’ANSES – que l’on ne peut soupçonner d’être à la botte des associations de protection animale – affirme clairement que la seule méthode permettant de réduire les souffrances de l’animal lors de l’abattage, c’est l’étourdissement, qui devrait être pratiqué dans tous les cas. Les rapports scientifiques les plus récents s’accordent pour établir que ce n’est pas tant le coup de couteau en lui-même qui est douloureux pour l’animal que l’agonie post-jugulation, car la perte de conscience peut être retardée de plusieurs minutes, notamment chez les bovins. Il ne faut pas se focaliser sur le fait que l’animal est égorgé vivant mais plutôt sur le temps qu’il faut avant que l’animal se vide suffisamment de son sang pour perdre conscience.
Encore faut-il, je le répète, que les méthodes d’étourdissement soient correctement appliquées, avec un matériel adéquat et par un personnel formé.
M. Philippe Vitel. Votre association, qui a pignon sur rue et dispose d’un budget conséquent, constate depuis très longtemps des dysfonctionnements. Toutefois, vos analyses ne sont pas arrivées jusqu’à nous : il a fallu les vidéos de L214 pour éveiller les consciences et amener les parlementaires à décider la création d’une commission d’enquête. Comment jugez-vous les méthodes de communication de cette association, qui se pose en lanceuse d’alerte ? N’avez-vous pas le sentiment, avec le recul, de ne pas avoir assez dénoncé ces problèmes ?
M. Guillaume Chevrollier. Le poste de responsable de la protection animale semble jouer un rôle clef dans les abattoirs. Quelle appréciation en faites-vous ? Faudrait-il préciser ses contours dans une fiche de poste ?
Compte tenu de votre expertise, pouvez-vous nous indiquer quelles pratiques concrètes, issues de pays plus en pointe en matière de protection animale, pourraient être appliquées en France ?
Mme Annick Le Loch. Vous avez précisé, monsieur Kieffer, que quatre-vingts abattoirs vous ouvraient encore leurs portes parmi les deux cent cinquante existants. S’agit-il d’un type particulier d’abattoirs comme les abattoirs mono-espèce ou bien des abattoirs tous classés en catégorie 1 ? S’agit-il plutôt de petites ou de grosses structures ?
Le Gouvernement a prévu un plan d’investissement pour les abattoirs afin de répondre aux besoins considérables en ce domaine. Quelle est votre analyse de l’état de nos abattoirs ? Dans quelle mesure faut-il les mettre aux normes et les moderniser ? En quoi ces opérations d’investissement contribueront-elles à une meilleure protection animale ?
M. Jean-Pierre Kieffer. Si nous n’avons pas eu recours aux vidéos pour dénoncer les dysfonctionnements, c’est que l’OABA, depuis sa création en 1961, a toujours souhaité maintenir un dialogue avec les professionnels des abattoirs. Il est certain que L214, en filmant en caméra cachée, a permis aux consommateurs comme aux responsables politiques d’être informés de ces mauvaises pratiques. Toutefois, cette association ne pourra pas, après cela, assurer un suivi dans les abattoirs ni poursuivre un dialogue.
Nous avons fait un choix, qui est peut-être à revoir : considérer que les responsables des abattoirs sont des professionnels qui doivent agir en professionnels, notamment en suivant les recommandations que les organismes techniques et nous-mêmes leur adressons. Visiblement, cette stratégie n’a pas été suivie d’effets.
Le choc des images, on le sait, est beaucoup plus fort que des écrits. Nous avons, vous avez en tant que responsables politiques, un travail à effectuer pour que ces images appartiennent au passé.
M. Philippe Vitel. Ces images vous ont-elles surpris ?
M. Jean-Pierre Kieffer. Nous n’imaginions pas des comportements d’un tel degré de gravité. Nous avons mené des centaines de visites, jamais de telles pratiques ne se sont déroulées sous nos yeux pour la simple raison que nous intervenons à visage découvert, en blouse blanche, accompagnés d’un représentant de la direction de l’abattoir, des services vétérinaires. Et même si nous décidions de faire nos visites du jour pour le lendemain, l’information que les « emmerdeurs de l’OABA » débarquent serait vite connue. Nous ne verrions pas de choses aussi scandaleuses. Il est donc certain que cette méthode a permis de révéler des dysfonctionnements dont nous n’avons jamais été témoins. Et ils ne sont certainement pas rares, d’où l’intérêt de la vidéosurveillance. Un RPA ou un vétérinaire inspecteur en blouse blanche ne pourra jamais exercer une surveillance suffisante : d’une part, il ne peut rester durant les huit heures de fonctionnement du poste d’abattage ; d’autre part, sa présence même induit un changement de comportement des opérateurs. La vidéosurveillance permettra de détecter plus sûrement des dysfonctionnements.
Le statut du RPA est défini dans le règlement de 2009. Le ministre de l’agriculture a annoncé que leur présence serait généralisée à tous les abattoirs alors qu’aujourd’hui, l’obligation de présence dépend d’un certain volume d’activité, si bien qu’une cinquante d’abattoirs n’en ont pas. Reste qu’il s’agit de salariés de l’entreprise, ce qui implique un lien de subordination. Ils sont dans une position délicate pour faire arrêter la chaîne. Nous avons donc suggéré au ministre que le RPA dispose d’un statut analogue à un délégué syndical qui lui assure une indépendance et la possibilité de consacrer spécifiquement, par délégation, des heures à la protection animale.
M. Frédéric Freund. Vous nous avez demandé, madame Le Loch, quels types d’abattoirs ouvraient leurs portes à l’OABA : ce sont des abattoirs à financement public. Les abattoirs de grands groupes comme le groupe Bigard-Charal-Socopa, depuis la diffusion en 2012 du reportage d’Envoyé spécial, nous ont clairement fait comprendre que nous n’étions plus les bienvenus même si certains directeurs, des fortes têtes, dérogent à cet ordre général et acceptent nos visites, estimant qu’ils n’ont rien à se reprocher. Nous constatons que nous avons moins de mal à entrer dans des abattoirs de porcs que dans des abattoirs de ruminants pratiquant l’abattage rituel – bizarre, bizarre… Et quand nous sommes autorisés à entrer dans ces derniers, il est demandé à nos délégués de venir vers sept heures et demie ou huit heures, lorsque les opérations d’abattage rituel sont achevées – bizarre, bizarre !
S’agissant du plan d’investissement pour les abattoirs, notons que, pour répondre aux exigences du « paquet hygiène » de l’Union européenne, ils ont déjà fait l’objet d’opérations de modernisation, mais sur le plan sanitaire avant tout. Certains ont transformé leurs équipements destinés aux animaux vivants, principalement les stabulations d’attente. Reste qu’il existe encore des abattoirs particulièrement vétustes. Je suis certain que si certains de ceux que nous avons récemment visités recevaient les inspecteurs de l’OAV, ils seraient fermés sur le champ comme cela est arrivé il y a quelques années à l’abattoir de Mâcon. Le plan de modernisation devra concerner les équipements dédiés aux animaux vivants
– stabulations, couloirs d’amenée, postes d’immobilisation –, plutôt négligés ces dernières années, c’est peu de le dire, au profit des améliorations sanitaires.
S’agissant des pays les plus protecteurs, nous sommes assez mal placés pour vous faire part de notre analyse sur les pays situés en dehors de l’Union européenne car nous sommes une association nationale qui a déjà fort à faire en France. Je peux vous dire que les abattoirs en Australie et en Nouvelle-Zélande suivent des protocoles d’abattage poussés avec contrôle systématique de la perte de conscience. Qui plus est, ils ont développé des méthodes qui n’existent pas encore en France, comme l’électronarcose des bovins : les animaux entrent dans de gros caissons où ils sont étourdis par choc électrique. Les loupés sont pratiquement inexistants. Qui plus est, l’étourdissement étant réversible, ces pays exportent de la viande halal vers les pays du Golfe et du Moyen-Orient. Plusieurs fatwas considèrent en effet que l’étourdissement est toléré par l’islam lorsqu’il ne tue pas l’animal mais le rend inconscient, l’un des préceptes du Coran commandant d’être bienveillant avec l’animal lorsqu’on le met à mort.
M. Jean-Pierre Kieffer. Pour finir, j’aimerais préciser que l’une de nos principales attentes est l’organisation d’un débat parlementaire. Certes, nous n’avons pas tourné de vidéos en caméra cachée, mais nous avons toujours apporté de l’aide aux parlementaires qui souhaitaient que l’on légifère sur les méthodes d’abattage. Cinq propositions de loi ont déjà été rédigées ; nous les connaissons par cœur. Aucune n’a été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat. J’espère qu’à la suite des travaux de votre commission, une proposition de loi verra bientôt le jour.
M. le président Olivier Falorni. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur le directeur, pour la clarté et la précision de vos réponses.
La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.
——fpfp——
2. Audition, ouverte à la presse, de M. Jack Pagès, directeur de l’abattoir d’Alès, et de M. Max Roustan, maire d’Alès.
(Séance du jeudi 28 avril 2016)
La séance est ouverte à neuf heures cinq.
M. le président Olivier Falorni. Mes chers collègues, notre commission d’enquête a été créée à la suite de la diffusion de trois vidéos tournées clandestinement par l’association L214 – que nous avons auditionnée hier, ainsi que l’association OABA. Ces vidéos ont heurté, ému, choqué, indigné un grand nombre de compatriotes et de parlementaires. Il nous a donc semblé nécessaire d’auditionner les responsables des trois abattoirs concernés : Alès, Le Vigan et Mauléon. Nous commençons ce matin par l’abattoir d’Alès : monsieur le maire, monsieur le directeur, nous vous remercions de votre présence.
Le 14 octobre 2015, l’association L214 de défense des droits des animaux a publié une vidéo de plus de quatre minutes mettant en évidence de nombreux abus commis sur les animaux. Ce montage a été effectué à partir de vidéos tournées sur une période de dix jours, d’avril à mai 2015, par une personne qui, selon les dires de l’association, avait accès à l’abattoir.
L’association a par ailleurs déposé plainte auprès du procureur de la République d’Alès, qui a ensuite envoyé un courrier à la préfecture demandant la fermeture immédiate de l’abattoir. Dans un communiqué de presse du même jour, monsieur le maire, vous en avez annoncé la fermeture immédiate, à titre conservatoire.
À la suite de la plainte déposée par l’association L214, le procureur de la République d’Alès a annoncé avoir ouvert une enquête pour faits d’actes de cruauté, mauvais traitements sur animaux, qui a été confiée à la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires, en cosaisine avec la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes.
Monsieur le maire, vous avez également annoncé l’ouverture d’une enquête administrative interne sur d’éventuels manquements aux normes d’abattage des animaux.
De votre côté, monsieur le directeur, vous avez porté plainte pour atteinte à la vie privée par fixation ou transmission de l’image des personnes, les vidéos montrant les salariés en train de travailler.
Enfin, après une table ronde conduite le 13 novembre 2015 à la sous-préfecture d’Alès et réunissant les élus locaux ainsi que l’ensemble de la filière viande, un accord a été pris sur la réouverture de l’abattoir le 9 décembre, aux fins d’un test en fonctionnement réalisé sous le contrôle d’un vétérinaire référent national des abattoirs.
Messieurs, je vous propose en préambule de nous présenter votre abattoir. Quand a-t-il été créé ? Combien de salariés employez-vous ? Quel est votre chiffre d’affaires ? Que représente l’abattoir au sein de vos communes en termes d’emploi, de dynamisme économique ? Quel est son tonnage ? Quels animaux y sont abattus ? Fonctionne-t-il tous les jours ? Y a-t-il des périodes de pointe ?
Je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse, et qu’elles sont diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Max Roustan et M. Jack Pagès prêtent successivement serment.)
M. Marx Roustan, maire d’Alès. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les parlementaires, nous appréhendions un peu cette visite, mais je crois que celle-ci nous permettra de faire la lumière et de faire avancer le schmilblick…
En préambule, la ville d’Alès conteste totalement la pratique consistant à associer dans une même démarche des situations distinctes. L’association L214 se livre à des pratiques à mes yeux scandaleuses, au service d’une orientation abolitionniste. Elle suit une idéologie, que je respecte, mais dans la mesure où on ne l’applique qu’à soi-même. Mais de là à vouloir l’appliquer à tout le monde… Pour ma part, je n’ai pas envie de manger de l’herbe toute ma vie ! Et je considère que la consommation de viande fait partie d’une culture.
S’il y a eu des manquements aux règles d’abattage, comme on a peut-être pu le constater ici ou là, il appartiendra à la justice de se prononcer : inutile d’en faire un long discours. Certes, les images qui ont été projetées ont profondément touché les gens. On ne peut pas le dire autrement : de fait, dans un abattoir, il y a du sang, surtout chez nous, où l’on tue énormément en rituel. Cette manière d’abattre est exigée, et ils en ont le droit, par nos clients musulmans. Nous avons des abatteurs nommés par la mosquée. Leur manière de procéder est conforme à la religion musulmane. Je comprends que les images qu’on en a montrées peuvent scandaliser les gens. Pour autant, on ne peut pas accepter que ma ville soit salie comme elle l’a été, et au niveau mondial, puisqu’internet a une portée internationale. Mais on verra ce que la justice dira.
S’agissant de l’abattoir d’Alès, je ne sais pas s’il y aura à redire. L’enquête administrative n’a pas décelé de faute professionnelle grave, hormis certains dysfonctionnements au regard du code rural.
La ville d’Alès, qui compte 42 000 habitants, se trouve au centre d’un territoire labellisé par l’UNESCO au titre de l’agro-pâturage. L’abattoir fait partie intégrante du projet de territoire de cette ville : je vous rappelle tout de même qu’Alès est un secteur urbain, que je n’ai aucun éleveur chez moi, et que si je fais en sorte que cet abattoir soit en état de fonctionner, c’est par solidarité pour le territoire.
L’abattoir coûte très cher à la collectivité. Nous y avons investi 4,3 millions d’euros en accord avec la Direction départementale de protection des populations (DDPP), les abatteurs, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les professionnels locaux. Chiffre d’affaires : environ 2,5 millions d’euros par an. Perte sèche pour la collectivité : environ 2 millions d’euros par an. C’est donc l’impôt des Alésiens qui paie le fonctionnement de cet abattoir. Je suis donc révolté quand j’entends dire que si nous abattons ainsi, c’est par souci de rentabilité ! Si je faisais de la rentabilité, je ne perdrais pas chaque année plus de 2 millions en fonctionnement…
Cela signifie que les efforts consentis n’ont pas eu de retour au plan économique. Nous nous en doutions, car les investissements dans les abattoirs sont très lourds et chaque année, les normes évoluant, il faut réinvestir. Nous le savions, nous le supportons, mais cela devient vraiment très difficile.
On nous reproche de ne pas former le personnel des abattoirs. Or nous organisons, pour les salariés de l’abattoir comme pour l’ensemble des 1 700 salariés de la commune et de la communauté d’agglomération, des formations continues – ce qui nous a d’ailleurs permis de faire baisser les accidents du travail de 60 % en trois ans. Nos agents suivent également une formation sur la bientraitance animale, assurée par le cabinet Barthélemy, spécialiste reconnu dans ce domaine.
Nous nous conformons aux normes en vigueur. Nous avons quatre agents de la DDPP dans l’abattoir, qui font leur travail – malgré quelques manquements dans l’affaire qui nous concerne aujourd’hui.
L’abattage, je le rappelle, est rituel ; il n’est effectué que par le sacrificateur habilité. Ni le directeur ni moi-même ne pouvons leur ordonner de procéder autrement ; s’ils faisaient autrement, la viande ne serait pas considérée comme halal. Il appartiendra au législateur de dire si l’on doit, ou non, continuer à abattre de cette manière-là. Pour notre part, nous agissons conformément aux règles actuellement en vigueur. L’Europe nous donne l’autorisation de le faire. Et M. le préfet nous a accordé, le 28 juin 2012, l’autorisation de continuer à tuer ainsi.
L’abattoir de la ville d’Alès est contrôlé et reconnu par les professionnels. Il a été créé en 1964 – et je suis arrivé à la mairie en 1995. Il est public, directement géré par la ville d’Alès en régie. C’est un abattoir de proximité, qui touche beaucoup de monde.
Nous respectons les sept critères reconnus dans le classement de la DDPP : la conception, la maintenance et l’équipement de travail ; la procédure de nettoyage et de désinfection – nous n’avons jamais eu de problèmes sanitaires ; la procédure de réception, d’exposition et de traçabilité ; les bonnes pratiques de la bientraitance de l’animal ; la maîtrise des processus et des procédures ; la maîtrise des températures des animaux ; la gestion des sous-produits.
Je m’insurge également contre le fait que l’association nous ait impliqués dans cette fameuse histoire des chevaux. L’abattoir d’Alès n’a jamais été mis en cause dans cette affaire.
La DDPP effectue en permanence des contrôles chez nous ; comme je l’ai dit, quatre de ses agents sont présents au quotidien au sein de l’abattoir, et valident chaque étape du processus. Depuis 2015, la DDPP a toujours souligné le respect des normes et des procédures. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, je vous fournirai le rapport et pour tous ceux qui le souhaitent, des clés USB. Vous aurez donc tous les documents attestant que depuis 2015, il n’y a jamais eu de souci particulier sur cet abattoir. Par ailleurs, l’OABA, que vous avez reçue, a validé en 2011 et en 2016 les procédures mises en œuvre par l’abattoir d’Alès. Les documents figurent également dans le dossier que je vous remettrai tout à l’heure.
L’abattoir d’Alès est le plus important du Languedoc-Roussillon. Il traitait 5 300 tonnes ; aujourd’hui, depuis ces images terribles, il n’en fait plus que 2 000. On se rabat sur de la viande foraine qui vient d’Australie ou d’ailleurs. Et l’on est content, même si on ne sait pas comment les animaux sont tués là-bas…
Notre abattoir est à l’origine de 580 emplois, directs ou indirects, ce qui représente du monde sur le territoire : 400 entreprises agricoles sont concernées. S’il devait fermer, le plus proche abattoir, d’une capacité suffisante, serait celui de Valence. Imaginez le petit éleveur, qui aurait besoin d’un camion pour porter sa bête à l’abattoir, et d’un camion frigorifié trois jours plus tard pour revenir chercher la viande, puisqu’elle aurait été mise en frigo : cela lui serait totalement impossible. Ce serait donc la mort de toutes les petites exploitations agricoles du secteur. Nous avons plus de 600 clients ; plus de 60 % d’entre eux sont situés dans l’environnement direct de l’abattoir.
Alès est la ville porte du Parc national des Cévennes et des Causses et Cévennes, paysage culturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO pour l’agropastoralisme. Nous avons nécessairement besoin d’un abattoir : sans abattoir, il n’y a pas d’élevage… Ainsi, ma ville s’occupe d’agriculture : c’est un peu mon fonds de commerce personnel. À l’exemple du Pata negra espagnol, bien connu, nous avons lancé l’élevage du « baron des Cévennes », un cochon nourri exclusivement à la châtaigne. Aujourd’hui une dizaine de producteurs agréés y travaillent, à partir d’un cahier des charges très précis. Ces cochons commencent à arriver sur le marché, et surtout le marché parisien.
Quel est notre avenir ? On ne peut évidemment pas passer sous silence les images choquantes que j’ai revues hier soir sur la chaîne 31 de la TNT. J’observe que si l’on avait pu, on aurait mis la caméra dans la gorge de l’animal… Cela m’a semblé un peu exagéré et caricatural, mais après tout, cela fait partie de la communication.
Quels manquements ont été constatés ? On avait mis six porcs dans les cages qui sont faites pour cinq. Mea culpa… Le directeur fera le sien tout à l’heure. Je ne vais jamais à l’abattoir, car je ne supporte pas le sang… Mais je fais confiance au personnel agréé qui s’en occupe.
L’abattage rituel pose question, malgré une demande sociale très forte. Entre notre région et la région de Marseille, pratiquement toute la clientèle se fournit en viande halal.
Faut-il maintenir cet abattoir ? Je me pose cette question depuis vingt-cinq ans, puisque nous perdons des sous chaque année. Notre communauté d’agglomération est en passe de comprendre une centaine de communes – toutes les Cévennes ; autrement dit, tout le secteur concerné par la vie de cet abattoir. Selon moi, il serait désolant d’en arriver à sa fermeture. Pour autant, même si c’est un établissement municipal, nous devons assurer un certain équilibre financier, et aujourd’hui nous sommes en difficulté.
Dans ces conditions, comment peut-on améliorer les conditions d’abattage des animaux ? On ne sait pas trop. S’il faut adapter le rituel et des conditions d’abattage, c’est au Parlement d’en décider. Certes, l’Europe permet l’abattage rituel, la France l’a accepté, mais c’est un verrou qui peut sauter. La décision vous appartient.
Plus de 50 % de notre tonnage, et donc une proportion importante, sont en halal. Si on ne peut pas continuer à abattre dans le respect des règles religieuses, on n’arrivera pas à faire tourner l’abattoir. Nous avons joint au dossier les courriers de la mosquée : si certaines autorités musulmanes acceptent l’étourdissement des animaux, les nôtres n’en veulent pas, même sous une forme légère.
La proposition que je ferai aujourd’hui, si j’en avais une à faire, c’est d’organiser une concertation avec le ministère de l’agriculture et de l’intérieur afin de réformer cette réglementation, avec vous, les autorités religieuses et les vétérinaires,
L’enquête vous le dira certainement, je pense que c’est uniquement à ce niveau-là que nous avons des problèmes. Nous avions également rencontré des problèmes particuliers, notamment techniques, avec l’abattage des chevaux. C’est la raison pour laquelle j’ai définitivement abandonné l’abattage des chevaux à Alès.
J’en viens à la formation de notre personnel.
Sur le plan sanitaire, il n’y a jamais eu de souci particulier. Je regrette que sur cinquante heures d’images, on n’ait montré que quatre photos. Mais l’homme est un homme, et celui qui abat des bêtes quotidiennement finit par agir de manière mécanique. Et malgré les formations que l’on peut leur dispenser, il arrive, comme on l’a vu hier dans le film, que pour voir si la bête est vivante, on ne la caresse pas, mais on lui donne un petit coup de pied. L’image peut paraître terrible, mais c’est malheureusement ainsi. Je crois que nous allons continuer à former notre personnel avec ce cabinet spécialisé.
Ce qui est choquant, monsieur le président, monsieur le rapporteur, ce sont les circonstances. Jusqu’à cette vidéo, nous n’avions eu que des rapports favorables de la DDPP et de l’organisation qui est venue voir l’abattoir fonctionner. Et subitement, on nous a avertis qu’une vidéo a été tournée dans l’abattoir – vous avez la chronologie dans le dossier. Bizarrement, deux jours après, l’abattoir a été inspecté de fond en comble. Certaines bêtes n’étaient pas abattues. Le rapport fut défavorable sur quelques points. La coïncidence entre l’action de la DDPP et celle de l’association nous a paru un peu particulière. Quelle relation pourrait-il y avoir ?
Le rapport d’inspection du 18 décembre nous a autorisés à rouvrir l’abattoir, à la suite des nouveaux travaux que nous avons effectués en partenariat avec le Conseil général et la région, qui nous ont aidés financièrement. On ne peut que se féliciter de cette solidarité. L’avis favorable vaut pour l’abattage des bovins camarguais et des bovins de race espagnole, et pour l’abattage rituel des bovins de plus de 350 kg. Nous sommes donc repartis sur un rythme normal.
M. le président Olivier Falorni. Avant de passer la parole à M. le rapporteur et aux collègues parlementaires, j’ai quelques questions à vous poser.
Au vu de cette vidéo, considérez-vous clairement qu’il y a eu des manquements ? Quelles mesures avez-vous adoptées depuis la diffusion de cette vidéo, maintenant que l’abattoir a été rouvert ? Envisagez-vous d’adopter au sein de votre abattoir des mesures spécifiques pour limiter la souffrance animale ?
Par ailleurs, employez-vous beaucoup d’intérimaires ? Exigez-vous une formation diplômante particulière ? Vos employés bénéficient-ils d’une formation au cours de leur carrière ? Sont-ils affectés à une seule tâche ? Avez-vous mis en place un turn over ? Pensez-vous que vos salariés soient suffisamment sensibilisés à la souffrance animale ? Que pensez-vous enfin de l’éventuelle installation d’une vidéosurveillance au sein des abattoirs ?
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Je remercie M. le maire d’Alès pour son exposé. L’objectif de notre commission d’enquête n’est évidemment pas de s’interroger sur la pertinence de l’abattage des animaux de boucherie, mais de voir dans quelles conditions cet abattage a lieu.
Je fais miennes les questions du président. Y a-t-il eu des écarts à la règle ? Qu’ils soient graves ou pas, d’autres instances pourront en juger. Mais même si la perfection n’est pas de ce monde, quelles mesures ont pu être prises pour limiter ces écarts, dont l’existence n’est pas contestable ?
Maintenant, vous avez cité le montant impressionnant des investissements que vous avez faits. Ne pensez-vous pas qu’en matière d’investissements comme de contrôles, l’aspect sanitaire du produit fini est privilégié par rapport à un autre aspect, en amont du processus : l’amenée des animaux vivants jusqu’à l’abattage ? Ce n’est pas de votre fait. Mais en tant que praticien, quel est votre point de vue ?
Pourriez-vous nous préciser comment sont amenés les animaux, par qui, de quelle distance ? Comment sont-ils traités avant d’entrer dans la chaîne – temps d’attente, conditions d’attente, abreuvement, animaux blessés, etc. ?
Ensuite, j’irai au-delà de la question du président sur la vidéosurveillance : pensez-vous pertinent de mettre en place des autocontrôles dans le cadre du processus de certification ? Ces autocontrôles permettent, le cas échéant, à des tiers n’appartenant pas forcément à l’administration de contribuer à améliorer de façon permanente ce qui doit l’être.
Enfin, par commodité de langage, on parle « d’abattage rituel ». Pour être plus technique, compte tenu des auditions d’hier, nous préférons distinguer les abattages avec ou sans étourdissement définitif. Peu importe la raison pour laquelle on étourdit ou pas. Mais l’aspect technique est important. Si on veut faire évoluer la situation, il faut être conscient de ce point particulier.
Le fait que ce soit rituel ne nous importe pas ; ce sont les conditions d’abattage qui nous importent et le fait que l’animal souffre ou pas, qu’il soit étourdi ou non. Cela peut relever d’autres dispositifs que vous ne maîtrisez pas.
M. Max Roustan. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, monsieur le rapporteur : le rituel est le rituel, il ne s’appelle pas autrement. C’est un vrai problème politique, il ne faut pas avoir peur de le dire ici, à l’Assemblée nationale. Il ne s’agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais le rituel est demandé pour des raisons cultuelles, et non pour des raisons liées à la qualité de la viande.
L’abattage rituel impose au directeur d’employer des sacrificateurs qui sont nommés extérieurement à l’abattoir. Leur manière d’abattre les bêtes est rituelle, on ne peut pas dire autrement. Il ne faut pas se le cacher, et il n’y a rien de scandaleux à reconnaître ce que la religion nous demande. On le fait ou on ne le fait pas. Certains pays, où l’on mange pourtant de la viande halal, ne le font pas. C’est un problème franco-français.
Les trois quarts des vidéos ont été tournés chez nous, à Alès. Je reconnais que le flot de sang que l’on voit dans la première image est insoutenable. Moi-même, j’ai fermé l’abattoir dans la minute où je l’ai vue. La bête est bien vivante quand on la tue : elle n’est ni assommée, ni engourdie. Qu’il faille attendre trois, quatre, cinq, dix minutes pour qu’elle ne bouge plus, je ne suis pas compétent pour le dire ; je ne suis pas vétérinaire. Mais étant agriculteur, je sais que cela met un certain temps.
La certification ne me pose aucun problème, monsieur le rapporteur. L’installation de caméras ne m’en poserait pas non plus. Cela étant, on ne peut pas visualiser en France des salariés au travail, comme on peut le faire en Espagne. Pour que ce soit possible, il faudrait que vous interveniez par une décision législative. Cela pourrait être la solution idéale car cela permettrait de savoir ce qui se passe dans un abattoir et de discipliner l’abatteur qui, se sentant surveillé, ne se laisserait pas aller à des gestes malheureux.
Sachez ensuite que nous recrutons nos agents sur compétences. Nous leur assurons par ailleurs chez nous une formation, qui est assurée par un cabinet spécialisé. Mais on peut toujours améliorer cette formation.
Enfin, nous avons pris de nouvelles mesures.
Par exemple, nous utilisons des pièges pour égorger les animaux. Mais ces pièges étaient à dimension fixe, alors que les animaux peuvent peser 150 kg, 155 ou 180 kg, ce qui posait des problèmes. C’est là que les financements de la région et du département nous ont aidés à les perfectionner. Ils nous ont également permis d’améliorer la circulation des animaux avant l’abattage, de mieux immobiliser les têtes avant d’utiliser le matador, etc. Le préfet avait conditionné l’autorisation de rouvrir l’abattoir à la résolution de certains problèmes. Aujourd’hui, c’est fait. Toutes ces mesures nouvelles ont été prises et l’abattoir est aujourd’hui en état de fonctionnement normal.
M. Jack Pagès, directeur de l’abattoir d’Alès. Parmi les mesures nouvelles que nous avons prises, je citerai la formation de l’ensemble du personnel sur la protection animale, au moment de la réouverture de l’abattoir, le 9 décembre.
Nous avons par ailleurs renforcé les surveillances aux postes d’abattage, avec un chef de chaîne désormais positionné en dehors de la chaîne, et qui est moins « œuvrant » que ce qu’il était. Ainsi, sur les quinze salariés en production, neuf opérateurs ont la certification de protection animale. Enfin, nous avons deux responsables de la protection animale : le bouvier et le responsable qualité.
J’en viens au recrutement. Il n’y a pas d’école de bouchers-abatteurs. Donc, nous recrutons dans le monde agricole, ou dans celui des bouchers traditionnels, avec des CAP de bouchers. Puis nous complétons leur formation en interne et en externe, sur les bonnes pratiques d’abattage, en faisant appel tous les ans à des cabinets spécialisés. Je précise qu’un nouveau salarié, lorsqu’il entre chez nous, ne fait pas tout de suite de l’abattage d’animaux ; il commence par de la manutention, des postes non sensibles, et au fur et à mesure, il progresse dans l’entreprise.
Nos salariés sont sensibilisés à la souffrance animale. Nous organisons deux ou trois fois par an des réunions internes, sous la direction du responsable qualité. Mais il est exact que la routine finit toujours par s’installer, et c’est alors que des manquements peuvent se produire.
Je terminerai sur l’amenée des animaux. Les stabulations sont très proches du poste d’abattage, et la réglementation nous demande de mettre dans le couloir d’amenée des animaux à moins de trente minutes de l’abattage – ce qui correspond chez nous à quatre ou cinq bovins.
M. Max Roustan. Il s’agit d’un abattage de proximité, qui n’a rien à voir avec celui d’un Intermarché. On tue une vache, une chèvre, etc., à la demande. Le travail diffère de celui d’une grande production où, par exemple, on ne tue que du mouton toute la journée, sur une chaîne à 6 km/h. Nous nous adaptons au client : c’est pour cela que nous vivons. Sinon, l’abattoir d’Alès n’aurait pas lieu d’être. Ce n’est pas un abattoir de production.
M. Thierry Lazaro. Monsieur le maire, vous avez d’emblée parlé d’abattage rituel. Je rejoins notre rapporteur : le sujet est assez tendu pour que nous ne stigmatisions personne, ni dans un sens ni dans l’autre. Mais vous l’avez rappelé vous aussi.
Si je vous ai bien compris, il y a 50 % d’abattage rituel à Alès et 50 % d’abattage non rituel. Confirmez-vous que les images prises par l’association sont liées à un abattage rituel ?
M. Max Roustan. En grande partie.
M. Thierry Lazaro. Quelles sont donc les pratiques d’abattage pour les 50 % restants ?
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Monsieur Roustan, vous avez l’habitude de gérer une commune, et vous être réputé avoir du caractère. Vous avez dit que votre établissement était géré en régie. Quel est donc le statut juridique des salariés ?
M. Max Roustan. Ils sont tous sous statut privé.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet établissement fait l’objet d’un agrément et de contrôles. Estimez-vous que la procédure d’agrément est insuffisante et que les contrôles, qui se font sous l’autorité de l’État, ne sont pas au niveau où ils devraient être ? Y a-t-il eu des manquements à ce niveau ?
M. Jacques Lamblin. Vous avez expliqué que l’abattoir d’Alès était un abattoir de proximité. De fait, son volume n’est pas considérable. Subissez-vous une certaine pression ? Pour des raisons de rentabilité, devez-vous imposer une certaine cadence à vos personnels ?
Ensuite, quelle est la rotation des personnels ? Le taux de renouvellement est élevé ? Les personnels changent-ils rapidement de profession ou pas ?
Enfin, à propos de l’abattage rituel, vous avez souligné le fait que les sacrificateurs étaient choisis par les représentants des cultes. Quel est votre degré d’intervention ? Pouvez-vous rejeter le sacrificateur qui vous est proposé parce qu’il est incompétent ou qu’il commet des erreurs ?
M. Fabrice Verdier. En tant qu’élu de ce territoire, je voudrais revenir sur les 4 millions d’euros d’investissement dont vous avez parlé. Je sais que la communauté municipale a beaucoup investi en fonction des objectifs qu’elle s’est fixés pour répondre au souci du territoire et des éleveurs.
Premièrement, dans quel rayon recrutez-vous vos éleveurs ?
Deuxièmement, sur ces 4 millions d’euros d’investissement, quelle est la part consacrée au sanitaire, et celle qui est consacrée au bien-être animal ? Vous avez respecté les lois et les réglementations avec beaucoup de volontarisme et peu de subventions. Vous avez assumé les obligations que l’on vous a fixées, mais pourriez-vous être plus précis ? Dans ces cinq ou six dernières années, où sont donc passés ces 4 millions d’euros investis ?
Mme Laurence Abeille. Monsieur le maire, vous avez dit que vous n’alliez jamais à l’abattoir et que vous ne supportiez pas le sang. Dans la mesure où l’abattoir d’Alès est en régie, je trouve surprenant que le maire d’une commune n’entre pas dans un établissement qui fait l’objet de si gros investissements…
Quel est le nom du cabinet spécialisé dans la protection animale ? Intervient-il dans d’autres abattoirs ? Est-il seulement affecté au vôtre ? Y a-t-il un lien entre le travail de ce cabinet et les sacrificateurs ?
Considérez-vous que le contrôle de l’État est suffisant ?
Vous dites que l’abattoir ne pourrait pas se maintenir financièrement sans l’abattage sans étourdissement, qui représente 50 % des commandes. Est-ce à dire qu’il n’y aurait pas suffisamment d’élevage dans le secteur pour vous fournir des animaux pour l’abattage ?
J’aimerais enfin avoir des précisions sur le turn over des personnels et leur formation. Vous nous avez dit que vous recrutiez parmi des gens qui avaient un CAP de boucher. Or on manque actuellement de bouchers partout en France ; il est donc assez surprenant que des gens possédant un CAP de boucher viennent travailler à l’abattoir. Est-ce parce qu’ils ne parviennent pas à trouver de l’emploi dans leur métier ? Avez-vous discuté, notamment avec le directeur de l’abattoir, sur la formation du personnel ?
Mme Françoise Dubois. Ma question concerne la formation de votre personnel. Pour ce qui est du personnel de la structure proprement dite, je vous fais entièrement confiance, car je sais qu’il a été formé. Mais qu’en est-il de celle des sacrificateurs, que vous ne pouvez pas maîtriser ? Les photos et les vidéos que nous avons vues concernaient l’abattage rituel, qui n’a rien à voir avec l’abattage traditionnel.
J’imagine que vos personnels pratiquent l’abattage traditionnel, avec étourdissement, en prenant toutes les précautions qui s’imposent. Mais qu’en est-il de l’abattage rituel, qui représente tout de même 50 % de votre activité ? Donc, comment faire pour s’assurer de la compétence des personnes qui arrivent de l’extérieur pour abattre rituellement les animaux ?
M. Élie Aboud. Monsieur le directeur, vous avez dit que les images choquantes, qui ont circulé d’abord sur les réseaux sociaux puis sur les médias généralistes, concernaient l’abattage rituel. J’aimerais avoir deux précisions. D’abord, les militants associatifs nous ont parlé d’animaux qui arrivaient morts dans les abattoirs. Est-ce exact ? Ensuite, on nous a confirmé qu’après étourdissement, les animaux suspendus étaient pratiquement tous vivants. Quelle est donc votre expérience personnelle en la matière ?
M. Max Roustan. Madame Abeille, je vous rappelle que dans le cadre de la fonction publique territoriale, le maire dirige une organisation où coexistent toutes sortes de métiers. De la même façon que je ne suis jamais allé dans l’abattoir, je n’ai jamais remplacé un changement de vitesse sur un camion. Je n’ai jamais construit non plus de salle des fêtes. Je compte sur des personnes compétentes qui ont des responsabilités dans les services. Et c’est heureux : sinon, la maison ne tournerait pas, malgré notre bonne volonté pour faire avancer le territoire.
Vous vous êtes par ailleurs interrogée sur nos personnels titulaires du CAP de boucher. Sachez que dans notre région, des villes qui comptaient 15 000 habitants n’en comptent plus désormais que 5 000. Certaines vallées sont en perdition. Les mines ayant disparu, les villages qui avaient été créés autour sont, eux aussi, en train de disparaître tranquillement, et avec eux les cafés, les boucheries, les charcuteries, etc. Nous avons donc la chance de pouvoir trouver, pour nos abattoirs, d’anciens bouchers ou d’anciens charcutiers de profession.
La rotation du personnel est minime ; nos salariés sont très fidélisés. Le personnel conserve donc la formation qu’il a reçue.
Le cabinet dont je parlais s’appelle le cabinet Barthelemy ; il est spécialisé dans la protection animale et intervient dans la formation de notre personnel.
Maintenant, comment se répartissent, dans les 4 millions d’euros d’investissement, les sommes consacrées à la protection animale et au sanitaire ? Pour moi, les deux aspects sont liés. Lorsque l’on amène une bête dans un couloir de stabulation, il faut éviter qu’elle ne s’accroche, qu’elle ne glisse, etc. Il y a des tas de conditions à remplir, qui relèvent tout à la fois du sanitaire et de la protection animale. Il est difficile de faire une distinction. On l’a vu à propos des pièges dont on se sert lorsqu’on égorge : on leur a reproché de n’être pas adaptés à la taille des bêtes, mais lorsqu’elles font de 80 à 150 kg, il est difficile d’avoir un piège pour chacune bête… Mais on est en train d’y travailler. On avance, tranquillement, mais on avance.
Ensuite, il est exact que l’on ne maîtrise pas la formation des sacrificateurs…
M. Jack Pagès. Ils n’en ont pas. La carte de sacrificateur est délivrée par les mosquées avec une lettre de recommandation. Il n’y a aucune formation.
M. Thierry Lazaro. Vous avez souligné tout à l’heure que l’abattage rituel représentait 50 % de votre activité. Sur les 50 % restants, quelles sont les pratiques d’abattage ?
M. Jack Pagès. Sur les bovins, on utilise le pistolet d’abattage par broche ; sur les ovins, l’électronarcose ; et sur les porcs, le CO2.
Nous sommes un abattoir communal, pas un abattoir privé ; nous n’avons pas besoin d’imposer de grosses cadences. On ne fait pas d’heures supplémentaires. On est même plutôt en deçà.
Pour ce qui est des rotations du personnel, en dehors des cas de maladie et de quelques incidents qui ont pu donner lieu à licenciement, les salariés ne nous quittent pas avant longtemps. La grande majorité travaille longtemps chez nous.
Peut-on refuser un sacrificateur ? Oui, s’il n’est pas compétent dans son travail. Cela étant on ne maîtrise pas la certification de l’abattage rituel : si le sacrificateur refuse de déclarer l’abattage rituel, il est maître chez lui. En d’autres termes, il est seul juge de l’appellation halal. Dans ce domaine, nous n’avons pas la main.
Mme Laurence Abeille. Vous pouvez le refuser ?
M. Jack Pagès. Oui, pour incompétence. Bien qu’il soit proposé par la mosquée, il entre dans l’abattoir au même titre que les autres salariés.
Mme Françoise Dubois. Mais comment le savez-vous ?
M. Jack Pagès. En le voyant travailler… Avant, on n’en sait rien, malheureusement.
M. Max Roustan. D’ailleurs, le sacrificateur que l’on voit sur les photos est un remplaçant. Et il donne deux coups de couteau…
M. Jack Pagès. Effectivement, il fait du cisaillement au lieu d’une coupe franche. Ce n’est pas le titulaire du poste. Il est vrai, comme l’a dit M. le maire, que la formation du sacrificateur est inexistante. Personne n’a jamais fait état d’une formation pour le sacrifice rituel.
Les éleveurs qui sont sur l’abattoir d’Alès sont souvent issus du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche.
Si des animaux arrivent morts à l’abattoir, ils partent à l’équarrissage et non sur la chaîne d’abattage. Nous ne sommes pas des charognards… Et il est tout à fait impossible que des animaux vivants soient suspendus, comme on le suggère sur la vidéo… Un animal ne se laisse pas soulever ainsi vivant.
M. Élie Aboud. Il y a peut-être une reprise de conscience…
M. Jack Pagès. On ne sait pas si c’est une reprise de conscience, comme le soutient l’association L214, ou tout simplement un réflexe. C’est sujet à interprétation.
M. Jacques Lamblin. Vous procédez simultanément à de l’abattage sans étourdissement et avec étourdissement. Est-ce à dire que, dans le fonctionnement de l’abattoir, vous organisez des journées avec étourdissement et des journées sans étourdissement ? Avez-vous une tranche horaire réservée à l’une ou l’autre méthode d’abattage ? Un abatteur peut-il passer simultanément d’une méthode à l’autre en fonction des animaux qui se présentent devant lui ?
M. Guillaume Chevrollier. Vous avez évoqué la présence, dans votre abattoir, de responsables « protection animale ». Pouvez-vous nous parler de leur mission au quotidien ? Comment vivent-ils la situation de votre abattoir aujourd’hui ?
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Après les vidéos qui ont été diffusées, et qui sont difficiles à regarder, comment avez-vous réagi ? Je pense à vous-même en tant que directeur d’établissement, et aux salariés. Que vous ont-ils dit exactement ?
M. Max Roustan. La ville d’Alès a été rudement salie, et le personnel de l’abattoir également. Pourtant, après l’enquête administrative, aucune punition n’a été infligée. Aucune faute, hors code rural, n’a été commise. Cela veut bien dire que les images qui ont été montrées cherchaient plutôt à inciter les gens à ne pas manger de la viande ; il faut bien reconnaître que la mise à mort des animaux n’est pas un geste noble.
J’ai conservé tout le personnel – vingt-huit salariés, dont le directeur – et je continue à le payer intégralement alors qu’aujourd’hui on ne fait plus que la moitié du tonnage. Je n’ai licencié personne, dans la mesure où l’enquête administrative n’a fait ressortir aucune faute. Quant à l’enquête publique, on verra à quoi elle aboutira.
Je maintiens que la méthode employée est scandaleuse. Mais on le voit bien, cette association n’a qu’un but : faire de nous des végétariens ! Je ne comprends pas qu’aujourd’hui, dans le monde dans lequel on vit, des minorités veuillent imposer aux autres leur manière de fonctionner. Je ne conteste à personne le droit de manger des légumes ; moi-même, je les adore. Mais cela ne justifie pas des opérations « commando » aussi scandaleuses.
Mon personnel a été vraiment traumatisé, ma ville aussi. Je vous rappelle tout de même que nous avons reçu des menaces – on connaît ta femme, ta fille, ta maison, etc. – et même des menaces de mort ! Les courriers étaient datés et signés, même pas anonymes. C’est allé très loin. Quand une association va aussi loin, on peut carrément parler de terrorisme. Cela ne peut pas durer ainsi ! Nous nous trouvons aujourd’hui sous la menace permanente d’organisations qui veulent imposer aux autres leur manière de fonctionner. Je crois qu’il vous appartient, à l’Assemblée nationale, de prendre certaines décisions, notamment sur la question de l’étourdissement. Pour nous, c’est vraiment important : si l’on ne peut plus abattre sans étourdissement, nous ne pourrons pas continuer notre activité.
M. Jacques Pagès. Vous nous avez interrogés sur notre matière de procéder entre les deux formes d’abattage. Nous faisons des lots. Sur un abattage de 30 ou 40 bovins, par exemple, on abat les 20 premiers bovins rituellement, puis les autres.
Par ailleurs, les responsables « protection animale » ont assez mal vécu les choses, car ils n’étaient pas présents sur site au moment où ces manquements ont eu lieu. Sans doute étaient-ils en bouverie ou ailleurs.
M. Max Roustan. Je vous rappelle que la présence d’un responsable qualité qui ne fait que surveiller la chaîne d’abattage, et celle d’un responsable de la protection animale augmentent d’autant le coût de l’abattage. Il faudrait donc que vous fassiez preuve de modération dans vos propositions. Car on est au bout du bout ! Nous sommes au maximum de ce que l’on peut demander pour notre prestation. Au-delà, c’est la mort du petit éleveur.
M. William Dumas. L’abattoir le plus proche, qui est le plus important du Languedoc-Roussillon, se trouve à Valence. À un moment, il faut aussi raisonner par territoire. Que deviendraient nos Cévennes, abattage rituel ou pas, sans les 28 ou 30 salariés de l’abattoir d’Alès ? Vous avez trois ou quatre vétérinaires…
M. Max Roustan. Quatre.
M. Willian Dumas. Je suis d’accord pour le bien-être animal. Mais le bien-être humain, dans tout cela ? Dans les vallées des Cévennes, il y a beaucoup de petits producteurs. Vous avez parlé de 5 000 tonnes, cela doit faire 30 000 animaux abattus par an.
M. Jacques Pagès. 60 000.
M. Willian Dumas. Que va-t-il se passer ?
Il y a quelques années, on s’est battu avec M. le maire pour améliorer la rentabilité de l’abattoir d’Alès, afin de pouvoir abattre le taureau de Camargue. Le taureau de Camargue étant certifié, il doit être abattu dans un certain périmètre. Il en sera de même pour le baron des Cévennes, dont la production vient d’être lancée. Mais il faudrait aussi qu’au sein de notre commission, nous prenions la mesure de ce que notre territoire pourrait perdre. Gardons-nous d’en faire un désert – surtout quand on sait ce que la protection contre l’incendie pour coûter à un département. Il serait dramatique de ne plus avoir d’élevage. N’oublions pas que le travail d’un éleveur entraîne des retombées économiques. Il arrive un moment où il faut aussi prendre ces choses-là en compte.
M. le rapporteur. Monsieur le maire, avez-vous une idée de ce que représente le coût de l’abattage par rapport au prix de la viande achetée sur pied, puis revendue ? C’est un point important, même si votre établissement n’a pas une activité intensive. En effet, si l’on veut agir sur les conditions d’abattage, on doit connaître la proportion que l’abattage prend dans l’économie de la filière, pour savoir si on agit de façon réaliste et éviter de mettre les établissements en péril.
Mme Laurence Abeille. Je voudrais tout de même revenir sur ce qui a motivé la constitution de cette commission d’enquête parlementaire, à savoir la souffrance animale et les actes que nous avons pu qualifier de barbares, dénoncés grâce à l’association L214 que vous qualifiez de terroriste. Je ne peux accepter que, dans le cadre de cette commission d’enquête, les personnes auditionnées se livrent à de tels commentaires. En l’occurrence, nous avons entendu cette association hier ainsi que l’association OBA qui, chacune à leur niveau, sont deux lanceurs d’alerte.
Les lanceurs d’alerte permettent aux parlementaires que nous sommes d’avoir des informations sur un certain nombre d’événements, dans tous les domaines. Je remercie donc l’action associative de nous donner l’occasion d’enquêter sur la réalité et, espérons-le, de faire progresser la condition animale – en l’espèce la fin de vie des animaux destinés à la consommation humaine.
J’observe par ailleurs que la question économique que vient de soulever mon collègue va peut-être entrer en ligne de compte dans le débat. Mais ce n’est pas l’objet de cette commission d’enquête qui est, je le rappelle : la question de la souffrance animale, la réalité de ce qui se passe dans les abattoirs, les raisons de tels manquements à la réglementation et les moyens d’améliorer la réglementation et les pratiques afin de pouvoir consommer de la viande abattue dans des conditions dignes pour l’animal.
J’ai accepté que nous n’abordions pas la question du végétarisme – même si ce fut le cas hier au cours des auditions. C’est une décision que nous avons prise collectivement. Nous devons respecter les avis des uns et des autres, sans ignorer ni ce qui se passe dans la société à ce propos, ni les difficultés qui se posent dans le domaine économique. Mais nous devons essayer de rester centrés sur la question de la souffrance animale. Voilà pourquoi je reste un peu insatisfaite de ce que j’ai entendu sur l’abattoir d’Alès.
Vous nous dites qu’il n’y a pas eu de manquements ni de fautes graves, hormis certaines – mais vous n’avez pas précisé lesquelles. Vous avez parlé des boxes de contention qui n’étaient pas adaptés. J’observe que sans cette vidéo, personne n’aurait rien su de tout cela, et les mesures qui ont été prises ne l’auraient pas été.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il n’est pas question de stigmatiser qui que ce soit. Mais quand l’association d’hier nous dit qu’elle fait du militantisme végétarien, son action s’en trouve en partie décrédibilisée : son orientation est claire.
Ensuite, vous ne nous avez pas dit si vous pensiez être suffisamment accompagnés par les services de l’État, tant au niveau des procédures d’agrément que du service des contrôles ? Que pouvez-vous nous répondre ?
M. Max Roustan. Depuis le début de l’année, 35 000 bêtes ont été abattues. Cela a donné lieu à 90 observations relatives à la protection animale, soit 0,05 % des animaux abattus ; treize rappels de corrections immédiates pour répondre à de petites observations ; une fiche demandant des travaux, qui ont été réalisés grâce à des subventions, et deux avertissements disciplinaires. J’aimerais bien avoir des hommes parfaits, mais malheureusement, je n’en connais pas beaucoup dans ce monde…
Madame, je parlais bien évidemment de terrorisme intellectuel. À la télévision, la présidente de l’association a indiqué clairement que ses membres étaient contre la consommation de la viande, et qu’ils feraient fermer les abattoirs. C’est une attitude logique, étant donné leur conviction personnelle, que je respecte pleinement, comme je l’ai dit tout à l’heure. Mais je dis aussi que des groupuscules qui déclarent 15 000 adhérents n’ont pas à imposer leur conviction aux 65 millions de Français !
Effectivement, économiquement, la question est liée. Plus on demandera de contrôles, plus on demandera de personnel, plus cela coûtera cher. Nous employons déjà trois personnes qui ne sont pas à la production, sans compter les quatre personnes de la DDPP. Autrement dit, il y a vingt-cinq personnes qui travaillent, et sept qui les regardent…
Vous devez savoir que l’abattoir étant en régie municipale, il a un conseil de surveillance, formé des éleveurs, des chevillards et des clients. Lorsque je leur propose de monter de 0,01 centime d’euro le prix du kilo de la viande abattue, ils partent tous en courant, ou en pleurant ! Mais je reconnais qu’aujourd’hui, par rapport aux viandes foraines qui nous arrivent des pays étrangers, notre niveau de coût n’est plus concurrentiel. C’est important à prendre en compte. Il y a quelques années, nous avons perdu un client qui représentait pour nous 2 000 tonnes. Il fait aujourd’hui dans la viande foraine. Je ne sais pas si la souffrance animale est observée au Brésil ou ailleurs… Je parle de cette viande qui arrive congelée, en morceaux choisis, par camions frigo, et qui est achetée à de grands abattoirs ou à des pays étrangers.
M. Élie Aboud. On a des pourcentages ?
M. Max Roustan. Sur le plan national, je ne peux vous répondre.
Encore une fois, un jour ou l’autre, il va falloir que vous décidiez. Nous attendons votre décision législative, pour savoir si nous devons continuer à abattre, et dans quelles conditions. Elles devront forcément être améliorées : personne n’est parfait, il y a toujours des progrès à faire. Mais il y avait d’autres manières d’arriver à ce que l’on voulait sans choquer à ce point la population par de tels procédés.
M. Jack Pagès. Je voudrais juste revenir sur la question des prix. L’abattoir d’Alès ne vend pas de viande, il ne fait que de la prestation de service, que nous facturons 60 centimes au kilo pour le bovin, 40 centimes pour le porc et 1 euro pour les ovins. Ensuite, il y a la marge des grossistes et des distributeurs.
M. le président Olivier Falorni. Messieurs, je vous remercie.
La séance est levée à dix heures quinze.
——fpfp——
3. Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Kauffmann, directeur de l’abattoir du Vigan, et de M. Roland Canayer, président de la Communauté des communes du Pays Viganais.
(Séance du jeudi 28 avril 2016)
La séance est ouverte à dix heures vingt-cinq.
M. le président Olivier Falorni. Mes chers collègues, nous auditionnons maintenant M. Roland Canayer, président de la Communauté de communes du Pays Viganais, et M. Laurent Kauffmann, directeur de l’abattoir du Vigan.
La Commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français a été créée suite à la diffusion, par l’association L214, de vidéos qui concernaient les abattoirs d’Alès, du Vigan et de Mauléon. Ces images ont choqué, ému, indigné un grand nombre de nos compatriotes. Nous avons lancé cette commission d’enquête pour faire la vérité sur les abattoirs et faire des propositions pour améliorer les conditions d’abattage dans notre pays.
Le 23 février 2016, l’association L214 de défense des droits des animaux a publié une vidéo de plus de quatre minutes, mettant en évidence de nombreux abus commis sur les animaux. Ce montage vidéo a été effectué à partir de vidéos tournées entre mai 2015 et février 2016 selon les dires de cette association. Le jour de la diffusion de la vidéo, l’association L214 a également déposé une plainte auprès du procureur de la République d’Alès dénonçant des faits de sévices graves et mauvais traitements sur animaux, ainsi que la violation de la réglementation relative à l’abattage. Suite au dépôt de cette plainte, le procureur de la République d’Alès a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire afin de vérifier les éléments contenus dans la plainte. Cette enquête a été confiée à la brigade nationale d’enquête vétérinaire et phytosanitaire, en co-saisine avec la brigade des recherches de la gendarmerie du Vigan.
Suite à la diffusion de la vidéo, une enquête administrative a également été ouverte et l’abattoir intercommunal a été fermé à titre conservatoire.
Dans un communiqué de presse en date du 18 mars 2016, la communauté de communes du Pays viganais, que vous présidez, monsieur Canayer, a annoncé la réouverture partielle de l’abattoir intercommunal, le 21 mars 2016, pour les seuls ovins et caprins.
Je vous rappelle, messieurs, que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Roland Canayer et M. Laurent Kauffmann prêtent successivement serment.)
M. Roland Canayer, président de la Communauté de communes du Pays Viganais. L’abattoir du Vigan a été construit en 1988 et repris en gestion par la Communauté de communes du Pays viganais en septembre 2001, suite à la cessation d’activité de la SARL La Viganaise.
Cette structure est soutenue par la collectivité car c’est un véritable outil d’aménagement du territoire et de développement. Il permet le maintien et l’installation d’éleveurs qui participent au dynamisme de l’emploi agricole et à l’entretien des paysages par le biais de l’élevage extensif. L’abattoir du Vigan est un acteur de ce territoire de tourisme vert dont j’ai défendu l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen, pour éviter que nos milieux ne se referment sur eux-mêmes.
À travers l’abattoir, la Communauté de communes du Pays viganais soutient les circuits courts de commercialisation de viandes de qualité, puisque tous ses clients éleveurs pratiquent la vente directe dans des boutiques et boucheries de producteurs, sur les marchés, à la ferme et par le biais de la livraison à domicile. Il est à noter qu’à l’abattoir proprement dit est adossé un atelier de découpe qui contribue au développement de cette vente directe de qualité.
L’abattoir du Pays viganais est un abattoir multi-espèces – ovins, bovins, porcins et caprins – et l’un des plus petits de France en termes de tonnage : il ne traite que 230 tonnes par an.
Depuis 2009, la Communauté de communes du Pays viganais a investi 1 million d’euros dans cet équipement avec le soutien de l’État, de la région et du département. L’abattoir est certifié bio et agréé européen depuis août 2010, tout comme son atelier de découpe.
Abattoir de proximité, il fonctionne avec trois personnes sur les chaînes d’abattage et un directeur à mi-temps. Il est reconnu pour la qualité du travail fini et le service rendu au client. Chaque année, les services de la Direction départementale de protection des populations (DDPP) réalisent au moins une inspection pour le renouvellement de l’agrément européen de l’abattoir.
Le 22 février, j’ai été informé qu’une vidéo réalisée par l’association L214 allait être diffusée, qui montrait notamment des actes de maltraitance animale.
Le 23 février, j’ai décidé la fermeture à titre conservatoire de l’établissement, suspendu l’ensemble des personnels et diligenté une enquête interne administrative afin de faire toute la lumière sur la teneur de certains agissements.
À l’issue de l’enquête, des fautes très graves de maltraitance animale par un agent ont été reconnues et ce dernier s’est vu signifier son licenciement. Un deuxième agent, qui opérait à ce moment-là à ses côtés et dont le comportement n’a pas été jugé acceptable, a vu la non-reconduction de son contrat de travail. Le reste des fautes directes ou indirectes par les deux autres agents a fait l’objet de sanctions administratives.
À l’approche des fêtes de Pâques et à la lumière des conclusions de l’enquête administrative, l’abattoir a été rouvert partiellement – caprins et ovins – le lundi 21 mars. Depuis, il retourne petit à petit à la normale, avec une activité affectée par la réduction de l’équipe.
Il est toutefois précisé que cette vidéo a été réalisée à partir d’un grand nombre d’heures de tournage. Au-delà des actes de maltraitance volontaires inacceptables, il faut signaler qu’elle est accompagnée de commentaires erronés. Rapportées aux neuf mois durant lesquels des enregistrements ont été réalisés à l’insu des agents d’abattage, les fautes relevées sont rares. Et le montage tel qu’il a été diffusé ne permet pas toujours d’appréhender l’origine contextuelle des images.
Le travail d’abattage réalisé tout au long de l’année est conforme aux réglementations en vigueur, notamment en termes de protection animale. Les conditions d’accueil des animaux avant l’abattage sont reconnues comme aisées sachant que l’abattoir a pu, il y a vingt ans, traiter jusqu’à 800 tonnes alors qu’il s’est recentré sur la vente directe pour 230 tonnes. La grande taille des parcs ovin et porcin ainsi que les logettes individuelles pour les bovins confortent cet état de fait.
Le personnel a suivi un important programme régulier de formation durant ces huit dernières années et tous les agents disposent de leurs certificats de compétences pour ce qui touche à la protection animale. Enfin, les étapes de mises à mort des animaux ont toujours fait l’objet de contrôles internes et externes, qui ont toujours attesté les bonnes pratiques d’abattage de l’abattoir du Vigan.
Il est important de noter à ce stade qu’aucun agissement tels que ceux mis en cause dans la vidéo n’a été constaté durant les contrôles ou formations réalisés.
Toutefois, la Communauté de communes a décidé de prendre un certain nombre de mesures fortes pour garantir davantage à l’avenir ces bonnes pratiques d’abattage, notamment d’équiper l’abattoir d’un matériel d’étourdissement doté d’enregistreurs avec conservation des enregistrements des tues de chaque animal individuel et de la bonne pratique des agents. Ce matériel est déjà opérationnel pour les ovins et les porcins. Je signale qu’il s’agit d’une démarche volontaire, la législation n’invitant à la mise aux normes qu’en 2019 pour les abattoirs disposant de matériels achetés avant 2013.Un système de vidéosurveillance pour contrôler notamment les bonnes pratiques d’abattage sera prochainement mis en place.
L’abattoir sera aussi accompagné par un bureau d’études spécialisé en éthologie pour aborder le bien-être animal et accompagner le personnel dans ce travail souvent difficile à plusieurs points de vue.
Nous nous positionnons comme un abattoir pilote qui sera doté de toutes les améliorations possibles pour ce qui touche aux pratiques d’abattage.
Hormis les agissements inexcusables d’un agent, l’abattoir du Vigan travaille dans un souci de grand professionnalisme. À l’issue de cette épreuve médiatique difficile, notre établissement a repris son activité, le 21 mars, d’abord partiellement. Cette période a été l’occasion d’appréhender les conditions de travail quotidiennes de nos agents.
La Communauté de communes du Pays viganais a fait le choix d’investir dans la vidéosurveillance afin que nos personnels, qui travaillent dans le respect de la réglementation, soient à l’abri de tout a priori négatif touchant l’ensemble de la filière.
La plupart des formations proposées en matière de protection animale sont souvent théoriques ; les contrôleurs eux-mêmes avouent ne pas maîtriser de nombreux paramètres. En fait, on y fait beaucoup de théorie, mais peu de pratique.
De la même manière que l’ensemble de la filière s’est plutôt focalisé sur les questions d’hygiène durant ces quinze dernières années, il faudrait aujourd’hui tout mettre en œuvre pour atteindre collectivement le même niveau de compétence en matière de protection animale.
Nous nous interrogeons quant aux missions de la DDPP. Ses agents contrôlent la bonne santé des bêtes en amont, puis la qualité de la viande pour la consommation du grand public, mais quasiment rien pour ce qui concerne l’abattage proprement dit. À l’exception des contrôles programmés, aucun soutien et aucun contrôle ne sont apportés dans le quotidien.
Enfin, l’abattoir du Pays viganais a fait le choix de s’entourer des compétences d’un éthologue pour améliorer encore davantage les notions de bien-être animal. Peut-être cette initiative devrait-elle être généralisée à toute la filière. Nous sommes prêts à vous accueillir et à travailler avec vous sur ce dossier. Nous avons l’ambition d’être reconnus comme un abattoir exemplaire.
M. le président Olivier Falorni. Vous avez abordé la question de la formation des personnels. Je souhaiterais avoir des précisions sur le processus de recrutement. Employez-vous beaucoup d’intérimaires ? Exigez-vous une formation diplômante particulière ? Vos employés bénéficient-ils d’une formation au cours de leur carrière ? Sont-ils affectés à une seule tâche ou bénéficient-ils d’un turn over afin de ne pas toujours se retrouver au poste d’abattage ? Considérez-vous que les salariés sont suffisamment sensibilisés à la protection animale ?
Estimez-vous les contrôles satisfaisants ? Qu’en est-il des services vétérinaires ? Selon vous, que faudrait-il modifier ? Vous avez prévu d’installer des caméras de vidéosurveillance ; pensez-vous que cette méthode pourrait être généralisée ? Plus largement, compte tenu de votre expérience, quelles préconisations pouvez-vous faire ?
Mme Sylviane Alaux. Vos salariés subissent-ils le stress de la contrainte économique à certaines périodes de l’année ? Les flux de production des élevages imposent-ils par moments un rendement accru à vos salariés ? Utilisez-vous des intérimaires, et sont-ils formés ? Si je pose ces questions sur les rythmes qui peuvent conduire à des « pétages de plombs », pour reprendre l’expression utilisée par l’association L214, tant décriée mais qui a pourtant été très utile, c’est parce que des cadences excessivement élevées ont forcément une incidence sur le bien-être animal.
M. Jacques Lamblin. Monsieur Canayer, vos propos sont tout à la fois extrêmement rassurants et inquiétants. Rassurants, car vous avez pris immédiatement des mesures extrêmement énergiques. Et l’on peut penser que votre établissement avait eu antérieurement la volonté de bien faire les choses. En tout cas, c’est ce qui ressort de vos propos.
Votre abattoir est un établissement local qui traite de petits volumes. Vous parlez de 230 tonnes par an, ce qui correspond, si mon calcul est juste, à environ une tonne par jour ouvré. On pourrait penser que des incidents ne peuvent pas survenir dans de telles structures parce que les pressions ne sont pas les mêmes qu’ailleurs, et j’avoue que je suis désolé qu’ils aient pu s’y produire. Ces incidents semblent être le fait de professionnels qui n’ont pas travaillé comme il convenait, et vous les avez sanctionnés.
Il semble que vous ne fassiez pas d’abattage sans étourdissement, autrement appelé abattage rituel. Vous avez donc des méthodes d’étourdissement pour chaque espèce animale. Votre matériel fonctionne-t-il correctement ?
Comme votre abattoir est un service public, il doit être, à mon sens, déficitaire. Quel prix au kilo demandez-vous aux éleveurs ?
M. Thierry Lazaro. Votre abattoir est une structure que l’on peut qualifier d’artisanale. Je suis de ceux qui pensent que plus la structure est petite, moins les problèmes de ce type doivent survenir puisque le contrôle a priori doit se faire de visu. Votre établissement compte peu d’employés ; vous en avez licencié un et décidé la non-reconduction d’un contrat. Autrement dit, c’est pratiquement tout votre personnel qui est passé à la trappe…
Nous ne sommes pas là pour vous stigmatiser. Comme M. Lambin, je considère que vos propos sont à la fois inquiétants et rassurants. Ils sont rassurants car vous avez pris très rapidement des dispositions et je n’ai pas à douter de votre sincérité. De plus, l’enquête administrative a abouti à un licenciement et à certaines observations.
La vidéo montre entre autres un porc qui met beaucoup de temps à mourir car la pince électrique n’a visiblement pas rempli son office. Est-ce le fait de l’employé qui n’a pas bien réglé l’appareil, ou l’appareil était-il défectueux ? Quelle est la méthode de contrôle qui permet de vérifier que les appareils d’étourdissement fonctionnent correctement ?
M. Roland Canayer. Effectivement l’abattoir du Vigan est un abattoir artisanal. Il n’y a pas de notion de rendement puisque c’est un service public. Les éleveurs nous amènent leur animal quand ils le souhaitent. Le personnel n’est pas stressé et il n’est pas soumis à des rendements élevés. Nous n’incitons pas les gros producteurs à venir abattre chez nous. Nous privilégions au contraire le circuit court. L’un de nos trois employés a pété les plombs, un matin. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête… Si nous avions eu un doute sur quiconque travaillait dans cet abattoir, nous l’aurions immédiatement sanctionné, mais jamais nous n’avons eu de raison de le penser.
M. Laurent Kauffmann, directeur de l’abattoir du Vigan. Je veux apporter quelques précisions sur la notion de rendement et de rythme. Nous sommes tout de même tenus, dans une journée, à traiter un certain volume. Toutefois, notre effectif est faible. Vous nous demandez si nos personnels étaient affectés à une seule tâche. Ce n’est absolument pas notre façon de fonctionner. Nos agents sont très compétents et très qualifiés : ils doivent savoir tout à la fois manipuler les animaux vivants depuis les stabulations jusqu’à l’entrée dans les frigos, que ce soit l’amenée des animaux, la tue, toutes les tâches de dépouille, d’éviscération, la pesée, la traçabilité, la découpe. Ils sont impliqués dans la connaissance de l’animal vivant et surtout, en bout de chaîne, sur la qualité de la viande.
Comme je viens de le dire, nous sommes tenus à un certain volume de travail dans la journée. C’est moi qui définis les rythmes de travail dans la journée. On sait que l’on ne peut pas abattre plus de X animaux par heure, qu’il y ait deux ou trois agents, car on n’est pas vraiment sur une chaîne d’abattage. On tient aussi compte du fait qu’il s’agit d’animaux vivants, que chaque animal peut avoir une réaction qui lui est propre par rapport au stress qu’il a pu avoir antérieurement, que certains agneaux, par exemple, ont des toisons plus épaisses que d’autres, autant de paramètres qui peuvent avoir une incidence sur l’amenée des animaux ou leur mise à mort. Sur une heure de travail, on a un rythme maximum absolu, quelles que soient les espèces : nos rendements à l’heure feraient sourire beaucoup de nos collègues… Nous pouvons traiter un lot de six à sept agneaux, ou un bovin. Quant aux porcs, nous disposons d’une échaudeuse-épileuse qui nous permettrait de traiter dix porcs par heure, mais en réalité nous en traitons plutôt quatre.
Notre abattoir est essentiellement focalisé sur les circuits courts, et cela se traduit également dans la gestion des animaux vivants : il arrive qu’un client ne vienne qu’avec un seul agneau. Quand nous parlons de lots, il s’agit en moyenne, la plupart du temps, de quatre ou cinq agneaux par client, ou de deux à quatre porcs, ou d’un seul bovin.
Bien sûr, nous sommes un peu plus sollicités à certaines périodes de l’année. Nous faisons alors appel à un intérimaire : c’est quelqu’un qui a une autre activité professionnelle et qui a une très grande expérience et une connaissance assez pointue de l’animal vivant puisqu’il travaille dans l’élevage. Il a été chef de chaîne à l’abattoir de Nîmes. Nous ne sommes donc pas du tout dans le cas d’intérimaires inexpérimentés.
Quand j’ai vu la vidéo, je suis tombé des nues. Je n’avais jamais vu cela. C’est inacceptable. Je ne sais pas quoi vous répondre… Comment peut-on en arriver là ? Nous avons longuement analysé les vidéos. On s’aperçoit que les actes de cet agent ont tous été commis, à une exception près, sur une seule et même journée : la maltraitance dans les stabulations, ce jeu sadique avec les pinces. Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé dans sa tête.
M. William Dumas. Il a disjoncté !
M. Laurent Kauffmann. Comme l’a dit le président Canayer, nous faisons des contrôles internes et externes. Ce genre d’acte n’a évidemment jamais été commis sous nos yeux. Les collègues de cet agent ne m’ont jamais fait part de tels comportements. Le président a pris la mesure de la gravité des actes : la sanction a été immédiate, il ne pouvait en être autrement.
Nous organisons au minimum une formation par an. Depuis la crise de la vache folle, beaucoup de choses ont été faites sur le plan sanitaire ces quinze dernières années. En 2014, on a exigé des certificats de compétences en matière de protection animale. Je pense que, dans la plupart de ces abattoirs, tout le monde a ces certificats. Bien que la taille de notre abattoir ne l’oblige pas, j’ai mon certificat de responsable protection animale (RPA). Mais il faut être honnête : tout le monde s’est laissé un peu déborder. Que ce soit à la fédération des abattoirs publics ou dans des structures privées, les formations sur la protection animale ont été avant tout théoriques. Il y a donc là une carence. Si des avancées s’imposent, c’est bien à ce niveau. C’est pour cela que le président de la Communauté de communes a demandé qu’un professionnel du bien-être animal travaille en situation à toutes les étapes : déchargement des animaux, conditions dans les stabulations, amenée au piège, mise à mort.
Nous avons des guides de bonnes pratiques d’abattage, des modes opératoires normalisés. Hormis les actes de maltraitance commis par notre agent, qui est un cas isolé, je peux vous assurer que nous travaillons tout au long de l’année en conformité avec la réglementation, et que nous travaillons particulièrement bien.
Toujours en matière de formation, la seule approche pratique dans notre abattoir a été faite à notre demande – encore a-t-il fallu insister. Nous avons demandé à un organisme privé de nous envoyer un intervenant ayant une connaissance particulièrement aiguë du maniement des animaux dans les stabulations. Celui-ci a conclu, dans son rapport, que nos installations étaient tout à fait conformes. Il nous a bien expliqué comment on devait déplacer un lot d’agneaux, etc. Si nous avons fait cette démarche, c’est parce que nous n’étions pas satisfaits des investissements que nous avions réalisés dans le domaine de l’amenée des animaux. Nous voulions aller plus loin.
Nous avons été très secoués par ce qui s’est passé dans notre abattoir. Nous attendons beaucoup du travail que nous allons faire avec l’éthologue. Nous nous sommes beaucoup remis en question. Tous les contrôles internes et externes confortent le travail que l’on accomplit tout au long de l’année. Nous avons beaucoup travaillé sur tout ce qui a trait à l’étourdissement et à la mise à mort des animaux. On peut noter que les services qui contrôlent ne maîtrisent pas certains paramètres. Nous maîtrisons les notions de perte de conscience et d’éventuels retours de conscience des animaux au moment des phases d’étourdissement, mais nous nous sommes demandé s’il n’y avait pas des choses qui nous échappaient. En fait, là aussi, il faut une montée en puissance au niveau de la formation. En tout cas, quand on creuse la question, on s’aperçoit que certains paramètres sont retenus par les instances de contrôle alors qu’ils ne sont pas pertinents. La vidéo fait à un moment donné état de retours de conscience, laissant sous-entendre que les animaux sont saignés alors qu’ils sont conscients. Je peux vous assurer que ce n’est pas vrai. Quand on parle de ces choses, il faut être précis car c’est un domaine très pointu. On laisse sous-entendre que l’on travaille n’importe comment et que l’on fait n’importe quoi. Au contraire, tous les critères de non-conscience de l’animal avant la saignée font l’objet d’une connaissance du personnel et de contrôles sur lesquels nous sommes prêts aujourd’hui à aller encore plus loin.
M. Roland Canayer. Je veux revenir sur ce qui pourrait être amélioré. Nous avons une personne qui est déléguée par les services de la DDPP et qui est à temps complet à l’abattoir. Elle regarde l’arrivée de l’animal et contrôle, une fois qu’il est abattu, s’il peut être consommé. Pendant tout le temps qui lui reste, ne pourrait-elle pas nous aider à contrôler l’abattage, voire avoir une fonction supplémentaire ?
M. Laurent Kauffmann. Nous sommes un des plus petits abattoirs de France, mais certainement aussi un des plus chers : il faut compter environ un euro hors taxes le kilo- carcasse pour les bovins – pour les ovins, c’est presque la même chose – et 0,50 euro pour les porcins. C’est sans commune mesure avec les prix pratiqués dans d’autres abattoirs.
M. William Dumas. Mais ce n’est pas comparable !
M. Laurent Kauffmann. Effectivement. Notre mode de fonctionnement n’est pas le même puisque nous sommes en circuit court. Les éleveurs peuvent mieux valoriser le produit fini.
M. Jacques Lamblin. Vous êtes très largement déficitaires. Mais il ne peut en être autrement : c’est un service public.
M. Roland Canayer. Nous avons essayé d’abaisser nos coûts au niveau de la structure, des fluides, de l’énergie. Nous fermons dorénavant l’abattoir en périodes de congés, alors qu’auparavant nous organisions un roulement. Cela nous permet de vérifier et de remettre en état tout le matériel. En 2009, lorsque nous avons repris la gestion de l’abattoir, le déficit s’élevait à 150 000 euros par an. En 2015, nous sommes parvenus à l’équilibre et nous avons un excédent de 6 000 euros.
Nous ne travaillons pas avec les gros producteurs et les maquignons, mais avec les petits éleveurs. En 2009, l’abattoir pouvait traiter 800 tonnes par an, alors qu’aujourd’hui on en est en dessous de 260. On a réduit le tonnage pour proposer un service de qualité. Il est normal qu’il y ait un peu de déficit…
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Votre présentation des choses est très intéressante. Vous n’êtes pas dans le déni du fait. Vous décrivez tout ce qui a été fait avant et tout ce que vous imaginez pouvoir faire après. Cela montre que vous êtes bien dans la recherche d’un process qui élimine la possibilité d’un phénomène qui a existé. Ce qui nous interpelle, c’est que cela ait pu se passer dans des conditions assez favorables, pour ne pas dire très favorables – la taille de votre établissement, l’attention portée, le nombre de personnes, l’intensité du contrôle, etc.
Je vais essayer d’articuler mes questions autour de ces points. Il y a eu un manquement et on peut mieux faire : comme l’a dit mon collègue tout à l’heure, c’est à la fois inquiétant et rassurant. Nous allons nous concentrer sur la phase rassurante.
Vous allez installer des caméras de vidéosurveillance. Comment le personnel a-t-il réagi à cette annonce ? Était-il lui-même demandeur – cela peut constituer pour lui une espèce d’autoprotection – ou était-il réticent ? A-t-il été convaincu ou l’a-t-il ressentie comme une obligation qui lui tombait dessus parce qu’on ne peut pas faire autrement ? Comment avez-vous prévu de gérer les images – conservation, communication, mise à disposition, etc. ?
Vous avez parlé de formation théorique. Il y a là un hiatus qui peut être important puisqu’il s’agit de métiers essentiellement pratiques.
Hier, nous avons auditionné le président de l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) qui commence à éditer des petits guides extrêmement pratiques. Jugez-vous cette démarche intéressante ? Auprès de qui pourrait-on rendre ces formations un peu plus pratiques et opérationnelles ?
Vous avez parlé à plusieurs reprises de l’intensité du contrôle, qui est très forte dans votre établissement, dans la mesure où cette tâche mobilise un agent sur quatre. Mais, manifestement, celui-ci se concentre sur les animaux vivants et sur les questions sanitaires après abattage. Cette faible intensité du contrôle sur la phase d’abattage, s’explique-t-elle par le manque de temps – vous avez déjà répondu qu’il l’avait –, par un manque d’appétence pour la chose, ou par une insuffisance de compétences, autrement dit parce qu’il ne s’estime pas formé et qualifié pour juger de la qualité de la phase d’abattage, moment critique qui exige des compétences particulières ?
Monsieur le directeur, vous avez le certificat de RPA. Cela signifie que vous avez été formé. Quel jugement portez-vous sur ce certificat ? A-t-il modifié en quoi que ce soit votre façon de pratiquer ?
Mme Laurence Abeille. Je veux revenir sur les méthodes d’étourdissement. Les membres de l’association L214 que nous avons auditionnés nous ont dit que le CO2 était un gaz particulièrement aversif pour les animaux. Quelle est votre opinion en la matière ?
Comme vous vous interrogez beaucoup sur ces méthodes d’étourdissement, pourriez-vous envisager de faire des propositions à terme ? À l’évidence, ces méthodes posent de vrais soucis en termes de souffrance animale.
Vous avez indiqué que vous aviez la certification pour traiter les animaux élevés en agriculture biologique. On a parlé d’abattoir bio. Or cette appellation n’existe pas. Il a pu y avoir des confusions dans les appellations. De quelle façon cela fonctionne-t-il dans la pratique ?
Je demanderai que l’on puisse investiguer plus largement sur la question du retour de conscience. Vous indiquez que ce sujet fait l’objet d’imprécisions, en tout cas que l’on dit là-dessus des choses erronées. Il serait important que des spécialistes s’expriment sur ce sujet.
Je veux revenir sur ce que l’on a appelé le « pétage de plombs » d’un agent qui s’est livré à des sévices sur les animaux. Vous vous êtes certainement demandé comment ce type de comportement pouvait arriver. On peut aussi craindre qu’il ne survienne de nouveau. Et peut-être se produit-il ailleurs, ce qui est extrêmement grave. Envisagez-vous des mesures préventives, une façon de travailler avec ces agents qui permettrait que de tels événements ne puissent plus se produire ? Bien évidemment, des sanctions existent, mais ce qui me préoccupe aujourd’hui c’est la question de la prévention et du lien dans l’entreprise.
Je ne sais pas dans quelles conditions la vidéo a été réalisée. En tout cas quelqu’un a dû placer une caméra dans l’abattoir. Cela peut vouloir dire qu’il y avait dans l’entreprise des personnes qui étaient sensibilisées à ce problème et qui ont voulu témoigner de quelque chose. En tant que directeur de l’abattoir, avez-vous le sentiment que les contacts et les relations entre les personnels et la direction ne sont pas suffisants, au point que quelqu’un estime ne pas avoir d’autres solutions que d’installer une caméra pour expliquer ce qu’il s’y passe, et ainsi devenir un lanceur d’alerte ? C’est un problème qui peut se produire dans de nombreuses entreprises : quelqu’un voit quelque chose, ne sait pas comment alerter et trouve cette méthode pour le faire.
Vous avez parlé des contrôles et des contrôleurs. À l’évidence, ce qui se passe n’est pas suffisant, ou en tout cas les contrôleurs ne maîtrisent pas suffisamment un certain nombre de sujets. Cela me semble très important. Peut-être pourriez-vous préciser de quoi vous voulez parler et peut-être avez-vous des éléments assez concrets à nous apporter. Pourquoi les contrôleurs ne peuvent-ils pas ou ne savent-ils pas faire ce qu’il faut pour effectuer les contrôles ?
Mme Françoise Dubois. Vous n’avez pas parlé d’abattage rituel. Vous demande-t-on de le pratiquer ? Si c’est le cas, expliquez-nous comment cela se passe.
M. Jacques Lamblin. Ma question rejoint celle de Laurence Abeille. J’ai été relativement surpris de vous entendre dire que les contrôleurs ne maîtrisaient pas un certain nombre de données. Il faut vraiment que vous nous en disiez davantage. Quels domaines ne maîtrisent-ils pas ? Quels problèmes cela peut-il vous poser ?
M. Laurent Kauffmann. Le problème est que ce sont eux qui nous délivrent l’agrément et qui nous préviennent en cas de non-conformités, majeures ou mineures… Si les personnes censées nous dire cela ne maîtrisent pas elles-mêmes certaines choses, cela ne nous aide guère !
Le jour de la réouverture de l’abattoir, le président et le directeur général des services étaient présents, ainsi que le directeur adjoint et l’inspecteur de la DDPP, la personne qui est là tous les jours dont a parlé tout à l’heure M. Canayer et qui est déléguée par les services de la DDPP, et la vétérinaire officielle. Nous avons fait un travail d’analyse, animal par animal, du bon étourdissement, du bon laps de temps entre l’étourdissement et la saignée, etc. Je peux vous dire que cela prêtait à rire. Nous connaissons notre métier, nous savons dire quand un animal est étourdi, inconscient. Or nous avions en face de nous des gens qui allaient jusqu’à paniquer, craignant la moindre réaction susceptible de laisser présupposer un retour de conscience. Entrons dans le détail : lors d’une inspection, on a laissé sous-entendre qu’il avait eu un retour de conscience d’un animal au motif qu’on avait détecté un réflexe cornéen après étourdissement – on met le doigt à proximité de l’œil de l’animal pour voir s’il y a une réaction oculaire. Et ce fut le cas… à ceci près que tous les guides de bonnes pratiques d’abattage vous apprendront qu’un étourdissement avec des pinces à électronarcose peut entraîner des phénomènes épileptiformes, autrement dit des réactions oculaires qui n’ont rien à voir avec des retours de conscience.
Les critères retenus dans nos grilles doivent être simples d’interprétation pour nos salariés. Actuellement, il y en a trois : l’effondrement immédiat, l’arrêt de la respiration et l’absence de vocalises. Ces critères sont facilement analysables par l’agent et parlants. Dans le cas que je viens de citer, après avoir discuté et nous être penchés très sérieusement sur les textes, nous sommes finalement convenus que le réflexe cornéen n’était pas un critère. Il faut se mettre une bonne fois pour toutes à la place des agents sur la chaîne : il faut que ce soit simple pour eux et qu’ils maîtrisent la notion de perte et de reprise de conscience. En l’occurrence, j’ai confiance dans le professionnalisme de mes agents parce qu’ils ont une grande expérience dans le domaine. Mais les contrôleurs sèment le doute et laissent sous-entendre que ce n’est pas si évident. Ils ne le font pas de mauvaise foi, mais plutôt par méconnaissance et manque de formation.
Il faut savoir qu’une semaine avant la diffusion de la vidéo, l’organisme de formation de la fédération des abattoirs était venu dans notre établissement. Le sujet de la mise à mort des animaux a été abordé en trente secondes parce que l’on m’a dit que nos agents maîtrisaient parfaitement le sujet, qu’il n’y avait aucun retour de conscience. Nous avons du mal à accepter que la vidéo, en plus de rapporter des actes affectivement inacceptables, laisse sous-entendre que nous faisons n’importe quoi.
Nous avons pris la décision de ne pas pratiquer d’abattage halal, décision que j’assume, alors qu’une communauté musulmane, qui habite sur le Vigan et la ville voisine de Ganges, nous demande à de rares occasions – des fêtes familiales par exemple – de sacrifier un animal. Nous le refusons systématiquement.
Vous m’avez demandé ce que m’avait apporté le certificat RPA. Pour ma part, cela m’a permis d’être très sensibilisé à la notion de protection et de bien-être animal. Peut-être faut-il que les agents qui travaillent sur la chaîne aillent plus loin dans la notion de sensibilisation. Je ne veux pas dire par là qu’ils sont insensibles au bien-être animal, mais chacun se rend bien compte que ce sont des métiers difficiles. On ne se vante pas d’être tueur dans un abattoir…
Il y a des stades post mortem – la dépouille, l’éviscération – où l’on peut sérier le temps plus ou moins facilement. Mais quand l’animal est encore vivant, il faut tenir compte de certains paramètres : tel animal est plus stressé qu’un autre, il a une corne placée de telle façon que l’application de la pince pourra peut-être poser problème. Autant de critères dont il faut tenir compte dans les notions de rythmes de travail.
Mme Abeille nous a interrogés sur le CO2. Je suis totalement incompétent en la matière puisque ce gaz n’est pas utilisé dans notre abattoir. Nous étourdissons les animaux uniquement par électronarcose.
Vous nous demandez ce qu’est un abattoir bio. Cela ne veut absolument rien dire. Le bio, c’est tout ce qui se passe en amont. Le seul critère qui figure dans notre cahier des charges c’est d’abattre l’animal bio avant les autres. Mais s’il est trop sale en arrivant, il passera en fin de chaîne pour des raisons d’hygiène : ce qui prime beaucoup chez nous c’est que les carcasses ne posent pas de problèmes à la consommation. Ce n’est pas parce qu’un animal est bio qu’il n’aura pas pu avoir été souillé pendant le transport ou dans les stabulations. J’ai lu dans la presse que l’on parlait beaucoup plus de label de protection animale. Il faut voir ce qu’il y a derrière cela. La notion de bio est pour moi inappropriée dans les abattoirs.
M. Roland Canayer. Le personnel est favorable à l’installation de caméras de vidéosurveillance. Il estime qu’ainsi tout le monde pourrait voir quelle est leur pratique.
Pour notre part, nous conserverons les images vidéo et nous les mettrons à la disposition de ceux qui le souhaiteront. Nous n’avons rien à cacher.
Je ne me remets pas en cause les compétences de la personne déléguée par les services de la DDPP, que nous connaissons depuis de nombreuses années, qui contrôle les animaux à leur arrivée et vérifie, une fois qu’ils sont abattus, s’ils peuvent être consommés. Peut-être est-ce à sa hiérarchie de lui donner l’ordre de surveiller l’abattage.
M. Laurent Kauffmann. Comme le dit M. Canayer, cette personne n’a pas été missionnée pour surveiller l’abattage. Et elle n’en a pas les compétences aujourd’hui.
Concernant la vidéo, je confirme que nos agents sont vraiment dans une démarche volontaire. Ils considèrent qu’ils n’ont rien à cacher.
M. William Dumas. Mais il ne faut pas que ce soit du flicage !
M. Laurent Kauffmann. Pour ma part, je mettrai un bémol non sur le principe, mais sur tout ce qui touche à l’exploitation de ces vidéos. N’oublions pas que nous sommes dans un abattoir. Dès lors que l’on dévoile des images, il faut avertir le public, faire un travail en amont, lui dire qu’on étourdit des animaux, qu’il y a du sang. Quand on voit des mouvements de pédalages chez un animal qui est au-dessus des loges de saignée, ce n’est pas parce qu’il est vivant et qu’il est conscient : il s’agit de réflexes musculaires, cloniques. Cela fait partie du processus de mise à mort. Mais l’animal ne souffre pas. Encore faut-il le savoir.
M. Fabrice Verdier. Il faut effectivement replacer ce genre d’images dans leur contexte. Pouvez-vous brièvement nous expliquer tout le processus, c’est-à-dire l’amenée, l’étourdissement, la saignée, car il y a parfois des confusions ? Le grand public ne sait pas exactement ce qui se passe dans les abattoirs.
M. William Dumas. Je connais bien l’abattoir du Vigan qui est situé dans ma circonscription. Comme l’a dit Roland Canayer qui est un ami, la Cour des comptes a trouvé anormal que la Communauté de communes paie le déficit de l’abattoir. Nous avons pu le maintenir car il est implanté sur le secteur des Causses et Cévennes classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis qu’il a été repris par la Communauté de communes, certains administrateurs ont été remplacés et les choses se passant mieux.
L’abattoir du Vigan n’est pas comparable aux autres : ce sont les éleveurs eux-mêmes qui amènent leurs animaux. Ils voient comment ils sont déchargés. Et ils viennent ensuite récupérer les animaux découpés, car ils vendent tous en circuit court. Ils savent que moins l’animal est stressé, meilleure sera la viande. On parle de stress et de cadences, mais j’aimerais que tous les abattoirs de France aient les mêmes cadences qu’au Vigan… Un gros chevillard qui amenait des cochons est d’ailleurs parti à l’abattoir d’Alès car il trouvait nos prix trop élevés. Du coup, Le Vigan s’est recentré sur la qualité.
Pour avoir managé du personnel – mais pas dans un abattoir – je sais qu’il peut arriver que quelqu’un pète les plombs, à cause de problèmes familiaux par exemple. Cela arrive dans tous les métiers et partout : j’ai vu des gens agresser physiquement leurs collègues. Nous vous avons expliqué que l’agent avait commis ces actes inadmissibles sur une même journée. Il devait être dans un état second. Peut-être avait-il fumé un pétard… Je n’en sais rien. En tout cas, il riait en travaillant. Il avait une attitude anormale.
Mais il faut remettre les choses dans leur contexte : j’aimerais bien que les 263 abattoirs de France aient la même façon d’abattre les animaux qu’au Vigan. Il faut faire attention aux vidéos, il ne faut pas que cela devienne du flicage. Je suis fils de viticulteur. Quand j’étais gamin, partout dans les villages on tuait le cochon. À l’époque, il n’y avait pas d’abattoir. Je connaissais les personnes qui « ensuquaient » le cochon et qui le saignaient tout de suite après. Il bougeait encore…
Comme Fabrice Verdier, j’aimerais que vous nous expliquiez le processus. Je crois qu’il faut que le cœur de l’animal batte encore pour pratiquer la saignée. Mais je ne suis pas du métier.
M. Thierry Lazaro. Est-ce l’agent qui règle l’intensité de l’outil électrique ou est-il préprogrammé ? Comment ces outils sont-ils contrôlés s’il y a des défaillances ?
Sur les quatre salariés de l’abattoir, un a été licencié et un autre n’a pas été reconduit. Comment avez-vous pu recruter de nouveau et dans quelles conditions ? Je suppose que vous avez dû faire cela dans l’urgence, et que cela n’a pas dû être simple.
M. Laurent Kauffmann. Actuellement, l’abattoir fonctionne avec deux salariés. Les volumes traités sont fonction du nombre d’opérateurs présents.
Chez nous, les lots sont petits, les animaux arrivent la veille ou le matin même. Comme l’a dit M. Dumas, ce sont les éleveurs qui accompagnent leurs animaux jusque dans les stabulations. Cela nous semble normal de procéder ainsi car l’éleveur connaît ses animaux : l’amenée est plus aisée.
Nos parcs sont très aisés en termes de bien-être animal. L’éthologue qui est déjà venue a été étonnée de voir que l’on paillait les stabulations pour les ovins et les porcins. Toutes les logettes pour les bovins sont individuelles. Je n’entrerai pas dans le détail en ce qui concerne les abreuvoirs et la brumisation pour les porcs.
Nous traitons de très petits lots : six à sept ovins ou quatre à cinq porcs. S’agissant de la phase cruciale d’étourdissement, nous disposons d’un matériel neuf dédié aux ovins et d’un matériel dédié aux porcs. Il n’y a donc aucun réglage d’intensité à effectuer. Dans la vidéo, on voit l’agent appliquer la pince électronarcose sur un porc. Je ne m’explique pas son acte car nous avons des pinces de marque Schermer dites Z3 dédiées à l’électronarcose des porcs. Je ne sais pas si cette vidéo a été prise le même jour, mais si, de surcroît, il n’a pas utilisé le bon outil, cela viendrait corroborer le fait que rien n’allait pour lui ce jour-là. L’électronarcose est faite avec des pinces tenaille pour les porcs. On applique le temps nécessaire sur l’animal pour que l’électricité se diffuse bien et qu’il perde conscience. Il y a tout de suite des signes facilement reconnaissables de perte de conscience : pour le porc, cela se traduit par une phase de contraction, une phase tonique et l’arrêt de la respiration. Ce sont les deux premiers signes probants. Tout de suite après, il bascule sur une table d’affalage. On nous dit que les porcs sont inconscients entre trente et quarante secondes. Nous réfléchissons actuellement pour pratiquer la saignée encore plus rapidement qu’on ne le fait. Les derniers chronométrages que nous avons réalisés sur les porcs montrent que l’on est entre vingt et vingt-cinq secondes pour arriver à la phase de saignée. Durant cette phase, l’animal est inconscient. Il est saigné dès qu’il arrive au poste de saignée. Le fait qu’il ne respire plus et qu’il ne tente pas de se redresser est un signe patent. J’ai pu lire des commentaires expliquant que l’on voit la tête de l’animal bouger : c’est différent d’une tentative de redressement qui présuppose une volonté, du moins un lien avec le cerveau de l’animal. Au vu de tous ces signes, l’agent constate qu’il n’y a pas de reprise de conscience et saigne alors l’animal. Là encore, il se passe deux minutes avant de considérer que l’animal est définitivement mort. Il y a donc deux minutes entre la saignée et le constat de la mort.
S’agissant des agneaux, le procédé est le même : on applique aussi une pince à électronarcose. Nous avons anticipé la nouvelle norme et l’agent dispose d’un repère sonore qui lui signale quand la bonne intensité n’a pas été appliquée à l’animal et qu’il faut procéder à un deuxième étourdissement. Dans l’idéal, l’étourdissement doit se faire du premier coup. Mais à cause de la conformité d’un animal, de son stress ante mortem, etc., il peut arriver qu’il faille pratiquer un deuxième étourdissement. Nous adoptons de nouvelles techniques : nous mouillons un peu la tête avec une éponge pour que l’induction électrique soit encore plus efficace. Il faut travailler en profondeur avec des experts sur ces sujets.
Après une électronarcose efficace, l’agneau est inconscient pendant trente à quarante secondes. Les guides de bonnes pratiques nous donnent au maximum vingt-cinq secondes pour saigner l’agneau ; pour notre part, nous mettons entre quinze et vingt secondes. Nous agissons vraiment en conformité avec la réglementation. Quand on voit qu’il n’y a pas de signe de reprise de conscience, on saigne l’animal. En cas de signe de reprise de conscience, on applique un deuxième étourdissement à la tige perforante à l’aide d’un matador chargé avec des cartouches bleues adaptées aux ovins.
Telles sont les phases de travail d’un agent au poste de tue. On lui demande de maîtriser des gestes, de savoir interpréter les signes de reprise de conscience de l’animal.
M. le président Olivier Falorni. Messieurs, je vous remercie pour vos réponses précises.
La séance est levée à onze heures quarante.
——fpfp——
4. Audition, ouverte à la presse, de M. Gérard Clemente, directeur de l’abattoir du Pays de Soule et de M. Michel Etchebest, maire de Mauléon-Licharre.
(Séance du jeudi 28 avril 2016)
La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq.
M. le président Olivier Falorni. Nous poursuivons nos auditions sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, à la suite la diffusion de trois vidéos par l’association L214 Ethique et animaux, que nous avons auditionnée hier, ainsi que l’association OABA. Après avoir reçu ce matin les représentants des abattoirs d’Alès et du Vigan, dans le Gard, nous allons maintenant entendre les responsables de l’abattoir du Pays de Soule dans les Pyrénées-Atlantiques, M. Gérard Clemente, directeur de l’abattoir, et M. Michel Etchebest, maire de Mauléon-Licharre.
Monsieur le maire, monsieur le directeur, le 29 mars 2016, l’association L214 a publié une vidéo de cinq minutes, mettant en évidence de nombreux abus commis sur les animaux dans votre abattoir, ce qui l’a amenée a porté plainte pour maltraitances, sévices graves et actes de cruauté. Ce montage vidéo a été réalisé à partir d’images tournées sur une semaine environ au cours du mois de mars 2016 ; le jour de sa diffusion, monsieur le maire, vous avez annoncé dans un communiqué prononcer la fermeture de l’abattoir pour une durée indéterminée à titre conservatoire, afin qu’une enquête administrative puisse être menée sur les conditions d’abattage au sein de l’établissement. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également suspendu l’agrément du site pour les activités d’abattage.
Avant de vous donner la parole, je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et qu’elles sont diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. En outre, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Gérard Clemente et M. Michel Etchebest prêtent successivement serment.)
Je vous remercie et vous propose maintenant de nous présenter votre abattoir et le contexte dans lequel vous travaillez. Puis, mes collègues et moi-même nous vous poserons des questions.
M. Michel Etchebest, maire de Mauléon-Licharre. Nous sommes ici aujourd’hui pour vous apporter des explications sur des événements largement relayés par la presse et Internet. Je vais vous présenter l’abattoir de Mauléon et vous expliquer le contexte dans lequel nous travaillons, en projetant trois diapositives.
Notre établissement n’est pas un abattoir industriel, mais un prestataire multi-espèces : nous n’achetons pas les animaux pour les revendre après transformation, nous facturons la prestation à nos clients qui amènent les bêtes et repartent avec le produit transformé. Nous ne pratiquons pas l’abattage rituel, conformément à notre communication de 2009 sur la notion de bien-être animal. Même si nous sommes épinglés aujourd’hui dans ce domaine, un travail de fond sur le bien-être animal est en effet mené au sein de l’établissement ; nous sommes également très attentifs aux conditions et à la charge de travail de notre personnel.
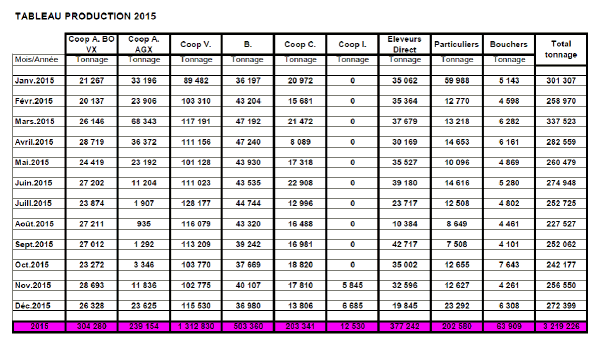
Notre établissement est un outil de territoire généraliste, en permettant aux 800 éleveurs de la vallée de la Soule, dans le Pays basque, de travailler avec les coopératives qui sont nos clients. Nous avons également 220 clients éleveurs qui amènent eux-mêmes leurs bêtes à l’abattoir qui effectue les prestations d’abattage, de découpe, de conditionnement et de mise sous vide. Comme le montre cette première diapositive, nous travaillons avec plusieurs coopératives, une entreprise privée spécialisée dans la cheville, et nos éleveurs en direct
– notre cœur de métier. Notre abattoir emploie 35 personnes et transforme chaque année 3 200 tonnes de viande.
Ainsi, nous intervenons dans un territoire où l’élevage est le cœur du système agricole et où la qualité de l’élevage local est largement reconnue au travers des signes officiels de qualité – « agneau de lait des Pyrénées » et, pour les bovins, « Label Rouge » et bio.
Notre personnel est constitué d’une équipe d’abattage de quinze personnes, de cinq salariés pour le volet administratif, et d’une équipe de découpe-conditionnement-mise sous vide.
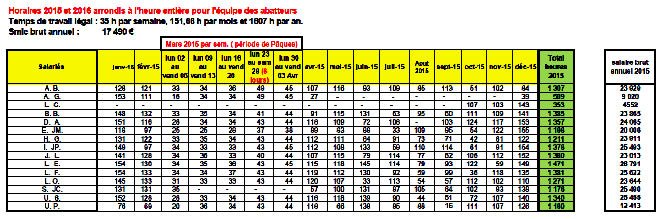
Comme le montre cette deuxième diapositive, nos abatteurs – payés à temps plein à l’année – travaillent en moyenne 1 200 heures par an, alors que la durée légale du travail à raison de 35 heures par semaine est de 1 607 heures. Depuis longtemps, notre choix est en effet de favoriser le travail de nos salariés sur la durée, pour leur épargner la fatigue et les troubles musculo-squelettiques (TMS) à l’âge de quarante-cinq ou cinquante ans. Notre directeur Gérard Clemente pourra témoigner de cet effort sur les conditions de travail, puisqu’il va prendre sa retraite le 14 juin prochain après quarante ans passés dans l’établissement.
Au sein de notre équipe d’abattage, nos ouvriers sont payés en moyenne 2 000 euros bruts par mois, soit 40 % au-dessus du SMIC, ce qui représente un salaire brut annuel moyen de 21 200 euros, le chef abatteur étant rémunéré à 28 700 euros par an. On vient travailler à l’abattoir de Mauléon, d’abord, pour l’attention portée au personnel, mais également pour les salaires corrects – même si, on peut évidemment toujours faire mieux.
En regardant la vidéo incriminée, et grâce à la traçabilité, nous avons pu en déduire qu’elle a été tournée les 7 et 8 mars 2016, c’est-à-dire durant la période de Pâques, la plus chargée de l’année en raison de la demande d’agneaux de lait. Pendant cette semaine-là, les trois abatteurs concernés ont fait respectivement 38 heures, 40 heures et 35 heures – chacun jugera si c’est beaucoup ou pas.
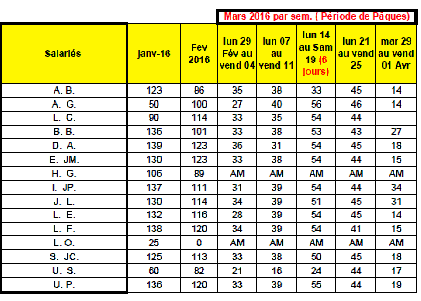
Une semaine avant Pâques, nos ouvriers ont travaillé six jours – semaine du 14 au 19 mars – et la durée maximum travaillée a été de 56 heures pour un abatteur, dont la durée annuelle de travail est de 1 300 heures. Autrement dit, les temps de récupération et de repos permettent d’encaisser les à-coups inhérents à la saisonnalité du produit.
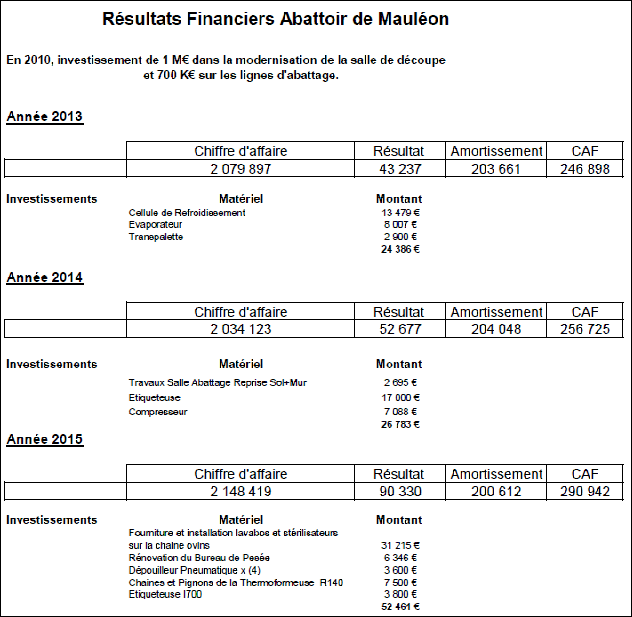
Sur le plan financier, notre abattoir est totalement autonome – et je le juge correctement géré. En 2013, son chiffre d’affaires s’est élevé à 2 079 897 euros, pour un résultat de 43 237 euros et un amortissement de 203 661 euros – notre régie investit lourdement et de manière continue –, soit une capacité d’autofinancement (CAF) de 246 898 euros. D’année en année, le chiffre d’affaires fluctue, car le marché de la viande est un marché dur, compliqué. Malgré un chiffre d’affaires en baisse, à 2 034 123 euros en 2014, notre résultat s’est élevé à 52 677 euros cette année-là, notre amortissement à 204 048 euros, pour une CAF importante, à 256 725 euros. Enfin, nous avons connu une bonne année en 2015, avec un chiffre d’affaires de 2 148 419 euros, un résultat de 90 330 euros, un amortissement de 200 612 euros et une CAF élevée, à 290 942 euros.
Notre établissement investit tous les ans. De 2013 à 2015, nos investissements se sont élevés à 24 386 euros, 26 783 euros et 52 461 euros. En 2010, nous avions déjà investi 1 million d’euros pour agrandir notre salle de découpe et conditionnement, plus 700 000 euros pour moderniser les lignes d’abattage. Pour l’année 2017, nous envisageons d’investir 2,5 millions d’euros, d’une part, pour relever toutes nos chaînes et les lignes d’abattage de 50 centimètres – les bêtes sont plus longues qu’autrefois, le poids-carcasse bovin est passé de 450 kg à 550 kg en l’espace de vingt ou trente ans –, et, d’autre part, pour améliorer les stabulations, où arrivent les animaux vivants.
Aujourd’hui, nous estimons avoir un contrôle sérieux, voire sévère de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Notre abattoir était considéré comme exemplaire « tout court » il y a encore un mois et demi ; aujourd’hui, je dirai qu’il est exemplaire à de multiples égards. En tout cas, notre activité est bien tenue, et les services vétérinaires nous encouragent à plus de transparence et plus de qualité en matière sanitaire comme dans le domaine de la protection animale.
M. le président Olivier Falorni. Votre abattoir bénéficie de la certification « Bio Ecocert ». De quoi s’agit-il ?
Quel est le processus de recrutement au sein de votre abattoir ? Employez-vous beaucoup d’intérimaires ? Exigez-vous une formation diplômante ? Organisez-vous des formations pour vos agents en cours de carrière ? Sont-ils affectés à une seule tâche ou soumis à un turn over ? Pensez-vous qu’ils soient suffisamment sensibilisés à la question de la souffrance animale ?
Les contrôles vétérinaires sont-ils satisfaisants selon vous ? En la matière, que faudrait-il modifier ? Enfin, que pensez-vous de la généralisation de la vidéosurveillance dans les abattoirs ?
Mme Sylviane Alaux. Hier, lors de leur audition, les représentants de l’association L214 ont indiqué que leur enregistrement de l’abattoir de Mauléon a porté sur une semaine complète. Ils ont ajouté que, dans les abattoirs filmés, les reprises de conscience des animaux sont quotidiennes, que les boxes d’immobilisation mal calibrés sont pratiques courantes, et des « pétages de plombs » des salariés heureusement peu fréquents, mais réels. Quelles précisions pouvez-vous nous apporter à ce propos ?
Lors du surcroît de travail pendant la période de Pâques, un de vos abatteurs a fait 56 heures la semaine du 14 au 19 mars. Combien d’heures cela représentait-il par jour ?
Quels sont les horaires de votre établissement, en particulier à quelle heure ouvre-t-il le matin ? Ma question n’est pas innocente. Les animaux arrivent-ils le matin et sont-ils pris en charge tout de suite ? Ou arrivent-ils la veille et, si oui, comment sont-ils gardés toute la nuit ? Quel système d’abreuvement est mis à leur disposition ?
M. Jacques Lamblin. Monsieur le maire, j’ai apprécié la précision de votre exposé, étayé par des données chiffrées et détaillées, à la fois sur les volumes traités et la chronologie. Cela est important car vos locaux ont été filmés au moment du coup de feu de Pâques. Apparemment, vous avez traité 330 tonnes en mars, contre 280 tonnes habituellement, soit une hausse de 20 % à 25 %, et les abatteurs ont fait davantage d’heures. Voyez-vous une corrélation entre, d’un côté, l’augmentation des volumes traités et l’augmentation du temps de travail des abatteurs, et, de l’autre, les pratiques constatées ? Autrement dit, cette accélération des cadences, en mettant les abatteurs sous pression – ce qui n’est manifestement pas l’usage dans votre établissement de proximité – n’est-elle pas la cause des pratiques incriminées ?
Dans les gros abattoirs industriels, la concurrence par les prix impose des cadences élevées. Vous avez un autre objectif : la qualité du service, en proposant un prix acceptable au client. Quel prix facturez-vous à vos clients ?
La DDPP est sévère dans ses contrôles, dites-vous. Est-elle est sévère, mais juste ? Ou ses observations ne sont-elles pas toujours faites à bon escient ?
M. Gérard Clemente, directeur de l’abattoir du Pays de Soule. Ecocert est un organisme habilité à contrôler les abattoirs qui produisent de la viande de consommation estampillée « bio ». La règle essentielle du cahier des charges est que les animaux « bio » doivent être abattus avant tous les autres, lorsque la chaîne d’abattage est parfaitement propre. Il faut également pouvoir produire tous les documents afférents lors des contrôles, en particulier le ticket de pesée qui, en comportant la date du jour, l’heure d’abattage et la minute de pesée, permet de vérifier si l’animal est bien passé en premier pour des raisons sanitaires. Par ailleurs, les animaux qui entrent dans les stabulations doivent avoir de l’eau à leur disposition.
En France, tous les abatteurs suivent une formation réglementaire et obligatoire. Dans notre abattoir, elle est dispensée par Adofia, émanation de la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de service (FNEAP). Cette formation de 48 heures inclut des passages en salle d’abattage où sont expliquées aux personnes les pratiques et les actions correctives en cas de problèmes.
Chaque abatteur dispose d’une fiche de poste qu’il a lue, signée et qu’il connaît par cœur – il ne la consulte donc pas tous les matins en arrivant au travail. Quand vous faites le même travail pendant cinq, dix ou quinze ans, vous êtes censé, comme tout employé modèle qui se respecte, connaître les bonnes pratiques.
Durant la semaine incriminée, le maximum d’heures effectué s’établit à 40 heures. Pour travailler depuis quarante ans dans cet établissement, je peux vous dire que 40 heures d’abattage n’ont rien de rédhibitoires et que l’on est en droit de demander un résultat performant à l’intéressé.
Vous parlez de surcroît d’abattage, mais, pour notre part, nous raisonnons par rapport à des cadences. Effectivement, en cas de cadence trop élevée dans un abattoir, il peut arriver qu’un salarié ait un comportement anormal parce qu’il n’arrive pas à suivre et bâcle les opérations. Cela n’est pas le cas dans notre établissement, car nous adaptons la cadence de la chaîne au nombre de personnes qui y opèrent. Chez nous, le ratio est la production d’animaux par abatteur : notre ratio est de dix agneaux de lait par abatteur ; si l’on juge à l’aune de la moyenne nationale, nous sommes nettement en dessous. Même en tournant à 120 bêtes à l’heure avec douze abatteurs sur la chaîne, vous faites le travail correctement, y compris en termes de protection animale.
Chez nous, tout le monde tourne. Sur la vidéo, vous voyez trois personnes, mais si la vidéo avait été tournée la semaine suivante, vous en auriez vu trois autres. Nous faisons tourner les gens car, parallèlement au bien-être animal, nous tenons compte du bien-être social. Nous incitons nos abatteurs – nous obligeons même certains – à tourner pour leur éviter des opérations répétitives : c’est ce qui explique que nous n’ayons jamais été confrontés à des apparitions de troubles musculosquelettiques. Un abatteur décontracté et content en arrivant le matin au travail aura de bons résultats, aussi bien en termes de bien-être animal que de prestation de service – que je pourrai facturer d’autant plus facilement qu’elle aura été de qualité. À l’inverse, des tâcherons ne pourront pas officier pendant plus de quinze ans : après, ils sont cuits.
M. le président Olivier Falorni. Alors comment expliquez-vous ce que nous avons vu ?
M. Gérard Clemente. Dans la mesure où j’ai tout mis en place, tant d’un point de vue réglementaire que d’un point de vue social, je ne l’explique pas ! C’est pour mois un constat d’échec : je n’aurais jamais pensé que dans mon établissement, où j’ai passé quarante ans de ma vie, de tels actes aient pu se produire.
Cela étant dit, les personnes ayant visité notre structure, notamment une dame envoyée par la Direction générale de l’alimentation (DGAL), ont constaté la présence d’un mur qui sépare les ouvriers – c’est obligatoire dans les abattoirs au motif que les animaux qui entrent dans la salle d’abattage, pour être anesthésiés et saignés, ne doivent pas voir leurs congénères suspendus en train d’être dépouillés et éviscérés. La DDPP a demandé comme action corrective le remplacement de ce mur par une vitre, ce qui a été fait. Par conséquent, je persiste et signe : s’il y avait eu une vitre à la place de ce mur, je ne serais pas en train de m’expliquer devant vous.
M. le président Olivier Falorni. En quoi cette vitre aurait empêché les comportements incriminés ?
M. Gérard Clemente. Parce que cette vitre aurait permis de voir les employés ! Devant le directeur, la vétérinaire inspectrice, la préposée sanitaire, le responsable qualité, ils n’auraient pas commis ces faits-là.
M. Jacques Lamblin. D’où la question sur la vidéosurveillance.
M. Gérard Clemente. La seule réponse à ce problème, c’est justement la vidéosurveillance. On peut nous reprocher un défaut de contrôle, et je l’accepte ; encore qu’un tel endroit est très difficile à contrôler, car il n’est pas permis de passer d’un endroit souillé à un endroit propre pour des raisons sanitaires. L’ajout de contrôleurs supplémentaires ne mettra pas à l’abri de ce type de dérive. Un responsable qualité passe aujourd’hui 65 % de son temps au bureau, parce que la documentation a pris le pas sur le fonctionnement : il pourrait donc consulter les vidéos sur l’écran de son ordinateur. C’est la seule réponse possible.
M. Michel Etchebest. Comme dans toute entreprise, il peut y avoir des dérives que, de mon côté, j’assimile à des « non-conformités » – j’exerce des activités de production dans la vie civile ; il faudrait donc parvenir à les corriger. En l’occurrence, cette dérive aurait pu facilement être corrigée si, dès le constat, elle avait été remontée au responsable qualité ou à la direction. Le mur opaque, conforme à la réglementation, a empêché de voir le poste d’étourdissement et de saignée des agneaux ; nous avons proposé à la DDPP l’installation d’une vitre, ce qu’elle a accepté. Désormais, la vétérinaire, la préposée sanitaire présente à 100 % du temps dans notre abattoir, ou le directeur, ne devrait plus constater ce genre de dérive. Pour les opérateurs eux-mêmes, voir leurs collègues dans la salle d’abattage est préférable – la suppression du mur paravent rend plus facile la vie de la communauté. Ainsi, la direction reconnaît qu’il y a eu un défaut de contrôle : ce défaut de contrôle se corrige.
Dans la vidéo, on voit principalement ce que j’appelle un « accident d’abattage » : un agneau étourdi a été attrapé en avançant sur la chaîne par un crochet qui n’aurait pas dû se trouver là et s’est fait écarteler Un accident de ce genre peut malheureusement arriver dans n’importe quelle activité de production, et pas seulement dans un abattoir. En revanche, ce qui nous paraît très dommageable – et cela a sans doute déclenché la diffusion de cette vidéo –, c’est le fait de taper sur la tête des agneaux : cela n’est pas possible en termes de bien-être et de protection animale. Mais cette pratique est perçue comme moins choquante à la vue de cette vidéo qui en réalité est un montage – avec de multiples coupures – et où l’on ne voit donc pendant cinq minutes que ces faits-là. Malheureusement, cet écartèlement d’un agneau a fait se lever la France entière, ce qui nous a fait un mal énorme. Quoi qu’il en soit, le bien-être animal n’a pas été respecté et si nous avions été mis au courant, Gérard Clemente et moi-même aurions réagi immédiatement et vigoureusement.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Votre abattoir est multi-espèces.
M. Gérard Clemente. Mais à dominante bovins, qui représentent 90 % de nos abattages.
M. le rapporteur. Le fait de traiter trois espèces engendre-t-il une moindre technicité pour celles qui sont moins fréquemment traitées ? Comment corriger cela ?
Comment jugez-vous l’efficacité du matériel d’étourdissement ? Quelle méthode utilisez-vous ? Comment l’opérateur est-il sûr que l’appareil délivre bien la décharge convenue ? Pratiquement, comment éviter les incidents ou les pannes ?
Parmi les événements relatés dans la vidéo mise en ligne, vous semblez séparer ce qui est visuellement très choquant, et que vous qualifiez d’accident de chaîne – l’écartèlement d’un agneau – d’une pratique moins choquante, mais beaucoup moins explicable à vos yeux, en l’occurrence une maltraitance physique volontaire.
Vous évoquez un défaut de contrôle, en ajoutant que si ces éléments avaient été remontés au responsable qualité ou à la direction, vous auriez apporté des corrections. Comment appréciez-vous l’ambiance collective dans votre abattoir ? Les gens se voient travailler, il n’y a pas des murs partout. Comment expliquez-vous que de tels événements – un collègue un peu vif, repris deux ou trois fois… – ne remontent pas dans le service ? Est-ce à dire qu’on ne se parle pas suffisamment dans votre établissement ?
Mme Sylviane Alaux. L’association L214 a évoqué des boxes d’immobilisation mal calibrés. Qu’est-ce qu’un box d’immobilisation ? Permet-il de traiter des espèces différentes ? Avec quarante ans de métier derrière vous, pensez-vous que 48 heures de formation soient suffisantes pour un nouvel arrivant ?
Mme Laurence Abeille. Je trouve également surprenant que seulement 48 heures de formation soient prévues.
Vous avez parlé de bien-être social et de bien-être animal. La vidéosurveillance peut, certes, être une solution utile, mais les caméras ne peuvent pas résoudre les problèmes de bien-être social – le visionnage des vidéos ne peut pas et ne doit pas se substituer au contact humain. À cet égard, quelles pistes imaginez-vous pour l’avenir ?
M. Thierry Lazaro. Si l’abattoir doit être propre pour la certification Ecocert, comme vous l’avez expliqué, vous allez presque me rendre biosceptique ! Car si vous tuez des animaux « bio » toute la journée, et si l’abattoir doit être propre du début à la fin, comment cela se passe-t-il en fin de journée ?
Votre homologue du Vigan a déclaré que la terminologie « bio » dans un abattoir ne veut rien dire. Qu’en pensez-vous ?
M. Gérard Clemente. Qu’il y ait un ou dix bovins « bio », tous passent en premier. S’il y en a beaucoup, il faut arrêter la chaîne cinq minutes, désinfecter tout ce qui entre en contact avec les carcasses, puis continuer. Un animal bio peut cependant passer en fin de chaîne si son état de propreté ante mortem n’est pas satisfaisant. C’est un élément déterminant sur le plan sanitaire. Les animaux sont classés en quatre catégories, de A à D, de propre à très sale. Un animal classé B, C ou D passera systématiquement en fin de chaîne pour éviter toute contamination. Autrement dit, un animal bio classé en C passe en dernier.
Le box d’immobilisation est agréé par les instances européennes. Nous avons un box mixte bovin/veau, avec un anti-recul, une des deux parois contenant l’animal – cet appareil n’est pas dernier cri, car il existe des boxes en théorie plus perfectionnés, dont les deux parties latérales peuvent être rapprochées pour contenir l’animal. Mais ça, c’est de la théorie, faite par des gens certainement plus compétents que moi, mais qui ne sont pas des gens de terrain. Nous tuons beaucoup d’animaux de la campagne, très dynamiques, contrairement aux animaux des élevages intensifs. Or je vous prie de croire qu’un veau de six mois de 350 kg, au mieux de sa forme, qui entre dans un piège de contention, il faut pouvoir le contenir ! Un profane qui n’a jamais vu un animal affolé dans un piège ne restera pas longtemps à côté… Comme nous avons remarqué que les choses se passaient beaucoup mieux lorsque deux animaux étaient côte à côte, nous avions pris la décision pour des considérations de bien-être animal, et en accord avec la vétérinaire, de ne plus passer un par un les animaux de plus en plus vifs – du fait des conditions actuelles d’élevage, des boxes de contention, des couloirs, etc. –, mais par deux. Mais si l’on en met trois animaux, c’est un non-respect de la procédure.
En pratique, le système comporte un couloir d’amenée avec des portillons de séparation et la porte du piège. Les veaux s’engouffrent dans le couloir, mais si jamais la porte du piège n’est pas fermée, ils vont entrer à trois. L’action corrective consiste alors à anesthésier immédiatement les animaux, certainement pas de les faire reculer. Mais ce sont des cas de force majeure – ils ne se produisent pas régulièrement. En fait, nous sommes tombés dans le panneau : nous n’aurions jamais dû décider de passer les veaux deux par deux. Mais nous l’avons fait dans un souci de bien-être animal, et la vétérinaire l’a bien compris. Je précise que c’est elle qui nous tire vers le haut et que c’est grâce à elle que nous sommes performants.
En fait, les contrôles d’un abattoir ne portent même pas sur l’établissement lui-même ni sur les personnes, ils portent sur les documents. Malheur à celui qui n’a pas de documents
– si vous en avez une pile d’un mètre de haut, vous arrivez à passer entre les gouttes ! Je ne dis pas que les documents sont inutiles, mais ils ne font pas tout.
Dans le cadre de la procédure d’embauche pour l’abattage, je cherche un autochtone ou, du moins, une personne désireuse d’en faire sa profession. On discute, je tente de comprendre son approche du métier – car il m’arrive de tomber sur des gens qui voudraient entrer chez nous, mais sans occuper ces postes-là. Je leur explique que s’ils ne veulent pas être polyvalents, ils ne pourront pas entrer chez nous. On parle aussi des questions de sécurité, des conditions sanitaires et de bien-être animal Cela étant dit, entre le discours de l’intéressé et la réalité de son fonctionnement ensuite sur le terrain, il y a souvent un écart – mais cela n’est pas propre à notre métier. Certes, quarante-huit heures de formation, c’est un peu léger. Mais un nouvel embauché n’est jamais mis en situation : pendant deux à quatre mois, il ne fait pratiquement rien. Pour former un abatteur, il faut donc au minimum trois ans. Si on abat vingt vaches, par exemple, on va le mettre sur la dernière ; il va peler un peu, faire deux ou trois gestes – pas quatre, parce qu’au quatrième, il va trouer le cuir, ou faire un trou dans la cuisse de l’animal, le client vous rectifiera le prix de la prestation et le marchand de cuir refusera la peau ! Tout cela se fait petit à petit, en voyant faire et en écoutant les collègues.
Nous sommes allés voir nos confrères d’Alès, où nous avons rencontré le responsable qualité, et nous avons décrypté la vidéo comme des gens de terrain : il y a des choses impardonnables et d’autres explicables ; nous en avons discuté. Ma démarche n’a pas visé à dire à mes collègues : « Attention, j’espère que vous ne faites pas ça » ; elle a été d’indiquer ce qui n’est pas normal, ce que nous ne devons pas faire. Ce métier ne nous exonère pas d’une approche éthique.
M. Jacques Lamblin. En plus du prix au kilo facturé au client, j’aimerais savoir si les démissions sont fréquentes dans votre établissement ou si les gens y restent pour la vie, comme vous ?
M. Gérard Clemente. Ils sont comme moi, ils restent.
M. Jacques Lamblin. Le salaire, que je trouve tout à fait correct, permet donc une fidélité du personnel.
M. Gérard Clemente. Tout ce que nous mettons en place pour le confort social participe de cette démarche de fidélisation des intéressés. Des gens travaillent avec moi depuis vingt-cinq ou trente ans.
M. Michel Etchebest. La régie revêt une dimension économique territoriale. De nombreux fils d’agriculteur ou d’éleveur font dix ans ou quinze ans chez nous, puis repartent à la ferme une fois leurs parents arrivés à la retraite. L’abattoir constitue ainsi un maillon d’une chaîne complète de valeur ajoutée. Le caractère fiable et remarquable de l’abattoir rejaillit sur l’ensemble de la filière, que ce soit en amont avec des éleveurs satisfaits d’un outil de bon niveau, ou en aval avec nos « clients », les coopératives qui obtiennent une prestation.
Cette vidéo choquante – au demeurant bien séquencée dans le but de choquer – nous dessert au regard du discours qui est le nôtre depuis longtemps. Sans faire la leçon à quiconque, nous avons toujours essayé de faire le mieux possible avant ce tsunami médiatique qui relève, je le redis, d’une non-conformité – il n’y a pas mort d’homme, ni empoisonnement. L’ensemble de la filière – de l’élevage à l’abattage – n’a pas encore intégré, culturellement parlant, la réglementation de 2009 sur le bien-être animal, mais les choses avancent dans les esprits – avec la formation, la conscientisation. Cet événement à Mauléon fera date et nous conduira certainement à améliorer notre niveau d’excellence.
Actuellement, la législation interdit de filmer directement un salarié sur son poste de travail. Gérard Clemente a un avis, j’en ai un autre : il sera difficile à un opérateur d’officier sous vidéosurveillance permanente, car cela supposerait le zéro défaut, alors que nous sommes dans l’humain. À l’embauche à quatre heures du matin, un abatteur peut être en pleine forme, ou pas ; il peut s’être fâché avec sa femme la veille et ne pas avoir dormi jusqu’à deux heures du matin, etc…
Mme Laurence Abeille. Mais de là à se venger sur des animaux !
M. Michel Etchebest.… mais le directeur n’est pas là pour s’en apercevoir.
Par conséquent, je plaide pour une certification qualité, comme dans l’industrie, intégrant les aspects de bien-être animal, de respect sanitaire, les temps de formation annuelle, la polyvalence, les actions correctives des événements non conformes, etc. Bref, un système qui s’autorégulerait, consistant à écrire ce qu’on va faire et à faire ce qu’on a dit en le démontrant. Je serais prêt à discuter avec la DDPP 64 pour faire de Mauléon un abattoir pilote doté d’une telle certification – car le « bio », le Label Rouge et autres signes officiels de qualité concernent la partie amont, c’est-à-dire l’élevage, et non la partie aval, la transformation. L’installation d’une vidéosurveillance impliquerait pour M. Clemente, ou son successeur à partir du 14 juin, de visionner les images de quatre heures du matin à six heures du soir, heure à laquelle peut se tenir un conseil d’administration, quand ce n’est pas le président qui viendra le voir pour discuter gestion commerciale : le directeur ne pourra pas travailler vingt heures par jour ! Ainsi, la notion de responsabilisation est importante : elle existe, mais tout système humain peut dériver – comme dans n’importe quel système où l’humain est présent. Une machine, cela fonctionne ou cela s’arrête ; l’humain, ce n’est pas pareil.
M. le rapporteur. Vous n’avez pas répondu sur la qualité des outils d’étourdissement. Comment vous assurez-vous, d’abord, de leur conformité, et, ensuite, de leur bon état de fonctionnement, afin d’éviter une panne éventuelle préjudiciable à la qualité de l’étourdissement ?
Je connais des entreprises où, pour limiter les accidents du travail, chaque salarié reporte avant de quitter son poste ce qu’il a vu dans la journée et qui lui paraît important. Pour un accident de chaîne comme celui vu dans la vidéo, on pourrait imaginer que la personne au poste écrive avoir rencontré un souci de telle nature le jour dit. Car la quantification est importante : un accident tous les vingt-cinq ans doit sans doute être corrigé, mais cela est compliqué, alors qu’un accident qui se produit tous les trois jours révèle un problème qui doit impérativement être réglé. De la même manière, la vidéo – dont je comprends les difficultés, mais ce serait au législateur d’en fixer les modalités – a le mérite de permettre, non pas un flicage, mais une quantification des accidents. Quel est votre avis sur ce point ?
M. William Dumas. Votre directeur est partisan de la vidéo. Les personnes auditionnées avant vous ont déclaré que leur personnel était favorable à la vidéosurveillance. Avez-vous discuté de cette possibilité avec votre équipe d’abatteurs ? Si elle était mise en place, sans doute ne devrait-elle pas fonctionner en permanence, mais plutôt par séquences.
Enfin, je vous repose la question : quel est le prix au kilo de l’abattage dans votre établissement ?
Mme Laurence Abeille. Votre remarque sur l’importance de l’humain me choque un peu, car ce type d’établissement accueille d’autres êtres vivants, en l’occurrence des animaux. D’après votre propos – et même si je pense que ce n’est pas ce que vous avez voulu dire –, le fait de se défouler après avoir passé une mauvaise nuit, ou avoir été confronté à des difficultés personnelles, peut expliquer certains débordements ou gestes inadmissibles. On peut comprendre qu’une personne donne un coup de pied dans un mur ou dans une machine ; mais s’en prendre à un être vivant, ce n’est pas la même chose. Dans les réflexions à venir sur les entreprises d’abattage, je pense important de rappeler que les animaux ne sont pas des choses, des objets, que ce sont des êtres vivants, même s’ils vont en ressortir morts, que les abatteurs exercent un travail forcément très violent, qu’ils subissent cette violence, mais que l’on ne peut admettre ou comprendre que cette violence soit rejetée sur les animaux pour des raisons de mal-être personnel. On peut avoir besoin de se défouler dans un métier aussi difficile ; selon moi, cette dimension doit être prise en compte dans les dispositifs de bien-être social que vous évoquez. Certes, ce problème de violence se pose dans d’autres situations, y compris avec des animaux de compagnie qui parfois sont les souffre-douleur de leur maître.
M. Jacques Lamblin. Nous aimerions vraiment avoir la réponse sur le prix…
M. Gérard Clemente. Oui, excusez-moi, quand il y a toute une série de questions, j’arrive à me souvenir des dernières, mais pas forcément des premières…
M. Jacques Lamblin. Comme nous allons certainement auditionner des abattoirs industriels, je voudrais savoir si la dimension du prix met la pression sur la qualité du travail
– pas chez vous, nous l’avons compris, mais plutôt dans les autres établissements.
Concernant la vidéo, l’intérêt n’est pas le visionnage permanent, mais l’enregistrement, c’est-à-dire le fait de détenir des archives à même de fournir des réponses. Si vous aviez disposé d’archives dans cette affaire malheureuse, vous auriez pu prouver qu’aucun accident ne s’est produit pendant plusieurs semaines d’affilée, et vous ne seriez pas dans la situation où vous êtes aujourd’hui.
M. Michel Etchebest. Je n’excuse nullement le fait de se défouler sur les animaux, madame Abeille ; je dis que la dérive existe partout où il y a de l’humain. Si aucun gendarme n’est affecté sur les routes de France aujourd’hui, tous les stops et toutes les lignes continues risquent de ne pas être respectés, et pourtant, on ne met pas un gendarme à tous les stops et même si c’était le cas, certains distinguent entre stops glissés et stops marqués… Bref, la dérive est humaine dans tout processus de production, de matière vivante ou autre.
Ensuite, j’ai dit ma réticence sur la vidéosurveillance. Car il faudrait alors affecter une personne pour visionner tous les films. Faudrait-il vérifier les cinq ou six jours d’abattage ? Ou le faire de temps en temps, mais comment ferez-vous dans la pratique ?
M. Gérard Clemente. Jusque dans les années 2000, les agneaux de lait étaient anesthésiés dans pratiquement tous les abattoirs avec une pince manuelle – ce système était moyennement performant et les animaux n’étaient pas toujours correctement étourdis. À notre niveau, nous avons donc fait installer une chaîne d’agneaux toute neuve, construite et brevetée par une entreprise française et que des Espagnols et des Italiens notamment sont venus voir. J’ai eu à cœur de faire installer cette chaîne pour avoir la garantie d’une anesthésie correcte des agneaux, d’un état de propreté du produit supérieur à celui en processus manuel et, enfin, pour m’assurer du confort social des opérateurs – et certainement pas pour les rendements ou les ratios. Et effectivement, la productivité n’a pas été prise en compte puisque nous tournons à 10 agneaux par abatteur, contre 14 lorsque nous opérions à la main. Ce restrainer amène correctement 80 % des animaux à la pince d’anesthésie ; les 20 % restants doivent être « gérés », mais nos opérateurs savent gérer ce type de situation, en arrêtant la chaîne – encore faut-il le faire.
Nos tarifs sont supérieurs à ceux des abattoirs industriels pour plusieurs raisons : l’économie d’échelle n’existe pas chez nous, les gens sont bien payés, nous n’employons pas de main-d’œuvre étrangère, et tous nos clients – nos partenaires, devrais-je dire – sont d’accord pour payer ce prix. Les éleveurs sont peu nombreux en France à pouvoir se targuer d’avoir un établissement spécialisé dans l’abattage, la découpe et le conditionnement à moins de dix minutes de chez soi. Nous avons un gros client depuis une dizaine d’années, satisfait de la qualité de notre travail après avoir traité avec d’autres abattoirs, et capable de nous payer un peu plus qu’un abattoir industriel. Notre prix est fonction du volume – il n’est pas le même pour un éleveur qui amène un veau et pour un chevillard avec 80 vaches, par exemple. Pour le bovin, le prix est de 33 à 40 centimes le kilo, soit 200 euros pour une bête de 500 kg ; pour un agneau de lait, qui ne fait que 7 kg en poids carcasse, le prix va de 1 euro à 1,70 euro. Ce tarif inclut des taxes d’État et les taxes afférentes à l’équarrissage – 55 % des produits partent à l’équarrissage.
M. Jacques Lamblin. Vos prix sont très corrects.
M. Gérard Clemente. Tout dépend de l’activité des abattoirs, car plusieurs éléments ont une incidence sur le prix : la valorisation du cinquième quartier, le salage du cuir, la mise en palettes, le transport, etc.
M. le président Olivier Falorni. Avez-vous parlé avec vos agents de la vidéosurveillance ?
M. Gérard Clemente. J’en ai parlé le lendemain en posant trois questions. Aux intéressés, d’abord, pour savoir si ces pratiques étaient fréquentes et pourquoi ils avaient fait cela. Aux autres agents qui officient à ces postes, ensuite, pour savoir s’ils avaient eux-mêmes ce type de comportement… Ah pardon, je croyais que vous m’aviez posé la question de savoir si j’avais parlé de la vidéo diffusée sur Internet !
M. le président Olivier Falorni. Certes, mais nous sommes très intéressés par les réponses que vous avez obtenues à ces trois questions !
M. Gérard Clemente. L’intéressé concerné par les coups m’a répondu : « Je me suis énervé ». Les autres ont dit : « Non, nous n’avons pas fait ça ».
M. Michel Etchebest. L’équipe incriminée par la vidéo a reconnu les faits. Les abatteurs de l’autre équipe, absente cette semaine-là, ont déclaré n’avoir jamais commis de telles pratiques – ceux-là ont davantage d’ancienneté chez nous.
M. le président Olivier Falorni. Pour finir, avez-vous évoqué avec les agents la possibilité d’installer une vidéosurveillance dans votre abattoir ?
M. Gérard Clemente. Non, car l’abattoir est fermé. Je n’ai pas revu mes collègues : ils travaillent dans les abattoirs voisins, à Oloron et à Saint-Jean-Pied-de-Port, car l’activité de découpe et de conditionnement est maintenue.
M. Michel Etchebest. Un accident chirurgical ou un accident d’anesthésie n’entraîne pas la fermeture d’un hôpital. Dans notre cas, il n’y a eu ni accident sanitaire, ni tromperie, ni empoisonnement ; c’est un problème de non-conformité dans une procédure, qu’il est possible de corriger, et le procureur définira les fautes éventuelles. Je ne comprends donc pas la fermeture notre abattoir. J’avais suspendu l’activité pour démontrer notre bonne foi. Mais cela fait maintenant trente jours que notre établissement est fermé et nos clients sont en train de prendre leurs habitudes ailleurs. Nous avons apporté à la DDPP l’ensemble des garanties nécessaires pour les quelques ajustements demandés pendant la fermeture – mise à jour des registres, installation de la vitre, etc. Le ministère de l’agriculture et la préfecture ne peuvent pas se déplacer chez nous avant le 17 ou le 19 mai, car la Direction générale de l’alimentation doit statuer auparavant. J’espère que mes propos seront entendus. Il faudrait que cette inspection de réouverture ait lieu le plus rapidement possible, faute de quoi, notre outil se retrouvera en grand danger, ainsi que toute la filière, mais aussi la communauté de communes – elle est caution de l’ensemble des prêts de l’abattoir – même si celui-ci est en bonne santé actuellement. On va mettre tout le monde à genoux, à commencer par notre abattoir.
M. le président Olivier Falorni. Le message est passé. Monsieur le maire, monsieur le directeur, merci de votre présence.
La séance est levée à treize heures.
——fpfp——
5. Audition, ouverte à la presse, de M. Patrick Dehaumont, directeur général de l’alimentation, de Mme Emmanuelle Soubeyran, cheffe du service de l’alimentation, de Mme Sylvie Vareille, adjointe de la sous-directrice de la sécurité sanitaire des aliments et de M. Jérôme Languille, chef du bureau de la protection animale à la Direction générale de l’alimentation (DGAL).
(Séance du mercredi 4 mai 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente.
M. le président Olivier Falorni. Nous poursuivons nos travaux sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, en accueillant M. Patrick Dehaumont, Directeur général de l’alimentation, Mme Emmanuelle Soubeyran, cheffe du service de l’alimentation, Mme Sylvie Vareille, adjointe de la sous-directrice de la sécurité sanitaire des aliments et M. Jérôme Languille, chef du bureau de la protection animale à la Direction générale de l’alimentation (DGAL).
À la suite du scandale déclenché par les vidéos clandestines diffusées par l’association L214, que nous avons auditionnée, ainsi que l’association OABA et les responsables des trois abattoirs concernés – Alès, Le Vigan et Mauléon-Licharre –, nous souhaitons aujourd’hui faire le point avec vous, mesdames, messieurs.
Avant de vous donner la parole, je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et qu’elles sont diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. En outre, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Patrick Dehaumont, Mme Emmanuelle Soubeyran, Mme Sylvie Vareille
et M. Jérôme Languille prêtent successivement serment.)
M. Patrick Dehaumont, Directeur général de l’alimentation. Au titre du programme 206, « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation », la Direction générale de l’alimentation est chargée d’une mission de sécurité sanitaire assez large, qui englobe la santé végétale, la santé animale et la protection animale, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments. Conformément à cette mission régalienne de sécurité, présentée régulièrement comme une priorité gouvernementale, il nous revient d’établir la règle en matière sanitaire et de protection animale et de nous assurer, par notre action sur le terrain, qu’elle est bien appliquée.
Notre action en matière de sécurité sanitaire et de protection animale est encadrée par un corpus réglementaire harmonisé à l’échelle européenne. Notre travail d’inspection revêt un caractère très technique, ce qui suppose de disposer d’agents formés à certaines techniques et d’être présents sur le terrain au quotidien, dans le cadre d’une chaîne de commande qui part de l’autorité ministérielle et descend, via les préfets de région et de département, jusqu’aux services vétérinaires d’inspection amenés à intervenir dans les abattoirs. Pour mener ces inspections, notre préoccupation constante est de nous inscrire dans une approche intégrée de l’ensemble de la chaîne – alimentation et animaux vivants.
Dans tous les domaines de sécurité sanitaire et de protection animale, le premier responsable des actes, qu’ils soient réalisés dans un établissement, dans un élevage ou pendant le transport, est de manière constante le professionnel – en l’occurrence, dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, le responsable de l’établissement d’abattage.
Concernant les abattoirs, donc, les inspections reposent sur deux grands principes généraux. Premièrement les professionnels ont la charge d’autocontrôle, en mettant en place un certain nombre de procédures. Deuxièmement, les services officiels réalisent des contrôles de différentes natures, proportionnés aux risques et aux moyens disponibles.
Les conditions des inspections en abattoirs peuvent être classées en deux grandes catégories. Il y a d’abord ce qui relève de l’inspection systématique, réalisée ante mortem, puis tout au long de la préparation de la carcasse et des viandes, au travers d’une série de gestes codifiés qui aboutissent soit à l’apposition d’une estampille sur la carcasse signifiant qu’elle est apte à la consommation humaine, soit au retrait de tout ou partie de la carcasse ou des abats en cas de risque pour la santé humaine. Ce à quoi vient s’ajouter une inspection continue, autrement dit des opérations de contrôle régulières au niveau de l’établissement et qui portent sur un certain nombre d’éléments, notamment, en matière de protection animale, le poste d’abattage, l’hygiène de l’établissement, les protocoles de nettoyage et de désinfection, les protocoles d’autocontrôle, la compétence des agents des abattoirs.
Il existe en France 263 abattoirs d’animaux de boucherie – 96 publics et 167 privés –, qui procèdent chaque année à l’abattage d’environ 32 millions d’animaux.
Au titre du programme 206, la DGAL dispose de 200 équivalents temps plein travaillé (ETPT) au niveau central et de 4 700 ETPT au niveau national pour l’ensemble des inspections sur le terrain. Sur ces effectifs, 30 % sont dédiés aux inspections en abattoirs, dans le cadre d’une règle d’allocation de moyens qui évalue la proportion du risque. En matière d’abattage des animaux de boucherie, l’inspection étant systématique, nous prenons en compte plusieurs paramètres pour allouer ces moyens, dont le nombre de chaînes en exercice, la cadence sur ces chaînes, l’amplitude horaire, etc. Ainsi, l’allocation de moyens humains dans les abattoirs prend en compte l’inspection systématique réalisée dans la phase ante mortem et la phase post mortem sur les carcasses, et l’inspection régulière réalisée en fonction des paramètres que j’ai cités plus haut – protection animale au poste d’abattage, traçabilité, nettoyage et désinfection, etc.
Nos effectifs dédiés aux inspections en abattoir sont donc importants : ces 30 % représentent 1 200 ETPT, soit à peu près 2 000 agents. Ces agents sont des vétérinaires officiels ou des « auxiliaires officiels » – c’est le terme européen –, autrement dit des techniciens. Nous faisons bénéficier nos agents d’une formation initiale et d’une formation continue, et nous procédons à des vérifications de compétences. Cette année, et au vu des événements récents, nous prévoyons de renforcer la formation ainsi que le maintien de la compétence de nos agents, notamment en matière de protection animale.
Je suis extrêmement attentif à ce que cette mission régalienne s’exerce avec la compétence et l’impartialité nécessaires, et que, en cas d’anomalies constatées dans le cadre de nos inspections, des suites proportionnées soient systématiquement données, qu’elles soient administratives ou judiciaires ; l’année 2015 a du reste été pour nous l’occasion de réviser un certain nombre de procédures en la matière.
Dans le domaine de la protection animale comme dans le domaine sanitaire, le premier responsable, je le répète, est le professionnel amené à manipuler des animaux vivants puis à mettre des produits sur le marché. Il est de ce fait soumis à plusieurs obligations, notamment pour les opérations d’abattage. En la matière, les dispositifs relèvent d’une réglementation communautaire qui prévoit que ces professionnels doivent disposer des compétences nécessaires et assurer les autocontrôles des opérations d’abattage.
La protection animale en abattoir ne doit pas être le seul sujet à retenir notre intérêt. Nous travaillons en effet, depuis 2014, à la demande du ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll, à une stratégie globale française pour le bien-être des animaux en France. Le plan d’actions prioritaires présentées à l’occasion du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) de mars, permettra à la France de se doter d’une stratégie globale ambitieuse en matière de bien-être animal, en déclinant plusieurs axes : recherche et développement, formation, accompagnement des acteurs, lutte contre les mauvais traitements et la cruauté, information des citoyens. Parmi les leviers prioritaires de ce plan d’actions, figure la mise en place dès cette année d’un centre national de référence sur le bien-être animal, ainsi que des efforts en matière de recherche sur la protection animale, en particulier sur le sexage des embryons dans l’œuf pour éviter le broyage des poussins – sujet qui avait lui aussi, à juste titre, défrayé la chronique.
M. le président Olivier Falorni. Cette commission d’enquête a été créée à la suite de la diffusion par l’association L214 de vidéos tournées dans trois abattoirs. Avez-vous été surpris par ces vidéos ?
Quelles sont vos relations avec les associations de défense des droits des animaux et de protection animale – je pense en particulier à l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), engagée sur le sujet depuis 1961 ?
Dans une note de service datée du 31 mai 2012, vous avez rappelé que « seul l’exploitant d’un abattoir peut autoriser l’accès à son établissement de personnes qui n’y sont pas spécialement habilitées par la loi. » Certes, c’est un rappel ; mais l’OABA, qui avait engagé un travail important, a senti dans cette note une volonté de fermeture. Pour notre part, nous avons décidé collectivement de procéder à des visites inopinées d’abattoirs : je n’imagine pas qu’un directeur puisse nous en refuser l’entrée… Sachez en tout cas que je veillerai donc à ce que les membres de cette commission d’enquête puissent accéder aux abattoirs que nous aurons choisis pour voir ce qui s’y passe.
Vos agents sont-ils en mesure d’agir de façon inopinée dans des abattoirs, à la suite d’une dénonciation ?
Enfin, que pensez-vous de la vidéosurveillance dans les abattoirs, d’une part, et des abattoirs mobiles, qui existent dans certains pays, d’autre part ?
Mme Françoise Dubois. À côté du bien-être animal, il y a le bien-être humain. Certes, la formation technique est indispensable. Mais existe-t-il un suivi psychologique des professionnels de l’abattage compte tenu de leurs conditions de travail – égorger une bête n’est pas forcément agréable, a fortiori si on le fait toute la journée ?
Mme Geneviève Gaillard. Dans une fiche emploi-métier de Pôle emploi intitulée « abattage et découpe de viandes », je lis que le métier consiste à « réaliser les opérations d’abattage d’animaux et de découpe de viandes », et qu’il est « accessible sans diplôme ni expérience professionnelle ». Or pour m’être rendue plusieurs fois dans des abattoirs, je peux vous dire que ce travail est loin d’être simple, y compris sur le plan psychologique. Vous avez parlé de formation initiale et de formation permanente. Dans ses annonces, Pôle emploi ne devrait-il pas prévoir une formation ?
La dimension psychologique est réelle, comme l’a montré Stéphane Geffroy dans son livre « À l’abattoir » où il décrit crûment les difficultés qu’il a rencontrées en tant qu’ouvrier à l’abattoir de Liffré, en Bretagne. Ce sujet devrait donc être abordé.
Disposez-vous d’informations qui laisseraient entendre qu’une ou d’autres vidéos seront bientôt diffusées ? Des rumeurs parviennent à nos oreilles, même si ce n’est pas dit clairement.
Enfin, quand on parle d’abattage, il faut parler de tous les abattages. Des directives européennes, transposées dans le droit français, rappellent l’interdiction de l’abattage des animaux conscients. Or nous avons en France un abattage rituel, qui fait l’objet d’une dérogation dans le code rural. La formation des sacrificateurs est indispensable. Certains pays ont renoncé à l’abattage sans étourdissement, sans que cela ne pose problème. Combien d’animaux sont tués selon l’abattage rituel chaque année en France ? Combien cela représente-t-il de tonnes de viande, et dans ce volume, quelle est la part destinée à être exportée et celle destinée à la consommation nationale ? Enfin, quelles sont vos relations avec les responsables des cultes à ce sujet ?
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Vous avez évoqué la formation des professionnels au poste d’abattage, qui pourrait être renforcée dans le cadre du plan d’actions de la stratégie globale pour le bien-être animal. Or depuis le début de nos auditions, nous avons l’impression que, si les contrôles liés à la santé du consommateur sont systématiques, la phase entre les éléments ante mortem et la carcasse fait l’objet d’un regard insuffisamment intense… Est-il selon vous nécessaire de renforcer l’agrément spécifique pour tenir le poste d’abattage ? Que pensez-vous de l’obligation d’une rotation sur ce poste ?
Les représentants des abattoirs concernés par les vidéos nous ont indiqué que les sacrificateurs sont des personnels extérieurs à l’établissement. Cela vous paraît-il normal au regard des compétences requises pour ce métier, a fortiori dans un abattoir public ? Dans un des abattoirs concernés, un sacrificateur remplaçant aurait causé quelques soucis. Et dès lors qu’ils n’ont pas de lien avec l’établissement, comment les sacrificateurs sont-ils rémunérés ?
Dans la formation du prix de la viande, quelle est la part de l’abattage ? Ce point est important pour savoir si l’on peut améliorer les choses sans trop porter atteinte au pouvoir d’achat des consommateurs.
Que pensez-vous d’une démarche de certification ? Qui devrait en supporter le coût ? Comment doit-il être réparti dans la chaîne de valeur ?
Comment jugez-vous le rôle des référents bien-être animal dans les abattoirs ? Sont-ils des lanceurs d’alerte, peuvent-ils l’être, doivent-ils le devenir ? Pour ma part, j’en doute : il est difficile d’avoir en même temps un regard interne et un regard externe quand on appartient à une structure.
Enfin, sur les conditions d’abattage, avec ou sans étourdissement, que pensez-vous d’un droit de regard des éleveurs et/ou des distributeurs ? Autrement dit, les éleveurs sont-ils légitimes à demander que leurs animaux soient bien traités, quand bien même ils en ont cédé la propriété, et les distributeurs à obtenir des garanties sur la viande qu’ils vont commercialiser ?
M. Patrick Dehaumont. Oui, j’ai été surpris par les vidéos tournées dans les trois abattoirs : elles montrent des pratiques inacceptables que je condamne sans aucune ambiguïté.
M. le président Olivier Falorni. Est-ce à dire que vous n’aviez jamais vu de telles pratiques dans votre carrière ?
M. Patrick Dehaumont. Non. Et pourtant, j’ai été en situation d’inspection en abattoirs. Mais lorsque l’inspecteur se rend au poste d’abattage, certaines des pratiques observées sur les vidéos n’ont évidemment pas lieu en sa présence…
M. le président Olivier Falorni. D’où ma question sur la vidéosurveillance.
M. Patrick Dehaumont. Pour ce qui est de nos relations avec les associations, elles me paraissent bonnes. Du reste, un certain nombre d’associations de protection animale, dont l’OABA, sont parties prenantes du CNOPSAV, au cours duquel sont abordées les questions de bien-être animal. Le travail avec les associations est donc constructif. La note de service du 31 mai 2012 visait à répondre à des questionnements de professionnels de l’abattage face à des membres de l’OABA qui se prévalaient du droit d’entrer dans les établissements sous couvert des services officiels. J’ai donc indiqué dans cette note que les agents de la DGAL ont un droit d’accès dans les abattoirs – y compris de manière inopinée, et nous ne nous en privons pas –, mais que je n’ai pas la capacité juridique de permettre à d’autres acteurs d’entrer dans les abattoirs, qui sont des lieux privés. Cette mise au point ne remet nullement en cause l’action de l’OABA, qui réalise un travail extrêmement efficace dans les abattoirs depuis des décennies. D’ailleurs, lors du dernier CNOPSAV, nous avons rappelé, et le ministre l’a également souligné, que nous sommes très favorables à des conventionnements entre les professionnels de l’abattage et des associations comme l’OABA pour assurer plus de transparence, renforcer la vigilance et sensibiliser les différents acteurs. Ainsi, je ne voudrais surtout pas qu’il soit dit que les relations avec l’OABA sont mauvaises, car ce n’est absolument pas le cas.
J’en viens à la question sur nos accès inopinés. Non seulement les agents en inspection au sein de l’abattoir ont le droit de s’y déplacer librement, mais les personnels de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ont également accès à l’établissement. Je dispose également d’une brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) ; sa directrice sera auditionnée par votre commission d’enquête, me semble-t-il. Ainsi, nous sommes habitués sur différents sujets à réaliser des contrôles inopinés, y compris avec l’aide de la force publique puisque la BNEVP intervient assez souvent dans un cadre judiciaire. Il est essentiel que notre capacité à opérer des contrôles inopinés soit maintenue.
La vidéosurveillance renvoie à plusieurs aspects. En termes techniques, elle présente un intérêt évident, car elle garantirait une surveillance, mais aussi une plus grande vigilance – on peut imaginer un effet « pédagogique » vis-à-vis des personnels qui se sauraient regardés. Sur le plan juridique, la vidéosurveillance dans les abattoirs nécessiterait une modification législative, car cette pratique est actuellement autorisée pour des raisons de sécurité uniquement – elle est interdite pour surveiller un poste de travail. Enfin, en termes d’exploitation, la question se pose de savoir comment les images seront exploitées par le responsable de l’abattoir et les services officiels. Faudrait-il procéder par sondages ? En résumé, la piste de la vidéosurveillance mérite d’être examinée, mais à l’aune des conditions à la fois juridiques et techniques d’exploitation des données : même avec un encadrement juridique adéquat, si l’on ne se donne pas les moyens de visionner tout ou partie des images, cela se saura très vite et le risque de dérapages reviendra.
Qu’ils soient mobiles ou pas, tous les abattoirs doivent être soumis aux mêmes règles. Autrement dit, les installations d’immobilisation et les outils utilisés pour la perte de conscience ne doivent pas générer de stress et de souffrances chez les animaux.
M. le président Olivier Falorni. Dans certains pays d’Europe du Nord, les abattoirs mobiles sont une référence en termes de bien-être animal. Que pensez-vous d’un développement des abattoirs mobiles en France, même si cela ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des besoins en termes d’abattage ?
M. Patrick Dehaumont. Le gros avantage de l’abattoir mobile tient au fait qu’il permet une meilleure occupation du territoire. En effet, le transport sur une longue distance des animaux, éventuellement blessés, vers l’abattoir est une difficulté. D’ailleurs, avant la diffusion des vidéos, un procès-verbal a été dressé à l’encontre d’un des abattoirs visés, car un animal dont les membres étaient brisés, au lieu d’être abattu sur place, avait été transporté sur une longue distance vers l’établissement. Ainsi, l’abattoir mobile peut répondre à certains cas de figure, mais pas en termes de capacité. Ce type de structure peut également présenter un intérêt dans la lutte contre certaines maladies animales : à cause de l’influenza aviaire dans le Sud-Ouest, il a fallu dans certains cas abattre les animaux dans les abattoirs, mais dans d’autres cas, nous avons dû abattre sur place par l’intermédiaire d’une société spécialisée qui intervient dans le cadre de nos plans d’urgence. Il aurait pu être intéressant de disposer d’un abattoir mobile. Cela n’a pas eu de conséquence en termes de protection animale, mais tous les produits ont été détruits, puisqu’il s’agissait non d’un abattage en abattoir, mais d’une euthanasie des animaux.
M. le rapporteur. L’abattoir mobile est intéressant en termes de transport, facteur de stress et de souffrances chez les animaux, a fortiori en cas de petits élevages très éloignés des abattoirs. Ce type de structure serait également intéressant en termes de contrôle par l’éleveur, qui pourrait être présent lors de l’opération, au lieu de faire 200 kilomètres pour voir ce qui se passe.
M. Patrick Dehaumont. Il faudrait alors prendre en considération la capacité de l’État à inspecter au coup par coup ce genre d’établissement. Il faudrait également se préoccuper des règles sanitaires et environnementales, car l’abattage produit notamment du sang – un certain nombre d’aspects techniques ne sont pas simples à gérer. D’ailleurs, le plan d’actions de la stratégie globale en matière de bien-être animal comporte une action visant à regarder les pratiques des autres pays européens. On sait en effet que certains pays d’Europe du Nord, comme l’Allemagne, utilisent ce genre d’outils dans certains cas de figure.
La question du bien-être humain est importante. Le métier d’abatteur est extrêmement difficile ; or rien n’est organisé en termes de suivi psychologique. Ces opérations d’abattage ne sont pas une sinécure, cela est compréhensible, mais il arrive un moment où les personnels se « distancient » – ils ne réalisent plus totalement ce qu’ils sont en train de faire. C’est une réaction tout à fait humaine.
Mme Françoise Dubois. Dans l’immédiat, il ne faut donc pas accabler ces professionnels.
M. Patrick Dehaumont. Absolument. Il est important que chacun assume sa responsabilité à son niveau : il faut que l’agent soit formé, que le responsable de l’abattoir encadre ses agents, que les services de l’État jouent leur rôle. Il faut remettre tout cela bien au clair.
Quand je parlais de formation, madame Gaillard, il s’agissait de celle de nos agents à la DGAL, et non de celle des personnels des abattoirs. Il y a une hiérarchie dans les formations de nos agents : formation initiale, formation continue, formations spécifiques d’aptitude à l’emploi et formations régulières. Je précise que nous avons mis en chantier une formation de formateur, notamment dans le domaine de la protection animale. Les agents ne viennent pas forcément auprès des formateurs ; il nous arrive d’envoyer les formateurs sur place, en regroupant les personnels de deux ou trois sites, pour assurer à la fois la remise à niveau théorique et la remise à niveau pratique, dans l’abattoir où nos agents sont amenés à intervenir.
S’agissant des personnels d’abattoirs, il n’existe en effet pas a priori de diplôme ou de compétence particulière. Par contre, conformément au règlement de 2009, il revient au responsable de l’abattoir de s’assurer que son personnel est formé techniquement – car ce geste n’est pas inné –, mais aussi qu’il est formé à la problématique de la souffrance animale. Tous les personnels impliqués dans l’abattage doivent faire l’objet d’une formation spécifique, avec des modules différents selon que l’on est abatteur ou responsable protection animale (RPA), et selon l’activité de l’établissement – type d’abattoir, espèces concernées. Cette qualification est valable cinq ans, ce qui permet une montée en puissance progressive de la compétence de ces personnels. Cela étant dit, madame la députée, la formation concerne tout le monde, autant les services de l’État que les services de l’abattoir.
Pour ce qui est de la dimension psychologique, il faut effectivement réfléchir à la façon de mieux la prendre en compte. Une solution serait de faire tourner les personnes sur des postes différents. Cela vaut pour les personnels d’abattoir, mais aussi pour les personnels d’inspection, qui doivent garder une certaine distance par rapport aux acteurs de l’abattoir, en étant capables d’arrêter une chaîne, de dresser un procès-verbal, de prendre des mesures administratives. Ainsi, au-delà de l’attention portée à la formation et au risque de perte d’impartialité, nous réfléchissons à la mobilité obligatoire des agents, dont la mise en œuvre s’avère complexe et difficile sur le plan humain. En outre, nous essayons de développer les postes mixtes où les agents exercent aussi bien des tâches en abattoirs que des tâches d’inspection sur le terrain – contrôles d’élevages, de restaurants –, afin de maintenir à la fois la compétence, la distanciation et l’impartialité dans le cadre du contrôle officiel.
Selon les chiffres pour 2014, 15 % des bovins et 27 % des ovins sont concernés par l’abattage rituel. L’abattage rituel s’exerce dans le cadre d’un décret de 2011 qui prévoit un agrément du préfet, une formation et une habilitation du sacrificateur, la conformité du matériel d’immobilisation des animaux, et la réalité des commandes – un établissement ne doit pas, par souci de simplification, abattre tous les animaux en rituel et ne vendre que 10 % de sa production en rituel.
M. le président Olivier Falorni. Bien évidemment, ce genre de situation n’existe pas.
M. Patrick Dehaumont. Je ne peux vous dire si cela existe ou pas : c’est aux services d’inspection sur le terrain de le vérifier.
M. le président Olivier Falorni. Avez-vous été amené à constater ce genre de situation ?
M. Patrick Dehaumont. En 2012, nous avons constaté une dérive dans certains abattoirs qui avaient augmenté leur tonnage en abattage rituel pour s’assurer de disposer d’une quantité suffisante de marchandises. Un rappel à l’ordre a été fait et les choses ont été remises dans les clous. Mais d’une façon générale, je n’ai pas connaissance d’une dérive en la matière.
Mme Geneviève Gaillard. À cette époque, une interview par une grande journaliste sur France Inter avait révélé que, pour des raisons économiques, il était plus facile d’abattre en casher ou en halal que d’abattre sur une chaîne normale. Quid de l’organisation des chaînes ? Y a-t-il des abus, car on sait qu’il faut aller de plus en plus vite, avec quelquefois de l’abattage casher ou halal, d’autres fois de l’abattage normal. Et quid du financement ? Car on sait très bien qu’il y a une taxe casher ou une taxe halal.
M. Patrick Dehaumont. Les cadences peuvent-elles inciter à faire plus de rituel ? Je n’ai pas la réponse. Il y a peut-être une tentation. Cela étant dit, les services d’inspection se font remettre par les responsables d’abattoir les plannings d’abattage d’une semaine sur l’autre, ce qui permet de vérifier l’absence de dérives. Les chiffres que je viens de vous citer pour l’année 2014 me semblent assez stables par rapport aux années précédentes.
Mme Geneviève Gaillard. Des animaux qui ne sont pas destinés à la consommation française sont abattus sans étourdissement en France, ce qui peut aussi nous interroger. J’aimerais avoir les chiffres sur l’exportation.
M. Patrick Dehaumont. Sur l’export, nous pourrons vous fournir des chiffres ultérieurement.
La dérive potentielle que vous évoquez en matière de rituel, outre le fait que nous manquons de données objectives pour la mesurer, n’avait concerné en 2012 que quelques abattoirs dans lesquels l’abattage sans étourdissement avait été retenu comme une solution de facilité. Sur le plan économique en revanche, elle n’était pas intéressante, car la chaîne va moins vite dans ce cas-là.
M. le président Olivier Falorni. Nous nous interrogeons en effet sur les cadences.
M. Patrick Dehaumont. Un gros abattoir de bovins qui tourne à 65-70 à l’heure, ce qui est très élevé pour un établissement de ce type, n’a pas intérêt à augmenter son abattage rituel.
M. le président Olivier Falorni. Quel est le différentiel de vitesse entre rituel et conventionnel ?
M. Jérôme Languille, chef du bureau de la protection animale. La cadence sur une chaîne de bovins est forcément moins élevée en rituel qu’en conventionnel, vu le temps de saignée et d’attente avant l’habillage. Sans avoir de chiffres précis à vous donner, je ne pense donc pas qu’on ait pu démontrer que l’abattage de bovins en rituel peut entraîner des gains en termes de cadences.
Mme Geneviève Gaillard. Cela n’a pas été démontré, mais c’est ce que j’ai entendu dans l’interview.
M. Patrick Dehaumont. J’en viens aux relations avec les responsables des cultes. L’abattage rituel s’inscrit dans le cadre du droit d’exercice du culte, auquel font référence la Cour de Justice européenne et la Constitution. Par conséquent, d’une part, il est possible de déroger à l’abattage avec assommage dès lors que la réglementation européenne l’admet. D’autre part, nos relations avec les cultes s’exercent en lien avec le ministère de l’intérieur, l’objectif étant que les cultes puissent s’exercer conformément à la Constitution et que l’abattage rituel soit pratiqué dans le respect du décret de 2011 qui définit les règles applicables en la matière.
L’inspection systématique intervient, comme je l’ai expliqué, avant et après le poste d’abattage. Pour l’heure, à cet endroit précis, seul un contrôle par sondages est réalisé, ce qui renvoie à la responsabilité du professionnel. Il est essentiel que ce contrôle par sondages soit réalisé régulièrement et fasse l’objet de suites administratives ou judiciaires en cas d’anomalies. Bien évidemment, il faut veiller à renforcer la formation des personnels d’abattoir, mais également à rappeler au directeur ses obligations. Faut-il renforcer l’agrément spécifique sur ce poste ? Je pense qu’un effort de formation et de responsabilisation de chacun des acteurs est indispensable. Faut-il mettre un contrôleur derrière chaque acteur ? Je n’en suis pas sûr. Comme je l’ai dit, notre allocation de moyens est fonction des moyens disponibles, d’une part, et des missions obligatoires, d’autre part – nous sommes dans un cadre contraint.
Sur la formation du prix de la viande, je suis incapable de vous répondre. Mais nous pourrons vous fournir des éléments ultérieurement.
Les responsables de la protection animale, qui dépendent des abattoirs, peuvent-ils être des lanceurs d’alerte ? Ces personnels sont-ils suffisamment indépendants ? Il s’agit là d’un sujet difficile, mais nous devons travailler dans ce sens. Les personnels de base et les RPA doivent pouvoir lancer l’alerte, le directeur de l’abattoir doit exercer le contrôle sur ses personnels, et les inspecteurs doivent évidemment essayer de contrôler autant que faire se peut. Il faut garantir la protection des personnels qui peuvent, qui doivent alerter sur ces sujets. À l’issue du CNOPSAV de mars, le ministre avait annoncé un travail sur le renforcement des sanctions : ce travail est en cours avec le service des affaires juridiques, l’idée étant que toute la chaîne de décision au sein de l’abattoir – du directeur aux abatteurs – puisse être concernée par une mise en responsabilité. Pour l’instant, non seulement il faut prouver l’acte délictuel, mais la poursuite sur l’ensemble de la chaîne hiérarchique n’est pas possible. La protection assortie d’une sanction potentielle serait de nature, me semble-t-il, à permettre au RPA d’alerter en cas d’éléments anormaux.
Enfin, sur le droit de regard des éleveurs et des distributeurs, je ne sais pas comment cela pourrait être organisé, mais il est évidemment nécessaire d’apporter une garantie aux acteurs de l’amont et de l’aval : un éleveur n’a pas envie de voir maltraiter les animaux qu’il a élevés pendant des années, et un distributeur se doit d’offrir à son client des produits obtenus dans de bonnes conditions. La certification peut-elle répondre à cette double exigence ? Je ne le crois pas. Il y a une réglementation, qui doit être appliquée avec rigueur : les responsables d’abattoirs doivent être mobilisés sur le sujet, et nos services eux-mêmes doivent être mobilisés pour donner des suites, y compris pénales, aux affaires, ce qui suppose pour la justice de prononcer des sanctions exemplaires lorsque des infractions sont constatées. Cette piste me paraît préférable ; la certification, délivrée par un organisme extérieur qui de toute façon sera financé par l’abatteur, ne me paraît pas un outil vraiment opérationnel capable d’assurer un meilleur niveau de protection animale.
Mme Laurence Abeille. Je souhaite également que les chiffres qui vous ont été demandés nous soient communiqués, en particulier sur l’exportation.
Vous parlez de 263 abattoirs, mais il en existe 800 au total en France si on inclut l’abattage des volailles. Existe-t-il des différences entre les types d’abattoirs en matière de contrôles et, si oui, lesquelles ? Vos moyens de contrôle sont-ils suffisants pour assurer partout des conditions d’abattage dignes, respectueuses du bien-être animal ?
Des témoignages ont montré qu’il existe des points de vue différents sur la question de l’étourdissement – les animaux ont des réflexes ou différents comportements, alors même qu’ils ne sont plus conscients. Sur ce point, qu’en est-il de la compétence des personnels de contrôle ? Quant à celle des abatteurs, une formation est assurée par l’abattoir, mais il n’existe pas de formation spécifique à ce métier. Pensez-vous qu’une formation spécifique soit nécessaire ? Vos inspecteurs sont-ils formés sur l’abattage rituel ?
Quels contrôles assurez-vous concernant le transport des animaux ? Ces contrôles sont-ils suffisants ? Avez-vous eu connaissance de cas d’animaux arrivés morts à l’abattoir et qui auraient été traités comme les autres ?
Vous dites avoir été surpris par les vidéos. J’imagine que les personnels qui inspectent les abattoirs vous font remonter des informations. Avez-vous été alertés par des agents de vos services sur des faits de maltraitance ou sur des cas d’animaux arrivés morts à l’abattoir ?
L’un des directeurs d’abattoir auditionnés a expliqué que l’inspection portait essentiellement sur les documents administratifs. Que vérifient exactement vos agents ? On a le sentiment que l’inspection en termes de bien-être animal reste pour l’essentiel subordonnée aux aspects sanitaires. La question du bien-être animal est-elle réellement prise en compte, ou êtes-vous plutôt dans l’intention ?
Enfin, sur la vidéosurveillance, on pourrait considérer qu’il ne s’agirait pas de surveiller seulement les salariés, mais qu’elle permettrait aussi de regarder ce qui se passe pour les animaux. La surveillance permettrait de s’assurer qu’ils sont traités dans les meilleures conditions possibles, ce qui nécessiterait des critères réévalués et partagés entre les responsables des abattoirs et les agents de contrôle.
M. Jacques Lamblin. Monsieur le directeur général, votre propos liminaire nous fait comprendre implicitement que la priorité accordée à l’aspect sanitaire – sur lequel la France est irréprochable – laisse peu de moyens à l’autre volet de l’inspection, la protection animale. Vous avez fait état de 1 200 EPTP pour 263 abattoirs ; cela ne fait que 4 ou 5 inspecteurs par abattoir. Ce n’est pas beaucoup, surtout si l’on y ajoute les abattoirs de volaille… Au vu des moyens trop faibles et de certains services imparfaitement rendus – en l’occurrence la protection animale –, une des solutions qui vient à l’esprit serait de renforcer l’efficacité des contrôles par des moyens supplémentaires, dont le vidéo-contrôle – on peut utiliser ce terme si le mot « vidéosurveillance » fait peur. Un tel contrôle ne porterait pas seulement sur le travail effectué par les personnels des abattoirs – ce ne serait donc pas du flicage ; il pourrait également porter sur l’efficacité du matériel, autrement dit sur les éventuels dysfonctionnements des outils de contention et d’étourdissement des animaux. Une telle procédure ne me paraîtrait pas illégitime. Pourquoi n’avoir jamais envisagé le vidéo-contrôle pour améliorer, à moyens humains constants, la qualité du contrôle, dont l’insuffisance, pour ce qui touche à la protection animale, est avérée depuis déjà un certain temps ?
Nos auditions précédentes, en particulier celles des responsables des abattoirs concernés par les vidéos, ont montré que les pratiques incriminées par l’association L214 relèvent soit de fautes commises par le personnel – autrement dit, de troubles du comportement –, soit de dysfonctionnements ou de mauvais usages du matériel d’étourdissement : des animaux ont été mal étourdis et les abatteurs n’ont pas pris les mesures correctives nécessaires. Le vidéo-contrôle présente-t-il un intérêt pour éviter ces dérives comportementales ?
Enfin, certains témoins auditionnés nous ont rapporté des scènes quelquefois insoutenables lors d’abattages sans étourdissement, en particulier après des égorgements de bovins. Or un jour ou l’autre, ces scènes insoutenables se reproduiront, et probablement sous l’œil d’une caméra. Pour régler en France ce problème du respect des animaux dans les abattoirs, l’étourdissement obligatoire est-il une solution souhaitable, incontournable – ou pas ?
M. William Dumas. Deux des abattoirs visés par les vidéos sont dans ma circonscription : celui du Vigan ne pratique pas l’abattage rituel, et avec un volume de 300 tonnes de viandes par an, ses cadences sont loin d’être infernales ; celui d’Alès traite 5 000 tonnes par an, dont à peu près 50 % en abattage rituel. Quant à l’abattoir de Mauléon-Licharre, dans les Pyrénées-Atlantiques, il traite 5 000 tonnes chaque année, mais sans abattage rituel. Dans ce contexte, la fermeture de l’abattoir d’Alès obligerait les éleveurs à faire abattre à Valence. Je défends le bien-être animal : à un moment ou à un autre, il faudra, comme l’a souligné le maire d’Alès, prendre une décision pour savoir s’il doit y avoir, ou pas, étourdissement en abattage rituel.
Les sacrificateurs sont habilités par les mosquées : ils ne dépendent pas de l’abattoir et n’ont aucune formation. C’est un réel problème : pour l’abattoir d’Alès, on nous a expliqué qu’un remplaçant avait été envoyé par la mosquée. Dans mon département, si l’on remonte à quinze ans en arrière, les préfets se faisaient un souci monstre lors des fêtes au cours lesquelles on abattait n’importe où et n’importe comment – dans des garages, avec le sang qui coulait dans les fossés… Le système de l’abattoir mobile dans certaines zones pourrait être une solution.
Enfin, nous importons plus d’ovins de Nouvelle-Zélande ou d’Australie que nous en exportons ; or dans le prix de détail au client, la part de l’abattage peut aller du simple ou double – de 0,30-0,50 à 1 euro le kilo selon la cadence. Pour lutter contre les importations, il est important que la commission d’enquête ait une idée du prix de l’abattage, mais personne jusqu’ici n’a été capable de nous le chiffrer ! C’est pourtant un élément déterminant.
M. Thierry Lazaro. Monsieur le directeur général, lors du premier colloque organisé par l’Ordre national des vétérinaires sur le bien-être animal, auquel a assisté Mme Geneviève Gaillard, vous avez annoncé que le ministère de l’agriculture préparait une stratégie rénovée sur le bien-être animal. Les débats qui ont ponctué ce colloque ont été passionnés, partant d’un sujet technique pour aboutir à un sujet plus culturel. Il y a des amateurs de viandes, c’est une évidence absolue, mais il y a aussi des partisans d’une alimentation sans viande, et c’est leur droit le plus strict, au travers du véganisme ou du végétarisme. Cette réflexion militante a le mérite d’exister et doit faire partie du débat qui nous occupe aujourd’hui. L’intégrez-vous dans votre mission ?
M. Guillaume Chevrollier. Monsieur le directeur général, faut-il imposer un responsable protection animale dans tous les abattoirs, quelle que soit leur taille ?
Dans l’hypothèse où des contraintes supplémentaires, comme la vidéosurveillance, seraient imposées aux abattoirs à l’issue des travaux de cette commission d’enquête, le coût de l’abattage, et donc la compétitivité des abattoirs, s’en trouveraient impactés. Pourrait-on imaginer de compenser ces contraintes supplémentaires en supprimant certaines mesures normatives actuellement en vigueur ?
M. le rapporteur. Les responsables des abattoirs auditionnés précédemment nous ont indiqué que les sacrificateurs n’étaient pas des personnels des abattoirs. Est-ce exact ? Si oui, comment sont-ils rémunérés ?
Quel est le coût de la certification cultuelle ? Que sait-on de ce circuit financier des produits casher et halal ?
Lors de leur audition, les représentants de l’OABA nous ont précisé que les couloirs d’amenée des animaux vivants n’étaient pas toujours d’un haut niveau technique, autrement dit que la conception des abattoirs n’était pas forcément très adaptée au comportement animal. Les choses peuvent-elles être améliorées en la matière, afin d’éviter un stress inutile aux animaux avant l’abattage ?
M. le président Olivier Falorni. Ce problème concerne même des structures récentes, voire très récentes.
M. Patrick Dehaumont. J’ai parlé tout à l’heure des 263 abattoirs d’animaux de boucherie, sans intégrer les abattoirs de volailles. Madame Abeille, en matière d’inspection dans les abattoirs en général, les obligations sont encadrées au niveau européen. Les moyens d’inspection en abattoirs d’animaux de boucherie alloués s’attachent à respecter toute la réglementation européenne et rien que la réglementation européenne. Car il faut tout de même être économe des moyens tout en répondant aux obligations sanitaires et de protection animale.
S’agissant des abattoirs d’animaux de boucherie, les standards européens sont respectés, que ce soit pour le contrôle sanitaire ou la protection animale – le contrôle ante mortem et le contrôle au poste d’abattage.
Concernant les abattoirs de volailles, des rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire européen (OAV) ont pointé la réalisation d’inspections hors des standards européens et le manque de personnels d’inspection. Par conséquent, nous procédons depuis deux ans à une augmentation des effectifs d’inspection : le ministre Stéphane Le Foll a obtenu une augmentation de 60 ETPT en 2015 et 2016 – ce sera également le cas en 2017 –, qui seront dédiés entre autres à l’inspection en abattoirs de volailles. La première salve a eu lieu l’année dernière : nonobstant le phénomène l’inertie liée à la formation et au recrutement de ces agents, les effectifs dédiés aux 700 abattoirs de volailles en France montent en puissance. Parallèlement, nous avons engagé à partir de 2012 un programme pilote visant à faire évoluer les règles d’inspection au niveau communautaire pour la protection animale et le contrôle sanitaire dans les abattoirs de volailles, ce qui devrait permettre d’intensifier le contrôle amont – protection animale – avec potentiellement moins d’inspecteurs. En effet, dans les abattoirs de volailles, le contrôle s’exerce visuellement sur une chaîne qui défile très rapidement, d’où la nécessité de faire évoluer la technique d’inspection. À l’inverse, dans les abattoirs d’animaux de boucherie, les gestes sont très codifiés : l’inspection ante mortem systématique vise à vérifier l’état des animaux – conditions de voyage, blessures, signes de maladie contagieuse –, cependant que l’inspection systématique des carcasses sur la chaîne d’abattage, réalisée au moyen de gestes codifiés – incisions de ganglions, palpations d’organes, etc. –, a pour but de s’assurer de l’absence de pathologies susceptibles de mettre en danger la sécurité du consommateur.
Ces précisions sur l’inspection des carcasses me permettent de rebondir sur la question du vidéo-contrôle, qui exige du temps-agent. Or en abattoirs d’animaux de boucherie, les agents en inspection ne peuvent pas, en même temps, être présents sur la chaîne et regarder un moniteur.
M. Jacques Lamblin. Dans mon esprit, il ne s’agit pas d’installer des agents devant un mur d’écrans, mais de procéder par sondages. Des sondages quotidiens de quelques minutes permettaient de savoir, sans moyens humains supplémentaires, si les dysfonctionnements pendant l’étourdissement sont réguliers ou si des comportements inappropriés de salariés se répètent. Ces problèmes existent depuis un certain temps : je me demande pourquoi on n’a pas poussé plus tôt cette idée, certes encore contestée aujourd’hui, mais qui pourrait être mise en œuvre à moyens pratiquement constants.
M. Patrick Dehaumont. Sans doute cette idée n’a-t-elle pas été poussée parce qu’on ne l’a pas eue… Ce sujet doit être approfondi, mais j’insiste sur le fait que le développement du contrôle officiel nécessiterait des moyens supplémentaires : même des contrôles par sondages ne seront pas sans effet sur l’expression des besoins en matière de personnels.
À la question sur l’étourdissement obligatoire qui pourrait être une solution pour éviter les scènes décrites, je rappelle que la Constitution « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion » et que la Cour de Justice européenne elle-même permet le libre exercice des religions ; or certaines religions exigent un abattage conforme à certains rites. Par conséquent, nous appliquons la Constitution, les règles européennes, et donc le dispositif législatif et réglementaire. Je ne peux rien dire de plus sur ce point.
Autre sujet ; aucun animal mort n’est jamais mis sur la chaîne, pour une bonne et simple raison : un cadavre ne peut pas être saigné… Cela ne ressemble pas du tout à de la viande. Je suis donc formel : ce cas de figure ne se produit jamais. Je n’imagine pas un responsable d’abattoir prendre un tel risque sanitaire, sans compter que les services d’inspection ne pourraient pas passer à côté.
Pour ce qui est des circuits financiers concernant les certificateurs, je serai bien en peine de vous répondre. Ces personnels ne sont pas des salariés de l’abattoir, mais, pour nous, ce sont des opérateurs techniques qui interviennent dans des abattoirs où nous effectuons des tâches d’inspection. Mais je n’ai pas d’éléments sur les modalités de rémunération des certificateurs.
M. Jérôme Languille. Je n’ai pas d’éléments précis sur les contrats qui lient les responsables d’établissement aux sacrificateurs permanents ou occasionnels dans les abattoirs. Par contre, au titre de la protection animale et du règlement CE 1099/2009, le responsable de l’établissement, dont relève le plan de maîtrise du bien-être animal, doit s’assurer de la compétence du salarié ou du prestataire qui intervient dans son établissement. Il y a donc une erreur manifeste au regard du respect de cette obligation quand un intérimaire sacrifie des animaux sans en avoir la compétence, notamment en cisaillant plutôt qu’en saignant nettement l’animal. Mais finalement, peu importe le contrat ou le statut de l’intervenant : la responsabilité incombe au responsable de l’établissement qui doit s’assurer que la personne chargée de mettre à mort les animaux sur la chaîne dispose de la compétence nécessaire. Telle est la préoccupation de nos services au titre de la protection animale.
Le recours au vidéo-contrôle est parfois présenté comme une solution de nature à pallier une défaillance de nos services. Deux points me paraissent devoir être rappelés à cet égard.
Premièrement, dans son rapport d’avril dernier, l’OAV a jugé globalement satisfaisant le niveau de protection des animaux dans les abattoirs en France – je ne parle pas du niveau de bien-être animal. Certes, il est normal d’être choqué par les mauvais traitements infligés aux animaux, comme on le voit dans les vidéos en question. Mais de là à faire un amalgame entre le niveau de protection des animaux en France et les pratiques observées dans ces vidéos, il y a un pas qu’on ne saurait franchir.
Deuxièmement, juger de telles images suppose que l’on ait les compétences pour ce faire. C’est notamment le cas sur un point précis, jugé déterminant pour qui se préoccupe du bien-être des animaux : la perte de conscience et l’appréciation de la perte de conscience des animaux étourdis avant d’entamer les opérations d’habillage. Tous les scientifiques vous diront que les animaux inconscients – l’inconscience étant une absence d’activité du cerveau prouvée scientifiquement par la technique de l’électroencéphalogramme – ont des mouvements réflexes, c’est-à-dire ne faisant pas intervenir le cortex. Or un mouvement réflexe observé sur une vidéo, notamment lors du mouvement du couteau au moment de la saignée, peut être troublant pour un citoyen lambda qui croira que l’animal est encore conscient, alors qu’il est bel et bien inconscient. Par conséquent, ce genre d’image ne devrait pas être diffusé au grand public qui n’a pas forcément les connaissances scientifiques pour les interpréter. Bien évidemment, cela n’enlève rien à la nécessité de détecter, et de condamner, les mauvais traitements et les actes de cruauté évidents : ils relèvent, je le redis, de la responsabilité du responsable d’établissement qui doit faire respecter la procédure de maîtrise du bien-être animal par son personnel.
M. Patrick Dehaumont. Selon moi, l’essentiel des contrôles ne porte pas sur les documents administratifs, car nous menons un travail technique important. Comme je l’ai expliqué, l’inspection sanitaire est très codifiée, tout comme l’inspection ante mortem car il faut aller voir les animaux et identifier ceux qui sont blessés ou malades. Mais il y a aussi, bien évidemment, un contrôle administratif : il faut en particulier vérifier les documents d’identification des animaux. Mais ce n’est pas l’essentiel du travail.
Les tâches de protection animale et les tâches d’inspection sanitaire des agents du programme 206 relèvent d’obligations communautaires : il est difficile d’envisager de les alléger, à moins de prendre un risque inutile, sanitaire, mais aussi économique : il y va de la confiance de nos partenaires étrangers vis-à-vis du système français qui certifie officiellement des exportations d’animaux vivants et de denrées. En fait, l’allégement des mesures me paraît impossible puisque notre action s’inscrit dans un cadre extrêmement contraint. D’ailleurs, l’OAV inspecte les États membres et les pays tiers : nous faisons l’objet d’une dizaine d’audits par an sur des sujets très variés, dont une inspection en 2015 sur la protection animale et, au mois de juin, nous mènerons avec cet organe d’inspection une évaluation générale de toutes les missions en cours. Nous sommes donc inspecteurs, mais aussi inspectés…
Mme Sylviane Alaux. Je suis de votre avis sur l’interprétation des vidéos : on se souvient tous d’avoir vu dans notre enfance un canard continuer de courir après s’être fait couper la tête…
Des auditions ont dénoncé deux choses, et les abattoirs visés ne les ont pas contestées. D’abord, le temps d’étourdissement peut être dépassé si le salarié est occupé à autre chose ou est interpellé, et l’animal reprendre conscience. Ensuite, l’étourdissement lui-même, selon la méthode utilisée, n’est pas forcément adapté à la taille ou à la race de l’animal – bovin ou ovin. Ce salarié qui cognait un agneau, comme on l’a vu sur une des vidéos, sentait bien que la bête était encore bien vive…
M. le rapporteur. L’étourdissement réversible peut être considéré comme un défaut, mais a été présenté comme une possibilité pour améliorer les conditions d’abattage rituel. Qu’en est-il exactement ? Existe-t-il un étourdissement réversible, susceptible d’être accepté par les cultes qui demandent des dispositions spécifiques ?
M. Jacques Lamblin. Monsieur Languille, je connaissais le rapport de l’OAV qui reconnaît la qualité des pratiques dans les abattoirs français. Cela étant dit, ces scandales à répétition jettent le discrédit sur l’ensemble de la filière, ce qui est dramatique, si bien que notre objectif est de trouver des solutions dans le cadre des moyens financiers actuels. C’est dans ce sens que j’ai posé des questions sur le vidéo-contrôle, et non pour pointer du doigt qui que ce soit ou faire un quelconque amalgame. Selon vous, le vidéo-contrôle peut-il vous aider à améliorer le contrôle, à moyens financiers à peu près constants, même si j’ai bien compris, monsieur le directeur général, nécessiterait tout de même quelques moyens humains supplémentaires ?
Enfin, M. le rapporteur a posé une question très intéressante sur l’étourdissement réversible, acceptable par certains rites.
M. Thierry Lazaro. M. Languille a répondu sur l’interprétation des vidéos. En tant que militant, sans doute peut-on avoir tendance, à un moment ou à un autre, à surexploiter une affaire – je ne sais pas si c’est le cas, c’est une question que je pose. D’autre part, lors du colloque en novembre de l’Ordre national des vétérinaires, deux écoles se sont affrontées – les adeptes du véganisme/végétarisme contre les amateurs de viande. Intégrez-vous cet aspect militant qui a le mérite d’exister et, si oui, dans quelles conditions ?
M. Patrick Dehaumont. Il existe en effet une technique dite « d’étourdissement réversible », mais la question est celle de son acceptation par les cultes. Je ne peux pas en dire beaucoup plus…
M. le rapporteur. Donc l’étourdissement réversible existe.
M. Patrick Dehaumont. A priori, cela existe.
Mme Laurence Abeille. Il nous faudrait des réponses précises, monsieur le président.
M. le président Olivier Falorni. Monsieur le directeur général, il faudrait que vous nous indiquiez si l’étourdissement réversible existe.
M. Patrick Dehaumont. L’électronarcose peut être réversible sur les volailles. Il n’en est pas de même avec l’assommage chez les bovins, au moyen d’une tige perforante, qui est une technique différente. En fait, la question de la réversibilité se pose surtout pour les volailles pour lesquelles les exportations sont importantes vers des pays qui demandent des animaux abattus rituellement. Ainsi, se pose la question de l’acceptabilité par les cultes de ces techniques lorsqu’elles existent.
Enfin, pour répondre à la dernière question de M. Lazaro, nous intégrons les aspects militants contribuant à l’amélioration de la protection animale, mais pas ceux qui promeuvent la disparition de l’élevage ou de la consommation de viande. C’est clair…
Nous allons vous remettre aujourd’hui des fiches techniques, notamment sur les conditions d’inspection, et nous vous enverrons rapidement des éléments complémentaires répondant à vos différentes questions, notamment des chiffres sur les abattages. Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous apporter d’autres éléments complémentaires.
M. le président Olivier Falorni. Il me reste à vous remercier, monsieur le directeur général, mesdames, monsieur, de ces réponses précises. Nous aurons l’occasion d’évoquer avec le ministre de l’agriculture un certain nombre de points qui ont été abordés dans cette réunion.
La séance est levée à dix-huit heures cinq.
——fpfp——
6. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des représentants des syndicats d’abattoirs, avec la participation de M. Éric Barnay, président, et de M. André Eloi, directeur de la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services (FNEAP), de M. Mathieu Pecqueur, directeur général adjoint de Culture viande et de M. Henri Thébault, membre du conseil d’administration de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce en gros des viandes (FNICGV).
(Séance du mercredi 4 mai 2016)
La séance est ouverte à dix-huit heures quinze.
M. le président Olivier Falorni. Mes chers collègues, nous accueillons maintenant, pour une table ronde, des représentants des syndicats d’abattoirs : M. Éric Barnay, président de la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de service (FNEAP), et M. André Eloi, son directeur, M. Mathieu Pecqueur, directeur général adjoint de Culture viande, et M. Henri Thébault, membre du conseil d’administration de la Fédération nationale de l’industrie et du commerce en gros des viandes (FNICGV).
Je vous rappelle, messieurs, que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Éric Barnay, André Eloi, Mathieu Pecqueur et Henri Thébault
prêtent successivement serment.)
M. Éric Barnay, président de la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de service (FNEAP). Mesdames, messieurs les députés, je suis président de la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de service qui existe depuis quarante-deux ans, et par ailleurs directeur d’un abattoir dans le sud de la France.
Notre fédération regroupe 112 abattoirs répartis sur le territoire national dont l’activité est essentiellement le service d’abattage d’animaux de boucherie. Ces établissements multi-espèces – vaches, veaux, agneaux, porcs, parfois du gibier – peuvent être des entreprises privées, ou des structures fonctionnant en régie municipale ou en délégation de service public. Nos utilisateurs sont principalement des bouchers abatteurs, mais aussi des éleveurs que l’on appelle des chevillards, des grossistes en viande, et des industriels. Les opérateurs qui travaillent sur la chaîne sont multitâches, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas spécialisés dans une activité. Nos abattoirs sont des outils de proximité, qui participent à l’aménagement du territoire. Nous estimons que nous ne sommes pas en concurrence avec les industriels, mais plutôt complémentaires. La taille de nos outils est très diverse : de 200 tonnes jusqu’à 25 000 tonnes par an.
La FNEAP est la seule fédération à avoir son propre organisme de formation pour tout ce qui touche à la transformation des viandes, notamment l’abattage mais aussi la découpe. La formation est une obligation réglementaire. Depuis 2013, la protection animale est une de nos activités. Cet organisme de formation, qui s’appelle l’Adofia, est habilité par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) pour délivrer les certificats de compétence protection animale (CCPA). Il est ouvert à toutes les entreprises, même celles qui ne sont pas affiliées à notre fédération.
Enfin, notre fédération représente de 10 à 12 % de l’activité nationale d’abattage et de 2 500 à 3 000 emplois.
M. André Eloi, directeur de la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de service. Notre particularité est d’être des d’abattoirs multi-espèces. De ce fait, nos opérateurs sur la chaîne sont totalement polyvalents, en termes d’espèces et de catégories travaillées comme en termes de postes occupés, contrairement à certains abattoirs industriels où un homme égale un poste.
Bon an mal an, les 112 abattoirs affiliés à notre fédération traitent chaque année 360 000 tonnes d’animaux de boucherie. Nous avons également la particularité de fédérer l’ensemble des abattoirs ultramarins – Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti.
M. Mathieu Pecqueur, directeur général adjoint de Culture viande. Culture viande est l’un des syndicats qui représente les entreprises françaises du secteur de la viande bovine, ovine et porcine en France.
Nous regroupons soixante-dix adhérents, 150 établissements – des entreprises plutôt de plus grande taille que celles que représente la FNEAP – et 35 000 salariés. Nous représentons 75 %, toutes filières confondues, de l’abattage d’animaux de boucherie en France – 84 % pour le porc et 65 % pour les bovins. Bien sûr, nous nous adressons à tous les débouchés possibles pour la viande, principalement la grande distribution qui représente 45 %, mais aussi la transformation, l’exportation qui représente 16 %, la restauration hors domicile (RHD) et les boucheries traditionnelles.
Nos différentes fédérations d’abattage ont fait des communiqués communs à la suite de la diffusion des vidéos de l’association L214. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes de maltraitance que l’on peut y voir, parfaitement intolérables, pour vous et surtout pour les salariés qui travaillent dans nos entreprises. Les salariés savent tous les efforts à réaliser en termes de formation, de bonnes pratiques pour le bien-être des animaux. Ce que montrent ces vidéos constitue une remise en cause pour les salariés ; c’est un vrai coup qui leur est porté.
Nous ne sommes pas non plus candides : outre le respect du bien-être animal et la dénonciation de pratiques inexcusables, ces vidéos ont également été diffusées pour faire porter une voix végétaliste, qui vise à lutter contre la viande en général. Nous avons bien vu, lors de leur audition devant votre commission d’enquête, que les représentants de l’association L214 aiment à généraliser ce genre de pratiques, ce sur quoi nous nous inscrivons en faux. Nous considérons que ce que l’on voit dans ces vidéos n’est pas généralisé dans nos outils. Toutes les bonnes pratiques que nous pouvons mettre en œuvre, tant en termes de formation que de management humain, visent à garantir, dans nos outils, le bien-être animal.
M. Henri Thébault, membre du conseil d’administration de la Fédération nationale de l’industrie et du commerce en gros des viandes (FNICGV). La Fédération nationale de l’industrie et du commerce en gros des viandes œuvre au service des entreprises depuis 1925. C’est une organisation française représentative des entreprises de la viande et des produits dérivés. Elle défend les activités de l’industrie – abattoirs, industrie de découpe, ateliers de transformation et entreprises de préparation –, du commerce en gros et du commerce international.
Les produits commercialisés par les adhérents de la FNICGV portent sur les viandes bovine, porcine, caprine, ovine et chevaline. Notre fédération regroupe 300 membres environ et représente 25 000 salariés.
Il existe diverses commissions au sein de notre fédération, dont une commission « abattoirs ». Gilles Gauthier, le président de notre fédération, a souhaité que ce soit un détenteur d’un outil d’abattage qui vienne s’exprimer devant votre commission d’enquête. D’où ma présence aujourd’hui. Je possède en effet en Bretagne, dans le petit bourg de Quintin cher à l’un de vos collègues, un outil d’abattage de petite dimension, multi-espèces, qui traite 1 800 tonnes par an. Il m’a semblé normal que je vienne devant vous en tant que dirigeant mais aussi acteur dans cet outil où je suis en permanence, afin que vous sachiez comment nous y travaillons et comment nous y prenons en considération le bien-être animal.
En regardant les auditions que vous avez déjà effectuées, nous avons entendu des choses que nous n’acceptons pas. Voilà pourquoi je veux d’ores et déjà vous donner mon sentiment.
Il a été dit que le volet relatif à la protection animale avait pris du retard dans les abattoirs. Ce n’est pas vrai : la plupart des abattoirs ont pris des mesures bien avant que la réglementation ne l’impose. Le bien-être animal est une préoccupation majeure dans nos outils depuis de nombreuses années. Les professionnels ont diffusé, avant 2013, des guides de bonnes pratiques pour nos opérateurs, afin de permettre une meilleure appropriation du règlement. Autrement dit, nous avons anticipé la préoccupation du bien-être animal.
Le règlement européen a introduit des modes opératoires normalisés qui consistent à anticiper tout ce qui peut se passer dans un outil d’abattage. L’opérateur connaît ainsi la conduite à tenir dans chaque situation. Notre commission « abattoirs » organise une réunion téléphonique tous les mois au cours de laquelle les détenteurs d’un outil d’abattage peuvent exposer leurs soucis et leurs attentes.
La formation au certificat de compétence est une formation interne qui dure quarante-huit heures. Une première session théorique a lieu au cours de laquelle différentes situations sont exposées dans des vidéos. Puis on en vient à la session pratique.
Pour ma part, je suis issu du monde rural. J’ai été négociant en bestiaux et éleveur
– nous l’étions de père en fils. Lorsque j’ai acheté cet outil d’abattage, il m’a été très facile d’apporter mon expérience et de la transmettre à tout mon personnel. Cela nous a énormément aidés.
Notre fédération fait appel à un organisme extérieur de formation dirigé par un docteur vétérinaire qui apporte son savoir en matière sanitaire en plus de l’aspect bien-être animal.
Je me réjouis que M. Le Foll ait décidé qu’un responsable de la protection animale (RPA) devra être présent dans tous les abattoirs, quels qu’ils soient. On se doit de connaître le respect du bien-être animal dès lors que l’on met une bête en abattage. Il est inadmissible que certains outils n’aient pas de RPA.
Je trouve également normal que le RPA soit un responsable. Il ne s’agit pas de fliquer les opérateurs pendant leur travail, mais de faire le lien entre l’opérateur, son directeur ou tous les services de l’outil d’abattage, au même titre que le responsable qualité qui lève le pouce sitôt que quelque chose ne va pas sur la chaîne d’abattage. Je ne vois donc pas d’inconvénient à ce que l’on donne davantage de force au RPA.
Je veux revenir sur les signes de perte de conscience. Lors de la précédente audition, les intervenants ont bien expliqué les choses. Les représentants de l’association L214 montrent des animaux qui se débattent au bout d’une chaîne. Certes, ils se débattent, mais les représentants de l’association ne savent pas apprécier s’ils sont encore vivants, comme ils le soutiennent, ou morts. Il faut savoir que ces animaux sont morts. Mais ils ont encore certains réflexes qui font qu’ils peuvent continuer à se débattre au bout d’une chaîne.
Un animal étourdi s’effondre. Il ferme les yeux. Il rouvre les yeux quatre secondes plus tard environ. Il arrête de respirer, il tremble, il étend ses pattes avant et pédale avec ses pattes arrière. Mais ce n’est pas parce que l’animal pédale au bout d’une chaîne qu’il n’est pas mort ; encore faut-il le savoir. Il est écrit dans le guide des bonnes pratiques que l’indicateur de chute au premier tir est de 95 %. Autrement dit, c’est le chiffre demandé pour une bonne exécution de l’assommage des animaux. Dans mon abattoir, il peut arriver – une fois tous les quinze jours – qu’un opérateur loupe un animal du premier coup et qu’il doive pratiquer une nouvelle percussion. Si nous avons un si faible taux d’échec, c’est parce que le piège à contentieux est bien adapté, ce qui participe au bien-être animal. Dans l’affaire de l’abattoir d’Alès, on a parlé de l’abattage rituel, ce qui fait que les animaux qui se débattent ; mais ce qui m’a choqué le plus, c’était le piège à contention, qui ne convenait pas du tout. C’est donc un point qu’il conviendra d’éclaircir.
M. le président Olivier Falorni. La FNEAP dispense des formations relatives au bien-être animal lors de l’abattage. Pouvez-vous nous présenter un peu plus précisément cette formation ? Combien de temps dure-t-elle ? Quel est le public concerné ? Combien de salariés formez-vous chaque année ? Comment est abordé le bien-être animal dans ces formations ? Je m’adresse aux représentants de la FNEAP, car il me semble que ce sont les seuls à délivrer cette formation.
Ma deuxième question s’adresse à vous tous : êtes-vous favorable à la vidéosurveillance ? Pensez-vous que ce dispositif pourrait entraîner de réels changements dans les pratiques ? Que pensez-vous de l’idée d’un étiquetage de la viande intégrant des critères de bien-être animal ?
Quelle est votre opinion sur les abattoirs mobiles ou itinérants ?
Comment expliquez-vous les comportements que l’on peut observer sur les vidéos diffusées par l’association L214 ? J’ai bien entendu que vous condamniez ces actes choquants. Quels sont les éléments, techniques ou humains, qui peuvent conduire à de tels dérapages ?
Mme Laurence Abeille. Les vidéos des lanceurs d’alerte ont choqué tout le monde. Comment pouvez-vous expliquer que de tels actes aient pu se produire ?
Pouvez-vous nous communiquer les noms des autres organismes de formation qui existent en France ? Existe-t-il des différences en ce qui concerne la durée de ces formations ? S’agit-il de formations en alternance ? Y a-t-il une formation continue ? Comment est délivré le certificat de compétence ? Quel est le contenu de ces formations ? Combien d’heures sont consacrées au bien-être animal ? Quelles sont les compétences des formateurs sur ce sujet-là ? Faites-vous appel à des éthologues ou à des spécialistes du comportement animal ?
Quelles sont vos relations avec les services de l’État ? Les contrôles se passent-ils bien ? Sont-ils suffisants pour ce qui touche au bien-être animal et aux conditions de travail des personnels ? On le sait, leurs conditions de travail sont difficiles : tuer des animaux n’est pas un geste anodin.
Quelle est la part de la viande issue de l’abattage dit rituel dans vos exportations ? Avez-vous constaté une évolution en ce qui concerne le recours à l’abattage dit rituel ?
Mme Françoise Dubois. Ce qui nous préoccupe surtout, c’est la formation des personnels. Le point clé pour beaucoup d’abattoirs, c’est que les employés soient bien formés. J’ai le sentiment que la formation théorique ne dure pas assez longtemps.
Les salariés ont-ils la possibilité de bénéficier d’un suivi psychologique ? Pratiquer des abattages peut être assez éprouvant, ce qui pourrait expliquer certains dérapages en fin de journée ou quand il y a beaucoup de bêtes à abattre ?
M. William Dumas. Je souhaiterais savoir quel est le prix au kilo de l’abattage. Jusqu’à présent, nous n’avons pas réussi à le savoir. C’est le flou artistique…
Pratiquez-vous l’abattage rituel dans vos abattoirs ?
M. Barnay a indiqué que les personnels étaient polyvalents, capables d’intervenir sur tous les animaux. Le turn over est-il pratiqué au poste d’abattage ?
M. Éric Barnay. Tous les salariés qui pratiquent la manipulation des animaux, du déchargement jusqu’aux pièges, y compris l’assommage et la saignée, ne le font que s’ils ont obtenu le certificat de compétence. Il appartient à chaque entreprise d’y affecter le nombre d’employés adéquat ; en général, plusieurs personnes s’en occupent, dans le cadre d’un turn over. Nous avons fait un communiqué commun où nous avons rappelé que des règles existent depuis longtemps et qu’elles ne sont pas discutables.
Lors de l’épreuve, les candidats se voient poser beaucoup de questions, par espèce et par type d’animal. Ces questions, aléatoires, ont été préparées par les services de l’État. Ce n’est pas l’organisme de formation qui rédige le questionnaire. À l’issue de la réussite de l’évaluation, le candidat se voit délivrer individuellement, via le préfet, son certificat de compétence qui est envoyé à son domicile. Et pour ce qui est de l’abattage rituel, les sacrificateurs eux aussi, en règle générale, doivent présenter ce certificat de compétence.
M. André Eloi. La FNEAP n’est pas le seul organisme à dispenser la formation protection animale, mais nous sommes la seule organisation professionnelle à avoir un organisme de formation affilié habilité par le ministère de l’agriculture à dispenser et à délivrer des certificats de compétence protection animale.
Vous trouverez la liste des organismes habilités dans le Journal officiel. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous la transmettre assez rapidement. L’habilitation des organismes de formation est régie par toute une série de textes. Nous avons été les premiers à être habilités, avec cinq ou six autres. Mais nous sommes le seul à être affilié à une fédération d’abattage. Et j’ai le privilège d’en être aussi le directeur…
Je suis un peu surpris de vos remarques concernant la faiblesse des formations en ce qui concerne le certificat de compétence. En tant que formateur, je puis vous assurer que pour les salariés c’est une très bonne sensibilisation théorique au bien-être animal. Nous délivrons deux types de certificats : un certificat de compétence protection animale pour les opérateurs et un autre pour les responsables.
S’agissant des opérateurs, la formation dure deux jours s’ils traitent toutes les espèces. Nous travaillons par modules : la mise à mort, l’abattage sans étourdissement et la manipulation des animaux. Il faut multiplier ces modules par le nombre d’espèces concernées. C’est d’autant plus important chez nous que nos opérateurs travaillent essentiellement en multi-espèces.
Comme l’a dit notre président, notre organisme de formation est habilité par les pouvoirs publics, mais ce n’est pas nous qui délivrons le certificat. Au bout de ces deux jours, les salariés passent un vrai examen : c’est une évaluation sous forme de questionnaire à choix multiples. Ce questionnaire apparaît de façon aléatoire en fonction du profil que l’on aura rentré dans le logiciel du ministère de l’agriculture. Cela n’a rien d’une formation galvaudée. C’est une très bonne initiation de départ à la protection animale pour des salariés qui découvrent des notions théoriques, mais qu’ils appliquent depuis de nombreuses années dans leurs entreprises. Autrement dit, le certificat de compétence formalise une formation à la protection animale.
Nous organisons aussi d’autres formations : sécurité du personnel, formation sanitaire, management des hommes, etc. Le certificat de compétence protection animale ne concerne que la protection animale, sujet pour lequel vous nous avez réunis aujourd’hui.
L’autre certificat de compétence protection animale est réservé au responsable protection animale. Leur formation dure trois jours : la différence par rapport au certificat des opérateurs tient surtout à la place réservée aux questions réglementaires : il faut savoir que le responsable protection animale sera chargé de coordonner de façon globale la politique de la protection animale dans l’entreprise. Tout comme les opérateurs, il passe un examen à l’issue de sa formation. Il doit répondre à une cinquantaine de questions, contre une quarantaine pour l’opérateur. De la même manière, son certificat lui est délivré à titre individuel par le préfet, envoyé directement à son domicile ; il est valable cinq ans. Nous recommandons à tous nos abattoirs de présenter ce certificat de compétence aux autorités de contrôle dans l’abattoir.
M. Éric Barnay. De nombreux abattoirs ont déjà installé des caméras de vidéosurveillance. On pouvait craindre que ce dispositif ne risque de casser la confiance qui existe entre la hiérarchie des abattoirs et les opérateurs. Mais s’il faut rassurer le consommateur, je pense que l’installation de ces vidéos ne posera pas de problème. Reste à savoir quelle exploitation sera faite de ces vidéos ? Si les services de l’État ou d’autres structures ont tous les mêmes critères d’appréciation de l’état d’inconscience, il n’y aura pas de souci. Bien sûr, ces images devront rester chez les professionnels. Il faudra définir un cadre en ce qui concerne l’exploitation des images. Chez nous, je pense que cela se fera sur la base du volontariat, à moins qu’il y ait une exigence réglementaire. Mais beaucoup de nos adhérents y sont disposés.
J’ai participé, avec des fabricants de matériels, à une réflexion sur les abattoirs mobiles. Un outil mobile est-il capable de respecter tous les critères sanitaires imposés aux outils d’abattage ? Si c’est le cas, pourquoi pas ? Mais cela ne va pas aller sans poser quelques petits problèmes. On vient en effet de parler du certificat de protection animale : il faudra que ceux qui travailleront dans ces abattoirs mobiles aient aussi ce certificat et qu’ils répondent à tous les mêmes critères que ceux qui exercent tous les jours. Se pose donc la question de l’habilitation des personnels qui travailleront dans ces outils.
Nous ne sommes pas opposés à un étiquetage bien-être animal si cela peut rassurer le consommateur. Les étiquetages sur le bio, les labels rouges correspondent à des cahiers des charges. Des critères de bien-être animal ont déjà été introduits dans certains cahiers des charges, mais ce n’est pas transparent pour le consommateur. Que voulez-vous rajouter exactement ? Les abattoirs sont un maillon de la chaîne en termes de prestation de service. Effectivement, pourquoi ne pas transmettre une information via l’étiquetage ?
Vous nous interrogez sur le suivi psychologique des personnes qui pratiquent l’abattage. Nous ne nous sommes pas trop penchés sur la question. Les vidéos qui ont été diffusées concernaient des cas isolés. Nos cadences ne semblent pas de nature à influer sur l’état psychologique du personnel. Mais peut-être faut-il, comme dans toute entreprise, écarter des personnes de certaines tâches. Il ne faut pas oublier que la qualité de la viande dépend aussi de la qualité de l’abattage. Cela fait de nombreuses années que l’on prend en compte le critère de la qualité de l’étourdissement de l’animal dans la qualité de la viande.
M. Mathieu Pecqueur. Vous trouvez la formation trop théorique, mais il ne faut pas oublier qu’elle s’adresse à des opérateurs présents tous les jours sur la chaîne. Elle leur sert de support théorique à ce qu’ils voient dans la pratique. Il faut qu’un salarié comprenne pourquoi un animal peut avoir des mouvements réflexes tout en étant mort ou inconscient, il faut qu’il comprenne qu’il vaut mieux avoir une bouverie calme pour que les animaux soient apaisés et qu’ils avancent vers le poste, il doit savoir où se placer pour faire avancer un bovin. Cela a beau être théorique, il le met en pratique tous les jours.
Mme Françoise Dubois. Je ne comprends pas bien : vous dites que la formation théorique s’adresse à des salariés qui sont déjà tous les jours sur la chaîne…
M. Mathieu Pecqueur. L’obligation de former nos salariés au bien-être animal date de 2013. Nous avons formé les salariés qui travaillaient déjà ou qui sont arrivés depuis sur nos chaînes. Et ils y sont toujours…
Ce support théorique aide les salariés à comprendre le comportement de l’animal. Cela fait un bien fou aux salariés, du point de vue psychologique, de savoir comment il faut réagir quand on a raté son étourdissement, comment il faut réagir pour s’assurer que l’animal est bien inconscient. Nos entreprises et nos salariés se préoccupent du bien-être animal. Ce support théorique est très important pour eux. Je veux insister sur le fait que le contenu de ces formations est validé par le ministre de l’agriculture, et que les questions qui sont tirées au sort sont préparées par le ministère. Les candidats passent l’examen dans une salle avec un formateur qui vient vérifier qu’ils répondent aux questions posées.
S’agissant du certificat de compétence des opérateurs, entre dix et trente-cinq personnes, suivant la taille des outils, sont formées à la compréhension du bien-être animal. Et deux à trois RPA sont systématiquement présents dans nos outils : ils veillent à ce que les opérateurs appliquent bien les procédures, ils enregistrent les problèmes qui ont pu survenir et s’efforcent de s’inscrire dans une logique de progrès et de suivi du bien-être animal. 6 000 certificats de compétences par espèce et un peu plus de 1 000 certificats RPA ont déjà été délivrés. Ce n’est pas rien. Il a fallu former ces salariés. C’est vraiment un thème que les entreprises ont pris à bras-le-corps.
Mme Laurence Abeille. Pouvons-nous, nous aussi, nous procurer ces questionnaires à choix multiples sur le site du ministère de l’agriculture ?
M. André Eloi. Non. Il faut être inscrit.
M. le président Olivier Falorni. Nous les demanderons au ministre lorsque nous l’auditionnerons.
Mme Laurence Abeille. Quel est le taux de réussite à cet examen ?
M. André Eloi. Pour notre part, nous avons formé 960 opérateurs au CCPA et nous avons obtenu un taux de réussite de 100 %. Mais un salarié qui rate son examen la première fois peut revenir en rattrapage. ; c’est arrivé plusieurs fois. Et nous avons mis en place 189 responsables protection animale.
M. Mathieu Pecqueur. Jamais une caméra de vidéosurveillance ne viendra remplacer l’encadrement et le management des équipes ou la sensibilisation de nos salariés. Culture viande considère que la vidéosurveillance peut être un outil pour certains établissements qui le souhaitent, mais elle ne doit en aucun cas devenir obligatoire, pour différentes raisons.
Pour commencer, l’exploitation des images peut avoir des effets pervers. Il faut être lucide : il n’y aura jamais une personne postée pour les regarder en direct. Autrement dit, ces vidéos ne serviront pas à éviter des actes de maltraitance mais à les constater a posteriori. Certains comptent sur l’effet dissuasif de ces caméras ; mais les opérateurs oublieront très vite leur présence et n’y penseront plus. La dissuasion, je n’y crois pas une seconde… Qui plus est, il faudrait à tout le moins garantir une confidentialité totale des images.
Au final, la formation du personnel et leur encadrement par un RPA sont beaucoup plus efficaces qu’une caméra. Et je n’ai pas parlé des préposés vétérinaires, présents en moyenne à dix ou quinze, voir à trente-cinq dans certains abattoirs. Globalement, les salariés sont en permanence sous surveillance pour ce qui touche au bien-être animal. Ce n’est pas une caméra qui viendra changer quelque chose.
S’agissant des vidéos diffusées par l’association L214, des enquêtes sont en cours. Je n’entrerai pas donc dans le détail. On ne peut pas expliquer de tels actes. Je considère que ce que l’on voit sur ces images ne peut pas se produire si un encadrant est présent et qu’il remonte les bretelles au salarié au moindre acte de maltraitance. Peut-être certains équipements ne sont-ils pas totalement adaptés ; je laisse aux experts de l’équipement le soin de le dire. Je pense qu’il y a eu une défaillance managériale. Quand des encadrants et des collègues constatent que de tels actes sont commis, ils ne doivent pas les laisser passer.
Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à la question des abattoirs mobiles. J’ai du mal à comprendre comment ils pourront répondre aux mêmes exigences que les autres en termes de sécurité sanitaire. On compare les RPA à des responsables qualité ; dans les abattoirs mobiles, nous n’aurons pas la possibilité de mettre en place une telle surveillance. Ce type d’établissement peut représenter une solution dans quelques zones bien particulières, mais je ne pense pas que de telles structures puissent être généralisées sur l’ensemble du territoire. Je sais que certains pays ont développé les abattoirs mobiles, mais il s’agit de régions où la production est très faible. En France, le volume d’animaux à traiter est tel que le sujet de l’abattoir mobile devient quasiment invalide.
M. Henri Thébault. S’agissant des abattoirs mobiles, outre l’aspect sanitaire il ne faut pas oublier le volet environnemental. Que faire des déchets des animaux que l’on abattra dans de prétendues bonnes conditions ? Qui va endosser les coûts ? Je ne sais pas par combien il faudra multiplier le prix de la viande. La fédération que je représente et moi-même n’accepterons pas de recevoir, pour les commercialiser, des animaux qui auront été abattus ailleurs que dans nos outils, car c’est bien nous qui apportons des garanties sanitaires quand les animaux sont passés par nos abattoirs. Certains articles de presse soutiennent qu’il n’y aura pas de maltraitance des animaux. Mais la maltraitance commence à l’élevage. Heureusement, beaucoup d’éleveurs sont consciencieux, comme il y a beaucoup d’abattoirs consciencieux qui ne maltraitent pas les animaux.
Comme je gère un abattoir de proximité qui pratique la vente directe, je ne suis pas bien placé pour vous parler exportations. Toutefois, ma fédération pourra vous communiquer des chiffres sur l’exportation.
Mon abattoir traite un faible tonnage : 2 000 tonnes par an ? Huit personnes travaillent sur la chaîne d’abattage, plus moi-même. Nous n’avons pas une cadence qui nécessite le recours à un soutien psychologique. Notre petite équipe commence le travail à six heures du matin. Nos journées durent dix heures les premier et deuxième jours, où l’affluence est la plus forte ; ensuite l’activité redescend. Une fois l’abattage terminé, mes employés passent dans la salle de découpe. Nous ne sommes pas toujours assidus à l’abattage et à l’amenée des animaux. Ce n’est certainement pas la même chose dans les outils de fort tonnage. Dans ma région, certains abattoirs traitent plus de 100 000 tonnes. C’est un autre concept.
S’agissant de la vidéosurveillance, je ne partage pas forcément l’avis du représentant de Culture viande. Tout dépend de la manière dont elle sera employée. Il ne s’agit pas de fliquer l’opérateur : c’est un outil pédagogique qui servira à analyser les comportements. L’opérateur qui aura fait un mauvais geste pourra regarder la vidéo et essayer de comprendre ce qui ne va pas ; mais il ne faudra pas attendre six mois. On ne peut pas se permettre d’engranger des images si elles ne servent à rien.
Je suis absolument contre la divulgation des images. Elles sont la propriété de l’outil. Si des instances nous demandent des images pour aller plus loin, je serai dans l’obligation de les fournir, mais cela devra se faire dans un cadre bien précis d’informations ciblées.
M. le président Olivier Falorni. Comment expliquez-vous les vidéos diffusées par l’association L214 ?
M. Henri Thébault. Je ne pouvais pas imaginer qu’on aurait besoin d’une commission d’enquête pour travailler sur ce sujet. Il est inacceptable de voir de telles images en 2016.
Dans un outil comme le mien, on voit tout ce qui s’y passe. Le représentant des services vétérinaires est présent à la pesée mais il lui suffit de regarder un peu sur la droite pour voir le poste d’assommage. S’il voyait des animaux continuer à se débattre ou abattus dans de mauvaises conditions, cela l’interpellerait. Peut-être y a-t-il eu un défaut de présence ; mais je ne veux incriminer personne. À mon avis, l’opérateur que l’on voit sur la vidéo n’a pas une bonne formation. Mais surtout, les outils dont il dispose ne sont pas adaptés pour l’abattage des animaux. Au Vigan, ils ont un piège à porcs magnifique – j’ai le même –, mais il manque une douchette pour mouiller la tête de l’animal de manière à bien réussir l’abattage. Quand vous mettez une pince à électronarcose sur une tête de porc humidifiée, le courant passe bien, même s’il bouge. Mais si la tête est sèche… Pour les agneaux et les porcelets, ils se servent d’un restrainer, mais cela ne convient pas du tout pour tuer quatre agneaux en une heure. Un box d’abattage pour les agneaux bien conçu permet de faire un travail très correct. Un restrainer est conçu pour les fortes cadences, et à condition qu’il y ait un nombre approprié d’hommes sur les postes. Pas loin de chez moi, j’ai un abattoir qui tue plus de 400 agneaux en une heure : ils ont un restrainer. Les gens sont postés pour qu’il n’y ait aucune erreur. Et on peut arrêter le restrainer quand on veut. Sur la vidéo, on voit des animaux se sauver et gambader dans l’abattoir : c’est une catastrophe. En tant que professionnel, je suis choqué de voir cela. Il s’agit d’un personnel qui manque de surveillance et qui n’a pas été éduqué. Et la faute, je suis désolé de dire cela, incombe au responsable de l’outil, qui n’est pas présent.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Je veux revenir sur une question qui pose problème depuis le début de nos auditions : quelle est la part de votre travail dans la formation du prix du produit ?
Ce n’est pas par indiscrétion de notre part que nous vous posons cette question. Imaginons que nous préconisions de ralentir les cadences, faire quarante-deux opérations nouvelles, etc. : on ne manquera pas de nous dire que cela coûtera beaucoup plus cher. Mais on ne pourra pas évaluer ce surcoût, savoir s’il est réaliste, acceptable ou compliqué si l’on ne connaît pas quel est actuellement le prix au kilo.
Comme la protection animale est un concept qui est en pratique depuis longtemps mais qui s’est formalisé récemment, il peut apparaître que les couloirs d’amenée, le dessin des logettes n’ont pas toujours bénéficié de la meilleure des sciences en matière de comportement animal. Quelle est la part de progrès que l’on pourrait intégrer, en mettant autant d’énergie dans la conception des outils en matière de bien-être animal que l’on en a mis autrefois dans la marche en avant, les aspects sanitaires, le traitement des effluents ?
Vous avez indiqué que l’obligation à la formation au bien-être animal datait de 2013, mais que vous l’aviez anticipée. Nous sommes manifestement dans une dynamique : si aujourd’hui on forme des gens qui étaient déjà, pour beaucoup d’entre eux, sur la chaîne, on formera demain des opérateurs avant même qu’ils ne se mettent au travail. J’imagine qu’après-demain on sera dans une dynamique d’alternance, de formation sur la chaîne parce que les gens n’auront ni l’expérience ni l’antériorité. Quelle place donnez-vous au progrès ? Peut-il y concevoir des formations avec des degrés différents – initiation, perfectionnement, de la maîtrise à l’expertise ? On pourrait peut-être imaginer des gradations dans la compétence.
M. Éric Barnay. Lors des dernières auditions, vous faisiez allusion à cette constante qu’est le prix. Il est difficile de vous répondre.
M. le rapporteur. On l’a constaté !
M. Éric Barnay. Vous avez réuni aujourd’hui les représentants de trois types d’abattoirs. Pour sa part, la FNEAP a fait une étude, il y a quatre ou cinq ans, qu’elle a rapportée lors d’une assemblée générale. Elle avait calculé que le prix allait de 20 centimes à plus de 1 euro le kilo.
Pour un outil tel que celui que je représente qui traite 7 000 tonnes par an, le prix moyen est de 32 à 35 centimes le kilo-carcasse pour les bovins et les veaux, de 60 à 70 centimes pour les agneaux, et de 22 à 25 centimes pour les porcs. Une part revient à des organismes extérieurs, comme l’interprofession, pour gérer l’équarrissage par exemple. Pour les bovins, il s’agit de 81 euros la tonne. Il faut aussi rémunérer les services de l’État, alimenter des fonds d’élevage, etc. Sur 30 centimes par exemple, 20 à 30 % servent à gérer les choses à l’extérieur.
Je vous livre un critère qu’il faut prendre avec précaution : pour 6 000 tonnes de carcasses consommables, comme c’est mon cas, il y a derrière 2 000 tonnes de sous-produits qui sont tous retraités – les viscères, les crânes, par exemple. Il faut aussi traiter le fumier, les stations d’épuration. Tout cela a un coût.
Le tarif d’abattage ne peut pas être le même pour un abattoir qui traite 200 tonnes et un qui en traite 2 000.
M. William Dumas. Ce qui est important pour nous, c’est d’avoir une fourchette. On sait bien que les prix ne sont pas les mêmes dans l’abattoir du Vigan qui traite 300 tonnes et dans celui d’Alès qui en abat 5 000. Mais ce n’est pas un problème pour le client qui abat au Vigan, dans la mesure où, vendant en circuit court, il récupérera le coût de l’abattage.
M. André Eloi. Les tarifs que vient de donner le président de la FNEAP s’entendent de la gestion de la bouverie jusqu’à la mise en frigos. Ils concernent la prestation technique d’abattage, y compris un certain nombre de taxes qui représentent 20 à 25 % de la facturation – redevances sanitaires pour les vétérinaires et toutes les cotisations interprofessionnelles. Nos abattoirs prestataire de service ont la particularité de ne pas faire de commerce de viande.
M. Mathieu Pecqueur. Le rapport de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires détaille les coûts dans la filière viande. Aussi pourrons-nous vous trouver des éléments.
Ce que sous-tend cette question, c’est celle des cadences des outils d’abattage : en regardant vos dernières auditions, on pourrait croire qu’un outil qui abattrait beaucoup d’animaux et irait vite aurait des mauvaises pratiques en termes de bien-être animal. Nous nous inscrivons totalement en faux contre une telle affirmation. La cadence d’un outil est fonction du nombre de postes que l’on est capable de mobiliser. Certains postes peuvent être doublés lorsque l’on veut aller vite. La cadence de l’outil est due à sa conception : un outil extrêmement efficace sera capable de traiter de 50 à 60 bovins en une heure sans que cela pose le moindre problème en termes de bien-être animal.
Quand on parle de cadence, cela concerne plutôt la partie mécanisée qui se trouve après la mort de l’animal, c’est-à-dire quand on le dépouille, qu’on l’éviscère et qu’on commence à le découper. Nos outils fonctionnent avec une zone tampon en amont de cette chaîne qui est cadencée. La zone tampon c’est l’endroit où a lieu la saignée de l’animal et où on a un stock d’animaux qui doivent permettre d’approvisionner régulièrement la chaîne. On sait très bien qu’il se produit toujours des aléas avec les animaux vivants : personne ne peut garantir une amenée fluide. Par exemple, un animal peut ne pas avoir envie d’entrer dans le piège, un autre peut rester dans le parc d’attente. Nos outils sont conçus pour gérer ces aléas tout en alimentant en continu des chaînes qui vont vite. Des zones de stockage permettent d’alimenter rapidement le piège et le poste de saignée. Après le poste de saignée, il y a une zone d’égouttage – c’est là que l’animal se vide de son sang – où l’on peut stocker un certain nombre d’animaux pour pallier les éventuels incidents d’abattage. Ce n’est donc pas parce qu’une chaîne va vite que l’on n’est pas capable de gérer les incidents. Pour nous, la cadence n’est pas un facteur explicatif de maltraitance animale. D’ailleurs, un représentant de l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) vous a indiqué, lors de son audition, qu’il avait visité un outil à la fois extrêmement performant en termes économiques et de bien-être animal.
M. William Dumas. Si nous vous demandons de nous communiquer les prix d’abattage, c’est aussi pour pouvoir les comparer à ceux pratiqués à l’étranger.
M. Mathieu Pecqueur. Ce que vous me dites me donne l’occasion de répondre à un éventuel étiquetage du mode d’abattage. Cette idée de transparence vis-à-vis du consommateur est séduisante et intellectuellement confortable ; toutefois, nous y voyons beaucoup d’effets pervers. La dérogation à l’obligation d’étourdissement est avant tout une question politique. La Commission européenne a prévu en effet des dérogations et la France a, comme d’autres pays, opté pour cette dérogation. Rejeter cette problématique sur l’étiquetage reviendrait quelque part à reporter la responsabilité sur les abattoirs et à leur faire payer les conséquences économiques.
Soyons clairs : pratiquer un abattage sans étourdissement est beaucoup plus compliqué pour les abattoirs. En cas d’abattage avec étourdissement, il se passe deux minutes entre la saignée et la zone d’égouttage, contre cinq minutes trente sans étourdissement. Autrement dit, sans étourdissement il y a ralentissement de la chaîne, ce qui a des impacts en termes économiques. Il ne serait donc pas logique qu’un abattoir pratique l’abattage rituel s’il n’avait pas la clientèle. Je le répète, pratiquer l’abattage sans étourdissement est techniquement difficile, et il est compliqué pour les salariés de gérer des quantités de sang plus importantes et des animaux qui peuvent continuer à bouger. Mais si nos outils ne pratiquent pas d’abattage rituel, le risque est de voir se développer l’importation de viande halal. Sommes-nous capables de parvenir à une conciliation collective sur ce sujet de l’abattage sans étourdissement sachant qu’une multitude de pratiques sont acceptées dans nos outils ? Dans certains endroits, en effet, on pratique l’étourdissement préalable parce qu’il est considéré comme réversible ; d’autres établissements sont capables de pratiquer du soulagement, c’est-à-dire un étourdissement post-jugulation pour que les animaux soient inconscients quelques secondes après la saignée. Voilà des solutions dont nous devrions être capables de discuter parce qu’elles sont plus favorables en termes de bien-être animal. Elles nous permettraient de rester positionnés sur le marché du halal dont nous avons besoin pour le marché intérieur mais aussi à l’exportation puisque nous fournissons les pays du Maghreb, les pays des Émirats arabes, etc. Il faudrait que le discours soit cohérent par rapport à ces pratiques. Reporter ce problème sur l’étiquetage revient à sortir d’une décision qui est avant tout politique.
La mise en place d’un étiquetage aurait pour conséquence l’arrêt de l’abattage sans étourdissement dans la plupart des abattoirs, compte tenu des contraintes économiques que cela entraînerait. Même si un décret prévoit qu’il est indispensable de répondre à une commande dès lors que l’on abat un animal sans étourdissement, on sait très bien que les pratiques du culte font qu’une partie de l’animal ou certaines carcasses ne seront pas validées viande halal par les cahiers des charges et qu’elles devront du coup passer dans le circuit conventionnel. Mais si elles sont étiquetées « abattage sans étourdissement », je ne trouverai pas de distributeur pour les commercialiser. Il faut donc prendre le problème à la base : est-on capable de mettre en place des bonnes pratiques permettant le soulagement des animaux, tout en correspondant au cahier des charges de l’abattage rituel ?
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Depuis la diffusion des vidéos, êtes-vous passif ou bien considérez-vous que l’administration française a une part de responsabilité ? Quelles sont vos relations avec l’administration, au niveau tant des agréments que des contrôles ? Les professionnels de la viande ont-ils décidé de réagir face à ces vidéos qui ont choqué beaucoup de monde ?
M. Henri Thébault. Effectivement, ces vidéos nous ont choqués et interpellés, mais nous n’avons pas été soucieux pour nos entreprises, parce que de tels actes n’existent pas chez nous. Ce qui nous inquiète en revanche, c’est la chute 15 % de la consommation depuis deux mois… Certains de nos abattoirs ont dû cesser de tourner certains jours, faute de commandes. Nous n’avons jamais eu le souci de nous remettre à niveau : nous avons l’encadrement nécessaire au niveau des vétérinaires dans nos régions. Ces images m’ont scandalisé. Mais ce que je vois surtout, c’est leur impact économique pour notre filière, déjà bien malade. C’est pourquoi nous avons besoin que votre commission d’enquête réfléchisse, réagisse et redore un blason qui a été terni par quelques incidents graves.
M. André Eloi. Les contrôles sont intenses ; peut-être faudrait-il mieux les organiser. Notre fédération souhaite que la commission d’enquête et les représentants de l’État que vous avez auditionnés tout à l’heure nous entendent : nous voulons impérativement discuter avec les services d’inspection car il est crucial que les critères d’appréciation du bien-être animal soient les mêmes partout. Il existe des guides de bonnes pratiques professionnels qui ont été validés par l’administration et par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Nous souhaiterions que tous les établissements d’abattage aient la même vision objective des paramètres d’inconscience, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux abattoirs.
La FNEAP réclame avec force que les services d’inspection soient obligatoirement formés à la protection animale. Je ne remets pas en cause les connaissances acquises par les services vétérinaires dans le cadre de leur cursus. Mais nous souhaitons tout simplement que chaque technicien préposé vétérinaire présent dans nos outils ait suivi une formation appliquée à la mise à mort des animaux et à la protection animale dans les abattoirs, sans oublier la manipulation des animaux vivants. J’espère que nous pourrons nous rapprocher des services d’inspection pour discuter très sereinement avec eux de la fixation d’une même base d’observation technique de la protection animale.
Monsieur le rapporteur, vous nous interrogez sur la conception des outils. Depuis trente ans que je traîne mes guêtres dans les outils, j’ai vu beaucoup de choses. À une époque, certains abattoirs ont été construits en dépit du bon sens en termes de protection animale. Aujourd’hui, notre fédération souhaite travailler de façon très approfondie et très ferme avec les fournisseurs de matériels et d’équipements, les architectes et les cabinets d’ingénierie. Outre un organisme de formation, notre fédération dispose d’un cabinet d’ingénierie qui travaille sur la conception des ouvrages dans les abattoirs. Nous sommes favorables à des discussions très spécifiques avec des fournisseurs, notamment sur les boxes rotatifs. Les abattages sans étourdissement – j’emploie très rarement l’expression « abattage rituel » – se font parfois dans des boxes qui nécessitent une adaptation bien précise. Il est nécessaire que les distributeurs de matériels en France nous fournissent du matériel correct. Même remarque pour les pinces à électronarcose : nous rencontrons des problèmes pour trouver des pinces techniquement conformes aux dispositions réglementaires – systèmes d’enregistrement, affichages sonores et visuels, etc. Nous souhaitons également que les fournisseurs nous apportent une meilleure formation et un meilleur service après-vente en ce qui concerne l’utilisation des outils. Et nous ne cessons de leur demander qu’ils nous fournissent des notices techniques en français pour que nos salariés puissent comprendre l’utilisation d’un équipement !
Notre fédération se demande enfin s’il ne faudrait pas dresser la liste des fournisseurs qui respecteraient strictement les prescriptions et les obligations techniques en matière réglementaire.
Mme Sylviane Alaux. Cela veut dire que tout cela n’existe pas à ce jour.
M. André Eloi. Pas systématiquement.
M. Mathieu Pecqueur. Les services de l’État et les préposés vétérinaires sont présents dans nos outils. Chez les adhérents de Culture Viande, de dix à quinze préposés vétérinaires sont présents en permanence, et jusqu’à trente-cinq dans les outils les plus grands. Autrement dit, nos rapports doivent être nécessairement positifs avec les services vétérinaires. Comme M. Eloi, je considère que ces services doivent avoir reçu une formation au bien-être animal, ce qui ne va pas forcément de soi dans leur cursus. Et nous devons tous avoir la même appréciation des guides de bonnes pratiques qui, je le rappelle, sont validés par l’administration et sont d’ores et déjà utilisés dans nos outils.
Nous avons demandé collectivement une présence systématique au poste d’abattage. Même si dix ou quinze proposés vétérinaires sont présents dans l’abattoir, il peut arriver qu’aucun ne soit passé au poste d’abattage. J’ose croire qu’il ne peut pas se produire de pratiques comme celles que l’on a pu voir sur les vidéos si un vétérinaire ou un préposé vétérinaire est à côté du poste d’abattage. Le ministre a répondu qu’il n’était pas possible de généraliser cette présence pour des questions budgétaires, ce que j’entends. Peut-être faut-il réfléchir à leur répartition dans l’établissement ? Faut-il qu’ils restent à trente-cinq dans un seul endroit, ou plutôt n’en mettre que trente-deux ou trente-trois, surtout si d’autres personnes ont été formées, et redispatcher les autres ailleurs ? Voilà une question que nous nous autorisons à poser.
Vous nous posez la question de notre passivité par rapport à la diffusion de ces vidéos. Elles ont constitué un choc pour nous : personne n’imaginait que de telles pratiques pouvaient exister. Je le répète, on ne peut en aucun cas considérer qu’elles sont nombreuses et généralisées. Cela dit, nous n’avions pas attendu ces vidéos ni le règlement européen pour prendre en compte le bien-être animal. Peut-être peut-on donner plus de place aux RPA dans nos outils. Culture viande souhaite créer un réseau de RPA pour que les différentes entreprises puissent échanger entre elles sur les bonnes pratiques et la manière de travailler, la façon dont ils doivent effectuer les suivis, etc. La comparaison a été faite tout à l’heure avec les responsables qualité. C’est un poste indiscutable aujourd’hui dans nos outils. Il en sera de même dans peu de temps du RPA.
M. Éric Barnay. Il n’y a pas d’activité d’abattoir sans les services vétérinaires. Je pense qu’ils sont aussi mal que nous face à ces images. Comme vient de le dire M. Pecqueur, ce sont des choses que l’on n’avait pas du tout imaginées. Les RPA sont présents, de même que les services qualité, les services de l’État. Cette pratique n’est vraiment pas généralisée : il s’agit d’actes individuels, qui nous ont totalement échappé. Je fais souvent la comparaison avec un chauffeur qui aura bu et qui aura eu un accident alors que son employeur n’aura rien pu faire, ni prévenir ni prévoir.
M. André Eloi. Monsieur Morel-A-L’Huissier, nous ne sommes pas passifs, mais choqués. Comme Culture viande, nous avons un réseau de responsables qualité qui s’est quelque peu transformé aujourd’hui en réseau RPA, puisque beaucoup de responsables qualité ont aussi la fonction de RPA. C’est un réseau dynamique. Nous échangeons, via internet, sur les pratiques, les équipements, etc. Notre fédération a également mis en place ce que j’appellerai la labellisation de l’abattoir : nous effectuons chaque semaine, à la demande de l’outil, des audits et des formations pour vérifier que le fonctionnement est optimum dans tous les domaines : protection animale, sécurité sanitaire, sécurité des personnels. Cette labellisation se traduit par un rapport très précis remis à nos abattoirs. Nous allons le redynamiser en mettant peut-être davantage l’accent encore sur la protection animale.
M. Henri Thébault. Il est indispensable d’instituer une rencontre annuelle avec les services vétérinaires et une formation commune pour pouvoir déterminer ce qui est bien fait ou mal fait.
J’invite cordialement les membres de votre commission d’enquête à visiter nos outils de façon inopinée. Vous y verrez des gens qui travaillent correctement, qui vendent de la bonne viande et surtout qui font tourner l’économie de notre pays. La France en a bien besoin.
M. le président Olivier Falorni. Messieurs, nous avons bien entendu votre invitation, et nous vous remercions pour vos réponses.
La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq.
——fpfp——
7. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des représentants d’associations de protection animale, avec la participation de M. Christophe Marie, directeur du pôle protection animale et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, M. Ghislain Zuccolo, directeur général de l’association Welfarm–Protection mondiale des animaux de ferme, Mme Agathe Gignoux, responsable affaires publiques de l’association Compassion in world farming (CIWF) France et Mme Caroline Brousseaud, cofondatrice et présidente de l’association en faveur de l’abattage des animaux dans la dignité (AFAAD).
(Séance du mercredi 11 mai 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.
M. le président Olivier Falorni. Mes chers collègues, notre commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français accueille aujourd’hui les représentants de quatre associations de protection animale. Nous recevons M. Christophe Marie, directeur du pôle protection animale et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, M. Ghislain Zuccolo, directeur général de l’association Welfarm – Protection mondiale des animaux de ferme, Mme Agathe Gignoux, responsable « affaires publiques » de l’association Compassion In World Farming (CIWF) France, et Mme Caroline Brousseaud, cofondatrice et présidente de l’Association en faveur de l’abattage des animaux dans la dignité (AFAAD).
Cette table ronde est ouverte à la presse et diffusée en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Christophe Marie, M. Ghislain Zuccolo, Mme Agathe Gignoux et Mme Caroline Brousseaud prêtent successivement serment.)
M. Christophe Marie, directeur du pôle protection animale et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Mesdames, messieurs les députés, la Fondation Brigitte Bardot a été créée en 1986, il y a trente ans cette année. Cependant, l’action de sa présidente remonte à une date bien antérieure puisque, dès 1962, elle a obtenu que soit pratiqué un étourdissement des bêtes avant leur abattage. Notre fondation, apolitique et reconnue d’utilité publique depuis 1992, est placée sous la tutelle des trois ministères de l’écologie, de l’agriculture et de l’intérieur, représentés au sein de notre conseil d’administration. Nos financements proviennent de donateurs privés et nous ne percevons pas de subventions publiques.
Nos actions visent à la fois les animaux sauvages et domestiques, en France et dans le monde entier. Nous sommes particulièrement présents sur le terrain aux côtés des services vétérinaires lors des saisies de cheptels laissés à l’abandon et lors des liquidations judiciaires. Nous intervenons également sur les sites d’abattage clandestins, notamment lors de l’Aïd el-Kebir. En décembre 2013, nous sommes intervenus avec les forces de l’ordre pour démanteler un abattoir illégal à La Courneuve, qui alimentait les restaurants asiatiques de Paris dans des conditions inimaginables ; en cette occasion, nous avons saisi plus de 300 animaux. Notre fondation accueille actuellement plus de 3 500 animaux saisis lors d’opérations de ce type. Il s’agit essentiellement d’animaux de ferme – plus de 650 bovins, autant d’équidés, plus de 500 moutons, 200 chèvres et une centaine de cochons – auxquels s’ajoutent, bien sûr, quantité de chiens et de chats.
Si la question de l’abattage fait souvent débat, elle ne doit pas pour autant nous faire oublier celle du transport, lors duquel les animaux sont soumis à un stress intense qui rend plus difficile leur manipulation jusqu’au poste d’abattage. Dans certaines situations extrêmes, les animaux arrivent à destination dans un état de souffrance épouvantable, qui justifie en principe qu’ils soient pris en charge et abattus en urgence. Or, c’est souvent l’inverse qui se passe : on fait passer sur la chaîne d’abattage tous les animaux manipulables et propres, tandis que les animaux blessés durant le transport, qui ont souvent été piétinés par les autres animaux, sont abandonnés dans un coin en attendant leur tour. En octobre 2015, nous avons porté plainte contre l’abattoir Sélection Viande Distribution, situé près de Vannes, où un bovin déchargé le samedi avec une fracture du bassin a souffert durant quarante-huit heures avant d’être enfin abattu le lundi suivant. Cette histoire soulève la question des contrôles, car on ne s’explique pas comment un inspecteur vétérinaire, en principe présent sur les lieux, a pu passer à plusieurs reprises devant un animal à l’agonie sans juger nécessaire d’intervenir.
La présence d’un responsable du bien-être des animaux a été rendue obligatoire dans les abattoirs à compter du 1er janvier 2013 par application d’un règlement européen. Cependant, rien ne garantit ni les compétences ni l’indépendance de cette personne : il peut même s’agir du responsable de l’abattoir, comme c’est le cas au Vigan, dans le Gard. Nous avons demandé à plusieurs reprises à Stéphane Le Foll de renforcer les équipes vétérinaires qui, actuellement, contrôlent davantage les carcasses que les conditions de mise à mort des animaux. Il a répondu publiquement le 5 avril dernier, lors de la réunion exceptionnelle du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV), qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour mettre en œuvre ces contrôles supplémentaires. Cette réponse ne saurait nous satisfaire, car elle va à l’encontre de l’arrêté du 12 décembre 1997 qui dispose que, dans les abattoirs, les conditions d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux sont placées sous la surveillance continue des agents du service d’inspection, qui s’assurent notamment de l’absence de défectuosité des matériels utilisés et de l’utilisation conforme de ces matériels. Sur ce point, je rappelle ce qui s’est passé à l’abattoir de Mauléon-Licharre, dans les Pyrénées-Atlantiques, où une vidéo a montré un employé obligé d’assommer un agneau en lui assenant des coups de crochet, le système d’étourdissement n’étant pas fonctionnel : un problème matériel comme celui-ci aurait dû être détecté avant la mise en œuvre de la chaîne d’abattage.
Depuis plusieurs années, nous réclamons la mise en place de caméras de surveillance dans tous les abattoirs, en particulier sur les postes sensibles, de la manipulation à la mise à mort des animaux. Cela nous paraît important pour trois raisons. Premièrement, le rôle de prévention d’une telle mesure : se sachant observé ou contrôlé, le personnel va réfléchir à deux fois avant de commettre un acte répréhensible. Deuxièmement, les vidéos enregistrées par les caméras pourront servir à des actions de formation continue, lors desquelles seront identifiées les pratiques posant problème, pour le bien-être animal mais aussi pour le personnel, car le taux d’accidents du travail des employés d’abattoirs est très supérieur à celui de la moyenne nationale : la prise en considération des bonnes pratiques dans le cadre du droit du travail constituerait une grande avancée. Troisièmement, enfin, les images enregistrées par les caméras pourront constituer des preuves des actes répréhensibles pouvant avoir été commis par les employés.
Indépendamment de toutes les mesures de contrôle et de formation qui pourraient être mises en œuvre, reste un problème essentiel, celui de l’abattage sans étourdissement préalable : dans le cadre de l’abattage rituel, l’animal n’est pas étourdi et l’égorgement à vif entraîne une souffrance, mise en évidence par de nombreuses études scientifiques, et que nous jugeons inacceptable et même injustifiable. J’accompagnais Brigitte Bardot lorsqu’elle a été reçue par le recteur Dalil Boubakeur à la Grande Mosquée de Paris en 2004, puis par Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur, en 2005, enfin par le même, Président de la République, en 2007. Nous sommes ressortis confiants de chacune de ces réunions, constatant qu’il ne semblait y avoir aucune opposition réelle à la mise en place de l’étourdissement préalable. La charte de la mosquée d’Évry mentionne explicitement que l’étourdissement, dès lors qu’il est réversible, est accepté. Or, la réversibilité de l’étourdissement des ovins a été confirmée par l’Académie vétérinaire de France en 2006, dans un rapport remis aux ministères de l’agriculture et de l’intérieur. Pour ce qui est des bovins, j’ai moi-même assisté à des reprises de conscience dans des pièges de contention électrifiés utilisés dans de nombreux pays, mais pas encore en France.
En résumé, dès lors que le culte n’est pas opposé par principe à l’étourdissement réversible, et qu’il existe des méthodes fiables pour le mettre en œuvre, on ne voit pas pourquoi on devrait continuer à s’acharner à égorger des animaux conscients, dans la souffrance. L’étourdissement des bêtes en toutes circonstances est donc l’une de nos deux principales demandes, avec celle consistant en l’installation de caméras de surveillance.
M. Ghislain Zuccolo, directeur général de l’association Welfarm – Protection mondiale des animaux de ferme. L’association Welfarm a été fondée en 1994 et compte 40 000 membres et donateurs, dont 25 000 membres actifs. Sa mission est reconnue d’utilité publique. Elle emploie 23 salariées ayant une certaine expertise, notamment dans le domaine de l’éthologie. Ses principales missions consistent à œuvrer pour obtenir de nouvelles réglementations pour le bien-être des animaux d’élevage, mais aussi pour que ces réglementations soient bien appliquées.
En matière de transport des animaux, nous avons édité une brochure présentant la réglementation destinée à protéger les animaux en cours de transport, qui a été distribuée à toutes les gendarmeries de France ; par ailleurs, nous formons régulièrement les gendarmes à cette réglementation, au sein des escadrons de sécurité routière.
Nous œuvrons également à la valorisation des bonnes pratiques et des initiatives des éleveurs, de l’industrie agroalimentaire et de la distribution, qui visent à une meilleure protection des animaux d’élevage. Nous menons une action éducative auprès des plus jeunes, mais aussi des ingénieurs agronomes. Enfin, nous exploitons une ferme éducative de 44 hectares dans la Meuse.
Nous avons constaté que les vidéos diffusées par l’association L214 Ethique et Animaux mettaient en évidence des problématiques de quatre ordres, pouvant être liées aux aménagements inappropriés pour la conduite des animaux ; aux dysfonctionnements des matériels utilisés pour la mise à mort des animaux ; au comportement de certains employés ; enfin, à des défaillances dans le processus de contrôle du respect de la réglementation. Les vidéos ont également mis en évidence le fait que certains procédés d’étourdissement ne sont pas efficaces, et montré que la pertinence de certains signes indicateurs de perte de conscience fait débat.
Nous considérons que, lorsqu’on s’intéresse au bien-être de l’animal en abattoir, il faut partir du point de vue de l’animal, qui a sa propre perception de l’environnement, bien différente de la nôtre. Je rappelle que tous les animaux d’élevage descendent d’animaux sauvages : ainsi la vache descend-elle de l’aurochs. Pour que la conduite des animaux au sein des abattoirs se fasse dans les meilleures conditions, il convient de faire appel à des notions d’éthologie. En quittant la ferme où il a été élevé pour partir à l’abattoir, l’animal quitte un lieu familier pour se retrouver dans un milieu inconnu, donc stressant.
Lors des trois étapes constituant le parcours de l’animal à l’abattoir – l’arrivée et l’attente en bouverie, la conduite des animaux au poste d’abattage et le processus d’abattage proprement dit, il importe de faire en sorte que l’animal soit le moins stressé possible. Lorsque les animaux arrivent, l’idéal est que les quais de déchargement permettent d’abaisser l’arrière du camion et de laisser la rampe à plat, car le fait de devoir passer par une rampe trop pentue provoque souvent des accidents. Lors de la phase d’attente, il faut éviter de mélanger différents lots d’animaux, car cela peut créer des interactions agressives ; il faut aussi que les animaux puissent se coucher tous en même temps ; pour les porcs, qui ne transpirent pas et régulent donc difficilement leur température, il est bon de prévoir des brumisateurs afin d’éviter qu’ils soient victimes de coups de chaleur. Lors de la manipulation, les contacts directs avec les animaux doivent être évités, car un opérateur ayant peur de l’animal peut être amené à avoir des gestes violents en voulant se protéger : pour cela, il est intéressant de prévoir deux couloirs distincts, l’un réservé à la circulation des animaux et l’autre à celle des opérateurs.
À l’abattoir, trois sens de l’animal se trouvent particulièrement en éveil : l’ouïe, l’odorat et la vue. Pour ce qui est de l’ouïe, l’animal est stressé par les sons forts et aigus : on atténuera donc les claquements de barrières métalliques en garnissant celles-ci de tampons de caoutchouc, et on évitera de crier. Pour ce qui est de l’odorat, les animaux stressés dégagent des phéromones, qui stressent à leur tour les autres animaux. En France, l’Institut de recherche en sémiochimie et éthologie appliquée (IRSEA) commercialise des phéromones apaisantes ; il m’a été précisé que ces substances, régulièrement utilisées dans les élevages et les transports, n’avaient jamais été mises en œuvre dans les abattoirs, mais sans doute y a-t-il là une piste à explorer. Enfin, pour ce qui est de la vue, il faut savoir que les animaux ont peur des impasses et des angles droits : les couloirs incurvés permettent de résoudre cette difficulté, car l’animal qui s’y trouve suit celui qui est devant lui sans être stressé par ce qu’il pourrait voir plus loin. Par ailleurs, il est conseillé d’éclairer le poste d’abattage, car les animaux ont tendance à se diriger instinctivement vers l’endroit le plus éclairé.
Dans le poste d’abattage, l’un des points importants est la contention. Dans l’une des vidéos de L214, l’absence de mentonnière est à l’origine des difficultés que rencontre l’abatteur à étourdir l’animal. La mentonnière ne sera obligatoire qu’à partir de 2019 mais, dans l’intérêt du bien-être animal, il serait bon que la France devance cette échéance. Il arrive aussi que les appareils électriques se dérèglent, délivrant trop ou pas assez de puissance. Le temps d’imposition de la pince doit être suffisant et la puissance du courant doit être adaptée. J’ai visité récemment un abattoir de lapins en Belgique, où le directeur avait installé des témoins lumineux rouges et verts indiquant à l’opérateur à quel moment il pouvait cesser d’appliquer le courant électrique à chaque lapin : un tel dispositif est très intéressant, car la cadence élevée d’abattage peut faire perdre la notion du temps aux abatteurs.
En matière d’étourdissement, le doute doit toujours bénéficier à l’animal, auquel doit être appliqué un deuxième choc électrique si le premier s’est révélé inefficace – après, bien sûr, avoir recherché les causes de ce premier échec. Jusque dans les années 1990, le matériel destiné à étourdir et abattre les animaux faisait l’objet d’un agrément délivré par le ministère de l’agriculture ; nous regrettons que cette mesure ait été supprimée et nous souhaitons qu’elle soit remise en vigueur.
Mme Agathe Gignoux, responsable « affaires publiques » de l’association Compassion In World Farming (CIWF) France. L’association Compassion In World Farming est une ONG internationale dédiée à la protection des animaux d’élevage, créée en 1967 par un éleveur laitier britannique en réaction à l’intensification de l’élevage. Nous sommes présents en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Chine, et actifs en France depuis 2009, et agissons essentiellement au moyen de campagnes visant à sensibiliser les problématiques liées à l’élevage et à proposer des solutions. Nous menons également des enquêtes afin de montrer la réalité de l’élevage et de l’abattage industriels, ainsi que des actions-plaidoyers, visant à faire évoluer les politiques publiques. Enfin, une partie importante de notre travail consiste à conclure des partenariats avec les grandes entreprises, afin de placer le bien-être animal au cœur de l’industrie agroalimentaire.
Je précise que notre action se base sur le travail scientifique mené par notre équipe de recherche, qui nous fournit des conseils techniques et une expertise en matière de bien-être animal. Nous sommes régulièrement sollicités par les acteurs du monde agricole ou agroalimentaire, à qui nous donnons des conseils et des recommandations.
Nous sommes membres de groupes de travail au niveau européen, et dans les États membres où nous sommes présents. En France, nous sommes membres du CNOPSAV et participons à différents groupes de travail. Nous suivons les problématiques du bien-être animal en abattoir dans les pays où nous sommes présents. En France, nous sommes alertés depuis de nombreuses années par les enquêtes réalisées par différentes associations, ainsi que par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de l’Union européenne – deux rapports de l’OAV, publiés en 2007 et en 2015, mettent en évidence des problématiques relatives à l’abattage. Enfin, nous exploitons aussi les vidéos de L214, qui corroborent les différents manquements et montrent qu’il ne s’agit pas de cas isolés.
Les problèmes les plus importants qui ressortent de ces différentes sources d’information ont trait au contrôle de l’étourdissement et des signes de conscience – aggravés par les lacunes constatées dans les modes opératoires normalisés, non corrigées par les autorités vétérinaires de l’État ; à l’étourdissement des volailles, qui constitue un gros point noir du rapport de l’OAV de 2015, et nécessite qu’une action soit menée en France à ce sujet ; enfin, à l’étourdissement des porcs au CO2.
L’accent doit être mis sur le contrôle du poste d’abattage, le point essentiel étant la vérification de la perte de conscience. On retrouve des situations récurrentes d’absence d’étourdissement suffisant, de reprise de conscience non corrigée par un étourdissement d’urgence, de délais d’attente trop longs entre l’étourdissement et la saignée, d’absence de mesures correctives et de sanctions appropriées par les autorités. Ces graves manquements, à l’origine de souffrances pourtant évitables, sont totalement contraires au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, en vigueur en France depuis le 1er janvier 2013. L’article 3 de ce règlement précise que « toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes » et son article 5 que « lorsque (…) les animaux sont mis à mort sans étourdissement préalable, les personnes chargées de l’abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation et ne présentent aucun signe de vie avant l’habillage ou l’échaudage ».
Les causes des manquements constatés sont multiples, qu’il s’agisse de l’absence de contrôle au poste de mise à mort – par les abattoirs eux-mêmes, mais aussi par les inspections vétérinaires, les contrôleurs étant concentrés sur les carcasses plutôt que sur les animaux ante mortem. On relève des lacunes en matière de formation et de sensibilisation des personnels et des contrôleurs, l’utilisation de matériels défectueux, inadéquats ou mal réglés. Pour remédier aux anomalies constatées, nous prônons l’installation de caméras permettant la mise en œuvre d’une surveillance continue par des agents de contrôle, essentiellement au poste d’abattage. La vidéosurveillance est mise en œuvre dans plusieurs pays de l’Union européenne. Au Royaume-Uni, c’est le cas dans 53 % des abattoirs de viande rouge et dans 71 % des abattoirs de viande blanche ; ces systèmes sont également présents dans de nombreux abattoirs des Pays-Bas ; ils sont obligatoires depuis 2016 dans tous les abattoirs d’Israël et de l’État indien d’Uttar Pradesh. En France, des caméras ont été installées à titre expérimental dans un abattoir du Nord, et la généralisation du dispositif ne poserait a priori pas de problèmes particuliers. Nous souhaitons qu’il soit rendu obligatoire, tout en étant strictement encadré par un contrôle indépendant.
Les lacunes des modes opératoires normalisés ont été mises en évidence par le rapport de l’OAV de 2015. Nous y voyons un point essentiel, car la structure de la nouvelle réglementation (CE) n° 1099/2009 repose sur la mise en place d’autocontrôles par les modes opératoires normalisés. Elle fait reposer la responsabilité sur les opérateurs des abattoirs, et peut avoir un effet positif à condition qu’elle soit vraiment prise au sérieux par les opérateurs, et surtout par les autorités de contrôle, ce qui n’est malheureusement pas le cas en France. Nous souhaitons donc un renforcement en urgence des procédures d’inspection des modes opératoires normalisés et une meilleure application des sanctions, afin de rendre celles-ci suffisamment dissuasives.
Je voudrais insister sur une problématique peu évoquée jusqu’à présent, celle des méthodes d’étourdissement en abattage de volaille, qui constitue l’un des plus gros points noirs du rapport de l’OAV. La France fait partie des plus importants producteurs de volaille : on abat chaque année 900 millions de volailles dans notre pays, sur un peu plus d’un milliard d’animaux abattus en tout. Les problèmes constatés peuvent avoir deux origines : d’une part, certains paramètres de la réglementation ne suffisent pas à garantir un étourdissement effectif de toutes les volailles au moyen de l’électronarcose par bain d’eau, notamment par application des fréquences élevées autorisées par la réglementation ; d’autre part, les paramètres fixés par la réglementation ne sont pas toujours respectés par les abatteurs, qui réduisent les intensités afin de diminuer l’impact de l’application des courants électriques sur les carcasses – il s’agit notamment de phénomènes hémorragiques et de fractures – ou de garantir la conformité des procédés utilisés à certains rituels. Dans ce dernier cas, l’étourdissement n’est pas suffisant et les volailles sont seulement immobilisées ou paralysées : or, selon l’OAV, l’étourdissement d’une intensité insuffisante « ne fait qu’entraîner une douleur supplémentaire » et un abattage effectué en pleine conscience. Nous estimons donc essentiel de développer l’étourdissement des volailles par méthode gazeuse, comme cela se fait au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et dans de nombreux autres pays européens.
L’une des vidéos de L214 met en évidence le fait que l’étourdissement des porcs au CO2, autorisé par le règlement (CE) n° 1099/2009, cause de vives souffrances aux animaux. Les autorités françaises et européennes ont connaissance de ce problème depuis de nombreuses années. La recherche scientifique a montré depuis longtemps que ce mode d’étourdissement provoque des sensations de brûlure et des douleurs aiguës durant quinze à trente secondes avant que le porc ne perde conscience. Il nous paraît donc urgent d’investir dans le développement d’alternatives non aversives.
D’une manière générale, les moyens alloués à la protection des animaux en abattoirs en France sont insuffisants, que ce soit en termes de contrôles ou de manque d’effectifs. Par ailleurs, la réglementation n’est pas toujours compatible avec les cadences appliquées aux chaînes d’abattage, notamment pour ce qui est des volailles.
Mme Caroline Brousseaud, cofondatrice et présidente de l’Association en faveur de l’abattage des animaux dans la dignité (AFAAD). Nous sommes en quelque sorte un « Petit Poucet » associatif, puisque l’AFAAD a été créée par moi-même en juillet dernier. Constatant, en tant que citoyenne et consommatrice, que l’on parlait assez peu des abattoirs et des conditions d’abattage en France, le sujet n’étant évoqué qu’au moment de la fête de l’Aïd et des abattages sans étourdissements auxquels elle donne lieu. M’interrogeant sur la question globale du bien-être animal, j’avais des difficultés à trouver des réponses accessibles au grand public. Aujourd’hui, l’AFAAD est avant tout une association de consommateurs et de citoyens, qui ne dispose d’aucune expertise particulière dans le domaine vétérinaire, et œuvre à l’amélioration des conditions d’abattage en essayant d’aborder les problématiques sous un angle différent pour faire émerger de nouvelles solutions.
Notre association travaille avec l’ensemble des acteurs de la filière de l’abattage, à savoir les éleveurs, les artisans bouchers, les inspecteurs vétérinaires en abattoirs : nous avons ainsi constitué un petit réseau de professionnels qui nous font part de leur expertise et nous suggèrent des améliorations qui pourraient être mises en place. Nous sommes également en relation avec des chercheurs à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et des éthologues, et travaillons dans une logique de co-construction de solutions afin de trouver des alternatives dans le cadre de l’échange et du dialogue.
Nos principales missions consistent en des actions de sensibilisation auprès du grand public sur ce que sont l’abattage et les abattoirs, en mettant l’accent sur ce qui fonctionne mal et ce qui pourrait être amélioré. Nous sommes également très attachés au droit des consommateurs à connaître la méthode d’abattage. Nous travaillons sur le terrain avec des bénévoles, qui vont parler des abattoirs, et avons commencé à structurer notre action en la répartissant entre des pôles régionaux. Par ailleurs, nous collectons de nombreux témoignages, provenant notamment d’éleveurs ou d’artisans bouchers, que nous diffusons sur notre site web.
L’AFAAD souhaite la mise en place d’un étourdissement systématique de tous les animaux et, d’une manière générale, la prise en compte du bien-être animal. Faute d’une évolution réglementaire en France, nous demandons expressément que le soulagement obligatoire post-jugulation de l’animal puisse être assuré dans les secondes qui suivent l’égorgement – c’est ce que l’on appelle un étourdissement de soulagement, pratiqué afin de ne pas laisser un bovin agoniser durant de longues minutes avec la gorge tranchée. Nous souhaitons également que l’électronarcose réversible soit développée et pratiquée en bonne entente avec les autorités concernées.
S’agissant des contrôles dans les abattoirs, nous sommes pour la mise en place d’une vidéosurveillance systématique aux postes d’abattage, qui nous semble une solution intéressante au manque d’effectifs en inspecteurs vétérinaires. Nous soutenons également la proposition consistant à permettre aux éleveurs d’accéder aux abattoirs. Il s’agit là d’une demande de plus en plus forte de la part des éleveurs, qui regrettent de ne pouvoir assister à la mort de leurs animaux s’ils le souhaitent. Nous suggérons donc qu’un contrat soit mis en place entre les responsables d’abattoirs et les éleveurs, garantissant à ces derniers au moins trois visites inopinées par an lorsque la chaîne d’abattage est en fonctionnement.
Un volet pratique doit absolument être ajouté à la formation, uniquement théorique pour l’instant, dispensée aux opérateurs d’abattage. Des sanctions dissuasives et effectives doivent être mises en œuvre.
Une autre disposition qui nous tient à cœur consisterait en la création de comités d’éthique au sein des abattoirs. Ce n’est pas nous qui l’avons imaginée, mais M. Laurent Lasne, président du Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNSPV), qui sera auditionné prochainement par votre commission. Des comités d’éthique statuent déjà dans le cadre des expérimentations animales. Ils rassemblent des membres de la société civile, pouvant garantir un regard totalement extérieur et sans a priori sur une activité sensible et constituant une sorte de garde-fou. En ce qui concerne l’abattage, on peut imaginer que les comités associent les responsables d’abattoirs, les services officiels d’inspection vétérinaire, des représentants des éleveurs, des associations de protection animale et des élus locaux. Cela permettrait d’augmenter la visibilité et de mettre en œuvre un travail commun pour l’amélioration des bonnes pratiques.
Nous sommes favorables au développement des abattoirs mobiles et de l’abattage à la ferme. C’est l’un des premiers dossiers que nous ayons ouverts en intégrant un collectif pluridisciplinaire créé l’année dernière et piloté par Mme Jocelyne Porcher, de l’INRA, dans le cadre de la recherche d’actions innovantes. D’autres associations de protection animale viennent de rejoindre ce collectif, ce dont nous nous félicitons. Nous sommes actuellement en train de structurer un cahier des charges très détaillé et menons un important travail de benchmarking au niveau des pays européens, afin de promouvoir les bonnes pratiques mises en œuvre à l’étranger – de ce point de vue, l’exemple suédois semble très intéressant. Cela permet de pallier la baisse du nombre d’abattoirs, notamment en raison de la fermeture d’abattoirs de proximité, de réduire le transport à zéro pour les animaux vivants, d’éviter que les animaux ne soient manipulés par des inconnus et de répondre à la demande morale des éleveurs souhaitant accompagner leurs animaux jusque dans la mort.
Nous plaidons en faveur d’un étiquetage indiquant systématiquement la méthode d’abattage employée, assurant une plus grande transparence et un accès plus facile à toutes les informations administratives de nature à nous permettre d’établir un benchmark des abattoirs selon des critères de bientraitance animale, comme cela se fait pour l’aspect sanitaire – sur ce point, ils sont classés de 1 à 3. Pour cela, il serait intéressant d’obtenir des statistiques sur le pourcentage d’étourdissements réussis du premier coup, la fréquence des réunions dédiées à la protection animale au sein des établissements, le pourcentage de chute des animaux, ou encore le temps d’attente moyen des animaux en bouverie. Le fait de disposer d’un classement établi sur la base de ces informations constituerait une avancée pour les consommateurs, qui pourraient acheter leur viande en toute connaissance de cause.
M. le président Olivier Falorni. Indépendamment de l’intérêt qu’il présente, l’abattage mobile ne saurait répondre à la consommation de viande au niveau national, et soulève la question du respect des normes sanitaires et environnementales. Quelle est votre position sur ce point ?
Par ailleurs, un certain nombre d’ONG, dont CIWF, me semble-t-il, travaillent à la mise en place d’un label éthique animal national. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
M. William Dumas. Monsieur Marie, vous avez évoqué la compatibilité de l’étourdissement avec l’abattage rituel, un sujet qui m’intéresse particulièrement car j’ai dans ma circonscription un abattoir pratiquant 50 % d’abattage rituel, avec toutes les questions que cela soulève – je pense notamment à l’intervention de sacrificateurs non certifiés. Pouvez-vous développer votre propos sur ce point ?
M. Jean-Luc Bleunven. J’aimerais savoir s’il existe un outil de mesure de l’évolution de ce que pense la population des pratiques d’abattage et, d’une manière plus générale, si vous estimez que la conception des éleveurs et des consommateurs est en train d’évoluer.
M. Jacques Lamblin. Vous avez tous évoqué des méthodes d’étourdissement censées être compatibles avec l’abattage rituel, qu’il s’agisse de l’électronarcose ou du post-cut stun. Comment, selon vous, éviter la souffrance animale tout en préservant l’intérêt économique du marché que représente la viande rituelle ? S’il fallait choisir une méthode d’étourdissement, laquelle aurait votre préférence ?
Les anomalies constatées par L214 ont toutes eu lieu dans des abattoirs de petite taille, jamais dans les grands abattoirs industriels – ce qui peut être dû au fait qu’il a été plus facile à cette organisation de s’introduire dans les petits abattoirs. Selon vous, les risques de dérives sont-ils plus élevés dans les abattoirs de taille modeste ?
Mme Geneviève Gaillard. Alors que le premier rapport de l’OAV date de 2007, comment se fait-il que les problématiques liées à l’abattage commencent tout juste à être introduites dans la sphère publique en France ?
Monsieur Marie, vous nous avez dit avoir rencontré le recteur Boubakeur. J’aimerais savoir si vous avez également vu le grand rabbin Bruno Fiszon, et où en est la question de l’abattage rituel dans la religion juive.
Pouvez-vous me préciser si, de votre point de vue, les cadences élevées pratiquées dans les abattoirs peuvent avoir une incidence sur le fait que des mauvais traitements soient appliqués aux volailles, mais aussi aux autres animaux ?
Enfin, on voit se développer actuellement la demande d’abattage à la ferme : qu’en pensez-vous ?
M. Christophe Marie. J’ai rencontré à plusieurs reprises le docteur Fiszon, qui est vétérinaire, et chargé de la certification casher. Les choses ne sont pas réglées, mais une dizaine de pays de l’Union européenne ont déjà légiféré sur la question ; en ce moment même, une proposition législative relative à l’étourdissement est en cours d’examen devant le parlement flamand. Lorsque le ministre de l’agriculture du Danemark a pris ses fonctions en 2013, il a tout de suite adopté une obligation d’étourdissement des animaux, considérant que les droits des animaux sont prioritaires par rapport aux droits religieux. En 2008, dans le cadre d’un débat européen sur l’étiquetage et la possibilité de mentionner sur les produits que ceux-ci sont issus d’un abattage rituel, Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’intérieur, avait déclaré : « L’État doit protéger les traditions cultuelles : je pense à l’abattage rituel, que rien ne doit pouvoir remettre en question, même au nom de droits reconnus à la protection animale. » Depuis, aucune évolution n’est intervenue en France.
Le dialogue est ouvert avec les autorités du culte musulman, et des positions très claires ont été définies. Lorsque nous nous sommes rendus à la Grande Mosquée de Paris, l’imam, habilité à faire une lecture des textes, nous a confirmé qu’il n’y avait pas d’opposition à l’étourdissement dès lors que celui-ci était réversible – or, la réversibilité a été établie par un rapport de l’Académie vétérinaire de France. À l’issue de notre rencontre, M. Boubakeur a déclaré à Associated Press que rien ne s’opposait à l’étourdissement, mais qu’il ne lui revenait pas de légiférer sur la question.
Le cahier des charges halal de la mosquée d’Évry-Courcouronnes précise que « le calme des sujets à égorger, provoqué par l’électronarcose, est toléré, du moment que ce procédé ne provoque pas la mort » et que « toute viande bovine, ovine, volaille, lapine ayant été produite suivant le procédé cité ci-dessus pourra recevoir la certification halal par la mosquée d’Évry-Courcouronnes ».
Mis à part le cas de Lyon, où les choses sont un peu plus compliquées qu’ailleurs, d’une manière générale, on ne note pas de blocage en ce qui concerne le culte musulman. Plusieurs abattoirs pratiquant l’étourdissement préalable sont certifiés halal, dont le grand abattoir ovin de Sisteron. Il ressort des discussions que j’ai eues avec les responsables d’abattoirs que les difficultés qu’ils peuvent rencontrer résultent de l’absence d’encadrement au niveau réglementaire : ils pratiquent donc l’étourdissement dans le cadre d’accords passés avec les autorités cultuelles, mais prennent, ce faisant, le risque de provoquer des réactions de rejet de la part de certains consommateurs musulmans.
M. Jacques Lamblin. Des consommateurs ou des négociants ?
M. Christophe Marie. Peut-être les deux. En tout état de cause, cela montre bien la nécessité de légiférer sur la question. Un nombre croissant d’éleveurs, notamment ceux chez qui nous avons placé nos animaux en pension, nous confient qu’élevant leurs animaux avec le plus grand soin, ils aimeraient être sûrs de savoir dans quelles conditions ils vont être abattus, et regrettent d’avoir de moins en moins de choix, le nombre d’abattoirs étant en diminution.
M. Jacques Lamblin. Si je comprends bien, les abattoirs pratiquant l’abattage rituel préféreraient se voir imposer une disposition réglementaire rendant l’étourdissement obligatoire, afin de faciliter leurs relations avec leur clientèle ?
M. Christophe Marie. C’est bien ce que m’a dit le directeur de l’abattoir de Sisteron.
Dans de nombreux pays, la question de la compatibilité de l’étourdissement avec le rituel halal est réglée. En Égypte, une fatwa a confirmé l’absence d’incompatibilité. Au Royaume-Uni, l’étourdissement est généralisé, bien qu’il ne soit pas imposé de façon réglementaire. Je ne m’explique pas qu’en France aucune réponse définitive n’ait encore été apportée sur ce point.
M. Ghislain Zuccolo. Je vous ai apporté une brochure qui dresse la liste de tous les organismes certificateurs de la viande halal, en distinguant ceux qui acceptent l’étourdissement par choc électrique de ceux qui ne l’acceptent pas. Je suis tenté de dire que ceux qui acceptent l’étourdissement par choc électrique sont pénalisés, car les autres ont beau jeu de prétendre pratiquer le « vrai halal ». Il serait bon que les pouvoirs publics reprennent la main, en soutenant ceux qui font une lecture moderne des textes religieux.
Pour avoir vu des centaines de moutons se faire égorger à l’occasion de l’Aïd el-Kebir, je peux vous dire que si un abattage avec étourdissement se déroule généralement dans des conditions correctes, l’abattage rituel est, lui, tout à fait inacceptable, et je ne peux comprendre comment certaines personnes, parfois même des vétérinaires, se permettent d’affirmer que l’animal ne souffre pas !
M. Bleunven nous a demandé s’il existait un outil de mesure de la perception des pratiques d’abattage par la population. L’Union européenne a publié récemment un sondage Eurobaromètre portant sur la sensibilité des citoyens européens au bien-être animal, dont il ressort que les consommateurs y sont très sensibles – l’évolution des sondages effectués sur cette question montre que c’est de plus en plus le cas.
Nous sommes favorables à la vidéosurveillance, qui peut être un outil de contrôle, mais aussi de formation. À l’instar de ce qui se fait lors des stages d’entraînement à la prise de parole en public, par exemple, les images prises par les caméras peuvent être analysées par les personnes directement concernées, qui prennent ainsi plus facilement conscience des gestes à faire ou à éviter. Il conviendra simplement de définir certains aspects pratiques, notamment le temps durant lequel les images peuvent être conservées, ou qui peut y avoir accès.
Je pense que les abattoirs de grande taille ont peut-être plus de facilité à veiller au bien-être animal, dans la mesure où ils sont dotés d’un directeur « qualité » à plein temps et, parfois, d’un responsable uniquement chargé de la question du bien-être animal. Par ailleurs, les abattoirs de grande taille ont souvent de gros clients, qui ont des exigences particulières en matière de qualité. Le groupe Carrefour, avec lequel nous travaillons, fait auditer les abattoirs qui fournissent de la viande à sa filière Qualité Carrefour par un organisme certificateur, qui vérifie notamment que la réglementation relative au bien-être des animaux au moment de l’abattage est bien respectée.
Si la problématique de l’abattage n’a pas rejoint plus tôt la sphère publique, c’est parce qu’il est bien difficile aux associations de faire entendre leur voix sur ce point – nous sommes bien placés pour le dire, nous qui nous efforçons depuis vingt ans de dénoncer la situation. Force est de constater qu’il faut recourir à des caméras cachées et faire un scandale pour que les pouvoirs publics s’emparent enfin du dossier. Je sais que les éleveurs et les abatteurs s’indignent de ces pratiques et je les comprends – pour notre part, nous préférons nous en tenir au dialogue et à la coopération avec les organisations professionnelles –, mais il faut bien que les choses avancent. Le fait que cette commission d’enquête existe, et que cette table ronde soit organisée aujourd’hui, nous rassure quant à l’intérêt que portent les élus au bien-être animal.
Il est fort probable que, plus les cadences sont élevées, plus le bien-être animal s’en ressent. Ces cadences ne doivent pas constituer une variable d’ajustement dont les animaux font les frais : en d’autres termes, peut-être faudrait-il fixer des cadences au niveau européen, interdire par exemple que l’on abatte plus d’un certain nombre d’animaux à l’heure.
Pour ce qui est de l’abattage à la ferme, je crois qu’il est toléré pour certaines espèces dans le cadre de la consommation familiale. En principe, il est interdit de transporter un animal qui serait incapable de se déplacer par lui-même, ce qui nécessite de l’abattre à la ferme : c’est ce que l’on a appelé l’abattage « technique ». Pour des raisons sanitaires, les éleveurs doivent en principe recourir aux services d’un vétérinaire pour ce type d’abattage, mais chacun sait qu’ils ne le font pas toujours, en raison du coût. Un jour, j’ai reçu le témoignage d’un artisan qui, travaillant dans une ferme, a assisté avec horreur à la mise à mort d’une truie par l’injection d’une dose de pesticide : l’animal a mis trois jours à mourir ! Nous ne sommes pas opposés par principe à l’abattage à la ferme, mais cela ne doit se faire qu’à la condition que l’éleveur ait suivi une formation et dispose du matériel adéquat – par exemple, il n’est pas évident de mettre à mort un porc à la ferme, car cet animal possède une boîte crânienne très résistante, ce qui nécessite un outil et un savoir-faire spécifiques.
Mme Agathe Gignoux. La Confédération française de la boucherie a contacté la CIWF ainsi que l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) afin de rédiger un label éthique – nous espérons que d’autres associations de protection animale y seront associées. Ce projet intéressant qui vise à préciser, dans le cadre d’un cahier des charges, les critères éthiques et de qualité de l’élevage jusqu’à la vente, est cependant très peu avancé et il faudra qu’il soit soutenu par l’ensemble des professionnels de la filière, jusqu’aux supermarchés.
Pour ce qui est de l’abattage mobile, s’il pose des problèmes d’ordre sanitaire, il existe cependant des solutions, tels les camions entièrement équipés. Ce système, très développé en Suède, permet de respecter les normes sanitaires et environnementales, puisqu’un vétérinaire inspecteur est présent. Son seul inconvénient est son coût, mais cela ne constitue pas un obstacle insurmontable à son développement, compte tenu de la demande des consommateurs.
S’agissant de la perception du bien-être animal, on assiste à une nette évolution de la perception des consommateurs européens. La France est un peu en retard de ce point de vue, mais les gens commencent à se demander comment ils peuvent continuer à consommer de la viande tout en s’assurant que le bien-être animal est respecté. Le sondage Eurobaromètre évoqué par Ghislain Zuccolo étant précis et effectué régulièrement, il est possible d’observer de manière très fine l’évolution des mentalités, pays par pays. L’une des questions posées aux consommateurs fait apparaître qu’ils sont disposés à payer la viande un peu plus cher si cela se fait au profit du bien-être animal, ce qui nous paraît très significatif.
M. Christophe Marie. On a observé la même chose pour les œufs : dès lors qu’a été imposé un étiquetage faisant apparaître le type d’élevage et permettant une meilleure traçabilité du produit, les consommateurs ont fait valoir leur préférence pour les œufs présentant les meilleures conditions de production.
M. Jacques Lamblin. Cela vaut-il aussi pour les volailles ?
Mme Agathe Gignoux. Non, nous parlons bien des œufs : en supermarché, la vente d’œufs de poules élevées hors cage est passée de 20 % à 50 % depuis la mise en place du nouvel étiquetage indiquant le mode d’élevage. Cet exemple justifie le souhait des associations que les consommateurs puissent connaître le mode d’abattage des animaux car, une fois informé, le consommateur fait de lui-même le choix du bien-être animal. Il s’agit d’un mécanisme de marché, qui ne révolutionne pas les choses du jour au lendemain, mais accompagne progressivement l’évolution des pratiques, de l’éleveur au consommateur.
Nous estimons évidemment que l’étourdissement préalable est une condition indispensable au bien-être animal.
Si les grands abattoirs sont effectivement dotés de cahiers des charges détaillant les modes opératoires, ce qui suppose en principe une plus grande exigence de qualité, des anomalies y sont régulièrement constatées en raison des cadences élevées d’abattage, en particulier en ce qui concerne les volailles.
M. Jacques Lamblin. Pour les volailles, il y a aussi le problème de la propreté des bains.
Mme Agathe Gignoux. Certes, mais les cadences restent le problème essentiel, et cela vaut pour tous les animaux. Des cadences trop élevées conduisent souvent à ce que l’on réduise le délai entre l’étourdissement et la mise à mort, ou entre la saignée et la découpe, notamment en abattage rituel. Dans ce domaine, nous pensons que la réglementation n’est pas suffisamment prise au sérieux, et se trouve donc fréquemment enfreinte.
Mme Caroline Brousseaud. Nous avons pour projet que l’abattage à la ferme fasse l’objet d’une phase de test dans un département donné. Certains camions-abattoirs, très bien conçus, offrent de bonnes garanties en matière sanitaire et de gestion des déchets. Cependant, la nécessité qu’un contrôle soit pratiqué ante mortem et post mortem par un vétérinaire des services de l’État continue de poser problème : peut-être faut-il envisager que les professionnels libéraux soient formés pour nous accompagner sur ce projet. Techniquement, il existe des caissons de saignée permettant d’étourdir et de saigner les animaux à la ferme ; la carcasse n’est pas travaillée sur place, mais transportée à l’abattoir à cette fin, ce qui nécessite qu’un abattoir se trouve à proximité de la ferme. Pour notre part, nous ne pensons pas que l’abattage à la ferme puisse être généralisé du fait des problèmes pratiques qu’il pose.
Pour ce qui est de la prise de conscience des citoyens, l’AFAAD mène des actions de sensibilisation sur les marchés, et je peux vous dire que nous assistons à une prise de conscience évidente. En tant que présidente de l’association, je reçois régulièrement des mails de personnes qui consomment bio et achètent aux petits producteurs locaux, mais déplorent le manque de transparence en ce qui concerne l’abattage et me demandent si je peux leur conseiller des abattoirs connus pour bien travailler – ce que je ne suis pas en mesure de faire, puisque nous ne disposons pas d’indicateurs du bien-être animal.
Je pense qu’il faut avoir le courage d’établir et de diffuser des comparatifs entre les abattoirs en fonction de critères relatifs à la prise en compte du bien-être animal, pour mettre fin à l’omerta qui règne actuellement dans ce secteur. Le critère de taille ne me paraît en rien déterminant : à mon avis, de petits abattoirs tenus par les éleveurs eux-mêmes peuvent effectuer un travail de grande qualité. Nous avons entrepris des démarches afin de rencontrer des abatteurs, mais les demandes que nous leur avons adressées n’ont pas encore abouti, ce qui peut s’expliquer par le fait que notre association est de création récente. En tout état de cause, nous nous intéressons en priorité aux abattoirs tenus par des éleveurs, notamment à celui de Bourgueil, en Indre-et-Loire, qui vient d’être modernisé, et à celui de Bourbon-l’Archambault, dans l’Allier.
Il est évident que plus les cadences sont élevées, plus il devient compliqué de respecter la réglementation ; de ce point de vue, l’idée consistant à déterminer des cadences normées au niveau européen me paraît intéressante.
Enfin, nous sommes favorables à l’étourdissement systématique, et insistons sur la nécessité de pratiquer un étourdissement post-jugulation sur les bovins, dont le sort nous préoccupe tout particulièrement.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. On a parfois l’impression que le débat s’articule presque exclusivement autour de l’hypothèse où les choses se passent mal, entre le camp de ceux qui dénoncent cet état de fait, et le camp de ceux qui prétendent qu’il est impossible de faire autrement, et qu’après tout ce n’est pas si grave. Cette présentation explique en partie l’immobilisme constaté depuis des années. À l’inverse, vous avez évoqué une communication positive sur le sujet – lorsqu’elle est justifiée, évidemment. Le fait de montrer qu’il est possible que les choses se passent bien, comme vous le faites, vous paraît-il susceptible de débloquer la situation ?
Plusieurs opérateurs d’abattoirs nous ont fait part d’incertitudes au sujet du matériel qu’ils utilisent, quant à ses modalités d’usage ou de maintenance, par exemple. Avez-vous constaté la même chose ?
Que pensez-vous de la compétence des concepteurs d’abattoirs ? N’importe quelle personne ayant eu à mener un animal dans un bâtiment sait que les animaux n’aiment pas les angles droits : comment se fait-il qu’il ne soit toujours pas tenu compte, en 2016, de cette information à la fois simple et essentielle ?
Pour ce qui est de la vidéosurveillance, il me semble qu’elle ne serait pas utile seulement dans les postes d’abattage, mais aussi dans la bouverie et sur le quai de déchargement, où l’arrivée des animaux se fait parfois dans des conditions très difficiles.
En dépit de leurs spécificités, vos associations ont des objectifs communs. J’aimerais savoir si vous coordonnez certaines de vos actions et démarches, afin de bénéficier d’un effet de synergie.
Enfin, l’idée de constituer un classement des abattoirs ne se heurte-t-elle pas à un obstacle en matière de norme ? Ne pensez-vous pas que, si l’on commence à dire aux consommateurs qu’il existe des abattoirs classés une, deux ou trois étoiles, ils vont forcément se dire que la norme doit être fixée à trois étoiles ?
M. Pierre Morel-à-l’Huissier. Madame Brousseaud, vous avez dit que les contrôles étaient insuffisants et que la réglementation n’était pas toujours respectée. Selon vous, quelles améliorations pourrait-on apporter à celle-ci ?
M. Philippe Vitel. Si je suis favorable à l’établissement d’une norme universelle, je ne crois pas très judicieux d’établir un « guide Michelin » des abattoirs et de faire figurer ce classement sur les étiquettes des viandes : si l’on procédait ainsi, les établissements les moins cotés seraient rapidement rejetés par les consommateurs et rayés de la carte, ce qui n’est certainement pas ce à quoi nous voulons aboutir.
J’ai lu sur Internet que « l’islam qui refuse l’étourdissement préalable de l’animal contrevient donc à la déclaration universelle des droits de l’animal laquelle précise notamment que "si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse" ». Si la Déclaration universelle des droits de l’animal, qui date de 1978, n’a aucune portée législative ou réglementaire, ne pourrait-elle servir de base à l’établissement d’une réglementation dont nous sommes nombreux à souhaiter la mise en œuvre ?
Les différents lanceurs d’alerte dénoncent depuis longtemps des situations inacceptables, mais peinent à se faire entendre. À votre avis, que devraient-ils changer à leur stratégie de communication pour que l’opinion publique prenne pleinement conscience des problèmes que pose l’abattage ?
Mme Laurence Abeille. Le scandale mis au jour par les vidéos de L214 a ceci de particulier qu’il n’a pas trait à la production d’appareils électroménagers ou d’automobiles, mais de viande pour la consommation humaine, ce qui implique l’élevage et la mise à mort d’animaux, qui sont des êtres sensibles. Or, bien que l’on s’intéresse depuis des années aux questions d’ordre sanitaire dans les abattoirs, la cause du bien-être animal n’a guère progressé. Il est frappant de constater que vous connaissez parfaitement le sujet que vous évoquez, sur lequel vous êtes en mesure de fournir des éléments précis et documentés, qu’il s’agisse de la sensibilité au bruit des animaux ou des précautions à prendre lors de leur transport et de leur manipulation – vos connaissances en la matière semblent bien plus étendues que celles des responsables d’abattoirs, si l’on en juge aux erreurs commises par ceux-ci. Seriez-vous disposés à entrer dans les comités d’éthique dont la création a été évoquée, et quel rôle pourriez-vous y jouer ?
Par ailleurs, avez-vous été informés d’une baisse de la consommation de viande depuis la révélation des scandales touchant certains abattoirs ? Considérez-vous que l’une des clés de l’amélioration du bien-être animal consisterait en une diminution de la consommation de viande ? Disposez-vous d’éléments permettant de déterminer quel est le coût représenté par l’abattage dans le prix final de la viande, et si un abattage réalisé dans de meilleures conditions – je pense notamment à l’abattage mobile – nécessiterait un coût beaucoup plus élevé ?
Enfin, j’aimerais savoir si Mme Brousseaud, qui travaille en co-construction avec certains éleveurs et abattoirs, a reçu des témoignages sur la maltraitance animale.
Mme Annick Le Loch. Je vous remercie pour vos contributions, qui comprennent des éléments techniques très intéressants. Pourriez-vous les compléter par des commentaires sur les conditions de travail des employés d’abattoirs ?
M. le rapporteur. À vous entendre, améliorer les choses n’aurait rien de très compliqué : la mise en œuvre de quelques mesures simples y suffirait. Dès lors, comment peut-on expliquer que des situations inacceptables se produisent, et que des employés se trouvent placés dans des situations personnelles extrêmement difficiles après que leurs agissements coupables ont été dévoilés ? Comment faire pour que ces personnes cessent d’être des fauteurs et des dissimulateurs de problèmes, et deviennent au contraire des moteurs pour améliorer la situation ?
Mme Caroline Brousseaud. Je n’ai jamais parlé d’établir un « Michelin » des abattoirs, mais simplement dit que nous défendions un étiquetage a minima de la méthode d’abattage, c’est-à-dire précisant si un étourdissement a été pratiqué. Cela dit, je ne suis pas sûre que ce seul critère suffise à garantir la bientraitance animale. Certains indicateurs complémentaires pourraient être portés à la connaissance du public, mais il n’est pas question de faire figurer le classement des abattoirs sur les étiquettes des viandes, ce qui risquerait effectivement de porter atteinte aux petits abattoirs, à l’existence desquels l’AFAAD tient particulièrement.
À ce jour, nous n’avons pas recueilli de témoignages d’employés d’abattoirs, mais plusieurs inspecteurs vétérinaires nous ont communiqué des éléments intéressants, dont j’ai fait une synthèse qui sera publiée prochainement. Les éleveurs sont très inquiets, et les quelques cas de maltraitance qu’ils nous ont rapportés avaient essentiellement trait au transport, notamment au chargement et au déchargement des animaux. La perte de confiance résultant des images qui ont été récemment diffusées explique en grande partie la volonté de développer l’abattage à la ferme, qui permet aux éleveurs de conserver un droit de regard sur la mise à mort de leurs animaux. Les petits éleveurs nous font souvent part d’un sentiment de détresse à l’idée de n’avoir aucune prise sur le sort réservé aux animaux qu’ils ont élevés et soignés dans la dignité et le respect, une fois que ceux-ci partent pour l’abattoir.
Nous estimons que la réglementation relative au bien-être animal est tout à fait correcte : le seul problème est de faire en sorte que les textes soient bien appliqués. Les vidéos réalisées par L214 montrent que certains étourdissements sont mal faits, mais aussi qu’il n’y a personne au poste d’abattage pour contrôler cette opération. Nous sommes favorables à la vidéosurveillance comme outil de formation et d’amélioration continue : la sanction seule ne suffira pas à ce que des cercles vertueux se constituent au sein des abattoirs, propageant une culture de la bientraitance animale parmi toutes les personnes concernées : employés, mais aussi inspecteurs vétérinaires.
Je ne suis pas en mesure de vous répondre au sujet de la souffrance au travail des personnels d’abattoirs, car c’est un dossier que nous n’avons pas ouvert. On sait que cette souffrance existe, puisque des travaux ont été menés sur ce point, et qu’il s’agit d’une problématique à prendre en compte si l’on souhaite améliorer le bien-être de l’animal : il ne faut jamais perdre de vue que les employés d’abattoirs font un travail que sans doute personne ici ne voudrait faire.
Mme Agathe Gignoux. Notre association ne dispose pas d’éléments particuliers sur la souffrance des employés d’abattoirs, mais nous considérons que, pour éviter à la fois un turnover excessif et ce qu’il est convenu d’appeler les « pétages de plombs », il est nécessaire de revaloriser ces professions, en termes de salaires, bien sûr, mais aussi en améliorant leur formation au bien-être animal : ce serait de nature à valoriser le rôle des personnes concernées au sein de l’abattoir comme dans la société, en les investissant de la fonction de garants du bien-être animal.
Les scandales sont malheureusement nécessaires pour alerter l’opinion. L’association CIWF préfère recourir à des modes d’action coopératifs, consistant à accompagner les professionnels. Cette méthode a fait ses preuves dans d’autres pays, notamment en matière d’élevage, et nous pensons qu’elle peut se révéler tout aussi efficace en matière d’abattage. Au Royaume-Uni, le mouvement qui a permis la mise en place généralisée de la vidéosurveillance est venu d’une demande des consommateurs, née dans les supermarchés avec le concours des associations, qui ont informé le grand public, mais aussi accompli un travail d’accompagnement des éleveurs et des abatteurs en faisant en sorte que des critères de bien-être animal soient progressivement pris en compte dans les pratiques. Pour notre part, nous avons fait le choix d’accompagner surtout les entreprises.
Nos associations respectives travaillent en commun sur certaines campagnes, chacune étant spécialisée dans une ou plusieurs thématiques. Ainsi, nous avons collaboré sur plusieurs sujets, qu’il s’agisse de l’étiquetage, des transports ou de l’abattage. Depuis septembre, nous avons écrit plusieurs lettres communes au ministre de l’agriculture et, en l’absence de réponse, au Premier ministre – onze associations étaient cosignataires. Enfin, la Fondation Brigitte Bardot, Welfarm et CIWF sont membres de l’organisation Eurogroup For Animals.
On constate effectivement une baisse de la consommation de viande à l’heure actuelle. En France, c’est surtout la consommation de viande rouge qui diminue, au profit de la viande de volaille qui pose elle aussi de sérieux problèmes – c’est pourquoi j’espère que cette question ne sera pas laissée de côté, en dépit de l’intitulé de votre Commission d’enquête. En effet, les volailles font très majoritairement l’objet d’un élevage intensif, et les conditions d’abattage sont loin d’être satisfaisantes. En tout état de cause, nous estimons que pour continuer à avoir une production durable, raisonnable et respectueuse du bien-être animal, il serait bon d’envisager une réduction de la consommation de viande. Nous ne plaidons pas pour le végétarisme, mais estimons indispensable de réduire la pression exercée sur la production – c’est valable pour l’élevage comme pour l’abattage.
M. Ghislain Zuccolo. Prendre en exemple les abattoirs où les choses se passent bien peut effectivement aider à mettre fin à l’immobilisme, et c’est la stratégie mise en œuvre par Welfarm. Nous nous efforçons d’avoir une communication positive, en attirant l’attention du public sur le fait qu’il existe, à côté de l’élevage intensif, d’autres formes d’élevage mettant en œuvre des méthodes plus respectueuses du bien-être animal.
En tant que représentant d’une association de protection animale, vous comprendrez qu’il me soit difficile, vis-à-vis de nos membres et donateurs, de reconnaître qu’il existe des abattoirs où les choses se passent bien. Nous assumons cependant le fait de travailler avec certains abatteurs qui, selon nous, font mieux que d’autres en matière de bien-être animal.
Pour ce qui est de la conception des abattoirs et du matériel utilisé, l’éthologie a malheureusement été le parent pauvre des sciences du bien-être animal en France : pendant longtemps, on s’est presque exclusivement référé à la science vétérinaire, à la neurophysiologie et à d’autres disciplines. Aux États-Unis, on s’inspire beaucoup des travaux de Temple Grandin, un docteur en sciences animales qui a aidé McDonald’s et d’autres grandes entreprises de l’agroalimentaire à concevoir des abattoirs. J’ai eu l’occasion de la rencontrer et d’évoquer avec elle les difficultés constatées sur les marchés aux bestiaux ; à ce sujet, elle m’a dit qu’il fallait sans cesse compter : compter le nombre de fois où les animaux chutent à un endroit donné, le nombre de beuglements, etc. – un nombre anormalement élevé signalant un problème à résoudre.
La bouverie est effectivement un endroit où il est intéressant de placer des caméras, car le déchargement des animaux est souvent problématique. En 2005, dans un abattoir de porcs, nous avons repéré un employé qui, resté seul le soir, faisait chuter les porcs d’une hauteur de plus d’un mètre en leur donnant des coups de pied. Il arrive aussi que des transporteurs apportant des animaux à l’abattoir le soir, après la fermeture, profitent d’être seuls pour se livrer à des exactions. La vidéosurveillance est de nature à décourager de tels agissements.
Comme l’a dit Agathe Gignoux, il nous arrive de travailler en commun : cela a été le cas lorsque nous avons adressé une lettre commune au ministre de l’agriculture.
Classer les abattoirs en fonction de la façon dont ils prennent en compte le bien-être animal me semble une bonne idée, même s’il est effectivement délicat d’en faire un outil de communication auprès des consommateurs : j’y vois plutôt un indicateur permettant aux abattoirs eux-mêmes de se positionner les uns par rapport aux autres, et les incitant à progresser s’ils sont mal classés.
Si la Déclaration universelle des droits de l’animal a été proclamée dans l’enceinte de l’UNESCO, ce n’est pas pour autant une déclaration officielle de cette institution. En revanche, je rappelle que nous célébrons cette année les quarante ans de la loi de 1976 sur la protection de la nature qui, pour la première fois, a défini l’animal comme un être sensible
– ce qui est maintenant inscrit dans le code rural à l’article L. 214-1, qui dispose que : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » Enfin, le traité d’Amsterdam stipule que l’Union européenne doit tenir compte du bien-être animal lorsqu’elle élabore une réglementation. Cela dit, j’estime qu’il serait opportun que la Déclaration universelle des droits de l’animal soit officiellement reconnue par l’UNESCO.
Nous sommes évidemment disposés à faire partie de comités d’éthique.
Pour ce qui est de la consommation de viande, nous avons constamment demandé aux consommateurs français de « consommer moins, mais mieux », en leur conseillant par exemple d’acheter des poulets fermiers, élevés en liberté. En 1997, ayant analysé les cahiers des charges des signes de qualité, à savoir les produits « Label Rouge » et ceux issus de l’agriculture biologique, nous avons déploré que cette dernière n’impose pas de normes supplémentaires en matière de transport et d’abattage des animaux. Si nous avions été entendus, peut-être l’agriculture bio ne serait-elle pas discréditée comme elle l’est aujourd’hui après la diffusion d’une vidéo montrant des pratiques inacceptables dans un abattoir certifié bio.
Mme Agathe Gignoux. Je précise que, sur ce point, le règlement bio est en cours de renégociation au niveau européen. Pour notre part, nous saisissons cette occasion pour souligner que des évolutions sont possibles et que la France devrait soutenir les initiatives en ce sens – ce n’est malheureusement pas le cas, et nous regrettons que le Gouvernement ne se montre pas plus ferme sur ce point.
M. le rapporteur. La carence que vous avez relevée en 1997 valait-elle pour l’ensemble des signes de qualité, ou seulement pour certains d’entre eux ?
M. Ghislain Zuccolo. En France, les seuls signes de qualité en dehors du Label rouge et du bio sont les appellations d’origine contrôlée (AOC) et les appellations d’origine protégée (AOP). Ayant également étudié le cahier des charges des AOC-AOP, nous avons pu constater qu’il est très minimaliste – et si le bureau des signes de qualité et de l’agriculture biologique de la direction des politiques économique et internationale (DPEI) du ministère de l’agriculture nous a assuré travailler à son amélioration, je ne pense pas qu’il soit prévu d’y intégrer des prescriptions relatives à l’abattage.
Mme Geneviève Gaillard. Le Parlement français refuse de reconnaître que les animaux sauvages sont des animaux sensibles : j’avais moi-même déposé une proposition en ce sens, qui a été rejetée. Actuellement, la seule dérogation concerne l’abattage des animaux sauvages d’élevage. Vous êtes-vous intéressés à cette question ?
M. Ghislain Zuccolo. Nous ne nous sommes pas intéressés à l’abattage du gibier d’élevage. Je crois que c’est le seul cas où des animaux d’élevage peuvent être abattus à la carabine, mais j’ignore dans quelles conditions. Sans doute devrions-nous nous rapprocher des professionnels concernés afin de faire progresser leurs pratiques.
Quant au coût de l’abattage, les abattoirs qui s’en sortent le mieux sont ceux qui ont intégré l’amont et l’aval, c’est-à-dire soit les abattoirs appartenant à des coopératives gérant à la fois l’élevage, l’abattage et la découpe, soit les abattoirs ayant contractualisé avec des éleveurs et pouvant donc compter sur un approvisionnement régulier. Je rappelle que la viande d’un animal stressé présente un pH trop bas, ce qui en fait une viande dite « pisseuse ». Bien prendre en compte le bien-être animal et veiller à ce qu’il ne soit pas trop stressé a donc un effet économique positif.
M. Christophe Marie. S’agissant des employés des abattoirs, je rappelle que ces personnes sont soumises à deux ou trois fois plus d’accidents du travail que la moyenne nationale, ce qui peut s’expliquer par les conditions de travail difficiles, mais aussi, sans doute, par une formation insuffisante. En la matière, toutes nos demandes visant à améliorer la conception des abattoirs, mais aussi la qualité du matériel, bénéficieront en premier lieu aux employés : cela évitera, par exemple, qu’un abatteur se trouve en situation de devoir assommer les agneaux au moyen d’un crochet. C’est la preuve que le bien-être animal et le bien-être humain – en l’occurrence celui des employés d’abattoirs – ne sont pas incompatibles, bien au contraire.
Pour ce qui est des animaux sauvages, nous sommes en présence d’une aberration du droit : un faisan tenu captif est un être sensible, mais redevient un animal sauvage dénué de sensibilité dès qu’on le sort de sa cage, et ne se voit donc plus appliquer les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code rural !
On parle de scandale, alors que les faits dénoncés par l’association L214 existent et sont connus de longue date. Si les choses ont pris une telle ampleur cette année, c’est peut-être parce que le public est mûr pour entendre la vérité, et aussi parce que le développement des réseaux sociaux a permis une plus grande mobilisation des consommateurs qui, de simples spectateurs, sont également devenus acteurs. Les élus ont eux aussi réagi, ce qui est plutôt rassurant. En 2012, un reportage du magazine télévisé Envoyé spécial, portant sur les abattoirs, avait déjà provoqué un scandale, et la journaliste Anne de Loisy avait sorti peu après un livre intitulé Bon appétit !
M. le président Olivier Falorni. Elle sera entendue très prochainement par notre commission d’enquête.
M. Christophe Marie. C’est une bonne idée, car elle a beaucoup de choses à dire. J’ai été très étonné, en écoutant l’audition du directeur général de l’alimentation à laquelle vous avez procédé le 4 mai dernier, de l’entendre dire que les choses étaient rentrées dans l’ordre après le scandale de 2012 et citer, au sujet du pourcentage d’animaux abattus sans étourdissement, des chiffres simplement collectés par la DGAL dans les registres des professionnels. J’ai du mal à croire que seuls 27 % des ovins feraient l’objet d’un abattage rituel, alors que le rapport de 2005 du Comité permanent de coordination des inspections (COPERCI), jamais publié parce que trop embarrassant, faisait état d’un chiffre de 80 %
– passé à 60 % quelques années plus tard. Une telle évolution paraît impossible, surtout si l’on tient compte du fait que les nouveaux abattoirs ne pratiquent pas l’abattage des ovins avec étourdissement. On relève la même incohérence en ce qui concerne les bovins, pour lesquels M. Dehaumont annonce un taux de 15 %, alors qu’un rapport commandé en 2011 par le ministère de l’agriculture faisait état de 40 %. Comme vous le voyez, il est difficile de progresser quand certains restent dans le déni. Le moment nous semble venu de mettre tout à plat afin de pouvoir avancer, comme de nombreux pays l’ont fait avant nous.
Nous sommes très fréquemment amenés à travailler avec d’autres associations sur des campagnes nationales de sensibilisation. Je vous rejoins pour considérer que, plutôt que d’établir un classement des abattoirs, il convient de fixer des normes universelles et de veiller à leur application par tous de la même manière.
Je fais partie de la Commission nationale de l’expérimentation animale, placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l’agriculture, et du Comité national de réflexion éthique dans l’expérimentation animale, qui chapeaute les comités d’éthique nationaux : si l’existence de comités d’éthique dans ce domaine me paraît justifiée – car l’expérimentation animale donne régulièrement lieu à l’élaboration de protocoles qu’il faut à chaque fois étudier –, l’abattage est une pratique générale qui, à mon sens, justifierait plutôt la rédaction de guides de bonnes pratiques.
La consommation de viande a effectivement tendance à diminuer, ce dont on ne peut que se féliciter compte tenu du très fort impact environnemental de l’élevage, surtout dans les pays les moins développés, qui subissent de plein fouet les ravages de la déforestation visant à produire des céréales ou du soja destinés à l’élevage intensif.
Le coût de la viande est variable, mais relativement faible dans le circuit classique. Faire appel aux abattoirs mobiles aurait pour conséquence une augmentation du prix final. S’il est possible de recourir à ce mode d’abattage dans le cadre de l’Aïd el-Kebir, c’est en raison des gros volumes d’abattage réalisés en une seule fois. En revanche, pour pratiquer un abattage d’urgence dans une ferme, nous sommes plutôt favorables à l’intervention d’un vétérinaire afin de soulager et d’euthanasier l’animal, qui ne sera pas valorisé dans la chaîne de production.
M. le président Olivier Falorni. Je vais maintenant demander à chacun de nos invités de conclure en insistant sur un ou plusieurs points qui lui tiennent à cœur.
Mme Caroline Brousseaud. J’ai visionné toutes les auditions auxquelles vous avez procédé jusqu’à présent, et pu constater que l’on ne cesse de demander davantage de visibilité et de transparence. Pour que les acteurs de la société civile puissent échanger avec les abatteurs, je persiste à penser que la mise en place de comités d’éthique constituerait une solution intéressante : la question du bien-être animal aurait, me semble-t-il, vocation à être évoquée dans le cadre de ces instances de dialogue et de concertation. J’ai rédigé une note de travail à ce sujet à votre intention, et je pense que M. Laurent Lasne reviendra certainement sur ce point lorsque vous l’auditionnerez.
M. le rapporteur. Certaines installations classées, par exemple celles relatives au traitement des ordures ménagères, donnent lieu à la mise en place d’une commission locale d’inspection du site, destinée à donner un droit de regard à la population locale. Peut-être serait-ce également la solution pour améliorer la transparence sur ce qui se passe à l’intérieur des abattoirs.
Mme Caroline Brousseaud. C’est effectivement une idée intéressante.
M. Ghislain Zuccolo. Je voudrais également évoquer la situation des poules de réforme, c’est-à-dire des poules pondeuses arrivées en fin de carrière, si j’ose dire, qui sont envoyées à l’abattoir. Il nous est arrivé de suivre un camion partant de la Drôme pour se rendre en Belgique, alors que l’on sait que ces animaux très fragiles supportent mal les longs trajets.
Il est une autre pratique particulièrement choquante, celle consistant à transporter des bêtes sur le point de mettre bas. Il est permis de transporter des bovins jusque dans le dernier dixième de leur temps de gestation : or, lorsque la mère sur le point de vêler est abattue, son petit meurt étouffé, ce que je trouve horrible.
Mme Geneviève Gaillard. Scandaleux !
Mme Caroline Brousseaud. Une éleveuse me confiait récemment que, depuis un mois, tous les maquignons auxquels elle a affaire demandent systématiquement si les bêtes sont en gestation, ce qu’ils ne faisaient jamais auparavant : ils ont manifestement été informés que des contrôles allaient être effectués par le ministère.
M. Ghislain Zuccolo. Même s’il m’en coûte un peu compte tenu de mes convictions, je voudrais conclure en remerciant les nombreux employés des abattoirs qui sont attachés au bien-être animal et ont à cœur de bien faire les choses – on ne peut se contenter de dénoncer ceux qui agissent mal –, et en les encourageant à persévérer. Ces personnes sont déconsidérées par la société, qui s’est déchargée sur elles de la responsabilité d’abattre les animaux : il est si facile de manger son steak en ayant bonne conscience, quand on n’a pas eu à tuer l’animal dont on consomme la viande ! À mon sens, la profession d’abatteur devrait être revalorisée par l’amélioration de la formation initiale dispensée à ces professionnels, afin qu’ils soient fiers de leur métier et qu’ils aient à cœur de le faire dans les règles de l’art : cela contribuera, sans nul doute, à ce qu’ils aient envie de bien traiter les animaux.
Mme Agathe Gignoux. Je vous communiquerai un rapport de la Commission européenne faisant apparaître les coûts de l’abattage de volaille et détaillant ces coûts en fonction de la méthode d’étourdissement mise en œuvre : la lecture de ce document permet de constater que les meilleures méthodes d’étourdissement – je pense notamment au gaz – ne coûtent pas forcément plus cher que les autres.
Nous espérons que cette commission d’enquête va permettre d’aboutir à des évolutions. L’un des points essentiels est la vidéosurveillance, qui doit être mise en œuvre dans un cadre strict. Il faut également adopter de nouvelles réglementations en vue de faire évoluer nos pratiques d’abattage, comme l’ont déjà fait plusieurs de nos voisins européens.
M. Christophe Marie. Au cours des auditions précédentes, vous avez évoqué à plusieurs reprises la difficulté d’interpréter les signes de perte de conscience. Un rapport de l’INRA de décembre 2009, intitulé « Douleurs animales – Les identifier, les comprendre, les limiter chez les animaux d’élevage », indique que, chez les veaux et les bovins adultes, on observe une grande variabilité dans le délai précédant la perte de conscience, qui peut atteindre quatorze minutes. Il est évident qu’aucun abattoir ne va attendre pendant quatorze minutes qu’un bovin maintenu dans un piège de contention perde conscience : l’animal va donc agoniser en suspension jusqu’à l’atelier de découpe et de déshabillage. Une telle situation est inacceptable : l’étourdissement est vraiment le strict minimum à exiger, et nous y tenons beaucoup.
M. le président Olivier Falorni. Mesdames, messieurs, nous vous remercions pour vos interventions de très grande qualité.
La séance est levée à dix-huit heures quarante-cinq.
——fpfp——
8. Audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Langlois, président de l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV).
(Séance du jeudi 12 mai 2016)
La séance est ouverte à neuf heures cinq.
M. le président Olivier Falorni. Nous continuons nos auditions sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, en recevant ce matin M. Dominique Langlois, président de l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV). Fondée en 1979, à l’initiative d’organisations professionnelles de la filière, INTERBEV regroupe 21 organisations professionnelles nationales représentant les différents métiers du secteur économique du bétail et de la viande.
Avant de vous donner la parole, monsieur le président, je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et qu’elles sont diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Dominique Langlois prête serment.)
M. Dominique Langlois, président de l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV). Comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, INTERBEV a plus de trente ans. Composée de quatre organisations lors de sa création, elle compte actuellement vingt membres organisés en quatre collèges : production – bovins, veaux, ovins, équins et caprins –, mise en marché, abattage/commerce de gros/transformation, et distribution.
Notre organisation, relativement simple, a été modifiée en application des nouvelles dispositions européennes sur les interprofessions, qui fixent à la fois les règles de fonctionnement et les attributions des interprofessions. Nos instances de décision comprennent une assemblée générale, une conférence des présidents, qui regroupe les vingt présidents et se réunit une fois par an, et un comité directeur, dont je suis le président, composé de treize membres et qui se réunit tous les deux mois. Dans chacune des sections d’INTERBEV – bovins, veaux, ovins, caprins, équins – sont représentées les organisations de l’interprofession. Depuis les nouvelles dispositions communautaires, c’est au niveau des sections que les accords interprofessionnels doivent être conclus afin d’être en mesure de faire la preuve de leur représentativité ; les projets d’accord sont soumis seulement pour avis au comité directeur.
Nous travaillons également dans le cadre de plusieurs commissions spécialisées parmi lesquelles une commission « communication » – le rôle de l’interprofession est d’abord de communiquer sur l’ensemble de la filière –, une commission « commerce extérieur », ce qui nous amène à travailler avec la plateforme France viande export, mise en place il y a peu, et une commission « enjeux sociétaux », créée il y a six mois et spécialisée dans les questions relatives à l’environnement, à la santé et au bien-être animal. Le bien-être animal fait partie des actions de l’interprofession depuis très longtemps, mais nous avons formalisé cette question au sein de cette commission qui a déjà énormément travaillé : nous avons des contacts très étroits avec les ONG environnementales, et avons eu le plaisir de nous voir attribuer deux labels dans le cadre de la COP21.
INTERBEV dispose de quarante collaborateurs. Son budget, de l’ordre de 32 millions d’euros par an, est composé essentiellement des contributions volontaires obligatoires payées par l’amont, c’est-à-dire le maillon industriel, et l’aval, c’est-à-dire la distribution avec les grandes et moyennes surfaces (GMS) et les bouchers.
Nous nous félicitons de la mise en place de cette commission d’enquête, car les pratiques inadmissibles observées dans les vidéos diffusées par l’association L214 ont suscité l’émoi dans la profession. Ces images choquantes, dont la véracité ne peut être contestée, portent préjudice à une filière déjà en crise : elles interpellent non seulement le consommateur, même si les effets sur la consommation ne sont pas encore mesurables, mais également les salariés de l’industrie des viandes, choqués d’être exposés à la vindicte – « C’est comme ça que vous travaillez ? » –, alors que leurs pratiques ne sont pas représentatives des actes dénoncés par ces vidéos.
Dans ce genre d’affaire, l’interprofession a toujours adopté une position constante : conformément à notre règlement intérieur, et dès lors que des infractions donnent lieu à des poursuites pénales, nous nous constituons systématiquement partie civile – quels que soient l’opérateur, le maillon de la filière, la fonction exercée au sein de l’interprofession –, et ce afin d’avoir accès au dossier de l’enquête. Nous l’avons fait lors de la crise de la viande de cheval et dans le cas d’un abattoir qui posait problème. Nous envisageons également de le faire pour ces cas de pratiques d’abattage dénoncées par l’association L214.
Pour l’interprofession, le bien-être animal a toujours été une question très importante. Dès 1999, nous avons élaboré une charte de bonnes pratiques d’élevage, dont le label est attribué aux éleveurs respectueux d’un certain nombre de règles, ainsi qu’un guide de bonnes pratiques à l’abattoir, largement diffusé aux fédérations qui le distribuent à leurs adhérents. Nous assurons une veille constante sur cette question, en particulier au travers de notre commission « enjeux sociétaux », notre volonté étant d’être toujours en capacité de répondre, mais également d’anticiper et de rester proactifs sur ces sujets.
Notre filière est souvent accusée de manquer de transparence. Pour prouver le contraire, nous avons lancé en 2014 les rencontres « Made in Viande », qui permettent au public de visiter les élevages, les marchés aux bestiaux, des centres de regroupement d’animaux, des ateliers de transformation de viande, des distributeurs ou encore des boucheries, soit plusieurs centaines de lieux représentatifs de l’ensemble de la filière, de l’élevage à la distribution en passant par la transformation. Lors de la première édition de l’opération, plusieurs milliers de personnes ont pu visiter des fermes, des ateliers d’engraissement, des abattoirs. Pour cette année, nous nous attendons à un taux de fréquentation aussi important.
M. le président Olivier Falorni. Les trois abattoirs concernés par les vidéos diffusées par l’association L214 sont-ils représentés dans INTERBEV ?
À la suite de la diffusion de ces vidéos, vous avez annoncé vouloir vous constituer partie civile dans le cas où l’enquête administrative confirmerait des manquements à l’abattoir d’Alès. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Avez-vous eu connaissance de faits similaires ? Si oui, comment l’interprofession a-t-elle réagi ?
Enfin, question récurrente dans nos auditions, quelle est la part de l’abattage dans le coût de la viande ?
M. Jean-Luc Bleunven. Le problème de la maltraitance des animaux se pose moins dans les gros abattoirs que dans les petits abattoirs ou de proximité, dont dépendent les abattages domestiques et l’approvisionnement des circuits courts. Quelle est la position d’INTERBEV en termes d’organisation du territoire ? Dans les territoires, l’abattage donne souvent lieu à des débats sans fin, car il y a de gros investissements à la clé. Autre problème : la viande de qualité reste relativement chère. Comment faire pour que tout ce que l’on souhaiterait mettre dans le prix de la viande reste gérable pour la filière ?
Mme Geneviève Gaillard. Avant la diffusion des trois vidéos, des maltraitances aux animaux dénoncées par les associations n’ont pas suscité un tel intérêt. Aviez-vous eu connaissance de manquements similaires ?
Si j’en crois votre propos, vous ne pouvez pas mesurer l’impact de ces problèmes sur la consommation. Avez-vous tout de même essayé de le faire ?
Enfin, si ces questions de bien-être animal avaient été traitées convenablement, l’État et l’Europe n’auraient pas eu à s’atteler au problème, en particulier en travaillant avec votre interprofession à partir de 2013 pour aboutir deux ans plus tard à une sorte de charte sur le bien-être animal, approuvée par tous les acteurs. Certes, les éleveurs indifférents au bien-être animal représentent une minorité, mais c’est une minorité de trop. Que pouvez-vous nous dire sur cette notion de bien-être animal dans le secteur de l’élevage, mais aussi dans les secteurs du transport et de l’abattage ?
M. Guillaume Chevrollier. Ces vidéos ont effectivement causé un grave préjudice à la filière. Quel est leur impact sur le marché, mais aussi sur l’attractivité du secteur ? Avant ces affaires, les abattoirs avaient-ils des difficultés pour recruter ?
Dans les abattoirs, le responsable de la protection animale (RPA) occupe un poste clé. Devrait-il bénéficier d’un statut spécifique lui conférant davantage d’autorité ?
La vidéosurveillance vous semble-t-elle une bonne idée ? Quel en serait l’impact en termes de coût ?
L’État est déjà présent dans les abattoirs. Des moyens supplémentaires sont-ils nécessaires ?
S’il fallait renforcer l’environnement juridique en matière de contrôle, certains dispositifs existants, jugés inutiles, pourraient-ils être supprimés ?
Enfin, vous vous portez systématiquement partie civile en cas d’anomalies constatées. Combien de fois INTERBEV s’est-elle portée partie civile en 2015 ?
M. Dominique Langlois. Nous n’avions pas connaissance des faits rapportés dans les vidéos tournées par l’association L214. Par contre, nous rappelons régulièrement à nos fédérations l’impérative nécessité de s’assurer du respect des animaux dans les abattoirs – sachant que l’interprofession n’y a pas accès, puisqu’elle n’y joue pas un rôle direct. J’ajoute que ces questions de bien-être animal sont également évoquées dans nos comités régionaux, qui nous assurent dans toutes les régions la même représentation qu’au niveau national. Ainsi, tous les maillons de la filière sont parfaitement au fait de ces questions sur le territoire.
Clairement, nous savons que certains abattoirs posent problème – en tout cas, c’est ce qu’on dit –, mais nous n’avons aucun pouvoir d’investigation. Cela renvoie à une autre question posée, celle de la « pression de contrôle ».
La question du bien-être animal remonte à la Convention européenne du 10 mai 1979 sur la protection des animaux d’abattage. Elle a été complétée depuis par plusieurs textes nationaux, législatifs ou réglementaires, et communautaires, en particulier le « paquet hygiène » qui a substitué à une obligation de moyens à une obligation de résultat.
Actuellement, la présence des RPA n’est obligatoire que dans les établissements qui abattent plus de 1 000 unités gros bovins (UGB) par an. Dans les gros abattoirs, où sont présents des services qualité étoffés, mais aussi du personnel vétérinaire en nombre important – cela peut aller jusqu’à vingt personnes –, la pression du contrôle est donc beaucoup plus forte que dans des structures qui abattent 600 bêtes par an. Le risque étant plus grand dans les abattoirs sous le seuil des 1 000 UGB, l’interprofession a demandé la présence d’un RPA dans tous les abattoirs, quelle que soit leur taille, et cette proposition a été reprise par le ministre.
Dans le respect de la présomption d’innocence, INTERBEV se porte partie civile une fois l’action pénale engagée – je n’ai pas en mémoire de cas où cela lui ait été refusé. En 2015, nous nous sommes portés partie civile pour un abattoir qui fait l’objet d’une instruction pénale dans l’Ouest de la France. Depuis le début de l’année, nous avons un cas d’abattoir dans l’Aveyron. Les trois affaires récentes donneront donc lieu à trois constitutions de partie civile si l’action pénale est engagée.
En cas de faits similaires, l’interprofession rappelle automatiquement à ses fédérations que les règles doivent être respectées. Cela a été fait, et vous le savez pour avoir auditionné plusieurs fédérations – Culture viande, la FNEAP, la FNICGV, qui elles-mêmes rappellent immédiatement les règles à leurs adhérents. Pratiquement tous les abattoirs adhèrent à une fédération. Les trois abattoirs visés par les vidéos ne sont pas directement représentés à INTEBEV, mais seulement via leur fédération. Les entreprises ne sont pas directement représentées au sein d’une interprofession.
Le coût de l’abattage dépend de la taille de l’abattoir et du volume réalisé. Sur le gros bovin, il se situe en moyenne à 0,50 euro le kilo-carcasse – le plus bas autour de 0,30 euro pour les gros abattoirs ; le plus élevé à 0,80-0,90 euros pour les abattoirs de très petite taille, en raison du poids des équipements. À cela s’ajoute la valorisation du cinquième quartier, qui couvrait pratiquement les coûts d’abattage jusqu’aux crises de l’ESB. C’était presque redevenu le cas il y a encore quelques mois avec le classement en « risque négligeable » de la France, mais à la suite du cas d’ESB révélé ces dernières semaines, le pays est repassé en « risque maîtrisé », avec une perte en revalorisation de 10 centimes le kilo – nous sommes aujourd’hui en moyenne à 0,40-0,45 euro en fonction de la taille de l’abattoir.
La maltraitance des animaux n’a rien à voir avec la taille de l’abattoir : elle est liée au fonctionnement de l’abattoir. L’interprofession a mis en place, je l’ai dit, une charte de bonnes pratiques d’élevage, et, en collaboration avec les fédérations de commerçants en bestiaux et les groupements de producteurs, nous avons élaboré un code des bonnes pratiques visant notamment à garantir un transport des animaux dans des conditions respectueuses du bien-être animal et la prise en compte des contraintes légales liées au temps de transport et aux arrêts obligatoires. Le bien-être animal n’est donc pas une question de taille, mais de respect de règles communes à tous. Certes, l’importance des services de contrôle varie en fonction de la taille des abattoirs, et ces contrôles sont parfois réalisés par des vétérinaires vacataires dans les très petites structures. Mais tous les abattoirs français, quels qu’ils soient, sont soumis au contrôle sanitaire, soit directement par les services de l’État, soit par le concours de vétérinaires privés qui agissent en tant que vacataires pour le compte de l’État et rendent compte de leur inspection sanitaire au représentant de l’État.
Existe-t-il d’autres cas similaires ? Nous espérons que non… Il est difficile de vous répondre dans la mesure où nous n’avons pas accès aux abattoirs. Le bruit circule que d’autres films pourraient sortir. Honnêtement, je n’ai pas connaissance de cas similaires qui seraient d’actualité.
Mme Geneviève Gaillard. Et antérieurement à 2015 ? Aviez-vous eu la puce à l’oreille ?
M. Dominique Langlois. Bien sûr, et c’est justement ce qui explique que la profession se soit mobilisée sur cette question. On ne peut pas avoir de gros abattoirs partout. Les petits abattoirs ont leur pertinence en termes de proximité et d’aménagement du territoire, mais n’ont pas toujours la capacité d’investir dans du matériel moderne, conforme aux normes ; un restrainer inadapté complique la tâche du salarié, même sans volonté de maltraitance. Il fallait mettre de l’ordre, et surtout ne pas s’exposer sur ce sujet particulièrement sensible, d’où l’élaboration de notre guide de bonnes pratiques pour le bien-être animal pour mettre un terme à certaines dérives.
Il est difficile de mesurer l’impact de ces affaires sur la consommation. En période de crise, nous suivons deux indicateurs : le « pic » au niveau de la presse et des réseaux sociaux, et les résultats de nos enquêtes auprès des collèges distribution. Depuis le début de l’année, la baisse de la consommation est légèrement plus forte qu’en 2015 : il y a donc bien un impact, mais le pourcentage correspondant ne sera connu qu’au bout d’un certain temps. La crise de la viande de cheval avait connu deux phases : d’abord, une très forte réaction de rejet du consommateur, aux yeux duquel la traçabilité était devenue inutile et la tricherie générale ; ce à quoi nous avons répondu avec une communication sur le renforcement de l’étiquetage d’origine au moyen du logo « Né, élevé, abattu et transformé en France ». La Commission a donné son accord pour une expérimentation en France, mais le décret n’est toujours pas publié, et certains acteurs industriels refusent toujours le « et transformé ». L’impact d’une crise est donc plus facilement mesurable dans un deuxième temps car, malgré les chiffres de vente, l’effet stock joue à court terme. Nos derniers indicateurs sortiront fin juin : nous verrons si la courbe s’est inversée en tendanciel plus fortement que la courbe de baisse actuelle.
Ces affaires, dommageables pour la profession et choquantes pour les salariés, ne sont évidemment pas de nature à attirer des jeunes – filles ou garçons – vers nos entreprises, au sein desquelles le pourcentage de femmes n’est pas négligeable. Nos métiers sont en tension : le besoin de renouvellement des générations est important. Nous avons donc engagé plusieurs actions : le développement de la formation, la révision des classifications – l’appellation « ouvrier polyvalent des industries des viandes », plus valorisante, a remplacé celle d’abatteur, par exemple ; la mise en place d’un site internet intitulé « Je deviens boucher », où distributeurs et industriels peuvent s’inscrire et s’engager à recevoir des candidats au CAP boucherie ou au poste d’ouvrier d’abattoir.
Par ailleurs, nous développons trois axes : l’accompagnement des nouveaux salariés par des tuteurs, c’est-à-dire des personnes expérimentées ; la polyvalence, pour éviter aux salariés de rester sur un poste difficile, et leur permettre de passer des échelons supplémentaires pour voir leur rémunération évoluer ; un plan de carrière enfin pour les jeunes en CAP. Dans nos industries, l’encadrement intermédiaire est issu à 90 % de la base, c’est-à-dire des ouvriers : la formation au métier d’agent de maîtrise en abattoir n’existe pas, le métier s’apprend sur le terrain. Face à la problématique de renouvellement de génération, notre rôle en matière de formation et d’accompagnement des jeunes dans les entreprises de la viande est très important. Car même si beaucoup de postes peuvent être automatisés, cela est plus facile dans le secteur du porc que dans le secteur du bovin – le premier est standard, le second disparate avec des petites et de très grosses carcasses –, et l’automatisation dans le désossage nécessite une capacité d’investissement importante, or les marges de l’industrie de la viande sont très faibles, de l’ordre de 0,70 euro pour les meilleurs. Sans oublier que certains postes, comme le désossage, resteront toujours manuels.
Les RPA devront être présents dans tous les abattoirs, quelle que soit leur taille, dès lors que le texte à ce sujet sera publié. Nous avons salué la proposition de leur donner le statut de lanceur d’alerte. Mais il faut aller plus loin, car on peut imaginer qu’ils subiront des pressions, et pas seulement de la direction. Les RPA doivent donc bénéficier d’une protection, comme celle des lanceurs d’alerte en matière de santé et d’environnement depuis la loi du 16 avril 2013, y compris en cas de changement de poste, à l’image de la protection des représentants du personnel pendant la durée de leur mandat et six mois après la fin de ce mandat. Grâce à un statut assorti d’une protection, les RPA pourront exercer leur rôle, qui est important et nécessite une formation, en signalant les anomalies, selon les cas, au directeur et au service qualité, au responsable de chaîne, au préposé vétérinaire, voire au vétérinaire.
De même, nous saluons l’annonce de la création d’un délit de maltraitance aux animaux, assorti de sanctions pénales à l’encontre des responsables d’abattoir. Au regard de la taille des abattoirs, la question se pose de savoir quel niveau sera concerné – le dirigeant ou le délégataire, ou les deux ? En tout cas, ce délit spécifique permettra de verrouiller le dispositif : seuil de 1 000 UGV supprimé pour la présence du RPA, statut protecteur pour le RPA ; sanction des dirigeants en cas de mauvais traitements aux animaux, car un responsable d’entreprise doit avoir connaissance de ce qui se passe dans son établissement.
Mme Geneviève Gaillard. Selon vous, les dirigeants des trois abattoirs visés connaissaient-ils les faits incriminés ?
M. Dominique Langlois. Je ne connais pas ces dirigeants. Dans les petites structures, comme les abattoirs publics ou municipaux, le dirigeant est souvent responsable de chaîne, voire responsable qualité.
M. Jacques Lamblin. Il peut aussi être responsable administratif : dans ce cas-là, il n’est pas forcément sur le site.
M. Dominique Langlois. Certes, mais il y a forcément un responsable dans l’abattoir.
Mme Geneviève Gaillard. Si je comprends bien, ces faits se produisent moins souvent dans les gros abattoirs.
M. Dominique Langlois. Avec un contrôle vétérinaire permanent et la présence d’une soixantaine de personnes sur la chaîne d’abattage, auxquelles s’ajoutent les six ou sept agents de maîtrise, de telles dérives peuvent difficilement se produire dans les gros abattoirs – si elles se produisent, elles ne durent pas. Mais on ne saurait pour autant condamner tous les autres : on trouve des petits abattoirs qui font très bien leur travail. Du reste, le règlement intérieur de certains établissements indique que la maltraitance constitue une faute grave.
Dans les trois affaires, qui révèlent des dérives dont il faudra établir la durée et la fréquence, des arguments ont été avancés, comme le volume accru des commandes, etc. Cela étant dit, le salarié n’est jamais tout seul : il est entouré de ses collègues. Certes, dénoncer un collègue est loin d’être simple, d’où l’importance d’instaurer une protection pour le lanceur d’alerte – et dans l’intérêt des salariés, car il y va de l’avenir de leur entreprise. C’est le sens de notre action auprès des fédérations, que je n’ai pas eu besoin de consulter sur notre intention de nous constituer partie civile, dans le respect évidemment de la présomption d’innocence. J’étais certain du soutien de mes collègues.
S’agissant de la vidéosurveillance, nous ne sommes ni pour ni contre. Cette mesure serait-elle pertinente ? Pour commencer, certaines structures pourraient ne pas avoir les moyens de financer l’installation d’un tel équipement. Ensuite, la question se poserait de savoir qui regarderait les vidéos et à quelle fréquence. Enfin, filmer les salariés sur leur poste de travail est actuellement interdit – la vidéosurveillance est autorisée pour des raisons de sécurité uniquement. Il faudrait en avoir la permission, et l’accord des salariés.
En définitive, nous avons déjà 80 % de la réponse, voire plus : ce qui manque, c’est la sanction, pour s’assurer de l’application des mesures existantes. Comme elle le fait pour le respect des règles sanitaires, l’administration doit jouer son rôle en saisissant le parquet en cas de faits délictueux – je n’ai pas connaissance de cas où l’administration aurait signalé des actes de maltraitance, en dehors de cas d’animaux abandonnés dans des conditions très particulières. Il faudrait qu’elle se montre totalement intransigeante sur ces faits.
M. le président Olivier Falorni. Des animaux abandonnés : de quoi s’agit-il ?
M. Dominique Langlois. Je pense à des animaux en souffrance dont les propriétaires agriculteurs ne peuvent plus s’occuper, pour des raisons de santé.
J’insiste : en abattoir, le préposé vétérinaire peut rendre compte au vétérinaire inspecteur, qui lui-même saisira l’inspecteur référent, qui saisira la direction départementale de la protection des populations, laquelle déclenchera une procédure. Il faut que les règles soient appliquées ; si elles sont complétées par le statut du lanceur d’alerte et la création d’un délit de maltraitance, je ne vois pas ce qu’on peut faire de plus. Chacun prendra ses responsabilités et le problème sera réglé. Mais il faut faire vite, car nos concitoyens attendent des réponses – communiquer n’est pas simple face à des images terribles. Ces affaires ne reflètent pas les pratiques dans la filière, ni l’état d’esprit des professionnels : non seulement la maltraitance est contraire à leur éthique, mais elle a pour conséquence d’altérer la qualité de la viande en raison de l’augmentation du pH chez les animaux stressés. En attendant, nous ne croyons pas à la vidéosurveillance. Voyez ce qu’il en est avec la vidéo-sécurité : lorsqu’un problème survient la nuit, c’est toujours à ce moment-là, comme par hasard, que la caméra est tombée en panne…
Enfin, pour répondre à la question de M. Chevrollier, la réglementation ne comporte pas de mesures inutiles susceptibles d’être supprimées. Le dispositif a été adapté à l’évolution de la filière – avec le passage de 450 à 280 abattoirs en vingt ans –, mais il n’est pas bouclé aujourd’hui : il manque un maillon, comme je viens de l’expliquer, or chacun des maillons est essentiel à la réussite de l’action en matière de bien-être animal.
Mme Françoise Dubois. La formation actuelle des abatteurs me semble insuffisante. Elle devrait être approfondie car, dans notre pays où le chômage sévit, je pense que beaucoup de personnes vont se porter candidates pour exercer ce métier. Le bien-être humain est également un point central : égorger des bêtes toute la journée n’est pas forcément évident. Existe-t-il un suivi pour ces professionnels ? À côté de l’accompagnement technique, un accompagnement psychologique vous paraît-il nécessaire ?
Même si elles sont inacceptables, les défaillances sont humaines, et on ne peut exclure le « pétage de plombs » d’un salarié débordé par l’arrivée d’un trop grand nombre d’animaux sur la chaîne.
Enfin, faites-vous la différence entre l’abattage traditionnel et l’abattage rituel ? Qu’en est-il de la formation des sacrificateurs nommés par les mosquées ?
Mme Annick Le Loch. Les interprofessions jouent un rôle essentiel dans la structuration et la pérennité des filières. La vôtre est-elle bien organisée pour assurer cette viabilité vis-à-vis de tous les maillons de la filière ?
Dans un contexte de crise de l’élevage, tous les producteurs sont en difficulté, en particulier les éleveurs de bovins dont les revenus sont les plus bas – vous avez vous-même évoqué à l’instant des cas dramatiques de producteurs qui abandonnaient leurs troupeaux. Comment ces crises se répercutent-elles sur l’ensemble de la filière ? Un maillon est-il plus fragilisé que les autres ? Quelles solutions verriez-vous ?
Le Gouvernement a présenté un plan abattoir assez conséquent ; certains gros abatteurs ont déjà fait savoir qu’ils n’auraient pas besoin de subventions. La remise à niveau des abattoirs relève-t-elle réellement d’un problème de financement ? Et ce plan de financement sera-t-il suffisant ?
Mme Sylviane Alaux. Je rejoins le propos de Françoise Dubois sur le bien-être des salariés. Grâce à la polyvalence, un nouveau salarié, qui a reçu une formation de 48 heures, tourne à tous les postes : mais au bout de combien de temps est-il affecté au poste d’abattage ? Car une formation de deux jours, c’est bien peu au regard d’un métier aussi particulier. En outre, la formation d’agent de maîtrise n’existe pas, avez-vous souligné. Vos fédérations sont-elles demandeuses, auprès des conseils régionaux et des chambres de métiers, d’une formation qui viendrait parfaire la formation de base et d’une formation ciblée au métier d’agent de maîtrise ?
M. Jacques Lamblin. Le travail de notre commission d’enquête a pour objectif de faire le point sur le fonctionnement des abattoirs, mais aussi de trouver des solutions aux problèmes. Au fur et à mesure de nos auditions, des propositions émergent. Après avoir souligné l’intérêt de la formation et la nécessité d’une sanction, vous vous êtes montré beaucoup plus réservé sur le vidéo-enregistrement. Pourtant, plusieurs auditions ont montré que, face à un manque de personnel de contrôle vétérinaire sur les chaînes d’abattage, le vidéo-enregistrement permettrait non seulement de multiplier les points de contrôle, mais pourrait être utilisé à décharge en cas d’accusation. Qu’en pensez-vous ? J’entends bien l’argument de la panne de la vidéosurveillance, mais le matériel des abattoirs lui-même peut tomber en panne.
L’abattage rituel a été évoqué. Faut-il imposer l’étourdissement préalable pour limiter la souffrance de l’animal au moment de la saignée, mais aussi les risques pour les abatteurs eux-mêmes ? Quel serait l’impact d’une telle mesure ? Comment faudrait-il en contourner les effets négatifs sur le plan économique ?
Une autre idée a été avancée : l’étiquetage qui, en mettant en valeur la qualité du produit, mais aussi l’éthique au sein du circuit, permettrait de tirer les pratiques vers le haut. Qu’en pensez-vous, même si la mise en place d’un tel étiquetage pourrait poser de sérieuses difficultés sur le plan économique ?
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Votre interprofession comporte un collège abattage/transformation, et elle intervient dans le domaine de l’équarrissage. Vous dites ne pas avoir de possibilité d’investigation dans les abattoirs, dont vous percevez pourtant les cotisations obligatoires, auxquelles s’ajoutent les conventions élaborées par votre interprofession. Où situez-vous le rôle d’INTERBEV, dont je connais bien les représentants en Lozère, au regard d’un éventuel contrôle dans les abattoirs ?
Une des conditions pour se porter partie civile est d’avoir un intérêt à agir. Comment les juges analysent-ils l’intérêt à agir d’INTERBEV lorsqu’elle se porte partie civile ?
Enfin, Arnaud Viala, député de l’Aveyron, et moi-même envisageons de visiter les abattoirs de Saint-Affrique et de Sainte-Geneviève. Quel abattoir de l’Aveyron, dont vous avez parlé, pose problème ?
M. Dominique Langlois. Alors que le renouvellement des générations est un enjeu majeur pour la profession, celle-ci a du mal à recruter car nos métiers sont peu attractifs. De surcroît, un cursus est nécessaire pour accéder à certains postes dans l’entreprise de viande, dont l’abattoir fait partie, où l’acquisition du savoir-faire nécessite plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans ce contexte, nous avons mené plusieurs actions. D’abord, la grille des classifications a été modernisée, pour l’adapter aux différents postes, dont certains n’existaient pas il y a plusieurs dizaines d’années. En outre, le tutorat se développe à l’initiative des entreprises pour « coacher » les nouveaux embauchés dans cet univers inconnu et parfois dangereux à cause de la circulation, de crochets ou de sols glissants, etc. Cela est d’autant plus important pour les nouveaux embauchés en reconversion – une centaine de salariés se sont reconvertis dans les métiers de la viande dans le cadre du plan de reconversion des mineurs de Lorraine.
Il existe des formations non spécifiques aux abattoirs, avec le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et le brevet professionnel (BP) « boucher » notamment. De notre côté, nous organisons des formations qualifiantes en abattage, avec les certificats de qualification professionnelle (CQP), et nous mettons en place avec Pôle emploi des formations externalisées de quatre mois avec des séquences pratiques dans l’entreprise. L’apprentissage du métier d’agent de maîtrise – nous disons « responsable de ligne » – se fait sur le tas, au moyen de formations spécifiques pour ceux qui souhaitent progresser. Quant à la formation de 48 heures, il ne s’agit pas d’une formation au poste de travail, mais de deux journées d’information au cours desquelles sont abordées les règles sanitaires – lavage des mains, etc. –, les risques du métier et les aspects de bien-être animal. Ce sont donc des journées d’information et d’intégration plutôt que de formation.
Un salarié issu du monde de la viande – un boucher affecté dans un atelier de désossage, par exemple – s’adaptera très vite. Pour les nouveaux embauchés qui ne connaissent rien du métier, nous avons recours, soit à des formations extérieures, soit à des formations internes avec des salariés expérimentés qui forment un groupe d’une dizaine de personnes, étape par étape, en commençant par le plus facile, la fin de chaîne de désossage par exemple, pour terminer par les gestes plus techniques, comme le désossage d’une carcasse. Jamais un salarié n’est affecté au poste d’abattage le premier jour : il doit avoir occupé auparavant plusieurs postes sur la chaîne d’abattage, et être jugé apte par le chef de service à faire ce travail, qui n’est pas forcément simple, sur le plan technique comme sur le plan psychologique. Enfin, le salarié ne démarre pas tout seul : il est accompagné par un collègue expérimenté qui déterminera le moment où il est capable de faire le geste sans cet accompagnement. Quoi qu’il en soit, le salarié n’est jamais seul : ce poste n’est pas isolé, tout au moins dans les grosses unités. C’est plus compliqué dans les petits abattoirs, mais les compétences des ouvriers sont identiques quelle que soit la taille des abattoirs.
Mme Sylviane Alaux. En matière de compétences, existe-t-il un cahier des charges commun aux entreprises ?
M. Dominique Langlois. Il n’y a pas de cahier des charges. En revanche, la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes prévoit la « classification des emplois », avec une définition des postes : le salarié doit donc avoir acquis un savoir-faire spécifique pour accéder à tel ou tel échelon. L’adaptation de la grille des classifications a été réalisée en 2010, étant entendu que le salaire de base déterminé par la convention collective n’est pas le salaire réel, qui relève de l’entreprise. Lors des entretiens individuels annuels, le chef de service fait le point avec les salariés, ce qui lui permet de détecter d’éventuels problèmes et de recevoir les demandes de formation et de changement de poste ou de service.
Grâce au tutorat, les salariés sont accompagnés sur les postes les plus difficiles par des salariés en poste depuis de longues années et dont le savoir-faire est incontestable : c’est cela qui les autorise à transmettre ce savoir-faire et surtout un savoir-être : il s’agit d’un lien d’accompagnement entre le salarié et son tuteur, et non un lien hiérarchique. Sans être une obligation, cette méthode est développée par bon nombre d’entreprises pour capitaliser le savoir-faire acquis, mais aussi alléger le travail des salariés en fin de carrière, éventuellement dans le cadre d’un accord sur la pénibilité.
L’information est un élément central : c’est par l’information qu’on pourra attirer des jeunes vers la profession. D’ailleurs, lors de nos opérations « portes ouvertes », les visiteurs se montrent toujours très surpris par les équipements existants dans nos entreprises. Nous avons donc tout intérêt à les leur montrer.
Comme dans tous les milieux, des « pétages de plombs » peuvent se produire dans les abattoirs. C’est le rôle de l’encadrement d’être vigilant vis-à-vis de ce problème qui peut se produire pour des raisons extraprofessionnelles – le lundi est, on le sait, un jour sensible… Votre question sur le sujet renvoyait à la problématique des cadences ; or il faut savoir que l’abattage rituel ralentit la chaîne – comme l’a expliqué un salarié dans le livre qu’il a écrit, le rituel permet de travailler moins vite. Ensuite, et même s’il est difficile d’appréhender la situation entreprise par entreprise, les cadences sur la chaîne sont adaptées au nombre de postes – une chaîne ne passera pas, à nombre de postes identiques, d’une cadence de 20 à une cadence de 40 animaux à l’heure. À cette adaptation des cadences s’ajoutent des temps de pause. Actuellement, un travail est mené avec les représentants du personnel et les CHSCT pour définir, dans le cadre des accords de pénibilité, les postes à pénibilité forte, moyenne ou faible.
Sur la vidéosurveillance, piste qui a été évoquée, nous maintenons que les mesures existantes contribuent à régler le problème sur lequel se penche votre commission d’enquête. D’abord, la réglementation communautaire a imposé une obligation de résultat avec le « paquet hygiène », qui traite du bien-être animal. Ensuite, les contrôles sont déjà importants, grâce aux vétérinaires, préposés vétérinaires, aux besoins vétérinaires vacataires, auxquels s’ajoutent les services qualité. Vous me demanderez alors pourquoi de tels faits se sont produits dans les trois abattoirs : les enquêtes judiciaires détermineront les causes de ces dysfonctionnements – les images n’ont pas été truquées. Nous ne sommes pas opposés par principe à la vidéosurveillance, pour peu que tous les critères soient réunis, d’autant que certaines situations peuvent être délicates, notamment la nuit lors du déchargement des animaux dans les bouveries : un chauffeur peut être bousculé par une bête agressive, or les petits abattoirs ne disposent pas toujours d’un gardien. Mais notre position sur la vidéosurveillance est réservée, car une telle mesure impliquerait un investissement supplémentaire et soulèverait des problématiques de droit à l’image – certains salariés ne souhaiteraient pas être filmés –, mais aussi d’acceptabilité sociale, car les représentants du personnel pourraient arguer que cette technique permettrait de filmer les salariés en train de faire des pauses, etc. En tout état de cause, ce n’est pas la solution miracle et beaucoup de choses existent déjà.
Comment notre intérêt à agir peut-il être retenu et nous amener à nous constituer partie civile ? Une interprofession a pour vocation de conclure des accords interprofessionnels qui porteront sur la pesée/classement/marquage, l’étiquetage, etc., étant de sujets qui concernent l’ensemble de la filière. Ces accords doivent recueillir l’unanimité des sections composant les collèges : un accord interprofessionnel ne peut être étendu que si la majorité des collèges a exprimé un avis favorable, étant entendu que le vote est acquis à la majorité des deux tiers au sein de chaque collège. La valeur juridique de cet accord découle de son extension prononcée par le ministère de l’agriculture, lequel contrôle sa légalité et son euro-compatibilité – c’est cette extension qui lui donne donc force de loi, à l’image d’un accord collectif étendu. La contribution volontaire obligatoire (CVO), que nous prélevons auprès des différents maillons de la filière – production/transformation/distribution – fait l’objet d’un accord interprofessionnel renouvelé tous les trois ans : chaque section approuve le renouvellement de l’accord interprofessionnel sur la collecte de la CVO, éventuellement en le modifiant – en fonction des budgets, avec une répartition différente entre les maillons par exemple –, mais cet accord fait l’objet d’une procédure d’extension. C’est la raison pour laquelle, bien que les opérateurs des différents maillons de la filière n’aient pas de lien direct avec l’interprofession, ils ont l’obligation de lui payer la contribution volontaire obligatoire.
Notre intérêt à agir se fonde sur le préjudice porté à l’image de la filière – tel a été le cas lors du scandale de la viande de cheval, où le juge d’instruction a immédiatement accédé à notre demande de constitution de partie civile. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement pour les trois affaires révélées par les vidéos diffusées par l’association L214 : le préjudice est considérable.
M. Jacques Lamblin. Les conséquences sont également graves au regard des recrutements dans la filière.
M. Dominique Langlois. Tout à fait. Ces affaires portent un coup terrible à la filière : aux producteurs – qui vivent très mal la situation car ils aiment leurs animaux –, aux industriels et aux distributeurs. Face à de telles images, les résultats positifs de nos campagnes de communication s’écroulent. Il est très difficile de chiffrer le quantum du préjudice, et donc d’évaluer la perte de volume. L’important pour nous est d’être acteurs dans la procédure pénale pour montrer que nous condamnons ces faits, même si les condamnations se réduisent généralement à une somme symbolique – dans l’affaire de la viande de cheval, notre objectif premier est de montrer que la fraude n’est pas cautionnée par la profession, d’où la nécessité d’une sanction pénale.
La filière bovine est en crise : après une petite accalmie, elle connaît à nouveau une dégradation très forte des prix payés aux producteurs pour lesquels la situation n’est pas tenable avec des « revenus », si l’on peut encore les appeler ainsi, qui tournent autour de 10 000 à 12 000 euros par an. Le plan de soutien à l’élevage, présenté en juillet, comporte des mesures immédiates. Par contre, nous sommes à un tournant : il s’agit de savoir si l’on veut, ou pas, conserver notre élevage en France. Selon les conclusions du rapport Chalmin, les producteurs perdent de l’argent, l’industrie fait très peu de marges, et la distribution elle-même n’y trouve pas de gains. Comment faire, sinon augmenter le prix de la viande ? D’un côté, les consommateurs disent acheter moins de viande bovine car elle est trop chère, de l’autre, les producteurs demandent une augmentation de 40 à 60 centimes par kilo. Dans ce contexte très difficile, on peut craindre de nouveaux problèmes avec les producteurs fin mai ou courant juin, à cause des sorties massives de jeunes bovins, de la présence massive de génisses sur le marché de l’abattage – car après un fort investissement sur les génisses pour l’export, celui-ci a été stoppé net à cause de la fièvre catarrhale ovine – et d’une sous-valorisation du troupeau allaitant. De surcroît, à la baisse de la consommation, s’ajoute une modification du mode de consommation : 49 % de la viande bovine est consommée sous forme de steak haché, fabriqué avec les morceaux avants. Que fait-on du reste ? Certes, dans les boucheries traditionnelles, l’acte d’achat se fait plus facilement que dans les rayons libre-service, car le boucher du quartier peut attester devant ses clients de la qualité et de la provenance de la viande. Par contre, le marché est atone. Quant au marché européen…
M. le président Olivier Falorni. Monsieur le président, vos réponses sont passionnantes, mais malheureusement, je dois vous demander d’abréger, car nous avons prévu une table ronde dans la foulée de votre audition, à dix heures trente. Pourriez-vous répondre maintenant sur l’abattage rituel et l’étiquetage ?
M. Dominique Langlois. Ce sujet éminemment compliqué sera au cœur des débats pour les élections en 2017. Trois hypothèses sont envisageables : la première est le statu quo, autrement dit, le maintien de la dérogation sous contrôle de l’État, complétée par le décret de 2011 qui impose le contrôle par les autorités sanitaires d’une déclaration en préfecture, de la formation des sacrificateurs, et de la tenue d’un registre attestant de l’adéquation entre les commandes et les ventes. Deuxième hypothèse : l’étourdissement préalable obligatoire, autrement dit la suppression de la dérogation, ce qui aurait comme conséquence 14 % d’abattage bovins en moins et 22 % d’abattage ovins en moins. Or dans la crise actuelle, une baisse de 14 % serait dramatique, sachant que 90 % de jeunes bovins sont exportés et que 90 % de nos clients sont des pays musulmans – le marché casher est plutôt français. L’arrêt de l’abattage rituel répondrait certes à une demande, mais serait donc catastrophique pour l’économie – le parlement polonais a rétabli la dérogation après avoir interdit l’abattage rituel, car le pays avait perdu 50 % de son marché à l’export au bout de six mois. Troisième hypothèse : réfléchir avec les cultes à la possibilité d’un soulagement juste après l’égorgement, qui permettrait de résoudre le problème des quatre-vingt-dix secondes. La communauté israélite a signifié un non catégorique ; pour ce qui concerne la communauté musulmane, certains pays l’acceptent, notamment la Malaisie. Mais nos mosquées ne l’acceptent pas, et le Conseil français du culte musulman n’a pas autorité pour le leur imposer – mais certains de ses membres n’y seraient pas hostiles.
L’étiquetage a fait l’objet de nombreux débats en 2012. La Communauté européenne considère que l’étiquetage serait discriminant et n’apporterait pas une information pertinente au consommateur. Il est clair qu’un produit étiqueté « abattu non conventionnellement » ne se vendra pas ; or dans le casher, seuls les avants sont consommés Faut-il mettre tout le reste à l’équarrissage ? Nous attirons donc votre attention sur les conséquences économiques d’une telle mesure.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. L’interprofession serait-elle prête à s’engager dans une démarche de certification avec des organismes extérieurs – du type de celle qui existe pour certaines installations classées avec une commission locale associant élus, associations et organisme gestionnaire –, autrement dit dans la constitution d’un lieu de concertation et d’échange d’informations qui permettrait de briser les incompréhensions ?
Lors des auditions, nous avons souvent entendu parler de matériels inadaptés, de process mal définis, de conceptions d’outils inappropriées. L’interprofession serait-elle prête à s’engager sur des recommandations au travers d’une certification de la qualité des matériels, d’une démarche de progrès qui éviterait aux petites structures d’investir dans du matériel qui ne fonctionne pas bien et réglerait au passage certains problèmes de pénibilité ?
M. Dominique Langlois. À votre première question, ma réponse est oui. Nous devons avoir des contacts avec les ONG environnementales, à condition qu’elles ne soient pas « anti-viande ». Nous devons également dialoguer avec les associations de consommateurs ; nous l’avons fait lors de la crise de la viande de cheval, ce qui nous a permis d’être en totale adéquation avec elles. Tout cela va dans le sens de la création de notre commission enjeux sociétaux.
Pour répondre à votre seconde question, notre rôle est toujours à la frontière de celui des fédérations. Cela étant, dans le cadre des sections, nous sommes constamment en veille sur les technologies d’abattage utilisées dans les autres pays, qu’ils soient européens ou plus lointains comme l’Australie. Ce faisant, nous avons un rôle de facilitateur. Surtout, nous essayons de faire comprendre, et ce n’est pas toujours facile, la nécessité d’adapter les investissements et l’outil à la taille de l’établissement : un abattoir de petite taille peut être tout à fait opérationnel avec un investissement adapté à sa taille, alors qu’un abattoir où les montants investis ne sont pas en adéquation avec les besoins ne sera jamais rentable. D’où l’importance du programme d’investissements d’avenir, doté de 25 millions supplémentaires pour moderniser les outils d’abattage/découpe dans le cadre du plan de soutien à l’élevage. Enfin, nous aimerions que la Banque publique d’investissement (BPI) soit davantage à nos côtés, car les prêts à 4 % qu’elle propose ne permettent pas aux entreprises de la viande d’investir.
M. le président Olivier Falorni. Merci, monsieur le président, pour la qualité et la précision de vos réponses.
La séance est levée à dix heures cinquante-cinq.
——fpfp——
9. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant chercheurs et instituts techniques, avec la participation de Mme Claudia Terlouw, chercheuse à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), M. Pierre Le Neindre, ancien chercheur de l’INRA, M. Pierre Frotin, ingénieur développement coordination et promotion services et produits à l’Institut de la filière porcine (IFIP) et M. Luc Mirabito, chef de projet « bien-être animal » à l’Institut de l’élevage.
(Séance du jeudi 12 mai 2016)
La séance est ouverte à onze heures.
M. le président Olivier Falorni. Madame, messieurs, nous vous remercions de votre présence devant cette commission.
Madame Claudia Terlouw, vous avez soutenu une thèse en Écosse sur la physiologie et le comportement au stress des animaux de ferme. Depuis 1992, vous travaillez à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Vous avez notamment été la co-auteure d’articles sur les origines des mouvements présentés par les bovins après l’étourdissement et pendant la saignée, ainsi que sur l’évaluation et la gestion du bien-être animal.
Monsieur Pierre Le Neindre, vous êtes ingénieur agronome, diplômé de l’Institut national agronomique (INA) de Paris ; vous avez obtenu un doctorat d’État de l’Université de Rennes. Désormais retraité, vous avez longtemps travaillé au sein de l’INRA ; vous avez été impliqué dans différents groupes d’expertise européens, et vous avez participé à un groupe de travail de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sur le bien-être des animaux ainsi qu’à une expertise collective de l’INRA sur la conscience animale.
Monsieur Pierre Frotin, vous êtes le spécialiste du bien-être animal au sein de l’Institut de la filière porcine (IFIP), organisme français de recherche et de développement, créé en 2006 au service de la filière. Cet institut agit à la fois pour le développement et la compétitivité du secteur et de ses acteurs et pour garantir une qualité des produits aux consommateurs. Il dispense notamment des formations aux abatteurs-découpeurs, et a aussi comme domaine d’expertise le bien-être animal à l’abattoir.
Monsieur Luc Mirabito, vous êtes chef de projet « bien-être animal » à l’Institut de l’élevage (IDELE), organisme de recherche et de développement dont la mission est notamment d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et des filières, et l’élaboration des techniques et outils destinés aux techniciens et éleveurs.
Je vous rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Claudia Terlouw, M. Pierre Le Neindre, M. Pierre Frotin et M. Luc Mirabito
prêtent successivement serment.)
Mme Claudia Terlouw, chercheuse à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Je travaille en effet à l’INRA depuis plus de vingt ans sur les questions de stress à l’abattage ; je m’intéresse à la fois aux causes et aux conséquences de ce stress, sous l’angle du bien-être animal mais aussi de la qualité de la viande. Je travaille sur toute la période de l’abattage, c’est-à-dire depuis la préparation de l’animal par l’éleveur en vue de son départ à l’abattoir jusqu’à la mort de l’animal.
Dans l’approche que nous adoptons, c’est la perception de l’animal qui compte, son expérience du stress. Nous nous fondons notamment sur l’étude des différences entre les individus d’un groupe : nous effectuons sur les animaux en cours d’élevage, plusieurs semaines avant l’abattage, des tests de réactivité, afin de mieux connaître leur réaction à la nouveauté, à la présence de l’homme… Ensuite, nous étudions leur comportement et leur physiologie lors de l’abattage. Et comme les animaux montrent une cohérence dans leur façon de réagir, nous trouvons des liens. Ainsi, nous avons découvert que les bovins les plus réactifs à la nouveauté sont aussi ceux qui donnent le plus de signes de stress à l’abattage. Et cela se retrouve également dans la qualité de la viande.
Récemment, nous nous sommes beaucoup intéressés à la période de l’étourdissement et de la mise à mort. Nous avons notamment réalisé une étude bibliographique sur les bases neurobiologiques de la perte de conscience et de la mort de l’animal. Nous avons également travaillé sur le gazage des porcs.
Je souligne que nous travaillons tout à la fois dans un abattoir expérimental, c’est-à-dire dans des conditions très contrôlées, mais aussi dans des abattoirs commerciaux, ce qui nous permet d’être en contact avec la réalité du terrain – je m’empresse de préciser que j’y ai toutefois moins de contacts que nos deux collègues.
Nous avons noté à quel point la mise en place du règlement européen a été vécue comme un soulagement dans ces abattoirs : les choses sont beaucoup plus claires. Les directeurs peuvent tenir un discours plus formel. Mais les personnels des abattoirs souhaitent encore plus de clarté, et ils attendent beaucoup des politiques.
M. Pierre Le Neindre, chercheur retraité. Lorsque j’étais plus jeune, j’ai travaillé sur la relation mère-jeune (1) : l’élevage, je veux le dire en introduction, ce n’est pas que de la douleur ; c’est aussi du plaisir.
Entre 1990 et 2009, j’ai participé à différents groupes d’experts, en particulier européens. J’ai vu évoluer notre dispositif ; les relations entre les experts et le monde de l’action ont été grandement clarifiées.
J’ai piloté à l’INRA une expertise consacrée à la douleur animale. Je vous ai transmis un document à ce sujet, qu’il faut lire comme une invitation à revisiter l’ensemble des processus d’élevage. Nous disions en 2009 qu’il y avait des choses à faire, et qu’il était possible de les faire.
Nous préparons actuellement un rapport sur la conscience animale. Nous partons de l’idée que l’important n’est pas ce que vivent les animaux, mais la façon dont ils le ressentent : c’est une approche légèrement différente de ce qui se faisait auparavant.
Concernant la qualité de vie des animaux à l’abattoir, j’ai participé à l’évaluation par l’ANSES des guides de bonnes pratiques : ce sont des documents riches, complets, qui constituent des outils de progrès.
Les points de vue comme les objectifs sont multiples, parfois inconciliables ; s’il faut supprimer la mort, alors il faut supprimer l’abattoir. Tout n’est pas qu’économie.
Il faut s’interroger davantage sur le savoir-être des acteurs que sur leur savoir-faire : la formation est importante, mais il faut avant tout un bon état d’esprit. Je ne m’étends pas sur le rôle des différents intervenants, dont le responsable de la protection animale et le vétérinaire officiel.
Il faut également noter que le souci de l’animal est brouillé par la coexistence de systèmes d’abattage avec et sans étourdissement.
Les industriels veulent bien faire, et agissent ; mais il faudrait que tout cela se passe dans la plus grande transparence, avec des procédures de contrôle et d’échantillonnage claires. Elles sont en cours de réalisation. C’est très important pour l’avenir.
M. Pierre Frotin (Institut de la filière porcine). L’Institut de la filière porcine est un centre technique, qui appartient au réseau ACTA (Association de coordination technique agricole), qui réunit une quinzaine de centres techniques agricoles en France liés aux activités de production – animales, mais aussi végétales. L’IFIP est devenu, depuis 2006, un institut agricole et agro-industriel, avec le rachat d’une partie des activités du centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viande (CTSCCV). L’IFIP regroupe tous les métiers, de la génétique à la fabrication du saucisson, et environ 85 experts. Nous développons des expertises très pointues sur l’ensemble des sujets qui concernent le porc, et nous nous intéressons depuis longtemps à la période qui va de la sortie de l’élevage jusqu’à la fin de la vie de l’animal.
Je suis moi-même plutôt spécialiste de la protection animale à l’abattoir, aussi bien du point de vue du comportement de l’animal que du matériel utilisé, de la gestion humaine, de la formation, de la rédaction du guide de bonnes pratiques en matière d’abattage des porcs.
La France compte, vous le savez, quelque 250 abattoirs, dont 29 spécialisés dans l’abattage de porcs. Ces derniers sont plutôt des abattoirs industriels : ce sont des outils calibrés, équipés, structurés, avec du personnel qualifié. Globalement, cela fonctionne bien. À côté de ces unités spécialisées, il existe des abattoirs multi-espèces, dont il est logique que le niveau d’équipement et de compétence soit moins élevé en matière porcine. C’est un détail qui a son importance.
La protection animale n’est pas pour nous un sujet nouveau ; nous n’avons pas commencé à nous en préoccuper avec les films de l’association L214, même si ceux-ci ont pu avoir le mérite de réveiller les consciences.
J’ai commencé mes missions en 2001 ; depuis, l’évolution est extrêmement importante. Les générations se renouvellent, et le rapport avec l’animal change. Les équipements sont devenus plus précis ; les procédures se modifient, les méthodes de protection animale aussi. L’intérêt des industriels ne date pas d’hier, il faut en avoir conscience : des choses existent déjà, même si on peut certainement en mettre en place de nouvelles. Après, il faut que ça tourne, nous en sommes d’accord.
Ce qui fait tourner un abattoir, c’est la main-d’œuvre. Le facteur humain est tout à fait essentiel : les hommes doivent être formés, et avoir, comme l’a dit Pierre Le Neindre, conscience de travailler avec des animaux vivants, et non avec des parpaings ou des palettes de boîtes de conserve. Ce n’est pas le plus facile à faire comprendre. La majorité des opérateurs sont sérieux et compétents ; mais, comme dans toute population, on trouve parmi les personnels des abattoirs des gens que nous qualifierons de moins concernés…
La formation est réglementée depuis 2013. Elle existait auparavant, sous différentes formes, mais elle s’est renforcée : il ne s’agit pas d’apprendre aux gens à travailler, car ils savent travailler, mais de les amener à comprendre pourquoi on fait tel ou tel geste. On n’apprend pas à un opérateur qui saigne 600 porcs à l’heure comment on saigne un animal ! Mais on peut lui enseigner que s’il vise correctement les deux artères carotides, l’animal mourra plus vite.
M. Luc Mirabito (Institut de l’élevage). J’apporterai d’abord un petit complément à la présentation que vous avez faite, monsieur le président, de l’Institut de l’élevage : nous travaillons non seulement sur la compétitivité, mais aussi sur l’adaptation au marché, aux attentes des consommateurs.
Nous avons commencé à agir en matière de bien-être et de protection des animaux à la fin des années 1980 ou au début des années 1990. Nous nous sommes d’abord concentrés sur les questions d’élevage, en raison des nouvelles réglementations européennes. Mais nous avons assez vite travaillé sur la protection des animaux à l’abattoir, principalement sur la conception des équipements – une synthèse avait été réalisée sur ce point au milieu des années 1990 – et sur la formation, mais aussi les aspects de sécurité. Nous pensons en même temps la sécurité des opérateurs et la protection des animaux : on travaille en effet avec un binôme homme-animal. Notre approche est couplée.
Dans les années 2000, l’approche du bien-être animal a changé : d’une approche essentiellement centrée sur les moyens mis à disposition des animaux, on a basculé vers une approche qui tente d’évaluer le bien-être des animaux en réalisant des mesures sur l’animal lui-même. À partir de la fin des années 2000, date de l’entrée en vigueur du règlement européen, nos travaux ont particulièrement porté sur cette question de l’évaluation du bien-être animal sur l’animal lui-même.
Nous avons développé des guides de bonnes pratiques de la protection animale à l’abattoir, qui formalisent tout à la fois la conception des bâtiments, la méthode de travail des opérateurs et les indicateurs objectifs de la performance des opérateurs et du système. Je fais mienne ici une formule de Temple Grandin : « On gère ce que l’on mesure ». Il fallait donc proposer une formalisation : si l’on sait mesurer, alors le plus souvent on peut adopter une démarche de progrès – ce qui constitue l’objectif de nos instituts techniques.
Aujourd’hui, nous continuons à travailler sur l’amélioration des équipements et des systèmes, en gardant toujours à l’esprit le binôme homme-animal, en envisageant ensemble protection animale et sécurité humaine. Nos recherches portent également sur la question de l’évaluation, autrement dit les méthodes statistiques de traitement ou méthodes d’échantillonnage, mais aussi des sujets plus prometteurs à long terme, tels que l’objectivation des indicateurs d’évaluation. Nous travaillons par exemple sur l’objectivation de l’évaluation de la perte de conscience ; nous essayons avec l’IFIP de construire des systèmes d’évaluation assistée. Nous avons des collègues en Allemagne qui creusent ces mêmes sujets. Ces pistes nous paraissent prometteuses pour essayer de sortir de certaines querelles de chapelle et réfléchir à partir d’éléments plus objectifs.
Nous travaillons sur l’abattage classique comme sur l’abattage sans étourdissement. Chacun peut avoir là-dessus son opinion personnelle, naturellement, mais les scientifiques n’ont pas à décider s’il faut ou pas un étourdissement : notre rôle, c’est d’essayer de mettre au point les systèmes qui soient les meilleurs possible pour les animaux – en tenant compte, je l’ai dit, du risque pour les humains.
Enfin, la question de la formation est souvent revenue au cours de vos premières auditions. L’IDELE est organisme formateur ; je suis moi-même animateur du réseau mixte technologique (RMT) « bien-être animal » qui a élaboré la base de données de questions qui permet l’évaluation des opérateurs. La formation ne doit surtout pas être prise à la légère ; il y a un corpus de connaissances, y compris didactiques et pédagogiques. Changer les attitudes, les représentations, les comportements est toujours difficile, d’autant que nous avons affaire ici à une activité très particulière, avec un binôme animal-homme. Nous réfléchissons donc aussi à cet aspect.
M. le président Olivier Falorni. Je voudrais vous entendre sur la question de la perte de conscience de l’animal après l’étourdissement. Pouvez-vous définir précisément les phénomènes de perte et de reprise de conscience des animaux ? Quels sont selon vous les délais optimaux entre l’étourdissement et la saignée ? Existe-t-il des signes sûrs de perte de conscience, et lesquels ? Quels tests doivent effectuer les opérateurs pour constater la perte de conscience ? Ces opérateurs sont-ils vraiment en mesure de déceler ces signes sur une chaîne d’abattage ?
En quoi consiste précisément l’étourdissement réversible, souvent évoqué lorsqu’il est question d’abattage rituel ? Est-il ou a-t-il déjà été pratiqué en France ou dans d’autres pays ?
Un responsable de fédération d’abattoirs a évoqué devant nous, la semaine dernière, la technique du « soulagement » c’est-à-dire un « étourdissement post-jugulation pour que les animaux soient inconscients quelques secondes après la saignée ». Est-ce une méthode de soulagement efficace de l’animal ? De la même façon, est-elle ou a-t-elle déjà été pratiquée en France ou dans d’autres pays ?
Serait-il utile selon vous que les abattoirs ne soient dédiés qu’à un seul type d’abattages, autrement dit qu’ils soient tous mono-espèce, conventionnels ou rituels ?
Monsieur Frotin, les associations de protection animale ont notamment soulevé le problème de l’utilisation du CO2 dans l’abattage porcin. Pouvez-vous revenir sur ce sujet ?
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Vous représentez ici la recherche, les instituts techniques, et une bonne transmission des connaissances issues de ces recherches vers la pratique est indispensable : ce continuum est-il correctement assuré dans notre pays ? Y a-t-il, inversement, des retours du monde de la pratique vers la recherche, des échanges ?
Nous avons en effet le sentiment que les connaissances ne sont pas toujours bien exploitées : la réglementation ne prend pas en considération tout ce que l’on sait, les formations pratiques délivrées aux opérateurs, les matériels, la conception des abattoirs eux-mêmes ne sont pas toujours au niveau. Bref, on s’aperçoit que certaines choses ne marchent pas, alors qu’on dispose des connaissances et des compétences idoines.
Vous avez dit, madame Terlouw, que les animaux présentaient des réactions très différentes. Quiconque d’ailleurs a élevé des animaux le sait… Reste que ces animaux sont destinés à être abattus. N’est-il pas étonnant qu’on n’ait pas sélectionné des animaux et des modes d’élevage qui permettent que l’abattage se fasse le mieux possible ? L’animal ne veut pas être tué ; il va tout faire pour s’en sortir. Il est logique que les plus performants soient les plus difficiles à amener à l’abattoir. Est-ce que je me trompe, ou avons-nous laissé de côté le choix des races et des modèles d’élevage ? Dans ma région du Charolais, l’élevage se fait à l’air libre, les bêtes ne voient pas souvent de bonshommes… Arrivent un camion et trois personnes, ils réagissent immédiatement !
Je voudrais également vous entendre sur l’organisation géographique de l’élevage : les abattoirs sont en ville, et de plus en plus concentrés ; les animaux sont à la campagne, loin – et le moins que l’on puisse dire est que les conditions d’existence à l’entrée d’un abattoir et dans un pré sont assez différentes. N’y a-t-il pas là un problème ? L’a-t-on pris en compte ? Faut-il modifier les structures pour éviter ces grandes distances ?
S’agissant enfin de la souffrance et de la mise à mort, plus la souffrance est courte, mieux c’est. C’est une question délicate, mais à choisir, quel est le meilleur équilibre à adopter entre l’intensité de la douleur et la rapidité de la perte de conscience ?
Mme Sylviane Alaux. Lors de son audition, M. Jean-Pierre Kieffer, président de l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), nous a notamment déclaré que beaucoup de mauvaises pratiques proviennent de non-vérification de la perte de conscience. Il précisait qu’un groupe de travail consacré à la perte de conscience des porcs allait être mis en place avec l’ANSES. Ce groupe est-il déjà en place, a-t-il commencé ses travaux ?
Ne serait-il pas utile d’adapter le rythme de l’abattoir à ces nécessaires vérifications de la perte de conscience, pour le bien-être animal et plus généralement pour le bien-être de tous ? Cela devrait être une obligation, me semble-t-il.
Mme Claudia Terlouw. Monsieur le rapporteur, l’animal est effectivement conçu pour survivre ; mais c’est aussi ce que l’on veut : il doit pouvoir se défendre. Les éleveurs ne veulent pas d’un animal totalement amorphe… Même à l’abattoir, ce ne serait pas souhaitable : les recherches ont montré que les animaux qui ont le moins peur de l’homme sont précisément ceux qui reçoivent le plus interventions de la part du personnel de l'abattoir, parce qu’ils n’avancent pas. Il faut donc trouver un juste équilibre.
Cet équilibre, on le recherche, et depuis longtemps : les éleveurs eux-mêmes, bien avant que des recherches formelles ne soient lancées, gardaient plutôt les animaux manipulables, et pas ceux qui étaient dangereux. C’est encore le cas : les directeurs d’abattoirs vous diront qu’il leur arrive parfois des animaux dangereux, et qu’il leur faut se débrouiller avec. Un animal trop dangereux et difficile à manipuler, on n’en veut pas, et on ne le fait pas se reproduire.
Des chercheurs – par exemple Alain Boissy, à l’INRA – s’intéressent depuis longtemps à ces questions. M. Le Neindre connaît d’ailleurs très bien ces travaux sur l’irritabilité et la réactivité ; il en a même été à l’origine, me semble-t-il. Une partie de ces traits de caractère sont héritables – la réactivité, mais aussi le comportement maternel chez les brebis, par exemple – et il est possible de s’en servir comme critère de sélection.
M. Pierre Le Neindre. Nous avons en effet traité ces questions dans les années 1990, en nous intéressant au cas de la race limousine.
M. le rapporteur. Elle est également excellente !
M. Pierre Le Neindre. Je prends mes précautions… Nous avons travaillé avec les sélectionneurs pour étudier la variabilité des réactions par rapport à l’homme. C’est un facteur essentiel. La sélection des meilleurs taureaux a, il faut le souligner, un impact extraordinaire : les animaux envoyés en centre d’insémination artificielle ont tellement de petits que les conséquences de ce type de sélection sont extrêmement fortes.
Nous avons également essayé de travailler sur l’importance du mode d’élevage, des contacts entre l’homme et l’animal. Deux semaines de contact gentil dans les semaines suivant la naissance suffisent à atténuer la violence des réactions des animaux lorsqu’ils sont manipulés des années plus tard.
M. Jacques Lamblin. C’est l’effet de l’imprégnation…
M. Pierre Le Neindre. Tout à fait. Les éleveurs en ont pris conscience au cours des dernières années.
S’agissant de la perte de conscience, il faut d’abord noter que le terme de conscience revêt des significations assez variées : ce peut être le simple éveil, la perception du monde, ou la conscience des autres, ou encore la conscience de soi-même… Ici, nous parlons de la seule conscience d’éveil.
Mme Claudia Terlouw. Très grossièrement, on peut distinguer deux aspects de la conscience : il y a un premier niveau de conscience, celui de l’éveil, du niveau de vigilance ; il y a un autre niveau, avec un contenu. Sans éveil, il n’y a pas de contenu.
En étourdissant l’animal, on veut abolir soit le contenu, soit l’éveil – ce qui abolit aussi le contenu. L’idée est que le cerveau d’un animal inconscient est incapable d’intégrer les informations de l’environnement : il ne pourra donc pas percevoir le stress, la peur, la douleur.
Différentes techniques ont donc été développées. L’utilisation du pistolet vise à supprimer l’éveil, et par conséquent tout contenu de la conscience. Il brise la formation réticulée qui se trouve à la base du cerveau, et qui, avec le thalamus, est une des structures impliquée dans l’éveil. Le but est de l’endommager suffisamment pour qu’elle ne fonctionne plus. Quant à l’électronarcose, elle consiste à faire passer à travers le cerveau un courant suffisant pour dépolariser l’ensemble des neurones : c’est tout le cerveau qui cesse de fonctionner. On supprime l’éveil et le contenu de la conscience.
Pour savoir si ce travail a été bien fait, il existe différents indicateurs. Tous ont leur intérêt et leurs limites.
Le plus connu, facilement observable, c’est la perte de posture : l’animal ne tient plus debout et il tombe. Il faut que ce soit immédiat, sauf dans le cas de l’étourdissement progressif qu’est le gazage.
La perte de réflexe cornéen est un second indicateur. Il est stimulé lorsqu’on effleure la cornée : une information part vers le cerveau, produit une connexion au niveau de la base du cerveau et actionne un nerf moteur qui ferme la paupière. C’est un circuit court, qui passe à travers la formation réticulée, responsable, je l’ai dit, de l’éveil de l’animal : si ce circuit ne fonctionne plus, il est extrêmement probable que la formation réticulée ne fonctionne plus non plus et que l’animal est correctement étourdi. En revanche, le fait que l’animal présente un réflexe cornéen ne signifie pas nécessairement qu’il soit conscient : c’est donc un indicateur que je qualifierai de « conservateur ».
La respiration est un troisième indicateur. Les centres de contrôle de la respiration sont encore plus bas dans la base du cerveau : c’est une fonction que l’on perd la plupart du temps plus tardivement. S’il n’y a plus de respiration, on peut donc également penser que les structures de la base du cerveau sont suffisamment atteintes pour qu’il n’y ait plus d’éveil.
Chacun de ces indicateurs présente des limites.
S’agissant de la perte de posture, il faut ainsi s’assurer que l’animal n’a pas été simplement paralysé : le pistolet, lorsqu’il est mal utilisé, peut sectionner la moelle épinière ; l’animal est alors paralysé, mais conscient.
Le réflexe cornéen n’est pas toujours observable : ainsi, après l’électronarcose, l’animal est en phase tonique ; tous ses muscles sont tendus, y compris ceux des yeux. Il est également possible, dans le cas d’un abattage sans étourdissement, qu’il y ait du sang dans les yeux et que le réflexe cornéen soit difficile à déclencher.
Enfin, l’absence ou la présence de la respiration n’est pas toujours facile à constater. C’est une fonction vitale, et le corps se défend bien. On voit souvent quelque chose qui ressemble à une respiration : l’évaluation n’est pas facile. Par ailleurs, il arrive que l’on ne puisse pas voir l’animal : dans l’abattage sans étourdissement, il est enfermé dans le piège, et il peut être difficile de vérifier s’il respire.
Du fait même de ces limites, il est important d’associer les différents indicateurs.
M. le président Olivier Falorni. Qu’en est-il de l’étourdissement réversible ? De quoi s’agit-il précisément ?
M. Pierre Le Neindre. Cette technique est utilisée dans le cadre de l’abattage religieux. Le rapport de 2009 que j’évoquais dressait une liste de solutions adoptées dans différents pays. Certaines choses ont pu changer depuis, mais on peut en tout cas constater que certains groupes religieux, dans certains pays, acceptent un étourdissement, selon différentes modalités. Cet étourdissement est plus ou moins réversible : si on laisse l’animal sans le saigner, il revient à la vie. Nous avions été surpris d’apprendre qu’en Nouvelle-Zélande, il y a systématiquement un étourdissement réversible avant la saignée, et qu’une grande partie de ces animaux sont vendus au Moyen-Orient. En fait, les règles adoptées sont le fruit de négociations sociales.
Mme Claudia Terlouw. Le « matador », le pistolet, provoque dans le cerveau des dommages tels que l’étourdissement est irréversible. En revanche, certaines techniques d’électronarcose permettent une réversibilité de l’étourdissement : c’est par exemple le cas de l’électronarcose à deux points, où le courant passe seulement au travers du cerveau. Les neurones ne fonctionnent plus jusqu’à ce qu’ils soient de nouveau polarisés, ce qui prend un certain temps. Il existe d’autres techniques d’électronarcose, à trois points, où le courant passe également à travers le cœur : la fibrillation provoquée entraîne le plus souvent un arrêt cardiaque. Dans ce second cas, on considère donc que l’étourdissement est irréversible.
Il faut souligner que, le cœur battant mal, l’étourdissement est prolongé, ce qui nous amène aux questions que vous avez posées sur le délai dont on dispose entre l’étourdissement et la saignée. C’est en effet un point majeur.
Tout dépend de l’espèce de l’animal et des techniques utilisées tant pour l’étourdissement que pour la saignée. L’animal ne doit pas se réveiller.
Ainsi, un porc met en moyenne 14 à 23 secondes pour mourir après la saignée ; il faut se fonder sur la durée la plus longue. Or après une électronarcose, la respiration reprend après 38 secondes. On peut donc estimer que le délai doit être de 15 secondes entre l’étourdissement et la saignée. Je précise que cet exemple se fonde sur une étude seulement, avec un seul opérateur.
Si l’on utilise un étourdissement irréversible, le raisonnement change.
Précisons que le gazage peut être réversible. Mais ce qui est difficile, c’est d’assurer une réversibilité sur 100 % des animaux, ce qui est nécessaire pour un abattage rituel.
M. Pierre Frotin. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais seulement apporter quelques précisions et faire le lien avec le guide de bonnes pratiques sur la protection animale, utilisé par l’ensemble des opérateurs.
En ce qui concerne la vérification de la perte de conscience, on raisonne aujourd’hui à deux niveaux. Tout d’abord, on fournit aux opérateurs quelques signes faciles, visuels, qui permettent de réagir : perte de posture, absence de vocalisation, certains mouvements… Les guides proposent de combiner l’observation de plusieurs signes, un signe isolé n’étant pas forcément assez robuste. Ensuite, il y a le niveau du responsable de la protection animale – le règlement européen impose certaines exigences, dont une démarche de contrôle interne. Dans ce cas, on proposera des signes qui demandent une manipulation de l’animal : réflexe cornéen, tests de nociception, de sensibilité… Ces signes supplémentaires demandent plus de temps.
S’agissant de la réversibilité, les opérateurs raisonnent étape par étape. On estime que l’effet de l’électronarcose dure 35 à 40 secondes, et le chiffre de 18 à 23 secondes est en effet retenu pour la durée nécessaire pour que l’animal meure. Les opérateurs ont en tête ce délai de 10 à 15 secondes. Mais il faut souligner que tous les abattoirs ne sont pas forcément conçus pour tenir de tels délais.
S’agissant enfin du CO2 et de la réversibilité, les délais sont fonction du temps d’immersion de l’animal dans le gaz, sous réserve que la proportion de gaz dans la cuve soit suffisante. Réglementairement, il faut 80 % de CO2 ; dans la réalité, c’est plutôt 90 % dans le fond de la cuve. Le temps d’immersion moyen tourne autour de 120 secondes : quand l’animal ressort, l’étourdissement n’est en principe pas réversible. Malheureusement, les effets de gaz sont assez aléatoires. Le rapport EFSA (European Food Safety Authority, Autorité européenne de sécurité des aliments) de 2004 indique donc un délai entre l’étourdissement et la saignée de 30 secondes – valable seulement pour les porcs, s’entend.
M. Luc Mirabito. Il faut bien garder en tête que les signes de perte de conscience sont très liés à la méthode utilisée, les conditions d’observation étant très différentes selon que l’on utilise un pistolet à tige perforante pour les bovins ou l’électronarcose, telle qu’elle est pratiquée sur les ovins ou les porcins. Dans le cas de l’électronarcose en effet, l’observation des signes de perte de conscience ne doit pas empêcher de pratiquer la saignée au plus vite, pour éviter que l’animal ne se réveille avant d’être mort, tandis que chez les bovins, le dispositif utilisé est théoriquement irréversible s’il est bien pratiqué.
Pour détecter ces signes, les opérateurs s’appuient sur une série d’indicateurs, sachant que la plupart des abattoirs suivent la ligne que nous défendons depuis plusieurs années, à savoir que le doute profite à l’animal. Au moindre signe d’une potentielle reprise de conscience, l’opérateur doit immédiatement réagir. Nous développons en outre des systèmes d’assistance automatisés qui marquent un véritable progrès et sécurisent les opérateurs dans leur travail. Reste que leur capacité de détection est pour l’essentiel liée à leur motivation et à la qualité de leurs conditions de travail. Il peut arriver que l’observation de l’animal mette en danger l’opérateur ou que l’équipement empêche à certains moments de voir l’animal et donc de l’observer. En cas de dysfonctionnement, ce sont donc la conception des lieux, la fatigue ou la routine qui peuvent être mises en cause plutôt que les compétences des opérateurs, d’autant que, depuis plusieurs années, l’accent est largement mis sur les connaissances qu’ils doivent maîtriser.
En ce qui concerne la réversibilité, à côté de l’électronarcose, il existe également un procédé d’étourdissement mécanique non létal, pratiqué à l’aide d’une tige ou d’une masse percutante. Certaines communautés musulmanes les tolèrent – par exemple en Malaisie –, à condition que les lésions sur la tête de l’animal soient limitées, ce qui implique de trouver le bon équilibre entre efficacité et absence de lésions.
M. le président Olivier Falorni. Qu’en est-il de la technique du soulagement ?
M. Luc Mirabito. Il s’agit d’une technique pratiquée par quelques abattoirs, qui d’ailleurs ne s’en cachent pas. Elle a fait l’objet d’un gros travail de Troy Gibson, un collègue néozélandais qui, dans sa thèse, a évalué la nociception de la douleur dans le cadre de l’abattage sans étourdissement. Mais il a montré par la même occasion qu’un étourdissement pratiqué dans les secondes suivant la saignée était efficace car il abolissait les réactions électrophysiologiques. C’est la raison pour laquelle c’est une des pratiques envisagées dans le Guide de bonnes pratiques pour la protection animale des bovins à l’abattoir.
M. le rapporteur. On a évoqué l’étourdissement réversible chez les ovins, mais peut-on pratiquer l’électronarcose sur des bovins avec le même effet de réversibilité ?
Mme Claudia Terlouw. Oui. Il existe des systèmes d’électronarcose pour les bovins, utilisés en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. Mais il faut savoir que chaque système a ses inconvénients. En l’occurrence, l’électronarcose provoque des réactions tonico-cloniques qui rendent un gros bovin, même étourdi, très dangereux. Pour limiter ces mouvements, on a donc recours à l’électro-immobilisation qui consiste à faire passer un courant faible à travers la moelle épinière : l’animal ne bouge plus, mais on ne peut plus observer s’il est correctement étourdi.
J’en profite pour revenir en un mot sur la question de la compétence des opérateurs : il ne faut pas hésiter à faire confiance à leur professionnalisme. Ils ont l’œil et captent des signes que nous-mêmes ne percevons pas. Ils savent intervenir quand il le faut.
M. Luc Mirabito. Je précise pour ma part que l’étourdissement mécanique à la masse ne figure pas dans la liste des méthodes autorisées figurant à l’annexe I du règlement européen sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
En ce qui concerne l’utilisation de l’électronarcose réversible chez les bovins, non seulement elle nécessite une électro-immobilisation mais se pose également le problème de la faible durée de l’insensibilisation induite par l’électronarcose chez les bovins. Les Néo-Zélandais, qui ont beaucoup travaillé la question, soulignent que la saignée doit être effectuée quasi immédiatement après l’électronarcose et qu’il faut parfois pratiquer une double saignée.
Il n’y a donc pas de solutions simples acceptées par tous, sinon nous les aurions adoptées depuis longtemps. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Selon les zones géographiques et les cultes, les interprétations de ce qui est autorisé ou non divergent. Nous sommes là au-delà des réponses que peuvent apporter les scientifiques ; c’est surtout aux musulmans et aux juifs qu’il faut poser la question de la réversibilité et de l’acceptabilité.
M. Pierre Le Neindre. Pour ce qui concerne l’intensité de la souffrance, il ne me semble pas qu’elle puisse se mesurer. C’est la raison pour laquelle on s’est toujours concentrés sur la durée d’inconscience.
Mme Claudia Terlouw. Il est en effet impossible de mesurer la souffrance. Lorsque l’on parle d’une souffrance intense sur une durée courte, de quelle intensité et de combien de secondes parle-t-on ? Par ailleurs, non seulement la perception de la souffrance varie selon les individus mais l’on a également tendance à mal juger comment l’autre perçoit la souffrance. Un chercheur israélien, victime d’une attaque à la bombe, s’était retrouvé brûlé sur 60 % du corps. Tandis que les infirmières avaient décrété que l’arrachage de ses bandages devait être fait le plus rapidement possible pour abréger la douleur, lui aurait préféré un arrachage plus lent, c’est-à-dire souffrir plus longtemps mais moins intensément. Il n’a pas su les convaincre… Il est difficile de juger pour l’autre, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un humain qui doit évaluer la souffrance d’un animal.
M. le rapporteur. Ma question n’avait pas uniquement une portée physiologique ou philosophique : il s’agissait surtout de savoir si, lorsqu’il faut faire un choix technique en fonction de différentes contraintes, un arbitrage était possible entre durée et intensité de la douleur. Il semble que non. Autrement dit, il faut que cela dure le moins longtemps possible.
Mme Claudia Terlouw. En effet.
M. Pierre Frotin. Vous nous avez également interrogés sur le recours au CO2. Cette technique, adaptée au caractère grégaire des bêtes, était à l’origine utilisée en amont de l’étourdissement : il permettait de les amener en groupe. Il était pratiqué dans les pays du Nord, au Danemark ou en Angleterre, et pendant longtemps on ne s’est guère intéressé à ce qui se passait dans la cuve.
Aujourd’hui, en France, seuls six abattoirs étourdissent les animaux au CO2. Cela ne concerne que 15 à 18 % du nombre de porcs abattus. C’est un chiffre très faible en comparaison d’autres pays européens comme l’Espagne et l’Allemagne, où 85 % des abattoirs utilisent le CO2, ou encore le Royaume-Uni et le Danemark, où cette proportion monte à 90 %.
Quant à savoir si c’est une technique recommandable, elle comporte comme toutes les autres des avantages et des inconvénients. Ne nous le cachons pas, le CO2 est un gaz aversif qui, pendant les 15 à 20 secondes que dure l’inhalation, plonge l’animal dans une grande souffrance jusqu’à la phase d’induction, où il bascule dans l’inconscience. Plus la proportion de gaz sera importante dès la première strate, plus la durée d’inhalation, et donc de souffrance, sera faible. Cela étant, si les paramètres – proportion de gaz et durée d’immersion – sont respectés, l’animal est correctement, indiscutablement étourdi, dans des conditions visuellement moins traumatisantes que l’électronarcose. L’impact sur le tissu musculaire aboutit également une qualité de viande plus homogène : les raisons qui plaident pour l’utilisation de cet outil peuvent donc aussi être d’ordre commercial.
J’ajoute que la Direction générale de l’alimentation (DGAL) et le Bureau de la protection animale vont financer dans les deux prochaines années un état des lieux et une étude des six abattoirs français qui ont recours à la technique d’étourdissement par CO2, afin de voir ce qui peut être amélioré, notamment dans le choix du gaz utilisé, qui pourrait être moins aversif.
Mme Claudia Terlouw. Je pense comme Pierre Frotin que plus la concentration en CO2 est élevée mieux c’est : avec une concentration à 70 %, la durée d’induction d’inconscience est beaucoup plus longue alors que l’expression comportementale laissant penser que l’animal souffre est quasiment au même niveau qu’avec une concentration plus forte. Autrement dit, la souffrance est là même, mais pendant un temps plus long.
M. Pierre Le Neindre. Pour ce qui concerne la fluidité des échanges entre le monde de la recherche et le monde professionnel, le débat ne date pas d’hier. Depuis une quarantaine d’années, j’ai pour ma part constaté que les synergies entre la recherche, les instituts de développement et les différentes instances professionnelles avaient considérablement progressé.
M. Luc Mirabito. La question du continuum entre la recherche et le terrain n’est pas propre à l’abattage ni même à l’agriculture ; elle concerne structurellement l’ensemble des activités. Dans le cadre de cette commission, il me paraît important néanmoins de souligner trois points.
Le premier concerne la formation, que l’on a fait l’effort de formaliser, la France ayant choisi de renouveler cette formation tous les cinq ans pour les personnels.
Il faut ensuite insister sur les guides de bonnes pratiques qui ont été réalisés par les chercheurs et les acteurs de terrain. Le guide sur les bovins a été officiellement validé, mais il en existe pour toutes les espèces. Cela a véritablement contribué à faire évoluer le fonctionnement des abattoirs, où l’on s’est efforcé de formaliser et d’optimiser les méthodes de travail, en particulier dans l’optique d’améliorer la protection animale.
La mise en place de responsables de la protection animale (RPA) dans chaque abattoir s’inscrit dans la même optique. C’est un métier qui reste à inventer, et cela se fera à travers des actions dédiées et la mise en place de réseaux professionnels. Le règlement européen faisait référence au bien-être animal ; nous avons préféré le terme de protection animale, et c’est cette notion qui a guidé la conception des formations, axées autour de la mise en œuvre concrète sur site de modes opératoires inspirés des bonnes pratiques. Le RPA aura la charge de ces modes opératoires, de leur contrôle, mais il sera aussi un référent par qui transitera l’information. Il aura donc un véritable rôle dans l’approfondissement du continuum entre la recherche et ses applications sur le terrain.
Mme Claudia Terlouw. L’INRA est également investi dans ce continuum. Nous collaborons avec les instituts ; je participe moi-même directement à la formation de vétérinaires ou de techniciens vétérinaires qui travaillent dans les abattoirs.
M. Pierre Le Neindre. Le métier de RPA est en effet à construire, ce qui peut être délicat car ils peuvent avoir un rôle de lanceur d’alerte qui ne sera pas forcément évident à gérer.
M. Jacques Lamblin. On a compris que l’abattage sans étourdissement entraînait de la douleur pour l’animal pendant un certain temps. Pour contourner cette difficulté dans le cas de l’abattage rituel, il a été proposé de recourir soit à un étourdissement réversible, selon des méthodes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, soit à un étourdissement dit post-cut, post-abattage. Ou alors, on laisse les choses en l’état, et on a la certitude que les animaux souffrent. Comment sortir de ce dilemme ? D’après vous, quel est donc le meilleur choix pour préserver au maximum de la souffrance les animaux voués à l’abattage rituel ? Des chercheurs israéliens travaillent, paraît-il, sur la question : savez-vous où ils en sont de leurs travaux ?
Mme Françoise Dubois. La formation du personnel est à mes yeux primordiale. Vous dites intervenir, madame Terlouw, auprès des vétérinaires. Certes, mais ce ne sont pas eux qui portent le coup de grâce. Quel est leur rôle auprès des salariés qui, eux, portent ce coup fatal ?
Ces salariés sont-ils parfaitement informés sur les différentes techniques ? Reçoivent-ils une formation scientifique ? Compte tenu du débit important de certains abattoirs, prennent-ils véritablement le temps de vérifier tous les signes d’inconscience avant d’achever l’animal ?
Ne faudrait-il pas par ailleurs que ce personnel bénéficie d’un accompagnement et au besoin d’un soutien psychologique ?
M. Pierre Frotin. En matière de protection animale, la formation dispensée aujourd’hui aux opérateurs consiste essentiellement à leur faire prendre conscience du sens et de la portée des gestes qu’ils accomplissent, qu’il s’agisse des personnels qui conduisent les animaux vers la zone d’étourdissement, de ceux qui les saignent ou de ceux qui les observent. Tous reçoivent la formation obligatoire et réglementaire composée d’une journée par espèce principale et d’une demi-journée par espèce complémentaire, dans le cas des abattoirs multi-espèces. Lors de cette formation, sont abordés la réglementation, le comportement animal et les éléments de physiologie – à des stades opérationnels, s’entend –, dont la connaissance est indispensable pour chaque poste de travail.
Mme Françoise Dubois. Tout cela en une seule journée ?
M. Pierre Frotin. Ce qu’il faut comprendre, c’est que si un opérateur occupe un poste de travail, c’est parce que l’entreprise a jugé qu’il en avait les capacités techniques. Ce que nous lui enseignons, c’est à comprendre et à gérer les réactions des animaux, par exemple la manière de gérer un porc récalcitrant dans un troupeau de vingt-cinq porcs qu’il faut amener dans un entonnoir… On aura d’instinct tendance à pousser le vingt-cinquième, même si c’est en fait le premier qui bloque. Il faut mettre l’opérateur en situation de comprendre le problème en l’aidant à prendre du champ par rapport au contexte opérationnel, grâce à des vidéos, des arrêts sur image, où il se rendra compte de son erreur. Il comprendra qu’on va finalement plus vite en amenant les animaux dix par dix plutôt que par paquet de vingt-cinq. Alors que dans une formation pratique, sur quatre ou cinq personnes, une seule est en train de manipuler, les autres regardent, et progressivement regardent ailleurs… L’objectif de ces journées de formation doit être remis dans son contexte : l’objectif est de leur faire prendre conscience d’eux-mêmes. Il me semble qu’elles ont réellement amélioré la prise de conscience des opérateurs par rapport à leur métier.
M. Luc Mirabito. La formation a été mise en place sous l’égide de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) et de la DGAL, au terme de trois ans de discussions et d’élaboration. L’objectif, dans cette première phase qui s’adressait à une population déjà en activité, était la délivrance du certificat de compétences pour la protection des animaux (CCPA) imposé par le règlement de 2009 et axé sur les messages-clés de la protection animale dans les abattoirs. Le dispositif fonctionne, ce qui mérite d’être souligné : nous avons réussi en moins de deux ans à former plusieurs milliers d’opérateurs et à élaborer un système d’évaluation qui a fait ses preuves. Les instructions n’étaient en aucun cas d’élaborer une énième formation pratique.
L’Institut de l’élevage organise des sessions de formation pratique sur la manipulation des bovins, par exemple, sur la manipulation des bovins dans les élevages, et dans le contexte de l’abattoir depuis les années quatre-vingt-dix. D’autres organismes dispensent des formations spécifiques à l’affûtage des couteaux, et les fabricants de matériel d’étourdissement eux-mêmes sont censés apporter une formation spécifique aux équipements qu’ils fournissent.
Nous poursuivons nos travaux sur la didactique et la pédagogie à développer, et réfléchissons à des démarches nouvelles comme la formation en réalité virtuelle, déjà pratiquée dans beaucoup de domaines industriels, et qui présentent un intérêt certain en termes de risques ou de coûts. Ces pistes de recherche sont développées dans l’optique de la nouvelle session de formation qui se profilera dans trois ans et, à terme, dans la perspective plus large de la formation tout au long de la vie.
Si je considère le CCPA comme une grande réussite, son contenu didactique, pédagogique et opérationnel a été conçu à un instant donné pour des besoins donnés. Mais son contenu n’est pas voué à rester figé, étant entendu, d’une part, que des évolutions scientifiques et technologiques vont nous obliger à évoluer et, d’autre part, que cette formation initiale s’adressait à une population déjà en activité. Mais j’espère bien que dans deux ans, on pourra par exemple envisager d’élargir la formation à l’échantillonnage et aux plans de contrôle, ou encore aux anti-recul dans les bouveries – autant de techniques dont le grand public ne sait rien, mais qui présentent une grande importance sur le plan de la manipulation des animaux comme de la prévention des risques. Quoi qu’il en soit, nous misons beaucoup sur les nouvelles techniques pédagogiques pour aborder des questions qui, éthiquement, sont complexes. Mais si nous formons des opérateurs qui se ratent sur un bovin sur deux, cela ne me convient pas tellement sur le plan éthique… D’où l’idée de travailler sur l’utilisation de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, dont se servent déjà les médecins et les vétérinaires pour s’entraîner avant leurs premières opérations.
M. Pierre Le Neindre. La question de l’échantillonnage – quel est le nombre d’animaux sur lequel il faut mesurer l’inconscience ? – est d’autant plus importante que le flux de ces animaux est dense, comme c’est le cas dans les abattoirs de volailles. C’est pourquoi l’ANSES s’est emparée du dossier.
Par ailleurs, Mme Françoise Dubois a raison d’évoquer la situation anxiogène dans laquelle se trouvent les abatteurs. Certains inspecteurs vétérinaires parlent même de situations de souffrance psychologique. Cela doit être dit, et il est indispensable d’envisager des mesures d’accompagnement de ces personnels.
Mme Claudia Terlouw. La formation des vétérinaires à laquelle je participe dure une semaine. Ils ont un rôle clé dans l’abattoir : même si ce ne sont pas eux qui achèvent les bêtes, ce sont eux qui ont le dernier mot en matière de bien-être animal. Ils assurent par ailleurs le contrôle sanitaire, et doivent donc se partager entre ces deux missions, ce qui n’est pas toujours facile.
Je pense, cela étant, que tous les opérateurs n’ont pas besoin de soutien psychologique. Si on a constaté des dysfonctionnements parmi le personnel dans les abattoirs qui se sont fait récemment remarquer, c’est moins parce que le responsable ne leur a pas dit ce qu’il fallait faire que parce qu’il ne parvient pas à imposer les règles dictées par la loi et décrites dans les guides de bonnes pratiques. Il s’agit donc d’un problème dans le fonctionnement des équipes et dans l’organisation, qui tient à la définition de la responsabilité de chacun. Dans un abattoir, les salariés sont souvent polyvalents, mais cela ne doit pas empêcher que les responsabilités des uns et des autres soient clairement identifiées. Il est impossible de faire fonctionner correctement un système dans lequel personne n’est responsable de rien. Il y a dans ce domaine de grands progrès à faire.
M. Jacques Lamblin. Vous n’avez pas répondu à ma question concernant la moins mauvaise des méthodes à retenir si l’on veut préserver l’abattage rituel en France : doit-on opter pour l’étourdissement réversible ou l’abattage post-cut ? Ce n’est pas une question simple…
Mme Claudia Terlouw. La réponse ne le sera pas non plus… Si elles sont correctement pratiquées, les deux méthodes sont acceptables. La question est de savoir comment s’assurer que les gestes sont toujours convenablement réalisés.
M. Jacques Lamblin. Ce que vous dites vaut-il également pour l’électronarcose chez les bovins ?
Mme Claudia Terlouw. C’est possible, même si ce n’est pas simple, et il faut pratiquer dans ce cas une électronarcose à trois points. Le troisième point dans ce cas ne fait pas fibriller le coeur, mais dépolarise les neurones de la moelle épinière pour limiter les mouvements de l'animal. Ou alors, il faut trouver une solution pour libérer l’animal très rapidement et pratiquer la saignée dans la foulée. Techniquement, nous n’en avons pas encore les capacités, mais si la France y met les moyens, nous trouverons la solution. C’est une question de priorité…
Ce cas mis à part, l’étourdissement réversible pose un autre problème : pour qu’une viande soit certifiée halal, il faut avoir la certitude qu’aucun animal n’est mort au cours de la procédure. Or certaines bêtes peuvent faire une crise cardiaque lors de l’étourdissement, sans nécessairement qu’il y ait un rapport de cause à effet. En cas de doute, les opérateurs ont donc tendance à ajuster les paramètres, au point que, parfois, l’étourdissement n’étourdit plus. L’opération doit donc être accompagnée d’un bout à l’autre et en permanence.
Quant à l’étourdissement post-jugulation, il est moins confortable pour l’animal car, au-delà de la douleur, il faut également tenir compte de la peur que ressent l’animal. L’animal qui vient d’être saigné se trouve dans une situation d’extrême urgence dont il a parfaitement conscience. Il faut donc pouvoir l’étourdir très rapidement. Des études ont montré que, si on saigne le bovin debout, il sera plus facile de l’étourdir rapidement dans la foulée ; le problème et que pratiquer une saignée sur un animal debout est plus difficile, et les réactions d’aversion sont plus marquées. Il est également possible de faire effectuer à la bête une rotation à 90 degrés ou à 180 degrés. Lorsque l’animal est sur le flanc, l’étourdissement est rapide, mais la saignée est plus difficile ; c’est lorsque l’animal est sur le dos que la saignée est la plus simple et il est possible de l’étourdir dans les secondes qui suivent mais, là encore, il faut s’en donner les moyens matériels. Je connais un abattoir qui pratique de la sorte.
M. le président Olivier Falorni. Lequel ?
Mme Claudia Terlouw. Lorsque je travaille avec des abattoirs, je certifie toujours que leur anonymat sera respecté, même si, dans ce cas précis, je ne doute pas que les responsables seraient prêts à communiquer sur le sujet. Mais ce n’est pas mon rôle.
Pour en revenir à l’étourdissement, les pièges sont actuellement conçus avec une plaque au-dessus de la tête pour bien contenir l’animal. Or cette plaque gêne le positionnement du pistolet. Mais c’est un obstacle assez facile à surmonter : il suffirait de remplacer la plaque par une boucle.
M. Jacques Lamblin. Si j’ai bien compris, il est donc plus facile de saigner un bovin positionné sur le flanc, et l’étourdissement reste assez simple hormis le problème de la plaque.
Mme Claudia Terlouw. Il n’y a pas de solution miracle, mais il me semble que l’étude montrait qu’il s’agissait de la position dans laquelle les réactions d’aversion de l’animal et son débattement étaient les plus atténués.
M. Jacques Lamblin. Il me semble qu’entre la peur et la douleur, le plus important est d’éviter la douleur.
Mme Claudia Terlouw. Tout dépend du degré de peur. La douleur est effectivement la stimulation qu’il est le plus difficile d’ignorer. Si l’on est évidemment obligé d’en tenir compte, on sait que certaines situations peuvent atténuer la perception de cette douleur. C’est le cas en particulier des situations d’extrême urgence où l’individu est en danger de mort. Ce sont des situations où la peur est émotionnellement si prégnante qu’elle en arrive à surpasser la douleur : lorsqu’on est en danger de mort, peu importe qu’on vienne de perdre une jambe, l’important est de s’enfuir. Dans le cas de l’abattage sans étourdissement, il faut donc prendre en compte ces deux facteurs.
M. Luc Mirabito. Claudia Terlouw a raison de souligner qu’il s’agit d’une question tout à la fois très simple et extraordinairement complexe, dont nous n’avons qu’une partie de la réponse.
Pour l’étourdissement post-saignée, il faut en effet trouver le juste équilibre entre le confort de l’animal et la simplification des gestes pour l’opérateur, mais on sait, dans certains abattoirs, pratiquer l’étourdissement dans les secondes qui suivent la saignée.
Reste la question de la méthode d’étourdissement. Pour les bovins, il existe des solutions plus acceptables, sachant que ces procédures potentiellement traumatisantes ne sont pas prévues dans le règlement européen.
En ce qui concerne l’étourdissement préalable, notamment dans l’abattage rituel, ce qui est autorisé peut varier d’une communauté à l’autre. Quelques abattoirs néo-zélandais utilisent l’électronarcose pour l’abattage rituel, mais la technique rencontre des limites techniques, liées à sa maîtrise ou à son coût, même si, à ma connaissance, certains abattoirs en France l’ont essayée.
Quant à l’étourdissement mécanique, tel qu’il est pratiqué en Malaisie, tout est question d’équilibre entre l’efficacité de l’étourdissement et l’absence de lésions. Mais, là encore, le matériel nécessaire n’est pas prévu dans la réglementation européenne et, par ailleurs, c’est une technique qui pose, elle aussi, la question de son acceptabilité par les cultes.
Quelle que soit la méthode envisagée, les enjeux ne sont plus uniquement scientifiques, puisqu’il est acquis que, si l’étourdissement est bien pratiqué, il limite la douleur ; c’est ce qu’il fait qu’il est obligatoire depuis plus de cinquante ans.
Reste la question de l’étourdissement réversible. Tout dépend ici de la manière dont on appréhende cette question de la réversibilité. Par ailleurs, on ne pourra jamais éviter les risques létaux sur une fraction des animaux : nous ne sommes pas dans la manipulation de boulons mais dans de la biologie…
En ce qui concerne l’étourdissement post-saignée, il faut parvenir à une maîtrise optimale du procédé, éventuellement grâce à une contention des animaux à l’envers – certains abattoirs maîtrisent cette technique et sont capables de pratiquer l’étourdissement dans les cinq à dix secondes suivant la saignée, le temps que l’animal soit remis en position.
Mais cela reste une question d’acceptabilité, et, au final, un choix politique dans lequel vous, parlementaires, avez votre mot à dire : on a coutume de dire en formation que la réglementation est la synthèse entre les attentes éthiques et sociétales et les connaissances scientifiques… C’est à vous qu’il revient de faire la synthèse !
M. le rapporteur. Je suis frappé de la divergence entre l’image que les personnels ont de leur métier et celle que s’en fait le grand public. Or, en la matière, il y a des cercles vertueux et des cercles vicieux. Si on porte sur votre travail un regard négatif, vous vous sentez dévalorisé, jusqu’à revendiquer cette dévalorisation pour finir par se l’approprier. Comme le dit l’un des personnages dans Les Voleurs de Louis Malle : « Je fais un sale métier, mais j’ai une excuse, je le fais salement. » C’est le cercle vicieux. À l’inverse, si vous êtes bien équipé, appelé à manipuler un matériel d’une grande technicité, et correctement payé, les autres vous perçoivent comme un maillon clé de la chaîne ; du coup, l’estime que vous portez à vous-même comme à l’ensemble du groupe est plus grande. La formation doit également amener aux opérateurs à porter un autre regard sur leur travail.
Mme Claudia Terlouw. Les personnes qui travaillent dans les abattoirs ne se sentent pas considérées et ont du mal à considérer l’autre, et à plus forte raison les animaux avec lesquels ils travaillent.
M. Pierre Frotin. Les formations débutent généralement par un échange sur la manière dont les opérateurs conçoivent leur métier, qui confirme ce qui vient d’être dit. Cela étant, depuis que la protection animale s’est traduite par de nouvelles règles opérationnelles, de nombreux abattoirs ont renouvelé leurs effectifs et embauché, pour travailler dans les bouveries et les porcheries, des gens spécialisés dans le domaine animalier et motivés. Cela se traduit par une montée du niveau de ces personnels qui, il y a quinze ans, étaient considérés comme la dernière roue du carrosse. Aujourd’hui, les clients qui viennent visiter les abattoirs s’attardent longtemps dans les lieux de vie de l’animal, considérant que les étapes postérieures de la chaîne sont maîtrisées. Les salariés qui y travaillent sont donc plus compétents et mieux reconnus.
M. le président Olivier Falorni. Madame, messieurs, il me reste à vous remercier pour cette audition très intéressante.
La séance est levée à douze heures cinquante-cinq.
——fpfp——
10. Audition, ouverte à la presse, de M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
(Séance du mercredi 18 mai 2016)
La séance est ouverte à seize heures quarante.
M. le président Olivier Falorni. Mes chers collègues, nous auditionnons aujourd’hui M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Depuis maintenant quatre semaines, notre commission d’enquête a organisé un nombre important d’auditions, tout aussi passionnantes et enrichissantes les unes que les autres. Différents acteurs ont été entendus, dont le Directeur général de l’alimentation M. Patrick Dehaumont, présent aux côtés du ministre et que je salue, les représentants de la protection animale, de la filière viande, des syndicats d’abattoirs, et les experts qui se sont penchés sur la question.
Votre présence, monsieur le ministre, est un moment important, d’autant que vous allez, je l’espère, nous faire part en avant-première des éléments du rapport que vous avez diligenté immédiatement après les scandales révélés par les vidéos de l’association L214 tournées dans l’abattoir municipal d’Alès, l’abattoir intercommunal du Vigan et l’abattoir intercommunal du Pays de Soûle, et qui ont été à l’origine de la création de cette commission d’enquête.
Dès le mois de novembre 2015, vous avez vous-même réagi en transmettant aux préfets des instructions afin de s’assurer de la prévention de tout acte de maltraitance envers les animaux et de responsabiliser les opérateurs en matière de sécurité sanitaire et de protection animale.
Ces vidéos ont été diffusées respectivement en octobre 2015, février 2016, et mars 2016. Après la diffusion de la troisième vidéo – celle de Mauléon –, vous avez jugé nécessaire, dans un courrier en date du 30 mars, d’ordonner aux préfets de réaliser immédiatement, et ce dans un délai d’un mois, des inspections spécifiques sur la protection animale dans l’ensemble des abattoirs de boucherie du territoire national. Vous y indiquez notamment : « Les suites administratives et judiciaires adaptées devraient être impérativement données, notamment la suspension de l’agrément des exploitants le cas échéant, dès constatation de manquement dans le domaine de la protection animale ». Les préfets avaient jusqu’au 13 mai pour vous faire part des résultats de ces inspections ; vous venez aujourd’hui devant nous, monsieur le ministre, et je vous en remercie ainsi que mes collègues, pour nous présenter la synthèse de ces inspections.
Cette audition sera également l’occasion pour vous de revenir sur le plan d’action national en faveur du bien-être animal qui a été présenté lors de la réunion du 5 avril du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) et dont certaines mesures concernent directement les abattoirs : la systématisation du référent protection animale (RPA) au sein de tous les abattoirs, la création d’un délit de maltraitance qui concernerait également le responsable de l’abattoir, et la création, d’ici à la fin de l’année, d’un comité de recherche sur le bien-être animal.
Je vous rappelle, monsieur le ministre, que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Stéphane Le Foll prête serment.)
M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Depuis que je suis ministre de l’agriculture, le bien-être animal est pour moi une priorité, en même temps que je dois faire face – et vous en êtes tous comptables – à des crises, des enjeux d’emploi, des enjeux économiques, des enjeux de compétitivité, et à des enjeux plus globaux liés à l’agriculture et à l’activité dans tous les territoires de la métropole.
Pour avoir été parlementaire européen, je sais que les règles qui régissent le bien-être animal au niveau européen sont sûrement – et c’est tant mieux – les plus exigeantes qui existent à l’échelle mondiale. J’ai d’ailleurs rappelé hier, au Conseil de l’agriculture à Bruxelles, que lorsque l’on discute d’accords commerciaux, tout le monde doit rester cohérent sur la question du bien-être animal. On ne peut pas prendre des décisions en Europe et considérer que le commerce échappe aux règles et aux normes que nous fixons nous-mêmes pour nos agriculteurs.
Je n’ai pas attendu la diffusion par l’association L214 de ces images qui ont légitimement suscité la réprobation, pour mener une réflexion. Dès 2014, nous avons choisi, avec le directeur de la DGAL, que vous avez auditionné, et les membres de mon cabinet, de doter la France d’une stratégie globale en faveur du bien-être animal. Par ailleurs, s’il est une cause pour laquelle je me bats depuis que je suis ministre de l’agriculture, c’est celle de l’agro-écologie. Parvenir à conjuguer performances économique, sociale et environnementale, tel est l’axe stratégique de la politique que j’ai conduite. Rappelons, mais certains ici s’en souviennent, que la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt l’a inscrit comme objectif national pour l’agriculture française dans un débat qui a rassemblé, et je m’en félicite, une large majorité, bien au-delà de la majorité actuelle.
Reste que la diffusion d’images inacceptables prises dans les abattoirs d’Alès, du Vigan et de Mauléon nous a tous interpellés et nécessite, au-delà de l’émotion, de définir des règles et de mettre en place des outils permettant de garantir dans les abattoirs le respect de la protection du bien-être animal.
Nous avons agi en mettant en œuvre le plan d’action « abattoir » pour optimiser les inspections. Nous avons mis en place des supervisions par des référents nationaux abattoirs et le principe d’audits annuels avec un appui extérieur au service local – chef de service ou coordinateur abattoir. Ainsi que vous l’avez indiqué, j’ai également demandé que les services de l’État se livrent à l’inspection de tous les abattoirs de boucherie avant le 30 avril.
J’ai également fait plusieurs propositions qui restent à traduire dans les faits. Le droit européen a prévu des référents bien-être animal qui ont la responsabilité de la totalité de la prise en compte du bien-être des animaux dans les abattoirs lorsqu’ils arrivent, mais pas de manière spécifique lors de la mise à mort. Pour ma part, j’ai souhaité aller plus loin en proposant la désignation d’un responsable de la protection animale pour la mise à mort dans tous les abattoirs de France. J’ajoute que la réglementation européenne ne prévoit des référents bien-être animal que dans les abattoirs les plus importants. Notre pays doit faire en sorte qu’il y ait des référents bien-être animal dans tous les abattoirs, grands, moyens et petits.
J’ai été souvent interrogé sur la nécessité de développer des petits abattoirs dans tous les territoires d’élevage. Je le dis de la manière la plus claire qui soit : je n’accepterai pas de rouvrir des petits abattoirs partout, y compris sous la forme d’abattoirs ambulants, comme cela a été proposé, parce qu’il faut être capable d’assurer les contrôles nécessaires exigés par la réglementation sanitaire sur l’ensemble du territoire.
Je propose le renforcement de la formation de tous les opérateurs. Je viens de lire le livre écrit par un salarié d’un abattoir, tueur de son métier. La clarté et la précision de son témoignage permettent de comprendre ce qu’est ce métier. J’ai considéré qu’il était indispensable d’accompagner ces salariés dans leur formation et dans leur métier, très particulier.
Il faut renforcer également le cadre des sanctions pénales en qualifiant désormais de délit les mauvais traitements sur les animaux en abattoir et dans les entreprises de transport.
Ces modifications seront proposées dans le cadre de la loi dite « Sapin 2 » qui sera discutée au Parlement. De fait, la protection de tous les salariés signalant un délit, inscrite dans la loi de décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, pourra alors s’appliquer au cas des mauvais traitements observés à l’abattoir. Nous allons d’ailleurs procéder à un arbitrage le plus rapidement possible pour choisir le véhicule législatif le plus approprié – projet de loi Sapin 2 ou projet de loi sur la justice du XXIe siècle – afin d’éviter tout risque de cavalier législatif et d’adopter des mesures législatives cohérentes avec notre droit et rapidement applicables.
J’ai pris l’engagement de garantir la transparence des résultats des contrôles officiels réalisés au titre de la sécurité sanitaire de l’alimentation. Cet engagement, inscrit dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, entrera en vigueur à compter du 1er juillet prochain. Les résultats de l’ensemble des contrôles officiels mis en œuvre au titre de la sécurité sanitaire des aliments, tout au long de la chaîne alimentaire, y compris dans les abattoirs, seront donc rendus publics. C’est un choix que nous avons fait dans le cadre de cette loi, et qui sera appliqué. Ces résultats seront directement consultables sur le site Internet des ministères concernés. Le consommateur pourra ainsi connaître, pour chaque abattoir, son niveau de conformité sanitaire, celui-ci prenant en compte le résultat du contrôle du respect des normes en matière de protection animale.
J’ai souvent été interrogé sur la question des postes affectés aux inspections en abattoirs, et sur celle des vétérinaires. Actuellement, ils représentent 2 300 emplois correspondant à 1 200 équivalents temps plein (ETP). Un ministre est évidemment comptable des décisions qu’il prend lorsqu’il exerce ses responsabilités, mais d’autres avaient été prises bien avant mon arrivée. Je rappelle que 440 postes avaient été supprimés entre 2009 et 2012. Lorsque j’ai pris mes fonctions, il était prévu d’en supprimer encore 120. J’ai décidé de stopper les suppressions de postes – soixante suppressions de postes avaient déjà eu lieu au premier semestre de l’année 2012. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, j’ai décidé de recréer soixante postes chaque année, avec un objectif de 180 postes sur trois ans jusqu’au budget de 2017. J’espère que tout le monde sera d’accord pour que ce processus se poursuive dans les années à venir. Ces postes dédiés au contrôle sanitaire en abattoirs sont primordiaux, à la fois pour la santé des consommateurs, le respect des règles de protection animale et la sécurisation de la qualité de nos exportations. Lorsque je suis arrivé au ministère, il y a eu à la fois un rapport de la Cour des comptes européenne et de la Cour des comptes française. Avant même qu’ait été pointée du doigt la faiblesse de l’encadrement des vétérinaires dans les abattoirs, qui pouvait d’ailleurs avoir comme conséquence de remettre en cause un certain nombre de certificats à l’exportation, j’avais décidé d’arrêter le processus de suppression de postes et d’engager à nouveau des créations de postes.
J’en viens aux résultats de l’inspection généralisée que j’ai commandée et qui s’est terminée le 30 avril 2016. Suite à ma demande du 30 mars, ces audits ont été conduits pendant tout le mois d’avril dans tous les abattoirs de boucherie. Je rappelle que, conformément à la règle européenne, il est de la responsabilité des exploitants de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, en tenant compte notamment des meilleures pratiques en la matière. Les contrôles ont porté sur le respect des obligations du professionnel d’apporter la preuve de sa maîtrise de la protection des animaux tout au long de l’abattage. En particulier, il a été vérifié, pendant la mise à mort, que toute douleur, détresse ou souffrance évitables étaient bien épargnées aux animaux.
Tous les abattoirs de boucherie en fonctionnement en avril 2016 ont été contrôlés en France métropolitaine et en outre-mer, soit 259 établissements – notre pays compte 263 établissements mais certains n’étaient pas en activité au moment des contrôles –, comprenant 460 chaînes d’abattage d’animaux de boucherie, un abattoir pouvant comprendre plusieurs chaînes distinctes.
Dans les deux tiers des établissements, absolument aucun problème n’a été mis en évidence. Dans le tiers restant, n’a été relevé dans la majorité des cas qu’un défaut de conformité mineur – absence de preuves documentaires –, mais aucun problème n’a été observé pendant les opérations pour la protection des animaux : la fiche d’utilisation d’un appareil, par exemple, n’était pas à jour alors que l’opérateur et le responsable bien-être animal en connaissaient parfaitement le fonctionnement. Dans d’autre cas, il pouvait s’agir de défauts de conformité, moyens ou graves.
Des défauts d’étourdissement ont été relevés dans trente-neuf chaînes. Dans la plupart des cas, des mesures correctives immédiates ont été exigées par les services et ont permis de reprendre l’activité d’abattage.
Les non-conformités les plus graves ont donné lieu à des suites immédiates. Elles concernaient moins de 5 % des chaînes inspectées – 19 chaînes sur 460.
Au total, quatre-vingt-dix-neuf avertissements, c’est-à-dire des rappels à la règle, ont été donnés et soixante-dix-sept exploitants ont été mis en demeure d’apporter des corrections à leur système dans un délai fixé par l’administration. Dans deux établissements, des arrêts d’activité – suspension ou retrait d’agrément – ont été ordonnés. Pour tout défaut de fonctionnement, la plus grande fermeté a été appliquée et des procès-verbaux ont été dressés dans huit établissements.
Ce résultat montre la forte mobilisation des services et le respect de la consigne donnée d’accompagner toute non-conformité d’une suite proportionnée et pertinente.
Cette inspection démontre que nous avons encore des progrès à faire. Nous n’y parviendrons pas uniquement par le renforcement des moyens de l’État. Considérer qu’il suffit de mettre dans des abattoirs des vétérinaires pour régler un problème qui est d’abord de la responsabilité de ceux qui ont à gérer des établissements, n’est pas la solution, même si j’ai renforcé le nombre des vétérinaires, sachant que les questions de qualité sanitaire et de protection du consommateur sont très importantes.
C’est pourquoi la désignation de responsables protection animale dans tous les abattoirs, le renforcement de leur formation et de leur protection, et l’aggravation des sanctions pénales sont absolument indispensables.
D’autres questions se posent, dont vous aurez certainement l’occasion de discuter : celle de la mise en place de caméras de vidéosurveillance au poste de mise à mort, par exemple. Je n’y suis pas opposé, mais je veux que vos débats précisent, si vous en faites le choix dans votre rapport, les conditions dans lesquelles cette vidéosurveillance peut s’exercer. Un article de journal en parlait encore hier : tout n’est pas fait pour les salariés et travailler dans un abattoir est extrêmement difficile. Si l’on doit envisager des procédures de contrôle, notamment par la vidéo, encore faut-il qu’elles soient encadrées et correctement gérées. On ne peut pas mettre toute la pression sur les seuls salariés. Votre travail parlementaire devra vous conduire à apporter toutes les précisions qui s’imposent dans votre rapport ; j’en tiendrai évidemment compte pour aller au-delà s’il apparaît nécessaire de modifier la loi.
Voilà ce que je voulais vous dire sur ces sujets extrêmement sensibles qui nécessitent que des décisions soient prises. Comme d’autres, j’ai été touché par les images qui ont été diffusées. Mais les courriers que j’ai reçus et les interpellations dont j’ai été l’objet lors du salon de l’agriculture accusant le ministre d’être pratiquement l’équivalent d’un tueur sans foi et sans morale sont assez insupportables pour toute personne qui exerce une responsabilité. J’assume la responsabilité que j’exerce et je considère que j’ai des comptes à rendre ; mais entre des comptes à rendre et des coups à prendre, il y a une distance que j’aimerais que chacun ait en bien en tête… Et cela vaut pour le ministre de l’agriculture comme pour les représentants de la nation. Si l’on veut des débats qui permettent d’ouvrir toutes les possibilités et de faire progresser les choses, cela suppose aussi un minimum de respect.
M. le président M. Olivier Falorni. Merci, monsieur le ministre. Avant de laisser la parole à mes collègues, je vous interrogerai sur trois points.
Concernant le programme d’investissement d’avenir (PIA), 50 millions d’euros ont été alloués à un appel à projet pour la reconquête de la compétitivité des abattoirs et des outils de découpe. Pouvez-vous nous présenter ce programme et nous donner des premières indications sur la consommation des crédits ?
Vous avez évoqué À l’abattoir, ce livre très intéressant de Stéphane Geffroy que nous auditionnerons dans quelques jours. Il y est question du problème récurrent de la formation des personnels. Ne serait-il pas possible de la généraliser et de progresser dans ce domaine ? Quelles sont vos pistes de réflexion ?
Vous avez parlé d’un article paru hier dans Libération. C’est avec stupéfaction – et le mot est faible – que j’y ai lu l’interview de M. Martial Albar, présenté comme un ex-inspecteur des services vétérinaires. J’ai bien entendu les conclusions de votre rapport et je dois avouer que cette interview de cette personne, qui se revendique comme un lanceur d’alerte, m’a laissé pantois. Cet article, dont le titre parlait de barbarie, dressait un portrait cataclysmique des abattoirs en France. Nous aimerions bien évidemment connaître votre point de vue.
M. le ministre. Nous avons débloqué une enveloppe de 50 millions d’euros jusqu’en 2017 dédiée à la modernisation des outils d’abattage et de découpe avec une double stratégie : utiliser ces investissements pour moderniser les abattoirs – c’est ce que l’on a appelé la stratégie des abattoirs du futur – en intégrant toutes les techniques possibles et potentielles permettant d’améliorer le travail, l’efficacité, mais aussi le bien-être animal. Cette enveloppe vise à tenir compte des sujets sur lesquels j’ai été interpellé lors de la crise des filières porcine et bovine que notre pays a traversée : le maillon de l’abattage découpe avait été très rapidement reconnu, et les députés de Bretagne le savent, comme un des éléments qui avait fait perdre de la compétitivité à ces filières. Les investissements pour l’abattoir du futur visaient à améliorer les conditions de travail, de compétitivité et de bien-être.
Sur ces 50 millions d’euros, six projets sont déjà accompagnés pour un montant de 13,2 millions d’euros : on est donc loin d’avoir utilisé l’enveloppe prévue. Ces projets concernent aussi bien les grands groupes que les PME – je pourrai vous fournir les noms si vous le souhaitez, nous n’avons rien à cacher. On peut donc investir pour améliorer les conditions de travail, la compétitivité et le bien-être. Nous sommes souvent coincés par les questions budgétaires pour ne pas avancer ; mais quand des moyens sont alloués mais ne sont pas utilisés, cela mérite d’être rappelé aux intéressés ! Trois projets sont en cours d’instruction pour un montant de 4 millions d’euros. À ce stade, il reste donc une ligne budgétaire de 32,7 millions d’euros. Il va donc falloir appuyer pour faire en sorte que les choses bougent de ce côté.
Nous avons également cherché à utiliser les PIA pour mieux faire dans le domaine du bien-être animal. Comme vous, j’ai été frappé par le broyage des poussins lors du sexage. Lors du salon de l’agriculture, une entreprise a présenté une innovation qui permet de faire du sexage in ovo. Ce projet a immédiatement bénéficié de 4,3 millions d’euros car il faut aller vite, pour faire de la France un pays d’innovations, mettre fin à ces pratiques et ne plus voir ces images terribles. FranceAgriMer a diligenté les choses très rapidement, et j’en suis très satisfait. Emmanuel Macron et moi-même sommes venus assister à la présentation de différents projets, dont celui-ci, pour le soutenir, précisément parce qu’il touche au bien-être animal.
La formation des personnels est un sujet sur lequel nous allons devoir travailler ensemble, et vos auditions seront un des éléments qui devraient permettre d’améliorer les choses. Il faut agir au niveau d’une formation initiale, au début de la carrière, et la renouveler constamment grâce à la formation continue. Il faudra réfléchir, dans le cadre de la discussion du projet de loi El Khomri et du compte personnel d’activité (CPA), à la manière de faire évoluer ces salariés. Dans son livre, M. Geffroy décrit la réalité de ces postes extrêmement difficiles sur le plan physique : au bout de quelque temps, ce sont les épaules, les coudes, etc. qui lâchent. On ne peut pas les laisser pendant quarante ans sur une chaîne, d’où la nécessité de se pencher sur la question de la pénibilité. Ces gens ont vraiment besoin d’être accompagnés. Il faut donc améliorer la formation sur l’acquisition des compétences, en particulier sur la protection animale. Il faut faire preuve de compréhension à leur égard : les cadences dans les chaînes peuvent faire perdre la conscience nécessaire que l’on doit avoir vis-à-vis des animaux. Nous devons sécuriser le parcours professionnel de ces personnes en visant l’acquisition de certificats de compétence. Mais globalement, c’est sur la totalité de la carrière que nous devons réfléchir, formation initiale et formation continue, et jusqu’à la manière dont elle devait pouvoir évoluer dans les abattoirs où il y est très difficile de tenir dans la durée – le livre l’explique très bien.
C’est le ministère de l’agriculture qui habilite les organismes de formation après des examens de moyens pédagogiques et conduites techniques. Treize organismes de formation sont habilités pour les animaux de boucherie. La aussi, les investigations que pourront mener le Parlement dans ce domaine pourront aider à voir où en sont les choses et proposer des améliorations.
Nous avons également créé un outil Web d’évaluation permettant des évaluations individuelles des opérateurs, avec des questions à choix multiples (QCM) corrigées automatiquement, avec tirage de questions aléatoires sur chaque test. Depuis le début du dispositif, ce sont près de 20 000 candidats et 4 000 référents protection animale qui l’ont suivi, avec un taux de réussite d’un peu plus de 99 % pour les opérateurs non référents et de 99,8 % pour les référents protection animale. Les certificats de compétence sont délivrés par le préfet, suite à la présentation de la demande et attestation de formation.
Au-delà des tests et des QCM, il faut mener une réflexion globale et engager un débat sur les treize organismes de formation. Le renouvellement des habilitations des organismes de formation se fera à partir de 2018 ; autrement dit, on a un peu de temps pour redonner et fixer le cadre. Les modifications prévues dans le contenu de formation sont en cours, avec des modes opératoires normalisés et le contrôle interne pour les opérateurs, afin d’intégrer des volets pratiques. Il faut consolider les textes permettant le retrait ou la suspension des certificats : il est nécessaire en effet d’avoir la capacité de donner des certificats à ceux qui sont chargés de former, mais aussi de les retirer lorsque l’on considère qu’ils ne sont pas satisfaisants.
Quelles sanctions définir lorsque l’on réalise des opérations d’abattage et des opérations annexes sans pouvoir justifier du certificat de compétence ? Actuellement, le fait de ne pas désigner de responsable de protection animale dans un établissement d’abattage n’a aucune conséquence. Des sanctions doivent être prévues ; nous en discuterons dans le cadre de la prochaine loi de finances.
Vous m’avez interrogé sur Martial Albar. Il est technicien des services vétérinaires, promotion 1996-1997 – il n’est donc pas vétérinaire. De 1997 à 2002, il est à la Direction départementale des services vétérinaires (DDSV) de l’Aube : aucune affectation en abattoir. De 2002 à 2009, il est à la DDSV de Haute-Savoie : aucune affectation en abattoir. De 2009 à 2012, il est à la Direction départementale des territoires (DDT) de Haute-Savoie. D’après ce que nous savons, il a effectué trois remplacements et vacations dans des abattoirs, à Troyes, Megève et Bonneville. En 2012, il a démissionné de la fonction publique. Dans son dossier, il n’y a pas de lien avec le travail en abattoir.
Moi-même, quand j’ai vu cette interview de quelqu’un qui était présenté comme un fonctionnaire et vétérinaire dans un abattoir, j’ai été surpris. Et surtout par ses propos, qui sont terribles : il dit avoir vu des opérateurs fracasser la tête des moutons. Je respecte toutes les opinions ; celles des militants sont respectables. Mais cet homme a été présenté comme étant vétérinaire ; or il ne l’est pas. Il n’a jamais été vétérinaire du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Et il a effectué trois vacations dans les abattoirs… La transparence vaut pour tout le monde. Voilà tout ce que je peux dire sur Martial Albar, qui travaille maintenant dans une société de conseil.
Mme Sylviane Alaux. Monsieur le ministre, vous nous avez déjà donné beaucoup d’informations et apporté des réponses à nombre de questions que nous allions vous poser.
Comme vous, je demande beaucoup de fermeté et de rigueur et surtout de rapidité dans l’exécution. On le sait, les salariés peuvent être confrontés à des cadences de travail élevées, surtout à certains moments de l’année. Pourrait-on définir un cadre afin de limiter voire d’organiser cette cadence de travail, même à des moments clés de l’année ?
Vous venez d’évoquer l’insuffisance de la formation. Aussi, je n’y reviendrai pas.
Il ne suffit pas de chercher du travail ou d’avoir une formation de boucher, ce qui est assez souvent le cas. Encore faut-il sélectionner les candidats – même si j’ai conscience qu’ils ne se bousculent pas au portillon – car ils œuvreront un jour ou l’autre au poste d’abattage. Quelles dispositions contraignantes comptez-vous prendre pour remédier à ces carences ?
Dans les dispositions prises ou à prendre, traitez-vous de l’abattage rituel ? La France pourrait avoir des exigences en ce qui concerne la compétence des sacrificateurs lors de la mise à mort des animaux. Il faudrait à tout le moins apporter la preuve de sa compétence en la matière.
Mme Françoise Dubois. Monsieur le ministre, je vous remercie pour toutes ces explications. Voilà quelques semaines que nous nous attardons sur le bien-être animal. Bien évidemment, nous avons tous étés émus par ces images insoutenables que je condamne, comme mes collègues. Mais au-delà de l’émotion ressentie, je voudrais également insister sur le bien-être humain. Comme vous l’avez dit, il est nécessaire de fixer des sanctions en cas de dérapage. Peut-on excuser les dérapages que l’on a vus sur les vidéos ? On ignore dans quelles circonstances ils ont eu lieu. Quand on est débordé par un rythme quelquefois insoutenable, ce genre de réaction humaine peut arriver. La formation semble à l’évidence insuffisante, comme le relate l’article paru hier dans le journal Libération – même si ces informations sont à vérifier.
Pour exercer un tel métier, il faut être bien formé. Pensez-vous que l’on pourrait mettre en place un accompagnement psychologique pour ces salariés qui égorgent des animaux pendant plusieurs heures d’affilée ? Une formation plus pointue serait sans doute plus un élément rassurant pour eux, dans la mesure où ils maîtriseraient bien les méthodes d’abattage des animaux.
Sur l’abattage rituel également, j’aimerais connaître votre position.
M. Jacques Lamblin. Monsieur le ministre, l’argent, la rentabilité à court terme participent-ils selon vous à la situation que nous déplorons dans les abattoirs ? Les impératifs de productivité qui seraient imposés aux personnels viendraient-ils à faire oublier la protection animale ? L’inadaptation des matériels, le manque de modernisation ou d’entretien pourraient-ils également être une explication ?
L’abattage sans étourdissement vous paraît-il conciliable avec la non-souffrance animale ? Si l’on veut régler ce problème en interdisant l’abattage sans étourdissement, peut-on trouver une solution conciliable avec les impératifs économiques auxquels est confrontée notre agriculture ? La viande halal est consommée en France, mais elle est également exportée. En d’autres termes, peut-on régler le problème de l’abattage sans étourdissement sans détruire le marché de la viande halal ?
Dernière question, plus anecdotique : vous avez parlé de votre engagement d’augmenter à nouveau les effectifs des services de contrôle vétérinaires en créant soixante postes par an. Je n’ai pas très bien compris s’il s’agissait de la loi de finances initiale pour 2013 ou pour l’année 2014.
M. Christophe Bouillon. Monsieur le ministre, je tiens à saluer votre réactivité et je vous remercie de nous avoir donné les résultats du contrôle généralisé que vous avez diligenté. Le nombre d’avertissements et de procès-verbaux est tout à fait intéressant. J’ai bien noté que le plan d’action « abattoir » comportait déjà des éléments chiffrés qui témoignaient du travail de contrôle permanent réalisé par les vétérinaires. A-t-on observé des cas de récidive de la part d’abattoirs qui avaient déjà reçu des avertissements les années précédentes ? Et que se passe-t-il ensuite ? Ce qui est intéressant, c’est d’aller au-delà du constat et de voir quelles mesures sont prises par la suite.
On a beaucoup parlé, à juste titre, de formation. Cela dit, la question de l’image de la profession est importante également, comme on le voit à travers l’ouvrage de Stéphane Geffroy que vous avez cité. Pour notre part, nous en avons eu la démonstration lorsque, avec Olivier Falorni, Jean-Yves Caullet et Thierry Lazaro, nous sommes allés visiter de façon inopinée l’abattoir de Maubeuge. Le directeur nous a fait part de l’énorme difficulté à trouver des jeunes ou des moins jeunes pour venir travailler dans son établissement pourtant moderne – il a été ouvert en 2008 – et situé dans un bassin d’emploi où le taux de chômage est élevé. Que comptez-vous faire en termes d’image ? En même temps que la formation, l’idée que l’on se fait de son métier peut aider à bien le faire.
Je vous rejoins dans votre opposition aux abattoirs ambulants. Et vous avez évoqué la question des abattoirs de proximité. Mais on le voit, cette équation est difficile à résoudre : moins il y a d’abattoirs, plus il y a de transport ; plus il y a de transport, plus il y a de stress animal ; plus il y a de difficultés, plus les petits éleveurs, qui n’ont pas nécessairement le matériel de transport adéquat, ont du mal à trouver un abattoir à distance raisonnable pour lui confier leurs animaux. On voit bien le hiatus qu’il y a entre les gros abattoirs spécialisés et l’utilité d’un bon maillage. Dans cette affaire, l’abattoir de proximité n’est pas forcément l’ennemi.
M. le président Olivier Falorni. Je confirme les propos du directeur de l’abattoir de Maubeuge : malgré un bassin d’emploi plutôt affecté, il ne parvient pas à trouver des employés. Il ajoutait que si on lui amenait vingt jeunes, il les embaucherait immédiatement, pour peu qu’ils arrivent à l’heure, et tous les jours, et qu’ils respectent les règles que tout abattoir exige. Cet échange était assez édifiant !
M. le ministre. Qu’est-ce qu’un abattoir ? C’est un lieu où les animaux arrivent vivants et en ressortent le plus souvent découpés. C’est une activité économique qui n’a pas d’autre équivalent dans aucun domaine, et dont la rentabilité est extrêmement faible. J’en veux pour preuve le nombre d’abattoirs municipaux qui ont été fermés ces dernières années. Il est difficile de combiner économiquement proximité et rentabilité.
Vous me demandez si l’on ne rogne pas sur le respect des règles au nom de l’économie ; cela peut se produire assez rapidement. Au vu de mon expérience, je considère qu’il faut d’abord consolider ce qui existe, structurer nos lieux d’abattage et les conforter plutôt que de s’obstiner à penser que l’on réglera le problème en installant des petits abattoirs partout.
Car c’est malheureusement le nombre d’abattages qui permet la rentabilité ; et comme il s’agit d’une activité économique à la rentabilité économique extrêmement faible alors qu’elle nécessite beaucoup de main-d’œuvre, on se heurte à une vraie difficulté. C’est pourquoi toute la réflexion sur l’abattoir du futur, et notamment la partie la plus difficile, c’est-à-dire l’abattage et la découpe, tous les investissements dans la recherche de solutions innovantes pour les années qui viennent sont très importants et utiles, et pourraient même conduire à définir une autre stratégie. Mais pour l’heure, compte tenu de la faiblesse de la rentabilité, je déconseillerai de créer de nouveaux abattoirs. Combien de fois suis-je interrogée par des parlementaires sur la fermeture de leur abattoir, la re-création d’un abattoir, la mise en place d’abattoirs mobiles... Imaginez quelles peuvent être les conséquences en matière sanitaire et de bien-être ! Qui contrôlerait ? Je le répète : commençons par consolider, par aider ce qui existe, par mettre en œuvre des politiques de bien-être animal et éviter de répondre à des demandes qui finissent par poser un vrai problème d’accompagnement.
Vous me demandez si la cadence a un impact sur le comportement des salariés. Il faut savoir que lorsque la cadence est extrêmement forte, la concentration l’est aussi. Mais si elle devient trop élevée, elle finit par faire disjoncter le système. A contrario, des moments plus calmes peuvent donner lieu à un relâchement général. Je n’ai pas fait d’études scientifiques, je ne suis pas vétérinaire, mais j’ai fait mes propres analyses : il n’y a pas de lien de causalité directe : dans un moment de faible activité, il peut survenir des risques de mauvaises pratiques ou de non-respect du bien-être animal. Mais si les cadences deviennent infernales, le système peut disjoncter. Mais on ne peut pas dire que ce sont les cadences qui entraînent une perte de repères. On peut intuitivement l’estimer, mais ce n’est pas aussi simple que cela.
Mme Alaux se demandait si l’on pouvait sélectionner les candidats. Stéphane Geffroy, dont le livre est d’une grande simplicité et d’une grande fluidité, viendra certainement devant votre commission pour vous raconter son histoire. Dès que ces hommes et ces femmes choisissent ce métier, il faut être là pour les accompagner. Il faut réfléchir, avec le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à un accompagnement psychologique, mais également à ce qui existe déjà, qu’il faut pouvoir mettre en œuvre et rendre efficace. Le pire serait de prendre des décisions qui ne pourraient pas être appliquées. Vous avez vu également quelles conséquences peuvent avoir les troubles musculosquelettiques. Il faut qu’il y ait une convergence de travail avec vous en la matière, et que nous réfléchissions à la manière dont on peut faire évoluer la carrière de ces salariés. Je suis certain que l’accompagnement des salariés est important pour la réussite du respect des règles de bien-être. J’examinerai toutes les propositions que vous ferez à cet égard.
S’agissant de l’installation des caméras de vidéosurveillance, il faudra bien mesurer le rapport entre le contrôle et la pression que cela peut induire pour un salarié. Évitons de faire des choix qui pourraient avoir des conséquences non souhaitées. J’ajoute que tous les chiffres que je vous ai donnés à l’instant sur les contrôles que nos services ont effectués seront envoyés à votre commission, afin que vous disposiez des éléments nécessaires. Tel est l’esprit dans lequel nous devons travailler ensemble.
J’en viens à la question de l’abattage rituel. Il y a cinq ans, lorsque je siégeais au Parlement européen, j’ai déjà été saisi de cette question alors que l’Europe discutait de la directive qui applique la convention européenne des droits de l’homme sur la liberté religieuse et l’abattage rituel. Au terme d’un débat, il avait été décidé que l’étourdissement serait la règle et que les dérogations ne seraient plus européennes mais nationales, ce à quoi je m’étais opposé : autrement dit, on renvoyait à chaque État la possibilité de déroger ou pas. Je considérais en effet que la règle, c’était l’étourdissement, et que la dérogation aussi devait être européenne ; il appartenait ensuite aux pays d’appliquer la dérogation ou pas. Mon prédécesseur, Bruno Le Maire, a pris un décret en 2011 sur l’abattage rituel pour que les règles soient fixées après les débats qui avaient eu lieu au niveau européen.
La dérogation à l’obligation d’étourdissement fait l’objet d’un encadrement spécifique en droit français – décret 2011-2006 du 28 décembre 2011 et son arrêté d’application. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette dérogation sont les suivantes : une autorisation préalable est délivrée par le préfet sous réserve que l’infrastructure et le fonctionnement le permettent – matériel adapté, personnel dûment formé, procédures garantissant des cadences et un niveau d’hygiène adaptés ; les sacrificateurs sont habilités par des organismes religieux agréés ; les bovins, ovins, et caprins sont immobilisés avant l’abattage par un procédé mécanique dans le but d’épargner à l’animal toute douleur évitable – le problème dans les abattages rituels tient souvent au fait que les animaux sont mal immobilisés. Du coup, ils bougent, ce qui a des effets énormes sur le plan de la souffrance. D’où l’obligation de les immobiliser. Enfin, un système d’enregistrement permet de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales ou à des ventes qui le nécessitent.
Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai rencontré à nouveau les autorités religieuses. J’ai discuté avec elles pour savoir ce que l’on pouvait faire et si l’on pouvait faire autrement. Le problème, c’est que vous êtes face à des religieux – des rabbins et des imams – qui appliquent les règles de leur propre religion. En tant que ministre et laïque, je n’ai pas à porter de jugement ; j’essaie seulement de trouver un moyen d’améliorer les choses. Je me suis donc tenu à une application stricte de ce décret. Dans le même temps, j’ai confié, au mois de janvier 2013, une mission au conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) pour évaluer la mise en place effective de ces dispositions, et, le cas échéant, de dégager des voies d’amélioration dans l’application du décret pour les abattoirs de boucherie. Ce rapport sera normalement disponible au mois de septembre prochain.
Aujourd’hui, en France, 218 établissements sont autorisés à abattre sans étourdissement, toutes espèces, y compris volailles. En nombre de têtes abattues, l’abattage sans étourdissement représentait, en 2014, 15 % des bovins abattus et 27 % des ovins. À titre de comparaison, en Europe, en 2012, treize États membres ont mis en œuvre cette dérogation de la pratique de l’abattage sans étourdissement, au premier rang desquels se situe la France en termes de pourcentage de bovins abattus, devant les Pays-Bas et la Hongrie, selon une étude de la Commission européenne.
Peut-on faire de la viande halal sans avoir la validation des autorités religieuses ? Non. Il en est de même pour le casher. Ce n’est pas nous qui pouvons décider des conditions dans lesquelles se délivrent les certificats. Cela dit, les dispositions qui ont été arrêtées en France avec ce décret doivent être scrupuleusement respectées. Nous devons être capables d’évaluer tous ces sujets qui sont très importants et qui risquent de revenir dans le débat, car les conséquences peuvent être lourdes. C’est d’ailleurs la première fois que je fais savoir que j’avais commandé ce rapport.
Je veux enfin répondre à M. Lamblin. Pour 2012, il était prévu de supprimer 120 emplois. Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai décidé de stopper ce processus. Au total, ce sont soixante emplois qui ont été supprimés cette année-là. Nous avons décidé, lors de la loi de finances pour 2013, une stabilisation. La loi de finances pour 2014 a prévu une première création de soixante postes. Puis les lois de finances pour 2015 et 2016 ont prévu chacune la création de soixante postes.
M. Jacques Lamblin. S’agissant de l’abattage rituel, certains font état de chiffres beaucoup plus élevés que ceux que vous venez de donner. Que faut-il en penser ?
Les représentants des religions ont des impératifs, mais les mosquées n’ont pas toute la même position. Certaines sont plus ouvertes que d’autres à des possibilités d’étourdissement réversible ou post cut. Est-ce une voie que l’on peut explorer ?
M. le ministre. Vous évoquez des sujets extrêmement techniques dont j’ai effectivement discuté. Mais il faut pouvoir les concrétiser. Il y a des instances qui décident. Je ne suis pas parvenu à modifier les règles que vous avez évoquées ; en attendant, j’en reste à l’application du décret tel que je vous l’ai indiqué. Effectivement, certaines mosquées avaient une position qui pouvait laisser penser que les choses pouvaient changer. Sur ce sujet, il n’y a pas d’accord qui permet à un ministre de dire que ce sera comme cela et pas autrement.
Pour ce qui est des chiffres, le directeur général de l’alimentation qui est à mes côtés me confirme que ceux que je vous ai donnés sont les vrais… J’ai plutôt tendance à lui faire confiance. Jusqu’à présent il ne m’a jamais donné de mauvais chiffres. On a dit que 100 % des abattages étaient rituels. Tout dépend de la façon dont on raisonne : selon les régions, — l’Île-de-France en particulier –, selon les périodes – avant l’Aïd par exemple. Les chiffres que je vous ai donnés s’entendent pour la France entière et peuvent être considérés comme fiables.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre exposé liminaire qui montre bien que tout en étant le plus rigoureux possible avec les outils que l’on a, une alerte peut être utile puisque les contrôles que vous avez diligentés ont fait apparaître des manquements, même s’ils ne sont pas généralisés. Cela veut dire que, dans ce domaine comme dans d’autres, il faut une constance dans le contrôle. Toute habitude occasionne forcément une dérive vers un laisser-aller plutôt que vers une plus grande rigueur. La confiance n’exclut pas le contrôle ; elle s’en nourrit, et c’est très vrai pour ce domaine.
Je veux vous interroger sur les abattoirs de proximité. Moins on est proche, plus on est grand, plus on a des économies d’échelle, plus on peut investir ; mais plus la distance de transport des animaux s’allonge et plus les problèmes liés au transport augmentent. Ne peut-on imaginer des temps de transport maximum qui pourraient, s’ils étaient dépassés, obliger à organiser des temps de repos avant d’entrer dans la chaîne d’abattage pour ne pas multiplier les stress lors de la montée dans le camion, pendant le transport, lors de la descente du camion, à la menée à l’abattoir ? Ne pourrait-on pas normaliser un tant soit peu les choses pour éviter ce conflit entre la distance et la maltraitance ?
Vous avez dit ne pas être opposé, sur le principe, à l’installation de caméras de vidéosurveillance. Pensez-vous qu’il serait possible que cet outil soit, non à la main de l’employeur mais à celle de l’État ? Ce serait en fait un inspecteur virtuel qui pourrait se déclencher à la volonté de l’État ou à celle du responsable bien-être animal qui aurait la possibilité de faire une sorte de reporting grandeur réelle, quitte à faire de la pédagogie interne ensuite. Ces caméras peuvent-elles permettre de faire autre chose que de surveiller le salarié ?
Vous avez parlé de transparence. Il n’est pas sain qu’une société refuse de porter un regard sur un maillon essentiel de sa chaîne alimentaire. Il existe, pour certaines installations classées, des commissions locales composées d’élus, d’associations, de responsables, qui discutent une ou deux fois par an de ce qui se passe avec l’exploitant. Cette piste vous paraît-elle intéressante sur le plan de la transparence ?
Les contrôles sont de la responsabilité de l’État. La démarche de certification par les distributeurs qui voudraient pouvoir garantir aux consommateurs qu’ils leur fournissent des produits tout à fait conformes vous semble-t-elle être une piste intéressante ?
Je ne reviendrai pas sur les échanges qui ont eu lieu sur la question de l’abattage rituel ; nous aurons l’occasion de l’approfondir. Le sacrificateur doit répondre de sa qualité rituelle et être agréé par l’autorité publique en termes de compétences ; or rien ne me semble vraiment clair en ce qui concerne sa relation avec l’exploitant de l’abattoir. Les responsables d’abattoir que nous avons auditionnés nous ont dit qu’ils n’avaient aucun regard ni aucune autorité sur ces gens qui, bien entendu, sont certifiés. Ils viennent avec leurs outils. Dans l’abattoir que nous avons visité, nous avons vu un autre système : le sacrificateur est agréé par les autorités publiques et par les autorités religieuses, mais il est aussi salarié de l’établissement. Ainsi, ses outils sont entretenus et aiguisés sous la responsabilité de l’établissement, et il doit se conformer aux règles de sécurité et aux cadences de l’établissement. Ne pourrait-on pas redonner à ces sacrificateurs un lien plus direct avec l’établissement dans lequel ils exercent, indépendamment des certificats qu’ils doivent avoir par ailleurs, pour éviter un peu d’amateurisme ou d’irresponsabilité ? On ne peut pas dire, d’un côté, que le directeur est responsable et, de l’autre, laisser entendre que certains agents agissant dans l’abattoir ne seraient pas en lien direct avec le responsable.
Enfin, tous les investissements qui permettront de réduire la pénibilité dans les abattoirs et les troubles musculosquelettiques seront évidemment les bienvenus. Mais ne pourrait-on pas mener une réflexion sur les exosquelettes qui permettent, dans certaines entreprises, grâce à un bras robotisé, de limiter l’effort de l’homme tout en gardant la maîtrise des gestes ? Cette piste pourrait permettre un meilleur contrôle de soi et éviter des carrières trop brisantes pour les personnels, qui du reste vont rarement dans le sens du bien-être animal.
Mme Geneviève Gaillard. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre propos liminaire particulièrement intéressant. Pour ma part, je veux revenir sur quelques-unes de vos réponses.
J’ai bien compris que vous ne souhaitiez pas la réouverture d’abattoirs de proximité, ce que l’on peut comprendre. Pensez-vous qu’il y en a encore trop aujourd’hui ?
Vous avez dit être opposé aux abattoirs mobiles. Or ils ont été développés dans certains pays. Au regard de la volonté des éleveurs qui sont très éprouvés par ce qui se passe actuellement, ne pensez-vous pas qu’il serait intéressant d’aller un peu plus loin dans la réflexion ?
S’agissant de l’abattage rituel, je partage les propos de M. Lamblin. Vous vous dites laïque ; moi aussi. La laïcité est un débat récurrent et intéressant dans notre pays. Or vous savez que, dans le cas de l’abattage casher, par exemple, seule la moitié de la carcasse est consommée. Et moi, qui suis laïque et qui défends la protection animale, je refuse de manger de la viande issue d’un animal qui a souffert et qui n’a pas été abattu dans des règles propres à éviter la souffrance. Or, et cela me choque, il n’y a pas d’étiquetage, on n’en sait rien, personne n’est au courant. Moi qui défends la cause de la protection animale, je n’ai pas envie de consommer de cette viande-là. Et si cela continue, je finirai par ne plus consommer de viande du tout, mettant en péril toute une filière qui n’en a pas besoin aujourd’hui, surtout quand on voit tout le travail effectué par nos éleveurs. Comment répondez-vous à cette question ?
Comme l’a dit le rapporteur, toute la chaîne est importante, du départ de l’animal de la ferme jusqu’à son arrivée à l’abattoir. Le transport occasionne du stress aux animaux qui sont désormais reconnus comme des êtres sensibles. Cela fait des années que des chercheurs et des associations de protection animale sérieuses travaillent avec le ministère sur la sensibilité de l’animal. Elles pourraient amplifier leurs recherches sur les questions d’étourdissement, sur l’adaptation de l’étourdissement. On le sait, les moyens utilisés pour étourdir le porc ne sont pas parfaits, certaines machines ne sont pas adaptées. Comptez-vous réfléchir avec des chercheurs, des universitaires ou autres, à l’amélioration de ces pratiques ?
L’abattoir du futur est un sujet intéressant. On n’améliora pas tout d’un seul coup, c’est évident. Mais ne serait-il pas possible de voir comment on peut réceptionner les animaux, les maintenir dans un lieu particulier avant d’être abattus pour faire baisser le stress ? Les chercheurs et les associations ne pourraient-ils pas mener cette réflexion ? On ne peut pas laisser de côté la souffrance animale. Moi qui suis déjà allée dans les abattoirs, j’ai pu constater que tout n’était pas parfait en la matière.
M. Jean-Luc Bleunven. Je veux revenir sur les abattoirs de proximité et la question de l’agro-écologie. Je ne suis pas inquiet en ce qui concerne les grandes chaînes d’abattage : là où il y a une grande concentration d’animaux, on peut en effet concentrer les moyens et améliorer l’efficacité des contrôles. Mais on ne pourra pas nier la nécessité d’une proximité de l’abattage pour répondre aux besoins de l’agriculture biologique et de la traçabilité. Parfois, sur les chaînes, on ne maîtrise pas tout. Pour ma part, je considère qu’il faudra également chercher du côté de l’abattage mobile car là aussi, on est encore un peu au Moyen âge… Rien n’a été fait pour trouver des solutions qui passent sans doute aussi par des techniques nouvelles.
Mme Laurence Abeille. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre présence.
La condition animale est devenue dans notre société un vrai sujet politique. La condition animale est-elle pour vous aujourd’hui un sujet politique, une priorité politique ?
La société s’est emparée de ce sujet parce que nos connaissances sur les animaux ont beaucoup évolué depuis quelques années. Dans le même temps, l’industrialisation de l’agriculture et de l’élevage a fini par désincarner la question de notre alimentation – et cela ne vaut pas seulement pour l’élevage. Il s’agit de consommation d’animaux, donc d’être vivants doués de sensibilité, comme le précise le code civil. La majeure partie de la population ne connaît pas ces animaux, qu’elle voit seulement dans des publicités où ils sont représentés gambadant dans les prés. Les morceaux de viande sont achetés dans des barquettes ; du coup, le lien entre l’animal qui gambade dans le pré et la barquette ne se fait plus du tout. Autrefois, la plupart des gens habitaient à la campagne et connaissaient davantage les animaux. Depuis, un changement s’est opéré dans la société : les animaux ne peuvent plus être considérés comme destinés à devenir de simples morceaux de viande puisque l’on sait aujourd’hui que ce sont des êtres intelligents, des êtres sensibles.
Les scandales soulevés par la diffusion de ces vidéos posent une vraie question de société. Va-t-on pouvoir, oui ou non, continuer à consommer des animaux ? Si oui, dans quelle proportion ? Une industrialisation toujours plus grande ne finira-t-elle pas par décourager un certain nombre de gens de consommer de la viande ? Je sais que tel n’est pas votre objectif même si, pour ma part, je défends ceux qui appellent à une non-consommation de viande ou à une consommation largement diminuée. La question de la souffrance animale est centrale : un animal élevé et abattu dans de bonnes conditions peut permettre à des gens de continuer à consommer de la viande, peut-être moins. Vous avez parlé de la rentabilité économique extrêmement faible des abattoirs. Nous avons demandé aux personnes que nous avons auditionnées jusqu’à présent quel était le prix de l’abattage, mais nous n’avons pas réussi à obtenir des réponses très précises. L’étiquetage ou la labellisation pourraient peut-être permettre de faire des choix en toute connaissance de cause, puisque le consommateur aurait la certitude que les animaux auraient été élevés et abattus dans les conditions les plus dignes possibles, sachant que la mise à mort d’un animal et son étourdissement a priori sont inévitablement facteurs de souffrance. Comptez-vous retravailler la question des techniques d’étourdissement des animaux, en particulier celle des porcs au CO2 ? Lorsqu’on lit l’article paru dans Libération, on se dit qu’il convient de poursuivre les recherches sur ce point : il semblerait que l’étourdissement ne supprime pas la souffrance des animaux, alors que, au-delà des parlementaires ici présents, la grande majorité de nos concitoyens souhaitent qu’elle diminue.
On a beaucoup parlé dans cette commission de la formation des personnels ; je n’y reviendrai pas. Certes, les caméras serviraient à surveiller les personnes qui travaillent et à améliorer la formation. Mais elles pourraient peut-être aussi permettre de vérifier que les animaux sont abattus dans de bonnes conditions, c’est-à-dire qu’ils ne souffrent pas et ne se réveillent pas après étourdissement : la question du réveil s’est posée à de nombreuses reprises.
À mon tour, je veux revenir sur la question des abattoirs mobiles qui existent dans certains pays d’Europe. Pourquoi êtes-vous opposé à cette solution qui peut permettre de réduire l’empreinte carbone et la souffrance des animaux transportés sur de longues distances ?
M. le ministre. Monsieur le rapporteur, vous m’interrogez sur l’exosquelette. Il ne faudrait pas que le rapport à l’animal soit complètement perdu à cause d’un système qui deviendrait intégralement technologique. Il ne faut pas oublier la sensibilité des femmes et des hommes qui, même si certains peuvent la contester, permet ce rapport à l’animal. Je suis favorable à la mise en place de systèmes de découpe qui allègent les efforts des salariés. Du reste, ces systèmes existent déjà. Il faudrait engager une concertation entre tous ceux qui innovent dans ces domaines et FranceAgriMer afin de regarder ce qui est fait et où cela nous mène.
Les sacrificateurs sont toujours sous la responsabilité de l’exploitant. Soyons clairs : l’exploitant est responsable de ce qui se passe dans son abattoir. Peut-être peut-on réfléchir à un salariat, sachant que l’agrément est donné aux sacrificateurs par les instances religieuses. Ira-t-on jusqu’à dire que les outils qu’ils utilisent sont sous la responsabilité de l’abattoir ? Voilà une question à laquelle il va falloir répondre. Je n’y suis pas du tout opposé.
La question des abattoirs de proximité a été reposée. Il y a aujourd’hui en France 259 abattoirs. Est-ce trop ou pas assez ? Je crois qu’y en a suffisamment. C’est un débat de fond. Suffit-il de limiter le transport et de multiplier le nombre d’abattoirs pour diminuer la souffrance animale. Je dis non. L’expérience montre clairement que cela ne marche pas. Il est plus facile, si je puis dire, d’améliorer les conditions de transport des animaux, pour éviter leur stress durant l’embarquement, la contention, le trajet. N’oublions pas, je le redis, qu’un abattoir est en endroit où un animal arrive vivant et où il doit être abattu, tué et découpé. Sans oublier ce qu’on appelle le cinquième quartier : une partie du chiffre d’affaires des abattoirs se fait sur la peau des animaux. Autrement dit, il faut dépiauter… Et il suffirait de mettre des abattoirs mobiles dans des camions, qui se baladeront à travers la campagne des camions pour abattre des animaux un peu partout ? Et vous me parlez d’empreinte carbone ? J’aimerais qu’on fasse le calcul… Et pour ce qui est de la souffrance, je suis sûr de mon fait : je préfère avoir 259 établissements contrôlés, dans lesquels on peut investir pour améliorer le bien-être animal, plutôt que de disséminer des abattoirs partout au nom de la proximité. Et après ? Il y aura d’autres ministres après moi qui se feront eux aussi alpaguer… N’oublions jamais qu’abattre un animal exige ensuite de le découper et de le transformer. Je voudrais bien voir comment les choses se passent exactement dans les pays européens où l’abattage mobile existe. N’oublions pas enfin les conditions sanitaires : il ne s’agit pas de mettre sur le marché de la viande qui ne répondrait pas aux normes sanitaires. Je suis bien placé pour savoir que la question sanitaire renvoie à des enjeux colossaux en termes de qualité, de microbiologie, d’agents pathogènes : je vous rappelle qu’il a fallu récemment faire le vide sanitaire pendant un à deux mois dans dix-sept départements avant de remettre en production des canetons. Il y va de ma responsabilité de ministre.
Voilà pourquoi, je l’ai dit au Sénat, je ne suis pas favorable à la multiplication des abattoirs, au nom de la proximité, car on risque de se mettre dans des situations où on aura de plus de plus de mal à lutter contre la souffrance animale. Il faut d’abord gérer les sites d’abattage existants. Des élus m’appellent tous les jours. On me demande de rouvrir l’abattoir de Mauléon. Je comprends l’enjeu : c’est un abattoir territorialisé, de proximité mais qui a rencontré les problèmes que l’on sait.
M. Sylviane Alaux. L’abattoir de Mauléon vient d’être contrôlé et aucune réserve n’a été émise.
M. le ministre. On va donc pouvoir le rouvrir. Mais il convient de respecter toutes les règles, pour ne pas revivre ce que l’on a déjà vécu parce que derrière c’est toute la filière qui paye, en particulier la filière de proximité et la filière bio. J’essaie de faire comprendre à tous ceux qui me demandent de multiplier les abattoirs, au nom de la proximité et de la filière bio, que le jour où l’on est confronté à des problèmes comme celui que l’on vient de connaître, le risque est de ne plus avoir aucune maîtrise. Maîtrisons ce que nous avons, améliorons le transport et limitons les stress. Je rappelle qu’un abattoir est un lieu économique où la rentabilité reste extrêmement faible, quoi qu’on fasse. Si tant d’abattoirs municipaux ont disparu au fil des ans, c’est bien parce que même les municipalités n’arrivaient plus à combiner les enjeux de respect des conditions sanitaires, de bien-être et d’équilibre économique. J’ai en tête le cas d’un abattoir municipal, situé dans l’Est de la France, concurrencé par d’autres abattoirs situés de l’autre côté de la frontière. C’est pourquoi, et j’ai bien réfléchi à la question, je ne suis pas favorable aujourd’hui à la multiplication des abattoirs.
Je ne peux pas être accusé de ne pas faire ce qu’il faut alors que c’est la première fois qu’a été mise en place une stratégie globale de bien-être animal. Hier, à Bruxelles, j’ai rappelé que le bien-être animal ne concernait pas seulement les animaux élevés dans des bâtiments : il faut aussi tenir compte de ceux qui sont en plein air. Le plein air fait partie des critères sur lesquels on doit s’appuyer pour mesurer le bien-être animal. Pour moi, c’est un enjeu majeur.
Un abattoir qui ne respecte pas les règles n’est pas agréé ; du coup, l’argument tombe. D’ici au mois de septembre il faudra surtout se pencher sur la question des sanctions. On l’a vu, certains directeurs d’abattoirs ont reporté la faute sur les employés, prétendant qu’il leur a suffi de s’absenter deux jours pour que le salarié fasse n’importe quoi. J’ai entendu des associations dire que c’est chaque fois la même chose, que les politiques disent qu’ils vont traiter le sujet, mais qu’une fois l’émotion passée ils passent à autre chose. En la matière, il faut mettre en place des éléments structurants qui permettent justement de garder la pression et surtout de protéger ceux qui informent. Car c’est bien cela le sujet : il y avait bien des référents bien-être animal dans les abattoirs du Vigan et de Mauléon, mais ils ne disaient rien. Si on ne protège pas les salariés et qu’on ne leur donne pas les moyens de dénoncer ce qu’ils voient, cela ne marchera pas. Et on aura beau mettre des vétérinaires partout, cela ne marchera pas non plus ; et on n’a pas le temps de le faire. La responsabilité des abattoirs doit aussi être engagée. C’est pourquoi je considère que ce sont des questions essentielles.
Vous m’avez interrogé sur la mise en place d’un étiquetage, en particulier pour la viande casher. C’est vrai, dans le rite casher, on ne mange que l’avant de l’animal. Or, jusqu’à nouvel ordre, un animal est génétiquement composé de deux parties et c’est tant mieux… Vous me dites ne pas vouloir manger le quartier arrière d’un animal qui aurait pu être abattu selon le rite casher. La probabilité est assez limitée, l’abattage casher n’étant pas aussi répandu que l’abattage halal. Mais le risque existe ; c’est donc une question de principe. Que va-t-il se passer si l’on met en place un étiquetage ? Il sera indiqué sur la barquette que l’animal a été tué selon le rite casher. Du coup, la moitié de l’animal ne sera pas commercialisable, alors même qu’il s’agit des parties arrière que nous, nous considérons comme les plus nobles… Autrement dit, c’est la fin. Chacun défend son point de vue ; mais pour ma part je ne suis pas favorable à l’étiquetage.
Les analyses scientifiques et les vétérinaires ont avancé sur la question de l’étourdissement. Il doit être fait dans de bonnes conditions. L’homme interviewé dans le journal Libération qui, je vous le rappelle, est technicien vétérinaire et non vétérinaire, exagère. Quand l’étourdissement est réalisé à l’aide d’un pistolet, l’animal est totalement insensibilisé. Mais il est possible que, selon ce qui s’est passé, ce ne soit pas toujours le cas. Ainsi, l’asphyxie des cochons au CO2 ne marche pas toujours. C’est un sujet technique qu’il faut améliorer. Et comme le temps de passage dans le bain est réduit, cela augmente les cadences et certains animaux passent au travers. Il a des exceptions partout.
Il y a deux ans déjà, j’ai présenté, avec Patrick Dehaumont, la stratégie de la France pour le bien-être des animaux. Le premier axe concerne la recherche, car je suis parfaitement conscient que des progrès doivent être faits dans ce domaine. Par ailleurs, la loi d’avenir pour l’agriculture a créé un Centre national de référence bien-être animal. Vous le voyez, nous n’avons pas attendu la diffusion de ces images pour faire quelque chose ; nous avions anticipé. C’est la première fois qu’a été définie une stratégie bien-être animal qui concerne à la fois la naissance, l’élevage et l’abattage. Ce n’est pas un sujet tabou.
Madame Abeille, vous me demandez si le bien-être animal est une priorité. Bien que le ministre de l’agriculture ait tous les jours beaucoup de dossiers sur sa table, cette question est pour moi restée prioritaire. Dès 2014, nous avions défini une stratégie spécifique en faveur du bien-être animal et certains articles de la loi d’avenir traitent de cette question. La DGAL et son directeur avaient parfaitement identifié ce sujet, et j’ai fait en sorte de le mettre en œuvre. Nous n’avons aucune raison de ne pas vouloir améliorer le bien-être animal. Au contraire, tout doit être fait, car cela participe de notre capacité à maintenir les filières d’élevage et la consommation de la viande, même si elle diminue.
Maintenant, faut-il manger de la viande ? C’est une vraie question.
Mme Sylviane Alaux. C’est la liberté de chacun !
M. le ministre. Certes. Mais est-ce à dire qu’il y aurait, d’un côté, ceux qui mangent de la viande et qui ne seraient pas sensibles à la question de la souffrance animale, et de l’autre, ceux qui, en cessant d’en consommer, règlent le problème ? Beaucoup d’associations considèrent qu’il faut arrêter de manger de la viande. Je respecte totalement ce point de vue, mais je maintiens que la stratégie sur le bien-être animal est indépendante du choix qu’on peut faire, en tant que consommateur, de manger ou non de la viande. C’est pour moi clair et net. Et je ne vais pas, dans ce débat philosophique, me mettre dans la posture de celui qui doit choisir : chaque individu est responsable de ses choix de consommation. Notre responsabilité, c’est d’assurer le bien-être des animaux, car il n’y a aucune raison de les faire souffrir. Manger ou non de la viande est un vrai sujet. Mais le jour où l’on ne mangera plus de viande, il n’y aura plus d’animaux domestiques élevés dans de grands pays comme le nôtre ; il faut que chacun en ait conscience. Les animaux, quand on les voit dans les champs, c’est joli, c’est mignon… Et après, on voit des barquettes.
Moi qui suis issu du monde rural, je me souviens que dans les fermes, tout le monde voyait tuer un animal ; tout le monde participait à la tuée du cochon. Et les poules, les lapins… Et l’on savait parfaitement ce que devenait l’animal après avoir été tué : le lapin du pâté, la poule autre chose ; quant au cochon, je ne vous rappelle pas la fameuse formule… Il y avait un rapport direct. Or nos sociétés urbaines se sont coupées de cette réalité ; une « boîte noire » a été mise entre l’animal que l’on voit dans les champs et le steak haché que l’on mange. Certains enfants ne savent même pas que le lait qu’ils voient dans la brique vient d’une vache. C’est un vrai sujet : il va falloir réfléchir à la manière de faire redécouvrir aux gens ce qu’est la réalité des choses. J’en ai parfaitement conscience en tant que ministre et ancien enfant des fermes. Un steak, cela vient d’un animal, une côte de porc provient d’un cochon. Mais à cause de l’urbanisation et de l’industrialisation de l’alimentation, les gens ne le savent plus, ne le voient pas, quelquefois ne veulent pas le savoir. Je vous indique, au passage, que nous sommes l’un des derniers pays d’Europe à manger du poulet rôti servi à table. Dans les autres pays, le poulet n’est plus consommé entier et rôti mais en morceaux : du coup, on ne mange plus un poulet, mais des nuggets par exemple. L’urbanisation de la société et l’industrialisation ont été à l’origine de la disparition de certaines réalités qui interpellent lorsqu’elles refont surface. Le ministre que je suis n’est pas responsable de tout, mais il doit mettre en place les outils qui s’imposent.
Mme Geneviève Gaillard. Vous avez oublié de répondre à une de mes questions, monsieur le ministre ; pour ma part, je n’ai pas demandé que l’on rouvre les abattoirs de proximité, mais seulement si vous comptiez encore en fermer.
M. le ministre. Madame la députée, ce n’est pas moi qui ferme les abattoirs, et je n’ai pas l’intention d’en fermer. J’ai dit que nous avions 259 abattoirs…
Mme Laurence Abeille. Sans compter les abattoirs de volailles.
M. le ministre. Effectivement. C’est notre base de travail. Nous devons améliorer les choses. Il est sûr que je n’ai pas envie d’en ouvrir de nouveaux, mais je n’ai aucunement l’intention d’en fermer, sauf si nous sommes saisis de problèmes. Et j’en connais quelques-uns qui ont encore des difficultés…
Mme Geneviève Gaillard. Il fut une période où on a fermé des abattoirs.
M. le ministre. Oui, et il n’y a pas si longtemps, à Landivisiau par exemple. Et ce fut un dossier lourd à porter…
M. Guillaume Chevrollier. Il y a dans les abattoirs un poste clé : celui du responsable protection animale dont les attributions doivent certainement évoluer et le statut juridique être consolidé. Comment voyez-vous l’évolution des relations entre le RPA et l’administration vétérinaire présente dans les abattoirs, pour que le système soit gagnant sur le plan de l’organisation de l’abattoir comme sur celui de la protection animale, et sans que ce soit coûteux en termes de dépenses publiques ? Alors que les comptes publics de notre pays sont dans l’état que l’on connaît, il faut éviter que l’organisation retenue n’aboutisse à un renchérissement permanent des coûts. La généralisation du responsable protection animale dans l’ensemble des abattoirs, quelle que soit leur taille, ne risque-t-elle pas de mettre en péril des petits abattoirs ? Un RPA représente une charge supplémentaire, donc un problème de compétitivité.
Le lanceur d’alerte L214, association militante pro-végétarienne, a joué sur l’émotion collective qui est la tendance de notre époque. La conclusion des contrôles que vous avez diligentés montre que les images ne sont pas en phase avec la réalité de la quasi-totalité des abattoirs dont il faut saluer le professionnalisme et l’engagement des personnels qui exercent un métier dur mais nécessaire. Quelle campagne comptez-vous lancer pour faire savoir que la quasi-totalité des abattoirs fonctionnent correctement ? Quelles actions entendez-vous mener pour relancer la consommation de la viande ? En tant que ministre de l’agriculture, vous savez que l’élevage est en crise, dans la Sarthe notamment et en Mayenne. Il y a une attente aujourd’hui à la fois de nos éleveurs et de la filière agroalimentaire pour relancer la consommation de viande dans notre pays.
Dernière question, que je vous pose au nom de mon collègue Pierre Morel-A-L’Huissier qui a dû nous quitter : votre ministère s’est-il porté partie civile dans les affaires mises en lumière par l’association L214 ?
Mme Annick Le Loch. Monsieur le ministre, en vous entendant tout à l’heure présenter la synthèse des inspections, je m’interrogeais sur la diversité des abattoirs. À côté des abattoirs classiques, il y a des abattoirs intégrés à des outils industriels et d’autres intégrés à des groupes de distribution. Le rapport que vous avez présenté tout à l’heure permet-il de donner quelques éléments sur cette répartition ? Avez-vous observé dans ces différentes catégories d’abattoirs des différences dans la prise en compte du bien-être animal ou la protection animale ?
Ma deuxième question concerne la crise de l’élevage. J’entends évoquer des départs tardifs d’animaux dans les élevages de porcs ou des abattages conséquents de troupeaux de vaches allaitantes. Je ne sais pas si cela a des conséquences sur le fonctionnement des abattoirs. Chacun sait que les distributeurs se livrent une guerre des prix féroce. La course aux prix bas aurait-elle des conséquences sur le fonctionnement des abattoirs, maillons essentiels de la filière ?
M. William Dumas. Monsieur le ministre, je vous remercie pour toutes les réponses que vous nous avez apportées.
Vous nous avez dit que les sacrificateurs étaient agréés par des organismes eux-mêmes agréés. Mais, dans l’abattoir d’Alès, on a bien vu que le sacrificateur était un remplaçant. Il faudra donc bien un jour clarifier les choses.
Les patrons de cet abattoir que nous avons auditionnés nous ont indiqué que la formation au poste d’abattage durait quarante-huit heures. Et le président de notre commission d’enquête nous a relaté les propos du directeur de l’abattoir de Maubeuge qui peine à recruter du personnel, alors même que son établissement est implanté dans une zone où le taux de chômage est élevé. On voit bien que ce métier est peu couru. Il y a certainement des problèmes de cadence et de productivité. Lors de nos auditions, nous avons essayé de savoir quel était le prix de l’abattage, mais nous n’y sommes pas parvenus… On nous donne jamais le même prix. Il y a très certainement un problème de rentabilité vis-à-vis des autres pays. On sait bien en effet que certains porcs bretons étaient tués en Allemagne il fut un temps parce que les droits sociaux des salariés ne sont pas les mêmes que chez nous.
Au cours de nos auditions, il a été question, à plusieurs reprises, de l’installation de caméras de vidéosurveillance. Au début, je pensais que cela pouvait être une des solutions, mais maintenant que je vois à quel point ce poste est décrié, je me demande si une caméra ne ferait pas peser davantage encore de pression sur les gens qui exercent ce métier. Je ne suis donc plus aussi sûr que l’installation d’une caméra pour surveiller des gens soit une bonne idée.
Hier, à Bruxelles, vous avez indiqué qu’il fallait tenir compte du bien-être des animaux élevés en plein air. Vous avez raison : dans les Cévennes, par exemple, on cherche à faire certifier les élevages de poules qui sont en liberté et on lance le porc noir des Cévennes sous l’appellation « Baron des Cévennes ». Ce cochon, élevé en liberté, ne mange que des châtaignes ; les éleveurs ne parviennent pas à répondre à la demande, tant elle est forte. Les prix de ces produits sont nettement plus rémunérateurs que ceux des poules ou des cochons élevés en batterie.
Actuellement, des taureaux de Camargue sont élevés aux portes d’Alès. À côté de chez moi, dès que des terres se vendent, elles sont achetées par des gens qui élèvent des taureaux de Camargue. Mais comme nous ne sommes pas dans la zone de production, ces taureaux doivent être obligatoirement abattus dans l’abattoir de Tarascon. Le maire d’Alès, dont l’abattoir affiche un déficit de 500 000 euros par an, aurait bien aimé que son établissement puisse abattre les taureaux de Camargue. Cela aurait réglé bien des problèmes.
Enfin, je tiens à vous remercier pour les éclaircissements que vous nous avez fournis à propos de Martial Albar. En douze ans, il a effectué trois remplacements dans les abattoirs, nous avez-vous dit. De tels articles, que l’on peut voir à la une d’un journal comme Libération font mal. Je me demande à quel jeu se livrent les journalistes. Ils ne vérifient pas leurs sources. C’est vraiment grave.
M. Yves Censi. Monsieur le ministre, je vous remercie pour les éclaircissements que vous nous avez apportés. Nous avons eu droit à notre minute philosophique en réponse à certaines questions qui vous ont été posées… Pour ma part, je considère que notre commission n’a pas à se prononcer sur la question de la consommation ou de la non-consommation de la viande. Cela me paraît parfaitement hors sujet. Je me réjouis que vous ayez centré votre propos sur la souffrance animale. Le Code civil reconnaît désormais la notion de sensibilité de l’animal. Pour ma part, j’aurais parlé d’affect, de système émotionnel, comme pour l’ensemble des êtres vivants d’ailleurs ; en tout état de cause, il faut prendre garde à ce que notre commission ne dérape pas vers des sujets qui dépassent son objet.
Vous avez rétabli certaines vérités à propos de l’article de Libération que pour ma part je trouve assez scandaleux, et rappelé que la consommation de la viande était conditionnée à une certaine transparence pour nos consommateurs, au fait que tout le processus doit être opéré de manière digne, dans le respect de l’animal et en évitant totalement, autant que possible, qu’il ne souffre, avec un enjeu de fond : favoriser l’élevage, la consommation de viande et l’excellence de nos filières en France. Élu de l’Aubrac, je ne peux pas imaginer les montagnes de l’Aubrac sans vaches, et de race Aubrac, bien évidemment, avec des cornes !
L’abattoir de Sainte-Geneviève-sur-Argence, dans le nord de l’Aveyron, est actuellement confronté à un mouvement de grèves des techniciens et des vétérinaires de la DDCSPP. Les autorités administratives répondent que la grève est un droit, mais j’appelle votre attention sur ses conséquences. L’enlèvement des animaux dans les élevages est retardé ; je vous laisse imaginer les embouteillages que cela peut représenter sur des centaines de bêtes et les effets en termes de stress des animaux… Bien évidemment, cela pénalise les ateliers de production, et notamment l’activité viande hachée surgelée qui fonctionne en flux tendu. Cela déstabilise absolument tout. Pourrait-on envisager un service minimum, sans bien sûr remettre en cause le droit de grève ?
L’impact sur la filière et sur l’organisation des abattoirs n’est pas uniquement économique dans la mesure où l’on revendique maintenant dans la loi les effets sur l’affect des animaux. En fait, rien n’est organisé pour supporter ces grèves. Il s’agit souvent de grèves perlées, mais les abattoirs ne peuvent pas s’adapter lorsqu’ils sont prévenus seulement la veille ou l’avant-veille. Je vous laisse imaginer les dérèglements que cela peut entraîner.
M. le rapporteur. On a beaucoup parlé des animaux de boucherie et peu évoqué la volaille. J’ai l’impression que nous souffrons tous un peu d’anthropomorphisme, autrement dit que plus l’animal est gros plus l’on s’en sent proche, tandis que l’on fait moins attention à une volaille qui est un animal moins touchant. Pourtant, les cadences dans les unités d’abattage sont élevées aussi bien pour les lapins que pour les poulets. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré, sachant qu’il s’agit de processus très industrialisés et très concurrentiels où le coût représente, là aussi, une forte pression ? Pensez-vous qu’il faudrait concentrer nos efforts sur ces abattoirs ?
M. le ministre. Vous me demandez si le ministère a pu se porter partie civile. Non, il ne le peut pas, dans la mesure où les agents du ministère sont des auxiliaires de justice.
Madame Le Loch, il n’y a aucun lien entre la taille des abattoirs et les résultats après inspection. Aucun lien non plus entre les résultats et les statuts – abattoirs liés à des grands distributeurs, à des coopératives, etc. En la matière, je vois à peu près à qui et à quoi vous faites référence. Les inspections n’ont pas révélé de différences susceptibles d’être liées au modèle économique.
Le responsable protection animale lors de la mise à mort doit être inscrit en préfecture. Pour moi, le lien entre privé et public est évident. La responsabilité de l’abattoir est engagée pour ce qui concerne le respect des règles de bien-être ; pour notre part, nous avons une responsabilité globale sur le bien-être et sur les questions sanitaires. Le partenariat public/privé doit exister. Je le répète, pour que le système fonctionne et que la responsabilité soit parfaitement identifiée, le responsable protection animale lors de la mise à mort doit être inscrit en préfecture, son nom doit être disponible en préfecture ; et en tant que lanceur d’alerte, il doit être protégé ; sinon, cela ne sert à rien. J’en veux pour preuve qu’il y avait déjà un RPA dans un des abattoirs mis en cause, mais il ne disait rien. C’est sur ce point que doivent porter les évolutions législatives. L’abattoir doit aussi être sanctionné pour le comportement de ses salariés. J’ai été frappé de voir sur la vidéo de l’abattoir du Vigan comment les moutons étaient balancés de l’autre côté d’une rambarde. Et les pauvres bêtes revenaient… On avait perdu tout sens rationnel. D’où la question de la présence de caméras. En la matière, monsieur le rapporteur, je suis ouvert aux propositions que vous ferez, mais elles ne doivent pas conduire à ce que le salarié soit soumis à une forte pression qui pourrait le troubler psychologiquement et qui ne résoudra pas le problème.
La relation avec l’administration se fait via les préfectures et à travers les mesures que vous allez inscrire dans la loi sur la protection de ces salariés concernant le CHSCT et la formation. Comme les noms des RPA seront disponibles en préfecture, on pourra y avoir accès, notamment lors des discussions et des contrôles avec les associations. Il est très important de cadrer les choses pour pouvoir avancer.
Monsieur Dumas, les taureaux de Camargue ne peuvent pas être abattus à l’abattoir d’Alès, mais à Tarascon, pour la bonne raison que l’indication géographique protégée (IGP) Camargue se limite à la Camargue… C’est la règle et on ne la changera pas. Mais vous touchez du doigt le débat de fond en termes économiques : si vous multipliez les abattoirs, il y aura moins de bêtes à abattre dans chaque abattoir, ce qui affectera leur rentabilité – et le déficit de l’abattoir d’Alès atteint déjà les 500 000 euros, avez-vous dit. Voilà pourquoi je ne souhaite pas augmenter le nombre d’abattoirs.
Quel est le coût de l’abattage ? Il est fonction des investissements, des coûts de fonctionnement, des salaires, de l’amortissement, etc. Mais la difficulté, c’est qu’un abattoir, quelle que soit sa taille, fonctionne à l’envers de ce que fait un système industriel : d’ordinaire, dans l’industrie, on assemble ; dans un abattoir, on désosse, on désassemble. Du coup, entre le moment où l’animal est tué et où il est découpé, les produits qui sont le fruit de ce travail et qui doivent le financer sont complètement éclatés, avec des prix différents, et qui de surcroît varient selon la saison : vous avez plus de chances de valoriser le quartier arrière de l’animal l’été, tandis que l’hiver les parties avant sont davantage consommées, et par conséquent mieux valorisées. La valorisation du produit est également fonction des pièces : il est très difficile de savoir ce que représente l’abattage dans le prix d’une côte de porc, par exemple. Il y a aussi des produits transformés, comme le jambon, qui nécessitent une cuisson ou un affinage. Le coût de l’abattage est donc lié à l’investissement, à l’amortissement, aux charges de personnel, à la consommation d’énergie, qui est importante. Je n’ai pas les chiffres en tête, mais je pourrai vous donner le pourcentage d’un prix global de carcasse, sachant qu’une partie de la valorisation de la carcasse se fait aussi sur les peaux, d’où les débats qui ont eu lieu il y a quelques années sur la qualité des peaux et la lutte contre le varron. Si la qualité des peaux n’est pas correcte, c’est tout le cinquième quartier qui est mal valorisé. Et dans le prix, il ne faut pas oublier non plus la triperie. Il s’agit de sujets très compliqués et extrêmement délicats en termes économiques.
Monsieur Censi, vous m’interrogiez en fait sur les grèves liées au projet de loi El Khomri en cours de discussion au Parlement. Mais vous vouliez aller plus loin que nous : il y en aurait eu davantage encore… Quoi qu’il en soit, le droit de grève existe, je ne peux pas le remettre en cause.
M. Yves Censi. Bien entendu, monsieur le ministre, je connais le droit du travail et le droit de grève dans la fonction publique. Mais la loi, vous le savez, prévoit un service minimum quand cela s’avère nécessaire. Pour des questions de tous ordres, sanitaires philosophiques, émotionnelles puisqu’elles touchent au bien-être des animaux, on pourrait imaginer l’application d’un service minimum. Je pourrai en faire la proposition à notre commission d’enquête. À votre avis est-il possible de l’imaginer dans ce cadre spécifique, sans remettre en question le droit de grève dans la fonction publique ?
M. le ministre. Je verrai ce que votre commission en dira. Mais le ministre de l’agriculture que je suis vous répond non. Je ne vois pas comment on pourrait mettre en place un service minimum. La grève est un droit constitutionnel. Cela étant, vous êtes une commission tout à fait indépendante…
Monsieur le président, toutes les questions que nous avons abordées cet après-midi vont nécessiter un suivi. Nous vous enverrons les résultats de l’ensemble de l’enquête que nous avons effectuée le mois dernier. Vous avez eu la primeur de ces chiffres, et c’était normal. Votre commission a un rôle important à jouer. Tout ce qui peut concourir à dire ce qui se passe réellement est un élément de communication, et nous devons l’utiliser pour redonner confiance dans l’élevage et la consommation de viande.
Je veux revenir sur le rapport du CGAAER sur les abattages rituels, sujet extrêmement sensible dont on voit tous les enjeux.
M. le président Olivier Falorni. Nous devons rendre notre rapport au plus tard le 22 septembre.
M. le ministre. Je ferai tout mon possible pour que ce document soit intégré dans le vôtre. On voit, à travers vos questions, que c’est un sujet qu’il va falloir traiter. De toute façon, il fera l’objet d’un débat. Je suis très attaché, et je le dis à mes services, à ce que l’on puisse donner les moyens à votre commission d’avoir la partie qui concerne l’abattage rituel. Il est important que vous abordiez tous les sujets.
M. le président Olivier Falorni. Nous sommes vraiment très demandeurs de recevoir ce rapport le plus rapidement possible, sachant que le nôtre nécessite un temps de rédaction et une validation de tous les membres de notre commission. Le planning est très serré.
Monsieur le ministre, je vous remercie pour tous les éléments d’information dont vous nous avez livré la primeur. Cela démontre, une fois de plus, que nos actions sont complémentaires et combien il est nécessaire de travailler ensemble pour améliorer le bien-être animal dans nos abattoirs.
La séance est levée à dix-huit heures cinquante.
——fpfp——
11. Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Lasne, président, et Mme Sylvie Pupulin, secrétaire générale du Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV), de M. Stéphane Touzet, secrétaire général adjoint du Syndicat national des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture (SNTMA-FO) et de Mme Alexandra Taillandier, secrétaire départementale SNTMA-FO du Tarn.
(Séance du jeudi 19 mai 2016)
La séance est ouverte à neuf heures dix.
M. Olivier Falorni, président. Nous avons le plaisir d’accueillir ce matin des représentants du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV) et du syndicat national des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture (SNTMA).
M. Laurent Lasne et Mme Sylvie Pupulin s’exprimeront au nom du SNISPV dont ils sont, respectivement, président et secrétaire générale. M. Stéphane Touzet, secrétaire général adjoint, et Mme Alexandra Taillandier, secrétaire départementale du Tarn, prendront la parole au nom du SNTMA.
Je rappelle que les auditions de notre commission d’enquête sont ouvertes à la presse et visible par l’ensemble de nos concitoyens puisqu’elles sont retransmises en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale. Je crois savoir qu’elles sont suivies, parfois même très suivies. Il arrive également qu’elles soient diffusées en direct ou en différé sur la chaîne LCP.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Laurent Lasne, Mme Sylvie Pupulin, M. Stéphane Touzet, et Mme Alexandra Taillandier prêtent successivement serment.)
M. Laurent Lasne, président du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV). J’ai l’honneur de présider le syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire, qui représente les vétérinaires travaillant à titre principal pour l’État, soit environ 800 fonctionnaires, et 550 agents contractuels représentant 300 équivalents temps plein : certains travaillent donc à temps plein pour l’État, d’autres à temps très partiel. Notre syndicat ne représente que les personnels qui travaillent à plus de 50 % pour l’État.
Les images qui sont à l’origine de notre présence devant vous sont inacceptables. Elles ont choqué tout le monde, y compris les professionnels que nous sommes. En même temps, elles ne sont pas représentatives de l’activité des abattoirs français, ni même, je crois, de l’activité quotidienne des trois établissements mis en cause. Nous ne contestons évidemment pas la réalité de ces images, mais elles ne représentent probablement pas la réalité quotidienne des abattoirs en question.
Les abattoirs sont des entreprises fermées – on a parlé de « boîtes noires ». Après les salariés, les techniciens ou les vétérinaires que nos syndicats représentent sont probablement les personnes qui connaissent le mieux l’abattoir pour y travailler tous les jours. C’est donc à ce titre que nous répondrons à vos questions ; nous nous sentons tout spécialement concernés par la question de la protection animale, notamment en abattoir.
D’ores et déjà, la médiatisation qui a entouré ce sujet et les travaux du Parlement facilitent le travail de nos collègues en abattoir, en faisant émerger un problème qui restait jusqu’alors confiné dans la « boîte noire ».
M. Stéphane Touzet, secrétaire général adjoint du syndicat national des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture (SNTMA-FO). Le SNTMA est le premier syndicat des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture qui comprennent les inspecteurs sanitaires en abattoirs.
Je commencerai par quelques éléments de contexte.
Vous avez déjà découvert la grande diversité des abattoirs, que ce soit en termes de structure, d’activité ou de gestion. Il est important d’avoir à l’esprit que nous sommes chargés de faire appliquer une réglementation partout de la même manière, alors que les établissements sont tous différents.
Nous souhaitons aussi insister sur les conditions de travail en abattoir qui génèrent une grande pénibilité : des horaires particuliers, des écarts de températures importants, du bruit, de l’agitation, un travail posté avec, la plupart du temps, l’exigence d’un haut rendement ; d’où de la fatigue, des troubles musculosquelettiques, des accidents du travail. Et tout cela dans un contexte de mise à mort massive et de stress.
Certes, ce n’est pas le bagne : les conditions de travail évoluent ; j’espère que des salariés viendront vous parler de leur travail. Reste qu’il faut avoir ces données à l’esprit : lorsque l’on est très fatigué, on ne réagit pas de la même manière que lorsqu’on est serein dans un environnement chatoyant.
Il faut aussi savoir que tous les postes de l’abattoir ne demandent pas le même niveau de qualification. Mais on constate souvent une rotation massive des salariés, qui parfois remet en cause les efforts de formation.
J’insiste enfin sur le fait que l’essentiel aux yeux des opérateurs, c’est la production. Lorsque tout va bien, d’autres paramètres peuvent être pris en compte ; mais si les choses se compliquent, la priorité reste que la production se fasse. C’est un simple constat.
J’en viens aux missions des techniciens à l’abattoir.
Nous réalisons différentes tâches d’inspection et de contrôle officiels sous la responsabilité des vétérinaires. La protection animale en fait partie. Nous sommes donc présents en permanence aux postes d’inspection qui sont matérialisés et dans la plupart des cas adaptés à nos missions. Durant l’abattage, un inspecteur est assigné à ce poste spécifique. Pour le reste, nos missions peuvent s’exercer n’importe où dans l’abattoir, selon les nécessités. Mais si l’inspecteur est seul, il ne pourra le faire qu’après ; l’inspection systématique doit être effectuée coûte que coûte durant l’abattage, en direct.
Quant à nos relations avec les abatteurs, on pourrait les qualifier de complexes : il y a une relation contrôlé-contrôleur, mais également une relation de réelle proximité : nos tâches et nos journées de travail sont étroitement liées ; elles dépendent pratiquement les unes des autres. Nous sommes formés pour gérer cela et travailler dans ces conditions, mais cet élément doit aussi être pris en compte.
J’insiste sur la forte implication de nos collègues, particulièrement dans les petites structures dans lesquelles ils sont souvent amenés à s’adapter aux contraintes et aux problèmes de fonctionnement qui peuvent survenir : les journées de travail peuvent être totalement décalées parce qu’un camion arrive en retard… Les collègues parlent souvent de « leur » abattoir. Il faut aussi garder cela à l’esprit, même si, je le répète, nous sommes formés pour savoir quels sont notre place et notre rôle.
Quels sont nos moyens d’action ? Ils vont de la pédagogie et la persuasion, à la notification des anomalies, voire à la mise en demeure. Nous avons des cahiers de liaison, nous avons la possibilité de rédiger des rapports ainsi que des procès-verbaux. Nous pouvons, si cela est nécessaire, arrêter la chaîne d’abattage, mais il s’agit d’un acte lourd, d’une décision très difficile à prendre dans le contexte d’impératifs de production que je vous ai décrit, avec des gens qui travaillent à l’abattoir, des animaux qui attendent.
L’ultime recours est le déclassement d’un abattoir, qui peut être très lourd de conséquence. Il est également possible de proposer la suspension ou le retrait de l’agrément de l’abattoir.
Quelles difficultés principales peut-on rencontrer lors du contrôle officiel ?
Le problème principal est celui des effectifs de plus en plus tendus en raison des réductions de personnels. Durant des années, ces dernières n’étaient fondées que sur une approche statistique et des objectifs chiffrés, sans tenir compte du travail effectué. Il arrive nécessairement un moment où cela devient compliqué. Au moindre problème du côté des abattoirs ou des inspecteurs qui peuvent par exemple rencontrer des ennuis de santé, il devient très difficile d’avoir toujours la personne qualifiée et en état de travailler au bon endroit.
Autre difficulté, les fortes pressions économiques et politiques dont nous pouvons faire l’objet. Les enjeux financiers, sociaux, et agricoles sont lourds – ne serait-ce qu’en termes d’emplois ; nous en avons conscience. Dès qu’ils veulent agir, les inspecteurs savent qu’ils peuvent très vite devenir des « empêcheurs de tourner en rond ». C’est alors que l’implication, l’investissement de la chaîne hiérarchique deviennent essentiels. Si un inspecteur qui a mis un PV n’est pas soutenu à l’échelon supérieur, et que sa démarche n’aboutit pas, il deviendra la risée de l’abattoir dans lequel il travaille ; il sera même désigné comme celui qui veut nous empêcher de travailler et qui invente des histoires… Si vous êtes décrédibilisé sur votre lieu de travail, il devient très difficile de continuer à travailler au quotidien.
Vous souhaitez évidemment nous entendre sur les images diffusées.
Nous ne contestons pas leur véracité, mais elles ne sont pas du tout représentatives de la généralité des abattoirs. Nous les condamnons de manière nette et incontestable.
Ces images ont toutes été prises au niveau du poste d’abattage, autrement dit à l’endroit le plus sensationnel, le plus spectaculaire, le plus émotionnel de la chaîne. Il y a d’autres endroits où l’on voit des animaux vivants dans l’abattoir : au niveau des quais de déchargement, dans les loges, les couloirs… La question du bien-être animal ne se résume pas à ce qui se passe au poste d’abattage, loin de là. Des problèmes peuvent se poser dans bien d’autres endroits.
Trois problèmes ressortent des films que nous avons visionnés : le défaut d’étourdissement, les animaux échappés, et les maltraitances volontaires.
La question de l’étourdissement, nous ramène à celle du réglage des appareils. Il nous revient de vérifier qu’ils fonctionnent correctement, ce que nous faisons du mieux que nous pouvons. Votre commission d’enquête a beaucoup évoqué les abattages rituels qui constituent une exception à l’étourdissement – avec les abattages familiaux qu’il ne faut pas oublier car ils se pratiquent encore beaucoup dans les campagnes sur les petits animaux.
J’ai participé l’an dernier, au Royaume-Uni, à une conférence sur le bien-être animal : plus de 80 % des animaux abattus selon le rituel halal sont désormais étourdis soit de façon synchronisée, soit après jugulation – en revanche aucune dérogation n’est admise lors de l’abattage casher.
Ces abattages particuliers ne sont pas compris par tout le monde. Ils sont même parfois instrumentalisés pour justifier les dysfonctionnements de postes d’étourdissement. « De toute façon, hier, vous ne nous avez rien dit et, demain, vous ne direz rien lorsque nous abattrons différemment » nous rétorque-t-on ! Tout cela n’est donc pas anodin, même si nous n’avons pas de position claire sur le sujet.
Si les animaux s’échappent, c’est souvent que les équipements ne sont pas adaptés à une espèce ou à leur gabarit. Les abattoirs peuvent changer d’activité ou ne pas disposer de tous les équipements nécessaires. La qualité de la contention compte aussi : les animaux ne réagissent pas de la même manière selon la façon dont on « s’adresse » à eux. La question de la formation des personnels est essentielle en ce domaine. Certains savent très bien faire, d’autres moins.
Ce qui relève de la maltraitance, et les crises de violence des opérateurs dont témoignent les images sont à la fois pour nous complètement inexcusables et, j’allais dire, incompréhensibles. Ou bien nous avons affaire à des malades qu’il faut diagnostiquer, et ils doivent changer de métier, ou bien, et c’est ce que les collègues qui ont été confrontés à ces situations nous disent, il s’agit de gens qui ont « pété les plombs » à cause de l’accumulation des problèmes, des dysfonctionnements, de la fatigue et du stress. Je ne cherche évidemment à excuser personne. Si nous constatons de tels comportements, nous n’avons qu’une seule conduite à tenir : les sanctionner si nous n’avons pas pu prévenir. Nous n’avons malheureusement pas d’autres explications que ces deux-là.
Avant de conclure, permettez-moi de faire un point sur l’actualité des problèmes de bien-être animal.
J’ai parlé de l’étourdissement et des mauvais traitements, mais il faut aussi signaler qu’arrivent parfois à l’abattoir des animaux qui ne sont pas en état d’être abattus. Notre travail consiste aussi à les identifier. Ils n’auraient pas dû faire le trajet : il fallait soit les conserver à l’élevage soit les euthanasier. Ce problème de bien-être animal ne doit pas être imputé à l’opérateur. Certaines images sensationnelles ne sont pas le fait de l’abattoir : l’élevage est un monde vivant, il peut aussi s’y poser des problèmes.
Plusieurs pistes ont été évoquées pour des améliorations.
La solution des caméras nous semble un peu surréaliste. Qui va regarder ce qu’auront filmé plusieurs caméras pendant dix, douze, quatorze ou quinze heures ? Ce sera un travail énorme. Tout dépend aussi de l’endroit où elles seront placées. Nous avons un peu de mal à imaginer comment cette solution s’appliquerait, mais nous sommes évidemment prêts à travailler sur le sujet, sachant qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur l’aspect légal de la question.
La création de référents bien-être animal et le statut de lanceur d’alerte peuvent être une solution efficace quand les choses vont bien, et même un « plus » indispensable termes de formation, de progrès, de tout ce qu’on voudra. En revanche, lorsque les choses vont mal, nous savons d’expérience que l’action des référents est limitée, voire totalement illusoire – les opérateurs le confirment eux-mêmes.
La création d’un délit de maltraitance est une autre piste importante. Le passage de la contravention au délit rend toutefois les choses plus compliquées. Il reste essentiel de disposer d’une réglementation opérationnelle : on peut faire toutes les réglementations qu’on veut, encore faut-il être en situation de les faire appliquer.
Pour conclure, nous nous considérons certainement comme le dernier rempart lorsque les choses vont mal – le « nous » désigne les services. Fragiliser ce rempart hypothèque l’avenir en termes de bien-être animal et de sécurité alimentaire.
La révision en cours du règlement européen 882/2004, qui est notre base réglementaire, notamment celle de son article 15, nous inquiète beaucoup. Cette révision pourrait donner à la Commission européenne les pleins pouvoirs pour modifier les modalités de réalisation des contrôles officiels, alors que ceux-ci relèvent plutôt du pouvoir législatif. La révision de cet article pourrait modifier les règles en matière de présence des inspecteurs et de délégation des missions. Le « trilogue » ayant lieu en ce moment, nous n’en savons pas davantage, mais les informations dont nous disposons ne sont pas très rassurantes.
M. le président Olivier Falorni. Vous êtes effectivement un maillon essentiel de la chaîne, parfois même l’ultime maillon. Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt nous a présenté hier les résultats de l’inspection générale qu’il a diligentée après le scandale causé par la diffusion de vidéos de l’association L214. Ces résultats sont assez éclairants. Comment se sont déroulées ces inspections spécifiques relatives à la protection animale ? Peut-on imaginer que d’autres phases d’inspection massives, généralisées et inopinées seront organisées à l’avenir sur cette même thématique ?
Hier matin, un quotidien a publié une interview de M. Martial Albar, qui se présente comme un ex-inspecteur des services vétérinaires. Celui-ci dresse un panorama cataclysmique des abattoirs français. Nous avons évoqué la question avec le ministre qui nous a fourni quelques éléments sur le parcours professionnel de cette personne. M. Albar soutient qu’aucune réflexion n’est menée sur l’étourdissement. Cela m’a surpris, car notre commission d’enquête a reçu la semaine dernière plusieurs chercheurs et universitaires qui ont précisément travaillé sur ce sujet.
Quels sont les signes de perte de conscience et de reprise de conscience de l’animal que les techniciens et les vétérinaires utilisent en abattoir ? Sont-ils identiques à ceux utilisés par les opérateurs, comme ceux de l’abattoir de Feignies, près de Maubeuge, où nous nous sommes rendus le lundi 9 mai au matin de façon inopinée ?
On peut aujourd’hui considérer que le principe de la vidéosurveillance à l’intérieur des abattoirs fait quasiment l’unanimité. Le ministre a lui-même indiqué qu’il n’y était pas hostile par principe. En revanche, les conditions de mise en œuvre, les règles et les modalités applicables font aujourd’hui débat. Êtes-vous favorables à la mise en place de ces dispositifs ? Selon vous, qui devrait être en charge du visionnage et du contrôle de ces images, notamment celles de la phase critique de l’étourdissement et de l’abattage ? Nous savons comme vous que la question du bien-être animal se pose lors de toutes les phases, que ce soit au moment du transport ou dans les salles de stabulation, mais celle-là est particulière.
M. Laurent Lasne. Le ministère a dû réagir à l’actualité : les inspections spécifiques à la protection animale sont une bonne chose. Elles ont été menées en terrain favorable : les abattoirs étaient réceptifs en raison de l’écho médiatique du scandale. Autrement dit, le terreau est fertile et l’on peut espérer que ces inspections seront suivies d’effets et que les abatteurs intégreront les remarques auxquelles elles ont donné lieu, y compris celles qui leur avaient été notifiées depuis longtemps, mais dans des cadres moins formels et médiatiques, et mèneront les actions correctrices nécessaires. Cela fera progresser la situation.
Rappelons que le rôle des services vétérinaires dans les abattoirs ne se limite pas à la protection animale. L’inspection permanente en abattoir a trois objectifs. L’un consiste à repérer les maladies contagieuses qui ne l’auraient pas été en élevage, notamment grâce à l’inspection ante mortem. C’est en bouverie d’abattoir que le Royaume-Uni a détecté la fièvre aphteuse sur son territoire. Un autre objectif consiste à protéger la santé publique : ces services garantissent que la viande mise sur le marché est propre à la consommation humaine. Les abattoirs, par le fait qu’ils constituent des goulots d’étranglement, ont énormément fait progresser la filière viande sur ce plan. Je rappelle que des milliers d’élevages apportent leurs animaux en abattoir, et que la viande en ressort, pour alimenter des milliers de boucheries ou d’établissements de découpe. L’abattoir a été déterminant pour faire reculer des maladies contagieuses pour l’homme, comme la tuberculose. Un dernier objectif consiste, pour les services, à veiller à la protection des animaux en abattoirs. Les actions des services en abattoir sont très codifiées : une inspection ante mortem obligatoire – chaque animal doit être vu vivant – est suivie d’une inspection post mortem, également obligatoire, qui est une sorte de mini-autopsie de l’animal mort. Chaque carcasse est inspectée avec les abats correspondants : elle fait l’objet d’un certain nombre d’observations, de palpations, d’incisions, et de prélèvements très codifiés. Ces deux étapes sont des passages obligés, on n’y coupe pas, et l’engagement des services publics est matérialisé par l’apposition d’une estampille sur la carcasse, un sceau de l’État, qui atteste que celle-ci est propre à la consommation. Ces deux inspections sont particulièrement consommatrices d’effectifs, et leur volume est fonction de l’activité de l’abattoir, sur laquelle nous n’avons pas la main.
De ce fait, lorsque les effectifs ont diminué, le nombre des personnels affectés à l’inspection ante et post mortem n’a pas décru. Les réductions d’effectifs ont en revanche eu un impact sur les autres catégories de personnels effectuant des tâches moins codifiées, comme la supervision du tri des sous-produits, l’inspection d’hygiène des ateliers de découpe en aval de l’abattoir, mais aussi les inspections aux postes d’étourdissement et de saignée.
Il est donc possible que la réduction des effectifs de 20 % ait eu comme conséquence un allégement de la fréquence des contrôles en protection animale. Nous espérons que, derrière l’action ponctuelle menée actuellement, un objectif sera fixé en termes de régularité pour des inspections sur ce sujet.
Je ne connais pas M. Albar. J’ai plutôt tendance à faire confiance aux organismes scientifiques qui sont venus témoigner devant vous plutôt qu’à un article de quotidien. Les chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), que vous avez reçus, estiment que l’électronarcose fait perdre conscience à l’animal. En tant que vétérinaire, j’ai l’impression que c’est bien le cas. Je ne veux pas commenter davantage des propos parus dans la presse.
Il n’existe pas un signe unique qui attesterait à coup sûr de la perte de conscience de l’animal. Nous sommes sur du vivant. C’est ce qui fait la complexité de notre métier, mais aussi sa richesse. Il y a d’ailleurs du vivant des deux côtés : au-delà de l’aspect biologique de l’animal, les interventions manuelles humaines restent nombreuses, malgré la mécanisation. Les collègues de l’INRA et de l’ANSES ont évoqué devant vous quelques signes que nous utilisons. Certains doivent être interprétés avec prudence, comme le réflexe oculo-palpébral. On touche l’œil de l’animal ; s’il ne cligne pas de l’œil, on peut considérer il n’est pas conscient ; s’il cligne de l’œil, il peut être conscient, mais il peut ne pas l’être… Autrement dit, certaines interprétations peuvent n’être que conservatoires. Il faut donc savoir croiser les signes : le réflexe oculo-palpébral, le maintien d’une respiration rythmique, le positionnement de la tête, la réaction à la menace… Il est indispensable d’être présent au poste d’abattage pour évaluer ces signes et pour pouvoir réaliser des stimuli sur l’animal.
Cela nous amène à la question de la vidéosurveillance. Pourquoi pas ? Mais attention aux formules magiques : il n’y en a pas. La vidéosurveillance pourrait être une aide pour l’inspection au poste de saignée, mais elle ne remplacera pas l’inspection à ce poste, effectuée à une fréquence régulière à déterminer. Cela peut être un complément.
Pour ce qui est des images enregistrées, c’est au responsable de l’abattoir en premier lieu qu’il revient de les exploiter pour superviser ses équipes, mais aussi pour l’empêcher de se dédouaner de sa responsabilité. Reste à voir si les services d’inspection pourront utiliser ces images par sondages ; encore faudrait-il savoir quelle charge de travail cela représente : il serait absurde de retirer des inspecteurs des postes physiques pour les installer derrière un écran. Les images pourront-elles être utilisées comme preuve pour prendre des mesures de police administrative ou des mesures pénales ? Cela aussi mérite d’être creusé.
Faisons cependant attention aux images. Certaines de celles qui ont été diffusées par l’association L124 sont totalement impossibles à interpréter. Lorsque l’on voit, de dos, un animal suspendu en train de « pédaler », on ne sait pas s’il s’agit de mouvements conscients, parce qu’il souffre, ou de mouvements réflexes – dans ce cas l’animal ne souffre pas. Pour s’en assurer, il faut voir tout l’animal et pratiquer des stimuli. Certaines réactions très spectaculaires pour le grand public ne traduisent pas nécessairement une souffrance animale : ce ne sont que des mouvements réflexes.
L’ouvrier d’abattoir est le premier responsable pénal des actes qu’il commet. En même temps, la direction de l’abattoir ne peut pas s’exonérer totalement de ses responsabilités dans un certain nombre de situations. C’est elle qui a les leviers sur la formation de son personnel, sur la cadence de la chaîne, sur le format des animaux traités, sur le choix du matériel. Si l’abattoir a acheté un matériel destiné aux gros animaux et qu’il en commande des petits, l’opérateur ne pourra pas travailler correctement. Peut-être faudrait-il réfléchir, en cas de maltraitance récurrente, à impliquer pénalement le responsable de l’établissement au-delà du seul opérateur.
M. Stéphane Touzet. Peut-on imaginer voir perdurer et même développer les inspections relatives au bien-être animal ? Nous le souhaitons parce que l’ouverture et la transparence permettent d’avancer. En tant qu’inspecteurs, lorsqu’on nous parle de nouvelles inspections nous disons oui, mais nous nous demandons toujours qui va les faire, quand et comment… Je ne vois pas d’objection sur le principe, mais il faut régler les vraies questions qui sont pratiques et matérielles.
Je vous confirme que Martial Albar est bien un ancien technicien des services vétérinaires – nous portions ce nom, à l’époque. Je ne connais pas son cursus professionnel ; il vous a été présenté, je n’y reviens pas. Son interview est quasiment un procès-verbal. Lorsque nous sommes amenés à rencontrer le procureur, nous lui faisons part de nos constats sous cette forme : « Je me suis rendu à tel endroit à telle date – il ne le dit pas, mais c’est peut-être mieux –, j’ai vu ceci, j’ai vu cela. » Il est possible qu’il ait vu ce qu’il raconte, nous n’allons pas le contester, mais nous nous interrogeons : qu’a-t-il fait de ce qu’il a constaté à l’époque ? Nous sommes assermentés, et lorsque nous sommes témoins de scènes comme celles qu’a vues M. Albar, nous sommes tenus d’agir, même s’il nous appartient de faire preuve de discernement selon le contexte et les actes concernés. Reste que si nous constatons des infractions, notre première obligation est d’en référer à la justice, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions du type de celles que décrit M. Albar. Il s’exprime douze ans après les faits ; mais sur le moment, qu’a-t-il fait ?
Bien sûr, il peut nous arriver de voir ce genre de choses. Mais il faut tout de même prendre cet article avec précaution : il part de faits extrêmes et exceptionnels et glisse ensuite vers la description de pratiques comme l’éviscération, qui sont peut-être « gores », comme on dit aujourd’hui, mais qui font partie de l’abattage. C’est comme cela, et c’est fait aussi proprement et aussi déontologiquement que possible, nous sommes là pour y veiller de notre mieux. Mais faire un lien direct entre des scènes extrêmes et le quotidien de l’abattoir ne nous paraît pas procéder d’un raisonnement très sain.
De la même façon, le rapport rédigé par Marcel Albar pour l’association L214, cherche à tirer des règles de faits constatés. Ce n’est pas ainsi que l’on raisonne : on peut casser une règle à partir d’un contre-exemple, mais on ne peut pas en construire une à partir d’un seul exemple. C’est en tout cas ce que j’ai appris à l’école…
Mme Alexandra Taillandier, secrétaire départementale SNTMA-FO du Tarn. Je reviens sur la question des signes de perte de conscience des animaux. En raison de la baisse des effectifs, les collègues ne peuvent pas se trouver en permanence au poste d’inspection qui se situe au niveau de la mise à mort pour s’assurer de la perte de conscience des animaux. Dans bon nombre d’abattoirs, les ouvriers en charge de la mise à mort effectuent eux-mêmes cette vérification. Ils sont formés pour cela, et leurs références en la matière sont les mêmes que les nôtres. Ils sont censés vérifier l’état de conscience de l’animal avant de l’affaler et de le saigner.
Pour revenir sur le cas de notre ancien collègue, je crois que chacun vit l’abattoir différemment. Travailler en abattoir exige d’avoir suffisamment de recul dans l’approche de la mort et surtout de ne pas tomber dans le sentimentalisme. Il est très important de savoir garder la distance nécessaire afin de mener nos inspections en toute connaissance de cause et en toute impartialité.
M. Stéphane Touzet. Qui visionnera et contrôlera les images prises par les caméras qui pourraient être installées dans les abattoirs ? Cela représenterait, en tout cas, un travail considérable. Que fera-t-on de ces images ? Sur ce sujet, nous avons plus de questions que de réponses.
Mme Alexandra Taillandier. Ces vidéos pourraient être très utiles en termes de pédagogie pour le personnel de l’abattoir si les choses sont mises en place correctement par les responsables de l’entreprise. Les personnels des abattoirs se réunissent régulièrement pour travailler sur les questions d’hygiène ou de protection animale – dans de nombreux abattoirs que je connais, ces réunions sont mensuelles. À cette occasion, le visionnage d’extraits de vidéos pourrait être l’occasion de corriger le tir en cas de besoin, d’être plus réactifs.
M. Stéphane Touzet. Les vidéos peuvent incontestablement constituer un outil de pression sur les opérateurs car ils sauraient qu’ils sont filmés – un peu comme des radars sur les autoroutes. Cependant, certains aspects de ce dossier nous dépassent totalement, notamment ceux concernant les relations au sein des équipes des abattoirs, ou ceux relatifs à la réglementation. Nous ne sommes pas du tout mandatés pour nous prononcer sur ces sujets.
En tout cas, dans l’état actuel des choses et de nos effectifs, j’imagine mal nos services visionner des heures de film à longueur de journée. Une question se pose en effet : qu’en serait-il d’images aussi choquantes que celles diffusées par L214 si elles n’étaient pas visionnées ? À nouveau, le sujet nous dépasse un petit peu.
Mme Sylviane Alaux. Le bien-être animal est aujourd’hui sur le devant de la scène alors que, jusqu’à maintenant, il faut reconnaître, en toute honnêteté, que nous n’étions pas très curieux de savoir ce qui se passait dans la « boîte noire » des abattoirs. Nous ne nous interrogions pas davantage d’ailleurs sur les élevages ou le transport des animaux jusqu’à l’abattoir. En fait, deux sujets de préoccupation dominaient, au demeurant parfaitement légitimes : la sécurité des salariés, même si beaucoup reste à faire dans ce domaine sur le plan de la formation et des pratiques, et surtout, le consommateur ne s’en plaindra pas, la qualité des produits qui arrivent dans son assiette.
Monsieur Touzet, vous déclarez que les faits de maltraitance sont exceptionnels. En votre âme et conscience, en êtes-vous sûrs, en êtes-vous intimement persuadé ? Pour ma part, je n’en suis pas aussi convaincue.
En vous entendant tous, je me dis que vous n’êtes sans doute pas mécontents que d’autres aient enfin mis le sujet sur la place publique. La maltraitance est là, on ne peut pas continuer à se voiler la face : parce que vous observez tout cela de plus près que le consommateur, vous pensez qu’il est temps que l’on se penche sur le problème. Suis-je en train de me tromper ?
M. Jacques Lamblin. Nous avons écouté très attentivement vos propos : ils viennent de gens qui sont sur le terrain et qui savent de quoi ils parlent.
Monsieur Touzet, vous nous avez décrit, dans votre propos liminaire, un métier difficile et des conditions de travail contraignantes : parliez-vous des ouvriers des abattoirs ou des personnels des services sanitaires ?
Monsieur Lasne, si je vous ai bien compris, parmi les missions que vous exercez en abattoir, celle relative à la protection de la santé publique n’a pas eu à souffrir des baisses d’effectifs constatées ces dernières années. Est-ce à dire que vos autres missions, comme celle relative à la prise en compte du bien-être animal, constituent des variables d’ajustement ? Le curseur s’est-il beaucoup trop déplacé en défaveur de la protection animale ou de l’inspection ante mortem ? Avez-vous le temps d’inspecter les animaux dans les bouveries avant l’abattage ?
Monsieur Touzet, en nous détaillant vos moyens d’action, vous avez insisté sur l’importance pour un inspecteur du soutien que doit lui apporter sa hiérarchie. Rencontrez-vous fréquemment des problèmes de ce point de vue ?
Je vous ai entendu dire que 80 % de l’abattage halal se ferait avec étourdissement…
M. Stéphane Touzet. Au Royaume-Uni.
M. Jacques Lamblin. Ce détail m’avait échappé. Cela répond à ma question.
Pensez-vous les uns et les autres qu’il serait possible d’archiver l’ensemble des images qui pourraient être filmées en abattoirs ? Il ne me paraît guère envisageable qu’elles soient visionnées intégralement en direct. En revanche, les images archivées pourraient être utilisées à des fins pédagogiques ou pour témoigner, à charge ou à décharge, du comportement des employés ou du fonctionnement du matériel. Cette solution, qui ne suppose pas un visionnage permanent, vous paraît-elle intéressante ? Monsieur Lasne, vous considérez que les images doivent être visionnées par la direction de l’abattoir. Mais le fait que l’œil du patron soit en permanence fixé sur le travail des ouvriers ne pose-t-il pas un problème social ?
M. William Dumas. N’ayant jamais visité d’abattoir, j’ai découvert certaines choses en vous écoutant.
Monsieur Touzet, vous avez eu l’air plutôt réservé, pour ne pas dire réticent, à l’idée d’utiliser des caméras dans l’abattoir. De votre côté, monsieur Lasne, vous considérez que le directeur de l’abattoir pourrait ainsi superviser ses équipes.
M. Laurent Lasne. Pas vraiment.
M. William Dumas. C’est ce que vous avez dit. En tout cas, c’est vraiment ce qu’il ne faut pas faire, si vous voulez mon sentiment. Comme M. Lamblin, je pense que l’on ne peut pas tout visionner et que les images peuvent, à la limite, permettre d’effectuer des contrôles ponctuels. Mais, elles ne doivent en aucune manière servir à vérifier si le personnel respecte la cadence – cela a été rappelé, nous sommes dans un univers marqué par le stress et les impératifs de production et de rentabilité.
Nous parlons du bien-être animal, mais il ne faut pas oublier celui des hommes, qui travaillent dans des conditions très éprouvantes. M. Touzet a évoqué la pénibilité des métiers de l’abattoir. Nos collègues qui ont visité hier celui de Feignies, dans le département du Nord, territoire durement touché par le chômage, nous ont rapporté que le directeur était prêt à prendre vingt personnes en formation, s’il les trouvait !
Ces métiers sont très difficiles. Les salariés sont soumis au stress alors qu’ils peuvent par ailleurs rencontrer des problèmes « personnels », familiaux ou autres. L’abattoir du Vigan, dans lequel certaines des images diffusées ont été filmées, se trouve dans ma circonscription. Le jeune que l’on voit jeter des moutons a complètement pété les plombs – vous-même avez employé l’expression, monsieur Touzet. Mais j’ai parlé avec les gens : ce jeune, il n’était pas comme ça. Peut-être que l’on flanche lorsque l’on est pris dans un engrenage, vous l’avez dit aussi.
Hier, le ministre nous a indiqué que des problèmes ont été détectés dans un tiers des 259 abattoirs inspectés au mois d’avril : 99 rappels à la règle ont été émis. Ces chiffres sont tout de même relativement élevés. Vous nous avez fourni certaines explications, comme le fait que vous ne pouvez pas en même temps, occuper un poste d’inspection qui exige une présence permanente, et vérifier ce qui se passe ailleurs dans la chaîne. Vous êtes aussi parfois considérés comme des « empêcheurs de tourner en rond », ce qui ne rend pas votre travail aisé : vous vous retrouvez entre le marteau et l’enclume. Faire remonter les choses devient de plus en plus difficile. On sait bien que c’est la direction de l’abattoir qui a la responsabilité des cadences, de la production, de la rentabilité ; je me doute que le dialogue ne doit pas être toujours évident.
La formation des abatteurs n’est peut-être pas suffisante – on nous a parlé d’une durée limitée à quarante-huit heures. Pensez-vous qu’il faudrait davantage de formation initiale et de formation continue ? M. Touzet a parlé des rotations entre les postes ; or certains exigent une plus grande technicité que d’autres.
Il peut aussi y avoir des difficultés liées au matériel. Alors que les plus gros abattoirs sont spécialisés par espèce, les plus petits font tout – celui de Vigan produit 300 tonnes par an. Il faut avoir le matériel adapté. Quand les bêtes ont toutes le même calibre, à peu de choses près, c’est plus facile.
La baisse de 20 % des effectifs a sans doute contribué à ce que, parmi les trois missions que vous nous avez décrites, monsieur Lasne, la protection animale en abattoir ait bénéficié de moins d’attention que le sanitaire et la santé publique : après les crises de la vache folle et autres, il n’est pas surprenant que la priorité leur ait été réservée aux dépens de ce qui posait le moins de problèmes. Quel est votre point de vue sur ce sujet ?
Dans ma circonscription, 50 % de la production de l’abattoir d’Alès est traitée selon le rituel halal. Quelle est la formation exacte des sacrificateurs ? Il paraît que des organismes religieux organisent des formations. Certaines mosquées seraient d’accord pour pratiquer un étourdissement, les autres le refusent. Quel est votre point de vue sur ces sujets ?
D’après ce que l’on nous a dit hier de votre ancien collègue qui a donné une interview à Libération, il semblerait que ce monsieur ne soit allé que trois fois dans un abattoir en douze ans… Votre parole ayant un autre poids que la sienne, il serait intéressant que vous puissiez vous exprimer clairement sur ses propos, d’autant que votre audition est ouverte à la presse : elle verra ainsi ce qu’il lui arrive de rapporter sans se soucier de respecter la déontologie ou de vérifier ses sources…
Mme Annick Le Loch. Pour ma part, contrairement à William Dumas, j’ai visité quelques abattoirs, mais un passage rapide ne permet pas d’en connaître le fonctionnement.
Lorsque je suis sur place, j’entends presque toujours les salariés dire que la cadence a été réduite en raison de la présence de visiteurs. À votre connaissance, diminue-t-on toujours le rythme de la chaîne d’abattage dans ce cas ?
Lorsque les abattoirs fonctionnent, les inspecteurs et les vétérinaires assurent-ils une surveillance permanente, sont-ils toujours présents ? Les plages horaires sont parfois très longues – plusieurs abattoirs sont organisés en deux-huit.
Certains types d’abattoirs fonctionnent-ils mieux que d’autres ? Les gros abattoirs mono-espèce ne rencontreraient aucun problème majeur au contraire des petits abattoirs multi-espèces, où ce peut être parfois plus compliqué.
On nous a parlé de moments qui peuvent être difficiles à gérer pour les opérateurs à la tuerie. Le tueur, ou un autre opérateur exposé, peut en effet ne pas se sentir bien à un moment donné. Ces salariés font-ils l’objet d’une attention particulière afin de prévenir les situations qui pourraient dégénérer ? Même si l’on s’habitue à tout, l’ambiance et les conditions de travail en abattoir ne sont pas faciles.
Le ministre nous a annoncé hier un maintien des effectifs, qui tranche avec les suppressions passées. Constatez-vous dans la réalité que les postes sont préservés ?
Les abattoirs rencontrent-ils vraiment des difficultés pour recruter ? Sur ce point, j’ai recueilli des témoignages contradictoires : le représentant des cadres du plus gros opérateur français me dit qu’il n’y a aucune difficulté de recrutement dans ses structures.
Existe-t-il des pays, notamment dans l’Union européenne, dont le fonctionnement des abattoirs vous paraîtrait exemplaire ?
Nous avons entendu parler d’une grande dame américaine, Mme Temple Grandin. Pourriez-vous nous dire ce qu’elle a apporté à l’abattage ?
M. le président Olivier Falorni. Je vous prie d’excuser mon départ mais je dois intervenir dans quelques instants dans l’hémicycle sur la prorogation de l’état d’urgence. Je laisse la présidence à Mme Annick Le Loch.
(Mme Annick Le Loch préside la réunion en remplacement de M. Olivier Falorni)
M. Laurent Lasne. Si vous le permettez, je laisserai mes collègues traiter de la question relative à Temple Grandin,…
M. Stéphane Touzet. Moi aussi ! (Sourires.)
M. Laurent Lasne.… faute d’être en mesure d’y répondre.
Formellement, la direction de l’abattoir est l’interlocuteur principal du service d’inspection, même si, évidemment, des relations se nouent au quotidien avec les ouvriers ou l’encadrement. Il n’appartient pas aux services d’inspection de l’État de gérer telle ou telle situation individuelle d’un salarié qui aurait des difficultés psychologiques ou autres. Si nous sommes confrontés à cette situation, nous en référons au directeur de l’abattoir qui devra réagir. Je ne sais pas si les fédérations d’abattoirs ou les abatteurs intègrent ces risques psychologiques, mais j’espère que c’est le cas, car les métiers en question sont particuliers.
Madame Allaux, sommes-nous contents que les problèmes des abattoirs aient été mis en lumière par cette affaire ? Nous le sommes en partie, car cela valorise le secteur industriel de l’abattage, mais aussi l’activité de nos services dans les abattoirs qui est méconnue – notre activité dans les restaurants ou contre les maladies animales comme l’influenza aviaire, en ce moment, dans le Sud-Ouest, l’est bien davantage. Cela valorise, en conséquence, un métier qui peut être jugé ingrat, mais qui est utile : on a rappelé nos trois missions principales.
La médiatisation nous aide aussi à faire passer nos messages. Nous sommes longtemps restés avec l’abatteur dans une relation bilatérale, de contrôleur à contrôlé, en vase clos, une sorte de jeu de chat et de la souris. Cela pose deux difficultés.
Comme nos collègues techniciens, nous devons sensibiliser l’ensemble de la chaîne hiérarchique, de notre direction jusqu’au préfet. La situation en la matière dépend du département concerné, mais les choses sont devenues plus compliquées avec la réforme de l’administration territoriale de l’État. Les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ont un champ d’intervention très large, qui va de l’hébergement d’urgence pendant le plan grand froid jusqu’à l’intégration des réfugiés politiques. Dans un périmètre aussi vaste, la protection animale en abattoir peut ne pas se trouver sur le haut de la pile des priorités du directeur ou du préfet. Et en toute honnêteté, je ne connais pas d’abattoir qui ait été jusqu’à présent fermé en France uniquement pour des raisons de protection animale : on a vu des abattoirs fermés en raison de conditions d’hygiène qui mettaient en péril la santé publique – décision peu facile, en raison des emplois directs et indirects à la clé –, mais jamais pour non-respect de la protection animale. Sans être catégorique, je ne crois pas qu’il existe de précédent de ce genre. Il est bon que ce sujet soit mis en avant : cela va sensibiliser les abatteurs.
Je travaille dans le secteur depuis vingt ans : les objectifs de sécurité des aliments ont été largement intégrés. Personne ne remet aujourd’hui en cause l’objectif de produire des viandes saines, mais il a fallu du temps. Cela sera peut-être aussi le cas pour l’intégration pleine et entière des enjeux de protection animale. Les aspects générationnels – les ouvriers d’abattoirs étaient souvent recrutés autrefois sur leur capacité à être durs au mal, et un peu insensibles – et la féminisation du personnel feront sans doute évoluer les choses.
Afin d’éviter que la « boîte » ne se referme lorsque les feux de l’actualité se seront détournés, nous avons une proposition à vous soumettre : ne pourrait-on imaginer une sorte de comité d’éthique des abattoirs, à l’image de ce qui existe dans d’autres secteurs d’activité, comme l’expérimentation animale ? Il peut être nécessaire de tester des médicaments sur les animaux, et les entreprises concernées se dotent généralement de comités d’éthique qui permettent à la société civile d’avoir un regard sur ce qui se passe dans les laboratoires. On pourrait de la même façon envisager des comités d’éthique rattachés aux abattoirs, où la société civile serait représentée par des bouchers, des éleveurs, des consommateurs, des associations de protection animale… Cela nous éviterait de retourner dans un face-à-face entre le service de contrôle et l’abatteur.
Certains abattoirs fonctionnent-ils mieux que d’autres ? Bien sûr, comme dans tout secteur d’activité. La différence en la matière se fait-elle forcément entre grosses et petites structures ? Je ne sais pas. Cela dépend beaucoup de la prise en compte, au plus haut niveau de l’abattoir, des enjeux de protection animale.
Monsieur Dumas, vous m’interpellez sur la responsabilité du directeur auquel il revient de superviser ses équipes. Je ne sais pas si cela passe par l’utilisation de caméras, mais je confirme que cette tâche lui incombe, et qu’il ne peut pas se dissocier de ses équipes. Nous ne pouvons pas admettre qu’un directeur puisse dire : « Cela s’est produit à cinq heures du matin, je n’étais pas là, ce n’est pas de ma responsabilité. »
M. William Dumas. Je suis d’accord sur ce point. Je parlais du fait de filmer les salariés en permanence.
M. Laurent Lasne. Il y a probablement des aspects de droit du travail que je ne maîtrise pas. Le salarié ne peut sans doute pas être filmé en permanence.
M. William Dumas. Il ne faut pas que ça soit du flicage !
M. Laurent Lasne. Non, mais le directeur doit être solidaire de ce qui se passe dans son établissement. Il faut qu’il puisse visionner les images avec ses équipes pour faire de la pédagogie.
Mme Alexandra Taillandier. Je reviens sur les difficultés de nos missions. C’est très dur : nous devons nous plier aux horaires de l’abattoir. La journée commence à trois ou quatre heures du matin et, dans les gros abattoirs, elle est organisée en deux-huit ou en trois-huit. En fait, nous nous plions au rythme et à la cadence de la chaîne d’arrivée des animaux. Nous sommes généralement plusieurs collègues : nous réalisons l’inspection ante mortem, nous assistons au déchargement, puis nous prenons notre place sur la chaîne où nous restons au poste d’inspection carcasses-abats tout au long de la tuée.
M. Stéphane Touzet. Il n’est pas question de choisir entre l’inspection ante mortem et le post mortem. Dans son état actuel, la réglementation européenne que j’évoquais en conclusion de mon propos liminaire, le paquet hygiène, détaille ce que nous devons systématiquement faire pour chaque carcasse – c’est pourquoi nous sommes très attachés à ce texte. Il y est décrit tout ce qui doit systématiquement être fait : des palpations, des incisions, des examens visuels ou au toucher… Si tous ces gestes ne sont pas faits sur chaque carcasse, nous sommes en infraction. Autrement dit, on ne choisit pas entre la protection animale et la sécurité alimentaire : si un seul membre des services est présent dans l’abattoir, il se trouvera nécessairement au poste d’inspection pendant tout le temps que l’on abattra, du début à la fin. Oui, madame Le Loch, nous sommes en permanence présents dans les abattoirs. Vous y trouverez même parfois six à huit inspecteurs : tout dépend de l’activité, de la taille de l’unité…
Mme Alexandra Taillandier. J’ai entendu un directeur d’abattoir affirmer devant vous que dans un petit établissement comme le sien, un inspecteur posté à la chaîne peut également, en tournant la tête à droite, voir le poste de tuerie.
M. Stéphane Touzet. C’est faux.
Mme Alexandra Taillandier. C’est totalement faux, en tout cas dans les petits abattoirs que je connais. Du poste d’inspection, on ne voit pas le poste de tuerie. Lorsque l’on est seule toute la journée, il est impossible de surveiller ce qui s’y passe.
M. Stéphane Touzet. Le poste d’inspection le plus stratégique se trouve après l’éviscération : les organes étant encore proches de la carcasse, nous pouvons faire le lien entre les deux, nous avons une vue générale, et nous avons le matériel à portée de main pour pratiquer les incisions et les examens nécessaires. Tout va très vite : ou bien il n’y a aucun problème et la carcasse continue son chemin, ou bien il y a un défaut. Si l’anomalie est mineure, nous pouvons la corriger rapidement ; nous sommes formés pour cela. Si c’est plus grave, il faut détourner la carcasse et la consigner pour un examen ultérieur plus poussé. Mais il y a une cadence à suivre, il faut rester concentrer, on n’a pas le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. L’aurions-nous que la séparation matérielle – il y a au moins des cloisons – entre les circuits propres et souillés nous empêcherait de voir comment se déroule la tuerie en secteur souillé. Ce n’est pas possible !
Mme Alexandra Taillandier. J’ai également entendu un directeur d’abattoir ou peut-être un membre de la fédération, vous dire que les techniciens vétérinaires n’étaient pas formés à la protection animale, et que nous n’avions pas les mêmes critères objectifs pour évaluer l’état d’inconscience d’un animal. Une nouvelle fois, c’est entièrement faux : la formation initiale et la formation continue, qui nous est dispensée tout au long de la carrière, ne se limite pas aux seules questions liées à l’hygiène et aux aspects sanitaires : nous sommes également formés à la protection animale et nous pouvons en attester.
S’agissant de formation, vous vous interrogiez sur celle des sacrificateurs. Ils nous présentent une carte attribuée par la mosquée ou par la synagogue, mais nous ne pouvons pas attester qu’ils ont bénéficié au préalable d’une formation dispensée par leur culte. C’est seulement en les observant dans l’exercice de leurs fonctions que nous apprécions si leur travail est bien ou mal fait. Dans ce dernier cas, il arrive que nous refusions un sacrificateur.
Mme Sylvie Pupulin, secrétaire générale du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV). Les situations peuvent être différentes selon les abattoirs : certains emploient directement des sacrificateurs halal formés au même titre que les autres employés aux règles relatives à la manipulation des animaux vivants et à l’hygiène. Ces sacrificateurs disposent aussi de la carte d’habilitation que délivrent trois mosquées en France – de mémoire, il s’agit des mosquées de Paris, d’Évry et de Lyon.
Dans d’autres abattoirs, les sacrificateurs halal ne font pas partie des personnels, mais il est très difficile de vérifier qu’ils ont bénéficié d’une formation de base : à ma connaissance, l’habilitation donnée par les mosquées n’inclut pas de formation spécifique relative au bien-être animal.
Pour l’abattage casher, les sacrificateurs sont des rabbins, donc forcément extérieurs à l’abattoir. C’est parfois assez compliqué…
M. Jacques Lamblin. Si vous observez qu’un sacrificateur ne fait pas correctement son travail, pouvez-vous demander qu’il soit exclu de l’abattoir ?
Mme Sylvie Pupulin. Tout à fait. Je peux même vous faire part d’une anecdote : Lors d’un abattage, j’ai constaté qu’un sacrificateur ne disposait pas d’un couteau suffisamment affûté et qu’il ne savait pas l’aiguiser. Et il refusait que le personnel le fasse pour lui… J’ai fait interrompre l’abattage, et j’ai fait intervenir le directeur de l’abattoir pour qu’il règle le problème.
Dans le quotidien de l’abattoir, l’inspection est conduite par une équipe au sein de laquelle chacun à son rôle et son importance, vétérinaires et techniciens. Notre premier interlocuteur est le directeur de l’abattoir auquel nous signalons tous les jours les problèmes constatés. Une relation bilatérale s’établit avec l’abatteur ; elle peut être conflictuelle – cela arrive – ou beaucoup plus constructive, ce qui permet de faire avancer les choses. En service d’inspection d’abattoir, l’appui de notre hiérarchie est primordial : l’équipe va jusqu’à notre directeur, et, au besoin, jusqu’au préfet.
Il faut gérer la mission d’inspection quotidienne. C’est toute la complexité de nos métiers. Les choses ne sont pas simples pour l’abatteur qui est contrôlé de façon permanente – même si cela peut parfois lui servir de caution. Quant au service d’inspection, il doit en permanence assurer sa fonction dans une posture spécifique. De nombreuses actions ne sont pas formalisées. Ainsi, lorsque je suis intervenue pour interrompre cet abattage rituel, il n’y a eu aucun écrit : grâce à un échange informel avec le directeur, l’animal n’a pas été abattu dans de mauvaises conditions. Nous sommes dans un rapport particulier. Les mesures que nous prenons et la formalisation vont crescendo en fonction de l’importance des problèmes rencontrés. Nous sommes toujours prêts à réagir. Mais ce n’est pas évident à expliquer…
Nous sommes présents en permanence lors de l’abattage. Nous procédons à l’inspection ante mortem. Il arrive que nous n’assistions pas à l’amenée de tous les animaux car les horaires ne le permettent pas – il m’est arrivé de travailler plus de vingt-quatre heures d’affilée pour faire du contrôle de camions. En tout état de cause, nous organisons notre travail, pour pouvoir assurer les tâches systématiques d’inspection ante et post mortem, et pour assurer nos autres missions, avec le temps et avec les moyens qui nous restent ; mais nous faisons en sorte d’organiser les choses pour que tout se passe au mieux.
Mme Alexandra Taillandier. Les abattoirs n’ont pas le droit de commencer à abattre si nous ne sommes pas présents et si nous n’avons pas vu les animaux.
M. Stéphane Touzet. Nous sommes non seulement formés en matière de protection animale, mais bon nombre d’entre nous sont assermentés en sécurité sanitaire des animaux, et en santé et protection animales.
Vous nous interrogez sur les performances comparées des abattoirs mono- et multi-espèces. Il y a une grande diversité dans les abattoirs, j’ai commencé mon propos liminaire par cette précision, et il n’y a pas de règles, seulement des cas particuliers. La complexité de notre travail réside aussi dans cette caractéristique : dans un même département, parfois au sein d’un même groupe, nous pouvons trouver des abattoirs qui ne fonctionnent pas de la même manière, qui n’ont pas les mêmes objectifs, et dont les valeurs ajoutées sont différentes. Entre abattoirs mono-espèce et abattoirs multi-espèces, nous ne pouvons pas vous dire qu’un type de structure est meilleur qu’un autre.
L’abattoir multi-espèces doit en tout cas être équipé pour toutes les espèces qu’il accueille : en matière de contention, on ne traite pas les porcs de la même façon que les moutons, ni les moutons comme les bovins, ni des truies de réforme comme des porcs charcutiers. Reste qu’un abattoir a besoin de faire rentrer du travail, et on prend parfois ce qu’il y a. Encore faut-il être équipé pour, ce qui est a priori le cas dans un abattoir mono-espèce standardisé. Mais à cette particularité près, je ne vois pas beaucoup d’autres différences dans le fonctionnement général de ces établissements.
Sommes-nous sûrs que les maltraitances sont exceptionnelles ? En mon âme et conscience, j’ai envie de répondre que oui. Je pense pouvoir le faire mais, pour être tout à fait honnête, il y a toujours une part de subjectivité dans le jugement. Quand on est au petit matin, au milieu de nulle part, dans le bruit, tout n’est pas aussi évident. Mais, même dans les pires situations, je ne pense pas que l’on puisse accepter des actes de cruauté, et n’en parler que douze ans après – c’est pour cela que les propos de Martial Albar m’ont un peu surpris –, à moins d’être dans l’incapacité de faire son travail pour une raison ou pour une autre. Et parfois, les choses ne sont pas simples. C’est ce que j’ai essayé de vous dire.
M. Laurent Lasne. Il y a peut-être aussi moins de mauvais traitements lorsque nous sommes en situation d’observation. Cela fausse éventuellement notre appréciation statistique. Sur le nombre d’animaux abattus, c’est marginal, même si cela reste trop.
M. Stéphane Touzet. En effet, il ne faut jamais perdre de vue notre rôle de gendarme, ou plutôt la relation essentielle de contrôleur à contrôlé.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Le ministre nous a indiqué hier que les recrutements avaient repris depuis 2015. Quels effets cela a-t-il eu sur le problème du bien-être animal ?
La question des cadences est souvent revenue. Vous paraît-il utile d’imaginer une normalisation en la matière ? Une limite maximale d’abattage pourrait être appliquée au-delà de laquelle, quelles que soient les performances du matériel, on considérerait qu’il n’est plus possible de préserver le bien-être animal ni celui du salarié à son poste.
Nous n’avons pas du tout parlé des petits animaux. Pensez-vous que, parce qu’ils semblent moins proches de nous sur le plan de la structure, nous nous sentons moins « concernés » ? L’abattage des petits animaux est plus rapide, les cadences sont plus importantes, par exemple pour la volaille ; et, comme ça va vite, on s’en soucie moins. Constatez-vous que la société fait cette différence ? Existe-t-elle au sein de vos services ou dans votre façon de travailler ?
Vous avez parfaitement expliqué que le contrôle sanitaire ante et post mortem est systématique. Chaque animal et chaque carcasse sont examinés. En matière sanitaire, il n’y a pas de rémanence : le fait d’avoir vu quatre-vingt-dix carcasses parfaites ne permet en aucun cas de supposer que la quatre-vingt-onzième pourrait l’être. En revanche, la rémanence existe s’agissant des éléments liés au bien-être animal : si les outils d’abattage et de contention sont adaptés, si les gestes de l’abatteur sont corrects, on peut considérer qu’ils le resteront. Même si, s’agissant d’actions humaines, on peut avoir un doute sur ce qui se passe en l’absence de contrôle, mais il n’y a pas de raison que cela se mette à dysfonctionner complètement. Ne serait-il pas nécessaire de distinguer, dans l’organisation du contrôle, ce qui pourrait être concentré, s’agissant du bien-être animal, là où des problèmes ont été relevés, jusqu’à ce qu’ils soient résolus ? On pourrait concentrer les moyens sans avoir besoin d’exhaustivité. Cela me semblerait plus efficace.
Parmi ce qui pourrait aider à sortir les abattoirs de la « boîte noire », ne pourrait-on pas donner un rôle aux commissions locales d’information et de surveillance, qui se consacrent actuellement à certaines installations classées ? Ce modèle ne serait-il pas plus pertinent que celui des comités d’éthique ? Les questions d’éthique se posent concernant des actes nouveaux, comme en cas d’expérimentation sur les animaux, lorsque chaque cas spécifique doit être étudié. Les actes d’abattage sont répétitifs, et, en la matière, les questions d’éthique ne se posent plus. Doit-on faire souffrir les animaux pour les abattre ? Non. La question éthique a été tranchée, même si de très nombreuses sous-questions demeurent.
Les caméras sont déjà utilisées dans certains milieux professionnels. La cabine de conduite des chauffeurs de bus d’une entreprise de transport parisienne bien connue est filmée en permanence. Les images sont écrasées toutes les demi-heures, mais les chauffeurs peuvent prendre l’initiative, en cas d’incident, de déclencher le stockage de la demi-heure précédente.
La vidéo permettrait une démultiplication du regard, qui pourrait avoir lieu à l’initiative du contrôle – en cas d’inspection, vous pourriez décider d’activer la caméra. Elle serait aussi utile au responsable bien-être animal de l’établissement : s’il constate qu’il y a des difficultés sur un poste, il visionnera les images stockées depuis le matin. Pourquoi ne serait-ce pas aussi un outil pour l’opérateur ? Il dispose d’un droit de retrait, et les images l’aideraient à justifier devant sa hiérarchie qu’il en use, par exemple, parce que l’électronarcose ne fonctionne pas ? Il pourrait déclencher un enregistrement qui montrerait qu’un dysfonctionnement se prolonge, et qu’il exerce légitimement son droit de retrait. La vidéo ne constitue-t-elle pas alors un élément de la démultiplication de la prise de conscience en faveur du contrôle et de la sécurité des êtres humains comme des animaux ?
M. Jean-Luc Bleunven. Monsieur Lasne, vous travaillez dans les abattoirs depuis vingt ans. Estimez-vous que l’évolution technologique est globalement favorable au bien-être animal ? Elle vise généralement les gains de productivité, ce qui permet sans doute d’augmenter les cadences dans un objectif de rentabilité – nous savons que, dans le secteur, les marges sont faibles –, mais pas nécessairement le bien-être animal. Peut-elle y contribuer ?
Le sacrificateur qui utilise un couteau mal aiguisé, comme celui que vous nous décriviez, madame Pupulin, peut-il refuser de changer d’instrument pour des raisons cultuelles ? Avez-vous la possibilité d’intervenir dans ce cas ? C’est un problème de fond…
M. Laurent Lasne. Nous avons perdu mille emplois équivalents temps plein entre 2004 et 2014, et nous en gagnons soixante par an depuis 2015. Les effets de la reprise ne sont donc pas encore visibles. Il faut aussi compter avec le temps nécessaire au recrutement puis à la formation des nouveaux personnels.
Je ne sais pas si la normalisation des cadences aurait un effet sur le bien-être animal. Elle faciliterait en tout cas l’inspection post mortem. Certaines cadences sont difficiles à tenir – il faut un certain temps pour pratiquer les incisions et les palpations codifiées dont nous parlions, notamment sur les porcs.
Notre sensibilité est probablement moindre à l’égard d’animaux, comme les volailles, auxquels nous nous identifions moins. Ajoutons qu’il s’agit souvent d’animaux très standardisés dans leur conformation, ce qui permet d’automatiser le processus d’abattage beaucoup plus facilement que pour les animaux de boucherie.
La rémanence de certains éléments constitutifs du bien-être animal justifie, en partie, un contrôle spécifique en la matière. D’une certaine façon, le ministre vous a un peu dit la même chose hier. En théorie, la protection animale en abattoir relève d’une inspection sur analyse de risques et non d’une inspection systématique. Il faut en revanche prendre garde aux effets « opérateur » – il peut y avoir des intérimaires, des remplacements, des périodes de suractivité –, mais également aux effets « animal », si l’on change par exemple la source d’approvisionnement et que l’on passe d’animaux très conformés à des animaux qui le sont moins.
Il nous semble tout à fait possible de donner un rôle aux commissions locales d’information et de surveillance en matière d’abattage plutôt qu’à un comité d’éthique. Notre idée consiste à permettre un regard de la société civile sur les abattoirs.
Sans que nous ayons consulté les collègues, l’idée de l’écrasement progressif des vidéos toutes les trente minutes, effacement qui pourrait être interrompu à l’initiative du responsable protection animale (RPA), du service d’inspection, ou de l’opérateur nous paraît aller dans le sens d’un encadrement plus précis. Je n’ai pas consulté mes collègues, mais cela me paraît aller dans la bonne direction.
Mme Alexandra Taillandier. Sur le plan pédagogique, cela ne peut être que positif.
Je veux insister sur le fait que nous faisons de la protection animale tous les jours, en particulier à chaque fois que nous pratiquons des inspections ante mortem : ce sont aussi des inspections protection animale.
M. Stéphane Touzet. Il semble difficile de concentrer l’inspection en matière de bien-être animal car les débordements et les pétages de plomb dont nous parlons sont ponctuels ; ils ne sont pas prévisibles. On peut certainement en revanche l’organiser et la structurer mieux.
M. le rapporteur. Que pensez-vous de la conception des secteurs des abattoirs qui accueillent des animaux vivants ? Nous avons entendu beaucoup de choses, y compris concernant des établissements assez récents, qui laissent entendre que les recherches scientifiques les plus poussées en matière de comportement animal n’ont pas été totalement intégrées. La situation est-elle globalement satisfaisante ou reste-t-il encore des progrès à faire pour que l’animal se présente dans les meilleures conditions à l’abattage ?
Mme Sylvie Pupulin. Tout dépend à nouveau de l’abattoir, de l’époque de sa construction, et de sa conception d’origine. Si, sur ce plan, la situation est différente dans chaque abattoir, il existe toujours des moyens assez simples pour améliorer et corriger les choses. Les travaux de Temple Grandin peuvent y contribuer. Cette éthologue américaine a beaucoup travaillé sur les méthodes d’amenée des animaux en fonction des espèces et de leur sensibilité au stress. Il est ainsi apparu qu’il était préférable de faire avancer les bovins sans les toucher, au moyen, par exemple, de petits drapeaux agités à côté, devant, et derrière eux. De la même façon, on sait que les parcours sans angles droits facilitent la progression, car les angles sont facteurs de stress.
M. Stéphane Touzet. Nous n’avons pas connaissance d’exemple de pays étrangers qui pourraient constituer un modèle. Il existe en revanche des travaux – en particulier au sein de l’Union Européenne, qu’il faudrait à l’évidence mettre en commun pour progresser.
M. Laurent Lasne. Je ne sais pas si les évolutions technologiques en matière d’abattage sont vraiment dynamiques. Les méthodes d’étourdissement – pistolet à tige perforante, électronarcose, et gaz –, sont anciennes. Je ne sais pas si des progrès ont vraiment été faits en la matière.
Certains abattoirs récents sont certainement mal conçus, mais il en existe d’autres très bien pensés, dans lesquels les animaux avancent seuls – même si ce n’est pas à l’aide de drapeaux –, et qui fonctionnent très bien. Nous pourrons vous donner une liste. Comme quoi c’est possible…
Mme Annick Le Loch, présidente. Mesdames, messieurs, nous vous remercions pour l’ensemble des informations dont vous nous avez fait part.
La séance est levée à dix heures cinquante.
——fpfp——
12. Audition, ouverte à la presse, de M. Christian Le Lann, président de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT).
(Séance du jeudi 19 mai 2016)
La séance est ouverte à onze heures.
Mme Annick Le Loch, suppléant M. Olivier Falorni, président. Nous vous remercions de votre présence en qualité de président de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie et traiteurs, monsieur Le Lann. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Christian Le Lann prête serment.
M. Christian Le Lann, président de la CFBCT. Je tiens avant toute chose à me féliciter de la création de cette commission d’enquête que nous avons été les premiers à réclamer, après l’association L214, lorsque nous avons visionné les images d’actes de barbarie – car on ne saurait les appeler autrement – tournées dans les abattoirs, qui ont révolté tous les artisans bouchers français. La CFBCT s’est fait leur porte-parole en plusieurs occasions, y compris sur les chaînes parlementaires où nous avons débattu avec L214 ainsi que la députée Laurence Abeille et la sénatrice Sylvie Goy-Chavent. Devant l’horreur de ces images, nous avons dénoncé le sadisme et la barbarie et souhaité que toute la lumière soit faite sur ce qui se passe dans certains abattoirs.
Gardons-nous toutefois de croire que ces pratiques sont généralisées. Un tiers des artisans bouchers – environ 7 000 sur les quelque 20 000 bouchers qui exercent en France – sont des acheteurs en vif qui utilisent directement les services des abattoirs. Certains d’entre eux nous ont, il est vrai, fait part de dysfonctionnements occasionnels lors d’abattages rituels, les animaux ayant alors été abattus sans étourdissement – parce que les chaînes d’abattage étaient demeurées en mode rituel – en dépit du fait que jamais les artisans en question n’avaient demandé qu’il soit procédé ainsi.
Très sensible au bien-être animal, la CFBCT est également opposée aux modes d’élevage productivistes et aux fermes industrielles. Dans sa publication mensuelle, La Boucherie française, notre confédération préconise régulièrement un élevage traditionnel et en plein air, l’interdiction des organismes génétiquement modifiés et des hormones de croissance. De même, nous prônons une consommation raisonnée de viande, qu’il vaut mieux manger en moindre quantité mais de meilleures qualités. Pour nous, la viande est une matière noble issue du vivant. Le boucher se rend immédiatement compte en travaillant une carcasse si un animal a été stressé : les viandes fiévreuses ou la présence d’hématomes sont la marque d’un problème de stress ou de maltraitance. La qualité d’une bonne viande dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels les conditions d’abattage.
Face à ces problèmes, nous avons pris conscience qu’il fallait agir. La CFBCT élabore actuellement une charte des viandes éthiques. Pour ce faire, nous avons réuni plusieurs intervenants : des chercheurs et des philosophes comme Frédéric Lenoir, mais aussi des associations de défense du bien-être animal telles que l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) et l’organisation Compassion in World Farming (CIWF), ainsi que des entreprises du monde de la viande. Nous travaillons à la création d’un label de viande éthique, qui devrait être créé dans les prochains mois.
Pour information, la CFBCT, fondée il y a 122 ans sous la forme d’un syndicat professionnel, est l’organisation professionnelle des bouchers, bouchers-charcutiers et traiteurs. Au service des artisans, elle s’attache à mener des actions collectives valorisant la profession et à représenter et défendre le métier auprès des pouvoirs publics. Sa mission principale consiste à aider la profession qu’elle représente à s’inscrire durablement dans les habitudes de consommation des Français et dans l’économie du pays. Elle intervient dans le cœur du métier tout en tenant compte de l’évolution constante de la consommation. La confédération propose de nombreux services, dont le conseil et l’information des artisans bouchers, et assure une véritable proximité auprès des professionnels. Elle se décline en structures départementales et en fédérations régionales.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros par an, le secteur de la boucherie-charcuterie emploie 80 000 personnes – chefs d’entreprise, conjoints, aides familiaux, salariés, apprentis. On dénombre près de vingt mille boucheries artisanales en France – étant entendu qu’il s’agit de boucheries traditionnelles qui, dans la Nomenclature d’activités françaises (NAF), appartiennent à la sous-classe 47.22Z.
Enfin, nous formons plus de 9 500 apprentis, un nombre que nous sommes parvenus avec fierté – et à force de communication – à faire passer en sept ans de 15 % à 20 % dans les centres de formation d’apprentis (CFA). Nous avons aussi la chance de disposer d’une école nationale professionnelle qui propose des programmes de formation continue et reçoit des délégations étrangères – venues d’Europe et au-delà – pour faire rayonner les techniques françaises de découpe de la viande, preuve que nombreux sont ceux qu’intéressent le travail et le savoir-faire des artisans bouchers français. Cette école forme des personnes issues d’horizons très variés qui souhaitent se reconvertir dans la boucherie, et délivre des certificats de qualification professionnelle (CQP).
La CFBCT est membre de la Confédération internationale de la boucherie et de la charcuterie (CIBC), où nous échangeons principalement avec nos homologues européens sur tous les problèmes liés au secteur de la viande. Nous sommes également membres de l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) et de l’interprofession nationale porcine (INAPORC). Nous siégeons à la Confédération générale de l’alimentation de détail (CGAD) ainsi qu’à l’Union professionnelle artisanale (UPA).
Enfin, la CFBCT emploie douze salariés, dont un secrétaire général, et s’est dotée de commissions thématiques – économie, éducation, formation – et dispose d’un pôle de recherche et d’innovation. Auquel s’ajoute, j’en ai parlé plus haut, ce formidable outil de rayonnement qu’est notre école nationale supérieure, qui permet de faire rayonner la boucherie artisanale en Europe et dans le monde entier.
Mme Annick Le Loch. Quel pourcentage des produits issus des abattoirs français est commercialisé en boucherie ?
M. Christian Le Lann. Hormis certains produits d’importation particuliers, la grande majorité des viandes commercialisées dans les boucheries artisanales provient du troupeau allaitant, qui est composé de races à viande, étant entendu que la boucherie artisanale représente 15 % à 20 % de la viande commercialisée en France. Environ 7 000 bouchers continuent à acheter des bêtes directement à l’éleveur avant de faire appel aux prestations d’un abattoir, qu’il soit public ou privé. Nous incitons d’ailleurs nos collègues à revenir aux fondamentaux du métier, et le contact direct avec l’éleveur en fait partie. Preuve de cette relation privilégiée, la boucherie artisanale s’enorgueillit d’acheter au juste prix les produits des éleveurs, durement frappés par la crise. Les bouchers exerçant dans les grandes agglomérations, en particulier en Île-de-France, achètent souvent la viande en carcasse. Dans ce cas, les arrivages proviennent directement des abattoirs ou des grossistes, mais bon nombre de nos collègues utilisent aussi le marché d’intérêt national de Rungis, où le pavillon des viandes est important et offre aux artisans la possibilité de trouver toutes les qualités de viande. Une part résiduelle est constituée par des viandes particulières, comme l’Angus britannique ou le Wagyu japonais, mais cela fait partie des phénomènes de mode, pour ne pas dire du folklore. La très grande majorité, 95 % des viandes commercialisées par la boucherie artisanale, sont des viandes françaises qui proviennent de notre troupeau allaitant.
M. le président Olivier Falorni. Que représente l’abattage dans la formation du coût de la viande ?
M. Christian Le Lann. Le coût de l’abattage des bovins peut varier de 20 centimes à 1 euro par kilogramme, en fonction de la nature de l’abattoir – public ou privé, par exemple. En tout état de cause, la part de l’abattage dans la formation du prix de la viande est minime.
M. le président Olivier Falorni. Les vidéos diffusées par l’association L214, qui sont à l’origine de cette commission d’enquête, ont-elles eu un retentissement économique avéré dans le secteur de la boucherie ?
M. Christian Le Lann. Leur impact a été moindre dans la boucherie artisanale que dans des secteurs pratiquant d’autres formes de distribution. L’artisan boucher entretient un lien de confiance avec le consommateur, comme on l’a constaté après chaque crise sanitaire – celle de la vache folle par exemple. En effet, les consommateurs obtiennent des explications et des informations plus précises et directes lorsqu’ils s’adressent à un professionnel qui connaît parfaitement les rouages de la filière que lorsqu’ils achètent de la viande en barquettes.
Pour autant, ces vidéos ont suscité une prise de conscience parmi nos collègues, à tel point que nous avons réagi en réclamant la création de cette commission d’enquête. Nous ne supportons pas les actes de maltraitance infligés aux animaux. Les actes commis sur ces vidéos sont absolument inadmissibles ; nous demandons que leurs auteurs soient fermement sanctionnés. De ce point de vue, je rends hommage à L214 d’avoir accompli un acte citoyen en dénonçant ces pratiques.
Ne généralisons pas, cependant, et veillons à éviter tout effet pervers. Nombreux sont les salariés qui travaillent très correctement. Or, certains d’entre eux se plaignent de l’image qu’on leur accole, au point que leurs propres enfants voient en eux des criminels ! Cela risque de nuire à l’attractivité des emplois en abattoirs, auxquels les candidats seront moins nombreux. Qu’il existe un problème économique lié à la baisse de consommation de viande, c’est un fait ; toutefois, ne négligeons pas les salariés qui travaillent correctement. À cet égard, je note que si les lois étaient pleinement appliquées, de tels faits ne se produiraient pas.
M. le président Olivier Falorni. La CFBCT dispense-t-elle des formations aux opérateurs travaillant dans les abattoirs, et existe-t-il des passerelles entre les métiers de la boucherie et ceux de l’abattage ?
M. Christian Le Lann. La CFBCT ne dispense pas de formations au personnel des abattoirs. En revanche, les passerelles existent, même si elles ne sont pas structurées : nombreux sont en effet les artisans bouchers, notamment les plus anciens, qui ont exercé dans des abattoirs – et ils avaient le respect de l’animal. Le métier était complet, alors ; aujourd’hui, sans doute la concentration et l’industrialisation ont-elles suscité l’apparition de pratiques répréhensibles. En Allemagne, les abattoirs ne sont pas aussi concentrés : il y existe encore des tueries particulières, or jamais de tels faits n’ont été mis sur la place publique. Le fait d’avoir poussé en France à une concentration systématique a-t-il abouti à imposer des cadences de travail excessives aux salariés, et ce malgré les évolutions techniques survenues depuis dix ou quinze ans – on ne travaille plus du tout dans les mêmes conditions ? Quoi qu’il en soit, les passerelles existent, et il arrive même que des artisans bouchers prennent un poste à responsabilité dans un abattoir.
M. le président Olivier Falorni. Que pensez-vous d’un étiquetage des produits alimentaires indiquant le mode d’abattage, avec ou sans étourdissement préalable ?
M. Christian Le Lann. L’idée peut paraître séduisante, mais elle pose de nombreux problèmes économiques. Elle ne correspond pas à une demande des consommateurs et la Commission européenne y est assez réticente. Avant de prendre une telle décision, il serait bon de mener des études d’impact.
Nous avons récemment proposé à l’assemblée générale de la CIBC d’adopter une initiative, actuellement à l’essai en France avec l’accord de la Commission européenne, qui, répondant à une demande des consommateurs, vise à indiquer l’origine de la viande utilisée dans les plats cuisinés. Or, à notre grande surprise, nos collègues européens s’y sont fermement opposés. En matière de traçabilité, d’information sur les ingrédients, de bien-être animal, nous sommes en effet très isolés, au point que l’on me considère parfois comme le mauvais élève de la classe… Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que certaines propositions du Gouvernement français n’aboutissent pas. Nos voisins européens n’ont pas du tout les mêmes conceptions que nous sur le bien-être animal comme sur la traçabilité.
Prenons pour exemple l’installation de caméras dans les abattoirs. En Angleterre, 50 % des abattoirs en sont équipés. Soit, mais qui va visionner les bandes ? Je me pose beaucoup de questions. De même, en ce qui concerne l’abattage rituel, un décret de décembre 2011 prévoit qu’il est autorisé par dérogation à condition de correspondre à des commandes commerciales. Sommes-nous sûrs pour autant que les registres de commandes en abattage rituel sont bien vérifiés ?
Au fond, si la loi était respectée, il n’y aurait sur ce sujet comme sur d’autres – y compris celui du bien-être animal – aucune raison d’en adopter d’autres. C’est aux pouvoirs publics qu’incombe la responsabilité de déployer les moyens adéquats pour effectuer les contrôles nécessaires. D’autre part, il faut prendre des mesures à l’encontre des salariés dont le comportement a posé problème, y compris en termes de formation : on ne peut soutenir que quarante-huit heures de formation suffiront à responsabiliser un employé nouvellement affecté à une chaîne d’abattage. À un moment donné, il faut savoir poser les bonnes questions, et se donner les moyens de contrôler.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. La charte éthique que vous avez évoquée, monsieur Le Lann, serait-elle pour vous un pas en direction d’une certification qui rassurerait les consommateurs et rétablirait leur confiance ? Cette démarche vous semble-t-elle un complément utile aux contrôles, étant entendu que les consommateurs ont tendance à croire a priori que les produits qu’ils achètent sont conformes à la loi ?
M. Christian Le Lann. L’initiative que nous avons prise d’élaborer une charte a recueilli l’approbation des organisations de protection animale ainsi que de professionnels, convaincus qu’il était temps d’agir. Nous devons en effet rétablir la confiance des consommateurs. Cette charte éthique associera des éleveurs, afin de garantir de bonnes conditions d’élevage – y compris une alimentation saine et de qualité, à l’herbe et excluant toute céréale génétiquement modifiée. De même, elle permettra de garantir que les conditions de fin de vie et d’abattage des animaux sont dignes, et qu’aucun dysfonctionnement ne s’est produit sur les chaînes d’abattage pour des raisons de rentabilité.
La viande n’est pas n’importe quoi. Le terme « sacrifice » contient la notion de sacré. Malheureusement, on a voulu en faire un produit d’appel dans la grande distribution, où les prix sont parfois si bas que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires a constaté que les rayons de viande de ces enseignes tournaient parfois à perte ! Et pourtant, la viande demeure au cœur de leurs offres publicitaires. Dans le même temps, certains éleveurs ne parviennent plus à vivre de leur travail au point que certains sont au bord du suicide. Où cela nous mènera-t-il ?
Il nous faut retrouver la raison. Les éleveurs doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Les professionnels de la distribution doivent quant à eux appliquer à leurs produits un juste prix, plutôt que de laisser les éleveurs disparaître en arguant du fait que la loi du marché est ainsi faite. La France a la chance de posséder une agriculture de qualité et des éleveurs qui font parfaitement leur travail. Malheureusement, le secteur de la grande distribution a reçu un chèque en blanc lors de l’adoption en 2008 de la loi de modernisation économique ; il est temps d’y revenir, et que les quatre grandes centrales de distribution cessent de mettre à genoux les PME et les éleveurs !
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Au-delà de la question des moyens qui doivent être consacrés aux contrôles, vous avez laissé entendre qu’en cas d’acte répréhensible, les sanctions ne sont ni assez rapides, ni assez fermes. Comment l’expliquez-vous ? Cela tient-il à l’économie des abattoirs, ou encore à leur importance sur le territoire dans lequel ils s’inscrivent ?
M. Christian Le Lann. Lorsque de tels actes sont commis, sans doute certains n’osent-ils pas parler pour des raisons économiques ou pour préserver des emplois. J’estime quant à moi que tout citoyen témoin de tels faits doit les dénoncer. De ce point de vue, je suis tout à fait d’accord avec les lanceurs d’alerte qui interviennent dans les abattoirs, de même que les référents sur la protection animale constituent une avancée tout à fait pertinente. On ne doit plus tolérer de tels actes qui nuisent au produit qu’est la viande et à l’ensemble des acteurs de cette filière.
Mme Annick Le Loch. Comme vous l’avez dit, 7 000 bouchers achètent encore leur viande en vif, et vous incitez les autres à en faire autant. S’agit-il d’une tendance de fond ou, au contraire, d’une pratique qui tend à disparaître ?
D’autre part, comment les bouchers choisissent-ils les abattoirs ? La proximité prime-t-elle ? Tenez-vous compte des conditions d’abattage, des contrôles, du bien-être animal ? En clair, quelles sont vos exigences à l’égard des abattoirs auxquels vous commandez d’abattre les animaux que vous achetez ?
M. Christian Le Lann. En effet, nous incitons de plus en plus nos collègues à revenir à un lien direct, en circuit court, avec les éleveurs. Il va de soi que les artisans bouchers connaissent les abattoirs, les personnes qui y travaillent – certains d’entre eux sont eux-mêmes gestionnaires d’abattoirs. Ils sont donc très attentifs aux conditions d’abattage. De plus, ce lien direct a l’avantage de permettre aux artisans bouchers de payer le juste prix aux éleveurs. Lorsque j’ai assisté au Festival du Charolais il y a quelques mois, j’ai vu des artisans venir de Savoie pour acheter des bêtes. J’ajoute que certains de nos collègues sont aussi éleveurs et possèdent leurs propres animaux. Nous essayons de revenir aux fondamentaux de notre métier.
Je le répète : les artisans bouchers ont été scandalisés par les images qu’ils ont vues. Je me souviens de ce qui me disait un président de syndicat de l’Ariège, gestionnaire d’un abattoir : il ne pouvait pas concevoir ce qu’il avait vu. Cela ne pouvait pas se passer ainsi dans son abattoir. Il faut donc faire très attention, et surtout ne pas généraliser. S’il est évidemment utile de les dénoncer, je constate tout de même que l’association L214 n’a d’autres objectifs, au fond, que de défendre le végétarisme, voire le végétalisme, et de proscrire tout ce qui vient de l’animal. J’ai même entendu l’une de ses représentantes regretter que l’on abatte les poulets – bio, en l’occurrence – sans leur consentement… Quand on pousse les choses aussi loin, il devient difficile d’entendre les arguments.
M. le président Olivier Falorni. Je vous remercie, monsieur Le Lann.
La séance est levée à onze heures trente-cinq.
——fpfp——
13. Audition, ouverte à la presse, de M. Thierry Gregory, directeur des affaires scientifiques et techniques de la Fédération française des charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT).
(Séance du jeudi 19 mai 2016)
La séance est ouverte à douze heures.
M. le président Olivier Falorni. Nous accueillons maintenant M. Thierry Gregory, directeur des affaires scientifiques et techniques de la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT).
Avant de vous donner la parole, monsieur le directeur, je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et qu’elles sont diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Thierry Gregory prête serment.)
M. Thierry Gregory, directeur des affaires scientifiques et techniques de la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT). L’histoire de la FICT débute en 1924, lorsque des charcutiers issus de toute la France décident de s’unir pour faire connaître leur profession et leurs produits. Structure syndicale reposant sur l’adhésion volontaire, la FICT fédère les industriels transformateurs de viandes, en regroupant plus de 200 entreprises, petites comme grandes, réparties sur tout le territoire ; nous ne représentons pas les artisans, regroupés au sein de la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs (CNCT). Nous sommes essentiellement un tissu de petites et moyennes entreprises, dont la majorité comprend moins de 50 salariés, une trentaine d’entreprises dépassant les 250 salariés. Ainsi, le pays du camembert est aussi la patrie de plus de 350 produits de charcuterie élaborés par nos entreprises.
Les entreprises représentées par la FICT sont essentiellement des acheteurs de viande qu’elles transforment. Sauf exception, elles n’abattent pas d’animaux et ne découpent pas les viandes : nous achetons des pièces adaptées à la transformation des produits, par exemple, des pattes arrière de porc pour fabriquer du jambon cuit ou sec, des poitrines pour les lardons, etc.
En France, la filière de la charcuterie représente environ 1,250 million de tonnes de produits fabriqués : 1 million de tonnes de produits de charcuterie proprement dite, et 250 000 tonnes de salades et de conserves de viandes. En matière d’approvisionnement, 80 % des produits sont d’origine porcine, 10 % environ d’origine volaille, le reste se répartissant entre le bœuf, le gibier et le mouton.
Pour nous, la viande n’est pas un minerai : c’est une matière première qui représente une part significative de la formation des coûts des produits. Vis-à-vis de nos fournisseurs, nous définissons des critères de qualité très stricts, adaptés à chaque type de produit, parmi lesquels un certain nombre sont liés aux conditions d’abattage – pour éviter le stress des animaux, qui altère la qualité de la viande. Quand sont diffusées des images choquantes comme celles tournées par l’association L214, toutes les filières animales sont impactées, y compris la nôtre. D’un point de vue éthique, nos adhérents sont généralement très attentifs au bien-être animal, qui correspond à une demande sociétale de plus en plus explicite.
M. le président Olivier Falorni. À la suite du scandale provoqué par la diffusion des vidéos tournées par l’association L214, quelles ont été les réactions des industriels charcutiers représentés par votre fédération ? Avez-vous constaté une baisse de la consommation au sein de votre filière ?
Quel est le pourcentage de viande produite en abattoir français commercialisée par les industriels charcutiers ?
Une question récurrente : quelle est la part de l’abattage dans la formation du coût de la viande ?
La Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT), que nous venons d’auditionner, a entrepris un travail collectif de réflexion afin d’établir une charte éthique. Votre fédération envisage-t-elle une démarche de ce type ?
Enfin, question sensible pour les professionnels des filières animales : que pensez-vous d’un étiquetage systématique des produits alimentaires indiquant le mode d’abattage, c’est-à-dire avec ou sans étourdissement préalable ?
M. Thierry Gregory. Nos entreprises ont des contacts avec leurs fournisseurs, et les plus grosses d’entre elles vont régulièrement les auditer. La profession a été choquée, comme tout le monde, mais peut-être davantage encore, par les images extrêmement violentes montrées dans les vidéos car elles ne correspondent pas à ce que constatent nos auditeurs dans les abattoirs.
Dans un environnement économique tendu, avec en particulier la crise porcine que nous connaissons, il est assez difficile de mettre en évidence les conséquences de ces affaires. Globalement, nous avons constaté un tassement significatif de la consommation de nos produits, mais nous ne sommes actuellement pas en mesure de vous démontrer que ces vidéos ont eu un impact économique.
Parmi les animaux de boucherie, le porc est un cas particulier dans la mesure où une part significative de cette viande est destinée à la transformation : 30 % sont destinés à la viande fraîche, c’est-à-dire les longes et les côtelettes, et le reste consommable – y compris les abats – est transformé. La proportion de viande issue des abattoirs français représente environ 80 % de nos produits, le taux de couverture variant selon les pièces. Lorsque la production française est déficitaire pour certaines pièces de découpe, nous sommes obligés d’acheter à l’étranger.
La part de la viande dans la formation du prix de nos produits charcutiers est d’environ 50 % ; le reste est lié à la transformation, aux salaires et aux aspects logistiques, y compris les emballages. Au sein du coût de la viande, la part de l’abattage représente environ 10 centimes par kilo de porc.
L’éthique est un élément central, mais le problème pour nous serait d’évaluer la non-conformité à une charte éthique et de mettre en œuvre des actions correctives : notre rôle n’est pas de pénaliser les entreprises, mais d’essayer de les faire progresser. Aussi travaillons-nous dans un autre cadre. D’une part, nous avons développé la démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui intègre la notion d’éthique. D’autre part, nous encourageons les initiatives intéressantes, notamment celles des entreprises qui se rapprochent de leur filière amont pour mettre en place des dispositifs de contractualisation incluant des obligations de moyens réciproques.
S’agissant de l’étiquetage « avec ou sans étourdissement », le problème ne se pose que pour 20 % de nos approvisionnements : on peut considérer que le porc n’est pas concerné. Dans un certain nombre de cas, nous utilisons délibérément des produits issus d’animaux abattus rituellement, car nous fabriquons des produits halal ou casher. Mais d’une manière générale, nous ne disposons pas de l’information sur le mode d’abattage. Il semble donc difficile de mettre en place un étiquetage spécifique, car cela nécessiterait une traçabilité en amont des pièces issues des animaux abattus sans étourdissement et de ceux abattus avec étourdissement. Je précise que nous ne procédons pas à l’étiquetage au moment de l’emballage : le modèle d’étiquette a une durée de vie importante car il est fabriqué très longtemps à l’avance. Par conséquent, s’il fallait étiqueter la matière première en fonction de telle ou telle caractéristique, les entreprises devraient développer beaucoup plus de types d’emballage et d’étiquettes spécifiques – à moins de décider individuellement d’inscrire dans leur cahier des charges le refus d’acheter des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Vous avez évoqué des initiatives d’entreprises en lien avec l’amont. Les entreprises ont-elles tendance à s’orienter vers une démarche de certification, ou de garantie, en lien avec leurs fournisseurs – de l’élevage jusqu’à l’abattoir ?
M. Thierry Gregory. Nos entreprises sont soumises à un cahier des charges qui détaille une série de critères à respecter au moment de l’achat – couleur, épaisseur de gras, pH, etc. Au-delà de l’aspect contractuel, les initiatives pour mettre en place des relations spécifiques entre entreprises et fournisseurs se développent depuis environ un an. C’est un phénomène assez récent.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Ce mouvement est-il accompagné, voire initié, par les distributeurs, qui eux-mêmes peuvent être sollicités par les consommateurs ? Autrement dit, les préoccupations sociétales auxquelles vous avez fait allusion dans votre propos liminaire remontent-elles du consommateur au distributeur, puis du distributeur au fabricant ?
M. Thierry Gregory. Les deux tiers de nos produits sont commercialisés en libre-service, au sein desquels une part très importante est fabriquée sous marque de distributeur : le lien est fort avec le distributeur, à l’initiative de la démarche de garantie à laquelle vous faites allusion. Les démarches que j’évoquais à l’instant étaient le fait des entreprises : les rapprochements avec l’amont présentent pour elles un intérêt en termes de qualité, de traçabilité des produits, mais aussi de sécurité d’approvisionnement qui leur permet d’être fournies en matière première en quantité suffisante et dans la qualité souhaitée. Nos entreprises ont effectivement tendance à développer des liens étroits avec des éleveurs, des groupements d’élevage, et des abattoirs.
Mme Françoise Dubois. Vous avez évoqué des critères de qualité très stricts, en particulier en matière d’abattage pour éviter l’achat de viande altérée – on sait en effet que les manipulations brutales, à l’origine d’hématomes notamment, ont des effets néfastes sur la qualité de la viande. Signalez-vous ce genre d’anomalies ou ne faites-vous que les constater ?
M. Thierry Gregory. Les contraintes en matière de qualité définies dans notre cahier des charges sont évidemment destinées à être respectées. Une livraison non conforme, au regard de l’aspect visuel des produits ou de tout autre critère, aura des conséquences sur les relations entre l’entreprise et son fournisseur. Si le problème est ponctuel, celle-ci informera le fournisseur de cette non-conformité, voire refusera le lot qui ne correspond pas à la qualité demandée. Si le problème se répète, l’entreprise propose un audit au fournisseur dans une démarche d’amélioration, si elle tient à maintenir sa relation commerciale ; mais dans l’hypothèse où aucune solution n’est trouvée, elle peut être amenée à rompre toute activité commerciale avec ce dernier. Dans cette relation client-fournisseur, il ne nous appartient évidemment pas de demander aux abattoirs de faire évoluer leurs pratiques.
Mme Françoise Dubois. C’est dommage.
M. Thierry Gregory. J’en conviens. Mais notre fédération regroupe essentiellement des petites entreprises de 50 salariés, qui n’ont pas la puissance d’achat d’un gros opérateur : il leur est plus difficile d’imposer de bonnes pratiques. Cela dit, un abattoir qui perd trois ou quatre clients à cause de problèmes de qualité sera rapidement amené à réfléchir à l’amélioration de ses prestations, sans compter que la plupart des abattoirs appliquent les guides de bonnes pratiques élaborés dans le secteur de l’abattage. Ainsi, les établissements d’abattage appliquent des démarches de qualité et, de notre côté, nous avons généralement le choix de nos fournisseurs.
Mme Annick Le Loch. Certains industriels ont depuis longtemps choisi d’avoir leur propre unité d’abattage. Quelle part représentent-ils au sein de votre fédération ? Quels sont les avantages de ce modèle de production ?
La FICT a choisi de quitter l’interprofession. Pour quelles raisons ? Quelles en sont les conséquences ?
M. Thierry Gregory. Il y a trente ou quarante ans, les transformateurs avaient coutume d’abattre eux-mêmes, ce qui les obligeait à transformer l’intégralité de la carcasse, c’est-à-dire à fabriquer une kyrielle de produits. Par la suite, les entreprises ont eu tendance à se spécialiser : or si vous ne fabriquez que du jambon, lorsque vous abattez un cochon, il vous faut vendre le reste… Elles ont donc peu à peu abandonné l’abattage pour se concentrer sur la transformation. Aujourd’hui, certains groupes du secteur coopératif, quelques PME et des filiales de distributeur, intègrent dans leur giron des ateliers de découpe et de transformation, afin de produire à la fois de la viande et des produits transformés. On ne peut pas dire que ce soient des charcutiers qui ont créé un outil d’abattage : il s’agit plutôt d’ensembles industriels qui ont, au sein de leurs abattoirs, intégré des ateliers de découpe de différentes espèces et qui commercialisent ce qu’ils ne transforment pas.
Votre deuxième question ne relève pas de mon domaine de compétence. Je pense que la FICT a quitté l’interprofession en raison de divergences politiques sur les modes de production et la qualité des produits.
M. William Dumas. Vous avez souligné que les pratiques observées dans les vidéos n’ont rien à voir avec celles que vous constatez dans les abattoirs. Je suppose que vos PME ont plus souvent affaire à des chevillards et ne traitent pas directement avec les abattoirs
– sauf lorsqu’il s’agit de produits bio ou très spécifiques qui supposent d’acheter des lots bien particuliers, achetés directement chez l’éleveur, et abattus à part. Réalisez-vous des contrôles dans les abattoirs ? Et si oui, vos PME peuvent-elles plus facilement effectuer ces contrôles dans les abattoirs de territoire, comme celui de Mauléon, par exemple ?
M. Thierry Gregory. Avant de venir à cette audition, j’ai interrogé des entreprises sur leurs modes d’approvisionnement. Même les petites entreprises font le plus souvent affaire directement avec des abattoirs. Les approvisionnements par des chevillards peuvent être un complément, mais les contraintes définies par notre cahier des charges s’appliquent également dans ces cas-là. Notre objectif est d’avoir la viande la mieux adaptée à nos différentes productions. En matière de qualité, les aspects visuels sont extrêmement importants car une part significative de nos produits est vendue préemballée – ils sont visibles par nos consommateurs. Des pétéchies sur le jambon, par exemple, constitueront une non-conformité qui rendra le produit très difficilement commercialisable.
Pour auditer les abattoirs, il faut avoir un staff capable de le faire. Les contrôles sont donc plutôt réalisés par des entreprises de taille moyenne, voire importante. Les petites entreprises visitent leurs fournisseurs régulièrement, mais je n’irai pas jusqu’à dire qu’il s’agit d’audits. Néanmoins, lors de ces visites, des scènes comme celles montrées par les vidéos ne seraient pas passées inaperçues et auraient fait l’objet d’une remarque assez violente de la part de nos entreprises clientes : il n’est pas besoin d’être expert pour se rendre compte que de telles pratiques sont inacceptables.
M. le président Olivier Falorni. Merci, monsieur le directeur.
La séance est levée à douze heures trente-cinq.
——fpfp——
14. Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Van Goethem, directeur, et de M. Denis Simonin, administrateur en charge du bien-être animal à la direction-générale santé et sécurité alimentaire de la Commission européenne
(Séance du mercredi 25 mai 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.
M. le président Olivier Falorni. Nous recevons M. Bernard Van Goethem, directeur à la direction générale santé et sécurité alimentaire de la Commission européenne, et de M. Denis Simonin, administrateur au sein de cette même direction générale.
Le droit communautaire joue un rôle essentiel dans le domaine du bien-être animal dans les abattoirs. La place prise par la politique agricole commune dans la construction communautaire a en effet très vite amené les institutions européennes à réglementer le domaine de l’abattage à la fois du point de vue sanitaire mais aussi du point de vue de la souffrance animale, sujet qui intéresse tout particulièrement notre commission d’enquête.
Une directive du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est ainsi venue fixer les règles minimales communes pour la protection des animaux.
Par la suite, en 2008, le traité de Lisbonne a créé l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui dispose que « lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux ».
Compte tenu des écarts dans la mise en œuvre nationale de la directive de 1993, le Conseil a été conduit à adopter un règlement d’application directe, le règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort qui constitue aujourd’hui le corpus réglementaire applicable à l’ensemble des États membres.
C’est dans ce cadre que l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission européenne, rattaché à la direction générale santé et sécurité alimentaire, conduit chaque année des audits pour garantir l’application des systèmes de contrôle officiel et pour évaluer la conformité aux normes communautaires dans les États membres et dans les pays tiers qui exportent vers 1’Union européenne.
L’OAV a effectué un audit en France du 8 au 17 avril 2015 en vue d’évaluer les contrôles relatifs au bien-être des animaux durant l’abattage et les opérations annexes. Cet audit a donné lieu à la fois à des réunions avec les autorités compétentes et à des visites en abattoirs. Le rapport de cet audit, publié le 7 septembre 2015, ne fait pas état de manquements graves à la réglementation européenne, si ce n’est dans le cadre de l’abattage de volailles. En l’occurrence, même si le sujet n’était pas évoqué directement dans les vidéos diffusées ce matin, la question des volailles est posée. La commission d’enquête l’a intégrée à ses travaux dès l’origine : une table ronde sur le sujet devrait avoir lieu dans les jours qui viennent ainsi qu’une visite inopinée d’un abattoir de volailles.
Comme chacune de nos auditions, celle-ci est publique, ouverte à la presse, et diffusée en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Bernard Van Goethem et M. Denis Simonin prêtent successivement serment.)
M. Bernard Van Goethem, directeur en charge de la santé et du bien-être animal à la direction générale santé et sécurité alimentaire de la Commission européenne. Vous avez demandé à la Commission européenne de vous présenter la législation européenne en matière d’abattage des animaux et en particulier en matière de bien-être animal.
Vous avez aussi souhaité connaître les résultats d’un audit réalisé en France en avril 2015 par des experts de la Commission sur les conditions d’abattage et, de façon plus générale, vous nous interrogez sur la situation en Europe s’agissant de cette question.
Avant de présenter ces deux points j’aimerais rappeler succinctement le rôle de la Commission en matière d’application du droit communautaire.
L’application du droit européen relève au premier lieu de la responsabilité des autorités compétentes de chaque État membre. Dans le cadre des règles vétérinaires, et notamment du bien-être animal, la Commission dispose d’un service spécial d’experts, chargé de procéder à des audits dans les États membres : l’Office alimentaire et vétérinaire.
Ces audits visent à contrôler le travail des autorités compétentes. Les experts n’ont pas de capacité juridique pour procéder à des inspections d’établissements. C’est dans ce cadre que l’audit d’avril 2015 a été réalisé en France.
Je vais d’abord vous présenter les grandes lignes de la législation européenne s’appliquant à l’abattage des animaux de boucherie.
Plusieurs textes sont applicables dans ce contexte puisque la législation sur l’abattage des animaux concerne l’hygiène des viandes, le bien-être des animaux, et les contrôles officiels.
Je m’attacherai surtout à présenter les dispositions concernant le bien-être animal qui ont sans doute déjà été évoquées à plusieurs reprises lors de vos auditions précédentes.
Historiquement la première législation européenne sur le bien-être des animaux a porté sur l’abattage : il s’agissait d’une directive datée de 1974, entrées en vigueur en juillet 1975. Je rappelle que dans l’Union européenne, on abat par jour un million d’animaux de boucherie.
Depuis cette époque, la législation européenne sur le bien-être animal s’est étoffée. Elle comprend désormais de nombreux textes. Les normes sur l’abattage ont aussi été étendues en 1993, puis en 2009.
Aujourd’hui, la législation européenne prend en compte les normes internationales de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Cette institution, dont la session générale se tient cette semaine, rue de Prony, à Paris, a élaboré des lignes directrices détaillées sur le bien-être des animaux à l’abattage dès 2005.
La législation actuelle en matière de protection des animaux dans les abattoirs a été adoptée en 2009, mais elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2013.
La mise en œuvre de la protection des animaux est d’abord et avant tout la responsabilité des professionnels. C’est à eux, comme dans le cas de l’hygiène alimentaire, de mettre en œuvre des procédures appropriées afin de prévenir ou de limiter les risques inhérents à leurs activités. En outre, la législation prévoit une obligation de compétence en matière de bien-être des animaux pour l’entièreté du personnel qui manipulent les animaux dans les abattoirs.
Les abattoirs doivent nommer un responsable chargé du bien-être animal dont la principale tâche est de superviser la mise en œuvre de la législation auprès du personnel. La législation exige aussi qu’ils procèdent à des contrôlesb représentatifs de l’efficacité de l’étourdissement.
Les autorités compétentes doivent s’assurer d’une bonne diffusion des connaissances techniques et scientifiques, notamment par le développement de guides de bonnes pratiques, et par la mise en place d’un système de formation et de délivrance des certificats de compétence.
Elles doivent aussi vérifier la conformité des établissements aux normes de construction et d’équipement ainsi qu’aux normes opérationnelles.
Elles doivent, par ailleurs, en plus des pouvoirs habituels d’inspection, comme la suspension ou le retrait d’agrément, disposer de pouvoirs permettant de modifier les procédures opératoires de l’abattoir, ralentir ou stopper la chaîne d’abattage, suspendre ou retirer le certificat de compétence.
Outre la législation, la Commission européenne a pris une série d’initiatives pour assister les États membres dans la mise en œuvre des textes.
Dès 2012, elle a publié une brochure dans toutes les langues officielles de l’Union sur le rôle du responsable bien-être animal dans les abattoirs. Nous pouvons vous en communiquer un exemplaire en français.
La Commission a aussi mis en place un système de formation du personnel responsable des contrôles officiels avec un module spécifique sur le bien-être à l’abattage. Un module a été développé ultérieurement sous forme d’un apprentissage en ligne qui a connu un succès croissant auprès des inspecteurs.
Parallèlement, la Commission a demandé une série d’avis scientifiques concernant les procédures de contrôle de l’étourdissement dans les abattoirs. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a ainsi fourni, en 2013, d’importantes données scientifiques pour permettre aux responsables d’abattoirs de surveiller l’étourdissement des animaux.
Enfin, la Commission prévoit de lancer cette année une étude pour la préparation d’un guide européen de bonnes pratiques sur l’abattage des animaux, document qui devrait être finalisé au cours de l’année prochaine.
L’audit réalisé en France en avril 2015 n’a pas révélé de dysfonctionnements majeurs concernant l’abattage des animaux de boucherie. Encore une fois, cet audit visait l’organisation des contrôles et non la conformité des établissements visités.
L’audit a relevé une série de points positifs. La France dispose d’un soutien scientifique et officiel en matière de bien-être des animaux à l’abattage via l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Elle s’est engagée dans le développement de guides de bonnes pratiques, et depuis 2013, vingt organismes de formation ont été habilités, et plus de 5 000 personnes ont été formées en matière de bien-être animal sur les animaux de boucherie. De plus, les contrôles sont planifiés sur la base d’évaluation des risques, et les plans sont respectés.
L’audit révèle aussi certaines faiblesses. Les services officiels ne vérifiaient pas suffisamment les procédures opératoires normalisées des abattoirs, notamment en matière de surveillance de l’étourdissement. Sur les six opérations d’abattage d’animaux de boucherie observées, les méthodes d’étourdissements étaient correctement appliquées sans reprise de conscience pendant la saignée. Dans un cas seulement, le box de contention pour bovins était inadapté.
Globalement, la situation en France a été jugée satisfaisante pour les animaux de boucherie. Les autorités françaises détectaient les principales non-conformités et des mesures correctives adéquates étaient prises.
L’audit de la France se situait dans le cadre d’une série d’audits, menée entre 2013-2015, sur le bien-être des animaux à l’abattage, qui visait à vérifier la mise en œuvre du nouveau règlement. Elle a couvert treize États membres représentant plus de 80 % de la production de viande bovine de l’Union. Au regard de cette série, les autorités françaises présentent une performance moyenne avec des faiblesses comparables aux autres États membres sur les points que j’ai déjà évoqués.
M. le président Olivier Falorni. Merci, monsieur le directeur.
Pouvez-vous nous donner la position de la Commission en matière de vidéosurveillance des abattoirs ? Cette pratique existe-t-elle dans d’autres pays de l’Union ?
Lors de nos auditions, nous avons évoqué l’étourdissement des animaux par CO2, en particulier concernant les porcs. Dans quels pays européens cette technique, dont on voit bien qu’elle pose un certain nombre de difficultés, est-elle mise en œuvre ? D’autres pays utilisent-ils un gaz non aversif pour l’étourdissement ?
Quels sont les pays de l’Union qui disposent de dérogation pour pratiquer des abattages sans étourdissement ?
M. William Dumas. Je souhaite également savoir si de nombreux pays européens pratiquent l’abattage rituel, et comment ils font – il semble qu’il puisse parfois y avoir étourdissement préalable, mais que, dans d’autres cas, l’abattage ait lieu sans étourdissement. Dans ma circonscription, un abattoir pratique l’abattage rituel pour 50 % de sa production.
Nous avons déjà beaucoup parlé de formation dans notre commission d’enquête. On nous a dit qu’elles duraient quarante-huit heures. Je ne sais pas ce qui est prévu au niveau européen, mais je trouve que quarante-huit heures, c’est peu !
La vidéosurveillance du poste d’abattage peut-elle être un outil de formation ?
Mme Sylviane Alaux. Monsieur le président, cette commission d’enquête nous aura révélé que vous avez le pouvoir de lire dans les pensées. Vous avez posé la question que William Dumas souhaitait poser, avant de passer à celles que j’avais moi-même préparées…
M. William Dumas. C’est pour cela qu’il est président !
Mme Sylviane Alaux. Tout à fait ! Je m’associe donc aux questions du président.
M. Bernard Van Goethem. La Commission européenne n’a pas de position très arrêtée sur la question de la vidéosurveillance. Je ne sais si le procédé a déjà été utilisé dans les abattoirs. Il l’a été, en tout cas, dans certains marchés de bestiaux : après que des « scandales » ont été dénoncés par la presse, des propriétaires avaient installé des caméras afin que les images soient accessibles sur le Web, comme le sont celles de cette audition. Nous n’avons pas, de notre côté, de position sur le sujet.
En ce qui concerne les abattages rituels, la législation actuelle prévoit que les États membres peuvent donner des dérogations concernant certains dispositifs de la réglementation. Le règlement prévoit aussi que les États membres peuvent aller, s’agissant de bien-être animal, plus loin que les prescriptions. Certains ont interdit d’une façon ou d’une autre les abattages rituels sur leur territoire.
M. le président Olivier Falorni. Vous pouvez nous les citer ?
M. Bernard Van Goethem. De mémoire, je ne saurai vous en dresser une liste. Le Danemark est le pays qui a le plus récemment interdit ces abattages particuliers. Cela dit, il n’y avait pas d’abattages rituels dans ce pays…
M. le président Olivier Falorni. Il est plus facile de les interdire dans ces conditions !
M. Bernard Van Goethem. En effet ! De façon générale, les États membres dont une communauté demande ce genre de viande maintiennent la possibilité de l’abattage rituel, que ce soit pour la consommation intérieure ou l’exportation.
M. Denis Simonin, administrateur en charge du bien-être animal à la direction générale santé et sécurité alimentaire de la Commission européenne. Il serait bon de préciser que la législation ne parle pas d’abattage rituel, mais d’abattage sans étourdissement.
M. le président Olivier Falorni. C’est l’expression que nous essayons d’employer !
M. Denis Simonin. Le raccourci est habituel, mais on peut faire du halal avec étourdissement réglementaire, et inversement. Il y a parfois des dérives dans l’interprétation. Il y a une confusion entre l’abattage conforme à une religion et l’abattage sans étourdissement, qui explique que nous ayons parfois du mal à avoir une bonne vision de la situation. Ce n’est pas exactement la même chose, et c’est même parfois très différent.
L’article 26 du règlement européen sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort oblige les États membres à notifier des mesures plus strictes dans le cas d’abattage sans étourdissement. Nous avons reçu des notifications de pays ayant pris des mesures plus restrictives. Les cas de la Suède et de la Finlande sont bien connus : elles autorisent des d’abattages sans étourdissement, ou plutôt sans saignée directe avec, parfois des méthodes d’étourdissement « non approuvées » – l’utilisation, par exemple, de paramètres électriques dont la fonctionnalité n’a pas été démontrée scientifiquement, ou de méthodes qui peuvent peut-être étourdir, mais pas à 100 %. Le règlement définit l’étourdissement en se fondant sur les méthodes autorisées.
Du point de vue légal, l’abattage sans étourdissement se fait donc soit par saignée directe – là, les choses sont claires –, soit en pratiquant un étourdissement avec des paramètres non réglementaires ou des méthodes non autorisées, comme l’utilisation d’une tige non perforante pour les bovins, par exemple : cette méthode dite de concussion n’est pas autorisée en Europe pour les animaux lourds, mais elle est très utilisée dans d’autres pays, comme l’Australie. L’étourdissement peut aussi être effectué avec des paramètres électriques inférieurs à ceux demandés dans la législation.
Le Danemark a été cité. Parmi les notifications récentes, on compte Malte, le Luxembourg, la Slovénie. Mais les choses évoluent sans cesse : les choses ont par exemple évolué en Pologne.
M. le président Olivier Falorni. Et l’utilisation du CO2 ?
M. Denis Simonin. Il faut distinguer l’abattage d’animaux destinés à la consommation humaine et la mise à mort pratiquée dans d’autres contextes, comme la destruction d’animaux en cas de maladies contagieuse. On rencontre trois cas de figure qui sont listés dans l’annexe du règlement.
L’usage du CO2 à haute concentration, au-delà de 40 %, est uniquement autorisé pour l’abattage du porc destiné à la consommation humaine. Dans l’Union européenne, il n’est autorisé pour les autres espèces, comme la volaille, qu’exceptionnellement, en cas d’abattage d’urgence, par exemple en cas de grippe aviaire, comme dans l’épisode récent qu’a connu la France. Pour la volaille, il est possible d’utiliser le CO2, mais avec un protocole en deux phases : on passe d’une phase à faible concentration, moins de 40 %, pendant laquelle l’animal perd conscience, à une phase à forte concentration, jusqu’à 80 ou 90 %. L’animal est alors quasiment mort – après, c’est une affaire d’évaluation. Pour la volaille, on peut aussi utiliser le CO2 en le mélangeant à des gaz inertes, comme l’argon, plus souvent l’azote. Ces derniers protocoles à faible concentration en CO2 sont utilisés dans l’industrie : ils fonctionnent très bien. En revanche, à ma connaissance, il n’en existe pas de similaire pour l’abattage des porcs, même si les recherches ont constaté l’efficacité du procédé. À l’époque de la préparation du règlement, une étude d’impact avait été réalisée sur ce sujet. L’autorité scientifique européenne avait démontré que le CO2 à forte concentration était aversif. Elle préconisait qu’il soit utilisé à faible concentration, et mélangé à des gaz inertes. Mais ces protocoles étaient aussi beaucoup plus lents : deux fois plus lents, si je me souviens correctement des données techniques. La mise en œuvre d’une telle méthode en abattage industriel de porcs aurait exigé une restructuration assez importante des abattoirs existants. Cela explique sans doute que le procédé n’ait pas été fortement développé – mais il s’agit d’une pure spéculation de ma part.
Mme Geneviève Gaillard. Les audits que vous avez effectués portaient-ils plutôt sur les gros abattoirs industriels ou sur les abattoirs de taille plus réduite que l’on trouve dans nos territoires ruraux ?
L’audit a révélé certaines faiblesses françaises, notamment, nous avez-vous dit « en matière de surveillance de l’étourdissement ». J’aimerais que vous alliez plus loin sur ce que vous avez vu, et sur ce que nous pourrions améliorer.
Avez-vous toujours trouvé un matériel adapté dans les abattoirs ? Nous savons, par exemple, que les cages de contention utilisées pour les gros bovins ne peuvent pas servir pour les veaux.
Enfin, l’étourdissement post cut – autrement dit après jugulation – est-il pratiqué dans l’Union européenne ?
M. Arnaud Viala. Comment se situe l’abattoir moyen français en termes de taille par rapport à l’abattoir moyen européen ?
Existe-t-il selon vous une corrélation entre les faiblesses des procédés constatés en abattoir au regard du bien-être des animaux et la taille des structures ? Les performances des petits abattoirs en la matière sont-elles moindres ?
Je n’ai pas compris si la méthode utilisée pour l’abattage rituel, consistant à percuter le crâne sans perforation, était autorisée par le règlement européen ou pas. Pouvez-vous préciser ce qu’il en est ?
M. Hervé Pellois. Je m’interroge sur la qualité de l’étourdissement. Comment vérifie-t-on si l’étourdissement a été fait dans de bonnes conditions ? Quels critères, quelles méthodes utilise-t-on pour s’en rendre compte ?
Vous nous avez distribué un document dans lequel il est indiqué que l’audit réalisé en France en 2015 avait montré que la situation était globalement satisfaisante, « volailles exclues ». Est-ce à dire que les volailles ne faisaient pas partie du champ d’investigation, ou bien que la situation n’est pas satisfaisante en France en matière d’abattage des volailles ?
L’audit a aussi montré que les autorités françaises étaient en mesure de détecter les principales non-conformités et d’appliquer des mesures coercitives, sauf pour éviter le transport d’animaux inaptes en abattoir. Quelles mesures plus contraignantes pourrions-nous imposer pour mettre fin à ces pratiques ?
S’agissant de l’abattage à la ferme, des expérimentations sont-elles menées en Europe ? Peut-on imaginer des petites structures de proximité pour abattre en petites quantités des animaux de grosse taille ?
M. Guillaume Chevrollier. Cette commission d’enquête a été créée après qu’un lanceur d’alerte, l’association militante pro-végétarienne L214, a diffusé des vidéos. Existe-t-il des associations similaires dans les autres États membres et qui auraient les mêmes modes d’action ? Quelles réactions provoquent leurs actions dans les pays de l’Union ?
Quelle est la tendance européenne en matière de consommation de viande ?
Que pensez-vous enfin des abattoirs itinérants ?
M. Bernard Van Goethem. Le service d’inspection de la direction générale santé et sécurité alimentaire réalise deux cents à deux cent cinquante audits par an, principalement dans les États membres, mais également dans les pays tiers qui exportent vers l’Union. Les produits d’origine animale sont inspectés avant d’être autorisés à l’export vers les États membres.
Les audits sont organisés longtemps à l’avance, en coopération étroite avec les autorités compétentes des États membres – le ministère de l’agriculture et sa direction générale de l’alimentation (DGAL) en ce qui concerne la France. Ils consistent, durant une semaine, à mener, sur place, une mission de contrôle de l’autorité compétente. Il n’y a pas d’inspection individuelle des abattoirs comme cela se pratique dans certains pays tiers lorsque les inspecteurs de l’Union visitent les abattoirs un par un avant une autorisation d’exporter vers l’Union : il s’agit de vérifier que l’autorité compétente a bien mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la vérification de l’application sur le terrain des normes européennes. Autrement dit, c’est un audit de l’auditeur. Bien sûr, nos inspecteurs visitent également des abattoirs sans aviser ces derniers longtemps à l’avance : ils se rendent dans une région et choisissent au dernier moment de visiter telle structure sans qu’il y ait vraiment d’information préalable des propriétaires. Ils l’ont fait en France, en 2015. Il ne s’agit pas d’une vision spécifique ou ponctuelle, mais d’un regard sur un échantillon de ce qui existe dans l’État membre audité.
Aucun manquement majeur n’a été détecté en France. Les inspecteurs ont noté dans leur rapport qu’ils ont découvert une cage de contention qui n’était pas aux normes ; le vétérinaire ne s’était pas rendu compte du problème, mais le matériel a immédiatement cessé d’être utilisé.
Le rapport évoque aussi un manque de contrôle des autorités compétentes concernant la vérification de l’étourdissement. Le nouveau règlement responsabilise beaucoup plus fortement les abattoirs. Dans chaque grand abattoir, une personne désignée comme responsable bien-être animal suit des formations spécifiques mises en place par la DGAL, bien plus approfondies que celles qui sont dispensées aux employés qui manipulent le bétail. La petite brochure dont je vous parlais sur le rôle du responsable bien-être animal dans les abattoirs a été fort appréciée par les professionnels. D’après les informations qui remontent à Bruxelles, lorsqu’un responsable bien-être animal est en place dans un établissement – c’est obligatoire dans les gros abattoirs –, la sensibilisation des professionnels à ce problème est bien plus grande.
S’agissant des abattoirs itinérants, des abattoirs à la ferme et des abattoirs de petit village, il faut rappeler, au-delà de la réglementation en matière de bien-être animal, que les règles en matière d’hygiène sont assez strictes. Cependant, toute une série de dérogations peuvent être utilisées par les États membres – c’est ce que nous appelons la flexibilité –, qui leur permettent de déroger à diverses exigences en matière de structure. On peut très bien imaginer, dans des régions reculées de l’Union ou dans celles où l’on abat qu’un porc par jour ou un bovin par semaine, que les autorités compétentes dérogent à des exigences en matière d’hygiène et permettent l’utilisation d’un abattoir au fonctionnement épisodique sans restreindre pour autant la destination de la viande produite au marché national. Cette flexibilité est utilisée davantage par certains États membres que par d’autres.
Enfin, il existe, au niveau européen, de nombreuses organisations très actives en matière de défense du bien-être animal. Nous recevons très fréquemment des vidéos du même style de celles diffusées par L214, qui concernent principalement le transport des animaux.
M. Denis Simonin. Le règlement comporte certaines obligations que doivent remplir les autorités compétentes : elles doivent mettre en place des formations, et valider ces dernières par des certificats et des examens indépendants. Le règlement donne des définitions très précises de ce qu’un professionnel doit connaître selon son activité dans l’abattoir – c’est l’annexe IV : correspondance entre les opérations et les matières requises pour l’examen de compétence. Toutefois, du fait des compétences relativement limitées de l’Union européenne en matière d’éducation, nous ne pouvons pas prescrire un cursus spécifique. C’est pour nous un problème récurrent, les questions de formation relevant essentiellement de la compétence nationale. Nous faisons le même constat pour les équivalences de certains diplômes – je suis vétérinaire, mais cela concerne par exemple aussi les médecins. Malgré la convergence de certains domaines de formation, ces sujets restent de la compétence des États membres. En conséquence, le règlement ne peut pas donner de temps minimal pour une formation ni imposer un choix entre formation pratique ou théorique. Cela induit une certaine variabilité – nous avons connu la même situation avec le règlement transport.
L’étourdissement post cut, après saignée, existe au moins sur le papier dans certains États membres. Est-ce pratiqué ? Je n’en sais rien. J’ai vu une vidéo : cela peut se faire, en particulier sur les bovins – cela a un certain sens. Je ne peux pas vous dire si le procédé est vraiment utilisé dans un pays de l’Union. Je ne suis pas certain qu’il soit facilement accepté par les communautés religieuses.
Mme Geneviève Gaillard. Certaines l’acceptent !
M. Denis Simonin. Il faut voir quel compromis est trouvé.
Je vous prie de m’excuser car ne n’ai pas été clair s’agissant de la concussion. L’étourdissement sans pénétration de la boîte crânienne est uniquement autorisé sur des animaux de petite taille. Il est en pratique interdit sur les bovins, mais, dans le cadre d’un abattage sans étourdissement, le procédé peut faire l’objet d’une dérogation, par exemple si une communauté musulmane l’accepte. Juridiquement, il est alors parfaitement possible d’utiliser cette méthode.
M. Arnaud Viala. Les abattoirs qui pratiquent l’abattage rituel sans étourdissement demandent à pouvoir utiliser cette technique pour améliorer les conditions de bien-être de l’animal. Je suppose en conséquence que les communautés religieuses l’acceptent.
M. Denis Simonin. Le cadre juridique européen permet d’utiliser ce procédé, mais il appartient aux autorités nationales de décider si elles sont d’accord.
M. Arnaud Viala. Cela doit faire l’objet d’une dérogation ?
M. Denis Simonin. Oui ! Les connaissances scientifiques qui ont servi à établir la liste des méthodes autorisées ne permettent pas d’être certain que l’étourdissement est bien complet et réel. Dans son avis de 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments considérait que le procédé pouvait être correct, mais qu’elle ne disposait pas d’éléments scientifiques lui assurant qu’il était fiable s’agissant des animaux d’un certain poids.
Cela dit, depuis 2004, les techniques et les connaissances scientifiques ont évolué. Une procédure relativement simplifiée existe pour modifier l’annexe I du règlement qui établit la liste les méthodes d’étourdissement, mais il faut pour la mettre en œuvre que nous soyons saisis d’une demande, et que le procédé soit évalué par l’autorité scientifique.
Vous nous avez interrogés sur la qualité de l’étourdissement. Nous avons nous-même questionné l’autorité scientifique sur ce sujet puisque le règlement prévoit que les abatteurs effectuent régulièrement des contrôles sur des échantillons d’animaux suffisamment représentatifs, pour vérifier que l’étourdissement fonctionne bien sur la chaîne. Ils doivent décrire la procédure qu’ils adoptent.
Nous avons demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments de nous fournir une sorte de boîte à outils qui puisse être utilisée par les abatteurs. Une série d’opinions scientifiques ont été émises en 2013 pour les grandes espèces de boucherie et de volaille au sujet des principales méthodes de vérification. Les connaissances scientifiques existent donc en ce domaine. Je ne les détaillerai évidemment pas, mais il faut au moins utiliser deux critères, et il y a tout de même des indicateurs. Par exemple, pour les bovins, sur les vidéos diffusées par L214, lorsque l’on voit ce que l’on appelle un « réflexe de redressement » de l’animal, il est clair qu’il est conscient ; il n’y a pas photo. Il y a des indicateurs négatifs et positifs, des réactions qui peuvent être provoquées, mais nous disposons d’une boîte à outils utilisable dans des conditions d’abattage habituelles.
Lorsque la chaîne tourne extrêmement rapidement, on peut réfléchir à des méthodes de détection automatisées, notamment pour l’abattage des porcs. En Allemagne, j’ai vu le cas d’un abattoir de porcs où l’on essayait de trouver un système de détection en stimulant les animaux par un petit jet d’eau avant qu’ils ne passent à l’échaudage – un système de déviation automatisé était prévu en cas de réaction.
Il s’agit d’une nouvelle approche que de nombreux abattoirs n’adoptaient pas jusqu’à aujourd’hui parce qu’ils n’en avaient pas l’obligation. Il y a toute une culture à changer, car les gens ont tendance à appliquer les paramètres sans vérifier qu’ils fonctionnent. Dans la philosophie du nouveau règlement, appliquer les paramètres qui sont dans la législation, c’est bien, mais vérifier qu’ils fonctionnent, c’est mieux… Il y a trop de réglages pratiques sur un chaîne d’abattage, trop de données pour que le contenu de la réglementation fonctionne à tous les coups. Certains éléments doivent être ajustés, il faut introduire des flexibilités.
M. Hervé Pellois. Je reviens sur mes « volailles exclues ». L’audit de 2015 a-t-il pris en compte les volailles ?
M. Denis Simonin. Le rapport de L’Office alimentaire et vétérinaire précise que : « Les résultats de l’audit fait en France sur l’abattage n’étaient pas pleinement satisfaisants dans la mesure où l’étourdissement des volailles dans les bains électriques ne répondait pas aux exigences du règlement sans que les autorités françaises ne prennent des mesures coercitives. » Nous avons rencontré ce problème dans d’autres États membres – je ne dis pas cela pour excuser les autorités françaises, car il y a clairement un problème de conformité.
Le nouveau règlement est beaucoup plus détaillé sur un certain nombre de points, notamment concernant les paramètres électriques minimaux à respecter pour l’étourdissement des volailles – de nouveaux avis scientifiques ont fait évoluer les choses. Il reste encore des progrès à faire sur ce sujet en France et en Europe. En tout cas, au moment où l’audit a été mené, les mesures nécessaires n’avaient pas été prises.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Nous avons entendu au cours des auditions qu’il y avait parfois des problèmes d’efficacité du matériel, notamment celui utilisé pour l’étourdissement. Fait-il l’objet d’une normalisation ou d’un agrément avant sa mise sur le marché ? On reproche souvent à l’Union européenne d’édicter des normes ; en la matière, elles seraient sans doute les bienvenues.
Vous avez été interrogé sur l’effet que la taille des abattoirs pouvait avoir sur leur efficacité en termes de bien-être animal. En la matière, quel est l’effet de la spécialisation ? Nous avons visité deux établissements, l’un, spécialisé, l’autre, multi-espèces : c’est assez différent. Quel modèle est le plus répandu en Europe, certains États membres sont-ils davantage « spécialisés » d’autres « multi-espèces » ?
Vous avez évoqué les inspections effectuées dans les établissements d’abattage des pays tiers qui exportent vers l’Union : portent-elles sur le bien-être animal, et sont-elles effectuées sur ce sujet avec d’autant d’acuité que s’agissant des aspects sanitaires ? Nous avons pu constater que la prégnance des réglementations sur la qualité alimentaire des produits était un peu supérieure à celles portant sur le bien-être animal – il est vrai que la préoccupation sanitaire est plus ancienne. Existe-t-il une règle qui permettrait de nous assurer que nous n’importons pas d’animaux abattus dans des conditions que nous n’accepterions pas au sein de l’Union européenne ?
Enfin, vous avez parlé de dérogations, d’adaptations des normes en fonction de la taille, de la cadence, ou de la capacité de certains établissements. Cela peut se comprendre pendant une certaine durée, mais une politique de convergence est-elle menée afin d’uniformiser les règles ? Je ne parle pas uniquement de l’abattage sans étourdissement, mais aussi par exemple de ce que vous nous avez dit à propos des petites structures et des dérogations en matière d’hygiène.
M. Thierry Lazaro. Monsieur Simonin, je pense que nous pouvons parler d’abattage « rituel » sans complexe. Des sacrificateurs se trouvent dans les abattoirs, et il y a des données culturelles que nous n’avons pas à nier : elles sont là. Beaucoup de nos compatriotes s’alimentent de la sorte, et je n’ai pas à juger si c’est bien ou mal. Je dois en revanche porter un jugement sur la méthode employée pour tuer l’animal, et savoir si elle est plus ou moins douloureuse. Il faut aussi tenir compte des données économiques car si, en France, nous consommons de la viande issue de l’abattage rituel, nous en exportons aussi beaucoup, ce que le législateur ne peut pas ne pas avoir à l’esprit.
Lorsque je vous entendais parler de viande halal avec étourdissement réglementaire, je me disais qu’il n’y a pas véritablement de lignes directrices en la matière au niveau européen : tout semble pouvoir fonctionner par dérogation. Si l’on va jusqu’au bout du raisonnement, il peut y avoir une pratique plus ou moins douloureuse de l’abattage selon les clients et leurs demandes.
Une réflexion est-elle menée sur la normalisation des matériels, qu’ils soient destinés aux petits ou aux grands abattoirs ?
Mme Françoise Dubois. La question du matériel me préoccupe aussi. L’audit a relevé un cas de box de contention inadapté : comment cela peut-il arriver techniquement ? Un seul cas, c’est déjà un cas de trop !
Dans le document que vous nous avez distribué, il est noté parmi les faiblesses constatées par l’audit mené en France : « Modes d’emploi des équipements insuffisants. » Nous avons cru comprendre que la formation des personnels était assez succincte, si les modes d’emploi sont par ailleurs insuffisants, il n’est pas étonnant que nous assistions de temps en temps à des dérapages, et il ne faut pas en vouloir au personnel des abattoirs.
Puis-je enfin avoir quelques précisions sur ce que vous qualifiez de « guide des bonnes pratiques » ?
M. Yves Daniel. Je précise que je suis député-paysan-éleveur, et que j’ai commencé à tuer les cochons, les veaux et les vaches à l’âge de quatorze ans. J’ai pu observer de nombreuses choses. Les méthodes de tuerie à la ferme, notamment celle du cochon, ont beaucoup évolué.
Lorsque l’on parle de maltraitance, on parle de la mise à mort. Quelle est la définition de la maltraitance en termes de souffrances de l’animal mis à mort ? En tant qu’êtres humains, il nous appartient d’analyser la maltraitance à partir d’études scientifiques et d’observations – ce ne sont pas les animaux qui vont faire cette commission d’enquête… Nous réagissons en êtres sensibles dotés d’une forme d’intelligence, mais aussi en êtres sentimentaux. Notre analyse est influencée par ce ressenti. L’animal, de son côté, est un être sensible selon les règles légales et les textes relatifs au bien-être animal, mais la notion de souffrance n’est peut-être pas la même pour les animaux que pour nous. Disposons-nous de résultats d’études qui permettent de bien définir les critères de la maltraitance et de la souffrance ? Comment les mesure-t-on ? Le comportement de l’animal varie suivant la manière dont on le tue : autrefois on tuait les cochons sans les assommer, en saignée directe, sur un banc, ensuite, on les a assommés, maintenant on leur met la tête en bas pour les désensibiliser. Mais d’autres critères entrent en ligne de compte, comme les conséquences sur la viande. J’aimerais y voir plus clair sur les notions de maltraitance et de souffrance.
M. Bernard Van Goethem. Mettons d’abord fin à ce mythe selon lequel l’Union européenne importerait de la viande du monde entier. C’est faux : en plus de la Norvège et de la Suisse, nous n’importons de la viande rouge que depuis dix pays dans le monde parmi lesquels les États-Unis et le Canada, le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Botswana, la Namibie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Pour autoriser des pays tiers à exporter vers l’Union, il y a d’abord des critères de santé animale : nous n’importons pas de viande d’un pays atteint par la fièvre aphteuse. Le respect des normes en matière d’hygiène dans les abattoirs entre ensuite en compte. Enfin, depuis quelques années, bien que cela ne soit pas couvert par l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, dit accord SPS, de l’Organisation mondiale du commerce, nous avons également imposé aux pays tiers de respecter nos propres normes en termes de bien-être animal lors de l’abattage.
Mme Sylviane Alaux. C’est contrôlé ?
M. Bernard Van Goethem. Tout à fait. Nos inspecteurs visitent les abattoirs et vérifient que les installations sont bien conformes à nos prescriptions.
Par ailleurs, les pays tiers doivent désormais aussi respecter les règlements européens, très stricts, en matière de transport d’animaux. La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu, il y a six à huit mois, à Luxembourg, un arrêt qui oblige les transporteurs exportant des animaux vivants vers les pays tiers à se conformer aux normes de bien-être animal dans les transports jusqu’au point d’arrivée.
Monsieur le rapporteur, il est évident que dans l’Union européenne, de plus en plus d’abattoirs se spécialisent. Le plus grand que j’ai visité se trouve au Danemark : on y abat 50 000 porcs par jour. C’est assez impressionnant ! C’est très automatisé : ils utilisent les gaz…
M. le président Olivier Falorni. C’est un étourdissement par gaz ?
M. Bernard Van Goethem. Les porcs descendent sous terre : c’est assez impressionnant… Que l’on me comprenne bien : l’Union ne pousse pas à la création de grosses structures de cette nature ; elle veut au contraire permettre à des structures locales, de taille plus réduite, de se maintenir sur tout le territoire – on ne peut pas comparer la production de porcs au Danemark avec la production de bovins ou de moutons dans d’autres États membres.
Dans ce but, nous avons prévu toute une série de flexibilités qui permettent d’abattre des animaux dans les coins les plus retirés de l’Union – cela peut être dans les montagnes de France ou au fin fond de la Roumanie – tout en garantissant que l’hygiène est également respectée. L’Union ne fait donc pas le choix des uns au profit des autres.
Des dispositions sont aussi prévues pour permettre au producteur local d’abattre lui-même sa volaille ou ses lapins et de les vendre directement à la ferme. Bien entendu, cette disposition ne vaut pas pour les bovins ou les porcs : il n’est pas question d’abattre à la ferme les produits destinés à la vente. En revanche, dans la réglementation européenne, rien n’empêche un fermier d’abattre lui-même son porc pour la consommation du ménage. Nous essayons de permettre à tous les types de structures de se maintenir, et d’aider ainsi les petits producteurs locaux à vendre leurs produits sur le marché.
M. Denis Simonin. Une disposition du règlement oblige les fabricants de matériel d’immobilisation ou d’étourdissement à fournir un mode d’emploi précisant le calibre des animaux concernés, les paramètres à respecter, et, éventuellement, les méthodes permettant de mesurer l’étourdissement. Il s’agit d’une obligation nouvelle qui se met difficilement en place dans la plupart des États membres, comme toutes les mesures nouvelles. Elle vise à pousser les fabricants à réfléchir aux conséquences : ceux qui fabriquent du matériel d’étourdissement ou de contentions n’ont pas nécessairement un intérêt particulier pour la biologie ou la connaissance de l’animal. Historiquement, ce sont plus souvent des spécialistes d’ingénierie. Les plus spécialisés font un bon travail ; mais il arrive que des firmes polyvalentes fournissent des systèmes intégrés. Le règlement doit tous les amener à évoluer.
Le système d’agrément a existé autrefois dans la réglementation française. Un équilibre doit être trouvé entre la lourdeur administrative de la procédure, et l’efficacité recherchée. L’approche réglementaire n’est pas privilégiée aujourd’hui. On préfère, au niveau de la législation européenne, l’approche qui consiste à laisser aux professionnels la responsabilité de leur travail, et à intervenir lorsqu’il y a un problème, plutôt que celle qui conduit à tout bureaucratiser. L’agrément me paraît en conséquence être peu d’actualité, en tout cas dans le cadre de la Commission actuelle.
La France a validé et développé un guide des bonnes pratiques ovines. C’est un très bon exemple de ce type de guide qui donne des outils aux professionnels pour bien appliquer la législation, voire aller au-delà puisque cette dernière ne couvre pas nécessairement toutes les étapes en détail étant donné le nombre de variables. Ces guides donnent la possibilité aux professionnels de définir leurs propres procédures opératoires normalisées de façon à ce qu’ils puissent s’adapter par rapport à leur propre chaîne.
Mme Françoise Dubois. Ces guides sont-ils utilisés pour la formation de personnels ?
M. Denis Simonin. Ils devraient l’être, et ce serait une bonne chose. L’article 20 du règlement prévoit que les autorités des États membres disposent « d’une assistance scientifique indépendante suffisante » qui leur fournit non seulement « des avis scientifiques concernant les guides des bonnes pratiques », mais qui a aussi une responsabilité dans la validation des programmes de formation. Cet organisme – en France, il s’agit de l’ANSES – devrait donc avoir une approche cohérente qui permette l’utilisation des guides de bonnes pratiques dans la formation. Vous avez parfaitement raison, madame la députée de faire le lien entre les deux.
Il n’est pas facile de répondre en quelques mots à la question qui nous a été posée sur la souffrance. C’est une question complexe. En terminologie, la souffrance et le bien-être animal ne se recoupent pas : la première notion a une dimension relativement limitée alors que la seconde est un concept plus positif. Il existe par ailleurs des degrés de souffrance. On peut simplifier en parlant de deux types de souffrance. L’une est physiologique : elle est liée à une atteinte physique de l’organisme qui provoque la douleur. L’autre, liée à une détresse, est psychologique. Elle existe aussi chez l’animal : c’est la peur. Si vous placez un animal d’élevage – ce sont pour la plupart des proies – face à un prédateur, il va exprimer un certain degré de souffrance. De même s’il fait l’objet d’une agression, même si elle est par exemple purement sonore. Il peut exister des souffrances qui ne sont pas des douleurs. Lorsqu’il y a douleur, il y a une souffrance psychologique : s’il est conscient durant l’abattage et la perte de vie, l’animal est angoissé parce qu’il sent qu’il va mourir. La douleur et la souffrance psychologique se combinent.
Comment mesurer cela ? Il existe plusieurs modes de mesures scientifiques. Une très abondante littérature a été publiée sur ces questions. Si cela vous passionne, nous vous transmettrons des références. Il est vrai que l’on part souvent de notre propre perception ; c’est une sorte d’anthropomorphisme conceptuel : nous transposons à l’animal des ressentis qui sont les nôtres. Ce principe de base n’est pas totalement erroné car nous sommes des mammifères. Du point de vue physiologique et évolutif, si nous ne sommes pas complètement des animaux d’élevage, nous en sommes tout de même extrêmement proches – nos dispositifs anatomiques sont très voisins. Nous savons que ce qui est douloureux pour l’homme l’est aussi pour l’animal. L’un et l’autre sont pourvus de terminaisons nerveuses qui stimulent la douleur. Lorsque nous découvrons sur le plan anatomique des parties d’organes plus sensibles que les autres chez l’animal, cela permet de mesurer sa sensibilité. Pour l’étourdissement, l’encéphalogramme est l’étalon en matière de mesure : c’est lui qui permet de garantir à coup sûr s’il y a perte de conscience ou pas. Mais des mesures physiologiques de la douleur peuvent aussi être utilisées : on peut chercher certains corticoïdes dans le sang, la salive ou les expressions urinaires – mais cela donne lieu à des interprétations, et il existe des biais.
Enfin, on peut observer le comportement de l’animal. Les comportements de retrait ou d’évitement constituent des indicateurs de la douleur. Ainsi, on sait que le CO2 est aversif parce que des expériences ont montré que si l’on attire un animal avec de la nourriture dans un espace où se trouve du CO2, il n’y reste pas longtemps ; et s’il a perdu conscience et que l’on répète l’expérience, il n’y revient pas. Il a donc retenu quelque chose de désagréable. On ne fait pas le même constat avec l’utilisation un gaz inerte. Dans la même situation, en azote complet, l’animal n’a pas eu une expérience négative alors qu’au-delà de 40 % de CO2, il a eu une expérience aversive.
Il existe donc au final de nombreuses méthodes de mesures de la douleur et de la souffrance. Elles évoluent en permanence. Nous disposons d’éléments assez nombreux qui peuvent être croisés pour des vérifications. Ils permettent de bien mesurer ces phénomènes.
M. le président Olivier Falorni. Quelle est la réglementation européenne en matière d’abattoirs ambulants ? Dans quels pays de l’Union en trouve-t-on ? Comment se déroulent les contrôles sanitaires dans ces établissements itinérants ? L’Office alimentaire et vétérinaire a-t-il déjà inspecté ce type de structure ?
Quelle est la position de la Commission concernant l’imposition d’un étiquetage systématique des produits alimentaires indiquant le mode d’abattage – avec ou sans étourdissement préalable ? Quels seraient les éventuels obstacles à un tel étiquetage ? Lorsque nous avons posé cette question lors de nos auditions, on nous a renvoyés à la Commission européenne. Vous êtes là, cela tombe bien !
M. Bernard Van Goethem. Les abattoirs ambulants doivent respecter les mêmes dispositions en ce qui concerne les règles d’hygiène que les autres établissements. Toutefois, le règlement bien-être animal prévoit la possibilité d’adopter des dérogations aux exigences de configuration, de constructions et d’équipement pour les abattoirs mobiles.
Aucune dérogation n’a été adoptée au niveau européen, mais en l’attente d’adoption, les États membres peuvent établir des dispositions nationales particulières pour ces abattoirs.
L’utilisation de ces abattoirs pose toutefois des difficultés par exemple pour leur agrément, pour l’apposition de l’estampille sanitaire après l’inspection post mortem, ou pour la mise à disposition d’eau potable. Il faut aussi savoir comment disposer des sous-produits animaux, qui représentent un poids important pour les bovins, ou comment régler les problèmes environnementaux tels que le traitement des effluents.
En l’absence d’obligation légale, la Commission ne dispose pas d’information sur le nombre d’abattoirs mobiles en Europe. Le maillage géographique de ces abattoirs est le reflet de choix économiques et bien sûr d’une adéquation avec une filière de production.
Lors de l’audit effectué, entre 2013 et 2015, dans treize états membres, l’Office alimentaire et vétérinaire n’a pas visité d’abattoir mobile. L’Office a été informé qu’un abattoir itinérant avait été autorisé au Danemark, mais il n’a pas pu le visiter lors de son inspection car il n’était pas utilisé à ce moment-là. En Allemagne, l’Office a appris qu’il existait également un abattoir mobile, mais qu’aucune dérogation au règlement n’avait été demandée. La mission d’audit a visité la structure, mais à un moment où elle ne fonctionnait pas.
Ce sujet a donné lieu à un important débat au moment de l’adhésion de la Finlande et de la Suède qui désiraient disposer d’abattoirs mobiles pour l’abattage des rennes.
La question de l’étiquetage revient très souvent. La Commission a commandé une étude sur l’étiquetage systématique des produits alimentaires avec mention du mode d’abattage. Ses résultats ont été publiés en 2015. Cette étude fait suite à une demande du Parlement européen lors de l’adoption du règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
L’information des consommateurs est bien sûr d’une importance cruciale, mais d’autres questions doivent être aussi prises en compte comme les coûts additionnels pour la filière ainsi que les conséquences sur les minorités religieuses.
De plus, plusieurs modalités d’étiquetage peuvent être envisagées et, même dans ce cas, l’étude n’apporte pas de preuve flagrante que l’information serait remarquée ou comprise par les consommateurs, la plupart d’entre eux n’ayant pas une connaissance précise du processus d’abattage.
Actuellement, seuls les œufs font l’objet d’un l’étiquetage obligatoire en matière de bien-être animal.
M. le président Olivier Falorni. Le sujet est d’actualité !
M. Bernard Van Goethem. Tous les œufs achetés sont marqués individuellement avec un chiffre de zéro à trois, mais nous avons constaté que très peu de consommateurs lisaient cette mention ou l’utilisaient. Nous avons reçu et présenté les résultats d’une étude, un « eurobaromètre » que nous avions commandé sur le bien-être animal. Ces données montrent que les gens sont intéressés par des étiquetages liés au bien-être mais que cela ne se répercute jamais au supermarché, lors de l’achat…
Mme Sylviane Alaux et Mme Françoise Dubois. Ils regardent le prix !
M. Bernard Van Goethem. Ils privilégient en effet le critère du prix.
Au regard des conséquences, nous en sommes restés à la divulgation des résultats de cette étude.
Mme Sylviane Alaux. Le consommateur s’intéresse maintenant un peu plus à ces informations, mais il regarde toujours les prix. Sur ce plan, les différences sont telles qu’elles semblent parfois injustifiées. La Commission serait inspirée de persévérer dans la voie de l’étiquetage tout en ayant une exigence en matière de prix. Ce n’est pas parce que les gens n’achètent pas qu’il faut abandonner.
M. Bernard Van Goethem. Rien n’empêche les professionnels de mettre en avant un étiquetage relatif au bien-être animal. Cette démarche volontaire est parfaitement possible dans le cadre du schéma certifié privé : il n’y a pas d’interdiction au niveau européen.
Mme Sylviane Alaux. De nombreuses chaînes de la grande distribution, comme Carrefour ou Hypermarché, font maintenant le distinguo entre les œufs provenant de poules élevées en plein air, et les œufs provenant de poules élevées en cage…
Je vois que vous vous regardez tous messieurs. Si vous faisiez les courses…
M. le président Olivier Falorni. Nous faisons les courses, madame Alaux !
Monsieur Van Goethem, je me permets d’émettre un petit doute sur vos propos relatifs au désintérêt pour le mode d’abattage. Cette commission parlementaire suscite l’intérêt de nos concitoyens. Nous avons de nombreux témoignages du fait qu’ils ont aujourd’hui pris conscience de ce qui se passe dans les abattoirs. Cela n’a pas été le cas pendant des années, et c’est peut-être le mérite des vidéos diffusées par L214 de nous avoir alertés collectivement.
La question du mode d’abattage, et particulièrement celle de l’abattage sans étourdissement, devient un peu plus prégnante qu’elle ne l’était auparavant. Il faut aussi peut-être s’adapter aux réalités de la société, et au niveau d’exigence de nos concitoyens. Cela ne signifie pas nécessairement que leur choix, au moment de l’achat, sera uniquement guidé par l’étiquetage relatif au bien-être animal ; dans ce contexte de crise, le prix reste le principal facteur de motivation du consommateur. Néanmoins, je crois que tous les membres de cette commission d’enquête ont pu mesurer la prise de conscience en cours sur la question du bien-être animal. Beaucoup de nos concitoyens nous disent : « Nous ne sommes pas végétariens, mais nous voulons savoir comment les animaux sont abattus, et s’ils sont abattus dignement. Si nous ne le savons pas, nous arrêterons de manger de la viande. » La question de l’étiquetage se pose bel et bien.
Parmi les trois vidéos diffusées par L214, certaines provenaient de l’abattoir de Mauléon qui distribuait de la viande pour des grands restaurateurs, pour des circuits courts, et pour des circuits bio ! Vous pensez bien que ceux qui achetaient cette viande étaient loin d’imaginer la façon dont les animaux étaient torturés dans cet abattoir.
M. Denis Simonin. S’agissant de la perception des consommateurs, il y a une dimension de l’étiquetage relatif à l’abattage que je souhaite mettre en avant. Plusieurs études sur les problèmes de consommation et de bien-être animal montrent que, si les consommateurs peuvent être sensibles à l’information – c’est le cas, par exemple, de celle portant sur les œufs, qui a induit des modifications de comportement –, il existe des zones où le bien-être animal n’est pas négociable. C’est typiquement le cas de l’abattage.
En clair, les gens ne veulent pas savoir. Il est désagréable de manger de la viande en pensant qu’il y a un animal derrière. C’est humain : je ne leur jette pas la pierre. En tant que vétérinaire, et avec mon expérience professionnelle, mon rapport à la viande n’est pas celui-là, mais nombreux sont ceux qui ne sont pas nécessairement à l’aise avec l’idée que derrière la viande, il puisse y avoir un animal. Si l’on mettait en avant une information sur ce sujet, elle ne serait ni nécessairement recherchée ni aisément acceptée.
Par ailleurs, monsieur le président, puisque vous citiez l’une des vidéos diffusées par L214, je rappelle que ce qu’elle montre est tout simplement illégal. Cela n’a rien à voir avec un problème d’étiquetage. S’il y avait eu étiquetage, il n’y aurait eu aucune différence. Nous avons de toute façon affaire à des gens qui fraudent : ils ne vont pas l’annoncer sur une étiquette ! Et nous n’allons pas préciser par étiquetage que tel abattoir fait un bon travail ou que tel autre le fait mal. Dans l’esprit des consommateurs, il n’y a pas de choix à faire, ce n’est pas négociable : tous veulent que les animaux qu’ils mangent soient bien abattus. C’est en tout cas la perception que j’ai eue en discutant avec les associations. Elles considèrent qu’il n’y a pas un bon et un mauvais abattage. On doit faire ça bien ; un point c’est tout, et la législation doit garantir qu’il en sera ainsi.
Le choix d’un étiquetage différentiel, selon qu’il y a ou non étourdissement, nous fait entrer dans un autre débat sur l’acceptation ou pas du fait qu’il existe un autre type de valeurs et un autre type de méthode. À mon avis, nous avons alors davantage affaire à un sujet de société qu’à une problématique liée au bien-être animal. Nous sommes plus dans la politique. C’est, à mon sens, la raison pour laquelle l’étude que nous avons menée a montré que le consommateur n’était pas nécessairement à la recherche d’informations sur ce point de vue précis. L’étiquetage obligatoire crée un gradient entre les différentes normes relatives au bien-être. Or à mon sens, aujourd’hui, le consommateur ne veut pas de gradient : lorsqu’il mange de la viande, il estime que les choses doivent être bien faites, basta ! C’est un peu l’impression que j’ai eue en travaillant avec les consultants responsables de l’étude.
M. le président Olivier Falorni. Messieurs, nous vous remercions pour votre présence et pour l’ensemble de vos réponses.
La séance est levée à dix-huit heures.
——fpfp——
15. Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Delzescaux, directeur de l’interprofession nationale porcine (INAPORC).
(Séance du mercredi 25 mai 2016)
La séance est ouverte à dix-huit heures cinq.
M. le président Olivier Falorni. Nous recevons aujourd’hui M. Daniel Delzescaux, directeur de l’interprofession nationale porcine. L’INAPORC est l’unique interprofession dans le secteur de la viande porcine. Elle représente les fabricants d’aliments pour porc, les éleveurs, les coopératives, les abatteurs-découpeurs, la grande distribution, les artisans bouchers, les charcutiers-traiteurs et la restauration collective.
Nous vous poserons sans doute, monsieur le directeur, une question sur les raisons de la décision de la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT) de quitter l’interprofession début 2016.
Je rappelle qu’en 2014, 23,7 millions de porcs ont été abattus dans les 157 abattoirs de France qui en ont la capacité. La production nationale de viande de porc était de 2,21 millions de tonnes-équivalent-carcasse tandis que la consommation s’élevait à 32 kg-équivalent-carcasse par personne.
Dans les deux vidéos tournées au sein des abattoirs d’Alès et du Vigan, des actes de maltraitance ont été commis sur des porcs. Il nous semblait donc important que votre interprofession soit auditionnée.
Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et diffusée en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Daniel Delzescaux prête serment).
M. Daniel Delzescaux, directeur de l’interprofession nationale porcine (INAPORC). Je tiens à excuser Guillaume Rouet, président de l’INAPORC, retenu par un empêchement personnel.
Vous avez présenté l’interprofession, je n’y reviens pas. Je vais évoquer d’emblée la situation de la FICT avant d’entrer dans le vif du sujet.
Une interprofession est une démarche volontaire : ce sont les fédérations professionnelles qui décident de se réunir pour mener un certain nombre d’actions collectives. INAPORC a été créée en 2003 après de nombreuses années de débats houleux et difficiles. Sur un certain nombre de sujets importants, des divergences de vue profondes se sont fait jour entre la FICT et les autres familles professionnelles notamment de l’amont, éleveurs et abatteurs. Malgré les travaux menés au sein de l’interprofession, nous n’avons pas réussi à recueillir un consensus. Début 2016, la FICT a déclaré qu’elle ne se reconnaissait plus dans les orientations prises par ses collègues – une interprofession, c’est l’ensemble des familles ; la concertation implique tous les professionnels de la filière – sur l’étiquetage d’origine ou les moyens interprofessionnels consacrés à la communication auprès des consommateurs français sur le porc français. Les divergences de vues ont conduit à la rupture début 2016, et au départ de la FICT. L’industrie de la charcuterie ne fait plus partie aujourd’hui des membres de l’interprofession.
Je tiens à préciser que les professionnels de la filière porcine, qui se sont réunis à plusieurs reprises au sein du conseil d’administration et du bureau, ont été les premiers choqués des images sur les abattoirs. Elles ne reflètent pas notre métier – j’associe l’ensemble de la filière. On peut arguer qu’il s’agit de petits abattoirs, qui n’abattent pas beaucoup de porcs, qui ne reflètent pas la réalité. Reste que ces images ont été jugées choquantes et inacceptables par les membres de l’interprofession.
Pour le reste, je propose de laisser la place aux échanges. J’ai lu dans les comptes rendus des auditions précédentes que de nombreux sujets ont été traités et que différents membres de l’interprofession se sont déjà exprimés devant vous.
M. le président Olivier Falorni. Nous avons abordé la question de l’étourdissement par CO2 lors de l’audition précédente avec les représentants de la Commission européenne. Ce procédé, qui représente une proportion minoritaire de l’étourdissement, pose question. Combien d’abattoirs en France le pratiquent ? Quelle part représente-t-il dans les méthodes d’étourdissement pour l’abattage des porcs en France ?
Vos adhérents sont-ils favorables à l’obligation de la vidéosurveillance dans les abattoirs ?
Vous avez évoqué la réaction de vos membres aux vidéos de L214. Avez-vous constaté après la diffusion de ces images largement médiatisées une baisse de la consommation de viande porcine en France ?
M. Daniel Delzescaux. Six abattoirs utilisent l’anesthésie au CO2 en France. Je tiens à faire un commentaire sur ce procédé. Dans les années quatre-vingt-dix, on discutait déjà du bien-être animal dans les abattoirs ; à l’époque le recours au CO2 était présenté dans les débats, y compris communautaires, comme la voie d’avenir, jugée moins traumatisante pour l’animal que l’électronarcose. S’est posée la question dans ces années-là de l’opportunité de préférer cette technique au vu des études qui avaient été menées, suscitant de longs débats parmi les professionnels. Ce procédé, même lorsqu’il est bien mené, comporte malgré tout un instant de suffocation – je suppose que les experts scientifiques vous l’ont expliqué ; il exige d’être bien conduit. Aujourd’hui, seulement 6 abattoirs sur 157 ont fait le choix du CO2. En dépit des recommandations de l’époque, la plupart des professionnels n’ont pas souhaité franchir le pas pour différentes raisons – le coût de l’investissement mais aussi l’instant de suffocation pour les animaux, qui, si le procédé est mal mené, peut altérer le bien-être de l’animal.
Ces six abattoirs représentent de 15 à 18 % de la production nationale. Ce n’est pas négligeable. Mais sur les six, trois sont plus importants, les autres, dont celui qui a fait l’objet des images vues dans les médias, sont plus petits.
Le procédé a-t-il été mal conduit dans l’abattoir mis en cause ? Nous nous sommes posé cette question dès que nous avons vu les images. Cela nous a amenés à réfléchir avec les pouvoirs publics et les instituts de recherche. Nous avons demandé une étude à l’Institut du porc (IFIP) afin de vérifier que, dans les six abattoirs en question, les paramètres étaient bien respectés et d’étalonner un certain nombre de données scientifiques sur l’utilisation de ce procédé pour juger s’il est opportun ou non de le conserver. Je ne peux pas vous dire que nous avons un avis arrêté dans l’état actuel des choses. Ces images ont suscité beaucoup de questions et d’investigations dont je ne connais pas encore les résultats.
M. le président Olivier Falorni. Vous dites que des investigations sont en cours. À quel moment pourrions-nous recueillir un avis plus affirmé de votre part ?
M. Daniel Delzescaux. Nous avons demandé à l’Institut du porc (IFIP) de réaliser l’étude. Elle est en cours.
M. le président Olivier Falorni. Nous remettons notre rapport mi-septembre. Il serait important pour nous de connaître l’avis de l’interprofession avant cette date, si possible en juin ou juillet.
M. Daniel Delzescaux. Je le note. J’en discute avec les personnes en charge de ce projet de recherche à l’IFIP et je reviens vers vous. J’essaierai d’accélérer les investigations afin d’être en mesure de vous présenter des résultats avant la remise de votre rapport.
La vidéosurveillance est un sujet récurrent, pas seulement pour les abattoirs, qui a donné lieu à des échanges entre les professionnels. Les premiers concernés sont les représentants des abattoirs puisqu’ils sont en première ligne, l’interprofession étant en deuxième rideau dans ce débat. Je ne sais pas si la vidéosurveillance est la bonne solution. Cette idée suscite des réactions de suspicion de la part des abattoirs et d’importants débats. L’interprofession ne s’est pas prononcée. Nous avons davantage insisté sur un encadrement plus fort du personnel. Nous voulons former le personnel au bien-être des animaux – à la réglementation en la matière mais aussi aux outils d’abattage. Ce souci ne concerne pas seulement l’abattage mais aussi le départ dans les élevages et le transport jusqu’à l’acheminement au poste de tuerie. Le porc est un animal très stressé. Dès qu’il est stressé, c’est-à-dire mal traité, la qualité de la viande s’en ressent. Indépendamment des images, le fait de bien conduire les animaux jusqu’au dernier stade est fondamental pour la qualité. Les abattoirs sont donc déjà très sensibilisés à cette question. Je pense aux aiguillons électriques qui étaient utilisés et qui le sont moins, en raison de leurs incidences sur la qualité de la viande.
M. le président Olivier Falorni. Nous étions, M. le rapporteur et moi-même, lundi matin dans un abattoir où, malheureusement, les structures impliquaient quasiment à chaque fois l’utilisation de l’aiguillon électrique sur des cochons.
M. Daniel Delzescaux. C’était un gros abattoir ?
M. le président Olivier Falorni. Non, c’était un abattoir multi-espèces.
M. Daniel Delzescaux. Je ne veux pas jeter l’opprobre…
M. le président Olivier Falorni. Ce n’est pas du tout le sens de mon propos. Nous avons publié un communiqué sur ce sujet. Les opérateurs n’étaient pas du tout dans la maltraitance, loin de là, mais les infrastructures d’amenée des animaux et de contention étaient totalement inadaptées. Les cochons étaient stressés, ils se montaient les uns sur les autres, ils essayaient de sortir, l’opérateur était obligé d’utiliser l’aiguillon électrique quasiment à chaque fois.
M. Daniel Delzescaux. Deux facteurs sont fondamentaux dans un abattoir : la configuration des locaux : est-elle adaptée pour respecter les conditions d’amenée ? et les hommes : si c’est un énervé qui occupe ce poste… L’aiguillon électrique a fait l’objet de débats assez nombreux liés à la qualité de la viande. Je ne sais pas comment il était utilisé dans le cas que vous citez, mais, dans les abattoirs spécialisés sur le porc qui manifestent ce souci de la qualité de la viande, au-delà du bien-être des animaux, d’autres matériels existent, comme les panneaux, qui peuvent permettre de conduire les animaux entre la bouverie et le poste de tuerie dans des conditions respectueuses de leur bien-être. Grâce aux nombreuses études de l’IFIP, les connaissances sont établies pour définir ces conditions : on n’introduit pas trop d’animaux à la fois, on utilise des panneaux. Avez-vous visité des gros abattoirs en Bretagne ?
M. le président Olivier Falorni. Non, nous avons visité un gros abattoir industriel pour les bovins, et un petit abattoir multi-espèces, pour les porcs et les moutons, dans lequel l’amenée des cochons était totalement insatisfaisante. D’après ce que nous avons vu, l’étourdissement était assuré dans de bonnes conditions mais le stress animal avant était total ; les animaux étaient stressés, paniqués, ils pouvaient se blesser. On peut s’interroger sur la qualité de la viande que vous avez soulignée. J’ajoute que l’aiguillon électrique était utilisé quasiment à chaque fois pour les faire avancer.
M. Daniel Delzescaux. La vidéosurveillance a donné lieu à un échange au sein de l’interprofession mais nous n’avons pas pris position ; nous laisserons les représentants des abattoirs s’exprimer puisque c’est leur métier.
Ce qui nous paraît important, c’est la surveillance par les pouvoirs publics – il est vrai qu’il y a des abattoirs dans lesquels les contrôles ne sont pas permanents. Nous sommes pris entre deux feux. Sur 157 abattoirs, une soixantaine sont de petits abattoirs multi-espèces. Pour ces derniers qui répondent à une volonté de maintenir l’activité au nom de l’aménagement du territoire : on entre dans d’autres considérations, sociales et économiques. Dans les abattoirs de faible taille, la spécialisation est moins forte, l’encadrement et le suivi moindres également. Quelle est la panoplie d’outils pour s’assurer du respect du bien-être mais aussi d’autres préconisations ? La vidéosurveillance est un outil, les contrôles en sont un autre, la formation également ; c’est un ensemble d’éléments qui permet d’obtenir des conditions de travail correctes, pour le personnel mais aussi pour les animaux.
Pour ce qui est de la consommation, les années 2015 et 2016 correspondent à une période particulièrement perturbée puisqu’on a observé une baisse de la consommation assez conséquente dans toutes les espèces, que l’on a d’ailleurs du mal à expliquer. De là à la lier aux images qui ont été diffusées, je ne ferai pas ce raccourci. D’autres sujets ont fait débat, comme les promotions, donnant lieu à l’arrêté du 10 juin 2015 relatif à l’encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande porcine fraîche. La tendance est à la baisse de la consommation de viande dans les sociétés européennes. Les outils dont nous disposons ne sont pas assez fins pour dire si les images sont à l’origine de la baisse de la consommation. Aujourd’hui, je vous parle de baisse mais on pourrait se revoir dans deux mois et constater une augmentation. À une tendance lourde de baisse s’ajoutent des effets saisonniers. La consommation fait le yo-yo.
Mme Sylviane Alaux. Dans la définition de votre mission, vous évoquez la promotion des produits de la filière porcine et vous mettez en avant le savoir-faire des opérateurs de cette filière et la culture gastronomique liée à ces savoir-faire. Je suppose que, pour affirmer cela, vous vous portez garants du triptyque que je voudrais voir imposé partout : la sécurité du consommateur, le bien-être des salariés – bien formés, bien protégés –, et le bien-être animal, que ce soit en termes de douleur, de stress ou de souffrance.
Ces exigences figurent-elles précisément dans un cahier des charges auquel doivent souscrire les personnes qui souhaitent adhérer à votre interprofession ?
Concernant l’usage du CO2, nous avons entendu les experts – je me plais à le répéter parce que c’est important – qui affirment que l’utilisation du CO2 conduit à une agonie qui peut être longue. Il faut que nous fassions de cette question notre préoccupation première en matière d’abattage des porcs – puisque c’est à eux que cela s’adresse.
M. Daniel Delzescaux. Sur votre première question, nous ne sommes pas une démarche qualité ni une démarche privée : nous sommes une interprofession. Autrement dit, je m’exprime aujourd’hui au nom de toute la filière porcine française, sans exclusion. Le rôle de l’interprofession, avec les moyens dont elle dispose – je le rappelle, ils sont loin d’être illimités –, est notamment d’amener l’ensemble des opérateurs de la filière à des standards de production, au respect d’un certain nombre de pratiques que nous jugeons en adéquation avec ce qui se doit d’être. Je m’exprime au nom de l’abattoir d’Alès comme de celui de Lamballe. Je parle pour l’ensemble. Nous essayons, à travers nos actions, de tirer l’ensemble des professionnels vers ces pratiques vertueuses. L’interprofession dispose de budgets de communication destinés au consommateur ; le gros du message reste la promotion de l’origine française et du savoir-faire français.
Rappelons tout de même que malgré des images malheureuses et déplorables, les standards européen et français sont nettement au-dessus de ce qui peut se faire par ailleurs ; je ne cherche pas à justifier mais il faut en avoir conscience. Nous déplorons les mauvais comportements, qu’il s’agisse des images et d’autres problèmes par le passé. À chaque fois que nous identifions ce genre de problème, nous essayons, avec les pouvoirs publics, d’encourager les pratiques vertueuses à travers les programmes de recherche et de développement, avec l’IFIP. Nous finalisons un guide de bonnes pratiques de la protection animale en abattoir sur lequel nous avons fait travailler les experts. Au-delà de la recherche conduite par l’IFIP pour essayer de juger quel est l’optimum du bien-être animal, l’objectif est d’accumuler des connaissances, de les traduire en bonnes pratiques et de trouver les moyens de vulgariser celles-ci au maximum. Cela ne dédouane pas de ce qui s’est passé à Alès ou qui peut se passer dans un autre abattoir, fût-ce dans une grosse unité : on n’est pas à l’abri de dérapages de la personne chargée de cet acte-là. Le rôle de l’interprofession est bien de définir ces standards et de mettre en œuvre les moyens pour amener collectivement les gens à les respecter. On ne peut pas exclure l’abattoir d’Alès. Mais on peut analyser ce qui s’est passé et essayer de comprendre.
Cela fait vingt-cinq ans que je travaille dans la filière porcine. Je vous avoue que si l’on revenait sur les débats de 1995 sur l’utilisation du CO2, on serait effarés. Si on avait écouté ce qui a été dit de 1995 à 2000 en matière de bien-être, tous les abattoirs utiliseraient le CO2. Effectivement, même si elle est bien conduite, cette technique comporte une phase d’étouffement de l’animal. Si cette phase est bien gérée, elle doit être la plus courte possible mais elle existe et on ne la supprimera pas. Pour apprécier le bien-être animal, la question est de savoir quelle doit être la durée de cette phase : dix secondes, est-ce satisfaisant ? vingt secondes ? visiblement, à Alès, c’était beaucoup plus. Il faut définir dans les paramètres ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.
Mme Sylviane Alaux. Le produit peut-il être modulable ?
M. Daniel Delzescaux. C’est ce que nous essayons d’objectiver. Il n’est pas normal de voir ces images. Nous avons demandé à l’IFIP un protocole pour objectiver ce qui se passe dans les six abattoirs et nous dire si cette technique est finalement acceptable ou pas. Les experts de l’IFIP que j’interroge me disent qu’un tel matériel bien utilisé se traduit par une durée d’étouffement de quinze à vingt secondes. C’est ce que préconisent les fabricants de ce type de matériel et ce qui était accepté sur le plan réglementaire. Cette méthode est jugée acceptable par la réglementation, y compris communautaire. Savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l’est, c’est ce que nous essayons de faire avec la recherche scientifique. Ensuite, viendra un débat plus politique pour savoir où placer le curseur.
M. Hervé Pellois. Nous avons au moins une chance ici, celle de ne parler que d’étourdissement. Nous ne parlons pas de non-étourdissement ; pour le porc, c’est déjà un atout…
Vous évoquez un guide de bonnes pratiques. Nous savons qu’il en existe un pour les bovins. J’ai cru comprendre qu’il n’était pas encore sorti pour les porcins. Vous allez sans doute nous le préciser.
En matière de recherche et développement, sur qui peut-on s’appuyer ? L’IFIP a-t-il les moyens de travailler sur ces sujets ? Doit-on faire appel à des études étrangères ou à des études menées par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ?
M. Daniel Delzescaux. Le guide de bonnes pratiques est en cours de validation, en navette avec les pouvoirs publics. Il n’est pas encore publié, c’est un document de travail. Mais a priori, il est disponible puisqu’il a été communiqué aux pouvoirs publics, on peut vous le transmettre, il n’est pas secret même s’il n’est pas complètement finalisé. Nous sommes en train de le finaliser.
Beaucoup d’études ont été menées sur le transport pour répondre à une préoccupation. Ces études comportent une phase bibliographique au cours de laquelle sont recensées d’éventuelles études dans d’autres pays et leurs résultats. L’IFIP possède les ingénieurs, les compétences et les moyens pour conduire des études sur le bien-être. Ces études reposent sur du concret : il s’agit d’un protocole expérimental conduit par les ingénieurs de l’IFIP qui donne lieu à la publication d’un rapport. Ce travail est fait quotidiennement sur de nombreuses thématiques – le bien-être mais aussi la microbiologie, la qualité, etc. On est dans le vif du sujet. Ce ne sont pas des investigations bibliographiques ; il s’agit de se mettre en conditions réelles. Pour les six abattoirs, il s’agit d’analyser ce qui se passe et d’objectiver les paramètres que j’évoquais tout à l’heure.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Avez-vous noté au sein de l’interprofession de la part soit des éleveurs, soit des clients des abattoirs des exigences complémentaires en matière de bien-être animal ? Y a-t-il des demandes de certification ou de contractualisation d’un certain nombre de pratiques dans le cadre du rapport marchand entre le propriétaire de l’animal et l’aval ou l’intégration de la filière joue-t-elle déjà ce rôle ?
J’ai cru comprendre que la viande de porc était un produit marchand et assez commercé au sein de l’Union européenne. Quelle est la situation dans les autres pays ? Quelles sont les exigences ? On a entendu parler de porcs qui allaient se faire abattre en Allemagne parce que c’était moins cher… A-t-on les moyens de vérifier qu’au moment de la mise sur le marché, les modalités d’abattage correspondent bien aux standards que nous souhaitons pour les produits vendus sur le marché français ?
M. Daniel Delzescaux. Sur le premier point, les images diffusées montrent l’illégalité la plus totale. Les textes réglementaires définissent bien la notion de bien-être. S’il y a trente ans, celle-ci n’était pas au cœur des préoccupations, depuis, les mentalités et les textes ont évolué pour mieux garantir le bien-être des animaux tout au long de leur vie jusqu’à l’arrivée à l’abattoir. Aujourd’hui, toutes les filières ne sont pas intégrées ; nous sommes donc obligés de proposer des dispositifs adaptés aux différentes situations ; dans une filière intégrée, le dialogue est peut-être plus facile entre les différents maillons ; dans une filière moins intégrée, c’est plus du « B to B ». Les gens se réfèrent avant tout à ce que prévoit la réglementation. D’autres questions liées au bien-être peuvent faire l’objet de cahiers des charges. Mais, aujourd’hui, toute la production n’est pas soumise à ce type de cahier des charges. L’arsenal réglementaire permet normalement de respecter le b.a.-ba du bien-être de l’animal. D’autres démarches peuvent exister : le plein air, la paille, etc., mais c’est de la segmentation.
M. le rapporteur. Cette segmentation existe ? Certains acteurs de la filière vont-ils au-delà du b.a.-ba, c’est-à-dire du respect de la réglementation, pour pouvoir se prévaloir ensuite de conditions de transport meilleures ? Est-ce une vue de l’esprit ou est-ce anecdotique ?
M. Daniel Delzescaux. Concrètement, c’est surtout au stade de l’élevage, avec les porcs plein air ou les porcs sur paille, que des démarches donnent lieu à contractualisation. Le label rouge fermier est l’exemple le plus probant.
M. le rapporteur. Et dans le transport ?
M. Daniel Delzescaux. Les règles dans ce domaine sont assez homogènes. Je le redis, la qualité de la viande est vraiment liée à l’absence de stress pour les animaux. Dans les années 2000, nous avons réalisé énormément d’études avec l’IFIP – ses experts sont reconnus au plan européen, des débats ont eu lieu pour la définition d’une réglementation européenne du transport des animaux.
Je vous livre une anecdote : dans les années 2000, on pensait qu’en mettant moins de porcs dans les camions, ils seraient mieux. Or, on s’est aperçu que les mouvements du camion entraînaient des problèmes de fracture et de chocs. Il faut un optimum de chargement, c’est très technique, pour garantir le bien-être et pour que les animaux arrivent à l’abattoir dans des conditions correctes. Les critères pour le transport ne sont pas suffisamment distinctifs, contrairement à l’élevage ou à l’abattoir, où les conditions d’amenée et les porcheries d’attente peuvent répondre à des critères précis. Ce type de démarche n’a pas vraiment été intégré dans des cahiers des charges. Il s’agit plus de « B to B » et d’optimisation des bonnes pratiques.
Sur l’Allemagne, je vais essayer de rester objectif. Ce pays a, en quinze ans, développé sa production de porc de 25 millions, ce qui équivaut à la production française. Je ne sais pas du reste s’il faut parler d’Allemagne ou du nord de l’Europe – Danemark, Pays-Bas, Allemagne et Belgique forment un gros bassin de production. L’Allemagne a tellement développé ses capacités d’engraissement qu’elle a manqué de porcelets et s’est retournée vers les Pays-Bas et le Danemark. Environ 12 millions de porcelets quittent le Danemark ou les Pays-Bas et sont engraissés en Allemagne.
Je ne juge pas : les choses sont faites dans les règles. Mais ce n’est pas le système que nous avons défendu en France. Nous avons plutôt adopté le système naisseur-engraisseur – toute la vie de l’animal se déroule sur le même site – plus sûrs sur le plan sanitaire. Ce choix a été fait dans les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix. De l’autre côté des Pyrénées, c’est également le système naisseur-engraisseur qui prévaut mais la taille des élevages diffère – ils comptent facilement 2 000 à 3 000 truies – et ils fonctionnent en intégration.
En matière de traçabilité, la France, malgré une perte de compétitivité et des relations avec les autres pays européens de plus en plus difficiles, reste sur un système naisseur-engraisseur et des exploitations familiales – 200 truies en moyenne contre 750 au Danemark aujourd’hui, et 1 000 truies pour 2020. Il faut avoir conscience des différences de systèmes de production entre les pays européens qui, au-delà des incidences en matière de traçabilité et de mouvement d’animaux, pèsent sur la compétitivité ; aujourd’hui, la production porcine française souffre.
M. le rapporteur. Qu’en est-il de l’abattage proprement dit ?
M. Daniel Delzescaux. En matière d’abattage, l’anesthésie au CO2 a trouvé un écho plus favorable – elle est plus développée dans le nord de l’Europe qu’en France, à juste titre ou pas. Je rappelle ce qui se disait en 1995 : il fallait utiliser cette méthode sinon on n’était pas bons… Les conditions d’abattage classiques font l’objet d’un standard européen – ce qu’on a vu, je pense qu’on peut le voir dans beaucoup de pays européens. Dans un fonctionnement normal, les niveaux sont équivalents en Europe de l’Ouest.
Ensuite se pose la question de l’information du consommateur, donc de l’étiquetage. La filière porcine française souffre de l’absence d’étiquetage, elle le réclame depuis plusieurs années, sur plusieurs sujets, dont l’origine, mais le règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO) l’interdit. Une expérimentation semble se dessiner qui permettrait pendant deux ans d’étiqueter l’origine sur les produits transformés. La France produit 2,2 millions de tonnes, elle exporte un peu plus de 700 000 tonnes et elle importe 600 000 tonnes : les importations sont utilisées dans la fabrication des produits. Avec ce genre d’échange, il devient plus difficile de suivre l’information.
Mme Annick Le Loch. Comment se porte la filière porcine aujourd’hui ? Les problèmes d’enlèvement et de prix payé au producteur qu’elle a connus sont-ils résorbés ? Si j’ai bien compris, le prix payé au producteur augmente légèrement.
Les porcs sont souvent traités dans des abattoirs mono-espèce, parfois avec une part de transformation derrière. Ce modèle économique fonctionne-t-il mieux qu’un abattoir qui se contente d’abattre ?
Y a-t-il des difficultés de recrutement de personnel dans les abattoirs de porc ?
J’ai compris qu’il n’existait pas d’abattoirs de coches en France et que toutes les coches étaient abattues en Allemagne. Est-ce exact ? Pour quelles raisons ?
Quelle est la part du coût de l’abattage dans le prix du kilo de porc ?
M. Daniel Delzescaux. Historiquement, le cycle du porc était un phénomène économique enseigné dans les écoles : il se caractérisait par deux sinusoïdes – la production et le prix – qui se croisaient. Lorsque la production monte, les prix baissent, donc les éleveurs arrêtent de produire, donc la production baisse et les prix montent et ainsi de suite.
En 2007 et 2008, nous avons subi un tsunami qui s’appelle le prix des matières premières. Rappelons que l’alimentation représente entre 65 et 70 % du coût du kilo de viande de porc. C’est le produit proposé au consommateur dans lequel l’incidence de l’aliment est la plus forte, plus forte que pour la volaille ou la baguette de pain. Les éleveurs de porcs français et européens ont dû faire face à une crise des matières premières avec, pour conséquence, une dérégulation de l’alimentation qui est devenue compliquée à gérer. Ensuite, ils ont connu des années au cours desquelles ils ont moins perdu, mais si on établit un bilan sur les huit dernières années, les mauvaises périodes ont été plus nombreuses que les périodes correctes – je n’irai pas jusqu’à parler de bonnes périodes. Il en a résulté des endettements successifs des éleveurs, si bien qu’aujourd’hui, la situation de certains d’entre eux, pas de tous, est compliquée.
La situation financière des éleveurs se répartit toujours par tiers : un tiers bon, un tiers moyen, un tiers mauvais. Entre 15 et 20 % des éleveurs sont aujourd’hui dans des situations d’endettement très difficiles. Nous avons débattu de la constitution d’un fonds de solidarité pour essayer de les soutenir. Même si la production française est très performante en moyenne par rapport aux autres pays, la situation économique est tendue. En 2014, la fermeture de la Russie n’a pas amélioré les choses. À l’époque, la France exportait 75 000 tonnes en Russie, l’Europe 750 000 tonnes ; du jour au lendemain, ce marché s’est fermé. 2014 aurait pu être une période un peu meilleure, sans la fermeture de la Russie qui a pesé.
Aujourd’hui, les choses vont un peu mieux, je dis bien un peu mieux. La cotation allemande vient de tomber : elle est montée de six centimes – je ne vais pas dire que c’est le nirvana, mais c’est beaucoup. Pourquoi ? Parce qu’un pays aujourd’hui achète beaucoup : la Chine. Elle est déficitaire en viande de porc, elle en importe donc énormément car elle est très grosse consommatrice. Ceci dit, si l’on peut s’en réjouir, cette situation suscite d’autres inquiétudes car elle nous rappelle le vieux scénario de la Russie. Il ne s’agit pas de dire qu’il ne faut pas aller en Chine mais, et nous essayons d’engager un débat au sein de l’interprofession, il ne s’agit pas faire du tout-Chine après avoir fait du tout-Russie… Il faut peut-être réfléchir aux équilibres de marché et voir quelle est la meilleure stratégie pour ne pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier : si on a un pépin sur un pays, et faut pouvoir débrayer et avoir une solution de repli sur d’autres pays.
Aujourd’hui, les choses vont un peu mieux – l’augmentation de six centimes en Allemagne laisse augurer une hausse du prix français demain. Mais si on fait un bilan, le coût de production du kilo de porc est autour de 1,40 euro et le prix du porc payé au producteur est de 1,35 : il manque 5 centimes pour l’éleveur ; et je ne parle pas des dettes qu’il a accumulées et qu’il n’a pas comblées. Il faudrait une longue période de bon cours pour les résorber.
Quant au modèle économique mono-espèce, historiquement, il y a une séparation entre l’abattage-découpe et la transformation. Les entreprises de charcuterie étaient plutôt des PME ; c’étaient deux mondes. Depuis une quinzaine d’années, des passerelles se construisent entre ces deux métiers. Je prends l’exemple de la COOPERL qui a investi dans la transformation avec Brocéliande, dans un système plus intégré ; mais je ne suis pas sûr que le système intégré soit meilleur que le système de partenariats. Des débats ont eu lieu l’année dernière sur la contractualisation pour essayer de stabiliser un peu plus le marché. Pour un marché qui, culturellement, est « spot », c’est-à-dire au jour le jour, c’est une révolution culturelle, il faut en avoir conscience, cela ne se fait pas d’un claquement de doigt. Aujourd’hui, la réflexion s’intensifie ; les gens demandent un peu plus de stabilité dans un monde devenu très chaotique. Peut-on contractualiser le swap entre certains salaisonniers et des éleveurs des groupements de producteurs ? Il y a quinze ans, il était inimaginable de prendre un engagement de volume au sein de la filière. C’est vraiment une révolution culturelle. Je pense qu’on est train d’essayer de trouver un nouveau modèle pour tenter de stabiliser la filière porcine française.
Oui, nous connaissons des difficultés de recrutement. Ces métiers restent difficiles malgré les efforts, depuis trente ans, en faveur de la sécurité et des conditions de travail. Quand vous discutez avec des responsables d’abattoirs, il en ressort que le recrutement est délicat. L’Allemagne fait une entorse à sa réglementation sociale puisque la filière fait appel à des travailleurs détachés. Des sociétés d’intérim recrutent des gens venant plutôt des pays de l’Est, qui sont payés au tarif de l’Est et c’est la société d’intérim qui gère. Nous dénonçons cette méthode depuis plus de dix ans. Nous sommes montés au créneau à tous les niveaux – ce n’est pas que nous souhaitons bénéficier des mêmes modalités que les Allemands, mais l’absence harmonisation sociale entre pays génère des distorsions de concurrence. Quand le coût du travail est en France de 18 à 20 euros de l’heure, il est de 4 ou 5 euros en Allemagne, quand les employés sont payés – vous avez dû voir des reportages sur leurs conditions de travail. Au final, pour une activité comme l’abattage ou la découpe dans laquelle la main-d’œuvre représente l’essentiel du coût de production, cela crée un différentiel qui explique que l’Allemagne a augmenté sa production de 25 millions de porcs en quinze ans. On a beau pointer régulièrement cette distorsion de concurrence sur le plan social, la seule réponse qu’on ait obtenue – effectivement un SMIC a été instauré mais loin de celui que nous avons en France – est que cela ne relève pas de la réglementation européenne. Notre demande est donc hors sujet. Cela laisse les professionnels de la filière très dépités.
Quant aux abattoirs de coches, un porc charcutier pèse 120 kg vifs alors qu’une coche peut aller jusqu’à 360 ou 380 kg. Ce sont des animaux beaucoup plus grands, qui exigent des équipements adaptés. On ne peut pas abattre des coches dans des abattoirs de porc charcutier. Il faut un équipement spécifique. Les Allemands, très judicieusement, ont construit un gros abattoir de coches. Ils se sont spécialisés sur ce type d’animaux et ont créé un appel d’air dans toute l’Europe en payant mieux les coches que ne le faisaient les abattoirs français. Des abattoirs ou des groupes français ont essayé de riposter – la viande de coche est assez caractéristique pour certains produits de charcuterie, notamment le saucisson – et de reconquérir le marché de la coche. Des outils se sont spécialisés, mais aujourd’hui on n’est pas à 100 % des coches françaises abattues en France. La situation s’est améliorée ces deux dernières années – plus de coches restent, on s’en félicite. Mais cela reste un marché très spécifique.
Je suis désolé, je n’ai pas le chiffre en tête de la part du coût de l’abattage. Je vais demander à l’IFIP car des études sont réalisées sur ce point. En fourchette, un porc est payé à l’éleveur 1,35 euro. Viennent ensuite l’abattage et la découpe, plus ou moins élaborée : il faut passer par six D : dénerver, dégraisser, etc., pour arriver à la viande en tant que telle. On peut ajouter entre 50 centimes et 1 euro en sortie d’abattoir et pour la découpe, un coût plus ou moins élevé selon l’élaboration. Ensuite, il y a un éclatement des coûts. Vous vendez de la viande : quand vous achetez une rouelle, vous n’achetez pas un filet mignon, un rôti ou une brochette. On est rendu pour le consommateur autour de 7 ou 8 euros pour la côte de porc et entre 12 et 15 euros pour le filet mignon. Il faut aussi tenir compte de l’élaboration : sur une carcasse de porc, 25 % est consommé en viande fraîche au rayon boucherie, 75 % est transformé en produit de charcuterie. Je vous transmettrai les éléments chiffrés.
Mme Françoise Dubois. Je reviens à un sujet qui nous préoccupe tous : le personnel, en particulier la formation. Il semblerait qu’elle ne soit peut-être pas suffisante compte tenu des tâches qui lui incombent. On pourrait ne pas leur en vouloir de certains dérapages. Vous dites que vous êtes en train de finaliser le guide des bonnes pratiques. À qui va-t-il servir ? Quelle utilisation en ferez-vous ? Peut-il s’intégrer dans une formation un peu plus complète du personnel qui travaille dans les abattoirs ?
M. Daniel Delzescaux. La formation est un sujet éminemment important. Le personnel qui travaille dans les abattoirs n’a pas forcément un haut niveau d’études. La formation in situ est donc fondamentale : amener un porc de la bouverie jusqu’au poste de tuerie, cela ne s’apprend pas à l’école, sinon dans certaines formations très spécifiques. Mais les abattoirs ont à cœur de former leur personnel. Jusqu’à présent, nous avons beaucoup travaillé au sein de l’interprofession sur le transport des animaux et la formation des chauffeurs. Le guide de bonnes pratiques sur la protection animale en abattoir – déchargement des animaux, garde en bouverie, acheminement jusqu’à la chaîne d’abattage – est la synthèse du savoir scientifique et des observations faites sur le terrain ; c’est une formalisation de ces connaissances. Mais le guide n’est que l’écriture ; ensuite, il y a la formation. Nous passons par l’IFIP puisqu’il est aussi un organisme de formation : les formations sont délocalisées, il est nécessaire d’aller sur le terrain pour l’enseignement de ces pratiques. Aujourd’hui, nous sommes en train de finaliser la connaissance, la deuxième phase sera la formation. C’est valable pour le guide de bonnes pratiques sur la protection animale en abattoirs mais nous le faisons tous les jours sur de nombreuses thématiques : le transport, la conduite de l’élevage, etc. La formation professionnelle est quelque chose de routinier. Le guide va donner lieu, de la part de l’IFIP, à des propositions de formation pour les abattoirs.
Mme Françoise Dubois. Je suis d’accord avec vous sur la formation des chauffeurs et des éleveurs. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est plus facile pour eux, mais on n’égorge pas des porcs toute la journée sans que cela laisse des traces. Il faut peut-être avoir une attention particulière pour ce personnel-là, placé dans des conditions difficiles sans formation préalable – d’après ce qu’on a compris, elle est très brève – et lui offrir un accompagnement psychologique dont il a besoin. C’est très particulier d’égorger des animaux toute la journée.
M. Daniel Delzescaux. Oui. Je ne voudrais pas donner le sentiment que nous occultons ce problème. Ce métier est très difficile. Les gens ne se bousculent pas pour occuper le poste. L’abattage n’est pas un acte facile. Aujourd’hui, je constate une prise de conscience du besoin de formation et d’accompagnement. Je ne dis pas que nous sommes au bout du chemin, mais il y a vingt-cinq ans, on ne se posait pas de questions. Aujourd’hui, les responsables des abattoirs et les responsables professionnels ont pris conscience de cette nécessité et des moyens y sont consacrés. Cela ne va peut-être pas assez vite, je ne le conteste pas, mais cela évolue. On va dans le bon sens, on se dote d’outils pour gérer cette situation. Je ne dis pas que le problème est réglé, mais la prise de conscience est réelle. C’est la même chose dans les élevages. Il y a vingt-cinq ans, l’environnement n’était pas un sujet. Aujourd’hui, n’importe quel éleveur de porc qui s’installe a fait son dossier environnement – il en parle avec passion. Il a fallu un cheminement avant d’arriver à la situation actuelle dans les élevages. Il a fallu, je ne dis pas une révolution culturelle, mais une compréhension, une acceptation. Le guide de bonnes pratiques, on ne l’a pas écrit suite aux images de L214 : c’était déjà le fruit d’une prise de conscience qu’il fallait travailler sur ce sujet pour encadrer les pratiques à ce stade. La prise de conscience est là.
M. le président Olivier Falorni. Ce sera la phrase de conclusion. Nous sommes preneurs des différents éléments que nous avons évoqués dans le calendrier que nous vous avons indiqué : avant la fin du mois de juin, ce serait idéal. Je vous remercie, monsieur le directeur.
La séance est levée à dix-neuf heures cinq.
——fpfp——
16. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des syndicats d’employés du secteur agro-alimentaire, avec la participation de M. Michel Kerling, secrétaire fédéral de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière (FGTA-FO), M. Pascal Eve, conseiller fédéral de la Confédération française des travailleurs chrétiens Agriculture (CFTC-AGRI), M. Michel Le Goff, membre du comité exécutif fédéral de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail (FNAF-CGT) et M. Alain Bariller, délégué syndical central du groupe Socopa de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
(Séance du jeudi 26 mai 2016)
La séance est ouverte à neuf heures cinq.
M. le président Olivier Falorni. Notre table ronde réunit les syndicats d’employés du secteur agroalimentaire. Nous souhaitons la bienvenue à M. Michel Kerling, secrétaire fédéral de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière (FGTA-FO), M. Pascal Eve, conseiller fédéral de la Confédération française des travailleurs chrétiens Agriculture (CFTC-AGRI), M. Michel Le Goff, membre du comité exécutif fédéral de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail (FNAF-CGT), accompagné de M. Roger Perret, secrétaire de la FNAF-CGT et de M. Denis Lefrançois, délégué syndical de Socopa Coutances, M. Alain Bariller, délégué syndical central du groupe Socopa, de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), accompagné de M. Philippe Henriq, coordonnateur du groupe Bigard-Charal-Socopa.
Je vous rappelle, messieurs, que toutes nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. Elles sont aussi parfois diffusées sur la chaîne LCP.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Michel Kerling, Pascal Eve, Michel Le Goff et Alain Bariller
prêtent successivement serment.)
M. Michel Kerling, secrétaire fédéral de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière (FGTA-FO). Mesdames, messieurs les députés, mon organisation vous remercie de nous permettre de nous exprimer devant votre commission. Je suis secrétaire fédéral de la FGTA-FO chargé des deux secteurs viande, le secteur coopératif agricole bétail et viande et celui de l’industrie et des commerces en gros des viandes. La FGTA-FO est représentée dans ces deux secteurs à hauteur de 27,64 % pour la première et de 27,53 % pour la seconde.
Les abattoirs jouent un rôle primordial. Il s’agit de permettre d’abattre, dans des conditions respectant les règles quant au bien-être animal, les animaux de boucherie élevés et destinés à la consommation humaine. Il nous semblait utile de le rappeler, compte tenu du contexte un peu compliqué que nous vivons actuellement.
Sur les 263 abattoirs de viande de boucherie que compte notre pays, la maltraitance animale a été avérée dans trois abattoirs – vous connaissez leurs noms –, soit un peu plus de 1 %. Après une visite de l’ensemble des abattoirs, 5 % de manquements graves ont été détectés. Ces chiffres montrent qu’il ne faut pas établir de règle en partant d’un pourcentage qui, bien qu’intolérable, reste faible. Il s’agit de situations extrêmes, non de réalités quotidiennes. Bien sûr, ces actes sont inadmissibles et condamnables – et je le dis bien que nous représentions les salariés qui travaillent dans ces outils, et notamment sur ce poste très controversé aujourd’hui qu’est l’abattage de l’animal.
Il est utile également de rappeler la grande diversité des abattoirs. Il y a les outils industriels, qui appartiennent à des grands groupes de viande, et ceux que je qualifierai de publics qui assurent bien souvent un service de proximité et qui sont peut-être plus fragiles sur le plan économique, sachant que l’activité d’abattage seule est peu rentable aujourd’hui. La question de la structure assurant la formation – service des ressources humaines – et l’encadrement des salariés – encadrants de proximité – est posée.
Il faut également connaître la réalité quotidienne des salariés. Nous sommes un secteur d’activité où la pénibilité est reconnue par accord collectif par l’ensemble des partenaires sociaux. Le travail, caractérisé par le froid associé à l’humidité, le geste répétitif et la cadence, laisse peu de latitudes aux salariés pour pallier un dysfonctionnement matériel. Je connais un outil qui abat vingt-huit bovins à l’heure avec une équipe d’environ seize personnes, autrement dit un bovin toutes les deux minutes. Cela vous donne une idée du rythme de travail dans les outils industriels. Sans parler des amplitudes de travail pouvant aller de neuf heures trente dans une convention collective à dix heures dans une autre.
Le poste d’abattage est un poste particulier qui concerne le bien-être animal, mais ce n’est pas le seul. Les conditions de vie de l’animal chez l’éleveur, l’arrivée à l’abattoir d’animaux – le pourcentage est faible, heureusement – hors d’état de supporter le transport, et qui n’auraient donc pas dû y être envoyés sont autant de considérations qui peuvent influer sur l’acte d’abattage proprement dit. Nous pensons que le rôle d’inspection ante mortem est primordial. Les vétérinaires, les services vétérinaires ont-ils le temps de remplir parfaitement cette mission aujourd’hui ?
Nous avons fait le choix d’évoquer l’abattage rituel dans son ensemble. C’est un sujet complexe qui touche à la fois à la liberté religieuse des personnes, mais aussi à la prise de responsabilité du législateur que vous êtes. À notre avis, une harmonisation européenne serait souhaitable. Les informations que véhiculent les médias sur ces disparités polluent la compréhension des citoyens qui sont aussi des consommateurs.
Les moyens d’action reposent essentiellement sur la pédagogie et la formation. Des actions de sensibilisation sont indispensables pour le personnel affecté à ce poste particulier, puisque l’animal y arrive vivant et en ressort mort. En allant plus loin, une demi-journée de sensibilisation pourrait être organisée chaque année avec l’ensemble des acteurs, y compris avec le concours des services vétérinaires qui pourraient mettre en avant son importance. Cette action pourrait être financée par le plan de formation des entreprises.
La responsabilité des encadrants de proximité doit être également prise en compte. L’aspect bien-être animal devrait obligatoirement être intégré dans le cursus de formation et
– pourquoi pas ? – délivré par l’intermédiaire d’un intervenant externe à l’entreprise.
Quant à l’idée de filmer le poste d’abattage, elle ne nous paraît pas pertinente pour plusieurs raisons. Qui aurait et prendrait le temps de visionner les journées d’abattage ? La maltraitance animale ne concerne pas uniquement le poste d’abattage mais également l’ante mortem. Enfin, l’aspect « surveillance des salariés » est un point non négligeable qui, pour nous qui les représentons, va bien au-delà du problème de la maltraitance animale.
La désignation d’un référent et/ou lanceur d’alerte pose un problème complexe à deux égards : celui du comportement de la hiérarchie à son égard – les petits outils qui n’exercent que l’activité d’abattage et qui ne sont pas adossés à des grands groupes ont une économie fragile – et de la protection dont il disposerait. La sensibilisation collective et régulière nous semble plus pertinente.
Prévoir des visites ponctuelles dans les abattoirs, comme celles qui ont été organisées de façon systématique dernièrement, nous semble indispensable.
En conclusion, l’ensemble des moyens mis en œuvre n’occulteront pas le fait que l’entreprise est un reflet de notre société. Aussi, si certains citoyens devenus salariés maltraitent les animaux dans le cadre de leur travail, cela devrait constituer un délit avec les conséquences qui s’y rattachent.
M. Pascal Eve, conseiller fédéral de la Confédération française des travailleurs chrétiens Agriculture (CFTC-AGRI). La CFTC déplore également les actes qui ont été commis dans les trois abattoirs ces dernières semaines. Il est clair que de telles choses ne devraient pas exister. Qui plus est, notre filière est en butte à de sérieuses difficultés, et de tels actes ne font que les aggraver.
La première chose qui doit être prise en compte, c’est le bien-être animal. Comme l’a dit à l’instant M. Kerling, le bien-être animal ne commence pas lors de l’arrivée de l’animal à l’abattoir. C’est bien en amont qu’il faut être vigilant : il faut veiller à ce que les animaux ne soient pas compressés pendant le transport. Bien entendu, il y a des choses à faire dans les abattoirs. Mais il faut laisser aux établissements le temps de faire les investissements nécessaires, afin d’améliorer le bien-être animal. Cela fait deux ans que mon entreprise travaille sur ce dossier qui nous paraît très important.
Nous ne sommes pas complètement favorables à l’installation de caméras de vidéosurveillance. Qui va surveiller ? Qui aura la capacité de surveiller ? De surcroît, ces matériels représentent un coût pour nos entreprises qui sont déjà en difficulté. Placer une personne devant un écran pendant huit à dix heures par jour me paraît un peu difficile.
M. Michel Le Goff, membre du comité exécutif fédéral de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail (FNAF-CGT). Je vais, par la présente intervention, vous expliquer les conditions de vie de l’animal et du salarié dans les abattoirs que je connais en France.
Je suis salarié dans l’agroalimentaire depuis 1981 et j’ai commencé à travailler dans le groupe Bigard en 1988. Je suis délégué syndical central CGT du groupe, pour les entités Bigard, Charal et Socopa. Mon statut dans le groupe m’a permis de visiter une dizaine d’abattoirs sur les dix-sept que possède Jean-Paul Bigard.
Cela fait vingt-cinq ans que je suis à la chaîne, sur les lieux de production et d’exploitation : je connais donc bien le métier. Le bien-être animal est expressément lié au bien-être du salarié dans son entreprise, sur son lieu de travail. Si les moyens de production, c’est-à-dire le matériel et la sécurité du salarié sont respectés, alors les conditions peuvent être réunies pour permettre un abattage dans le respect de l’animal.
L’abattage d’un animal est en lui-même un acte violent. Ne pas le faire souffrir doit être le but ultime. Des règles élémentaires doivent prévaloir avant l’abattage d’une bête, quelle qu’elle soit. Il faut un milieu propre en bouverie, en porcherie ou en lieu d’attente. Les couloirs d’amenée doivent être sécurisés avec des rails qui empêchent l’animal de sauter ou de s’échapper, en optimisant l’avancée par des cases amovibles qui suppriment le recours à la matraque électrique. Un box d’assommage avec blocage de tête permet une maîtrise de l’emploi du matador pour les bovins ou autres outils adaptés à chaque espèce. L’étourdissement est effectué par un opérateur habilité d’un certificat de compétence. La saignée se fait dans la continuité le plus rapidement possible, mais dans un temps bien défini avant le travail sur l’animal. Malheureusement, souvent dans les abattoirs, les cadences sont infernales. Les salariés travaillent dans l’humidité et la chaleur – ils peuvent travailler à plus de 40 °C l’été, et autour de zéro l’hiver – avec une hiérarchie oppressante qui ne cesse de relancer l’opérateur au moindre arrêt de la chaîne. À l’abattoir de Guingamp par exemple, des salariés se sont vus infliger un avertissement parce qu’ils laissaient trop de trous dans la chaîne. Ils sont allés aux prud’hommes ; le tribunal a levé la sanction en condamnant la Socopa, mais la direction a fait appel. Cet exemple montre jusqu’où peut aller l’entreprise pour mettre la pression sur les salariés. Le salarié, dans la crainte ou la peur de se faire sanctionner, voire licencier, peut arriver à une dérive quand certaines situations deviennent intenables et se retrouver à faire ce que l’on a vu dans les vidéos. Mais il faut se rendre compte de toute la pression subie par le salarié pour en arriver là. Ce n’est pas de gaieté de cœur que l’on voit un salarié taper sur une bête ou la malmener ; mais il peut être dans une situation tellement extrême, au point de ne même plus se rendre compte de ses gestes.
Dans les élevages intensifs, l’animal est très peu au contact de l’homme. Quand la bête arrive à l’abattoir, elle est effrayée et peu conciliante, particulièrement les jeunes bovins. Les cadences élevées qui sont imposées, les amplitudes de travail de plus en plus fortes – les journées de neuf heures trente ou dix heures sont monnaie courante –, les contraintes sanitaires, d’hygiène, de qualité en constante évolution, la pression de l’agent de maîtrise qui ne cesse d’interpeller l’opérateur quand la chaîne est arrêtée, poussent le salarié à flirter avec les limites. Un temps de saignée parfois écourté ou un assommage précipité font que l’incident peut se produire à tout moment.
Les salariés ont une haute conscience de leurs responsabilités. En favorisant des formations professionnelles qualifiantes et rémunérées en conséquence, il est possible d’organiser des rotations sur les postes de saignée et d’assommage. Il est inconcevable que les salariés puissent se retrouver toute la journée à l’assommage ou à la saignée, car ce sont des métiers très éprouvants sur le plan psychologique. Les rotations sur les postes permettent aux salariés de souffler. Aussi pensons-nous que la rotation devrait être obligatoire pour éviter le traumatisme psychologique de la tuerie qui s’additionne à la pénibilité du métier en abattoir.
Des garde-fous sont nécessaires. Un ou des référents responsables de la protection animale indépendants doivent être présents dans tous les abattoirs, petits ou grands.
Certes, des contrôles existent déjà, mais de moins en moins nombreux en raison des politiques de réduction d’emplois dans les services publics. Les autocontrôles réalisés par les directions d’entreprise ne permettent pas une impartialité de jugement des situations à risque, du fait du lien de subordination entre le salarié et l’employeur. Abattre en toute transparence pour éviter les dérives est une exigence fondamentale. L’installation de caméras de vidéosurveillance n’apportera pas grand-chose, sinon du stress supplémentaire pour le salarié.
On parle également de cloisonner les postes d’assommage et de saignée et d’en limiter l’accès pour éviter des vidéos sauvages. Nous y sommes défavorables, car cela pourrait attiser les soupçons du consommateur. La filière viande est régulièrement attaquée, de l’agriculteur aux salariés de l’industrie agroalimentaire. Des milliers d’emplois sont concernés. Garantir notre souveraineté alimentaire assurera le maintien de l’activité sur notre territoire. Baser notre alimentation sur une nourriture saine, de qualité et en quantité suffisante, accessible pour tous, voilà les enjeux à venir. Une politique ambitieuse devra nationaliser les grands groupes de l’industrie agroalimentaire, permettant le développement de notre économie industrielle.
M. Alain Bariller, délégué syndical central du groupe Socopa, de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC). Je suis délégué syndical central SNCOA CFE – CGC AGRO au sein du groupe Bigard-Charal-Socopa. Je travaille sur le site d’Évron, dans la Mayenne, depuis trente-huit ans. Notre entreprise est spécialisée dans l’abattage, la découpe et le désossage de porcs charcutiers. Nous abattons 26 000 porcs par semaine, dont 25 500 sont découpés et 500 vendus en carcasses. Je suis responsable de production en première transformation : je m’occupe de la gestion de la porcherie, du hall d’abattage, du cinquième quartier et de la gestion des carcasses. Ce secteur compte 180 personnes, pour un site de 950 personnes.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec les propos que vient de tenir Michel Le Goff. Je suis responsable de la protection animale depuis le 24 septembre 2013. Notre site compte quatre RPA, afin de couvrir l’amplitude horaire. Vingt-six personnes ont par ailleurs été formées bien-être animal (BEA), dont sept chauffeurs même si cette formation n’est pas obligatoire pour eux puisqu’ils ont déjà, en tant que « chauffeurs vifs », leur certificat d’aptitude professionnelle au transport d’animaux (CAPTAV). De plus, une équipe de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), composée de vingt-deux personnes, dont deux vétérinaires et un technicien, est présente en permanence à la porcherie. Je vous remettrai le manuel bien-être animal spécifique à Évron ainsi que deux rapports d’auditions surprises effectuées par l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) le 19 juin 2007, le 20 mars 2012 et le 4 mars 2015. Leurs conclusions soulignent de manière positive notre façon de travailler tout en respectant les règles de protection animale.
Suite aux reportages diffusés dernièrement dans les médias – je soupçonne pour ma part le dernier d’être un scénario truqué, car travailler cagoulé dans une ambiance telle que celle de la porcherie me paraît un comportement assez douteux – je veux souligner le mal-être qu’en ont ressenti les RPA et les personnes ayant passé le BEA. De grandes interrogations se posent, d’une part sur le devenir du noble métier des salariés de la production, d’autre part sur celui des entreprises agroalimentaires qui voient leurs commandes de viande diminuer.
M. le président Olivier Falorni. Vous avez parlé de la formation des opérateurs en abattoir. Comment l’évaluez-vous ? Quelles pourraient être les pistes d’amélioration de cette formation, tant qualitativement que quantitativement ? Comment sont formés ces opérateurs à la manipulation de l’équipement de l’abattoir, et en particulier des outils d’étourdissement ? On voit parfois des problèmes liés à l’utilisation de pinces à électronarcose ou de pistolets à tige perforante. Comment les opérateurs sont-ils formés au bien-être animal et à la protection animale ?
Que pensez-vous de l’instauration d’un statut de lanceur d’alerte pour protéger les référents protection animale ?
M. Michel Kerling. Monsieur le président, votre dernière question démontre que le lanceur d’alerte est un point central de votre commission. Comme l’a dit M. Le Goff, il faut garder à l’esprit l’existence de ce lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Nous avons parlé de protection. Il existe des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les entreprises d’une certaine taille – dans les entreprises plus petites, ce sont les délégués du personnel qui jouent ce rôle. Pourquoi ne pas désigner le lanceur d’alerte parmi ses membres, puisqu’ils jouissent déjà d’une protection, donc d’une liberté de langage et d’une liberté d’action, certes relative, mais réelle ? Nous sommes très attachés à la liberté de parole du lanceur d’alerte. Si les entreprises désignent un référent ou un lanceur d’alerte, celui-ci doit être protégé d’une façon ou d’une autre.
J’en viens la formation. Je vous résume très rapidement quel a été mon parcours : avant d’être à la fédération, j’ai travaillé pendant vingt-neuf ans, de 1976 à 2005, dans un outil d’abattage en Normandie, qui appartenait à la Socopa, désormais intégrée dans le groupe Bigard. Je n’étais pas à la production proprement dite, mais dans un service administratif de gestion étroitement liée à la production ; et lorsque j’ai pris des responsabilités en tant que représentant du personnel, j’ai pu aller voir en toute liberté ce qui se passait dans l’ensemble des ateliers, et notamment au poste d’abattage. Même si cela fait un peu plus de onze ans que je suis à la fédération, je ne pense pas avoir un regard uniquement parisien, si vous me permettez l’expression, de ce qui se passe. Il n’y a pas si longtemps, j’ai visité les sites de Socopa Évron et de Bigard Castres. Je vois ce qui se passe au quotidien dans les outils d’abattage.
J’ai connu une époque où la formation des encadrants était axée uniquement sur le résultat économique. On leur expliquait qu’ils ne seraient appréciés que par rapport à cet élément. Depuis, les choses ont évolué. Leur formation porte désormais de plus en plus sur la gestion du personnel, sur la façon de gérer les ressources humaines. L’évolution de la société nous incite peut-être à intégrer un vrai module de formation sur le bien-être animal. Nous avons mis en place une politique de formation avec les certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnus au registre national des certifications professionnelles (RNCP). Peut-être serait-il utile de revoir les référentiels de formation et d’y inclure un vrai volet bien-être animal, en travaillant avec tous les services liés à l’alimentation, les services vétérinaires par exemple.
M. Pascal Eve. J’appelle votre attention sur le fait que les nouveaux postes créés reviennent souvent à du personnel d’encadrement et d’encadrement de proximité. Il faut surtout éviter que le lanceur d’alerte soit désigné dans cette catégorie, car le lien de subordination est évident. Il faudrait nommer quelqu’un de totalement indépendant, qui ait un droit d’expression, qui ait la liberté d’aller et venir, autrement dit quelqu’un qui soit libre dans l’entreprise. Or, comme vient de l’expliquer Michel Kerling, les représentants du personnel disposent de certaines libertés. Ils pourraient donc apporter quelque chose et permettre que le projet réussisse.
Dans une entreprise, une formation est un investissement. Il n’y a aucun doute là-dessus : il faut organiser des formations sur le bien-être animal. Mais il faut progresser rapidement en la matière, car seules les formations permettront d’obtenir des résultats concrets et rapides.
M. le président Olivier Falorni. Selon vous, sur quoi faudrait-il insister ? À votre avis, la formation des opérateurs chargés de l’étourdissement est-elle suffisante ?
M. Pascal Eve. La formation ne doit pas concerner un seul homme. Il faut que l’animal qui arrive dans nos abattoirs se sente le mieux possible. La personne qui est au poste d’assommage n’est pas la seule responsable de son mal-être. Celle qui amène l’animal jusqu’au piège est concernée également. Plus l’animal sera amené jusqu’au piège dans de bonnes conditions, meilleure sera la viande. Quand un animal n’est pas au mieux, la viande est fiévreuse, elle présente parfois des hématomes. Il est indispensable que toutes les personnes qui interviennent de près ou de loin jusqu’après le poste de saignée soient formées. Et il faut que cette formation tienne la route.
M. le président Olivier Falorni. La question que je vous pose me vient de l’expérience que le rapporteur Jean-Yves Caullet et moi-même avons eue lors de notre visite à l’abattoir d’Autun. Nous avons pu apercevoir des défaillances, en termes d’équipements, de structures, en particulier sur l’amenée des animaux. On a vu à quel point cela mettait en grande difficulté les salariés qui faisaient pourtant le maximum. Ils se retrouvaient dans des situations infernales à devoir rattraper les cochons et les moutons qui passaient par-dessus les barrières. L’outil de contention n’étant pas adapté, ils se retrouvaient face à un mouton qui bougeait la tête en permanence et il leur était très difficile de bien placer la pince à électronarcose. On a pu constater qu’un matériel inadapté pouvait entraîner des conditions de travail absolument épouvantables.
On a vu par ailleurs que les animaux pouvaient arriver à l’abattoir blessés – vous avez parlé d’hématomes, mais cela pouvait être pire – et particulièrement stressés. Il était évident que les animaux arrivaient totalement stressés au moment de l’étourdissement. Je n’oserai pas utiliser le terme de « maltraitance » car nous n’avons pas vu de maltraitance, mais du mal-être animal. Mais ce n’était pas de la faute des opérateurs qui, du reste, étaient jeunes, ce qui nous a fait comprendre la difficulté physique de ce métier.
Nous avons demandé à l’opérateur chargé de la saignée s’il y avait un turn over dans l’entreprise. Il nous a répondu que pour sa part il ne le souhaitait pas, qu’il voulait rester à ce poste. Une telle attitude est-elle fréquente ? Y a-t-il une obligation de turn over ? On imagine bien que passer toute sa carrière au poste de saignée doit finir par avoir des conséquences, au niveau tant psychologique que physique.
M. Pascal Eve. L’entreprise dans laquelle je travaille est équipée de couloirs de contention fermés sur les côtés et au-dessus, de l’arrivée de l’animal jusqu’à l’amenée au piège. Aussi n’avons-nous pas de réelle difficulté sur ce sujet-là. Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, cela fait quelques mois que nous travaillons sur le dossier du bien-être animal pour que les animaux soient au mieux avant le poste d’assommage. Mon entreprise a donc fait le nécessaire pour que les animaux passent tous dans un couloir. La personne qui les amène a donc moins de difficultés à les pousser. Il suffit qu’elle soit derrière l’animal pour qu’il avance.
Vous nous demandez pourquoi certains opérateurs ne souhaitent pas faire un roulement. C’est une attitude très fréquente dans nos entreprises. À une certaine époque, c’est le rendement qui était demandé en priorité. Laisser quelqu’un au même poste pendant huit heures lui permettait d’acquérir des gestes systématiques. Tout le monde s’y retrouvait. Mon collègue parlait à l’instant de quarante animaux à heure ; pour notre part, nous en abattons plutôt quatre-vingts à l’heure… Il faut dire que ce n’est pas un petit abattoir : nous sommes 500 salariés environ. Nous aurions dû demander aux opérateurs de faire une rotation, car plus on change de poste, moins les gestes sont répétitifs sur le long terme et cela limite les troubles musculosquelettiques (TMS). Pour ma part, je suis partisan de la polyvalence, d’abord parce que je le suis moi-même. Cela m’évite d’avoir mal partout et de devoir me faire opérer. Tous mes collègues de plus de trente-cinq ans se sont fait opérer du canal carpien, car cela fait dix, vingt ou trente ans qu’ils sont au même poste. Le poste le plus dur dans notre abattoir est celui de la levée des mamelles : l’opérateur affecté à ce poste peut lever des mamelles pendant dix heures d’affilée…
M. Michel Kerling. Vous avez dit que les salariés faisaient le maximum. Nous en sommes convaincus. Ce n’est pas sur la première transformation qu’une entreprise va chercher sa performance économique. Plus elle transforme le produit, plus elle améliorera sa performance. S’il n’y a pas de performance économique, il n’y aura pas d’investissement.
Nous avons besoin des abattoirs de proximité. Ils sont parfois soutenus par les collectivités locales. Bien évidemment, cela ne doit pas se faire au détriment de l’animal et du salarié. Des difficultés économiques ont été mises en avant, même dans les grands outils. J’ai vécu la casse sociale qui s’est passée dans le groupe GAD à cause d’un manque de performances économiques. Certains salariés ont vidé des panses de porc durant toute leur carrière professionnelle, car ils étaient très attachés à la performance économique. Et quand il n’y a pas de performance économique, la gestion des ressources humaines est un peu mise de côté. Ce n’est pas quand vous êtes au chômage que vous vous demandez si vous allez repeindre la façade de votre maison, mais quand votre situation est économiquement bonne.
Quant à la culture du turn over, nous y travaillons très sérieusement, au niveau de la branche. Il faut espérer que la loi travail nous permettra de continuer à travailler sur ces sujets dans le cadre des conventions collectives… Pardonnez-moi cette parenthèse, je ne pouvais pas faire autrement !
Actuellement, nous avons beaucoup de difficultés à emmener le salarié jusqu’à la fin de sa carrière professionnelle. On sait que cela passe par la rotation des postes. Mais quand un salarié fait bien son travail sur un poste et qu’il est performant, surtout dans les petits outils, son supérieur est satisfait de lui ; il n’aura donc guère envie de changer, de crainte de se voir reprocher de ne plus l’être autant. Quand une entreprise dégage de bons résultats économiques – c’est le cas de notre groupe, même s’ils n’ont rien à voir avec ceux que dégagent Danone et autres –, elle essaie de faire une politique de ressources humaines et de consacrer des moyens à la formation des salariés. C’est ce que j’essaie de faire en tant qu’administrateur à l’OPCALIM. Reste que certains refusent de changer de poste : ils sont en fin de carrière, ils ont cinquante-cinq ans, ils sont fatigués, ils n’ont plus envie de se former, ils ne veulent pas revenir sur les bancs de l’école. Alors nous essayons de faire le point, avec le salarié, sur son parcours professionnel. Si l’on veut arriver à des résultats, il faut faire des césures dans la carrière professionnelle et parler avec le salarié – c’est ce qu’a impulsé la loi sur la formation professionnelle. Aujourd’hui, dans le monde de la viande, notamment dans le secteur de la production, on ne sait pas prendre un salarié au début de sa carrière professionnelle et l’emmener jusqu’à la fin. C’est un vrai challenge pour les années à venir ; espérons que l’âge auquel il pourra faire valoir ses droits pour partir à la retraite ne montera pas jusqu’au ciel et qu’il ne devra pas travailler jusqu’à un âge inadapté au monde industriel d’aujourd’hui, à plus forte raison celui de la viande.
M. Michel Le Goff. J’ai surtout parlé tout à l’heure du problème que posait le lien de subordination dans l’entreprise. Comment voulez-vous que votre lanceur d’alerte, appelons-le ainsi, soit en mesure de dénoncer quelque dysfonctionnement que ce soit ? Ce sera très compliqué. Imaginez la pression qu’il peut subir : cela peut entraîner la fermeture de l’abattoir, le licenciement de l’employé fautif. Cela mettra une pression incroyable sur cette personne. Il faut avant tout donner des moyens aux services vétérinaires d’être présents sur le terrain et de surveiller les conditions de travail.
Le problème est d’abord celui de l’organisation du travail dans l’entreprise, autrement dit des moyens que l’on donne au salarié pour qu’il puisse travailler, du matériel adéquat. Il existe encore des abattoirs où il n’y a toujours pas de piège. La bête arrive dans un couloir, elle est plus ou moins bloquée. On assomme une bête en une fraction de seconde, avec un geste très précis ; il suffit qu’elle tourne la tête pour qu’on la rate. Dans le groupe Bigard, les abattoirs se dotent progressivement de pièges équipés d’une mentonnière qui bloque bien la tête : l’opérateur a une grande facilité pour assommer l’animal. Il faut donc un matériel adéquat et régulièrement remis à niveau. C’est sur l’organisation du travail qu’il faut vraiment insister.
Le salarié est conscient de la responsabilité qu’il a quand il fait ce travail. À Bigard Quimperlé, le turn over est une revendication de notre syndicat. Des rotations sur les postes ont été mises en place, ce qui permet une plus grande polyvalence, une qualification, une rémunération et une certaine souplesse dans le travail. Cela économise le salarié en lui évitant les gestes répétitifs. Mais il faut savoir qu’en le rendant plus polyvalent, on peut être tenté de l’exploiter encore plus : au lieu d’avoir un seul coude cassé, il aura les deux coudes, les épaules et le dos cassés… Autrement dit, le système peut avoir des effets pervers ; il faut faire attention à tous ces aspects.
J’ai entendu M. Eve parler d’une cadence de quatre-vingts bêtes à l’heure. Tout dépend comment la chaîne est équipée : certaines chaînes tournent à vingt-sept, d’autres à trente, quarante, soixante ; à Quimperlé, nous en traitons soixante. Après, tout dépend du nombre d’opérateurs qu’il y a sur la chaîne, du matériel et de la conception même de la chaîne. Un chauffeur routier par exemple est obligé de s’arrêter, ce qui n’est pas le cas dans l’agroalimentaire. Il n’y a aucune obligation de rotations en ce qui concerne les tueries. Elles sont fonction de l’organisation du travail appliquée dans l’entreprise ou sur le site. À Quimperlé par exemple, un accord d’entreprise impose une rotation sur ces postes toutes les heures, pour permettre aux salariés de souffler. Mais cela implique des actions dans le domaine de la polyvalence, de la formation, etc.
Le lanceur d’alerte pourrait être désigné parmi les instances représentatives du personnel (IRP) – délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE). Il y a aussi le CHSCT : c’est déjà en quelque sorte un lanceur d’alerte, il a les compétences pour le faire. Il serait plus intéressant de donner les moyens à ces gens-là plutôt que de faire peser autant de pression sur un lanceur d’alerte.
Chez Bigard, un accord de groupe a été signé sur le parcours professionnel. Mais il est compliqué pour une personne qui a travaillé trente-cinq ou quarante ans au même poste d’en changer, même si on lui en propose un plus facile : comme elle n’a pas été éduquée dans ce sens, elle ne voudra pas. Mais si, dès le début de sa carrière, on met en place un parcours professionnel, si le salarié est habitué à suivre régulièrement des formations avec des remises à niveau et qu’il évolue dans son travail, il aura naturellement envie de changer de poste, d’apprendre des choses, bref d’évoluer tout simplement. Vous avez vous-même remarqué, monsieur le président, qu’il n’y a malheureusement que des jeunes sur la chaîne. C’est que nous sommes des sportifs de haut niveau : il faut travailler à soixante à l’heure et à une température de 40 °C. Et savoir manier le couteau : nous sommes presque aussi performants qu’un chirurgien… L’éviscération exige des gestes extraordinairement précis, bien calculés, une grande dextérité et des couteaux affûtés comme des rasoirs. Le parcours professionnel devrait permettre à une personne qui est embauchée à l’âge de vingt ans dans l’entreprise de travailler jusqu’à cinquante-huit ans sans détériorer sa santé. Maintenir le salarié dans son emploi sans le casser : voilà l’enjeu auquel est désormais confronté le secteur agroalimentaire.
Les formations existent. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent tout un monde. Pendant les formations on nous dit de faire des choses. Mais ensuite, quand on est sur le terrain, on se rend compte qu’on ne peut pas faire ce que l’on nous a appris. C’est frustrant. Faudrait-il là aussi lancer une alerte, dénoncer ? Il faut pouvoir mettre ce qu’on apprend en application sur le terrain, et avec de bonnes conditions de travail.
M. Alain Bariller. Comme je l’ai déjà dit, dans mon entreprise nous sommes quatre RPA. Nous avons pour cela suivi une formation de deux jours. Et les opérateurs qui travaillent dans l’environnement du vif ont reçu une formation bien-être animal.
Pour s’assurer que la formation est efficace sur le long terme, les RPA et le service qualité font environ quatre audits chaque semaine sur les postes de descente des camions, la réception, la montée des porcs, l’amenée, l’anesthésie et la saignée. Grâce à ces audits, que nous archivons soigneusement et que n’importe qui peut consulter, nous dressons un bilan mensuel. Bien sûr, nous n’attendons pas un mois pour réagir si nous avons constaté quelque chose d’anormal. Si on a vu une personne faire quelque chose de contraire au bien-être animal, nous la recevons sur-le-champ. Mais il ne s’agit pas de recevoir les gens pour leur mettre la pression. En tant que responsable de chaîne, je préfère avoir des « trous » sur la chaîne que de voir des porcs mis sur la zone de consigne et qui finiront en saisie totale pour viande congestive. On est largement perdant quand on se retrouve avec de la viande congestive plutôt qu’avec un porc ou deux de moins sur la chaîne.
Le groupe Bigard a choisi pour politique de donner la priorité à l’Homme, avec un grand H, avant de parler de la production. Nous faisons de sérieux progrès dans le domaine de la polyvalence et la polycompétence. Les salariés affectés aux niveaux de la porcherie et de la montée tournent toutes les demi-heures, ce qui évite la monotonie qui peut conduire au laisser-aller. La polyvalence et la polycompétence valent aussi bien pour le vivant que pour la chaîne d’abattage et les deuxième et troisième transformations. Tout à l’heure, M. Kerling n’a pas cité de noms, mais il pensait fortement à notre groupe…
M. Roger Perret, secrétaire de la FNAF-CGT. Au cours de ma carrière, j’ai eu à m’occuper d’autres secteurs de l’alimentation. Les problèmes d’image, ou de ce qui était répercuté dans la société, conduisaient un certain nombre de citoyens à s’interroger sur la façon dont les produits étaient fabriqués. Aujourd’hui, le problème essentiel est que l’entreprise est un monde extrêmement fermé. Disposer de la parole n’est pas si simple. Du coup, ce sont des citoyens extérieurs à l’entreprise qui soulèvent les problèmes. J’en veux pour preuve ce qui s’est passé avec la banane aux Antilles. Quand on est dans l’entreprise et lanceur d’alerte, reste-t-on citoyen ou est-on dans un monde où la question est fermée ?
La deuxième question, c’est celle de la place du social par rapport à l’économique. Il ne faut pas se voiler la face : les situations que les uns et les autres connaissent aujourd’hui sont liées au fait que l’économique prévaut sur le social. Et si vous ne changez pas cela, les lanceurs d’alertes resteront menacés, au point de devoir se réfugier dans les ambassades, et soumis à des pressions énormes. Qui plus est, le Parlement a adopté des textes de loi qui ont réduit les possibilités d’intervention des salariés. La remise en cause des délégués du personnel et des prérogatives des comités d’entreprise est une réalité.
La question du lanceur d’alerte sera résolue dès lors que le salarié de l’entreprise restera citoyen. Il y a longtemps, j’avais été amené à dénoncer la qualité d’un certain nombre de produits. Il faut voir le type de pression que l’on peut subir quand on est amené à appeler les services vétérinaires… Quand on le fait, on est conscient que cela crée chez les salariés des entreprises agroalimentaires des interrogations, parce que la question de l’image dans l’agroalimentaire est extrêmement importante. S’agissant des lanceurs d’alerte, il faut en revenir à ce que sont aujourd’hui l’organisation et le monde du travail. Sinon on ne s’en sortira pas.
Mme Geneviève Gaillard. Je vous remercie, messieurs, pour vos propos. Vous avez bien exprimé vos points de vue, et par avance répondu à bon nombre de questions que je voulais vous poser.
J’ai senti dans vos interventions qu’il y avait une différence entre les abattoirs intégrés ou de grands groupes et les abattoirs plus petits, ce qui se comprend parfaitement. Pensez-vous que les petits abattoirs aient encore un avenir ? Croyez-vous que l’on puisse réellement améliorer les choses dans les unités à faible tonnage et multi-espèces ? Pensez-vous qu’il faille imposer un RPA en dessous d’un certain tonnage ? Vous le savez, les contrôles vétérinaires ne sont pas les mêmes non plus : dans certains cas, il n’y a pas de vétérinaires affectés, contrairement à ce qui se passe dans de grands groupes. Pensez-vous qu’il soit possible d’améliorer certaines choses ?
Vous avez parlé des cadences. Je suis assez convaincue que les cadences sont importantes – au cours de nos auditions, on a vu que certains le sont moins. Lorsque vous avez fait remonter à votre hiérarchie des problèmes, comment avez-vous été entendus ? J’ai une petite idée de la réponse… Cela donne-t-il lieu à des résultats par la suite ? Dans les postes d’abattage et tous ces postes difficiles, y a-t-il beaucoup d’absentéisme ?
Le bien-être animal concerne tout le monde, y compris les responsables des outils d’abattage, qu’il s’agisse des collectivités ou des personnes privées. Ne serait-il pas intéressant que la hiérarchie soit aussi formée au bien-être animal et que la culture du bien-être animal fasse partie de l’entreprise ? Je suis intimement convaincue que sans cette culture on ne parviendra jamais à faire au mieux.
Enfin, je ne sais pas si vos abattoirs font du halal ou du casher, autrement dit de l’abattage sans étourdissement. Si c’est le cas, comment voyez-vous les choses ? Pensez-vous qu’un abattage…
M. Pascal Eve. Rituel ?
Mme Geneviève Gaillard. Je ne veux pas utiliser le mot « rituel ».
Pensez-vous donc qu’un abattage avec un étourdissement post cut pourrait être possible ? On sait que cela existe. L’État doit donner des dérogations pour pratiquer l’abattage sans étourdissement et les sacrificateurs doivent être agréés. Mais tout est-il calé ? J’aimerais connaître votre sentiment global sur ce sujet.
M. Alain Bariller. Mon abattoir étant spécialisé dans le porc, je ne répondrai pas à votre dernière question… Je considère qu’un référent est indispensable sur tous les sites, même les petits. La responsabilité du bien-être animal doit évidemment concerner au minimum le directeur du site ; il doit être totalement impliqué en la matière. Si le directeur n’est pas persuadé que le bien-être animal est une priorité, je ne vois pas comment il peut le faire respecter sur le terrain.
Dans mon groupe, l’absentéisme représente 5,5 %, ce qui est assez faible par rapport au milieu. Comme je l’ai dit tout à l’heure, notre groupe a placé l’homme au centre du dispositif. C’est grâce à la polyvalence que l’absentéisme baisse chaque année. Visiblement, cette politique est payante.
M. Michel Le Goff. Je crois que les petits abattoirs ont leur place en milieu rural, pour conserver cette économie locale qui est nécessaire sur tout le territoire français. Il faut leur donner tous les moyens de fonctionner correctement parce que l’économie locale a son importance. On a l’impression qu’en ce moment on tape surtout sur les petits abattoirs, notamment les abattoirs municipaux, qu’ils « dérangent » les grosses structures qui aimeraient bien s’approprier ce marché. À force de tout centraliser, on éloigne les gens les uns des autres. Au final, où est le bien-être du salarié qui devra, en plus de ses neuf heures de travail, faire une heure de route pour se rendre sur son lieu de travail, et encore une autre heure pour en revenir ?
À Quimperlé, par l’intermédiaire du CHSCT ou des représentants du personnel, nous parvenons à faire intervenir l’agent de maîtrise local en cas de problème sur la chaîne. Souvent, le salarié nous appelle, et nous venons voir l’agent de maîtrise, et nous parvenons à faire évoluer les choses. Si rien n’avance, nous faisons une enquête par l’intermédiaire du CHSCT, enquête qui est remise à l’inspection du travail. Cela met une certaine pression pour faire réaliser les travaux et les améliorations nécessaires. Nous en parlons aussi en réunion des délégués du personnel ou du comité d’entreprise ; là aussi, cela fait avancer les choses. Mais si c’est un salarié tout seul qui dit que quelque chose ne va pas quelque part, il ne sera pas écouté, c’est certain.
Dans le groupe Bigard, l’absentéisme représente 5,6 %. Mais il faut savoir que ce qui peut être considéré comme maladie professionnelle est systématiquement contesté. Voilà comment on parvient à faire chuter l’absentéisme dans un groupe. Les équipements de protection individuelle (EPI) deviennent de plus en plus contraignants, de plus en plus lourds. Les tabliers, les chasubles ressemblent à des armures des chevaliers de la Table ronde… Rendez-vous compte que la main qui tient le couteau est recouverte d’un gant en kevlar et que la chasuble descend jusqu’au-dessous des genoux parce que, dans la précipitation, il arrive de se couper jusqu’aux mollets ! Pourquoi le salarié qui travaille dans l’artisanat, le petit boucher du coin ne se coupent-ils jamais alors qu’ils ne portent ni gants en maille ni tablier ? Parce que les cadences ne sont pas les mêmes que dans les abattoirs. Plus on augmente les cadences, plus on est obligé de se protéger : un gant en maille, l’autre gant en kevlar, chasuble jusqu’au-dessous des genoux… Bientôt, il faudra un casque car on a déjà vu des salariés se blesser à l’œil ou se couper le nez ! Ne vaudrait-il pas mieux décomposer les gestes, donner tout simplement le temps aux choses ? Qu’est-ce qui prévaut ? L’économique ou le social ?
L’acte de tuer est en lui-même d’une extrême violence. Où est le bien-être de l’animal lorsqu’on ne l’étourdit pas avant de le tuer ? Dans notre groupe, un piège est en cours de validation. Plutôt que d’étourdir la bête avec un matador, il est question d’installer un système électrique. Y aurait-il des façons d’assommer l’animal qui seraient mieux tolérées que d’autres dans la religion musulmane ?
Mme Geneviève Gaillard. On pourrait pratiquer un étourdissement réversible, par exemple.
M. Michel Le Goff. Il faudrait creuser la question. Quoi qu’il en soit, ne pas étourdir la bête et devoir la retourner, consciente, avant de la tuer, c’est atroce.
M. Pascal Eve. Il est certain qu’il ne devrait pas y avoir de différence entre les abattoirs. Nous espérons tous que les petits abattoirs pourront continuer à exister. C’est mieux pour l’économie de nos petites villes. Les petits abattoirs municipaux sont utiles pour l’économie locale, même si les grosses structures aimeraient très certainement qu’ils disparaissent.
Vous nous demandez comment réagissent nos entreprises lorsqu’on les alerte sur les cadences excessives. Leur discours est toujours économique : plus on produit dans un temps donné, plus l’entreprise gagne de l’argent. Mais, au bout du bout, ce n’est pas toujours vrai. Il faut tenir compte des aléas : plus les matériels fonctionnent, plus les pannes sont récurrentes. Au final, l’entreprise ne gagne pas davantage. Il fut un temps où l’on pensait que plus on produisait, plus on gagnait d’argent : c’était une erreur. Et en plus, on a esquinté les salariés.
Bien entendu, tout le monde devrait être formé au bien-être animal. Comment un responsable digne de ce nom pourrait-il imposer à un salarié de respecter le bien-être animal si lui-même n’a pas été formé ou ne connaît pas le sujet sur le bout des doigts ? C’est une évidence : tout le monde doit être formé, le responsable de proximité comme le grand responsable.
L’abattage sans étourdissement est un dossier épineux. Chez nous, on en fait malheureusement beaucoup – entre 300 et 500 bêtes par jour. Comme on ne peut pas assommer l’animal, l’entreprise a trouvé une alternative en réduisant les cadences de plus de moitié : on traite trente bêtes à l’heure au lieu de quatre-vingts bêtes, ce qui permet à l’animal de saigner correctement. Ce que je vais dire est assez cru, mais c’est ce que nous vivons tous les jours : mon entreprise a demandé à pouvoir mettre immédiatement un coup de couteau au niveau de la moelle pour que l’animal souffre le moins possible. Ce procédé est en cours de négociation : certaines mosquées acceptent, mais d’autres ne veulent même pas en entendre parler ; c’est une négociation permanente. Les salariés détestent très clairement ce mode d’abattage. Les représentants du personnel que nous sommes s’insurgent contre cette façon de faire, mais à chaque fois on nous remet l’aspect économique sur la table : cela reste des clients avec lesquels on travaille et qui nous permettent de gagner encore un peu d’argent. Les délégués du personnel se sont opposés à cette méthode. Mais il arrive un moment où l’on ne peut plus aller contre, dans la mesure où cela peut représenter la moitié de notre production journalière. Nous avons fini par nous incliner : nous sommes tous là pour que notre entreprise et les salariés gagnent de l’argent…
M. Michel Kerling. Nous sommes convaincus que ce n’est pas seulement la taille de l’outil d’abattage qui compte, mais aussi l’aspect économique. Il est difficile d’investir. Je suis d’origine normande, mais je ne vais pas vous faire une réponse de Normand. La taille de l’outil importe peu, c’est le résultat économique qui permet de faire ou non des investissements. Il est difficile d’écrire l’histoire à l’avance, mais je dirai que sans résultat économique on peut être très pessimiste quant à l’avenir des outils de proximité dont l’utilité est pourtant évidente.
Dans un grand groupe que je ne nommerai pas mais qui a été abondamment cité, le taux d’absentéisme diffère selon les établissements. Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte.
Mme Geneviève Gaillard. Je vous ai posé la question parce que vous avez parlé du syndrome du canal carpien chez les enleveurs de mamelles. Y a-t-il beaucoup d’absentéisme au poste d’abattage ?
M. Michel Kerling. Je ne peux pas vous donner le taux d’absentéisme sur le poste d’abattage. Mon collègue de la CGT vous a expliqué comment les salariés étaient harnachés
– c’est le terme que les employés utilisent. Cela étant, cela a permis de réduire très sensiblement le nombre d’accidents du travail. La vraie question dans le monde de la viande est celle de la maladie professionnelle : certains salariés qui se font opérer du canal carpien s’en sortent bien, tandis que d’autres passent en inaptitude et en deux mois ne sont plus dans l’entreprise. Le résultat de l’opération n’est pas garanti… Et il y a bien d’autres maladies professionnelles que le syndrome du canal carpien.
En ce qui concerne l’abattage halal ou casher, je répondrai, pour rester politiquement correct, que les salariés travaillent dans un cadre réglementaire. Ce disant, je ne veux pas renvoyer la responsabilité vers le législateur que vous êtes, mais je ne suis pas là pour parler de l’aspect citoyen. Je n’ai pas d’autre réponse à vous apporter.
Je reviens sur la problématique de l’équilibre entre le social et l’économique. Dans les petits outils ou les entreprises qui connaissent des difficultés, vous ne pouvez pas demander à un manager de faire à la fois du social et de l’économique. Les gens ne sont pas schizophrènes : pour faire du social, il faut un service de ressources humaines digne de ce nom, structuré et qui réponde aux remarques des représentants du personnel. À notre avis, c’est la seule façon que cela fonctionne.
Un mot sur l’inspection ante mortem. Autrefois, les cadences n’étaient pas les mêmes. Le nombre de bêtes à abattre quotidiennement n’était bien évidemment pas non plus le même. Il y a, en fonction de la taille de l’outil, un ou plusieurs techniciens en permanence sur la chaîne d’abattage, car il faut examiner les carcasses et les abats. En 2005, j’étais dans un outil qui faisait 20 000 tonnes. Un technicien vétérinaire était affecté aux abats et un autre aux carcasses. Ont-ils le temps d’aller inspecter ce qui se passe ante mortem ? Il n’y a pas un technicien en permanence dans la bouverie : lorsque le salarié constate un problème sur un animal qui entre à l’abattoir, il en parle à son responsable qui essaie à son tour d’appeler un technicien vétérinaire. Le salarié n’est pas vétérinaire. À notre avis, si cette mission n’est pas remplie à cause du manque d’effectifs, autrement dit pour des raisons économiques, cela pose évidemment un problème : on peut se retrouver au poste d’abattage avec un animal qui n’aurait jamais dû arriver jusque-là. On voit encore des animaux euthanasiés avant abattage alors qu’ils auraient dû l’être à la ferme. Certes, ce sont des cas exceptionnels, mais ils existent.
Vous auditionnez aujourd’hui d’anciens salariés, des permanents syndicaux. Mais si les résultats économiques ne s’améliorent pas, notamment dans le secteur porcin, vous ne pourrez plus jamais organiser une audition comme celle-ci, car vous aurez affaire, comme c’est le cas en Allemagne, à des entreprises constituées à plus de 80 % par des prestataires. Et eux ne viendront pas vous répondre. N’oubliez pas la levée de boucliers de certains pays récemment entrés dans l’Union européenne que je ne citerai pas à propos de la directive sur le détachement des salariés… C’est un réel problème pour toute la profession.
Enfin, vous avez devant vous des permanents syndicaux parce qu’il existe des conventions collectives qui déterminent une égalité de droits, un socle commun auquel peuvent prétendre tous les salariés. Si, demain, nous n’avons plus ces connaissances, si tout est fait au niveau de l’entreprise, nous ne pourrons plus répondre aux questions que vous nous posez aujourd’hui.
Mme Sylviane Alaux. Je tiens à vous remercier, messieurs, d’être venus jusqu’à nous. J’ose dire que je savoure vos réponses et vos échanges.
Je veux revenir sur un sujet que je n’ai pas très bien compris concernant l’abattage rituel. Ceux qui le pratiquent sont-ils des salariés de l’abattoir ou bien des sacrificateurs qui viennent de l’extérieur ? Si tel est le cas, avez-vous le sentiment qu’ils maîtrisent suffisamment les gestes, ou tombe-t-on plutôt dans un certain amateurisme ?
Je suis intimement convaincue qu’il faut aller plus avant dans un triptyque et prendre en considération, à égalité, le bien-être animal, la protection du consommateur et la sécurité des salariés. La sécurité des salariés passe par l’aménagement des postes et la formation. Actuellement, celle-ci est assurée en interne ; il n’y a pas véritablement de socle commun. Il appartient au législateur d’exiger un véritable parcours de formation dispensé par des professionnels de l’enseignement. Une formation très orchestrée, très organisée est indispensable.
Il n’y a pas si longtemps, l’animal était encore considéré comme un produit. Fort heureusement, nous sommes quelques-uns – mais pas assez, je le déplore – à répéter que la donne n’est plus la même. L’animal n’est pas un produit : c’est un être doué de sensibilité. Je partage vos propos en ce qui concerne les cadences et les pressions économiques, tout en sachant que cela a une incidence sur les coûts. C’est bien la raison pour laquelle nous faisons un peu le forcing.
Moi qui ne suis pas végétarienne, je serai tentée de remercier l’association L214 de nous avoir montré ce qui arrive dans les abattoirs, ce que j’appelle les « pétages de plomb ». Beaucoup de ceux qui consomment de la viande ne veulent pas savoir comment sont abattus les animaux. Il va pourtant bien falloir que chacun en prenne conscience. Il est clair que l’abattoir ne peut plus demeurer une boîte noire. Il faut de la transparence et tout faire pour que ces « pétages de plomb » n’existent pas. Le salarié d’un abattoir est avant tout un être humain.
M. Hervé Pellois. Beaucoup a déjà été dit.
Pourrait-on connaître le pourcentage de personnes qui suivent des formations ? Les travailleurs intérimaires, les travailleurs détachés, les employés en contrat à durée déterminée qui travaillent dans vos entreprises suivent-ils une formation ? J’ai entendu dire que des salariés refusaient la formation, estimant qu’ils n’en avaient pas besoin. Existe-t-il vraiment une formation, suffisamment intensive, dans les abattoirs ?
Nous le savons, nous avons besoin des petits abattoirs qui sont souvent polyvalents. Mais ceux-ci rencontrent beaucoup de difficultés à recruter du personnel du jour au lendemain pour assurer des remplacements, en cas d’épisode de grippe par exemple. Existe-t-il des solutions pour remédier à ce problème ?
Bien qu’ayant déjà visité des abattoirs, je dois dire que j’ai toujours du mal à différencier un animal bien étourdi de celui qui ne l’est pas. Ce n’est pas évident… Avez-vous des méthodes qui vous permettent de vous assurer que l’animal est bien étourdi ?
Dans l’industrie automobile, les postes de travail ont énormément évolué de même que la conception des outils, ce qui n’est pas le cas dans les chaînes d’abattoirs. Le modèle que j’ai connu il y a quarante ans dans les chaînes d’abattoirs perdure encore presque toujours, à l’exception de la fente de la carcasse qui est désormais mécanisée. Connaissez-vous des outils innovants, en Europe ou en France ? Des recherches sont-elles en cours pour rendre le travail moins difficile ? Il faut certainement faire évoluer les choses en matière d’ergonomie.
Mme Annick Le Loch. Je vous remercie, messieurs, pour vos contributions que je trouve essentielles dans notre débat sur les abattoirs.
En écoutant l’intervention liminaire de M. Bariller, j’ai eu le sentiment que tout allait bien dans les filières d’abattage. Mais en y regardant de plus près, je me suis aperçue que M. Bariller et M. Le Goff faisaient partie du même groupe… J’ai bien vu que les appréciations étaient différentes, et c’est tout à fait normal.
Je vous ai entendu dire que les abattoirs étaient un maillon essentiel dans nos filières d’élevage. Il faut prendre acte de cette réalité et chercher à préserver nos grandes entreprises d’abattage. J’ai bien compris qu’il s’agissait d’outils économiques fragiles et que de la réalité économique de ces entreprises dépendait bien entendu tout le reste. Les cadences, qui sont de plus en plus importantes, conditionnent le bien-être des salariés et du coup le bien-être animal.
Vous avez évoqué la configuration des abattoirs et les investissements. Le Gouvernement a mis en place, vous le savez, un programme d’investissements d’avenir. J’ai entendu dire que certains propriétaires d’abattoir ne l’utilisaient pas, estimant que leurs entreprises dégageaient suffisamment de marge pour pouvoir investir sans faire appel à l’argent public. À mon avis, l’investissement est une orientation tout à fait essentielle pour l’ergonomie, l’accueil des animaux dans de bonnes conditions. Vous avez dit, les uns et les autres, beaucoup de choses sur la formation, le dialogue social, etc., bref, tout ce qui nous semble primordial.
Que doit-on mettre demain sur le devant de la scène en ce qui concerne les investissements ? Est-il vrai qu’il est difficile de recruter des salariés, car il s’agit de métiers difficiles ? J’entends dire qu’il n’y a pas de difficultés de recrutement en raison des politiques de rémunération, de politiques sociales fortes dans certaines entreprises. Que pensez-vous de ce qui se passe en amont ? Si les abattoirs existent, c’est parce que l’élevage existe aussi. Or actuellement, les éleveurs souffrent de prix bas parce que l’aval commande. Cette toute-puissance de l’aval a-t-elle des répercussions sur les cadences ou sur le climat social dans vos entreprises ?
M. Thierry Lazaro. Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour mon retard. Ce que j’ai entendu depuis que je suis arrivé est particulièrement riche d’enseignements.
Hier, nous avons auditionné M. Simonin, administrateur chargé du bien-être animal à la Commission européenne, qui n’a pas du tout répondu à ma question sur l’abattage rituel sans étourdissement, ou abattage sans étourdissement rituel – il y a là de la sémantique qui n’empêche pas le respect. Monsieur Eve, vous avez indiqué que des mosquées acceptaient des pratiques, tandis que d’autres ne les acceptaient pas. Cela veut dire qu’il y a une religion, mais plusieurs appréciations sur l’abattage rituel.
Monsieur le président, je ne sais pas si notre commission a prévu de recevoir les hauts dignitaires de ces religions. Il serait important de les entendre parce que nous sommes dans un État de droit, et nous devons avoir peu ou prou les mêmes règles. Je suis élu d’une circonscription où il y a une mosquée. Je connais les responsables religieux, je connais les pratiquants. Beaucoup sont des gens d’une grande générosité, d’une grande ouverture. Peut-être faut-il mener une réflexion pour atténuer la douleur et, si j’ai bien compris, la dureté du travail dans les abattoirs.
M. Michel Le Goff. La durée du transport est aussi un élément à prendre en compte dans le bien-être animal : de ce point de vue, la présence de petits abattoirs permet précisément d’éviter des temps de transport trop longs.
Dans un abattoir, personne ne peut travailler sur la chaîne sans avoir suivi une formation. Tous les salariés qui travaillent dans le groupe Bigard ont reçu une formation interne grâce au Pass IFRIA. On parle beaucoup de Bigard, mais c’est normal puisque c’est le numéro un national. Bigard possède son propre organisme de formation interne, AFORVIA. Une formation, dispensée par des personnes extérieures, serait peut-être être un plus ; mais c’est pour pallier le manque d’écoles de formation dans l’industrie de l’abattage que Bigard a créé son propre organisme de formation.
Mme Sylviane Alaux. On pourrait peut-être adjoindre cette formation à celle de boucher, par exemple.
M. Michel le Goff. Pourquoi pas ? Mais ce sont deux domaines totalement différents… Ce n’est pas du tout le même métier.
Il est clair que les abattoirs sont confrontés à des difficultés de recrutement. Savoir que vous serez cassé dès l’âge de quarante-cinq ans ne donne pas envie d’exercer ce métier… La rémunération est aussi un frein, même si Jean-Paul Bigard considère que son groupe fait beaucoup d’efforts en la matière. Mais à l’exception du patron, je ne vois personne rouler en Porsche… Certes des efforts sont consentis en ce qui concerne la complémentaire santé, la prévoyance. Chez Bigard, par exemple, 75 % de la complémentaire est prise en charge. Mais toute l’industrie agroalimentaire n’est pas à la même enseigne. Ne faudrait-il pas généraliser cela dans l’ensemble des abattoirs ? Il faut savoir qu’en travaillant dans l’industrie agroalimentaire, on met malheureusement sa santé en péril.
Des efforts ont été accomplis en matière d’ergonomie. Dans ma société, l’ergonomie se fait par autofinancement. Il faut apporter des améliorations. Cela dit, les abattoirs créent des emplois. Veut-on tout mécaniser ? Que fait-on ? Dans les abattoirs allemands spécialisés dans le mouton et le cochon, tout est mécanisé, il n’y a plus personne. Les opérateurs surveillent les robots, les ordinateurs, etc.
L’industrie automobile a été robotisée, car rien ne ressemble plus à une voiture qu’une autre voiture. Mais dans le domaine de la viande, aucune bête n’est identique : il y en a des petites, des grosses, des maigres, etc. On est presque parvenu à une uniformisation en ce qui concerne les cochons – moins en ce qui concerne les moutons et les bovins – grâce à des robots intelligents. L’ordinateur, avec le laser, peut faire la différence entre les petits et les gros morceaux. Dans le domaine de la viande, nous arrivons dans une ère qui risque de ne plus créer beaucoup d’emplois car le métier est pénible. Voilà pourquoi les grands abattoirs veulent robotiser au maximum. L’employeur veut se protéger contre la faute inexcusable.
Le bien-être de l’animal, moi, je veux bien… Oui, la bête a une sensibilité. Mais elle sent le sang à des kilomètres. On a beau lui mettre de la musique, des jets d’eau tiède, quand elle arrive dans l’abattoir, elle sait ce qui va lui arriver. Mais veut-on continuer ou non à manger de la viande ? Doit-on ou non fermer les yeux ? C’est un sujet compliqué, qui s’adresse à la conscience.
Comme je l’ai dit, il est indispensable que la bête souffre le moins possible. Elle doit rester le moins longtemps possible en porcherie ou en bouverie. Et quand elle arrive dans le piège, le geste doit être précis et la saignée doit être faite le plus rapidement possible. On doit lui laisser le temps de saigner, faire en sorte qu’elle soit vraiment morte quand on arrive à la première patte.
M. Roger Perret. Nous sommes dans un secteur industriel qui a une vocation particulière : nourrir les hommes. C’est aussi l’un des tout premiers secteurs industriels français de par le nombre de salariés, sa participation au produit intérieur brut, mais également à notre commerce extérieur. Certes, la question du bien-être animal est extrêmement importante, mais d’autres aspects doivent également être pris en compte. Nous sommes dans une phase nouvelle, me semble-t-il : le regard des citoyens sur les produits qu’ils achètent ne sera plus le même. Dorénavant, ils se demanderont dans quelles conditions ils sont fabriqués. Le sanctuaire qui existait est désormais sous les phares publics, et c’est normal. Du coup, cela pose plusieurs types de questions.
Tout à l’heure, on a évoqué les conditions dans lesquelles il faut se protéger pour éviter au maximum les accidents. Mais cela a un coût, financier et humain. Dans ce secteur comme dans d’autres est posée la question de la prévention primaire et de l’ergonomie, qui renvoie à celle de l’organisation du travail. Les gens commencent à regarder dans quelles conditions sont abattues les bêtes, leurs conditions de transport, etc. Cela pose la question de la formation de l’ensemble de la chaîne du monde du travail. Or, dans les industries agroalimentaires, la part consacrée à l’encadrement est extrêmement limitée. Si on ne résout pas ces questions, on n’en résoudra pas d’autres.
Ajoutons que l’on observe une contestation permanente de la part des employeurs en ce qui concerne les formations qualifiantes reconnues dans le cadre des diplômes. Qu’est-ce qui a été fait depuis de nombreuses années ? Pass IFRIA, certificats de qualification, etc. Autrement dit, la qualité de la formation dispensée est uniquement liée à la réponse de production dans l’entreprise ; toutes les questions ayant trait aux aspects théoriques, aux connaissances générales, etc. ont été mises de côté. Ceux qui y travaillent sont considérés uniquement comme des machines à produire. Il faut redonner aux salariés toute l’intelligence qu’on a tenté de leur enlever. La question du bien-être animal, ou de la souffrance, ne peut être déliée de l’organisation telle qu’elle est conçue aujourd’hui dans nos secteurs industriels.
Quelqu’un qui apprécie beaucoup le bon vin se pose immédiatement des questions quand il voit une sorte de cosmonaute travailler au milieu de la vigne… Il se demande pourquoi le viticulteur doit se protéger autant : du coup, il finit par s’interroger sur ce qu’il boit.
Mme Geneviève Gaillard. Tout à fait.
M. Roger Perret. Cette question se posera de plus en plus dans les industries agroalimentaires. C’est donc à une autre organisation dans ce secteur qu’il faudra réfléchir. Aujourd’hui, nous parlons de l’abattage ; mais demain, d’autres problèmes verront le jour, qui concerneront l’ensemble des filières. On ne pourra plus produire comme auparavant. Avec l’agrandissement des exploitations, des établissements industriels, on pense dégager des économies, mais cela crée d’autres problèmes qui en viennent à coûter avantage sur le plan humain et financier. C’est donc un autre type de réflexion qu’il faut envisager pour pouvoir répondre correctement à la situation.
M. Pascal Eve. Les sacrificateurs sont bien évidemment des professionnels, comme tous les salariés. Et surtout, ce ne sont pas des donneurs d’ordres. Ils respectent ce qu’on leur demande. Le sacrificateur aurait tendance à vouloir aller un peu plus vite, mais, Dieu merci (sourires), les salariés qui sont derrière lui demandent de ne pas le faire. Il faut laisser le temps à l’animal de saigner correctement.
Pour ma part, je travaille dans une très grosse structure. On n’y forme que les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI). Il y a très peu de salariés en contrat à durée déterminée (CDD), car ce n’est pas dans la culture de mon entreprise. En revanche, nous avons beaucoup d’intérimaires, qui ne sont pas formés par mon établissement, mais plutôt par leur employeur.
Effectivement, les grosses structures ont du mal à embaucher. Vous imaginez donc bien que les petits abattoirs ont encore plus de mal. Dans une grosse structure, si un salarié sur cinquante est en arrêt maladie, on trouvera toujours quelqu’un pour le remplacer. Dans une petite structure, c’est beaucoup plus compliqué car un salarié peut être affecté à trois ou quatre postes dans une même journée. Il est très difficile de remplacer autant de professionnalisme.
On nous a demandé si les méthodes d’étourdissement étaient irréprochables. J’ose espérer qu’elles le sont, mais je n’en suis pas très convaincu. Je suis un peu loin de ce poste, mais je ne suis pas certain que mon collègue soit sûr, à 100 %, du résultat de ce qu’il vient de pratiquer.
L’ergonomie est un gros dossier qui occupe, depuis quelques années, surtout mes collègues du CHSCT. Bien entendu, c’est un sujet primordial car il facilite la gestuelle. Des formations existent. Je citerai celle consacrée aux gestes et aux postures. L’ergonomie se fait en interne chez nous et fait l’objet d’un suivi car il s’agit d’éviter des arrêts de travail et de maladies professionnelles qui pèseront sur les résultats. C’est donc toujours intéressant pour l’entreprise.
Mon collègue vient de vous dire que son entreprise refusait de faire des formations qualifiantes. C’est loin d’être le cas dans mon entreprise, puisque cela nous permet de recruter du personnel. Nous organisons des formations tous les deux ans et nous délivrons des certificats de qualification professionnelle. De ce côté-là, la convention collective a du bon… Les CQP, qui sont donc issus des conventions collectives, nous permettent de former une vingtaine de personnes tous les deux ans. Malheureusement, au vu des tâches à accomplir dans nos métiers, il ne reste à l’issue de la formation que 40 % au maximum des effectifs de départ ; les autres se tournent vers d’autres métiers beaucoup moins exigeants. Et les salaires dans l’agroalimentaire sont loin d’être ceux que l’on peut trouver dans l’industrie automobile. Notre patron nous répète souvent que nous ne travaillons pas dans une grande marque automobile et que les marges que nous dégageons sont loin d’être les mêmes.
M. Michel Kerling. Je crois savoir que les autorités religieuses délivrent une carte au sacrificateur, conformément, j’y insiste, à ce qui est prévu dans le cadre réglementaire. Les actes de maltraitance avérés qui ont été rendus publics dans les trois outils mis en cause n’ont pas, à ma connaissance, été commis dans le cadre d’un abattage, ni casher ni halal.
Pendant ma carrière professionnelle, j’ai participé à trois journées portes ouvertes en zone rurale, dans le nord du département de l’Eure. Même si l’on ne s’attarde généralement pas au poste d’abattage les réactions sont très différentes d’une personne à l’autre. Sur dix citoyens, vous aurez dix réactions différentes ; j’ai pu le constater moi-même. Voilà pourquoi il est indispensable d’avoir un cadre réglementaire afin de répondre aux attentes du plus grand nombre.
Dans le grand groupe dont on parle depuis le début de cette audition, une formation d’intégration est organisée. Elle est indispensable. Depuis la désindustrialisation des années quatre-vingt, nous recrutons des salariés venant de tous les horizons professionnels.
Suite à la dernière réforme de la formation professionnelle, les branches de l’industrie agroalimentaire, et plus particulièrement celles de la viande parce qu’elles y ont consacré davantage de moyens, sont en train de faire accepter les certificats de qualification professionnelle et de les faire agréer par le répertoire national des certifications professionnelles. Lorsque les CQP seront inscrits et reconnus par le RNCP, ils auront la même valeur que les diplômes de l’éducation nationale. Aujourd’hui, lorsque vous consommez un steak dans un restaurant, vous ne savez pas nécessairement s’il provient d’une boucherie artisanale ou de la boucherie industrielle. Or ce sont deux façons de travailler la viande, deux métiers différents, mais qui répondent tous les deux aux attentes du consommateur. Et les salariés auront des diplômes qui seront reconnus par le RNCP.
Une petite parenthèse : j’ose espérer, depuis qu’il n’y a plus d’obligation légale sur le plan de formation, qu’il existe encore un plan de formation dans les entreprises, car ce ne sont pas les fonds mutualisés des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui permettront de former les salariés…
Madame Alaux, les « pétages de plomb » peuvent être évités grâce à la rotation des postes. Lors de la négociation de l’accord sur la pénibilité, nous avons fait réaliser un audit qui nous a permis de constater que les salariés étaient attachés à trois éléments : la rémunération bien sûr, les conditions de travail, difficiles dans nos métiers, mais également la reconnaissance. Nous ne nous attendions pas à ce que ce troisième élément, qui a été porté à la connaissance des organisations professionnelles et des organisations syndicales au niveau de la branche, fasse autant d’audience.
Ces trois choses vont ensemble. Pour éviter les TMS, il faut faire de la rotation mais aussi de la formation. Quand on change de poste de travail, tout le monde essaie de faire de la pédagogie sans défendre nécessairement les mêmes intérêts même si, au bout du compte, ils sont convergents pour le salarié. Pour notre part, nous essayons de faire en sorte qu’il termine sa carrière en bonne santé, tandis que l’employeur souhaite qu’il soit rentable. Encore faut-il derrière que les diplômes soient assortis d’une rémunération adéquate. Nous y travaillons actuellement au niveau de la branche. La rémunération d’un salarié est fonction du niveau d’études, selon qu’il a le brevet des collèges, le baccalauréat ou un diplôme bac + 5 ; mais pour ce qui est de la reconnaissance professionnelle, on est vraiment dans l’entreprise. Il faut aussi que les entreprises du secteur de la viande voient bien toute la nécessité de la rémunération.
Pour ce qui est du travail sur l’ergonomie, j’ai vu certaines recherches que le grand groupe dont on parle est en train de faire, notamment sur le couteau. Je leur laisserai le soin de développer cela car je ne veux pas trahir de secret. Il y a une réelle volonté de la part de ce groupe de travailler sur la pénibilité. Nous ne croyons pas à une robotisation du métier à l’avenir, mais davantage, au moins dans un premier temps, à une « cobotisation », c’est-à-dire à une aide du salarié par le robot. Bien évidemment, il faudra inclure tout cela dans la formation.
Un mot sur les événements relayés par les médias et qui ont provoqué, et c’est bien normal, le travail que vous faites en tant que parlementaires. On se concentre beaucoup sur ce qui s’est passé, et c’est logique car de tels actes sont inadmissibles. Mais comme l’a dit notre organisation, notre société évolue. Un jour ou l’autre, elle se focalisera sur le poisson par exemple. On se demandera ce qu’il advient de tous ces poissons qui restent dans les filets, on s’interrogera sur la pêche industrielle, etc. Je partage les propos tenus par mon collègue de la CGT à partir de l’exemple de la vigne : le consommateur qui voudra boire un verre de vin se posera des questions sur ce que fait le viticulteur dans la vigne… Actuellement, c’est l’acte d’abattage qui est monté en épingle. Demain, d’autres secteurs d’activité seront touchés.
Enfin, j’ai été interrogé par un média national de la presse écrite qui a consacré cinq pages aux événements qui se sont produits dans les abattoirs, en faisant un procès à charge sans tenir compte de ce que nous avons pu lui dire. Nous regrettons ce procès à charge, dans lequel la défense n’a pas été écoutée.
M. Alain Bariller. S’agissant de la formation, je pense que tout a déjà été dit. Lorsqu’un nouvel opérateur arrive, on fait une demande de CERFA pour l’autoriser à travailler en porcherie. Il a trois mois pour suivre la formation bien-être animal. Quant au RPA, la formation est reconnue par l’État.
La chaîne d’abattage d’Évron traite 685 porcs à l’heure. Ce chiffre peut faire peur, comparé aux cadences constatées pour les bovins. Mais, il faut savoir qu’il y a quarante-cinq personnes sur cette chaîne, dont dix personnes sont affectées à l’étourdissement, l’anesthésie et la saignée. Les porcs passent sur deux Midas qui ont trois électrodes, deux qui touchent la tête et une qui touche le cœur. Ils reçoivent une décharge de 400 volts sur la tête avec deux ampères et une décharge de 100 volts avec 0,4 ampère sur le cœur.
Quand le porc sort du Midas, l’opérateur reconnaît tout de suite si l’animal est bien ou mal anesthésié. Si le porc tombe immédiatement, qu’il a les pupilles dilatées, la langue sortie et une absence de réflexes cornéens, c’est qu’il a été bien anesthésié. Si, au contraire, il a la gueule ouverte, qu’on l’entend et qu’il émet une certaine vocalisation, qu’il essaie de se relever et qu’il cligne des yeux, on lui applique directement une pince Morphée. Là, il reçoit une décharge directement sur la tête, derrière les oreilles, pendant trois secondes pour que l’anesthésie fasse de l’effet.
Je fais partie du groupe Bigard et du comité de groupe. Lors de nos réunions, nous faisons des tours de table. Certes, c’est un groupe qui avance, mais comme certains sites ont du retard, il est clair que tout ne peut pas être rattrapé du jour au lendemain. Toutefois, on sent une évolution. Je confirme que l’on avance bien, comme le démontrent nos résultats.
Quant aux RPA, ils sont indispensables, tant dans les grands que dans les petits abattoirs.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Monsieur le président, je n’ai qu’une quarantaine de questions à poser !
Je tiens à remercier nos interlocuteurs pour leur contribution.
Tout à l’heure, il a été question de l’arbitrage citoyen-salarié. Un jour, il faudra aussi se pencher sur l’arbitrage du consommateur, autrement dit du prix, savoir ce que l’on consacre à son alimentation par rapport à d’autres usages. Quand on est dans l’économique, il y a les volumes, les cadences, l’organisation du travail, etc., et le prix que la société est prête à mettre dans ce qu’elle consomme.
Il a été question à de nombreuses reprises, au cours de nos auditions, de l’installation de caméras de vidéosurveillance. J’ai bien entendu ce que vous avez dit. Mais vous parliez d’une vidéo permanente, observée en permanence par quelqu’un qui pourrait très bien être un inspecteur sur le site. Je souhaite vous interroger sur l’apport qu’une vidéo différente pourrait apporter afin de lever un certain nombre de difficultés que vous avez soulevées.
Il a été dit que les services d’inspection étaient très concentrés sur l’aspect sanitaire et qu’ils n’avaient pas un regard suffisamment intensif et attentif sur l’ante mortem. Nous avons également pu voir que les contrôles qui ont été spécifiquement demandés sur le bien-être animal par le ministre de l’agriculture, à la suite de la diffusion des vidéos par l’association L214, ont révélé des problèmes. J’en déduis que ces problèmes n’avaient pas été détectés. Je ne porte pas de jugement sur leur gravité, mais certains problèmes ont été révélés grâce à une inspection ciblée sur le bien-être animal dans 259 abattoirs.
Un outil vidéo en place, mais déclenché à la main du contrôle de l’État, ne serait-il pas une manière de démultiplier sa capacité d’inspection, en procédant de temps en temps à un « flash » de vingt minutes sur tel ou tel poste, qui serait ensuite analysé avec l’entreprise et ses salariés ?
Par ailleurs, il existe un droit de retrait des salariés. Or ce n’est pas à vous que j’expliquerai qu’il est souvent compliqué pour un salarié de le faire valoir. Sur certains postes exposés, pensez-vous qu’une vidéo à la main du salarié, comme cela existe dans une entreprise de transport public dans laquelle j’ai travaillé, pourrait être une démarche intéressante ? En cas d’incident, le salarié pourrait lui-même déclencher un pré-enregistrement des trente minutes précédentes, qui pourra montrer ce qui s’est passé et justifier son droit de retrait.
Enfin, vous avez parlé de la difficulté du responsable bien-être animal d’être un lanceur d’alerte indépendant. Pensez-vous qu’un outil de ce type, à sa main, qu’il déclencherait sur une période de vingt, trente minutes ou une heure pourrait être intéressant ? Il pourrait servir d’élément aux structures internes – CHSCT –, aux structures externes
– contrôle vétérinaire – et – pourquoi pas ? – lors des formations pour montrer ce qu’il ne faut pas faire. Ce type de vidéo, qui ne serait pas un regard permanent, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur des salariés qui y verraient une pression supplémentaire, ne serait-il pas un dispositif intéressant, pour peu qu’on y réfléchisse suffisamment ?
Nous avons été surpris de voir parfois des matériels manifestement inadaptés. Vous avez parlé de l’importance des cadences. Vous imaginez bien que la recherche de cadences avec des matériels inadaptés décuple les difficultés pour les salariés et les souffrances pour les animaux. Une normalisation ou un agrément un peu plus précis à la fois des matériels et des cadences ne pourraient-ils pas permettre de conduire à des investissements indispensables, même dans les petits abattoirs, au moins sur des équipements dont on sait qu’ils ne sont pas intrinsèquement défaillants ou sur des manières de les utiliser qui ne sont pas systématiquement génératrices de difficultés ?
M. Michel Kerling. Vous nous interrogez sur l’installation de caméras déclenchées de façon aléatoire, à la main de l’État. Je vous répondrai par un constat : aujourd’hui, on observe une recrudescence de mortalité sur la route alors qu’il y a de plus en plus de radars…
Il est de plus en plus difficile de faire valoir le droit de retrait ; les entreprises y regardent de très près. Pour exercer son droit de retrait, il faut vraiment qu’il y ait un énorme problème ou bien il faut être, permettez-moi l’expression, sûr de son coup, cela coûte à l’entreprise.
Je suis favorable à la normalisation des outils. Cela dit, elle est en route depuis des années. Des abattoirs ont été classés, d’autres ont été fermés.
Quid des dérogations, et pourquoi ?
Quand l’outil est sur la ligne de flottaison ou dans le rouge, qui financerait les investissements indispensables ?
M. Pascal Eve. Moi non plus, je ne suis pas forcément favorable à la vidéosurveillance. Si l’on sait ce qu’elle peut apporter, on sait aussi qu’elle peut avoir des effets négatifs. C’est la même chose que lorsque l’on prend un nouveau traitement : il y a toujours des effets secondaires… Vous avez proposé que la vidéo ne fonctionne pas toute la journée. Mais si on demande à un salarié de la mettre en route de manière volontaire, on sait bien qu’au fil du temps cela deviendrait une obligation. Voilà pourquoi, pour le moment, je n’y suis pas favorable.
Actuellement, notre filière est en grande difficulté. Qui paiera le remplacement d’un matériel inadapté ? Combien de temps disposeront les entreprises pour se mettre en conformité avec une nouvelle réglementation ? Mon entreprise a déjà du mal à dégager le moindre centime de marge alors que je travaille sur un site où l’animal rentre sur pied pour en sortir complètement découpé, ce qui laisse des possibilités un peu plus grandes. Je ne sais pas comment un abattoir qui ne fait que de l’abattage peut dégager de la marge.
M. Michel Le Goff. Oui, il faut un contrôle de l’État. Mais sous quelle forme ? Je ne suis pas favorable à la vidéo. Je pense qu’il faut donner aux élus davantage de pouvoirs. Les membres du CHSCT ont le pouvoir de prendre des photos et même d’enregistrer une vidéo. Peut-être faut-il leur donner davantage de moyens, notamment au niveau de la surveillance. Dans ces conditions peut-être, je ne serais pas contre…
Quant au droit de retrait, il existe pour le salarié si sa vie est mise en danger, et uniquement dans ce cas : il n’est pas question de bien-être animal. Nous le faisons appliquer dans le groupe Bigard lorsque c’est nécessaire, c’est-à-dire lorsque la vie du salarié est mise en danger.
Je pense qu’une normalisation du matériel est nécessaire, sachant qu’il existe déjà des agréments. Faut-il des agréments supplémentaires, mettre un agrément sur un agrément ? Je ne sais pas. Et qui financera les investissements ? Peut-on demander à un petit abattoir qu’il réalise les mêmes investissements qu’un grand groupe sans le mettre en danger ? Si l’État est prêt à les subventionner, pourquoi pas ?
M. Alain Bariller. Je suis contre la vidéo. La présence d’un RPA dans tous les abattoirs doit déjà permettre de respecter le fonctionnement, sans qu’il soit nécessaire d’installer de la vidéo qui perturberait les opérateurs.
Il est plus facile à un grand groupe qu’à un petit établissement de s’équiper de bonnes machines. Comment faire pour aider les petites structures à se mettre à jour ?
M. le président Olivier Falorni. Je remercie les représentants des quatre organisations syndicales présentes pour leur participation et leurs réponses particulièrement enrichissantes pour nos travaux. Je tiens à préciser que la CFDT avait été également invitée, mais qu’elle n’a pas été en mesure de nous proposer un représentant pour cette audition, ce que nous regrettons.
La séance est levée à onze heures vingt.
——fpfp——
17. Audition, ouverte à la presse, de Mme Karine Guillaume, directrice, M. Jean-Blaise Davaine, directeur adjoint et Mme Marie-Claude Boucher, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, de la Brigade nationale d’enquête vétérinaire et phytosanitaire à la Direction générale de l’alimentation (DGAL)
(Séance du jeudi 26 mai 2016)
La séance est ouverte à onze heures trente.
M. le président Olivier Falorni. Nous recevons à présent des membres de la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) à la Direction générale de l’alimentation (DGAL). Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Karine Guillaume, directrice de la BNEVP, Mme Marie-Claude Boucher, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement et M. Jean-Blaise Davaine, directeur adjoint.
Mesdames, monsieur, nous avons souhaité vous entendre, compte tenu de vos missions, qui consistent à lutter contre la délinquance sanitaire et phytosanitaire organisée, à réaliser des enquêtes nationales et à appuyer techniquement les services de contrôle sanitaire.
La BNEVP compte une quinzaine d’agents. Selon leur spécialité, les enquêteurs prennent en charge des investigations ayant trait à la santé et à la protection animale, à la pharmacie vétérinaire, à l’identification des animaux domestiques, aux substances interdites, à l’hygiène alimentaire et à la protection des plantes. Ces agents disposent de pouvoirs de police judiciaire et administrative, qu’ils peuvent exercer sur l’ensemble du territoire national.
Il se trouve que votre brigade a été saisie des trois enquêtes ouvertes suite à la diffusion des vidéos mettant en cause les abattoirs d’Alès, du Vigan, et de Mauléon-Licharre et qui ont été à l’origine de cette commission d’enquête.
Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de lever la main droite et de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Karine Guillaume, Mme Marie-Claude Boucher et M. Jean-Blaise Davaine prêtent successivement serment.)
Mme Karine Guillaume, directrice de la Brigade Nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNVP), à la Direction générale de l’alimentation. La Brigade Nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires, dont je suis la directrice depuis le 1er janvier 2016, est un service de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) du ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt ; elle est directement rattachée au directeur général de l’alimentation.
Dotée d’une compétence territoriale nationale, la Brigade a été créée en 1992, dans le contexte de la lutte contre les anabolisants présents dans les viandes. À l’origine, son activité était donc orientée vers la lutte contre le trafic des substances interdites et des médicaments vétérinaires ; elle s’est ensuite étendue aux fraudes à l’identification des animaux, et notamment au trafic des carnivores domestiques. D’abord axée sur le domaine vétérinaire, elle intervient dans le domaine phytosanitaire depuis 2002 ; de ce fait, les produits phytopharmaceutiques et la santé végétale entrent également dans son champ de compétence. De fait, la BNVP intervient désormais dans tous les domaines qui relèvent de la DGAL et, ainsi, dans un nombre croissant de domaines techniques.
Nos missions sont précisées par un arrêté ministériel du 30 juillet 2008, qui porte organisation et attributions de la DGAL. Elles se déclinent en trois volets.
La lutte contre la délinquance sanitaire et phytosanitaire organisée représente 80 % de nos missions. Nous réalisons des enquêtes qui visent à rechercher et constater les infractions afin de traduire en justice leurs auteurs. Nous apportons également notre concours aux autorités judiciaires, aux autorités de police et aux administrations qui participent à cette lutte.
À l’origine, l’action de la Brigade visait principalement à faciliter les contrôles lorsque les trafics concernaient plusieurs départements – ce qui était fréquent dans le cas de trafic d’anabolisants. Puis la Brigade a pris peu à peu en charge les demandes des autorités judiciaires, et intervient désormais en appui des services judiciaires pour la réalisation des enquêtes.
La Brigade peut être requise pour assurer un appui technique aux autorités judiciaires et aux enquêteurs, en tant que « sachant » – c’est du reste le cas dans les dossiers qui concernent plus directement votre commission d’enquête. Elle peut également être elle-même à l’origine de l’ouverture d’un dossier destiné aux autorités judiciaires, suite à un signalement des services locaux ou à une enquête administrative.
À titre d’information, de 2005 à 2015, la Brigade a pris en charge 438 signalements judiciaires ; 168 sont actuellement jugés, 175 ont été transmis à la justice et sont encore en cours d’instruction.
La deuxième activité de la BNVP consiste à réaliser des enquêtes administratives, à la demande de la DGAL. En effet, compte tenu de la compétence des agents, de leur connaissance des filières à l’échelle nationale et de leur vision pragmatique, nous sommes mis à contribution pour des enquêtes qui peuvent aussi bien porter sur des enjeux sanitaires que sur des problèmes d’épidémiologie ou des études de filières. Des enquêtes administratives ont ainsi été diligentées dans le secteur de la viande hachée, ou sur la traçabilité de la filière coquillage. Tout récemment, la découverte d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a justifié une enquête administrative afin d’en découvrir l’origine ; elle a été confiée à la Brigade, en coopération avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Entre 2005 et 2015, la BNVP a effectué 77 enquêtes administratives.
Notre troisième mission consiste en un appui technique aux services de contrôle sanitaire. En cas de crise sanitaire, nos agents peuvent, dans la mesure de leurs moyens, venir aider les services déconcentrés sur une partie du plan de lutte, dans un cadre évidemment limité, dans l’attente de l’intervention d’autres services : nos effectifs, vous l’avez indiqué, se limitent à seize agents. Les services de contrôle peuvent également demander l’appui d’un agent spécialisé de la brigade pour des questions techniques.
Enfin, la BNVP réalise elle-même tous les ans un certain nombre d’enquêtes, notamment dans les domaines phytopharmaceutiques. En 2015, vingt-trois contrôles administratifs d’entreprises de distribution ont ainsi été réalisés à l’initiative de la Brigade, en concertation avec les services régionaux de l’alimentation.
Les seize agents qui constituent la Brigade sont des vétérinaires, des ingénieurs ou des techniciens. Nos bureaux sont installés à Rungis, avec des agents basés à Dijon, Toulouse, Lyon et Nantes. Il s’agit d’agents mobiles, capables d’intervenir en tout lieu et en tout temps. Du fait de leur pouvoir de police administrative et de leur pouvoir judiciaire spécialisé, ils sont juridiquement habilités pour intervenir sur tout le territoire national. Lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une enquête judiciaire, ils le font sous l’autorité du magistrat compétent. C’est le cas pour les trois enquêtes qui vous intéressent.
LA BNVP se caractérise par une forte réactivité, sa capacité à intervenir en tous lieux et en tout temps, mais aussi par sa liberté d’action : nous ne sommes ni un service départemental ni un service régional, ce qui nous dégage des contextes locaux. Par ailleurs notre structure est institutionnellement bien reconnue, en France comme à l’étranger.
Je voulais également insister sur le fait que nous travaillons en réseau, avec les services départementaux et régionaux, ainsi qu’avec les services d’enquête de la police ou de la gendarmerie, les douanes ou les services judiciaires.
Nos agents possèdent une expertise dans le domaine pénal et un savoir-faire dans les relations avec les autorités judiciaires. Ils ont par ailleurs été recrutés pour des compétences techniques affirmées dans des domaines spécialisés, après une expérience professionnelle dans des services départementaux ou régionaux. C’est en grande partie la clef de notre efficacité.
Nous intervenons dans le domaine phytosanitaire, pour traquer notamment le détournement d’usage de produits phytopharmaceutiques, les contrefaçons ou la mise sur le marché de produits sans autorisation de mise sur le marché. Dans le domaine vétérinaire, nous intervenons lorsque sont en jeu la sécurité sanitaire des aliments, la protection animale, la santé animale – en cas de tuberculose ou d’influenza aviaire, par exemple –, mais également la pharmacie vétérinaire, l’alimentation animale et l’utilisation de substances interdites.
Nos enquêtes portent donc sur des sujets très variés, et nous conduisent à intervenir dans les abattoirs. Cela a pu être le cas lors d’une enquête qui portait sur la commercialisation de viande contaminée par des salmonelles, à la suite de la dissimulation du résultat des prélèvements d’autocontrôle obligatoires, ou encore à la suite d’un signalement concernant des chevaux présentés à l’abattoir avec des documents d’accompagnement falsifiés.
En ce qui concerne la protection animale, nous avons récemment enquêté dans un couvoir, sur des procédures d’euthanasie de poussins qui n’étaient pas conformes. Nous intervenons également régulièrement, en concertation avec les pouvoirs de police et de gendarmerie, dans des élevages de chiens ou sur des sites de vente de chiens et chats entretenus dans de mauvaises conditions. Nous avons été conduits à ordonner des retraits d’animaux, qui ont été confiés à des associations de protection animale. Nous avons également enquêté, il y a quelque temps, sur un transport de truies qui s’effectuait dans de mauvaises conditions. Suite à l’enquête, le transporteur et le responsable du centre de rassemblement ont été poursuivis.
Concernant les abattoirs d’Alès, du Vigan, et de Mauléon-Licharre, l’association L214 a porté plainte. Chaque procureur a ouvert une enquête préliminaire, confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie, et requis les agents de la Brigade en tant que « sachants ». Il ne leur a pas été demandé d’apporter un jugement, mais d’étudier les vidéos, de relever les infractions constatées et de préciser si, sur le plan réglementaire, elles s’apparentent à des contraventions ou à des délits. Ils ont également pour mission d’étudier la plainte écrite envoyée par l’association afin de comparer les infractions relevées par l’association à celles qu’ils ont eux-mêmes répertoriées à partir des bandes. Sur les heures de films qu’ils ont visionnés, ce qui représente un énorme travail, les agents ont estimé qu’il leur était difficile d’estimer l’état de conscience ou d’inconscience des animaux lors des différentes opérations. Les vidéos ont donc également été présentées à des experts, spécialistes des états de conscience chez les animaux, afin de recueillir leur avis et de pouvoir être le plus factuel possible dans le relevé des différentes infractions.
Enfin, dans leur rôle de sachants, les membres de la Brigade ont également vocation à aider les services d’enquête dans la préparation des auditions et l’exploitation des scellés, c’est-à-dire des documents saisis lors des perquisitions.
M. le président Olivier Falorni. Les membres de la BNEVP sont-ils formés à la protection animale ou au bien-être animal ?
Quelles sont les étapes de l’abattage ou les points de contrôle généralement les plus défaillants ? Comment l’expliquez-vous ?
Quelles sont les éventuelles difficultés que rencontre la BNEVP lors de ses interventions en abattoir ?
Mme Karine Guillaume. Nos agents entrent à la Brigade après avoir accompli ailleurs une partie de leur parcours professionnel ; les enquêteurs qui travaillent sur les dossiers touchant à la protection animale ont auparavant travaillé comme inspecteurs en abattoir. Techniciens ou vétérinaires, ils ont acquis au cours de leur formation initiale des connaissances sur le comportement des animaux ainsi que sur les techniques de manipulation et d’abattage, auxquelles s’ajoute l’expérience acquise au cours de leur vie professionnelle antérieure. Tout au long de leur carrière, les agents du ministère de l’agriculture ont par ailleurs accès à des formations très diverses couvrant un large spectre de compétences ; mais ceux de la BNEVP ont également la possibilité de suivre des formations organisées au niveau communautaire. Néanmoins, lorsqu’ils parviennent aux limites de leurs compétences, ils n’hésitent pas, dans un domaine aussi complexe que celui de la protection animale, où les connaissances sont en perpétuelle évolution, à solliciter l’aide de chercheurs spécialisés ; c’est ce qu’ils ont fait à l’occasion de cette enquête. Autrement dit, même si leur formation peut certainement être intensifiée, nos agents travaillent sans cesse à se documenter et à l’améliorer.
En ce qui concerne les étapes de l’abattage où les défaillances sont les plus importantes, force est d’admettre que nos agents, sur le terrain, ne constatent jamais de manquements aussi graves que ceux qui apparaissent dans les vidéos diffusées par L214. Cela tient au fait qu’en présence d’un agent de la Brigade et d’un membre des services vétérinaires, les opérateurs qui travaillent sur les postes d’abattage s’attachent à respecter strictement la réglementation… Jamais nos agents n’ont vu des employés frapper des animaux.
Les agents procèdent systématiquement à une inspection ante mortem – examen des animaux en bouverie – et post mortem – examen des carcasses. En revanche, l’inspection du poste d’abattage se fait par sondage, l’agent y passant ponctuellement au cours de sa visite : il n’est pas systématiquement derrière l’opérateur.
Mme Marie-Claude Boucher, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, agent à la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. Les difficultés qui se présentent en abattoir sont rares et, quand elles existent, nous les réglons rapidement. Nous avons accès à tous les établissements, sitôt qu’ils sont ouverts. Nous n’avons en général aucun problème pour accéder au poste d’abattage, et les cas d’obstruction sont très rares ; en général, les choses se passent bien, même si les opérateurs ne sont pas toujours contents de nous voir arriver… En général, nos contrôles sont inopinés : nous ne prévenons pas et, après nous être rapidement changés dans les vestiaires, nous nous rendons aux postes que nous souhaitons inspecter. Durant toute ma carrière, qui commence à être un peu longue, j’ai rarement eu des difficultés pour voir ce que je voulais voir. Et si d’aventure le cas se posait, il me suffit de faire appel immédiatement aux services judiciaires pour avoir accès aux endroits que j’entends visiter.
Mme Geneviève Gaillard. On savait qu’il existait des dysfonctionnements dans certains abattoirs mais, avant les trois affaires qui viennent d’être médiatisées ; aviez-vous déjà eu l’occasion d’être saisis pour des problèmes similaires par les services vétérinaires de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ? Quelles sont vos relations avec ces services, qui jouent un rôle important sur le terrain et interviennent en général très rapidement lorsqu’ils sont saisis d’un problème ?
Lorsque vous constatez des dysfonctionnements dans un abattoir – privé ou public –, faites-vous part de vos remarques à la direction et assurez-vous un suivi pour savoir si vos recommandations ont été mises en œuvre ? Une partie de vos plaintes aboutit, mais d’autres pas. Et pourtant, cela méritait certainement d’aller un peu plus loin. Mais les animaux ne sont pas forcément la priorité des procureurs…
Mme Karine Guillaume. Au cours des enquêtes en abattoir que nous avons pu mener avant les trois affaires révélées par L214, jamais nous n’avions constaté de faits aussi graves. Nos agents avaient rapporté quelques signalements, mais jamais de ce niveau.
Quant à nos relations avec les services vétérinaires, elles sont très étroites. Nos échanges sont continus dans la mesure où, tandis que nous intervenons de façon ponctuelle, ce sont leurs agents qui sont responsables de la conduite des missions sur le terrain : ce sont eux qui assurent généralement le suivi en aval afin de faire évoluer les situations, et leur travail n’est pas facile. Pour les épauler, le ministère de l’agriculture vient de mettre en place un réseau d’experts, composé de six référents nationaux pour les abattoirs, chargés d’apporter aux agents de terrain les compétences techniques qui peuvent leur manquer, les assister et les légitimer dans leurs missions de supervision – rappelons que la brigade intervient principalement sur les questions de nature pénale. Ce réseau sera extrêmement utile, notamment en matière de partage des bonnes pratiques.
Quant à nos enquêteurs qui interviennent dans les abattoirs, ils rendent évidemment compte de leurs constatations aux agents et à la direction des abattoirs, pour étudier avec eux les solutions envisageables aux problèmes identifiés.
Mme Marie-Claude Boucher. Je ne vous parlerai pas des enquêtes en cours, couvertes par le secret de l’instruction, mais l’exemple concret d’une de mes précédentes interventions vous éclairera sur le déroulement de nos procédures. Sollicitée par la DGAL pour intervenir dans un abattoir afin de vérifier le poste d’abattage des ovins, je me suis présentée sur le site à cinq heures du matin – heure de l’ouverture – sans avoir prévenu auparavant ni le directeur de l’abattoir ni la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Après être passée par le vestiaire pour me changer, je me suis ensuite rendue au poste d’abattage, en compagnie du directeur et du collègue chargé de l’inspection permanente. L’observation a duré environ une heure trente, après quoi nous nous sommes réunis dans les bureaux pour vérifier les procédures administratives, discuter des améliorations à envisager et des mesures que la DDPP allait imposer. Pour ce qui concerne le suivi ultérieur, je me suis fait communiquer copie des réponses apportées par l’abattoir au sujet des anomalies constatées.
Dans tous les cas, nos visites des sites s’effectuent avec le directeur ou le responsable qualité, à qui il sera rendu compte de nos conclusions. De même, si nous entendons saisir le procureur, le directeur en est averti. Jamais nous ne quittons le site sans lui avoir fait part de nos constats et de nos informations.
Mme Geneviève Gaillard. Les services vétérinaires qui œuvrent sur le terrain nous ont dit que la menace d’une contravention incitait souvent les directeurs d’abattoir à se mettre en conformité avec la réglementation : partagez-vous ce point de vue ?
Mme Marie-Claude Boucher. La menace d’une contravention n’est pas forcément nécessaire. Dans chaque abattoir existe un cahier de liaison que les agents de contrôle remplissent chaque jour en notant, le cas échéant, les anomalies qu’ils ont constatées et indiquent les modifications à effectuer. Ce cahier de liaison est transmis à l’opérateur comme au directeur et au responsable qualité, et la réponse est attendue pour le lendemain. Ce système fonctionne globalement bien et, s’il ne remplace pas les contrôles annuels, il permet un échange et un suivi quotidien.
Mme Geneviève Gaillard. Il n’y a pas toujours, dans les petits abattoirs de vétérinaire présent en permanence. En zone rurale notamment, ces vétérinaires sont souvent, par ailleurs, des praticiens, qui n’interviennent que de manière ponctuelle et irrégulière. Comment garantir, dans ces conditions, la qualité du contrôle ?
Mme Karine Guillaume. S’il n’y a pas toujours un vétérinaire sur place dans les petits abattoirs, un agent de la DDPP est toujours présent : c’est lui qui fait remonter les informations aux cadres qui, au sein de celle-ci, sont chargés du suivi de l’abattoir. Il est certain que les vétérinaires qui assurent les inspections ante mortem mais qui, ensuite, partent s’occuper de leur clientèle privée ne peuvent assurer un contrôle permanent ; mais c’est le rôle de la DDPP, dont les agents sont également là pour que les personnels des abattoirs n’aient pas le sentiment d’être livrés à eux-mêmes.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Jugez-vous le niveau des sanctions délictuelles ou contraventionnelles prévues par la législation adapté aux infractions relevées ? Considérez-vous qu’elles intègrent suffisamment la problématique du bien-être animal ?
On sait que certains magistrats sont plus ou moins réceptifs à ce type de problématiques, quand bien même elles paraissent techniquement et socialement très importantes. Il est avéré qu’un magistrat est par nature omniscient, mais pensez-vous que votre brigade puisse contribuer à les sensibiliser, voire à les former, afin que la souffrance animale soit mieux prise en compte ?
Nous avons constaté que les contrôles ante et post-mortem effectués au nom des pouvoirs publics privilégiaient les enjeux sanitaires sur la question du bien-être animal, sans doute par manque de temps et de moyens. Ne conviendrait-il pas, dans ces conditions, d’augmenter le nombre de référents nationaux au fait des questions de souffrance animale, afin de renforcer le suivi de l’organisation et des pratiques dans les abattoirs ?
Mme Karine Guillaume. En ce qui concerne la pertinence des infractions, ces dernières sont constatées au titre du code rural ou du code pénal. Il s’agit essentiellement d’infractions de niveau contraventionnel : pour qu’il y ait délit, il faut qu’il y ait cruauté envers les animaux, ce qui implique de pouvoir démontrer qu’il y a eu volonté délibérée de faire souffrir l’animal, ce qui est compliqué. Il serait donc plus efficace, selon nous, de créer un délit de maltraitance animale, que ce soit en abattoir ou dans le cadre des transports. Cela faciliterait grandement l’action des services car, outre son aspect dissuasif, la qualification de délit peut viser une personne morale et pas uniquement l’individu ayant commis les faits. Elle permet également des poursuites pour complicité. Enfin, une plainte pour délit a davantage de poids auprès d’un procureur et les délais de prescription ne sont pas les mêmes. Il me semble d’ailleurs que le ministère a engagé des démarches en ce sens, ce dont les agents de la Brigade se félicitent.
En ce qui concerne les magistrats, il faut en effet reconnaître que le bien-être animal, bien que médiatisé, ne figure pas toujours parmi leurs priorités. Je tiens néanmoins à souligner ici que, dans ses missions, la Brigade est en contact fréquent avec les procureurs et qu’au-delà des échanges noués dans le cadre de procédures, nous menons également auprès de ces procureurs des actions de formation et d’information.
Quant au réseau des référents nationaux pour les abattoirs mis en place par le ministère de l’agriculture, il comporte, comme je l’ai dit, six agents dont le travail est précieux. Il est évident que, plus les effectifs sont nombreux, plus leur mission est efficace, mais il ne m’appartient pas de me prononcer sur la possibilité d’augmenter le nombre de ces référents.
M. le rapporteur. Ma question était précisément sous-tendue par l’idée que le renforcement des moyens pose toujours un problème budgétaire : donnez-moi des effectifs, je vous ferai de bonnes tactiques, disait Joukov… Il me semble qu’augmenter le nombre de référents nationaux serait un moyen d’améliorer les choses en créant un étage un peu plus musclé ; ce serait plus efficace et sûrement moins cher que de dupliquer des postes un peu partout.
Mme Karine Guillaume. La formation pratique est très efficace. Et de ce point de vue, l’apport du référent sur le terrain est extrêmement utile car, au-delà de la formation théorique, il apporte au personnel des abattoirs et aux agents de la DDPP un savoir-faire précieux et aide à la mise en place de pratiques adaptées au terrain.
M. Thierry Lazaro. Lorsqu’un inspecteur arrive sur un site d’abattage, il est normal que le comportement des opérateurs s’en trouve modifié. La nature est ainsi faite : sitôt qu’on voit un gendarme, on lève le pied… Vous n’avez donc jamais constaté de visu lors de vos visites des pratiques aussi inhumaines que celles qu’ont dévoilées les vidéos de L214, toute la question que nous nous posons étant de savoir s’il s’agit d’actes ponctuels ou récurrents.
Cela étant, je suppose que, en tant qu’experts habitués au terrain, il peut vous arriver de détecter qu’un opérateur est tendu, énervé ou fatigué. Bien évidemment, il ne s’agit pas pour vous de le dénoncer, car ces personnels, que je ne veux en aucun cas stigmatiser, exercent un métier difficile – dont, par ailleurs, ils sont fiers. Pour être direct, jugez-vous que le système d’abattage français est un bon système ou y a-t-il lieu de nourrir des doutes et des inquiétudes à son endroit ?
Mme Marie-Claude Boucher. Il y a quarante et un ans que je travaille en abattoir. J’ai donc vu les choses évoluer et s’améliorer. Je n’ai jamais vu dans aucun établissement ce que j’ai vu sur les films de L214, que j’ai visionnés de nombreuses fois à la demande du procureur de la République. Pour moi, il s’agit d’actes isolés d’individus qui avaient un problème ponctuel.
Aujourd’hui, dans les abattoirs, je vois des gens qui travaillent bien et en ayant conscience qu’ils ont en face d’eux des animaux vivants et non des cartons ou des boîtes de conserve. Les opérateurs que je rencontre savent que leur tâche est complexe, que chaque animal peut réagir différemment et qu’à un bovin très calme peut succéder une bête beaucoup plus violente, pour X raisons. Ils y sont très attentifs.
Depuis 2013, on s’est beaucoup focalisé sur le bien-être animal, mais il existait déjà auparavant, dans les petits comme dans les gros abattoirs, des responsables qualité qui en faisaient cas et veillaient aux conditions dans lesquelles se pratiquait la mise à mort. Les actes qui sont dénoncés aujourd’hui peuvent être le fait de personnes qui, mal équipées, vont mal se comporter ; mais, globalement, les opérateurs ont fait d’énormes progrès et ont pris en compte la protection animale en abattoir.
M. Hervé Pellois. Pensez-vous que l’installation de caméras dans les lieux d’abattage pourrait être un instrument de dissuasion efficace ?
Mme Marie-Claude Boucher. Les caméras sont un outil intéressant, car un opérateur qui sait qu’il est surveillé n’aura pas le même comportement que lorsque personne ne l’observe. Or il est impossible qu’un agent des services vétérinaires se tienne en permanence au poste d’abattage. Qui plus est, cela ne servirait à rien parce qu’au bout d’un moment l’opérateur aurait l’impression d’avoir une potiche à côté de lui et n’y prêterait même plus attention ; et de son côté, l’agent finirait inévitablement par relâcher sa surveillance car c’est un endroit particulièrement éprouvant. Pour avoir fait, récemment encore, de longues séances d’observation à ce poste, je peux vous assurer qu’au bout de plusieurs heures, cela devient difficilement tenable.
Tout dépend ensuite de l’usage que l’on fait des caméras. Elles doivent être utilisées comme un outil pédagogique, qui permette d’analyser les gestes des opérateurs et, éventuellement, de les corriger. Un directeur d’abattoir, très perturbé par les films de L214, a dernièrement décidé de les montrer à son équipe. Ils les ont visionnés en compagnie des services vétérinaires et les ont ensuite commentés, ce qui leur a permis d’analyser les risques de dérives que comportait leur travail, lorsqu’un animal est violent et difficile à manipuler : qui ne serait tenté d’avoir une réaction brutale le jour où vous êtes énervé et qu’un cheval vous monte sur le pied ? À partir de cette expérience, ils ont estimé que l’installation de caméras dans l’abattoir pouvait être un instrument intéressant.
M. le président Olivier Falorni. Quelles sont vos relations avec les associations de protection animale ?
Pensez-vous que la taille des établissements d’abattage ait un impact sur la survenance d’incidents assimilables à de la maltraitance ?
Pensez-vous par ailleurs que le type d’abattoir – mono-espèce ou multi-espèces – ait un impact sur la survenance de ces incidents ?
Enfin, pensez-vous que les périodes « de pointe », évoquées dans le cas de Mauléon soient plus propices aux dérives ?
Mme Karine Guillaume. Nous avons de fréquents contacts avec les associations de protection animale parmi lesquelles l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), que nous connaissons très bien. Nous avons également des relations avec des associations comme la fondation Brigitte Bardot ou la SPA, lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des placements d’animaux. Il arrive d’ailleurs que certaines de ces associations se portent partie civile.
En ce qui concerne l’impact que peuvent avoir la taille et le type d’abattoir sur la maltraitance, il est certain que c’est dans les abattoirs multi-espèces de taille limitée que les risques sont les plus grands. Dans un grand abattoir qui n’intervient que sur une seule espèce, on a généralement affaire à des opérateurs très spécialisés qui travaillent sur un matériel adapté. Mais il ne faut pas généraliser : certains petits abattoirs fonctionnent très bien. Tout dépend des personnes sur place et de l’attention qu’elles portent à leur travail.
Quant aux périodes de forte activité, il faut effectivement les prendre en compte, notamment parce qu’elles peuvent imposer de recourir à des intérimaires insuffisamment formés. Par ailleurs, quand les lots d’animaux sont très importants, les agents peuvent être amenés à vouloir travailler plus vite pour ne pas rallonger excessivement leur journée de travail.
M. le rapporteur. À certaines installations classées est associée une commission locale d’information et de surveillance (CLIS) où siègent, entre autres, des élus et des représentants d’associations. Elle a notamment pour but une meilleure circulation de l’information sur ce qui se passe dans ces installations. Un tel dispositif contribuerait-il, selon vous, à sensibiliser l’opinion publique aux questions de bien-être animal, avec d’éventuelles retombées positives pour les abattoirs ?
Par ailleurs, que pensez-vous des abattoirs mobiles, utilisés notamment en Suède ?
Mme Karine Guillaume. Les commissions de protection de l’environnement mises en place pour les installations classées sont des lieux de concertation et d’information qui pourraient sans doute contribuer à mieux faire connaître à la « société civile » le fonctionnement des abattoirs, et faciliter la compréhension de ceux qui ne les connaissent pas.
M. le rapporteur. Pourraient-elles, selon vous, jouer un rôle préventif ?
Mme Karine Guillaume. Je le pense. Tout échange entre les responsables d’un abattoir et des membres de la société civile peut avoir un aspect préventif en faisant mieux comprendre les problématiques.
Pour ce qui concerne les abattoirs mobiles, je m’interroge sur la faisabilité technique d’un tel dispositif, compte tenu de la complexité du matériel d’abattage, qu’il s’agisse de la chaîne d’abattage, des frigos de stockage, des équipements de contention ou d’étourdissement. Se pose par ailleurs le problème, très complexe, de la gestion des effluents – eaux usées et déchets. Si l’on songe aux investissements considérables que doivent déjà engager les petits abattoirs pour respecter les normes sanitaires et les normes de protection animale, il me semble qu’un abattoir mobile ne peut être envisagé que dans des cas très spécifiques et, en tout état de cause, pour des effectifs limités.
M. Hervé Pellois. Nous avons beaucoup parlé au cours de nos auditions de l’abattage des bovins, des ovins et des porcins. Qu’en est-il de la volaille ? Êtes-vous souvent alertés dans ce type d’abattage ?
Mme Marie-Claude Boucher. Il m’est déjà arrivé de faire des enquêtes en abattoir de volaille, mais nous n’avons jamais mis en évidence de problème particulier ayant trait à la protection animale. L’abattage y est beaucoup plus facile, les animaux ayant moins de caractère et étant beaucoup moins difficiles à transporter jusqu’au poste d’abattage.
M. le président Olivier Falorni. Nous avons abordé hier, avec les représentants de la commission européenne, la question de l’étiquetage. Comment évaluez-vous la faisabilité d’un étiquetage garantissant le respect du bien-être animal sur les produits alimentaires d’origine animale, qui indiquerait notamment le type d’abattage : avec étourdissement ou sans étourdissement préalable – pour ne pas parler d’abattage rituel ? Une telle option est-elle envisageable, et souhaitable ?
Mme Karine Guillaume. Le rôle des services vétérinaires en abattoir consiste à attester que le produit qui sort de l’abattoir est apte à la consommation humaine. Pour être estampillée, une carcasse nécessite non seulement des contrôles sur les animaux ante et post mortem, mais également des contrôles de traçabilité ainsi que des contrôles d’hygiène générale de l’établissement. Les abattoirs ont d’ailleurs fait énormément d’efforts et de progrès en matière de traçabilité, notamment grâce aux systèmes informatisés, type code-barres. Un étiquetage tel que vous le suggérez est donc possible. Est-ce une option intéressante ? Je ne saurais me prononcer.
M. le président Olivier Falorni. Mesdames et monsieur, nous vous remercions.
La séance est levée à douze heures trente.
——fpfp——
18. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des universitaires spécialistes de l’abattage rituel, avec la participation de M. Mohammed Hocine Benhkeira, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, titulaire de la chaire d’histoire des sciences légales en islam, de Mme Anne-Marie Brisebarre, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), membre du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, et de Mme Sophie Nizard, chercheuse en sociologie et en anthropologie du judaïsme, associée au CéSor (Centre d’Études en Sciences Sociales du Religieux-CNRS-EHESS).
(Séance du mercredi 1er juin 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente.
M. le président Olivier Falorni. Nous poursuivons nos travaux sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, en recevant cet après-midi des universitaires spécialistes de l’abattage rituel.
Je souhaite la bienvenue à M. Mohammed Hocine Benhkeira, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, titulaire de la chaire formation des doctrines juridiques et du rituel en islam (du VIIe au XVe siècle). Monsieur Benhkeira, vous êtes l’auteur d’ouvrages et de publications sur les interdits alimentaires en islam, l’animal et l’abattage en islam, ainsi que sur la consommation de viande rituelle en France.
Mme Anne-Marie Brisebarre est directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et membre du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France. Madame, vous êtes l’auteure d’ouvrages et de publication sur la mort et la mise à mort des animaux, sur l’abattage rituel musulman, et sur la fête de l’Aïd el-Kébir et sa célébration en France.
Mme Sophie Nizard est chercheuse en sociologie et en anthropologie du judaïsme, associée au CéSor (Centre d’études en sciences sociales du religieux-CNRS-EHESS). Madame, vous êtes l’auteure d’ouvrages et de publications sur les pratiques alimentaires juives, et sur les rapports entre l’alimentation et les religions.
Avant de vous donner la parole, mesdames, monsieur, je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et qu’elles sont diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Mohammed Hocine Benhkeira, Mme Anne-Marie Brisebarre et Mme Sophie Nizard prêtent successivement serment.)
M. Mohammed Hocine Benhkeira, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, titulaire de la chaire d’histoire des sciences légales en islam. Dans l’expression « abattage rituel », le mot « rituel » est important. Depuis toujours, les rites sont un élément essentiel de toute société – ils sont même caractéristiques de l’Humanité.
Concernant la mise à mort des animaux de boucherie, l’islam s’appuie sur une « législation », un ensemble de prescriptions, au premier rang desquels le Coran, avec en particulier le verset 173 de la sourate 2 dite « La vache », le verset 3 de la sourate 5 dite « La table », le verset 145 de la sourate 6.
J’en citerai un autre, le verset 121 de la sourate 6, particulièrement important, qui dit ceci : « Ne mangez pas ce sur quoi le nom de Dieu n’aura pas été invoqué, car ce serait une perversité ». Autrement dit, on ne peut pas consommer ce sur quoi le nom de Dieu n’a pas été prononcé, sous peine de devenir soi-même l’auteur d’un acte grave.
La législation islamique sur l’abattage rituel est complexe, très détaillée. Selon l’esprit de la loi islamique, on ne peut avoir une relation instrumentale avec l’animal, qui est une créature du Dieu créateur. Autrement dit, cette religion considère que le monde a été créé par un Dieu, que ce Dieu a créé l’Homme comme il a créé les animaux ; par conséquent, celui-ci n’a aucun droit sur les animaux, si ce n’est avec l’autorisation ou la permission du Dieu créateur. En invoquant le nom de Dieu, l’homme demande la permission au Dieu créateur de mettre à mort un animal.
Cela a d’ailleurs posé un gros problème aux théologiens : pourquoi Dieu permettrait-il de faire souffrir les animaux ? La réponse qu’ils ont échafaudée a été la suivante : à chaque fois qu’un animal sera abattu par un homme, Dieu sera tenu de lui offrir une compensation après la mort. À ma connaissance, c’est la seule exception où les théologiens musulmans ont reconnu que les animaux pouvaient espérer quelque chose après la mort…
La relation à l’animal est donc importante : on ne peut pas traiter les animaux comme des choses. Au demeurant, il est interdit de vendre ou d’acheter des chiens ou des chats, les animaux sauvages eux-mêmes sont protégés, la chasse est très réglementée et les relations avec les animaux domestiques sont elles-mêmes réglementées. Selon un récit très connu de la tradition islamique du VIIe siècle, Dieu aurait pardonné toutes ses fautes à une prostituée et l’aurait admise au paradis parce qu’elle avait pris sa chaussure pour offrir à un chien assoiffé – animal réputé impur dans l’islam – de l’eau tirée d’un puits. Je décris là une norme idéale que les musulmans sont en principe tenus d’observer ; mais ils ne l’observent pas forcément tous…
En conclusion, selon la loi islamique, le rituel vise à « instituer » la viande, c’est-à-dire à humaniser la victime : la viande qui ne passe pas par le rite, par exemple un mouton tué par un loup, n’est pas consommable ; c’est évidemment une perte sur le plan économique, mais pas sur le plan symbolique, au contraire.
Mme Sophie Nizard, chercheuse en sociologie et en anthropologie du judaïsme, associée au CéSor (Centre d’études en sciences sociales du religieux-CNRS-EHESS). Mon propos liminaire visera à replacer l’abattage rituel dans le cadre de la tradition juive, d’une part, et d’en montrer les enjeux anthropologiques, d’autre part.
L’abattage rituel s’inscrit dans le cadre plus général du rapport de l’homme aux animaux. Dans la Bible hébraïque – que les chrétiens appellent l’Ancien Testament, et les juifs la Torah –, les animaux sont des êtres vivants créés par Dieu et dotés d’une âme qui siège dans leur sang ; c’est pour cette raison que le sang est rigoureusement interdit à la consommation. Cependant, l’ordre de la création est hiérarchisé : l’homme domine les autres règnes, et les animaux peuvent lui servir pour sa consommation, ses travaux agricoles et pour le transport. En même temps, ces usages sont fortement réglementés : l’homme ne peut se comporter de n’importe quelle manière avec les animaux, il est soumis à des lois. Parmi les lois que l’on trouve dans la Bible figurent l’interdiction de prélever un membre d’un animal vivant, autrement dit, l’interdiction de la vivisection ; l’interdiction de la chasse ; l’interdiction d’atteler ensemble deux animaux d’espèces différentes, qui auraient donc des rythmes différents, ou de museler l’animal qui laboure pour l’empêcher de se nourrir ; l’obligation de repos pour les animaux le jour du shabbat ou encore de nourrir les bêtes avant de se nourrir soi-même ; et même l’obligation d’aider son ennemi à décharger son âne si celui-ci plie sous la charge.
À partir de ces lois bibliques, le Talmud – cet ensemble de débats rabbiniques s’étalant sur plusieurs siècles et consignés dans un nombre très important de traités – édicte un principe fondamental : l’interdiction de causer de la souffrance aux animaux, qui est une valeur essentielle de la tradition juive.
En matière d’alimentation, la consommation de viande issue d’animaux permis suppose la mise à mort animale, c’est-à-dire l’acte d’ôter la vie à un être vivant. Cet acte est loin d’être anodin dans cette tradition : il engage la responsabilité de celui qui le pratique, il est ritualisé et ce « savoir-abattre » a été transmis depuis près de 3 000 ans. Il ne s’agit pas pour autant d’un sacrifice : le sacrifice pratiqué dans l’Antiquité juive l’était uniquement dans l’enceinte du Temple de Jérusalem et uniquement par des prêtres, et il a été totalement interdit depuis la destruction du Temple en 70 de l’ère chrétienne.
L’acte de mise à mort est ritualisé en ce sens qu’il est régi par des lois religieuses qui le valident, qu’il suppose des paroles et des gestes codifiés, qu’il est producteur de sens. La chekhita – terme désignant le geste d’égorgement – permet à la fois de limiter la souffrance animale, grâce à des lois très rigoureuses sur l’instrument et sur le geste lui-même – et de rendre la viande consommable par l’homme. Elle doit être pratiquée par le chokhet, qui est un homme érudit : il doit être versé dans la connaissance des textes, notamment ceux relatifs aux lois alimentaires qui font l’objet d’un traité entier dans le Talmud ; il doit être pieux, moralement intègre et formé auprès d’un maître. Depuis le XIIIe siècle, un diplôme attestant de ses aptitudes lui est nécessaire pour exercer ce métier. En France, depuis le début des années quatre-vingt, il doit être en possession d’une carte de « sacrificateur » – terme de la réglementation française – délivrée par le Grand Rabbin de France et, depuis le 1er janvier 2013, il doit posséder un certificat de compétence délivré par le ministère de l’agriculture. Le couteau utilisé doit être adapté à la taille de l’animal et parfaitement aiguisé. Le chokhet vérifie l’état de son couteau avant et après chaque saignée et l’aiguise régulièrement ; la moindre brèche sur la lame entraverait le geste et serait source de souffrance pour l’animal.
En d’autres termes, l’abattage n’est religieusement valide que si le chokhet est formé en théorie et en pratique et que son instrument répond à des normes précises ; ces conditions sont censées garantir une bonne pratique. La chekhita doit se faire sur un animal vivant et viable, en un seul geste, sans pression ni levée du couteau ; tout « raté » de la saignée invalide le geste et rend la viande issue de cet abattage impropre à la consommation. Je n’ai jamais constaté un tel raté lors de mes observations en abattage, dans les années quatre-vingt-dix. Une fois la bête abattue, la carcasse est soumise à un examen pour vérifier l’intégrité de certains organes, principalement le poumon ; cette « visite », comme la désignent les professionnels, conduit à l’écartement des bêtes dont les organes ne sont pas conformes.
J’en viens à quelques considérations socio-anthropologiques. Parmi les Juifs de France – dont le nombre est estimé à 500 000, avec une très grande diversité –, 20 % mangeraient régulièrement de la viande casher, soit 100 000 personnes environ. La consommation de viande est associée, comme dans de nombreuses cultures, aux célébrations et aux fêtes du calendrier, mais elle n’a pas de caractère obligatoire. On sait par ailleurs à quel point identité et nourriture ont partie liée.
Pour en revenir à l’abattage, toute carcasse issue d’une bête abattue rituellement ne rejoint pas le circuit casher pour deux raisons : d’une part, la visite conduit à écarter une partie des bêtes ; d’autre part, les arrières ne sont pas consommés en France depuis une décision consistoriale de 1949. Les taxes sur les nourritures casher, essentiellement la viande, le vin, le pain azyme, mais aussi sur certains services comme les restaurants et les traiteurs, permettent de financer les institutions certificatrices et de couvrir les frais liés à la surveillance. La taxe sur la viande est aujourd’hui de 1,66 euro par kilo et ne s’applique que sur la viande vendue dans les circuits casher.
Dire que l’abattage rituel répondrait avant tout à des enjeux financiers, comme si le reste de la filière viande n’y répondait pas, est un argument qui me semble particulièrement spécieux. Réfléchir aux conditions d’abattage, c’est aussi réfléchir sur les rythmes et les temps dans les abattoirs. Il est clair que l’abattage casher ralentit la chaîne et que ce mode d’abattage est peu adapté au rythme industriel des chaînes d’abattage modernes. En effet, deux ralentissements apparaissent : au moment de la saignée, qui suppose la contention et un temps suffisant entre la saignée et le début de l’habillage – autrement dit au moment où l’on commence à dépecer la bête –, puis au moment de la visite, réalisée plus loin sur la chaîne d’abattage.
L’observation de la mort animale ne laisse évidemment pas indemne et conduit à une réflexion sur le droit de tuer pour manger, qui est tout à fait présente dans la tradition juive. Toute mise à mort suppose une violence infligée aux bêtes. Le fait qu’un seul personnage prenne sur elle cet acte la rend consciente de la portée de son geste – j’ai pu le vérifier en discutant avec des chokhet. Ainsi, le caractère casher d’un aliment, a fortiori d’un aliment carné, résulte non seulement d’une technique conforme, mais aussi de considérations éthiques.
Le modèle alimentaire qui a conduit à une consommation de masse et à des modes de production industrialisés et opérationnalisés doit continuer à être questionné par tous les acteurs qui y participent, de l’éleveur jusqu’au mangeur. L’abattage rituel est très controversé : il a été interdit en Suisse dès la fin du XIXe siècle dans un contexte de montée de l’antisémitisme en Europe – un roman de Charles Lewinsky, Melnitz, paru chez Grasset en 2008, décrit parfaitement le contexte de cet interdit à travers l’histoire d’une famille juive en Suisse. L’abattage rituel a été interdit par l’Allemagne nazie et sous Vichy, puis plus tard par certains pays d’Europe. Aujourd’hui, la Norvège, la Finlande, la Suède, l’Islande l’interdisent. Il est par ailleurs en débat en Belgique.
L’abattage rituel a fait l’objet de nombreuses études vétérinaires, dont les résultats restent contrastés quant au temps de perte de conscience d’une bête saignée sans étourdissement préalable, a fortiori quant à la douleur ressentie. C’est ce laps de temps qui, selon les tenants de l’interdiction de l’abattage sans étourdissement serait source de souffrance – l’étourdissement consistant pour les bovins en l’usage d’un pistolet à tige perforante. Or on ne dispose pas d’un instrument de mesure unique et fiable pour mesurer cette souffrance, d’autant que les conditions des expérimentations sont variables et que peu d’entre elles se déroulent in situ. Le doute porte sur un différentiel de temps sur lequel les experts avancent des chiffres assez divergents et variables selon les espèces.
La réflexion sur l’abattage rituel – lequel relève d’une liberté constitutionnelle, la liberté de culte – doit s’inscrire dans une réflexion plus globale sur l’ensemble des pratiques de l’homme vis-à-vis de l’animal dans nos sociétés : la chasse, la corrida, le gavage des oies, etc. Dire que l’abattage rituel est source de souffrance et que les autres modes d’abattage ne le seraient pas me semble assez naïf, voire dangereux.
Mme Anne-Marie Brisebarre, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), membre du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France. Je ne me considère pas comme une spécialiste de l’anthropologie religieuse, contrairement à mes collègues : mon thème de recherche concerne les relations entre les sociétés ou groupes humains et leurs animaux domestiques. Néanmoins, les recherches que j’ai menées, avec des enquêtes sur la mise à mort des animaux, sont complémentaires des leurs, qui m’ont d’ailleurs apporté un éclairage fort intéressant.
Dans les années soixante-dix, au début de mes recherches sur le pastoralisme transhumant en Cévennes, destiné à la production de viande, j’ai abordé avec les éleveurs le volet de l’abattage. « On est des éleveurs, on n’est pas des tueurs », m’ont affirmé la plupart de mes informateurs, ajoutant que leurs bêtes étaient tuées par « celui qui sait ». À l’époque, les villages cévenols comptaient encore des bouchers abatteurs, souvent apparentés aux éleveurs. Ce n’est qu’en 1985 que j’ai eu l’information sur la commercialisation de moutons vivants entre éleveurs transhumants et familles musulmanes installées dans le Gard et l’Hérault pour la célébration du sacrifice de l’Aïd el-Kébir.
Habitant et travaillant à côté de la Mosquée de Paris, et ne trouvant pas dans la littérature de réponses à mes questions, j’ai entamé dès 1986 une recherche personnelle, puis j’ai encadré des recherches collectives sur la célébration de ce sacrifice familial en milieu urbain. Parmi les lieux collectifs de sacrifice, j’ai été amenée à enquêter dans les abattoirs publics ou privés à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, à Couilly-Pont-aux-Dames en Seine-et-Marne, à Ezanville, dans le Val-d’Oise ; rappelons que les abattoirs sont les seuls lieux légaux de la mise à mort des animaux de boucherie.
En France, le sacrifice de l’Aïd est considéré comme un simple abattage rituel : on ne reconnaît pas son caractère familial, même si dans les années quatre-vingt-dix des solutions ont été tentées pour le contrôler, auxquelles j’ai participé.
Les entretiens que j’ai menés lors de mes enquêtes montrent que les musulmans ne considèrent pas que l’abattage rituel est un sacrifice à proprement parler. Bien qu’il ne soit pas un acte obligatoire – il ne fait pas partie des piliers de l’islam –, le sacrifice de l’Aïd el-Kébir est recommandé à celui qui a les moyens de l’accomplir. Il nécessite de la part du sacrifiant – celui qui offre le sacrifice, qui peut être distinct du sacrificateur – une intention. Il est la commémoration du sacrifice d’Ibrahim, Abraham, mais aussi de celui accompli par le prophète en l’an 2 de l’Hégire. Outre son caractère religieux, il revêt une importante dimension sociale, en particulier par le partage de la viande sacrificielle : un tiers au minimum doit être donné aux pauvres. Ce sacrifice constitue une des étapes du Hajj, le Pèlerinage à La Mecque ; et, au même moment, il est accompli par l’ensemble des musulmans dans le monde entier sur une période d’un jour – qui correspond au début de l’Aïd – à trois jours. Au cours des dernières décennies du XXe siècle, il a été un des moments de visibilité de l’islam en France, et fortement dénoncé par les associations de protection animale.
Dans les années quatre-vingt-dix, en enquêtant dans des abattoirs halal en dehors de la période de l’Aïd el-Kébir, j’ai essayé de voir si l’abattage pendant cette grande fête présentait des différences techniques par rapport à l’abattage rituel au quotidien. À mon avis, il n’y a pas de différence par rapport à l’acte d’égorgement rituel pratiqué par l’opérateur
– improprement dénommé « sacrificateur » dans la réglementation française, puisqu’il ne s’agit pas d’un sacrifice. Par contre, dans certains abattoirs, il était possible plusieurs jours avant le sacrifice de choisir un mouton, donc de se l’approprier – ce mouton familial remplaçant l’enfant promis au sacrifice, comme dans le sacrifice d’Ibrahim, ce qui est rappelé lors de la prière de l’Aïd à la mosquée. Le mouton choisi, et payé par le père de famille qui l’avait choisi, était identifié, en général par une bague à l’oreille : la tête de l’animal n’était donc pas détachée, alors qu’elle l’est habituellement dans l’abattage rituel. Il était également possible de sortir les carcasses chaudes, au lieu de les mettre systématiquement en ressuage en chambre froide pendant au moins vingt-quatre heures pour éviter le développement des bactéries. Ainsi, les différences que j’ai constatées sont des différences post-égorgement : techniquement, le sacrifice à l’abattoir est pratiqué de la même façon que l’abattage rituel et par le même opérateur, qui doit être un musulman adulte et sain d’esprit.
J’ai également interrogé le personnel de plusieurs abattoirs sur leur représentation de la « bonne mort » animale, c’est-à-dire sur la façon acceptable de tuer un animal de boucherie, avec ou sans assommage. Ces entretiens m’ont montré que ces représentations étaient fortement liées à l’histoire et au vécu de mes interlocuteurs. Ainsi, les personnels d’un abattoir halal de la région parisienne, à qui j’expliquais la méthode d’anesthésie par dioxyde de carbone utilisée au Danemark pour les porcs, m’ont répondu : « On n’est pas des nazis ». L’utilisation du CO2 renvoyait au souvenir des chambres à gaz… J’ai également reçu les témoignages « en miroir » d’hommes qui avaient combattu en Algérie, d’un côté et de l’autre : celui qui avait servi comme appelé dans l’armée française comparait l’égorgement rituel au « sourire kabyle » – l’égorgement des Français pendant la guerre d’Algérie –, tandis qu’un homme originaire d’Algérie, à propos de l’électronarcose des moutons, soutenait qu’il n’y avait rien de pire pour un animal ou un homme que l’électricité, en référence à l’utilisation de la « gégène », la torture par l’électricité.
On voit à quel point peuvent varier les représentations de la bonne mort, même chez des personnels d’abattoirs quotidiennement confrontés à la mort des animaux. L’assommage ou l’étourdissement est parfois considéré par certaines personnes comme plus cruel ou plus douloureux qu’un égorgement bien fait : dans l’islam comme dans le judaïsme, il faut égorger d’un seul coup, le cisaillement est interdit et la viande d’une bête dont le cou aurait été cisaillé est illégale. Dans l’islam également, un très grand nombre de recommandations ont été édictées pour éviter la souffrance animale.
Votre commission d’enquête a été mise en place à la suite de vidéos tournées dans plusieurs abattoirs par l’association L214. Deux de ces établissements sont situés dans le Gard, et c’est précisément là que les éleveurs avec lesquels je travaille depuis quarante-cinq ans font abattre leurs agneaux. C’est particulièrement le cas du Vigan, petite structure à laquelle les éleveurs faisaient confiance pour que leurs agneaux élevés de façon extensive, dans le respect du bien-être animal, soient mis à mort dans les règles de la bientraitance. À la suite de ces vidéos, ces éleveurs se sont demandé s’ils ne devaient pas prendre en charge eux-mêmes la mort de leurs animaux. Or ce sont les enfants ou les petits-enfants de ceux qui, au début de mes recherches en Cévennes, affirmaient leur rôle d’éleveur et non pas de tueur… Et ils ne sont pas les seuls à se poser cette question : sous l’égide de l’Association en faveur de l’abattage des animaux dans la dignité (AFAAD), le collectif « Quand l’abattoir vient à la ferme » souhaite faire changer la législation française qui interdit les abattoirs mobiles, qui existent dans d’autres pays, en particulier en Allemagne. Les abattoirs mobiles permettent à l’éleveur de ne pas déplacer ses animaux, mais aussi de veiller à leur bientraitance lors de l’abattage.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Je m’interroge moins sur le rite lui-même ou les conditions techniques de l’abattage rituel, que sur le lien entre ces conditions techniques et le rapport de l’homme à l’animal dans la religion. Si j’ai bien compris, aussi bien l’islam que la religion juive contiennent des prescriptions très strictes sur le respect des animaux et la nécessité de pratiquer l’abattage – quand on en a la permission, quand on peut sacrifier l’animal – dans les meilleures conditions possibles au regard de la souffrance animale. Cet objectif est très largement partagé dans la société : les gens qui mangent de la viande, quelle que soit leur religion, ne souhaitent pas qu’elle soit produite dans les pires conditions. Je n’ai pas la naïveté de penser que ceux qui veulent interdire l’abattage, quel qu’il soit, ou qui stigmatisent telle ou telle pratique, n’ont pas d’arrière-pensées. Et à certains moments tragiques de l’histoire, vous l’avez rappelé, correspondent des représentations que l’on peut comprendre. Reste qu’il y a des principes communs, et que notre connaissance de la souffrance animale a évolué : les scientifiques que nous avons auditionnés nous ont apporté des éclaircissements, en distinguant notamment perte de conscience et douleur. Comment le rite peut-il prendre en compte – au regard de la gestuelle, de la technique – les progrès de la connaissance sur la souffrance animale ?
M. Mohammed Hocine Benhkeira. La question du bien-être animal a été constamment débattue dans la loi islamique.
Premièrement, pour avoir un abattage licite, c’est-à-dire offrant une viande instituée, la bête doit être vivante : on ne peut pas rendre licite ce qui est déjà mort, disent les docteurs de la loi. Tout le nœud du problème est là : insensibiliser la bête ne revient-il pas à la tuer un peu ? En principe, les progrès de la connaissance scientifique devraient être pris en compte, puisque les textes fondateurs de l’islam font référence à la médecine. Il n’y a donc pas de raison que cela s’arrête de nos jours…
Mais il y a un deuxième aspect. Le verset 5 de la sourate 5 du Coran, très connu des musulmans qui ont un peu de culture religieuse, dit ceci : « La nourriture des gens du Livre vous est permise » – les gens du Livre étant les chrétiens et les juifs, Samaritains compris. Autrement dit, une victime abattue par un chrétien ou un juif, ou supposé tel, devrait être licite pour un musulman. Les muftis, y compris les plus radicaux, comme Yûsuf al-Qaradhâwî, télé-prédicateur vedette d’Al-Jazira, défendent cette position : les bêtes abattues dans les abattoirs français, britanniques ou allemands sont parfaitement licites !
Le problème est que ce principe, s’il est accepté par la grande majorité des autorités religieuses de l’islam, puisque le Coran, qui est la parole de Dieu, le formule explicitement, n’est pas admis par les musulmans ordinaires. C’est cela que j’ai découvert en 1995, et qui m’a amené à écrire un article sur les boucheries musulmanes en France. Les boucheries musulmanes n’existent pas en terre musulmane : c’est une invention des musulmans vivant en Europe de l’Ouest ! Selon les textes de la loi, donc, faire abattre un animal par un chrétien ou par un juif, y compris dans le cadre sacrificiel, est tout à fait admis.
Ainsi, le problème pourrait être résolu d’une façon détournée. Malheureusement, dans le contexte actuel, il est très difficile de faire accepter à la population musulmane qu’elle peut consommer la même viande que tous les Français – du moins une grande partie d’entre elle, car bon nombre de musulmans achètent leur viande en supermarché, dont je doute qu’elle puisse avoir le label musulman… En fait, la difficulté ne tient pas à la loi, mais à la compréhension qu’en ont les adeptes.
Mme Sophie Nizard. Les rabbins réfléchissent à la prise en compte par la loi des avancées scientifiques. Aux États-Unis, une réflexion existe sur le rapport entre l’homme et l’animal, certains ayant proposé d’élargir le label casher à d’autres aspects que l’abattage, notamment les conditions d’élevage au regard du bien-être animal.
J’ai été frappée de constater que les termes utilisés par les rabbins, sur le couteau par exemple, sont très proches de ceux définis dans les normes françaises en matière d’abattage rituel, prévu à titre dérogatoire. Au point que je me demande si la norme religieuse n’a pas guidé en quelque sorte le législateur pour décrire le geste tel qu’il doit s’effectuer…
Dans la religion juive, l’insensibilisation avant l’abattage peut être difficilement retenue, en raison de l’impératif d’avoir une bête vivante et viable – pendant au moins un an, selon les textes du Talmud – au moment de l’abattage. J’ignore ce qu’il en est des débats rabbiniques en France sur l’insensibilisation ou l’assommage post-saignée. Néanmoins, la tradition juive n’interdit pas de s’interroger sur les techniques au regard de la loi.
Mme Anne-Marie Brisebarre. Dans une entrevue avec Brigitte Bardot, le recteur de la Mosquée de Paris avait déclaré que si un mouton insensibilisé, et non égorgé aussitôt, pouvait se relever pour rentrer dans sa bergerie, il n’y avait pas de raison de ne pas faire évoluer les choses. Le problème est que certaines méthodes d’insensibilisation à l’électricité des moutons peuvent provoquer un arrêt du cœur, ce qui expose à un des interdits du Coran : l’interdiction de la charogne (mayita). Il n’y a pas trente-six interdits dans le Coran, seulement quatre : la bête abattue au nom d’un autre que Dieu, la charogne, le porc et le sang.
En discutant avec des consommateurs musulmans, je me suis rendu compte qu’ils pensaient que la viande issue de l’abattage conventionnel en France n’était pas saignée. Une des raisons de cette croyance est qu’au restaurant, on vous demande si vous souhaitez votre steak saignant. Et pourtant, on ne pratique pas dans l’islam la cashérisation pour retirer totalement le sang. Dans le cadre d’une conférence sur l’alimentation dans un lycée à Blois, à un groupe de jeunes filles qui refusaient de manger de la viande à la cantine, persuadées qu’elle contenait du sang, j’ai expliqué que, pour la conservation de la viande, tout abattage nécessitait de saigner les animaux et que les animaux abattus de façon conventionnelle étaient aussi saignés. Vous le voyez : des termes du quotidien peuvent amener à des représentations fausses. On croit à tort que les Français mangent la viande avec le sang, ce qui est interdit par le Coran.
M. le président Olivier Falorni. Une fatwa égyptienne de 1978 permettait de recourir à l’étourdissement, à condition qu’il ne provoque pas la mort de l’animal. L’étourdissement préalable et l’étourdissement post-jugulation sont-ils admis dans d’autres pays que la France pour l’abattage rituel juif et musulman ? Si oui, quelles sont les méthodes utilisées ?
M. Jacques Lamblin. Vos exposés, mesdames, monsieur, nous aident à mieux comprendre les raisons des impératifs religieux. La volonté de respecter l’animal est clairement exprimée dans la religion juive ou musulmane.
Lorsque les conditions d’abattage ne sont pas celles qu’elles devraient être, l’animal n’est ni paisible ni tranquille, mais au contraire apeuré, paniqué : il n’est pas respecté, au sens où l’entend la religion. Cette exigence du respect de l’animal ne doit-elle pas primer sur celle d’un animal vivant et viable ? Autrement dit, l’étourdissement préalable ne paraîtrait-il un bon compromis pour que l’animal ait moins peur avant la saignée ?
J’ignorais que le verset 5 de la sourate 5 autorisait la consommation de viande issue d’éleveurs ou de producteurs des religions du Livre. Cela vient complètement changer la donne. En outre, les règles halal sont variables selon les mosquées. Finalement, tout n’est pas aussi codifié qu’il y paraît : la viande issue des gens des religions du Livre est licite. Mais une viande licite est-elle halal au sens strictement religieux ? Existe-t-il une différence entre viande licite et viande halal et, si oui, tient-elle aux conditions d’abattage ?
Enfin, la viande halal est-elle soumise à une taxe, comme l’est la viande casher ?
M. Guillaume Chevrollier. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur la formation à l’abattage rituel ? Est-elle uniformisée en France ?
Des contrôles des pratiques sont-ils effectués sur le terrain ? Existe-t-il des différences entre la France et d’autres pays européens ?
Quelle évolution serait envisageable à court terme en matière de bien-être animal ?
M. Arnaud Viala. Comme notre président, j’aimerais savoir si l’étourdissement préalable est en vigueur dans d’autres pays.
La méthode consistant à percuter le crâne de l’animal sans le perforer ne produit pas de séquelles et est entièrement réversible. Les professionnels des abattoirs, en lien avec les représentants de vos cultes, demandent que cette méthode soit acceptée par voie dérogatoire, afin d’améliorer le bien-être animal. Qu’en pensez-vous ?
M. Yves Censi. Merci, mesdames, monsieur, de vos exposés. Les représentations très diverses selon les approches anthropologiques ou culturelles, que vous nous avez décrites, renvoient à une dimension subjective. Les progrès scientifiques sur les douleurs nociceptives, grâce auxquels la souffrance animale est mesurable, renvoient quant à eux à une dimension objective. Monsieur Benhkeira, vous avez évoqué la difficulté à tracer la frontière entre conscience et mort. Dans une conception anthropologique, je peux le comprendre ; mais sur le plan scientifique, l’état de conscience et l’état de mort sont très nettement différenciés. Madame Nizard, vous dites avoir été frappée par le fait que les textes de la réglementation eux-mêmes utilisent des termes empruntés au religieux ; mais ces termes peuvent être marqués par les représentations davantage que par leur caractère opératoire.
Nonobstant la pluralité des représentations, un travail rapide pourrait-il être réalisé sur la base de données, non pas subjectives, mais objectives – auxquelles tout le monde devrait se soumettre – pour aboutir à l’acceptation d’un certain type d’abattage ? Le verset 5 de la sourate 5 sur la viande licite pourrait-il lui-même être reconnu rapidement, malgré la diversité des croyants ? Faute de quoi, nous serons obligés de légiférer à l’aune de considérations économiques afin d’éviter des pertes financières dans la filière, alors que certaines pratiques sont clairement inacceptables sur le plan de la souffrance animale.
M. Yves Daniel. Mesdames, monsieur, je vous remercie de votre présentation. En tant que paysan éleveur – j’ai tué des animaux à la ferme dès l’âge de quatorze ans –, je m’interroge moi-même beaucoup sur le rapport entre l’homme et l’animal. Les animaux sont des êtres sensibles. L’humain est également un être sensible, mais également sentimental. Du coup, cela devient compliqué… Notre rapport à l’animal est lié à notre rapport à la vie d’une manière générale – la religion, la nature, nos réactions, notre sensibilité, nos sentiments, etc. Comment interprétez-vous la notion de sensibilité par rapport à celle de sentiment ? De quelle manière pouvez-vous nous aider à bien comprendre la notion de souffrance ou de maltraitance chez les animaux que nous mettons à mort ?
Mme Françoise Dubois. Madame Nizard, qui dispense la formation aux opérateurs et qui leur délivre le diplôme attestant de leurs aptitudes ? Madame Brisebarre, Monsieur Benhkeira, les sacrificateurs de nos provinces, nommés par la mosquée, détiennent-ils un tel diplôme les habilitant à pratiquer un abattage rituel « propre » ?
Combien de temps après l’égorgement survient la mort de l’animal ? Autrement dit, pendant combien de temps agonise l’animal avant de mourir ?
Mme Anne-Marie Brisebarre. Il me semble qu’en Irlande certains abattoirs pratiquent l’étourdissement pré-abattage. Par contre, quand il s’agit d’exporter vers les pays du Golfe, il peut y avoir une autre façon de faire : si des personnes passent un contrat pour demander de la viande halal, l’électronarcose n’est pas pratiquée, par exemple. Il y a donc une certaine hypocrisie en la matière. De la même façon, la Suisse interdit l’abattage rituel depuis plus d’un siècle, mais n’interdit pas l’importation de viande halal abattue à Besançon…
L’insensibilisation post-jugulation est pratiquée aux Pays-Bas dans l’abattage rituel : pour les ovins, elle doit intervenir au maximum 30 secondes après l’égorgement, et pour les bovins 45 secondes après, et ce afin d’abréger l’agonie. En Belgique, beaucoup de discussions ont lieu sur l’abattage rituel musulman. C’est effectivement la situation minoritaire des musulmans qui amène le développement d’un abattage rituel dit « halal, de boucherie musulmane », comme l’a expliqué M. Benhkeira : dans les pays du Maghreb ou majoritairement musulmans, on ne se pose pas la question : tout se fait selon les règles, à supposer qu’elles soient vérifiées… Pour tout le monde, c’est de l’abattage rituel.
L’électronarcose permet-elle d’anesthésier un animal sans le tuer ? Je pense que cela est possible. Pour certaines races ovines, il faut tondre ou arroser l’endroit où sont placées les électrodes, sinon le courant ne passe pas. Or, quand on lit les descriptions sur les effets du courant électrique sur l’animal, avec les stades correspondant au passage du courant électrique, on peut se demander si cette anesthésie, ou cette insensibilisation, ou cet assommage – est véritablement indolore. D’où les représentations dont je vous ai parlé sur l’électricité faisant référence à la torture à l’électricité chez les humains.
L’homme est-il un être sentimental ? Je ne le pense pas. C’est en tout cas le seul être vivant à savoir qu’il va mourir. Les animaux n’ont pas conscience de la mort. Ont-ils des sentiments ? Je n’en sais rien. Par contre, les animaux sont des êtres sensibles et ressentent la douleur : j’en suis certaine, comme tout le monde.
Dans l’islam, que ce soit dans le sacrifice ou l’abattage rituel, il est interdit d’abattre un animal devant un autre animal vivant, de lui montrer le couteau – comme dans le sacrifice grec, où le couteau était caché dans un panier de grains et où l’on demandait à l’animal d’acquiescer à sa mort en lui faisant hocher la tête –, de coucher l’animal de façon brutale, de poser son pied sur lui pour l’immobiliser avant de l’abattre, etc. Dans l’abattage industriel, les animaux sont insensibilisés et abattus à la chaîne les uns après les autres : quel que soit le type d’abattage, rituel ou conventionnel, on ne peut pas dire que les prescriptions propres à l’abattage familial ou au sacrifice soient forcément respectées.
M. Mohammed Hocine Benhkeira. Nous avons tous tendance à attribuer aux animaux ce que nous ressentons…
Mme Anne-Marie Brisebarre. Surtout aux mammifères.
M. Mohammed Hocine Benhkeira.… et moi le premier avec mon chat ! L’anthropomorphisme est certainement l’attitude la plus répandue, comme le bon sens de Descartes.
Quelqu’un a parlé de nos cultes. Je ne représente aucun culte : en tant qu’historien de l’islam, je m’intéresse à toutes les religions en enseignant la section des sciences religieuses, soit une vingtaine de religions. Je parle donc en mon nom propre, en tant que spécialiste.
En tant que savant, donc, je me méfie de l’anthropomorphisme : je ne cherche pas à attribuer aux animaux ce que je ressens. Cela étant dit, je conçois parfaitement que l’on puisse penser que les animaux savent qu’ils vont mourir ou même qu’ils ont une pensée. Mais il ne faut pas tourner autour du pot : pour manger de la viande, il faut tuer les animaux. Qu’on les tue brutalement, ou qu’on les tue en les insensibilisant, nous avons bel et bien affaire à un meurtre… C’est un problème que l’Humanité se pose depuis qu’elle mange de la viande et qu’elle essaie de résoudre en s’ingéniant à le transformer, par une série de fictions, en acte acceptable. Anne-Marie Brisbarre a fait référence au sacrifice grec dit « bouffonie », dans lequel on juge le bœuf avant de le tuer : on l’accuse d’avoir commis un acte délictueux afin de justifier sa mise à mort… Les musulmans, eux, invoquent Dieu qui les a autorisés à commettre ce meurtre. D’autres invoquent toutes sortes d’arguments. Bref, tout le monde invoque un système.
Dans le monde industriel, et dans le monde sécularisé, on a perdu cette possibilité d’invoquer une transcendance quelconque qui permette de justifier la possibilité de tuer des êtres vivants, et qui plus est tout à fait pacifiques. C’est là qu’intervient le sentiment selon lequel les animaux sont nos frères et qu’on ne peut donc pas les tuer – sentiment qui existe depuis très longtemps : déjà Pythagore refusait de manger de la viande. Alors comment faire pour surmonter ce sentiment tout en mangeant de la viande ? La difficulté est là. Moi-même, je suis pris dans cette difficulté comme beaucoup de gens : je mange de la viande.
Un jour, au supermarché où j’avais l’habitude d’acheter du veau, je suis tombé sur un vendeur qui justement faisait la promotion du veau. Et il me parlait du petit veau, que l’on prend alors qu’il tète encore sa mère… Décidément, cet homme n’avait aucun sens du commerce : il m’a totalement dissuadé d’acheter du veau… Je me suis immédiatement représenté en train d’arracher un enfant du sein de sa mère pour l’égorger et le manger avec plaisir ! Ce sentiment est très difficile à admettre pour nous tous, et la loi peut difficilement résoudre ce problème. Du reste, ce n’est pas à la loi de le résoudre ; c’est à d’autres instances de le faire. C’est ailleurs ainsi que cela se passe. La loi dit qu’on peut faire ceci et pas cela, mais elle ne pourra pas nous enlever ce sentiment de culpabilité que l’on ressent en mangeant de la viande ! Dieu, lui, dit que vous pouvez faire ce que vous voulez…
M. le président Olivier Falorni. Mais ici, c’est de la loi de la République qu’il est question, non de la loi divine…
Je vais reposer ma question plus directement. Peut-on imaginer en France une viande casher ou halal issue d’un animal tué après étourdissement ou avec la méthode de post-jugulation, comme c’est le cas dans certains pays européens ?
Mme Sophie Nizard. Sur l’anthropomorphisme, je suis tout à fait d’accord. De la même manière, en tant que spécialistes de sciences sociales, nous ne sommes pas là pour défendre quelque culte que ce soit.
Vos questions, sur lesquelles j’ai travaillé il y a longtemps, dans les années quatre-vingt-dix, sont difficiles mais tout à fait légitimes. À l’époque, le problème ne se posait pas en ces termes. Et pourtant, quand on entre dans un abattoir, la question de la mort animale
– et de la mort tout court – nous saute à la figure. La sensibilité, le sentiment sont des questions philosophiques essentielles. Nous avons tous une sensibilité par rapport à la souffrance et à la maltraitance animales – c’est notre tendance à l’anthropomorphisme, d’autant que ces mammifères nous ressemblent.
On oppose souvent les sciences sociales et humaines, dites « sciences molles » ou « souples » aux sciences « dures », mais les sciences dures aussi comportent une part de subjectivité. Les rapports des scientifiques et des vétérinaires donnent des chiffres très variables sur le temps qui s’écoule entre la saignée et la perte de conscience.
Mme Anne-Marie Brisebarre. Les chiffres sont très variables, non seulement entre espèces, mais aussi entre individus.
Mme Sophie Nizard. Les rapports de l’ANSES et de l’INRA indiquent que la réglementation impose pour un bovin une durée minimale de 45 secondes dans le piège rotatif pour s’assurer de la perte de conscience de l’animal, mais j’ai également trouvé dans ces rapports une durée moyenne de 19,5 secondes. Laisser l’animal pendant 45 secondes sur la zone d’affalage permet sans doute de s’assurer de l’inconscience totale de la bête avant sa suspension. Quoi qu’il en soit, j’ai l’impression que les études sont souvent faites en laboratoires, et non dans les abattoirs. Je suis donc incapable de répondre à cette question.
À ma connaissance, aucun pays ne pratique un étourdissement pré-saignée en abattage casher. Pour savoir si cela pourrait être pratiqué en France, il faudrait poser la question à des rabbins. D’après ce que je sais des normes religieuses en matière d’abattage, cela n’est pas possible. Pour l’étourdissement post-jugulation, là encore, ce n’est pas à moi de répondre, mais on peut imaginer que ce soit possible, car je sais que des débats rabbiniques au plus haut niveau ont lieu actuellement sur la souffrance animale. Ainsi, le gavage des oies est interdit depuis sept ou huit ans en Israël, et du coup de la production de foie gras, alors que ce pays figurait parmi les trois premiers producteurs mondiaux de foie gras. Cette interdiction a été obtenue grâce aux associations de défense des animaux, qui sont extrêmement actives en Israël. Des réflexions ont donc lieu sur la souffrance animale, y compris à l’appui d’arguments religieux avancés par les militants d’associations.
S’agissant de la formation des chokhatim, des sacrificateurs casher, un traité entier du Talmud est consacré à la nourriture casher, à l’abattage et au rapport à l’animal au moment de l’abattage. Le temps théorique d’apprentissage des textes est relativement long ; en général, les étudiants passent par la yechivah, c’est-à-dire une académie rabbinique. Un sacrificateur français de volailles, avec lequel j’ai discuté, m’a expliqué qu’il avait étudié plusieurs années en yechivah en Israël pour acquérir cette connaissance théorique, avant d’accompagner pendant six mois un chokhet sur les lieux d’abattage, pour enfin obtenir son diplôme par l’académie talmudique. À ma connaissance, il n’y a plus de formation pratique en France, peut-être en raison de la perte de vocation ou du manque de maîtres. À l’époque où elle existait, Emmanuel Chouchena était à la fois Grand Rabbin et chokhet, donc maître ; aujourd’hui, plus personne ne peut former des étudiants à la chekhita en France. Selon la tradition juive, le sacrificateur dépend toujours de quelqu’un pour « vérifier le couteau » : c’est l’expression consacrée pour dire que l’on dépend toujours d’un maître.
Mme Anne-Marie Brisebarre. Les opérateurs en abattoir halal ne sont pas des personnages religieux : tout homme adulte, croyant et sain d’esprit peut pratiquer le sacrifice et l’abattage rituel halal. Dans les abattoirs où je me suis rendue, il y avait un sacrificateur habilité, c’est-à-dire envoyé par une mosquée, mais qui devait avoir passé un test auprès des services vétérinaires. Quand il fallait organiser des abattoirs temporaires pour l’Aïd el-Kébir, comme il fallait plus d’opérateurs et que la plupart de ceux opérant en abattoir étaient déjà occupés, les associations musulmanes ou les mosquées déléguaient des gens qui passaient aussi un test et qui recevaient un certificat pour la journée. Sans parler de formation, il y a donc une certification religieuse délivrée par une des trois grandes mosquées et une vérification des services vétérinaires pour les aspects techniques. Si problème il devait y avoir, cela relèverait donc plutôt des services de contrôle de l’État, non de la mosquée. J’avais également constaté dans certains abattoirs que lorsque le sacrificateur attitré était occupé, un autre salarié sur la chaîne, lui-même musulman, prenait le couteau.
Le savoir que détenaient les pères de famille musulmans pour le sacrifice de l’Aïd el-Kébir est désormais très peu partagé. Aujourd’hui, les pères de famille ne savent plus sacrifier. Dans les villes, et même au Maghreb, en Mauritanie et Sénégal où j’ai travaillé, 50 % au moins des sacrifices de l’Aïd sont réalisés par des bouchers. Par conséquent, la formation technique des opérateurs en abattoir en France ne peut relever que de l’État : c’est à lui de s’en assurer.
À propos des connaissances sur la nociception, j’ai une expérience un peu particulière. En 1980, j’ai regardé l’émission « SOS animaux de boucherie » de Brigitte Bardot, dans laquelle un vétérinaire disait « regardez cette pauvre bête comme elle souffre » en commentant des images sur l’abattage rituel de bovins casher. Mais le vétérinaire qui regardait l’émission avec moi m’a dit : « pas du tout, ce sont des réflexes, et non des signes de souffrance. » Lequel des deux avait raison ? Je l’ignore. En tout cas, même entre vétérinaires, les avis sont partagés selon qu’ils se positionnent au travers d’une association de protection animale ou de certaines représentations, ou qu’ils sont détachés…
M. Yves Censi. C’était il y a trente ans.
Mme Anne-Marie Brisebarre. Certes. Mais il y a toujours un point d’interrogation sur la réceptivité individuelle des animaux, croisée avec la façon dont travaille l’opérateur. Les associations de protection animale dénoncent dans les vidéos les étourdissements ratés qui ne sont pas suivis de la mise en place d’un système d’urgence avant la suite des opérations. J’ai lu des textes scientifiques sur l’abattage selon lesquels l’égorgement d’un animal bien traité et non stressé, effectué par une personne compétente avec les instruments appropriés, provoquait immédiatement un collapsus – et donc un électroencéphalogramme plat. D’un autre côté, on entend dire que certains moyens d’étourdissement paralysent l’animal, qu’il ne peut pas exprimer de souffrance, mais qu’on ne sait pas s’il souffre. Il y a un an ou deux, j’ai lu un article qui expliquait qu’aux États-Unis les animaux étaient mieux traités que les condamnés à mort : les médecins refusant de pratiquer l’anesthésie, ce sont des gens non qualifiés qui s’en chargent, et si les condamnés à mort ne peuvent pas exprimer la douleur, cela ne veut pas dire qu’ils ne souffrent pas au moment où on leur injecte le poison. Bref, nous voyons, nous entendons, nous lisons des choses, et il est très difficile pour nous de vous répondre. Un animal tombé est-il conscient ou non ? Est-il tombé parce que l’électronarcose a provoqué un réflexe épileptique ? Souffre-t-il ou pas ? Combien de temps dure l’agonie ? Les choses sont compliquées, car j’ai l’impression, d’après tout ce que j’ai lu, que tout le monde n’est pas d’accord.
Pour ce qui est de l’abattage rituel musulman, des gens disent que les textes sont anciens et qu’il serait donc possible d’évoluer. Selon moi, le problème se situe moins au niveau des mosquées ou des savants de l’islam qu’au niveau des organismes de certification, privés ou liés à des associations, dont certains ont intérêt à proposer du halal plus halal que le halal d’à côté – de la même manière, qu’il existe du plus casher que le casher. En clair, ces organismes de certification, parfois concurrents entre eux, peuvent être tentés de rajouter des normes aux normes pour donner l’impression d’être plus orthodoxes, plus respectueux des règles. Sans parler des intérêts financiers.
Mme Sophie Nizard. Anne-Marie Brisbarre soulève la question de l’autorité religieuse. Pour ce qui est du casher, je ne pense pas que l’on puisse mettre en doute la bonne foi des institutions religieuses dans leur croyance de ce qui est bon ou pas. En France, la principale organisation religieuse juive est le Consistoire, qui historiquement avait le monopole depuis le Concordat ; c’est donc plutôt à elle que les pouvoirs publics s’adressent pour toutes les questions touchant au religieux.
M. le président Olivier Falorni. Je précise que nous organiserons, dans quelques semaines, une table ronde réunissant les représentants du culte musulman et du culte juif.
M. William Dumas. L’abattage casher ralentit la chaîne, dites-vous ; je veux bien le croire. Vous avez également parlé du prix de la certification par kilo de viande…
Mme Sophie Nizard. En casher, la taxe prélevée par le Consistoire de Paris est de 1,66 euro par kilo de viande de boucherie – j’ignore si les consistoires régionaux prélèvent la même taxe. Pour les volailles, ce doit être à la tête ; pour le vin, c’est à la bouteille.
M. William Dumas. Dans la mesure où les organismes prélèvent cette taxe de 1,66 euro, qui peut compenser le coût de l’abattage de 0,50 euro le kilo en moyenne, les cadences de l’abattoir pour le casher peuvent être moins importantes.
Mme Sophie Nizard. Le prix de l’abattage est également intégré dans le prix de la viande casher qui est supérieur d’un tiers à celui d’une viande non casher. Cette taxe de 1,66 euro est facturée aux boucheries casher et est versée au Consistoire : elle ne permet pas d’amortir les frais d’abattage pour les grossistes ou les chevillards.
M. William Dumas. Vous avez indiqué que 100 000 personnes seulement – 20 % de la population juive – consomment de la viande casher ; autrement dit, c’est surtout un marché de niche.
Dans mon département, le Gard, nous avons de gros problèmes lors de la fête de l’Aïd el-Kébir. On a été jusqu’à créer des abattoirs provisoires pour la durée de l’Aïd ; Les pouvoirs publics ont essayé de remédier à cette situation, en contrôlant le nombre de bêtes vendus par les éleveurs. Même si la situation – invraisemblable il y a quelques années – s’est un peu améliorée, il y a encore beaucoup à faire : 40 % à 50 % des abattages ne se font pas dans les abattoirs, si bien que les normes sanitaires ne sont pas respectées, sans parler des normes environnementales.
À l’époque où je n’étais pas encore député, un abattoir de volailles situé à un kilomètre de mon village avait obtenu un marché de quatre ou cinq ans avec l’Arabie Saoudite. Le propriétaire de l’abattoir avait dit à mon père : « j’ai été obligé d’embaucher un imam » ; autrement dit, celui-ci faisait sur chaque volaille un signe pour certifier que l’abattage avait été réalisé dans les conditions demandées. Dans tout cela, il n’y a pas de bien-être animal…
L’abattoir du Vigan, que je connais bien, produit 350 tonnes de viande par an et travaille en circuit court ; beaucoup d’éleveurs du Gard, mais aussi de l’Aveyron et de l’Hérault y amènent leurs bêtes. La vidéo tournée dans cet établissement par l’association L214 dure quatre minutes, pour une durée totale de cinquante heures de rush. Elle montre, non des pratiques d’abattage, mais deux employés qui « pètent les plombs » en jetant des agneaux violemment au-dessus de la barrière – ils ont été licenciés. On parlait de la nécessité pour les bêtes d’arriver sereines à l’abattoir : ce n’était clairement pas le cas. Je tenais à mettre les choses au point car les éleveurs, que je connais bien, ont été les premiers à demander la réouverture de cet abattoir dont ils ont besoin et où leurs bêtes sont abattues correctement.
Mme Anne-Marie Brisebarre. Je suis tout à fait d’accord avec vous. Lors de cette affaire, j’avais d’ailleurs indiqué qu’il s’agissait d’une petite structure. Néanmoins, les éleveurs avec lesquels j’ai parlé au téléphone m’ont dit avoir été choqués par la vidéo. J’en profite pour dire que ce type de vidéos diffusées sur le Web pose un gros problème, et je vais vous expliquer pourquoi.
Quand je dirigeais une recherche sur l’Aïd el-Kébir, un de mes collègues a voulu que des images soient filmées pour réaliser un carnet d’enquête ; j’ai alors refusé de prendre moi-même la caméra, car je voulais garder le contact avec les familles qui faisaient ce sacrifice de l’Aïd dans une ferme de Seine-et-Marne ; c’est donc une autre personne qui s’en est chargée. Je suis restée avec une des familles pendant tout le sacrifice : les gens ont cajolé le mouton, lui ont donné du sel « comme à un enfant à qui l’on donne un bonbon avant de lui faire une piqûre », m’ont-ils expliqué ; le père de famille, très expérimenté, l’avait égorgé d’un seul coup de couteau ; puis la bête a été dépouillée, la mère de famille a grillé le foie… Par contre, le film tourné par le professionnel, qui s’était approché de la bête lors de l’acte, n’était pas du tout représentatif ce tout ce que j’avais vécu avec cette famille : l’image de l’égorgement pris plein cadre et vue sur une petite lucarne de télévision était proprement insoutenable, totalement à l’opposé de ce que j’avais moi-même vu de ce sacrifice familial.
L’association L214 joue un rôle en dénonçant, vis-à-vis des pouvoirs publics, des choses qui dysfonctionnent, certes. Mais diffuser des vidéos sur le Web, qui sont de surcroît des montages et que tout un chacun peut voir, je suis contre. D’autant que cette association prône le végétarisme et l’arrêt de l’élevage.
Les bouchers maquignons de Marseille, à qui on permettait d’organiser le sacrifice de l’Aïd dans les anciens abattoirs de Saint-Louis, avaient réalisé une vidéo pour montrer leur organisation. J’ignore si c’est un professionnel qui avait filmé ; les égorgements avaient peut-être été filmés, mais ils n’avaient pas été intégrés pas dans le montage. Sans doute ces gens étaient-ils conscients, alors que leur objectif était de montrer que la fête de l’Aïd est une fête familiale, où la viande sacrificielle a une valeur, à laquelle on trouve un goût particulier, que leur film ne serait plus montrable avec les égorgements.
M. Thierry Lazaro. La semaine dernière, nous avons reçu des représentants syndicaux des personnels d’abattoir, dont certains nous ont indiqué que les demandes des clients pouvaient être diverses et variées. En parlant de la loi de l’islam, Monsieur Benhkeira, vous avez cité un verset du Coran qui apporte une ouverture. À mes yeux, l’islam se doit d’être ouvert, comme toutes les religions, et c’est le cas. La loi de la République doit s’imposer à toutes et à tous. Et, si j’ai bien compris votre propos, comme pour la loi de la République, il y a l’esprit et l’interprétation de la loi de l’islam ; or la grande difficulté est que l’autorité ne s’applique pas à l’ensemble des musulmans. J’espère que nous obtiendrons une réponse à cette question lorsque nous recevrons des responsables religieux, quelle que soit leur religion.
Monsieur Benhkeira, vous avez évoqué la question de savoir si la phase d’étourdissement n’était pas déjà la mort. Madame Brisbarre, vous avez évoqué les doutes que pouvaient éprouver certains : peut-être un animal étourdi ressent-il la douleur. Je pense pour ma part que mourir peut prendre beaucoup de temps, mais que le passage de la vie à la mort est un moment extrêmement rapide. Notre préoccupation n’est pas tant la mort elle-même que le temps pour y arriver, car plus ce temps est long, plus le risque de souffrance est important. Autrement dit, qu’il y ait étourdissement ou pas, plus le délai sera court, plus le risque de faire souffrir l’animal sera diminué : quelle que soit notre religion, quel que soit notre parcours de vie, les hommes et les femmes que nous sommes ont à cœur de voir ce délai raccourci.
M. Jacques Lamblin. En tant que spécialistes des sciences humaines, il est très difficile pour vous de répondre sur le plan des sciences dures – le temps de la souffrance, etc. –, ce qui est tout à fait compréhensible. En revanche, vous avez rappelé le danger de l’anthropomorphisme, et je partage totalement votre analyse. Vous avez rappelé une autre évidence, Monsieur Benhkeira : pour manger de la viande, il faut tuer l’animal, et cette réalité incontournable pose un problème impossible à résoudre par la loi. Cela étant dit, la loi peut faire en sorte de diminuer le plus possible la peur et la souffrance de l’animal. Car si celui-ci n’a pas conscience de sa finitude, il a conscience du danger.
Pour la religion juive, il y a une collecte de fonds, dont l’usage a été clairement expliqué par Mme Nizard. Pour la religion musulmane, si j’ai bien compris, le développement de la consommation en France de viande halal n’est pas imposé par la religion. Ce développement est-il lié à des considérations financières – liées au profit de la filière – ou à des considérations identitaires, ou aux deux ?
M. Mohammed Hocine Benhkeira. Je vais nuancer mon propos de tout à l’heure. Certes, le verset 5 de la sourate 5 dit que la nourriture des gens du Livre est licite pour les musulmans. Néanmoins, les règles de l’abattage rituel s’appliquent aux musulmans, et non aux chrétiens, ni aux juifs, ni aux autres. Autrement dit, lorsque les musulmans tuent des animaux, ils sont tenus d’appliquer les règles de l’abattage rituel pour avoir une viande licite.
M. Jacques Lambin. Cette précision est importante.
M. Mohammed Hocine Benhkeira. Sur l’aspect financier, je suis incapable de vous apporter des informations ; ma collègue Anne-Marie Brisbarre pourra le faire. Sur les autres aspects, je peux répondre.
En tant que spécialistes de sciences humaines, nous avons la chance de ne pas être trop certains de ce que nous avançons – nous parlons d’hypothèses. L’hypothèse est que les musulmans en situation minoritaire qui vivent dans un environnement pas toujours très favorable auront tendance à mettre l’accent sur des aspects de leur vie quotidienne qui permettent de renforcer leur identité : j’ai moi-même parlé il y a une vingtaine d’années de « frontière rituelle », c’est-à-dire de ces barrières que l’on pose pour se protéger de la dissolution dans le tout environnant. À la différence du judaïsme, où la loi édictée par les rabbins s’impose à tous, dans l’islam, une fatwa émise par un mufti peut n’avoir aucun effet sur les fidèles. J’ai beaucoup de respect pour les gens du Conseil français du culte musulman, mais ils pourront édicter autant de règles qu’ils voudront, les musulmans pratiquants ne sont pas tenus de les suivre ! C’est la particularité de l’islam, sur laquelle on peut difficilement agir.
La difficulté se réglera dans le temps, à moyen terme, dirais-je, d’autant que le contexte est assez particulier. Car vouloir contraindre les adeptes d’une religion à abandonner une de leurs règles – qui n’est pas fondamentale – aboutirait précisément à la rendre fondamentale ! Elle deviendrait identitaire, alors qu’elle ne l’était pas au départ. Vous connaissez cet effet pervers de l’éducation : obliger quelqu’un à changer de comportement l’amène à résister, comme le font les adolescents.
Mme Anne-Marie Brisebarre. Des jeunes couples issus de la classe moyenne, de religion ou de culture musulmane, tiennent à manger halal et vont regarder sur Internet si tel boucher est bien certifié par tel organisme de certification. Pour les cantines scolaires de leurs enfants, certains sont plus exigeants que leurs parents ou grands-parents immigrés qui se contentaient du « sans porc ». Mais c’est justement parce qu’ils sont français, qu’ils se sentent chez eux en France, qu’ils réclament ce qui leur convient du point de vue alimentaire, au même titre que d’autres Français souhaitent manger végétarien ou bio. De la même façon, ces gens tiennent de plus en plus à se faire enterrer en France alors qu’auparavant, la majorité tenait à ce que leur corps retourne dans leur pays d’origine pour y être enterré, et cotisaient pour cela, alors même qu’ils avaient vécu la plus grande partie de leur existence en France. Contrairement à ce que pensent certains, certaines pratiques identitaires ne sont pas une façon de se séparer, mais au contraire de mieux s’intégrer. Pour d’autres en revanche, c’est une manière de se renfermer dans une communauté. Du coup, il est très difficile de démêler entre tous ces comportements et de savoir si c’est une façon de se séparer du reste des Français ou, au contraire, de s’intégrer en faisant valoir, comme tout un chacun, ses propres exigences d’ordre philosophique. On est donc, sur ces aspects alimentaires, davantage dans le domaine de la philosophie que dans celui de la religion.
M. le président Olivier Falorni. Merci, mesdames, monsieur, pour ces interventions particulièrement enrichissantes.
La séance est levée à dix-huit heures trente-cinq.
——fpfp——
19. Audition, ouverte à la presse, de Mme Maria Celia Potdevin, chargée de mission alimentation et agriculture de l’association de consommateurs Consommation logement et cadre de vie (CLCV)
(Séance du jeudi 2 juin 2016)
La séance est ouverte à neuf heures vingt.
Mme Françoise Dubois, présidente. Nous recevons ce matin Mme Maria Celia Potdevin, chargée de mission alimentation et agriculture au sein de l’association de consommateurs Consommation, logement et cadre de vie (CLCV).
La CLCV est une association de consommateurs qui a été créée en 1952. Elle fédère un réseau de 360 associations locales et compte 31 000 adhérents. À la suite des révélations sur l’abattoir d’Alès, l’association a publié, le 10 novembre 2015, un communiqué dénonçant les conditions indignes dans lesquelles étaient abattus les animaux. L’association demande davantage de transparence autour des contrôles effectués dans les abattoirs, qui doivent être communiqués aux associations concernées et au public. Elle est aussi favorable aux contrôles inopinés et à un meilleur étiquetage de l’origine de la viande, de la naissance à la mort de l’animal.
Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de lever la main droite et de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Maria Celia Potdevin prête serment.)
Mme Maria Celia Potdevin, chargée de mission alimentation et agriculture au sein de l’association de consommateurs Consommation logement et cadre de vie (CLCV). La question du bien-être animal n’est pas uniquement un effet de mode à la CLCV : dès les années quatre-vingt-dix, nous nous étions intéressés à cette question, en produisant notamment un rapport pour la Direction générale de l’alimentation (DGAL) sur le bien-être animal, réalisé entre autres à partir de l’étude des conditions de transport des chevaux et de leur incidence sur la qualité de la viande mise en vente. Nous avions en particulier mis au jour les conditions indignes dans lesquelles étaient transportés certains chevaux en provenance de Pologne.
Depuis, le sujet est régulièrement abordé au travers de nos actions locales : nous sommes présents dans 72 départements en métropole et outre-mer, au contact des consommateurs qui nous interrogent souvent sur le bien-être animal et sur les labels qui le garantissent. Des questions nous parviennent également via notre site internet Le point sur la table, dédié aux questions alimentaires ; elles portent en particulier sur les conditions de vie des poules pondeuses, sur la castration des porcs ou sur l’abattage rituel. En plus de nos communiqués de presse, qui sont des prises de position, nous sommes donc amenés à publier régulièrement des articles qui informent le public sur les pratiques en vigueur dans notre pays ou chez nos voisins, par exemple en matière de logos valorisant le bien-être animal.
Si nous nous sommes penchés sur cette question, c’est en partie parce que le secteur de la viande a connu ces dernières années plusieurs crises et qu’il est indispensable, pour rassurer le consommateur et enrayer la baisse de consommation, de redéfinir la notion de qualité, qui doit, plus globalement, prendre en compte les conditions dans lesquelles l’animal a vécu depuis sa naissance jusqu’à celles de la mise en rayon de la viande qui en est issue, ce qui passe nécessairement par les conditions d’abattage.
Aux différents scandales sanitaires – ESB ou grippe aviaire – qui ont écorné l’image de la viande est venu s’ajoute un phénomène de paupérisation de la population, qui conduit les Français à consommer de moins en moins de viande, car c’est un produit cher, pour se reporter sur des aliments à calories vides. Néanmoins, malgré la surmédiatisation des méfaits de la viande sur la santé ou sur l’environnement, la consommation de viande sous label Bio continue, elle, de progresser : les consommateurs qui optent pour ce type de produits – cela vaut également pour les œufs – invoquent, entre autres raisons, les garanties qu’apporte ce label en matière de respect du bien-être animal lors de la phase d’élevage. Même si, dans notre pays latin, nous sommes encore loin de l’engouement des Européens du Nord pour le bien-être animal, cette préoccupation prend donc de l’ampleur en France.
Dans un travail que nous menons actuellement avec l’INRA sur les attentes des consommateurs en matière d’étiquetage des produits alimentaires nous constatons, nous aussi, une progression du bien-être animal et, plus généralement, de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans la liste des critères invoqués par les consommateurs dans leurs motivations d’achat. Néanmoins cela ne se concrétise pas forcément lors de l’acte d’achat, les mentions figurant sur les denrées valorisant assez peu cet aspect.
En ce qui concerne les événements qui ont déclenché la mise en place de cette commission d’enquête, la CLCV, qui avait déjà réagi aux rapports de l’OAV sur le traitement des animaux d’élevage, a été particulièrement choquée par les vidéos diffusées récemment, qui ont révélé aux Français que des pratiques indignes perduraient dans certains abattoirs français, le plus scandaleux étant que l’un des trois abattoirs mis en cause était certifié bio. Or si un consommateur accepte de payer plus cher une viande sous label bio, c’est parce que celui-ci est censé correspondre à un cahier des charges impliquant notamment le respect du bien-être animal pendant la phase d’élevage, respect dont on peut imaginer qu’il s’étend également à la phase de l’abattage. Il ne semble pas que cela ait été le cas…
Le non-respect de la réglementation en matière de bien-être animal est inacceptable. Nous avons donc réagi immédiatement. Nous sommes en effet profondément attachés au respect de la réglementation européenne, qui impose de prendre toutes les mesures nécessaires à l’atténuation des souffrances des animaux destinés à la consommation, et ce lors de l’élevage, pendant le transport et au moment de l’abattage, et ce d’autant plus que, en tant qu’ingénieure agronome, je puis affirmer qu’il existe une relation indéfectible entre la « qualité » du moment de l’abattage – même si l’on se doute qu’il n’a rien d’agréable – et la qualité sanitaire et organoleptique de la viande. Nous sommes une association de consommateurs, non une association de défense des animaux : mais nous soutenons que de bonnes conditions de mise à mort de l’animal contribuent aussi au bien-être des travailleurs, dans un secteur d’activité où les cadences sont de plus en plus rapides.
Nous souhaitons donc la généralisation dans tous les établissements du responsable protection animale (RPA), censé veiller à l’application du règlement européen. Nous réclamons sa présence effective sur les postes allant de la réception des animaux jusqu’à l’abattage.
Cependant, nous nous interrogeons sur sa réelle marge de manœuvre dans certains établissements, notamment ceux qui connaissent des difficultés financières, en particulier dans certains territoires enclavés où l’abattoir reste le dernier maillon, et ne survit que parce que l’on veut éviter de devoir parcourir des distances trop importantes pour faire abattre les animaux. En effet, le RPA se trouvant sous la même autorité hiérarchique que les autres salariés – celle du responsable de l’abattoir –, nous craignons qu’il ne soit pas toujours en mesure d’exiger de ces derniers de modifier leurs pratiques. Nous demandons donc que les responsables protection animale puissent bénéficier du statut de lanceur d’alerte, tel qu’il a été défini par le projet de loi sur la corruption et que nous souhaitons voir transposé à d’autres secteurs que ceux de la finance.
Nous pensons par ailleurs que la formation des RPA est un peu courte. Il est difficile, en deux jours, de sensibiliser une personne aux bonnes pratiques en matière de bien-être animal, tout en lui enseignant les codes d’une communication efficace avec les salariés et la direction d’un abattoir. Cette formation devrait donc, à nos yeux, être allongée et renforcée, par exemple par des études de cas concrets, qui permettraient d’apprendre à gérer certaines situations de crise.
En ce qui concerne les personnels sur la chaîne d’abattage, leur travail n’est pas toujours correctement valorisé. Il serait souhaitable que leur formation initiale comprenne un module sur le bien-être animal et qu’ils soient incités à profiter d’une formation continue. Dans ces métiers en effet, les dérives peuvent résulter de la routine, et une remise à plat régulière des pratiques permettrait de prévenir ce type de risques.
En ce qui concerne l’installation de caméras de surveillance, nous y sommes plutôt favorables dès lors qu’elles sont installées dans le respect de la réglementation en vigueur, car elles peuvent éviter que s’installe un climat de suspicion généralisé dans lequel les mauvaises pratiques de quelques abattoirs finiraient par peser sur l’ensemble de la filière et sur la perception d’un produit de consommation aussi essentiel que la viande. Cela se fait d’ailleurs dans d’autres pays, sans poser de problèmes particuliers.
S’agissant des niveaux de contrôle, les rapports de la Cour des comptes et de l’OAV ont mis en évidence, dans notre pays, de graves lacunes dans l’inspection vétérinaire en abattoir. Nous avons donc déjà demandé que les inspections soient renforcées et qu’elles se fassent de manière inopinée, afin que la pression des contrôles assure la fiabilité de notre chaîne alimentaire. Dans un souci de transparence, nous avions également réclamé, pour ce secteur comme pour d’autres, que les résultats des inspections soient rendus publics et que les manquements soient sanctionnés. Nous n’avons pas changé d’avis depuis cette époque.
La plupart des abattoirs traitant de gros volumes de viande ont mis en place des certifications de type ISO ou IFS. Celles-ci portent prioritairement sur les conditions sanitaires – et c’est bien normal –, mais, à notre sens, elles devraient également comporter un volet sur les traitements réservés aux animaux. En ce qui concerne les normes IFS Food, il s’agit de certifications dont il est assez difficile de maîtriser tous les détails, et je n’ai pas eu le temps d’examiner s’il était possible d’y intégrer des critères relatifs au bien-être animal.
Ce que nous préconisons est également valable pour les entreprises qui mettent en place des procédures d’analyses de risques le long de la chaîne de travail (HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point) ; l’intégration de la problématique du bien-être animal dans ces pratiques d’autocontrôle, à côté des enjeux sanitaires ou liés à la santé au travail, constituerait un facteur de progrès.
Cependant, les procédures d’autocontrôle et de certification ont un coût, et les petits abattoirs n’ont pas forcément les moyens de les mettre en œuvre. Ce n’est pas une raison de se voiler la face pour autant et de leur permettre de faire n’importe quoi. Il est hors de question pour nous de les laisser déroger aux règles définies en matière de bien-être animal et de sécurité sanitaire.
Il importe donc que le ministère de l’agriculture et l’ensemble des professionnels entendent les évolutions de la société et prennent toutes les mesures qui s’imposent pour que les pratiques en abattoir évoluent de manière à ce que le bien-être fasse partie des exigences incontournables, au même titre que l’hygiène.
En ce qui concerne les dispositifs d’étiquetage, la question d’un « label » portant sur le bien-être animal est une question délicate. De nombreux labels ornent déjà les emballages, et il nous semble que, si un label portant sur le bien-être animal devait être mis en place, il devrait être porté par l’institution et ne pas relever d’initiatives privées ou émanant d’associations, comme c’est le cas en Allemagne ; nos consommateurs sont en effet plus sensibles aux labels institutionnels qu’aux labels d’origine privée, dont on voit bien qu’ils ont du mal à percer en France. Ce label devrait par ailleurs, selon nous, couvrir tous les aspects de la vie de l’animal et pas uniquement les conditions d’abattage. Bien sûr, pour être crédible il devrait s’appuyer sur un cahier des charges et un plan de contrôle solides, et des contrôles par une tierce partie indépendante.
Mme Françoise Dubois, présidente. Quelles sont, selon vous, les solutions à adopter pour améliorer le bien-être animal dans les abattoirs ?
Êtes-vous favorables à la mise en place d’un étiquetage mentionnant si l’animal a été étourdi avant sa mise à mort ?
Comment pourrait-on améliorer la transparence au sein des abattoirs ? Y a-t-il d’autres mesures à envisager que la publication du résultat des inspections et la vidéosurveillance ?
Mme Maria Celia Potdevin. Avant d’en arriver à défendre l’idée d’un label qui couvrirait toutes les phases de la vie de l’animal jusqu’à sa mise à mort, nous nous sommes posés la question de la pertinence de faire figurer sur l’étiquetage le procédé d’abattage, avec ou sans étourdissement, pour en arriver finalement à la conclusion que le consommateur était sans doute trop éloigné des pratiques utilisées dans l’agriculture ou la transformation industrielle pour en avoir une compréhension suffisante. Il n’est pas certain que cela lui apporte grand-chose, si ce n’est un peu plus d’angoisse. Se pose également la question de la fiabilité des indicateurs en matière de souffrance ou de mal-être animal ; il s’agit d’un domaine où les investigations scientifiques doivent être poussées plus loin. Ainsi, on parle en ce moment de l’abattage des animaux de boucherie mais sans nous interroger sur l’abattage des poissons d’élevage. Les poissons ne font pas de bruit, et nous nous sentons sans doute plus distants d’eux que des mammifères d’élevage, notamment parce qu’ils vivent dans un milieu différent du nôtre. Certains s’interrogent pourtant déjà sur les conditions de vie des truites dans les bassins d’aquaculture, ce qui rejoint les questions soulevées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dans son rapport sur l’élevage des insectes à des fins alimentaires, à propos de la nécessaire prise en compte des conditions d’élevage et d’abattage, y compris dans ce secteur. Il nous paraît donc essentiel d’étendre les recherches sur le bien-être animal aux autres espèces vouées à la consommation, afin que les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui avec les animaux de boucherie ne se reposent pas avec les espèces que nous serons amenés à consommer dans le futur.
M. Hervé Pellois. Je comprends qu’un label sur le bien-être devrait être assez général et prendre en compte les différentes phases de la vie et de la mort de l’animal. Or, s’il est facile d’évaluer et de contrôler le respect du bien-être de l’animal lors de la période de l’élevage, au moment du transport et lors de la phase de préparation à l’abattoir, le moment de l’abattage est un moment critique. En effet, si la plupart des animaux sont généralement abattus correctement, que faire dans le cas où, à la suite d’une erreur de manipulation, une bête doit être étourdie à deux reprises – et donc souffrir ? Comment délivrer un label « bien-être dans ces conditions » ? L’abattage suppose des gestes très techniques, et la réussite à 100 % n’est pas assurée.
Présidence de M. Olivier Falorni, président de la commission d’enquête
M. Jean-Luc Bleunven. Tenir compte du bien-être animal dans les procédures de labellisation aura un impact sur l’ensemble de la filière, puisque je considère, comme vous, que ce bien-être doit concerner la totalité de la chaîne de production jusqu’à l’abattage. Il me semble pourtant que cela ne pourra que se traduire par une augmentation du prix final, alors que les pressions qui s’exercent aujourd’hui sur la filière tendent à écraser les prix et à aboutir à la production d’une viande de qualité médiocre. Toute la question est de savoir si le consommateur sera prêt à mettre le prix nécessaire à ce surcroît de qualité que représente le bien-être de l’animal. Qu’en pensez-vous ?
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Un certain nombre d’installations classées
– centrales nucléaires, centres de traitement des ordures ménagères – disposent d’une commission locale d’information et de surveillance (CLIS). Pensez-vous que mettre en place auprès des abattoirs ce type de structure regroupant des consommateurs, des opérateurs, des élus et des personnalités qualifiées serait de nature à accroître la transparence sans courir le risque de fournir à l’opinion des éléments bruts, sans le recul nécessaire pour les analyser ?
Selon vous, la pression à la baisse qui s’exerce in fine sur le prix de vente des pièces de boucherie a-t-elle une incidence déterminante sur les conditions d’abattage des animaux, sachant qu’il nous a été dit que le coût de l’abattage n’entrait que pour une faible part dans la formation du prix global ?
En matière d’étiquetage, le plus simple serait sans doute d’intégrer le bien-être animal dans les labels existants – le label bio ou le label rouge, par exemple. Mais, n’est-ce pas finalement un travail de Sisyphe, avec des consommateurs de plus en plus éloignés, physiquement et cognitivement, de la production de leur alimentation ? Est-il possible de combler par un étiquetage de combler ce fossé grandissant ?
Vous avez évoqué enfin le fait que tout devait être mis en œuvre pour que les problèmes rencontrés aujourd’hui avec l’abattage des animaux de boucherie ne se posent pas demain avec d’autres espèces. Les progrès de la science et des techniques ne poussent-ils pas à toujours plus d’exigences ?
Mme Maria Celia Potdevin. Je vous remercie pour ces nombreuses questions très intéressantes. Je vais commencer par répondre sur les labels, qui se multiplient au point qu’il devient compliqué de s’y retrouver. La création d’un label supplémentaire est toujours délicate. Pour qu’il vive et qu’il soit reconnu, il faut remplir de multiples conditions.
On pourrait envisager d’intégrer le bien-être animal dans le label bio. Ce serait peut-être le label pour lequel ce serait le plus simple. Malheureusement, cette question est du ressort européen. Il ne me semble pas que l’abattage soit évoqué dans les discussions en cours sur l’évolution du label bio européen, à la différence du transport ou des conditions d’élevage : l’abattage est un peu la boîte noire dont personne ne veut parler. Le plus simple serait peut-être de l’intégrer, soit dans la pratique minimale exigible, soit dans la labellisation bio.
Vous avez évoqué le label rouge. Mais vous allez vous heurter à une difficulté avec l’INAO, dans la mesure où il s’agit d’un label de qualité organoleptique, qui n’est pas prévu pour prendre en compte de telles préoccupations. Il en va de même pour les labels d’origine. Il n’est pas évident de trouver le moyen d’intégrer le bien-être animal dans les labels existants, sauf dans le bio, à condition que le législateur européen en soit d’accord.
S’agissant du sérieux du label, vous vous interrogez sur le devenir des animaux pour lesquels un souci est apparu lors de l’abattage. Ainsi que je l’ai expliqué, ce qui fait la force d’un label, c’est le cahier des charges et le plan de contrôle. Je prends le cas du poulet label rouge : lorsqu’il se produit des « loupés » dans l’élevage, on déclasse. Déclasser un lot ne signifie pas nécessairement remettre en cause toutes les pratiques de l’établissement ; on prend les mesures correctives si nécessaire et le lot suit un circuit économique différent. Certes, cela représente une perte financière puisque le produit n’est pas vendu au même prix. Mais ce sont des choses qui arrivent tous les jours dans toutes les certifications : un écart par rapport aux exigences entraîne un déclassement du lot ou de l’animal, mais pas nécessairement la perte du label.
Il est très difficile aujourd’hui de savoir ce qu’est un juste prix. La CLCV considère qu’un juste prix est un prix équitable pour tous les maillons de la chaîne de valeur. Tirer les prix vers le bas n’est pas la meilleure solution.
Vous avez fait remarquer que le coût de l’étiquetage est faible. En effet, une bonne partie du coût final de la viande est absorbée par l’étape de transformation. Dans les travaux de l’observatoire des prix, il apparaît que les ateliers de découpe entrent pour une bonne part dans la formation du prix de la viande : le steak haché, c’est une étape de plus… Le coût de l’abattage n’est pas un élément bloquant. Affirmer que l’intégration du bien-être animal va inévitablement se traduire par une forte augmentation des prix me semble fortement exagéré. Il faut d’abord une prise de conscience des opérateurs que le souci du bien-être animal devient une nécessité.
Le fossé est grandissant entre le consommateur et ce qu’il mange, vous l’avez dit. Nous sommes éloignés des animaux que nous mangeons et des agriculteurs qui nous fournissent à manger. Cette distance biaise la perception qu’a le consommateur de ce qu’est un aliment, de la formation de son prix, du travail nécessaire pour le lui fournir de la part des agriculteurs et des opérateurs qui forment la chaîne de valeur.
Néanmoins, s’interdire de s’interroger aujourd’hui sur ce que pourrait être le bien-être animal des espèces que nous mangerons demain me semble nier le principe même du bien-être animal.
M. le rapporteur. Ce n’est pas du tout ce que j’ai dit. Je pense que la question du bien-être animal, quelles que soient les techniques, sera toujours posée et que le souci de la mise à mort de l’animal dans les meilleures conditions demeurera. Je voulais dire que cette question est permanente, et non la nier, au contraire.
Mme Maria Celia Potdevin. Pardonnez-moi, j’avais peut-être mal interprété votre question qui renvoie à l’expertise scientifique que j’évoquais précédemment. Si on connaît assez bien les déterminants de la souffrance chez une volaille, pour de nombreuses autres espèces, on manque vraiment d’indicateurs, notamment pour les animaux que nous n’élevons pas encore ou que nous élevons mais qui nous semblent très éloignés, comme les poissons. Je suis parfois surprise des questions des consommateurs sur les conditions d’élevage ou d’abattage des espèces qui semblent calquer nos sentiments humains sur les leurs. Faute d’expertise scientifique pour documenter le confort d’un poisson dans un bassin ou son degré de souffrance quand on l’abat, nous sommes incapables de leur apporter une réponse. C’est la raison pour laquelle j’ai insisté sur l’accumulation de connaissances et la nécessité d’anticiper. Si dans dix ans, le problème de l’élevage des insectes et de leur souffrance lors de leur abattage se pose, on ne pourra pas demander aux chercheurs de l’étudier : il faut s’y intéresser dès maintenant.
Nous connaissons bien les CLIS où certains de nos membres sont amenés à siéger. Cet organe de transparence permet à des relais dans la société de mieux connaître les boîtes noires qui peuvent exister autour de nous, en posant des questions à un professionnel qui va prendre le temps d’expliquer. À l’instar des comités de surveillance qui sont installés auprès de nombreux organismes, dont les hôpitaux, ce pourrait être une bonne solution de créer un lieu d’échange. Il n’y a rien de pire que deux mondes qui s’ignorent et qui ne se parlent pas. Il faut un lieu où ces questions peuvent être débattues, mises à plat, en toute sérénité. Dans des débats de cette nature, on a besoin de sérénité pour construire son information, ce qui n’est pas toujours le cas.
Lorsqu’on visite un abattoir, on ne visite plus jamais la partie dédiée à la tuerie. Je sais bien que ce lieu ne peut pas être montré à tout le monde. Mais je me demande parfois si le fait de ne jamais pouvoir le visiter ne nuit pas aux abattoirs : est-ce parce que ce n’est pas montrable ou parce qu’il s’y passe des choses anormales ? Dans la tête des gens, le raccourci peut être fait. Il serait intéressant que des personnes expertes puissent relayer auprès d’autres ce qu’il se passe dans les abattoirs : ce n’est pas forcément agréable, mais si on veut manger de la viande, c’est inévitable.
Mme Françoise Dubois. Nous manquons de temps, mais je souhaite revenir sur la formation du personnel. Nous devons étudier cette question de très près car, comme vous l’avez dit, la formation pour nombre de personnels semble insuffisante, voire inexistante. Doter les RPA du statut de lanceur d’alerte me paraît être une bonne idée. La formation est sans doute beaucoup trop courte et incomplète.
Mme Maria Celia Potdevin. Ce problème nous semble essentiel. Tant qu’il ne sera pas réglé, il n’y aura pas de personnel compétent et performant. Les RPA sont censés être les garants des bonnes pratiques.
Mme Annick Le Loch. La CLCV est une grande organisation de consommateurs, soucieuse des prix à la consommation et du pouvoir d’achat. Vous l’avez dit, la viande est un produit cher. Quel regard portez-vous sur la crise des éleveurs ? Les producteurs de viande bovine notamment ont des revenus extrêmement faibles. Notre modèle, qui n’a rien à voir avec le modèle américain qui repose sur une concentration d’animaux tout à fait exagérée, connaît des difficultés majeures. Certains distributeurs se livrent aujourd’hui à une guerre des prix à tous les niveaux. Si demain, l’un d’entre eux décide de faire du bio low cost, pourra-t-on intégrer les coûts de l’abattage, en particulier le bien-être animal ?
Quel regard portez-vous sur cette filière qui ne va pas bien aujourd’hui ?
M. William Dumas. Nos éleveurs et nos viticulteurs ont fait d’énormes progrès dans bien des domaines. Les circuits courts prennent de l’importance. Je le vois dans mon département où est organisée, deux ou trois fois par an, l’opération « bienvenue à la ferme » qui permet aux consommateurs de rencontrer les éleveurs. Une partie des gens ne regardent plus le label, ils préfèrent rencontrer directement ceux qui produisent et constatent que les animaux sont bien soignés.
Je vous livre une anecdote en écho à vos propos sur l’impossibilité de voir les postes d’abattage. Je faisais partie du jury d’un festival taurin au cours duquel des Suisses ont présenté un film sur la filière économique taurine : les taureaux ne sont pas seulement faits pour les raseteurs dans l’arène, les manadiers doivent pouvoir abattre les taureaux qu’ils produisent et le taureau de Camargue bénéficie d’une IGP. La vue du sang par les 700 ou 800 spectateurs présents a provoqué des réactions terribles. Nous avions attribué à ce film le deuxième prix : cela a suscité un tollé. Il faut faire attention, car les gens aujourd’hui ne sont pas prêts à voir le sang.
M. le président Olivier Falorni. Je pose une dernière question à laquelle vous ne pourrez peut-être pas répondre : avez-vous une opinion sur les abattoirs mobiles ? Les avis sont très tranchés sur cette idée, certains la considérant comme totalement farfelue, d’autres en faisant un exemple intéressant, voire un modèle. Je sais que je sors un peu de votre champ de compétence…
Mme Maria Celia Potdevin. Je vais me débarrasser tout de suite du sujet des abattoirs mobiles, qui, il est vrai, ne fait pas exactement partie de notre champ de compétence. Il me semble que ce n’est pas à nous qu’il n’appartient pas de se prononcer. Plusieurs questions se posent : la qualité du contrôle sera-t-elle identique dans ces gros camions à celle d’un abattoir fixe ? Comment les conditions d’hygiène et les conditions environnementales – le traitement des effluents – seront-elles garanties ? C’est à la filière de s’exprimer.
Nous avons été amenés cet été à nous prononcer sur la crise de l’élevage, que l’on ne saurait nier. Pour moi qui suis ingénieur agronome, un tel phénomène est assez perturbant : il me semble dommageable que celui qui produit de la nourriture ne soit pas en mesure de vivre décemment. Il y a là quelque chose d’illogique.
Nous avons réfléchi aux moyens de garantir une vie décente des agriculteurs grâce à leur travail. Deux modèles s’opposent : celui de la concentration et celui du circuit court. Si la concentration n’est pas dictée par la volonté de faire du chiffre pour faire du chiffre mais répond à un réel besoin, il ne faut pas la dénigrer par principe. Si le modèle économique est aberrant – s’il ne s’agit plus de produire et de vendre de la viande mais de produire et de vendre du méthane, comme dans certains élevages de porc en Allemagne –, je ne pense pas que cela soit la bonne solution pour l’agriculture, en tout cas pour l’agriculture telle que la conçoivent les Français. Le circuit court est un moyen de réassurance important. Mais il ne faut pas oublier que certaines personnes sont très éloignées du circuit court car elles habitent dans les grands centres-villes. Le circuit court permet en effet de très bons échanges entre les consommateurs et les producteurs. C’est une manière de réduire le fossé qui s’est creusé entre deux mondes qui s’ignorent désormais.
La CLCV a mis en place plusieurs structures qui favorisent les échanges, organisent des rencontres, et mettent à disposition des flyers sur lesquels sont recensés les points de vente collectifs, les adresses de producteurs à proximité. Ces structures existent en province dans les villes moyennes autour desquelles sont encore installés des agriculteurs. Lorsqu’on est dans de grandes métropoles, il est plus compliqué de récréer ce lien. D’où l’idée d’une labellisation, qui est la première porte d’entrée pour le consommateur qui fait ses achats en grande surface – c’est malheureusement là qu’il effectue en premier lieu ses achats alimentaires. Le consommateur qui se pose des questions sur son alimentation et qui veut aller vers plus de qualité va en premier lieu se tourner vers les labels. Ensuite, il sera amené à se poser plus de questions ; dans ce cas-là, notre travail consiste à mettre en relation agriculteurs et consommateurs. Et il est vrai que cela marche très bien.
J’habite en Nord-Pas-de-Calais et je suis responsable d’une association locale sur le littoral de la Côte d’Opale. Nous avons organisé un cycle de rencontres avec des producteurs, dont certains en démarche bio, des points collectifs, des producteurs en démarche bio mais aussi des entreprises agroalimentaires de taille humaine présentes sur le territoire qui travaillent en label rouge, pour expliquer le fonctionnement et pour briser cet aspect « boîte noire ». Les producteurs aussi posent des questions aux consommateurs. Ce temps d’échange est très important pour les uns et pour les autres. Cela contribue à la réassurance ; celle-ci ne passe plus par le label mais par la connaissance de la pratique de celui qui vend. Malheureusement, cette possibilité n’est pas donnée à tous puisque tout le monde n’a pas une ferme à proximité de chez soi.
M. le président Olivier Falorni. Nous avions souhaité entendre les grandes associations de consommateurs ; vous nous confortez dans notre choix car votre intervention apporte un éclairage très intéressant. Je tenais à vous en remercier.
Mme Maria Celia Potdevin. Je souhaitais également vous remercier au nom de Mme Reine-Claude Mader, la présidente de la CLCV, d’avoir fait l’effort d’écouter une association de consommateurs alors qu’il nous semblait au départ que seul l’avis des associations responsables du bien-être animal était sollicité. Il nous paraît important que notre parole qui représente celle de tout le monde, y compris la vôtre puisque vous êtes tous consommateurs, puisse être portée.
La séance est levée à dix heures dix.
——fpfp——
20. Audition, ouverte à la presse, de M. Michel Baussier, président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires de France (CNOV) et de M. Laurent Perrin, administrateur de la fédération des syndicats vétérinaires de France (FSVF) et secrétaire général du Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL)
(Séance du jeudi 2 juin 2016)
La séance est ouverte à dix heures quinze.
M. le président Olivier Falorni. Mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Michel Baussier, président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires de France (CNOV), et M. Laurent Perrin, administrateur de la Fédération des syndicats vétérinaires de France (FSVF) et secrétaire général du Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL).
L’Ordre national des vétérinaires est l’organisme qui représente tous les vétérinaires sur le sol français. Il est administré par vingt conseils régionaux et par un conseil national. Monsieur Baussier, vous êtes médecin vétérinaire depuis 1975 – autrement dit, vous avez une grande expérience – et président de l’Ordre national des vétérinaires depuis 2010.
Le 24 novembre 2015, lors d’un colloque organisé au Sénat, l’Ordre s’est engagé en faveur du bien-être animal en appelant les vétérinaires « à réfléchir et à débattre sur le rôle du vétérinaire en tant qu’expert du bien-être animal ». C’est une dimension importante dans le cadre de notre audition de ce matin. En conclusion du colloque, le CNOV s’est déclaré favorable à la perte de conscience systématique de tous les animaux de rente avant leur mise à mort, ainsi qu’à un strict respect des dérogations à l’étourdissement préalable avec un étiquetage informatif clair pour identifier les animaux abattus sans étourdissement. Nous reviendrons sur cette position extrêmement précise.
Le Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral que vous représentez, Monsieur Perrin, a été créé en 1993. Cette organisation professionnelle a pour but de promouvoir les intérêts des vétérinaires libéraux. Je crois pouvoir dire que vous défendez grosso modo les mêmes positions que le CNOV concernant l’abattage et l’étiquetage des animaux.
Je vous rappelle, messieurs, que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Michel Baussier et M. Laurent Perrin prêtent successivement serment.)
M. Michel Baussier, président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires de France (CNOV). Mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de m’accueillir en tant que président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires de France.
L’Ordre représente les 18 000 vétérinaires du secteur privé et libéral. Autrement dit, il ne représente pas l’ensemble des vétérinaires, et notamment pas les vétérinaires du secteur public.
Sur ces 18 000 vétérinaires, on compte 16 000 praticiens, c’est-à-dire ceux qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux et que le public connaît comme étant les médecins de l’animal. Ces vétérinaires ont un objectif de santé animale : l’objectif premier du vétérinaire est de prévenir et guérir la maladie, mais aussi de protéger l’animal, ce qui justifie sûrement notre audition devant votre commission aujourd’hui.
Historiquement, le fait de confier la santé animale aux vétérinaires répond d’abord à un objectif de sécurité alimentaire – on n’y pense plus beaucoup dans nos pays européens où l’on ne meurt pas de faim. Il s’agissait de soigner les animaux, pas forcément pour eux-mêmes mais surtout pour permettre à l’homme de se nourrir. Aujourd’hui, cet objectif de sécurité alimentaire demeure extrêmement important pour les vétérinaires dans le monde, mais sûrement pas en Occident.
On leur a confié aussi une mission de santé publique : il n’y a pas de mission de santé animale et de protection animale sans préoccupation majeure de santé publique. Ils veillent à la sécurité sanitaire des aliments – cela rejoint l’une des missions des vétérinaires dans les abattoirs –, à la santé environnementale et luttent contre les zoonoses, c’est-à-dire les maladies animales transmissibles à l’homme.
En quoi l’Ordre est-il concerné par vos travaux puisqu’il ne comprend pas les vétérinaires inspecteurs qui interviennent dans les abattoirs dans le cadre de la fonction publique ? Certes, un certain nombre des vétérinaires qui inspectent les animaux sont en réalité des vacataires : ils appartiennent au secteur privé et interviennent dans le cadre d’une mission qui leur est dévolue par l’État. Mais, dans le cadre de cette mission précisément, ils ne relèvent pas directement de l’autorité de l’Ordre. Cela étant, ces praticiens, qui sont peut-être au nombre de 500 en France et qui sont par ailleurs généralement inscrits au tableau de l’Ordre, n’en sont pas moins tenus au respect d’un code de déontologie. L’Ordre est concerné parce que ces vétérinaires ont une mission de protection animale – la protection de l’animal est devenue la motivation première des jeunes qui veulent devenir vétérinaires. Mais surtout, les vétérinaires que je représente sont tenus au respect d’un code de déontologie vétérinaire qui est pris sous forme d’un décret en Conseil d’État, imposé par la République française à l’ensemble des vétérinaires qui relèvent de l’Ordre. Ce code de déontologie impose aux vétérinaires de respecter l’animal et d’avoir parmi leurs objectifs d’atténuer ou de supprimer la souffrance, chaque fois que cela est nécessaire.
Au demeurant, même si nous n’avons pas été directement concernés en tant qu’ordre par les scandales qui nous amènent à nous réunir aujourd’hui, l’idée que la société se fait du rôle des vétérinaires et de l’Ordre des vétérinaires est telle que de toute façon nous sommes interpellés par les médias ou les citoyens sur ce qui s’est produit dans les abattoirs, même si, je le répète, cela ne relève pas de l’autorité de l’Ordre.
L’article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime qui institue notre ordre a été légèrement modifié au mois d’août dernier. Cet article précise que : « L’Ordre des vétérinaires peut participer à toute action dont l’objet est d’améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal. » En fait, nous avions un peu anticipé cette évolution : si mes prédécesseurs considéraient que l’Ordre n’avait pas de légitimité particulière à prendre position sur toutes les questions de société qui touchaient à la relation entre l’homme et l’animal, au bien-être animal, nous avons considéré sous ma présidence que cette situation ne pouvait perdurer, l’Ordre étant régulièrement interpellé par la société. Il m’est arrivé, sur certains sujets, de recevoir des milliers de pétitions reprochant à l’Ordre de rester silencieux et à la profession de ne pas s’exprimer sur ces questions de société dans le cadre de la relation entre l’homme et l’animal. Aussi avons-nous décidé d’instituer au sein du Conseil national de l’Ordre un pôle de réflexion sur la relation entre l’homme et l’animal, et de désigner au sein de nos vingt conseils régionaux des référents éthiques de la relation entre l’homme et l’animal. Des débats ont eu lieu, qui ont conduit nos 200 représentants à considérer que nous devions nous emparer d’un certain nombre de sujets : les conditions d’élevage des animaux dans les élevages industriels, la corrida, etc. La mission qui m’avait été confiée par ces référents à la suite de débats concernait précisément la manière dont les animaux étaient traités en abattoir et la question de leur étourdissement. Vous avez rappelé, monsieur le président, l’engagement de l’Ordre lors du colloque organisé au Palais du Luxembourg, au mois de novembre dernier, sur le thème du vétérinaire expert du bien-être animal ; autrement dit, il ne s’agit pas d’un point de vue personnel, mais bien d’une position de l’Ordre prise à la suite des débats organisés au sein de ses conseils régionaux.
L’abattoir reste un abattoir, l’image d’un abattoir ne pourra jamais être celle du paradis terrestre. Il ne faut pas avoir peur des mots : on y égorge des animaux, il y a forcément du sang. Il est facile de jouer, comme le font certaines associations, avec ces images spectaculaires. L’abattage n’a rien d’un spectacle idyllique. Mais celui d’une intervention chirurgicale dans une salle d’opération ne l’est pas davantage…
Ce que nous exigeons, c’est que l’animal y soit respecté en tant que tel, qu’il ne souffre pas et que toute souffrance évitable soit évitée, et ce dans toutes les phases jusqu’à la mort – transport, amenée à l’abattoir. Même si la souffrance ne dure que trente secondes ou une minute, on ne doit pas l’accepter, pour les animaux eux-mêmes, mais également pour la dignité de l’homme. L’homme doit pouvoir se regarder dans la glace et se considérer en tant qu’homme dans sa relation vis-à-vis des animaux. C’est également très important pour les éleveurs et la filière élevage : moi qui suis fils et frère de paysans, je peux dire qu’aujourd’hui les éleveurs de France prennent grand soin, et de plus en plus, de leurs animaux, même si, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il est intolérable que les efforts des éleveurs et de la filière élevage soient gâchés dans la dernière minute de vie de l’animal à l’abattoir. Ne serait-ce que pour cette raison, on doit être intransigeant sur la manière dont les animaux sont traités à l’abattoir.
M. Laurent Perrin, administrateur de la Fédération des syndicats vétérinaires de France (FSVF) et secrétaire général du Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL). À mon tour, je tiens à vous remercier de nous avoir invités à participer à vos travaux.
La Fédération des syndicats vétérinaires de France regroupe la plupart des vétérinaires libéraux, soit d’exercice classique – les vétérinaires praticiens en cabinet –, les vétérinaires conseils davantage impliqués dans les filières organisées porcs et volailles, les vétérinaires salariés d’entreprises dans le secteur des coopératives agricoles, mais aussi les vétérinaires spécialistes canins titulaires des collèges européens, les vétérinaires retraités, les enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises et les inspecteurs de santé publique vétérinaire que vous avez déjà auditionnés.
Mon rôle de secrétaire général du Syndicat fera que je parlerai aussi au nom des praticiens d’exercice libéral. Comme l’a indiqué Michel Baussier, de par leur choix de carrière, leur formation et leur investissement en élevage, ces praticiens sont parfaitement conscients de la nécessité de gérer le bien-être animal. Ils le font en permanence, soit lorsqu’ils soignent les animaux malades, soit dans leur action de conseil en élevage, y compris en structures de bâtiments ou d’alimentation, de façon à obtenir des animaux bien entretenus en élevage. Ce partenariat avec nos éleveurs se poursuit jusqu’à l’abattoir. Les images qui ont été diffusées par l’association L214 ont choqué fortement les vétérinaires qui les condamnent, car elles sont abominables, même s’il ne faut pas en faire une généralité dans les abattoirs. Elles ont aussi fortement choqué les éleveurs qui prennent soin de leurs animaux et qui entendent que cela reste le cas jusqu’au bout de la chaîne.
Plus de 500 vétérinaires libéraux interviennent dans les abattoirs à temps partiel en tant que vacataires. Pour ma part, j’assure l’inspection dans un tout petit abattoir local multi-espèces, qui traite environ 400 tonnes par an. Je suis amené à intervenir en abattoir tous les jours, et je partage mon poste avec un collègue avec lequel je suis associé. Il est évident que notre présence en élevage et en abattoir fait que nous sommes également très impliqués dans l’amélioration des conditions d’abattage. Même si je suis installé depuis un peu moins longtemps que Michel Baussier, cela fait tout de même trente-deux ans que je suis inspecteur dans l’abattoir de la commune où je réside.
M. le président Olivier Falorni. Selon vous, quelles sont les priorités pour améliorer le bien-être animal à l’abattoir ? Que pensez-vous du référent bien-être animal ? Êtes-vous favorables à l’installation de caméras de vidéosurveillance ? Que pensez-vous de la mise en place d’un comité d’éthique dans chaque abattoir ?
Comment évaluez-vous les compétences des opérateurs en abattoir en termes de bien-être animal ? Considérez-vous que les effectifs de contrôle sont suffisants ? Une augmentation du nombre de vétérinaires au poste d’abattage serait-elle souhaitable ?
Pouvez-vous nous expliquer comment le vétérinaire est rémunéré par l’abattoir qui l’emploie ? Quels sont les rapports entre les vétérinaires et les abattoirs ? Quelles sont vos relations avec les associations de protection animale – particulièrement l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) ?
M. Michel Baussier. Vous nous demandez ce que nous pensons du référent protection animale ; cette solution nous paraît aller dans le bon sens. Toutefois, on a pu voir dans les exemples récents que tel ou tel référent était particulièrement impliqué, ce qui montre les limites de l’exercice.
Pour ce qui est de la vidéosurveillance, je dirai spontanément que nous y serions plutôt favorables, sous réserve des règles que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est susceptible d’édicter.
M. le président Olivier Falorni. Vous n’êtes pas opposé au principe.
M. Michel Baussier. Nous n’y serions pas opposés, effectivement. Certes, c’est une pression exercée sur les ouvriers, une contrainte, mais je pense que cela va plutôt dans le bon sens.
Personnellement, je suis favorable à la mise en place d’un comité d’éthique. J’établirai un parallèle avec les comités d’éthique dans le domaine de l’expérimentation animale qui ont permis de réaliser de nombreux progrès en la matière. Je suis spontanément tenté de penser que le parallèle devrait pouvoir jouer, même si cette question n’a pas fait l’objet de débat avec mes fameux référents dont je vous parlais tout à l’heure.
Je suis en revanche très réservé s’agissant de la compétence des opérateurs en bien-être animal. Je pense que l’État doit continuer à disposer de ses missions régaliennes, en matière de sécurité sanitaire des aliments, mais aussi en ce qui concerne le bien-être animal. Il faut donner la possibilité à des inspecteurs de santé publique vétérinaire d’être présents dans les divers postes de l’abattoir et de pouvoir effectuer leur mission. Notre société, qui a les yeux braqués sur cet aspect, comprendra facilement que les contrôles font partie des missions régaliennes de l’État.
Je laisserai M. Perrin s’exprimer sur la rémunération des vétérinaires dans les abattoirs.
Vous nous demandez quelles sont nos relations avec les associations de protection animale. L’Ordre, qui représente l’ensemble des vétérinaires du secteur privé de France, a vocation à entretenir des relations avec les diverses organisations qui ont un lien direct avec l’animal, qu’il s’agisse des organisations professionnelles agricoles ou des associations de protection animale. En tant que vétérinaire praticien, j’avais spontanément adhéré à l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, bien avant de me voir confier des missions ordinales et bien avant que cette association soit présidée par un vétérinaire. Le vétérinaire praticien rural que je suis, qui a exercé son activité au cœur du Charolais, avait pris conscience que les éleveurs eux-mêmes étaient très attachés à la protection animale.
Rappelons toutefois que la mission des vétérinaires répond historiquement à un objectif de sécurité alimentaire : il ne s’agit donc pas de remettre en cause le fait de consommer de la viande. La position de l’Ordre des vétérinaires est celle du respect de l’animal ; on doit lui éviter toute souffrance. Cela étant, nous sommes loin de la position des antispécistes. Il ne faut pas se tromper sur le sens de ces « reportages », de ces captures d’images faites de façon cachée à l’insu des personnes, et dont l’objectif est d’amener la population à renoncer à la consommation de viande animale. Nous ne sommes pas du tout sur cette ligne. Il s’agit pour nous de respecter l’animal, ce qui est une façon de se respecter en tant qu’homme.
M. Laurent Perrin. Le référent bien-être animal n’offre pas de garantie totale, en particulier parce que cette personne est salariée de l’abattoir.
Je ne suis pas sûr que l’on fera beaucoup avancer les choses en installant des vidéos qui fonctionneront vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Autant mettre directement une personne au poste d’abattage qui pourra éventuellement agir en cas de problèmes. Votre commission a évoqué la possibilité d’une vidéosurveillance qui pourrait être déclenchée par le salarié et qui reviendrait sur les quinze ou trente dernières minutes. C’est une bonne idée. Cela permettrait, en cas d’inspection inopinée au poste de saignée, de voir si le problème s’est posé précisément au moment de l’arrivée de l’inspecteur, ou si cela fait déjà dix ou quinze minutes que quelque chose ne va pas. Je ne parle pas des réserves qui s’imposent en termes de protection du personnel vis-à-vis de la direction.
Je suis favorable à la mise en place d’un comité d’éthique, mais sur le modèle des comités locaux d’information et de surveillance. Il ne doit pas s’agir d’un comité de super-experts : ils sont déjà présents dans les abattoirs via les inspecteurs de la santé publique vétérinaire (ISPV), ils peuvent être représentés par des vétérinaires libéraux. Il faut pouvoir y faire entrer des usagers des abattoirs – bouchers, éleveurs –, des associations de protection animale, des représentants de la société civile. Cela étant, comme l’a indiqué M. Baussier, il faut se rappeler qu’un abattoir ne sera jamais un spectacle agréable, même quand tout se passe bien. Entrer dans un abattoir reste un choc pour qui n’est pas prévenu ni formé. Sans parler des cadences : pour ma part, j’ai la chance de travailler dans un abattoir où tout se passe bien, et où les cadences ne sont pas élevées. Mais dans un établissement où les cadences sont fortes, avec des tueries très rapprochées, c’est encore plus impressionnant.
Vous nous interrogez sur les compétences des opérateurs en termes de bien-être animal. Dans des abattoirs de faible volume où les rapports entre services d’inspection et personnels sont proches en raison du nombre peu élevé de salariés – pour ma part, je travaille dans un abattoir qui emploie cinq personnes qui abattent – il est assez simple de faire monter les gens en compétence. Cela se fait par la confiance, la présence des vétérinaires. Effectivement, il faudra progresser dans les abattoirs de grande taille.
Au poste de saignée, il ne doit pas y avoir de rotation – même si cela signifie que les opérateurs risquent de développer des troubles musculosquelettiques. Il faut des spécialistes de l’étourdissement et de la saignée, et particulièrement bien formés, car ce n’est pas un travail facile. Quant aux matériels mis à leur disposition, ils doivent être très bien adaptés au volume des animaux traités, particulièrement dans les outils multi-espèces où les cages ne sont pas toujours parfaitement adaptées à tous les volumes d’animaux. Mais ce problème de matériel sera compensé si l’opérateur est très expérimenté.
J’ai déjà répondu tout à l’heure à la question du nombre de vétérinaires en parlant du référent bien-être animal.
Les vétérinaires qui interviennent en abattoir sont rémunérés par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), autrement dit par l’État. Ils ne dépendent absolument pas de l’abattoir. Mais le système peut trouver ses limites quand un vétérinaire qui fait de grosses missions dans un abattoir de grande taille en dépend pour 50 ou 60 % de son revenu. Pour ma part, si j’exerce un droit de retrait demain, cela ne mettra pas en péril mon revenu : pour parler franchement, la part de l’abattoir est anecdotique – c’est presque du service. Ce sera plus compliqué pour un vétérinaire qui tirera une grande part de son revenu.
Ainsi que l’a dit Michel Baussier, la mission initiale de protection des animaux à l’abattoir ne doit pas dériver vers l’interdiction de la consommation de viande.
Un inspecteur de l’OABA est venu une fois dans l’abattoir où je travaille. Nous l’avons reçu. Cela ne me pose aucun problème dès lors que la mission qui nous est présentée est celle de la protection animale en abattoir.
M. Thierry Lazaro. Notre commission d’enquête a reçu hier trois universitaires spécialistes de l’abattage rituel, dont une spécialiste de la religion juive et un spécialiste de la religion musulmane. Ils ont parlé de la notion même de la mort. M. Benhkeira s’est demandé, en substance, si le fait d’étourdir n’était déjà pas la mort. Je suis de ceux qui pensent que mourir peut prendre du temps, mais le fait d’être mort est un moment instantané. Je ne partage pas tout à fait le sens de son interrogation.
Mme Brisebarre a fait état d’avis plutôt contrastés sur l’étourdissement lui-même, rappelant que certains experts pouvaient considérer que l’étourdissement n’empêchait pas la conscience et que, dès lors qu’il y avait conscience, il pouvait y avoir souffrance.
Monsieur Baussier, vous avez rappelé – et cela m’a bien plu – que même si la souffrance ne dure que trente secondes ou une minute, on ne doit pas l’accepter. Vous qui êtes, si j’ai bien compris, des spécialistes depuis un peu de temps (sourires), considérez-vous que dès lors qu’il y a étourdissement la bête est sans conscience, quelle que soit la méthode employée pour l’étourdir, matador ou CO2, et que dès lors qu’elle est sans conscience, elle ne souffre pas ?
M. Hervé Pellois. De moins en moins de vétérinaires travaillent sur la production agricole en tant que telle. Bon nombre préfèrent s’orienter vers les animaux familiers et sont plus au fait de l’euthanasie que du sujet qui nous occupe aujourd’hui. Et sans doute, dans leur subconscient, vos clients font-ils plus facilement la liaison entre la mort d’un animal familier par euthanasie et la mort des animaux en abattoir. Il est évident que cela ne peut pas être la même chose, cela ne peut pas se pratiquer de la même façon.
Monsieur Perrin, vous travaillez dans un petit abattoir qui traite 400 tonnes par an et qui emploie cinq personnes – nous en connaissons qui fonctionnent avec trois ou quatre employés seulement. Vous nous avez dit que l’abattage et la saignée devaient toujours être pratiqués par les mêmes personnes. Mais nous avons du mal à remplacer de manière inopinée un agent qui tombe malade ou qui se blesse – j’ai vécu cela dans un petit abattoir. C’est un vrai problème pour les responsables d’abattoirs. Ne pourrait-on pas mettre en place une sorte de service de remplacement, un système de personnel mobile ?
Lorsque vous officiez en tant que vétérinaire inspecteur, vous n’êtes pas en permanence toute la journée dans l’abattoir. Comment exercez-vous les contrôles ? Est-ce vous qui vous chargez du contrôle ante mortem ? Que faites-vous vraiment dans un abattoir au regard de ce qui concerne le bien-être animal ?
M. William Dumas. Monsieur Perrin, vous intervenez dans un abattoir très similaire à celui du Vigan, situé dans ma région, où l’association L214 a enregistré des vidéos. Vérifiez-vous les conditions de transport, de stockage des animaux avant qu’ils arrivent sur la chaîne d’abattage ? Ces petits abattoirs sont multi-espèces : on y abat aussi bien des agneaux, des bovins que des cochons. C’est sûrement là que l’on peut rencontrer les plus gros problèmes. Parfois, le matériel n’est pas adapté. Les abattoirs standardisés qui n’abattent qu’une seule espèce ont certainement moins de problèmes avec le matériel que dans les petites unités. Qu’en pensez-vous ?
Vous avez dit que le poste de saignée nécessitait que les gens soient bien formés. Qu’entendez-vous par là ?
L’abattoir qui est implanté dans ma circonscription pratique beaucoup l’abattage rituel – cela représente environ 50 % de son activité. Que pensez-vous des compétences des sacrificateurs ? Certaines mosquées acceptent que l’animal soit étourdi avant l’abattage, tandis que d’autres ne le veulent pas.
Enfin, que pensez-vous des abattoirs mobiles ?
Mme Françoise Dubois. Bien évidemment, le bien-être animal nous préoccupe tous. Mais le personnel aussi se trouve certainement parfois dans des situations assez difficiles. Vous trouviez que les images étaient difficiles à supporter pour les spectateurs, mais je n’ose imaginer dans quel état d’esprit sont les opérateurs à la fin de la journée, quand ils rentrent à la maison. J’espère qu’ils ne continuent pas à y penser chez eux… Cela suppose assurément une grande résistance psychologique de leur part.
Nous nous sommes aperçus, au cours de nos auditions, que leur formation était vraiment très restreinte. Intervenez-vous dans cette formation ? Est-elle seulement théorique ? N’y a-t-il pas de formation technique ? Se forment-ils sur le tas ? Il ne faut pas louper son coup, il faut être sûr de ce que l’on fait. En même temps, c’est plutôt rassurant de bien maîtriser ses gestes et de bien savoir ce qu’il faut faire pour que l’animal ne souffre pas.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Beaucoup de mes interrogations ont déjà été levées grâce à vos réponses.
Quand l’alerte a été donnée, dans les conditions que vous savez, le ministère a déclenché une inspection systématique dans les abattoirs d’animaux de boucherie sur ce thème du bien-être animal et de la souffrance au moment de l’abattage. Cette enquête a révélé un certain nombre d’anomalies. Cela prouve que le contrôle d’habitude n’était pas suffisamment précis. Vous le savez, l’habitude est une seconde nature : dès lors que l’opérateur est toujours le même, le directeur est toujours le même, la manière de faire est toujours la même, le contrôleur est toujours le même, ne faudrait-il pas aérer le système, avec une mise en réseau, un échange de constats ? On voit bien que des améliorations sont possibles dès lors que l’on apporte un regard extérieur. Nous nous sommes rendus dans l’abattoir d’Autun où le déplacement de deux mètres d’une manette avait fait gagner dix secondes entre l’étourdissement et la saignée. Cela aurait dû être vu ; or cela n’a été vu que par quelqu’un qui venait de l’extérieur. Les vétérinaires qui participent au contrôle n’auraient-ils pas intérêt à se parler entre eux, à échanger, à se retrouver sur des plateformes d’échanges, voire à échanger parfois leurs rôles ? C’est la même chose pour les opérateurs. Comment peut-on gérer cette acquisition de compétences croisées ?
M. Michel Baussier. Je vais intervenir sur les deux ou trois premières questions, laissant à M. Perrin le soin de répondre aux questions plus techniques qu’il connaît mieux car il a l’expérience du travail en abattoir. Pour ma part, j’ai une expérience de praticien, mais je n’ai jamais eu de mission en abattoir, contrairement à certains de mes collègues associés qui y participent régulièrement.
Non, l’étourdissement n’est pas déjà la mort. Du reste, il est question d’étourdissement réversible. Nous sommes de formation scientifique. Notre réflexion se fonde sur les recherches qui ont été menées, notamment par l’Institut national de la recherche agronomique, (INRA). Ce qui compte, pour nous vétérinaires, c’est la perte de conscience. Nous connaissons nous-mêmes l’expérience de la perte de conscience à chaque fois que nous subissons une anesthésie…
Je veux insister fortement sur le fait que nous avons pris position sur la nécessité d’une perte de conscience. Mais je veux y insister : jamais l’Ordre des vétérinaires, institution de la République qui respecte parfaitement la laïcité, n’a remis en cause les rites et les abattages rituels. Je n’ai jamais prononcé ce terme de remise en cause de l’abattage rituel. Du reste, les rites ont évolué au cours de l’histoire : la religion juive, par exemple, est l’une des trois religions du Livre qui s’est le plus préoccupée, dès l’origine, de la protection de l’animal. Il s’agissait de faire en sorte d’atténuer au mieux la douleur. Ensuite, l’évolution des connaissances, de la science est telle que le rite peut évoluer dans ses modalités, sans que pour autant les fondements mêmes de la religion soient remis en cause. C’est en cela que nous sommes intervenus.
S’agissant de l’islam, nous constatons que les modalités sont extrêmement variables dans le monde. Je connaissais bien l’un des vétérinaires inspecteurs de l’abattoir d’Autun : le sacrificateur exigeait l’étourdissement préalable… Ce n’est pas forcément ce que l’on entend dire en haut lieu. Mais, sur le terrain en tout cas, le sacrificateur exigeait, pour des raisons qui lui sont propres, que l’animal soit étourdi.
Non, l’étourdissement, ce n’est pas la mort. Mais, je le répète, l’Ordre des vétérinaires, qui est une institution républicaine laïque, n’a jamais remis en cause l’exercice des cultes. Je le revendique très fortement.
Il n’y a pas très longtemps, à l’occasion d’un déjeuner-débat sur les questions d’éthique autour de l’expérimentation animale, je me suis retrouvé assis en face d’une journaliste très impliquée dans la protection animale. Elle parlait d’euthanasie préalable à l’abattoir… Cela montre bien la grande confusion qui peut exister dans l’esprit du public. On n’injecte pas une substance à un animal que l’on va immédiatement consommer !
Je n’ai pas compris, monsieur Pellois, votre allusion aux vétérinaires canins…
M. Hervé Pellois. Si j’ai fait ce lien, c’est pour dire que sur les 16 000 vétérinaires que compte notre pays, un petit nombre seulement s’occupe des animaux d’élevage. Pensez-vous que le consommateur puisse faire dans sa tête la relation entre la mort de son animal familier et la mort de l’animal qu’il mange ? Avez-vous ce genre de discussions avec vos clients ?
M. Michel Baussier. Les vétérinaires mixtes que nous sommes tous les deux ont souvent affaire à des clients qui sont tout à la fois propriétaires d’animaux de rente et d’animaux de compagnie. L’urbanisation de nos sociétés a conduit à une sorte de rupture du lien entre l’homme et la terre, et du coup avec la mort : à la campagne, on vit la naissance, la vie, la mort, c’est quelque chose de beaucoup plus naturel.
Effectivement, nous avons ce genre d’échanges. En cela, le vétérinaire participe à cette interface entre le citadin, qui n’a plus cette culture de la vie et de la mort, et l’homme de la terre. Au cours de vos auditions, il a été question d’une « boîte noire ». On identifie parfois la vache et le petit veau à un animal de compagnie : cela vient de cette rupture entre le citadin et l’homme de la terre.
M. Laurent Perrin. Vous nous interrogez sur les remplacements dans les abattoirs. Dans l’abattoir où j’exerce, nous avons formé trois opérateurs à l’étourdissement. Mais nous essayons de faire tourner le plus rodé sur le même poste. C’est seulement en interne que l’on pourra prévoir un service de remplacement, en formant toutes les personnes présentes. Il n’est pas possible de mettre en place un service de remplacement entre les abattoirs.
La formation doit être dispensée à suffisamment de personnes pour que le poste puisse être occupé. Ensuite, c’est la dextérité qui sera privilégiée en faisant travailler en particulier un des opérateurs.
J’en viens à la présence vétérinaire dans les petits abattoirs. Dans l’abattoir où je travaille, il s’agit d’un quart de poste. Nous sommes rémunérés pour dix-neuf heures de présence vétérinaire chacun, mes deux collègues et moi-même, soit trente-neuf heures par mois. La tuerie se fait sur trois à quatre jours – la plupart du temps sur trois jours. Nous sommes présents à l’arrivée des animaux. Nous contrôlons environ 80 % des animaux qui sont abattus. Le reste sera vu par la technicienne vétérinaire qui sera là toute la journée. Je suis présent à l’abattoir entre une demi-heure et une heure et demie. Très souvent, j’assiste à la tuerie des gros bovins – c’est eux que l’on tue en premier. J’assiste aussi à une partie de la tuerie des porcs. Je ne peux pas contrôler la totalité des abattages, mais le relais est pris par la technicienne vétérinaire, même si elle est occupée. Nous sommes dans un petit outil ; le poste d’abattage des bovins est visible de partout. On le voit même lorsque l’on est en train d’inspecter les carcasses. Par contre, le poste d’abattage des porcs et des petits ruminants est à l’autre bout de l’abattoir. Il faut être sur place pour le voir.
Je me rends donc le matin à l’abattoir. Ensuite, comme je travaille sur la même commune, je peux être appelé toute la journée en cas de problème lors de l’arrivée d’un animal. Enfin, je repasse en fin de tuerie pour valider les saisies et sorties de consigne des animaux qui auront été triés par la technicienne qui aura été présente toute la journée à l’abattoir.
Le fait d’être présent sur une grosse partie de la tuerie me permet de penser que le bien-être est aussi respecté lorsque je ne suis pas là. Qui plus est, notre technicienne vétérinaire est femme d’éleveur : elle est donc très sensibilisée à la question du bien-être animal. Enfin, j’ai eu la chance, même lorsque notre structure était très archaïque – c’était le cas lorsque je me suis installé – de travailler avec des opérateurs d’abattoirs qui étaient très soucieux du bien-être animal, mais également du bien-être du personnel. Car mal travailler autour d’animaux mal contenus peut être extrêmement dangereux.
Nous ne pratiquons pratiquement plus d’abattage sur des animaux accidentés. J’ai toujours exigé, sans que cela ait jamais posé de problème à l’abatteur, l’étourdissement des animaux dans les camions de transport. Autrement dit, nous n’avons jamais déchargé d’animaux blessés conscients. La question reste de savoir si cela est toujours possible.
Tout à l’heure, il a été question des problèmes dans les abattoirs traitant de petits volumes. Je ne suis pas sûr que ce soit dans les tout petits abattoirs que les problèmes se posent, mais plutôt dans les abattoirs de moyen volume. Les très gros abattoirs sont très bien équipés en personnel ; mais les petits abattoirs sont un peu comme des structures familiales, si je puis dire, bien que le terme soit mal choisi. Tout le monde se connaît, on se voit beaucoup. Nous sommes écoutés en tant qu’experts et professionnels vétérinaires, mais nous ne sommes pas ressentis comme une pression de contrôle. Nous essayons de conseiller. Cela fait trois mois qu’un salarié est arrivé dans l’abattoir. Il a fallu l’aider, même sur des procédures concernant l’hygiène. Il ne s’agit pas de prendre un carnet et de procéder toutes les cinq minutes à une notification de non-conformité. Il faut lui expliquer qu’à tel endroit il s’y prend mal. Grâce à l’aide de ses collègues et de nous-mêmes, nous arrivons à le faire progresser très rapidement.
Quand je suis présent lors du déchargement, je peux éventuellement faire des remarques sur les conditions de transport. En général, ce sont les éleveurs ou les marchands de bestiaux qui nous amènent les animaux. Mais comme il s’agit de petits volumes, nous ne rencontrons pas de problèmes de transport.
En revanche, au poste de stockage il peut nous arriver de devoir gérer des afflux d’animaux importants : c’est le cas par exemple à Pâques avec les agneaux. Nous arrivons à gérer en étalant les arrivées sur toute la journée. Mon collègue ou moi-même nous rendons à l’abattoir plusieurs fois dans la journée pour vérifier l’ante mortem si c’est nécessaire. Sinon, les techniciens sont sur place.
Comme notre abattoir est multi-espèces, nous pouvons effectivement avoir des problèmes de matériel. Nous avons remis notre outil à niveau ; cela nécessite des investissements monstrueux. Comme je ne fais pas partie du conseil municipal qui gère l’abattoir, je n’ai pas les chiffres ; je sais cependant que cela représente des sommes considérables pour une commune. Notre abattoir ne fait que de la tuerie à façon : il n’y a pas de cheville à l’aval. Les animaux sont abattus au profit des bouchers, des particuliers, ou d’éleveurs du secteur, et les animaux repartent vers des boucheries du secteur. Nous sommes prestataires de services.
Si un jour je devais exercer mon droit de retrait, ce qui me poserait problème, ce ne sera pas la diminution de mon revenu, mais le risque que je ferais peser sur les circuits courts et la consommation locale. Heureusement, je n’ai jamais eu ce genre de souci. Cela m’est arrivé une fois avec un appareil à électronarcose qui ne marchait pas, nous avons fait remonter l’information. La première fois, personne n’a bougé ; la deuxième fois, je suis allé expliquer que la situation ne pouvait plus durer et que si nous ne venions plus à l’abattoir, la tuerie allait devoir s’arrêter ; nous avons été rééquipés très rapidement d’un outil qui fonctionnait.
Si le bien-être animal est important, le bien-être du personnel l’est tout autant. Je ne pourrai pas me prononcer sur les gros abattoirs. Récemment a été rediffusée une émission sur la Société vitréenne d’abattage. On y voyait que la contrainte psychologique et physique était monstrueuse sur ces postes. Dans l’abattoir où je travaille, les opérateurs font presque tout ; nous sommes donc moins confrontés à ces problèmes. C’est vrai, abattre des animaux, ce n’est pas comme travailler dans une maternité… Mais travailler dans une maternité impose aussi de devoir gérer les naissances difficiles ou la mort de nouveau-nés : ce ne doit pas être facile non plus. Ce qui compte après, c’est la répétition du geste et de l’acte.
Le vétérinaire n’intervient pas du tout dans la formation des opérateurs dont la formation est technique. Visiblement, dans les gros abattoirs, ils sont formés sur poste, autrement dit sur le tas.
Je ne me prononcerai pas sur la technicité des sacrificateurs au poste de saignée car nous ne pratiquons pas d’abattage rituel. Deux abattoirs de l’Indre s’en chargent.
Monsieur le rapporteur, effectivement l’habitude est l’un des risques. Mais il est déjà pris en compte puisque nous sommes amenés à faire des réunions régionales avec des référents régionaux des abattoirs qui se déroulent dans un abattoir ou un autre. Nous organisons aussi des réunions départementales entre les personnels des trois abattoirs des services vétérinaires d’inspection, vétérinaires et techniciens, des échanges de pratiques. Comme mon collègue était référent pour le département, il faisait le tour des abattoirs en plus de ses missions dans notre abattoir. Enfin, nous rencontrons les techniciens des autres abattoirs lorsqu’ils effectuent des missions de remplacement. Récemment, les personnels d’un abattoir sont venus voir comment fonctionnait notre système de contention pour les petits ruminants, car ils devaient s’équiper.
Notre abattoir a fait l’objet d’une inspection, dans le cadre des inspections demandées par le ministre de l’agriculture. Des remarques ont été faites sur le déchargement des animaux sur quelque chose auquel on s’était habitué. Mais c’était un détail.
Enfin, vous nous avez interrogés sur la mise en place d’abattoirs mobiles…
M. le président Olivier Falorni. Nous avons évoqué, lors de nos auditions, des expériences qui ont eu lieu en Suède. Un certain nombre d’associations de protection animale y font référence. Quant au ministre, il est beaucoup plus réservé sur le sujet.
Autant une sorte de consensus se dégage sur le principe des caméras de vidéosurveillance, autant les avis sont très tranchés et très catégoriques en ce qui concerne les abattoirs mobiles.
M. Laurent Perrin. Il y a actuellement un manque de cohérence, pour ne pas dire une incohérence entre deux réglementations : celle qui concerne la protection animale pendant le transport des animaux accidentés, et celle qui concerne la possibilité que ces animaux passent dans la chaîne alimentaire humaine. Autrement dit, on a le droit d’abattre des animaux pour les consommer, mais on n’a pas le droit de les transporter jusqu’à l’abattoir ! Cela donne lieu à des abattages à la ferme qui posent deux problèmes. D’abord du point de vue sanitaire : comme ces animaux sont souvent abattus loin de l’abattoir, il faut les transporter sous couvert du froid, ce qui n’est pas toujours pratique. Ensuite, il faut trouver des abattoirs qui acceptent de recevoir des animaux morts, ce qui n’est pas toujours le cas. De surcroît, le vétérinaire doit se déplacer car l’examen ante mortem doit être fait à la ferme. Une structure mobile faciliterait techniquement un abattage dans de bonnes conditions pour que l’animal puisse ensuite aller dans un abattoir. Restera le problème de la technicité de celui qui abattra en ferme. Quand de tels cas se sont présentés, je suis allé chercher un matador à l’abattoir. Puis je me suis rendu chez le client où j’ai procédé à l’abattage, à la saignée et au début de l’éviscération de l’animal. Ensuite, je me suis organisé, soit avec des bouchers, soit avec des transporteurs, pour transporter la carcasse, dans un bref délai, jusqu’à l’abattoir.
Je ne sais pas si l’abattoir mobile pourrait constituer une réponse tout à fait satisfaisante. Il faudrait aussi prévoir du personnel aguerri capable de travailler dans une structure qui ne serait pas nécessairement très opérationnelle.
M. le président Olivier Falorni. Je vous remercie, messieurs, pour cet éclairage particulièrement intéressant.
La séance est levée à onze heures quinze.
——fpfp——
21. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant Mme Florence Burgat, philosophe et directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), M. Jean-Pierre Marguénaud, professeur à l’Université de Limoges et Mme Catherine Rémy, chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
(Séance du mercredi 8 juin 2016)
La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq.
M. le président Olivier Falorni. Nous allons entendre, dans le cadre d’une table ronde, trois universitaires.
Florence Burgat est philosophe et directrice de recherche à l’INRA ; elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur la condition animale et sur le droit, en particulier : « Animal mon prochain », « Liberté et inquiétude de la vie animale », et, dernièrement, « Une autre existence : La condition animale ». Mme Burgat est également corédactrice de la Revue Semestrielle de Droit Animalier.
Jean-Pierre Marguénaud est pour sa part professeur à l’université de Limoges et spécialiste en droit animalier. Auteur de nombreux ouvrages et publications sur la question, il a dernièrement publié, avec Jacques Leroy et Florence Burgat, « Le droit animalier », aux Presses universitaires de France (PUF). M. Marguénaud s’intéresse particulièrement à l’évolution du droit des animaux et à leur place dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Mme Catherine Rémy, enfin, est chargée de recherche en sociologie au CNRS et membre du Laboratoire interdisciplinaire d’études sur les réflexivités (LIER) à l’institut Marcel-Mauss. Auteure de nombreux ouvrages sur les rapports entre les hommes et les animaux, elle a réalisé des études ethnographiques dans les abattoirs et a notamment publié, en 2009, « La Fin des bêtes — une ethnographie de la mise à mort des animaux ».
Je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et retransmises en direct sur le portail vidéo l’Assemblée nationale, certaines étant diffusées sur la chaîne parlementaire (LCP).
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure. »
(M. Marguénaud et Mmes Burgat et Rémy prêtent successivement serment.)
Mme Florence Burgat, philosophe et directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Je vous remercie de m’auditionner. Docteur en philosophie, habilitée à diriger des recherches (HDR), je suis directrice de recherche à l’INRA. Je suis par ailleurs membre de la 17e section – philosophie – du Conseil national des universités (CNU). Mes quatre champs d’investigation sont les suivants : la condition animale dans les sociétés industrielles, ce qui m’a amenée, dès 1995, à publier un « Que sais-je » sur les animaux de boucherie ; le droit animalier, sous un angle d’épistémologie juridique, et la notion de droit des animaux qui relève, pour sa part, de la philosophie morale et de la philosophie du droit ; les approches phénoménologiques de la vie animale comme existence subjective au sein d’un monde propre ; enfin, un travail d’anthropologie philosophique sur l’humanité carnivore, qui m’a occupée ces dernières années, à paraître au mois de janvier prochain.
Je commencerai par rappeler la spécificité du questionnement philosophique : la profondeur, le fait d’aller à la racine des choses que commande l’étonnement qui, depuis Platon, caractérise le mode d’interrogation philosophique. Philosopher, écrit Vladimir Jankélévitch, c’est se comporter à l’égard du monde comme si rien n’allait de soi… Il n’est probablement pas inutile non plus de souligner le caractère autonome de la réflexion philosophique au regard non seulement des contraintes politiques ou juridiques, mais encore des pratiques culturelles, pour ne rien dire des arguments marchands. Le temps de la réflexion n’est pas celui du consensus pragmatique qui vise à concilier, jusqu’à un certain point, des intérêts contradictoires ; la tâche de la pensée est de mettre au jour des fondements que l’ordinaire des pratiques masque, faisant passer pour allant de soi ce qui n’est pas nécessairement légitime.
C’est ainsi que, dès l’antiquité présocratique, par conséquent bien avant l’élevage et l’abattage industriel, la mise à mort des animaux en vue du plaisir pris à la manducation de leur chair a été tenue comme n’allant pas de soi. L’absence totale de proportionnalité entre le plaisir gustatif d’un côté et ce qu’il coûte aux animaux de l’autre est d’abord évoquée dans plusieurs mythes ou fictions poétiques grecques. Je me bornerai à trois exemples : d’abord le mythe de l’âge d’or, un temps d’abondance et de non-violence décrit par Hésiode dans Les travaux et les jours puis dans la littérature gréco-latine ; ensuite, la version orphique du mythe de Dionysos qui place l’origine du meurtre alimentaire dans un acte anthropophage et conduit les Grecs à forger le concept d’allélophagie, à savoir le fait de se manger les uns les autres pour caractériser toute alimentation carnée. Troisième et dernier exemple : l’épisode des vaches du soleil au chant XII de L’Odyssée d’Homère, au cours duquel la dépouille des vaches tuées par les compagnons d’Ulysse se mettent à marcher : « Des chairs crues et cuites meuglaient autour des broches, on aurait dit la voix des bêtes elles-mêmes. » L’animal reprenant vie dans ses chairs mortes et pour partie déjà cuites fait se heurter deux réalités que la boucherie contemporaine s’efforce de tenir à bonne distance : montrer comment les animaux meurent dans les abattoirs a le même rôle dévoilant, dessillant que cette séquence de l’Odyssée qui peut en effet être vue comme une sorte de scène primitive.
C’est d’ailleurs sur elle que Plutarque s’appuie, cette fois dans le cadre d’une argumentation philosophique, dans son traité intitulé : S’il est loisible de manger chair, qui constitue le texte fondateur concernant précisément la mise en question de l’alimentation carnée. Ce traité, écrit au premier siècle de notre ère, fut traduit en français à la Renaissance par Jacques Amyot. Rousseau, dans Émile ou de l’éducation, en restitue plusieurs pages. Voici les premières lignes du traité de Plutarque : « Tu me demandes pourquoi Pythagore s’abstenait de manger la chair des bêtes ; mais moi, je te demande, au contraire, quel courage d’homme eut le premier qui approcha de sa bouche une chair meurtrie, brisa de sa dent les os d’une bête expirante, qui fit servir devant lui des corps morts, des cadavres, et engloutit dans son estomac des membres qui, le moment d’avant, bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient ? C’est de ceux qui commencèrent ces festins cruels et non de ceux qui les quittent qu’on a lieu de s’étonner. »
Il va de soi que la réflexion sur le traitement des animaux n’est pas cantonnée à l’antiquité grecque et qu’elle jalonne l’histoire de la philosophie, pour connaître aujourd’hui un développement sans précédent. De nombreux outils conceptuels, que des siècles de controverse ont affinés, sont donc disponibles.
Les arguments en faveur de la boucherie, dans un contexte où la nécessité ne peut pas être invoquée, laquelle lève en effet la difficulté, sont moralement très faibles. La balance entre le plaisir gustatif de l’un, obtenu par la mort de l’autre est grandement déséquilibrée. On s’étonne par ailleurs de la fréquente naturalisation de l’alimentation carnée, qui s’appuie sur le chasseur du paléolithique, en vérité souvent charognard, parfois cannibale. Cette justification est à tous égards une aberration.
Les habitudes culturelles, les traditions culinaires, sont de peu de poids au regard de l’argument, clairement énoncé par Rousseau dans la préface du deuxième Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, selon lequel, « […] si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c’est moins parce qu’il est un être raisonnable que parce qu’il est un être sensible ; qualité qui, étant commune à la bête et à l’homme, doit au moins donner à l’une le droit de n’être point maltraitée inutilement par l’autre ».
On le voit : soit on pense le problème à l’intérieur du cadre réglementaire en vigueur et l’on tient sans examen pour légitime ce qui est légal, on s’interdit alors de comprendre pourquoi certains remettent en cause la boucherie et l’on cantonne le problème à des dérives ou à des aspects techniques ; soit on s’interroge depuis les fondements sur la légitimité de la boucherie et l’on se demande alors s’il est juste de faire subir aux animaux ce que nous leur faisons subir, c’est-à-dire le pire – de quel droit, en l’absence de nécessité, assimilons-nous les animaux à des ressources transformables ou à des biens dont l’usage implique la destruction ?
Ajoutons que jamais nous n’avons fait souffrir et tué autant d’animaux qu’aujourd’hui alors que jamais nous n’avons eu moins besoin des animaux pour notre survie ou pour notre développement.
C’est sur le caractère à la fois ancien et pérenne de l’interrogation sur la légitimité même de l’abattage des animaux que je voulais appeler votre attention. Non, cette préoccupation n’est pas le fait d’étranges groupuscules qui puisent dans des sources occultes ; il s’agit bien d’une question philosophique et morale que seule l’ignorance de l’histoire des idées peut ranger au magasin des bizarreries.
M. Jean-Pierre Marguénaud, professeur à l’Université de Limoges. Je vous remercie à mon tour de m’avoir invité. Je suis professeur de droit privé et des sciences criminelles à l’Université de Limoges et en même temps chercheur à l’Institut de droit européen des droits de l’homme de l’Université de Montpellier. Je suis devenu universitaire grâce à, ou plutôt en dépit d’une thèse soutenue en 1987 et publiée en 1992 sur l’animal en droit privé, sujet qui, à l’époque, passait pour le plus fantaisiste qu’un juriste pouvait aborder. J’ai néanmoins continué d’avoir des relations d’amitié avec ce sujet, ce qui m’a permis, en 2009, de créer, avec le doyen Jacques Leroy et Florence Burgat, la Revue Semestrielle de Droit Animalier dont je suis le directeur.
Ma spécialité universitaire n’est pourtant pas le droit animalier mais les droits de l’homme et plus précisément le droit européen des droits de l’homme. Je suis le coauteur, avec le professeur Frédéric Sudre, depuis 2002, du livre Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Cet intérêt pour les droits de l’homme vu depuis la CEDH m’a valu, il y a quelques années, d’être auditionné par la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, présidée par le député André Gerin. Je pourrai donc m’exprimer devant vous à la fois comme prétendu spécialiste de droit animalier et en tant que droit-de-l’hommiste – dénomination souvent péjorative et même quelquefois un peu méprisante, mais que j’assume pleinement.
Le droit animalier ne doit pas être confondu avec le droit des animaux. Le droit animalier s’intéresse certes également à la question de savoir si certains animaux pourraient être protégés par l’octroi de droits, mais il est beaucoup plus vaste et, d’une certaine manière, plus neutre, et par conséquent plus ambitieux : il recouvre l’ensemble des règles nationales ou internationales, législatives ou réglementaires, et les jurisprudences qui se rapportent à la question des animaux, aux règles actuellement applicables et à celles qui pourraient s’appliquer dans un avenir meilleur.
On pense immédiatement au droit pénal spécial animalier, mais peut-être moins à un aspect du droit civil sur lequel j’entends revenir un instant. Sont laissés aux portes des abattoirs ceux – excepté les animaux, bien sûr – qui sont le plus directement concernés par les atrocités qui peuvent s’y dérouler : les éleveurs. Ils sont concernés du point de vue économique, évidemment, car la révélation de la réalité des conditions d’abattage est de nature à détourner une part des consommateurs vers le végétarisme ou le végétalisme, ce dont beaucoup se réjouiront autour de cette table. Concernés, les éleveurs le sont peut-être aussi d’un point de vue éthique, voire affectif : tous ne sont pas animés, en effet, par la logique de la ferme des mille veaux ; certains, je crois, portent à leurs bêtes une attention très forte et ne sont pas indifférents à ce qui va leur arriver une fois que se seront refermées sur elles, brutalement, les portes du camion. Certains seront même intéressés par ce qui va se passer pour leurs bêtes qui, juridiquement, ne seront plus les leurs et sur le sort desquelles, donc, ils n’auront pratiquement aucun droit de suite ; ils n’auront en effet aucune possibilité de suivre du regard ce qui va se passer dans les abattoirs malgré les conséquences morales et économiques, j’y insiste, susceptibles de les concerner.
En ce qui concerne le droit pénal spécial animalier, de la lecture, dans La Revue Semestriel de Droit Animalier, des chroniques de jurisprudence écrites par les pénalistes Jacques Leroy et Damien Roets, doyen de la faculté de droit et de sciences économiques de Limoges, il ressort que le plus urgent serait de procéder à une refonte complète du droit pénal animalier spécial puisque plusieurs dispositions du code pénal et du code rural et de la pêche maritime se chevauchent – et je laisse de côté le code de l’environnement.
Pour en revenir plus précisément à l’abattage, je signalerai une importante difficulté : le code pénal prévoit une contravention pour mauvais traitement envers les animaux domestiques. Une disposition du code rural transforme cette contravention en délit lorsqu’il s’agit de mauvais traitements exercés sur des animaux au titre d’une activité professionnelle. Or, curieusement, les activités d’abattage n’y figurent pas. Autrement dit, les mauvais traitements, nommément énumérés, qui pourraient être commis sur les animaux pendant l’abattage sont passibles, aux termes du code rural, d’une contravention de quatrième classe. Il y a donc un hiatus entre les mauvais traitements infligés à titre professionnel à toute autre activité que celle d’élevage, délit puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, et les mauvais traitements constatés lors de l’abattage qui ne sont passibles que d’une contravention.
Quand bien même on rendrait le droit plus cohérent à cet égard, subsisterait une grave question : celle de la preuve des faits qui se déroulent dans les abattoirs. C’est ici que le droit européen des droits de l’homme pourrait avoir son mot à dire. Il ne s’agira pas de rechercher comment on pourrait mieux protéger les animaux de boucherie en leur conférant des droits comparables à ceux dont certains êtres humains peuvent être titulaires, mais de savoir quels droits de l’homme ceux qui défendent activement les animaux pourraient invoquer pour faire savoir ce qui se passe réellement dans les abattoirs. C’est ici qu’un droit important, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut entrer en jeu : celui de la liberté d’expression, à savoir la liberté de communiquer mais également de recevoir des informations.
On pourrait, en la matière, se référer au documentaire réalisé par Georges Franju en 1949, Le sang des bêtes. Je ne doute pas que tous les membres de la présente commission ont commencé par le regarder pour se mettre dans l’ambiance – je n’ose dire dans le bain. Le juriste que je suis s’est posé la question suivante : un Georges Franju pourrait-il en 2016 filmer la réalité des abattoirs aussi librement et aussi facilement qu’à l’époque ? La réponse est non, pour une raison simple et paradoxale : en 1949, ce qui se passait dans les abattoirs, à Vaugirard ou à la Villette, ne tombait sous le coup d’aucune disposition pénale – n’existait alors que la contravention de mauvais traitement envers les animaux, à condition que ces mauvais traitements soient exercés publiquement, ce qui n’est pas le cas dans un abattoir. C’est ce qui explique pourquoi un Georges Franju a pu filmer la réalité des abattoirs sans inquiéter qui que ce soit. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et l’on se trouve face à un paradoxe du droit animalier : plus il protège l’animal pour lui-même en faisant abstraction de la condition de publicité, plus il incite à dissimuler les éléments constitutifs des infractions qu’il demande de poursuivre. Ici encore nous nous retrouvons face à un nouvel hiatus : comment faire pour chercher dans les abattoirs ce que Georges Franju y avait trouvé en 1949 ? Le droit européen des droits de l’homme peut apporter des réponses. J’ai retenu trois arrêts de la CEDH qui concernent directement notre propos et sur lesquels nous pourrons revenir. Ils concernent la France et apportent des arguments pour justifier des intrusions, à des conditions que je préciserai, pour capturer des images que les Georges Franju d’aujourd’hui ne peuvent pas filmer.
Mme Catherine Rémy, chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Je remercie la commission pour son invitation. Puisque nous ne disposons pas de beaucoup de temps pour nous exprimer, je vais entrer dans le vif du sujet.
Je rappellerai pour commencer d’où vient l’idée de construire des espaces clos et surveillés consacrés à la mise à mort des animaux de boucherie. L’histoire me paraît en effet essentielle pour comprendre comment s’est constitué ce que j’appellerai une culture du combat dans les abattoirs, culture du combat qui existe encore, même si elle s’est atténuée.
Les abattoirs sont apparus en France au début du XIXe siècle. Auparavant, la mise à mort des animaux s’effectuait au grand jour. La mise à mort par saignée contenait nécessairement une forme de violence puisqu’il s’agit d’ouvrir le corps de l’animal pour qu’il se vide de son sang ; cette activité, connue de tous, était, d’une certaine manière, acceptée.
Toutefois, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, parallèlement aux préoccupations hygiénistes, le spectacle de la mise à mort, du fait de la violence qu’il comporte, commence à poser problème. Pour certains, le spectacle de la mise à mort rendrait les hommes violents entre eux et aurait un effet très négatif sur les enfants. On décide donc, notamment, de « cacher la mise à mort des animaux pour n’en pas donner l’idée », pour reprendre les mots de l’historien Maurice Agulhon. Aussi crée-t-on progressivement un monde coupé de l’extérieur : quelques hommes seulement vont accomplir le geste de mise à mort que désormais la société ne veut plus voir.
Qui accomplit l’abattage ? Au départ, ce sont essentiellement des bouchers et leurs commis, puis, peu à peu, avec l’industrialisation, des ouvriers d’abattoir. Dans les archives et les travaux de vétérinaires écrits tout au long du XXe siècle, que j’ai pu étudier, une idée revient sans cesse : celle de l’existence d’un milieu très spécial à l’abattoir qui se caractérise notamment par un rapport violent à la mise à mort et à l’animal. De nombreux visiteurs décrivent un univers difficile, brutal. Les « tueurs », pour reprendre le nom que les travailleurs en question se donnent eux-mêmes, accomplissent un geste qui s’inscrit très souvent dans un corps à corps risqué au cours duquel l’animal est perçu non comme un être innocent, mais comme un ennemi défiant qu’il faut dompter. Il y a dans ce que Pierre Gascar appelait le bref combat de la mort, une source de légitimité à tuer. Ce n’est pas, je le répète, un être innocent que l’on tue, mais bien un être menaçant. Par conséquent, le geste de mise à mort se transforme en acte de bravoure, de virilité.
Pendant longtemps, le risque encouru au moment de la mise à mort était effectivement très important pour les hommes. Il a aujourd’hui largement diminué avec les évolutions techniques. Il n’en demeure pas moins à bas bruit, notamment quand les travailleurs vont trop vite et ne respectent pas les prescriptions.
Lors de l’enquête ethnographique que j’ai menée dans un abattoir pendant trois mois et demi en m’y rendant tous les jours, j’ai pu observer des comportements qui s’apparentaient à cette culture du combat, source de légitimité pour les hommes. Quand les animaux sont dociles, les travailleurs tuent avec détachement – il y a donc bien des moments de « pacification ». Mais, très souvent, lorsqu’un animal résiste, lorsqu’il exhibe ce que j’ai appelé « un éclat de vie », lorsqu’au fond il ne se comporte pas comme il est attendu par le dispositif, alors les travailleurs peuvent user de la violence, une violence non seulement verbale, mais physique. Ce que j’ai observé peut se résumer ainsi : une alternance entre froideur, détachement, et violence, entre objectivation des animaux et leur subjectivation négative.
A contrario, au cours de cette enquête, je n’ai pas repéré d’expression de compassion de la part des tueurs, au moment de la mise à mort aussi bien qu’au cours de mes discussions avec eux, sauf une fois, lors de l’abattage de chevaux – animal très rarement tué dans cet abattoir –, le tueur n’ayant pas pu faire son travail et ayant dû sortir de l’espace de la mise à mort. Pourquoi les travailleurs ne font-ils pas preuve de compassion alors même que la réglementation humanitaire les y invite, depuis les années 1960 ? Cette réaction témoigne de la difficulté des hommes à accomplir leur métier de tueur à la chaîne. Quand les animaux résistent, les ouvriers leur reconnaissent une forme d’intelligence et de sensibilité, mais celles-ci sont vécues comme menaçantes. L’animal devient dès lors furtivement un ennemi à dompter. Cette attribution à l’animal du statut de sujet s’accompagne d’une dégradation : la mise en scène de combat valorise le geste de mise à mort qui nécessite force et courage de la part des travailleurs.
Lors de mon enquête de terrain, j’ai eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de discuter avec des employés de la direction des services vétérinaires (DSV) chargés en particulier de contrôler l’application de la réglementation humanitaire à l’abattoir, et j’ai été souvent frappée par leur discours au sujet du bien-être animal dans un tel contexte. Ils soulignaient en effet combien il était difficile pour eux d’aborder ce sujet, combien celui-ci était intolérable, inaudible pour les ouvriers d’abattoir. Pourquoi ? Parce que, selon moi, ce discours sur l’animal entre en opposition avec cette culture du combat et la valorisation dont elle est porteuse pour les hommes, mais aussi avec l’objectivation des animaux liée à l’industrialisation – n’oublions pas que les ouvriers d’abattoir tuent à des cadences industrielles des êtres anonymes et interchangeables, à savoir des êtres avec lesquels ils n’ont tissé aucun lien.
C’est autour de la valorisation du métier d’ouvrier d’abattoir qu’il faut agir. Les incitations financières au respect des règles et notamment de la réglementation humanitaire me semblent indispensables. Comment rendre audible la question du bien-être animal dans l’abattoir ? En lui donnant du poids dans la formation des travailleurs, mais surtout dans leur activité au quotidien. J’ai été frappée par le fait que les ouvriers veulent souvent aller vite, cela pour des raisons complexes : par souci d’efficacité, parfois par laxisme, mais aussi, très souvent, parce qu’ils veulent prendre des risques, cette prise de risque renvoyant à la culture du combat évoquée il y a un instant. Or cette recherche de rapidité est entravée par le geste d’insensibilisation. Il faut donc que ce geste d’insensibilisation ait une valeur pour les travailleurs et ne soit plus un geste superflu, voire qui les empêche d’accomplir leur tâche comme ils le souhaiteraient. En même temps, dans un contexte d’abattoir industriel, j’insiste sur la difficulté de demander aux ouvriers de développer un sentiment de compassion pour des animaux alors qu’ils ont précisément pour tâche de mettre à mort en série des êtres interchangeables et anonymes.
Faire respecter la réglementation humanitaire ne se traduira pas par la transformation des ouvriers des abattoirs en « bons euthanasistes pleins de compassion », expression que j’ai pu lire à de nombreuses reprises dans les travaux des vétérinaires qui ont milité pour l’introduction de la réglementation humanitaire dans les abattoirs. La compassion n’a pas sa place dans le dispositif tel qu’il existe.
C’est pourquoi il faudrait que des « porte-parole » des animaux – j’insiste sur le pluriel car un représentant de la protection animale ne suffira pas pour avoir un impact sur l’activité elle-même – rappellent la valeur de la vie et soient associés de près au travail dans les abattoirs. Ce sera néanmoins très difficile étant donné la dimension de secret et de confinement qui existe dans ces espaces.
M. le président Olivier Falorni. Merci pour ces présentations très intéressantes. Comment expliquez-vous, si tant est qu’on puisse l’expliquer, ou tout au moins comment analysez-vous, en tant que chercheurs, la violence des vidéos dont des extraits ont été diffusés par l’association L214 – à l’origine de la création de la présente commission d’enquête ?
Ensuite, l’évolution du statut de l’animal a-t-elle influencé le droit des animaux au sein des abattoirs ? Je fais référence à ce paradoxe selon lequel on prend mieux en compte le droit des animaux domestiques alors qu’on assiste à une forme de déconsidération des animaux de rente. Que pensez-vous de ce paradoxe ? Le jugez-vous avéré ?
Enfin, madame Rémy, pensez-vous que les ouvriers sont assez sensibilisés à la question du bien-être animal ? Quand nous avons visité de façon inopinée des abattoirs, nous avons interrogé les ouvriers travaillant au poste de tueur sur le fait de savoir s’ils souhaitaient être affectés à une autre tâche et, régulièrement, ils répondaient par la négative. Pensez-vous qu’à défaut d’un roulement qui, donc, pour des raisons diverses, n’est pas toujours souhaité, on devrait procéder à un suivi personnalisé de ces ouvriers ? Ils n’occupent en effet pas un poste comme les autres, un poste qui n’est anodin ni physiquement ni moralement.
Mme Catherine Rémy. Je vais répondre à votre dernière question, qui me paraît importante, sur les personnes chargées de la mise à mort – plus concrètement de l’insensibilisation et de la saignée. Leur volonté, que vous rapportez, de rester à leur poste m’interpelle. Cela corrobore ce que j’ai pu observer : ceux que j’ai appelés « les vrais tueurs de l’abattoir » agissaient dans cette logique de bravoure du combat, d’exhibition d’une forme de courage au quotidien, et cette façon de faire leur assurait un ascendant certain au sein du groupe. La force symbolique de la mise à mort influe sur les rapports des hommes entre eux et se révèle très importante pour comprendre les dynamiques au travail.
Mais ce n’est pas parce que les personnes en question manifestent le souhait de rester à ce poste qu’elles sont conscientes de ce que ce poste leur fait. L’idée de les amener à réfléchir à l’impact de cette fonction me paraît par conséquent très importante. Du reste, dans l’abattoir que j’ai observé, les « vrais tueurs de l’abattoir » étaient ceux qui, le plus souvent, avaient des comportements violents. Or quand, parfois, pour diverses raisons, il était procédé à un roulement, les remplaçants étaient globalement beaucoup moins violents. Le roulement se heurte à une organisation, à une dynamique interne du travail sous-tendue par la symbolique de la mise à mort.
M. le président Olivier Falorni. Quelle analyse faites-vous des comportements tout de même stupéfiants que nous avons pu observer et qui ont horrifié de nombreux Français ? On a évoqué un « pétage de plombs », mais sans doute est-ce un peu réducteur. Vos études vous ont-elles amenés à donner une explication rationnelle de cette violence ?
Mme Florence Burgat. Les éléments apportés par Catherine Rémy sont très éclairants. Notre étonnement est, d’une certaine manière, étrange et montre bien que nous n’arrivons pas à penser que ce sont des animaux qui sont tués – en réalité des individus, même si l’abattage en série ne permet plus de les considérer ainsi – et que ce travail n’est pas un travail comme un autre. Nous avons l’air d’être surpris que les choses ne se passent pas comme si des robots étaient en train de tuer d’autres robots. Mme Rémy a montré les enjeux complexes de cette activité et montré que la violence lui est inhérente. Il y a là une très grande difficulté.
M. le président Olivier Falorni. Quand vous évoquez la violence, elle recouvre deux phénomènes : la violence de l’acte et des violences qui vont au-delà du fait d’étourdir et de tuer un animal. Dans les trois vidéos, le problème n’était pas seulement de voir des animaux saigner, mais le fait que des gens faisaient preuve soit de sadisme, soit d’un tel manque d’humanité qu’ils en venaient à traiter les animaux vraiment comme des objets. J’entends bien que vous considériez la violence comme inhérente à ce travail d’abattage, comme quasi institutionnelle, mais rien ne légitime les comportements que nous avons vus.
Mme Florence Burgat. Bien sûr !
M. Jean-Pierre Marguénaud. Pour répondre complètement à la question, il faudrait mener de sérieuses études de criminologie qui semblent faire défaut. Je ne dispose pas d’assez de données pour expliquer ce type de violences qui vont au-delà de celle nécessaire pour la mise à mort. Ce qu’on voit dans les vidéos montre en tout cas qu’il ne s’agit pas de simples mauvais traitements – vous avez évoqué le sadisme, la barbarie, ce qui relève des actes de cruauté au sens de l’article 521-1 du code pénal. Ces violences posent en outre, comme je l’ai indiqué, la question de la preuve car nous ne savons pas si elles montrent des comportements tout à fait exceptionnels ou des pratiques généralisées dans la majorité des abattoirs. D’où l’idée, peut-être, d’installer…
M. le président Olivier Falorni. La vidéo surveillance ?
M. Jean-Pierre Marguénaud.… pour voir exactement ce qui se passe. Il y a, j’y insiste, un vrai problème d’établissement de la preuve d’actes qui sont parfois des actes de cruauté, parfois des mauvais traitements et qui relèvent de la loi pénale. Se sont-ils présentés seulement dans ces trois établissements, où comme par hasard avaient été installées des caméras pour les capter ?
Pour ce type d’infraction, à supposer qu’on puisse en ramener les éléments constitutifs, les associations de protection des animaux ne peuvent pas exercer les droits reconnus à la partie civile par l’article 2-13 du code de procédure pénale qui vise la plupart des infractions prévues par le code pénal, mais aucune de celles qui relèvent du code rural. Ce point mériterait d’être débattu : étendre aux associations de protection des animaux déclarées depuis cinq ans, le droit reconnu aux parties civiles, afin qu’elles puissent poursuivre, devant les juridictions répressives, ce type de mauvais traitements, pour peu qu’il ne s’agisse que de mauvais traitements.
Vous avez par ailleurs posé une question sur l’incidence de l’évolution du statut de l’animal sur le droit des animaux de boucherie. Il y a eu une petite révolution théorique avec la loi du 16 février 2015 qui a fait sortir les animaux de la catégorie des biens : les animaux ne sont plus des meubles ou des immeubles. Cette avancée théorique remarquable permet aux animaux, par fiction juridique et par défaut, d’être soumis au régime des biens sous réserve des lois qui les protègent. On note néanmoins, dans le code civil, une incohérence : le livre contenant ces dispositions s’intitule toujours : « Des biens et des différentes modifications de la propriété », alors qu’il devrait s’intituler, pour être en accord avec les dispositions mentionnées : « Des animaux, des biens et des différentes modifications de la propriété ». Pour le reste, l’article 515-14 du code civil se trouve dans une situation intermédiaire, avant le chapitre consacré à la distinction des biens, lesquels sont les meubles et les immeubles ; il n’y a plus la moindre trace des animaux dans la catégorie des meubles. On ne peut par conséquent plus dire que, juridiquement, les animaux sont des biens, mais qu’ils sont, je le répète, soumis au régime des biens – ce qui revient à dire qu’ils n’en sont plus ; mais que sont-ils ? On ne le sait pas trop. Vont-ils rester en état de lévitation pendant longtemps ?
Reste que l’avancée théorique évoquée va avoir des conséquences jurisprudentielles – c’est l’interprétation qu’en donne le juge qui fait vivre le texte voté par le législateur. Pour l’heure, nul ne sait ce que le juge va faire des nouvelles dispositions et notamment de l’affirmation, aux termes de l’article 515-14 du code civil, selon laquelle les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. On n’en note pas moins déjà un certain nombre d’amorces comme ce récent jugement du tribunal correctionnel de Brest à propos du broyage des poussins mâles : sans s’appuyer directement sur la nouvelle définition de l’animal par le code civil, le tribunal l’a citée. On peut relever, par ailleurs, d’autres condamnations à un an voire deux ans de prison ferme pour actes de cruauté ; avant la modification du code civil, ce n’était pratiquement jamais le cas. Avant même l’entrée en vigueur de la loi en question, un tribunal correctionnel, de Marseille si je me souviens bien, pour condamner quelqu’un à un an de prison ferme pour actes de cruauté envers un animal domestique, avait expressément décidé que les animaux étaient des êtres vivants doués de sensibilité. Les choses peuvent donc changer, petit à petit, y compris pour les animaux de boucherie qui sont aussi des êtres vivants doués de sensibilité. J’en reviens toutefois à la difficulté majeure : comment faire pour savoir quel sort leur est infligé ?
Mme Sylviane Alaux. Vous avez publié, madame Burgat, une tribune dans le journal Libération, début avril, dans laquelle vous écrivez : « Bien connue des enquêteurs des associations de défense des animaux, l’absence des services vétérinaires à ce point crucial de la chaîne – le poste d’abattage – n’est pas le fruit d’un hasard. S’ils sont occupés ailleurs, c’est parce qu’il est tacitement entendu que les employés sont libres de faire ce qu’ils veulent de ces victimes qui sont aussi les nôtres. »
Que voulez-vous dire exactement par là ? Que l’État donne à vos yeux l’impression d’encadrer les choses mais que, dans la réalité, il est impossible d’appliquer les règles prévues et qu’il y aura donc toujours de la souffrance, quoiqu’on dise, quoiqu’on fasse ?
Monsieur Marguénaud, vous avez déjà commencé de répondre à mon autre question. Vous avez écrit que nous étions à une époque charnière. Vous avez évoqué les récentes évolutions législatives, fruit d’une nuit de débat dont Mme Abeille et moi-même sommes ressorties peu satisfaites, c’est le moins que l’on puisse dire. Vous mentionnez par ailleurs trois stades : le ridicule, la discussion et l’adoption. Vous semblez considérer que nous parvenons au stade de la discussion ; ne pensez-vous pas en fait que nous n’en sommes encore qu’au stade du ridicule ? Ou alors pensez-vous que nous sommes déjà arrivés à une forme de maturité par rapport au ridicule ?
M. Arnaud Viala. Je reste un peu sur ma faim quant au rapport que vous établissez entre l’homme et l’animal. Vous effectuez un glissement entre une approche philosophique, anthropologique et une approche plus juridique, si bien que je ne parviens pas à déceler le fondement de vos positions.
Vous établissez une tension très forte entre l’animal domestique et l’animal de boucherie – ne serait-ce que dans les termes. J’aimerais savoir où vous placez la barre qui sépare ces deux catégories d’animaux. La distinction ne m’apparaît en effet pas toujours très claire.
Vous relevez ensuite, madame Burgat, une tension entre le passé et le présent. Vous semblez considérer que la mise à mort à la ferme, auparavant, n’était pas si violente en comparaison avec les pratiques, à huis clos, dans l’abattoir.
Enfin, vous définissez une tension entre l’éleveur et le tueur. Le premier n’a pas accès au stade de l’abattage et par conséquent ne voit pas ce qui se passe avec le fruit de son travail.
J’en reviens donc à ce qui sous-tend votre approche : s’agit-il d’une posture philosophique selon laquelle il ne faut plus mettre à mort les animaux parce que l’homme n’est pas censé les consommer – dans le texte évoqué par Sylviane Alaux vous employez d’ailleurs le terme de « victimes » ? Ou bien votre réflexion porte-t-elle simplement sur l’amélioration des conditions de ce qui de toute façon est un acte irréversible ?
J’ajoute que je suis fils d’éleveurs, né dans une ferme, et que ces sujets me touchent au plus profond de moi-même parce que je sais la barrière mentale qu’établit l’éleveur entre l’acte d’élevage et la destination, qu’il connaît, de l’animal qu’il a devant lui tous les jours.
Mme Florence Burgat. La direction des services vétérinaires est censée contrôler l’application de la réglementation au moment de la mise à mort des animaux. Or on sait par un certain nombre de témoignages, notamment écrits, au long de plusieurs décennies, que la DSV se trouve à l’autre bout de la chaîne pour contrôler les aspects sanitaires, sans effectuer aucun contrôle sur la manière de mettre à mort les animaux. Je pense que ce n’est pas tout à fait un hasard.
Je ne fais pas du tout partie des gens qui pensent, monsieur Viala, que le passé était meilleur pour les animaux, que l’élevage d’antan était meilleur. Quand on se renseigne sur les méthodes d’élevage dans l’antiquité, on constate que les méthodes de contention, le gavage, les mutilations étaient pratiqués depuis fort longtemps. L’élevage industriel n’a fait que radicaliser et étendre des pratiques consubstantielles à l’élevage. Ajoutons que l’abattage n’était pas réglementé. Je sais que certains souhaitent revenir à la liberté totale, pour les éleveurs, de tuer leurs animaux à la maison. Je trouve qu’il est très grave de soutenir cette position, car il n’y aurait dès lors plus aucun contrôle.
Vous vous interrogez sur ce qui sous-tend nos approches ou en tout cas ma position philosophique. Je pense en effet que si j’ai été appelée à m’exprimer aujourd’hui devant vous, ce n’était pas pour proposer des améliorations techniques à l’abattage des animaux ; d’autres personnes ont dû le faire dans le cadre des auditions organisées par la présente commission. Pour ma part, et c’est le sens de mon travail, je considère qu’en l’absence de nécessité, la mise à mort des animaux pour le seul plaisir de les manger n’est pas moralement recevable. J’ai donc voulu, dans mon bref exposé, montrer que cette question philosophique n’est pas née dans les sociétés industrielles, qu’elle n’est pas le fait de farfelus, mais qu’elle s’est posée d’âge en âge dans la philosophie. J’ai donc pensé que, dans le cadre de cette audition, il pouvait être important de le rappeler.
M. Jean-Pierre Marguénaud. Je reviens sur le passage de la phase du ridicule à celle de la discussion. Si l’on n’était pas entré dans la phase de la discussion, la diffusion des trois vidéos par l’association L214 n’aurait pas justifié la création d’une commission d’enquête parlementaire. J’ai rappelé avoir soutenu ma thèse en 1987 et, pendant longtemps, son sujet m’a valu des lazzis, des quolibets : s’intéresser à l’animal paraissait sympathique, mais pas très sérieux. Or, depuis quelques années, notamment grâce à la Revue semestrielle de Droit Animalier, l’intérêt pour ce domaine se répand dans le monde universitaire : nous n’avons pas de difficulté à trouver des collègues qui écrivent, dans leur spécialité, sur les questions animales.
Un événement récent montre bien que nous sommes entrés dans la phase de la discussion : depuis la loi du 16 février 2015, un diplôme universitaire d’éthique animale a été créé à Strasbourg. À la rentrée 2016, l’université de Limoges va créer un diplôme de droit animalier, le premier en France ; il en existe déjà un à Barcelone. Je puis vous certifier, puisque je m’exprime sous serment, qu’il y a cinq ans il était hors de question de proposer à quelque instance universitaire que ce soit la validation d’un diplôme de ce type. Or la création du diplôme de droit animalier a été approuvée cette année sans aucune difficulté et le nombre de candidats à cette formation dépasse toutes nos espérances. C’est vraiment la preuve que nous entrons dans la phase de la discussion et nous allons donc pouvoir désormais parler à armes égales : il ne suffira plus de quelques lazzis, de quelques quolibets pour discréditer le débat.
J’en viens à la distinction entre animaux domestiques et animaux de rente. D’un point de vue théorique, cette question est très importante. Je dirige actuellement une thèse sur l’animal transcatégoriel – lequel peut, en fonction d’un certain nombre de circonstances, basculer d’une catégorie à l’autre : on pense au statut particulièrement ambigu, de ce point de vue, des chevaux.
Pour le reste, je suis moi aussi fils d’éleveurs limousins et j’ai gardé des contacts très précieux avec des cousins germains qui sont éleveurs de vaches limousines. Je suis philosophiquement partagé entre la forte influence que la philosophe Florence Burgat exerce sur moi depuis que nous travaillons ensemble et la fidélité à mes cousins germains. J’essaie de trouver un juste équilibre…
M. le président Olivier Falorni. Ce sont les problèmes de famille, que voulez-vous…
M. Jean-Pierre Marguénaud. Une famille très, très large en l’occurrence.
Mme Catherine Rémy. Je reviens sur la direction des services vétérinaires avec les personnels de laquelle j’ai beaucoup discuté au cours de mon enquête. On insiste sur la difficulté pour les tueurs d’accomplir leur travail, mais il faudrait également évoquer celle des agents de la DSV. Au long de mon enquête, j’ai rencontré trois agents, deux permanents et un dépêché pour effectuer un contrôle pendant quelques mois. Or je me souviens de la très grande difficulté de ces agents pour s’approcher de l’espace souillé dans l’abattoir mais aussi pour entamer la discussion sur la question, en particulier, du bien-être animal. Il faut donc bien comprendre que pour ces agents, c’est très difficile. Aussi, comment les aider dans leur mission de contrôle ?
Cela renvoie au fait que les abattoirs sont issus d’un processus d’occultation : on a voulu cacher la mise à mort. On a donc créé un espace que la société ne veut plus voir ; du coup, toutes les personnes qui y travaillent sont porteuses, d’une certaine manière, du stigmate d’une activité honteuse. Il est donc très difficile pour les agents de la DSV de soulever un certain nombre de sujets du fait de la force de la culture du combat mais aussi du secret, du confinement, qui règne dans les abattoirs.
Au début de mon enquête ethnographique, j’ai voulu tout voir. Or j’ai senti, après plusieurs semaines passées au sein de l’espace souillé, que mon regard posait énormément de problèmes. Aussi, dans un deuxième temps, me suis-je tenue à distance, me comportant de fait comme les agents de la DSV : je n’observais plus la mise à mort, tâchant d’en comprendre les conséquences dans mes rapports avec les travailleurs – et, en effet, cet éloignement a été un facteur d’apaisement.
Enfin, pour ce qui sous-tend mon positionnement, je ne suis pour ma part pas du tout philosophe mais sociologue. Mon approche est donc celle de la sociologie, de l’ethnographie du travail. J’essaie de pointer la convergence ou bien le décalage entre des discours, des règlements et l’action au quotidien.
Mme Laurence Abeille. Merci infiniment pour vos interventions qui abordent la question d’un point de vue philosophique, sociologique et juridique ; elles se complètent de façon très intéressante et votre approche est assez nouvelle, du moins au sein de l’Assemblée.
Comment expliquer, madame Burgat, que la tradition de l’élevage des animaux pour les abattre afin d’en consommer la viande l’ait, au cours de l’histoire, emporté sur d’autres considérations selon lesquelles on ne peut pas tuer d’êtres vivants doués de sensibilité ?
Nous avons évoqué la violence inhérente à l’abattage de l’animal, de la culture du combat qui l’accompagne. Reste que les vidéos diffusées par l’association L214 vont au-delà de la simple violence : elles montrent des actes ignobles. D’un point de vue philosophique ou sociologique, comment expliquer ce passage du geste violent au geste barbare ?
Pour ce qui est du droit, nous avons eu des débats passionnés sur l’animal en tant qu’être vivant doué de sensibilité. Nous avons réclamé un changement du régime juridique de l’animal moins théorique, notamment en introduisant la notion d’impératif biologique des espèces pour les êtres vivants doués de sensibilité. L’ajout de cette notion dans le code civil aurait-il pu, à votre avis, avoir des implications, en particulier en ce qui concerne la mise à mort des animaux dans les abattoirs ?
Enfin, madame Burgat, vous avez évoqué à plusieurs reprises la notion de nécessité. Pourriez-vous la préciser ? Comment est-on passé d’une absence de nécessité à ce qu’on nous présente comme nécessaire dans la nutrition du consommateur ?
M. Jacques Lamblin. Vous avez dit la vérité en affirmant qu’on ne voulait plus voir la mise à mort des animaux, mais vous n’avez pas dit toute la vérité : dans nos sociétés, on ne veut plus voir la mort, sous toutes ses formes, en particulier dans l’espèce humaine.
Vous avez beaucoup insisté, madame Rémy, sur la symbolique de la mise à mort qui conférait un statut à l’exécutant. Cependant, je connais moi aussi le fonctionnement des chaînes d’abattage et je souhaite que vous précisiez à quel moment cette valorisation de la mise à mort peut être ressentie par le tueur – dans une chaîne d’abattage de bovins où tout se déroulerait comme le règlement l’exige, s’entend.
L’animal ne sait pas ce qui va lui arriver. Il est acheminé dans un couloir d’amenée, mis en cage et étourdi ; instantanément il tombe et, inconscient, son corps est alors suspendu par les membres postérieurs. Le tueur donne à ce moment-là le coup de couteau afin de saigner l’animal. Pour l’avoir moi aussi observé, il me semble que le tueur est surtout préoccupé par la précision de son geste pour qu’il soit « parfait », le plus efficace possible. La chaîne suit son cours avec « l’habillage » de la carcasse, à savoir le dépeçage et l’éviscération. Si l’on ajoute à cela que le poste de tueur n’est pas toujours occupé par le même individu du fait d’une rotation impliquant qu’il sache effectuer tous les gestes de la chaîne – selon une logique de taylorisation –, je ne vois guère à quel moment le tueur peut ressentir cette mise en valeur de la mise à mort.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’abattage rituel, l’animal est contenu et, suivant la manière dont il l’est, on peut noter des difficultés et une souffrance avérée puisqu’il est conscient au moment où il reçoit le coup de couteau fatal. Il me semble donc que si l’abattage conventionnel respecte bien les règles, l’animal n’a pas conscience de sa finitude
– même si, n’étant pas dans son cadre de vie habituel, il peut être un peu inquiet – et il y a peu de risque qu’il souffre.
Aussi, que pensez-vous de l’abattage rituel ?
Quant à vous, madame Burgat, vous avez raison de considérer que le retour de l’abattage à domicile serait encore pire que l’abattage industriel. Reste que le rôle de la présente commission d’enquête n’est pas de juger du bien-fondé ou non de la consommation de viande, mais d’examiner ce qui ne fonctionne pas dans les abattoirs. Notre sujet ne recoupe par conséquent pas vraiment celui que vous vous proposez de traiter. Toutefois, votre exposé m’a paru particulièrement intéressant. Vous concentrez votre réflexion sur le moment précis où l’on abat l’animal pour le manger ensuite. Mais, au moment d’arriver à l’abattoir, l’animal a déjà un vécu : l’homme l’a fait naître, l’a élevé, l’a protégé et l’a nourri. Aussi l’homme – je fais ici abstraction de l’élevage industriel – l’a-t-il protégé de ses préoccupations d’animal – manger et ne pas être mangé – et s’est-il efforcé de lui mener la vie la meilleure possible, même si, nous en sommes d’accord, cela se termine plutôt mal pour l’animal.
Supposons que l’homme n’exploite pas l’animal, ce dernier se développerait en toute liberté, comme les corbeaux, pratiquement sans prédateur. Il risquerait dès lors de devenir un concurrent de l’homme ; il ne serait plus chassé mais probablement pourchassé.
Quel est votre sentiment sur une telle conception, dans laquelle l’homme n’élèverait pas l’animal pour le manger mais le laisserait vivre sa vie en toute liberté ?
Mme Florence Burgat. Je sais que la commission n’a pas pour but de remettre en question l’alimentation carnée. Cependant, si j’ai été invitée, j’ai pensé que…
M. Jacques Lamblin. Je ne vous reproche rien, madame.
Mme Florence Burgat. Vous m’interrogez sur la perspective d’un monde où l’on n’élèverait plus les animaux pour les mangers. Dans un tel monde, les animaux ne se développeraient probablement pas en liberté puisque les animaux d’élevage ne naissent que parce qu’on les fait naître, en particulier par le biais de l’insémination artificielle – tout cela est très planifié. Qui plus est, la génétique a mis au point des races animales dont certaines ne s’accommodent pas d’une vie quelque peu spartiate. La fin de l’élevage n’entraînerait donc pas une sorte d’envahissement des animaux dans l’espace humain où, en effet, ils n’ont plus de place. On pourrait imaginer de nombreuses perspectives où certains animaux, anciennement d’élevage, pourraient avoir une fonction autre que celle de servir à la boucherie ; mais il est bien évident que cette perspective s’accompagnerait d’une diminution considérable du nombre d’animaux de boucherie, aujourd’hui très élevé précisément parce que l’élevage est cantonné dans des espaces hors-sol. Le problème ne se poserait donc pas, me semble-t-il, dans les termes que vous avez définis.
M. Jacques Lamblin. Vous regrettez l’importance croissante de l’élevage et une consommation de viande excessive. Vous semblez préconiser, à l’avenir, de ne pas tuer d’animaux pour les manger. Cela dit, la frugalité, à savoir une consommation raisonnable, vous conviendrait-elle ?
Mme Florence Burgat. Ma position est plutôt la première. Reste que pour instaurer la frugalité, il faut que beaucoup de gens aient renoncé à l’alimentation carnée. Une voie est envisageable avec les personnes qui tendraient vers un modèle beaucoup moins industriel et qui en viendraient à proposer que la viande soit un produit de luxe, ce qui ne me paraît pas choquant dans la mesure où elle n’est pas nécessaire à l’alimentation. Ainsi les gens qui s’abstiennent de manger les animaux et ceux qui prôneraient un modèle d’élevage différent pourraient faire du chemin ensemble.
Mme Catherine Rémy. Votre question, monsieur Lamblin, concernait un abattoir qui fonctionnerait correctement. Or mon point de vue est celui de l’ethnographe qui se rend sur le terrain et qui tâche de décrire le plus précisément possible la réalité. Il se trouve que dans l’abattoir qu’il m’a été donné d’observer, les choses ne se passaient pas de manière idéale.
M. Jacques Lamblin. J’ai pris la précaution de préciser que dans un abattoir idéal tout devait se passer de telle manière, ce qui ne signifie pas que la réalité n’est jamais celle-ci : je pense même qu’elle est assez souvent conforme à celle que j’ai décrite.
Mme Catherine Rémy. Ce n’est pas ce que j’ai constaté. J’ai observé un abattoir où, par moments, les choses se passaient telles que vous les décrivez et j’ai tâché, dans ma présentation, de mettre l’accent sur les moments où il n’y a pas d’accroc, pas de résistance du vivant, ou tout « coule ». Mais on voit aussi des moments où l’animal résiste – n’étant pas éthologue, je n’ai pas pu me placer du point de vue de l’animal, ce qui serait par ailleurs très intéressant : les bêtes se chevauchent dans le couloir d’amenée, font marche arrière, des animaux très puissants essaient de se débattre alors qu’ils sont sur le point d’être insensibilisés – si bien que même si l’ouvrier veut accomplir son geste le mieux possible, cela lui est difficile. Bref, il y a bien une résistance du vivant.
On a voulu penser l’abattoir comme une usine traditionnelle et, au fond, réduire l’animal à de la matière ; mais l’animal résiste, se rappelle à nous et se rappelle au tueur en résistant. J’ai constaté que ces moments sont très troublants pour les hommes et que c’est alors qu’on voit apparaître une violence.
Vous affirmez ensuite que, grâce au roulement des effectifs, tout le monde est amené à occuper le poste de tueur. La réalité est beaucoup plus complexe, en tout cas dans l’abattoir que j’ai observé. Quelques membres de l’équipe occupaient ces postes, certains s’y refusaient expressément. Du coup, la symbolique que j’ai évoquée s’applique à ceux qui prennent en charge le geste et une distinction se crée entre ceux qui font le geste et ceux qui s’y refusent selon la logique : je suis un vrai tueur ou je ne suis pas un vrai tueur. Ceux qui font le geste ont un ascendant très fort sur le groupe. Du reste, mes rapports avec les « vrais tueurs » et ceux qui ne l’étaient pas étaient très différents. À travers cette expérience, je puis donc témoigner de l’importance du geste de mise à mort dans les abattoirs alors même qu’on en parle très peu dans l’abattoir : ce n’est pas un sujet qu’on aborde.
Pour ce qui est de l’abattage rituel, il ne m’a pas été donné d’en observer. Je ne peux donc pas directement en témoigner. Mais ce qui m’interpelle est que le tueur, dans le contexte d’un abattoir, prend des risques, accomplit parfois mal son geste, soit parce que l’animal résiste, soit pour des raisons plus obscures liées sans doute à la souffrance au travail, aux cadences, etc. Le problème de l’abattage rituel est qu’il met en cause le geste d’insensibilisation qui lui-même a déjà du mal à être appliqué dans les abattoirs. L’abattage rituel impose finalement une autre norme qui va à rebours de celle qu’on essaie d’imposer aux personnels.
M. Jean-Pierre Marguénaud. L’ajout à l’article 515-14 du code civil d’une référence aux impératifs biologiques de l’espèce, madame Abeille, n’aurait pas changé grand-chose pour les animaux d’abattoir : une fois qu’ils en ont franchi la porte, les conditions compatibles avec lesdits impératifs ne me paraissent pas devoir revêtir une signification pendant bien longtemps… Je pense même que l’absence à cet article de référence aux impératifs biologiques de l’espèce est une bonne chose dans la mesure où, du coup, l’article L. 214-1 du code rural n’a pas été abrogé. Le fait que l’article 515-14 précise que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », sans autre précision, permet la protection de la sensibilité des animaux sauvages, sans propriétaires et d’ores et déjà placés dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Vous l’avez d’ailleurs fort bien compris, puisque je crois me souvenir qu’en 2014 vous aviez fait voter par la commission du développement durable un amendement étendant, au nom de la cohérence avec le futur article, la répression des actes de cruauté envers les animaux sauvages.
Le Québec a lui aussi modifié son code civil, le 4 décembre 2015, en s’inspirant directement de la réforme française et l’article correspondant se réfère aux impératifs biologiques de l’espèce. Seulement, ce pays était tellement en retard qu’il n’avait pas l’équivalent de l’article L. 214-1 de notre code rural. Cela consolide notre avance…
On a également évoqué la nécessité. Du point de vue strictement juridique un point me paraît assez intéressant. Jusqu’en 1999, les actes visés par l’article 521-1 du code pénal qui, aujourd’hui, réprime « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal […] », étaient les actes commis « sans nécessité ». Si cette dernière disposition a été supprimée en 1999, elle subsiste dans les contraventions pour mauvais traitements et atteintes volontaires à la vie des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Par souci de cohérence, il conviendrait de supprimer, dans ce dernier cas, la référence à la nécessité, à l’occasion de la réforme du code pénal.
Mme Florence Burgat. Pourquoi, à un moment donné, la société française a-t-elle ressenti le besoin de cacher la mise à mort ? Il s’agissait d’abord de faire baisser le niveau de violence des hommes entre eux, comme l’a bien montré Maurice Agulhon dans un article pionnier du début des années 1980. Mais dans le même temps, il y a toujours eu une tradition de pensée, et pas seulement chez les philosophes – j’aurais pu évoquer également des écrivains, des hommes politiques… –, pour s’interroger de façon plus approfondie, plus radicale sur ces questions.
Ainsi, deux points de vue, on pourrait presque dire deux humanités, cheminent parallèlement. C’est l’anthropocentrisme qui triomphe et une sorte d’enjeu identitaire de la part de l’humanité – si l’on peut employer ce concept – de garder la mainmise sur l’animal, comme le droit positif, du reste, l’illustre parfaitement. Les uns, s’appuyant sur la notion de sensibilité qui serait au fondement des droits aussi bien humains qu’animaux, souhaitent, depuis des siècles et des siècles, faire valoir les conséquences de ce point de vue sur notre comportement ; les autres entendent borner les considérations morales et les relations de justice au seul monde humain. Cette controverse se répète d’âge en âge, et l’anthropocentrisme demeure.
Philosophiquement, la nécessité est ce qui ne peut pas ne pas être. En ce sens, on le sait, l’alimentation carnée n’appartient pas, du moins aujourd’hui, à la catégorie de la nécessité. D’un point de vue historique, elle a pu être une nécessité dans certaines situations et elle peut l’être encore dans certains cas, cela n’est pas douteux.
Comment, cependant, alors que nous savons que l’alimentation carnée n’est pas une nécessité physiologique, un certain nombre de discours, en particulier de discours médicaux, ont-ils installé dans nos esprits l’idée qu’il s’agissait bien d’une nécessité ? Tout un travail de communication reste à mener.
M. Yves Daniel. Je ne suis pas un expert, ni un scientifique, ni un philosophe, ni non plus un anthropologue, mais seulement un député, paysan, éleveur et tueur – je n’entends pas vous faire peur en vous disant cela ; c’est qu’à la ferme, j’ai commencé à tuer des animaux à l’âge de quatorze ans ; je n’en tire pas de fierté particulière mais c’est simplement une réalité de mon parcours et cela ne m’autorise aucune vérité. La vérité ne peut être que collective et le sujet dont nous discutons est très complexe, un peu à l’image de notre débat sur le projet de loi sur la fin de vie, question sur laquelle il y a autant d’avis que d’individus.
De quoi parlons-nous ? De la lutte contre la maltraitance, contre la souffrance des animaux au moment de leur mise à mort. Nous parlons d’êtres sensibles au regard du droit mais ce qui est aussi une réalité. Mais nous, les humains, sommes aussi des êtres sensibles mais également dotés de sentiments, donc des êtres sentimentaux.
Nous parlons d’« abattage » des animaux. Or il y a sur cette terre des êtres vivants, animaux et végétaux, et je fais le lien entre l’abattage des animaux et l’abattage des arbres. Il y a donc peut-être des raisons pour qu’on ait employé ce mot-là. Je n’ai pas d’explication, mais je me pose la question.
Notre réflexion porte sur notre rapport aux animaux. Or je constate une importante dérive : comme nous sommes des êtres sensibles et sentimentaux, nous sommes parfois dans la confusion en entretenant avec l’animal un rapport sentimental. Est-ce possible ? Je pense que non : il ne doit pas y avoir de confusion. Lorsque nous parlons de sensibilité, de violence, de souffrance… nous les percevons en tant qu’êtres, encore une fois, sensibles et sentimentaux. Or nous ne pouvons pas nous mettre à la place des animaux.
Ce qui importe est de préserver l’existence humaine : elle doit prendre en compte l’existence des autres vivants, animaux comme végétaux, en veillant à préserver les nécessaires équilibres entre eux pour que la vie soit possible.
Aussi, puisque nous, les humains, allons traiter de cette question, je vous alerte afin que nous ne tombions pas dans la confusion. Il faut respecter les objectifs que nous nous sommes fixés, et si, certes, nous devons réfléchir en termes de droit, nous devons nous appuyer sur des expertises scientifiques, mais également pratiques, sans y mêler de sentiments. L’exercice est difficile, la question étant de savoir si nous sommes d’accord pour considérer que, pour nous, la priorité est la vie de l’humanité.
J’écoute avec intérêt vos propos éclairants qui peut-être contribuent à me rendre plus objectif dans la mesure où, comme je l’ai indiqué, mon rapport à l’animal est celui d’un éleveur tueur.
M. Jean-Luc Bleunwen. Je crains que, faute d’une réflexion philosophique approfondie, l’on ne fasse porter, de plus en plus, une forme de culpabilité sur les éleveurs et sur ceux qui se trouvent dans la « boîte noire » de l’abattage, qui tous poursuivent le même objectif : permettre la consommation de viande. On se valorise en effet, aujourd’hui, par le fait de ne pas manger de viande. N’y a-t-il pas un travail à faire, donc, pour éviter que les éleveurs et les travailleurs de la viande ne soient les victimes collatérales de l’évolution en cours qui ne prendra pas la forme, à mes yeux, de la fin de la consommation de viande mais plutôt celle d’un rééquilibrage ?
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Je commencerai par évoquer ce que vous avez appelé l’occultation, incontestable puisque la présente commission d’enquête a été constituée à la suite de la révélation de faits insupportables. Celle-ci a été suivie d’une série de contrôles systématiques, de la part du ministère, de l’observation de la réglementation sur le bien-être animal dans des abattoirs qui ont révélé un certain nombre de manquements. Il apparaît assez vite que la mise à l’écart de cette activité sociale et économique est de nature à favoriser l’affranchissement de la règle, d’où la nécessité d’un renforcement des contrôles.
Au-delà du contrôle, il semble que la transparence doit être envisagée. Or, selon vous, une transparence organisée – tant il est vrai que faire entrer n’importe qui n’importe quand dans un abattoir n’est pas forcément constructif – ne passe-t-elle pas par la création d’un échelon intermédiaire, à l’exemple des commissions locales d’information et de surveillance déjà mises en place pour le nucléaire et pour les stations de traitement des déchets ? En effet, j’y insiste, l’isolement dont il a été question ne va pas dans le sens du progrès global. Il paraît par ailleurs important, concernant le fait de vouloir consommer de la viande ou non, de préserver la liberté d’un choix responsable qui suppose une bonne connaissance des conditions de l’élevage et de mise à disposition des produits carnés. Ici aussi, une meilleure information ne permettrait-elle pas un choix plus éclairé étant entendu que nous ne pouvons prétendre conduire l’évolution en cours ?
Ensuite, la mort d’un animal n’est jamais un événement banal, qu’elle ait lieu dans un abattoir ou à la chasse… Cette mort est toujours accompagnée d’une image forte. À cet égard, nous avons auditionné des universitaires à propos des rites notamment juifs et musulmans. Ici, la mise à mort doit être institutionnalisée, ritualisée pour honorer un Dieu, ce qui montre bien qu’on ne saurait la réduire à un acte exclusivement économique. La réglementation est-elle capable de se substituer au rite ? Serait-elle une sorte de rite moderne nous donnant toute assurance ?
Ma question suivante concerne plutôt l’exposé de Mme Burgat. Je suis interloqué par l’opposition entre plaisir et nécessité. Ma formation et mon expérience de biologiste montre que, bien souvent, la nature a fait en sorte que le plaisir et la nécessité s’associent pour que la nécessité puisse se résoudre. Opposer nécessité et plaisir, dans l’affaire qui nous occupe, peut se révéler pertinent pour l’individu, mais pas pour une société ou pour une espèce. La notion de nécessité collective et de plaisir individuel est souvent mêlée, l’un construisant l’autre. Le plaisir se construit, il est social également et permet que ce qui est nécessaire au groupe se fasse. Ainsi pourquoi aime-t-on danser, quel plaisir intrinsèque peut-on trouver à s’agiter ? C’est qu’il y a une nécessité sociale dans ce geste.
Je suis frappé que l’homme déploie en général une énergie considérable à s’abstraire de la chaîne trophique : il ne considère pas son retour dans la chaîne du carbone et de l’azote de manière banale. Il se met dans des boîtes, il essaie, la plupart du temps, de s’extraire du retour à la nature de la manière la plus prosaïque, il part en fumée… Je ne connais qu’un rite, abondamment décrit, où le corps des défunts est réintégré à la chaîne trophique par l’intermédiaire d’oiseaux charognards, aux confins de l’Inde. Reste que nous n’aimons pas nous considérer à notre place dans la chaîne trophique, et c’est vrai aussi pour notre consommation. Nous sommes omnivores, nous mangeons un peu de tout, par opportunisme, parfois, par nécessité, souvent – peut-être pas aujourd’hui pour ce qui est de la consommation de viande de bœuf d’élevage, j’en conviens –, mais nous n’avons jamais mangé tous les animaux. Nous ne mangeons pas les carnivores, sauf les poissons – mais, parmi les mammifères, il est très rare que nous consommions des carnivores. Nous ne mangeons pas les charognards, nous ne mangeons pas les corbeaux : ceux qui font de la soupe de corbeaux sont déconsidérés dans la société. Les animaux que nous consommons sont la plupart du temps herbivores, à savoir plus capable que nous de valoriser certains produits de la photosynthèse, et d’une durée de vie bien inférieure à la nôtre ; autrement dit, si nous ne les consommions pas, nous les verrions mourir sans même en avoir tiré aucun « profit » ; a contrario, nous sommes choqués à l’idée de manger de l’éléphant par exemple.
Vous avez opposé ceux qui mettent l’homme au-dessus de tout et qui considèrent que l’on fait ce qu’on veut avec les animaux et ceux qui estiment que l’homme n’a pas à influer sur la vie des animaux et qu’il doit donc s’abstenir de tout acte à leur égard. Il me semble qu’existe une autre voie consistant à considérer, tout simplement, que nous faisons partie de la chaîne et que la consommation des surplus, la valorisation de l’ensemble de cette chaîne peut se faire de façon appropriée. Cette piste est-elle prise en compte par la philosophie, matière que je maîtrise encore moins bien que toutes les autres ?
Mme Florence Burgat. Je suis surprise que vous ayez compris que je condamnais le plaisir. Vous avez évoqué celui de la danse, que j’apprécie particulièrement. Je faisais allusion à une balance déséquilibrée : le fait de prendre son plaisir aux dépens de la vie des animaux ; je prenais là en considération le prix du plaisir que je m’accorde.
M. le rapporteur. Je vous ai sans doute mal comprise, mais je ne voudrais pas que vous me compreniez mal en retour. Je voulais simplement rappeler que vous aviez évoqué la consommation carnée comme un plaisir, en l’opposant à une nécessité. C’est cette dichotomie que j’ai du mal à comprendre : souvent, j’y insiste, le plaisir et la nécessité ont été associés dans des comportements sociaux parce qu’ils sont bénéfiques au groupe. Je pense aux travaux d’un excellent auteur, Lorenz, sur l’agression intraspécifique : l’homme est une des espèces qui s’extermine le plus, et pourtant cela ne nuit pas à la progression de son effectif. Il y a des choses qui sont de l’ordre du collectif, et non de l’individu, dans cette matière…
Mme Florence Burgat. Bien sûr, plaisir et nécessité peuvent être très utiles.
Vous avez par ailleurs abordé la question du rite et de la réglementation. Je suis très loin d’une anthropologie ritualiste qui considère que, sous prétexte qu’il y a certaines manières de procéder, la violence disparaît. Cette tendance, très répandue chez les anthropologues, me paraît tout à fait discutable. En ce sens, je défendrais bien plus la réglementation.
Mme Catherine Rémy. Vous avez souligné, monsieur le rapporteur, l’importance de l’occultation qui est en effet centrale pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. La hausse de la consommation de viande me semble trouver son explication dans cette occultation qui a créé les conditions d’une industrialisation de la mise à mort, industrialisation qui est le pilier de la consommation sous sa forme actuelle.
Dans les années 1960, avec la réglementation, on a voulu défendre l’idée qu’on pouvait à la fois industrialiser la mise à mort et l’humaniser. Or, on découvre que cette humanisation n’a pas eu lieu ou, en tout cas, pas sous les formes qu’on nous avait décrites. J’irais dès lors dans votre sens sur l’idée qu’il faille combattre ce confinement, mener une politique d’ouverture. Ce sera très difficile car on n’ouvre pas ainsi un milieu confiné depuis si longtemps.
M. le rapporteur. Un milieu organisé comme tel.
Mme Catherine Rémy. Tout à fait. Il y a un défi à relever en la matière.
Je reviens à la question posée auparavant sur l’ultra-violence. Je distinguerais trois niveaux. Le premier est la violence inhérente à la mise à mort – la mise à mort par saignée est un geste violent puisque l’on ouvre le corps : quand on l’observe, on en est toujours frappé. Le deuxième niveau est celui que j’ai appelé la culture du combat : il y a une résistance du vivant à laquelle les hommes répondent par la violence car il y a quelque chose de très difficile à accepter et à légitimer, et c’est précisément ce qui fait le terreau de l’ultra-violence, troisième niveau. Il y a par conséquent une quotidienneté de la violence, une habituation ; aussi ai-je été finalement peu étonnée de ce qu’on a pu voir dans ces vidéos, y décelant un prolongement de la culture du combat.
M. Jean-Pierre Marguénaud. J’ai été très sensible, monsieur Daniel, à votre parallèle entre l’abattage des arbres et l’abattage des animaux. L’article R. 214-64 du code rural distingue la mise à mort et l’abattage : la première désigne tout procédé qui cause la mort d’un animal tandis que le second est le fait de mettre à mort un animal par saignée. Peut-être un lien doit-il donc être établi entre la sève et le sang…
J’ai participé, il y a une quinzaine de jours, à Bruxelles, à un colloque sur l’interdépendance du vivant, où des considérations intéressantes et importantes ont été échangées. Un éminent collègue, le professeur Rémy Libchabert, avait proposé, en 1999, de conférer à tout le vivant les mêmes droits qu’aux hommes, de manière à être plus sûr, en définitive, de protéger l’homme lui-même. Il faudra peut-être y réfléchir.
Pour finir, je ne suis pas seulement fils d’agriculteurs, mais j’ai été associé à des activités d’élevage jusqu’à l’âge de trente-neuf ans ; si je ne pense pas avoir abattu beaucoup de bêtes moi-même, je sais ce que c’est que d’accompagner une vache accidentée à l’abattoir municipal et quel est alors le sentiment de l’éleveur ou du fils de l’éleveur à l’égard des animaux d’élevage ; et j’ignore comment vous faites mais, pour ma part, je ne parviens pas à l’éliminer – peut-être est-ce pour cela je suis universitaire et pas éleveur…
M. le président Olivier Falorni. Je vous remercie infiniment pour la précision de vos réponses ; cette table ronde participera largement à la réflexion devant nous conduire à la rédaction de notre rapport.
La séance est levée à dix-huit heures trente-cinq.
——fpfp——
22. Audition, ouverte à la presse, de M. Pierre Hinard, auteur du livre « Omerta sur la viande » et de Mme Anne de Loisy, auteure du livre « Bon appétit, quand l’industrie de la viande nous mène en barquette »
(Séance du mercredi 8 juin 2016)
La séance est ouverte à dix-huit heures quarante.
M. Olivier Falorni, président de la Commission. Nous accueillons Mme Anne de Loisy, journaliste d’investigation. Vous avez enquêté, madame, pendant trois ans au sein de la filière industrielle de la viande et vous avez publié, en février 2015 : « Bon appétit ! Quand l’industrie de la viande nous mène en barquette ». Vous y dénoncez de nombreuses non-conformités au sein des abattoirs.
Nous recevons également M. Pierre Hinard, agronome, éleveur et fils d’éleveur, ancien directeur qualité d’un site d’abattage et de transformation de viande. Vous avez été licencié, monsieur, par votre entreprise après avoir dénoncé divers manquements de sa part en matière de transformation de la viande. En novembre 2014, cinq ans après votre licenciement, vous avez publié « Omerta sur la viande », livre dans lequel vous racontez votre expérience au sein de l’abattoir où vous travailliez.
Vos témoignages, vos réflexions et vos analyses nous semblent particulièrement pertinents dans le cadre des travaux de notre commission.
Je vous rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Pierre Hinard et Mme Anne de Loisy prêtent successivement serment.)
Mme Anne de Loisy. Je suis journaliste et je me suis intéressée à ce sujet lorsque je travaillais pour Envoyé spécial. Nous venions de tomber sur un rapport de la Cour des Comptes indiquant que 47 % des abattoirs étaient non conformes. On m’a demandé d’aller voir ce qu’il en était dans les faits.
J’ai commencé par demander des autorisations pour entrer dans les abattoirs, qui m’ont été systématiquement refusées. J’ai fait le tour de toutes les associations qui travaillaient autour et à proximité des abattoirs, j’ai rencontré des vétérinaires, des éleveurs ; et j’ai fini par rencontrer des abatteurs de façon non officielle – lorsqu’on est journaliste, si la porte est fermée, il faut entrer par la fenêtre.
J’ai ainsi réalisé le reportage « La viande dans tous ses états » qui a été diffusé dans l’émission Envoyé spécial en 2012. Ce travail m’avait demandé énormément de temps, et j’ai décidé de continuer à enquêter, et sur toute la filière du début jusqu’à la fin pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Cette enquête a débouché sur ce livre, qui est presque une analyse de la société à travers le prisme de la viande. On peut faire de grandes déclarations, mais si l’on ne regarde pas concrètement ce qui est possible sur le terrain, on brasse du vent.
J’ai pu constater qu’un grand nombre d’abattoirs n’étaient toujours pas conforme. Il suffit de regarder les nombreux rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire européen, et ceux de la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires – des super-inspecteurs, très compétents, qui interviennent en cas de crise. Les vétérinaires eux aussi font des rapports extrêmement alarmants. Nous avons donc le constat ; il nous faut ensuite mettre les moyens en regard des besoins pour progresser dans ce domaine. Il y a de plus en plus d’intoxications alimentaires : les chiffres sont très variables, mais on estime qu’il y en a plus de 850 000 par an, et qu’elles causent 750 décès. Ce n’est pas rien. Une commission de santé publique avait produit un travail intéressant qui montrait qu’un euro dépensé en prévention entraînait une économie de cinq à six euros en réparation des préjudices et des frais médicaux. Nous avons donc tout à gagner à optimiser le point de départ pour que le consommateur retrouve dans son assiette quelque chose qui ressemble à ce qui figure sur l’étiquette.
Cela étant, j’avoue être assez perplexe, car nous nous retrouvons face à un constat assez effrayant : les Français sont totalement déconnectés de la réalité de l’élevage et de ce qu’ils mettent dans leur bouche pour se nourrir. C’est encore pire chez les jeunes : un enfant sur deux ne sait pas que le jambon est fait à partir du cochon ; qu’un nugget, c’est du poulet ; et que le steak haché, c’est du bœuf – encore que dans certains cas, ce n’est pas le cas ! Il y a urgence à reconnecter l’humain avec ce qui lui permet de se nourrir. Sans compter que si l’on mange des aliments de mauvaise qualité, il faudra aller chez le médecin ; et même si c’est la Sécurité sociale qui paie, c’est tout de même nous qui sommes malades…
M. Pierre Hinard. Je suis devenu lanceur d’alerte malgré moi, simplement avec la volonté de faire mon travail, de faire respecter la loi. J’avais mis toute mon énergie, dans l’entreprise dont j’étais directeur qualité, à faire respecter les cahiers des charges de nos grands clients : Auchan, Système U, McDonalds, Lustucru, William Saurin, etc., et de faire respecter la loi sanitaire. J’avais pris note que l’industriel marchait assez allégrement sur la limite – il était plus que borderline ; j’ai tout fait pour le recadrer en lui signalant tout ce qui ne devait jamais se reproduire. Je pensais, dans un premier temps, avoir la latitude pour m’assurer que les fraudes ou les choses qui ne devaient pas se faire ne puissent plus jamais se reproduire. Je pensais que l’industriel ne ferait jamais sauter les verrous que je posais. En fait, je me suis aperçu à l’occasion d’une crise sanitaire avec Auchan que, dans mon dos, on avait dérogé à tout ce que j’avais mis en place. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et comme je suis citoyen, consommateur, père de famille, je me suis demandé ce que je devais faire.
J’ai commencé par en parler à l’administration. Et là, ce fut un grand sentiment de solitude… C’est affreux de dire cela à l’Assemblée nationale ! J’aimerais tellement vous dire que je me suis senti protégé, aidé, accompagné… Mais je viens de prêter serment de dire la vérité, et je me vois mal vous mentir, même pour faire plaisir aux ors de la République.
Quand j’en ai parlé à la responsable départementale de la direction des services vétérinaires, elle semblait acquise, rigoureuse. Mais le cas est monté d’un cran lorsque, de retour d’un week-end, j’ai appris que l’usine avait travaillé pendant le week-end, ce qui n’était pas du tout dans les habitudes de l’entreprise, et qu’ils avaient fait de la remballe de viande avariée que j’avais déjà fait revenir de chez Flunch, car nous avions déjà intoxiqué cinquante restaurants. Bien entendu, jamais rien n’avait été déclaré à l’époque, ni par les services vétérinaires, ni par l’entreprise, ni par les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des restaurants concernés. Tout était resté couvert par un profond silence.
Ce jour-là, lorsque j’ai vu réapparaître cette viande que j’avais mise en destruction presque un an plus tôt, j’ai décidé d’aller trouver l’inspecteur vétérinaire pour qu’il saisisse. Je pensais que nous en resterions là : une saisine permettrait à l’industriel de comprendre qu’il y avait une limite à ne pas franchir. Il n’en a rien été : l’inspecteur vétérinaire est allé pousser la porte du patron en lui disant que son directeur qualité venait de l’informer que sa société avait fait de la remballe, et que ce n’était pas bien… Une heure après, j’étais viré manu militari par la deuxième actionnaire, également directrice générale. En une heure, j’étais mis à pied et disparaissais de l’entreprise pour ne plus avoir accès aux ordinateurs ni aux collègues salariés qui pouvaient attester et témoigner.
Mon premier réflexe a été de me tourner vers ceux qui sont censés me représenter : l’inspection du travail. Mais il m’a été dit que depuis que j’étais mis à pied, elle ne pouvait plus rien faire ni intervenir dans l’entreprise, car le président-directeur général y a pouvoir de police. Pourtant c’était un cas de force majeure, de mise en danger de la santé du consommateur, il y avait urgence ! Mais il m’a été répondu qu’on ne pouvait rien pour moi.
Je me suis retourné vers la direction des services vétérinaires, en la personne de son inspectrice générale, qui est mystérieusement passée aux abonnés absents. J’ai laissé une vingtaine de messages sans qu’elle ne me rappelle jamais. Je me suis adressé à l’échelon supérieur, le directeur des services vétérinaires à Nantes. Lui a rapidement accepté de me donner un rendez-vous, et j’ai eu la surprise d’y retrouver l’inspectrice générale… Il m’a été dit que ce n’était pas la première fois qu’un salarié servait de fusible, mais que l’affaire n’allait pas en rester là. Et elle n’en est pas restée là, c’est sûr : il l’a purement et simplement enterrée !
Un an après, j’ai repris rendez-vous, et il m’a dit que l’on me fournirait l’attestation prouvant que j’avais fait mon travail d’alerte, c’était une question de mois. Un an après, j’ai envoyé une lettre recommandée. Il m’a donné un nouveau rendez-vous, il m’a passé de la pommade, et un an s’est encore écoulé. J’ai repris rendez-vous. Il m’a alors dit que l’attestation était sur le bureau du ministre, et qu’elle allait être signée d’ici à un mois ou deux. Il a laissé le temps s’écouler, jusqu’à ce que le délai au-delà duquel je ne pouvais plus porter plainte contre la DSV soit écoulé. Trois ans et trois mois plus tard, j’ai reçu une belle lettre recommandée me faisant savoir qu’il aurait bien voulu m’aider, mais qu’il n’avait pas pu circonstancier les faits, qu’il n’avait pas pu retrouver l’inspecteur vétérinaire – alors que ce dernier était toujours censé faire partie de son équipe ! – et qu’il ne pouvait donc plus rien pour moi.
J’ai alors décroché mon téléphone et je lui ai dit qu’il m’avait bien roulé et qu’il était aberrant que la force publique couvre des agissements frauduleux. Je l’ai informé que je ne comptais pas en rester là, que le dossier était au Canard enchaîné et que je le mettrais en première ligne. Quinze jours plus tard, il m’a donné un rendez-vous – comme quoi les choses peuvent parfois se faire dans l’urgence – et m’a informé qu’il avait retrouvé l’inspecteur vétérinaire qui lui avait attesté que j’avais bien fait mon travail citoyen d’alerte, quatre ans auparavant. Imaginez-vous ? On pourrait en rire si le constat n’était pas aussi triste ! Entre-temps, il faut savoir que ce directeur des services vétérinaires avait été promu directeur de la protection de la population. C’est-à-dire qu’il avait englobé la direction des services vétérinaires et direction de la répression des fraudes, lui qui avait couvert la fraude de l’industriel pendant quatre ans et qui avait résisté ardemment pour ne pas émettre la première pièce officielle attestant qu’en tant que lanceur d’alerte, j’avais fait mon travail citoyen !
Tout est dit : l’État a tous les moyens d’empêcher la souffrance animale et la fraude sanitaire et de protéger la santé du consommateur, mais il ne le fait pas. Le rapport de la Cour des Comptes de 2014 est édifiant à ce sujet. Les moyens sont réduits, mais quand ils sont présents, ils ne sont pas utilisés. Quand les moyens sont utilisés et que des sanctions doivent être prises, elles ne tombent pas. Et quand elles tombent, elles sont ridicules au regard des enjeux économiques et aux gains que l’industriel a tirés de la fraude ! Ainsi, si un industriel gagne quelques millions ou quelques centaines de milliers d’euros par la fraude, il recevra au mieux un avertissement, au pire une amende de 500 euros. Mon livre est abondamment illustré de tels exemples concrets, pour lesquels je n’ai jamais été poursuivi en diffamation, alors que je cite nommément toutes les pièces. J’attends les accusations, car nous avons des montagnes de pièces, et entre-temps, la justice a commencé à œuvrer. Après mon départ, la fête a continué chez l’industriel, alors que j’avais lancé l’alerte auprès des plus hautes sphères de la direction des services vétérinaires et de la protection de la population. On m’a suffisamment reproché d’avoir médiatisé cette affaire ; on ne peut donc pas dire que l’on ignorait mes démarches. Pourtant, la fête a continué, puisque l’industriel est aujourd’hui mis en examen : la personne morale et quatre personnes, dont mon ancienne assistante qualité, qui a repris mon poste de directeur de la qualité, sont mises en examen pour mise en danger de la santé du consommateur pour des faits courants de 2009 à 2013, autrement dit jusqu’à la veille de la perquisition lancée par le procureur.
Cela illustre le dysfonctionnement des services de l’État : on a beau tirer la sonnette d’alarme, il ne se passe rien. Tout au long de la chaîne, tout le monde se complaît à laisser pourrir la situation et à étouffer les affaires. Pendant ce temps, les lanceurs d’alerte paient de leur poste, on leur promet de leur pourrir la vie et de faire en sorte qu’ils ne retrouvent jamais de travail.
Dans un premier temps, j’ai pensé que les grands clients seraient contents de récupérer un lanceur d’alerte, et notamment un directeur qualité « à qui on ne la fait pas » : je sais pertinemment comment les industriels trichent et comment ils font pour présenter des documents officiels falsifiés. Je pensais avoir des ressources, et que l’on viendrait me chercher. Quand j’ai compris que la direction des services vétérinaires couvrirait totalement les agissements frauduleux des industriels, j’ai décidé d’aller trouver les grands clients, notamment Auchan, qui pèse 50 % du marché. On m’a déroulé le tapis rouge, le directeur qualité et le directeur des achats de chez Auchan m’ont mis en confiance, en me disant que ce que j’avais fait était bien, qu’ils avaient besoin de savoir. Prudent, je n’avais apporté que des photocopies pour ne pas me faire détrousser de mes pièces… Ils ont noté, mais ils s’en sont servis pour se renforcer vis-à-vis de l’industriel, sans rien changer. Ils ont continué à s’approvisionner chez lui, et ils l’ont couvert. Lorsque j’ai rappelé quinze jours plus tard, il m’a été dit que j’avais fait le travail que j’estimais devoir faire, et qu’eux allaient faire leur devoir conformément à la politique Auchan. Le résultat a été l’omerta et l’étouffement total. Cela a été la même chose chez Flunch.
M. le président. Merci de ce témoignage édifiant.
Avez-vous été surpris par les vidéos de L214, qui ont été à l’origine de la création de cette commission d’enquête ? Je rappelle que ces vidéos ont été tournées clandestinement dans les abattoirs d’Alès, du Vigan et de Mauléon. Considérez-vous qu’il s’agit de phénomènes exceptionnels, ou de phénomènes récurrents ?
Que pensez-vous de l’éventualité de mettre en place la vidéosurveillance, notamment aux postes d’abattage, pour avoir le contrôle le plus régulier et le plus pertinent possible ?
Mme Anne de Loisy. S’agissant des vidéos publiées par l’association L214, j’ai pu visiter une quinzaine d’abattoirs sans dire que j’étais journaliste, donc dans des conditions de travail classiques. Effectivement, j’ai pu constater des comportements extrêmement violents à l’égard des animaux, pas systématiques, mais assez récurrents, dans de nombreux abattoirs que j’ai visités. Ce ne sont donc malheureusement pas des cas exceptionnels.
Les salariés des abattoirs sont assez mal formés, quand ils le sont. La formation est extrêmement courte, c’est une sorte de formalité administrative. Ils sont souvent assez mal encadrés, et dans les abattoirs que j’ai visités – je n’ai pas visité celui dans lequel travaillait M. Hinard –, les responsables qualité n’y connaissaient rien. Devant le responsable qualité, le salarié égorgeait la bête vivante et la pendait vivante par les pieds. Comme il avait peur du sang qui giclait, il coupait la gorge de la bête, cela durait cinq minutes pendant lesquelles la bête étouffait dans son sang et ahanait. C’était horrible, je garde ces images en tête, de même que celles de bêtes à moitié mourantes que l’on place quand même sur la chaîne. Ce sont des choses que l’on voit dans les abattoirs.
Aujourd’hui, les services vétérinaires ne sont pas suffisamment nombreux. Pour rappel, nous avons en France environ 1 000 vétérinaires contre 4 500 en Allemagne et 6 000 en Italie. Par ailleurs, la France est le premier producteur de volailles, premier producteur de bovins et troisième producteur de porcs. Nous ne mettons pas nos services vétérinaires dans ces abattoirs pour faire leur travail en nombre suffisant. Ils sont en sous-effectif, les alertes sont multiples et j’imagine que vous les avez entendus à plusieurs reprises. Les gens ne sont pas présents en permanence dans les abattoirs. On essaie de renforcer les équipes avec des techniciens vétérinaires, mais leur formation est tellement légère qu’ils n’ont pas les compétences réelles pour intervenir, et sans ces compétences, ils n’ont pas la force de s’opposer à un directeur d’abattoir. Il y a également des préposés sanitaires qui se contentent de tamponner, sans aucune formation sanitaire ou en protection animale. Un gros travail doit donc être fait en direction des services vétérinaires.
En 2005, la France était classée au trente et unième rang mondial pour le nombre d’animaux suivis par les vétérinaires. Aujourd’hui, nous sommes en quatre-vingt-dix-septième position, derrière le Costa Rica, l’Iran et la Tunisie ! Rappelons que nous sommes les premiers producteurs de volaille, premiers producteurs de bovins et troisièmes producteurs de cochons. Quelque chose ne va pas. Nous sommes les cinquièmes exportateurs de produits alimentaires, et nous ne mettons pas les moyens pour garantir aux Français et aux autres consommateurs du monde que les aliments d’origine française qu’ils vont manger sont de qualité. Cela va finir par se retourner contre nous : il est temps de réagir. Nous voyons d’ailleurs la consommation de viande diminuer, et l’impact de ces affaires sur les populations en France et dans le reste de l’Europe.
Ces images ne sont donc pas choquantes : malheureusement, c’est une réalité.
M. le président. Vous nous dites donc que ce que les vidéos de L214 montrent dans les abattoirs du Vigan, d’Alès et de Mauléon ne sont pas des cas exceptionnels, ni des phénomènes isolés, et que vous avez pu constater les mêmes phénomènes lors de vos visites ?
Mme Anne de Loisy. Absolument. Les images de L214 montrent qu’il existe des problèmes avec certains opérateurs, mais comment un patron peut-il prétendre ne pas être au courant de ce qui se passe dans son abattoir alors qu’il n’a que dix salariés ? Si lui n’est pas au courant, les collègues le savent. Quand on va dans un abattoir, on entend et on voit ce qui s’y passe. À plusieurs reprises, les gens sont venus me voir parce qu’ils voulaient me montrer ce qu’ils ne supportaient plus. Ils ne supportent plus d’avoir des cadences infernales, pris entre le directeur qualité qui leur demande de prendre le temps et d’être efficaces, et le responsable commercial qui leur demande d’accélérer.
La réalité est que les cadences dans les abattoirs sont infernales. Dans les gros établissements, on abat entre cinquante et soixante vaches par heure, autrement dit une vache toutes les minutes. Or il faut au moins quatre minutes pour qu’une vache meure, et quatorze pour un veau. Tous ces chiffres sont des moyennes, tirées de rapports officiels. De fait, les bêtes sont abattues et découpées vivantes. L’abattage et l’industrialisation vont tellement vite que les bêtes n’ont pas le temps de mourir, on les accroche et on commence à les découper alors qu’elles sont encore vivantes.
M. le président. Établissez-vous une distinction entre les grands abattoirs industriels, souvent mono-espèce, et les abattoirs artisanaux, de type multi-espèces ?
Mme Anne de Loisy. Il y a des différences ; tout dépend de la manière dont l’abattoir est géré et dirigé. J’ai aussi vu des abattoirs qui fonctionnaient très bien, avec des gens qui abattaient les bêtes de façon tout à fait respectueuse. Certes, faire passer de vie à trépas est un acte violent, mais cela peut être fait dans des conditions optimales et sans que la bête ne souffre de façon terrible. J’ai vu des gens qui bossaient très bien, et souvent le travail est meilleur dans les petits abattoirs, où les travailleurs sont moins soumis à des cadences infernales.
M. le président. Vous considérez que ce sont les cadences qui sont principalement à l’origine des maltraitances ?
Mme Anne de Loisy. Les cadences, mais aussi les équipements. Le problème dans les petits abattoirs tient au fait que les équipements n’ont souvent pas été rénovés depuis quarante, cinquante voire soixante ans ; cela pèche souvent de ce côté-là. Alors que les gros abattoirs ont fréquemment réussi à obtenir beaucoup de subventions pour acheter des installations plus conformes – même si aujourd’hui, les plus beaux outils se trouvent en Roumanie, pas en France. Car les abattoirs en Roumanie sont tout neufs, avec du matériel de haute technologie.
M. le président. Nous avons pu le constater, certains directeurs d’abattoirs que nous avons visités ont reconnu que la France avait beaucoup de retard sur l’équipement des outils. Nous avons visité l’abattoir d’Autun, un abattoir artisanal multi-espèces, et la directrice convenait elle-même les défauts de certains équipements, en particulier sur l’amenée des animaux et le piège de contention pour l’étourdissement. Cela donnait lieu à un véritable un combat entre l’opérateur et l’animal du fait de l’inadaptation des infrastructures.
À l’inverse, dans un grand abattoir industriel du groupe Bigard à Maubeuge, nous avons constaté des phénomènes tout à fait différents. Les cadences étaient fortes, mais les équipements très modernes – je crois que 50 millions d’euros avaient été investis sur ce site – et le caractère mono-espèce jouent beaucoup sur la façon dont l’animal est traité de l’amenée jusqu’à la phase d’étourdissement.
Vous considérez qu’il y a des problèmes d’équipement, de formation…
Mme Anne de Loisy. D’encadrement, de surveillance, de contrôle en fait.
M. le président. J’en reviens donc à ma deuxième question : que pensez-vous de la vidéosurveillance ?
Mme Anne de Loisy. Je pense que la vidéosurveillance peut être une bonne chose, certains abattoirs l’ont adoptée et cela fonctionne ; mais encore faut-il placer quelqu’un derrière l’écran. Il y a des enregistrements, donc on peut revenir en arrière et regarder ce qui s’est passé, mais je pense que l’humain ne doit pas disparaître au profit de la vidéosurveillance. L’urgence commande de renforcer les équipes vétérinaires. Si la France veut continuer à se prévaloir de sa haute qualité gastronomique et de la qualité de ses produits, elle doit y mettre les moyens, qui sont bien faibles au regard des conséquences potentielles. Certains pays refusent déjà d’acheter de la viande française. Dans l’intérêt des éleveurs et de toute la filière, c’est important.
M. Pierre Hinard. Vous avez entendu mon témoignage : vous comprenez donc que je n’ai absolument pas été surpris des révélations contenues dans les vidéos de L214. Quand j’ai pris mon poste de directeur qualité, ce n’était pas moi qui suis allé chercher l’entreprise, c’est elle qui est venue me chercher car j’avais une aura d’homme de qualité et d’agronome expérimenté sur les filières bio animales. L’industriel avait besoin de cette aura de qualité pour faire bonne figure auprès de ses grands clients.
Je suis né en bio, de parents pionniers des causes animales et de la notion de bien-être animal. Il y a quarante ans, lorsque l’on parlait de bien-être animal, on nous rigolait au nez. Aujourd’hui, tout le monde s’en réclame et se l’approprie alors que nous étions ridiculisés. Les notions de sensibilité et de bien-être animal sont les premières avancées des cahiers des charges bio.
Moi qui suis issu de ce milieu, dans lequel la sensibilité animale d’un être vivant est très importante, quand j’ai pris mon poste le premier jour et que je suis allé sur la chaîne d’abattage, j’ai été horrifié. Je me suis aperçu que les salariés, notamment les tueurs et ceux qui amènent au piège et à la saignée, sans être de mauvais bougres, étaient abrutis par la cadence et étaient habitués à mal faire, sans avoir aucune conscience qu’ils faisaient mal.
J’avais rapporté à la directrice générale de l’entreprise que son frère, qui était le PDG, avait tendance à ne pas y porter d’attention particulière, l’important à ses yeux étant la cadence sur la chaîne. Comme c’était un métier difficile, on allait même jusqu’à payer un coup à boire à cinq ou six heures du matin, ce qui était parfaitement contraire à toutes les normes et à la politique de l’entreprise. Introduire des boissons sur le lieu de travail alors que l’on utilise des objets contondants est impensable. Mais ce sont des pratiques qui existent, parce que cela permet aux gars de tenir l’effort : ils rechigneront moins à faire un quart d’heure supplémentaire, ils ne le décompteront pas.
Je ne suis donc pas surpris du tout. Il faut savoir que L214 ne l’a pas fait uniquement pour de petits abattoirs. En 2008, il me semble qu’ils ont fait la même chose dans l’abattoir Charal de Metz. À l’époque, cela n’a pas fait un grand scandale, parce que la société civile et les médias n’étaient pas prêts. Nous n’étions pas encore sensibles à cette thématique, et cette vidéo était passée sous les radars. J’ai re-visionné les images : elles étaient pourtant inacceptables pour un groupe comme Bigard. Mais il n’y a pas eu de scandale à l’époque.
Tout cela est également possible parce qu’il y a une pression sur le recrutement. Les industriels sont lancés dans une course effrénée pour gagner plus et dépenser moins, en recrutant des gens toujours moins bien payés. Un ex-collègue, salarié sur la chaîne d’abattage, a été mis en contact avec moi alors que je suis considéré comme un pestiféré. Il m’a rappelé que lorsque j’étais au poste de directeur qualité, sur quarante personnes sur la chaîne d’abattage, il y avait cinq roumains que le patron avait testés pour tenter de faire pression à la baisse sur les salaires. Aujourd’hui, il ne reste plus que cinq français… Les roumains sont majoritaires, et le patron va maintenant chercher des guinéens pour les payer encore moins cher. Voilà qui dit tout de la pression permanente sur les salaires. Lorsque j’étais en poste, j’ai vu arriver les roumains. Même l’inspecteur vétérinaire, pourtant déjà totalement corrompu, se plaignait de ne pas pouvoir faire son boulot puisque le gars en face ne comprenait rien quand on lui expliquait qu’il faisait de mauvais gestes. Comment voulez-vous faire appliquer la politique sanitaire à des ouvriers qui ne parlent pas un mot de français, et quand on permet à un industriel de recruter sans former ni même apprendre la langue ?
Qui plus est, parmi la cohorte des techniciens vétérinaires, des gens sont recrutés sans aucune compétence : des vendeuses de boulangerie sont reconverties comme techniciens vétérinaires. Ce sont des gens qui n’ont jamais fait d’élevage, qui n’ont jamais élevé un animal. M. Yves Daniel, qui est aussi éleveur, pourra en attester : un éleveur s’est battu pour sauver une vie à la naissance, au vêlage. Il ne lui viendrait pas à l’idée de ne pas faire attention à la mise à mort de son veau ou de son bœuf, par respect pour la vie qu’il a fait évoluer chez lui. Même si donner la mort reste un acte brutal, on peut quand même le faire avec le minimum de souffrance, et en le respectant au maximum. Encore faut-il en avoir conscience ; or cette conscience vient du contact avec la sensibilité de l’animal, et il faut avoir vécu avec les animaux pour l’expérimenter. Ces techniciens vétérinaires n’ont jamais vécu avec des animaux, c’est à déplorer.
S’agissant de la vidéosurveillance, j’avais rédigé un article suite aux scandales : Le Monde m’avait demandé de réagir et j’avais proposé d’instaurer une transparence totale dans les abattoirs.
Aujourd’hui, il est plus compliqué de visiter un abattoir qu’une centrale nucléaire. Ce n’est pas normal. La vidéosurveillance sur les postes d’abattage, d’étourdissement et de saignée me paraît donc indispensable : cela permettra de garder une trace de ce qui s’est fait. Certains protestent au nom de la vie privée du salarié, mais je ne vois pas quels actes de nature privée peuvent être commis dans un endroit aussi glauque qu’une chaîne d’abattage ! C’est juste de l’enfumage pour ne pas mettre ces mesures en œuvre. Dans l’espace public, nous sommes sous vidéosurveillance sur l’autoroute ou quand nous allons retirer de l’argent dans les distributeurs de billets. Si nous nous émouvons plus du devenir des billets de banque que de la sensibilité et la vie animale, cela en dit long sur notre société…
La vidéosurveillance doit s’accompagner de la transparence totale. Il faut que le législateur autorise les associations de protection animale à entrer dans un abattoir n’importe quand. Je ne parle pas des plus extrémistes, mais le préfet peut agréer des associations telles que l’œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs afin qu’elles puissent entrer dans les abattoirs, sans que l’industriel ne soit en mesure de refuser.
La seule chose qui fonctionne, ce sont les contrôles inopinés. Je suis éleveur et producteur en bio, et nous sommes contrôlés de façon inopinée par l’organisme de certification – dans mon cas, c’est ECOCERT. C’est la seule solution valable. On rétorque qu’il y a des audits des services vétérinaires et des grands clients ; c’est vrai, mais ces visites sont prévues, un rendez-vous est pris. Lorsque j’étais directeur qualité, l’industriel passait avant les visites pour que je donne les consignes, et les jours d’audit, il déplaçait certains salariés puisqu’il a la maîtrise totale du personnel. Il faut donc que les contrôles soient inopinés. L’État sait pertinemment ce qu’il faut faire.
Il est vrai qu’il n’y a certainement pas assez de vétérinaires et de techniciens vétérinaires, mais si déjà ceux qui sont en place avaient la volonté de faire leur travail ! Dès mon arrivée, le premier jour, j’avais exprimé le souhait de bien travailler et de faire de belles choses avec l’inspecteur vétérinaire. Mais il m’a répondu que nous n’étions pas là pour travailler ensemble. Pourtant, pour faire progresser les choses, ce serait utile.
Il y avait une douzaine de techniciens vétérinaires sur le site. Aujourd’hui, une procédure pénale est en cours, le procureur et le juge sont allés les chercher : dix sur douze sont soit frappés d’amnésie, soit ne savent pas ou ne veulent pas parler. Ce sont des fonctionnaires de l’État qui font de la rétention d’information, car ils ont appris dans l’administration qu’il vaut mieux ne rien voir, ne rien savoir, ne rien dire. Voilà qui en apprend encore beaucoup sur le fonctionnement de l’administration ! Aujourd’hui, dans cette équipe, seules deux personnes ont fait leur travail citoyen, alors que les fonctionnaires auraient dû lancer l’alerte avant moi. Eux voyaient tout, ils étaient payés pour cela et ils sont indépendants : ils ne risquent pas de perdre leur poste, eux…
C’est une autre chose à faire pour améliorer la condition animale : faites que les inspecteurs vétérinaires et les techniciens vétérinaires ne soient pas fonctionnaires à vie. Ils doivent être responsabilisés dans leur travail et dans leur tâche. S’ils ne font pas leur boulot, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être cassés, ils doivent être mutés, ils ne doivent plus être fonctionnaires. J’ai dû enfoncer des portes, repousser les murs, et à chaque étape, à chaque niveau hiérarchique, on organisait l’omerta. L’Assemblée nationale doit donner les moyens de responsabiliser les gens, responsabiliser la fonction publique. Tous ceux qui ont couvert toutes les fraudes et la mise en danger de la santé des consommateurs et des enfants sont toujours en poste, ils ne sont pas inquiétés, et s’ils ne veulent pas témoigner, ils ne témoignent pas. Le directeur a même été promu directeur de la répression des fraudes ! C’est le pompon !
M. Arnaud Viala. Je suis surpris et admiratif de votre franc-parler à tous deux. J’imagine que ce n’est pas facile à assumer tous les jours.
Je veux vous interroger sur votre statut de lanceur d’alerte. Aujourd’hui, ce que vous faites a des conséquences considérables sur l’industrie de l’abattage des animaux, sur l’industrie agroalimentaire, sur la perception qu’ont les consommateurs de leur acte de consommation. Cela pourrait modifier beaucoup d’équilibres de notre société ; avoir des effets sur des pans entiers de notre économie et sur des territoires qui vivent de l’agroalimentaire ; à terme cela pourrait déstabiliser des filières d’élevage, autrement dit tout l’amont. Je voudrais connaître l’état de vos réflexions sur les pistes permettant de sortir de cette situation.
Dans vos propos, vous semblez dire que seule la solution du flicage est valable, que les situations frauduleuses continueront et qu’il faut simplement mettre en place des systèmes de manière à en réduire le nombre.
Est-ce votre conviction profonde ? Pensez-vous qu’il existe encore des structures qui font leur travail correctement ? Pensez-vous que la bonne volonté des responsables d’abattoirs et une bonne formation des salariés suffiraient pour faire perdurer ce secteur d’activité et tout ce qui en dépend ?
M. Pierre Hinard. Je suis aussi un éleveur passionné. Et je sais que les animaux que j’élève seront consommés, donc abattus. C’est une étape qui peut être considérée violente par certains consommateurs, mais c’est un droit que j’octroie à l’homme, et c’est pour cela que je préconise une troisième voie entre celle qui consiste à ne plus manger de viande et celle qui consiste à se désintéresser complètement du mode de production et d’abattage et de la condition animale – vive l’industrialisation, tout va bien et on se fout du reste… Je soutiens qu’il y a une voie de sagesse : il faut élever moins, élever bien, donner à l’animal une vie décente et avoir envie de partager sa vie.
Certes, nous savons que nous allons décider à un moment donné d’une fin, mais c’est aussi le cas dans la nature. J’observe des animaux qui ne sont pas élevés pour être abattus, et parfois leurs fins de vie ne sont pas heureuses. Les fins de vie, quelles qu’elles soient, ne sont pas idylliques. Dans le cas de l’élevage, nous fixons une date butoir pour une consommation ; il faut que ce soit fait dans le respect de l’animal, en ayant conscience que c’est un être sensible auquel on doit du respect, d’autant plus que nous allons le consommer.
Cette troisième voie consiste à élever un animal en respectant ses besoins physiologiques : il doit être élevé en plein air et avoir une vie soutenable. Lors de l’abattage, il faut intervenir en amont, c’est-à-dire limiter le stress dans les transports et durant l’amenée jusqu’au piège au poste de tuerie. Nous sommes dans une société moderne, les moyens existent. L’innovation est possible, c’est le refus d’investir qui la limite. Faisons l’investissement !
L’autre voie possible, notamment pour les filières qualité, serait de permettre l’abattage à la ferme, comme en Suisse ou au Canada. C’est totalement interdit aujourd’hui, alors que ce sont les conditions idéales pour limiter le stress de l’animal. Certes, il n’est pas question de se contenter de donner un coup de masse pour assommer l’animal et de le saigner à la ferme, mais il est possible qu’un camion d’abattage, un abattoir ambulant se déplace à la ferme. Ce sont les conditions idéales pour la qualité de la viande, parce que l’animal n’a jamais été stressé, et il reste dans son milieu jusqu’au moment où il est étourdi et assommé. C’est vraiment important.
Une troisième voie est donc possible. Mon propos n’est pas de condamner tout ce qui est transformation, commercialisation et consommation de la viande, tout d’abord parce que je suis éleveur, et je suis conscient qu’il y a moyen de faire autrement. Je le fais d’ailleurs déjà aujourd’hui.
Il m’a fallu commencer à réinventer une autre vie puisque l’on m’empêche d’exercer mon métier. C’est le paradoxe insupportable des lanceurs d’alerte : nous ne sommes pas indemnisés, nous ne sommes pas protégés, et celui qui doit virer et disparaître dans l’histoire est celui qui a amené l’information, qui a révélé et qui a fait respecter la loi, et non pas le fraudeur, l’industriel qui a été pris en flagrant délit. Lors d’une précédente commission parlementaire sur les lanceurs d’alerte, M. de Courson disait qu’il faudrait faire en sorte que ce soit le fraudeur qui soit contraint de laisser la direction de l’entreprise, qu’il soit indemnisé, et qu’il ne soit plus actionnaire et ne puisse plus gérer l’entreprise. Ce serait normal. Ce n’est pas au lanceur d’alerte d’être brûlé sur la place publique ; pourtant c’est ce qui se passe aujourd’hui.
Mme Anne de Loisy. S’agissant des mérites comparés des petites et des grosses structures, le problème des grosses structures est qu’elles sont souvent assez éloignées des élevages, ce qui implique beaucoup de transport, donc du stress, donc une viande de moins bonne qualité. Par exemple, un éleveur qui se trouve dans la Seine-et-Marne et qui voudrait se rendre dans un abattoir qui ne pratique pas l’abattage rituel doit faire 380 kilomètres aller-retour. Ce sont autant de frais de carburant, de temps et d’argent. Le maillage est donc important.
Lorsqu’un camion de cochons arrive de Bretagne dans un abattoir du sud de la France, 7 à 8 % des bêtes sont mortes à l’intérieur du camion. Dans un élevage de volailles, tant que la mortalité avant l’abattage ne dépasse 8 %, on considère que vous êtes dans les normes… Imaginez qu’on vous dise qu’un enfant mort sur dix, ce n’est pas grave ! Il faudrait donc revoir ces normes. Je crois beaucoup aux circuits courts et à la proximité, ce qui impose des élevages et des abattoirs de proximité, et tout un système permettant de nourrir la clientèle des environs en faisant vivre les éleveurs. Cela recréerait un tissu social et une activité économique, tout le monde y gagnerait.
L’éleveur qui produit un animal en sachant qu’il est destiné à Mme Untel et ses deux enfants n’aura pas la même démarche que si le consommateur est un numéro et que la viande va voyager pendant deux ou trois ans autour du monde avant de finir dans une assiette.
Nous parlons beaucoup de prix, mais nous gaspillons 30 à 40 % de notre alimentation. Cela représente des tonnes de tranches de jambon qui passent à la poubelle parce qu’elles ont fini au fond du frigo et que nous les avons oubliées. Ces tranches de jambon, c’était auparavant un animal qu’il a fallu nourrir, abreuver, transporter, abattre… Tout cela représente un coût énorme.
Il est urgent de repenser notre façon de consommer aujourd’hui. Cela nous fera tous faire des économies, car en circuit court, nous achetons moins cher qu’au supermarché, et cela permet à l’éleveur de vendre à un meilleur prix, car les éleveurs ont besoin de gagner leur vie. Rappelons qu’en France, nous comptons un à deux suicides d’éleveurs par jour. Nous vivons dans une société où les gens qui sont chargés de nourrir la population se suicident. Quelque chose ne va pas, il est temps de réagir ! Il faut que nous arrivions à un système dans lequel tout le monde puisse vivre de son travail, il est anormal que les éleveurs n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois alors qu’ils bossent au minimum soixante-dix heures par semaine. Quelque chose ne va pas.
Mme Sylviane Alaux. Lors de l’audition précédente, un de nos invités nous disait que dans cette problématique que nous prenons à bras-le-corps, il y a trois stades : le ridicule, la discussion et l’adoption. Cette description me semble bien correspondre à vos propos, monsieur Hinard : lorsque vous évoquez ce qui se passait-il y a quarante ans ou lors de vos débuts, nous en étions au stade du ridicule. Notre interlocuteur ajoutait d’ailleurs que si les mêmes images avaient circulé il y a cinq ans, elles n’auraient ému personne.
Nous en sommes aujourd’hui au stade de la discussion. Êtes-vous conscient de cet électrochoc ? L’être humain se préoccupe de son propre avenir, donc de sa condition. On voit fleurir un peu partout les fameuses associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP), les circuits courts, les ventes directes. Je viens d’une région où c’est tout fait dans l’air du temps et cela entre dans la pratique.
Vos propos sont quand même porteurs d’espoir, même si vous avez payé le prix fort. Le cas des lanceurs d’alerte est très souvent évoqué dans nos auditions. « Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté », chantait Guy Béart ; nous vérifions aujourd’hui le bien-fondé de ces propos. Nous allons faire notre travail d’enquête, autour de notre président, et notre commission fera des préconisations.
Je vous encourage à continuer, nous sommes quelques-uns ici à lutter contre la maltraitance animale ; et quand on lutte contre la maltraitance animale, on prend forcément en compte le problème de l’humain, y compris les personnels d’abattoirs : leur formation, leur recrutement, les conditions de travail, la pression économique.
M. Pierre Hinard. L’exploitation de l’homme et l’exploitation de l’animal, ce sont les mêmes combats. On les dissocie ou on les oppose souvent ; mais venant d’une famille humaniste, j’y ai toujours appris que c’était une seule et même chose. On s’aperçoit qu’en luttant contre l’exploitation de l’animal, on lutte aussi contre l’exploitation de l’homme par l’homme.
Mme Sylviane Alaux. Je crois que dans cette commission, nous devons garder en vue trois objectifs : le bien-être animal, le bien-être humain et la sécurité du consommateur.
Mme Anne de Loisy. Les salariés des abattoirs font en effet partie d’une profession particulièrement à risque. Ils sont très mal formés, souvent mal équipés, souvent très mal encadrés. Les chiffres le prouvent, puisqu’ils connaissent deux à trois fois plus d’accidents du travail que dans les autres secteurs.
Par exemple, dans un abattoir Doux, le taux d’accidents du travail dépassait les 97 % ! Quand j’ai lu ce chiffre, j’ai pensé que ce n’était pas possible. J’ai vérifié et il était bien exact. Il est vrai qu’un abattoir est une zone dangereuse. Le sol est glissant : il y a du sang, de la graisse, des matériaux coupants, des grosses machines. Mais surtout, l’abattoir en question n’avait bénéficié d’aucune innovation technologique depuis plus de cinquante ans. De tels taux d’accidents du travail sont absolument inacceptables, là encore, les services de l’inspection du travail et de la Sécurité sociale devraient intervenir.
En ce qui concerne le recrutement, M. Hinard nous disait que l’abattoir dans lequel il travaillait faisait venir des salariés guinéens. C’est une pratique aujourd’hui extrêmement répandue, et ce sont des familles entières que l’on fait venir du Maroc, de Tunisie, de Roumanie, de Bulgarie, pour accomplir les tâches les plus ingrates dans les abattoirs, parce que personne n’a envie de les faire et que c’est très mal payé. Tout s’accumule : si vous êtes mal payé, mal formé, mal encadré et mal équipé, il ne faut pas s’attendre à trouver beaucoup de satisfaction dans votre travail. Et c’est tout de même un travail difficile, car un sacrificateur de bovins va égorger 500 vaches dans la journée, c’est son rythme de travail. Peut-être faudrait-il payer correctement la personne qui doit abattre ces 500 vaches dans la journée, parce qu’il se sacrifie pour le reste de la société.
Mme Laurence Abeille. Vous nous apprenez beaucoup de choses, en particulier sur la question du recrutement, de la formation et des langues parlées.
Monsieur Hinard, vous avez indiqué que des boissons alcoolisées étaient distribuées aux employés de l’abattoir…
M. Pierre Hinard. A priori, cette pratique a cessé, mais ce sont des choses qui se faisaient.
Mme Laurence Abeille. À quelle époque faites-vous référence ?
M. Pierre Hinard. Entre 2000 et 2007.
Mme Laurence Abeille. C’est donc une période récente. Est-ce que vous avez des certitudes sur le fait que cette pratique n’existe plus aujourd’hui ?
M. Pierre Hinard. C’est à souhaiter.
Mme Anne de Loisy. Pour ma part, je n’ai jamais vu d’alcool servi aux opérateurs dans les abattoirs. Cela ne veut pas dire que ça n’existe pas, mais je ne l’ai pas vu.
M. Yves Daniel. Monsieur Hinard, nous partageons beaucoup de nos choix professionnels. Vous disiez qu’il faut avoir vécu avec les animaux pour connaître leur sensibilité. Quand on est éleveur, on vit avec les animaux, on connaît la sensibilité de l’animal de manière générale.
Pour ma part, j’ai le sentiment que notre société vit dans la confusion s’agissant des rapports entre l’humain et l’animal. C’est surtout vrai pour les animaux domestiques. L’animal est un être sensible, l’homme est un être sensible et sentimental, et je vois de plus en plus de gens entretenir une relation sentimentale avec leurs animaux domestiques. C’est à mon sens une dérive. Comment le faire comprendre et appeler l’attention de tout le monde sur cet aspect des choses sans pour autant remettre en cause le caractère d’être sensible reconnu à l’animal par le droit ?
Dans le cadre des travaux de cette commission, nous voyons que c’est une question difficile car nous sommes des êtres sentimentaux. Nous devons mener un travail autour des notions de maltraitance et de bientraitance, mais nous définissons ces notions par rapport à nos propres sentiments. Nous ne pouvons pas nous mettre dans la peau de l’animal, et jamais un animal ne vous dira ce qu’il pense de la mort ni de ses conditions de vie. La mission est donc compliquée, car il y a autant de ressentis que d’individus sur ces questions – j’ai eu l’occasion de faire le parallèle avec la fin de vie, sujet sur lequel nous avons également tous notre propre vision des choses.
Quand nous sommes éleveurs, il n’y a pas de confusion possible entre l’homme-éleveur et l’animal, et nous sommes parfois tueurs d’animaux. Dans ce rapport avec l’animal, même le chien est là parce qu’il est utile, il a un travail à faire dans la ferme, de même que le chat. Et nous allons donc nourrir le chien parce qu’il ne peut pas se nourrir autrement, mais pas le chat, car son rôle est de dératiser, de chasser, et il va vivre de sa chasse. Or une foule de gens n’imaginent pas du tout que l’on puisse ne pas donner à manger au chat…
Mme Sylviane Alaux. Je vais vous mettre la SPA sur le dos… (Sourires)
M. Yves Daniel. De la même façon, nous régulons la population d’animaux domestiques, et c’est heureux. Ce sont des réalités que nous vivons.
Nous avons besoin d’études scientifiques qui viennent étayer, nous apporter des arguments, et nous permettre d’évoluer dans nos analyses, nos objectivités. Mais nous avons aussi besoin de prendre en compte ces réalités de la vie. L’homme doit survivre, mais il ne peut le faire que si l’on protège dans le même temps l’animal et le vivant de manière générale.
Dans ce contexte, alors que nous n’avons pas tous le même rapport aux animaux, comment voyez-vous les choses et quelles évolutions juridiques notre rapport pourrait selon vous proposer ?
L214 a sorti des vidéos, mais si elles sont projetées hors de leur contexte, elles ne reflètent qu’un bout de la réalité. Elles feront réagir, mais apportent-elles une vision objective ?
M. Pierre Hinard. Pour objectiver les choses, la manière la plus évidente est d’instaurer la transparence dans les abattoirs. La vidéosurveillance des endroits sensibles, notamment du piège et de la saignée, permettra d’éviter d’extraire quelques minutes de toute une journée et d’objectiver ce qui se passe. Même si, comme le disait le ministre, il s’agit d’un cas particulier, lorsque des cas particuliers apparaissent toutes les semaines, cela finit par faire beaucoup et n’explique pas les dérives industrielles et individuelles. Cela veut dire que le sujet est à creuser et à travailler.
La massification et l’industrialisation à outrance ne sont pas une solution à terme pour les abattoirs, même si cela leur permet d’avoir un niveau d’investissements élevé. On pourrait penser que s’ils disposent de plus de moyens économiques, ce sera mieux pour les animaux. Mais comme le rappelait Mme de Loisy, le problème est l’éloignement et les conditions pitoyables de transport des animaux. L’abattoir doit garder une dimension locale. Il est bien dommage que l’État se soit totalement désinvesti des abattoirs municipaux alors qu’il aurait fallu en faire une force pour notre pays et coupler la proximité des abattoirs municipaux avec le développement de filières qualité.
Dans un contexte économique difficile, les éleveurs n’ont fait que grandir, et la taille des troupeaux a doublé ou triplé. Mais ils n’y arrivent pas mieux, il y a toujours autant de suicides. On sait que pour vivre mieux, il faut aller chercher la valeur ajoutée, qui vient de la différenciation par la qualité. Ce ne sera possible qu’avec une traçabilité certaine, c’est-à-dire la transparence offerte par un abattoir local ; et l’adhésion du consommateur, qui devient sensible au sujet de la cause animale alors que ce n’était pas du tout le cas, parce qu’il sait que la qualité de ce qu’il consomme est en jeu. Si l’on consomme des animaux qui ont souffert, on consomme des produits toxiques. On peut le faire par ignorance, mais quand on le sait, cela ne vous donne plus envie de manger.
Il existe une alternative. Pour les bovins, cela se joue dès l’origine, au niveau des conditions d’élevage. M. Daniel disait qu’il faut arriver à ne pas tomber dans la sensiblerie tout en respectant la sensibilité animale. Pour moi, la frontière est de respecter la physiologie des animaux ; on se le doit. La science a tranché : ainsi, la vache est un herbivore. Pourquoi n’a-t-on de cesse, depuis quarante ans, d’en faire un cochon, c’est-à-dire un granivore, en la nourrissant de céréales, de maïs, et de la priver d’herbe ? La vache est un herbivore, remettons-la à l’herbe ! C’est une première souffrance infligée à l’animal, mesurable scientifiquement, parce que l’on ne respecte pas sa physiologie.
Si l’on remet les bœufs à l’herbe, on va aussi leur donner du plaisir à vivre, parce qu’ils vont vivre en plein air. On me répondra que l’on ne pourra pas produire autant. C’est vrai, nous allons réduire la consommation de viande, mais la viande que nous allons consommer sera de bien meilleure qualité. Au lieu de consommer des calories creuses, qui n’amènent aucun nutriment, nous consommerons des viandes qui apportent trois fois plus d’oméga-3. Car naturellement, les oméga-3 sont dans les prairies, mais pas dans le maïs ni dans le soja.
Il faut donc que l’animal soit bien élevé et bien abattu pour que le consommateur lui aussi soit rassuré dans son acte de consommation. Car l’impact est ensuite économique : si le consommateur se détourne des filières animales, cela mettra en difficulté les éleveurs. Mais ce n’est pas le fait que le consommateur soit très sensible à la cause animale qui a mis l’agriculture en crise ; c’est notre modèle économique productiviste qui est en faillite. Il ne faut donc pas avoir peur de le réformer, y compris dans le mode d’abattage. Ce n’est pas juste le problème de l’abattage qui est raté : l’élevage est raté, l’abattage est raté, et au stade de la consommation, on fait n’importe quoi et on se retrouve avec une population obèse et diabétique. Il y a quand même mieux à faire !
Si l’on veut faire des économies globales dans un budget globalisé, plutôt que de s’attaquer aux conséquences du problème, attaquons-nous aux causes. Nous y gagnerons aussi sur le plan des gaz à effet de serre, car les prairies naturelles et les surfaces en herbe sont des puits à carbone. Sur la planète, il y a deux endroits qui fixent naturellement le carbone en très grandes quantités : les prairies naturelles – quand elles ne reçoivent pas d’engrais chimiques – et les océans avec le phytoplancton.
D’ailleurs, la nature est bien faite : le poisson sauvage qui s’est nourri de beaucoup de phytoplanctons est extrêmement riche en acides gras essentiels du type oméga-3 – les bons acides gras qui protègent contre les maladies cardiovasculaires. Et si vous consommez des bœufs d’herbe, l’herbe étant riche en oméga-3, en remontant dans la chaîne alimentaire elle nous permet de consommer des calories pleines au lieu de calories creuses. Non seulement on ne vous pollue pas, mais on vous amène des nutriments. Vous pouvez consommer moins de viande, de meilleure qualité, et toutes les surfaces qui n’ont pas été utilisées pour faire pousser des céréales destinées à faire manger les vaches comme des cochons, tout ce maïs que vous n’avez pas donné aux vaches pourra servir à alimenter des humains. L’efficacité énergétique est bien plus grande. Le sujet doit être appréhendé dans sa globalité.
Mme Anne de Loisy. Je suis journaliste, je vais aussi plaider ma cause. Je pense qu’il est important de communiquer aux Français et de leur expliquer la face cachée de l’agriculture. On leur a trop longtemps caché les réalités de l’élevage, de l’agriculture, de l’abattage, et l’on s’étonne ensuite qu’ils soient choqués. Peut-être devrions-nous faire comme au Danemark, où les enfants vont en visite scolaire dans les abattoirs. On leur montre le plus moderne, pas le plus imprésentable. La seule chose qu’on ne leur montre pas est le moment où l’on égorge la bête, mais ils voient tout le reste.
Il ne faut pas s’étonner qu’un enfant sur deux ne sache pas de quoi est fait un nugget, une tranche de jambon ou un steak haché. Il en est de même pour les végétaux : un enfant sur quatre ne sait pas que l’on fait des frites avec des pommes de terre, un sur trois ne sait pas identifier un poireau, une courgette, une figue ou un artichaut. Et neuf enfants sur dix ne savent pas à quoi ressemble une betterave. Nous parlons du pays dont la gastronomie a été inscrite au patrimoine mondial de l’humanité ! Il est temps d’informer nos jeunes, car s’ils ne savent pas ce qu’ils mettent dans leurs gosiers, nous allons au-devant de problèmes beaucoup plus importants. Il y a urgence à ce que les jeunes aillent visiter des fermes, visiter des élevages, et se rendent compte de la réalité.
Il est d’ailleurs intéressant de constater l’impact de tout cela. La consommation de viande diminue car les gens ont du mal à associer leur steak et ce qu’ils ont vu avant. Mais par exemple, en Angleterre, sept émissions ont été faites en 2008 par de grands chefs cuisiniers pour montrer la réalité de l’élevage industriel. À la suite de ces émissions, les ventes de poulets de batterie ont diminué de 11 %, et celles de poulets de plein air ont augmenté de 17 %. Il y a donc un impact, et le poulet élevé en plein air rapporte plus à l’éleveur. Tout le monde y gagne, il est donc temps d’enclencher ce cercle vertueux.
Sur les relations entre l’humain et l’animal, peut-être avez-vous entendu parler de Temple Grandin, cette vétérinaire américaine, autiste, dont les travaux sur la communication entre l’humain et les animaux sont extrêmement reconnus dans le monde entier. Ses travaux ont apporté un grand bénéfice aux humains également, car si l’on comprend mieux les animaux et ce qui le leur fait peur, ce qui les stresse, ce qui les angoisse, il est plus facile de gérer les rapports. Dans les vidéos de L214, nous voyons un ouvrier jeter un mouton et recommencer toutes les dix minutes. C’est totalement contre-productif : pour l’ouvrier qui se fatigue à jeter un mouton ; pour le mouton qui est dans une situation de stress absolu ; et pour le consommateur qui va manger de la vieille carne. L’information passe par là, et il faut commencer tôt. On emmène les enfants voir les musées, il faut aussi les emmener voir les fermes : c’est là que l’on produit ce qui les nourrit.
M. Thierry Lazaro. Je suis tout à fait d’accord avec les propos d’Yves Daniel sur la sensibilité avec les animaux. Mais cela me pose un réel problème : mes enfants me prennent pour un vieux gâteux avec mes chats… Et je doute fort qu’ils s’attaqueront aux souris si je leur enlève leurs croquettes !
Madame de Loisy, dans un article de presse, vous souligniez le poids de deux ou trois grands groupes. C’est une réalité. Monsieur Hinard, vous parliez du poids de la grande distribution, qui est au fond complice. Dans une autre commission, parlant de la famille Mulliez, je disais qu’ils étaient les seigneurs – et les saigneurs – des temps modernes.
Cela étant, vous préconisez tous deux le circuit court. C’est le bon sens que d’éviter les grandes distances, faire des produits de qualité, remettre les bêtes en pâture. Attention toutefois à notre tendance bien franco-française à nous autoflageller : lorsque je vois les mégas exploitations allemandes, je suis horrifié.
Mais si les circuits courts sont une solution, la population grandit et la terre comptera entre 9 et 10 milliards d’habitants en 2050. Il faudra des milliards d’animaux pour nourrir tout le monde, avec tous les enjeux écologiques dont vous parliez. Il y a donc un principe de réalité : pour alimenter les McDonalds, quoi qu’en disent leurs images publicitaires, il faut l’industrie agroalimentaire derrière. Cela semble une évidence. Pensez-vous qu’une transition vers le modèle que vous préconisez – moins de viande, mais de meilleure qualité – soit possible ?
Je voulais également vous poser une question sur l’abattage rituel. Certains sacrificateurs demandent l’étourdissement. Pourriez-vous être plus précis sur le sujet ?
Mme Anne de Loisy. Sur la transition, je crois que le plus probant, c’est ce qui fonctionne. Si l’éleveur ou l’agriculteur parvient à vivre de son travail, c’est déjà pas mal. Si les gens sont contents de manger ce qu’ils ont dans leurs assiettes, ils en parlent, et le modèle se développe assez bien. Il y a une forte croissance des circuits courts ; selon la configuration retenue, certains marchent mieux que d’autres, mais globalement, ce modèle fonctionne et permet à des éleveurs de sortir la tête de l’eau et de vivre de leur travail, ce qui devrait être la base.
Aujourd’hui notre agriculture fonctionne mal. On ne peut pas imaginer que 60 % du revenu des agriculteurs soit issu de subventions, alors que nous vivons dans un pays tempéré ou l’on peut à peu près tout élever et tout faire pousser. Nous nous retrouvons à faire importer des tonnes d’aliments de partout. La viande bovine que l’on consomme dans les cantines universitaires et scolaires est à 70 % importée, ce ratio monte à 87 % pour la volaille et entre 70 et 80 % pour le cochon. Est-il normal que nos éleveurs ne puissent pas vivre de leur métier car ils n’arrivent pas à vendre leurs produits à nos enfants, aux hôpitaux et aux cantines professionnelles ?
Il y a sans doute des réformes à apporter aux appels d’offres. Aujourd’hui certains contournent la réglementation, car il faut trouver la faille. Le directeur d’un centre de formation agricole, spécialisé justement dans l’élevage, me disait qu’il ne voyait pas pourquoi il expliquerait à ses étudiants comment élever une bonne bête tout en leur donnant de la viande issue de je ne sais où et qui a passé trois ans dans un frigo. Pour contourner ce système, il achète ses bêtes sur pieds. Du coup, il faut manger toute la bête, c’est une autre façon de consommer, et il a créé tout un réseau avec les écoles environnantes. Enfin, les apprentis éleveurs peuvent manger ce qu’ils ont produit.
Il existe donc des solutions, il faut trouver les failles permettant de bien nourrir la population. C’est pourtant la base : une population mal nourrie est une population malade, et ce n’est pas parce que l’on est trop nourri que l’on est en meilleure santé, loin de là. Quand on voit l’augmentation continue des frais médicaux, il serait bon de se rappeler les paroles d’Hippocrate : « Que ton aliment soit ta première médecine ».
Quant à l’abattage rituel, c’est un sujet qui touche énormément les Français. Cinq propositions de loi sur l’étiquetage ont été préparées, avec des dénominations différentes : casher ou halal, avec ou sans étourdissement, beaucoup de choses ont été proposées, mais le plus inquiétant est de savoir que ces cinq propositions de loi ont toutes été retirées avant même d’avoir été discutées… Les députés et les sénateurs représentent les Français et sont censés porter ces revendications de la population. Mais on comprend que ce sont les pressions de la part de religieux et d’industriels qui bloquent cette réforme. Ce n’est pas ce que nous voulons entendre, nous avons confiance en vous ! La balle est dans votre camp…
Il faut savoir qu’il existe aujourd’hui des entreprises spécialisées pour faire venir travailler des personnes dans les abattoirs français. En termes de tissu économique et de travail, quand les industriels viennent voir le ministre en prétendant représenter 150 000 salariés, il faut regarder qui sont ces 150 000 salariés, comment ils sont payés et comment fonctionne le système.
Dans les grosses entreprises, les cinq premières tranches de salaire, qui sont les plus proches du SMIC, ne sont pas soumises aux charges sociales. Donc quand des entreprises comme Doux ont des taux d’accidents du travail de 97 %, ces accidents du travail ne sont finalement pas pris en charge par la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) de la Sécurité sociale, mais par le citoyen lambda. Est-il logique de laisser perdurer ce genre de système ?
M. Pierre Hinard. Lors des trente à quarante dernières années, les éleveurs ont perdu la main sur les abattoirs. Aujourd’hui, ce sont de gros groupes privés qui mènent la danse, alors qu’il faudrait que les abattoirs redeviennent de petits abattoirs, dont la propriété serait partagée au sein d’une société mixte regroupant les éleveurs et les consommateurs. Cela changerait totalement la donne.
Un abattoir travaille pour les consommateurs ; or ils en sont totalement exclus. Plutôt que de préconiser des faux moyens, avec des travailleurs détachés ou l’importation de misère sociale d’Asie et du Maghreb, ce qui n’est ni souhaitable, ni durable, ni humaniste, il serait vital de créer des sociétés mixtes avec des agriculteurs pour créer de la richesse localisée en France. Il faut des abattoirs municipaux locaux, avec la participation des éleveurs, et où les consommateurs et la personne publique – État ou collectivité territoriale – seraient actionnaires. Il faut faire entrer les consommateurs, en tant qu’actionnaires, dans les abattoirs.
M. le président. Merci de vos témoignages.
La séance est levée à vingt heures quinze.
——fpfp——
23. Audition, ouverte à la presse, de M. Stéphane Geffroy, auteur du livre « À l’abattoir »
(Séance du jeudi 9 juin 2016)
La séance est ouverte à neuf heures quinze.
M. le président Olivier Falorni. Nous reprenons nos auditions dans le cadre de la commission d’enquête sur les conditions d’abattage dans les abattoirs français. Ce matin, nous avons le plaisir d’auditionner Stéphane Geffroy, auteur d’un livre remarquable intitulé « À l’abattoir ». À travers votre ouvrage et votre expérience, nous souhaitons connaître le vécu quotidien de quelqu’un qui travaille dans un abattoir depuis longtemps, vingt-cinq ans en l’occurrence. Tel est le sens de notre rencontre, dirais-je, puisqu’il s’agit d’un échange destiné à nous faire mieux connaître le quotidien des salariés des abattoirs.
Dans ce livre, vous relatez votre carrière au sein de l’abattoir de bovins de Liffré, qui appartient au groupe Société Vitréenne d’Abattage Jean Rozé (SVA Jean Rozé). Cet abattoir emploie 200 personnes et traite en moyenne 1 400 animaux par semaine, dont 200 selon le rituel halal. Vous êtes entré à l’abattoir de Liffré à l’âge de dix-neuf ans, sans formation spécifique, alors que vous étiez à la recherche d’un emploi d’appoint. Au bout de vingt-cinq ans vous y travaillez toujours et vous y êtes devenu délégué du personnel.
Dans votre ouvrage, vous évoquez « les images de mort et d’enfer » que vous avez eues dès votre entrée à l’abattoir de Liffré. Vous dénoncez « la foutue cadence » que subissent les ouvriers, un des facteurs de la pénibilité du travail en abattoir en plus des bruits, des odeurs, des charges et des postures qui engendrent des troubles musculaires et des maladies professionnelles. Si vous soulignez la pénibilité d’un travail « toujours aussi physique qu’autrefois », vous évoquez aussi sa pénibilité psychologique et les difficultés à en discuter avec les personnes étrangères au milieu.
Grâce à nos auditions, nous essayons d’être des personnes de moins en moins étrangères à ce milieu. Nous vous remercions de votre présence ce matin pour cette audition qui est diffusée en direct sur le portail de l’Assemblée nationale. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous dire, en quelques minutes, quel est le sens de votre ouvrage et quel est le message que vous souhaitez faire passer.
Au préalable, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Stéphane Geffroy prête serment.)
M. Stéphane Geffroy. Bonjour à tous.
La prise en charge de la souffrance animale à l’intérieur des abattoirs dépend beaucoup de la taille de ces entreprises et des moyens économiques dont elles disposent. Les abattoirs de dimension industrielle, qui appartiennent à de grands groupes, ne connaissent pas de déficit de prise en charge des animaux de boucherie, contrairement aux structures de petite taille qui manquent souvent de moyens.
Les cas de souffrance animale sont réduits au minimum lorsque la formation des salariés est assurée, lorsque la procédure d’accueil et le protocole d’abattage des animaux sont formalisés et respectés. Cela dit, il faut faire attention à ne pas prendre des mesures de contrôle généralisé à partir d’un cas particulier. Il existe déjà des organismes d’État comme les directions départementales des services vétérinaires (DDSV) qui permettent ce niveau de contrôle ; malheureusement, nous assistons depuis plusieurs années à un manque d’agents en abattoir. La tendance ne va donc pas dans le sens du risque zéro. Les petits abattoirs auraient besoin d’être accompagnés dans la mise en place de procédures d’accueil par des mesures renforcées.
À l’extérieur de l’abattoir, les éleveurs ont une part de responsabilité dans la prise en charge des animaux. Le nombre de vaches gestantes qui se retrouvent dans les abattoirs est significatif ; il est même arrivé que certaines d’entre elles vêlent à proximité du piège. Rappelons qu’au cours de l’épisode de sécheresse de 2011, les éleveurs de l’association France Milk Board (FMB) avaient organisé le transfert de milliers de jeunes bovins vers la Turquie, par bateau au départ de Sète. De nombreux cadavres avaient été retrouvés en mer car les conditions de transports n’avaient pas été respectées.
Pourquoi ai-je écrit ce livre ? Pierre Rosanvallon m’a convaincu que mes propos ne seraient pas détournés et qu’ils toucheraient un très large public. Je voulais faire découvrir la pénibilité de notre métier, raconter ce que cela signifie d’être sur une chaîne d’abattage cadencée ou continue. Nous sommes oubliés des gouvernements et, après les vidéos sur la maltraitance animale, on nous montre encore du doigt.
Avec ce livre, j’espère que la pénibilité de notre travail sur les chaînes d’abattage cadencées ou continues sera reconnue par les pouvoirs publics. Car on cumule tout : les cadences, le bruit, l’odeur, la vue du sang, le stress, les gestes de force répétitifs, l’humidité, les dangers et les effets psychologiques. Et on n’a pas le droit d’être malade : chez nous, le délai de carence est de sept jours en cas d’arrêt maladie… Après quarante années de cotisation, on devrait donc avoir le droit à une retraite entière.
Nous aussi, nous avons on a été choqués par les vidéos sur la maltraitance animale. En plus, ces comportements sont contraires à la logique de l’entreprise qui cherche à faire de la qualité : la viande d’un animal stressé devient poisseuse ; celle d’un animal battu présente des hématomes qui la rendent impropre à la consommation et provoquent son retrait du circuit alimentaire par le service vétérinaire.
Chaque personne en contact avec les animaux vivants doit recevoir une formation sur le bien-être animal. Il faut aussi former le délégué du personnel du hall d’abattage, quand il y en a un, pour qu’il puisse défendre ou condamner le salarié en cas de problème. On parle beaucoup d’installer des systèmes de vidéosurveillance dans les abattoirs. Pourquoi pas, à condition que la caméra ne filme que l’approvisionnement de la chaîne, que la direction de l’établissement n’ait pas de droit de regard sur ces images dont le visionnage serait réservé au service vétérinaire, et qu’il n’y ait pas d’enregistrement.
M. le président Olivier Falorni. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu ces vidéos diffusées par l’association L214 Éthique et animaux ? Avez-vous été surpris ? Quel a été votre sentiment en voyant ces images ? Pensez-vous que ce genre de pratiques est généralisé ou exceptionnel ? Comment l’expliquez-vous, si tant est que l’on puisse l’expliquer ?
Évoquant le manque de considération du grand public par rapport à votre métier, vous écrivez que les personnels d’abattoirs sont vus comme « de gros ouvriers un peu primaires dont on préférerait ne pas trop entendre parler ». D’après vous, qu’est-ce qui pourrait faire changer le regard porté par le grand public sur les opérateurs en abattoir ?
Qu’est-ce qui vous a motivé pour continuer à travailler sur le site de Liffré après y être entré à la recherche d’un travail temporaire ? Au départ, vous n’imaginiez pas rester aussi longtemps dans cet abattoir, semble-t-il.
Voici les trois questions que je voulais vous poser pour comprendre à la fois votre parcours et votre point de vue concernant en particulier les vidéos qui ont été à l’origine de la création de cette commission d’enquête.
M. Stéphane Geffroy. En tant qu’ouvriers de chaînes d’abattage, nous avons été surpris. Comme je l’ai dit précédemment, ce n’est pas une chose à faire quand on veut produire de la viande de qualité. Comment expliquer cette chose ? Dans de petits abattoirs publics, bien localisés, peut-être que cela peut se produire. Le risque zéro n’existe pas. Les images sont fortes, c’est vrai. Est-ce que cette personne a pété les plombs ? Y a-t-il un suivi des services vétérinaires dans ces abattoirs ? Le vétérinaire était-il présent ?
M. le président Olivier Falorni. Est-ce que vous avez été surpris ?
M. Stéphane Geffroy. Bien sûr ! Nous sommes encore montrés du doigt.
M. le président Olivier Falorni. Mais vous n’avez jamais assisté à de tels comportements dans votre entreprise ?
M. Stéphane Geffroy. Ah non, pas du tout.
M. le président Olivier Falorni. Un pétage de plombs peut arriver. Dans l’abattoir où vous travaillez, avez-vous vu des salariés péter les plombs à un moment donné ?
M. Stéphane Geffroy. Non, pas du tout. D’autant que dans mon établissement, nous avons affaire à des bovins : ce sont de gros animaux, plus difficiles à maltraiter que d’autres…
M. le président Olivier Falorni. Comment pouvez-vous éventuellement expliquer ces faits ? Est-ce une histoire de cadence, d’inadaptation du matériel, d’absence de formation ? Il y a trois vidéos…
M. Stéphane Geffroy. À mon avis, il n’y a pas eu de suivi au niveau des formations, c’est certain. Chez nous, toutes les personnes qui sont en contact avec les animaux vivants reçoivent une formation sur le bien-être animal, validée par le service vétérinaire. Y a-t-il de telles formations dans ces structures-là ? Je ne sais pas.
M. le président Olivier Falorni. Que faudrait-il faire pour redorer le blason de votre profession aux yeux du grand public ? Inciter les abattoirs à une plus grande transparence ? Instaurer un contrôle accru par le biais d’un système de vidéosurveillance susceptible de rassurer les gens sur la manière dont les animaux sont tués ? Ouvrir les établissements à une association de protection animale agréée par le préfet ? Pensez-vous que les abattoirs doivent s’ouvrir davantage pour améliorer l’image de marque des salariés ? À mon avis, la question du bien-être des salariés est intimement liée à celle du bien-être des animaux. C’est l’une des conclusions globales de nos travaux.
M. Stéphane Geffroy. C’est sûr, mais comme nous avons toujours été cachés et ignorés des pouvoirs publics, cela va être très long et difficile de changer les choses. Les images de chaînes d’abattage sont très fortes. À notre époque, elles peuvent choquer le public. Je pense qu’il est très difficile de montrer des images de notre travail au public.
M. le président Olivier Falorni. En tout cas, j’entends que vous n’êtes pas hostile par principe à la vidéosurveillance à condition que le dispositif soit encadré.
M. Stéphane Geffroy. Il faut faire très attention à l’utilisation de la vidéosurveillance. Pour ma part, je ne suis pas contre, à condition que l’on filme l’approvisionnement du piège, mais pas la mise à mort, l’assommage ou l’anesthésie de l’animal.
M. le président Olivier Falorni. Pour quelles raisons ?
M. Stéphane Geffroy. Parce que ce sont des images fortes qui pourraient être détournées.
M. le président Olivier Falorni. Elles ont vocation à être utilisée en interne.
M. Stéphane Geffroy. Certes, mais beaucoup de gens sont contre la vidéo. Il faut trouver un juste milieu.
M. le président Olivier Falorni. Il n’y en a pas tant que cela : nos auditions montrent que l’idée de la vidéosurveillance est de plus en plus acceptée, même dans votre profession. Elle peut apparaître comme une garantie vis-à-vis du consommateur qui est de plus en plus exigeant à ce niveau-là.
M. Stéphane Geffroy. C’est possible. Mais la mise en route du système doit être réservée au service vétérinaire. Ce service doit aussi être le seul à avoir un accès direct à ces images qui ne doivent pas être enregistrées. La direction ne doit pas y avoir accès.
M. le président Olivier Falorni. L’enregistrement des images pourrait être utilisé comme un matériel pédagogique, à des fins de formation des salariés. Ne pensez-vous pas que cela pourrait être intéressant ? On peut citer d’autres expériences dans des domaines très différents. À la veille de l’Euro 2016, rappelons que les joueurs de football regardent les vidéos de leurs matchs pour améliorer leur jeu ; sans vouloir pousser la comparaison, on peut se demander si les images filmées dans les abattoirs ne pourraient pas être utilisées comme un outil pédagogique au sein de l’entreprise, et servir à analyser les techniques et les manquements éventuels.
M. Stéphane Geffroy. Un outil de travail ? Je ne sais pas, il faudrait étudier la chose. C’est complexe et il y a déjà des formations pour les gens au contact avec les animaux.
M. le président Olivier Falorni. Quelle a été votre motivation à continuer à travailler dans un abattoir, celui de Liffré en l’occurrence.
M. Stéphane Geffroy. À l’époque où j’ai commencé, nous avions de bonnes rémunérations, et des augmentations… Dans ces conditions, on investit dans une maison, dans une voiture, on a des enfants… Une fois qu’on s’est adapté à un budget, reprendre une formation, repartir au SMIC, tout remettre en question, ce n’est pas évident. Et comme tout le monde restait, l’ambiance était bonne. À présent, il y a un turn over important parmi les jeunes qui entrent dans les abattoirs. Et pour ce qui me concerne, je suis devenu délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, ce qui m’a permis de suivre des formations, de m’ouvrir aux questions sociales et syndicales, de découvrir autre chose.
Mme Geneviève Gaillard. Merci, monsieur, pour votre livre et pour votre témoignage. Pourriez-vous nous donner des précisions concernant les moyens des petits abattoirs dont l’insuffisance pourrait être à l’origine des problèmes dont nous parlons ? Ces petits abattoirs manquent-ils de moyens pour rénover ou aménager les bâtiments, pour recruter du personnel ?
Vous parlez des cadences. J’en suis un peu convaincue : les cadences jouent un rôle important dans la capacité des agents à faire leur travail dans de bonnes conditions. Au cours des vingt-cinq dernières années, avez-vous constaté une augmentation assez substantielle des cadences dans votre abattoir ? Il est important de pouvoir éventuellement quantifier le phénomène.
Pour expliquer la longueur de votre carrière dans cet abattoir, vous nous avez indiqué qu’avant l’ambiance était bonne, ce qui veut dire qu’elle l’est moins à présent. Le changement d’ambiance s’explique-t-il par autre chose que le turn over ? Comment la direction de votre établissement gère-t-elle ces problèmes de qualité de vie du personnel, même si ce n’est pas facile dans un abattoir ? Vous semblerait-il utile de mettre en place des groupes de travail, d’accueil, de parole, afin de faire en sorte que l’ambiance s’améliore et que tout le monde y trouve son compte ?
Vous avez évoqué la responsabilité des éleveurs et indiqué que des vaches gestantes arrivaient à l’abattoir. Que pourrait faire l’éleveur en amont, afin de s’assurer d’une bonne prise en charge des animaux qu’il amène ?
M. Stéphane Geffroy. Il y a quelques années, les éleveurs accompagnaient très souvent leurs bêtes. Ils faisaient un suivi depuis l’arrivée de leurs bêtes jusqu’à la pesée des carcasses, en passant par l’abattage. Cela a complètement disparu.
Mme Geneviève Gaillard. Pour quelles raisons ? Parce qu’ils ne veulent plus le faire ou parce que la direction de l’abattoir s’y oppose ?
M. Stéphane Geffroy. Je pense que les éleveurs ont d’autres préoccupations, et sont moins disponibles pour suivre leurs troupeaux.
Pour les cadences, nous sommes contraints par une norme : il ne doit pas s’écouler plus d’une heure entre l’abattage de l’animal et la pesée de la carcasse. En plus, une fois que la chaîne d’abattage est lancée, il faut bien l’approvisionner en continu. Je n’ai jamais vu de « trou » sur ces chaînes cadencées.
Mme Geneviève Gaillard. Même il y a vingt-cinq ans ?
M. Stéphane Geffroy. Même il y a vingt-cinq ans.
Mme Geneviève Gaillard. Dans ces conditions, comment se fait-il que la cadence a augmenté ?
M. Stéphane Geffroy. Parce qu’on a modernisé les chaînes d’abattage. Les têtes et les pattes sont déjointées à la pince hydraulique et non plus au couteau ; des passerelles pneumatiques, qui ont remplacé des postes fixes, permettent de monter et de travailler en hauteur ; des postes ont été rajoutés sur les chaînes. Automatiquement, cela a fait augmenter les cadences.
Mme Geneviève Gaillard. Quant aux moyens limités des petits abattoirs, comment se manifestent-ils ? On peut imaginer, par exemple, que la configuration d’un établissement vieillissant ne permet pas d’accueillir les animaux dans de bonnes conditions, ce qui contribue à stresser le personnel. Est-ce que le manque de moyens se traduit par un manque de personnel ? Comment voyez-vous les choses ?
M. Stéphane Geffroy. Quasiment tous les abattoirs fonctionnent avec des effectifs à flux tendu. Les entreprises ont du mal à recruter, les jeunes ne restent plus. Dans ces petits abattoirs, y a-t-il un bon suivi des formations ? Je ne sais pas. Pour en avoir discuté avec un vétérinaire, j’ai compris que certains petits abattoirs ont des amplitudes horaires très larges car les éleveurs veulent que leurs bêtes soient tuées de bonne heure le matin ou tard le soir. Du coup, il arrive que certaines bêtes soient tuées en l’absence de vétérinaire.
Mme Geneviève Gaillard. C’est alors une question d’organisation ?
M. Stéphane Geffroy. Une question d’organisation et de manque d’effectifs dans les services vétérinaires.
M. Alain Rodet. Dans votre abattoir, avez-vous été concerné par des accidents du travail ? Y avez-vous vécu des mouvements sociaux durant ces vingt années ?
Avez-vous un souvenir assez précis de la crise de la vache folle qui s’est traduite par une baisse brutale de l’activité des abattoirs ? Peut-être vous a-t-on obligé à prendre des congés en plein mois de novembre ou de décembre à cette époque ?
Ressentez-vous la pression des chevillards ou l’abattoir de Liffré est-il intégré dans un groupe ? Les gens du négoce ont l’habitude du coup de feu et ils peuvent exiger beaucoup de la direction et des personnels d’un abattoir.
Je terminerai par un commentaire lié aux interrogations de ma collègue Geneviève Gaillard : il vaut mieux fermer les petits abattoirs, car l’expérience montre qu’il est impossible de faire fonctionner de telles unités dans de bonnes conditions.
M. Stéphane Geffroy. C’est délicat de fermer les petits abattoirs parce qu’il faudra alors faire de longs trajets avec les animaux – dans des créneaux horaires à respecter – alors que le transport les stresse.
M. Alain Rodet. J’ai vu fermer quatre ou cinq abattoirs au cours de ma vie publique et heureusement que nous les avons fermés ! Au départ d’une exploitation agricole, que vous fassiez dix ou trente-cinq kilomètres, cela ne change pas grand-chose. En général, les abattoirs sont près des zones de forte production et il n’y a pas beaucoup de différence de durée de trajet.
M. Stéphane Geffroy. Peut-être. Mais les grands abattoirs pourront-ils supporter le flux supplémentaire d’animaux si de nombreux petits établissements sont fermés ? Je ne sais pas. Les bouveries et les parcs sont déjà bien remplis…
M. Alain Rodet. Tout dépend de ce que l’on entend par petit abattoir. Pour moi, c’est un établissement qui produit moins de 5 000 tonnes de viande par an. Et pour ceux qui produisent entre 5 000 et 10 000 tonnes par an, ce n’est pas la gloire non plus. En plus, ils ont tendance à générer des déficits abyssaux quand ils sont publics.
M. Stéphane Geffroy. Il y a certainement aussi de petits abattoirs qui font très bien leur travail.
Lors de la crise de la vache folle, notre site a été mis en stand by et le personnel a été redéployé dans les deux autres sites d’abattage.
En ce qui concerne les mouvements sociaux, il m’est arrivé une fois d’organiser un débrayage parce que nous faisions beaucoup d’heures supplémentaires et que nous avions du mal à prendre nos congés. Quant aux accidents du travail, j’en ai vu beaucoup. À une époque, il y avait de graves accidents tous les ans : une éventration, un jeune qui s’était planté un couteau entre les deux yeux…
Mme Geneviève Gaillard. Il est mort ?
M. Stéphane Geffroy. Heureusement non… Il arrive assez souvent des accidents. Les gens se plantent un couteau dans les cuisses, les bras, un peu partout. Cela dit, on est maintenant très bien protégé, je dirais même surprotégé : il n’est pas évident de travailler pendant neuf heures avec des manchettes, des tabliers en cotte de maille. C’est pour notre sécurité, mais au fil de la journée, cela finit par peser…
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Sur cette question des accidents du travail, nous avons auditionné des représentants syndicaux. Ils nous ont dit que la protection individuelle s’alourdit considérablement face à la course qui s’est engagée entre la rapidité des gestes demandée et la dangerosité des outils utilisés. Il vaudrait peut-être mieux ralentir un peu les cadences pour que les salariés soient moins exposés aux risques d’accidents et qu’ils puissent travailler dans des conditions moins pénibles. Qu’en pensez-vous ? Ne peut-on pas éviter les accidents autrement que par une protection accrue ?
M. Stéphane Geffroy. Tout à fait. On revient au même problème des cadences : plus on modernise, plus on nous protège, plus les cadences augmentent.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Vous allez finir en armure ?
M. Stéphane Geffroy. À certains postes, on travaille avec des gants métalliques qui arrivent au niveau du coude. Si un opérateur se coupe plus haut, les ouvriers qui occupent ce poste auront dès le lendemain des manchettes qui partiront de l’épaule…
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Vous avez parlé de la question du contrôle que vous jugez insuffisant dans certains établissements, notamment au moment où les animaux sont amenés et tués. Vous n’êtes pas opposé à la vidéo, à certaines conditions. Mais le contrôle est parfois une protection pour les agents : ils peuvent s’en servir pour prouver qu’ils ne sont pas à l’origine de l’accident. Pensez-vous que ce type de surveillance vidéo pourrait être aussi déclenché par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou par le salarié lui-même s’il estime que les conditions qu’on lui impose ne lui permettent pas de travailler correctement ? Le salarié pourrait alors démontrer les difficultés qu’il rencontre en cas de contestation de ses conditions de travail. La vidéo peut aussi être une protection, directe ou à travers le CHSCT, et pas seulement une surveillance destinée à le mettre en cause en cas de dysfonctionnement. Qu’en pensez-vous ?
M. Stéphane Geffroy. Par l’intermédiaire du CHSCT, je pense que c’est faisable. Mais on serait obligé d’enregistrer les images et ça…
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Tout dépend de l’usage qu’on en fait ensuite.
M. Stéphane Geffroy. Exactement. Ces images enregistrées ne doivent pas sortir de l’établissement. Elles ne doivent être visionnées que par les membres du CHSCT ou du service vétérinaire.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Ou par la justice, en cas de soucis.
M. Stéphane Geffroy. Oui.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Dans votre ouvrage, vous évoquez le côté fermé des abattoirs : on y est dans un entre-soi, méconnu et non reconnu à l’extérieur. Pour y remédier, il faudrait ouvrir. Or, vous le dites vous-même, c’est un milieu particulier que personne ne regarde. Si on se met à tout regarder d’un seul coup, cela va provoquer des chocs… Ne pourrait-on pas imaginer une sorte de sas – la réunion périodique d’élus, d’associations de consommateurs et de défense des animaux comme l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), de salariés, etc., – qui serait une manière de laisser la lumière pénétrer dans la boîte noire, sans passer pour autant du secret à la transparence totale ?
M. Stéphane Geffroy. Oui, je pense que ce serait possible. Mais il faut savoir que lors des opérations portes ouvertes, la chaîne d’abattage n’est pas en marche. J’ai déjà visité d’autres abattoirs où moi-même je n’avais pas accès à l’assommage ou à l’anesthésie des animaux.
M. le rapporteur. On peut le comprendre lors de journées portes ouvertes qui s’adressent à un large public. On peut penser que certains postes ne peuvent être vus que par des regards un peu avertis. Mais du coup, personne ne voit jamais ces postes. C’est pourquoi je vous proposais cette idée de sas pour que quelques personnes puissent porter le message à l’extérieur, en posant un regard averti sur ce qui se fait de bien et de moins bien dans l’établissement.
Suite à la diffusion des vidéos, une inspection spécifique annuelle sur le bien-être animal a été déclenchée par Stéphane Le Foll dans tous les abattoirs. Le ministre a ainsi fait remonter un certain nombre d’anomalies, ce qui prouve que le contrôle habituel n’avait pas été suffisamment attentif à cet aspect des choses. Pensez-vous que c’est une solution ? Une fois par an, sans que ce soit programmé, il pourrait y avoir une inspection spécifique sur ces questions de bien-être animal, d’assommage, de sensibilité et autres, parce que ce ne sont pas celles qui suscitent spontanément l’attention. Au jour le jour, on s’intéresse davantage aux normes sanitaires ou au contrôle ante mortem. Pensez-vous qu’une telle inspection annuelle serait un moyen intéressant de corriger les dérives ?
M. Stéphane Geffroy. Ce serait bien. Mais tous les abattoirs, sauf les petits publics, sont très fermés : il y a des caméras partout, il faut des badges d’accès, etc. Si vous vous annoncez à l’entrée, le chef de l’entreprise sera prévenu et tout le monde sera au courant de l’inspection dans les dix minutes. Tout étant informatisé, un chef de chaîne d’abattage peut réduire la cadence en deux clics, et dire à un ouvrier de passer un coup de jet d’eau pour nettoyer au lieu de faire autre chose. Ça me paraît compliqué…
M. le rapporteur. Mais tout cela ne milite-t-il pas pour l’installation d’une vidéo qui pourrait être déclenchée par l’inspection de l’extérieur et de manière inopinée ?
M. Stéphane Geffroy. Elle serait déclenchée par le biais du service vétérinaire ?
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Bien sûr, pour éviter que tout le monde soit prévenu.
M. Stéphane Geffroy. Cela peut être envisagé.
M. le rapporteur. J’ai une dernière question concernant les vidéos diffusées par l’association L214 Éthique et animaux. Au départ, comment avez-vous eu connaissance de leur existence ? Par la presse ? Je ne suis pas sûr que les agents qui travaillent en abattoir passent toute la journée les yeux rivés sur Twitter et internet. Comment ont-elles circulé dans le milieu ? Ont-elles vraiment circulé ?
M. Stéphane Geffroy. Ah oui, parce que l’information a été donnée à la télévision et dans les journaux. Tout le monde l’a su dès le lendemain.
M. le rapporteur. Une fois l’information donnée à la télévision et dans la presse, vous êtes allé voir les vidéos ?
M. Stéphane Geffroy. Bien sûr !
M. le rapporteur. Et vous en avez parlé entre vous ?
M. Stéphane Geffroy. Bien sûr !
M. le rapporteur. C’était un besoin d’en parler ?
M. Stéphane Geffroy. Tout à fait parce qu’on est caché du public et que les images étaient très fortes et incompréhensibles. Ce n’est pas parce qu’on fait de l’élevage qu’il faut maltraiter les animaux.
M. le rapporteur. Le regard des gens a-t-il changé après ces vidéos ? Avez-vous été interrogé par des personnes qui vous connaissent et qui savent que vous travaillez dans un abattoir ?
M. Stéphane Geffroy. Pas forcément. En revanche, après le film qui a été réalisé sur la chaîne d’abattage, j’ai eu des regards différents, y compris dans ma propre famille qui connaissait déjà mon travail par le biais de ce que je leur racontais et du livre. Ils ont été un peu choqués par les images, on peut le dire.
M. le rapporteur. Que vous ont-ils dit ?
M. Stéphane Geffroy. Qu’ils ne pensaient pas que c’était cela, mon travail.
M. le rapporteur. Était-ce de l’empathie pour vous parce qu’ils ne pensaient pas que c’était aussi dur ? Ou vous ont-ils mis en cause en disant qu’ils ne pensaient pas que vous puissiez faire ça ?
M. Stéphane Geffroy. Ce n’était pas une mise en cause. Ils réagissaient surtout à la pénibilité.
M. le président Olivier Falorni. Le film sur la chaîne d’abattage auquel vous faites référence est Saigneurs, n’est-ce pas ?
M. Stéphane Geffroy. Oui.
M. le président Olivier Falorni. Nous diffuserons ce documentaire le mardi 21 juin pour les parlementaires et les journalistes qui souhaitent le voir. Le lendemain, nous recevrons son auteur.
Mme Françoise Dubois. Monsieur Geffroy, je vous félicite d’avoir eu le courage d’écrire ce livre : il ne doit pas être évident de raconter ce qu’on fait, surtout dans ces conditions.
Je voudrais revenir sur l’aspect humain de votre travail. En préambule, vous avez dit que vous étiez un peu des oubliés du Gouvernement – je suppose que vous faites référence à tous ceux qui se sont succédé. Il se trouve que la nouvelle loi travail comporte une clause de pénibilité. En tant que délégué syndical, pensez-vous que vous pouvez intégrer ces clauses de pénibilité ? Personnellement, je le souhaite.
Vous dites être entré à dix-neuf ans dans cet abattoir, sans aucun bagage. Comment avez-vous appris ce métier ? Avez-vous reçu une formation ou avez-vous seulement observé avant de pratiquer ? Comment les choses se passent-elles pour les jeunes qui arrivent maintenant ? S’ils reçoivent une formation, considérez-vous qu’elle est suffisante ?
Le grand public manifeste peut-être plus d’indifférence que d’ignorance à l’égard de votre métier. On fait l’autruche : on ne tient pas à savoir ce qui se passe entre le moment où on voit la vache brouter tranquillement dans son pré et celui où on achète un beefsteak. Tout à coup, les images ont interpellé les gens. Ce manque de considération n’est certainement pas facile à vivre. On parle d’inspections pour vérifier le bien-être animal. Y en a-t-il pour s’occuper du bien-être humain ? Des services s’en chargent, je pense.
Qu’en est-il du retour à la maison, le soir, pour des gens qui pratiquent ce métier qui peut troubler ? Les jeunes qui entrent pour la première fois dans un abattoir pour y travailler doivent être dans une situation compliquée. Psychologiquement, comment surmontez-vous ce décalage qui existe entre la vie de l’abattoir et celle de l’extérieur ?
M. Stéphane Geffroy. À l’époque où je suis entré dans le hall d’abattage, il n’y avait pas de pré-visite. Quand je suis arrivé, on m’a laissé un couple d’heures pour observer mon collègue et pour me mettre petit à petit au travail sur ce poste. Les jeunes bénéficient maintenant d’une pré-visite parce que certains peuvent être choqués d’emblée par la vue de ces gros animaux, au point de ne pas pouvoir travailler dans ce milieu. En tant que formateur d’intégration, je prends en charge les nouveaux arrivants jusqu’à ce qu’ils soient totalement autonomes dans l’entreprise.
Mme Françoise Dubois. Vous êtes formateur dans votre entreprise uniquement, pas au niveau départemental ou régional ?
M. Stéphane Geffroy. Je ne suis formateur que dans mon entreprise. À mon époque, on était conditionnés pour travailler sur un poste et on y restait pendant des années. Ce n’est plus le cas : quand on connaît un poste parfaitement, on en change ; on peut passer d’un bout à l’autre de la chaîne si on le veut. On peut aussi passer des certificats de qualification professionnelle (CQP). Ce sont aussi des formations qui n’existaient pas avant. Les choses ont bien évolué de ce point de vue.
Au retour à la maison, il faut un petit moment de décompression… On va jardiner, promener le toutou…
Mme Françoise Dubois. On n’entre pas dans le conflit tout de suite…
M. Stéphane Geffroy. Surtout pas !
me Françoise Dubois. À l’extérieur, vous n’avez jamais été traité d’assassin comme le ministre de l’agriculture ?
M. Stéphane Geffroy. Non, seulement dans les journaux ces temps derniers.
Mme Laurence Abeille. Je voudrais revenir sur la question des rémunérations des salariés. Vous avez dit que le salaire fait partie des raisons qui vont ont fait rester dans ce métier. Pourriez-vous nous dire ce que représentait votre salaire par rapport au SMIC de l’époque ?
M. Stéphane Geffroy. Je ne me souviens plus trop, mais je sais qu’au bout de deux ou trois ans, je gagnais quasiment autant que mon père qui était menuisier depuis une vingtaine d’années.
Mme Laurence Abeille. Lors de l’audition d’hier, nous avons appris que la politique actuelle des abattoirs était d’embaucher des étrangers – des Roumains et plus récemment des Guinéens – à des salaires bien inférieurs à ceux qui se pratiquent habituellement. Connaissez-vous ce genre de pratiques qui consiste à changer le profil des salariés pour pouvoir diminuer les salaires, y compris en engageant des gens qui ne maîtrisent pas la langue française ?
M. Stéphane Geffroy. C’est arrivé il y a deux ou trois ans, surtout parmi les tâcherons du désossage, mais pas sur le haut de l’abattage. Pas chez nous en tout cas.
Mme Laurence Abeille. D’après vous, les services vétérinaires font-ils bien leur travail ?
M. Stéphane Geffroy. Chez nous oui, très bien, je peux vous l’assurer. Depuis la maladie de la vache folle, les services vétérinaires ont beaucoup changé et le suivi est devenu plus strict sur le plan sanitaire.
Mme Laurence Abeille. Et au niveau du bien-être animal ?
M. Stéphane Geffroy. Il y a eu aussi des progrès dans ce domaine-là. Notre entreprise a été l’une des premières à pailler les bouveries des animaux ; début 2013, un protocole a été mis en place et toutes les personnes en contact avec des animaux vivants ont été formées.
Mme Laurence Abeille. Au regard de ce qu’on a pu voir sur les vidéos, pensez-vous que ces formations sont suffisantes ?
M. Stéphane Geffroy. Oui, je pense. Il y a quelques années, on recrutait des jeunes issus du milieu agricole et ils étaient au contact avec les animaux, en début de chaîne. Maintenant, on a du mal à recruter ce personnel. Ces formations sont très bien pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu.
Mme Laurence Abeille. Avez-vous eu connaissance, dans votre entreprise ou ailleurs, de pratiques consistant à fournir des boissons alcoolisées aux personnels pour leur « donner du courage » et la force d’accomplir les gestes ?
M. Stéphane Geffroy. Ah non, je n’ai jamais vu de telles choses !
Mme Laurence Abeille. Je vous pose la question parce que ce sont des éléments qui nous ont été rapportés.
Votre métier s’exerce dans le secret, le confinement. On en parle beaucoup depuis le début des auditions. Vous êtes visiblement opposé à l’enregistrement d’images vidéo. Même si ces images ne sont pas à montrer à n’importe qui, ne pourraient-elles pas servir à la défense des salariés en cas de problème et à garantir que les animaux sont le mieux traités possible dans la chaîne ? Je ne comprends pas très bien votre refus de l’enregistrement.
M. Stéphane Geffroy. Qui va gérer et conserver ces enregistrements ? Il ne faut pas qu’on retrouve ces images partout, que l’on voie tout et n’importe quoi.
Mme Laurence Abeille. Et pourquoi ?
M. Stéphane Geffroy. Parce que cela pourrait conduire à des polémiques alors que, à mon avis, il n’y en a pas besoin.
Mme Geneviève Gaillard. Qu’entendez-vous par n’importe quoi ?
M. Stéphane Geffroy. Il est peut-être possible de fabriquer des vidéos. Personnellement, je n’y vois pas trop d’inconvénients, mais il faut que ce soit contrôlé.
Mme Geneviève Gaillard. Encadré.
M. Stéphane Geffroy. Très encadré.
Mme Laurence Abeille. Vous ne seriez pas forcément contre un enregistrement à partir du moment où il y aurait un encadrement précis de l’utilisation des images.
M. Stéphane Geffroy. Oui, et je pense que cette gestion est compliquée à mettre en place.
Mme Laurence Abeille. Je vais revenir sur le dur métier que vous exercez : c’est difficile de voir arriver un être vivant qu’on va tuer pour la consommation. Dans quel état d’esprit faut-il se trouver pour arriver à effectuer ces gestes de violence ? Au cours de l’audition d’hier, il a été question de l’impossibilité d’éprouver de la compassion, et du fait que les agents des abattoirs devaient plutôt se mettre dans une posture de combattant vis-à-vis de l’animal pour arriver à effectuer ce geste. Est-ce que ce que je vous dis correspond à quelque chose que vous avez pu vous-même ressentir ou observer autour de vous ?
M. Stéphane Geffroy. Peut-être sur certains postes, quand on commence. Il faut aussi se rappeler que ce sont des animaux d’élevage, nés de la main de l’homme pour subvenir à nos besoins en lait, viande, cuir, laine. Sans cela, beaucoup d’animaux n’existeraient pas.
Mme Laurence Abeille. Autrement dit, pour vous, comme ils sont destinés à la consommation, ils ne peuvent pas être considérés de la même façon que d’autres animaux ?
M. Stéphane Geffroy. Tout à fait, mais ce n’est pas une raison pour les maltraiter.
Mme Laurence Abeille. Ce n’est pas ce que je voulais vous faire dire. Mais c’est un aspect important : l’état d’esprit qui permet de travailler dans ces conditions.
Autre caractéristique de votre profession où il y a beaucoup d’accidents du travail : on est obligé de porter des protections pour éviter les blessures et maintenir les cadences. Dans d’autres métiers – le travail du bitume, l’abattage d’arbres, etc. – les gens doivent porter des masques pour se protéger d’émanations toxiques ou de la poussière. Or on constate souvent que ces travailleurs enlèvent leurs équipements de protection dès qu’ils ne sont plus trop surveillés. Avez-vous observé ce genre de comportement ? Avez-vous constaté que, pour être plus libre de leurs mouvements, des gens enlèvent leurs protections même dans des cadences difficiles ?
M. Stéphane Geffroy. Non, pas chez nous. Le service de sécurité passe tous les jours et à n’importe quelle heure de la journée. Quand une personne n’a pas ses équipements de protection individuelle (EPI), elle ne peut pas prendre son poste ou y rester. C’est impératif.
M. le rapporteur. Dans ce domaine de la sécurité et dans d’autres, y a-t-il une « culture maison » ? Vous dites qu’il y a un contrôle pour les équipements de protection et j’imagine que tout le monde sait qu’il n’est pas toléré de ne pas les mettre. De la même façon, on fait les gestes d’une manière et pas d’une autre quand on appartient à cette entreprise. Est-ce qu’il y a une émulation pour bien faire, une culture maison qui conforte la règle ? N’y a-t-il pas, au contraire, une tendance à passer à côté ?
M. Stéphane Geffroy. Quand on se met à passer à côté, c’est lié à la pénibilité et à la cadence : il faut finir et on a peu de moyens pour arrêter une chaîne d’abattage. C’est là qu’un coup de couteau sera mal donné à un moment précis. Sinon, il y a des règles à respecter : on apprend au jeune à mettre toujours la pointe de son couteau vers le bas quand il circule, etc.
M. le rapporteur. Si un jeune oublie cette consigne au début, qui va le rappeler à l’ordre ? Son formateur, son responsable hiérarchique, son voisin de chaîne ?
M. Stéphane Geffroy. Tous ces gens-là vont le rappeler à l’ordre.
Mme Sylviane Alaux. Dans les articles qui lui sont consacrés, chacun s’accorde à trouver que votre livre est un bel hymne à la camaraderie et à l’entraide. Dans l’un d’eux je lis que l’entraide est ce qui permet « de ne pas sombrer, même si avec la multiplication des contrats à durée déterminée ces dernières années, il est de plus en plus difficile de tisser des liens. » De votre côté, dans ce turn over qui s’inscrit dans le quotidien de l’entreprise, avez-vous noté l’arrivée d’une main-d’œuvre étrangère avec tout ce que cela peut entraîner en termes de manque de formation et de difficultés de communication quand les nouveaux arrivants ne maîtrisent pas la langue ?
En m’intéressant à vous et à votre livre, j’ai aussi lu que votre surnom était « Cactus ». Vous déclarez ouvertement que vous entendez bien faire bouger le Gouvernement. Quels sont vos projets et les prochaines étapes de votre militantisme ?
M. Stéphane Geffroy. Les jeunes surfent sur internet et ils voyagent plus que nous à leur âge. Ils se voient moins fonder une famille, acheter une maison, rester dans un coin. Ils sont plus ouverts d’esprit. C’est pour cela qu’il y a un grand turn over au niveau des jeunes, d’autant plus que la pénibilité du métier n’est pas prise en compte. C’est vrai aussi qu’on voit davantage d’étrangers dans les abattoirs : des Africains, Mexicains, Italiens. Mais tous ces jeunes sont tous pris en charge ; on ne les laisse pas dans l’entreprise tant qu’ils ne sont pas aptes à s’y déplacer seuls.
Vis-à-vis du Gouvernement, je suis content de me faire entendre, parce qu’on nous a oubliés pendant des années. On ne nous a jamais entendus ni regardés. Et pour faire reconnaître la pénibilité de notre métier, on ne peut pas bloquer le pays… J’aimerais bien qu’un gouvernement se pose un jour les bonnes questions et reconnaisse la pénibilité de notre travail.
Mme Sylviane Alaux. Ces images, qui ont déclenché une indignation nationale, peuvent-elles être exploitées en ce sens ?
M. Stéphane Geffroy. C’est possible. Jusqu’à présent, rien n’a été fait parce que tout le monde estime que son métier est pénible. Nos revendications porteront-elles leurs fruits un jour ? Je l’espère.
M. Thierry Lazaro. Il serait peut-être utile de repréciser votre position sur les enregistrements. Si j’ai bien compris, vous seriez rassuré par la présence d’un organisme public, telle que suggérée par le rapporteur, ce qui pourrait d’ailleurs engendrer d’autres problèmes administratifs et légaux. Dès lors que les images vidéo du poste d’abattage seraient consultables par un organisme public, l’enregistrement pourrait-il être l’une des solutions ? À juste titre, vous émettez un doute sur les directions d’entreprise…
M. Stéphane Geffroy. C’est très compliqué. Beaucoup de gens sont hostiles à l’idée d’être filmé sur leur lieu de travail, tout en sachant qu’ils le sont déjà dans la rue, à la banque, au supermarché, et partout. Personnellement, je ne vois pas où est le problème ; mais la direction et le personnel appartiennent à des milieux assez différents. Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce que la direction ait un droit de regard sur ces images-là.
M. le président Olivier Falorni. Monsieur Geffroy, au nom de tous les membres de la commission, je vous remercie pour votre témoignage très intéressant.
La séance est levée à dix heures vingt.
——fpfp——
24. Audition, ouverte à la presse, de M. François Hochereau, sociologue à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et M. Félix Jourdan, sociologue, auteurs du rapport « Abattage et bien-être animal »
(Séance du jeudi 9 juin 2016)
La séance est ouverte à dix heures vingt.
M. le président Olivier Falorni. Nous recevons à présent M. François Hochereau, chargé de recherche en sociologie, rattaché à l’unité de recherche Sciences en société de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA SenS), et M. Félix Jourdan, sociologue, chargé d’études au sein de l’INRA/ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Messieurs, vous êtes les auteurs du rapport Abattage et bien-être animal, qui étudie la diffusion dans les abattoirs, du règlement européen 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, notamment grâce au Guide de bonnes pratiques pour la maîtrise de la protection animale des bovins à l’abattoir.
Pour les besoins de votre étude, vous avez enquêté dans des établissements d’abattage représentatifs de la diversité des outils français. Vous avez visité vingt et un abattoirs, dont huit abattoirs de proximité, huit semi-industriels et cinq industriels.
Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de lever la main droite et de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. François Hochereau et M. Félix Jourdan prêtent successivement serment.)
M. François Hochereau, sociologue à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Sociologue à l’INRA, j’en suis venu à m’intéresser à la problématique du bien-être animal à travers les questions de construction de la mesure, notamment en matière de relation homme-animal, de docilité et de domestication des animaux. J’ai ainsi intégré AgriBEA, le réseau de l’INRA qui travail sur la question du bien-être animal, et candidaté à l’ANSES pour intégrer le premier groupe de travail consacré au même sujet.
C’est à la suite de la publication des règlements européens, qui s’appliquent partout et dans leur totalité, que l’ANSES s’est penchée sur la question, la Direction générale de l’alimentation (DGAL) l’ayant saisie à plusieurs reprises. Si les premières saisines de la DGAL portaient sur l’abattage rituel, elles se sont étendues à l’abattage en général, qui a fait l’objet d’un guide des bonnes pratiques, que la France est le seul pays à avoir mis en place sous cette forme, sachant que cette formalisation du règlement n° 1099/2009 – qui contient surtout des dispositions cadres, si ce n’est en matière d’évaluation de la perte de conscience animale – n’était pas une obligation mais une recommandation de l’Union européenne.
Je me suis pour ma part intéressé, au sein des abattoirs, aux rapports entre les hommes et les animaux ainsi qu’aux liens existant entre le bien-être animal et l’activité humaine. Je ne vous cache pas que les difficultés ont été nombreuses car, si les polémiques peuvent faire office d’alertes, dans la pratique, elles ferment les portes des abattoirs, et il devient extrêmement compliqué de construire une relation de confiance avec leurs personnels, dans un esprit de progrès et non de contrôle ou de jugement extérieur. Partant, il n’est pas évident pour l’enquêteur d’observer concrètement la réalité derrière ce que l’on veut bien lui montrer.
Pour inscrire mes propos dans un contexte général, je rappellerai qu’il existe une très grande diversité d’abattoirs, que l’on peut regrouper en deux grandes catégories : les abattoirs publics territoriaux et les abattoirs industriels.
Les abattoirs publics sont des abattoirs comme ceux dont les pratiques ont été dénoncées par L214. Il s’agit d’établissements insérés dans un réseau socio-politico-économique assez complexe, dans lequel interviennent des éleveurs comme des élus locaux, à la convergence de problématiques comme la valorisation du territoire ou l’agropastoralisme. Dans ces conditions, l’abattoir, qui assume les fonctions d’un service public, est pris en tenailles entre, d’un côté, l’injonction des actionnaires que sont les professionnels du territoire de ne pas pratiquer des prix trop élevés et, de l’autre, la concurrence, plus ou moins proche, des autres établissements commercialisant de la viande.
Les abattoirs industriels, quant à eux, sont dans une logique d’internalisation des coûts, car il faut savoir qu’un abattoir est avant tout un centre de coûts et que la rentabilité passe par le développement, en aval, d’activités lucratives, qui peuvent aller jusqu’à la vente de produits finis en barquette.
On comprend dès lors que la problématique du bien-être animal ne peut que complexifier l’organisation et la gestion des abattoirs, dans la mesure où tant la protection animale que les mesures de contrôle entraînent des coûts supplémentaires dans un univers où l’on compte déjà au plus juste. Cela étant, des dispositions peuvent être ou ont déjà été mises en place.
Du fait de cette grande diversité, les situations que l’on peut relever à droite ou à gauche ne sont pas toujours généralisables. En tout cas, nous n’avons jamais rien vu de comparable aux images que vous savez, même en allant chercher ce qui se dissimulait derrière les paravents que l’on déployait à notre intention.
M. Félix Jourdan, sociologue, chargé d’études au sein de l’INRA/ANSES. Le bien-être animal au sein d’un abattoir ne peut être considéré dans l’absolu, mais doit être envisagé dans la perspective beaucoup plus large des relations socioprofessionnelles au cœur desquelles il se trouve. Non seulement il procède de la relation entre le travailleur au sein de l’abattoir et l’animal, mais il s’inscrit également dans un processus beaucoup plus long, qui commence dès l’élevage et se poursuit avec le transport. En effet, quand un animal arrive en abattoir, il a accumulé des « traces » et capitalisé parfois de la fatigue ou des blessures, autant de facteurs de « non-conformité » jusqu’alors latents, mais qui vont se cristalliser au moment de l’arrivée à l’abattoir. Ce qui se passe en amont est donc crucial.
Au sein de l’abattoir, le bouvier, chargé de réceptionner les animaux à leur arrivée, est le premier confronté, au-delà de la gestion du bien-être animal, aux conséquences des différents facteurs intervenus au cours de l’élevage et durant le transport, et qui se manifestent par des situations très variables. Dans les petits abattoirs de proximité notamment, il arrive que les éleveurs amènent leurs bêtes en ne tenant pas compte du planning d’abattage fixé au préalable, sans qu’on n’ose leur imposer de contrainte car ils participent au financement de l’abattoir contraint de se moderniser et de se remettre aux normes.
M. François Hochereau. Ce que vient de dire Félix Jourdan vaut aussi pour des abattoirs industriels : même s’il y a une planification, les temps de transport imposés aux bêtes sont beaucoup plus longs.
Il faut savoir qu’avec la rationalisation de la filière, entre 80 et 90 % de l’abattage se fait en Bretagne : c’est là que convergent des animaux de toute la France, voire de l’étranger. Or certains donneurs d’ordre demandent aux bouveries d’évaluer le transport et la gestion du bien-être animal en amont, à des fins de validation de leurs fournisseurs. Se met ainsi en place de manière implicite et informelle une forme de traçabilité qui passe par l’abattoir.
M. le président Olivier Falorni. Dans votre rapport, vous qualifiez l’abattoir de « nœud réglementaire » ; qu’entendez-vous par là, et quelle place tient le bien-être animal dans ce nœud réglementaire ?
En quoi le règlement 1099/2009 a-t-il été innovant et quelles en ont été les conséquences concrètes dans les abattoirs français ?
Quelles différences avez-vous pu constater entre les abattoirs industriels et les abattoirs locaux ?
Vous a-t-il été facile d’enquêter en abattoir ? Le personnel s’est-il montré disposé à s’entretenir avec vous ? Avez-vous eu l’occasion d’échanger et quels enseignements en avez-vous retirés ?
M. Félix Jourdan. Entrer dans les abattoirs n’a pas toujours été facile. Les polémiques autour de leurs pratiques ont engendré une grande méfiance, y compris vis-à-vis des chercheurs qui travaillent dans le cadre de structures officielles. Nous avons eu énormément de difficultés à enquêter, particulièrement avec les gros abattoirs industriels. Les abattoirs locaux nous ont plus facilement ouvert leurs portes.
M. François Hochereau. Les abattoirs industriels ont étroitement participé avec l’Institut de l’élevage à la conception du guide des bonnes pratiques : il est paradoxal que ce soient les établissements les plus impliqués qui, à quelques exceptions près, nous aient fermé leurs portes. Sans doute les abattoirs de proximité obéissent-ils davantage à une logique de service public et d’ouverture. Dans une filière intégrée, on travaille en autonome en surveillant les concurrents internationaux…
M. Félix Jourdan. En ce qui concerne ensuite les échanges avec les différents personnels au sein des abattoirs, le contact a été vraiment bon. Nous avons senti une réelle volonté de témoigner et de montrer, au-delà des images de façade, ce qu’était réellement le travail en abattoir. Sans doute accordaient-ils une attention particulière à leur tâche lorsque nous les observions ; reste que nous avons pu mener des entretiens sincères et observer une grande diversité de situations.
M. François Hochereau. Le concept de nœud réglementaire traduit d’abord l’idée que l’abattoir n’est pas un lieu où l’on tue et on fait les choses n’importe comment : c’est un endroit extrêmement réglementé. Il est important de se souvenir que, historiquement, c’est dans les abattoirs, à Chicago, en 1860, que naît le travail à la chaîne, avec la parcellisation et la rationalisation des tâches : c’est en allant les visiter que Henry Ford cherchera à faire la même chose pour fabriquer ses automobiles. Le taylorisme est né dans les abattoirs. Stéphane Geffroy montre bien dans son livre que c’est encore le cas aujourd’hui. Même si, grâce aux treuils et aux systèmes pneumatiques qui facilitent le maniement et la circulation des animaux et des carcasses, le travail en abattoir n’exige plus la même force physique, le principe reste le même, avec une organisation et des cadences très précises.
La rationalisation du travail s’est effectuée en plusieurs étapes, motivée d’abord par des considérations de marché, puis, très rapidement, par des préoccupations hygiénistes, qui ont conduit à sortir les abattoirs des villes, à en faire des lieux fermés et à encadrer très fortement les pratiques. La pression sanitaire a été le principal vecteur de la modernisation de l’abattage, l’objectif essentiel des contrôles mis en place étant de garantir un état sanitaire optimal des viandes et des animaux.
Cela étant, la préoccupation de la protection animale n’est pas si récente qu’on le croit. On a réellement commencé à s’en préoccuper dans les années quatre-vingt-dix et à modifier le code rural en conséquence ; mais la survenue de la crise de la vache folle a focalisé tous les efforts sur l’amélioration des conditions sanitaires en abattoir et faire passer la question du bien-être animal au second plan des préoccupations de l’inspection vétérinaire, quand bien même certains vétérinaires sont toujours restés sensibles à cet enjeu. À la même époque, une grosse structure privée a d’ailleurs l’idée de mettre en place dans ses abattoirs un audit bien-être animal afin de valoriser l’image de la viande qu’elle vendait.
M. le président Olivier Falorni. Peut-on savoir de quelle entreprise il s’agit ?
M. François Hochereau. Je préfère taire son nom, dans la mesure où il y a du bon et du moins bon dans cette initiative qui répond à un but plus commercial qu’éthique, même si elle s’appuie sur les travaux de Mary Temple Grandin, qu’elle a d’ailleurs en partie financés. Toujours est-il que cela a contribué à sensibiliser les très gros abattoirs à la problématique du bien-être animal, avant même la publication des guides de bonnes pratiques. Là encore, il y a un écart entre les très grosses structures et les petites unités, qui découvrent seulement cette logique d’assurance qualité dans la protection animale.
Dans cet univers très rationalisé qu’est l’abattoir, le bien-être animal ajoute ainsi une couche supplémentaire aux normes très précises qui existent déjà. C’est là que se porte l’attention du public : les enquêtes régulières menées par l’Union européenne montrent que les gens associent bien-être animal à santé de l’animal et santé du consommateur. Si le citoyen est sensible à cette question du bien-être animal, le consommateur, lui, se préoccupe avant tout de la qualité sanitaire des aliments, de leur provenance et donc de leur traçabilité. Le bien-être animal vient bien après – mais tout dépend de la façon dont est posée la question dans ces sondages.
Si j’ai donc parlé de « nœud réglementaire », c’est parce qu’une triple pression en matière de normes s’exerce dans l’abattoir : celle de la réglementation du travail, celle de l’hygiène et celle qui concerne le bien-être animal.
Pour ce qui concerne les conséquences concrètes qu’a eues le règlement 1099/2009 pour les abattoirs, son intérêt majeur a été d’y introduire une obligation de formation pour les salariés. Si l’on avait réfléchi, jusqu’à son entrée en vigueur, aux moyens d’améliorer l’organisation du travail, rien n’était explicitement prévu en matière de formation individuelle des employés. Malgré quelques réticences au départ, du fait du niveau de qualification très variable des personnels, la validation d’un certificat de compétences a été globalement positive, même si l’on peut regretter que, dans la plupart des cas, ces formations soient restées trop théoriques. Certains organismes de formation ont néanmoins su contourner cet écueil en organisant au sein des abattoirs des formations collectives axées sur des démarches didactiques appuyées sur l’analyse et le commentaire de vidéos.
Ces modes d’échange ont été d’autant plus bénéfiques qu’ils ont permis de resserrer les liens entre les salariés dans un contexte marqué par le déclin de l’ancienne solidarité que des conditions de travail physiquement difficiles tissaient entre les employés en favorisant l’entraide.
La sociologie des personnels a évolué : comme le montre le sociologue Séverin Muller dans son ouvrage, À l’abattoir. Travail et relations professionnelles face au risque sanitaire, des lignes de fracture séparent désormais, au sein de l’abattoir, les anciens des plus jeunes, les personnels techniques qui travaillent à la production des agents chargés du contrôle qualité. Avec cette dichotomie, la répartition des rôles a changé. À une logique du tutorat assumé par les services vétérinaires a succédé la logique de l’assurance qualité, en vertu de laquelle la charge de la preuve incombe à l’abattoir : les relations de confiance parmi le personnel peuvent s’en trouver perturbées. Le guide des bonnes pratiques peut à cet égard présenter un inconvénient s’il devient une sorte de paravent derrière lequel on se réfugie au lieu d’aborder les problèmes de fond : dès lors qu’il est respecté, on n’a rien à dire…
Ce phénomène est d’autant plus prononcé que le contrôle vétérinaire, autrefois exercé par des agents de l’État qu’on appelait vétérinaires inspecteurs est une activité qui s’est considérablement dépréciée, a perdu des effectifs et emploie aujourd’hui, en CDI ou en CDD, une catégorie de salariés qu’on pourrait qualifier de sous-prolétariat vétérinaire. Certes, la DGAL en a pris conscience et réaffecte des administrateurs en abattoirs, mais les vétérinaires que nous avons interrogés nous ont souvent dit qu’ils n’avaient pas toute latitude pour intervenir dans une organisation où prime désormais l’assurance qualité. Il s’agit d’une démarche interne à l’entreprise, prise en charge, au moment de la mise à mort, par le responsable protection animale (RPA), qui va s’appuyer sur le respect de la réglementation en vigueur et le guide de bonnes pratiques, le rôle du vétérinaire se bornant non plus à juger de la qualité des contrôles mais à seulement vérifier qu’ils ont été effectués. Cela m’amène à considérer qu’en définitive, l’évolution de la réglementation a eu des effets ambivalents.
M. Félix Jourdan. Je confirme qu’à un système dans lequel les services vétérinaires jouaient un rôle de soutien technique, en prodiguant le cas échéant des conseils pratiques, a succédé un système dans lequel prévaut désormais une logique de contrôle. Or, qui dit contrôle dit prise de recul, d’où une coopération moindre avec les opérateurs et une plus grande distance entre ces derniers et les vétérinaires.
M. François Hochereau. Aujourd’hui, un vétérinaire ne se prononce plus en amont sur les modifications techniques qu’envisage un abattoir : c’est seulement après qu’il dira si cela va ou pas. Cela s’explique notamment par le fait qu’il n’existe plus de référentiel national, chaque abattoir mettant en place sa propre démarche qualité. C’est d’ailleurs en partie pour en savoir plus sur les procédures d’évaluation des vétérinaires et la position de l’ANSES que les grands abattoirs industriels ont consenti à nous recevoir, alors qu’il s’agissait davantage pour les petits abattoirs et les abattoirs de taille moyenne de s’informer ou de glaner des renseignements sur la concurrence.
Il faut dire ici un mot de la gestion des incidents, qui peuvent affecter l’évaluation du bien-être animal. On s’est beaucoup focalisé, dans l’usage qui a été fait des guides de bonnes pratiques, sur les fiches KOOK, qui sont des fiches de procédure, dont la mise en œuvre n’a guère posé de problème. En cas d’incident en revanche – et cela arrive fréquemment car un animal est un être vivant qui peut se blesser ou mal réagir –, c’est la panique et tout le monde souffre : les animaux, les hommes, l’organisation. Ce qui intéressait le plus les RPA dans la formation, c’était d’échanger avec les autres RPA pour savoir comment ils géraient ces situations-là. Si des abattoirs se sont modernisés pour minimiser les risques d’accidents, ce n’est pas le cas de bon nombre d’entre eux, dans lesquels le rapport quotidien entre l’homme et l’animal reste dangereux et susceptible de mal tourner. Les dérives surviennent alors moins parce que les opérateurs sont fatigués que parce qu’ils sont dépassés par la situation. La question de la gestion des incidents se pose notamment dans le rapport d’évaluation des éléments de bien-être animal.
Se pose notamment le problème des animaux qui sont déchargés la nuit, sur décision du transporteur qui a planifié ainsi la rotation de ses camions, en l’absence du vétérinaire ou du RPA : il n’y a plus de passage de relais. D’où, dans certains abattoirs, l’installation de caméras sur les quais de débarquement, qui permettent de vérifier, dans le cas d’un animal blessé, s’il l’était déjà lorsque le transporteur l’a déchargé.
Face à un animal en souffrance, il est compliqué pour le RPA de prendre la bonne décision : ne pas l’abattre peut lui valoir un procès-verbal de la part du vétérinaire qui l’accusera de l’avoir laissé souffrir ; l’abattre l’expose à une mise en accusation de la part du propriétaire de l’animal, qui lui reprochera d’avoir tué sans raison un animal en bonne santé. C’est toute la question de l’imputation de la responsabilité.
M. Félix Jourdan. Le règlement européen de 2009 a été mis en application à partir de 2010, soit il y a six ans. Le recul que nous avons est à peine suffisant car cela a impliqué, notamment pour les petits abattoirs, la mise en œuvre de dispositifs lourds et complexes, la logique de l’assurance qualité impliquant notamment que l’établissement possède déjà un service qualité structuré et susceptible de traduire en mesures concrètes sur le terrain le guide des bonnes pratiques.
Ce qui est d’ores et déjà tangible quoi qu’il en soit, c’est que la nouvelle réglementation a contribué à sensibiliser les professionnels à la question du bien-être animal, qui avait déjà fait l’objet d’un arrêté de 1997, dont la portée avait malheureusement été réduite par la crise de la vache folle. Avec le règlement 1099/2009, la protection animale est remise au cœur du dispositif, avec cette idée qu’il faut en tenir compte non seulement dans les situations de routine mais aussi dans les procédures de gestion de l’incertitude.
M. François Hochereau. Il faut insister ici sur la question de la formation, sachant que nous avons mené notre enquête peu de temps après la mise en œuvre du règlement et que, tandis que les gros abattoirs venaient tout juste de former leur personnel, les petits abattoirs, eux, en étaient encore dans la phase de réflexion.
Si l’on se réfère aux trois abattoirs qui ont été dénoncés par L214 et à ce que montrent les vidéos d’épisodes de maltraitance ou de malfaisance, il apparaît que, dans le premier cas, elles sont totalement incompréhensibles : malgré une situation de surcharge ponctuelle, le personnel ne semble pas en situation de stress et tout semble fonctionner normalement ; et pourtant on assiste à des actes de maltraitance et même de malfaisance. Dans le deuxième cas, il s’agit d’un tout petit abattoir où, malgré d’excellents équipements, le travail est organisé en dépit du bon sens : c’est du n’importe quoi. Qui plus est, l’aménagement n’a pas été prévu pour gérer un petit nombre d’animaux appartenant à des espèces différentes. D’où le pétage de plombs. Dans le dernier cas enfin, il apparaît clairement qu’il s’agit d’un problème de formation, notamment du sacrificateur.
Nous touchons ici à un vrai point d’achoppement dans la question du bien-être animal à l’abattoir. La technique de l’abattage rituel exige un geste très sûr ; or, s’il y a des sacrificateurs extrêmement compétents d’autres, au contraire, se distinguent par une totale incompétence, ce qui s’explique par le fait que l’agrément accordé au sacrificateur l’est sur des critères religieux et non sur des critères techniques.
Deux arrêtés de décembre 2011 et juillet 2012 imposent pourtant que les sacrificateurs aient reçu une formation mais, dans la réalité, la question de leurs compétences reste très largement dépendante des autorités religieuses. Or il n’y a chez les musulmans ni clergé ni hiérarchie capable d’organiser et de garantir la maîtrise des aptitudes nécessaires aux sacrificateurs, si bien que les plus compétents d’entre eux appartiennent à une société privée, qui les salarie et a précisément fondé son image de marque sur le savoir-faire de ses employés.
Du côté du Consistoire juif en revanche, les choses sont structurées et organisées depuis fort longtemps, et les sacrificateurs ont reçu une formation technique. La plupart des sacrificateurs ont leur propre valise de matériel, car il est essentiel, comme le rappelait Stéphane Geffroy, de posséder son propre couteau, qui doit être bien aiguisé. Un sacrificateur qui se présente sans son couteau, c’est anormal, d’autant que les animaux tués selon le rite halal bougent beaucoup plus que lorsqu’ils sont étourdis, même s’il n’est pas toujours évident de discerner s’il s’agit d’un mouvement conscient ou d’un spasme nerveux.
Il ne s’agit pas ici de stigmatiser cette pratique et, au cours de nos entretiens, nous avons eu de nombreux témoignages confirmant que certains sacrificateurs opéraient parfaitement, qu’un seul coup de couteau leur suffisait. D’autres au contraire doivent s’y reprendre cinq à six fois, et laissent l’animal agoniser dans des conditions qui choqueraient même les plus pratiquants. Nous avons vu des stagiaires horrifiés du spectacle qu’ils découvraient dans l’abattoir, alors qu’ils consomment du rituel…
J’en reviens donc à la formation qui doit être l’occasion, pour pallier la perte de solidarité, de recréer des moments d’échange entre le bouvier, l’abatteur, l’étourdisseur, voire l’accrocheur. Ils manipulent tous des animaux vivants, en tout cas qui réagissent ; or ils ne se parlent pas. Le dialogue est en général plus fréquent dans les petits abattoirs, a fortiori si le responsable a une expérience de la chaîne, et rien n’interdit de l’appuyer sur des analyses de vidéos – y compris des extraits qui ne montrent aucun problème –, les quelques expériences menées ayant montré que cela était toujours très bénéfique, entre deux cycles de formation, qui n’ont lieu, pour les personnels, que tous les cinq ans. Il me semble enfin indispensable de toujours relier la question du bien-être animal à celle de la protection du travailleur et à celle de l’inscription de la bête et de l’homme dans l’espace et dans le cycle de l’abattoir.
M. Félix Jourdan. Je pense en effet que se focaliser uniquement sur le bien-être animal peut avoir des effets pervers. Je conçois que l’on puisse être choqué en pénétrant dans un abattoir, puisque c’est un lieu de mise à mort, et que nos modes de vie modernes nous ont éloignés – les citadins en particulier – de cette réalité paysanne. Pourtant, le bien-être n’y concerne pas que l’animal. Certes, il est important, dans la « tuerie », ainsi que Stéphane Geffroy nomme la zone d’abattage, de réfléchir à la meilleure façon de positionner le pistolet pour éviter toute souffrance inutile à l’animal, mais bien d’autres questions se posent qui concernent la sécurité des opérateurs et les risques auxquels ils sont exposés. À trop se concentrer sur le bien être animal, on risque de générer de la frustration chez les travailleurs des abattoirs, qui passent leurs journées dans le sang, depuis tôt le matin jusqu’à tard le soir. Il est donc essentiel de ne pas opposer l’homme à l’animal mais de travailler à une forme de convergence de leurs bien-être respectifs.
M. Thierry Lazaro. Pour ce qui concerne la protection animale, le poste d’abattage est l’étape ultime d’un parcours qui commence dès la naissance à la ferme et qui passe notamment par le transport de la bête jusqu’à l’abattoir. Vous évoquez dans votre rapport le rôle essentiel du bouvier qui, dans les abattoirs de petite ou moyenne envergure, peut accompagner l’animal depuis sa réception – où il lui faudra, le cas échéant, calmer un chauffeur un peu « vif » ou négligent – jusqu’au poste d’étourdissement. En d’autres termes, c’est à lui qu’incombe la tâche d’« aimer » l’animal jusqu’à ses derniers instants. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce poste éminemment important dans la chaîne d’abattage ?
Vous soulignez également que les vétérinaires, qui arrivent en abattoir à l’issue de parcours très divers peuvent avoir une appréhension très différente de la souffrance animale, laquelle reste très difficile de mesurer avec exactitude, et qu’ils sont pour cette raison très demandeurs de données objectives leur permettant de disposer d’un référentiel commun. Quel est votre sentiment sur cette question ?
Enfin, en ce qui concerne le guide des bonnes pratiques, pouvez-vous préciser la distinction que vous établissez entre les petits abattoirs qui semblent avoir quelque difficulté à le mettre en application et les grands abattoirs où il a d’emblée pu trouver sa place dans le process industriel ?
Mme Françoise Dubois. Toutes nos auditions ont confirmé que la formation était le point faible de l’abattage en France. On ne choisit pas d’être abatteur comme l’on choisit d’être mécanicien ; on le devient souvent par hasard, pour échapper au chômage et à la crise économique. Il n’existe donc pas de formation professionnelle en amont. Cela explique pour beaucoup, comme M. Geffroy nous l’a expliqué, l’important turn over chez les jeunes et la disparition de la solidarité parmi les équipes. C’est d’autant plus dommageable qu’il est prouvé que le bien-être animal est très lié au bien-être humain. Je pense donc que le certificat de compétences décerné aux abatteurs est une bonne chose, un élément sécurisant et rassurant qu’il est indispensable de bien encadrer.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Ne pensez-vous pas qu’il serait souhaitable que l’abattoir salarie les sacrificateurs ? Cela permettrait en effet le partage de la responsabilité entre, d’une part, le certificateur religieux, et, d’autre part, l’employeur.
Il est difficile d’engager une démarche de progrès sans se parler. Pensez-vous qu’il serait possible de mettre en place auprès des abattoirs une forme de commission locale d’information et de sécurité, qui permettrait d’améliorer la communication au sein de l’établissement mais également avec les acteurs extérieurs, associations de consommateurs et élus ?
Vous situez l’origine du taylorisme dans les abattoirs. Où en est-on aujourd’hui ? Sont-ils toujours le lieu d’une réflexion sur la robotisation, l’intégration des tâches et le travailleur « augmenté », dans la perspective d’une nouvelle organisation du travail ?
M. Félix Jourdan. Le bouvier joue en effet un rôle fondamental, et les critères de recrutement ne sont pas les mêmes que pour un opérateur qui travaille sur la chaîne ou au poste d’abattage, à des tâches plus ingrates et faiblement valorisées. Le bouvier en revanche assume une multitude de rôles, notamment en relation avec l’extérieur. En ce sens, c’est un métier potentiellement valorisant.
M. François Hochereau. Le bouvier est le seul à ne pas être assujetti à la chaîne. Sa seule contrainte est qu’il arrive sur le site vers quatre heures du matin, tandis que la chaîne ne démarre qu’à six heures ; en dehors de cela, il gère son travail en relative autonomie. C’est un poste sur lequel il n’y a guère de difficultés de recrutement, à la différence des postes liés à la chaîne d’abattage, d’autant que notre société a connu une rupture sociologique et que, contrairement à il y a trente ans, les jeunes aujourd’hui ne sont plus familiers de la manière dont on tue les animaux à la ferme.
M. Félix Jourdan. Le risque est qu’il soit de plus en plus difficile de recruter des opérateurs motivés pour travailler sur les chaînes d’abattage. Qui, en effet, peut avoir envie de travailler à la tuerie ? Lorsqu’un jeune y va, c’est souvent un choix par défaut. Les bouviers en revanche ont généralement une expérience dans l’élevage ; ce sont des enfants d’agriculteurs, ou d’anciens bergers. Tout l’enjeu est donc de rapprocher et de mieux coordonner ces différents métiers, souvent isolés les uns des autres au sein de l’abattoir, en particulier pour ceux qui sont dans la zone d’abattage.
M. François Hochereau. Le critère primordial pour recruter un bouvier est d’ordre psychologique : avant même d’avoir une expérience dans l’élevage, il faut être quelqu’un de calme. Les abattoirs en effet ne veulent pas de problèmes avec les animaux vivants.
Les métiers de la chaîne, eux, sont, pour certains, des métiers techniques et l’on pourra trouver des jeunes, titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) boucher, plutôt contents de travailler au découpage : il n’est pas évident de découper la juste proportion de gras sur une carcasse. En revanche, personne ne veut aller ni à l’accrochage ni à la tuerie, d’autant que ce sont des postes dangereux.
Quant à la formation, l’idéal serait de mettre en place des filières d’apprentissage qui restent ouvertes, laissant aux apprentis la possibilité de se réorienter. Dans cette optique, on pourrait envisager d’intégrer dans le CAP boucher une option abattage, sachant cependant que la filière boucherie connaît déjà des difficultés de recrutement.
Cela étant, un jeune n’est jamais lâché d’emblée seul sur la chaîne. Les abattoirs pratiquent le tutorat, ce qui peut leur coûter très cher, car, souvent, le jeune qu’ils ont formé en binôme pendant plusieurs mois choisit de ne pas rester.
M. Félix Jourdan. C’est l’un des effets pervers de la réglementation, qui impose un certificat de compétences en matière de protection animale. L’abattoir devra ainsi payer et l’opérateur et sa formation, sans aucune garantie qu’il reste salarié chez lui.
M. François Hochereau. En ce qui concerne les sacrificateurs, j’ai dit que, selon moi, c’était un problème majeur, en dehors de toute considération d’ordre politique ou religieux. Les fatwas indiquent certes qu’il faut respecter l’animal, réciter une prière et prendre son temps ; mais lorsque l’on observe les sacrificateurs en situation, on n’a pas toujours l’impression que c’est le cas… Ce qui est flagrant en revanche, c’est la différence de compétences de l’un à l’autre sur un poste qui nécessite pourtant beaucoup de technicité, un geste ferme et solide, sur un animal qui se débat et qu’il faut pouvoir maintenir en place.
Se pose ici la question du box rotatif. L’Angleterre a imposé que l’animal soit tué debout, mais une communauté – je ne la citerai pas pour ne stigmatiser personne – est totalement hostile à tout aménagement. Mary Temple Grandin a pourtant démontré qu’il était préférable qu’un animal ne soit pas tué la tête en bas. Vient ensuite la question de l’étourdissement pré- ou post mortem qui, là encore, rencontre l’opposition de certaines communautés religieuses. Au-delà donc de toutes ces techniques, il importe surtout que religieux et politiques se mettent autour de la table pour s’entendre sur les exigences requises en matière de formation des sacrificateurs. Cela vaut également pour l’abattage casher, même si celui-ci est mieux organisé. La grande différence avec l’abattage halal, c’est que le rabbin opère de manière moins intégrée dans la chaîne : on « loue » en quelque sort l’abattoir pour y pratiquer son rite, et l’abattoir reprend ensuite son activité normale. Par ailleurs, la viande casher est vendue beaucoup plus chère que la viande halal, ce qui permet de financer les coûts supportés par l’abattoir. La viande halal à l’inverse sert de marché de dégagement pour les abattoirs, qui peuvent vendre alternativement du halal et du conventionnel, même si la réglementation interdit désormais de mélanger les chaînes. Reste que l’abattoir qui produit du halal le vend au même prix que la viande conventionnelle alors que c’est un processus de production plus coûteux.
Quant à salarier les sacrificateurs, une mosquée a fait une tentative en ce sens mais ce n’est pas réellement à elles de le faire.
M. le rapporteur. Je parlais de sacrificateurs salariés par les abattoirs.
M. François Hochereau. Beaucoup de sacrificateurs sont salariés par les abattoirs, ce qui peut aboutir à des situations complexes, car, dans le même temps ces sacrificateurs peuvent se voir imposer de pratiquer un étourdissement ante mortem, tout en ayant le pouvoir de décréter que la viande n’est pas halal. Que ce soit un organisme certifié ou l’abattoir qui salarie le sacrificateur, l’un comme l’autre ont donc leur mot à dire : d’où la nécessité que les institutions religieuses veillent, en lien avec les pouvoirs publics, à ce que les sacrificateurs qui ont reçu l’agrément maîtrisent bien les compétences techniques requises. Il existe des sacrificateurs très compétents ; ils devraient pouvoir former les autres.
Quant aux commissions locales, c’est une bonne idée pour les abattoirs de proximité intégrés dans le tissu territorial, car elles ne peuvent que favoriser les échanges. Reste la question des gros abattoirs industriels. C’est autre chose…
M. le rapporteur. Ces commissions existent pour les centrales nucléaires, réputées pour leur esprit d’ouverture…
M. François Hochereau. Les gros abattoirs privilégient le dialogue avec les autres unités du groupe. Par rapport au territoire, ils sont des pourvoyeurs d’emplois, ce qui leur donne évidemment un moyen de pression, à l’inverse de l’abattoir de proximité qui, lui, tire ses financements du territoire dans lequel il s’inscrit.
M. le président Olivier Falorni. Dans ce cas, ces commissions locales doivent être obligatoires.
M. François Hochereau. Certes, mais les uns et les autres doivent retirer un bénéfice de la mise en place de ces commissions, sinon l’obligation restera purement de façade.
M. le rapporteur. Ma référence est les instances de dialogue que la loi oblige à mettre en place auprès des centrales nucléaires et des installations classées, avec cette idée que du dialogue avec l’extérieur peut naître un dialogue interne à l’entreprise.
D’ailleurs, vous a-t-on souvent opposé le secret des affaires ?
M. François Hochereau. Oui, pour ce qui est des coûts et des prix.
M. le président Olivier Falorni. Nous avons remarqué que c’était compliqué !
M. François Hochereau. Les abattoirs publics, qui font de la prestation de service, peuvent afficher leurs prix mais, pour les gros abattoirs privés, ce sont des données beaucoup plus compliquées à obtenir. J’ai d’ailleurs remarqué que vous n’aviez pas auditionné de grosses structures.
M. le président Olivier Falorni. Il est prévu que nous auditionnons M. Bigard.
M. François Hochereau. Le groupe Bigard a fait accréditer son centre de formation interne. Cela peut offrir quelques avantages pour le groupe, mais cela ne favorise pas les échanges avec l’extérieur. Or les formations où ces échanges sont possibles sont les plus enrichissantes, plus que les séquences un peu « Powerpoint » que j’ai vues chez Bigard.
Enfin, pour ce qui concerne le taylorisme et l’organisation du travail, ne perdons pas de vue qu’il n’est pas question ici d’automobiles mais d’animaux. Il se développe des logiciels de reconnaissance des formes, il existe des outils d’évaluation de la qualité des viandes, mais il faut en général une intervention humaine en dernier recours, car leur fonctionnement est loin d’être parfait.
M. le rapporteur. Qu’en est-il en matière de réintégration des tâches ? Je sais que, dans certaines usines automobiles, au lieu de segmenter la chaîne, on confie au même opérateur plusieurs tâches afin de le responsabiliser et de l’impliquer davantage dans le résultat final.
M. François Hochereau. C’est en effet imaginable. Je préconise pour ma part de favoriser au maximum les micro-solidarités le long de la chaîne, ce qui revient à imaginer qu’une petite équipe puisse se voir confier plusieurs tâches sur une portion de la chaîne : les employés peuvent ainsi se remplacer les uns les autres plus facilement. Il s’agit, selon moi, d’une option préférable au développement d’une polyvalence générale, dans lequel l’affectation du salarié est décidée en fonction des situations, et totalement déconnectée de la dimension collective du travail. Il est très important d’essayer de reconstituer des collectifs de travail.
M. le président Olivier Falorni. Messieurs, il me reste à vous remercier.
La séance est levée à onze heures trente.
——fpfp——
25. Table ronde, ouverte à la presse, sur la filière avicole, avec la participation de M. Paul Lopez, 1er vice-président, et Mme Julie Mayot, responsable technique et réglementaire, de la Fédération des industries avicoles (FIA), de M. Roland Tonarelli, représentant des interprofessions dinde, poulet et canard à rôtir, de M. Jean-Michel Schaeffer, président de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI) et de M. Dominique Ramon, administrateur du Comité national des abattoirs et ateliers de découpe de volailles, lapins et chevreaux (CNADEV)
(Séance du mercredi 15 juin 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.
M. le président Olivier Falorni. Notre commission d’enquête s’intéresse aux abattoirs de la filière avicole, ce qui nous a amenés à visiter certains d’entre eux, et à réunir ce matin, dans le cadre d’une table ronde, les représentants de ce secteur.
La France est le deuxième producteur européen de volailles, avec, en 2014, plus de 1,8 million de tonnes équivalent carcasse produites, et un chiffre d’affaires de plus de 6,9 milliards d’euros. Cette production est répartie en 415 abattoirs avicoles – dont 81 % produisent des poulets de chair – et cunicoles, parmi lesquels 76 abattoirs abattent plus de 2,5 millions de têtes par an, soit 1,6 million de tonnes d’animaux. En incluant les salles d’abattage à la ferme, on dénombre 4 000 abattoirs de volailles en France. Sachant que la France est aussi le deuxième consommateur européen de volailles, nous ne pouvons que constater l’enjeu économique que représente cette filière.
L’importance de ce secteur nous amène à nous interroger sur les conditions d’abattage et le bien-être animal. Notre commission d’enquête a été créée après la diffusion par l’association L214 d’images scandaleuses filmées dans des abattoirs français. Les trois vidéos en question ne concernaient pas l’abattage des volailles, mais vous n’êtes pas sans savoir qu’une vidéo relative à l’élevage de volailles diffusée ultérieurement a également provoqué une très vive émotion dans le pays.
Cette table ronde nous permet d’échanger avec plusieurs acteurs de la filière.
La Fédération des industries avicoles (FIA) représente les acteurs du secteur abattage-transformation au sein de la filière avicole, c’est-à-dire les centres d’abattage, de transformation, ateliers de découpe et centres de conditionnement. Monsieur Paul Lopez est le premier vice-président de la FIA, et Madame Julie Mayot en est la responsable technique et réglementaire. Monsieur Lopez a lui-même dirigé plusieurs établissements d’abattage, parmi lesquels l’entreprise d’abattage et de découpe Boscher Volailles, et l’usine d’abattage de volailles de Keranna, en Bretagne.
Les Comités interprofessionnels du poulet de chair (CIPC), de la dinde française (CIDEF), du canard à rôtir (CICAR), représentent les professionnels de la sélection et de l’accouvage, de la fabrication des aliments, des élevages, des abattoirs et des ateliers de découpe dans ces secteurs. Monsieur Roland Tonarelli, président du CICAR, représentant du secteur abattoir, est également directeur général de la société Ernest Soulard, en Vendée, producteur de viande de canard et de foie gras. Il préside l’Association pour la promotion de la volaille française (APVF).
L’Institut technique de l’aviculture (ITAVI), membre du réseau des instituts techniques agricoles (ACTA), est un organisme de recherche appliquée, doté d’un conseil scientifique, qui apporte son expertise aux professionnels des filières avicole, cunicole et piscicole. L’ITAVI fournit également des données de référence sur ces filières. Il est présidé par M. Jean-Michel Schaeffer, ingénieur diplômé de l’Institut des hautes études de droit rural et d’économie agricole. Monsieur Schaeffer est lui-même aviculteur, puisqu’il produit des poulets Label rouge Alsace au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). Il fut également président du syndicat Jeunes agriculteurs, et il est actuellement président de la Confédération française de l’aviculture (CFA).
Le Comité national des abattoirs et ateliers de découpe de volailles, lapins et chevreaux (CNADEV) représente également les professionnels de l’abattage-transformation au sein de ces filières, soit soixante adhérents et 3 000 emplois directs. Monsieur Dominique Ramon est administrateur du CNADEV. Il dirige, avec son frère, deux sociétés familiales de production de viande de volaille : l’entreprise Rémi Ramon, dotée de deux abattoirs, et le site industriel Sofral.
Comme chacune de nos auditions, cette table ronde est publique, ouverte à la presse, et diffusée en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Paul Lopez, Mme Julie Mayot, M. Roland Tonarelli, M. Jean-Michel Schaeffer et M. Dominique Ramon prêtent serment.)
M. Roland Tonarelli, représentant des interprofessions de la dinde, du poulet et du canard à rôtir. Les comités interprofessionnels de la dinde française, du poulet de chair et du canard à rôtir, au nom desquels je m’exprime aujourd’hui, représentent 14 000 éleveurs, réunis au sein de 120 organisations de production, 60 couvoirs, 340 usines d’aliments et 422 établissements d’abattage, de découpe et d’élaboration.
La filière compte près de 60 000 emplois directs et indirects : 33 220 emplois directs et indirects dans la production, 22 400 emplois dans les établissements d’abattage.
Monsieur le président, la France n’est plus aujourd’hui le deuxième producteur européen de volailles : elle passe en troisième position, et se trouve actuellement au coude à coude avec l’Allemagne, derrière la Pologne.
M. le président Olivier Falorni. Je n’avais que les chiffres de 2014 !
M. Roland Tonarelli. La filière est présente sur tout le territoire, avec une prédominance sur la façade du grand Ouest.
Les trois secteurs que je représente ont un poids économique de 10 milliards d’euros, calculé à partir de leur chiffre d’affaires, dont près de 1 milliard à l’export, sous forme de génétique ou de viandes. Quelques établissements qui exportent ont fait parler d’eux dans le passé, comme l’entreprise Doux. Plus de 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires proviennent de la production, et près de 7 milliards d’euros de l’abattage.
Ce secteur est économiquement très sensible en raison de sa grande ouverture à la concurrence et à l’importation européenne et mondiale. Plus de 40 % de notre consommation de poulet provient d’importations, et ce ratio monte à plus de 70 % dans le secteur de la restauration hors domicile. La distorsion de concurrence n’est pas qu’économique et sanitaire ; elle est aussi réglementaire.
M. Jean-Michel Schaeffer, président de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI). En tant qu’expert, j’espère pouvoir éclairer sous un angle technique les différents sujets que vous aborderez avec les professionnels de l’abattage.
M. Dominique Ramon, administrateur du Comité national des abattoirs et ateliers de découpe de volailles, lapins et chevreaux (CNADEV). Nous sommes la troisième génération de la famille dans le secteur. Je représente le CNADEV, qui compte soixante entreprises d’abattage et de transformation. Il s’agit essentiellement d’entreprises familiales ou de taille moyenne qui peuvent abattre de 500 à 20 000 tonnes par an. Nos adhérents abattent 15 % du volume national, avec un effectif de 3 000 salariés. Seul un tiers d’entre eux emploie plus de vingt salariés.
Nous sommes sensibilisés à la question du respect du bien-être animal. Nous avons mis en place depuis longtemps des outils en la matière, et, bien évidemment, nous appliquons la loi.
M. Paul Lopez, premier vice-président de la Fédération des industries avicoles (FIA). Pour ma part, j’ai également l’honneur de présider le secteur d’activité au niveau européen, ce qui me permet d’avoir une vision internationale et européenne des différents sujets que nous aborderons.
M. le président Olivier Falorni. Quelles ont été vos réactions à la diffusion des vidéos tournées par l’association L214, notamment celle filmée au sein du GAEC Perrat ? Comment pouvez-vous expliquer une telle situation ?
Quelles sont les diverses méthodes utilisées pour l’étourdissement des volailles dans notre pays ? Dans quelles proportions chaque méthode est-elle utilisée ?
Êtes-vous favorables à la mise en place obligatoire d’un système de vidéosurveillance au sein des établissements d’abattage ? Sous quelle forme la vidéosurveillance pourrait-elle éventuellement être acceptée ?
Vous militez pour un étiquetage indiquant l’origine géographique de la volaille ; êtes-vous favorable à un étiquetage indiquant le mode d’abattage des animaux et précisant s’ils ont été abattus avec ou sans étourdissement ?
M. Paul Lopez. Il n’entre pas dans mes attributions de répondre à une question relative à l’élevage de la poule pondeuse, qui ne relève pas de notre secteur d’activité. Le GAEC Perrat n’est pas un abattoir. Par correction à l’égard de mes confrères, je n’ai pas de jugement à porter.
En France, la méthode d’étourdissement la plus répandue, l’électronarcose, s’applique à plus de 85 % du tonnage. L’anesthésie au gaz est utilisée sur environ 15 % de la production, et moins de 1 % de la volaille doit être abattue sans anesthésie – nous ne disposons pas vraiment de chiffres en la matière.
M. le président Olivier Falorni. Ces proportions vous paraissent-elles satisfaisantes, ou vous paraîtrait-il plus judicieux de pratiquer plus d’étourdissements au gaz ?
M. Paul Lopez. Le passage à l’étourdissement au gaz pose d’abord une question économique, car, pour utiliser cette méthode, il faudrait s’équiper et, dans la plupart des cas, il serait nécessaire de changer tout le parc de transport et de containers. L’investissement minimal pour un abattoir français qui voudrait utiliser cette technologie s’élèverait à 1 million d’euros. De façon générale, il faudrait au moins dépenser 1,5 million d’euros par outil. L’usage de cette technologie ne peut donc pas être généralisé à l’échelle de l’Europe ni même du pays, car les investissements nécessaires entraîneraient un mouvement de concentration qui n’est pas souhaitable.
L’étourdissement exclusivement au gaz est ensuite exclu, parce que la France produit des espèces pour lesquelles la méthode n’est pas applicable. Je rappelle que les canards peuvent se mettre en apnée. Il est vrai que certains pays européens ont choisi de ne plus utiliser que le gaz, ce que nous ne pourrions de toute façon pas faire.
Nous ne sommes pas favorables à la vidéosurveillance. Nous avons déjà été sollicités sur le sujet par des clients, étrangers pour la plupart. Cela pose en particulier un problème à l’égard du personnel qu’il faudrait filmer en permanence durant toute leur journée de travail, tout au long de l’année.
Enfin, vous m’avez interrogé sur l’étiquetage. Il y a quelques années, la Commission européenne a lancé une enquête qui l’a convaincue de ne pas retenir l’information relative à l’abattage et à l’étourdissement pour l’étiquetage des produits. De plus, je rappelle que la taille des barquettes diminue avec celle des foyers, et que l’on demande qu’y soient inscrites de plus en plus d’informations. À partir d’un certain nombre de données, ces dernières deviennent peu exploitables.
M. Roland Tonarelli. Ce que nous avons vu sur les vidéos est inacceptable. Nous avons la même réaction sur ce sujet que tous les citoyens. Comme l’indiquait Monsieur Paul Lopez, les lieux qui ont été filmés ne relèvent pas de notre activité professionnelle. Le ministre de l’agriculture a indiqué que ces images mettaient en cause un éleveur qui faisait mal son travail, mais qu’elles ne devaient pas jeter le discrédit sur l’ensemble d’une profession. À l’issue d’une enquête contradictoire, la justice fera son travail.
L’électronarcose est aujourd’hui la meilleure technique disponible pour un étourdissement conforme aux règlements en vigueur et efficace pour des espèces comme le canard. Il faut préciser que les paramètres recommandés doivent souvent être adaptés à l’espèce que l’on souhaite étourdir, et même à la morphologie d’un lot d’animaux. Il est donc essentiel que les opérateurs soient bien formés et règlent correctement le matériel. Les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) sont très rigoureux sur ces sujets.
Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit Monsieur Paul Lopez sur la vidéosurveillance ou sur l’étiquetage relatif à l’étourdissement, même si je suis un grand militant de l’étiquetage relatif à l’origine des produits.
Mme Julie Mayot, responsable technique et réglementaire de la Fédération des industries avicoles (FIA). J’ai interrogé les responsables protection animale (RPA) et les responsables qualité, qui sont souvent les mêmes personnes dans les abattoirs de volailles de nos adhérents, au sujet de la vidéosurveillance. Ils ont surtout insisté sur l’importance de la formation du personnel, et sur le rôle du management qui relève de la responsabilité du chef d’équipe. La vidéosurveillance leur paraît constituer un outil additionnel qui peut être utilisé si l’abattoir le souhaite. Il nous semble que l’exploitation des images risque d’être compliquée. C’est la responsabilité de l’exploitant d’installer une caméra s’il pense qu’elle peut être un outil pédagogique additionnel, mais il ne s’agit en aucun cas d’un outil à mettre en place de façon systématique.
Selon nous, il n’y a pas de différence sur le plan du bien-être animal entre l’électronarcose et l’étourdissement au gaz. Si les deux méthodes sont bien appliquées, et que les paramètres sont maîtrisés par l’exploitant, les résultats sont les mêmes. En laboratoire, nous insistons d’ailleurs sur le résultat puisque nous contrôlons des indicateurs d’inconscience définis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Ils sont vérifiés sur le terrain où ils nous indiquent, quelle que soit la méthode employée, si l’anesthésie est correctement pratiquée.
M. Jean-Michel Schaeffer. En tant qu’éleveur, je peux répondre à la question relative au GAEC Perrat. Sur ce sujet, nous devons avancer avec discernement et éviter de prononcer des jugements dans l’émotion. Nous sommes réunis pour parler des abattoirs ; est-ce pour parler d’une association qui joue le rôle de lanceur d’alerte ?
M. le président Olivier Falorni. Ce n’est pas le sujet du jour, mais les lanceurs d’alerte ont précisément joué leur rôle. Il nous appartient ensuite de nous prononcer.
M. Jean-Michel Schaeffer. Évidemment, ce que nous avons vu est totalement inacceptable. Nous avons dénoncé cela dans un communiqué de presse. Évitons tout de même de généraliser et de jeter le discrédit sur tous les éleveurs français. Dans leur immense majorité, ils font très bien leur travail. De plus, des chartes sanitaires encadrent la production d’œufs, pour laquelle diverses démarches et procédures apportent des garanties.
D’après les quelques éléments d’information qui nous sont parvenus, l’affaire concernait un éleveur qui se trouvait dans une situation familiale et financière très compliquée. Il élevait aussi du porc dans le contexte de crise que le secteur a connu l’année dernière. Peut-être faudrait-il se demander comment accompagner les agriculteurs confrontés à des difficultés avant que les choses ne dérapent dans les élevages ?
Monsieur Dominique Ramon. Je n’ai pas grand-chose moi non plus à ajouter aux propos de Paul Lopez. Je crains cependant que son estimation s’agissant du coût de l’équipement pour l’anesthésie gazeuse ne soit trop juste. J’étudie le dossier actuellement pour notre entreprise : il nous en coûtera plus de 1,5 million d’euros. Le procédé ne sera par ailleurs applicable que pour le poulet et la dinde standards. Nous avons évoqué le problème posé par les canards, mais ces équipements européens et mondiaux ne sont pas davantage adaptés à la spécificité de la production française, notamment à celle des adhérents du CNADEV, avec des volailles fermières, les poules ou la pintade. Cette méthode ne constitue pas une solution pour cinquante-huit des soixante adhérents !
M. le président Olivier Falorni. La différence entre l’électronarcose et l’anesthésie gazeuse, c’est que cette dernière est préalable à l’accrochage des volailles – c’est lors de l’accrochage que certains problèmes se posent. En termes de bien-être animal, nous avons pu constater que l’on ne pouvait pas placer les deux méthodes sur le même plan. Un certain nombre de professionnels présentent d’ailleurs le passage futur de l’électronarcose à l’anesthésie gazeuse comme un progrès pour le bien-être animal. L’électronarcose a ses limites, tant pour les animaux que pour le personnel. L’accrochage de volailles vivantes à longueur de journée, ce n’est pas un poste facile à occuper !
M. Dominique Ramon. Ça fait soixante ans que c’est comme ça, monsieur !
M. le président Olivier Falorni. Sans doute, mais nous sommes tout de même au XXIe siècle !
M. Dominique Ramon. On doit avancer, certes, mais il faudra faire des études pour adapter éventuellement l’anesthésie gazeuse à des productions auxquelles elle n’est aujourd’hui pas adaptable – et je ne parle même pas des questions de coût. En la matière, l’estimation qui nous est donnée est sous-évaluée, et je ne vois pas comment les structures que je représente, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au million d’euros, pourraient investir les sommes nécessaires.
Mme Julie Mayot. Après électronarcose, le temps d’accrochage des volailles vivantes est réglementé : il doit être inférieur à une minute pour le poulet, et à deux minutes pour le canard et la dinde. Dans nos guides des bonnes pratiques, en cours de développement, nous préconisons de trier les animaux à leur arrivée à l’abattoir. Ceux qui présentent une faiblesse, une patte cassée par exemple, doivent être mis de côté et anesthésiés séparément avec des techniques approuvées.
Quelle que soit la méthode utilisée, électronarcose ou gaz, nous avons affaire à des systèmes agréés au niveau européen qui respectent le bien-être animal – c’est l’objet même du règlement européen 1099/2009.
S’agissant de la manipulation de la volaille vivante par les salariés, un travail est en cours avec des instituts techniques sur l’empoussièrement et l’ambiance de travail. Le fait qu’elles soient vivantes et qu’elles battent des ailes demande de faire évoluer les systèmes de ventilation afin d’améliorer la qualité de l’air. Les gestes de l’accrochage restent les mêmes, que la volaille ait été anesthésiée au gaz ou non. Nous disposons également d’études sur le bien-être du salarié.
M. Jacques Lamblin. Monsieur Lopez, nous vous avons entendu parler de pays européens qui passeraient à l’anesthésie gazeuse comme méthode unique d’étourdissement. Pourquoi ce qui est possible ailleurs ne le serait pas en France ? Je ne parle évidemment pas du problème des espèces auxquelles cette méthode n’est pas adaptée.
J’ai entendu dire qu’il était arrivé que l’électronarcose ne fonctionne pas bien – on m’a parlé de bains souillés. Qu’en est-il de la fréquence du changement de l’eau du bain, si j’ose dire ? L’anesthésie ne constitue-t-elle pas parfois une variable d’ajustement dans le fonctionnement de la chaîne ?
Le nom de « vidéosurveillance » me paraît impropre. Nous pourrions parler de « vidéo-enregistrement » s’agissant d’un outil qui permettrait d’évaluer la difficulté du travail du personnel et de repérer les mauvais gestes en vue de prévenir les troubles musculo-squelettiques. Ces images pourraient aussi constituer des témoignages à décharge si des accusations étaient portées contre l’abattoir.
M. Yves Daniel. Nous parlons de la lutte contre la maltraitance et de la souffrance des animaux au moment de leur mise à mort. Au regard de la loi, les animaux sont des êtres sensibles. C’est également le cas des humains, mais nous sommes aussi dotés de sentiments, ce qui nous amène à réagir sur le sujet en fonction de notre propre ressenti d’êtres sensibles et sentimentaux. Notre rapport à la notion de mise à mort est celui des humains : aucun animal ne nous livrera jamais l’analyse de sa relation à la mise à mort ni son ressenti. C’est à nous que revient la responsabilité d’assurer le bien-être animal et de lutter contre la maltraitance et la souffrance animale.
Les abattoirs sont, malgré tout, des lieux de mise à mort. On ressent en y pénétrant un choc inversement proportionnel à l’habitude que l’on peut avoir de ce type d’endroit. Le visiteur novice, l’éleveur et le salarié de l’abattoir ne vivent pas les choses de la même façon. Tout en assurant le bien-être animal, en luttant contre la souffrance et la maltraitance, comment faire admettre culturellement que l’alimentation carnée ne peut exister que s’il existe ces lieux si particuliers ? Un travail ne doit-il pas être entrepris pour faciliter la compréhension de tous et l’évolution de nos cultures ? Cela concerne bien sûr les animaux, qui ne se protégeront pas eux-mêmes – il faut adapter la loi et les pratiques –, mais aussi notre responsabilité en tant qu’acteurs de la chaîne de la vie des animaux, notamment au moment de la mise à mort.
M. Arnaud Viala. La filière avicole est celle pour laquelle il existe la plus grande perméabilité entre les questions relatives à l’abattage et à l’élevage des animaux. L’alerte lancée avec la diffusion d’images filmées dans les abattoirs n’a pas manqué de susciter un débat et des réflexions sur les conditions d’élevage des volailles. Comment comptez-vous transformer l’imaginaire collectif et donner une meilleure image à la production de volailles ? Croyez bien qu’en tant qu’élu de l’Aveyron, département où l’on élève de la volaille, je mesure l’importance de cette production, et que je me pose cette question à vos côtés !
M. Guillaume Chevrollier. J’ai visité des abattoirs de volailles de mon département, où l’on utilise l’électronarcose, et je peux dire que cela se passe bien.
Afin de mieux veiller au bien-être animal, estimez-vous qu’il faudrait conférer un statut juridique particulier au responsable protection animale ? Pouvez-vous nous en dire plus sur la formation de l’ensemble de vos collaborateurs sur ce sujet ?
Quelles relations entretenez-vous avec les services de l’État ? Sont-ils bien présents dans vos établissements pour contrôler l’abattage ?
M. Paul Lopez. Pourquoi ne passons-nous pas à l’anesthésie gazeuse alors que d’autres pays européens le font ? Cette solution est envisagée par un pays du nord de l’Europe plus petit que le nôtre, même si sa production de volailles est significative. La filière y est caractérisée par une ultra-concentration des outils industriels. Elle est telle que, pour parvenir à un niveau équivalent en France, il nous faudrait diviser pas cent le nombre de nos structures. Voulons-nous d’une telle évolution ? La réponse collective de nos fédérations professionnelles est très clairement négative.
M. Jacques Lamblin. À juste titre !
M. Paul Lopez. J’ajoute que le pays en question ne produit quasiment pas de canard – il compte un seul abattoir pour cette espèce, qui ne pratique évidemment pas l’anesthésie au gaz.
Quel que soit le mode d’anesthésie utilisé aujourd’hui, il répond aux normes européennes du règlement européen 1099/2009, en application depuis 2013. En tant que fédération européenne et nationale, nous avons demandé une évaluation de ces normes établies en laboratoire afin que nous puissions faire évoluer le système. Aujourd’hui, il ne nous semble pas satisfaisant, car il est difficile à appliquer. Il faut surtout avoir conscience que chaque lot est différent : deux lots ne se comportent jamais de la même manière. Dans un cadre réglementaire, les professionnels doivent être davantage soumis à une obligation de résultat qu’à une obligation de moyens pour pouvoir moduler les paramètres sur la base de critères établis.
Monsieur Lambin, vous parlez de « changer l’eau du bain ». Les volailles ne sont pas « baignées » durant l’anesthésie. Leurs têtes trempent dans l’eau afin que le courant passe dans l’ensemble de la carcasse. Un arrosage permanent permet à l’eau de se renouveler.
M. Jacques Lamblin. J’employais volontairement une formule qui ne décrit pas une réalité que je connais. Il reste que j’ai entendu des personnes autorisées m’expliquer que l’on rencontrait parfois des dysfonctionnements dus à la mauvaise transmission du courant électrique.
Je souhaitais surtout, en vous interrogeant sur la généralisation de l’anesthésie au gaz, que votre réponse permette de préciser les choses : il est maintenant clair que le montant des investissements demandés provoquerait une concentration de la production qui n’est pas nécessairement ce qu’attend le consommateur en France.
M. Paul Lopez. Je maintiens mes propos s’agissant de l’idée de filmer le personnel des abattoirs à longueur d’année et de journée. Je ne suis pas certain que ce serait prendre la question sous le bon angle.
À ce jour, les vidéos diffusées ne concernent pas nos productions, mais je pense qu’il faut aussi les relativiser. Il s’agit sans aucun doute de cas très particuliers et marginaux par rapport à l’immense majorité des situations. Je ne nie pas qu’un problème se pose, mais s’il survient dans un cas sur mille, dix mille ou cent mille, ce n’est peut-être pas vraiment comme si 10 % des abattoirs étaient concernés.
Monsieur Daniel, nous sommes conscients que les animaux sont des êtres sensibles. Avec les règles européennes, il existe un cadre d’évaluation de la qualité de l’anesthésie et du respect du bien-être animal au moment de l’abattage. Nous devons continuer à travailler dans ce cadre, même s’il doit, à notre sens, faire l’objet d’un certain nombre d’aménagements, notamment en termes technologiques s’agissant de l’électronarcose.
Nous sommes évidemment en relation avec les services de l’État. Le ministre a déjà annoncé l’augmentation des effectifs de contrôle et de surveillance dans les outils d’abattage, en particulier dans les structures qui traitent les plus gros volumes. Les relations en question sont quotidiennes dans les structures de grande taille, et un peu moins fréquentes dans les outils moins importants.
Mme Julie Mayot. Les fédérations professionnelles préconisent dans leurs recommandations de bonnes pratiques d’utiliser pour l’électronarcose une eau qui soit la plus propre possible – il y a en la matière une obligation de résultat – afin d’assurer une meilleure conductivité. Cela se fait par changement complet de l’eau, mais je ne crois pas que cela se fasse pour chaque lot, ou par aspersion continue, ce qui assure un renouvellement permanent.
Il existe un RPA dans tous les outils qui abattent plus de 150 000 volailles par an, soit quasiment toutes les structures françaises. Une formation « opérateur protection animal » est assurée pour tous les opérateurs qui manipulent des volailles vivantes, quelles que soient les structures dans lesquelles ils travaillent.
Lors d’une commission technique, la semaine dernière, des responsables protection animale ont éclaté de rire lorsque je leur ai demandé s’ils risquaient une sanction dans leur entreprise au cas où ils dénonceraient de mauvaises pratiques. Tous ont répondu qu’ils seraient sanctionnés s’ils ne faisaient pas le signalement, qu’ils sont obligés de le faire, que c’est leur travail : leur fiche de poste leur impose de former les salariés, de surveiller, de dénoncer et d’apporter les actions correctives lorsqu’elles sont nécessaires.
M. Roland Tonarelli. Monsieur Lamblin, vous évoquiez la possibilité que la vidéo puisse servir de preuve à décharge. Mais, lorsqu’on est au cœur du cyclone médiatique, on a du mal à se servir d’une vidéo ! On ne peut pas diffuser quarante-huit heures d’images où tout se passe bien au journal de vingt heures ! Pour se défendre et prouver que l’entreprise est vertueuse, il faut compter sur des tiers. Je pense évidemment aux DDPP qui sont les gendarmes de nos métiers. Il faut s’assurer qu’ils ont les moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions.
Le RPA assume une fonction transversale qui s’apparente à celle du responsable sécurité qui a été créée ces quinze dernières années. Ce dernier est également un lanceur d’alerte s’agissant d’éventuelles procédures inadaptées qui risqueraient de provoquer des accidents ou de dégrader l’état de santé des personnels. Il veille notamment aux gestes des salariés pouvant favoriser l’apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS), par exemple lors de l’accrochage à l’abattoir. Cela intéresse l’entreprise qui peut être sanctionnée financièrement si son taux de TMS est trop élevé. Les chefs d’entreprise écoutent les responsables sécurité, car ils font progresser l’entreprise et la préservent d’un risque qui pèse aussi sur ses finances.
On peut faire un parallèle avec les RPA, car un risque réel existe pour l’image de plusieurs marques à forte valeur économique qui défendent publiquement une certaine éthique. Les marques commerciales communiquent en effet en présentant un peu « Martine à la ferme » : elles vendent du rêve. Mais, comme le disait M. Daniel, la première fois que vous entrez dans un abattoir de volaille, vous pénétrez dans une salle sombre avec une lumière bleue pour éviter d’effrayer les animaux, conformément à la réglementation. Vous subissez un choc.
L’acceptabilité de nos métiers par la société est un vrai sujet de débat sur lequel nous réfléchissons depuis des années. Nous avançons, mais on ne peut pas systématiquement s’appuyer sur les labels et sur les volailles fermières, car ce segment ne représente que 20 % de la production française. Nous sommes face à un véritable enjeu de société. Nous en sommes parfaitement conscients.
Il est sans aucun doute surprenant de pénétrer pour la première fois dans une salle d’accrochage. On ne peut pas nier que l’ambiance soit glauque. Cela dit, dans mon entreprise, j’ai encore remis récemment la médaille du travail à des « accrocheurs » qui avaient occupé leur poste pendant trente-cinq ans. Lorsque je leur propose des postes moins exigeants physiquement, la réponse est toujours négative. Ces hommes sont habitués à faire ce travail ; ils s’y plaisent. Nous sommes très attentifs aux questions de TMS parce que l’entreprise risque d’être sanctionnée.
M. Jean-Michel Schaeffer. Si nous nous comparons à l’Europe, et sans doute au monde, la France est probablement le pays qui accueille la plus grande diversité d’espèces de volailles, mais aussi de modèles d’élevage. L’Europe du Nord, par exemple, avec son industrie très concentrée, fait principalement du poulet standard premier prix. Il suffit de se rendre dans le rayon volailles des commerces en France et dans les autres pays européens : chez nous, la diversité et la richesse de l’offre sont impressionnantes.
Tous les types d’élevage respectent les normes relatives au nombre d’animaux au mètre carré inscrites dans la directive européenne. Nous sommes sans doute le pays précurseur en matière de production sous signe de qualité. Nous nous sommes engagés dans cette voie, que les Pays-Bas commencent à découvrir, il y a plus de cinquante ans. Aujourd’hui, en France, 20 % de la viande de volaille est issue de cette production. Nous cherchons toujours des améliorations. L’ITAVI développe notamment un projet EBENE visant à objectiver des indicateurs de bien-être animal. Nous devons aussi mieux valoriser ce que nous faisons bien, et accompagner les démarches de progrès, avec les associations et les consommateurs.
M. Dominique Ramon. On m’a suggéré, lors une conférence, de changer le nom des « abattoirs de volailles » pour les appeler « centres de transformation des animaux ». Beaucoup de citadins semblaient plus à l’aise avec cette appellation.
Les services de l’État sont continuellement présents dans tous nos outils. Nous sommes destinataires de rapports qu’ils soumettent à leur hiérarchie de façon trimestrielle ou semestrielle, mais les points avec les responsables des services qualité sont aussi mensuels. Ces rapports ne sont pas sans suite. En tant que chef d’entreprise, je suis obligé d’y répondre tous les mois, comme je suis obligé de me conformer à la législation, qu’elle soit relative au bien-être animal ou aux impératifs sanitaires.
Croyez bien que les agents de l’État sont présents dans nos entreprises et qu’ils travaillent d’arrache-pied pour faire appliquer les textes que le législateur national a adoptés, ainsi que les règlements nationaux et européens !
Nous collaborons, en Pays-de-Loire et en Bretagne, avec la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), qui nous a demandé d’être une filière pilote s’agissant des TMS. La semaine dernière, à Angers, huit cents entreprises ligériennes et bretonnes du secteur de l’agroalimentaire étaient présentes sur les mille invitées pour discuter de ce sujet. Les abattoirs de volailles sont très impliqués en la matière afin de faire progresser leurs méthodes de travail au bénéfice de leurs salariés – notamment grâce à des formations complémentaires.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Quel est l’ordre de grandeur du coût de l’abattage dans la chaîne de valeur de la volaille ? Je souhaiterais évaluer ce que pourraient représenter des prescriptions supplémentaires en matière d’abattage.
Vous avez indiqué, Monsieur Lopez, que la proportion d’abattage sans étourdissement préalable était de moins de 1 %. Cela m’a étonné dans la mesure où le débouché de viande de volaille à destination de pays de confession musulmane est important. Comment les volailles que vous vendez à l’export sont-elles certifiées de ce point de vue ? Quelle est la situation des autres pays producteurs ayant des marchés de même destination ?
Ce qui frappe, dans les abattoirs de volailles, c’est que la distance à l’animal n’est pas du tout la même que dans les abattoirs de porcs ou de ruminants. La forme de l’animal, sa taille, le nombre et la cadence créent une distance plus grande, qui n’est pas anthropique. Le fait que le public ne sache pas trop ce qui se passe dans les abattoirs de volailles et n’ait guère envie de le savoir est aussi un point faible de la filière, surtout lorsque ce public vient à découvrir, de manière parfois spectaculaire, des choses qu’il ignorait. Ne pourriez-vous partager l’information dans des structures telles que les commissions locales d’information et de surveillance (CLIS) qui existent auprès d’autres installations classées ? Ces CLIS, qui réunissent des gens connus et reconnus – consommateurs, éleveurs, services vétérinaires de l’État, producteurs et responsables de l’outil – ne permettraient-elles pas un échange et un suivi autres que de crise en crise ?
Le contrôle vétérinaire est permanent et extrêmement orienté vers la santé des animaux. Est-il, selon vous, également réparti et suffisant en matière de bien-être animal, notamment avant l’étourdissement, c’est-à-dire à l’arrivée à l’abattoir et lors du stockage intermédiaire ? Ce sont des caisses qui sont déchargées des camions et l’on a l’impression que leur stockage est presque inerte : le traitement et l’entrepôt des animaux avant leur entrée dans la chaîne ont quelque chose de non-animal. Pourrait-on concevoir, à cet endroit, une surveillance de l’État ? Il ne s’agirait pas d’un contrôle permanent, mais de permettre, une fois de temps en temps, aux personnes que l’on envoie surveiller un abattoir de filmer le déchargement d’un camion. A priori, on se dit, comme vous, qu’on ne peut pas surveiller quelqu’un à son poste toute la journée. Puis, lorsqu’on approfondit la question, on s’aperçoit que vous ne voyez aucun inconvénient à ce qu’un inspecteur vétérinaire observe une chaîne du matin au soir. Le problème n’est donc pas d’être surveillé, mais de l’être sans le savoir, en permanence et de manière impersonnelle. Seriez-vous moins opposé à ce que l’on accorde la possibilité à l’État d’assurer une surveillance ponctuelle en de multiples points de la chaîne, si l’on détermine les modalités de traitement des images et les personnes ayant le droit de les voir ? Certaines des personnes que nous avons auditionnées étaient même favorables à ce que l’outil soit à disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui, en cas de problème à un poste de la chaîne, pourrait ainsi fournir une vidéo.
M. Arnaud Viala. J’ai oublié de vous interroger tout à l’heure quant aux étapes préalables à l’arrivée à l’abattoir et notamment quant au transport. Cette question fait toujours débat s’agissant des volailles, compte tenu du pourcentage d’animaux qui meurent pendant leur trajet du fait de conditions de transport difficiles. Pourriez-vous nous fournir des chiffres à ce sujet ?
M. William Dumas. Ne sont-ce pas les accrocheurs qui règlent la cadence des chaînes ?
M. Paul Lopez. Non.
M. William Dumas. Ayant visité un abattoir, je croyais que si. Il me semble en tout cas bénéfique d’avoir installé des systèmes de ventilation dans ce type de lieux qui sont envahis de poussière et de plumes.
Dans de nombreux élevages, les poulets sont attrapés, puis transportés de nuit. Ils arrivent à l’abattoir le matin et certains d’entre eux s’affolent ou s’étouffent, surtout l’été. J’ai connu beaucoup de poulaillers dans le département du Gard et j’ai travaillé dans une banque qui était proche des éleveurs. Pour avoir parfois aidé un collègue éleveur à mettre les poulets en cage, je sais que l’acte n’est pas anodin. Mais il est vrai que le transport s’est amélioré depuis quelques années et que les moyens se sont accrus.
S’agissant du poste d’accrocheur, je suis d’accord avec vous, car j’ai moi-même, en tant que conseiller général, remis des médailles de travail à des gens ayant exercé ce métier pendant trente-cinq ans et qui ne voulaient pas en partir. Il n’empêche que j’ai trouvé ce métier très pénible, comparé aux autres postes de l’abattoir.
M. Paul Lopez. Selon une étude comparative européenne, le coût de l’abattage représente quelque 20 % du prix du produit sorti de l’abattoir. Ce chiffre est à relativiser, compte tenu du fait que nous importons 40 % de notre consommation de poulet. Nos coûts d’abattage sont supérieurs de 33 % à ceux de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne, et de 81 % à ceux de la Pologne. Ces chiffres sont issus d’études que nous pourrons vous transmettre, car elles ont été publiées.
M. Jacques Lamblin. Cela est-il lié à la masse salariale ?
M. Paul Lopez. Cela est lié à des éléments tels que la taille des outils, celle des élevages et l’écart des coûts de main-d’œuvre. Sur ce dernier point, des progrès ont certes été accomplis outre-Rhin, mais le problème n’est pas résolu pour autant, puisque la prestation de services peut être assurée dans le cadre de la réglementation de pays situés plus à l’Est.
La France, on l’a dit, se distingue par une très forte diversité des productions. C’est un atout en termes d’offre pour le consommateur, mais un handicap en termes de coûts d’abattage, puisque nous avons beaucoup plus d’outils polyvalents que nos voisins.
Concernant les 1 % d’animaux abattus sans étourdissement préalable, je pense que le chiffre est bien inférieur, mais je l’ai cité pour montrer que la proportion de volailles non étourdies était relativement faible. Cette proportion marginale est plutôt destinée au marché intérieur qu’à l’exportation.
Vous avez ensuite évoqué la distance par rapport aux animaux, due à leur taille, et leur contention pendant le transport. Ces aspects sont réglementés par des normes de densité et de hauteur dont l’application est contrôlée par les services de l’État. Il est vrai que nous approchons différemment un animal de 500 kilogrammes et un autre qui n’en pèse que deux.
Notre profession est réticente au partage d’informations que vous avez évoqué. J’ai observé que l’ouverture à notre environnement immédiat, c’est-à-dire à nos voisins, aux habitants de la commune, dans le cadre d’opérations portes ouvertes, était toujours extrêmement positive. Bien que les abattoirs aient une image très négative, ces visiteurs nous disent toujours, lorsqu’ils en ressortent, que l’abattoir est beaucoup plus propre qu’ils ne le pensaient. Sans doute ne communiquons-nous pas assez. La société nous amène à combler ce déficit. Ce partage d’informations se pratique de plus en plus, mais est lié à une question d’intégration des abattoirs sur leur territoire plutôt qu’à une évolution réglementaire à proprement parler.
Vous avez indiqué que les contrôles vétérinaires étaient essentiellement sanitaires. Je ne partage pas cet avis. La première étape du contrôle – avant le contrôle sanitaire de la qualité des viandes – s’effectue ante mortem, au déchargement des animaux ou lors de leur stockage. C’est ce premier contrôle qui détermine si un lot passera sur la chaîne d’abattage.
M. le rapporteur. J’ai pu constater qu’une charmante dame d’un mètre soixante contrôlait des piles de douze caisses empilées les unes sur les autres. Elle a avoué qu’elle ne voyait pas celles du haut.
M. Paul Lopez. Elle a accès à ces animaux lorsque la pile est défaite. Je ne pense pas qu’il y ait de différence dans la circulation des flux d’air entre la partie haute et la partie basse du bâtiment.
Vous nous avez demandé quel était le taux de mortalité des animaux pendant le transport. En vertu de la réglementation, un taux supérieur à 2 % de mortalité pour les poulets, et à 0,7 % pour les dindes, est un critère d’alerte nous obligeant à entamer une procédure particulière. Le taux de mortalité observé varie suivant la saison et d’autres paramètres, mais est d’environ 0,3 % – loin du plafond fixé par la réglementation.
M. Jacques Lamblin. Quelles sont les causes de cette mortalité ?
Mme Julie Mayot. Ce peuvent être les conditions climatiques défavorables ou des accidents imprévus. Je précise que le transport commence par le travail de l’éleveur. Je pense que toutes les entreprises imposent aux éleveurs d’effectuer un repérage des animaux qui ne seraient pas aptes au transport – pendant toute la durée d’élevage, mais surtout juste avant l’enlèvement des volailles – et de les euthanasier à l’aide de méthodes éprouvées scientifiquement. Ensuite, la deuxième personne à manipuler les animaux est celle qui les charge dans les caisses. Si elle repère un animal souffrant, elle doit également l’euthanasier avant le transport. Enfin, à l’arrivée à l’abattoir a lieu l’inspection ante mortem, et je reviendrai sur la notion d’échantillonnage qui distingue les volailles des animaux de boucherie : en volaille, les lots étant très importants, on ne peut contrôler chaque animal individuellement, que ce soit ante mortem ou sur la chaîne d’abattage. On réalise un échantillonnage en fonction de la taille du lot.
M. le rapporteur. J’ai cru comprendre que la densité des animaux dans les caisses de transport était un facteur de confort évitant les chahuts. Cela étant, moins longtemps les animaux restent stockés dans un hangar, mieux c’est. Comment, en tant qu’abatteurs, gérez-vous le flux par rapport à vos fournisseurs d’animaux vivants pour limiter le temps pendant lequel les animaux sont dans ces caisses – plus adaptées au transport qu’à l’attente ?
M. Paul Lopez. Le temps de transport et le temps de stockage doivent être les plus courts possible. Le stockage n’atteint jamais quarante-huit ni même vingt-quatre heures. Il dure généralement deux à trois heures, parfois même une heure, voire trente minutes. Il est au grand maximum de quatre heures. Du fait de la diversité des outils et de leur présence sur l’ensemble du territoire, la distance de transport est, elle aussi, souvent relativement limitée
– de l’ordre d’une à deux heures. On est plutôt dans ces ordres de grandeur que dans les huit à dix heures.
M. Dominique Ramon. En principe, les volailles sont enlevées la nuit, mais beaucoup le sont désormais le jour, pour diminuer leur temps d’attente. Si l’on attendait vingt-quatre heures, ce qui est interdit, les animaux perdraient du poids et certains mourraient. Les temps réglementaires d’attente sont de six heures au maximum pour les volailles label, mais nous nous inspirons forcément de ces cahiers des charges pour les volailles standard.
Quant à la densité, elle est laissée à l’appréciation du chef d’entreprise et du RPA. Les animaux étant plus épais en hiver, la densité des caisses est légèrement plus importante à cette saison. Elle est réglementée. Monsieur Paul Lopez vous disait qu’un contrôle était effectué à l’arrivée à l’abattoir, mais un autre contrôle est aussi effectué sur la route par les services de l’État. Je reçois, en tant que chef d’entreprise, des rapports de conformité à la réglementation : mon entreprise est toujours considérée comme conforme à ces règles. Mes chauffeurs reçoivent une formation au captage : cette dernière, de deux jours, vise à leur apprendre à respecter le bien-être animal entre l’élevage et l’abattage. Le RPA, lors de son inspection sur site, effectue un contrôle de température dans la pièce en amont. Les contrôles des services de l’État s’effectuent non pas de huit à dix-sept heures, mais à des horaires et des dates qu’eux seuls connaissent. Enfin, des fiches d’identification de la chaîne alimentaire (ICA) sont préalablement signées par nos RPA, puis transmises aux services vétérinaires, quarante-huit heures avant l’abattage. Si un lot avait un jour un problème, les éleveurs le communiqueraient aux services de notre entreprise, qui en informeraient les services de l’État.
M. le rapporteur. Les chauffeurs des camions sont-ils toujours des salariés de votre entreprise, ce qui permettrait un meilleur contrôle de leur formation et de leurs compétences ?
M. Dominique Ramon. Dans les petits abattoirs de volailles, les chauffeurs sont majoritairement des employés. Les grands outils font, quant à eux, appel à des sociétés spécialisées, dont les chauffeurs sont formés – condition sine qua non pour entrer dans un camion. Nous appliquons la réglementation qui nous est imposée.
Mme Annick Le Loch. Mes questions ayant déjà été posées, vous y avez largement répondu. La première concernait la présence des services de l’État – vétérinaires et techniciens. Comment comprendre qu’il y ait des manquements alors que, dès qu’un abattoir est ouvert, ces services effectuent des contrôles en permanence d’un bout à l’autre de la chaîne et établissent des rapports et des audits exigeants ?
Vous avez dit tout l’intérêt d’avoir un responsable d’équipe d’abattoir et de former vos équipes : est-ce la réalité aujourd’hui ?
Enfin, nous avons évoqué tout à l’heure le transport des animaux : mais au-delà, chez l’éleveur, comment l’enlèvement se pratique-t-il ? J’ai souvenir d’avoir vu dans le passé des images assez dures d’enlèvement dans des poulaillers. Les temps ayant bien changé, pourriez-vous nous indiquer ce qu’il en est ? Êtes-vous vous-mêmes propriétaires de poulaillers ? La filière avicole me semble globalement intégrée.
M. Paul Lopez. Je laisserai Madame Julie Mayot répondre à la question concernant la présence des services de l’État et la formation. S’agissant du transport, les deux systèmes existent dans les entreprises : soit elles ont un parc en propre, soit elles sous-traitent la tâche en recourant à des entreprises spécialisées en ce domaine. Dans 99,9 % des cas, les entreprises d’abattage ne sont pas propriétaires des bâtiments d’élevage. Quant au ramassage, il se fait sous la surveillance et la responsabilité – économique, notamment – de l’éleveur, puisque c’est lui qui paie l’équipe de chargement des animaux. C’est l’abattoir qui assure en propre ou qui fait assurer le transport. Le transfert s’effectue à ce moment-là.
Mme Julie Mayot. S’agissant de la présence vétérinaire en abattoir, le secteur avicole présente une spécificité : le personnel y est autorisé à participer aux contrôles ante mortem et post mortem sous la supervision des vétérinaires officiels et des auxiliaires vétérinaires, avec une formation préalable délivrée par des organismes de formation agréés. Il n’y a donc pas de vétérinaire en permanence pour contrôler la viande sur la chaîne. En revanche, les vétérinaires sont présents dans l’abattoir et peuvent intervenir à tout moment. Les salariés placés sur la chaîne à ces postes sont formés. Le contenu de leur formation est vérifié et validé. Ils passent de manière inopinée pour contrôler eux-mêmes certains postes.
Ont été formées au poste d’opérateur protection animale plus de 5 000 personnes depuis trois ans, et au poste de responsable protection animale, 551 personnes. Il y a en permanence un RPA dans l’entreprise.
M. Roland Tonarelli. Pour vous donner un autre regard sur le ramassage, je précise qu’il n’est pas dans l’intérêt économique des opérateurs – éleveurs comme abattoirs – de se retrouver avec des animaux morts. Au moment du transfert de propriété, c’est-à-dire une fois le camion chargé, la responsabilité économique pèse sur l’éleveur. Et si un camion arrive à l’abattoir avec des morts au quai, le prix de ces animaux sera, en vertu du contrat qui lie les opérateurs, défalqué de la rémunération de l’éleveur. Si un abattoir ne fait pas bien son travail – si, notamment, il n’est pas doté d’un hangar ventilé permettant d’abriter les camions à l’ombre, par exemple en cas de panne de la chaîne d’abattage, et donc d’éviter les étouffements d’animaux –, la sanction sera économique. C’est d’ailleurs bien souvent pourquoi, en l’absence de ce type de hangar, les camions redémarrent. Le mode d’organisation financière de la filière avicole n’a rien à voir avec celui des filières porcine et bovine, dans la mesure où le prix est fixé de façon contractuelle, et non par le marché.
Monsieur Dumas nous a interrogés sur les accrocheurs et les cadences sur la chaîne. Je précise que c’est le chef d’équipe qui fixe la cadence d’abattage, conférant un rythme de travail à tous les opérateurs. L’organisation est mécanisée et le geste répétitif. La cadence dépend du nombre d’opérateurs présents sur la chaîne et l’entreprise n’a pas intérêt à ce que ceux-ci aient des troubles musculo-squelettiques du fait d’un rythme trop rapide. La nature humaine est capable de s’adapter à une certaine vitesse. Si le chef d’entreprise va au-delà, non seulement il en porte la responsabilité en cas d’accident, mais cela ne fonctionne pas sur la durée. Une chaîne qui tourne à 2 000 ou à 3 000 animaux à l’heure sera donc équipée du nombre d’opérateurs nécessaire. Si l’on passe de trois opérateurs pour 2 000 animaux à l’heure à quatre opérateurs pour 3 000, les opérateurs travailleront proportionnellement moins, car ils feront moins de gestes répétitifs. La cadence peut donc paraître surprenante, mais doit être relativisée en fonction du nombre d’opérateurs présents sur les postes de travail.
Mme Julie Mayot. Deux temps sont réglementaires et conditionnent la cadence en abattoir : le temps d’accrochage d’un animal vivant – moins d’une minute pour un poulet – et l’intervalle entre l’étourdissement et la saignée – qui doit être de vingt secondes au maximum.
M. Jacques Lamblin. La création de notre commission d’enquête fait suite aux scandales que vous connaissez. Nos concitoyens – les consommateurs – ont réagi massivement, parce qu’ils veulent être certains qu’il n’y a pas de souffrance animale inutile. Notre travail consiste donc à dresser un état des lieux. Aussi justes soient-elles, les observations que nous pourrons faire ne remplaceront pas, pour nos concitoyens, les certitudes qu’ils se forgeront par eux-mêmes.
Vous avez formulé plusieurs objections à l’idée de la vidéosurveillance. Vous dites en premier lieu que le personnel se sentirait surveillé. Certes, mais c’est le cas dans des milliers de commerces : les caissières de supermarché ont une caméra au-dessus de leur poste de travail. Que vous le vouliez ou non, le refus du vidéo-enregistrement peut induire une suspicion chez le consommateur. Vous expliquez en deuxième lieu que les inspecteurs vétérinaires et les personnels sanitaires sillonnent les établissements. Mais, dans les établissements de petite taille, il n’y a pas présence permanente, mais passage régulier de ces personnels – ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Le vidéo-enregistrement peut donc permettre d’amplifier les moyens de contrôle sanitaire existants sans qu’il soit nécessaire de créer des postes supplémentaires. En effet, l’État n’a pas de moyens infinis en la matière. Si l’on voit la vidéosurveillance comme un moyen d’amplifier l’action des services de contrôle et d’offrir une garantie supplémentaire à nos concitoyens, votre position ne risque-t-elle pas d’être contre-productive pour la filière ?
M. Paul Lopez. Il ne s’agit pas d’être têtu : c’est par égard pour le personnel que j’ai formulé ces observations. De plus, je le répète, nous sommes soumis à un cadre réglementaire. Ce n’est pas comme si n’était prévue aucune règle de respect du bien-être animal. Les règles existent à chaque étape : pendant le transport, lors de l’inspection ante mortem et sur la chaîne. Nous vous avons parlé de la manière dont les choses se passaient à chaque poste de travail.
Il importe que les mesures soient proportionnées. La vidéosurveillance est une solution séduisante, d’autant qu’elle peut être assurée à l’aide de petits appareils peu onéreux. Mais le recours à un tel système risque de coûter plus cher à certaines entreprises qu’à d’autres. Vous avez évoqué le fait que les services de l’État contrôlaient de façon moins régulière les outils de petite taille. Le ministre de l’agriculture a également confirmé qu’il intensifierait les contrôles et augmenterait les effectifs chargés de contrôler les outils de taille un peu plus importante. Avant de dire qu’il faut réaliser des vidéos pendant 100 % du temps d’accrochage, assurons-nous que le cadre réglementaire global fonctionne bien. Les services de l’État interviennent à tout moment du jour ou de la nuit. Ils effectuent parfois même au milieu de la nuit, bien avant le démarrage des opérations, des contrôles de nettoyage et de désinfection. Ces services vétérinaires ont un accès permanent au site – y compris dans leurs zones sécurisées –, ce qui leur permet déjà d’évaluer la situation. Avant de rendre la vidéosurveillance systématique – ce à quoi nous ne sommes pas favorables –, on pourrait déjà dresser un état des lieux des contrôles actuels : cette solution me paraît d’autant plus simple que, normalement, l’état des lieux est déjà fait.
Bref, nous insistons sur la notion de proportionnalité des mesures et sur la nécessité de procéder par étapes. La réglementation est en vigueur depuis 2013 et Madame Julie Mayot a évoqué le nombre de personnes qui, en trois ans, ont pu être formées dans nos filières. Nous bénéficions de l’effet cumulatif de notre expérience et de ces formations – effet qui va continuer à s’accroître.
Mme Julie Mayot. Aujourd’hui, personne ne demande de contrôle vidéo permanent de l’état sanitaire des carcasses et de la viande. Pourquoi y aurait-il un contrôle vidéo permanent de l’avant-abattage ? Vous nous faites confiance pour assurer la sécurité sanitaire de nos produits sous contrôle vétérinaire : pourquoi ne pas en faire autant avant l’abattage ? Notre personnel est formé, des vétérinaires sont présents sur place et nous contrôlons des indicateurs de bien-être animal. C’est la formation des salariés qui importe le plus pour nous. C’est pourquoi les fédérations professionnelles envisagent de réunir les responsables de la protection animale une à deux fois par an afin qu’ils procèdent à des échanges de bonnes pratiques et qu’ils effectuent un travail constructif d’amélioration continue de ces pratiques.
M. le président Olivier Falorni. Le vidéo-enregistrement ne pourrait-il pas servir dans ce type de réunion à l’amélioration des bonnes pratiques ?
M. Roland Tonarelli. D’un point de vue pragmatique se pose la question de l’exploitation de ces images. Si vous décidez d’imposer cette vidéosurveillance, cela n’empêchera pas, demain, une association lanceur d’alerte de trouver un épiphénomène – par exemple, une caisse mal arrimée tombant d’un camion –, de le filmer, d’accuser une marque et de faire éclater un nouveau scandale. Le fait de pouvoir opposer à cela des images ne réglera pas le problème, la motivation première de ces lanceurs d’alerte étant de créer du désordre et de jeter le discrédit sur une profession. Si nous ne sommes pas favorables à la vidéosurveillance, c’est plutôt par pragmatisme, parce que nous ne sommes pas persuadés que cela changera le regard de nos contemporains sur notre métier. Nous sommes beaucoup plus favorables au fait d’ouvrir nos portes, de dialoguer, de montrer comment nous travaillons et de faire des efforts de formation, car nous constatons que cela donne des résultats.
M. le président Olivier Falorni. L’ouverture des portes a néanmoins ses limites. Vous n’allez pas organiser des portes ouvertes pendant la phase qui nous intéresse, qui est celle de la mise à mort des animaux. La vidéosurveillance relève évidemment d’un processus interne. Vous nous parlez d’ouverture, mais il est des choses que le grand public ne peut pas voir même si les animaux sont respectés et si leur mise à mort est opérée à l’aide des techniques adéquates et avec l’étourdissement nécessaire. Vous pouvez certes faire visiter un établissement vide en en montrant les outils, mais c’est le bien-être animal qui nous intéresse. L’organisation de portes ouvertes ne répond pas du tout à cette question centrale.
M. Roland Tonarelli. C’est bien vrai. Mais les vidéos des lanceurs d’alerte faisaient apparaître des comportements scandaleux de la part de certains opérateurs salariés des entreprises. Je passe presque tous les jours dans les ateliers pour savoir ce qui s’y passe et pour rencontrer les gens, mais je ne m’imagine pas visionner chaque jour huit heures de vidéo. La formation des opérateurs, les compétences du RPA et le fait qu’il ait une relation directe avec le chef d’entreprise pour intervenir et éviter les comportements criminels me paraissent beaucoup plus importants que de garder une trace vidéo.
M. le rapporteur. Il y a une grande différence entre le contrôle nécessairement statistique de l’abattage et du traitement des volailles et le contrôle individuel des gros animaux et de leur carcasse. Certaines de nos questions s’expliquent par le regard croisé que nous portons sur différentes filières. La question est théoriquement la même : il s’agit de savoir dans quelles conditions de bien-être sont traités les animaux lorsqu’ils passent de l’état d’êtres vivants à celui d’objets de consommation. Mais les situations en termes de rythme et de nombre de bêtes concernées sont fort différentes.
M. Thierry Lazaro. En réaction à Madame Mayot, je ferai remarquer qu’il est assez compliqué de filmer un aspect sanitaire. J’ignore quelle sorte d’animaux nous sommes ici, à l’Assemblée nationale, mais il y a une caméra à chaque coin de bureau. Nous préférerions nous en passer, mais nous nous y sommes habitués. Je ne suis pas un fervent défenseur de ces caméras, mais ainsi va la société. Comme l’a rappelé tout à l’heure Monsieur Jacques Lamblin, le moindre commerce, aujourd’hui, en compte trois ou quatre, et les employés font avec.
Dans le contexte de l’abattage, on est forcé de parler de bientraitance ou de maltraitance animale. C’est pourquoi le propos tenu tout à l’heure par notre président sur ce GAEC n’était pas iconoclaste : il est vrai qu’il n’est pas inutile de savoir ce que l’autre pense, indépendamment des relations qu’il peut avoir avec des sociétés concurrentes.
Nous ne savons pas encore quelles seront les conclusions de notre commission d’enquête. Tout est ouvert et les avis sont divers et variés. Nous avons découvert que le sujet est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraissait au départ, et nous nous interrogeons sur l’opportunité d’instaurer un système de vidéosurveillance du point sensible qu’est l’abattage. Il ne s’agit pas pour nous de penser une seule seconde que toutes les personnes qui sont à ce poste sont « sanguinaires ». C’est un métier difficile et honorable, quelle que soit l’entreprise. Mais, s’il y a des dérapages, c’est notre rôle de les souligner. Et la vidéosurveillance, qui ne se ferait peut-être pas sous l’égide de l’entreprise, mais des services vétérinaires ou d’autres services d’État, pourrait peut-être constituer une solution en cas de problème particulier
– solution n’excluant en aucun cas la formation du personnel.
M. le président Olivier Falorni. Puisque ma question relative au GAEC du Perrat n’était pas iconoclaste, j’en poserai une autre qui ne l’est pas plus. Le broyage des poussins a également provoqué un scandale. Quel est votre point de vue sur le traitement des poussins dans les couvoirs ? Je ne décrirai pas les images que nous avons vues, mais, bien que la question ne soit pas au cœur des préoccupations de notre commission, on ne peut pas ne pas l’évoquer dans un débat sur la filière avicole.
M. Paul Lopez. Vous nous avez interrogés sur l’utilité de la vidéo dans le cadre de nos formations. Nous nous servons de cet outil pour former notre personnel, mais il y a une différence entre les vidéos que nous réalisons à dessein, dans ce cadre, pour illustrer les bonnes et mauvaises pratiques, et un enregistrement permanent.
Monsieur Lazaro a évoqué les dérapages éventuels. Dans cette hypothèse et en vertu de leur fiche de mission, les RPA, qui sont présents en permanence, ont obligation d’appliquer des sanctions. Il n’est donc pas question de « pas vu, pas pris » : il y a toujours quelqu’un ayant délégation pour assurer le bien-être animal. Monsieur Roland Tonarelli l’a dit : l’intérêt économique de nos entreprises et de la filière est d’assurer ce bien-être, même si tout n’est pas toujours parfait – et je n’excuse pas les pratiques anormales.
Vous avez aussi évoqué le scandale du broyage des poussins. Il convient, une fois de plus, de distinguer entre les secteurs d’activité : dans les filières de ponte, on élimine un poussin sur deux, puisque le coq ne pond pas d’œufs ; dans les filières de production de chair, on effectue un simple tri et le taux est extrêmement bas, après quoi l’on a recours à la meilleure technique disponible. Si vous faites référence aux vidéos qui ont circulé dans un département de l’Ouest il y a un certain temps déjà, il s’agit clairement d’un montage et non d’une pratique de l’entreprise qui, malheureusement, n’a pas survécu au tsunami qu’elle a dû affronter. Faire tourner les animaux en l’air dans un sac et les cogner n’est pas une pratique courante.
M. le président Olivier Falorni. Qu’entendez-vous par montage ?
M. Paul Lopez. Selon nos informations, la personne qui s’est livrée à ces actes a été incitée à faire des gestes dont elle n’était pas coutumière.
M. Arnaud Viala. Voulez-vous parler d’une mise en scène ?
M. Paul Lopez. Je n’ai pas utilisé le terme, mais c’est possible. N’ayant pas été présent, je ne puis l’affirmer.
M. Dominique Ramon. Je souhaiterais compléter les propos de Paul Lopez concernant les poussins. Au salon de l’agriculture, une société ligérienne dont les recherches portent sur un système fiable et non invasif de prédiction du sexe du poussin avant éclosion de l’œuf a été nommée lauréate des projets agricoles et agroalimentaires des investissements d’avenir (P3A), en présence du ministre de l’agriculture et de Monsieur Emmanuel Macron, et s’est vu attribuer 2 millions d’euros d’avances par FranceAgriMer. Le projet scientifique de cette société, qui verra le jour demain, a donc interpellé les services de l’État.
M. Jean-Michel Schaeffer. La filière travaille à ce sujet de façon très sérieuse. De nombreuses études ont été réalisées, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, afin de déterminer comment sexer l’animal avant qu’il ne soit considéré comme un embryon. Une entreprise française a notamment réalisé des recherches importantes en ce domaine. Nous l’avons soutenue dans sa démarche auprès des pouvoirs publics afin qu’elle puisse nous apporter des solutions techniques. Il existe différents types de techniques selon les pays.
M. Roland Tonarelli. Les projets de sexage dans l’œuf permettraient effectivement d’éviter les images qui ont été portées à la connaissance du public même si, dans certains cas, on peut s’interroger quant à l’aspect contradictoire de ce type d’enquêtes – si on peut appeler cela des enquêtes. Cette technique est choquante pour notre sensibilité humaine, mais c’est aujourd’hui la meilleure disponible.
M. le président Olivier Falorni. Souhaiteriez-vous conclure cette audition, Monsieur Lopez ?
M. Paul Lopez. Je vous remercie de nous avoir reçus. Je rappellerai en conclusion que nous sommes dans un marché européen. La France est devenue le maillon faible à l’échelle du continent après avoir été depuis toujours, jusqu’à il y a deux ans, le premier pays européen. Notre compétitivité est en perte de vitesse. Dès que nous avons des écarts de prix, même inférieurs à 1 %, nos entreprises gagnent ou au contraire perdent des marchés. Je ne suis pas en train de monétiser le bien-être animal, mais nous devons être conscients que nous nous trouvons dans un cadre global de marché.
J’ai parlé du marché européen, mais les enjeux sont aujourd’hui encore plus importants, puisque 25 % des filets de poulet consommés en Europe sont importés des pays tiers auxquels il n’est demandé de suivre aucune réglementation européenne – y compris en termes de bien-être animal. Je me dois, au nom de notre profession, de m’élever contre cet état de fait et de saluer la démarche du ministre de l’agriculture à Bruxelles – ce qui a d’autant plus de poids que ce n’est pas dans notre habitude. Monsieur Stéphane Le Foll a en effet demandé l’instauration d’un étiquetage d’origine des produits transformés, qui n’est pas aujourd’hui à l’ordre du jour de la réglementation européenne. Il faut que la France soit exemplaire pour bien montrer à ses confrères européens que c’est la démarche à suivre pour garder et nourrir la confiance du consommateur européen à l’égard des productions du continent et, a fortiori, du consommateur français. C’est d’abord notre intérêt économique.
M. le président Olivier Falorni. Je vous remercie d’avoir répondu à nos questions.
La séance est levée à dix-huit heures quarante.
——fpfp——
26. Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Paul Bigard, président du directoire du groupe Bigard
(Séance du mercredi 15 juin 2016)
La séance est ouverte à dix-huit heures cinquante.
M. le président Olivier Falorni. Nous reprenons nos auditions dans le cadre de la commission d’enquête sur les conditions d’abattage dans les abattoirs français en recevant M. Jean-Paul Bigard.
Vous êtes, monsieur, à la tête du groupe Bigard depuis 1997. C’est Lucien Bigard qui a créé la Société commerciale des viandes (SOCOVIA) en 1968, puis le groupe Bigard en 1974. Avec plus de 500 000 tonnes de viandes transformées par an, votre groupe est aujourd’hui le premier transformateur de viandes en France. Son siège social, situé à Quimperlé, dans le Finistère, est structuré en trois entités principales, chacune avec sa marque : Bigard, Charal et Socopa Viandes. Fort de cinquante-deux implantations industrielles et commerciales, votre groupe emploie 14 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2014.
À la lumière de ces éléments d’information, il nous a semblé utile de vous entendre pour recueillir votre sentiment sur la situation et vous interroger sur les conditions d’abattage des animaux.
Vous le savez, notre commission d’enquête, qui a été créée à la suite de la diffusion, par l’association L214, de vidéos des abattoirs du Vigan, d’Alès et de Mauléon qui ont suscité la légitime indignation de nos concitoyens, vise à savoir ce qui se passe vraiment dans les abattoirs et à voir comment la question du bien-être animal y est abordée.
Nous sommes ravis, monsieur Bigard, de vous accueillir ici. Je vous rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale, certaines étant diffusées sur La chaîne parlementaire (LCP).
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Paul Bigard prête serment.)
M. Jean-Paul Bigard, président du directoire du groupe Bigard. Votre présentation du groupe Bigard est juste à 100 %. Je précise que les volumes traités par le groupe sur l’exercice 2015 s’élèvent à 950 000 tonnes. Cela dit, les problèmes sont exactement les mêmes, que l’on traite 450 000 ou 950 000 tonnes.
Je réponds à votre convocation sur un sujet bien pénible, mais qu’il faut traiter. Notre groupe y consacre beaucoup de temps, au travers de la formation, d’une implication au quotidien pour gérer les animaux, et beaucoup d’argent au travers des investissements. En 2015, il a traité 1,3 million de bovins, 400 000 veaux, 5 millions de porcs et 400 000 agneaux. Nous sommes à peu près rodés à toutes les problématiques, aussi bien aux animaux de poids qu’à des bêtes plus dociles, à des animaux qui ne sont pas toujours faciles à manipuler, car ils sont en troupeaux, comme les ovins.
Le groupe Bigard s’est constitué, après une vingtaine d’années de croissance interne, à coup de rachats de structures extérieures. En 1995, la société familiale était le quatrième opérateur en France. En quinze ans, il a racheté le numéro 3, le numéro 2 et le numéro 1. Chaque fois qu’un achat a été réalisé, il a fallu composer avec l’outil industriel repris, et donc procéder plus ou moins rapidement à des aménagements. C’est toujours la chaîne d’abattage qui est la plus difficile à régler, car il s’agit parfois d’anciens outils publics, qu’il faut mettre à niveau et pour lesquels on doit investir des sommes considérables.
Lorsque nous avons posé la première pierre de l’outil que vous avez visité à Maubeuge il y a quelques semaines, monsieur le président, on nous a accusés de tous les maux et traités de tous les noms. Sa construction a nécessité un budget de plus de 50 millions d’euros : il s’agissait de se doter d’un outil digne de ce nom en remplacement d’un ancien équipement municipal situé à Avesnes-sur-Helpe.
Tous les animaux passent dans un abattoir, mais, dès lors qu’on veut industrialiser le processus, on ne peut pas bricoler et il faut de lourds investissements. Certes, l’outil ne sera pas le même pour traiter 5 000 tonnes, 10 000 tonnes ou 100 000 tonnes. Mais le groupe Bigard a souhaité dimensionner tous ses outils à un niveau plus que satisfaisant et réglementaire, l’abattage devant toujours se faire dans de bonnes conditions.
Les gros bovins sont ceux qui nécessitent les investissements les plus lourds. Ensuite, ce sont les porcs, car le nombre de ceux que l’on est amené à traiter est très important. Pour 100 000 porcs par semaine, il faut des outils très résistants et bien étudiés. Il existe deux méthodes d’étourdissement, soit par électrodes, soit au gaz. Pour les bovins et les veaux, l’étourdissement se fait uniquement par percussion frontale.
Pour le personnel, le métier est rude, difficile. Nous consacrons plus de la moitié des budgets de formation du groupe au traitement de la phase amont. Nous sommes accompagnés par les services vétérinaires. Force est de reconnaître que cet accompagnement se fait un peu à la carte. Les positionnements, les postures, les comportements ne sont pas standardisés. Les contrôles sont très pointus, très rigoureux dans certaines installations, tandis que les services vétérinaires sont moins présents dans des outils de plus faible capacité.
Au-delà de ces précisions, je n’ai pas de remarque particulière à formuler. Je me prête à toutes vos questions.
Nous évoquerons très certainement un sujet particulièrement sensible, difficile, que je n’hésite pas à aborder, celui de l’abattage rituel. En France, cette question est gérée sous l’angle d’une dérogation, alors que la règle européenne voudrait que tous les animaux soient étourdis. Il faudrait donc mettre un peu d’ordre dans cette pratique difficile à supporter. C’est mon avis personnel.
M. le président Olivier Falorni. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu les vidéos concernant les trois abattoirs que j’ai cités ? Comment, à la lueur de votre expérience de ce métier, pouvez-vous expliquer de tels faits ?
Pensez-vous qu’il existe un lien entre la cadence d’abattage et la maltraitance de l’animal ?
Pensez-vous qu’il existe un lien entre abattoirs anciens et vétustes et mal-être animal ?
Quel est votre avis sur la vidéosurveillance ? Est-ce une bonne solution pour rassurer le consommateur sur la pratique d’abattage ?
Quelle est votre opinion sur la formation des sacrificateurs ? Votre groupe en emploie-t-il directement ? Le directeur de l’abattoir de Maubeuge nous a indiqué que deux ou trois sacrificateurs étaient directement salariés dans votre groupe, mais c’est loin d’être le cas partout dans les abattoirs français. Comment sont intégrés les sacrificateurs aux équipes d’opérateurs en abattoir ?
M. Jean-Paul Bigard. Les trois vidéos qui ont été diffusées concernent chacune un petit outil. Les pratiques révélées par les deux premières ne sont pas tolérables, mais on les rencontre, hélas, assez fréquemment dans de petits outils où les équipements sont rudimentaires et où les moyens font défaut, où le contrôle est faible et la formation quasi nulle.
Je suis très souvent choqué par l’état physiologique invraisemblable des animaux qui arrivent à l’abattoir, et dont l’abatteur n’est pas responsable. Ces animaux ont pourtant vécu dans des prés, dans des étables, mais les vétérinaires les ont vus plus ou moins rapidement, plus ou moins soigneusement. La surveillance, la formation devraient commencer en amont, car c’est là que se posent des problèmes de suivi du cheptel.
Lorsque l’animal arrive à l’abattoir, il faut le faire descendre du camion, ce qui est plus ou moins facile. Dans les petits outils, il n’y a pas véritablement d’encadrement : certes, il y a un directeur, mais on constate aussi un mélange des genres, tous les employés étant polyvalents, et les abattages devant être réalisés dans un délai très court, avec un matador qui ne fonctionne pas toujours. Je ne suis donc pas surpris par ce que montrent les vidéos des deux premiers sites.
S’agissant du troisième site, je suis stupéfait de ce qui est montré, au point de me dire que l’on n’est pas dans un schéma naturel. J’ai une trentaine d’outils, je visite de très nombreux abattoirs en France et dans d’autres pays ; je n’ai jamais vu d’opérateurs cagoulés en tête de chaîne. Je ne parle pas de mise en scène, mais je n’ai vu nulle part, dans le cadre d’un mode opératoire, ce que montre cette vidéo. Les scènes où des ovins sont projetés en l’air sont macabres. Je n’ai jamais vu cela de ma vie. Je m’interroge.
Il y a quatre ans, l’intérieur de l’abattoir de Metz, qui appartient aujourd’hui au groupe Bigard, a été filmé avec un téléphone portable : c’était une enquête en caméra cachée, un reportage sauvage. J’ai su par la suite comment le tournage s’était déroulé et qui étaient les garçons qui opéraient. Quand on veut condamner l’abattage, rien n’est plus facile que de mettre en scène une vidéo insoutenable. C’est ce que nous avons vécu, et c’est inadmissible.
Pour en revenir à ce qui s’est passé à l’abattoir de Mauléon, c’est du jamais vu. Ce fut mon premier sentiment lorsque j’ai vu ce court reportage.
M. le président Olivier Falorni. Y a-t-il un lien entre la cadence et le mal-être animal ?
M. Jean-Paul Bigard. La cadence participe au mal-être animal dès lors que les conditions matérielles ne sont pas réunies. Dans l’abattoir que vous avez visité, nous pouvons traiter de quarante-huit à cinquante-huit bovins à l’heure. Quand les couloirs d’amenée au poste d’abattage sont bien adaptés et que vous disposez d’une bonne minute pour réaliser l’assommage, la cadence n’est pas un problème. Elle le devient lorsque vous n’avez pas les conditions matérielles ad hoc.
À plusieurs reprises, j’ai fait remarquer aux ministres qui me demandaient ce qu’il fallait faire pour remettre un peu d’ordre dans le monde des abattoirs et pour améliorer l’image des professionnels de la viande, qu’il existe des règlements et que les abattoirs sont classés en quatre catégories. Si un abattoir de catégorie IV ne réalise pas certains travaux dans un délai de un an, il perd l’estampille sanitaire et est menacé de fermeture. On trouve, dans des outils qui n’ont pas obligatoirement de grosses cadences, des conditions inacceptables faute de moyens. Il existe aussi des abattoirs de conception ancienne qui sont bien entretenus, avec de bons professionnels, et où tout se passe correctement. Mais s’ils n’engagent que du personnel intérimaire, s’ils font conduire les animaux par des gens qui n’en ont jamais vu et qui sont mal outillés, les cas de maltraitance animale se multiplient, même avec de faibles cadences. Un animal ne marche pas toujours droit, il peut faire des écarts, être rétif. Il faut du personnel qui aime les animaux, même si, en définitive, c’est pour leur donner la mort. Plus que la cadence, ce sont l’état des lieux et le savoir-faire des opérateurs qui peuvent entraîner une forme de maltraitance.
M. le président Olivier Falorni. Pensez-vous que l’installation de caméras de vidéosurveillance peut constituer une solution en termes de contrôle, de formation des salariés, et pour permettre que le consommateur retrouve confiance dans la façon dont a été abattu l’animal qu’il consomme ?
M. Jean-Paul Bigard. L’industrie de la viande est soumise à bien des règles et nous exerçons déjà notre activité sous le contrôle constant d’agents de l’État. Sans préposé, sans vétérinaire, on ne peut démarrer l’abattage, et l’on est obligé de rendre des comptes en permanence. L’environnement réglementaire est très contraignant. Qu’apportera de plus une caméra de vidéosurveillance ? Nous en utilisons déjà pour certaines activités, en particulier pour tout ce qui concerne le classement, le marquage des animaux. Ce dispositif doit être entretenu, ce qui est relativement difficile en milieu humide, tantôt chaud, tantôt froid. On peut installer d’autres caméras, de même qu’on peut en installer dans les couloirs de l’Assemblée nationale : on verra passer des gens, mais on se heurtera rapidement à une question de confidentialité humaine.
Si la vidéo représente, pour la formation, un outil pédagogique de première importance, je ne suis pas favorable à son utilisation pour la surveillance du personnel. Quand je pense aux difficultés que nous avons eues pour des questions de pause ou de badgeage, je n’ose imaginer ce qui se passerait si le personnel devait être filmé en permanence !
Certains cahiers des charges – surtout pour des clients étrangers, notamment britanniques – imposent la présence d’une caméra dans certains outils. Celles qui fonctionnent en France ne filment que le cheminement d’un animal à un moment donné, en dehors de toute prise de vue humaine. L’emploi de la vidéo ne peut aucunement garantir que tout se passe bien. S’il n’est pas difficile de surveiller le cheminement de l’animal de la descente du camion jusqu’au poste d’étourdissement et à la saignée dans un outil qui traite trente bovins par jour, ça l’est davantage dans un outil qui en traite 600. Vous avez vu, à Feignies, que l’on n’a pas besoin de caméras pour que le personnel travaille dans de bonnes conditions.
M. le président Olivier Falorni. Les sacrificateurs sont-ils salariés dans votre groupe ? Comment sont-ils intégrés aux équipes d’opérateurs ?
M. Jean-Paul Bigard. Il y a deux rituels d’abattage : halal et casher. S’agissant de l’abattage halal, je n’hésiterai pas à dire que c’est un joli bordel. Dans un petit outil, deux ou trois musulmans possèdent une carte de sacrificateur délivrée par la mosquée de Paris, de Lyon, de Marseille, etc. L’uniformisation est loin d’être la règle. Nous avons eu la surprise, hier matin, de voir arriver M. Boubakeur à l’abattoir de Formerie. Il venait s’assurer du bon déroulement des opérations, et nous avions été prévenus que quelques heures auparavant.
M. le président Olivier Falorni. À ma connaissance, il n’est pas membre de la commission d’enquête…
M. Jean-Paul Bigard. J’ai été surpris de voir M. Boubakeur, que je n’ai jamais rencontré, arriver dans un abattoir où opèrent trois sacrificateurs, salariés du groupe Bigard, avec lesquels nous n’avons aucun problème. Dans d’autres outils de notre groupe, ce sont des prestataires qui procèdent à l’abattage. Des sociétés ont un agrément de la mosquée de Paris, de Lyon ou de Marseille. La majorité des opérateurs sont extérieurs au groupe Bigard : ce ne sont pas nos salariés.
M. le président Olivier Falorni. Pensez-vous qu’ils ont la formation nécessaire pour pratiquer l’abattage dans les conditions dérogatoires que l’on connaît ?
M. Jean-Paul Bigard. Dans de nombreux cas, ces opérateurs opèrent depuis très longtemps. Mais la pratique de longue durée n’est pas synonyme de mode opératoire irréprochable. Il n’y a pas d’uniformité et la formation pour pratiquer l’abattage halal n’est pas suffisante.
Quant à l’abattage casher, il est très problématique. Il est beaucoup plus rigoureux dans la forme. Pour notre groupe, il s’agit exclusivement d’opérateurs extérieurs. Même si l’obtention de la carte est beaucoup plus difficile que dans le cas de l’abattage halal, les opérateurs ne sont pas uniformément éduqués. L’abattage casher est un abattage très dur.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Lors d’une précédente audition, l’opérateur d’un abattoir nous a dit que l’abattage sans étourdissement connaissait de très grandes variabilités d’exécution et qu’il était beaucoup plus acceptable lorsqu’il était pratiqué par quelqu’un qui savait bien le faire que lorsque l’opération était en quelque sorte improvisée. Indépendamment de la certification religieuse, qui ne relève ni de l’administration ni de l’entreprise, vous paraîtrait-il possible de former techniquement les sacrificateurs, de vérifier les équipements ?
M. Jean-Paul Bigard. Oui, c’est certain.
Je vous ai dit qu’il n’y a pas une grande uniformité parmi les opérateurs : certains savent faire et d’autres sont beaucoup moins efficaces. Je crois qu’il faut s’attacher à policer, à discipliner cette pratique et à la regarder sous l’angle religieux pour la comprendre.
Ce type d’abattage représente un poids économique très important. Il faut donc prendre garde à toute prise de décision. Nous avons cherché, non à contourner la problématique, mais à l’améliorer. J’ai investi beaucoup d’argent pour tester, dans l’outil de Castres qui traite des bovins et des ovins, un appareil qui vient de Nouvelle-Zélande et qui est déjà utilisé dans certain pays. Il permet d’étourdir l’animal de façon réversible. Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse pour dire que j’ai des doutes quant à la réversibilité et que je n’ai encore jamais vu un animal se relever après une phase d’étourdissement. Cet outil avait été livré, dans un premier temps, à Feignies, mais les autorités vétérinaires ont refusé de s’engager dans un protocole de test pour vérifier si l’appareil était conforme ou non.
M. le président Olivier Falorni. Pour quel motif ?
M. Jean-Paul Bigard. Sans motif. Je me demande d’ailleurs pourquoi l’outil, situé dans le Nord, n’est pas classé en catégorie I. Voilà cinq ans que cela dure et je m’en explique régulièrement avec M. Dehaumont, directeur général de l’alimentation. Il me répond qu’il applique la décision des services locaux. Dont acte.
J’ai transféré l’outil à Castres, où j’ai construit un local pour l’installer. Nous avons effectué des tests pendant plusieurs mois, avec un inspecteur vétérinaire qui a accepté de vérifier comment l’étourdissement se faisait, et s’il s’agissait vraiment d’un étourdissement réversible, si l’on pouvait ensuite procéder à la saignée, à l’égorgement. Nous en sommes maintenant à la phase finale. Nous allons établir un rapport qui devrait déboucher sur un agrément, c’est-à-dire sur l’autorisation d’utiliser l’outil. Mais je ne sais pas si cet agrément sera réservé à l’outil de Castres ou s’il aura une portée nationale.
M. le président Olivier Falorni. Pouvez-vous nous dire à quel moment ce rapport sera établi ? Il s’agit d’un élément important qui pourrait enrichir notre propre rapport, que nous rendrons à la mi-septembre.
M. Jean-Paul Bigard. Je vous transmettrai l’information dans les prochains jours et les conclusions du rapport vous seront communiquées.
M. le rapporteur. Vous avez rappelé le rôle de l’État dans le contrôle de l’ensemble de la chaîne d’abattage, et nous avons vu que ce contrôle était présent. Néanmoins, sa répartition sur la chaîne n’est pas forcément homogène. D’ailleurs, à la suite des alertes dont nous avons parlé, le contrôle spécifique du bien-être animal déclenché par le ministre a fait remonter, dans un certain nombre d’établissements, des manquements mineurs ou moyens, mais quelquefois un peu plus sérieux. Le contrôle, tel qu’il est organisé en ce qui concerne le bien-être animal, ne semble pas éliminer toutes les difficultés. Cela signifie-t-il qu’il est trop concentré sur l’aspect sanitaire ante mortem ou post mortem, et pas assez sur l’étourdissement et la mise à mort ?
Il n’est pas question de filmer en permanence. Mais la vidéosurveillance ne pourrait-elle pas constituer un outil de contrôle stochastique ? Plutôt qu’un contrôle humain, l’État pourrait très bien décider de ne regarder ce qui se passe sur telle chaîne que pendant une ou deux heures, voire un jour ou deux. Cela permettrait un contrôle moins coûteux et plus focalisé sur certains points de la chaîne.
M. Jean-Paul Bigard. Avec une caméra ou du personnel ?
M. le rapporteur. Une caméra, le cas échéant.
M. Jean-Paul Bigard. On se heurterait au même problème de confidentialité. Je ne vois pas comment on pourrait réussir à ne pas filmer le personnel.
Je veux revenir sur les contrôles. À l’origine, il ne s’agissait que d’un contrôle sanitaire des viandes en bout de chaîne. L’affaire de la vache folle a fait remonter en amont quelques opérateurs qui effectuent dorénavant une inspection ante mortem. Mais il faudrait qu’il y ait un peu plus de rigueur, davantage de contrôles dans les fermes. Quand un animal est euthanasié à la ferme, l’éleveur doit payer son enlèvement, ce qui n’est pas le cas à l’abattoir. Nous formons nos chauffeurs pour qu’ils puissent, lors du chargement d’un lot, à trois ou quatre heures du matin, refuser de charger l’animal s’il n’est pas en état de voyager. Notre groupe a établi des statistiques hebdomadaires et je sais combien d’animaux sont refoulés chaque semaine au moment du chargement. Lorsque le transport est effectué par du personnel et des camions de chez Bigard, Charal ou de la Socopa, cela se passe bien. Mais je ne suis pas certain que les transporteurs accordent la même attention.
À la suite d’un contrôle sur l’ante mortem, nous avons installé des couloirs d’amenée. Traditionnellement, les animaux étaient réceptionnés dans des parcs. Des logettes ont été installées presque partout. Le vétérinaire, le contrôleur technicien peut examiner l’animal, vérifier la boucle, en toute sécurité. Je ne suis pas sûr que les services de la direction générale de l’alimentation (DGAL) aient pour mission de surveiller le bien-être animal.
En ce qui concerne l’abattage rituel, nous appliquons, depuis plusieurs semaines, des contrôles d’une grande rigueur. Certains outils voient des opérateurs du service public intervenir, un chronomètre à la main, pour vérifier que le temps d’attente est bien respecté. Aujourd’hui, une chaîne qui procède à de l’abattage rituel halal ne traite pas plus de vingt-trois ou vingt-quatre bovins à l’heure, soit deux minutes à deux minutes trente par carcasse. Je n’ai pas souvenir de beaucoup de préposés sanitaires ou de techniciens procédant à un contrôle rigoureux en matière de bien-être animal.
M. le rapporteur. C’est sans doute pourquoi, lorsqu’on leur demande de se pencher sur la question, ils découvrent des choses qui auraient dû être repérées plus tôt.
M. Jean-Paul Bigard. C’est vrai. Mais il faut noter que cela fait plusieurs années que les effectifs des services vétérinaires sont en baisse. Je n’en dirai pas plus sur le mode de fonctionnement de ces opérateurs, mais, si vous en avez le loisir, vérifiez quel est leur temps de travail. Il y a une grande différence entre ceux qui travaillent 35 heures et ceux du service public. C’est un sacré problème.
M. Jacques Lamblin. Monsieur Bigard, le message que vous délivrez semble assez clair : les problèmes sont plus fréquents dans les petits outils artisanaux que dans les outils de plus grande taille, où les investissements permettent que les choses se passent bien, ou en tout qu’il y ait moins d’incidents. Cela dit, vous avez une vision industrielle. Or, si une grande partie des consommateurs veut des produits fabriqués à grande échelle, une autre demande des produits locaux, en circuit court. En dessous de quelle taille ne faut-il pas descendre pour que les investissements soient rentabilisés dans un abattoir ?
Avez-vous des problèmes pour recruter du personnel et en matière de rotation du personnel ? Le personnel reste-t-il suffisamment longtemps, est-il fidèle à l’établissement ?
Je veux revenir sur l’abattage rituel. Vous avez dit avoir tenté d’importer du matériel permettant l’étourdissement réversible des bovins. Les tests que vous avez effectués portaient-ils sur un étourdissement par électronarcose ou par percussion non perforante ? À défaut d’étourdissement préalable, une autre technique pourrait exister : l’étourdissement post jugulation, dit post cut. Quelle est votre opinion sur ces deux méthodes ?
Il semblerait par ailleurs que le volume de viande halal produit en France ait augmenté dans des proportions considérables au cours de ces vingt dernières années, en tout cas plus que l’augmentation de la population musulmane. On pourrait penser qu’un nombre de plus en plus important de musulmans consomme de la viande halal, alors que ce n’est pas culturellement obligatoire pour eux. Certains opérateurs développent-ils le marché halal de façon à en faire un marché captif ? Est-ce une stratégie commerciale qui se développe ?
M. Jean-Paul Bigard. Notre groupe compte 14 000 personnes, dont 12 000 contrats à durée indéterminée (CDI) et 2 000 emplois précaires. Nous sommes en train d’éliminer presque totalement les intérimaires, pour un problème de coût-horaire et de mauvais rendement. La sanction est double lorsque vous employez ces personnels. Dès lors qu’il faut utiliser un couteau, nous n’avons pas recours à des intérimaires.
Il n’est pas facile de trouver du personnel pour travailler sur une chaîne d’abattage. Il est des garçons que cela ne gêne pas, mais force est de reconnaître que le travail en tête de chaîne est difficile. Je dois remercier mon père de m’avoir initié à ce métier, à l’âge de quatorze ans. Mais, quand vous l’avez un peu exercé, vous comprenez qu’il faille prendre quelques dispositions. Les salariés de Bigard qui travaillent sur ces postes-là dans de bonnes conditions n’en changent pas. Ils touchent un très bon salaire. Je ne connais pas de garçons procédant à l’abattage des animaux qui postulent pour aller faire du désossage ou autre chose. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi, mais nous n’avons pas, au niveau des têtes de chaîne d’abattage, de demandes spécifiques et de rotation importante. Aujourd’hui, nous faisons beaucoup de formation.
L’appareil dont je vous ai parlé est fabriqué en Nouvelle-Zélande. On applique des électrodes sur l’animal. C’est un peu le même procédé que pour étourdir les porcs avant la saignée, si ce n’est qu’il est plus difficile d’immobiliser et d’étourdir un bovin de 600 kilos qu’un porc. Un mâle très puissant, très musculeux, se contracte si fort que l’effet de raidissement peut briser la colonne vertébrale.
S’agissant de l’abattage rituel, vous avez évoqué l’étourdissement immédiat ou concomitant avec l’égorgement. Cela reste, à mes yeux, la meilleure formule si l’on veut concilier l’impossible, l’insupportable, avec le culte. Cela dit, cela reste épouvantable et ce ne sera jamais un spectacle brillantissime. Mais le fait d’égorger puis d’étourdir l’animal dans les secondes qui suivent, permet de régler certains problèmes, d’autant qu’il a la tête prise. L’égorgement se fait sur un animal vivant, qui est étourdi aussitôt après. C’est une double peine. En tout cas, nous n’avons pas, au travers de cette procédure, d’effet d’ébattement, de séquences épouvantables comme celles que l’on peut voir dans le cadre d’un abattage rituel.
L’abattage rituel est un thème de campagne qui revient à chaque élection. Hélas, je crains que nous n’y échappions pas la prochaine fois. La méthode dont je vous parle est une réponse plus satisfaisante que les déclarations des représentants des différentes communautés, qui, à la sortie d’une réunion, clament sur le perron de l’Élysée ou de Matignon que l’affaire a été réglée : en vérité, rien n’a été réglé. En Europe, avant d’abattre un animal, il faut l’étourdir. La France a choisi d’accorder des dérogations, si bien qu’elle reporte la responsabilité sur les opérateurs. C’est une façon un peu fuyante de traiter le problème.
Un ministre m’a un jour demandé pourquoi, en France, il n’y avait que de petits outils, alors qu’il en faudrait de plus grands. Je lui ai répondu qu’un outil qui abat 2 000 bovins par semaine peut perdre des fortunes faute d’adéquation entre les volumes abattus et son commerce, et que, à l’inverse, un outil qui traite seulement 150 à 200 bovins par semaine – et il en existe de beaucoup plus petits encore – sera très rentable parce qu’il abattra, à la carte, des animaux vendus dans des circuits de boucherie, avec peu de désossage à effectuer, ce qui assure une bonne marge. Il n’y a donc pas de corrélation immédiate entre la rentabilité et la taille d’un outil. Évidemment, si, dans un grand outil, le travail est fait correctement, si une solution est apportée à tous les déséquilibres qui se présentent, tout se passera bien.
Mais tout peut aller fort bien aussi dans un abattoir municipal qui traite vingt bêtes par semaine et dans lequel travaillent trois ou quatre salariés qui ont toujours fait ce métier. Mais il est évident que le maire de la commune qui possède l’abattoir devra mettre au pot tous les ans. Je dis souvent que, chez nous, on ferme des bureaux de poste, des tribunaux, des gares, des hôpitaux, mais jamais d’abattoirs. Au contraire, on en crée, alors qu’il y a de plus en plus de problèmes. La régionalisation est en train de faire naître des initiatives folles. On compte aujourd’hui au moins vingt projets de création d’abattoirs pour les circuits courts. Pourquoi pas ? Sauf qu’il n’est pas aussi facile d’abattre un bovin : il faut un minimum d’installations, un minimum d’investissements et un minimum de recettes. Sinon, on est très vite confronté à des problèmes économiques. On peut comprendre qu’une municipalité décide de consacrer 50 000 ou 200 000 euros à cet outil. Mais on sait comment fonctionnent ces petits outils, avec une société d’exploitation et du personnel d’entretien. Je ne connais pas d’outil capable de fonctionner avec moins de quinze ou vingt personnes. Pour ma part, j’ai des outils qui fonctionnent avec un coût d’abattage qui va de 0,25 à 0,45 euro du kilo. Je ne parle là que de l’abattage, c’est-à-dire de l’animal qui est abattu, pesé en fin de chaîne et placé dans une chambre de refroidissement.
Je rappelle que le contrôle sanitaire se pratique de façon assez folklorique dans les petits outils. Bien sûr, personne ne meurt, personne n’est empoisonné quand on produit de petites quantités. Mais il faut faire beaucoup plus attention lorsque ces petits outils veulent augmenter leurs volumes dans de mauvaises conditions d’exploitation. Et, surtout, que font-ils ensuite de la viande ? Elle ne doit surtout pas être transformée en viande hachée.
Les initiatives nouvelles ne me gênent pas. Encore faudrait-il que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Dès lors que l’on imposera des règles à ces outils, certains seront à la hauteur, mais beaucoup ne le seront pas. Beaucoup d’abattoirs français sont classés en catégorie IV ; et, je le répète, ce serait une bonne initiative que d’en fermer un certain nombre, ce qui n’empêcherait pas d’en ouvrir d’autres à côté. Si ces outils continuent de fonctionner, il y aura toujours un risque qu’ils soient accusés, car ils ne fonctionnent pas dans des conditions acceptables, tant du point de vue du bien-être animal que sanitaire. Il est scandaleux que certains outils, que je ne citerai pas, fonctionnent encore aujourd’hui. Sans faire de concurrence à l’association L214, j’estime qu’il faut en fermer certains d’urgence.
M. Jacques Lamblin. À cause de la souffrance animale ou des conditions sanitaires ?
M. Jean-Paul Bigard. Surtout à cause des conditions sanitaires. Mais, lorsque celles-ci ne sont pas à la hauteur, on trouve bien souvent aussi de la souffrance animale. Les conditions de déchargement des camions et d’accès de l’animal à la chaîne d’abattage sont souvent déplorables. Même si le personnel est formé et précautionneux, ses conditions de travail ne sont pas faciles. Conduire un animal n’est pas une tâche aisée. Il ne doit pas pouvoir se sauver. S’il n’y a pas de quai de chargement, il faut que l’animal saute. Mais il risque de tomber, de glisser, de se casser une patte. Même dans un outil comme celui de Feignies, où l’on a tout prévu, on rencontre des problèmes au moins une fois par jour. Entre parenthèses, l’installation des caméras ne serait pas facile, car il faut imaginer un système de plateau pour aller récupérer un animal. Mais, pour récupérer un animal dans un couloir d’accès, il faut un palan. Parfois, cela tourne presque au gag, mais c’est un gag dangereux. Nous sommes confrontés à des problèmes difficiles.
M. William Dumas. Vous êtes le premier de ceux que nous avons auditionnés qui se dise choqué par l’état des animaux qui arrivent à l’abattoir.
M. Jean-Paul Bigard. Par quelques-uns, oui.
M. William Dumas. Vous nous avez dit avoir des statistiques, et refuser parfois de charger des animaux. Or tout le monde nous a parlé du bien-être de l’animal chez l’éleveur.
M. Jean-Paul Bigard. Je ne veux pas accuser les éleveurs. Je dis seulement que, là encore, il peut y avoir des exceptions et des anomalies. Le monde agricole est très rude. On y voit parfois des choses qui ne sont pas satisfaisantes.
M. William Dumas. Vos tueurs reçoivent-ils une formation continue, annuelle ? On nous a dit que la formation d’un tueur durait trois jours. La formation est-elle privilégiée sur ce poste par rapport à d’autres ?
M. Jean-Paul Bigard. Cela fait plusieurs années que le bien-être animal a été intégré dans la formation. Il fait l’objet de thèmes écrits pour apprendre à manipuler les animaux. Je rappellerai qu’une formation est dispensée aux chauffeurs chargés de faire monter les animaux dans les camions, et nous avons des référents dans chaque abattoir : leur travail consiste à récupérer l’animal dans le camion, à le faire descendre, à le convoyer au poste d’identification où l’on contrôle les boucles. Ensuite, très souvent lorsqu’il s’agit des gros bovins, il faut les stocker en logettes où il y a systématiquement de l’eau, du foin et de la paille dès lors que le délai d’attente avant l’abattage est de quelques heures. Enfin, il faut conduire l’animal vers le poste d’étourdissement. Ces gens-là n’ont pas besoin d’avoir une formation au couteau, mais ils ont suivi une formation spécifique sur l’attitude à adopter avec l’animal.
Je vous ai dit que nous n’employions pas d’intérimaires à ces postes-là. Il faut en effet des femmes et des hommes qui aiment les animaux, même si c’est pour les conduire à la mort. Chaque semaine, je visite trois ou quatre abattoirs. Je passe toujours par la bouverie, car j’ai plaisir à discuter avec des garçons qui sont dans leur tenue verte ou bleue. Les animaux, c’est leur univers. Et vous ne pourrez pas les faire travailler au poste d’affalage et d’étourdissement ou au désossage. Ils sont avec les animaux, et ça leur va très bien. La formation a été facile à conduire avec ces gens-là, car ils ne sont pas stressés par des cadences. Dans un abattoir qui traite 400 à 500 bovins par jour, il y a une demi-douzaine de femmes et d’hommes à ce poste, et deux équipes se succèdent, de cinq heures du matin à vingt et une heures. Ce sont eux qui gèrent le parc d’animaux. Cela fait deux ou trois ans que nous avons développé ces formations. Je vous concède que ce n’était pas le cas il y a dix ans. On se préoccupait alors de l’affûtage des couteaux ou du mode opératoire, des découpes anatomiques, de la façon de traiter la viande, mais pas de l’amont. Nous ne refusions alors jamais de charger un animal.
M. William Dumas. C’est dans ma circonscription qu’est implanté l’abattoir du Vigan qui traite 320 tonnes et celui d’Alès, qui en traite 5 000, dont beaucoup d’abattages rituels. Vous avez raison, ces abattoirs peuvent subsister grâce aux communautés de communes ou aux communes. Le maire d’Alès que nous avons auditionné nous a indiqué que l’abattoir coûtait entre 300 000 et 500 000 euros par an. Mais il nous a aussi confié que, s’il fermait l’abattoir, tous les éleveurs de cette région des Cévennes devraient se rendre à Valence, puisque l’abattoir de Tarascon est spécialisé dans l’abattage du taureau de Camargue classé IGP. Ce sont les éleveurs eux-mêmes qui amènent, font abattre et découper leurs bêtes à l’abattoir du Vigan : c’est donc un circuit court. Il y a quelque temps, cet abattoir, qui est géré par la communauté de communes, affichait un déficit de 50 000 euros, mais, après un contrôle de la Cour des comptes demandé par la sous-préfète et beaucoup de clarifications, il est aujourd’hui à l’équilibre.
Vous nous avez dit aussi que, dans ces abattoirs, les matériels étaient souvent mal adaptés. Les animaux ne sont pas tous les mêmes…
M. Jean-Paul Bigard. Il n’y a pas de programmation. C’est formidable de travailler à la carte, mais cela coûte cher.
M. William Dumas. Vous avez parlé d’un coût d’abattage de 0,45 euro par kilo.
M. Jean-Paul Bigard. Au maximum !
M. William Dumas. Dans ces abattoirs, les prix ne sont pas les mêmes.
Quel pourcentage – en augmentation constante – représente la viande halal ?
M. Jean-Paul Bigard. C’est très variable selon les établissements. Il y a actuellement un très fort développement des boucheries halal. Est-ce pour servir uniquement les gens de confession musulmane ? Je connais beaucoup de gens qui fréquentent les boucheries halal parce que la viande n’y est pas chère, et je connais surtout beaucoup de bouchers qui cèdent leur fonds de commerce à des boucheries halal. La multiplication des boucheries halal à Paris est effarante ! Il y a deux sur trois, quand ce n’est pas trois sur quatre, de ces bouchers qui ne savent pas compter, et leurs établissements sont régulièrement en situation financière plus que délicate. Leur fournir de la viande, c’est prendre un grand risque. Les impayés font florès. La demande de viande halal est relativement forte et se développe beaucoup plus que le marché de la viande non halal, qui stagne, voire régresse.
Vous avez sans doute vu – elles apparaissent toujours au mois de juillet – les affiches d’Isla Délice et d’autres opérateurs vantant les productions halal. Des marques de steak haché halal ont été lancées. Le phénomène s’étend, c’est indéniable. Le rite halal concerne surtout les bovins mâles, très peu les femelles, ce qui pose d’importants problèmes économiques. Depuis le début du ramadan, il y a quinze jours, les volumes ont doublé.
Mme Sylviane Alaux. Que pensez-vous des abattoirs mobiles, qui évitent le transport des animaux ?
M. Jean-Paul Bigard. Si un modèle existe, et s’il fonctionne dans de bonnes conditions, il faut le dupliquer. Cela évitera de multiplier des investissements dont la rentabilité est plus qu’aléatoire, voire improbable.
J’ai lu la semaine dernière un article de La France agricole sur un modèle d’abattoir ambulant en Suède. Que fait-on des rejets ? Une fois que l’animal est abattu, comment refroidit-on la carcasse ? L’article ne le disait pas. Sans doute y a-t-il là une idée à creuser, mais elle n’est sûrement pas facile à mettre en œuvre au vu des règles sanitaires. Avec un tel outil, on doit rapidement se poser ce genre de questions, et je ne suis pas certain qu’on puisse abattre ainsi un animal dans de bonnes conditions. Quand on en tue un seul dans une cour de ferme, de façon clandestine, c’est assez simple. Mais quand on en abat cinq ou dix, il faut bien rendre des comptes.
M. le président Olivier Falorni. Je précise que nous organisons deux auditions sur ce sujet. Nous recevons demain matin Mme Porcher, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), qui a travaillé sur ce sujet, et un éleveur, représentant du collectif « Quand l’abattoir vient à la ferme ». Nous aurons aussi le retour d’expérience d’une personne qui travaille en lien avec des Suédois où est expérimenté un abattoir mobile, et qui veut importer le procédé.
M. Jean-Luc Bleunven. Je veux revenir sur une question évoquée par William Dumas qui concerne l’état des animaux arrivant à l’abattoir. On constate une augmentation de la taille des élevages, ce qui a une incidence sur le travail de l’éleveur. A-t-on remarqué une amélioration de l’état des animaux ?
Le personnel des abattoirs suit-il une véritable formation de qualité ? Quel est l’état de la formation initiale dans la filière de la viande ?
M. Jean-Paul Bigard. Le programme de formation est très pointu en ce qui concerne la proximité avec les animaux, la conduite du bétail. Nous organisons des cycles de formation, nous avons des feuilles pédagogiques, nous utilisons des caméras. On explique aux gens de manière très concrète ce qu’ils doivent faire pour qu’un animal avance. Il est plus facile de former un opérateur pour s’occuper du bétail que pour désosser les animaux. De nombreux opérateurs sont issus du monde rural. À Castres, à Cuiseaux, à Quimperlé, nous n’avons aucun mal à trouver des porchers ou des bouviers ; c’est plus difficile à Maubeuge. Les veaux sont plus délicats à gérer, parce qu’ils sont un peu fougueux. Quant aux ovins, il suffit qu’ils soient dans un couloir, qu’il y en ait un devant, et les autres suivent.
En ce qui concerne la qualité des animaux, les grandes exploitations présentent moins d’anomalies que les petites structures. Il n’y a aucune corrélation entre la taille d’une exploitation, les volumes traités et la dégradation des animaux. Nous trouvons plutôt des animaux dans de mauvaises conditions sur des cas isolés. Dans les grosses exploitations, il y a un suivi, un contrôle permanent. Les vaches laitières sont moins vieilles qu’à une certaine époque. Quant au cheptel allaitant, on trouve encore dans le centre de la France des animaux âgés de quinze ans et plus – entre 150 000 et 200 000 animaux sont nés avant 2001. Il est temps de détruire ce cheptel s’il n’est pas reproducteur ou s’il n’est pas d’exception. Vous me répondrez que, si ces animaux vivent encore à cet âge-là, c’est parce qu’ils ont été bien traités. Mais cet état de vieillesse qui s’installe à un moment donné est fatigant pour l’animal.
M. Thierry Lazaro. Je ne conteste pas la véracité des images diffusées par l’association L214, mais une vidéo, comme un mot, peut avoir son importance et, sortie de son contexte, elle peut prendre un poids disproportionné. Dans votre propos liminaire, vous avez précisé que vous aviez déjà été l’objet, dans une de vos filiales, Charal, d’un reportage.
M. Jean-Paul Bigard. Oui, à Metz, qui est un outil de catégorie I, un abattage de femelles avait été filmé sans étourdissement, avec saignée à cru. On voit l’animal au bout d’une élingue. Le folklore dure plus d’une minute ; c’est très long. Il faut l’interdire. Aujourd’hui, Charal ne fait plus d’abattage rituel sans étourdissement. L’abattage sans étourdissement d’un bovin femelle est encore plus difficile que celui d’un mâle. L’égorgement d’une vache laitière de race Holstein peut durer deux minutes ; c’est insupportable. Certes, ce reportage rapportait une pratique qui n’était pas bonne, mais il avait été, lui aussi, mis en scène d’une certaine manière, avec des images qui tournaient en boucle. Il est facile de répéter quinze secondes de vidéo : le spectateur, sous le choc des images, n’imagine même pas qu’il voit la même scène trois ou quatre fois de suite. Quand on veut prouver quelque chose, tous les moyens sont bons.
M. Thierry Lazaro. C’est ce qui explique la retenue et la pondération des membres de la commission sur cette question : il n’y a pas de vérité absolue.
Le président de la commission, le rapporteur, quelques collègues et moi-même avons visité avec un grand intérêt votre établissement de Feignies, inauguré il y a quatre ou cinq ans. C’est Fort Knox ! Pour y entrer, il faut vraiment montrer patte blanche et un peu plus que cela, notamment pour des raisons sanitaires. Vous êtes à la tête d’un groupe important qui communique beaucoup – cela fait partie du commerce. Certains de vos confrères, les Danois notamment, ont une politique plutôt ouverte vers l’extérieur. Il ne s’agit pas d’organiser des visites guidées de vos entreprises, mais, comme nous sommes dans une époque où le consommateur a besoin de savoir, il serait bon qu’une politique de communication permette d’éclairer certaines zones d’ombre.
Vous avez employé l’expression « joli bordel », qui a le mérite de la clarté. S’agissant de l’abattage rituel, il ne faut pas se voiler la face : cela représente un véritable enjeu économique. Personne ne conteste qu’il faille respecter les rites, et, à cet égard, notre audition des recteurs des mosquées de Lyon et de Paris, demain, sera intéressante. On sait que les sollicitations ne sont pas les mêmes selon les mosquées. Vous avez rappelé que la France a adopté un système dérogatoire, ce qui n’est pas le cas dans bon nombre de pays européens. Êtes-vous hostile à ce mode dérogatoire ?
M. Jean-Paul Bigard. Chacun doit prendre ses responsabilités. Si nous étions dans un système qui l’interdit, j’en prendrais acte. Or, comme nous sommes dans un système dérogatoire, c’est à nous de régler le problème. Cela dit, la situation est peut-être plus claire en France que dans des pays qui ont interdit l’abattage rituel alors que la pratique perdure. C’est le cas de la Pologne, de l’Allemagne, de l’Angleterre et de l’Irlande. Quand je me rends dans les abattoirs de ces pays, j’aime bien traîner et ouvrir des portes. Je vois tout de suite, grâce à l’allure de la carcasse, que c’est de l’abattage rituel. Au moins, en France, les choses sont claires. Un jour, quelqu’un m’a dit que, dans un pays laïque, chacun se débrouillait comme il pouvait. Je lui ai répondu que la règle, en Europe, étant d’étourdir les animaux, on avait refilé la patate chaude aux abattoirs français. Dont acte : nous réglons le problème. Au moins, en France, il n’y a pas de tricherie, contrairement à ce que l’on voit dans les pays où l’abattage rituel est interdit mais se pratique tout de même.
Il est difficile de communiquer sur le sujet. Je tiens à ce que ces établissements soient des lieux fermés. Vous êtes arrivés à cinq heures quinze à l’abattoir de Feignies. Quand le téléphone a sonné, j’étais à mon bureau. J’ai tremblé, je me suis demandé ce qui se passait. Vous aviez un ordre de mission. J’ai seulement demandé que les caméras n’entrent pas dans l’abattoir. Nous allons fermer l’accès au début des chaînes d’abattage. Il y a quelques semaines, j’étais aux États-Unis, dans l’un des plus gros abattoirs du monde. Nous n’avons plus du tout accès au début des chaînes. C’est Fort Knox. L’acte de mort est totalement verrouillé. Ce n’est pas un spectacle, c’est un acte difficile, même lorsqu’il est bien géré. On voit du sang, on entend du bruit, il y a une odeur. C’est plus impressionnant sur un bovin de 500 kilos que sur un poulet de 1,5 kilo. Il est possible de renforcer encore les règles, mais nous n’avons aucun intérêt à mettre en scène et à ouvrir le début d’une chaîne d’abattage. La première partie de la chaîne d’abattage, c’est-à-dire de la mort de l’animal jusqu’à son éviscération thoracique, abdominale, autrement dit la vidange de l’animal, est délicate à montrer à des gens qui ne connaissent pas. Cela constitue obligatoirement un choc. Du reste, beaucoup de personnes ne veulent pas voir. On peut montrer des carcasses en bout de chaîne, lors de l’inspection sanitaire, mais pas ce qui est en amont.
Il faut s’attacher à définir des règles claires, à les imposer. Les contrôles sont effectués par les services vétérinaires. Ils savent comment cela se passe dans tous les outils. Il ne s’agit pas de leur confier une mission supplémentaire, mais d’intégrer cela dans leur contrôle, dans leur travail. Certains le font très bien – j’ai parlé tout à l’heure de techniciens qui opèrent avec un chronomètre. Pourquoi pas, si cela peut améliorer les budgets et enrichir les effectifs ? Le travail sera sous contrôle, et ce sera bien.
Autant on peut communiquer sur le produit fini, autant c’est compliqué en ce qui concerne la phase amont. Nous constatons aujourd’hui une évolution dans le message et dans l’acceptabilité par le consommateur, ce qui me vaut des échanges vifs et des désaccords de position avec le monde de la production. Il est de plus en plus difficile de faire la corrélation entre un animal et un morceau de viande. Le reportage de Mauléon a fini d’écœurer ceux qui ne l’étaient pas encore. Certains estiment qu’il ne faut plus consommer des agneaux de lait.
Il fut un temps où le monde de l’élevage considérait qu’il fallait montrer une belle Normande, une belle Charolaise pour faire consommer de la viande. Mais, aujourd’hui, il faut partir dans une autre voie. Que l’on montre des animaux, des paysages, pourquoi pas ? Mais on ne peut pas montrer des animaux pour dire au consommateur qu’il va manger de la bonne viande. Bigard, Charal et Socopa investissent des sommes considérables dans la communication. Avec les « Hachés de nos régions », on voit furtivement, pendant une seconde, un troupeau de vaches normandes, mais tout de suite après on parle de viande et surtout pas de ce qui se passe dans l’abattoir.
Il ne faut pas communiquer sur l’amont de la chaîne d’abattage pour expliquer aux consommateurs que tout se passe bien. Il faut agir, prendre des dispositions pour que le travail en amont soit fait et que l’association L214 ou d’autres n’aient plus l’occasion de montrer des choses réelles ou arrangées. Il faut être rigoureux, exigeant et obligatoirement sanctionner si des anomalies sont constatées.
Mme Annick Le Loch. Monsieur Bigard, vous êtes un industriel important, qui réussit, qui est craint quelquefois, dans un secteur d’activité difficile, où les marges ne sont pas toujours très importantes. Vous nous avez parlé de votre métier avec beaucoup de force et de façon très positive. Vous avez dit qu’il y avait une grande stabilité du personnel, que vous employiez des salariés en CDI, et que vous n’aviez globalement pas de problème de recrutement. Vous avez également parlé des investissements considérables que vous réalisez. Vous avez la réputation de ne pas faire appel aux subventions publiques qui sont offertes dans le cadre de programmes d’investissement, notamment par le Gouvernement. Comment faites-vous ? Est-ce grâce à votre modèle économique d’abattoirs, la production aval équilibrant ce groupe industriel que vous dirigez depuis longtemps ? Aujourd’hui, la distribution est toute puissante. Elle a la réputation, comme vous d’ailleurs, de tirer les prix, en tout cas de rechercher le prix le plus bas pour les productions que vous achetez. Est-ce grâce à ce modèle économique que vous conservez cette activité importante pour la France qui compte un nombre considérable de salariés et que vous parvenez à faire des investissements importants et des acquisitions au niveau français ?
M. Jean-Paul Bigard. Effectivement, ce n’est pas toujours facile. Il faut beaucoup de travail et faire les bons choix stratégiques. Une fois que vous avez fait cela, comment progresse-t-on ? La grande distribution est un univers difficile. J’ai été le premier dans la profession et dans la filière agroalimentaire à dire aux distributeurs que je ne les livrerais pas au prix qu’ils me proposaient. Cela m’a coûté cher, mais c’est un peu comme la bombe atomique : vous ne l’employez qu’une seule fois. Je ne citerai pas leurs noms ; vous les connaissez bien. Les distributeurs se disent que, si M. Bigard a sauté le pas une fois, il risque de recommencer et de ne plus les livrer. Effectivement, j’étais capable de faire cela.
Nous avons racheté la société Socopa il y a huit ans. Ma première mesure a été de faire disparaître 15 % du chiffre d’affaires. Je suis moi-même allé voir tous les gros clients et je leur ai dit : « Messieurs, cela ne peut plus durer, ce prix-là ne correspond à rien. On peut trouver une phase d’adaptation, mais voilà le prix auquel nous serons d’ici à deux mois. Si vous n’êtes pas d’accord, nous arrêtons de travailler ensemble ; si vous êtes d’accord, nous trouverons un arrangement. » Ce n’est rien d’autre qu’une réorganisation, une rationalisation dans les services. Ce que je vous dis là concerne la phase aval.
S’agissant de la phase amont, on peut nous critiquer, mais, quand on achète 25 000 bovins par semaine, il faut obligatoirement les acheter au moins aussi cher que nos concurrents. Je rappelle que notre règle d’or a toujours été de payer nos apporteurs à dix jours. C’est certainement l’aboutissement de quarante années de travail. J’ai travaillé pendant vingt ans avec mon père, qui est parti de zéro, à développer une structure qu’il possédait déjà au début des années quatre-vingt-dix, à Quimperlé – je l’avais rejoint en 1975. Pendant une quinzaine d’années, nous avons densifié, comme une entreprise familiale est capable de le faire, en travaillant beaucoup. Nous avions la volonté d’investir, de croître. À l’époque, nous utilisions les possibilités offertes par la collectivité, c’est-à-dire l’État et l’Europe, pour investir, ce qui nous a beaucoup aidés. Ensuite, dès lors que nous avons atteint un certain niveau, nous avons pu passer à de la croissance externe. Nous n’avons pas hésité à racheter des entreprises deux fois et demie plus grosses que nous, avec toujours une exigence, une rigueur, et peut-être une certaine dureté dans l’application des règles avec les fournisseurs, les clients et le personnel. Au début des années quatre-vingt-dix, nous avons eu des problèmes avec la « pause pipi » – cela vous dit certainement quelque chose. Ce fut un épisode épouvantable avec un délégué CGT. Pour ma part, j’ai une méthode : je ne vois jamais la presse, je m’interdis de communiquer. Et j’ai un leitmotiv : le personnel est bien payé et travaille dans de bonnes conditions. Les 5 000 salariés, qui étaient dans le périmètre Socopa et que nous avons repris, trouvent formidable d’être payés sur la base du travail qu’ils font. Je ne sais pas si nous avons un secret : en tout cas, nous ne faisons pas de folies. Nous travaillons beaucoup.
M. le rapporteur. Vous avez été très précis sur la communication avec le grand public. On peut très bien comprendre votre position, qui est assez claire. Mais le public a besoin de confiance, à moins que l’on accepte qu’il soit secoué de temps en temps par un élément extérieur. Vous avez rappelé qu’il y a des règles, c’est-à-dire les contrôles. Je ferai un parallèle entre les abattoirs et les centrales nucléaires dans lesquelles on n’entre pas non plus comme dans un moulin. Tout le monde ne comprend pas ce qui s’y passe, mais cela concerne pourtant chacun d’entre nous. Il existe des commissions locales d’information et de surveillance dans lesquelles siègent quelques interlocuteurs, des professionnels, des élus, des services qui contrôlent, des associations de consommateurs. Ils n’entrent pas nécessairement dans la centrale nucléaire, mais ils échangent autour des rapports d’inspection et servent de garants. Que pensez-vous de cette idée en ce qui concerne les abattoirs ?
M. Jean-Paul Bigard. Elle ne me gêne pas du tout.
M. le rapporteur. C’est une manière d’ouvrir la boîte noire sans faire entrer tout le monde dans l’abattoir.
M. Jean-Paul Bigard. Bien sûr. Je rappelle que c’est l’une des rares activités industrielles sous contrôle des services de l’État. Des centaines de salariés de l’État travaillent à l’intérieur de nos outils ! Ils ne travaillent d’ailleurs pas partout de la même façon… Il n’y a pas d’uniformité dans le travail des services de l’État. Il y a de nombreux contrôles, des rapports sont effectués sur les conditions sanitaires et de sécurité. Nous avons des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités d’entreprise, avec parfois, malheureusement, un mélange des genres. La semaine dernière, sur le site de Quimperlé, nous avons encore eu, pendant trois jours, un audit ISO 14001. Tout s’est bien passé. Si des responsables ont besoin de consulter ce type de document, nous pouvons consacrer deux ou trois heures à expliquer comment nous faisons notre travail, dans un cadre qui ne serait pas fermé totalement, mais pas non plus entièrement public. Notre activité industrielle n’est pas facile, mais on peut s’expliquer.
M. le président Olivier Falorni. Je vous remercie, monsieur Bigard, pour vos réponses à la fois franches et précises.
La séance est levée à vingt heures quarante-cinq.
——fpfp——
27. Audition, ouverte à la presse, de Mme Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), et M. Stéphane Dinard, agriculteur, représentants du Collectif « Quand l’abattoir vient à la ferme »
(Séance du jeudi 16 juin 2016)
La séance est ouverte à neuf heures dix.
M. le président Olivier Falorni. Ce matin, nous abordons le sujet des abattoirs mobiles et de l’abattage à la ferme, qui a soulevé de nombreuses questions lors des auditions précédentes. Ces dispositifs suscitent tout à la fois l’interrogation, l’intérêt, l’enthousiasme et la suspicion. S’ils reposent sur des principes qui ne sont pas contestables – la proximité, la volonté de garder l’animal dans son environnement familier, l’absence de transport –, ils posent de multiples questions en matière sanitaire et environnementale. Rappelons que les abattoirs à la ferme sont interdits en France, excepté pour l’autoconsommation. Ils constituent toutefois un enjeu important car ils peuvent représenter une solution pour l’abattage, notamment dans les territoires ruraux.
Nous recevons Mme Jocelyne Porcher, sociologue, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) à Montpellier. En 2001, vous avez soutenu, Madame, une thèse sur les relations affectives entre éleveurs et animaux pour laquelle vous avez reçu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Vous militez pour des alternatives aux abattoirs actuels tels l’abattage à la ferme ou les abattoirs mobiles. Vous êtes également l’auteure de Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle.
Nous allons également entendre M. Stéphane Dinard, agriculteur en Dordogne où il élève des cochons gascons à pieds noirs, des vaches Dexter et des poulets en plein air. Vous êtes, Monsieur, représentant du collectif « Quand l’abattoir vient à la ferme » qui milite pour une mort plus respectueuse de l’animal à la ferme, par celui qui l’a élevé, et pour la légalisation de cette forme d’abattage.
Je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et retransmises en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale, certaines étant diffusées sur la chaîne parlementaire (LCP).
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Jocelyne Porcher et M. Stéphane Dinard prêtent successivement serment.)
Mme Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie de cette invitation devant votre commission.
Je tiens à préciser que c’est dans le cadre de mes activités de recherche sur les innovations dans l’élevage et dans l’agroalimentaire que j’ai fondé avec Stéphane Dinard le collectif « Quand l’abattoir vient à la ferme ». Il s’agit, pour ce qui me concerne, d’une recherche-action-innovation plus ouverte que les travaux que j’ai menés précédemment sur le même sujet.
D’une manière plus générale, mes recherches portent sur les relations de travail entre humains et animaux en élevage, mais également dans d’autres secteurs de production de biens et de services. Au sein de ces relations de travail, la mort des animaux occupe une place centrale et sa compréhension est un enjeu majeur pour la pérennité de nos liens avec les animaux domestiques. C’est pourquoi elle est l’un de mes objets de recherche les plus anciens.
Je travaille en effet depuis plus de vingt ans à décrypter la place de la mort des animaux dans le travail en élevage et dans les productions animales. J’appelle « élevage » les rapports historiques de travail que nous avons avec les animaux et qui reposent sur de multiples rationalités dont la première est relationnelle. J’appelle « productions animales » les rapports de domination et d’exploitation des animaux engendrés par les scientifiques et par les industriels au XIXe siècle avec l’émergence du capitalisme industriel et qui se poursuivent aujourd’hui dans les systèmes industriels et intensifiés. Conceptualiser les différences entre ces deux types de relations aux animaux et les situer dans leurs dynamiques propres est crucial pour comprendre les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés dans les abattoirs.
J’apprécie d’autant plus d’être auditionnée dans votre commission que j’ai publié en 2014, avec d’autres chercheurs, un ouvrage sur la situation alarmante des abattoirs dits de proximité, Le Livre blanc pour une mort digne des animaux, que nous avons adressé à une centaine de députés et de sénateurs concernés par les questions agricoles.
C’est en nous fondant sur le constat que le visuel médiatique prime beaucoup sur l’écrit que nous avons construit le collectif « Quand l’abattoir vient à la ferme », aujourd’hui très présent sur les réseaux sociaux. Notre démarche est suivie par plusieurs journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Grâce à eux, nos concitoyens peuvent savoir qu’il existe d’autres voies que l’abolitionnisme, autrement dit la rupture de nos liens avec les animaux, ou bien la vaine poursuite du processus d’industrialisation.
L’un des principaux résultats des enquêtes qui ont servi de matériaux à notre livre blanc est le refus de plus en plus marqué de certains éleveurs d’emmener leurs animaux à l’abattoir, petit ou grand, et le choix de les abattre à la ferme, même s’il leur faut pour cela enfreindre la loi. Car, et c’est un paradoxe à considérer de près, pour respecter leurs devoirs moraux envers les animaux, les éleveurs sont contraints de recourir à des pratiques illégales.
J’ai pu remarquer d’autre part, sur le temps long de mes recherches, que la situation, loin de s’améliorer, s’est au contraire considérablement aggravée. Par exemple, entre 2005, date à laquelle j’ai publié un article à propos de l’abattage mobile, et aujourd’hui, la critique des éleveurs sur le fonctionnement des abattoirs industriels s’est étendue aux abattoirs de proximité et leurs positions se sont renforcées. Si en 2005, de nombreux éleveurs pouvaient encore s’arranger pour faire abattre leurs animaux conformément à leur volonté dans le cadre des règles légales, en acceptant de multiples contraintes, de transport notamment, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et un nombre croissant d’éleveurs n’a d’autre choix que d’abattre les animaux à la ferme s’ils veulent leur éviter les souffrances liées au transport et à l’abattage. Comme me l’a dit récemment une éleveuse, « tout nous pousse à désobéir ».
Cette éleveuse a récemment conduit quatre cochons à l’abattoir, dont trois ont été saisis pour myopathie. C’est le signe qu’ils ont été malmenés à l’abattoir car, pour avoir visité sa ferme, je sais comment ils ont été élevés : on ne saurait mieux faire. Ces cochons n’étaient absolument pas préparés à ce qui allait leur arriver. Pour un animal qui a eu une vie aussi bonne qu’elle peut l’être à la ferme, l’arrivée à l’abattoir est en effet une terrible violence tandis que pour un cochon produit dans l’industrie, elle n’est jamais que la suite de ce qui précède. L’obligation de conduire les animaux à l’abattoir génère donc de la souffrance chez les animaux et de la souffrance chez les éleveurs, traumatisés par ce qui arrive à leurs bêtes. Elle génère aussi du gâchis par rapport à la qualité de la viande obtenue par l’élevage.
Je rappelle que l’élevage repose sur une forte relation aux animaux, une relation qui renvoie à une rationalité économique mais surtout à des rationalités relationnelles et morales. Les éleveurs aiment leurs animaux, ils les estiment et ils les respectent. Ils leur ont donné une bonne vie et c’est pour eux un devoir moral que de leur donner une bonne mort. Entre respecter la loi et abandonner leurs animaux à des abattoirs dont ils réprouvent les pratiques et transgresser la loi pour donner une mort digne à leurs animaux, ils sont de plus en plus nombreux à choisir la transgression.
L’objectif de fond de notre collectif est de contribuer à rendre légales ces pratiques illégales qui, quoiqu’elles concernent surtout les éleveurs en vente directe et les circuits courts, sont révélatrices de la souffrance induite chez les animaux mais aussi chez les éleveurs et chez les consommateurs par les process d’abattage en abattoir.
Notre collectif regroupe des éleveurs, des associations de protection animale, des vétérinaires, des associations de consommateurs et des citoyens ordinaires. Nous sommes également en relation avec des bouchers. Nous travaillons sur l’abattage à la ferme dans ses deux formes principales : l’abattage mobile et la construction de locaux dédiés dans la ferme.
Pour ce qui concerne l’abattage mobile, nous faisons un double constat : d’une part, l’existence de difficultés réglementaires, au niveau européen, qui freinent le développement des équipements souhaités ; d’autre part, la forte demande des éleveurs européens en faveur de l’abattage à la ferme – en Autriche et en Allemagne, ils réclament des règlements et une organisation du travail leur permettant de respecter leurs animaux.
Il existe actuellement deux grands types d’abattoirs mobiles.
Il s’agit d’abord des abattoirs mobiles totalement autonomes et capables d’assurer un certain rendement. C’est le cas d’un camion suédois, autonome en eau et en électricité, ou du camion Schwaiger, du nom de l’éleveur autrichien qui l’a conçu. Utilisé en Hongrie, en Californie et en Argentine, mais interdit en Autriche et en France, il est constitué, outre la partie dédiée à la traction, de remorques d’abattage et de remorques frigorifiques.
Il s’agit ensuite des caissons d’abattage, équipements plus légers permettant uniquement l’abattage et la saignée à la ferme. Ces caissons peuvent aussi être un outil complémentaire de l’abattage au pré, comme c’est le cas en Suisse.
Ces divers outils concernent aussi bien les bovins que les moutons ou les cochons. Leur prix va de 2,5 millions d’euros pour l’abattoir mobile suédois à moins de 15 000 euros pour le caisson d’abattage, en passant par 500 000 euros pour l’abattoir Schwaiger. Ils ne sont donc pas accessibles aux mêmes types d’acteurs.
L’abattage dans un local dédié, du même type que les abattoirs de volailles à la ferme, est, quant à lui, d’un coût plus faible. Il intéresse plus particulièrement les éleveurs de petits animaux.
Les freins au développement de ces outils sont d’ordre réglementaires, liés notamment aux aspects sanitaires, mais ils pourraient, à notre sens, être facilement levés grâce à une véritable politique d’aide.
Précisons que ces équipements, loin de concurrencer les abattoirs de proximité, en constituent au contraire le prolongement. L’utilisation notamment du caisson d’abattage, qui ne sert qu’à l’abattage et à la saignée, implique de se rendre rapidement dans un abattoir de proximité pour le traitement de la carcasse.
L’enjeu aujourd’hui pour notre collectif est d’obtenir les moyens réglementaires et financiers qui nous permettront d’évaluer la validité de nos propositions et d’apporter des réponses aux nombreuses questions en suspens.
M. Stéphane Dinard, agriculteur, représentant du Collectif « Quand l’abattoir vient à la ferme ». En tant qu’éleveur, je vous remercie de prendre en considération ma démarche partagée par de nombreux autres éleveurs. J’ai fait le choix depuis 2007 d’abattre mes animaux à la ferme sur leur lieu de vie afin de leur éviter le stress et la souffrance occasionnés par le transport et l’attente, et que je partage avec eux. Je me suis équipé d’une pièce d’abattage et d’un laboratoire pour la transformation avec une chambre froide. Je fais appel aux personnes compétentes pour réaliser l’abattage ainsi qu’à un boucher pour la découpe, ce qui me permet d’assurer aux consommateurs venus acheter ma viande une totale transparence sur la traçabilité.
L’interdiction d’abattre mes animaux dans ma ferme m’empêche de développer correctement mon exploitation et pèse sur la pérennité de mon activité. Je suis donc venu devant vous dans l’attente d’une évolution de la législation. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.
M. le président Olivier Falorni. Vous avez effleuré le sujet, Madame Porcher, mais vous comprendrez bien que notre préoccupation principale porte sur le respect des normes sanitaires et environnementales. Vous avez évoqué des exemples étrangers. Pouvez-vous nous indiquer comment ces normes sont respectées ailleurs ? Qu’en est-il par exemple du camion suédois ? Vous insistez sur la nécessité d’une expérimentation ; encore faut-il que nous ayons des assurances en termes de respect des normes.
Par ailleurs, l’abattage mobile ne va-t-il pas contribuer à renchérir le coût de la viande ? Si oui, qui doit supporter ce surcoût ? Les abattoirs mobiles ont-ils vocation à être rentables ? Doivent-ils être pris en charge par le secteur public ou par le privé ?
Enfin, l’abattage mobile ou à la ferme n’est-il pas condamné à n’être utilisé que pour les petits élevages ? Si ces formes d’abattage étaient légalisées, Monsieur Dinard, quel serait le tonnage annuel envisageable ?
Mme Jocelyne Porcher. Vous posez des exigences sur des équipements qui précisément n’ont pas pu être expérimentés en France… Depuis 2005, j’essaie de poser la question de l’abattoir mobile pour que sa pertinence et son coût soient évalués mais mes tentatives restent vaines. La question du respect des normes sanitaires et environnementales doit être mesurée à l’aune de la situation actuelle des abattoirs industriels. Les visites que j’ai pu faire me laissent circonspecte sur ce point.
M. le président Olivier Falorni. Pouvez-vous nous donner des précisions ?
Mme Jocelyne Porcher. Ce sont des choses connues.
M. le président Olivier Falorni. Nous aimerions avoir votre point de vue…
Mme Jocelyne Porcher. Les animaux sont victimes d’une « violence soft », du fait des cadences extrêmes de travail, qui pèsent aussi lourdement sur la santé des travailleurs : si les troubles musculo-squelettiques sont une réalité connue, les problèmes psychiques ne sont pas du tout pris en compte. Mon expérience en psychologie du travail me fait dire que ces personnes souffrent indéniablement de problèmes psychiques. Elles ont besoin d’être entendues. J’ai rencontré plusieurs d’entre elles qui n’avaient jamais consulté de médecin du travail. Moi qui suis assise derrière un ordinateur, je le vois tous les ans…
Il y a aussi les conditions dans lesquelles les animaux arrivent et sont découpés, à peine morts, et le traitement des carcasses.
M. le président Olivier Falorni. Avez-vous des éléments tangibles prouvant que les normes sanitaires et environnementales ne sont pas respectées ?
Mme Jocelyne Porcher. Une norme peut être respectée sans pour autant apporter du bien-être aux animaux. Par exemple, une exploitation de mille vaches peut utiliser des tapis d’une épaisseur parfaitement conforme.
Dans les abattoirs, ce qui m’a frappé, ce sont les énormes quantités d’eau utilisées. Cette débauche d’eau me paraît aller à l’encontre du respect de l’environnement ; et pourtant aucune norme ne vient régler l’usage de l’eau.
Qui plus est, entre ce que disent les normes et la réalité du travail… Les conditions de travail des employés ont un impact évident sur les conditions sanitaires. La fatigue peut avoir une répercussion directe sur le respect des normes. Il n’y a pas un flic derrière chaque employé. Toute personne s’étant rendue dans un abattoir industriel sait le décalage entre ce qui est prescrit et ce que les gens font réellement.
Cela étant, le niveau d’exigence pour les abattoirs mobiles ne peut être du même ordre que pour les abattoirs industriels : on n’est pas dans le même monde. Il faut adapter les exigences au contexte.
Quant au coût de la viande, il faut bien voir qu’il est minoré dans le système industriel : il est pris en charge par la communauté. A priori, un poulet industriel a un prix très bas, mais est-ce vraiment de la viande ? Tué à quarante jours, il est avant tout constitué d’eau et de résidus de produits médicamenteux. Si l’on fait le calcul à partir des seules matières sèches, une viande issue d’un élevage comme celui de Stéphane Dinard est proportionnellement moins chère. À cela s’ajoutent le coût environnemental de l’exploitation industrielle avec la pollution des eaux et les dommages sur la santé des travailleurs.
Enfin, je considère que les abattoirs relèvent du service public : il faudrait viser l’équilibre plutôt que la rentabilité. C’est d’ailleurs un des plus gros problèmes des abattoirs de proximité : comment peut-on leur imposer une exigence de rentabilité alors qu’il s’agit d’un service rendu aux petits élevages ?
M. le président Olivier Falorni. Monsieur Dinard, l’abattage mobile n’est-il pas condamné à n’être réservé qu’aux petits élevages ? Quel tonnage annuel serait envisageable si cette forme d’abattage était légalisée ?
M. Stéphane Dinard. S’agissant du tonnage, je n’ai pas de réponse. L’abattage mobile peut être utilisé également dans les élevages de taille moyenne car ils n’ont pas à abattre des animaux chaque jour. Je suis persuadé qu’il s’agit d’un outil complémentaire et qu’il serait très utile là où les infrastructures manquent. Il faut le mettre en place à titre expérimental pour évaluer sa pertinence. Tant que l’expérience ne sera pas lancée, il n’est pas possible de se prononcer.
M. le président Olivier Falorni. La mise en place d’abattoirs mobiles ne mettrait-elle pas en péril certains abattoirs de proximité et donc les emplois qui y sont attachés ?
M. Stéphane Dinard. Je les vois avant tout comme des outils complémentaires par rapport aux abattoirs de proximité, souvent en difficulté. Ceux-ci pourraient être reconvertis en salle de découpe avec des frigos où opéreraient des bouchers à disposition des éleveurs. Cela éviterait à chaque éleveur de se doter d’un laboratoire pour transformer la viande. Autrement dit, il faudrait repenser le fonctionnement des outils, parallèlement à l’activité de l’abattoir mobile qui passerait dans les fermes. Du coup, je pense que ce serait plutôt l’inverse de ce que vous redoutez : ce pourrait être créateur d’emplois.
Mme Sylviane Alaux. J’entends bien vos arguments. Certains éleveurs, très attachés à leurs animaux, ont du mal à les conduire à l’abattoir, dites-vous. Je me demande toutefois si cette vision un peu angélique ne vaut que pour un très petit nombre : la transformation de l’animal en viande de consommation est la finalité même de tout élevage.
Par ailleurs, vous avez évoqué les opérateurs des abattoirs et leurs problèmes psychiques. Il faut rappeler les difficultés de recrutement et le manque de formation mais aussi la présence des services vétérinaires qui apporte une certaine garantie dans l’encadrement, même si tout n’est pas parfait.
Faire venir l’abattoir à la ferme paraît être une solution très séduisante. On imagine le stress de l’animal, arraché à la tranquillité de son pré, subissant toutes sortes de nuisances pendant son transport. Toutefois, ne pensez-vous pas que tout cela sera très compliqué à mettre en place et à sécuriser ? Je reste dubitative, malgré les réponses que vous avez apportées à notre président. J’aimerais avoir des précisions supplémentaires.
M. Stéphane Dinard. Nous sommes effectivement très attachés à nos animaux, nous les aimons, nous les respectons, nous passons tout notre temps avec eux, depuis leur naissance à la ferme jusqu’à l’abattage. Ce qui me pose problème, ce n’est pas la mise à mort d’un animal que j’ai élevé, mais le stress qu’il va subir, du chargement dans le camion de transport jusqu’à l’attente dans l’abattoir. Il va quitter le champ où il est né pour se trouver confronté à un lieu totalement inconnu et néfaste. Pour moi, il est douloureux d’abandonner mes animaux. Que l’abattoir vienne à la ferme change tout : cela permet de leur épargner tous ces moments. Je considère que mon travail, c’est de les élever et de les accompagner jusqu’à la fin de leur vie, dans les meilleures conditions possibles. Quant à la finalité, je la connais : ce sont des animaux de consommation. Personnellement, cela ne me pose pas de problème. Mon travail est de les amener dans les meilleures conditions jusqu’à cette étape, pour en faire des animaux de consommation de bonne qualité.
Mme Sylviane Alaux. Qui s’occupe de l’abattage ?
M. Stéphane Dinard. Je fais appel à des personnes compétentes de manière que l’abattage soit fait dans de bonnes conditions.
Mme Sylviane Alaux. Comment est déterminée la compétence de ces personnes ?
M. Stéphane Dinard. Ce sont des gens du métier. Ce serait manquer de respect aux animaux que d’improviser leur mise à mort. De la même manière, même si je suis capable de le faire, je confie la découpe à des bouchers professionnels.
Mme Sylviane Alaux. J’aurai une dernière question qui porte sur la préservation de l’environnement : comment traitez-vous les rejets de cette unité mobile ?
M. Stéphane Dinard. Il y a très peu de rejets. Prenez les cochons : une fois les ongles et les poils enlevés, il ne reste plus grand-chose à jeter ; le peu qui reste part à la poubelle. Si ces abattoirs étaient légalisés, il pourrait être envisagé, comme cela se fait pour les chasseurs, de mettre en place des poubelles dédiées à ce type de déchets, ramassées par les services d’équarrissage. La France dispose d’ores et déjà de toute la technologie et des équipements pour que le système fonctionne dans de bonnes conditions, comme chez nos voisins européens.
M. le président Olivier Falorni. Pratiquez-vous l’étourdissement ? De quelle façon ?
M. Stéphane Dinard. Oui, je pratique l’étourdissement à l’aide d’un pistolet de calibre 22. Je sais que sur internet, il est possible de se procurer des pistolets d’abattage de type matador qui permettent de neutraliser l’animal.
M. Hervé Pellois. J’ai une question d’ordre juridique. L’abattage mobile est autorisé en Hongrie, en Suède, mais pas en France ou en Autriche. Ces distorsions sont-elles compatibles avec la législation européenne ?
Par ailleurs, j’aimerais en savoir plus sur le déroulement concret de l’abattage dans votre ferme et avoir une description précise de ces fameuses unités mobiles que personne ici n’a jamais vues. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
M. le président Olivier Falorni. Oui, pourriez-vous nous décrire le fonctionnement de ces abattoirs mobiles ?
M. François Pupponi. Une unité mobile, vous pouvez venir en visiter une à Sarcelles quand vous voulez…
Mme Jocelyne Porcher. Notre collectif est entièrement composé de bénévoles ; nous n’avons pas de juristes, À notre connaissance, même si l’abattage mobile est interdit en Europe, il existe des dérogations. En Hongrie, les propriétaires d’un camion Schwaiger sont ainsi en voie d’obtenir un agrément européen.
Comme je le disais, il existe plusieurs types d’abattoirs mobiles. Le camion suédois, le plus lourd, est complètement autonome : il a ses réserves d’eau, ses compartiments frigorifiques, des palans pour manipuler les animaux, les réserves pour les déchets. C’est ce qui explique qu’il soit très coûteux. Pour ce qui concerne le camion Schwaiger, vous trouverez de plus amples renseignements dans le livre blanc que nous avons publié et que je tiens à votre disposition – un court article lui est consacré.
M. Stéphane Dinard. Je vais répondre aux questions sur le déroulement concret de l’abattage dans ma ferme. L’animal est étourdi sur son lieu de vie, puis amené une trentaine de mètres plus loin dans la pièce d’abattage où il est saigné puis préparé pour être conservé directement en chambre froide. Je l’ai moi-même réalisée, avec une petite charpente en bois, des bacs acier, du carrelage au sol, l’eau et le palan, bref, tout ce qu’il faut pour préparer un cochon.
Le camion suédois a une capacité d’abattage d’une quarantaine de bovins à la journée. Il est totalement autonome et n’a pas besoin d’être raccordé à l’eau ou à l’électricité. Il peut être stationné au milieu d’un champ et mener ses opérations.
Pour le caisson d’abattage, tel qu’il est utilisé en Autriche, il faut ramener la carcasse de l’animal abattu sur place dans un délai d’une heure à l’abattoir. C’est une manière, là encore, de travailler avec les abattoirs locaux, sans qu’il y ait de concurrence.
M. William Dumas. Je dois dire, Madame Porcher, que je trouve très bizarre que certains opérateurs d’abattoir ne voient pas le médecin du travail. Peut-être est-ce un cas très particulier que vous avez rencontré. Tous les salariés doivent se rendre régulièrement chez le médecin du travail. Par exemple, les attachés qui travaillent pour moi ont une visite tous les deux ans. Et je sais, pour bien connaître le milieu agricole, qu’il en va de même pour les ouvriers agricoles.
En utilisant des abattoirs mobiles, vous transgressez la loi. Cela pose un problème sanitaire, me semble-t-il. Qu’en est-il du respect des normes ?
En outre, il apparaît que la méthode du caisson mobile induit un très fort renchérissement puisque celui-ci doit être transporté jusqu’à la ferme puis de la ferme à l’abattoir.
M. Stéphane Dinard. Mes animaux ne passent pas par l’abattoir. Ils sont abattus puis transformés sur place. Je citais l’exemple autrichien.
M. William Dumas. Mais vous n’avez aucune autorisation.
M. Stéphane Dinard. Aucune.
M. William Dumas. Cela implique donc qu’il n’y a aucun contrôle sanitaire.
M. Stéphane Dinard. Il n’y a aucun contrôle extérieur, mais les personnes qui viennent travailler chez moi veillent au bon déroulement des opérations. Comme cette pratique n’est pas autorisée, je ne peux pas aller voir un vétérinaire pour faire les vérifications.
M. William Dumas. Je considère que vous prenez des risques énormes.
M. Stéphane Dinard. Je ne refuse en aucune façon les contrôles. Des vétérinaires viennent chaque année dans mon exploitation pour les actes de prophylaxie. Simplement, il ne m’est pas possible, en l’état actuel de la législation, de leur demander de contrôler aussi l’abattage. Et si nous sommes devant vous aujourd’hui, c’est pour que la loi soit modifiée. Nous n’avons aucune intention de transgresser quelque règle que ce soit : nous disons simplement qu’il y a un vide juridique qui ne nous permet pas de faire ce que nous estimons moral pour nos animaux et pour nous-mêmes.
Mme François Dubois. Je n’irai pas jusqu’à dire que ce que vous faites est inquiétant, mais il est sûr que cela pousse à s’interroger : vous travaillez tout de même plus ou moins dans la clandestinité. Je sais que vous avez fait ce choix parce que vous aimez vos animaux : vous les avez vus naître, vous les avez élevés. Je comprends vos motivations, nous avons tous eu le cœur serré en croisant des camions de transport de bétail sur la route. Je ne doute pas que vous les abattiez dans de bonnes conditions, et vous n’avez probablement aucune difficulté à écouler toute votre marchandise. Les consommateurs aiment venir acheter à la ferme, cela a un côté bucolique. Le problème, comme le souligne William Dumas, c’est que vous prenez des risques. Vos clients ne peuvent avoir aucune garantie quant au respect des normes sanitaires. Y a-t-il d’abattoirs à la ferme en France ?
M. Stéphane Dinard. Depuis que j’ai rencontré Jacqueline Porcher, plusieurs réunions ont été organisées par notre collectif. Il y a eu notamment un colloque à Strasbourg en 2013. J’ai été amené à rencontrer dans différents coins de France des éleveurs qui pratiquent l’abattage à la ferme. Seulement, ils ne l’affichent pas comme je l’affiche.
Mme François Dubois. Autrement dit, tout le monde le sait, mais tout le monde ferme les yeux.
M. Stéphane Dinard. Je ne sais pas si tout le monde ferme les yeux.
Concernant la vente, étant donné mes choix dans ma façon de travailler, je ne peux proposer mes produits qu’à des personnes consentantes. Je ne vais pas sur les marchés, je ne démarche pas les restaurateurs ou les bouchers. Je ne vends qu’à des particuliers qui approuvent ma manière de travailler, qui connaissent ma ferme et les raisons de mes choix. C’est la seule voie par laquelle j’écoule ma production. Ce n’est pas suffisant : je ne peux pas développer mon activité et augmenter les volumes de manière à pouvoir vivre de mon travail.
Mme Jocelyne Porcher. Dans mon travail, je rencontre un grand nombre d’éleveurs qui pratiquent un abattage à la ferme de petits animaux. Ils ne le disent pas, seuls leurs clients le savent. Pour les consommateurs, le produit que vendent ces éleveurs est 100 % traçable. On ne peut pas faire plus traçable : le consommateur connaît l’éleveur, il va à la ferme, il peut être là le jour de l’abattage s’il le souhaite.
Mme Françoise Dubois. Acceptez-vous la présence des consommateurs lors de l’abattage ?
M. Stéphane Dinard. Absolument.
Mme Jocelyne Porcher. J’ai noté que de nombreux consommateurs sont intéressés par l’abattage à la ferme. Beaucoup d’éleveurs le font déjà et beaucoup d’autres en ont l’intention parce que l’abattoir tel qu’il est ne leur convient pas – et depuis les vidéos de L214, c’est encore pire ; certains éleveurs n’avaient pas idée que l’on puisse traiter leurs animaux de cette manière, ils en ont eu des cauchemars.
L’éleveuse que j’ai citée, a été obligée d’amener quatre cochons très bien élevés, heureux pendant toute leur vie, dans un abattoir où ils ont dû avoir extrêmement peur pour que la viande ait été à ce point dégradée. Elle en a pleuré. Elle a abandonné ses animaux à un système qu’elle réprouve. Cela constitue une violence énorme contre les éleveurs. Ce système a tenu jusqu’à présent par déni de la relation affective que vous avez soulignée et sur laquelle j’ai travaillé dans ma thèse. Or cette relation affective est le ciment de l’élevage. C’est cela qu’il faut prendre en compte, et qui justifie la demande d’abattoirs à la ferme.
Mme Françoise Dubois. Vous avez souligné, Mme Porcher, le décalage entre les prescriptions et la pratique dans les abattoirs. Est-ce dû à la cadence ?
M. Stéphane Dinard. Mon élevage représente de tout petits volumes.
Mme Françoise Dubois. Les dérapages qu’on a pu observer sont sans doute liés à la cadence et à l’affolement des animaux du fait du nombre. En outre, la formation du personnel n’est pas toujours vérifiée dans les abattoirs. Monsieur Dinard, vous dites faire appel à du personnel qui serait plus qualifié que certains employés des abattoirs. Pouvez-vous nous le confirmer ?
M. Stéphane Dinard. Ces professionnels n’ont pas les mêmes impératifs, ni la même démarche. Une personne qui travaille dans un abattoir a des cadences à respecter alors que la personne que je sollicite vient pour abattre un cochon. Ce n’est pas du tout le même travail, ni la même relation. Cela n’a rien de comparable.
Mme Jocelyne Porcher. Stéphane fait appel à des personnes compétentes, tueurs et bouchers ; les éleveurs ont constaté que les abattoirs emploient des gens qui ne connaissent absolument pas le travail et qui sont formés à vitesse grand V.
Mme Françoise Dubois. Nous ne souhaitons pas jeter l’opprobre sur ces personnes.
M. Stéphane Dinard. Nous non plus.
Mme Françoise Dubois. Ce sont des gens qui cherchent du travail, qui en trouvent un et qui font ce qu’on leur demande. Il y a sans doute un problème de formation en matière de bien-être animal, qu’il est possible de corriger.
Mme Jocelyne Porcher. Certaines personnes se retrouvent dans les abattoirs sans connaître le métier, sans même avoir de relation à l’animal. Or, pour tuer un animal, il faut avoir une relation avec lui ; c’est un paradoxe, mais il ne faut pas détester les animaux. Un tueur qui détesterait les animaux ferait un travail nul. Ces employés sont débordés psychiquement. L’absence de formation a un effet négatif sur eux, ce qui peut conduire à des comportements inadmissibles, faute de pouvoir penser son propre travail. Ils ne comprennent pas ce qu’ils font ni pourquoi ils le font.
Mme Françoise Dubois. J’imagine qu’on ne fait pas ce métier par plaisir. Certaines personnes peuvent déraper parce qu’elles ne maîtrisent plus ni leurs pulsions ni l’animal.
M. le président Olivier Falorni. Madame Porcher, vous n’avez pas répondu à la question de William Dumas. Vous avez affirmé qu’un certain nombre de salariés dans les abattoirs ne voyaient jamais la médecine du travail. Pouvez-vous étayer cette affirmation qui nous interpelle tous ?
Mme Jocelyne Porcher. Lors de mes enquêtes dans des abattoirs, j’ai rencontré des travailleurs qui m’ont dit n’avoir jamais rencontré la médecine du travail. Je ne peux pas dire plus ; je n’ai pas fait de statistiques. J’ai été très étonnée moi aussi, mais on mesure là le fossé entre ce qui se passe réellement dans les abattoirs et ce qui est prescrit. Bien sûr, il y a des normes, on est supposé faire ceci ou cela, mais les choses ne se passent pas comme c’est prévu. Certaines personnes peuvent parfois ne pas être employées dans le bon registre sans que les ressources humaines en soient conscientes.
M. le président Olivier Falorni. Je dois avouer que cela nous laisse pantois.
M. William Dumas. Je ne comprends pas, car les abattoirs sont contrôlés.
Mme Jocelyne Porcher. Regardez les vidéos de L214 : cela non plus, ce n’est pas normal… Des tas de choses ne sont pas normales dans les abattoirs. C’est pour cela que nous en sommes là. Cela ne devrait pas arriver.
M. William Dumas. Une telle situation ne peut pas durer des années !
Mme Jocelyne Porcher. Je ne pense pas que la personne qui m’a dit cela était employée à l’abattoir depuis vingt ans. Il ne s’agissait pas de vieux travailleurs.
M. François Pupponi. Je suis impressionné car c’est courageux de la part des éleveurs de dire ici ce qu’ils font, même si c’est à la limite de la légalité. Mais je sais qu’ils sont nombreux à pratiquer cette forme d’abattage qui est intelligente, respectueuse pour l’animal, pertinente sur le plan économique – le circuit court – et financièrement intéressante pour l’éleveur. Or, ils sont obligés de le faire, pour certains clandestinement, pour d’autres officiellement. Je pense qu’il faut les entendre parce qu’ils proposent une piste de réflexion pour notre commission.
Nous avons un abattoir mobile à Sarcelles depuis deux ans, qui fonctionne très bien. Au moment de l’Aïd, on tue 2 000 moutons en trois jours, au vu et au su de tout le monde, sous le contrôle des services vétérinaires. L’abattoir est ouvert, les gens voient leur mouton vivant et ils repartent huit minutes après avec la carcasse. Cela se passe à vingt minutes de Paris début septembre, je vous y invite pour une journée expérimentale. C’est propre, c’est contrôlé, tout le monde est content, ce n’est pas très cher et c’est très efficace. Cela permet de développer une activité économique au plus proche des personnes.
Le responsable de l’opération doit aller recruter pendant trois jours cinq Gallois – ce sont les plus efficaces, paraît-il. Tout est mécanisé, c’est assez impressionnant : ils tuent l’animal, ils le basculent dans une chaîne mécanique où il est dépouillé et éviscéré, tout le monde voit ce qui se passe. Cela me paraît être une solution intelligente, peu coûteuse, efficace, respectueuse pour l’animal et pour l’hygiène. Nous sommes deux ou trois villes à faire cela en France.
M. Stéphane Dinard. Je savais que des outils avaient été mis en place pour l’abattage des moutons, notamment pour la fête de l’Aïd. Cela démontre que cet outil fonctionne. On aurait tort de s’en priver.
M. le président Olivier Falorni. Que devient l’abattoir mobile le reste de l’année ?
M. François Pupponi. Il est stocké… On ne le sort qu’une fois par an.
Mme Françoise Dubois. Au Mans, un abattoir qui était désaffecté est ouvert une fois dans l’année pour la fête de l’Aïd. Cela permet de mieux maîtriser l’abattage rituel.
M. le président Olivier Falorni. Nous parlons d’un abattoir mobile, c’est-à-dire d’un abattoir qui se déplace dans les fermes.
M. Stéphane Dinard. Pour rebondir sur les propos de Madame, l’existence d’un abattoir mobile pourrait permettre de transformer l’abattoir qui ne fonctionne qu’une fois par an en salle de découpe à disposition des éleveurs. Le camion abattoir tournerait de telle sorte que les éleveurs des alentours puissent abattre leurs animaux dans de bonnes conditions. L’abattoir désaffecté serait ainsi réutilisé pour une autre fonction ; le camion abattoir serait le complément des structures existantes qui ne sont plus utilisées. Le coût d’installation d’un laboratoire pour réaliser la transformation à la ferme est difficile à assumer pour de petits élevages.
M. Guillaume Chevrollier. Je voudrais seulement exprimer une réflexion : nous sommes à l’Assemblée nationale, là où on fait la loi. Or, vous venez nous dire que vous travaillez dans l’illégalité, et vous mettez en cause ceux qui travaillent dans la légalité selon un autre modèle, industriel certes, mais que la société a voulu à un moment donné. Vous pointez les irrégularités qu’ils commettent, les cadences et le personnel maltraité. Ce n’est pas une bonne façon de poser un débat qui peut par ailleurs être légitime sur l’intérêt des abattoirs mobiles, non pas en opposition mais en complémentarité des abattoirs industriels, pour répondre à une autre demande d’une partie de nos concitoyens.
Des agriculteurs dans ma circonscription m’ont fait valoir l’utilité de développer l’abattoir mobile, mais davantage en complément. Les industriels investissent de manière significative pour intégrer le bien-être animal. En dépit de cadences soutenues, si l’outil industriel est bien organisé, les animaux, comme les personnels, peuvent être bien traités.
Il faut se garder de tout débat manichéen, comme vous l’avez posé de façon un peu militante.
Mme Jocelyne Porcher. Je ne veux pas me répéter, mais je pense que si nous en sommes là aujourd’hui, c’est justement parce que dans les abattoirs industriels et dans les abattoirs de proximité – l’abattoir de proximité, et c’est là le problème, est en fait un petit abattoir industriel, avec une organisation du travail similaire – se pose un grave problème d’organisation du travail, de traitement des animaux et de durabilité de l’élevage.
Le choix des éleveurs comme Stéphane, qui ne veulent pas emmener leurs animaux dans les abattoirs – vous dites que le bien-être animal est assuré ; il n’empêche que, pour ces éleveurs, il ne l’est pas de manière suffisante –, met en cause leur rapport à la loi. Ils prennent des risques importants car leur rapport moral aux animaux est plus fort que leur souci de respecter la loi. À ces éleveurs qui font un choix moral très fort en privilégiant le rapport aux animaux, il faut offrir des alternatives ; à défaut, un grand nombre d’entre eux vont disparaître. S’ils ne peuvent plus faire ce qu’ils font, certains arrêteront, ils ne mettront pas leurs animaux à l’abattoir, connaissant la façon dont sont traités leurs animaux.
Les normes de bien-être animal, qui peuvent être respectées dans un grand abattoir industriel, ne suffisent pas pour un éleveur qui veut voir ce qui arrive à ses animaux – il veut pouvoir rentrer dans l’abattoir, accompagner ses bêtes, ne pas les abandonner. Pour les éleveurs, il s’agit d’un enjeu moral. Il en va de même pour les consommateurs qui ne veulent plus ce rapport violent aux animaux ; ils demandent à pouvoir manger de la viande en étant assurés de ne pas être des criminels…
M. le rapporteur. Je ne m’étendrai pas sur l’aspect militant de la démarche. J’ai appris au cours moyen première année que chacun est libre et responsable. Nous sommes ici dans la maison où nous faisons la loi et vous comprendrez que nous ne puissions pas trop commenter le choix militant de ne pas la respecter. Je vais donc me cantonner à l’objet technique de notre audition qui est de réfléchir sur les moyens et la pertinence d’offrir une alternative au modèle de l’abattoir fixe.
Vous avez souligné à juste titre, nous le pensons tous, que l’abattoir mobile permet de supprimer l’étape du transport et les opérations connexes – chargement, déchargement, etc., qui sont par ailleurs soumises à des normes, respectées le plus souvent, parfois non, et contrôlées. Il est certain qu’en supprimant le transport, on supprime un certain nombre d’aléas qui peuvent affecter le bien-être animal. C’est ce qui explique l’intérêt de notre commission pour l’idée de rapprocher l’abattoir du lieu d’élevage.
Vous avez dit, Madame Porcher, qu’on ne peut pas imaginer un policier derrière chaque travailleur pour expliquer les dérives par rapport à la règle relevées dans les abattoirs. Il en va de même pour l’élevage : je suis un élu rural, j’ai une culture agricole et je peux vous assurer qu’il y a aussi des petits élevages dans lesquels les animaux ne sont pas bien traités. Nous sommes bien dans la recherche d’une relation de confiance globale entre un éleveur, un consommateur et plus généralement une société.
Dans le modèle de l’abattoir mobile, on réduit la distance avec l’animal, mais le consommateur reste à 80 % urbain. Le modèle économique que vous développez est celui de la proximité du consommateur qui peut se rapprocher du lieu de production de la viande qu’il va consommer. Ce n’est pas donné à tout le monde. La traçabilité d’un abattoir mobile ne va-t-elle pas connaître une interruption ? Une fois que l’abattoir quitte la ferme avec les carcasses, peut-on rentrer dans le cycle normal de la boucherie classique ou est-on cantonné à une consommation directe ? Est-on limité au circuit court ou peut-on regagner le circuit de la boucherie ? Les volumes ne sont pas du même ordre.
M. Stéphane Dinard. Les deux options sont possibles. Un boucher ou un restaurateur peuvent acheter les carcasses. La viande peut rejoindre le circuit classique, bien sûr.
Mme Jocelyne Porcher. Nous avons discuté avec deux grands bouchers – notamment M. Le Bourdonnec – qui sont très intéressés par l’abattoir mobile dans la mesure où ils sont dans une recherche d’excellence.
M. le rapporteur. Où ce boucher achèterait-il ?
Mme Jocelyne Porcher. Il achète aux éleveurs.
M. le rapporteur. Il achète un animal vivant ?
Mme Jocelyne Porcher. Il achète un animal vivant, mais qui pourrait être tué à la ferme dans un abattoir mobile.
M. Thierry Lazaro. J’éprouve une allergie assez profonde à la grande distribution, mais, comme tout le monde, une partie de ce que je consomme en provient. Nous recevions hier un major de la viande et de l’abattage avec Monsieur Bigard. On est là dans le gigantisme, on ne peut pas le contester, mais cela fait partie de la société.
Je rejoins ce que mon collègue Chevrollier a dit : il y a un côté militant dans votre démarche. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons mais pour essayer de se comprendre. Je ne sais pas si le militantisme est la meilleure formule pour convaincre le plus grand nombre.
À l’aube des années 2050, nous serons 70 ou 75 millions de Français. Nous observons une baisse de la consommation de la viande, mais elle sera probablement compensée par la hausse de la population. Le système industriel n’est certainement pas le meilleur mais, de facto, il existe.
L’opposition permanente entre les deux modèles – c’est cela, le militantisme – me chagrine un peu. L’abattoir mobile peut être une des réponses mais il n’est pas l’unique réponse. Notre rôle est d’examiner si les abattoirs répondent au problème qui est le nôtre aujourd’hui, la maltraitance animale. Comme William Dumas le rappelait, des abattoirs petits et moyens contribuent au fonctionnement économique et social de certaines de nos contrées.
Je me demande si, plus qu’une alternative, l’abattoir mobile n’est pas plutôt un complément. Les mentalités évoluent, c’est vrai – je pense aux « vegans » –, mais on est loin d’avoir changé. Pour ce qui me concerne, je suis un amateur de viande, je préfère une viande de qualité, c’est une évidence, je préfère savoir que la bête a bien vécu. Certaines personnes, quel que soit leur parcours, ont un respect profond pour l’animal, mais d’autres pas du tout.
En essayant de mettre de côté l’aspect militant, je voulais savoir si vous ne voyez pas plus un complément qu’une alternative dans l’abattoir mobile.
Mme Jocelyne Porcher. On ne peut pas penser que les systèmes de production industriels des animaux et les abattoirs qui vont avec vont disparaître du jour au lendemain, ni que la majorité de la consommation ne va plus passer par la grande distribution. Nous voudrions pouvoir tester la validité de la solution de l’abattoir mobile en le faisant fonctionner en grandeur réelle dans une région pour recueillir d’autres résultats que ceux des Suédois, des Autrichiens, des Hongrois, des Californiens, obtenus dans un contexte à chaque fois différent. Il faut offrir des alternatives aux différents types de consommateurs : les personnes qui achètent en grande surface, celles qui fréquentent les magasins Biocoop ou celles qui vont chez les producteurs. Il faut que chaque consommateur puisse avoir accès au produit qu’il désire, qui correspond à ses valeurs morales notamment. L’élevage est une question morale.
Je le répète : je défends un point de vue, mais je fais un travail scientifique. Je ne suis pas militante ici. Je sais que cela peut paraître étonnant, mais je défends mes résultats de recherche. Je rapporte ce que m’ont dit les éleveurs et les travailleurs d’abattoir que j’ai rencontrés. Ce n’est pas moi qui le dis ; je ne fais que rendre compte de mon travail de recherche. Je ne suis pas plus militante que mes collègues qui travaillent pour le système industriel. Ils ne sont pas militants, mais moi non plus. Je rapporte ce que j’entends, de ce que je vois et de ce que je comprends. Je suis sociologue. Les résultats en sociologie ne sont pas de même nature qu’en biologie. On entend quelqu’un souffrir, on le reconnaît et on cherche à comprendre pourquoi.
M. Stéphane Dinard. Je suis d’accord avec ce que vient de dire Monsieur Lazaro. À l’heure actuelle, l’abattoir mobile n’est pas en capacité d’absorber la demande industrielle. Trente-quatre millions d’animaux sont abattus chaque année en France, répartis sur moins de 300 abattoirs, de mémoire…
Mme Jocelyne Porcher. Il y a 283 abattoirs.
M. Stéphane Dinard. Ce ne sont pas quelques camions qui y suffiront.
Mme Françoise Dubois. La sociologie n’est pas une science exacte. Comment pouvez-vous évaluer la souffrance ? Estimez-vous que l’animal souffre dans les abattoirs traditionnels ? Cette souffrance est-elle due à la cadence, à l’attente, au transport ? Plusieurs paramètres peuvent expliquer la souffrance de l’animal. Les animaux sont-ils suffisamment réfléchis pour souffrir ?
Mme Jocelyne Porcher. Il faut d’abord distinguer la souffrance et la douleur sur laquelle travaillent mes collègues de l’INRA.
En tant que sociologue, je m’intéresse à la souffrance des humains et des animaux. La souffrance est subjective : face à un même fait, on n’éprouve pas la même souffrance.
Pour penser la souffrance des animaux à l’abattoir industriel, il faut la relier à ce qui se passe en amont, c’est-à-dire à la production industrielle. Pour moi, les animaux souffrent de leur naissance à leur mort dans le système industriel. C’est un système violent qui ne tient aucun compte de la subjectivité des animaux : le seul but est de produire le plus vite possible, le moins cher possible. Les animaux sont maltraités dans le système de production, ils sont toujours maltraités à l’abattoir, mais c’est un seul et même processus.
Mme Françoise Dubois. Peut-être que ces animaux souffrent moins à l’abattage ?
Mme Jocelyne Porcher. Exactement, je l’ai moi-même constaté à l’occasion d’enquêtes auprès des travailleurs d’abattoir ; je regardais un quai de déchargement et j’ai vu une truie assise sur son cul qui regardait ce qui se passait. Tous les animaux étaient comme des piles parce qu’ils venaient d’être déchargés en sortant des élevages industriels. Visiblement, elle n’en sortait pas : elle n’avait pas peur, elle était tout simplement étonnée. Son comportement a changé à partir du moment où le salarié est venu la pousser, sans violence, avec un bâton en plastique, pas un bâton électrique : c’est là qu’elle s’est effrayée. Un animal qui vient de l’élevage de Stéphane et qui se retrouve à l’abattoir est totalement perdu ; il n’a pas été habitué à ce type de relation avec les humains. C’est pour cette raison que les éleveurs sont malheureux d’abandonner leurs animaux, c’est parce qu’ils savent que leur animal va être perdu. Et cette pauvre truie était totalement perdue.
M. Stéphane Dinard. Un animal élevé dans un système industriel n’aura pas le même comportement en arrivant à l’abattoir qu’un animal élevé en plein air. L’animal industriel est habitué à être élevé en milieu clos, il est familiarisé avec la lumière artificielle, il ne va pas être surpris d’arriver sur un quai de déchargement. En outre, ce ne sont pas les mêmes durées d’élevage. Dans mon élevage, un cochon est élevé plus d’un an ; dans le milieu industriel, les délais d’élevage sont beaucoup plus courts. Ils n’ont pas la même vie, donc ils n’ont pas le même comportement à l’abattoir.
Mme Françoise Dubois. Avez-vous pu mesurer une différence de degré dans la souffrance entre une volaille et un porc ou un veau ?
Mme Jocelyne Porcher. Je ne saurais vous répondre ; je suis plutôt spécialiste de la production porcine.
Mme Françoise Dubois. On peut imaginer une différence de souffrance. En outre, l’homme n’a peut-être pas les mêmes rapports avec le mammifère.
Mme Jocelyne Porcher. Les enquêtes que j’ai faites ont montré que le lien affectif avec l’animal est bien plus fort pour les personnes qui travaillent avec des bovins que pour celles qui travaillent avec les porcs. Elles ont plus de patience. Les représentations que les personnes ont de l’animal jouent sur leur comportement. Même en abattoir, les travailleurs que j’ai interrogés étaient très proches des animaux ; ils aimaient cette proximité, certains disaient qu’ils aimaient l’odeur des bovins. C’est assez dur à comprendre, mais ces personnes étaient en abattoir parce que c’était le lieu où elles pouvaient travailler avec des animaux, même s’il fallait les tuer.
Mme Sylviane Alaux. Tout dépend du lien qu’on établit avec l’animal. À la télévision, j’ai vu un éleveur de porcs qui avait un rapport avec eux similaire à celui qu’on établit avec un chien ; il leur donnait des noms, les porcs venaient à l’appel de leur nom, ils se laissaient caresser. Tout de même, il exagère, me disais-je, dire qu’après, il va les tuer ! Mais je n’ai pas d’états d’âme quand la côtelette est dans mon assiette… Tout cela repose finalement sur une certaine hypocrisie.
Mme Jocelyne Porcher. Les enquêtes montrent cette complexité de l’élevage : les éleveurs ont une relation affective avec les animaux mais ils savent que le bout du travail, non pas le but, c’est de les tuer. Dans les enquêtes que je réalise actuellement auprès des éleveurs, je note une forte demande de leur part de revenir sur des choses qui ont été imposées par l’industrialisation de l’élevage, comme le choix des races, notamment pour augmenter l’espérance de vie. Les cochons de Stéphane sont abattus au bout d’un an ; en système industriel, c’est cinq mois et demi…
La relation à l’animal en élevage se définit à la fois par la proximité, mais aussi par une certaine distance : si on aime trop les animaux, on ne peut plus les tuer. Les animaux préférés des éleveurs ne vont pas à l’abattoir, ils meurent à la ferme. Cela demande un travail sur soi.
M. le président Olivier Falorni. Votre relation est-elle différente avec les porcs et avec les vaches ?
M. Stéphane Dinard. J’ai la même affection pour les deux. J’ai choisi de travailler avec ces animaux-là parce que ce sont ceux que je préfère. Je ne suis pas particulièrement attiré par les chèvres : je n’aurai pas pu élever des chèvres pour faire du fromage. J’aime bien les cochons, je m’entends bien avec eux. C’est la même chose avec les vaches. Mon comportement avec les vaches et les cochons n’est pas différent, j’accorde autant de temps aux uns et aux autres, je fais en sorte de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour être élevés dans de bonnes conditions. Un cochon est un animal aussi intelligent qu’un chien, il se domestique très facilement, vous pouvez l’emmener en promenade avec vous. C’est la même chose avec les vaches. Ensuite, il faut composer avec le caractère des animaux : ils sont plus ou moins proches de moi. Pour les vaches, il y a une hiérarchie dans le groupe.
Mme Sylviane Alaux. Combien de vaches et de porcs élevez-vous ?
M. Stéphane Dinard. J’élève une douzaine de vaches et une vingtaine de porcs. C’est une petite structure mais c’est le fait de ma situation.
M. le président Olivier Falorni. Votre témoignage est assez fort. On sent le lien d’affection qui vous unit à vos animaux, presque similaire à celui qu’on peut avoir avec un animal domestique ; mais, on l’a dit, la finalité est différente. Ceux qui ont un animal domestique ont tous été confrontés à la nécessité de le faire piquer quand la douleur est trop forte, c’est une vraie souffrance. Comment avez-vous « domestiqué » la rupture de ce lien affectif ? Le déchirement est-il atténué au fil des ans ? Vous créez un lien d’affection avec vos animaux tout en sachant que vous les élevez pour qu’ils soient mangés et tués. C’est une situation un peu paradoxale, même si elle est parfaitement compréhensible : c’est votre métier, vous avez un lien d’affection avec vos animaux, et tant mieux, c’est une garantie de leur bien-être. Néanmoins, comment appréhendez-vous avec le temps le moment du départ, de la mise à mort ? Peut-on parler d’une forme d’habitude ?
M. Stéphane Dinard. Je ne me dédouane pas, je sais que la finalité est celle-là, que les animaux devront être abattus pour la consommation de leur viande. Je m’impose que cela se passe dans les meilleures conditions pour eux. Cette étape-là, je la vis, mais eux ne doivent pas s’en apercevoir. Il faut que ce soit le plus instantané possible, qu’ils ne voient pas ce qui leur arrive. Je l’assume, cela fait partie de mon travail.
Vous parliez d’hypocrisie. Je pense qu’aujourd’hui, les gens se sont en quelque sorte dédouanés de leur alimentation. Ils ne savent plus d’où elle vient, comment elle est produite ; ils viennent au salon de l’agriculture, mais cela ne va pas plus loin. Le métier d’éleveur consiste à bien élever l’animal, mais aussi à lui donner la mort. J’en suis totalement conscient, j’assume cette finalité. Les gens ont oublié ce qu’il se passe entre l’animal qu’ils voient dans le pré et le morceau de viande qu’ils consomment dans leur assiette. Et s’ils sont choqués, c’est parce qu’ils ne sont plus du tout connectés à cette réalité.
Mme Sylviane Alaux. Un animal domestique, c’est un compagnonnage de dix ou quinze ans. Pour vos porcs, ce n’est qu’un an.
M. Stéphane Dinard. C’est un an, parce que j’achète des petits sevrés. Cette année, j’ai décidé de faire naître sur place ; donc je vais garder des truies. Mais mes vaches passent une dizaine d’années sur la ferme à faire des veaux.
Mme Jocelyne Porcher. Un des intérêts du point de vue de la relation aux animaux de l’abattoir mobile est de laisser du temps à cette rupture du compagnonnage avec l’animal. Beaucoup d’éleveurs – je ne sais si c’est le cas de Stéphane – se mettent dans un état mental particulier au moment de tuer l’animal ; j’en connais qui récitent des poèmes ; d’autres se posent pour réfléchir à ce qu’ils se préparent à faire. C’est le contraire de tuer les animaux sans y penser. Il s’agit de donner la mort. Les éleveurs ont donné la vie, ils doivent donner la mort. Mais donner la mort, ce n’est pas l’infliger ni tuer les animaux sans y penser. L’abattoir mobile permet justement de prendre le temps de penser à ce qu’on fait.
M. le président Olivier Falorni. Madame, Monsieur, je vous remercie de vos interventions et de vos témoignages.
La séance est levée à dix heures quarante.
——fpfp——
28. Audition, ouverte à la presse, de M. Dalil Boubakeur, recteur de la Grande mosquée de Paris, M. Kamel Kabtane, recteur de la Grande mosquée de Lyon, de M. Haïm Korsia, grand rabbin de France, et de M. Bruno Fiszon, grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller de M. le grand rabbin de France et de M. le président du consistoire central, membre de l'académie vétérinaire de France
(Séance du jeudi 16 juin 2016)
La séance est ouverte à onze heures cinq.
M. le président Olivier Falorni. Je souhaite la bienvenue à nos invités.
M. Dalil Boubakeur est le recteur de la grande mosquée de Paris depuis 1992. Il est également président de la société des habous et des lieux saints de l’Islam. Il a été élu plusieurs fois président français du Conseil français du culte musulman (CFCM). Je rappelle que la grande mosquée de Paris a été inaugurée le 15 juillet 1926 ; depuis un arrêté du 15 décembre 1994, elle est agréée en tant qu’organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l’égorgement rituel. L’Institut musulman de la mosquée de Paris, dont M. Boubakeur est également le recteur, s’assure, conjointement avec un organisme privé, du contrôle et de la certification des viandes et produits agroalimentaires destinés à la consommation de la communauté musulmane.
M. Kamel Kabtane est pour sa part le recteur de la grande mosquée de Lyon depuis 2000, la mosquée ayant été inaugurée en 1994. Depuis un arrêté du 27 juin 1996, la grande mosquée de Lyon est agréée en tant qu’organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l’égorgement rituel et a créé l’Association rituelle de la grande mosquée de Lyon (ARGML), association à but non lucratif qui s’assure en son nom du contrôle et de la certification des viandes et produits agroalimentaires destinés à la consommation de la communauté musulmane.
Nous accueillons également M. Haïm Korsia, nommé grand rabbin de France le 22 juin 2014. Diplômé de l’École rabbinique de Reims, M. Korsia a été le rabbin de Reims de 1998 à 2001 ; il a également été aumônier général israélite des armées de 2007 à 2014. Le grand rabbin de France est investi des pouvoirs les plus étendus en matière religieuse ; il est membre de droit de l’assemblée générale, du conseil et du bureau du Consistoire central. Le consistoire de Paris a mis en place une certification des produits casher, indiquée par le logo KBDP – Kasher Beth Din de Paris.
Enfin, M. Bruno Fiszon est le grand rabbin de Metz et de Moselle depuis 1997. Diplômé de l’École vétérinaire de Nantes et de l’Institut Pasteur, il est également membre de l’Académie vétérinaire de France. M. Fiszon est conseiller auprès de M. le grand rabbin de France et de M. le président du Consistoire central, notamment concernant la cacherout et la chekhita.
Je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et retransmises en direct sur le portail vidéo l’Assemblée, certaines étant diffusées sur la chaîne parlementaire (LCP).
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Kabtane, Boubakeur, Korsia et Fiszon prêtent successivement serment.)
M. Dalil Boubakeur, recteur de la grande mosquée de Paris. C’est en 1920 que, sur le rapport d’Édouard Herriot, la loi a créé l’Institut musulman de la mosquée de Paris. On a donc pu édifier à Paris une mosquée désirée depuis longtemps par la communauté musulmane.
Afin de permettre aux musulmans d’appliquer les divers rites de l’islam, au-delà de la prière et des prédications, un arrêté du 26 juin 1939 a attribué à l’Institut musulman de la mosquée de Paris un échaudoir dans les abattoirs de la Villette – l’échaudoir n° 48 –, dédié à l’abattage rituel sous la double égide de la mosquée de Paris et de la préfecture de la Seine. Ainsi, à côté d’un sacrificateur désigné par la mosquée de Paris, un représentant de l’administration vérifiait que les différentes obligations légales, en particulier en matière d’hygiène, étaient bien respectées. Cet échaudoir a continué de fonctionner malgré la guerre et après la guerre jusque dans les années 1950, date à laquelle les pouvoirs publics ont voulu moderniser les échaudoirs.
J’en viens directement à 1994, année de parution d’un décret du ministre de l’intérieur habilitant les mosquées de Paris, Lyon et Évry à agréer des sacrificateurs musulmans aptes à œuvrer au sein des abattoirs réguliers et pourvus d’une double compétence : en matière religieuse, compétence attestée par la mosquée de Paris en particulier, et dans le domaine de la connaissance des animaux d’abattage. Cet agrément a remplacé l’ancienne autorisation délivrée par les préfectures ; le décret de 1994 a par conséquent régularisé une fonction à l’évidence religieuse. S’y est ajouté un contrôle sur les lieux de l’abattage : c’est à la suite de ce contrôle que la mosquée délivre le label de licéité – le halal – des viandes mises à disposition des commerçants.
Les lieux d’abattage sont eux-mêmes autorisés ou agréés par la préfecture, et le décret de décembre 2011 a créé une nouvelle dérogation à la réglementation européenne, permettant de ne pas anesthésier les animaux en pré-saignée. L’opinion a joué un rôle important pour sensibiliser les pouvoirs publics à la souffrance animale et, beaucoup plus récemment, à la maltraitance des animaux. C’est pourquoi le décret de 2013 oblige les sacrificateurs, avant même d’opérer, avant même d’obtenir leur carte, à suivre une formation qui leur donne une compétence en matière de prévention de la souffrance animale. Bref, l’avancée a été très importante puisque le sacrificateur, qui à l’origine n’était qu’un religieux, certes compétent et agréé, doit désormais suivre une formation dûment sanctionnée par des examens. C’est seulement une fois qu’il est pourvu de cette attestation, délivrée par le ministère de l’agriculture, que le sacrificateur peut être nommé par l’institut agréé et opérer dans un abattoir souhaitant avoir à demeure un sacrificateur musulman capable de respecter les rites exigés par la religion.
Ces rites sont de deux ordres : d’abord, l’animal à sacrifier doit être orienté vers La Mecque ; ensuite, le sacrificateur doit prononcer les paroles consacrées, afin de montrer qu’il s’agit d’un sacrifice fait au nom de Dieu. De ce fait, le sacrifice doit répondre aux conditions très précises que la religion impose : l’animal ne doit pas souffrir ; sa présentation doit être parfaite ; l’opération doit être effectuée dans des conditions de respect de l’animal.
Le contrôleur garantit le caractère halal de la viande. Dans l’idéal, c’est lui qui suit tout le processus depuis l’arrivée de l’animal jusqu’au site de saignée. Il vérifie que l’animal est apte à intégrer le circuit de la saignée et pour cela que les conditions de stabulation et que son alimentation ont été correctes. Il jette préalablement un coup d’œil sur l’ensemble du site d’abattage pour en constater l’hygiène, pour vérifier l’absence de sang ou d’éléments dont la vue pourrait stresser l’animal, notamment les couteaux. Les gros animaux comme les bovins suivent une filière particulière qui aboutit à un piège, à une benne qui reçoit l’animal, où il a été acheminé dans le calme et avec respect. Là, il est soumis à une ferme contention bilatérale du corps et de la tête, correctement orientée grâce à une mentonnière pour offrir au sacrificateur, au moment où le piège tourne, un endroit précis.
Le cou doit alors être correctement tendu. Il faut savoir que l’élément central est le larynx – je suis médecin, donc tout ce que je vais dire m’apparaît évident, ce qui n’est pas forcément le cas pour les abatteurs. Les quatre vaisseaux – les carotides droite et gauche et les jugulaires droite et gauche – qui passent au-dessus du larynx doivent être sectionnés à cet endroit précis. Ces deux types de vaisseaux ont des fonctions radicalement différentes : dans les carotides circule du sang artériel et dans les jugulaires du sang veineux. Or c’est ici qu’il peut y avoir un problème : la veine jugulaire est en effet susceptible de se thromboser au-dessus de la section ; la thrombose crée alors un blocage qui peut occasionner un caillot. Si bien que, une fois la section opérée, on peut avoir la surprise de constater un arrêt du sang puis l’arrivée d’un thrombus. Dès lors, d’un point de vue religieux, la bête n’est plus considérée comme ayant été abattue dans les règles : elle n’est pas halal. Intervient alors un second type d’appareillage destiné à anesthésier l’animal par électronarcose ou par un matador, autrement dit un système à tige mécanique perforante.
La jugulation est la tranchée des éléments du cou : on doit veiller à ce que les quatre vaisseaux que j’ai mentionnés ont bien été sectionnés et ont bien saigné. D’autres organes doivent être également sectionnés, comme l’œsophage et le thymus. La section ne doit pas aller au-delà des arcades mandibulaires ni au-dessous, faute de quoi la saignée n’est pas valable. De même, si le couteau va jusqu’aux vertèbres, l’abattage est religieusement invalide.
Il faut attendre un certain temps pour que l’animal se vide de son sang puis il faut vérifier l’absence de spasmes, contrôler les réflexes de vigilance, notamment le réflexe cornéen, celui de l’audition, en tapant dans les mains. Puis on affale l’animal avant qu’une chaîne ne prenne sa patte arrière gauche, afin qu’on procède à l’habillage, au dépeçage, pesée, etc. La carcasse peut être utilisée entièrement ou en partie, de même que les abats. Toutes ces opérations sont suivies soit par le sacrificateur soit, de préférence, par un contrôleur qui délivre l’estampillage au moment de la pesée de l’animal et du conditionnement des morceaux.
Les contrôles vétérinaires que j’ai pu observer se sont toujours révélés complets et efficaces. Il revient aux vétérinaires de vérifier l’estampillage de l’abattoir, qui doit répondre à des critères définis au plan européen et qui constitue une véritable fiche d’identité de l’animal : origine, âge, lieu d’achat, de stabulation, nom de la société qui le prend en charge, numéro de son sacrificateur, etc., afin de garantir la traçabilité, essentielle pour le consommateur.
Au-delà de l’action des contrôleurs, indispensable et de plus en plus fréquente, nous procédons à des audits. J’en ai moi-même effectué un il n’y a pas longtemps à Bigard-Formerie. Je vous communiquerai des documents précisant toutes les règles que nous imposons à nos sacrificateurs et la liste des abattoirs avec lesquels nous travaillons.
Il m’a été demandé, en 1987, par le ministère de l’intérieur, lui-même sollicité par les autorités européennes, d’étudier la question de la souffrance animale. Ce sujet avait été soulevé par des gens sensibles, écologistes et autres, dont Brigitte Bardot qui est venue me voir à plusieurs reprises à la mosquée de Paris. Mme Bardot s’était émue de la fête du sacrifice, l’Aïd el-Kébir, à l’occasion de laquelle on tue des centaines sinon des milliers d’animaux sans qu’on sache très bien dans quelles conditions. Des articles ont été publiés récemment à ce sujet dans la presse, photographies à l’appui, montrant le caractère scandaleux de certains modes d’abattage, qui sont loin d’être conformes au rituel. J’ai donc réalisé une étude, que je vous communiquerai, de même que je l’ai diffusée auprès de tous mes frères et amis, où je précise que certaines parties de l’islam, si elles ne sont pas favorables à l’électronarcose – pratiquée par de nombreux pays européens, que l’abattage soit rituel ou normal –, elles n’y sont du moins pas défavorables, à la stricte condition qu’elle soit réversible – aussi la dosimétrie doit-elle être précise : un ampère pour les volailles et cinq ampères pour les autres animaux. Les conditions de l’abattage rituel sont respectées dans la mesure où l’animal est seulement anesthésié : la douleur est moins importante et il peut être réveillé à tout instant.
On nous a également demandé si nous autoriserions l’anesthésie post-jugulation. Nous nous sommes récemment réunis – M. Kamel Kabtane était présent – avec les représentants de la mosquée d’Évry et ceux du CFCM. Le consensus qui a prévalu a été le suivant : niet. C’est non : pas d’électronarcose ni en pré-jugulation ni en post-jugulation.
Sachez que la préoccupation de la souffrance animale nous est très chère. Quand j’étais étudiant, nous procédions à des dissections ; elles ont été interdites au nom de la protection de l’animal. Pour mon compte, je ne peux supporter la souffrance animale, et, en tant que responsable d’une institution religieuse, je me suis efforcé de transmettre mon expérience parfois douloureuse en la matière.
M. Kamel Kabtane, recteur de la grande mosquée de Lyon. Dans le cadre de la mission qui vous a été confiée, vous avez souhaité nous auditionner pour vous informer des conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, mais aussi pour mieux connaître les conditions religieuses qui encadrent l’abattage rituel musulman.
Votre institution est le fondement de notre République. C’est ici que la République s’est construite. C’est ici que les principes fondamentaux de liberté, d’égalité et de fraternité trouvent tout leur sens et c’est vous qui en êtes les garants.
C’est dans cet esprit que vous nous avez conviés à venir échanger avec vous pour comprendre la philosophie qui fonde les habitudes de consommation d’une partie des citoyens de notre pays mais aussi comprendre les relations qui existent entre l’islam et l’animal. Les polémiques actuelles ne doivent pas venir édulcorer le débat et affaiblir la compréhension du problème, laquelle doit se nourrir d’une réflexion prenant en compte les réalités sociologiques et économiques.
Comme leurs concitoyens, les musulmans sont aussi sensibles au bien-être animal et, comme eux, ils ont été mal à l’aise de constater les conditions de traitement des animaux de boucherie dans certains abattoirs. D’ailleurs, l’islam dans son essence même accorde à l’animal toute sa place d’être vivant et ne peut concevoir qu’il soit traité autrement.
C’est parce que je suis Français et musulman que je suis heureux aujourd’hui de venir débattre avec vous pour qu’ensemble nous puissions nous comprendre et avancer sur ces questions qui créent la polémique, voire parfois le rejet.
L’abattage rituel est devenu aujourd’hui, pour certains, un argument de stigmatisation. Or qui mieux que la représentation nationale peut savoir ce à quoi a mené la stigmatisation d’une partie de la communauté nationale ?
C’est pourquoi je suis heureux et fier de me retrouver devant la représentation nationale de mon pays, pour aborder avec elle ces questions en toute franchise et dans le respect mutuel.
Conscients de l’exigence exprimée par la communauté nationale d’obtenir des viandes conformes à son éthique, nous avons créé, en 1995, l’Association rituelle de la grande mosquée de Lyon (ARGML), association loi de 1901, afin d’organiser l’abattage rituel suivant les textes religieux et de mettre en place un processus de contrôle et de certification des produits halal.
Un arrêté conjoint du ministère de l’intérieur et du ministère de l’agriculture, du 21 juin 1996, considère qu’il est d’intérêt public d’organiser l’abattage rituel islamique dans des conditions garantissant l’ordre et la santé publics. La grande mosquée de Lyon, du fait, toujours selon l’arrêté, de son rayonnement spirituel et culturel, de sa représentativité dans la communauté musulmane de France et de sa capacité à encadrer le marché de la viande rituellement abattue, a été agréée en tant qu’organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs à pratiquer l’égorgement rituel.
Cet agrément implique que tout sacrificateur rituel musulman souhaitant opérer dans un abattoir en France, doit être détenteur d’une habilitation délivrée par la grande mosquée de Lyon ou par l’une des deux autres mosquées habilitées, la grande mosquée de Paris et la grande mosquée d’Évry. Ainsi, en 2013, nous avons délivré 29 cartes de sacrificateur, 26 en 2014, 41 en 2015 et 30 en 2016. Quelque 80 % des habilitations concernent des personnes travaillant dans des abattoirs contrôlés par l’ARGML ou directement salariées par l’ARGML. Le reste est composé de petits bouchers ou de petits abattoirs de volaille.
Au-delà de l’habilitation des sacrificateurs, qui n’est qu’une étape vers la garantie halal, l’ARGML a mis en place un dispositif de contrôle des abattages, des opérations de découpe, de transformation et d’élaboration des viandes et autres produits agroalimentaires destinés à être commercialisés sous l’appellation « halal ». En effet, l’habilitation du sacrificateur rituel ne suffit pas à attester du caractère halal des produits : il est nécessaire de superviser l’ensemble des opérations de production pour garantir au consommateur la licéité
– du point de vue islamique – des produits. Entre ici en jeu la notion islamique de témoignage.
En ce sens, l’ARGML a progressivement développé son activité au sein de plusieurs entreprises en France : abattoirs, ateliers de découpe, de transformation ou d’élaboration. Ce développement s’est fait au fur et à mesure de la demande des entreprises et des consommateurs, conscients du travail réalisé par l’ARGML.
Le recours à nos services permet aux entreprises de sécuriser leur démarche de production halal et d’apporter ainsi la garantie d’une tierce partie qui n’est autre qu’une institution religieuse, elle-même garante des principes fondamentaux de l’islam en matière de consommation halal, ce qui est essentiel pour les consommateurs de confession musulmane. Cette garantie halal est réalisée par un contrôle rituel permanent à tous les stades d’élaboration, depuis l’abattage rituel jusqu’au conditionnement final des produits.
Les produits sont ensuite estampillés ou identifiés avec notre logo de certification halal. La nécessité du contrôle permanent est justifiée, je le répète, par la notion islamique de témoignage. Par sa fonction de contrôleur rituel, le salarié de l’ARGML atteste visuellement que la fabrication des produits est bien conforme au rituel islamique.
À ce jour, l’ARGML compte environ 70 salariés à temps complet ou à temps partiel, répartis dans l’ensemble des entreprises qu’elle contrôle et certifie. Pour ce qui est de la France, nous travaillons régulièrement avec une dizaine d’abattoirs bovins ou ovins.
Nos contrôleurs rituels sont salariés de l’ARGML et, à ce titre, exercent leur activité de contrôle en toute indépendance par rapport aux sociétés dans lesquelles ils sont affectés. Les sacrificateurs rituels sont par contre salariés des abattoirs ; ils sont habilités par l’ARGML et exercent leur activité sous la supervision de nos contrôleurs rituels.
Je tiens à préciser que notre service se limite au contrôle des dispositions rituelles au sein des abattoirs dans lesquels nous exerçons. Nos contrôleurs sont sensibilisés aux notions de bien-être animal. Certains d’entre eux ont même passé le certificat de compétence. Toutefois, leur champ d’action se limite au contrôle de la qualité du sacrifice rituel, des conditions de propreté nécessaires à la conduite des opérations d’abattage, de découpe, et de transformation, et au suivi de la traçabilité halal. En aucun cas, nos contrôleurs ne se substituent aux services vétérinaires délégués par l’État ou aux services qualité des entreprises. Ainsi, ils n’ont pas vocation à être « responsables protection animale » (RPA) sur les sites car c’est une fonction exercée par le personnel interne à l’entreprise.
J’en viens plus précisément à ce qu’est le halal. Il s’agit d’un concept qui émane des sources scripturaires musulmanes : le Coran et la Sunna – la tradition prophétique. Le sens du halal dans les textes renvoie à ce qui est permis et licite, par opposition à ce qui est haram, qui renvoie à l’interdit. Le Coran précise : « Ô Messagers ! Mangez de ce qui est pur et faites des bonnes œuvres. » (XXIII, 51) Le halal est donc un moyen et une condition pour cheminer vers le Créateur, et revêt donc une importance fondamentale pour les musulmans : il constitue même la condition pour que les prières du croyant soient exaucées. Le halal régit l’ensemble des actes de la vie du musulman et donc, parmi eux, son rapport à l’alimentation.
L’alimentation du musulman obéit par conséquent à des règles qui lui autorisent certains aliments et boissons. Pour ce qui est des produits carnés, on appelle communément une viande « halal » une viande qui a été obtenue via la dhakat – acte d’abattage rituel –, et décrit donc toute pièce de viande provenant d’un animal autorisé selon la loi islamique, abattue conformément aux règles de l’abattage rituel musulman et contrôlée selon le principe de la chahada – à savoir l’attestation, le témoignage, principe que j’ai évoqué précédemment – pour valider et garantir au musulman sa licéité. La dhakat est un abattage rituel réalisé au nom du Dieu unique. Il constitue donc une forme d’adoration, un acte religieux et ne peut se réduire à une pratique d’abattage standard : cela suppose de définir les catégories d’animaux permis ou interdits, d’exiger que l’animal soit parfait en son genre, d’observer une compassion soucieuse d’éviter le stress, de provoquer une mort rapide par une saignée sûre et complète, enfin de prononcer la formule rituelle d’invocation qui légitime la mise à mort sous la permission et la bénédiction divines.
Le rapport de l’homme à l’animal en islam est régi par un contexte lié à la considération qui lui est portée : les animaux sont considérés comme des créatures de Dieu. La miséricorde, en islam, s’étendant à toutes les créatures de Dieu, les animaux sont donc, à ce titre, couverts par cette miséricorde. La sourate « Les Abeilles » dit : « Et Il a créé, pour vous, les bestiaux dont vous faites des vêtements chauds, dont vous retirez divers profits et dont vous mangez, aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez, le soir, de même que le matin, lorsque vous les menez au pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n’atteindriez [autrement] qu’avec peine. Vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. Et [Il a créé] les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez, et aussi pour l’apparat. Et Il a créé [d’autres] choses que vous ne connaissez pas. » (XVI, 5-8)
L’islam reconnaît chez l’animal une conscience évoluée : il souffre, connaît et adore Dieu, a conscience de la mort et sera ressuscité comme les humains. La sourate « Les Bestiaux » précise : « Pas de bêtes sur la terre, ni d’oiseau volant de ses deux ailes qui ne constituent des nations pareillement à vous ; dans le Livre, Nous n’avons absolument pas omis la moindre chose. Et puis vers le Seigneur, ils seront rassemblés » (VI, 38). Dans la sourate « La Lumière », on peut lire : « Ne vois-tu pas que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne cessent de proclamer la gloire et la pureté de Dieu, de même les oiseaux qui étendent leurs ailes ? Chacun a sa manière de prier Dieu et de proclamer Sa gloire et Sa pureté et Dieu sait parfaitement ce qu’ils font. » (XXIV, 41)
En outre, le saint Coran honore les animaux en nommant plusieurs Sourates par le nom d’animaux : « La Vache », « Les Bétails », « Les Abeilles », « Les Fourmis », « L’Araignée », « L’Éléphant ». Le Prophète – que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui – enseigna le respect des animaux à ses compagnons, privilégiant certains d’entre eux, notamment pour leur noblesse, comme le cheval, ou leur pureté, comme le chat. La préservation des espèces animales a été réalisée grâce à l’Arche de Noé, il y a bien longtemps, par ordre de Dieu, sans lequel nous ne connaîtrions pas d’animaux aujourd’hui. C’est là un rappel pour que nous continuions de préserver les espèces animales.
En parallèle de l’activité de contrôle rituel, nous avons considéré, dans la mesure où le bien-être et la bientraitance des animaux sont des notions fondamentales en islam, qu’il fallait prendre toutes les dispositions afin d’assurer que les opérations de sacrifice rituel se déroulent de façon conforme à ces principes.
Ainsi, depuis la publication par le ministère de l’agriculture de l’arrêté rendant obligatoire l’obtention du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, nous avons considéré qu’il était important d’accompagner les services de l’État dans ce domaine. C’est pourquoi nous avons mis en place une formation qui a été agréée le 20 juillet 2015, afin de former les opérateurs et plus particulièrement les sacrificateurs rituels, pour qu’ils puissent obtenir ce certificat de compétence. Cette formation est délivrée par notre organisme DEFI, sous l’égide également de la grande mosquée de Lyon.
Nous avons été agréés pour délivrer les formations d’opérateurs bovins-équidés et ovins-caprin, manipulation et soins, mise à mort complète et sans étourdissement. Nous avons organisé en 2013 trois formations sur les ovins, qui ont intéressé trente et une personnes, et deux en 2014, pour quatorze personnes. En 2015, notre organisme a organisé quatre sessions qui ont accueilli vingt-huit participants, toujours sur les ovins, et une session pour sept personnes sur les bovins. Cela prouve à quel point nous sommes intéressés à la protection animale.
Pour ce qui est de la délivrance de la carte de sacrificateur, nous procédons à un entretien de moralité, nous vérifions sommairement les connaissances du candidat et sa pratique religieuse. Nous exigeons en outre une lettre de recommandation de la part de la mosquée fréquentée, la signature du cahier des charges du sacrificateur rituel, qui édicte les conditions de base que doit respecter le sacrificateur pour réaliser l’abattage rituel. Quant à la formation pratique, elle est réalisée sur le terrain avec le contrôleur rituel chargé de superviser l’abattage, et avec le ou les sacrificateurs expérimentés.
M. Haïm Korsia, grand rabbin de France. C’est un grand honneur pour moi d’avoir, pour la première fois, prêté serment devant vous et devant le drapeau ; et moi qui ai servi sous les drapeaux pendant de longues années, je sais ce que représente le fait de dire non pas la vérité, puisque chacun a la sienne propre, mais le fait de vivre cet engagement à partager un espace commun qui s’appelle la France qui, fondamentalement, s’intéresse aux grandes aspirations de la société comme aux petites choses, finalement tout aussi importantes. Car c’est la grandeur de la République de considérer que chaque petit fil qu’on tisse ou détisse crée un futur merveilleux ou un futur dangereux.
Comme l’ensemble de la société, j’ai été choqué par les images terrifiantes qu’on a pu montrer et qui ont révélé la réalité dramatique de certains abattoirs. Je l’ai vécu en tant que citoyen et non en tant que consommateur de cette viande, puisque dans les établissements concernés on ne pratiquait pas l’abattage rituel. C’est du reste une préoccupation permanente des textes, de la morale humaine : si l’on est capable d’avoir de la tendresse pour le plus petit des insectes, pour l’animal le plus modeste, on en aura aussi pour les hommes. Sans entrer dans les détails bibliques, rappelons que Moïse – personnage tout de même assez connu – a été choisi par Dieu parce qu’il a un jour manifesté de la compassion pour une petite brebis qui s’était perdue. Et Dieu, selon la Bible, a dit : « Un homme qui est capable de compassion pour un animal en aura pour mon peuple. » Prendre en compte le bien-être animal est un impératif pour notre société, une obligation que nous devons tous partager. Je n’accepte pas la présentation qu’en font certains, dans laquelle ce seraient eux contre nous : nous sommes ensemble pour essayer de défendre une vision cohérente de la société où nous faisons attention à chacun et où nous faisons attention à tous ceux qui partagent cet espace de vie qu’est notre biosphère.
Aussi, bien évidemment, le bien-être animal est un enjeu majeur du judaïsme, au point que si le couteau de l’opérateur présente une ébréchure qui risquerait de faire souffrir l’animal, l’acte rituel n’est pas considéré comme valable. C’est dire si notre impératif premier et même unique est la perception que peut avoir l’animal de la souffrance ou de la mort.
Je me limiterai à trois points.
Le premier est l’impératif de laïcité. On ne se rend pas compte que la liberté des pratiques religieuses est essentielle en France – elle est non seulement garantie par la Constitution mais elle se trouve au cœur de ce que nous essayons tous de vivre. Je sais que certains voudraient faire de la laïcité une forme nouvelle d’athéisme qui nierait la possibilité de pratiquer sa foi, quand d’autres, à l’inverse, voudraient qu’on ne puisse pas participer à la vie en société si on ne pratique pas une religion. Dans les deux cas, ce serait un scandale. Il faut donc garantir la possibilité de croire, mais aussi celle de ne pas croire, l’essentiel étant de toujours vivre ensemble. C’est ce que permet la laïcité. Sous la IIIe République circulait une formule étonnante destinée aux juifs : « Il faut être français à l’extérieur et juif chez soi ». Autrement dit, être 100 % du temps schizophrène, en se coupant forcément d’une partie de ce que nous sommes : je ne peux pas vous dire si je suis plus juif ou plus français, ou plus supporter du PSG ou de l’équipe de France… Je suis tout ce que je suis en même temps, et notre République nous donne la chance de vivre tout ce que nous sommes sans avoir à faire un choix permanent entre notre statut fondamental, vital même, de citoyen et le fait que nous ayons – ou non – une foi quelconque. Ce principe essentiel doit être protégé y compris en ce qui concerne l’abattage rituel.
Deuxième point : aussi étrange cela puisse-t-il vous paraître, je tiens à vous faire part d’une petite blessure personnelle, toutefois essentielle et peut-être parce que j’ai eu l’honneur de servir sous les drapeaux ; sachez que lorsqu’on mange casher à bord d’un avion appartenant à notre compagnie nationale, Air France, il ne s’agit plus de cassolettes fabriquées en France. C’est un de mes échecs personnels – j’ai eu l’honneur de servir dans l’armée de l’air et c’est un domaine dont je m’occupais également… Pour des raisons économiques, Air France a préféré les cassolettes distribuées par la compagnie KLM, appartenant au même groupe, et donc fabriquées aux Pays-Bas. C’est un combat que je vais mener, car il me paraît essentiel que l’on puisse consommer de la viande française, compte tenu de la façon dont nous garantissons la traçabilité, et la façon que nous avons de traiter les animaux, qui est tout de même différente de ce qu’on peut constater dans d’autres pays. Si par malheur on en venait à ne pas pouvoir produire de viande provenant de l’abattage rituel – c’est le cas en Suisse et en Suède, pays modèle pour certains footballeurs mais pas forcément dans d’autres domaines –, on serait obligé d’aller la chercher ailleurs. Ce serait terrible, à mon sens, qu’une partie de la communauté nationale ne puisse pas consommer un produit national. Et je puis vous assurer, après en avoir longuement, et depuis très longtemps, discuté avec eux, que les représentants de la filière bovine et de la filière ovine partagent cette préoccupation.
J’aborde avec mon dernier point une question sensible ; mais j’ose l’évoquer devant vous car vous avez conscience de ce qu’est cette notion d’engagement et de parole forte de la République et vous êtes une part importante de cette parole forte. Nous courons le risque majeur de délivrer un message contradictoire. Lorsque le Président de la République, ou le Premier ministre, énonce des phrases aussi fortes, aussi justes que : « La France, sans les juifs, n’est plus la France », ne courons-nous pas en effet le risque terrible d’un message contraire ? Ne peut-on y voir une sorte d’injonction paradoxale consistant à dire aux juifs que leur place est en France mais qu’ils ne peuvent pas manger casher ? Des maires de tous bords – François Pupponi à Sarcelles, Claude Goasgen dans le XVIe arrondissement de Paris, Anne Hidalgo à Paris, Christian Estrosi à Nice – réalisent de gros efforts à l’endroit de chaque partie de la communauté nationale – qui est une –, font en sorte que la communauté juive se sente heureuse – « heureux comme un juif en France », dit le proverbe. Empêcher un juif de manger casher, n’est-ce pas l’empêcher d’être lui-même ?
Je ne viens donc pas ici défendre l’abattage rituel, mais le principe de laïcité, défendre devant vous, avec vous l’idée d’une France bienveillante, celle dont nous rêvons tous.
M. Bruno Fiszon, grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller de M. le grand rabbin de France et de M. le président du consistoire central, membre de l’académie vétérinaire de France. Il me revient la tâche de vous expliquer la procédure de l’abattage rituel et, surtout, j’évoquerai ce qui, au fond, nous rassemble : le bien-être animal. Est-il possible de l’améliorer ? Est-il compatible avec l’abattage rituel ?
Il faut tout d’abord savoir que le bien-être animal est une préoccupation biblique très ancienne : en témoignent, par exemple, l’interdiction de la chasse ou des combats d’animaux. La méthode ancestrale d’abattage, inscrite dans les textes bibliques, dans les textes talmudiques et qui, à ce titre, ne peut être changée – on ne peut y déroger si l’on veut manger casher –, est elle-même considérée comme limitant la souffrance animale. Encore faut-il le démontrer. Je vais donc tâcher de voir en quoi les travaux scientifiques, divers et parfois contradictoires, peuvent nous offrir des pistes intéressantes.
L’abattage rituel doit être pratiqué sur un animal en bonne santé et conscient, ce qui exclut toute forme d’étourdissement avant ou après. On procède par saignée à l’aide d’un couteau très affûté – du reste, l’arrêté ministériel de référence, signé par Bruno Le Maire, prend pour décrire l’outil adéquat l’exemple du couteau des sacrificateurs israélites, qui fait notamment le double de la taille du cou de l’animal. La saignée doit être rapide et complète ; la section des carotides doit permettre une hémorragie massive et donc une perte de connaissance puisque l’animal n’est plus alimenté en oxygène. Temple Grandin, du Colorado, aux États-Unis, une des grandes « papesses », une des scientifiques les plus reconnues en matière de bien-être animal, et en particulier en ce qui concerne les animaux de boucherie, note que « lorsque l’incision est appliquée correctement, l’animal ne semble pas la ressentir ». Ses travaux s’étendent sur une dizaine d’années et ses derniers articles datent de 2014.
Cette hémorragie massive doit être comparée avec les méthodes conventionnelles qui prévoient un étourdissement préalable. Ce dernier est obtenu par tige perforante, par électronarcose, ou encore par le gaz – notamment pour les volailles ou les porcins, même si ces derniers ne nous intéressent pas ici. Il faut savoir que l’étourdissement lui-même n’est pas indolore. La souffrance animale est difficile à mesurer ; ce qu’on évalue, c’est la perte de conscience et même, d’ailleurs, la perte de sensibilité, ce qui ne revient pas tout à fait au même : un animal inconscient n’est pas forcément insensible. Il s’agit en tout cas des deux seuls critères objectifs que l’on peut étudier en laboratoire, encéphalogrammes à l’appui. On en déduit que plus on va vers l’inconscience et, ensuite, plus on va vers l’insensibilité, moins l’animal va ressentir la douleur.
Or il faut comparer ce qui est comparable et mesurer, d’un côté, le temps de perte de conscience et de la sensibilité après la chekhita – l’abattage rituel juif –, à savoir après la section des carotides et de l’hémorragie, et mesurer le temps de perte de conscience après perforation du crâne de l’animal par un pistolet à tige perforante. Aucune étude n’existe sur la douleur ressentie par l’animal au moment de cet « étourdissement », qui est un véritable traumatisme. Eh bien, la comparaison entre les deux méthodes réserve un certain nombre de surprises.
L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) a remis un rapport en 2009 qui met en évidence l’échec de l’étourdissement. Il faut bien avoir à l’esprit qu’après cette étape, l’animal est saigné : l’étourdissement ne signifie pas qu’on chante à l’animal une berceuse, qu’on l’endort gentiment avant de le tuer on ne sait trop comment. L’animal est donc bel et bien saigné. Quand l’étourdissement est mal effectué, que l’animal ne perd pas conscience, n’est pas rendu insensible, c’est dramatique. Des travaux néo-zélandais font apparaître que l’échec de l’étourdissement chez les ovins peut aller de 2 % à 54 %. Pour ce qui est des bovins, on parle de 16 % à 17 % d’échecs de l’étourdissement par tige perforante. Cela représente un nombre d’animaux qui souffrent considérable par rapport aux animaux abattus rituellement. Mal étourdis, les animaux arrivent sur la chaîne conscients et sensibles et sont saignés, mais pas du tout par une section des carotides nette et franche suivie d’une hémorragie massive. Il y a donc là un vrai débat, ; si certains scientifiques soutiennent que l’étourdissement est une bonne méthode, d’autres estiment qu’il n’est pas la panacée, et cette controverse d’experts n’est pas encore tranchée, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots. Temple Grandin considère que l’abattage rituel, quand il est effectué dans les règles de l’art, est une méthode acceptable, voire humaine.
Je prendrai l’exemple des volailles, assez symptomatique. En abattage rituel, l’animal est saigné à la main, comme il se doit : on le présente à l’opérateur d’abattage, le chokhet en hébreu, qui procède à la section. L’animal, comme le veut la loi, est immobilisé avant d’être accroché sur la chaîne, il perd son sang et, en quelques secondes, il perd conscience et est insensible, ce qu’on peut constater en vérifiant le fameux réflexe cornéen. S’il bat encore des ailes, c’est un mouvement réflexe. En abattage conventionnel, ces animaux sont au contraire accrochés en étant conscients ; ils partent dans la chaîne et leur tête est plongée dans un bain traversé d’un courant électrique. L’inconvénient – je l’ai constaté par moi-même et un film a été réalisé puis projeté dans le cadre de la formation de nos sacrificateurs – est que non seulement l’électricité n’est pas répartie uniformément, mais que les animaux n’ont pas tous la même taille : certains vont se recroqueviller et seront donc tout à fait conscients au moment de passer sur la lame. Je vous laisse juge de savoir quelle est la meilleure méthode d’abattage, la plus humaine – si tant est qu’il puisse exister une méthode humaine pour abattre, mais ce n’est pas l’objet de la présente audition.
L’étourdissement n’est donc pas la panacée et il me semble que nous devons travailler ensemble pour améliorer les conditions d’abattage. Nous y sommes tout à fait prêts et nous avons d’ailleurs organisé très rapidement les formations destinées à acquérir le certificat de compétence – ainsi que le prévoit une directive européenne. Mais même auparavant, les chokhatim, les opérateurs d’abattage, suivaient déjà une formation de trois ans. Ils ne peuvent abattre que s’ils possèdent une carte signée du grand rabbin de France – garantie de compétence et de qualité. Et il arrive que le grand rabbin de France ait refusé des cartes de sacrificateurs à certains qui étaient trop peu ou mal formés.
Le bien-être animal est l’une de nos préoccupations principales. Nous souhaitons travailler à l’amélioration des conditions d’abattage – qui concernent également l’élevage, le transport, les conditions de contention. Temple Grandin considère qu’une bonne contention, lors d’un abattage rituel, permet de diminuer le stress et donc le temps de perte de conscience et de perte de sensibilité. Nous parvenons ainsi, selon des travaux américains, à des chiffres inférieurs à dix-sept secondes pour les gros bovins.
J’ai eu la chance de participer aux travaux du projet européen DIALREL réunissant des religieux, des scientifiques et des défenseurs des animaux. Le dialogue était parfois difficile, voire houleux, mais le résultat de ces discussions a pu servir à la Commission européenne pour établir le règlement voté en 2009 et appliqué en 2013.
Travaillons donc ensemble, j’y insiste, à l’amélioration du bien-être des animaux, tout en préservant les droits de chacun, en République, à vivre conformément à ses traditions et à ses convictions religieuses : il n’y a pas d’antinomie entre les deux démarches.
M. le président Olivier Falorni. Merci, monsieur le grand rabbin. Je souhaite savoir quelle distinction vous opérez, dans les prescriptions religieuses concernant l’abattage rituel, entre les animaux vivants et les animaux conscients.
J’entends ensuite vos réserves concernant l’étourdissement, qui est la règle commune en France : l’abattage dont nous parlons ce matin est dérogatoire. Estimez-vous néanmoins, messieurs, qu’il existe des méthodes d’étourdissement acceptables pour l’abattage rituel en France ? Si oui, lesquelles ?
Est-il envisageable pour vous, monsieur le recteur, d’imposer l’étourdissement post-jugulation des animaux destinés à l’abattage rituel ? En cas de réponse négative, quels sont les obstacles à une telle mesure ? L’abattage rituel avec étourdissement est admis dans d’autres pays dans le monde ; comment expliquez-vous ces différences avec la France ?
Ensuite, messieurs les recteurs, selon le verset V de la sourate 5 du Coran, les musulmans peuvent consommer « la nourriture des gens du Livre » ; quel sens donnez-vous à cet écrit ?
Enfin, messieurs les grands rabbins, quelles sont les raisons de l’interdit de consommer les parties postérieures de l’animal abattu ? Serait-il possible de réintroduire en France la pratique de l’extirpation du nerf sciatique, afin que l’intégralité de l’animal abattu selon le rite juif intègre le circuit casher ?
M. Haïm Korsia. Le grand rabbin Fiszon vous apportera une réponse technique concernant l’étourdissement. Il y a toujours, dans la vie, un idéal et une façon dégradée d’envisager les choses. On envisage toujours l’idéal ; après, on fait comme on peut… Si certains pays ont décidé de faire différemment, ils font différemment. L’intelligence du système laïque, en France, grâce auquel l’État n’intervient pas dans la police des cultes, nous conduit à répondre par la négative à votre question sur l’étourdissement.
Pour ce qui est des parties arrière, vous avez raison. Je n’en ai jamais consommé, mais on me dit qu’elles seraient les meilleures parties de la viande. Et en effet, il serait plus simple d’avoir un circuit complet sans avoir à les réintégrer dans le circuit courant, grand public, avec tous les problèmes de traçabilité que cela pose. Nous allons y travailler, mais comme cette question vient de la représentation nationale, je me dois d’y trouver une réponse collective.
Le judaïsme est divisé en deux grandes branches, l’une appelée séfarade et l’autre ashkénaze. La première – il y a de cela cinq cents ans – se trouvait plutôt dans des pays musulmans – le Maghreb essentiellement – et l’autre était située en pays chrétiens. Quand les juifs disent, comme le rabbin de Cracovie, ne pas savoir retirer le nerf sciatique, les parties arrière repartent dans le circuit courant et les chrétiens n’ont aucun problème pour consommer cette viande. Dans un pays à forte population musulmane au contraire, les musulmans ont une réticence à consommer une viande que les juifs déclarent non casher. Du coup, nous avons gardé cette tradition du geste : dans de nombreux pays, y compris en Israël, il s’est transmis. Nous pourrons en tout cas mener ce travail interne grâce à votre question.
M. Bruno Fiszon. L’abattage se fait sur un animal vivant, certes, mais conscient – pour peu qu’on puisse définir précisément la conscience chez l’animal –, bref, qui n’a pas été étourdi. Nous n’acceptons l’étourdissement ni avant ni après la saignée. En effet, c’est la chekhita qui doit provoquer la mort ; or un étourdissement post-abattage entraînerait une diminution de la saignée : le cœur s’arrêtant, nous n’obtiendrions pas une hémorragie aussi massive que souhaitée. Donc pas de post-cut stunning.
Les pays qui interdisent l’abattage sans étourdissement, par définition, ne produisent pas de viande casher : la Suisse, la Suède, le Danemark… Le cas de la Pologne est intéressant : l’abattage sans étourdissement – donc l’abattage rituel – a été interdit avant d’être rétabli à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle parce que cette interdiction portait atteinte aux droits fondamentaux de la communauté juive : or un accord avait été passé eu égard à l’histoire de la communauté juive de Pologne. De fait, la Pologne est devenue l’un des pays où l’abattage rituel est le plus important au point qu’elle exporte massivement de la viande casher vers Israël mais aussi, depuis peu, vers la France – ce qui peut être un sujet de préoccupation pour la viande française.
Le rejet des parties postérieures est une tradition rabbinique des pays européens. La question se pose, néanmoins, en effet, et mérite d’être travaillée. Dans certains pays, en Israël, en Afrique du Nord – il y a encore un peu de juifs au Maroc –, on pratique le retrait du nerf sciatique et des graisses interdites, et les gens mangent les parties arrière ainsi expurgées.
M. Dalil Boubakeur. Je ne suis pas vétérinaire mais on aborde, avec la question de la conscience et de l’inconscience de l’animal, tout le problème lié à la structuration, chez les mammifères, des fonctions du système nerveux dont les unes sont conscientes et les autres inconscientes. La structure consciente, chez l’homme, est le cortex, la partie superficielle de l’encéphale, lieu de la sensibilité consciente ou de la motricité consciente. La conscience, chez l’être humain, est très certainement différente de la conscience chez l’animal, dans la mesure où elle s’exprime. Dans l’islam, c’est par la conscience que nous sommes réunis à la nature de Dieu. Dans notre religion transcendante, notre conscience ne peut parvenir à le définir ni à lui donner une forme – et surtout pas anthropomorphique, ce qui est du reste interdit ; par contre, Dieu est connu grâce à ses quatre-vingt-dix-neuf attributs, caractéristiques compréhensibles par notre conscience.
Aussi, tout ce qui peut nous rendre inconscient nous éloigne-t-il de Dieu. Et si le premier interdit est le vin, c’est tout simplement parce qu’il rend la conscience trouble au point de conduire à l’erreur. Un des compagnons du prophète avait cité, pour la prière, un verset du Coran particulièrement ardu en se trompant au point de lui faire dire le contraire de ce qu’il signifiait, montrant par là que sa conscience était complètement troublée – d’où l’interdiction de l’alcool. Il est dit dans le Coran de ne pas entrer dans une mosquée alors qu’on est saoul. Au-delà, ce sont tous les éléments chimiques et biochimiques, qui vont rendre la conscience difficilement accessible à la clarté de la vision de Dieu, qui sont interdits par l’islam, et uniquement, j’y insiste, parce que les drogues, quelles qu’elles soient – LSD, cocaïne, psychotropes, psychodysleptiques… –, empêchent de connaître Dieu. La conscience est donc un élément fondamental du vivant.
Pour ce qui est de l’inconscience, je vais rappeler une expérience que beaucoup ont dû réaliser à l’école primaire : une grenouille décérébrée, quand on la soumet à un peu de courant électrique, réagit ; mais elle réagit inconsciemment. Les formations végétatives, sous-corticales, comme le thalamus, fonctionnent malgré tout ; les cheveux d’un cadavre poussent, de même que ses ongles ; mais cette vitalité apparente n’est plus la vie.
Aussi la différence entre conscience et inconscience répond-elle à une définition anatomique de la physiologie humaine et animale.
Le sacrifice d’un animal est un témoignage religieux. Or on ne peut sacrifier un animal déjà mort, ou dans un état qui ne donne pas à sa fin un caractère sacré. Dès lors que l’on va, d’une certaine manière, dégrader cette vitalité en mort apparente, en passant par l’inconscience, nous ne disposons pas d’éléments religieux nous permettant d’affirmer que nous opérons sur un animal halal ou casher.
J’en viens à la dernière question du président sur le verset 5 de la sourate V du Coran. Oui, l’islam évoque l’aliment casher, mais aussi l’aliment des chrétiens. À la naissance de l’islam, le prophète a commencé par croire qu’en s’adressant aux croyants chrétiens mais surtout aux tribus juives de La Mecque, il allait être aussi juif que le plus juif des pratiquants et aussi chrétien que le plus chrétien. Il y avait quantité de moines et de monastères en Arabie à cette époque, et pas seulement de l’église byzantine : l’église arianiste, l’église nestorienne, l’église monophysite étaient présentes aussi, chacune avec sa propre vision de la religion, différentes de celle de Byzance qui les considérait comme hérétiques, mais dont s’accommodaient très bien les peuples arabes. Et leurs aliments étant considérés comme tout à fait licites, tout comme ceux des Sabéens qui ne sont ni juifs ni chrétiens mais croyants, gnostiques.
Ce qui compte, en l’occurrence, est la foi en un Dieu unique. Les juifs, sur le sujet, sont très stricts et nous avons beaucoup appris d’eux en matière théologique, beaucoup plus qu’on ne pense. Je demanderais d’ailleurs volontiers à M. le grand rabbin de m’envoyer quelques rabbins pour enseigner la théologie à mes étudiants, à l’école de formation des imams ; ce serait très intéressant… Les juifs sont donc nos maîtres en théologie et pour ce qui est de la rigueur de la réflexion sur Dieu. L’interdit du porc nous vient du judaïsme comme nombre de nos interdits. C’est dire la grande proximité entre nous aux débuts de l’islam : le prophète a été se réfugier parmi les tribus juives pour échapper à ses propres compatriotes arabes qui venaient l’ennuyer, voire le tuer. Le fondement de l’islam est judéo-chrétien. Le respect de Mahomet pour le judaïsme a été exemplaire et c’est Virgil Gheorghiu, l’auteur de La vingt-cinquième heure, qui, dans sa biographie de Mahomet, affirme qu’il n’y avait pas d’homme plus tolérant que le prophète de l’islam. Nous avons malheureusement beaucoup régressé depuis… Lorsque le convoi d’un défunt juif est passé devant l’assemblée des musulmans où siégeait Mahomet, ce dernier s’est levé, et à ses compagnons lui ont demandé pourquoi, il a répondu : « C’est une âme qui passe. » Pour nous, l’âme est sacrée, de quelque individu qu’il s’agisse, de quelque race à laquelle il appartienne. L’âme est, si l’on peut dire, une émanation de Dieu ; elle est un privilège de l’homme qui lui permet de se mettre en rapport avec Dieu. Et nous estimons que Dieu a donné peut-être un peu de ce trésor à l’animal pour qu’on le respecte.
M. Kamel Kabtane. Il est en effet écrit dans le Coran : « Vous sont permises les nourritures des gens du Livre. » Cela signifie que les abattages, à l’époque, étaient réalisés par la communauté chrétienne et par la communauté juive. Or, aujourd’hui, en France, les abattoirs ne sont pas placés sous la responsabilité religieuse de juifs ou de chrétiens : nous sommes dans un contexte laïque. D’autre part, l’interprétation des versets du Coran ne peut être réalisée que par les savants musulmans. Certaines pratiques ne sont autorisées qu’en cas de nécessité absolue ; or, en France, on a accès très facilement à la viande certifiée halal par des organismes religieux chargés d’en contrôler la licéité ; il n’y a donc aucune nécessité absolue pour les musulmans d’accepter les viandes autres que celles abattues selon le rituel islamique.
Vous nous avez ensuite demandé pourquoi l’abattage rituel avec étourdissement était admis dans d’autres pays et pas en France. Les cinquante-sept pays qui composent l’Organisation de la coopération islamique (OCI) s’efforcent d’harmoniser leurs pratiques en matière d’abattage rituel et de contrôle, et s’accordent sur le rejet de l’assommage. L’objectif visé est la sortie de la divergence. Nous avons ainsi récemment accompagné une délégation officielle égyptienne dans certains abattoirs français, qui sollicitait un agrément pour exporter leur viande : l’assommage a été totalement proscrit. Il se trouve que les abattoirs ont du mal à trouver des débouchés sur ces marchés-là du fait du changement des exigences : la Malaisie, par exemple, n’accepte pas d’utiliser le pistolet à tige perforante, et requiert un abattoir 100 % halal pour que l’on puisse exporter. Autant de conditions qu’il est difficile de réunir.
Les musulmans, dans le monde, se réfèrent à leurs pratiques religieuses, à des écoles juridiques différentes et donc peuvent avoir des avis divergents sur certaines questions. C’est pourquoi la jurisprudence musulmane impose la règle de la sortie de la divergence ; elle incite les autorités religieuses à choisir les avis qui permettent d’atténuer les divergences entre les écoles juridiques en choisissant l’avis le plus communément admis par l’ensemble des savants musulmans.
D’autre part, pendant longtemps, les pays musulmans ont été importateurs de viandes provenant des pays occidentaux, compte tenu de la faiblesse de la production locale. Une méconnaissance des techniques d’abattage et d’assommage les a conduits à accepter certaines pratiques par nécessité. Or, aujourd’hui, plusieurs de ces pays produisent localement. L’élévation du niveau des connaissances techniques et pratiques et la visite plus régulière des sites d’abattage des pays importateurs conduisent de nombreux pays à prendre position contre l’assommage.
M. William Dumas. Ma première question concerne les sacrificateurs. Vous nous en avez longuement parlé, monsieur le recteur, mais sans entrer dans le détail de leur formation. Vous avez précisé qu’elle durait trois ans : c’est beaucoup…
Ensuite, on constate qu’il y a de plus en plus de boucheries halal et de plus en plus de viande halal sur le marché, comme nous l’ont confirmé des industriels que nous avons auditionnés. Auparavant, les musulmans en France mangeaient de la viande qui n’était pas systématiquement halal. Je suis fils de viticulteur et les ouvriers agricoles, chez moi, mangeaient de la viande qui n’était pas halal, à l’exception de celle provenant des poules qu’ils tuaient eux-mêmes ou du mouton sacrifié lors de la fête de l’Aïd. Or ils étaient tout aussi attachés à leur religion aujourd’hui. Comment expliquez-vous cette importance croissante de la viande halal ?
Vous avez indiqué, monsieur le recteur de la grande mosquée de Lyon, le nombre de sacrificateurs que vous certifiez chaque année. Seulement, quand on songe, à l’occasion de l’Aïd, au nombre de lieux destinés à l’abattage – car auparavant les sacrifices se faisaient n’importe où et n’importe comment –, êtes-vous vraiment sûr de n’avoir affaire qu’à des sacrificateurs agréés ?
Ma dernière question s’adresse à M. Fiszon. Une saignée rapide entraîne la perte de conscience en combien de temps, selon vous ?
M. Bruno Fiszon. La perte de conscience et la perte de sensibilité ne recouvrent pas la même réalité : la perte de conscience précède la perte de sensibilité : on peut la mesurer en laboratoire avec des électroencéphalogrammes qui montrent qu’on parvient alors à une activité cérébrale très réduite. Les volailles perdent conscience en trois ou quatre secondes et les ovins en moins de dix secondes. L’idéal serait, pour les bovins, d’arriver à une perte de conscience en dix-sept ou dix-huit secondes, et surtout de ne pas dépasser trente secondes. Ce laps de temps dépend de la compétence du sacrificateur et de la qualité de son matériel. C’est pourquoi le couteau est systématiquement vérifié.
L’un des grands scientifiques travaillant sur cette question, le professeur Regenstein, déclarait en mai 2011 : « Il faut reconnaître que l’abattage rituel nécessite plus d’efforts pour être accompli selon les règles de l’art, en conformité avec le bien-être animal ; mais, lorsqu’il est accompli correctement, il peut être considéré comme égal, voire supérieur – notamment pour les volailles, comme je l’ai expliqué – à d’autres modes d’abattage avec étourdissement. »
Vous avez rappelé, monsieur le président, que l’abattage rituel constituait une dérogation, certes ; reste que, d’un point de vue scientifique, il n’est pas évident que l’étourdissement soit supérieur, dans tous les cas, à un abattage rituel accompli selon les règles de l’art. Encore une fois, les travaux sont contradictoires et il est vrai que si ceux, notamment, de Gregory au Royaume-Uni et de Gibson en Nouvelle-Zélande, montrent que l’abattage rituel n’est pas une bonne méthode, ils ont été réalisés à partir d’expériences en laboratoire et non in situ, ce qui pose tout de même un problème de méthodologie.
J’ajouterai que l’abattage rituel juif représente seulement 1,6 % de l’abattage total des mammifères – hors porcins, cela va de soi. Autrement dit, c’est très peu. Enfin, nous allons mener une réflexion sur le sort des parties postérieures mais, comme vous le constatez, cela représente une quantité de produits très faible.
M. Dalil Boubakeur. En ce qui concerne la consommation de viande halal, au cours des cinquante dernières années, j’ai pu observer l’évolution de la communauté musulmane. Pendant la phase purement française, avant 1962, il y avait quelques centaines de milliers de musulmans qui vivaient avec ce qu’ils pouvaient trouver. Ainsi que l’a excellemment exposé mon collègue et ami Kamel Kabtane, nécessité faisait loi : les imams avaient alors décrété que, n’ayant pas les moyens de se procurer de la viande halal, les musulmans pouvaient tout à fait manger de la viande non halal parce que la physiologie humaine commande de manger de la viande.
M. William Dumas. Dieu est miséricordieux…
M. Dalil Boubakeur. Absolument, Dieu est miséricordieux : en cas de nécessité, Dieu permet, avec son pardon, que la viande non rituellement égorgée soit consommée.
Puis, à partir de 1962, de nombreux musulmans, en particulier d’Algérie, ont été considérés comme rapatriés. On sortait brutalement du code de l’indigénat malgré le souhait du général de Gaulle, en 1958, de réaliser l’intégration en Algérie. Nous avons eu un an ou deux pour choisir entre être Français ou prendre la nationalité algérienne qui venait d’apparaître, comme ce fut le cas pour les Marocains en 1955 et pour les Tunisiens en 1957
– alors que l’ensemble des musulmans étaient jusqu’alors ressortissants de la communauté française.
À partir de 1962 s’est posé le douloureux problème des harkis. Un rapatriement massif a eu lieu, avec des aléas sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir, créant des difficultés notamment concernant la pratique religieuse. La question a été de savoir si ces gens-là devaient adopter une conception laïque vouée à la satisfaction des besoins familiaux, à la scolarité, au travail, etc., ou si, petit à petit, leur identité n’allait pas revenir affleurer parmi ces besoins. Je reconnais les efforts de mon ami Kabtane, tout jeune à l’époque, qui, avec un certain nombre de personnalités françaises, dont des officiers dont je salue la mémoire, a formé une association des Français musulmans. Ils ont commencé par demander une mosquée. Ainsi la grande mosquée de Lyon, la première obtenue après celle de Paris, a-t-elle répondu à une demande des musulmans pour l’exercice de leur culte. Elle a été inaugurée en 1994 après un terrible parcours du combattant, après des difficultés dont vous n’avez pas idée.
Auparavant, François Mitterrand, dès après son élection à la présidence de la République, avait promulgué une loi d’exemption pour les musulmans étrangers formant des associations loi de 1901 : les musulmans étrangers comme les musulmans français bénéficiaient désormais de la même facilité pour devenir président d’une association loi de 1901. Vous pouvez imaginer que leur première demande a été la création de mosquées. La première a été installée dans une usine désaffectée, à Roubaix, après que le Gouvernement s’y est opposé, tout comme le maire, André Diligent. Il a fallu en effet des manifestations aussi importantes que le serait, un peu plus tard, la marche des beurs, pour que le fait musulman soit considéré comme partie intégrante de notre République laïque. L’efflorescence des mosquées, à partir du début des années 1980, fut telle qu’on a constaté, en 1995, donc quelque quinze années après la promulgation de cette loi par François Mitterrand, que l’islam était devenu la deuxième religion de France.
Tout le reste, vous l’imaginez bien, a suivi : les prières, le pèlerinage, les pratiques religieuses… L’augmentation de la production de viande halal a commencé à ce moment-là, sans être bien contrôlée puisque les sacrificateurs étaient agréés par les préfets. Deux ministères, celui de l’intérieur, qui est chargé de tous les cultes, et celui de l’agriculture, chargé pour sa part des questions touchant à l’alimentaire, ont donc mis les autorisations en place, le décret de 2011 prévoyant que les sacrificateurs soient formés, notamment en matière de prévention de la souffrance animale.
On note donc une importante évolution de la communauté musulmane qui a poussé les autorités à exiger que les sacrificateurs et les contrôleurs soient formés, en partie par le ministère de l’agriculture qui délivre l’attestation, et par les instituts musulmans comme l’a précisé le recteur de la grande mosquée de Lyon.
M. William Dumas. J’ai bien compris que la formation était complète du point de vue religieux, mais quelle est précisément la formation pour procéder à la saignée ? M. Fiszon a parlé de trois ans de formation.
M. Kamel Kabtane. Vous vous êtes demandé, monsieur le député, pourquoi, il fut un temps, des ouvriers, dans votre exploitation, consommaient de la viande non halal. Le recteur de la grande mosquée de Paris vous en a donné la raison : en cas de nécessité l’islam est une religion de miséricorde. De plus, dans les années que vous évoquez, l’islam n’était pas organisé.
Dans le milieu des années 1970 a été autorisé le regroupement familial. À la même époque, une circulaire du ministre de l’intérieur, M. Poniatowski, prévoyait la création de carrés musulmans dans les cimetières. Ensuite, les municipalités ont incité les musulmans, afin de pouvoir mettre un lieu à leur disposition, à se constituer en association loi de 1901 – possibilité offerte aux étrangers, on l’a vu, à partir de 1981 – et non en association aux termes de la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Dès lors qu’on nous demandait de nous intégrer, on ne pouvait pas nous intégrer à moitié, mais en tant que musulmans.
Pour ce qui est de la boucherie, ce n’est pas notre faute si la boucherie française est en déclin, si les boucheries ferment et sont rachetées par des musulmans. Je comprends tout à fait que le mot « halal », sur les enseignes, puisse gêner, mais ces boucheries répondent à un besoin, certaines se portent très bien et les abattoirs sont très heureux de les avoir comme clientes.
M. William Dumas. Ce n’est pas ce que je voulais dire ; je vous demandais comment vous expliquiez l’importance croissante de la viande halal.
M. Dalil Boubakeur. Elle est le résultat d’une prise de conscience des musulmans.
M. Kamel Kabtane. En effet. Aujourd’hui, avec la création du CFCM et d’autres organisations, des relations se nouent entre les autorités publiques et les responsables musulmans. Je comprends tout à fait qu’on soit étonné de cette évolution mais nous ne sommes plus dans une France fermée : nous sommes en train de vivre la mondialisation – qui implique aussi que les musulmans puissent vivre leur foi.
Je reviens sur la formation. Le 15 juin 2015 s’est réuni au ministère de l’intérieur un groupe de travail devant élaborer un guide pratique, réunion au cours de laquelle nous avons fait des propositions. En attendant leur éventuelle prise en compte, nous continuons à accompagner les abattoirs avec lesquels nous travaillons pour mettre en place une formation pratique des sacrificateurs. La réglementation imposant qu’on ne peut pas abattre plus d’animaux qu’il n’en est commandé, il faudrait que nous puissions former nos sacrificateurs en abattoir. Nous-mêmes avons mis en place une formation de sacrificateur, nous délivrons un certificat de compétence.
Nous proposons par ailleurs que soit imposée une contention dans des boxes rotatifs afin de réduire le stress de l’animal lors de sa contention debout, et afin d’éviter, lors du sacrifice, la présence de sang dans la trachée, et l’aspiration de sang dans les bronches, ce qui peut provoquer une réaction irritante pour l’animal. D’autre part, il est préconisé, dans le cadre de l’abattage rituel musulman, de coucher l’animal sur son flanc, position naturelle pour lui. Ensuite, il conviendrait d’adapter les boxes aux espèces d’animaux et à leur taille, ce qui implique d’aider les abattoirs à investir dans des pièges adéquats.
Surtout, il faut combattre les idées reçues et en finir avec les débats passionnels provoqués par certaines associations de défense du bien-être animal, qui partent du principe que l’abattage des animaux en général, et que l’abattage rituel en particulier, tel qu’il est pratiqué en France, est barbare. Est-ce parce que nous sommes musulmans ou juifs que nous serions des barbares ?
L’islam traite du bien-être animal depuis quatorze siècles. Nous n’avons pas attendu le XIXe siècle pour en parler. Et il a fallu attendre 1964 pour voir arriver les premières dispositions en la matière. J’ai participé, en compagnie du rabbin Fiszon, à toutes les réunions en Europe sur la question – car nous faisons partie de cette Europe : est-ce à dire que nous serions d’une autre planète ? Je suis Français et fier de l’être, mais je suis aussi musulman et, comme le soulignait le grand rabbin de France tout à l’heure, on ne peut pas nous demander de n’être qu’une moitié de nous-mêmes.
Il y a une volonté de détruire l’élevage en France, et particulièrement chez les membres de l’association L214 qui veut faire de nous des végétariens. Nous sommes respectueux des lois et c’est pourquoi nous acceptons de venir discuter avec vous et afin de trouver, avec vous et avec personne d’autre, des solutions qui tiennent compte de nos convictions religieuses.
M. Yves Censi. Je vous remercie, les uns et les autres, pour vos exposés très précis, très documentés, mais que je ne qualifierai pas de « savants », terme que je réserve à la démarche scientifique, monsieur le recteur. Reste que j’ai apprécié la somme de vos connaissances et le récit très précieux de vos expériences.
Je souhaite, pour commencer, réagir aux propos introductifs du grand rabbin de France, que j’ai approuvés, bien sûr. Évidemment, la pratique religieuse est une liberté en France et moi non plus je ne partage pas les injonctions schizophréniques de la IIIe République, suivant lesquelles il faudrait avoir un comportement privé différent du comportement public : ce n’est pas ma conception de la laïcité. Chacun a la liberté de pratiquer sa religion. J’ai en effet ressenti, par moments, au cours de vos exposés, la crainte chez vous d’une certaine menace de ne pas pouvoir exercer vos pratiques religieuses. Ce n’est toutefois pas l’objet de cette commission, ni de ses futures propositions.
Il faut en outre faire attention, monsieur Kabtane, quand, évoquant certaines critiques contre l’abattage barbare, vous dites : « Ce n’est pas parce qu’on est juif ou qu’on est musulman qu’on est barbare. » On ne peut pas tenir ce genre de propos…
M. Kamel Kabtane. C’est ce que certains affirment !
M. Yves Censi. Il est permis de critiquer certaines pratiques sans s’en prendre pour autant aux fondements des principes religieux de l’opérateur.
Vous avez tous inscrit l’évolution des recommandations religieuses, en matière d’abattage, dans une histoire qui relève à mes yeux du mythe – lequel repose par définition sur une croyance plutôt que sur une histoire. Quoi qu’il en soit, cette historicité existe. Cela étant, vous avez bien montré, monsieur Boubakeur, évoquant le XXe siècle, que les évolutions étaient tout à fait possibles. L’interprétation des textes n’est donc pas immuable et il nous importe, dans un cadre laïque, de ramener le débat non pas à un jugement moral, mais à la loi qui s’impose à tous.
La question est de savoir ce qui pose concrètement problème : c’est d’abord, vous l’avez dit vous-mêmes, la souffrance animale. Vous avez chacun accepté d’approfondir la dimension scientifique du sujet, établissant une différence entre la sensibilité, la sensation, la perception – qui, elle, est consciente –, vous concentrant sur le fonctionnement biologique : vous avez évoqué les noyaux sous-corticaux, les propriétés nociceptives propres à chaque espèce… Aussi, considérez-vous devoir évoluer comme nous le devons nous-mêmes ? Seriez-vous prêts à accepter, le président vous a déjà posé la question, l’assommage post-jugulation ? La réponse ne peut être à mon avis que positive, puisque tout le monde est capable d’évoluer en fonction, notamment, des connaissances scientifiques.
M. Bruno Fiszon. En fonction des connaissances scientifiques…
M. Yves Censi. Bien sûr. Je ne suis personnellement pas tout à fait d’accord avec vos descriptions pour le moins incertaines des connaissances scientifiques sur la nociception et sur les seuils de déclenchement de la douleur – qui en l’occurrence sont plus précises.
Je souhaite ensuite vous interroger sur les implications sociales de l’abattage rituel ; son acceptabilité par nos populations est déterminante. La transparence est indispensable pour que nos concitoyens en aient une interprétation correcte. Évidemment, un égorgement paraît de prime abord forcément barbare ; mais on peut aussi le considérer autrement dès lors qu’il est rendu acceptable au regard de la loi.
Soit vous considérez que la loi est mal faite et qu’elle mérite une dérogation, soit ce n’est pas le cas et vous admettez la nécessité de l’assommage. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce point ?
J’aurai également voulu en savoir un peu plus sur ce développement impressionnant de la tendance à manger halal ; cette évolution un peu surprenant pose question, dans la mesure où nos concitoyens ont l’impression de très peu la maîtriser.
M. Kamel Kabtane. Pourquoi ne visez-vous que le halal ?
M. Yves Censi. Parce que je ne pense pas que la consommation casher évolue au même rythme que la consommation halal.
M. Bruno Fiszon. C’est tout simplement une question démographique.
Mme Annick Le Loch. Je vous remercie pour vos contributions et j’ai beaucoup appris en vous écoutant.
Hier soir, nous avons longuement échangé avec un grand industriel français qui nous a déclaré qu’il y avait de gros progrès à faire en matière d’abattage rituel en France. Il a même dit que c’était « le bordel », pour reprendre ses propres termes… Quant à l’abattage casher, il trouvait même que c’était encore pire, car extrêmement violent – ce qui m’a touchée. Il a évoqué l’uniformité à rechercher et insisté sur la nécessité de parfaire la formation des sacrificateurs. Il a mentionné, toujours à propos de l’abattage rituel, si je me souviens bien, un appareil testé dans un abattoir de Castres pour lequel il attendait un agrément afin de pouvoir l’utiliser au plan national. Il s’agit d’un appareil qu’il a fait venir de Nouvelle-Zélande et qu’il a dans un premier temps testé dans le Nord de la France ; malheureusement, les services de l’État n’y ont, à l’entendre, prêté aucun intérêt, contrairement à ceux de Castres.
Par ailleurs, j’ai lu récemment un article sur la multiplication désordonnée des certifications halal – je crois d’ailleurs, monsieur le recteur de la grande mosquée de Paris, que vous vous êtes séparé, à un moment donné, de votre certificateur, mais je ne sais pour quelle raison. Il n’y aurait en tout cas pas de normes, aucun cahier des charges uniques en France. Pour moi, la religion est une, or il y a plein de certifications halal, alors j’avoue que je ne comprends pas bien, c’est pourquoi je souhaite obtenir de votre part une clarification sur ce point. J’ai lu aussi que l’égorgement totalement rituel d’un poulet coûterait très cher s’il fallait respecter strictement cette façon de faire… Vous me faites signe que c’est ce que vous faites, il ne s’agit donc pas de commentaires fondés.
Pensez-vous, donc, qu’il puisse y avoir une seule définition de l’abattage rituel et un seul certificat halal alors que je crois qu’il y a plus de six certificateurs en France ?
M. François Pupponi. J’ai été très intéressé et très impressionné par tout ce que j’ai entendu. Je puis témoigner, en tant que maire de Sarcelles où vit une communauté juive importante, que la pratique de la cacherout est beaucoup plus marquée aujourd’hui qu’il y a cinquante ans lors de l’arrivée des juifs dans la ville. On constate, d’une manière générale, que les croyants, qu’ils soient juifs, musulmans, catholiques, chrétiens d’Orient… sont de plus en plus rigoureux dans la pratique de leur religion. Du coup, les musulmans et les juifs ont de plus en plus envie de manger halal ou casher. Mon beau-frère est agriculteur et élève des poulets dans le Nord de la France. La part de sa production destinée à la consommation halal est passée à 80 % en dix ans : les clients entendent de plus en plus respecter des prescriptions religieuses, et les agriculteurs savent bien où sont les clients.
Je peux entendre l’inquiétude du grand rabbin de France, puisque des propositions de loi nous parviennent d’un peu partout, visant à imposer l’étourdissement préalable à l’égorgement. Ce qui signifie, si je vous ai bien entendu, qu’une telle pratique ne serait pas conforme à vos textes religieux et que, donc, la viande ainsi obtenue ne serait ni halal ni casher. Si une telle loi devait être votée – et qui, selon moi, serait contraire au principe de laïcité puisqu’elle attaquerait le principe de la liberté absolue de conscience – quelles en seraient les conséquences pour vous et quelles solutions de rechange envisageriez-vous ?
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Je vous remercie, messieurs, pour vos exposés. Nous avons tous ici bien conscience que, quel que soit le mode d’abattage, les conditions objectives d’exécution sont loin d’être parfaites ; c’est du reste ce qui justifie l’existence de la présente commission. Beaucoup de travail nous attend pour combler l’écart entre la règle et la pratique ; ce qui ne retranche rien aux questions qui ont été posées. Il n’y a pas un modèle d’abattage idéal vers lequel nous devrions tendre, mais des règles dont la mise en œuvre pose des problèmes. Autrement dit, il n’y a pas une perfection et des soucis ; il y a des règles et des soucis dans leur mise en œuvre.
Je commencerai par les techniques admises et leur évolution. À un moment donné, il faut bien que des autorités, légales d’un côté, religieuses de l’autre, conviennent des pratiques admises par les uns et par les autres, et conviennent d’un processus d’évolution. Autrement dit, il convient de définir une méthode pour savoir si et les autorités légales et les autorités religieuses acceptent un outil nouveau. Il ne servirait à rien, en effet, de l’accepter sur le plan réglementaire s’il n’est pas utilisable aux fins rituelles auxquelles on le destine ; de même, s’il est conforme aux prescriptions religieuses mais inacceptable d’un point de vue réglementaire, le problème ne sera pas mieux résolu. Nous devons donc réfléchir à un process adéquat.
Surtout, une fois cette technique définie, comment en contrôler la bonne exécution ? Nous nous heurtons ici à un problème spécifique à l’abattage rituel : ce contrôle devrait à mon sens être partagé. La décision de sa conformité à la prescription religieuse vous appartient mais, sur le terrain, dans l’abattoir, quiconque voit l’acte, pourrait avancer que la pratique n’est pas halal ou pas casher : « Moi qui ne suis pas savant en matière de religion, j’ai un texte qui me dit comment procéder et je vois bien que ce n’est pas ce que vous faites ! Vous êtes venu sacrifier un animal dans mon abattoir, vous êtes agréé pour le faire, c’est parfait, mais je suis responsable de mon établissement et je constate que votre couteau est ébréché, que l’aiguisage n’est pas bon, que vous n’êtes pas venu à l’heure prévue, etc. » Pouvons-nous donc accepter ce contrôle double de la licéité religieuse et de l’exécution qui, elle, peut être contrôlée à plusieurs ?
Enfin, j’estime qu’il faut faire des efforts en matière de formation. Les générations passent et les gestes requis sont très techniques. Je dis souvent qu’il y a plus de différence entre un abattage rituel mal fait et un abattage rituel bien fait qu’entre un abattage rituel et un abattage non rituel. Ce qui signifie que le progrès accompli est loin de friser la perfection et qu’il convient d’améliorer la formation, j’y insiste, le contrôle, l’agrément des équipements et des personnels… Sur ce dernier point, je suis frappé par la durée des agréments : l’opérateur est agréé, soit, mais quand vérifie-t-on que l’agrément tient toujours, que l’intéressé est toujours capable de remplir sa fonction, qu’il maîtrise les nouvelles techniques, meilleures que celle mises en place dix ans auparavant, bref, qu’il est au top, comme on dit en bon français ? Nous devons, ici aussi, travailler ensemble pour mieux assurer le progrès : ne pouvons-nous concevoir des instances paritaires de réflexion technique, de réflexion éthique qui le diffuseraient ? Il faut en effet bien reconnaître que, dans la pratique, on note une grande émancipation par rapport aux règles en vigueur, qu’elles soient administratives ou religieuses.
M. Haïm Korsia. Je remercie vraiment les députés qui ont posé ces questions et en particulier le rapporteur qui a exprimé ce que j’aurais voulu dire.
Je rappelle que l’abattage rituel représente 15 % du total et que l’abattage rituel juif ne compte que pour 1,6 % des animaux.
Je ne suis pas forcément d’accord avec ce qui a été dit sur l’association L214 : même si elle donne un coup qu’on peut prendre personnellement, l’alerte qu’elle lance est vitale pour nous tous. Ensemble, faisons face – devise de l’armée de l’air où j’ai servi – à ces critiques, même si l’abattage rituel juif et l’abattage rituel musulman ne sont en rien concernés par les images atroces qui ont été diffusées. Et vous avez raison, monsieur le rapporteur : quand j’étais rabbin de Reims, j’étais allé visiter les abattoirs pour voir ce qui s’y passait. Quiconque voit un abattage ne mange pas de viande pendant au moins plusieurs semaines, tant il est difficile de le supporter dans une société qui a normalement évacué la violence de sa sphère. Nous devons ensemble améliorer les choses.
Oui, madame Le Loch, si une nouvelle technique nous arrive de Nouvelle-Zélande ou d’ailleurs, si elle est conforme à la fois à la réglementation en vigueur – par nature évolutive – et aux prescriptions religieuses, nous saurons nous adapter.
En ce qui concerne votre audition d’hier soir, je ne l’ai pas visionnée mais j’ai l’impression, d’après ce que vous en dites, que vous avez eu affaire à quelqu’un qui n’aime pas l’abattage rituel juif – qu’il trouve, je reprends son mot, bordélique –, qui n’aime pas l’abattage rituel musulman, qui n’aime pas non plus l’État, bref, quelqu’un qui n’aime personne… Eh bien, nous irons abattre ailleurs ! Je pense néanmoins qu’il y a un problème majeur dans ce qu’il décrit : malheureusement, des abattages rituels juifs sont réalisés par des sacrificateurs qui ne sont pas sous mon autorité. La carte que je délivre est terrifiante : je peux la retirer sur simple contrôle des vétérinaires. Le ministère de l’agriculture a un corps d’inspection auquel nous nous fions totalement, au point que si les vétérinaires nous signalent – et c’est arrivé, j’évoque ici un cas concret – que tel abatteur rituel a fait un geste un peu rapide ou non conforme aux prescriptions, je lui retire sa carte et il se retrouve dans l’impossibilité de travailler. Et, afin d’éviter tout souci avec les prud’hommes, nous lui confions le contrôle de la phase qui suit l’abattage.
J’aime cette idée qui me rappelle l’article 40 du code de procédure pénale qui oblige les fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions, à aviser sans délai le procureur de la République d’un crime ou d’un délit dont ils auraient eu à connaître. De la même manière, si quelqu’un constate une pratique dangereuse, qui affaiblit la confiance qu’on place dans la filière collective, il doit la dénoncer.
Sur le tableau accroché derrière votre président, on peut lire cette phrase : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Il s’agit d’une phrase quasi biblique : tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse. Cette liberté, on conçoit bien que, parfois, on doive la normer.
Oui, nous nous adaptons, monsieur Censi, mais, et c’est le génie de la France, cette adaptation se fait dans le respect de nos traditions, dans le respect de ce que nous sommes.
Vous avez également évoqué le système dérogatoire. Je vais vous donner un exemple qui me rappelle mon expérience militaire : en France, depuis un décret de 1939, on n’a pas le droit de vendre d’armes à l’étranger, sauf système dérogatoire. C’est ce système dérogatoire, qui s’appelle la CIEEMG (Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre), qui fait aujourd’hui de nous, très immodestement, le troisième vendeur d’armes au monde… La dérogation ne consiste pas à vous vous autoriser à faire dans votre coin votre petit truc pas terrible ; c’est une façon de dire qu’il s’agit d’un acte grave, grave au sens d’important. Oui, c’est un acte grave, important, de vendre des armes ; on ne le fait pas de manière anodine. Oui, c’est un acte grave, important, d’abattre un animal, un être vivant. Le système dérogatoire, j’y insiste, dans le cas qui nous occupe, ne signifie pas qu’on condescend à vous laisser faire votre truc entre vous, mais qu’on a conscience que, vous donnant cette dérogation, vous devez être encore plus attentifs au respect de l’être vivant que vous devez abattre pour le consommer. Ce système est construit sur la confiance de tous les intervenants, y compris sur celle du brave homme que vous avez auditionné hier soir. Je crois profondément que c’est ensemble que nous pourrons instiller de la confiance.
Il s’agit d’une règle que j’ai théorisée sur l’éthique – j’étais membre du Comité national d’éthique. Certes, quand, on parle d’éthique, on ralentit le système et on est moins efficace. Mais quand on parle d’éthique, on instille de la confiance dans le système et, à moyen et, surtout, à long terme, le système sera plus efficace.
De la même façon que l’État a mis en place des comités d’éthique sur les rites funéraires, ce serait une belle idée que vous proposiez la création d’une sorte de comité d’éthique sur l’abattage et qui ne réunirait pas uniquement des représentants religieux – je répète que tout ce qui a heurté l’opinion n’a jamais concerné l’abattage rituel : il s’agissait, en l’occurrence, d’abattage bio… Nous y participerions, pour ce qui nous concerne, comme une part de la pensée collective pour renforcer la confiance dont la société a tant besoin.
M. Bruno Fiszon. Que se passerait-il si l’on supprimait la dérogation dont nous bénéficions et donc si nous étions obligés d’étourdir l’animal avant ou après ? Eh bien, nous ne pourrions plus consommer de la viande produite en France et nous l’importerions. C’est le cas des juifs en Suisses qui importent la viande française. Cette viande serait plus chère et ce serait dommage pour le secteur bovin français. Or, on en importe déjà de Pologne…
Pour ce qui est des références scientifiques, auxquelles M. Censi a fait allusion, je citerai un rapport remis en 2013 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui précise que « les passages à l’inconscience et à la mort restent des étapes difficiles à définir de façon précise au plan scientifique ».
M. Yves Censi. Pourtant, l’électroanesthésie…
M. Bruno Fiszon. Il ne faut pas confondre étourdissement par matador, où l’on perfore le crâne, et anesthésie : on n’injecte pas un produit à l’animal pas plus qu’on ne lui fait tranquillement respirer un gaz. Il y a une grande difficulté à évaluer la souffrance et la conscience, ce qui explique que les résultats scientifiques soient contradictoires.
J’irai dans votre sens, monsieur le rapporteur : un grand travail reste à faire, quel que soit le mode d’abattage, conventionnel avec étourdissement ou rituel. Le même débat que celui que nous avons, au sujet des techniques, a cours aux Pays-Bas où l’on réfléchit, sur la base de données scientifiques, à la position d’abattage : il s’agit de savoir à quel niveau du cou abattre l’animal afin de provoquer le moins de souffrance possible. Les rabbins réfléchissent et sont en passe d’accepter cette proposition. Les possibilités existent, travaillons ensemble pour le bien-être animal, certes, mais aussi pour le bien-être des citoyens que nous sommes.
M. Dalil Boubakeur. Sur le plan éthique, monsieur le député Censi, vous avez posé des questions fondamentales. C’est l’éthique musulmane qui chapeaute la question du halal.
L’éthique est fondée sur la morale. Jusqu’au XVIIIe siècle, la morale visait à rapprocher le fidèle de Dieu. Mais depuis le XVIIIe siècle, les choses ont totalement changé : la morale est fondée sur la philosophie de Kant, à savoir sur la raison ; ce n’est plus la proximité avec Dieu qui rend une chose bonne ou mauvaise, mais son caractère universalisable.
Auguste Comte, philosophe français, a pour sa part défini la loi des trois états : l’état théologique, encore très présent dans certaines religions, et particulièrement dans l’islam, l’état métaphysique et l’état positif, qui procède d’une vision plus rationnelle. La laïcité que nous vivons est pour nous la meilleure organisation rationnelle qui soit des peuples en France – et je pèse mes mots. Il faut accepter le fait que nous vivions dans une société plurielle dont l’organisation est rationnelle. Toutes les décisions de la société française découlent de la raison et non pas de Dieu. Dans ma morale personnelle je peux considérer que Dieu ou même Satan est mon élément de référence, mais la société française…
M. Yves Censi. La République est agnostique.
M. Haïm Korsia. Elle est laïque.
M. Dalil Boubakeur.… à laquelle nous avons tous dit notre attachement, est, dans ses décisions, fondamentalement laïque.
Nous devons évoluer dans le sens de la rationalité. La souffrance animale nous heurte parce que nous sentons qu’il y a là un élément qui échappe à la raison, qui échappe à une conception universaliste. L’abattage rituel a-t-il un caractère universel ? En France, en tout cas, c’est une pratique dérogatoire. Je me souviens de la difficulté qu’a eue la France pour l’obtenir des autorités européennes, marquées non par la religion mais par cette vision rationnelle qui doit caractériser ceux qui décident, même si, en l’occurrence, ils n’ont pas la même vision que nous de la laïcité : un commissaire britannique était déterminé à taxer la France pour ne pas appliquer la réglementation… Je me souviens qu’en France même il n’a pas été facile de faire accepter cette dérogation au ministère de l’intérieur.
La France a fait le maximum pour ouvrir sa laïcité. On a beaucoup parlé de laïcité ouverte, mais au point que des modifications de la loi de 1905 ont été préconisées ; or je ne les souhaite pas – grands dieux ! Les partisans de ces modifications reviennent parfois à la charge et je leur réponds : non. Nous devons avancer.
Quant aux musulmans en particulier, où allons-nous ? Tout ce qui se passe actuellement relève encore de cette vision théologique décrite par Comte, d’une vision totalement étroite de la religion – ce n’est d’ailleurs même plus de la religion, c’est du fanatisme. Je suis des plus hostiles à Daech – et pour cela je suis menacé physiquement – ; je n’accepte pas cette organisation vers laquelle tous les musulmans se précipitent comme des veaux, des moutons de Panurge…
Kamel Kabtane. Pas tous ! (Sourires.)
M. Dalil Boubakeur. Pas tous, certes ! Heureusement, il nous en reste quelques-uns ! Mais, je le répète : où allons-nous ? Hier, nous étions avec le ministre de l’intérieur et nous avons vérifié que non seulement ce phénomène était un danger pour la société française, mais qu’à cause de lui les musulmans subissaient une double peine.
M. Kamel Kabtane. Je donnerai pour ma part quelques chiffres. J’ignore si vous le savez, monsieur le député Censi, mais un musulman consomme en moyenne 45 kilogrammes de viande par an contre 17 kilogrammes pour l’ensemble de la population. Voilà qui contribue à expliquer pourquoi on produit tant de halal. Ensuite, 14 % de l’abattage bovin est halal, et cette part monte à 22 % pour les ovins. Tous les petits éleveurs font désormais le gros de leur chiffre d’affaires de l’année à l’occasion de la fête de l’Aïd.
Le rapporteur nous a invités à poursuivre le travail de formation des sacrificateurs. Nous y sommes tout à fait disposés et sommes même demandeurs. Nous avons besoin de l’aide de l’État pour renforcer nos propres programmes de formation et en particulier, on l’a vu, au sein même des abattoirs. Les sacrificateurs sont les salariés de l’entreprise.
M. le président Olivier Falorni et M. le rapporteur. Ce n’est pas toujours le cas.
M. Kamel Kabtane. Il y a effectivement besoin de clarifier tout cela, et nous sommes prêts à le faire avec vous.
Il ne faut pas oublier que le contrôle est effectué dans les abattoirs par les vétérinaires qui ont donc la main pour vérifier que le sacrificateur est bien titulaire de la carte et qu’il effectue bien son travail – dans le cas contraire, il leur revient d’agir.
M. le rapporteur. Pensez-vous que les contrôleurs vétérinaires sont suffisamment formés à l’abattage rituel ?
M. Kamel Kabtane. Je parle simplement de la carte autorisant à abattre. La compétence en matière d’abattage rituel, les contrôleurs vétérinaires ne l’ont pas : c’est notre responsabilité et ce sont nos contrôleurs qui interviennent dans les abattoirs et constatent que le travail du sacrificateur a été conforme aux prescriptions. Nous avons du reste déjà procédé au retrait ou au non-renouvellement de cartes de sacrificateurs. Il faut dès lors éviter qu’il leur en soit délivré une autre par une autre mosquée. Nous devons donc renforcer l’organisation de ce système.
Vous avez abordé la question de la durée des formations. Il faudrait instaurer un véritable programme de formation dans les entreprises d’abattage, qui aborde, au-delà des questions théologiques, les aspects juridiques, pratiques et de sécurité.
Nous sommes donc tout à fait d’accord avec vous pour ce qui est de l’éthique, de la formation et, monsieur le rapporteur, j’y insiste, en la matière, nous sommes demandeurs.
M. Haïm Korsia. Je souhaite ajouter un mot, si vous m’y autorisez. Compte tenu des mots si gentils que le recteur Boubakeur a prononcés à l’endroit du judaïsme tout à l’heure, même si nous sommes dans le temple de la laïcité, permettez-moi de souhaiter à nos amis musulmans un bon ramadan : ramadan moubarak !
MM. Dalil Boubakeur et Kamel Kabtane. Merci !
M. Dalil Boubakeur. Quand les religions se donneront la main…
M. le président Olivier Falorni. Voilà une belle conclusion. Je vous remercie, messieurs, pour votre venue et pour vos réponses précises. Et je vous indique, monsieur le grand rabbin, que nous en sommes à peu près à la trentième audition, mais c’est seulement la deuxième sur l’abattage rituel…
M. Bruno Fiszon. Autrement dit, les proportions sont respectées.
M. le président Olivier Falorni. Tout à fait. Merci, messieurs.
La séance est levée à treize heures quarante.
——fpfp——
29. Audition, ouverte à la presse, de M. Raphaël Girardot, réalisateur du documentaire « Saigneurs », et de Mme Manuella Frésil, réalisatrice, et M. Philippe Hagué, chargé de la distribution, du documentaire « Entrée du personnel ».
(Séance du mercredi 22 juin 2016)
La séance est ouverte à seize heures vingt-cinq.
M. le président Olivier Falorni. Mes chers collègues, nous reprenons nos auditions dans le cadre de la Commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français. Cet après-midi, nous recevons M. Raphaël Girardot, réalisateur du documentaire Saigneurs, ainsi que Mme Manuella Frésil et M. Philippe Hagué, respectivement réalisatrice et chargé de la distribution du documentaire Entrée du personnel. Ces deux documentaires ont été projetés hier soir à l’Assemblée nationale et les membres de la Commission ont pu les visionner.
Monsieur Girardot, vous avez réalisé Saigneurs avec M. Vincent Gaullier. Ce documentaire a été tourné entre les étés 2014 et 2015 au sein de la Société vitréenne d’abattage Jean Rozé (SVA Jean Rozé), un établissement d’Ille-et-Vilaine qui emploie environ 1 000 salariés. Il a été diffusé en 2015. Cette société d’abattage, créée en 1955, est devenue une filiale du Groupement des Mousquetaires en 2001. Le tournage à Vitré a été autorisé par le responsable du site, à condition que ni l’abattage ni le poste d’abattage ne soient filmés, le responsable se réservant également le droit de contrôler les images. De fait, on ne voit pas l’abattage à l’écran, et vous pourrez nous parler de la manière dont vos images ont été contrôlées.
Tourné également sur la chaîne et dans le hall, ce documentaire a permis de mettre en évidence trois choses en particulier : la pénibilité, la précarité et la dangerosité du métier de salarié en abattoir. Vous aurez l’occasion de vous étendre sur le sujet. En tout cas, je vous félicite pour la qualité de ce documentaire qui a été particulièrement instructif pour mes collègues et moi-même. Il nous semble chaque jour un peu plus que la question du bien-être des salariés est intimement liée à celle du bien-être animal.
Le deuxième documentaire, Entrée du personnel, a été diffusé en 2013. Madame, Frésil, votre film a été réalisé à partir de témoignages de salariés et de scènes tournées dans de grands abattoirs industriels. Il met en lumière ce qui ne l’est jamais : le travail des ouvriers en abattoirs et la rudesse de leur quotidien dans ces lieux. Le film évoque tout particulièrement les gestes répétitifs des salariés, les accidents de travail, les pressions sur les délégués du personnel, les problèmes de sommeil, les cadences mais aussi la pression économique qui se transmet de l’entreprise aux salariés. Les images qui ont été tournées au sein des abattoirs ont été autorisées, sinon contrôlées, par les responsables des établissements concernés.
J’ai en mémoire cette chorégraphie d’agents qui miment ensemble les actes répétitifs qu’ils sont amenés à faire, séquence à la fois belle sur le plan esthétique et révélatrice de ce que peut représenter ce travail à la chaîne. Votre excellent documentaire nous a, lui aussi, permis de mesurer la dureté de ce métier, qui n’est pas sans conséquence sur le sujet initial de notre commission d’enquête. La diffusion des vidéos clandestines, et pour le coup inacceptables, de l’association L214 Éthique & Animaux, nous a poussés à créer cette commission d’enquête sur le bien-être animal. Mais comme je le disais, on ne peut pas dissocier la question du respect de l’animal de celle des conditions de travail du personnel des abattoirs.
À dix-sept heures, je vais interrompre l’audition pendant une quinzaine de minutes pour que nous puissions nous rendre sur la place du Palais Bourbon afin de participer à l'hommage rendu à Jo Cox, députée britannique lâchement assassinée il y a quelques jours. Je vous rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse, diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale et très fréquemment sur la chaîne parlementaire où elles sont visiblement très suivies.
Avant de vous donner la parole, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Manuella Frésil, M. Philippe Hagué et M. Raphaël Girardot prêtent successivement serment.)
Mme Manuella Frésil, réalisatrice du documentaire Entrée du personnel. Avant ce film, j’avais réalisé Si loin des bêtes, un documentaire sur les élevages industriels pour Arte. Entrée du personnel est né de là car, comme vous le faisiez remarquer pour votre commission, on se pose initialement la question des bêtes. Dans Si loin des bêtes, il s’agissait de comprendre comment des éleveurs engagés dans un système industriel pouvaient se revendiquer paysans. Comment acceptez-vous de faire ça aux bêtes ? Cette question que je leur posais, j’ai voulu l’adresser aussi aux ouvriers des abattoirs. C’est comme ça que j’ai commencé.
Nous étions alors dans les années 2000, à une époque où ce n’était pas très compliqué d’entrer dans les abattoirs car les acteurs de la filière n’en étaient pas à cacher l’origine animale de la viande. À la sortie de la crise de la vache folle, l’agro-industrie était surtout préoccupée par l’hygiène et les nouvelles normes européennes sur la traçabilité de la viande et le bien-être animal. Elle avait vraiment besoin de prouver son savoir-faire – qui est réel – dans ces domaines : il n’y a plus d’accident sanitaire majeur comme il y a pu y en avoir dans les années 1990.
Je suis donc entrée dans les abattoirs où j’ai posé cette question aux salariés : qu’est-ce que ça vous fait de faire ça aux bêtes ? Ils m’ont répondu que ce n’était pas la question pour une raison simple : peu de gens travaillent à la tuerie, appelée le secteur sale. Pour la plupart, les salariés sont dans le secteur propre où ils effectuent un travail de boucherie, d’emballage et de mise en barquette de la viande. Par mesure d’hygiène, les ouvriers des deux secteurs entrent par des portes différentes dans l’abattoir, et ils ne passent pas de l’un à l’autre. Dans leur majorité, ils me disaient n’avoir affaire aux bêtes que de façon lointaine et un peu fantasmatique. Cela étant, il apparaissait dans leurs propos qu’elles étaient là et qu’elles les hantaient. Certains m’ont raconté qu’ils rêvaient la nuit de carcasses accrochées en imaginant que c’était des corps humains. Comment ne pas être hanté quand on sait la proximité anatomique qui existe, par exemple, avec les carcasses de porc ? Ça contamine.
Ils m’ont aussi dit qu’ils avaient mal aux doigts, aux articulations, aux muscles, aux os. C’est ce qui a déclenché le désir de ce filM. C’est ce qui m’a donné l’énergie de me battre pour faire ce film qui m’a pris énormément de temps et qui a été réalisé dans des conditions économiques particulièrement difficiles. Par une espèce d’ironie, les ouvriers ont mal là où ils coupent les bêtes. « Je coupe la dinde là et j’ai mal là », m’a dit l’un d’eux. J’ai décidé de faire le film pour essayer de comprendre cette contagion, alors que l’univers des abattoirs se refermait et qu’il devenait de plus en plus difficile d’y entrer. Les ouvriers refusent de parler de ce sujet qui hante pourtant tout l’abattoir.
M. Philippe Hagué, chargé de la distribution du documentaire Entrée du personnel. Pour ma part, je vais vous proposer de faire un petit pas de côté, de sortir des abattoirs pour entrer dans les salles de cinémas où les deux films sont censés être distribués. Le premier l’a été ; le deuxième recherche un distributeur. Ces films documentaires, qui passent dans les salles de cinéma, ne sont pas du tout de la même facture que les reportages télévisés. Que des députés aient eu envie de les visionner – et je pense qu’ils vous ont plu – est pour moi une excellente nouvelle. Les documentaristes français sont extrêmement mobilisés. Manuella Frésil a mis dix ans à faire son film, et je ne parle pas des conditions financières. Il faut être capable de s’investir dans un projet, de le tenir et de donner un film d’une telle facture. Cette invitation est aussi une manière de reconnaître son travail et de la féliciter.
Les documentaristes qui travaillent pour la distribution cinématographique ont peut-être une caractéristique commune : ils prennent leurs spectateurs pour des personnes pensantes et, en règle générale, ils n’utilisent pas ces voix off si présentes dans les reportages télévisés. Dans ces derniers, on vous montre des images tout en vous disant ce que vous devez en penser.
Les films de ces documentaristes abordent des questions qui ne correspondent pas forcément au calendrier politique puisqu’ils sont le produit d’un cheminement personnel du réalisateur avec le producteur et la maison de distribution. Ces sujets, qui taraudent la société, ne correspondent pas forcément à des moments médiatico-politiques. Quand ils les proposent aux salles de cinéma, les distributeurs le font avec l’idée que les projections donneront lieu à des débats, à des rencontres entre les réalisateurs, le public, des syndicalistes, etc. Ce type de débats est extrêmement précieux. Rappelons qu’en France nous avons la chance d’avoir le plus important réseau de salles de cinéma du monde : quelque 5 000 écrans. Toutes les semaines, de très nombreux débats sont organisés, notamment dans les salles d’art et d’essai qui sont parmi les lieux les plus dynamiques de l’expression citoyenne.
Étant persuadés que les questions posées concernent les représentants de la nation, nous invitons les députés et les sénateurs au moment de la sortie nationale de ces films. Parfois, on peut organiser des projections au sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Pendant les six mois de vie du film dans les salles de cinéma, les députés sont aussi invités au niveau local. Je profite de cette audition pour proposer la création d’un espace de rencontre entre députés et documentaristes, afin que ces films puissent alimenter le débat public.
Saigneurs étant produit par Iskra, une maison avec laquelle je travaille très souvent, j’espère être associé à sa distribution. La Ligue des droits de l’homme (LDH) est la première organisation à avoir soutenu et accompagné Entrée du personnel dès sa sortie. Du point de vue de la condition animale, cela peut paraître un peu décalé. En tout cas, j’ai été personnellement surpris que la LDH puisse prendre position sur un film qui parle des conditions de travail en France.
Lors d’un débat, l’un des spectateurs a fait cette réflexion : en France, il est plus facile de filmer dans une prison que dans une usine, sans parler de le faire dans un abattoir. Les syndicalistes ont participé à de nombreux débats. Au niveau national, ils étaient gênés : il est difficile de parler des conditions de travail en période de crise et de chômage. Au niveau local, j’avoue avoir été extrêmement surpris de constater une sorte d’omerta : nous avions du mal à convaincre certaines personnes d’intervenir et d’accompagner le film dans des lieux proches des abattoirs. Non qu’elles n’eussent rien à dire, mais elles avaient une certaine peur.
Mme Manuella Frésil. À ce propos, je voudrais que vous soyez assez conscients du fait que les documentaristes vont sur le terrain dans des conditions très compliquées. Il faut avoir la foi pour y aller.
M. Raphaël Girardot, réalisateur du documentaire Saigneurs. Au préalable, je précise que je co-réalise avec Vincent Gaullier des films produits par Matthieu de Laborde d’Iskra. Nous travaillons ainsi depuis 2000, en nous épaulant sur le long terme. C’est la manière que nous avons trouvée pour faire ce genre de films pour lesquels les financements classiques sont inadaptés et qui naissent d’une conviction : à un moment donné, on a absolument envie de parler d’un sujet même s’il ne répond pas à la demande de chaînes de télévision ou à l’intérêt d’une commission parlementaire. Des années plus tard, le sujet peut révéler toute son actualité. Il faudrait que notre travail soit mieux reconnu auprès des financeurs à long terme.
Avant d’en venir à Saigneurs, je précise que l’important pour nous est de documenter, de restituer, d’être à une place où l’on fait les films avec les gens. Je ne fais pas un film sur un éleveur ou un étudiant, je le fais avec lui, avec ses questions. Cette perspective permet de faire évoluer notre réflexion, et nous espérons qu’elle produise le même effet sur les spectateurs. Avec Vincent, nous avons travaillé pendant neuf ans avec un éleveur laitier dans différentes situations mais, pour autant, nous ne sommes pas devenus des spécialistes de l’agriculture. Nous sommes avec lui, nous nous intéressons à ses questions et à son positionnement. Nous espérons que les spectateurs pourront s’identifier à lui à certains égards et, par empathie, mieux comprendre ses problèmes et le malaise qui peut exister dans l’agriculture. Cela étant, je le répète, je ne me considère pas du tout comme un expert en questions agricoles ou agroalimentaires, ni même en abattoirs ou en halls d’abattage.
Au départ, nous voulions documenter la classe ouvrière au travail. Comment les personnes qui travaillent à la chaîne parlent-elles de leur métier ? A-t-on le droit et la possibilité de les filmer ? Compte tenu de notre expérience de l’agriculture, nous nous sommes intéressés à l’agroalimentaire et notamment à un endroit particulièrement caché, honteux, interdit d’accès. Un documentariste aura d’autant plus envie d’aller dans ce lieu qu’on le lui interdit. À ce stade, nous nous demandions même pourquoi personne ne le faisait.
Tout en comprenant ceux qui opèrent en caméra cachée, nous ne pratiquons pas cette méthode. Nous sommes partis à l’assaut de ce que l’on nous disait impossible : filmer pendant un an dans un abattoir. C’était en 2009 ; nous avons terminé le film en 2015. Pourtant, au début, nous avions eu la chance d’être accueillis par un petit abattoir de Blois, les Établissements Gourault. Le tournage se passait très bien. Le film aurait été très différent parce que l’abattoir était vraiment beaucoup plus petit que SVA Jean Rozé. Nous étions en repérage depuis trois ou quatre mois quand les Établissements Gourault ont fait faillite. C’est aussi l’un des problèmes de ce travail à long terme : il faut trouver un endroit stable.
Nous avons connu ensuite une longue traversée du désert parce que tous les abattoirs nous fermaient leur porte. Nous en avons appelé une trentaine, notamment Bigard, Sicavyl et Abattoirs industriels de la Manche (AIM). Jean-Paul Bigard nous a même ri au nez, en nous disant que l’idée de tourner un film dans l’un de ses abattoirs était totalement contraire à sa politique qui vise à faire en sorte que le client ne fasse plus du tout le lien entre la vache et le steak. En vertu de cette politique, tout ce qui se passe dans l’abattoir doit rester dans une boîte noire. Pour un documentariste, cette idée est ahurissante. Comment cela pourrait-il être une bonne chose que ce lieu soit interdit d’image, que l’on ne puisse pas documenter ce qu’il s’y passe ? Cet endroit n’est pas hors de notre société. Nous devons y être, réfléchir avec les ouvriers qui y travaillent sur ce qu’il s’y construit.
Nous nous sommes donc adressés à M. Dominique Langlois, qui préside à la fois Interbev, l’organisation interprofessionnelle du bétail et de la viande, et la SVA Jean Rozé. Quand nous l’avons rencontré, il était conscient que la communication des abattoirs ne pouvait se réduire à de l’institutionnel – qui n’intéresse qu’un public restreint, notamment de personnes à la recherche d’un emploi – et à des films tournés en caméra cachée. Au départ, il a essayé de nous envoyer vers d’autres abattoirs que le sien, qui ont tous refusé de nous accueillir. Nous sommes donc revenus vers lui, au bout de six mois. Comme il avait accepté notre projet au départ, il a bien été obligé d’approuver notre demande d’aller chez lui. Il nous a donc accueillis pendant plus d’un an dans l’abattoir vitréen SVA Jean Rozé.
Tout ce cheminement fait que le film est ce qu’il est. Les ouvriers prennent eux-mêmes la parole sur leur lieu de travail. Il n’y a pas de commentaires. Les images montrent le travail des ouvriers, leurs gestes, la cadence. On entend le bruit. Nous avions plus de cent heures de rushes à la fin du tournage et, au montage, nous n’avons gardé que les moments représentatifs de cette année-là. Nous ne prétendons pas que le film est représentatif de tous les abattoirs ni même de ce qui s’est passé dans celui-là depuis dix ans. En revanche, il montre ce que ce métier a de pénible, de dangereux et de précaire, comme vous le souligniez, en raison notamment des cadences imposées dont se plaignent la plupart des ouvriers. On le ressent assez vite, au bout d’un mois, et l’impression est confortée par tous les témoignages qui arrivent au fil du temps.
M. le président Olivier Falorni. Merci pour ces présentations qui m’inspirent une première question : les responsables des abattoirs vous ont-ils imposé des restrictions lors des tournages ? Pour avoir effectué des visites inopinées dans les abattoirs, nous ne sommes d’ailleurs pas surpris que vous ayez rencontré des difficultés pour y pénétrer. Hier encore, nous avons été accueillis par la police. En vertu de nos prérogatives dans le cadre de cette commission d’enquête, nous finissons toujours par entrer, en forçant les portes. Je peux facilement imaginer les réactions suscitées par vos demandes.
Une fois que vous avez été acceptés, avez-vous ressenti une réelle volonté de vous fermer l’accès à ces phases sensibles que sont l’étourdissement et l’abattage ? Était-il facile de vous entretenir avec les salariés ? Avez-vous constaté que la direction exerçait une pression pour les empêcher de parler ? Eux-mêmes étaient-ils prêts à le faire ? Comment ont-ils vécu le fait d’être filmés ? Lors de visites inopinées avec des médias, on remarque que leurs attitudes diffèrent face à la caméra. Vous prenez évidemment beaucoup plus de temps que les journalistes de télévision et la logique d’un film d’une heure n’est pas la même que celle d’un reportage de cinq minutes. Reste la problématique de l’image. Nous avons ressenti la réticence de certains ouvriers. Était-il difficile d’obtenir leur accord ? Ont-ils réagi depuis la sortie de votre film ? Si c’est les cas, comment ont-ils perçu le film et leur propre témoignage ?
Mme Manuella Frésil. Nos deux expériences sont différentes car nos films ont des formes et des entrées différentes. Pour ma part, je n’ai pas eu l’audace de penser que j’arriverais à convaincre un directeur d’abattoir de me laisser filmer. En plus, comme j’étais intéressée dès le départ par les conditions de travail, je savais que j’allais devoir mentir à la direction : j’étais obligée de cacher le vrai sujet de mon film. Je n’ai jamais eu suffisamment confiance en moi pour aller les voir en disant : au nom de la démocratie et de la transparence, laissez-moi entrer. Probablement en raison de mon caractère et du fait que je suis une femme, j’ai anticipé un refus et j’ai inventé un autre dispositif. J’ai filmé dans huit abattoirs et j’ai brouillé les pistes, c'est-à-dire que les extérieurs ne correspondent pas aux intérieurs. Je raconte l’usine en général, pas un abattoir en particulier. Je parle du destin des ouvriers en général, pas du destin de ceux de tel abattoir particulier.
Partant de là, je me sentais capable de mentir pendant deux jours. Quand j’ai commencé, la boîte noire n’était pas encore complètement fermée et je restais très floue sur mes intentions, expliquant que je voulais faire un film sur l’histoire du progrès. La plupart du temps, je me heurtais à un refus. Quand ça passait, on allait filmer pendant trois jours et on revenait mettre les images au chaud. Le temps passant, c’est devenu impossible, l’endroit le plus inaccessible étant l’abattoir de volailles. Dans les abattoirs de bœufs, les gens revendiquent encore une sorte de dignité du métier, ce qui n’est pas le cas dans les abattoirs de volailles où il a été vraiment très dur d’entrer. Avec mon assistant, j’ai insisté pendant un an jusqu’à ce qu’un type finisse par accepter de nous recevoir. Je me souviens de lui avoir serré la main en repartant, tout en le remerciant infiniment de nous avoir accueillis, et il m’a dit qu’il espérait ne pas avoir à le regretter. Je l’ai rassuré en lui disant que c’était un petit film dont il n’entendrait même pas parler. Mentir c’est très difficile, cela fait partie de la souffrance au travail.
M. le président Olivier Falorni. C’est pour cela que vous témoignez sous serment ! (Sourires.)
Mme Manuella Frésil. J’apprécie de témoigner sous serment ! Bien entendu, tout était toujours contrôlé. J’ai eu l’autorisation de filmer des images d’étourdissement et d’abattage mais j’ai décidé de ne pas les monter dans le film. Les images de la tuerie auraient occulté le reste tant elles éblouissent. On ne voit plus rien d’autre. On est avec la vache qui meurt. L’ouvrier ne meurt pas, il va revenir travailler le lendemain. En tant que spectateurs, on éprouve de l’empathie pour la victime, la vache. Il y a bien un sacrifice et c’est elle qui est sacrifiée. Comme je voulais parler de la condition des travailleurs, j’ai choisi de ne pas montrer ces plans-là. Mais je n’ai eu qu’une seule fois l’autorisation de filmer dans la tuerie, après c’était fini, ce n’était plus possible.
Tout était donc contrôlé mais à chacun son métier : les contrôleurs n’avaient pas de prise sur la durée des plans, ils ne savaient pas ce que j’allais faire au montage. Ils imaginaient des plans de quatre secondes, comme à la télévision, alors que certains plans du film durent sept minutes. C’est dans cette écriture que résidait notre seule liberté. Pour le reste, ils m’ont demandé de ne pas filmer le sang et ils m’ont refusé tout accès aux triperies. Une fois, j’ai pu pénétrer dans la triperie d’un tout petit abattoir et j’ai d’ailleurs monté ces images. En revanche, je n’ai pas pu filmer les triperies des grands abattoirs, c'est-à-dire le travail sur la bouse.
M. Raphaël Girardot. De notre côté, nous avons signé une convention avec M. Langlois, aux termes de laquelle nous nous engagions à lui montrer le film en premier. Il n’avait pas de droit de regard mais il a été notre premier spectateur. Il a été impressionné et il n’a pas du tout aimé le film. Il ne pouvait rien y faire parce qu’aucune disposition de la convention ne prévoyait qu’il pouvait demander le retrait des scènes ou des propos qui lui déplaisaient. Et il s’est rendu compte qu’une procédure en diffamation était vouée à l’échec puisqu’il n’y avait pas de propos diffamatoires ou de montages tendancieux. Les gens disaient ce qu’ils pensaient et nos images montraient la réalité, en particulier concernant les cadences filmées en plans longs sans effets dus au montage.
La convention prévoyait aussi une restriction concernant l’abattage. Elle nous convenait très bien parce que nous avions déjà filmé de tels lieux, notamment pour Archimède, une ancienne émission scientifique d’Arte. Comme Manuella Frésil, je sais que ce sont des images aveuglantes, qui empêchent de penser à quoi que ce soit d’autre pendant au moins les dix minutes suivantes. Toute souffrance d’ouvrier devient alors totalement inaudible. Nous avons donc accepté sans problème de ne pas tourner des images que nous n’aurions pas pu monter, mais nous voulions nous approcher le plus possible de l’endroit de la saignée.
Vis-à-vis des salariés, nous étions suspects puisque nous étions entrés dans l’abattoir avec l’autorisation du patron, même si nous commencions la journée en même temps qu’eux le matin, revêtus des mêmes tenues réglementaires. Où leur expliquer notre projet ? Dans les vestiaires et la salle de pause, où ils ne faisaient que passer, ils nous écoutaient ou pas. Il est vite apparu que nous devions monter avec eux sur les nacelles, non seulement pour nous faire accepter, arriver à leur parler assez longtemps et gagner leur confiance, mais aussi parce que c’est un endroit où on peut parler seul à seul.
Or, si savoir gagner la confiance d’un interlocuteur fait partie de notre métier, nous devions aussi composer avec la réticence éventuelle des ouvriers à s’exprimer devant leurs collègues et a fortiori devant leurs chefs. Que peuvent-ils se dire entre eux ? Est-ce qu’ils acceptent que l’autre sache exactement ce qu’ils pensent ? Dans ce milieu, il faut tenir. Assis côte à côte dans la salle de pause, ils peuvent choisir de ne pas se plaindre, de dire qu’ils n’ont mal nulle part. Sur la nacelle, j’étais moi-même obligé de crier pour que l’ouvrier puisse entendre mes questions. Son collègue du poste voisin pouvait voir que nous discutions mais il ne pouvait rien entendre, et le chef, en contrebas, entendait encore moins.
Nous pouvions aller partout tout en étant surveillés. Nous avions nos casiers, nos tenues. Nous prévenions de notre venue la veille de notre arrivée, et nous restions pendant trois ou quatre jours. Ils ne changeaient évidemment pas les cadences en fonction de notre présence. Nous partions en annonçant que nous reviendrions un mois plus tard et, parfois, nous étions de retour dans les quinze jours, non pas pour les piéger mais pour des raisons de changement d’emploi du temps. Sans vouloir m’appesantir sur nos problèmes de financement, nous devions nous montrer réactifs et venir souvent sur un lieu de tournage.
Est-ce que les salariés ont eu du mal à parler, une fois la confiance établie et le lieu idoine trouvé pour qu’ils puissent se lâcher ? Dans le film, ils ne se lâchent pas terriblement mais ils disent les choses. Le souci n’était d’ailleurs pas de filmer des moments de grande colère. Nous voulions qu’ils sentent que leurs propos étaient audibles et intéressants pour d’autres qu’eux-mêmes. En général, ils ne parlent à personne, ni à leur famille ni à leurs collègues, pensant que s’ils disent tous les jours qu’ils ont mal, ce sera insupportable pour tout le monde. Normalement, on n’a pas le droit d’être à deux sur une nacelle parce que c’est très dangereux. C’était une sorte de baptême du feu. Si quelqu’un prend les mêmes risques que vous et reste là pendant une heure pour vous écouter, il arrive qu’on se décide à lui dire quelque chose. Ils ont accepté de parler même si, jusqu’au bout, ils n’ont pas cru que leur parole pouvait intéresser quiconque.
Quant aux projections, elles ont commencé dans le bureau de M. Langlois. Il était impressionné ; il trouvait que c’était costaud ; il disait qu’il ne pensait pas que c’était comme ça. Il n’avait jamais dû voir son abattoir sous ce jour. Le lendemain, après réflexion, il nous a envoyé un message pour nous dire qu’il voulait faire interdire le film. Nous avons décidé d’aller le montrer tout de suite aux ouvriers pour qu’ils s’en fassent une opinion avant d’avoir celle de la direction via les chefs de ligne. C’était le jeudi. Le week-end suivant, nous étions en projection et nous l’avons montré à un maximum d’ouvriers. Les réactions ont été à la hauteur de ce que nous espérions. Ils étaient étonnés que le sujet puisse intéresser et nous avons eu des commentaires du style : c’est dingue, je ne me suis pas emmerdé pendant une heure et demie ! Ils sont comme ça, un peu francs du collier. Ensuite, ils nous disaient être surpris par la justesse du propos, par le fait que nous ayons rendu la cadence et le bruit de la manière dont ils les vivaient tous les jours. Ils nous ont beaucoup remerciés.
Ces remerciements nous ont soulagés. Quand on fait un documentaire, on a toujours peur d’avoir une vision biaisée. Or nous n’avons eu que des remerciements et la reconnaissance de personnes qui pensaient qu’il était impossible de décrire exactement leurs conditions de travail. Quant aux familles, elles étaient sidérées, abasourdies par la violence de l’endroit. Je me souviens d’une fille disant à son père qu’elle comprenait pourquoi il était stressé au retour du travail. Quand j’entends ce genre de réactions, je pense que j’ai fait mon travail.
Mme Manuella Frésil. J’ai eu le même type de retours. Lors de la première projection aux ouvriers, un délégué du personnel d’une quarantaine d’années était resté longtemps silencieux. À la fin, il s’est levé, extrêmement bouleversé. Il a dit qu’il n’avait plus d’épaules après avoir été désosseur pendant vingt ans, qu’il avait toujours pensé que c’était de sa faute parce qu’il était faible, et qu’en se voyant à l’écran, travaillant à une telle cadence, il avait compris tout à coup qu’il était impossible qu’il ne soit pas malade. Nous avons eu constamment ce genre de réactions. Les gens ne se voient pas au travail ; ils ne savent pas qu’ils réalisent des exploits.
Suspendue à dix-sept heures quinze, l’audition reprend à dix-sept heures trente.
M. William Dumas. Comme les abattoirs, vos documentaires sont des films particuliers. Il y a du sang partout, ce qui est saisissant pour les gens. Ils me rappellent une expérience de président de jury dans un festival taurin – certains taureaux de Camargue font de la course libre mais d’autres vont à l’abattoir pour des raisons d’équilibre financier des exploitations. Lorsque nous avons attribué le deuxième prix du jury à un film où l’on voyait du sang, il y a eu un mouvement de foule. Les gens n’avaient pas vu l’aspect économique, la filière. Vous avez bien fait de ne pas montrer la saignée, le poste le plus difficile.
En voyant vos documentaires, j’ai été surpris d’apprendre que les ouvriers étaient obligés de s’échauffer le matin, comme des sportifs, en faisant des mouvements avec leurs doigts, leurs mains, leurs bras. Je pensais que les gens arrivaient, revêtaient leur tenue et allaient directement à leur poste. Un ouvrier a expliqué qu’il était resté neuf mois en arrêt maladie à cause d’une tendinite. Ces gestes répétitifs entraînent des troubles musculo-squelettiques même quand les ouvriers changent de poste. Le poignet et l’avant-bras sont toujours à la manœuvre, et le désossage ne mobilise pas l’organisme de la même manière que d’autres postes.
En visitant l’abattoir de volailles de la société Duc, situé à un kilomètre de chez moi, je n’avais pas été frappé par le caractère à ce point répétitif des gestes des personnes employées sur la chaîne. Il m’avait semblé que seule la personne qui accrochait les volailles à leur sortie des caisses faisait toujours le même geste. Dans un abattoir de poulets, il a aussi l’odeur et les cadences. Dans votre film, madame Frésil, j’ai été frappé par les cadences infernales qui sont imposées sur cette chaîne de volailles. On dirait que les salariés font la course pour amener les poulets dans la salle de congélation. C’est vraiment impressionnant, pire que dans les abattoirs de bovins. Et les ouvriers ont tous des appareils dans les oreilles en raison du bruit.
Vous avez parlé de plans de six ou sept minutes, madame Frésil, et il est vrai que vous restez longtemps sur certains postes. Par moments, c’est un peu long et répétitif, mais j’ai néanmoins apprécié. Je ne savais pas que l’on coupait les cornes de cette manière. Cela étant, il faut diffuser ce genre de films dans des salles d’art et d’essai, comme le disait M. Hagué, en organisant un débat à la suite de la projection. On voit du sang en permanence, ce qui choque.
Cependant, j’aurais aimé voir un autre lieu qui intéresse notre commission axée sur le bien-être animal : la bouverie, c’est-à-dire l’endroit où sont stockés les animaux en amont. Dans vos films, on les entend par moments mais on les voit peu. Lorsque nous l’avons auditionné, M. Bigard nous a dit que ses chauffeurs laissaient à la ferme les animaux qui ne pouvaient pas marcher ou qui étaient blessés d’une manière ou d’une autre. Dans l’un de vos films, il y avait une brebis qui n’avait pas l’air effrayée du tout dans le système de contention. En revanche, un autre animal, un bœuf ou un veau, semblait avoir la colonne vertébrale cassée. Était-il tombé ? Le système de contention avait-il mal fonctionné ? On voit une image furtive mais il n’y a pas d’explication et on en est réduit aux suppositions. C’est peut-être l’une des images que M. Langlois n’aime pas dans votre film. Du point de vue du bien-être animal, il est important de savoir comment les bêtes sont reçues dans les box et comment on les amène à la saignée, autrement dit dans le couloir de la mort. Cette image un peu furtive m’a laissé sur ma faim.
À part cela, je tiens à vous féliciter. Vous avez travaillé dans un milieu spécial, pas facile. On sent d’ailleurs la retenue des ouvriers. Au moment de la pause déjeuné, on les voit dans leurs habits maculés de sang. Je n’aurais pas eu envie de déjeuner ou de boire une tasse de café. Eux, ils sont habitués. Reste qu’il s’agit d’un métier difficile et payé au SMIC, comme le disait l’un des ouvriers. Je comprends qu’ils aient les épaules ravagées au bout de quarante ans, un peu comme les plâtriers. Combien de temps peuvent-ils tenir à des postes comme ceux-là ? Dans l’abattoir Duc, je suis allé remettre des médailles du travail à des personnes qui ont fêté leurs trente-cinq ans au poste où l’on attache les poulets qui arrivent. Trente-cinq ans à un poste pareil, il faut le faire, il faut avoir envie de travailler et peu d’opportunités d’emploi dans la région où l’on habite.
Dans vos films, on aurait peut-être pu voir aussi la sélection des morceaux, selon leur qualité. Vous avez eu la chance que M. Langlois vous ouvre les portes alors que M. Bigard avait refusé de le faire. Ce dernier nous a assuré que ses ouvriers touchaient de bons salaires et qu’il n’avait pas de mal à recruter du personnel, sauf peut-être dans son nouvel abattoir de Maubeuge, situé un peu loin des zones de production. Avec les crises agricoles qui se sont succédé, des fils d’agriculteurs, qui connaissent les bêtes, se sont reconvertis dans ce métier.
Quoi qu’il en soit, j’ai apprécié les deux films que j’ai vus hier soir. Je ne pensais pas que vous aviez mis autant de temps à obtenir les autorisations de filmer. D’un autre côté, je comprends que l’on ne montre pas ce qui nous intéresse en priorité : le poste d’abattage. À voir dans Saigneurs ces carcasses qui dégoulinent de sang, qu’on ouvre, qu’on découpe, qu’on fait tomber, je pense que tout le monde ne peut pas accepter facilement ce documentaire. Nous sommes allés souper au sortir de la projection, et je n’ai pas pris de viande, me contentant de fromage et de fruits. Cela ne m’a pas empêché d’en manger ce midi mais, sur le coup, on en prend plein la gueule pour parler vulgairement.
Mme Manuella Frésil. L’effet ne dure pas !
M. le président Olivier Falorni. Pour rebondir sur les propos de William Dumas, il me semble qu’il n’y a pas dans vos films de témoignages de personnes chargées de la bouverie. Nous les rencontrons lors de nos visites. Ils ont un rôle un peu différent, qui peut être difficile dans les petits abattoirs où le bouvier a beaucoup de mal à faire circuler l’animal dans le couloir et à le maintenir dans le piège avant l’étourdissement.
Mme Manuella Frésil. Sur ce sujet, je vous invite à voir mon film précédent, Si loin des bêtes. Avec Entrée du personnel, j’ai voulu passer de la question de la viande à celle du travailleur de l’abattoir. Je sais d’expérience qu’à partir du moment où vous filmez les animaux, vous voyez les choses de « leur point de vue », et le spectateur avec vous. On est alors dans l’empathie.
Finalement, si l’on voulait vraiment simplifier, on pourrait dire qu’à l’abattoir la question des animaux ne se pose pas tant que cela puisque, en fait, ils sont morts. Ils meurent immédiatement. La tuerie n’est qu’une toute petite partie de l’abattoir. Le bien-être animal n’est pas tant un enjeu à l’abattoir qu’à l’élevage ou durant le transport. La question se pose aussi un peu à la bouverie, c’est vrai. Cela dit, honnêtement, je n’ai rien vu de monstrueux.
Vous l’avez bien compris, je ne cherche pas précisément à défendre l’agro-industrie, je dois néanmoins reconnaître que le process fonctionne. L214 a tapé là où cela faisait mal en montrant que, même dans les petits abattoirs, où l’on pouvait espérer que les choses se passent de façon plus humaine, ce n’était pas le cas. Oui, le process industriel de mise à mort des animaux fonctionne. Il est cadré, les animaux ne souffrent pas, ou, en tout cas, pas plus que ce qu’il faut pour qu’ils soient tués – mais tuer un animal est évidemment un acte violent. Le process est maîtrisé par l’agro-industrie, sauf lorsque cela ne marche pas. Personnellement, je n’ai pas vraiment vu d’animaux maltraités – ce n’est arrivé qu’une fois.
Les abatteurs se débarrassent du problème des animaux qui ont une patte cassée en les laissant chez l’éleveur. Et celui-ci doit se débrouiller pour les mettre à mort. On lui transfère cette responsabilité alors que, normalement, son travail ne consiste pas à tuer les animaux, mais à les faire vivre.
M. Raphaël Girardot. Vincent Gaullier et moi avons voulu faire un film sur la pénibilité du travail dans les abattoirs et sur la condition des ouvriers. Même si la bouverie n’est pas un endroit où règne une très grande violence, la montrer aurait provoqué une empathie avec les animaux. Cela aurait complètement transformé le point de vue du film. Nous n’avons donc pas filmé la bouverie d’autant que cela était convenu dans l’accord avec M. Langlois, mais nous y allions régulièrement, et cela se passait plutôt bien.
S’agissant de la maltraitance animale, je ne suis pas du tout un expert, et je ne peux parler que de ce que j’ai vu pendant un an et deux mois, dans un lieu précis. Je peux attester que le souci dans l’abattoir n’était vraiment pas celui-là, mais beaucoup plus celui de la cadence de travail et de la difficulté que les ouvriers ont à y travailler longtemps. Certains passent trente-cinq ans à l’abattoir, vous en parliez, monsieur le député. J’ai aussi vu des ouvriers de SVA qui avaient reçu une médaille, mais combien y en a-t-il qui n’ont pas tenu, et qui ne sont plus là pour en parler ?
M. William Dumas. Même quand les enfants connaissent le métier de leur père, ils n’imaginent pas qu’ils travaillent dans l’atmosphère que vous montrez.
M. Raphaël Girardot. Vous disiez qu’il est peut-être compliqué de montrer ce film, mais c’est justement pour cela qu’il faut le diffuser, et pas seulement auprès des enfants des ouvriers d’abattoirs, mais auprès de tous. Nous devrions tous avoir conscience de la façon dont les choses se passent pour que nous puissions avoir de la viande dans nos assiettes.
Il faut savoir que l’on tue des bêtes pour les manger. Les patrons des abattoirs, et M. Jean-Paul Bigard en particulier, cherchent à éliminer le lien entre la vache et le steak. Je ne trouve pas normal, au regard de notre rôle de citoyen, que l’on puisse nous dire cela, considérant que nous ne serions pas assez adultes pour savoir que la viande était auparavant une bête vivant dans un champ. Si l’on n’assume pas, il faut arrêter de manger de la viande. Et si l’on veut continuer à en manger, il faut le faire dans de bonnes conditions, et accepter l’abattage.
Cela signifie aussi que nous devons pouvoir filmer dans les abattoirs, ce qui permet de se rendre compte que les ouvriers ne travaillent pas dans des conditions classiques. Ils ne sont pas assis, ils sont en train de se casser, au sens littéral du terme, avant de finir à quarante ou quarante-cinq ans dans l’incapacité de faire autre chose parce qu’ils n’ont pas de formation. Ce que l’on donne à ces gens-là dans le cadre des accords sur la pénibilité qui doivent être mis en place au 1er juillet est absolument ridicule par rapport à tous les problèmes auxquels ils ont dû faire face durant des années.
Bien entendu, nous avons répondu présents pour témoigner devant vous qui vous intéressez à la souffrance animale, mais vous entendez bien dans mon émotion qu’il est terrible pour nous de travailler longuement sur la souffrance humaine et la condition de travail des ouvriers, et de n’être convoqués devant une commission parlementaire que parce que l’on y traite de la souffrance animale. Paradoxalement, ce dernier sujet est exactement celui sur lequel nous ne voulions pas faire notre film. Nous avions constaté que l’on ne parlait que de la souffrance animale dans les abattoirs et qu’il fallait parler aussi de la souffrance humaine.
M. le président Olivier Falorni. Nous avons commencé à travailler sur les problèmes de maltraitance animale après la diffusion de la vidéo de l’association L214, mais notre réflexion nous a amenés à faire le constat que le bien-être animal et le bien-être des salariés étaient intimement liés – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous vous avons invités aujourd’hui. Nous ne pourrons pas résoudre totalement la question du bien-être animal à l’abattoir si nous ne nous préoccupons pas du bien-être de ceux qui y travaillent.
Votre approche n’est pas pour nous hors sujet ; elle est complémentaire. Nous voulons aussi comprendre ce que vivent les salariés. Les vidéos de L214 en donnent une image primaire : elles font penser que les abatteurs sont des barbares et des tortionnaires. Il est bon de montrer qu’il s’agit d’hommes et de femmes, avec leurs qualités et leurs défauts, ce que vous faites dans vos documentaires.
Monsieur Girardot, avez-vous été témoin de maltraitance animale ?
M. Raphaël Girardot. Non, absolument pas ! Nous n’avons pas monté nos images de l’assommage, mais les lieux étaient totalement ouverts, et nous y passions au moins une fois par jour en arrivant pour saluer tout le personnel. Nous n’y avons jamais vu de maltraitance, pas davantage que dans la bouverie où, comme vous le savez, on diffuse de la musique. Cela se passe généralement très bien. Il peut y avoir des heurts, et le poste de travail est potentiellement dangereux parce qu’il faut parfois aller chercher des animaux coincés. Je le répète, nous n’avons jamais été témoins de maltraitance sur les animaux.
Mme Manuella Frésil. Tous les animaux n’ont pas le même comportement dans la bouverie. Je crois que les vaches restent assez placides : elles ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas vétérinaire, mais je n’ai jamais senti qu’une vache anticipait ce qu’il allait lui arriver. Ce n’est pas le cas des cochons, qui sont extrêmement intelligents, plus intelligents que les chiens. Ils sont donc très stressés quand ils arrivent en bouverie. On le voit très bien dans Si loin des bêtes. Ils captent très vite : il y a l’odeur du sang et du lisier, les grognements…
Je n’ai pas assisté à des actes de maltraitance, mais il était peu probable que quiconque se livre à des actes sadiques devant témoin – d’autant que nous avions toujours l’autorisation du patron, ce qui signifiait que nous n’étions pas des observateurs neutres. Il me semble que le système a intégré au mieux le dispositif de mise à mort industriel.
Nous parlons d’ouvriers qui ont passé trente-cinq ans à leur poste dans l’abattoir, mais je rappelle que le système industriel lui-même n’a pas tenu aussi longtemps. Tous les abattoirs industriels ont fermé en effet avant d’avoir eu quarante ans d’existence – je vous renvoie à la grosse crise récente et à la fermeture notamment d’abattoirs bretons comme Gad.
M. Jacques Lamblin. Je n’ai malheureusement pas pu assister hier soir à la projection de vos documentaires. J’ai toutefois le sentiment que vous avez voulu montrer les conditions réelles du travail à la chaîne dans un abattoir. La segmentation de l’activité et la répétition de gestes stéréotypés peuvent entraîner des problèmes physiques, comme les troubles musculo-squelettiques (TMS). Ces inconvénients surviennent cependant dès qu’il y travail à la chaîne, et le bruit et les odeurs existent probablement dans d’autres secteurs d’activité, même s’ils sont différents. En quoi le travail à chaîne dans les abattoirs est-il pire qu’ailleurs ?
Après avoir visité un certain nombre d’abattoirs, j’ai le sentiment que la segmentation des actes empêche les ouvriers de se rendre compte qu’ils tuent des animaux, les découpent et les transforment en matière première. Chacun a un geste précis à accomplir. Il y a ainsi celui qui assomme, celui qui égorge, et celui qui dépèce. À cet égard, le système industriel est bien pensé et lorsqu’on l’observe, étape par étape, on n’a pas le sentiment que des animaux sont tués. Il reste qu’à un bout de la chaîne, il y a un animal vivant, et, qu’à l’autre bout, vous retrouvez une carcasse. Ce découpage de l’activité n’a-t-il pas l’avantage de soulager psychologiquement l’ouvrier ?
Avez-vous assisté à des abattages rituels, halal ou casher ?
Mme Manuella Frésil. Dans les abattoirs, est-ce pire qu’ailleurs ? J’ai montré le film partout au cours de deux cent cinquante projections – souvent dans des associations d’éducation populaire. Jamais le travail à la chaîne ne se fait à de telles cadences, nous dit-on de façon unanime. La plupart du temps, on me demande si je n’ai pas accéléré les images des filles qui travaillent sur la chaîne d’abattage des poulets. Cette vitesse est saisissante. Pourtant, les ouvrières de chez Doux, après avoir vu le film, ont trouvé que leurs collègues allaient lentement. Il faut ouvrir la boîte noire. Il y a un mystère de l’abattoir : c’est l’endroit où il y a le plus fort taux de TMS, le plus grand nombre d’accidents du travail, le plus de casse. Pourquoi ? Pourquoi ne voit-on pas la réalité de la cadence ? Peut-être parce l’on est si aveuglé par la mort des bêtes que l’on ne se pose plus le problème de la présence humaine. Il me semble que nos deux films répondent à ces questions. Peut-être auriez-vous dû venir les voir. (Sourires.)
Vous nous demandez également si la taylorisation soulage les ouvriers d’abattoirs. La réponse est non parce qu’elle induit une perte de sens complet du geste accompli. Tuer un animal est un sacrifice. Ce n’est que très récemment que les industriels, je pense évidemment à Bigard, ont décidé de faire disparaître de leur publicité le lien entre la vache dans le pré et la viande. Manger de la viande, c’est manger du vivant ! Nous sommes des animaux carnivores, nous appartenons à la cosmogonie, mais la tuerie est devenue un point aveugle, et cela pose des problèmes.
En tournant Si loin des bêtes, je me suis aperçue que je ne pouvais pas dire à quel moment le cochon était mort. Il passe de la bouverie, au couloir de contention, puis il est électrocuté – on dit « anesthésié » donc il n’est pas mort. Il est ensuite saigné, mais meurt-il de la saignée ? Non, il était déjà mort. Pour le bœuf, il y a sans doute un geste qui a davantage de sens ; on peut dire quand il meurt. Je ne parle même pas des poulets : ils n’ont jamais été vivants. Le fait de désacraliser le moment de la mort des bêtes laisse rôder une violence inconsciente. Une ombre plane. Il faudrait interroger des philosophes et des anthropologues sur ce sujet.
J’ai assisté à deux abattages rituels. Un premier s’est très mal passé car les gestes accomplis n’avaient aucun sens pour l’opérateur lui-même. À ses propres yeux, il s’agissait d’actes violents. Un second s’est très bien déroulé parce que l’opérateur connaissait le sens de ses gestes : il rendait hommage aux animaux. L’abattage rituel vise précisément à donner du sens à un sacrifice.
M. Raphaël Girardot. La SVA pratique des abattages rituels. J’ai donc pu y assister même si je n’en ai pas filmé. Tout s’est toujours bien passé. La chaîne tourne au ralenti pendant un bon moment. On sent qu’il se passe quelque chose de plus important. Une machine retourne l’animal, ce qui fait courir moins de risques.
Mme Manuella Frésil. L’important c’est que cela ralentit la cadence !
M. Raphaël Girardot. Comme le disait Manuelle Frésil, la taylorisation enlève du sens, c’est une évidence. On ne peut pas dire que l’ouvrier ne souffre pas parce qu’il ne voit pas la tuerie. Dans notre film, l’un d’entre eux, qui occupe depuis trois ans un poste assez éloigné de l’assommage et de la saignée, explique qu’à chaque fois qu’une tête de vache découpée arrive devant lui, il se force à s’imaginer que c’est une boîte en carton afin de ne pas trop y penser. Si on en est là au bout de trois ans, c’est bien qu’il se produit quelque chose psychologiquement, et que ça n’est pas simple. Même dans le déni, c’est compliqué.
Nous avons aussi rencontré certains de ceux qui n’avaient pas tenu à l’abattoir ou qui en étaient partis. L’un des ouvriers nous avait parlé de l’un de ses amis qui était venu y travailler, mais qui avait abandonné au bout de deux semaines et qui ne pouvait plus manger de viande. Pour diverses raisons, ces témoignages ne sont pas dans le film. Il y a celui d’un ouvrier qui a travaillé douze ans dans le hall d’abattage. Il nous a raconté que durant ses trois dernières années d’activité, il rejoignait son poste en se cachant les yeux pour ne pas voir. Après avoir quitté son travail, il est resté en dépression pendant deux ans. Ce n’est pas parce que les choses arrivent qu’elles sont nécessairement acceptées. Ce n’est parce que l’on n’en parle pas qu’il n’y a pas du déni. C’est difficile, et c’est d’autant plus difficile qu’il y a la taylorisation.
Lorsque l’on regarde le Sang des bêtes de Franju, on constate que les choses sont aujourd’hui très différentes de ce qu’elles étaient à la fin des années 1940, ne serait-ce que sur le plan sanitaire par exemple – évidemment, sur un grand nombre de points, la situation de l’époque ne serait pas acceptable aujourd’hui. Il n’en demeure pas moins que le film montre des hommes qui sont aux côtés des bêtes, et qui savent ce qu’ils sont en train de faire. Aujourd’hui, les ouvriers d’abattoirs ne savent plus ce qu’ils font alors qu’ils travaillent sur un animal qui était encore vivant un quart d’heure auparavant. C’est cela le problème le plus dur à gérer.
Mme Manuella Frésil. Sur la spécificité de la cadence dans les abattoirs, je vous livre la réflexion d’un ergonome qui a constaté que, sur la chaîne, l’ouvrier était obligé d’être en avance s’il ne voulait pas prendre du retard parce qu’il ne pouvait jamais savoir s’il n’allait pas tomber sur un morceau très dur – paradoxalement, la situation est pire avec les bêtes « bio » qui ne sont pas standardisées. Lorsque l’on lit L’Établi de Robert Linhart, on voit comment, sur la chaîne de production automobile, les gars prennent de l’avance pour pouvoir faire des micro-pauses. À l’abattoir, ce n’est tout simplement pas possible. Il faut juste prendre de l’avance parce que l’on risque de tomber sur une peau que l’on n’arrivera pas à tirer, sur un tendon difficile… Ces éléments expliqueraient en partie le nombre très élevé de TMS. La viande résiste. Même mortes, les bêtes résistent.
M. le président Olivier Falorni. Madame, messieurs, nous vous remercions pour vos témoignages. J’incite tous ceux qui n’ont pas vu vos documentaires à les regarder car ils nous apprennent beaucoup sur la réalité des abattoirs.
La séance est levée à dix-huit heures quinze.
——fpfp——
30. Table ronde, ouverte à la presse, sur la vidéo-surveillance, avec la participation de M. Grégoire Loiseau, professeur à l’Université Paris-1, de M. Frédéric Géa, professeur à la Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy-Université de Lorraine, et de M. Paul Hébert, directeur-adjoint, et Mme Wafae El Boujemaoui, chef du service des questions sociales et ressources humaines, à la Direction de la conformité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
(Séance du mercredi 22 juin 2016)
La séance est ouverte à dix-huit heures vingt.
M. le président Olivier Falorni. Cette table ronde est consacrée à deux questions importantes qui se sont posées de façon récurrente durant toutes nos auditions depuis la création de cette commission d’enquête : le contrôle et la formation des opérateurs en abattoirs. Ces deux préoccupations nous ont amenés à nous interroger, de façon tout aussi récurrente, sur la vidéosurveillance. Doit-on et peut-on l’introduire dans les abattoirs, et tout particulièrement aux postes, particulièrement sensibles, d’étourdissement et d’abattage ?
Nous avons le plaisir d’accueillir M. Paul Hébert, directeur adjoint à la conformité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et Mme Wafae El Boujemaoui, chef du service des questions sociales et ressources humaines. Je rappelle que la CNIL est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen, et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. La CNIL est également compétente pour toutes les questions relatives à la mise en place de la vidéosurveillance sur le lieu de travail.
Nous recevons également M. le professeur Grégoire Loiseau, professeur à l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne, où il enseigne depuis 2003. Monsieur Loiseau, vous êtes directeur du master 2 recherche « Personne et droit », et du master 2 professionnel « Juristes de droit social ». Vous assumez de nombreuses responsabilités éditoriales, et vous êtes un spécialiste de la question de la vidéosurveillance des salariés sur leur lieu de travail.
Participe enfin à cette table ronde, M. le professeur Frédéric Géa, professeur à la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy-Université de Lorraine. Vous dirigez notamment, monsieur Géa, le master droit du travail et de la protection sociale. Spécialiste en droit du travail, vous avez publié, dans diverses revues, de nombreux articles sur la vidéosurveillance.
Je rappelle que, comme toutes nos auditions, cette table ronde est publique, ouverte à la presse, et diffusée en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. Elle pourra être visionnée à tout moment sur le site internet de l’Assemblée, comme l’ensemble de nos travaux dont certains sont diffusés en direct ou en différé sur la Chaîne parlementaire.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Paul Hébert, Mme Wafae El Boujemaoui, M. Grégoire Loiseau, et M. Frédéric Géa prêtent successivement serment.)
M. Paul Hébert, directeur adjoint à la direction de la conformité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les dispositifs vidéo peuvent être soumis à deux régimes juridiques distincts : celui de la vidéosurveillance et celui de la vidéoprotection.
La vidéosurveillance, mise en œuvre dans des lieux qui ne sont pas ouverts au public, comme les bureaux ou les entrepôts, est soumise aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés », alors que la vidéoprotection concerne la voie publique ou des lieux ouverts au public et relève du code de la sécurité intérieure. Mon propos sera évidemment centré sur la vidéosurveillance.
Au quotidien, la CNIL accompagne divers acteurs, notamment les entreprises et l’administration, dans la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance. Pour répondre à la demande, elle a publié, sur son site internet, des fiches qui expliquent aux employeurs les précautions à prendre pour installer des caméras dans leur entreprise en respectant les dispositions de la loi informatique et libertés. En 2015, nous avons reçu 12 500 déclarations de la part d’employeurs, relatives à l’installation de systèmes de vidéosurveillance. Nous sommes également destinataires de plaintes de citoyens, de salariés ou de syndicats. Sur un total d’environ 7 900 plaintes enregistrées en 2015, cinq cents concernaient la vidéosurveillance dans des lieux de travail. La CNIL a également pour mission d’opérer des contrôles de l’application de la loi de 1978, et de prononcer des sanctions en cas de manquement à la loi.
Je rappellerai les grands principes à respecter en cas d’installation d’un système de vidéosurveillance, comme c’est le cas pour tout traitement informatique de données à caractère personnel.
Le premier est le principe de finalité. La finalité de la mise en place d’un système de vidéosurveillance doit, aux termes de la loi, être « déterminée, explicite et légitime ». Il s’agit très fréquemment de la sécurité des biens et des personnes, par exemple lorsque l’on installe des caméras dans un entrepôt pour lutter contre le vol, mais il en existe d’autres – la formation peut constituer une finalité en tant que telle. Même si les animaux ne sont juridiquement ni des biens ni des personnes, par extension, la préservation de leur sécurité, pour tout ce qui touche aux mauvais traitements, me paraît être une finalité tout à fait légitime.
J’insiste sur le principe de finalité car la loi informatique et libertés exclut que des images soient utilisées pour une autre finalité que celle qui est initialement prévue. Un employeur qui aura, par exemple, installé des caméras pour surveiller un stock de matériels coûteux ne peut pas en visionner les images pour s’assurer de la productivité de ses salariés. Il est donc essentiel que les finalités d’un dispositif vidéo soient parfaitement établies. Peut-être serez-vous amenés, dans les conclusions de vos travaux, à déterminer les finalités qui pourraient être poursuivies par des systèmes de vidéosurveillance installés dans les abattoirs.
Deuxième principe : la proportionnalité. Tous les dispositifs qui relèvent de la loi de 1978 doivent être « proportionnés » par rapport à la finalité qui leur a été assignée. Quelle que soit cette dernière, la CNIL considère en général que ces dispositifs ne doivent pas conduire à placer des salariés dans un système de surveillance constante et permanente, sauf si des circonstances particulières le justifient, par exemple en raison de la nature de la tâche à accomplir. Très concrètement, et de façon assez casuistique, la délégation de la CNIL qui viendrait s’assurer du respect de ce principe vérifiera l’orientation des caméras, leur nombre, leurs horaires de fonctionnement, leur capacité à conserver les images, à enregistrer le son, la possibilité de visionnage à distance, etc..., autant d’éléments qui lui permettent d’apprécier la proportionnalité du dispositif par rapport à la finalité poursuivie et la nature des opérations effectuées. Par exemple, si l’objectif consiste à surveiller qu’il n’y a pas de vol à une caisse, la caméra doit être davantage orientée vers la caisse que vers le caissier lui-même. On pourrait tenir un raisonnement similaire si un dispositif de vidéosurveillance visait à éviter les maltraitances sur les animaux. En tout état de cause, le dispositif retenu doit évidemment limiter au maximum les atteintes à la vie privée des salariés.
Troisième principe : il est impératif d’informer les personnes filmées, qu’il s’agisse des salariés ou des visiteurs éventuels. Cette information se fait par affichage ou de manière individuelle. Le droit du travail prévoit également que les représentants du personnel sont consultés. Il ne peut y avoir de surveillance à l’insu des personnes qui doivent être informées des finalités du dispositif, ainsi que de leurs propres droits. Toute personne filmée dispose, au titre de la loi informatique et liberté, d’un droit d’accès à ses propres données, comme c’est le cas pour tous les fichiers. Elle peut demander à consulter les images où elle apparaît, voire à en obtenir une copie.
Dernier principe essentiel : la sécurité des données et la limitation du nombre de personnes habilitées à visionner les images enregistrées. Le responsable d’un dispositif de vidéosurveillance doit garantir la confidentialité de toutes les informations collectées qui ne doivent pas être diffusées. À l’instar de nombreuses autres obligations imposées par la loi informatique et libertés, la violation de ce principe de sécurité est sanctionnée pénalement. Il appartient au responsable en question de prendre des mesures, telles que la mise en place de codes d’accès ou de systèmes de traçabilité, afin d’éviter l’accès de tous aux images et leur circulation incontrôlée.
Selon la finalité de la vidéosurveillance, finalité qui constitue la pierre angulaire du dispositif, une réflexion devra donc être menée sur ceux qui seraient amenés à visionner d’éventuelles images filmées dans les abattoirs. S’il s’agit d’assurer la sécurité des travailleurs, on pourrait imaginer que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait accès aux images ; s’il s’agit davantage de lutter contre la maltraitance subie par les animaux, les autorités sanitaires pourraient être compétentes.
M. Grégoire Loiseau, professeur à l’Université Paris I. L’essentiel a été dit, et les règles posées par la CNIL se retrouvent dans la jurisprudence car elles sont appliquées par la chambre sociale de la Cour de cassation. Cette dernière se comporte en effet en excellent élève puisque les décisions qu’elles rendent reprennent quasiment mot pour mot celles de la CNIL.
Le salarié concerné peut-il s’opposer à la mise en place d’un système de vidéosurveillance ? Non. On considère que la surveillance fait partie du pouvoir de contrôle de l’employeur et que, dans l’exercice de ce pouvoir de contrôle, il est fondé à imposer aux salariés le fait d’être filmé, sous réserve des principes de finalité, de proportionnalité – les juristes parlent parfois de « principe de loyauté » car il s’agit d’éviter qu’un enregistrement serve à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été déclaré –, et de transparence. Les salariés doivent être informés non seulement de l’existence du dispositif, mais aussi de sa finalité. Les institutions représentatives du personnel doivent être informées et consultées lors de sa mise en place – le comité d’entreprise dans les entreprises de plus de cinquante salariés, et le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHCST). Le salarié ne peut pas s’opposer à la vidéosurveillance : les quelques petits litiges marginaux dans lesquels des salariés invoquaient leur droit à l’image ont fait long feu.
Il faut aussi évoquer le cas de l’employeur. Nous sommes partis d’une hypothèse classique et bien connue selon laquelle un employeur, dans l’exercice spontané de son pouvoir de contrôle, souhaite mettre en place un système de vidéosurveillance. Il doit dès lors déclarer le dispositif à la CNIL et est tenu à un certain nombre d’obligations et de règles. Mais il me semble que la question posée en l’espèce est un peu différente et un peu plus complexe, car il s’agit d’imposer à l’employeur d’installer des caméras dans l’établissement d’abattage dont il est propriétaire.
Je pense que, par la loi ou le règlement, il est possible de l’obliger à agir ès qualités d’employeur : il est déjà soumis à un certain nombre d’impératifs d’intérêt général auxquels on peut aujourd’hui considérer que la protection des animaux se rattache. Si l’on pouvait encore en douter jusqu’à l’année dernière, l’introduction de l’amendement Glavany dans la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures l’a confirmé en modifiant le code civil qui précise désormais, dans son article 515-14 que les animaux sont « doués de sensibilité ».
J’ai en revanche une toute petite hésitation lorsque je considère non plus l’employeur, mais le propriétaire de l’abattoir, même si je pense que l’impératif d’intérêt général resterait un élément suffisant pour l’obliger à agir. L’exploitant d’un abattoir en est généralement le propriétaire, et il n’est pas évident d’imposer à un propriétaire d’installer, dans l’enceinte d’un lieu dans lequel il est souverain, des dispositifs qui n’auraient pas son agrément. Voilà pourquoi, telle qu’elle est assurée par les instances juridiques de notre pays, la protection du droit de propriété qui a valeur constitutionnelle pourrait nous faire émettre une petite réserve sur la possibilité d’imposer, non à l’employeur ès qualités, mais au propriétaire des locaux, l’installation d’un système de vidéosurveillance.
M. Frédéric Géa, professeur à la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy-Université de Lorraine. L’essentiel a été dit, et bien dit. La question de la vidéosurveillance, comme d’autres techniques, nous place au cœur d’une dialectique bien connue entre, d’un côté, les pouvoirs de l’employeur qui peut légitimement contrôler l’activité de ses salariés, et, de l’autre, le respect des droits des salariés, notamment de leur vie privée.
Si l’on se pose, de façon générale, la question de principe de savoir si l’employeur peut surveiller ses salariés, la réponse est évidemment affirmative. Il peut le faire, mais pas à n’importe quelles conditions, car il doit satisfaire à plusieurs exigences. L’exigence de transparence se décline aux plans individuel et collectif, avec la consultation des représentants du personnel. L’exigence de proportionnalité résulte d’un article phare du code du travail, l’article L.1121-1 ainsi rédigé : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » L’employeur se trouve aussi dans l’obligation de déclarer à la CNIL les aspects techniques du dispositif, et le fait qu’il envisage par ce moyen de recueillir des données personnelles sur ses salariés, ce qui entre dans le champ d’application de la loi informatique et libertés.
Il faut aussi souligner que ces principes se déclinent de façon nuancée. Par essence, le principe de proportionnalité donne lieu à une appréciation. Cette dernière s’exprime en particulier par rapport à une finalité que l’employeur est supposé avoir clairement définie. Un certain nombre d’arrêts de la Cour de cassation portent sur des systèmes de vidéosurveillance qui visaient un objectif, mais qui ont été utilisés à d’autres fins. Je pense, par exemple, à un arrêt de février 2011 sur la validité des images d’un système de vidéosurveillance d’un bar, dont l’objet initial était d’assurer la sécurité des biens et des personnes, mais qui a finalement servi à montrer qu’un salarié omettait d’encaisser des consommations. À cette époque, la Cour de cassation ne paraissait pas très sensible au respect de la finalité initiale du dispositif, considérant que les salariés du bar avaient été préalablement informés de la mise en place de caméras – mais pas de ce à quoi, le cas échéant, elles pouvaient servir. Mais en 2012, la Cour a fait évoluer sa position. Elle se demandait si un dispositif de caméras pouvait être légalement accepté comme preuve des horaires de présence de salariés qui se rendaient chez un client extérieur ; or la vidéo n’a pas été admise comme preuve au motif que l’employeur n’avait jamais informé ses salariés que les caméras installées chez le client pouvaient servir au besoin à décompter leur temps de travail et à contrôler leur activité. Il faut aujourd’hui que la finalité annoncée corresponde à la finalité mise en œuvre. La CNIL est très vigilante sur ce point : elle exige depuis longtemps que les finalités soient clairement exprimées.
L’enjeu est d’autant plus sensible que, d’un point de vue juridique, on peut distinguer deux types de vidéosurveillance : celle qui concerne les salariés, soumise au régime juridique que j’ai décrit avec ses exigences de transparence et de proportionnalité, mais aussi celle qui porte sur des lieux où ne se déroule pas l’activité des salariés – comme des lieux de stockage par exemple. Dans cette dernière catégorie de vidéosurveillance, les conditions que nous avons évoquées ne s’appliquent pas ; autrement dit, cela n’interdirait pas d’utiliser, le cas échéant, ces images pour sanctionner un salarié. Un arrêt relativement récent a permis qu’une vidéo provenant d’un dispositif de cette nature soit utilisée pour licencier un salarié qui avait été filmé en dehors de son temps de travail.
Les conditions très précises qui ont été présentées s’appliquent lorsque le système de vidéosurveillance filme des salariés ; il faut alors être extrêmement rigoureux sur la finalité déclarée. Elles ne s’appliquent pas aux dispositifs qui ne visent pas à filmer les salariés ou leur activité, mais qui servent principalement à surveiller des pièces, des matériaux, des biens, des phases du processus de traitement ou certains éléments des ateliers dans le cas des abattoirs, et qui dès lors échappent aux justifications précédemment évoquées.
M. le président Olivier Falorni. Nous pouvons tirer une première conclusion du début de cette table ronde : la mise en place de la vidéosurveillance au poste d’abattage est d’ores et déjà possible en droit français. Quelle serait la procédure à suivre, et quelles modifications législatives ou réglementaires vous paraissent-elles éventuellement nécessaires ou souhaitables ?
Par ailleurs, durant combien de temps les images enregistrées peuvent-elles être conservées ? Doivent-elles l’être durant une durée minimale ?
La loi peut-elle comporter des précisions s’agissant des personnes ayant accès aux images de la vidéosurveillance ? Une entreprise peut-elle, si elle le souhaite, donner un accès plus large à ces vidéos ? Si c’est le cas, peut-on l’en empêcher ?
M. Paul Hébert. Vous l’avez compris, il n’y a pas d’obstacle en droit français à la mise en place un système de vidéosurveillance au poste d’abattage.
La procédure à suivre dépend un peu de l’orientation que l’on souhaite prendre, et de l’encadrement que l’on souhaite donner. Sauf erreur de ma part, un abattoir pourrait, dès aujourd’hui, installer un système de vidéosurveillance à condition qu’il déclare sa finalité à la CNIL. Chaque abattoir pourrait définir la finalité, et choisir les destinataires ou la durée de conservation des données. Une autre possibilité consiste à prendre un texte général qui préciserait la finalité de la vidéosurveillance dans les abattoirs…
M. le président Olivier Falorni. Selon vous, s’agirait-il d’un texte législatif ou réglementaire ?
M. Paul Hébert. À mon sens, il n’y a pas besoin de passer par la loi ; une modification des textes réglementaires serait suffisante. Tout dépend évidemment de la finalité retenue. De manière générale, je rappelle en effet que tout ce qui touche à la vie privée est traité par la voie législative, car la loi assure une meilleure protection en la matière – en l’espèce la vie privée des salariés. Cependant, je le répète, en première analyse, il ne me semble pas indispensable de passer par un véhicule législatif pour prendre un texte général qui préciserait les finalités de la vidéosurveillance dans les abattoirs, les destinataires et les durées de conservation des données.
Par défaut, la CNIL recommande à un employeur qui installe dans sa société lambda un système de vidéosurveillance pour surveiller son stock de ne pas conserver d’images au-delà d’un mois. Un texte pourrait évidemment déroger à ce délai : tout est affaire de proportionnalité au regard de la finalité retenue.
S’agissant de l’accès aux images, la déclaration d’un système de vidéosurveillance oblige actuellement à lister les destinataires des données recueillies, mais il existe des « tiers autorisés ». Cette notion recouvre toutes les personnes légalement habilitées à accéder aux images, comme les forces de police sur réquisition judiciaire par exemple.
Un texte aurait l’avantage d’être bien précis en termes de finalités. Il faudra ensuite se poser la question des moyens. Comment se déclenche le système, conserve-t-il les images ? Les questions sont nombreuses. Le dispositif de la loi informatique et libertés s’appuie sur l’existence d’un « responsable de traitement » qui détermine la finalité et les moyens du système, mais les choses peuvent également être précisées par un texte.
M. Grégoire Loiseau. On pourrait sans doute mettre en place la vidéosurveillance dans les abattoirs à droit constant ; on ferait toutefois beaucoup mieux avec un texte.
Si l’on voulait conserver les images au-delà du délai d’un mois recommandé par la CNIL, un texte serait le bienvenu. Il pourrait aussi poser une obligation d’archivage. Et je reviens au problème de l’entrepreneur qui ne voudrait pas installer un système de vidéosurveillance dans son entreprise. Cela se comprend car le contrôle exercé sur les salariés n’est, en fait, qu’incident ; le contrôle porte d’abord sur les conditions d’abattage – même si indirectement il suppose bien que les salariés soient filmés dans l’exercice de leur activité. C’est d’ailleurs pour cette raison que la question de l’atteinte à la vie privée me paraît assez résiduelle. Je le répète : la finalité du système est de filmer les conditions d’abattage et non les visages des salariés durant leur travail.
Si tant est que certains employeurs soient rétifs à l’installation du système, un texte serait nécessaire pour les y obliger. Et si l’on se place sur le terrain de la défense du droit de propriété, il est clair qu’un texte réglementaire n’y suffirait pas : il faudrait une loi.
En vous écoutant, je songeais à un autre moyen possible. Il faudrait vérifier à quelle branche d’activité appartient l’abattage, et passer éventuellement par une obligation de négocier au niveau de la branche d’activité. Les partenaires sociaux pourraient ainsi être contraints de négocier au niveau de la branche les conditions de mise en œuvre de la vidéosurveillance. Cette solution aurait un immense mérite car la convention de branche, une fois étendue par arrêté, s’appliquerait à tous les employeurs et à tous salariés du secteur. Autrement dit, le problème d’un exploitant hostile à la vidéosurveillance ne se poserait plus, puisqu’il sera tenu d’exécuter les dispositions de l’accord de branche. De plus, nous sommes en terrain connu : nous savons comment obliger les partenaires sociaux à négocier, alors qu’un texte contraignant les employeurs à installer un système de vidéosurveillance serait assez difficile à rédiger. L’obligation serait aussi forte pour ces derniers dans l’un ou l’autre cas.
M. Frédéric Géa. Je pense également qu’il vaut mieux passer par une solution négociée plutôt que par une obligation légale. Je ne vois d’ailleurs pas très bien quel serait l’objet de cette dernière au regard de l’état du droit existant.
Le précédent du chronotachygraphe donne une idée de l’enjeu. L’installation de ce dispositif dans les véhicules de transport routier permet d’enregistrer la vitesse du véhicule, mais aussi le temps de conduite et d’activités du salarié. Il s’agit d’une obligation qui résulte d’un règlement européen, et qui s’impose à toutes les entreprises concernées. De ce fait, et pour la première fois, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 14 janvier 2014, que le fait qu’un employeur n’ait pas déposé de déclaration du dispositif auprès de la CNIL, ne lui interdisait pas de se prévaloir des données enregistrées. L’enjeu juridique de l’obligation est donc considérable : elle autorise, d’une certaine manière l’employeur, à se dispenser de respecter la procédure habituelle. La CNIL a cependant précisé que les employeurs qui installaient des chronotachygraphe dans leurs véhicules devaient respecter un certain nombre d’obligations relatives notamment à l’information fournie aux personnes concernées, aux droits de ces dernières, à la durée de conservation des données collectées, ou aux mesures de sécurité prises pour le traitement des données. Une modulation de l’encadrement juridique de ce dispositif technique a donc été effectuée par la CNIL elle-même. Ce processus alternatif me semble intéressant : une prescription initiale libère l’employeur de l’obligation du respect de la procédure classique de déclaration, mais des normes souples sont définies par la CNIL elle-même, qui ont l’avantage de s’ajuster éventuellement au secteur concerné. Un schéma similaire pourrait s’appliquer en matière de vidéosurveillance. Nous ne serions alors plus dans l’obligation de passer par la négociation collective.
M. William Dumas. Le problème de la vidéosurveillance revient en permanence dans les auditions que nous conduisons. Il faut incontestablement que notre Commission prenne une décision à ce sujet, mais tout le monde n’y est pas favorable. M. Bigard notamment nous a dit qu’il n’était pas partisan de la vidéosurveillance. Or ce monsieur est employeur, mais également très souvent propriétaire des locaux…
Vous dites que les enregistrements peuvent être conservés un mois. Si l’on filme un poste de travail en permanence, le film ne peut être visionné sur toute la durée ; il faut procéder au coup par coup. Les vidéos diffusées par L214 montrent quatre ou cinq minutes de maltraitance animale sur cinquante heures – et peut-être plus – de film. Nous avons reçu tout à l’heure des personnes qui ont réalisé des reportages sur des abattoirs, et ils nous ont dit n’avoir rencontré aucun problème, que ce soit à la bouverie ou aux postes d’abattage. S’ajoute la question de l’abattage halal, mais les gens que nous avons vus nous ont affirmé que, dès lors qu’il y a une bonne contention et que l’animal est retourné, les choses se passaient bien. Au départ, j’étais plutôt favorable à la vidéosurveillance ; mais, plus nous avançons dans nos travaux et plus j’ai des doutes : un tel contrôle pourrait être prétexte à licencier des personnes, surtout si les images sont gardées un mois, voire archivées. Je suppose que la CNIL ne verrait aucun inconvénient à ce que le poste d’abattage soit filmé à une double fin : contrôle et formation.
M. le président Olivier Falorni. Vous m’avez répondu que le maximum était d’un mois. Un minimum est-il prévu ?
M. Paul Hébert. Le minimum, c’est de ne pas garder les images. Il est possible d’avoir un système permettant de visualiser des images sans les conserver. Tout dépend de la finalité.
M. William Dumas. Quand je travaillais dans l’audit bancaire, je me servais de vidéosurveillance sur des caisses où se produisaient beaucoup d’erreurs, dans le but d’en déterminer les causes. Dans un cas, c’était une femme de ménage qui se servait dans une caisse que l’employée de la banque ne fermait pas correctement. Mais nous ne gardions pas les images aussi longtemps ; au bout d’une semaine elles étaient effacées, sauf celles qu’il fallait éventuellement donner à la police – mais, à l’époque, on nous disait que de telles images ne pouvaient servir de preuve.
Mme Wafae El Boujemaoui. La durée d’un mois a été déterminée à la suite d’une concertation avec des professionnels. Nous avons constaté qu’elle était suffisante pour visionner les images et exploiter les informations en cas de besoin. Mais la durée réelle de conservation peut varier en fonction de l’entreprise. S’il s’agit de vérifier que le salarié manipule bien l’animal ou les outils, l’employeur peut visionner les images toutes les semaines, par exemple, et, ne constatant aucun incident, les supprimer au fur et à mesure, dans la mesure où les informations ont été exploitées et l’objectif atteint. Tout dépend de la finalité retenue : s’agit-il de contrôler l’activité du salarié, ou simplement d’identifier la cause d’un incident – mauvaise manipulation par le salarié ou défaillance de la machine, par exemple. Dans un cas ou dans l’autre, la durée de conservation des images ne sera pas forcément la même.
M. le président Olivier Falorni. Un visionnage collectif des salariés est-il possible ? C’est l’aspect « formation » dont je parlais : peut-on utiliser les vidéos archivées à titre pédagogique, en vue de montrer les bonnes et les mauvaises pratiques ?
M. Grégoire Loiseau. Autant le salarié, dans l’exercice du pouvoir de contrôle de l’employeur, a le devoir d’accepter une vidéosurveillance, autant l’exploitation d’une vidéo, même à des fins non lucratives, comme la formation, implique l’accord des salariés filmés. Il existe toute une jurisprudence civile à ce sujet, sur le respect du droit à l’image du salarié, qui doit impérativement donner son accord – pour peu évidemment que la personne soit être identifiable sur l’enregistrement ; si l’on ne voit que ses mains, il n’y a pas de problème. Mais si le masque ne couvre pas suffisamment le visage, par exemple, il faut obligatoirement l’accord de l’intéressé.
M. Paul Hébert. Par ailleurs, les technologies du floutage se développent. Si les visages sont floutés, on sort des problématiques du droit à l’image.
M. Arnaud Viala. Vous avez beaucoup insisté sur l’environnement du salarié, ses droits, l’accord qu’il doit donner pour l’utilisation de son image. Or les images peuvent aussi porter sur les pratiques imposées par l’employeur à ses salariés. Quel est le cadre juridique à cet égard ? Comment gère-t-on l’utilisation d’images par l’employeur, qui peut être aussi le propriétaire des lieux, en vue de porter une appréciation sur ses propres instructions ?
Ma seconde question concerne l’opportunité. Faut-il ou non légiférer pour mettre en place de la vidéosurveillance dans les abattoirs ? Avez-vous un panel d’activités professionnelles où l’utilisation de la vidéosurveillance est déjà développée, qui nous permette d’apprécier si une extension aux abattoirs est justifiée ?
M. le président Olivier Falorni. Un terme n’a pas encore été prononcé dans nos échanges, alors qu’il est au cœur du problème : le contrôle, qui doit être pris en charge par l’administration. Aujourd’hui, sans inspecteur vétérinaire dans l’abattoir, la chaîne d’abattage ne démarre pas. Chaque entreprise d’abattage, publique ou privée, est soumise à un contrôle administratif. Les actes filmés par L214 ont été commis alors qu’un inspecteur vétérinaire était forcément présent quelque part : on ne le voit jamais, mais il était là. Cela pose question. Il ne s’agit pas seulement de la relation employeur-employé : nous sommes bien dans le cadre d’un contrôle administratif.
M. Paul Hébert. S’il s’agit d’un contrôle de nature administrative et pas seulement de relations entre employeur et salariés, il ne fait pas de doute qu’il faudra un texte, législatif ou réglementaire.
M. le président Olivier Falorni. Nous en sommes seulement au stade des hypothèses, mais une des plus probables est celle d’une utilisation aux fins de contrôle administratif, dans la logique de ce qui se fait aujourd’hui de façon humaine et directe. Le contrôle administratif existe déjà par une intervention humaine directe, l’inspection vétérinaire devant contrôler à la fois l’aspect sanitaire et le bien-être animal, jusqu’à présent négligé. La vidéosurveillance sur la bouverie et le poste d’abattage peut-elle être un complément pour ce contrôle administratif ?
M. Paul Hébert. La vidéo se développe, par exemple la vidéo-verbalisation, notamment du fait qu’il n’y a pas assez de personnes pour assurer la surveillance. Mais la CNIL n’est pas en mesure de dresser un bilan de son efficacité, faute d’études poussées sur ce type de dispositifs.
Il peut aussi y avoir des mécanismes à la main du salarié : certains chauffeurs de bus utilisent un système vidéo qu’ils activent eux-mêmes en cas de danger. Si l’objectif est de protéger les salariés contre d’éventuelles pressions, on peut concevoir un système de vidéo qui soit à leur main.
Mme Wafae El Boujemaoui. La question de la finalité est fondamentale. Si la vidéo a pour objectif de contrôler la productivité du salarié, c’est l’employeur qui aura la main sur les images. S’il s’agit en revanche de vérifier que les consignes données par l’employeur sont respectueuses des textes et de l’animal, ce devra être bien évidemment l’administration, dans le cadre de sa mission de contrôle.
M. le président Olivier Falorni. Qui pourrait avoir la main sur ce contrôle, justement ?
Mme Wafae El Boujemaoui. Les autorités compétentes, mais ce n’est pas à nous de dire lesquelles. Il faudrait en tout cas que ce soit prévu par un texte.
M. Arnaud Viala. Parmi les vidéos qui ont conduit à la création de cette commission d’enquête, l’une montre des pratiques non conformes, mais l’employeur affirme qu’il ne savait pas que le salarié se laissait aller à de telles pratiques. Il faut donc aussi que le texte prévoie que, si le salarié ne respecte pas les consignes qui lui sont données, sa responsabilité individuelle est engagée.
Mme Wafae El Boujemaoui. Je pense que s’appliquent les règles classiques de la responsabilité de l’employeur du fait des actions commises par ses salariés ; je ne crois pas qu’il y ait de règles spécifiques aux abattoirs en la matière. Dans toute société, le règlement intérieur fixe le cadre et rappelle ce que peut faire et ne pas faire le salarié.
M. Jacques Lamblin. Je constate que vous êtes unanimes pour dire que l’installation de vidéosurveillance sur une chaîne de travail est tout à fait possible. C’est très important parce que, tout au long de nos auditions, nous avons entendu à ce sujet des points de vue différents selon que l’on était du côté de l’industriel et, parfois, des représentants du personnel ou du côté de ceux qui ont pour objectif la protection animale.
Maintenant que nous savons qu’on peut utiliser la vidéosurveillance, la question est de savoir si l’on peut la rendre obligatoire. Vous avez expliqué, monsieur Loiseau, que ce serait plus facile par le biais d’une loi, qui permettrait en particulier de lever les difficultés qu’un propriétaire pourrait soulever s’il était seulement soumis à une injonction.
Supposons que nous rendions obligatoire par la loi un dispositif de vidéosurveillance : peut-on déterminer des finalités minimales ? Si nous n’en disons pas plus, l’installateur pourrait se contenter de filmer le plafond plutôt que les postes de travail… Je vois deux finalités à prendre en compte : éviter les mauvais traitements aux animaux et assurer la sécurité des travailleurs, l’ergonomie du poste de travail. La première est plutôt au bénéfice de l’administration, puisque c’est elle qui pourrait exploiter ces images, la seconde davantage au bénéfice du patron. Jusqu’où peut-on aller, selon vous, dans les exigences qui pourraient être formulées ?
Même si la loi dit que c’est obligatoire, n’est-ce tout de même pas constitutionnellement une atteinte au droit de propriété que d’imposer à un propriétaire d’installer un équipement de ce type ? Vous avez évoqué la possibilité d’un accord de branche. Le législateur ne peut imposer un quelconque résultat en la matière puisque cela se passe entre les syndicats et les organisations d’employeurs.
Enfin, dans le cas où une information se dégage de l’exploitation des images, où il est avéré par exemple qu’un membre du personnel a eu des gestes répréhensibles envers les animaux, l’image peut-elle être gardée pour servir de preuve, à charge, ou au contraire à décharge, pour réfuter des accusations infondées ?
Mme Wafae El Boujemaoui. Si une faute du salarié est constatée en visionnant les images enregistrées pour vérifier qu’il fait bien son travail, il semble logique d’utiliser ces images, puisque c’est en lien avec la finalité du dispositif. Il est également possible d’extraire les images à des fins contentieuses. Même en fixant une durée de conservation d’un mois, la CNIL permet d’extraire les images intéressantes ; le reste sera supprimé.
M. Grégoire Loiseau. En ce qui concerne la négociation collective, le législateur a déjà posé des obligations de résultat en imposant aux entreprises de parvenir à un accord, assorties d’une sanction non négligeable de 1 % de la masse salariale pour celles qui n’auraient pas négocié et, à défaut de parvenir à un accord, élaboré un plan de l’employeur de façon unilatérale. Cela n’existe pas au niveau de la branche mais je ne vois pas d’impossibilité juridique à l’imposer à ce niveau. Il existe une seule obligation de négocier au niveau des branches, depuis la loi du 14 juin 2013, qui a fixé un minimum de seize heures hebdomadaires pour les salariés au temps partiel ; les entreprises des branches où sont employés beaucoup de salariés à temps partiel ont eu l’obligation de négocier sur cette question. Mais le résultat n’est pas très probant, il faut le dire : de nombreuses branches n’ont toujours pas négocié alors que la négociation aurait dû aboutir il y a un an et demi. Mais il peut être de l’intérêt bien senti des syndicats d’employeurs comme des salariés de négocier un accord plutôt que de se voir imposer une obligation par le bâton de la loi…
À ce propos, plus cette discussion se prolonge, plus je pressens qu’il faudra un texte législatif plutôt que réglementaire, ne serait-ce que pour surmonter l’obstacle lié au respect du droit de propriété. Ce droit, aussi absolu soit-il, est aménageable ; on admet depuis toujours que l’intérêt général puisse justifier des limites.
Ces limites, j’en vois deux, liées aux finalités et des modalités de consultation de ces enregistrements. La première est la sécurité des personnes, autrement dit tout ce qui relève des prérogatives du CHSCT. Il est à noter qu’une loi de 2013 a élargi les compétences de celui-ci aux matières environnementales. De ce fait, les préoccupations de sécurité et d’environnement pourraient faire office de leviers pour exciper du principe d’intérêt général. On pourrait par ailleurs imaginer un accès des représentants du personnel, et notamment du CHSCT, aux images pour vérifier que les pratiques supposées être l’exécution des ordres de l’employeur sont conformes aux textes.
Seule la loi, me semble-t-il, pourrait permettre un visionnage par l’administration. Dans ce cas également, je crois que l’on pourrait utiliser le biais de l’intérêt général, lié à la sécurité – entendue au sens large, dans la mesure où, si le sort de l’animal est scellé, encore doit-il disparaître dans les conditions les plus acceptables ou les moins inacceptables possibles. Je rappelle à cet égard que, dans le code pénal, l’animal n’est ni dans le titre relatif aux personnes ni dans celui relatif aux biens, mais dans celui des « autres infractions ». Cela montre la préoccupation du législateur pour les questions de santé et de sécurité des animaux, même sur leur dernier chemin.
M. Frédéric Géa. Les différents contrôles appellent des outils juridiques différenciés et probablement des acteurs différents. S’il s’agit de déterminer la responsabilité du salarié, dans la mesure où celui-ci exerce son activité sous le contrôle de l’employeur, c’est ce dernier qui est juridiquement responsable. Si l’on souhaite, à l’inverse, vérifier que l’employeur respecte les normes d’ergonomie ou de conditions de travail, cela relève de la DIRECCTE, et l’on peut tout à fait concevoir que les abattoirs soient une priorité de l’administration du travail – même si je n’ai pas connaissance que nos abattoirs, en Lorraine, posent quelque problème de cet ordre. Enfin, le rôle du comité d’entreprise a été renouvelé en 2013, au point qu’il en vient à jouer un véritable rôle de lanceur d’alerte, y compris dans des sujets comme le CICE, qui ne sont pas a priori de sa compétence directe. On pourrait imaginer que le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, ou le CHSCT, disposent du moyen de saisir tel ou tel organe au sein de la structure ou telle autorité à l’extérieur en dehors, en présence de tel ou tel type de problème, par exemple lié au traitement des animaux. Une telle approche nécessitera à l’évidence de passer par une loi. Attention toutefois à ne pas élargir de manière exponentielle les attributions des représentants du personnel, qui ont déjà bien du mal à faire face à leurs compétences historiques.
M. le président Olivier Falorni. Dans le cas de l’abattage rituel, sans étourdissement, il peut arriver que les « sacrificateurs » ne soient pas directement salariés par l’entreprise. Est-il légal de les filmer même s’ils n’appartiennent pas à l’entreprise ?
Par ailleurs, un certain nombre de professionnels ont exprimé la crainte d’un possible détournement des images. Si des associations de protection animale détournent ces images et les rendent publiques, quelles sanctions juridiques pourraient-elles encourir ?
M. Paul Hébert. La première question peut être rapidement évacuée : les dispositifs de vidéosurveillance s’appliquent souvent à des personnes qui ne sont pas salariées de l’entreprise : les visiteurs, par exemple, sont eux aussi filmés. Tous les principes que j’ai développés, notamment pour ce qui touche à l’information des personnes sur la finalité de l’enregistrement, sont applicables indépendamment de la qualité de salarié.
Le détournement des images pose une vraie question. La loi Informatique et libertés dit que celui qui est responsable du traitement et du stockage des images l’est également de la sécurité. Si ces images fuitent à l’extérieur, c’est jusqu’à sa responsabilité pénale qui peut être engagée. La CNIL peut même aller jusqu’à infliger des sanctions pécuniaires pour violation de la vie privée.
M. Jacques Lamblin. Même si les images sont volées ?
M. Paul Hébert. Le cas du vol est un peu différent mais, en tout état de cause, le responsable doit prendre les mesures de sécurité nécessaires. Si aucune précaution n’est prise conformément aux règles de l’art, sa responsabilité sera engagée. Il faut qu’il soit sensibilisé au fait que le stockage et la transmission des images doivent être sécurisés.
Le fait de filmer des salariés de manière permanente et continue constituant une atteinte à la vie privée, un vecteur législatif paraît nettement plus protecteur pour les personnes.
M. Jacques Lamblin. On peut donc imposer une ou deux finalités, mais, à l’inverse, peut-on imposer un usage maximal, c’est-à-dire imposer une vidéosurveillance mais en exigeant qu’elle n’aille pas au-delà des finalités prévues ? On peut imaginer par exemple qu’un exploitant installe la vidéosurveillance qu’on l’oblige à installer, et qu’il soit tenté de s’en servir pour mesurer la cadence de travail, c’est-à-dire qu’il la fasse servir au profit de son établissement. Peut-on prévoir, en plus d’un plancher, un plafond ?
M. Grégoire Loiseau. Oui, les finalités du dispositif peuvent être circonscrites, à plus forte raison si l’on passe par un vecteur législatif. La Cour de cassation reprend du reste la position de la CNIL selon laquelle, dès l’instant où le dispositif est utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles sa création a été motivée, les enregistrements sont juridiquement irrecevables. Cela se fait aujourd’hui au regard de ce que l’employeur a déclaré lors de la mise en place du dispositif, mais cela peut être a fortiori le cas si la loi a précisément énuméré les finalités.
M. Jacques Lamblin. Si les finalités énumérées sont a minima, l’employeur peut ajouter celles qui lui sont propres, la productivité ou autre. Votre réponse est claire : un plafond est possible.
M. Grégoire Loiseau. De la même façon que certaines finalités peuvent être imposées, d’autres peuvent être clairement interdites à l’employeur. C’est parfaitement conforme à la philosophie de la CNIL : dans le cas des dispositifs biométriques, par exemple, la CNIL a bien précisé qu’ils pouvaient être utilisés à telles fins et non à telles autres. Si telle est déjà la position de l’autorité administrative indépendante, il n’y a aucun problème à ce que la loi le dise également.
M. Paul Hébert. La loi Informatique et Libertés prévoit déjà ce principe : toute autre finalité que celles prévues est un détournement de finalité. Rien n’empêche non plus d’exclure explicitement des finalités dans un texte.
M. Frédéric Géa. J’introduirai une nuance : la Cour de cassation admet que certains dispositifs de vidéosurveillance qui n’avaient pas vocation à permettre un contrôle de l’activité des salariés puissent au final servir à licencier un salarié, si l’on s’est aperçu, par exemple, qu’il a volé un objet. C’est une jurisprudence constante. Cela signifie donc, de mon point de vue, qu’il est souhaitable de fixer clairement les finalités du dispositif afin qu’il ne soit pas détourné avec la bienveillance de la Cour de cassation. Nous sommes là sur un terrain délicat : il y a encore cinq ans, la Cour ne semblait pas y voir problème. Elle a resserré son approche en janvier 2012, mais il serait plus net de l’inscrire dans un texte.
Mme Wafae El Boujemaoui. La CNIL établit une distinction s’agissant du détournement de finalité. Admettons qu’un système de vidéosurveillance ait été mis en place à des fins de sécurité des biens et des personnes, et qu’un feu se soit déclaré dans l’entreprise. Si l’on se rend compte, en examinant les vidéos pour essayer de déterminer la cause de l’incendie, qu’il a été causé par un salarié pyromane, il semble cohérent d’utiliser ces images à l’encontre du salarié, même si ce n’est pas l’objectif initial ; on ne parlera pas dans ce cas de détournement de finalité. En revanche, si l’employeur visionne les images tous les jours afin de trouver un motif pour licencier tel ou tel salarié, il s’agit clairement d’un détournement de finalité.
M. William Dumas. On parle beaucoup de vidéosurveillances à la suite des agissements de L214. Or ces gens-là ont agi en dehors de la loi : c’est par effraction qu’ils se sont introduits dans un abattoir de ma circonscription pour y placer des caméras un peu partout. À la suite de la diffusion de leurs vidéos, un employé a vu son contrat non renouvelé et un autre est bien mal en point… Vous venez nous expliquer tout ce que les employeurs doivent faire pour rester dans la légalité. Et nous discutons dans le cadre d’une commission d’enquête qui s’est constituée en s’appuyant sur ce qu’on rapporté des gens qui ont délibérément bafoué tout ce que vous nous expliquez ! Je trouve que c’est grave. Nos invités nous expliquent que les images ne peuvent être conservées plus d’un mois, mais les images de L214 sont visibles tant qu’on veut, et cela fait des mois que cela dure ! Je suis pour le bien-être animal, mais il faut respecter la loi, et c’est ce que nous nous attachons à faire. Mais ces gens-là ne respectent rien et je ne les respecte pas.
M. le président Olivier Falorni. Je précise que, dans le cadre de la loi Sapin, nous avons voté, il y a quelques jours, un amendement qui a fait de la maltraitance sur les animaux, dans les abattoirs comme dans les transports, un délit pénal, avec une protection de ce que l’on peut considérer comme des lanceurs d’alerte.
Cela étant, William Dumas a raison : nous avons eu affaire à des vidéos clandestines. Il se trouve qu’elles reflétaient la réalité et qu’elles ont ému l’opinion publique. En tant que législateur, nous devons voir comment substituer à des vidéosurveillances clandestines une vidéosurveillance légale. C’est aussi le sens de notre réflexion.
En conclusion, j’aimerais avoir votre sentiment sur l’opportunité d’installer de la vidéosurveillance dans les abattoirs en vue du bien-être animal. Je m’adresse aux spécialistes autant qu’aux citoyens : cela vous semble-t-il être un moyen de contrôle pertinent, certes insuffisant, mais nécessaire et souhaitable ?
M. Paul Hébert. La réponse n’est pas facile… La CNIL, je l’ai dit, reçoit des plaintes. La vidéo peut être une forme de pression sur les salariés. Autrement dit, ce n’est pas un procédé ordinaire, même s’il se banalise : il faut être très attentif aux modalités concrètes de sa mise en œuvre. Se pose également la question de son efficacité réelle : la CNIL est mal placée pour y répondre, d’autant qu’il existe très peu d’études poussées sur le sujet, y compris sur ce qui touche à la vidéoprotection installée sur la voie publique et à ses effets sur la délinquance. Ce n’est sans doute pas la solution miracle ; il faut en tout cas que cela se fasse dans le cadre de la loi. Cela se justifie à mon avis bien plus dans le cadre d’un contrôle administratif, mais prenons garde tout de même aux dérives possibles, aux fuites d’images, aux détournements.
Mme Wafae El Boujemaoui. La CNIL n’est pas très favorable à la surveillance permanente des salariés, mais elle l’admet lorsque c’est nécessaire, dans des cas exceptionnels. Sur la question du bien-être animal, il faudrait plutôt conduire un travail sur les pratiques au sein des abattoirs d’une manière générale. La CNIL a l’habitude de rappeler qu’il faut toujours réfléchir à une solution qui soit la moins intrusive possible. Dans le cas qui nous occupe, est-ce les outils qui posent problème ou la manière de faire ? Ne faudrait-il pas dès lors plutôt songer à revoir les pratiques, voire à en imposer de nouvelles ? En tout état de cause, il faut toujours raisonner en fonction de la finalité.
M. Grégoire Loiseau. On peut sans doute se passer de la vidéosurveillance : il existe d’autres leviers, et je reste convaincu que les représentants du personnel sont bien placés pour signaler des excès. Il existe aujourd’hui un dispositif appelé le droit d’alerte : un représentant du CHSCT ou tout salarié saisissant un représentant du CHSCT peut lancer une alerte qui oblige l’employeur à mener une enquête, et, si celle-ci n’aboutit pas, il faut s’en remettre à l’inspection du travail. Ce droit d’alerte existe en matière environnementale ; il suffirait donc d’ajouter la question animale, qui s’inscrirait très facilement dans ce cadre.
J’ai une autre réponse, beaucoup plus théorique que pratique. Certains juristes attendaient beaucoup de l’amendement Glavany du 7 février 2015 selon lequel les animaux sont des « êtres vivants doués de sensibilité ». Bon nombre ont été déçus, considérant que cette disposition visait avant tout à faire plaisir aux associations de protection des animaux mais n’aurait pas de conséquences directes. La vidéosurveillance sera la première manifestation d’une conséquence de cette législation, qui marque à mon avis un pas fondamental. Et à ceux qui doutent que cela puisse se concrétiser par des avancées législatives, en voilà une…
M. Frédéric Géa. La vidéosurveillance est une technique qui n’est pas neutre, pour les salariés en particulier : elle peut engendrer du stress et donc une dégradation de leurs conditions de travail. C’est une réalité, et qui fait que le CHSCT pourrait être compétent au même titre que le comité d’entreprise lorsqu’est mis en place un dispositif de ce type. C’est la raison pour laquelle je ne suis a priori pas très favorable à la vidéosurveillance ; j’aurais tendance à privilégier d’autres mécanismes et d’autres acteurs, que nous avons évoqués.
Si vous optez pour la voie de la vidéosurveillance, il faudra se demander, de manière très pratique, où l’on place les caméras : c’est un enjeu majeur. Il ne faut pas que ce dispositif permette le contrôle de l’activité des salariés, en tout cas pas une surveillance permanente et continue que réprouvent la CNIL comme le juge judiciaire, sauf circonstances particulières. S’il s’agit en particulier de vérifier que le caissier encaisse bien les sommes qu’on lui remet, on aura plutôt intérêt à braquer la caméra sur la caisse, et non sur le caissier…
Il faudra sans doute revoir certaines pratiques des abattoirs, mais cela ne passe pas nécessairement par un système de vidéosurveillance. Il ne faudrait pas sacrifier les droits des salariés ni faire empirer leurs conditions de travail sans être assuré de l’efficacité d’un tel dispositif. Et si on ne l’est pas, il faudra privilégier d’autres moyens, et d’autres acteurs.
M. le président Olivier Falorni. Merci à tous.
La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.
——fpfp——
31. Audition, ouverte à la presse, de M. Anouar Kbibech, président du Conseil français du culte musulman (CFCM) et de M. Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de France.
(Séance du jeudi 23 juin 2016)
La séance est ouverte à neuf heures quinze.
M. le président Olivier Falorni. Nous poursuivons nos travaux sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, en nous consacrant en cette première partie de matinée à l’abattage rituel, en présence des présidents des deux grandes institutions représentatives du culte musulman et du culte israélite, le Conseil français du culte musulman (CFCM) et le Consistoire central israélite de France.
Le Conseil français du culte musulman, association régie par la loi de 1901, a été fondé en 2003 dans le but de représenter le culte musulman de France. Composé de diverses associations et organisations, il bénéficie d’une représentativité géographique grâce aux conseils régionaux du culte musulman qui le composent. Il a pour mission la formation des imams et des cadres religieux, l’arrêt du calendrier des fêtes religieuses, l’organisation de la célébration de l’Aïd, du pèlerinage ainsi que l’organisation et la gestion du marché des produits certifiés halal. Nous recevons son président, M. Anouar Kbibech, qui a été nommé à ces fonctions le 30 juin 2015, succédant à M. Dalil Boubakeur que nous avons entendu il y a quelques jours. Monsieur le président, je précise que vous êtes par ailleurs diplômé de l’École nationale des ponts et chaussées.
Le Consistoire central israélite de France, créé en 1808, est l’institution représentative du judaïsme en France. Il a notamment pour mission l’organisation du culte et du rabbinat, la formation des rabbins à l’école rabbinique de France et la gestion de la cacherout. M. Joël Mergui, élu président en 2008, vient d’être réélu à sa tête, il y a quelques jours.
Messieurs les présidents, avant que mes collègues ne vous interrogent, vous nous exposerez dans une intervention liminaire vos positions sur l’abattage rituel, sujet qui nous intéresse particulièrement – nous venons d’effectuer une visite inopinée, comme nous en avons désormais pris l’habitude, dans un abattoir spécialisé dans l’abattage rituel à Meaux. Précisons toutefois que l’abattage rituel n’est qu’un sujet parmi d’autres dans nos travaux. Les vidéos clandestines de l’association L214, à l’origine de la création de notre commission d’enquête, concernaient exclusivement des pratiques d’abattage conventionnel.
Je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et retransmises en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale, certaines étant diffusées sur la chaîne parlementaire (LCP).
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Anouar Kbibech et M. Joël Mergui prêtent successivement serment.)
M. Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de France. Je vous remercie, monsieur le président, de nous donner l’occasion d’un nouvel échange sur l’abattage rituel. Lorsque j’ai commencé mon mandat de président du Consistoire, en 2008, la société française commençait de s’interroger sur la saignée rituelle et je n’imaginais pas, je dois l’avouer, passer autant de temps à m’exprimer sur ce sujet, avec le rabbin Fiszon, en France et dans les différentes enceintes européennes.
Avant de répondre aux différentes questions d’ordre pratique et technique, il m’appartient de revenir sur le climat dans lequel vit aujourd’hui la communauté juive de France. Il y a une dizaine d’années, lors de ma première élection, la question de défendre notre liberté religieuse en France et en Europe ne se posait quasiment pas : la priorité, pour ce qui concerne le casher, était davantage de trouver les moyens de diminuer le prix de la viande casher, que la communauté trouvait un peu trop élevé. Mais au fur et à mesure, les choses ont changé : pour ma réélection, la priorité que j’ai dégagée a clairement été la sécurité des juifs de France et la liberté de la pratique religieuse. Et c’est pour moi une occasion un peu solennelle de le rappeler : les juifs sont dans un moment d’interrogation sur leur avenir en France. Après les événements dramatiques que l’on sait, l’État a pris des mesures exemplaires pour faire en sorte que la communauté juive continue de mener une vie normale dans ses institutions et lieux de culte. Nous considérons qu’il est du rôle de l’État et du législateur, de prendre également en compte d’autres préoccupations de cette partie de la communauté nationale. Sans possibilité de manger casher, il n’y a pas d’avenir pour une communauté juive dans quelque pays que ce soit : c’est une base fondamentale des règles du judaïsme. Et je ne peux pas imaginer que la France, où vit la principale communauté juive d’Europe, puisse prendre des dispositions visant à revenir sur cette pratique. Le fait que l’abattage rituel fasse l’objet d’attaques répétées, que nous soyons régulièrement invités à débattre de ces sujets, en plus des menaces pour notre sécurité, apparaît comme une forme d’atteinte à notre liberté de conscience, au point d’induire des envies, chez certains de membres de la communauté juive, de quitter la France. Il y va de notre responsabilité conjointe : depuis deux siècles, le Consistoire agit, malgré les vicissitudes de l’histoire, pour faire en sorte, avec l’État, que la communauté juive de France vive le plus sereinement possible et il continuera bien sûr de le faire.
La saignée rituelle est une pratique très ancienne du judaïsme. C’est la première pratique qui a été conçue dans la volonté de respecter le bien-être de l’animal. Plusieurs textes fondamentaux rappellent l’importance de cet impératif. Pensons à l’obligation de repos pour les animaux le jour du shabbat ou encore à l’obligation de nourrir les bêtes avant de se nourrir soi-même. L’abattage rituel vise à limiter au maximum les souffrances de l’animal : la longueur du couteau est réglementée, sa lame ne doit présenter aucune aspérité et le geste doit être pratiqué par un sacrificateur – le chokhet – formé à cette fin. Aucune des études réalisées ces dernières années ne prouve qu’il existe une méthode scientifiquement reconnue comme meilleure aux autres.
Je veux à ce propos rendre hommage à la France qui, au sein des instances européennes, a défendu le maintien de l’abattage rituel. Actuellement, il relève d’une dérogation et il me semble nécessaire de réfléchir aux conditions qui permettraient qu’il soit pleinement autorisé, sans relever d’une forme d’exception. Je suis médecin, je me suis penché sur les diverses études consacrées à l’abattage rituel juif et je suis persuadé que la chekhita, comme nous l’appelons, est conforme aux attentes exprimées par notre société à l’égard du bien-être animal. À moins qu’il ne s’agisse d’une volonté délibérée d’instrumentaliser un problème autour d’une certaine conception de la laïcité ; je veux en tout cas espérer que notre pays continuera à défendre la liberté de conscience.
La question est régulièrement posée de l’étourdissement préalable. La loi juive veut que l’animal soit conscient et vivant au moment de la saignée. Comme celle-ci lui fait perdre immédiatement conscience, il n’est pas nécessaire de le blesser auparavant. Précisons que l’abattage rituel juif concerne seulement 1,6 % de l’abattage rituel en général, soit moins de 200 000 bêtes par an sur un total annuel de 9 millions d’animaux abattus. Or, à croire les études, il apparaît que ce qu’on appelle « l’étourdissement préalable » – en fait, la perforation du crâne – dans l’abattage conventionnel occasionnait des ratages, dont la proportion est estimée entre 17 % et 56 %, ce qui représente un ou deux millions de bêtes. La saignée rituelle, elle, ne donne lieu à quasiment aucun raté et les rares incidents qui peuvent se produire ne portent en tout état de cause que sur un nombre très limité d’animaux. En quelques secondes, le cerveau n’est plus irrigué et la perte de conscience, et donc l’insensibilisation, survient très rapidement.
L’État, ces dernières années, a montré sa volonté que les membres de la communauté juive continuent de croire en leur avenir en France alors que d’autres pays les appelaient à migrer. Des mesures de sécurité sont prises pour nous permettre de vivre sereinement notre culte, mais il est important aussi, sur ce sujet de l’abattage rituel comme sur d’autres, de nous assurer, en même temps que de poster des militaires devant nos synagogues, que notre liberté de conscience ne sera pas remise en cause.
M. Anouar Kbibech, président du Conseil français du culte musulman (CFCM). Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, permettez-moi tout d’abord de vous dire comme je suis honoré de m’exprimer devant les représentants de la nation dans le cadre des travaux de votre commission qui s’occupe d’un sujet d’une grande importance et d’une grande actualité.
L’abattage rituel est un sujet qui tient à cœur au CFCM et je suis heureux d’avoir l’occasion de m’exprimer aux côtés de mon cher ami Joël Mergui. Cette invitation commune a une forte charge symbolique : l’abattage rituel musulman et l’abattage rituel juif sont proches et convergents. Le Consistoire central et le CFCM ont d’ailleurs décidé de mettre en place une commission commune mixte sur l’abattage rituel.
Cette audition intervient à un moment très particulier : d’une part, de plus en plus cas de maltraitance d’animaux sont mis au jour dans certains abattoirs – qui pratiquent plutôt l’abattage conventionnel et non l’abattage rituel, vous l’avez rappelé, monsieur le président ; nous avons tous vu ces enregistrements vidéo insoutenables. Mais d’autre part, on découvre de plus en plus de traces de porc dans des produits certifiés halal, ce qui pose la question de la transparence, de la crédibilité et de la sincérité de la procédure de certification pour les musulmans de France.
Le CFCM travaille, depuis sa création ou presque, et plus particulièrement depuis 2008, à l’élaboration d’une charte halal, un référentiel religieux commun à l’ensemble des musulmans de France qui définirait le caractère halal des produits carnés et de leurs dérivés. Les consommateurs musulmans pourront ainsi être rassurés quant à la conformité aux principes religieux auxquels ils adhèrent des produits qu’ils mangent. On constate malheureusement une utilisation non réglementée, de plus en plus abusive, du terme « halal », et les consommateurs musulmans s’inquiètent du manque de considération dont ils font l’objet. Ils exigent plus de transparence dans l’application du rituel islamique, de la même manière que nos amis juifs sont très sensibles au respect de la saignée rituelle, comme vient de le rappeler Joël Mergui.
Cette charte halal est le fruit, depuis 2008, d’une collaboration entre le CFCM et les différents acteurs musulmans engagés dans la filière halal. En mars 2011, nous étions pratiquement sur le point d’aboutir à la signature d’une charte, mais certains points n’avaient pas fait consensus, notamment l’étourdissement préalable. Sous l’impulsion de la présidence collégiale mise en place au sein du CFCM en juillet 2015, le groupe de travail a été remis en route en septembre dernier. Aujourd’hui, un consensus s’est dégagé au niveau tant national qu’international sur les conditions et les critères qui définissent précisément ce qu’est le halal pour les musulmans.
Bien sûr, l’application de cette charte doit se faire dans le cadre de textes réglementaires, internationaux ou européens, et conformément à la législation française.
Sa mise en œuvre sera progressive, car il faut favoriser les conditions qui rendront possible son application. Le CFCM entame en ce moment même les discussions nécessaires avec les représentants des filières industrielles pour examiner avec eux les modalités d’évolution de leurs pratiques ainsi que de leurs installations et équipements. Ces discussions ont pour but de permettre une adaptation progressive de leurs sites de production et portent notamment sur la période transitoire.
Cette charte comporte deux parties : la première est consacrée au référentiel religieux ; l’autre est un guide des procédures de suivi et de contrôle rituel du halal, qui s’attache aux moyens de certifier que les règles ont été appliquées à chacune des étapes du processus de transformation, de l’abattage de l’animal à l’arrivée de la viande dans les rayons.
Le travail sur le référentiel religieux a bien avancé. Il a d’ores et déjà reçu l’aval des trois grandes mosquées agréées par le ministère de l’agriculture pour l’agrément des sacrificateurs : Paris, Évry et Lyon.
Dans le cadre du guide, nous envisageons de mettre au point un label halal, placé sous l’égide du CFCM, qui garantira aux fidèles musulmans le respect des règles édictées dans le référentiel religieux.
Le bien-être animal est une préoccupation majeure de l’abattage rituel tant israélite que musulman. Dans la religion musulmane, les animaux sont considérés comme une communauté à part entière, semblable à celle des hommes. J’en veux pour preuve le verset 38 de la sourate VI du Coran : « Il n’est bête sur la terre ni oiseau volant de ses ailes qui ne forment des communautés semblables à vous ». Les actes et paroles du Prophète sont riches d’enseignements en ce domaine également : dans un hadith, le Prophète évoque ainsi une femme allée en enfer pour avoir fait mourir de faim une chatte en l’enfermant et en l’empêchant de se nourrir elle-même ; dans un autre, à un homme qui avait immobilisé une bête puis aiguisé son couteau devant elle, il fait ce reproche : « Tu veux donc la faire mourir deux fois ? Pourquoi n’as-tu pas aiguisé ton couteau avant de l’immobiliser ? ». L’homme a certes le droit de tirer profit des ressources de la terre, mais il a le devoir de le faire en bonne intelligence, dans le respect du bien-être des animaux.
Des règles très précises s’appliquent pendant l’abattage afin de ne pas faire souffrir la bête. Rappelons la parole du Prophète dans cet autre hadith : « Allah a prescrit la bienveillance envers toute chose, si vous immolez, faites-le de la meilleure manière et si vous égorgez un animal, faites-le de la meilleure manière. Qu’une personne parmi vous aiguise bien son couteau et qu’il soulage son animal ». Le soulagement de l’animal, la bienveillance et la bienséance sont des dimensions très importantes dans l’abattage rituel.
Dans le processus d’abattage en lui-même, deux acteurs majeurs interviennent. Le premier est le contrôleur – al mouraqib –, chargé de vérifier la conformité de l’abattage aux critères religieux : il doit évidemment être musulman, formé aux conditions d’abattage rituel et doté de grandes compétences en matière de traçabilité du halal. Le second est le sacrificateur – al moudhakki : musulman également, il doit être agréé par l’une des trois grandes mosquées agréées par le ministère de l’agriculture, celle de Paris, agréée par un arrêté de décembre 1994, ou celles d’Évry ou de Lyon, agréées par un arrêté de juin 1996. En outre, il doit avoir suivi une formation préalable attestant de ses capacités à exercer l’abattage rituel. L’ensemble des grandes organisations musulmanes – CFCM, fédérations musulmanes, acteurs de la filière halal, grandes mosquées – sont en train de mettre en place une vraie formation pour les sacrificateurs afin qu’il puisse procéder à la saignée rituelle dans les meilleures conditions possibles.
S’agissant de l’abattage rituel en lui-même – la dhakat –, il est prescrit que l’animal doit être respecté : il doit être transporté confortablement, sans stress, et bénéficier d’un repos avant l’abattage. Tout cela est rappelé dans le référentiel religieux cosigné avec les trois grandes mosquées Par ailleurs, un animal ne doit jamais être tué à la vue d’un autre et le couteau doit être soustrait à son regard avant son sacrifice. Une autre règle veut que l’abattage ait lieu sans aucune forme d’étourdissement, que ce soit avant ou après l’égorgement. Un consensus s’est clairement dégagé sur ce point entre les CFCM et les trois grandes mosquées agréées. Comme l’a rappelé devant vous le rabbin Fiszon la semaine dernière, la mise à mort de l’animal sans étourdissement est certes une exigence rituelle, mais qui participe au bien-être animal et à l’hygiène. Enfin, l’animal ne doit faire l’objet d’aucune intervention jusqu’à ce qu’il soit totalement inanimé. Il est plus particulièrement interdit de dépecer, de déplumer ou d’intervenir sur la plaie avant inertie complète. Cette condition également est clairement posée dans le référentiel religieux.
Je terminerai par les perspectives. Les abattoirs, ainsi que l’industrie alimentaire, doivent impérativement anticiper les évolutions pour relever trois grands défis.
Le premier est de répondre à la très forte demande des citoyens français de confession musulmane qui réclament de plus en plus un accès à du halal certifié, conforme en tout point au rite musulman. Une enquête publiée au mois de septembre dernier indique que 95 % des musulmans de France souhaitent consommer des produits halal et que 80 % en consomment effectivement. Il existe donc un marché national important, sur lequel les industriels français doivent se positionner.
Le deuxième défi consiste à répondre à la demande grandissante des pays musulmans qui exigent de plus en plus de halal sans étourdissement. Autant les avis divergeaient il y a quelques années, autant une tendance de fond traverse désormais l’ensemble des pays musulmans, du Maroc jusqu’à la Malaisie, où le rejet de l’étourdissement, qu’il soit pré ou post mortem, fait de plus en plus l’objet d’un rejet catégorique. Là aussi, les industriels français qui travaillent à l’exportation auraient tout intérêt à faire évoluer leurs pratiques pour conquérir de nouveaux marchés.
Le troisième défi est de répondre aux préoccupations liées au bien--être animal, dans le respect des prérogatives de l’abattage rituel, tant dans le culte musulman que dans le culte israélite. Nous sommes des défenseurs des animaux avant tout.
M. le président Olivier Falorni. Je vous remercie, messieurs.
Vous avez évoqué la mise en place d’une commission mixte, commune à vos deux religions dédiée à l’abattage rituel. Pourriez-vous nous en dire plus ?
S’agissant de la certification de la viande halal et casher, pouvez-vous nous indiquer combien il existe d’organismes certificateurs en France ? Quel est leur statut ? Comment sont-ils financés ?
Les sacrificateurs se voient-ils délivrer une carte valable à vie ? Exercent-ils cette activité à plein temps ou bien de façon ponctuelle ?
Enfin, j’aimerais revenir à la question de l’étourdissement. Notre commission entend se concentrer sur la technique d’abattage au regard du bien-être animal. Il ne s’agit pas pour nous d’entrer dans un débat sur la laïcité et sur les pratiques religieuses en tant que telles. C’est précisément pour éviter toute instrumentalisation que nous avons souhaité associer, pour toutes les réunions consacrées à l’abattage rituel, des représentants du culte musulman et du culte israélite.
Vous avez souligné, monsieur Kbibech, l’évolution de la position des organisations musulmanes sur la question de l’étourdissement. Mais il faut rappeler que dans certains pays, l’étourdissement est pratiqué dans le cadre l’abattage rituel. Quelles sont les raisons de ces différences ? Est-il envisageable pour vous d’imposer en France l’étourdissement post-jugulation ? Quels seraient selon vous les obstacles à une telle pratique ?
Monsieur Mergui, j’ai interrogé les grands rabbins qui ont participé à la réunion du 16 juin à propos de l’extirpation du nerf sciatique, nécessaire pour que l’animal abattu selon le rite juif puisse intégrer dans son entier le circuit casher. Une réflexion est-elle menée à propos de cette pratique ? En quoi consiste la taxe sur la cacherout ? Comment est-elle calculée et que finance-t-elle ?
Enfin, quelle est votre position à propos de l’étiquetage des produits selon le mode d’abattage, à savoir avec ou sans étourdissement ?
M. Joël Mergui. S’agissant de la commission mixte, nos deux bureaux se sont réunis, symboliquement, à l’école rabbinique, pour faire émerger une liste de préoccupations qui pourraient donner lieu à une réflexion commune. Dans la mesure où ce sujet concerne nos deux religions, il était important d’y réfléchir ensemble et d’arrêter les modèles les plus parallèles possible.
La certification est assurée par le Consistoire : les cartes d’abattage sont signées par le grand rabbin de France et sont renouvelées tous les six mois. Tous les chokhatim, qui pratiquent l’abattage rituel, répondent à un cahier des charges précises établies avec l’aval du ministère de l’agriculture et ont obtenu le certificat de compétence « Protection animale ». Pour la plupart, c’est leur activité principale ; certains, minoritaires, sont en même temps rabbin ou enseignant. Ce n’est pas une carte à vie : si certains ne remplissent pas les critères réglementaires, ils peuvent se voir refuser le renouvellement de leur carte. Outre leur formation initiale de plusieurs années, ils sont régulièrement évalués par les vérificateurs. Précisons qu’en France est vendue aussi de la viande importée, ayant fait l’objet d’autres procédures de certification, qui n’est pas forcément reconnue comme casher par l’ensemble de la communauté juive.
L’abattage rituel peut aussi comprendre l’extirpation du nerf sciatique, opération d’une particulière complexité qui permet de rendre consommable la partie arrière de la bête, laquelle n’est pas intégrée dans le circuit casher si seule la saignée est pratiquée. L’une des grandes questions qui préoccupe la communauté juive est le prix de la viande casher. Des études sont menées pour examiner la possibilité d’utiliser la deuxième moitié de la bête, mais le retrait du nerf exige de recourir à davantage de personnel, ce qui conduirait à renchérir davantage encore le prix final.
La redevance sur la cacherout, qui fait souvent l’objet de discussions, s’élève à 1,66 euro par kilo au Consistoire de Paris et varie selon les régions. Elle permet de financer la filière du casher. Elle sert en particulier à rémunérer les chokhatim et les mashgihim, les vérificateurs, qui sont payés non par les abattoirs mais par les consistoires de Paris et de province – je le dis car certaines informations fausses ont circulé. Le surcoût provient aussi du fait que toutes les bêtes abattues ne sont pas utilisées : si le chokhet, en application des règles religieuses, décèle certaines adhérences dans les poumons d’une bête, il l’écartera et elle sera remise dans le circuit de la consommation non rituelle tout comme la partie arrière de l’animal, réputée la plus tendre. Il n’y a donc aucune perte pour la société, mais plutôt un gain, puisque nous n’utilisons que 25 % de la viande des bêtes dont nous avons financé l’abattage.
S’agissant de l’étiquetage, nous avons tendance à considérer que l’indication de la méthode d’abattage constituerait une stigmatisation, dans la mesure où toutes les études montrent qu’il n’y a pas de différences entre abattage rituel et abattage conventionnel en termes de souffrance de l’animal. En outre, pour que l’information du consommateur soit complète et que la communauté musulmane et la communauté juive n’aient pas l’impression que leurs pratiques religieuses sont entravées, il faudrait prendre en considération d’autres critères en indiquant, par exemple, les ratés – 16 % des cas – qui entraînent forcément des souffrances, ou encore, pour les porcs, si la bête a été gazée au dioxyde de carbone. Après mon audition devant la mission d’information sur la filière viande du Sénat, où j’ai été confronté à l’une de vos collèges qui a été un peu difficile avec moi, j’ai reçu de nombreux messages de membres de la communauté juive soulignant que l’on ne parlait jamais dans ces enceintes de la corrida, de la chasse, des poussins broyés ou encore des chapons… Pour être sérieux et ne pas être considéré comme une entrave religieuse, l’étiquetage devrait aborder tous les sujets, et non se limiter à l’abattage rituel présenté comme une forme de barbarie en oubliant tous les ratés qui, effectivement, font souffrir la bête.
Pour finir, j’aimerais revenir sur la saignée rituelle en insistant sur un aspect très technique. Les ovins et les bovins, à la différence des chevaux et des porcs dont la consommation est interdite dans la religion juive, comporte une particularité anatomique : le polygone de Willis, cercle artériel qui lie les artères de la carotide aux artères vertébrales par anastomose, si bien que lorsque l’on sectionne les premières, les secondes sont également shuntées et n’irriguent plus le cerveau. C’est la raison pour laquelle la saignée rituelle provoque une perte de conscience immédiate.
M. Anouar Kbibech. Lors de la réunion des bureaux du Consistoire et du CFCM, nous avons identifié certains dossiers qui pouvaient faire l’objet d’un travail en commun : formation des cadres religieux, prévention de la radicalisation et abattage rituel. Nous travaillons pour unir nos efforts et nos réflexions.
S’agissant des organismes certificateurs, il faut distinguer les sacrificateurs des vérificateurs. Les sacrificateurs doivent être certifiés par une des trois grandes mosquées. Les vérificateurs relèvent quant à eux d’une activité plus libre. Bien sûr, les trois grandes mosquées se sont dotées de leurs propres organismes de contrôle, les organismes de contrôle du halal (OCH), mais plusieurs organismes indépendants se sont constitués en associations régies par la loi de 1901. L’un des plus connus est AVS – À votre service – qui opère un contrôle assez rigoureux. Citons également European Halal Services ou Breizh Halal. Ces organisations pourraient, grâce aux fonds qu’ils lèvent grâce à leur activité, contribuer à terme au financement du culte musulman. C’est une des questions que nous sommes en train d’examiner avec tous les acteurs de la filière halal.
Les cartes délivrées aux sacrificateurs sont temporaires et renouvelées tous les ans ou tous les trois ans. Pour la plupart, ces personnes se consacrent à cette activité à plein-temps. Certaines, minoritaires, travaillent dans les abattoirs à temps partiel : cette organisation du temps est facilitée par le fait que dans les abattoirs pratiquant divers types d’abattage, l’abattage rituel commence tôt dans la journée pour se terminer vers dix heures ou onze heures, ce qui permet d’éviter tout mélange.
Vous avez souligné, monsieur le président, que plusieurs pays musulmans toléraient l’étourdissement. C’est une réalité. Il y a une multitude de points de vue. Reste qu’un consensus pour ne pas dire une unanimité émerge autour du refus de l’étourdissement. L’Arabie saoudite, naguère moins regardante sur cette question, devient de plus en plus rigoureuse. Que l’étourdissement intervienne avant ou après l’égorgement, pour nous, le problème est le même. L’animal doit être conscient et vivant, c’est la condition pour que tout le sang puisse être évacué afin d’éviter toutes sortes de complications sanitaires par la suite.
Concernant l’étiquetage indiquant s’il y a eu ou non étourdissement, je ne vous cache pas qu’une discussion a lieu au sein du culte musulman pour peser le pour et le contre. Nous sommes assez partagés. Parmi les avantages, il y a le fait que cela pourrait contribuer à la traçabilité. Mais il y a ce gros désavantage, souligné par Joël Mergui : le risque de stigmatisation en pointant du doigt un mode d’abattage en particulier.
Mme Françoise Dubois. Vous avez montré, messieurs, que vous étiez attentifs au bien-être animal. C’est sur les humains que porteront mes questions, plus particulièrement sur les sacrificateurs. J’aimerais en savoir plus sur leur formation. S’agit-il d’un métier à part entière ? Est-ce une activité ponctuelle ? Quels sont les critères de choix ? Je vous pose la question car il me semble qu’une clarification s’impose, compte tenu de certaines rumeurs que l’on entend, selon lesquelles ils seraient parfois choisis par tirage au sort.
M. Joël Mergui. Merci, madame, pour cette question qui nous donne l’occasion d’apporter de nouvelles clarifications. Il s’agit d’un vrai métier, un métier compliqué et difficile – on ne trouve d’ailleurs pas toujours suffisamment de volontaires pour s’y former. C’est une forme d’apprentissage où le savoir est transmis par ceux qui savent à ceux qui ne savent pas.
Ce métier a une composante religieuse. Les personnes choisies doivent avoir des connaissances en ce domaine. Les textes talmudiques comportent de nombreux passages consacrés au bien-être animal. Le principe, vieux de plusieurs siècles, est que la saignée doit être immédiate et ne pas faire souffrir l’animal.
L’apprentissage passe également par la technique en vue de la maîtrise de la méthode du maniement du couteau. Celui-ci doit être parfaitement aiguisé. Sa lame fait l’objet d’une double vérification : de la part du sacrificateur, de la part du vérificateur. Il doit être appliqué sans forcer avec une grande rapidité. Au moment de la saignée, la bête peut ainsi ne rien sentir. Chacun de nous a pu faire l’expérience de se couper avec une lame très fine ou même une feuille de papier sans même s’en rendre compte.
L’apprentissage de la méthode prend plusieurs années avant de pouvoir prétendre pouvoir exercer cette fonction. Il diffère aussi selon les animaux. Pour chaque type – volailles, ovins, bovins –, il y a des sacrificateurs différents. C’est un métier très spécialisé, qui s’est transmis de siècle en siècle, partout où il y a eu une communauté juive. Et dans certains pays où cette transmission ne peut plus avoir lieu, parce qu’il n’y a plus de personnes qui savent, il faut faire venir des spécialistes d’ailleurs.
Enfin, à cet apprentissage religieux et technique, s’ajoute un apprentissage de type réglementaire. Pour que leur carte puisse être renouvelée, les sacrificateurs doivent avoir obtenu un certificat de compétence « Protection animale ». Ils suivent des stages pratiques et sont régulièrement évalués. Si un chokhet vieillit ou qu’il est malade, il peut ne plus être capable de pratiquer la saignée rituelle et se voir interdire de poursuivre son activité, ce qui peut d’ailleurs poser des problèmes en matière de droit du travail.
Il s’agit donc d’une pratique encadrée de façon très consciencieuse et rigoureuse, par des règles qui relèvent tant de la religion que de la technique et de l’hygiène.
J’ai parlé de la vérification des poumons à laquelle procèdent les chokhatim. Cela a une importance en matière non seulement de religion mais aussi de santé publique, car les vétérinaires dont l’attention aura été appelée peuvent à cette occasion découvrir une maladie.
M. Anouar Kbibech. La question de la formation est effectivement fondamentale. Il fut un temps où l’abattage rituel musulman constituait une pratique minoritaire, d’ordre artisanal. Nous commençons à entrer dans une ère industrielle, avec des chaînes d’abattage importantes, où les approximations ne sont plus permises.
Nous menons depuis plusieurs années un travail de mise en place de formations avec des organismes dédiés. Nous avons ainsi monté des sessions pour l’abattage durant les trois jours de l’Aïd el-Kébir afin de former des personnes qui occupent ponctuellement des fonctions de sacrificateur.
La charte halal du CFCM indique clairement que les sacrificateurs qui occupent leurs fonctions à plein-temps doivent être formés en bonne et due forme. Nous nous inscrivons donc dans un mouvement de professionnalisation.
M. Jacques Lamblin. Messieurs, je vous ai écoutés avec la plus extrême attention, comme tous mes collègues, et parfois même avec quelque surprise, je dois le dire.
L’objectif de notre commission, partagé – je pense pouvoir le dire – par l’ensemble de ses membres, n’est évidemment pas de s’attaquer à la liberté du culte et à certaines pratiques religieuses. Nous voulons enquêter sur la situation dans les abattoirs afin de proposer des solutions qui évitent aux animaux des souffrances inutiles.
Nous essayons pour ce faire de trouver un équilibre entre les exigences que vous avez formulées tous deux avec force et les attentes de la société, qui a considérablement évolué depuis quelques dizaines d’années. De plus en plus de personnes se montrent attachées au respect de la sensibilité des animaux. Le Parlement est d’ailleurs venu sanctionner cette évolution puisque la loi reconnaît désormais que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Le grand émoi suscité dans la population par les vidéos de L214 témoigne de ce changement dans les mentalités.
Nous devons essayer de trouver un chemin qui convienne à tout le monde. C’est du moins l’esprit qui m’anime à titre personnel.
Face à la crainte que les animaux souffrent lors de l’abattage rituel, vous partagez la même position : selon vous, ils ne souffrent pas. Le problème, c’est que vous êtes à peu près les seuls à l’affirmer… Lors d’autres auditions, nous avons pu entendre des descriptions décrivant une réalité beaucoup plus rude. Autrement dit, nous nous retrouvons avec des informations totalement contradictoires. Certes, l’abattage conventionnel peut s’accompagner de ratés ; mais cela ne nous exonère nullement de l’obligation de régler l’ensemble des problèmes, y compris pour l’abattage rituel, sans oublier les attentes des communautés juive et musulmane.
J’aurai deux questions.
L’un et l’autre, vous avez montré que le respect du bien-être de l’animal faisait partie des préceptes contenus dans les livres saints de vos religions respectives et de pratiques pluriséculaires. Une première règle consiste à s’assurer de sa tranquillité ; la deuxième consiste à le saigner alors qu’il est conscient. Mais il est permis de penser qu’au moment où il reçoit le coup de couteau fatal, l’animal n’est pas forcément paisible et empli de quiétude. Autrement dit, on a l’impression que la deuxième règle prend le pas sur la première. Pouvez-vous m’expliquer comment ces deux impératifs peuvent être conciliés ?
Deuxièmement, vous êtes l’un et l’autre hostiles à l’étourdissement – et je suis surpris d’apprendre l’existence d’une vague allant dans ce sens au sein de la communauté musulmane ; j’avais le sentiment d’une tendance inverse ou du moins d’une acceptation de différentes options. Saigner l’animal en pleine conscience garantit une saignée complète : le cœur doit fonctionner jusqu’au bout pour que le sang soit évacué du corps de l’animal, puisque vos religions interdisent de consommer le sang. Cela, on peut le comprendre. Mais lorsqu’on pratique un étourdissement dit réversible avant la saignée – autrement dit, on rend l’animal inconscient, mais il peut revenir à la conscience si l’on en reste là –, on peut considérer que l’animal conserve son intégrité physique, ne serait-ce que parce que son cœur continue de battre, garantissant ainsi la saignée totale.
J’en viens à l’étourdissement post cut, soit juste après le coup de couteau. M. Mergui l’a rappelé : quand on se coupe avec un instrument effilé, on ne sent rien – c’est vrai et nous en avons tous fait l’expérience. À ceci près que, quelques secondes plus tard, on ressent la douleur de la coupure. C’est par conséquent très probablement le cas pour les animaux qui reçoivent le coup de couteau : dans les premières secondes, il n’y a pas de signe de douleur mais après, ce n’est plus tout à fait la même chose. L’étourdissement post cut, réalisé juste après que le coup de couteau a été donné dans le respect de votre rituel, contribuerait à garantir que l’animal ne souffre pas, sans pour autant interrompre le fonctionnement du cœur, et donc tout en permettant une évacuation totale du sang.
Je vous avoue donc avoir beaucoup de mal à comprendre que l’une et l’autre religion soient opposées même au post cut qui permettrait, à mes yeux, de concilier tous les points de vue.
M. Joël Mergui. Il me paraissait important, dans le cadre d’une audition de cette qualité, avec la présence de nombreux élus, de rappeler des éléments de contexte. Je ne doute pas que votre intention à tous soit uniquement liée au bien-être animal et n’obéit pas à d’autres considérations – vous êtes conscients de l’instrumentalisation dont ces discussions peuvent faire l’objet, d’où les précautions oratoires que nous prenons tous.
Il m’est difficile de ne pas revenir sur un principe fondamental : quand toutes ces bêtes arrivent dans un abattoir, c’est pour être tuées puis consommées. En effet, quand on parle de bien-être animal…
M. Jacques Lamblin. Je parlais de souffrance animale.
M. Joël Mergui. Certes, mais peut-être la société imagine-t-elle que les bêtes sont endormies, alors que c’est tout de même par une tige perforante dans le crâne que les ovins et les bovins sont étourdis… Si j’ai parlé des loupés, c’est tout de même parce que la question peut se poser : alors que moins de 200 000 bêtes sont saignées chaque année par chekhita, près de 9 millions sont abattues par d’autres méthodes. Quel que soit le pourcentage, le nombre de loupés sera de toute façon supérieur à celui de bêtes abattues rituellement : la transparence exige de régler également ce problème, tout comme ceux liés à la chasse, à la corrida, etc. Et tout cela dans le même temps, et dans le cadre de la même commission, afin d’éviter toute stigmatisation.
Je fonde mon avis sur les analyses d’experts, notamment sur celles, qui remontent à moins de trois ans, du professeur Grandin. Certes, il n’est pas simple de savoir si la bête souffre ou non, d’établir avec précision la différence entre inconscience et insensibilité. Mais je pense avoir répondu techniquement en évoquant le polygone de Willis et montré que, dès lors que la saignée se fait correctement, du fait de la particularité anatomique des bêtes concernées par l’abattage rituel, le cerveau cesse immédiatement d’être irrigué ; or le cerveau étant le centre de la douleur, l’absence soudaine d’irrigation entraîne vraisemblablement l’insensibilité la plus rapide qui soit – et sans doute aussi rapide que si l’on donnait à l’animal un coup de pistolet, qui du reste pourrait provoquer d’autres dégâts en cas de raté…
Ensuite, nos experts religieux, dans l’islam comme dans le judaïsme, se concertent régulièrement sur la question. Il faut savoir qu’en Israël, où vit la plus importante communauté juive dans le monde et où il y a le plus grand abattage casher dans le monde – et où, comme ici, les députés sont régulièrement sollicités sur le sujet –, le foie gras a été interdit du fait qu’on fait souffrir les oies en les gavant. Eh bien, les mêmes députés, suivant les mêmes critères, n’ont pas interdit l’abattage rituel parce que toutes les études montrent que la saignée telle qu’elle est pratiquée selon la chekhita ne fait pas plus souffrir l’animal que dans un cadre conventionnel – indépendamment de tous les loupés dont le nombre s’élève ici, tout de même, à quelque 2 millions, soit autant de bêtes qui souffrent dans le silence général : si la tige, qui s’est enfoncée dans son crâne ne provoque pas l’étourdissement et qu’elle se prend ensuite un coup de couteau, la bête va inévitablement souffrir. Et même dans le cas d’un étourdissement réussi, j’y insiste, des études montrent qu’on ne peut pas connaître quels sont le degré d’inconscience et le degré d’insensibilisation.
Reste que la règle religieuse commande que l’animal soit vivant et conscient au moment de la saignée – et s’il est endormi, même si son cœur continue de battre, il n’est plus conscient. Du coup, elle n’est plus respectée. Or, je le répète quitte à me faire redondant, cette règle religieuse n’est pas contradictoire avec le bien-être animal.
M. Anouar Kbibech. Je souscris à tout ce que vient de dire Joël Mergui. J’ajoute qu’en effet nous ne pouvons que nous réjouir du préalable selon lequel il ne s’agit pas d’attaquer la liberté de culte.
Si certaines études entendent montrer que les bêtes souffrent quand elles sont abattues rituellement, d’autres, dont dispose le CFCM et qui vont dans le même sens que celles sur lesquelles s’appuie le consistoire central, démontrent l’inverse. Nous pouvons vous les communiquer.
Pourquoi ne pas accepter un étourdissement réversible et un étourdissement post-jugulation ? Si la pratique de l’étourdissement réversible, tolérée pendant un certain temps, a été interrompue, c’est surtout pour éviter que la cause réelle ou définitive de la mort ne soit l’étourdissement lui-même et non la saignée. Reste que pendant l’étourdissement, même s’il est réversible, la bête n’est pas consciente et donc ne réagira pas de la même manière que si elle était complètement vivante, si je puis dire.
La recherche d’un équilibre entre le respect du bien-être animal et celui des conditions exigées par l’abattage rituel reste, cela a été mon mot de la fin, un vrai défi. Si des améliorations techniques sont possibles sans qu’il soit procédé à l’étourdissement ni avant ni après la saignée, nous sommes prêts à avancer avec vous, ainsi que le grand rabbin de France et le recteur de la grande mosquée de Paris vous l’ont déclaré la semaine dernière. Il n’en demeure pas moins que nous nous en tiendrons aux principes fondamentaux posés notamment dans le référentiel religieux de la charte halal du CFCM.
M. William Dumas. Monsieur Mergui, vous avez indiqué que la carte d’abatteur était renouvelée tous les six mois. Or le grand rabbin de France nous a informés que la formation d’un sacrificateur casher prenait trois ans. Ce renouvellement m’apparaît du coup bien rapide…
Vos opérateurs sont-ils des salariés des abattoirs ou bien, comme les sacrificateurs musulmans, sont-ils payés à part ?
Opérez-vous dans des abattoirs spécialisés ou dans des abattoirs conventionnels ? Dans la viticulture, par exemple, une partie de la cave coopérative est réservée à la production de vin bio, afin qu’il ne soit pas contaminé par les produits utilisés dans la production conventionnelle.
Monsieur Kbibech, quelle est la redevance par kilogramme pour la viande halal ? M. Mergui nous a parlé de 1,66 euro pour la viande casher.
En ce qui concerne les sacrificateurs, on nous a dit que, dans certains abattoirs, il s’agissait de salariés, ce qui n’est pas le cas d’autres sacrificateurs, toutefois certifiés par les mosquées – sont-ils payés par la redevance ?
Enfin, de plus en plus de viande halal est mise sur le marché. Je constate dans ma région qu’à chaque fois qu’une boucherie se vend, apparaissent des enseignes « halal ». J’imagine que la proportion de musulmans dans la population totale est peu ou prou la même qu’auparavant : est-ce à dire que les musulmans ne mangeaient pas halal auparavant, ou bien y a-t-il un engouement particulier pour la viande halal – je n’irai pas jusqu’à parler d’effet de mode ? Toujours dans ma région, il y a quelques années, lors de la fête de l’Aïd, nous étions obligés d’aménager des lieux d’abattage spécifiques, faute de quoi beaucoup achetaient leur mouton chez l’éleveur et le tuaient dans un coin. Cette pratique s’est notablement réduite, mais je souhaite savoir si vous disposez d’un nombre suffisant de certificateurs agréés, à l’occasion de cette fête, où la consommation augmente dans des proportions énormes.
M. Joël Mergui. La fréquence du renouvellement de la carte d’abatteur, vous avez raison, peut ne pas sembler adaptée. Reste que les opérateurs ont en général un contrat de travail à durée indéterminée. Le renouvellement de la carte est un moyen de contrôler leur capacité à parfaitement maîtriser les techniques. Je souhaite que votre commission prenne bien conscience que la réflexion sur le bien-être animal et sur le geste du chokhet, qui doit être très rapide afin que le sang s’évacue rapidement, a toujours fait partie de la tradition juive. Indépendamment même des débats récents, le souci de faire souffrir le moins possible la bête dans ce geste a toujours existé. Le renouvellement tous les six mois vise donc à vérifier qu’il est toujours aussi sûr.
Reste qu’en tant que président du consistoire central israélite de France, je suis l’employeur et donc le responsable de la très grande majorité des chokhatim et il me revient donc de vérifier la compatibilité entre la carte de chekhita et le droit du travail. Ceux qui opèrent à Paris sont pour la plupart des salariés du consistoire de Paris ; les autres peuvent être soit salariés directement de l’institution consistoriale de Paris, de Lyon, de Marseille ou de Strasbourg, soit salariés de l’opérateur – je pense aux grands fournisseurs – mais en aucun cas ils ne sont les salariés de l’abattoir où ils opèrent. C’est ce qui fait, et nous tâchons de l’expliquer à la communauté juive, que cela représente pour nous une charge financière importante, qu’il s’agisse des charges salariales, du remboursement des déplacements : les chokhatim vont parfois très loin. Le consistoire de Nice, par exemple, a dû interrompre la chekhita parce que la faible consommation de viande casher ne lui permettait plus d’assumer la charge financière de sa production. Le consistoire de Paris ayant une plus grande assise, il parvient pour sa part à assurer cette charge financière, la reportant sur le consommateur casher. Je rappelle au passage que toutes les bêtes qui ne sont pas certifiées casher se retrouvent dans le circuit général, ce qui ne représente aucune charge financière pour l’abattoir ni pour le consommateur.
La quasi-totalité de notre production est traitée dans des abattoirs généraux qui réservent à la chekhita certains jours et certains horaires ; nous avons un seul abattoir spécifique, pour les volailles casher.
M. Anouar Kbibech. Pour le halal, nous nous finançons grâce aux ressources liées à la certification du sacrificateur par l’une des trois grandes mosquées agréées : mais à raison de 100 à 150 euros par an et par carte, cela ne va pas chercher très loin. De leur côté, les organismes du contrôle du halal (OCH) passent des accords privés avec les abattoirs : le pourcentage prélevé varie de 80 centimes à 1,20 euro par kilogramme.
Au-delà, vous avez certainement entendu parler de la volonté du CFCM de mettre en place une sorte de redevance du halal pour financer le culte musulman ; cette proposition a été reprise par certains hommes – voire par certaines femmes – politiques, étant entendu que le chiffre d’affaires global généré par l’ensemble du halal en France est de 5 à 6 milliards d’euros. Cette taxe ou redevance prendrait la forme d’un certain pourcentage qui viendrait s’ajouterait au prix au kilogramme, à l’image de ce qui se fait avec les produits que l’on trouve dans les rayons consacrés à l’« économie éthique » dans les grandes surfaces : moyennant un surcoût de 10 à 15 centimes, le consommateur a la garantie que les produits en question ne sont pas fabriqués par des petits Chinois ou par des mineurs employés dans des conditions un peu particulières. Un prélèvement de 5 à 10 centimes par kilogramme nous permettrait de lever des fonds conséquents pour financer les œuvres de l’islam. Mais pour le moment, un tel système paraît encore un peu compliqué. En attendant, nous semblons plutôt nous orienter vers un système de contribution forfaitaire annuelle des acteurs du halal, notamment des trois grandes mosquées, qui serait collectée par une fondation ou un organisme spécialisé, ce qui éviterait d’avoir à éplucher les chiffres d’affaires des uns et des autres. L’idée commence à faire son chemin.
Vous m’avez ensuite interrogé sur la rémunération des sacrificateurs. Il faut bien les distinguer des contrôleurs dont il est hors de question – et c’est écrit noir sur blanc dans la charte du CFCM – qu’ils soient salariés par les abattoirs : ils ne sauraient être juge et partie, ils doivent conserver une certaine indépendance d’action et de jugement. Les sacrificateurs, en revanche, dans la mesure où ils participent à la chaîne d’abattage, peuvent être salariés de l’abattoir ; cela ne pose aucun problème dès lors qu’ils répondent aux conditions requises : être musulman, avoir été formé et être certifié par une des trois grandes mosquées agréées. Mais rien n’interdit qu’ils soient salariés par un OCH plutôt que par l’abattoir. Dans l’un ou l’autre cas, cela ne pose aucun problème déontologique. Les contrôleurs en revanche doivent conserver leur indépendance.
Vous constatez par ailleurs, monsieur le député William Dumas, qu’il y a de plus en plus de boucheries halal. Nous vivons dans un pays libéral où prévaut la règle de l’offre et de la demande. Or on observe un accroissement constant de la demande d’un halal certifié, rigoureux ; cela participe d’un regain de religiosité qui n’est du reste pas propre au seul culte musulman. Qui plus est, le consommateur musulman est sans doute de plus en plus averti : il existe désormais deux ou trois associations de défense des consommateurs musulmans, qui participent aux travaux du CFCM sur la charte halal. Elles ont par conséquent contribué à sensibiliser les fidèles et les consommateurs musulmans de plus en plus regardants quant à la traçabilité du halal.
J’en viens à votre dernière question sur l’abattage pendant les trois jours de l’Aïd. On constate alors, en effet, une très forte demande à laquelle nous faisons face en mettant en place des procédures de certification spécifiques. Un certain nombre d’imams, pourvus de la formation religieuse requise, suivent une formation préalable pour se mettre au niveau des exigences d’un sacrificateur et ils sont certifiés ponctuellement, pour les trois jours de l’Aïd, par une des trois grandes mosquées agréées. Sans cette certification, ils n’ont pas le droit d’exercer dans un abattoir. Il faut à cet égard saluer l’évolution opérée grâce, notamment, au travail de pédagogie du CFCM pour inciter les musulmans de France à étaler l’abattage de l’Aïd sur les trois jours et à ne plus le réserver au seul premier jour, afin de disposer d’une capacité d’abattage suffisante. Enfin, les conditions d’hygiène et de sécurité étant désormais assurées, les musulmans n’ont plus recours qu’à des abattoirs agréés – le mythe de l’abattage dans les baignoires est heureusement derrière nous.
M. Joël Mergui. La redevance de 1,66 euro dont j’ai parlé ne concerne que les opérateurs qui sont sous la responsabilité du consistoire de Paris. D’autres opérateurs en province, et même à Paris, financent eux-mêmes leurs chokhatim – mais pas les surveillants généraux. La redevance du consistoire central, bien connue, permet de financer le circuit, mais également de compenser, par solidarité, l’insuffisance de financements qui peuvent se produire ailleurs, et d’assurer le fonctionnement d’autres rabbinats ; mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. La redevance n’est donc pas la même dans toutes les régions et ne couvre pas toujours les frais de la chekhita.
Mme Annick Le Loch. Un gros abatteur nous a déclaré il y a quelques jours, qu’il faudrait mettre de l’ordre dans l’abattage rituel. Partagez-vous ce point de vue, notamment en ce qui concerne la formation ? Il nous a par ailleurs indiqué qu’il expérimentait, à Castres, un outil en provenance de Nouvelle-Zélande et qui serait adapté à l’abattage rituel. Avez--vous connaissance de cet outil, que je n’ai pas vu, qui permettrait sans doute d’aller plus vite ?
Vous avez éveillé ma curiosité, monsieur Mergui, quand vous avez précisé que la moitié arrière de la bête sacrifiée n’était pas consommée à cause du nerf sciatique, et était de ce fait remise dans le circuit classique. Pouvez-vous nous donner une explication ?
Enfin, monsieur Kbibech, vous avez évoqué l’important travail que vous menez pour élaborer une charte, dans la mesure où il semble qu’il y ait une multiplication désordonnée de certificats halal – on compterait six ou sept certificateurs dans le pays et sans doute beaucoup à l’étranger car il faut tenir compte des produits importés. Avez-vous une idée, d’ailleurs, de la part de ces produits importés ? Un travail est-il mené au niveau européen pour qu’un jour soit édictée une norme européenne ?
M. Joël Mergui. Mettre de l’ordre dans l’abattage rituel ? Il serait plus juste de dire, après la diffusion de ces vidéos qui ont entraîné la création de cette commission, que c’est dans l’abattage en général qu’il faudrait mettre de l’ordre ! Je n’exclus donc pas de cette exigence l’abattage rituel. Nous avons, M. Kbibech et moi-même, une mission de responsabilité – comme vous – et, au fur et à mesure de nos réflexions, nous nous rendons compte qu’il y a toujours matière à perfectionner un système. Je reste donc à l’écoute de toutes les suggestions dès lors qu’elles restent compatibles avec la règle religieuse et qu’elles ne nous empêchent pas de répondre aux besoins de consommation de nos communautés, tout en respectant, bien sûr, les règles de notre pays. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons été immédiatement favorables aux modifications réglementaires imposant la délivrance d’un certificat d’hygiène, d’un certificat d’aptitude, et tous nos opérateurs, nos chokhatim s’y sont conformés.
Je reviens tout de même sur un point : notre pays s’honorerait de décider que l’abattage rituel n’est plus une dérogation. Peut-être vous aurai-je convaincus… Peut-être, au fur et à mesure de la lecture des textes, finira-t-on par admettre qu’il s’agit d’un mode d’abattage acceptable. Il est difficile d’avoir l’impression, après des siècles d’organisation de la communauté juive, que, pour pouvoir pratiquer notre culte, il faille bénéficier d’une mesure dérogatoire. Et si la France décidait, après réflexion et quitte à imposer davantage de règles encore pour la chekhita, qu’il y a plusieurs possibilités d’abattre dont la saignée rituelle, encadrée de telle ou telle façon ? Peut-être un jour serai-je entendu ; ce serait une bonne chose alors que nous voulons donner l’exemple à l’Europe de ce qu’est le vivre-ensemble et de permettre l’exercice de la liberté de conscience sans entraver le bien-être animal ni choquer le reste de la société, qui sait bien les efforts qui sont faits pour le respecter. De la même façon que nous étions, sur la question de l’écologie, tous d’accord pour défendre une certaine vision du monde, nous sommes tous ici des défenseurs du bien-être animal.
Pour ce qui est de votre question concernant le nerf sciatique, il s’agit d’un problème religieux sur lequel je ne m’étendrai pas, n’étant pas rabbin moi-même. Les juifs ont interdiction de consommer le nerf sciatique qui se trouve dans la partie postérieure de la bête. Dans certains pays, comme en Israël, où la production est très importante, des experts savent décortiquer la partie arrière de l’animal pour extirper le nerf sciatique et la rendre propre à la consommation. Cette question revient souvent pour nous et pas seulement de votre fait, dans la mesure où nous-mêmes sommes lésés : nous envoyons un chokhet, nous le finançons et nous ne pouvons prendre que la moitié de la bête… Si nous pouvions utiliser la totalité, ce serait tant mieux pour notre communauté. Malheureusement, c’est une opération complexe et les spécialistes qui savent le faire sont très peu nombreux. Nous en avons encore discuté entre nous il y a quelques années et peut-être y viendrons-nous pour des raisons économiques.
M. Anouar Kbibech. Revenant à la première question de Mme Le Loch sur l’ordre qu’il faudrait remettre dans l’abattage rituel, je rejoins ce que vient d’affirmer Joël Mergui en ajoutant que le consommateur musulman est inquiet lorsqu’il va acheter un produit réputé halal : est-il vraiment certifié, l’animal a-t-il été abattu avec la rigueur nécessaire ? Or, en la matière, des progrès restent en effet à faire – c’est tout l’objet de la charte halal avec les engagements des contrôleurs, des organismes, des mosquées qui agréent les sacrificateurs, des abattoirs qui doivent être nos partenaires dans le renforcement de la rigueur des pratiques et de l’amélioration de la traçabilité.
Je n’ai pas connaissance de l’expérience menée à Castres, à laquelle Mme Le Loch a fait allusion. Je sais que l’on expérimente par ailleurs des procédés qui permettraient de concilier l’abattage rituel et le bien-être animal. Toutes les expérimentations méritent d’être observées de près.
Vous avez ensuite évoqué, madame la députée, la multiplication des certifications halal : là aussi, il convient de faire la part des choses entre l’agrément des sacrificateurs, qui reste l’exclusivité des trois grandes mosquées de Paris, Lyon et Évry, et les organismes de contrôle du halal qui opèrent sur un marché libre. Plusieurs organismes se sont créés ces dernières années, qui d’ailleurs participent aux discussions organisées par le CFCM ; il n’y en a pas tant que cela… Mais, à la limite, tant mieux que les initiatives se multiplient dès lors qu’elles permettront un contrôle encore plus rigoureux du halal !
Pour ce qui est de la part de halal provenant de l’étranger, je n’ai pas le chiffre exact, mais elle est en augmentation. Nous importons en effet de plus en plus de viande halal depuis la Belgique, la Pologne, l’Irlande voire la Nouvelle-Zélande. C’est le défi que j’ai mentionné tout à l’heure : les industriels français doivent pouvoir adapter leurs procédés d’abattage pour pouvoir faire face à cette concurrence internationale.
Il y a bien eu une tentative de normalisation au plan européen. Le comité européen de normalisation (CEN) et l’association française de normalisation (AFNOR) s’étaient saisis de cette question, mais j’ai l’impression que, depuis trois ou quatre mois, la démarche a été abandonnée. Reste qu’entre le CFCM et les organismes similaires dans les autres pays, une collaboration et une coordination sont en train de se mettre en place : nous sommes en particulier en contact avec nos homologues de Belgique, d’Allemagne et du Royaume-Uni pour essayer d’avancer sur la question de l’abattage rituel musulman au niveau européen. Cette préoccupation du respect des règles de l’abattage rituel musulman est très forte en Belgique et au Royaume-Uni. Nos collègues belges sont très demandeurs de la charte halal du CFCM, que nous sommes en train, d’ailleurs, de leur transmettre.
M. Joël Mergui. Vous avez, madame Le Floch, évoqué un outil dont je n’ai pas connaissance.
En ce qui concerne l’Europe, le problème s’est posé au moment où j’ai pris mes fonctions ; cela m’a du reste permis de mieux connaître mes collègues des différentes communautés juives d’Europe puisque nous nous sommes très souvent rencontrés sur cette question comme sur d’autres – la circoncision, par exemple – qui sont devenus autant de sujets européens. Il y a donc bien une concertation entre les différentes communautés juives d’Europe, mais il n’y a pas pour autant de certification unique, seulement des critères communs que nous nous efforçons d’harmoniser au maximum.
M. Jacques Lamblin. Votre souhait, monsieur le président Mergui, que l’abattage rituel ne soit plus une dérogation mais fasse partie du droit commun, est tout à fait possible moyennant certains aménagements dont j’ai donné une sommaire description…
J’indique que l’appareil évoqué par Mme Le Loch est un appareil d’électronarcose pour bovins et qui, donc, est censé provoquer un étourdissement réversible avant le sacrifice de l’animal.
Je souhaite vous poser une question concernant le tonnage casher. Selon vous, une bonne partie des animaux, ne serait-ce qu’à cause du fait qu’on n’en extirpait pas le nerf sciatique, n’était pas reconnue casher après l’abattage et repassait dans le circuit conventionnel. Quand vous parlez de tonnage annuel de viande casher, prenez-vous en compte la viande qui, au terme du processus, est classée casher ou bien l’ensemble des carcasses ?
Je tiens au passage, avant d’entendre la réponse de M. Mergui, à indiquer à M. Kbibech que si nos importations de viande halal augmentent, nos exportations vers les pays du Moyen Orient ou d’Afrique du Nord sont importantes.
M. Joël Mergui. Je suis heureux d’entendre votre position sur la possibilité de sortir de la dérogation, mais elle ne peut se faire au prix d’un renoncement.
M. Jacques Lamblin. Tout dépend de ce qu’on entend par renoncement…
M. Joël Mergui. Nous nous sommes suffisamment expliqués sur le sujet, il me semble. Ma proposition est très sérieuse et je l’ai déjà évoquée devant plusieurs ministres. Il est vrai que quand on lit les textes et qu’on voit « dérogation pour l’abattage rituel », on ressent un certain malaise. Après toutes ces années de réflexion, s’il était prouvé que les musulmans ou les juifs ne respectaient pas les règles d’hygiène, s’ils n’avaient pas conscience du risque de la souffrance animale, je comprendrais. Mais dès lors qu’il y a une conscience, une volonté, dès lors qu’on peut s’appuyer sur des études, la saignée rituelle – ou la saignée au couteau, si l’on veut employer une expression plus laïque – des carotides et des jugulaires en quelques secondes, pourrait être considérée comme un mode d’abattage comme les autres.
Pour ce qui est du tonnage, quand j’ai avancé le chiffre de 180 000 bovins et ovins, je parlais bien des animaux abattus : la partie casher ne représente au maximum que 30 % ou 40 % du tonnage total, car il faut exclure les bêtes non reconnues casher en raison de la présence d’adhérences pulmonaires et les parties arrière. Mais même en raisonnant en nombre de bêtes, le pourcentage est infime.
Un mot sur l’importation et de l’exportation de viande casher. Dans la mesure où les chokhatim qui opèrent en France sont titulaires de cartes délivrées par nos organismes et de certificats d’aptitude signés par l’Institut de l’élevage, sous le contrôle du ministère de l’agriculture, il serait bon que les viandes importées répondent au même cahier des charges. Pour commencer, cela nous aiderait à ne pas brouiller le message délivré à nos consommateurs. Ensuite, il ne paraît pas logique de nous imposer un cahier des charges aussi lourd, et que nous acceptons, et de nous retrouver dans le circuit français avec des viandes provenant de bêtes abattues sans avoir respecté les mêmes critères ; ce qui signifie que tout le travail réalisé ici ne servirait à rien : on ne pourrait contrôler qu’une partie du marché et on ferait n’importe quoi ailleurs, sans souci du bien-être animal, sans compétences, etc. Je ne veux pas dire par là qu’on ne respecte rien en Europe, mais dès lors que le marché est ouvert, il est préférable d’imposer à ceux qui importent de la viande casher en France les mêmes critères que ceux que ceux que nous sommes tenus de respecter.
M. Jacques Lamblin. Cela vaut dans de nombreux domaines.
M. Joël Mergui. En effet, et je dépasse ici un peu ma compétence. Mais c’est vous dire mon intérêt sur le sujet, et mon souci de coopération.
M. Anouar Kbibech. On constate que de plus en plus de viande halal ou supposée telle est importée, de pays européens notamment. Vous avez par ailleurs signalé que la France travaille également beaucoup à l’exportation. C’est précisément pour maintenir notre capacité d’exportation, voire la développer que nous invitons les industriels à anticiper cette question de l’étourdissement. Pas plus tard qu’il y a trois jours, une fatwa du conseil supérieur des Oulémas marocains a réitéré son rejet de tout étourdissement préalable ou post-jugulation. L’industrie française doit donc anticiper la tendance pour maintenir, voire accroître ses parts de marché à l’exportation.
M. le président Olivier Falorni. Monsieur le président du consistoire, monsieur le président du CFCM, je vous remercie de cette audition très riche et qui nous a permis d’obtenir de nombreux éléments d’information sur la question qui nous préoccupait ce matin et qui s’inscrit, vous l’avez compris, dans une réflexion beaucoup plus large sur l’abattage en France.
La séance est levée à onze heures quinze.
——fpfp——
32. Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Poulet, directeur du pôle animal de Coop de France, et de M. Philippe Dumas, président de Sicarev-Aveyron
(Séance du jeudi 23 juin 2016)
La séance est ouverte à onze heures vingt.
M. le président Olivier Falorni. Nous poursuivons nos auditions en recevant M. Jacques Poulet, directeur du pôle animal de Coop de France, et M. Philippe Dumas, président de Sicarev-Aveyron.
La Coop de France, créée en 1966, est une organisation professionnelle représentant des entreprises coopératives agricoles. Elle est structurée autour de trois pôles : animal, végétal et agroalimentaire. La coopération agricole regroupe quelque 2 700 entreprises, soit une marque alimentaire sur trois, réalise 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français et compte 165 000 salariés. En matière animale, les coopératives regroupent 35 % de l’industrie d’abattage de volailles, 21 % des bovins et veaux, 31 % des porcs – dont la Cooperl, premier abattoir français de porcs – et 34 % des ovins.
La Sicarev, pour sa part, a été fondée en 1962 ; il s’agit d’un groupe coopératif régional qui s’appuie sur des filières approvisionnées par des éleveurs situés dans les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin, Centre, Bourgogne et Champagne-Ardenne. La Sicarev dispose de cinq sites d’abattage et de découpe et commercialise 200 000 tonnes de viande par an.
Il nous semblait indispensable, messieurs, de vous auditionner dans le cadre de nos travaux et nous vous remercions vivement de votre présence ce matin.
Je rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et retransmises en direct sur le portail vidéo l’Assemblée, certaines étant diffusées sur la chaîne parlementaire.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Poulet et Dumas prêtent successivement serment.)
M. Jacques Poulet, directeur du pôle animal de Coop de France. Je vous remercie de nous avoir invités à cette audition et j’espère que nous pourrons répondre à toutes vos questions. Votre présentation, monsieur le président, était très complète. J’y ajouterai seulement qu’une trentaine de nos coopératives disposent d’outils d’abattage-transformation avec des chiffres qui vont de 2 000 tonnes à plus de 100 000 tonnes par an. Nous avons donc, au sein même de la coopération, toutes sortes d’outils – une diversité qui, j’espère, enrichira le débat.
M. Philippe Dumas, président de Sicarev-Aveyron. Je vous remercie également de me permettre de participer à cette audition. Je suis moi-même éleveur dans le département de la Loire. À ce titre, je préside le groupe Sicarev-Aveyron qui a la spécificité de concerner à la fois les métiers d’abattage-découpe pour les bovins, porcins et veaux, l’export et le négoce d’animaux vivants.
M. le président Olivier Falorni. Je vais entrer dans le vif du sujet.
Vous savez quelle est l’origine de la création de la présente commission d’enquête. Quelle a été votre réaction personnelle à la suite de la diffusion de plusieurs vidéos par l’association L214 ? Et surtout, quelles ont été les réactions des différents acteurs de la filière avec lesquels vous êtes en contact ? Avez-vous une explication à avancer ?
Ensuite, au cours de ces derniers mois, avez-vous observé une évolution de la prise en compte du bien-être animal au sein de la filière et plus précisément dans le secteur de l’abattage ? La prise en compte du bien-être animal, au cœur de notre réflexion, a-t-elle entraîné un renchérissement du coût d’abattage ?
Enfin, question que nous avons longuement évoquée hier au cours d’une table ronde réunissant des spécialistes du droit du travail et des représentants de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), que pensez-vous de l’introduction éventuelle de la vidéosurveillance dans les abattoirs à certains postes – déchargement des animaux, amenée, étourdissement, saignée ? Y êtes-vous favorables ? Serait-ce à vos yeux une bonne solution pour rassurer le consommateur, de plus en plus exigeant quant à la façon dont sont tués les animaux ? Les pratiques en abattoir ont en effet été ignorées pendant longtemps et, d’ailleurs, le grand public n’a pas forcément voulu les connaître alors qu’un certain nombre de lanceurs d’alerte comme l’association L214 ont mis récemment le sujet sur la scène publique. La confiance quant à la manière dont sont tués les animaux exige peut-être l’instauration de dispositifs nouveaux.
M. Philippe Dumas. Nous n’avons évidemment pas apprécié les images auxquelles vous faites allusion, nous les condamnons. Nous ne souhaitons pas voir de telles pratiques au sein de nos outils – ce qui m’amènera dans un moment à vous parler de la vidéosurveillance. Quand on porte, comme moi, la double casquette d’éleveur et de responsable d’outil d’abattage, on souhaite que les animaux soient bien traités.
Nous travaillons à la prise en compte du bien-être animal depuis un certain nombre d’années à l’aide des référents pour la protection animale (RPA) et en demandant à nos personnels, à nos chauffeurs de suivre une formation. Quand on a annoncé à des chauffeurs qui exerçaient ce métier depuis dix ans qu’on allait les former à la manipulation des animaux, ils ont souvent réagi en disant : « On ne va tout de même pas m’apprendre mon métier ! » Moi-même j’ai suivi, en tant qu’éleveur, des formations sur le comportement animal : on découvre ainsi, par exemple, que le champ de vision d’un bovin n’est pas le même que le nôtre, et c’est ce qui explique leur manière particulière de réagir. Ces formations nous permettent d’appréhender d’une manière différente les animaux, de mieux les approcher, de mieux comprendre et de mieux anticiper leurs réactions. Or ces chauffeurs, dont je viens de parler, mais aussi des opérateurs d’abattoir, ont admis qu’au lieu de perdre une journée, comme ils le craignaient, ils avaient appris des choses. Car il faut éviter de transposer au comportement de l’animal notre ressenti personnel : il ressent les choses différemment, sa vision, son odorat n’est pas le même que nous. Finalement, ces formations sont entrées dans leurs mœurs et ont permis de faire avancer les choses dans l’ensemble de la filière, éleveurs compris : car le bien-être animal, c’est tout au long de la vie de l’animal, jusqu’à sa mort, autrement dit jusqu’à l’abattage.
Si l’on peut mesurer, pour répondre à l’une de vos questions, le coût de mesures favorables au bien-être animal, comme une journée de formation ou la création d’un poste supplémentaire, il faut également être capable d’apprécier le plus qu’elles apportent pour rassurer le consommateur. J’en profite pour dire, quitte à m’écarter un peu de notre sujet, qu’il faut bien avoir conscience de tout notre travail d’étiquetage des produits de la filière française, et ne pas fermer les yeux sur les produits que nous importons : si l’on s’impose des exigences pour un produit né, élevé et abattu en France, on ne peut en dispenser les produits qui viennent d’ailleurs. Bref, si l’on sait mesurer des surcoûts, il est plus difficile d’en mesurer le retour ; reste que si, demain, nous n’avons plus de consommateurs de viande parce qu’ils ne sont plus rassurés par les pratiques de la filière, nous en mesurerons directement les conséquences… Il faut donc voir le côté positif des choses.
J’en viens à la vidéosurveillance. Il y a plusieurs façons de l’appréhender. Je pense qu’il faudra réfléchir à son utilisation. Si l’on doit mettre en place une vidéosurveillance, nous proposons que ce soit d’une vidéosurveillance en direct, avec un écran visible par un vétérinaire, à défaut de pouvoir mettre un vétérinaire à tous les postes ni aux côtés de chaque opérateur. Ainsi, dès que l’on constate une dérive dans la gestuelle, dans la façon de traiter les bêtes, quelqu’un est à même d’intervenir immédiatement pour corriger le geste inapproprié : c’est tout l’intérêt de la vidéosurveillance en direct. Il ne sert à rien d’enregistrer des heures d’images si c’est pour constater que le salarié a passé toute une journée à ne pas travailler comme il faudrait, faute d’avoir été bien formé, d’avoir bien compris sa tâche, etc., et qu’on n’a pas su le corriger rapidement. Avec la vidéo en direct, le vétérinaire peut réagir immédiatement, quitte à faire arrêter la chaîne : le bien-être animal ne peut admettre qu’une mauvaise gestuelle se prolonge pendant une heure, voire une journée. Peut-être faudra-t-il tenir un registre, au besoin former l’opérateur ; ce n’est pas la sanction qui m’intéresse, mais les marges de progrès, tout ce qui permettra de tirer par le haut toute une approche centrée autour du bien-être animal.
M. Jacques Poulet. Tout d’abord, j’ai trouvé la vidéo en question choquante et je ne vois aucune explication qui pourrait justifier de tels actes. Nous sommes les premiers à dénoncer les mauvaises pratiques, les premiers à encourager tous nos industriels à sensibiliser, à encadrer, à former leurs employés, à mettre en place de bonnes pratiques sur les outils d’abattage – il existe d’ailleurs des guides en la matière et qui évoluent régulièrement en fonction des exigences sanitaires et du bien-être animal. Il ne faut toutefois pas rechercher le scandale car il éclabousse tout le monde. De nombreux opérateurs travaillent correctement et essaient de progresser pour toujours être à la pointe de la demande du consommateur. Ce qui sous-tend tout de même l’activité de nos filières, c’est le consommateur et le produit qu’on lui vendra. Si le consommateur ne veut plus du produit, c’est toute la filière qui va s’effondrer. Nous sommes donc très attentifs aux attentes de la société.
Ensuite, bien sûr, une évolution progressive s’est faite dans la prise en compte du bien-être animal, tout comme cela a été le cas en matière sanitaire à la suite des crises passées. Cette progression s’est faite tant au niveau des hommes – qui travaillent dans des conditions relativement difficiles – qu’à celui des animaux, puisque nous travaillons avec des êtres vivants lorsqu’ils entrent dans un abattoir. C’est un processus régulier de remise en cause et d’analyse de ce qui ne va pas, afin de toujours faire mieux dans la limite évidemment de ce qui est économiquement faisable : n’oublions pas que nous travaillons, M. Dumas l’a rappelé, sur un marché ouvert à tous, face à des concurrents français, mais également européens et même internationaux. Il nous faut donc préserver, voire renforcer la compétitivité qui aujourd’hui manque à nos filières.
Ajoutons que nos outils ne sont pas tous au même niveau d’engagement quant au bien-être animal. Il faut donc tirer tout le monde vers le haut de façon à bien respecter la réglementation en la matière et à satisfaire les demandes sociétales qui peuvent parfois aller au-delà.
Comme l’a dit le président Dumas, la vidéosurveillance doit être un outil d’aide à la décision. Elle ne résoudra pas à elle seule le problème : c’est un élément supplémentaire qui doit permettre au référent bien-être animal (RPA), au vétérinaire, au chef de ligne de vérifier que tout se passe bien, tant sur les aires d’amenée des animaux qu’au moment de l’abattage. Pour être efficace, la vidéo devra fonctionner en flux permanent, de façon que la personne chargée de contrôler le bien-être animal puisse voir régulièrement ce qui se passe. La vidéosurveillance sera d’un intérêt moindre si les films sont stockés et visionnés ultérieurement. Cela dit, rien ne remplacera le savoir-faire, la sensibilisation des opérateurs, le rôle du RPA, des responsables et de l’encadrement. L’œil humain détectera toujours plus rapidement les conditions de mal-être animal qu’une vidéo dont la qualité des images est parfois discutable.
M. Jacques Lamblin. Je suppose que ces vidéos, au-delà de l’impact psychologique immédiat qu’elles ont engendré sur les consommateurs, ont eu des répercussions sur la consommation de viande en France, en particulier de viande bovine et ovine. Avez-vous des éléments de réponse sur cette question ?
Quelle est la part de la viande halal ou casher en France ? A-t-elle une répercussion sur les cours ? Comment ces filières rituelles pèsent-elles sur le commerce global de la viande en France, selon que le volume consommé augmente ou diminue ? Ces filières sont-elles bien organisées et avez-vous des échanges directs avec elles ? Si oui, pour quels types d’animaux – je pense qu’il s’agit plutôt des bovins et des ovins ? À votre connaissance, quels types d’animaux, parmi les bovins et les ovins, sont recherchés de préférence ?
M. Jacques Poulet. Nous sommes actuellement sur une tendance de baisse de la consommation de viande en France : il s’agit d’un phénomène relativement stable depuis plusieurs années, que nous gérons dans nos outils et au niveau des productions animales. La crise économique que nous traversons depuis quelques années l’a accentué, dans la mesure où la viande est un produit relativement cher. La baisse de la consommation est plus forte sur certaines espèces, notamment les ovins. Cela dit, il est très difficile de savoir si ce phénomène est dû à la diffusion des vidéos ou à d’autres facteurs environnants. Je pense que ces vidéos ont entraîné une réaction de dégoût vis-à-vis de ces pratiques, et je crains que ce dégoût ne se généralise : lorsque l’on voit ces vidéos, on n’a plus envie de consommer de viande. Mais je pense que c’était le but recherché. À nous de faire la preuve qu’il y a des gens qui savent travailler et que la viande est un produit noble, un produit plaisir qui fait partie de notre culture.
Il est assez difficile d’avoir des chiffres précis sur la part que représente l’abattage rituel. Par contre, des estimations qui nous viennent de notre interprofession font état de 14 % des volumes abattus en bovins et de 22 à 24 % en ovins.
M. Jacques Lamblin. Parlez-vous de viande commercialisée ou de viande abattue ? Ce n’est pas tout à fait la même chose. On entend dire parfois que des animaux sont abattus de façon rituelle pour des raisons de commodité et d’organisation. Un animal abattu de façon rituelle peut être vendu dans le circuit rituel, mais également dans le circuit conventionnel.
M. Jacques Poulet. Mon voisin vient de me souffler la réponse : il s’agit bien des volumes abattus.
Des efforts ont été réalisés pour adapter les volumes abattus par rapport au marché. Par contre, il ne faut pas se voiler la face : la totalité de la viande abattue de façon rituelle n’est pas destinée à cette filière, ne serait-ce que parce que certaines parties des animaux ne peuvent pas être consommées dans ces circuits-là. Elles repassent alors dans le circuit conventionnel.
Quant au pourcentage de volailles abattues rituellement, c’est-à-dire sans électronarcose, il est extrêmement faible : moins de 1 %.
M. Jacques Lamblin. Lorsque vous parlez de la diminution de la consommation de viande en France, intégrez-vous dans votre observation la viande de volaille ?
M. Jacques Poulet. Non, je ne parlais que de la viande bovine, ovine et porcine.
M. Philippe Dumas. Vous laissez entendre que les animaux seraient abattus selon le mode rituel pour des raisons de commodité. Mais il faut savoir que l’abattage rituel ralentit le rythme de la chaîne, en tout cas dans les outils que je connais. On n’a donc économiquement aucun intérêt à pratiquer l’abattage rituel, puisque cela augmente les coûts.
Comme l’a précisé Jacques Poulet, on ne vend pas toujours l’animal en entier, mais des parties de l’animal, voire des coproduits – c’est particulièrement vrai pour la filière ovine. Comme l’équilibre économique de la filière viande est très fragile, nous cherchons à valoriser la totalité des produits. Or certains produits et coproduits ne trouvent de valorisation que sur le marché de la viande rituelle. C’est un marché diversifié qui ne correspond pas à des catégories particulières, même s’il s’agit davantage de troupeaux laitiers ou d’animaux mâles. Un des sites de notre groupe réalise entre 10 et 12 % d’abattage rituel ; dans notre site de Roanne, qui traite plutôt des races à viande, le rituel ne représente que de 2 à 3 %. Mais cette règle ne vaut pas pour tout le monde, elle correspond à notre fonds de commerce, à nos clients. Nous abattons les animaux dont nous avons besoin pour ce fonds de commerce. Ne serait-ce que pour des questions économiques, de productivité et de cadence des chaînes, on ne fait pas de rituel pour le plaisir de faire du rituel.
M. Jacques Lamblin. Quand je vous disais que les animaux sont abattus de façon rituelle pour des questions de commodité, cela ne voulait pas dire que j’y adhérais nécessairement. Je me faisais seulement l’écho de propos entendus, et je voulais surtout obtenir une réponse de gens de terrain qui connaissent la vérité.
M. Hervé Pellois. Vous avez une trentaine d’outils. Dans combien d’outils pratiquez-vous l’abattage rituel ? Cela ne se fait-il que dans certains abattoirs, ou pratiquent-ils tous, de temps en temps, l’abattage rituel ?
Avez-vous des demandes à l’exportation de viande abattue de façon rituelle ? L’abattage rituel peut-il favoriser l’exportation de viande, sachant que certains pays n’autorisent pas ce mode d’abattage ?
Vous avez certainement une grande expérience dans le monde de la viande. Comment ont évolué, au cours des deux dernières décennies, les méthodes d’étourdissement des animaux ? Les choses ont-elles progressé parce que l’on a amélioré les matériels et la formation des hommes ? Vous avez laissé entendre tout à l’heure que vous ne pouviez pas tout faire en matière d’investissements, mais que vous faisiez l’essentiel pour que cela fonctionne bien. Utilisez-vous encore des technologies qu’il faudrait remplacer ?
M. Philippe Dumas. Certains outils ne peuvent pas faire de rituel du tout, faute de disposer des équipements nécessaires, notamment de pièges spécifiques. Mais ce n’est pas non plus parce que nos outils sont équipés d’un piège que nous faisons obligatoirement de l’abattage rituel. Nous faisons de l’abattage rituel en fonction des commandes que nous avons.
Aujourd’hui, nous avons des sollicitations à l’exportation. Dans les tout premiers jours du mois de juin, nous avons eu un appel d’offres turc de l’ESK, la structure chargée des appels d’offres des marchés publics en Turquie, pour 10 000 tonnes de jeunes bovins abattus. La France, qui a répondu à cet appel d’offres, n’a pas été retenue pour des raisons de prix. C’est la Pologne, qui s’est depuis quelque temps équipée pour faire de l’abattage rituel, qui prend aujourd’hui ces marchés-là. Nous avons intérêt à nous équiper pour pouvoir faire de l’abattage rituel, afin d’être présents sur des marchés export spécifiques. Ce n’est pas toujours nous qui décidons, mais les clients. Si on ne leur vend pas la viande, ils l’achèteront ailleurs, ou ils achèteront des animaux vivants qu’il faudra expédier pour qu’ils soient abattus ailleurs. Il faut être réaliste : nous avons tout intérêt à avoir des outils conformes, capables d’abattre rituellement, dans de bonnes conditions. C’est un moyen de s’ouvrir à des marchés extérieurs.
Nos abattoirs français renouvellent régulièrement le matériel d’étourdissement, mais également les dispositifs de contention adaptés qui empêchent l’animal de bouger, afin que l’opérateur puisse faire le bon geste et l’étourdir dans de bonnes conditions. Dans l’un de nos outils, nous investissons régulièrement dans des matériels plus efficaces, plus performants, plus sûrs, et nous améliorons les moyens de contention des bovins, pour des questions d’hygiène et pour pouvoir étourdir correctement l’animal et respecter ainsi le bien-être animal. Dans un abattoir, les problèmes ne doivent pas être regardés par un seul bout de la lorgnette, mais de manière globale : si le bien-être animal est un élément important, il ne faut pas non plus oublier l’hygiène qui renvoie à la santé du consommateur, ni les conditions de travail des salariés.
M. Jacques Poulet. Les personnes qui travaillent sur les postes d’abattage rituel suivent aussi une formation particulière, pour être à même de travailler le mieux possible.
Mme Françoise Dubois. Quels sont les critères pour recruter du personnel ? Si j’ai bien compris, il n’y a pas de formation préalable, elle se fait sur le tas. Devenir abatteur n’est pas un choix de carrière. Comment se passe la formation dans vos établissements ? Pensez-vous qu’elle est suffisante ? Comme l’a dit Hervé Pellois, elle a été améliorée, mais on se demande si elle est vraiment suffisante. Ce n’est pas anodin d’égorger des animaux toute la journée. Cela peut provoquer certaines réactions humaines, même si elles ne sont pas incontrôlables : les images qui ont été diffusées sont inacceptables, et l’on peut du reste se demander comment elles ont pu être filmées. Il a bien fallu que quelqu’un s’introduise dans un abattoir. Et comme vous l’avez dit, monsieur Poulet, on connaît le but de ces images.
Monsieur Dumas, vous suggérez que des caméras de vidéosurveillance filment en direct et en continu. Si l’on peut être d’accord sur le principe, je crains que le fait d’avoir une caméra au-dessus de la tête toute la journée n’engendre encore plus de stress chez les salariés. Imaginez ce qui se passerait si tous les salariés de n’importe quelle entreprise avaient une caméra qui les surveille à longueur de journée ! Je ne suis pas hostile par principe à la vidéosurveillance, mais peut-être pas en direct et en continu…
M. Philippe Dumas. Il vaut mieux que la vidéosurveillance fonctionne en direct, plutôt que d’accumuler des enregistrements qui seront visionnés par la suite. Imaginez le salarié rentrant chez lui, en demandant s’il a bien travaillé dans la journée, s’il n’a pas fait des gestes inadaptés, et s’il ne risque pas d’être sanctionné le lendemain, le surlendemain ou dans un mois au moment où on lira les vidéos… Le stress sera pire que le direct, et ce sera encore plus stressant s’il pense que son chef, avec lequel il aura pu avoir des mots, pourra chercher sur l’enregistrement vidéo un motif à le sanctionner.
Il y a plusieurs façons d’appréhender un enregistrement en direct. Soit dans un objectif de sanction, ce qui engendre du stress – mais il faut savoir qu’un salarié ne travaille jamais seul puisqu’un responsable est présent en permanence –, soit dans un objectif de progrès. C’est ce message-là qu’il conviendra de faire passer à nos personnels.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a dû vous donner les informations en la matière. La question n’est pas si simple que cela. S’il faut de la vidéo – je n’en suis pas sûr, mais la question est posée – nous considérons qu’elle doit servir à améliorer la marge de progrès, et non à sanctionner le salarié, sachant que les vétérinaires circulent dans le hall d’abattage et dans les différents postes et que l’opérateur n’est pas seul, qu’il a toujours un collègue à côté de lui qui peut lui dire de travailler différemment.
Mme Françoise Dubois. Il faudra bien expliquer à quoi doit servir la vidéo, qu’elle est là dans l’intérêt de tous. Elle doit permettre de remédier rapidement aux défaillances ou aux dérives que l’on peut comprendre lorsque les cadences sont trop élevées.
M. Jacques Poulet. La vidéo n’est qu’un outil supplémentaire d’aide à la bonne gestion de cette partie de l’abattoir. Elle n’est pas dirigée vers les hommes, mais vers les animaux puisque c’est leur bien-être qui nous intéresse.
Pour répondre à une exigence d’un client étranger et obtenir un marché, un de nous outils a dû installer de la vidéosurveillance. Les caméras sont tournées de façon à ne jamais voir les hommes, ou de dos, ou d’assez loin pour ne pas pouvoir les identifier. Se pose également la question de la qualité des images : le but est de permettre au vétérinaire de détecter un affolement du troupeau, un mouvement de panique, un animal blessé. Cela peut se vérifier assez rapidement, sans qu’il soit nécessaire de voir en détail ce que font les hommes. La vidéosurveillance n’est pas la solution, mais seulement un outil d’aide à la décision. La solution consiste à former les hommes, à les sensibiliser car eux seuls sont capables de détecter des conditions de mal-être et d’y remédier immédiatement.
M. le président Olivier Falorni. Pour quel motif un de vos clients vous a-t-il demandé d’installer des caméras ? Était-ce lié au bien-être animal ?
Vous souhaitez que les vidéos ne montrent pas le visage des salariés, et vous avez raison car c’est le bien-être animal qui nous intéresse. Toutefois, il s’agit d’identifier les cas de maltraitance : s’il s’en produisait, il faudrait pouvoir identifier les salariés qui se livreraient à ces exactions, ces actes répréhensibles. Il y a également l’aspect pédagogique : or cela passe par l’enregistrement. Il faut pouvoir regarder quelle est la pratique des salariés pour pouvoir éventuellement l’améliorer.
M. Jacques Poulet. Le client nous a demandé d’installer des caméras pour des raisons de bien-être animal. Je ne me suis pas rendu sur place pour voir comment cela se passait ; c’est le RPA de l’entreprise qui m’a expliqué le fonctionnement. Effectivement, on n’identifie pas les hommes, mais les couloirs de contention et les aires sur lesquelles les animaux attendent. Si vous voyez sur une caméra un bras qui tient un bâton ou un geste non conforme aux exigences de l’entreprise en matière de bien-être animal, il est relativement facile d’identifier le salarié. Cela étant, il ne s’agit pas de sanctionner les hommes, mais de permettre au RPA, au vétérinaire, au responsable de chaîne, voire au directeur de l’entreprise qui peut être mis en cause pénalement, de progresser. Nous ne sommes pas là pour dire au salarié que ce qu’il a fait n’est pas bien et lui coller deux jours de mise à pied, mais pour lui demander s’il a pris conscience de son geste et lui expliquer pourquoi il ne faut plus le faire. Nous sommes plutôt dans un esprit constructif et de progrès que dans la sanction. La sanction doit vraiment avoir lieu en dernier recours.
M. le président Olivier Falorni. Vous savez que notre assemblée a voté récemment, dans le cadre de la première lecture du projet de loi Sapin II, une disposition qui prévoit que la maltraitance sur animal dans les abattoirs et les transports sera désormais un délit pénal. Voilà pourquoi j’ai abordé la question de la maltraitance, et donc l’identification des auteurs de délits pénaux.
Mme Annick Le Loch. Je tiens tout d’abord à saluer Coop de France, acteur très important dans le secteur agroalimentaire en France, et l’abattoir est évidemment un élément essentiel de cette filière.
Nous avons vu, à travers nos auditions, que, pour que les animaux soient bien traités, il est indispensable que le personnel travaille dans de bonnes conditions et que l’accueil des animaux soit de qualité et tout à fait conforme à la réglementation.
Le Gouvernement a mis en place un programme d’investissements d’avenir. Envisagez-vous d’être demandeur ? Est-il suffisant aujourd’hui pour mettre à niveau vos abattoirs ?
L’accueil des animaux dans ces abattoirs est tout à fait essentiel. J’ai eu l’occasion de rencontrer du personnel qui travaille à l’amenée des animaux. Avez-vous élaboré une politique particulière dans ce domaine ? On m’a rapporté que certains animaux étaient plus stressés que d’autres, notamment le porc. Prenez-vous des précautions particulières par rapport à cet animal ?
Chacun sait que le bien-être animal dépend aussi du bien-être des salariés dans les abattoirs. Quelle est votre politique par rapport à vos salariés ?
Vous avez des abattoirs de taille différente, des petits et des gros abattoirs, des abattoirs mono-espèce et abattoirs multi-espèces. Votre politique de bien-être animal est-elle différente suivant le type d’outil ?
Combien y a-t-il, dans votre groupe, d’abattoirs autorisés à pratiquer l’abattage sans étourdissement ? Vous avez déjà répondu à cette question, me semble-t-il.
Enfin, l’abattage rituel répond, dans notre pays, à un système dérogatoire. Pensez-vous, comme certains acteurs de notre pays, que ce système doit être corrigé, revu, en tout cas que la réglementation doit évoluer ?
M. Philippe Dumas. Il n’y a pas de formation spécifique d’ouvrier d’abattoir. Si ces métiers ne font pas rêver les jeunes qui fréquentent les bancs de l’école, il n’empêche qu’ils offrent un emploi, et un salaire. Ce métier doit être revalorisé car la diffusion des vidéos a choqué nos salariés qui se sentent agressés dans leur profession par ces amalgames. Il faut donc tirer vers le haut l’image des métiers de la viande car nous avons du mal à recruter du personnel malgré le nombre de chômeurs que compte notre pays.
Nous n’avons pas d’exigences particulières en termes de formation. Nous voulons seulement que les gens viennent au travail, qu’ils respectent les consignes qu’on leur donne, l’hygiène, la qualité et le bien-être animal. Les nouveaux salariés sont formés en binôme, avec un responsable. Si nous voulons conserver nos personnels, il faut revaloriser leur image. Les résultats de la filière viande étant un peu difficiles, il est certain que les salaires ne font pas rêver ; il faut donc trouver des formes qui motivent les gens à venir travailler dans nos outils. J’insiste sur l’image de la filière viande, car nos personnels se sentent agressés alors qu’ils ne se reconnaissent pas dans les scènes qu’ils ont pu voir sur les vidéos.
Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous investissons dans les pièges, mais aussi dans les bouveries, autrement dit dans les conditions d’accueil et de stockage des animaux. Abattre un animal stressé aura des répercussions sur la qualité de la viande – cela donne ce que l’on appelle des viandes à pH élevé. On sait que certaines races et certains animaux doivent pouvoir être accueillis dans de bonnes conditions et qu’il faut les laisser douze heures dans des logettes avec de l’abreuvement. Combiner bien-être et économie est toujours efficace. Les investissements que nous réalisons permettent d’améliorer la qualité des viandes, les conditions de travail des salariés et le bien-être animal.
M. Jacques Poulet. Nous sommes un des rares secteurs à pouvoir embaucher du personnel sans qualification et à lui en délivrer une. Comme nous ne sommes pas très attractifs, nous avons dû faire des efforts en matière de formation afin de donner une qualification à du personnel qui avait du mal à trouver du travail. Nous sommes assez familiers de ce système de formation continue et d’accompagnement. Une formation théorique de sept heures est obligatoire pour pouvoir travailler au poste d’abattoir. Mais comme nous ne saurions nous satisfaire de cette formation théorique, la plupart des abattoirs ont mis en place un volet pratique : il s’agit d’accompagner la personne qui vient de suivre une formation théorique et de lui expliquer comment cela fonctionne dans la pratique, car chacun sait qu’il y a, d’un côté la théorie et, de l’autre la pratique. Il faut généraliser le principe de parrainage, d’accompagnement des nouveaux arrivants, des personnes qui n’ont qu’une formation théorique ou qui n’ont pas de formation du tout. C’est déjà le cas dans beaucoup de grands groupes. Il faut cultiver cet état d’esprit dans l’ensemble des entreprises. Comme partout, il y a toujours des précurseurs, qui montrent que l’on obtient ainsi des résultats positifs. Et l’effet d’entraînement incite les suiveurs, ce qui permet progressivement de faire monter le niveau de l’ensemble de nos entreprises.
Il n’y a aucune différence entre petits et gros abattoirs en matière de bien-être animal. Le bien-être animal ne se nuance pas : soit on le fait correctement, soit on ne le fait pas. Il n’y a pas de degrés dans le bien-être animal, seulement des exigences auxquelles tout le monde doit se plier, petit ou grand. C’est à chacun de voir, en fonction de son organisation, comment il peut répondre au mieux à ces exigences.
M. le président Olivier Falorni. Seriez-vous favorable à la mise en place d’un étiquetage bien-être animal, et/ou à un étiquetage mentionnant si l’animal a été étourdi avant sa mise à mort ?
Hier, nous avons auditionné deux réalisateurs de documentaires intitulés Saigneurs et Entrée du personnel. Ils ont effectué un travail de fond sur ce qui se passe dans les abattoirs et ont interrogé de nombreux salariés de ces établissements. Nous avons pu distinguer trois difficultés liées à ce métier : la pénibilité, la précarité et la dangerosité.
Que pensez-vous de la prise en charge de la pénibilité du travail des opérateurs en abattoir ? Pensez-vous que certains salariés auraient besoin d’un suivi psychologique ? Il ne s’agit pas de dire que les gens qui travaillent dans un abattoir ont besoin d’être traités en psychiatrie, mais les témoignages que nous avons vus montrent que tout n’est pas simple quand on sort de sa journée de travail, surtout au poste d’abattage.
Quelle est la fréquence des accidents de travail dans un abattoir ? Quelles seraient les causes de ces accidents ? Il n’est pas toujours évident de manier des outils qui ont vocation à donner la mort et à manipuler les animaux. Lorsque l’on accroche un animal, il peut bouger, donner un coup de corne, etc. Sans parler des troubles musculosquelettiques (TMS) qui constituent un problème récurrent.
Êtes-vous favorables à la mise en place, au sein de chaque abattoir, d’un comité d’éthique qui regrouperait les représentants des abattoirs, des vétérinaires, des associations de consommateurs et certaines associations de protection animale, un peu à l’image des Commissions locales d’information et de surveillance (CLIS) qui concernent des installations classées – les sites classés Seveso par exemple ? C’est une proposition dont notre rapporteur est à l’origine.
M. Philippe Dumas. Nous ne sommes pas favorables à l’étiquetage bien-être animal ni à celui mentionnant si l’animal a été étourdi avant sa mise à mort.
Un étiquetage bien-être animal laisserait sous-entendre que l’on tolérerait que certains abattoirs puissent abattre des animaux sans le respecter, tout en continuant à vendre leur viande. Il faut faire progresser le bien-être animal, mais il n’est pas question d’étiqueter cette approche.
Notre position est la même en ce qui concerne un étiquetage mentionnant le mode d’abattage. Il revient aux élus de faire en sorte que tous les modes d’abattage respectent le bien-être animal tout au long de la chaîne, y compris lors de l’abattage, en trouvant les meilleures solutions. Étiqueter le mode d’abattage risquerait de mettre en porte-à-faux certains cultes alors que la religion relève du personnel et du privé. C’est à vous de déterminer quel est le bon moyen d’abattre selon des rites qui respectent le bien-être animal et qui conviennent à tout le monde. Si l’on étiquette une viande halal par exemple, cela peut sous-entendre que le bien-être animal n’a pas été bien respecté, et l’on risque de montrer du doigt une religion. En revanche, nous sommes favorables à la définition d’un vrai cadre législatif clair en ce qui concerne l’abattage rituel. Ensuite, il faudra s’assurer que tout le monde l’applique.
Vous avez parlé de la pénibilité du travail, de la précarité des salariés et des risques d’accidents du travail. Les investissements ont pour but de réduire la pénibilité et les risques d’accidents du travail. Nos entreprises n’ont aucun intérêt à ce que des salariés formés et performants dans leur métier soient en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail ou de TMS. Nous devons sans cesse réfléchir à diminuer la pénibilité et trouver des solutions pour donner les moyens à cette filière qui n’en a malheureusement pas assez. Je sais ce que signifie investir dans un abattoir : notre groupe vient de rénover un outil sur Saint-Étienne pour 20 millions d’euros et un autre sur Roanne pour 12 millions d’euros. Bien que ces sommes soient colossales, il faudrait parfois quelques millions d’euros supplémentaires pour franchir de nouveaux caps, dans le domaine de la robotisation par exemple. Lorsque l’on réfléchit à un nouvel atelier de découpe, on se demande toujours comment réduire la pénibilité, car ce sont de vrais enjeux pour nos salariés.
Au cours des échanges que nous avons eus avec des préfets ou l’inspection du travail, on a reproché à notre groupe d’avoir recours à trop de salariés temporaires et trop de prestataires. Nous leur avons répondu que, pour notre part, nous étions prêts à les embaucher mais qu’eux ne le voulaient pas. Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous avons énormément de mal à recruter. Et quand on a formé des salariés, on a tout intérêt à ce qu’ils restent dans l’entreprise.
Je ne me vois pas proposer à nos salariés un suivi psychologique. Je suis certain qu’un salarié qui travaille au poste d’abattage ou d’éviscération, voire à n’importe quel poste, ne se sent pas concerné par la nécessité d’un suivi psychologique lié à son métier. Dans toutes les professions, on rencontre des gens qui peuvent avoir besoin d’un suivi psychologique, et pour d’autres raisons que celles liées à leur métier. Moi qui côtoie les salariés du groupe, je n’ai jamais senti un besoin de suivi psychologique. Je les sens surtout attaqués dans leur amour-propre, et très perturbés quand ils voient des images laissant sous-entendre que tous les abattoirs travaillent comme cela, car ils ont toujours l’intention de travailler du mieux possible.
M. le président Olivier Falorni. Avez-vous des données chiffrées sur les accidents du travail ?
M. Jacques Poulet. Je n’ai pas de données chiffrées avec moi, mais je pourrai me renseigner et je vous les communiquerai. Je serais surpris que l’on ne dispose pas au moins d’une estimation sur les accidents du travail.
M. le président Olivier Falorni. Et nous aimerions connaître quelles en sont les raisons.
M. Jacques Poulet. Je ne sais pas si nous connaissons les raisons. En tout cas, c’est une de nos préoccupations : l’absentéisme représente un coût supplémentaire et pénalise notre compétitivité. De même, la pénibilité devient rapidement une charge pour l’entreprise. Ce sont des choses dont on doit se préoccuper au plus haut point.
Des expérimentations sont en cours, notamment avec de la robotique : ce sont des exosquelettes que les hommes peuvent porter de façon à garder la précision du geste de l’artisan qui travaille dans nos entreprises tout en démultipliant l’effort. Cela permet de conserver l’expertise sans rendre la tâche pénible.
M. Philippe Dumas. Nous avons eu beaucoup d’accidents liés au fait de pousser des charges lourdes. Nous avons donc automatisé ces opérations. Il arrive aussi que les salariés glissent car ils travaillent dans un milieu humide. L’utilisation d’un couteau peut aussi occasionner des accidents : c’est par essence l’outil dangereux. Le salarié est équipé de gants métalliques, d’un tablier et d’un porte-couteau. Ainsi, quand il va de son poste à la salle de pause, il ne se promène pas avec son couteau dans la poche. Effectivement, il est important de savoir s’il existe des statistiques en matière d’accidents du travail.
Vous suggérez la création d’un comité d’éthique. Il faut savoir qu’à l’abattoir de Roanne qui appartient au groupe Sicarev, nous avons en permanence quatorze vétérinaires ou préposées vétérinaires. Il y a donc des relations quotidiennes entre les opérateurs, les responsables de sites, le responsable de chaîne et ces personnels. En cas de dysfonctionnement, qui ne concerne pas uniquement le bien-être animal mais aussi les conditions d’hygiène tout au long de la chaîne puisqu’il s’agit d’un produit alimentaire, des réunions ont lieu pour y remédier.
M. Jacques Poulet. Il existe, au niveau national, un Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV), et au niveau régional, des conseils régionaux d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV), dans lesquels on retrouve toutes les parties prenantes concernées par les différents sujets qui touchent à l’agriculture, en santé animale ou végétale. Coop de France participe très régulièrement au CNOPSAV spécialisé sur le bien-être animal. Nous avons, chez nous, une personne chargée du bien-être animal et un référent responsable du bien-être animal chargé d’étudier ces dossiers, d’apporter des réponses et d’alimenter le débat au CNOPSAV. Tout le monde est représenté dans cet organisme, au point qu’on surnomme le Parlement du sanitaire. Peut-être faut-il utiliser ce lieu avant d’en créer d’autres.
M. Yves Censi. Je tiens à remercier M. Dumas et M. Poulet pour les précisions qu’ils nous ont apportées.
Je veux revenir sur ce que l’on appelle les risques psychosociaux (RPS) en entreprise. Le président Dumas a relevé que le problème était bien souvent davantage celui de l’image négative qui est présentée et qui retentit sur les salariés. Cette image est souvent renforcée et surmultipliée dans les réseaux sociaux, comme on l’a vu avec les vidéos qui ont circulé. Le droit du travail prévoit une obligation de prévention des risques psychosociaux, avec une obligation de résultat. Vous travaillez dans un univers très concurrentiel et vous faites l’objet d’attaques d’une partie de la société, attaques que je ne partage pas forcément puisque je connais bien les conditions d’abattage dans ma circonscription de l’Aveyron. Avez-vous constaté, comme cela existe dans certains secteurs et certains métiers, des difficultés psychosociales et psychologiques qui seraient supérieures à d’autres ? Avez-vous mis en place des chartes de prévention des RPS ou envisagez-vous de le faire ?
On m’a rapporté que les grèves des services vétérinaires de l’État entraînaient une certaine désorganisation de toute la filière, en particulier des postes qui travaillent en flux tendu – je pense à la fabrication des steaks hachés surgelés. Avez-vous déjà été confrontés à ce phénomène ? Mérite-t-il à vos yeux une attention particulière, ou considérez-vous qu’il s’agit d’un épiphénomène ?
M. Philippe Dumas. Il serait intéressant que M. Poulet puisse récupérer des éléments sur les risques psychosociaux. Cela dit, en tant qu’agriculteur, je suis parfois plus inquiet de la détresse des agriculteurs que de celle des salariés de nos entreprises. Mais ce n’est pas le sujet qui nous occupe aujourd’hui.
Lorsque les préposés vétérinaires sont en grève, cela désorganise forcément le travail en abattoir : si les services vétérinaires ne sont pas là, nos salariés ne peuvent pas travailler. Ces préposés vétérinaires ne sont pas nos salariés, mais s’ils sont bien intégrés dans nos outils et conscients de leur rôle, ils savent que s’ils font grève ils désorganisent tout un métier, toute une équipe. Quelquefois, cela ne se passe pas trop mal, mais dans certains cas cela peut être le bazar, si je puis dire…
M. Jacques Poulet. Coop de France gère sa propre convention collective, la convention collective nationale concernant les coopératives et sociétés d’intérêt collectif agricole bétail et viande du 30 septembre 2014, dans laquelle sont inclus les coopératives de mise en marché ainsi que les outils d’abattage et de transformation. Nous avons une commission sociale spécialisée dans les filières viande, et nous avons des échanges avec les partenaires sociaux. Il est évident que nous ne négligeons aucun sujet. Cela dit, la question de la pénibilité dans nos métiers est de loin celle qui arrive en tête dans les remontées de nos partenaires sociaux et du terrain : les conditions de travail, de température, d’humidité, d’horaire et de gestes sont relativement difficiles pour nos salariés. C’est un dossier sur lequel nous travaillons beaucoup et sur lequel j’espère que nous progressons. Cela ne veut pas dire que nous avons oublié le volet psychosocial. Mais on ne nous a jamais demandé de mettre en place un suivi psychologique. Les rares fois où l’on a pu aborder ce sujet par rapport à des postes difficiles, comme la mise à mort, on nous a répondu qu’il ne fallait pas stigmatiser un poste en particulier et considérer qu’il pouvait rendre un peu dingue au bout de quelque temps… L’idée est plus de s’organiser au sein de l’outil d’abattage pour effectuer un turn over. D’ailleurs c’est ce qui se fait assez régulièrement maintenant, ce qui permet également de développer la multicompétence. Nous essayons de remédier à ces problèmes en trouvant des solutions en interne dans les entreprises.
M. le président Olivier Falorni. Messieurs, je vous remercie pour vos réponses extrêmement précises.
La séance est levée à douze heures quarante.
——fpfp——
33. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des représentants d’associations de protection animale, avec la participation de M. Alain Pittion, docteur vétérinaire, membre du conseil d’administration de la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France (CNSPA), de M. David Chauvet, juriste, membre fondateur de l'association « Droits des Animaux », de M. Arnauld Lhomme, responsable des enquêtes de la Fondation 30 millions d’amis, de Mme Anne-Claire Chauvancy, responsable protection animale de la Fondation assistance aux animaux (FAA), et de M. Jean-Claude Nouët, professeur et vice-président de la Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA)
(Séance du mercredi 29 juin 2016)
La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq.
M. le président Olivier Falorni. La commission d’enquête sur les conditions d’abattage dans les abattoirs français a été créée à la suite de la diffusion de vidéos par l’association L214 sur trois abattoirs. Malheureusement, ce matin, de nouvelles vidéos des abattoirs de Pézenas et du Mercantour ont été rendues publiques. Ces témoignages démontrent la pertinence de nos travaux et la nécessité de présenter des propositions, ce que nous ferons à l’issue des auditions en remettant notre rapport dans la première quinzaine de septembre.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons souhaité auditionner les associations de protection animale. Nous en avons déjà entendu quelques-unes. Aujourd’hui, nous recevons des associations signataires, avec notamment l’Œuvre d’assistance aux abattoirs (OABA), l’association L214 et la fondation Brigitte Bardot que nous avons reçues, d’un courrier adressé fin octobre au Premier ministre et au ministre de l’agriculture.
Parmi elles, la Société protectrice des animaux (SPA), association d’utilité publique fondée en 1845, qui œuvre pour la protection de tous les animaux en France et combat toutes les formes de maltraitance animale, ainsi que l’abattage sans étourdissement. Elle est représentée par M. Alain Pittion, docteur vétérinaire, membre du conseil d’administration de la Confédération nationale des SPA de France ;
L’association Droits des animaux, créée en 2004 et dont l’activité principale est de promouvoir l’amélioration de la condition animale et les droits des animaux. M. David Chauvet, qui la représente, est juriste et membre fondateur de l’association ;
La Fondation 30 millions d’amis, créée en 1982 et reconnue d’utilité publique, qui a pour objet de défendre et d’améliorer la condition animale au sein de la société française. Elle est représentée aujourd’hui par M. Arnauld Lhomme, responsable des enquêtes au sein de la Fondation ;
La Fondation assistance aux animaux, fondée en 1930, qui porte secours aux animaux en détresse et promeut le respect de la vie animale partout où elle le juge nécessaire. Mme Anne-Claire Chauvancy, responsable protection animale, la représente ici ;
Enfin, la Fondation droit animal, éthique et sciences, fondée en 1977, qui s’est organisée en un groupe d’études, de réflexion et d’expertise pluridisciplinaires visant à améliorer la condition animale par la transposition juridique des nouveaux acquis scientifiques et des évolutions éthiques, relatifs à la vie des animaux et à leurs relations avec l’homme. M. Jean-Claude Nouët en est le vice-président.
Madame, messieurs, avant de vous céder la parole, je vous rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et retransmises en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
MM. Alain Pittion, David Chauvet, Arnauld Lhomme, Jean-Claude Nouët et Mme Anne-Claire Chauvancy prêtent successivement serment.
M. Alain Pittion, docteur vétérinaire, membre du conseil d’administration de la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France (CNSPA). La confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France, dont le siège est situé à Lyon, regroupe 260 associations et compte 450 000 adhérents. Si nos associations sont connues pour la défense des animaux de compagnie, elles n’oublient pas les animaux de rente. Nos adhérents sont de plus en plus sensibilisés à cette question. En outre, nombre de nos refuges sont installés sur des terrains qu’ils partagent souvent avec des abattoirs. Cette proximité accroît la sensibilité à ces activités.
La législation en matière d’abattage est relativement bien faite ; c’est son application qui est en cause. Pour nous, le principal problème réside dans le contrôle. Les autres associations penseront sans doute la même chose.
Je n’évoque pas l’abattage sans étourdissement qui pose un véritable problème.
Je cite un exemple, un peu connexe du sujet de cette audition, pour illustrer le fait que la sensibilité des consommateurs est de plus en plus grande : il fut un temps où les carcasses de lapins étaient vendues sur les étals des boucheries avec la tête – la réglementation sanitaire l’imposait pour éviter la confusion avec les chats. Avec l’évolution des sensibilités, la consommation du lapin avait considérablement diminué, les consommateurs ne supportant plus de voir les lapins avec leur tête. Depuis, la vente du lapin en morceaux a été autorisée, et la consommation a pu repartir. Je pense que les conditions d’abattage jouent un rôle dans la baisse de la consommation du bœuf. Je connais des gens qui ne veulent plus manger de bœuf à cause de tout ce qu’ils ont vu ces derniers temps.
Je reviendrai plus tard dans la discussion sur l’abattage rituel. J’ai eu l’occasion de voir, lors de mes études de vétérinaire et de mon service militaire, des abattages rituels qui ne m’ont pas laissé un très bon souvenir.
M. David Chauvet, juriste, membre fondateur de l’association Droits des animaux. Je vous remercie de me donner la parole sur cette tragique question de la condition des animaux dits de rente. Mon intervention portera sur la vidéosurveillance dans les abattoirs, sans oublier les lieux de déchargement des animaux.
Quelques mots d’abord sur mon positionnement politique concernant la condition animale. Je défends un point de vue à la fois abolitionniste et réformiste. Réformiste, puisque comme les membres de cette commission et comme l’immense majorité des Français, je pense qu’il faut proscrire toute souffrance des animaux ; abolitionniste, car je plaide aussi pour l’abolition du meurtre et de l’esclavage généralisé et institutionnalisé des animaux. C’est bien de cela qu’il est question dès lors que les animaux, eux aussi, ont une volonté, volonté dont nous ne tenons pas compte, que nous méprisons, mais volonté tout de même. Et qu’est-ce que le meurtre sinon l’anéantissement d’une volonté ? Qu’est-ce que l’esclavage sinon l’asservissement d’une volonté ?
Venons-en à la question de la vidéosurveillance. J’avais prévu d’apporter une démonstration juridique de la légalité de la vidéosurveillance mais ce n’est plus très utile puisque des juristes, notamment des représentants de la CNIL, m’ont précédé la semaine dernière.
Lors de cette audition du 22 juin, vous avez pu constater que la vidéosurveillance dans les postes d’abattage n’est pas illégale par principe. Le débat, fort intéressant, a montré que la voie législative devait sans doute être privilégiée pour plusieurs raisons. D’abord, il ne s’agit pas simplement de permettre à l’employeur, qui le plus souvent est le propriétaire des locaux, d’installer un système de vidéosurveillance, mais de le lui imposer. Ensuite, il serait souhaitable de prévenir tout détournement de finalité. Un contrôle doit, de toute façon, être exercé par les services de l’État et pas uniquement par l’employeur – se pose aussi la question d’un contrôle par les associations. Il serait également souhaitable d’étendre le délai de conservation des enregistrements, qui est d’un mois selon les recommandations de la CNIL. Pour ma part, puisqu’il est question de prévenir et de sanctionner le délit pénal de maltraitance, il me semble qu’un délai correspondant à la prescription de ce délit serait mieux indiqué. Enfin, il faut valider le principe d’un contrôle permanent des salariés, quoique ce ne soit pas une nécessité juridique. La CNIL, par une délibération du 3 janvier 2013, a affirmé qu’il est interdit de surveiller en permanence les salariés sur leur lieu de travail, sauf circonstances particulières – elle en donne pour exemple le fait que des employés manipulent de l’argent. Il n’est pas contestable que tuer des animaux relève tout autant d’une circonstance particulière, dès lors que cela peut occasionner une souffrance sanctionnée par le délit de maltraitance. On ne comprendrait pas que le vol de liquidités à la caisse en relève et pas le fait de maltraiter les animaux.
J’insiste sur l’impérieuse nécessité de mettre en place la vidéosurveillance des abattoirs, car si la légalité de cette mesure n’est désormais plus douteuse, il subsiste encore quelques doutes sur son opportunité. Plusieurs intervenants dans de précédentes auditions ont insisté sur le stress que la vidéosurveillance occasionnerait aux salariés quand son efficacité ne serait pas démontrée, en l’absence d’études poussées sur ce point. La vidéosurveillance s’est pourtant développée largement dans le monde du travail sans que l’on ait exigé qu’une telle preuve soit apportée. Pourquoi la vidéosurveillance des abattoirs devrait-elle attendre que son efficacité soit démontrée pour être mise en place ? Quant au stress, dès lors que l’on a prévenu tout détournement de finalité, il me semble assez évident qu’il ne peut concerner un salarié qui n’a rien à se reprocher. Les radars sur les routes peuvent aussi être perçus comme une source de stress, mais surtout par ceux qui ont du mal à respecter les limitations de vitesse.
Pourquoi la vidéosurveillance est-elle absolument nécessaire ? De fait, il est, sinon impossible, du moins très difficile d’obtenir la preuve d’infractions à la législation de protection des animaux sans un contrôle des salariés. Ce contrôle peut être exercé de deux manières : l’inspection et la surveillance. Qu’est ce qui les différencie ? Comme le dit M. Benjamin Dabosville dans L’information du salarié, « contrairement à l’inspection, la surveillance est un mode de contrôle qui s’inscrit nécessairement dans la durée ». De cette différence de durée entre contrôle ponctuel et surveillance constante en résulte une autre, qui justifie de ne pas faire l’économie de la vidéosurveillance des abattoirs : la différence d’attitude du salarié contrôlé. On se doute bien que le salarié, lors d’une inspection, ne se livrera pas à des actes de maltraitance – de même qu’un salarié qui manipule de l’argent n’en détournerait pas sous le nez des inspecteurs. Comme l’a dit très justement M. Jean-Pierre Kiefer de l’association OABA lors de son audition, le 27 avril dernier, « quand bien même un vétérinaire inspecteur serait présent en permanence sur le poste d’abattage, il est en blouse blanche, à visage découvert, au vu et au su de tous ; or, si les caméras cachées de L214 ont pu mettre au jour des pratiques inacceptables, c’est parce que le personnel ne se savait pas surveillé ». Cela montre les limites de l’inspection et justifie pleinement la mise en place de la vidéosurveillance des abattoirs. Monsieur le président, vous ne dites d’ailleurs pas autre chose sur le site lemonde.fr ce matin lorsque vous déclarez, à la suite des nouvelles révélations de L214 : « c’est la limite des contrôles humains : les actes de maltraitance avérés ne vont pas se produire sous nos yeux ». Le fait est que l’abattoir de Pézenas, où des moutons ont eu les yeux crevés, avait fait l’objet d’une visite inopinée le 17 mai dans le cadre de votre commission. Aucun dysfonctionnement n’avait été relevé ce jour-là.
Notons, pour finir, que la vidéosurveillance est demandée par les inspecteurs eux-mêmes. Récemment interrogé sur les pistes à suivre pour améliorer l’inspection, M. Laurent Lasne, président du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire, a déclaré, sur le site lemonde.fr, que la première piste « est la mise en place de caméras au niveau des postes de saignée dans tous les abattoirs ».
M. Arnauld Lhomme, responsable des enquêtes de la Fondation 30 millions d’amis. Je vous remercie pour votre invitation en espérant que cette commission d’enquête aboutisse à quelque chose.
La Fondation 30 millions d’amis est plutôt connue pour la défense des animaux familiers, mais, malheureusement, de plus en plus, elle intervient sur tous types de problèmes.
Nous avons cosigné la lettre demandant au ministère des explications. Dans le cas, déjà évoqué par mon collègue de la fondation Brigitte Bardot, d’un bovin arrivé un samedi à l’abattoir de Vannes, abattu seulement le lundi, après être resté quarante-huit heures avec l’arrière-train cassé, la décision judiciaire a été rendue vendredi dernier : l’abattoir a été condamné à 800 euros d’amende – pas même la valeur marchande de l’animal ! Comment voulez-vous que la sanction soit dissuasive ? On comprend que l’abattoir n’en ait rien à faire du contrôle de l’État. De nombreux abattoirs ont été contrôlés à la suite de la diffusion des vidéos. Trois fermetures administratives ont été décidées, 50 % des établissements ont eu des petits soucis – quatre-vingt-sept mises en demeure et neuf procès-verbaux ont été établis.
En tant que responsable des enquêtes, je constate que la difficulté tient à la preuve de la maltraitance. Sans témoignage, on ne peut rien faire contre le responsable. Dans le cas que j’ai cité, on a eu la chance que les employés montrent ce qui se passe à l’intérieur de l’abattoir et aient le courage de dénoncer les faits. Sans vidéosurveillance, on restera toujours les mains liées. La Fondation 30 millions d’amis demande que la vidéosurveillance soit rendue obligatoire, mais aussi que les mauvais traitements soient reconnus comme un délit. C’est la moindre des choses. La vidéosurveillance est primordiale, non pas pour faire peur, mais pour que l’employé sache qu’on ne manipule pas une vie n’importe comment.
M. le président Olivier Falorni. Je veux rappeler que nous avons voté, il y a quelques jours, dans le cadre de la loi Sapin 2, un amendement qui fait de la maltraitance sur les animaux en abattoir et lors du transport un délit. Les membres de la commission d’enquête ont soutenu cet amendement qui s’appliquera lorsque la loi sera définitivement votée. On progresse, même si ce n’est pas aussi vite qu’on le souhaiterait. Les actes de maltraitance dans les abattoirs et les transports deviendront demain des délits, et ceux qui dénonceront ces faits délictueux seront dès lors plus protégés.
Mme Anne-Claire Chauvancy, responsable protection animale de la Fondation assistance aux animaux (FAA). La Fondation assistance aux animaux a été créée en 1930 et reconnue d’utilité publique en 1989. Elle est soutenue par près de 70 000 donateurs, compte une centaine de salariés et environ 400 bénévoles, et dispose d’établissements répartis sur toute la France, qui sont aussi bien des refuges que des dispensaires, des maisons de retraite ou des centres d’accueil pour équidés et animaux de ferme.
La fondation intervient quotidiennement sur le terrain, notamment pour procéder à la saisie d’animaux maltraités, en collaboration avec les autorités administratives ou judiciaires. Elle est de plus en plus amenée à prendre en charge des animaux dits de rente – ovins, caprins, volailles, bovins – destinés à la consommation.
Je tiens à souligner que l’acte de la mise à mort des animaux en abattoir est précédé du passage en bouverie, de l’amenée, du déchargement et du transport. En 1974, la législation imposait que les animaux déchargés du camion restent douze heures au moins en stabulation avant d’être abattus afin de les calmer après un transport stressant. Ce temps de repos est tombé en désuétude, au profit de l’idée que les animaux doivent être abattus le plus rapidement possible. Les bouveries ne sont donc plus adaptées si les animaux doivent rester plusieurs heures, voire des jours, comme on l’a vu à l’abattoir de Vannes. Il arrive que les animaux restent des jours sans être nourris et abreuvés, ni pouvoir se coucher. Le rapport de 2011 du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux avait déjà mis en lumière ce problème, qui ne fait l’objet d’aucune sanction. Ce serait déjà une avancée que de prévoir l’obligation de fournir de l’eau et de la nourriture dans toutes les bouveries.
Je souligne également que l’abattage rituel constitue une dérogation à la règle. Or c’est une exception qui est malheureusement presque devenue la règle. Dans le rapport précité de 2011, les enquêteurs ont établi que plus d’un milliard d’animaux avaient été tués en abattoir en France pour la consommation en 2010. Alors que la demande en viande halal ou casher devrait correspondre à environ 10 % des abattages totaux, le volume d’abattage rituel est estimé à 40 % pour les bovins et 60 % pour les ovins. On en déduit une surproduction de viande halal. Toujours selon ce rapport, les professionnels interrogés ont indiqué préférer l’abattage rituel pour des questions de cadence et pour la possibilité qu’il offre de pratiquer une commercialisation d’opportunité. En d’autres termes, le temps, c’est de l’argent. Il est plus pratique de faire l’impasse sur l’étourdissement. C’est plus rapide et plus rentable puisque les animaux tués peuvent partir aussi bien dans le circuit conventionnel que dans le circuit rituel.
Faute d’information, le consommateur se retrouve à consommer, à son insu, un animal abattu de manière rituelle. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons revenir sur la proposition d’étiquetage de la viande. Le consommateur serait ainsi libre de choisir, en toute connaissance de cause, son produit. Le rapport de 2011 indiquait déjà que « la protection des animaux au moment de leur abattage est une question d’intérêt public qui influe sur l’attitude des consommateurs ». Si le consommateur n’est pas informé, il ne peut pas exprimer ses choix dans ses achats. L’étiquetage limiterait de facto la surproduction de viandes issues d’abattage rituel.
En outre, nous sommes favorables soit à l’interdiction de l’abattage sans étourdissement, soit au recours à l’étourdissement réversible.
Les différents rapports, notamment de l’Office alimentaire et vétérinaire de l’Union européenne (OAV), et les vidéos diffusées mettent en lumière trois sources de dysfonctionnement.
On note d’abord un défaut de formation. Les opérateurs ne sont pas formés, ils ne savent pas s’occuper des animaux ni les tuer correctement.
Ensuite, on observe un défaut de contrôle. L’absence de sanction favorise la généralisation de mauvaises pratiques. Nous sommes favorables à l’installation de la vidéosurveillance, d’une part, pour responsabiliser les opérateurs, d’autre part, pour identifier les mauvaises pratiques et pouvoir les utiliser comme contre-exemples dans le cadre de la formation.
Le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, lors du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale d’avril 2016, a reconnu qu’il n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour augmenter les effectifs de contrôle dans les abattoirs. La fondation lui a proposé, dans un courrier que je vous remettrai, de mettre à disposition du ministère de l’agriculture un certain nombre de salariés qu’elle prendrait en charge financièrement, afin de veiller au bon respect de la législation et de limiter les souffrances des animaux en abattoirs. Conscients de la réticence des abattoirs à accueillir dans leurs murs des militants de la protection animale, nous proposons que ces salariés soient choisis par les autorités compétentes et placés sous leur autorité.
Nous soutenons aussi la création d’un comité d’éthique qui garantirait une plus grande indépendance des référents bien-être animal et une remontée efficace des informations.
Enfin, on constate de nombreux dysfonctionnements de matériel qui mènent à des scènes d’horreur. On voit ainsi des animaux électrocutés à plusieurs reprises sans perdre conscience et d’autres avec la gorge cisaillée parce que le couteau est mal aiguisé. Ces problèmes ne sont pas compliqués à résoudre. En cas de dysfonctionnement, la chaîne d’abattage doit être interrompue jusqu’à réparation, et les manquements doivent être sanctionnés.
Avec l’OABA, nous plaidons pour l’habilitation de représentants d’associations spécialisées aux fins de visites inopinées des abattoirs. Aujourd’hui, les associations de protection animale sont exclues de ces lieux.
Enfin, vous l’avez rappelé, la maltraitance animale doit devenir un délit.
M. Jean-Claude Nouët, professeur, vice-président de la Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA). Je remercie la commission de s’intéresser à ce problème cruel.
La fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA) souffre d’un manque de notoriété, car elle ne mène pas d’actions de terrain. Elle travaille pour préparer des textes législatifs et proposer des amendements.
La LFDA a été fondée en 1977 par le Prix Nobel Alfred Kastler, Philippe Diolé, écrivain-explorateur, Rémi Chauvin, professeur d’éthologie à la Sorbonne, et moi-même, professeur à la faculté de médecine. Nous avons rassemblé des personnalités scientifiques, juridiques, philosophiques, littéraires, pour mettre nos compétences au service de la cause animale.
En 1978, la LFDA a été corédactrice de la déclaration universelle des droits de l’animal, proclamée solennellement à l’UNESCO, dont l’article 3-2 dispose : « si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse ».
En 1985, la LFDA a obtenu le premier règlement européen imposant l’étiquetage du mode d’élevage des poules sur les boîtes d’œufs, puis la modification du code civil distinguant l’animal des objets et des corps inertes dans la loi du 6 janvier 1999, ainsi que la répression par le code pénal des sévices sexuels sur les animaux dans la loi du 9 mars 2004. En 2005, Mme Suzanne Antoine, administrateur de la LFDA et ancienne magistrate à la cour d’appel de Paris, a été chargée par le garde des sceaux Dominique Perben de préparer un rapport sur le régime juridique de l’animal ; ce rapport a été publié à la Documentation française, et s’il n’a pas eu de suites immédiates, ses propositions de modification du code civil ont inspiré directement les initiatives ultérieures, parlementaires comme associatives.
Sous les présidences successives de Rémi Chauvin, Alfred Kastler, Etienne Wolff de l’Académie française, Albert Brunois membre de l’Institut, moi-même, et, depuis 2012, Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement, la LFDA a publié plusieurs ouvrages dont, en 1981, Le grand massacre, première analyse critique de l’élevage industriel. Elle a organisé onze colloques à l’Institut de France, au Collège de France, à l’Université Pierre et Marie Curie, dont les deux derniers, « La souffrance animale, de la science au droit » en 2012, à l’Organisation mondiale de la santé animale, et « Le bien-être animal de la science au droit », à l’UNESCO, en 2015, ont connu un retentissement international. En 2010, en changeant notre intitulé en Fondation droit animal, éthique et sciences, nous avons voulu souligner notre ligne d’action constante : faire progresser le droit en se fondant à la fois sur les avancées des connaissances scientifiques sur les animaux, quels qu’ils soient, et sur l’évolution de la sensibilité éthique de nos sociétés à leur égard.
La fondation a toujours considéré l’élevage comme un sujet primordial. Il faut savoir que, dans le comptage des animaux impliqués, l’abattage se classe à la première place, avec 100 millions d’animaux annuels, devant la chasse, 30 millions d’animaux, et l’expérimentation, 2 millions. Ces chiffres nous montrent les trois grands sujets dont nous devons nous occuper, au premier rang desquels l’élevage, et nécessairement l’abattage, puisque l’un ne va pas sans l’autre.
Que demandons-nous ?
Tout d’abord, l’étourdissement systématique avant tout abattage. L’absence d’étourdissement est contradictoire avec les prescriptions générales du règlement européen. Les dérogations qui la permettent ne respectent en rien le caractère sensible de l’animal à qui ne sont épargnées ni douleur, ni souffrance, ni angoisse. Elles sont accordées à plus de la moitié des abattoirs en France, et rendent impossible pour le consommateur un choix en toute connaissance de cause. À défaut de suppression des dérogations, nous demandons, lors d’un abattage sans étourdissement préalable, que soit pratiqué au moins un étourdissement post-jugulation immédiat.
Les images des abattoirs d’Alès, du Vigan et de Mauléon, et celles aujourd’hui même, de Pézenas et du Mercantour, montrent des actes de maltraitance et de cruauté inadmissibles. On peut se demander si le personnel est véritablement conscient des peines qu’il encourt. Nous demandons que de véritables mesures dissuasives soient mises en place ; cela doit passer par un durcissement des peines. Monsieur le président, vous avez fait allusion à l’amendement qui a été adopté dans le projet de loi Sapin 2, c’est une excellente chose. Nous demandons que les mesures dissuasives aillent au-delà. Les peines en cas d’acte de cruauté sont inférieures à celles prévues en cas de vol – deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende contre trois ans et 45 000 euros. Or il est infiniment plus grave, du point de vue moral, de torturer un animal que de le voler. Des peines alourdies seraient certainement plus dissuasives.
L’article L. 1132-3-3 du code du travail prévoit une protection du salarié d’abattoir devenu lanceur d’alerte. Cette protection lui permet ainsi de ne pas se retrouver en situation de conflit d’intérêt. Le salarié doit connaître ces dispositions et les manquements graves à la loi qu’il peut constater afin de pouvoir agir. Ces points doivent être notifiés dans les contrats de travail et lors des formations, mais aussi affichés au sein des abattoirs.
Les formations dispensées au personnel opérateur comme au responsable protection animale sont insuffisantes. Elles restent théoriques. Comment garantir qu’une formation généraliste, souvent réduite à une journée au lieu des deux prévues, passée autour d’une table, puisse permettre au personnel d’effectuer les bons gestes ? Un volet pratique doit être mis en place, ce qui induit un allongement du temps de formation.
Le taux de réussite à l’examen, comme cela a été rappelé par le ministre, est de 99 % – on n’a jamais vu ça, c’est tout à fait exceptionnel. En outre, lors de l’examen, l’accès à internet est autorisé, ce qui facilite les réponses, et le système de notation est fixé par instruction ministérielle. Par ailleurs, une partie du personnel d’abattoir ne parle pas couramment le français. Enfin, l’examen se passe dans la foulée de la formation ; c’est le meilleur moyen pour que les connaissances ne soient pas mémorisées Pour ces raisons, il semble difficile d’affirmer que la formation et son évaluation suffisent pour former correctement le personnel.
Par ailleurs, la France est le quatrième pays pour l’abattage d’équins en Europe ; il est regrettable que ces animaux soient traités comme les bovins, dont ils sont pourtant différents d’un point de vue morphologique et comportemental.
Un responsable protection animale devrait être présent dans tous les abattoirs, alors que le règlement européen fixe un seuil minimal pour exiger cette présence. Il doit pouvoir y jouer un rôle central. En interaction avec le personnel placé sous sa responsabilité et en lien avec la direction, ses missions doivent être précisées ; il doit être doté d’un statut particulier lui garantissant de disposer du temps nécessaire à la réalisation de ses missions. Par exemple, nous demandons que le responsable protection animale soit chargé de mettre en place une formation continue permettant au personnel de concrétiser les connaissances acquises lors de sa formation initiale dans le cadre de l’abattoir pour lequel il travaille.
Le matériel devrait être amélioré. En outre, certaines pratiques, parce qu’elles ne garantissent pas un véritable étourdissement et parce qu’elles sont sources de souffrance, douleur et angoisse, doivent être remises en cause : étourdissement par gazage au CO2 des porcs, électronarcose des ovins, bain électrique chez les volailles. Afin que l’animal ne soit pas saigné en étant conscient, la vérification de la perte de conscience doit être systématique. Les modes opératoires et les signes de réapparition de la conscience devraient être connus et affichés.
Enfin, la LFDA encourage les responsables d’abattoir à mettre en place un système d’enregistrement vidéo, lequel, s’il peut décourager les actes de malveillance, peut principalement être un outil de formation continue, permettant de montrer en quoi tel geste est incorrect, et d’enseigner le geste approprié.
M. le président Olivier Falorni. Je souhaite vous poser une question très générale : la maltraitance animale est-elle, selon vous, consubstantielle à un abattoir ? En d’autres termes, si le contrôle était renforcé, les sanctions alourdies, la formation améliorée et les équipements modernisés, pourrait-on éviter la maltraitance animale, ou pensez-vous que, par définition, un animal est maltraité dans un abattoir ?
M. Jean-Claude Nouët. Certainement pas. La maltraitance n’est pas consubstantielle. On peut parfaitement, grâce à des efforts sur tous les plans, espérer que la maltraitance n’advienne plus. Le même problème s’est posé en matière d’expérimentation animale, où l’expérimentateur était associé à un horrible individu qui torture l’animal. Or ce n’est pas du tout la réalité ; cela l’a été par ignorance de la sensibilité animale à la douleur et à la souffrance – comme d’ailleurs pour les enfants jusque dans les années soixante. Dès lors que des règles sont établies, il n’y a aucune raison que des actes de malveillance soient commis à condition que celles-ci soient suivies dans tous les domaines.
Mme Anne-Claire Chauvancy. Je rejoins les propos du professeur Nouët. La mise à mort est toujours un acte très dur, mais il est possible de limiter au maximum les souffrances, les angoisses, les peurs, et le stress des animaux en abattoir avant et lors de la mise à mort. L’abattage peut se faire sans mauvais traitements ; c’est parfois le cas dans les « bons » abattoirs. Lorsque le matériel fonctionne, que les opérateurs sont formés et que des contrôles sont effectués, cela se passe mieux.
M. Jean-Claude Nouët. Si vous posez la question, monsieur le président, c’est que vous connaissez la réponse.
M. le président Olivier Falorni. C’est une question très candide.
M. Jean-Claude Nouët. C’est une réponse de bon sens.
M. le président Olivier Falorni. Cela va mieux en le disant.
M. Arnauld Lhomme. C’est difficile de répondre. Le problème vient parfois du personnel – certains commettent ces actes de cruauté par plaisir, par sadisme. Mais on sera toujours dans un abattoir. Il est difficile de donner la mort sans que l’animal le sente. Les animaux sentent ce qui se passe devant eux, c’est pour cette raison qu’on essaie de faire en sorte qu’ils ne soient pas témoins. Aujourd’hui, il est difficile de dire qu’il n’y a pas de mauvais traitements dans les abattoirs. Et au vu des enquêtes que j’ai menées, je considère que, selon la manière dont elle est donnée, la mort peut-être synonyme de maltraitance.
M. David Chauvet. Si on met de côté la question de la mise à mort des animaux et qu’on se concentre sur la souffrance, nous sommes tous d’accord pour admettre que l’acte de tuer un animal est un acte d’une extrême violence. M. Michel Le Goff, membre de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail, l’a dit ici même le 26 mai.
On entend beaucoup de gens dire que la souffrance des animaux ne pourrait être effacée dans le processus qui conduit à la viande. Martial Albar, qui a travaillé comme inspecteur vétérinaire dans les abattoirs pendant douze ans, fait cette remarque assez glaçante : « En 2016, en France, on est incapable de tuer les animaux sans les faire souffrir ». La question mériterait une étude approfondie.
En ne se donnant pas les moyens d’appliquer la législation qui est censée prévenir les actes de maltraitance, on fait l’aveu qu’on accepte un système qui fait souffrir les animaux. Il faut saluer la création du délit de maltraitance, mais si l’on s’en tient à la loi sans avoir les moyens de l’appliquer, on reste au milieu du gué. En même temps qu’on s’interroge sur les peines et qu’on cherche à les homogénéiser – dans le code rural, la maltraitance concernait les élevages, pas les abattoirs et le transport –, il faut donner les moyens de mettre en œuvre ces sanctions.
M. Alain Pittion. Je n’ai pas grand-chose à ajouter. Il faut insister sur le contrôle et le matériel. Deux remarques en la matière : alors qu’un deuxième matador, matériel utilisé pour l’étourdissement des bovins, doit obligatoirement pouvoir remplacer le premier en cas de dysfonctionnement, il n’est pas toujours présent ; l’inspection ante mortem faite par des vétérinaires, pourrait être étendue à la prévention des mauvais traitements.
Mme Sylviane Alaux. Je vous remercie, monsieur Nouët, de nous avoir rappelé des chiffres que nous ignorons ou que nous ne voulons tout simplement pas connaître. Il nous faut, de temps en temps, avoir le courage de nous mettre à face ces réalités.
Vous avez évoqué le fait que certains salariés ne parlent pas français. Cela sous-entend-il qu’on fait de plus en plus appel dans les abattoirs à des personnels étrangers qui n’auraient pas de formation – ou qui, du moins, seraient encore moins formés que les autres – et qui, pour certains, ne seraient pas déclarés ? Ai-je l’esprit tordu ou est-ce une réalité qui s’impose de plus en plus à nous ?
Madame Chauvancy, vous parlez de mettre à disposition des salariés qui seraient pris en charge financièrement. Je suis surprise d’une telle proposition de la part d’une fondation. L’argent de vos donateurs suffit-il à prendre de tels engagements financiers ? Quelles garanties pouvez-vous apporter ? Quels fonds « secrets » vous permettent de faire une telle proposition ?
Mme Anne-Claire Chauvancy. C’est une proposition que nous avons envisagée du fait de l’urgence à régler le problème posé dans les abattoirs. À notre sens, sans effectifs humains, ce problème ne sera pas convenablement ou immédiatement réglé. Or, chaque jour qui passe, des animaux sont abattus dans des conditions inacceptables. Nous estimons que cela relève du rôle de la fondation Assistance aux animaux qui a statutairement la mission de lutter contre la souffrance animale. Cela étant, cette proposition n’est pas aboutie pour l’instant. C’est un point sur lequel nous devrions discuter avec le ministère de l’agriculture, les représentants des abattoirs, les associations de protection animale et toutes les personnes concernées. La fondation a les ressources nécessaires pour financer un certain nombre de salariés pendant une période d’un an, éventuellement renouvelable. Tout dépend évidemment du montant des salaires, du nombre de salariés et du type de contrats. La fondation pourrait financièrement assumer cette charge, sous réserve que ces salariés aient pour mission de veiller à la protection animale dans les abattoirs.
Mme Sylviane Alaux. Avec quel argent ?
Mme Anne-Claire Chauvancy. La fondation Assistance aux animaux a un patrimoine et des réserves lui permettant de subvenir aux besoins des établissements pour pallier d’éventuelles difficultés économiques. Une partie de nos réserves pourrait être utilisée dans ce but.
M. Jean-Claude Nouët. Vous m’avez demandé qui étaient les salariés ne parlant pas français. Ce n’est pas moi qui lance les appels d’offre. Si l’information sur laquelle nous nous sommes fondés est exacte, ce sont des gens qui cherchent un travail sans en connaître du tout les conditions et les difficultés. Et il se trouve que parmi ceux qui cherchent un travail en France, certains ne parlent pas français. Je ne sais pas quelle langue ils parlent ni de quel pays, de l’Est ou du Sud, ils viennent. Mais cela pose un gros problème, car si on ne parle pas français, à quoi sert la formation ? On reste assis autour de la table et c’est tout. Il y a un très gros effort à faire quant aux modalités, à la durée et au contenu de ces formations ainsi que sur la valeur qu’il faut leur accorder et sur le contrôle de l’acquisition des notions qui y sont dispensées. D’ailleurs, on se moque un peu du résultat : quand on se contente de dire qu’il y a 99 % de résultats, c’est qu’on ne connaît pas la question.
Monsieur le président, je reviens sur votre question de tout à l’heure : les actes de malveillance à l’égard des animaux ne sont pas consubstantiels à l’abattoir, ils sont consubstantiels à la nature humaine. Quoi qu’on fasse, il y aura toujours des assassins et des voleurs. C’est inéluctable. Quand ils se trouvent dans un abattoir, c’est dramatique.
M. le président Olivier Falorni. Certes, mais ce n’était pas le sens de ma question. Malheureusement, on sait que les choses sont ainsi, en abattoir comme dans la société. C’est d’ailleurs pourquoi, bien que des policiers et des gendarmes soient présents dans la rue, la société a jugé utile de compléter cette surveillance humaine par de la vidéosurveillance dans quelques endroits. Sans vouloir faire de comparaisons, on voit bien que partout, à l’Assemblée nationale comme dans les abattoirs, il y a des gens qui sont en dehors de la loi. Ma question était de savoir si l’abattoir est forcément un lieu de maltraitance. Il va de soi qu’il y aura toujours des gens malveillants. L’important aujourd’hui est de pouvoir les voir, les arrêter et les sanctionner.
M. Jean-Claude Nouët. L’abattoir peut ne pas être un lieu de malveillance si on fait le nécessaire.
M. Hervé Pellois. Vos exposés ont été de nature très différente. Même certains parmi vous doivent, après l’exposé de M. Chauvet, se sentir des meurtriers. À l’entendre, on a l’impression que comme l’euthanasie est interdite en France, quand on a été vétérinaire et qu’on a euthanasié des animaux, on est un meurtrier potentiel.
Je voudrais m’intéresser plus particulièrement à l’étourdissement, et ma question s’adresse plutôt au professeur Nouët. Compte tenu des nombreuses réflexions qu’il a pu mener, peut-être est-il capable de nous apporter plus d’éléments sur la vérification de la perte de conscience avant saignée. A-t-on les moyens, à l’échelle d’un abattoir, de faire ce travail de manière sûre à 100 % ? Beaucoup des choses qui ont été dites ont trait à cet aspect, et s’il en est beaucoup question lors de chaque audition, nous restons quand même toujours dans le flou. Nous n’avons pas l’impression qu’il existe un diagnostic permettant de savoir si le processus peut continuer ou pas. Pourtant, tous les intervenants que nous avons entendus se sont dits préoccupés par la souffrance et les actes de cruauté qui sont dénoncés dans les vidéos diffusées.
M. Jean-Claude Nouët. Ce qui est intéressant, c’est de rechercher des signes, non pas de perte de conscience, mais de reprise de la conscience. Nous travaillons avec des collaborateurs qui appartiennent à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), des ingénieurs agronomes et des personnes qui ont de l’expérience en ce domaine. Il ne me semble pas qu’il existe un document qui, espèce par espèce, énumère avec précision les signes de reconnaissance de l’inconscience et les signes les plus faciles à déceler de reprise de la conscience. C’est une question extrêmement importante, à tel point que nous avons suggéré que les signes de reprise de conscience ou d’inconscience soient en permanence sous les yeux des opérateurs. Je ne sais même pas si on leur en parle en formation, car je n’en ai pas vu les programmes. Il serait intéressant que les signes les plus patents, qui permettent un diagnostic rapide – car la chaîne n’attend pas –, soient clairement identifiés et affichés sous les yeux de l’opérateur qui va prendre en charge l’animal immédiatement après l’égorgement. Car l’animal peut être égorgé sans être forcément totalement inconscient. Lorsqu’il y a égorgement sans étourdissement préalable, la perte de conscience n’est pas immédiate : elle dure jusqu’à une demi-minute, quelquefois plus. Il a même été cité des cas d’attente de plus de dix minutes avant que la perte de conscience ne survienne par hémorragie. Or une chaîne ne s’arrêtera pas même si l’on sait qu’un animal mettra dix minutes à perdre conscience. Et il est absolument certain – et monstrueux – que des animaux entrent dans la chaîne de déshabillage alors qu’ils ne sont pas totalement inconscients. Il ne me semble pas que nous disposions d’une liste claire à mettre sous les yeux des opérateurs de façon à ce qu’ils puissent l’utiliser facilement. Je suis désolé de ne pas répondre avec précision à votre question.
M. Alain Pittion. La perte de conscience peut très facilement être vue et suivie sur un animal seul. Le problème est de pouvoir le faire dans une chaîne. Techniquement, on est tout à fait capable de voir si un animal est encore conscient ou pas. Le problème, c’est qu’il faut aller vite.
M. Jean-Claude Nouët. Il y a plusieurs signes à identifier, ce qui prend du temps, et la chaîne n’attend pas.
M. Jean-Luc Bleunven. Vous avez évoqué le fait que le consommateur ne pouvait pas choisir sa viande en connaissance de cause. Des expériences visant à l’informer quant à la qualité des conditions d’abattage d’un animal ont-elles été tentées ? Avez-vous des initiatives à proposer sur cette question ? Cela permettrait de faire évoluer la situation, dans la mesure où le choix des consommateurs induirait en amont des options différentes.
M. Jean-Claude Nouët. Les demandes d’étiquetage des viandes spécifiant le mode d’abattage des animaux ont été rejetées au motif que cela risquait d’être discriminatoire. Notre fondation a donc proposé un étiquetage, destiné au consommateur, certifiant que l’animal a été abattu après étourdissement. Certains veulent voir préserver leur liberté de conscience, très clairement mentionnée à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais cette même liberté peut susciter chez d’autres la volonté de consommer de la viande venant d’un animal qui n’a nullement souffert, c’est-à-dire qui a été abattu après étourdissement. Il me semble que ce type d’étiquetage positif, et non pas négatif, satisferait à la fois le consommateur désireux d’acheter cette viande et celui qui, pour des raisons religieuses, ne le ferait pas. C’est une proposition que nous avons faite au ministère de l’agriculture.
Mme Anne-Claire Chauvancy. Nombre de nos donateurs veulent savoir comment l’animal qui a donné la viande qu’ils achètent a été tué et s’il a souffert ou pas. Nous avons donc déjà observé à notre échelle une forte demande. Ce constat a également été établi dans le rapport de 2011 sur la protection animale en abattoir, qui relève que « la protection des animaux au moment de leur abattage est une question d’intérêt public qui influe sur l’attitude des consommateurs » et aussi qu’« on ne peut pas nier que la souffrance animale cohabite mal avec le consommateur ». La place de l’animal grandit dans notre société de même que l’intérêt du citoyen à l’égard de celui-ci. Le consommateur n’a pas envie de se nourrir d’animaux qui ont souffert. Nous en avons l’exemple avec l’étiquetage des œufs, de zéro à trois. Une fois que cet étiquetage a été mis en place, on a observé une nette augmentation de la consommation d’œufs qui n’avaient pas été pondus par des poules élevées en batterie. La demande sociétale étant forte, il importe d’y répondre.
M. Jean-Claude Nouët. C’est bien pourquoi nous avons agi dès 1984 au niveau européen. En 1985, nous avons obtenu le premier règlement sur l’étiquetage du mode d’élevage des poules, pour permettre au consommateur de ne pas acheter d’œufs pondus par des poules détenues en cage. Cela a très bien fonctionné.
M. Alain Pittion. Pour les consommateurs, l’abattage avec étourdissement – ou plutôt après insensibilisation – représente une garantie sanitaire supplémentaire. Désormais, dans l’esprit de beaucoup d’entre eux, l’abattage dit « rituel » présente des risques pour la santé, en plus de poser un problème de souffrance animale. Il est peut-être plus facile d’insister sur cet aspect sanitaire que sur la souffrance qui, rappelant l’abattage rituel, a des connotations religieuses. Je ne donnerai pas les détails de ce qui peut se passer lorsqu’un animal est égorgé sans avoir été insensibilisé et qu’il se vide par l’avant et l’arrière, en se débattant. Un consommateur achète des fruits bio, non pas parce qu’ils n’ont pas souffert, mais parce qu’on leur suppose une meilleure qualité sanitaire.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Je vous demanderai quelques précisions en matière de contrôle. Des alertes ont été lancées et des statistiques de dysfonctionnement remontent jusqu’à nous. Cela veut dire que le niveau de bien-être animal n’est pas satisfaisant dans les abattoirs. Peut-on en déduire, alors que ce sont des lieux très contrôlés sur le plan sanitaire, que le bien-être animal y reste secondaire aujourd’hui ? Faudrait-il organiser un contrôle spécifique du bien-être animal et non seulement un contrôle sanitaire ?
Il ressort de vos propos que le contrôle doit poursuivre un double objectif de surveillance, permettant éventuellement de sanctionner un acte délictueux, mais aussi de perfectionnement ou d’apprentissage du juste geste qui, dans un passé encore récent, se faisait grâce à un contrôle des pairs, à mesure que les cas particuliers survenaient. Ce n’est pas lorsque tout va bien mais lorsqu’il y a difficulté que la connaissance et l’expérience apportent du secours. Pensez-vous que la vidéo soit plutôt un outil de surveillance ou de perfectionnement ? Comme vous, je mets de côté la question de savoir qui doit avoir accès aux images – État ou comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – et quel doit être leur traitement juridique. Cette vidéo doit-elle nécessairement être activée en continu ou bien seulement être installée de façon continue et déclenchée de façon stochastique, les salariés étant informés qu’ils peuvent être contrôlés à tout moment ? Car regarder toutes les images tout le temps est aussi prégnant en termes de personnel que si un inspecteur était là en permanence.
Je suis très surpris des problèmes de matériel. J’ai l’impression que dans beaucoup de cas, les abattoirs sont encore, sinon dans le bricolage, du moins dans l’expérimentation. Le matériel ne devrait-il pas faire l’objet de davantage de certifications et d’expertise, notamment en matière de contention et d’amenée ?
Enfin, s’agissant du contrôle des installations mêmes, ne pensez-vous pas qu’on a tendance à laisser les bouveries en l’état au motif qu’il serait compliqué de les changer ? Même si l’on se concentre éthiquement sur la mise à mort, le temps passé et les souffrances possibles sont quand même de plus longue durée entre le moment où l’animal est débarqué et son arrivée au poste de mise à mort. J’ai le sentiment que c’est à cet endroit que le problème est le plus grave, car le reste dure heureusement peu de temps – même si cela reste toujours trop long en cas de souffrances. Ne pourrait-on faire un effort de certification, de contrôle et d’aide à la conception ? Comment expliquer que du matériel ne fonctionne pas alors qu’il n’a que cinq ans d’âge ?
M. David Chauvet. Le constat que vous dressez de ces multiples carences s’explique par l’état très insatisfaisant du matériel. La protection animale dans les abattoirs est entièrement à faire. Finalement, sans les images révélées par l’association L214, les Français ne se poseraient pas la question et les choses continueraient comme actuellement.
Les aspects préventif et répressif de la vidéosurveillance ne s’opposent pas du tout. On peut parfaitement utiliser des images pour aider à la formation et, dans le même temps, pour sanctionner un délit de maltraitance qui, encore une fois, n’a aucun intérêt si sa reconnaissance n’est pas assortie de moyens permettant de le réprimer.
On a beaucoup évoqué la question de savoir si la vidéosurveillance était légale et juridiquement recevable. Il faudrait aussi se poser la question de savoir si l’absence d’information des associations ne serait pas en elle-même illégale. Ces dernières ont une mission d’information et de protection judiciaire des animaux, conformément au code de procédure pénale. Or, du fait de l’opacité qui règne dans les abattoirs, les associations n’ont strictement aucun moyen de mener à bien leur mission, si ce n’est en révélant des vidéos clandestines. Pourtant, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que la liberté d’expression recouvre tant la liberté d’informer que celle d’être informé. Un arrêt Guseva contre Bulgarie du 17 février 2015 a d’ailleurs posé le principe pour la question animale. Il est quasiment une obligation juridique que les associations puissent avoir accès à ce qui se passe dans les abattoirs pour pouvoir assurer leur mission d’information et de protection judiciaire des animaux.
M. Arnauld Lhomme. Deux veaux seront toujours différents, que ce soit en termes de morphologie, de poids ou autre. Lorsqu’un animal se retrouve devant un box rotatif et qu’il n’est pas bloqué, il peut se retourner et ne sera pas immobilisé, ce qui pose un gros problème. Je pense que l’animal devrait être étourdi et abattu au sol et ne devrait même pas se retrouver dans un tel box. Combien d’accidents se sont produits à cause de ces box ? Y mettre les animaux est complètement illogique : moi-même, je suis petit et gros et une autre personne du même âge que moi sera grande et de morphologie différente.
En matière de vidéosurveillance, je reviendrai sur le procès dont je vous parlais tout à l’heure s’agissant d’un animal arrivé le samedi avec l’arrière train cassé et abattu seulement le lundi. Il est peut-être difficile de faire de la vidéosurveillance 24 heures sur 24, mais il y a, dans beaucoup d’agences de sécurité, des gens qui passent leur vie devant des écrans. C’est même le cas de certaines polices municipales. On peut donc placer un opérateur devant un écran en permanence pour avoir une sécurité visuelle : en cas de problème, on pourra appeler le vétérinaire de sorte que l’animal ne soit pas mis sur la chaîne d’abattage mais qu’il soit abattu dans la cour ou ailleurs. Normalement, lorsqu’il y a abattage d’urgence, l’animal passe en priorité. Or, en l’espèce, l’animal n’a été abattu que quarante-huit heures plus tard.
La fondation 30 millions d’amis n’est pas pour la répression mais pour que les méthodes changent et pour trouver des solutions, comme vous tous. On parle d’abattoir pour les visons mais ces animaux ne passent pas en abattoir : c’est l’éleveur qui les abat lui-même. J’ai lancé, il n’y a pas longtemps, une procédure contre un éleveur de Besançon dont je tairai le nom : vous ne pouvez même pas imaginer comment il procède. Même les animaux morts servent à nourrir les autres. Il a été condamné pour ce qui est aussi considéré comme un système d’abattage, mais il a recommencé. La notion d’abattoir est très générale.
Mme Anne-Claire Chauvancy. Que le contrôle ne s’effectue pas du vivant de l’animal mais plutôt après sa mort, nous ne pouvons qu’être d’accord avec ce constat. En principe, un vétérinaire doit contrôler les animaux avant l’abattage et au moment de celui-ci ; or on ne le voit pas sur les vidéos. Il est probablement ailleurs ou peut-être n’est-il pas là par manque d’effectifs. La mise à mort est quand même un instant plus sensible que la découpe de l’animal. La vidéo permettrait de pallier cette absence. Elle est aussi un formidable outil de formation parce qu’en visualisant les gestes sur images, on les retient mieux qu’en discutant et en lisant une feuille de papier autour d’une table. Vous avez aussi parlé de la transmission des connaissances pratiques des anciens : c’est un point que nous évoquons dans un document que nous allons vous remettre. Nous pensons effectivement que la formation théorique devrait être complétée par une formation pratique encadrée par du personnel compétent – c’est-à-dire des personnes ayant déjà de l’expérience dans l’entreprise.
Par ailleurs, David Chauvet parlait de la place des associations en abattoir. Alors qu’un milliard d’animaux sont abattus en abattoir chaque année en France, il n’y a pas d’association de protection animale dans ces structures alors que c’est là que leur présence est nécessaire, et même absolument vitale. Je sais que cela fait peur, mais on ne parle pas de n’importe quelles associations. Ce sont des associations spécialisées, des personnes qui connaissent la législation et le domaine. Il nous paraît essentiel que ces dernières soient habilitées à visiter les abattoirs.
M. le rapporteur. On a, à plusieurs reprises, fait l’analogie avec d’autres installations classées, telles que les centrales nucléaires et les centres de traitement d’ordures ménagères, au sein desquelles sont présentes des commissions locales d’information et de surveillance. Participent à ces dernières des professionnels, des représentants du personnel, l’administration mais aussi des associations de riverains ou des associations spécialisées. Ces commissions servent de sas entre le monde des consommateurs et des citoyens et celui des spécialistes, qui aujourd’hui ne se parlent pas beaucoup, les uns soupçonnant les autres soit de ne pas tout dire, soit de ne pas vouloir être objectifs. Constituer des commissions dans lesquelles on trouverait des représentants d’associations de consommateurs, de riverains et de protection animale et auxquelles on donnerait la possibilité d’échanger régulièrement mais aussi de participer à des visites, prévues ou pas, ne serait-il pas une solution ?
Mme Anne-Claire Chauvancy. Ce serait une voie envisageable qui ne pourrait être que positive, si toutefois cette commission dispose de moyens suffisants pour assurer sa mission.
M. Jean-Claude Nouët. Les contrôles portant spécifiquement sur le bien-être animal n’existent effectivement pas. Des vétérinaires inspecteurs sont présents dans tous les abattoirs, mais ils sont essentiellement occupés à vérifier la qualité des viandes. Leur rôle principal consiste à apposer le coup de tampon final certifiant que telle ou telle carcasse est bonne. En principe, ils devraient aussi s’occuper des postes précédant la mise à mort, mais ils n’ont apparemment pas le temps de tout faire. Le contrôle du bien-être animal n’est pas suffisamment effectué, notamment à la bouverie où les animaux attendent. Il est probable que de nombreuses installations ne facilitent pas la fluidité de la marche. Or les animaux, lorsqu’ils sont un peu empêchés ou gênés, ressentent automatiquement un stress ; et quand un animal est stressé, on le conduit mal jusqu’à l’immobilisation. C’est là un moment de l’abattage qui devrait être largement amélioré.
S’agissant de la vidéo, j’y vois certes un moyen de surveillance des actes, mais surtout un moyen capital d’amélioration de la formation – y compris continue – pouvant être utilisé a posteriori pour montrer ce qui a été mal fait et comment mieux faire.
M. David Chauvet. Je doute très fortement, pour les raisons évoquées tout à l’heure, de l’efficacité des visites, qu’elles soient inopinées ou pas. La question qui se pose réellement est de savoir si les associations doivent avoir un droit d’accès aux vidéos et comment ces dernières pourraient être mises à disposition sans risque qu’elles soient malencontreusement diffusées – sachant que si cela arrivait, la responsabilité de l’association serait engagée et la diffusion devrait aussi être sanctionnée.
La question du contrôle que pourraient exercer les associations se pose dès lors que les fonctionnaires n’ont pas suffisamment d’effectifs pour pouvoir contrôler l’ensemble des enregistrements, même de manière aléatoire. Que l’on filme de manière continue ou ponctuelle, on ne pourra effectivement pas visionner l’ensemble des enregistrements. Mais on peut toujours, sur une large période, observer les abattoirs de manière ponctuelle ou peut-être visionner les vidéos en accéléré. Je ne connais pas vraiment la manière dont on procède habituellement, mais j’imagine que plus on a d’enregistrements, mieux le contrôle peut être exercé. Je serais donc plutôt partisan d’enregistrements en continu – ce qui, comme je le disais tout à l’heure, n’a rien d’illégal – et favorable à la reconnaissance, au profit des associations, d’un droit d’accès à ces enregistrements, dans le cas où l’État ne serait pas en mesure d’assurer un contrôle suffisant.
L’employeur peut exercer un contrôle sur ses employés puisque ces derniers peuvent commettre des gestes malencontreux sans qu’il en soit responsable. Mais sa responsabilité est désormais en cause dans les abattoirs sur le fondement de l’article L. 215-11 du code rural. Un contrôle extérieur doit donc être effectué soit par les fonctionnaires de l’État, soit par les associations, soit par les deux.
M. le rapporteur. Vous dites que les visites, inopinées ou non, n’ont pas beaucoup d’intérêt. Vous savez sans doute qu’historiquement, les abattoirs ont été conçus pour soustraire à la vue du public la mise à mort des animaux. D’après ce que j’ai pu entendre en audition et lors des visites que nous avons faites, j’ai l’impression qu’il en résulte, chez les gens qui travaillent en abattoir, un sentiment de relégation qui finit par justifier le particularisme de leur attitude vis-à-vis de l’extérieur et par légitimer les actes accomplis : « comme on est dans un abattoir, qu’on n’est pas regardé parce qu’on ne veut pas nous voir, cela se passe comme ça. » Briser cette opacité, même par des visites organisées, c’est porter le regard, avec une certaine bienveillance, sur les gens qui travaillent dans ce lieu, et cela les tire du côté de l’amélioration plutôt que de la relégation. Comme il est dit dans le film : « On fait un sale métier mais on a une excuse, on le fait salement ». Je pense que briser le voile pudique que nous avons voulu mettre sur notre responsabilité de consommateurs de viande serait un facteur d’amélioration. C’est une opinion plus qu’une question.
M. David Chauvet. Je suis tout à fait d’accord avec vous. Sortir de l’isolement les employés d’abattoir peut contribuer, à titre préventif, à leur faire prendre conscience de la nécessité de respecter la législation sur la protection des animaux. Tout à l’heure, je parlais plutôt de l’aspect répressif puisqu’on a pu constater que les visites ne permettaient pas le respect de la législation. Mais encore une fois, les volets préventif et répressif ne s’excluent pas ; d’une manière générale, on les associe. L’erreur serait de ne s’en tenir qu’à un seul des deux : l’aspect répressif seul n’empêchera pas les maltraitances s’il n’y a pas de prise de conscience des employés ; l’aspect strictement préventif ne permettrait pas cette prise de conscience non plus.
M. Alain Pittion. Ce sont, pour moi, les contrôles qui sont importants. Comme vous venez de le dire, monsieur le rapporteur, ils peuvent valoriser le personnel qui travaille dans les abattoirs et qui n’est effectivement pas toujours très bien considéré.
Le matériel est un autre point très important. Dans les abattoirs où j’ai eu l’occasion d’aller, j’ai pu constater que le matériel prévu par les textes n’était pas en état. Je pense notamment au pistolet d’étourdissement, le matador, qui doit s’y trouver en deux exemplaires, car si l’on rate le premier coup, le deuxième finira le travail. Le box rotatif, dont M. Lhomme a parlé, serait en effet un point à revoir. J’ai pu voir que, la plupart du temps, il ne fonctionnait pas comme prévu : les veaux arrivaient dans des positions extraordinaires et souffraient énormément. La réglementation n’est pas si mal faite, c’est son application qui pose problème.
S’agissant de l’abattage sans étourdissement, il conviendrait d’insister, vis-à-vis des citoyens et des consommateurs, sur le volet sanitaire. La souffrance animale est une chose, la question sanitaire en est une autre. Je ne parlerai pas de l’abattage sans étourdissement, mais l’abattage avec insensibilisation préalable donne quand même une viande de meilleure qualité et fait courir moins de risques sanitaires au consommateur. Je précise que les religions qui ont mis en avant l’abattage sans insensibilisation ont pris naissance dans des pays chauds où, traditionnellement, un animal ainsi abattu se vidait mieux de son sang et sa viande se conservait mieux. Telle est l’origine de cette pratique. Or, de nos jours, l’animal insensibilisé se vide aussi bien de son sang que l’animal qui ne l’est pas.
M. Arnauld Lhomme. Les associations sont toujours aussi à l’écoute des abattoirs. On peut dire que l’OABA fait un audit des abattoirs. Ses enquêteurs et inspecteurs sont des anciens des services vétérinaires, ils connaissent très bien le problème. Ils vont dans les établissements dire aux personnels ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a donc vraiment une relation de confiance entre les associations et les abattoirs, même s’il est vrai que quelques-uns ont fermé leurs portes. Compte tenu de sa connaissance du problème, l’OABA pourrait être reconnue comme pouvant contrôler ce type d’établissement en toute symbiose avec l’État. Quant à l’association de M. Nouët, elle fait partie du Comité d’éthique. Il y a donc des associations qui, étant dans le milieu, peuvent parler des problèmes sans être extrémistes, pour faire avancer les choses. Enfin, peut-être qu’à notre époque, l’abattage sans étourdissement ne devrait plus avoir lieu. Beaucoup de pays d’Europe l’ont interdit, peut-être devrions-nous prendre exemple sur eux.
Mme Anne-Claire Chauvancy. De nombreuses mesures faciles et rapides à mettre en place pourraient résoudre les problèmes soulevés : vidéo, contrôle du matériel, création d’un comité d’éthique, organisation de visites d’associations spécialisées et renforcement des sanctions.
Pour finir, je citerai Clemenceau, selon qui « quand on veut enterrer un problème, on crée une commission ».
M. le président Olivier Falorni. Pour une fois, je suis en désaccord avec lui.
Mme Anne-Claire Chauvancy. J’ai un dossier rempli de rapports sur les abattoirs, et rien n’a été mis en place à la suite de leur publication. Nous espérons donc sincèrement que le vôtre aura une utilité concrète et permettra de faire avancer le débat.
M. le président Olivier Falorni. Clemenceau faisait sans doute référence à des comités Théodule. Nous constituons ici une commission d’enquête parlementaire bénéficiant de certaines prérogatives, dont celle de présenter un rapport dont les conclusions deviendront proposition de loi.
M. Jean-Claude Nouët. Je crois que le président Clemenceau disait également qu’un vrai homme politique s’occupe aussi des animaux.
Ma conclusion sera simple. Il me semble que finalement, c’est une affaire de moyens, car la réglementation existe. Cela se résume à peu de choses : si l’on veut vraiment, on peut. Cela ne me semble pas insurmontable. L’abattoir n’est pas un lieu irrémédiablement voué à la maltraitance. Comme l’énonce la Déclaration universelle des droits de l’animal, si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse. C’est parfaitement possible mais il faut le vouloir.
M. le président Olivier Falorni. Je vous remercie pour cette table ronde qui nous a appris beaucoup de choses. J’espère qu’elle vous a permis, à tous, d’exprimer votre point de vue.
La séance est levée à dix-huit heures trente.
——fpfp——
34. Audition, ouverte à la presse, de M. Arnaud Schaumasse, chef du Bureau central des cultes au ministère de l’Intérieur
(Séance du mercredi 29 juin 2016)
La séance est ouverte à dix-huit heures cinquante.
M. le président Olivier Falorni. Monsieur Schaumasse, je vous remercie très chaleureusement d’avoir répondu à notre invitation. Vous avez la très grande qualité d’être professeur d’histoire et de géographie – comme moi ; vous êtes également agrégé de géographie et diplômé de l’École nationale d’administration – moi pas, hélas ! Vous êtes aujourd’hui chef du Bureau central des cultes depuis le 17 février 2016.
Le Bureau central des cultes a été créé par un décret du 17 août 1911, pour succéder à la Direction générale des cultes. Au sein de la sous-direction des libertés publiques du ministère de l’intérieur, le Bureau que vous dirigez est chargé des relations de l’État avec les autorités représentatives des religions présentes en France et de l’application de la loi de 1905 en matière de police des cultes.
Parmi les attributions actuelles du Bureau central des cultes figure notamment l’agrément des organismes habilités à désigner les sacrificateurs rituels pour les communautés israélite et musulmane. Le sujet de notre commission d’enquête étant la maltraitance animale en abattoir – il n’est pas question d’aborder un champ autre que celui-là –, nous avons souhaité vous inviter pour débattre de l’abattage sans étourdissement lié aux rites israélite et musulman.
Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Arnaud Schaumasse prête serment.)
M. Arnaud Schaumasse, chef du Bureau central des cultes au ministère de l’intérieur. Je vous remercie d’avoir associé le Bureau central des cultes aux travaux de votre commission d’enquête.
Comme votre rapporteur l’a souligné dès le début de vos travaux, il est essentiel que nous puissions aborder la question très spécifique du bien-être animal lors d’un abattage selon un rite religieux, qu’il soit juif ou musulman, sans stigmatisation aucune.
J’ai noté, au cours des auditions que vous avez menées, que les responsables des cultes concernés ont unanimement rappelé l’attention qu’ils portent, dans leur rituel, à la prise en compte de la question de la souffrance animale. Gardons-nous de toute stigmatisation, de tout raccourci, et n’oublions pas que, dans l’histoire, ce type de raccourci a souvent été nourri de sentiments de haine contre des communautés cultuelles.
Les vidéos qui sont à l’origine de vos travaux illustrent que le principal problème est le non-respect des procédures réglementaires établies et non que l’abattage se fait ou non selon un rite religieux.
Je vous propose de présenter de manière précise la procédure de l’agrément des organismes habilités à désigner les sacrificateurs, qui constitue la seule intervention du ministère de l’intérieur en la matière, avec ponctuellement l’organisation d’abattoirs temporaires à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd al-Adha, encadrée par les services déconcentrés des préfectures. Je resituerai cette procédure dans son cadre juridique, national et européen, puisque c’est dans le cadre du droit communautaire que s’exerce aujourd’hui cette dérogation.
L’abattage selon un rite religieux des animaux de boucherie est organisé afin de garantir le libre exercice des pratiques religieuses dans le respect des dispositions réglementaires relatives à l’hygiène alimentaire, à la protection de l’environnement et à la protection animale. Depuis le décret du 16 avril 1964, qui est la première inscription dans notre droit positif de l’étourdissement préalable des animaux avant leur saignée et de la dérogation, il constitue une dérogation aux pratiques normalisées de l’abattage. Ainsi, bien que la pratique de l’abattage rituel juif, la chekhita, existe depuis plusieurs siècles en France, l’expression d’abattage rituel, c’est-à-dire selon un rite religieux – qui me semble une expression préférable –, fait avec ce texte de 1964 sa première entrée dans notre système juridique.
Dix ans plus tard, le principe apparaît en droit communautaire, avec la directive du 18 novembre 1974 relative à l’étourdissement des animaux avant leur abattage, les États membres ayant la possibilité d’y déroger uniquement pour un motif religieux. Par la suite, d’autres textes ont été pris, aussi bien en droit interne qu’européen, pour renforcer, conforter, améliorer la prise en compte du bien-être animal et encadrer les pratiques dérogatoires. Ainsi, la directive du 22 décembre 1993 constitue à la fois la première reconnaissance juridique de la compétence d’organismes religieux agréés, même si elle continue de placer leur travail sous le contrôle d’un vétérinaire officiel, et l’articulation avec des acteurs reconnus comme représentatifs d’un culte.
L’Union européenne a donc introduit dans sa réglementation la notion d’abattage rituel afin de limiter à ce seul cas l’application d’une dérogation à l’étourdissement. Il s’agit d’un statut d’exception défini par référence à l’abattage ordinaire. Aujourd’hui, l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime et le règlement 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 prévoient la possibilité de cette dérogation lorsque l’étourdissement n’est pas compatible avec les prescriptions rituelles qui font explicitement partie du libre exercice du culte.
Pour autant, le sujet reste controversé, en tout cas au sein de la religion musulmane où existent des divergences d’appréciation sur les techniques qui peuvent ou doivent être mises en œuvre. Il n’appartient pas à l’État de se substituer aux responsables des cultes pour définir les rites, ni de trancher des débats purement religieux sur l’orthopraxie d’une pratique. Il ne m’appartient pas plus d’entrer dans le débat sur la gradation de la souffrance animale entre les méthodes traditionnelles et modernes d’abattage. Je situe mon propos exclusivement dans le champ du droit.
L’État a décidé d’adopter une disposition spécifique afin de garantir la liberté religieuse en la conciliant avec les normes sanitaires et vétérinaires. Pour écarter tout risque d’abus, l’encadrement de cette dérogation a été renforcé par le décret du 29 décembre 2011 pris à l’issue de discussions avec l’ensemble des parties concernées : représentants des cultes, des associations de protection des animaux et fédérations d’abatteurs. Depuis son entrée en vigueur, ce décret soumet cette dérogation à un régime d’autorisation préalable. Aujourd’hui, les abattoirs qui peuvent pratiquer l’abattage selon un rite religieux doivent être préalablement autorisés par les préfectures.
Parallèlement, le règlement de 2009 a renforcé les exigences en matière de protection des animaux à l’abattoir, avec l’accroissement de la responsabilité des exploitants et l’obligation de formation en matière de bien-être animal pour tous les opérateurs.
La mise en œuvre de la dérogation repose sur un double régime d’autorisation préalable au titre duquel quatre conditions très strictes doivent être observées : l’abattage selon un rite religieux doit être effectué par des sacrificateurs habilités ; il ne peut être mis en œuvre que dans un abattoir préalablement autorisé ; les sacrificateurs, comme tous les opérateurs travaillant au contact des animaux vivants, doivent être titulaires d’un certificat de compétence protection animale (CCPA) ; lors de l’opération d’abattage, les animaux doivent être correctement immobilisés par des matériels de contention spécifiques et précisément définis.
L’habilitation des sacrificateurs est régie par l’article R. 214-75 du code rural : « l’abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l’intérieur, par le ministre chargé de l’agriculture ». Cet encadrement est le plus ancien ; il a été mis en place par le décret du 23 septembre 1970 qui procédait du constat qu’en l’absence d’encadrement, de nombreux abattages selon un rite religieux étaient opérés par des intervenants qui n’avaient pas toujours les qualifications requises. À l’époque, la question ne se posait quasiment exclusivement que pour l’abattage de rite religieux juif. Le texte précisait que si aucune organisation n’avait été enregistrée, le préfet du département pouvait accorder des autorisations individuelles. De fait, pendant une décennie, aucun organisme n’ayant été désigné, les préfets ont été amenés à donner à plusieurs centaines de personnes l’autorisation d’opérer. Elles étaient, le plus souvent, identifiées parmi les opérateurs des abattoirs pour répondre à une forme d’urgence sociale.
En 1981, un décret concernant le culte juif institue l’exclusivité de la nomination des sacrificateurs rituels juifs, les chokhatim, à la commission rabbinique intercommunautaire de l’abattage rituel. Cette commission étant liée au Consistoire, le monopole de ce dernier s’en est trouvé traduit en droit, sachant qu’il existait en fait depuis longtemps comme la conséquence naturelle de la création du Consistoire par Napoléon. Avant 1808, chaque communauté juive vivait de façon autonome et organisait localement sa cacherout ; la création du Consistoire a eu pour conséquence pratique de mettre en place progressivement une centralisation qui a été avalisée par le décret de 1981. Le Consistoire avait d’ailleurs créé, dès 1950, une commission de la cacherout à laquelle on doit la formalisation des principes de l’abattage rituélique appliqués à la Villette, avec la définition des fonctions précises des chokhatim et des contrôleurs, et celle des opérations de cachérisation des viandes en boucherie.
Une décennie plus tard, en 1994, volontairement sur le même modèle, le ministère de l’intérieur a accordé un monopole de la délivrance des cartes de sacrificateur à la grande mosquée de Paris, dans l’idée de canaliser, sécuriser et moraliser les pratiques totalement éclatées et peu contrôlées. Deux ans plus tard, pour des raisons d’équilibre entre les traditions culturelles de l’islam de France, le Gouvernement a décidé de transformer ce monopole en oligopole en étendant la faculté de délivrer des cartes de sacrificateur à la grande mosquée d’Évry-Courcouronnes, qui représentait la tradition culturelle marocaine, et à la grande mosquée de Lyon qui représentait une autre tendance de la tradition algérienne. C’est donc l’État qui a pris un rôle actif dans la normalisation de la pratique de l’abattage rituel musulman, car, à la différence du judaïsme, il n’y a pas, dans l’islam, de sacrificateur au sens d’une personne dotée d’un statut et d’une fonction religieuse clairement définis – lors de la fête de l’Aïd, le mouton est traditionnellement abattu par le père de famille qui n’a ni formation ni statut religieux particuliers. Avec cette normalisation, l’État a clairement montré sa volonté de mettre en place des circuits rituels clairs, précis et répondant à la sécurité sanitaire et au bien-être animal. À partir de ce moment ont été interdites toutes les pratiques d’abattage non encadrées, familiales ou complètement sauvages, lors de la fête de l’Aïd.
Quatre organismes religieux sont aujourd’hui agréés en France : la commission rabbinique intercommunautaire de l’abattage rituel, par l’arrêté du 1er juillet 1982 ; la grande mosquée de Paris, par l’arrêté du 15 décembre 1994 ; la grande mosquée de Lyon et la grande mosquée d’Évry-Courcouronnes, par les arrêtés du 27 juin 1996. Il appartient à chacune de ces structures d’accréditer, au plan régional ou local, des structures certificatrices garantissant que les opérations ont été réalisées selon les règles ritualisées. Cela ne regarde plus le ministère de l’intérieur ni celui de l’agriculture.
Que l’État donne un agrément à des structures désignées pour une opération religieuse doit être apprécié à travers les motivations des arrêtés pris en 1994 et 1996 pour justifier du choix des trois grandes mosquées : l’intérêt public d’organiser l’abattage rituel islamique dans des conditions garantissant l’ordre et la santé publics ; le rayonnement spirituel et culturel de ces structures ; leur représentativité dans la communauté musulmane de France et leur capacité à encadrer le marché de la viande rituellement abattue – il en ressort parfaitement qu’il s’agit de motifs d’ordre public, de sécurité sanitaire et, de façon conséquente, de bien-être animal.
Deuxième condition à la dérogation, l’abattage selon un rite religieux ne peut être mis en œuvre que dans un abattoir agréé, expressément autorisé à déroger à l’obligation d’étourdissement. L’autorisation est délivrée par le préfet, sous réserve de satisfaire quatre critères cumulatifs : matériel adapté ; personnel dûment formé ; procédures garantissant des cadences – qui sont plus lentes – et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ; système d’enregistrement permettant de vérifier que l’usage de la dérogation répond à des commandes commerciales. L’autorisation peut être suspendue, voire retirée, aux établissements qui ne répondraient pas ou plus à ces critères
S’agissant des sacrificateurs, ils doivent, au même titre que tous les opérateurs d’abattoir, être titulaires d’un certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort ». Ce certificat est délivré à l’issue d’une session de formation dispensée par un organisme habilité par le ministère de l’agriculture, et après réussite à un test d’évaluation harmonisé sur le territoire national. Deux arrêtés portant publication de la liste des organismes de formation ont été pris en septembre 2012 et septembre 2013. Parmi les treize dont vous a parlé le ministre de l’agriculture, sept ont une habilitation spécifique pour dispenser une formation à l’abattage sans étourdissement préalable – il y en a en région parisienne, en Bretagne, en région Rhône-Alpes. Ces formations conjuguent dans leur habilitation la protection animale et les opérations de manipulation, de soins et de mise à mort sans étourdissement. Autrement dit, un sacrificateur est avant tout un opérateur d’abattoir qui a suivi une formation religieuse pour pratiquer selon le rite, la partie la plus complexe étant l’apprentissage du geste particulier fait avec un couteau qui a également été normalisé dans les textes quant à sa taille et son affûtage. Cette formation doit être prise en compte.
Enfin, les animaux doivent être immobilisés avant leur saignée par des matériels de contention conformes et précisément définis : bovins, ovins et caprins doivent être immobilisés par un procédé mécanique, en respectant l’ensemble des mesures en matière de bien-être animal prévues par les réglementations.
Ce sont les directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) qui contrôlent le bon déroulement de ces abattages, comme de toutes les procédures d’abattage. Elles vérifient également l’habilitation des sacrificateurs et la conformité de leur matériel, y compris le type de couteau utilisé – la taille et l’affûtage comptent pour beaucoup dans la question de la souffrance animale.
Ce dispositif est conforme au droit de l’Union européenne et pleinement respectueux du principe de laïcité.
Le paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du Conseil du 24 septembre 2009 prévoit une obligation d’étourdissement dans une optique d’épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux, notamment lors de leur mise à mort. Par dérogation, le paragraphe 4 de cette même disposition prévoit, à l’identique du droit français, que « pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir ». L’adéquation entre le droit national et le règlement européen est à cet égard parfaite. L’article 7 du règlement prévoit la notion de certificat de compétence et l’article 21 le contrôle d’une autorité compétente désignée à cet effet.
Au sujet de la conformité aux principes constitutionnels et conventionnels de laïcité et de libre exercice des cultes, le considérant 18 du règlement du 24 septembre 2009 prévoit que celui-ci « respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». De fait, le régime de dérogation a été voulu dès l’origine comme étant de nature à permettre le libre exercice du culte, dont participe l’abattage selon un rite religieux, dans le respect de l’ordre public – il s’agit de la jurisprudence du Conseil d’État du 2 mai 1973, Association cultuelle des israélites nord-africains.
De même, dans la décision Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) du 5 juillet 2013, le Conseil d’État a jugé que la dérogation à l’étourdissement pour la pratique de l’abattage selon un rite religieux avait été édictée « dans le but de concilier les objectifs de police sanitaire et l’égal respect des croyances et traditions religieuses ». Il a considéré que si le principe de laïcité imposait « l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, ce même principe impose que la République garantisse le libre exercice des cultes ; que, par suite, la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement pour la pratique de l’abattage rituel ne porte pas atteinte au principe de laïcité ».
Enfin, dans l’arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek contre France du 27 juin 2000, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a relevé que la dérogation au principe d’étourdissement préalable, critiquée par l’association requérante, constituait un « engagement positif de l’État visant à assurer le respect effectif de la liberté d’exercice des cultes » et « à assurer le respect effectif de la liberté de religion », protégée en tant que telle par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De cet arrêt, il ressort qu’il y aurait « ingérence dans la liberté de manifester sa religion [...] si l’interdiction de pratiquer légalement cet abattage conduisait à l’impossibilité pour les croyants [...] de manger de la viande provenant d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses qui leur paraissent applicables en la matière ». Notre droit positif est donc pleinement respectueux des grands principes de notre République, du droit de l’Union européenne, et s’articule parfaitement avec le code rural.
Si l’administration centrale du ministère de l’intérieur n’est pas engagée dans les contrôles réalisés dans les abattoirs autorisés à pratiquer l’abattage sans étourdissement pour raison cultuelle, l’administration déconcentrée l’est, en revanche, directement dans la gestion de l’encadrement de l’abattage temporaire à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Kébir. Il s’agit, dans ce cas encore, de concilier le profond attachement des musulmans à l’accomplissement de ce rite avec les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé publique, de protection animale et de respect de l’environnement.
Le code rural impose que l’abattage selon un rite religieux, y compris dans ce cadre temporaire des trois jours de fête, s’effectue en abattoir. Il prohibe la mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériels ou équipements qui permettraient l’abattage en dehors d’abattoirs ou d’abattoirs temporaires aménagés et encadrés à cet effet, même pour une aussi courte période. En l’absence d’abattoir proche pouvant répondre à une demande ponctuelle importante, et après une analyse précise des besoins locaux, l’aménagement d’installations temporaires pour ovins agréées pour la durée de cette fête peut être envisagé dans le dialogue avec les préfectures, en répondant à l’ensemble des règles en vigueur. La pratique dérogatoire de l’abattage sans étourdissement des ovins nécessite donc la délivrance aux abattoirs temporaires de la même autorisation et fait l’objet du même encadrement réglementaire spécifique. Il en est de même pour les abattoirs pérennes agréés pour l’abattage sans étourdissement pour la seule durée de la fête.
À cet effet, les dossiers de demande d’agrément des abattoirs temporaires doivent être déposés en préfecture et auprès des services vétérinaires au minimum trois mois avant la fête religieuse. Les certificats de compétence en protection animale des sacrificateurs doivent être demandés dès cette phase d’instruction du dossier d’agrément. L’identité et la preuve de la qualité des sacrificateurs qui opéreront pour la fête dans ces installations temporaires font donc partie des pièces à communiquer pour la recevabilité du dossier. Dès l’acceptation du dossier, l’installation doit être testée ; c’est cette phase d’essai qui conditionnera l’agrément temporaire. Pour les sacrificateurs disposant d’une expérience pratique limitée, les services de l’État sont invités à encourager les associations musulmanes à se tourner vers les structures de formation pour organiser des stages dédiés, ciblés sur ces personnes pour cette période.
À l’issue de la première instance de dialogue avec l’islam de France, en juin 2015, le ministre de l’intérieur avait annoncé la constitution d’un groupe de travail sur les modalités de l’organisation de l’Aïd el-Kébir. Ses travaux ont permis d’élaborer un guide pratique, réalisé conjointement par nos services et ceux de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) pour le ministère de l’agriculture. Il mettra à disposition des professionnels, des administrations, des collectivités et des porteurs de projet un ensemble de données concrètes et une recension des bonnes pratiques. Il paraîtra dans la première quinzaine du mois de juillet 2016. Il sera adressé aux préfectures ainsi qu’aux conseils régionaux du culte musulman (CRCM) qui en disposeront donc dès la préparation de l’Aïd 2016, même s’il est probablement trop tard pour mettre en place des installations temporaires d’ici au mois de septembre.
L’administration territoriale de l’État assure le suivi et le contrôle des projets mais elle n’en assure en aucun cas le portage. Elle contrôle que les conditions de transport, de garde et de parcage des animaux sont compatibles avec les impératifs biologiques de l’espèce et avec les prescriptions réglementaires relatives au bien-être des animaux. La dérogation à l’étourdissement implique ainsi que l’immobilisation des animaux soit, comme dans tout abattoir classique, assurée par un procédé mécanique excluant toute contention manuelle. La contention doit être maintenue pendant un délai suffisant pour atteindre la perte de conscience de l’animal et, comme dans un abattoir, la mort de l’animal doit être constatée avant que les phases d’habillage des carcasses ne débutent.
En cas de dysfonctionnements graves en matière de protection animale ou d’hygiène des manipulations, le préfet est invité, par une circulaire conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture, à suspendre l’agrément de l’abattoir, voire à décider la fermeture de tout ou partie de l’établissement, que ce dernier bénéficie d’un agrément pérenne ou temporaire. Il s’agit de l’application de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime pour les manquements en matière de protection animale, et des articles L. 233-1 et 2 du même code pour les manquements relatifs à l’hygiène.
En parallèle – c’est la partie la plus visible que vous devez connaître dans vos circonscriptions –, les contrôles dans les centres de rassemblement et les sites d’approvisionnement doivent être renforcés dans les jours qui précèdent l’Aïd el-kébir. La vigilance des services de police et de gendarmerie est appelée en la matière, afin de lutter contre tout site d’abattage clandestin. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune tolérance à l’égard des personnes qui commettraient une infraction en la matière.
M. le président Olivier Falorni. Votre présentation a été extrêmement exhaustive et précise. Vous avez abordé beaucoup de questions que je souhaitais vous poser.
Le recteur de la grande mosquée de Lyon, M. Kabtane, a indiqué, lors de son audition, avoir participé à une réunion qui s’est tenue le 15 juin 2015 au ministère de l’intérieur concernant l’élaboration d’un guide sur l’abattage halal. Avez-vous connaissance de cette réunion ? Y avez-vous participé ? Quel en est l’objectif à moyen et long terme ?
J’aimerais avoir des précisions sur l’abattage rituel dans les abattoirs mobiles – notre collègue François Pupponi nous a dit en avoir un qui venait à Sarcelles à chaque fête de l’Aïd. Comment se déroule cet abattage ? Avez-vous des éléments sur la pratique qui en est faite, en particulier à Sarcelles ?
M. Arnaud Schaumasse. La réunion du 15 juin 2015 au ministère de l’intérieur est la première instance de dialogue avec l’islam de France dont je parlais à la fin de mon propos. Cette instance a été mise en place, non pour se substituer au Conseil français du culte musulman, mais pour élargir le dialogue à d’autres sujets que les questions relevant de l’organisation du culte. Elle a été préparée dans chaque département, dans chaque préfecture par les autorités locales, et les thèmes ont été définis en fonction des remontées du terrain. L’organisation de l’Aïd faisait partie des problèmes évoqués. Le guide qui est issu de cette réunion ne concerne pas le halal en général mais l’organisation de l’abattage rituel à l’occasion de la fête de l’Aïd ; il sera publié par La documentation française dans quelques jours. Nous pourrons en adresser un exemplaire à votre commission.
M. le président Olivier Falorni. Nous le souhaitons vivement.
M. Arnaud Schaumasse. Je ne connais pas l’exemple spécifique de Sarcelles, le Bureau des cultes n’intervenant pas en tant qu’acteur de terrain ; ce rôle revient aux préfectures. Toutefois, je peux vous faire part d’une expérience passée lorsque j’étais directeur de cabinet en Bourgogne. À l’occasion de la fête de l’Aïd, nous avions tenté de compenser une carence des capacités d’abattage en mettant en place une structure d’abattoir mobile. D’abord, il a fallu identifier un porteur de projet. En l’occurrence, il s’agissait du CRCM qui devait faire, éventuellement avec des partenaires, l’acquisition d’une structure mécanique démontable, comportant essentiellement la chaîne d’abattage, l’appareil de contention et le rail. Ensuite, il a fallu trouver le terrain susceptible d’accueillir cette structure et les opérations de récupération, drainage et évacuation des fluides dans le respect des prescriptions sanitaires. Malheureusement, l’opération n’a pas pu se faire car nous n’avons pas trouvé de terrain répondant aux attentes de la DDPP.
Mme Annick Le Loch. Un gros abatteur de notre pays nous a dit qu’il y avait encore beaucoup de progrès à faire en matière d’abattage rituel en France. Sur les 260 abattoirs que compte notre pays, 218 sont agréés pour l’abattage rituel alors que le pourcentage de viande abattue de façon rituelle serait relativement faible. Qu’en est-il ?
Des responsables religieux nous ont indiqué qu’en France, le refus de l’étourdissement constituait une lame de fond très puissante au sein de la population croyante.
J’ai également retenu de nos auditions que la Suède et la Suisse auraient des modèles tout à fait exemplaires en matière d’abattage rituel. Ces pays semblent fonctionner selon un autre modèle que notre système dérogatoire. Lequel ?
Le gros abatteur que j’évoquais plus haut nous a indiqué être en train d’expérimenter dans son abattoir de Castres un matériel plus soucieux du bien-être animal qu’il était allé chercher en Nouvelle-Zélande. Il attendait l’agrément de l’administration. Avez-vous connaissance de ce matériel ?
M. Arnaud Schaumasse. Nous avons découvert cet appareillage lors de l’audition de l’industriel en question, et la DGAL nous a indiqué en avoir connaissance. Les tests en cours semblent confirmer son caractère prometteur, et il pourrait être diffusé dans un avenir proche s’il répond aux différentes normes techniques applicables, par exemple en matière de contention.
S’agissant des abattoirs agréés, la plupart ne pratiquent pas exclusivement l’abattage halal ou casher. Le nombre de 218 abattoirs autorisés à abattre sans étourdissement peut sembler élevé au regard des 15 % de bovins abattus au titre de la dérogation, mais les besoins sont répartis sur l’ensemble du territoire, et ce nombre est appelé à croître. Ce n’est objectivement pas la solution idéale, puisque les contraintes de rythme et de chaîne conduisent les abattoirs à procéder à l’abattage rituel par exemple le matin, puis à repasser à l’abattage conventionnel. Mais cela relève de l’organisation économique et commerciale des opérateurs, que nous n’avons pas à connaître. Nous aurions matière à réagir si nous constations que le nombre d’établissements agréés n’est plus en adéquation avec le nombre de cartes de sacrificateurs délivrées par les autorités habilitées. Aujourd’hui, les trois mosquées ne semblent pas pratiquer une politique malthusienne en la matière, et le grand rabbin de France délivre des cartes en fonction des demandes qui lui sont faites. Pourvu que les personnes soient formées et aient réussi les tests, ils peuvent leur délivrer l’autorisation de procéder à des abattages rituels. Pour ce qui nous concerne, nous sommes très vigilants sur l’application du cadre réglementaire, qui est sain pour tous – à la fois pour les cultes, car il évite la stigmatisation et les fantasmes dans un secteur qui a pourvu la langue française de son lot de mots dévoyés, et parce qu’il répond aux exigences de la loi. Avec le ministère de l’agriculture et les organismes religieux concernés, nous veillons donc à ce que chacun soit conscient de ses responsabilités. Les sacrificateurs religieux sont d’abord des opérateurs d’abattoirs ; cette règle n’est pas négociable. La seule dérogation concerne l’étourdissement, tout le reste du processus relève du droit commun. C’est en veillant au respect serein de la norme que la République permet de garantir le libre exercice des cultes tout en évitant la stigmatisation de telle ou telle pratique religieuse.
Il est vrai qu’il existe dans le monde entier une lame de fond d’ordre économique, car de nombreuses institutions publiques ou parapubliques de pays d’Asie, en particulier, ont compris tout l’intérêt que revêt le développement d’un marché halal qui dépasse d’ailleurs largement le seul secteur des produits carnés : il existe aujourd’hui de l’eau halal, mais aussi des services halal – de voyage ou de mariage, par exemple. À l’origine, pourtant, le halal représente le degré médian, c’est-à-dire le plus neutre, dans l’échelle des cinq degrés de licéité allant de l’obligation à l’interdiction. Autrement dit, le halal est ce qui n’est ni interdit ni obligatoire. Dans le monde contemporain, hélas ! il est souvent trop compliqué d’envisager cinq possibilités ; tout est noir ou blanc. C’est pourquoi le halal est devenu l’opposé de l’interdit, et est désormais synonyme de bonne pratique. Cela s’est traduit par un phénomène économique qui, en France notamment, mobilise de nombreux acteurs.
À cette lame de fond économique s’en ajoute une autre, d’ordre sociologique : elle tient à l’affirmation – que d’aucuns jugent positive, d’autres négative – de l’identité religieuse par une pratique sociale. Ce phénomène est propre à des pays où la religion musulmane n’est pas dominante, mais minoritaire. Dès lors que la norme suscite un débat, son harmonisation se fait sur la base des positions maximalistes. S’il est fréquent qu’un consommateur estimant que l’électronarcose n’est pas une pratique problématique accepte de manger de la viande provenant d’un animal abattu sans étourdissement, l’inverse ne se produit pas : les consommateurs opposés à l’étourdissement n’achèteront que de la viande provenant d’animaux abattus rituellement. Or il est apparu nécessaire d’adopter une norme halal commune pour mettre fin aux duperies de toutes sortes dont sont victimes les consommateurs. Cependant, nous sommes dans un pays sans tradition établie en la matière, ni autorité morale reconnue à même de certifier ce qui est halal et ce qui ne l’est pas ; les consommateurs sont incrédules, si j’ose dire. Le consommateur musulman exigeant une certification, celle-ci a tendance à être établie sur la base de positions maximalistes. Le Conseil français du culte musulman définira un référentiel qu’il appelle « Charte halal », sans pour autant considérer que d’éventuelles autres chartes sont haram, et sans juger la conformité d’autres pratiques. Quoi qu’il en soit, je constate ce mouvement comme vous, madame la députée.
Mme Françoise Dubois. Qui dispense les formations dont bénéficient les sacrificateurs, s’il ne s’agit ni des mosquées ni de centres de formation spécifiques ? Autrefois, les pratiques se transmettaient de père en fils. L’image de l’abattage sauvage et clandestin est demeurée dans l’opinion publique ; il serait donc utile de réhabiliter l’abattage rituel de ce point de vue, même s’il est légitime de ne pas approuver l’abattage sans étourdissement.
Par ailleurs, j’ai le sentiment, à vous écouter, que les contraintes et les contrôles imposés à l’abattage rituel sont beaucoup plus stricts que pour l’abattage conventionnel. Compte tenu du fait que l’abattage rituel concerne une période particulière, le risque de dérapage existe-t-il et les contrôles sont-ils dûment effectués ?
M. Arnaud Schaumasse. Les abattoirs temporaires sont particulièrement contrôlés par les 2 000 inspecteurs vétérinaires, parce que les opérations d’abattage qui y sont conduites ont un caractère symbolique fort et qu’elles obéissent à des processus moins routiniers. De plus, les sacrificateurs n’exercent pas toujours cette fonction tout au long de l’année. Il est donc indispensable de veiller au respect des règles d’hygiène et de santé animale, et ce dans la sérénité du vivre-ensemble républicain, afin de ne pas laisser prospérer les fantasmes que suscite parfois la fête de l’Aïd – on a ainsi pu entendre parler voici quelques années d’abattage dans les baignoires.
Il existe en France treize organismes de formation, dont sept ont, outre la compétence de formation des responsables de la protection animale (RPA), la compétence de formation à la mise à mort sans étourdissement. Pour le reste, les procédures sont les mêmes. Les cartes de sacrificateurs ne sont donc pas attribuées au hasard.
Les quatre organismes agréés demeurent libres de dialoguer avec les abattoirs, lesquels peuvent leur présenter des opérateurs susceptibles de répondre à leurs besoins. C’est à ces organismes qu’il appartient ou non de délivrer les cartes. Nous les aidons, quant à nous, à éviter la circulation de fausses cartes ou leur utilisation par des personnes autres que leur titulaire, et à éviter tout trafic – il s’agit, de ce point de vue, d’un pouvoir de police ordinaire. Le suivi a posteriori relève des inspecteurs vétérinaires, même si je constate comme vous qu’ils se sentent en sous-capacité pour exercer leurs fonctions. Quoi qu’il en soit, les 2 000 agents en exercice s’assurent sur le terrain que les choses sont bien faites.
S’agissant des exemples européens, madame Le Loch, je partage le regret du ministre : lorsque nous avons instauré la dérogation, nous n’aurions pas dû laisser la capacité de choisir ou non d’en bénéficier à l’autorité subsidiaire, mais plutôt choisir entre en faire ou non une compétence européenne – ce qu’elle devait être, selon moi. Les pays qui ont interdit l’abattage sans étourdissement préalable ou qui s’apprêtent à le faire, comme le Danemark, jouent tout de même une double partition, car ils interdisent ce type d’abattage sur leur territoire mais autorisent l’importation de viande provenant d’animaux abattus selon cette pratique, permettant ce faisant à leurs ressortissants de confession juive ou musulmane de consommer de la viande que les intéressés jugent conforme à leur foi. Autrement dit, cette mesure de protection du bien-être animal sert principalement à satisfaire le parti « animaliste » dont les voix sont nécessaires à la majorité, mais il n’est pas question d’aller au-delà. Cette position ne me paraît pas refléter un choix pleinement assumé.
Cependant, toutes les autorités religieuses ne sont pas sur la même longueur d’ondes : aux Pays-Bas, par exemple, les autorités musulmanes ont accepté par un contrat passé avec l’État le principe de l’étourdissement post-jugulatoire, qui permet d’abréger la période de souffrance. Si la mort de la bête n’est pas constatée dans les quarante secondes qui suivent l’incision, alors il peut lui être appliqué un choc électrique fatal. D’autres pays sont tout à fait hostiles à cette méthode. La Pologne a fait marche arrière après que le marché de la viande bovine a connu un recul de 60 % dans ce pays, sachant qu’il est un gros exportateur de viande casher. La Suisse, enfin, est le premier pays à avoir interdit l’abattage sans étourdissement, dès 1893, mais il existe naturellement des possibilités d’approvisionnement transfrontalier.
En tout état de cause, il me semble essentiel de réfléchir à la question du bien-être et de la souffrance des animaux en toute lucidité. Comme vous, je constate qu’elle fait débat entre scientifiques, qui produisent des rapports tout à fait contradictoires sur les modes d’abattage les plus violents ou qui provoquent les plus grandes souffrances. Le conseil supérieur du ministère de l’agriculture travaille sur ce sujet, qu’il faut examiner sereinement. Faut-il pour autant se réfugier derrière l’importation de produits venus d’autres pays, même si les viandes provenant de l’Union européenne présentent probablement les garanties nécessaires en matière de sécurité sanitaire ? Quoi qu’il en soit, il me semble que notre système offre un équilibre satisfaisant entre le respect des différents principes et le réalisme social et économique.
Mme Sylviane Alaux. À vous entendre, on pourrait se réjouir qu’il existe enfin des textes et des règles qui encadrent ce secteur. Pourtant, je ressens un véritable décalage par rapport aux propos que nous ont tenus des dirigeants et des salariés d’abattoirs, notamment au sujet des sacrificateurs, dont il semble – c’est l’interprétation que je fais de ce qui nous a été rapporté – qu’ils sont peu compétents et formés, même s’ils détiennent une carte délivrée par leur mosquée. Certains utilisent même leurs propres outils.
Les treize organismes de formation auxquels vous faites référence sont-ils identifiés comme tels ? Je retiens d’autres auditions que les formations sont le plus souvent internes, ne durent guère plus de quarante-huit heures et se déroulent parfois même sur le tas, puisque les intéressés exercent d’abord à différents postes dans l’abattoir avant d’aboutir au poste de tuerie. J’ai donc le sentiment qu’il n’existe pas de véritable formation, et j’entends pour la première fois parler d’organismes de formation proprement dits. S’agit-il d’émanations de la profession ? Est-ce celle-ci qui les finance ou bien l’État participe-t-il ? Est-il vrai que la durée de formation ne dépasse pas quarante-huit heures, comme nous l’avons souvent entendu ? Qu’en est-il de l’amateurisme des sacrificateurs qui nous a été rapporté, même s’ils sont titulaires d’une autorisation de leur mosquée ? Il semble, en effet, qu’ils ne soient guère habitués au geste. Certains grands abattoirs emploient eux-mêmes des salariés dédiés à l’abattage rituel, mais le tableau d’ensemble demeure flou. Qu’en est-il précisément ?
M. Arnaud Schaumasse. Il existe 218 établissements habilités à procéder à l’abattage rituel, et les mosquées ont délivré environ 450 cartes de sacrificateurs. La norme est que les sacrificateurs exercent sur plusieurs sites.
Je ne nie pas le décalage qui existe entre les textes et la réalité : c’est un constat évident qu’il ne faut pas éluder si l’on veut résoudre les problèmes. À chacun, cependant, d’assumer sa part de responsabilité. Je comprends que des opérateurs d’abattoirs témoignent de carences et de difficultés concernant l’abattage rituel, mais que des responsables d’abattoirs tiennent les mêmes propos me surprend, car c’est leur responsabilité qui est engagée. Depuis l’adoption du règlement de 2009, les choses sont claires : ils sont responsables de tout ce qui se passe dans leur établissement en matière de bien-être animal, de sécurité sanitaire et de respect des procédures. Que des légèretés soient signalées par des collègues, soit : ce secteur a comme les autres ses lanceurs d’alerte. Que des responsables se défaussent ainsi, c’est plus étonnant. Parce que nous vivons dans une République laïque, le Bureau central des cultes n’est pas doté d’une police religieuse ; les cas d’abus ne se soldent donc pas par une intervention immédiate de sa part.
Les treize centres de formation que le ministre de l’agriculture a évoqués devant vous sont des organismes privés liés aux professions et aux interprofessions et habilités par le ministère de l’agriculture après contrôle de leurs moyens et de leurs pratiques pédagogiques. Stéphane Le Foll s’est engagé à ce que cette question fasse partie de l’audit plus large qui est en cours et dont les conclusions seront naturellement rendues publiques. Reste à poser clairement la question de l’adaptation de l’offre de ces organismes aux besoins spécifiques de formation à l’abattage rituel. De ce point de vue, la transparence est la meilleure alliée tant des organismes religieux qui donnent leur agrément que des opérateurs d’abattoirs et des industriels de la viande et, bien entendu, des pouvoirs publics.
La lame du couteau et son affûtage sont définis par les textes réglementaires. Rien n’empêche un sacrificateur de disposer de son propre ustensile ; comme dans d’autres métiers, il suffit que l’intéressé soit sérieux et appliqué pour que le fait de disposer de son propre outil puisse constituer un gage de qualité. C’est une question importante : l’un des principaux problèmes soulevés dans l’étude que le ministère de l’agriculture a conduite en 2011 tient au fait que des couteaux trop petits ou mal affûtés provoquent manifestement de la souffrance, parce que les artères et les veines ne sont tranchées ni assez vite ni assez nettement. S’agissant des ovins, la procédure en vigueur prévoit que la gorge est tranchée en un seul passage de lame. Il faut donc être vigilant sur ce point.
Je ne peux pas vous répondre précisément sur la durée de la formation, même si elle est relativement simple – il ne s’agit pas de diplômes d’État. Il me semble sain et adapté qu’il existe une formation continue. Si l’abattage rituel était encore massivement effectué par des personnes manifestement inexpérimentées, cela se saurait. Des insuffisances ponctuelles sont concevables, mais nous traquons les cartes falsifiées ou usurpées. La vigilance en la matière est partagée : le grand rabbin de France, par exemple, qui signe personnellement les cartes de choketh, examine d’abord les dossiers avec attention.
Mme Françoise Dubois. Les cartes de sacrificateur sont-elles délivrées à vie ?
M. Arnaud Schaumasse. Non, elles sont normalement renouvelées tous les six mois ou tous les ans. Le certificat de compétence délivré à l’issue de la formation est valable cinq ans ; ce délai n’est pas encore épuisé, puisque le décret n’a pas cinq ans d’âge, mais par définition, le renouvellement de la carte est automatique pendant ces cinq années sauf si les inspecteurs vétérinaires ont constaté une incapacité à opérer, auquel cas l’habilitation peut être suspendue.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Les circonstances concrètes dans lesquelles est effectué le geste de mise à mort soulèvent trois questions distinctes : la compétence technique des opérateurs, la pertinence du matériel et l’habilitation religieuse. Vous nous avez bien présenté les responsabilités des uns et des autres en la matière, mais les auditions que nous avons précédemment tenues me donnent le sentiment qu’il n’existe pas une grande homogénéité du contrôle de ces différents aspects. Cela peut expliquer le caractère récent de la réglementation, adoptée en 2009, par rapport à l’ancienneté des pratiques. Nous ne sommes donc pas encore en phase de régime permanent : quels progrès peut-on espérer dans la mise en place des formations ? Il pourrait ainsi être clairement rappelé aux responsables d’abattoirs que les sacrificateurs n’échappent pas à leur responsabilité, contrairement à ce que certains d’entre eux nous ont dit très explicitement, d’autres reconnaissant en revanche qu’il s’agissait avant tout de salariés de l’abattoir. Comment améliorer la connaissance des textes ? Comment faire pour qu’ils entrent dans les mœurs ? Comment réduire l’écart entre la pratique jugée habituelle et la pratique conforme aux textes ?
Les sites d’abattage font l’objet d’une autorisation préfectorale. Or nous avons visité des abattoirs où la contention des ovins est loin d’être mécanique. Existe-t-il des cas d’établissements auxquels l’autorisation d’abattage rituel a été refusée ?
M. Arnaud Schaumasse. J’ignore s’il existe des cas de refus, mais je sais qu’il existe des cas de retrait.
M. le rapporteur. Soit. S’il n’y avait ni retrait ni refus, cela signifierait que tout le monde peut obtenir l’autorisation en question. Au contraire, si des retraits sont prononcés, c’est le signe d’une phase de progrès. Où en sommes-nous entre ce qui devrait être et ce qui est ?
Enfin, certains pays interdisent l’abattage sans étourdissement mais semblent autoriser l’importation de viande provenant d’animaux ainsi abattus. Avez-vous connaissance de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au motif que cette interdiction serait contraire au libre exercice de la foi ?
M. Arnaud Schaumasse. Non. Les pays qui prévoient une interdiction stricte sont souvent petits – le Liechtenstein, par exemple – ou l’interdiction y est très ancienne, ce qui explique que d’autres habitudes ont été prises – c’est le cas des pays nordiques et de la Suisse. En Pologne, c’est la Cour constitutionnelle qui a annulé l’interdiction au terme d’une procédure de deux années.
M. le rapporteur. La juridiction constitutionnelle polonaise ayant satisfait la demande qui lui était faite, la CEDH n’a donc pas été saisie ; est-ce bien cela ?
M. Arnaud Schaumasse. C’est exact.
Pour le reste, je crois aux vertus de la pédagogie et de la persuasion. Le guide que nous allons diffuser et qui pourra être téléchargé sur le site du ministère contient une partie liée à l’exercice temporaire de l’abattage au cours de l’Aïd. Cependant, le corpus juridique comprenant un tronc commun à toutes les activités d’abattage, le guide pourra être diffusé sur le terrain par les directions départementales de la protection des populations et par les préfectures dans le cadre du dialogue qu’elles entretiennent avec les conseils régionaux du culte musulman, l’idée étant que le respect partagé de ces règles et le fait que chaque acteur assume ses responsabilités contribuent à apaiser le débat, tant sur la question des abattoirs proprement dits que sur celle de la coexistence de diverses pratiques religieuses.
Peut-être peut-on expliquer le fait que certains responsables d’abattoirs se sentent moins concernés par les pratiques des sacrificateurs s’il s’agit de vacataires ou d’intermittents, en quelque sorte, qui n’exercent que ponctuellement et ne sont pas salariés par l’abattoir en question. La démarche d’appropriation des responsabilités, des pratiques et des outils est plus aisée lorsqu’un employé permanent est affecté à l’abattage rituel et lorsque l’organisation de l’abattoir tient compte de la réalité et des contraintes – de cadence, en particulier – qui y sont liées. Elle est plus difficile dans des structures plus petites, plus anciennes ou correspondant à un modèle économique différent, qui ne font appel aux sacrificateurs que lorsqu’elles en ont besoin et qui n’ont donc pas noué avec eux une relation de même nature.
C’est l’un des aspects de la réflexion sur les vertus et les faiblesses de l’abattoir de proximité. L’un des deux abattoirs concernés par des vidéos diffusées ce matin sur le site d’un grand quotidien national est l’une des dernières structures d’abattage d’ovins dans l’arrière-pays du département où il se trouve. Si le conseil départemental décide de soutenir cette structure, même si elle n’est évidemment ni la plus moderne ni la plus performante de France, c’est en vertu d’un choix qui répond à une réalité agropastorale locale. Cela n’empêche pas d’adopter des pratiques qui doivent devenir un réflexe. C’est en portant la bonne parole que nous y parviendrons, en insistant sur le fait que la protection animale n’est pas un élément secondaire mais qu’elle va de pair avec la sécurité sanitaire : on ne saurait se préoccuper d’abord de la qualité de la viande et ensuite de la condition de l’animal lors de son abattage. Dans leur dialogue avec les entrepreneurs et le personnel, les pouvoirs publics doivent présenter simultanément toutes ces dispositions, qui sont d’égale importance. Il faudra du temps.
Compte tenu du caractère particulier – et brutal – de cette activité, il est difficile de transposer des processus de formation continue et de diffusion de l’information comme cela se fait pour d’autres métiers plus standardisés. Il faut, en effet, tenir compte de circonstances pratiques particulières. Nous y parviendrons néanmoins : il n’y a aucune fatalité à se contenter de mettre en œuvre comme on le peut des textes par ailleurs satisfaisants. Songez que le premier décret date de 1964, le deuxième de 1980 ; ce n’est qu’en 1978, soit quatorze ans après le premier décret, que l’on s’est aperçu que les trois quarts de la viande commercialisée provenaient de bêtes abattues sans étourdissement – or l’abattage rituel ne représentait évidemment pas 75 % de la viande consommée en France à l’époque. Il s’agit d’une matière complexe, mais nous devons continuer d’avancer.
M. le rapporteur. Dans cette matière complexe, le caractère rituel de l’abattage sert parfois de prétexte pour ne pas agir, par exemple en cas de difficulté économique entravant l’équipement d’un abattoir. Vous évoquiez à juste titre le risque de stigmatisation : il pourrait presque en l’occurrence s’agir d’une stigmatisation en creux, certains opérateurs justifiant du fait que l’on ne peut améliorer le fonctionnement de leur abattoir en raison des opérations d’abattage rituel, alors qu’ils pourraient, et même devraient, réaliser des investissements et adapter les pratiques pour se mettre en conformité avec les règles en vigueur, y compris concernant l’abattage rituel. Puisque vous êtes en première ligne des efforts consacrés à ce que l’abattage dérogatoire se fasse dans les règles, ne constatez-vous pas une légère réticence de certains opérateurs qui utilisent l’abattage rituel comme un alibi pour ne pas évoluer et ne pas investir ?
M. Arnaud Schaumasse. De ce point de vue, nous avons la chance que les acteurs religieux soient pleinement conscients de cet enjeu. Pour les connaître, je sais qu’ils ne tolèreront pas d’être utilisés comme les paravents de mauvaises pratiques. Le grand rabbin de France, le recteur de la mosquée de Lyon, le président du Conseil français du culte musulman lorsqu’il s’exprime au nom des trois acteurs habilités à délivrer des autorisations, ne laisseront pas instrumentaliser la religion et présenter l’abattage rituel comme un folklore qui permet d’évacuer les problèmes. Les élus, les pouvoirs publics et les associations qui le souhaitent ont là des alliés avec lesquels ils pourront avancer.
Cela étant, l’alibi que vous évoquez est une solution de facilité qui existe. Certains acteurs du marché halal ont cherché à faire croire que la viande halal était de meilleure qualité. Le halal est une norme religieuse, et non un gage de qualité ; la viande halal, comme la viande casher, peut être bio ou labellisée. Sans doute certains s’en servent-ils comme d’un paravent, mais je crois qu’ils n’y ont pas intérêt.
M. le rapporteur. Le responsable de l’abattoir d’Alès, un abattoir public, nous a très explicitement indiqué que tout dysfonctionnement constaté dans son abattoir était dû à l’abattage rituel, dont l’interdiction permettrait de résoudre tous les problèmes.
M. Arnaud Schaumasse. Les images dramatiques de l’abattoir de Pézenas qui ont été diffusées ce matin montrent notamment une séquence d’abattage sans étourdissement au cours de laquelle rien ne correspond aux processus de contention, d’encadrement, d’acheminement, de vérification et de contrôle tels qu’ils sont normés. Le caractère rituel ou non de l’abattage et la présence éventuelle d’un sacrificateur ne change rien au non-respect des normes de contention et au fait qu’il n’a pas été vérifié que la bête était bien morte avant d’être accrochée et traînée le long du rail. Si nous visionnions ces images hors contexte, rien ne nous permettrait de savoir s’il s’agit d’un abattage à caractère rituel ou pas. Autrement dit, la dimension rituelle n’est pas en cause dans le non-respect des règles.
En tout état de cause, je connais des acteurs religieux qui sont pleinement concernés par cette question et qui souhaitent que les choses s’améliorent. Les sept organismes de formation habilités à former à l’abattage rituel sont pleinement préparés à la spécificité de la mise à mort sans étourdissement préalable. Le chemin reste long, cependant, et je crains hélas ! que votre commission d’enquête ne soit pas la dernière à étudier la question des pratiques des abattoirs.
M. le président Olivier Falorni. Nous vous remercions.
La séance est levée à vingt heures vingt.
——fpfp——
35. Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Luc Daub, auteur de « Ces bêtes qu’on abat, journal d’un enquêteur dans les abattoirs français »
(Séance du jeudi 30 juin 2016)
La séance est ouverte à neuf heures dix.
M. le président Olivier Falorni. Mes chers collègues, nous auditionnons ce matin M. Jean-Luc Daub, auteur de Ces bêtes que l’on abat, journal d’un enquêteur dans les abattoirs français.
Monsieur, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez longtemps travaillé comme bénévole ou salarié pour des associations de protection animale. Votre ouvrage, paru en 2009, retrace les enquêtes que vous avez effectuées dans les abattoirs durant une quinzaine d’années. Vous vous y déclarez choqué de la manière dont est traité l’animal dans les abattoirs. Selon vous, les animaux « sont tués dans l’indifférence, sans que l’on prenne réellement en compte leur bien-être ». Vous travaillez aujourd’hui dans le secteur médico-social comme éducateur auprès de publics lourdement handicapés, en particulier des personnes autistes.
Nous souhaitions, suite à la publication de votre ouvrage et en raison de votre expérience, avoir votre analyse, votre expertise, votre vécu et votre point de vue sur la situation dans les abattoirs, et vous interroger sur votre affirmation selon laquelle les animaux sont tués dans l’indifférence dans les abattoirs.
Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale, et vous demander, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d’enquête, de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Luc Daub prête serment.)
M. Jean-Luc Daub. Monsieur le président, je tiens à remercier la commission d’enquête de me permettre de m’exprimer ce matin.
Pendant plus de dix ans, j’ai été enquêteur dans les abattoirs. Mon travail consistait à vérifier le bon déroulement des activités d’abattage en fonction des normes réglementaires. J’allais à la rencontre des membres de la direction des abattoirs, des différents responsables, du personnel, mais aussi des membres des services vétérinaires.
J’effectuais mes missions seul et de façon inopinée : je ne prenais jamais de rendez-vous. Je n’étais pas un militant, bien que mon cœur fût voué à la cause animale. Il n’y avait pas de réseau internet et la société ne s’intéressait pas aux animaux des abattoirs comme c’est le cas aujourd’hui. J’étais un enquêteur objectif, posé et très calme, même si j’ai dû assister à bien des situations de détresse et de souffrance des animaux, et à bien des infractions. Le sérieux de mon travail était reconnu ; j’ai été mis à l’honneur par l’association pour laquelle je travaillais, qui m’avait remis, lors d’une assemblée générale, une médaille du ministère de l’agriculture.
J’ai visité des centaines d’abattoirs, dont certains plusieurs fois. Je dialoguais avec les professionnels de ces structures, le but étant de faire améliorer les conditions d’abattage, et évidemment de venir en aide et au secours des animaux en détresse.
Mes missions n’étaient pas faciles. Vivre régulièrement avec les animaux, leur détresse et leur souffrance m’a atteint au plus profond de moi-même, et laissé des traces. Le milieu de la filière viande était très dur, même entre les professionnels. J’étais bien accueilli dans certains abattoirs par des intervenants coopératifs avec lesquels j’ai pu avoir des échanges instructifs, voire constructifs. Mais j’ai vécu la frilosité du milieu en matière de protection animale, j’ai essuyé des propos agressifs, subi des actes violents à mon encontre, jusqu’à une agression sur un marché aux bestiaux où je me suis retrouvé seul au monde, sans personne pour me porter secours.
Hostilité, agressivité, tension et pressions, non-conformité des abattages, infractions à la réglementation, mauvais traitements, tel était le quotidien de mes missions. Pour autant, cela ne me freinait pas, car les animaux vivaient des situations injustes, et c’est pour cela que je n’abandonnais pas, même si j’ai pu en souffrir moi-même. Il était impératif de venir en aide aux animaux.
En 2009, j’ai écrit cet ouvrage Ces bêtes qu’on abat, journal d’un enquêteur dans les abattoirs français (1993 à 2008). Mais aujourd’hui, la situation est exactement la même que celle que j’y décrivais, qu’il s’agisse de la dureté du milieu, des conditions d’abattage, de ce que vivent et subissent les animaux.
De fait, si nous sommes réunis ici, si votre commission d’enquête auditionne un certain nombre de personnes, c’est parce que le sort des animaux ne s’est pas beaucoup amélioré dans les abattoirs – ni d’ailleurs dans les élevages de type industriel et intensif d’où ils sont transportés.
Je remercie l’association L214 qui, grâce à ses vidéos, a percé l’abcès. Sinon, le débat dans la société et au sein de la commission d’enquête n’aurait pas pris cette ampleur. Nous serions encore à nous imaginer que l’abattage des animaux se passe comme sur une table d’opération, avec une anesthésie évitant toute douleur. Mais le sang des bêtes coule, alimenté par le peu d’intérêt pour l’animal lequel est considéré comme une marchandise économique, voire comme « un objet sur pattes » permettant de faire fonctionner des abattoirs soumis à une logique de rentabilité.
J’espère aujourd’hui de cette commission qu’elle permettra de mettre en place des mesures d’urgence, que l’on améliorera les conditions d’abattage et d’élevage. Il n’est pas acceptable que les animaux arrivent dans les abattoirs en mauvais état : volailles déplumées, animaux affaiblis, carencés, incapables de se mouvoir et de marcher, femelles sur le point de mettre bas... Bien des vaches et des truies donnent naissance dans les abattoirs. À moins que, lorsqu’elles sont éviscérées, on ne retrouve leur petit à l’intérieur de leur ventre.
Aujourd’hui, il est urgent d’agir, afin que les animaux souffrent moins. Mais le vrai débat qui se pose dans la société ne porte pas sur l’amélioration des structures d’abattage pour mettre fin à ce massacre à grande échelle – trois millions d’animaux par jour ! La grande question tourne autour de notre alimentation. Les animaux sont tués pour nous permettre de nous nourrir, mais il est tout à fait possible de s’alimenter autrement. Voilà pourquoi il faut végétaliser au maximum notre mode d’alimentation. C’est une piste intéressante pour l’être humain, mais aussi pour les animaux à qui nous éviterions bien des souffrances inutiles.
M. le président Olivier Falorni. Merci monsieur Daub. Je souhaite, en préambule, vous poser deux types de questions.
Les premières concernent certains passages de votre livre.
Vous évoquez « un appareil anesthésiant innovant qui apeure terriblement les animaux et les met dans un état de souffrance ». Pouvez-vous en dire plus sur cet appareil ?
Ensuite, vous parlez « des services vétérinaires qui se préoccupent peu du bien-être animal, les bonnes initiatives étant des cas isolés ». Quelles étaient ces bonnes initiatives ? Est-ce à dire que le bien-être animal n’est pas pris en compte par les services vétérinaires ? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets ? Les vétérinaires sont-ils à votre avis les seuls responsables de l’inertie totale de l’administration dont vous parlez ?
Enfin, vous évoquez des « bêtes découpées encore vivantes ». Est-ce une situation fréquente ?
Mes autres questions visent à recueillir votre point de vue.
Que pensez-vous de la mise en place de la vidéosurveillance dans les abattoirs ? Est-ce que ce serait un moyen utile pour lutter contre les dérives que vous dénoncez dans votre livre ?
Enfin, depuis la parution de votre ouvrage, sept années se sont écoulées. Êtes-vous revenu dans les abattoirs depuis 2009 ? Si oui, avez-vous constaté des changements dans les pratiques ?
M. Jean-Luc Daub. Pouvez-vous me préciser de quel appareil innovant vous parlez ? J’ai vu beaucoup d’appareils plus ou moins innovants…
M. le président Olivier Falorni. Vous avez évoqué un appareil anesthésiant, mais de manière plus générale, considérez-vous que l’étourdissement obligatoire dans l’abattage traditionnel ne fonctionne pas, ou fonctionne mal ? Est-il fréquent que des animaux soient conscients au moment de la saignée ?
M. Jean-Luc Daub. Je ne sais pas si vous avez vu les récentes images de l’association L214, mais on y voit bien que l’utilisation de la pince électrique, pour étourdir les porcs, n’est pas conforme : soit l’intensité du courant n’est pas la bonne, soit la pince est obsolète, ou mal réglée, mal entretenue ou mal utilisée. Cela n’anesthésie pas le porc, qui devrait tomber tout de suite sans se rendre compte de rien.
Quand on reste deux heures sur l’animal, qu’il bouge dans tous les sens et qu’il essaie de fuir, c’est qu’il y a un problème. Cela arrive fréquemment avec ces pinces manuelles. Si elles ne sont pas efficaces, les animaux – et notamment les porcs – souffrent.
M. le président Olivier Falorni. Et l’utilisation du matador ?
M. Jean-Luc Daub. C’est pareil. J’ai pu revoir sur les vidéos de ce matin ce que j’avais déjà constaté dans les abattoirs, à savoir qu’il y a beaucoup de ratés et que l’animal bouge. Cela dépend aussi de la conception du piège, des cadences de l’abattoir, de la compétence de l’employé, de l’efficacité et du bon entretien du matériel. Une grande partie se joue sur l’entretien du matériel.
M. le président Olivier Falorni. Ainsi, la majorité de ces situations ne relève pas d’actes de maltraitance volontaires de salariés, mais de l’inadéquation du matériel pour étourdir et mettre à mot les animaux ?
M. Jean-Luc Daub. Les vidéos constituent une preuve tangible de l’obsolescence du matériel. Elles montrent un cheval qui a été étourdi à l’aide du pistolet matador. Mais elles montrent ensuite comment on peut utiliser la pince pour les cochons : si c’est pour faire avancer l’animal, juste pour s’amuser et le chatouiller un peu, c’est que l’employé fait quelque chose qu’il n’a pas le droit de faire.
M. le président Olivier Falorni. Je ne sais pas s’il faut qualifier ces cas de particuliers ou d’exceptionnels : c’est à vous de nous le dire. Mais estimez-vous, de façon générale, que l’étourdissement ne fonctionne pas ?
M. Jean-Luc Daub. J’estime que l’étourdissement, de façon générale, aurait dû être amélioré et perfectionné depuis longtemps. Cela fait des années qu’on utilise le pistolet matador. On n’est même pas sûr que l’animal ne ressente effectivement plus rien. Il en est de même des pinces électriques. Il y a vraiment un gros travail à faire sur les structures et les appareils d’étourdissement.
M. le président Olivier Falorni. Estimez-vous que le contrôle de l’étourdissement soit suffisant, notamment de la part de celui qui est chargé de procéder à la saignée ?
M. Jean-Luc Daub. Au poste d’étourdissement, on n’a pas forcément le temps de contrôler. L’employé fait son travail pour étourdir l’animal. Soit l’animal est groggy, soit il réagit encore. L’employé peut voir qu’il a raté son étourdissement, mais il n’y a pas de contrôle à chaque étourdissement. Ce n’est pas possible en raison des cadences de travail des abattoirs.
M. le président Olivier Falorni. Sur les services vétérinaires, vous avez été assez sévère.
M. Jean-Luc Daub. J’ai été modéré…
M. le président Olivier Falorni. Vous dites qu’ils ne se préoccupent pas du bien-être animal.
M. Jean-Luc Daub. C’est une simple constatation, pas une attaque personnelle, ni même une réaction de militant. D’ailleurs, je ne m’attaque à personne, ni aux employés d’abattoir, ni aux éleveurs, ni aux services vétérinaires.
J’ai vu que les services vétérinaires n’étaient pas toujours au poste d’abattage. Ils avaient d’autres préoccupations, à savoir l’aspect sanitaire et l’hygiène de la viande. À cette époque et encore maintenant, tous ces dérapages et toutes ces infractions s’expliquent par le fait que la protection animale n’est pas le souci majeur des services vétérinaires : ou ils n’ont pas les moyens de s’en occuper, ou ils ne sont pas assez nombreux, ou ils n’en ont pas la volonté ou c’est leur administration qui ne les y pousse pas… Quoi qu’il en soit, au cours de mes visites, il m’est arrivé d’assister à des infractions alors qu’un inspecteur vétérinaire se trouvait à côté de moi.
M. le président Olivier Falorni. Il y assistait sans réagir ?
M. Jean-Luc Daub. C’était le lot courant et cela fonctionnait ainsi. Parfois le vétérinaire m’expliquait que l’on n’avait pas d’autre moyen de procéder. Je me souviens avoir fait intervenir un inspecteur vétérinaire sur un marché aux bestiaux, pour faire euthanasier une vache qui s’était fracturé une patte sur un sol glissant – dans un marché aux bestiaux, les sols ne doivent pas être glissants. Selon la réglementation, la vache aurait dû être euthanasiée sur place. Un inspecteur vétérinaire du département est arrivé avec un technicien vétérinaire, mais ils ont fait en sorte de charger l’animal dans un camion pour le porter à l’abattoir le plus proche. Pour y parvenir, il a fallu le tirer au bout d’une chaîne, de très loin, passer des angles et des portes, ce qui l’a fait souffrir. Les services vétérinaires ont agi en totale infraction, sans prendre en compte le bien-être de l’animal, mais plutôt l’intérêt économique : en l’envoyant à l’abattoir coûte que coûte, on pouvait récupérer une partie de la viande de la carcasse. Or, selon la réglementation, si l’animal n’est pas transportable, il doit être euthanasié sur place. Et c’était bien le cas de cette vache, dont une des pattes ne tenait plus que par la peau et qui meuglait de douleur.
En abattoir, c’est la même chose. J’ai vu un cochon qui était par terre, en train d’agoniser et qui bavait. J’ai demandé à un inspecteur vétérinaire qui était avec moi s’il ne pouvait pas l’euthanasier pour abréger ses souffrances. Il m’a répondu que les cochons, souvent, se remettaient vite. Mais une demi-heure après, celui-ci est mort tout seul…
M. le président Olivier Falorni. Vous évoquez des bêtes découpées encore vivantes. C’est très grave. L’avez-vous vu fréquemment ?
M. Jean-Luc Daub. C’est ce qui se passe lorsque l’on n’attend pas la fin de la saignée – qui provoque la mort effective de l’animal – avant de commencer à découper les pattes. Cela arrive encore, comme on le voit sur les images de L214.
Je suis obligé de parler de ces vidéos, parce qu’elles dénoncent une réalité. Et heureusement qu’elles existent ! Elles prouvent que tout ne se passe pas comme sur une table d’opération et que, malgré la réglementation, les contrôles au niveau de la protection animale et les nombreux textes, les infractions et les cas de non-conformité sont monnaie courante.
M. le président Olivier Falorni. Que pensez-vous de la vidéosurveillance ?
M. Jean-Luc Daub. Ce ne peut être qu’une bonne chose. Dans le secteur du médico-social où je travaille désormais, nous avons aussi des vidéos. Elles ne m’empêchent pas de travailler. Mais si j’ai tendance à me laisser aller, par exemple à plaisanter avec les résidents, elles se rappellent à moi. Les vidéos permettent d’exercer une certaine surveillance, mais également de revenir en arrière en cas de situations critiquables.
En revanche, j’ai pu constater, en visionnant les auditions, que l’existence de vidéos pouvait poser problème à l’employé de l’abattoir. En effet, elles mettent toute la pression et toute la responsabilité sur ses épaules. Mais qui a la responsabilité de l’abattoir ? C’est le directeur, le PDG. Qui a la responsabilité de contrôler que le directeur s’occupe bien de l’abattoir ? Ce sont les services vétérinaires. L’employeur ne peut pas porter sur lui la responsabilité de tout.
Lorsqu’il y a des cadences excessives, l’employé n’a pas le temps de faire son travail de façon convenable. Il est soumis, au quotidien, à la pression de l’employeur. Il faut savoir que dans les grandes structures, il faut éviter les « trous » dans les abattages parce qu’il y a derrière 500, 1 000 ou 2 000 personnes qui attendent. Coûte que coûte, l’animal doit alimenter la chaîne.
M. le président Olivier Falorni. Êtes-vous retourné dans des abattoirs depuis 2009 ?
M. Jean-Luc Daub. Oui, j’y suis retourné.
Sur la route, par exemple, un automobiliste est responsable de sa conduite et de sa voiture. Pour autant, que penseriez-vous de gendarmes qui le regarderaient passer en état d’ébriété sans rien faire ? C’est un peu ce que j’ai vu dans les abattoirs. Les services vétérinaires ont la responsabilité de ce qui se passe dans les abattoirs pour ce qui touche à la protection animale et aux aspects sanitaires. Mais comment se fait-il que les situations que je dénonçais en 2009 dans mon livre existent encore en 2016, comme le prouve la vidéo que j’ai encore regardée ce matin ? Et qui contrôle le matériel et la mise en conformité ? Ce sont les services vétérinaires. Je ne dis pas qu’ils sont responsables de tout. Reste qu’ils ont un pouvoir de police et qu’ils devraient s’en servir.
M. William Dumas. À vous entendre, il n’y a rien de bien pour tuer les animaux ; donc, il ne faut pas manger de viande. C’est en tout cas ce que j’ai retenu de vos propos jusqu’à maintenant.
Vous avez parlé des images qui ont été prises à Pézenas, dans l’Hérault. Or la directrice de la DDPP – Direction départementale de protection des populations – a déclaré que cette vidéo, que l’on sort maintenant, avait été prise par la L214 il y a un certain temps déjà. De fait, la herse et bien d’autres choses qui y figurent n’existent plus depuis que l’abattoir s’est mis en conformité à la suite du contrôle général décidé par l’État.
Je connais l’abattoir du Vigan qui se trouve dans ma circonscription. J’y suis allé. Un employé a « foiré », il a été mis dehors. Mais il faut arrêter de dire que tout est négatif ! Il y a des choses faites, et bien faites. Moi qui suis sensible au bien-être animal, je peux vous dire que, dans ma région, il y a des éleveurs qui vendent en circuit court, et qui aiment leurs animaux. Lorsqu’ils amènent leurs vaches, leurs cochons ou leurs agneaux à l’abattoir, ils attendent qu’ils aient été abattus. Après qu’ils ont été conditionnés dans une salle attenante, ils repartent pour les vendre. Autrement dit, ils sont présents.
Qu’il y ait eu, qu’il y ait encore parfois des problèmes, je le sais. Mais je sais aussi qu’au Vigan, il a fallu prendre cinquante heures de vidéo pour trouver quatre minutes à critiquer. Cela signifie que tout n’est pas négatif dans les abattoirs. Comme partout, comme dans tous les métiers, il peut y avoir des gens, du matériel qui dysfonctionnent. Mais je pense que dans l’ensemble, le travail est bien fait. Et depuis, au Vigan, le matériel qui dysfonctionnait a été changé.
Bien sûr, tout peut arriver. Ce matin, alors que je prenais ma douche, un plomb a sauté et je me suis retrouvé dans le noir… C’est pareil dans un abattoir. Je vous invite à modérer vos propos. N’oubliez pas qu’il y a, derrière, des intérêts économiques, des éleveurs, des gens qui entretiennent le paysage et protègent d’environnement de nos Cévennes. Si demain il n’y a plus d’éleveurs, il n’y aura plus de gens pour se préoccuper l’environnement. Il y aura davantage de bien-être animal, mais il n’y aura plus personne ! Il faut aussi savoir ce que l’on veut.
Je suis d’accord pour que l’on prenne en compte le bien-être animal et que l’on applique des sanctions quand cela ne va pas. Mais ne me dites pas que les services vétérinaires ne vont pas, que le matériel ne va pas, etc. Trop c’est trop !
M. Jean-Luc Daub. Ce sont des faits. Je ne sais pas si L214 avait filmé cette dernière vidéo bien avant de la diffuser. En tout cas, qui a permis de mettre en place des contrôles dans les abattoirs ? Ce sont tout de même les associations qui se préoccupent du bien-être des animaux. Sinon, la situation ne changerait pas.
Maintenant, posons-nous cette question : qu’est-ce que le bien-être des animaux ? Si, ce matin, vous avez été incommodé sous la douche, vous n’avez pas souffert. Pour contre, même s’il n’y a eu que quatre minutes de mauvais traitements, c’est quatre minutes de trop pour les animaux !
M. William Dumas. Il peut y avoir des incidents de matériel.
M. Jean-Luc Daub. Bien sûr, mais il y a encore du matériel obsolète.
M. William Dumas. Votre voiture aussi peut tomber en panne.
M. Jean-Luc Daub. Mais la voiture, il faut l’entretenir…
M. William Dumas. Je peux vous répéter ce que la directrice de la DDPP de l’Hérault nous a répondu. Selon elle, les vidéos ont été prises avant qu’on ne change le matériel.
M. Jean-Luc Daub. Tant mieux. Mais qu’est-ce qui a permis de faire bouger les choses ? C’est le milieu associatif.
M. William Dumas. Sur le principe, je suis d’accord. Mais arrêtez de mettre systématiquement L214 en avant. Qu’ils retournent dans les abattoirs, maintenant que le matériel a été changé. Qu’ils arrêtent de ressortir des vidéos anciennes, maintenant que l’État a procédé à des contrôles. On met la parole de tout le monde en doute. Je trouve que c’est grave !
M. Jean-Luc Daub. Quand je visitais les abattoirs, je me suis fait agresser. On m’a dit que les images qui avaient été diffusées à cette époque à la télévision venaient de l’étranger. Or en France je voyais des choses pires qu’à l’étranger – sauf que ce n’était pas filmé… Et j’ai visité des abattoirs pendant suffisamment longtemps pour le savoir. Mais j’étais sérieux, correct, jamais agressif, jamais violent avec personne. Je ne suis pas venu pour embêter les professionnels…
M. William Dumas. Je ne suis pas agressif, je dis ce qui arrive…
M. Jean-Luc Daub. Il faut savoir aussi que, même en fonctionnant en conformité avec la réglementation, avec du matériel efficace, on n’arrivera jamais à assurer le bien-être des animaux dans les abattoirs. Le bien-être animal en abattoir, cela ne peut pas exister : jamais un animal ne songera à aller à l’abattoir pour son bien-être… On peut juste rendre la chose moins pire. L’expression souvent utilisée de « bien-être animal en abattoir » est donc un non-sens. Pour mon bien-être, je vais au sauna, à la piscine, courir… mais je ne vais pas à l’abattoir !
M. le président Olivier Falorni. Hier, j’ai demandé aux associations de protection animale si elles estimaient que la maltraitance était consubstantielle à l’abattoir. Vous-même, considérez-vous que, dans un abattoir, il y a forcément de la maltraitance parce que l’on y tue un animal ? A contrario, est-ce que vous considérez qu’il peut y avoir des abattoirs qui ne maltraitent pas les animaux ?
M. Jean-Luc Daub. La maltraitance ou le mal-être des animaux commence dès l’élevage, par l’élevage industriel ou intensif. Mais en abattoir, aucun animal ne peut être bien. La maltraitance est là, implicitement, même si on veut bien faire. Elle sera toujours là, tout simplement parce qu’un animal n’a pas envie de mourir. Il suffit d’observer son comportement. Même quand le matériel fonctionne correctement, même quand la réglementation est respectée, il faut regarder les animaux dans les yeux et essayer de les comprendre : ils sont en détresse.
Le box rotatif pour la contention des animaux, en abattage rituel comme en abattage classique, parfaitement conforme, est effrayant pour un bovin : des parois vont se rabattre sur lui de chaque côté ; avec une mentonnière, on va lui lever la tête ; ensuite, on va le retourner sur le dos. Et cela, c’est quand tout se passe bien : j’ai vu des box rotatifs inadaptés à la taille des animaux. Cela reste une source de souffrance pour l’animal, même si le matériel est conforme et la réglementation appliquée, et malgré tous les bons soins du personnel. On n’arrivera jamais à la souffrance zéro.
Mme Françoise Dubois. Vos propos m’ont interpellée, comme ceux de mon collègue William Dubois. Mais je serai peut-être un peu moins brutale…
Je voudrais savoir si les faits que vous dénoncez se retrouvent à chaque enquête. Dans ce cas-là, à quoi sert l’enquêteur ? Y a-t-il un suivi dans les abattoirs ? Avez-vous pu échanger avec le personnel, avec les salariés qui font les abattages, pour savoir comment ils avaient été formés et dans quelles conditions ils travaillaient – par exemple, des cadences parfois difficiles à tenir. Avez-vous pu discuter sur ce que vous aviez vu et observé ?
M. Jean-Luc Daub. Mes propos peuvent sembler négatifs. Mais je ne m’attaque à personne. Il y a des employés d’abattoirs, des directeurs, des membres des services vétérinaires ou des éleveurs qui font au mieux leur travail. Reste que la situation n’est pas facile pour eux : c’est un système particulier où la rentabilité, l’économie est prioritaire, et cela se fait au détriment du bien-être animal.
J’ai beaucoup discuté avec les directeurs, les services vétérinaires, les employés. Certains employés vivent mal leur travail. S’ils pouvaient faire autre chose, ils le feraient. Il y a aussi une souffrance du personnel.
Un inspecteur des services vétérinaires m’a dit clairement qu’il ne pouvait pas dresser de procès-verbal ou euthanasier tel animal à tel moment. Car il a toute une pression derrière lui : la filière ou l’éleveur qui viendra lui demander des comptes. Il ne peut pas faire autrement. De mon côté, je pense qu’il est difficile pour un inspecteur vétérinaire, vacataire dans un petit abattoir et propriétaire d’une clinique vétérinaire en milieu rural, de se montrer strict vis-à-vis de cet établissement au point d’en faire arrêter l’activité.
Mme Françoise Dubois. L’inspecteur vétérinaire est là pour contrôler les règles sanitaires. Est-il là aussi pour contrôler la façon dont les animaux sont traités ?
M. Jean-Luc Daub. C’est écrit dans les textes.
Mme Françoise Dubois. Mais il ne peut pas être partout…
M. Jean-Luc Daub. Il ne peut pas être partout s’il y a un problème d’effectifs. C’est d’ailleurs ce que l’on met en avant maintenant. Mais quand je visitais des abattoirs, ce n’était pas encore le cas : c’est seulement à partir de 2008 et jusqu’en 2012 que les effectifs ont baissé. Cela étant, il faut reconnaître que le travail des inspecteurs vétérinaires n’était pas facile non plus.
Vous m’avez également interrogé sur le résultat de mes enquêtes.
À la fin de mes visites d’abattoirs, je faisais un débriefing avec le directeur : tel point est conforme ; vous avez eu raison de faire cela, même si vous n’y étiez pas obligé ; votre piège peint en blanc, cela fait peur aux animaux… Il faut savoir qu’un piège doit toujours être brun ou d’une couleur sombre, sinon il ne va pas vouloir entrer. Et cela ne sert à rien de chercher à les pousser à coup de bâton électrique, parfois même sur les parties génitales. Au-delà de la structuration du matériel et de l’accueil des animaux, il y a de nombreux points auxquels on doit réfléchir.
Ensuite, je faisais des comptes rendus. L’association pour laquelle je travaillais écrivait à la direction des services vétérinaires, au directeur de l’abattoir, parfois même au ministère de l’agriculture. Pour autant, cela n’a pas beaucoup bougé. J’étais même franchement écœuré. C’est d’ailleurs, pour partie, en raison de cette inertie que j’ai abandonné ce travail.
Dans certains cas, on a pu améliorer la situation. On est venu en aide à des animaux. Mais franchement, à voir la situation actuelle, notre action n’a pas eu un grand impact.
Mme Sylviane Alaux. Nous l’avons constaté au cours de ces auditions, l’abattoir est un lieu de souffrance. La société est-elle prête à s’engager dans une révolution culturelle pour faire de ce lieu de souffrance un lieu où l’on souffre le moins possible ? N’oubliez pas que l’on s’appuie sur une véritable économie de marché.
Votre livre avait suscité beaucoup d’intérêt en 2009. Dans un article de Mediapart, un journaliste se félicitait d’« une enquête digne de la plus grande rigueur sociologique », et de votre « désir de comprendre le travail de ceux qui tuent les animaux pour nourrir les humains ». Je pourrais en citer d’autres.
Reste qu’on ne fera pas de nous tous des végétariens. On mange de la viande, mais on ne veut pas savoir ce qui se passe avant. On l’a constaté, l’abattoir est un lieu de souffrance pour les animaux. Mais l’élevage et le transport aussi.
Que pensez-vous des abattoirs mobiles ? Avez-vous le sentiment que cela peut réduire la souffrance animale tout en permettant à l’éleveur de vivre de son produit ?
J’ai trouvé votre livre très intéressant. Avez-vous publié par la suite – ou avez-vous envie de publier – des préconisations pour réduire la souffrance animale ? Mais il faut savoir qu’il faudra impérativement répondre à quatre priorités absolues : le bien-être animal, mais également le bien-être des salariés, la sécurité du consommateur et la préservation de l’environnement. On ne peut plus passer outre parce qu’ils doivent conditionner tout ce qui nous unit, nous qui ne sommes pas tous végétariens, au fait que l’animal peut, à un moment ou à un autre, devenir un produit.
M. Jean-Luc Daub. Je ne suis pas devenu végétarien du jour au lendemain, mais quand on regarde, à l’abattoir, les animaux dans les yeux, qu’on lit leur détresse, on comprend que c’est un grand massacre injuste – à mon époque, on tuait 700 cochons à l’heure, aujourd’hui sans doute davantage. Nous ne sommes pas obligés de manger autant de viande. Mais je ne suis pas là pour faire la guerre aux consommateurs qui mangent de la viande. Je n’ai de leçon à donner à personne ni à culpabiliser personne, juste à ouvrir les yeux, à éveiller les consciences et à montrer la réalité.
Les abattoirs mobiles seraient une bonne chose – même si on en revient toujours à la question centrale, qui est en débat dans la société, à savoir l’alimentation – et pour l’éleveur et pour l’animal. En effet, ils éviteraient à l’animal d’être transporté, déplacé vers un lieu qu’il ne connaît pas, et parqué à l’abattoir pendant une nuit – car maintenant, on fait arriver les animaux la veille. J’imagine mal ce que c’est de passer une nuit à l’abattoir pour un animal qui sent, notamment dans les traces d’urine de ses congénères, le stress, la détresse et la mort. Dans un abattoir, il y a des odeurs, des bruits métalliques, les hurlements du personnel et les cris des bêtes. L’animal ne comprend pas, c’est horrible. Quand on vous fait visiter un abattoir, on a l’impression que tout se passe bien, mais ce n’est pas si simple.
Cela étant, l’utilisation de ces abattoirs mobiles remettrait en question notre mode d’alimentation. Pour que le système fonctionne, il faudrait que l’on végétalise notre nourriture, c’est-à-dire que l’on mange moins de viande, voire pas du tout pour ceux qui le souhaitent ou en sont capables. En effet, on ne pourrait pas en produire autant avec des abattoirs mobiles.
M. Jean-Luc Bleunven. Vous avez parlé des animaux en état de gestation. Mais dans la mesure où ceux-ci représentent une valeur, je ne vois pas l’intérêt de les abattre. Est-ce fréquent, comme vous semblez le dire, ou anecdotique ?
Je voudrais ensuite vous interroger sur ce que l’on pourrait appeler « la culture de l’abattoir ». Je pense que l’abattoir est un lieu où, au fil du temps, on a pris des habitudes. Le seul fait de porter un autre regard, comme vous l’avez fait, vous exclut de cette culture : les animaux étant là pour être abattus, c’est une sorte de fatalité, il faut passer par ce stade, c’est ainsi. Est-il possible de trouver une porte de sortie ?
M. Jean-Luc Daub. De nombreux petits abattoirs ont fermé à cause des normes sanitaires européennes, et leur activité a été reprise par les grosses structures. Mais il est difficile de faire fonctionner différemment ce genre d’installation. Les abattoirs n’ont pas été mis en place pour faire du mal aux animaux, mais parce que l’on consomme de la viande. Le problème est que l’on entre ensuite dans un circuit économique de rentabilité, qu’il faut aller vite et que l’animal n’est plus considéré que comme un produit à valeur marchande. Voilà pourquoi il faut revenir en arrière et regarder les animaux dans les yeux. Qui sont-ils ? Que ressentent-ils ?
Il serait utile d’installer des vidéos dans les abattoirs. À ce propos, j’observe un phénomène curieux : certains, dans la filière, veulent bien des vidéos, mais ils pensent qu’il ne faut pas montrer l’abattage en lui-même pour ne pas choquer. Mais pourquoi ne regarderait-on pas l’abattage en face ? Pourquoi ne veut-on pas voir la réalité de ce que vivent les animaux ? On sait ce qu’est un animal vivant dans une ferme, on le retrouve en quartiers ou en morceaux dans l’assiette, mais entre ces deux phases, on ne veut pas trop savoir ce qui se passe.
On tourne toujours autour de la question de l’animal en lui-même. Le débat porte sur la conformité des abattoirs, la structure ou la formation du personnel. Mais il ne faut pas écarter l’animal et la perception que la société a de l’animal : ce qu’il vit, ce qu’il ressent, c’est important. Un seul animal qui souffre en abattoir, c’est toujours un animal de trop.
Ensuite, il est en effet interdit de faire partir à l’abattoir des animaux gravides ou sur le point de mettre bas. Les coches – terme professionnel pour les truies – sont souvent envoyées à l’abattoir parce que l’on n’a pas détecté qu’elles étaient gravides. Il arrive aussi que si, à la suite des inséminations, il y a davantage de coches porteuses de porcelets que de places en maternité, on fait abattre celles qui sont en trop. C’est le système industriel intensif, tourné vers la rentabilité, qui veut cela.
M. Jacques Lamblin. J’ai trois questions à vous poser.
Premièrement, vous avez raison de dire que l’on ne peut pas parler de bien-être animal à l’abattoir. Il serait plus approprié de parler de « souffrance évitable ». Donc, sous réserve que toutes les dispositions réglementaires sont respectées, que les équipements de la chaîne d’abattage sont conformes et en excellent état technique, peut-on abattre un animal sans qu’il ne souffre inutilement, voire sans souffrance ?
Deuxièmement, avez-vous vu des abattages rituels ? Qu’en pensez-vous ?
Troisièmement, on associe souvent les souffrances ou les actes de cruauté constatés à la pression de la cadence. Ce n’est peut-être pas aussi évident que cela. Vous qui avez visité un certain nombre d’abattoirs, avez-vous observé des actes non conformes liés à la pression de la cadence ? En fin de compte, la situation n’est-elle pas plus satisfaisante dans les établissements où le partage des tâches est très rationalisé, où chacun a son rôle dans la chaîne d’abattage ? Sous réserve que les règles soient respectées, n’est-ce pas mieux dans ces établissements à caractère industriel que dans les établissements artisanaux où le partage des tâches est plus empirique ?
M. Jean-Luc Daub. Ce n’est pas mieux d’avoir de très grosses structures. Les grandes usines, le travail industriel, les cadences ne peuvent pas être bonnes pour l’humain. L’humain aussi souffre dans ces structures. Et pour les animaux qui y entrent, c’est dramatique.
M. Jacques Lamblin. Je parle de l’acte d’abattage, dans une filière rationalisée, où chacun a sa fonction.
M. Jean-Luc Daub. C’est bien pour le fonctionnement de l’abattoir.
M. Jacques Lamblin. Je parle de l’abattage, du moment où l’animal souffre physiquement. Vous évoquez les souffrances psychiques ; c’est votre droit. Mais je vous pose une question précise, sur l’acte d’abattage lui-même.
M. Jean-Luc Daub. Les animaux qui alimentent les grands abattoirs proviennent d’élevages intensifs, industriels où déjà, ils ne sont pas bien. Une fois arrivés, ils sont exposés à la lumière du jour, alors qu’ils ne l’ont jamais été, ce qui les stresse. On fait en sorte de ne pas les abattre tout de suite pour les calmer, on les douche : les grands abattoirs sont mieux équipés, ils ont plus de moyens, et l’activité est plus sectorisée. Mais cela reste une épreuve pour les animaux.
J’ai vu beaucoup de coches blessées ou « mal-à-pied », c’est-à-dire incapables de marcher. Elles sont transportées dans des conditions difficiles pour elles. Quand elles arrivent à l’abattoir, elles sont prises en charge à part. Parfois, elles sont stockées dans un local et ne sont abattues qu’en fin de journée alors qu’elles peuvent être en état d’agonie. On les abat toutes ensemble parce qu’il ne faut pas souiller les chaînes d’abattage.
Le terme de « souffrance évitable » est effectivement le plus correct. On ne peut pas parler de bien-être animal en abattoir.
J’ai vu beaucoup d’abattages rituels, et j’ai été choqué comme beaucoup l’ont été. Mais j’ai été tout aussi choqué par les différents étourdissements auxquels j’ai assisté. On ne peut pas se focaliser sur l’abattage rituel et s’en prendre à une communauté sous prétexte qu’elle pratique ce type d’abattage rituel. Mais cela reste horrible : on doit retourner le bovin sur le dos en le faisant rentrer dans un box rotatif, une sorte de gros tambour de machine à laver. C’est effrayant : j’ai vu des bovins meugler, des taureaux costauds perdre leurs urines tellement ils avaient peur. On a institué l’étourdissement pour éviter toute souffrance inutile, pour le « bien-être » de l’animal. Pourquoi accepter de faire souffrir les animaux sans les étourdir ? Il est vrai que certains soutiennent que lorsqu’on n’étourdit pas les animaux et qu’on les saigne directement, ils souffrent moins.
M. Jacques Lamblin. Vous pensez que les animaux souffrent moins de ne pas être étourdis ?
M. Jean-Luc Daub. Ce sont les propos qui sont tenus pour justifier l’abattage sans étourdissement : les animaux souffrent moins et moins longtemps parce que le sang s’écoule plus rapidement, etc. Comme le cœur continue à battre, il joue son rôle de pompe, le sang sort très vite et l’animal s’évanouit.
Ou l’on pratique l’étourdissement pour éviter toute souffrance aux animaux, mais il faut l’améliorer. Ou l’on abat en égorgeant directement, si effectivement les animaux souffrent moins. Mais je ne la crois pas. J’ai vu des animaux agoniser pendant longtemps, bloqué dans le box rotatif, tant que leur sang se vidait et jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent.
On suspend aussi des animaux avant la mort complète, c’est-à-dire avant la fin de la saignée – qui va causer la mort de l’animal. Il faut donc attendre, avant de les suspendre, que la saignée soit effective et complète.
Mme Annick Le Loch. Monsieur Daub, je n’ai pas lu votre livre, mais on vous sent très imprégné de ce que vous avez vécu pendant une dizaine d’années. Quel est le nom de l’association pour laquelle vous avez travaillé ?
Ensuite, à vous entendre, pendant ces années, vous avez visité les abattoirs de façon inopinée. Vous avez donc eu accès sans difficulté à tous les abattoirs du pays, en tant que membre de cette association. Dix ans, cela me semble extrêmement long, y compris pour vous qui, si j’ai bien compris, avez souffert de cette activité.
Vous avez visité des centaines d’abattoirs. Y en avait-il, parmi ceux-là, où la mise à mort était faite correctement, où les pièges, les matériels, les moyens d’anesthésie étaient aux normes, neufs, et où l’on faisait les investissements nécessaires ? Vous souvenez-vous de structures d’abattage conformes, où le bien-être animal ou du moins la moindre souffrance étaient pris en compte ?
Vous avez dit tout à l’heure qu’il était difficile de se rendre compte si un animal était effectivement bien anesthésié. Pour ma part, j’ai remarqué que dans certains abattoirs, la pince d’électronarcose était reliée à un ordinateur, qui indiquait si l’anesthésie avait été faite correctement ; et c’était le cas à 99,5 %. L’avez-vous vu également, au cours de vos nombreuses visites ?
Y a-t-il une différence entre les abattoirs industriels, les abattoirs publics, privés, mono-espèce, multi-espèces, etc. ? Une inspection générale nationale a été diligentée par le ministère il n’y a pas très longtemps, un état des lieux a été fait. Qu’est-ce que cela vous a inspiré ?
Enfin, je souhaitais vous poser une question sur l’abattage rituel pour savoir si les animaux souffraient plus ou moins. Mais vous avez déjà répondu.
M. Jean-Luc Daub. Je faisais effectivement mes visites de façon inopinée. Je travaillais pour l’OABA (Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir), dont vous avez auditionné le directeur et le président. Et je précise que j’ai écrit mon livre après l’avoir quittée.
Je ne procédais pas à la légère. J’ai toujours été très sérieux, et je le suis encore maintenant, avec mon expérience, et une position qui peut sembler plus radicale. Mais on tourne toujours autour d’une même question : la nécessité de végétaliser l’alimentation, peut-être pas à 100 %, mais au maximum, pour limiter les impacts négatifs de la consommation de viande.
Je pouvais visiter des abattoirs à peu près partout en France. Je m’y rendais à quatre ou cinq heures du matin, suivant le plan de route que j’avais moi-même établi, et je venais me présenter. À l’époque, c’était très dur. Défendre la protection animale était mal vu, d’autant que sévissaient plusieurs crises : la crise de la vache folle, la crise de l’agriculture, etc.
Parfois, dans certaines structures, on ne me laissait pas rentrer ; c’était plutôt le fait de structures privées. Mais c’était assez rare, et j’ai donc eu accès à de nombreux abattoirs. Certains directeurs ne me connaissaient pas, peut-être parce qu’ils venaient de prendre leurs fonctions et n’avaient pas encore eu affaire à l’OABA.
J’ai vu aussi des abattoirs conformes, au niveau de l’abattage ou du matériel. Mais il n’est jamais arrivé que tout soit correct, à 100 %, entre le moment où les animaux quittaient leur élevage, arrivaient à l’abattoir et étaient abattus.
Par exemple, à un moment donné, à un certain endroit, un étourdissement peut être correct, avec l’utilisation d’une pince électrique très perfectionnée couplée à un boîtier, permettant de moduler la décharge de courant en fonction de l’animal. Mais souvent, les pinces sont mal réglées. Les directeurs et les techniciens en abattoir ne savent pas forcément comment faire, et ils ne sont pas toujours aidés quand ils téléphonent à ceux qui les ont vendues. Il faut jouer avec le courant électrique qui doit être radical, mais pas trop puissant non plus : sinon, l’animal ne se crispe et cela provoque des déchirements dans la carcasse, l’épaule et le jambon.
Un mauvais réglage entraîne des actes de cruauté et de souffrance : l’opération prend trop longtemps, l’animal lève encore la tête, hurle et la pince ne fait que lui envoyer des décharges électriques. J’ai pu le constater dans les derniers abattoirs que j’ai visités en Bretagne : les coches étaient crispées, la tête relevée. L’étourdissement n’était pas efficace. Cela fumait, même au niveau des cosses électriques. Cela leur brûlait la peau, c’était horrible.
Je ne veux pas attaquer les éleveurs, les professionnels des abattoirs, les services vétérinaires ou qui que ce soit. Mais je veux défendre et aider les animaux, parce que je suis témoin de leur souffrance et de leur détresse en abattoir.
Le problème des abattoirs multi-espèces, ce sont les cadences ou la rentabilité. On l’a vu à l’abattoir de Mauléon, s’agissant des moutons : c’est un petit abattoir qui s’est industrialisé. Il a pris plus de commandes qu’il ne pouvait en assurer. D’où certains agissements, de la part du personnel, qui n’avaient pas lieu d’être.
Moi aussi, dans le milieu médico-social en tant qu’éducateur, avec peu de moyens, peu de personnels, j’ai des difficultés avec les résidents handicapés. Je dois faire mon travail en temps et en heure. Pour autant, je ne m’en prends pas à eux et je ne leur tape pas dessus. Même si ma position est difficile, je prends sur moi.
C’est le système qui veut cela, quand tout doit aller vite, quand tout doit être rentable.
Mme Françoise Dubois. Qui vous mandate pour aller faire les enquêtes dans les abattoirs ? Vous avez beaucoup parlé du transport et du « stockage » des animaux avant abattage. Avez-vous fait un rapport sur ce sujet ? Car vous n’êtes pas là pour enquêter sur le transport des animaux, que vous ne voyez qu’à leur arrivée à l’abattoir.
M. Jean-Luc Daub. Qui nous mandate ? Parfois, c’étaient des membres du personnel des abattoirs ou des services vétérinaires qui téléphonaient pour nous dire ce qui s’y passait.
Mme Françoise Dubois. Avez-vous une carte ?
M. Jean-Luc Daub. J’en avais une. Je n’en ai plus, car je ne travaille plus pour l’association.
Cette association, au fil des années, s’était fait reconnaître dans les abattoirs, où elle avait fait un travail intéressant depuis ses débuts, en 1964. Maintenant, elle est moins tolérée dans les abattoirs. Elle n’en visite plus que 80 %, et encore sur rendez-vous, ce qui n’a plus rien à voir avec ce que je faisais. Parfois, on me laissait visiter, ou je me faisais oublier dans l’abattoir, et j’avais alors tout loisir d’observer de façon objective. Je n’étais pas un militant venu pour faire la guerre, mais pour voir ce qui se passait, et comment il était possible d’améliorer les choses. Mais je me suis rendu compte qu’il y avait encore de la souffrance animale, y compris aujourd’hui, en 2016.
Je faisais également quelques enquêtes sur le transport, même si ce n’était pas notre domaine premier. Si un camion de porcs était garé en surpoids sur le parking, rempli de porcs, qui allaient alimenter des abattoirs industriels et qui se marchaient les uns sur les autres, avec quelques animaux déjà morts, je faisais intervenir les gendarmes.
Avec une autre association, qui s’occupe davantage des transports, j’ai également mené des enquêtes. Lors d’une des dernières, nous avons suivi des camions remplis de petits veaux de moins de huit jours, qui venaient d’Irlande pour alimenter le marché en élevage dans le Sud de la France ou en Espagne. Les chauffeurs ne respectaient pas les points d’arrêt pour faire reposer les veaux, les faire boire et manger : ils fonçaient… Mais ils présentaient des papiers déjà signés aux gendarmes, comme s’ils s’étaient arrêtés ! Il y a encore beaucoup à faire…
M. Hervé Pellois. Vous avez écrit que les animaux étaient tués dans les abattoirs dans l’indifférence générale. Nous nous interrogeons tous à propos de l’abattage rituel, qui est sans doute le plus impressionnant, le plus choquant. Or c’est justement là qu’il y a sans doute le moins d’indifférence, avec des observateurs, des sacrificateurs, un cérémonial. Qu’en pensez-vous ?
M. Jean-Luc Daub. Cela se passe de la même façon pour l’abattage rituel, tel qu’il est fait actuellement. Car il est soumis à une certaine productivité. Certes, on prend davantage de temps avec l’animal, on dit quelques paroles saintes, il y a une petite cérémonie rapide pour que la viande soit conforme à l’alimentation halal ou casher. Mais il y a encore des box rotatifs trop grands pour certains animaux. On utilise des cordes pour les maintenir, on leur tourne la tête en leur mettant un bâton dans la bouche, on manipule plusieurs fois le box où ils tournent comme dans un tambour de machine à laver…
Il ne s’agit pas de faire du voyeurisme avec les vidéos. Mais si l’on accepte les vidéos et qu’on ne veut pas montrer l’abattage en lui-même, c’est qu’il y a encore dans la société quelque chose que l’on ne veut pas admettre, qu’on ne veut pas montrer pour éviter de choquer. Or c’est l’ultime passage de l’animal entre l’élevage et l’abattoir.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. On a évoqué avec de nombreux interlocuteurs la vidéo comme outil complémentaire, comme outil de contrôle. Mais qui regarde les images, et pourquoi faire ? La question est centrale. Je tiens à dire que l’abattage des animaux n’est pas le seul moment qu’il convient de contrôler, et qu’il n’est pas souhaitable de le montrer à un public non averti. Il y a tout de même dans la vie un certain nombre de choses qui, pour être regardées, méritent un peu de recul et de compétences.
Une saignée, même d’un animal parfaitement étourdi dans des conditions presque idéales, reste impressionnante pour quelqu’un qui n’y a jamais assisté. Encore une fois, je pense que ce serait un problème que de jeter de telles scènes à la vue d’un public totalement vierge. D’ailleurs, les abattoirs ont été faits pour que les gens ne voient pas ce qui se passe ; il ne faut pas l’oublier.
Nombre des choses que vous dénoncez sont liées à cette opacité. Vous parlez de la dureté du milieu. Mais le milieu qui n’est pas vu, qui n’est pas observé, qui ne se sent pas reconnu, qui se sent même mis en cause, se renferme forcément sur lui-même et génère cette sorte d’autoprotection : puisque vous ne voulez pas me voir, je ne veux pas me montrer.
Ne pensez-vous pas que l’on pourrait organiser la transparence, avec des associations, avec les élus locaux, sous une forme organisée, de façon régulière et constante ? Un regard extérieur ne vous semblerait-il pas bénéfique ? Cela limiterait le repli sur soi, cet effet de fermeture génératrice d’indifférence. On ouvrirait les abattoirs à un certain nombre de personnes, comme on l’a fait pour vous en tant que membre d’une association, mais en élargissant un peu la palette des personnes habilitées à savoir ce qui s’y passe et à partager avec les professionnels. Cela vous paraît-il une piste intéressante ?
M. Jean-Luc Daub. C’est intéressant. C’est ce que nous essayons déjà de faire au niveau des élevages, pour informer et montrer ce qui s’y passe. Il faudrait pouvoir le faire au niveau des abattoirs. Mais quel intérêt des abattoirs auraient-ils à ouvrir leurs portes ou à mettre des vitrines ? Il faut le faire, mais cela risquerait de faire chuter la consommation de la viande…
M. le rapporteur. Peut-être temporairement, on ne sait pas.
Je fais référence à ce qui se passe dans les centrales nucléaires, où ce n’est pas « portes ouvertes » tout le temps, mais où des organismes, des associations de protection de l’environnement et les professionnels se rencontrent et se connaissent, et finissent par échanger en confiance et à alimenter le progrès.
M. Jean-Luc Daub. Les visites guidées, c’est bien, mais…
M. le rapporteur. Je parle d’un organisme de contrôle que l’on constituerait et qui tous les mois, tous les trois ou six mois, irait voir, discuterait et ferait le point.
Enfin, vous avez beaucoup parlé du contrôle et de ses lacunes. Ne pensez-vous pas que la proximité du contrôleur de l’outil qu’il contrôle est un handicap ? Je m’explique. Il est souvent utile d’avoir un certain recul par rapport à ce que l’on contrôle. Vous avez parlé du dilemme des vétérinaires dont l’abattoir assure une part de l’activité. Vous avez cité les contrôleurs qui travaillent dans le même abattoir depuis très longtemps et qui, de ce fait, sont dans la logique de l’établissement. Est-ce qu’il ne faudrait pas introduire une plus grande distance, faire venir quelqu’un d’extérieur, qui serait moins lié au système qu’il est chargé de contrôler ?
M. Jean-Luc Daub. Effectivement, il vaudrait beaucoup mieux qu’une personne extérieure à l’abattoir effectue ces contrôles et ces visites. C’est ce que je faisais. Mais parfois, mes visites d’abattoir étaient mal perçues parce que je contrôlais le travail de personnes qui elles-mêmes étaient déjà censées procéder à des contrôles.
Il y a bien des contrôleurs en permanence à l’abattoir pour s’assurer de l’hygiène et de la qualité sanitaire des viandes. Pourquoi n’y en aurait-il pas aussi pour s’assurer du respect de la protection animale ? On n’est pas obligé de rester tout le temps devant le poste d’abattage. D’ailleurs, la protection animale ne commence pas au poste d’abattage, mais au pied du camion, au déchargement – quai de déchargement, stockage des animaux, chemins d’amenée. Il ne faut pas se focaliser sur le poste d’abattage.
M. le rapporteur. Je parlais du contrôle des services de l’État, du contrôle vétérinaire. Le fait que ces contrôleurs soient affectés toujours aux mêmes établissements ne crée-t-il pas chez eux une certaine habitude ? S’ils allaient visiter un établissement qu’ils n’ont jamais vu, ils auraient l’œil plus aguerri, plus aigu pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ne faudrait-il pas faire venir des contrôleurs de plus loin, pour changer leur regard, notamment sur les questions liées au bien-être animal ?
M. Jean-Luc Daub. C’est vrai qu’il faut différencier ses expériences, aller voir ce qui se passe ailleurs, s’informer, se former, échanger. Sinon, on prend des habitudes.
Sur les vidéos que j’ai vues, les chevaux qui ne veulent pas aller dans le piège de contention sont tirés à l’aide d’un câble ou d’une chaîne. C’est horrible. Si le cheval ne veut pas y aller, c’est qu’il y a une raison. Il ne faut pas le forcer, en tout cas comme cela. Mais il est facile d’y remédier : un seul contrôle suffit pour constater que le chemin d’amenée n’est pas conforme, qu’il y a trop de lumière, trop de bruit, que le cheval voit tout ce qui se passe dans le local d’abattage, avec d’autres animaux suspendus, qu’il y a trop de sang, etc. On fait un compte rendu et après on agit en conséquence.
M. le président Olivier Falorni. Merci, monsieur Daub pour votre témoignage et vos réponses.
La séance est levée à dix heures trente.
——fpfp——
36. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant des syndicats agricoles, avec la participation de Mme Christiane Lambert, première vice-présidente de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), de M. Bertrand Venteau, président de la Coordination rurale de la Haute-Vienne et membre de la section viande de la Coordination rurale (CRUN), de M. Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne et de M. Jacky Tixier, président du Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF) de la Creuse
(Séance du jeudi 30 juin 2016)
La séance est ouverte à dix heures trente.
M. le président Olivier Falorni. Nous avons aujourd’hui le plaisir d’organiser une table ronde réunissant des syndicats agricoles : la FNSEA, représentée par Mme Christiane Lambert, vice-présidente depuis 2010, la Coordination rurale, représentée par M. Bertrand Venteau qui la préside dans la Haute-Vienne et qui est membre de sa section « viande », la Confédération paysanne représentée par son porte-parole, M. Laurent Pinatel, et le Mouvement de défense des exploitants familiaux, représenté par M. Jacky Tixier, qui le préside dans la Creuse où il est éleveur de bovins et producteur de viande bio.
Avant de vous donner la parole pour un propos liminaire, je dois vous rappeler que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais demander à chacun des intervenants de prêter serment en jurant de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Christiane Lambert et MM. Laurent Pinatel, Bertrand Venteau et Jacky Tixier prêtent successivement serment.)
Mme Christiane Lambert, première vice-présidente de la FNSEA. Après avoir élevé des bovins et des porcs dans le Cantal, j’élève désormais des porcs dans une exploitation familiale du Maine-et-Loire ; je suis donc une passionnée de l’élevage, que je connais parfaitement. Je vous remercie de l’invitation que vous nous avez faite de témoigner en tant qu’éleveurs dans le cadre de vos travaux. J’ai lu les comptes rendus de différentes auditions que vous avez tenues, et je salue la qualité de votre travail qui, nous l’espérons, permettra de conduire un débat posé et dépassionné sur un sujet complexe que certains événements ravivent régulièrement, comme ce fut le cas des images diffusées hier, que nous avons tous vues et qui sont insoutenables, notamment parce qu’elles sont récurrentes. En revanche, s’il faut dénoncer ces gestes inadmissibles, le fait d’entrer dans les abattoirs de cette façon et avec un équipement vidéo pose question. De même, les propos tenus par le préfet hier soir, selon lesquels ces images pourraient être obsolètes, nous interrogent : j’espère que toute la lumière sera faite sur cet événement si les actes rapportés sont avérés.
La réglementation encadrant les conditions d’abattage a été très souvent rappelée ; je n’y reviens donc pas. La France et l’Europe sont sans doute les lieux où ces normes sont les mieux respectées au monde. Les pouvoirs publics français en sont les garants et doivent le rester. Nous comptons beaucoup sur la présence d’inspecteurs vétérinaires pour contrôler le bon déroulement des opérations dans les abattoirs et s’assurer que le passage de la vie à la mort des animaux se fait dans les meilleures conditions et sans souffrance. En tant qu’éleveurs, nous sommes attachés au bon traitement des animaux : nous les élevons avec soin et professionnalisme, et nous avons peu à peu intégré les nouvelles demandes sociétales de bien-être des animaux et de connaissance de leur comportement. Nombreux sont les agriculteurs qui se forment pour être plus à même d’appréhender ces questions : plus de 4 500 agriculteurs se sont formés l’an dernier pour mieux cerner la sociologie et le comportement des animaux, et pour leur offrir des bâtiments, une alimentation et des soins adaptés. Nous savons aussi que les conditions économiques sont plus ou moins favorables. En raison de la crise actuelle de l’élevage, les éleveurs sont plus inquiets, plus stressés. Or, ce sujet crée un stress supplémentaire lorsqu’il est abordé de manière critique et stigmatisante.
Nous sommes donc au travail. La FNSEA a coordonné voici un an les travaux de vingt-six organisations d’élevage – instituts techniques, interprofession, associations d’élevage, de vétérinaires et d’anthropologues qui travaillent autour de l’élevage – pour bien montrer que de la naissance au départ pour l’abattoir et à l’abattoir même, nous sommes attachés aux bonnes pratiques d’élevage, de transport et d’abattage des animaux. Je tiens le document issu de ces travaux à votre disposition.
En tant que responsables d’une organisation syndicale, nous sommes attachés à accompagner les agriculteurs pour tenir compte de ces nouvelles perceptions et pour qu’un travail de professionnalisation et de prise en compte de ces sujets soit accompli. Cela suppose d’informer, de conseiller, de former mais aussi de déployer des chartes de bonnes pratiques d’élevage auprès de tous les agriculteurs, et de mettre en œuvre des guides de bonnes pratiques et d’hygiène – que nous impose la réglementation européenne mais qui trouvent aussi des déclinaisons intéressantes lorsque nous les accompagnons dans les élevages. Aujourd’hui, 90 % des éleveurs – en produits laitiers et en viande – ont signé la charte des bonnes pratiques de l’élevage, et ce pourcentage est très légèrement inférieur en production ovine. Autrement dit, les élevages se caractérisent par un fort niveau de professionnalisme.
Cependant, nous devons aussi expliquer notre métier, faire savoir comment il fonctionne. La société est de plus en plus urbaine et le secteur des services prend une part croissante ; en clair, on s’éloigne du vivant, de l’animal, de son comportement, de ses attentes, parfois aussi de ses excès – un coup de sabot de cheval ne fait pas de bien, un coup de pied de vache ou un coup de dent de cochon pas davantage. Les animaux sont vivants et parfois imprévisibles. Nous devons expliquer que nous travaillons avec du vivant et que les animaux ne se ressemblent pas. C’est pour cette raison que nous avons pris conscience que la sensibilité des animaux, sur lequel les parlementaires ont statué l’an dernier, était un vrai sujet : nous savons que les animaux sont des êtres sensibles, car il y a toujours une vache qui est leader du troupeau, toujours un animal plus impétueux ou nerveux que les autres. Nous connaissons cette sensibilité.
Nous sommes les premières sentinelles auprès des animaux, puisque nous vivons avec eux et auprès d’eux au quotidien, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Nous les accompagnons dans les phases les plus délicates que sont le vêlage, le changement de pâture ou de bâtiment. Nous avons à cœur d’expliquer notre métier davantage. Il est vrai que certains types d’élevage posent aujourd’hui plus de questions. Les caricatures existent : grands élevages égalent souffrance, lit-on parfois. Or, le bien-être animal est aussi appréhendé dans les grands élevages, et les règles des directives européennes – qu’il s’agisse de la surface, de la ventilation, de l’éclairage, de la luminosité ou du confort – sont prises en compte afin de donner aux animaux les meilleures conditions d’élevage et de leur permettre d’exprimer leur comportement. Les agriculteurs respectent notamment la directive européenne sur le bien-être de 2001, toilettée en 2008 ; et en cas de non-respect, des sanctions financières s’appliquent en vertu de la conditionnalité de la politique agricole commune (PAC).
De plus, nous sommes très durs vis-à-vis des mauvaises pratiques d’élevage, de transport et d’abattage. Ces pratiques sont aujourd’hui médiatisées. Permettez-moi une parenthèse à ce sujet : nous savons qu’un certain nombre d’associations de protection des animaux les médiatisent dans un réel souci de protection des animaux ; d’autres associations – c’est le cas de L214 – expliquent clairement sur leur site que leur objectif est la non-consommation de viande et la libération des animaux ; il y a là un idéal masqué, puisque cette association s’attache à diffuser des images choquantes dans le seul but de dissuader de consommer de la viande – c’est en tout cas ainsi qu’elle l’exprime. Nous sommes très attentifs à ce durcissement de ton de la part de certaines associations. En revanche, nous avons à cœur de dialoguer avec certaines autres pour expliquer quelle est la nouvelle attente et pourquoi elle se manifeste. Nous travaillons avec d’autres organisations comme CIWF, qui visite des élevages et contribue à écrire des cahiers des charges, et qui est intervenue devant la FNSEA. Nous travaillons également avec l’association Welfarm, qui visite aussi des exploitations et avec laquelle nous avons projeté plusieurs réunions de travail thématiques pour entrer dans le détail de ce que l’on peut faire ou pas dans l’intérêt des animaux. En clair, nous faisons un net distinguo entre les objectifs poursuivis par certaines associations et par d’autres.
Nous formons également en matière de transport et sommes très attachés à ce que nos outils économiques, lorsqu’ils sont opératifs, s’appuient sur des transporteurs consciencieux. Nous le constatons lors de l’embarquement des animaux. Lors du transport de l’élevage à l’abattoir, les animaux passent par des lieux identiques : au quai d’embarquement dans l’exploitation agricole correspond la bouverie à l’abattoir. Nous avons rénové nos quais d’embarquement, qui sont désormais plus lumineux ; les animaux sont brumisés, ont accès à l’eau, ont de la place pour se coucher ; les bâtiments ont été dotés d’un certain confort. Pour les bovins, des couloirs de contention ont été aménagés pour éviter tout risque, car c’est quand les hommes sont stressés par le comportement des animaux que de mauvais gestes peuvent être commis. Il faut donc prévoir les meilleures conditions de stockage des animaux dans ces endroits, pour que leur départ dans les camions et leur arrivée dans les couloirs ou les bouveries des abattoirs suscitent chez eux le moins de stress possible.
Nous savons que le passage de la vie à la mort est particulier. Les éleveurs ont tous donné la mort, à un moment ou à un autre. J’élève des porcs : nous en tuons à la ferme – c’est autorisé, et nous faisons de très bonnes charcuteries. Oui, nous aimons nos animaux ; l’instant du coup de couteau est donc très particulier. Nous comprenons que ce geste qui, en abattoir, est répétitif, puisse changer la façon d’appréhender l’animal et la relation que l’on a avec lui.
C’est pourquoi nous soutenons la proposition de M. Le Foll d’étendre la présence d’un référent protection animale aux établissements de petite taille ; c’est nécessaire. Dans notre profession, nous avons mis du temps à intégrer ces problématiques de bien-être animal, et nous comprenons qu’il faille du temps pour l’intégrer dans les structures d’abattage, où les salariés sont parfois insuffisamment reconnus et valorisés, non seulement en termes de salaire mais aussi parce que leur métier est mal connu et parfois décrié. J’ajoute que les images actuellement diffusées créent un énorme trouble dans le monde des salariés d’abattoirs, qui jugent leur profession trop stigmatisée en raison de quelques mauvaises pratiques qui sont minoritaires, mais que certains voudraient faire passer pour des pratiques généralisées.
Plusieurs sujets sont en débat. Faut-il ou non installer des caméras dans les abattoirs ? Qu’en est-il de la formation, ou encore de l’abattage rituel ? Sur le premier sujet, nous ne pensons pas qu’installer des caméras soit la solution magique, car les salariés auront du mal à l’appréhender. En revanche, l’installation ponctuelle de caméras aux endroits les plus sensibles peut permettre d’encadrer les choses pour le référent vétérinaire. Autrement dit, notre avis est plutôt réservé, voire défavorable par rapport aux salariés, et parce qu’il sera très difficile d’exploiter des milliers d’heures d’images. On peut cependant envisager l’utilisation d’images à des fins de formation : les éleveurs savent par exemple qu’il est préférable, pour expliquer le parage d’un pied ou l’écornage d’un bovin, de faire référence à des images filmées en situation réelle afin de montrer les bons et mauvais gestes dans un souci d’amélioration continue. Cela étant, le respect des salariés doit être total – la question demeure délicate.
J’en viens aux contrôles et à la tentative de généralisation des mauvaises images. M. Le Foll a émis l’idée intéressante de faire visiter tous les abattoirs en avril, et l’analyse des résultats a été utile. L’alternative entre small is beautiful et big is bad n’existe pas : les choses sont plus compliquées. La taille n’est pas toujours en cause : c’est plutôt le management et l’état d’esprit de l’abattoir qui importe, ainsi que le dialogue et l’échange. À ce titre, peut-être pourrions-nous envisager des groupes mixtes de travail et de dialogue associant des éleveurs et des salariés d’abattoirs, et pourquoi pas des associations de protection animale, dans un cadre bien précis et de façon volontaire, afin de permettre une plus grande fluidité des échanges plutôt que la pérennisation de conflits.
Un mot, pour conclure, sur l’abattage rituel et sur les types d’abattoirs. Le sujet de l’abattage rituel est très délicat et oppose deux visions : celle des responsables du culte et celle des associations de protection des animaux. Nous, éleveurs, avons un avis en tant que citoyens mais, dans un pays laïque, le débat et le dialogue ont lieu entre les associations de protection animale et les responsables du culte. Étant moi-même pratiquante et très attachée à une religion, je suis très respectueuse des cultes : le dialogue est nécessaire et doit être intensif, pour qu’il débouche sur des solutions. Certains pays comme l’Allemagne et le Danemark ont avancé ces derniers temps s’agissant d’un étourdissement préalable à la saignée. Je sais que ces sujets sont délicats vis-à-vis des cultes en France, et je respecte ce dialogue. La FNSEA en tant que telle n’y participe pas directement, mais elle le suit, est questionnée et a son avis sur le sujet.
Toutefois, nous pensons que la montée en puissance de la préoccupation relative au bien-être animal arrive pratiquement à égalité d’enjeu avec les aspects sanitaires et hygiéniques, et nous devons envisager les questions qui se posent en fonction d’une sociologie complètement renouvelée, où ce sujet est devenu particulièrement important. J’appelle chacun à la responsabilité : ce n’est pas en stigmatisant, comme peuvent le faire certaines associations, que l’on amènera à un dialogue apaisé. Il faut que chaque partie prenante fasse un pas vers les autres. Le fait que l’Allemagne et le Danemark aient réussi à trouver un compromis me rend optimiste quant à la capacité que nous aurons en France à en trouver un à notre tour. Je note quand même que la Pologne, qui avait fait ce choix, a baissé pavillon quelques mois plus tard en raison de la perte de marchés, parce qu’il y a naturellement derrière cette question des enjeux économiques.
Sans doute aborderons-nous plus tard la question des sites d’abattage itinérants et des abattoirs à la ferme, puisque je constate qu’elle a souvent été évoquée lors des autres auditions.
M. le président Olivier Falorni. Dans le cas de la Pologne, il existe en effet une dimension économique, mais c’est la Cour constitutionnelle qui, pour des raisons de non-discrimination, a cassé la décision prise concernant l’abattage rituel. Il y a donc aussi une dimension juridique, même si l’aspect économique n’a certainement pas été étranger à ce retour en arrière.
M. Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne. Il nous semble important, à la Confédération paysanne, que cette commission d’enquête ait lieu, et nous suivons attentivement vos travaux, que nous devinons particulièrement lourds et astreignants pour vous. L’approche consistant à creuser le sujet et à écouter l’ensemble des acteurs qui ont des choses à dire sur la filière me semble intéressante, car elle vous permet de ne pas vous appuyer sur un postulat orienté d’emblée et d’adopter une approche très large avant de vous faire un avis et de prendre des décisions. Nous saluons donc l’organisation de vos travaux.
S’agissant de l’état des lieux, on ne peut pas nier, au vu de certaines vidéos, qu’il existe des problèmes dans certains abattoirs. On ne peut pas non plus nier que ces problèmes sont aussi mis en scène et montés en épingle, et que ces vidéos de L214 visent aussi à généraliser un mouvement abolitionniste et, comme l’a dit Christiane Lambert, à faire disparaître l’élevage. Nous condamnons fermement cette volonté qu’a l’association L214 de s’enfermer dans une idéologie complètement déconnectée de ce que peut être la réalité des éleveurs et des modes de consommation, même si elle signale des points sur lesquels il faut se pencher.
Il nous semble important de rappeler que l’abattoir n’est pas qu’un maillon de la filière viande. Il faut aborder cette filière comme un tout, depuis la naissance de l’animal chez l’éleveur jusqu’à son arrivée sur les étals des bouchers et des grandes surfaces. Il faut considérer l’ensemble de ces filières non pas de manière segmentée, mais comme un ensemble unique, et c’est sur cet ensemble qu’il faut agir pour que le bien-être animal soit respecté et que l’objectif final d’obtenir un produit de qualité soit atteint. En ce sens, l’abattoir n’est pas un outil de profit quelconque, qui serait placé quelque part au milieu d’une filière, entre le producteur et le distributeur.
Certaines politiques visent aujourd’hui à améliorer la rentabilité, à travailler avec moins de personnels dans les abattoirs, à accélérer les cadences dans certains abattoirs – on entend parler de huit à neuf cents porcs abattus à l’heure… Je n’ose imaginer ce qu’est la vie de la personne qui effectue cet acte. On assiste en fait à une dérive de l’industrialisation de l’abattage, dans un contexte global de dérive de l’industrialisation de l’agriculture. De ce fait, une certaine logique prévaut, qui vise à accélérer les quantités produites dans les fermes et traitées dans les abattoirs sans se soucier de la nature même de l’être vivant qu’est l’animal, des éleveurs et des salariés d’abattoirs. Dans certains élevages de très grande taille, le lien entre l’éleveur et l’animal a tendance à disparaître. On peut certes trouver des artifices pour améliorer le bien-être de l’animal, mais rien ne remplacera jamais le lien fort qui existe entre l’animal et l’éleveur.
Dans ce scandale des abattoirs, il y a tout de même des victimes nettement identifiées : ce sont les éleveurs, qui, tout au long de l’acte de production, prennent soin de leurs animaux, respectent leur bien-être, les aiment et les accompagnent, jusqu’au moment où ils montent dans le camion pour partir à l’abattoir ; ce sont aussi les salariés des abattoirs, qui subissent un système d’extrême rentabilité et qui, aujourd’hui, sont montrés du doigt et livrés à la vindicte populaire parce que certaines choses fonctionnent mal.
Nous devons réfléchir à tout cela et nous demander si les pouvoirs publics ne portent pas une part de responsabilité dans cette dérive. Lors d’une de mes précédentes auditions dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, présentée par M. Le Foll, la Confédération paysanne avait souligné la faiblesse du volet économique de ce projet de loi. Nous avons en effet un problème avec les abattoirs : y en a-t-il encore assez dans notre pays pour permettre un abattage correct et limiter les temps de transport des animaux ? Tôt ou tard, la disparition des abattoirs finira par provoquer un scandale en matière de temps de transport des animaux ; ayons cela à l’esprit.
Il nous semble que l’abattoir doit être un outil de service public, au fond. La privatisation des abattoirs entraîne les dérives de l’augmentation des cadences et de la diminution des moyens alloués aux personnes qui effectuent l’acte d’abattage. Les vidéos diffusées hier montrent par exemple des problèmes manifestes de fonctionnement du matériel, qui s’expliquent par un manque de moyens. Ce n’est pas que l’employé ne sait pas se servir de l’outil ; c’est tout simplement l’outil qui ne fonctionne pas. Surtout, ce souci permanent de rentabilité s’inscrit dans un contexte économique très libéral où il faut produire toujours plus. À l’heure où l’État français envisage la négociation au niveau européen de traités de libre-échange, notamment avec le Canada et les États-Unis, pour lesquels le bien-être animal n’est rien, à quoi servira votre commission ? Si nous nous imposons des entraves – je caricature à dessein – en matière de bien-être animal, pourra-t-on faire du commerce avec ces grandes puissances économiques et les concurrencer ? Nous pensons naturellement que nous devons affirmer notre forte identité agricole, réaffirmer que le bien-être animal est important et que, dans ce cadre, on ne saurait continuer d’aller buter sur le mur du libéralisme et de l’échange à tout prix.
Une fois que l’on a établi ce constat et identifié les lieux dans lesquels il faut agir, il faut chercher des solutions. Il nous semble que certaines d’entre elles relèvent de l’organisation même des abattoirs, qu’il s’agisse de la diminution des cadences ou, surtout, de la formation. Le métier n’est pas très intéressant : outre ma formation agricole, j’ai aussi une formation aux métiers de la viande, notamment les métiers d’abattage, et pour avoir visité beaucoup d’abattoirs, je sais que ce n’est vraiment pas un travail épanouissant – et il l’est d’autant moins qu’il est soumis à des cadences infernales. Il faut déployer un effort de sensibilisation auprès des employés des abattoirs pour les responsabiliser en tant qu’acteurs à part entière de la filière, au même titre que les éleveurs et que les bouchers. Inévitablement, il faut aussi réduire les cadences dans certains abattoirs et définir un seuil à partir duquel un homme ne peut plus travailler correctement et produire l’acte dans de bonnes conditions.
S’agissant de l’amélioration du fonctionnement des abattoirs, nous nous interrogeons également sur les fonds alloués à la rénovation des abattoirs, notamment par FranceAgriMer. Le ticket d’entrée est fixé à 1 million d’euros ; aucun investissement inférieur à ce montant n’est subventionné. Cela nous semble préjudiciable aux petits abattoirs ; sans doute faudrait-il réexaminer cette question.
Le nombre d’abattoirs pose également problème, car il est en chute libre. Or la concentration aggrave forcément les difficultés à réaliser un travail correct. Il nous semble qu’il faut recréer des abattoirs de proximité auprès des lieux de production, ce qui permettrait de diminuer les temps de transport des animaux et d’améliorer leur bien-être, même si la filière, comme l’a dit Christiane Lambert, a déjà réalisé un énorme travail sur le bien-être animal au moment du chargement, du transport et du déchargement. Il nous semble toutefois primordial de recréer des abattoirs et des unités économiques de proximité – en somme, de relocaliser l’acte d’abattage, ce qui permettrait en outre de créer localement des emplois dans certaines régions mises à mal par la crise.
De même, nous sommes très attachés à l’amélioration du paquet « hygiène » européen, pour qu’il soit effectivement possible de pratiquer l’abattage à la ferme grâce à l’abattage mobile. La Confédération paysanne travaille sur le sujet depuis de nombreuses années ; un groupe d’éleveurs y a travaillé avec des collègues d’autres pays, en organisant notamment des visites et des échanges d’expérience avec des éleveurs autrichiens qui pratiquent l’abattage mobile à la ferme, qui diminue le stress de l’animal et qui permet à l’éleveur d’accompagner son animal jusqu’au bout et d’améliorer les conditions d’abattage. C’est une piste à expérimenter, même si nous ne prétendons pas qu’il faille la généraliser. Il faut étudier la diversité des modes d’abattage et ne pas s’interdire les expérimentations qui fonctionnent ailleurs pour améliorer les pratiques d’abattage dans notre pays.
Parmi les propositions qui semblent émerger des différentes auditions que vous avez tenues, nous réaffirmons notre opposition à la vidéosurveillance, parce qu’elle génère un stress supplémentaire pour les salariés. Le fait de surveiller des employés pour vérifier comment ils travaillent ne sert en fait qu’à se donner bonne conscience, et crée une pression supplémentaire. Les images d’hier le montrent : la vidéosurveillance n’aurait pas permis que les couteaux soient mieux aiguisés et que les animaux correctement anesthésiés au préalable. Ce n’est pas un problème de vidéosurveillance, mais de matériel. En revanche, nous sommes d’accord avec la FNSEA concernant l’utilisation de vidéos dans les supports pédagogiques pour former les tueurs et les employés de la filière viande.
Pour ce qui est de la présence systématique d’un référent protection animale dans les abattoirs, nous n’y sommes ni hostiles ni vraiment favorables, car ce ne sera pas la solution au problème. Il nous semble qu’il faut employer davantage de personnes dans les abattoirs et qu’elles soient toutes formées, plutôt que d’ajouter un surveillant d’abattoir. Plutôt que d’employer trois personnes à l’acte d’abattage et une à le surveiller, peut-être vaut-il mieux employer quatre personnes bien formées à la tuerie.
Il faudra effectivement davantage de transparences et de concertation dans le fonctionnement des abattoirs, car les éleveurs ont leur mot à dire en la matière. Il est utile, en effet, qu’ils puissent échanger leur expertise avec les abattoirs, notamment sur les parcs de contention et sur l’amenée. Il faut donc constituer des groupes de dialogue civil autour des abattoirs. Comme la FNSEA, la Confédération paysanne travaille avec des associations telles que CIWF : c’est le signe que certains militants du bien-être animal ont réellement la volonté d’être les interlocuteurs de l’ensemble des professionnels agricoles. C’est avec ces gens-là que l’on pourra travailler en toute objectivité pour trouver des pistes d’amélioration entre les éleveurs et les abattoirs.
M. Bertrand Venteau, président de la Coordination rurale de la Haute-Vienne. Je vous remercie de nous avoir invités pour parler d’un sujet aussi polémique. Je n’emploierai pas le même ton que mes collègues, et je commencerai d’emblée en disant ceci : l’homme est un omnivore à tendance carnivore. À voir la manipulation de la communication que font les végans, on pourrait en douter ; c’est pourtant la réalité.
S’agissant du bien-être animal, clarifions les choses : lorsqu’un animal est tué à l’abattoir ou à la ferme dans de mauvaises conditions, alors la viande n’est pas bonne. On peut remuer les images de L214 et autres, mais toute la filière viande sait bien qu’un animal mal élevé et abattu dans de mauvaises conditions ne produit pas de la bonne viande – au point qu’il faut quasiment la jeter, tellement elle n’est pas facile à travailler. Revenons donc aux fondamentaux.
Que cette commission ait été constituée, soit ; mais même si la loi a évolué concernant le bien-être animal et la sensibilité des êtres, il faut tout de même établir certaines différences. Le modèle social actuel est globalement chamboulé, et j’ai parfois le sentiment que certains de nos anciens qui partent en maison de retraite souffrent beaucoup plus que les animaux qui sont emmenés à l’abattoir. Faisons la différence entre l’humain et l’animal ; ce n’est pas la même chose. Que ces animaux soient sensibles, c’est certain ; mais nous aussi. L’humain est sensible. L’éleveur, au quotidien, est confronté à la vie. Quand on donne la vie, malheureusement, on donne aussi la mort. Il nous arrive d’avoir des pertes sur nos exploitations, et il faut s’y habituer. La mort d’un animal n’est pas taboue. Bien entendu, nous faisons tout notre possible pour les sauver, mais ce n’est pas forcément la priorité du monde agricole aujourd’hui. Les agriculteurs, en particulier les éleveurs, sont à bout à cause d’un système de normes qui ne leur procure ni revenus ni perspectives. Lorsque les mouvements végans, principalement, les traitent de « sanguinaires », toutes les conditions sont en train d’être réunies pour provoquer une nouvelle jacquerie, parce que l’agriculteur n’est pas responsable de tous les maux, que ce soient les pesticides ou l’irrigation. Depuis Sivens, l’agriculteur de base « ramasse » : c’est lui que l’on désigne comme la cause de toutes les pollutions et de tous les maux de la terre. Ce n’est pas le cas ! La Coordination rurale est atterrée de se faire attaquer tous les jours dans nombre de domaines.
De plus, comme l’a dit Christiane Lambert, le bien-être animal est bordé au niveau européen s’agissant des productions aidées. On ne peut donc guère faire d’impasses, au risque de le payer cash. Les retenues sur les primes arrivent très rapidement et, avec la nouvelle PAC, la moindre erreur nous fait facilement perdre 50 % des soutiens. Les agriculteurs ne s’amusent donc pas à faire les fous ; ils ne peuvent se le permettre, ni dans le système aidé ni même dans l’autre.
Si je suis inquiet, c’est aussi parce que nous pouvons en déduire que le rôle des anciennes directions départementales des services vétérinaires (DDSV) serait repris par des associations de bien-être animal. Le rôle de l’État est pourtant prépondérant dans le secteur sanitaire, et ce n’est pas à ces associations d’y mettre le pied. L’État est en effet la seule structure indépendante. Les autres acteurs ont forcément un parti-pris.
Or, l’abattoir est un lieu de mort et il faut vivre avec : c’est ainsi. Concernant les pratiques d’abattage halal et surtout casher, on tuait autrefois des animaux à la ferme selon des pratiques qui n’étaient pas forcément meilleures. De plus, certains agriculteurs ont trouvé dans l’abattage rituel un débouché. Si nous ne l’exploitons pas chez nous, d’autres le feront ailleurs en Europe, et il est regrettable de laisser passer ces marchés. La mort, c’est la mort. La méthode utilisée pour la donner peut choquer, mais peut-être aurait-il fallu que ces gens qui la dénoncent aient vu comment mes grands-parents tuaient les lapins en leur arrachant les yeux pour qu’ils se vident de leur sang… Je ne suis pas sûr que les animaux souffrent beaucoup plus dans les abattoirs d’aujourd’hui, qu’ils soient industriels ou non, qu’ils ne souffraient à l’époque de l’abattage à la ferme ; bien au contraire. Et je ne crois pas que l’on puisse faire un parallèle entre les mauvais traitements en termes de bien-être animal et l’industrialisation des abattoirs.
La filière a certes ses problèmes de marges en interne, mais c’est dans son ensemble qu’elle est attaquée, depuis le producteur jusqu’à l’abatteur, voire l’industriel, à qui l’on veut coller une image déplorable et ce dans le seul but que la consommation de viande cesse. Pourtant, on sait pertinemment que pour être en bonne santé, il faut des protéines d’origine animale, en particulier pour la croissance des enfants.
On ne peut donc pas attaquer frontalement de la sorte. Au fond, nous avons besoin que le mouvement végan se fasse un peu taper sur les doigts par l’État, parce qu’il touche à l’intérêt général du pays, précisément, en particulier des producteurs et des filières. Nous tenions à vous alerter sur ce point : c’est l’un des rôles de l’État. Véhiculer de fausses informations n’est pas tenable. Pour une fois – car c’est très rare –, toutes les filières du monde agricole, dans la production de viande ou de lait, sont affectées. J’ai vu une vidéo de 269 Life – l’entité qui fédère les associations de type L214 dans le monde entier – dans laquelle on proclame que « le lait, c’est du sang » et où l’on voit déverser du sang dans les grandes surfaces. J’ai été terriblement choqué pour les producteurs laitiers. Le vrai débat est là.
Quant à la présence d’un lanceur d’alerte dans les abattoirs, je suis sceptique, parce que cela peut s’avérer dangereux si un salarié n’aime pas son supérieur ou un collègue. Les abattoirs sont régis par des conventions collectives et les salariés sont capables de se gérer entre eux.
S’agissant de la vidéo, je ne partage pas forcément la vision de la FNSEA et de la Confédération paysanne – je m’étonne d’ailleurs du point de vue exprimé par Laurent Pinatel. Mon associé est fils de boucher et son frère travaille dans la filière de la viande bovine : la formation se fait d’homme à homme, rarement au moyen d’une vidéo.
M. Jacky Tixier, président du Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF) de la Creuse. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de m’accorder votre intérêt. Mon syndicat, le MODEF, m’a demandé de venir témoigner de mon expérience en me convainquant que la présentation d’un exemple positif pouvait faire plus facilement bouger les choses que la dénonciation de ce qui n’est pas satisfaisant.
Face à la diffusion de plusieurs vidéos d’abattoirs, le MODEF dénonce l’organisation industrielle des abattoirs qui entraîne de graves dysfonctionnements par rapport au bien-être animal : étourdissement inefficace, cadences d’abattage trop rapides ou encore non-prise en compte de la perception des animaux. Le MODEF revendique que les éleveurs puissent avoir un droit de regard et d’un droit d’agir lors de l’abattage de leurs animaux. Face à ces anomalies, il existe des solutions alternatives pour promouvoir la mise en œuvre d’outils d’abattage de proximité en lien étroit avec les paysans, en permettant d’éviter le stress des animaux et de les tuer dans de meilleures conditions de proximité.
La plus grande fierté de ma vie professionnelle est de conduire aujourd’hui avec une cinquantaine d’autres paysans le chantier du pôle « viandes locales » en Limousin, un exemple qu’il m’a semblé intéressant de vous présenter. L’objectif est de réunir sur un même site toutes les étapes qui relient les animaux de nos champs aux produits que nous vendons à nos consommateurs. En France, il est rare que tous les flux soient réunis en un même lieu. On y trouve sur 1 100 mètres carrés un abattoir innovant et des box individuels de maturation destinés à obtenir des conditions atmosphériques sur mesure à chaque carcasse. Nous avons des salles de découpe, de transformation froide en steaks hachés, par exemple, et de transformation chaude pour faire des pâtés, des saucissons et des jambons. Nous avons une zone logistique avec du stockage en froid et en surgelé pour mieux gérer nos stocks. Nous consacrons 10 % de notre budget à un centre pédagogique accolé à l’outil où, sur 160 mètres carrés d’écrans tactiles, le grand public pourra découvrir notre savoir-faire et être sensibilisé à la lutte contre le gaspillage car, aujourd’hui, une vache sur cinq sert à nourrir les poubelles. À l’heure des plats carnés « micro-ondables » et des big burgers à la semelle de viande, nous ferons redécouvrir les viandes paysannes et leurs techniques de cuisson. Une bonne viande est une viande que l’on finit ; c’est aussi cela, le respect de l’animal.
Nous sommes reconnus comme acteur de l’économie sociale et solidaire. Nous fonctionnons comme une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA), c’est-à-dire que nos membres ont investi dans des parts. Chaque part leur donne le droit d’occuper un ou plusieurs bouchers-abatteurs pendant un total de dix heures trente. Statutairement, chaque part oblige à verser annuellement une cotisation. Ensuite, chaque paysan emploie son crédit-temps comme il l’entend, un peu à la manière d’un forfait téléphonique à carte prépayée. Nous savons donc dès aujourd’hui qui l’utilisera. Notre planning n’est pas dépendant des éventuels utilisateurs ; il est construit pour être régulier avec les éleveurs qui, dans les circuits courts, ont un rythme de vente prévisible qui ne dépend pas du cours de la viande.
L’abattage, uniquement avec étourdissement, représente 15 % de notre activité, soit une dizaine de vaches par semaine. Comme nous avons remis la lenteur au cœur de notre production et que nous n’avons fait aucune économie d’investissement sur cette activité, nous n’avons pas cherché à la rendre rentable. En revanche, notre modèle économique repose sur l’intégration de toutes les marges de l’aval de la chaîne de production, avec la découpe et la transformation qui, elles, sont bien rémunératrices. L’acte de commercialisation reste à la main de chaque éleveur, car c’est la partie la plus rémunératrice. Ainsi, notre outil autonomise les paysans membres par rapport à toute prestation extérieure.
Comme nous sommes propriétaires et comme nous choisissons comment cela se passe, nous ne restons plus en dehors des murs. Et comme nous travaillons tous en circuit court, nous avons pu imaginer un outil spécifiquement conçu pour les besoins qualitatifs de la filière courte. Par exemple, notre ingénieur de projet a dessiné une bouverie circulaire inspirée des étables des grands chevaux de courses et des plans de Temple Grandin. Nous avons travaillé sur la luminosité pour qu’il n’y ait aucune ombre sur le sol, pour que l’avancée se fasse toujours de manière instinctive du plus obscur vers le plus clair, et pour que l’humain, source de stress, soit le moins visible possible. Nous avons travaillé sur la lutte contre les odeurs avec des rideaux brise-vent et des brumes. Nous avons travaillé sur l’acoustique avec une bouverie en bois aux murs irréguliers pour briser les résonances. Compte tenu de la faible vitesse et la courte distance à traverser – moins de cinquante mètres –, il n’y aura plus besoin d’aiguillons électriques. Nous avons prévu des panneaux circulaires coulissants pour l’avancée, selon le principe de l’horloge. Nous avons également inventé l’observatoire, une pièce vitrée donnant une vue d’ensemble sur le quai de déchargement, la bouverie et le hall d’abattage, qui permet à chaque éleveur de constater par lui-même ce qui se passe avec son animal. Nous avons rapproché au maximum le lieu de l’affalement de celui de la mise à mort afin d’éviter les reprises de connaissance, car on sait que dans cet intervalle, le temps joue de façon exponentielle.
Notre chantier est soumis à une charte éthique et écologique. Nous compensons notre empreinte carbone. Notre bâtiment a été conçu dans le respect des bonnes pratiques bioclimatiques. Il est semi-enterré dans une butte afin d’accroître sa passivité énergétique.
Un élu de l’ancienne culture a pu nous prendre pour des hurluberlus. Nous avons dû faire face à de nombreux a priori sur notre capacité de gestionnaire parce que nous sommes des paysans et que cet outil ne vient pas du monde industriel. Nous en tirons la leçon suivante : c’est justement parce que ce projet vient des éleveurs que nous avons pu bouleverser les habitudes des bureaux d’études agroalimentaires – non sans peine. Nous avons finalement été reconnus « projet industriel d’avenir ». Nous avons même dû rejeter des offres bancaires, car nous avions déjà réuni les 3,3 millions d’euros nécessaires. Dans les circuits courts, comme nous le constatons chaque jour, nous savons que c’est la confiance qui est le socle de l’acte d’achat. Pour nous, la qualité et le goût sont ce qui nous permet de constituer durablement notre clientèle. Par qualité, j’entends la façon dont nous produisons, je ne la réduis pas au seul aspect hygiénique – qui est un préalable. Nous nous inscrivons d’ailleurs dans le cadre des normes ISO 22000.
Je peux témoigner qu’il existe une clientèle demandeuse de ces produits issus d’une pratique plus humaine. Cela représente un nombre d’emplois non négligeable et permet de relocaliser les retombées économiques sur un territoire. Nous n’empêchons personne de manger ce qu’il veut. Nous n’opposons personne. Chacun cherchera les meilleures solutions selon son histoire et ses valeurs. Nous n’avons pas été courageux ; simplement, nous n’avions plus le choix. L’abattoir le plus proche de Bourganeuf est aujourd’hui à plus d’une heure de route. Nous connaissons tout de même un peu en bêtes : nous savons que chaque minute dans un camion est un moment de stress en trop. Nous proposons juste un autre modèle qui répond à un besoin que l’on sent croissant, grâce à des consommateurs qui prennent en main leur acte d’achat.
S’il arrive que nous soyons un peu plus chers, notamment en bio, cela s’explique d’abord par le fait que nous nous ne brumisons pas nos carcasses pour vendre de l’eau au prix de la viande, et que les box de maturation sur mesure permettent à la viande de gagner en tendreté et en goût, quitte à perdre jusqu’à 20 %, voire davantage, du poids de nos carcasses. Les grammes de viande que les consommateurs nous achètent ne vont pas se transformer en eau dans leur poêle ou leur assiette. Nous leur demandons de ne pas changer leur budget, mais de manger quelques grammes en moins et de finir leur assiette plutôt que de nourrir les poubelles. Notre slogan est le suivant : « moins mais mieux, moins mais tout ».
Le MODEF considère que les produits agricoles ne peuvent être classés comme de simples marchandises : ils constituent l’alimentation des hommes et des femmes et recouvrent des enjeux vitaux pour les peuples. L’agriculture elle-même n’est pas un secteur économique ordinaire, que certains voudraient assimiler au secteur industriel. En effet, l’agriculture est porteuse de l’enjeu alimentaire, qui consiste à nourrir les êtres humains en quantité, en qualité et en diversité. Les produits agricoles sont la base de la souveraineté alimentaire des peuples.
Le MODEF formule cinq propositions qui éclairent des points déjà étudiés par votre commission et d’autres, qui pourraient répondre à des enjeux que vous avez soulevés.
Premièrement, nous proposons – contrairement à la Confédération paysanne – l’installation obligatoire d’un enregistrement vidéo chronométré et couvrant trois zones : les quais de déchargement, les bouveries et les halls d’abattage, à condition que la finalité de l’autorisation accordée par la CNIL porte uniquement sur la bientraitance, et que le visionnage soit limité à une commission éthique compétente afin que les images soient analysées collectivement et avec le personnel en vue d’améliorer les erreurs commises.
Deuxièmement, nous proposons d’instaurer une limite d’actes d’abattage par jour et par opérateur, ainsi qu’une limite de tonnage annuel par les services vétérinaires de l’État, en fonction du comportement dans l’abattoir.
Troisièmement, nous proposons de formuler clairement des consignes de soutien aux abattoirs de proximité et de donner les moyens aux agents de l’État de détecter les errements, puis d’agir en faveur de l’amélioration du respect animal.
Quatrièmement, nous proposons de clarifier la réglementation en fixant des objectifs de résultats et non plus de moyens autorisés pour l’étourdissement et l’abattage.
Cinquièmement enfin, nous proposons de créer une labellisation exigeante et sous contrôle de l’État pour les acteurs ayant effectivement mis en place des protocoles visant à réduire le stress et la douleur animale.
En espérant faire avancer par l’exemple tous ceux qui, parmi les acteurs de la filière courte mais aussi de la filière longue, ainsi que les consommateurs, veulent inventer l’abattage de ce nouveau millénaire, il me semble que nous sommes dans le sens de l’histoire, car nous sommes dans le sens de plus d’humanité. Je conclurai en cours remerciant pour les travaux importants que vous conduisez dans le cadre de cette commission.
M. le président Olivier Falorni. Estimez-vous que le maillage territorial des abattoirs de notre pays est suffisant ? Cette question est récurrente, comme celle de la répartition entre grands abattoirs industriels privés et petits abattoirs artisanaux publics. Au-delà des différences de pratiques, jugez-vous ce maillage satisfaisant ? Je sais que c’est là une question importante pour les territoires et pour les éleveurs qui y travaillent. Quelles ont selon vous été les conséquences de la diminution, ces dernières années, du nombre d’abattoirs en France ?
Ensuite, quelle visibilité avez-vous en tant qu’éleveurs de l’abattage des animaux que vous avez élevés ? Nous avons entendu des éleveurs nous dire qu’ils élevaient leurs animaux au quotidien mais qu’ils en perdaient la trace une fois ceux-ci amenés à l’abattoir. Quelle visibilité avez-vous sur la façon dont on abat vos animaux dans les abattoirs où vous les amenez ?
Ma dernière question s’inscrit dans la continuité de la précédente. Nous avons reçu un éleveur qui refuse d’amener ses animaux à l’abattoir et qui les abat à la ferme, de façon illégale. Nous avons entendu de nombreux éleveurs formuler le souhait de pouvoir faire abattre leurs animaux à la ferme. Plusieurs expériences ont déjà été conduites, notamment en Suède, autour de ce que l’on appelle l’abattage mobile ; nous recevrons la semaine prochaine M. Ribière, qui entend importer ce mode d’abattage en France. Avez-vous un avis sur l’abattage mobile comme éventuelle solution alternative dans des territoires ruraux qui sont privés d’abattoirs pour cause de fermeture, sachant que j’ai eu écho récemment encore d’éleveurs ovins qui craignaient de perdre leur appellation d’origine protégée parce qu’il ne se trouvait plus aucun abattoir dans la région ? Je pense en particulier à Mme Jeanine Dubié, qui se bat pour la préservation de l’AOP des Hautes-Pyrénées et qui se trouve confrontée à la fermeture d’un abattoir. L’abattoir mobile, à condition qu’il respecte les normes hygiéniques, sanitaires et environnementales, pourrait-il constituer une solution dans de tels cas particuliers ?
Mme Christiane Lambert. La question de l’insuffisance éventuelle du maillage des abattoirs est récurrente, surtout dans les régions à faible densité d’élevage, soit que l’élevage y ait disparu, soit qu’il y ait toujours été peu important, et que certains agriculteurs souhaitent le réimplanter. On pourrait être généreux et souhaiter des abattoirs partout, mais j’y vois deux difficultés : d’une part, il s’agit d’une activité économique dans laquelle la question de la rentabilité de l’outil se pose quoi qu’il advienne : même lorsque des collectivités se sont parfois très fortement engagées pour soutenir ou réimplanter un abattoir, la question de l’équilibre financier s’est reposée quelques années plus tard. De plus, il faut pouvoir déployer partout des agents vétérinaires capables de vérifier la sécurité, la salubrité et les autres éléments à contrôler en matière de bien-être animal.
Nous savons que le volume des effectifs capables d’effectuer cette mission de service public de surveillance des abattoirs a suscité un débat compliqué. Lors de la présentation de la feuille de route sur le bien-être animal, le 6 avril, M. Le Foll a fait état du nombre de postes qui avaient été supprimés, de ceux qu’il a conservés et de ceux qu’il envisage de créer en 2016 et en 2017. Au regard de la très forte attente de l’opinion et des consommateurs concernant ce qui se passe réellement dans les abattoirs – sujet sur lequel nous faisons par-dessus tout confiance aux services publics et aux directeurs d’abattoirs qu’ils contrôlent –, cette question ne saurait être jugée secondaire. Lors de mes déplacements professionnels, j’ai souvent eu des échanges avec des agriculteurs qui craignaient la disparition d’un abattoir et qui appellaient les collectivités au secours pour l’aider et le renflouer. Le cas se présente souvent, et les élus que vous êtes avez déjà dû en être témoins.
Un compromis peut être trouvé en construisant un outil économiquement équilibré, autrement dit à même de recevoir un nombre suffisant d’animaux et doté de capacités de fonctionnement adéquates. Rappelons que la rentabilité des abattoirs en France est extrêmement faible : elle oscille souvent entre 0 et 2 %, et est parfois même négative. Qui plus est, la modernisation de ces outils pose souvent une véritable difficulté : dans les abattoirs plus modernes, où les équipements de bouverie, du poste d’abattage et de contention ont été régulièrement rénovés, il se pose moins de problèmes liés à des animaux qui échappent au mécanisme ou qui ne sont pas correctement électrocutés. La modernisation des outils et l’équipement en instruments de pointe, avec des capteurs permettant de tenir compte de la différence de taille entre les porcs ou les agneaux, sont autant de facteurs de réassurance. Quoi qu’il en soit, la rentabilité est un élément clé de maintien des outils.
Je sais que le ministre s’est souvent exprimé sur ce sujet, et les opérateurs sont eux aussi confrontés à ce véritable dilemme. Dans ma région, à la limite entre le Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire, un abattoir de proximité a pu être créé parce qu’il a été soutenu par les chambres d’agriculture, qui accompagnaient concomitamment le développement de productions de petits animaux – principalement des volailles, des agneaux et des porcs – apportant les flux nécessaires pour maintenir la rentabilité de l’établissement. Autrement dit, il faut mener une réflexion globale à l’échelle du territoire, en prenant des engagements économiques en termes de volume. En l’occurrence, le projet a pu aboutir parce qu’il a été porté par des agriculteurs extrêmement engagés ; mais personne ne peut garantir que de telles exploitations resteront rentables dans vingt ans. C’est une véritable difficulté qui ne laisse aucune place aux incantations.
J’en viens à votre question sur notre visibilité de l’abattage. En tant qu’agricultrice, je n’assiste pas à l’abattage en abattoir de chacun de mes animaux. Je livre des animaux et j’ai confiance en l’outil auquel ils sont destinés. J’ai la possibilité, comme me le proposent mon groupement et ma coopérative, d’assister in situ à l’abattage d’un lot complet – et non pas seulement d’un animal –, afin d’appréhender l’ensemble des séquences que traverse l’animal depuis la bouverie jusqu’à la mort. Il demeure toutefois indispensable que nous puissions avoir confiance dans la manière dont il est abattu. C’est là que le service public vétérinaire en abattoir joue un rôle déterminant. Il en va de même pour l’alimentation : lorsque j’achète une côte de bœuf ou une boîte de petits pois, je n’effectue pas une vérification contradictoire de la sécurité sanitaire de l’une ou de l’autre. Dans ce domaine, il faut pouvoir travailler en confiance. À titre personnel, je fais confiance à l’outil qui se trouve en aval – non pas seulement parce que nous avons un élevage de 230 truies, ce qui suppose un grand nombre de porcelets à contrôler. Il est donc essentiel de rétablir cette nécessaire confiance.
Il nous arrive de tuer un animal à la ferme. Ce n’est pas un acte anodin, et je suis certaine que nous l’effectuons moins bien que les professionnels du secteur, parce que nous ne possédons pas toujours le même matériel et le même savoir-faire, parce que le couteau n’est peut-être pas parfaitement aiguisé ou parce que l’animal bouge plus. Cela étant, j’ai pu constater lors des abattages auxquels j’ai assisté que si l’électronarcose est correctement effectuée et que la pince est bien appliquée derrière les oreilles des porcs, et si le coup de couteau est donné au bon moment, la saignée génère un flux de sang extrêmement rapide et le relâchement avec perte de connaissance se produit dans les douze secondes. Ces images sont difficiles à voir pour un éleveur, mais il faut entendre le passage de la vie à la mort comme tel. L’abattoir n’est pas un lieu que j’affectionne particulièrement ; j’en préfère d’autres. Mais le fait de savoir la mise à mort est rapide et que l’employé qui intervient est capable d’expliquer son geste me rassure.
Je ne souhaite pas que les associations de protection des animaux remplacent les services publics, contrairement à ce que souhaitent certaines d’entre elles. Ce sont les services publics qui sont les premiers compétents. D’ailleurs, certaines de ces associations n’ont pas toujours une connaissance parfaite des animaux, de leur cycle, de leur sociologie, même si elles peuvent l’acquérir : de ce point de vue, les échanges sont bénéfiques. Nous n’avons donc pas une visibilité sur chaque animal, mais une visibilité générale qui repose sur la confiance.
J’en viens enfin à l’abattage mobile. J’ai pu visiter dans les Bouches-du-Rhône un élevage familial d’environ 600 ovins. Lors de la fête de l’Aïd, les exploitants reçoivent une demande importante d’agneaux, mais l’abattoir est éloigné, et de nombreux musulmans souhaitent choisir leur agneau à la ferme même. Les exploitants ont donc réfléchi avec la chambre d’agriculture et la DDPP à l’installation d’un site d’abattage mobile et provisoire à la ferme, étant entendu qu’ils en gèrent toutes les étapes au mieux, y compris celle de la gestion des déchets, toujours délicate à la ferme et dont il ne faut pas négliger l’importance, tant la sécurité sanitaire est essentielle. Accompagné par les techniciens de la chambre d’agriculture et du service public, cet agriculteur a bâti cette installation qui donne satisfaction tout à la fois aux acheteurs et aux services publics, qui l’ont validée. Cela ne s’est pas fait à la légère : il a fallu trois ans de travail. Si un tel abattage mobile semble envisageable pour des petits animaux, il est plus difficile à concevoir pour de grands animaux comme des bovins, qui pèsent huit cents à mille kilogrammes, ou des chevaux. Il n’existe sans doute pas de recette unique. En outre, il faudra un énorme effort de formation des agriculteurs eux-mêmes pour qu’ils puissent appréhender cette activité. À mon sens, l’élément clé est la gestion de la sécurité sanitaire, tant le moindre pépin peut s’avérer dramatique en termes d’image et de retombées.
M. Laurent Pinatel. Nous manquons d’abattoirs de proximité mais aussi d’inspecteurs sanitaires dans les abattoirs existants.
Dans le département de la Loire, quand l’abattoir de Saint-Étienne, un ancien abattoir municipal, a été privatisé, le premier souci du groupe qui l’a racheté a été de le rentabiliser : il a donc supprimé les chaînes porc et mouton qui ne rapportaient pas suffisamment. Les éleveurs et les bouchers ont réalisé un gros effort, coordonné par la chambre d’agriculture de la Loire, en vue de recréer un abattoir de proximité pour les petites espèces, porc, veau et mouton, afin de servir le marché local. Mais cet abattoir n’est pas rentable ; c’est le conseil régional de Rhône-Alpes, sous l’impulsion de Jean-Louis Gagnaire, à l’époque vice-président en charge des questions économiques, qui a pris en charge une partie de l’investissement et des frais de fonctionnement.
L’alimentation n’est pas un bien industriel comme les autres : c’est un bien commun. Faut-il absolument tout rentabiliser, attendre systématiquement un retour d’investissement, ou bien considère-t-on que le bien-être animal est important, qu’il n’est peut-être pas nécessaire de transporter les animaux sur des kilomètres et des kilomètres, qu’une structure de proximité peut permettre un abattage de meilleure qualité, une meilleure valorisation de la carcasse, une gestion des déchets plus facile ? Si ces questions sont jugées prioritaires, il faut alors admettre que de l’argent public peut venir compenser la non-rentabilité de ces outils. Nous sommes attachés à un maillage plus dense du territoire en termes d’abattoirs. La disparition des structures pose la question de l’externalisation des coûts – davantage de transport – et des dynamiques locales. Quand l’abattoir de Saint-Étienne a fermé, par exemple, les bouchers de la commune qui achetaient du porc à la ferme et le transformaient dans leurs boucheries ont dû acheter du porc en carcasses. L’acheter où ? Peu importe…
Il y a un manque de transparence dans les abattoirs. M. Bigard dit qu’il n’est pas question d’aller voir chez lui ; mais s’il n’a rien à se reprocher, qu’est-ce que cela lui coûte d’ouvrir son abattoir ? La confiance et la transparence vont de pair.
La Confédération paysanne a beaucoup travaillé sur les alternatives à l’abattage industriel : l’abattage de proximité mais aussi l’abattage à la ferme avec des abattoirs mobiles. C’est quelque chose de compatible avec le paquet Hygiène européen, les règles sanitaires et le bien-être animal. L’expérience de la Suède montre que c’est parfaitement possible. D’ailleurs, le dernier gros scandale de la viande, Spanghero, ne concernait pas un abattage à la ferme…
M. Bertrand Venteau. En ce qui concerne le maillage territorial, une bonne densité, selon nos estimations, correspondrait une distance de 100 kilomètres entre l’élevage et l’abattoir.
La chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne a repris un abattoir. Cela montre qu’une chambre consulaire peut reprendre des outils économiques. Nos abattoirs vieillissent et font l’objet de restructurations. On peut attendre beaucoup des pouvoirs publics, mais il faut aussi que les agriculteurs, y compris dans l’économie sociale et solidaire, investissent ; même si l’abattage ne gagne pas d’argent directement, il permet un maintien de l’activité dans les territoires et une dynamique de production. Sans abattoir pas d’éleveur et sans éleveur pas d’abattoir. Si l’on ferme les abattoirs, comme le demande le mouvement végan, nous n’aurons plus d’élevage, alors que nous avons été, même si nous sommes en perte de vitesse, le premier pays européen en termes de production animale.
En ce qui concerne la visibilité, la réponse est que cela dépend des productions. Il est difficile de suivre les animaux pour quelqu’un qui fait du porc industriel, par exemple ; de même pour les poulets qui partent à la chaîne. Et plus l’abattoir est éloigné, plus l’éleveur a du mal à aller voir les animaux. Tout est lié ; la restructuration des abattoirs a aussi une conséquence à ce niveau. Pourtant, il est toujours intéressant de voir ses animaux à l’abattoir, ne serait-ce que pour voir s’il répond aux besoins de la filière.
Nous ne sommes pas forcément hostiles aux abattoirs mobiles, là où le maillage n’est pas évident, dans des zones extrêmement reculées, des contextes de circuits courts, s’il n’y a pas moyen de maintenir un abattoir fixe ou d’en créer un.
M. Jacky Tixier. Il y a longtemps que le MODEF déplore que le nombre des petits abattoirs de proximité se réduise de plus en plus. Nous avons organisé un groupe d’une cinquantaine d’éleveurs parce que nous sommes en circuit court et que les abattoirs ont disparu les uns après les autres, à Limoges, et même dans la Creuse, précisément là où il y a le plus de vaches allaitantes. C’est proprement lamentable : il faut parfois aller jusqu’à deux cents kilomètres… Pour emmener mes bêtes à l’abattoir, je vais au plus près, ce qui représente 150 kilomètres aller-retour. Ce n’est pas négligeable, y compris en termes de stress animal. Il faut des abattoirs de proximité, mais sans exagérer pour autant : disons qu’il faut faire ce qu’il faut au regard du nombre d’animaux sur un territoire donné, et aussi des perspectives de vente : je sais bien que tout le monde ne peut pas faire de la vente directe mais c’est quelque chose qui fonctionne. Encore faut-il mettre en place les outils qui permettent aux agriculteurs de réaliser ce genre de commercialisation.
C’est moi qui emmène mes animaux à l’abattoir car nous sommes équipés – précisément parce que nous pratiquons beaucoup la vente directe à la ferme, qui représente 80 % de notre production – d’un camion adapté. Emmener ses animaux n’est pas sans créer des soucis, et on pense aussi au fait que la bête va se faire tuer. Mais si la bête est tuée correctement, je n’y vois aucun inconvénient. Encore faut-il que le travail soit bien fait. Ce qu’on voit sur les vidéos est tout à fait lamentable. Personne ne peut accepter cela.
Quand nous avons commencé à réfléchir à un pôle viande en Creuse, un projet soutenu par la chambre d’agriculture, nous nous sommes rendus à l’étranger, en Suisse, en Autriche, pour aller voir les abattoirs mobiles autrichiens, qui fonctionnent bien. Ce n’est pas autorisé en France mais, si les règles d’hygiène et de sécurité sont suffisamment claires, nous n’y sommes pas hostiles.
Vous avez parlé d’un éleveur qui abattait chez lui…
M. le président Olivier Falorni. Nous avons reçu un éleveur, M. Dinard, qui nous a expliqué qu’il ne souhaitait pas conduire ses animaux à l’abattoir, par conviction, et qu’il les abattait donc chez lui, illégalement. Par ailleurs, des élus locaux me font part de la difficulté d’éleveurs bénéficiant d’une AOP de remplir, faute d’abattoirs, un des critères, qui est que l’animal soit abattu sur place. Ma question vise donc à savoir si l’abattoir mobile peut être une solution pour permettre cet abattage sur place.
M. Jacky Tixier. Oui, ce pourrait être une solution ; en attendant, il est illégal en France d’abattre des animaux chez soi.
M. Jacques Lamblin. Votre exposé, monsieur Tixier, sur ce que vous avez entrepris avec vos collègues, était très convaincant. Votre système est-il à peu près à l’équilibre financier ? Car votre présentation est très intéressante…
Selon vous, Monsieur Pinatel, les abattoirs de proximité, de petite taille, et plutôt de service public, seraient davantage susceptibles d’apporter des solutions que les grands établissements industriels. Or les différentes vidéos que nous avons vues sont toutes réalisées dans de petits établissements, publics pour la plupart. N’est-il pas permis de penser que les établissements de plus grande taille permettent une rationalisation de l’organisation du travail, ont davantage de moyens financiers pour l’aménagement de la chaîne d’abattage et sont paradoxalement plus à même d’éviter toute souffrance inutile ?
M. Jacky Tixier. Nous savons tous que l’abattage n’est jamais rentable…
M. Jacques Lamblin. Certes, mais l’écart avec un système classique est-il important ?
M. Jacky Tixier. Justement non. Peut-être sommes-nous un centime ou deux plus chers au kilo de carcasse, précisément pour des raisons d’équilibre financier. Les agriculteurs achètent des parts. Nous avons calculé que notre système était dans les clous, en sachant que nous sommes évidemment obligés de récupérer sur la transformation. En complément, nous irons chercher les porcs chez nos agriculteurs pour les transformer et les vendre au nom du pôle viande. Cela nous permettra d’équilibrer notre budget. Pour plus de renseignements, je remettrai à votre rapporteur une lettre ouverte que nous avons rédigée, et vous pouvez toujours adresser d’autres questions directement à notre président ou à notre ingénieur de projet.
M. Laurent Pinatel. Personne, Monsieur le député, ne sait ce qui se passe dans les abattoirs industriels : les gens qui tournent des vidéos n’y sont jamais entrés…
Il ne nous semble pas qu’un modèle doive prendre le pas sur l’autre ; il faut simplement accompagner les alternatives aux grands abattoirs, dont les abattoirs de proximité, auxquels il faudra inévitablement accorder davantage de moyens financiers. Nous voyons bien, en effet, notamment sur les vidéos, que ces structures ont des problèmes d’équipement et de mauvais fonctionnement des parcs de contention et des outils d’abattage. J’en reviens à ce que je disais sur l’accès aux subventions pour la modernisation et la mise en conformité : le ticket d’entrée à 1 million d’euros de FranceAgriMer exclut de fait les plus petits abattoirs. Par ailleurs, en ce qui concerne le bien-être animal, la proximité limite l’effet du transport. Enfin, en guise de mise en perspective, il existe en France environ 280 abattoirs, alors que l’Allemagne en compte 3 500…
M. Jacques Lamblin. Le mot de « confiance » que vous avez utilisé, Madame Lambert, est très important. Les attaques médiatiques sapent la confiance qu’inspire encore la filière agroalimentaire française, particulièrement la viande.
Mme Christiane Lambert. Pendant longtemps, certains ont pensé que les attaques portaient seulement sur les grands abattoirs, comme elles portent, très souvent, sur les grands élevages, avec une idéalisation du small is beautiful. Or, dans les grands élevages, la question du bien-être animal est appréhendée dès le stade de la construction, et il est bien plus facile de l’intégrer à ce moment-là que d’adapter des bâtiments existants. De même, les enquêtes montrent que les abattoirs où les équipements sont modernes et les cadences appropriées peuvent être de grande, moyenne ou petite taille ; c’est en réalité plus une question de management et d’état d’esprit que de taille.
Si l’association végan s’attaque aux petits abattoirs, ce n’est pas anodin ; c’est parce que, dans le subconscient des consommateurs français, la viande, comme le vin, du petit producteur est quelque chose de rassurant, de même que le bio, même si cela peut paraître irrationnel. S’attaquer à des abattoirs de petite taille, dont un certifié ECOCERT, est une façon de saper la confiance des Français : les cibles ont été choisies à dessein. Les mêmes personnes avaient visité de grands abattoirs, comme à Cholet en Maine-et-Loire, des abattoirs appartenant à M. Bigard, et n’avaient pas trouvé de choses invraisemblables. Leur slogan : « Il n’y a pas de viande heureuse » tourne autour de ce thème : derrière tout animal, même bio, il y a la mort. L’idée est de parler de tuerie et non d’abattage, pour choquer. Je lis beaucoup de leurs publications, ayant la responsabilité de ce dossier à la FNSEA et cherchant à comprendre leurs motivations. La vraie finalité, c’est de rompre avec la consommation de viande, une consommation qui, en France, tient à notre culture, notre histoire, notre tradition : le cassoulet de Castelnaudary, l’agneau de pré-salé, le bœuf bourguignon, la poule au pot d’Henri IV… Nous avons des traditions régionales où la viande est très présente. L’homme est un omnivore, mais il a une mâchoire de carnivore : nos canines et molaires servent à manger de la viande, même si nos jeunes s’en servent un peu moins en mangeant beaucoup de viande hachée…
C’est un choc de cultures. L’insistance de ces associations à trouver chaque fois quelque chose de nouveau montre bien que leur finalité n’a rien à voir avec le bien-être des animaux. Il est nécessaire de conduire le travail d’enquête de cette Commission pour garantir aux 97 % de Français qui mangent de la viande que l’on peut en manger en confiance, que les animaux ont été respectés de leur naissance à leur mise à mort, afin de ne pas prêter le flanc à ceux qui poursuivent un tout autre objectif.
Les éleveurs qui se rendent eux-mêmes à l’abattoir le vivent parfois difficilement. Quant aux salariés, ils sont soumis au stress de la mort donnée toutes les secondes ou toutes les deux minutes, mais c’est une confiance qu’on leur délègue, plus qu’une tâche dont on se décharge. Ne nous trompons pas de sujet. Or votre commission est sur le bon sujet. Il convient de restaurer la confiance des Français qui ont du plaisir à manger de la viande.
M. William Dumas. Vous avez indiqué, Monsieur Tixier, que vous parveniez à peu près à l’équilibre financier. Mais dans les circuits courts de la filière viticole, alors que la filière aujourd’hui marche bien, les gens ne sont pas encore gagnants, contrairement à ceux qui vendent, comme on le dit un peu vulgairement chez nous, au cul de la citerne. Mais le jour où survient une crise, les circuits courts sont incontestablement la réponse, et sont rentables.
Vous avez dit abattre une dizaine de bovins par semaine. Vous n’abattez que du bovin ?
M. Jacky Tixier. Non, nous faisons du multi-espèces : ovins, caprins, porcs et bovins.
M. William Dumas. Quel est votre tonnage à l’année ?
M. Jacky Tixier. Notre objectif est de 500 tonnes ; pour l’instant, nous en sommes entre 250 et 300 tonnes.
M. William Dumas. Et vous parvenez à l’équilibre. Je vous la pose cette question car j’ai dans ma circonscription un abattoir, au Vigan, qui a été pris pour cible par L214. C’est un abattoir comme le vôtre, qui sert environ 200 éleveurs, dans une zone classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les Causses. Il n’y a peut-être pas comme dans votre projet une salle vitrée d’où l’on peut voir tout ce qui se passe…
M. Jacky Tixier. C’est en construction.
M. William Dumas. Cet équipement public, repris par la communauté de communes, était déficitaire au départ et est aujourd’hui à l’équilibre. Ils ont réalisé l’an dernier 6 000 euros de bénéfices alors qu’ils étaient à 50 000 euros de déficit au moment de la reprise. La Cour des comptes était même venue à la suite d’une enquête de la sous-préfète sur ce déficit. Ils sont parvenus à l’équilibre car ils ont diminué leur tonnage, après avoir laissé partir un client qui abattait sept à huit cents tonnes de cochon, qui travaille aujourd’hui avec l’abattoir d’Alès : ils s’étaient aperçus que cette activité leur coûtait en fait de l’argent. Votre système est peut-être plus cher mais vous vous y retrouvez, dans le circuit, avec votre clientèle, à qui vous vendez un produit certifié et qui peut venir voir à la ferme comment sont élevés les animaux.
Il manque, comme le dit M. Pinatel, des abattoirs. Le maire d’Alès, où se trouve le second abattoir de ma circonscription, nous a dit qu’il abattait quelque 5 000 tonnes, dont 50 % en rituel. Si l’abattoir ferme, les gens seront obligés de se rendre à Valence, à plus de 150 kilomètres. Or cet abattoir perd entre 300 000 et 500 000 euros par an, ce qui est énorme. Après la vidéo de L214, des investissements ont été programmés, de l’ordre de 400 000 à 500 000 euros. La région et le département viendront certainement à son aide, mais il est incontestable qu’il sera, dans certains endroits, difficile de parvenir à l’équilibre.
Ce qu’a fait votre chambre d’agriculture, Monsieur Venteau, en reprenant un abattoir, est bien. Dans des zones comme les Cévennes, où je mets trois heures de route pour aller d’un bout à l’autre de ma circonscription, il faut incontestablement des abattoirs de proximité.
Madame Lambert, vous avez parlé d’abattoirs mobiles au moment des fêtes de l’Aïd. Nous en avons quelques-uns. Un de nos collègues nous a même appris qu’il en avait un à Sarcelles… Bref, cela existe déjà et ça peut fonctionner. Vous n’êtes pas tous d’accord sur le sujet. C’est une question que nous nous posons. Dans certains pays, cela se passe bien, dans d’autres moins bien. Notre ministre, que nous avons interrogé, n’y semble pour l’instant pas très chaud… Il faudra sans doute expérimenter.
Les gros abattoirs sont souvent spécialisés, avec des chaînes qui n’abattent que de la vache ou que du porc. Je lisais hier dans Le Monde un article sur un abattoir en Côtes-d’Armor, où un porc est abattu toutes les cinq secondes. Ce sont des cadences infernales. On parle beaucoup aujourd’hui du bien-être animal – qui me semble mieux pris en compte qu’auparavant – mais peu du bien-être humain, c’est-à-dire des gens qui travaillent dans ces abattoirs, dont les tâches sont répétitives et qui souffrent de problèmes articulaires. On ne parle pas non plus de la filière économique, alors que ce sont les petits éleveurs qui assurent l’entretien du paysage. Les agriculteurs et les éleveurs sont les premiers jardiniers de l’espace. Il faut savoir ce que l’on veut.
L214 n’est pas ma tasse de thé, et ce depuis longtemps. Au salon de l’agriculture, les enfants de la capitale qui vont voir les petits cochonnets et les autres bêtes ont souvent des animaux de compagnie ; il en résulte un amalgame entre l’animal de compagnie et l’animal d’abattage. C’est aussi pour cette raison que ces vidéos choquent terriblement.
Cela m’a en tout cas fait plaisir d’entendre aujourd’hui tous les représentants de la profession. Il est important d’avoir votre avis.
Mme Sylviane Alaux. J’étais à deux doigts d’étrangler mon collègue…
M. le président Olivier Falorni. Sans étourdissement ? (Sourires.)
Mme Sylviane Alaux. Plus sérieusement, je partage, Monsieur Venteau, votre point de vue quand vous dites que, si l’animal est mal élevé et mal abattu, la viande n’est pas bonne, et c’est pourquoi je m’interroge sur la qualité de la viande des élevages et abattages industriels, que je dénonce toujours. En tant que consommatrice, je suis convaincue que l’élevage industriel n’offre pas au consommateur un bon produit.
Je suis également convaincue que l’abattoir est par nature un lieu de souffrance, dans la mesure où l’on y donne la mort. Tout doit donc être fait pour minimiser la souffrance de l’animal. Je ne suis pas végétarienne et je ne pense pas que je le serai devenue au terme des travaux de cette Commission d’enquête, même si j’ai maintenant quelques interrogations sur la côte de bœuf ou de porc dans mon assiette.
En vous entendant les uns et les autres, j’ai eu le sentiment que vous vous défendiez plutôt que d’affirmer ce que vous êtes. Il n’y a pas de suspicion de notre part mais cette Commission et les images de L214 nous mettent face à nos contradictions. Nous aimons la bonne côte de bœuf, nous aimons voir le petit veau qui gambade dans le pré, mais il ne faut pas occulter que ce que nous achetons au supermarché n’est pas toujours issu du petit veau dans la prairie… Je dénonce les élevages industriels, dans lesquels la dignité de l’animal n’est pas du tout respectée. Gandhi disait que l’on mesure le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux…
Notre commission a un rôle d’investigation et, quand nous avons la chance d’avoir devant nous un large panel d’éleveurs, nous sommes aussi demandeurs de suggestions. Vous êtes à cet égard allés très loin dans ce que je demande en tant que consommatrice, et je vous en remercie. Je suis pour ma part favorable à la vidéosurveillance pour peu qu’elle soit bien encadrée. Nous sommes déjà surveillés de partout ; un petit peu plus, un petit peu moins, on ne s’en rendra sans doute pas compte. D’autres professions connaissent déjà la vidéosurveillance : les employés de banque ou de joaillerie sont en permanence sous vidéosurveillance dans leur activité.
Tous ensemble, éleveurs, consommateurs, abattoirs, nous pouvons retrouver un bon consensus dès lors que nous ne perdons pas de vue quatre points essentiels : le bien-être animal, le bien-être des salariés, la sécurité du consommateur et la préservation de l’environnement. Ces quatre points sont indissociables les uns des autres et doivent rendre possible une autre façon d’appréhender ces métiers.
M. Bertrand Venteau. Juste une précision : l’un des premiers pays exportateurs de bœuf au monde est l’Inde…
Mme Sylviane Alaux. Cela n’enlève rien aux paroles de Gandhi. Il était peut-être végétarien, je ne l’ai pas vérifié, mais nous devrions en tout cas nous inspirer de cette phrase car c’est une réalité. Il y a quelques années, on arrachait l’œil du lapin, on sectionnait le gosier du poulet. Je l’ai vu faire et cela a soulevé mon indignation de défenseure des animaux, mais cela ne m’a pas empêché de manger du poulet. Je fais partie d’un groupe d’étude contre la maltraitance animale – ceci explique sans doute cela. Nous devons rendre à l’animal sa dignité. Nous l’élevons certes pour le manger mais cela peut se faire sans souffrance inutile.
Mme Christiane Lambert. Je suis surprise que vous nous trouviez sur la défensive, car ce que j’ai présenté est tout le contraire. À la suite de la médiatisation de certains événements, des questions sont posées, certaines fondées, d’autres non, et parce que nous avons entendu beaucoup de choses, nous avons souhaité prendre la parole, de manière non défensive mais pédagogique, comme si nous ouvrions les portes de nos exploitations pour montrer ce qui s’y passe vraiment.
La réalité de ce que consomment les Français aujourd’hui est loin de l’idéalisation de la belle et gentille agriculture… Acheter des produits d’alimentation dans un grand supermarché ou un hypermarché, ce n’est pas forcément moins bien que dans un petit supermarché ou une supérette de village, de la même manière que, lorsqu’on fait réparer sa voiture dans un grand garage, il n’est pas certain que l’on soit moins bien servi que dans un petit. L’opposition du grand et du petit que vous entretenez est un peu ennuyeuse car elle n’est pas fidèle à la réalité.
Faisons attention également à ne pas entretenir, à travers des mots dits de façon très soft, une opposition entre ce qui est bien et ce qui ne le serait pas. Il y a toutes sortes de consommateurs. Certains ont un pouvoir d’achat « plus plus plus », d’autres « plus plus », d’autres encore n’ont pas d’emploi et ont besoin de manger à peu de frais. Le coût de l’alimentation est aussi un élément de choix. Une enquête de la Commission européenne montre que 1 % des gens seulement demandent à être renseignées sur les conditions d’élevage. Le chiffre est peut-être un peu plus élevé en France en ce moment, mais la diversité des consommateurs explique la diversité de la production. Le prix est également un élément décisif : le déclaratif est une chose, la réalité de l’acte d’achat en est une autre. Les produits élevés plus longtemps dans des conditions plus sophistiquées ont nécessairement un coût supérieur. Je ne mange pas moi-même la même chose en semaine et le week-end quand je reçois des amis. Cette diversité de l’offre doit être préservée.
Il ne faut pas non plus laisser circuler l’idée, largement diffusée par certaines organisations, que le bien-être animal n’est pas assuré dans les grands bâtiments. Des enquêtes montrent que les bâtiments de taille importante, quand ont bien été appréhendés les paramètres de la lumière, de la chaleur, de la climatisation, permettent d’élever les animaux dans des conditions de bien-être.
J’ai élevé des porcs en plein air dans le Cantal. Je peux vous assurer qu’ils n’étaient pas en condition de bien-être, ni l’été, en cas de canicule, car ils avaient tous des coups de soleil sur le dos, ni l’hiver car à cause de la boue et du bel, les truies avaient toutes des gerçures aux tétines et, au moment de la tétée des porcelets, elles se levaient très vite en criant parce qu’elles avaient très mal. Dois-je vous faire un dessin ? La réalité est parfois bien loin des images qui peuvent être véhiculées ici ou là. Élever des porcs en bâtiment, ce n’est pas les élever dans la souffrance. Les équipements dont nous disposons permettent de leur offrir des conditions de bien-être tout à fait correctes.
La France est probablement le pays qui a poussé le plus loin ce concept, en l’encadrant. Quand M. Le Foll a initié en 2014 le travail sur la feuille de route « Bien-être animal », finalisé en avril, notre pays a été l’un des premiers à le faire. On parlait à Bruxelles d’une loi-cadre sur le bien-être animal. Je ne sais pas s’il faut une loi, mais à la suite d’un engagement ayant donné lieu à deux ans de dialogue positif entre les parties prenantes, ONG et agriculteurs, on peut dire que l’élevage en France est aujourd’hui de qualité, car la puissance publique a fait en sorte que des règles soient respectées mieux qu’ailleurs. Pour avoir visité des feed lots au Brésil, je peux vous assurer que ce n’est pas du tout la même façon d’élever des animaux, en termes d’alimentation ou de conditions de logement.
Nous avons un niveau d’exigence élevé ; il faut aussi être volontaire pour maintenir les éleveurs sentinelles, les vétérinaires experts, les techniciens conseillers dans une chaîne vertueuse, une démarche de progrès. Depuis que nous avons conduit ce travail, la filière cheval vient d’élaborer une charte bien-être en élevage équin. La filière volaille y réfléchit pour requalifier, dans la production d’œufs, tous les bâtiments dans les huit ans, alors que la majorité d’entre eux ne sont pas encore amortis. Il faut du temps pour réaliser ce saut qualitatif, mais nous sommes au travail. Il est important de parler pour dissiper les jugements partiels ou partiaux. Visiter des élevages est également utile : je peux vous montrer de grands élevages qui sont à la pointe du respect de la santé des personnes qui y travaillent et des animaux.
L’abattage mobile, oui, mais n’oublions pas que la grande majorité de l’abattage continuera de se faire dans des abattoirs. D’où l’importance que le travail de cette Commission débouche sur des propositions pour que soit assuré le maximum de transparence dans les grands abattoirs, avec des cadences convenables.
Mme Sylviane Alaux. Le coût de la viande en supermarché permet certes à des familles modestes de manger mieux et de façon plus diversifiée. Pour ma part, je suis membre de l’association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), où je côtoie beaucoup de familles modestes – je suis moi-même issue d’une famille modeste. Les gens s’abonnent, pour la volaille, la viande rouge, les œufs, le fromage, en plus d’un panier de légumes toutes les semaines. Je vous assure que cela permet une réelle économie à la fin du mois, tout en assurant une alimentation de qualité.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur de la Commission d’enquête. Nous avons bien noté la nécessité d’une approche intégrée de la filière, dont vous êtes l’amont. Toute segmentation des modes de production, dès lors qu’elle s’accompagne d’une répartition inégalitaire de la valeur, crée des problèmes. Il est important de le faire ressortir, car quand on parle de petits, de grands, de nécessité d’investissements, de difficultés d’équilibre, c’est toujours à ce problème que l’on touche. Quand une collectivité ou un établissement public vient en soutien, on pallie un déséquilibre, mais il faut bien avoir à l’esprit la nécessité que chacun, de l’éleveur au consommateur, rémunère les fonctions qu’il délègue pour se nourrir sur l’ensemble de la chaîne.
Il est apparu dans nos auditions que les contrôles en abattoir étaient asymétriques entre l’aspect sanitaire et celui du bien-être animal. Historiquement, le bien-être animal est une préoccupation plus récente que le sanitaire. Vous semblerait-il utile qu’un contrôle spécifique soit organisé ? Ce n’est pas la même chose d’examiner chaque carcasse ou l’ante mortem des animaux sur le plan sanitaire et de contrôler les installations et les outils. Que les deux contrôles soient exercés par les mêmes personnes n’est-il pas responsable de la relative relégation du bien-être animal dans la hiérarchie des priorités et ne faudrait-il pas dès lors prévoir un contrôle spécifiquement dédié, dans lequel pourrait d’ailleurs être intégrée la vidéo ? Dans une entreprise de transports où j’ai travaillé, ce sont les salariés eux-mêmes qui déclenchent le rétro-enregistrement de la séquence de l’heure précédant un incident. La suspicion que traduit la présence permanente de caméras peut être problématique, même si certaines professions y sont déjà habituées, mais se priver de ce mode de preuve, de démonstration, de dénonciation aussi de certains dysfonctionnements, peut être dommage : lorsqu’un matériel ne fonctionne pas, si l’agent ou le CHSCT peut le prouver aux yeux de sa direction, c’est aussi un atout au bénéfice du salarié.
Historiquement, les abattoirs ont été construits pour que les gens ne voient pas l’acte d’abattage. On s’aperçoit à présent que cela coupe les gens de la responsabilité de leur acte de consommation. Seriez-vous prêts, en tant qu’organisations syndicales, à participer à des commissions locales d’information et de surveillance des abattoirs, aux côtés des consommateurs, des professionnels, des services de l’État, en vue de promouvoir une transparence organisée, plutôt que d’avoir affaire à des vidéos sauvages ?
M. Jacky Tixier. Il faut que la vidéosurveillance soit contrôlée. Nous ne voulons pas que ce soit un moyen de pression sur les salariés, et il faut donc que cela se passe dans un régime d’autorisation de la CNIL, avec la participation de tous les opérateurs. Ce serait plutôt une forme d’autosurveillance, sur les outils, la contention des animaux, etc. Il n’est pas acceptable qu’un opérateur soit obligé, à cause d’une mauvaise contention, de faire des choses un peu limites pour assommer l’animal. Il faut travailler autrement, immobiliser l’animal correctement, avec une mentonnière. Dans le pôle viande que nous créons, nous allons dépenser un peu plus d’argent pour les box, de façon à mieux travailler sur l’assommage des animaux car, si l’animal n’est pas bien contenu, le travail devient en effet une vraie boucherie. Pourquoi pas une vidéosurveillance à cet endroit ? Nous y sommes favorables, non pour « fliquer » les opérateurs, mais pour faire avancer les choses, dans le cadre d’une autosurveillance.
M. Bertrand Venteau. Nous sommes pour notre part opposés à la vidéosurveillance qui risque de n’être qu’un palliatif au manque de moyens du sanitaire et des services de l’État dans les abattoirs.
M. le rapporteur. La vidéosurveillance peut être à la main des services de l’État. Cela a été évoqué dans d’autres auditions.
M. Bertrand Venteau. L’idée est bonne, mais j’ai des craintes sur la déclinaison. Et s’il faut en plus créer une nouvelle commission… Les responsables syndicaux que nous sommes savent par expérience que commissions et simplification ne font pas bon ménage.
M. Laurent Pinatel. L’idée de commissions locales d’information rejoint la demande de la Confédération paysanne de favoriser les synergies, créer un dialogue entre acteurs à l’intérieur des abattoirs et au dehors, notamment sur les parcs de contention, où il peut être intéressant de croiser le regard de ceux qui travaillent dans les abattoirs avec l’expertise des éleveurs. Nous sommes très attachés à la présence d’éleveurs dans les commissions locales.
J’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à la vidéosurveillance.
L’alimentation, ce n’est pas comme de produire des pièces de voiture. Cela ne se produit pas de la même façon dans les grands et dans les petits élevages ; la qualité de la viande n’est pas la même à l’issue d’une chaîne très industrialisée que dans des unités plus petites. Nous savons qu’il y a des gens qui ont des problèmes de pouvoir d’achat dans ce pays, mais nous sommes assez horrifiés d’entendre qu’il faut une agriculture industrielle pour nourrir les pauvres, et que ceux-ci devront s’en contenter… Nous préférons nous poser la question : comment rééquilibrer les soutiens publics en direction d’une alimentation de qualité accessible à tous ?
Mme Christiane Lambert. Je ne sais pas si je suis pauvre ou riche, mais il m’arrive de manger de l’alimentation industrielle et de bien m’en porter…
En ce qui concerne les commissions locales d’information, j’ai proposé de développer le dialogue entre éleveurs, salariés et, probablement aussi, responsables d’abattoir sur la conception et la réorganisation. Cela s’est déjà produit sur un sujet au cœur de débats difficiles ces deux dernières années, à savoir la question de la propreté des animaux, notamment des bovins, qui étaient parfois livrés aux abattoirs avec des traces de terre ou de déjection sur les pattes ou les cuisses, et des problèmes sanitaires que cela pouvait poser. Des réunions mixtes se sont tenues pour responsabiliser les éleveurs, qui ont été invités à visiter les bouveries pour voir comment le problème se traduisait au niveau de l’abattage. C’est une démarche très pédagogique.
La question nouvelle est de savoir s’il faut ou non associer les organisations de protection des animaux et, j’ajouterai, les associations de consommateurs. Ce débat doit être organisé – je ne sais pas sous la tutelle de qui ; c’est un élément qui peut rétablir la confiance, lever la suspicion sur ce qui se passe dans les abattoirs, car il a été dit un peu n’importe quoi sur le sujet, des choses vraies comme des choses fausses.
Nous sommes très réservés sur la vidéosurveillance, mais tout dépend de son usage. Si l’écran de réception se trouve dans le bureau de l’inspecteur vétérinaire, qui ne peut être partout dans l’abattoir à tout moment, pourquoi pas ? Cela dépend aussi de celui qui aura la propriété de ces images, de leur délai de conservation, ainsi que de l’usage qui en est fait. S’il s’agit de permettre des retours en arrière dans un processus d’amélioration continue, là encore pourquoi pas ? Il faudra tout de même un dialogue avec les salariés de l’abattoir. Je sais qu’il existe déjà des caméras en poste fixe installées en relation avec les organisations de certification internes et externes, dans le but d’attester des bonnes pratiques.
Le vétérinaire a une compétence multiple. Les aspects d’hygiène sont très liés à ceux du bien-être animal et, pour avoir entendu dans le cadre des longs travaux du conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV), sous l’autorité de la direction générale de l’alimentation (DGAL), l’ordre des vétérinaires et le syndicat national des vétérinaires, je suis convaincue que la même personne peut avoir la double casquette. Les vétérinaires revendiquent leur compétence en matière de bien-être, et c’est vrai qu’ils l’ont. Il ne faut pas non plus multiplier les intervenants. Dans un élevage, l’éleveur a la totalité de la responsabilité : il faut tout à la fois que les animaux soient bien nourris, propres, en situation de bien-être, et c’est une seule personne qui gère le tout.
M. le président Olivier Falorni. Merci à tous pour ces présentations particulièrement complètes. Nous tenions à connaître le point de vue des organisations agricoles.
La séance est levée à midi trente.
——fpfp——
37. Audition, ouverte à la presse, de M. Franck Ribière, réalisateur du film « Steak (R)évolution » et fondateur de la société « Le bœuf éthique »
(Séance du mercredi 6 juillet 2016)
La séance est ouverte à seize heures vingt.
M. le président Olivier Falorni. Nous reprenons nos auditions dans le cadre de la commission d’enquête sur les conditions d’abattage dans les abattoirs français. Nous auditionnons cet après-midi M. Franck Ribière, producteur et réalisateur de films.
Vous êtes, monsieur, issu d’une famille d’éleveurs et l’auteur du film Steak (R)évolution, sorti en salle en 2014, et qui a donné lieu à l’édition d’un livre du même nom. Vous réalisez actuellement un film intitulé Steak in France, en collaboration avec Interbev.
Vous avez également créé la société Le Bœuf éthique, dont l’objectif est d’être un nouvel acteur de la filière bovine, répondant à des impératifs de qualité, de prix et de bien-être animal. À cette fin, cette entreprise a mis en place un partenariat avec la société suédoise de Britt-Marie Stegs, qui a développé un camion d’abattage mobile, dans lequel peuvent travailler cinq opérateurs et un vétérinaire, capable d’abattre six bovins à l’heure, avec un stockage maximal par jour de cinquante-cinq carcasses. De plus, votre société souhaite travailler avec des éleveurs qui répondent aux critères d’une charte éthique précise, et dont les produits qui en résulteraient seraient commercialisés sous une marque spécifique.
Je vous rappelle, monsieur, que nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Franck Ribière prête serment.)
M. Franck Ribière, réalisateur du film Steak (R)évolution et fondateur de la société Le bœuf éthique. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je suis effectivement issu d’une famille d’éleveurs puisque ma famille élevait des vaches de race Charolaise dans le centre de la France. J’ai toujours voulu savoir et comprendre comment améliorer le goût de notre viande, car je me suis rendu compte, grâce à mes nombreux voyages, que la France n’était pas spécialement l’endroit où la viande avait le plus de goût. Si la France est le pays de la gastronomie, et la viande en fait partie, elle n’a pas une culture de la viande pure, contrairement à l’Argentine par exemple.
Je suis donc parti à la recherche du meilleur steak du monde, pour faire un tour du monde et essayer de combler une forme d’absence de curiosité de la part des éleveurs et des professionnels de la filière que je connais bien : ils ne cherchent pas trop à savoir ce que font les autres, de peur de mal faire ou pas assez bien. En voyageant et en visitant un grand nombre d’éleveurs, de bouchers et de restaurateurs, j’ai pu me faire une idée de ce qu’était la bonne viande et de la façon dont on pouvait l’améliorer en France. Or une des conditions, qui m’a paru assez étonnante mais qui a été la force du film et du livre, c’est que pour faire un bon steak, il faut une vache heureuse. Heureuse tout au long de son processus, c’est-à-dire de sa naissance à sa mort.
Je me suis beaucoup intéressé à l’alimentation, à l’élevage, aux différentes races, à leur amélioration, aux croisements, à leur adaptation ou non à leur territoire et je suis parvenu à la conclusion que pour obtenir une bonne viande, il fallait effectivement répondre à toutes ces questions, parmi lesquelles la problématique de l’abattage. J’ai visité et filmé des abattoirs dans le monde entier, y compris en France, et rencontré des abatteurs d’à peu près partout ; j’ai ainsi pu considérer que, d’une manière générale, l’abattage ne posait pas forcément problème. Je n’ai pas vu de choses ignobles, seulement des gens qui travaillaient et qui étaient plutôt professionnels, même si j’ai bien conscience que la mort d’un animal est un moment difficile, délicat. Grâce aux différents lanceurs d’alerte dont nous avons tous entendu parler, nous nous sommes aperçus que certains actes y étaient commis, mais je n’ai pas d’autre avis personnel là-dessus. Je pense qu’il y a des idiots et des méchants partout, y compris dans les abattoirs. Toutes les solutions que votre commission voudra bien imaginer iront dans le sens d’une meilleure surveillance.
J’insisterai toutefois sur un point : dans tous les abattoirs du monde que j’ai visités, j’ai constaté une vraie dévalorisation du travail de ces gens. Ils sont souvent fatigués, stressés, honteux ou mal à l’aise avec le métier qu’ils exercent. Je me suis notamment demandé ce que peut répondre un enfant d’abatteur à un professeur qui lui demande quel est le métier de son papa ou de sa maman. Je me suis rendu compte que l’on était face à des gens qui n’ont pas été traités correctement, alors qu’ils effectuent un travail que vous et moi serions bien incapables de faire. Il y a là quelque chose qui fragilise le système : ils sont sous pression, ils font un sale métier, pour des rémunérations relativement modestes, quelle que soit leur expérience. Ma relation à l’abattage en reste là.
C’est en Espagne que j’ai pu goûter la meilleure viande du monde. Entre trois et six mois avant la mort de l’animal, l’éleveur le trimbalait dans son camion, deux ou trois fois par semaine, afin de l’habituer. Je me suis donc intéressé au transport. J’ai rencontré des Canadiens qui m’ont dit que leurs vaches parcouraient 700 kilomètres pour aller à l’abattoir, j’ai discuté avec des gens qui se plaignaient de la disparition de certains abattoirs de proximité et qui devaient faire des trajets de plus en plus longs. Ils m’ont dit qu’il était de plus en plus compliqué d’amener les bêtes au bon moment, car les abattoirs commencent à être un peu encombrés, si bien que les animaux passent plus de temps qu’auparavant, les uns derrière les autres, à attendre la mort. Un animal dans son environnement, avec ses congénères, en présence de son éleveur, n’a pas du tout la même attitude qu’un animal qui a voyagé sur quatre-vingts kilomètres, glissé trente fois, entendu parler trois ou quatre personnes différentes, et qui, après avoir entendu les cris des porcs et les moutons, comprend très vite que quelque chose de désagréable va lui arriver.
Quand j’ai commencé à réfléchir, avec mes partenaires, à une chaîne complète qui permettait de réduire les intermédiaires pour passer directement de l’étable à la table, il m’a paru incohérent que l’abattage ne fasse pas partie de ce concept. La seule façon de limiter le stress de l’animal avant sa mort, c’est de l’empêcher de voyager. C’est donc à l’abatteur de venir sur place. Cela correspond à l’idée générale des films que j’ai réalisés et à la position que je défends : le retour au bon sens paysan, à ce que faisaient les bouchers avant, c’est-à-dire venir au bon moment à la ferme pour abattre l’animal, le stocker assez longtemps pour que la viande puisse maturer et ainsi être de bonne qualité, et la confier ensuite au boucher qui la préparera correctement et continuera le processus de maturation jusqu’à sa consommation finale.
Le système industriel a changé la donne et mis en avant une nouvelle conception, tout à fait valable : proposer une nourriture accessible et saine. Mais il faut bien faire la différence entre une viande saine et une viande bonne. Je considère que l’on ne peut trouver de la bonne viande que si une charte éthique implique l’éleveur à tous les niveaux, de la naissance à la mort de l’animal. Cela suppose de demander à l’agriculteur de ne plus pratiquer l’insémination artificielle, de nourrir les animaux uniquement à l’herbe, d’éviter tout médicament, d’essayer les médicaments alternatifs. Tous les éleveurs que j’ai interrogés m’ont répondu : tout ça, c’est bien beau, on a essayé des tas de choses, mais il y en a une où il faut que cela change, sinon cela ne marchera jamais, c’est l’abattage. Un contrôle sur l’abattage, c’est-à-dire un abattage à la ferme, permettrait de garantir le côté éthique et le respect de l’animal. Dès lors, les éleveurs seraient capables de s’engager à fournir des animaux éthiques à tous les niveaux, pour peu qu’ils soient abattus dans des conditions acceptables, à défaut d’être agréables.
Comme je ne voyais pas particulièrement de problèmes en France, je me suis intéressé à ce qui se passait à l’étranger. Sur Internet, on trouve beaucoup de bêtises, des méthodes étranges. Aux États-Unis et en Suisse, certains abattent les animaux au fusil, et quelques abatteurs tuent une bête sur place et se dépêchent ensuite de l’emmener à l’abattoir le plus proche dans un camion frigorifique… Bref, tout était envisageable. Mais la société suédoise que nous avons rencontrée a développé un business model très au point et qui répond à toutes les normes européennes : autrement dit, sur le plan technique, leur camion pourrait opérer en France dès demain matin. Reste un problème, celui de la présence des vétérinaires. Les services vétérinaires qui délivrent les homologations des carcasses et l’autorisation de leur commercialisation auraient-ils la possibilité de venir travailler dans un camion ? Ils seraient rémunérés aux lieu et place de l’État puisque le modèle que je propose est une société privée. Cela permettrait de revenir à une chose que les vétérinaires demandent beaucoup : la discussion directe avec l’éleveur. Le modèle suédois que je vous présenterai montre que l’animal reste dans son environnement et que l’éleveur est en permanence avec lui.
M. le président Olivier Falorni. Nous allons le voir dans quelques minutes, puisque je vais suspendre la séance le temps que mes collègues et moi-même nous rendions dans l’hémicycle pour un vote solennel.
La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures cinquante.
M. le président Olivier Falorni. Monsieur Ribière, vous allez maintenant pouvoir nous présenter les photos de ce système d’abattage particulier.
M. Franck Ribière. Pour élaborer notre produit, le bœuf éthique, de l’étable à la table, il fallait trouver le moyen d’éviter la dernière partie très compliquée de la vie de l’animal, c’est-à-dire son transport et tout ce qui peut lui arriver juste avant d’être abattu, quand il change d’endroit et se retrouve dans des groupes différents alors qu’il aurait besoin de calme.
Après avoir écarté les méthodes un peu étranges, comme l’abattage au fusil, pratiquées dans certains pays, nous avons rencontré une Suédoise, fermière de son état, qui a décidé il y a dix ans de construire une chaîne complète correspondant exactement à ce que nous cherchons : faire naître, élever correctement, nourrir et accompagner l’animal jusqu’au bout. Elle l’a fait d’abord pour sa ferme, avec ses animaux, avant de s’apercevoir qu’il y avait une demande, sachant que la Suède est l’un des rares pays européens où la consommation de viande augmente et que les Suédois sont attachés au bien-être animal, à l’écologie et aux dimensions éthiques.
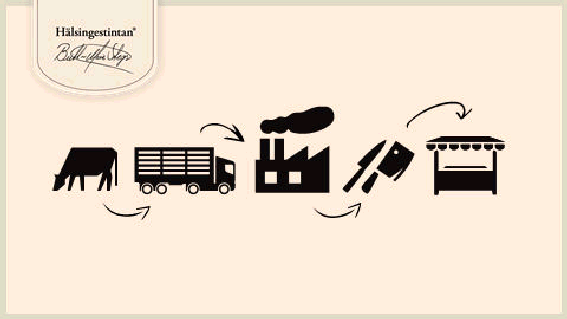
L’image ci-dessous illustre le modèle qui existe partout : la vache est élevée dans un pré. Avant de se retrouver chez le boucher ou en grande surface, elle est transportée par camion jusqu’à l’abattoir.
Britt-Marie Stegs a décidé de supprimer le transport et l’abattage dans un abattoir fixe pour garantir une viande éthique, ethical meat, de la vie à la mort de l’animal. Cela passe par la mise en place d’un outil performant d’abattage qui correspond aux normes sanitaires d’abattage imposées à tous les pays européens, ce qui fait que ce camion aujourd’hui est european sensibility, autrement dit qu’il peut opérer partout, y compris en France.
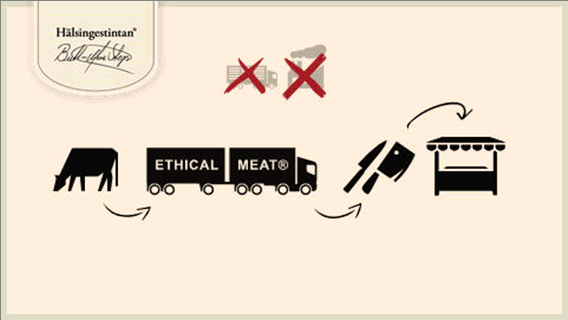

Il a fallu choisir, dans un premier temps, un vecteur qui puisse supporter l’intégralité de la chaîne d’abattage, c’est-à-dire un camion de transport qui comprend un générateur, un épurateur d’eau – il est autonome en électricité et en eau –, l’atelier et tous les espaces nécessaires à l’abattage d’un animal, comme les vestiaires, les toilettes spécifiques à un abattoir et ce qu’il faut pour nettoyer tous les instruments. Le dispositif se compose au total de deux camions et deux remorques. Cet abattoir peut être installé partout, dans un pré notamment.


Sur la photo ci-dessous, on peut voir le dispositif installé, en état de marche. Les deux camions sont accolés à leurs deux remorques.
Sur la photo ci-dessous, vous apercevez à droite une porte avec une grille : c’est le piège. Avant de venir tuer les animaux, les abatteurs sont passés au préalable pour étudier la situation de la ferme – étable, écoulement des eaux usagées, traitement des déchets – et prévoir tout ce qui facilitera la mise en place et la stabilité du camion.

Sur la photo ci-dessous, l’animal est dans l’étable. Ce système de demi-spirale a été inventé pour sélectionner l’animal, si l’on constate qu’il commence à ne pas se tenir tranquille, et l’isoler un moment avant de passer à l’étape suivante.

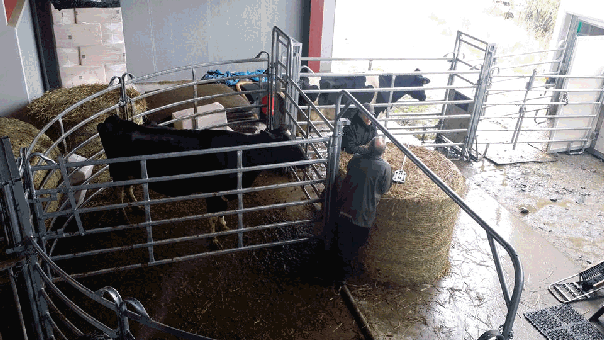
Sur la photo ci-dessous se déroule la partie la plus étonnante du processus, celle dans laquelle c’est l’éleveur lui-même qui emmène sa bête à la mort. L’animal croit aller de l’étable au pré. Il n’a qu’une chose dans son axe de vision : ce qu’il croit être une porte qui donne sur un environnement qui lui est familier, où il va manger. À chaque fois que j’ai filmé, je n’ai jamais vu un animal faire demi-tour. Il n’a aucun stress. Et dans le pré, d’autres animaux attendent : il faut être malin, et lui faire croire qu’il va rejoindre ses copains.

À partir de ce moment, l’animal n’a plus aucun moyen de faire demi-tour. Dès l’instant où il passe par la petite porte, la grille arrière remonte et il est aussitôt étourdi. Car l’abatteur l’attend à l’intérieur de la remorque et est en train de viser cette pièce de deux euros située juste au-dessus de la tempe. L’animal a juste le temps de se rendre compte que la porte est fermée, autrement dit qu’elle ne donne pas directement dans le pré. Mais c’est trop tard pour lui : c’est fini.
Mme Françoise Dubois. C’est de l’arnaque… (Sourires.)
M. Franck Ribière. Effectivement, il a été bluffé !

Il n’y a donc pas de piège de contention, juste la main de l’opérateur. À ce moment-là, l’animal tombe, les grilles se lèvent et le travail commence.

Le camion est conçu pour abattre six animaux à l’heure, avec un maximum de cinquante-cinq animaux par jour. Le camion est rentable à partir de douze animaux abattus. En dessous de douze animaux, c’est faisable, mais plus compliqué. Il y a un vétérinaire en permanence dans le camion et quatre opérateurs. Le travail est le même que dans un abattoir fixe. L’abatteur tue l’animal après l’avoir étourdi. Il ne le confie à son collègue qu’après vérification par le vétérinaire. Ensuite, il est découpé avec des instruments auto nettoyés avec de l’eau purifiée.

Enfin, l’animal est stocké dans la dernière partie du camion, la chambre froide, qui peut contenir cinquante-cinq carcasses coupées en quatre. Cette partie pourra se déplacer, à différents moments de la journée, et emmener les carcasses à l’atelier de découpe. La chaîne du froid est bien respectée afin que la carcasse ne soit jamais au-dessus de 7 °C. Lorsqu’elle est entrée dans l’atelier de découpe, la bête est stockée pendant quinze jours ; elle est découpée et commercialisé sous leur propre marque, Etiskt Kött, « Viande éthique ». Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir que toutes les inscriptions de traçabilité sont respectées et que l’étiquette est signée. Le flash code permet à n’importe quel porteur d’un iPhone ou d’un téléphone Android d’obtenir des informations sur l’éleveur, le lieu, la race consommée, etc.
Lorsque j’entre dans un restaurant et que je demande quelle est l’origine de la viande, on me répond seulement que la viande est française. Lorsque je regarde la carte des vins et que je me contente de demander un vin français, on me demande de préciser mon choix… À cela, je réponds : comment pouvez-vous ne pas avoir de respect pour un animal et en avoir pour le vin ? Il y a là quelque chose d’illogique. C’est cette absence d’échange entre le consommateur et l’éleveur qui justifie la charte éthique.
Le flash code donne aussi des indications sur la qualité. Les viandes sont en effet notées de zéro à cent, comme le café, pour faire comprendre aux consommateurs quels sont les niveaux de goût et les caractéristiques globales des viandes de chaque race afin de déterminer la qualité la plus élevée. Cela permet de comprendre quelles pourraient être les variations de prix. Une viande de Black Angus sera certainement plus chère qu’une Charolaise, pour une raison de rapport entre la taille, le poids et la carcasse, mais surtout en raison de ses qualités gustatives. Nous avons aussi défini une grille d’arômes, comme le café. L’éleveur également aura en retour des informations sur la qualité de la viande qu’il a produite.
L’autre avantage de ce système est de mettre en contact deux personnes qui en général ne se parlent pas : l’éleveur et le vétérinaire. L’éleveur est libre de monter dans le camion pour suivre tout le processus, à l’exception de l’atelier de découpe. Tout est transparent. Il voit surtout la bête au stade final, et il peut discuter avec le vétérinaire des problèmes détectés sur l’animal. Grâce au système de notation que nous avons mis en place, il pourra aussi, à l’avenir, faire des calculs pour savoir si ses méthodes d’élevage se sont améliorées, si la qualité gustative a progressé, et si le prix de la viande éthique est justifié pour le consommateur, puisque celui-ci a la possibilité, par le biais de l’application sur son smartphone, de donner son avis sur la viande qu’il mange. Ce qui manque à toute la filière, dans le monde entier, c’est de savoir si la viande est bonne ou non. On revient donc au bon sens paysan, à ce qui se faisait auparavant, d’une certaine manière, mais en l’adaptant aux conditions sanitaires requises en Europe et en France.
Une seule interrogation demeure : comment faire entrer, en France, un vétérinaire dans le camion ? Qui va nous donner la possibilité de saisir un vétérinaire pour lui demander de venir, à tel endroit, à tel moment de l’année ? Comment seront garantis tous les éléments nécessaires à son travail ?
M. le président Olivier Falorni. Je vous remercie pour votre présentation.
Lorsque vous avez évoqué la phase d’étourdissement, vous avez dit qu’il n’y avait pas de piège à contention. Une fois que l’opérateur a étourdi l’animal avec le pistolet matador, comment est pratiquée la saignée, à quel endroit, et par qui ?
M. Franck Ribière. Tout à l’heure j’ai dit effectivement qu’il n’y avait pas de piège de contention ; en réalité, il y en a un, que l’opérateur peut actionner au cas où. Il l’utilise souvent pour éviter qu’un animal un peu gros ne s’écrase trop lourdement. Quand il n’en a pas besoin, le piège à contention se lève. Il accroche l’animal par la jambe gauche, et il le monte immédiatement, comme le ferait n’importe quel abatteur. C’est à ce moment qu’est pratiquée la saignée, de manière classique.
M. le président Olivier Falorni. Lorsque l’animal est étourdi, il tombe sur le côté. Comment est vérifié l’étourdissement ?
M. Franck Ribière. Les vétérinaires se positionnent différemment selon les bêtes. Le vétérinaire se tient à côté de l’étourdisseur. Lorsque l’animal est tombé, la première chose que fait le vétérinaire, c’est de donner l’ordre de lever. L’abatteur ne touche pas la bête tant qu’elle n’est pas levée. Une fois la bête levée, il la découpe de manière on ne peut plus classique. Le vétérinaire participe activement à toutes les étapes – en Suède, c’est traditionnellement lui qui enlève les joues.
M. le président Olivier Falorni. Nous avons remarqué que, dans les abattoirs, les inspecteurs vétérinaires étaient présents aux postes ante mortem et post mortem, c’est-à-dire à chaque bout de la chaîne, mais peu présents lors de la phase d’abattage.
M. Franck Ribière. Dans un abattoir mobile, il est là en permanence. Et surtout, c’est le premier à donner les informations à toute la chaîne pour que les animaux suivent correctement tout le processus et à laisser entrer l’éleveur dans la partie commune pour lui expliquer s’il y a eu un problème sur la bête ou, au contraire, si tout va bien.
Tous les vétérinaires que nous avons rencontrés dans les camions refusent obstinément de retourner dans un abattoir classique. Ils considèrent que c’est une façon beaucoup plus humaine, chaleureuse de travailler, et que cela participe à l’esprit d’équipe d’opérer en même temps que les abatteurs. De leur côté, les abatteurs sont fiers de partager ce moment avec le vétérinaire, car s’ils se sentent contrôlés, ils se sentent aussi épaulés à tout moment, ils ne sont pas seuls. Quand c’est la vétérinaire qui est dans le camion, ils l’appellent « maman »… Cela montre à quel point ils ont besoin de cette présence qui rassure tout le monde.
M. le président Olivier Falorni. Vous avez dit que le camion pouvait abattre au maximum cinquante-cinq bêtes.
M. Franck Ribière. Le camion peut stocker cinquante-cinq bêtes dans une journée.
M. le président Olivier Falorni. Quel est le seuil de rentabilité ?
M. Franck Ribière. On ne peut pas déplacer le camion pour moins de douze à quatorze animaux par jour. On ne va pas chez l’éleveur juste pour rendre service. C’est une véritable opération éthique, mais qui répond aussi à des nécessités commerciales fortes. Il n’a pas été très dur de convaincre les éleveurs à ce système ; ce qui est le plus difficile, c’est le travail de programmation. Il faut demander à un éleveur qui abat une bête par semaine, soit environ soixante bêtes par an, s’il serait d’accord pour en abattre davantage dans les prochaines années, par exemple quatre-vingt-dix, quatre fois par an, et quinze bêtes à chaque fois. Cela suppose de le « travailler » pour l’amener à changer ses habitudes, sachant que les éleveurs qui produisent de la viande de qualité font souvent aussi de la vente directe. Du coup, s’il accepte de nous vendre la quantité voulue de viande, nous lui rendrons le service de tuer pour lui la vache qu’il va garder : c’est aussi un échange de bons procédés.
Nous avons rencontré de nombreux responsables d’abattoirs, parce que nous avons besoin d’être rassurés en ce qui concerne le traitement des déchets. De leur côté, les abattoirs qui n’abattent que trois ou quatre jours par semaine demandent à avoir davantage de travail. Aussi sont-ils très intéressés de pouvoir utiliser un camion. Construire leur propre camion, serait compliqué, mais se servir de l’abattoir à la ferme comme un travail complémentaire est possible.
M. le président Olivier Falorni. Combien coûte une telle infrastructure ?
M. Franck Ribière. Une unité, dans sa version finale, capable d’abattre six bêtes par heure et cinquante-cinq bêtes par jour, coûte 1,5 million d’euros.
M. Arnaud Viala. Au vu de votre connaissance du marché français et du nombre de bêtes à abattre chaque année en France, quelle part de ce marché pensez-vous qu’un tel système pourrait absorber à terme ?
Quel est le coût de l’abattage avec ce système par rapport à un abattage classique ? Est-il beaucoup plus élevé ?
Vous avez dit avoir visité beaucoup d’abattoirs. Que pensez-vous des conditions d’abattage en France par rapport aux autres pays ? Que pensez-vous de la différence qu’il peut y avoir entre les conditions d’abattage dans les abattoirs de petite taille et de proximité et les abattoirs industriels de grande taille, donc plus éloignés des élevages ?
M. Franck Ribière. Je résumerai le public que nous visons par cette formule : ce sont les 10 % de gens qui vont arrêter de consommer de la viande. Pour ces gens-là, le problème n’est pas de savoir si la viande est saine : ils en sont persuadés. Mais ils ne sont plus sûrs du tout qu’elle soit bonne. Ils ont intégré des données morales, sociétales, lies au bien-être animal qui leur posent désormais un vrai problème. Les informations qui nous ont été données par rapport à certaines études de marché montrent que ces gens-là représentent à peu près 10 % de la consommation de viande. De toute façon, la filière les a déjà perdus. Lors des avant-premières de mon premier film, j’ai rencontré beaucoup de gens qui m’ont dit qu’ils allaient peut-être se remettre à consommer de la viande après avoir regardé mon documentaire ; ils avaient arrêté d’en manger parce qu’ils n’avaient pas d’informations claires et nettes sur la viande et découvraient qu’il y avait enfin moyen de manger de la bonne viande. Car il n’y a aucune bonne raison de manger de la viande, si ce n’est pour en éprouver du plaisir. Se battre pour dire qu’il faut à toute force manger de la viande n’a pas beaucoup d’intérêt.
Pour être rentable, le coût d’abattage ne doit pas être supérieur à deux fois le coût d’abattage dans un abattoir fixe. C’est ce que les Suédois ont réussi à faire. En France, le coût d’abattage dans un abattoir fixe se situe autour de 0,40 euro le kilo. Après avoir commencé avec un coût d’abattage à 1,40 euro, les Suédois ont réussi à le ramener à 1 euro, puis à 0,80 euro. Ce coût est d’autant plus envisageable que nous nous engageons à payer la carcasse à un prix supérieur à celui du marché : entre 25 et 40 % plus cher qu’une carcasse bio. Ensuite, il est possible de négocier le prix de l’abattage des animaux que nous achetons, dans la mesure où, ne l’oublions pas, l’éleveur économise le coût du transport. Tout cela modifie beaucoup l’approche de l’éleveur.
Sur les conditions d’abattage en France par rapport aux autres pays et entre petits et grands abattoirs, je serai tenté de vous faire une réponse de Normand.
S’agissant de la différence entre les petits et grands abattoirs, je n’ai jamais vu quelque chose qui puisse me gêner : que vous soyez dans un abattoir Bigard ou dans un abattoir de proximité, le métier est exactement le même, et d’une certaine manière effectuée avec la même qualité. C’est au niveau de la relation avec les éleveurs qu’il y a une différence. Le petit abattoir de proximité ou l’abattoir moyen cherche avec l’éleveur à modifier et à améliorer l’approvisionnement en proposant des races différentes, des produits plus adaptés au marché local, tandis que la finalité dans les grandes entités est d’une autre nature : il faut bien que quelqu’un tue nos vaches laitières. Quand les végans nous demandent d’arrêter de manger de la viande, je leur réponds d’arrêter de boire du lait. Il faut être logique : dès lors que l’on élève des vaches laitières, on va forcément les manger… On ne va pas les jeter ! Le bon sens a disparu… Le travail effectué sur les vaches laitières est de qualité, mais son prix de vente ne peut pas être celui d’un produit sur lequel on aura imposé une charte éthique compliquée, sachant qu’il n’est pas évident de proposer une charte éthique après des labels, des appellations d’origine protégées (AOP), des Indications géographiques protégées (IGP), qui n’ont pas, dans l’absolu, rendu tout le monde heureux. Ce qui plaît aux éleveurs, c’est la cohérence de notre proposition.
Cela étant, nous proposons un produit alternatif, non un produit de remplacement. Je n’imagine pas l’abattage mobile comme une solution à l’abattage, mais comme un modèle supplémentaire qui peut résoudre beaucoup de problèmes dans les abattoirs en général. Une fois qu’il y aura 600 ou 800 camions d’abattage sur les routes, les problèmes de contrôle ne risquent-ils pas d’être les mêmes que dans les abattoirs fixes ? Y faudrait-il des référents et des caméras ? Je ne le sais pas. J’espère seulement que notre démarche est comprise et que le poids global que représentera notre bœuf éthique ne sera un frein pour personne. Nous ne cherchons pas à prendre des parts de marché à quelqu’un, seulement à apporter quelque chose à des gens qui, de toute façon, vont arrêter de manger de la viande.
M. William Dumas. Les photos ne montrent que l’abattage des bovins. Abattez-vous aussi des ovins et des porcs ?
M. Franck Ribière. Non.
M. le président Olivier Falorni. Rien ne l’empêche techniquement.
M. Franck Ribière. Non. Je dirai même que le camion peut être pour les ovins une solution extrêmement intéressante. Je parle des bovins car je considère que c’est l’aliment roi et qu’il mérite le camion. Mais les ovins et les porcins le méritent aussi. Cela dit, je n’ai pas vu d’abattoir mobile qui pratiquait l’abattage des porcins et des ovins.
Cela dit, je refuserai toujours d’abattre autre chose que du bœuf avant le bœuf. Je considère que le bœuf doit passer en premier. Or on le fait souvent passer en dernier alors que les autres animaux sont plus bruyants, plus énervés, plus stressants. Ajoutons à ce propos que le camion a l’avantage d’émettre un bruit très limité, à l’extérieur comme à l’intérieur, et d’évoluer dans une ambiance de ferme. On entend le coq, on voit d’autres animaux, bref, on est à la campagne. C’est sympathique.
M. William Dumas. Je vous ai posé cette question car nos abattoirs de proximité sont multi-espèces, c’est-à-dire qu’ils abattent des ovins, des caprins, etc. Si le fermier n’élève pas que des bovins, il ne pourra pas faire abattre ses ovins ou ses porcins dans votre abattoir mobile.
M. Franck Ribière. Il devra les faire abattre ailleurs.
M. William Dumas. Combien de personnes travaillent dans le camion ?
M. Franck Ribière. Cinq personnes, en comptant le vétérinaire.
M. William Dumas. Parlez-nous du recyclage des déchets.
M. Franck Ribière. En Suède, c’est une société extérieure mandatée, et qui fait partie de la programmation, qui s’en occupe : elle passe dans la ferme pour ramasser les déchets. Tous les déchets sont expurgés dans des bacs en dehors du camion : bacs à eau, bacs à sang, bacs à peaux, bacs à boyaux blancs et rouges – les rouges sont les boyaux utilisables. Les Suédois ont résolu le problème en n’utilisant ni les boyaux rouges ni les boyaux blancs. Ce n’est donc pas le camion proprement dit qui gère les déchets. Le camion est mis en place, nettoyé, et propre quand il repart. Mais tous les déchets générés ont été traités.
Ce n’est pas le déplacement, le logement des abatteurs la veille pour qu’ils soient en forme le lendemain matin pour abattre – il faut les loger à l’hôtel –, mais le traitement des déchets qui est le poste le plus coûteux du camion d’abattage. D’où l’intérêt que notre camion d’abattage soit associé à un abattoir fixe qui prendrait en charge la gestion des déchets, des abats, du stockage et de la découpe.
M. William Dumas. Les abattoirs de proximité sont souvent des circuits courts, la découpe étant comprise : le producteur amène sa bête vivante à l’abattoir et repart avec la viande rangée en cagettes.
M. Franck Ribière. Nous voudrions, dans un partenariat avec un abattoir fixe, ajouter les deux ou trois machines nécessaires à la commercialisation de nos produits. Mais ce sont des investissements que les abattoirs ne font pas parce que cela correspond à un marché qui n’existe pas encore en France et que nous sommes en train d’essayer de créer. Car notre idée n’est pas de vendre en carcasse ce que nous avons fabriqué, mais un produit prêt à consommer dont les informations nécessaires à sa cuisson sont diffusées. Le flash code fournit en effet des informations sur l’épaisseur de la viande, la température à laquelle elle doit être cuite si la cuisson se fait au four, etc. Il faut savoir que 40 % de la viande est bousillée à la cuisson…
M. William Dumas. Combien de temps faut-il pour installer le camion ?
M. Franck Ribière. Notre objectif est de réaliser le premier abattage en camion au mois de mai 2017. La procédure d’homologation est assez longue et la fabrication du camion demande un peu de temps.
Le camion sera français – je pense que nous allons travailler avec Renault – alors que les Suédois ont un camion américain. Notre camion aura de la gueule et un beau logo. Cela fera joli sur les routes…
M. William Dumas. Je ne pense pas que ce camion pourra emprunter certaines routes de nos Cévennes pour se rendre dans une ferme, même s’il y a la place nécessaire pour l’installer. Votre système semble idyllique, mais certaines fermes sont situées sur des terrains pentus, et les éleveurs ont du mal à y construire des bergeries.
M. Franck Ribière. Pour avoir tourné mes deux films dans beaucoup de fermes qui élèvent des bovins, j’ai constaté que le camion passait partout, même dans l’Aubrac où cela peut être compliqué. Cela dit, certains élevages ovins sont plus inaccessibles que d’autres. Il ne faut pas oublier que la taille du camion peut varier : tout à l’heure, j’ai dit que le camion pouvait traiter jusqu’à cinquante-cinq bêtes par jour, mais ce n’est pas forcément ce que nous recherchons. Nous sommes en train de nous demander s’il ne serait pas plus simple d’avoir deux camions qui traiteraient chacun trente bêtes, de façon à accélérer les rotations et pouvoir se déplacer plus facilement pour un plus petit nombre de bêtes.
Mme Françoise Dubois. À qui appartient cet abattoir mobile ?
M. Franck Ribière. À Mme Britt-Marie Stegs. C’est la même personne qui négocie, qui achète la bête à l’éleveur et vend la viande au consommateur.
Mme Françoise Dubois. C’est un gros investissement !
M. Franck Ribière. Effectivement. Le prix que paie le consommateur n’est pas le même que pour un produit classique. Il s’agit de s’adapter à cette nouvelle catégorie de consommateurs de viande, c’est-à-dire à ceux qui vont bientôt arrêter d’en manger ou qui veulent vraiment commencer à manger de la bonne viande, sans avoir pour autant à dépenser 80 ou 100 euros pour acheter de la viande japonaise.
Mme Françoise Dubois. Par qui sera géré l’abattoir mobile qui sera en France ?
M. Franck Ribière. Par notre société, Le Bœuf éthique.
Mme Françoise Dubois. Ce seront toujours les mêmes salariés qui circuleront dans le camion ?
M. Franck Ribière. Techniquement, oui, sous réserve de l’accord ou du partenariat que nous pourrions passer avec un abattoir existant. Dans ce cas-là, nous pourrions aussi utiliser les abatteurs de l’abattoir fixe. Les opérateurs auront besoin d’une petite formation, d’une revalorisation de leur travail car nous voulons dans notre camion une bande de passionnés qui a envie d’exercer ce métier.
Mme Françoise Dubois. Avez-vous beaucoup de candidats ?
M. Franck Ribière. Le même problème se pose pour les abattoirs fixes. Mais lorsque vous parlez d’abattage éthique à la ferme, dans un camion, qu’il faut voyager 250 jours par an, qu’il y a des indemnités de déplacement, un salaire revalorisé et une formation incluant des méthodes dans tous les domaines – commercial, marketing, découpe –, je pense que l’on peut attirer les gens. Ceux que j’ai rencontrés en Suède sont motivés. Lorsqu’ils sortent en ville le soir pour aller boire une bière, ils gardent leurs tee-shirts sur lequel est imprimée la marque et où figure la mention : « je suis un abatteur ». Ils en sont fiers.
Mme Françoise Dubois. Ça, ce sont les Suédois…
M. Franck Ribière. Certes. De surcroît, ils sont très impressionnants puisqu’ils mesurent tous quasiment deux mètres, femmes comprises. Parmi eux, il y a une abatteuse… C’est assez surprenant.
Mme Françoise Dubois. Ce sont des forces de la nature.
Qui délivrera une formation à ces futurs salariés ?
M. Franck Ribière. Nous avons acheté aux Suédois un savoir-faire qui inclut tous les éléments économiques, technologiques et techniques, y compris d’éducation pour les abatteurs et les conducteurs. Dans un premier temps, nous allons mandater deux ou trois personnes en Suède pour qu’elles reçoivent cette formation en anglais – Il n’y a pas beaucoup d’abatteurs qui parlent anglais. Nous allons chercher des communicants ; il peut s’agir de gens qui travaillent dans l’éducation nationale, dans des écoles et qui peuvent réexpliquer les données nouvelles du camion.
Cela étant, lorsqu’un abatteur d’un abattoir fixe regarde comment travaille son collègue qui est dans le camion, il comprend très vite ce qui est fait et ce qui peut être amélioré, il voit tout de suite quelles sont les conditions de travail. En général, tous ceux que nous avons emmenés sont prêts à signer. Il en est de même pour les vétérinaires : ils auront du mal à s’arrêter de travailler dans un camion.
M. le président Olivier Falorni. Avez-vous obtenu l’agrément sanitaire ?
M. Franck Ribière. Non, mais au vu des contacts que j’ai pu avoir à droite et à gauche, je pense que l’agrément sanitaire ne posera pas de problème, à moins que certaines décisions ne me dépassent. J’attends juste que soit réglé le problème de la présence du vétérinaire. C’est pour moi le dernier écueil.
Le Parlement suédois a voté l’agrément sanitaire à l’unanimité. Tout le monde était debout. L’abattage à la ferme était devenu pour les Suédois une nécessité impérative, car ils ne voulaient pas être le pays où l’on abat encore les animaux dans des conditions terribles. Ils en ont fait un enjeu politique fort. De toute façon, si ce n’est pas nous qui mettons en place ce système, il se fera tout de même. Personne ne luttera contre quelque chose qui, à mon avis, est inéluctable, au vu des conditions actuelles de la filière et de l’abattage. Tôt ou tard, le camion arrivera.
M. Jean-Yves Caullet, rapporteur. Je veux rebondir sur l’aspect strictement réglementaire, puisqu’en France ce sujet relève du domaine réglementaire. Où en êtes-vous de la démarche ?
M. Franck Ribière. Tant que nous n’avons pas arrêté le plan final, il est très difficile de commencer les démarches. Les techniciens travaillent dessus.
M. le rapporteur. Sur le plan administratif, vous allez vous présenter comme un investisseur dans un outil d’abattage qui demande un agrément sanitaire. Le fait qu’il soit sur roues n’est qu’une particularité intéressante et importante pour le modèle économique et éthique que vous défendez : l’administration devrait regarder comment sont respectées les différentes contraintes réglementaires dans l’outil.
M. Franck Ribière. Si nous nous associons à un abattoir qui a déjà un agrément sanitaire, je pense que nous n’avons pas besoin de le demander pour le camion.
M. le rapporteur. N’étant pas le représentant de l’administration, il m’est difficile de vous répondre. De toute façon, l’outil doit être agréé. Ce que je retiens, c’est que vous ne l’avez pas encore demandé.
M. Franck Ribière. Non. Sinon, vous le sauriez.
M. le rapporteur. Nous avons reçu ici des personnes qui revendiquent aussi l’abattage la ferme, mais dans des conditions assez différentes de celles que vous envisagez, et qui se situent de façon volontaire en dehors de la norme sanitaire. Ne pensez-vous pas qu’il serait important d’établir une distinction entre l’abattage à la ferme, qui a un caractère un peu improvisé, et l’abattoir à la ferme qui consiste à amener à la ferme un outil professionnel ?
M. Franck Ribière. Il pourrait être intéressant de faire la différence, car nous nous rapprochons tous les deux du même principe. Je suppose que vous faites référence à Jocelyne Porcher qui a été auditionnée par votre commission. Mais quel serait l’impact pour le consommateur ? Cela serait-il réservé à la vente directe ?
M. le rapporteur. En France, l’abattage à la ferme fait référence à une pratique agricole traditionnelle : l’éleveur avait l’habitude de tuer un cochon ou un veau de temps en temps pour sa propre consommation. Nous ne sommes pas du tout dans le même registre…
M. Franck Ribière. Ce n’est pas pareil
M. le rapporteur. Vous ne proposez pas du tout la même chose puisqu’il s’agit de commercialiser de la viande, avec les garanties qui s’y rattachent, et même davantage de garanties que la filière classique, puisque vous recherchez un caractère éthique.
M. Franck Ribière. Tout à fait.
M. le rapporteur. Vous faites la démonstration qu’il est techniquement possible d’abattre des animaux dans des conditions identiques à celles qui existent dans un abattoir fixe, même s’il reste quelques interrogations, comme le traitement des eaux. Mais ce genre de question peut se résoudre puisqu’on peut très bien prévoir des bacs de rétention, conclure un marché avec un vidangeur. Sans oublier les équarrisseurs, qui pourraient se charger du cinquième quartier.
M. Franck Ribière. Exactement.
M. le rapporteur. Nous avons vu que beaucoup de petits outils de proximité ont un problème de point mort économique, qui est fonction du tonnage. Pour les collectivités qui portent en général ce genre d’outil, le coût fixe d’une installation est parfois bien supérieur à ce que pourrait représenter celui d’un camion qui viendrait un jour ici et un autre jour ailleurs.
M. Franck Ribière. C’est là tout l’intérêt d’un travail en amont. Nous partons du principe que nous pouvons vraiment améliorer la qualité de la viande en France. On doit expliquer aux éleveurs qu’ils seront davantage rémunérés, et que l’on fera gagner de l’argent à tout le monde, mais que les règles économiques s’appliqueront, que le camion ne se déplacera pas pour le plaisir et pour abattre seulement trois animaux virgule quatre… Les éleveurs devront nous proposer des dates d’abattage susceptibles d’être rentables, faute de quoi nous ne viendrons pas : nous ne le pourrons pas. D’où la différence avec l’abattage à la ferme. Mais il faut savoir que le concept que nous proposons est très vite rentable. Il faut juste changer les mentalités et les méthodes, organiser une programmation annuelle plus intelligente.
Les Suédois ont cette qualité de savoir fort bien mélanger l’aspect folklorique et écologique tout en restant des business men. Ils ont clairement créé une machine pour faire de l’argent, à tous les niveaux de la chaîne : ils achètent plus cher, qu’ils donnent plus d’argent aux éleveurs, ils ont dégagé tous les intermédiaires – il n’y a plus de maquignons –, et au final, ils vendent plus cher que le marché une viande de qualité.
M. William Dumas. Vous avez dit payer l’éleveur entre 25 et 40 % plus cher…
M. Franck Ribière. Non, c’est le prix de vente qui sera de 25 à 40 % plus élevé que le bio, grâce à la réduction de certains coûts. Nous essayons d’être dans un business model qui donnerait 1 euro de plus au kilo à l’éleveur. Et cela change tout.
Le prix mis en avant par tout le monde correspond à un certain type de viande. Dans notre démarche, la problématique du prix de la viande n’est pas la même. Soucieux de rester éthiques et équitables jusqu’au bout, notre idée est de faire en sorte qu’une famille qui veut se nourrir de viande et se faire plaisir puisse le faire au lieu d’en acheter un peu plus, mais de moins bonne qualité, chaque semaine. C’est le calcul que tout le monde fait aujourd’hui. La meilleure chose qui arrive à la viande, ce sont les végétariens : plus il y a de végétariens, meilleure sera la viande…
M. le président Olivier Falorni. Ce sera la conclusion de cette audition, mais aussi du travail de la commission d’enquête puisque vous étiez la dernière personne à être auditionnée. Cette phrase entrera dans l’histoire, mais je n’imaginais pas qu’elle devienne la conclusion de cette commission d’enquête… Je ne suis pas sûr qu’elle soit reprise dans notre rapport !
En tout cas, je tenais à vous remercier pour cette présentation éclairante qui nous a permis de connaître un peu mieux quelque chose dont on entendait beaucoup parler, l’abattage à la ferme suscitant plus de controverses que l’abattoir à la ferme pour les raisons exposées par le rapporteur. Votre audition nous a permis de mieux comprendre le système. Sachez que ce sera un des points abordés dans le rapport de notre commission d’enquête parlementaire. Nous allons maintenant nous atteler à sa rédaction : il sera présenté début septembre.
La séance est levée à dix-sept heures quarante-cinq.
——fpfp——
(1) La relation mère-jeune chez les bovins : influences de l'environnement social et de la race – Pierre Le Neindre – thèse d'État, 1984.
© Assemblée nationale