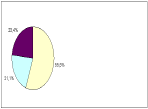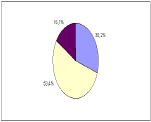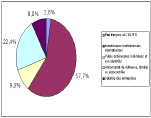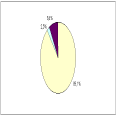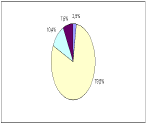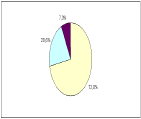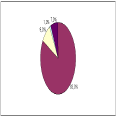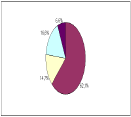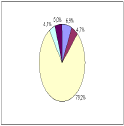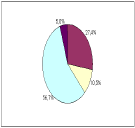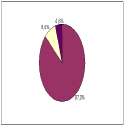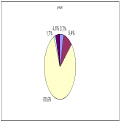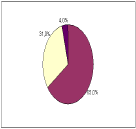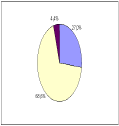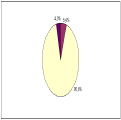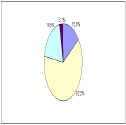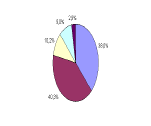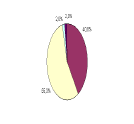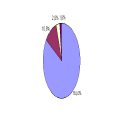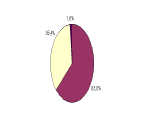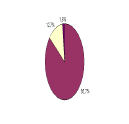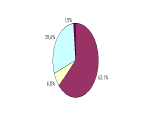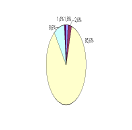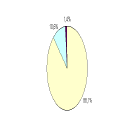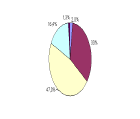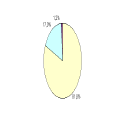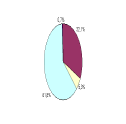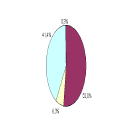![]()
N° 737
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 février 2013.
RAPPORT D’INFORMATION
déposé
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
en conclusion des travaux d’une mission d’information (1)
sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises,
ET PRÉSENTÉ
PAR MM. Jean-Michel CLÉMENT et Philippe HOUILLON,
Députés.
——
La mission d’information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises est composée de :
M. Jean-Michel Clément, président-rapporteur ; M. Philippe Houillon, vice-président et co-rapporteur ; Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Sergio Coronado, Marc Dolez, Philippe Doucet, Édouard Fritch, Yves Goasdoue, Bernard Gérard, Mmes Marietta Karamanli, Anne-Yvonne Le Dain, M. Alain Tourret, Mmes Cécile Untermaier, Marie-Jo Zimmermann.
AVANT-PROPOS 7
INTRODUCTION 9
I. – POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE LA LOI ET LES CODES DE GOUVERNANCE 12
A. L’ARTICULATION ENTRE LA LOI ET LES CODES DE GOUVERNANCE 13
1. Instaurer, par la loi, une obligation de se référer à un code de gouvernance 13
a) Le modèle britannique 14
b) Un large consensus au niveau national 15
2. Fixer, dans la loi, une liste non exhaustive des questions devant être abordées par les codes de gouvernance 16
3. Sanctionner la violation de l’obligation de se référer à un code de gouvernance 17
B. DES PROCÉDURES D’ÉLABORATION ET DE CONTRÔLE PLUS OUVERTES ET PLUS STRICTES 19
1. Conforter une autorégulation critiquée dans sa légitimité et dépourvue d’instruments de contrôle efficients 19
2. Établir des codes de gouvernance associant plus largement toutes les parties prenantes de l’entreprise 22
a) Pour les entreprises cotées 22
b) Pour les entreprises non cotées 26
II. – POUR UNE GOUVERNANCE STABLE ET OUVERTE AUX DIVERSES PARTIES PRENANTES DE L’ENTREPRISE 28
A. STABILISER L’ACTIONNARIAT 31
1. Élaborer un code de bonnes pratiques à l’attention des investisseurs 32
2. Fidéliser l’actionnariat en octroyant plus de pouvoirs et d’avantages aux actionnaires de long terme 36
a) Le constat, largement partagé au niveau national et international, d’une nécessaire stabilisation de l’actionnariat 36
b) Faciliter l’attribution de droits de vote doubles aux actionnaires de long terme 38
c) Moduler la taxation des plus-values sur les cessions de titres de capital en prenant mieux en compte la durée de détention des titres cédés 39
3. Mieux impliquer et mieux connaître les actionnaires 41
a) Mieux impliquer les actionnaires dans la vie de l’entreprise 41
b) Contraindre en contrepartie les actionnaires à mieux se faire connaître de l’entreprise 48
B. FAIRE DES SALARIÉS DES ACTEURS À PART ENTIÈRE DE LA GOUVERNANCE DES GRANDES ENTREPRISES 51
1. Mieux associer les salariés au processus décisionnel pour rendre les entreprises plus compétitives 52
a) Remédier à une trop faible représentation des salariés au sein des conseils d’administration 52
b) Rendre les relations du travail plus productives en associant plus étroitement les salariés au processus décisionnel 54
2. Favoriser un dialogue social plus fructueux pour des entreprises appréciant mieux les enjeux et les risques 59
a) Contribuer au développement d’une véritable culture de l’échange 60
b) Organiser le dialogue social pour anticiper et traiter les difficultés des entreprises 66
C. MIEUX REPRÉSENTER LES FEMMES ET LES PERSONNES ISSUES DE LA DIVERSITÉ 71
1. Faire de la parité une réalité dans tous les organes dirigeants des grandes entreprises 72
a) Prendre la juste mesure et dépasser les premiers objectifs atteints 73
b) Encourager l’ascension des femmes à des postes dirigeants 75
2. Faire de la diversité l’un des indices d’une gouvernance de qualité 78
III. – POUR UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE AU SERVICE DE STRATÉGIES DE LONG TERME 81
A. ENCADRER PLUS STRICTEMENT LE CUMUL DES MANDATS SOCIAUX 83
1. Renforcer un cadre légal formellement bien respecté mais n’empêchant pas des situations problématiques 83
2. Dissiper toute incertitude sur la disponibilité et l’indépendance des administrateurs 86
B. RENDRE LES DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX PLUS RESPONSABLES 89
1. Instaurer une action de groupe permettant aux actionnaires d’engager plus facilement la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux 89
a) Les lacunes de l’actuel régime de mise en cause de la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux 89
b) Une solution : la consécration d’une action de groupe étendue au droit économique et financier 92
2. Rendre plus effective et plus personnelle la sanction pécuniaire encourue par les dirigeants-mandataires sociaux responsables de fautes de gestion 96
C. ATTRIBUER AUX DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX DES RÉMUNÉRATIONS ALLIANT L’ÉTHIQUE À LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 97
1. Instaurer par la loi un vote des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux 99
a) Faire voter les actionnaires sur la politique de rémunération et sur les montants des rémunérations versées à chacun des dirigeants-mandataires sociaux 99
b) Accorder plus de poids aux critères de performance extra-financiers et de long terme dans les rémunérations globales des dirigeants-mandataires sociaux 105
2. Préférer l’outil de la fiscalité au plafonnement des rémunérations 107
a) Privilégier une réforme de la fiscalité portant sur l’ensemble des hauts revenus à un plafonnement des rémunérations des seuls dirigeants-mandataires sociaux 107
b) Abaisser le plafond de la partie des rémunérations versées aux dirigeants-mandataires sociaux qui est déductible de l’impôt sur les sociétés 109
3. Inciter à une utilisation plus raisonnée et pertinente des « stock-options » et des actions gratuites 111
a) Encadrer des modes de rémunérations variables toujours porteurs de dérives 111
b) Faire des « stock-options » et des attributions d’actions gratuites des éléments de rémunération plus propices à la performance de long terme 113
4. Interdire les rémunérations sous forme de « retraites-chapeau » 118
5. Interdire le versement d’indemnités de départ en cas de départ volontaire du dirigeant-mandataire social 121
6. Subordonner le versement des jetons de présence à une participation effective aux séances des conseils d’administration 123
CONCLUSION 126
EXAMEN EN COMMISSION 127
LISTE DES PROPOSITIONS 135
ANNEXE N° 1 : LES CODES DE GOUVERNANCE « AFEP-MEDEF » ET « MIDDLENEXT ». 141
ANNEXE N° 2 : LE CODE BRITANNIQUE DE BONNE CONDUITE DES INVESTISSEURS (« UK STEWARDSHIP CODE ») 142
ANNEXE N° 3 : « STOCK-OPTIONS » ET ACTIONS GRATUITES 143
ANNEXE N° 4 : LES STRUCTURES DE GOUVERNANCE 144
ANNEXE N° 5 : LES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS 146
ANNEXE N° 6 : PARITÉ ET DIVERSITÉ DANS LES ORGANES DIRIGEANTS DES GRANDES ENTREPRISES 147
ANNEXE N° 7 : L’ACTIONNARIAT SALARIÉ 150
ANNEXE N° 8 : LA STRUCTURE DES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX (MS) 152
ANNEXE N° 9 : ÉLÉMENTS DE CALCUL DES « RETRAITES CHAPEAU » 153
ANNEXE N° 10 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES INDEMNITÉS DE DÉPART DES DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX 154
ANNEXE N° 11 : MONTANTS DES JETONS DE PRÉSENCE DES DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX 156
PERSONNES ENTENDUES PAR LA MISSION D’INFORMATION 157
MESDAMES, MESSIEURS,
Il n’est pas courant que le président de la commission des Lois juge nécessaire de consacrer un avant-propos à un rapport d’information présenté par des membres de cette même commission. Ce travail leur appartient. Il représente des dizaines d’heures d’audition, de rencontres avec des spécialistes de ces questions, de nombreuses réunions pour aboutir à ce rapport consacré à la transparence de la gouvernance des grandes entreprises.
Cet avant-propos est né du souci de rendre justice à Corinne Narassiguin, présidente et rapporteure de cette mission d’information, députée de la 1ère circonscription (Amérique du Nord) des Français établis hors de France ; elle a été frappée par une décision du Conseil constitutionnel en date du 15 février 2013 qui, de manière très sévère, a non seulement annulé son élection mais l’a également déclarée inéligible pour une année. J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet dans d’autres enceintes. Il faudra rapidement clarifier les conditions dans lesquelles les candidats aux élections législatives hors de France peuvent faire campagne. Les incertitudes du droit ont des conséquences trop graves en la matière.
C’est à l’initiative de Corinne Narassiguin que cette mission d’information a été créée le 18 juillet 2012, dans les tout premiers jours qui ont suivi le début de la XIVe législature. Députée nouvellement élue, enthousiaste et habitée par la volonté d’exercer pleinement son mandat, elle a su immédiatement conduire les travaux de cette mission, tirant parti de sa parfaite connaissance du monde de l’entreprise mais aussi des règles et pratiques observées dans le monde anglo-saxon.
Ce rapport est évidemment le fruit de ce travail approfondi et rigoureux mené par Corinne Narassiguin avec Philippe Houillon, vice-président et co-rapporteur de cette mission. Adopté le 12 février dernier par la mission d’information, le présent rapport est ainsi le résultat d’une convergence de vues sur les constats et les remèdes à apporter à la gouvernance des grandes entreprises afin d’en assurer la transparence.
Entre l’adoption du rapport par la mission et son examen par la commission des Lois le 20 février 2013, la mission d’information a désigné Jean-Michel Clément pour succéder à Corinne Narassiguin en qualité de rapporteur. Vice-président de cette mission, il avait également pris une part très active aux travaux menés ainsi pendant six mois.
Il n’en demeure pas moins que, même si le nom de Corinne Narassiguin ne pourra figurer sur la couverture de ce document à côté de celui de Philippe Houillon, le présent rapport lui appartient en propre. Il fallait que ce soit dit.
Jean-Jacques Urvoas
Président de la commission des Lois
Les difficultés économiques et financières que presque tous les pays du globe traversent aujourd’hui ont mis en exergue l’impérieuse nécessité de lutter contre l’opacité des « mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants [d’entreprises], autrement dit qui gouvernent leur conduite » (2) et qui constituent ce que l’on appelle donc la « gouvernance ».
La transparence des processus décisionnels à l’œuvre au sein des grandes entreprises a été au cœur des réflexions de la mission d’information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises, créée par la commission des Lois le 18 juillet 2012. Cette mission s’est en particulier interrogée sur la clarté, la précision et l’exhaustivité des informations ayant trait non seulement aux rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux (3), mais aussi à la composition et au mode de fonctionnement des organes dirigeants ainsi qu’à la définition et à la lisibilité de la stratégie des entreprises à moyen et long termes.
Des scandales retentissants, provoqués par des rémunérations excessives, ont émaillé les deux dernières décennies. La légitime indignation face à ces comportements aussi abusifs que marginaux ne doit pas conduire à aborder les questions relatives à la gouvernance des grandes entreprises sous un angle exclusivement moral.
Il y a en effet un intérêt non seulement d’équité et de justice sociale, mais aussi et surtout d’efficacité économique à corriger des rémunérations dont le caractère excessif est souvent le symptôme le plus manifeste de défaillances affectant en profondeur les processus décisionnels des grandes entreprises.
C’est donc dans une optique alliant préoccupations éthiques et souci de la performance économique sur les moyen et long termes que la mission a mené ses réflexions.
Pour délimiter le champ de ses travaux, la mission s’est appuyée sur la définition de la notion de « grandes entreprises » proposée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (4), sans s’interdire pour autant d’étendre le périmètre de certaines de ses propositions à un ensemble plus vaste d’entreprises. En effet, il est possible de définir la catégorie des grandes entreprises d’une façon plus large que ne le fait l’INSEE, en s’inspirant notamment de critères boursiers tels que leur segment d’appartenance au sein du marché réglementé (5) ou leur indice de capitalisation boursière (6).
Pour mener à bien ses travaux, la mission a choisi d’entendre, dans le cadre de tables rondes ou d’auditions individuelles ouvertes à la presse, différentes catégories d’acteurs concernés par les questions de gouvernance des grandes entreprises : organisations d’employeurs, représentants des syndicats de salariés, représentants des administrations françaises et européennes, des investisseurs, des dirigeants-mandataires sociaux, des cabinets de conseil en politique de vote, etc. La mission a également adressé aux magistrats de liaison et aux services économiques d’un certain nombre de nos ambassades des questionnaires susceptibles de lui apporter un éclairage sur les règles et pratiques de gouvernance d’entreprise dans d’autres pays et continents. Elle regrette qu’aucune réponse n’ait été apportée à ces questionnaires en temps utile. Le déplacement effectué par une délégation de la mission à Londres, le 12 novembre 2012, a toutefois permis de recueillir de précieuses informations quant à l’approche qui est celle de notre voisin britannique sur ces enjeux.
De ces nombreux échanges, la mission a dégagé des pistes de réflexion ainsi que des propositions concrètes et opérationnelles pour assurer un meilleur équilibre entre la loi et les codes de gouvernement d’entreprise ou « codes de gouvernance » (7), pour favoriser la mise en œuvre d’une gouvernance stable et ouverte aux diverses parties prenantes de l’entreprise, et enfin pour mettre une gouvernance plus responsable au service de stratégies de long terme.
I. – POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE LA LOI ET LES CODES DE GOUVERNANCE
En l’état du droit, le fait de se référer à un code de gouvernance n’est qu’une faculté pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Pour les sociétés anonymes qui sont dotées d’un conseil d’administration (sociétés dites « à gouvernance moniste ») et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’article L. 225-37, alinéa 7, du code de commerce dispose que lorsqu’une de ces sociétés « se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport [du président du conseil d’administration] précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été ». Le texte ajoute que « si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d’entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise ».
Pour les sociétés anonymes qui sont dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance (sociétés dites « à gouvernance dualiste ») et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’article L. 225-68, alinéa 8, du code de commerce, reprend les dispositions précédemment énoncées, étant précisé que les explications à fournir doivent alors figurer dans le rapport du président du conseil de surveillance.
Aux termes de la loi, les sociétés cotées sur un marché réglementé ont donc une faculté de se référer à un code de gouvernance, mais, le cas échéant, une obligation d’expliquer pourquoi elles ne le font pas, et si elles ont choisi de se référer à un code de gouvernance, elles ont alors une obligation d’expliquer pourquoi elles n’en appliquent pas certaines recommandations. Il s’agit là de l’adaptation, en droit français, du principe « appliquer ou s’expliquer » (« comply or explain ») issu du droit anglo-saxon.
Deux codes de gouvernance ont été élaborés par les organisations représentatives des entreprises : l’un est connu sous le nom de « code AFEP-MEDEF », car il a été élaboré par l’Association française des entreprises privées (AFEP) et par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; l’autre est appelé « code Middlenext », du nom de l’association « Middlenext » qui l’élabore et qui, depuis 1987, fédère et représente, tous secteurs d’activités confondus, les valeurs moyennes et petites (ou « VaMPs »), dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros et qui sont cotées sur les compartiments B et C du marché réglementé Eurolist ou sur le système multilatéral de négociation organisé (« SMNO ») Alternext (8).
Tout au long des travaux de la mission, s’est imposé le constat que l’auto-régulation avait montré ses limites. Il est vrai qu’elle a l’avantage de permettre de définir un corpus de règles identiques dans différents États, ce qui facilite l’action des entreprises multinationales implantées dans plusieurs États dont certains n’imposent pas de règles en matière de gouvernance, tandis que ceux qui en définissent ne s’harmonisent pas nécessairement entre eux. Il est également vrai que l’auto-régulation a l’avantage de permettre d’adapter les règles aux spécificités des entreprises (en termes de taille notamment) et de faire évoluer facilement ces règles.
Toutefois l’actuelle crise économique et financière et les récents scandales provoqués par des rémunérations excessives voire irréalistes ont montré que le législateur ne pouvait pas donner un blanc-seing à l’auto-régulation. La Commission européenne, dans son Livre vert sur le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union européenne, a d’ailleurs constaté que « la qualité informative des explications publiées par les entreprises qui dérogent aux recommandations formulées dans leur code de gouvernance d’entreprise n’est, dans la plupart des cas, pas satisfaisante » et que, « dans un grand nombre d’États membres, le respect de ces codes est insuffisamment contrôlé » (9). Plus récemment, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a déploré une certaine « standardisation » des justifications qui sont apportées par les sociétés cotées sur les changements de structure de leur gouvernance, en application du principe « appliquer ou s’expliquer » : le gendarme boursier a estimé « qu’elles devraient être plus précises et adaptées à la situation particulière de la société » (10).
A. L’ARTICULATION ENTRE LA LOI ET LES CODES DE GOUVERNANCE
1. Instaurer, par la loi, une obligation de se référer à un code de gouvernance
Alors que les sociétés cotées au Royaume-Uni ont l’obligation de se référer à un code de gouvernance, les sociétés cotées en France n’ont qu’une faculté de s’y référer, situation qu’il convient de faire évoluer au regard du large consensus qui s’est dégagé sur cette question au cours des auditions de la mission.
Au Royaume-Uni, les sociétés commerciales qui offrent leurs titres financiers au public (« public companies ») et qui sont cotées à la bourse de Londres (« London Stock Exchange ») ont l’obligation de se référer à un code de gouvernance et, le cas échéant, d’expliquer pourquoi elles n’en appliquent pas certaines recommandations, en vertu de règles de cotation (« Listing rules ») qui constituent l’équivalent du Règlement général de notre Autorité des marchés financiers (AMF).
En effet, les articles 9.8.6 R et 9.8.7 R des règles de cotation prévoient que les sociétés immatriculées au Royaume-Uni ou à l’étranger qui font l’objet d’une cotation dite « premium », c’est-à-dire les sociétés commerciales et les fonds d’investissement de type ouvert ou fermé (11), doivent indiquer dans leur rapport annuel comment elles ont appliqué les grands principes contenus dans le code de gouvernance de la place londonienne (« UK Corporate Governance Code »). Et si elles y ont dérogé pendant tout ou partie de leur exercice comptable, elles doivent indiquer les recommandations précises qui n’ont pas été appliquées, la période pendant laquelle les recommandations n’ont pas été respectées ainsi que les raisons pour lesquelles ces recommandations ont été écartées.
Ce code de gouvernance de place est élaboré et régulièrement actualisé par une autorité de reporting financier (« Financial Reporting Council » ou « FRC »).
Le processus d’élaboration et d’actualisation
du code de gouvernance au Royaume-Uni
Le Financial Reporting Council (FRC) élabore et actualise le code de gouvernance des entreprises qui émettent des instruments financiers sur les marchés de la bourse de Londres. À cette fin, le FRC consulte au préalable l’ensemble des parties prenantes parmi lesquelles les entreprises.
Au terme de ces consultations, ce sont les services du FRC qui proposent une rédaction des règles de bonne pratique, rédaction soumise à l’approbation du conseil d’administration du FRC, instance formée de professionnels ayant exercé des responsabilités éminentes au sein d’entreprises cotées, d’institutions financières, d’organismes de régulation publics. Seuls le président et le vice-président du conseil d’administration du FRC sont nommés par le Gouvernement. Les entreprises n’y nomment pas de représentants en tant que tels.
Le FRC procède à l’actualisation du code de gouvernance à une fréquence qui ne peut être inférieure à deux ans. Il publie chaque année un rapport établissant le bilan de l’exercice de sa mission.
Ce code énonce un certain nombre de principes et de règles de bonne conduite que les entreprises auxquelles il est destiné doivent respecter, à défaut de quoi elles sont tenues de fournir une explication pertinente pour justifier leurs éventuels manquements. L’interprétation britannique du principe « appliquer ou s’expliquer » (« comply or explain ») tend à devenir de plus en plus exigeante. Lors de son déplacement à Londres, le 12 novembre 2012, votre mission a appris du rédacteur du code de gouvernance britannique, M. Chris Hodge, que le FRC avait, il y a quelques mois, décidé de durcir les règles relatives au contenu des explications à fournir en cas de manquement aux règles du code de gouvernance : les entreprises doivent désormais indiquer un motif clair, précis et circonstancié pour justifier leurs dérogations au code de gouvernance et mentionner si ces dérogations ont vocation à être temporaires ou pérennes.
La mission estime que l’exemple britannique devrait inspirer l’instauration d’une obligation légale, pour les grandes entreprises, qu’elles soient cotées ou non, de se référer à un code de gouvernance – idée qui semble faire l’objet d’un large consensus parmi les personnes entendues.
b) Un large consensus au niveau national
La quasi-totalité des personnes entendues par la mission se sont prononcées en faveur de l’instauration d’une obligation légale, pour les grandes entreprises, de se référer à un code de gouvernance.
Ainsi, du côté des émetteurs, M. Robert Leblanc, président national du Mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC), s’est déclaré favorable à la création d’une telle obligation. Du côté des investisseurs, tant M. Paul-Henri de la Porte du Theil, président de l’Association française de la gestion financière (AFG), que M. Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis Asset Management, ou M. Louis Godron, président l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) ont accueilli positivement l’instauration, par la loi, d’une obligation pour les grandes entreprises de se référer à un code de gouvernance.
Au regard d’une telle convergence de vues, la mission estime opportun d’introduire dans le code de commerce une obligation de se référer à un code de gouvernance.
Pour appliquer cette obligation aussi bien aux sociétés anonymes qui sont cotées sur un marché réglementé, qu’aux sociétés qui, bien que non cotées, n’en sont pas moins des grandes entreprises, il conviendrait de modifier le septième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce et le huitième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, de façon à ce qu’ils prévoient désormais que « les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État se réfèrent à un code de gouvernement d’entreprise ». S’inspirant du dispositif retenu en matière de reporting social et environnemental dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ce décret en Conseil d’État devrait délimiter le champ des grandes entreprises non cotées assujetties à l’obligation de se référer à un code de gouvernance en fixant ces seuils à 100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.
2. Fixer, dans la loi, une liste non exhaustive des questions devant être abordées par les codes de gouvernance
La mission juge par ailleurs utile que la loi énonce, de façon non limitative, les principales matières que devront traiter les codes de gouvernance.
Il est vrai que certaines des personnes entendues ont vanté la complétude des codes de gouvernance existants. Mais dans son rapport pour l’année 2012 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, l’AMF a constaté la mise en place, en 2011, de dispositifs de rémunération des dirigeants-mandataires sociaux non encadrés par les dispositions du « code AFEP-MEDEF » (régimes de retraite, indemnités diverses…) (12). Par ailleurs, ces codes n’intègrent pas assez la dimension sociale, sociétale et environnementale de l’entreprise. L’AMF a par conséquent invité les associations professionnelles à faire évoluer leur code afin d’encadrer les rémunérations et avantages non visés spécifiquement par une recommandation (13).
La mission a pris note de ce que l’AFEP et le MEDEF se sont récemment engagés à réviser leur code cette année (14). Néanmoins, la mission estime que c’est au législateur qu’il revient de guider les organismes chargés de la rédaction des codes de gouvernance en énonçant, de façon non exhaustive, les questions qui devraient faire l’objet de recommandations, à savoir :
– l’organisation de la gouvernance des entreprises : cumul et durée des mandats sociaux, critères d’indépendance des administrateurs, rythme et évaluation des travaux des conseils d’administration ou de surveillance, déontologie des administrateurs, dissociation ou non des fonctions de président et de directeur général dans les sociétés à gouvernance moniste, désignation (le cas échéant) d’un administrateur référent, création et composition des comités des risques et des rémunérations ;
– les relations des organes dirigeants des entreprises non seulement avec les actionnaires, mais aussi avec les parties prenantes que sont les collectivités publiques, les fournisseurs et les sous-traitants ;
– la façon dont les organes dirigeants des entreprises prennent en compte, dans le cadre de la RSE, les exigences de mixité, de lutte contre les discriminations, de promotion des diversités et de promotion du développement durable, etc. ;
– les modalités de détermination et les conditions de versement de l’ensemble des éléments de la rémunération globale des dirigeants-mandataires sociaux, qu’il s’agisse des composantes de la rémunération totale (rémunération fixe, rémunération variable, notamment sous forme de bonus annuels ou pluriannuels, rémunérations exceptionnelles, notamment en espèces ou sous forme d’indemnités de bienvenue, de départ ou de non-concurrence, jetons de présence, avantages de toute nature), des rémunérations différées sous forme de titres de capital (actions gratuites – dites « actions de performance ») ou encore des rémunérations sous forme de régimes de retraite ;
– les contours de la politique salariale et de l’échelle des rémunérations.
Cette énumération pourrait être complétée par un certain nombre de recommandations dont, au fil du présent rapport, la mission préconise l’inscription dans des codes de gouvernance.
3. Sanctionner la violation de l’obligation de se référer à un code de gouvernance
Dès lors que la référence à un code de gouvernance deviendrait une obligation pour les grandes entreprises, il conviendrait d’assortir les éventuels manquements à cette obligation de sanctions dissuasives et efficaces.
Afin de définir ces sanctions, la mission propose de s’inspirer des pouvoirs d’injonction et de sanctions administrative, disciplinaire et pécuniaire dont dispose aujourd’hui l’AMF.
En application de l’article L. 621-18 et du I de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, l’AMF dispose d’un pouvoir d’injonction directe. Le II du même article L. 621-14 reconnaît en outre au président de l’AMF un pouvoir d’injonction indirecte lui permettant de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris pour ordonner, en la forme des référés et, le cas échéant, sous astreinte, qu’il soit mis fin à une pratique irrégulière ou à ses effets.
Pour ce qui concerne les sociétés cotées à l’égard desquelles l’AMF est compétente, il serait donc tout à fait concevable de confier à celle-ci le pouvoir d’enjoindre aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de se conformer à l’obligation qui leur serait faite de se référer à un code de gouvernement d’entreprise. Il pourrait s’agir d’un pouvoir d’injonction indirecte : il reviendrait alors au président de l’AMF de saisir le président du tribunal de commerce de Paris pour qu’il statue en référé et ordonne, le cas échéant sous astreinte (versée au Trésor public), que la société se conforme à son obligation.
Pour ce qui concerne les sociétés non cotées, ce pouvoir d’injonction pourrait être confié au président du tribunal de commerce compétent, à savoir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège social de l’entreprise. Saisi par le ministère public ou par toute personne intéressée, ce magistrat pourrait enjoindre à l’entreprise contrevenante de se conformer à son obligation de se référer à un code de gouvernance, le cas échéant sous astreinte (versée au Trésor public).
La menace de l’injonction pouvant être regardée comme insuffisamment dissuasive, la mission n’exclut pas que la violation de l’obligation de se référer à un code de gouvernance puisse faire l’objet de sanctions pécuniaires. Le président du tribunal de commerce de Paris (pour les sociétés cotées sur un marché réglementé) ou le président du tribunal de commerce compétent (pour les sociétés non cotés) pourrait prononcer une sanction pécuniaire, par exemple sous forme d’amende civile, soit immédiatement soit en cas d’inexécution d’une injonction de se conformer à l’obligation de se référer à un code de gouvernance. Cette décision serait susceptible de recours, portés devant la cour d’appel de Paris ou devant la cour d’appel compétente.
Un dispositif analogue pourrait être envisagé pour sanctionner non plus la violation de l’obligation de se référer à un code de gouvernance, mais l’incapacité des entreprises à expliquer de façon exacte, précise, sincère et circonstanciée les dérogations qu’elles feraient aux recommandations du code de gouvernance auquel elles se référeraient.
Dans ce cas, des pouvoirs d’injonction (le cas échéant sous astreinte) et de sanction pécuniaire devraient être reconnus à l’autorité chargée de contrôler la bonne application du code de gouvernance. S’il ne s’agit pas de l’autorité judiciaire, le montant de ces sanctions pécuniaires devrait être plafonné : les règles de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, qui plafonnent les sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées par l’AMF, peuvent inspirer les plafonds qui pourraient être prévus pour les sanctions de la violation de l’obligation de se référer à un code de gouvernance.
Pour les sociétés cotées, l’intervention de l’AMF s’impose avec une certaine évidence, dans la mesure où, en introduisant dans le code monétaire et financier, l’article L. 621-18-3, le législateur l’a d’ores et déjà investie de la mission d’établir chaque année un rapport portant sur le gouvernement d’entreprise, la rémunération des dirigeants et le contrôle interne, sur la base des informations publiées par les personnes morales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et ayant leur siège statutaire en France.
En revanche, pour les sociétés non cotées, pour lesquelles il n’existe pas, aujourd’hui, de code de gouvernance de référence, il convient de concevoir un dispositif nouveau et d’identifier les acteurs pouvant être chargés d’élaborer et d’actualiser le(s) code(s) de gouvernance ainsi que d’en contrôler le respect.
Proposition n° 1 : instaurer, par la loi, une obligation de se référer à un code de gouvernance pour les grandes entreprises cotées et pour les grandes entreprises non cotées dont le total de bilan excède 100 millions d’euros ou dont le montant net du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice dépassent respectivement 100 millions d’euros et 500 salariés ;
Fixer, dans la loi, une liste non exhaustive des questions devant être abordées par les codes de gouvernance ;
Conférer au président du tribunal compétent le pouvoir d’enjoindre aux sociétés cotées ou non cotées de se conformer à leur obligation de se référer à un code de gouvernance, et de sanctionner pécuniairement la violation de cette obligation.
B. DES PROCÉDURES D’ÉLABORATION ET DE CONTRÔLE PLUS OUVERTES ET PLUS STRICTES
Cette nécessité découle tout naturellement du besoin précédemment évoqué d’une d’articulation entre d’une part le droit positif et, d’autre part, les bonnes pratiques identifiées et formalisées par les grandes entreprises.
Certes, le législateur pas plus que le pouvoir réglementaire, ne saurait, par une norme abstraite et générale, prétendre appréhender des situations diverses et régler dans le détail la gouvernance d’entreprise qui présentent des caractéristiques parfois spécifiques. Du reste, l’autorégulation a ses vertus : les codes de gouvernance participent d’une démarche et d’un engagement des entreprises elles-mêmes qui marquent, de leur part, une capacité à prendre conscience des enjeux de manière partagée, tout en prenant en considération les contraintes qui pèsent sur chaque secteur d’activité.
Mais l’intérêt qui, précisément, s’attache à une autorégulation efficace et pertinente doit également conduire à mesurer les imperfections que présente ce cadre pour la gouvernance des grandes entreprises. Alors qu’en l’état actuel de notre droit, les règles et recommandations édictées dans les codes de gouvernance n’ont aucune valeur contraignante, il importe de conforter une autorégulation parfois contestée dans ses fondements mêmes en élargissant le cercle des acteurs qui, à des titres divers, peuvent prendre part à l’élaboration des codes et au contrôle de leur application.
1. Conforter une autorégulation critiquée dans sa légitimité et dépourvue d’instruments de contrôle efficients
Outre l’absence de force contraignante des codes et le caractère très relatif des obligations inhérentes à une adhésion volontaire des entreprises, l’autorégulation promue par les codes de gouvernance pâtit manifestement de deux insuffisances qui en limitent l’effectivité et la reconnaissance par l’ensemble des entreprises et des agents économiques.
La première faiblesse de l’autorégulation tient sans doute au caractère relativement restreint du cercle des acteurs dont procèdent aujourd’hui les codes de gouvernance en vigueur. Ainsi que l’ont relevé plusieurs de personnes entendues par la mission, le code de gouvernance des grandes entreprises assez largement adopté aujourd’hui en France par les sociétés cotées, en l’occurrence celui porté par l’Association française des entreprises privées (AFEP) et par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), le « code AFEP-MEDEF » résulte des réflexions menées par les groupes de travail constitués par ces deux associations représentant les entreprises. De même, l’actualisation des codes de gouvernement en France se présente aujourd’hui comme relevant du seul fait des entreprises, de leurs associations et des organisations représentatives des employeurs.
Or, du point de vue de la mission, les modalités d’élaboration de ces instruments de soft law (15) peuvent mettre à mal leur légitimité dans la mesure où les codes pourraient apparaître comme ne prenant pas en considération les positions et les intérêts de l’ensemble des parties prenantes à la gouvernance et à l’existence des grandes entreprises. Ainsi, lors de la table ronde réunissant des représentants d’investisseurs organisée par la mission, M. Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis Asset Management, a-t-il indiqué qu’il n’était pas sain de laisser cette procédure aux seuls représentants des émetteurs [l’AFEP et le MEDEF] et qu’il conviendrait plutôt de confier la rédaction de ces codes à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Interrogée parmi les représentants des syndicats de salariés entendus par la mission le 10 octobre 2012, Mme Verveine Angeli a pour sa part, en qualité de secrétaire nationale du syndicat Solidaires unitaires démocratiques (SUD), relevé que les codes de gouvernance ne résultent pas de négociations entre partenaires sociaux mais procèdent seulement des organisations représentant les grandes entreprises.
Objectivement, certains secteurs de l’opinion publique peuvent d’autant plus facilement développer cette analyse que le rôle exclusif d’organisations représentatives des employeurs dans l’élaboration des codes de gouvernance ne constitue pas la règle. Des pays européens tels que l’Allemagne donnent en effet à voir d’autres modèles où la formalisation des bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise prend la forme de codes dont l’élaboration revient à une entité publique et associe des acteurs très divers.
Le processus d’élaboration du code allemand de gouvernement d’entreprise
Le code de gouvernance allemand se présente comme le fruit des travaux d’une commission gouvernementale, la Commission Cromme, installée en septembre 2001, par le ministre fédéral de la Justice, Mme Herta Däubler-Gmelin, mais indépendante de ce ministère.
Cette commission était formée de représentants des investisseurs institutionnels privés, de membre des bureaux exécutifs et de contrôle de corporations professionnelles, de représentants des salariés, de représentants de la bourse, de représentants des commissaires aux comptes et d’universitaires.
La commission s’inscrivait dans la suite des travaux conduits par une première commission présidée par le Professeur Théodor Baums (« Commission gouvernementale sur la gouvernance d’entreprise, le management et le contrôle d’entreprises et la réforme du droit allemand des sociétés anonymes »), laquelle avait rendu un premier rapport en juillet 2001 sur la gouvernance des entreprises.
Le code ainsi établi par la Commission Cromme a remplacé, dès sa publication, l’ensemble des codes existant en fixant des règles générales destinées à fournir de bonnes pratiques à la gouvernance des sociétés cotées.
La seconde insuffisance touche à l’absence d’une véritable instance de contrôle de la mise en œuvre des codes de gouvernance.
À cet égard, il peut être constaté que le Comité des sages, créé par l’AFEP et le MEDEF en avril 2009, peine à remplir la mission qui lui a été assignée, à savoir contribuer à la bonne application des principes de mesure, d’équilibre et de cohérence des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux définis par le code (16). Le comité doit en théorie rendre des avis sur totalité des rémunérations des mandataires sociaux. Or, on remarquera que cette instance, « compétente pour les sociétés qui adhèrent au code AFEP-MEDEF, au cas où elles recourent massivement au chômage partiel ou à des plans sociaux de forte ampleur », dispose d’une capacité d’intervention relativement restreinte puisque la saisine du Comité demeure à la discrétion des conseils d’administration ou de surveillance, par les comités de rémunérations ou par les assemblées générales dans le respect du droit des sociétés (la saisine pouvant avoir lieu ex ante ou ex post de la décision). En outre, les décisions du Comité des sages revêtent un caractère confidentiel et ses avis s’adressent à l’instance l’ayant saisi ainsi qu’au conseil d’administration de l’entreprise concernée. Le Comité se réserve en théorie la possibilité de communiquer sur ses avis s’il estime qu’il n’en a pas été tenu compte de manière appropriée.
Cela étant, ainsi que l’a souligné Mme Sophie de Menthon, présidente d’Ethic, au cours de la table ronde réunissant des représentants de dirigeants-mandataires sociaux le 3 octobre 2012, le Comité manque de visibilité sinon de moyens efficaces afin de garantir une bonne application du « code AFEP-MEDEF ».
En soi, ce constat met en lumière les limites d’une démarche dont il ne faut pas mésestimer ni l’importance, ni les apports. De fait, la seule sanction d’un comportement non-conforme aux recommandations réside, pour les grandes entreprises, dans le seul risque de voir leur réputation ternie sur les marchés, la mauvaise image entourant la gouvernance pouvant pousser les potentiels investisseurs à se détourner d’elles.
Dès lors, il importe d’envisager une refondation des procédures d’élaboration et de contrôle des codes de gouvernance dans leur ensemble.
2. Établir des codes de gouvernance associant plus largement toutes les parties prenantes de l’entreprise
Dans l’optique de la mission qui consiste à instaurer, pour les grandes entreprises, l’obligation légale de se référer à un code de gouvernance, on ne saurait en effet éluder le problème du cercle des acteurs chargés de l’élaboration et de l’actualisation de ces documents essentiels à l’autorégulation.
Compte tenu de la portée normative inédite que ces derniers acquerraient, il convient en effet de s’assurer que les règles et recommandations appelées à s’imposer à la gouvernance des grandes entreprises ne méconnaissent pas les intérêts parfois divergents de toutes ses parties prenantes, (salariés, actionnaires, clients, etc.) sans pour autant affaiblir l’efficacité du processus décisionnel et occulter des considérations touchant à la pérennité et à la compétitivité des entreprises.
Cette préoccupation d’établir un cadre adapté amène ainsi votre Rapporteure et votre Co-rapporteur à distinguer, dans les préconisations présentées à la mission afin de renforcer l’acceptation des codes de gouvernance et d’améliorer le contrôle de leur mise en œuvre, les sociétés cotées des sociétés non cotées.
a) Pour les entreprises cotées
Établir des codes de gouvernance susceptibles de favoriser une autorégulation conciliant les contraintes inhérentes au fonctionnement des entreprises mais, également, la qualité de la gouvernance pour l’ensemble des parties prenantes, suppose, en soi, un travail continu d’arbitrage entre des intérêts potentiellement divergents. La recherche de cet équilibre souvent précaire, en tout cas soumis sans cesse à actualisation, implique nécessairement que l’élaboration des codes intègre la prise en compte, sinon l’examen, des analyses et des propositions touchant à un problème de gouvernance.
Dès lors, aux yeux de la mission, il s’avère indispensable qu’à un stade ou à un autre de la procédure d’élaboration des codes de gouvernance, toutes les parties prenantes de l’entreprise puissent défendre leurs analyses et leurs préconisations. Dans son principe, cette association de l’ensemble des acteurs présente l’avantage de mieux cerner les enjeux de la gouvernance d’une grande entreprise en abordant cette question de manière pluraliste, sous plusieurs angles, et par conséquent, d’enrichir la réflexion sur les règles et recommandations à adopter en la matière.
Par ailleurs, dans la mesure où l’autorégulation repose, par définition, sur l’interaction d’acteurs susceptibles de poursuivre des objectifs différents, voire antagonistes, la mise en œuvre de codes de gouvernance rend nécessaire l’intervention d’une instance indépendante. Dans cette optique partagée par les membres de la mission, il importe en effet que la multiplicité des acteurs de l’autorégulation et la divergence des intérêts ne se traduisent pas par des incertitudes quant à l’application des règles et recommandations que les acteurs de la gouvernance se sont eux-mêmes données. Se pose ici à la question du contrôle de l’application des codes de gouvernance, c’est-à-dire de l’évaluation de la pertinence de leurs règles et de leurs recommandations au regard des objectifs de qualité de la gouvernance des grandes entreprises mais également du respect même des codes.
Ces principes posés, rien n’interdit d’envisager des modalités différentes pour leur mise en œuvre pratique.
Votre Rapporteure estime ainsi que l’élaboration des codes de gouvernance pourrait relever d’une négociation interprofessionnelle classique.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux auraient à définir et à actualiser les recommandations et les règles nécessaires à l’autorégulation sur la base d’un document de travail préparatoire établi par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce document aurait deux finalités : d’une part, rappeler les normes de droit positif et les stipulations des codes de gouvernance actuellement applicables aux entreprises cotées ; d’autre part, sur la base des recommandations et signalements contenus dans ses propres rapports, identifier des problèmes récurrents ainsi que les pistes d’amélioration de la gouvernance des grandes entreprises ; enfin, proposer un dispositif minimal susceptible de servir à l’élaboration d’un cadre de base, applicable aux sociétés cotées et aux sociétés non cotées et que les partenaires sociaux pourraient à loisir écarter, amender ou enrichir.
Les codes de gouvernance devraient être actualisés tous les trois ans.
Le contrôle de l’application des codes de gouvernance établis pour les sociétés cotées pourrait relever de la compétence de l’AMF, en sa qualité d’autorité publique indépendante chargée d’assurer la protection de l’épargne investie en produits financiers, de garantir la qualité de l’information financière délivrée aux investisseurs ainsi que le bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.
Du point de vue de votre Rapporteure, ce dispositif comporterait plusieurs avantages.
En premier lieu, le processus d’élaboration des règles de gouvernance verrait sa légitimité confortée dans la mesure où la négociation interprofessionnelle doit permettre à l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise de participer pleinement à l’établissement du cadre de la gouvernance des grandes entreprises, sujet d’intérêt éminemment commun qui doit faire l’objet d’un dialogue social renouvelé et responsable. Du reste, l’intervention de l’AMF pourrait permettre de fournir une base de travail de nature à favoriser des discussions fructueuses par l’apport initial d’une expertise neutre. Dans cette optique, compte tenu de sa composition et de ses pratiques, l’Autorité devra organiser, préalablement à l’élaboration du document préparatoire aux négociations, une large consultation de toutes les parties prenantes de l’entreprise : les organisations représentatives des employeurs mais également les représentants des dirigeants mandataires sociaux et des investisseurs, les professionnels du droit et de l’audit, les syndicats de salariés, éventuellement les sous-traitants. Ce faisant, les codes ne se présenteraient plus comme le fruit des travaux des seules entreprises émettrices.
En second lieu, ce dispositif semble de nature à dissiper les éventuelles incertitudes qui peuvent entourer non seulement l’interprétation des règles et recommandations de l’autorégulation mais également l’autorité de l’instance chargée du contrôle du respect des codes de gouvernance. Votre Rapporteure pense en effet que l’AMF doit être investie par le législateur de la mission de veiller à leur application dans la mesure où la qualité de la gouvernance des entreprises peut également affecter le fonctionnement des marchés d’actions et la protection de l’épargne. On notera du reste que l’Autorité exerce déjà un rôle assez similaire concernant la mise en œuvre des codes établis par certaines organisations représentatives des professionnels du secteur financier.
S’il souscrit tout à fait à l’idée que la gouvernance des grandes entreprises constitue une préoccupation d’intérêt public, votre Co-rapporteur juge pour sa part que l’AMF ne saurait se substituer aux entreprises dans l’élaboration des règles de l’autorégulation.
À ses yeux, associer plus étroitement l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise à l’élaboration des codes de gouvernance n’emporte pas nécessairement l’obligation de les déposséder de cette tâche. La prise en compte de la diversité des positions peut parfaitement reposer sur l’organisation par les auteurs des actuels codes de gouvernance de concertations plus larges et systématiques sur le terrain. À ce propos, votre Co-rapporteur a noté, ainsi que les membres de la mission, le souci exprimé par les représentants de l’AFEP et du MEDEF d’animer la réflexion sur les conditions de mise en œuvre du code de gouvernance, d’ailleurs en concertation avec l’AMF, et d’assurer l’évolution de ce dispositif de sorte que celui-ci permette d’appréhender des problématiques sans cesse renouvelées. Du reste, il se félicite de ce que M. Robert Leblanc, en sa qualité de président du comité d’éthique du MEDEF, ait pu indiquer l’importance qu’attachait son organisation à la conduite d’une concertation, de discussions et de consultations au-delà des organisations à l’origine de l’élaboration du « code AFEP-MEDEF », par exemple avec les petits et les moyens investisseurs.
De surcroît, du point de vue de votre Co-rapporteur, il importe que les entreprises s’approprient pleinement les règles et recommandations auxquelles elles pourraient être soumises dès lors que la loi les obligerait à se référer à un code de gouvernance. Or, elles intérioriseront d’autant mieux des règles de l’autorégulation qu’elles seront intervenues directement et éminemment dans la formalisation de bonnes pratiques qui appellent des jugements en opportunité et des considérations qu’un dialogue avec une autorité administrative indépendante, même très approfondi, aurait plus de difficultés à retranscrire.
En revanche, votre Co-rapporteur n’entend pas occulter le besoin d’un contrôle de l’application des codes de gouvernance, problème dont le livre vert de la Commission européenne sur le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union européenne rappelle le caractère récurrent et général (17).
Certes, l’AFEP a annoncé en décembre 2012, de concert avec le MEDEF, vouloir réviser le code de gouvernance qu’ils avaient édicté et, dans ce cadre, travailler à la création d’un « haut comité » de gouvernance (18). Formé de juristes, de fiscalistes, ce comité aurait pour mission de vérifier la bonne application du code de gouvernance révisé par les entreprises. D’après les déclarations de M. Pierre Pringuet, président de l’AFEP, « il serait construit sur le mode de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité [ARCEP], chargée de contrôler la publicité et qui peut ester en justice ». Si il peut être pris acte de cette intention, des interrogations demeurent sur l’activité effective d’une telle structure et sur sa capacité à infléchir les pratiques.
C’est pourquoi votre Co-rapporteur juge opportun qu’en premier lieu, l’AMF émette un simple avis sur le contenu des codes de gouvernance élaborés par les émetteurs. Ce faisant, l’AMF pourrait livrer une évaluation utile de la pertinence des règles et recommandations contenues dans les codes de gouvernance et amener leurs auteurs à en préciser la signification ou à les faire évoluer, ce qui contribuerait à l’information des investisseurs et à la lisibilité du cadre de la gouvernance.
En second lieu, il incomberait à l’AMF de rendre un avis motivé sur le caractère approprié des explications fournies par les entreprises afin de justifier d’éventuelles dérogations aux règles et recommandations énoncées par les codes de gouvernance. Cet avis interviendrait au moment de la réactualisation des codes de gouvernance, laquelle pourrait être réalisée suivant une périodicité à définir, idéalement tous les trois ans.
Ainsi, s’exercerait en pratique un contrôle de l’application des codes qui mettrait les entreprises devant leurs responsabilités et pourrait favoriser une discipline des pratiques de gouvernance, les entreprises s’exposant à une dégradation de leur réputation sur les marchés. Votre Co-rapporteur remarque du reste que c’est dans cette voie que l’AMF s’est engagée en citant nommément, dans son rapport 2012 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, des entreprises dont les explications concernant les dérogations au « code AFEP-MEDEF » apparaissent insuffisantes car superficielles (19).
Proposition n° 2 de votre Rapporteure : pour les sociétés cotées comme pour les sociétés non cotées, faire ressortir la rédaction des codes de gouvernance d’un accord interprofessionnel, négocié par les partenaires sociaux sur la base d’un document de travail préparatoire établi par l’AMF qui, à cet effet, devra consulter l’ensemble des parties prenantes (organisations représentatives des employeurs, représentants des dirigeants-mandataires sociaux et des investisseurs, professionnels du droit et de l’audit, les syndicats de salariés, sous-traitants).
Proposition n° 2 bis de votre Co-rapporteur : pour les sociétés cotées, confier à l’AMF le soin d’émettre un simple avis sur le contenu des codes de gouvernance élaborés par les émetteurs et de formuler un avis motivé sur la pertinence des explications fournies par les entreprises pour justifier d’éventuelles dérogations aux règles définies par ces codes.
Pour les sociétés non cotées, confier à une autorité de contrôle le soin d’émettre un simple avis sur le contenu des codes de gouvernance.
b) Pour les entreprises non cotées
S’agissant des entreprises non cotées, les membres de la mission s’accordent à penser que la prise en compte de contraintes spécifiques et la nécessité de ne pas entraver leur développement par des règles trop lourdes justifient la mise en place d’un dispositif d’auto-régulation proportionné.
Dans cette optique, ils considèrent que les codes de gouvernance susceptibles de s’appliquer à l’avenir devraient être établis par les entreprises elles-mêmes. Compte tenu de l’inexistence aujourd’hui de tels instruments d’auto-régulation, cette procédure de rédaction des codes de gouvernance permettrait aux entreprises non cotées de s’approprier pleinement les bonnes pratiques qui peuvent améliorer la qualité de leur gouvernance. À cette fin, votre Rapporteure estime qu’à l’instar des codes applicables aux sociétés cotées, la rédaction des codes de gouvernance applicables aux sociétés cotées devrait résulter de la négociation d’un accord interprofessionnel entre partenaires sociaux, la base des négociations pouvant être le dispositif élémentaire que l’AMF propose pour les sociétés cotées.
Pour autant, il apparaît difficile de ne pas s’intéresser à la formalisation de ces règles et recommandations et surtout de leur mise en œuvre, l’absence de cotation de certaines entreprises ne signifiant pas qu’elles ne possèdent pas une importance décisive pour l’économie française. Aussi, il importe qu’une autorité de contrôle du secteur dans lesquelles opèrent les entreprises non cotées – organisme existant ou éventuellement à créer – se prononce, par un avis simple, sur la pertinence du contenu des codes de gouvernance et, par un avis motivé, sur le caractère opportun et suffisamment approfondi des explications fournies par les entreprises non cotées pour justifier d’éventuelles dérogations aux règles définies par les codes qui s’appliquent à elles. Comme dans le dispositif envisagé précédemment s’agissant de l’obligation pour les entreprises d’adhérer à un code, il appartiendrait éventuellement à toute personne justifiant d’un intérêt à agir ou au ministère public de saisir le juge de manquements caractérisés aux règles et recommandations applicables aux sociétés non cotées, ce qui aurait pour effet de rendre le code de gouvernance en question opposable aux sociétés qui s’y réfèrent.
La mission évoque ici des autorités chargées de contrôle car elle ne veut pas préjuger des choix arrêtés par les différentes branches à l’avenir. En revanche, cette tâche de contrôle et d’évaluation ne saurait être raisonnablement confiée à l’AMF dans la mesure où, en application des lois et règlements en vigueur, notamment de l’article L. 621-1 du code monétaire et financier précité, la vocation de celle-ci consiste en la régulation et en la surveillance des marchés d’actions et d’instruments financiers.
Proposition n° 3 : pour les sociétés non cotées, formuler un avis motivé sur la pertinence des explications fournies par les entreprises pour justifier d’éventuelles dérogations aux règles définies par ces codes.
Permettre à l’autorité de contrôle de saisir le président du tribunal de commerce compétent en cas de non-respect avéré des obligations du code de gouvernance auquel l’entreprise se réfère.
II. – POUR UNE GOUVERNANCE STABLE ET OUVERTE AUX DIVERSES PARTIES PRENANTES DE L’ENTREPRISE
Tout au long de ses travaux, l’attention de votre mission a été attirée sur la nécessité de mieux intégrer les diverses parties prenantes de l’entreprise dans la gouvernance de celle-ci, qu’il s’agisse des actionnaires, des salariés ou des profils féminins ou issus de la diversité. M. Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain, a appelé de ses vœux l’émergence d’un « capitalisme de parties prenantes » (« stakeholders ») qui, tout en ménageant aux actionnaires (« shareholders ») la part qui leur est due, n’accorde pas pour autant à ces derniers la primauté absolue comme le fait le capitalisme anglo-saxon que notre pays a peu ou prou adopté.
M. Pierre-Yves Gomez, directeur de l’Institut français de gouvernement des entreprises (IFGE), et Me Najib Saïl, avocat spécialiste des fusions-acquisitions et des marchés financiers, ont appelé à concevoir un modèle de gouvernance « à la française », qui fasse une plus grande place aux parties prenantes des entreprises. De son côté, M. Marc Deluzet représentant la Fondation Terra nova, a souligné que la diversification des organes dirigeants des grandes entreprises, et notamment de leurs conseils d’administration ou de surveillance, ne pouvait que favoriser leur performance non seulement sociale et environnementale, mais aussi économique et financière : le rôle de l’entreprise ne se réduit pas à la production de biens et de services, mais s’étend aussi à l’apport de réponses à des besoins sociétaux qui doivent être pris en compte au sein des organes dirigeants. M. Jean-Louis Bianco, ancien ministre, représentant la Fondation Jean Jaurès, a lui aussi promu le développement d’un dialogue pérenne des organes dirigeants des entreprises avec toutes les parties prenantes : non seulement les actionnaires, mais aussi les collectivités publiques, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, les consommateurs ou les associations de protection de l’environnement.
La mission entend formuler un certain nombre de propositions qui répondent à ce souci de diversifier la gouvernance des grandes entreprises et de mieux impliquer aussi bien les actionnaires, aujourd’hui très volatiles, que les salariés, aujourd’hui trop peu entendus.
Toutefois, la mission estime nécessaire de laisser aux grandes entreprises une marge de liberté pour organiser leur gouvernance. C’est la raison pour laquelle elle juge préférable, par exemple, de laisser aux grandes entreprises le choix d’adopter une gouvernance dualiste ou moniste et, si elles optent pour la gouvernance moniste, de leur laisser le choix de dissocier ou non les fonctions de président et de directeur général. Ces diverses formules comportent en effet leurs avantages et leurs inconvénients.
La mission convient, avec M. Marc Deluzet et M. Antoine Gosset-Grainville, directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations, que la structure dualiste est souvent propice à la mise en œuvre d’une distinction claire et effective des responsabilités entre, d’une part, les personnes qui, au sein du conseil de surveillance, sont chargées de l’élaboration de la stratégie à long terme et du contrôle, et, d’autre part, les personnes qui, au sein du directoire, sont chargées de l’exécution opérationnelle. Si la plupart des grandes entreprises allemandes optent pour cette forme d’organisation de leur gouvernance, la mission estime, avec M. Jean-Louis Bianco, qu’il n’est pas opportun d’imposer ce modèle rhénan de gouvernance aux grandes entreprises françaises dont les spécificités et les besoins peuvent exiger qu’elles optent pour une structure moniste d’inspiration anglo-saxonne et se dotent donc d’un conseil d’administration (20). L’organisation de la gouvernance de l’entreprise selon une structure dualiste devrait, tout au plus, faire l’objet de recommandations dans des codes de gouvernance qui pourraient, le cas échéant, la préconiser lorsque l’entreprise est confrontée à telle ou telle situation.
Lorsque les sociétés anonymes retiennent un modèle de gouvernance moniste, l’article L. 225-51-1 du code de commerce leur ouvre la possibilité de confier leur direction générale soit au président du conseil d’administration soit à toute autre personne physique nommée par le conseil d’administration. La mission convient, avec M. Marc Deluzet (21) et M. Philippe Desfossés, directeur l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), que la dissociation des fonctions de président et de directeur général a des vertus, notamment lorsqu’il s’agit d’opérer une transition à la tête de l’entreprise. M. Pierre-Yves Gomez a d’ailleurs indiqué qu’environ 60 % des sociétés anonymes françaises dotées d’un conseil d’administration choisissaient de dissocier ces fonctions (22). La majorité des entreprises britanniques pourvues d’un conseil d’administration fait de même.
Toutefois, il semble que l’unification des fonctions de président et de directeur général peut être très utile lorsque l’entreprise traverse des difficultés car elle favorise une certaine réactivité à la tête de l’entreprise et permet de définir un cap clair et cohérent. Ainsi, tout en se déclarant plutôt favorable à une dissociation des fonctions de président et de directeur général, M. Antoine Gosset-Grainville a admis qu’il existait des cas particuliers où les caractéristiques de l’entreprise et les qualités de ses dirigeants commandaient la fusion de ces deux fonctions. Rappelant que près de 70 % des grandes entreprises américaines confiaient les fonctions de président et de directeur général à une seule et même personne, Mme Marie-Ange Debon, présidente de la commission « droit de l’entreprise » du MEDEF, a invité le législateur à préserver la souplesse qui caractérise aujourd’hui notre droit. Les différentes possibilités que la loi offre aux grandes entreprises pour organiser leur gouvernance permettent à ces dernières de s’adapter aux périodes d’expansion et de crise qui rythment leur existence, aux enjeux liés aux modalités de succession à leur tête, ainsi qu’aux évolutions de la structure et des attentes de leur actionnariat.
Sur le fondement de ces considérations, la mission a fait sien le point de vue de M. Jean-Louis Bianco, et de Mme Caroline Weber, directrice générale de « Middlenext », pour qui il n’apparaît pas opportun d’imposer par la loi une dissociation entre les fonctions de président et de directeur général. Selon la mission, il revient plutôt aux codes de gouvernance de formuler, le cas échéant, des recommandations en faveur d’une telle dissociation lorsque certaines circonstances l’exigent.
Cela étant, lorsque les fonctions de président et de directeur général sont attribuées à une seule et même personne, les codes de gouvernance pourraient recommander aux conseils d’administration des sociétés anonymes de désigner un administrateur indépendant comme administrateur référent, ce qui permettrait de contrebalancer le pouvoir concentré entre les mains du président-directeur général. C’est d’ailleurs la proposition qui a été faite à votre mission par M. Daniel Lebègue, président de l’Institut français des administrateurs (IFA).
Inspiré du modèle anglo-saxon du « lead/senior independent director » (23), cet administrateur référent qui pourrait être nommé aussi bien au sein de conseils d’administration qu’au sein de conseils de surveillance, serait chargé de nouer et d’entretenir un dialogue pérenne avec toutes les parties prenantes de l’entreprise, et plus particulièrement avec les actionnaires et les pouvoirs publics. La mission retient l’idée, exprimée par M. Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis Asset Management, que cet administrateur référent devrait être doté, par les statuts de l’entreprise, de pouvoirs propres à lui permettre de mener à bien ses missions (pouvoirs de réunir le conseil d’administration, de fixer son ordre du jour, de suppléer immédiatement le président du conseil d’administration en cas d’empêchement…).
L’administrateur référent pourrait avoir, entre autres missions, celle de tenir les autorités publiques, et plus particulièrement l’État et les collectivités territoriales, informées de la stratégie de développement de l’entreprise aux niveaux international, national et local. Dans ce cadre, il serait amené à faire part aux pouvoirs publics des éventuelles difficultés auxquelles l’entreprise serait susceptible de faire face, afin de les anticiper au mieux, en amont, et d’éviter que l’État et les collectivités locales soient tardivement mis devant le fait accompli d’un plan de restructuration ou d’une procédure collective, comme c’est parfois le cas aujourd’hui.
Comme l’a suggéré M. Daniel Bernard, président de la Fondation HEC et président-directeur général de Kingfisher, cet administrateur référent pourrait en outre être chargé de rencontrer régulièrement les actionnaires et/ou leurs représentants afin de les tenir continuellement informés de la vie et des orientations de l’entreprise en dehors de la seule assemblée générale annuelle dont, bien souvent, la durée n’excède pas une demi-journée. M. Jean-Nicolas Caprasse, responsable de l’activité gouvernance pour l’Europe du cabinet de conseil en politique de vote Institutional Shareholder Services (ISS), a estimé que cette pratique pourrait conduire les investisseurs institutionnels à intégrer cette politique de dialogue dans leurs pratiques.
C’est là un enjeu majeur compte tenu des effets néfastes que peut avoir aujourd’hui le manque de communication et de confiance entre les organes dirigeants des grandes entreprises et les investisseurs, effets au premier rang desquels figure le développement de stratégies de court terme aussi bien au sein de l’actionnariat qu’au niveau de la direction de l’entreprise.
La mission a constaté au cours de ses travaux un large consensus autour de l’idée selon laquelle bon nombre des dérives en matière de rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux, notamment sous forme de bonus, de « stock-options » ou d’actions gratuites, s’expliquaient par la définition de critères de rémunération purement quantitatifs et fondés sur la réalisation d’objectifs essentiellement financiers à (très) court terme. Ces objectifs « court-termistes » sont fixés en bonne partie pour satisfaire les attentes elles-mêmes « court-termistes » d’un actionnariat de plus en plus volatile et capté par des fonds d’investissement dont la vision stratégique et les objectifs de rentabilité ont rarement un horizon lointain.
C’est d’ailleurs l’analyse que fait le professeur John Kay dans son Rapport sur le processus décisionnel de long terme sur les marchés de capitaux britanniques (24), qui a été publié en juillet 2012 et dont certaines recommandations ont été adoptées par le gouvernement britannique, le 22 novembre dernier (25). Ce dernier a fait sien le point de vue du professeur John Kay selon lequel les critères « court-termistes » qui président à l’élaboration de la stratégie d’investissement des sociétés de gestion de portefeuille sapent la création de valeur à long terme et nuisent ainsi à l’économie du pays (26).
Au Royaume-Uni comme en France, le « court-termisme » de l’actionnariat n’a fait que s’accentuer à la faveur du développement du trading à haute fréquence (27) que la mission, à l’instar de M. Jean-Louis Beffa, appelle à enrayer en encourageant la mise en place, au niveau de l’Union européenne et du Groupe des vingt (ou G 20), d’une taxe sur les transactions financières qui soit suffisamment dissuasive.
Votre Rapporteure se félicite d’ailleurs de ce que le projet de loi n° 566 de séparation et de régulation des activités bancaires, déposé le 19 décembre dernier sur le bureau de notre Assemblée, comporte des dispositions qui visent à interdire aux banques de prendre des participations dans des fonds spéculatifs tels que les « hedge funds » (28) et de mener des activités spéculatives qui engagent leur propre bilan, sauf à les cantonner dans des filiales ayant par ailleurs elles-mêmes l’interdiction de pratiquer le trading à haute fréquence.
1. Élaborer un code de bonnes pratiques à l’attention des investisseurs
À l’occasion de la table ronde qui a réuni des cabinets de conseil en politique de vote, le 24 octobre 2012, M. Jean-Nicolas Caprasse, responsable de l’activité gouvernance pour l’Europe du cabinet Institutional Shareholder Services (ISS), a fait valoir qu’il serait utile d’élaborer un code de bonnes pratiques à l’attention des investisseurs institutionnels, sur le modèle britannique du « UK Stewardship Code » (29).
Contrairement au code de gouvernance de la place londonienne (« UK Corporate Governance Code »), qui, en vertu des règles de cotation, constitue une référence obligatoire pour la plupart des sociétés cotées à Londres, le code de bonne conduite des investisseurs (« UK Stewardship Code ») n’est qu’une référence facultative pour les actionnaires et fonds d’investissement de la place londonienne. L’application du code de bonne conduite repose sur la base du volontariat : l’article 2.2.3 des règles de conduite des affaires (« Conduct of Business Rules ») édictées par l’autorité britannique des services financiers (« Financial Services Authority » - FSA) exige seulement des sociétés autorisées à gérer les fonds de clients professionnels personnes morales qu’elles publient un communiqué indiquant si elles se réfèrent ou non au code et, si elles ne s’y réfèrent pas, quelle politique d’investissement alternative elles adoptent.
L’autorité britannique de reporting financier (« Financial Reporting Council » ou « FRC ») publie sur son site Internet la liste des actionnaires, des gestionnaires de fonds d’investissement, des investisseurs institutionnels et des prestataires de services liés à l’investissement (comme les cabinets de conseil en politique de vote) qui déclarent adhérer au code de bonne conduite. Ces derniers sont invités à notifier au FRC qu’ils se réfèrent au code.
Le FRC attend également des investisseurs adhérant au code qu’ils publient sur leur site Internet ou, s’ils n’en ont pas, par tout moyen susceptible de rendre l’information accessible, un communiqué indiquant la façon dont ils appliquent chacun des sept principes édictés par le code et dont ils rendent publiques les informations exigées dans les guides d’interprétation de ces principes. Le FRC attend également de ce communiqué, d’une part, qu’il précise si un ou plusieurs des sept principes énoncés par le code n’a ou n’ont pas été appliqué(s) ou si les informations exigées dans les guides d’interprétation de ces principes n’ont pas été rendues publiques, et, d’autre part, qu’il explique pourquoi les investisseurs signataires du code ont dérogé aux recommandations de ce dernier. Enfin, les investisseurs sont invités à actualiser ce communiqué, au moins une fois par an, et à l’occasion de tout changement de pratique.
Ce dispositif britannique d’auto-régulation des investisseurs qui repose sur le principe « appliquer ou s’expliquer » (« comply or explain ») mériterait d’être intégré à la réflexion qui, en France, s’organise autour de plusieurs difficultés signalées à votre mission.
En premier lieu, les principes de gestion vigilante, dynamique et cohérente des portefeuilles de titres qu’énonce le code britannique de bonne conduite des investisseurs pourraient amener l’actionnaire étatique à compléter la Charte des relations avec les entreprises publiques de l’Agence des participations de l’État (APE). En effet, M. David Azéma, commissaire aux participations de l’État, a attiré l’attention de votre mission sur le fait que certaines des règles régissant l’intervention des autorités publiques dans les conseils d’administration des entreprises dont elles sont actionnaires ne permettent pas de définir rapidement une position unitaire. Il apparaît notamment nécessaire de mieux harmoniser les positions des différentes administrations de tutelle des représentants de l’État dans les entreprises dont ce dernier est actionnaire, en particulier lorsqu’il est majoritaire. La représentation de l’actionnaire public étant trop fractionnée, son poids dans le capital d’une entreprise ne lui confère pas toujours l’impact attendu sur la gestion de cette dernière, en raison du morcellement de sa représentation dans les organes dirigeants.
En deuxième lieu, la France devrait se doter d’un code de bonne conduite des investisseurs, conçu sur le modèle du « UK Stewardship Code », pour apporter par l’auto-régulation une réponse souple aux besoins d’encadrement de certaines pratiques, besoins que ne satisfait pas une législation aujourd’hui embryonnaire.
En application de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier, seuls les investisseurs organisés sous forme de sociétés de gestion de portefeuille sont tenus d’expliquer leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu’ils gèrent, lorsqu’ils n’exercent pas les droits de vote attachés aux titres détenus par ces OPCVM. Le même texte les oblige par ailleurs à exercer ces droits de vote dans l’intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts des OPCVM et à rendre compte, notamment dans leurs documents de référence, de leurs pratiques en matière d’exercice des droits de vote, dans des conditions fixées par le Règlement général de l’AMF.
M. Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis Asset Management, a déploré le fait que les mêmes contraintes ne pèsent pas sur les investisseurs institutionnels organisés sous d’autres formes que celle d’une société de gestion de portefeuille.
L’élaboration d’un code de bonne conduite à l’attention des investisseurs de la place parisienne serait d’autant plus aisée que, comme l’a rappelé M. Paul-Henri de la Porte du Theil, président de l’Association française de la gestion financière (AFG), bon nombre de sociétés de gestion de portefeuille se sont déjà dotées, individuellement, d’un code de bonnes pratiques, et ce bien avant les sociétés cotées.
La matière existe donc, qui permettrait de s’inspirer des codes individuels existants pour élaborer un code de bonne conduite à l’attention de l’ensemble des investisseurs de la place parisienne.
Cette initiative s’inscrirait par ailleurs dans un mouvement plus large, au niveau européen, qui, tôt ou tard, pourrait amener notre pays à étoffer le cadre juridique, contraignant ou non, dans lequel les investisseurs institutionnels déploient leurs activités. En effet, parmi les éléments du plan d’action en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise que la Commission européenne a publié, le 12 décembre 2012, figure le « renforcement des règles de transparence applicables aux investisseurs institutionnels en ce qui concerne leurs politiques en matière de vote et d’engagement » (30).
Proposition n° 4 : élaborer un code de bonnes pratiques à l’attention des investisseurs.
En dernier lieu, le modèle du « UK Stewardship Code » pourrait inspirer les réponses à apporter aux interrogations que de nombreux acteurs, à commencer par la direction générale du Trésor, au sein du ministère de l’Économie et des Finances (31), formulent quant à l’opportunité de réguler les activités de prestataires de services liés à l’investissement, tels que les cabinets de conseil en politique de vote.
En effet, les informations dont les guides d’interprétation du code britannique conseillent fortement la publication concernent :
– la façon dont les investisseurs institutionnels ont, en cas de conflit d’intérêts, fait prévaloir l’intérêt de leurs clients dans le processus décisionnel d’investissement ;
– les circonstances dans lesquelles, en cas d’initiative collective, les investisseurs institutionnels se sont joints à d’autres investisseurs pour s’assurer que les organes dirigeants des grandes entreprises cotées prennent en compte et satisfassent leurs préoccupations communes au sujet de problèmes particulièrement sensibles ou dans des périodes particulièrement difficiles ;
– la façon dont les investisseurs institutionnels exploitent les recommandations des cabinets de conseil en politique de vote (« proxy voting agencies » ou « proxy advisors »).
À l’endroit des cabinets de conseil en politique de vote, comme à l’endroit des autres prestataires de services auxquels les investisseurs institutionnels font appel, le FRC formule la recommandation qu’ils publient les moyens mis en œuvre pour satisfaire les attentes de leurs clients à l’aune de chacun des principes du code de bonne conduite des investisseurs qui est pertinent au regard de la nature des services fournis.
Comme l’a souligné M. Xavier Huillard, président de l’Institut de l’entreprise et président-directeur général de Vinci, la plupart des investisseurs sont désormais établis hors de France, votent le plus souvent par correspondance et ont pris l’habitude de suivre les recommandations de cabinets de conseil en politique de vote (32).
Certaines des personnes entendues, parmi lesquelles M. Philippe Desfossés, directeur l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), ont donc exprimé le souhait que, compte tenu de leur influence, les « proxy advisors » soient contraints de publier leur politique générale de vote.
Cette aspiration réformatrice est relayée au niveau européen puisque la Commission européenne a inscrit, parmi les éléments du plan d’action en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise qu’elle a publié le 12 décembre dernier, la « création de règles opérationnelles appropriées pour les conseillers en vote […], tout particulièrement en matière de transparence et de conflits d’intérêts ».
Le choix fait par les Britanniques d’encadrer avec souplesse l’activité des cabinets de conseil en politique de vote, de façon incidente, dans le prolongement de l’auto-régulation des investisseurs, pourrait constituer une piste de réflexion dans le cadre des débats qui ont lieu en France sur cette question.
La même méthode pourrait nourrir la réflexion autour de nouveaux dispositifs d’encadrement des activités des cabinets de conseil en politique de rémunérations qui ne sont que trois ou quatre à se partager l’essentiel du marché mondial. Cette situation oligopolistique paraît de nature à favoriser les conflits d’intérêts et à entretenir une dynamique de surenchère en matière de rémunération des dirigeants-mandataires sociaux, d’autant que les conseils fournis par ces cabinets sont très largement suivis par les organes dirigeants des grandes entreprises.
Quoiqu’avant tout destiné à protéger leurs intérêts, un code de bonne conduite à l’attention des investisseurs pourrait avoir pour effet d’orienter leur comportement afin que ce dernier favorise la performance sur le long terme des entreprises bénéficiaires des investissements. C’est du reste l’une des finalités que le FRC assigne au « UK Stewardship Code ». Or M. Philippe Desfossés a souligné qu’en matière d’actionnariat, l’un des principaux problèmes rencontrés en France était précisément le manque d’investisseurs institutionnels de long terme.
2. Fidéliser l’actionnariat en octroyant plus de pouvoirs et d’avantages aux actionnaires de long terme
La mission constate avec inquiétude les effets dévastateurs qu’a l’adoption, par les actionnaires, de vues et de comportements de court terme, et insiste sur les enjeux décisifs qu’il y a donc à pérenniser l’actionnariat.
a) Le constat, largement partagé au niveau national et international, d’une nécessaire stabilisation de l’actionnariat
Lors de la table ronde qui a réuni des représentants d’investisseurs, le 17 octobre 2012, Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), a estimé très choquant que des actionnaires de court terme, voire des actionnaires qui sont non pas propriétaires mais seulement emprunteurs des titres de l’entreprise, se voient reconnaître autant de pouvoir que des actionnaires de long terme qui, de leur côté, sont toujours présents au capital de l’entreprise pour supporter les conséquences des décisions prises, plusieurs années après les votes. Cette analyse rejoint celle de M. Olivier Favreau, professeur d’économie à l’Université de Paris-X, qui, dans un plaidoyer « Pour un actionnariat responsable », publié au début du mois de septembre 2012, a écrit que « l’actionnaire qui valorise par-dessus tout sa liberté de quitter le bateau pour trouver mieux ailleurs, donc son irresponsabilité, devrait n’avoir que des pouvoirs minimaux », tandis que « l’actionnaire qui s’engage dans le projet économique de l’entreprise devrait bénéficier de pouvoirs supérieurs » (33).
Lors de la table ronde qui a réuni des spécialistes des questions de gouvernance des entreprises, le 14 novembre 2012, M. Marc Deluzet, représentant la Fondation Terra Nova, a appelé à favoriser les actionnaires de long terme en leur reconnaissant soit des droits de vote doubles, soit une part des dividendes progressant avec la durée de détention de titres de capital.
Lors du déplacement de votre mission à Londres, le 12 novembre 2012, M. Stephen Haddrill, directeur général de l’autorité britannique de reporting financier (FRC), a déploré le fait que les investisseurs institutionnels de long terme aient été supplantés par des investisseurs « court-termistes » prenant soit la forme de fonds souverains, soit celle d’actionnaires pratiquant le trading à haute fréquence et n’investissant dans l’entreprise que pour quelques secondes. De son point de vue, la bourse de Londres n’est plus un outil permettant de lever des fonds et de développer l’économie réelle. Mme Deborah Hargreaves, présidente du High Pay Centre (34), a expliqué à la mission que, dans un pays pourtant aussi attaché au principe « une action, une voix » (« one share, one vote ») que l’est le Royaume-Uni, le récent rapport du professeur John Kay (35) avait relancé le débat sur l’octroi de droits de vote multiples au bénéfice des actionnaires de long terme.
Au regard d’une telle convergence de vues, la mission juge nécessaire que le législateur intervienne pour que les actionnaires soient fortement incités à investir dans les entreprises sur le long terme. Cette intervention pourrait s’inspirer de la proposition faite par M. Louis Gallois, commissaire général à l’investissement, dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre le 5 novembre 2012 (36), selon les modalités développées ci-après.
b) Faciliter l’attribution de droits de vote doubles aux actionnaires de long terme
En l’état du droit, l’article L. 225-123, alinéa 1er, du code de commerce dispose qu’« un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire ».
Si ce droit de vote double est attribué par une assemblée générale extraordinaire, celle-ci « statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés », en application de l’article L. 225-96 du même code.
Par ailleurs, si ce droit de vote double est attribué à l’occasion d’une modification des statuts, l’assemblée générale extraordinaire sera là aussi appelée à statuer à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, dans la mesure où le même article L. 225-96 prévoit que « l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ».
En d’autres termes, le principe qui prévaut à l’heure actuelle est celui selon lequel des droits de vote doubles ne sont pas attribués aux actionnaires justifiant qu’ils détiennent des titres de capital depuis au moins deux ans, sauf si l’assemblée générale extraordinaire décide du contraire à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
Dans son récent rapport au Premier ministre, M. Louis Gallois a proposé de renverser le principe et de modifier la loi de façon à ce qu’elle prévoie désormais que des droits de vote doubles seront automatiquement attribués aux actionnaires justifiant qu’ils détiennent des titres de capital depuis au moins deux ans, sauf si l’assemblée générale extraordinaire décide du contraire à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés (37).
La mission approuve cette proposition qui a par ailleurs recueilli l’assentiment d’un certain nombre des personnes entendues, parmi lesquelles Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), et M. Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain. Il conviendrait de modifier en conséquence la rédaction du premier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce.
Proposition n° 5 : octroyer un droit de vote double aux actionnaires justifiant détenir leurs titres de capital depuis au moins deux ans, tout en ménageant la possibilité, pour l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de s’y opposer par un vote à la majorité des deux tiers.
Cette réforme viendrait compléter une modulation de la taxation des plus-values sur les cessions de titres de capital qui tienne davantage compte de la durée de détention des titres cédés.
c) Moduler la taxation des plus-values sur les cessions de titres de capital en prenant mieux en compte la durée de détention des titres cédés
Déplorant l’absence de perspective de long terme pour les entreprises, et insistant sur l’importance de mesures privilégiant l’actionnariat de long terme, M. Jean-Louis Beffa a préconisé d’alourdir la taxation des plus-values pour les actionnaires qui cèdent leurs titres de capital alors qu’ils les détiennent depuis peu de temps. Partageant ce point de vue, la mission préconise de moduler davantage la taxation des plus-values sur les cessions de titres de capital en prenant mieux en compte la durée de détention des titres cédés.
La mission note que la loi de finances pour 2013 (38) a aménagé un dispositif fiscal incitant les particuliers à conserver leurs titres de capital sur le long terme.
En effet, depuis la loi de finances pour 2000, les plus-values réalisées par des personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à l’occasion de la cession à titre onéreux (vente, échange, apport…) d’actions, de droits de souscription ou d’achat d’actions, de parts sociales, ou encore de titres de fonds communs de placement (FCP) étaient soumises à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 19 % (39). Cette imposition à un taux forfaitaire ne prenait pas en compte la durée de détention des titres de capital cédés.
La loi de finances pour 2011 ayant supprimé le seuil annuel de cessions (créé en 1978 et fixé à 25 830 euros en 2010) en deçà duquel les plus-values de cessions de valeurs mobilières étaient exonérées d’impôt sur le revenu, toutes les plus-values mobilières étaient imposées au taux forfaitaire dès le premier euro.
Désormais, l’article 10 de la loi de finances pour 2013, telle qu’adoptée en lecture définitive par notre Assemblée le 20 décembre dernier, soumet les gains réalisés par les particuliers à l’occasion de la cession à titre onéreux de leurs valeurs mobilières et droits sociaux à une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu qui tient compte de la durée de détention des titres de capital par les cédants (40).
Si les plus-values réalisées par les particuliers en 2012, à l’occasion de la cession de leurs titres de capital, resteront soumises à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 24 %, les plus-values nettes réalisées par les particuliers à compter de 2013 seront soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après abattement.
La loi de finances pour 2013 a en effet prévu un système d’abattements sur les plus-values imposables nettes, selon la durée de détention des valeurs mobilières et droits sociaux, durée qui est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres.
Ainsi, pour ce qui concerne les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de leurs titres de capital, la loi fiscale tient désormais compte de la durée de détention des titres cédés, en organisant une série d’abattements progressifs dont le taux est proportionnel à cette durée de détention : 20 % du montant des gains réalisés lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ; 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ; 40 % de leur montant lorsqu’à la date de cession, les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.
Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme à la Constitution, et notamment au principe d’égalité devant les charges publiques (41).
La mission rappelle que, pour les plus-values réalisées par les sociétés à l’occasion de la cession de leurs titres, la loi de finances rectificative pour 2005 avait déjà instauré des abattements pour durée de détention, qui pouvaient aboutir à une exonération totale au bout de 8 ans. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficiaient d’un abattement sur les plus-values qu’elles réalisaient à l’occasion de la cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés. Le taux de cet abattement était de 33,33 % pour chaque année au-delà de la cinquième année de détention des titres cédés.
La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a transformé cet abattement en un report d’imposition soumis à la double condition que les titres aient été détenus de manière continue pendant 8 ans au moins et que le montant de la plus-value ait été réinvesti dans le capital d’une autre société à hauteur de 80 % au moins, dans les 36 mois suivant la cession desdits titres. Au terme de cinq années supplémentaires (soit 13 ans à compter de la souscription ou de l’acquisition des titres cédés), ce report peut se transformer en une exonération d’imposition des plus-values réalisées.
3. Mieux impliquer et mieux connaître les actionnaires
a) Mieux impliquer les actionnaires dans la vie de l’entreprise
• Abaisser le seuil requis pour déposer des résolutions en assemblée générale
En l’état du droit, l’article L. 225-105 du code de commerce prévoit que « l’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation », qui, aux termes de l’article L. 225-103 du même code, est, sauf exceptions, le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance.
Toutefois, l’article L. 225-105 précité ajoute qu’« un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution », et qu’« un décret en Conseil d’État […] peut réduire le pourcentage exigé […] lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret ». Ce décret a introduit dans le code de commerce un article R. 225-71 qui précise que « lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter [pour demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée] est, selon l’importance de ce capital, réduit ainsi qu’il suit : a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ; b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ; c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ; d) 0,50 % pour le surplus du capital ».
En d’autres termes, l’immense majorité des grandes entreprises ayant un capital supérieur à 15 millions d’euros, le seuil de détention de titres de capital exigé des actionnaires pour pouvoir déposer individuellement des projets de résolutions est aujourd’hui fixé à 0,5 %.
Toutefois, s’ils représentent moins de 0,5 % du capital, les actionnaires ont la faculté de s’associer dans les conditions fixées par l’article L. 225-120 du code de commerce pour exercer le droit d’inscrire un point ou un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée. Le I de cet article prévoit que « dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société », notamment pour inscrire un point ou un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l’Autorité des marchés financiers. Le II du même article ajoute que « lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter [pour se regrouper en association] est, selon l’importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu’il suit : 1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu’à 4 500 000 euros ; 2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ; 3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ; 4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros ».
En d’autres termes, l’écrasante majorité des grandes entreprises ayant un capital supérieur à 15 millions d’euros, le seuil de détention de droits de vote exigés des actionnaires pour pouvoir déposer des projets de résolutions collectivement, en tant qu’association, est aujourd’hui fixé à 1 %.
Au cours des travaux de votre mission, plusieurs des personnes entendues ont signalé que le seuil de 0,5 % de capital exigé des actionnaires pour pouvoir déposer individuellement des projets de résolution était trop élevé. M. Loïc Dessaint, directeur associé du cabinet de conseil en politique de vote Proxinvest, a indiqué que le niveau de ce seuil empêchait le dépôt de projets de résolutions et nourrissait des conflits entre certains actionnaires et les organes dirigeants des grandes entreprises qui, en l’état du droit, sont seuls investis d’un pouvoir de police sur l’examen des résolutions, et notamment du pouvoir d’en refuser le dépôt, lorsque les seuils légaux ou réglementaires de représentativité ne sont pas atteints. Il serait regrettable que ces conflits conduisent à des blocages que seule la révocation, par les actionnaires, du mandat des dirigeants soit susceptible de résoudre.
En premier lieu, il a été proposé par M. Geoffroy de Vienne, conseiller du président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et par M. Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis Asset Management, d’abaisser le seuil exigé des actionnaires pour pouvoir déposer individuellement des projets de résolutions.
En second lieu, il a été proposé par MM. Geoffroy de Vienne, Philippe Zaouati et Loïc Dessaint, d’attribuer à l’AMF le rôle de juge des éventuels conflits pouvant opposer des actionnaires de sociétés cotées au directoire, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance qui refuserait d’inscrire leurs projets de résolutions à l’ordre du jour d’une assemblée. La possibilité de ne pas inscrire une résolution contestée à l’ordre du jour d’une assemblée ne serait ainsi ouverte aux dirigeants que sur autorisation de l’AMF.
Pour sa part, votre Co-rapporteur estime qu’il n’est pas opportun d’abaisser le seuil aujourd’hui exigé des actionnaires pour pouvoir inscrire individuellement un point ou un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, dans la mesure où le régime actuel leur offre la possibilité de s’associer et de déposer collectivement un projet de résolution dès lors que leurs droits de vote cumulés représentent au moins 1 % du total des droits de vote – seuil relativement faible.
Votre Co-rapporteur fait sien le point de vue exprimé par l’AFEP et le MEDEF dans la contribution écrite qu’ils ont fournie à la mission. Le seuil de 0,5 % du capital est un gage de représentativité des actionnaires, de sérieux du projet de résolution qu’ils souhaitent déposer, et de bon déroulement des assemblées. Si ce seuil venait à être abaissé, l’ordre du jour des assemblées risquerait d’être fortement encombré par des propositions peu sérieuses ou représentatives d’intérêts particuliers. Une telle réforme pourrait en outre favoriser des fonds activistes animés par une stratégie d’investissement « court-termiste ».
Votre Rapporteure ne partage pas ce point de vue. Elle tient à rappeler que, dans le rapport final sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées qu’il a publié le 2 juillet 2012, le groupe de travail de l’AMF présidé par M. Olivier Poupart-Lafarge, membre du collège de l’AMF, a préconisé de modifier les dispositions du code de commerce afin de permettre aux sociétés de prévoir, dans leurs statuts, des seuils moins élevés que les seuils réglementaires de capital aujourd’hui exigés des actionnaires pour pouvoir inscrire des points ou projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées générales (proposition n° 3). Il est à noter que, dans la mesure où la fixation de ces seuils abaissés requerrait une modification des statuts, elle devrait être votée par l’assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
Votre Rapporteure relève que le groupe de travail de l’AMF s’est refusé à proposer un seuil en termes de capital, de droits de vote ou de nombre de titres, préférant ménager la liberté des grandes entreprises de fixer statutairement le seuil qui leur paraîtra le plus opportun. M. Philippe Desfossés, directeur l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a rappelé qu’aux États-Unis, ce seuil était fixé en nombres de titres et qu’il suffisait à un actionnaire de détenir environ deux mille titres pour pouvoir inscrire un projet résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
Une modification du deuxième alinéa de l’article L. 225-105 du code de commerce, allant dans le sens d’un abaissement du seuil de capital exigé des actionnaires pour pouvoir inscrire, à titre individuel, des points ou des projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées des sociétés cotées ne pourrait que favoriser une véritable démocratie actionnariale. Votre Rapporteure est en outre favorable à ce qu’en cas de litige, l’AMF soit appelée à se prononcer sur la recevabilité du point ou du projet de résolution contesté.
Proposition n° 6 de votre Rapporteure : abaisser le seuil exigé des actionnaires de sociétés dont le capital dépasse 15 millions d’euros pour pouvoir demander l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée.
L’accroissement de l’implication des actionnaires dans le quotidien et le fonctionnement de l’entreprise passe non seulement par la facilitation de leur participation à ces moments forts de la vie des sociétés que sont les assemblées générales, mais aussi par le renforcement de leur contrôle sur les liens que l’entreprise tisse avec ses dirigeants-mandataires sociaux ou certains de ses actionnaires de référence à travers la conclusion de conventions réglementées.
• Renforcer le contrôle des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
En application des articles L. 225-38 (pour les sociétés à gouvernance moniste) et L. 225-86 (pour les sociétés à gouvernance dualiste) du code de commerce, doivent être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance :
– toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du même code ;
– toute convention à laquelle une des personnes précédemment mentionnées est indirectement intéressée ;
– toute convention intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Dans la mesure où la conclusion de ces conventions n’est ni libre ni prohibée, mais simplement encadrée par une procédure de contrôle, on a coutume de les qualifier de « conventions réglementées ». En pratique, il s’agit de conventions qui comportent un risque d’atteinte à l’intérêt social de la société et qui, par exemple, peuvent prendre la forme :
– d’un prêt de sommes d’argent consenti par la société à l’un de ses dirigeants, mandataires sociaux ou actionnaires, ou à l’inverse d’un prêt de sommes d’argent consenti à la société par l’un de ses dirigeants, mandataires sociaux ou actionnaires (conventions dites « de compte courant ») ;
– d’accords écrits ou simplement verbaux attribuant aux dirigeants divers avantages en nature sous réserve d’une contrepartie financière (véhicule de la société, jouissance d’un logement appartenant à la société…) ;
– de la souscription par la société d’un contrat d’assurance-vie au profit du président du directoire ou du conseil d’administration.
Les articles L. 225-39 (pour les sociétés à gouvernance moniste) et L. 225-87 (pour les sociétés à gouvernance dualiste) du code de commerce excluent du champ des conventions dites « réglementées » les « conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».
En application des articles L. 225-40 (pour les sociétés à gouvernance moniste) et L. 225-88 (pour les sociétés à gouvernance dualiste) du code de commerce, c’est au bénéficiaire de la convention qu’il revient d’informer le conseil d’administration ou de surveillance, dès qu’il a connaissance d’une convention réglementée. L’intéressé dispose donc d’une marge de manœuvre, certes étroite, mais bien réelle, pour qualifier la convention à laquelle il est partie et choisir, ou non, de la soumettre au régime des conventions réglementées.
Une fois les conventions autorisées, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance en donne avis aux commissaires aux comptes et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. Ces derniers sont en principe éclairés sur la nature, la portée et l’intérêt des conventions réglementées pour leur société grâce au rapport spécial que les articles L. 225-40 et L. 225-88 précités imposent aux commissaires aux comptes de présenter à l’assemblée générale. Sauf exceptions, c’est d’ailleurs sur ce rapport spécial, et non sur chacune des conventions réglementées que l’assemblée générale est appelée à statuer (42).
Or, M. Hervé de Villeroché, chef du service du financement de l’économie au sein de la direction générale du Trésor du ministère de l’Économie et des finances, a indiqué qu’il était souvent reproché aux rapports spéciaux des commissaires aux comptes de ne contenir que des analyses purement formelles. Votre mission en a eu confirmation grâce au témoignage de M. Didier Cornardeau, président de l’Association des petits porteurs actifs (APPAC), qui a souligné que les commissaires aux comptes devraient présenter aux actionnaires les tenants et aboutissants des conventions réglementées, et pas seulement leur indiquer si ces conventions sont juridiquement valables. Plus récemment, le cabinet de conseil en politique de vote Proxinvest a qualifié de « préoccupante » la « complaisance » des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées qui, selon lui, permettent d’opérer un « détournement de richesse » (43).
Du point de vue de Mme Catherine Bergeal, directrice des Affaires juridiques des ministères économique et financier, l’insuffisance du contrôle des conventions réglementées, conclues notamment par l’entremise des filiales, a eu autant d’effets sur les politiques de rémunération des dirigeants qu’en a eu l’endogamie des conseils d’administration.
De son côté, M. Gérard Rameix, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), s’est déclaré favorable à un renforcement du contrôle des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, renvoyant aux conclusions publiées le 2 juillet 2012 par un groupe de travail mis en place au sein de l’AMF et présidé par M. Oliver Poupart-Lafarge, membre du collège de l’AMF.
Il ne s’agit pas pour la mission de reprendre ici l’ensemble des propositions (n° 19 à n° 33) que ce groupe de travail a formulées dans son Rapport final sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées (44).
Toutefois, ces propositions pourraient être complétées. En effet, s’étonnant de ce que la qualification des conventions réglementées, qui, par hypothèse, impliquent souvent des dirigeants-mandataires sociaux, soit laissée à l’appréciation des intéressés eux-mêmes, Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), a suggéré à la mission que la tâche de définir les conventions qui méritent d’être qualifiées de « réglementées » revienne aux commissaires aux comptes.
Sans exiger des commissaires aux comptes qu’ils apprécient l’opportunité ou l’utilité de la conclusion de la convention pour la société, il pourrait être envisagé de leur demander un avis qui, à titre purement consultatif, serait fourni au conseil d’administration ou de surveillance avant que ce dernier ne se prononce sur l’autorisation de la convention, et qui indiquerait si, de leur point de vue, la convention qui leur est soumise relève du régime des conventions réglementées ou constitue une convention portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (45).
Proposition n° 7 : renforcer le contrôle des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, notamment en leur permettant de qualifier ces conventions.
Une telle réforme s’inscrirait dans un mouvement plus large, au niveau européen. Dans le plan d’action en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise qu’elle a publié le 12 décembre dernier, la Commission européenne a indiqué vouloir encourager l’engagement des actionnaires dans la vie des entreprises en étendant leur droit de regard sur les transactions de leur société avec des parties liées (administrateurs ou actionnaires majoritaires), c’est-à-dire sur ce que l’on qualifie en France de « conventions réglementées ».
L’octroi aux actionnaires de plus grands pouvoirs d’intervention et de contrôle doit s’accompagner de contreparties. C’est d’ailleurs la démarche de la Commission européenne dans le cadre de son plan d’action en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise. Comme l’a expliqué devant la mission M. Ugo Bassi, directeur au sein de la direction générale « Marché intérieur et services » de la Commission européenne, le 28 novembre 2012, de même que les entreprises cotées diffusent des informations au bénéfice des investisseurs, de même les actionnaires doivent fournir des informations sur leur identité aux entreprises cotées dans lesquelles ils investissent. La Commission européenne semble particulièrement soucieuse d’assurer une meilleure identification des actionnaires dont certains se cachent aujourd’hui derrière des sociétés-écrans ou des fonds d’investissement opaques (46). La mission partage le souci de la Commission européenne, notamment au regard de certaines difficultés qui lui ont été signalées.
b) Contraindre en contrepartie les actionnaires à mieux se faire connaître de l’entreprise
• Exiger davantage d’informations de la part des fonds d’investissement de type fermé
Lors de la table ronde qui, le 17 octobre 2012, a réuni des représentants d’investisseurs, Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), a exprimé le souhait que les rapports annuels fassent état de l’échéance à laquelle les fonds d’investissement de type fermé qui, pour le compte de clients, prennent des participations, parfois majoritaires, au capital d’une entreprise, sont tenus de restituer à leurs clients les sommes qui ont financé ces prises de participations et donc de vendre les titres de capital acquis.
Ces fonds sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont les parts ne peuvent être souscrites que pendant une période de temps déterminée. N’étant pas nécessairement cotés, ils sont dispensés d’un certain nombre de règles de transparence. Or leur sortie du capital des entreprises dans lesquelles ils ont investi peut avoir des conséquences considérables sur la stratégie de ces dernières.
Votre Rapporteure estime donc utile que, dans le rapport qu’il fait à l’assemblée générale ordinaire en application de l’article L. 225-100 du code de commerce, le conseil d’administration ou le directoire soit tenu d’indiquer l’échéance à laquelle les fonds d’investissement de type fermé qui ont pris des participations dans le capital de l’entreprise se sont engagés à restituer les fonds qui leur ont été versés par leurs clients. Pour que le conseil d’administration ou le directoire soit en mesure de s’acquitter de cette obligation, il conviendrait également de contraindre les fonds d’investissement de type fermé à fournir cette information aux entreprises lorsqu’ils entrent à leur capital.
Votre Rapporteure note qu’en l’état du droit, le conseil d’administration ou le directoire des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé est d’ores et déjà tenu par l’article L. 225-100-3 du code de commerce d’informer l’assemblée générale ordinaire de la structure du capital de la société et des participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance. Il suffirait donc de compléter cette information.
Proposition n° 8 de votre Rapporteure : améliorer la visibilité de la stratégie des fonds d’investissement au bénéfice des petits actionnaires en complétant le rapport que le conseil d’administration ou le directoire doit fournir à l’assemblée générale ordinaire annuelle en application de l’article L. 225-100 du code de commerce par une information sur l’échéance à laquelle les fonds d’investissement de type fermé qui ont pris des participations dans la société se sont engagés à restituer les fonds qui leur ont été remis par leurs clients.
• Clarifier les effets des prêts de titres
L’article L. 211-22 du code monétaire et financier dispose que le prêt portant sur des titres financiers et souscrit par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d’imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable, est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 du code civil. En d’autres termes, le prêt de titres financiers est assimilé à un prêt de consommation, les titres financiers étant eux-mêmes regardés par le législateur comme des choses qui se consomment juridiquement par l’usage que l’on en fait.
Or l’article 1893 du code civil prévoit que « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée », à charge pour lui de restituer au prêteur la même quantité de choses équivalentes, au terme convenu. Dans le cadre d’un prêt de titres, l’emprunteur des titres non seulement jouit des droits à dividende attachés aux titres empruntés, mais peut aussi exercer les droits de vote attachés à ces titres.
Or il a été signalé à la mission que certains investisseurs souscrivaient des prêts de titres seulement pour exercer les droits de vote attachés aux titres empruntés lors d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, notamment afin d’approuver ou de refuser telle ou telle résolution inscrite à l’ordre du jour et susceptible d’avoir un certain impact sur la stratégie de l’entreprise ou sur leurs propres intérêts, et qu’une fois l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire passée, ces mêmes investisseurs restituaient les titres empruntés.
Votre Rapporteure estime qu’il faut lutter contre ces comportements « court-termistes ». Il conviendrait donc de neutraliser les droits de vote attachés à des titres empruntés depuis peu tout en prenant garde d’assortir le dispositif de toutes les garanties constitutionnelles nécessaires, notamment au regard de l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qui fait du droit de propriété un droit « inviolable et sacré ».
Pour satisfaire à ces exigences, un dispositif pourrait être conçu, dans lequel les emprunteurs de titres seraient privés des droits de vote attachés aux titres empruntés dès lors que l’emprunt aurait été souscrit entre la date de la convocation adressée aux actionnaires et la date de la tenue de l’assemblée.
En effet, en application de l’article R. 225-67 du code de commerce, l’avis de convocation est adressé aux actionnaires et inséré dans un journal d’annonces légales dans un délai qui est fixé par les statuts de la société (article R. 225-62 du même code), mais qui ne peut être inférieur à 15 jours (article R. 225-69 du même code).
Si les emprunteurs de titres venaient à être privés des droits de vote attachés aux titres empruntés au motif que l’emprunt aurait été conclu entre la date de la convocation des actionnaires et la date de l’assemblée, cette privation des droits de vote, constatée par le bureau de l’assemblée, ne concernerait que les emprunts dont la durée, à la date de l’assemblée, est faible. Compte tenu des délais minimaux de convocation fixés par les textes réglementaires (15 jours), on peut penser que les emprunteurs concernés par la privation des droits de vote ne détiendraient les titres empruntés que depuis une quinzaine de jours, ou depuis un ou deux mois environ. À nul moment, les emprunteurs de titres ne seraient privés des droits à dividende attachés aux titres empruntés. Par ailleurs, dans la mesure où les emprunteurs de titres recouvreraient l’exercice des droits de vote attachés aux titres empruntés lors de l’assemblée suivante, sauf si cette assemblée résulte de l’ajournement de la première assemblée lorsque le quorum requis n’a pas été atteint, la privation des droits de vote subie par les emprunteurs de titres ne serait que provisoire.
Votre Rapporteure rappelle que des atteintes provisoires au droit de propriété ou à certains de ses attributs existent d’ores et déjà. Preuve en est, en matière de titres financiers, le régime de privation des droits de vote prévu en cas de manquement aux obligations de déclaration mises à la charge des actionnaires dont les participations franchissent certains seuils de capital (article L. 233-14 du code de commerce).
S’il est vrai que cette privation des droits de vote sanctionne un manquement à une obligation légale, il faut néanmoins noter que la durée de privation des droits de vote ainsi prévue (deux ans) est très supérieure à celle qui affecterait un emprunteur de titres ayant souscrit un prêt de titres peu de temps avant l’assemblée d’une société. Qui plus est, la privation des droits de vote attachés à des titres récemment empruntés peut être regardée comme étant motivée par un but d’intérêt général – la lutte contre le « court-termisme » actionnarial – et l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété de l’emprunteur de titres peut être regardée comme proportionnée au but recherché, sous réserve de l’appréciation du Conseil constitutionnel.
Proposition n° 9 de votre Rapporteure : neutraliser provisoirement les droits de vote attachés à des titres financiers empruntés.
Pour que le bureau de l’assemblée de la société constate qu’un actionnaire doit être privé des droits de vote attachés à ses titres parce qu’il détient ces derniers en vertu d’un contrat de prêt de titres conclu entre la date de l’avis de convocation et la date de l’assemblée, encore faut-il que le bureau puisse identifier cet actionnaire.
Cette identification pourrait être rendue possible si une autre préconisation était mise en œuvre. La mission suggère de contraindre les actionnaires à déclarer de façon distincte les titres dont ils sont propriétaires par l’effet d’un prêt de titres et ceux dont ils sont propriétaires pour toute autre cause (transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort…).
Cet objectif pourrait être atteint si l’article L. 211-24 du code monétaire et financier était complété par un alinéa prévoyant que les emprunteurs de titres financiers seraient contraints de notifier les prêts de titres qu’ils contractent auprès des sociétés dont les titres financiers sont concernés. Cette notification devrait, entre autres, mentionner le nombre de titres empruntés. Un décret en Conseil d’État pourrait préciser les modalités de cette notification, et notamment le délai, relativement bref, dans lequel l’emprunteur serait contraint d’y procéder, une fois le prêt conclu.
La même logique d’octroi de pouvoirs nouveaux sous réserve de certaines contreparties anime les propositions que font vos rapporteurs pour renforcer l’association des salariés aux organes dirigeants des grandes entreprises.
B. FAIRE DES SALARIÉS DES ACTEURS À PART ENTIÈRE DE LA GOUVERNANCE DES GRANDES ENTREPRISES
Dans l’esprit des membres de la mission, au même titre que les actionnaires qui investissent leur épargne au capital social, les salariés constituent l’une des deux principales parties prenantes de ces véritables « systèmes politiques » que les grandes entreprises tendent à devenir au gré de l’internationalisation de l’activité économique. Compte tenu de leur part décisive dans la création de valeur ajoutée et donc de richesse pour le pays, on ne s’étonnera donc pas que leur soit accordée une place tout aussi éminente dans une réflexion destinée à améliorer la gouvernance de celles-ci.
Cette préoccupation quant à la place et au rôle des différents personnels dans la marche des entreprises s’impose d’autant plus qu’elle se révèle aujourd’hui comme l’une des conditions incontournables de la compétitivité et de l’attractivité du territoire national. D’ailleurs, les dernières réflexions ou initiatives publiques prises dans ce domaine procèdent d’une démarche qui met ces questions sur un même pied. Qu’il s’agisse des préconisations du rapport de M. Louis Gallois (47), ou des décisions prises par le Gouvernement dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi (48), la qualité de la gouvernance des entreprises et place des salariés constituent deux volets indissociables d’une même politique.
La mission s’inscrit ici dans une même logique par des propositions visant deux objectifs essentiels : mieux associer les salariés au processus décisionnel pour des entreprises plus compétitives ; favoriser un dialogue social plus fructueux pour des entreprises appréciant mieux les enjeux et les risques.
1. Mieux associer les salariés au processus décisionnel pour rendre les entreprises plus compétitives
Dans la proposition n° 2 de son rapport sur la compétitivité(49), M. Louis Gallois a préconisé l’ouverture des conseils d’administration ou de surveillance des entreprises de plus de 5 000 salariés à au moins quatre représentants des salariés (sans dépasser le tiers des membres des conseils concernés). Ces salariés y disposeraient d’une voix délibérative, y compris dans les comités spécialisés des conseils.
Même si l’on peut discuter de l’effectif des salariés ainsi admis à siéger dans les organes dirigeants des grandes entreprises, cette proposition ne manque pas de justesse. En effet, en l’état actuel, la représentation des salariés au sein des conseils des grandes entreprises se révèle pour le moins singulièrement restreinte alors qu’une meilleure participation des salariés à la marche des entreprises constitue l’un des termes d’une action résolue en faveur de la compétitivité.
a) Remédier à une trop faible représentation des salariés au sein des conseils d’administration
L’examen des statistiques disponibles montre de fait qu’aujourd’hui, les salariés administrateurs siègent en nombre insignifiant au sein des conseils d’administration des grandes entreprises françaises.
Ainsi, selon les données issues des études réalisées par le cabinet Ernst & Young sur la gouvernance des sociétés cotées (50), les représentants des salariés ne comptent en moyenne que pour 0,4 % des administrateurs siégeant dans les conseils d’administration. Au sein des entreprises du CAC 40, cette proportion atteint péniblement 0,9 %, ce pourcentage tombant à 0,4 % pour les entreprises du SBF 120. Ainsi, on recense 41 administrateurs salariés au sein des entreprises du CAC 40 : 24 représentants des salariés, 17 représentants des actionnaires salariés. Les éléments fournis à la mission par les représentants d’Ethics & Boards offrent une autre illustration de cette réalité (51) : d’après cet observatoire, au 21 novembre 2012, 16 sociétés du CAC 40 (soit 40 % de cet indice boursier) comptaient des administrateurs représentant les salariés et/ou des représentants des salariés actionnaires.
À l’aune de la place des salariés administrateurs en Allemagne, lesquels représentent 7,1 % des administrateurs (52), on peut donc parler d’une présence très marginale des représentants des salariés au sein des organes dirigeants des grandes entreprises françaises.
De fait, la présence des salariés doit beaucoup à la volonté du législateur ainsi, éventuellement, qu’à la culture et à l’histoire propres à chaque grande entreprise française.
Le premier motif pour lequel des représentants des salariés siègent dans des conseils d’administration tient, en premier lieu, à l’application résiduelle de textes législatifs ou réglementaires autrefois en vigueur pour le secteur public et aujourd’hui maintenus dans des entreprises depuis lors privatisées. Il en va ainsi à la Société générale (depuis 1987), chez Renault (depuis 1994), à France Télécom (2000) ou encore au Crédit agricole et chez EDF.
En effet, avant leur privatisation, les conseils d’administration de ces entreprises comprenaient des représentants des salariés ainsi que des personnalités qualifiées en application de dispositions telles que notamment celles de la loi relative à la démocratisation du secteur public de 1983 (53). Ce dernier texte prévoyait, en ses articles 5 et 6, qu’au sein des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte ou dans des sociétés anonymes majoritairement détenues par l’État, les conseils d’administration ou de surveillance comprenaient, suivant la taille des entreprises, des représentants élus par les salariés. La présence aujourd’hui d’administrateurs salariés dans le cadre de ces instances s’explique ainsi par le choix de la plupart des entreprises appartenant autrefois au secteur public de conserver cette représentation dans l’un de leurs organes dirigeants.
Le second motif de la présence des représentants de salariés dans les conseils des grandes entreprises tient à la place que le législateur a souhaité ménager aux salariés actionnaires dans la gouvernance des entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
En application de l’article L. 225-23 du code de commerce, dès lors que les actions détenues par le personnel de la société (ainsi que par le personnel de sociétés détenues à plus de 50 % par celle-ci) représentent plus de 3 % de son capital social, l’assemblée générale doit élire un ou deux administrateurs parmi les salariés actionnaires de la société. On notera cependant que la loi exclut logiquement la représentation individuelle des salariés. En outre, le septième alinéa de l’article L. 225-23 précité exonère de cette obligation les entreprises dont le conseil d’administration « comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application » des statuts de l’entreprise (54).
La mission rappelle enfin que les représentants du comité d’entreprise peuvent siéger dans les conseils d’administration avec voix consultative.
b) Rendre les relations du travail plus productives en associant plus étroitement les salariés au processus décisionnel
Du point de vue des membres de la mission, cette orientation se justifie autant par une certaine idée de l’entreprise que par des considérations touchant à l’efficacité économique et au partage des enjeux de la mondialisation.
Comme l’investissement des actionnaires de long terme, le travail des salariés représente volens nolens un engagement durable au service de l’entreprise par lequel ils se posent en artisans de sa prospérité et de sa pérennité. Dans cette conception faisant de l’entreprise une véritable communauté d’intérêts rassemblée autour de la création de richesses, on pourrait même considérer, par exemple à l’instar de Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires, que les salariés prennent autant de risques que les actionnaires, et qu’à ce titre, ils méritent d’obtenir une plus grande place au sein des organes dirigeants de leur entreprise. On remarquera que la Commission européenne ne développe pas une approche si foncièrement différente lorsque dans son livre consacré au cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union européenne, elle affirme que « l’intérêt du personnel dans la viabilité à long terme de son entreprise est un élément que le cadre en matière de gouvernance d’entreprise devrait prendre en compte » (55).
En tant que parties prenantes, les salariés peuvent apporter leur pierre à la stratégie de l’entreprise, dans le cadre d’un échange source d’amélioration du fonctionnement de l’organisation et d’un positionnement de ses acteurs plus conforme à leurs intérêts de long terme.
Au terme des analyses recueillies par la mission auprès des représentants des employeurs, des salariés ou des personnes qui réfléchissent à la gouvernance des entreprises, l’expérience tend à démontrer que l’association des représentants des salariés aux conseils d’administration est susceptible d’enrichir le débat au sein de ces instances de décision. Suivant l’analyse développée par nombre de personnes entendues par la mission, dont M. Alain Champigneux, administrateur salarié CFE-CGC à Renault, afin de prendre la meilleure décision stratégique possible, il importe que le conseil d’administration s’entoure de tous les avis possibles, dont ceux des salariés ; il faut que les dirigeants d’entreprise aient notamment une idée des conséquences sociales des mesures qu’ils présentent au conseil d’administration. La présence d’administrateurs représentant les salariés doit ainsi permettre d’examiner la stratégie des entreprises avec une pluralité de points de vue mais également de porter à la connaissance des dirigeants-mandataires sociaux des problèmes existant sur le terrain et l’état du climat social, problèmes qui peuvent altérer l’efficacité productive. On pourrait même faire le pari qu’une certaine proximité avec le quotidien amène les représentants des salariés à soutenir au sein de ces instances des stratégies de nature à mieux garantir la pérennité de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. C’est en tout cas l’opinion émise par Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM) : selon elle, si les salariés avaient plus de place au sein des conseils d’administration ou de surveillance ou au sein des comités de rémunérations, le recours aux méthodes de gestion tendant à privilégier le retour sur investissement à tout prix par la diminution des fonds propres et des actifs de l’entreprise serait moins répandu.
Quoi qu’il en soit, dans l’esprit des membres de la mission, l’échange que la présence des représentants des salariés peut favoriser au sein des organes dirigeants ne doit pas seulement permettre une remontée de l’information de la base au sommet d’une entreprise. L’association plus étroite des salariés aux délibérations des conseils doit aussi leur permettre prendre pleinement leur part à l’élaboration de décisions correspondant à l’intérêt de long terme de chacune des parties prenantes des grandes entreprises.
Il s’agit de donner aux salariés la capacité d’appréhender la stratégie de leurs entreprises dans toute sa complexité, de mieux comprendre les implications et les contraintes du secteur d’activité dans lesquelles elles opèrent ainsi que les adaptations auxquelles peuvent parfois contraindre les mutations technologiques et l’approfondissement de la concurrence internationale.
Sur ce point, on peut volontiers partager l’opinion émise par M. Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain, suivant laquelle une meilleure représentation des salariés au sein des organes dirigeants constitue une mesure qui permettrait de les rendre plus familiers à certaines réalités de la mondialisation.
Cette intelligence des situations – qui ne signifie pas pour autant une renonciation face à certaines réalités – semble en tous cas indispensable pour que chacun contribue, dans son propre intérêt, à la pérennité des entreprises. Ainsi que la mission a pu l’entendre auprès de nombre de participants aux tables rondes et auditions qu’elle a organisées, il n’y pas d’entreprise pérenne sans une certaine cohésion de son corps social face à des accidents conjoncturels ou à une concurrence redoublée. Telle apparaît notamment la conclusion de l’expérience dont M. Daniel Bernard, président-directeur général de Kingfisher, a fait état : il importe que la stratégie de l’entreprise, les questions et les difficultés auxquelles elle se heurte ou qu’elle peut soulever soient comprises par l’ensemble des collaborateurs pour être motivantes.
Cet objectif peut être atteint par une meilleure association des représentants des salariés au processus décisionnel dans la mesure où du reste, ainsi que l’ont indiqué des personnes représentant les salariés ou exerçant des responsabilités de direction à la tête des entreprises, la nécessaire confidentialité des débats entourant les décisions des conseils dirigeants ne représente pas un obstacle dirimant ou rédhibitoire. Les témoignages recueillis par la mission donnent en effet à penser que de manière générale, les représentants des salariés savent faire la part entre leurs devoirs d’information vis-à-vis de leurs mandants et l’obligation de réserve quant aux délibérations des conseils dirigeants. Le souci légitime de préserver cette confidentialité ne saurait donc constituer un motif à l’inaction.
Aussi la mission préconise-t-elle l’adoption d’une disposition législative prévoyant, au sein des conseils d’administration ou de surveillance (y compris leurs comités spécialisés) des entreprises de plus de 5 000 salariés, la représentation obligatoire des salariés par des administrateurs, élus ou désignés, disposant d’une voix délibérative.
Il apparaît raisonnable de laisser aux partenaires sociaux le soin de définir les modalités de désignation (par les organisations syndicales) ou d’élection (par les salariés eux-mêmes) de ces administrateurs. De même que pour le choix de la représentation éventuelle au conseil d’administration des seuls salariés de nationaux ou des salariés de tous pays d’implantation d’un groupe, ou l’alternative entre une représentation par des salariés syndiqués appartenant à l’entreprise ou extérieurs à elle, il s’agit là d’une question relativement ouverte. Auteur d’un rapport pour la fondation Terra Nova consacré au fonctionnement des entreprises (56), M. Marc Deluzet a d’ailleurs évoqué à ce propos l’existence d’alternatives variées. Néanmoins, il est sans doute possible, à l’instar de la position exprimée par M. Jean-Louis Beffa, d’envisager la désignation de mandataires des centrales syndicales élus par le personnel, étant entendu qu’il conviendrait que les représentants des syndicats les plus représentatifs siègent au sein des conseils d’administration.
La mission a conscience que cette mesure porte potentiellement en elle les germes de profonds bouleversements non seulement dans le fonctionnement des entreprises, mais encore dans les pratiques du dialogue social.
Elle n’ignore pas les difficultés qu’une telle orientation comporte, à commencer pour les acteurs eux-mêmes celle d’en faire application. Ainsi a-t-elle bien pris note des réserves que pouvait éprouver une organisation syndicale telle que Force ouvrière à l’idée d’un dispositif susceptible d’aboutir sinon à une cogestion, à une co-responsabilité des représentants des salariés dans la conduite des entreprises. De même a-t-elle pris en considération les réticences que pouvait susciter l’entrée des salariés dans certains conseils dirigeants de certains secteurs d’activités. D’après le tableau dressé par M. Gérard Andreck devant la mission, il en va ainsi dans certaines entreprises mutualistes : quoique depuis 1981, la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration des mutuelles constitue une obligation et malgré des évolutions sensibles, il s’avère que le comité de sélection et de nomination des dirigeants demeure l’un des cercles au sein desquels ces administrateurs ne sont pas nécessairement toujours admis.
En réalité, l’association plus étroite des salariés au processus décisionnel des entreprises par leur participation aux conseils d’administration nécessite, au sens propre du terme, une phase d’acculturation propice à la maturation des esprits.
À cet égard, il convient ici de préciser que le propos de cette mesure ne saurait être la mise en place aujourd’hui d’une cogestion telle que l’Allemagne la pratique depuis plus de soixante ans. Ainsi que l’a observé M. Jean-Louis Beffa, la France peut certainement s’inspirer des enseignements des pratiques sociales allemandes afin de faire évoluer son propre modèle. Pour autant, la pratique de la cogestion procède d’un modus vivendi que les partenaires sociaux outre-Rhin ont mis des années à définir et qui exigerait, en France, une profonde évolution culturelle et une pédagogie dans le dialogue social. De manière générale, la mission retient l’idée développée devant elle par M. Pierre-Yves Gomez, directeur de l’Institut français de gouvernement des entreprises (IFGE): il n’est pas pertinent de recourir à des concepts et des modèles étrangers (américains, britanniques, allemands) sous-tendus par une logique propre afin de traiter de questions de gouvernance spécifiques à la culture française.
Cette analyse explique que la présente proposition puisse, sur certains aspects, apparaître en retrait par rapport à certaines préconisations relativement audacieuses. Ainsi, si elle souscrit au principe qui sous-tend la proposition n° 2 du rapport de M. Louis Gallois (57), la mission entend limiter dans un premier temps à deux – et non à quatre – le nombre de sièges accordés, avec voix délibérative, aux représentants des salariés. À terme, ce nombre pourrait être porté au tiers de l’effectif des membres des conseils des conseils d’administration ou de surveillance.
Votre Rapporteure suggérerait même, pour sa part, d’envisager également un calendrier de mise en œuvre progressive pour atteindre cet objectif. Dans cette perspective, la mesure proposée par la mission pourrait entrer en vigueur à compter de 2014, la part des administrateurs représentant les salariés non-actionnaires étant portée à un quart des effectifs des conseils d’administration en 2016 puis à un tiers en 2018. À la moitié de la législature, une grande conférence sociale pourrait être organisée, destinée non seulement à évaluer les conditions pratiques de la représentation des salariés au sein des conseils d’administration mais encore à réfléchir à la mise en cohérence du droit du travail et du fonctionnement du dialogue social eu égard au poids nouveau des salariés dans la marche des entreprises.
Cette esquisse de cogestion à la française ne saurait en effet être réalisée et acceptée par l’ensemble des partenaires sociaux que si elle s’inscrit dans le cadre plus vaste d’une refonte de notre droit social.
Dans l’esprit de votre Rapporteure, cette refonte doit notamment favoriser une simplification des normes du droit du travail qui, tout en préservant les droits et garanties dont bénéficient actuellement les salariés, peut poursuivre deux objectifs : supprimer des formalités devenues sans objet et ne contribuant pas à la protection des détenteurs d’un contrat de travail ; travailler à l’allègement de certaines procédures et à la rédaction de certains textes normatifs qui compliquent la vie des entreprises de manière inutile et concourent à l’illisibilité de notre droit du travail sans bénéfice pour les salariés. En cela, votre Rapporteure s’inscrit dans l’esprit qui a sous-tendu les négociations interprofessionnelles sur le marché du travail. Engagée dans le prolongement de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, cette négociation pourra notamment aboutir à une taxation du recours abusif aux contrats courts (les contrats à durée déterminée), ainsi qu’à une mobilité volontaire sécurisée (58)et à la création de droits rechargeables (59).
Outre la simplification de notre droit social, il convient en effet de réfléchir à la mise en place d’une « sécurité sociale professionnelle ». Par ce concept qui participe en partie d’une démarche analogue à celle engagée par les partenaires sociaux de « sécurisation des parcours professionnels », votre Rapporteure entend l’instauration d’un droit à la qualification et à la mobilité, protégé dès la sortie du système éducatif et tout au long de la vie professionnelle. Ce droit ouvrirait à chacun la possibilité de bénéficier d’une aide à l’orientation, à la qualification ou à la requalification si nécessaire et à la mobilité dans l’emploi protégée en termes de revenus et d’accompagnement.
C’est dans ce cadre qu’une meilleure association des salariés au processus décisionnel des grandes entreprises prendrait tout son sens.
Si votre Co-rapporteur conçoit tout autant l’intérêt de rendre obligatoire la représentation des salariés dans les conseils d’administration et de leur accorder une voix délibérative, il tient toutefois à mettre ici l’accent sur les conditions indispensables, de son point de vue, à l’efficacité et à l’acceptation de cette mesure.
D’une part, il importe de veiller à la parfaite concomitance entre l’entrée en vigueur des dispositifs améliorant la représentation des salariés au sein des conseils d’administration et la réforme du droit du travail. L’entrée des salariés dans les organes dirigeants des entreprises peut susciter des réticences dès lors qu’à bien des égards, elle marque le franchissement d’un cap décisif vers une forme de cogestion. Dès lors, cette mesure paraît devoir être d’autant mieux admise – et intégrée dans le fonctionnement des entreprises – qu’elle ne revêtira pas un caractère unilatéral car dépourvue de toute contrepartie.
D’autre part, votre Co-rapporteur estime précisément que la réforme du droit du travail ne doit pas se limiter aux orientations que la Rapporteure semble pouvoir esquisser. Une véritable réforme doit desserrer les carcans qui alourdissent le fonctionnement des entreprises et complexifient inutilement les relations sociales sans bénéfice pour le dynamisme de notre économie et la préservation de l’emploi. Ainsi, il convient d’œuvrer à l’établissement d’un contrat de travail unique et, surtout, de traiter le problème de la judiciarisation des relations entre employeurs et employés, notamment dans le cadre des procédures de licenciement. Sur ce dernier point, il n’apparaît pas déraisonnable de réfléchir aux moyens d’établir un encadrement des licenciements qui ne se solde pas inévitablement par des contentieux devant le juge et par des procédures dont l’issue, en termes de délais et de coûts, demeure incertaine.
Proposition n° 10 : instaurer, par la loi, une représentation obligatoire des salariés non-actionnaires, avec voix délibérative, au sein des conseils d’administration et de surveillance des entreprises de plus de 5000 salariés, y compris dans les comités spécialisés de ces conseils. Dans l’immédiat, fixer à deux le nombre de représentants des salariés non-actionnaires.
En contrepartie :
– accompagner la représentation des salariés dans les conseils d’administration et de surveillance en engageant concomitamment une simplification du droit du travail, sans mettre en cause la protection des salariés, notamment grâce à l’instauration d’une sécurisation des parcours professionnels (proposition de votre Rapporteure) ;
– de manière parfaitement concomitante, alléger les obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, en créant un contrat de travail unique et en simplifiant les modalités de licenciement sans amoindrir le contrôle du juge (proposition de votre Co-rapporteur).
2. Favoriser un dialogue social plus fructueux pour des entreprises appréciant mieux les enjeux et les risques
Cet objectif constitue presque le corollaire de la mesure instaurant une représentation obligatoire des salariés dans les conseils d’administration car le renforcement du rôle de ces derniers dans la marche de l’entreprise ne prendra tout son sens que s’il contribue à revivifier le dialogue social. Du point de vue de la mission, il importe en effet de favoriser le développement d’une véritable culture de l’échange et d’organiser un dialogue social permettant d’anticiper et de traiter les problèmes, durables ou non, que rencontrent les grandes entreprises.
a) Contribuer au développement d’une véritable culture de l’échange
On ne rappellera pas ici la multiplicité des essais, études ou rapports qui soulignent tous, depuis longtemps, la relative atonie du dialogue social dans notre pays. Cette situation regrettable s’explique par de nombreux facteurs : la faiblesse des organisations syndicales, lesquelles se heurtent à un problème d’audience et de représentativité avec un taux de syndicalisation très réduit et une présence surtout affirmée dans les entreprises et établissements du secteur public ; le positionnement fréquemment conflictuel voire concurrent des partenaires sociaux et, dans une certaine mesure, l’importance du rôle de l’État, traits caractéristiques du paysage français qui ne facilitent pas la recherche et la conclusion de compromis dans un cadre interprofessionnel.
Ces deux derniers facteurs renvoient à l’évidence à des schémas de nature presque culturelle. Aussi le développement d’une véritable culture de l’échange passe nécessairement par des mesures touchant à la fois au fonctionnement institutionnel des entreprises mais également aux pratiques de leurs parties prenantes.
• S’agissant des pratiques, il convient d’étoffer la formation économique des salariés, a fortiori de ceux d’entre eux qui exercent des fonctions d’administrateurs représentant les salariés dans les conseils d’administration.
Ainsi que la plupart des personnes entendues par la mission l’ont souligné en ce qui concerne les qualifications nécessaires aux administrateurs, le fonctionnement et le rôle des institutions représentatives du personnel, ou encore la promotion de la parité à la tête des entreprises, constituent une condition essentielle de la bonne marche des entreprises. Il faut en effet maîtriser et partager des concepts et des données en commun pour évaluer et répondre aux positions affirmées par les autres parties prenantes de l’entreprise et se prononcer avec pertinence sur des options stratégiques. Dialoguer suppose d’abord de pouvoir se comprendre.
Du reste, ainsi que certains des grands patrons entendus par la mission l’ont indiqué, l’offre de formation économique suscite souvent l’intérêt des salariés en général et des membres des organisations syndicales en particulier. Il existe une perception assez partagée suivant laquelle la formation constitue un authentique besoin. Ainsi, devant la mission, Mme Verveine Angeli, a tenu à déplorer l’insuffisance du temps alloué aux membres des comités d’entreprise pour suivre une véritable formation économique. En l’état, la formation assurée ne concerne souvent que le fonctionnement de cette instance.
En application de l’article L. 2325-44 du code du travail, « les membres titulaires du comité d’entreprise élus pour la première fois bénéficient, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État », soit par un « des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés » (60). L’article L. 2325-44 précise encore que le temps consacré à cette formation « est pris sur le temps de travail et est renouvelé comme tel » et que « cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non ».
Cela étant, il apparaît également qu’en dehors de leur qualité éventuelle de membres d’un comité, les salariés peuvent, en droit, bénéficier d’autres initiatives de formation permettant d’appréhender les réalités du fonctionnement de l’entreprise dans le cadre d’actions relevant de la formation professionnelle continue.
Ainsi, en application de l’article L. 6313-1 du code du travail, entrent dans ce champ les actions de formation relative à l’économie et à la gestion de l’entreprise qui, suivant l’article L. 6313-9 du même code, « ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l’entreprise ». On pourrait également citer les actions de formation relatives à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié (prévue au 9° de l’article L. 6313-1 du même code).
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions relatives aux congés payés et autres congés, les articles L.3142-7 à L.3142-15 du code du travail organisent quant à eux le droit des salariés au bénéfice de congés de formation économique et sociale et de formation syndicale. D’une durée totale ne pouvant excéder 12 jours (61) par an, maximum variant suivant un plafond fixé par voie réglementaire compte tenu de la taille de l’établissement (62), ces congés donnent droit aux salariés de suivre « des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale » (article L. 3142-7 du code du travail). L’organisation de ces formations relève, de par la loi, des mêmes organismes que ceux chargés de la formation des membres des comités d’entreprise.
Ainsi, le code du travail du travail offre – au moins juridiquement – une assez large palette de droits à la formation qui peuvent permettre de mieux s’approprier les réalités de l’économie contemporaine et du fonctionnement de l’entreprise. Dès lors, la difficulté réside sans doute davantage dans la complexité des conditions de mise en œuvre des droits à formation que ceux-ci se voient reconnaître.
En effet, de manière générale, le statut du salarié pendant la formation (autrement dit ses conditions de rémunération et de protection sociale, ses obligations à l’égard de son employeur ou encore les modalités de prise en charge des coûts de formation) demeure tributaire du dispositif juridique dont cette dernière relève : plan de formation de l’entreprise, congé individuel de formation (CIF), droit individuel à la formation (DIF), validation des acquis de l’expérience (VAE), etc.
Aussi importe-t-il que pouvoirs publics, services des ressources humaines et organisations syndicales contribuent à la meilleure information possible des salariés sur les formations auxquelles ils peuvent prétendre. Il appartient par ailleurs aux entreprises et aux comités d’entreprise d’organiser des plans individuels incitatifs susceptibles de faire des salariés des interlocuteurs potentiels, au fait de la gouvernance des entreprises dans lesquelles ils travaillent et, notamment dans le cas des administrateurs appelés à siéger dans les conseils d’administration, parfaitement crédibles pour émettre un avis autorisé sur des options stratégiques.
Du point de vue de votre Rapporteure, à ces outils, il conviendrait d’ajouter le bénéfice d’une formation économique spécifique destinée aux délégués du personnel, aux membres du comité d’entreprise et aux administrateurs représentant les salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance.
La spécificité de cette formation doit tenir à deux éléments. Il s’agit, premier lieu, que le contenu des enseignements ainsi délivrés apporte les connaissances précisément nécessaires à l’exercice des fonctions de représentants du personnel. Il importe, en second lieu, que ces personnels ne soient pas placés de fait dans l’obligation de choisir entre une formation à visées strictement professionnelles et une formation leur permettant d’assumer leurs responsabilités de représentants. À cette fin, il conviendrait que les heures de formation économique spécifique dont bénéficient les salariés représentant le personnel ne soient pas décomptées des heures de formation auxquelles ils peuvent prétendre au titre du DIF. Cette orientation implique sans doute de définir strictement un contingent d’heures ad hoc, lequel pourrait éventuellement être fongible avec celui des heures de délégation, suivant les termes d’une négociation entre partenaires sociaux. Du point de vue de votre Co-rapporteur, cette fongibilité constitue une condition indispensable si l’on veut que la mise en oeuvre de nouveaux droits à formation – dont on ne peut contester ni la légitimité, ni l’opportunité – ne revête pas un caractère éventuellement problématique pour le fonctionnement des entreprises.
• S’agissant du fonctionnement de l’entreprise, la mission propose deux mesures destinées à stimuler, par le biais institutionnel, les échanges entre partenaires sociaux sur les enjeux ayant trait à l’efficacité de la gouvernance.
En premier lieu, la mission préconise que soit confiée aux salariés la présidence des comités d’entreprise.
Cette mesure, évoquée par certaines personnes entendues par la mission dont M. Jean-Louis Bianco, ancien ministre, représentant de la fondation Jean Jaurès (63), présente l’intérêt de pouvoir éventuellement revaloriser le rôle des comités d’entreprises et de permettre de mieux associer cette institution représentative du personnel majeure à la définition de la stratégie de l’entreprise. Aujourd’hui, la présidence de ces instances échoit à l’employeur, « éventuellement assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative » en application de l’article L. 2325-1 du code du travail.
Dans l’optique de conforter le rôle des institutions représentatives du personnel, il pourrait être souhaitable de modifier cette disposition sans pour autant exclure toute représentation de l’employeur dans le fonctionnement des comités d’entreprise.
En second lieu, la mission appelle de ses vœux la généralisation, au sein des conseils d’administration ou de surveillance, de véritables comités spécialisés dans la détection des risques des grandes entreprises françaises.
Certes, la mission peut volontiers admettre qu’il n’existe dans l’absolu aucune procédure susceptible de prémunir en tout temps l’entreprise contre des difficultés liées à des erreurs de stratégies, à des anticipations erronées ou à une insuffisante vigilance.
Dans cette optique, elle peut parfaitement prendre en compte l’analyse développée par de nombreuses personnes entendues par la mission et qui repose en partie sur l’observation d’expériences récentes. Ainsi, suivant l’analyse développée par M. David Azéma, commissaire aux participations de l’État, le risque fait partie intégrante de la création et de l’existence de l’entreprise. L’infaillibilité n’existe pas dans le monde des affaires. La notion de risque a pour corollaire celle d’échec, et il s’avère extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de se prémunir contre un risque de mauvais choix de stratégie et contre les faillites qu’il est susceptible d’entraîner. En atteste le sort connu par une entreprise telle que Kodak : la détérioration de la situation financière de Kodak est liée au fait que son concurrent Fujifilm a mieux réagi que lui face à l’arrivée de la technologie numérique ; aucune règle, qu’elle soit juridique ou comptable, ne pouvait prévenir les mauvais paris stratégiques de Kodak.
Toutefois, prendre acte de l’imperfection inévitable des dispositifs institutionnels face au large éventail de risques internes et externes, qui fait le lot des entreprises, ne justifie pas pour autant un désintérêt face au risque.
Selon les conclusions du G30 dont M. Jean-Claude Trichet a fait état au cours de son audition par la mission, en sa qualité de président du G30 et d’ancien président de la Banque centrale européenne, depuis la crise systémique des années 2007-2008, les entreprises ayant été les plus sujettes à défaillance ou ayant rencontré de graves difficultés sont celles dont le management avait négligé les risques de manière coupable. Or, l’éventualité d’une crise systémique demeure assez forte. Certaines des entreprises qui sont parvenues à surmonter le choc de 2008 peuvent croire aujourd’hui qu’elles doivent leur survie à une bonne gestion et ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour l’avenir. De la même manière, le consensus mondial sur des dispositions destinées à garantir la solidité du système économique qu’ont su établir un temps les gouvernements ne donne pas toujours lieu à des mesures nationales.
La mission peut parfaitement faire sien ce point de vue. Ainsi que M. Trichet, elle estime que, même s’il n’a pas à se substituer au management dans le contrôle des risques, le conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise doit néanmoins, de manière générale, s’assurer que celui-ci accomplit toutes les diligences nécessaires en ce domaine, notamment sur des questions vitales pour l’entreprise. En cela, la mission exprime une position similaire à celle de la Commission européenne qui, dans son Livre vert sur le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union européenne, affirme qu’ « une politique de gestion des risques efficace et cohérente doit clairement venir d’en haut, c’est-à-dire qu’elle doit être clairement définie par le conseil d’administration pour l’ensemble de l’organisation » (64). Il importe que les conseils d’administration s’imposent comme des interlocuteurs indépendants du management. Aussi, par-delà la responsabilité première de celui-ci, le conseil doit-il être en relation avec les superviseurs directs, en connaître les appréciations sur les risques potentiels pour l’entreprise, de sorte que ceux-ci soient correctement appréciés. Dans ce contexte, il faut refonder et renforcer tout un corpus d’analyse, l’expérience ayant révélé la faiblesse des analyses traditionnelles. Les procédures de contrôle des risques doivent faire l’objet d’un examen très attentif.
À cette fin, la mission juge indispensable que les grandes entreprises se dotent de véritables instances chargées, au sein des conseils d’administration ou de surveillance, d’évaluer et de signaler les risques.
Certes, on peut se féliciter de ce qu’à l’heure actuelle, la très grande majorité des entreprises dispose d’un comité d’audit, soit en l’espèce : 100 % des sociétés du CAC 40 ; 95 % des sociétés du SBF 80 ou 81% des sociétés du SBF 250 hors SBF 120 (65). Cela étant, la notion de risque ne se limite pas forcément à des questions d’ordre purement financier et la mission ne peut que retenir les remarques formulées par M. David Azéma suivant lesquelles il semble illusoire de miser sur les méthodes comptables pour dissiper tout risque.
On notera de surcroît que les missions assignées aux comités d’audit, notamment en vertu de l’article L. 823-19 du code de commerce, ne permettent pas réellement à cette instance d’appréhender les risques qui ne présenteraient pas un caractère financier. En effet, suivant cet article « sans préjudice des compétences des organes chargés de l’administration, de la direction et de la surveillance de l’entreprise », autrement dit les conseils d’administration ou de surveillance, les comités d’audit sont « notamment » chargés « d’assurer le suivi : a) Du processus d’élaboration de l’information financière ; b) De l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ; d) De l’indépendance des commissaires aux comptes. »
D’où l’intérêt de créer ex novo, un comité spécialisé au sein des conseils d’administration ou de surveillance, instance formée d’administrateurs non exécutifs possédant les qualifications requises afin d’apprécier les risques pour l’entreprise. Ce rôle ne peut être assumé par le comité d’audit.
Cela posé, la mission partage l’analyse de M. David Azéma, selon laquelle la mise en place d’un trop grand nombre de procédures de contrôle trop lourdes conduit en fait à la bureaucratisation des grandes entreprises. En effet, un formalisme excessif pourrait être propice à un accroissement de la déresponsabilisation, les mécanismes de contrôle de la gestion des entreprises fonctionnant alors suivant un esprit routinier.
Aussi, la mission préconise-t-elle que la création des comités des risques et les procédures qui commandent leur intervention dans le processus décisionnel des entreprises relève de règles et de recommandations des codes de gouvernance.
Les dirigeants comme les actionnaires des grandes entreprises semblent en effet assez bien placés pour déterminer, en ce domaine, les procédures les plus adaptées aux réalités du terrain, éventuellement de concert avec les commissaires aux comptes (66). Suivant les travaux du cabinet de conseil en politique de rémunérations Aon Hewitt, 53 % des sociétés du CAC 40 et 42 % des sociétés du SBF 80 disposent d’un comité de stratégie (67).
Il s’agit là d’une démarche qu’il conviendrait d’encourager et d’étendre au risque. Du point de vue de votre Rapporteure, il pourrait être utile de prévoir, dans les codes de gouvernance, l’obligation pour les comités spécialisés ainsi créés de fournir une information bi-annuelle aux conseils d’administration ou de surveillance ainsi qu’aux comités d’entreprise. En assurant une circulation optimale de l’information et en valorisant les travaux de tels comités spécialisés, cette procédure devrait avant tout concourir à une juste sensibilisation au risque de l’ensemble des organes ayant part à la gouvernance de l’entreprise. Elle pourrait ensuite leur permettre d’accomplir toutes les diligences nécessaires, par exemple en questionnant les membres de la direction ou en recourant à la procédure du droit d’alerte économique (68).
Proposition n° 11 : améliorer le dialogue social :
– en développant la formation économique délivrée aux salariés, une formation spécifique devant être assurée aux délégués du personnel, aux membres des comités d’entreprise, ainsi qu’aux administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance ;
– en confiant la présidence du comité d’entreprise à un représentant des salariés ;
– en complétant les codes de gouvernance par une recommandation invitant à créer des comités des risques au sein des conseils d’administration et de surveillance, les comités devant informer les conseils d’administration ou de surveillance ainsi que les comités d’entreprise deux fois par an .
En proposant ces mesures, la mission ne mésestime pas l’impact des procédures sur des pratiques qui souvent plongent leurs racines dans des traditions et des cultures professionnelles et sociales. Elle croit en revanche au jeu des institutions qui, à terme, peut induire une évolution des comportements et un rapprochement des analyses. Les procédures ne peuvent sans doute pas tout, mais leur réforme peut offrir des instruments permettant d’anticiper et de traiter les difficultés.
b) Organiser le dialogue social pour anticiper et traiter les difficultés des entreprises
De nombreuses personnes entendues par la mission ont mis en exergue cette réalité: du fait d’une organisation de plus en plus internationale des groupes, conjuguée à la complexification du droit social français, il existe un décalage croissant entre, d’un côté, la structuration de nos grandes entreprises, lesquelles déploient de plus en plus leurs activités à l’échelle mondiale, et de l’autre, les modalités de notre dialogue social. Ce hiatus crée des difficultés sur deux plans.
Il pose en particulier un problème de cohérence entre l’organisation des entreprises et la localisation des institutions représentatives du personnel prévue par le code du travail.
De l’analyse des représentants des salariés entendus par la mission, il ressort ainsi que certains groupes tendent à fractionner leurs activités en créant des sociétés dont la forme juridique, quoique résultant des dispositions mêmes du code de commerce, ne garantit pas nécessairement la présence d’institutions représentatives des salariés. Il s’agit par exemple des sociétés par actions simplifiées (SAS) régies par les articles L. 227-1 et suivants du code du commerce. En effet, la loi prévoit pour de telles formes de société des dérogations par rapport aux règles de droit commun applicables notamment aux sociétés anonymes (SA). Un problème analogue se pose parfois pour les sociétés de franchisés, les seuils prévus par le code du travail ne permettant pas, en raison des faibles effectifs de ces unités de production, d’imposer la mise en œuvre de procédures de droit commun, s’agissant notamment de la présence d’institutions représentatives du personnel ou de l’établissement d’un rapport de gestion consolidé sur la situation financière et l’évolution des affaires (69). Ainsi, suivant l’analyse développée notamment par M. Marcel Grignard, secrétaire national de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la gouvernance d’entreprises de taille relativement importante subit, dans ce cadre, une dilution, et le pouvoir des directions ne s’exerce pas nécessairement dans la transparence.
Une forme problématique de société pour le fonctionnement
des institutions représentatives du personnel :
Les sociétés par actions simplifiées (SAS)
La société par action simplifiée (SAS) se définit comme une société commerciale instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supporte(nt) les pertes qu’à due concurrence de son/leur apport. Régies notamment par les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, les SAS bénéficient de l’allègement d’un certain nombre d’obligations pesant sur les sociétés anonymes.
Ainsi, le seul organe de gestion obligatoire est un président mais la direction peut être confiée à un directeur général ou à un conseil ; la SAS peut être dotée d’un commissaire aux comptes ; les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires au sein des sociétés anonymes peuvent, dans les conditions fixées par les statuts, être exercées collectivement par les associés.
Du point de vue de la mission, il s’agit là d’une tendance préoccupante que les pouvoirs publics ne sauraient ignorer. La résolution de ce problème dépasse cependant la seule question de la gouvernance des grandes entreprises au sens strict car elle amène à s’interroger sur le bien fondé de tel ou tel particularisme par rapport aux normes encadrant le fonctionnement des sociétés anonymes.
La mission estime par conséquent que cette question doit être traitée dans le cadre d’une réforme plus globale qui s’intéresserait aux équilibres du code de commerce et aux interactions de celui-ci avec l’application des règles fixées par le code du travail en matière de dialogue social. Ainsi que l’a souligné M. Marcel Grignard, il apparaît de fait que le fonctionnement des institutions représentatives du personnel se caractérise par une relative complexité, la multiplication des instances au cours du dernier demi-siècle aboutissant à ce que l’investissement des élus ne se traduise pas nécessairement par des résultats concrets dans l’entreprise au plan social. Dans ces conditions, la transmission d’informations prévue par la loi peut intervenir trop tard ou à contretemps, du fait de la multiplicité des interlocuteurs rencontrés. Or, il convient que les représentants du personnel obtiennent davantage d’informations préalablement à la prise de décision afin qu’ils puissent jouer pleinement un rôle d’anticipation.
Par ailleurs, il importe de redéfinir les procédures de consultation et de fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Qu’il s’agisse des représentants des organisations d’employeurs ou des organisations représentatives des salariés, nombre des interlocuteurs de la mission s’accordent à penser qu’il convient aujourd’hui d’en finir avec un certain formalisme en matière d’information sur l’état des entreprises qui ne permet pas d’anticiper et de traiter leurs problèmes.
À cet égard, la mission estime nécessaire d’envisager au plus vite la réforme de la législation bâtie autour du délit d’entrave.
De manière générale, dans le domaine des relations du travail, constitue un tel délit tout obstacle mis au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel. L’atteinte ainsi incriminée par diverses dispositions du code du travail peut porter sur : la constitution d’un comité d’entreprise (70), d’un comité de groupe (71) ou d’un comité d’entreprise européen (72) (en empêchant, par exemple la première réunion de ces instances) ; la désignation de personnes relevant des institutions représentatives du personnel (par exemple, membres des comités d’entreprise, candidats à l’élection aux conseils des prud’hommes (73)), le fonctionnement d’un comité d’entreprise (s’agissant de l’utilisation du crédit d’heures alloué à ses membres, de la disposition d’un local ou de la tenue de ses réunions) ; l’accès à l’information délivrée aux instances représentative du personnel ; l’accès à la consultation.
Comme n’importe quelle autre infraction, le délit est constitué dès lors que sont réunis un élément matériel et un élément moral. L’élément matériel consiste en un comportement, en l’espèce une action ou une omission portant ou susceptible de porter atteinte à la législation concernant les institutions représentatives du personnel. L’élément moral résulte quant à lui du caractère intentionnel de l’acte ou de l’omission constitutive d’une méconnaissance des dispositions légales. Le délit d’entrave est puni par les diverses dispositions du code du travail par une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement peut être portée à deux ans et le montant de l’amende atteindre 7 500 euros. De surcroît, la victime peut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Or, l’étendue potentielle des atteintes que recouvre ce délit ne paraît pas de nature à faciliter une communication aisée sur les problèmes de l’entreprise avec les institutions représentatives du personnel.
Ainsi que l’a souligné devant la mission M. Paul Hermelin, président-directeur général de Capgemini et membre de l’AFEP, en l’état du droit, la direction d’une entreprise ne peut s’exprimer sur les difficultés éventuelles par anticipation et en dehors des procédures de consultation du comité d’entreprise. De fait, il pourrait être considéré qu’elle fait obstacle à l’accès à l’information auquel a droit le comité en ne suivant pas le déroulement des procédures de droit commun. Ce faisant, la législation bâtie autour du délit d’entrave tend à enfermer les employeurs dans une alternative assez stérile que M. Marcel Grignard a clairement exposée : soit préparer des décisions en catimini et mettre les institutions représentatives du personnel devant le fait accompli, soit communiquer préalablement à la saisine de ces dernières au risque de se rendre coupable d’un délit d’entrave.
Dans ces conditions, il apparaît que le code du travail séquence trop la transmission de l’information alors que les entreprises ont besoin de réactivité, et les salariés d’informations leur permettant de jouer un rôle d’anticipation face aux difficultés.
Afin de remédier à cette situation, la mission préconise l’adoption de procédures permettant un dialogue de long terme entre les partenaires sociaux qui permettraient aux employeurs de faire état de difficultés à venir de manière préventive.
À cette fin, elle juge qu’en premier lieu, il importe d’utiliser davantage et faire connaître des dispositifs existant en droit français tels que le droit d’alerte économique établi par les articles L. 2323-78 et suivants du code du travail. Sous réserve d’une évaluation approfondie des conditions concrètes de leur mise en œuvre, ces dispositions semblent en effet pouvoir donner au comité d’entreprise des moyens substantiels pour prévenir la survenue de difficultés préjudiciables à l’emploi et à la pérennité de l’entreprise. Ainsi, suivant l’article L. 2323-78 précité, « lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise. Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2325-23 ».
L’article L. 2323-80 du même code donne au dispositif toute sa portée en permettant au comité d’entreprise de saisir les organes dirigeants de l’entreprise et d’attirer leur attention sur des problèmes insuffisamment perçus. Il dispose en effet que « le rapport du comité d’entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique. Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information ».
En second lieu, il pourrait être également intéressant de s’inspirer des procédures qui, actuellement, font l’objet de réflexions au sein des institutions de l’Union européenne.
En l’espèce, on peut citer le rapport du Parlement européen concernant des recommandations à la Commission sur l’information et la consultation des travailleurs, l’anticipation et la gestion des restructurations (74). Portée par la commission de l’Emploi et des affaires sociales de cette assemblée, ce document comporte un certain nombre de dispositifs transposables en droit français, dans le cadre d’une réforme du délit d’entrave. D’une part, la recommandation n° 5 met à la charge des entreprises l’obligation de concevoir « en concertation avec les représentants des travailleurs (..) et, le cas échéant, avec les pouvoirs publics et les autres parties prenantes concernées, des stratégies de développement des ressources humaines adaptées à leurs conditions particulières, ainsi que des mécanismes d’anticipation et de planification des futurs besoins d’emplois et de compétence ». D’autre part, la recommandation n° 6 incite les entreprises et toutes leurs parties prenantes à anticiper les restructurations. Suivant la rédaction proposée, « Sauf dans des circonstances où la restructuration est provoquée par des événements imprévus ou soudains, toute opération de restructuration, en particulier lorsqu’elle est susceptible d’avoir des effets négatifs considérables, est précédée d’une préparation appropriée avec les parties prenantes concernées selon leurs compétences respectives, en vue de prévenir ou d’atténuer ses incidences économiques, sociales et locales ». La recommandation n° 6 associe également les salariés et pose le principe d’un dialogue préalable: « Toute opération de restructuration proposée devrait être pleinement expliquée aux représentants des travailleurs, qui devraient recevoir ces informations sur la restructuration proposée pour être en mesure d’entreprendre une évaluation approfondie et de se préparer aux consultations, le cas échéant ». « Cette préparation est effectuée le plus tôt possible et commence dès que le besoin de restructurer est envisagé, selon les méthodes et les procédures négociées, le cas échéant, au niveau du secteur, de la région ou de la société concernée. Sauf dans les circonstances exceptionnelles […], elle est conduite dans des délais qui permettent une véritable consultation de toutes les parties prenantes et l’adoption de mesures permettant d’éviter ou de réduire au maximum les incidences défavorables des points de vue économiques, social et local ». En outre, elle intègre parmi les parties prenantes de l’entreprise ayant à vocation à être informées de la possibilité d’une restructuration les sous-traitants : « les acteurs économiques locaux, notamment les entreprises et leurs travailleurs qui sont dans une situation de dépendance à l’égard de l’entreprise procédant à la restructuration, doivent également être informés dès le départ de la restructuration proposée. »
Enfin, le dispositif recommandé à la Commission européenne par le Parlement européen présente l’intérêt de comporter des éléments incitatifs pour que les entreprises s’approprient pleinement cette logique d’anticipation concertée des restructurations. Ainsi, la mise en place des plans proposés dans le libellé de la recommandation n° 5 relève tout d’abord de la négociation entre partenaires sociaux. Ensuite, le dispositif normatif qui pourrait entrer en vigueur sur le fondement de ces recommandations ne s’appliquerait qu’aux entreprises et aux salariés déjà « couverts par un accord conclu à l’échelon pertinent et avec les parties pertinentes sur les procédures d’anticipation des compétences ou d’évaluation des besoins d’emplois et de compétences ». Enfin, la recommandation n° 14 tend à établir une conditionnalité des aides publiques de l’Union européenne au respect des normes adoptées en matière d’anticipation et de gestion des restructurations. La recommandation propose à cette fin un texte suivant lequel « les États membres prévoient que les entreprises qui ne respectent pas la législation de l’Union ne bénéficient d’aucun financement provenant du budget de l’Union dans les cinq ans suivant une décision judiciaire constatant le manquement. »
Proposition n° 12 : réformer le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise pour permettre une meilleure anticipation des difficultés des entreprises.
C. MIEUX REPRÉSENTER LES FEMMES ET LES PERSONNES ISSUES DE LA DIVERSITÉ
Au regard des préoccupations que peut inspirer le souci légitime de préserver les droits des actionnaires investisseurs de long terme et de consacrer le rôle non moins décisif des salariés dans la gouvernance des entreprises, on pourrait penser que la place des femmes et des personnes issues de la diversité constitue un thème très périphérique.
Aux yeux des membres de la mission, il n’en est rien. Ils ont au contraire souhaité traiter de ces questions car la place des femmes et des personnes issues de la diversité leur semble être un élément concourant à la qualité de la gouvernance des grandes entreprises.
Il ne s’agit pas là seulement de convictions personnelles. De récentes études semblent démontrer l’existence d’une certaine corrélation entre la place occupée par les femmes dans la gouvernance des entreprises et les performances réalisées par ces dernières (75). Ainsi, en intégrant ces deux thématiques dans nos réflexions sur la gouvernance des grandes entreprises, nous ne faisons donc pas que poursuivre un objectif de justice et d’égalité. Nous nous intéressons à l’une des manières de rendre nos entreprises plus efficaces et donc mieux armées dans la compétition internationale.
C’est pour ces motifs que la mission entend examiner les moyens d’atteindre deux objectifs : faire de la parité une réalité dans tous les organes dirigeants des grandes entreprises ; faire de la diversité l’un des indices d’une gouvernance de qualité.
1. Faire de la parité une réalité dans tous les organes dirigeants des grandes entreprises
La réalisation de cet objectif dans notre pays conduit tout naturellement à s’intéresser à la mise en œuvre de la loi tendant à la parité dans les conseils d’administration ou de surveillance des grandes entreprises dite « loi Copé-Zimmermann » (76).
Promulgué le 27 janvier 2011, ce texte essentiel fixe aux entreprises privées (cotées ou répondant à certains critères tenant aux effectifs employés, au montant du chiffre d’affaire réalisé ou du bilan) comme aux entreprises publiques (77) une obligation : faire en sorte que les femmes représentent au moins 40 % des membres de leurs conseils à l’issue des assemblées générales de 2017 (78). À cette fin, la loi a mis en place un calendrier exigeant qui comporte des étapes intermédiaires auxquelles les entreprises doivent se conformer: à l’issue des assemblées générales de 2011, chaque sexe devait être représenté dans les conseils ; après les assemblées générales de 2014, les conseils devront compter au moins 20 % d’administrateurs de chaque sexe. Ce dispositif comporte en outre une mesure qui se présente sinon comme une sanction du moins comme un instrument incitatif : la nullité des nominations d’administrateurs qui, intervenant après l’entrée en vigueur de la loi, n’auraient pas pour effet de remédier à une irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance au regard des objectifs successifs que celle-ci prescrit à chaque étape de sa mise en œuvre.
D’après les données dont la mission peut aujourd’hui prendre connaissance, les premiers bilans de l’application de ce dispositif se révèlent globalement très encourageants. Ce motif de satisfaction ne doit pas pour autant donner à penser que la cause est entendue. Par-delà les chiffres, il convient en effet de surmonter des obstacles persistants à la parité et de favoriser l’exercice par les femmes de postes de direction exécutive.
a) Prendre la juste mesure et dépasser les premiers objectifs atteints
Indéniablement, l’entrée en vigueur des dispositions de la loi « Copé-Zimmermann » constitue une source de progrès rapides et majeurs pour la féminisation des conseils d’administration ou de surveillance des grandes entreprises françaises.
D’après les chiffres extraits du bilan établi par Ethics & Boards et communiqués à la mission, le pourcentage de femmes siégeant dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance des sociétés du CAC 40 s’élève actuellement à 24,07 % (contre 8,5 % en 2008 et 20 % en 2011). Il s’agit donc d’une progression assez spectaculaire. Par exemple, aucune femme ne représentait l’État dans les conseils d’administration des sociétés du CAC 40 il y a deux ans.. Aujourd’hui, on recense 5 femmes parmi les 21 représentants de l’État dans les sociétés du CAC 40. L’amélioration constatée résulte de la cotation en octobre 2012 de Safran (dont le conseil d’administration comprend trois femmes administratrices) et de la nomination d’administratrices à France Télécom et à GDF. Au palmarès des sociétés du CAC 40 respectant le mieux le principe de parité, figurent, selon les données dont ont fait état les représentants du think thank « République et diversité » : la société Publicis (avec une parité parfaite de sept femmes et sept hommes) et la Société générale (avec 37 % de femmes parmi les membres de son conseil d’administration).
Les chiffres rendus publics par le cabinet Ernst & Young (79) illustrent une évolution aussi sensible parmi les entreprises du SBF 120, avec une proportion de femmes dans les conseils qui est passée de 8 % en 2010 à 15 % en 2012. Dans les sociétés de plus petite taille, les « Midcaps », les conseils d’administration sont composés de 13 % de femmes contre 10 % en 2012.
Ainsi, suivant ces deux sources, la France se trouve en pointe en matière de féminisation des conseils d’administrations par rapport à ses principaux partenaires économiques. Les taux observés en la matière au sein des conseils des sociétés du CAC 40 dépassent en l’occurrence ceux observé pour les sociétés du Dow Jones (21, 3 % au 30 juin 2012) ou du Footsie (16,6 % à cette même date) selon les éléments fournis par Ethics & Boards.
Toutefois, les statistiques montrent également que l’impact de la loi « Copé Zimmermann » peut être relativisé car elle n’induit pas pour autant une progression de la représentation des femmes dans l’ensemble des organes dirigeants des grandes entreprises, et notamment dans les comités exécutifs (« comex »).
Certes, il apparaît que les groupes français semblent assurer aux femmes une plus grande place dans leurs équipes dirigeantes que leurs homologues d’Europe continentale. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude menée par le cabinet de recrutement Heidrick & Struggles en partenariat avec European Professionnal Women’s Network (80). Reposant sur un panel de 19 grandes entreprises de l’EuroStoxx 50, dont douze entreprises françaises, cette étude montre que si 45 % des entreprises du panel comptent en moyenne au moins une femme exerçant des responsabilités exécutives (et 20 % deux ou plus), cette proportion atteint près de 75% pour les entreprises françaises. Du reste, en leur sein, la proportion de femmes responsables d’une division opérationnelle connaît un triplement en six ans en atteignant le pourcentage de 29 %. Cependant, l’étude relève par ailleurs que 71 % des femmes exerçant des fonctions exécutives dans les entreprises françaises observées dirigent des fonctions support (communication, ressources humaines, etc.). Sachant que les fonctions support ne sont pas toujours représentées dans les organes dirigeants des entreprises françaises, ces données offrent un aperçu de la faible féminisation des comités exécutifs.
De fait, les femmes occupent relativement peu de poste à haute responsabilité exécutive dans la direction des grandes entreprises.
L’ensemble des statistiques disponibles fournit de nombreuses illustrations de cet état de fait. Ainsi, suivant les chiffres communiqués à la mission par Ethics & Boards (81), au 30 septembre 2012, on ne recensait aucune femme exerçant les fonctions de présidente ou de directrice générale à la tête des entreprises du CAC 40. Seules deux femmes occupaient à cette date le poste de présidente du conseil de surveillance (à Publicis Groupe et chez Pernod Ricard). Dans 16 des 39 sociétés du CAC 40 ayant fait l’objet d’un suivi, le comité des nominations ne comprend pas une représentation équilibrée des deux sexes. D’après l’étude des instances dirigeantes des entreprises du CAC 40 réalisée par Ethics & Boards, dans 11 des 15 sociétés du CAC 40 sur lesquelles des informations sont disponibles, aucune femme ne se trouve dans les comités exécutifs.
Au final, le taux de féminisation de ces comités s’élève en moyenne à 8,88 %. En outre, les sociétés dont le siège social ne se trouve pas établi en France se caractérisent par un pourcentage de femmes siégeant dans les conseils d’administration inférieur à 20 %.
La place des femmes dans les conseils d’administration
des grandes entreprises aux États-Unis
D’après les conclusions de l’étude réalisée par Alliance for Board Diversity concernant la place des femmes dans la gouvernance des entreprises américaines et dont a fait état Mme Ellen Kountz, ancien membre du comité de direction de Democrats Abroad France, les conseils d’administration des sociétés cotées au marché boursier homologue du SBF120 aux États-Unis se composent à 15 % de femmes blanches, à 3,5 % de femmes de couleur.
Dans le panel étudié dans un rapport de la Securities and Exchange Commission (SEC), le pourcentage de femmes dans les comités de direction s’établit à 30%. Il apparaît que les femmes de couleur siègent plutôt dans les comités d’audit qu’au sein des comités des rémunérations aux États-Unis. Ce décalage entre la place des femmes au sein des organes dirigeants des entreprises et leur poids démographique (51 % de la population américaine) n’est pas accepté par le corps social.
D’après les chiffres communiqués à la mission par M. Paul Lanois, avocat et auteur de « L’effet extraterritorial de la loi Sarbanes-Oxley », à partir d’une étude réalisée en juillet 2012,
36 % des sociétés américaines ne compteraient pas de femme au sein de leur conseil d’administration. Il existe néanmoins une très grande disparité en fonction des États : au Texas par exemple, 52% des entreprises n’auraient ainsi nommé aucune femme au sein de leur conseil d’administration.
Il ressort ainsi des éléments recueillis par la mission qu’aux États-Unis, les femmes demeurent confrontées à certains obstacles qui les placent dans une situation comparable à celle observée en Europe.
Derrière ces chiffres, il apparaît que des obstacles persistants sont à lever qui renvoient au concept désormais célèbre de « plafond de verre » et appellent, de la part des pouvoirs publics, mais également de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise, un engagement et l’adoption de mesures incitatives.
b) Encourager l’ascension des femmes à des postes dirigeants
Les statistiques précédemment évoquées sur la place des femmes dans les comités exécutifs en apportent la preuve : l’établissement d’une véritable parité dans les instances dirigeantes des grandes entreprises ne passe pas seulement par l’application d’un dispositif normatif, aussi ambitieux soit-il.
Il va de soi que dans les mois à venir, les pouvoirs publics devront veiller à la stricte application des objectifs fixés par la loi « Copé-Zimmermann ». Dans la situation actuelle, la mission ne juge pas nécessaire d’en accélérer la mise en œuvre : les efforts déjà fournis par les grandes entreprises françaises apparaissent en effet très significatifs et il importe de promouvoir une réelle féminisation de leurs conseils dirigeants d’un point de vue tant numérique que, surtout, qualitatif. En effet, le propos ici n’est pas d’inciter les entreprises à atteindre l’objectif final de 40 % par une marche forcée qui pourraient se traduire par des nominations d’affichage et une féminisation factice.
Cela étant, rien n’interdit aux pouvoirs publics de mener des actions complémentaires et de ne pas s’en tenir à la seule application de la loi sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration.
En premier lieu, on peut penser que des mesures réformant la gouvernance des grandes entreprises pourraient, même indirectement, conforter cette promotion de la parité en favorisant la diversification des modalités de recrutement au sein des conseils. Telle est en tout cas la conclusion qui ressort de l’exposé présenté par Mme Ellen Kountz devant la mission. Suivant son analyse, l’obligation posée par la loi américaine de recruter des administrateurs indépendants (82)et de fournir des éléments sur les critères de nomination (83), même diversement appliquée, aurait ainsi permis l’abandon de procédures de cooptation et la nomination de davantage de femmes dans les conseils. Même si la mission ne possède à ce jour aucune étude sur l’impact exact de ces dispositifs, l’idée que la transparence des modes de recrutements puisse jouer en faveur de la féminisation ne lui semble pas intellectuellement hors de propos.
En second lieu, la mission estime que la France pourrait donner toute sa dimension au dispositif de la loi « Copé-Zimmermann » en soutenant les mesures en cours d’élaboration à l’échelle de l’Union européenne.
Aussi a-t-elle noté avec intérêt l’initiative, évoquée par M. Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des Finances, d’un courrier du Gouvernement français adressé à la Commission européenne qui, sous la signature du ministre de l’Économie et des finances et de la ministre des Droits des femmes, affirmerait le désir de la France que l’Union européenne se dote de norme d’inspirant du cadre établi dans notre pays. La mission juge que la France devrait participer à l’adoption de dispositifs susceptibles de fixer des objectifs ambitieux à l’ensemble des grandes entreprises de l’Union européenne. Dans cette perspective, il convient de suivre l’évolution de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes, présentée par la Commission européenne le 14 novembre 2012 (84).
Briser le « plafond de verre » suppose en effet de surmonter le poids de certaines représentations véhiculées par la société et des perceptions dans lesquelles les femmes elles-mêmes sont entretenues.
La nécessité de s’affranchir de stéréotypes presque culturels transparaît dans nombre d’études. Celle réalisée par le cabinet de conseil Diverseo (85) semble confirmer ainsi l’existence de critères inconscients qui conditionnent la sélection des dirigeants au détriment des femmes. Selon cette étude, si 69 % des individus considèrent que les hommes et les femmes font d’aussi bons dirigeants, 55 % des personnes sondées accorderaient davantage leur confiance à un homme plutôt qu’à une femme, même si l’homme leur est inconnu et que la femme a fait ses preuves. Ce choix s’explique par un certain nombre de schémas : les personnes interrogées associent les femmes à des comportements moins empreints d’autorité et à des responsabilités familiales ; dans leur inconscient, celles-ci ne correspondent pas à l’archétype du dirigeant qui renvoie traditionnellement à des valeurs ayant part dans l’exercice du pouvoir ou l’expression d’une virilité.
De leur côté, les femmes peuvent éprouver des difficultés à se positionner et à envisager l’exercice de hautes fonctions exécutives, indépendamment de leurs compétences réelles qui reposent souvent sur un capital universitaire supérieur à celui des hommes. Ainsi, selon les travaux réalisés par la société de consulting en management Mac Kinsey & Company (86), seulement 18 % des femmes ayant atteint un niveau de direction opérationnelle ou fonctionnelle déclareraient vouloir intégrer la direction générale alors que ce souhait est émis par 36 % des hommes.
Il importe donc de modifier des perceptions parfois anciennes. Pour ce faire, la mission préconise que soient inscrites dans les codes de gouvernance des mesures favorisant l’intégration des femmes aux comités de direction ou comités exécutifs (« comex »).
Le choix du cadre de l’autorégulation se justifie par la volonté que les entreprises s’approprient pleinement l’enjeu que constitue la promotion de la parité dans leurs instances dirigeantes. Il faudrait ainsi que les comités de nomination comptent davantage de femmes. Du reste, nombre de grandes entreprises adoptent des dispositifs intéressants de promotion des femmes à des postes de direction (87).
La formation apparaît ici comme une action décisive afin de donner aux femmes les compétences nécessaires à leur crédibilité et à leur efficacité dans l’exercice des fonctions d’administrateurs et constituer un vivier.
Mais il importe également de prévenir la perpétuation de schémas ou de pratiques de recrutement qui conduisent à demander aux femmes de posséder les seules qualités attribuées aux hommes, pratiques nuisant à la promotion de la parité. Dans ce but, il convient de recommander l’organisation plus systématique de formations à la parité dans les entreprises qui s’adresseraient aux managers et aux responsables des ressources humaines.
Par-delà l’amélioration des compétences personnelles de ces responsables, ces formations doivent en outre inspirer aux directions d’entreprises la nécessité d’une politique de ressources humaines au plein sens du terme. Ces politiques doivent se donner pour objectif que les femmes soient placées en situation de bénéficier de promotions internes et d’être nommées à des postes de responsabilité exécutive afin de créer un vivier de futures dirigeantes. Par cette orientation, les politiques de ressources humaines pourraient offrir un moyen de surmonter un handicap dont souffrent souvent les femmes et qu’identifient nombre d’observateurs, à l’instar de Mme Julie Battilana (88) : une bien moindre intégration que leurs homologues masculins aux réseaux d’influence de leur entreprise qui nuit à leur progression relative vers les sommets de la hiérarchie.
2. Faire de la diversité l’un des indices d’une gouvernance de qualité
Au vu des statistiques établies à ce propos, l’objectif d’assurer à nos compatriotes d’origine étrangère (89) une place égale, en fonction de leurs compétences et de leurs talents, demeure plus que jamais d’actualité.
D’après les conclusions de l’étude de République & diversité énoncées par M. Adrien Rogissart devant la mission, les personnes issues de la diversité ne représentent aujourd’hui que 4,5 % des membres des conseils des sociétés du CAC 40. Seules cinq entreprises comptent au sein de leurs conseils plus de 10 % de personnes issues de la diversité, celles-ci étant complètement absentes de 21 sociétés du CAC 40. Dans le palmarès des entreprises en pointe en matière de diversité, on trouve Arcelor Mittal (28 % des membres du conseil), Renault (15,5 %) et Danone (14 %). Il s’avère que les entreprises exemplaires en matière de parité au sein de leurs organes dirigeants ne figurent pas nécessairement parmi celles qui recrutent le plus de personnes issues de la diversité au sein de leurs conseils. Par exemple, on remarquera que le conseil de surveillance de Publicis Groupe n’en compte aucune.
De surcroît, la diversité affichée dans la gouvernance de certaines entreprises peut revêtir un caractère assez largement factice. Exploitant les conclusions de l’étude réalisée par République & diversité, M. Adrien Rogissart a ainsi relevé que même si Arcelor-Mittal se classe premier dans le palmarès de la diversité, il convient néanmoins de s’interroger sur la réalité de celle-ci, dès lors que siègent au sein du conseil du groupe des parents et amis proches du président-directeur général.
Ces éléments tendent à démontrer que l’entre-soi demeure la règle dans les entreprises du CAC 40. Les managers et les recruteurs n’ont pas mesuré l’importance décisive d’une expertise diversifiée, émanant de personnes ne venant pas des mêmes milieux, alors que les entreprises doivent s’adapter afin de tenir leur rang sur les marchés mondiaux.
Dans cette optique, la mission peut partager l’analyse faîte par un certain nombre d’interlocuteurs de la mission, dont Mme Floriane de Saint Pierre, fondatrice et présidente d’Ethics & Boards : un conseil d’administration doit, par sa composition, offrir une diversité d’expertises et de compétences avant tout en rapport avec la stratégie de l’entreprise, laquelle peut se traduire par une diversité des nationalités, des origines géographiques et des âges. Le recrutement de personnes issues de la diversité peut permettre aux entreprises de s’assurer de compétences culturelles ou d’une proximité avec certains milieux sociaux souvent très utiles au développement d’une stratégie, notamment pour des groupes d’envergure mondiale.
Ainsi s’explique d’ailleurs la présence dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés du CAC 40, en 2012, près de 23 % d’administrateurs de nationalité étrangère d’après le panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises établi par Ernst & Young (90). Au-delà de ce qu’elle traduit de l’importance considérable des actionnaires étrangers sur la place de Paris, ainsi que l’a fait remarquer Mme Ellen Kountz (91), cette présence d’administrateurs étrangers permet aux entreprises d’intégrer à leur plan d’affaires les compétences dont elles ont besoin pour la conduite de leur stratégie.
Pour ce qui est de l’intégration des personnes issues de la diversité, on ne peut pas exclure qu’à terme, un risque de réputation et des questions d’image conduisent les grandes entreprises à vouloir procéder à un recrutement plus diversifié.
Aussi, la mission estime nécessaire d’amener les entreprises à davantage communiquer, devant les marchés et l’opinion publique, sur le recrutement des personnes issues de la diversité.
À cette fin, elle préconise d’étoffer le rapport de gestion prévu par l’article L. 225-102-1 du code de commerce sur les questions de diversité. Il s’agirait par ce biais d’obliger les entreprises à rendre publiques des informations concernant la diversité des origines, des profils, des parcours (universitaires, promotion interne ou recrutement externe…) des dirigeants-mandataires sociaux. Le propos de cette mesure n’est en aucun cas d’établir un fichage ethnique, notion qui recouvre en réalité l’association pérenne, dans une base de données, d’informations concernant l’appartenance à un groupe ethnique, ce que la loi française interdit seulement. Elle a pour finalité de disposer d’informations sur le profil des administrateurs recrutés de façon à détecter éventuellement sinon des discriminations, du moins une insuffisante sensibilisation à la promotion de personnes compétentes issues de la diversité.
Dans cette perspective, il convient de préciser le contenu des obligations informatives posées par le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1, qui prévoit déjà d’inclure dans le rapport de gestion « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. ».
Du point de vue de votre Rapporteure, cette obligation informative devrait être complétée en précisant, dans le dispositif de cet article, l’obligation pour les entreprises d’adopter des plans d’actions en faveur du développement de la diversité dans les conseils d’administration ou de surveillance.
Proposition n° 13 : améliorer la quantité et la qualité des informations du rapport de gestion prévu par l’article L. 225-102-1 du code de commerce sur les questions de diversité, et notamment sur la diversité des origines, des profils, des parcours (universitaires, promotion interne ou recrutement externe…) des dirigeants-mandataires sociaux ;
Prévoir l’obligation pour les entreprises d’établir des plans d’action en faveur du développement de la diversité dans les conseils d’administration ou de surveillance (proposition de votre Rapporteure).
Ce rapport de gestion enrichi ne peut que constituer un instrument au service d’une politique de ressources humaines qui traite tout autant de la place des femmes que celle des personnes issues de la diversité dans la gouvernance des grandes entreprises.
Du point de vue de votre Rapporteure, cette politique ne peut résulter que d’une impulsion des conseils d’administration ou de surveillance. Mais encore faut-il que le flux des questions qui remontent vers ces instances laisse à leurs membres le loisir de se pencher spontanément et de manière fréquente sur ce type de questions. Ainsi, d’après le « Panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises » établi par Ernst & Young (92), la mention de l’existence d’une procédure de recrutement des membres du conseil menée par le comité de nomination ne figure, parmi les thèmes de travail abordés par ces comités, que pour 33,3 % des sociétés du CAC 40. Aussi votre Rapporteure estime-t-elle que par les codes de gouvernance devraient inciter les entreprises à la nomination, au sein des conseils d’administration ou de surveillance ainsi que dans les comités exécutifs, de personnes qui disposent de compétences particulières ou d’une expérience significative en matière de gestion des ressources humaines. Ce faisant, les entreprises françaises adopteraient une pratique permettant d’accorder l’importance qu’elle mérite à la place des femmes et des personnes issues de la diversité dans la gouvernance des entreprises et qui, aux États-Unis, apparaît assez répandue.
Par-delà la spécificité des enjeux et des difficultés qu’elles soulèvent, les questions relatives à la promotion de la parité et de la diversité au sein des conseils d’administrations représentent autant de défis qui révèlent combien la gouvernance des entreprises intéresse au premier chef la vie de la cité.
III. – POUR UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE AU SERVICE DE STRATÉGIES DE LONG TERME
Les dérives qui ont pu être constatées en matière de gouvernance des grandes entreprises procèdent en bonne part d’une déresponsabilisation des dirigeants-mandataires sociaux. Celle-ci a été entretenue par des rémunérations qu’il conviendrait de soumettre à une fiscalité plus adaptée et à un contrôle plus poussé des actionnaires.
Les actionnaires, pour leur part, devraient par ailleurs être mieux informés des conditions de fonctionnement des organes dirigeants des grandes entreprises, comme l’ont suggéré certaines des personnes entendues. Cette préoccupation semble partagée par la Commission européenne qui a fait de l’amélioration de l’information sur la gouvernance d’entreprise l’un des éléments-clés du plan d’action qu’elle a publié le 12 décembre dernier (93).
Tout en mettant en garde contre une transparence intégrale qui pourrait être nuisible au secret des affaires, Me Najib Saïl, avocat spécialiste des fusions-acquisitions et des marchés financiers, a proposé de contraindre les grandes entreprises à publier, notamment sur Internet, un certain nombre d’informations relatives au fonctionnement de leur conseil d’administration ou de surveillance, et plus particulièrement le règlement intérieur de ces conseils – ce qui avait déjà été proposé à l’occasion des débats sur la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite « loi NRE »).
Si la mission s’accorde à considérer, avec Me Najib Saïl, que la publication du règlement intérieur des conseils peut être une initiative bienvenue, elle estime que cette publication devrait faire l’objet d’une recommandation d’un code de gouvernance plutôt que d’une disposition législative contraignante.
La méthode de l’auto-régulation devrait également être privilégiée s’agissant du souhait, formulé par certaines des personnes entendues, que soit fixé dans les règlements intérieurs des conseils d’administration ou de surveillance un délai minimal entre la date à laquelle les documents soumis aux membres de ces conseils leur sont communiqués et celle à laquelle ces conseils se réunissent pour en débattre.
Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), a en effet déploré que les documents soumis à l’examen des membres des conseils d’administration ou de surveillance ne leur soient bien souvent fournis que la veille, voire le jour même, de la réunion du conseil. S’il est vrai que ces documents sont souvent étudiés de façon approfondie au sein des comités spécialisés des conseils auxquels participent certains administrateurs, la mission convient néanmoins avec Mme Colette Neuville qu’il faut donner à l’ensemble des administrateurs qui sont appelés à voter le temps de s’y pencher afin que leur décision soit prise en connaissance de cause.
À cette fin, M. Didier Cornardeau, président de l’Association des petits porteurs actifs (APPAC), a préconisé de fixer un délai minimal, par exemple dans le règlement intérieur, entre la date à laquelle les documents sont communiqués aux membres des conseils d’administration ou de surveillance et celle à laquelle le conseil d’administration ou de surveillance est réuni pour les examiner.
La mission estime que cette recommandation pourrait utilement figurer dans des codes de gouvernance.
A. ENCADRER PLUS STRICTEMENT LE CUMUL DES MANDATS SOCIAUX
Dans le cadre d’une réflexion axée précisément sur l’objectif de responsabilité dans la gouvernance des grandes entreprises, on ne peut éviter de traiter à nouveau de cette problématique, objet de multiples controverses en raison de son impact supposé sur la qualité du processus décisionnel des entreprises ainsi que sur la perception de rémunérations par le cercle de leurs dirigeants.
Même si l’on doit prendre acte des progrès sensibles qui, en ce domaine, ont pu être enregistrés notamment grâce à la diffusion des codes de gouvernance, la mission juge pour sa part que l’on ne saurait s’en tenir au cadre légal actuel. Il importe au contraire, par le renforcement des obligations de ce dernier, de conforter l’exigence de disponibilité et d’indépendance des administrateurs qui le sous-tend.
1. Renforcer un cadre légal formellement bien respecté mais n’empêchant pas des situations problématiques
En application des articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce (94), les administrateurs ne peuvent détenir simultanément plus de cinq mandats de membres d’un conseil d’administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. La loi établit donc une limitation du cumul des mandats sociaux nombre de mandats détenus mais également de leur exercice dans le temps.
D’après les éléments aujourd’hui disponibles, il apparaît établi que le non-cumul des mandats constitue une norme assez bien intégrée dans les pratiques des dirigeants-mandataires sociaux et des administrateurs non-mandataires sociaux des sociétés du CAC 40.
D’après les statistiques établies par l’AFEP et le MEDEF, que corroborent les chiffres publiés par l’AMF, 48 % des dirigeants mandataires sociaux ne disposent pas d’autres mandats que leurs fonctions exécutives à titre principal. 21 % d’entre eux exercent au moins trois mandats et 10 % au moins quatre mandats.
CUMUL DE MANDATS POUR LES MANDATAIRES SOCIAUX EXÉCUTIFS ET NON EXÉCUTIFS
Nombre de mandats sociaux |
Mandats exécutifs |
Mandats non exécutifs | ||
Nombre de mandataires |
Proportion (en %) |
Nombre de mandataires |
Proportion (en %) | |
1 mandat |
29 |
48 % |
9 |
36 % |
2 mandats |
19 |
31 % |
5 |
20 % |
3 mandats |
7 |
11 % |
4 |
16 % |
4 mandats |
3 |
5 % |
7 |
28 % |
5 mandats |
1 |
2 % |
0 |
0 % |
6 mandats |
2 |
3 % |
0 |
0 % |
7 mandats |
61 |
100 % |
25 |
100 % |
Source : AMF.
Mandats exécutifs : président-directeur général, directeur général, gérant ou président du directoire.
Suivant cette même source, 83 % des administrateurs exécutifs des sociétés du CAC 40 n’exercent qu’un seul mandat dans le périmètre des sociétés relevant de cet indice. L’AMF recense 74 administrateurs en situation de cumul, 80 % d’entre eux n’exerçant que deux mandats dans ses sociétés. Seul un administrateur détient cinq mandats dans des sociétés du CAC 40.
Mandats non exécutifs : président du conseil d’administration ou président du conseil de surveillance
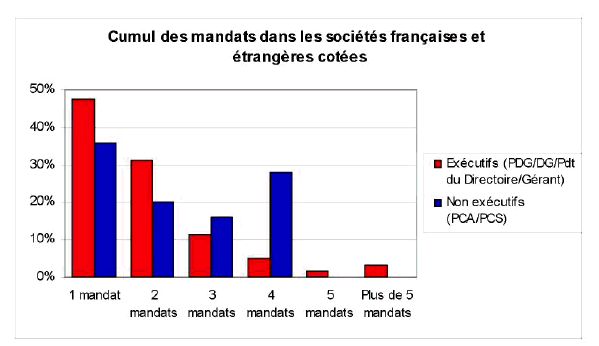
Source : AMF.
Toutefois, il s’avère que la mise en œuvre de ce dispositif n’empêche pas des cumuls de mandats susceptibles d’apparaître comme problématiques.
Certes, les articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce imposent à tout administrateur « qui se trouve en infraction » avec les règles que ces deux textes édictent « de se démettre de l’un de leurs mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l’événement ayant entraîné la disparition » de l’une des conditions permettant d’y déroger que ceux-ci prévoient. Mais précisément, les modalités de comptabilité des mandats pris en compte pour appliquer la limitation du cumul prévue par le code de commerce peuvent apparaître aujourd’hui insuffisantes dans la mesure où notamment, ces règles ne portent que sur les mandats exercés dans des sociétés anonymes établies en France.
Ainsi, dans son rapport 2012, tout en montrant le caractère exceptionnel de ce genre de situations, l’AMF cite deux cas dans lesquels le cumul peut apparaître déroger très sensiblement aux pratiques recommandées dans le cadre de l’application des codes de gouvernance.
Citons par exemple le cas assez hors norme du président-directeur général du groupe Bolloré : suivant le rapport précité de l’AMF (95), celui-ci détenait en octobre 2012 onze mandats d’administrateur dans des sociétés cotées, dont dix hors de son groupe, deux dans des sociétés françaises, sept dans des sociétés étrangères et un au sein de la société mère Financière de l’Odet.
En ce qui concerne les administrateurs non-exécutifs au sein des sociétés du CAC 40, on relèvera avec l’AMF que seules deux sociétés n’ont aucun administrateur commun avec d’autres sociétés du CAC 40. Du reste, suivant cette même source, plus de la moitié des sociétés du CAC 40 étudiées voient entre 20 % et 40 % de leurs administrateurs non-exécutifs non-mandataires sociaux siéger au conseil d’au moins une autre société du CAC 40.
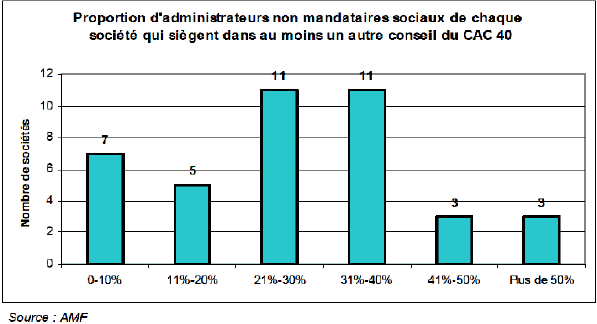
2. Dissiper toute incertitude sur la disponibilité et l’indépendance des administrateurs
Il s’agit là de l’objectif principal du renforcement du cadre législatif que la mission appelle de ses vœux et que nombre des acteurs de la gouvernance semblent pouvoir partager.
Cet objectif se justifie d’autant mieux que nombre d’études sur la gouvernance montrent l’inégale transparence des sociétés en ce qui concerne les mandats détenus par les administrateurs. Telle est la conclusion qui se dégage des études réalisées par le cabinet Ernst & Young : suivant les statistiques établies par ce cabinet (96), 56,4 % des sociétés du CAC 40 et 53,8 % des sociétés du SBF 120 établissent dans les informations qu’elles communiquent une distinction claire entre les mandats d’administrateurs de leur groupe et ceux exercés hors du groupe ; de même, seules 41 % des sociétés du CAC 40 et 27,5 % des sociétés du SBF 120 distinguent clairement entre les mandats d’administrateurs selon qu’ils sont exercés dans les sociétés cotées ou dans les sociétés non cotées. Or ces imprécisions contribuent à favoriser une suspicion inutile dans la mesure où l’on ne peut mettre en cause l’assiduité des administrateurs aux séances des conseils d’administration et de surveillance.
Le rythme de travail des Conseils en 2012 |
CAC 40 |
SBF 120 |
Midcaps |
Mention du taux d’assiduité des membres du Conseil |
100 % |
98 % |
88 % |
Taux d’assiduité aux réunions du Conseil (hors comités) |
90 % |
89 % |
87 % |
Mention du taux de présence individuel des membres du Conseil |
21 % |
15 % |
2 % |
Mention du nombre de réunions annuelles du Conseil |
100 % |
99 % |
98 % |
Nombre de réunions annuelles du Conseil (hors comités) |
8,8 |
7,6 |
6,3 |
Source :Ernst & Young. Panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises, édition 2012, octobre 2012.
Pour autant, l’assiduité ne permet pas de préjuger de la capacité réelle à approfondir les dossiers concernant les options stratégiques propres à une entreprise. Dans cette optique, la limitation du cumul des mandats sociaux apparaît comme de nature à assurer une meilleure disponibilité des administrateurs et des dirigeants-mandataires sociaux en même temps qu’à limiter les conflits d’intérêt liés à des « participations croisées ».
Comme nombre de personnes qu’elle a entendues, la mission conçoit difficilement que siéger dans plusieurs conseils d’administration ou de surveillance favorise une connaissance approfondie des caractéristiques et des enjeux propres à une société. En revanche, il lui semble qu’au moins théoriquement, les « participations croisées » peuvent ne pas favoriser l’exercice de l’esprit critique attendu des administrateurs. Ce risque peut survenir, sinon du fait de réelles solidarités inhérentes aux phénomènes d’entre-soi, du moins en raison d’une communauté de vues que favorise la fréquentation régulière des mêmes instances de régulation.
De ce point de vue, parallèlement à la problématique de l’encadrement du cumul des mandats sociaux, la mission n’a pu manquer de se pencher sur la question du cumul d’un contrat de travail avec la qualité de mandataire social.
Le statut de mandataire social se distingue de celui de salarié en ce qu’ il exclut en principe tout lien de subordination vis-à-vis du mandant. Les mandataires sociaux ont à rendre compte de leurs actes devant les organes de la société qui les ont nommés. Le mandataire peut être librement révoqué par la société sans préavis et sans indemnité (révocation ad nutum). Cette liberté de révocation constitue une règle d’ordre public qui, a priori, ne peut être mise en échec.
Néanmoins, la législation en vigueur autant que la jurisprudence ménagent la possibilité d’un cumul entre mandat social et contrat de travail, sous réserve que le mandataire :
— exerce, dans le cadre de son contrat de travail, des fonctions techniques réelles et nettement dissociées des fonctions relevant du mandat, exercice qui ne peut être prouvé par la seule production d’un bulletin de paie (97);
— perçoive une rémunération distincte pour ses activités de salarié et sa fonction de direction ;
— soit soumis à un lien de subordination juridique qui ne saurait résulter des seules directives émanant du conseil d’administration.
En outre, le contrat de travail ne doit pas avoir été conclu dans le seul dessein de faire obstacle à la libre révocabilité du dirigeant. Notons enfin qu’en principe, l’exercice d’un mandat social aboutit à la suspension du contrat de travail d’un salarié car, en devenant mandataire social, il cesse d’exercer des fonctions techniques distinctes et ne se trouve plus dans un rapport de subordination juridique (98).
Sur ce point, la mission juge que les responsabilités particulières qu’assument les dirigeants-mandataires sociaux au sein de l’entreprise doivent, en principe, conduire à une distinction plus nette entre leur statut et celui de salarié dans la mesure où, la jurisprudence, autant que la pratique des entreprises, tendent déjà à atténuer dans les faits la précarité qui s’attache à leur situation juridique. Du reste, conformément à la position définie dans le « code AFEP-MEDEF » et qui a été réaffirmée par M. Robert Leblanc, en sa qualité de président du comité d’éthique du MEDEF (99), un mandataire social ne saurait à la fois se prévaloir de la précarité de son statut afin d’exiger une rémunération élevée susceptible de l’en prémunir et souhaiter bénéficier de surcroît des protections qu’accorde un contrat de travail.
À cet égard, il convient de souligner que ce code de gouvernance contient des recommandations plus exigeantes que les dispositions législatives tant sur la question du cumul des mandats sociaux que sur celle du cumul entre mandat social et contrat de travail, ce qui prouve l’importance de ces enjeux et la nécessité d’une évolution du cadre posé par le législateur.
Pour tous ces motifs, la mission préconise de limiter plus strictement dans la loi le cumul des mandats applicable aux mandataires sociaux, en tenant compte par ailleurs de l’exercice ou non de fonctions exécutives.
En ce qui concerne le cumul des mandats sociaux, la mission établit une distinction qui vise à tenir compte de la différence qui sépare, en termes de charge de travail et donc de capacité à s’impliquer pleinement dans la préparation et le suivi des décisions des conseils d’administration, un dirigeant mandataire social d’un administrateur n’assumant pas de responsabilités exécutives.
Pour ce qui est du cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, la mission souhaite évidemment ménager aux représentants des salariés la possibilité de siéger dans les conseils d’administration tout en conservant leur contrat de travail. C’est pourquoi, la proposition de la mission prévoit l’aménagement d’une exception en leur faveur au principe strict du non-cumul.
Pour sa part, même s’il adhère à la philosophie générale affirmée par la mission s’agissant de la limitation du cumul des mandats sociaux, votre Co-rapporteur souhaiterait qu’un éventuel dispositif législatif en ce domaine ménage des dérogations pour ce concerne le cumul entre mandat social et contrat de travail, au-delà du cas particulier des administrateurs représentant les salariés.
De son point de vue, on ne peut complètement méconnaître les arguments suivant lesquels le fait de bénéficier d’un contrat de travail évite le développement d’une logique de mercenariat parmi les mandataires sociaux et favorise la stabilité des cadres dans les entreprises. En outre, certaines personnes entendues par la mission ont pu en effet faire valoir qu’il apparaissait peu justifié de faire perdre tous leurs avantages à des cadres ayant accompli une longue carrière dans la même entreprise et se voyant confier un mandat social. Enfin, la proposition de votre Co-rapporteur prend en considération un besoin exprimé par certaines des personnes entendues par la mission : permettre aux conseils d’administration ou de surveillance des entreprises de tirer utilement parti de l’expérience que peuvent apporter des administrateurs disposant d’une expérience de dirigeants dans d’autres entreprises et, à ce titre, susceptibles d’avoir été confrontés à des problèmes similaires.
Proposition n° 14 : limiter plus strictement par la loi les cumuls de fonctions :
- en limitant à deux le nombre de mandats sociaux pouvant être détenus par un dirigeant en sus du mandat social qu’il détient dans l’entreprise qu’il dirige ;
- en limitant à quatre le nombre de mandats sociaux pouvant être exercés par des mandataires sociaux n’ayant aucune fonction de direction dans les entreprises où ils exercent ces mandats ;
- en interdisant le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail dans les grandes entreprises, sauf pour les administrateurs représentant les salariés.
Proposition n° 14 bis de votre Co-rapporteur : dans un encadrement plus strict par la loi du cumul des fonctions des mandataires sociaux, prévoir des dérogations spécifiques et mesurées en cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail.
Un cadre normatif plus strict s’impose à l’évidence. Mais s’agissant de la limitation du cumul des mandats sociaux comme, plus globalement, de la participation de leurs détenteurs au processus décisionnel des grandes entreprises, les pouvoirs publics ne sauraient faire l’impasse sur une nécessité première : œuvrer à la responsabilisation des mandataires sociaux.
B. RENDRE LES DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX PLUS RESPONSABLES
Une meilleure responsabilisation des dirigeants-mandataires sociaux des grandes entreprises passe par la mise en place d’un dispositif qui devrait à la fois faciliter les moyens procéduraux permettant de mettre en cause leur responsabilité civile pour faute de gestion et contribuer à leur faire supporter plus personnellement les sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées si leur responsabilité est établie.
1. Instaurer une action de groupe permettant aux actionnaires d’engager plus facilement la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux
a) Les lacunes de l’actuel régime de mise en cause de la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux
L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que, dans les sociétés anonymes à gouvernance moniste, « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». L’article L. 225-256 du même code étend ce principe de responsabilité aux membres du directoire des sociétés anonymes à gouvernance dualiste, mais l’article L. 225-257 du même code l’écarte pour les membres du conseil de surveillance de ces sociétés qui « sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat », mais « n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat ».
Pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux, le droit positif distingue différents types d’actions selon qu’elles visent à réparer le préjudice collectif subi par la société (et donc la collectivité des actionnaires) ou le préjudice individuel subi soit par un actionnaire soit par un tiers.
Lorsqu’il s’agit de réparer le préjudice subi par des tiers (cocontractants, fournisseurs, clients…) qui s’estiment lésés par des dirigeants-mandataires sociaux en tant que personnes physiques, et non par la personne morale de la société que ces derniers représentent, l’action relève du régime de droit commun de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. La jurisprudence est venue préciser qu’ils devaient prouver que les dirigeants en cause avaient commis une faute séparable de leurs fonctions (100). Les juges ont défini la « faute séparable » des fonctions de dirigeant-mandataire social comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (101).
Lorsqu’il s’agit de réparer le préjudice collectif subi par la société en raison des fautes d’un ou plusieurs de ses dirigeants, l’action est dite « sociale », car il s’agit de réparer le dommage causé au patrimoine social tout entier, et notamment aux droits sociaux (actions, parts…). En principe, il revient aux représentants légaux de la personne morale de la société d’exercer cette action. L’action sociale est dite « ut universi » lorsqu’elle est intentée par ces représentants légaux – qui, en pratique, sont les dirigeants eux-mêmes : soit le directeur général ou le président-directeur général (article L. 225-56 du code de commerce), soit le président du directoire (article L. 225-66 du même code).
Dans la mesure où il est rare que les dirigeants coupables de fautes de gestion intentent une action sociale « ut universi » qui pourrait aboutir à des sanctions à leur propre encontre ou à l’encontre de certains de leurs collègues, l’article L. 225-252 du code de commerce prévoit que les actionnaires peuvent se substituer aux représentants légaux défaillants et intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire, dans quel cas l’action sociale est dite « ut singuli ». Les actionnaires sont alors « habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
L’action sociale « ut singuli » peut être intentée par un actionnaire agissant seul, si minime soit sa participation. Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital excède 15 millions d’euros, l’action peut également être mise en œuvre par une association d’actionnaires, à condition qu’elle satisfasse aux exigences de l’article L. 225-120 du code de commerce, c’est-à-dire qu’elle regroupe des actionnaires justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 1 % des droits de vote.
Le développement de l’action sociale « ut singuli » est freiné par la jurisprudence qui interdit aux actionnaires d’exercer cette action, d’une part dans le cadre d’associations de droit commun (102), et, d’autre part, pour engager la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux d’autres sociétés appartenant au même groupe (103).
Par ailleurs, même si elle est exercée et financée par des actionnaires agissant individuellement ou en association, l’action sociale « ut singuli » bénéficie à la société, et non aux actionnaires, dans la mesure où elle vise à réparer le préjudice collectif subi par la société, et non le préjudice individuel subi par les actionnaires.
Lorsqu’il s’agit de réparer le préjudice individuel subi personnellement par un ou plusieurs actionnaires qui dénoncent une atteinte à leurs droits de vote, à leurs droits à dividende ou à leurs droits à l’information, l’action est dite « individuelle » et n’obéit pas au régime fixé par l’article L. 225-252 du code de commerce qui distingue nettement l’action individuelle de l’action sociale « ut singuli » (104).
L’exercice de l’action individuelle a longtemps été entravé par une jurisprudence qui assimilait les actionnaires à des tiers et leur imposait donc de prouver que les dirigeants-mandataires sociaux avaient commis une faute détachable de leurs fonctions, autrement dit une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Toutefois, les actionnaires peuvent désormais espérer faire valoir plus facilement les préjudices personnels qu’ils subissent par la faute de dirigeants-mandataires, dans la mesure où la jurisprudence a récemment cessé d’assimiler les actionnaires à des tiers (105).
Néanmoins, l’exercice de l’action individuelle reste difficile puisqu’il reste aux actionnaires à prouver qu’ils ont subi un préjudice personnel, direct, certain, et en outre distinct de celui de la société, critères que la jurisprudence interprète de manière restrictive. La Cour de cassation a par exemple jugé que « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé [ou actionnaire], mais un préjudice subi par la société elle-même » (106).
Par ailleurs, l’action individuelle a longtemps été hors de portée des actionnaires en raison des coûts importants qu’elle engendre en termes de frais de justice au regard des bénéfices aléatoires et souvent maigres qu’elle procure. Désormais, des associations agréées d’investisseurs, constituées en vue de la défense de l’épargne en général, et non des intérêts des actionnaires d’une société en particulier, peuvent se constituer parties civiles pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres et pour agir en réparation de préjudices individuels, dans le cadre d’une action en représentation conjointe fondée sur le mandat.
Mais comme l’explique Mme Véronique Magnier, professeure à l’Université Paris-XI, « les contraintes matérielles et financières que la représentation par mandat impose [aux actionnaires] dans le cadre d’une action en représentation conjointe réduisent à néant toute volonté d’initiative de leur part. Le système actuel devrait rapidement montrer ses limites si […] les demandes de réparation en venaient à se multiplier et donner lieu à des litiges de masse. La réponse aux litiges de masse, dans la plupart des pays occidentaux, a constitué à mettre en place une action de groupe » (107). Ce point de vue rejoint celui exprimé devant la mission par Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), qui a exhorté le législateur à créer une procédure inspirée de la « class action » américaine pour mieux faire reconnaître la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux.
b) Une solution : la consécration d’une action de groupe étendue au droit économique et financier
L’action de groupe est une voie ouverte par la procédure civile, permettant à un ou plusieurs requérant(s) d’exercer, au nom d’une catégorie de personnes une action en justice.
Elle est surtout connue aux États-Unis, depuis le XIXe siècle, sous l’appellation « class action ». Mais elle existe également, avec des variantes, sous la forme du « recours collectif » au Québec, de l’« action populaire » au Portugal et de l’« action de groupe » en Angleterre, au Pays de Galles et en Suède.
Pour délimiter le groupe, certains pays, dont les États-Unis, le Québec et le Portugal, ont choisi le régime dit de l’« opt-out ». Dans ce régime, sont considérées comme membres du groupe toutes les personnes affectées par le préjudice, qu’elles aient ou non expressément manifesté leur volonté d’agir dans le cadre de l’action de groupe. A contrario, ne sont pas membres du groupe les personnes qui ont expressément indiqué ne pas vouloir se joindre à l’action de groupe, un délai pouvant être fixé par le juge pour se manifester.
D’autres pays, comme l’Angleterre et la Suède, ont retenu le régime dit de l’« opt-in ». Dans ce régime, seules sont membres du groupe les personnes affectées par le préjudice qui ont expressément manifesté leur volonté d’être représentées à l’instance, ce qui exclut celles qui ne se sont pas manifestées. L’action de groupe repose alors sur un mandat exprès et le silence des personnes affectées par le préjudice est assimilé à un refus de se joindre à l’action collective. Le juge peut fixer un délai pour se manifester.
Aux États-Unis, la « class action » a été étendue à tous les contentieux de masse : droit de la consommation, mais aussi droit de l’environnement, droit du travail et droit financier (« securities class action »).
La mission n’ignore pas les critiques qui sont formulées à l’encontre de la « class action » américaine et qui portent principalement sur le système de rémunération des avocats – lesquels, en cas de succès de l’action, sont payés sur la base d’un pourcentage du montant total de la somme allouée (« contingency fees ») –, ainsi que sur la judiciarisation de la vie économique pouvant résulter de procédures abusives.
Toutefois, comme l’a expliqué M. Pierre-Henri Leroy, président du cabinet de conseil en politique de vote Proxinvest, la judiciarisation n’est pas une fatalité de l’action de groupe et l’alternative ne se réduit pas à choisir entre le vide actuel de la législation nationale et les dérives de la « class action » telle qu’elle est pratiquée aux États-Unis.
Preuve en est la solution intermédiaire et novatrice qui a été retenue en Allemagne dans le cadre d’une loi sur la « procédure-modèle dans les litiges de droit financier » (« Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz » ou « KapMuG »). Cette loi a été adoptée à la suite du fiasco judiciaire provoqué par la paralysie complète d’un tribunal auprès duquel près de 15 000 investisseurs avaient déposé plainte contre la société Deutsche Telekom, accusée d’avoir diffusée une information financière trompeuse. Entrée en vigueur le 1er novembre 2005, initialement pour une période expérimentale de 5 ans, cette loi s’est pérennisée et a été réformée à la marge en octobre 2012.
En Allemagne, les actionnaires qui souhaitent engager la responsabilité des dirigeants-mandataires des sociétés cotées sont tenus de les assigner individuellement : les actions engagées ne sont donc pas à proprement parler « collectives ». Toutefois, lorsque le demandeur ou le défendeur à une instance fait valoir que les questions de fait et/ou de droit soulevées par l’assignation peuvent concerner d’autres litiges similaires, nés ou à naître, et qu’il convient donc de mettre en œuvre une « procédure-modèle », le tribunal de première instance peut publier cette demande sur un registre spécial librement consultable sur Internet. Dès lors que, dans un délai de 4 mois à compter de cette publication au moins neuf autres demandeurs ou défendeurs à des instances parallèles formulent la même demande, les tribunaux de première instance se dessaisissent au profit de la cour d’appel du siège social de la société cotée, qui se voit reconnaître la compétence exclusive pour trancher par une décision unique les questions de fait et de droit communes à l’ensemble des litiges présentant entre eux un lien de connexité. Les questions propres à chaque litige demeurent, quant à elles, de la compétence du tribunal de première instance saisi.
Le dispositif allemand concilie la nécessité de faciliter la réparation des préjudices individuels, mais néanmoins sériels, subis par les actionnaires victimes de la diffusion d’une information financière fausse ou trompeuse ou de la dissimulation d’une information pertinente, avec la nécessité de respecter les principes de l’exercice individuel de l’action en justice et de l’indemnisation individuelle du préjudice, qui constituent un fondement du droit civil allemand comme du nôtre (108).
Si le dispositif original mis en place en Allemagne a permis tout à la fois de réduire le coût, pour les investisseurs, des actions en réparation dirigées contre les dirigeants des sociétés cotées, et de traiter rapidement et efficacement les préjudices financiers sériels en désengorgeant les tribunaux et en empêchant le « forum shopping » (109), on lui a cependant reproché de n’être pas allé assez loin dans la protection des investisseurs, faute de consacrer une véritable action de groupe reposant sur le mécanisme de l’« opt-in ».
En France, des groupes de travail ont été créés pour explorer des pistes afin de mettre en place une action de groupe en droit de la consommation (110), puis en droit financier (111).
Lors de son audition, le 19 décembre 2012, Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a indiqué que le Gouvernement réfléchissait à la création d’une procédure civile susceptible d’être mise en œuvre pour la réparation de dommages et de contentieux sériels.
Votre Co-rapporteur forme le vœu que le champ d’application de la procédure civile aujourd’hui à l’étude ne sera pas cantonné au droit de la consommation, mais élargi à d’autres domaines du droit, et notamment au droit économique et financier, et que le Gouvernement fera ainsi droit à la proposition n° 26 du groupe de travail présidé par M. Jean-Marie Coulon, président honoraire de la cour d’appel de Paris, qui a préconisé en 2008 de créer une action de groupe avec un système d’« opt-in » (112).
La mission estime que « pouvoir doit rimer avec responsabilité » (113). S’appuyant sur le constat que les dirigeants-mandataires sociaux évoluent aujourd’hui dans une zone d’impunité et que « le parcours procédural à franchir avant même de commencer à évoquer la faute et le préjudice est tellement complexe que [l’actionnaire] minoritaire s’y perd et s’y ruine » (114), la mission préconise la création d’une procédure d’action de groupe fondée sur un mécanisme d’« opt-in » qui permettrait aux investisseurs qui le souhaitent de se joindre à une action collective.
Sans renier les principes fondamentaux de la procédure civile française, il est en effet possible de mettre en place « une action de groupe bien conçue et efficace [qui] présenterait le double avantage d’éviter une exportation du procès vers des horizons très incertains et d’améliorer, en Europe, le degré de protection des investisseurs » (115), et donc leur confiance dans les marchés financiers. Cette procédure devrait être pensée pour assurer un équilibre qui permette de faciliter la mise en cause des dirigeants-mandataires sociaux fautifs tout en décourageant les actions judiciaires abusives. En effet, si la déresponsabilisation des dirigeants-mandataires sociaux indigne nos concitoyens, une menace de condamnation injustifiée peut aussi décourager les candidats aux fonctions de dirigeant-mandataire social.
Une fois que la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux sera plus facile à établir, grâce à la consécration d’une action de groupe dont le large champ d’application couvrira le droit économique et financier, il conviendra de faire en sorte que les dirigeants-mandataires sociaux dont la responsabilité aura été établie supportent effectivement et personnellement les sanctions pécuniaires prononcées.
2. Rendre plus effective et plus personnelle la sanction pécuniaire encourue par les dirigeants-mandataires sociaux responsables de fautes de gestion
Dans la mesure où les décisions prises par les dirigeants-mandataires sociaux au sein des conseils d’administration ou des directoires sont collégiales, le droit positif organise un régime de responsabilité solidaire qui conduit à sanctionner pécuniairement les membres des organes dirigeants dans leur ensemble, plutôt que ceux des dirigeants qui sont principalement responsables des fautes commises.
En l’état de la jurisprudence, pour espérer échapper à des sanctions pour des fautes qu’il n’aurait pas commises, un dirigeant-mandataire social ne doit pas se contenter d’être absent lors du vote, ni même de s’abstenir, ni même d’exprimer un vote défavorable : il doit soit marquer fermement son désaccord en formulant des protestations ou des réserves consignées dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration ou du directoire, soit demander la convocation de l’assemblée générale des actionnaires, soit démissionner.
De telles manifestations d’opposition sont rares. Si des actionnaires ou des tiers parviennent à faire établir la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux, celle-ci est le plus souvent solidaire, et la condamnation pécuniaire infligée est souvent prise en charge par les assureurs au titre des polices d’assurance de responsabilité civile que les sociétés souscrivent au profit de leurs dirigeants-mandataires sociaux.
C’est la raison pour laquelle, afin de faire supporter les conséquences financières d’une faute de gestion par les dirigeants-mandataires sociaux coupables, et non par leurs assureurs, Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), et M. Pierre-Henri Leroy, président du cabinet de conseil en politique de vote Proxinvest, se sont déclarés favorables à ce que leur gestion fautive soit sanctionnée par une franchise obligatoire de leurs polices d’assurance de responsabilité civile égale à un an et demi de leurs rémunérations.
Cette proposition avait été formulée par le groupe SRC de notre Assemblée dans sa contribution au rapport d’information que votre Co-rapporteur a présenté en juillet 2009 au nom de la commission des Lois (116).
Elle s’inspire d’une loi allemande sur la proportionnalité de la rémunération des dirigeants-mandataires sociaux (« Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung »), adoptée par le Bundestag le 18 juin 2009, qui, dans des périodes exceptionnellement difficiles, permet en outre au conseil de surveillance, ou au juge saisi par lui, de réduire, proportionnellement à la détérioration de la situation de l’entreprise, les rémunérations des membres du directoire ainsi que les retraites et prestations assimilées versées aux anciens membres du directoire qui ont quitté l’entreprise depuis moins de 3 ans.
Aux États-Unis, la loi dite « Dodd-Frank » du 21 juillet 2010 a contraint les sociétés cotées à établir des procédures pour récupérer les rémunérations versées auprès des dirigeants-mandataires sociaux responsables de la publication d’informations comptables erronées (mécanisme dit de « clawback »). Aux termes de l’article 954 de cette loi, si une société cotée est contrainte de rectifier des informations comptables non conformes aux règles de reporting financier, elle doit recouvrer auprès de ses actuels ou anciens dirigeants la différence entre le montant des rémunérations qui leur ont été versées, sur la base des données comptables erronées, au cours des trois années précédant la rectification, et le montant des rémunérations qui auraient dû leur être attribuées sur la base des données comptables rectifiées.
Proposition n° 15 : créer une procédure d’action de groupe reposant sur le mécanisme de l’« opt-in » et permettant aux investisseurs victimes de préjudices sériels d’engager la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux ;
Rendre plus effective et plus personnelle la sanction pécuniaire encourue pas les dirigeants-mandataires sociaux responsables d’une gestion fautive, en créant, sur le modèle américain, une action en recouvrement des rémunérations versées.
C. ATTRIBUER AUX DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX DES RÉMUNÉRATIONS ALLIANT L’ÉTHIQUE À LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
La mission a rencontré certaines réticences face à d’éventuelles réformes des modalités de détermination et de publicité des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux des grandes entreprises. Ainsi, M. Christian Schricke, délégué général de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA), a mis en garde contre un encadrement trop rigoureux des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux, par rapport à ce qui se pratique à l’étranger. Un tel encadrement risquerait, selon lui, d’engendrer une perte d’attractivité pour les entreprises françaises, qu’aggraverait encore le fait que les filiales françaises de sociétés-mères étrangères ne seraient pas soumises au régime applicable aux sociétés-mères françaises. M. Christian Schricke a souligné qu’il n’était pas rare aujourd’hui que les cadres dirigeants américains des grands groupes français soient mieux payés que les présidents-directeurs généraux français de ces mêmes groupes. Un argument similaire a été soulevé par M. Daniel Bernard, président de la Fondation HEC et président-directeur général de Kingfisher, pour qui il est essentiel, pour la compétitivité des entreprises françaises, qu’elles puissent offrir des éléments de rémunération comparables à ceux qui sont proposés à l’étranger : un encadrement trop strict des rémunérations risquerait d’empêcher les grandes entreprises françaises d’attirer des talents à l’international.
Votre Rapporteure s’inscrit en faux contre l’argument, souvent brandi, selon lequel de telles réformes préjudicieraient à l’attractivité et à la compétitivité de la France dans un marché mondial des dirigeants-mandataires sociaux.
Dans une étude dont la publication est attendue pour ce mois de février 2013, et dont la mission a pu connaître les résultats provisoires lors de son déplacement à Londres, le 12 novembre 2012, le High Pay Centre (117) montre que la réalité du marché mondial des dirigeants-mandataires sociaux est loin d’être celle que l’on prétend.
L’observatoire britannique des hautes rémunérations réfute, dans cette étude, l’argument qui est tiré de la compétition sur le marché mondial des « managers » et qui est souvent avancé pour faire pièce à toute velléité d’encadrement des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux, au motif que ce dernier serait préjudiciable à la compétitivité nationale.
Selon les premières conclusions du High Pay Centre, au sein des 500 premières entreprises mondiales, et au cours des cinq dernières années, seuls 3,5 % des directeurs généraux ont été recrutés à l’étranger ; seuls 0,8 % des directeurs généraux ont été débauchés à l’étranger par des « chasseurs de têtes » ; et seulement 0,2 % des directeurs généraux ont été recrutés sur un autre continent. Ces pourcentages sont légèrement plus élevés au sein des entreprises implantées en Europe occidentale où, durant les cinq dernières années, 10 % des directeurs généraux ont été recrutés à l’étranger et 2,5 % des directeurs généraux ont été débauchés à l’étranger par des « chasseurs de têtes ». Mais en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe orientale, en Chine et au Japon, pas un seul dirigeant-mandataire social n’a été recruté dans un pays distinct de celui dans lequel l’entreprise est établie. Au sein des 500 premières entreprises mondiales, au cours des cinq dernières années, 80 % des directeurs généraux ont été recrutés par voie de promotion interne à l’entreprise et 20 % par voie de recrutement externe.
On ne peut donc affirmer que les dirigeants-mandataires sociaux sont mus essentiellement par les rémunérations et que cela concourrait à la constitution d’un marché mondial de dirigeants-mandataires sociaux. C’est la raison pour laquelle votre Rapporteure n’entend pas renoncer à proposer des pistes de réforme en matière de rémunérations de ces dirigeants-mandataires sociaux.
La logique de renforcement de l’implication des actionnaires dans la vie de l’entreprise pourrait servir celle de la prévention et de la correction des excès en matière de rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux si les actionnaires se voyaient reconnaître un pouvoir de contrôle sur ces rémunérations.
1. Instaurer par la loi un vote des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux
a) Faire voter les actionnaires sur la politique de rémunération et sur les montants des rémunérations versées à chacun des dirigeants-mandataires sociaux
En l’état du droit, les assemblées générales d’actionnaires sont d’ores et déjà appelées à voter sur certaines des rémunérations versées aux dirigeants-mandataires sociaux. Elles statuent par un vote a priori sur les enveloppes globales des jetons de présence, des actions gratuites et des « stock-options » attribués aux dirigeants-mandataires sociaux. Elles se prononcent par un vote a posteriori sur les indemnités de départ et « les retraites-chapeau » qui leur sont consenties. Ces dernières rémunérations résultent en effet de conventions qui entrent dans le champ d’application du régime des conventions réglementées (118). Or les conventions réglementées autorisées par le conseil d’administration ou de surveillance doivent être soumises à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires (119).
En revanche, la rémunération fixe et la rémunération variable (sous forme de bonus annuels ou pluriannuels) qui sont versées aux dirigeants-mandataires sociaux sont déterminées par le conseil d’administration ou de surveillance, et elles ne sont pas soumises à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Ce n’est pas le cas dans d’autres pays, où l’ensemble des rémunérations octroyées aux dirigeants-mandataires sociaux, y compris les rémunérations fixes et variables, est soumis au vote des actionnaires, suivant un principe que l’on a coutume d’appeler « say on pay ». Ainsi, aux États-Unis, en application de la loi dite « Dodd-Frank » du 21 juillet 2010, les sociétés cotées dont la capitalisation boursière excède 75 millions de dollars (soit environ 58 millions d’euros) doivent soumettre les politiques (ou « plans ») de rémunération de certains de leurs dirigeants (dont le directeur général et le directeur financier) au vote consultatif de l’assemblée générale des actionnaires depuis le 21 janvier 2011, et ce selon une périodicité au moins triennale. Depuis le 21 janvier 2013, ce régime a été étendu aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à ce seuil. Il faut en outre noter que la loi « Dodd-Frank » laisse aux sociétés la liberté de rendre ce vote contraignant.
En Europe, c’est le Royaume-Uni qui, le premier, a institué le « say on pay », en soumettant les rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux au vote consultatif de l’assemblée générale des actionnaires dès 2002. La Suède (en 2006), la Norvège (en 2007), la Belgique et l’Allemagne (en 2011) ont suivi le mouvement initié par le Royaume-Uni, optant également pour un « say on pay » consultatif.
En 2004, les Pays-Bas ont en revanche choisi de soumettre chaque année les rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux au vote contraignant de l’assemblée générale des actionnaires.
Ils pourraient être suivis dans cette voie par le Royaume-Uni où, dans le cadre du projet de loi n° 2012-13 de réforme de la régulation des entreprises (« Enterprise and Regulatory Reform Bill »), qui devrait être définitivement adopté par le Parlement britannique dans les semaines à venir, il est envisagé :
– de soumettre à un vote triennal et contraignant des actionnaires les grandes lignes de la politique de rémunération des dirigeants-mandataires sociaux pour les trois années à venir ;
– de soumettre à un vote annuel et consultatif des actionnaires les montants précis des rémunérations perçues individuellement par les dirigeants-mandataires sociaux au cours de l’exercice précédant l’assemblée générale.
Lors du déplacement de la mission à Londres, le 12 novembre 2012, M. Stephen Haddrill, directeur général de l’autorité britannique de reporting financier (FRC), a indiqué que le vote annuel et consultatif des actionnaires devrait prendre la forme d’un vote sur un rapport indiquant, pour chaque dirigeant-mandataire social, un seul et unique chiffre correspondant à sa rémunération globale. Mme Deborah Hargreaves, présidente du High Pay Centre (observatoire britannique des hautes rémunérations), a ajouté que Lord Robert Gavron, membre de la Chambre des Lords (parti travailliste), envisageait d’amender le projet de loi pour prévoir que ces rapports ne seraient réputés adoptés que s’ils parvenaient à réunir une majorité de 75 % des actionnaires.
De son côté, la Suisse réfléchit à la mise en place du « say on pay » (120). Dans son Rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées pour l’année 2012, l’AMF note que huit sociétés suisses ont, au cours du premier trimestre 2012, soumis volontairement leur rapport sur les rémunérations de leurs dirigeants au vote des actionnaires (121).
Au total, 15 des 27 pays membres de l’Union européenne ont adopté ou sont sur le point d’adopter le « say on pay ». Dans le plan d’action en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise qu’elle a publié le 12 décembre 2012, la Commission européenne indique vouloir encourager des initiatives en faveur d’« un droit de vote des actionnaires sur la politique de rémunération et le rapport consacré aux rémunérations », sans toutefois prendre parti sur le caractère consultatif ou contraignant de ce vote (122).
En France, l’AMF s’est dite « favorable à ce que soit envisagé un vote consultatif des actionnaires sur la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux » (123). Dans l’appel qu’ils ont lancé au Président de la République et qui a été publié le 28 octobre 2012 dans le Journal du dimanche (JDD), les dirigeants d’entreprises adhérant à l’AFEP ont proposé de modifier le code de gouvernance « AFEP-MEDEF » pour soumettre les rémunérations des dirigeants à un vote consultatif des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de la société. Vos rapporteurs ont en outre noté que Publicis Groupe avait pris l’initiative de soumettre les rémunérations des membres de son directoire à un vote consultatif de l’assemblée générale de ses actionnaires au printemps prochain (124).
Lors de la table ronde qui a réuni des représentants des dirigeants-mandataires sociaux, le 3 octobre 2012, M. Robert Leblanc, président national du Mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC), s’est déclaré favorable à ce que l’assemblée générale des actionnaires se prononce de façon purement consultative sur les grandes orientations de la politique de rémunération des dirigeants-mandataires sociaux. M. Louis Godron, président de l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), et M. Paul-Henri de la Porte du Theil, président de l’Association française de la gestion financière (AFG), ont abondé en ce sens, le second ajoutant que, dès lors qu’un tel vote ne porterait que sur les principes des rémunérations, et non sur leur montant, il serait selon lui sans grande incidence qu’il soit consultatif ou contraignant.
De son côté, M. Geoffroy de Vienne, conseiller du président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), a préconisé que le vote consultatif de l’assemblée générale des actionnaires porte également sur la rémunération globale perçue individuellement par les dirigeants-mandataires sociaux. Cette rémunération serait présentée dans un rapport nominatif et détaillé.
La mission estime qu’il y a un véritable intérêt, en termes de démocratie actionnariale et de transparence de la gouvernance des grandes entreprises, à ce que soit introduit dans notre droit le principe d’un vote de l’assemblée générale des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux.
S’inspirant de la fréquence des votes telle qu’elle est prévue dans le projet de loi britannique en cours d’adoption, le « say on pay à la française » devrait prendre la forme d’un vote de l’assemblée générale des actionnaires qui serait :
– triennal et ex ante lorsqu’il porterait sur les principes et les grandes lignes de la politique de rémunération des dirigeants-mandataires sociaux pour les trois années à venir ;
– annuel et ex post lorsqu’il porterait sur le détail des rémunérations (fixes et variables, mais aussi sous forme d’indemnités de bienvenue, de départ et de non-concurrence) perçues individuellement par les dirigeants-mandataires sociaux au cours de l’exercice précédant l’assemblée générale.
S’inspirant des initiatives prises par certains parlementaires britanniques dans le cadre des débats sur le projet de loi de réforme de la régulation des entreprises (« Enterprise and Regulatory Reform Bill »), votre Rapporteure estime qu’il faudrait reconnaître aux actionnaires un droit de veto sur les principes et le détail des rémunérations tels qu’ils leur sont soumis. Ce veto devrait réunir les votes négatifs exprimés par une majorité des deux tiers des actionnaires réunis en assemblée générale.
En revanche, votre Co-rapporteur défend l’idée que le vote de l’assemblée générale des actionnaires sur les principes et le détail des rémunérations devrait conserver un caractère consultatif en toutes circonstances. Cela permettrait de ménager les éventuelles réticences susceptibles de résulter du changement de culture qu’un tel vote représente.
En toute hypothèse, la mission estime, avec M. Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis Asset Management, que ce vote ne devrait pas remettre en cause le caractère contraignant du vote de l’assemblée générale des actionnaires sur les éléments de rémunérations qui donnent accès au capital de la société (actions gratuites, « stock-options »…).
Jugeant paradoxal qu’en l’état du droit, une partie des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux (indemnités de départ, « retraites-chapeau »…) relève du régime des conventions réglementées et soit donc soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, tandis que l’autre partie (rémunérations fixes et rémunérations variables) ne relève pas de ce régime et échappe donc au contrôle de l’assemblée générale des actionnaires, Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), a suggéré que la mise en œuvre concrète du « say on pay » en France passe par un élargissement du champ des rémunérations perçues par les dirigeants-mandataires sociaux et soumises au régime des conventions réglementées. C’est d’ailleurs ce qu’avait suggéré votre Co-rapporteur dans le rapport d’information sur les rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux et des opérateurs de marchés qu’il a présenté, au nom de la commission des Lois de notre Assemblée, en juillet 2009 (125).
Toutefois, il est également concevable que la mise en œuvre du « say on pay » passe par l’expression d’un vote de l’assemblée générale des actionnaires portant sur des rapports, triennaux et annuels, exclusivement dédiés à la présentation de la politique des rémunérations et à la description lisible, précise et exhaustive des montants et des critères des rémunérations individuellement perçues par les dirigeants-mandataires sociaux. C’est en général la forme qu’a prise le « say on pay » chez nos voisins, et c’est ce qu’a suggéré M. Gérard Rameix, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La réforme législative rendue nécessaire par l’instauration d’un « say on pay » devrait en conséquence être complétée par une modification des dispositions du code de commerce qui imposerait aux grandes entreprises, d’une part, la publication d’un rapport triennal sur la politique de rémunération de leurs dirigeants-mandataires sociaux pour les trois années à venir, et, d’autre part, la publication d’un rapport annuel sur le détail des rémunérations effectivement versées à chacun des dirigeants-mandataires sociaux.
Toutefois, le contenu de ce rapport annuel ne devrait pas doublonner celui du rapport que le conseil d’administration ou le directoire est aujourd’hui tenu de présenter à l’assemblée générale ordinaire, en application des trois premiers alinéas de l’article L. 225-100 du code de commerce. Ces dispositions devraient être adaptées en conséquence.
Le périmètre des grandes entreprises concernées par l’obligation de produire ces rapports et de les soumettre au vote de leurs actionnaires pourrait être le même que celui qui a été retenu pour les nouvelles obligations de reporting social et environnemental dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), à savoir les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les sociétés dont le total de bilan ou le montant net du chiffre d’affaires excède 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice excède 500 (articles L. 225-102-1, alinéa 6, et R. 225-104 du code de commerce) (126).
Cette proposition répond à un besoin, identifié notamment par Mme Catherine Salmon, responsable de la recherche sur la gouvernance pour le marché français du cabinet de conseil en politique de vote ISS. Celle-ci a déploré un certain éparpillement des données relatives aux rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux dans la masse des différents documents publiés par les entreprises, ainsi qu’une communication sur ces données fractionnée dans le temps.
Mme Catherine Salmon a également fourni à votre mission un éclairage utile sur le dispositif qui pourrait être mis en place dans le cadre du « say on pay à la française » en citant l’exemple de l’Australie. Ce pays a instauré le « say on pay » en 2004 et son droit prévoit que si, pendant deux années consécutives, 25 % des membres de l’assemblée générale des actionnaires ont contesté la politique de rémunération de l’entreprise, une résolution peut être déposée afin de mettre en cause le mandat des administrateurs.
À défaut d’introduire de telles règles dans notre droit, un vote négatif qui n’atteindrait pas la majorité des deux tiers des actionnaires sur la politique ou le détail des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux devrait constituer un sérieux avertissement pour les organes dirigeants des grandes entreprises. Le conseil d’administration ou de surveillance devrait, éventuellement sur avis du comité des rémunérations, délibérer sur le sujet et publier dans les plus brefs délais, le cas échéant sur le site Internet de la société, un communiqué mentionnant les suites qu’il entend donner au vote négatif des actionnaires (127).
Proposition n° 16 : imposer aux grandes entreprises une obligation légale de publier des rapports spécifiquement consacrés à la présentation de leur politique de rémunération de leurs dirigeants-mandataires et à la description lisible, précise et exhaustive des rémunérations individuellement perçues par ces derniers ;
Modifier la loi pour reconnaître à l’assemblée générale des actionnaires un droit de vote qui serait :
- triennal et ex ante lorsqu’il porterait sur les principes et les grandes lignes de la politique de rémunération des dirigeants-mandataires sociaux pour les trois années à venir ;
- annuel et ex post lorsqu’il porterait sur le détail des rémunérations (fixes et variables, mais aussi sous forme d’indemnités de bienvenue, de départ et de non-concurrence) perçues individuellement par les dirigeants-mandataires sociaux au cours de l’exercice précédant l’assemblée générale.
Pour votre Rapporteure : reconnaître aux actionnaires un droit de veto sur les principes et le détail des rémunérations dès lors qu’une majorité des deux tiers des actionnaires réunis en assemblée générale exprime un vote négatif ;
Pour votre Co-rapporteur : conférer au vote des actionnaires un caractère purement consultatif.
La proposition que font vos rapporteurs d’imposer aux entreprises l’obligation de publier des rapports spécifiquement consacrés aux rémunérations constitue le prolongement de celle qui préconise la mise en œuvre du « say on pay ». Ces rapports devraient faire état des critères justifiant les rémunérations soumises au vote des actionnaires.
b) Accorder plus de poids aux critères de performance extra-financiers et de long terme dans les rémunérations globales des dirigeants-mandataires sociaux
Les deuxièmes alinéas des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce interdisent « les éléments de rémunération, indemnités et avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement [des fonctions de dirigeant-mandataire social], ou postérieurement à celles-ci dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée » ou « dont il est membre du directoire » (selon le cas).
Pour les indemnités de départ comme pour d’autres formes de rémunération (bonus, actions gratuites…), ces conditions de performance sont généralement interprétées comme devant être appréciées sur le fondement de critères quantitatifs et financiers. Or votre mission partage l’analyse de Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), qui a expliqué que les critères de performance qui motivent l’attribution de bonus, de « stock-options » et d’actions gratuites, et qui, à l’heure actuelle, sont essentiellement quantitatifs et ancrés dans le court terme, ont beaucoup contribué à la financiarisation de l’économie. La concentration de ces critères sur des résultats financiers à échéance trimestrielle, semestrielle ou annuelle a conduit les dirigeants-mandataires sociaux à focaliser leur attention sur la rentabilité financière à court terme. Mme Colette Neuville a regretté que l’on ait ainsi aligné les intérêts des dirigeants-mandataires sociaux sur ceux d’actionnaires « court-termistes » (128).
Lors de son déplacement à Londres, le 12 novembre 2012, la mission a pu constater qu’outre-Manche, Mme Deborah Hargreaves, présidente du High Pay Centre, faisait la même analyse. De son point de vue, les critères de performance purement financiers encouragent les processus de fusions-acquisitions (et tous les licenciements qui s’ensuivent), car plus la taille des entreprises est grande, plus les rémunérations de leurs dirigeants sont importantes. Il est plus difficile pour les dirigeants-mandataires sociaux d’augmenter leurs rémunérations dans de brefs délais en créant de la valeur ajoutée par l’innovation, la recherche ou le développement de la marque de l’entreprise.
Nombreuses sont les personnes entendues qui ont émis le vœu que les critères de performance justifiant l’attribution de certaines rémunérations soient davantage qualitatifs, extra-financiers et définis sur le long terme. M. Geoffroy de Vienne, conseiller du président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), M. Jean-Frédéric Dreyfus, trésorier confédéral de la Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), M. Marcel Grignard, secrétaire national de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), M. Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis Asset Management, et M. Didier Cornardeau, président de l’Association des petits porteurs actifs (APPAC) ont tous proposé que soient introduits des critères de performance sociale et environnementale dans les conditions d’attribution des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux, notamment lorsqu’elles prennent la forme de bonus, d’actions gratuites ou de « stock-options ».
Mme Deborah Hargreaves a expliqué que les études du High Pay Centre démontraient qu’à contrepied de la tendance actuelle qui consiste à déterminer les rémunérations en fonction de critères de performance purement financiers et court-termistes, il est plus efficace, d’un point de vue économique, de fonder les rémunérations sur des critères extra-financiers et inscrits dans le long terme.
Or, d’après le 14e rapport sur « La rémunération des dirigeants des sociétés du SBF 120 » que le cabinet de conseil en politique de vote Proxinvest a publié le 11 décembre 2012, la rémunération variable des dirigeants-mandataires sociaux des entreprises appartenant aux indices boursiers CAC 40 et SBF 80 n’est indexée sur des conditions de performance de long terme, c’est-à-dire sur une durée supérieure ou égale à 3 ans, respectivement qu’à hauteur de 16 % et 8 %.
La mission n’ignore pas que certaines grandes entreprises prennent en la matière des initiatives louables. Par exemple, l’entreprise Schneider Electric indexe, depuis 2011, une partie de la rémunération variable de ses dirigeants sur des critères de performance extra-financière, et notamment sur des critères de développement durable. Dans un accord de participation signé en juin 2012, elle a même étendu ces critères à l’attribution de l’intéressement de l’ensemble des salariés de ses entités françaises (129).
Toutefois, il convient d’aller plus loin dans la promotion de cette conception renouvelée de la performance des dirigeants-mandataires sociaux. Au niveau européen, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a indiqué réfléchir à l’introduction de critères non-financiers dans l’évaluation de la performance des professionnels, dans le cadre d’une consultation publique ouverte jusqu’au 7 décembre dernier (130). Au cours des travaux de votre mission, Mme Colette Neuville a suggéré que tous les critères de performance sur le fondement desquels sont versées les rémunérations variables soient soumis au vote de l’assemblée générale des actionnaires dans le cadre du « say on pay ».
Pour sa part, la mission considère qu’à tout le moins, les codes de gouvernance devraient comporter des recommandations plus étoffées et plus précises pour inciter les entreprises à soumettre l’octroi de rémunérations sous forme de bonus ou d’actions gratuites à des critères qualitatifs, extra-financiers, exigeants et ancrés dans le long terme qui pourraient être par exemple, des critères sociaux, environnementaux, de parité ou de diversité.
2. Préférer l’outil de la fiscalité au plafonnement des rémunérations
Le contrôle des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux de leur société pourrait se doubler d’un encadrement législatif qui privilégierait la fiscalisation au plafonnement de ces rémunérations.
a) Privilégier une réforme de la fiscalité portant sur l’ensemble des hauts revenus à un plafonnement des rémunérations des seuls dirigeants-mandataires sociaux
Afin de prévenir les abus et les scandales qui défraient régulièrement la chronique, il a été suggéré à la mission de plafonner soit la rémunération globale soit la seule rémunération variable des dirigeants-mandataires sociaux.
Lors de la table ronde qui a réuni des représentants des syndicats de salariés, le 10 octobre 2012, M. Geoffroy de Vienne, conseiller du président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), a proposé de plafonner la rémunération globale mensuelle des dirigeants-mandataires sociaux à un montant égal à 240 fois celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ce qui représenterait environ 4,1 millions d’euros bruts par an.
Lors de la table ronde qui a réuni des représentants d’investisseurs, le 17 octobre dernier, M. Philippe Desfossés, directeur l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), a estimé préférable de plafonner la rémunération globale mensuelle des dirigeants-mandataires sociaux à 100 fois le SMIC, soit environ 1,7 millions d’euros bruts par an.
Toutefois, lors de cette même table ronde, M. Didier Cornardeau, président de l’Association des petits porteurs actifs (APPAC), a invité votre mission à proposer un plafonnement de la seule rémunération variable des dirigeants-mandataires sociaux (bonus annuels, pluriannuels…) plutôt qu’un plafonnement de leur rémunération globale. Il a ainsi suggéré de limiter le montant de la rémunération variable à trois fois celui de la rémunération fixe – ce qui rejoint d’ailleurs une proposition également formulée par M. Geoffroy de Vienne (CFTC). Néanmoins, M. Hervé de Villeroché, chef du service du financement de l’économie au sein de la direction générale du Trésor du ministère de l’Économie et des finances, a mis en garde contre les effets pervers d’un tel plafonnement qui aurait l’avantage d’éviter certains excès mais également l’inconvénient de pousser la rémunération fixe à la hausse.
La mise en place d’un plafonnement des rémunérations globales ou seulement variables des dirigeants-mandataires sociaux dans les entreprises privées ne se posent pas dans les mêmes termes que dans les entreprises dont l’actionnariat est majoritairement public. Dans ces dernières, l’État dispose d’un pouvoir d’intervention qui remonte notamment au décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social (131).
C’est d’ailleurs ce décret que le Gouvernement a récemment modifié en adoptant le décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques, qui plafonne ces dernières à un montant de 450 000 euros bruts par an (132).
À l’endroit des entreprises privées qui ne bénéficient pas d’aides publiques, l’intervention des autorités publiques doit ménager la liberté contractuelle qui préside à la fixation des rémunérations que les dirigeants-mandataires sociaux négocient avec leurs entreprises et qui est garantie par la Constitution.
Pour cette catégorie d’entreprises, Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), a jugé qu’un plafonnement par la loi des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux n’était guère réaliste et qu’il conviendrait plutôt de permettre aux sociétés de fixer dans leurs statuts des plafonds de rémunérations : les sociétés seraient ainsi libres de fixer ou non de tels plafonds et, le cas échéant, leur niveau.
S’il est vrai que ce dispositif aurait l’avantage de la souplesse, la mission estime qu’il serait plus juste – et plus efficace – d’utiliser le levier de la fiscalité pour corriger et prévenir des excès qui sont souvent médiatisés quand ils concernent des dirigeants-mandataires sociaux de grandes entreprises, mais qui peuvent néanmoins être également commis par d’autres professionnels (sportifs, artistes, avocats…).
La mission fait donc sienne l’idée d’encadrer les rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux en adaptant leur fiscalité plutôt qu’en les plafonnant. Cette réforme de la fiscalité devrait concerner l’ensemble des hauts revenus, et non pas seulement les revenus perçus par les dirigeants-mandataires sociaux d’entreprises – démarche qui a notamment été défendue devant votre mission, lors de son déplacement à Londres, le 12 novembre 2012, par M. Camille Landais, économiste, chargé d’enseignement à la London School of Economics (LSE).
b) Abaisser le plafond de la partie des rémunérations versées aux dirigeants-mandataires sociaux qui est déductible de l’impôt sur les sociétés
Parmi les réformes fiscales envisageables, figure l’abaissement du plafond de la partie de la rémunération versée aux dirigeants-mandataires sociaux qui est déductible de l’impôt sur les sociétés.
L’article 209 du code général des impôts prévoit que, sous certaines réserves, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 du même code. Or le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts prévoit que toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais, « ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu ».
À cette première condition posée à la déductibilité des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux de l’assiette des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur les sociétés s’en ajoute une seconde. Le 5 bis de l’article 39 du code général des impôts dispose en effet que « les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce [à savoir les indemnités de départ et les « retraites-chapeau »] sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire ». En conséquence, la limite de déductibilité de certaines rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux est, pour l’année 2013, d’environ 222 000 euros par bénéficiaire.
Le dispositif fiscal qui régit aujourd’hui la déductibilité des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux ne dissuade pas suffisamment les organes dirigeants des grandes entreprises de faire preuve de largesses à l’égard de leurs membres. Dans la mesure où une grande partie des sommes et avantages attribués sont déductibles de l’impôt sur les sociétés, les organes dirigeants des grandes entreprises peuvent être enclins à maintenir voire à augmenter le niveau des rémunérations versées, y compris lorsque leurs entreprises traversent des périodes de difficultés.
La mission propose par conséquent de modifier le régime fiscal de déductibilité des rémunérations et avantages de toutes sortes du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés afin qu’il incite davantage les grandes entreprises à faire preuve de modération dans la politique de rémunération qu’elles adoptent à l’égard des membres de leurs organes dirigeants.
Dans le rapport d’information sur les rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux et des opérateurs de marchés qu’il a présenté, au nom de la commission des Lois de notre Assemblée, en juillet 2009, votre Co-rapporteur a proposé de modifier la rédaction du 5 bis de l’article 39 du code général des impôts afin de supprimer la déduction fiscale des rémunérations globales qui seraient attribuées, au-delà d’un plafond annuel correspondant à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 1 110 000 euros pour l’année 2013 (133). Cette proposition a l’avantage d’allier souplesse et dissuasion : il ne serait pas interdit aux conseils d’administration ou de surveillance de consentir des rémunérations et des avantages tels qu’ils dépasseraient un montant annuel d’1,1 million d’euros ; toutefois, au-delà de ce montant, les grandes entreprises ne pourraient pas déduire les rémunérations globales attribuées de leur bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elles en supporteraient le coût. Par conséquent, les organes dirigeants des grandes entreprises seraient contraints de justifier de façon plus circonstanciée le montant des rémunérations globales octroyées aux dirigeants-mandataires sociaux devant les assemblées générales d’actionnaires, a fortiori si celles-ci sont appelées à se prononcer, à titre consultatif, sur ces rémunérations, dans le cadre du « say on pay ».
Proposition n° 17 : corriger les excès des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux non pas par leur plafonnement, mais par une réforme de la fiscalité qui ne serait pas limitée aux revenus des seuls dirigeants-mandataires sociaux des grandes entreprises, mais concernerait l’ensemble des hauts revenus ;
Abaisser le plafond du montant des rémunérations globales versées aux dirigeants mandataires-sociaux qui est déductible des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur les sociétés.
L’abaissement de ce plafond pourrait être assorti d’un alourdissement de la taxation de la partie de la rémunération versée aux dirigeants-mandataires sociaux qui n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés.
3. Inciter à une utilisation plus raisonnée et pertinente des « stock-options » et des actions gratuites
Au terme de ces travaux, la mission a résolu de ne pas préconiser une suppression pure et simple de ces instruments de rémunération (134). Elle a en effet acquis la conviction qu’il ne s’agissait pas là d’un objectif nécessairement souhaitable dans la mesure où, comme l’ont souligné nombre de ses interlocuteurs, cette suppression pourrait réduire la capacité des entreprises françaises à attirer et assurer la promotion en leur sein de jeunes talents face à des multinationales qui, quant à elles, assureraient le bénéfice de ce type de rémunération variable.
De surcroît, ces instruments peuvent présenter une grande utilité pour certaines entreprises qui, même si elles font face à des situations diverses et à des besoins multiples, ne doivent pas moins s’assurer de la motivation et de la fidélité de leurs mandataires sociaux et de leurs cadres. Enfin, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 contribue à ouvrir le champ des bénéficiaires de ce type de rémunération variable aux salariés et non plus aux seuls cadres dirigeants(135).
Dans cette optique, la mission juge nécessaire de proposer des mesures tendant à encadrer le recours à des modes de rémunération qui demeurent d’autant plus problématiques qu’ils ne reposent pas nécessairement sur des critères en rapport avec l’objectif de performance des entreprises.
a) Encadrer des modes de rémunérations variables toujours porteurs de dérives
Certes, les dernières statistiques disponibles montrent que les grandes entreprises tendent à moins recourir aux « stock-options », certaines personnes entendues par la mission ayant même évoqué une perte d’attractivité de ce système.
En 2011, 52,4 % des sociétés du SBF 120 et 63,9 % des sociétés du CAC 40 ont attribué des options de souscription ou d’achat d’actions (136). Mais d’après les travaux du cabinet de conseil en politique de vote Proxinvest (137), les « stock-options » ne représentaient plus que 11,5 % du total de la rémunération des dirigeants des sociétés du CAC 40 contre 51, 5 % en 2006.
En revanche, suivant la même source, l’attribution d’actions gratuites semble prendre une importance nouvelle, notamment au détriment des « stock-options ». La part des actions gratuites dans la rémunération des dirigeants s’élevait en 2011 à 15,9 % contre seulement 3,7 % en 2006. En moyenne, d’après les chiffres communiqués par Ethics & Boards, le montant des « stock-options » perçues par les dirigeants du CAC 40 s’élevait en 2011 à 501 248 euros, celui des actions gratuites (et de performance) atteignant 428 051 euros. Ces chiffres peuvent dissimuler de grands écarts. À titre d’illustration, d’après l’étude de Proxinvest, le directeur général de Dassault Systèmes aurait reçu en 2011 des actions attribuées d’une valeur de 8,8 millions d’euros.
Le mouvement en défaveur du recours aux « stock-options » s’explique notamment par un durcissement des mesures fiscales applicables depuis quelques années à ces instruments. Ainsi, en plus d’être soumis à l’impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée (CSG), ce mode de rémunération variable supporte une contribution spécifique assise sur le gain tiré de la levée d’option (138). En application de la loi de finances rectificative pour 2012, la part salariale de cette contribution a été portée de 8 % à 10 % de la valeur du gain tiré de la levée des options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012 (contre 2,5 % en 2008); la part supportée par l’employeur atteint désormais 30 % (contre 14% depuis 2010 et 10 % en 2008) (139).
Cela étant, le recours aux « stock-options » et à l’attribution d’actions gratuites n’en demeure pas moins problématique à plusieurs titres.
Par-delà les risques de dilution du capital social inhérents aux options de souscription, ces deux instruments peuvent constituer une source de rémunération différée sans lien nécessaire et évident avec les performances réalisées sur le long terme.
D’une part, il apparaît que les critères conditionnant la distribution de « stock-options » ou l’attribution d’action gratuites manquent souvent de lisibilité et de pertinence par rapport aux résultats obtenus et aux compétences qui devraient requises des mandataires sociaux et des cadres de l’entreprise. Sur le seul plan de la lisibilité, ainsi que les personnes entendues par la mission ont pu le souligner, il s’avère que les entreprises ne produisent pas toutes systématiquement des informations réellement exhaustives en matière de rémunération variable. Ainsi, suivant les statistiques établies par Ethics & Boards, si 95 % des entreprises du CAC 40 étudiées communiquaient, en 2011, des éléments relatifs au montant de la rémunération variable perçue, seules 72,5 % d’entre elles livraient des informations en ce qui concerne le plafond de la rémunération variable, la nature et le degré de réalisation des objectifs. Quant à la nature des critères révélés, les objectifs quantitatifs comptent pour 56 % de la rémunération en moyenne.
D’autre part, le mécanisme même des « stock-options » et de l’attribution des actions gratuites peut pousser à des actions à court terme dans la mesure où ces instruments ont pour finalité et effet d’aligner l’intérêt des dirigeants d’entreprise sur celui des actionnaires en suspendant potentiellement la perception d’une rémunération, suivant les critères retenus, à l’évolution des cours de bourse. D’ailleurs en droit, rien ne s’oppose à ce qu’un mandataire social puisse cumuler l’attribution de « stock-options » avec des actions gratuites. Ce faisant, il lui est possible de bénéficier des avantages financiers des deux formules et d’accroître un peu plus sa rémunération différée, indépendamment de sa performance, d’ailleurs, puisque le gain issu d’une cession d’actions gratuites est, par définition, systématique.
Ces différents constats fondent la mission à proposer des mesures susceptibles d’amener les entreprises à recourir à des instruments de rémunération plus en rapport avec la performance à long terme.
b) Faire des « stock-options » et des attributions d’actions gratuites des éléments de rémunération plus propices à la performance de long terme
À cette fin, la mission propose une réforme des règles applicables aux conditions de détention et de vente et au prix d’exercice des options ou des actions gratuites dans la mesure où ces variables conditionnent les gains qui peuvent être tirés de ces instruments et, par conséquent, le comportement des mandataires sociaux à la tête de l’entreprise.
La procédure décisionnelle aboutissant à la distribution de « stock-options » ou à l’attribution d’actions gratuites lui semble en revanche adéquate dès lors que pour une décision touchant au capital, c’est à l’assemblée générale extraordinaire qu’il appartient, en application des articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, d’autoriser le conseil d’administration ou de surveillance à consentir à une telle mesure, pendant un délai donné, et dans la limite d’un pourcentage du capital social de l’entreprise pouvant être détenu.
En ce qui concerne le prix de souscription des « stock-options », la mission préconise de supprimer, par la loi, la décote pouvant s’appliquer au prix de souscription des options.
En l’état du droit, les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code du commerce permettent de consentir des options sur la souscription ou l’achat d’actions sur le prix de souscription desquels le conseil d’administration ou de surveillance peuvent accorder un rabais allant jusqu’à 20 % de leur valeur (calculée par référence à la moyenne des cours du marché vingt séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie).
Or, ce rabais constitue un avantage qui peut susciter l’interrogation. Dans son rapport d’information sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché établi en 2009 (140), votre Co-rapporteur avait d’ailleurs préconisé une suppression ciblée de cet avantage pour les dirigeants-mandataires sociaux. Cette mesure était inspirée par le constat que la décote constituait un avantage excessif dès lors que dans leur position éminente, les dirigeants-mandataires sociaux sont en mesure de mieux apprécier les perspectives de développement de l’entreprise et donc de la valeur de ses actions.
Aujourd’hui, il s’avère que la quasi-totalité des sociétés du CAC 40 et SBF 120 appliquent la recommandation du « code AFEP-MEDEF » et n’utilisent plus le mécanisme de la décote lors de l’attribution des options d’actions. D’après le rapport publié en 2012 par l’AFEP et le MEDEF sur l’application de leurs codes de gouvernance (141), 93,9 % des sociétés du SBF 120 et 100 % des sociétés du CAC 40 se seraient trouvées dans ce cas en 2011. Cependant, suivant cette même source, « l’information ne figure pas toujours explicitement dans la partie des documents de référence consacrée aux options de souscription et d’achat d’actions ».
Aussi la mission juge-t-elle que le législateur devrait consacrer cette tendance dans la loi par une interdiction formalisée dans le dispositif des articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.
Afin d’éviter que les dirigeants mandataires sociaux n’indexent leurs décisions et la stratégie de l’entreprise sur le seul cours de bourse, il conviendrait également d’allonger la période de référence pour le calcul du prix d’exercice des options.
En application des articles L. 225-177 du code de commerce, la période de référence prise en compte pour le calcul du prix de souscription se limite pour les sociétés cotées « aux vingt séances de bourses précédant […] » le jour où est consentie l’option. Or, ainsi que l’a souligné Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM), un tel dispositif peut favoriser des effets d’aubaine compte du caractère relativement court de ce délai.
La mission retient donc l’idée qu’il convient de prévoir une période plus longue pour le calcul du prix de souscription, par exemple de trois mois voire un an, l’idéal étant de faire coïncider le prix d’exercice des options sur une période de référence dont la durée correspondrait à la durée de la période d’exercice des options. Ainsi, dans son rapport précité de 2009, votre Co-rapporteur préconisait de lisser le calcul du prix d’attribution des « stock-options » sur le cours moyen observé sur une période de 130 jours de séances boursières, soit environ six mois. Il s’agit là d’une piste de réflexion que le Gouvernement et le Parlement pourraient explorer.
Dans la même logique, la mission préconise l’interdiction de tout mécanisme susceptible de permettre aux bénéficiaires de « stock-options » ou d’attribution d’actions gratuites de se prémunir contre les aléas du cours des marchés.
Il s’avère en effet que de tels instruments contreviennent à la finalité même de ces instruments de rémunération variable, auxquels doit s’attacher une part de risque afin qu’existe une certaine solidarité entre l’intérêt des dirigeants et celui des actionnaires investissant durablement dans l’entreprise. Or, des techniques comme le « repricing » ou le « reloading » pour les « stock-options » tendent à rompre cette communauté d’intérêts en ce qu’elles atténuent voire suppriment les aléas du cours des actions de l’entreprise au moment de l’exercice des options pour les mandataires sociaux qui peuvent en bénéficier. Le « repricing » permet au bénéficiaire de « stock-options » dont l’intérêt a fortement pâti d’une chute des cours, de renégocier le prix de ses options avec l’assentiment du conseil d’administration ou du directoire. Le « reloading » ne remet pas en cause le prix des options mais permet d’octroyer au bénéficiaire un nombre équivalent d’options nouvelles de façon à compenser la chute des cours. En outre, certaines institutions financières offrent à des détenteurs de « stock-options » une garantie sur les cours, entre le moment où l’option est levée et celui où elle s’exerce.
C’est pourquoi la mission a pris note avec intérêt de la pratique développée au sein d’une société telle que Capgemini, laquelle a au demeurant désormais renoncé à la distribution de « stock-options ». Selon les explications de M. Paul Hermelin, son président-directeur général, les cadres devaient s’engager sur l’honneur à ne pas se couvrir contre une éventuelle baisse du cours de leurs actions de performance, sous peine de perdre le bénéfice de leur attribution. Un tel engagement représente un moyen de solidarité avec les actionnaires.
Cependant, compte tenu de l’incidence de ce type de techniques sur le recours aux options, il apparaît plus judicieux de prendre les moyens législatifs ou réglementaires nécessaires à une interdiction générale de ces mécanismes de couverture. Une telle disposition comporte l’avantage de ne pas fausser la concurrence entre les entreprises, notamment du point de vue du recrutement des mandataires sociaux et des cadres.
Dans un même objectif de performance à long terme, en ce qui concerne les conditions de détention, la mission préconise l’allongement de la durée de conservation des actions gratuites.
À l’instar des « stock-options », les actions gratuites ne sont définitivement acquises qu’au terme d’une durée fixée par l’assemblée générale (période d’acquisition) et ne pouvant être inférieure à deux ans. Elles doivent en outre faire l’objet d’une durée minimale de conservation par leurs bénéficiaires (appelée période de cession), fixée là aussi par l’assemblée générale et ne pouvant être inférieure à deux ans (obligation légale fixée à l’article L. 225-197-1 du code de commerce dans le cas des actions gratuites).
Afin d’assurer la stabilité du capital des entreprises et de détourner les dirigeants-mandataires sociaux de décisions qui ne seraient pas fondées dans le long terme et pourraient donc affecter la valeur de leurs actions gratuites, la mission préconise d’allonger la durée de conservation obligatoire des actions gratuites avant que leur bénéficiaire puisse éventuellement céder ses titres. Dans cette optique, une durée de trois ans apparaît susceptible de créer une solidarité entre le dirigeant-mandataire social et l’entreprise, sans pour autant bloquer complètement l’utilisation des titres concernés, ce qui retirerait tout intérêt à cet instrument de rémunération variable.
Cette mesure présente également un intérêt en matière de recrutement et de fidélisation des cadres et des dirigeants-mandataires sociaux. Ainsi que l’a montré M. Paul Hermelin, le délai séparant la distribution d’actions de performance du transfert de leur propriété (délai de 2 ans en France contre 4 ans aux États-Unis) conditionne nécessairement la propension des cadres qui en bénéficient à démissionner de l’entreprise. Le système français ne favorise pas la fidélisation, d’autant qu’il permet en outre aux cadres qui démissionnent de garder leurs actions.
De ce point de vue, il conviendrait sans doute de prendre en considération le dispositif du vesting en vigueur aux États-Unis. Celui-ci se définit comme une modalité d’attribution progressive de « stock-options », les bénéficiaires de ces titres obtenant, parfois sur une période de trois à cinq ans, le droit de lever une partie des « stock-options » qui leur sont attribuées.
Enfin, il importe que la distribution de « stock-options » et l’attribution d’actions gratuites reposent sur des critères extra-financiers et pas exclusivement sur des critères quantitatifs tels que ceux liés à l’évolution des cours de bourse ou aux résultats financiers comparés d’entreprises similaires opérant dans les mêmes secteurs d’activité.
Suivant la définition et le périmètre retenus, ces derniers critères peuvent en effet pousser les conseils d’administration à se placer dans une perspective trop conjoncturelle qui ne prenne pas suffisamment en compte les enjeux stratégiques pour la pérennité et le développement durable de l’entreprise ainsi que son rôle social. En outre, ces critères ne permettent pas nécessairement de mesurer la valeur ajoutée des bénéficiaires des « stock-options » et des actions gratuites par rapport à ce que l’entreprise peut attendre dans l’exercice de telles fonctions.
Par critères extra-financiers, la mission pense bien entendu aux objectifs qui peuvent être définis dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle II »), l’article L. 225-102-1 du code de commerce oblige déjà les entreprises à communiquer, dans leur rapport de gestion, des informations sur la manière dont elles prennent en compte « les conséquences sociales et environnementales de [leurs] activité[s] ». Le contenu de ces informations est précisé à l’article R. 225-105-1 du code du commerce.
S’agissant des « stock-options » et des actions gratuites, il semble plus opportun d’envisager l’inscription dans les codes de gouvernance d’une recommandation qui inciterait les entreprises à soumettre le versement de ces rémunérations à des critères extra-financiers appréciables sur le long terme. Il importe que les entreprises s’approprient pleinement cet objectif ainsi que, de manière plus générale, la culture qui imprègne le concept de responsabilité sociétale des entreprises . La mission peut partager à cet égard le point de vue de Mme Marie-Laure Parthenay, secrétaire générale l’Association de cabinets d’audit ATH : il convient sans doute de ne pas trop légiférer tout de suite sur la RSE, mais au contraire de laisser le mouvement de promotion de la RSE se développer au sein des entreprises où bon nombre de jeunes y sont sensibles. C’est dans cette optique que la mission privilégie la formalisation de recommandation par les principaux intéressés ; les codes de gouvernance comportant par ailleurs l’avantage de permettre la définition de critères plus pertinents car plus proches du terrain.
Votre Rapporteure tient ici à souligner qu’à défaut de pouvoir procéder à l’interdiction des « stock-options » dans les grandes entreprises, mesure objectivement non dépourvues d’inconvénients majeurs, les présentes propositions présentent l’intérêt de rapprocher le mécanisme des « stock-options » de leur vocation première. Dans son esprit, ces instruments de rémunération variable devraient en effet s’adresser en priorité aux seules petites entreprises à forte croissance et, en tout cas, ne pas donner lieu à des rémunérations différées qui ne constituent pas la récompense ou la sanction de performances et d’une prise de risque fructueuse pour les entreprises sur le long terme pour l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.
Atteindre ce but suppose qu’une très grande transparence entoure les modalités et les critères de distribution de « stock-options » et d’attribution d’actions gratuites. Il importe que ces instruments de rémunération valorisent l’apport de tous au développement de l’entreprise et n’altèrent pas sa cohésion en créant des différences de traitement peu justifiables.
C’est pourquoi la mission préconise d’inscrire dans les codes de gouvernance une recommandation qui obligerait les entreprises à fournir les motifs d’une distribution de « stock-options » ou de l’attribution d’actions gratuites limitée aux seuls dirigeants-mandataires sociaux.
Cette mesure viendrait utilement compléter le dispositif instauré par la loi de 2008 en faveur des revenus du travail (142)et codifié aux articles L. 225-186-1 (pour les « stock-options ») L. 225-197-6 (pour les actions gratuites) du code de commerce. Certes, ces textes subordonnent l’attribution à ces dirigeants d’options ou d’actions gratuites à une attribution des mêmes instruments « au bénéfice de l’ensemble du personnel et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés des filiales » ou à l’existence d’un accord d’intéressement au bénéfice de ces mêmes catégories. Toutefois, cette obligation légale ne vaut aujourd’hui que pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. La proposition de la mission pourrait quant à elle concerner l’ensemble des grandes entreprises qui, indépendamment de leur cotation, utilisent de tels instruments.
Proposition n° 18 : réformer le régime des « stock-options » et des actions gratuites, notamment :
- en supprimant la décote applicable aux prix de souscription des options de souscription ou d’achat d’actions par une modification des articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce ;
- en allongeant leur durée de conservation minimale obligatoire sur le modèle du « vesting » pratiqué aux États-Unis ;
- en interdisant les mécanismes de couverture ;
- en inscrivant dans les codes de gouvernance une recommandation incitant les entreprises à soumettre le versement de ces rémunérations à des critères extra-financiers appréciables sur le long terme.
Proposition n° 18 bis de votre Rapporteure : réserver l’utilisation des « stock-options » aux petites et moyennes entreprises (TPE, PME).
C’est ce même souci de cohésion entre les dirigeants et leurs personnels qui fonde la mission à vouloir mettre un terme à des pratiques qui, au détriment de la qualité d’une gouvernance reposant sur la responsabilité de ses acteurs, atténuent la possibilité d’une réelle sanction de l’échec à la tête des entreprises.
4. Interdire les rémunérations sous forme de « retraites-chapeau »
Cette volonté procède autant du constat des problèmes inhérents à ces pratiques que de l’idée qu’elles contreviennent à la nature des fonctions de dirigeant-mandataire social.
La notion de « retraites-chapeau » désigne les retraites supplémentaires à prestations définies prévues par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Suivant cet article, ces régimes de retraite peuvent être gérés soit par l’entreprise du bénéficiaire, soit par des institutions de prévoyance, des institutions de gestion de retraite complémentaire, des organismes mutuels ou des sociétés d’assurance. En application de l’art. L. 225-102-1 du code de commerce, l’attribution des « retraites-chapeau » se trouve encadrée par la procédure stricte des conventions réglementées dans la mesure où la pension de retraite ainsi promise constitue un engagement de l’entreprise au sens du code de commerce (143).
Le premier problème posé tient donc à l’importance des charges pour les grandes entreprises que peut représenter ce type très particulier de régimes de retraite.
D’après le rapport de l’association de cabinets d’audit ATH sur les rémunérations de 400 dirigeants de sociétés cotées en 2011, 86 dirigeants de société cotées bénéficiaient en 2010 d’un régime de retraite supplémentaire (soit 23 % des dirigeants dont la situation a pu être examinée, contre 75 en 2009, c’est-à-dire 20 % du panel). Sur ces 86 dirigeants, 38 d’entre eux pouvaient prétendre à une retraite à prestations définies (contre 34 en 2009).
Compensant la différence entre les montants versés par les régimes de cotisation obligatoire (AGIRC et ARCO) et le plancher garanti, les « retraites-chapeau » donnent lieu au provisionnement de sommes qui peuvent atteindre des montants considérables pour l’entreprise. À titre d’illustration, d’après les chiffres rendus publics par la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), au 31 décembre 2011, les seuls contrats relatifs aux retraites à prestations définies souscrits par les entreprises auprès des sociétés d’assurance représentaient 32 % de l’ensemble des cotisations de contrats de retraite d’entreprises en 2011. Le montant des engagements des sociétés d’assurance à ce titre représentait une provision de 30,94 milliards d’euros (35 % de l’ensemble des provisions).
À une plus large échelle, le problème de financement posé par les « retraites- chapeau » revêt – presque paradoxalement – un caractère d’autant plus aigu que le cercle de leurs bénéficiaires tend aujourd’hui à s’élargir. En effet, en application d’une recommandation du « code AFEP-MEDEF », dans 91,5 % des sociétés du SBF 120 et dans 90,3 % des sociétés du CAC 40, les régimes de retraites supplémentaires mis en place ne bénéficient pas qu’aux seuls mandataires sociaux.
La seconde difficulté que comporte la mise en œuvre des « retraites-chapeau » réside dans l’absence d’un lien nécessaire et incontestable entre le versement d’une pension souvent importante et les performances obtenues dans l’intérêt de l’entreprise.
Cette difficulté tient d’une part aux formes mêmes et à la nature contractuelle de ces dispositifs. Dans le cadre de ces régimes spécifiques de retraite, l’entreprise garantit en général le versement d’une pension viagère d’un niveau global prédéterminé, exprimé en pourcentage du dernier salaire perçu, dès lors qu’il est mis fin aux fonctions d’un mandataire social. Le bénéficiaire doit être présent dans l’entreprise au moment du départ à la retraite. Il existe certes également des variantes qui peuvent prendre la forme d’une distribution d’actions gratuites ou d’une prime exceptionnelle, équivalente à la somme des bonus perçus sur une certaine durée. En toute hypothèse, le bénéfice d’une telle pension de retraite et la détermination du pourcentage du dernier salaire perçu retenu pour son calcul procèdent des stipulations convenues entre un mandataire social et son entreprise.
On notera du reste que, assez logiquement, ce caractère d’engagement contractuel ne favorise pas un examen périodique de la pertinence des « retraites-chapeau ». D’après les études réalisées par Ernst & Young (144), la revue périodique par le comité des indemnités des régimes de retraites additionnelles des dirigeants mandataires sociaux ne fait partie des thèmes de travail abordés par les comités des rémunérations que dans 38,5 % des sociétés du CAC 40, ce pourcentage se réduisant à 31,1% pour le SBF 120.
D’autre part, l’importance du critère d’ancienneté dans la détermination des droits à pension réduit nécessairement la part accordée à la performance réelle. Cette question se pose en ce qui concerne la période de calcul de l’assiette de référence des « retraites-chapeau. » D’après les statistiques établies par Aon Hewitt, pour près de 58 % des sociétés du CAC 40 et 74 % des sociétés du SBF 80 étudiées, cette période de référence pour le calcul des pensions ne dépasse pas trois ans (145).
Sur plan des principes, l’importance des « retraites-chapeau » ne paraît pas conforme à la nature des responsabilités que les dirigeants mandataires sociaux doivent assumer. En effet, elles tendent à compenser de manière excessive la précarité qui, par principe, doit s’attacher à leur mandat et à atténuer, dans un premier temps, la portée de la sanction liée une révocation. À cette aune, on peut ainsi s’interroger sur la justesse de régimes de retraites spécifiques qui, en moyenne, assurent des pensions avec un taux de remplacement de 50 % des revenus d’activité perçus dans les sociétés du CAC 40 et du SBF 80 (fixe dans 12 % des cas ; fixe ainsi que variable dans 88 % des sociétés) (146).
Aussi la mission préconise-t-elle l’interdiction par la loi des rémunérations sous-forme de « retraites-chapeau ».
Certes, il existe aujourd’hui un contrôle du juge, même si l’obtention d’une retraite chapeau ressortit de stipulations conventionnelles. Celui-ci peut ainsi annuler la convention qui en accorde le bénéfice dès lors qu’elle ne respecte pas la procédure prévue par le code de commerce (notamment l’autorisation du conseil d’administration) ou qu’elle constitue un avantage dommageable pour la société. La cour d’appel de Paris en 2008, par exemple, a jugé que tel était le cas s’agissant de la retraite chapeau accordé par le groupe Carrefour à son ancien président, M. Daniel Bernard (147).
Néanmoins, il importe de moraliser les pratiques en offrant un cadre normatif lisible et dont l’application ne soit pas tributaire de l’interprétation de codes de gouvernance même exigeants ou d’évolutions jurisprudentielles
Proposition n° 19 : interdire les rémunérations sous forme de « retraites chapeau ».
5. Interdire le versement d’indemnités de départ en cas de départ volontaire du dirigeant-mandataire social
Par indemnités de départ, il faut entendre les éléments de rémunération ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement des fonctions de dirigeant-mandataire social, ou postérieurement à celles-ci.
Certes, le versement d’indemnités de départ semble, en théorie comme en pratique, ne pouvoir être qu’extrêmement marginal et très difficile à concevoir en raison même du statut juridique du mandat social.
Les statistiques disponibles tendent à montrer que de fait, dans la très grande majorité des entreprises, le versement d’une indemnité de départ suppose que son bénéficiaire ait rempli des conditions de performance mais également que le départ revête un caractère contraint. Ainsi, selon les chiffres communiqués par le cabinet de conseil en politique de rémunération Aon Hewitt, 94 % des sociétés du CAC 40 (89 % des sociétés du SBF 80) examinées suspendent ces versements à des conditions de performance ; 79 % sociétés du CAC 40 (58 % des sociétés du SBF 80) prévoient de telles indemnités sous réserve d’un départ contraint à la suite d’un changement de contrôle, 76 % d’entre elles (58 % des sociétés du SBF 80) retenant en outre l’hypothèse d’un départ contraint lié à un changement de stratégie (148).
Cela étant, il convient de remarquer que ces indemnités relèvent pour l’essentiel de stipulations contractuelles ou conventionnelles, ce qui pose – au moins en théorie – la question de la juste qualification par les parties prenantes de la situation des bénéficiaires et, notamment des circonstances susceptibles de donner à leur départ un caractère contraint. Suivant les études réalisées par Aon Hewitt, par exemple pour le « premier dirigeant » (149), le versement d’indemnités de départ constitue un engagement pris dans le cadre du mandat et/ou le contrat de travail dans plus de la moitié des sociétés du SBF 120 (150).
En application des principes de la liberté contractuelle, les sociétés peuvent consentir à une indemnité dès lors que les conditions de performance – définies au demeurant par elles-mêmes – sont remplies. Par ailleurs, dans l’hypothèse très spécifique où le dirigeant quitterait tout à fait une entreprise dont il est en outre salarié, il ne faut pas écarter complètement la possibilité d’un recours au procédé de la rupture conventionnelle (151). Dans ce cadre, le départ de l’entreprise devrait s’accompagner du versement d’une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle » dont le montant ne peut être inférieur aux indemnités légales de licenciement et résulte de la libre négociation entre les parties à la convention qui doit formaliser la rupture.
Du point de vue de votre mission, la cessation volontaire des fonctions de dirigeant mandataire social d’une entreprise constitue nécessairement une renonciation à un mandat ou, dans le cas où son bénéficiaire peut se prévaloir d’un contrat de travail, une démission. Elle ne saurait donc être entourée de garanties similaires à celles prévues par le code du travail en cas de perte involontaire d’un emploi.
Dès lors, la mission préconise d’établir un cadre qui interdise le versement d’une indemnité de départ en cas de départ volontaire d’un dirigeant mandataire social.
Cet objectif pourrait prendre la forme d’une disposition législative, le cas échéant complétée par une recommandation des codes de gouvernance, qui poserait ce principe expressément. Une autre solution envisageable consisterait à prévoir une procédure d’information systématique et immédiate de l’assemblée générale des actionnaires, sous la forme d’un rapport du conseil d’administration ou de surveillance, de sorte que l’assemblée se trouve en mesure éventuellement de se saisir des conditions de ce départ avant le versement de toute indemnité.
Cette mesure se justifie d’autant mieux que le montant des indemnités de départ peut être significatif en raison de leur mode de calcul. Outre une assiette portant sur 94 % (dans les sociétés du SBF 80) à 100 % de la rémunération fixe et variable, ce montant peut en effet représenter jusqu’à 24 mois de salaire d’après l’étude réalisée par Aon Hewitt. C’est le cas de 78 % des sociétés du CAC 40 examinées (58 % dans les sociétés du SBF 80) (152).
Il s’agit donc d’un enjeu dont les pouvoirs publics doivent pleinement se saisir.
6. Subordonner le versement des jetons de présence à une participation effective aux séances des conseils d’administration
Cette préconisation répond à une exigence à propos de laquelle existe depuis quelques années un assez large consensus. D’ailleurs, les organisations représentatives des employeurs en ont parfaitement mesuré l’enjeu puisqu’elles ont souhaité établir, dans le « code AFEP-MEDEF », une recommandation destinée à encadrer l’usage de ces modes de rémunération accessoire.
Il faut dire que les sommes apparaissent relativement importantes eu égard à l’échelle des revenus dans la société française et peuvent conduire parfois à s’interroger tant sur le principe de cette rémunération que sur ces modalités.
Définie, pour les sociétés anonymes, aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, la notion de « jetons de présence » désigne la somme fixe annuelle que l’assemblée générale des actionnaires a la faculté d’allouer aux administrateurs « en rémunération de leur activité », à raison notamment de la participation et du temps consacré aux séances des conseils d’administration ou de surveillance. D’après les statistiques disponibles, les jetons de présence représentent des montants assez significatifs tant pour l’entreprise (qui peut les porter à ses charges d’exploitation) que pour leurs bénéficiaires. Suivant l’étude réalisée par le cabinet de conseil en politique de rémunération Aon Hewitt (153), la médiane des enveloppes globales de jetons de présence accordées aux présidents de conseil d’administration, en 2010, s’établit ainsi dans le panel étudié : à près de 650 000 euros pour les sociétés du CAC 40, 300 000 euros au sein du SBF 80 et 90 000 euros au sein du SBF 250 hors SBF 120. Au plan individuel, le montant annuel des jetons accordés aux présidents de conseil peut atteindre 70 000 euros dans les sociétés du CAC 40, 45 000 euros dans les sociétés du SBF 80 et 19 000 euros dans les sociétés du SBF 250 hors SBF 120. Suivant cette même source, la médiane s’élève pour les présidents à 50 000 euros et à 48 000 euros pour les autres administrateurs.
Au regard de l’assiduité et à l’implication des administrateurs, dont rendent compte notamment les éléments que la mission a recueilli auprès des personnes entendues, ces sommes peuvent paraître relativement justifiées.
Néanmoins, au plan des principes, le versement des jetons de présence ne va pas de soi dans la mesure où la participation aux séances des conseils d’administration ou de surveillance entre a priori dans les missions qui incombent normalement, dans l’exercice de leurs fonctions, aux dirigeants-mandataires sociaux appelés à siéger dans ces instances. Leurs salaires vaut déjà rémunération de ces missions. Dans cette optique, – ainsi que votre Co-rapporteur l’avait déjà souligné en 2009 en tant que rapporteur d’une précédente mission (154)–, il apparaît difficile de comprendre le bien fondé de certaines pratiques telles que la majoration des sommes versées en fonction de la présence effective des intéressés.
La diversité des usages tient à la grande latitude dont disposent les assemblées générales et les conseils d’administration dans l’octroi de jetons de présence. Ainsi, les articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce précisent que l’assemblée générale décide de cette allocation « sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures ». De même, ces articles accordent a priori tout pouvoir aux conseils d’administration pour répartir les jetons de présence entre administrateurs.
Dès lors que la recommandation déjà édictée dans le « code AFEP-MEDEF » ne semble pas produire les effets escomptés, la mission préconise d’introduire une disposition légale qui subordonnerait le versement de jetons de présence à la participation effective des membres aux réunions des conseils d’administration ou de surveillance.
Par-delà le caractère législatif des suites qui pourraient être données à ces propositions, il s’avère indispensable que les entreprises fassent leurs les principes et les objectifs destinés à promouvoir et à établir une gouvernance responsable et de long terme.
Dans le domaine spécifique des rémunérations, il apparaît ainsi nécessaire qu’elles se dotent de procédures qui garantissent une attention vigilante sur leurs pratiques et l’évolution de leur environnement. Ce devoir de vigilance incombe au premier chef aux conseils d’administration ou de surveillance et, sous leur autorité, aux comités spécialisés responsables des rémunérations. Cela étant, la place de ce comité spécialisé varie sensiblement.
Sur un plan quantitatif, il convient de souligner que si 98 % des entreprises du CAC 40 et 88 % des sociétés du SBF 80 en sont pourvues, d’après les statistiques disponibles, ce n’est le cas que pour 52 % des sociétés du SBF 250 hors SBF 120 (155). Sur un plan qualitatif, une étude empirique des thèmes de travail abordés tend à montrer que les comités de rémunération ne traitent pas nécessairement de toutes les questions de rémunération de manière égale. Or, celles-ci revêtent généralement une importance décisive dans la qualité de la gouvernance des entreprises.
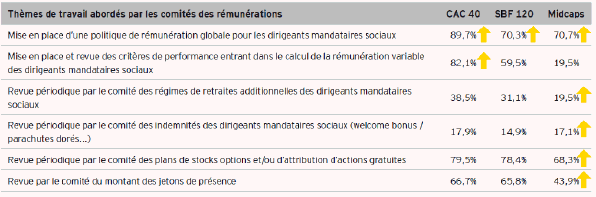
Source : Ernst & Young, Panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises édition 2012, octobre 2012, p. 21.
Aussi la mission juge indispensable d’instaurer par la loi l’obligation pour les entreprises de créer un comité des rémunérations et de formaliser les compétences qu’il exercera sous la responsabilité du conseil d’administration ou de surveillance.
Pour ce faire, le Gouvernement et le législateur pourraient s’inspirer du dispositif légal relatif aux comités d’audit institués par l’article L. 823-19 du code de commerce. En effet, la formulation de ce texte présente l’intérêt de définir assez précisément le positionnement de ce comité (sous l’autorité des conseils d’administration et de surveillance et en collaboration avec le commissaire aux comptes) ainsi que ses missions et ses pouvoirs.
Sur ce modèle, la disposition législative que la mission appelle de ses vœux pourrait ainsi reconnaître au comité des rémunérations une compétence particulière s’agissant des critères qui conditionnent le versement de certains éléments de rémunération variable ou différée. Cette évaluation systématique pourrait donner lieu à un rapport ad hoc qui devrait être obligatoirement soumis au vote de l’assemblée générale.
Proposition n° 20 : instaurer par la loi l’obligation pour les entreprises de créer un comité des rémunérations et de formaliser les compétences exercées sous la responsabilité du conseil d’administration ou de surveillance.
Éthique et efficacité économique : tels sont les deux pôles autour desquels la mission a organisé ses réflexions. Ces deux exigences doivent cesser d’être regardées comme antithétiques, tant tout démontre au contraire qu’elles peuvent être parfaitement conciliables et complémentaires.
Soucieuse qu’il soit donné des suites à ses recommandations, la mission a formulé des propositions opérationnelles, préconisant notamment des modifications législatives concrètes.
La bonne gouvernance des grandes entreprises et la qualité du dialogue social en leur sein ne sont pas qu’une question de principe, elle détermine aussi largement l’efficacité et la compétitivité de nos sociétés. C’est un véritable changement de culture que la mission souhaite appuyer, pour permettre une convergence des intérêts des acteurs dans le sens de l’intérêt général de l’entreprise.
La mission forme le vœu que ses réflexions nourrissent les débats qui auront lieu à l’occasion de l’examen par notre Assemblée du projet de loi sur la modernisation de la gouvernance des entreprises dont le dépôt été annoncé par M. Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des Finances, pour le premier trimestre 2013.
Certaines des propositions de la mission pourraient inspirer d’éventuels amendements au texte qui sera soumis à notre Assemblée par le Gouvernement ainsi qu’une éventuelle proposition de loi réformant la gouvernance des grandes entreprises.
Au cours de sa réunion du mercredi 20 février 2013, la Commission procède à l’examen du rapport d’information présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur, et M. Philippe Houillon, co-rapporteur.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mes chers collègues, nous en venons à l’examen du rapport de la mission d’information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises. Comme vous le savez sans doute, Corinne Narassiguin était présidente et rapporteure de cette mission. Son élection a été annulée par le Conseil constitutionnel le vendredi 15 février. Vous me permettrez de dire à ce propos combien j’ai été frappé par la sévérité des décisions rendues par le Conseil. En effet, j’ai trouvé pour le moins surprenant que l’on reproche aux parlementaires qui ont vu leur élection annulée – mais également aux nombreux candidats invalidés – le non–respect de règles qui n’existaient pas au moment où leurs candidatures ont été enregistrées. De fait, les décrets en question ont été publiés quatre mois après la date d’ouverture de la période où les dépenses de campagne doivent faire l’objet d’une comptabilité. Je trouve qu’en la circonstance, le Conseil a fait montre d’une exigence qu’il convient de souligner. Après tout, c’était la première fois qu’était organisée l’élection des députés des Français de l’étranger. Or, il n’existe pas de jurisprudence établie et le droit tâtonne en cette matière. Les élections des députés des Français établis à l’étranger se tiennent dans des circonscriptions où il y a plusieurs monnaies et plusieurs pays. C’est pourquoi, même si pour l’application du droit électoral, la rigueur est toujours souhaitable et la vigilance toujours appréciable, je pense que notre Commission devrait examiner la manière dont les règles vont évoluer à l’avenir. Demain, il y aura sans doute à nouveau des élections des députés des Français établis à l’étranger. Quand les règles sont hésitantes, on ne peut pas reprocher aux candidats d’avoir des difficultés à les appliquer, surtout quand elles ne leur sont pas opposables au début de la campagne électorale. Je trouve important que cela soit dit à cet instant car c’est la raison pour laquelle Corinne Narassiguin ne peut présenter le rapport auquel elle a travaillé. En sa qualité de vice-président de la mission, Jean-Michel Clément a été désigné hier soir pour assumer les fonctions de président-rapporteur et présenter avec notre collègue Philippe Houillon le fruit d’une réflexion collective qui n’est pas remis en cause. Je crois savoir que le rapport a été approuvé à l’unanimité par les membres de la mission le 12 février. Il nous appartient aujourd’hui d’en autoriser la publication.
C’est manifestement le résultat – à la lecture du document que j’ai pu parcourir – d’une convergence de vue sur les constats et les remèdes à apporter à la gouvernance des grandes entreprises afin d’en assurer la transparence, ce qui est notre ambition. Ce travail doit également beaucoup – j’imagine – au sens de la conciliation dont Corinne Narassiguin et Philippe Houillon ont su faire preuve.
En effet, chacun dans son rôle et avec sa sensibilité propre, nos collègues semblent être parvenus à établir un compromis équilibré, qui ouvre des perspectives pour une réforme alliant éthique et efficacité mais qui, naturellement, n’exclut pas des divergences. Dans cette confrontation des points de vue, éminemment utile à ce grand chantier qu’il faudra peut-être entreprendre, toutes les propositions seront versées au débat. Celles que Corinne Narassiguin aura portées en son nom propre y trouvent à mes yeux parfaitement leur place. Aussi chacun comprendra que je tenais à associer notre collègue aux remerciements que j’adresse par ailleurs à la mission, pour son engagement ainsi que pour le travail qu’elle aura fourni pendant ces quelques mois.
Je cède à présent la parole à Jean-Michel Clément.
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. J’ai participé aux travaux de la mission aux côtés de Corinne Narassiguin et c’est à elle que je pense en cet instant car il lui revenait d’en présenter le rapport. Il s’agit d’un travail qu’elle a réalisé en collaboration avec Philippe Houillon et je tenais d’abord à lui rendre hommage pour ce qu’elle a ainsi accompli. Nous avons eu l’occasion de travailler ensemble. Sa parfaite maîtrise de la langue anglaise nous aura permis de comprendre toute la subtilité des règles de nos amis britanniques lorsque nous avons réalisé un déplacement à Londres. Son expérience professionnelle du monde de la banque aura été également très précieuse. Son travail nous manquera.
Avant de présenter les conclusions des travaux de la mission, je voudrais simplement rappeler qu’avec Philippe Houillon, nous avions déjà travaillé en 2009 sur un rapport qui posait la question de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché. Ainsi, nous avions déjà abordé un certain nombre des questions que nous traitons dans le cadre de la présente mission sur la gouvernance, même si celle-ci couvre un champ plus large que la seule problématique des rémunérations.
Comme le Président Jean-Jacques Urvoas vient de le rappeler, ce rapport résulte de nos différents échanges ainsi que des arbitrages auxquels Philippe Houillon et Corinne Narassiguin sont parvenus préalablement à l’adoption du rapport par la mission. Il témoigne donc tout à la fois d’une certaine communauté de vue quant aux insuffisances actuelles de la gouvernance des grandes entreprises mais également de la persistance de quelques divergences quant aux solutions qu’il convient d’y apporter.
Cela étant, je crois pouvoir dire ici que ces divergences peuvent apparaître relativement minimes eu égard à l’étendue des problèmes que nous nous sommes efforcés d’appréhender et surtout au faible nombre de préconisations sur lesquelles nous n’avons pu nous accorder.
Le présent rapport comporte ainsi 20 propositions qui traitent de l’ensemble des aspects de la gouvernance des grandes entreprises et expriment les exigences que l’ensemble de nos collègues peuvent raisonnablement porter.
Le premier ensemble de propositions vise à instaurer un meilleur équilibre entre la loi et les codes de gouvernance, notamment en créant l’obligation pour les grandes entreprises de se référer à un code de gouvernance, les modalités d’élaboration de ce code devant être profondément rénovées par-delà les divergences d’appréciation quant au champ exact des acteurs appelés à cette tâche. De manière générale, la mission a entendu privilégier une approche pragmatique qui fasse la part de ce qui relève de l’autorégulation et de ce qui nécessite une intervention du législateur.
Une deuxième série de propositions tend à établir une gouvernance stable et ouverte aux diverses parties prenantes de l’entreprise : il s’agit notamment d’octroyer des droits de vote doubles aux actionnaires de long terme, car il est pour le moins choquant que des actionnaires « de passage » se voient aujourd’hui reconnaître autant de pouvoir que des actionnaires pérennes qui, contrairement aux premiers, sont toujours présents au capital de l’entreprise pour supporter les conséquences des décisions prises, parfois plusieurs années après les votes.
Par ailleurs, il convient de renforcer le contrôle sur les conventions réglementées dont le détournement peut nuire à l’intérêt social des entreprises.
En outre, nous estimons nécessaire d’instaurer par la loi une représentation obligatoire des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance : comme les actionnaires, les salariés contribuent à la création de richesses et peuvent tout autant percevoir des vulnérabilités susceptibles d’altérer l’activité économique. Leur valeur ajoutée mérite d’être pleinement reconnue et intégrée dans les instances de gouvernance des grandes entreprises.
Dans cette même optique, il nous faut améliorer la qualité du dialogue social par le développement de la formation proposée aux salariés ainsi que par la réforme du délit d’entrave. Sur ce dernier point, je tiens à préciser qu’il ne s’agit nullement de porter atteinte aux procédures de consultation des instances représentatives du personnel, mais de favoriser un dialogue constructif le plus en amont possible des difficultés de l’entreprise. Ce dialogue sera d’autant plus aisé que chacun assumera pleinement ses responsabilités : c’est notamment cette finalité que la mission poursuit lorsqu’elle préconise de limiter plus strictement le cumul des mandats sociaux.
En dernier lieu, des propositions ont été formulées afin de favoriser une gouvernance responsable, au service de stratégies de long terme. Dans ce but, la mission a réfléchi à des sanctions pécuniaires plus efficaces en cas de gestion fautive. Mais pour sanctionner les dirigeants ayant commis des fautes de gestion, encore faut-il pouvoir engager leur responsabilité. Cet objectif peut être atteint par la création d’une procédure d’action de groupe reposant sur le mécanisme de l’« opt-in ». Ainsi, seules seraient membres du groupe les personnes affectées par un préjudice financier qui auraient expressément manifesté leur volonté d’être représentées à l’instance, ce qui exclurait celles qui ne se seraient pas manifestées. L’action de groupe reposerait alors sur un mandat exprès et le silence des personnes affectées par le préjudice financier serait assimilé à un refus de se joindre à l’action collective.
La commission de fautes passibles de sanctions pourrait être évitée si les dirigeants-mandataires sociaux étaient mieux contrôlés. C’est la raison pour laquelle il nous paraît souhaitable de renforcer le poids du vote de l’assemblée générale des actionnaires sur la politique de rémunération des dirigeants dans le cadre de ce que l’on appelle communément le « say on pay ».
Consubstantielle au métier d’entrepreneur, la prise de risques ne doit pas pour autant conduire à des paris inconsidérés qu’encourage la structure actuelle de certaines rémunérations variables. C’est pourquoi la mission préconise notamment une réforme du régime des « stock-options » et des actions gratuites destinée à leur rendre leur vocation première, ainsi que l’interdiction des rémunérations sous forme de « retraites chapeau ».
En somme, j’estime que ce rapport propose des mesures qui peuvent contribuer à la fois à une moralisation des pratiques et à un indispensable changement de culture. C’est pourquoi je vous proposerai qu’au terme de notre discussion, la Commission autorise la publication de ce rapport.
M. Philippe Houillon, co-rapporteur. Je voudrais m’associer à l’hommage qui a été rendu à Corinne Narassiguin. J’ai travaillé avec elle pas loin de six mois à l’élaboration du rapport qui vous est soumis aujourd’hui. Je regrette la décision qui sans doute humainement est particulièrement difficile à vivre surtout quand on a quitté un pays pour s’installer ici avec sa famille. Cela étant, il faut reconnaître que depuis des années, cette commission et l’Assemblée nationale en général ne cessent – sans doute pour donner en vain des gages à l’opinion publique – de durcir la législation, ce qui contraint les juridictions à rendre des décisions qui aboutissent à des résultats comme celui-ci, que l’on déplore, et qui suscite à mes yeux un drame humain. En tout cas, je salue par ailleurs l’esprit de consensus dont a fait preuve Corinne Narassiguin, attitude qui a sans doute été facilitée par le fait qu’elle était députée des Français établis à l’étranger, élue en Amérique du Nord et installée à New York, ce qui la disposait à avoir une vision qui la rapprochait davantage de la mienne.
Pour le reste, notre collègue Jean-Michel Clément a parfaitement expliqué les choses et je ne veux pas être redondant.
Ce rapport ne constitue pas une révolution en ce qu’il fait le point sur des sujets qui se trouvent sur la table depuis un certain temps. En 2009, j’avais déjà présenté un rapport et je constate qu’un certain nombre de constats que j’y avais formulés sont textuellement repris ici. Peut-être un jour seront-ils appliqués et ne resteront pas simplement dans un rapport.
Il y a donc, dans le présent rapport, un tronc commun de constats et de propositions et puis des variations entre les deux rapporteurs, Madame Narassiguin développant des conceptions plus contraignantes sur un certain nombre de points.
Ainsi, en ce qui concerne les codes de gouvernance, si nous étions d’accord sur les principes, elle a souhaité que ce soient les partenaires sociaux qui les écrivent. Je pense pour ma part que ce rôle appartient aux professions et aux organisations patronales, sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers.
Je me suis également accordé avec Corinne Narassiguin sur un sujet tout aussi important que le principe de la participation de salariés aux conseils d’administration, mesure qui figure dans le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi et vers laquelle nous nous dirigeons nécessairement par la force des choses. Mais, pour ma part, puisqu’elle porte en elle un véritable changement des cultures, je souhaite que cette mesure soit mise en œuvre de manière concomitante et consubstantielle avec un allègement d’un code du travail, qui est aujourd’hui prohibitif en bien des matières, et des procédures de licenciement.
Sur les « stock-options », nous nous retrouvons encore sur un certain nombre de principes. En revanche, Corinne Narassiguin souhaitait qu’elles soient réservées aux très petites entreprises. Je pense que cela n’est pas réaliste. D’abord, il n’y a pas de « stock-options » dans les TPE et les PME. Par ailleurs, il s’agit d’un mode de rémunération extrêmement attractif, non seulement pour les dirigeants mais également pour les cadres les plus importants. C’est pourquoi il faut conserver les « stock-options », moyennant les réserves dont nous sommes convenus.
Pour ce qui est du principe « say on pay », dont l’application tend à s’étendre en Europe et qui implique que l’assemblée générale des actionnaires se prononce sur la politique des rémunérations et les rémunérations individuelles, tout dépend où l’on met le curseur. Nous sommes entendus sur les principes mais des divergences d’appréciation subsistent. Ainsi, Corinne Narassiguin souhaitait que l’assemblée générale des actionnaires porte une appréciation, a posteriori, sur les rémunérations individuelles, avec la possibilité d’un vote négatif. Cela paraît aller assez loin car dès lors que l’on intervient a posteriori, cela signifie que les rémunérations sont déjà versées. Or, après un vote négatif de l’assemblée générale, il serait bien compliqué d’exiger la restitution de ces sommes, ce qu’impliquait le raisonnement développé par Corinne Narassiguin. Je suis quant à moi partisan d’un avis simple de l’assemblée générale, comme cela se pratique ailleurs. L’assemblée générale des actionnaires est souveraine et un conseil d’administration qui, de manière réitérée, ne suivrait pas ses avis ne manquerait pas de se heurter à des difficultés sans qu’il soit besoin de créer une procédure compliquée de vote négatif.
Au total, puisque le rapport rend parfaitement compte de ces opinions divergentes, je ne vois que de l’intérêt à autoriser sa publication.
Mme Cécile Untermaier. Je souhaite m’associer à la tristesse bien partagée de mes collègues en ce qui concerne l’inéligibilité de Mme Corinne Narassiguin, qui a conduit les travaux de la mission auxquels j’ai essayé de participer aussi régulièrement que possible. Je tiens à souligner la qualité du travail mené, en toute transparence. À ce titre, il est très intéressant que ce rapport fasse valoir les avis divergents sur les différents points évoqués.
Un élément du rapport a particulièrement retenu mon attention, celui d’un mode de gouvernance désormais ouvert aux diverses parties prenantes de l’entreprise. J’avais d’ailleurs moi-même évoqué le mode de gouvernance de l’entreprise Saint-Gobain et je me félicite que cet exemple ait été repris par le rapport. C’est dans le sens du développement du dialogue avec les organes dirigeants de l’entreprise, mais également avec toutes les parties prenantes – qui sont également les collectivités publiques, les sous-traitants et les associations de consommateurs – qu’il faut aller.
Bien évidemment, c’est le dirigeant qui prend la décision in fine. Mais celle-ci doit être éclairée par un collège qui représente bien toute l’entreprise dans son ensemble, au-delà des actionnaires et du conseil d’administration, qui ne représente qu’une dimension particulièrement restreinte à l’heure actuelle.
M. Alain Tourret. Je souhaiterais formuler deux observations. Tout d’abord, j’ai écouté avec attention M. Philippe Houillon sur la façon dont les règles que nous nous mettons autour du cou finiront par nous étrangler.
Je souhaiterais évoquer les peines complémentaires et accessoires qui renforcent une décision d’annulation de l’élection. J’éprouve de grandes difficultés à comprendre qu’une peine d’inéligibilité puisse être prononcée quand la faute est sans rapport avec l’honneur, la probité et les bonnes mœurs.
M. Philippe Houillon, co-rapporteur. Ce n’est que l’application de la loi !
M. Alain Tourret. Il serait souhaitable qu’une réflexion soit conduite à ce sujet au sein de notre commission, car les manquements à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs sont les critères qui ont toujours constitué les limites des lois d’amnistie et sur lesquels nous étions tous d’accord. En revanche, de mon point de vue, en l’absence de tout enrichissement personnel, il ne devrait pas y avoir de peines complémentaires comme celle qui a été prononcée dans le cas présent. Nous verrons bien jusqu’où nous pouvons aller, mais nous devons cesser de tout accepter. Cette notion de double peine permanente me semble insupportable.
En ce qui concerne les « stock-options », j’avais été très intéressé par un rapport du président-directeur général de L’Oréal, qui y était opposé pare qu’il estimait que ce système ne correspondait plus à rien. Cette position est certes minoritaire, mais elle émane d’un grand, si ce n’est le plus grand, président-directeur général français, à la tête d’une entreprise qui a de surcroît, avec intelligence, permis un certain nombre d’avancées dans le domaine des ressources humaines. Elle me porte à m’interroger. C’est pourquoi je souhaiterais que notre rapporteur nous donne un éclairage complémentaire sur les propositions du rapport relatives aux « stock-options ».
M. Dominique Raimbourg. Tout d’abord, je m’associe à l’hommage rendu à Corinne Narassiguin et à l’idée défendue par Philippe Houillon selon laquelle « trop de vertu tue la vertu » et « on ne se renforce pas en s’épurant ». Il est exact que nos concitoyens attendent que nous fassions preuve d’honnêteté et de vertu mais ils nous demandent avant tout d’être efficaces. Ce qu’ils ne nous pardonnent pas serait plutôt notre inefficacité et notre incapacité à les protéger suffisamment face à la crise actuelle.
S’agissant du rapport, en lui-même, je souhaiterais poser deux questions. Tout d’abord, une suite législative a-t-elle été envisagée avec le Gouvernement ?
Par ailleurs, je partage l’avis de la rapporteure sur la question des « stock-options », qui ne devraient être réservées qu’aux TPE et aux PME, ainsi qu’aux sociétés nouvellement créées. Lorsque la société EADS a connu des difficultés à l’occasion de la construction de l’Airbus A380, ces difficultés n’étaient connues qu’au sein de l’entreprise. Or, une partie des cadres a rapidement vendu ses actions, ce qui a aggravé les difficultés de la société, les actions perdant alors une partie de leur valeur. Ainsi, par le jeu des « stock-options », le comportement des cadres peut être contraire à l’intérêt de la société. Aussi, je me demande s’il n’y aurait pas lieu, pour éviter ce genre d’effets pervers, d’interdire les « stock-options » dans certaines grandes sociétés, ou à tout le moins dans les sociétés cotées.
À la suite de la revente des « stock-options » dans cette affaire, des poursuites avaient été engagées devant l’Autorité des marchés financiers et il était apparu que la procédure devant ladite autorité était très particulière, le ministère public n’ayant pas la possibilité de faire appel. Le droit d’appel était réservé aux personnes poursuivies – en l’espèce, il y avait eu une décision de relaxe. Le ministre de l’époque avait considéré que la procédure devait être modifiée mais je ne sais pas si cela a été fait. Peut-être en avez-vous connaissance.
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. En ce qui concerne la suite législative donnée à ce rapport, je crois que les propositions peuvent relever du champ de plusieurs textes. Il pourrait y avoir un texte spécifique consacré à la gouvernance ou bien des dispositions incluses dans des textes préparés par le ministère du Travail et relatifs à la place des salariés dans l’entreprise. C’est une question à laquelle réfléchissent le ministère de l’Économie et des finances et le ministère du Travail, afin de déterminer le texte où les propositions de la mission trouveront le mieux leur place. Je pense que le projet de loi destiné à retranscrire l’accord interprofessionnel sur la réforme du marché du travail pourrait être un véhicule législatif qui permettrait de voir concrétiser ces propositions au plus vite. Je crois aujourd’hui que tout le monde est d’accord sur l’idée de la participation des salariés aux conseils d’administration. Il faudra évidemment préparer cette arrivée en assurant aux salariés une formation et un cadre. Cela étant, cette mesure peut trouver rapidement un débouché législatif.
S’agissant des « stock-options », je souhaiterais d’abord formuler une remarque générale. De l’ensemble de nos auditions, il ressort l’idée qu’il nous faut récompenser – par des dispositifs juridiques tels que l’octroi d’un droit de vote double, ou des mesures fiscales – ceux qui restent durablement au sein de l’entreprise et y assument des risques. Il ne faut pas favoriser ceux qui ne font que passer afin d’obtenir une plus-value de court terme préjudiciable à l’intérêt de l’entreprise, en poussant à décisions stratégiques dont ils ne subiront pas les conséquences. Toutes les personnes entendues par la mission, notamment les grands patrons, nous l’ont dit. Par comparaison avec ce qui se passe dans d’autres pays, il faudra travailler à une législation qui encourage l’engagement durable dans les entreprises et contribue à la stabilité de leur capital, deux aspects qui vont de pair.
La question des « stock-options » a également à voir avec des mesures de fiscalité puisqu’il faut comparer les dispositions applicables à ce dispositif avec celles relatives aux actions gratuites. En effet, un traitement fiscal plus favorable pour les actions gratuites incite nécessairement à utiliser davantage cet instrument que les « stock-options ». C’est pourquoi il faut mener une réflexion sur les mesures fiscales en rapport avec la mise en place de dispositions juridiques destinées à fidéliser les cadres dans l’entreprise. Il faut prendre en considération la situation des petites entreprises et des entreprises de plus grande importance car on ne peut parler des « stock-options » distribuées dans une entreprise comme L’Oréal comme de celles attribuées dans une petite PME qui vient de se créer et cherche à encourager ses dirigeants. Au-delà de la technique juridique et des mesures fiscales, il faut remettre le système à plat.
M. Philippe Houillon, co-rapporteur. Très succinctement, si le Président m’y autorise, premièrement, je veux rappeler que M. Moscovici, lorsqu’il a été entendu par la mission, avait indiqué qu’un projet de loi serait déposé fin mars.
Deuxièmement, s’agissant des « stock-options », la réalité est que la mode est aux actions gratuites. Cela dit, sans rentrer dans des détails techniques, l’idée de la mission est bien d’accorder une « prime » à la conservation et à la stabilité de l’actionnariat. Pour autant, il ne faut pas supprimer les « stock-options » dont l’attrait peut varier en fonction de la fiscalité. Troisièmement, pour répondre à la question de M. Raimbourg, la réforme de la procédure devant l’Autorité des marchés financiers n’a pas été faite. À ma connaissance, elle a été effectivement envisagée afin de permettre au parquet d'interjeter appel.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. S’il n’y a pas d’autres questions, je vous soumets la question de l’autorisation de publier le rapport de la mission d’information.
La Commission, à l’unanimité, autorise ensuite le dépôt du rapport de la mission d’information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises.
POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE
ENTRE LA LOI ET LES CODES DE GOUVERNANCE
Proposition n° 1 : instaurer, par la loi, une obligation de se référer à un code de gouvernance pour les grandes entreprises cotées et pour les grandes entreprises non cotées dont le total de bilan excède 100 millions d’euros ou dont le montant net du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice dépassent respectivement 100 millions d’euros et 500 salariés ;
Fixer, dans la loi, une liste non exhaustive des questions devant être abordées par les codes de gouvernance ;
Conférer au président du tribunal compétent le pouvoir d’enjoindre aux sociétés cotées ou non cotées de se conformer à leur obligation de se référer à un code de gouvernance, et de sanctionner pécuniairement la violation de cette obligation.
Proposition n° 2 de votre Rapporteure : pour les sociétés cotées comme pour les sociétés non cotées, faire ressortir la rédaction des codes de gouvernance d’un accord interprofessionnel, négocié par les partenaires sociaux sur la base d’un document de travail préparatoire établi par l’AMF qui, à cet effet, devra consulter l’ensemble des parties prenantes (organisations représentatives des employeurs, représentants des dirigeants-mandataires sociaux et des investisseurs, professionnels du droit et de l’audit, les syndicats de salariés, sous-traitants). (156)
Proposition n° 2 bis de votre Co-rapporteur : pour les sociétés cotées, confier à l’AMF le soin d’émettre un simple avis sur le contenu des codes de gouvernance élaborés par les émetteurs et de formuler un avis motivé sur la pertinence des explications fournies par les entreprises pour justifier d’éventuelles dérogations aux règles définies par ces codes.
Proposition n° 3 : pour les sociétés non cotées, confier à une autorité de contrôle le soin d’émettre un simple avis sur le contenu des codes de gouvernance et de formuler un avis motivé sur la pertinence des explications fournies par les entreprises pour justifier d’éventuelles dérogations aux règles définies par ces codes.
Permettre à l’autorité de contrôle de saisir le président du tribunal de commerce compétent en cas de non-respect avéré des obligations du code de gouvernance auquel l’entreprise se réfère.
POUR UNE GOUVERNANCE STABLE ET OUVERTE
AUX DIVERSES PARTIES PRENANTES DE L’ENTREPRISE
Proposition n° 4 : élaborer un code de bonnes pratiques à l’attention des investisseurs.
Proposition n° 5 : octroyer un droit de vote double aux actionnaires justifiant détenir leurs titres de capital depuis au moins deux ans, tout en ménageant la possibilité, pour l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de s’y opposer par un vote à la majorité des deux tiers.
Proposition n° 6 de votre Rapporteure : abaisser le seuil exigé des actionnaires de sociétés dont le capital dépasse 15 millions d’euros pour pouvoir demander l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée. (157)
Proposition n° 7 : renforcer le contrôle des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, notamment en leur permettant de qualifier ces conventions.
Proposition n° 8 de votre Rapporteure : améliorer la visibilité de la stratégie des fonds d’investissement au bénéfice des petits actionnaires en complétant le rapport que le conseil d’administration ou le directoire doit fournir à l’assemblée générale ordinaire annuelle en application de l’article L. 225-100 du code de commerce par une information sur l’échéance à laquelle les fonds d’investissement de type fermé qui ont pris des participations dans la société se sont engagés à restituer les fonds qui leur ont été remis par leurs clients. (158)
Proposition n° 9 de votre Rapporteure : neutraliser provisoirement les droits de vote attachés à des titres financiers empruntés. (159)
Proposition n° 10 : instaurer, par la loi, une représentation obligatoire des salariés non-actionnaires, avec voix délibérative, au sein des conseils d’administration et de surveillance des entreprises de plus de 5000 salariés, y compris dans les comités spécialisés de ces conseils. Dans l’immédiat, fixer à deux le nombre de représentants des salariés non-actionnaires.
En contrepartie :
– accompagner la représentation des salariés dans les conseils d’administration et de surveillance en engageant concomitamment une simplification du droit du travail, sans mettre en cause la protection des salariés, notamment grâce à l’instauration d’une sécurisation des parcours professionnels (proposition de votre Rapporteure) ;
– de manière parfaitement concomitante, alléger les obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, en créant un contrat de travail unique et en simplifiant les modalités de licenciement sans amoindrir le contrôle du juge (proposition de votre Co-rapporteur).
Proposition n° 11 : améliorer le dialogue social :
– en développant la formation économique délivrée aux salariés, une formation spécifique devant être assurée aux délégués du personnel, aux membres des comités d’entreprise, ainsi qu’aux administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance ;
– en confiant la présidence du comité d’entreprise à un représentant des salariés ;
– en complétant les codes de gouvernance par une recommandation invitant à créer des comités des risques au sein des conseils d’administration et de surveillance, les comités devant informer les conseils d’administration ou de surveillance ainsi que les comités d’entreprise deux fois par an .
Proposition n° 12 : réformer le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise pour permettre une meilleure anticipation des difficultés des entreprises.
Proposition n° 13 : améliorer la quantité et la qualité des informations du rapport de gestion prévu par l’article L. 225-102-1 du code de commerce sur les questions de diversité, et notamment sur la diversité des origines, des profils, des parcours (universitaires, promotion interne ou recrutement externe…) des dirigeants-mandataires sociaux ;
Prévoir l’obligation pour les entreprises d’établir des plans d’action en faveur du développement de la diversité dans les conseils d’administration ou de surveillance (proposition de votre Rapporteure).
Proposition n° 14 : limiter plus strictement par la loi les cumuls de fonctions :
- en limitant à deux le nombre de mandats sociaux pouvant être détenus par un dirigeant en sus du mandat social qu’il détient dans l’entreprise qu’il dirige ;
- en limitant à quatre le nombre de mandats sociaux pouvant être exercés par des mandataires sociaux n’ayant aucune fonction de direction dans les entreprises où ils exercent ces mandats ;
- en interdisant le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail dans les grandes entreprises, sauf pour les administrateurs représentant les salariés.
Proposition n° 14 bis de votre Co-rapporteur : dans un encadrement plus strict par la loi du cumul des fonctions des mandataires sociaux, prévoir des dérogations spécifiques et mesurées en cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail.
POUR UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE
AU SERVICE DE STRATÉGIES DE LONG TERME
Proposition n° 15 : créer une procédure d’action de groupe reposant sur le mécanisme de l’« opt-in » et permettant aux investisseurs victimes de préjudices sériels d’engager la responsabilité des dirigeants-mandataires sociaux ;
Rendre plus effective et plus personnelle la sanction pécuniaire encourue pas les dirigeants-mandataires sociaux responsables d’une gestion fautive, en créant, sur le modèle américain, une action en recouvrement des rémunérations versées.
Proposition n° 16 : imposer aux grandes entreprises une obligation légale de publier des rapports spécifiquement consacrés à la présentation de leur politique de rémunération de leurs dirigeants-mandataires et à la description lisible, précise et exhaustive des rémunérations individuellement perçues par ces derniers ;
Modifier la loi pour reconnaître à l’assemblée générale des actionnaires un droit de vote qui serait :
- triennal et ex ante lorsqu’il porterait sur les principes et les grandes lignes de la politique de rémunération des dirigeants-mandataires sociaux pour les trois années à venir ;
- annuel et ex post lorsqu’il porterait sur le détail des rémunérations (fixes et variables, mais aussi sous forme d’indemnités de bienvenue, de départ et de non-concurrence) perçues individuellement par les dirigeants-mandataires sociaux au cours de l’exercice précédant l’assemblée générale.
Pour votre Rapporteure : reconnaître aux actionnaires un droit de veto sur les principes et le détail des rémunérations dès lors qu’une majorité des deux tiers des actionnaires réunis en assemblée générale exprime un vote négatif ; (160)
Pour votre Co-rapporteur : conférer au vote des actionnaires un caractère purement consultatif.
Proposition n° 17 : corriger les excès des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux non pas par leur plafonnement, mais par une réforme de la fiscalité qui ne serait pas limitée aux revenus des seuls dirigeants-mandataires sociaux des grandes entreprises, mais concernerait l’ensemble des hauts revenus ;
Abaisser le plafond du montant des rémunérations globales versées aux dirigeants mandataires-sociaux qui est déductible des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur les sociétés.
Proposition n° 18 : réformer le régime des « stock-options » et des actions gratuites, notamment :
- en supprimant la décote applicable aux prix de souscription des options de souscription ou d’achat d’actions par une modification des articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce ;
- en allongeant leur durée de conservation obligatoire sur le modèle du « vesting » pratiqué aux États-Unis ;
- en interdisant les mécanismes de couverture ;
- en inscrivant dans les codes de gouvernance une recommandation incitant les entreprises à soumettre le versement de ces rémunérations à des critères extra-financiers appréciables sur le long terme.
Proposition n° 18 bis de votre Rapporteure : réserver l’utilisation des « stock-options » aux petites et moyennes entreprises (TPE, PME). (161)
Proposition n° 19 : interdire les rémunérations sous forme de « retraites chapeau ».
Proposition n° 20 : instaurer par la loi l’obligation pour les entreprises de créer un comité des rémunérations et de formaliser les compétences exercées sous la responsabilité du conseil d’administration ou de surveillance.
ANNEXE N° 1 : LES CODES DE GOUVERNANCE
« AFEP-MEDEF » ET « MIDDLENEXT ».
Le « code AFEP-MEDEF » est inspiré d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées produit en octobre 2003 par l’AFEP et le MEDEF. Ce rapport a été complété par la formulation, en janvier 2007 puis en octobre 2008, de recommandations sur la rémunération des dirigeants-mandataires sociaux de ces sociétés. L’ensemble des règles de bonne conduite édictées par l’AFEP et le MEDEF entre 2003 et 2008 a été regroupé au sein d’un code de gouvernance publié en décembre 2008. L’AFEP et le MEDEF se réservent le droit de saisir les dirigeants des sociétés cotées qui se réfèrent à leur code de gouvernance mais ne fournissent pas d’explication suffisante sur les dérogations qu’elles y font. Par ailleurs, ces organisations d’employeurs se sont engagées à publier chaque année un rapport global sur l’évolution du suivi des recommandations, en se fondant sur l’analyse des informations diffusées par les 120 entreprises ayant la plus forte capitalisation boursière sur la place de Paris (SBF 120).
Le « code AFEP-MEDEF » comporte un certain nombre de recommandations en matière de composition et de fonctionnement des organes dirigeants des sociétés cotées (critères d’indépendance des administrateurs, évaluation des travaux du conseil d’administration…), ainsi qu’en matière de rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux (conditions de cumul d’un contrat de travail avec un mandat social, modalités de détermination des parties fixe et variable de la rémunération des dirigeants-mandataires sociaux, modalités de versement des indemnités de départ et des retraites supplémentaires à prestations définies – ou « retraites-chapeau », modalités d’attribution, d’exercice et de conservation des options de souscription ou d’achat d’actions – ou « stock-options » – et des actions gratuites – ou « actions de performance »…).
Le « code AFEP-MEDEF » a été conçu par référence aux grandes valeurs cotées dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros et dont l’actionnariat est souvent dilué dans le public. Il lui a été reproché de comporter des règles de bonne conduite inadaptées à la situation des petites et moyennes valeurs cotées. En effet ces valeurs ont souvent un actionnaire de référence important, soit familial, soit entrepreneurial, dont il n’est pas rare qu’il détienne la majorité des droits de vote et/ou du capital. Par ailleurs, il est fréquent que le(s) représentant(s) de l’actionnaire de référence exerce(nt) des fonctions de direction au sein de l’entreprise. Dans le cas de ces valeurs, les questions de gouvernance portent surtout sur une juste articulation entre, d’une part, la liberté d’action entrepreneuriale de dirigeants qui sont aussi, le plus souvent, les actionnaires majoritaires, et, d’autre part, la protection des actionnaires minoritaires.
C’est la raison pour laquelle l’association professionnelle des petites et moyennes valeurs cotées (« Middlenext ») a publié en décembre 2009 un code de gouvernance (ou « code Middlenext ») adapté à ce type d’entreprises et inspiré par le Référentiel pour une gouvernance raisonnable des entreprises françaises qui a été établi en juin 2009 par M. Pierre-Yves Gomez.
Élaboré après consultation non seulement des dirigeants des entreprises concernées, mais aussi des investisseurs, des juristes, des auditeurs et des régulateurs publics, le « code Middlenext » a vocation non pas tant à se substituer au « code AFEP-MEDEF », qu’à adapter, compléter ou préciser certaines de ses recommandations de façon à les rendre plus adéquates aux réalités de l’organisation et du fonctionnement des petites et moyennes valeurs cotées.
Ce code de gouvernance contient à la fois des recommandations, que les entreprises qui adoptent le code doivent appliquer, sauf à expliquer dans leur rapport annuel pourquoi elles ne le font pas, conformément au principe « comply or explain », et des points de vigilance qui ne font qu’inviter le conseil d’administration ou de surveillance à s’interroger sur certains aspects de la gouvernance.
Comme le « code AFEP-MEDEF », le « code Middlenext » traite des questions relatives à la composition et au mode de fonctionnement des organes dirigeants des entreprises (cumul et durée des mandats sociaux, critères d’indépendance des administrateurs, rythme et évaluation des travaux des conseils d’administration ou de surveillance, déontologie des administrateurs…) ainsi que des questions relatives à la rémunération des dirigeants-mandataires sociaux (conditions de cumul d’un contrat de travail avec un mandat social, modalités de versement des indemnités de départ et des « retraites-chapeau », modalités d’attribution, d’exercice et de conservation des « stock-options » et actions gratuites…).
ANNEXE N° 2 : LE CODE BRITANNIQUE DE BONNE CONDUITE DES INVESTISSEURS
(« UK STEWARDSHIP CODE »)
La première version du « UK Stewardship Code » a été publiée en 2010 par l’autorité britannique de reporting financier (« Financial Reporting Council » - FRC) qui, pour l’élaborer, s’est largement inspirée des Principes relatifs aux responsabilités des investisseurs institutionnels (162), édictés dès 2002 par la commission des investisseurs institutionnels (« Institutional Shareholders Committee » - ISC) qui, en 2009, avaient compilé ces règles dans un code de bonne conduite. La prise en charge, par le FRC, de l’élaboration et du contrôle de la bonne application du code de conduite des investisseurs institutionnels répond aux recommandations du rapport de David Walker sur la gouvernance des institutions financières (163).
Ce code de bonne conduite s’adresse aux actionnaires et aux sociétés gestionnaires de fonds d’investissement qui détiennent des participations dans des entreprises cotées au Royaume-Uni. Lorsque des investisseurs institutionnels choisissent d’externaliser certaines activités liées à la gestion de portefeuille de titres, en faisant appel notamment à des cabinets de conseil en politique de vote ou à des consultants spécialisés dans les investissements, le code s’applique aussi, par extension, à ces prestataires de services.
Ce code de bonne conduite formule sept exigences à l’égard des investisseurs institutionnels, à savoir :
– qu’ils publient leur politique d’investissement ;
– qu’ils définissent et publient une politique rigoureuse de gestion des conflits d’intérêts ;
– qu’ils suivent de près les performances des entreprises dans lesquelles ils investissent ;
– qu’ils établissent des orientations claires sur la façon dont ils intensifient leurs activités et la période à laquelle ils comptent le faire ;
– qu’ils soient disposés à agir collectivement avec d’autres investisseurs quand la situation est appropriée ;
– qu’ils définissent et publient une politique de vote claire ;
– qu’ils rendent compte périodiquement de leur gestion et de leurs votes.
ANNEXE N° 3 : « STOCK-OPTIONS » ET ACTIONS GRATUITES
Inspirés des « stock-options plans » anglo-saxons et introduits en droit français par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, les options de souscription ou d’achat d’actions (ou « stock-options ») relèvent d’une forme mixte d’intéressement et de participation au capital : l’entreprise consent à son personnel le droit d’acquérir ses propres actions à des conditions privilégiées, lui offrant ainsi l’occasion de réaliser une plus-value.
En application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code du commerce, les « stock-options » sont distribuées dans le cadre de plans d’options pouvant porter soit sur la souscription, soit sur l’achat d’actions. La souscription d’actions, régie par l’article L. 225-177 du code de commerce, porte sur des titres qui n’ont pas encore été émis mais qui le seront dans le cadre d’une augmentation de capital soumise à une procédure allégée, en termes de publicité ou de paiement notamment. L’achat d’actions, prévu à l’article L. 225-179 du code de commerce, porte sur des titres déjà émis et rachetés par la société avant qu’elle ne les propose, sous forme d’options, à ses salariés.
Dans les deux cas de figure, la procédure se déroule en trois étapes : en premier lieu, l’attribution au bénéficiaire par sa société du droit, pendant une période donnée, à se porter acquéreur d’un certain nombre de titres à un prix déterminé ; en deuxième lieu, l’exercice du choix par le bénéficiaire de lever l’option qui lui a été attribuée ; en dernier lieu, la revente à la discrétion par le bénéficiaire ayant exercé sa levée d’options des titres ainsi acquis et la perception éventuelle d’une plus-value.
Le mécanisme d’attribution d’actions gratuites a été introduit dans notre droit des sociétés par la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Cette initiative parlementaire visait à pallier les imperfections des « stock-options » en permettant une association la plus large possible des salariés au capital.
Aux termes des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, l’assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de l’entreprise ou à une partie seulement, à une attribution gratuite des actions existantes ou à émettre. Le déroulement de la procédure d’attribution est calqué sur celle qui prévaut pour la souscription de « stock-options ».
S’ils sont éligibles au dispositif des actions gratuites comme pour les « stock-options », le président du conseil d’administration, le directeur général, les membres du directoire et le gérant de société par actions sont toutefois soumis à des modalités un peu particulières, dans la mesure où le conseil d’administration ou de surveillance doit fixer la proportion d’actions gratuites ainsi attribuées qui ne peuvent être cédées avant la fin de leur mandat.
ANNEXE N° 4 : LES STRUCTURES DE GOUVERNANCE
Tableau n° 1
PRÉVALENCE DES DIFFÉRENTS TYPES DE GOUVERNANCE
CAC 40 |
SBF 80 |
SBF 250 hors 120 | |
Conseil d’administration avec présidence et direction générale uniques |
53 % |
47 % |
53 % |
Conseil d’administration avec présidence et direction générale distinctes |
24 % |
29 % |
25 % |
Conseil de surveillance & directoire |
20 % |
19 % |
17 % |
En commandite |
3 % |
5 % |
5 % |
Source : Aon Hewitt, Étude – Vade-mecum Comité des rémunérations 2011-2012.
Tableau n° 2
PRÉVALENCE DES COMITÉS SPÉCIALISÉS
CAC 40 |
SBF 80 |
SBF 250 hors 120 | |
Comité d’audit |
100 % |
95 % |
81 % |
Comité des rémunérations / nominations |
98 % |
88 % |
52 % |
Comité de stratégie |
53 % |
42 % |
15 % |
Pas de comité |
0 % |
3 % |
18 % |
Source : Aon Hewitt, Étude – Vade-mecum Comité des rémunérations 2011-2012.
Graphique
FUSION ET DISSOCIATION DANS LE CAC 40
Au 21 novembre 2012
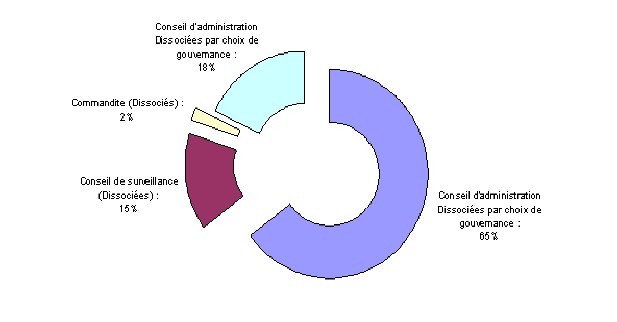
Source : Ethics & Boards – novembre 2012
26 sociétés avec fusion des fonctions, soient 65 %, ou 78,8 % hors CS et commandite
- 14 sociétés avec scission des fonctions, dont 7 du fait du choix de la structure juridique (6 conseil de surveillance et 1 commandite) ;
- 7 conseils d’administration par choix de gouvernance (Alcatel, BNP, Crédit Agricole, Pernod Ricard, Sanofi, Solvay).
ANNEXE N° 5 : LES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
RÉPARTITION DES MANDATS DANS LES CONSEILS DU CAC 40
Au 21 novembre 2012
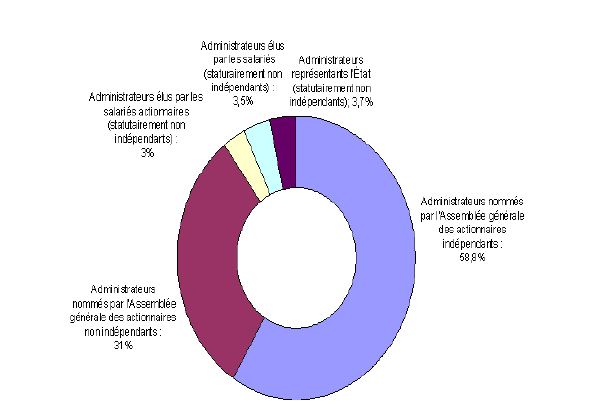
Source : Ethics & Boards
Au 21 novembre 2012 les Conseils du CAC 40 compte 562 mandats dont 58 mandats statutairement non indépendants.
Le taux d’indépendance globale du CAC 40 est de 58,8 %.
Le taux d’indépendance des administrateurs nommés par l’Assemblée générale des actionnaires est de 65,5 %.
ANNEXE N° 6 : PARITÉ ET DIVERSITÉ DANS LES ORGANES DIRIGEANTS DES GRANDES ENTREPRISES
ÉVOLUTION DE LA PARITÉ DE LA PARITÉ DU CAC 40 PAR RAPPORT AUX AUTRES INDICES MONDIAUX (2010-2012)*
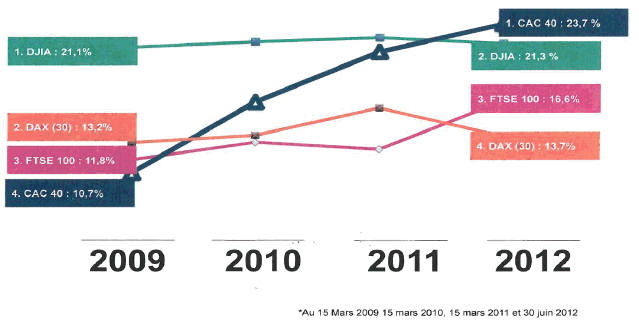
* Au 15 mars 2009 15 mars 2010, 15 mars 2011 et 30 juin 2012
Source : Ethics & Boards – novembre 2012
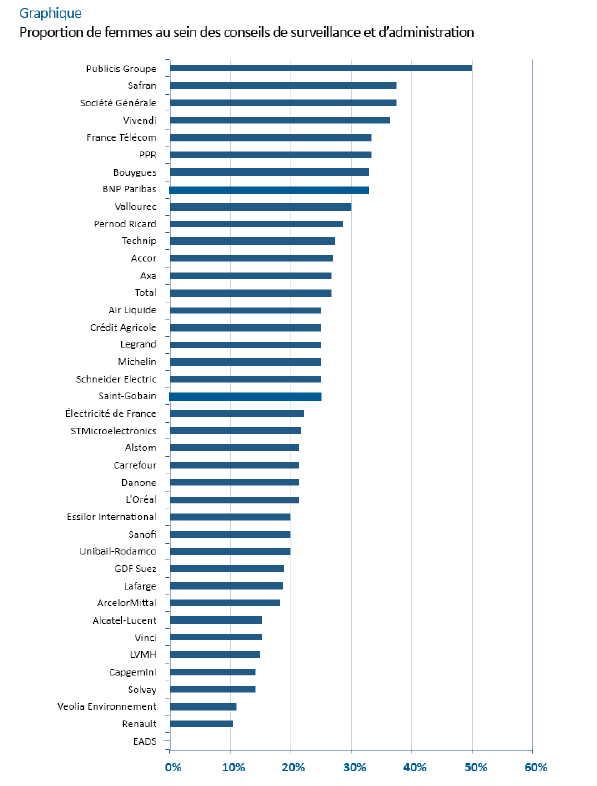
Source : République et diversité, Le CAC 40, parité, diversité, octobre 2012, p. 7.
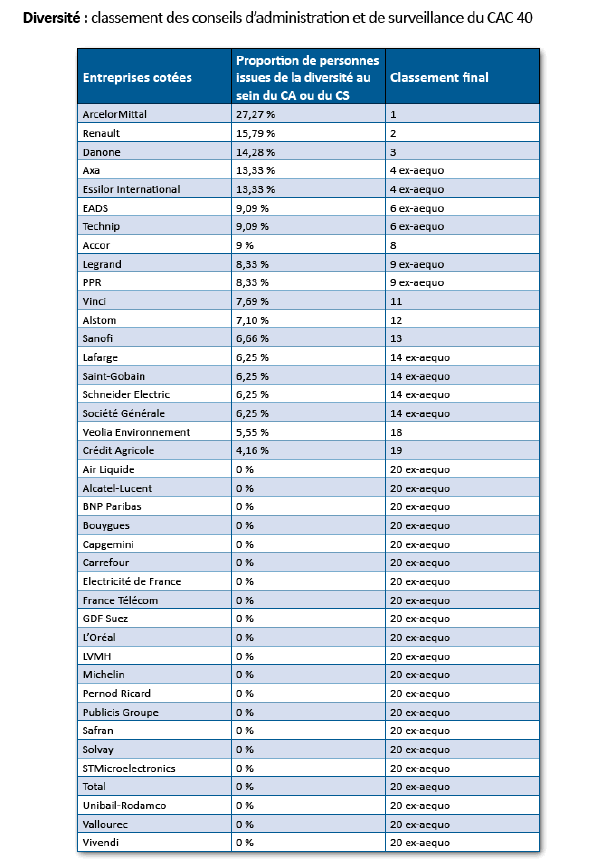
Source : République et diversité, Le CAC 40, parité, diversité, octobre 2012, p. 9.
ANNEXE N° 7 : L’ACTIONNARIAT SALARIÉ
Au 31 décembre 2011, les entreprises du CAC 40 disposant d’un actionnariat salarié :
- 40 % des entreprises du CAC 40 (16) plus de 3 % (Seuil de la loi NRE)
- 30 % des entreprises du CAC 40 (16) entre 0,3 % et 3 %
PLACE DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ > 3 % DANS LES ENTREPRISE DU CAC 40
au 31 décembre 2011
Bouygues
|
Safran
|
Saint-Gobain
|
Essilor
|
Société Générale
|
AXA
|
Cap Gemini
|
BNP Paribas
|
Vallourec
|
Crédit Agricole
|
Total
|
Schneider
|
Alcatel-Lucent
|
France Telecom
|
Legrand
|
Renault
|
Salariés des entreprises |
Actionnariat de référence, familial ou autocontrôle | ||
État français et CDC / FSI |
Investisseurs institutionnels internationaux | ||
Public – actionnaires individuels et non identifiés |
Source : Ethics & Boards, novembre 2012.
PLACE DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ < 3 % DANS LES ENTREPRISE DU CAC 40
au 31 décembre 2011
GDF Suez
|
Technip
|
EDF
|
Air Liquide
|
Michelin
|
Alstom
|
Danone
|
Sanofi
|
Pernod-Ricard
|
Carrefour
|
L’Oréal
|
PPR
|
Catégories d’actionnaires :
Salariés des entreprises |
Actionnariat de référence, familial ou autocontrôle | ||
État français et CDC / FSI |
Investisseurs institutionnels internationaux | ||
Public – actionnaires individuels et non identifiés |
Source : Ethics & Boards, novembre 2012.
ANNEXE N° 8 : LA STRUCTURE DES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX (MS)
RÉMUNÉRATION MÉDIANE ET STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION TOTALE
DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX
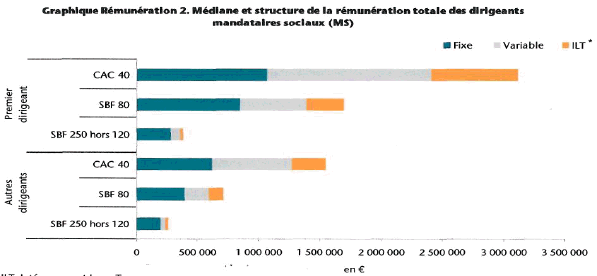
en €
* ILT : Intéressement Long Terme
Source : Aon Hewitt, Étude – Vade-mecum Comité des rémunérations 2011-2012
ANNEXE N° 9 : ÉLÉMENTS DE CALCUL DES « RETRAITES CHAPEAU »
Tableau n° 1
PÉRIODE DE CALCUL DE L’ASSIETTE DE RÉFÉRENCE.
CAC 40 |
SBF 80 | |
1 an |
8 % |
14 % |
2 ans |
4 % |
5 % |
3 ans |
46 % |
57 % |
5 ans ou plus |
42 % |
24 % |
Source : Aon Hewitt, Étude – Vade-mecum Comité des rémunérations 2011-2012.
Tableau n° 2
OBJECTIFS DE TAUX DE REMPLACEMENT
CAC 40 |
SBF 80 | |||||
Q1 |
M |
Q3 |
Q1 |
M |
Q3 | |
Taux de remplacement supplémentaire |
20 % |
27 % |
40 % |
16 % |
25 % |
60 % |
Taux de remplacement tous régimes confondus |
36 % |
50 % |
58 % |
35 % |
50 % |
60 % |
Source : Aon Hewitt – Vade-mecum – Comité des rémunérations 2011-2012.
ANNEXE N° 10 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES INDEMNITÉS DE DÉPART DES DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX
Tableau n° 1
PRÉVALENCE PAR ENTREPRISE DES ENGAGEMENTS D’INDEMNITÉS DE DÉPART
CAC 40 |
SBF 80 | |||
Nature du mandat |
Premier dirigeant |
Autres |
Premier dirigeant |
Autres |
Engagement dans la cadre du mandat |
45 % |
16% |
46% |
13 % |
Engagement dans le cadre du contrat de travail |
5 % |
22 % |
7 % |
23 % |
Engagement dans le cadre du contrat ou du mandat |
50 % |
38 % |
53 % |
36 % |
Engagement dans le cadre d’une convention collective |
8 % |
42 % |
14 % |
24 % |
Pas d’indemnités* |
45 % |
33 % |
46 % |
59 % |
Non communiqué |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
* Ni au titre du mandat, ni au titre du contrat, ni au titre d’une convention collective.
** Pour les entreprises ayant au moins un dirigeant MS autre que le premier dirigeant.
Source : Aon Hewitt – Vade-mecum – Comité des rémunérations 2011-2012.
Graphique
ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION SERVANT D’ASSIETTE
AU CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART
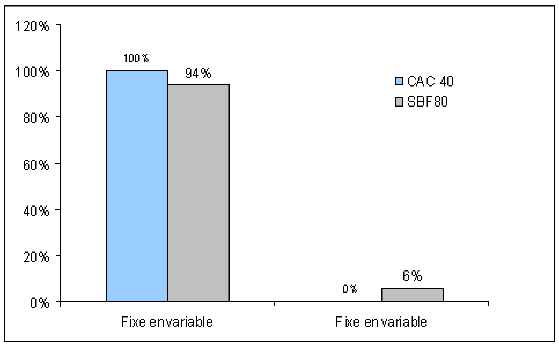
Source : Aon Hewitt – Vade-mecum – Comité des rémunérations 2011-2012.
Tableau n° 2
CONDITIONS D’APPLICATION DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART
CAC 40 |
SBF 80 | |
Conditions de performance |
94 % |
89 % |
Départ contraint lié à un changement de contrôle |
79 % |
58 % |
Départ contraint lié à un changement de stratégie |
76 % |
58 % |
Non communiqué |
6 % |
3 % |
Source : Aon Hewitt, Étude – Vade-mecum Comité des rémunérations 2011-2012.
ANNEXE N° 11 : MONTANTS DES JETONS DE PRÉSENCE DES DIRIGEANTS-MANDATAIRES SOCIAUX
ENVELOPPE DE JETONS DE PRÉSENCE 2010 (€)
CAC 40 |
SBF 80 |
SBF 250 hors 120 | |||||||
Q1 |
M |
Q2 |
Q1 |
M |
Q2 |
Q1 |
M |
Q2 | |
Enveloppe allouée |
600 000 |
875 000 |
1 063 000 |
253 000 |
400 000 |
595 000 |
58 000 |
105 000 |
154 000 |
Enveloppe distribuée |
509 000 |
651 000 |
901 000 |
200 000 |
294 000 |
468 000 |
34 000 |
90 000 |
146 000 |
Source : Aon Hewitt, Étude – Vade-mecum Comité des rémunérations 2011-2012.
PERSONNES ENTENDUES
PAR LA MISSION D’INFORMATION
Les auditions de la mission d’information ayant été ouvertes à la presse, leur enregistrement vidéo est consultable sur le site Internet de l’Assemblée nationale, au lien suivant :
http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?dossier=Commissions&commission=GOUVENTR.
Mardi 25 septembre 2012
Table ronde sur la place de l’État dans la gouvernance des grandes entreprises
— M. Hervé de Villeroché, chef du service du financement de l’économie au sein de la direction générale du Trésor (ministère de l’Économie et des finances)
— Mme Catherine Bergeal, directrice des Affaires juridiques des ministères économique et financier (ministère de l’Économie et des finances), et représentante de l’État au conseil d’administration de la RATP
— M. Laurent Vallée, directeur des Affaires civiles et du Sceau (ministère de la Justice)
— M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail (ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)
— M. Gérard Rameix, président de l’Autorité des marchés financiers
— M. David Azéma, commissaire aux participations de l’État (Agence des participations de l’État), et ancien directeur général délégué de la SNCF
— M. Antoine Gosset-Grainville, directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations
— M. Olivier Bailly, conseiller du comité de direction, chargé de mission auprès du directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations
Mercredi 26 septembre 2012
Table ronde réunissant des organisations représentant les employeurs
• Représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
— Mme Marie-Ange Debon, présidente de la commission droit de l’entreprise
— M. Robert Leblanc, président du comité d’éthique
— Mme Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques
— M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques
• Représentants de l’Association française des entreprises privées (AFEP) :
— M. Paul Hermelin, président-directeur général de Capgemini
— Mme Odile de Brosses, directrice du service des affaires juridiques de l’AFEP
Mercredi 3 octobre 2012
Table ronde réunissant les représentants de dirigeants-mandataires sociaux
— M. Daniel Lebègue, président de l’Institut français des administrateurs (IFA)
— M. Robert Leblanc, président national du Mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)
— M. Xavier Huillard, président de l’Institut de l’entreprise et président-directeur général de Vinci
— Mme Sophie de Menthon, présidente d’Ethic

— Mme Pascale Auger, administratrice de Manutan, membre d’Ethic
— M. Pierre Cejka, chargé de mission auprès d’Ethic
— Mme Caroline Weber, directrice générale de Middlenext, présidente de l’association européenne des valeurs moyennes cotées
Mercredi 10 octobre 2012
Table ronde réunissant des représentants des syndicats de salariés sur la place des salariés et sur l’actionnariat salarié
• Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
— M. Jean-Frédéric Dreyfus, trésorier confédéral CFE-CGC, administrateur salarié CA-CIB
— M. Alain Champigneux, administrateur salarié CFE-CGC Renault
— Mme Francine Didier, chargée d’études économiques au sein de la CFE-CGC
• Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
— M. Marcel Grignard, secrétaire national
— M. Olivier Berducou, secrétaire confédéral en charge des questions de RSE et de gouvernance
• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
— M. Geoffroy de Vienne, conseiller du président
• Force ouvrière (FO) :
— Mme Marie-Alice Medeuf-Andrieu, secrétaire confédérale (secteur conventions collectives)
— M. Pascal Pavageau, secrétaire confédéral (secteur économie)
• Confédération générale du travail (CGT) :
— M. Jack Toupet, coordinateur au groupe Atos origin
• Solidaires Unitaires Démocratiques (SUD) :
— Mme Verveine Angeli, secrétaire nationale
Mercredi 17 octobre 2012
Table ronde réunissant des représentants d’investisseurs : actionnaires, fonds de pension, fonds d’investissement…
— International Corporate Governance Network (ICGN) : M. Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis Asset Management
— Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) : M. Philippe Desfossés, directeur
— Association nationale des sociétés par actions (ANSA) : M. Christian Schricke, délégué général
— Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM) : Mme Colette Neuville, présidente
— Association des petits porteurs actifs (APPAC) : M. Didier Cornardeau, président
— Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) : M. Louis Godron, président
— Association française de la gestion financière (AFG) : M. Paul-Henri de la Porte du Theil, président
Mercredi 24 octobre 2012
Table ronde réunissant des cabinets de conseil en politique de vote
• Cabinet Proxinvest :
— M. Pierre-Henri Leroy, président
— M. Loïc Dessaint, directeur associé
• Cabinet Towers Watson :
— M. Sylvain Perrier, responsable de l’entité Executive Compensation pour la France
• Cabinet Institutional Shareholder Services (ISS) :
— Mme Catherine Salmon, responsable de la recherche sur la gouvernance pour le marché français
— M. Jean-Nicolas Caprasse, responsable de l’activité gouvernance pour l’Europe
Mercredi 31 octobre 2012
Table ronde réunissant des représentants de cabinets d’audit
• Association de cabinets d’audit ATH:
— M. Pierre Godet, président
— Mme Marie-Laure Parthenay, secrétaire générale
• Cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) :
— Mme Marie Supiot, avocate-associée, barreau des Hauts-de-Seine
Mercredi 7 novembre 2012
Table ronde sur quelques expériences patronales de la gouvernance des grandes entreprises
— M. Gérard Andreck, président de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA)
— M. Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain
— M. Daniel Bernard, président-directeur général de Kingfisher, président de Provestis, président de la Fondation HEC
Lundi 12 novembre 2012
Entretiens menés lors du déplacement à Londres
• High Pay Centre :
— Mme Deborah Hargreaves, présidente
• Financial Reporting Council (FRC) :
— M. Jim Sutcliffe, président de la commission du FRC chargée de l’élaboration des codes de gouvernance
— M. Stephen Haddrill, directeur général du FRC
— M. Chris Hodge, rédacteur du UK Corporate Governance Code
• Ministère du Commerce et de l’innovation (Business, Innovation and Skills Department - BIS) :
— M. Graham Turnock, délégué général
• Chambre des communes :
— MM. Julian Smith et David Mowat, députés
• London School of Economics (LSE)
— M. Camille Landais, économiste français, chargé d’enseignement
• Compagnie des conseils et experts financiers
— Mme Susan Liautaud, membre
Mercredi 14 novembre 2012
Table ronde réunissant des spécialistes des questions de gouvernance des entreprises
— M. Jean-Louis Bianco, ancien ministre, auteur d’« Entreprise et démocratie sociale : pour une nouvelle approche » (Fondation Jean Jaurès)
— M. Marc Deluzet, auteur du rapport « Une vision progressiste de l’entreprise » (Fondation Terra nova)
— M. Guillaume Garnotel, enseignant-chercheur à l’INSEEC Business School
— M. Pierre-Yves Gomez, directeur de l’Institut français de gouvernement des entreprises (IFGE)
— M. Aurélien Éminet, chercheur associé à l’Institut français de gouvernement des entreprises (IFGE)
— M. Paul Lanois, avocat, auteur de « L’effet extraterritorial de la loi Sarbanes-Oxley »
— Maître Najib Saïl, avocat spécialiste des fusions-acquisitions et des marchés financiers
Mercredi 21 novembre 2012
Table ronde sur la place des femmes et des personnes issues de la diversité dans les organes dirigeants des grandes entreprises
• Fédération des Femmes administrateurs :
— Mme Agnès Bricard, présidente
— M. Xavier Delcros, avocat à la Cour, professeur des Universités
• Observatoire Ethics & Boards :
— Mme Floriane de Saint Pierre, Fondatrice et Présidente d’Ethics & Boards
— M. Guillaume de Piédoüe, Directeur Général d’Ethics & Boards
• Think tank République & diversité :
— M. Louis-Georges Tin, président
— M. Badis Boussouar, secrétaire général
— M. Adrien Rogissart, chargé de communication
• Democrats Abroad France
— Mme Ellen Kountz, ancien membre du comité de Direction
Mercredi 28 novembre 2012 :
Audition de M. Ugo Bassi, directeur au sein de la direction générale Marché intérieur et services de la Commission européenne
Mercredi 5 décembre 2012 :
Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des Finances
Mercredi 19 décembre 2012 :
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Audition de M. Michel Sapin, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () G. Charreaux (dir.), Le gouvernement de l’entreprise : Corporate Governance, Théories et faits, Économica, 1997.
3 () Par « dirigeants-mandataires sociaux », il faut entendre, outre le gérant des sociétés en commandite par actions :
- dans les entreprises qui sont dotées d’un conseil d’administration : le président, le directeur général (ou, le cas échéant, le président-directeur général), le directeur général délégué et les membres du conseil d’administration ;
- dans les entreprises qui sont dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance : le président et les membres du directoire, le président et les membres du conseil de surveillance.
4 () L’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, précise qu’une « grande entreprise » est un entreprise qui, soit occupe au moins 5000 personnes, soit occupe moins de 5000 personnes mais a un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliards d’euros ou un total de bilan supérieur à 2 milliards d’euros.
5 () La taille des entreprises cotées est souvent appréciée au regard de la segmentation du marché réglementé Eurolist qui est géré par l’entreprise de marché Euronext. Euronext distingue en effet trois segments au sein du marché réglementé, selon l’importance de la capitalisation boursière des entreprises cotées : le compartiment A qui regroupe les « grandes entreprises » dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d’euros ; le compartiment B qui regroupe les « valeurs moyennes » dont la capitalisation boursière est comprise entre 150 millions et 1 milliard d’euros, et le compartiment C qui rassemble les petites sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.
6 () Sont souvent considérées comme de « grandes entreprises » celles qui appartiennent à l’indice boursier « Société des Bourses Françaises 250 » ou « SBF 250 » qui rassemble les 250 entreprises ayant la plus forte capitalisation boursière sur la place de Paris. L’indice boursier « SBF 120 » regroupe les valeurs appartenant aux indices « CAC 40 » et « SBF 80 ». Le « CAC 40 » (ou « Cotation assistée en continu 40 ») est l’indice boursier qui regroupe les 40 entreprises ayant la plus forte capitalisation boursière. Le « SBF 80 » englobe les 80 entreprises qui, après celles du CAC 40, ont la plus forte capitalisation boursière.
7 () Cette dénomination sera retenue dans le cadre du présent rapport.
8 () Sur ces codes de gouvernance, voir l’encadré figurant en annexe n° 1.
9 () Livre vert de la Commission européenne sur le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union européenne, 5 avril 2011.
10 () AMF, Rapport 2012 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, 11 octobre 2012, pp. 6 et 35.
11 () Un fonds d’investissement est de type ouvert quand la société gestionnaire du fonds (souvent un organisme de placement collectif en valeurs mobilières – OPCVM) est tenue d’acheter ou d’émettre des parts à la demande, à tout moment. Le nombre de parts augmente en fonction des investissements des souscripteurs qui ne sont pas tenus de souscrire des parts dans un délai déterminé.
À l’inverse, un fonds d’investissement est de type fermé quand la société gestionnaire du fonds limite la durée pendant laquelle ses parts peuvent être souscrites, aucune part ne pouvant être souscrite au-delà de la période de souscription initiale.
12 () AMF, Rapport 2012 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, 11 octobre 2012, p. 7.
13 () Ibid.
14 () A. Kahn, « Rémunération : les patrons du CAC s’engagent à plus d’autodiscipline », Le Monde économie, 15 décembre 2012, p. 13.
15 () Le concept de « soft law » désigne des normes ne reposant sur des règles de droit positif inscrites dans la loi ou le règlement. La traduction française du terme serait « droit mou ».
16 () D’après le communiqué conjoint de l’AFEP et du MEDEF publié le 19 mai 2009 (http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-presse/communiques-de-presse/communiques-de-presse/article/composition-du-comite-des-sages-et-modalites-de-fonctionnement.html.)
17 () Commission européenne, Livre vert sur le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union européenne, 5 avril 2011, p. 4 et 21. Publiée le 23 septembre 2009 et réalisée sur la commande de la Direction générale marché intérieur et services de la Commission européenne, l’Étude sur les systèmes de contrôle et la mise en place de règles de gouvernement d’entreprise au sein des États membres de l’Union européenne montre que dans plus de 60 % des cas, lorsque les entreprises résolvent de ne pas appliquer des recommandations des codes de gouvernance auxquels elles ont adhéré, elles ne fournissent pas d’explication suffisantes à ce sujet.
18 () A. Kahn, « Rémunération : les patrons du CAC s’engagent à plus d’autodiscipline », Le Monde économie, 15 décembre 2012, p. 13.
19 () AMF, Rapport 2012 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, 11 octobre 2012.
20 () Voir le tableau n° 1 en annexe n° 4.
21 () Id.
22 () Id.
23 () Au Royaume-Uni, le « lead independent director » désigne un administrateur chargé de conseiller le directeur général de l’entreprise mais aussi d’évaluer les décisions qu’il prend. Le plus souvent, il s’agit de l’administrateur le plus âgé ou le plus expérimenté ou du Président du comité des rémunérations et des nominations.
24 () J. Kay, The Kay Review of UK equity markets and long-term decision making, juillet 2012.
25 () V. Cable, Secrétaire d’État pour le commerce et l’innovation (BIS), Ensuring equity markets support long-term growth (« Garantir le soutien des marchés financiers à une croissance de long terme »), novembre 2012.
26 () Ibid., pp. 8 et s.. Adde : N. Madelaine, « Londres veut mettre fin au règne du court-termisme », Les Échos, 28 novembre 2012, p. 26.
27 () Le « trading à haute fréquence » (« THF ») désigne l’exécution à grande vitesse de transactions financières dont la conclusion est commandée par des algorithmes informatiques. Dans le cadre du trading à haute fréquence, les ordres d’achat et de vente sont exécutés en quelques microsecondes voire nanosecondes.
28 () Il n’existe pas de définition légale et précise de la notion de « hedge funds ». Si la traduction littérale en français est « fonds de couverture », c’est-à-dire se livrant à des placements de protection contre les fluctuations des marchés considérés et si une telle définition devrait conduire à classer ces fonds du côté des fonds sans risque, il s’agit au contraire de fonds particulièrement risqués, beaucoup plus risqués que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), car ils sont peu ou pas réglementés. À la différence des fonds d’investissement destinés au grand public, une part importante des fonds peut être investie en actifs non liquides ou complexes. À la différence des OPCVM, les « hedge funds » font appel à l’emprunt pour composer leurs portefeuilles. Par ailleurs, en général, les investisseurs ayant acquis des parts de ces fonds ne peuvent pas réduire leur participation à tout moment, mais seulement à certaines périodes prédéterminées. Ces fonds utilisent massivement les techniques permettant de spéculer sur l’évolution des marchés, à la baisse comme à la hausse (utilisation massive de produits dérivés, de la vente à découvert et de l’effet de levier).
29 () Sur ce code de bonne conduite, voir l’encadré figurant en annexe n° 2.
30 () Les grandes lignes de ce plan d’action peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1340_fr.htm?locale=fr
31 () Voir à cet égard la consultation publique menée par la direction générale du Trésor du 8 août au 15 septembre 2012, en vue de préparer un projet de loi relatif à l’encadrement des pratiques de rémunération et à la modernisation de la gouvernance des entreprises.
32 () Une étude du cabinet de conseil Semler Brossy, publiée en 2012, montre qu’une recommandation du cabinet de conseil en politique de vote « ISS » peut faire varier les résultats des votes de 30 % (L. Boisseau, Les Échos, 1er octobre 2012, p. 30).
33 () O. Favreau, « Pour un actionnariat responsable », La Croix, 7 septembre 2012, pp. 12-13.
34 () Initialement, le « High Pay Centre » était un think tank apolitique qui se consacrait à l’étude des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux. Journaliste spécialisée dans ces questions au Financial Times et au Guardian, Mme Deborah Hargreaves en a pris la tête, avant de prendre la présidence d’une commission provisoire (« High Pay Commission ») qui, financée par le think tank de gauche Kompass, a travaillé sur les questions liées aux hautes rémunérations en octobre-novembre 2011 et produit, en novembre 2011, un rapport sur l’évolution des rémunérations des dirigeants-mandataires sociaux britanniques au cours des trente dernières années. En janvier 2012, la commission provisoire sur les hautes rémunérations est devenue une structure pérenne : le « High Pay Centre ».
35 () J. Kay, The Kay Review of UK equity markets and long-term decision making (« Rapport sur le processus décisionnel de long terme sur le marchés de capitaux britanniques »), juillet 2012.
36 () L. Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, Rapport au Premier ministre, 5 novembre 2012, p. 21.
37 () Id. Une proposition semblable figure également dans le Livre blanc pour la promotion de l’actionnariat individuel et salarié qui a été publié en novembre 2012 par le Salon de la Bourse et des produits financiers, en collaboration avec Havas Paris.
38 () Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.
39 () Anciens articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts.
40 () Elle les soumet également aux prélèvements sociaux (au taux de 15,5 %), de sorte que la contribution sociale généralisée (CSG) acquittée sur les plus-values imposables brutes sera imputable, à hauteur de 5,1 %, sur le revenu global imposable du contribuable.
41 () Conseil constitutionnel, décision DC n° 2012-662, 29 décembre 2012, considérant n° 58 : « en augmentant l’imposition pesant sur les plus-values de cession de valeurs mobilières tout en prenant en compte la durée de détention de ces valeurs mobilières pour diminuer le montant assujetti à l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas instauré des modalités d’imposition qui méconnaîtraient les capacités contributives des contribuables ».
42 () Le vote de l’assemblée générale, qu’il soit positif ou négatif, ne remet pas en cause les effets à l’égard des tiers des conventions autorisées par le conseil d’administration ou de surveillance, sauf annulation pour fraude. En application des articles L. 225-41 et L. 225-89 du code de commerce, les conventions désapprouvées ne sont donc pas nécessairement annulées : leurs conséquences préjudiciables pour la société peuvent simplement être mises à la charge de l’intéressé. En vertu des articles L. 225-42 et L. 225-90 du même code, les conventions non autorisées peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Toutefois, les conventions conclues sans autorisation peuvent être régularisées par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.
43 () B. de Roulhac, « Proxinvest demande une réforme des conventions réglementées », L’AGEFI Quotidien, 7 décembre 2012, p. 8.
44 () Selon ce rapport, il est indéniable que le régime des conventions réglementées gagnerait :
– à ce que soient clarifiées les notions de « conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales » ou de personne « indirectement intéressée » ;
– à ce que le rapport annuel de la société cotée ou, le cas échéant, son document de référence présente aux actionnaires les conventions conclues par une filiale, détenue directement ou indirectement, et concernant, directement ou indirectement, un dirigeant-mandataire social de la société cotée, ou un actionnaire détenant plus de 10 % du capital de la société cotée ;
– à ce que la partie réglementaire du code de commerce soit modifiée afin de rendre obligatoires la motivation de la décision d’autorisation du conseil d’administration ou de surveillance au regard de l’intérêt de la convention pour la société, la transmission de ces motifs aux commissaires aux comptes et leur reprise dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
– à ce que le contenu et la présentation de l’information diffusée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes soient améliorés et clarifiés de façon à permettre aux actionnaires de mieux apprécier les enjeux des conventions conclues ;
– à ce que le conseil d’administration ou de surveillance nomme un expert indépendant lorsque la conclusion d’une convention réglementée est susceptible d’avoir un impact très significatif sur le bilan ou les résultats de la société et/ou du groupe ;
– à ce que le conseil d’administration ou de surveillance passe en revue chaque année les conventions réglementées dont l’effet s’étale dans le temps.
45 () Il conviendrait donc de compléter les premiers alinéas des articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce de façon à ce qu’ils prévoient désormais que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs / l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance (selon le cas), l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du présent code, est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration / du conseil de surveillance (selon le cas) qui délibère après avoir recueilli un avis consultatif des commissaires aux comptes ».
En outre, il pourrait être inséré dans le code de commerce des articles L. 225-39-1 et L. 225-87-1 nouveaux, disposant que « dans l’avis consultatif mentionné au premier alinéa de l’article L. 225-38 / L. 225-86 (selon le cas) du présent code, les commissaires aux comptes déterminent si la convention qui leur est transmise pour avis par le conseil d’administration / de surveillance (selon le cas) doit être soumise aux dispositions de l’article L. 225-38 / L. 225-86 (selon le cas) du présent code, ou si elle constitue une convention portant sur des opérations courantes et conclue à des conditions normales devant être soumise aux dispositions de l’article L. 225-39 / L. 225-87 (selon le cas) ».
46 () Parmi les éléments-clés du plan d’action en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise qu’elle a publié le 12 décembre 2012, la Commission européenne indique souhaiter « une meilleure identification des actionnaires par les émetteurs ».
47 () L. Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, Rapport au Premier ministre, 5 novembre 2012.
48 () Voir le lien suivant :
http://www.gouvernement.fr/presse/pacte-national-pour-la-croissance-la-competitivite-et-l-emploi
49 () L. Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, Rapport au Premier ministre, 5 novembre 2012, p. 21.
50 () Ernst & Young, Panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises, édition 2012, octobre 2012, p. 12.
51 () Voir les documents figurant en annexe n° 7.
52 () Ernst & Young, Panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises, édition 2012, octobre 2012, p. 12.
53 () Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
54 () En application de l’article L. 225-27 du code de commerce, « il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.»
55 () Commission européenne, Livre vert : le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union européenne, publié le 5 avril 2011, p. 20.
56 () M. Deluzet, Projet 2012-contribution n° 30 : Une vision progressiste de l’entreprise, Fondation Terra Nova, mars 2012.
57 () L. Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, Rapport au Premier ministre, 5 novembre 2012, p. 21.
58 () Le projet d’accord pourra conclure à l’instauration d’un nouveau type de congé sans solde afin de donner la possibilité aux salariés, avec l’accord de leur employeur, de travailler à l’essai sur un poste offert par une autre entreprise pendant une période donnée. À l’issue de cette période, le salarié pourra soit démissionner de son entreprise d’origine, soit quitter le poste qu’il aura ainsi occupé temporairement et retrouver ses fonctions initiales dans les mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant son départ.
59 () Cette notion, défendue par les organisations syndicales, repose sur l’idée de permettre aux chômeurs qui reprendraient un emploi de conserver le reliquat des droits à l’assurance-chômage afin de ne pas décourager la reprise d’emploi.
60 () Article L. 3142-7 du code du travail.
61 () Article L. 3142-9 du code du travail.
62 () Article L. 3142-10 du code du travail.
63 () Table ronde réunissant des spécialistes des questions de gouvernance des entreprises, le 14 novembre 2012.
64 () Commission européenne, Livre vert : le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union européenne, 5 avril 2011, p. 11.
65 () Voir le tableau n° 2 en annexe n° 4.
66 () En application du code de commerce, les commissaires aux comptes et les actionnaires minoritaires peuvent jouer un rôle d’alerte sur l’évolution financière et stratégique de l’entreprise en ce qu’ils sont habilités à demander la nomination d’experts pour analyser la situation comptable de celle-ci.
67 () Voir le tableau n° 2 en annexe n° 4.
68 () Voir infra p. 68.
69 () Rapport prévu par l’article L. 225-100-2 du code de commerce.
70 () Article L. 2328-1 du code du travail.
71 () Article L. 2335-1 du code du travail.
72 () Article L. 2346-1 du code du travail.
73 () Article L. 1443-3 du code du travail.
74 () Rapport 2012/2061(INI) concernant les des recommandations à la Commission sur l’information et la consultation des travailleurs, l’anticipation et la gestion des restructurations, , fait au nom de la commission de l’Emploi et des affaires sociales par M. Alejandro Cercas et adopté par le Parlement européen le 4 décembre 2012..
75 () Voir notamment l’étude de MM. Cristian L. Dezsö et David Gaddis Ross : « Does female representation in top management improve firm performance ? A panel data investigation », publié le 27 janvier 2012 et reprise dans le Strategic Management Journal (Volume 33, Issue 9, pp. 1072-1089, septembre 2012). Cette étude se fonde sur l’examen d’un panel constitué de données recueillies pendant quinze ans et portant sur les équipes de la haute direction des entreprises du S&P 1500 firms (indice composite établi par Standards &Poors afin de mesurer les performances de certaines sociétés cotées américaines). Ses résultats tendent à conclure que la représentation des femmes aux plus hauts postes de la direction des entreprises constitue un facteur d’amélioration de leurs performances mais seulement dans la mesure où la stratégie de ces entreprises vise l’innovation. Dans cette perspective, la diversité des genres, avec les bénéfices qu’elle peut apporter sur un plan social et en termes d’information, et les comportements induits par la présence de femmes à des postes de gestion apparaissent, de manière probable, comme étant d’une importance particulière pour la performance dans les tâches du management.
76 () Loi n° 2011-103 du 27 janvier relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.
77 () Plus précisément, l’article 6 de la loi « Copé-Zimmermann » renvoie aux entreprises auxquelles s’applique la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : entreprises nationales, sociétés anonymes majoritairement détenues par l’État, etc.
78 () Réformant les dispositions du code de commerce, les articles 1er à 4 de la loi s’appliquent aux entreprises privées. Complétant la loi du 26 juillet 1983, l’article 6 instaure la même obligation de représentation pour les entreprises et les établissements publics, l’article 7 imposant au Gouvernement de déposer avant le 31 décembre 2015 « un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d’administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs de l’État et des établissements publics industriels et commerciaux de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ».
79 () C. Lejoux, « Si si, c’est la France qui compte le plus grand nombre de femmes administratrices de sociétés cotées », La Tribune, n° 5072, 18 octobre 2012, p. 97.
80 () B. de Roulhac, « Les entreprises françaises peinent à féminiser leur comité exécutif », L’AGEFI Quotidien, 3 octobre 2012, p. 7.
81 () Table ronde sur la place des femmes et des personnes issues de la diversité dans les organes dirigeants des grandes entreprises, le 21 novembre 2012.
82 () Loi « Sarbanes-Oxley » de 2002.
83 () Loi « Dodd-Frank » de 2010.
84 () Le projet propose ainsi, d’une part, l’instauration d’un quota minimal de 40 % de femmes parmi les membres non exécutifs des conseils d’administration ou de surveillance, la féminisation des postes exécutifs étant laissée à l’initiative des entreprises elles-mêmes (ce qui exclut les directoires d’entreprises). D’autre part, il prévoit un système de sanctions consistant, au choix des États membres : soit en des amendes administratives à l’encontre de celles d’entre elles qui n’auraient respecté ce quota à l’horizon 2020 (échéance ramenée à 2018 pour les entreprises cotées à capitaux publics) ; soit en la nullité de la nomination ou de l’élection d’un administrateur masculin en contravention du quota fixé par la directive. Par ailleurs, le projet de directive vise à obliger les sociétés cotées en bourse à adopter des procédures de sélection des candidats basées sur des « critères préétablis, clairs, univoques et formulés de façon neutre ». Les entreprises devront en outre communiquer aux candidates non sélectionnées des éléments précis et détaillés qui ont déterminé le recrutement d’un candidat masculin.
85 () Diverseo, The unconscious sealing – Women in leadership, octobre2012.
86 () A. Kahn, « L’ascension des femmes à des postes de dirigeantes reste difficile », Le Monde, 10 octobre 2012, p. 14.
87 () Suivant l’étude précitée du cabinet de recrutement Heidrick & Struggles en partenariat avec European Professionnal Women’s Network ), 44 % des 19 grandes entreprises de l’EuroStoxx 50 faisant partie de son panel se sont fixés des objectifs chiffrés de postes de dirigeants occupés par des femmes, généralement à l’horizon de 2015. 70 % des entreprises du panel soutiennent un réseau féminin en interne ; 25 % d’entre elles appartiennent à des réseaux sectoriels de soutien à la promotion des femmes dans le monde de l’entreprise. En outre, plus d’un tiers d’entre elles a lancé ou va lancer un programme d’accompagnement de leurs futures dirigeantes.
88 () J. Battilana, « Les dirigeantes, moteurs de l’ascension professionnelle des femmes », Le Monde économie, 3 juillet 2012, p. 6.
89 () Dans ses développements, la mission entend ainsi traiter de la situation particulière des personnes que le concept de diversité visait dans sa première acception. Elle n’occulte pas cela étant l’évolution sémantique de ce concept qui, de manière pertinente, tend désormais à renvoyer aux cinq critères de discrimination définis en droit européen, notamment par la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Ces critères sont la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.
90 () Ernst & Young, Panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises, édition 2012, octobre 2012, p. 12. La part des administrateurs étrangers dans les conseils d’administration ou de surveillance s’élève à 15,4 % pour les sociétés du SBF 120, la moyennes étant de 15,2 % pour l’ensemble du panel d’entreprises sur lequel s’appuie cette étude.
91 () Table ronde sur la place des femmes et des personnes issues de la diversité dans les organes dirigeants des grandes entreprises, le 21 novembre 2012.
92 () Ernst & Young, Panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises, édition 2012, octobre 2012, p. 22. Voir : www.ey.com/...Gouvernance_2012/.../Etude_Gouvernance_2012.pdf.
93 () Les grandes lignes de ce plan d’action peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1340_fr.htm?locale=fr
94 () L’article L. 225-21 encadre le cumul des mandats sociaux dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, l’article L. 225-77 s’appliquant quant à lui aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.
95 () AMF, Rapport 2012 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, 11 octobre 2012.
96 () Ernst & Young, Panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises, édition 2012, octobre 2012, p. 22. Voir : www.ey.com/...Gouvernance_2012/.../Etude_Gouvernance_2012.pdf.
97 () Cass., soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-40.259.
98 () Cass. soc., 23 septembre 2009, pourvois n° 08-41. 397 et n° 08-41. 415 ; Cass. soc., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-42-544.
99 () Table ronde réunissant des organisations représentant les employeurs, le 26 septembre 2012.
100 () Cass. com. 28 avril 1998, pourvoi n° 96-10.253 : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ».
101 () Cass. com. 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092.
102 () Cass. com. 3 mars 2004, pourvoi n° 02-10.484.
103 () Cour d’appel de Lyon, 19 février 2004, jurisdata n° 2004-238535.
104 () Voir également Cass. com. 26 novembre 1912.
105 () Cass. com. 9 mars 2010, pourvois n° 08-21.547 et n° 08-21.793 : « la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».
106 () Cass. crim. 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-80.387.
107 () V. Magnier, « Information boursière et préjudice des investisseurs », Recueil Dalloz 2008, p. 558.
108 () Voir au sujet de cette loi : M. Tomasi, « L’introduction en droit allemand d’une procédure modèle pour les investisseurs en produits financiers : un pas timide vers la « securities class action » », Recueil Dalloz 2006, p. 1594.
109 () Le « forum shopping » est un terme informel anglais de droit international privé qui n’a pas d’équivalent en français. Il s’agit de la possibilité que la diversité des règles de compétences internationale offre à un demandeur (et plus exceptionnellement à un défendeur) de saisir les tribunaux (ou « fors ») des pays appelés à rendre la décision la plus favorable à ses intérêts.
110 () Groupe de travail présidé par MM. Guillaume Cerutti et Marc Guillaume, Rapport sur l’action de groupe, remis aux ministres de l’Économie et de la Justice le 16 décembre 2005.
111 () Groupe de travail présidé par M. Jean-Marie Coulon, Rapport sur la dépénalisation de la vie des affaires, remis au ministre de la Justice en janvier 2008.
112 () Ibid., pp. 89-97.
113 () J.-L. Navarro, « Suggestions pour une amélioration des régimes de responsabilité civile des dirigeants sociaux », Les Petites Affiches, 2 août 2007, n° 154, p. 39.
114 () D. Schmidt, « Les actionnaires minoritaires, un combat légitime ? », in colloque « La gouvernance d’entreprise : entre réalités et faux-semblants », Cahiers de droit de l’entreprise, n° 5, septembre-octobre 2005, p. 60.
115 () V. Magnier, « Information boursière et préjudice des investisseurs », Recueil Dalloz 2008, p. 558.
116 () Rapport d’information n° 1798 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché, déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, et présenté par M. Philippe Houillon en conclusion d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc Warsmann, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2009, pp. 87-92.
117 () Voir supra note n° 2, p. 37.
118 () Le régime de ces conventions est fixé aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce pour les sociétés à gouvernance moniste, et L. 225-86 et suivants du même code pour les sociétés à gouvernance dualiste. Voir supra les développements sur le contrôle des conventions réglementées par les commissaires aux comptes, pp. 44 et s.
119 () Articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce. Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 prévoient en outre que la soumission des indemnités de départ à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires en application des articles L. 225-40 et L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire.
120 () L. Boisseau, « En Suisse aussi, on veut limiter les salaires des grands patrons », Les Échos, 25 septembre 2012, p. 30.
121 () AMF, Rapport annuel 2012 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, p. 30.
122 () Dans une recommandation du 14 décembre 2004, la Commission européenne avait déjà préconisé qu’une déclaration sur les rémunérations soit soumise au vote consultatif ou contraignant de l’assemblée générale annuelle des actionnaires.
123 () AMF, Rapport annuel 2012 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, p. 32.
124 () L. Boisseau, « Publicis va soumettre à ses actionnaires la rémunération de tous ses dirigeants », Les Échos, 30 novembre 2012.
125 () Rapport d’information n° 1798 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché, déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, et présenté par M. Philippe Houillon en conclusion d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc Warsmann, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2009, pp. 68-71 (proposition n° 7).
126 () C’est également le périmètre proposé pour délimiter le champ d’application de l’obligation de se référer à un code de gouvernance (proposition n° 1).
127 () Dans son Rapport annuel 2012 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, l’AMF note qu’aux États-Unis, un vote négatif des actionnaires n’a concerné, en 2011, qu’1,6 % des sociétés contraintes de mettre en œuvre le « say on pay ». Au Royaume-Uni, la proportion moyenne des votes négatifs sur l’ensemble des votes exprimés sur les rémunérations des dirigeants depuis 2002 est de 5 % (B. de Roulhac, « Les émetteurs semblent bien seuls dans leur combat contre le « say on pay », L’AGEFI Quotidien, 24 octobre 2012, p. 7).
128 () Voir également : N. Mottis, « Rémunérations des patrons : le vrai enjeu pour demain », Les Échos, 28 août 2012, p. 11.
129 () Les Échos, 12 octobre 2012, p. 45.
130 () L’Agefi Quotidien, 18 septembre 2012, p. 15.
131 () Voir également le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’État ou bénéficiant du soutien de l’État du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques.
132 () Ce plafonnement a été étendu aux rémunérations des dirigeants de 11 filiales d’entreprises publiques par un arrêté du 15 octobre 2012 soumettant les sociétés Areva NP, EDF Énergies Nouvelles, EDF Développement Environnement SA, EDF International, Geodis, Geopost, Groupe Keolis SAS, Keolis, La Banque postale, SNCF Participations et Sofipost à certaines dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié.
133 () Rapport d’information n° 1798 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché, déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, et présenté par M. Philippe Houillon en conclusion d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc Warsmann, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2009, pp. 58-59 (proposition n° 3).
Votre Co-rapporteur estime que le plafonnement à environ 1,1 millions d’euros du montant des rémunérations globales déductibles des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur les sociétés est de nature alourdir le coût fiscal des rémunérations pour les sociétés appartenant à l’indice boursier SBF 120, mais qu’il n’entraînerait pas de modification significative pour les sociétés appartenant à l’indice boursier SBF 250.
134 () Sur ces éléments de rémunération, voir l’encadré figurant en annexe n° 3.
135 () Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
136 () AFEP et MEDEF, Quatrième rapport annuel sur le code AFEP-MEDEF – Exercice 2011, décembre 2012.
137 () Proxinvest, La Rémunération des dirigeants des sociétés du SBF 120, 11 décembre 2012.
138 () Articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale.
139 () Article 31 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012.
140 () Rapport d’information n° 1798 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché, déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, et présenté par M. Philippe Houillon en conclusion d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc Warsmann, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2009, pp. 78-80.
141 () AFEP et MEDEF, Quatrième rapport annuel sur le code AFEP-MEDEF – Exercice 2011, décembre 2012. p. 47.
142 () Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
143 () Cf. supra.
144 () Ernst & Young, Panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises , édition 2012, octobre 2012, p. 21.
145 () Voir le tableau n° 1 en annexe n° 9.
146 () Id.
147 () CA Paris, 3e chambre, 7 octobre 2008 : infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2007, la cour d’appel a estimé que le complément de rémunération sous forme de retraite supplémentaire, accordé à l’ancien président du conseil d’administration, n’entrait pas dans le champ d’application de l’art. L. 225-47 du code de commerce car cet engagement apparaissait disproportionné par rapport aux services rendus par lui et constituait une charge excessive pour la société. L’annulation de la convention a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009.
148 () Voir le tableau n° 2 figurant en annexe n° 10.
149 () L’expression est reprise des études réalisées par Aon Hewitt et désigne le dirigeant-mandataire social le plus haut placé dans la hiérarchie de l’entreprise (président du conseil d’administration ou du directoire).
150 () Voir le tableau n° 1 figurant en annexe n° 10.
151 () Articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.
152 () Voir le graphique n° 5 en annexe n° 10.
153 () Aon Hewitt, Étude - Vademecum Comité des rémunérations 2011-2012, pp. 94-95.
154 () Rapport d’information n° 1798 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché, déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, et présenté par M. Philippe Houillon en conclusion d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc Warsmann, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2009, pp. 77-78.
155 () Voir le tableau n° 2 en annexe n° 4.
156 () Cette proposition ne recueille pas l’assentiment de votre Co-rapporteur.
157 () Cette proposition ne recueille pas l’assentiment de votre Co-rapporteur.
158 () Cette proposition ne recueille pas l’assentiment de votre Co-rapporteur.
159 () Cette proposition ne recueille pas l’assentiment de votre Co-rapporteur.
160 () Cette proposition ne recueille pas l’assentiment de votre Co-rapporteur.
161 () Cette proposition ne recueille pas l’assentiment de votre Co-rapporteur.
162 () ISC, The Responsabilities of Institutional Shareholders and Agents : Statement of Principles, 2002.
163 () D. Walker, A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities : Final recommendations (« Rapport sur la gouvernance des banques et autres entités de l’industrie financière du Royaume-Uni : recommandations finales »), 26 novembre 2009.
© Assemblée nationale