ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 octobre 2013.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) (1)
sur le thème « Prévention et accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi »
et prÉsentÉ
par M. Christophe CASTANER et Mme VÉronique LOUWAGIE
Députés
___
MM. Olivier CARRÉ et Alain CLAEYS
Présidents.
____
La mission d’évaluation et de contrôle est composée de : MM. Olivier Carré, Alain Claeys, Présidents, Gilles Carrez, Président de la commission des Finances, M. Christian Eckert, Rapporteur général, M. Christophe Castaner, Charles de Courson, Marc Francina, Mme Annick Girardin, MM. Jean-Pierre Gorges, Laurent Grandguillaume, Mme Véronique Louwagie, MM. Hervé Mariton, Nicolas Sansu, Mme Éva Sas, MM. Thomas Thévenoud, Philippe Vigier, Éric Woerth.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
LES PROPOSITIONS DE LA MEC 10
I. LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF : UNE RESPONSABILISATION DES PARTENAIRES SOCIAUX APPUYÉE PAR LE RÔLE ACTIF DE L’ADMINISTRATION 15
A. UNE PROCÉDURE COMPLEXE ET UNE JURISPRUDENCE HÉSITANTE QUI APPELAIENT UNE RÉFORME 16
1. Une histoire législative mouvementée en matière de PSE 16
2. Une procédure complexe qui a entraîné une insécurité juridique croissante 17
a. Une procédure excessivement complexe 17
b. La judiciarisation croissante des licenciements économiques collectifs 18
c. Une tentative pour gagner en responsabilisation des acteurs : les accords de méthode 19
d. Le rôle essentiellement consultatif de l’administration 20
3. La réforme de la procédure encadrant les PSE résultant de l’ANI du 11 janvier 2013 et de la loi relative à la sécurisation de l’emploi 20
a. La responsabilisation des partenaires sociaux sous le contrôle de l’administration 20
b. La possibilité de négocier des accords de maintien dans l’emploi 22
4. Des questions de procédure qui demeurent ouvertes 23
B. LE RÔLE DE L’ADMINISTRATION : UN CONTRÔLE RÉNOVÉ DONT LES LIMITES MÉRITENT D’ÊTRE CLARIFIÉES 24
1. La nécessité de critères suffisamment clairs pour encadrer l’intervention publique en matière d’homologation ou de validation des PSE 24
2. Associer Pôle emploi à la phase de négociations autour du PSE 26
II. DYNAMISER LA REVITALISATION DES TERRITOIRES EN APPUI À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 27
A. L’OBLIGATION DE REVITALISATION ET SES LIMITES 27
1. L’absence de plafond à l’obligation légale de revitalisation 28
2. Une procédure souple qui conduit parfois à une dispersion des moyens 29
3. Un suivi qui n’est pas satisfaisant 32
B. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION : UNE APPROCHE PLUS COMPLÈTE ET PLUS DYNAMIQUE DE LA REVITALISATION 32
1. La question de la mutualisation des ressources générées par la revitalisation 33
2. L’extension légitime de l’obligation de revitalisation aux entreprises de 250 à 1 000 salariés 35
C. LE FNRT : UN OUTIL ÉTEINT QUI DEVRAIT ÊTRE RAVIVÉ ET DÉVELOPPÉ 36
1. Un bilan satisfaisant mais unidimensionnel 36
2. Un Fonds de revitalisation aux missions élargies serait utile à l’accompagnement des territoires en difficulté 38
III. MIEUX ANTICIPER LES RESTRUCTURATIONS GRÂCE À UNE GOUVERNANCE COHÉRENTE ET DES OUTILS PUBLICS PLUS EFFICACES 38
A. DÉFINIR DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES : UN TRAVAIL EN AMONT NÉCESSAIRE POUR STRUCTURER L’INTERVENTION PUBLIQUE 39
1. La dimension sectorielle de l’anticipation : la politique de filières 39
2. Le développement nécessaire des démarches EDEC/GPEC, notamment au niveau territorial et interentreprises 41
a. Le renforcement des démarches de GPEC et d’anticipation prévisionnelle 41
b. Le développement nécessaire des mécanismes de gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC) 43
c. Le renforcement de la gouvernance des acteurs publics 44
3. Les plateformes de mutations économiques : un premier pas vers la coordination 45
B. DYNAMISER LA CAPACITÉ DE VEILLE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 46
1. La phase de détection des difficultés : des outils efficaces mais pouvant être améliorée 46
a. Les deux principaux problèmes identifiés par la mission : la détection des difficultés et la réticence des entreprises 46
b. Les outils de détection et de résolution des difficultés des entreprises en région et au niveau central : une fluidification nécessaire 47
c. L’amélioration des dispositions de la loi de sauvegarde 48
2. Le rôle des commissaires au redressement productif : un complément utile au CIRI et aux outils régionaux, dont la portée pourrait être augmentée 49
3. Les outils d’accompagnement : des cellules de médiation au CIRI 51
a. Les cellules de médiation 51
b. Le CIRI 51
c. Les procédures amiables 52
C. FACILITER LES PÉRIODES DE TRANSITION PAR DES OUTILS PUBLICS INNOVANTS 53
1. L’incitation à la recherche d’un repreneur en cas de fermeture de sites 53
2. Le recours à des prises de participation publiques temporaires 54
a. Développer les possibilités pour les acteurs publics de s’engager dans le capital d’une entreprise 54
b. La prise de participation temporaire 56
c. La possibilité de recourir plus largement aux prises de participation : que dit le droit européen ? 56
3. Développer une compétence publique spécifique en matière de retournement d’entreprises en difficulté 57
a. Des outils existants presque malgré eux… 57
b. La nécessité d’une intervention structurée et assumée 58
4. Améliorer l’utilisation des créances publiques dans l’objectif de sauvegarder l’emploi 59
D. SIMPLIFIER ET RENFORCER LES MÉCANISMES D’ACTIVITÉ PARTIELLE 60
E. LE RÔLE AMBIVALENT DE L’UNION EUROPÉENNE DANS L’AIDE AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES 62
1. Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation : un outil qui devrait être plus largement utilisé 62
2. L’assouplissement nécessaire de la contrainte européenne pesant sur l’action des acteurs publics en faveur des mutations économiques. 64
IV. MIEUX EMPLOYER LES DISPOSITIFS PUBLICS D’ACCOMPAGNEMENT DES PSE 65
A. LA NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE PLUS COHÉRENTE DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 65
1. La coopération des acteurs publics avec les acteurs de la formation professionnelle 66
2. Le développement du compte personnel de formation : un progrès majeur issu de l’ANI du 11 janvier 2013 66
B. LA DOTATION GLOBALE DE RESTRUCTURATION 67
1. Les allocations du FNE-formation : un outil qui demeure largement sous-doté 67
2. Les cellules d’appui à la sécurisation professionnelle 70
3. Les financements apportés au service public de l’emploi pour l’accompagnement des mutations économiques 70
C. LES OUTILS D’AIDE DIRECTE MOBILISABLES PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE : UN ÉQUILIBRE À REDÉFINIR 72
1. L’allocation temporaire dégressive 72
2. Le congé de reclassement 72
3. Le CSP : une réforme utile qui pourrait être approfondie 73
a. Préserver la possibilité d’une reconversion collective 75
b. Améliorer la complémentarité entre les mesures prévues dans le PSE et le CSP 76
4. L’accompagnement des territoires : une exonération générale qui peut conduire à des effets d’aubaine 77
D. UN ÉLARGISSEMENT NÉCESSAIRE DES DISPOSITIFS PUBLICS POUR UNE PRISE EN COMPTE DE TOUS LES SALARIÉS FRAGILISÉS : INTÉRIM, SOUS-TRAITANCE, SENIORS 78
1. Permettre aux salariés en contrats courts d’accéder à un accompagnement et à une formation renforcée, sur le principe du CSP 78
2. Prendre en compte la spécificité des salariés âgés 80
V. DÉVELOPPER DE NOUVEAUX OUTILS POUR AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS ET FACILITER LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES 82
1. Encadrer juridiquement la question des licenciements diffus 82
2. Revenir sur l’exclusion des marchés publics de toutes les entreprises en procédure de sauvegarde 84
3. Renforcer l’assistance offerte aux salariés en cas de PSE 84
4. Encadrer le recours aux primes supra-légales afin de ne pas risquer d’altérer les parcours professionnels 84
EXAMEN EN COMMISSION 87
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 91
Les licenciements économiques, et plus encore les licenciements économiques collectifs que l’on désigne habituellement sous le terme de « plan social », ou plus exactement de « plans de sauvegarde de l’emploi » (PSE) depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, n’occupent plus la place qu’ils représentaient auparavant dans les évolutions de l’emploi.
À la fin des années 1980, on comptait en effet 500 000 licenciements économiques en moyenne chaque année ; en 2009, au plus fort de la crise, ils ont été de 230 000. Le recours accru à l’intérim, aux contrats courts, ainsi que l’émergence de formes de ruptures conventionnelles du contrat de travail, ont en effet sensiblement réduit la part de ces licenciements.
De la même manière, le nombre de PSE s’est stabilisé autour de 1 000 par an en moyenne : 1 300 PSE en 2006, 957 en 2007, 1 030 en 2008, 2 260 en 2009 au plus fort de la crise, 1 180 en 2010 et 953 en 2011.
Ainsi, bien que certains « plans sociaux » résonnent d’un écho tout particulier en raison de leur ampleur, de leurs conséquences sociales et territoriales ou de leur impact symbolique (à l’instar de la disparition de la sidérurgie en Lorraine), les licenciements pour motif économique ne représentent, en 2012, qu’environ 3 % des inscriptions à Pôle emploi. En outre, parmi ces licenciements pour motif économique, moins de la moitié entraîne le déclenchement d’une procédure de licenciement collectif.
Est-ce à dire que les licenciements collectifs seraient devenus un sujet marginal et, par ailleurs, déjà bien encadré par la législation qui soumet les entreprises à de nombreuses obligations concernant à la fois le reclassement et l’accompagnement de leurs ex-salariés et la revitalisation des territoires ainsi affaiblis (pour les entreprises in bonis de plus de 1 000 salariés) ?
La réalité est bien différente. En premier lieu, les chiffres concernant les licenciements économiques sont à relativiser : ils ne prennent en compte ni les salariés qui ne s’inscrivent pas à Pôle Emploi après leur licenciement, ni ceux qui retrouvent un emploi immédiatement, ni les salariés reclassés en interne, ni ceux qui partent à la retraite sur le champ ou peu après. En outre, une partie importante des licenciés économiques ne sont pas inscrits à Pôle emploi dans les catégories classiques que sont les catégories A, B ou C mais en catégorie D, c'est-à-dire parmi les demandeurs d’emplois non tenus de procéder à des actes de recherche positifs d’emploi pour diverses raisons (stage, formation, etc.). Les licenciés économiques, notamment dans le cadre des PSE, ayant le statut de stagiaire de la formation professionnelle dès lors qu’ils bénéficient d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) apparaissent donc dans les statistiques comme stagiaires (catégorie D) et non comme licenciés économiques.
En outre, l’impact social et économique sur les territoires de la perte simultanée de plusieurs dizaines ou centaines d’emplois n’est pas proportionnel au nombre d’emplois supprimés, notamment en cas de fermeture d’un site important. Les sous-traitants, les intérimaires et l’ensemble de la structure économique locale (restaurants, magasins, supermarchés) peuvent s’en trouver bouleversés. C’est précisément en raison de cet impact majeur que la puissance publique peut et doit agir.
En ce sens, l’accompagnement par les acteurs publics, ici regroupés sous l’appellation « puissance publique », des mutations économiques, qui touchent en 2013 la quasi-totalité des secteurs d’activité (banque, assurance, sidérurgie, automobile, pharmacie, textile, etc.), apparaît légitime. Il est aussi perfectible.
En effet, si l’on admet qu’une économie moderne fonctionne selon un principe de destruction créatrice permanente des emplois, que les économistes Pierre Cahuc et André Zylberberg estiment à 15 % du nombre d’emplois total en moyenne chaque année, il convient cependant de penser la prévention et l’accompagnement des PSE dans un contexte économique marqué à la fois par l’accélération des mutations économiques et par la fin d’un mode de régulation fordiste qui s’accompagnait d’un modèle d’emploi à durée illimitée.
L’enjeu est donc bien de responsabiliser socialement les entreprises en les incitant à anticiper le plus en amont possible les restructurations et à contrebalancer leurs conséquences négatives pour les salariés et les territoires par des outils adéquats tels que le reclassement, la reconversion professionnelle, l’aide à la création d’activités nouvelles ou la revitalisation du bassin d’emploi.
L’intervention de l’État répond ainsi à une double logique économique et sociale qui consiste à accompagner les mutations économiques des entreprises et des territoires tout en permettant la meilleure reconversion possible des salariés. Comme le disait Robert Castel dans Les métamorphoses de la question sociale, « L’État social est la forme, mais la forme variable, que prend le compromis entre la dynamique économique commandée par la recherche du profit et le souci de protection commandé par les exigences de solidarité ». Pour remplir cette double tâche, l’État intervient à trois niveaux différents dans le champ des plans sociaux.
En premier lieu, il pose les règles en matière de procédure. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, repris par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, a entendu simplifier les démarches juridiques et responsabiliser les acteurs sous le contrôle de l’administration. Le rôle de cette dernière n’en doit pas moins être précisé. C’est également l’administration qui détermine la contribution financière des entreprises in bonis – c’est-à-dire hors situation de redressement ou de liquidation judiciaire – à la revitalisation des territoires après un PSE. Cette originalité française qu’est la contribution à la revitalisation devrait faire l’objet d’une nouvelle approche afin de limiter les effets d’aubaine et de renforcer l’efficacité des actions conduites grâce aux moyens dégagés. La mission formule des recommandations fortes en ce sens.
L’État doit également permettre aux entreprises d’anticiper au mieux les mutations économiques, en appuyant les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et tenter de prévenir des plans sociaux évitables grâce à l’action d’acteurs publics efficaces travaillant en bonne coordination et disposant d’instruments financiers adéquats. La mise en place des Commissaires au redressement productif (CRP), de la Banque publique d’investissement (BPI), qui viennent compléter les acteurs que sont le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), le médiateur du crédit ou le médiateur interentreprises, ainsi que l’action des collectivités territoriales, pose ainsi la question de la coordination des acteurs publics et de l’efficacité des instruments à leur disposition. À ces structures, il convient d’intégrer dans l’analyse les moyens engagés par l’État au travers de mécanismes particuliers, tels que les dispositifs d’activité partielle.
Enfin, l’État accompagne également les entreprises et les salariés, lorsque la perspective d’un licenciement collectif est devenue inéluctable, en participant au financement et au fonctionnement de dispositifs tels que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les conventions du Fonds national pour l’emploi (FNE) ou la dotation globale de restructuration (DGR). Le budget que l’État consacre à ces dispositifs, retracé dans le programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi de la mission Travail et Emploi, a quasiment triplé, passant de 109 millions d'euros en 2009 à 270 millions d'euros en 2013. Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation du budget alloué au financement du CSP, qui représente plus de 140 millions d’euros en exécution 2012. C’est pourquoi la mobilisation et l’efficacité de ces outils sont au cœur de ce rapport.
I.– Rationaliser les mécanismes d’anticipation des difficultés économiques pouvant conduire à un PSE
Proposition n° 1 : Rationaliser les mécanismes de recueil et d’analyse de l’information relative aux difficultés des entreprises en favorisant la collaboration entre le CRP et les DIRECCTE. Harmoniser le positionnement des CRP au sein des structures déconcentrées auprès du préfet de Région et veiller à ce que les CRP puissent exercer leur fonction à plein temps. Renforcer les moyens humains permettant aux CRP de s’appuyer plus largement sur les DIRECCTE et développer leurs réseaux de correspondants.
Doter les CRP d’une faculté d’accès aux informations sensibles des entreprises dans le cadre d’une réglementation relative au « secret partagé ».
Proposition n° 2 : Prévoir la possibilité pour les CRP d’être nommés, lorsque cela apparaît nécessaire, comme contrôleurs dans le cadre des procédures collectives, au même titre que les créanciers. Leur permettre également de participer aux moyens de prospection en vue de faciliter la recherche d’éventuelles solutions de reprise des entreprises en difficulté.
Proposition n° 3 : Mettre fin à la pratique d’exclusion des marchés publics pour les entreprises engagées dans une procédure de redressement judiciaire, en supprimant notamment l’obligation pour l’entreprise de fournir une copie du jugement dans son acte de candidature, prévue par l’article 44 du code des marchés publics.
Proposition n° 4 : Porter de 2 à 6 mois le délai pour saisir la CCSF pour une remise de créances publiques.
Proposition n° 5 : Mettre en place, au niveau régional, un fichier unique relatif aux entreprises en difficulté, alimenté par l’ensemble des acteurs publics intervenant directement dans les procédures de suivi et d’accompagnement des entreprises en difficulté, afin d’assurer une meilleure capacité de détection et de suivi des entreprises. S’assurer de la confidentialité des informations fournies dans ce cadre.
Proposition n° 6 : Fusionner les CODEFI et les CCSF ou, au moins, prévoir qu’un membre du CODEFI siège au sein de la CCSF (le DIRECCTE étant le plus qualifié à ce titre).
Proposition n° 7 : Transformer les CCREFP en véritable structure de décision relative aux orientations et aux actions à mettre en œuvre en matière la formation professionnelle, et assurer un copilotage par le préfet de région et par le président du Conseil régional dans chaque région.
Proposition n° 8 : Inciter les entreprises à distinguer clairement, dans les accords de GPEC, les emplois en déclin, en transformation et en croissance. Inciter les entreprises à mobiliser les fonds qu’elles consacrent à la formation professionnelle prioritairement en faveur des personnes occupant un emploi en déclin, tels qu’ils ont été identifiés dans les accords de GPEC.
Proposition n° 9 : Élaborer un guide, ainsi qu’un site internet unique, pour les entreprises en difficulté afin qu’elles puissent identifier facilement les dispositifs publics capables de les aider. Fusionner les dispositifs existants pour en accroître la visibilité.
II.– Développer une nouvelle approche de la revitalisation des territoires
Proposition n° 10 : Soumettre les entreprises de 250 à 1 000 salariés in bonis, qui mettent en place un PSE, à une obligation de revitalisation proportionnée aux moyens dont elles disposent (en abaissant cette base minimale à un SMIC pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 250 et 1 000 salariés).
Proposition n° 11 : Mettre en place dans chaque département un Fonds de mutualisation pour la revitalisation des territoires cogéré par les partenaires sociaux et par l’État, afin de renforcer les moyens mobilisables pour engager des actions de revitalisation économique. Assurer une concertation avec les représentants des collectivités territoriales sur les actions mises en œuvre. Prévoir que la participation à ce fonds puisse être orientée vers un fonds de mutualisation interentreprise.
Proposition n° 12 : Fixer un délai de quatre à six mois maximum pour la négociation des conventions de revitalisation ou, le cas échéant, pour le versement des sommes correspondantes à un fonds mutualisé.
Proposition n° 13 : Développer et harmoniser, au niveau déconcentré comme au niveau des collectivités territoriales, les mécanismes de cartographie des emplois et des compétences qui servent de base au diagnostic territorial.
Proposition n° 14 : Fixer un plafond légal à la contribution qui peut être demandée dans le cadre de l’obligation de revitalisation. La base minimale étant équivalente à deux SMIC pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, le plafond pourrait se situer à 6 SMIC (et éventuellement plus si l’entreprise y consent volontairement). La marge de manœuvre ainsi confortée légalement pourrait permettre aux services de l’État de moduler davantage la contribution des entreprises en fonction de leur situation économique, des efforts précédemment réalisés en termes de GPEC et de formation professionnelle, ainsi que de leur implication dans la recherche d’un repreneur (en cas de fermeture de site).
Proposition n° 15 : Ne pas reconduire l’exonération générale de cotisations sociales au profit des territoires en difficulté en raison de l’effet d’aubaine qu’elle entraîne.
III.– Renforcer les outils d’accompagnement des restructurations
Proposition n° 16 : Généraliser le bénéfice du CSP aux salariés précaires (CDD, interim) dans le cas de licenciements collectifs supérieur à 50 salariés licenciés. Associer les salariés en contrats courts des entreprises sous-traitantes à cette ouverture lorsque le nombre de licenciements dans l’entreprise donneuse d’ordre est supérieur à 50 salariés.
Proposition n° 17 : Faciliter la prise en charge collective des salariés suite à un PSE, en élargissant les compétences des cellules d’appui à la sécurisation professionnelle et en renforçant leur base légale d’existence (laquelle ne repose actuellement que sur la circulaire du 13 juillet 2012).
Proposition n° 18 : Doter l’État d’un fonds d’appui exceptionnel, dont l’utilisation serait réservée aux grands licenciements collectifs (4 à 5 par an en moyenne), pour lui permettre de trouver des solutions rapides et concrètes en matière de reconversion des salariés et de revitalisation du territoire.
Prévoir que ce fonds d’appui puisse financer des cellules collectives de reconversion professionnelle afin de développer des prises en charge collectives lorsque des salariés présentent des caractéristiques socio-économiques proches en termes de qualification, de parcours professionnels et de rémunération. Ces cellules pourraient mobiliser les ressources du volet « accompagnement » du CSP. Leur existence permettrait de favoriser la mobilisation des ressources du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM).
Ce fonds pourrait notamment être alimenté par redéploiement des ressources budgétaires jusqu’ici consacrées à la compensation de l’exonération de cotisations sociales en faveur des bassins d’emploi à redynamiser (16 millions d’euros en 2012).
Proposition n° 19 : Préserver les moyens humains d’analyse économique des DIRECCTE afin de leur permettre d’analyser dans les meilleures conditions et dans les délais impartis la validité des mesures contenues dans les PSE. Développer une grille d’analyse nationale afin de structurer cette interprétation autour de repères identifiables.
Proposition n° 20 : Associer Pôle emploi à l’analyse des PSE afin que l’opérateur puisse formuler des propositions, en se basant sur sa connaissance du bassin d’emploi.
IV.– Définir de nouveaux droits pour les salariés en situation de licenciement collectif
Proposition n° 21 : Suspendre les droits liés au bénéfice d’un congé de reclassement ou d’un contrat de sécurisation professionnelle lorsque le salarié retrouve un emploi, pendant la période de travail effectif, sur une durée maximum de 24 mois.
Proposition n° 22 : Limiter le versement des primes supra-légales, selon des outils fiscaux ou juridiques dont la forme reste à déterminer, dans le cadre de PSE, autour d’un seuil moyen (l’échantillon d’analyse de la DGEFP situant la moyenne des primes versées à 27 000 euros). En contrepartie, inciter plus largement les salariés à accepter des mobilités professionnelles dans le cadre des accords de GPEC en alignant le régime fiscal et social avec celui des PSE.
Proposition n° 23 : Préciser l’application des critères d’ordre, en cas de licenciement économique collectif, aux seuls salariés employés sur le site faisant l’objet du PSE.
Proposition n° 24 : Définir préalablement, en accord avec le salarié, les limites géographiques de l’obligation de reclassement qui doit lui être proposée dans le cadre d’un PSE.
Proposition n° 25 : Allonger l’obligation de maintien dans l’emploi des bénéficiaires de 6 à 12 mois après le terme de la convention, après avoir reçu une aide de FNE formation.
V.– Préciser le cadre d’intervention économique de l’État afin de faciliter les mutations économiques
Proposition n° 26 : Créer rapidement des outils publics dédiés aux opérations de retournement au sein des structures publiques existantes. Une branche de la BPI pourrait être exclusivement consacrée à cette mission.
Proposition n° 27 : Accroître la possibilité pour les acteurs publics de développer la conversion de leurs créances en capital. Ce recours devra être temporaire et encadré (actionnaires dans l’incapacité d’intervenir, plan de continuation de l’activité possible, sortie des dirigeants). Afin de renforcer l’incitation des acteurs publics en la matière, leur donner la possibilité de bénéficier du privilège de « new money » tel qu’il est prévu à l’article L. 611-11 Code de commerce.
Proposition n° 28 : Dans l’hypothèse de l’adoption d’une législation pénalisant financièrement les employeurs n’effectuant pas une recherche active de repreneur préalablement à une fermeture de site (adoption non souhaitée par l’un des deux rapporteurs), attribuer le montant de cette pénalité au Fonds de mutualisation du bassin d’emploi concerné.
Proposition n° 29 : Mettre en place un comité interentreprises au niveau d’un bassin d’emploi associant les entreprises donneuses d’ordres et les entreprises sous-traitantes.
VI.– Mieux encadrer les licenciements diffus
Proposition n° 30 : Soumettre les entreprises de plus de 1 000 salariés pratiquant des licenciements diffus à une contribution de revitalisation.
Proposition n° 31 : Attribuer au FNRT, dont les missions seraient revues et élargies afin de les rapprocher de celles des Fonds de mutualisation départementaux, le produit des montants perçus au titre de l’obligation de revitalisation pour licenciements diffus.
VII.– Encourager les institutions européennes à jouer un rôle actif dans le domaine des mutations économiques
Proposition n° 32 :
– Inciter les institutions européennes à débloquer plus largement les crédits annuels dont dispose le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (500 millions d’euros annuels mais dont l’utilisation reste inférieure à 40 % chaque année).
– Inviter les institutions européennes à davantage de souplesse dans l’aide apportée par les États aux entreprises en difficulté, notamment en relevant le seuil d’aide maximale pouvant être apportée à une entreprise en difficulté de 10 à 20 millions d’euros ou en allongeant la période d’aide maximale de 6 à 12 mois afin de disposer d’un délai suffisant pour des opérations de restructuration souvent longues et complexes.
I. LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF : UNE RESPONSABILISATION DES PARTENAIRES SOCIAUX APPUYÉE PAR LE RÔLE ACTIF DE L’ADMINISTRATION
Les PSE sont généralement élaborés dans l’objectif de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou sont motivés par des difficultés économiques dans des entreprises qui ne sont pas encore défaillantes.
Un tel plan est obligatoire dès lors qu’une entreprise de plus de 50 salariés envisage 10 licenciements ou plus sur une période de 30 jours.
Les PSE ne concernent donc pas la totalité des licenciements économiques puisqu’environ 45 % de ceux-ci ont lieu dans des entreprises de moins de 50 salariés. En outre, les licenciements économiques qui concernent moins de 10 salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés ne sont pas soumis à l’obligation de mettre en place un PSE. Enfin, les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, y compris lorsqu’elles mettent en place un plan de licenciement de plus de 10 salariés et que leurs effectifs sont supérieurs à 50 salariés, n’y sont pas non plus tenues (2).
Par rapport aux autres formes de licenciements, l’obligation de mettre en place un PSE s’applique aux ruptures du contrat de travail pour motif économique, à l’exclusion de la rupture conventionnelle (article L. 1233-3 du code du travail) (3). Or, les ruptures conventionnelles représentent 16 % des fins de CDI et près d’un million de salariés, dont une part importante se trouve contrainte de mettre un terme à son contrat selon cette procédure plutôt que d’entrer dans une phase de licenciement plus contraignante pour l’entreprise.
La place des licenciements économiques ne représente optiquement que 2,6 % des entrées à Pôle emploi en 2012. Cependant, 40 % des entrées à Pôle emploi, selon ces mêmes données, sont, en réalité, classées dans la catégorie « autres cas ». Il s’agit notamment des personnes qui, suite à un licenciement économique, ont accepté le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui leur a donné le statut de stagiaires de la formation professionnelle. L’enquête régulière sur les « entrants au chômage » réalisée par Pôle emploi, dans laquelle les « autres cas » ne représentent plus que 8 %, montre que la part des entrées à Pôle emploi suite à un licenciement économique est estimée à 6,9 % (dernière vague de décembre 2010).
Il faut également y ajouter les salariés qui entrent en congé de reclassement dans les entreprises in bonis de 1 000 salariés et plus (84 340 salariés par an, ce qui représente un taux d’adhésion de 75 % à ce congé) et dont le contrat de travail n’est pas encore rompu (le contrat est suspendu pendant la durée du congé mais le salarié reste rémunéré par son employeur) et qui, à l’issue ou avant le terme de leur congé de reclassement, retrouvent un emploi ou accèdent à la retraite (environ 60 000 par an).
Par conséquent, les licenciements économiques représentent une part bien plus importante que les statistiques ne le laissent apparaître de prime abord.
ÉVOLUTION DES MOTIFS D’INSCRIPTIONS À PÔLE EMPLOI
Année |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Inscriptions à Pôle emploi après un licenciement pour motif économique dont adhésion CRP / CTP / CSP |
173 600 49 200 |
188 600 65 200 |
302 000 139 700 |
220 100 107 700 |
176 900 93 600 |
153 000 90 000 |
Nombre d’inscriptions à Pôle Emploi après une démission |
268 600 |
256 700 |
226 200 |
199 300 |
193 100 |
180 600 |
Nombre d’inscriptions à Pôle Emploi pour le motif « autres licenciements » |
699 600 |
692 400 |
644 300 |
531 300 |
509 400 |
500 100 |
Ruptures conventionnelles homologuées par l’administration |
31 671 (août à décembre) |
190 789 |
246 080 |
287 338 |
261 606 |
Source : Pôle emploi, fichier historique statistique exhaustif des demandeurs d'emploi et Séries mensuelles nationales cvs-cjo, au 26 février 2013 ; calcul Dares.
1. Une histoire législative mouvementée en matière de PSE
La notion de « plan social » puis de « plan de sauvegarde de l’emploi » a été l’objet de multiples réformes législatives depuis son apparition. Elle remonte à l’avenant du 21 novembre 1974 à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969. La loi n° 89-549 du 2 août 1989, dite loi « Soisson », a ensuite donné une base légale au plan social pour venir compléter les dispositions encadrant le licenciement pour motif économique contenues dans la loi nº 73-4 du 2 janvier 1973.
La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a précisé les mesures à inclure dans le plan et introduit le fait que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Enfin, le plan social a été rebaptisé « plan de sauvegarde de l’emploi » (PSE) par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Le PSE a pour objectif, comme son nom l’indique, d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements et de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.
Le contenu du plan est ainsi soumis à un principe de proportionnalité, sa validité étant en principe appréciée par l’administration au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou, le cas échéant, l’unité économique et sociale ou le groupe auquel appartient la société qui procède aux licenciements.
2. Une procédure complexe qui a entraîné une insécurité juridique croissante
a. Une procédure excessivement complexe
Jusqu’à la signature de l’ANI du 11 janvier 2013 et à sa traduction concrète dans la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, la procédure encadrant les plans sociaux, complexe et détaillée, s’était écartée, dans ses effets, de l’objectif initialement recherché.
La législation cherchait initialement à favoriser la consultation des salariés à travers le principe de double consultation du comité d’entreprise : sur l’aspect économique du projet (livre IV) et sur le projet de licenciement économique (livre III). En cas de désaccord entre le comité d’entreprise et l’employeur, la loi de modernisation sociale de mai 2001 prévoyait le recours à un médiateur. Depuis la loi de cohésion sociale de janvier 2005, cette mesure a été supprimée, ainsi que le découplage des deux procédures, c’est-à-dire la discussion du bien-fondé économique du projet avant l’élaboration précise de même projet.
Dans le même temps, le recours au juge est devenu la norme. La procédure de consultation pouvait en effet être contestée en référé devant le juge judiciaire pendant les quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise. La régularité et la validité du licenciement peuvent être contestées au fond dans les douze mois. Enfin, chaque salarié peut contester individuellement devant les conseils des prud’hommes le motif de licenciement ou le non-respect de l’obligation de reclassement.
Progressivement, la judiciarisation des licenciements a donc pris le pas sur la recherche d’un accord négocié entre employeur et salariés, à la différence de la pratique d’autres pays européens. Ainsi, en Allemagne, l’accord collectif est indispensable pour arrêter le contenu des mesures d’accompagnement social. En Espagne, il permet de garantir l’obtention de l’autorisation administrative de licenciement. En Italie, il permet d’éviter l’intervention directe de l’administration pour tenter de concilier les parties. En Suède, l’employeur est incité à conclure un accord s’il veut s’affranchir de la règle du « dernier entré, premier sorti » et, en pratique, 90 % des restructurations donnent lieu à un accord collectif.
b. La judiciarisation croissante des licenciements économiques collectifs
La judiciarisation des conflits portant sur le licenciement économique a eu pour effet de faire primer la négociation des indemnités sur la recherche du reclassement et de la reconversion professionnelle. Elle a aussi eu pour conséquence une insécurité juridique pour les entreprises (sur les délais de procédure, sur le coût des restructurations) comme pour les salariés (incertitude sur leur devenir, difficultés à se projeter…) et une insatisfaction des représentants du personnel sur les conditions d’exercice d’un réel dialogue au sein de l’entreprise.
Plusieurs dysfonctionnements ont ainsi pu être identifiés.
En premier lieu, les juges pouvant être saisis sont nombreux : outre le conseil des prud’hommes qui peut être saisi de chaque cas individuel, le tribunal de grande instance (TGI) peut être saisi par le comité d’entreprise ou les organisations syndicales et le juge pénal peut condamner l’employeur pour « délit d’entrave » lorsqu’il se rend coupable de n’avoir pas respecté les prérogatives des représentants du personnel.
Ensuite, les délais de jugement en matière de licenciement économique sont longs : ces délais s’élevaient à 11 mois en moyenne en 2012 devant le TGI, près de 2 ans en appel, puis encore à environ 2 ans pour le recours en cassation avec le risque d’annulation tardive du plan de sauvegarde de l’emploi et des licenciements. Des décisions de justice favorables aux salariés peuvent parfois n’intervenir que plusieurs années après les licenciements, comme cela a été le cas pour la biscuiterie Lu. Cette entreprise avait annoncé sa restructuration en 2001 mais les licenciements ne sont intervenus qu’en 2004 et 2005. Les salariés ont obtenu de la Cour d’appel de Paris la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse en 2011, et la Cour de cassation a finalement rejeté le pourvoi de l’entreprise en 2012. D’autres exemples, comme celui de l’entreprise Goodyear, ont récemment mis en lumière les difficultés entraînées par des procédures non bornées dans le temps.
Enfin, le caractère « réel et sérieux » du motif économique des licenciements a donné lieu à des jurisprudences contradictoires. Si l’administration ne dispose pas de statistiques sur les PSE mis en place dans des entreprises appartenant à un groupe dégageant des profits nets, la jurisprudence est a priori protectrice sur ce sujet. Elle écarte le caractère réel et sérieux du licenciement lorsque la cause économique invoquée correspond à la seule volonté de l’employeur de réaliser des économies de gestion, d’augmenter le niveau de profit de l’entreprise (Cass. soc. 26/11/1996 n° 93-44811) ou de supprimer des emplois jugés non rentables, alors que l’entreprise est par ailleurs financièrement saine.
Toutefois, le juge ne s’autorisait généralement pas à vérifier si le motif économique invoqué par l’entreprise justifiait effectivement le plan de sauvegarde de l’emploi et à prononcer la nullité si tel n’est pas le cas.
Cependant, dans l’affaire Viveo, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 mai 2011, avait estimé que « le défaut de motif économique », pouvait conduire à prononcer la nullité du licenciement. Cette décision de la Cour d’appel, consacrant la possibilité d’une nullité au fond, a été cassée par la Cour de cassation par une décision du 3 mai 2012, qui s’est fondée sur l’article L. 1235-10 du code du travail, en énonçant que celui-ci prévoyait que « seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique », signifiant ainsi que la décision économique qui a motivé son adoption ne peut faire l’objet d’un recours devant le juge. La position de la Cour de cassation s’appuie sur l’adage « pas de nullité sans texte ».
Or, malgré la décision de la Cour de cassation, deux arrêts récents ont procédé à la même analyse que la Cour d’appel de Paris : un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 3 janvier 2012 (Sodimecal) et un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 22 mai 2012 (Leader Price).
L’ensemble de ces éléments témoignait, jusqu’à la réforme de la procédure induite par la loi relative à la sécurisation de l’emploi en juin 2013, des faiblesses de la législation en matière de licenciements collectifs comme de la difficulté à établir des relations de confiance entre les acteurs, ce qui a conduit à un manque d’anticipation, d’information et de responsabilisation de ceux-ci.
c. Une tentative pour gagner en responsabilisation des acteurs : les accords de méthode
En 2003, le législateur avait néanmoins cherché à introduire de la souplesse à travers la possibilité offerte aux entreprises de négocier des accords de méthode. Ceux-ci visent à fixer les conditions d’une meilleure consultation des instances représentatives du personnel – notamment par la définition du calendrier de la procédure d’information et de consultation – et à anticiper la mise en œuvre de certaines mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.
Les accords de méthode ont été pérennisés par la loi de cohésion sociale (article L. 1233-21 du code du travail). Ces accords peuvent être négociés en amont de la restructuration. Ils couvrent aujourd’hui près de 15 % des restructurations et 25 % des restructurations hors redressement et liquidation judiciaire. La place accordée à l’organisation de la procédure de licenciement témoigne de la volonté de dépassionner les débats et de créer les conditions nécessaires à un dialogue social de qualité. Cependant, les accords de méthode n’abordent pas, ou peu, trois sujets pourtant essentiels : les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise peut formuler des propositions alternatives au projet de licenciement (aucun accord de méthode ne le prévoit alors même que le comité d’entreprise y a intérêt), l’implication des salariés (les modalités d’information des salariés sur le contenu de l’accord sont minoritaires), et le suivi de l’application de l’accord.
Si la portée de ces accords n’est pas négligeable, elle ne semblait cependant pas suffisante.
d. Le rôle essentiellement consultatif de l’administration
Depuis la suppression de l’autorisation administrative de licenciement en mai 1986 et jusqu’au vote de la loi relative à la sécurisation des parcours professionnels en mai 2013, le rôle de l’administration, était resté essentiellement consultatif en matière de licenciement économique collectif.
L’administration dispose certes de la capacité de présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise. Elle peut également relever une irrégularité de procédure et adresser à l’employeur un avis écrit précisant la nature de l’irrégularité constatée : il s’agit du constat de carence. À ce titre, environ 85 % des PSE font annuellement l’objet d’observations de la part des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Il ne s’agit toutefois, jusqu’à l’ANI du 11 janvier 2013, que de remarques importantes à prendre en compte mais sans portée juridiquement contraignante.
3. La réforme de la procédure encadrant les PSE résultant de l’ANI du 11 janvier 2013 et de la loi relative à la sécurisation de l’emploi
L’ANI et la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi procèdent à la fois à une responsabilisation des partenaires sociaux au sein de l’entreprise et à une déjudiciarisation des licenciements économiques collectifs. La loi inverse une donnée : à la réparation a posteriori par le juge, elle substitue l’intervention a priori par l’accord ou l’homologation, sans priver salariés et employeurs du recours au juge. Elle prévoit donc une montée en puissance du rôle de l’administration et du juge administratif. Enfin, elle permet l’adoption d’accords de maintien dans l’emploi.
a. La responsabilisation des partenaires sociaux sous le contrôle de l’administration
La nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi sont fixés soit par accord collectif majoritaire validé par l’administration (nouvel article L. 1233-24-1 du code du travail) soit par un document produit par l’employeur et homologué par la DIRRECTE (cf. Encadré n° 1).
La procédure se déroule sous le regard de l’administration qui peut être saisie si les organisations représentatives du personnel estiment que l’information dont ils disposent est insuffisante ; dans ce cas, la DIRECCTE peut enjoindre l’entreprise de fournir des données complémentaires.
Le refus d’homologation de la procédure par l’administration doit être motivé. L’entreprise doit alors établir un nouveau document. Le délai maximum est suspendu jusqu’à l’homologation, par l’administration, du nouveau document établi par l’employeur.
Toute action en contestation de l’homologation doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de son obtention devant le juge administratif.
Il convient de souligner que les délais d’information-consultation prévus pour la nouvelle procédure dans le cadre d’un projet de licenciement collectif sont plus longs que les délais minima qui avaient antérieurement cours. Par ailleurs, il est désormais expressément prévu dans la loi que le CE doit se prononcer sur les alternatives possibles au projet de licenciement.
Toute contestation par le salarié visant le motif du licenciement ou le non-respect par l’employeur des dispositions du PSE doit être formée dans un délai de 12 mois suivant la notification du licenciement. Comme auparavant, ce recours est formé devant les prud’hommes.
Une fois la phase administrative achevée par l’homologation ou la validation du plan, les licenciements peuvent être contestés devant le juge judiciaire, qui indemnise le cas échéant les salariés, mais ne peut annuler le PSE. C’est donc le juge administratif qui détient la compétence d’invalider le plan en cas d’absence de contenu. La loi relative à la sécurisation de l’emploi supprime donc le référé et la saisine du juge judiciaire au cours de la procédure d’élaboration du PSE, mettant aussi un terme aux possibilités de contester et de suspendre la mise en œuvre des PSE, le recours au juge administratif sur le contenu du plan n’étant ouvert qu’une fois celui-ci adopté.
ENCADRÉ N° 1 : LA NOUVELLE PROCÉDURE DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE COLLECTIF
Dans le cas d’un accord collectif, celui-ci devra être signé par une ou plusieurs organisations ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des précédentes élections professionnelles. Par dérogation aux dispositions concernées du chapitre III du Titre III du Livre II du code du travail, il pourra fixer les procédures applicables à un licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, en ce qui concerne, en particulier, le nombre et le calendrier des réunions avec les IRP, la liste des documents à produire, les conditions et délais de recours à l’expert, l’ordre des licenciements, et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Lorsque l’employeur recourt à la procédure d’homologation, il établit un document qu’il soumet à l’avis du comité d’entreprise, préalablement à sa transmission à la Dirrecte. Ce document précise le nombre et le calendrier des réunions des instances représentatives du personnel, les délais de convocation, la liste des documents à produire ainsi que le projet de PSE. L’administration se prononce dans un délai de 21 jours sur le document et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi. À défaut de réponse expresse dans ce délai, ils sont réputés homologués.
À compter de la date de présentation du document au CE, la procédure s’inscrit dans un délai maximum préfixe, non susceptible de suspension ou de dépassement :
– de 2 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant de 10 à 99 salariés ;
– de 3 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant de 100 à 249 salariés ;
– de 4 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant 250 salariés et plus.
b. La possibilité de négocier des accords de maintien dans l’emploi
En ce qui concerne les accords de maintien dans l’emploi, les dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, issue de l’ANI du 11 janvier 2013 encadrent précisément les conditions de recours aux accords d’entreprise aménageant l’équilibre global temps de travail/salaire/emploi. En effet, si les entreprises peuvent déjà aujourd’hui conclure des accords aménageant la durée du travail, sur le fondement de l’article L. 3122-2 du code du travail, et ajuster à la baisse la rémunération des salariés en cas de difficulté économique, il n’existe pas à ce jour de dispositions de nature législative encadrant le recours à ce type d’accords. De fortes garanties sont toutefois maintenues (cf. Encadré 2).
ENCADRÉ 2 : LES GARANTIES ENTOURANT LES ACCORDS DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
La loi prévoit des garanties importantes pour les salariés :
– un accord majoritaire à 50 % sera nécessaire, pour assurer la forte légitimité de l’accord ;
– la durée de l’accord est strictement limitée : il ne pourra pas excéder 2 ans maximum ;
– l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique pendant la durée de l’accord ;
– un accord de maintien dans l’emploi ne peut avoir pour effet de diminuer les salaires des salariés compris entre 1 et 1,2 SMIC ;
– les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires devront participer aux efforts demandés aux salariés, dans un souci d’équité entre les différents acteurs ;
– si un employeur ne respecte pas les engagements de maintien dans l’emploi, il devra verser des dommages et intérêts aux salariés lésés, selon des modalités fixées dans l’accord ;
– en cas de rupture du contrat de travail, notamment à la suite d’une décision judiciaire de suspendre les effets de l’accord, le calcul des droits des salariés se fait sur la base du salaire perçu avant la conclusion de l’accord ou sur la base du salaire perçu au moment de la rupture du contrat de travail, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour le salarié ;
– l’accord individuel du salarié est nécessaire pour que l’accord de maintien dans l’emploi lui soit applicable. Si le salarié accepte, les éléments du contrat de travail qui seraient contraires à l’accord sont suspendus pendant la durée de celui-ci. Si le salarié refuse, la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement individuel pour motif économique et il bénéficiera d’un accompagnement spécifique à ce titre.
4. Des questions de procédure qui demeurent ouvertes
Plusieurs questions devraient faire l’objet d’adaptations, au-delà des mesures déjà adoptées dans le cadre de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
La première concerne l’articulation entre le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). En rendant le CHSCT autonome en 1982, la loi n’a pas favorisé la coopération entre celui-ci et le comité d’entreprise. Aujourd’hui, le CHSCT peut seul bloquer une procédure et provoquer une expertise. Les Rapporteurs recommandent donc de mieux réfléchir à l’articulation entre les compétences du CE et du CHSCT.
Le second point concerne les critères d’ordre des licenciements, notamment dans le cadre d’un PSE. Au sein de la même catégorie professionnelle, l’ordre des licenciements doit être fixé au moyen d’une attribution de points et d’un système de pondération qui s’applique à l’ensemble de l’entreprise sans tenir compte du site concerné par la restructuration. Cette procédure complexe génère des inquiétudes au-delà de ce qui est nécessaire pour l’ensemble des salariés d’un groupe. Il serait par conséquent légitime de limiter l’obligation d’établir des critères d’ordre au seul site concerné par un PSE, lorsque celui-ci ne concerne qu’une unité de production.
Enfin, l’obligation de proposer des offres de reclassement aux salariés ne tient pas compte du caractère réel des possibilités de relocalisation de ces mêmes salariés. Une entreprise est ainsi tenue de proposer des offres de reclassement sur l’ensemble du territoire national, (à l’exclusion récente des autres pays ce qui avait parfois conduit des entreprises à proposer des reclassements dans des filiales situées dans des pays émergents en cas de délocalisation), sans tenir compte des aspirations des salariés. Les rapporteurs soulèvent donc le problème de la mobilité géographique réelle des salariés. À cet égard, le droit devrait mieux protéger les entreprises comme les salariés en les incitant à s’entendre mutuellement sur les limites géographiques acceptables en matière de reclassement. Il conviendrait ainsi de réfléchir à un mécanisme permettant aux salariés de faire savoir, en amont des offres de reclassement, les limites géographiques au sein desquelles ils sont prêts à accepter un emploi au titre du reclassement, tout en préservant les obligations des entreprises.
Au-delà de ses nouvelles prérogatives issues de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, la position générale de l’administration aura un effet considérable sur l’attitude des participants aux négociations. Certains pourraient considérer qu’ils ont intérêt à les faire échouer si la position de l’administration leur semble plus favorable que ce qu’ils pourraient obtenir par le biais de la négociation. Il s’agit donc d’en tirer les conséquences en clarifiant la « doctrine » d’intervention de l’administration afin de réduire ce risque d’interférence dans la sincérité des négociations et, par ailleurs, de s’assurer que celle-ci sera en mesure de traiter de façon similaire des situations identiques.
1. La nécessité de critères suffisamment clairs pour encadrer l’intervention publique en matière d’homologation ou de validation des PSE
L’implication de l’administration sera plus forte à tous les stades de l’élaboration du PSE, que ce soit en vue désormais de son homologation (procédure unilatérale) ou de sa validation (procédure négociée). Les DIRECCTE vont ainsi être amenées à développer leur mission d’analyse des mesures contenues dans le PSE, notamment des mesures de reclassement, de revitalisation et de reconversion, en vue de l’approbation ou non des mesures contenues dans le plan.
Certains points méritent d’être précisés. Ainsi, il serait souhaitable que les DIRECCTE s’efforcent de traiter de manière comparable des situations semblables. C’est l’esprit qui a présidé à l’adoption de la loi sur la sécurisation de l’emploi. En effet, l’action de l’administration devra reposer sur la notion de proportionnalité : plus l’entreprise disposera de moyens pour accompagner ses salariés et plus l’administration se montrera exigeante.
L’appréciation ne portera pas sur le motif, mais sur l’ampleur du plan et le devenir des salariés au regard de la situation de l’entreprise. Ainsi, un groupe en bonne santé financière, qui déciderait de se séparer d’une activité qu’il estimerait condamnée, pourrait faire l’objet d’une exigence quantitative et qualitative très poussée de la part de l’administration, afin qu’il investisse significativement dans le reclassement et l’indemnisation de ses salariés. Les orientations et les outils fournis aux services seront logiquement conçus à partir de ce concept de proportionnalité.
Le ministère du Travail a ainsi indiqué aux membres de la mission que sera prochainement élaboré, afin de renforcer la professionnalisation des services, un référentiel qui leur permettra de se doter rapidement de bonnes pratiques tant sur le déroulement de la procédure que sur le contenu d’un PSE. Ce référentiel sera accompagné d’un important programme de formation pilotée par l’INTEFP.
Au-delà de cet effort de formation, il pourrait être envisagé de déterminer une série de critères d’appréciation cohérents et suffisamment généraux pour pouvoir servir de référence aux DIRECCTE dans leur mission d’analyse des plans de sauvegarde de l’emploi. Il est en effet ressorti des travaux de la mission que ce n’est pas sans crainte que les DIRECCTE abordent cette nouvelle responsabilité, l’appréciation réelle de la situation d’une entreprise, notamment des plus grandes, étant une tâche parfois complexe. Les rapporteurs ont ainsi pu rencontrer des directeurs, notamment de Lorraine, de Bretagne et de PACA, qui leur ont fait part des mêmes inquiétudes : alors que les moyens humains à leur disposition se réduisent, seront-ils à même de pouvoir dégager une appréciation suffisamment claire et étayée de la proportionnalité des mesures contenues dans le PSE par rapport aux moyens dont dispose le groupe, et cela dans des délais raccourcis de 15 ou 21 jours ?
En effet, les pôles d’analyse économique des DIRECCTE ne possèdent pas toujours une expertise suffisante en matière de connaissance des comptes des entreprises, d’autant plus qu’une partie de l’expertise économique issue des ex-DRIRE (Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement) est en cours de transferts au profit des régions. Cet affaiblissement des compétences économiques et comptables au sein des services déconcentrés de l’État ne semble pas cohérent avec l’attribution de nouvelles missions à ces mêmes services.
En l’absence de critères précis, il existe un risque que les entreprises qui réussiront à se faire entendre seront celles qui auront le plus de talent pour plaider leur cause auprès des autorités de l’État et des collectivités territoriales, et cela même si le pouvoir propre des DIRECCTE en matière d’homologation ou de validation ne peut être délégué. La difficulté sera évidemment d’apprécier la capacité contributive de l’entreprise dans des délais très courts (15 ou 21 jours à partir de la notification du PSE, auxquels il convient d’ajouter la phase préalable de consultation tripartite entre l’employeur, le comité d’entreprise et la DIRECCTE).
Cela conduit la mission à penser que l’État devrait se doter de son propre conseil juridique en matière d’analyse de la capacité contributive des groupes, tout en étoffant les services d’analyse comptable et financière des DIRECCTE.
Il pourrait également être utile de mettre à disposition des services une grille harmonisée d’analyse financière des moyens d’une entreprise ou d’un groupe. Tout en conservant l’autonomie de décision des DIRECCTE, cette grille d’analyse constituerait la contrepartie de l’autonomie accordée aux partenaires sociaux. Ces critères pourraient reposer sur les paramètres suivants :
– moyens appréciés à l’échelle du groupe ;
– nombre de salariés reclassés en interne et en externe ;
– efforts réalisés au cours des années passées dans le cadre de la formation continue et investissement dans les démarches de GPEC/EDEC ;
– initiatives conduites par l’employeur pour la recherche d’un repreneur dans le cas de la fermeture d’un site.
L’analyse devra bien évidemment reposer sur les moyens du groupe, et non de l’entreprise ou du site pris isolément. En effet, si la rentabilité devait s’apprécier site par site, des artifices comptables (comme la localisation des actifs immatériels) permettraient de transférer les éléments de valorisation de l’entreprise. De tels critères rendraient possible, dans le cas d’un PSE qui serait l’objet d’un accord majoritaire, mais dont la DIRECCTE estime que les mesures sont insuffisantes au regard des enjeux liés à la reconversion (notamment dans le cas où le PSE contiendrait une forte prime supra-légale), de ne pas valider un plan qui serait insuffisant, tout en se préservant de pressions pouvant survenir de part et d’autre. L’action des DIRECCTE serait ainsi confortée.
2. Associer Pôle emploi à la phase de négociations autour du PSE
Si Pôle emploi agit effectivement assez peu en amont du PSE, son intervention pourrait être pertinente au moment de l’élaboration de celui-ci, étant donné sa bonne connaissance du marché du travail et sa capacité à mobiliser des acteurs et à identifier des solutions. Pôle emploi présente en effet l’avantage d’être implanté sur près de 1 000 bassins d’emploi. En sens inverse, son implication en amont permettrait à l’opérateur de mieux connaître le contenu du PSE et donc de mieux calibrer les outils d’accompagnement des salariés.
La mission recommande donc d’associer Pôle emploi à la phase de négociation du PSE. Les échanges des Rapporteurs avec les responsables locaux de Pôle emploi, notamment lors d’un déplacement dans l’unité territoriale de Pôle emploi d’Alençon (Orne), ont confirmé l’intérêt pour les agents de Pôle emploi d’être mieux informés des mesures adoptées dans le cadre des PSE. Cela permettrait notamment d’améliorer les synergies et de poser une première réponse à la difficulté souvent soulevée, qu’il y a à articuler les moyens du PSE avec les outils publics de reconversion.
Par ailleurs, les Rapporteurs soutiennent la proposition de la Cour des comptes, formulée dans son rapport de juillet 2013 sur la rationalisation de l’organisation territoriale de l’État, de confier l’ensemble de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi à Pôle emploi. Un tel schéma de rationalisation pourrait en effet permettre d’assurer une meilleure coordination entre les besoins des entreprises et la formation des demandeurs d’emploi, notamment suite à un PSE.
Le rôle de la puissance publique en matière d’accompagnement des restructurations s’affirme également, ce qui est une spécificité française, en matière de revitalisation des territoires. Cet outil, original et utile, qui repose sur la contribution des entreprises in bonis de plus de 1 000 salariés, pourrait toutefois faire l’objet d’améliorations conséquentes afin d’éviter les effets d’aubaine et la dispersion des ressources.
RÉPARTITION DES CONVENTIONS DE REVITALISATION
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ EN 2011
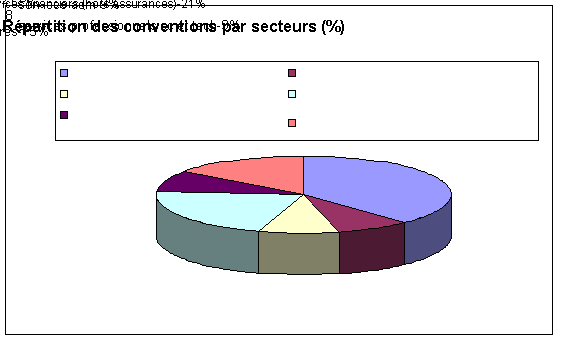
Source : DGEFP.
1. L’absence de plafond à l’obligation légale de revitalisation
Le dispositif de revitalisation constitue un autre levier, en dehors du PSE, permettant de moduler les obligations des entreprises en fonction de leur situation financière appréciée au niveau du groupe. L’article L. 1233-84 du code du travail, introduit par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a ainsi instauré le principe d’une participation des entreprises à la revitalisation des territoires (en proportion de leurs moyens) lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées.
Pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, cette contribution est obligatoire et le montant financier qu’elles doivent y consacrer ne peut, sauf exception due à une insuffisance flagrante de moyens, être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.
En revanche, si l’entreprise décide ne pas signer de convention de revitalisation, elle doit s’acquitter d’une contribution au Trésor public de quatre SMIC par emploi supprimé. Ce système conduit donc bien souvent à fixer la modulation dans une fourchette, comprise entre deux et quatre SMIC – même si certaines entreprises acceptent de porter leur participation à six, huit, dix, voire douze SMIC et que d’autres, connaissant des difficultés financières, se contentent de la limiter entre zéro et quatre SMIC. En tout état de cause, il n’existe pas de plafond en droit à la contribution que doivent verser les entreprises en matière de revitalisation.
La mission recommande donc de fixer un plafond légal à la contribution qui peut être demandée dans le cadre de l’obligation de revitalisation. La base minimale étant équivalente à deux SMIC pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, le plafond pourrait se situer à 6 SMIC (cette participation pouvant toujours être supérieure si l’entreprise y consent et trouve un accord en ce sens avec les services de l’État). La marge de manœuvre ainsi légalement encadrée pourrait permettre aux services de l’État de moduler davantage la contribution des entreprises en fonction de leur situation économique, des efforts précédemment réalisés en termes de GPEC et de formation professionnelle, ainsi que de leur implication dans la recherche d’un repreneur (en cas de fermeture de site). En contrepartie, la pénalité de 4 SMIC en cas d’absence de signature d’une convention de revitalisation disparaitrait.
Ce plafonnement permettrait également aux entreprises de calculer en amont le coût maximum associé à la revitalisation, ce qui constituerait une réponse partielle à l’imprévisibilité, souvent dénoncée par les chefs d’entreprise interrogés par les rapporteurs, du coût global lié à une restructuration.
2. Une procédure souple qui conduit parfois à une dispersion des moyens
L’entreprise peut s’acquitter de l’obligation de revitalisation, soit à travers une convention signée avec le préfet, soit par un accord collectif en tenant lieu. Dans tous les cas, cette convention doit déterminer la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions de revitalisation du bassin d'emploi. Au cours du processus de négociation de la convention, le préfet et l’entreprise doivent consulter les collectivités locales intéressées, les organismes consulaires et les partenaires sociaux membres de la Commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l’emploi (COPIRE) sur les actions que pourrait contenir la convention.
La procédure de revitalisation a connu une mise en œuvre assez lente entre 2002 et 2005, mais son utilisation a crû notablement depuis. Ainsi, entre 100 et 150 conventions de revitalisation sont signées chaque année (avec un pic à 239 conventions signées en 2010 du fait de la crise). Les régions connaissant les restructurations industrielles les plus nombreuses – l’Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la région Rhône-Alpes, la Lorraine, et la Champagne-Ardenne – en signent davantage que d’autres. L’ensemble de ces conventions engagent environ 75 à 80 millions d’euros en moyenne chaque année et constituent donc un véritable levier pour le développement économique dans ces territoires. En termes de recréations d’emploi, les chiffres s’élèvent en 2012 à 10 394 contre 18 222 en 2011.
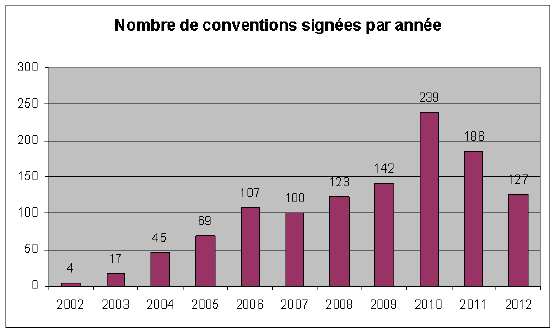
Source : DGEFP.
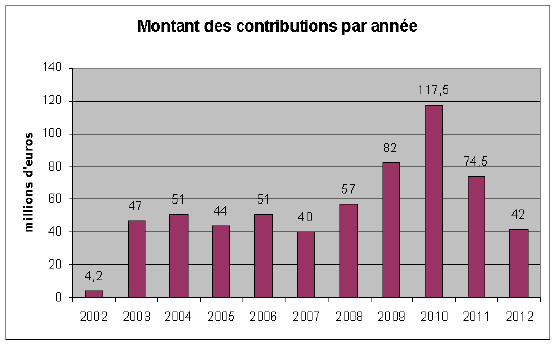
Source : DGEFP.
Pour l’année 2012, parmi les principales mesures, l’aide à l’emploi et au développement de l’activité est prédominante, pour un total de 20,3 millions d’euros. Cependant, la part entre subventions (11,3 millions d’euros) et prêts (9 millions d’euros) est plus équilibrée qu’en 2011 (respectivement 17,5 millions d’euros et 8,5 millions d’euros). Les actions pour la reconversion de site (5,7 millions d’euros) constituent le troisième axe d’intervention le plus important.
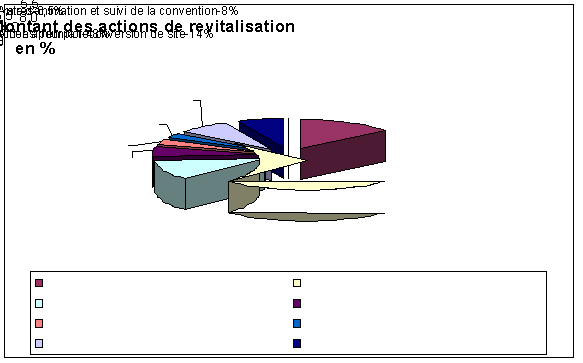
Source : DGEFP.
Par ailleurs, toujours en 2012, 133 conventions de revitalisation, signées entre 2009 et 2010, sont arrivées à échéance. Elles concernent un montant de 45,1 millions d’euros. Le nombre de création d’emplois est de 10 352 pour un objectif de 13 273 (78 %). Néanmoins, certains emplois prévus seront créés après l’échéance de la convention (« emplois programmés »).
Le bilan montre surtout la prépondérance de l’aide à l’emploi qui représente 64 % des actions (22 millions d’euros de subventions et 7 millions d’euros de prêts). Ainsi, bien qu’on constate ces dernières années une diversification des mesures et types d’actions, de l’aide directe à l’emploi - mesure traditionnelle – jusqu’aux mesures plus innovantes telles que l’appui au TPE-PME ou la mise à disposition de compétences, cet élargissement reste limité.
Or, l’aide à l’emploi, qui prend souvent la forme de prêts à taux zéro ou de subventions à l’embauche, est souvent distribuée sans vérification de la pérennité et de la qualité de l’emploi créé, de l’éventuel effet d’aubaine induit (l’entreprise aurait embauché de toute manière sans cette subvention) ou de sa pertinence au regard de l’activité économique au sein du bassin d’emploi concerné. L’aide à la revitalisation a ainsi nourri des dispositifs passifs sans distinction entre entreprises sur un même bassin d’emploi. En outre, la longueur des procédures de PSE et l’arrêt de l’activité ont un impact sur les sous-traitants en termes d’emploi alors que ces mêmes sous-traitants peuvent se situer en dehors du périmètre de la revitalisation. La logique comptable, induite par l’obligation de recréer autant d’emplois qu’il y a eu de suppressions, l’emporte ainsi souvent sur des considérations plus utiles aux salariés et aux territoires.
En outre, en période de crise, de nombreuses restructurations s’opèrent actuellement sans revitalisation, soit parce que l’entreprise n’est pas soumise à cette obligation en raison de sa taille, soit parce qu’elle en est exonérée en cas de liquidation ou de redressement judiciaire. Ainsi, lorsque la Bretagne subit la liquidation du pôle frais de l’entreprise Doux, l’absence de cette obligation de revitalisation a contraint à mobiliser d’autres outils publics, plus complexes et moins souples d’utilisation.
Enfin, ce ne sont pas toujours les actions qualitatives, c’est-à-dire celles qui permettraient de favoriser une réindustrialisation du territoire dans la durée, une reconversion des salariés sur le long terme ou, dans le cas de la fermeture d’un site, une reprise du site en abaissant son coût de reprise et en favorisant son réaménagement, qui sont privilégiées.
À ce constat, il convient d’ajouter que le plan de revitalisation subit parfois la concurrence des montants distribués dans le cadre de la prime supra-légale. La mission a eu connaissance d’une entreprise qui a versé 7 millions d’euros au titre de la revitalisation pour près de 500 salariés alors que les indemnités légales et supra légales accordées aux salariés se sont élevées à plus de 30 millions d’euros. L’outil efficace pour favoriser la réindustrialisation et l’emploi se trouvait ainsi cinq fois moins doté.
3. Un suivi qui n’est pas satisfaisant
Le suivi et l’évaluation des résultats réellement obtenus en matière d’emploi par le biais de la revitalisation sont bien souvent insatisfaisants.
Par exemple, dans les Vosges, les structures déconcentrées et les collectivités territoriales, en association avec les entreprises, ont mis en place des comités d’engagement communs aux conventions de revitalisation sur chaque territoire. Il existe également un comité de suivi départemental.
Ce type de suivi doit être encouragé afin de mieux se rendre compte de l’efficacité des mesures engagées. Il n’est pour l’instant que très limité : aucun suivi réel des crédits engagés au titre de la revitalisation n’est actuellement en place pour limiter les effets négatifs décrits ci-dessus.
B. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION : UNE APPROCHE PLUS COMPLÈTE ET PLUS DYNAMIQUE DE LA REVITALISATION
Il serait donc souhaitable de développer une nouvelle approche, fondée sur de nouveaux moyens et sur une réorientation de ces moyens vers des dispositifs actifs en faveur de l’emploi et de l’activité économique des territoires. Tel est déjà l’objectif poursuivi par le ministère du Travail, notamment à travers le « Guide méthodologique pour l’accompagnement de la mise en œuvre des conventions de revitalisation », édité par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) en février 2013. Ce guide incite l’administration à se tourner vers des mesures plus actives. Il vise à trouver ce délicat point d’équilibre, en associant des dispositions qualitatives aux mesures quantitatives. À titre d’illustration, on peut citer :
– le financement d’actions de prospection pour la reprise du site en cas de fermeture ;
– le soutien à la création ou à la reprise d’entreprises ;
– des actions de formation des cadres et des dirigeants des entreprises locales ;
– un soutien aux structures d’insertion par l’activité économique (IAE) ;
– le soutien à la mise en réseau d’entreprises sur un même territoire (plateformes, pôles de compétitivité, filières, etc.) ;
– ou encore l’abondement de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque dont la politique d’investissement bénéficie aux entreprises implantées dans le bassin d’emploi concerné.
Les rapporteurs saluent ces nouvelles orientations, notamment pour le renforcement de sociétés de capital-risque agissant sur le territoire. À travers leurs recommandations, ils cherchent cependant à aller plus loin vers le renforcement et la mutualisation des démarches et des moyens associés à l’obligation de revitalisation, pour remédier de façon cohérente aux problèmes identifiés ci-dessus.
1. La question de la mutualisation des ressources générées par la revitalisation
Les conventions de revitalisation étant séparées, isolées et limitées à un seul territoire, il s’avère parfois difficile d’établir de véritables actions en soutien de l’activité économique du bassin d’emploi concerné. Conscientes du problème, de plus en plus d’entreprises créent leurs propres « agences de revitalisation », à l’instar de SNCF développement ou de la société Géris lancée par le groupe Thalès, qui regroupe désormais les moyens issus de conventions de revitalisation signées par d’autres entreprises. Air France, Sanofi, SNCF ou Vivendi disposent également de structures spécialisées dans la gestion des conventions de revitalisation. Pour Air France, la société Sodesi accompagne par exemple la revitalisation de la zone du grand Roissy ou de la zone d’Orly. En 2009, toutes les conventions nationales ont été regroupées dans 7 territoires dont Roissy, Orly, Montreuil ou les territoires insulaires (Corse, Martinique, etc) pour un total d’environ un millier d’emplois. Il est par ailleurs possible de regrouper plusieurs conventions, issues d’entreprises différentes, en une seule, comme les membres de la mission ont pu l’observer lors d’un déplacement effectué à Rousset dans les Bouches-du-Rhône.
On assiste ainsi au développement d’une mutualisation privée des moyens de revitalisation qui a pour ambition de favoriser des actions concertées et efficaces entre plusieurs entreprises soumises à l’obligation de revitalisation.
La « départementalisation » des fonds de revitalisation permet de créer un effet de levier comparable à celui qui existe dans le cadre du dispositif ALIZE (4). Cela existe parfois aussi sur un registre semi-public : en Lorraine, le « fonds lorrain de consolidation », financé par une partie des fonds de chaque enveloppe de revitalisation, se charge ainsi d’accompagner des projets structurants au profit des PME. De la même manière, en Ille-et-Vilaine, un fonds mutualisé dénommé « Idéa 35 » est en place depuis juin 2009.
Ces fonds mutualisés ont vocation à réduire les frais de gestion des conventions de revitalisation en les regroupant ainsi qu’à assurer une démarche plus professionnelle et mieux coordonnée pour retrouver des emplois.
Or, bien que les moyens financiers issus des conventions de revitalisation soient de plus en plus orientés vers des plates-formes départementales mutualisées, aucun mécanisme n’est formalisé, ni même prévu par la loi. En outre, l’administration s’efforce de mobiliser les fonds de la revitalisation pour engager la réindustrialisation sur le site même des destructions de postes, alors que cette logique de proximité n’est pas toujours la plus efficiente.
Ainsi, tout en conservant le cadre de gestion privé et partenariale de fonds privés issus de la revitalisation – puisqu’une gestion publique risquerait de conduire à une requalification des fonds en aides publiques soumises au droit de l’Union européenne sur les aides d’État – il pourrait être pertinent d’institutionnaliser des « Fonds mutualisés de revitalisation » dans chaque département. Ce dispositif permettrait de financer des reformations de site, la reconversion de personnels, des subventions aux entreprises innovantes, la création de laboratoires de recherche ou d’autres actions actives de ce type.
Le dispositif présenterait plusieurs avantages :
– réunir plus de ressources pour la mise en œuvre d’actions qualitatives plus aisées à identifier et à suivre si elles sont issues d’un seul et même fonds plutôt que de multiples conventions ;
– associer les salariés à la démarche de revitalisation, alors que de nombreux syndicats dénoncent le fait que la revitalisation ne concerne au final que très peu les salariés ;
– atténuer le caractère « one shot » des conventions de revitalisation et privilégier des actions dans la durée ;
– éliminer une concurrence néfaste entre opérateurs recherchant des emplois de manière non coordonnée ;
– réduire les frais de gestion occasionnés par le recours à des opérateurs privés souvent très chers pour une efficacité limitée (moins de 10 % des salariés d’une entreprise soumise à l’obligation de revitalisation bénéficient directement ou indirectement des actions prévues à ce titre) ;
– associer plus en amont les sous-traitants, les partenaires sociaux et les chefs d’entreprises à la politique de développement de l’emploi mise en œuvre sur ce bassin d’emploi ;
– éviter de subventionner des emplois temporaires ou qui auraient de toute manière été créés sans revitalisation ;
– éviter le gâchis consistant parfois à ne pas réussir à mobiliser l’ensemble des fonds issus des conventions de revitalisation ;
– contribuer à une politique de réindustrialisation qui associe l’ensemble des acteurs d’un territoire.
Sur ce sujet délicat, la mission est cependant consciente des objections qui pourraient être formulées.
Ainsi, l’objectif de la revitalisation étant de responsabiliser les entreprises par rapport au territoire sur lequel elles sont implantées, n’y a-t-il pas un risque de dilution de cette responsabilité si les entreprises venaient à se décharger de leurs obligations auprès d’un Fonds mutualisé ?
En outre, la masse financière disponible (42 millions d’euros en 2012 pour l’ensemble du territoire), bien qu’importante pour les territoires concernés, est-elle suffisante pour justifier une mutualisation par bassin d’emploi ?
Les Fonds ainsi constitués ne risqueraient-ils pas de fonctionner par intermittence faute de ressources disponibles et régulières ?
Ces objections ne semblent cependant pas insurmontables. En premier lieu, l’analyse détaillée des actions mises en œuvre par les entreprises au titre de la revitalisation montre que les entreprises s’acquittent parfois de leurs obligations sans chercher une réelle visée qualitative. Dans ce cadre, la mise en place de Fonds mutualisés pourrait permettre de renforcer ce sentiment de responsabilité, en associant l’ensemble des acteurs compétents sur le territoire (État, collectivités, partenaires sociaux, observatoires de l’emploi, etc..). D’autant plus que la gestion de ces fonds serait confiée aux partenaires sociaux pour en conserver la nature privée.
Par ailleurs – en termes de mobilisation de moyens – cette proposition doit être associée à d’autres recommandations de la mission, comme l’extension de l’obligation de revitalisation à toutes les entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 250 salariés, ce qui contribuerait à renforcer les moyens à la disposition de ces fonds mutualisés.
2. L’extension légitime de l’obligation de revitalisation aux entreprises de 250 à 1 000 salariés
Il n’existe actuellement aucune obligation légale pour les entreprises de moins de 1 000 salariés de contribuer à la revitalisation du territoire sur lequel elles procèdent à un licenciement collectif. Pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 50 salariés et 1 000 salariés ou n’appartenant pas à un groupe de plus de 1 000 salariés, c’est à l’État d’intervenir pour la mise en œuvre d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration. L’entreprise ne prend part à ces actions compte tenu de sa situation financière, que sur sollicitation du préfet. Ceci demeure très rare : seules quatre conventions de revitalisation ont été signées à ce jour avec des entreprises de moins de 1 000 salariés.
Par ailleurs, la définition habituellement utilisée par les organismes sociaux relative aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) concerne les entreprises dont la taille est comprise entre 250 à 4 999 salariés. En l’état actuel de la législation, une partie seulement des ETI est donc soumise à l’obligation de revitalisation. Au-delà des effets de seuil identifiés par la DARES, cette différenciation de traitement n’apparaît pas justifiée économiquement.
Il serait, au contraire, judicieux de soumettre à l’obligation de revitalisation certaines entreprises de moins de 1 000 salariés dans des secteurs dont la responsabilité territoriale est importante. Dans le cas de la Bretagne par exemple, les secteurs automobile et agroalimentaire n’ont pas toujours contribué à la redynamisation du territoire à la hauteur de leurs moyens et proportionnellement à l’impact de leurs restructurations sur le bassin d’emploi.
C’est pourquoi la mission recommande d’étendre l’obligation de revitalisation aux entreprises in bonis comprises entre 250 et 1 000 salariés. Cette extension du champ applicable de l’obligation de revitalisation pourrait néanmoins être adaptée en abaissant la base minimum légale à un SMIC, au lieu de deux, pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 250 et 1 000 salariés.
Cette contribution pourrait alimenter les fonds mutualisés envisagés par la mission. Elle renforce d’ailleurs la nécessité de la mutualisation puisque s’agissant d’entreprises moins dotées, l’individualisation des conventions perdrait tout son sens.
1. Un bilan satisfaisant mais unidimensionnel
Le Fonds National de Revitalisation des Territoires (FNRT) a été créé pour trois ans (2009-2012) dans le contexte particulier de la crise économique et financière de 2008. Il a finalement été reconduit jusqu’à la fin de l’année 2013.
Son objet est essentiellement de garantir une égalité territoriale entre les bassins d’emploi bénéficiaires d’actions de revitalisation et ceux non couverts par de telles conventions.
Il a aussi pour objectif de favoriser l’accessibilité au crédit pour des entreprises moins solides (cotation de la Banque de France 4 à 6) que celles privilégiées par le secteur bancaire, dans une logique d’effet levier. Ce fonds permet, sur un territoire déclaré éligible, de soutenir, sous la forme d’un prêt sans garantie accordé par OSÉO, des projets de développement de l’emploi, ou de maintien de l’emploi en cas de reprise d’activité, qui nécessitent des financements complémentaires. Il s’adresse aux entreprises qui créent ou préservent de 10 à 500 emplois et qui répondent aux critères suivants :
– des PME dont les effectifs sont compris entre 10 et 500 salariés et qui n’appartiennent pas à un groupe de plus de 5 000 salariés ;
– des créations d’entreprises issues de la reprise d’établissements de moins de 500 salariés ;
– les entreprises de moins de 3 ans constituées pour la reprise d’établissements sains en vue du maintien de l’emploi ;
– des entreprises dont la notation financière satisfaisante (BB) ou faible (B) selon la classification de la communication n° 2008/C 14/02 de la Commission Européenne.
L’intérêt du Prêt pour la Revitalisation des Territoires (PRT), pour les entreprises, résulte du fait qu’il s’inscrit dans une gamme de « produits mezzanine », intermédiaire entre les fonds propres et les fonds d’emprunt. Il est généralement accompagné d’un financement bancaire équivalent en moyenne au double du financement OSÉO. Le crédit doit ainsi permettre un effet levier en complétant des financements du secteur bancaire classique, grâce à son absence de garantie et un différé de remboursement. Par rapport à l’offre bancaire classique, ce prêt permet, en outre, de financer des objets que les banques ne financent pas comme, par exemple, des frais de certification ou de mise aux normes, de la formation et du recrutement, des salons, des dépenses marketing, ou l’installation de matériel.
La convention du 16 mars 2009 prévoyait la mobilisation de 135 millions d’euros de prêts aux entreprises à l’échéance de la convention fixée au 15 mars 2012, soit, en moyenne, 45 millions d’euros de prêts accordés chaque année. Entre avril 2009, date de lancement du dispositif, et le 10 mai 2012, 76 territoires ont été soutenus dans le cadre du FNRT pour une capacité totale de PRT de 134,97 millions d’euros. L’effet levier du PRT est avéré, et il est croissant sur la période. Ainsi, sur l’année 2011, les PRT accordés ont permis de lever des financements bancaires à hauteur de 165 millions d’euros soit un effet levier de 7,2. Cet effet levier était de 5,7 en 2009 et de 7 en 2010.
Le montant moyen des PRT accordés est relativement constant (248 000 euros en 2010), pour des programmes d’investissement d’un montant moyen de 1,9 million d’euros. Les PRT ont principalement bénéficié aux petites entreprises (60 %) du secteur de l’industrie (69 %), de la construction (15 %) et des services (13 %). On constate que le PRT s’adresse majoritairement à des PME du secteur industriel, qui emploient de 10 à 50 salariés, avec un ancrage territorial fort et ancien (moyenne d’âge de 20 ans des entreprises bénéficiaires), pour accompagner les besoins immatériels générés par des programmes d’investissements structurants (nouvelle activité ou diversification, augmentation de la capacité de production…).
En guise de bilan, il apparaît donc que le FNRT a globalement rempli ses objectifs. Cependant, force est de constater que si ce fonds a servi à financer des prêts utiles par leur effet de levier, il ne permet pas de mobiliser des fonds au profit d’actions qualitatives telles que celles engagées au titre de la revitalisation. Le FNRT a ainsi obéi à une logique d’accompagnement de l’emploi plus que d’aide à l’activité économique. En raison de l’impératif de création d’emplois, la sélection des bénéficiaires a été insuffisamment ciblée alors qu’elle aurait pu traduire des choix industriels.
Son objet pourrait donc être repris et développé.
2. Un Fonds de revitalisation aux missions élargies serait utile à l’accompagnement des territoires en difficulté
La mission a identifié deux problèmes majeurs. En premier lieu, il est inévitable que certains territoires puissent bénéficier de montants élevés au titre de la revitalisation alors que d’autres n’ont pas accès à cette aide complémentaire - ce qui légitime pleinement l’existence d’un outil du type FNRT. Cependant, le FNRT tel qu’il existe jusqu’à présent ne peut correctement répondre aux enjeux pour développer une nouvelle approche de la revitalisation fondée sur la montée en puissance d’actions qualitatives.
Il s’y ajoute, en second lieu, une interrogation tenant aux ressources disponibles dont pourrait bénéficier ce fonds.
À ce constat, la mission propose de répondre en réinstaurant le FNRT pour les années à venir, tout en élargissant la gamme de ses missions, afin de les rapprocher de celles qui pourraient être confiées aux Fonds départementaux mutualisés. Pour accroître ses moyens, ce fonds réformé pourrait être alimenté d’une part par les contributions envisagées au titre de la compensation pour licenciements diffus, ainsi que par une fraction, dont le montant reste à déterminer, des conventions nationales signées au titre de la revitalisation.
III. MIEUX ANTICIPER LES RESTRUCTURATIONS GRÂCE À UNE GOUVERNANCE COHÉRENTE ET DES OUTILS PUBLICS PLUS EFFICACES
L’anticipation porte en elle un paradoxe : plus on anticipe les difficultés, plus on crée de l’inquiétude, ce qui peut contribuer à accroître les difficultés. Tous les acteurs s’accordent néanmoins sur la nécessité d’anticiper le plus en amont possible les mutations économiques. En effet, plus les difficultés restent ignorées ou dissimulées, moins les entreprises ou les salariés ont de chance d’être accompagnés efficacement.
Par conséquent, l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques et des restructurations, vaste champ d’investigation qui dépasse et rejoint à la fois celui des PSE, constituent un enjeu de première importance.
Cet enjeu se structure autour de deux objectifs :
– inciter à la définition en amont d’orientations stratégiques partagées tant au niveau des filières que des territoires, et qui concernent aussi bien les salariés que les entreprises ;
– détecter et accompagner le plus rapidement et efficacement possible les entreprises en difficulté pour les aider à surmonter leurs problèmes.
A. DÉFINIR DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES : UN TRAVAIL EN AMONT NÉCESSAIRE POUR STRUCTURER L’INTERVENTION PUBLIQUE
Bien en amont des licenciements, la puissance publique cherche à anticiper les mutations économiques, que ce soit par la définition de politiques de filières, par le recours à des démarches de type Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou Engagement au développement de l’emploi et des compétences (EDEC), ainsi que par l’organisation de structures publiques permettant aux entreprises et aux salariés de trouver appuis, conseils et formations, à l’instar des récentes plateformes de mutation économique.
S’il n’existe pas, dans ce domaine complexe, de solutions évidentes, une meilleure coordination stratégique permettrait certainement d’améliorer les transitions et de mieux guider l’intervention publique.
1. La dimension sectorielle de l’anticipation : la politique de filières
Connaître les compétences utiles dans l’avenir – et s’assurer que les dispositifs de formation et de reconversion des salariés sont efficaces pour les développer – exige de fixer un cap. La politique de filière rejoint donc les questions de politique industrielle.
Au sein du Conseil National de l’Industrie (CNI), les comités stratégiques de filière (CSF) réunissent dans un format resserré et spécialisé, les industriels concernés, l’État et les organisations syndicales. Les sujets qui sont abordés, filière par filière, portent sur :
● la stratégie collective de la filière ;
● la solidarité de filière, entre les entreprises, notamment entre grands groupes et PME ;
● le financement à court et long termes, notamment des PME ;
● l’innovation et les caps technologiques ;
● la formation, initiale et continue, et l’emploi ;
● l’export ;
● les enjeux de la transition énergétique ;
● le cadre réglementaire, les enjeux de simplification et de normalisation.
Sur la base de diagnostics collectifs, des engagements réciproques sont formalisés sous la forme de contrats partenariaux de filières. Pour les sujets relatifs à l’emploi, ces contrats doivent être cohérents avec les accords nationaux de GPEC. Le ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social participe ainsi aux travaux des CSF par le biais de la DGEFP. Un groupe de travail transverse à toutes les filières, groupe Emploi/formation, est chargé de partager entre CSF les bonnes pratiques, d’injecter une logique de travail entre les filières et enfin de proposer aux différents CSF des outils spécifiques.
Au niveau régional, 51 Comités stratégiques de filières régionaux (CSFR) ont ainsi été installés avec pour ambition, en lien avec les CSF nationaux, de définir des orientations stratégiques régionales pour leur filière et de les décliner dans des plans d’actions. Les productions des CSFR peuvent se caractériser par des plans d’action de soutien à la filière régionale avec notamment des actions de développement des compétences. Ces actions sont souvent cofinancées par l'État, les Conseils régionaux et les fonds européens.
À titre d’illustration, en Alsace, le CSFR Agroalimentaire a mis en place une table ronde sur l'emploi, les compétences et la formation professionnelle. En Franche-Comté, pour le CSFR automobile, un EDEC est en cours d’élaboration avec l’intervention de l’UIMM. En Midi-Pyrénées, pour le CSFR « Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués », un groupe de travail se charge de faire monter en compétence des salariés ou des demandeurs d’emplois du secteur aéronautique (mutualisation des besoins et des centres de formation des PME, accompagnement des demandeurs d’emploi formés et des jeunes issus de formation initiale industrielle).
De nombreuses actions ont ainsi été entreprises, au niveau national comme au niveau régional. Cette politique manque toutefois de cohérence et de lisibilité.
En premier lieu, l’articulation entre les travaux des CSF et les négociations conduites au niveau des branches ne semble pas suffisante. La pertinence de conserver deux logiques parallèles pour une finalité identique ne semble d’ailleurs pas établie.
En outre, les critères qui ont présidé à la répartition des 800 millions d’euros d’argent public déjà investis dans cette politique ne semblent pas avoir été clairs aux yeux des partenaires sociaux, comme certains responsables l’ont confirmé à la mission : il est difficile de savoir si ces aides visent à soutenir l’emploi, l’investissement ou les entreprises.
Enfin et surtout, les choix qui ont présidé à la sélection de ces filières apparaissent discutables. Censées être des filières d’avenir, certaines connaissent de telles difficultés sur le plan de l’emploi (à l’instar de la filière automobile) que l’attention des acteurs publics devrait plutôt se porter sur la reconversion de leurs salariés alors que pour les filières qui ont réellement un avenir, l’objectif des aides publiques devrait être de soutenir leur montée en gamme. Si ces filières sont en fin de vie, il faut mettre en place un vaste plan de formation et d’adaptation aux mutations. Or, entre 2008 et 2013, près de 10 milliards d’euros ont été distribués sous diverses formes – prêts, primes, avantages fiscaux – sans que cette cohérence d’approche ne soit respectée.
La mission recommande donc de donner de la cohérence et de la lisibilité au pilotage de ces politiques et de mieux évaluer les effets concrets de ces aides publiques. Par ailleurs, il est indispensable que les partenaires sociaux soient mieux consultés sur la distribution des aides, notamment puisqu’ils siègent au sein des comités de filière.
2. Le développement nécessaire des démarches EDEC/GPEC, notamment au niveau territorial et interentreprises
a. Le renforcement des démarches de GPEC et d’anticipation prévisionnelle
L’État peut et doit aider les entreprises désireuses d’intégrer leur stratégie économique dans une vision à long terme. Les crédits consacrés au développement des accords d’EDEC et de GPEC sont ainsi au centre d’une réflexion sur la prévention des plans sociaux puisqu’ils permettent de définir une trajectoire économique et industrielle, trajectoire reprise par les OPCA et relayée par les DIRECCTE, afin d’anticiper les évolutions économiques qui pourraient affecter le niveau d’activité et donc l’emploi dans la branche concernée.
Les crédits GPEC (44,6 millions d’euros en 2013 dont 25 millions d’euros au titre des crédits PLF 2013 et 21,19 millions d’euros obtenus par fongibilité interne au BOP 103) sont ainsi dédiés à la politique d’anticipation des mutations de l’emploi et à l’accompagnement des entreprises (principalement des PME/TPE), et des actifs (principalement les premiers niveaux de qualification et les séniors).
Deux outils principaux sont mobilisés :
– les CEP (Contrats d’Études Prospectives) qui sont des études ayant pour finalité de préciser les scenarii d’évolution d’une filière, d’un secteur ou d’une branche et les implications en termes d’emplois et de ressources humaines ;
– les ADEC (Action de Développement des Emplois et des Compétences) qui ont pour objet de définir des actions concrètes (action en faveur des mobilités professionnelles interbranches, démarche d’aide à la gestion prospective des emplois et des compétences dans les PME, …).
Ces outils sont mobilisés soit en faveur des branches ou secteurs professionnels (accord textile habillement cuir, charte automobile, accord industrie du médicament, CEP raffinage, etc.) soit en interbranche au niveau des territoires (GPEC territoriale, Plateforme en faveur de l’accompagnement des mutations de l’emploi au niveau territorial dans le cadre du pacte de compétitivité).
Ils contribuent ainsi à l’anticipation « à froid » des mutations de l’emploi au niveau des territoires. En facilitant les démarches territoriales d’observation, d’anticipation et les outils concrets dédiés à la mobilité professionnelle, leurs actions contribuent à renforcer les capacités de réaction des territoires face aux mutations économiques et constituent en parallèle des outils de sécurisation pour les salariés et les demandeurs d’emploi (par exemple dans le cadre de passerelles de mobilité).
Les conséquences pratiques de la GPEC, qui a fait l’objet d’un ANI en novembre 2008, suscitent cependant des interrogations.
Bien souvent, la GPEC est en effet vécue par les entreprises et par les salariés comme une procédure obligatoire lorsque des suppressions d’emplois sont envisagées. L’anticipation que devrait permettre cet instrument reste alors théorique. Certaines entreprises, comme Saint-Gobain, ont signé des accords intéressants sur la GPEC, car elles ont déconnecté ce sujet de celui du PSE et ont traité de la stratégie du groupe, de ses conséquences sur l’emploi et la formation à l’échelle du bassin d’activité, et de l’avenir des sous-traitants de la filière. L’information sur la stratégie de l’entreprise est en mesure de redonner de l’utilité à la GPEC.
La mission recommande donc de faire en sorte que les accords de GPEC soient mieux orientés vers les questions stratégiques tenant à l’évolution du secteur et des métiers dans la branche ou dans l’entreprise. Il faut en effet faire de la GPEC un outil concret d’information pour les salariés. C’est grâce à cette pratique que l’on pourra déceler en amont des difficultés éventuelles et préparer des reconversions professionnelles par la mise en place de formations adaptées. À cet égard, l’ANI du 11 janvier 2013 prévoit deux outils intéressants :
– la mise en place d’une base de données unique et mise à jour régulièrement, regroupant et rationalisant exhaustivement les données existantes sans remettre en cause les attributions des représentants du personnel ;
– la présence de salariés dans les conseils d’administration des entreprises de plus de 5 000 salariés, ou dans les entreprises appartenant à des groupes de plus de 10 000 salariés.
Ces éléments positifs pourraient également être amplifiés par un meilleur partage de l’information en amont quant à la pérennité de ces emplois au sein de l’entreprise ou de la branche. En effet, il ne semble pas, à ce jour, que l’État incite suffisamment les signataires à identifier les emplois « menacés » ou les emplois « sous-tension » en fonction de la terminologie en vigueur. C’est pourquoi la mission recommande aux acteurs publics d’inciter systématiquement les entreprises à distinguer clairement, dans les accords de GPEC, les emplois directement menacés, les emplois sous-tension et les emplois confortés.
Une classification différente des emplois est également envisageable, dans une approche plus dynamique : les accords pourraient identifier les emplois en déclin, en transformation et/ou en croissance. Les emplois en déclin ne correspondent plus à une technologie ou à des produits générant une forte demande et donc une forte activité. Ils doivent être transformés quand cela reste possible, ce qui effectivement suppose une adaptation de la main d’œuvre aux nouvelles technologies et aux nouveaux produits. Une dernière catégorie pourrait être constituée d’emplois appelés à connaître un fort développement dans le cadre d’activités elles-mêmes en croissance. Ce sont ces emplois qui pourraient être à privilégier dans le cadre d’une revitalisation.
b. Le développement nécessaire des mécanismes de gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC)
La GPEC n’a de sens que si elle s’applique à un ensemble d’entreprises dans un territoire donné (ce que l’on désigne comme une GPEC territoriale). Les exemples des entreprises du bois dans les Vosges, de la plasturgie à Oyonnax ou de l’automobile à Belfort, montrent que ces exemples de GPEC interentreprise fonctionnent avec efficacité. La mobilité, la complémentarité des emplois, les besoins en formation ne peuvent en effet être correctement et précisément anticipés et connus que dans le cadre d’un travail commun entre des entreprises proches géographiquement.
Parmi les 285 projets recensés en 2012, on peut identifier trois types d’actions :
– une mise en réseau et partenariat autour des problématiques d’observation et d’étude, parfois prospective, des évolutions de l’emploi sur le territoire, d’un point de vue global ou sur quelques secteurs et/ou thématiques clés (saisonniers par exemple) ;
– des actions de professionnalisation RH et GPEC d’entreprises du territoire, le plus souvent des TPE/PME ;
– des actions pour mieux gérer et favoriser les mobilités des actifs sur le territoire, entre entreprises notamment, en développant des plateformes RH.
À cet égard, la mission recommande de développer les approches de GTEC en permettant aux DIRECCTE de mobiliser prioritairement les fonds de la GPEC pour organiser de tels dispositifs interentreprises sur les territoires.
c. Le renforcement de la gouvernance des acteurs publics
Au niveau territorial comme au niveau national, ces démarches souffrent néanmoins d’un éparpillement et d’un manque de coordination préjudiciables à l’efficacité et à la portée de leurs actions. La mission a ainsi recueilli plusieurs témoignages faisant état de la quasi-inexistence d’échange d’informations entre les Régions et les DIRECCTE. De la même manière, bien qu’au cœur de la problématique de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle, les CCREFP (5) sont très rarement impliqués, en tant que tels, dans la mise en œuvre des démarches de GTEC, notamment parce que ces démarches ont des périmètres infra régionaux qui ne correspondent pas aux compétences des CCREFP.
Certaines régions ont mis en place des cadres opérationnels formalisés en matière d’anticipation territoriale des mutations économiques, afin de mieux articuler leur intervention. Elles se montrent d’ailleurs favorables à l’émergence de dispositifs régionaux de prospective et d’intelligence collective. Le Nord-Pas-de-Calais tente ainsi de construire une cartographie des emplois et compétences cibles sur le territoire et une cartographie des salariés en poste dans les entreprises. Une autre approche a été mise en place en Picardie sous la forme d'une mission expérimentale d’identification des compétences collectives. Elle est testée sur deux bassins d'emploi spécialisés dans l'aéronautique : Albert et Péronne (dans la Somme). L’objectif est d’essayer de mettre en place une forme de CV du territoire régional concerné de manière à en faire un outil de promotion et de valorisation économique.
Ces démarches isolées gagneraient certainement en efficacité si l’on se donnait les moyens de réfléchir à une meilleure coordination entre les initiatives régionales et les actions menées parallèlement par l’État (DIRECCTE ou observatoires régionaux de l’emploi et de la formation – OREF), ou par ses opérateurs (Pôle emploi). Trop d’acteurs produisent de façon non coordonnée des études, des synthèses ou des recommandations dont l’objectif est souvent le même.
À cet égard, les rapporteurs estiment nécessaires d’étendre, de renforcer et d’harmoniser les compétences des CCREFP afin de les transformer en organismes référents en matière d’analyse de l’information relative aux besoins des territoires en matière d’emploi, et de mise en œuvre des actions relatives à la formation professionnelle. Ces organismes pourraient notamment être chargés de produire un document commun visant d’une part à identifier les compétences sur un bassin d’emploi et d’autre part à analyser les mutations économiques à venir sur ce même bassin d’emploi : ce « diagnostic territorial » servirait ainsi de référence en la matière.
3. Les plateformes de mutations économiques : un premier pas vers la coordination
Les 13 plateformes d’appui aux mutations économiques constituent l’une des 35 mesures du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, présenté par le gouvernement le 6 novembre 2012. Elles visent à aider les entreprises à renforcer leur compétitivité – prioritairement les TPE/PME – et les salariés à adapter leurs compétences ou à préparer leur reconversion professionnelle face aux mutations économiques. Dans ce but, elles mettent à disposition des personnes et des entreprises concernées :
– des moyens d’information et d’accompagnement ;
– la possibilité d’effectuer des bilans de compétences ou de valider leurs acquis ;
– des offres de formation ou de reclassement ;
– une mutualisation des ressources humaines, d’appui RH et de gestion des âges et compétences au bénéfice des entreprises locales.
Ces compétences sont rendues possibles par une coordination accrue des différents acteurs concernés (services de l’État, organismes de formation, organisations professionnelles ou syndicales, entreprises, collectivités locales, OPCA, Pôle emploi…), dont la mobilisation intervient en fonction des enjeux locaux spécifiques qui font l’objet d’un diagnostic commun. Les plateformes agissent ainsi au plus près du territoire et de ses besoins. À Saint-Nazaire, par exemple, la plateforme sera chargée d'accompagner les mutations sectorielles des secteurs de la construction navale, de l’aéronautique et des énergies marines renouvelables.
Si les plateformes d’appui n’ont donc pas pour vocation première d’intervenir dans le champ des PSE, elles peuvent néanmoins, grâce à des actions suffisamment anticipatrices de sécurisation des mobilités externes de salariés, éviter la mise en œuvre de tels plans.
Afin de mutualiser l’offre de services des 13 plateformes d’appui, la contractualisation du partenariat s’inscrit dans un accord-cadre et une convention financière dédiés. Sous pilotage global assuré par une instance associant a minima les services de l’État et les partenaires sociaux, un (ou plusieurs) organisme relais est chargé de la mise en œuvre de l’offre de services de chaque plateforme. Le dispositif est doté d’un budget total de 14 millions d’euros, dont 4 millions apportés par l’État au titre du Pacte de compétitivité. Les 10 millions d'euros restants proviennent essentiellement de sources de financement privées (branches professionnelles, Opca, entreprises, conventions de revitalisation…), publiques (collectivités locales dont les régions…) et parapubliques (consulaires) et du Fonds social européen (FSE).
Cette initiative visant à regrouper et à coordonner les acteurs, bien que trop récente pour qu’on puisse procéder à une véritable évaluation de son efficacité, paraît aller dans le bon sens pour pallier les difficultés identifiées par la mission, et souvent évoquées lors des auditions, en termes de cohérence de l’action menée tant sur la formation professionnelle que sur l’aide à la reconversion.
Si l’anticipation en amont, grâce à des politiques industrielles et de formation cohérentes et articulées, est nécessaire, il est également indispensable que la puissance publique développe des outils d’alerte et d’accompagnement des entreprises en difficulté, non pour tenter de sauvegarder ce qui ne peut pas l’être, mais pour éviter que ne soit détruit ce qui peut être sauvé.
1. La phase de détection des difficultés : des outils efficaces mais pouvant être améliorée
a. Les deux principaux problèmes identifiés par la mission : la détection des difficultés et la réticence des entreprises
De nombreux interlocuteurs de la mission ont alerté les rapporteurs sur le fait que de plus en plus souvent les procédures collectives étaient lancées sans qu’il y ait eu de signaux avant-coureurs, ce qui témoigne à la fois d’une difficulté à détecter ces signaux, d’une part, et à convaincre les chefs d’entreprise de faire part de leurs difficultés avant que celles-ci ne deviennent irrémédiables, d’autre part.
Les signes avant-coureurs des difficultés des entreprises sont pourtant nombreux : utilisation du chômage partiel, saisine du commissaire au redressement productif, des comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou des cellules de médiations, baisse de déclaration de TVA, retards de règlements de cotisations sont autant d’exemples qui peuvent alerter les pouvoirs publics sur les difficultés d’une entreprise.
Si la coopération fonctionne bien entre ces services, mettre en place un fichier unique relatif aux entreprises en difficulté pourrait certainement permettre une meilleure capacité de détection et de suivi des entreprises.
D’autre part, la réticence des chefs d’entreprise à faire part de leurs difficultés suffisamment en amont pour que les mécanismes de prévention se révèlent efficaces est fréquente. Les chefs d’entreprise craignent que leurs partenaires ne se méfient d’eux. Il en a été ainsi pour le groupe Doux, dont la gravité de la situation n’avait pas été anticipée de manière satisfaisante. Le système comporte donc des failles, notamment lorsque le chef d’entreprise ne joue pas le jeu d’une relation constructive avec les pouvoirs publics.
Afin de renforcer la confiance que les entrepreneurs peuvent avoir envers les partenaires publics, il pourrait être pertinent, aux yeux des rapporteurs, de supprimer la règle d’exclusion des marchés publics pour les entreprises engagées dans une procédure de sauvegarde, pour laisser place à un examen au cas par cas. Le risque pour les finances publiques serait ainsi vraisemblablement limité tout en permettant aux entreprises en difficulté d’accéder à des marchés publics, et donc de relancer leur activité et l’emploi.
b. Les outils de détection et de résolution des difficultés des entreprises en région et au niveau central : une fluidification nécessaire
Les mécanismes d’alerte en région sont structurés autour des CCSF (Commission départementale des Chefs de Services financiers et des représentants des Organismes de Sécurité Sociale) et des CODEFI (Comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises).
Les CODEFI représentent le niveau déconcentré du dispositif de prévention et de traitement des difficultés piloté par la Direction Générale du Trésor (en pratique par le secrétariat général du comité interministériel sur les restructurations industrielles – CIRI). Ils traitent des difficultés des entreprises de moins de 400 salariés (les entreprises de taille supérieure relevant directement de la compétence du CIRI). Leur mode d’intervention consiste à réaliser le diagnostic de la situation de l’entreprise grâce au financement d’audit, puis à élaborer un plan de redressement.
Les CODEFI peuvent saisir la commission des chefs de services financiers (CCSF) du département, seule compétente pour accorder des reports d'échéances de paiement des charges fiscales et sociales. Celle-ci est présidée par la DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques) et a compétence pour examiner les demandes de délais de paiement des passifs fiscaux (impôts et taxes diverses) et sociaux (cotisations de sécurité sociale, cotisations d’assurance chômage) sollicités par les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie conjoncturelle. La CCSF examine les demandes de moratoire des entreprises et établit des plans de règlement des dettes fiscales, sociales, et d'assurance chômage. Elle peut accorder des délais de paiement étalés sur une durée de 24 mois, pouvant au cas par cas être portés à 36 mois.
La mission constate que la CCSF est donc le seul organe à posséder un réel pouvoir en matière de report d’échéances. Or, au sein de cette structure, aucun représentant des services chargés du soutien à l’activité économique n’est présent (ni le DIRECCTE, ni des représentants de la préfecture). Il pourrait ainsi être envisagé de confier aux CODEFI la capacité de décider d’un report ou, au moins, de prévoir qu’un membre du CODEFI siège au sein de la CCSF (le DIRECCTE étant le plus qualifié à ce titre). Cela permettrait de remédier à une vision qui peut s’avérer unidimensionnelle du traitement des difficultés des entreprises et de mieux accorder les compétences et la mission dévolues aux services économiques. Les membres qui composent actuellement la CCSF n’ont en effet aucune compétence particulière quant au fonctionnement des entreprises, bien que leur secrétariat et celui des CODEFI soit commun. L’équilibre entre préservation des finances publiques et maintien de l’emploi et de l’activité économique serait ainsi mieux assuré.
Au niveau central, la DGCIS dispose également d’un outil d’audits et de diagnostics dénommé « audit CESAAR ». Il s’adresse aux PME afin d’établir une analyse de situation technique, financière et organisationnelle de l’entreprise et d’accompagner le chef d’entreprise dans la formulation de propositions d’ordre stratégique. Les interventions peuvent donner lieu à des diagnostics compris entre 3 et 11 jours en fonction de la taille de l’entreprise et des problématiques posées.
En pratique, les audits CIRI–CODEFI interviennent en phase de difficultés financières avérées de l’entreprise alors que celles de la DGCIS – DIRECCTE se positionnent plus en amont.
Le principal frein aux recours aux audits CODEFI semble être lié à la longueur de la procédure d’appel d’offres ce qui n’est pas le cas des audits DGCIS qui fonctionne grâce à un consortium d’intervenants. Il pourrait ainsi être utile de transposer ce système de consortium au niveau local.
Enfin, plusieurs régions ont également mis en place des outils de détection des difficultés. La région Alsace a par exemple mis en place une cellule de veille et d’alerte co-présidée officiellement par le préfet de région et le président de la région, ce qui permet de réunir l’ensemble des acteurs pouvant identifier les signes avant-coureurs témoignant de difficultés à venir. Cet outil de détection « à tiède » permet d’inciter ces entreprises à un contact précoce à la fois avec les services de l’État et des collectivités territoriales. Ce type de coordination semble profitable et devrait être généralisé pour fluidifier les relations entre les acteurs publics.
c. L’amélioration des dispositions de la loi de sauvegarde
La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, modifiée par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, a ouvert la possibilité aux créanciers publics, au travers de remises d’une partie de ses dettes à une entreprise, de consentir des efforts supplémentaires pour aider une entreprise en difficulté, dans le cadre d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Selon le droit européen, afin de n’être pas qualifiées d’aides d’État, ces remises ne peuvent être accordées que « dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation ».
Cette faculté n’est que très rarement mobilisée. M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif de la région Haute-Normandie, a ainsi fait part aux membres de la mission du fait qu’en 2011, sur 1 178 ouvertures de procédures collectives par les tribunaux de commerce, 44 seulement ont donné lieu à une saisine du comité des créanciers publics (c'est-à-dire la CCSF). En 2012, 69 remises seulement pour l’ensemble du territoire national ont été accordées, soit moins d’une remise pour 1 000 dossiers, pour un total de 20,8 millions d’euros. Cette procédure n’est donc tout simplement pas appliquée.
Pour la rendre effective, plusieurs améliorations pourraient être apportées. En premier lieu, la mission rejoint la proposition de M. Cauvet selon laquelle il conviendrait de porter de deux à six mois le délai pour saisir la CCSF après le début de la procédure. Ce délai apparaît en effet trop court pour constituer un dossier, ce qui dissuade certaines entreprises d’y recourir.
L’impact et le risque pour les finances publiques devraient être limités, de telles mesures visent à éviter les liquidations judiciaires, lesquelles conduisent le plus souvent à ce que les acteurs publics ne récupèrent rien, ou quasiment rien, de leurs créances.
2. Le rôle des commissaires au redressement productif : un complément utile au CIRI et aux outils régionaux, dont la portée pourrait être augmentée
L’année 2012 a vu l’émergence d’un nouvel acteur : le commissaire au redressement productif (CRP). Les 22 commissaires (un par région) jouent une fonction d’alerte, de détection des difficultés des entreprises, mais ils exercent aussi un rôle de facilitateur – rôle appelé à se développer –, pour informer les entreprises de la possibilité de recourir à l’activité partielle ou à des aides spécifiques de la part de l’État ou des collectivités par exemple.
La mission a noté une extrême hétérogénéité des profils (ingénieurs des mines, sous-préfets, professionnels des entreprises), du positionnement administratif (auprès du préfet ou auprès du Direccte, ou encore cumulant les fonctions de Direccte et de CRP) et, parfois, des approches entre les commissaires au redressement productif qu’elle a pu rencontrer.
Si cette diversité peut être source de richesse, les rapporteurs recommandent néanmoins d’adopter un positionnement administratif unique auprès du Pôle 3E des DIRECCTE, sous l’autorité du préfet de Région. Par ailleurs, la mission recommande de développer une formation harmonisée pour l’ensemble des commissaires au redressement productif. Il faudrait par exemple que chaque commissaire au redressement productif puisse bénéficier d’une formation approfondie en matière de restructuration du crédit, ce qui ne semble pas encore être le cas.
Au-delà de ces observations, les CRP apparaissent comme un acteur public capable de faciliter l’identification et l’accompagnement des entreprises en difficulté, ainsi que de coordonner l’action de l’ensemble des acteurs publics en matière de détection des difficultés.
Assurée par la DGCIS, la compilation des tableaux de bord des commissaires au redressement productif, des dossiers portés par le cabinet du Ministre du Redressement productif et par le CIRI recense 2 200 entreprises ou sites en situation fragile ou en difficulté. Selon le ministère du Redressement productif, jusqu’au mois de mai 2013, 624 dossiers ont été traités avec succès, ce qui représente près de 76 907 emplois préservés sur un total de 90 881 emplois concernés. Ces chiffres mettent en évidence l’ampleur du travail engagé et le positionnement de l’action des CRP sur des cas de nature très hétérogène. Parmi les succès connus, le site General Motors à Strasbourg (équipementier automobile, 989 emplois), le site ACC (ferroviaire, 350 emplois) en Auvergne, l’entreprise Sealynx (équipementier automobile, 520 emplois) en Normandie, ou la société Thomson Broadcast (électronique de défense, 83 emplois) en Île-de-France sont autant de réussites qui ont permis de sauvegarder des emplois et d’éviter des PSE.
Les CRP sont chargés d’animer une cellule régionale de veille regroupant les services de l’État en charge de ces sujets mais également la Banque de France, la Caisse des dépôts, les médiations, OSÉO et le cas échéant la Région. Ces cellules se réunissent une à deux fois par mois. Les tableaux de bord qu’elles réalisent mettent en évidence une meilleure détection des entreprises menacées, opérée plus tôt grâce à la mise en commun des informations des différents membres de la cellule. Ce travail de coordination pourrait cependant être renforcé si les CRP, sous l’autorité du préfet, étaient désignés comme les interlocuteurs chef de file pour recueillir et analyser l’information relative aux difficultés des entreprises.
En effet, le dirigeant d’entreprise qui reçoit successivement des agents de la Chambre de commerce et d’industrie, d’OSÉO, de l’Agence régionale de développement et de la DIRECCTE finit par ressentir une certaine lassitude à devoir répétitivement faire part de ses attentes et de ses difficultés, si bien que le dialogue perd en efficacité et en qualité, sans compter les craintes que cette multitude d’acteurs peut entraîner sur le plan de la confidentialité des informations transmises même si tous les intervenants sont évidemment tenus à une discrétion dans l’exercice de leurs fonctions.
En instaurant le CRP comme autorité de référence pour les chefs d’entreprise en difficulté, celui-ci devient la figure identifiable et unique à laquelle les entreprises peuvent faire appel.
Afin de renforcer la capacité des CRP à assurer efficacement leur mission, trois pistes de réforme pourraient ainsi être envisagées :
– faire du CRP l’acteur chef de file, parmi les multiples acteurs publics, chargé d’organiser et d’harmoniser l’ensemble des acteurs publics chargés de la prévention et du traitement des difficultés (un questionnaire unique pourrait ainsi être élaboré pour simplifier les demandes d’aides des entreprises),
– doter les CRP d’une équipe pouvant travailler sous forme de « cellule » et disposant d’un référent dans chaque département (qui pourrait être un fonctionnaire de la DIRECCTE) afin de faciliter la remontée d’informations,
– doter les CRP de la capacité à être nommés contrôleurs dans le cadre des procédures collectives, au même titre que les créanciers, et leur permettre de participer activement aux moyens de prospection en vue de faciliter la recherche d’éventuelles solutions de reprise des entreprises en difficulté.
3. Les outils d’accompagnement : des cellules de médiation au CIRI
En dehors des systèmes de veille et d’alerte, dont l’articulation autour du CRP est une recommandation forte de la mission, les acteurs publics doivent également organiser des mécanismes efficaces de prévention des difficultés.
Il existe ainsi, au niveau national, deux cellules de médiation, une pour le crédit aux entreprises et une pour les relations interentreprises, dirigées chacune par un médiateur. Leur existence permet d’introduire un acteur extérieur et indépendant dans le processus de négociation entre une entreprise et ses créanciers.
La médiation du crédit constitue, pour sa part, un instrument de masse, avec 300 saisines par mois qui, pour 90 % des cas, concernent de très petites entreprises (TPE) connaissant un différend avec leur banque sur leur ligne de crédit. C’est pourquoi la médiation du crédit, qui a besoin d’un réseau réactif, s’appuie sur celui de la Banque de France.
Pour les entreprises de plus de 400 salariés, le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) constitue un outil utile et reconnu. À la différence des CODEFI qui ont également une mission de détection, le CIRI ne s’autosaisit jamais. À la demande du chef d’entreprise, il va examiner ses difficultés et, le cas échéant, ce qui a déjà été fait pour tenter de les résoudre.
La procédure est toujours amiable. Le CIRI n’intervient donc pas en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Son objectif est d’aboutir à un accord contractuel, ce qui exige l’unanimité des parties prenantes.
Son mode d’intervention consiste à réaliser le diagnostic de la situation de l’entreprise grâce au financement d’audit, puis à élaborer un plan de redressement. Le protocole d’accord, qui sera élaboré dans ce cadre pourra, le cas échéant, être constaté ou homologué par un tribunal de commerce.
En 2012, le CIRI a traité 56 entreprises en difficulté, dont 29 nouveaux dossiers, représentant au total un peu plus de 78 000 emplois. La moitié d’entre elles a connu une issue positive, préservant environ 31 000 emplois. Le CIRI a par contre connu une importante croissance de son activité sur les 7 premiers mois de 2013 (janvier-juillet) avec 30 nouvelles saisines, portant le nombre de dossiers en cours de traitement à 58. En termes de dossiers entrants, le CIRI a donc connu en un semestre une activité comparable à celle de 2012 (12 mois). Dans ce contexte, le CIRI a renforcé ses ressources en recrutant un rapporteur supplémentaire à la fin du 1er semestre 2013. Dans le même temps, l’efficacité du CIRI s’est statistiquement améliorée puisqu’il a participé à 29 issues positives sur les 7 premiers mois de l’année 2013, à comparer aux 27 issues positives sur l’ensemble de l’année 2012. Cette comparaison est toutefois à prendre avec précaution, les problématiques et la difficulté de leur résolution étant variables. Depuis cet été, on constate une décroissance du nombre de nouveaux dossiers entrants. Par conséquent, aucun dossier suivi par le CIRI n’a fait l’objet d’une procédure collective par défaut de traitement ou par incapacité à le traiter selon les procédures habituelles.
Néanmoins, les Rapporteurs souhaitent que le Gouvernement veille à ce que le CIRI continue de disposer d'effectifs adaptés à l'évolution de la conjoncture économique. En effet, il convient de rappeler qu’au moment de sa création en 1982, le CIRI pouvait compter sur une équipe de près de 30 rapporteurs, descendue jusqu’à 3 rapporteurs en 2004, et depuis remontée à 7 rapporteurs aujourd’hui (8 en incluant le chef d’équipe).
Les procédures amiables sont organisées par les tribunaux de commerce. Ainsi, dès l’apparition de ces difficultés ou lorsque d’autres solutions telles que la médiation du Crédit (pour les difficultés bancaires), n’ont pu aboutir, les dirigeants peuvent solliciter un entretien avec le Président du Tribunal de Commerce ou présenter directement une demande de mandat ad hoc ou de conciliation, que l’on qualifie de « procédures de règlement amiable des difficultés des entreprises ». Elles permettent au dirigeant d’entreprise de négocier ses dettes sous l’égide soit d’un mandataire ad hoc, soit d’un conciliateur, désigné par le président du tribunal de commerce. Lors de la désignation du mandataire, le coût de son intervention est déterminé en accord avec le chef d’entreprise.
L’ensemble de ces dispositifs semble faire la preuve de leur efficacité dans la prévention et l’accompagnement des entreprises en difficulté. Ils pourraient cependant être renforcés par le développement d’outils complémentaires.
1. L’incitation à la recherche d’un repreneur en cas de fermeture de sites
L’ANI du 11 janvier 2013, puis l’article 14 de la loi sur la sécurisation de l’emploi, ont renforcé les incitations des entreprises à rechercher un repreneur en cas de fermeture de site.
Les dispositions de l’article 14 de l’ANI ne prévoient pas de sanctions en tant que telles mais rendaient possible la valorisation dans la convention de revitalisation des actions de recherche menées par l’employeur : plus elles sont poussées, moins la contribution requise de l’entreprise au titre de la revitalisation sera importante.
La proposition de loi « visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel », en cours de discussion, va plus loin. Le mécanisme envisage une procédure en deux étapes : une étape préventive et une étape punitive. Le dirigeant d’une entreprise de plus de 1 000 salariés devra informer les salariés de la fermeture d’un site, par la voie du comité d’entreprise. Il disposera d’une période de trois mois pour rechercher un repreneur. Au terme de cette étape et s’il considère que l’employeur n’a pas « joué le jeu », le comité d’entreprise pourra prendre l’initiative de lancer une procédure devant le tribunal de commerce, dont le rôle sera de vérifier que l’effort de recherche de repreneur a bel et bien été fourni. Il aura également la charge de déterminer si l’employeur a refusé des offres de reprise crédibles. Si le tribunal juge en ce sens, alors l’entreprise devra verser une forte pénalité, d’un montant maximum de vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.
Au-delà du bien-fondé de cette proposition, sur lequel les Rapporteurs ne partagent pas la même appréciation, la mission ne pouvait que s’interroger sur les problèmes de cohérence de cette mesure avec les propositions qu’elle formule. En premier lieu, que se passerait-t-il si une entreprise qui envisage de fermer un site ne trouve pas de repreneur lui proposant de reprendre l’intégralité des salariés ? Ainsi, si la meilleure offre est une offre de reprise de seulement 50 % des salariés par exemple, et que par ailleurs cette offre n’est pas acceptée par l’employeur, devra-t-il payer une pénalité de 20 SMIC sur la totalité des emplois supprimés ou seulement sur ceux qui auraient dû l’être même en cas de reprise ?
Il conviendrait donc de préciser la notion d’offre de reprise sérieuse au regard de son impact sur l’emploi.
Par ailleurs, cette obligation de rechercher un repreneur ne s’applique qu’aux entreprises soumises à l’obligation de revitalisation, soit les entreprises in bonis de plus de 1 000 salariés. Dans le cadre des recommandations déjà formulées par la mission, ce seuil pourrait être descendu à 250 salariés.
Enfin, l’affectation de la pénalité ne semble pas être tranchée pour le moment et c’est uniquement à ce titre que la mission aborde certains points qui seraient la conséquence de l’adoption de cette proposition de loi.
L’affectation de la pénalité
La mission remarque ainsi une synergie potentielle entre les ressources tirées des pénalités payées par les entreprises au titre du non-respect de la recherche de repreneurs et la volonté de la mission de renforcer l’action des fonds mutualisés de revitalisation sur les territoires. En effet, ces ressources pourraient tout à fait être redéployées au profit de ces fonds de mutualisation, fonctionnant sur un principe de gestion privée, alors que leur affectation au sein du budget de l’État n’est pas possible en vertu du principe de non-affectation des recettes.
En affectant le produit des amendes aux fonds mutualisés de revitalisation créés dans chaque département, le législateur renforcerait le lien entre la pénalité issue de la fragilisation des salariés et d’un territoire et son redéploiement au profit de ce même territoire. La sanction ne viserait donc pas à enrichir l’État mais bien à développer les ressources mises à disposition d’initiatives locales pour l’emploi et le soutien à l’activité économique.
2. Le recours à des prises de participation publiques temporaires
a. Développer les possibilités pour les acteurs publics de s’engager dans le capital d’une entreprise
Les acteurs publics, que ce soit l’État ou les collectivités territoriales, s’engagent parfois, sous des formes différentes, dans le capital d’entreprises dans l’objectif de pérenniser leur existence pendant une période difficile ou bien de favoriser la recherche d’un repreneur. À titre d’exemple, les Régions interviennent parfois à travers des prises de participation sous réserve d'autorisation du Conseil d’État (comme l’avait fait la région Poitou-Charentes en 2009 avec la branche véhicule électrique d’Heuliez). Autre exemple, le département de l’Eure a racheté, fin janvier 2013, le site fermé par M-REAL pour le céder aussitôt au papetier thaïlandais Double A. Une grande partie du site représentant une quarantaine d’hectares en bord de Seine est cédée à l’Établissement public foncier de Normandie qui devra l’aménager pour y accueillir de nouvelles activités. Dans le cas d’espèce, le conseil général a joué le rôle de tiers de confiance en assurant le portage de la cession finale. Cette opération a été conduite dans des conditions neutres au plan financier ; le prix de cession est identique au prix payé au finlandais M-REAL.
Toutefois, ces interventions restent ponctuelles et limitées, à tel point que certains ont pu les qualifier d’« arbitraires ». De nombreux interlocuteurs de la mission ont noté le caractère fluctuant et le besoin de cohérence des acteurs publics dans ce domaine.
Ainsi, pour pouvoir juridiquement agir, le Conseil général de l’Eure a eu recours à la clause de compétence générale prévue par le Code général des collectivités territoriales (articles L. 1111-2, L. 2121-29, L. 3211-1 CGCT et L. 4221-1) qui autorise l’intervention au-delà des compétences dévolues expressément par la loi, dans les domaines où elles peuvent justifier l’existence d’un « intérêt public local ».
Dans les autres cas, les interventions des collectivités territoriales relèvent de prise de participation au capital d’une entreprise privée prévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1-6° du code général des collectivités territoriales, qui prévoient des dispositions identiques pour les communes, les départements et les régions. Dans ce cadre, les prises de participation doivent être autorisées par décret pris en Conseil d’État et sont donc beaucoup plus longues à mettre en place : l’autorisation donnée à la Région Poitou-Charentes de participer au capital de Heuliez Véhicule Électrique a nécessité un délai de 7 mois : la collectivité doit adresser au préfet une délibération sollicitant une autorisation délivrée par décret en Conseil d'État. Le préfet transmet cette demande au ministère de l'Intérieur (DGCL), qui procède à l'instruction juridique du dossier conjointement avec le ministère de l'Économie, des finances et de l’industrie puis le transmet au Conseil d'État.
Le Conseil d’État, lorsqu’il autorise ce type de participation, plafonne l'engagement des collectivités à 33 % du capital. En effet, la détention du tiers du capital d’une société commerciale (SARL, SA) suffisant à obtenir une « minorité de blocage » à l’Assemblée générale et confère un poids suffisant à la puissance publique pour éviter des licenciements ou des évolutions défavorables à la pérennisation de l’activité.
Les discussions en cours portant sur le projet de loi « de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l’égalité des territoires », qui sera examinée à l’automne 2013, visent à clarifier la doctrine d’intervention des collectivités en les fédérant autour de la région. Dans ce texte, la région est affirmée comme l’échelon principal de soutien aux entreprises. Les autres collectivités peuvent intervenir auprès des entreprises dans le cadre d’une convention avec la région, en accord avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation adopté en liaison avec le Préfet de région. Plus encore, la Région disposera dorénavant d’une compétence de plein droit pour accorder des aides à des entreprises en difficulté, dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence. Les autres collectivités territoriales ne pourront intervenir que dans le cadre d'une convention passée avec la région ou la métropole. Enfin, le texte prévoit le transfert ou la délégation aux régions de l’autorité de gestion des fonds européens, notamment du FSE (Fonds social européen).
Si cette évolution est appréciable, l’ensemble de ces règles ne permet pas de faire face de manière suffisamment efficace aux restructurations d’entreprises dont le modèle économique n’est pas devenu obsolète ou l’offre irrémédiablement décalée par rapport aux besoins du marché.
b. La prise de participation temporaire
La prise de participation temporaire de l’État peut alors s’avérer efficace. Elle vise plus spécifiquement les cas de fermetures de site ou d’arrêts d’activité consécutifs à une réorientation stratégique de l’actionnaire, soit pour résorber des surcapacités soit par abandon de l’activité. Elle peut permettre de protéger et de sauvegarder, pendant une période de destruction de valeur industrielle, des savoir-faire stratégiques et un patrimoine industriel important qui, s’il devait fermer ou être acquis par un acteur étranger, pourrait conduire à déplacer définitivement hors de France une production industrielle.
Une telle intervention paraît efficace et justifiée lorsqu’il existe un projet crédible et réalisable, sous quelques mois, de reprise de l’activité ou de reconversion du site sur d’autres spécialités. Les États-Unis ont ainsi nationalisé General Motors pour sauver le principal constructeur automobile de la faillite : l’entreprise, privatisée, a aujourd’hui renoué avec la croissance.
La prise de participation vise donc avant tout à donner le temps nécessaire à la construction d’un scenario alternatif à la fermeture. Sur ce plan, l’ANI a prévu des avancées notables puisque les entreprises soumises à l’obligation de revitalisation devront désormais rechercher un repreneur et expliciter ces démarches auprès du comité d’entreprise. Mais cette phase de prospection reste cantonnée au délai de mise en œuvre du PSE qui dure, selon le nombre de licenciements, de deux à quatre mois. Dans les cas où il apparaît illusoire de trouver un projet alternatif dans ce délai, notamment lorsque le sujet implique une recherche mondiale, la prise de participation apparaît un moyen possible de maintenir en condition opérationnelle le site et de donner des chances supplémentaires à sa cession.
c. La possibilité de recourir plus largement aux prises de participation : que dit le droit européen ?
Le droit de l’UE n’interdit pas a priori les prises de participation ou le contrôle d’entreprises privées par l’État. Il traite ce sujet au travers du droit des aides d’État. Ainsi, il n’y a pas d’aide d’État lorsque la puissance publique agit en tant qu’investisseur avisé en économie de marché, c’est-à-dire qu’il se comporte comme l’aurait fait un acteur privé souhaitant investir ou prendre des parts dans une entreprise.
La Commission applique néanmoins des critères restrictifs à cette intervention publique. La communication de la Commission sur les participations des autorités publiques dans les capitaux des entreprises de 1984 prévoit que seules les prises de participation par acquisition partielle ou totale des avoirs sociaux dans une entreprise, sans apport de capital nouveau, sont analysées comme n’étant pas des aides d’État. La communication entend par avoirs sociaux les parts sociales, actions et droits de vote. En outre, la Commission procède par analyse d’un faisceau d’indices pour déterminer s’il s'agit bien d’un comportement d’investisseur avisé. Elle examine notamment si c’est la participation de l’État qui a permis la participation d’autres investisseurs privés (dans ce cas, elle considère être en présence d’une aide d'État) ou si les investisseurs privés étaient présents avant même la décision de participation de l'État.
Une prise de contrôle par les acteurs publics dans une entreprise mettant en œuvre un PSE devrait donc se faire dans des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur privé animé par la recherche de la rentabilité de son investissement. Les considérations sociales ne peuvent pas être prises en compte pour justifier le choix de l’investissement. En outre, les aides directes de l’État font l’objet d’un contrôle interne préalable vérifiant leur compatibilité avec les limites des « équivalents subvention bruts » autorisés selon les régimes cadres. Enfin, il convient de noter que les interventions publiques ne sont valides que dans le cas où elles ne s’adressent pas à des entreprises dont les difficultés sont avérées, ce qui exclut celles en procédures collectives (même amiables).
L’ensemble de ces critères limite sérieusement les possibilités pour la puissance publique d’intervenir en accompagnement d’entreprises en difficulté. Il ne rend pourtant pas cette intervention impossible : des outils publics existent déjà, bien que leur portée soit limitée.
3. Développer une compétence publique spécifique en matière de retournement d’entreprises en difficulté
a. Des outils existants presque malgré eux…
La question du « retournement » (intervention auprès d’une entreprise qui rencontre des difficultés passagères) n’est pas aisée à appréhender et à mettre en œuvre pour le secteur public.
La Banque publique d’investissement (BPI) semble ainsi réservée sur cette possibilité : son directeur Nicolas Dufourcq (6) a déclaré devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale que la BPI ne ferait pas de retournement en direct, sauf cas exceptionnels. Le projet de doctrine de la BPI précise en effet que « bpifrance peut intervenir exceptionnellement sur le segment du capital retournement qui vise au redressement des entreprises en difficulté, en particulier pour les PME et les plus petites des ETI, en s’entourant de précautions particulières ».
Si l’État pouvait prendre temporairement la majorité du capital d’une entreprise dans cette situation, pour refaire un tour de table et préserver l’entreprise d’un effondrement rapide, une telle intervention serait de nature à sauvegarder l’emploi et les savoir-faire et à rassurer les investisseurs. La doctrine de BPI France ne va donc, sans doute, pas assez loin sur ce point.
Il existe déjà un premier outil, mais il n’est que partiel : le Fonds de consolidation des entreprises (FCDE). Ce FCDE est majoritairement contrôlé par des acteurs privés : il est en effet doté de 190 millions d’euros (détenus à 47 % par BPI France et à 53 % par un consortium BNP Paribas, Société générale, AXA, crédit mutuel, CIC, CM capital). Il intervient sur des tickets de 1 à 15 millions d’euros et a procédé à 14 opérations à ce jour, dont 3 ont fait faillite seulement. La nature privée du Fonds permet de ne pas se heurter aux règles européennes en matière de soutien aux entreprises ; néanmoins, cela entraine plusieurs limites concrètes.
En premier lieu, les actionnaires attendent du FCDE qu’il soit également un fonds d’investissement rentable. Par conséquent, il sera amené à faire « du rebond » (après le règlement judiciaire et au moment d’une éventuelle reprise) plutôt que du « retournement » (intervenir en amont de la catastrophe).
En outre, le FCDE investit dans des PME indépendantes non cotées dont le chiffre d’affaires est compris entre 20 et 200 millions d’euros et dont la situation financière fait ressortir au moins un exercice bénéficiaire parmi les trois derniers. Ces critères d’intervention limitent sérieusement sa capacité d’intervention. Par comparaison, dans la filière automobile, le FMEA, alimenté par les constructeurs et qui a le même objet dans un contexte de restructuration de la filière, dispose d’un fonds de 650 millions d’euros et de tickets d’intervention jusqu’à 5 millions d’euros, et n’est pas soumis à de telles règles prudentielles.
Le FCDE n’apparaît donc pas répondre suffisamment au besoin d’une intervention directe au profit d’entreprises en difficulté.
L’État peut également intervenir en soutien de retournement à travers le volet ad hoc de l’aide à la réindustrialisation (ARI), remaniée en décembre 2012. Ce fonds d’avance remboursable sans intérêts peut financer les investissements d’une entreprise en situation de retournement. Le fonds dédié à l’ARI dispose d’environ 170 millions d’euros. Mais là encore, il ne s’agit que de prêts remboursables sans intérêt et non d’une réelle prise de participation.
b. La nécessité d’une intervention structurée et assumée
L’absence d’outils à la disposition des acteurs publics pour lutter contre les défaillances d’entreprises et leurs conséquences sur l’emploi apparaît problématique. Certes, les nouvelles orientations en matière de revitalisation suggèrent de financer plus largement les sociétés de capital-risque qui interviennent sur des bassins d’emplois fragilisés mais ces outils demeurent indirects et limités sur le plan des moyens.
La question de la création d’un fonds de retournement public avec prise de participation majoritaire a ainsi été évoquée dans le débat public. En matière de mutations économiques, il s’agit en effet souvent, pour reprendre la formule de Jean-Pierre Aubert, de « mettre des temps longs dans des temps courts ». (7)
La mission est cependant bien consciente des difficultés à mettre en place une structure de cette nature. Un « fonds public de retournement » serait soumis aux lignes directrices de la commission, qui prévoient qu’une aide au sauvetage peut être accordée à une entreprise en difficulté pour une durée de 6 mois maximum (sous la forme d’un prêt ou d’une garantie uniquement). À l’issue de cette période, l’État doit pouvoir démontrer à la Commission, soit que le prêt a été remboursé ou que la garantie a pris fin, avant 6 mois, soit présenter un plan de restructuration crédible ou un plan de liquidation.
Ainsi, la mission préfère insister sur la nécessité de mettre en place, au sein de la BPI ou d’un autre établissement de financement public (Caisse des dépôts par exemple), une structure dédiée au retournement d’entreprises en difficulté. Il serait en effet incohérent que la puissance publique soit en mesure de détecter les difficultés des entreprises, de faciliter la médiation en cas de différents bancaires ou interentreprises, de permettre à ces entreprises de bénéficier de prêts à taux zéro et d’aides diverses, sans pour autant que soit institutionnalisée la possibilité de conduire des opérations de retournement et sans qu’un financement dédié n’y soit consacré.
4. Améliorer l’utilisation des créances publiques dans l’objectif de sauvegarder l’emploi
L’État est presque toujours créancier lors des procédures collectives, amiables ou contentieuses. À ce titre, il est membre à part entière du comité des créanciers (second comité) constitué tant dans la procédure de sauvegarde que dans la procédure du redressement judiciaire. La décision de valider le plan étant prise, par chaque comité, à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres, l’État peut, lorsque le passif public a été creusé de manière importante, disposer d’un pouvoir décisionnaire clé.
Dans ce cadre, l’État peut – de la même manière que les banques privées – transformer ses créances en capital lorsqu’il estime que cette opération pourrait lui permettre de sauvegarder l’emploi ou l’existence d’une entreprise stratégique. Cette technique est connue dans les pays anglo-saxons sous le vocable « debt equity swap ». Cette faculté doit certes être utilisée avec précaution eu égard aux risques importants résultant d’une prise de participation au sein du capital d’une entreprise fragilisée. L’État se trouve alors exposé au risque de comblement de passif. Il doit surtout endosser un rôle d’administrateur qui requiert une expérience éloignée de ses missions, notamment lorsque l’entreprise concernée est une PME.
De fait, il ne semble pas que l’État ait souvent recours à cette possibilité qui aboutit à une prise de participation. L’existence d’une structure publique dédiée au retournement, fonctionnant sur des critères précis fondés sur l’avenir de l’entreprise, permettrait certainement de pallier ce manque d’expérience, y compris dans les PME. En effet, cette activité de gestionnaire de portefeuille ne pourrait certainement pas être assurée par l’Agence de participation de l’État (APE), qui ne gère qu’un portefeuille limité de 58 sociétés de taille importante.
Par ailleurs, il serait bon que les créanciers publics disposent des mêmes outils que les créanciers privés. Par exemple, ils ne bénéficient pas, aujourd’hui, dans le cadre d’une conciliation, du privilège dit de « new money », permettant à l’entreprise de survivre durant la négociation (article L. 611-11 du code de commerce). Le régime de remboursement du passif public pourrait donc être amélioré, afin que le créancier public puisse raisonner comme un partenaire économique : la frilosité des acteurs publics à s’engager dans le retournement d’entreprises pourrait s’en trouver atténuée.
Les dispositifs d’activité partielle constituent une des principales mesures directes et concrètes d’accompagnement des entreprises en difficulté. Ce dispositif, dont l’objectif est de ne pas recourir à des licenciements en cas de difficultés transitoires d’une entreprise, pose néanmoins deux problèmes tenant à sa complexité et à sa méconnaissance par les entreprises.
Pour ces raisons, le « chômage partiel » demeure largement moins utilisé que dans les pays européens voisins de la France comme l’Allemagne ou l’Italie. Même en 2009, au plus fort de la crise, le recours au chômage partiel n’a pas représenté plus de 14 000 équivalents temps plein (ETP) essentiellement parce que cet instrument est trop complexe pour les PME. Il n’est donc employé que par les grandes entreprises industrielles comme le montre le fait que l’industrie automobile représente à elle seule 18 % des heures utilisées dans ce cadre.
Toutefois, l’analyse de l’exécution du budget 2012 montre que l’utilisation des dispositifs d’activité partielle a connu une progression en 2012. Celle-ci a en effet augmenté de plus de 40 % par rapport à 2011 en nombre d’heures effectivement chômées (26,6 millions d’heures au 31 décembre 2012). La dotation prévue en loi de finances initiale 2012, qui s’élevait à 30 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, s’est donc révélée insuffisante (92,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ont finalement été consommés).
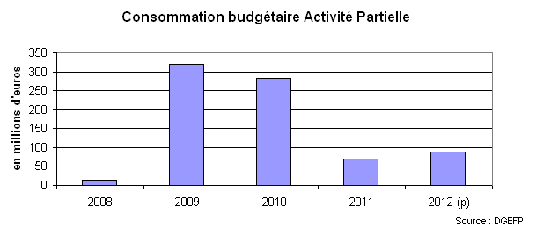
L’expérimentation de la durée minimale de conventionnement APLD (8), qui autorisait la réduction à 2 mois (au lieu de 3) la durée minimale de conventionnement au titre de l’activité partielle de longue durée, semble avoir contribué à cette plus large utilisation des dispositifs d’activité partielle. Le système demeure cependant moins utilisé qu’en 2009.
Le système devrait gagner en attractivité grâce à la fusion des deux dispositifs existants (AS et APLD) prévue par la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Il s’agit de disposer d’un dispositif unique d’indemnisation en fusionnant les régimes de l’allocation spécifique et des allocations complémentaires de chômage partiel (en particulier le régime d’activité partielle de longue durée APLD) sans nécessité de conventionnement. Le niveau de financement par la solidarité nationale d’une heure chômée pourrait ainsi être aligné sur les taux actuels de l’APLD. Tout salarié placé en activité partielle aurait la garantie de percevoir par heure chômée une indemnité globale ne pouvant en tout état de cause pas être inférieure à un taux élevé de remplacement de sa rémunération horaire brute. À cette fin, ce taux sera fixé dans le code du travail alors que jusqu’à présent ce taux était déterminé par des accords nationaux interprofessionnels ou accords de branche.
Par ailleurs le chômage partiel agira en complémentarité des accords de maintien dans l’emploi permis par l’ANI. Une entreprise peut ainsi recourir au chômage partiel, puis subir une nouvelle dégradation conjoncturelle qui la conduit à négocier un accord de maintien dans l’emploi.
Les rapporteurs recommandent cependant de faciliter l’accès à la formation pendant les heures d’activité partielle. La possibilité d’organiser des actions de formation, des bilans de compétence ou des actions de VAE, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation devrait être étendue à toutes les heures chômées et non plus seulement réservée à la seule APLD, comme c’est actuellement le cas. La fusion des dispositifs devrait faciliter cette extension.
Enfin, il faut renforcer la visibilité du dispositif d’activité partielle et ainsi permettre que de nombreuses entreprises qui n’ont pas une connaissance suffisante de ce dispositif ou bien l’estiment dissuasif en raison de sa complexité, puissent désormais y recourir.
L’Union européenne (UE) joue un rôle direct, à travers les outils dont elle dispose (Fonds social européen, Fonds européen d’ajustement à la mondialisation), et indirect, à travers les règles juridiques qu’elle édicte, concernant les mutations économiques. Au-delà de considérations relatives à l’approche économique qui sous-tend les règles de l’UE, certains outils et certaines dispositions pourraient faire l’objet de réformes immédiates afin de faciliter l’intervention au profit des entreprises en difficulté.
1. Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation : un outil qui devrait être plus largement utilisé
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), créé en 2006 et doté de 500 millions d’euros par an, a pour objectif d’apporter un soutien aux salariés licenciés en raison d’un choc économique lié à la mondialisation. Ce fonds co-finance des prestations de réinsertion ou de reconversion allant au-delà des obligations légales ou conventionnelles des employeurs dans les États membres. Conçu à l’origine pour pallier les difficultés résultant des évolutions du commerce mondial (la disparition des quotas textile-habillement en 2005 par exemple) le FEM a été étendu en 2009 aux travailleurs ayant perdu leur emploi du fait de la crise économique et financière mondiale.
Ses règles de fonctionnement, telles qu’elles ont été redéfinies par le règlement 546/2009 du 18 juin 2009 ont permis une intervention plus large. Ainsi, depuis cette date, le FEM peut intervenir à partir de 500 licenciements (1 000 auparavant), appliquer des mesures pour une durée maximale de 24 mois (12 mois auparavant) et assurer un cofinancement à hauteur de 65 % (au lieu de 50 % auparavant).
Selon une évaluation récente conduite par la Commission européenne, le FEM a été actionné 78 fois par 19 États membres (dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal ou l’Irlande) afin d’aider au reclassement de 78 000 salariés de secteurs industriels tels que l’automobile (les équipementiers de PSA et Renault), l’électronique, les télécommunications, et le textile. Près de 358 millions d'euros ont ainsi été accordés à des travailleurs licenciés, parfois âgés, et de faible niveau de qualification afin de les aider à trouver un nouvel emploi, ou à créer leur entreprise. En réalité, la crise (87 % des interventions) mobilise le FEM bien davantage que la mondialisation.
La France a toutefois eu l’occasion de rappeler les dysfonctionnements majeurs qui affectent l’efficacité de ce Fonds.
En premier lieu, on constate une sous-utilisation, difficilement acceptable, des crédits alloués au FEM. En effet, entre janvier 2007 et décembre 2011, 97 demandes d’aides ont été reçues pour un total de 415 millions d’euros alors que le fonds est doté annuellement de 500 millions d’euros : en quatre ans, 415 millions d’euros seulement ont donc été consommés sur les 2 milliards d’euros alloués au Fonds (le taux d’exécution est ainsi inférieur à 24 %). Si l’utilisation du fonds est en hausse constante, surtout depuis l’adoption en 2009 de la dérogation de crise qui concerne désormais la majorité des dossiers, on se situe encore très loin du budget fixé à 2,5 milliards d’euros sur cinq ans.
En outre, la lourdeur des procédures attachées aux aides dans les deux dossiers de Renault (24 millions d’euros versés en 2012) et Peugeot (12 millions d’euros versés en octobre 2012) a été rappelée. Les procédures de saisine sont trop complexes et aboutissent à des délais d’instructions beaucoup trop longs (18 mois en moyenne pour une aide d'urgence). Par ailleurs, la notoriété du Fonds est faible. Combien d’élus, de responsables politiques ou syndicaux français connaissent-ils l’existence et les moyens de ce Fonds européen d’ajustement à la mondialisation ?
Comme l’a noté la présidente de la Commission des affaires sociales et de l’emploi au Parlement européen, Pervenche Bérès (9), ce fonds pourrait être davantage mobilisé « pour accompagner les restructurations de manière plus globale, plus dynamique, dans une optique de réinvestissement ». Il pourrait également concerner davantage les PME.
La mission formule ainsi plusieurs souhaits dans le cadre des négociations sur le renouvellement des règles et de l’existence du FEM, qui doivent se tenir d’ici au 31 décembre 2013.
Ils rejoignent en partie ceux qui ont pu être formulés par d’autres institutions telles que le Comité des Régions et le Comité économique et social européen (CESE). Ce dernier a ainsi proposé que le seuil d'intervention soit porté à 250 salariés pour concerner davantage les ETI. La mission propose également de relever de 10 à 20 millions d’euros le montant de l’aide maximale qui peut être accordée à une entreprise et de recommander aux institutions européennes de concentrer les aides du Fonds sur les restructurations, notamment en aidant les salariés à reprendre leur entreprise sous une forme participative.
Enfin, la mission apporte son soutien à une recommandation du comité des régions (CDR) qui suggère d’appliquer une clause « anti-délocalisation » imposant le recouvrement des aides lorsque l’investissement n’est pas maintenu dans un délai de trois ans pour les PME et de cinq ans pour les plus grandes entreprises.
Il est urgent de convaincre de nombreux États européens, dont l’Allemagne et la Suède qui contestent la pérennité du FEM, de l’utilité de ce fonds pour faciliter les mutations économiques, s’il était mieux utilisé et ses structures repensées.
2. L’assouplissement nécessaire de la contrainte européenne pesant sur l’action des acteurs publics en faveur des mutations économiques.
Au cours des auditions qu’elle a pu mener, la mission a pu également noter des lourdeurs tenant à l’existence de dispositions européennes parfois excessivement contraignantes. Quelques points méritent d’être soulignés.
En premier lieu, il semble nécessaire d’allonger la période maximale des mesures d’aide. Le délai actuel de six mois, est trop court compte tenu de la complexité de l’élaboration des plans de continuation, notamment lorsqu’il s'agit d’une reprise. Ce délai devrait être porté à 12 mois au minimum. Il est ainsi paradoxal de constater que le FEM, outil à la disposition de la Commission, puisse mener des actions sur une durée de 24 mois maximum (12 mois avant 2009) alors que les États européens ne peuvent actuellement, sans risquer une sanction de la Commission, prolonger leurs aides plus de six mois.
La législation sur les aides d’État peut également apparaître inadaptée sur certains points. Ainsi, en matière de revitalisation des territoires, il a été constaté que la mise en place de Fonds mutualisés de nature publique serait certainement compromise, si elle était engagée, puisque les aides distribuées dans ce cadre seraient certainement qualifiées d’aides d’État malgré l’origine privée des fonds. La mission ne peut cependant qu’inciter à réfléchir plus en profondeur à la législation en la matière. Il serait notamment utile de vérifier si de telles aides pourraient correspondre à des critères du règlement général d’exemption par catégories (RGEC), qui permet de faciliter la procédure et l’octroi d’une aide d’État dans certains domaines jugés prioritaires ou selon certains critères comme un taux élevé de chômage dans une région. Dans ce cas, une notification n’est plus nécessaire (une simple fiche d’information est envoyée à la DG Concurrence), ce qui permet aux États membres de délivrer l’aide plus rapidement.
Enfin, la mission propose d’introduire des seuils spécifiques en deçà desquels une notification de la Commission ne serait plus nécessaire : 200 000 euros pour les PME et 500 000 euros pour les autres entreprises par année (et non plus sur trois ans) afin de permettre aux entreprises faisant face à des difficultés de trésorerie d’être aidées plus facilement par les acteurs publics. Une telle mesure permettrait une exclusion des aides qui ne produisent pas d’effet de distorsion sur la concurrence du champ des aides d’État et conduirait à faciliter la mise en œuvre de mesures d’aide temporaire aux entreprises.
Les dispositifs inscrits au budget de l’État pour l’accompagnement des PSE ont fait l’objet d’une évaluation particulière par la mission.
Sur les années 2008 à 2012, les dépenses au titre des différents dispositifs d’accompagnement des restructurations n’en représentent pas moins près de 1,46 milliard d’euros en autorisations d’engagement et 1,39 milliard d’euro en crédits de paiement.
PRINCIPALES DÉPENSES ENGAGÉES ENTRE 2009 ET 2012
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES
Exécution 2008 |
Exécution 2009 |
Exécution 2010 |
Exécution 2011 |
Exécution 2012 ** | ||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP | |
AS FNE (en extinction) |
204,06 |
204,06 |
151,09 |
151,09 |
125,64 |
125,64 |
94,42 |
94,2 |
94,42 |
94,2 |
Congé de conversion |
0,7 |
0,69 |
0,02 |
0,06 |
0,03 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cellules de reclassement (tombée en désuétude depuis fin 2011) |
15,80 |
19,80 |
26,75 |
22,25 |
18,4 |
22,7 |
0,03 |
0,03 |
24,1 |
24,1 |
FNE formation |
1,77 |
3,76 |
26,5 |
20,9 |
38,5 |
34,8 |
34,4 |
27,55 | ||
ATD |
10,20 |
9,09 |
13,47 |
9,5 |
12,25 |
9,89 |
8,06 |
8,54 |
8,4 |
8,4 |
CRP (en extinction) |
11,9 |
15,21 |
11,9 |
11,3 |
104,8 |
104,8 |
21,9 |
21,9 |
- |
- |
CTP (en extinction) |
25,4 |
24,2 |
145,2 |
143,2 |
93,81 |
98,20 |
- |
- | ||
CSP (entré en vigueur en septembre 2011) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
140,1 |
140,1 |
TOTAL |
259,2 |
249,2 |
244,4 |
252,6 |
444,8 |
441,1 |
252,6 |
250,4 |
267 |
267 |
** Les données 2012 ne sont pas encore consolidées.
Source : DGEFP/MFBDG.
La formation joue un rôle majeur dans la capacité des salariés à préparer leur reconversion professionnelle face aux mutations économiques inévitables.
1. La coopération des acteurs publics avec les acteurs de la formation professionnelle
Les acteurs publics jouent un rôle majeur dans l’accompagnement des restructurations par le biais d’actions de formation. La région, l’État en région
– en particulier les DIRECCTE –, Pôle emploi, les missions locales, les comités de développement lorsqu’ils existent, les chambres de commerce, les pôles de compétitivité sont au cœur du travail d’identification des possibilités de reclassement. L’instance centrale de coordination est le Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CCREFP) qui réunit notamment l’État, la Région et les partenaires sociaux (10).
La place des OPCA dans cette instance est cependant aléatoire alors que c’est l’OPCA qui, dans 80 % des cas, finance l’essentiel des formations tirées du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé aux salariés faisant l’objet d’un licenciement économique, même si Pôle emploi et les conseils régionaux apportent également un complément.
Deux difficultés majeures sont soulignées par les Rapporteurs : l’insuffisance d’orientations claires en matière de formation professionnelle, ce qui renvoie à la question de la gouvernance et les délais de mise en place des formations.
Sur le premier point, les membres de la mission recommandent de généraliser les structures de concertation et de coopération, à l’instar des plateformes de mutations économiques, en matière de formation. Il est toutefois difficile de définir des orientations claires à ce stade dans l’attente de l’acte III de la décentralisation qui va a priori accroître sensiblement le rôle des régions en la matière.
Concernant le second point, certains salariés pris en charge dans le cadre d’un CSP attendent plusieurs mois avant de commencer leur formation, et la terminent parfois alors que leur contrat avec Pôle emploi a depuis longtemps expiré. Même si la volonté de chaque salarié joue également un rôle, accélérer la mise en place des formations ne peut qu’améliorer l’efficacité du système.
2. Le développement du compte personnel de formation : un progrès majeur issu de l’ANI du 11 janvier 2013
L’implication du salarié joue également un rôle dans le succès de sa reconversion. Pour voir émerger un salarié acteur, il faut mener un travail d’accompagnement long et d’autant plus difficile que les personnes sont peu qualifiées. À cet égard, le compte personnel de formation (CPF), bientôt effectif, ainsi que la prestation de conseil en accompagnement, prévue dans le dernier accord national interprofessionnel (ANI), peuvent jouer un rôle essentiel. Cependant, remettre à niveau des personnes sans qualification exige des moyens financiers importants, alors que les chefs d’entreprise préfèrent généralement affecter leur budget à la formation de la main-d’œuvre qualifiée. Il convient donc de veiller à ce que le nouveau droit individuel à la formation (DIF) soit mobilisé en faveur des personnes les moins qualifiées.
La dotation de restructuration (DGR) permet de prévenir les conséquences sociales des restructurations d’entreprises. Les différentes mesures qu’elle comporte sont destinées, d’une part, à éviter les licenciements (allocation complémentaire de chômage partiel résiduel et actions de formation) et, d’autre part, à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement n’a pu être évité.
Cette dotation globale est déconcentrée au niveau départemental à hauteur de 23,5 millions d’euros pour permettre une gestion au plus près du terrain et concerne les conventions de formation et d’adaptation du Fonds national pour l’emploi (FNE). Par ailleurs, une dotation de 8 millions d’euros assure le financement des cellules d’appui à la sécurisation professionnelle.
EXÉCUTION AU TITRE DE LA DGR
Exécution 2008 |
Exécution 2009 |
Exécution 2010 |
Exécution 2011 |
Exécution 2012 ** | ||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP | |
DGR |
18,5 |
24,3 |
80,5 |
268,3 |
60,7 |
63,1 |
34 |
28 |
26 |
26 |
** Les données 2012 ne sont pas encore consolidées.
Source : Rapport annuel de performances 2012.
1. Les allocations du FNE-formation : un outil qui demeure largement sous-doté
Les sommes engagées dans le cadre de la DGR le sont essentiellement au titre des conventions de FNE–formation, à hauteur de 16 millions d’euros, et au titre du financement des cellules d’appui à la sécurisation professionnelle (pour 8 millions d’euros).
À travers les auditions qu’elle a menées, la mission constate que les actions entreprises dans le cadre du FNE-formation sont saluées par la quasi-totalité des acteurs.
Les allocations du FNE formation constituent en effet un outil utile tant pour la prévention des licenciements collectifs que pour leur accompagnement. En amont, elles permettent une application pratique du principe « former plutôt que licencier ». En aval, elles interviennent pour assurer la reconversion rapide des salariés.
Le champ d’intervention est large puisqu’il permet le financement d’actions d’accompagnement, de positionnement, de bilan de compétences et de VAE ou des actions de formation qualifiante. Il peut s’agir soit de formation spécifique, principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise, soit de formation générale, qui procure des qualifications largement transférables à d’autres entreprises ou d’autres domaines de travail. Une formation générale est ainsi reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics.
En pratique, des conventions État-entreprise (ou collectif d’entreprises), d’une durée maximum de 12 ou 18 mois, sont mises en place. Elles peuvent être ciblées sur les publics prioritaires, c’est-à-dire les salariés des premiers niveaux de qualification dans les entreprises de moins de 250 salariés. Le taux d’intensité des aides varie de 25 à 80 % selon trois critères :
– le type de formation : spécifique ou général ;
– la taille de l’entreprise : petite, moyenne ou grande ;
– le public concerné : majoration pour les travailleurs défavorisés ou handicapés.
NOMBRE DE CONVENTIONS POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS
EN 2012 ET 2013
2012 |
2013 (à fin février) | |
Cellules de reclassement |
44 |
0 |
ATD |
537 |
77 |
FNE-formation |
189 |
8 |
Source : DARES.
Cette intervention de l’État permet en outre un important effet de levier : quand l’État s’engage, il incite à des cofinancements avec l’entreprise, l’OPCA, le FSE et, éventuellement, les collectivités territoriales (principalement la région). Ainsi, pour 2011, 1,6 million d’heures de formation et 46 757 000 euros (coût total des projets) ont été mobilisés : 33 % ont été financés par l’État, 37,4 % par les entreprises, 22,4 % par les OPCA, 4,3 % par les collectivités territoriales et 1,6 % par le Fonds social européen (FSE). (11)
Bien que longtemps délaissé, le FNE a montré sa pertinence et son efficacité dans la reconversion des salariés. À titre d’exemple, c’est grâce au FNE, qui a financé près de 70 % de la formation des salariées de Lejaby en partenariat avec OPCALIA, que ces salariées ont pu se reconvertir dans la maroquinerie de luxe. Aux termes de l’accord signé entre l’entreprise, l’État et les Ateliers du Meygal, les 78 salariées, spécialistes de la lingerie, ont pu bénéficier en moyenne de 390 heures pour se former aux techniques de la maroquinerie de luxe pour un coût d’environ 1,5 million d’euro, prenant en charge à la fois les coûts pédagogiques proprement dits et les charges salariales des ouvriers au titre des heures pendant lesquelles ils sont en formation.
Cette « success story », souvent citée comme un cas d’école de reconversion réussie, nécessite certes des conditions qui ne sont pas toujours aisées à réunir. Néanmoins, il serait certainement possible de favoriser d’autres réussites de ce type. L’usage du FNE Formation a d’ailleurs quasiment décuplé entre 2008 et 2010, avant de retomber alors même que la crise s’est amplifiée sur le champ de l’emploi. Il apparaît donc nécessaire de réactiver plus largement ce dispositif et de le doter de moyens conséquents.
À ce titre, il est regrettable de constater que les financements initialement prévus pour les cellules de reclassement en loi de finances initiale pour 2012 qui n’ont pas été consommés (notamment en raison de la montée en puissance du CSP qui a rendu inutile le recours aux cellules de reclassement) n’ont pas été redéployés sur le FNE.
UNE FORTE MOBILISATION DU DISPOSITIF PENDANT LA CRISE
2008 : 48 entreprises bénéficiaires, pour 1 319 salariés, et un montant total de 3,17 millions d’euros
2009 : 252 entreprises bénéficiaires pour 8 078 salariés, un montant total de 20,94 millions d’euros
2010 : 533 entreprises bénéficiaires pour 18 129 salariés, un montant total de 38,5 millions d’euros
2011 : 183 entreprises bénéficiaires pour 15 114 salariés, un montant total de 18 millions d’euros
2012 : 189 conventions FNE – formation auraient été signées pour un ensemble des adhésions individuelles de 11 108 salariés.
2013 : 23, 5 millions d’euros programmés.
Source : DGEFP.
Il conviendrait également, parallèlement à la montée en puissance de cet outil, de réformer son fonctionnement. Ces aides sont en effet assorties d’une obligation de maintien dans l’emploi des bénéficiaires pour au moins 6 mois après le terme de la convention. La mission recommande que cette durée soit portée à 12 mois étant donné la hauteur des financements publics mobilisés justement pour préserver l’emploi.
Au final, le FNE ne joue sans doute pas un rôle proportionnel à son efficacité, en raison notamment des obligations communautaires en matière d’aides publiques qui s’appliquent à des projets financés sur la base du FNE-Formation. D’une part, le taux de financement du FNE-Formation ne peut être mobilisé qu’à hauteur maximale de 17 % de l’assiette éligible dans le respect des taux d’intensité d’aide maximum autorisés par le règlement général d’exemption (RGEC) par catégorie n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008. Ce taux peut être porté à 30 % en fonction de la situation de l’entreprise (ou du groupement d’employeurs) et des cofinancements mobilisables (notamment non cofinancement du FSE). D’autre part, tout projet de formation au bénéfice d’une entreprise ou d’un groupement d’employeurs pour lesquels un montant d’aides publiques supérieur à deux millions d’euros est envisagé, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires, est soumis à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne.
Afin de fluidifier les démarches, il pourrait être envisagé d’augmenter le seuil qui entraîne une obligation de déclaration à la Commission européenne.
2. Les cellules d’appui à la sécurisation professionnelle
L’objectif de cette nouvelle prestation, financée par l’État et ciblée sur les entreprises en redressement et liquidation judiciaire, vise à permettre la prise en charge anticipée et collective de tous les salariés dont le licenciement est envisagé, qu’ils projettent ou non d’adhérer au CSP.
L’objet de la prestation, d’une durée maximum de 45 jours, est d’apporter aux salariés concernés un soutien administratif favorisant l’adhésion au CSP, d’initier une réflexion sur leur projet professionnel afin de faciliter le travail des équipes CSP, d’apporter le cas échéant un appui psychologique. L’appréciation sur la nécessité de mobiliser cette prestation se fait ainsi au regard de la situation sociale de l’entreprise (existence et intensité d’un éventuel conflit social, conditions d’annonce et d’accompagnement de la décision de redressement ou de liquidation judiciaire, capacité des salariés à admettre la décision…), du calendrier prévisionnel des licenciements et de tout élément qui fonde l’intérêt de la mise en œuvre d’une cellule d’appui avant les licenciements. La prestation ne vise donc pas le retour direct à l’emploi mais plutôt l’optimisation du temps passé en CSP par une préparation préalable du bénéficiaire.
Depuis juillet 2012, cette prestation a permis la prise en charge de 2 000 personnes, pour un coût de 1,03 million d’euros. En LFI 2013, les besoins sont estimés à 12,60 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Ces cellules constituent ainsi une réponse, quoique partielle, au problème de la dimension uniquement individuelle du contrat de sécurisation professionnelle dont il sera question dans le chapitre suivant.
3. Les financements apportés au service public de l’emploi pour l’accompagnement des mutations économiques
Les financements apportés par l’État au service public de l’emploi dans le champ de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations économiques visent à anticiper les transitions professionnelles inévitables : en évaluant la transférabilité des salariés menacés sur les emplois et métiers offrant des opportunités sur le territoire et, en identifiant les besoins de formation permettant de compléter et d’adapter leurs compétences afin de permettre leur reclassement. Les DIRECCTE et les plateformes d’accompagnement dans l’emploi se chargent d’identifier les mesures pouvant être proposées soit dans le cadre d’un PSE soit en dehors.
Le champ d’intervention de ces actions est très large et répond à des besoins spécifiques à chaque territoire. En conséquence, l’initiative et la mise en œuvre de ces actions relèvent de la compétence des services déconcentrés.
Depuis 2013, le financement de ces prestations sort progressivement du champ de la subvention pour donner lieu à des mises en concurrence. Il a donc été transféré en dotation sur les budgets opérationnels de programme (BOP) régionaux du programme 103 des DIRECCTE.
Ces prestations sont réparties en quatre catégories :
● L’appui individuel au projet de reconversion (APR)
Cette prestation individuelle est un outil spécifique ciblé sur la problématique des compétences mobilisables dans un contexte de reconversion obligée. Les DIRECCTE mobilisent cette prestation de manière systématique en particulier suite à des diagnostics collectifs d’employabilité sur leurs territoires.
● Le diagnostic collectif d’employabilité et de transfert de compétences
Cette prestation d’étude s’adresse aux entreprises pour répondre aux besoins d’analyse des emplois et des compétences dans un contexte de traitement préventif (GPEC) ou de traitement d’un PSE en préparation. L’analyse s’effectue à la fois au niveau de l’entreprise et au niveau du territoire.
● Les journées d’appui au service public de l’emploi
Ces journées visent à soutenir l’application locale des politiques initiées par le ministère de l’Emploi. Le ministère fournit ainsi conseil et appui dans la construction et la mise en œuvre des dispositifs de gestion des mutations économiques au niveau local ainsi que dans le champ de l’accompagnement des personnes pour les aider à construire et sécuriser leur parcours de transition professionnelle
● Le bilan à mi-carrière
Le bilan à mi-carrière est une prestation individuelle mise en œuvre dans le cadre du Plan Seniors. Cette prestation, initiée par la DIRECCTE dans le cadre de son programme d’action, est ensuite prescrite par Pôle emploi.
La diversité des actions entreprises à travers cette dotation (de 12,6 millions d’euros en PLF 2013) rend difficile leur évaluation par le Parlement. Il serait utile de rationaliser l’ensemble des analyses relatives aux compétences et à la transférabilité des salariés sur d’autres emplois en les regroupant dans la production d’un seul et même diagnostic territorial comme évoqué supra.
1. L’allocation temporaire dégressive
Les entreprises procédant à des licenciements économiques peuvent conclure avec l’État des conventions permettant de faciliter le reclassement des personnes licenciées. Parmi ces conventions, la convention d’allocation temporaire dégressive (ATD) permet le versement aux salariés licenciés et reclassés dans un emploi moins bien rémunéré, d’une allocation destinée à compenser cette différence de rémunération.
Le reclassement doit se faire sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou de travail temporaire de six mois ou plus.
Le financement de l’allocation temporaire dégressive est à la charge de l’entreprise et de l’État. La participation de celui-ci ne peut excéder 75 % du montant de l’allocation, ni dépasser un plafond fixé à 200 euros par mois et par bénéficiaire, pendant une période ne pouvant excéder deux ans. L’entreprise participe au financement de l’allocation dans les conditions fixées par la convention passée avec l’État. Elle peut toutefois être dispensée de cette participation lorsqu’elle se trouve dans l’incapacité d’en assumer la charge financière (notamment les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire) ou lorsqu’elle est située dans des bassins d’emploi en grande difficulté. Dans ce cas, le montant de l’allocation versée au salarié est limité à la contribution financière de l’État qui peut être portée, au maximum, à 300 euros par mois.
Le coût total pour l’État de ce dispositif en LFI 2013 se monte à 11 millions d’euros.
La pertinence d’un tel dispositif dépend toutefois du niveau de salaire antérieur des personnes auxquelles il profite. Si sont essentiellement concernées des personnes ayant un haut niveau de revenu avant leur licenciement, la légitimité du dispositif est moindre et les sommes qu’il engage pourraient éventuellement être redéployées ailleurs (FNE formation ou FNRT par exemple). De tels éléments d’évaluation n’ont pas été fournis aux membres de la mission qui s’interrogent donc sur la pertinence de ce dispositif.
Lorsqu’une entreprise d’au moins 1 000 salariés in bonis envisage un licenciement pour motif économique, elle doit proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement. Ce congé, d’une durée variable, a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et de l’aide d’une cellule d’accompagnement dans ses démarches de recherche d'emploi.
Pendant la période du préavis correspondant au congé, l’employeur verse la rémunération habituelle du salarié. Pour la durée du congé qui excède le préavis, le salarié perçoit une rémunération mensuelle au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, sans pouvoir être inférieur à 85 % du SMIC.
Le congé est suspendu durant chaque période de travail effectué par le salarié. Il reprend au terme de chaque période de travail.
Bien que l’État soit financièrement absent du fonctionnement du dispositif, la mission a fait le constat que la prise en charge dans le cadre d’un congé de reclassement ne motive pas toujours un retour immédiat à l’emploi. Ainsi, il pourrait être incitatif pour les salariés d’étendre le bénéfice de la suspension du congé de reclassement et du contrat de sécurisation professionnelle aux périodes de formation et de travail sur une durée maximum de 24 mois, afin de récompenser le salarié actif à la fois dans la recherche d’emploi et dans sa démarche de qualification.
3. Le CSP : une réforme utile qui pourrait être approfondie
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) constitue le principal dispositif d’accompagnement des licenciés économiques et, à ce titre, a fait l’objet d’une attention particulière de la part des rapporteurs.
Le CSP bénéficie aux salariés licenciés pour motif économique des entreprises de moins de 1 000 salariés ou des entreprises de plus de 1 000 salariés en situation de redressement ou de liquidation judiciaire.
Grâce à ce dispositif, le salarié bénéficie d’une sécurisation financière, en percevant une allocation proche de son salaire net antérieur pendant 12 mois (pour les bénéficiaires qui avaient plus de 12 mois d’ancienneté au moment de leur licenciement).
L’Unedic finance principalement l’allocation. L’État y contribue également en prenant en charge la moitié du surcoût de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) par rapport à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour les personnes qui avaient entre 12 et 24 mois d’ancienneté au moment de leur licenciement.
Pour financer cette allocation, une contribution exceptionnelle a été instaurée. En effet, en cas d’adhésion d’un salarié au CSP, le préavis n’est pas exécuté mais l’employeur doit en reverser l’équivalent à Pôle emploi. De même, les droits individuels à la formation (DIF) non-consommés par le salarié sont monétisés et reversés à Pôle emploi. Le CSP est donc en quelque sorte cofinancé par l’employeur, le salarié et l’État.
En contrepartie, le salarié bénéficie d’un accompagnement renforcé auprès de Pôle emploi ou de ses sous-traitants. Le coût moyen d’accompagnement d’un bénéficiaire est valorisé à 1 600 euros environ. Le financement de cet accompagnement est assuré à parité par l’État et l’Unedic, par reversement à Pôle emploi d’un forfait de 800 euros par entrée dans le dispositif. Dans le cadre de cet accompagnement renforcé, le salarié bénéficie d’un accès facilité à la formation grâce aux financements dédiés dans la convention signée entre l’État et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). L’État participe également au financement de ces formations en cofinançant les parcours à hauteur de 45 % via le Fond social européen.
En 2012, pour un nombre d’entrées d’un peu plus de 100 000, le coût global du CSP s’est élevé à près de 1,5 milliard d’euros.
COÛT DÉTAILLÉ DU CSP POUR L’ANNÉE 2012
(en millions d’euros)
Employeurs / Salariés |
État |
Unedic |
FPSPP |
Total | |
Allocation (1) |
443,61 |
23,19 |
736,33 |
- |
1 203,13 |
Accompagnement |
- |
76,65 |
76,65 |
- |
153,30 |
Formation (2) |
- |
59,70 |
- |
73,01 |
132,71 |
Total |
443,61 |
159,56 |
812,89 |
73,01 |
1 489,15 |
(1) La contribution nette de l’Unedic aux dépenses d’allocation est de 1 200,13 millions d’euros diminuée de 443,61 millions d’euros de contributions liées aux préavis et au DIF.
(2) Le montant des engagements (dépense prévisionnelle) s’est élevé à 132,71 millions d’euros au total. Sur ce total, le financement FSE doit s’élever à 45 %, soit un peu moins de 60 millions d’euros. La dépense réelle est en règle générale assez proche de la dépense engagée.
Source : ministère du Travail (réponses au questionnaire envoyé par les rapporteurs).
À la fin mars 2013, on compte plus de 140 000 entrées depuis le début du dispositif en septembre 2011, avec une moyenne de 8 000 entrées par mois, ce qui représente environ 82 000 bénéficiaires. Les adhérents sont suivis à 47 % par des prestataires privés. Le taux d’accès à la formation est d’environ 30 % (à comparer au taux moyen pour les demandeurs d’emploi, qui est de 9 %). Ces formations ont une durée moyenne de 203 heures et ont très souvent un objectif de reconversion (dans 43 % des cas). Le taux d’accès aux périodes de travail en entreprises est d’environ 10 %. Ces périodes de travail ont une durée moyenne de 2 mois et 13 jours. Enfin, le taux de sortie vers l’emploi durable (CDI, CDD et CTT de plus de 6 mois et création / reprise d’entreprise) est d’environ 26 %, soit un résultat encourageant au regard d’autres dispositifs visant le retour à l’emploi.
Le CSP a entraîné l’obsolescence des cellules de reclassement. L’offre de service du CSP s’en rapproche, en effet, très largement, ce qui explique qu’elle soit mise en œuvre par les mêmes prestataires qui sont aussi les sous-traitants de Pôle emploi pour l’accompagnement des bénéficiaires de CSP. Les services déconcentrés ont reçu l’instruction de ne plus financer de cellules de reclassement. Pour autant, l’État n’interdit pas la mise en place de cellules de reclassement financées par les entreprises.
De nombreux interlocuteurs de la mission ont fait part des progrès permis par le CSP pour l’accompagnement des licenciés économiques. Certains points pourraient toutefois faire l’objet d’améliorations.
a. Préserver la possibilité d’une reconversion collective
En premier lieu, la dimension individuelle du CSP peut parfois constituer un obstacle dans la recherche de solutions collectives pour des salariés dont le parcours professionnel, les qualifications ou la mobilité géographique sont proches. Cette difficulté concerne particulièrement les licenciements collectifs importants (au-delà de 100 ou 200 personnes), notamment lorsqu’ils interviennent à la suite de la fermeture d’un site. En effet, si l’on prend l’exemple du volailler Doux qui s’est séparé de 1 000 salariés en août 2012, on constate qu’une majorité de ces salariés était constituée par un personnel féminin, peu qualifié, et relativement âgé.
Or, non seulement le maintien du collectif de travail après un licenciement économique peut parfois être utile pour permettre aux salariés de rebondir, mais il peut également répondre à une logique économique, dans la mesure où il ne conduit pas les salariés d’une même entreprise et possédant le même profil à élaborer les mêmes projets professionnels et donc à entrer potentiellement en concurrence. Dans le cas de la « success story » incarnée par la reconversion des salariées de l’entreprise Lejaby, c’est bien le maintien du collectif de travail et une reconversion collective qui en a permis la réussite. Il y a donc une cohérence à chercher des solutions collectives pour des salariés dont les profils et le bassin de vie et d’emploi sont identiques.
Les cellules d’appui à la sécurisation professionnelle ne répondent que partiellement à cette attente. Ces cellules d’appui interviennent pendant six semaines, à la demande de l’État et en concertation avec Pôle emploi, en cas de difficultés particulières sur un bassin. Lorsque l’entreprise se trouve dans un contexte social difficile, elles permettent d’offrir un appui psychologique aux salariés, mais elles ne permettent pas d’identifier des solutions de reconversion et de travailler à leur mise en œuvre.
On constate parfois des difficultés notables dans la gestion de dossiers de restructurations importants (difficultés de mise en œuvre d’un pilotage consolidé, éclatement de l’accompagnement confié sur chaque site à un OPP différent et à Pôle emploi, difficulté à bénéficier d’un traitement collectif, etc…). Le CSP n’est pas opérationnel pour le traitement de restructurations importantes et multisites.
La mission recommande donc de réfléchir à la création d’un mécanisme intermédiaire permettant de conserver les bénéfices individuels attachés au CSP, tout en mobilisant la partie des financements prévus pour l’accompagnement au sein d’une cellule de reconversion ayant une visée collective. Il s’agirait ainsi d’allier logique individuelle et logique collective dans une optique stratégique pour le bassin d’emploi. Une telle cellule, que l’on pourrait qualifier comme visant l’« appui à la reconversion collective » pourrait, dans un premier temps, être réservée à des cas de licenciements collectifs importants pour lesquels une solution de reconversion au niveau local ou au niveau national (en cas de restructurations multisites) apparaîtrait évidente ou nécessaire pour éviter un choc social.
Son financement pourrait être assuré à la fois par les ressources tirées du volet « accompagnement » du CSP (800 euros par salarié) et par un complément spécifique de l’État inscrit au programme 103 prélevé sur d’autres dispositifs dont l’utilité est moindre. L’activation de cette cellule pourrait être décidée par le Ministre lui-même, lorsqu’il jugera qu’une situation sociale consécutive à un licenciement collectif de grande ampleur nécessite un traitement particulier. L’effet psychologique découlant d’un tel mécanisme serait également rassurant pour les salariés.
Il serait également souhaitable de doter l’État d’un fonds d’appui exceptionnel, dont l’utilisation serait réservée aux grands licenciements collectifs, pour lui permettre de trouver des solutions rapides et concrètes en matière de reconversion des salariés et de revitalisation du territoire. L’utilisation de ce fonds ne devrait concerner que les très grands licenciements collectifs (4 à 5 par an en moyenne) et serait directement actionné par le Gouvernement. Dans ce cadre, le Ministre serait en mesure d’actionner facilement des cellules de reconversion collective et ce type de mécanisme serait en outre de nature à faciliter le dépôt de dossiers et la réception d’aides en provenance du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM). Ce fonds pourrait notamment être alimenté par redéploiement des ressources budgétaires jusqu’ici consacrées à la compensation de l’exonération de cotisations sociales en faveur des bassins d’emploi à redynamiser (16 millions d’euros en 2012).
b. Améliorer la complémentarité entre les mesures prévues dans le PSE et le CSP
Il importe également de permettre aux conseillers en charge du bénéficiaire du CSP de connaître et de mobiliser les actions prévues au PSE, notamment les actions de formation. Trop souvent la mise en œuvre du PSE et l’accompagnement renforcé du salarié au titre du CSP restent deux logiques étrangères l’une à l’autre. En pratique, Pôle emploi ou l’OPP ne connaissent pas toujours les mesures qu’ils peuvent mobiliser et ne savent pas nécessairement qu’un PSE est mis en œuvre. Cela a pour conséquence des mesures redondantes, voire concurrentes, en matière de validation des acquis de l’expérience et de bilan professionnel.
Il convient donc que les services déconcentrés puissent influer sur le contenu des PSE afin que ceux–ci comportent des mesures complémentaires à celles déjà prévues dans le cadre de l’accompagnement renforcé des personnes acceptant un CSP (notamment en matière de formation ou de bilan de compétences). Cette exigence va être renforcée dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’homologation.
Cela renforce la portée de la proposition de la mission visant à associer Pôle emploi à la phase de négociation du PSE afin de pouvoir imaginer et discuter en amont des solutions possibles et de leur complémentarité. Le ministère du Travail a également fait état des recommandations visant la mise en place d’un référent PSE dans les directions territoriales de Pôle emploi, sans que la mission n’ait eu d’éléments pour confirmer que cette orientation avait bien été appliquée.
4. L’accompagnement des territoires : une exonération générale qui peut conduire à des effets d’aubaine
L’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs des bassins d’emploi à redynamiser a été créée par l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. Elle vise à relancer l’activité sur ces territoires, marqués par un fort taux de chômage et une déperdition de population et d’emplois. Les bassins listés par un décret du 20 février 2007 ont été créés en Région Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées. Ils ne concernent donc que deux territoires.
Trois critères devaient à l’origine guider l’identification de ces territoires :
– un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national,
– une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 %,
– une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.
Au sein de ces territoires, les établissements des entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 sont tous concernés par l’exonération, quels que soient leurs effectifs, leur situation financière ou la qualité de leur politique de gestion des ressources humaines. La probabilité d’un effet d’aubaine pour les entreprises dans ces territoires est donc forte, sachant que dans d’autres territoires, d’autres dispositifs sont mobilisables, notamment au titre de la revitalisation.
Or, la dépense budgétaire résultant de cette dépense fiscale a continuellement augmenté sans que ce dispositif ne soit évalué en termes de création ou de maintien de l’emploi.
(en millions d’euros)
Exécution 2010 |
Exécution 2011 |
Exécution 2012 | |
AE |
7 321 314 |
17 558 496 |
16 869 033 |
CP |
7 321 314 |
17 553 696 |
16 869 033 |
Source : DGEFP.
La mission recommande donc de ne pas reconduire cette dépense fiscale dont l’échéance est prévue au 31 décembre 2013.
D. UN ÉLARGISSEMENT NÉCESSAIRE DES DISPOSITIFS PUBLICS POUR UNE PRISE EN COMPTE DE TOUS LES SALARIÉS FRAGILISÉS : INTÉRIM, SOUS-TRAITANCE, SENIORS
1. Permettre aux salariés en contrats courts d’accéder à un accompagnement et à une formation renforcée, sur le principe du CSP
Comme cela a été rappelé, les fins de contrats courts, qu’ils soient à durée déterminée type CDD ou bien qu’ils relèvent de l’intérim, constituent la première cause d’entrée à Pôle emploi.
Leur accompagnement, en marge d’une restructuration, est délicat puisque ces salariés ne sont pas inclus dans le champ du PSE et ne bénéficient pas de droits renforcés à l’accompagnement, tels que ceux qui existent dans le cadre du CSP pour les licenciés économiques. Pourtant, lorsqu’une restructuration de grande ampleur à lieu, les salariés travaillant dans le cadre de contrats courts et précaires, notamment dans les entreprises sous-traitantes touchées par la restructuration d’une entreprise donneuse d’ordres, sont les premiers touchés.
À titre expérimental, il a donc été décidé, en 2012, que le contrat de sécurisation professionnelle pourrait être ouvert aux demandeurs d’emploi en fin de CDD, en fin de mission d’intérim ou en fin de contrat de chantier visé à l’article L. 1236-8 du Code du travail, sur un bassin d’emploi donné. Cette expérimentation couvre trente-deux bassins d’emploi et profite à 6 000 bénéficiaires arrivant au terme de leur CDD ou de leur intérim, sachant que les partenaires sociaux et l’État ont fixé une cible de 8 700 bénéficiaires maximum.
Elle concerne les personnes ayant droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) – ce qui la distingue de l’accompagnement fourni au titre du CSP. Ce dispositif est très apprécié de ses bénéficiaires qui jouissent d’un suivi individualisé assuré par un référent unique et de services de proximité comme l’ont confirmé les agents de Pôle emploi rencontrés par les Rapporteurs à Alençon en juillet 2013. L’accès à la formation constitue un levier important de leur reclassement.
Par conséquent, le Comité national de pilotage du CSP, qui réunit des représentants de l’État et des organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 créant le CSP, a acté le doublement de l’enveloppe financière consacrée à l’expérimentation du dispositif pour les salariés en fin de CDD, en fin de contrat de travail temporaire et en fin de chantier. Cette expérimentation bénéficiera ainsi à près de 9 000 demandeurs d’emploi supplémentaires dans quinze bassins d’emploi identifiés comme prioritaires. Au final ce seront donc près de 50 bassins d’emplois concernés.
Les premiers éléments de bilan, tels qu’ils ressortent de l’analyse sur l’ensemble des bassins d’emploi, malgré des différences notables entre ceux-ci, sont encourageants. En premier lieu, on constate que le taux d’accès à la formation est sensiblement identique à celui des bénéficiaires du CSP de droit commun (environ 30 %) et que le taux de retour à l’emploi durable est presque le même que pour les bénéficiaires de droit commun (environ 25 % dont 50 % de CDI), ce qui est très encourageant. En revanche, on constate que le taux de recours à des périodes de travail est très supérieur à celui constaté pour les bénéficiaires de droit commun (environ 35 % contre 10 %), ce qui est normal s’agissant d’un public habitué à reprendre des missions courtes et pour lequel l’usage des périodes de travail est facilité.
Se pose ainsi la question d’une extension générale du dispositif à tous les anciens titulaires de contrats courts indemnisés. Selon le ministère du Travail interrogé par la mission à ce sujet, le coût de l’ouverture du CSP à l’ensemble des contrats courts , en conservant une structure de coût identique (limitée à la prise en charge de l’accompagnement renforcé et des frais de formation), s’élèverait à environ 327 millions d’euros, réparti comme suit :
ESTIMATION DU COÛT DE L’OUVERTURE DU CSP AUX CONTRATS COURTS
(en millions d’euros)
Employeurs / Salariés |
État |
Unedic |
FPSPP |
Total | |
Allocation (1) |
- |
- |
- |
- |
- |
Accompagnement |
- |
112,50 |
87,50 |
- |
200,00 |
Formation (2) |
- |
51,14 |
- |
75,83 |
126,97 |
Total |
- |
163,64 |
87,50 |
75,83 |
326,97 |
Source : ministère du Travail.
Ce coût est basé sur les hypothèses suivantes :
– une population éligible de 894 000 personnes : c'est-à-dire environ un tiers de la population totale des personnes indemnisé en 2011, dont la DARES estime qu’un tiers sont des anciens titulaires de contrats courts ;
– un nombre annuel d’entrées de 125 000 : cette hypothèse est basée sur un taux d’adhésion de 14 %, constaté depuis le début de l’expérimentation ;
– un coût moyen d’accompagnement identique à celui de l’expérimentation, soit 1 600 euros par entrée (dont 900 euros à la charge de l’État et 700 euros à la charge de l’Unedic) ;
– un coût moyen de formation de 3 386 euros par bénéficiaire de formation ;
– un taux d’accès à la formation de 30 %.
Cette ouverture représenterait certes un coût non négligeable pour les finances publiques mais soutenable, surtout si on le compare aux bénéfices attendus en termes d’accompagnement de salariés fragilisés et d’adaptation aux mutations économiques. Il s’agirait en effet de faciliter les transitions, ce qui profiterait non seulement aux salariés, mais également aux entreprises et aux territoires qui pourraient trouver là une main-d’œuvre plus aisément reconvertible.
Une solution intermédiaire pourrait être de n’envisager cette ouverture du CSP aux contrats courts que dans le cadre de restructurations ayant donné lieu à un PSE au sein de l’entreprise qui procède à la restructuration ou ayant directement impacté les entreprises sous-traitantes. Le PSE mis en place par l’entreprise donneuse d’ordres agirait ainsi comme le repère permettant d’étendre le champ du CSP aux contrats courts, sans procéder à une généralisation plus coûteuse.
2. Prendre en compte la spécificité des salariés âgés
Le recours massif aux mesures aux préretraites et autres mesures d’âge comme moyen d’accompagnement des restructurations industrielles dès les années 1970, ainsi que l’abaissement de 65 à 60 ans de l’âge de départ à la retraite, avaient entraîné une forte décrue du taux d’activité des seniors. Face à l’évolution démographique et à son impact sur les finances publiques et sociales, la France, comme les autres pays européens, s’est engagée dans une politique d’allongement de la durée d’activité professionnelle. Cette politique a permis aux seniors d’être de plus en plus présents sur le marché du travail. Depuis 2000, le taux d’activité des 55-64 ans a progressé de 15 points et se rapproche désormais de la moyenne européenne.
Cette progression du taux d’activité des seniors s’est traduite à la fois par plus d’emploi et plus de chômage, mais cette hausse du chômage est moins due à l’extinction de ces dispositifs qu’à la crise économique. Sous l’effet de la crise, le taux de chômage des 55-64 ans progresse nettement depuis 2008, même si ce taux reste bien en deçà de celui de l’ensemble des actifs.
Face à cette situation, la mission constate qu’il existe un problème majeur quant à la capacité des seniors à retrouver un emploi après un licenciement, notamment en période de crise. Ainsi, l’État se retrouve face à un dilemme difficile à résoudre : en allongeant la période de cotisations nécessaire pour toucher une retraite à taux plein, il accroît les difficultés des salariés âgés dont l'emploi est supprimé et qui ont peu de chances de retrouver un autre poste de travail, dont le traitement relevait justement de la politique de pré-retraite. Mais dans le même temps, ce type de mesures semble favorable à l’activité des seniors.
C’est pourquoi toutes les mesures en faveur des seniors sont actuellement en extinction. En effet, l’État permettait aux salariés âgés licenciés, jusqu’en 2011, de bénéficier de dispositifs de cessation d’activité afin de les accompagner jusqu’à leur retraite. Parmi les différents types d’aides, actuellement en extinction, les allocations spéciales du Fonds national pour l’emploi (ASFNE) et les cessations anticipées de certains travailleurs salariés (CATS) permettaient d’assurer un revenu de remplacement à des salariés âgés dont l’emploi était supprimé et dont les perspectives de reclassement étaient réduites. Ces dispositifs représentaient encore en 2012 près de 70 millions d’euros.
La disparition progressive du dispositif ASFNE a seulement permis de réduire la dotation de l’État de 25 millions d’euros environ, puisque celle-ci est passée de 76,3 millions d’euros en 2011 à 48,6 millions d’euros en 2013. Comme aucune nouvelle entrée n’est possible, elle a pour objet de financer le versement des allocations payées aux actuels bénéficiaires de l’ASFNE. Un cheminement similaire concerne les CATS, également en voie d'extinction. Depuis 2012, plus aucune adhésion n’étant possible, le nombre de bénéficiaires diminue (moins de 2 500 en 2012), ce qui autorise une diminution sensible des crédits : 17 millions d’euros ont été prévus en LFI 2013 contre 25 millions d’euros en LFI 2012.
Les effets des nouvelles orientations visant à accroître le taux d’activité des seniors ont donc conduit le nombre de bénéficiaires de l’ASFNE à diminuer de manière continue depuis 2003. Le nombre d’entrées dans le dispositif au premier semestre 2011 a été inférieur à 300, ce qui a conduit la DGEFP à adresser une instruction à ses services déconcentrés leur demandant de suspendre la conclusion des conventions ASFNE.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L'ASFNE
Nombre de conventions signées |
Entrées |
Stock moyen | |
2003 |
2 191 |
7 071 |
33 313 |
2004 |
1 913 |
4 855 |
27 472 |
2005 |
1 628 |
4 048 |
22 080 |
2006 |
1 452 |
3 631 |
17 545 |
2007 |
1 064 |
3 400 |
14 717 |
2008 |
666 |
1 892 |
12 358 |
2009 |
818 |
1 766 |
12 341 |
2010 |
498 |
1 070 |
7 642 |
2011 (au 30 juin) |
161 |
295 |
5 008 |
Source : ministère de l’Emploi.
Dans une certaine mesure, les entreprises ont pris le relais à travers des mécanismes de portage salarial. Ainsi, Sanofi a mis en place un système de ce type qui permet à un courtier de payer les salaires nets des préretraités. Cela pose néanmoins un problème pour les comptes de la sécurité sociale puisqu’une généralisation de ces dispositifs conduirait à creuser son déficit.
En période de fort chômage, ces dispositifs peuvent toutefois conserver une utilité pour accompagner les mutations économiques. En effet, les seniors, notamment ceux qui sont peu qualifiés, ont le plus faible taux de retour à l’emploi.
À cet égard, les rapporteurs estiment qu’il serait utile de réfléchir à développer des mécanismes d’activité à temps partiel pour les salariés âgés, avec un complément de revenus financés par l’État, voire à un rétablissement temporaire de l’ASFNE, le temps de trouver d’autres réponses à la crise. Le dispositif pourrait par ailleurs être amélioré en enjoignant les allocataires de procéder à une recherche active d’emploi. Entre l’abandon pur et simple de toute mesure en faveur des seniors et leur activation dans le sens d’une recherche active d’emploi, il y a ainsi une marge qui peut être renforcée, au-delà des avancées permises par le contrat de génération.
V. DÉVELOPPER DE NOUVEAUX OUTILS POUR AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS ET FACILITER LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES
Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont identifié certains manques en matière de législation relative à la prévention et à l’accompagnement des PSE et ont souhaité faire part de propositions à ce sujet.
1. Encadrer juridiquement la question des licenciements diffus
Certaines grandes entreprises procèdent à des restructurations d’impact très significatif au niveau national, mais avec un effet territorial diffus. Elles ne sont donc pas soumises à l’obligation de revitalisation dans sa forme actuelle.
Dans le secteur tertiaire notamment, l’emploi se répartit sur l’ensemble du territoire national (par exemple, dans la grande distribution, les sociétés d’assurances, les banques…) et les licenciements collectifs auxquels procèdent les entreprises de ce secteur peuvent impacter l’ensemble du territoire national de manière si diffuse que ces restructurations rendent quasiment impossible la signature de conventions de revitalisation sur tel ou tel bassin ou, au contraire, peuvent aboutir à la signature d’une multitude de conventions de revitalisation avec des montants très peu significatifs.
Le caractère géographiquement diffus des licenciements ne les fait pas pour autant échapper aux obligations prévues pour les licenciements économiques collectifs de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours. Pour les années 2010 à 2011, ils concerneraient 5 800 suppressions de postes. Les principaux secteurs concernés sont le secteur bancaire et le secteur de l’industrie pharmaceutique.
Deux problèmes se posent alors :
– un problème d’équité entre entreprises ;
– un problème d’accompagnement de ces licenciements diffus.
En premier lieu, il peut paraître inéquitable que les entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent à des licenciements diffus, dont l’impact est souvent important, ne soient pas soumises à une obligation de revitalisation comme les autres entreprises. C’est en ce sens que la proposition de loi présentée début 2009 par nos collègues députés Gérard Cherpion et Gaëtan Gorce, entendait instituer une obligation de revitalisation des territoires en cas de licenciements diffus. Pour l’année 2012, l’État évalue l’assiette des suppressions d’emplois rattachables à des licenciements diffus (pour les entreprises de plus de 1 000 salariés) à environ 3 000 emplois. Sur la base d’un assujettissement moyen limité à deux SMIC brut mensuel par emploi supprimé, la ressource ainsi dégagée serait d’environ 8 millions d’euros. D’autres estimations montrent qu’il serait possible de dégager de 12 à 15 millions d’euros de fonds de revitalisation chaque année (évaluation réalisée à partir des restructurations engagées ces trois dernières années pour lesquelles cette réforme aurait pu s’appliquer).
Les financements ainsi obtenus par cet élargissement de l’obligation de revitalisation permettraient d’améliorer le soutien à la revitalisation de certains bassins d’emplois. En effet, à la différence des zones les plus denses et les plus industrialisées, qui bénéficient des conventions de revitalisation, d’autres bassins d’emploi, le plus souvent situés en zone rurale, souvent couverts par un tissu de petites et moyennes entreprise (PME), ne bénéficient pas de dispositif de soutien suffisant en cas de crise. Les fonds ainsi dégagés pourraient ainsi abonder les ressources des fonds mutualisés par département ou élargir les ressources d’un FNRT transformé et rénové.
La question est pourtant de savoir à partir de quel niveau on peut considérer que le licenciement collectif diffus, sans pour autant remettre en cause l’équilibre d’un bassin d’emploi, aurait toutefois un impact globalement significatif sur l’ensemble du territoire national ? Le territoire national ayant une résilience aux chocs beaucoup plus forte qu’un simple bassin d’emploi, la logique conduit à ne pouvoir envisager qu’un nombre plus élevé de licenciements que dans le cadre d’un PSE classique. Un seuil de 100 licenciements, c'est-à-dire 10 fois le seuil réglementaire utilisé dans le cadre d’un PSE, pourrait être envisagé.
Enfin, la question de l’accompagnement de PSE de ce type pose également problème. Avant la disparition de fait des cellules de reclassement financées par l’État, le dispositif cellule inter-entreprises permettait d’accompagner, avec des moyens d’État, les salariés d’un secteur d’activité concerné par ce type de licenciement (par exemple dans le cas de la société American Express qui avait procédé à des licenciements diffus sur l’ensemble de la France). Le ministère du Travail avait alors décidé d’assujettir le groupe à la convention de revitalisation et l’enveloppe avait été répartie sur différents territoires en France, dont Saint-Dié. Désormais, les licenciements diffus touchent surtout les banques et la grande distribution mais aucune cellule spécifique n’est prévue. L’existence d’une cellule « de reconversion collective » pourrait éventuellement s’avérer utile dans ce cas.
2. Revenir sur l’exclusion des marchés publics de toutes les entreprises en procédure de sauvegarde
Il serait souhaitable que l’interdiction pour des entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde de soumissionner aux marchés publics ne soit pas systématique mais conditionnée à un examen individualisé de leur situation. Cette règle est trop rigide pour certaines d’entre elles dont les perspectives d’avenir sont rassurantes et pour lesquelles l’accès aux marchés publics est essentiel. Elle devrait donc être assouplie pour permettre une évaluation au cas par cas.
3. Renforcer l’assistance offerte aux salariés en cas de PSE
Selon la DARES, dans un quart des procédures étudiées, le comité d’entreprise a fait appel à un expert pour le conseiller dans la négociation des mesures du PSE. Les représentants du personnel n’utilisent ainsi qu’assez rarement cette possibilité offerte par la loi et financée par l’employeur. En effet, son coût peut grever la future enveloppe destinée au PSE. Ils recourent encore moins souvent à un expert pour analyser les motivations économiques du plan. L’État pourrait donc aider financièrement les comités d’entreprises à recourir à des experts pour envisager des formules alternatives au PSE.
Il est également possible de s’interroger sur la capacité des salariés à reprendre des entreprises sous forme de SCOP. Les Scop qui se sont créées dans ce cas de figure représentent aujourd’hui 8 % des 2 000 Scop françaises.
4. Encadrer le recours aux primes supra-légales afin de ne pas risquer d’altérer les parcours professionnels
Enfin, en cas de PSE, les mesures actives d’accompagnement des salariés licenciés sont généralement moins au cœur des négociations que les indemnités de licenciement dites « supra-légales ». Cette question, bien que traitée en dernière position de ce rapport, n’en est pas moins essentielle.
En effet, la judiciarisation importance des procédures collectives pour motif économique a déplacé le débat sur le terrain de la réparation des préjudices subis par les salariés concernés par les licenciements au détriment de la sécurisation de leurs parcours professionnels. En 2009, le montant des indemnités supra-légales de licenciement prévu dans les plans de sauvegarde de l’emploi s’est élevé en moyenne à 27 000 euros par salarié (source : échantillon MAAPSE de la DGEFP concernant 27 PSE), et peut atteindre jusqu’à 70 000 euros, et parfois bien au-delà, souvent à la suite d’un conflit social se traduisant par des procédures judiciaires ou des menaces de procédures.
Le recours aux indemnités supra-légales représente aussi un levier incitatif aux ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre d’un plan de départs volontaires. C’est alors l’équilibre du contenu du PSE qui est remis en cause. En effet, les salariés les plus fragiles peuvent être sensibles au montant des indemnités offertes par l’entreprise, sans percevoir l’intérêt de bénéficier de mesures d’accompagnement leur permettant de se réinsérer sur le marché du travail. Cette sensibilité peut être accrue s’agissant de salariés dont l’âge de liquidation de la pension de retraite est proche.
Pour les entreprises, la pression existant au niveau du versement de primes supra-légales s’apparente à « une double peine » : en effet l’entreprise peut être amenée à payer une indemnité supra-légale au moment du PSE puis à payer à nouveau dans le cadre du recours individuel du salarié devant les prud’hommes. Les sommes ainsi consacrées à l’indemnisation des salariés échappent à leur accompagnement professionnel. La mission a ainsi eu connaissance de cas où le montant cumulé versé au titre de la prime supra-légale était cinq fois supérieur à l’ensemble des moyens consacrés à la fois aux mesures du PSE et à la revitalisation.
L’encadrement des indemnités supra-légales n’en est pas moins un sujet délicat puisqu’il s’agit d’indemnités versées en sus des indemnités conventionnelles, dont le montant est fortement variable d’une convention collective à une autre. Il s’agit cependant, au sein d’un PSE, d’apprécier les conditions de mobilisation de ces indemnités dont la finalité peut être d’accompagner les projets professionnels des salariés volontaires au départ. Il convient alors de s’intéresser aux mesures d’accompagnement prévues au plan.
Dans ce cadre, si l’instauration dans la loi de sécurisation de l’emploi d’une procédure de validation ou d’homologation des PSE, renforcera bien l’exigence en matière de qualité des mesures d’accompagnement et, par conséquent, permettra que les DIRECCTE puissent apprécier plus finement l’équilibre et l’intérêt des mesures d’accompagnement prévus dans le PSE, il semble en pratique difficile de croire qu’un DIRECCTE puisse s’opposer à un plan homologué par les partenaires sociaux, dont l’accord aura pu être obtenu en échange de la promesse d’une forte prime supra-légale, en arguant de l’insuffisance des mesures d’accompagnement prises.
À ce titre, l’État, garant de l’intérêt général doit plutôt veiller à l’accompagnement des salariés plutôt qu’à un enrichissement dont l’expérience montre qu’il est aussi rapide que temporaire et qu’il peut de surcroît allonger la période de transition professionnelle car il n’incite pas à la reprise immédiate d’un emploi. La mission recommande à cet égard de réfléchir à un mécanisme de plafonnement ou d’encadrement des primes supra-légales, à travers des outils fiscaux ou juridiques qui restent à préciser, à hauteur de l’équivalent de 30 SMIC nets par salarié, ce qui correspond à la moyenne des primes versés dans le cadre d’un PSE. Ceci et permettrait d’éviter des primes individuelles excessives au regard des moyens mobilisés pour la reconversion professionnelle et pour le territoire. Une réforme en ce sens permettrait à l’administration de mieux vérifier si les mesures contenues dans un PSE sont bien tournées vers la réinsertion des salariés et leur accompagnement dans leur recherche d’emploi. En contrepartie, la mission recommande d’alléger le régime fiscal et social pesant sur les salariés qui acceptent un départ dans le cadre d’accords de GPEC afin de l’aligner sur le régime des indemnités perçues dans le cadre d’un PSE. Une telle mesure serait de nature à favoriser le développement d’une politique de gestion des ressources humaines active et responsable de la part des employeurs et des salariés.
Au cours de sa séance du 2 octobre 2013 à 9 heures 30, la Commission des Finances examine le présent rapport.
Un débat s’engage après l’exposé des rapporteurs.
Mme Valérie Rabault. Le montant des prêts accordés dans le cadre du fonds pour la revitalisation des territoires a été d’environ 135 millions d’euros sur trois ans. Ce montant n’est pas très élevé. Dispose-t-on d’un chiffrage des besoins en ce domaine ? Je souhaiterais également une précision sur le coût de l’extension du CSP aux contrats cours. En 2012, le coût global du CSP s’est élevé à près de 1,5 milliard d’euros. L’extension que vous proposez entraînerait-elle bien une dépense supplémentaire de 326 millions ? Vous proposez également de porter de deux à six mois le délai pour saisir la CCSF d’une remise de créances publiques. Disposez-vous du montant des créances de l’État échelonnées à ce jour ?
M. Jérôme Lambert. Vous avez raison de souligner que les fonds européens ne sont pas suffisamment employés au regard des sommes budgétées. Vous proposez de revoir certaines conditions d’attribution de ces fonds – celles relatives au seuil et à la période – mais ne pensez-vous pas que c’est l’ensemble des critères de déblocage qui devrait être révisé ? La commission des Affaires étrangères avait formulé des préconisations lors de la création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour que plus d’entreprises en difficulté puissent en bénéficier.
Mme Marie-Christine Dalloz. Avez-vous analysé la question de l’avenir des maisons de l’emploi ? Leur généralisation était prévue. Est-on toujours dans cette perspective ?
M. Laurent Wauquiez. Quelles sont vos propositions pour développer la synergie entre les acteurs concernés par l’anticipation des chocs économiques sur des territoires ? En effet les acteurs à mobiliser étant très nombreux, il serait important de savoir quels outils pourraient nous y aider.
M. Guillaume Bachelay. L’enjeu du retournement est, comme vous le soulignez, décisif et il est juste de dire que la France n’a pas de fonds de retournement spécifique. Il existe bien un fonds de consolidation et de développement qui peut apporter un financement après le règlement judiciaire, dans le cas d’une reprise, mais il intervient après. Vous nous proposez donc de se tourner vers la Banque publique d’investissement (BPI) mais ce type d’action ne fait pas partie de sa doctrine d’investissement même si celle-ci peut intervenir indirectement en soutenant les repreneurs et en apportant des financements aux fonds d’investissement dédiés au retournement. Je pense qu’il vaudrait mieux apporter une réponse définitive à cette question en préservant les missions de la BPI et en créant une structure idoine. Par ailleurs, je voudrais vous interroger sur la possibilité d’associer le représentant de l’État et la DIRECCTE à la phase amont du PSE.
M. Marc Francina. Permettre aux entreprises en redressement judiciaire de soumissionner aux marchés publics ne comporte-t-il pas des risques importants pour les collectivités locales qui devront prendre des experts et saisir le tribunal pour faire exécuter le marché si l’entreprise se révèle insolvable ?
M. Régis Juanico. Je voudrais souligner que pour ce qui est du volet social, les outils ont très fortement progressé que ce soit au travers des dispositifs de reclassement ou de formations de longue durée avec des résultats significatifs. Pour le volet revitalisation, l’aide directe à la création d’emplois par des PME fonctionne bien, en particulier après des licenciements intervenus dans de grands groupes industriels. Enfin , et cela a été expérimenté dans la Loire, quand plusieurs grands groupes ferment en même temps, il est intéressant de mutualiser les financements dans un fonds de revitalisation commun créant ainsi un effet de levier très important qui permet de faire venir de nouvelles entreprises.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Merci pour toutes ces questions qui manifestent l’intérêt que vous portez à nos propositions. Je vais revenir sur quelques points.
Mme la présidente, vous nous avez interrogés sur l’ouverture du CSP aux contrats courts, dont le montant est évalué à environ 325 millions d’euros. Pour limiter le coût de cette proposition, nous proposons de limiter le bénéfice du CSP aux seuls salariés précaires et aux salariés en contrats courts des entreprises sous-traitantes uniquement lorsque le nombre de licenciements dans l’entreprise donneuse d’ordre est supérieur à 50 salariés. Ce montant doit aussi être corrigé des apports positifs des CSP : les salariés licenciés qui font l’objet de cet accompagnement retrouvent beaucoup plus facilement un emploi. Cela devrait être encore plus vrai pour les salariés précaires qui sont plus mobiles.
Laurent Wauquiez a posé une question sur la pluralité des acteurs. Il est vrai que les chefs d’entreprise sont parfois perdus devant leur multiplicité (CCI, Pôle emploi, commissaire au redressement productif,…) et que leur coordination est primordiale. Les régions devraient anticiper de manière beaucoup plus forte les actions de formation et fournir une offre qui réponde aux attentes des territoires. Nous proposons donc d’établir une cartographie des besoins, des offres emplois et des compétences qui serve de base au diagnostic territorial, en s’approchant au plus des territoires, des bassins de vie. Nous avons suggéré que le commissaire au redressement productif, soit le chef de file pour le recueil des informations auprès des entreprises en difficulté. Quant au pilotage global au niveau des politiques d’emploi et de formation, il pourrait être assuré par les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).
Il est important que Pôle emploi, qui a une bonne connaissance de ce qui se passe sur les territoires, soit associé dès le début des discussions sur les PSE.
Nous souhaitons mettre fin à la pratique d’exclusion des marchés publics des entreprises engagées dans une procédure de redressement judiciaire. Il faut donner à une entreprise en redressement judiciaire qui a trouvé un accord sur l’échelonnement de ses dettes la possibilité de soumissionner aux marchés publics et de ne pas être identifiée comme « en difficulté » auprès des entreprises et des donneurs d’ordre.
M. Christophe Castaner, rapporteur. La BPI est, en effet, assez réservée sur les interventions de retournement. Elle ne peut intervenir qu’exceptionnellement sur le segment du capital retournement qui vise au redressement des entreprises. Le fonds de cotisation et de développement est un fonds de rebond mais pas de retournement. C’est pourquoi nous proposons de créer une branche de la BPI qui serait consacrée à cette mission.
Nous souhaitons également une réinvention totale du Fonds national de revitalisation des territoires (FNRT). Il doit être revitalisé et ses missions élargies sur le même principe que les fonds départementaux mutualisés. Réformé et alimenté par les montants perçus au titre de l’obligation de revitalisation pour licenciements diffus, il pourrait avoir les moyens d’intervenir.
Sur l’Europe, il faut revoir les conditions d’attribution du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Elles sont d’ailleurs en cours de révision. Il faut élargir les critères pour apporter davantage de souplesse. En France, seul le secteur automobile a profité de ce fonds.
Les maisons de l’emploi constituent un vrai sujet mais qui se situe hors de notre mission. On pourra en discuter lors de l’examen du budget du ministère de l’Emploi. Les engagements sont gelés en attendant les conclusions des évaluations. Un rapport de l’inspection générale des finances montre une très grande hétérogénéité des maisons de l’emploi. Mais il existe d’autres outils de pilotage, en particulier Pôle emploi, qui voit ses moyens fortement accrus pour accompagner les chômeurs sur les territoires.
Au niveau de la gouvernance globale, les CCREFP sont des instances qui doivent monter en puissance.
En ce qui concerne le volet revitalisation, une approche départementale doit permettre de répondre à la problématique des territoires. Le guide méthodologique de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, publié en juillet 2012, était extrêmement clair sur les aides directes mais il faut rester vigilant sur les effets d’aubaine.
Le fait de porter de deux à six mois le délai pour saisir la CCSF d’une remise de créances publiques ne coûterait que quelques millions d’euros.
La Commission autorise la publication du rapport d’information de la mission d’évaluation et de contrôle sur la prévention et l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi, en application de l’article 145 du Règlement.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
ET COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Auditions du 28 février 2013
À 9 heures 30 : Mme Emmanuelle WARGON, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle 95
À 10 heures 30 : MM. Pierre-André IMBERT, conseiller Entreprises, mutations économiques au cabinet du ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et Boris VALLAUD, conseiller cellule restructurations, au cabinet du ministre du Redressement productif 105
À 11 heures 30 : M. Jean-Pierre AUBERT, délégué à l’évolution des métiers et des emplois à la direction des ressources humaines de la SNCF 115
Auditions du 28 mars 2013
À 9 heures 30 : Mme Danièle GIUGANTI, directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Lorraine 123
À 10 heures 45 : Mme Florence DUMONTIER, directrice générale adjointe en charge de la direction des opérations de Pôle emploi 133
Auditions du 11 avril 2013
À 9 heures 30 : M. Sébastien RASPILLER, secrétaire général du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) 139
À 10 heures 30 : M. Gilles MERGY, délégué de l’Association des régions de France (ARF) pour l’emploi et la formation professionnelle 147
À 11 heures 30 : M. Jean-Denis COMBREXELLE, directeur général du travail 153
Auditions du 15 mai 2013
À 16 heures 30 : Mme Jeanne-Marie PROST, Médiatrice nationale du crédit au ministère de l'économie et des finances 161
À 17 heures 30 : M. Valérian PHAM NGOC, Commissaire au redressement productif, région Nord 169
À 18 heures 30 : M. Pierre BERETTI, président-directeur général d’ALTEDIA, conseils en management et outplacement 175
Auditions du 16 mai 2013
À 9 heures 45 : M. Patrice LOMBARD, vice-président d’OPCALIA, et M. Philippe HUGUENIN-GÉNIE, directeur général adjoint d’OPCALIA 183
À 10 heures 45 : M. Michel CADOT, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 190
À 11 heures 45 : MM. Jean-Christophe SCIBERRAS, président du bureau de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH) et Philippe DORGE, directeur des ressources humaines du groupe PSA 200
Auditions du 30 mai 2013
À 9 heures 30 : Table ronde avec les représentants des syndicats de salariés : M. Christian JANIN, secrétaire confédéral CFDT, Mme Sylvia VEITL, assistante confédérale Force Ouvrière, M. Michel BEAUGAS, secrétaire général de l’Union départementale Force Ouvrière du Calvados, M. Mohamed OUSSEDIK, secrétaire confédéral de la CGT, Mme Isabelle DEPUYDT, conseillère confédérale de la CGT 208
À 11 heures : Audition de représentants du MEDEF : M. Benoît ROGER-VASSELIN, président de la commission Relations du travail, Emploi, Formation, M. Antoine FOUCHER, directeur des Relations sociales et Mme Kristelle HOURQUES, chargée de mission senior de la direction des Affaires publiques 217
Audition du 13 juin 2013
À 9 heures : M. Christian CAUVET, commissaire au redressement productif, région Haute-Normandie 226
Audition du 11 septembre 2013
À 16 heures 15 : M. Michel SAPIN, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 233
Auditions lors de déplacements
Déplacement dans l’Orne du 18 juillet 2013
– Mme Sylvia LECARDRONNEL (Directrice Territoriale Pôle Emploi Orne)
– Des salariés de Pôle Emploi d’Alençon
– M. Philippe RETO (Directrice Adjoint Direccte Basse-Normandie)
– Mme Corinne DIGNE (Service Mutations Économiques Direccte Orne)
– M. Claude RENAULT (Président Association Anciens Salariés de Moulinex
– Mme Régine NOUVEL (Responsable Ressources Humaines Trophy Group)
– M. le Directeur Adjoint du site fertois de Trophy Group
Déplacement du lundi 3 juin 2013
– M. Patrick MADDALONE : DIRECCTE adjoint de PACA, chef du Pôle 3E. Exerce les fonctions de CRP par intérim et M. Gilles BARSACQ : secrétaire Général pour les Affaires Régionales
– M. Bernard MOREL, vice-président en charge des questions économiques du Conseil Régional PACA, Mme Sophie CAMARD, présidente de la Commission Emploi / développement économique, enseignement supérieur, recherche et innovation Conseil Régional PACA, M. Lanislas POLSKI, élu régional dans les affaires relevant du développement économique des entreprises. Conseil Régional PACA, Mme Pascale GERARD, vice-Présidente à la Formation professionnelle et apprentissage. Conseil Régional PACA, M. Thierry FELLMANN, directeur général adjoint de l’administration, chargé du pôle Innovation emploi formation. Conseil Régional PACA
– Jean-Michel COOK, DRH Entreprise Atmel à Rousset.
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Audition du jeudi 28 février 2013
À 9 heures 30 : Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, accompagnée de M. Pierre Ramain, en charge de la sous-direction Mutations de l'emploi et du développement de l'activité à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).
Coprésidence de M. Christophe Castaner et de Mme Véronique Louwagie, rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Nous inaugurons aujourd’hui, dans le cadre de la MEC, la première série d’auditions consacrées à la prévention et à l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi. Il n’est pas nécessaire de souligner l’importance de ce sujet alors que 1 000 à 1 200 plans sociaux sont mis en œuvre chaque année, niveau constant d’une année sur l’autre, même si une appréciation en nombre et non en volume fait mal ressortir leur impact réel.
Cette mission d’évaluation et de contrôle ne porte pas sur les plans sociaux, mais plus précisément sur leur accompagnement par la puissance publique. Nous auditionnerons au cours des prochaines semaines les personnes en prises avec ce sujet et, notamment celles exerçant au sein de l’État, des collectivités locales ou des cabinets ministériels. Conformément à la tradition de la MEC, nous accueillerons également tout au long de nos travaux des magistrats de la Cour des comptes, Mmes Corinne Soussia et Dominique Lassus-Minvielle.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Nous avons souhaité centrer cette mission sur l’action de prévention conduite par la puissance publique et avons donc exclu les actions menées par les organismes financiers, les tribunaux de commerce ou d’autres acteurs. Les auditions d’aujourd’hui visent à dresser un panorama général des approches administratives et des dispositifs publics d’accompagnement des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Madame Wargon, le portefeuille de l’important poste que vous occupez est très large, puisque vous conduisez, coordonnez et évaluez la mise en œuvre de ces dispositifs de la politique de l’emploi. Quatre sous-directions – ayant en charge le retour à l’emploi, la formation et le contrôle, les mutations de l’emploi et le développement de l’activité, et le service public de l’emploi (SPE) – sont placées sous votre autorité.
Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle. Pierre Ramain vous présentera l’action globale de la puissance publique en matière de PSE et je consacrerai plus particulièrement mon intervention à l’Accord national interprofessionnel (ANI), signé le 11 janvier dernier, et dont le projet de loi opérant la transposition sera bientôt soumis au Conseil de ministres puis à l’Assemblée nationale.
M. Pierre Ramain, en charge de la sous-direction Mutations de l’emploi et du développement de l’activité. L’action de l’État et l’encadrement juridique des PSE ont eu pour objectif, depuis plus de quarante ans, d’accroître l’anticipation des mutations économiques, de renforcer la concertation et le dialogue social au sein de l’entreprise, et d’affermir les dispositifs d’accompagnement des plans.
L’action de prévention cherche à pressentir le plus tôt possible les évolutions qui donneront lieu à des restructurations, afin de gérer ces dernières dans un contexte apaisé et d’éviter les PSE. En renforçant les mécanismes d’anticipation, l’ANI prolonge un mouvement amorcé il y a plusieurs années. Le dialogue social au sein de l’entreprise se fortifie également depuis quelques années. Il s’appuie notamment sur le rôle historique important confié à l’information et à la consultation du comité d’entreprise et sur la place de la négociation, place consolidée par l’ANI.
Cette politique repose sur l’idée selon laquelle l’anticipation et la concertation permettent de construire des solutions innovantes en matière d’accompagnement. Les modalités de l’accompagnement des PSE ont en effet varié dans le temps : pendant trente ans, elles ont consisté principalement dans des « mesures d’âge » grâce aux dispositifs – publics ou privés – de préretraite, avant que, au début des années 1990, puis avec l’arrêt du retrait massif des salariés en fin de carrière du marché du travail, n’émergent les aides au reclassement, les plans sociaux, puis les PSE. Les mesures d’accompagnement contiennent un volet de droit commun « socle », le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), à destination des PME et des entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, et un volet de mobilisation des entreprises, prenant la forme d’un investissement financier et d’outils comme le PSE et le congé de reclassement – mesure alternative au CSP pour les entreprises de plus de 1 000 salariés.
Mme Emmanuelle Wargon. L’ANI renforce la tendance que Pierre Ramain vient de présenter. Il repose sur deux axes, l’anticipation et la négociation. Il crée de nouvelles règles qui vont permettre aux salariés d’avoir différemment accès à l’information grâce à leurs institutions représentatives et à leur présence dans les conseils d’administration. L’accord pose le principe de la création d’une base de données unifiée qui permettra aux représentants du personnel de bénéficier d’une information globale et consolidée, alors qu’elle n’était jusqu’à présent que ciblée et limitée à chaque négociation ou consultation du comité d’entreprise. Cette base aidera à établir un diagnostic sur la situation de l’entreprise et sur ses orientations stratégiques à trois ans. Il s’agit d’un pari fondé sur la diffusion d’informations exhaustives et stratégiques aux représentants du personnel. Ainsi, mieux informés, les salariés ne ressentiront plus un éventuel PSE comme un coup de tonnerre. La présence des salariés dans les conseils d’administration des entreprises employant plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 dans le monde constitue la mesure la plus en pointe de cette politique.
L’accord et son avant-projet de transposition législative prévoient un profond renouvellement des procédures du PSE. Ce dernier pourra soit découler d’une démarche unilatérale, soit résulter d’une négociation, ce qui est nouveau. Aujourd’hui, en effet, les entreprises négocient des accords uniquement de méthode alors que le contenu du plan reste un document unilatéral, même s’il peut faire l’objet de discussions. Ce dernier ne disparaîtra pas, mais il sera soumis à l’administration qui disposera d’un délai de vingt-et-un jours pour l’homologuer. En revanche, lorsque le plan fera suite à une négociation, l’administration le validera dans les huit jours. Dans les deux cas, l’administration devient le référent du patronat et des organisations représentatives du personnel tout au long du processus. Elle est en effet informée en amont et veille au respect de la procédure et à la qualité du plan. Pour que la négociation aboutisse, l’accord doit être majoritaire. Sa qualité est alors présumée et l’administration se contentera d’une vérification plus formelle – notamment sur le caractère bien majoritaire de l’accord. Si, en revanche, le plan est unilatéral, l’administration analysera son contenu – en vérifiant la présence de l’ensemble des mesures de reclassement et le caractère favorable des propositions faites aux salariés – au regard de la situation de l’entreprise.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Le rôle de l’administration variera suivant le caractère négocié ou unilatéral du plan. Cette situation pose question, car elle comporte le risque de voir l’administration s’immiscer davantage dans la gestion de l’entreprise.
Si l’ANI permettait de développer la démocratie sociale et, par là, d’éviter les coups de tonnerre, il jouerait un rôle positif. Néanmoins, on devrait pouvoir dépasser cette dimension qui relève de la seule communication pour mieux anticiper l’évolution de la situation de l’entreprise. Monsieur Ramain, vous avez évoqué ce point lorsque vous avez décrit les objectifs des PSE, mais des doutes subsistent sur la possibilité de favoriser l’anticipation lorsque des PSE – et donc des licenciements de masse – sont mis en œuvre. À l’occasion de la transposition de l’ANI, existe-t-il des pistes pour accroître les capacités d’anticipation ?
M. Christophe Castaner, rapporteur. Sur la question de l’anticipation, les mutations des sites stratégiques se trouvent au cœur de la vigilance du Gouvernement – quelle que soit son orientation politique – et les évolutions des filières donnent lieu à la mise en place de nouveaux outils. Nous avons cependant choisi de ne pas inclure ces sujets dans le périmètre de notre mission – ils nous conduiraient trop en amont – et de nous concentrer sur l’anticipation, au sein de l’entreprise, lorsque des perspectives de tension se dessinent.
Si le rôle de l’État reste formel dans le cas d’un accord négocié, ce ne sera pas le cas pour les PSE unilatéraux. Dès lors, comment rendre objectives les conditions de validation des plans sociaux ? Pensez-vous que les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) possèdent les instruments nécessaires à cette objectivation ? Étudiez-vous ce sujet sur lequel nous pourrions également nous mobiliser dans les semaines à venir ?
Qu’est-ce qui est évalué dans les PSE ? Pendant longtemps, les plans sociaux se contentaient de comporter des mesures quantitatives qui associaient un emploi remplacé à un emploi supprimé, mais qui ne possédaient aucun caractère structurant pour les personnes comme pour les territoires. Dispose-t-on d’outils pour évaluer leur restructuration ? Ne pourrait-on pas saisir l’occasion de l’ANI pour aborder la revitalisation sur une base collective et non individuelle ?
Mme Emmanuelle Wargon. Il me paraît fondé d’établir une différence selon que la négociation ait abouti ou non. Cela répond à la volonté explicite des signataires de l’ANI ; ce dernier ne prévoyait d’ailleurs pas d’intervention de l’administration dans le cas où la négociation se concluait par un accord. Cette intervention sera un peu plus que formelle, puisqu’elle aura vocation à vérifier la régularité de la procédure et le caractère majoritaire de l’accord, mais également le respect de critères d’ordre public auxquels l’entreprise n’aura pas la faculté de déroger.
M. Pierre Ramain. Parmi les points qui ne peuvent souffrir de dérogation figurent la proposition du CSP dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et du congé de reclassement dans celles en comportant plus de 1 000, mais également la nécessité de la formation et de l’adaptation des salariés à l’évolution de leur poste – même si les modalités de leur mise en œuvre peuvent être négociées. Pour ce dernier critère, si un accord stipulait que l’employeur se trouvait délié de cette obligation – en contrepartie du versement d’une indemnité substantielle par exemple –, nous nous retrouverions face à un problème important.
Mme Emmanuelle Wargon. L’ANI et le projet de loi prévoient par ailleurs une présence accrue de l’administration tout au long de la discussion et, dans bien des cas, nous ne saurons qu’à la fin de la négociation si le plan reposera sur un accord majoritaire ou sur un document unilatéral. Il est même vraisemblable que des plans contiendront des parties négociées et d’autres unilatérales. Les syndicats pourraient, en effet, accepter quelques éléments d’un PSE comme les mesures de reclassement, et en refuser d’autres comme les critères d’ordre – qui sélectionnent les personnes auxquelles des postes sont proposés. Le paquet global de la négociation sera évalué par l’administration, d’où son suivi de l’ensemble de la procédure. Aujourd’hui, l’administration est déjà informée en amont des PSE de grande taille ; elle reste en contact régulier avec l’entreprise, elle passe des messages sur le contenu du plan – notamment au moyen de lettres d’observation si l’entreprise rencontre des difficultés – et se trouve ainsi associée à l’ensemble du processus.
Les critères d’homologation du plan et la nature des outils dont disposeront les DIRECCTE pour les contrôler constituent une question centrale. La loi posera les principes généraux, leur application sera régie par des décrets, mais c’est la pratique qui s’avérera in fine déterminante. Une circulaire de mise en œuvre du texte sera donc nécessaire pour fournir des indications sur la procédure d’homologation. À ce stade, nous restons réticents à l’idée d’insérer des critères dans la loi, car leur appréciation doit s’opérer au cas par cas. Ni la validation ni l’homologation ne portent sur le motif économique. L’examen des conditions économiques ayant entraîné l’entreprise à licencier relève du juge judiciaire. Or la Cour de cassation, dans son arrêt Viveo du 3 mai 2012, a refusé d’annuler un PSE pour défaut de motif économique. Le juge judiciaire peut donc constater l’absence de fondement économique, en tirer des conséquences sur les licenciements en proposant une réintégration – avec l’accord de l’entreprise – ou une indemnisation, mais ne peut pas pour autant déclarer la nullité du PSE. Tel est le droit positif que nous n’avons pas l’intention de modifier.
Puisque l’administration interviendra sur la qualité de la procédure, son action devra reposer sur la notion de proportionnalité : plus l’entreprise disposera de moyens pour accompagner ses salariés et plus l’administration se montrera exigeante. L’appréciation ne portera donc pas sur le motif, mais sur l’ampleur du plan et le devenir des salariés au regard de la situation de l’entreprise. Ainsi, un groupe en bonne santé financière, qui déciderait de se séparer d’une activité qu’il estimerait condamnée, ferait l’objet d’une exigence quantitative et qualitative très poussée de la part de l’administration, afin qu’il investisse significativement dans le reclassement et l’indemnisation de ses salariés. Les orientations et les outils fournis aux services seront conçus à partir de ce concept de proportionnalité.
Comme vous l’avez affirmé monsieur Castaner, se pencher sur l’anticipation des mutations économiques conduit rapidement à analyser les risques par filière. Les analyses menées dans les comités stratégiques de filières, nationaux et régionaux, visent à accompagner les branches – et donc les entreprises – dans une réflexion stratégique portant sur les métiers menacés ou ceux qui sont à développer, ainsi que sur la façon d’adapter les compétences, par une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et de formation intelligente, pour atténuer les effets des mutations économiques. Nous ne distinguons pas ces deux politiques qui forment un continuum. Des travaux d’anticipation à froid permettent parfois d’éviter les plans sociaux, mais lorsqu’ils sont mis en place, notre mission consiste à les accompagner.
M. Pierre Ramain. L’obligation d’accompagnement territorial des restructurations date de 2002 ; elle repose principalement sur la revitalisation des bassins d’emploi, impératif s’imposant aux groupes de plus de 1 000 salariés. Lorsque ces groupes procèdent à une restructuration ayant un impact territorial, une convention signée avec le préfet met en place des mesures d’accompagnement et d’atténuation de ses conséquences. Cette procédure de revitalisation a connu une mise en œuvre assez lente entre 2002 et 2005, mais son utilisation a crû notablement depuis. Ainsi, entre 130 et 140 conventions de revitalisation sont signées chaque année. Les régions connaissant les restructurations industrielles les plus nombreuses – l’Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la région Rhône-Alpes, la Lorraine, et la Champagne-Ardenne – en signent davantage que d’autres. L’ensemble de ces conventions engage environ 75 à 80 millions d’euros en moyenne chaque année au titre de la revitalisation et constitue donc un véritable levier dans les territoires où elles existent. L’une des difficultés actuelles réside dans le fait que des restructurations s’opèrent sans revitalisation, soit parce que l’entreprise n’est pas soumise à cette obligation en raison de sa taille, soit parce qu’elle en est exonérée en cas de liquidation ou de redressement judiciaires. Ainsi, lorsque la Bretagne subit la liquidation du pôle frais de l’entreprise Doux, l’absence de cette obligation de revitalisation a contraint à mobiliser d’autres outils publics, plus complexes et moins souples d’utilisation.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Malgré l’arrêt Viveo, des tribunaux – la cour d’appel de Créteil en particulier – ont recommencé à contester le motif économique, d’où le développement d’un climat d’incertitude. Ne pourrait-on pas profiter de la transposition dans la loi de l’ANI pour aborder ce sujet ?
Au sujet de la proportionnalité, lorsqu’une entreprise dépourvue de difficultés financières élabore un PSE pour des raisons stratégiques, son engagement financier dans le plan doit se situer à un niveau élevé. Il convient d’insister sur ce point.
Vous avez rapidement abordé les volets GPEC et formation devant accompagner l’anticipation des mutations économiques. Un projet de loi sur la décentralisation sera probablement transmis au Parlement d’ici à l’été ; il devrait renforcer le rôle de chef de file des régions, y compris dans le domaine des formations prescrites par Pôle emploi, ce qui justifie la nécessité de développer une gouvernance performante.
Le nombre des acteurs intervenant dans la procédure du PSE se multiplie. Dans ce maquis, la gouvernance de l’anticipation et de l’accompagnement des plans sociaux vous paraît-elle satisfaisante ?
Mme Emmanuelle Wargon. Le texte actuel du projet de loi supprime le référé et la saisine du juge judiciaire au cours de la procédure d’élaboration du PSE. Il renvoie le recours au juge à l’adoption du PSE et donc à une période où les licenciements ont déjà été mis en œuvre. La procédure se déroule sous le regard de l’administration qui peut être saisie si les organisations représentatives du personnel estiment que l’information dont ils disposent est insuffisante ; dans ce cas, la DIRECCTE peut enjoindre l’entreprise de fournir des données complémentaires. Une fois la phase administrative achevée par l’homologation ou la validation du plan, les licenciements peuvent être contestés devant le juge judiciaire, qui indemnise le cas échéant les salariés, mais ne peut annuler le PSE. C’est désormais le juge administratif qui détient la compétence d’invalider le plan en cas d’absence de contenu. Le rôle du juge judiciaire évoluera donc fortement par rapport à la procédure actuelle.
Nous n’avons pas encore entamé le travail sur la nature des instructions que nous fournirons aux services, mais nous adapterons les exigences relatives au contenu du PSE à la situation de l’entreprise.
La délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) dispose déjà d’outils de GPEC et de formation. Elle signe régulièrement des accords avec des branches pour conduire des études stratégiques sur l’évolution des emplois et des compétences – les contrats d’études prospectives (CEP) – et mettre en œuvre des actions de développement de l’emploi et des compétences (ADEC) et des engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) – qui se répercutent dans les entreprises. Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) proposent aux entreprises – qui sont leurs adhérents – des formations conformes au contenu de ces accords, en lien avec les DIRECCTE. Ce système évoluera avec la mise en œuvre de l’ANI, qui prévoit la création d’un compte personnel de formation – outil de développement de la portabilité des droits à la formation pour le salarié licencié ou non –, et le vote d’une loi sur la formation professionnelle. Nous conduisons une réflexion sur l’évolution de ce système, autour de ce compte personnel de formation et compte tenu du transfert de la politique de formation des non-salariés aux régions.
Il est vrai que ces sujets mettent en scène de multiples acteurs. L’État et les collectivités locales agissent dans le domaine de la revitalisation. Ainsi, à Aulnay-sous-Bois, le préfet anime la concertation dans le dossier PSA avec les maires des communes concernées par le plan pour faire émerger un consensus sur l’accueil des licenciés économiques du site par d’autres entreprises. Cette configuration de dialogue entre l’État et les collectivités locales se retrouvera dans la formation des demandeurs d’emploi. Si les régions sont compétentes pour la formation des non-salariés, Pôle emploi reste un établissement public gouverné de manière tripartite avec les partenaires sociaux et l’État développe une politique de développement des emplois et des compétences. La gouvernance à quatre pôles – régions, État, syndicats et organisations patronales – se renforcera dans le but d’élaborer une politique d’emploi et de formation cohérente dans chaque territoire.
M. Philippe Vigier. L’ANI ne comporte pas beaucoup de dispositions sur la revitalisation. Je suis l’élu d’un département dans lequel un troisième plan se met en œuvre. À chaque fois, 400 salariés sont concernés. Ce que vous venez d’évoquer sur la gouvernance, nous le vivons au quotidien. Les régions disposent d’enveloppes microscopiques pour leurs fonds d’urgence d’intervention pour la formation, alors que le plan régional de formation professionnel (PRFP) est préparé six mois avant le début de l’année civile pour l’année à venir. Au vu des perspectives en matière d’emploi pour l’année 2013, comment pourrions-nous mieux articuler les PRFP avec la cellule de veille et l’action d’anticipation sur les filières ? La région Centre vit l’hécatombe annoncée dans les secteurs de l’automobile, de la pharmacie et du médicament. Rien n’ayant été établi en amont, comment allons-nous faire face ?
La DIRECCTE n’est pas humainement équipée face à certaines entreprises. Dans ma région, trois collaborateurs de très bon niveau, travaillant soixante-dix heures par semaine dans une préfecture à la DIRECCTE, doivent suivre l’accord élaboré par Johnson&Johnson, qui dispose de moyens très importants et recourt à des cabinets d’avocats spécialisés. Vingt-quatre mois ont été nécessaires pour que le tribunal valide le plan ; il est heureux que l’ANI prévoie le raccourcissement de ces délais. D’un côté, le plan de revitalisation s’élève à 2 millions d’euros pour 400 salariés, enveloppe ridicule que le préfet fait distribuer par un cabinet payé très cher pour des résultats qui restent à évaluer ; de l’autre, les indemnités légales et supra légales accordées aux salariés pour acheter la paix sociale se montent à 10 millions d’euros. L’outil efficace pour favoriser la réindustrialisation et l’emploi se trouve ainsi cinq fois moins doté. Cette situation s’avère d’autant plus préjudiciable qu’à Châteaudun ou à Auneau en Eure-et-Loir, le nombre d’entreprises susceptibles d’embaucher des salariés licenciés est bien plus faible qu’à Aulnay-sous-Bois ! Sur la gouvernance et la proportionnalité, nous devons progresser en pragmatisme et en efficacité.
Vous avez affirmé qu’un même accord pourrait contenir des parties négociées et d’autres adoptées unilatéralement. Il convient d’être prudent face à un tel découpage car un accord peut être obtenu grâce à l’octroi d’indemnités légales et supra légales. Ainsi, dans ma région, chaque salarié a perçu entre 150 000 et 200 000 euros, alors que leur rémunération mensuelle était comprise entre 1 800 et 2 000 euros nets dans des bassins d’emploi où la moyenne salariale s’élève à 1 400 euros par mois. Ces salariés ne sont plus réemployables à la suite de tels accords. J’appelle votre attention sur l’effet d’aubaine induit par de tels plans : les syndicats puissants, malgré la perception des indemnités légales et supra légales, saisissent les conseils des prud’hommes et font condamner l’entreprise a posteriori. Cette dernière paie donc à deux reprises, ce qui pose un véritable problème d’image pour notre pays.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Au-delà de son témoignage, M. Vigier pose la question des indemnités supra légales et de l’incertitude juridique dans laquelle évoluent les acteurs économiques. En termes d’attractivité du territoire, ces dimensions ne constituent pas des atouts.
Mme Eva Sas. Lorsque j’occupais, encore récemment, la fonction d’experte auprès des comités d’entreprise, nous évaluions la pertinence des mesures d’accompagnement du plan social au regard des moyens, non de l’entreprise, mais du groupe. Il est nécessaire, à mon sens, de conserver cette dimension, car une entreprise peut connaître des difficultés dans un groupe en bonne santé qui possède, en réalité, les moyens de mettre en œuvre des mesures sociales de qualité pour accompagner le départ des salariés. Prendrez-vous en compte cette dimension ?
L’ANI ne concerne que le droit individuel à la formation (DIF). Quels problèmes découleraient de la faculté de porter des droits à la formation autres que le DIF et quelles sont les difficultés à résoudre pour que les salariés disposent d’un compte individuel de formation complet ?
Avez-vous réfléchi à l’élaboration d’outils incitant les entreprises à dévoiler leurs orientations stratégiques ? En effet, malgré la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, très peu d’entreprises font part de leurs plans de long terme. Le souci des entreprises de ne pas livrer des informations essentielles à la concurrence se comprend parfaitement, aussi ne pourrait-on pas imaginer des mécanismes d’incitation financière récompensant – notamment par le biais de l’obligation de revitalisation – les entreprises ayant anticipé la gestion des branches en déclin et ayant ainsi permis aux salariés de partir dans de bonnes conditions et de se reconvertir ?
Mme Emmanuelle Wargon. Nous allons développer la prise en compte des mutations économiques anticipées dans la conception de la formation. Nous nous situons au début d’un processus d’alignement stratégique entre les régions, l’État et les partenaires sociaux qui n’existe pas actuellement. La DGEFP dispose d’outils nationaux : nous avons, par exemple, conduit une analyse commune avec l’industrie pharmaceutique qui nous a fourni des données précises sur les risques encourus par certains sites de production, sur les visiteurs médicaux et sur les opportunités en matière de recherche et de développement. Comment créer une stratégie régionale moins formelle qu’un plan adopté trop en amont pour tenir compte de la réalité ? Dans le futur projet de loi sur la décentralisation, nous tâcherons de rendre le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) plus opérationnel. La région PACA tente de mettre en place un fonds de continuité des parcours en sollicitant financièrement l’État et en demandant aux partenaires sociaux d’y participer. À moyen terme, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pourrait donner une dimension plus régionale à son action. Cette question de la consolidation d’une stratégie entre la collectivité, l’État et les partenaires sociaux est importante. Les lois sur la décentralisation et la formation professionnelle apporteront une partie de la réponse et nous contraindront à avancer.
Dans le cadre du plan pour la compétitivité et l’emploi issu du rapport Gallois, le Gouvernement a annoncé la création de dix plates-formes d’analyse et d’appui aux mutations économiques. Des projets ont été présentés et douze sont en voie de labellisation. Ils reposent tous sur la réunion d’acteurs territoriaux d’un bassin d’emploi – la région, les partenaires sociaux, la maison de l’emploi, les autres collectivités locales et l’État – qui élaborent un diagnostic stratégique et identifient des moyens de formation.
M. Philippe Vigier. Auprès de qui les projets ont-ils été sollicités ?
Mme Emmanuelle Wargon. Auprès des DIRECCTE et des préfets qui ont, ensuite, sollicité les élus. Ce sont des financements de l’État, mais ces projets associent les collectivités locales qui se retrouvent parfois en chef de file. Après la prochaine étape de décentralisation, il sera intéressant de solliciter directement les collectivités – régions ou intercommunalités – en même temps que l’État.
Au vu de la situation budgétaire, les DIRECCTE ne bénéficieront pas de renforts humains massifs. Par ailleurs, elles suivent déjà les principaux plans sociaux, si bien que l’enjeu réside davantage dans l’amélioration de l’articulation avec l’échelon national. La DGEFP et la direction générale du travail (DGT) disposent de ressources administratives permettant de connaître des principales procédures en cours. En revanche, face à une entreprise américaine disposant d’un puissant cabinet d’avocats, l’État devra se doter de son propre conseil juridique. Le développement de l’interaction entre les services de terrain et les services nationaux leur apportant une aide constitue le principal sujet à traiter. Pour ce faire, nous formaliserons et valoriserons la présence déjà existante des DIRECCTE à effectif constant, par une réallocation interne de moyens.
M. Pierre Ramain. Les DIRECCTE adressent des observations dans 85 % des PSE et ont donc déjà adopté un rôle d’analyse et de suggestion.
Mme Emmanuelle Wargon. Si la loi traduit l’ANI sur l’impossibilité de recourir au référé devant le juge judiciaire au cours de la procédure, le rapport de force évoluera. L’homologation et la validation du plan ne pourront plus être contestées que devant le juge administratif. Les licenciements ne pourront être remis en cause devant les prud’hommes qu’une fois qu’ils auront été réalisés, si bien que les éventuelles sanctions ne seront qu’indemnitaires.
M. Pierre Ramain. L’homologation du plan par l’administration ne portera pas sur le montant des indemnités. Si un plan comporte des indemnités supra légales importantes, les mesures d’accompagnement des salariés contenues dans le plan devront être ambitieuses. Dans le cas contraire, l’administration n’homologuera pas le plan.
Mme Emmanuelle Wargon. La proportionnalité s’appréciera bien à l’échelle du groupe et pas à celle de l’entreprise ou de l’établissement.
Le versement de fortes indemnités individuelles supra légales pourra fait l’objet d’un accord, mais il ne pourra servir de justification à l’entreprise pour ne pas financer les mesures collectives devant figurer dans le plan. L’administration veillera à la présence de dispositifs d’accompagnement des salariés et de revitalisation du bassin d’emploi. Elles conditionneront l’homologation du plan, si bien que l’entreprise devra en prévoir le financement. Cela ne sera pas forcément facile à imposer, mais nous devrons présenter ce critère, dès le début de la négociation, comme une condition sine qua non à l’homologation du PSE.
M. Pierre Ramain. Il convient d’encourager les bonnes pratiques existantes en matière d’anticipation pour le reclassement et pour la revitalisation. Dans la prise en compte des mesures sociales et de la revitalisation, la DIRECCTE devra – avant toute homologation – faire preuve de souplesse avec les entreprises qui ont déjà agi dans ces domaines – par exemple en facilitant la mobilité de ses emplois menacés en interne ou dans d’autres entreprises du bassin d’emploi – et de fermeté avec celles qui n’ont mené aucune action de formation pour leurs salariés. Nous avons déjà transmis ces instructions dans le cadre de la signature des conventions de revitalisation, mais l’application de l’ANI constituera l’occasion de renforcer la portée de ce message.
Mme Emmanuelle Wargon. Nous venons d’engager une réflexion sur le compte individuel de formation. Il fait l’objet d’un article de l’ANI. Le Gouvernement a choisi de transposer le principe général dans le projet de loi, sans entrer dans le détail de la mécanique afin de laisser le temps à l’État, aux partenaires sociaux et aux régions de discuter de la façon de remplir ce compte. Pour l’instant, l’accord prévoit son alimentation à partir du DIF. On pourrait concevoir un apport supplémentaire, mais cela poserait des questions de financement pour les entreprises, de mobilisation des droits par les demandeurs d’emploi et d’ouverture des comptes pour les personnes entrant sur le marché du travail avec une formation initiale très limitée. La transposition législative de l’accord ne répond pas à ces interrogations, ne serait-ce que parce que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) rendra des conclusions sur ce sujet le mois prochain. Du coup, le véhicule législatif traitant cette question devrait être le texte sur la formation professionnelle.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Nous avons bien noté le rôle central que jouera la DIRECCTE dans le suivi des accords. Nous retenons également que la proportionnalité constituera un élément important mais j’avoue ma perplexité sur les accords dont certaines parties seraient négociées et d’autres résulteraient d’une démarche unilatérale. Les partenaires sociaux ont-ils évoqué cette possible cohabitation à l’intérieur d’un même plan ou n’ont-ils pas perçu cette éventualité que nous déduisons du texte de l’ANI ?
Mme Emmanuelle Wargon. Les partenaires sociaux ont esquissé les grandes lignes de la réforme des procédures avec l’idée que les deux voies étaient alternatives et non cumulatives. À l’occasion des contacts que nous avons noués avec plusieurs directeurs de ressources humaines pour transposer cet accord dans un projet de loi, nous nous sommes aperçus que ces deux options pouvaient se superposer. Nous ne savons pas précisément quelle sera la part des accords négociés, des documents unilatéraux et des plans mixtes. Nous avons simplement veillé, lors de la rédaction du projet de loi, à ce que la cohérence du système soit maintenue et qu’aucun vide juridique n’advienne en cas de plan contenant des parties négociées et d’autres unilatérales. Mais peut-être que cette hypothèse ne se vérifiera-t-elle jamais. Il est difficile de déterminer si le nombre d’accords signés sera inférieur au souhait des partenaires sociaux et, pour ceux qui le seront, si l’entente portera sur l’intégralité du plan. Les signataires de l’ANI ont fait le pari que cet accord favoriserait l’adoption de davantage de PSE négociés.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Nous aurions encore beaucoup de questions à vous poser – je pense notamment à celle des licenciements diffus –, mais nous aurons l’occasion de vous adresser des questions par écrit.
Nous voyons poindre dans l’ANI un risque de contradiction entre deux volontés : d’une part, la réaffirmation de la place de l’État dans une fonction de régulateur, de l’autre, le souhait de faire confiance au dialogue social dans l’entreprise. Or ces deux objectifs pourraient apparaître incompatibles dans certaines occasions. Si le premier plan négocié à la suite du vote de la loi octroyait des indemnités supra légales élevées et négligeait les territoires, il serait étonnant que le directeur de la DIRECCTE accordât son homologation au plan sans réserve. Je salue la double ambition d’un État régulateur et facilitateur du dialogue social, mais il convient d’être conscient du danger de confrontation qu’elle porte.
Audition du jeudi 28 février 2013
À 10 heures 40 : M. Pierre-André Imbert, conseiller Entreprises et mutations économiques au cabinet du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Boris Vallaud, conseiller cellule restructurations au cabinet du ministre du redressement productif
Coprésidence de M. Christophe Castaner et de Mme Véronique Louwagie, rapporteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Notre mission a fait le choix de vous entendre conjointement, messieurs, car vous représentez l’un et l’autre des ministres impliqués dans le suivi des plans sociaux, de leur amont à leur aval. Nous constatons que l’anticipation et l’accompagnement participent du même système global et que votre action est nécessairement imbriquée.
La difficulté de définir le périmètre de notre mission tient à la prise en compte des actions d’anticipation. Nous avons décidé de limiter ce thème sans l’exclure. Cette limitation s’imposait, car nous savons que nous ne pouvons pas travailler dans de bonnes conditions sur toutes les politiques d’anticipation et d’évolution des filières et des territoires. Néanmoins, comme ce sont des domaines dont vous avez également la charge, il serait intéressant que vous nous présentiez rapidement les orientations du Gouvernement en la matière.
Nous souhaitons nous pencher sur les enjeux liés à la qualité du reclassement, à la sécurisation des parcours, à la revitalisation – question importante qui doit donner lieu, pour les parcours individuels comme pour les territoires, à un traitement plus qualitatif et moins quantitatif – et à la gouvernance des politiques d’accompagnement. Cette dernière devra relever un défi de pilotage, car la transposition de l’Accord national interprofessionnel (ANI), la montée en puissance des collectivités locales avec la future loi sur la décentralisation, et l’évolution de la formation professionnelle exigeront des adaptations. L’importance de ce sujet peut également se lire dans la multiplicité des outils et des acteurs qu’il mobilise : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), la politique de formation professionnelle, le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), le médiateur du crédit et de la sous-traitance, Oséo, la Banque publique d’investissement (BPI) et les commissaires du redressement productif (CRP).
Le projet de loi transposant l’ANI cherche à concilier le retour de l’État régulateur avec la confiance dans la démocratie sociale, deux orientations qui peuvent pourtant entrer en contradiction.
M. Boris Vallaud, conseiller cellule restructurations au cabinet du ministre du redressement productif. Votre mission « Prévention et accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi » s’inscrit dans un champ en effet plus restreint que notre domaine d’intervention, puisque nous avons à connaître de situations d’entreprises en difficulté qui ne sont pas forcément engagées dans une procédure collective. Ce positionnement très en amont permet d’ailleurs de les aider efficacement. A contrario, lorsque nous sommes sollicités alors qu’une procédure collective a déjà été enclenchée – parfois même à la veille d’une liquidation –, notre capacité d’action se trouve fortement réduite, certains outils n’étant plus mobilisables à ce stade.
Il est ardu, vous l’avez noté, de tracer la frontière entre l’action du ministère du redressement productif et celle du ministère de l’emploi. Dans nos postes, nous avons, Pierre-André Imbert et moi, connaissance au même moment des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises et notre coopération s’organise avec fluidité. Nos services régionaux participent ainsi aux mêmes cellules de veille qui reçoivent les signaux émis par les entreprises ; ces messages peuvent être de faible intensité : demandes de chômage partiel, non-paiement de dettes fiscales et sociales, difficultés à régler des fournisseurs.
Les CRP ont été conçus pour assurer la fonction d’interlocuteur unique et privilégié des chefs d’entreprise dans les régions. Ils participent à l’élaboration d’un diagnostic commun visant à déterminer la nature des difficultés rencontrées et à la définition des actions, sur mesure, à conduire : si les problèmes de l’entreprise relèvent de relations avec d’autres sociétés, le CRP les met en relation avec la bonne médiation ; s’ils proviennent de tensions avec le secteur bancaire, le CRP sollicite l’antenne locale de la Banque de France et la médiation nationale du crédit. La première mission du CRP fut d’installer rapidement dans les régions l’équivalent du CIRI, qui existe pour l’ensemble du pays. Le CIRI ne traite que des entreprises comptant plus de 400 salariés et n’ayant pas encore ouvert de procédure collective. Son fonctionnement repose sur une culture de confidentialité exigée par la fragilisation qu’entraîne, pour une entreprise, la publicité de ses difficultés – notamment avec les banquiers et les fournisseurs. Voilà pourquoi, nos services diffusent des chiffres bruts et n’évoquent des entreprises qu’avec leur autorisation et une fois celles-ci hors de danger.
Les CRP sont des instances très jeunes qui doivent trouver leurs marques, alors que le CIRI a été créé en 1982. Nous installons et formons les commissaires et nous clarifions les relations entre leurs missions de prévention et celles originellement dévolues à l’inspection du travail et aux services du ministère de l’emploi. L’objectif est, à terme, de faire des CRP des CIRI régionaux. Une réunion avec des CRP a lieu tous les vendredis matin. Le pôle économique de la DATAR participe parfois à ces sessions afin d’élargir la vision de la situation. Tous les commissaires sont réunis une à deux fois par trimestre et ces assemblées sont un lieu d’information et de formation. La prochaine rencontre se tiendra le 8 mars et l’ANI devrait figurer à son ordre du jour.
M. Pierre-André Imbert, conseiller Entreprises et mutations économiques au cabinet du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Nous avons fait le choix heureux de travailler dans une grande proximité qui permet de répondre à la forte contrainte des délais, que ce soit en amont ou a fortiori au cours d’une procédure collective risquant de déboucher sur un redressement ou une liquidation judiciaire. Le but principal de notre action est la poursuite de l’activité de l’entreprise, mais nous devons également faire émerger très rapidement des solutions sociales. Nous cherchons donc à acquérir une vision globale des questions financières, économiques et sociales sur les sujets liés à la restructuration, notre attention se focalisant sur des aspects différents selon les étapes de la procédure et de l’accompagnement. Nous veillons à ne pas séparer la recherche d’un repreneur du traitement du chapitre social. C’est la logique qui a présidé à la création des CRP et à leur ancrage décentralisé en relation avec les services. L’émergence d’une culture commune se révèle nécessaire, car les CRP proviennent d’origines administratives variées ; ceux dont le parcours possédait une dominante financière doivent s’approprier les contraintes sociales et inversement. Cette hybridation, au bout de six mois d’expérience, fonctionne et stimule, dans les territoires, un apprentissage collectif qui est un atout pour l’action de l’État. Les signaux sont générés par le recours aux dispositifs, mais aussi par les élus, les représentants du personnel ou les chefs d’entreprise. Ainsi, nous mobilisons l’ensemble des capteurs pour agir rapidement. L’emploi de plusieurs outils permet de faire émerger des solutions : un moratoire des dettes fiscales et sociales peut, par exemple, être prononcé en même temps que du chômage partiel, qui allégera la trésorerie et favorisera une potentielle reprise. Pour les CRP et l’ensemble des services, la tâche demeure ardue et peut s’avérer infructueuse, mais, au total, cette mobilisation réussit, depuis six à huit mois, à sauver davantage d’entreprises qu’auparavant.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Merci pour cet exposé méthodologique. J’aimerais que vous évoquiez également l’utilisation actuelle des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), leur évaluation et l’anticipation des prochaines mutations. L’intervention de l’État répond à une logique économique et sociale – notamment dans le soutien à la reconversion des territoires et des salariés ; quels sont les moyens efficaces et les effets de levier que vous pouvez mobiliser à l’appui de cette action ? Nous pourrions nous contenter de constater que le budget de l’État dévolu à ces dispositifs a triplé depuis 2009 et célébrer l’importance qui leur est accordée. Cependant, les montants sont relativement faibles, puisque seuls 290 millions d’euros seront débloqués en 2013. Pourriez-vous nous apporter un éclairage politique sur cette situation ?
M. Pierre-André Imbert. La loi dispose que l’entreprise in bonis assure le financement du PSE et, notamment, de son dispositif central, le congé de reclassement, qui a vocation à faciliter la reconversion des salariés. Cela ne donne donc pas lieu à l’ouverture d’une ligne de dépenses dans le budget de l’État, mais les services y veillent – par des lettres d’observation, par des constats de carence et, plus sûrement, par un dialogue permanent avec l’entreprise et les représentants des salariés – et s’assurent de l’efficacité de l’accompagnement des employés vers un nouvel emploi. Les dispositifs en place permettent de mobiliser dans la durée des parcours de formation ou de reconversion qui, s’ils ne créent pas directement des emplois, facilitent la reprise d’un poste. L’État insiste sur le fait que les PSE doivent être tournés vers l’emploi. Le système fonctionne correctement, car les sociétés in bonis doivent financer des dispositifs bien dotés.
Pour les entreprises comptant moins de 1 000 salariés en Europe ou se trouvant en situation de redressement et de liquidation judiciaire, l’instauration du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) fut un apport notable, car il met en place un dispositif équivalent au congé de reclassement pour les salariés d’entreprises qui ne possèdent pas – ou qui ont perdu – les moyens de les accompagner dans une dynamique de reconversion. Même dans les cas de liquidation judiciaire les plus délicats, l’État apporte le soutien de la politique de l’emploi pour éviter les ruptures brutales, qui entraînent des drames personnels. Le CSP permet ainsi d’accompagner les salariés financièrement et de les aider dans leur période de reconversion.
Mme Isabelle Le Callennec. Le taux de chômage dans le bassin d’emploi, très industrialisé, de ma circonscription reste inférieur à la moyenne nationale. J’assure la vice-présidence d’une maison de l’emploi et suis attentivement ces questions.
Quelle est la composition de la cellule de veille à laquelle vous avez fait allusion, monsieur Vallaud ? Se situe-t-elle à l’échelle départementale ou régionale ?
Les entreprises ont fait appel au chômage partiel en 2008 et en 2009. Réunir l’ensemble des partenaires pour activer le volet formation a requis beaucoup de temps. Les salariés doivent pouvoir utiliser ces périodes pour se former afin d’accroître leurs compétences et rester dans l’entreprise lorsque l’activité reprend, ou rejoindre une autre société du même bassin. Les pouvoirs publics travaillent-ils à améliorer leur réactivité dans ce domaine ?
Par quelle voie la liste des outils à la disposition des CRP est-elle communiquée aux élus locaux ? Ces derniers se trouvent immédiatement sollicités en cas de difficulté et cette position de premier interlocuteur exige de respecter, avant même l’instauration du dialogue social, une grande confidentialité.
Le bassin de Vitré a eu la chance, avec six autres territoires, d’expérimenter le contrat de transition professionnelle (CTP), créé par Jean-Louis Borloo en 2006. Le CTP a entraîné une vraie révolution des mentalités, puisque les salariés ont pu se rendre compte qu’ils pouvaient réaliser d’autres tâches que celles effectuées dans la même entreprise pendant des années et exporter, dans d’autres établissements, les compétences qu’ils avaient développées. Ainsi, les salariés bénéficiant de CTP ou de CSP profitent d’un meilleur accompagnement. Par conséquent, le CSP peut-il être étendu à tous et combien une telle mesure coûterait-elle ?
M. Philippe Vigier. Comme M. le rapporteur l’a très bien dit, consacrer seulement un peu plus de 250 millions d’euros à ces politiques publiques, au moment où la dégradation de l’économie française s’accélère, pose question. Quels moyens supplémentaires conviendrait-il de mobiliser pour mettre en œuvre une véritable stratégie de reconstruction des filières industrielles ? Sur ce sujet, nous ne pouvons pas nous contenter de déclarations, car nous constatons, élus de la majorité comme de l’opposition, qu’il s’agit d’un enjeu majeur auquel il faut sensibiliser les parlementaires dans la perspective des lourds arbitrages qui devront être rendus.
Le CRP de ma région joue un rôle très utile. Donnez également une mission aux sous-préfets dans ce domaine, car, entourés de leurs équipes, ils se tiennent dès le premier jour à nos côtés lorsque des entreprises rencontrent des difficultés. Ils connaissent bien leurs arrondissements et pourraient apporter un complément précieux à l’action des CRP. La région Centre est composée de six départements et s’étend sur 430 kilomètres du nord au sud et sur 270 kilomètres d’est en ouest, ce qui constitue un vaste territoire à couvrir pour les CRP.
Bien qu’elle ait connu un désastre économique important il y a quelques années, ma circonscription n’a pas bénéficié des CTP. Je le regrette d’autant plus que cet outil fonctionne. Les raisons de ce succès tiennent au fait qu’il rassemble tous les acteurs d’un même bassin d’emploi – chefs d’entreprise, élus et services de l’État. En revanche, je suis beaucoup plus critique envers le CIRI. Dans le dossier Johnson&Johnson que vous suivez comme vos prédécesseurs, monsieur Vallaud, où est le CIRI ? Votre proposition de constituer des CIRI régionaux m’apparaît pertinente, mais en dehors d’une entreprise et d’un hôpital, aucune structure n’emploie plus de 400 salariés dans ma circonscription, dont la superficie atteint presque la moitié du département d’Eure-et-Loir. La Cour des comptes met régulièrement – et avec raison – l’accent sur l’insuffisance du maillage d’entreprises de taille moyenne. Mais n’oubliez pas les entreprises de 50 salariés !
La Cour des comptes a également publié un excellent rapport sur le chômage partiel, qui souligne que l’Allemagne a dix fois plus mobilisé cet outil que notre pays.
M. Boris Vallaud. Instances régionales, les cellules de veille sont exclusivement animées par les services de l’État. Les directions locales de Pôle emploi n’y participent pas, mais les DIRECCTE relaient leur message, et je ne pense pas que beaucoup d’informations, même mineures, nous échappent. Par contre, un certain nombre de chefs d’entreprise ne s’adressent pas aux services de l’État. Ce sont souvent les CRP qui effectuent cette démarche, les entrepreneurs décidant ou refusant de saisir cette opportunité. Il importe donc d’instaurer des relations de proximité et de confiance avec les chefs d’entreprise. Nous connaissons leurs réticences à faire part de leurs difficultés. Le mentorat permet de lever ce tabou, puisque ce sont des patrons qui parlent à leurs semblables – à l’origine, de projets de développement, mais les problèmes rencontrés par certains d’entre eux peuvent être évoqués dans ce cadre.
Les outils à la disposition de cette politique publique ne sont pas si nombreux. Les CRP et les médiations participent aux relations entre les entreprises et aux discussions entre celles-ci et les banques, dans un statut de tiers intéressé prévu par les accords de place ayant instauré les médiations ; cette présence compte beaucoup dans les échanges. En outre, la Banque de France peut réaliser des audits sur la trésorerie des entreprises afin d’imaginer des solutions techniques, comme des ponts de trésorerie ou des moyens d’obtenir des délais. Ces opérations ne doivent pas se substituer à la réflexion de fond : le traitement financier ne structure pas la réponse industrielle. C’est la raison pour laquelle je suis attaché à la culture industrielle du CIRI.
Les CRP sont souvent situés dans les pôles 3E (entreprises, emploi et économie) des DIRECCTE dont ils partagent la culture. Nous entretenons également des relations denses avec les collectivités locales pour rechercher des solutions de reprise. L’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) joue également un rôle, même si elle est dépourvue de représentation territoriale, en s’appuyant sur les agences régionales de développement (ARD) qui sont les référents locaux. Quant aux sous-préfets, beaucoup se mobilisent déjà en relayant l’action des CRP. Leur investissement – ainsi que celui des préfets de département – répond à une nécessité, les CRP ne pouvant pas tout faire eux-mêmes dans des régions aussi industrielles que le Nord-Pas-de-Calais ou Rhône-Alpes. Le préfet de l’Eure s’est ainsi beaucoup impliqué dans le dossier M-Real.
Nos services déconcentrés doivent assurer une fonction de placement de certains outils – celui du chômage partiel comme ceux contenus dans le dispositif d’aide à la réindustrialisation (ARI) –, capables de procurer de la souplesse aux entreprises.
M. Pierre-André Imbert. Le chômage partiel renvoie à la culture de l’anticipation qui exige le partage de l’information plutôt que la méfiance réciproque. L’ANI, s’inscrit dans ce mouvement de prise de conscience et de développement des bonnes pratiques, car il vise non seulement à favoriser l’échange de renseignements en amont sur la stratégie et les difficultés de l’entreprise, mais aussi à donner à l’entreprise, par la négociation collective, un ensemble d’outils – dont le chômage partiel – pour affronter les périodes délicates. Cet accord cherche donc à ancrer l’anticipation dans le dialogue social.
L’outil du chômage partiel a démontré son intérêt lors de la grave crise économique de 2009. Il a été modifié à quatre ou cinq reprises depuis lors, afin de l’améliorer et de favoriser sa diffusion. L’ANI poursuit cette nécessaire logique de réforme, car cet instrument n’est bien employé que par les grandes entreprises industrielles – 18 % des heures sont utilisées par l’industrie automobile. Mais même en 2009, le recours au chômage partiel n’a pas représenté plus de 14 000 équivalents temps plein (ETP) car cet instrument est inadapté aux PME. L’ANI simplifie donc l’architecture du chômage partiel en fusionnant les deux dispositifs existants et en allégeant les dossiers de demande. Par ailleurs, le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a lancé une campagne de sensibilisation. Tous les intervenants – comme l’ordre des experts-comptables, qui conseille les PME dans l’utilisation des instruments de ressources humaines – doivent s’impliquer. Récemment, un chef d’entreprise, confronté à une forte difficulté conjoncturelle, a refusé de mettre en place du chômage partiel pour ne pas envoyer un signal très négatif à ses clients ; le niveau des dépenses salariales s’est donc maintenu et la trésorerie s’est dégradée du fait de la baisse de l’activité. Il convient d’agir pour accroître l’acceptabilité de cet outil par le développement de la culture de l’anticipation – pour le chômage partiel comme pour les autres dispositifs. L’accroissement des dépenses budgétaires liées au chômage partiel prouvera que son emploi s’est répandu.
Le CSP, qui s’adresse aux salariés subissant un licenciement économique, a démontré son efficacité même si son coût est élevé. L’ANI étendra l’expérimentation qui a élargi son accès aux salariés précaires. Dans le flux d’entrées et de sorties de l’emploi, le licenciement économique reste minoritaire ; l’élaboration d’un PSE se trouve toujours précédée de la fin des contrats à durée déterminée et intérimaires et ces salariés ne bénéficient d’aucun accompagnement. Ouvrir le CSP à ces publics précaires permet de le renforcer – dans un respect global d’équilibre budgétaire – et de tester son efficacité sur d’autres catégories d’employés. Ces expériences se révèlent parfois complexes, car les profils sont très différents, notamment dans l’intérim.
La collaboration étroite de nos deux ministères se retrouve dans les filières : la rénovation du Conseil national de l’industrie (CNI) et l’action des comités stratégiques de filières (CSF) poursuivent ainsi l’objectif de conjuguer les dispositifs d’emploi et de compétence et de les intégrer dans les perspectives industrielles. Les démarches collectives, déclinées régionalement, doivent s’articuler avec une vision stratégique de la filière, notamment l’encouragement aux évolutions technologiques. Connaître les compétences utiles dans l’avenir – et s’assurer que les dispositifs de formation et de reconversion des salariés sont efficaces pour les développer – exige de fixer un cap. La déclinaison territoriale de cette politique de filière doit prendre en compte la dimension industrielle et doit définir l’aire de mobilité des salariés, car la reconversion peut s’opérer d’une filière à une autre, mais à l’intérieur du bassin de vie du salarié.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Une circulaire du mois de juillet a porté sur les enjeux qualitatifs de la revitalisation. Comment pourrait-on rendre objectives les conditions de validation, par les DIRECCTE, des plans négociés, une fois l’ANI mis en œuvre ?
Certains dispositifs peuvent créer des inégalités dans l’accompagnement des salariés. Les moyens conférés par les CRP, les CTP et les CSP ne bénéficient pas à tous. Ainsi, les chômeurs qui ont cumulé des CDD et les sous-traitants qui subissent les plans sociaux d’autres sociétés pâtissent de ces inégalités – parfois de manière plus violente que les entreprises qui leur passaient des commandes, puisque ces dernières peuvent verser des indemnités supra légales pour accompagner leur réorganisation interne, alors que les sous-traitants ne reçoivent pas de soutien financier ; sauf à imaginer la création d’un fonds qui permette de les accompagner dans le cadre de la restructuration territoriale ? Les moyens aujourd’hui mis en œuvre suffisent-ils ?
M. Philippe Vigier. Je suis tout à fait d’accord avec le rapporteur. Lors des procédures de revitalisation, le préfet et l’entreprise choisissent un territoire, la tendance allant, dans la lignée de la circulaire à laquelle vous avez fait allusion, vers l’émergence de plates-formes départementales. Je comprends que l’objectif d’un plan de revitalisation soit de reconstituer autant d’emplois qu’il en a été détruit. Néanmoins, les plates-formes contribuent à émietter l’aide aux salariés et aux territoires : ceux qui ont perdu leur travail ne sont pas forcément les bénéficiaires de l’aide à l’emploi, puisque les nouveaux postes peuvent se situer loin de leur domicile. Quelle est votre vision sur cette question ?
Les pouvoirs publics vont-ils réellement donner une impulsion forte au développement du chômage partiel ? Renforcer l’anticipation exige de se donner des moyens pour favoriser l’utilisation du chômage partiel – l’ANI reste discret sur ce point. Comme la Cour des comptes l’a montré, l’Allemagne a eu massivement recours à ce procédé de 2003 à 2005, ce qui lui a permis de faire diminuer son taux de chômage.
M. Boris Vallaud. La convention de revitalisation cherche en effet à recréer, dans un bassin d’activité, autant d’emplois qu’il en a été supprimé. Nous essayons de mobiliser les fonds de la revitalisation pour engager la réindustrialisation sur le site même des destructions de postes. Avec les CRP, nous réalisons des audits industriels pour déterminer s’il est possible que l’entreprise qui ferme soit reprise – pour la même activité ou pour une autre. Il convient de s’appuyer de plus en plus sur les fonds de revitalisation afin de diminuer les coûts de la reprise de l’entreprise ou ceux de sa reconversion. Nous rencontrons quelques succès dans ce domaine, même si cette démarche reste complexe. Les crédits dévolus à la revitalisation permettent souvent de reconstituer les emplois disparus, mais nous nous interrogeons sur l’effet d’aubaine qu’ils induisent.
Enfin, la reprise de salariés licenciés dans le cadre de la convention de revitalisation donne lieu au versement de bonifications majorées.
M. Pierre-André Imbert. Le dispositif de la revitalisation est encore jeune et sa pratique a beaucoup évolué. Au départ, il mettait l’accent sur la responsabilité territoriale de l’entreprise notamment envers les prestataires, les sous-traitants et les commerces. Il a donc été conçu pour s’adresser davantage aux territoires qu’aux salariés : les conventions sont ainsi conclues le plus souvent après les licenciements, puisqu’elles sont signées six mois après la notification à l’administration. De bonnes pratiques, consacrées par l’ANI, visent à anticiper la recherche d’activités de réindustrialisation et de reconversion pour accroître la possibilité de sauver l’activité – identique ou connexe – et de conserver les salariés.
La revitalisation couvre aussi la sous-traitance de proximité. Or la longueur des procédures de PSE et l’arrêt de l’activité ont déjà eu un impact sur les sous-traitants en termes d’emploi. Le sous-traitant peut, en outre, se situer en dehors du périmètre de la revitalisation. Dans ce cas, les plates-formes et la mutualisation visent à prendre davantage en compte les interdépendances et les impacts induits par une revitalisation. Alors qu’à l’origine le dispositif était tourné vers la distribution d’aides à l’embauche, de prêts à taux zéro destinés aux PME, ou de réduction du coût de locaux destinés à des reprises, il a évolué vers plus de mesures qualitatives, car si les effets des fonds distribués doivent perdurer à moyen terme pour soutenir le développement économique, les salariés doivent aussi retrouver rapidement du travail. La circulaire vise à trouver ce délicat point d’équilibre, en associant des dispositions qualitatives aux mesures quantitatives.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Permettez-moi d’insister sur la question de l’objectivation des critères. Jugez-vous souhaitable de différencier les obligations pesant sur les entreprises selon qu’elles affrontent ou non des difficultés financières ? L’ANI modifie le moment où le juge judiciaire peut être saisi, mais le problème jurisprudentiel d’élaboration de critères d’évaluation des difficultés économiques des entreprises et des engagements qu’elles souscrivent subsiste.
M. Pierre-André Imbert. Les textes régissant le PSE disposent clairement que les moyens consacrés par l’entreprise au reclassement doivent être modulés en fonction des moyens de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. L’effort des entreprises pour adapter les compétences des salariés à leur poste de travail est également pris en compte. Cette question fondamentale rejoint celle de l’anticipation. Le reclassement échouera en effet si les salariés devant faire face à la perte de leur emploi, perçoivent un financement pour entrer dans un dispositif de reconversion sans avoir reçu la moindre formation depuis des années.
L’ANI confère à l’État le rôle central de garant de l’application de la modulation, qui nécessite l’évaluation de la qualité des mesures sociales au regard des moyens du groupe. Or, le dialogue social se concentre souvent, dans les faits, sur le montant de la prime supra légale. Les lettres d’observation peuvent pointer l’absence de mesures de reclassement dans le plan malgré la santé du groupe, mais elles ne possèdent pas d’effet contraignant. L’objectif de la procédure d’homologation est de s’assurer que les sommes engagées permettent la reconversion et la sécurisation du parcours professionnel des salariés.
Le dispositif de revitalisation constitue un autre levier pour prendre en compte la situation financière de l’entreprise et du groupe. La contribution de l’entreprise ne peut pas descendre en-dessous d’un seuil égal à deux fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé, le préfet pouvant prescrire une étude d’impact social et territorial pour apprécier le montant global des disparitions de postes. En revanche, il n’existe pas de plafond pour cette mesure, mais si l’entreprise décide ne pas signer de convention de revitalisation, elle doit s’acquitter d’une contribution au Trésor public de quatre SMIC par emploi supprimé. Ce système conduit donc bien souvent à fixer la modulation dans une fourchette, comprise entre deux et quatre SMIC – même si certaines entreprises acceptent de porter leur participation à six, huit, dix, voire douze SMIC et que d’autres, connaissant des difficultés financières, se contentent de rester entre zéro et quatre SMIC.
M. Boris Vallaud. La modulation en fonction de la situation de l’entreprise est déjà pratiquée et l’élaboration de critères précis pourrait conduire à des rigidités. En outre, si la rentabilité devait s’apprécier site par site, nous savons que des artifices comptables – comme la localisation des actifs immatériels – permettraient de transférer les éléments de valorisation de l’entreprise. Nous préférons donc retenir une définition simple, voire tautologique : un site rentable est celui qui trouve un repreneur.
Mme Isabelle Le Callennec. Évaluer la modulation en fonction de la situation de l’entreprise et des efforts qu’elle a consentis pour la formation de ses salariés tout au long de leur carrière peut donner lieu à des jugements très subjectifs. Qui portera cette appréciation ? D’un département ou d’une situation à l’autre, les estimations pourront varier. Les négociations, qui aboutissent en effet souvent à la simple détermination du montant du chèque d’indemnité, peuvent prendre du temps et je m’interroge sur le rôle d’une personne extérieure qui aurait le pouvoir de fixer le niveau de l’effort auquel les entreprises doivent consentir.
Mme Eva Sas. Le projet de loi transcrivant l’ANI prévoit que l’homologation intervienne à la fin de la procédure d’information et de consultation. N’est-ce pas trop tard pour influer sur la qualité des mesures d’accompagnement du plan social ?
La loi comporte déjà des obligations de formation. L’employeur doit préserver l’employabilité de ses salariés et il est déjà arrivé qu’un chef d’entreprise soit condamné pour ne pas avoir rempli cette exigence. Néanmoins, cet impératif de maintien de l’employabilité est très peu mis en œuvre. Comment assurer son effectivité ?
M. Pierre-André Imbert. Actuellement, les DIRECCTE mènent un dialogue avec le chef d’entreprise et les représentants des salariés. Elles formulent des remarques, notamment par des lettres d’observation, sur les différentes versions du plan qui sont discutées. Le rôle de l’administration s’apparente à du conseil : faire connaître les bonnes pratiques et apporter des suggestions plus ou moins fermes en tenant compte – et là entre la part de subjectivité – des spécificités de chaque bassin d’activité et des caractéristiques d’ancienneté, d’âge et de formation des salariés. Tout l’esprit de l’ANI repose sur le renforcement de la négociation collective. L’homologation du plan consacrera, en fin de processus, l’aboutissement du dialogue social ; elle dépendra de la bonne application de la loi et, notamment, des garanties apportées à la sécurisation des parcours professionnels. Elle ne sera pas un couperet qui tombera en fin de procédure, mais un soutien au dialogue entre l’État, les chefs d’entreprise et les représentants des salariés pour améliorer les mesures du plan.
Les bonnes pratiques sont déjà partagées grâce aux retours – effectués par l’administration du ministère du travail – sur les expériences réalisées sur le territoire. Les acteurs qui participent à l’accompagnement des salariés – chefs d’entreprise et représentants des salariés tout d’abord, mais également tous ceux qui prennent part au service public de l’emploi – œuvrent collectivement pour faire émerger les mesures les plus adaptées aux besoins des salariés, de l’entreprise et du bassin d’activité. L’inévitable dose de subjectivité doit s’appuyer sur l’examen objectif des actions conduites dans le pays. Ainsi, les formations seront adaptées aux évolutions des métiers dans les bassins d’emploi et à la situation des salariés d’une entreprise, et seront prises en compte par la commission de suivi du plan de reclassement, puis par Pôle emploi au terme du congé de reclassement.
Mme Eva Sas. Comment seront formalisés les critères d’évaluation de la qualité du plan social ?
Quels seront les recours ouverts aux salariés jugeant l’homologation abusive ?
M. Pierre-André Imbert. Les salariés et les chefs d’entreprise pourront former un recours contre l’homologation du plan, puisqu’il s’agit d’une décision administrative qui, en tant que telle, peut faire l’objet d’une procédure devant la juridiction administrative. En cas de refus d’homologation, l’entreprise pourrait revoir les mesures contenues dans le plan.
En revanche, l’application d’une grille trop rigide dans le processus d’homologation diminuerait la capacité d’adaptation du plan aux spécificités du territoire. Presque tous les PSE donnent lieu à l’envoi d’une lettre d’observation par la DIRECCTE. Ces lettres sont adressées au chef d’entreprise, avec une copie au comité d’entreprise ; elles fournissent des éléments développés et précis. Ainsi, elles peuvent faire état d’améliorations à apporter en termes de durée de congé de reclassement, de budget et de mutualisation des formations, de prise en compte de ce qui existe dans le territoire concerné, ou d’accompagnement des salariés pour la création d’entreprise. Les critiques appuyées à l’encontre de ces lettres sont rares. Elles sont perçues comme un élément important du dialogue social et comme un moyen de concentrer les discussions sur l’objectif fondamental poursuivi par la puissance publique, à savoir la sécurisation des parcours des salariés, ce qui inclut le retour à l’emploi.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Vous avez présenté la DIRECCTE comme garante du dialogue et comme force de proposition. Il me semble pourtant que sa participation aux discussions pourrait être mal perçue. En outre, elle s’exposerait à la critique d’apparaître comme juge et partie si, dans le cas d’un échec des négociations, elle homologuait un plan ayant intégré ses suggestions. Son rôle doit donc être précisé.
M. Pierre-André Imbert. La DIRECCTE envoie des lettres d’observation plus que de suggestion sur le contenu d’un PSE. Elle n’évoque jamais le sujet des indemnités extralégales qui ne font pas partie de sa mission. Elle formule des observations sur la qualité des mesures de reclassement au regard de sa connaissance du bassin et des qualifications des salariés. En se concentrant sur ce point, elle ne risque pas d’apparaître comme juge et partie ; d’ailleurs, ses interventions suscitent très peu de polémiques. Elle veille avant tout à ce qu’un plan ne soit pas vierge de toute mesure de reclassement même si cette absence était compensée par le versement d’indemnités plus fortes. En effet, les salariés peuvent rencontrer des difficultés à gérer le montant élevé d’un chèque et se retrouver dans une situation délicate ensuite sans avoir été aidés pour rebondir professionnellement. Les lettres d’observation et l’homologation apparaissent donc comme deux instruments complémentaires.
M. Christophe Castaner, rapporteur. L’ANI procède à la fois à une déjudiciarisation et à une montée en puissance du juge administratif, accompagnées d’une distinction temporelle. Cette évolution est positive, car elle mettra un terme aux possibilités de contester et de suspendre la mise en œuvre des PSE, le recours au juge sur le contenu du plan n’étant ouvert qu’une fois celui-ci adopté.
Toutefois, si la loi ne fixe pas les critères d’homologation du plan, les conflits de jurisprudence ne devraient pas cesser. Ce sujet devra être étudié, car il est source d’incertitude et pose un problème d’attractivité de la France pour les investissements étrangers.
Pensez-vous qu’il convienne d’appréhender la question des licenciements diffus ?
De nouvelles formes de relations entre l’État et l’entreprise en crise vont-elles émerger ? Je pense notamment au passif public : pourrait-on le recycler pour ne pas aggraver la situation de l’entreprise qui se redresse, et assumer ainsi une fonction de co-investisseur ?
M. Boris Vallaud. Aborder le sujet du passif public renvoie à la doctrine que l’on se fixe sur son usage pour les entreprises en difficulté. Le créancier public pourrait-il – comme d’autres – convertir ses dettes en capital ? Est-ce opportun ? Dans quelles conditions et dans quel but effectuer une telle opération ? Je n’ai pas encore de réponses à apporter à ces questions, mais elles sont posées. La réflexion doit être entourée de précautions, car toutes les situations ne se valent pas.
S’il n’y a pas de licenciement diffus aujourd’hui, nous pressentons que la responsabilité territoriale de l’entreprise ne doit pas y être étrangère. Néanmoins, cette question mérite que l’on s’y penche et elle a d’ailleurs fait l’objet d’au moins une proposition de loi.
M. Pierre-André Imbert. Ce sujet se trouve lié à celui de l’obligation de revitalisation ; il pose le problème de la responsabilité territoriale de l’entreprise, qui ne se limite pas forcément à un périmètre précis, mais touche l’ensemble du territoire.
L’ANI ne remet pas en cause le contrôle de la loi opéré par le juge. Si la mise en œuvre d’un processus de restructuration – que l’ANI cherche à empêcher – se révélait inévitable, cet accord favorisera le dialogue social et la conclusion d’accords collectifs – pour surmonter de manière optimale une telle situation et pour assurer notamment le reclassement des salariés –, au détriment de batailles judiciaires. L’ensemble des dispositions de l’ANI ambitionne de fournir davantage d’outils et d’opportunités pour surmonter les conflits – que la tension sociale ne cessera de générer – par la discussion plutôt que par la confrontation.
Audition du jeudi 28 février 2013
À 11 heures 55 : M. Jean-Pierre Aubert, délégué à l’évolution des métiers et des emplois à la direction des ressources humaines de la SNCF
Coprésidence de M. Christophe Castaner et de Mme Véronique Louwagie, rapporteurs
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Nous accueillons M. Jean-Pierre Aubert, délégué à l’évolution des métiers et des emplois à la direction des ressources humaines de la SNCF. Notre mission porte sur la prévention et l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi. L’accord national interprofessionnel (ANI) signé en janvier qui a pour objectif de favoriser l’anticipation, sera donc au cœur de notre débat. Lorsqu’on parle accompagnement des PSE et prévention, on pense bien sûr reclassement, reconversion et formation des salariés – l’ANI comporte d’ailleurs un volet relatif au compte personnel de formation.
Au vu de vos fonctions à la SNCF et de celles – nombreuses – que vous avez occupées tout au long de votre carrière, il nous a paru intéressant de connaître votre approche de ces questions, votre expérience et le diagnostic que vous posez sur les dispositifs existants.
M. Jean-Pierre Aubert, délégué à l’évolution des métiers et des emplois à la direction des ressources humaines de la SNCF. C’est à partir d’une expérience multiple que j’évoquerai la question qui vous intéresse. Au-delà de mes fonctions actuelles au sein de la SNCF, qui est sans doute une entreprise un peu atypique de ce point de vue, mon expérience est assez riche. Mon âge et mon parcours me permettent en effet d’avoir un recul de presque quarante ans sur ce sujet, et sous des angles très différents. J’ai débuté en tant que responsable syndical, à l’époque des premières crises pétrolières, qui ont rapidement fait naître une réflexion sur les restructurations liées à cette conjoncture nouvelle. J’ai ensuite été patron de PME, puis haut fonctionnaire – contrôleur général économique et financier jusqu’à ma retraite de fonctionnaire. J’ai par ailleurs été, durant huit ans, délégué interministériel aux restructurations de défense auprès des deux ministres qui ont conduit la transformation de notre système de défense. Enfin, j’ai été un temps responsable de la mission interministérielle pour les mutations économiques (MIME). J’ai accompagné de nombreuses mesures de restructuration et de plan sociaux – aujourd’hui plans de sauvegarde de l’emploi. Une formule que j’ai employée dans un livre symbolise bien ce que j’ai essayé d’accomplir : « l’obligation de mettre des temps longs dans des temps courts ». Elle résumait mon constat de l’époque : nous étions pris dans le cadre des procédures engagées au moment des restructurations et de l’élaboration des PSE, qui ne permettaient pas toujours d’accompagner les salariés dans de bonnes conditions et de traiter correctement des questions exigeant beaucoup plus de temps. Je pense en particulier à la responsabilité sociale de l’entreprise, et des autres acteurs, sur le repositionnement professionnel des salariés concernés.
J’ai ainsi contribué à mettre en valeur la nécessité de l’anticipation et de la prévention – qui sont deux choses différentes. Même dans des conflits sévères que j’ai personnellement vécus, comme ceux de Chausson, de la fermeture de la centrale Superphénix, de la sidérurgie, de la construction navale ou encore de la mine de La Mure, j’ai toujours pensé que bien des choses auraient pu être faites si l’on s’y était pris plus tôt. Anticiper, c’est se donner des marges de manœuvre pour faire plus et mieux.
J’ai aussi toujours été préoccupé par l’implication de tous les acteurs et je suis un fervent défenseur de la négociation – y compris à chaud. Je peux me prévaloir d’être parvenu à quelques accords, même dans des situations difficiles. Il importe que les acteurs soient directement concernés par la procédure, mais aussi qu’ils soient engagés dans une forme de responsabilité – qui doit bien sûr rester soucieuse des intérêts de chacun. Or une partie du droit des licenciements a fait fuir cette responsabilité vers d’autres pouvoirs, qu’il s’agisse de l’État, de l’administration, du pouvoir judiciaire ou de tout autre acteur extérieur à l’entreprise. Au vu de l’expérience d’autres pays, il est pourtant possible de parvenir à des accords. Lors d’une mission qui m’avait été confiée par le Premier ministre Lionel Jospin, j’avais réuni toutes les parties prenantes et osé aborder un sujet tabou : « peut-on négocier l’emploi ? » Pour ma part, je pense que oui.
J’ai donc deux convictions : la nécessité d’anticiper et celle de donner la priorité à la négociation interne à l’entreprise, même s’il convient d’y associer d’autres acteurs dans certaines phases. C’est ainsi que j’ai toujours tenu à promouvoir la revitalisation économique : j’ai par exemple créé SNCF Développement, filiale de la SNCF que je préside, pour accompagner les entreprises ayant des projets générateurs d’emploi sur les territoires en rebond.
Une question se pose plus particulièrement dans la période actuelle : celle de la légitimité des opérations de restructuration et de leurs conséquences. La question de la légalité se pose dans un certain nombre de cas mais pas seulement. J’ai créé, à l’IAE de l’université de Paris-I Sorbonne, où je suis professeur associé, la chaire « mutations-anticipations-innovations » avec de grandes entreprises et des organisations syndicales. Dans ce cadre, nous avons organisé une conférence sur cette question de la légitimité. En effet, on ne sait plus qui est légitimité pour engager les restructurations, et la contestation est diverse, ce qui délégitime les partenaires sociaux qui pourraient éventuellement négocier.
M. le rapporteur. Comment anticiper et coopérer ? Pensez-vous que l’ANI et sa transcription législative puissent apporter une réponse à cet égard ?
M. Jean-Pierre Aubert. La question de l’anticipation a pris corps au cours des années 90. Un article de Dominique Balmary paru dans la revue Droit social en 1998 – « Le droit du licenciement économique est-il vraiment un droit favorable à l’emploi ? » – a valeur de référence.
La nécessité de l’anticipation s’est affirmée au fil du temps. Je pense notamment à l’obligation triennale de négocier sur la stratégie de l’entreprise et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). L’anticipation est une question clé pour la construction du dialogue social, indispensable pour donner la priorité à la négociation interne à l’entreprise. L’enjeu n’est pas tant de disposer de scénarii pour l’avenir que de créer de la confiance, d’établir une écoute réciproque entre les partenaires de l’entreprise. Il faut les construire dans le temps. Lorsque j’étais délégué interministériel aux restructurations de défense, j’ai participé à la transformation de la Direction des constructions navales (DCN) en société anonyme – à capitaux entièrement publics dans un premier temps. Le changement était d’autant plus considérable que l’essentiel des personnels était sous statut. Nous avons mis en place une dynamique qui a marqué une étape dans ma réflexion: nous avons joué le jeu de l’information économique sur l’entreprise et sur ses prévisions et nous avons accepté que l’expertise syndicale soit mobilisée pour les discuter et les critiquer. Bref, nous avons fait le moins possible de rétention d’information afin d’aborder franchement l’avenir. À un moment donné, il faut bien créer un terrain de discussion. Cela montre à tous les interlocuteurs qu’ils ont leur mot à dire sur cette évolution, même si les décisions prises ne les satisferont peut-être pas pleinement.
C’est cette ligne de conduite que j’ai adoptée au moment de la fermeture de la centrale Superphénix. La tension était très vive, au point que nous avions été séquestrés durant une journée. On nous opposait que la fermeture de la centrale signait l’arrêt de mort du territoire, et que des milliers d’emplois allaient disparaître. J’ai demandé à l’INSEE de conduire une étude des possibilités existantes sur le territoire, donc de créer un objet de discussion permettant à chacun d’estimer qu’il avait l’information et qu’il était libre de la traiter comme il le souhaitait. Les experts des syndicats ont donc dû argumenter à partir de données partagées.
J’applique aujourd’hui la même méthode pour l’évolution du Transilien, qui est un enjeu de taille, puisque 50 000 agents sont concernés. Nous avons construit avec la responsable du Transilien un système d’information qui nous permet d’apprécier exactement les parcours professionnels réels des agents – et non ceux que l’on imagine être – et de faire des projections qui permettent de discuter de l’avenir des métiers et des effectifs concernés.
Anticiper, c’est construire cette confiance, avec des outils qui supposent une certaine transparence, mais permettent de discuter de sujets difficiles – en réservant à l’entreprise le pouvoir de décision ultime. Cela permet d’aborder les réorganisations majeures, et de mettre place les outils nécessaires. À titre d’exemple, je suis venu à la SNCF à la demande de Guillaume Pepy pour gérer une partie des importants sureffectifs de la branche fret. Cela m’a conduit à construire un système permanent de mobilité intérieure à la SNCF, sachant que ses agents bénéficient – au moins au niveau de l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) – de la sécurité de l’emploi. Ce système permet de concilier à tout moment, de manière transparente, les contraintes de l’entreprise et les impératifs des choix individuels de parcours professionnel.
M. le rapporteur. Il est plus facile d’établir ce terrain de discussion par anticipation, c’est-à-dire avant la crise. Au moment de la crise, le chef d’entreprise est contraint de veiller à sa communication, non qu’il se méfie des organisations syndicales, mais parce que faire état de ses fragilités peut lui faire perdre des marchés – je pense en particulier à l’accès aux marchés publics.
Mme la rapporteure. Même en l’absence de difficultés économiques, il n’est pas toujours facile pour une entreprise de faire état de ses prévisions économiques et de sa stratégie. La confidentialité est parfois nécessaire pour assurer la réussite. Il y a là un paradoxe : s’il est important de permettre un échange entre les acteurs, l’exercice a ses limites.
Je reviens par ailleurs sur la légitimité des opérations de restructuration. Si une discussion s’établit entre tous les partenaires au sein de l’entreprise, la légitimité découle de celle-ci, des informations qui sont données à cette occasion, et in fine des négociations.
Enfin je souhaiterais connaître votre analyse de l’ANI ?
Mme Isabelle Le Callennec. Nous nous sommes déjà interrogés, lors de l’audition de MM. Imbert et Vallaud, sur le périmètre de la notion de licenciement économique aujourd’hui. Il me semble important de répondre à cette question.
Vous avez évoqué le système de mobilité interne à la SNCF, nous aimerions que ces systèmes puissent être appliqués à l’échelle d’un territoire. De même que l’on parle de GPEC, on parle de plus en plus de gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC). En Ille-et-Vilaine, nous essayons d’instaurer ce système de mobilité entre les entreprises, dans une optique de sécurisation des parcours professionnels, et de mettre au point un système d’information ressources humaines (SIRH) à l’échelle d’un bassin d’emplois. En effet, beaucoup de petites entreprises n’ayant pas de direction des ressources humaines, les questions que nous évoquons sont souvent méconnues. Comment décliner à l’échelle des bassins d’emploi ces systèmes de mobilité qui ont fait leurs preuves dans les grandes sociétés comme la SNCF ?
M. Jean-Pierre Aubert. L’anticipation telle que je l’ai décrite concerne les réorganisations structurelles ou permanentes, plus « discrètes » que les fermetures d’activité. La manière dont cela se passe au moment où surviennent les difficultés dépend du terreau que l’on a façonné : si l’on a patiemment construit le débat sur la stratégie de façon ouverte, et assuré l’échange d’informations, les choses seront facilitées.
Je reviens sur la question du secret. L’information circule désormais largement, et beaucoup de syndicalistes ont les moyens de tout savoir s’ils le veulent – heureusement, d’ailleurs. Pour l’anecdote, j’ai dispensé lundi soir un cours sur ce sujet. Les futurs directeurs des ressources humaines à qui je m’adressais estiment encore que mieux vaut ne pas donner l’information ! C’est évidemment plus difficile si cela n’a pas été bien préparé et que l’on s’inscrit dans un système de conflit. Néanmoins, on prend parfois plus de risques en ne donnant pas l’information telle qu’on veut la donner. Ne nous faisons pas d’illusions : lorsqu’il y a une difficulté dans une entreprise, tout le monde le sait. Autant donc mettre les syndicats dans le jeu. Certes, il y a toujours un risque, mais celui-ci peut être géré pour peu que le dialogue social ait été construit dans une période plus sereine.
Reste qu’il est parfois nécessaire de prendre des décisions « à chaud ». Il y a des précautions à prendre et des procédures juridiques à respecter, ce qui ne facilite pas toujours le dialogue. Nous avions inventé en leur temps les accords de méthode, qui avaient justement pour vocation d’essayer de maîtriser la procédure de préparation de la décision. Quelques accords intéressants ont ainsi été signés, pour le cas où un plan de sauvegarde devrait être mis en œuvre. Cela permet à chacun de réfléchir « à froid ». Cela participe du long et difficile chemin de la négociation en France, créée par les faits plutôt que par la loi. Soyons donc attentifs aux réalités qui se construisent avant de les enfermer dans des procédures qui font davantage appel à des juristes qu’à des gestionnaires des affaires sociales.
M. le rapporteur. Pour en revenir à un sujet d’actualité, quel regard portez-vous sur l’ANI et sur sa transposition future ? Il me semble que cet accord va dans le sens que vous souhaitez.
M. Jean-Pierre Aubert. Permettez-moi d’abord de vous répondre sur la légitimité. Vous avez parfaitement résumé ma pensée, madame la rapporteure. La légitimité se construit : elle n’est pas donnée une fois pour toutes. Or il est plus difficile pour l’entreprise de convaincre de la légalité d’une opération que de sa légitimité. Pour prendre un exemple, M. Riboud s’est rendu célèbre par l’exemplarité du dialogue social conduit chez Danone. Au moment de la restructuration de la branche biscuits, on a pourtant assisté à une rupture dans la compréhension de la légitimité de cette opération, alors même que le groupe Danone avait procédé à des transformations autrement plus importantes. La légitimité se construit progressivement par la prise en considération des enjeux de l’entreprise et des intérêts particuliers de chacun, ce qui implique de conforter le champ de la négociation.
J’en viens à l’ANI, qui marque une étape importante à plusieurs égards. Tout d’abord, il conforte – au-delà même de la relance de la GPEC – la nécessité de l’anticipation dans la stratégie de l’entreprise, et comme démarche à construire. Ensuite, il permet de distinguer des situations différentes, avec – notamment – la possibilité de signer des accords de maintien de l’emploi. Cela légitime les accords sur ces sujets. Du reste, il y en a déjà eu. Je pense aux accords signés chez Thales ou chez Areva, qui permettent de construire la démarche que j’évoquais.
L’ANI donne également ses lettres de noblesse à la négociation de l’emploi en donnant acte que ces procédures peuvent être négociées. C’est un changement profond, qui nous met au diapason d’une partie de l’Europe. J’observe à cet égard que les directives européennes encouragent les discussions visant à obtenir un accord négocié, alors que nous aurions tendance en France à en rester aux discussions – consultation et information. L’ANI fait donc un pas important sur la légitimité de l’accord.
Reste à en réaliser les conditions sur le terrain. Il est essentiel que vous instauriez un suivi de la mise en œuvre de l’accord. En effet, l’important est bien la manière dont les partenaires sociaux et les acteurs concernés vont s’en emparer pour l’appliquer concrètement. En plus des articles de loi et des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation, on devrait intégrer à notre culture les accords majeurs qui ont contribué à façonner le droit social en France. Je suggérerais donc qu’une mission parlementaire soit constituée pour assurer le suivi et la valorisation de ce qui se réalisera à partir de l’accord. Nous devons avoir une approche modeste de ces processus, et accepter d’expérimenter des démarches nouvelles.
Un troisième point important a retenu mon attention : la prise en considération de tous les salariés. Je suis depuis longtemps frappé par la grande inégalité de traitement qui prévaut dans l’accompagnement des salariés. Jacques Chérèque, me rappelait souvent combien la Lorraine avait souffert en perdant 100 000 emplois dans la sidérurgie. Je lui répondais immanquablement que l’ouest de la France avait perdu 100 000 emplois, notamment dans le secteur textile, sans que nul ne s’en préoccupe vraiment… Les inégalités sont considérables. Nous devons notamment penser à ce qui peut être fait dans les PME. C’est là que les territoires peuvent jouer un rôle, madame Le Callennec. On ne partage pas assez cette préoccupation, car l’accent est mis sur certains salariés seulement.
L’accord a également l’intérêt de porter sur tous les types de contrat, ce qui tient compte des évolutions du marché du travail. Vous avez d’ailleurs noté que la notion de licenciement économique avait perdu de sa pertinence. Je ne conteste pas la nécessité d’une certaine flexibilité ; la difficulté est de prendre en considération toutes les formes de contrat dans les mesures d’accompagnement mises en œuvre. Lors de la fermeture de la centrale Superphénix, les salariés d’EDF ont été très bien accompagnés par leur entreprise. Mais ce n’était pas le cas des centaines de salariés qui occupaient des emplois périphériques et n’étaient pas sous statut EDF, pour lesquels j’ai bâti un plan d’accompagnement spécifique, qui a été financé en partie par EDF. Bref, nous devons nous efforcer d’assurer un accompagnement plus égalitaire, qui ne se limite pas à certaines catégories de salariés. Ce n’est pas facile à mettre en œuvre.
L’approche territoriale est bien sûr essentielle, madame Le Callennec. Même pour les grandes entreprises et les multinationales, la plupart des solutions d’accompagnement ne peuvent être trouvées que dans un environnement local. Simplement, tous les territoires ne sont pas dotés des moyens pour y parvenir. Il faut en effet être à même de fédérer tous les acteurs concernés. Lorsque j’étais délégué interministériel aux restructurations de défense, nous avions créé pour les grandes restructurations, notamment celles de GIAT Industries, des « comités de site » réunissant tous les acteurs autour du préfet, afin de discuter des projets envisageables et des mesures permettant d’accompagner d’autres entreprises que celle concernée par la restructuration. C’est en Bretagne qu’est née l’idée que les territoires pouvaient avoir une démarche de gestion territoriale des emplois et des compétences. Je pense au bassin de Lannion, qui a été successivement touché par les mutations des télécoms et de l’agroalimentaire. Il faut donc soutenir la capacité du territoire à apporter sa contribution à l’accompagnement en anticipant les événements. À l’époque où j’étais responsable de la MIME, j’avais lancé les observatoires des mutations économiques régionales pour développer des capacités de dialogue entre les différents acteurs. Ce dispositif doit être distingué des systèmes de prévention des entreprises en difficulté, qui sont tout aussi nécessaires. On a par exemple débattu de l’hypothèse de la disparition de Citroën Rennes. Cela permet de marier une analyse sectorielle et une analyse locale, voire de mettre en évidence le décalage qui peut affecter une région par rapport aux moyennes sectorielles – nous savions par exemple depuis des années que le secteur de la volaille connaissait des difficultés en Bretagne. Reste à passer du constat à l’action. Le territoire peut ici être à géométrie variable : selon le moment et la problématique abordée, la communauté de communes, l’agglomération, le bassin d’emploi ou le département peuvent se mobiliser. Il est aujourd’hui important d’impliquer les régions, qui ont mis longtemps à s’engager dans ce champ d’action. Elles doivent devenir des acteurs à part entière dans l’accompagnement des restructurations, d’autant qu’elles sont compétentes en matière de formation. J’ai quelques exemples de cas où il a été très intéressant de les associer.
J’en viens à la définition du licenciement économique. Honnêtement, il est aujourd’hui difficile de la cerner pour qui n’est pas juriste. Les salariés ayant subi un licenciement économique ne constituent qu’une petite minorité apparente dans les statistiques des nouveaux inscrits à Pôle emploi. Ce ne sont pas les grands PSE qui créent le plus de chômeurs, mais les fins de mission et les mesures individuelles telles que les ruptures conventionnelles et autres plans volontaires de départ. Bref, aujourd’hui le droit des licenciements économiques est en train de faire faillite.
Mme la rapporteure. Nous déplorons comme vous le caractère inéquitable de l’accompagnement des salariés. Dans le cadre de la transcription de l’ANI, la DIRECCTE se verra confier un rôle important : elle est appelée à être l’acteur principal de cet accompagnement, en concertation avec tous les acteurs locaux. Les pratiques ne pourront donc être homogènes d’un territoire à l’autre, et les appréciations seront nécessairement subjectives selon les acteurs. Sommes-nous sûrs de ne pas renforcer l’inéquité ? Quelles contreparties imaginer pour limiter ce risque ?
Vous avez évoqué l’Europe et la culture de la négociation de certains pays. Faut-il rappeler que certaines centrales syndicales n’ont pas signé l’ANI au motif qu’un certain nombre des dispositions seraient contraires au droit européen ? Il y a une contradiction entre votre propos et leur attitude.
M. Jean-Pierre Aubert. Le territoire permet une gestion de la proximité. Les salariés n’ont pas nécessairement accès dans de bonnes conditions aux offres d’emploi en dehors du territoire. Cela peut tenir à des raisons de mobilité géographique comme à la taille et aux moyens de l’entreprise qui est en passe de les licencier. Lors de la fermeture de Chausson, nous avions bénéficié d’importants moyens – aide au reclassement du conjoint et au logement, notamment – pour accompagner les familles des salariés repris à Sochaux par Peugeot. Il est évident que de telles mesures ne sont pas à la portée de toutes les entreprises. À ces inégalités directes peuvent s’ajouter celles de l’environnement. C’est là que le principe de solidarité – entre collectivités et avec l’État – doit jouer. Il faut partir du terrain et des attentes réelles des salariés en matière de reconversion. La solidarité, comme la réflexion stratégique et l’anticipation, ne doivent cependant pas jouer au seul niveau de l’État central, mais aussi au niveau local et au niveau régional. C’est la raison pour laquelle la DIRECCTE a les moyens d’en assurer l’articulation, en même temps que d’apporter à l’accompagnement des moyens complémentaires – comme elle le fait parfois pour financer une cellule de reclassement.
C’est ici que peut intervenir la revitalisation économique. Je mène actuellement une opération de ce type avec SNCF Développement à Culmont-Chalindrey, en Haute-Marne. Nous allons soutenir la création de 200 emplois en deux ans par des entreprises que nous avons fait venir. Il faut partir des réalités concrètes et pratiques et apporter des compléments d’accompagnement qui ne viennent pas seulement de l’État. Les collectivités doivent être solidaires sur le territoire. J’appelle donc à une complémentarité de la solidarité régionale avec la solidarité administrative et étatique.
M. le rapporteur. Selon certains, il serait aujourd’hui plus facile à l’État, voire aux collectivités locales – sans doute parce qu’ils n’ont pas de doctrine précise en matière d’interventions économiques – de financer un PSE que d’être un acteur du maintien de l’emploi. Quel peut donc être le rôle de la puissance publique dans le maintien d’activités économiques rentables au moment où des difficultés conjoncturelles conduisent à envisager un PSE ? Avez-vous des exemples de cas dans lesquels l’État a été capable d’anticiper – donc d’éviter le PSE – en se faisant acteur économique ? Pour prendre un exemple d’actualité, faut-il nationaliser Arkema ?
Je crois aux vertus du dialogue, et je vous rejoins sur le fait que l’anticipation permet de coopérer le moment venu pour bâtir un PSE. Que pensez-vous de la prime supra légale, qui permet « d’acheter la paix sociale » en satisfaisant dans l’immédiat les salariés concernés, mais en excluant toute approche territoriale ? Nous retombons ici sur la question de la qualité du PSE, laquelle ne saurait se réduire à une approche quantitative en termes d’emplois recréés. Le dialogue ne risque-t-il pas de favoriser une réponse à court terme, privilégiant les individus, au détriment d’une réponse à long terme, plus orientée vers le territoire et le collectif ?
M. Jean-Pierre Aubert. Il n’existe aucune raison pour ne pas envisager, dans certaines circonstances et de manière pragmatique, une intervention des pouvoirs publics dans un dossier. Je pense à des entreprises implantées sur un site qui ne leur permettait pas de poursuivre leur activité. J’ai contribué, avec d’autres, à accréditer l’idée que les pouvoirs publics pouvaient s’associer à l’entreprise pour créer un site ex nihilo à côté de l’ancien site, et donc financer ce que j’ai appelé le « changement de peau » de l’entreprise. L’intervention des pouvoirs publics ici de diminuer des coûts, qui sont honnêtement abordés par l’entreprise comme un enjeu dans le cadre de son analyse économique, et de financer des investissements exceptionnels. J’ai par exemple encouragé cette approche à Fougères, où la collectivité a racheté le site de l’unité Sagem Industries, aujourd’hui filiale de Safran. Cela a permis de le gérer autrement et d’y faire venir d’autres entreprises.
Faut-il aller plus loin – momentanément – dans certains cas ? Je n’ai pas d’objection à formuler, dès lors que cela se fait sous de façon transitoire. Il ne doit pas s’agir simplement de sauvegarder l’emploi, mais de permettre à une entreprise de continuer à se développer. Les investissements des pouvoirs publics doivent permettre de garantir l’emploi. Il faut réfléchir à la stratégie dans laquelle cette aide peut s’inscrire. Ses formes peuvent être très variées et sont loin de se limiter à la nationalisation temporaire. On peut par exemple, comme nous l’avons fait pour Alstom à Tarbes, soutenir la reconversion d’un site – qui coûte très cher – et donc la formation des personnels. Nous avons ainsi accompagné l’entreprise pour assurer le transfert sur ce qui était un site de production, d’un laboratoire de recherche pour les produits nouveaux. Ces formes d’aide peuvent avoir un impact positif si elles s’inscrivent dans la stratégie de l’entreprise.
L’entreprise peut être aidée par les pouvoirs publics lorsqu’elle est en difficulté. La procédure judiciaire – redressement judiciaire, liquidation et reprise – est une aide : c’est une façon de relancer l’entreprise grâce à la réduction ou à l’abandon des dettes. Le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) est un spécialiste de ce type d’opérations, qui peut être géré dans de bonnes conditions : c’est un processus relativement maîtrisé, à condition de trouver de bons repreneurs et de préparer la reprise.
Les entrepreneurs peuvent aussi se mobiliser pour trouver des solutions locales. Je pense au territoire des Herbiers, en Vendée, où les patrons investissent les uns chez les autres.
Au total, il faut se garder de s’enfermer dans une logique, et gérer avec précaution les investissements dans une entreprise dont on a du mal à percevoir la stratégie.
J’en viens à l’indemnité supra légale. J’ai toujours lutté contre l’approche que vous dénoncez. Les salariés de Chausson, en pleine crise, réclamaient que les 400 millions de francs restant en caisse soient consacrés au financement de ces indemnités. Au terme de plusieurs mois de discussion, j’ai convaincu les organisations syndicales que la priorité première était le reclassement, et que les deux actionnaires – Renault et Peugeot – devaient mettre de l’argent pour l’accompagner. Il faut reconnaître que les pouvoirs publics ont parfois poussé au versement d’indemnités supra légales – par exemple à Seafrance. Les inégalités sont criantes en pareil cas. Je peux comprendre que les salariés soient tentés par cette option, mais cela coûte cher, sans être adapté à leurs besoins. Il reste qu’il est plus facile de céder sur des indemnités supra légales que sur un autre point. L’État lui-même a déjà financé ce type d’indemnités dans le secteur privé.
M. le rapporteur. Nous vous remercions pour cet intéressant tour d’horizon. Le cadre volontairement réduit de notre mission fait que nous n’allons pas aborder la question de la mutation économique des sites stratégiques. Nous ne doutons cependant pas que ce sujet viendra bientôt sur le devant de la scène. Au-delà de ces sites, ce sont très vite des enjeux territoriaux qui vont nous mobiliser. L’élu de Provence Alpes Côte d’Azur que je suis ne peut ici s’empêcher de penser à Berre l’Étang. Pour arriver à mettre en œuvre l’anticipation dont vous nous parlez, il reste encore bien du chemin à parcourir aux hommes de bonne volonté…
Audition du jeudi 28 mars 2013
À 9 heures 30 : Mme Danièle Giuganti, directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Lorraine, accompagnée de M. Sébastien Hach, directeur adjoint emploi de l’unité territoriale des Vosges et de M. Philippe Sold, directeur de l’unité territoriale de Meurthe-et-Moselle
Présidence de M. Alain Claeys, co-président de la Mission
M. le président Alain Claeys. Nous poursuivons nos travaux relatifs à la prévention et l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi.
Nous recevons tout d’abord Mme Danièle Giuganti, directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Lorraine, accompagnée de M. Sébastien Hach, directeur adjoint emploi de l’unité territoriale des Vosges et de M. Philippe Sold, directeur de l’unité territoriale de Meurthe-et-Moselle.
Madame, je vous remercie d’être venue jusqu’à nous pour nous faire part de votre expérience. Je vous cède immédiatement la parole pour nous présenter brièvement vos actions avant de procéder à un échange sous forme de questions avec les rapporteurs.
Mme Danièle Giuganti, directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Lorraine. L’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi étant une question non seulement régionale mais également territoriale, j’ai demandé à deux de mes collaborateurs de m’accompagner.
La création des DIRECCTE en 2010 a entraîné le regroupement de différents services dédiés au développement des entreprises, notamment les ex-directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et les échelons départementaux et régionaux des services de l’emploi, qui travaillent en étroite collaboration avec Pôle emploi.
La DIRECCTE de Lorraine regroupe 380 agents pour assurer l’ensemble de ses missions : concurrence, consommation et répressions des fraudes, travail avec l’inspection du travail, ainsi que le développement de l’emploi, le développement économique et la mise en œuvre des politiques d’emploi. Plusieurs outils sont dédiés à la prévention et à l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi, dans une démarche d’intelligence économique, exercée tant au plan régional qu’au plan départemental. La veille sur la situation économique des entreprises nous permet, grâce au Comité départemental d’examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI), de connaître, via les premiers retards de paiement des cotisations sociales et fiscales, les entreprises qui commencent à rencontrer des difficultés. Nous travaillons aussi étroitement avec les commissaires au redressement productif (CRP) sur la veille anticipative. Les visites d’entreprises effectuées par les agents des ex-DRIRE, qui travaillent au développement, nous permettent par ailleurs, au plan régional, de bien connaître la situation économique des entreprises.
Avant la création des commissaires au redressement productif, nous disposions déjà d’un commissaire à la réindustrialisation.
Les CODEFI sont placés sous l’autorité des préfets de départements et de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) qui associent les unités territoriales de la DIRECCTE (c'est-à-dire les ex-directions départementales du travail). Il existe également un comité plus restreint au sein de la DDFIP, la Commission des chefs des services financiers et des organismes de sécurité sociale (COCHEF), qui travaille à l’étalement des dettes des entreprises en contrepartie d’engagements de redressement.
L’inspection du travail, auprès de laquelle des représentants du personnel peuvent s’inquièter de la situation de leur entreprise, capte également des signaux faibles, ce qui permet d’enclencher les dispositifs de prévention des conflits dans l’entreprise liés à la situation de l’emploi.
Le PSE ne concerne que les entreprises qui envisagent de supprimer au moins dix emplois sur une période de trente jours. La prochaine loi sur la sécurisation de l’emploi modifiera la procédure actuelle. Des contentieux tendent souvent le climat social.
Les cellules de reclassement ont été récemment supprimées au profit des CSP, dans le cadre desquels nous travaillons étroitement avec Pôle emploi : en effet, ces contrats ne constituent pas seulement une nouvelle catégorie d’indemnisation mais exigent un accompagnement plus important, notamment en termes de reconversion.
La situation de l’entreprise est différente selon qu’elle est en redressement, voire en liquidation judiciaire, ou qu’elle appartient à un groupe qui a les moyens de financer un plan social. La palette des outils s’étend du congé de reclassement - ou du contrat de sécurisation professionnelle - , à l’aide à la création d’entreprise, en passant par l’aide à la mobilité géographique, l’allocation temporaire dégressive, l’aide aux entreprises qui recrutent, l’aide incitative au retour à l’emploi, l’aide au conjoint démissionnaire. Dans le cas des entreprises qui n’ont pas les moyens de financer un plan social, l’allocation temporaire dégressive peut aussi être activée. Enfin, les conventions de revitalisation permettent de prendre en compte la dimension territoriale. L’aide doit évidemment être dosée en fonction des capacités économiques du territoire, de la volonté politique des élus locaux et de la capacité de l’entreprise.
Il faut savoir que la région Lorraine comprend 120 000 demandeurs d’emplois de catégorie A. La progression des chômeurs de longue durée – plus de deux ans de chômage – a progressé 37 % en trois ans en raison des fermetures ou des restructurations des entreprises de la région à la suite du premier choc de 2009. Certaines se sont réorganisées et ont gagné en productivité, mais nous conservons malheureusement un volant incompressible de demandeurs d’emploi.
Si nous connaissons le coût de notre action et si nous savons qu’elle a permis d’éviter la fermeture pure et simple de nombreuses entreprises, toutefois, quantifier avec précision ses résultats demeure très difficile.
Pour être complet, il convient d’évoquer l’activité partielle, qui est une des grandes préoccupations de nos services. Nous avons procédé, dans ce cadre, à de nombreuses indemnisations.
M. Christophe Castaner, rapporteur. La revitalisation des territoires concerne particulièrement les DIRECCTE.
Aujourd'hui encore, on délaisse trop souvent l’accompagnement des territoires au profit de l’accompagnement individuel. L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, du fait qu’il organise les négociations à l’intérieur de l’entreprise, pourrait même conduire à négliger encore plus l’accompagnement collectif.
La mise en place, au travers d’un fonds commun pour la revitalisation des territoires, de programmes de revitalisation territorialisés au plan régional ou départemental est-elle à vos yeux envisageable ? Quelles pourraient être les modalités de gouvernance d’un tel fonds ? Les collectivités locales ne devraient-elles pas jouer un rôle plus grand en matière de revitalisation ? La multiplication des acteurs ne nuit-elle pas à l’efficacité des actions qui sont menées ?
Je tiens aussi à aborder la question de la proportionnalité dans laquelle les DIRECCTE jouent un rôle majeur. En l’absence de critères, comment l’évaluer ? La transposition de l’ANI ne devrait-elle pas conduire à définir des critères – le sujet fait débat –, d’autant que votre responsabilité sera accrue demain en la matière ?
Mme Danièle Giuganti. S’agissant de la proportionnalité, il serait effectivement utile aux services de l’État de disposer de critères. Ce n’est pas sans crainte que les DIRECCTE abordent cette nouvelle responsabilité parce que l’appréciation réelle de la situation de l’entreprise est aujourd'hui une affaire de spécialistes. L’idéal serait de nous appuyer sur nos collègues des ex-DRIRE, qui ont une vraie connaissance des comptes des entreprises. Toutefois, en vertu de la prochaine arrivée de l’acte III de la décentralisation, ces mêmes personnels seront probablement mis à la disposition des conseils régionaux. Or si les services de l’État se privent de leur compétence, les entreprises qui réussiront à se faire entendre seront celles qui auront le plus de talent pour plaider leur cause auprès du préfet de département, même si le pouvoir propre des DIRECCTE ne sera pas délégable.
Nous avons déjà assumé ce type de responsabilité dans le cadre, notamment, des autorisations administratives de licenciement. L’homologation des PSE ne sera pas comparable puisque nous n’aurons pas à nous prononcer sur le caractère économique ou non des PSE. Toutefois, nous aurons besoin d’expertise économique et il faudra que nous puissions nous appuyer sur des personnels compétents, fins connaisseurs, de la politique des grands groupes. Disposerons-nous demain en nombre suffisant de tels experts, alors même que nos effectifs ne cessent de baisser ? C’est un sujet d’inquiétude.
M. Christophe Castaner, rapporteur. D’autant que les délais seront très encadrés, allant, selon les cas, de huit à vingt et un jour.
M. Philippe Sold, directeur de l’unité territoriale de Meurthe-et-Moselle. La difficulté sera évidemment d’apprécier la capacité contributive de l’entreprise. Il fut un temps où nos services disposaient d’économistes – des postes ciblés sur l’analyse de la situation financière ou du bilan. Nous sommes tous formés à ces compétences mais elles relèvent toutefois d’une expertise propre. Nous devrons donc former spécifiquement des personnels - même si, déjà, nous cherchons à enrichir les PSE au regard de ce que nous estimons être les moyens de l’entreprise - pour donner notre réponse dans des délais qui, comme vous l’avez rappelé, seront très courts.
Mme Danièle Giuganti. Il est d’autant plus nécessaire de raisonner au niveau du territoire que les salariés licenciés en premier sont à la fois les moins qualifiés et souvent les moins capables de mobilité géographique. On ne saurait cependant faire reposer notre action uniquement sur les territoires car nous ne pouvons pallier l’absence de tissu économique. Les collectivités territoriales ont un rôle à jouer en matière d’attractivité économique, qui dépend beaucoup de la volonté politique.
L’Observatoire régional de l’emploi, de la formation et des qualifications de Lorraine (OREFQ) chargé d’expertiser notre gouvernance en matière de conventions de revitalisation avait conclu que nous devions resserrer le suivi de ces conventions. Un groupe de travail, réunissant la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a permis la publication d’un guide sur la revitalisation.
Le bilan dépend des territoires et de l’implication du corps préfectoral, notamment du sous-préfet d’arrondissement auquel certains départements ont confié le suivi des territoires. Le facteur humain est incontournable.
M. Sébastien Hach, directeur adjoint emploi de l’unité territoriale des Vosges. Dans les Vosges, 30 % des salariés travaillent dans l’industrie – ce qui est un chiffre atypique –, notamment dans des filières historiques : l’ameublement, le papier carton ou le textile. Depuis 2006, le nombre de conventions de revitalisation y est très important.
Le plan de sauvegarde de l’emploi est notifié à l’unité territoriale, qui se tourne vers le préfet pour savoir si l’entreprise est assujettie à la convention de revitalisation.
Les expérimentations sont diverses. Alors que, dans la Nièvre, le territoire recoupe le département, dans les Vosges, les conventions de revitalisation correspondent aux bassins d’emploi. Des périmètres prioritaires et secondaires ont été définis. Un maire dont ferme l’entreprise agroalimentaire installée sur sa commune voudra tout naturellement que la convention de revitalisation soit axée sur son territoire. Mais le taux d’assujettissement à une convention demeure très faible. Il convient d’associer aux plans d’action les collectivités territoriales, qu’il s’agisse du conseil régional ou du conseil général, même si ces conventions mobilisent de l’argent privé.
Nous avons aussi procédé à des diagnostics en ressources humaines, menant ainsi une politique de maintien dans l’emploi, dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels au sein de l’entreprise. Je donne un exemple : les salariés des industries textiles sont souvent d’un bas niveau de qualification, mais ils possèdent un vrai savoir-faire, qui n’a pas toujours été valorisé. Les conventions de revitalisation permettent d’utiliser les outils du service public de l’emploi, tels que des cartographies collectives ou individuelles de compétences, pour obtenir la certification de ces compétences dans le cadre des titres professionnels délivrés par le ministère du travail, des diplômes délivrés par l’éducation nationale ou des certifications de qualification professionnelle interindustries. S’il est vrai qu’à l’origine, les conventions de revitalisation devaient permettre de compenser le nombre d’emplois supprimés par un nombre équivalent de créations d’emplois, aujourd'hui, nous orientons vers la formation professionnelle – les budgets dédiés à la formation ne sont pas extensibles –, l’accompagnement des salariés ou des demandeurs d’emplois. Nous devons, dans le cadre des conventions de revitalisation, parmi d’autres démarches innovantes par rapport à la seule création d’emploi, orienter notre action aussi vers le maintien dans l’emploi. C’est d’autant plus nécessaire dans un département industriel comme les Vosges, où il n’est guère probable que se réimplante une entreprise de 300 salariés.
Mme Danièle Giuganti. Si les conventions de revitalisation sont signées sous l’autorité du préfet, elles sont toujours décidées en accord avec les élus locaux. Nous avons la possibilité de conjuguer plusieurs fonds, comme le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) ou le fonds de restructuration de la Défense (FRED). Je le répète : l’aspect humain joue pour beaucoup dans l’action des élus locaux. Nous utilisons également les conventions de revitalisation pour conforter l’activité dans un territoire sinistré, qui est en panne de développement.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Vous avez insisté sur le rôle des agents des ex-DRIRE en matière de prévention. Serait-il utile de développer cette mission en lui donnant des moyens supplémentaires ? Si oui, lesquels ? Par ailleurs, est-il envisageable d’instaurer un partenariat avec les tribunaux de commerce, qui agissent eux aussi en matière de prévention des difficultés ? Avez-vous déjà tissé des liens sur le terrain ?
Vous avez évoqué l’aspect régional et territorial de la revitalisation des territoires, qui s’inscrit dans les bassins d’emplois. La transposition législative de l’ANI entraînant un partenariat encore plus important avec les élus locaux et le monde politique, notamment lors des négociations, ne risque-t-on pas de voir se creuser les inégalités entre les territoires ?
La DIRECCTE est destinée à intervenir dans la négociation ou l’homologation du PSE : dans la mesure où les DIRECCTE se seront investies dans la négociation, seront-elles encore légitimes pour homologuer le PSE en cas d’échec de la négociation ?
Pourrait-on améliorer les liens existant entre les organismes de formation – ils sont nombreux ! – et les régions, qui sont chargées de la formation, en vue de mieux accompagner les salariés ?
Mme Danièle Giuganti. Notre dispositif régional en matière de prévention est rôdé : son organisation en échelons assure sa fluidité, de l’unité territoriale au commissaire régional au redressement productif. Au niveau des DIRECCTE, nous disposons également d’ingénieurs des mines et d’attachés d’administration qui suivent des filières industrielles précises, et nous pouvons nous appuyer sur les réseaux en région du médiateur inter-entreprises. Notre seule demande est en matière d’expertise dans le cas où l’on serait saisi d’un très grand nombre de PSE. Notre préoccupation, je le répète, est un risque de perte de compétences, à la suite de l’Acte III de la décentralisation, nos effectifs étant fléchés « développement économique ».
La commissaire au redressement productif de Lorraine travaille déjà en étroite collaboration avec les tribunaux de commerce et le réseau des experts-comptables. Il a fallu renouer la confiance avec la direction régionale des finances publiques (DRFiP), compte tenu des questions spécifiques de confidentialité liées aux entreprises en difficulté. Chacun a ses règles déontologiques en matière de circulation des informations. Au plan départemental les liens sont plus étroits avec les administrateurs judiciaires.
En accroissant les pouvoirs des élus locaux, la décentralisation aura nécessairement pour effet d’aggraver les déséquilibres entre les territoires.
Le métier de l’État est en train de changer : ses moyens baissant, il noue davantage de partenariats. Les plus anciens de nos agents, qui ont été formés à gérer des mesures et non à prendre des contacts, n’ont pas toujours le savoir-faire adéquat. Or il est d’autant plus difficile d’assurer la formation que les départs à la retraite liés à la baisse de nos effectifs nous privent parfois des compétences dont nous avons besoin. Le hiatus entre l’évolution de notre métier et la réduction des effectifs à marche forcée nous interdit de conduire certains de nos agents au niveau de compétence nécessaire. Ce n’est pas noircir le trait que d’affirmer que c’est à la fois compliqué pour les directions et anxiogène pour les fonctionnaires.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Je note votre inquiétude.
Il convient, à mes yeux, de bien faire la différence entre prévention et anticipation, lesquelles répondent à des temps différents. Pour paraphraser Jean-Pierre Aubert, je dirai qu’il faut arriver à concilier temps long et temps court, le temps court de la gestion des crises avec le temps long de l’anticipation. Or le chapitre III du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, destiné à « favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques, pour développer les compétences, maintenir l’emploi et encadrer les licenciements économiques » fait appel à lui seul à trois temps différents ! Comment assurer l’articulation de l’action publique entre prévention des PSE et utilisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), prévue à l’article 9 du texte, par les branches et leur déclinaison au niveau des entreprises ? Comment pratiquer l’anticipation au plan de la formation pour diriger les salariés vers d’autres métiers ?
Mme Danièle Giucanti. Nous travaillons en collaboration avec le conseil régional, avec lequel nous avons signé en 2009 un accord sur le travail partiel, auquel ont également participé les organismes paritaires collecteurs agrées (OPCA). Cet accord vise à financer des formations plutôt qu’à recourir au chômage partiel. Un comité de pilotage a été institué, comprenant le vice-président du conseil régional chargé de la formation, la DIRECCTE ainsi que les numéros un régionaux du MEDEF, de la CGPME, de l’UPA et des cinq organisations de salariés représentatives au plan national. Il faut reconnaître que les deux organisations qui n’ont pas signé l’ANI du 11 janvier dernier constituent des maillons faibles : au moindre incident, la CGT et FO, disparaissent. Compte tenu de l’éventualité du financement d’une GPEC territoriale sur le bassin houiller, il faudra convaincre le responsable de la CGT régionale de revenir dans le comité.
Ce comité tripartite se situe en amont du Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP), qui est l’instance de concertation stratégique au plan régional.
Nos services ont l’habitude de travailler avec les entreprises, à la fois dans l’exercice des missions régaliennes d’inspection et dans un rôle de médiation. Si les partenaires peuvent avoir temporairement des intérêts antagonistes, ils ont un intérêt commun : la pérennité de l’entreprise et de l’emploi. C’est pourquoi nous avons l’habitude de nous tenir à équidistance des représentants du personnel et de la direction. C’est la raison pour laquelle, si décriés soient-ils, l’inspection du travail et l’ensemble des services de la DIRECCTE conservent la confiance de leurs partenaires en matière de médiation, alors que la médiation professionnelle ne fonctionne pas au sein des entreprises. Le projet de loi contient toutefois le risque que les représentants du personnel refusent de signer des accords, pensant que l’État pourra obtenir mieux. Il faut être lucide.
Chaque année, l’État et Pôle emploi signent une convention régionale, qui n’est qu’une batterie d’indicateurs. Cette année, le ministre et le directeur général de Pôle emploi nous ont demandé de travailler uniquement sur des priorités, notamment sur la formation. Les demandeurs d’emploi les moins formés étant ceux qui restent sur le bord de la route. Le conseil régional de Lorraine a, de son côté, déjà entamé des discussions avec Pôle emploi sur le sujet. Nous serons donc la seule région à signer cette année une convention annuelle régionale tripartite entre la région, l’État et Pôle emploi. La négociation a notamment porté sur la répartition des rôles, les besoins de formation faisant l’objet d’un diagnostic. Cette stratégie partagée anticipe l’acte III de la décentralisation. L’argent devenant rare, nous sommes dans l’obligation de nous organiser pour optimiser les moyens dont nous disposons.
M. Christophe Castaner, rapporteur. En vous appuyant sur votre expérience, pensez-vous possible d’instituer un critère de mobilité en temps de trajet ou en distance du domicile – les deux ne pouvant être cumulés ?
M. Sébastien Hach. C’est une vraie question. Dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, le fait que les frais annexes ne soient pas remboursés, ou le sont de manière inégale selon les collectivités, crée une difficulté importante. Le problème de l’accompagnement individuel n’est donc pas tout à fait réglé puisque seule la partie pédagogique est prise en charge.
Il faut également savoir que dans un département comme les Vosges, une heure de trajet signifie un changement de vallée. Or changer de bassin d’emploi, c’est toucher à un élément substantiel du contrat de travail. Si le salarié refuse, il aura droit à un licenciement pour motif économique.
M. Christophe Castaner. Les zones d’emploi sur lesquelles vous travaillez doivent avoir un périmètre supérieur à trente kilomètres.
M. Sébastien Hach. Le bassin de vie correspond au mouvement des différents acteurs du territoire.
M. Christophe Castaner. Est-il fréquent, selon votre expérience, que des aides publiques – participation aux cellules de reclassement ou financement des indemnités différentielles de reclassement – soient attribuées à des entreprises qui ne rencontrent pas de réelles difficultés financières, qui sont en situation de bénéfices nets à N-1 ou qui procèdent à des restructurations dans une logique de délocalisation ?
Par ailleurs, quel est le coût pour les finances publiques du CSP ? Les cellules de reclassement ont-elles vraiment disparues depuis l’apparition du CSP ?
M. Sébastien Hach. En cas de conflit majeur, lorsqu’un PSE est notifié à notre unité territoriale, nous le soumettons à une grille d’analyse : plus les capacités financières de l’entreprise sont importantes, plus nous sommes exigeants.
Grâce à la mise en oeuvre des CSP, la question du recours aux cellules de reclassement ne se pose quasiment plus pour les entreprises qui n’appartiennent pas à un groupe. Le recours, depuis 2006, au contrat de transition professionnelle sur le territoire de Saint-Dié y a supprimé le recours aux cellules de reclassement.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. A quel échelon est établie la grille d’analyse que vous avez évoquée ?
M. Sébastien Hach. C’est une grille d’analyse nationale fournie dans le cadre des formations à l’anticipation des mutations économiques. Elle nous permet de traiter de manière quasi-uniforme les plans de sauvegarde de l’emploi au sein de nos unités territoriales.
Un député a remis un excellent rapport sur les cellules de reclassement en 2009-2010 et sur la question du taux de retour à l’emploi dans le cadre de ce dispositif. Les prestataires privés annonçaient des taux de reclassement situés en 90 % et 100 %. Nous avons procédé à une analyse portant sur quatre à cinq années antérieures : sur le département des Vosges, le taux de retour à l’emploi durable s’élève aujourd'hui entre 45 % et 50 % – CDI, CDD de plus de six mois et créations d’entreprises – ce sont les critères du CSP.
Mme Danièle Giucanti. Je tiens à saluer le travail réalisé par Pôle emploi, dont l’antenne de Lorraine doit traiter 1 000 demandeurs de plus par mois depuis un an.
Les CSP sont perçus par les agents de Pôle emploi comme une catégorie différente d’indemnisation qui ouvre un niveau d’indemnisation relativement confortable, avec l’objectif de donner aux salariés les moyens de se former et de se reconvertir. Or, plus l’indemnisation est importante, moins le chômeur se mobilise pour retrouver rapidement un emploi : il attend la fin de son indemnisation pour réagir.
Pôle emploi doit également traiter de manière prioritaire les chômeurs en fin de droit dans le cadre du plan Grande pauvreté – en Lorraine seul un demandeur d’emploi sur deux est indemnisé.
Sans doute, Pôle emploi tend à considérer que les CSP sont des nantis alors qu’il conviendrait au contraire de mobiliser ces demandeurs d’emploi, mais il faut savoir que Pôle emploi assume une charge de travail très difficile, notamment en termes d’accueil des nouveaux demandeurs d’emplois. Je leur tire mon chapeau.
Nous travaillons étroitement avec eux pour réduire le délai entre l’inscription à Pôle emploi et le début de la formation. Alors que la moyenne nationale est de quatre mois et vingt-cinq jours, elle est en Lorraine de quatre mois et vingt-deux jours. Plus on agit en amont, moins on perd de temps et plus l’investissement collectif porte ses fruits.
Mme Véronique Louwagie. Vous avez précisé qu’en raison d’un manque de moyens humains, vous rencontrerez des difficultés à mettre en place l’ANI. Avez-vous des préconisations à faire en vue d’agir avec plus d’efficacité ?
Par ailleurs, à vos yeux, la création des droits rechargeables favorisera-t-elle un retour plus rapide à l’emploi ?
Quelles actions recommanderiez-vous en direction des chômeurs de longue durée ?
Mme Danièle Giucanti. Nous savons où en sont les comptes publics et il ne serait pas raisonnable de demander des moyens supplémentaires. Nous devons faire des choix mais nous en faisons notre affaire. Ce dont nous avons besoin, c’est de stabilité, après l’épisode brutal de la révision générale des politiques publiques. De ce point de vue, la méthode de la modernisation de l’action publique est à la fois plus profonde et réfléchie. De plus, nous devons absolument conserver nos moyens d’expertise économique : si nous les perdions, l’État se couperait les bras.
M. Christophe Castaner. Aujourd'hui, 87 % des PSE sont suivis par les DIRECCTE et le nombre moyen de PSE, ces dernières années, s’est stabilisé. L’absence de recours judiciaires durant la procédure simplifiera le travail des DIRECCTE.
Mme Danièle Giucanti. Probablement. Toutefois, il ne faut pas oublier les pratiques qui permettent, avec l’accord de tous, y compris des organisations syndicales, de diminuer le nombre de PSE : les ruptures conventionnelles, les départs volontaires, la gestion des intérimaires – l’intérim a baissé de 20% en région Lorraine –, le non-renouvellement des CDD. Les organisations syndicales ne s’occupent pas des salariés précaires autant que des salariés en CDI.
Mme Corinne Soussia, magistrat à la Cour des comptes. Dans le cadre de la revitalisation, la formation se substitue-t-elle à la création d’emplois ou est-elle proposée en sus ? Il faut rappeler que les conventions de revitalisation ont pour objectif la reconstitution de l’emploi détruit.
Par ailleurs, procédez-vous en Lorraine – j’ai cru le comprendre pour les Vosges – à la mutualisation de fonds, pour servir de leviers ? Convient-il d’encadrer davantage ces pratiques ?
Enfin, comment voyez-vous l’avenir du FNE formation dans l’éventualité de l’acte III de la décentralisation, compte tenu des besoins que vous détectez ?
M. Sébastien Hach. Dans le cadre des conventions de revitalisation, la formation intervient évidemment comme un plus. L’objectif demeure la reconstitution de l’emploi. De nombreux rapports ont été rendus sur la question. Par exemple, le financement d’un permis de conduire permet d’accélérer le retour à l’emploi. Le maintien dans l’emploi entre dans l’anticipation, notamment au profit des PME.
Dans les Vosges, nous avons réussi à créer des comités d’engagement communs aux conventions de revitalisation sur chaque territoire. Il existe un comité de suivi départemental.
La départementalisation des fonds de revitalisation créerait un effet de levier. Il ne faut pas non plus oublier le dispositif ALIZE, qui permet de mutualiser les moyens humains, notamment d’expertise, et financiers – crédits à taux zéro –, des grandes entreprises au profit des PME. Il existe également au plan régional le fonds lorrain de consolidation : une partie de l’enveloppe de la convention de revitalisation remonte au niveau régional pour accompagner des projets structurants au profit des PME.
Mme Danièle Giucanti. Le département de la Moselle a monté des projets importants en matière de formation.
Si, dans le cadre de l’acte III, l’État ne peut plus être acheteur de formation, ce sera une bonne chose car il convient d’éviter les doublons. Je le dis à titre personnel.
Je tiens à souligner, s’agissant de la question des droits rechargeables, que rien n’est pire que les ruptures de parcours professionnels. Parfois, le demandeur d’emploi renonce à une initiative lui permettant de repartir dans la vie professionnelle parce que cela lui ferait perdre temporairement des droits. C’est favoriser les poches de pauvreté. Il faut raisonner, y compris en matière de protection sociale et de mutuelle, en termes de parcours tout au long de la vie, comme on l’a fait en matière de formation. La création des droits rechargeables s’inscrit dans cette logique et nous y sommes favorables.
M. Philippe Sold. Les droits rechargeables inciteront les demandeurs d’emploi à retourner sur le marché du travail puisqu’ils ne perdront plus tous leurs droits dans le cas où, de nouveau, ils se retrouveraient sans travail.
M. Christophe Castaner. Comment analysez-vous les licenciements diffus au regard de leur nombre, de leur impact et des solutions proposées, notamment dans le cadre de la proposition de loi Cherpion qui prévoyait la mise en place d’un dispositif du type PSE dasn cette hypothèse ? Je pense notamment aux caissières de la grande distribution.
M. Philippe Sold. Le dispositif cellule inter-entreprises permettait d’accompagner, avec des moyens d’État, les salariés d’un secteur d’activité concerné par ce type de licenciement. Or les nouveaux dispositifs sont plus centrés sur l’entreprise que sur le secteur d’activité.
M. Sébastien Hach. Dans un cas de licenciements diffus sur l’ensemble de la France, le ministère du travail a décidé d’assujettir le groupe à la convention de revitalisation et l’enveloppe avait été répartie sur différents territoires en France, dont Saint-Dié. Les licenciements diffus touchent surtout les banques et la grande distribution.
M. le président Alain Claeys. Madame et messieurs, je vous remercie.
Audition du jeudi 28 mars 2013
À 10 heures 50 : Mme Florence Dumontier, directrice générale adjointe en charge de la direction des opérations de Pôle emploi
Présidence de M. Alain Claeys, coprésident de la Mission.
M. le président Alain Claeys. Madame Dumontier, je vous propose de commencer cette audition par un propos introductif, avant de donner la parole aux rapporteurs.
Mme Florence Dumontier, directrice générale adjointe en charge de la direction des opérations de Pôle emploi. Créé en 2008, Pôle emploi est issu de la fusion de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et des associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic). L’établissement exerce des missions de prospection du marché du travail, d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des demandeurs d’emploi, d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et de tenue à jour de celle-ci. Il assure également, pour le compte du gestionnaire du régime d’assurance-chômage et de l’État, le service des allocations. Il recueille, traite, diffuse et met à disposition des services de l’État et de l’Unedic les données relatives au marché du travail et exécute les actions confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, qui sont en relation avec sa mission. Pôle emploi collabore avec les instances territoriales.
Pôle emploi n’intervient qu’indirectement en cas de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) puisque sa mission est centrée sur les demandeurs d’emploi et les entreprises. C’est d’ailleurs non pas la loi, mais une convention tripartite conclue entre l’État, l’Unedic et Pôle emploi qui nous a confié la mission de prendre en charge le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Créée l’an dernier par cette convention et dans le cadre du plan stratégique Pôle emploi 2015, la direction des opérations de Pôle emploi est chargée de l’offre de services, de l’animation du réseau et de la politique de qualité de l’établissement. Il existe, au sein de cette direction, un département dédié au traitement des licenciements économiques au sens large, dont la responsable, Mme Sandrine Hervé, m’accompagne aujourd’hui.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Quel rôle Pôle emploi joue-t-il lors des licenciements collectifs et des PSE ? Le chiffre souvent avancé – et très faible, selon nous – de seulement 4,5 % des entrées à Pôle emploi qui feraient suite à un licenciement collectif vous paraît-il correspondre à la réalité ? Le CSP est-il un instrument adapté ou faut-il le faire évoluer ?
Mme Florence Dumontier. Pôle emploi intervient à un double titre sur les CSP : d’une part, nous traitons les dossiers d’indemnisation des salariés ; d’autre part, nous accompagnons leur reclassement et leur retour à l’emploi. Nous assurons un suivi personnalisé de chaque salarié concerné afin de l’aider à réintégrer le marché du travail. Lorsqu’il peut accéder à un emploi de même nature sur un bassin d’emploi donné, il est inutile de le réorienter ; dans le cas inverse, il lui faut suivre des formations d’adaptation, voire de qualification.
Notre établissement dispose, dans chacune de ses directions régionales, d’équipes dédiées au CSP dont l’effectif varie en fonction du nombre de licenciements à traiter. Mais Pôle emploi n’assure pas seul sa mission d’accompagnement, contrairement à celle d’indemnisation : conformément à notre cahier des charges, nous confions à des prestataires l’accompagnement d’un bénéficiaire du CSP sur deux. Nous opérons cet arbitrage en fonction des situations.
M. Christophe Castaner, rapporteur. N’est-il pas anormal que les chômeurs qui ont enchaîné les contrats à durée déterminée (CDD) ne puissent profiter de l’accompagnement privilégié dont bénéficient les chômeurs ayant fait l’objet d’un licenciement économique ? Dans son plan d’action, votre directeur général affirme sa volonté – confirmée cette semaine par la création de 2 000 emplois supplémentaires – d’instaurer un accompagnement renforcé de droit commun et de disposer d’un correspondant pour soixante-dix chômeurs maximum. Le CSP ne correspond-il pas précisément à ce que devrait être cet accompagnement renforcé de droit commun ?
Par ailleurs, n’y a-t-il pas une contradiction entre l’approche collective du PSE, soutenue par l’intervention de cellules de reclassement, et la dimension individuelle du CSP – susceptible d’entraver la recherche de solutions collectives et donc la revitalisation de nos territoires ?
Mme Florence Dumontier. Nous menons actuellement une expérimentation d’accompagnement privilégié en direction des salariés sortant de CDD ou de contrat précaire.
Mme Sandrine Hervé, responsable du département « licenciements économiques » au sein de la direction des opérations de Pôle emploi. Cette expérimentation couvre 32 bassins d’emploi et profite à 6 000 bénéficiaires arrivant au terme de leur CDD ou de leur intérim, sachant que les partenaires sociaux et l’État ont fixé une cible de 8 700 bénéficiaires maximum. Elle concerne les personnes ayant droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) – ce qui la distingue de l’accompagnement fourni au titre du CSP. Ce dispositif est très apprécié de ses bénéficiaires qui jouissent d’un suivi individualisé assuré par un référent unique et de services de proximité. L’accès à la formation est en effet un levier important de leur reclassement.
Mme Florence Dumontier. L’expérimentation est pilotée par l’État et les partenaires sociaux. Elle pourra être généralisée si les résultats obtenus sont probants, comme ce fut le cas pour le CSP.
Vous vous interrogez sur le lien entre le type d’accompagnement offert et le type de public qui en bénéficie. Il est vrai que les partenaires sociaux et l’État apportent une aide plus importante aux salariés qui viennent de subir un licenciement économique qu’aux chômeurs ayant enchaîné les CDD, mais ils ne sont pas dans la même situation. En outre, le CSP est très encadré : il dure un an maximum et s’il est vrai que les allocations touchées par le salarié sont majorées, le contrat est assorti d’obligations particulières. Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) participent au volet « formation » du CSP, contrat dont l’objectif majeur est le reclassement et la réorientation de salariés qui seront peut-être contraints de changer de métier.
L’accompagnement renforcé est l’une des trois modalités de suivi des demandeurs d’emploi figurant dans le plan stratégique Pôle emploi 2015. Dans ce cadre, le nombre de chômeurs suivi par un même correspondant est limité à 70, contre 40 à 60 pour le CSP. Comme pour ce dernier, nous appuyons cet accompagnement renforcé sur des rendez-vous réguliers et concentrons nos actions sur le projet d’orientation et la formation du demandeur. Nous nous inspirons donc du CSP pour enrichir l’offre de services que nous proposons au titre de l’accompagnement renforcé – la différence majeure étant que les demandeurs bénéficiant d’un CSP, parce qu’ils viennent de perdre leur emploi, sont plus facilement employables que ceux qui sont au chômage depuis longtemps. Pôle emploi ne proposera d’accompagnement renforcé qu’aux demandeurs d’emploi qui en ont le plus besoin.
M. Christophe Castaner, rapporteur. La dimension individuelle de l’accompagnement fourni dans le cadre du CSP n’entre-t-elle pas en contradiction avec la recherche de solutions collectives propre aux PSE ? Ainsi, si l’on a pu avancer dans le dossier Lejaby, c’est parce que la situation sociale et la qualification des salariés étaient relativement homogènes et que les cellules de reclassement ont joué un rôle d’accompagnement important.
Mme Florence Dumontier. Le CSP est pris en charge par des équipes relevant d’agences spécialisées, ce qui lui confère une dimension collective. Celle-ci peut aussi devenir une identité collective lourde à porter pour des salariés qui souhaitent se reclasser et mener leur propre projet individuel.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Contrairement à ce que vous nous indiquez, nous n’avons pas toujours l’impression que les effectifs de Pôle emploi soient adaptés au volume des demandes à traiter. Le recours à des prestataires extérieurs dans 50 % des cas constitue-t-il une variable d’ajustement ? Vous paraît-il un atout ou un handicap ?
Par ailleurs, le bilan des actions de formation menées dans le cadre du volet « accompagnement » du CSP diffère-t-il selon les régions ?
Mme Florence Dumontier. C’est dans le cadre du CSP, dispositif qui bénéficie d’un financement à part, que nous faisons varier les moyens alloués en fonction des problèmes à traiter, en lien avec la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Nous sommes organisés de la manière la plus souple possible même s’il existe sans doute des marges d’amélioration. Le recours aux sous-traitants et aux prestataires extérieurs est un atout pour Pôle emploi puisqu’il lui permet de partager le volume de licenciements à traiter et de mieux couvrir le territoire – au plus près du besoin du salarié. Dans le cas de Doux, par exemple, si les salariés ont souhaité être accompagnés par Pôle emploi du fait de sa proximité géographique, nous avons néanmoins dû faire appel à des prestataires pour couvrir certains endroits éloignés.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Le salarié tient-il également compte du critère géographique dans le choix de sa formation ?
Mme Sandrine Hervé. C’est l’OPCA qui, dans 80 % des cas, finance l’essentiel des formations du CSP – Pôle emploi et les conseils régionaux apportant également un complément. Ainsi, depuis un an, Pôle emploi apporte une aide individuelle à la formation, notamment en cas de parcours long de reconversion ou si le coût de la formation est supérieur à l’aide fournie par l’OPCA. Nous souhaiterions que les conseils régionaux contribuent davantage à ce volet formation qu’ils ne le font actuellement. Quoi qu’il en soit, toutes les demandes de formation qui ont été adressées dans le cadre du CSP ont pu être satisfaites jusqu’ici. Notre mode d’organisation nous permet ainsi de mieux répartir nos actions sur le territoire et de proposer une offre de formation très individualisée. Les bénéficiaires apprécient d’ailleurs beaucoup cette possibilité de commencer leur formation très rapidement.
M. Christophe Castaner, rapporteur. C’est en aval du PSE que vous intervenez. Cependant, il nous faudrait bénéficier de la vision la plus large et la plus anticipée possible de la situation : Pôle emploi, qui dispose à la fois d’une vision territoriale et d’une approche par filières, devrait-il avoir des fonctions de prévention et d’anticipation ? Devrait-il intervenir dans le cadre de l’obligation, prévue par l’article 14 du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, faite aux entreprises souhaitant cesser leur activité, de chercher un repreneur ?
Par ailleurs, dans le cadre de votre mission d’accompagnement et d’indemnisation des salariés licenciés, prenez-vous en compte les primes supralégales, parfois élevées, que certains d’entre eux obtiennent d’employeurs dont le but est d’acheter la paix sociale ? Disposez-vous de cette information ?
Mme Florence Dumontier. Si Pôle emploi agit effectivement assez peu en amont du PSE, son intervention pourrait être pertinente au moment de l’élaboration de celui-ci, étant donné sa bonne connaissance du marché du travail et sa capacité à mobiliser des acteurs et à identifier des solutions en prise avec le territoire. Pôle emploi présente, en effet, l’avantage d’être implanté sur 1 000 bassins d’emploi. Une telle implication en amont nous permettrait aussi de mieux connaître le PSE et donc de mieux articuler les outils à disposition – dont il faudrait d’ailleurs réduire le nombre.
La revitalisation du territoire dans le cadre du PSE est complexe, car elle implique un très grand nombre d’acteurs. La place de Pôle emploi en ce domaine n’est pas toujours reconnu et le serait effectivement davantage s’il était associé au PSE en amont de son élaboration. Une entreprise en difficulté qui licencie aujourd’hui, peut très bien recruter demain. Il importe donc d’adopter une vision dynamique de ces problèmes.
En accordant davantage de temps et de marges à la préparation du PSE, l’Accord national interprofessionnel et le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi offrira sans doute la possibilité à Pôle emploi d’agir plus en amont.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Pourtant, le projet de loi n’accorde aucun rôle à Pôle emploi dans le dispositif …
Mme Florence Dumontier. Sans aller jusqu’à associer Pôle emploi à la rédaction du PSE, nous pourrions y apporter des éléments de réflexion.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Vous déplorez un trop grand nombre d’outils : pourriez-vous les hiérarchiser en fonction de leur pertinence ?
Mme Florence Dumontier. Si tous les outils ont une fonction et balayent le champ des besoins, on pourrait en fusionner certains qui sont très proches, comme par exemple l’action de formation préalable au recrutement (AFPR) et la préparation opérationnelle à l’emploi (POE). Pôle emploi s’est engagé dans un processus de simplification de ses outils, en lien avec le conseil d’administration, en ce qui concerne les aides et les mesures et avec l’Unedic sur d’autres thèmes.
Mme Sandrine Hervé. Dans le cadre du PSE, les circuits de financement des formations sont également complexes et les enveloppes et l’aide de l’OPCA ne sont pas mobilisables dans les mêmes conditions.
Quant aux primes supralégales, Pôle emploi n’en a effectivement pas connaissance lorsqu’il déploie les mesures d’accompagnement sauf si la personne en parle elle-même; l’information n’a lieu que par le biais de l’indemnisation des salariés licenciés.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi prévoit l’instauration de droits rechargeables : quel en sera l’impact sur les personnes indemnisées ?
Mme Florence Dumontier. Nous y sommes plutôt favorables : cette mesure sécurisera les salariés licenciés qui ne parviennent pas à retrouver un emploi et dont le parcours est souvent très fractionné. Cela simplifiera aussi le droit en vigueur, sous réserve que les textes d’application ne viennent pas à nouveau compliquer les choses.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Face à l’extinction progressive des mesures d’âge, telles que l’allocation progressive du Fonds national de l’emploi ou l’allocation de cessation d’activité des travailleurs salariés, êtes-vous véritablement en mesure de favoriser le retour à l’emploi des ex-salariés âgés ? Ne pourrait-on les inciter à travailler à temps partiel, tout en leur versant une indemnité différentielle ?
Mme Florence Dumontier. Je préfère répondre par écrit à cette question, car je crains de ne pas être suffisamment précise.
Pour revenir au chiffre de 4,5 % de salariés faisant l’objet d’un licenciement économique et qui s’inscrivent ensuite à Pôle emploi, nous ne connaissons pas la source de ce chiffre. Il nous est donc difficile de nous prononcer.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Quelle est votre estimation ? Les écarts entre les territoires sont-ils importants ?
Mme Sandrine Hervé. Nous ne disposons d’aucun outil pour évaluer le fait que les bénéficiaires du CSP aient fait l’objet d’un licenciement économique collectif ou pas, et si l’entreprise dont ils sont issus comporte plus ou moins de 1 000 salariés. En revanche, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) a institué un outil de pilotage du CSP qui permet de connaître le nombre de personnes qui entrent ou sortent du système ainsi que le nombre de bénéficiaires suivis, les formations utilisées et le nombre de personnes qui reprennent le travail.
Mme Florence Dumontier. Cet outil est administré par un comité de pilotage national et des comités régionaux et départementaux. Le suivi du CSP est donc très structuré. Nous ne sommes pas en mesure de rapporter ces chiffres à l’assiette du nombre de salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique. Néanmoins, les motifs d’inscription chez Pôle emploi figurent dans la statistique du marché du travail, qui est diffusée chaque mois.
Le projet de déclaration sociale nominative (DSN) nous fournira une base commune de connaissances, c’est-à-dire une source unique, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il serait d’ailleurs souhaitable que ce projet se concrétise rapidement.
Mme Corinne Soussia, conseiller référendaire à la Cour des comptes. Lorsque, face à une augmentation du nombre de CSP, vous renforcez les équipes présentes dans les agences dédiées, procédez-vous à des redéploiements d’effectifs ou recourez-vous à des effectifs temporaires ?
Mme Florence Dumontier. Comme il s’agit d’un accompagnement renforcé, nous veillons à y affecter des personnels expérimentés, d’autant que le métier s’est beaucoup diversifié. Nous proposons d’abord ces postes aux personnels de l’agence concernée et ce n’est que si nous ne trouvons pas preneur que nous procédons à des recrutements.
Mme Corinne Soussia. Quel est l’ordre de grandeur des effectifs assurant le suivi des bénéficiaires de CSP dans ces agences dédiées ?
Mme Florence Dumontier. Je vous répondrai plus précisément par écrit. Les personnes à qui l’on propose de s’occuper du CSP sont remplacées dans leur agence.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Dans quel délai procèderez-vous à l’évaluation de l’expérimentation dont vous nous avez parlé ?
Mme Sandrine Hervé. L’expérimentation, dont les délais sont encadrés par la convention relative au CSP, a débuté en janvier 2012 et de nouveaux territoires continuent à intégrer le dispositif. Le comité de pilotage national en a confié l’évaluation à la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) qui devrait la publier d’ici à un mois.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, rapporteure à la Cour des comptes. Quel bilan tirez-vous de votre expérience des cellules d’appui à la sécurisation professionnelle – sorte de sas entre le plan de licenciement et le recours au CSP ? Pôle emploi est-il en mesure de prendre en charge les salariés ayant été confrontés à une situation de crise lors du PSE ?
Mme Sandrine Hervé. Ces cellules d’appui interviennent pendant six semaines, à la demande de l’État et en concertation avec Pôle emploi, en cas de difficultés particulières sur un bassin. Lorsque l’entreprise se trouve dans un contexte social difficile, on essaye de les installer aussi tôt que possible, en faisant appel à ceux des prestataires de notre réseau qui sont compétents pour offrir un appui psychologique aux salariés. Il peut donc s’écouler un certain temps entre l’intervention de ces cellules et la conclusion du CSP. Si les équipes de Pôle emploi poursuivent bien entendu leur action dans l’intervalle, sans doute conviendrait-il d’améliorer l’enchaînement de ces deux dispositifs.
Mme Florence Dumontier. Nous considérons la coexistence du CSP et des cellules de reclassement comme une redondance, source de complexités. Même si ces cellules sont financées dans le cadre du PSE, mieux vaudrait que les salariés aient un interlocuteur unique. Or, Pôle emploi est de toute façon chargé de leur indemnisation. Le CSP est donc suffisant.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Les cellules de reclassement se fondent sur une approche collective et de revitalisation territoriale, qui n’est pas forcément possible dans le cadre de l’accompagnement individuel. Vous m’avez répondu que vos équipes seraient en mesure d’y parvenir. Dès lors, si un dispositif devait en chasser un autre, il conviendrait d’assigner au CSP un double objectif de reclassement individuel et de revitalisation territoriale.
Mme Florence Dumontier. Il existe pour ce faire d’autres dispositifs tels que les services publics de l’emploi locaux.
M. le président Alain Claeys. Nous vous remercions, mesdames, et vous invitons à répondre par écrit au questionnaire que nous vous avons adressé.
Audition du jeudi 11 avril 2011
À 9 heures 30 : M. Sébastien Raspiller, secrétaire du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI)
Présidence de M. Olivier Carré, président
M. Olivier Carré, président. Nous vous remercions de votre présence pour nous faire part de votre expérience sur cet important sujet.
M. Sébastien Raspiller, secrétaire du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Créé par un décret de 1982 et prenant la suite du Comité interministériel d’aménagement des structures industrielles (CIASI), qui datait de 1974, le CIRI est l’organisme public le plus ancien en matière de traitement des difficultés des entreprises. Structure légère, administrativement rattachée à la direction générale du Trésor, il comporte un secrétaire général et cinq – bientôt six – rapporteurs. Son fonctionnement est cependant interministériel car il répond à la nécessité de réduire, pour un chef d’entreprise en difficulté, le nombre d’interlocuteurs publics, et d’assurer le lien, pour un même dossier, entre les différentes administrations concernées. Sont plus spécialement visées la direction générale des finances publiques et la direction de la sécurité sociale, pour les créanciers publics, auxquelles nous adressons des recommandations ; le ministère de la justice, pour les aspects juridiques qui peuvent être très complexes ; ainsi que des directions plus techniques, depuis celles de l’agriculture jusqu’à celles de la défense …
Le CIRI n’a guère évolué depuis trente ans dans ses méthodes de travail, restant fidèle à certains principes.
Il ne s’autosaisit jamais. Il reçoit, à sa demande, le chef d’entreprise concerné, accompagné de ses conseils et, éventuellement, du mandataire ou du conciliateur, afin d’examiner ses difficultés et, le cas échéant, ce qui a déjà été fait pour tenter de les résoudre. Il considère également l’environnement et les partenaires éventuels de l’entreprise, tels qu’un groupe de banques, l’existence d’une assurance crédit et d’un passif public, la situation du poste clients, les relations avec les fournisseurs, la mobilisation des actionnaires, les efforts déjà accomplis ou envisageables par la direction de l’entreprise. Ce premier rendez-vous permet de déterminer si le dossier est, ou non, éligible au CIRI, et de porter une première appréciation, chaque cas étant singulier et devant donner lieu à une relation de confiance.
La procédure est toujours amiable, les procédures collectives relevant des tribunaux de commerce et des administrateurs judiciaires. Le CIRI n’intervient donc pas en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Son objectif est d’aboutir à un accord contractuel, ce qui exige l’unanimité des parties prenantes. Il cherche donc à définir une stratégie qui ne vise pas à minimiser les efforts de chacun mais de les répartir équitablement.
Cela se traduit d’abord par l’établissement d’un diagnostic sur l’origine et le niveau des difficultés, avec le concours d’auditeurs indépendants et reconnus, condition indispensable à la crédibilité de la démarche.
Nos règles de base sont intangibles.
La première réside dans la confidentialité, condition indispensable à la réussite d’une procédure amiable, faute de quoi la situation économique de l’entreprise peut se dégrader très rapidement. Celles qui s’adressent à nous éprouvent le plus souvent des difficultés de trésorerie qui déterminent le calendrier de notre intervention. Avant même de formuler des recommandations de restructuration, il nous faut gérer ce problème urgent. Dans les quelques exemples où la confidentialité n’a pas été respectée, toutes les parties prenantes de l’entreprise ont eu à en souffrir.
La deuxième réside, comme je l’ai déjà dit, dans la répartition équitable des efforts, selon un ordre relativement classique.
En premier lieu, l’actionnaire, dont le premier rôle, y compris sur le plan juridique, est d’assurer la poursuite de l’activité. C’est donc à lui qu’il revient d’accomplir les premiers efforts, notamment en matière de trésorerie. Nous n’intervenons que pour les entreprises comptant plus de 400 salariés, mais dont la détention du capital est très variable, pouvant relever de personnes physiques, d’autres entreprises, d’institutionnels, de fonds de placement … Ce qui n’a pas la même incidence quand il s’agit d’apporter de l’argent en cas de difficultés.
En deuxième lieu, les créanciers privés, en distinguant les créanciers interentreprises, notamment au titre de l’affacturage, des créanciers bancaires, qui ont intérêt à préserver leurs créances en réinjectant de l’argent frais mais qui veillent souvent à ce que l’actionnaire soit mis le premier à contribution.
En troisième lieu, les créanciers publics, adossés à un passif un peu particulier puisque celui-ci résulte non d’un contrat mais du défaut de paiement.
Le CIRI, jouissant de la confiance des parties prenantes, s’efforce d’abord de maîtriser le calendrier, disposant de toutes les relations nécessaires avec les administrations, ce que ne possède pas forcément un administrateur judiciaire. Il ne détient toutefois aucun instrument financier direct, à l’exception des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) mais qui restent marginaux. Il ne dispose pas davantage de pouvoirs d’ordre réglementaire ni de pouvoir d’injonctions.
Le CIRI constitue un espace de médiation, mais qui peut être assez ferme, son principal atout résidant dans sa capacité de persuasion et sa force dans sa parfaite connaissance de tous les ressorts et de tous les intervenants du traitement des entreprises en difficultés. S’est ainsi instaurée une certaine discipline collective qui permet d’éliminer, d’un dossier à l’autre, les « passagers clandestins ».
Nos moyens humains sont limités mais totalement dédiés à notre objectif.
Nous sommes indépendants, gratuits et constants, inspirant ainsi confiance aux entreprises pour définir des stratégies respectant toutes les parties et selon les mêmes principes depuis trente ans. Nous recevons donc plutôt mal les dirigeants d’entreprise qui ne songent qu’à préserver leurs propres intérêts et, compte tenu de notre longue expérience, ils le savent ! Ce qui vaut aussi pour les actionnaires.
Cela étant, toute restructuration comporte un coût pour les parties prenantes. Et toute solution discutée et basée sur un effort de chacun est, à l’expérience, plus pérenne qu’une solution imposée par un juge. Les solutions amiables présentent un taux de réussite bien supérieur à celui des procédures judiciaires. Il vaut mieux intervenir le plus possible en amont mais il est également vrai que seul le pied du mur oblige à accepter certains efforts.
Les entreprises sortant d’un problème traité par le CIRI en retirent généralement l’impression qu’on ne pouvait agir autrement et que toutes les pistes ont été explorées pour préserver leur activité ainsi que l’emploi salarié.
Pour autant, nous ne sommes pas dogmatiques : le cas échéant, des ajustements de charges salariales s’avèrent inévitables, impliquant des réductions d’organisation ou d’activités qui, à terme, permettent des réembauches. Le droit français privilégie la préservation de l’emploi ; nous nous efforçons de préserver l’activité économique.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Combien d’entreprises recourent à vos services ? Comment, ensuite, évoluent-elles ? Quel est donc le taux de réussite de votre mission à moyen et à long terme ?
Le seuil de 400 salariés est-il le seul critère d’éligibilité aux prestations du CIRI ?
La nouvelle procédure judiciaire de sauvegarde des entreprises, qui comporte aussi médiation, conciliation et confidentialité, entre-t-elle en concurrence avec vous ? Quel est l’intérêt d’une entreprise en difficultés de s’orienter vers l’une ou vers l’autre formule ?
Dans quels cas la confidentialité n’a-t-elle pu être respectée ? Les cas sont-ils nombreux ? Pourquoi ? Et quels sont les remèdes envisageables ?
Quelles suggestions feriez-vous pour améliorer le dispositif et les moyens du CIRI ?
M. Sébastien Raspiller. Notre rapport annuel, à paraître avant la fin du premier semestre, fournira dans le détail toutes les statistiques dont vous avez besoin.
En 2012, le CIRI a traité 60 entreprises en difficulté, dont 30 nouveaux dossiers, représentant au total un peu plus de 78 000 emplois. La moitié d’entre elles ont connu une issue positive, préservant environ 31 000 emplois. Mais nous avons subi trois échecs. Au cours des trois années précédentes, le nombre de nouveaux dossiers était plus élevé, se montant à environ 45 000 : 2012 a donc marqué un ralentissement mais le premier trimestre de 2013 traduit une forte augmentation, de l’ordre d’une trentaine, soit à peu près le même nombre que pour toute l’année 2012.
M. Olivier Carré, président. C’est considérable !
M. Sébastien Raspiller. Cette augmentation s’est manifestée à partir de décembre 2012.
M. Olivier Carré, président. Représentant combien d’emplois ?
M. Sébastien Raspiller. Toutes les tailles d’entreprises sont concernées, avec une moyenne de 1 500 salariés. En termes d’emploi, le premier trimestre de 2013 est également comparable à toute l’année 2012.
Le seuil des 400 salariés, en France, est le principal critère d’éligibilité à l’intervention du CIRI mais s’apprécie au niveau du groupe : si une filiale en difficulté emploie moins de personnes, nous la prenons tout de même en compte dans le cadre d’un traitement global.
Intervient un second critère : le CIRI n’intervient que dans l’hypothèse de besoin de restructuration, financière et/ou industrielle, et non pour un simple moratoire bancaire. Il n’a vocation à traiter que des dossiers complexes impliquant des décisions lourdes mettant notamment en cause l’organisation et l’efficacité de la direction d’entreprise, la recherche de nouveaux actionnaires et de nouveaux investisseurs, la cession de pans d’activité, la restructuration de la dette …
M. Olivier Carré, président. M. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, a récemment donné des chiffres très précis mais différents des vôtres : ayant traité 70 909 emplois menacés, son action – et bien sûr celle de ses services – avait permis d’en sauver 59 961. Le premier chiffre n’est donc pas loin du vôtre mais le deuxième n’est plus que de la moitié de ce que vous venez de nous dire …
M. Sébastien Raspiller. Je vous ai communiqué les statistiques, arrondies, de l’année 2012. M. Arnaud Montebourg ne compte qu’à partir de son entrée au Gouvernement et jusqu’aux données les plus récentes de 2013. Il tient également compte du travail des commissaires au redressement productif, que nous n’intégrons pas dans les statistiques portant sur les entreprises de plus de 400 salariés.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Vous avez souligné le maquis des intervenants publics concernant le redressement des entreprises en difficulté. Le CIRI a trente ans mais de nouveaux acteurs publics sont apparus : comment la gouvernance administrative s’organise-t-elle vraiment ? Quelles réformes seraient souhaitables pour articuler au mieux les cellules de médiation du crédit et de la sous-traitance, les commissaires au redressement productif, le Comité départemental de soutien au financement des entreprises (CODEFI), la banque publique d’investissement (BPI), le fonds stratégique d’investissement (FSI), les collectivités territoriales et le CIRI ?
Le secret de l’instruction de vos dossiers est évidemment un sujet majeur. Mais comment entre-t-il en cohérence avec le projet de loi de sécurisation de l’emploi qui préconise le maximum de transparence en amont vis-à-vis des représentants syndicaux ? La médiatisation pouvant en résulter risque-t-elle de gêner le travail du CIRI ?
M. Sébastien Raspiller. Si certains gros dossiers d’entreprises en difficulté occupent les premiers rangs de l’actualité, le CIRI se soucie avant tout de l’intérêt public, c’est-à-dire des entreprises dont la disparition entraînerait de graves perturbations dans l’économie nationale ou territoriale, au niveau de la filière de production comme des bassins d’emplois. C’est ce qui a justifié la création et qui justifie aujourd’hui son existence.
La crise de 2008 et 2009 a accéléré les besoins de médiation pour sauver des entreprises au plan financier, d’où la création de la médiation du crédit et des commissaires au redressement productif (CRP) après celle des quelques commissaires à la réindustrialisation.
Le CIRI n’éprouve aucune difficulté à travailler avec la médiation du crédit ni avec les CRP. Le seuil de 400 salariés permet en effet de départager nos compétences respectives. Ce nombre n’est cependant pas un dogme : il peut arriver que nous traitions un dossier d’entreprise un peu en-dessous.
Les CRP ont en portefeuille beaucoup plus d’entreprises que le CIRI mais, s’appuyant sur les services des préfectures, ne traitent pas leurs problèmes en profondeur comme nous le faisons. Car on n’aborde pas les difficultés d’une entreprise de 50 ou de 100 salariés comme celles d’une entreprise de 1 000 salariés. Les mécanismes de crédit, le mode de direction, l’implication des actionnaires ne sont pas les mêmes. De sorte que CIRI et CRP ne sont pas des concurrents, seul le premier pouvant travailler sur des dossiers individuels pendant plusieurs mois, voire davantage.
La médiation du crédit constitue, pour sa part, un instrument de masse, avec 300 saisines par mois qui, pour 90 % des cas, concernent de très petites entreprises (TPE) en délicatesse avec leur banque sur leur ligne de crédit. C’est pourquoi la médiation du crédit, qui a besoin d’un réseau réactif, s’appuie sur celui de la Banque de France. Mais nous discutons régulièrement avec elle afin de clarifier la frontière de nos interventions respectives, selon qu’il existe un besoin de restructuration ou seulement de moratoire de crédit.
Les missions et le mode de fonctionnement de chacun sont bien définis.
Moyennant quoi, les dirigeants d’entreprise en difficultés peuvent encore hésiter dans la recherche du bon interlocuteur. Il serait peut-être utile d’éditer un vademecum facilitant leur tâche à cet égard.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Selon vous, la communication à l’intention des entreprises serait encore insuffisante, mais pas jusqu’à créer une « main unique » pour suivre tous les cas ?
M. Sébastien Raspiller. Du fait de ses missions, le CIRI ne saurait se confondre avec la médiation du crédit, pas plus qu’avec la BPI ou le FSI. Il traite un actionnaire public comme un actionnaire privé, sans passe-droit, sinon les créanciers pourraient dénoncer un traitement non égalitaire. Il en va de même de ses relations avec Oséo. Car il ne faut pas confondre la fonction de médiation avec celle d’intervenant financier public. La « main unique » risquerait donc de mélanger les genres. Car il est moins difficile d’investir que de se comporter en actionnaire et encore moins dans une entreprise en difficulté.
Le CIRI occupe une position neutre à l’égard de tous les intervenants, ce qui conforte une crédibilité acquise et reconnue à travers trente ans d’exercice et qui ne coûte rien à l’État. Je ne suis donc pas demandeur d’une quelconque évolution de l’organisme.
Il ne faut pas confondre secret et confidentialité. Ce qu’on peut lire dans les journaux sur des dossiers que nous traitons comporte généralement des éléments inexacts et, si ceux-ci proviennent de certaines parties prenantes c’est afin d’orienter la négociation en leur faveur. Nous garantissons un processus transparent, qui exige la confidentialité, mais qui ne comporte rien de secret : la première protège les parties et est opposable aux tiers.
Notre principal outil de travail réside dans la conciliation, afin d’aboutir à une homologation, dans le cadre de laquelle les salariés sont représentés. Ces derniers seront-ils plus présents avec l’entrée en vigueur de la future loi sur la sécurisation de l’emploi ? En l’état actuel du texte, je n’entrevois pas de difficultés nous concernant. La responsabilité d’informer les salariés sur l’évolution des discussions en vue de dégager une solution incombe à la seule direction d’entreprise et non au CIRI.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Un des nos collègues interrogeait récemment le Gouvernement sur la mise en redressement judiciaire de l’entreprise Heuliez, mettant en cause le CIRI. Comment analysez-vous cette perception de votre action ?
S’agissant des instruments à perfectionner pour faciliter le redressement des entreprises en difficultés, que pensez-vous de l’idée de transformer les créances publiques en participations au capital ou en quasi fonds propres ?
Comment jugez-vous la position de la Commission européenne dans le dossier SeaFrance, considérant certaines aides indirectes comme des aides d’État déguisées ?
Des fonds territoriaux pourraient-ils soutenir votre action en facilitant des reprises d’entreprises ?
D’une façon plus générale : faut-il inventer de nouveaux outils ou renforcer certains outils existants ?
M. Sébastien Raspiller. Concernant Heuliez, il ne faut pas confondre le CIRI et le FSI. Le CIRI a déployé dans ce dossier, symbolique, tous les efforts possibles relevant de sa compétence. Mais ne pas accepter la contribution proposée, et raisonnable à mes yeux, du FSI relève du seul choix de l’actionnaire, qui n’a pas voulu ouvrir son capital.
La reprise de créances publiques par les actionnaires exposerait ceux-ci à des risques juridiques et financiers considérables. Quant à la transformation de ces créances en capital, cela reviendrait à nationaliser des PME, le plus souvent dépourvues de direction financière et de documentation, et aussi à envoyer des administrateurs d’État partout en France… Mieux vaut raisonner de façon plus générale : une telle solution est rarement nécessaire. L’actionnaire qui ne remet pas d’argent dans l’entreprise alors que celle-ci souffre d’une impasse de trésorerie, et qu’elle choisit du coup de ne pas payer ses impôts, en abandonne de fait la propriété économique. Celle-ci se trouve donc transférée au créancier public. Ce dernier doit-il alors provoquer une mise en redressement judicaire pour cessation de paiement ? Le comportement de certains actionnaires le justifie mais il serait préférable que le créancier public puisse agir comme un créancier de droit commun. J’ai demandé, sur ce thème, une mission à l’inspection générale des finances, actuellement en cours.
M. Olivier Carré, président. Hormis les salariés, le créancier fiscal est un créancier de premier rang …
M. Sébastien Raspiller. Certes, mais il en va différemment dans une procédure de traitement amiable.
M. Olivier Carré, président. La question a été débattue avec la direction du trésor lors du plan de relance. L’État voulant être payé avant les fournisseurs, ceux-ci exigeaient d’être payés par avance. De ce fait, avoir momentanément rétrogradé les créances de l’État derrière les créances « économiques » a permis de rétablir une certaine confiance et d’éviter une embolie.
La puissance publique n’est pas créancier prioritaire dans tous les pays. Souvent, la vie économique prime sur la dette à l’égard de l’État.
M. Sébastien Raspiller. Il serait bon que les créanciers publics disposent des mêmes outils que les créanciers privés. Par exemple, ils ne bénéficient pas, aujourd’hui, dans le cadre d’une conciliation, du privilège dit de « new money », permettant à l’entreprise de survivre durant la négociation, selon l’article L.611-11 du code de commerce.
Le régime de remboursement du passif public me paraît donc devoir être amélioré, afin que le créancier public puisse enfin raisonner comme un partenaire économique et non comme un simple revendicateur de dû.
M. Olivier Carré, président. Faut-il, pour autant, transformer le Trésor en créancier ordinaire ?
M. Christophe Castaner, rapporteur. Cela risque, en outre, d’avoir des incidences sur la sous-traitance et, partant, sur les emplois à la clé.
M. Sébastien Raspiller. Le CIRI examine bien sûr avec soin la situation des sous-traitants, surtout s’ils sont peu nombreux.
L’ordre des privilèges des créances et des sûretés mérite en effet d’être revu car il s’agit aujourd’hui d’un maquis nuisant à la capacité des acteurs économiques de se positionner par rapport au réel de l’entreprise : personne ne sait vraiment quel rang il occupe.
Comparativement à d’autres pays européens, notamment le Royaume-Uni, il est particulièrement difficile en France d’accéder à de l’argent frais pour des entreprises en difficulté et en négociation en vue de leur redressement. Car notre système de hiérarchie des privilèges des créanciers, difficilement lisible, dissuade de prendre des risques économiques quand justement ils seraient particulièrement nécessaires. En outre, les dirigeants d’entreprise s’adressent tardivement à nous, alors que quelques mois supplémentaires auraient permis d’aborder leurs problèmes de trésorerie avec davantage de sérénité et de passer plus vite au problème de fond de la restructuration.
M. Olivier Carré, président. Ne décrivez-vous pas là une époque disparue, quand le dialogue était beaucoup plus cloisonné, chaque partie prenante ne raisonnant que chacune pour soi ? Aujourd’hui on se met plus facilement, acteurs publics comme privés, autour de la table pour chercher des solutions en commun.
M. Sébastien Raspiller. S’agissant des créances publiques, je considère que l’instrument de la dette doit toujours l’emporter sur celui de la participation au capital. Je suggère donc que l’actionnaire défaillant, qui dispose aujourd’hui du seul pouvoir de nuisance à travers la propriété juridique de l’entreprise alors qu’il ne dispose plus de sa réalité économique et que d’autres partenaires ont sauvé celle-ci à sa place, puisse être évincé, mais évidemment selon un encadrement juridique précis, un peu comme dans le système du « bail in » bancaire.
Encore que des instruments juridiques existent déjà pour conforter les vrais actionnaires : les quasi fonds propres mais aussi des formules de transfert de propriété comme la fiducie récemment introduite en droit français, qui permet d’échapper à la confusion des patrimoines tout en défendant les créances publiques. Réfléchissons- y.
La Commission européenne surveille de près les aides d’État. Mais tous les dossiers traités par le CIRI ont bénéficié de son blanc-seing. Car nos principes de fonctionnement répondent à ses préoccupations : s’il y a effort public, il doit aussi y avoir effort privé ; les créanciers publics ne sont pas mieux traités que les privés ; en cas d’investisseur public, intervient aussi un investisseur privé … Cette panoplie de règles et d’usages permet donc de faire jouer à plein l’effet de levier d’une intervention financière publique, de mieux boucler les tours de table, de préserver les responsabilités juridiques de chacun, surtout quand de grandes banques s’en mêlent. La Commission européenne le comprend d’autant mieux qu’elle s’est approprié les principes à la base du CIRI, et même du CIASI.
Je me permets, en conclusion, de signaler que l’effet levier, notamment grâce aux prêts du FDES, joue comme l’effet boule de neige mais qu’il est difficile de l’arrêter.
Dans un cas récent, pour une grosse entreprise souffrant d’une impasse de trésorerie de plusieurs dizaines de millions d’euros, qui ne pouvait même plus payer les salaires et qui voulait faire endosser au créancier public un passif de 30 millions, le CIRI est intervenu pour qu’elle obtienne un prêt grâce à la mobilisation des autres créanciers, ce qui a divisé par 2,5 l’exposition des deniers publics.
Donc mieux vaut un créancier actif que passif !
M. Olivier Carré, président. Ce n'est pas, en effet, à l’État de se substituer au banquier … Monsieur nous vous remercions.
Audition du jeudi 11 avril 2013
À 10 heures 45 : M. Gilles Mergy, délégué de l’Association des régions de France (ARF) pour l’emploi et la formation professionnelle, accompagné de M. Erwan Salmon, conseiller au développement économique, à l’enseignement supérieur, à la recherche et aux technologies de l’information et de la communication
Présidence de M. Olivier Carré, coprésident de la Mission
M. Olivier Carré, président. Nous poursuivons nos travaux sur la prévention et l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) en accueillant M. Gilles Mergy, délégué de l’Association des régions de France (ARF) pour l’emploi et la formation professionnelle. Il nous dira comment les régions s’efforcent à l’efficacité en ces matières. Il est accompagné de M. Erwan Salmon, conseiller.
M. Gilles Mergy, délégué à l’Association des régions de France. N’étant pas élu mais technicien, c’est en technicien que je vous parlerai. Sur un plan général, qu’il s’agisse du soutien des entreprises en difficulté ou de l’accompagnement des salariés, la coopération des acteurs est bonne. On perçoit cependant deux lacunes. D’abord, les interventions sont majoritairement défensives : elles ont lieu en réaction à un problème. Ensuite, la multiplication des acteurs est source de complexité, et il serait sans doute bon de clarifier les compétences et les responsabilités respectives des services de l’État et des régions.
Pour illustrer mes réponses, je vais vous présenter les actions prioritaires qu’engagent trois régions lorsqu’elles sont informées d’un plan social d’entreprise. J’ai choisi les exemples du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui, sans être exhaustifs, sont assez représentatifs de la manière dont se mobilise l’ensemble des régions.
Le Nord-Pas-de-Calais a élaboré, comme toutes les autres régions, un schéma régional de développement économique et adopté, le 5 décembre 2012, une feuille de route établissant une stratégie « de soutien au tissu économique et de résistance à la crise ». Elle vise à coordonner les politiques de soutien à la consolidation financière des entreprises en définissant collectivement un cap commun pour optimiser et renforcer l’accompagnement des entreprises en difficulté et surtout des salariés fragilisés. Il est un peu tôt pour faire un bilan, mais un comité de suivi a été installé, qui réunit les partenaires sociaux autour du secrétaire général pour les affaires régionales et du vice-président chargé du développement économique de la région. La priorité est donnée à la formation et à la continuité professionnelle, avec l’objectif d’articuler les interventions, ce qui illustre la volonté de coopération.
La Picardie s’est dotée dès 2007 d’une mission d’intervention économique et sociale qui regroupe toutes les compétences. La mission a une approche économique, avec une forte spécialisation dans le traitement des difficultés de l’entreprise, qu’il s’agisse de restructuration financière ou de recherche d’un repreneur potentiel, et un volet social d’accompagnement des salariés caractérisé par un accompagnement juridique et une offre de formation régionale.
La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a mis sur pied des interventions régionales pour l’investissement social (IRIS). Elles ne visent pas à traiter le problème de fond – le nécessaire rehaussement du niveau de qualification des salariés – mais à répondre à des besoins spécifiques en cas d’urgence. L’intérêt du dispositif réside dans sa souplesse, et dans ce qu’il permet, en liaison avec les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), le déblocage de financements complémentaires qui montrent l’engagement de tous les acteurs.
Votre questionnaire évoque la prise de participation temporaire dans une entreprise par une région. Il en est peu d’exemples. L’illustration emblématique est celle d’Heuliez, avec les résultats nuancés que l’on sait. Le président de la République souhaitait inciter les régions à intervenir plus directement dans les entreprises en difficulté. Ce que nous souhaitons éviter, ce sont, pour reprendre une formule du directeur général de la Caisse des dépôts, des prises de participation dans des « canards boiteux ». Notre préférence va à l’accompagnement des entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles. Outre cela, il reste à définir si la région participe directement au capital ou si elle passe par un autre canal ; la création de la Banque publique d'investissement, avec la possibilité de créer des fonds régionaux de retournement, devrait permettre de régler la question.
Une autre des questions figurant dans la liste que vous m’avez adressée est relative aux pistes possibles d’amélioration de la coordination entre l’État, les DIRECCTE, Pôle emploi et les collectivités territoriales. Nous souhaitons à la fois coordonner les efforts et anticiper les difficultés. Cela suppose que les régions connaissent bien les situations. Or, souvent, elles apprennent les difficultés que rencontre une entreprise par les interpellations politiques des représentants des salariés auprès des élus, alors que les problèmes sont très graves, si bien qu’elles sont amenées à réagir dans l’urgence. Actuellement, les DIRECCTE ont connaissance des difficultés en amont, mais peu les régions, bien qu’existent des comités présidés par les préfets qui associent les régions à leurs travaux de manière plus ou moins efficace selon les lieux. La récente création des commissaires au redressement productif tend à faciliter la cohérence de l’action.
Pour améliorer l’anticipation et permettre une réaction rapide en cas de difficulté, les régions sont favorables à des dispositifs régionaux de prospective et d’intelligence économique articulés à un dispositif national permettant une vision prospective globale. Une meilleure anticipation des mutations économiques permettrait de mieux préparer la spécialisation des bassins d’emplois et la réindustrialisation – notamment par le soutien à l’innovation, sujet majeur de politique économique régionale. Il faut travailler de manière cohérente sur un territoire donné et aussi en amont, pour prendre connaissance à temps des difficultés conjoncturelles de sociétés fragilisées, par exemple, par la perte de commandes d’un client important. Cela étant, se pose alors la question du secret bancaire, car si le préfet peut obtenir des informations de la Banque de France, il n’en va pas de même pour les présidents de région.
Vous m’aviez aussi interrogé par écrit sur les moyens déployés par les régions pour mettre au point une gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC) efficace afin d’anticiper les plans sociaux. La région Nord-Pas-de-Calais a mis en évidence la nécessité, pour traiter les difficultés potentielles le plus en amont possible, de cartographier d’une part les emplois et les compétences « cibles », d’autre part les salariés en poste en entreprise, tout en soulignant la complexité de l’exercice. Non seulement il est malaisé de déterminer à quelle échelle une telle cartographie serait la plus efficace, mais la vitesse des mutations économiques provoque l’obsolescence tout aussi rapide de ces recensements s’ils ne sont pas convenablement mis à jour. De plus, les entreprises décidant librement si elles souhaitent fournir ces données ou si elles ne le souhaitent pas, on risque de dessiner une macro-cartographie mal renseignée.
Pour pallier cette difficulté, la Picardie a créé une mission expérimentale d’identification et de valorisation des compétences collectives dans les bassins d’emploi d’Albert et de Péronne, dont l’activité est ciblée sur l’aéronautique. L’objectif est de rédiger une sorte de curriculum vitae du territoire comme outil de promotion économique. Cela passe par le dialogue social : la GTEC a été abordée dans le cadre de la conférence sociale régionale de Picardie et il m’a été dit que les partenaires sociaux y sont plutôt favorables car elle permet d’anticiper les évolutions.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Le tout premier problème est celui de l’information des régions – d’expérience, j’en suis d’accord avec vous. Comment renforcer la coordination, en ce domaine mais aussi en matière de formation, entre la région, les OPCA, l’État et Pôle emploi pour accompagner les entreprises ? Les régions créent-elles des pôles régionaux de compétitivité, des plateformes d’interventions coordonnées comme il en existe une autour de Lacq par exemple ? Quelle optimisation permettra, selon vous, les transferts de compétences à venir ?
M. Gilles Mergy. Les exemples que je vous ai donnés montrent que les régions sont sensibilisées au défi majeur du renforcement de la coordination des acteurs et des moyens de financement. Mais, étant donné la multiplicité des intervenants, cette mobilisation demande beaucoup d’énergie et la coexistence des différents échelons ne facilite rien.
En Picardie, en cas de crise, tous les acteurs se réunissent et la coordination est assurée, y compris avec les financeurs privés – banques et fonds d’investissement – de l’entreprise considérée. Pour accompagner les salariés, la région a lancé en 2009 le programme « Former plutôt que chômer » de financement de l’effort de formation des entreprises en difficulté. Ce dispositif créé dans le cadre du règlement communautaire sur les aides compatibles d’un montant limité a été reconduit dans une forme élargie sur le fondement des aides de minimis plafonnées à 200 000 euros par entreprise. Mais nos collègues de la région se sont rendus compte d’un risque de concurrence entre ce mécanisme régional et le FNE, dont les niveaux d’engagement seraient moins contraignants, qu’il s’agisse du maintien de l’emploi ou du maintien de l’activité. Il peut donc y avoir une sorte d’effet d’aubaine, les entreprises se dirigeant vers celui des dispositifs dont les exigences en contrepartie sont les moindres. Cette concurrence peut compliquer la négociation entre les services publics au sens large et les entreprises.
M. Erwan Salmon, conseiller au développement économique, à l’enseignement supérieur, à la recherche et aux technologies de l’information et de la communication auprès du délégué général de l’ARF. Il faut distinguer la coordination qui s’opère lors du déclenchement d’un plan social de celle qui s’exerce en amont pour éviter que de tels plans ne doivent être déclenchés. Les pôles régionaux de compétitivité – dits « pôles régionaux d'innovation et de développement économique solidaire (PRIDES) » en Provence-Alpes-Côte-d’Azur – participent de cette démarche. D’autres initiatives sont prises par les régions pour identifier les filières et les secteurs potentiellement fragilisés d’une part, d’autre part ceux qui pourraient au contraire contribuer au développement économique du territoire. Nous faisons le pont entre les deux pour aider les entreprises intervenant dans les filières fragilisées à se réorienter vers des secteurs où elles auraient potentiellement plus de facilité à se développer. Mais le rôle joué par les régions en ce domaine est encore insatisfaisant car les acteurs sont trop nombreux. Les choses fonctionnent là où les services déconcentrés de l’État associent systématiquement les régions à leur démarche, ou lorsque les régions prennent l’initiative de rassembler tous les acteurs dans le cadre de leur stratégie régionale de développement économique.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. La création des commissaires au redressement productif a-t-elle eu un impact sur la coordination ? Vous avez fait état des initiatives prises par trois régions ; un des modèles présentés est-il de tous le plus efficace et de ce fait le plus pertinent ? Vous avez souligné que les réactions des régions sont tardives, ce que vous expliquez par la multiplicité des acteurs, le manque de coordination et le fait que l’information sur les difficultés des entreprises n’est pas immédiatement partagée avec les régions ; comment améliorer cela ? Le manque d’anticipation a aussi des conséquences sur la formation, les décisions en ce domaine étant également prises tardivement. Enfin, l’idée d’une cartographie des compétences actualisée – obsolète, elle n’a plus de raison d’être – est intéressante ; comment lier, très en amont, formation et cartographie des besoins ?
M. Olivier Carré, président. À ce sujet, alors que la formation professionnelle est de la compétence des régions depuis de nombreuses années, quelque 500 000 emplois seraient non pourvus et de très nombreuses entreprises sont empêchées de se développer faute de trouver des jeunes un peu formés. À quoi attribuez-vous cet échec majeur ?
M. Gilles Mergy. L’un des reproches faits aux régions par les partenaires sociaux est effectivement de cibler les formations en fonction des besoins des entreprises…
M. Olivier Carré, président. Ce qui n’existe pas !
M. Gilles Mergy. … sans intégrer la dimension plus générale de la formation. La création des commissaires au redressement productif a utilement clarifié les rôles et amélioré la coordination.
Nous n’avons pas trouvé de modèle régional optimal. Cependant, certaines approches fonctionnent mieux que d’autres : celles qui consistent à travailler ensemble « à froid » pour se mobiliser plus facilement en cas d’urgence économique et sociale. Ce qui contribue à une meilleure connaissance réciproque en amont facilite la mobilisation générale en cas de difficultés ponctuelles. Le temps de la décision publique étant parfois en décalage avec l’urgence du temps économique, toute accélération est de nature à améliorer les choses, sachant que l’on est parfois à un ou deux jours près.
Une anticipation efficace demande une cartographie des besoins qui suppose elle-même la mise à jour permanente des données économiques, sociales et d’emplois sans laquelle les dispositifs perdent de leur efficacité. La mobilisation doit donc être permanente ; ce suivi est un défi à relever collectivement car, dans un domaine où les mutations sont rapides, il y a parfois une inertie de l’action publique.
Pour ce qui est des emplois non pourvus et du rôle des régions en ce domaine, des dispositifs se mettent en place avec Pôle emploi. Sur le fond, certains présidents de région ont fait état de leur souhait d’être davantage chargés du service public de l’orientation et de l’emploi pour intervenir sur l’ensemble du spectre – orientation, formation, développement économique, connaissance fine des filières et des besoins – avec une approche territoriale. Cependant, les bassins d’emplois dépassant parfois le territoire d’une région, une coordination sera, là encore, nécessaire. Les partenariats conclus entre les régions et Pôle emploi constituent un progrès mais il conviendrait en effet d’aller plus vite pour remédier à la situation dramatique que vous avez décrite – 500 000 emplois non pourvus parce que les entreprises ne trouvent pas les salariés ayant les compétences requises, dans un pays qui connaît un fort taux de chômage.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, rapporteur à la Cour des comptes. En matière d’anticipation, la coordination avec le volet « développement économique » de l’action des DIRECCTE est intéressant. Leurs agents font des visites d’entreprises et connaissent les partenaires économiques territoriaux. Les renseignements recueillis sont-ils partagés ? D’autre part, les contrats conclus avec Pôle emploi formalisent-ils le suivi des publics prioritaires ? Êtes-vous associés à la revitalisation, et à quel niveau ? Avez-vous, à ce sujet, des idées et des attentes ? Enfin, disposez-vous de documents précis d’évaluation des dispositifs régionaux que vous avez cités ?
M. Erwan Salmon. Il n’y a pas d’échanges systématiques d’informations entre acteurs publics ou assimilés, sauf sur des points saillants ou en cas de difficultés particulières. Ainsi, les comptes rendus des visites faites dans les entreprises par les agents de la DIRECCTE vont à l’administration centrale, jamais à la région. Cela étant, on comprend la limite de l’exercice : un lien de confiance se crée entre l’agent de l’État qui visite une entreprise et son dirigeant, lequel veut maîtriser la diffusion des informations relatives à sa société. Un chef d’entreprise qui fait mention d’une difficulté financière ou d’une perspective d’affaiblissement de son activité ne souhaite pas que ses clients en aient connaissance.
Mme Dominique Lassus-Minvielle. Je parlais de la filière.
M. Erwan Salmon. Il faut tenir compte d’un autre facteur : la multiplicité des visiteurs, qui ne se communiquent pas les renseignements recueillis. Le dirigeant d’entreprise qui reçoit successivement des agents de la Chambre de commerce et d’industrie, d’Oseo, de l’Agence régionale de développement et de la DIRECCTE finit par ressentir une certaine lassitude à devoir répétitivement faire part de ses attentes et de ses difficultés, si bien que le dialogue perd en efficacité et en qualité. C’est pourquoi nous souhaiterions un pilotage du lien entre les acteurs publics et l’entreprise. C’est ce que nous commençons de faire pour l’international : là où les régions ont été désignées pilotes de l’internationalisation des entreprises, nous allons établir des plans d’action partagée, de manière que l’entreprise n’ait à exprimer ses attentes qu’une seule fois. Il faudrait généraliser ce principe, qui trouverait sa traduction dans une charte définissant, en fonction des spécificités de l’entreprise, un plan d’action et des objectifs pour chaque acteur.
M. Gilles Mergy. La revitalisation suppose l’accompagnement des territoires, qui passe par les politiques régionales d’aide à l’innovation pour les bassins d’emplois potentiellement fragilisés. Les fonds de revitalisation apportent un élément positif en mobilisant des ressources privées pour agir sur un territoire. Je crois savoir qu’il s’agit de plus en plus souvent de prêts gérés par les banques. Peut-être pourrait-on réorienter ces fonds en les affectant à l’apport de fonds propres ou de quasi fonds propres aux entreprises. On peut aussi se demander si l’intervention des fonds de revitalisation doit être limitée au seul bassin d’emploi fragilisé ou s’il ne faudrait pas définir une stratégie de filière pour mener une action économique plus structurante.
Je sais qu’une évaluation des politiques publiques régionales menées en ce domaine est en cours mais je n’ai pas à ma disposition d’éléments précis à vous soumettre.
M. Erwan Salmon. Je souhaite préciser mon propos relatif à l’accompagnement des entreprises en amont. Si les régions revendiquent d’être le chef de file de la coordination des stratégies de développement, cette revendication ne s’applique pas nécessairement aux entreprises en difficulté. D’ailleurs, le ministère du redressement productif considère qu’il est de sa responsabilité d’assurer cette coordination par le biais des commissaires nouvellement nommés. C’est le principe d’une coordination et de plans d’action que je voulais mettre en avant, indépendamment de qui les pilote en fonction des sujets.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Vous avez parlé des progrès permis par le renforcement des liens entre les régions et Pôle emploi. Mais Pôle emploi se limite à constater une situation ; étant donné le temps nécessaire à l’achèvement d’une formation qualifiante, ne serait-il pas plus judicieux que d’autres acteurs, en donnant des indications plus tôt, permettent plus de célérité dans les réactions ?
M. Gilles Mergy. Le progrès permis par le renforcement des liens avec Pôle emploi est réel mais je pense comme vous qu’il intervient assez tardivement dans la chaîne de mobilisation des acteurs. Parallèlement, un travail doit être mené avec l’Éducation nationale et la formation professionnelle pour mieux anticiper les évolutions. Je n’ai pas de pistes précises à suggérer mais je puis dire que plus précoce est l’anticipation, mieux s’opèrent les mutations. Le défi tient à ce qu’il est plus facile de constituer un tour de table en cas d’urgence que de se mobiliser en permanence « à froid ».
M. Christophe Castaner, rapporteur. Le déclenchement d’un PSE doit susciter l’accompagnement individuel des salariés concernés mais aussi la revitalisation territoriale par le biais de l’action économique et de l’aménagement du territoire. Or, jusqu’à présent, on a globalement privilégié l’accompagnement individuel au détriment de la revitalisation du territoire, notamment par la politique du chiffre : si 300 emplois sont supprimés, on en recrée autant sans s’interroger outre mesure sur la qualité des emplois recréés. Les territoires sont les grands perdants de cette politique. Quel est votre point de vue ? Avez-vous des revendications à ce sujet ?
M. Gilles Mergy. Il est vrai que Pôle emploi, parce qu’il a des objectifs quantitatifs, tend à cibler les formations qui donnent des résultats rapides, au détriment d’une politique structurante ; de fait, les indicateurs chiffrés peuvent biaiser le dispositif.
Alors que l’action économique et l’aménagement du territoire sont deux compétences traditionnelles des régions, nous ressentons aujourd’hui une difficulté collective à élaborer des schémas régionaux d’aménagement du territoire de référence. De plus, une fois ces schémas élaborés, sont-ils dans les temps de l’évolution économique ou en retard par rapport à elle ? Enfin, s’imposent-ils à tous – dit autrement, les décisions de tous les acteurs y sont-elles compatibles ? Or, fait défaut, dans le projet de loi de décentralisation, un volet sur le renforcement du rôle stratégique de l’État – pour le territoire national – et des régions – en matière d’aménagement du territoire. On a renvoyé la question à la contractualisation État-régions, que le texte ne traite pas davantage. L’aménagement du territoire, qui est au cœur des missions des régions, est donc occulté dans ce texte. Une occasion a peut-être été manquée, car il existe des pistes de progrès.
M. Olivier Carré, président. Madame, Messieurs, je vous remercie.
Audition du jeudi 11 avril 2013
À 11 heures 40 : M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail, assisté de Mme Anne Sipp
Présidence de M. Olivier Carré, coprésident de la Mission
M. Olivier Carré, président. Je vous remercie de votre présence, madame, monsieur, pour cette audition consacrée à un sujet qui est particulièrement d’actualité : la prévention et l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Après vos propos liminaires, les rapporteurs Christophe Castaner et Véronique Louwagie vous poseront quelques questions.
M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail. Sur un plan administratif, la question que nous abordons aujourd’hui concerne à la fois la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et la Direction générale du travail (DGT) mais, sur un plan opérationnel, le suivi des PSE via les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) relève plus de la première que de la seconde.
La transposition législative de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier dernier a entraîné une profonde modification de la législation sur les PSE. Ce n’est pas un retour à l’autorisation administrative de licenciement, supprimée en 1986, non plus qu’au contentieux judiciaire, qui a soulevé un certain nombre de problèmes en matière de sécurité juridique, mais c’est un nouveau dispositif qui a été proposé.
Le contrôle des PSE relève de l’administration ; celui du motif économique de la compétence du juge judiciaire. Le contrôle administratif, en l’occurrence, s’exercera selon deux modalités : l’homologation des plans unilatéraux et la validation des accords.
En priorité, il faudra travailler à ce que les PSE soient conclus sous la forme d’accords collectifs d’entreprises, la loi prévoyant des accords majoritaires dérogeant aux règles habituelles de validité des accords collectifs, lesquels doivent être signés par des syndicats qui représentent 30 % des salariés sans opposition du syndicat qui en représente 50 %. Cela, toutefois, dépendra des conditions du dialogue social au sein des entreprises.
Dans ce cas-là, le contrôle administratif sera techniquement restreint alors que l’homologation d’un plan unilatéral supposera qu’au-delà des aspects purement juridiques s’exerce un contrôle de proportionnalité, soit du contenu des mesures de reclassement par rapport aux moyens dont dispose l’entreprise.
Quels moyens les administrations et, notamment, les DIRECCTE, auront-elles dès lors que la décision sera prise par les responsables de ces dernières – et non par l’inspecteur du travail – et qu’aucun recours hiérarchique ne sera possible auprès du ministre ?
Autre défi, au-delà du strict contrôle juridique : l’exercice d’un contrôle qualitatif, qui n’est d’ailleurs pas spécifique aux PSE. Des mécanismes de « négociations administrées » se développent en matière d’égalité hommes-femmes, de pénibilité ou de contrats de génération. L’approche de l’administration n’est donc pas seulement juridique mais concerne l’opportunité des mesures à prendre, ce qui est souvent délicat puisque cela relève de l’activité même des entreprises.
In fine, l’administration dispose de pouvoirs conséquents, les décisions étant très importantes pour elle et pour les entreprises.
Je rappelle qu’un recours a été formulé devant le Conseil constitutionnel concernant le passage d’une partie des contrôleurs du travail des catégories B à A dans le cadre de la loi portant création du contrat de génération, le « ministère fort » cher au ministre du travail supposant un accroissement des compétences de son administration dans ces domaines. Autrement dit, il ne s’agit pas simplement de savoir si l’on homologue les services des DIRECCTE et si les effectifs seront assez nombreux, le problème étant moins quantitatif que qualitatif. L’administration agissait déjà en matière de PSE mais l’accroissement des compétences des services déconcentrés du ministère du travail est de plus en plus important. Cet enjeu essentiel concerne les rapports internes entre les administrations mais, aussi, entre l’administration du travail, les entreprises et les partenaires sociaux.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. S’agissant des moyens des DIRECCTE, vos propos confirment le sentiment que nous avions eu lors des auditions précédentes. À cela s’ajoute des délais d’examen raccourcis, comme en dispose le projet de sécurisation de l’emploi, ce qui entraînera une augmentation des besoins. Les DIRECCTE sont-elles donc prêtes à agir ou faudrait-il recourir à l’expertise de structures privées ?
Avant la fermeture d’un site, une entreprise devra rechercher d’éventuels repreneurs. Comment l’administration pourra-t-elle s’assurer qu’il en a bien été ainsi ?
Suite à l’ANI, pouvez-vous préciser les rôles respectifs du juge administratif et du juge judiciaire en matière de PSE ? Comment les nouvelles procédures s’articuleront-elles en cas de liquidations et de redressements judiciaires ?
M. Jean-Denis Combrexelle. S’agissant des délais, il faut avoir une vision précise de la situation. Nous ne passons pas d’une période dans laquelle l’administration ne faisait rien à une forme d’omniprésence.
Dès la première réunion du comité d’entreprise de PSA/Aulnay et, donc, bien avant le vote du projet de sécurisation de l’emploi, l’administration et, notamment, les services des DIRECCTE, étaient présents. Le texte prévoit un système de décision implicite d’acceptation, une décision étant rendue après un délai de quinze jours, ce qui ne signifie pas que l’administration statuera dans ce délai-là. Comme c’est le cas aujourd’hui, elle suivra de très près le dossier dès le premier jour. La décision juridique est certes importante mais les relations antérieures entre l’administration, l’entreprise et les partenaires sociaux le sont au moins tout autant. La différence, c’est que l’administration disposait jusqu’ici de très peu de pouvoirs juridiques et que, maintenant, elle a un pouvoir de décision.
Sans avoir une vision idyllique et naïve des services administratifs, leur proximité avec nos entreprises me laisse penser que l’expertise privée ne s’imposera pas. On dénombre environ 1 100 PSE par an. Certes, c’est déjà beaucoup trop mais les statistiques de la DARES montrent que la raison principale des inscriptions à Pôle Emploi ne relève pas tant de ces derniers que de la fin de CDD.
M. Olivier Carré, président. Et de contrats d’intérim.
M. Jean-Denis Combrexelle. En effet.
J’ajoute que ces PSE sont essentiellement concentrées à Paris et dans les Hauts-de-Seine. En région, ils sont gérables sans une complète transformation de l’organisation administrative.
En outre, nous ne manquons pas d’experts, peut-être même sont-ils trop nombreux, et la question de la légitimité de leurs analyses peut parfois se poser.
Lors de la réunion que nous avons eue hier avec le ministre à propos des PSE, des DIRECCTE et de la formation, nous avons estimé que si la question de l’organisation des pôles 3E et T se posera, tel n’est pas le cas, je le répète, de celle du recours à des structures privées.
S’agissant de la question d’éventuels repreneurs, je vous invite à auditionner des représentants de la DGEFP.
L’ancien conseiller de tribunal administratif que je suis se souvient que, dans le cadre des autorisations administratives de licenciement, le juge disposait de trois mois pour rendre sa décision. Il en sera toujours de même, avec dessaisissement, tout comme pour la Cour administrative d’appel.
Lorsque j’ai présenté le texte devant le conseil supérieur des tribunaux administratifs, les syndicats se sont interrogés. Compte tenu des mécanismes de décision tacite d’acceptation, ils ont fait remarquer que les délais seront très courts et que certains dossiers seront vides. Mais comme le ministre l’a dit et comme il en sera sans doute fait état dans les circulaires, les décisions tacites seront quasi-inexistantes. Sauf cas exceptionnels et dérogatoires, l’administration ne prendra que des décisions motivées et circonstanciées en ce qui concerne les PSE de telle façon que le juge puisse disposer du délai nécessaire en cas de contentieux.
La question des délais est en effet essentielle : la sécurité juridique, dont nous parlons souvent, ne concerne pas les seules entreprises mais, également, les salariés. Or, il arrive un moment où les salariés licenciés doivent trouver un autre emploi. C’est précisément pour cette raison que la décision est prise par « le » DIRECCTE, sans recours hiérarchique devant le ministre, et que les délais sont très courts devant les tribunaux administratifs et la Cour administrative d’appel.
Un débat a également eu lieu sur la mention du délai de trois mois, les juges ayant fait valoir qu’ils étaient capables de le respecter d’eux-mêmes.
En tenant compte de tous ces éléments, je gage que la situation sera satisfaisante.
M. Christophe Castaner, rapporteur. J’entends vos propos : vous serez donc en mesure de faire face.
Le prochain texte sur la décentralisation prévoit que les ex-Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE), qui sont à ce jour au sein des DIRECCTE, doivent relever des conseils régionaux au titre de leur compétence économique. Dès lors, qu’en sera-t-il de vos capacités à accompagner la recherche et l’évaluation des bonnes conditions d’homologation et de validation ?
De plus, considérez-vous qu’il convient de formuler des critères de proportionnalité ou faut-il maintenir une approche au cas par cas, laquelle implique de ne pas définir de critères trop stricts ? Plus globalement, qu’en sera-t-il des moyens de contrôle de l’administration de ce point de vue-là ?
Que pensez-vous de la situation des salariés victimes de licenciements diffus ? Ils échappent à l’ensemble des procédures que nous évoquons et, comme tels, subissent une inégalité de traitement puisqu’ils ne bénéficient pas des mesures d’accompagnement des PSE. Je rappelle que M. Cherpion a déposé une proposition de loi à ce sujet, qui a d’ailleurs été reprise par d’autres.
Enfin, l’approche négociée telle qu’elle est promue par la loi de sécurisation de l’emploi ne peut-elle très rapidement s’exercer au détriment d’une approche collective alors que les incidences territoriales des PSE, la question de la revitalisation et des conditions de reprises d’activité sont également essentielles ? Par exemple, si dans le cadre de la clause de mobilité et aux termes d’un accord négocié les salariés sont prêts à effectuer 42 kilomètres pour travailler dans une autre zone, celle qu’ils quittent sera immanquablement appauvrie.
Le reclassement et la revitalisation constituent le double enjeu de l’accompagnement salarial dans le cadre des PSE.
M. Jean-Denis Combrexelle. Au-delà, c’est la question politique, au sens large du terme, de la confiance accordée à la négociation collective qui est posée. L’ANI en est issu, en vertu de la loi Larcher, et il renvoie lui-même à une série d’accords : accords d’entreprises pour le maintien de l’emploi ou concernant la mobilité interne ; accords de branche pour le temps partiel notamment.
Le problème est de savoir si le renvoi de la question de la mobilité interne à la négociation constitue une garantie suffisante. Tel est le cas dans nombre de pays où les syndicats et les partenaires sociaux travaillent volontiers ensemble. En France, en revanche, le renvoi à la négociation n’est pas toujours considéré comme une garantie suffisante, d’où l’ajout de telle ou telle procédure dans la loi. Ce sujet est donc très sensible.
Je ne suis pas sûr que, dans le cadre d’un grand groupe, la négociation n’inclurait pas la question des micro-reclassements, des sites et des territoires. La complexité et la diversité des situations sont telles que l’on peut se demander, sur le plan des principes, dans quelle condition il est possible de poser des règles législatives générales. Il n’est pas question de considérer que la loi ne doit pas intervenir mais il faut trouver un équilibre assez délicat avec la négociation collective.
Le motif économique, quant à lui, ne relève pas du champ de la décision administrative. Juridiquement, il n’appartient pas à l’administration de se prononcer sur son existence ou non et si celle-ci justifie ou non l’organisation d’un PSE. En revanche, et c’est déjà beaucoup, le contrôle de proportionnalité implique qu’elle se prononce sur l’adaptation et la suffisance des mesures de reclassement eu égard à la situation économique. Même s’il faudra faire montre de vigilance, quel que soit le devenir des DRIRE, l’administration s’adaptera.
La question de l’organisation et des niveaux de compétences des DIRECCTE me paraît plus délicate que celle de leurs moyens. Les sujets les plus sensibles tels que la pénibilité ou l’égalité hommes-femmes relèvent à la fois du travail et de l’emploi alors que les pôles T et 3E sont distincts. Il n’est pas question d’une fusion générale mais nous devons parvenir à faire travailler les pôles ensemble.
Je ne répondrai pas directement sur le problème des licenciements diffus mais nous savons combien il est difficile d’avoir une approche globale des ruptures conventionnelles, homologuées ou non par l’administration. J’ai signé des circulaires précisant que ces dernières n’ont pas pour vocation de détourner les règles relatives aux licenciements. L’administration vérifie que leur multiplication ne masquerait pas la volonté de contourner d’agir de la sorte. Jusqu’ici, une telle vérification était possible si tous les licenciements avaient lieu, par exemple, en Rhône-Alpes mais, en cas de licenciements diffus, nous ne disposions pas d’un système informatique permettant de savoir s’il y avait eu cinq ruptures conventionnelles en Rhône-Alpes, trois en Île-de-France et sept en Alsace. Nous sommes en train de remédier à cette situation afin d’avoir une approche globale. Le système d’information de l’inspection du travail, qui est parfois contesté par les syndicats, joue un rôle central en la matière.
Le contrôle de proportionnalité ne sera pas élaboré différemment en fonction des situations qui se présenteront – ce qui pourrait être perçu comme discrétionnaire, voire, arbitraire – mais il n’est pas question pour autant d’exposer des critères dans des circulaires de 300 pages. Avec la DGEFP, nous nous efforcerons de donner des directives à nos administrations en mentionnant des critères généraux auxquels il sera possible de déroger en fonction des cas particuliers. L’essentiel est que les salariés et les chefs d’entreprise comprennent la décision administrative.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Nous avons bien compris que les DIRECCTE jouent un rôle majeur mais avez-vous envisagé de nouer des partenariats ou d’organiser des concertations avec l’ensemble des acteurs locaux, collectivités, Pôle emploi ou autres ?
Des accords que l’on pourrait qualifier de « mixtes » pourront-ils être partiellement négociés ?
M. Jean-Denis Combrexelle. La DIRECCTE ne doit pas être une forteresse qui n’entretiendrait aucun contact avec l’administration. Hier, le ministre a réuni les directeurs régionaux de Pôle emploi, des DIRECCTE, des Pôles T et 3E. Il n’est pas question que la DIRECCTE prenne une décision de type juridico-administratif sans lien avec Pôle emploi ou les collectivités locales concernées. Il faut certes attendre la parution des circulaires mais, politiquement, l’intention du ministre est très claire.
Juridiquement, le texte a été élaboré pour permettre de tels accords « mixtes » et partiels. La clarté et l’intelligibilité de la règle repose sur deux modalités, celle du plan unilatéral et celle de la négociation, chacune ayant sa logique. Dans certains cas, pourquoi ne pas envisager un accord mixte, oui, mais il doit être l’exception.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, rapporteur à la Cour des comptes. Même si c’est un peu prématuré, quelle sera l’organisation des Pôles T et 3E suite à la loi sur la sécurisation de l’emploi.
Le Pôle T et les inspecteurs du travail sont concentrés dans des unités territoriales au niveau départemental alors que les compétences économiques des ex-DRIRE relèvent plutôt du siège régional des DIRECCTE où se trouvent donc les acteurs dont la vision de l’emploi est un peu stratégique, lesquels sont de surcroît responsables de la gestion des crédits. Le pouvoir régional a ainsi été très fortement renforcé.
L’analyse détaillée des procédures de terrain impliquera-t-elle un déplacement des agents ou une organisation resserrée avec des réunions très fréquentes, l’impact étant important d’un point de vue temporel et sur le plan de la gestion des ressources humaines ?
Nous avons constaté une limitation des dispositifs d’accompagnement social des restructurations économiques dans les PSE et, en particulier, de ceux dédiés aux salariés âgés. Avez-vous analysé des accords passés relatifs à l’emploi des seniors ? Un passage de relais est-il prévu avec le contrat de génération de manière que les questions de préretraites ou de congés ne relèvent pas des seules entreprises ?
M. Jean-Denis Combrexelle. La situation de la DIRECCTE du Limousin, qui gère une dizaine de PSE par an, diffère complètement de celle d’Île-de-France. Avec la DGEFP et le cabinet du ministre, nous considérons qu’il faut certes avoir un certain nombre de principes mais qu’il convient tout autant de tenir compte de la différence des situations.
Nous n’envisageons pas de réorganisation ni, a fortiori, de mutations d’agents. Les Pôles T et l’inspection du travail ont une approche « juridique » et les Pôles 3E une approche plus économique ou d’ingénierie. Parce qu’un synthèse sera nécessaire, la décision sera prise au niveau « du » DIRECCTE, une délégation pouvant être éventuellement accordée au responsable de l’unité territoriale, notamment en région parisienne où le responsable territorial des Hauts-de-Seine, par exemple, est directement concerné. In fine, la responsabilité administrative et juridique de la décision échoit à une personne.
Sans doute conviendra-t-il d’organiser des procédures et d’opérer des différenciations en fonction des régions mais, je le répète, l’application de la loi de sécurisation de l’emploi n’impliquera pas une réorganisation des DIRECCTE.
Les accords concernant les seniors comportent un aspect qualitatif mais quelle est la capacité de négociation des entreprises ? Elle existe dans les grands groupes, moins dans les PME. La même question se pose au niveau des branches. Les résultats de la mesure d’audience de la représentativité des syndicats publiés le 29 mars montrent que certaines branches ne peuvent pas négocier. Nous devons travailler avec la DGEFP et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) afin de mettre en place des mécanismes d’appuis et de conseils qui permettront à des entreprises de négocier sur des points innovants pour les seniors ou les bénéficiaires des contrats de génération.
Ensuite, je le répète, la politique en amont demeure fondamentale. Ce défi n’est d’ailleurs pas facile à remporter parce qu’il ne relève ni de la loi ni du règlement. La capacité de négocier concerne les mondes patronal et syndical et, en la matière, beaucoup reste à faire.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Cela me semble en effet important. Une telle situation ne conduira-t-elle pas la DIRECCTE à formuler des propositions ou des orientations lors de la négociation de l’accord ? Ne risque-t-elle pas d’être à la fois juge et partie lorsqu’elle sera sollicitée pour l’homologation ?
M. Jean-Denis Combrexelle. C’est une bonne question ! L’administration du travail et de l’emploi relève à la fois de Bison futé et du radar : elle essaie d’impulser et de faciliter le dialogue social et elle exerce sa mission régalienne de contrôle de l’ordre public.
Ainsi, l’administration a accompli des efforts importants pour faciliter la convention collective du spectacle vivant privé, laquelle a été signée par tous les syndicats. Cet après-midi, lors de la réunion de la sous-commission de l’extension des conventions collectives, l’arrêté d’extension aboutira à exclure certaines stipulations qui ont été négociées. Dans le cadre des « négociations administrées » sur la pénibilité, l’égalité hommes-femmes ou les contrats de génération, les DIRECCTE sont dans la même situation. Cela ne soulève pas de problèmes juridiques dès lors que la spécificité de l’inspection du travail est préservée. En outre, nos fonctionnaires et nos agents sont familiers d’un tel positionnement, de même que nos interlocuteurs que sont les entreprises et les partenaires sociaux. J’ajoute que ce questionnement est assez central au sein du ministère du travail.
Sans doute la séparation des fonctions celle-ci doit-elle être rappelée mais si nous voulons être efficaces, nous devons aussi accepter certaines situations. Si nous voulons que des accords de qualité soient conclus sur les contrats de génération ou en matière d’égalité hommes-femmes, « le » DIRECCTE doit avoir un pouvoir d’impulsion ou de conseil et dire qu’il n’accepte pas tel ou tel point. J’insiste : un tel positionnement est accepté, voire, demandé par nos interlocuteurs.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Pourriez-vous nous communiquer plus d’informations concernant l’approche globale que vous êtes en train de promouvoir s’agissant des licenciements diffus ? Nous savons ce qu’il en a été avec l’industrie pharmaceutique, nous verrons ce qu’il en sera demain avec la grande distribution.
Qu’en est-il de l’élargissement des procédures aux entreprises sous-traitantes ? Il est impossible de ne pas tenir compte de leur situation alors qu’elles subissent les conséquences des fermetures des entreprises majeures et que leurs salariés licenciés ne bénéficient ni d’une approche globale ni, sur le plan individuel, d’une approche plus qualitative.
M. Jean-Denis Combrexelle. Le texte aborde la question des entreprises sous-traitantes, de l’information des comités d’entreprises ou de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
La question de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) fait parfois sourire tant l’on y trouve de tout. Sous ce label, certaines entreprises font parfois de la « communication ». Les pouvoirs publics, au sens large, ne se rendent pourtant pas suffisamment compte combien il s’agit là d’un levier très important afin de favoriser une évolution positive sur un plan social ou environnemental.
Notre droit du travail, s’agissant notamment des PSE, doit appréhender de plus en plus la notion de groupe et, au-delà, de « communauté » incluant les sous-traitants tant les conséquences sont en effet immédiates pour eux lorsqu’un grand groupe licencie. Certaines grandes entreprises commencent à intégrer une telle logique.
Globalement, il existe trois leviers : la législation, la négociation et la RSE.
M. Olivier Carré, président. Cela relève de la gouvernance.
M. Jean-Denis Combrexelle. Quelle est la place des partenaires sociaux dans la RSE ? C’est un vrai sujet.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, rapporteur à la Cour des comptes. Qu’en est-il des filiales – dont l’homologation impliquera d’apprécier la situation financière – alors qu’il est déjà problématique, dans le cadre de la loi actuelle, de savoir si la responsabilité pèse sur elles ou sur le groupe ? Disposez-vous d’éléments de jurisprudence ?
M. Jean-Denis Combrexelle. La jurisprudence qui concerne le co-emploi. Nous voyons bien quel est le but poursuivi lorsqu’un groupe est considéré comme co-employeur dans le cadre du PSE d’une filiale. Or, un équilibre doit être préservé.
Certains DRH de grands groupes investissent beaucoup dans une politique RH « corporate », c’est à dire pour l’ensemble du groupe, celui-ci étant doté d’une politique globale en matière de GPEC ou de sites, par exemple. Mais il ne faudrait pas qu’une jurisprudence légitime en matière de co-emploi soit perçue comme la sanction d’une politique RH « coporate ». Autrement dit, si le DRH d’un groupe propose une telle politique et que le groupe soit jugé responsable du PSE d’une filiale, il peut vouloir éviter le risque induit et faire en sorte que la politique RH soit définie par chaque filiale.
Le problème, ce sont les conditions d’application de la jurisprudence. Je connais un DRH qui voulait promouvoir une politique ambitieuse, au niveau du groupe, et qui a procédé à d’importants investissements sociaux. Une petite filiale a été déclarée en faillite et le groupe a quant à lui été considéré comme co-employeur, déclaré responsable et en faillite.
M. Olivier Carré, président. La notion de proportionnalité change l’échelle. La France et l’Espagne comptent parmi les pays européens dont le marché du travail est jugé rigide par l’Eurogroupe ou l’OCDE. Qu’en pensez-vous ? Le dernier ANI a-t-il contribué à changer la situation ? Comment pourrait-on encore progresser ?
M. Jean-Denis Combrexelle. Nous connaissons la situation dans laquelle se trouvent nos jeunes diplômés. Trouver un emploi relève souvent du parcours du combattant.
Les fonctionnaires de Bruxelles me demandent souvent quand la France instaurera le contrat de travail unique, seule façon selon eux de battre en brèche la rigidité du marché du travail. Selon moi, il ne changerait rien car il n’y a pas de solution purement juridique aux problèmes d’embauche. Il est certes possible de jouer sur les taux de cotisations d’assurance-chômage des CDD mais, dans certaines situations, d’autres solutions sont possibles. La rigidité du marché du travail ne résultant pas de la loi, je ne suis pas certain qu’y remédier passe par la législation. La croissance économique, les comportements, le sens des responsabilités ou les négociations me semblent plus indiqués.
M. Olivier Carré, président. Je vous remercie.
Audition du mercredi 15 mai 2013
À 16 heures 30 : Mme Jeanne-Marie Prost, Médiatrice nationale du crédit au ministère de l’Économie et des finances
Présidence de M. Olivier Carré, coprésident de la Mission
M. Olivier Carré, président. Madame, après René Ricol et Gérard Rameix, vous êtes la troisième personne à occuper le poste de Médiateur national du crédit. Je vous laisse présenter votre action et faire le point sur ce dispositif créé lors de la crise de 2008, et dont chacun constate aujourd’hui le succès sur nos territoires.
Mme Jeanne-Marie Prost, Médiatrice nationale du crédit au ministère de l’économie et des finances. La Médiation a été mise en place quand les entreprises, particulièrement les PME et les TPE, risquaient de se retrouver confrontées à un credit crunch, c’est-à-dire à un resserrement du crédit. Il fallait trouver une solution décentralisée et réactive pour éviter de les laisser seules face à des difficultés de financement. Le dispositif a été créé à titre provisoire, mais il vient d’être reconduit jusqu’au 31 décembre 2014 par l’accord de place du 1er mars 2013.
Son originalité tient d’abord à son caractère contractuel. En signant l’accord de place, le ministre des finances, le gouverneur de la Banque de France et les banques, représentées par la Fédération bancaire française (FBF) ont adopté un mode de travail qui est peu courant dans notre pays. Dès lors qu’un chef d’entreprise saisit le médiateur, les banques qui participent au dispositif acceptent la discussion et s’engagent à ne pas retirer leurs concours existants. On pare ainsi le risque de restrictions brutales du crédit, qui, en 2008-2009, pouvaient découler de la situation des banques elles-mêmes. L’accord conclu à l’origine de la Médiation a été reconduit dans les mêmes termes, puisque ce schéma très simple s’est avéré efficace.
Deuxième originalité : le dispositif, loin de créer des structures nouvelles, est adossé au réseau départemental de la Banque de France. De ce fait, nous assurons le traitement de proximité d’un grand nombre de dossiers. Notre population cible est constituée de PME et de TPE, qui se tournent vers des banquiers et des assureurs crédit locaux ou régionaux, éventuellement affiliés à de grandes structures nationales. Notre objectif est de trouver la solution au niveau le plus adapté, c’est-à-dire au niveau local. Sur l’ensemble des entreprises qui nous saisissent, 95 % emploient moins de cinquante salariés, et 80 % moins dix salariés. Dans 40 % des cas, le montant en jeu est inférieur à 50 000 euros. À ce jour, 30 000 dossiers ont été acceptés, avec un taux de succès de 60 %.
L’originalité du dispositif tient enfin à la dématérialisation de la saisine. Aussitôt que le chef d’entreprise saisit son dossier sur le site mediateurducrédit.fr, le dialogue s’engage, sous l’égide du directeur départemental de la Banque de France. Cette démarche nous permet d’être particulièrement réactifs.
Dès sa création, nous avons mis l’accent sur l’importance des partenaires locaux pour prévenir les difficultés des entreprises. Premier Médiateur du crédit, René Ricol était un socioprofessionnel et non un haut fonctionnaire. C’est pourquoi il a perçu d’entrée l’intérêt de mobiliser les réseaux locaux, pour en faire des auxiliaires de la Médiation ainsi que des appuis pour les chefs d’entreprise, même en amont de la saisine formelle. C’est ainsi que s’est constitué le réseau des tiers de confiance. Sur le terrain, collaborent efficacement des acteurs publics – préfets, directeurs des finances publiques, directeurs de la Banque de France, représentants de Pôle emploi – ou socioprofessionnels – chambres consulaires, banques, assureurs crédits. Au cours des déplacements en province attachés à ma mission, j’ai constaté que ce travail collectif était plus positif et plus étroit qu’on ne le pense généralement au niveau national. Des efforts importants sont faits au niveau local, y compris pour prévenir les difficultés des entreprises.
Dernière précision : nous n’avons pas d’argent et aucun pouvoir de police. Notre seule autorité tient à notre capacité à instruire un dossier et à négocier pour trouver la solution la plus adaptée. Le dispositif est « light ». Il s’appuie seulement sur les acteurs en présence. Si, fin 2008, les relations avec les banquiers étaient un peu râpeuses, parce qu’ils craignaient qu’on ne les oblige à prendre certaines décisions de crédit, ceux-ci sont désormais très à l’aise avec nous, comme l’a indiqué le président de la FBF lors du renouvellement de l’accord de place.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. À défaut de moyens financiers, de quels moyens humains disposez-vous ? Comment votre équipe est-elle déployée sur le territoire ?
Avez-vous consacré plus d’énergie à coordonner les acteurs des réseaux et à créer une mobilisation collective qu’à résoudre des difficultés de financement, ce qui est pourtant votre mission première ?
Les tribunaux de commerce vous sollicitent-ils pour que vous préveniez les difficultés des entreprises ? Conseillent-ils à celles-ci de se tourner vers la médiation, notamment pendant les périodes de sauvegarde ?
Mme Jeanne-Marie Prost. L’équipe de la Médiation nationale se compose d’une douzaine de personnes redéployées du ministère des finances. Nous avons cherché des compétences là où elles se trouvaient. Plusieurs analystes viennent de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), où se concentrent paradoxalement les meilleurs connaisseurs des entreprises. D’autres viennent du Trésor.
La Banque de France, qui n’a créé aucun emploi supplémentaire pour assurer les tâches de médiation, considère que celles-ci occupent actuellement une trentaine d’équivalents temps plein, ce qui est marginal par rapport à son effectif global. Si, en 2009 et en 2010, le nombre de dossiers traités était considérable, il se limite aujourd’hui à 4 000 par an. Cette activité est fluide. Certains départements n’ont traité l’an dernier qu’une dizaine de dossiers. Le temps qu’exige chacun d’eux est variable. Ce travail est généralement bien perçu par ceux qui l’exécutent. Les directeurs de la Banque de France apprécient le rôle qu’ils sont amenés à jouer localement vis-à-vis des banques et des autres acteurs économiques.
J’en viens à votre deuxième question. En sollicitant des tiers de confiance, la Médiation a été une des premières enceintes à formaliser le rôle de certains organismes, comme les chambres de commerce ou les chambres de métiers, ou de certains agents comme les experts comptables. En quatre ans, cette démarche s’est beaucoup développée. Désormais, il existe de nombreux centres d’information destinés à prévenir les difficultés des entreprises. Des tribunaux de commerce ont développé leur mission de prévention. Selon les territoires, l’acteur qui se montre le plus actif n’est pas toujours le même.
La Médiation n’a pas à s’imposer comme le coordinateur majeur. Elle figure seulement dans la panoplie des dispositifs. Sa vocation est de travailler en réseau. Nous sommes toujours disposés à parler aux tribunaux de commerce ou aux experts comptables, ou à demander aux entreprises de se rapprocher de la chambre de commerce si elles hésitent à nous saisir. C’est un ouvrage qu’il faut cent fois remettre sur le métier pour fournir aux directeurs de la Banque de France des interlocuteurs dans leur département.
Votre troisième question porte sur la prévention des difficultés. La Médiation n’a pas vocation à traiter des dossiers qui entrent ou vont entrer en procédure collective car, alors, il n’est plus temps d’intervenir. Il arrive aussi que le médiateur conseille au chef d’entreprise, après discussion, de se tourner vers le tribunal de commerce. Quand la procédure de sauvegarde est engagée, le cas est limite, car la négociation avec les banques est compromise.
En revanche, il arrive régulièrement que la médiation concerne une entreprise qui est également en procédure amiable. C’est particulièrement fréquent pour les dossiers en médiation nationale, c’est-à-dire les plus complexes, et les affaires spéciales des banques. Il est logique que celles-ci souhaitent un cadre juridique plus formalisé que le nôtre, comme le mandat ad hoc ou la conciliation. Elles cherchent à bénéficier du privilège du new money, que nous ne pouvons pas leur offrir. Mes anciennes fonctions m’ayant permis de connaître tous les mandataires et conciliateurs de la place, il ne m’est pas difficile d’effectuer un co-pilotage sur certains dossiers. C’est même une situation enrichissante, qu’apprécient les mandataires. Le co-pilotage concerne aussi certains dossiers traités en province.
Il y a quelques semaines, je me suis rapprochée des enceintes nationales réunissant les présidents des tribunaux de commerce, pour leur rappeler l’intérêt, au niveau départemental, d’envoyer en médiation des dossiers qui ne relèvent pas encore de la procédure amiable. Sous l’entête de la Conférence générale, donc en parfaite intelligence avec les organismes pilotes des tribunaux de commerce, j’ai écrit à tous les présidents de ces tribunaux et suggéré aux directeurs départementaux de la Banque de France de se rapprocher d’eux, quand ce n’était pas déjà fait. À Dijon ou à Beauvais, j’ai constaté l’entente cordiale régnant entre le président du tribunal de commerce et le médiateur départemental. Ce n’est pas toujours le cas, mais, au niveau national, les relations sont bonnes. Quand je me déplace dans un département, j’essaie de rencontrer le président du tribunal de commerce. Dans bien des cas, par exemple quand les difficultés proviennent d’une querelle entre banques ou d’un manque de dialogue entre l’entreprise et son banquier, il n’y a pas lieu d’aller en procédure amiable. La médiation suffit amplement.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Dans un premier temps, le placement sous sauvegarde n’était quasiment jamais utilisé. Si cette procédure monte en puissance, elle est toujours perçue comme le signe d’une situation très critique, ce qui génère de l’inquiétude, voire un jugement très négatif qui risque de condamner l’entreprise, alors que le but est au contraire de la faire redémarrer. Avez-vous l’impression que l’attitude des tribunaux de commerce évolue à cet égard ?
Les relations avec les institutions comme la BPI, qui vient de naître, OSÉO ou le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) sont-elles bonnes ? Comment travaillez-vous avec les commissaires au redressement productif (CRP) et les collectivités locales, puisque les régions sont censées être des chefs de file des questions économiques ? Comment intégrez-vous les dispositifs de garantie que certaines collectivités ont créés grâce aux fonds européens, comme JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Entreprises) ? Quelles améliorations suggérez-vous dans ce domaine ?
La Médiation a été lancée pour lutter contre le risque de credit crunch imputable à une crise des liquidités bancaires. Comment l’accès au crédit a-t-il évolué depuis les accords de Bâle III ? Comment peut-on orienter le financement de l’économie vers les entreprises, sachant que l’essentiel des besoins concerne les fonds de roulement ? Comment garantir le risque des banques pour les investissements lourds ou le financement de haut de bilan ?
Mme Jeanne-Marie Prost. Nous intervenons avant les procédures amiables et la sauvegarde, dont nous ne sommes pas spécialistes. Aux dires des mandataires, les procédures amiables suscitent peut-être moins de défiance de la part des entreprises. Cela dit, le sujet reste sensible, certains patrons de PME redoutant la réaction de leurs partenaires ou de leurs fournisseurs. Si la situation a évolué ces dernières années, on le doit aux efforts consacrés par les tribunaux de commerce à leur cellule de prévention, qui a amélioré la compréhension de part et d’autre.
Quand l’entreprise est sous le coup d’une procédure de sauvegarde, la situation devient plus compliquée : la dette est gelée, un plan est mis en place. En outre, ce type de procédure peut aussi bien réussir – si les objectifs sont bien compris et que les partenaires soient en phase – qu’échouer.
Je ne dispose pas d’informations assez complètes pour décrire l’attitude des tribunaux de commerce et son évolution à l’égard de ces procédures, mais il est certain que les partenaires financiers ne mettent pas sur le même plan un mandat et une sauvegarde.
Sur tous les dossiers que je vois, les banquiers jouent le jeu de la procédure amiable. Les tribunaux de commerce confirment qu’elle a prouvé son efficacité. C’est ce qui fait tout l’intérêt de notre métier : quand on réunit les gens met autour d’une table, il faut du temps pour qu’ils se mettent d’accord et qu’ils parviennent à la même vision, mais le jeu en vaut la chandelle.
Comme toujours, la situation des petites entreprises est plus difficile. Certaines risquent même de se retrouver en procédure collective, sans qu’on ait pu en percevoir de signes avant-coureurs. Les dispositifs de prévention n’ont alors pas fonctionné. Une de mes priorités est de rendre la médiation du crédit plus visible, notamment auprès des petits patrons de TPE ou de PME, qui ont tendance à ne nous appeler que lorsque la maison a brûlé. Je dois par conséquent faire œuvre de pédagogie.
Dans notre comité exécutif siègent le directeur des activités fiduciaires et de place, le directeur du réseau de la Banque de France, et celui des réseaux d’OSÉO, devenu BPI France. La Médiation a toujours travaillé main dans la main avec OSÉO. C’était d’ailleurs indispensable en 2008, puisque le plan de relance confiait à cet organisme un rôle essentiel dans les mécanismes de garantie. Ses directeurs, qui sont des piliers dans les régions, sont aussi nos interlocuteurs quotidiens. OSÉO, très souvent représenté dans les réunions de médiation, parce que nous lui demandons d’intervenir en garantie ou en financement, peut aussi mettre en place des lignes « avance plus » de mobilisation de créance. La Médiation utilise toute la palette de ses outils, qui complètent en partie ceux des banques commerciales.
Elle est également liée au Fonds stratégique d’investissement (FSI) et plus spécifiquement au Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE), qu’elle considère en partie comme son œuvre, puisque l’idée en revient à René Ricol et à Jean-Claude Volot. Créé en 2009, ce fonds mi-public mi-privé – ses dotations viennent pour moitié de la Caisse des dépôts, pour moitié des banques et des compagnies d’assurances – aide aussi des entreprises qui ne passent pas en médiation, puisqu’il finance au sens large le rebond des PME. Toutefois, je peux citer l’exemple d’une entreprise située non loin d’Aix-en-Provence, que ses banquiers, l’an dernier, ont poussée à saisir la Médiation. Ceux-ci, qui lui reconnaissaient un vrai potentiel, étaient consternés par ses pertes. Ils ont fait comprendre au manager qu’il était essentiel d’investir. La Médiation a commencé par sécuriser le court terme, pour éviter tout problème de financement, puis elle a demandé l’aide du FCDE, qui, en accord avec les actionnaires dirigeants de l’entreprise, entrera bientôt au capital. En région comme à l’échelon national, il faut toujours du temps – au moins trois à six mois – pour investir en capital.
M. Olivier Carré, président. Six mois ? Il serait idéal qu’on puisse toujours répondre dans ces délais !
Mme Jeanne-Marie Prost. Le FCDE travaille assez vite : il lui faut entre six mois et un an pour traiter le cas d’entreprises confrontées à de réels besoins de financement. Il intervient juste après le retournement, quand il faut, pour redémarrer, assurer le haut de bilan. Ce fonds, qui dépend de la CDC, est géré par une équipe dédiée.
Dans le cas que j’évoquais, la méthode de travail a été pleinement satisfaisante : le partenariat noué avec des banquiers a permis l’arrivée d’un investisseur. C’est ainsi qu’il faut travailler pour trouver des fonds propres.
Depuis l’origine, un dossier ne peut être à la fois à la Médiation et au CIRI. Il est impensable qu’il en soit autrement. Le CIRI reçoit les dossiers lourds, de plus de 400 personnes, et ceux qui comportent des restructurations industrielles. La Médiation traite plutôt du financement bancaire et de l’assurance-crédit. Elle peut se voir confier des dossiers de 800, de 1 000 voire de 2 000 personnes, s’il s’agit non d’une opération de restructuration industrielle, mais d’une restructuration de la dette, et qu’il faille remettre les banquiers d’accord parce que l’un d’eux veut se retirer. J’ai d’excellentes relations avec Sébastien Raspiller, secrétaire général du CIRI. L’échange entre nous est d’autant plus fluide que notre métier n’est pas courant à Bercy. Le CIRI ou la Médiation sont les seuls endroits où l’on fasse de la microéconomie, et où l’on s’intéresse au financement des entreprises. Nous n’avons donc pas de mal à nous comprendre.
J’avais déjà apprécié, il y a longtemps, les services de la Banque de France tournés vers l’international. Pour travailler quotidiennement avec elle, je veux saluer la qualité de son réseau, qui est agréable, professionnel et compétent.
À la création de la Médiation, j’étais médiateur délégué. C’était une bonne école pour apprendre comment financer les entreprises en difficulté. Quel que soit le Gouvernement, nous travaillons avec le cabinet du ministre des finances et celui du ministre de l’industrie. Notre seule demande concerne le fait que le dossier soit saisi en médiation, car nous n’aimons pas travailler sans filet.
J’ai plus de mal à vous répondre sur les CRP, car, d’une région à l’autre, leurs profils et leurs personnalités varient, tout comme leur manière de concevoir leur mission, mais, dans l’ensemble, les directeurs régionaux de la Banque de France m’assurent qu’ils ont de bonnes relations avec eux. Contrairement à nous, qui ne pouvons pas nous autosaisir, les CRP vont parfois d’eux-mêmes vers des structures en difficulté. Nous l’avons répété aux directeurs de la Banque de France : face à un sujet bancaire, le CRP doit envoyer le dossier à la Médiation. Nos réunions se tiennent à la Banque de France. Tels sont notre cadre et les règles auxquelles nous nous tenons. Le dispositif s’est peu à peu imbriqué dans le paysage et je dois intervenir prochainement devant les CRP à Bercy.
Quand un dossier traite de fonds propres ou de garantie, le directeur de la Banque de France, qui a l’habitude des dossiers de médiation, connaît les dispositifs locaux. C’est d’ailleurs le directeur régional de la Banque de France qui a appelé notre attention sur JEREMIE, même si nous travaillons plutôt sur le bas que sur le haut de bilan.
Notre rôle étant de faire que les banques continuent à financer les entreprises, nous jouons le rôle de vigies. Il nous arrive de faire appel à des dispositifs pertinents, par exemple de compléter une garantie OSÉO par celle d’un conseil régional. Cependant, il faut savoir que les attentes de certaines entreprises ne sont pas réalistes. Quand le chiffre d’affaires n’est pas au rendez-vous ou que les pertes demeurent, la messe est dite. D’ailleurs, la médiation ne doit pas introduire de distorsion de concurrence. Dans le secteur du BTP par exemple, où il est probable qu’interviendra une restructuration, on trouve malheureusement des entreprises qui ne sont pas viables, ou qui sont trop petites ou qui ont fait du dumping, ce qui a considérablement réduit leurs marges.
Le financement des entreprises m’intéresse particulièrement, puisque j’ai repris la fonction de président de l’Observatoire du financement des entreprises, créé en 2010 lors des états généraux de l’industrie. Depuis cette date, ceux-ci se sont réunis régulièrement. Ils ont publié plusieurs rapports sur le financement des PME. Un autre, qui date de la fin de 2011, porte sur le financement des TPE. L’Observatoire réunit des acteurs de la Banque de France, de l’INSEE, du Trésor, d’OSÉO et de la BPI, mais aussi des fédérations professionnelles – MEDEF, CGPME, UPA –, des chambres de métiers, de la chambre de commerce de Paris, des banques, de la FBF et certaines personnalités qualifiés en matière d’investissement. Nous travaillons sur les sujets d’actualité.
Ce matin, nous avons évoqué le risque d’une tension des financements. L’octroi de crédit s’est ralenti cette année. Si, au vu de différentes enquêtes, l’accès au crédit pour l’investissement reste satisfaisant, on observe plus de tension à l’égard des crédits de trésorerie, même si l’évolution reste légèrement positive, y compris pour les PME. Dans ce contexte, le Gouvernement a réactivé certains dispositifs, comme le fonds de garantie de la trésorerie d’OSÉO, qui permet de garantir 50 % d’un crédit à court terme transformé en crédit à moyen terme d’un à cinq ans. Il a également mis en œuvre le préfinancement du CICE, qui représente une véritable avance de trésorerie pour les entreprises. Celles-ci montrent aussi beaucoup d’appétit pour les lignes de mobilisation de créance publique, comme la ligne « avance plus » d’OSÉO.
Nous arrivons à un moment clé. J’ai réuni les banquiers pour les sonder, à l’heure de la publication des bilans, où les entreprises font renouveler leur ligne de trésorerie. Ils sont conscients qu’il ne faut pas assécher le crédit. Pourtant, on ne peut sous-estimer les risques : certaines entreprises sont dans une situation très fragile. L’INSEE a annoncé ce matin que nous étions en récession. Dans certains secteurs – BTP, distribution –, les performances ne sont pas bonnes.
M. Olivier Carré, président. On connaît le discours des banquiers : « Si le nombre de crédits accordés diminue, la faute en revient non à notre capacité de financement, mais à la qualité des dossiers. »
M. Christophe Castaner, rapporteur. L’argument est recevable pour les crédits à l’investissement mais pas pour les crédits de trésorerie.
M. Olivier Carré, président. La Médiation est un des seuls capteurs à faire le lien entre la perception macroéconomique des besoins de liquidités et la vision microéconomique.
Mme Jeanne-Marie Prost. Les banquiers ont continué à prêter. Ils n’ont donc pas tort de dire qu’ils ont fait leur métier. Cela dit, ils sont tenus par leurs comptes de résultats. Quand les dossiers sont bons et que les entreprises sont solides, dans le contexte actuel, tout le monde se précipite. Il faut aussi noter que le crédit n’est pas cher, ce dont chacun se réjouit. La grande crainte des banquiers, y compris pour les crédits de trésorerie, c’est d’avoir à financer des pertes.
M. Olivier Carré, président. Ne serait-ce que parce que c’est illégal ! Il n’y a pas seulement une vérité comptable…
M. Christophe Castaner, rapporteur. …mais un risque pénal.
Mme Jeanne-Marie Prost. C’est l’obsession des banquiers. Voilà pourquoi, dans une situation de fort ralentissement, nous passons beaucoup de temps à instruire chaque dossier, pour comprendre la situation le plus précisément possible. Les petites entreprises ne disposent pas toujours d’un niveau d’analyse très sophistiqué. Il existe évidemment un plan de trésorerie, mais rien ne garantit qu’il soit complet. On y décèle parfois des oublis involontaires. Quand l’entreprise est sur le fil du rasoir, le banquier est vigilant. Dans ce cas, je le répète : elle ne doit pas hésiter à nous saisir, pour que nous jouions le rôle d’amortisseur.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Pensez-vous que les petites entreprises connaissent le mécanisme de médiation ? Comment améliorer leur niveau d’information ?
M. Olivier Carré, président. Les experts comptables peuvent jouer ce rôle.
Mme Jeanne-Marie Prost. Bonne réponse ! René Ricol s’est d’ailleurs appuyé sur eux. Pour nous, il est assez difficile de toucher un boulanger ou un petit artisan. C’est pourquoi, depuis trois mois, j’ai lancé plusieurs actions. J’ai rencontré toutes les fédérations professionnelles. J’ai utilisé leur site. J’ai effectué une démarche systématique auprès des chambres de commerce et d’industrie, et auprès des chambres de métiers, pour communiquer par tous les moyens. J’ai lancé une campagne d’affichage. Mon collègue de la direction générale des finances publiques a accepté de poser des affiches dans les 900 points de contact des DGFIP. Cette action a été relayée par la Banque de France. La presse quotidienne régionale joue aussi un rôle important. Demain, où je me rends à Charleville-Mézières, je rencontrerai la presse locale. Je demande aussi aux directeurs de la Banque de France d’utiliser tous les canaux locaux : l’Union professionnelle artisanale (UPA), les chambres de métiers doivent participer, comme les experts comptables, à la diffusion de l’information.
M. Christophe Castaner, rapporteur. L’État peut-il intervenir de manière plus directe et plus massive, par exemple en mobilisant la BPI, pour financer les BFR ?
Mme Jeanne-Marie Prost. La BPI intervient déjà par la branche OSÉO. Garantir les banques commerciales est un moyen d’apporter des financements. D’ailleurs, la ligne « avance plus » a augmenté.
La Médiation a été instaurée pour que les banques commerciales, qui sont relativement solides en France, financent les entreprises et l’outil de production. Je vois tous les jours fonctionner le partenariat entre les outils publics ciblés et l’énergie privée, à laquelle ils servent de catalyseurs. Ma mission de Médiatrice est d’aider nos banques commerciales à financer l’investissement et la trésorerie, bref à faire leur métier.
Si, entre 2010 et 2011, le nombre de dossiers en médiation a beaucoup baissé, c’est soit que la crise a pris fin et que la situation économique s’est améliorée, soit que l’existence de la Médiation a poussé les banques à remettre en cause leur mode de travail avec les PME. Certains réseaux bancaires l’ont reconnu. Ils ont essayé de mieux les traiter. On doit se réjouir de ce que les acteurs puissent travaillent mieux et parviennent à financer l’outil économique.
Avez-vous comparé la situation de la France à celle des autres pays européens ? Il y a quinze jours, la BCE a publié des enquêtes alarmantes, dont il ressort qu’en Italie et en Espagne, les banques restreignent l’offre de crédit aux PME. Il serait très grave que cela se produise en France. En cas d’ajustement, nous sommes là pour rappeler aux banques qu’elles n’ont peut-être pas fait tout ce qu’il fallait et qu’elles doivent aussi prendre des risques.
M. Olivier Carré, président. Je vous remercie.
Audition du mercredi 15 mai 2013
À 17 heures 30 : M. Valérian Pham Ngoc, Commissaire au redressement productif, région Nord
Présidence de M. Christophe Castaner et de Mme Véronique Louwagie, rapporteurs
M. Olivier Carré, président. Monsieur, dans le cadre des auditions relatives à la prévention et à l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde et de l’emploi, nous avons souhaité que vous nous présentiez votre mission de commissaire au redressement productif. Vous êtes le commissaire au redressement productif de la région Nord. Comment voyez-vous cette mission sur le terrain ? Il sera aussi intéressant de voir comment concrètement vous vivez la mise en place des plans de sauvegarde. En effet, il y a la question de la prévention, largement abordée dans le cadre de l’audition précédente, mais leur mise en œuvre est aussi importante. Nous sommes tous des parlementaires et nous avons vécu malheureusement des sinistres dans nos circonscriptions. Invité à certaines tables rondes sur ce sujet, j’ai parfois été étonné de la façon dont cela se passait et j’aimerais avoir là-dessus votre retour, en particulier sur ce qui est perfectible.
M. Valérian Pham Ngoc, commissaire au redressement productif de la région Nord. Il me semble, en effet, intéressant qu’un commissaire au redressement productif puisse témoigner de son rôle et répondre à vos questions car il s’agit d’un acteur nouveau.
En juin 2012, le ministre du redressement productif a demandé à chaque préfet de proposer un de ses cadres pour assumer les fonctions de commissaire au redressement productif. L’enjeu s’est accompagné d’une forte attente locale des élus ou de certains salariés qui se disaient un commissaire au redressement productif, ca va être un « mini Arnaud Montebourg » sur le terrain et les choses vont vraiment pouvoir avancer. Cette forte attente n’était pas modérée par la volonté technique et politique de pouvoir intervenir de façon pertinente. Je pense qu’une des valeurs ajoutées qu’a amenée le commissaire au redressement productif c’est un aspect de mobilisation inter-administration et une facilitation des relations entre les administrations qui sont en jeu dans l’ensemble des sujets industriels et sociaux.
Je suis rattaché à la préfecture de région et je travaille avec le SGAR (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales). J’ai également des fonctions au sein de la DIRECCTE qui est la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et c’est une valeur ajoutée forte que partagent environ les deux tiers des commissaires au redressement productif. Si je n’étais pas à la DIRECCTE, je pense que mon rôle serait bien différent. Aujourd’hui je peux être réactif face à certaines demandes ponctuelles d’entreprises parce que je peux m’appuyer sur une équipe à la DIRECCTE sur laquelle j’ai une autorité hiérarchique. Cela a aussi un intérêt aussi en termes de compétences techniques.
Quand j’ai été nommé, j’ai pu profiter, à la fois au niveau national et régional, de deux facteurs. D’une part, une formation pour comprendre le droit des entreprises en difficultés. Avant d’être nommé, je dois vous l’avouer, je ne savais pas très bien en quoi consistait un administrateur judiciaire. J’ai rapidement été mis dans le bain et j’ai pu découvrir leur fonctionnement. Cela passe par un aspect pratique et aussi théorique grâce à des formations continues.
D’autre part, le titre permet une reconnaissance au sein de l’État du rôle des commissaires auprès des entreprises en difficultés. Cela donne une légitimité auprès d’un certain nombre d’acteurs : je pense notamment aux services fiscaux qui ont une culture du secret fiscal et un métier régalien, mais qui comporte aussi des fonctions d’accompagnement sur certains volets. L’idée est simple : au niveau régional ce n’est pas la DIRECCTE ou le sous-préfet, mais le CRP qui a un rôle de coordinateur et de facilitateur. On va donc apprendre à le connaître, on va lui faire confiance, on va lui dire des choses que l’on souhaite qu’il garde pour lui. Et en contrepartie, on attend qu’il partage sa vision des entreprises qu’il traite, qu’il n’agisse pas seul sans le dire aux autres, le but étant finalement une bonne coordination. C’est une valeur ajoutée au sein de l’État. Que cela signifie-t-il lorsque le tribunal de commerce souhaite la liquidation avec maintien d’activité ? Le sous-préfet n’a pas forcément la compétence technique ou encore les contacts avec les administrateurs judiciaires. Le commissaire peut lui apporter un certain nombre de choses. De même, quand le conseil régional, avec ses différents interlocuteurs dans le champ économique, souhaitait agir pour une entreprise qui rencontre des difficultés, il lui était un peu difficile de trouver le meilleur interlocuteur dans les services de l’Etat en région. Désormais c’est largement plus facile. Ils savent que le commissaire est en contact avec les préfets, les sous-préfets, les services nationaux et éventuellement d’autres partenaires extérieurs à la puissance publique.
Les commissaires au redressement productif bénéficient d’une animation au niveau national. Dans le traitement des dossiers ponctuels cela permet de bénéficier d’une vision d’expert sur une filière par exemple, et les commissaires peuvent faire appel au niveau national sur certains sujets ou quand il y a besoin de la mobilisation d’un outil de l’État. Il y a un dialogue qui se crée.
Donc, cela présente un intérêt en termes de traitement des dossiers, comme on vient de le voir, mais aussi en termes d’animation politique. On a des échanges entre commissaires, sachant qu’il y a beaucoup d’entreprises dont les enjeux dépassent le niveau régional.
M. Olivier Carré, président. Je vous suggère d’aller plus directement sur les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Qu’est-ce qui vous frappe dans les procédures suivies, dans vos dossiers – sans les nommer, c’est important – ? Concrètement, qu’est ce qui marche, qui ne marche pas ou qui pourrait être amélioré. Sans vouloir entrer dans des questions politiques, mais en restant sur la technique des plans de sauvegarde, dans la mesure où vous êtes dans une région qui n’est pas facile.
M. Valérian Pham Ngoc. Les commissaires au redressement productif ont un rôle mesuré dans le traitement des PSE ; ils interviennent plutôt sur le traitement des entreprises en difficulté, en appelant des banques, en travaillant avec les administrateurs judiciaires etc. Une fois que l’on est dans le social, cela relève de compétences en droit du travail donc de la DIRECCTE ; pour le volet politique de médiation et d’information c’est le rôle de la préfectorale donc du préfet de région ou du sous-préfet selon l’importance du dossier. Le commissaire, selon moi, n’a pas pour rôle de donner un avis sur la qualité du travail d’un fonctionnaire du service de l’emploi. Je ne peux donc pas discuter de la qualité d’un PSE sur le niveau de congé de reclassement ou du niveau des primes de formation de départ des salariés avec le directeur d’une unité territoriale d’une DIRECCTE qui lui, est au cœur du suivi du PSE.
M. Christophe Castaner, Rapporteur. Si vous me permettez, on est en amont et dans l’amont ce n’est effectivement pas la compétence de votre ministère. Mais, l’objet de notre rapport est aussi l’anticipation. Par rapport à votre positionnement, qu’est-ce qui aujourd’hui vous paraîtrait plus efficace pour éviter les PSE ? Quels sont à votre avis les éléments qui dysfonctionnent et qui pourraient permettre de les éviter ? Quels sont les sujets sur lesquels une amélioration est possible ?
M. Valérian Pham Ngoc. Éviter un PSE, c’est en général aider une entreprise à surmonter ses difficultés. Lorsqu’une entreprise en arrive à recourir à un PSE c’est qu’elle a accumulé des pertes depuis plusieurs années et que la restructuration est inévitable. Les commissaires agissent surtout sur le volet financier pour essayer de trouver une solution. Finalement si on aide une entreprise qui est en difficulté financière et donc qui ne paye plus ses fournisseurs, on cherche à éviter la procédure judiciaire, le PSE ou la restructuration. En matière de prévention, les commissaires ont pour but d’aider les entreprises à être le moins possible en difficulté pour ne pas en arriver au PSE. Mais il est vrai qu’il existe des cas où la survie d’une entreprise passe par la vente d’une activité ou des licenciements; dans cette hypothèse, d’une certaine manière le commissaire accompagne des entreprises qui mettent en œuvre des PSE pour leur survie.
M. Olivier Carré, président. Avez-vous des exemples de dossiers traités dans lesquels vous avez pu éviter que l’on aboutisse à un PSE majeur, ou finalement que votre action a débouché sur un moindre mal par rapport à ce que ça aurait été en votre absence ? Comment avez-vous été facilitateur dans de tels dossiers ?
M. Valérian Pham Ngoc. Je pense au cas d’une société en liquidation judiciaire avec maintien de l’activité, un administrateur judiciaire ayant été nommé. La seule possibilité de maintien de l’activité était qu’il y ait un repreneur. Un repreneur s’est manifesté auprès du tribunal de commerce mais il ne disposait pas de toutes les ressources financières nécessaires. Avec l’aide de l’Etat, du conseil régional et de la communauté d’agglomération du territoire, nous avons travaillé pour boucler le financement. Il fallait trouver environ 3 millions d'euros, le repreneur apportant 500 000 euros de fonds propres. Nous avons eu recours à différents dispositifs : le fonds national de revitalisation du territoire (FNRT) a permis de mobiliser une première tranche de 500 000 euros, le conseil régional a avancé 300 000 euros, ainsi que des banques du département. Les sommes étant toujours insuffisantes, on pu augmenter le FNRT à 1 million d’euros sur la base de l’amélioration de l’outil productif. L’entreprise était dans une situation originale car elle avait un foncier conséquent en milieu urbain mais son activité était très bruyante. L’agglomération s’est portée acquéreuse du foncier pour développer un projet immobilier urbain, ce qui constituait un apport conséquent. Finalement, sur les 120 salariés, 46 salariés ont été maintenus dans leur emploi dans le cadre de la reprise au tribunal de commerce. Aujourd’hui 56 personnes y sont employées dont 46 en CDI. Si on ne s’était pas mobilisé auprès du repreneur l’activité aurait été arrêtée. Si je n’avais pas été commissaire, je n’aurais pas eu de mandat pour appeler le Président du tribunal de commerce et faire passer un certain nombre de messages. Il a d’ailleurs souhaité que je sois reçu à l’audition au tribunal pour expliquer la situation en termes de financement. C’est une société qui a travaillé dans le ferroviaire, alors nous nous sommes dit qu’on pourrait demander à la SNCF de financer la reprise car elle a besoin de maintenir ce sous-traitant de deuxième rang sur le territoire national. La SNCF a un outil, via « SNCF développement », de prêt participatif d’un montant de 200 000 euros. À la fin, 3 millions d’euros ont été consolidés, le tribunal a considéré le business plan comme faisable et a validé la cession.
M. Olivier Carré, président. Le rapport c’est 2,5 millions plus 500 000 euros…
M. Valérian Pham Ngoc. Le rapport c’est, 3,2 millions d’euros. Cela comprend, notamment 500 000 euros de fonds propres, 300 000 euros de prêt à moyen terme de la banque avec une garantie OSEO, 1,5 million d’euros d’immobilier et 1 million d’euros du FNRT.
M. Olivier Carré, président. Que représentent ces 1,5 million d’euros d’immobilier.
M. Valérian Pham Ngoc. Il s’agit d’un achat de l’agglomération, l’entreprise est ensuite devenue locataire des biens dont elle avait la propriété. Un déménagement est prévu en 2015 pour que la communauté d’agglomération puisse mettre en œuvre son projet immobilier.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Sans commissaire au redressement productif, aurait-on pu aboutir au même résultat ? Votre intervention a-t-elle véritablement contribué à trouver une solution ? Vous disiez que vous aviez un rôle très mesuré au niveau des PSE pour ce qui est du rôle social. On a l’impression que votre intervention s’effectue au côté des autres acteurs et peu dans la prévention puisque vous avez tout de suite parlé des difficultés des entreprises. Pourriez-vous par ailleurs nous donner quelques indications sur le nombre des interventions effectuées auprès des entreprises, sur le nombre des sollicitations que vous avez reçues, et des résultats, pour faire un état des lieux de ce que vous avez pu connaître dans votre région ? Quelques chiffres aussi sur la taille et la manière dont les entreprises ont recours à vous ?
M. Valérian Pham Ngoc. Avant d’être nommé commissaire, j’étais chargé de mission auprès du préfet sur les questions économiques et responsable du service développement économique à la DIRECCTE. Ma mission portait sur les politiques économiques, l’aspect innovation des pôles de compétitivité etc. La mobilisation sur les entreprises en difficultés était moins forte hors des interventions ponctuelles ; surtout pour les petites PME il y avait moins d’énergie mise en œuvre. S’il n’y avait pas eu de commissaire au redressement productif il n’y aurait pas eu d’animation, du côté de l’Etat et il n’y aurait pas eu de dialogue de confiance, ce qui aurait fait échec à la reprise. Le financement de l’état, qui était conséquent n’aurait pas pu être réalisé si je n’avais pas agi en tant que commissaire avec un appui au niveau national. Intervenir en amont sur ces sociétés est plus utile, car on a la possibilité de mobiliser les outils publics et privés, tandis que devant le tribunal de commerce il est impossible de faire intervenir une nouvelle banque. Du coup l’impact en matière de prévention est plus difficile à mesurer, car que le commissaire agisse ou non, il n’y aura ni licenciement ni PSE l’année suivante ; par contre il est utile d’agir pour éviter que la situation ne se dégrade petit à petit.
Sur les chiffres, 110 entreprises sont suivies, avec en moyenne 100 salariés par entreprise. Je suis interpellé sur des petites entreprises de 30 ou 40 salariés, le premier contact se fait alors par un chargé de mission de la DIRECCTE qui est sous mon autorité et qui permet de faire un diagnostic. Parfois il s’agit uniquement de rencontrer le dirigeant, de lui faire part d’un certain nombre de dispositifs publics existant, de lui demander un plan de règlement sur les charges de fiscalité sociales, lui expliquer qu’il y a un contact à la direction départementale des finances publiques, afin d’améliorer sa situation et qu’il trouve plus de trésorerie pour repartir dans une situation plus saine. On essaie cependant de ne pas uniquement traiter ponctuellement la question financière, qui est souvent l’objet de l’interpellation, mais d’apporter un accompagnement sur le moyen terme, parfois sur le volet stratégie, grâce à des dispositifs – financés par la DIRECCTE – ou par d’autres dispositifs d’accompagnement du dirigeant sur des volets relatif aux mutations économiques. Cela revient à préparer un dirigeant de PME ou TPE à une mutation de marché prévisible.
Sur l’aspect financier, on pense souvent au plan de règlement sur les charges fiscales et sociales. Il n’est pas sous mon autorité et je ne fais donc que transmettre des contacts ; parfois j’apporte un argumentaire au comptable public. Sur les 110 entreprises que j’ai mentionnées, 60 % relèvent de contacts pris par des élus locaux, les partenaires sociaux, ou les sous-préfets. Pour les autres, ce sont les dirigeants de l’entreprise qui se sont manifestés. Souvent, nous travaillons en réseau avec OSEO, car malgré le secret bancaire ils peuvent être amenés à me transmettre des informations utiles. Je me consacre principalement au secteur industriel. Pour une société BTP, ma capacité d’action est bien plus faible. De même, il y a des enjeux sociaux réels sur les services à la personne qui relèvent de mécaniques complètement différentes de celles que je traite habituellement. J’y passe peu de temps car mon action est limitée.
M. Christophe Castaner, Rapporteur. Je souhaiterais aborder la question de la revitalisation des territoires. Avec les PSE, on sait aujourd’hui accompagner individuellement les salariés mais le volet revitalisation du territoire est très souvent négligé. Aujourd’hui, avez-vous les moyens d’agir sur ce volet à travers la mobilisation de financement qui peuvent être générés par le PSE lui-même mais aussi par d’autres outils ? Les commissaires au redressement productif sont-ils en capacité de contribuer à la revitalisation du territoire ?
M. Valérian Pham Ngoc. C’est un enjeu important que de continuer le progrès déjà engagé il y a quelques années sur les questions de revitalisation. Par exemple, pour la filière textile, sur le territoire le plus délicat du Nord Pas de Calais, la communauté d’agglomération du Calaisis, des fonds de revitalisation ont été mobilisés pour financer une étude. Certaines entreprises en difficulté ont pu être aidées en partie en mobilisant des prêts issus d’une convention de revitalisation. Depuis que je suis commissaire, il n’y a pas eu de signature d’une convention de revitalisation qui se soit opérée, mis à part celle de SIS France, pour laquelle la SNCF, qui n’était pas soumise à cette obligation, a quand même souhaité mener une action territoriale de revitalisation sur le territoire du Calaisis.
Rapporteur. Comment cela se traduit aujourd’hui ?
M. Valérian Pham Ngoc. L’actionnaire de SIS France qui est la SNCF a souhaité mettre en œuvre, de manière spontanée, une action de revitalisation, c'est-à-dire sans qu’elle soit obligée par les textes. D’autres projets émergent, sur le territoire de Calais, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, sous le format de start-up, avec un partenariat de l’université de la Côte d’Opale. Cela donne une dynamique d’avenir sur un territoire qui a connu une baisse de son industrie et des difficultés sur ses activités maritimes. Une partie de l’enjeu tient à la manière dont on demande à l’entreprise d’agir sur la revitalisation. L’État a raison d’être exigeant sur le rôle que doit tenir une entreprise en matière de revitalisation et pas seulement en termes de montant financier. Si l’entreprise ne s’investit pas personnellement sur la revitalisation, l’Etat veille à ce qu’elle fasse appel à des structures de qualité, dans le contenu et le suivi. L’enjeu est désormais dans le suivi, une fois que la convention est conclue, en s’assurant que l’entreprise a respecté ses engagements.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Je voudrais revenir sur votre situation. Vous disiez que vous étiez à la fois membre de la DIRECCTE et commissaire au redressement productif. Est-ce une situation unique ou cette situation existe-t-elle dans d’autres régions ? Vous aviez évoqué cela comme étant un atout.
M. Valérian Pham Ngoc. J’ai deux fiches de paye. Je pense effectivement que c’est un atout d’être aussi à la DIRECCTE et cette situation n’est pas rare. En Rhône Alpes un agent est à mi-temps à la DIRECCTE et à la préfecture. J’étais dans cette situation avant d’être nommé commissaire.
M. Olivier Carré, président. L’une est émise par le ministère de l’Intérieur et l’autre par Bercy ?
M. Valérian Pham Ngoc. À la préfecture, c’est le Premier ministre qui émet la fiche de paie dans la mesure où je suis rattaché au Service général aux affaires régionales. J’ai une fiche de paie DGCIS et une fiche de paie qui émane des services du Premier ministre.
M. Olivier Carré, président. Existe-il un profil type pour devenir commissaire ?
M. Valérian Pham Ngoc. Non il n’y a pas de profil type, je ne pense pas que mes homologues qui sont uniquement rattachés à la préfecture sont moins compétents mais ils n’ont pas la chance de pouvoir s’appuyer directement sur des chargés de mission qui permettent une certaine réactivité.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, magistrate à la Cour des comptes. Vous avez indiqué que dans votre travail en tant que commissaire au redressement productif, vous étiez plutôt présent sur l’amont, sur l’économique et la prévention des difficultés des entreprises et qu’à un certain moment vous passiez la main à la partie emploi de la DIRECCTE. Je voudrais savoir si votre positionnement actuel, en étant commissaire au redressement productif tout en restant responsable du secteur développement des entreprises, vous permet encore de nouer les liens nécessaires avec vos collègues de l’emploi. Au cœur du projet de la DIRECCTE, il y a effectivement ce lien entre l’analyse et le développement des entreprises, et l’approche emploi, tant en développement qu’en traitement des difficultés. Vous avez dit que vous n’intervenez pas véritablement dans les PSE, mais le fait que la variable emploi, coût du travail, soit un des arguments avec lequel vous établissez un lien pour le PSE fait peut être le lien avec la procédure des plans de départ volontaire. Toutes les difficultés en matière d’emploi ne passent pas nécessairement par des PSE et toutes les difficultés de l’entreprise ne se traduisent pas par des problèmes d’emploi. Prenez-vous cet aspect en compte dans votre travail de commissaire au redressement productif ?
M. Valérian Pham Ngoc. Quand j’ai été nommé commissaire, la directrice régionale de la DIRECCTE a souhaité que soit mis en œuvre une animation exclusive au sein de la DIRECCTE avec les unités territoriales, qui sont à la fois des sources d’informations sur les difficultés de l’entreprise et qui permettent le traitement d’objets tels que le chômage partiel. Une fois par mois, je réunis l’ensemble des directeurs adjoint d’unités territoriales, le responsable des affaires économiques de la DIRECCTE, le service synthèses études et le pôle C qui est en lien avec des services de contrôle au sein des entreprises. Au sein des unités territoriales il y a trois secteurs, une partie marché du travail, une partie inspection du travail et une partie mutation économique. Je réunis donc les directeurs adjoints en charge des mutations économiques tous les mois au siège de la DIRECCTE pour faire un point sur l’ensemble de nos dossiers. Ce matin, j’ai appris par un administrateur judiciaire que la direction d’une société en redressement n’avait pas l’intention de proposer un plan de redressement. Il peut y avoir une reprise par un des repreneurs mais on sait qu’ils iront sur un périmètre d’emploi plus limité. J’ai donc contacté l’unité territoriale de la DIRECCTE pour qu’elle envisage une cellule d’appui qui permet d’accompagner socialement les salariés qui font l’objet de licenciement économique. Si je n’étais pas à la DIRECCTE je n’aurais pas pu mettre en place une telle cellule. Le lien Bercy/emploi est maintenu au sein de la DIRECCTE. Concernant les plans de départ volontaires, l’action des commissaires au redressement productif est limitée en fonction de la taille de l’entreprise et donc du nombre de salarié. Au-dessus de 400, l’intervention peut se faire au niveau national. Dans les sociétés de moins de 400 salariés je n’ai pas vu de plan de départ volontaire dans les entreprises que j’ai suivi.
Audition du mercredi 15 mai 2013
À 18 heures 30 : Audition de MM. Pierre Beretti, président-directeur général d’ALTEDIA, François Moreau, Directeur général adjoint, et François Kalfon, Directeur de la communication conseils en management.
Présidence de M. Christophe Castaner et de Mme Véronique Louwagie, rapporteurs
M. Olivier Carré, président de la MEC. Nous avons souhaité vous entendre dans la mesure où votre cabinet intervient au moment où le PSE est mis en œuvre. Votre retour d’expérience nous sera très utile sur des exemples concrets illustrant les difficultés que vous avez pu rencontrer. Des recommandations que vous pourriez formuler pour faciliter le reclassement ou la revitalisation qui découlent des plans, sont évidemment les bienvenus.
M. Pierre Beretti, Président directeur général d’Altedia. Je préside Altedia depuis 3 ans et j’ai été DRH de Thalès et Alcatel. J’ai donc initié plusieurs plans de restructuration, de cessions, de fermetures, ou de cessation d’activité en Europe et dans le reste du monde.
Altedia est une filiale à 100 % du groupe ADECCO depuis 2005 et nous appartenons à une division du groupe chargée des questions de transition professionnelle dans le monde entier. Nous avons donc une très grande connaissance de ce secteur dans d’autres pays du monde et en particulier aux États-Unis et en Europe. Nous sommes 600 salariés en France pour un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros en 2013, dont les deux tiers sont réalisés auprès du secteur industriel.
Nous avons deux activités principales : le conseil aux entreprises pour les projets de restructuration, de transformation et de réorganisation sous l’angle RH, ce qui nous place en amont dans le projet et donc dans une phase très confidentielle ; puis l’accompagnement des salariés dans la phase de transition professionnelle, – c’est-à-dire 25 000 personnes par an – dont 20 % auprès de pôle Emploi et le reste dans le secteur privé.
Nous avons tenu à exercer également une activité dans le secteur public depuis plusieurs années : cela était stratégique pour nous. Nous avons ainsi une vue d’ensemble de la restructuration des entreprises et des administrations. Nous sommes très sensibles à l’accompagnement des personnes qui ont choisi, ou pas, de quitter l’entreprise, mais également à l’accompagnement de ceux qui restent. Cet accompagnement managérial nous est souvent demandé pour préparer l’avenir de l’entreprise. Il est donc très important pour nous de faire les deux en même temps et de conduire l’entreprise à réfléchir à son projet post-restructuration.
De manière générale, à l’exception de l’aéronautique, force est de constater que pratiquement tous les secteurs sont actuellement en transformation (banque, assurance, automobile, etc.). Il s’agit vraiment de mutations, de transformations profondes à l’échelle nationale et européenne. C’est pourquoi nous sommes très soucieux d’amener nos clients à réfléchir à ces évolutions. Cela nous conduit à équilibrer nos actions entre la direction de l’entreprise, les partenaires sociaux et les salariés. Lorsque nous parlons à l’un, nous pensons toujours aux deux autres, surtout quand nous sommes nous-mêmes négociateurs des plans.
Sur la question des composantes d’un plan réussi, quelques facteurs-clés sont à retenir : il faut premièrement intervenir le plus en amont possible. Je sais d’expérience que l’entreprise attend en général le dernier moment, pour une raison simple : lorsqu’elle sait qu’elle va annoncer quelque chose de difficile à mettre en œuvre, elle sait aussi que cela peut créer de la perturbation. Or, son souci est d’éviter que ces perturbations soient les plus longues et les plus dommageables possibles pour son activité. Il est donc toujours difficile d’anticiper. Dans certaines situations néanmoins, l’anticipation est possible : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est un facteur assez neutre qui la rend possible.
Deuxièmement, et nous l’observons dans beaucoup de cas, plus l’entreprise est ouverte à la négociation et plus il y a de chances que la restructuration se passe dans de bonnes conditions. Ce parti n’est pas facile à prendre car il a un coût en termes de délais et de mise en œuvre. Cette logique est actuellement bien perçue par la plupart des grands groupes, ce qui nous permet de les conseiller quant à la façon d’aborder ce sujet avec les salariés et leurs représentants.
Dans la négociation, il est important d’aller le plus vite possible. Je tiens ceci de mon expérience de DRH, et plus récemment, de consultant. Plus la partie en amont est courte (entre l’annonce de la restructuration et la notification des départs), plus nous pouvons nous concentrer sur l’accompagnement des salariés qui partent de façon contrainte ou non. La rapidité de cette phase de définition des conditions d’exécution du plan est un premier facteur de succès.
Ensuite vient la rapidité de la mise en œuvre : les plans où les congés de reclassement durent deux ans font perdre un an ou an et demi à l’entreprise. Plus la durée du plan de reclassement est ajustée au profil des populations (plus long pour les personnes de rang senior qui peuvent avoir plus de problèmes dans le reclassement ; plus court pour un jeune cadre) et plus il est efficace. Cela s’explique par le fait que le processus de reclassement est plus intensif dans les premières semaines, lorsque nous enchaînons des entretiens, en face à face, avec les consultants et des ateliers. Nous avons notamment mis en place des ateliers pour aider les candidats à se repositionner (CV, modalités de recherche, préparation des entretiens, etc.). Statistiquement, sur les personnes que nous suivons, nous observons deux asymptotes : les salariés qui se reclassent au bout de six mois, et ceux qui se reclassent dans les 9 à 12 mois.
Enfin, je voudrais aborder la question de l’indemnisation ou de l’accompagnement financier des salariés. Sur ce plan également, nous sommes toujours tournés vers une indemnisation forte du retour à l’emploi. Je vais prendre un exemple caricatural mais parlant : si le projet de reclassement est de 12 mois mais que le salarié trouve une opportunité de reclassement intéressante au bout de 6 mois, nous préconisons de payer le solde global du projet de reclassement au salarié. Le salarié a alors intérêt à retrouver un emploi rapidement. Ce phénomène joue sur la dynamisation des salariés. Dans les projets de reclassement qui durent deux ans, il y a 50 % d’absentéisme aux entretiens individuels la première année ou la première année et demi. Or, pendant ce temps, le cabinet cherche des postes : c’est ainsi que des milliers de postes ne trouvent pas de candidats. Lorsque nous travaillons sur un bassin, le nombre d’emploi est limité : si les salariés ne viennent pas aux ateliers et vont « en fond de fauteuil » aux entretiens avec le consultant, les emplois sont perdus car ils sont pourvus par d’autres en dehors du projet de reclassement. C’est pourquoi nous incitons à adopter des projets de reclassement rapides et efficaces.
J’ajoute quelques éléments que nous avons expérimentés ces derniers mois. Nous recommandons, par exemple, de conduire systématiquement une ingénierie de l’emploi dans le bassin où le plan (volontaire ou contraint) va s’opérer dans les semaines ou les mois qui précèdent le démarrage de la procédure sociale. Cela permet d’aller chercher les emplois en tensions, de regarder la structure des emplois les plus attractifs, de ceux qui sont le moins éloignés des compétences des salariés, et donc de réfléchir à la meilleure manière de faire correspondre ces compétences avec celles des emplois en tension sur le territoire. Ainsi, lorsque l’entreprise rentre dans le processus de négociation, elle bénéficie déjà d’une information précise sur la nature des emplois futurs que pourraient trouver les salariés. De façon très symbolique, à Aulnay, nous avons mis en place le Centre de transition professionnelle qui va encore plus loin : avec le mandat de PSA, nous avons identifié les entreprises qui recrutent en permanence sur le territoire, particulièrement dans trois domaines (aéroportuaire, transport de personnes ou logistique, secteur automobile). Nous sommes aussi associés à l’AFPA pour réfléchir à des formations de reconversion de sorte que, le jour où le plan démarre, nous pouvons déjà présélectionner entre 100 et 150 candidats par an (sur 2 ou 3 ans) dans les entreprises que nous avons identifiées, pour les faire ensuite intégrer l’AFPA et ensuite le poste. Cela ne peut se faire que sur des bassins où les opérateurs économiques peuvent anticiper de 6 ou 8 mois leur recrutement. Mais cela ne peut se faire sur plusieurs milliers de personnes.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Nous vous remercions pour cette présentation très complète de votre activité. Compte tenu de votre expérience de DRH et de votre fonction actuelle, quel est votre sentiment sur la réforme en cours de la procédure de licenciement collectif pour motif économique issue de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 ? Comment cela pourrait-il changer les choses concernant l’anticipation, la rapidité et l’efficacité du dispositif ? J’aimerais également aborder la proposition de loi Brottes concernant la reprise des sites rentables et vous demander votre sentiment sur ce sujet d’actualité ?
M. Pierre Beretti. L’ANI va certainement permettre une meilleure articulation de la partie sécurisation des parcours professionnels et de la partie gouvernance sociale, alors que les entreprises ont tendance à ne voir que la première. Avec l’appui du ministère du travail, nous cherchons à promouvoir l’ANI, dans les régions et auprès des entreprises. Il faut d’abord comprendre le dispositif concernant la procédure de validation et d’homologation. À partir de l’année prochaine, la gouvernance sociale sera aussi réformée : participation des salariés au conseil d’administration pour les entreprises d’une certaine taille, base de données unique concernant l’évolution des emplois, avec une vision prospective à trois ans, ce qui permettra une meilleure articulation de l’économique et du social.
Dans l’esprit des négociateurs, il était important d’inciter à la négociation. Dès le déclenchement de la procédure, l’administration peut intervenir, et si un des acteurs considère que l’information n’est pas suffisante, que la négociation n’est pas équitable ou que les éléments sur la table ne sont pas pertinents, l’alerte est formulée auprès de la DIRECCTE qui pourra suspendre la procédure. Les entreprises n’ont pas toujours perçu le contrôle ou les attentes des acteurs à ce moment de la négociation, avec des règles qui restent à préciser, mais qui sont celles d’une saine négociation sociale.
M. Christophe Castaner, rapporteur. L’État est-il capable de jouer son rôle en région ?
M. Pierre Beretti. Il s’agit d’une vraie question : un engorgement rapide est prévisible. Sans parler des grandes entreprises qui sont habituées à ces processus, avec les PME, la sollicitation de l’administration va être encore plus volumineuse. On peut espérer que l’on n’aboutira pas à une homologation par défaut (sauf si le dossier est parfait) et qu’il y aura un regard attentif de l’administration. Les syndicats ont d’ailleurs conscience qu’ils peuvent alerter la DIRECCTE pour avoir son appui à n’importe quelle phase de la négociation, alors qu’avant ils se tournaient uniquement vers le juge.
Quant à la proposition de loi Brottes visant à renforcer les incitations à la recherche de repreneur dans le cas de sites rentables, nous espérons que l’alternative ne sera pas « vendre ou fermer ». Il est devenu de plus en plus difficile de trouver un candidat prêt à reprendre une entreprise, et encore moins une entreprise qu’on conserverait intacte. Qui va prendre le risque de recruter des personnes qui ont en moyenne entre 40 et 50 ans, dont le coût salarial est élevé, de préférence à des jeunes dont le niveau de qualification et de rémunération est plus intéressant ?
Quand vous cherchez un repreneur, la première phase est toujours confidentielle. Ce qui est important c’est que l’entrepreneur rende compte au comité d’établissement de la démarche effectuée et prouve sa bonne foi. C’est la fonction de l’expert du comité d’établissement de vérifier ce qui a été fait. Malheureusement il n’est pas possible de donner les noms des candidats à la reprise, ces derniers ne voulant pas que cela se sache. Nous attendons donc des éléments plus précis quant à la proposition de loi en question.
M. François Moreau, Altedia. Je ferai à ce sujet deux observations. En premier lieu, il y a toujours le risque qu’une société low cost vienne utiliser un savoir-faire alors qu’il y a déjà une surcapacité sur le marché donné. Une entreprise ne ferme pas un site par plaisir, mais pour des raisons économiques et un problème de surcapacités. Par ailleurs, plusieurs grands groupes qui ont tenté de rechercher un repreneur ont connu un échec. S’il faut inciter les entreprises à la recherche d’un repreneur, rendre la démarche obligatoire risque de compliquer les choses.
Ce sujet est d’ailleurs en lien avec la revitalisation, dans le cadre de laquelle on préfère souvent faire du saupoudrage d’aides. La reconversion du site devient alors une option, ce qui est dommage parce que celle-ci est plus structurante, même si ses résultats peuvent être aléatoires. Le saupoudrage permet de dire qu’on a soutenu des emplois alors que la reprise d’un site vide risque d’échouer.
M. François Kalfon, Altedia. Il existe une véritable difficulté à définir l’entreprise ou l’établissement « rentable », et cette difficulté est indépassable. En effet, il est très facile pour des experts en comptabilité de « vider » la rentabilité d’un site.
Le dispositif de préemption commerciale est une idée d’élu local. La collectivité va préempter pendant un certain temps pour trouver un repreneur. Le parallélisme s’arrête là. La préemption commerciale fonctionne assez mal en réalité et pas du tout de la même façon pour une entreprise et une collectivité.
Même si on comprend la demande sociale à ce sujet, le fait qu’un concurrent souhaite reprendre une entreprise entraîne des difficultés qui sont tout à fait déterminantes dans la décision de lui revendre ou non le site. S’il y a une surcapacité, le nouvel entrant peut déstabiliser la position du leader et des effets pervers peuvent apparaître. C’est peut-être dans la mutualisation ou la revitalisation, voire dans la reprise d’un site vide, qu’il faut chercher l’efficacité.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Je voudrais revenir sur les points que vous avez évoqués dans le cadre d’un plan réussi. Si vous aviez trois idées principales à donner dans le cadre des nouvelles politiques qui pourraient être mises en place pour améliorer le dispositif, quelles seraient-elles ?
Que pensez-vous du dispositif des indemnisations avec versement du solde du congé de reclassement ? Quels sont les pourcentages de reclassement avec versement du solde au moment de l’embauche ?
Dans l’esprit de l’accord national interprofessionnel (ANI), pourrait-on imaginer un mécanisme qui contraindrait au versement du solde de reclassement au moment de l’embauche ?
Enfin, quelle vision avez-vous de ce qui se passe à l’étranger et qui serait transposable en France pour améliorer notre dispositif ?
M. Pierre Beretti. Un point est, à mon avis, fondamental : plus un dispositif d’accompagnement des salariés, du type antenne de reclassement, est proche du site de l’entreprise, plus son niveau d’efficacité est élevé. En général, dans ce type de dispositif, une commission paritaire de suivi est mise en place au sein de l’entreprise. La commission nous sollicite en tant que cabinet d’études et nous lui présentons régulièrement les résultats obtenus. Les membres de la commission connaissent les salariés qui sont en accompagnement et l’échange peut être riche. Un tel dispositif crée une pression sur les trois acteurs : les dirigeants, les syndicats mais aussi les partenaires extérieurs qui ont à rendre compte de l’avancement des projets.
Deuxième élément très important : avec une unité de temps et une unité de lieu vous ne rompez ni le lien social, ni le lien de travail. Ceci est fondamental parce que la durée moyenne d’un plan de reclassement se situe entre 6 et 12 mois. La personne n’est pas un individu isolé dans un circuit administratif loin de son lieu de vie et de travail. Les salariés sont dans une communauté et les liens ne sont pas rompus.
Enfin, la vitesse de négociation et le timing de mise en œuvre du dispositif sont des éléments fondamentaux. Quand rien ne se passe pendant des mois, cela a des conséquences désastreuses sur l’état psychologique des personnes. Le réamorçage vers l’emploi demande une énergie considérable et le nombre d’échecs est considérable. Les pays où le timing est le plus long, entre la première annonce et le départ du denier salarié, sont la France et l’Allemagne. En France, le cycle est de 16, 18 ou 24 mois alors qu’en Allemagne il est de 12 mois, en Belgique de 6 mois, en Espagne de 6 à 9 mois.
La question de l’anticipation est fondamentale, c’est tout l’enjeu de la GPEC. Comme je l’avais dit à M. Louis Gallois, je ferais remonter le débat économique au niveau du conseil d’administration parce que c’est là que se rencontrent actionnaires, direction et syndicats de salariés pour n’avoir en aval que la négociation. Je préconise aussi un plus grand nombre d’administrateurs représentant les salariés au sein du conseil d’administration. Si cela marche mieux en Allemagne, c’est parce que le débat économique a lieu très en amont. Il est au bon niveau, au bon moment, au bon endroit.
Je suis tout à fait favorable au versement du solde du congé de reclassement avant la prise de fonction dans la nouvelle entreprise. Dernier point très important : je suis tout à fait favorable à la possibilité de suspendre le congé de reclassement. Donner ce droit peut être très utile, en particulier pour les seniors. Garder son crédit facilite l’acceptation de contrats courts. L’instauration d’un droit rechargeable fait partie des dispositions négociables dans l’entreprise.
M. Christophe Castaner, rapporteur. La négociation et des délais courts vont se traduire par des réponses individuelles du type prime au départ et un saupoudrage des aides alors que l’enjeu est la revitalisation. Plus on favorise la négociation individuelle et la rapidité, plus on contribue à des solutions individuelles qui vont fragiliser l’enjeu de revitalisation territoriale. Quel est votre avis sur la nécessaire revitalisation territoriale ?
Par ailleurs, existe-t-il des outils intermédiaires entre démarche individuelle et démarche collective ? Vous avez parlé des centres de transition professionnelle (CTP) qui pourraient constituer un outil intermédiaire entre le CSP (contrat de sécurisation professionnelle) et les cellules de reclassement. Faut-il mettre en place de nouveaux outils d’accompagnement, qui ne soient pas, comme ceux que nous connaissons aujourd’hui, soit trop collectifs, soit très individualisés ?
Enfin, y a-t-il des outils de gestion des effectifs, comme la GPEC, qui ne sont pas assez pris en compte ?
M. Pierre Beretti. On constate un consensus des acteurs sur les plans de départs volontaires, qui représentent la solution la plus facile – à condition d’avoir suffisamment de volontaires. Le jeu des acteurs de l’entreprise s’accommode de ces formules. Nous avions préconisé de plafonner les indemnités de départ et de réallouer une partie du budget à l’incitation à la reprise d’emploi. Il y a des plans de départs volontaires dans lesquels le droit au congé de reclassement n’est même pas mentionné.
Une voie prend de plus en plus d’importance dans l’accompagnement des plans de départ volontaires ou contraints, c’est la formation de reconversion lourde : le vrai changement de métier. Cette voie est plus facile à mettre en place sur le plan individuel que sur le plan collectif. En effet, au niveau collectif, il faut être sûr que les emplois seront bien là. Il faut identifier les emplois qui vont attirer ces personnes et pouvoir rémunérer l’ingénierie du dispositif mis en place par l’entreprise.
En ce qui la GPEC, on est resté trop statique et pas assez opérationnel. Dans une première étape de sensibilisation, la GPEC permet de faire prendre conscience à tous les acteurs de ce qu’est un emploi sous tension ou un emploi menacé, un emploi en développement ou en risque d’obsolescence à terme. Cette étape de sensibilisation est suivie d’une phase de négociation plus complexe sur l’anticipation des évolutions de métier, les dispositifs de formation, la nature des contrats, la mobilité interne. Ces différents points doivent être articulés avec la base de données unique qui projette les profils des emplois de l’entreprise à trois ans. On pourra grâce à ce dispositif déterminer plus facilement les compétences nécessaires sur les années qui viennent.
Ces questions, qui constituent un véritable enjeu culturel, sont très difficiles à aborder ouvertement au sein de l’entreprise. La volonté des acteurs, qu’il s’agisse des dirigeants, des syndicats, des salariés, joue un rôle essentiel dans la réussite du dispositif.
M. François Moreau, Altedia. Il est fondamental que les procédures soient courtes. C’est déterminant pour le retour des salariés au monde du travail. Quelle entreprise va pouvoir embaucher un salarié qui n’a pas travaillé pendant 18 mois ?
Pour la réussite de la revitalisation, une réelle volonté de la puissance publique d’impliquer l’entreprise est déterminante.
Est-ce que le saupoudrage de primes de 2 000 à 4 000 euros par emploi créé constitue une solution ? Il vaudrait mieux exiger de l’entreprise qu’elle s’implique et négocier avec elle de vraies prestations, par exemple la mise à disposition des compétences sur les territoires. Cela vaudrait toutes les aides financières.
En matière de revitalisation, il faut un leader, que ce soit le préfet, le Direccte, un entrepreneur et que le degré d’exigence soit élevé. Il ne s’agit pas seulement de faire payer l’entreprise mais de mettre ses cadres et ses compétences à disposition des territoires.
M. François Kalfon, Altedia. On pourrait se dire que pour lutter contre le saupoudrage, la réponse est la mutualisation des fonds. Mais ce qui est essentiel à une revitalisation réussie, c’est un projet de territoire porté par des élus leaders, les pouvoirs publics et une entreprise qui adhère à ce projet.
Si on monétise des emplois détruits avec des primes et si le lien avec le territoire est rompu par la mutualisation, alors on encourage le financement de projets non structurants. Les fonds de péréquation déliés de la problématique du territoire constituent une fausse bonne idée.
M. Olivier Carré, président. Si on compare avec ce qui se passe dans d’autres pays, les entreprises françaises sont-elles incitées à payer davantage ou pas ?
M. François Kalfon, Altedia. Les autres pays n’ont pas de dispositif équivalent. Mais l’Espagne, l’Italie s’intéressent à notre dispositif de revitalisation.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Vous avez souligné l’importance d’avoir un manager pour la revitalisation. Est-ce que la pluralité des acteurs dans les discussions n’a pas un effet néfaste sur l’efficacité des dispositifs qui peuvent être mis en place et sur les délais ?
M. François Moreau, Altedia. Tout dépend la façon dont le projet est conduit. Si le leader crée une dynamique, et si les partenaires apprennent à se connaître les résultats peuvent être très intéressants. Les facteurs clés sont l’implication de l’entreprise et le choix du leader. Les résultats sont très contrastés entre les territoires.
M. Olivier Carré, président. Il y a un nouvel arrivant : le commissaire au redressement productif. Il a un mandat qui lui permet d’avoir une lecture transversale.
M. François Moreau, Altedia. On côtoie plutôt le commissaire à la réindustrialisation dont le rôle auprès du préfet est d’intervenir sur les grandes réorganisations. Dans les cas récents, on a eu le sentiment que les commissaires au redressement productif étaient davantage préoccupés des difficultés des TPE et des PME et n’intervenaient pas beaucoup dans la négociation des grandes restructurations qui étaient plutôt du ressort du DIRECCTE ou du préfet.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, magistrate à la Cour des comptes. Comment voyez-vous votre interaction sur le terrain avec les services de l’État, sachant que le préfet est très présent dans la phase amont de la convention de revitalisation, puis est relayé par le Dirrecte au niveau de la négociation du contenu de la convention de revitalisation, le préfet étant nécessairement en retrait sur l’engagement des crédits privés ?
Faut-il encadrer la nature des actions sur le territoire qui peuvent entrer dans les conventions de revitalisation ?
Les préfets doivent-ils fixer des obligations de résultats, voire introduire la notion d’intéressement auprès des cabinets pour la re-création d’emplois ou s’en tenir à des obligations de moyens ?
M. François Moreau, Altedia. En ce qui concerne les rapports avec la puissance publique, notamment les préfets et les DIRECCTE, nous avons un rôle de conseil auprès des entreprises. Il est important de faire comprendre à l’entreprise qu’une convention de revitalisation n’est pas seulement une négociation financière, mais l’occasion de s’impliquer et l’opportunité de s’ouvrir à son écosystème.
Par rapport au coût des plans sociaux, la contribution à la revitalisation est parfois très faible. Un parallèle doit être fait entre le coût d’un plan social et les sommes fléchées vers un territoire.
M. Pierre Beretti. L’effet positif d’une revitalisation est extrêmement durable quand l’entreprise a été motrice. Salariés et anciens salariés vivent sur le territoire et sont témoins de la réussite ou non du plan.
Mme Dominique Lassus-Minvielle. Le compteur à emplois ne différencie pas les emplois très structurants des emplois de courte durée ou provisoire. Rien ne contraint le préfet à différencier la qualité des contrats.
M. François Moreau, Altedia. La convention de revitalisation doit être une négociation comme l’a prévu le législateur. Mais les DIRECCTE et les entreprises n’ont pas l’habitude de négocier ensemble.
Comment apprécier la qualité d’une convention ? Elle doit porter un projet de territoire et ne pas créer un effet d’aubaine. La convention doit apporter de l’innovation et de la valeur ajoutée au tissu local.
Mme Dominique Lassus-Minvielle. Faut-il allonger la durée des conventions ou réutiliser les fonds ? Quelle est votre pratique dans ce domaine ?
M. Christophe Castaner, rapporteur. Que pensez-vous de la mutualisation des fonds - la constitution de fonds de fonds -, pour faire face aux moyens importants nécessités par la mutation profonde des filières en restructuration ?
M. François Moreau, Altedia. On préconise des actions fortes et l’attribution des aides en priorité aux entreprises qui recrutent des salariés difficiles à reclasser.
Les partenaires sociaux ont du mal à accepter qu’il y ait d’un côté le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et de l’autre la revitalisation. Dans les territoires où la situation est très difficile, on pourrait prévoir que la revitalisation favorise le reclassement des salariés.
Les « fonds de fonds » sont souvent portés par les chambres consulaires ou des collectivités. Une convention de revitalisation ne fonctionne que sur un temps donné. C’est une action coup de poing qui exige des contrôles, des comptes à rendre et un leadership très exigeant.
Audition du jeudi 16 mai 2013
À 9 heures 45 : M. Patrice Lombard, vice-président d’OPCALIA, et M. Philippe Huguenin-Génie, directeur général adjoint d’OPCALIA
Présidence de M. Christophe Castaner et de Mme Véronique Louwagie, rapporteurs
M. Christophe Castaner, rapporteur. Nous accueillons ce matin MM. Patrice Lombard et Philippe Huguenin-Génie, respectivement vice-président et directeur général adjoint d’OPCALIA. Je vous remercie, Messieurs, d’avoir accepté notre invitation à participer à la réflexion que nous menons sur la prévention et l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) en France.
Nous souhaiterions vous interroger sur l’évolution du rôle d’OPCALIA et des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en général à la suite de l’adoption, cette semaine, par le Sénat, de la loi sur la sécurisation sur l’emploi ? Les mutations profondes que connaissent aujourd’hui la plupart des filières de production en France impliquent de privilégier la formation, dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). Comment peut-on aujourd’hui favoriser la reconversion des salariés licenciés, mais également anticiper les évolutions pour éviter les licenciements ?
M. Patrice Lombard, vice-président d’OPCALIA. Les OPCA étant des organismes paritaires, OPCALIA est actuellement présidé par Dominique Schott, syndicaliste à la centrale FO ; je suis pour ma part chef d’entreprise et président du MEDEF Lorraine. Depuis la réforme des OPCA, OPCALIA – désormais deuxième opérateur français dans le domaine de la formation continue – collecte et gère annuellement 650 millions d’euros de fonds de formation, destinés tant à l’alternance et à la professionnalisation qu’aux plans de formation des entreprises. Comptant 110 000 entreprises adhérentes, il s’adresse à 3 millions de salariés et intervient à parts égales dans le domaine interprofessionnel comme auprès d’entreprises de 29 – et bientôt 31 – branches très diversifiées : transport aérien, télécommunications, textile, cristallerie, banque, traitement des déchets, enseignement privé, énergie, environnement, eau, industrie du jouet, puériculture, etc.
Avec nos 120 implantations territoriales, nous sommes présents dans tous les départements français, y compris ceux d’outre-mer. Nos conseillers de formation – assistés par un personnel administratif en charge des dossiers – agissent sur le terrain, dans la proximité des chefs d’entreprises et des salariés, et en partenariat avec l’ensemble des opérateurs concernés – l’État en région, les conseillers régionaux, Pôle emploi et les missions locales. Nous travaillons également sur l’insertion des salariés les plus fragiles en favorisant l’intégration des salariés handicapés et en luttant contre l’illettrisme.
OPCALIA fait partie des OPCA qui, depuis 2009, aident au reclassement des salariés en cas de PSE. Nous intervenons dans les entreprises adhérentes ou non, à la demande de Pôle emploi, pour organiser la formation de récents demandeurs d’emploi et les aider à retrouver au plus vite un travail. Le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) – qui remplace celui de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP) – nous offre à cet égard un outil adapté. Depuis la création du système, OPCALIA a accompagné 45 000 salariés, dont 16 000 en 2012, engageant 48 millions d’euros au travers du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Le coût de la formation s’élève à 180 heures – soit 3 000 à 3 500 euros – par bénéficiaire, et son impact est réel : 62 % des salariés formés prennent le chemin du retour vers l’emploi, décrochant un CDD de plus de 6 mois.
Nous intervenons également dans le domaine du chômage partiel – solution souvent choisie par les entreprises pour parer aux difficultés. Certaines entreprises ont signé des accords permettant de remplacer le chômage partiel par une période de formation. Entre avril 2009 et décembre 2012, OPCALIA a accompagné dans ce cadre 19 000 salariés – dont 70 % relèvent du premier niveau de qualification –, employés dans les branches en difficulté : industrie du verre mécanique, transport aérien, textile, cristallerie.
Parmi les exemples de nos interventions, celui de l’entreprise Lejaby a bénéficié d’une couverture médiatique importante. Ses salariées, âgées de 42 ans en moyenne, auraient eu du mal à retrouver un emploi dans la zone rurale très isolée où elles travaillaient, mais leur savoir-faire a séduit un grand repreneur, LVMH. Bénéficiant de l’expérience de notre branche textile, nous sommes intervenus pour les former aux métiers de la maroquinerie, leur permettant de conserver un emploi stable. L’opération fut si bien réussie qu’aujourd’hui, l’entreprise envisage à nouveau d’embaucher. Dans ce type de reconversions, OPCALIA joue le rôle d’organisme architecte, rassembleur d’énergies : connaissant tant le domaine de la formation que l’ensemble des acteurs concernés, nous représentons l’épine dorsale du système.
Le groupe Doux en Bretagne offre un autre exemple où nous essayons d’apporter notre aide, quoiqu’avec plus de difficultés. Il s’agit également de secteurs ruraux et difficiles, et de salariés d’un bon niveau de qualification. Les capacités de reclassement à l’intérieur de la branche faisant défaut, ils doivent s’orienter vers d’autres activités, mais leur manque de mobilité – certains n’ont même pas le permis de conduire – rend la reconversion délicate.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Vous représentez, dites-vous, l’épine dorsale en matière d’accompagnement des licenciements collectifs, Pôle emploi vous sollicitant souvent dans ce type de contexte. Mais êtes-vous associés à un stade suffisamment précoce aux discussions intervenant dans le cadre des PSE, ou bien n’intervenez-vous qu’à la fin du processus ? Avez-vous constaté des différences de pratiques d’une région à l’autre ? Certaines approches vous paraissent-elles plus pertinentes que d’autres ?
L’anticipation en matière de formation quotidienne vous semble-t-elle aujourd’hui satisfaisante ? Peut-on améliorer notre approche de la GPEC ?
Le monde de la formation comprend une multiplicité d’intervenants ; comment renforcer la coordination entre différents acteurs, afin de répondre plus efficacement aux besoins de formation qui varient d’un territoire à l’autre ?
M. Philippe Huguenin-Génie, directeur général adjoint d’OPCALIA. Il est difficile de pointer des règles, notre action relevant souvent du sur-mesure. Deux grands cas peuvent cependant être distingués : lorsqu’un nombre conséquent de salariés risque le licenciement, la mobilisation est généralement forte ; mais il n’en va pas de même lorsque les pertes d’emploi interviennent de façon diffuse, au sein de différentes petites entreprises.
M. Patrice Lombard. Un préfet de région me disait récemment son inquiétude à ce propos ; les mêmes échos nous parviennent des responsables des tribunaux de commerce et moi-même, en tant que chef d’entreprise, j’ai le même ressenti. Aujourd’hui, alors que beaucoup de TPE disparaissent, nous faisons face non à de grands collectifs de licenciés par une grosse entreprise, mais à une multitude de salariés qui perdent leur emploi sans que l’on s’en aperçoive, et qui se retrouvent particulièrement isolés. Lorsque ferme une grande entreprise, laissant 150 ou 300 salariés au chômage, la mobilisation générale qui s’ensuit facilite la réaction. Mais lorsqu’il s’agit d’un débit de boissons qui met la clé sous la porte ou d’un maçon ou d’un boulanger qui licencient une ou deux personnes, le caractère diffus des pertes d’emploi les rend difficiles à suivre.
M. Philippe Huguenin-Génie. Malheureusement, les chefs d’entreprise attendent souvent la dernière minute pour afficher leurs difficultés, mus par l’espoir de voir la situation s’améliorer ou par la crainte de l’aggraver. Il est donc très difficile de détecter les problèmes en amont, alors que l’anticipation permet de mieux gérer les transitions.
Le paritarisme constitue la force d’OPCALIA, et plus généralement des OPCA. Nouant des contacts avec les syndicats du personnel, ils ménagent le climat social, souvent tendu, et respectent une certaine déontologie. Par conséquent, ils sont considérés comme une entité neutre venant s’interposer entre l’entreprise et le salarié pour trouver une solution aux difficultés économiques. Ce statut nous permet de jouer efficacement le rôle d’intermédiaire entre différents acteurs en présence.
Les situations restent pourtant éminemment diverses et la spécificité irréductible de chaque dossier interdit de construire un dispositif bien cadré d’intervention. La mobilisation joue souvent un rôle positif, à condition que l’on sache qui la pilote : l’État, la région, le département ou une direction du travail. Ne pas pouvoir identifier le chef d’orchestre est au contraire facteur de ralentissements.
Contrairement à une époque où l’absence de dispositifs efficaces d’intervention nous laissait démunis face aux suppressions d’emplois massifs, comme à Roissy en 2007, nous avons aujourd’hui, avec le CSP, tout l’outillage nécessaire pour remplir notre mission. En matière de grosses opérations, il ne reste qu’à améliorer la réactivité. Lorsqu’il existe un repreneur, il s’agit d’une sortie par le haut, comme dans le cas de Lejaby : rebaptisée Les Ateliers du Meygal, l’entreprise parvient même à embaucher. À côté de cette success story, nous avons accompagné des reconversions moins heureuses, comme celle de Thomson où le repreneur a souhaité passer du tube cathodique au pare-brise de voitures, avant que la crise du secteur automobile ne le mette lui-même en difficulté. Mais la situation la plus fréquente reste l’absence de repreneur, avec son cortège de reclassements individuels ; l’accompagnement est alors plus laborieux, l’illettrisme et les problèmes de mobilité rendant la réinsertion professionnelle délicate.
S’agissant des petites opérations, Pôle emploi les prend généralement en charge et nous les suivons dans le cadre des dossiers individuels de CSP. Mais le caractère diffus de ces reconversions freine la mobilisation.
M. Patrice Lombard. Nous répondons aux demandes de Pôle emploi, y compris pour organiser et financer des formations dans des entreprises qui ne dépendent pas de nos secteurs habituels.
Les partenaires du processus ne sont pas si nombreux : par exemple, lors d’une formation dans le cadre d’un CSP, un seul OPCA agit. Quant aux organismes de formation, ils interviennent à la demande. L’amélioration consisterait plutôt à trouver la bonne formation pour chaque salarié en difficulté, sans que ce dernier doive s’en occuper lui-même.
Il faudrait également diminuer les délais de mise en place de la formation. Actuellement, certains salariés pris en charge dans le cadre d’un CSP passent plusieurs mois avant de démarrer leur formation, et la terminent donc alors que leur contrat avec Pôle emploi a depuis longtemps expiré. Même si la volonté de chaque salarié joue également un rôle – certains recherchent plus ou moins activement un nouvel emploi –, accélérer la mise en place des formations ne peut qu’améliorer l’efficacité du système.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Comment expliquer ce délai ? Relève-t-il d’un retard dans le choix de la formation par le salarié ou bien d’une difficulté à trouver un organisme de formation proposant le cursus souhaité ?
M. Patrice Lombard. Aucune cause unique ne peut être pointée ; aux deux cas que vous avez évoqués s’ajoutent les délais de mise en place d’une formation, une fois qu’elle a été choisie.
M. Christophe Castaner, président. Il semblerait que la prise en charge dans le cadre d’un congé de reclassement ne motive pas toujours un retour immédiat à l’emploi. Une des suggestions consiste à en maintenir le bénéfice quand on entre en formation, voire que l’on trouve un emploi, afin de récompenser le salarié actif dans la recherche. Qu’en pensez-vous ?
Lejaby constitue la success story dont on parle à chacune de nos auditions ; mais comment multiplier ce type de reconversions ?
Vous avez évoqué la difficulté fréquente de déterminer qui pilote la mobilisation, le manque de coordination limitant l’efficacité des opérations ; à votre avis, à qui faut-il confier ce pilotage ?
M. Philippe Huguenin-Génie. Même si certains profitent du chômage pour réaliser un projet personnel, le plus souvent, le salarié qui apprend qu’il est licencié cherche un emploi et non une formation, puisque pour continuer à faire vivre son foyer, il lui faut avant tout retrouver une rémunération. À l’exception des cadres de haut niveau, prêts à changer de lieu de vie, le gros des salariés préfère changer de métier pour ne pas déménager ; or l’emploi manque souvent à proximité. Si l’on arrive à lui garantir un niveau de revenu minimum, le salarié se voit libéré de cette urgence et peut se diriger plus sereinement vers une formation.
L’attitude du salarié joue également un rôle dans le succès de sa reconversion. On pointe souvent le peu de formation destiné aux moins qualifiés ; mais ces personnes en sont en réalité peu demandeuses. Pour voir émerger un salarié acteur – figure mise en avant par les organisations syndicales – il faut mener un travail d’accompagnement long et d’autant plus laborieux que les personnes sont peu qualifiées. Parmi les outils dont nous disposons, il faut mentionner le compte personnel de formation (CPF), bientôt effectif, ainsi que la prestation de conseil en accompagnement, prévue dans le dernier accord national interprofessionnel (ANI). Mais remettre à niveau des personnes illettrées exige des moyens financiers importants, alors que les chefs d’entreprise préfèrent affecter leur budget à la formation de la main-d’œuvre qualifiée. L’un des enjeux du CPF sera donc d’en faire bénéficier cette population – et non seulement les cadres, aujourd’hui les plus nombreux à utiliser le droit individuel à la formation (DIF).
En somme, allouer des droits ne suffit pas : pour que les salariés se dirigent vers la formation, il faut sécuriser leurs revenus tout en travaillant sur la figure du salarié acteur.
Lejaby représente l’exception qui confirme la règle ; le succès de cette reconversion a clairement été favorisé par la forte mobilisation médiatique, encore amplifiée par les effets de la campagne électorale. Le rôle des médias dans la mobilisation des repreneurs potentiels se révèle donc considérable. Mais cette reprise a également joué sur l’image de LVMH, arrivé en sauveur et présenté comme l’entreprise en bonne santé qui choisit de produire en France.
M. Patrice Lombard. La capacité de réaction de ce secteur d’activité s’explique par sa longue expérience de la crise économique. Il bataille depuis de longues décennies pour sauver des emplois en France.
M. Philippe Huguenin-Génie. Les opérations de reprise dépendent toutefois de l’implication d’une pluralité d’acteurs économiques – conseils régionaux, chambres consulaires, comités de développement – qui dépasse le cadre des OPCA. Dans les cas les plus réussis, les salariés ne connaissent même pas de cessation d’activité, changeant de métier sans subir de licenciement. Avec la période de professionnalisation – possibilité, pour les personnes en CDI, de bénéficier d’une formation de longue durée –, la réforme de 2004 nous a apporté un formidable outil. Elle permet d’envisager une ingénierie sereine, en y impliquant les partenaires sociaux.
Enfin, il serait difficile de fixer a priori un pilote pour toutes les mobilisations. Les 20 ans d’expérience d’OPCALIA montrent que les acteurs dynamiques d’un territoire sont très variés, et le succès d’une opération tient souvent au tissu relationnel d’une personne qui arrive à fédérer les autres intervenants et à les faire travailler ensemble. Qu’elle parte ou qu’elle soit remplacée, et le dispositif se reconfigure autrement. L’essentiel reste de désigner clairement le chef d’orchestre qui coordonne l’opération ; mais entre l’État, les régions et les acteurs locaux, il faut choisir au cas par cas.
M. Patrice Lombard. Il est très difficile d’anticiper les difficultés d’une entreprise. D’après mon expérience, les lois de sauvegarde des entreprises ne fonctionnent pas vraiment : le chef d’entreprise doit d’abord comprendre qu’il est au bord d’une difficulté importante – or, les petites entreprises ne disposent pas toujours d’outils de gestion adéquats – et ensuite accepter d’avouer ses problèmes à ses clients, fournisseurs et banquiers. Je doute que la présence dans les régions des commissaires au redressement productif ait apporté une solution à ce problème. L’action, dans ce domaine, relève du cousu main, et non de l’institutionnel ; elle n’est pas forcément reproductible. C’est l’organisation des bonnes volontés et des dynamismes et la qualité du terreau régional qui assurent le succès à un endroit et le rendent plus incertain ailleurs.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Il ne me semble pas que les OPCA aient eu des relations sur le terrain avec le commissaire au redressement productif.
M. Patrice Lombard. Je suis allé le rencontrer en tant que responsable patronal.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Avec quels acteurs les OPCA travaillent-ils sur le terrain ?
M. Patrice Lombard. La région bien sûr, l’État en région – en particulier les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) –, Pôle emploi, les missions locales, les comités de développement lorsqu’ils existent – interlocuteurs qui connaissent bien les entreprises et permettent de trouver des possibilités de reclassement –, les chambres de commerce, les pôles de compétitivité.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Comment, dans le choix des formations, tenir compte à la fois des besoins des filières sur les territoires et des évolutions structurelles, de façon stratégique et anticipée ?
D’après votre présentation, le CSP représente l’outil idéal ; mais sa dimension collective est-elle suffisamment forte ? À trop privilégier l’accompagnement individuel, on laisse souvent de côté la revitalisation territoriale.
Que pensez-vous du FNE Formation comme outil public d’urgence, et des dispositifs que certaines régions ont mis en place, tels que le fonds de formation Intervention régionale pour l’investissement social (IRIS) en région PACA ?
M. Philippe Huguenin-Génie. Le FNE fut longtemps délaissé, avant de retrouver ses lettres de noblesse. Il a financé 60 à 70 % de la formation des salariées de Lejaby ; son rôle n’est donc pas à négliger. Depuis 2009, la plupart des conseils régionaux dégagent également des moyens, en proportions variables.
Le CSP a le mérite d’exister et de répondre à un véritable besoin. Son utilité se mesure au fait que les deux tiers des personnes qui en bénéficient parviennent à rebondir. Certes, il serait idéal d’arriver à orienter les gens vers une logique collective ; il serait alors plus facile de bâtir une offre de formation adaptée. Pourtant, dans ces situations de crise, il est difficile de garder le collectif des salariés, a fortiori lorsqu’on ne sait pas quel sera leur avenir. Les gens qui n’ont plus de lieu de travail rentrent chez eux, puis s’adressent chacun à l’agence de Pôle emploi la plus proche de leur domicile ; c’est alors d’un accompagnement individuel qu’ils bénéficient. Tenter de conserver, pour ceux qui le souhaitent, une forme de collectif peut cependant constituer une piste intéressante.
M. Patrice Lombard. La GPEC – obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés – représente un sujet tabou dans les entreprises : l’annonce d’une action de ce type est en effet interprétée par les syndicats comme la préparation d’un plan de licenciement. Quant aux TPE, elles ont du mal à évaluer leurs besoins à long terme.
OPCALIA a développé un outil de conseil en ressources humaines – « Capital compétences » – qui aide les chefs d’entreprise à déterminer l’évolution à venir de leurs métiers et donc des compétences qu’il faudrait obtenir. Cet outil – que nous sommes en train de généraliser à l’ensemble de nos implantations sur nos territoires – aura une double utilité : il rendra service aux chefs d’entreprise, mais permettra également d’accumuler des renseignements pour connaître les besoins en compétences par branche ou par région, et donc de travailler en amont des difficultés. Il s’agit du cœur même de la GPEC.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, magistrate à la Cour des comptes. Vous avez évoqué le congé de reclassement et le congé de mobilité, destinés aux grandes entreprises. L’usage du FNE Formation – doté d’une visée générale – a quasiment décuplé entre 2008 et 2010, avant de retomber. S’agit-il d’un bon outil de crise ? Faudrait-il disposer d’un dispositif ciblé pour les PME ?
De façon générale, en période de crise, les dispositifs d’accompagnement des salariés ayant des besoins en formation doivent-ils faire l’objet d’un ciblage supplémentaire ou bien les outils de droit commun, s’adressant à toute la palette des entreprises, vous paraissent-ils suffisants ?
M. Philippe Huguenin-Génie. Dans l’ensemble, nous disposons de l’outillage et des financements nécessaires, le retour du FNE intervenant très à propos ; le succès des opérations dépend dès lors de la mobilisation des acteurs. En matière d’accompagnement individuel, Pôle emploi joue un rôle essentiel ; à cet égard, il faut saluer son choix de se tourner vers le conseil en formation, et non plus seulement en recherche d’emploi. Ses agents doivent désormais se repérer dans la multitude d’organismes à l’offre de qualité très variable et très peu lisible. Cette difficulté vaut d’ailleurs également pour les entreprises, les individus et les acheteurs collectifs comme OPCALIA, d’autant que les formations les plus récentes sont très peu organisées, contrairement aux cursus sur l’année que les conseils régionaux avaient historiquement l’habitude d’acheter. L’apparition des demandes urgentes et individuelles rend la gestion des formations plus complexe. Ainsi, s’il est difficile de mettre en place une formation dans le cadre d’un CSP, c’est qu’il faut trouver le bon organisme, à proximité du bénéficiaire, qui démarre une formation rapidement, et avec un coût maîtrisé.
M. Patrice Lombard. Attention à ne pas multiplier inutilement les outils ; mieux vaut bien utiliser ceux qui existent déjà qu’en créer des supplémentaires. Afin de conférer au système un minimum de stabilité, il faut éviter de tout changer en permanence. Faisons connaître les dispositifs disponibles pour que chacun puisse en comprendre le fonctionnement et réussir à les mettre en œuvre.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Nous vous remercions, Messieurs, d’avoir répondu à nos questions.
Audition du jeudi 16 mai 2013
À 10 heures 45 : M. Michel Cadot, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, accompagné de Mme Élisabeth Maillot Bouvier, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en Bretagne, de M. Stéphan de Ribou, commissaire au redressement productif auprès du préfet de la région Bretagne, de M. Gilles Tauzin, chargé de mission entreprises, filières industrielles et études au secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de Bretagne, et de M. Philippe Alexandre, directeur de l’unité territoriale des Côtes d’Armor au sein de la DIRECCTE
Présidence de M. Christophe Castaner et Mme Véronique Louwagie, corapporteurs
M. Christophe Castaner, rapporteur. Nous recevons aujourd’hui M. Michel Cadot, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs.
Nous souhaiterions connaître, monsieur le préfet, votre opinion sur les dispositifs permettant d’accompagner les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), à la fois du point de vue de l’anticipation et des conditions de mise en œuvre – lesquelles seront modifiées par l’entrée en vigueur de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi de janvier dernier. Comment appréhendez-vous les évolutions en la matière et comment les services de l’État peuvent-ils jouer leur rôle de coordinateur et de facilitateur dans un contexte marqué par de nombreux acteurs, que ce soit dans l’anticipation, l’accompagnement ou la transformation des filières ?
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Que se passe-t-il sur le terrain, en matière de prévention et d’accompagnement ? Que pensez-vous de l’organisation mise en place depuis juin 2012 dans le cadre de la nouvelle mission confiée au commissaire au redressement productif ?
M. Michel Cadot, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Je suis venu avec la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), le commissaire au redressement productif, le chargé de mission qui suit ces dossiers au secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) et auprès de la DIRECCTE, ainsi que le directeur de l’unité territoriale des Côtes d’Armor, qui vous feront également part de leur expertise.
En tant que préfet de région et préfet de l’Ille-et-Vilaine depuis quatre ans, je constate, en ce qui concerne l’anticipation et la remontée d’informations au titre de la mission de veille, qu’il existe dans la région, comme dans d’autres où je suis passé, un assez grand nombre de dispositifs permettant de suivre, au travers de quelques indicateurs révélateurs, l’émergence d’éventuelles difficultés dans les principales entreprises, qu’il s’agisse des données sur l’évolution du chômage partiel, de l’information de la Banque de France et du milieu bancaire, ou de la commission des chefs de services financiers (COCHEF). Nous avons aussi des cadres de travail et de mise en commun de ces informations qui sont assez développés : les comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI), qui se réunissent à peu près tous les deux mois en Ille-et-Vilaine, ou la cellule de veille et d’alerte précoce (CEVAP), dans laquelle sont associés désormais le procureur de la République, qui représente les parquets du département, et l’autorité judiciaire, au travers du tribunal de commerce.
En outre, des synthèses mensuelles sur les remontées de documents permettent aux préfets, aux sous-préfets et aux différents acteurs de l’État de disposer d’un tableau de suivi et de connaître les entreprises fragiles et celles qui présentent les difficultés les plus importantes.
Les élus sont davantage mobilisés pour les dossiers sensibles. Se pose alors le problème du chef d’entreprise qui n’alerte pas rapidement les pouvoirs publics. Si les outils de détection que j’évoquais n’ont pas été actionnés ou n’ont rien révélé – s’il n’y a pas eu par exemple une augmentation significative du chômage partiel ou des retards de paiement traduisant une grande tension de trésorerie –, on peut être confronté au cas où un dossier significatif soulève tout à coup une difficulté. Il en a été ainsi pour le groupe Doux, dont la gravité de la situation n’avait pas été anticipée l’an dernier de manière tout à fait satisfaisante. Le système comporte donc des failles, notamment lorsque le chef d’entreprise ne joue pas le jeu d’une relation constructive avec les pouvoirs publics. En l’occurrence, on est allé très vite, alors que le Gouvernement avait changé et que le groupe avait fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire.
La relation avec les élus et les collectivités territoriales est très bonne en Bretagne. Il existe des liens étroits et constants avec le conseil régional pour analyser les moyens d’action tendant à accompagner l’entreprise et à éviter une difficulté ou une mesure de sauvegarde de l’emploi : cette démarche est systématique pour les dossiers sensibles, que ce soit au niveau du département, avec le conseil général, ou au niveau régional, voire aux deux, selon la nature des sujets. Cela fonctionne très bien.
Quand un dossier a été signalé, la liaison avec le commissaire au redressement productif, les différents services de l’État et ceux actionnés de manière un peu plus lointaine comme la Banque publique d'investissement (BPI) ou d’autres mécanismes tendant à faciliter des solutions administratives ou autres, est bien activée. Il en est de même avec les maisons de l’emploi ou d’autres structures de ce type.
S’agissant du volet curatif, quand il faut gérer des mesures de licenciements, surtout dans des groupes importants – plus de 1 000 salariés – et lorsque ces mesures peuvent avoir un impact substantiel sur le bassin d’emploi, notre dispositif révèle certaines faiblesses pour appliquer les règles régissant le PSE ou le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Dans le cas d’un redressement judiciaire, la préparation du mécanisme de PSE n’est pas suffisamment prise en charge par les services de l’État et les collectivités territoriales. Une meilleure anticipation serait nécessaire, de façon à essayer de faciliter la coordination entre le volet territorial et le volet emploi. On voit bien que la démarche d’une revitalisation du territoire et celle de l’accompagnement des salariés ne se recoupent pas toujours. Celles-ci ont deux logiques différentes : l’une tend à accompagner l’effet sur un territoire donné d’une fermeture d’entreprise ou de licenciements collectifs ; l’autre consiste à gérer, avec un calendrier juridique, des comités d’entreprise. Il faut par ailleurs articuler les outils du PSE ou du CSP pour la formation, la mobilité ou les conjoints.
On a vu que, dans le comité national de suivi du dossier Doux, qui se tient régulièrement à Rennes – notre région, et au premier chef les départements du Morbihan et du Finistère, étant la plus touchée –, l’administrateur judiciaire mobilisait assez peu les aides du PSE, soit en raison de la lenteur de la remontée des demandes des salariés, soit, surtout, parce que Pôle emploi les traitait dans le cadre du CSP et qu’on ne cherchait pas à optimiser les moyens de financement et à mieux articuler le PSE et le CSP pour trouver la solution la plus favorable au salarié – retour vers l’emploi ou formation.
Dans des cas très difficiles, pendant les 45 jours suivant l’annonce du problème et l’ouverture des négociations internes à l’entreprise, les salariés ont besoin d’un lieu de rencontre – qui n’est plus la cellule de reclassement –, où ils peuvent absorber le choc social que constitue le plan de licenciement. On sent bien – et là encore le cas de Doux est symptomatique, ses salariés ayant été peu formés, et étant depuis longtemps dans l’entreprise – qu’il existe chez certains un obstacle psychologique à se remettre en question. Le fait d’être seul dans cette situation constitue un problème majeur. Il faut donc trouver une formule intermédiaire entre ce qui était autrefois la cellule de reclassement et le dispositif actuel.
Mme Élisabeth Maillot Bouvier, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en Bretagne. On constate en effet que le CSP conduit à une prise en charge très individuelle du demandeur d’emploi, qui a besoin d’une cellule d’appui. Dans certains cas, le dispositif prévoit qu’on puisse mettre en place des cellules d’appui limitées – puisqu’elles ne peuvent durer que 45 jours –, mais il s’agit d’une mesure exceptionnelle. On en constate le bien-fondé pour les salariés ayant des difficultés particulières de formation ou pour retrouver un emploi.
Ce besoin est apparu clairement dans le dossier Doux. On a aussi mis en place ce type de mesures dans une affaire concernant la société Plastimo-Navimo. Elles sont appréciables pour les salariés.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Merci pour cette présentation.
Le fait d’avoir depuis quasiment un an un commissaire au redressement productif a-t-il conduit les entreprises à faire davantage part de leurs difficultés ?
Par ailleurs, des moyens importants sont engagés pour la revitalisation des entreprises : les dispositifs actuels sont-ils efficients ?
Enfin, que peut-on faire pour améliorer les délais dans la mise en œuvre des dispositifs ? En effet, plus les salariés restent longtemps au chômage et plus ils sont seuls, plus leur situation est difficile.
M. Michel Cadot. En Bretagne, avant la nomination d’un commissaire au redressement productif, nous avions obtenu en 2009 la désignation d’un commissaire à la réindustrialisation, qui a fonctionné jusqu’en 2011. S’il y a eu une vacance de six mois environ entre les deux, on ne partait pas de zéro et il ne semble pas y avoir eu de changement total dans l’approche d’anticipation, de veille et de contact avec les entreprises. La formule du commissaire au redressement productif me paraît nécessaire : elle permet d’identifier une personne et un lieu de concertation pour des entreprises bien déterminées – nous avons d’ailleurs prévu demain avec notre commissaire au redressement productif, M. de Ribou, ici présent, une communication dans la presse sur le sujet. Il dispose à cet effet d’une petite équipe rattachée au préfet de région, mais qui fonctionne très bien avec les collectivités territoriales et les niveaux départementaux et infra-départementaux, y compris les sous-préfets. L’efficacité du dispositif dépend du pilotage qui en est fait, du partenariat local et aussi des qualités propres du commissaire.
En Bretagne, je suis certain qu’il contribue à faire remonter un certain nombre de dossiers beaucoup plus facilement. À côté des outils d’alerte habituels, il constitue un moyen plus souple et efficace, permettant de donner confiance au chef d’entreprise quand il dévoile des difficultés.
Quant au cas de Doux, il est particulier, compte tenu de l’importance du sinistre et de la lenteur avec laquelle il a été signalé. D’abord, le commissaire est arrivé en cours de route et, surtout, le groupe traînait depuis une dizaine d’années des difficultés constantes, qu’il réussissait à reporter.
J’appuie personnellement, dans les principales régions ou pour deux régions de plus petite taille, la mise en place systématique, pour la fonction d’anticipation, de veille et de contact avec les entreprises, d’un chargé de mission – quelle que soit son appellation – qui ne s’inscrive pas dans un cadre institutionnel. Il a, de ce fait, une liberté de propos et d’appréciation et des liens plus approfondis avec le monde bancaire et les collectivités territoriales. Il complète très bien le rôle, nécessaire aussi, de la DIRECCTE, dont la mission administrative et de contrôle est plus régalienne, ce qui, à certains moments, pose problème.
Sa relation avec les préfets et les sous-préfets est bonne : il ne se situe pas dans un positionnement hiérarchique, même s’il fait l’objet d’un rattachement lui permettant d’ouvrir des portes et de faciliter ses relations avec le président du conseil régional ou avec tel élu important.
S’agissant de l’efficacité des moyens de redynamisation des territoires, je rappelle que nous avons en Ille-et-Vilaine un fonds mutualisé depuis juin 2009, qui a vocation à réduire les frais de gestion dans le cas où est prévue une convention de revitalisation – soit une dizaine de cas au maximum par an, et beaucoup moins depuis un an. En outre, ce système évite une concurrence un peu néfaste entre des opérateurs pouvant chercher des emplois de manière non coordonnée. Enfin, on constate un plus grand professionnalisme de l’organisme qui gère et fait le travail de démarchage : en Ille-et-Vilaine, il s’agit d’Idéa 35. Sur le secteur de Saint-Brieuc, il y a aussi un fonds mutualisé, mais pour le reste, les départements s’appuient sur des démarches classiques de conventionnement par entreprise, chacune choisissant son opérateur.
L’efficacité des dispositifs est bonne en termes de recréation d’emploi. Les aides sont pour l’essentiel consacrées à des subventions à l’emploi, de l’ordre de 2 500 euros, ou 5 000 euros si la personne vient de l’entreprise qui a signé la convention de redynamisation. Mais il y a peu de cas de véritables innovations dans les démarches de redynamisation.
Si l’effet n’est pas mauvais au regard des bilans chiffrés, l’impact incitatif de cette aide supplémentaire sur certains bassins d’emploi moins défavorisés – comme c’était le cas jusqu’à présent en Bretagne – est incertain. En tout cas, les emplois recréés bénéficiant aux salariés licenciés ou en reconversion de l’entreprise ayant signé la convention sont peu nombreux – dans le meilleur des cas, ils représentent 5 à 10 % du total et, dans d’autres, sont quasiment inexistants.
Les fonds mutualisés m’ont semblé plus efficaces ; ils permettent d’avoir un véritable partenariat et un échange avec les acteurs locaux, qu’il s’agisse du conseil général, des communautés de communes ou de l’association des maires. Mais dans certains territoires, ou certains cas, l’accompagnement en termes de redynamisation est sans doute moins utile. En ce moment, la Bretagne est par exemple très touchée par des dossiers agro-alimentaires ou automobiles, mais l’est moins dans le domaine des télécommunications ou d’autres secteurs où la situation évolue correctement. Ce dispositif est donc utile : il est apprécié par les préfets car il leur donne des moyens, mais il n’est sans doute pas un levier décisif ; il fait partie d’une panoplie d’outils permettant de redynamiser les territoires.
Je pense qu’il n’y a pas de sélectivité. On n’est sans doute pas en mesure d’inventer de nouvelles formes d’accompagnement, d’abord parce que le dispositif en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, est assez riche en termes de financements, de prêts ou de garanties, avec une forte implication des collectivités. Le plus facile dès lors est de recourir à la prime à l’emploi. En outre, le tissu de PME est assez vivant et crée régulièrement des emplois ; il profite des occasions qui lui sont offertes, ce qui peut accélérer la prise de décision à certains moments.
Pourrait-on, avec un ciblage et un professionnalisme encore plus poussés, être plus efficace ?
On a essayé il y a un an, sur la proposition du prédécesseur de M. de Ribou – ce qui a ralenti le fonctionnement de ce fonds en Ille-et-Vilaine – la mise en place de prêts à taux zéro pour les PME. Finalement, cette mesure n’a pas été retenue : le besoin n’a pas été absolument avéré et il existe des problèmes de qualification en fonds public ce qui est aujourd’hui – et c’est sa force – un fonds privé.
Cette difficulté à inventer quelque chose de mieux est sans doute liée à un problème d’efficacité de la gouvernance. Je constate aussi qu’aucun des présidents n’est personnellement présent dans les comités d’engagement, cette tâche revenant plutôt au vice-président chargé des affaires économiques. Il y a probablement une sorte de consensus local pour ne pas remettre systématiquement en cause les pratiques.
M. Stephan de Ribou, commissaire au redressement productif auprès du préfet de région Bretagne. Pour une PME, la décision d’embaucher une personne supplémentaire ne dépend pas d’une subvention de 3 000 euros. Cette aide est bienvenue en ce qu’elle améliore la trésorerie souvent fragile de ces entreprises mais elle ne suffit pas à déclencher l’embauche.
D’autres dispositifs susceptibles de créer de l’emploi ex nihilo seraient peut-être envisageables mais ils nécessiteraient des fonds très importants, une stratégie industrielle ainsi qu’une volonté forte d’implanter des filières au plan local comme cela fut le cas pour l’usine PSA qui a été « importée » à Rennes.
M. Michel Cadot. L’information et l’association des partenaires locaux font parfois défaut dans la préparation du plan de sauvegarde de l’entreprise. Nous devons parfois nous contenter d’en accuser réception lorsqu’il est finalisé.
Si plusieurs départements sont concernés, la convention de revitalisation relève de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et fait ensuite l’objet de déclinaisons locales. Les délais de négociation sont alors très longs. Dans le cas de PSA, la convention cadre a été signée en 2009 mais la convention pour la Bretagne a été signée, à force d’insistance, en 2012 seulement. Dans l’intervalle, des montants importants ont été préemptés pour couvrir les dépenses engagées par PSA pour des mutations de salariés. Notre faible capacité à influer sur le contenu local du plan est problématique.
Rien ne justifie que les négociations durent plus de deux ou trois mois. Le dispositif de revitalisation, très centralisé, demeure opaque pour le préfet malgré les améliorations constatées depuis un an. La déclinaison locale de la convention est préparée par l’unité territoriale mais son contenu ne fait pas l’objet d’une réflexion suffisante en amont. La tentation est donc forte de se contenter des dispositifs existants comme le fonds mutualisé de revitalisation.
Je plaide pour que la négociation de la convention de revitalisation, qui devrait compléter les mesures d’accompagnement des licenciements, soit encadrée dans le temps afin de permettre à l’État d’afficher rapidement sa volonté de soutenir la recréation d’emplois dans le territoire, même si la concrétisation des projets est plus longue.
M. Gilles Lurton. Les parlementaires peinent à anticiper les difficultés des entreprises et à être alertés. Ils sont souvent mis devant le fait accompli lorsque le plan de licenciement est annoncé. Il leur est alors d’autant plus difficile de trouver des solutions lorsqu’ils sont sollicités.
M. Michel Cadot. Je conviens de l’exclusion des parlementaires des processus de veille, de préparation et de concertation mis en place dès que les problèmes surviennent. En matière d’anticipation des difficultés, le dialogue s’établit plutôt avec les collectivités territoriales qui accordent les financements. Cela sera encore plus vrai demain avec la compétence économique exclusive des régions.
Dans le dossier pourtant très sensible de PSA, les parlementaires rennais n’ont pas été spontanément associés à la concertation malgré l’existence d’une commission tripartite – réunissant les syndicats, la direction de l’entreprise et les collectivités – alors même que certains d’entre eux exercent des fonctions locales. La place des parlementaires, leur information et leur participation aux réunions de travail, à côté des collectivités locales, doivent être un sujet de réflexion.
Mme Isabelle Le Callennec. Il est, en effet, important d’associer les parlementaires. Puisque nous sommes sollicités par les organisations syndicales et informés des difficultés par les chefs d’entreprise, nous pouvons jouer un rôle de médiateur.
Je veux témoigner de l’anticipation plutôt satisfaisante des difficultés dans notre région. De nombreux outils et indicateurs permettent de les appréhender avant que les problèmes sérieux ne surviennent.
Face aux inquiétudes des salariés en cas de plan de sauvegarde de l’emploi, la communication sur les solutions qui leur sont offertes est insuffisante. Des efforts doivent être entrepris pour rapprocher l’offre et la demande et pour diffuser l’information afin de dédramatiser autant que possible la situation.
La valeur ajoutée des fonds de revitalisation réside dans leur mutualisation qui doit, selon moi, être préservée. Il convient néanmoins de faire évoluer le dispositif afin que les emplois subventionnés profitent effectivement aux personnes licenciées. Le comité de pilotage du fonds peut-il faire des propositions en ce sens ?
Quel sera le rôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans la nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique prévue par la loi transposant l’accord national interprofessionnel ?
M. Michel Cadot. L’implication des parlementaires est différente selon les territoires. Elle est plus forte dans les territoires industriels ruraux que dans les milieux urbains, sans doute parce que la proximité et la qualité des contacts avec les chefs d’entreprise ne sont pas les mêmes.
Il est aujourd’hui possible dans de rares cas de mettre en place, dans les premières semaines d’application d’un plan de sauvegarde de l’emploi, une cellule d’appui aux salariés, à l’instar des anciennes cellules de reclassement. Ce lieu permet aux salariés de se retrouver entre eux, de ne pas être isolé et suivi seulement par Pôle emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Cette soupape avant la recherche individuelle d’emploi permet de maintenir les contacts et de faciliter l’acceptation des difficultés. Il serait donc intéressant d’élargir les cas dans lesquels cette structure peut être créée.
S’agissant des conventions de revitalisation, nous devons veiller à ce qu’elles servent au reclassement des salariés et pas seulement à la redynamisation d’un territoire. Nous devons formuler des exigences sur le contenu des emplois subventionnés et sur leurs bénéficiaires qui doivent être en priorité les salariés licenciés faisant l’objet de mesures d’accompagnement. Mais l’analyse des bénéfices pour les salariés licenciés de ces efforts de revitalisation n’est pas suffisamment fine. Il nous faut aller plus loin et mener un travail propre à chaque entreprise. Cet objectif va à l’encontre de la mutualisation des fonds de revitalisation.
Mme Elisabeth Maillot Bouvier. Le rôle de la DIRECCTE est renforcé par les nouvelles règles en matière de licenciement. Celle-ci doit désormais se prononcer sur le plan de sauvegarde de l’emploi dans des délais resserrés : elle dispose de huit jours pour valider l’accord majoritaire et de 21 jours pour homologuer le document unilatéral. Le respect de ces délais n’est possible que si la DIRRECCTE a travaillé étroitement avec l’entreprise en amont. L’unité territoriale doit être en contact régulier avec l’entreprise et être associée à la préparation du PSE. Cette association devra être accrue du fait de ces contraintes nouvelles en termes de délai qui permettent d’apporter aux salariés et à l’entreprise des assurances sur la validité du PSE.
M. Philippe Alexandre, directeur de l’unité territoriale des Côtes d’Armor. L’anticipation est la clé de la réussite. Plusieurs outils sont à disposition des entreprises à cet effet.
Le chef d’entreprise et les représentants syndicaux peuvent signer, en cas de restructuration, un accord de méthode dans lequel ils conviennent notamment d’aménager le calendrier et les délais. Cela suppose de nouer un dialogue social sur les difficultés économiques de l’entreprise, ce qui n’est jamais facile. En outre, grâce à la signature d’un accord de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), qui permet notamment de prévoir la disparition de certains métiers, les réductions d’emploi peuvent être anticipées.
L’objectif est de parvenir par ces accords d’entreprise à éviter le plan de sauvegarde de l’emploi et à créer les conditions propices à la formation des salariés, aux départs volontaires et à la création d’entreprises.
L’accord national interprofessionnel accentue l’incitation au dialogue social au sein de l’entreprise, à l’anticipation ainsi qu’à la formation tout au long de la vie qui est essentielle pour des salariés bousculés voire menacés par les évolutions technologiques.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Aurez-vous les moyens d’assurer le suivi des PSE prévu par l’accord national interprofessionnel, d’autant que les anciens agents de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) pourraient être transférés aux régions ?
Mme Elisabeth Maillot Bouvier. L’homologation du PSE ne signifie pas l’analyse complète de celui-ci. Il s’agit de vérifier que l’entreprise met en œuvre tous les moyens dont elle dispose. Ce travail est relativement simple dès lors que les services ont une bonne connaissance de l’entreprise. À cette fin, il est important que tous les services de la DIRECCTE soient mobilisés, y compris les anciens agents de la DRIRE et le pôle 3E. Nous ferons en sorte d’adapter nos moyens aux exigences du législateur.
M. Philippe Alexandre. Nous trouverons les moyens en facilitant la collaboration entre les services en charge de l’emploi et ceux compétents en matière de mutations économiques. Nous disposons de la capacité à anticiper les difficultés car nous prenons quotidiennement le pouls des entreprises. Rares sont les dossiers sur lesquels nous pouvons être pris au dépourvu.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Les chefs d’entreprise sont réticents à solliciter les outils disponibles en cas de difficultés par méconnaissance de ces derniers mais aussi par crainte des conséquences. En particulier, les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ne peuvent pas être candidates aux marchés publics. Est-ce une bonne mesure selon vous ?
Les fonds de revitalisation mutualisés permettent-ils de mener une politique de réindustrialisation des territoires efficace ?
L’obligation de revitalisation ne s’impose qu’aux entreprises de plus de 1 000 salariés. Puisque les PSE concernent de nombreuses petites entreprises, cette obligation ne pourrait-elle pas être étendue aux entreprises de moins de 1 000 salariés ?
M. Michel Cadot. Il serait souhaitable que l’interdiction pour des entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde de soumissionner aux marchés publics ne soit pas systématique mais conditionnée à un examen de leur situation. Cette règle est trop rigide pour certaines d’entre elles dont les perspectives d’avenir sont rassurantes et pour lesquelles l’accès aux marchés publics est important. Elle devrait donc être assouplie pour permettre une évaluation au cas par cas.
Le fonds de revitalisation obéit à une logique d’accompagnement de l’emploi plus que d’industrialisation. Le dispositif actuel ne permet pas de garantir la réindustrialisation d’un territoire. En raison de l’impératif de création d’emplois, la sélection des bénéficiaires est insuffisamment ciblée alors qu’elle devrait traduire des choix industriels. Le dispositif devrait être revu pour répondre efficacement à l’objectif de réindustrialisation.
Il serait judicieux de soumettre à l’obligation de revitalisation certaines entreprises de moins de 1 000 salariés dans des secteurs dont la responsabilité territoriale est importante. Dans le cadre d’un schéma régional de développement économique, il serait logique de faire contribuer les entreprises à la redynamisation du territoire, dans le cas de la Bretagne par exemple, celle des secteurs automobile et agroalimentaire. Il convient de réfléchir à un dispositif plus souple et mieux adapté aux territoires.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Qui doit être le chef d’orchestre de l’accompagnement des plans de sauvegarde de l’emploi ?
M. Michel Cadot. Ce nécessaire chef d’orchestre ne peut être que le commissaire au redressement productif, voire le préfet de région pour les dossiers les plus lourds. Cependant, les choses risquent de se compliquer demain avec la compétence exclusive confiée aux régions dans le domaine économique. J’ai observé combien les sensibilités économiques pouvaient être différentes au sein des régions et entre les départements. Il est donc nécessaire de faire preuve d’autorité pour surmonter les divergences des acteurs locaux et vaincre les réticences, quitte à jouer de la médiatisation pour obtenir l’approbation d’une solution. Il est indispensable de conserver demain une figure d’autorité malgré les pouvoirs accrus des régions.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Peut-on imaginer que le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d’un bureau pour résoudre les difficultés que vous venez d’évoquer ?
M. Michel Cadot. Le CCREFP ne s’inscrit pas dans cette logique puisque sa vocation est stratégique et son fonctionnement très formel.
Pourquoi confier au CCREFP la tâche de rassembler tous les partenaires dans les domaines de l’économie et de la formation professionnelle alors qu’un comité d’engagement local pourrait s’en acquitter. Si le cadre institutionnel est trop rigide, nous risquons de nous heurter rapidement aux limites d’un fonctionnement trop mécanique.
La concertation doit demeurer informelle et la coordination s’organiser autour de l’opérateur technique que doit être le commissaire au redressement productif. Elle pourrait prendre la forme d’un groupe de travail rattaché au CCREFP et doté d’une coprésidence, qui serait une manière de donner satisfaction à chacun.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, magistrate à la Cour des comptes. Comment sont coordonnées dans la région Bretagne les missions du commissaire au redressement productif et de la DIRECCTE ?
En matière de revitalisation, que préconisez-vous pour mieux articuler la convention cadre et ses déclinaisons sur le terrain ? Afin d’améliorer la qualité des emplois recréés, faut-il modifier les textes ou les pratiques des préfets ?
L’extension des fonds mutualisés n’est-elle pas risquée au regard de la réglementation communautaire ?
M. Michel Cadot. La coordination entre le commissaire au redressement productif et la DIRRECTE pose problème lorsque la volonté de travailler ensemble fait défaut.
Le rôle du commissaire au redressement productif doit être davantage mis en avant dans l’action de coordination des différents acteurs. Il dispose de la souplesse et du temps nécessaire pour le faire, contrairement aux services de l’État. Dans le même temps, le commissaire au redressement productif ne peut travailler seul. Il doit nouer une relation de confiance et de collaboration, avec la DIRECCTE, sous peine d’être privé d’une grande richesse d’informations et de la capacité d’instruction des dossiers dont dispose cette dernière.
Cela suppose des efforts de l’administration qui n’est pas habituée à conjuguer fonctions de gestion et de mission. Pour un fonctionnement harmonieux, le préfet de région doit être proche de la DIRECCTE comme du commissaire et se départir d’une vision strictement administrative.
Il faut donner toute sa place à la déclinaison territoriale des conventions de revitalisation et permettre de l’enrichir en associant les élus locaux.
Alors que j’étais dans un premier temps séduit par le dispositif, je considère désormais que les fonds mutualisés apportent une forme de sécurité qui n’incite pas à la remise en question. Ils favorisent l’affichage de chiffres au détriment de la recherche de résultats adaptés à chaque projet de redynamisation. Je suis donc aujourd’hui plus réservé sur ce dispositif. En Bretagne, il n’a pas fonctionné depuis un an, en l’absence de licenciements, il est vrai.
Mme Elisabeth Maillot Bouvier. Il est évident que le commissaire au redressement productif et la DIRECCTE ne peuvent pas travailler de manière indépendante. La proximité est indispensable au bon fonctionnement.
M. Stephan de Ribou. La proximité entre le commissaire et la DIRECCTE est nécessaire mais elle l’est aussi, dans le cas de la Bretagne, avec la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) en raison des difficultés de l’industrie agroalimentaire dans cette région.
Audition du jeudi 16 mai 2013
À 11 heures 45 : M. Jean-Christophe Sciberras, président du bureau de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH) et de M. Philippe Dorge, directeur des ressources humaines du groupe PSA
Présidence de M. Christophe Castaner et Mme Véronique Louwagie, corapporteurs
M. Christophe Castaner, rapporteur. La question complexe de la prévention et de l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi a connu récemment des bouleversements législatifs avec la transposition dans la loi de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 (ANI). Notre mission s’intéresse surtout aux engagements financiers de l’État, mais nous souhaitons évidemment savoir comment ces évolutions sont vécues dans les entreprises, en particulier chez Peugeot-Citroën qui a anticipé l’application de loi en ce qui concerne les accords d’entreprise accompagnant les plans sociaux.
Que pensez-vous de l’évolution sur le long terme de la législation en matière de plans sociaux ? En tant qu’acteurs privés, considérez-vous que l’accompagnement public est efficace ? Quels moyens manquent à votre sens en termes de coordination ou de gouvernance ? Que pensez-vous de la pratique de la prime supra-légale qui permet parfois « d’acheter » la paix sociale ? À l’échelle de grands groupes, qu’en est-il des plans sociaux diffus, parfois nécessaires, que nous avons connus dans l’industrie pharmaceutique et qui risquent de toucher demain le secteur de la grande distribution ?
M. Jean-Christophe Sciberras, président du bureau de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH). La législation en matière de licenciement économique a connu depuis trente ans un extraordinaire mouvement de complexification et de sédimentation. Aucun pays n’a construit un droit du licenciement aussi complexe que le nôtre – directeur des relations sociales du groupe de Solvay-Rhodia, je crois pourtant avoir une bonne vision d’ensemble de la situation dans de nombreux pays du monde. Même en Europe, une telle situation n’existe pas ! Comment avons-nous pu laisser la création collective de droit, tant législative que jurisprudentielle, produire un tel enchevêtrement de normes et une telle confusion ?
Non seulement cette dérive se paie en termes de délais et d’insécurité juridique, mais elle ne donne satisfaction ni au management ni aux organisations syndicales. En effet la situation ne s’est pas améliorée au fur et à mesure que l’on créait un droit de plus en plus protecteur. Je rappelle qu’en 2009, alors que nous traversions la pire crise économique de l’après-guerre, notre pays a enregistré 230 000 licenciements économiques, soit deux fois moins qu’en 1985. La complexification du droit a ainsi entraîné une précarisation, car il a bien fallu que les entreprises trouvent des marges de manœuvre où elles le pouvaient.
Une catégorie de salarié a été de plus en plus protégée alors qu’une autre se retrouvait sans protection. Au-delà d’une évolution juridique, il y a donc une société qui se disloque en groupes à statuts différents, celui qui est protégé devenant l’objet de toutes les préoccupations, y compris celles des syndicats. Les droits sont désormais différents, tout comme le rapport à l’entreprise, et les jeunes générations finissent par en payer le prix en subissant la précarité. On reproche parfois aux directeurs des ressources humaines d’être les acteurs de cette évolution, mais ils font avec ce qu’ils ont, et avec le droit. Pour répondre aux enjeux de compétitivité qui sont de premier ordre, nous ne pouvons qu’utiliser les outils dont nous disposons.
Contrairement à ce qui se répète souvent, l’ANI, qui vient d’être transposé dans la loi, ne crée pas de la flexibilité : il ne fait que transférer aux entreprises la responsabilité de mener des discussions en la matière. Pour que ce texte produise éventuellement des effets, des actes juridiques sont encore nécessaires – soit accord, soit homologation par l’administration. Si une étape a été franchie de façon symbolique, articulant de façon harmonieuse démocratie sociale et démocratie politique, nous nous retrouverons à pied d’œuvre le 1er juillet prochain. Les choses vont dans le bon sens, mais des interrogations fortes demeurent.
Tout d’abord, pourquoi imagine-t-on que la négociation sera plus facile que la procédure unilatérale d’information-consultation ? Dans les entreprises qui se trouvent au bord du gouffre, la responsabilité des partenaires sociaux sera telle que la possibilité de la signature d’un accord deviendra envisageable, mais quand une entreprise sera en meilleure santé et qu’elle devra néanmoins s’adapter et se restructurer, la négociation deviendra très difficile.
Ensuite, est-on assez conscient des aléas que fait peser sur l’homologation l’incertitude de décisions prises par le juge du référé qui se prononce seul, sous la pression de l’actualité, du contexte et des médias ?
Il est judicieux de soustraire les procédures de plan de sauvegarde de l’emploi du contrôle du juge judiciaire, pour autant que l’on sache comment réagira l’administration du travail. Quelles instructions le ministre donnera-t-il aux directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ? Nous voudrions pouvoir discuter avec la direction générale du travail en amont d’une future circulaire, car la position générale de l’administration aura un effet considérable sur la posture des participants aux négociations, dont certains pourraient considérer qu’ils ont intérêt à les faire échouer.
Dans l’esprit de l’ANI, à savoir donner la plus grande place possible à la négociation au plus près du terrain, il faut que l’administration concentre son contrôle sur la loyauté et la transparence de la procédure, et qu’elle conserve une position d’équilibre sans trop s’intéresser au contenu et au détail. De la même façon, le juge administratif ne devra exercer qu’un contrôle minimum sur la décision de l’administration. Sauf situation extrême, ce que le droit administratif qualifie d’« erreur manifeste », il est nécessaire de laisser les partenaires négocier et décider : il n’y a pas une seule bonne réponse, contrairement à ce que pensait le juge judiciaire – cette immodestie expliquant les dérives constatées.
Le champ d’application du droit du licenciement économique est trop large dans notre pays ; il faut le redéfinir. Au moindre risque pour l’emploi, nous mettons en place un plan de sauvegarde de l’emploi, alors même que nous faisons tout pour éviter des licenciements économiques. Le lancement des procédures et l’utilisation des termes juridiques adéquats créent l’affolement. Nous nous trouvons dans l’obligation de prononcer des mots qui font peur, même lorsque, conformément au souhait du législateur, nous mettons tout en œuvre pour qu’ils ne trouvent aucune traduction concrète. Cette dramatisation a des conséquences considérables, les uns et les autres étant tétanisés et s’enfermant souvent dans des postures dont ils ne peuvent plus sortir. Or il s’agit souvent d’une frayeur inutile : au bout du compte, malgré des suppressions de postes, 90 % des salariés ont généralement conservé un emploi – dans le cas que je viens de vivre, un an et demi après la procédure lancée au moment de la fusion de Rodhia et de Solvay, pas un seul départ contraint n’a été enregistré ! J’estime en conséquence que le « curseur » du déclenchement du licenciement économique devrait être déplacé et situé très en aval, au moment où il s’agit non plus d’un cas purement hypothétique, mais d’une solution très prévisible. Malheureusement, sur ce plan, l’ANI ne change guère les choses : les accords de maintien dans l’emploi ne devraient pas empêcher le licenciement économique dont le champ n’a pas été modifié. Toutefois, il ne sera pas mis en œuvre dans le cadre des accords de mobilité géographique et professionnelle, ce qui constitue une amélioration.
Des progrès restent à faire en matière de licenciement économique, j’en citerai trois exemples. Le premier concerne l’articulation entre le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Jean Auroux a fait une erreur en rendant le CHSCT autonome en 1982 : ce comité aurait dû rester une commission du CE avec lequel il ne se coordonne pas. Aujourd’hui, le comité d’hygiène et de sécurité seul peut tout bloquer et provoquer une expertise. Le deuxième exemple concerne l’étendue de l’obligation de reclassement. On comprend que les salariés puissent ne pas souhaiter un reclassement à l’autre bout de la France, mais pourquoi ne pas reconnaître la validité des limites géographiques qu’ils fixeraient eux-mêmes. Le droit doit aussi nous protéger de la mauvaise foi. Enfin, il faudrait revenir sur les obligations en matière de critères d’ordre de licenciement économique tels qu’ils sont énoncés par la jurisprudence. Au sein de la même catégorie professionnelle, un ordre doit par exemple être fixé avec l’attribution de points et un système de pondération sans tenir compte du site concerné. Encore une procédure complexe qui génère des inquiétudes souvent inutiles !
M. Philippe Dorge, directeur des ressources humaines du groupe PSA. Je souscris à l’analyse essentiellement juridique que nous venons d’entendre, et centrerai mon propos sur la politique de l’emploi du groupe PSA. Pour ce faire, je mettrai en évidence quelques principes fondamentaux, lesquels définissent une méthode permettant d’appréhender la gestion des ressources humaines dans un groupe tel que le nôtre.
La première difficulté est que toute anticipation, par ailleurs nécessaire, suscite un émoi qui peut paradoxalement conduire à précipiter certaines procédures judiciaires. Les managers doivent donc trouver les moyens de garder la maîtrise du calendrier tout en clarifiant la stratégie de l’entreprise, stratégie qui dépend aussi des évolutions du marché, très rapides, auxquelles il faut s’ajuster. La communication sur cette stratégie est donc également un enjeu majeur. Reste que l’anticipation est une clé du succès des politiques de l’emploi.
Le deuxième élément majeur est le dialogue social : les partenaires syndicaux y sont prêts ; l’arsenal juridique doit donc lui donner toute sa place – aussi sommes-nous favorables au projet de loi transposant l’Accord national interprofessionnel (ANI). Un bon accord est toujours la meilleure solution : il serait dommageable de le remettre en cause parce que tel ou tel point contreviendrait à des dispositions législatives très secondaires. Le dialogue social est d’autant plus important au regard, par exemple, des indemnités extra légales, décidées lors de conflits qui se radicalisent sous l’influence de mouvements politiques alors que les syndicats, eux, essaient de trouver des solutions. L’approche contractuelle suppose bien entendu la confiance au sein de l’entreprise et la juste anticipation de la gestion des emplois. Quoi qu’il en soit, il est bien entendu préférable de privilégier le reclassement et le parcours sécurisé dans l’emploi plutôt que la « prime à la valise », qui n’a certes pas cours dans les grands groupes tels que PSA mais que j’ai pu observer, par exemple, dans des entreprises de sous-traitance du secteur automobile.
Le troisième principe est l’innovation, dans le cadre de laquelle nous entretenons un dialogue fécond avec l’administration et les autorités politiques. Je reste donc confiant sur les progrès que nous pouvons réaliser en ce domaine, à travers des dispositions telles que les congés de reclassement ou les mesures de transition professionnelle actuellement testées sur le site d’Aulnay, et qui le seront bientôt sur celui de Rennes. Nous réfléchissons aux moyens de sécuriser l’emploi au sein des filières en difficulté – par exemple à travers des « passerelles » sur des plateformes régionales –, ainsi qu’à l’emploi des seniors, auxquels pourraient être proposées des tâches dans d’autres entreprises ou des dispenses partielles d’activité ; cela peut d’ailleurs faire l’objet de contreparties en faveur de l’emploi des jeunes. La gestion des ressources humaines selon les âges est évidemment un enjeu du dialogue social dans une situation difficile pour l’emploi.
En 2007, PSA a signé son premier accord de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) ; cet accord a été revu en 2010. C’est là un volet important de notre politique sociale pour les trois ans qui viennent – puisqu’il est difficile d’avoir une vision au-delà. Le retournement de la conjoncture s’est malheureusement confirmé, puisque les ventes de véhicules sur le marché européen sont passées de 18,5 millions en 2007 à 13,5 millions en 2012. Le groupe PSA détenant 13 % de parts de marché, il a donc vendu 550 000 voitures de moins, soit une baisse de 27 %. Encore ne s’agit-il que d’une moyenne européenne : si les ventes en Allemagne sont restées stables, elles ont chuté de 60 % en Espagne et de 35 % en Italie. Un tel tsunami impose d’avoir la bonne « boîte à outils », car il faut bien ajuster, non seulement l’emploi – 550 000 voitures représentent trois flux d’usines de montage –, mais aussi les structures globales du groupe.
Sans mesurer l’ampleur de ces évolutions, nous pressentions, en 2007, que le climat s’assombrirait ; c’est ce qui a justifié l’accord de GPEC, articulé selon trois chapitres. Le premier portait sur la définition de la stratégie du groupe avec les partenaires sociaux, dans le cadre de comités paritaires stratégiques et d’observatoires de l’emploi, grâce auxquels le groupe communique aux salariés sa vision, en termes d’évolution des emplois, sur les différents métiers. Le deuxième chapitre reprenait les outils habituels de gestion des emplois et des compétences « en temps de paix », tels que la mobilité interne, les entretiens individuels et tout ce qui contribue à la définition du parcours professionnel – autant d’éléments utilement éclairés par le premier chapitre. Le troisième chapitre portait sur la possibilité d’un accord de méthode en cas de difficultés, avec des mesures allant du congé de reclassement jusqu’au départ volontaire. Nous n’avions pas pris l’engagement, bien entendu, de ne jamais recourir à des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui suspendent nécessairement l’application des dispositions de ce dernier chapitre.
En tout état de cause, l’accord s’est appliqué jusqu’en 2012. Il nous a permis non seulement d’aborder certaines évolutions en matière d’emplois et de compétences, mais aussi, il ne faut pas s’en cacher, de diminuer le niveau de l’emploi au sein du groupe.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Dans quelle proportion ?
M. Philippe Dorge. De l’ordre de 5 000 à 6 000 postes, mais, compte tenu des recrutements massifs en 2009 et 2010, la diminution nette, dont je n’ai pas le chiffre exact, est moindre.
Au reste, l’expression d’« accord de GPEC » est peut-être de nature à entretenir une certaine ambiguïté, dans la mesure où son chapitre 3 prévoyait la stricte application du code du travail sur la tenue de deux comités centraux d’entreprise (CCE), nonobstant le plan de redéploiement des emplois et des compétences, dit « PREC ». Cela dit, un engagement avait été pris, en l’absence de licenciements contraints, de renoncer aux expertises et d’organiser deux réunions au lieu de trois, afin d’aller plus vite.
En 2012, le contexte est devenu un peu différent : l’accord de GPEC est devenu insuffisant pour traiter le problème de la fermeture du site d’Aulnay qui employait quelque 3 000 personnes. Le groupe a donc dû recourir à un PSE classique. Pour autant, après avoir annoncé la fermeture du site en juillet, il est revenu à ses pratiques, avec l’assentiment des pouvoirs publics, pour proposer un accord de méthode en septembre, à cette différence près, cette fois, que l’accord fut précédé par la réunion du CCE – soit la procédure inverse de celle prévue par l’accord de GPEC.
Après une dizaine de réunions, un accord a été conclu en mars 2013 sur le contenu du PSE, accord qui s’est traduit par la tenue d’un troisième CCE et la mise en œuvre du plan de départs. Cependant les principes que j’évoquais ont été respectés, qu’il s’agisse de l’anticipation, du dialogue social – l’accord a été signé par cinq organisations syndicales sur six – ou de l’innovation, avec le contrat de transition professionnelle (CTP), lequel s’ajoute, pour les salariés d’Aulnay, aux congés de reclassement ou aux départs volontaires. Cet accord permet à la SNCF, Aéroports de Paris et la RATP de présélectionner les salariés qu’ils souhaitent reclasser, moyennant un éventuel plan de formation pour ajuster les compétences. Du point de vue juridique, cette passerelle sécurisée passe par le congé de reclassement, même si le salarié ne connaît pas de période de chômage.
Sans lever le voile sur ce dont nous allons discuter avec les organisations syndicales dans les prochaines semaines, à commencer par l’accord de compétitivité, je crois nécessaire de renouer avec l’anticipation, le dialogue social et l’innovation. Cette méthode, au demeurant, me semble tout à fait compatible avec les dispositions de la nouvelle loi.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. S’agissant du champ juridique du licenciement économique, dont a parlé M. Sciberras, le souhait est apparemment de différer l’application de certaines dispositions : vous avez vous-même évoqué la crainte que suscite la simple annonce d’un PSE. Ce souhait me semble contradictoire avec la nécessité d’anticiper, que vous avez aussi soulignée.
Avez-vous par ailleurs des suggestions sur les critères d’ordre du licenciement ? À défaut d’être suffisants – puisque votre groupe a eu recours aux contrats de transition professionnelle –, les principaux dispositifs publics vous paraissent-ils pertinents ?
Enfin, être-vous satisfait des relations que vous entretenez avec les acteurs publics qui interviennent dans les négociations, qu’il s’agisse des collectivités, des services de l’État ou du commissaire au redressement productif ?
M. Philippe Dorge. Je commencerai par votre dernière question en répondant par l’affirmative, même si un peu plus de marges de manœuvre seraient souhaitables – ce qui nous ramène au problème du cadre légal. La question du bon support juridique se pose par exemple pour le congé d’un senior dans le cadre d’une mesure de maintien dans l’emploi. Nos interlocuteurs me paraissent mobilisés et de bonne volonté pour trouver des solutions équilibrées – leur culture économique, d’ailleurs, s’est visiblement développée : peut-être la crise a-t-elle permis une prise de conscience –, même si les conseils qu’ils nous donnent peuvent s’apparenter à des injonctions paradoxales, compte tenu des contraintes financières qui empêchent des aides plus concrètes ; au moins pourrait-on, à défaut de ces aides, nous laisser davantage de souplesse pour innover. Nos interlocuteurs y semblent d’ailleurs disposés, mais nous butons vite sur des contraintes légales, de sorte que le risque juridique tend à « gripper » le système. Le contrôle par le juge est bien entendu normal, mais ce dernier ne se prononce que sur la base des textes votés par le législateur. Quoi qu’il en soit, je reste optimiste sur de futures améliorations.
Quant à votre question sur l’anticipation, les grandes entreprises comme PSA ont vraiment besoin d’outils complexes – on pourrait prendre l’image d’une boîte de vitesses, où l’on passe la première, la deuxième, la troisième. Or, dans notre cadre législatif, on a souvent l’impression d’entrer dans une procédure de licenciement économique dès la première ou deuxième vitesse, quand cela ne devrait concerner en réalité que la cinquième.
Au premier niveau, il y a la gestion courante de l’emploi et de la mobilité dans l’entreprise : il n’y a alors aucune baisse globale de l’emploi, mais des mouvements dus au fait que les besoins se modifient en permanence. On est alors tout à fait dans le champ de la GPEC, même si certains voient déjà là des licenciements économiques.
Au deuxième niveau, on redéploie l’emploi et les compétences de façon collective : un site qui ferme, des métiers qui périclitent ou, au contraire, qui prennent de l’ampleur. La GPEC permet alors d’éclairer les salariés ; tout repose encore sur le volontariat, on ne parle pas encore nécessairement de PSE, mais il y a déjà, légalement, deux réunions du CE. Il nous faut apprendre à gérer les transformations collectives de façon banale : le monde change, l’environnement économique change, l’entreprise doit être très agile, très réactive.
Le troisième niveau commence lorsqu’il y a une baisse globale de l’emploi, mais sans qu’il soit encore nécessaire de prendre des mesures contraignantes. Légalement, on est déjà dans le cadre d’un PSE, mais les mesures fondées sur le volontariat suffisent en général. Jusqu’à présent, nous avions toujours réussi à en rester là, et à éviter les licenciements.
Enfin, un jour, il faut fermer un site, arrêter complètement une activité. C’est ce qui se passe à Aulnay. Nous avons bon espoir, aujourd’hui, d’avoir trouvé une solution de reclassement pour tous les salariés de ce site au 31 décembre prochain ; mais, sinon, il faudra bien engager une phase de mesures de contrainte. C’est le dernier niveau.
Vous le voyez, mon approche est pragmatique : il y a différents niveaux d’action. Nous attendons des dispositifs légaux qu’ils nous permettent de régler toutes les situations qui se présentent sans recourir, sauf nécessité absolue, au licenciement économique.
M. Christophe Castaner, rapporteur. L’administration devra homologuer les accords : comment pensez-vous que cela se passera ?
M. Philippe Dorge. Nous verrons, mais je suis plutôt optimiste sur ce point.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Estimez-vous qu’il serait utile d’établir des critères d’homologation, ou bien vous semblerait-il préférable de privilégier l’approche pragmatique au cas par cas, qui paraît souvent la plus adaptée ?
Faudrait-il que la nature des emplois sous tension, par exemple, soit obligatoirement précisée dans les accords de GPEC ? Une loi serait-elle utile pour encadrer ces accords ?
Faudrait-il plafonner ou encadrer la prime supra-légale ?
Enfin, vous n’avez guère évoqué la question de la revitalisation des territoires, qui est pourtant cruciale. Les entreprises de la taille de PSA ont des obligations financières. Comment abordez-vous ces questions ?
M. Philippe Dorge. Il faut garder à l’esprit que nous n’avons jamais eu à recourir à des départs directs dans le cadre d’accords de GPEC : gérer de façon prévisionnelle l’emploi et les compétences, c’est faire bien d’autres choses qu’organiser des départs. Une loi sur la GPEC permettrait sans doute une meilleure sécurité juridique, mais cela ne me semble pas urgent – aucune menace ne pèse aujourd’hui sur la GPEC. On peut même craindre que la loi ne soit déviée, ce qui empêcherait de conclure de tels accords.
Franchement, je ne sais pas comment répondre à votre question sur les primes. Bien sûr, un plafonnement ou un encadrement permettrait d’éviter les pressions et l’inflation des montants ; cela nous aiderait parfois. Mais toutes sortes de cas individuels, de circonstances exceptionnelles peuvent se présenter. Aujourd’hui, de plus, beaucoup de plafonds de sécurité sociale ont été revus à la baisse, et les primes ont perdu de leur intérêt social et fiscal : cela freine les attitudes déraisonnables.
Je comprends bien votre souci de revitaliser les territoires. Mais, pour l’entreprise, il y a là une sorte de double peine : une entreprise qui rencontre des difficultés au point de devoir se séparer de certains de ses salariés se voit en plus pénalisée par un impôt supplémentaire. L’administration devrait, je crois, veiller à bien définir ces obligations pour éviter les disparités régionales et assurer l’équité, quelles que puissent être les pressions médiatiques ou politiques : il paraît donc normal que l’administration intervienne au niveau central. Elle doit aussi, je crois, veiller à la manière dont sont utilisés les fonds destinés à la revitalisation.
Il faudrait également valoriser les entreprises qui mettent en œuvre, d’elles-mêmes, dans leurs PSE, des mesures de compensation, et éviter une sorte de double imposition en les taxant alors même qu’elles avaient déjà prévu des mesures et engagé des dépenses. À Aulnay, nous avons ainsi travaillé sur ce point – je note au passage que les agences de développement publiques ne sont pas toujours les mieux placées pour apporter des solutions de revitalisation : il existe aujourd’hui des entreprises privées bien plus efficaces.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, magistrate à la Cour des comptes. Comment envisagez-vous l’articulation de la GPEC et des PSE ? Cette articulation n’a pas toujours été claire : la GPEC a été accompagnée d’aides financières de l’État, mais elle n’a pas toujours servi à éviter les licenciements économiques – qui ne sont bien sûr pas toujours évitables.
Serait-il utile d’inscrire dans la loi que la prime extra-légale n’est pas suffisante dans le cadre d’un plan de départs volontaires, ou bien est-ce une règle implicite que s’appliquent les grandes entreprises dotées de moyens suffisants ?
M. Philippe Dorge. La question des primes est délicate. À Aulnay, certains demandent une prime de 130 000 euros, quand nous pensons accorder des primes allant de 25 000 à 40 000 euros ! C’est vous dire l’écart énorme entre ce qui est possible et ce qui est revendiqué par une petite frange très radicale. Mais les partenaires sociaux préfèrent s’en tenir à ce que prescrit le code du travail, c’est-à-dire donner la priorité au reclassement et à la sécurisation des parcours.
Aujourd’hui, ce ne sont pas les entreprises qui veulent se débarrasser de leurs obligations légales en donnant des primes supra-légales ; c’est la situation sociale qui fait naître les abus. Ce n’est pas le cas de PSA, mais j’ai des exemples de fournisseurs, d’équipementiers qui se trouvent dans l’obligation d’accorder des primes exorbitantes - 100 000 euros ! – parce qu’ils sont pris en otage, parce que leurs outils de travail sont pris, ce qu’ils ne peuvent pas se permettre.
Aujourd’hui, même les syndicats sont parfois débordés : la peur de perdre un contrat à durée indéterminée et de sombrer dans la précarité est telle que le blocage est insurmontable. En acceptant une prime, certains salariés ont l’impression de « vendre » leur CDI.
L’administration joue globalement le jeu de l’apaisement et de la médiation ; nous avons des interlocuteurs syndicaux responsables, et les directions des entreprises le sont aussi. Les abus sont plutôt des cas marginaux, mais qui font beaucoup parler.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Nous vous remercions.
Audition du jeudi 30 mai 2013
À 9 heures 30 : Table ronde avec les représentants des syndicats de salariés : M. Christian Janin, secrétaire confédéral de la CFDT ; M. Guillaume Lefèvre, secrétaire confédéral de la CFDT ; M. Michel Beaugas, secrétaire général de l’Union départementale Force Ouvrière du Calvados ; Mme Sylvia Veitl, assistante confédérale de Force Ouvrière ; M. Mohamed Oussedik, secrétaire confédéral de la CGT et Mme Isabelle Depuydt, conseillère confédérale de la CGT
Présidence de M. Olivier Carré, coprésident de la Mission
M. Olivier Carré, président. Nous poursuivons ce matin nos travaux sur la prévention et l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Nous avons le plaisir de recevoir une délégation de représentants de différents syndicats de salariés : M. Christian Janin et M. Guillaume Lefèvre de la CFDT, Mme Sylvia Veitl et M. Michel Beaugas de Force Ouvrière, M. Mohamed Oussedik et Mme Isabelle Depuydt de la CGT. Nous organisons cette audition en partenariat avec la Cour des comptes.
M. Christian Janin, secrétaire confédéral de la CFDT. En recevant votre invitation, mesdames, messieurs les députés, nous nous sommes interrogés sur son objet. Cherchez-vous à analyser la manière dont la puissance publique prévient et accompagne les PSE aujourd’hui ou souhaitez-vous réfléchir à ce que pourrait faire celle-ci à l’avenir compte tenu des évolutions en cours ?
M. Christophe Castaner, rapporteur. Nos auditions servent à rédiger un rapport élaboré dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) ; celui-ci ne répond donc pas à une commande gouvernementale et a vocation à produire une analyse financière sur l’engagement de l’État dans ces dispositifs.
Votre question est particulièrement pertinente, parce que les rapporteurs ont proposé ce thème d’étude bien avant la signature de l’Accord national interprofessionnel (ANI) le 11 janvier dernier ; l’ANI et sa transposition dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi – ainsi que la proposition de loi déposée par M. François Brottes sur les conditions de reprise des sites rentables – ont profondément modifié l’anticipation et l’accompagnement par la puissance publique des PSE, si bien que nous sommes passés de l’évaluation à l’accompagnement de ces changements ; nous observerons ainsi la capacité des acteurs publics à prendre en compte et à appuyer la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Notre objectif est de réaliser un audit des PSE, cet état des lieux devant dresser les forces et les faiblesses du système actuel en intégrant les conséquences de la nouvelle législation née de l’ANI ; à la suite de ce constat, nous élaborerons des propositions visant à améliorer l’action de la puissance publique en amont et en aval des PSE.
M. Olivier Carré, président La majorité et l’opposition mènent ensemble ce travail et cosigneront le rapport.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Je tiens à préciser qu’il s’agit ici non pas de refaire le débat sur l’ANI et sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi, mais d’étudier les conditions de mise en œuvre de ces textes, de recueillir vos éventuelles inquiétudes et de mettre en lumière certains sujets sur lesquels l’ANI ou la loi ne seraient pas allés assez loin, afin que nous puissions faire des recommandations sur les conditions d’application de la loi.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Ce qui nous intéresse c’est de bénéficier de votre expérience sur le sujet.
M. Michel Beaugas, secrétaire général de l’Union départementale Force Ouvrière du Calvados. Je vous remercie pour cet éclairage, car nous avions nous aussi des interrogations.
Le nombre de PSE est faible et ne constitue pas, de très loin, le premier motif d’inscription à Pôle emploi : les licenciements économiques représentent à peine 3 % des ruptures du contrat de travail, loin derrière l’arrêt des contrats précaires – 25 % pour les seuls CDD et 30 % si l’on y ajoute l’intérim. Le thème principal, à nos yeux, réside donc bien dans la précarisation des contrats.
Jusqu’à l’ANI et la loi relative à la sécurisation de l’emploi – le terme de sécurisation étant, en l’espèce, bien mal choisi puisque l’on parle surtout de licenciement –, l’administration, par le biais des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), pouvait contrôler les PSE, mais pas les autres ruptures – notamment conventionnelles –, qui, par leur nombre, peuvent se transformer en plans sociaux déguisés. Ainsi, l’administration rencontrerait de grandes difficultés à suivre une entreprise procédant à quatre ou cinq ruptures conventionnelles par mois.
M. Olivier Carré, président Elle donne pourtant un accord !
M. Michel Beaugas. Certes, mais les moyens alloués aux DIRECCTE sont restreints et devraient être renforcés pour que l’administration puisse remplir cette mission de vigilance.
Les entreprises devraient utiliser l’instrument de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) bien en amont du PSE, et sans lier les deux sujets. Il y a un vrai manque d’implication des employeurs dans le développement de la GPEC et comme tout a été fait pour associer GPEC et PSE, les salariés pensent au licenciement quand on leur parle de GPEC ; ces deux facteurs ne facilitent pas la mise en place d’une gestion de long terme dans l’entreprise.
M. Christian Janin. Dans la période précédant l’ANI et la loi relative à la sécurisation de l’emploi, la prévention et l’accompagnement des PSE ont été cogérés par la puissance publique et les directions d’entreprise sans que les représentants des salariés y soient associés. Au niveau national, nous avons uniquement pu débattre de ces questions de manière indirecte, à l’occasion des discussions sur les projets de loi de finances ou au sein du Conseil national de l’emploi lorsque l’on aborde les très rares accords du Fonds national de l’emploi (FNE). Il s’agit donc pour nous d’une zone noire. Le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) vient de publier une étude sur les aides publiques aux entreprises en faveur de l’emploi, qui pointe un certain nombre de difficultés. Nous considérons que l’État ne mène aucune politique de prévention et d’accompagnement des PSE ; la puissance publique joue seulement le rôle de pompier lorsqu’un gros incendie se déclare.
Cette situation découle de la suppression de l’autorisation administrative de licenciement et de celle de la mission interministérielle sur les mutations économiques, ainsi que d’autres décisions de retrait de l’investissement public dans ces domaines ; le nouveau contexte pose ainsi la question du retour de l’État. Dans la situation économique que nous connaissons, espérer faire des économies sur cette ligne budgétaire est illusoire et il conviendrait davantage de renforcer les moyens des DIRECCTE.
À l’intérieur de ce cadre général, les pouvoirs publics ont toujours mené des actions en fonction d’opportunités ou de situations conjoncturelles particulières, notamment par le biais des engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC). Nous considérons que ces interventions sont trop éclatées et que la prévention et l’accompagnement des PSE devraient reposer sur des accords sectoriels ou territoriaux définissant des priorités. Des initiatives en ce sens se font jour et il y a lieu de les encourager.
De notre point de vue, les ruptures conventionnelles ne constituent pas une voie de contournement massif du PSE. Des salariés et des entreprises se mettent en revanche d’accord pour requalifier en rupture conventionnelle des départs négociés en préretraite, ce qui pose un vrai problème.
La direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) nous promet depuis six mois la publication d’une enquête qualitative réalisée auprès de 3 000 salariés ayant bénéficié de la rupture conventionnelle, qui nous permettra de connaître l’utilisation de ce dispositif.
M. Mohamed Oussedik, secrétaire confédéral de la CGT. Nous nous sommes également interrogés sur le sens de votre invitation, mais les éclairages que vous nous avez apportés ont permis de préciser la nature de la contribution que vous attendiez de nous. Il est intéressant de mettre en place une mission d’évaluation sur ce sujet, même si, M. Michel Beaugas l’a rappelé, les licenciements économiques ne sont à l’origine que de 3 à 4 % des inscriptions à Pôle emploi, et les PSE ne concernent que les entreprises qui en ont les moyens et qui sont donc de grande taille ; de nombreux dispositifs pour les salariés ne relèvent donc pas des PSE, alors même que le motif économique du licenciement est avéré. La souplesse pour licencier est donc assurée.
Il faut se pencher sur les contrats précaires comme les CDD et l’intérim. Les salariés seniors sont également fragilisés, ce qui pose la question des départs volontaires. Les ruptures conventionnelles représentent 16 % des fins de CDI et un million de salariés, dont une part importante se trouve contrainte de mettre un terme à son contrat selon cette procédure plutôt que d’entrer dans une phase de licenciement plus contraignante pour l’entreprise.
Il convient également d’analyser les raisons pour lesquelles on privilégie le moment du licenciement pour accompagner les salariés plutôt que celui où l’entreprise rencontre des difficultés. Symptomatique de ce choix, le dispositif du chômage partiel est sous-utilisé en France et il serait intéressant de déterminer les causes de ce phénomène. Une différence existe entre les grands groupes et les entreprises sous-traitantes, et le système actuel de chômage partiel n’est pas adapté aux réalités de l’emploi.
La GPEC – qui a fait l’objet d’un ANI en novembre 2008 – est vécue par les entreprises comme une procédure obligatoire lorsque des suppressions d’emplois sont envisagées. L’anticipation que devrait permettre cet instrument reste donc théorique. Certaines entreprises, comme Saint-Gobain, ont signé des accords intéressants sur la GPEC, car elles ont déconnecté ce sujet de celui du PSE et ont traité de la stratégie du groupe, de ses conséquences sur l’emploi et la formation à l’échelle du bassin d’activité, et de l’avenir des sous-traitants de la filière. L’information sur la stratégie de l’entreprise est en mesure de redonner de l’utilité à la GPEC.
Je suis heureux que la puissance publique veuille accompagner – voire anticiper – les PSE ; néanmoins, il faut s’interroger sur les raisons de la suppression de dispositifs qui fonctionnaient. Je pense notamment à l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (AS-FNE), mise en sommeil en dépit de son grand intérêt. Ce que l’on aborde aujourd’hui, l’AS-FNE le traitait de façon concrète : il n’y a qu’à songer au congé de conversion, au mécanisme de préretraite pour les salariés âgés de plus de cinquante-six ans, aux cellules de reclassement confiées dorénavant au secteur privé et qui devraient faire l’objet d’une enquête, et au système de mutualisation des fonds de formation. Tous ces instruments engendraient des dépenses, mais celles-ci doivent être comparées au coût du chômage.
Nous devrons donc connaître le degré d’effort – notamment financier – que la puissance publique est disposée à consentir pour mettre en place des dispositifs efficaces de prévention et d’accompagnement des PSE.
Outre le rapport du COE évoqué par M. Christian Janin, le Conseil national de l’industrie (CNI) et le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) publieront prochainement des études évaluant l’efficacité des aides publiques aux entreprises en faveur de l’emploi. Ces aides – exonération de cotisations sociales sur les bas salaires ou mesures fiscales dérogatoires comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) – visent à maintenir ou à encourager l’emploi, mais il ne serait pas inutile que votre mission étudie les moyens de mieux utiliser les ressources publiques.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Notre travail se concentre sur les 4 % des salariés concernés par les PSE et auxquels vous avez fait allusion, monsieur Oussedik, mais d’autres missions se penchent sur la situation des autres salariés.
Vous avez peu abordé la façon dont vous voyez les éventuels effets de l’ANI du 11 janvier 2013 et de la loi relative à la sécurisation de l’emploi sur les PSE.
Quel est votre avis sur la gestion des effectifs dans les entreprises en difficulté, sur les plans de départs volontaires et sur les dispositifs publics d’accompagnement ? Les contrats de sécurisation professionnelle (CSP) représentent-ils une bonne solution ? Les collectivités locales sont-elles suffisamment associées aux PSE pour prévoir la restructuration des territoires et formuler des propositions au monde économique, ou faut-il agir d’une manière différente ?
M. Michel Beaugas. Dans l’ANI, nous regrettons que la mission de l’administration ne comprenne pas le contrôle de la cause économique du PSE ; si l’administration avait été en mesure de constater l’absence de raison économique aux licenciements, alors la procédure du PSE aurait pu être immédiatement arrêtée. La loi transposant l’ANI raccourcit énormément les délais, notamment ceux du recours juridique. Par ailleurs, les équipes syndicales étaient habituées aux tribunaux de grande instance (TGI) et ne sont pas familières des tribunaux administratifs. Ceux-ci doivent déjà traiter un contentieux important et ils n’auront que trois mois pour statuer, sous peine de transfert direct de la requête à la cour administrative d’appel. En outre, les comités d’entreprise et les organisations syndicales devront obligatoirement disposer d’un avocat, ce qui engendrera un coût pouvant dissuader certaines actions en justice.
Nous sommes perplexes sur l’utilité de la proposition de loi de M. François Brottes. En effet, cette proposition ne concerne que les entreprises de plus de 1 000 salariés ; le comité d’entreprise devra s’adresser au tribunal de commerce et, s’il est reconnu que l’employeur n’a pas suffisamment recherché de repreneur, la sanction sera une pénalité. Cela signifie que l’entreprise paiera, mais que les salariés seront licenciés. Ce texte n’apporte donc presque rien aux salariés et permettra à l’État d’encaisser des amendes.
Le CSP est un outil pertinent et efficace, car les salariés sont suivis individuellement jusqu’à trouver une formation ou un emploi, même s’il est actuellement difficile d’être embauché. Il convient de renforcer les moyens qui lui sont alloués, notamment dans les entreprises de moins de 1 000 salariés où le CSP individuel devrait pouvoir devenir collectif. Ainsi, nous avons suivi collectivement le dossier de l’usine Plysorol de Lisieux, où les salariés qui allaient être licenciés ont été très tôt pris en charge ; nous avons organisé à leur intention des réunions d’information sur le CSP et sur leurs droits, si bien que 85 % d’entre eux ont adhéré à ce contrat – alors que le taux d’adhésion individuelle est plus faible et que les 15 % de salariés restants disposaient de solutions alternatives comme le départ en retraite. Nous avons pu élaborer un plan de recherche de formation et un plan de recherche d’emploi, qui ont démontré l’efficacité du dispositif du CSP.
Je partage le constat de M. Oussedik sur la trop faible utilisation de l’allocation temporaire dégressive et du chômage partiel dans la prévention des difficultés des entreprises.
M. Christian Janin. L’ANI et la loi relative à la sécurisation de l’emploi introduisent des éléments porteurs d’un changement culturel dans les entreprises, car ils associent différents instruments. C’est ce lien qui constitue à nos yeux la garantie pour les salariés. Le schéma doit obéir à la séquence suivante : développer l’anticipation, tout faire pour maintenir l’emploi et, seulement en cas extrême, procéder à des licenciements économiques. Tous ces outils sont regroupés dans le chapitre III de la loi. Il est évident que si l’on ne privilégie qu’un seul de ces mécanismes, ce système échouera.
Il convient de renforcer les DIRECCTE pour qu’elles puissent assumer la fonction que la loi leur confie dans le processus ; il n’y aurait en effet rien de pire que d’avoir un dispositif d’homologation ou de validation des accords qui reste simplement formel. Il est d’ailleurs indispensable de développer un traitement administratif de qualité pour ces opérations.
Le patronat avait refusé, dans l’ANI de novembre 2008 sur la GPEC, que la stratégie des entreprises soit discutée, alors qu’il l’a accepté dans celui de janvier 2013. Cet acquiescement de principe devra se concrétiser dans la pratique, mais nos équipes syndicales doivent se préparer à intervenir avec compétence sur ces questions. Il s’agit d’un défi d’expertise que nous devons relever, afin que nous ne puissions pas être instrumentalisés par les employeurs.
Au niveau de la puissance publique, l’enjeu est double, voire triple. Nous devons parvenir à structurer le dialogue social entre l’État et les partenaires sociaux afin de garantir un pilotage et un suivi de dispositifs appelés à se développer à l’avenir. C’est le cas des excellentes mesures du Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi qui devaient accompagner la mise en place des commissaires au redressement productif, notamment celle de plateformes territoriales d’appui aux mutations. C’est l’objectif de la mission confiée à Jean-Pierre Aubert portant sur l’amélioration de l’anticipation des mutations économiques et leur accompagnement.
S’ajoutent à cela les outils mis en place par les états généraux de l’industrie, la Conférence nationale de l’industrie et la politique de filières. Il est temps de tirer les conclusions de tous ces travaux et de les traduire sous forme de politiques publiques à mettre en œuvre. Si l’État ne parvient pas à faire des choix, à indiquer des orientations – dans le secteur automobile, par exemple – les investissements de la puissance publique resteront dispersés, voire contre-productifs. En revanche, la mise en œuvre concrète de ces grandes décisions doit être confiée aux territoires, seuls à même de les adapter aux particularités du tissu économique local.
La CFDT considère qu’un comité national de pilotage, sur le modèle du comité de pilotage du CSP, pourrait être le lieu où discuter de l’ensemble de ces politiques. L’objectif est de permettre l’articulation entre toutes ces politiques et de s’assurer qu’elles fonctionnent de façon satisfaisante. Faute d’un tel pilotage, ces politiques publiques sont vouées à l’échec.
Il faudra évidemment que les régions puissent assurer l’articulation de ces décisions avec les territoires, mais dans ce domaine il n’y a pas de remède miracle.
Enfin, nous sommes convaincus que la puissance publique doit conditionner ses investissements au respect de certaines obligations, au premier rang desquelles celle de négocier avec les partenaires sociaux. Cela inciterait les entreprises à entrer dans le dispositif. Aujourd’hui, celles-ci préfèrent user du lobbying auprès des élus et de leurs réseaux pour obtenir des financements, ce qui relève quasiment du délit d’initié. Au contraire, un véritable pilotage des investissements publics mettrait toutes les entreprises sur un pied d’égalité, pourvu que leurs objectifs soient conformes aux axes prioritaires fixés par la puissance publique.
M. Mohamed Oussedik. En matière de gestion des effectifs, le problème majeur des petites entreprises est plutôt de trouver le moyen de préserver leurs compétences et leurs savoir-faire, donc leurs salariés. Celui des grandes entreprises, en revanche, semble plutôt de développer le plus large panel de dispositifs leur permettant de se séparer plus facilement de leurs salariés quand elles traversent des difficultés. Cela va du recours à l’emploi précaire – intérim, contrats à durée déterminée, recours aux stages – jusqu’aux plans de départs volontaires. S’agissant de ces derniers, la situation est paradoxale, puisque, même s’ils sont issus d’un PSE et négociés de manière collective, ces départs sont des décisions individuelles, fruits d’un accord entre l’entreprise et le salarié, donc très peu contrôlables. En outre le salarié volontaire au départ se voit octroyer de fortes indemnités. C’est autant d’argent qui ne va pas aux caisses de la sécurité sociale et aux mesures d’accompagnement des licenciements, notamment aux mesures de reclassement.
Le contrat de sécurisation professionnelle est un bon dispositif, mais il faudrait désormais qu’il passe à une autre dimension. Aujourd’hui, il ne s’applique qu’aux salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés et environ 140 000 salariés en bénéficient : il conviendrait de l’étendre aux entreprises de moins de 10 000 salariés. Quant au délai de douze mois, il est insuffisant pour permettre au salarié de se former à un nouvel emploi. Il faudrait donc augmenter les moyens consacrés au CSP et étendre le bénéficie de celui-ci à d’autres catégories de salariés : il faudrait notamment que les salariés en CDD puissent en profiter. Une telle extension fait aujourd’hui l’objet d’une expérimentation, mais celle-ci ne concerne que l’accompagnement. Il faudrait également renforcer l’attractivité du CSP afin d’inciter les salariés à adhérer à ce dispositif.
La véritable question est celle de la création d’emplois, donc de la politique industrielle. Certes, l’État a mis en place un Conseil national de l’industrie et défini une stratégie de filières, avec treize comités stratégiques et des contrats de filières. Mais cette politique manque de cohérence et de lisibilité. On ignore notamment les critères qui ont présidé à la répartition des 800 millions d’euros d’argent public déjà investis dans cette politique.
Surtout, alors que ces filières sont censées être des filières d’avenir, la plupart sont dans une situation très préoccupante sur le plan de l’emploi – je pense notamment à la filière automobile –, et la question qui est au centre des débats est celle de la reconversion de leurs salariés. On mesure l’incohérence de cette approche : soit il s’agit de filières d’avenir, et alors l’objectif des aides publiques devrait être de soutenir leur montée en gamme ; soit on considère que ces filières sont en fin de vie, et dans ce cas il faut mettre en place un vaste plan de formation et d’adaptation aux mutations. Le problème est qu’on reste dans un entre-deux qui interdit tout choix sérieux, alors qu’entre 2008 et 2013, ce sont près de 10 milliards d’euros qui ont été distribués sous diverses formes – prêts, primes, avantages fiscaux, etc. Quant aux aides décidées dans le cadre de la politique de filières, on ne sait pas si elles visent à soutenir l’emploi, l’investissement ou les entreprises. Cet argent est distribué sans que les organisations syndicales soient consultées, alors que nous sommes représentés au sein des comités de filière. Il est temps de donner de la cohérence et de la lisibilité au pilotage de ces politiques et d’évaluer l’utilisation de ces aides publiques.
L’ANI est supposé inciter les entreprises à embaucher en leur permettant de se séparer plus facilement de leurs salariés. Il y a là à mon avis une erreur de diagnostic. Au lieu d’inventer un faux problème, Il aurait fallu s’attaquer aux vrais problèmes des entreprises, notamment en aidant les PME et les PMI, c’est-à-dire les entreprises qui créent de l’emploi, à passer le cap quand elles connaissent des difficultés et à préserver leurs compétences et leurs savoir-faire. Ce problème-là, l’ANI ne permet pas de le traiter, en dépit de quelques avancées, tel le renforcement de la place des salariés dans les conseils d’administration, disposition prise à l’initiative de la CGT.
On ne voit pas bien non plus l’apport de l’ANI s’agissant des accords compétitivité emploi, même pour répondre à des difficultés conjoncturelles, d’autant qu’il était déjà possible de passer de tels accords avant la traduction législative de l’ANI.
S’agissant des licenciements économiques, les délais ont été raccourcis. Quant au comité d’entreprise, il est réputé avoir donné un avis même quand il s’est abstenu, notamment pour se donner le temps de vérifier la réalité du motif économique. Enfin, la loi n’a pas réglé le problème d’absence de motif au licenciement économique, alors que par son arrêt Viveo, la Cour de cassation appelait le législateur à dire si le juge devait annuler un PSE dans le cas où la cause économique du licenciement n’est pas établie.
La proposition de loi relative à la reprise de sites rentables est un signe de bonne volonté, même si elle ne traite pas la question de la reprise de sites industriels en général ni celle de la préservation de l’emploi en cas de transmission d’entreprise. En imposant aux dirigeants d’entreprise envisageant la fermeture d’un site de rechercher un repreneur, sous peine d’une pénalité, cette proposition de loi « visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel » va dans le bon sens. Il serait cependant nécessaire de réformer le fonctionnement des tribunaux de commerce avant de légiférer sur cette question.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Les entreprises procédant à des licenciements diffus devraient-elles être soumises à une obligation de revitalisation ?
Faut-il étendre le bénéfice du CSP aux salariés sortant d’un contrat précaire, notamment pour accompagner les licenciements des entreprises sous-traitantes et faudrait-il instituer un outil intermédiaire entre le CSP et la cellule de reclassement, qui traduisait une approche plus collective ? Faut-il instituer un droit rechargeable au CSP ?
Êtes-vous associés à la mise en œuvre de la revitalisation des territoires en aval du PSE et faudrait-il instituer une obligation de revitalisation pour les entreprises de moins de 1 000 salariés ? Pensez-vous que le dispositif d’exonération fiscale en faveur des territoires en difficulté pourrait être mieux employé ? Quel serait l’outil idéal à mettre en œuvre pour assurer la reconversion des salariés ?
M. Gérard Cherpion. Pouvez-vous préciser pour quelles raisons il faudrait consacrer plus de moyens au contrat de sécurisation professionnelle ? Les expérimentations d’extension du CSP aux contrats à durée déterminée ont permis de toucher un public plus jeune et plus qualifié : faut-il aller au-delà ?
M. Michel Beaugas. Il faut étendre et adapter le CSP aux contrats précaires et aux contrats courts. Étendre le principe des droits rechargeables au CSP me semblerait également une bonne chose, puisqu’aujourd’hui un salarié en CSP perd ses droits s’il retrouve un travail. Ces adaptations supposent des moyens supplémentaires.
S’agissant de l’obligation de revitalisation, nous pensons que la charge de la preuve doit être renversée : il faut faire peser sur les entreprises d’une certaine importance – il reviendrait évidemment au législateur de définir des seuils – une présomption d’impact négatif de leurs licenciements économiques sur leur bassin d’emploi, alors qu’actuellement la charge de la preuve repose sur l’administration. Ce serait une réponse possible à la question des licenciements diffus : aujourd’hui les entreprises qui procèdent à de tels licenciements échappent à la taxe de revitalisation du bassin d’emploi. Cela permettrait en outre d’augmenter les ressources du Fonds national de revitalisation des territoires.
Si les organisations syndicales sont consultées dans le cadre des conventions de revitalisation de bassin d’emploi, elles ne le sont qu’une fois les licenciements décidés. Pourtant, si nous étions consultés en amont de la décision de licencier, nous pourrions proposer d’autres pistes car nos équipes connaissent bien les territoires et l’impact que peut avoir la fermeture d’un site industriel.
À un moment où l’on vante beaucoup la démocratie sociale et la contractualisation, je ne voudrais pas que l’approbation d’un plan de licenciement économique par 50 % des salariés interdise son contrôle par l’administration, car ce serait faire partager aux salariés la responsabilité de leur licenciement.
M. Christian Janin. L’obligation de revitalisation doit s’inscrire dans cette nouvelle culture de gestion des entreprises que nous appelons de nos vœux. Notre sentiment est que l’absence d’anticipation des conséquences d’une décision de licenciement économique devrait coûter plus cher. Tout le problème est de fixer des critères d’évaluation dans ce domaine. Ce mécanisme vertueux aurait en outre l’avantage de traiter les problèmes de sous-traitance ou de licenciement diffus. Reste que c’est avant tout la qualité du dialogue social qui permet de construire des solutions intelligentes.
La CFDT est depuis l’origine assez réservée quant à la pertinence du CSP, considérant que c’est toute l’assurance chômage qui devait s’adapter à la situation des demandeurs d’emploi et que le licenciement économique ne devait pas fonder des droits supplémentaires. Si nous avons finalement donné notre accord à la création de ce nouveau dispositif, c’était par nécessité de faire preuve de pragmatisme dans une période de crise.
L’expérimentation de son extension à d’autres publics se révèle plutôt un échec, avec un taux d’adhésion de l’ordre de 30 %. Nous ne souhaitons pas une extension plus large, qui reviendrait selon nous à créer une assurance chômage « bis » au détriment du régime de base.
A priori, nous sommes partisans de maintenir ce dispositif comme réponse d’urgence face aux grosses opérations de licenciement économique et, dans tous les autres cas, de laisser prospérer la dernière convention tripartite entre l’État, l’UNEDIC et Pôle emploi pour assurer un accompagnement et un suivi des demandeurs d’emploi qui soient plus pertinents. Je doute a fortiori de l’intérêt d’un droit rechargeable au CSP.
Les partenaires sociaux sont aujourd’hui trop peu associés à la gouvernance locale des restructurations. Il faut imaginer des dispositifs renforcés pour les sites en difficulté et des outils de reconversion des salariés spécifiques. De telles opérations devraient être contractualisées sur des durées déterminées.
M. Mohamed Oussedik. Les organisations syndicales ne sont pas associées aux démarches de revitalisation des bassins d’emplois, qui relèvent du préfet. Certes, les pénalités prévues pour les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques représentent jusqu’à quatre fois le SMIC par salarié, mais que fait-on quand, comme c’est souvent le cas, l’entreprise est en liquidation judiciaire et que le principal objectif est de permettre aux salariés de percevoir les salaires auxquels ils ont droit ? Il est difficile, dans de telles conditions, de parler de revitalisation du bassin d’emploi.
Il faut allonger la durée du CSP : douze mois ne suffisent pas pour permettre au salarié de se projeter dans des perspectives d’emploi. Il faut également élargir le public du CSP. Faute de ces adaptations, ce dispositif va vite atteindre ses limites, en dépit du succès relatif qu’il connaît actuellement. On ne peut pas limiter cette question au risque que le CSP ferait poser sur l’assurance chômage, d’autant moins quand on sait que seul un chômeur sur deux est indemnisé.
Il faut travailler à une meilleure organisation de la politique de filières, sur le modèle de ce qui se fait en Allemagne dans le secteur automobile : Volkswagen a mis en place un système d’alerte, qui permet aux sous-traitants et aux équipementiers de s’adapter, et une responsabilité du donneur d’ordre, alors qu’en France les constructeurs automobiles dissimulent jusqu’au dernier moment leur intention de mettre en place des plans sociaux, sans se soucier de leur impact sur leurs propres sites ou sur les sous-traitants.
Il y a des dispositifs réglementaires à mettre en place pour protéger l’emploi dans les entreprises sous-traitantes – obligation d’alerte des sous-traitants, respect des délais de paiement, etc. – ainsi que des droits nouveaux à reconnaître aux salariés de ces entreprises, notamment en matière d’information : aujourd’hui, les salariés des sous-traitants sont complètement privés des droits dont bénéficient les salariés des donneurs d’ordre dans ce domaine. On pourrait envisager la mise en place d’un comité interentreprises au niveau d’un groupe ou d’un bassin d’emploi, qui assurerait au minimum l’information et la consultation de l’ensemble des représentants des salariés des entreprises sous-traitantes comme des entreprises donneurs d’ordre.
M. Olivier Carré, président. Messieurs, Mesdames, je vous remercie.
Audition du jeudi 30 mai 2013
À 11 heures : Audition de représentants du MEDEF : M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission Relations du travail, emploi, formation, et Mme Kristelle Hourques, chargée de mission senior de la direction des affaires publiques
Présidence de M. Olivier Carré, coprésident de la Mission
M. Olivier Carré, président. Nous sommes heureux d’accueillir M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission Relations du travail, emploi, formation du MEDEF, qui est accompagné de Mme Kristelle Hourques, chargée de mission senior de la direction des affaires publiques.
M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission Relations du travail, emploi, formation du MEDEF. Nous vous remercions de votre accueil. Nous étions conviés à cette réunion avec les autres organisations représentatives des employeurs. À l’heure où nous discutons de la représentativité patronale, nous voulons voir un présage dans l’absence de nos amis de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et de l’Union professionnelle artisanale (UPA), avec lesquels nous sommes en constantes relations.
Vous souhaitez d’abord connaître notre sentiment sur la place des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans le cadre des nouvelles pratiques de gestion des effectifs que sont les plans de départs volontaires, la rupture conventionnelle et la montée en puissance de l’intérim et des contrats courts.
À nos yeux, la rupture conventionnelle ne constitue pas une pratique de gestion des effectifs. Ce mode de rupture est à l’initiative aussi bien de l’employeur que du salarié. Si l’on s’en tient à l’esprit et à la lettre de la loi, il est totalement déconnecté de la situation économique et des besoins de réorganisation des entreprises. Parmi les outils qui sont à la disposition des entreprises pour adapter les effectifs à leur niveau d’activité, nous privilégions bien sûr les solutions qui permettent de maintenir le lien contractuel avec le salarié. C’est tout le sens de notre travail des dernières années. Pour peu que l’on accorde suffisamment de souplesse aux entreprises dans l’application de ces dispositifs, ils seront de nature à aider nombre d’entre elles à passer des caps difficiles sans licencier, contrairement à ce qui se passe aujourd’hui.
Les PSE ne sont pour nous qu’un ultime recours, lorsque la situation des entreprises ne leur permet vraiment pas de faire autrement que de se séparer d’une partie de leurs salariés. Ils sont parfois couplés avec des plans de départs volontaires. Lorsque ceux-ci ne sont pas mis en place seuls, ils peuvent être l’occasion pour des salariés qui n’auraient pas sauté le pas de se lancer dans une nouvelle expérience professionnelle avec un appui financier et opérationnel. Je le dis non seulement en tant que représentant du MEDEF, mais aussi en tant que directeur des ressources humaines (DRH) d’un grand groupe.
Quant à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), elle est un moyen d’anticiper les évolutions de l’activité des entreprises, et donc de limiter les réductions d’effectifs. L’accord du 11 janvier 2013 lui accorde d’ailleurs une place particulière : il accentue le lien entre la GPEC et la formation afin d’améliorer l’employabilité des salariés. La loi prévoit de soumettre à la négociation les grandes orientations du plan de formation : c’est un changement considérable. En ce domaine, un nouveau changement – alors même que le précédent n’est pas encore entré en vigueur – n’aurait donc pas de sens.
En ce qui concerne le recours aux contrats courts et à l’intérim, il faut se garder de s’engager dans des voies illusoires. Rappelons que c’est l’activité économique même qui appelle l’utilisation de ce type de contrats, en particulier les remplacements et les surcroîts d’activité. Nous sommes à mon avis dans un paradigme erroné s’agissant du contrat à durée déterminée (CDD) et de la précarité dans la société française. D’une part, nous qualifions de « précaire » un contrat court. Or un CDD de longue durée peut être précaire s’il est l’objet de constants renouvellements. D’autre part, l’organisation de notre société fait que tant que le salarié ne dispose pas d’un contrat à durée indéterminée (CDI), il lui est beaucoup plus difficile d’obtenir un prêt bancaire ou de louer un appartement. Ces réactions en cascade sont dues à une perception partielle du CDD en France. Permettez-moi de vous citer une anecdote à ce sujet. Il y a une dizaine d’années, Michel de Virville, qui fut l’un de mes prédécesseurs, avait proposé, dans son rapport Pour un droit du travail plus efficace, un CDD de cinq ans. Immédiatement, on cria à la précarisation, jusqu’au jour où le professeur Jean-Emmanuel Ray, spécialiste incontesté du droit du travail, expliqua que le CDD de cinq ans était le contrat le plus « verrouillé » au monde. Cette proposition fut néanmoins retirée. Il faut donc se demander où est la vraie précarité et en quoi elle consiste réellement. Le CDD et le contrat court sont des concepts qui mériteraient d’être approfondis.
Néanmoins, on ne peut contester qu’il y a un problème dans la mesure où, alors que 83 % des salariés sont en CDI, plus de 75 % des embauches se font en CDD. Il y a donc un travail collectif à conduire. Notre analyse est que la peur de l’embauche en CDI est liée aux risques juridiques, voire financiers qui pèsent sur l’entreprise en cas de rupture du contrat. Nous avons commencé à y apporter une réponse dans l’accord du 11 janvier, en ramenant les délais de prescription de cinq à deux ans et en rendant plus attractif l’arbitrage prud’homal par l’instauration du barème. Cela va dans la bonne direction, celle de l’instauration d’une possibilité de rompre un contrat de travail par consentement mutuel sans drame et dans le respect de l’autre, sur le modèle de ce qui existe en droit de la famille depuis 1975.
Vous nous interrogez ensuite sur la proposition de loi Brottes visant à renforcer les incitations à la recherche de repreneur dans le cas de sites rentables, et sur la manière de renforcer ces incitations sans tomber dans des sanctions confiscatoires.
Prenons un exemple : posons-nous la question de savoir comment il faudrait procéder dans le cas de la centrale nucléaire de Fessenheim. Si des propositions sont faites, elles devront être examinées avec beaucoup d’intérêt : nous sommes en effet typiquement dans un cas où la question devrait se poser. Vous ne mesurez pas l’impact négatif que cette proposition de loi peut avoir sur l’image internationale de la France, donc sur l’investissement et sur l’emploi ! À l’heure où le chômage atteint un niveau historique dans notre pays, nous avons besoin de relancer la croissance, d’envoyer des signes positifs aux investisseurs. Quelles que puissent être les bonnes intentions de son auteur, cette proposition de loi est très mal acceptée par les entrepreneurs et risque d’aggraver la situation économique de notre pays – c’est un point sur lequel je tiens à insister. Je me permets par ailleurs de soumettre deux remarques à votre réflexion. Le montant de la pénalité prévue est-il compatible d’une part avec notre droit, au regard du principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre, d’autre part avec le droit communautaire, au regard du principe de la liberté d’installation ? Comment articuler cette proposition de loi avec la loi sur la sécurisation de l’emploi ? Il est nécessaire de repartir de l’article 19 de celle-ci, qui traite du même problème.
Vous nous interrogez par ailleurs sur l’articulation entre les principaux dispositifs publics d’accompagnement des salariés, à savoir la dotation globale de restructuration, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les cellules de reclassement et les conventions du Fonds national de l’emploi (FNE).
Comme vous le savez, le CSP est réservé aux salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés ou en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Les congés de reclassement sont obligatoires dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. Dans ce cadre, depuis la création du CSP en septembre 2011, les conventions du FNE ont théoriquement disparu – même si elles subsistent parfois exceptionnellement. À nos yeux, il n’existe donc plus de problème d’articulation, comme c’était le cas avant la création du CSP. La seule redondance que l’on puisse encore constater est la mise en place de cellules de reclassement alors même que les salariés bénéficient du CSP. Il nous semble néanmoins difficile d’interdire ce type de cellules, qui sont créées à la demande des organisations syndicales en raison du manque de confiance qui subsiste à l’égard de Pôle emploi – qui gère les CSP dans 60 % des bassins – en dépit des progrès considérables réalisés ces derniers temps. Connaissant l’extrême difficulté de la tâche, je voudrais pour ma part rendre hommage à Pôle emploi. Ma remarque se veut davantage une photographie de la situation qu’une critique des efforts mis en œuvre.
Vous nous demandez si les dispositifs publics d’aide à la formation tels que le FNE formation ou les fonds d’urgence des régions sont suffisants.
Il est difficile de répondre de manière générale à cette question. Les fonds d’urgence relevant des conseils régionaux, l’appréciation que nous portons dépend de la politique de chacun d’eux. Néanmoins, notre analyse est que les conseils régionaux disposent de moyens suffisants pour aider à la restructuration des bassins d’emploi sinistrés. Lorsque tel n’est pas le cas, cela relève d’un arbitrage politique qu’il nous appartient de respecter.
Quant aux moyens du FNE formation, ils sont en baisse. Compte tenu du niveau historique de l’endettement public, c’est sans doute inévitable.
Faudrait-il créer un outil intermédiaire entre les CSP et les cellules de reclassement afin de développer des prises en charge collectives lorsque des salariés présentent des caractéristiques socio-économiques proches en termes de qualification, de parcours professionnels et de rémunération ?
Pour nous, le problème du chômage n’est pas fondamentalement un problème de prise en charge des demandeurs d’emploi ou de formation ; c’est avant tout un problème de croissance. Sur les cinq dernières années, un point de croissance a représenté en moyenne 66 000 emplois. Selon l’INSEE, la population active de la France devrait s’accroître d’environ 120 000 personnes par an dans les prochaines années. La stabilisation du chômage requiert donc une croissance d’au moins 1,5 %. Or, compte tenu des perspectives pour 2013 et 2014, il va continuer à augmenter. Le meilleur moyen de le faire reculer est donc de relancer la croissance, c’est-à-dire de diminuer les charges des entreprises, d’investir dans la recherche et développement (R&D) et de faire monter nos productions en gamme.
Dans ce contexte de faible croissance, tous les dispositifs d’accompagnement, si performants soient-ils, donnent des résultats médiocres. Le taux d’insertion du CSP est inférieur à 30 %, pour un dispositif qui coûte plus d’un milliard d’euros par an à l’assurance chômage. Comment pourrait-il en être autrement ?
En l’état actuel de la situation économique, au moment où la seule question qui vaille est celle de la création d’emplois, il ne nous paraît donc pas utile de développer de nouveaux dispositifs d’accompagnement. En l’absence d’emploi et de croissance, c’est en effet toujours vers le chômage que l’accompagnement se fera.
Au moment de la création du CSP, qui a fusionné le contrat de transition professionnelle (CTP) et la convention de reclassement personnalisé (CRP), nous avions déjà observé que lorsque l’on généralise un dispositif qui fonctionne très bien parce qu’il y a peu d’élus, cela revient en quelque sorte à passer de la haute couture au prêt à porter, si bien que le succès est souvent moindre. Nous avons malgré tout encouragé la création du CSP, mais nous ne sommes pas surpris que les résultats de la mesure aient été amoindris : l’effet de masse est inévitable.
L’ouverture du CSP aux contrats précaires est une bonne chose. Le CSP est un dispositif intéressant, moins par ses résultats, du moins à ce stade, que par le changement de culture qu’il entraîne. Je rends ici hommage aux comités de pilotage régionaux du CSP, qui réunissent les différents acteurs autour de la table pour leur permettre de jouer en équipe, ce qui était loin d’être toujours le cas auparavant. Près de 40 bassins sur 345 sont aujourd’hui concernés. Les résultats sont pour l’instant variables selon le degré de mobilisation locale. Globalement, l’expérimentation mérite cependant d’être prolongée.
De nouveaux outils publics – capacité de transformer les créances publiques en capital, création d’un fonds de retournement public – pourraient-ils être envisagés pour renforcer la capacité d’accompagnement des mutations économiques de l’État ? Nous n’avons pas d’objection sur le principe, mais il nous faudrait examiner la proposition en détail – en particulier le fonctionnement de ces dispositifs – pour nous prononcer plus avant. Sachez toutefois que nous sommes intéressés.
La mutualisation des ressources financières issues de l’obligation de revitalisation des territoires, pour les entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent à un licenciement collectif, permettrait-elle de mener des actions qualitatives en faveur de la réindustrialisation, de la reformation de sites, de la reconversion de personnels ou de l’investissement en R&D, tout en évitant les éventuels effets d’aubaine ?
L’équilibre à réaliser est subtil. Pour prendre une image, on ne peut être assuré tous risques pour le prix d’une assurance au tiers. Toute décision a sa part de risque. Entre celui d’un effet d’aubaine mais assorti d’une relance de l’emploi et le risque inverse, le choix est vite fait. Mais dans la mesure où plusieurs conventions de revitalisation seraient conclues dans le même bassin d’emploi, les contributions des entreprises pourraient être mutualisées sur des projets de ce type, les actions prévues étant de toute façon déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale (COPIRE). C’est donc une voie qu’il ne faut pas fermer.
En revanche, vous ne serez pas surpris qu’il ne nous paraisse pas opportun de soumettre les entreprises de moins de 1 000 salariés qui mettent en place un PSE à une obligation de revitalisation différenciée et proportionnée aux moyens dont elles disposent.
La question des licenciements diffus peut-elle faire l’objet d’un traitement similaire à celui des PSE afin de renforcer les objectifs de sauvegarde de l’emploi et des territoires ?
Selon nous, les règles relatives aux PSE prennent déjà en compte les pratiques de licenciement diffus : si plus de dix salariés ont été licenciés sur une période de trois mois consécutifs, tout nouveau licenciement engagé au cours des trois mois suivants est soumis à la procédure de PSE. Ensuite, tout dépend de la position du curseur, et surtout de la qualité des relations sociales et de celles qui existent entre l’entreprise et l’inspection du travail et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), certaines appliquant la règle de manière très stricte et d’autres moins.
J’en viens à la pratique généralisée de la prime supra-légale partiellement défiscalisée, qui évite aux entreprises de financer des reconversions.
Les mesures contenues dans un plan social sont fonction des possibilités financières de l’entreprise et des besoins des salariés. Elles sont longuement discutées avec les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, même lorsque celles-ci ne signent pas toutes l’accord – ce qui est fréquent. L’administration dispose déjà d’un droit de regard sur le contenu du PSE, et peut formuler des observations. Nos partenaires attirent régulièrement notre attention sur le caractère parfois néfaste de ce qu’ils appellent le « chèque valise ». Nous les comprenons fort bien : la généralisation systématique de cette prime n’est bonne ni en soi, ni pour les salariés, qui en font parfois un usage très discutable. Nous essayons donc de trouver des solutions de substitution. Néanmoins, il faut reconnaître qu’en pratique, les demandes des salariés – relayées par les organisations syndicales – vont toutes dans ce sens. Lorsque nous proposons des mesures de reclassement, souvent plus coûteuses pour l’entreprise, dans neuf cas sur dix le salarié préfèrera le « chèque valise ». Nous avons donc collectivement le devoir de réfléchir à la manière de faire évoluer les comportements. C’est un sujet à la fois légitime et difficile.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Je souhaite précisément vous interroger sur la prime supra-légale, et notamment sur l’idée d’instaurer un plafonnement encadré, qui permettrait d’éviter les « chèques valise ».
Au-delà de cette question, j’aimerais vous interpeller sur le volet revitalisation des territoires des PSE. Dans la phase amont, la réflexion collective portée par les organisations syndicales et les entreprises se traduit généralement par des mesures d’accompagnement ou de reconversion, mais peut négliger le territoire. C’est souvent une difficulté pour les élus locaux et les acteurs des territoires. Quel est votre sentiment ? Quels outils faudrait-il mettre en place pour mieux anticiper les restructurations que connaissent nos grandes filières – ce que nous n’avons pas toujours su faire ? La désindustrialisation des dix dernières années en France est liée non seulement au poids des charges sociales, mais aussi à un certain attentisme. Comment faire évoluer la gouvernance du système pour prendre en compte une approche plus territorialisée de la réponse dans la phase suivante ?
Ma deuxième question porte sur l’anticipation nécessaire pour améliorer l’acceptabilité des PSE. Loin d’être le fruit de la volonté ou de la mauvaise humeur du chef d’entreprise, le PSE est la conséquence directe de la nécessité de faire face, à un moment donné, à des contraintes qui peuvent appeler des réponses douloureuses. Néanmoins, l’anticipation, à travers la GPEC et l’information des salariés sur la réalité de la situation de l’entreprise, permet une meilleure acceptabilité du PSE, donc une plus grande adaptabilité des salariés. Or, il est très délicat pour une entreprise de communiquer sur sa situation. Comment envisagez-vous, à partir de votre expérience, l’association le plus en amont possible des salariés à la réalité des difficultés traversées par l’entreprise pour favoriser l’accompagnement ?
M. Benoît Roger-Vasselin. À votre deuxième question, il est très difficile d’apporter une réponse générale, valable pour tout type d’entreprise. Je suis moi-même directeur des ressources humaines d’un grand groupe dans le secteur de la communication. Dans ce groupe, le turnover structurel est de 21 %. Dans un secteur comme le nôtre, qui est l’un de ceux qui sont le plus rapidement touchés par les changements de conjoncture, la stricte application des procédures de la GPEC permet tout au plus de s’adapter à une conjoncture déjà dépassée. Le turnover naturel que nous constatons nous permet de ne pas remplacer tous les départs. Mais cela peut se révéler bien plus compliqué dans d’autres secteurs, notamment les secteurs industriels. La réponse réside alors davantage dans des accords de branche que dans une vision collective globale. Les situations sont en effet si complexes et diverses qu’une vision trop générale risquerait de déboucher sur des réponses inadaptées. Il revient donc à chaque branche – dans la mesure du possible – de faire les propositions les plus adaptées au type d’entreprises qu’elle représente.
Je reviens à votre première question. Comment faire pour prendre davantage en considération les aspects territoriaux ? C’est une question délicate, sur laquelle il existe des divergences parfois importantes – par exemple entre la CFDT et FO, l’une étant de culture plutôt girondine, l’autre plutôt jacobine. Selon les plus optimistes, un travail d’équipe fidélisé par des relations de confiance entre les partenaires sociaux locaux, les élus et la puissance publique pourrait donner des résultats extrêmement intéressants ; mais selon d’autres – les plus nombreux –, cela risque d’aboutir à des chasses gardées.
Une voie particulièrement féconde serait de suivre l’exemple des comités de pilotage du CSP et d’apprendre à travailler en équipe, dans le respect des prérogatives de chacun et avec le souci de l’intérêt général. Certes, il y a un écart entre cette ambition et les expériences qui nous remontent du terrain, mais je préfère une vision délibérément volontariste et optimiste à un constat désabusé.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Que pensez-vous des comités stratégiques de filières (CSF) ? Quels sont leurs atouts et leurs faiblesses ? Considérez-vous qu’ils participent à la difficulté de déterminer une politique générale ? Ne serait-il pas préférable de revenir à un pilotage au niveau des branches et des territoires ?
Concernant les nouveaux outils destinés à mieux anticiper et accompagner des mutations économiques, vous vous déclarez prêts à entendre nos propositions ; mais vous, que proposeriez-vous ?
Vous avez rappelé que la formation professionnelle était de la responsabilité de la région. Or, aujourd’hui, certaines formations ne sont pas pourvues faute de candidats. Estimez-vous qu’il faudrait faire évoluer les relations entre le monde économique et les régions, de manière à mieux adapter les formations aux besoins du terrain ?
M. Benoît Roger-Vasselin. À notre avis, il n’existe aucune contradiction entre les CSF et les branches ; le problème est de bien les articuler. Il importe de développer une vision stratégique, et le MEDEF y travaille. Avant-hier soir, nous avons, avec l’UPA, la CGPME, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, présenté à la presse un rapport commun sur la question. D’une manière générale, nous considérons qu’une réflexion stratégique collective nationale, voire européenne, devrait aller de pair avec un affinement à l’échelon local ; il faut veiller à la bonne complémentarité des deux, tout en évitant les redondances.
S’agissant des nouveaux outils, nous sommes demandeurs d’un dialogue qui nous permettrait d’aller davantage dans le détail ; nos équipes sont à votre disposition pour cela. Il reste que dans la période actuelle, pour nous, la priorité est le retour de la croissance : tant que le bateau n’avance pas, il ne sert à rien d’agiter le gouvernail dans tous les sens. À notre avis, cela implique une diminution générale des charges, mais nous sommes parfaitement conscients de la difficulté de la situation et nous reconnaissons les efforts qui ont été faits. Depuis que Laurence Parisot en a pris la direction, le MEDEF a l’intérêt général comme point de mire ; au « y’a qu’à… faut qu’on », nous préférons le dialogue et la réflexion collective avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les régions.
Pour ce qui est de la responsabilité des régions dans la formation professionnelle, il peut en sortir le meilleur comme le pire. Il fut très compliqué de persuader les entrepreneurs du bien-fondé de l’accord de 2009, car selon eux il n’y avait aucune raison que l’argent des entreprises serve à pallier les carences de l’éducation nationale ; ils estimaient en outre qu’ils n’avaient pas à former des jeunes qui n’avaient jamais travaillé et qui n’avaient pas été formés. Avec Jean-François Piliard, nous avons fini, après moult difficultés, par les convaincre qu’il fallait être solidaires avec ces jeunes. En tant que directeur des ressources humaines, j’ai toujours été choqué par l’attitude de mes collègues qui reprochent à des jeunes de ne pas avoir de première expérience sans vouloir la leur offrir. Mon équipe, qui comprend une trentaine de personnes, est organisée en groupes de cinq ; quand un poste se libère, les quatre autres doivent recruter un jeune qui n’a jamais travaillé, lequel prend en retour l’engagement de procéder de même par la suite. Cela fonctionne ainsi depuis une douzaine d’années, et certains de mes collaborateurs ont accédé à des fonctions importantes après avoir commencé de cette manière ; malheureusement, je n’ai pas réussi à étendre ce mode de fonctionnement au reste du groupe !
Dans l’idéal, il serait important qu’à l’échelon territorial, les élus participent à la formation professionnelle, mais d’après les échos que j’ai du terrain, les entrepreneurs craignent que les élus ne fassent main basse sur la formation professionnelle et la réservent aux chômeurs. Or, s’il nous semble normal que la formation professionnelle paie son écot, nous récusons le sophisme – répandu à droite comme à gauche – consistant à dire que l’argent de la formation professionnelle ne doit pas servir à former des personnes déjà formées : permettre à un ingénieur de se maintenir au plus haut niveau suppose de dépenser beaucoup d’argent en formation professionnelle.
Là encore, je veux être optimiste. Si l’on se met autour d’une table, si chacun essaie de comprendre les problèmes des autres, si les élus dialoguent avec les partenaires sociaux locaux, en liaison avec les partenaires sociaux nationaux – qui déterminent les grandes orientations stratégiques –, on peut aboutir à des résultats de qualité. Nous avons prévu d’aborder la question lors de la grande conférence sociale des 20 et 21 juin prochains, dans le cadre du groupe de travail « Emploi et formation professionnelle » ; d’ailleurs, la commission que je préside au MEDEF s’appelle désormais « Relations du travail, emploi et formation », parce que les trois sont liées.
Nous sommes donc prêts à travailler en ce sens, mais à condition de faire passer l’intérêt général en premier. Or les échos que j’ai du terrain sont plutôt pessimistes. Du coup, il y a des tentations de repli de la part de certains employeurs. Il faudrait arriver à restaurer un climat de confiance, de façon à ce que les entrepreneurs comprennent qu’il est de leur intérêt que la formation professionnelle se passe au plus prêt du terrain ; quant aux élus locaux, ils devraient être attentifs à ne pas donner l’impression aux entreprises qu’ils veulent les déposséder de la formation professionnelle.
M. Gérard Cherpion. Un licenciement diffus, c’est quand une entreprise – par exemple une banque – procède à un licenciement collectif sur l’ensemble du territoire français. Je me permets donc de vous reposer la question : pensez-vous que cela pourrait faire l’objet d’un traitement similaire à celui des PSE ?
Ne pourrait-on pas envisager une mutualisation de tout ou partie de la prime supra-légale, de manière à satisfaire des demandes qui ne sont pas prises en compte par les PSE, comme un déménagement ou une formation lointaine ?
M. Benoît Roger-Vasselin. Je reconnais que j’avais envisagé les licenciements diffus sur une période plutôt que sur un territoire ! Que les choses soient claires : nous trouverions parfaitement légitime que cette pratique soit régulée si elle tendait à se systématiser ; mais n’oublions pas que, dans le cas des banques, les salariés, même lorsqu’ils perdent leur emploi, continuent à être très bien traités dans le cadre des plans sociaux : il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal ! Néanmoins, il faut certainement procéder à un ajustement.
S’agissant de la prime supra-légale, comment envisageriez-vous sa mutualisation ? Il n’y a pas de sujet tabou, et nous savons que cette solution est la plus demandée par les organisations syndicales et par les salariés.
Je crois qu’il existe une très grande disparité entre les petites et les grandes entreprises sur la question. Les grandes entreprises peuvent se permettre de faire des plans très « généreux » – au point que certains employés demandent à être intégrés dans le plan social, et que ce qui est à l’origine une mesure destinée à compenser un préjudice devient un effet d’aubaine. Les organisations syndicales alimentent ce cercle vicieux en soulignant que, vu les profits réalisés par ces entreprises, cela ne changera pas grand-chose pour elles. Or des centaines de milliers de petites entreprises ne peuvent pas faire de même, et leurs salariés ont de ce fait l’impression d’être mal traités.
Aujourd’hui, on en viendrait plutôt à regretter le fameux plan social de Lu, qui avait mis tant de monde dans la rue et avait fait l’objet d’une telle pression médiatique ! Du côté syndical comme du côté patronal, on considère désormais qu’il était plutôt généreux. S’il a été si mal perçu, c’est parce que l’accompagnement humain était insuffisant. Il est évident que les entreprises sont prêtes à donner plus d’argent aux salariés à qui elles créent un préjudice, en échange d’une réduction des délais qui favoriserait une reconversion rapide.
Mettre en place un système homogénéisé et mutualisé n’est pas dans nos projets, mais, sur le principe, je ne vois aucun inconvénient à ce qu’on examine la question sous cet angle, car la situation actuelle n’est pas satisfaisante. Il conviendrait cependant d’évaluer avec précision les conséquences d’une telle mesure.
Mme Dominique Lassus-Minvielle, magistrate à la Cour des comptes. Quelle est votre opinion sur le FNE formation ?
Veillez-vous à la diffusion de bonnes pratiques en matière de revitalisation, sachant que les entreprises tantôt réalisent elles-mêmes le montage des actions, tantôt le délèguent à des cabinets spécialisés ? Y a-t-il une harmonisation des pratiques à partir de ces retours d’expérience ?
M. Benoît Roger-Vasselin. L’harmonisation des pratiques se fait surtout branche par branche, et les résultats sont inégaux. Dans le cadre du groupe de travail « Échanges de bonnes pratiques », nous essayons de recenser les pratiques qui ont obtenu de bons résultats. L’objectif est de produire un document de synthèse afin que, malgré la conjoncture difficile, les chefs d’entreprise soient sensibilisés à des solutions de maintien ou de réorientation de l’emploi, grâce à l’activité partielle, à la formation professionnelle ou aux autres outils existants. Pour le moment, le rendu est disparate : les résultats sont très contrastés non seulement suivant les branches, mais aussi suivant les territoires. Lorsqu’ils sont positifs, c’est qu’il y a eu une relation de confiance et un travail d’équipe. Je ne sais pas si les résultats seront suffisamment pertinents pour qu’on puisse en tirer une règle générale, mais c’est une démarche qui nous paraît indispensable.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Dans l’hypothèse d’un travail d’équipe, qui devrait être le chef de file ?
M. Benoît Roger-Vasselin. La question fait débat. Certains considèrent que les partenaires sociaux doivent le rester, d’autres pensent qu’il est préférable que la région tienne ce rôle dès lors que des règles claires sont arrêtées. Nous sommes plusieurs à être prêts à faire l’essai : nous considérons que, dans la continuité de la loi Larcher, il serait légitime que les élus locaux soient en première ligne ; il faudrait toutefois que les choses soient strictement codifiées, car les partenaires sociaux craignent d’être dépossédés. C’est pourquoi il est si nécessaire d’établir une relation de confiance.
M. Olivier Carré, président. Monsieur Roger-Vasselin, je vous remercie.
Audition du jeudi 13 juin 2013
À 9 heures : M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif en Haute-Normandie
Présidence de M. Olivier Carré, coprésident de la Mission
M. Olivier Carré, président. Monsieur Cauvet, vous êtes commissaire au redressement productif de la région Haute-Normandie. Nous vous remercions d’avoir répondu à la demande des membres de cette mission d’information et de contrôle qui ont souhaité pouvoir bénéficier de votre expérience en tant que commissaire au redressement productif. Nous avons déjà auditionné votre collègue, Monsieur Pham Ngoc, qui est commissaire pour la région Nord. Un regard complémentaire sur une région aux caractéristiques différentes nous a paru utile.
Après vos propos liminaires, les rapporteurs Christophe Castaner et Véronique Louwagie vous poseront quelques questions.
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. J’ai été nommé dans cette fonction par M. Arnaud Montebourg à la suite de la circulaire du 14 juin 2012. Je suis le seul commissaire au redressement productif dont le corps d’origine est la direction du budget, en l’occurrence la direction des finances publiques. Environ la moitié des commissaires au redressement productif provient des Directions générales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (les DIRECCTE), en général du pôle « entreprises », l’autre moitié du corps préfectoral.
Compte tenu de mon expérience des relations entre créanciers publics et entreprises en difficulté, j’ai rédigé une note à l’intention du cabinet de M. Montebourg sur la non-application des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 relative aux remises de dettes par les créanciers publics en procédure collective.
La survie d’entreprises en difficulté confrontées aux procédures judiciaires de conciliation, de sauvegarde ou de redressement peut être facilitée par des remises de dettes accordées par les créanciers publics. Cette faculté s’exerce très rarement alors qu’elle constitue le moyen de ne pas aboutir à un plan de sauvegarde de l’emploi.
En Haute-Normandie, j’étais le principal collaborateur du TPG, devenu maintenant le directeur des finances publiques, sur l’accueil des entreprises en difficulté. Je présidais la commission des chefs de services financiers qui octroyait des délais et éventuellement des remises.
J’ai constaté que le dispositif était très peu mis en œuvre en Haute-Normandie comme ailleurs. À titre d’exemple, en 2011, en Haute-Normandie, sur 1 178 ouvertures de procédures collectives par les tribunaux de commerce (dont 410 sauvegardes ou redressements judiciaires – hors conciliations), 44, soit 3,7 % seulement, ont donné lieu à saisine du Comité des créanciers publics. Cinq dossiers ont été menés à leur terme et examinés en commission, et un seul a donné lieu à une remise.
En 2012, au plan national, selon les données du ministère du budget (DGFIP), seules 69 remises sur 61 000 procédures collectives ouvertes ont été accordées pour un total de 20,8 millions d’euros, soit une moyenne de 301 k€ par dossier. La procédure continue à ne pas être utilisée pour différentes raisons qu’il convient d’examiner.
L’article L. 626-6 du code de commerce prévoit que les créanciers publics, en cas de procédures de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent procéder à la remise de tout ou partie de leurs créances. Cet article est généralement celui qui est cité, mais en réalité divers articles du code sont applicables selon les procédures retenues.
Le principe est qu’une entreprise qui est soumise à une procédure judiciaire de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peut bénéficier de la remise de tout ou partie de ses créances publiques (essentiellement l’Urssaf) sous trois conditions :
– Les remises qui auparavant ne pouvaient porter que sur l’accessoire peuvent maintenant porter sur le principal,
– Les demandes de remises doivent être faites dans les deux mois de l’ouverture de la procédure collective. Or ce délai de deux mois est trop court pour les administrateurs judiciaires compte tenu des autres délais de procédure et notamment des délais nécessaires à l’obtention des documents dont ils ont besoin,
– Les créanciers publics doivent se prononcer dans les deux mois de la constitution complète du dossier. À défaut, la demande est réputée rejetée.
Il existe une deuxième possibilité d’obtenir des remises de la part des créanciers publics : en cours d’exécution d’un plan d’apurement du passif, sa révision peut être demandée au tribunal si une modification dite « substantielle » est intervenue. Cette possibilité semble n’être jamais utilisée.
Le délai de deux mois est trop court pour les administrateurs d’autant que le nombre de dossiers augmente régulièrement à effectif constant d’administrateurs. La constitution du dossier en plusieurs étapes ne facilite pas non plus les choses. Dans de nombreux cas, l’administrateur dépose dans les deux mois une demande incomplète. Les créanciers publics l’acceptent même si elle n’est pas rigoureusement conforme aux exigences de la loi. Pour différents motifs le dossier complet n’est jamais constitué et ne donnera pas lieu à l’attribution de remises par les créanciers publics. C’est réellement dommage parce que des entreprises auraient pu être sauvées ou reprendre une activité dans de bien meilleures conditions si elles avaient pu bénéficier de ces remises.
J’ai rencontré beaucoup d’entreprises depuis que j’ai pris mes fonctions de commissaire au redressement productif. Certains entrepreneurs n’avaient que des dettes publiques, notamment auprès de l’Urssaf et ne savaient pas qu’il existait des possibilités de remises. D’autres avaient des plans d’apurement de dettes très lourds qui auraient pu être considérablement allégés par des remises, ne serait-ce que de 20 ou 30 % sur leurs créances publiques. Ils auraient pu rebondir, investir et avoir d’autres ambitions que leur seule survie.
Je pense que la loi pourrait être améliorée si on allongeait le délai de deux mois à quatre ou six mois ou si on autorisait le dépôt de la demande de remise pendant toute la période d’observation, c'est-à-dire toute la période pendant laquelle le tribunal de commerce analyse la situation de l’entreprise pour savoir si elle peut ou non survivre compte tenu de ses capacités financières.
Si un délai fixe devait être maintenu, il faudrait créer une possibilité de relevé de forclusion pour rouvrir les dossiers, notamment quand le commissaire au redressement productif apprend qu’une entreprise aurait pu être aidée par des remises qui n’ont pas été faites.
Si des entreprises sont placées en liquidation judiciaire dès leur arrivée au tribunal de commerce, d’autres le sont quand elles ont un plan de redressement qui n’est pas respecté. Il est dommage qu’un plan de redressement avec essentiellement des dettes publiques ne puisse faire l’objet d’aménagements.
Sur le montant des remises :
Comme je vous l’ai dit, avant la loi de sauvegarde, les commissions de chefs de services financiers pouvaient octroyer des remises sur la totalité des pénalités et majorations mais aucune remise ne pouvait être faite sur le principal.
La loi de sauvegarde a introduit la possibilité de faire des remises sur le principal, à l’exception des impôts indirects (TVA). Dans les faits, la principale dette publique qui peut faire l’objet d’une remise est celle de l’Urssaf, souvent assez significative. Quand une entreprise dépose le bilan, le dernier mois de salaire n’est pas payé et l’Urssaf ne l’est pas non plus.
La pratique des remises a un impact très limité pour le budget de l’État. Elles portent sur des créances privilégiées, mais pas superprivilégiées. En procédure de redressement, les créances salariales sont assez importantes et l’Urssaf est loin d’être désintéressé.
L’attribution de remises allège le plan de redressement et évite à des entreprises de se retrouver en situation de liquidation judiciaire.
M. Olivier Carré, président. Je vous remercie de votre exposé très concret et très étayé.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Merci d’être rentré dans le vif du sujet. Votre démarche est particulièrement intéressante. Je voudrais que vous reveniez sur le fait que le dispositif existe mais est très peu utilisé, d’abord vous l’avez dit parce qu’il n’est pas connu et ensuite parce qu’il est très encadré dans le temps. Mais n’est-ce pas aussi parce que, par nature, le représentant de l’État qui à un moment donné doit gérer une dette publique fait en sorte d’inscrire cette dette et n’entre pas dans la négociation ? Ne pensez-vous pas que nous sommes confrontés à un problème culturel et que c’est la doctrine de l’État plus que les textes qui devraient évoluer ?
Autre question, l’abandon de créance peut être considéré comme une subvention déguisée et est donc encadré juridiquement et très sensible politiquement. Pourrait-on envisager de transformer les créances publiques en capital de l’entreprise. L’État plutôt que d’être « actionné » deviendrait acteur. La créance ne serait pas éteinte mais elle serait associée.
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. La dernière question relève d’une appréciation qu’il ne m’appartient de formuler en tant que fonctionnaire. Mais effectivement cela pourrait être envisagé.
Je pense que cela pourrait être très utile, pas forcément pour toutes les entreprises, mais pour celles du secteur des nouvelles technologies. Pendant les premières années, leurs dépenses sont très importantes (en particulier les frais de recherche et de développement) et elles consomment très vite leur capital. Elles se retrouvent après deux ou trois ans avec des dettes publiques alors qu’elles ont des perspectives de développement à relativement court terme.
Vous dites que les comptables publics ont tendance à vouloir retenir l’argent de l’État. La compétence pour octroyer les remises de créances publiques appartient à la commission des chefs de services financiers présidée par le directeur des finances publiques. Elle ne comporte aucun membre de l’administration capable de porter une appréciation sur l’intérêt économique de l’entreprise à sauvegarder. Il pourrait être souhaitable que lorsque la commission a à se prononcer sur une remise de principal de dettes publiques, elle prenne conseil auprès d’acteurs plus avisés.
Le directeur des finances publiques est en même temps secrétaire du Codefi qui est lui-même présidé par le préfet. Le Codefi régit un certain nombre d’administrations dont la DIRECCTE qui a des connaissances sur les entreprises en difficulté plus fines que la commission des chefs de services financiers. Il pourrait être utile que la commission des chefs de services financiers se prononce avec l’avis du Codefi.
Sur le premier point, le respect des réglementations relatives aux aides publiques, la circulaire cosignée par les quatre fonctionnaires d’administrations concernées rappelle les conditions dans lesquelles les remises doivent être octroyées, c'est-à-dire des conditions identiques à celles que ferait un opérateur privé dans les conditions normales du marché.
La remise ne peut pas être assimilée à une aide d’État et donc soumise à la réglementation européenne relative aux aides publiques. C’est la raison pour laquelle il est prévu que, dans l’instruction des demandes, on se réfère à l’effort parallèle fait par les créanciers privés et les actionnaires.
M. Olivier Carré, président. Le fisc et les créanciers publics sont privilégiés par rapport aux créanciers chirographaires. N’y a-t-il pas là une ambiguïté ? Ne faudrait-il pas mettre les créanciers publics au même rang que les autres créanciers ?
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. C’est une question à laquelle je n’ai pas réfléchi. Mais les créanciers privilégiés sont primés par les créanciers super-privilégiés et en réalité ils n’arrivent pas en rang utile.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Je voudrais que vous reveniez sur les dossiers déposés en plusieurs fois et qui sont problématiques.
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. Dans les deux mois d’ouverture de la procédure, on doit déposer la demande accompagnée d’un certain nombre de pièces. Une fois que la demande est enregistrée on complète le dossier par un certain nombre d’autres pièces, et c’est souvent là qu’il y a un blocage parce que ces pièces n’arrivent jamais. Les administrateurs sont débordés et n’ont absolument pas le temps de s’occuper des petits dossiers. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’entreprises vont directement en liquidation judiciaire alors qu’elles auraient des chances de survivre en redressement.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Ne pourrait-on pas donner l’initiative du recours à cette procédure à d’autres acteurs que l’administrateur ou le mandataire ? Ce pourrait être le juge commissaire ou le chef d’entreprise, encore qu’il soit dessaisi d’un certain nombre de pouvoirs.
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. Pourquoi pas ? Ce tiers pourrait être le commissaire au redressement productif. Le nombre d’entreprises qui nous saisit est extrêmement élevé. J’ai ouvert plus de 190 dossiers depuis le 1er juillet dernier. Quand nous sommes positionnés en préfecture, nous n’avons aucun collaborateur et gérons l’urgence en permanence. Si les commissaires au redressement productif pouvaient bénéficier de l’appui d’une équipe, ce serait très positif.
Le commissaire au redressement productif correspond véritablement à un besoin. Je viens de la direction des finances publiques et c’est le TPG qui avait la vocation d’accueil des entreprises en difficulté. Cela ne fonctionnait pas parce que les entrepreneurs ne venaient pas se confier à leur percepteur. Ils pourraient aller voir la chambre de commerce ou la chambre des métiers, mais ne veulent non plus se confier à leurs pairs surtout dans la période actuelle.
Dès qu’une entreprise est connue pour avoir des problèmes, ses difficultés s’accroissent. La consigne de M. Montebourg était d’intervenir avant que l’entreprise ne se retrouve en situation de redressement judiciaire, position dans laquelle elle n’a plus la confiance de ses partenaires. J’ai l’exemple d’une entreprise en plan de redressement depuis 8 ans, qui respecte scrupuleusement ses échéances et pour qui tout se passe bien, à qui la banque refuse tout prêt.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Je voudrais avoir des précisions sur les remises. Peuvent-elles être accordées au moment de la négociation du plan proposé par les repreneurs ?
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. C’est au début de la procédure que l’on décide si cette remise sera de 30 ou 40 %, voire de 100 % sur la partie « pénalités et majorations ».
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Le plan est décidé après la période d’observation qui peut être renouvelée, donc cela peut-être au bout de six mois. Ce serait intéressant que ce soit à ce moment-là que la remise puisse intervenir en fonction d’un plan présenté et qui retiendrait l’attention de l’ensemble des acteurs. C’est là qu’une remise est intéressante parce qu’elle permet la poursuite de l’activité et constitue une aide forte.
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. C’est la raison pour laquelle il serait très utile de prolonger la période de deux mois parce que l’opportunité de la remise n’est pas toujours ressentie par les personnes qui suivent le dossier dans les deux premiers mois, mais seulement quand ils ont une bonne connaissance de la situation de l’entreprise. Il faut d’abord rétablir la réalité des chiffres avant de pouvoir dire s’il faut ou non faire des remises.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Je voudrais revenir sur la question de votre positionnement et des moyens du commissaire au redressement productif. Aucun commissaire au redressement productif n’a la même fonction sur l’ensemble du territoire et beaucoup n’ont pas le même positionnement. Vous êtes placé auprès du préfet, d’autres sont dans les DIRECCTE, d’autres sont responsables de service de ces DIRECCTE et « accessoirement » commissaires au redressement productif.
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. Tous ceux qui sont d’origine préfectorale se consacrent uniquement à l’activité de commissaire au redressement productif, mais ceux qui sont dans les DIRECCTE ont parfois une activité à temps partagé.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Je voudrais savoir quelle appréhension de la question de la gouvernance globale de l’accompagnement vous donne votre expérience et si vous souffrez de l’absence d’ordonnateur public qui puisse trancher sur ces sujets.
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. La gouvernance des entreprises en difficulté est à mon avis beaucoup trop laissée à la main des comptables publics. Ce sont eux qui ont la compétence pour gérer le recouvrement et ses à-côtés, c'est-à-dire les pénalités et majorations. C’est vrai qu’en commission des chefs de services financiers, surtout dans les petits départements, on n’a pas de connaissance physique de l’entreprise, on ne va pas sur le terrain, on ne connaît pas l’intérêt économique que présente la sauvegarde de telle ou telle entreprise, on croit ce que nous dit le chef d’entreprise. Le secrétariat, assuré par les services du directeur des finances publiques, est commun à la commission des chefs de services financiers et au CODEFI. Les DIRECCTE, elles, savent si l’entreprise présente un intérêt au plan national et international.
Les comptables publics ont trop tendance à porter un jugement à partir du seul comportement fiscal de l’entreprise. En commission des chefs de services financiers, il est très difficile d’obtenir une aide pour une entreprise en redressement fiscal. Ce n’est parce qu’un chef d’entreprise n’a pas respecté la loi qu’on doit sacrifier l’activité économique et les emplois représentés par son entreprise, surtout si son activité est exportable.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Vous avez dit que vous n’aviez pas les moyens des DIRECCTE et évoqué les cellules de veille et d’alerte que vous avez mises en place. Comment sont-elles composées ?
Quelles sont vos suggestions pour faire évoluer le dispositif du commissaire au redressement productif ?
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. Participent à la cellule de veille et d’alerte tous les services de l’État plus la région, directement en lien avec l’activité économique de l’entreprise. Les sous-préfectures, la direction des finances publiques, la Banque de France, la DRIRE, la DREALE sont tous les services que je peux actionner dès que j’ai une difficulté. On a ajouté les régions parce qu’elles aident les entreprises par des prêts sans intérêt. Ma principale activité est d’orienter des entreprises qui ne savent pas du tout à qui s’adresser le jour où elles sont en tension. Elles ignorent des dispositifs aussi simples que celui du chômage partiel ou le crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises, par exemple, qui peut permettre de récupérer en une quinzaine de jours des fonds qui font défaut.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Vous avez évoqué la situation de redressement judiciaire comme une condamnation, les entreprises ne pouvant plus soumissionner aux marchés publics pour des raisons de protection juridique du donneur d’ordre. Pensez-vous que l’on pourrait revenir sur cette interdiction ?
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. C’est le problème du non accès aux marchés publics des entreprises en phase de procédure collective. On pourrait revenir sur ces dispositions, mais il ne faut pas perdre de vue qu’elles ont été prises pour éviter aux acheteurs publics de se retrouver devant des entreprises qui ne feraient pas face à leurs engagements.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Les tribunaux de commerce, souvent à l’initiative du président, peuvent lancer des procédures d’enquête sur les entreprises en difficulté. Ces enquêtes ne sont pas publiques, mais est-ce qu’en tant que commissaire au redressement productif vous en avez connaissance ?
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. Je n’ai pas eu de liens avec les tribunaux de commerce aussi soutenus que j’aurais souhaité les avoir parce que j’ai été submergé par le nombre de dossiers à traiter. Si le rôle des commissaires était au départ d’aller à la recherche des entreprises en difficulté, grâce à la communication qui a été faite sur la création de la fonction, les entreprises sont venues spontanément vers nous. Ceci dit, il m’arrive fréquemment d’envoyer des entreprises voir le président du Tribunal de commerce dans le cadre de la prévention. Le président les conseille sur la date de dépôt et les informe sur la façon dont cela va se passer ; mais la peur du tribunal de commerce est très forte.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur le volume d’entreprises que vous avez reçues depuis un an et votre sentiment sur la réussite du dispositif du commissaire au redressement productif ? Quel est le volume des entreprises qui ont tiré un véritable bénéfice de ce dispositif ?
M. Christophe Castaner, rapporteur. Sur les 190 dossiers que vous évoquiez toute à l’heure, combien correspondent à des demandes d’information parce que la zone est tendue et combien sont des dossiers d’entreprises véritablement en danger ?
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. Les entreprises qui viennent me voir sont toutes dans une situation très délicate.
Certaines situations ne sont pas du ressort de la commission des chefs de services financiers mais relèvent de problèmes avec l’administration pour des procédures qui n’avancent pas assez vite et qui mettent l’entreprise en difficulté. Je peux intervenir à différents niveaux pour faire avancer le dossier. En réalité, j’interviens sur toute situation d’entreprise qui peut conduire à terme à un dépôt de bilan ou une disparition. Les problèmes de trésorerie représentent plus de la moitié des dossiers, mais ce ne sont pas les seuls. Trois secteurs très touchés par la crise : le bâtiment, les transports et le travail des métaux.
M. Christophe Castaner, rapporteur. L’essentiel des difficultés rencontrées par les entreprises correspond à une baisse du chiffre d’affaires liée à la concurrence. Est-ce que vous êtes confrontés aux problèmes de tensions sur la trésorerie et de besoins en fonds de roulement qu’elles connaissent pour passer les caps difficiles ?
M. Christian Cauvet, commissaire au redressement productif. Il m’arrive souvent de téléphoner à des banques en leur demandant d’agir pour une entreprise qui a des problèmes de trésorerie. Je leur indique que la commission de chefs des services financiers va octroyer des délais de paiement exceptionnels mais leur demande en contrepartie de faire un effort. Cela est d’autant plus facile que depuis 2009 la commission des chefs de services financiers peut octroyer des délais non seulement sur des créances échues mais aussi sur des créances à échoir. Dans ce cadre-là, aucune publicité du privilège du Trésor n’est faite et les partenaires de l’entreprise ne peuvent pas connaître la tension de trésorerie. Le président du tribunal de commerce n’approuve pas toujours cette pratique parce qu’il considère que les aides des créanciers publics en matière de délais accroissent les difficultés des entreprises. Dans l’hypothèse où elles ne se redresseraient pas, il serait alors plus difficile d’établir un plan d’apurement.
M. Olivier Carré, président. Il me reste à vous remercier. C’était particulièrement utile et éclairant.
Audition du mercredi 11 septembre 2013
À 16 heures 15 : M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Présidence de M. Olivier Carré, coprésident de la mission
M. Olivier Carré, président. Nous concluons nos travaux relatifs à la prévention et à l'accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) en recevant aujourd'hui M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Si le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi s'est stabilisé autour de 1 000 par an en moyenne ces dernières années – soit moitié moins que ce qu'il était dans les années 1990 –, l'impact social et économique de la perte de plusieurs dizaines ou centaines d'emplois dans des territoires continue de poser des problèmes d'accompagnement et d'anticipation à la puissance publique.
En matière d'anticipation, la question des incitations à développer une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou à recourir au chômage partiel se pose. De même celle des dispositifs publics dont l'objectif est d'identifier ou d'aider les entreprises en difficulté : plusieurs de nos interlocuteurs ont mis en lumière les évolutions qu’il convient de conduire à ce sujet en fonction de la nouvelle répartition des responsabilités territoriales en matière de politique économique.
L'accompagnement des salariés victimes de licenciements économiques collectifs suscite également des interrogations. En effet, des outils tels que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le Fonds national pour l'emploi (FNE) ou la dotation globale de restructuration (DGR) ont vu leurs crédits augmenter ces dernières années, sous l'effet de la crise, jusqu’à atteindre près de 300 millions d'euros pour les seuls dispositifs pilotés par l'État et ce sans qu'ait été menée une véritable évaluation de leur efficacité.
Enfin, l’action en faveur de la revitalisation des territoires pâtit d’effets de dispersion, de l'absence de consultation des salariés et d’un défaut de logique économique.
Sur tous ces sujets, Monsieur le ministre, nous sommes désireux de vous entendre.
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le président, vous venez de rappeler que le nombre de PSE atteignait environ le millier par an ; il reste stable depuis plusieurs années, à l’exception de la grave crise économique de 2009. Dans au moins 30 % des cas, ces plans concernent des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires, qui sont des situations très spécifiques.
Les licenciements économiques ne sont à l’origine que de 3 à 7 % des inscriptions à Pôle emploi, soit entre 150 000 et 300 000 personnes par an : les statistiques du chômage augmentent donc bien plus en raison de l’effet des fins de CDD ou des missions d’intérim qu’en conséquence des PSE. Cependant, ces chiffres bruts ne rendent pas compte de l’importance de tels événements : ces plans constituent, en effet, la partie visible des mutations qui affectent en profondeur notre économie et donc l’emploi, ce qui justifie une action des pouvoirs publics. Les intérimaires et les salariés en CDD sont les premiers touchés par les difficultés des entreprises et l’on sait à quel point - excessif - ces contrats précaires se sont répandus dans notre pays ; mais il ne faut pas perdre de vue que chaque destruction d’emploi intervenant dans le cadre d’un PSE se répercute sur la chaîne des sous-traitants, des prestataires, des très petites entreprises, des artisans et des commerçants.
Les PSE traduisent également une perte de potentiel industriel qu’il est ensuite difficile de reconstituer, contrairement à ce qui se passe pour certaines activités de services. Ils marquent l’échec de l’anticipation et l’absence d’adaptation négociée pour éviter de faire de l’emploi la variable d’ajustement, au prix d’un gâchis des compétences dans de nombreux territoires.
L’État a déjà agi sur ce sujet et devra continuer de le faire dans les prochaines années. Les commissaires au redressement productif (CRP) ont comblé un vide en améliorant la coordination des instances aptes à aider les entreprises avant qu’elles n’en arrivent à envisager des licenciements ; ils constituent pour les PME un référent apprécié et sont à même de mobiliser les différents outils de l’État et des collectivités territoriales. Ils ont ainsi contribué à sauver des milliers d’emplois.
Nous avons également souhaité donner un nouvel élan à la politique en faveur des filières : la création du conseil national de l’industrie (CNI) contribue au renforcement du tissu productif et à la montée en gamme des entreprises, gages d’emplois durables. J’ai veillé à ce que, dans ce domaine, toute notre politique d’emploi et de formation – contrats d’études prospectives et actions de développement de l’emploi et des compétences – soit étroitement coordonnée avec celle qu’anime le ministère du redressement productif ; ce point est crucial, car il n’y aura pas de filières industrielles performantes si les salariés ne possèdent pas les compétences requises pour les développer et pour occuper les nouveaux emplois. La charte automobile pour les années 2012-2015, que j’ai signée en décembre dernier, constitue un bon exemple d’une démarche tripartite de formation définie en fonction des enjeux industriels de la filière.
L’anticipation et la prévention des licenciements doivent occuper une place centrale dans la stratégie des entreprises ; il faut reconnaître que la France a des progrès importants à réaliser à ces égards. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi apportera des changements majeurs dans la culture de l’adaptation des entreprises ; elle ouvre des espaces de négociation et de dialogue permettant de mieux anticiper les évolutions de l’activité et des compétences et d’améliorer les dispositifs de maintien de l’emploi pour que cette variable ne soit pas celle qui soit immédiatement utilisée en cas de difficulté économique. Il faut tourner le dos à la préférence française pour le licenciement !
Tout cela nécessite de partager en amont, de confronter les points de vue, de faire davantage participer les salariés qui sont souvent les meilleurs experts de leur métier. D’où les choix faits avec cette grande réforme : présence des salariés dans les conseils d’administration des grandes entreprises, consultation du comité d’entreprise sur la stratégie, création d’une base de données économiques et sociales unique, et articulation de la GPEC à la stratégie et au plan de formation.
À ces instruments d’anticipation il convient d’ajouter ceux que nous avons donnés aux entreprises pour s’adapter aux difficultés et éviter les pertes d’emplois et de compétences : mobilité interne, mobilité volontaire sécurisée, compte personnel de formation, accord de maintien de l’emploi et simplification du recours à l’activité partielle pour rendre celle-ci plus accessible aux PME.
Le territoire est à la fois le creuset dans lequel se forgent les avantages compétitifs et l’espace de vie des salariés ; le Gouvernement cherche à articuler efficacement les actions de développement économique avec celles en faveur de l’emploi et de la formation. Tel est le sens des mesures d’appui à la gestion territoriale des emplois et des compétences, des conseils destinés aux très petites entreprises, de la promotion de campagnes menées par plusieurs entreprises et des plateformes de mutation économique mises en place dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. L’une de ces plateformes concerne le programme de lignes à grande vitesse (LGV), immense chantier qui emploie beaucoup de salariés mais qui aura une fin ; nous élaborons donc dès maintenant les actions de reconversion nécessaires pour que les travailleurs ne se retrouvent pas sans solution ce moment venu. C’est en effet tout le sens d’une politique moderne d’anticipation de l’emploi : donner aux acteurs le pouvoir de négocier des alternatives aux destructions d’emplois et sécuriser l’activité – grâce à des dispositifs comme celui des filières – et les transitions entre emplois. Si l’on ne peut arrêter le mouvement de l’économie, on peut en effet le devancer pour l’organiser et faire en sorte que de moins en moins de salariés aient à passer par la « case chômage » entre deux emplois. Il convient également de protéger et de développer les compétences, matière première de l’économie moderne – ce que devrait permettre la future réforme de la formation professionnelle.
Notre défi est de réussir l’articulation de l’ensemble des dimensions de cette politique – filières, entreprises et territoires –, non pour corseter l’action des uns et des autres, mais pour accroître la compétitivité et ainsi maintenir et développer l’emploi.
Nous connaissions depuis longtemps les lacunes dont souffrait la gestion des restructurations : faible anticipation, délais de procédure légaux rarement respectés et de ce fait sources d’incertitude pour les entreprises et les salariés, essor de la judiciarisation où l’affrontement entre avocats remplace le dialogue social, respect formel d’une procédure plutôt que recherche de solutions alternatives et prévalence croissante de la « logique du chèque » sur la recherche de mesures permettant aux salariés licenciés de retrouver un emploi. C’est à tous ces défauts que la loi de sécurisation de l’emploi s’attaque afin de transformer profondément l’encadrement des licenciements économiques.
Cette loi renforce le dialogue social dans le cadre d’une procédure qui donne de la visibilité aux parties prenantes, permet de maîtriser les délais – fixés à deux, trois ou quatre mois selon le nombre de licenciements envisagés – et encadre les conditions de recours à l’expertise. Le projet de licenciement économique pourra désormais s’inscrire dans le cadre d’un accord collectif, majoritaire et négocié au sein de l’entreprise. L’élévation de la qualité du PSE doit aboutir à un meilleur accompagnement des salariés dans leur retour à l’emploi, en contrepartie de délais mieux maîtrisés et d’une plus grande sécurité juridique pour l’entreprise. À défaut d’un accord collectif majoritaire, l’État homologuera le PSE et sera donc le garant de sa qualité.
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) apprécieront les PSE en fonction des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise, des mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciements et des efforts de formation et d’adaptation déjà engagés. La loi accroît donc l’incitation à former les salariés, car ceux-ci seront alors plus aptes à retrouver un emploi. La DIRECCTE engagera l’entreprise à prendre en compte la situation du salarié ainsi que les possibilités de redéploiement dans le bassin d’emploi. L’appréciation se fera au cas par cas et ne se limitera donc pas à la simple vérification du déploiement de dispositifs types.
J’ai surtout demandé à mes services de veiller à ce qu’il n’y ait pas de disproportion entre les mesures indemnitaires et les mesures d’aide active à la recherche d’emploi. Cette question – dite du « chèque » – est complexe : notre volonté n’est pas de réduire les indemnités extralégales, mais nous savons qu’un chèque ne remplace pas la formation nécessaire à une reconversion. La loi a d’ailleurs allongé le congé de reclassement, porté à douze mois, et nous avons, pour les entreprises en procédure collective, ouvert la voie à une prise en charge de dispositifs actifs de reclassement par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
La loi de sécurisation de l’emploi n’est entrée en vigueur que le 1er juillet dernier, ce qui n’offre que peu de recul pour juger de ses effets mais le fait que le nombre de procédures engagées – 79 – soit comparable à celui qui était enregistré précédemment démontre que les entreprises n’ont pas retardé le lancement de licenciements collectifs pour bénéficier de l’application de ce texte. Près de la moitié de ces cas – 45 % – concernent des procédures collectives de redressement ou de liquidation judiciaires, qui ne permettent pas d’évaluer les spécificités du nouveau dispositif légal. Les DIRECCTE ont déjà rendu 35 décisions, presque exclusivement pour des entreprises en procédure collective car les délais y sont plus courts que dans les situations de droit commun. Elles ont refusé cinq fois l’homologation lors de la première demande, ce qui a permis d’améliorer le contenu du PSE ou de le rendre conforme au droit.
Point fondamental à nos yeux, la négociation entre les partenaires sociaux sort nettement renforcée de ces deux premiers mois d’application. Ainsi, pour les procédures non collectives, une discussion a été engagée dans 75 % des cas – il est vrai que j’ai donné instruction aux DIRECCTE de favoriser le dialogue.
Le contrôle effectué par celles-ci ne sera bien sûr pas le même selon que les plans sociaux seront issus d’un accord majoritaire ou non. Ces négociations prennent des formes différentes – dans un tiers des cas, elles se situent en amont de la procédure alors que, dans d’autres, elles se développent en parallèle à celle-ci – et portent sur des sujets variables – calendrier, moyens accordés, articulation entre les différentes consultations ou nature des mesures. Deux accords majoritaires ont déjà été conclus et plusieurs sont sur le point de l’être.
Même si une certaine prudence s’impose dans l’appréciation de ces premiers résultats, les débuts de l’application de la loi sont donc encourageants et j’espère que la culture de la négociation prospérera.
L’intervention de l’État ne se cantonne pas à la procédure : il facilite le dialogue en tant que conseiller des parties et financeur des dispositifs d’accompagnement. Plusieurs outils d’intervention aident les salariés à s’adapter pour prévenir les licenciements ou, lorsque ceux-ci ont eu lieu, pour favoriser leur retour à l’emploi. La loi de sécurisation de l’emploi a réformé l’activité partielle en augmentant l’aide apportée aux entreprises et aux salariés pour les aider à faire face à cette diminution temporaire de l’activité. Les conventions de formation et d’adaptation du FNE permettent aux salariés d’acquérir de nouvelles qualifications ou de se reconvertir afin de rester dans l’emploi. En cas de licenciement, l’État – surtout pour les entreprises non soumises au congé de reclassement – intervient par le biais du CSP, dispositif essentiel du PSE pour les PME et pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). En lien avec les cellules d’appui, le CSP peut apporter, pour les PSE importants, un soutien similaire à celui du congé de reclassement. Ces mesures seront d’autant plus efficaces qu’elles seront articulées avec l’action menée en faveur des territoires.
Aux termes de la loi, l’administration recevra un bilan détaillé des PSE, ce qui aidera à recenser les bonnes pratiques, et donc à améliorer la qualité des reclassements, et contribuera à responsabiliser les entreprises. Il importe en effet avant tout que les salariés retrouvent rapidement un emploi et toute notre énergie doit être tendue vers cet objectif.
Le fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) contribue à l’amélioration des dispositifs de reclassement pour les salariés des entreprises soumises à la concurrence ; il a principalement été utilisé par le secteur automobile – parfois avec difficulté comme pour Renault et PSA. La France et d’autres pays se sont mobilisés pour son maintien lorsqu’il a été question de le supprimer. La réforme de ses critères d’attribution nous oblige à développer notre capacité à présenter des dossiers suffisamment solides pour pouvoir bénéficier de ses crédits. Notre pratique, en effet, a trop souvent été contraire de celle de l’Allemagne, qui souhaitait la suppression du FEM dans un souci d’économies, mais qui en a été la première utilisatrice, alors même qu’elle n’était pas le pays le plus confronté aux restructurations.
L’obligation de revitalisation des territoires – spécificité française – crée une responsabilité à la charge des entreprises dont les PSE affectent l’équilibre d’un ou de plusieurs bassins d’emploi. Elles sont en effet tenues de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois dans ces territoires à hauteur du nombre de postes supprimés. Ces actions doivent s’inscrire dans une stratégie de développement partagée au niveau local, d’où la signature d’une convention qui associe l’État, les collectivités territoriales, les syndicats et les chambres consulaires. Dans ce domaine également, il convient de favoriser l’anticipation car plus on agit en amont, plus la transition s’effectue rapidement ; la recherche de repreneurs participe d’ailleurs de cette démarche tout comme le nouveau calendrier de négociation des conventions. La revitalisation ne doit pas devenir une taxe supplémentaire que l’entreprise acquitterait sans se préoccuper du territoire où elle est implantée. Il y a lieu d’encourager les actions ayant un impact durable dans le bassin d’emploi : les aides au recrutement sont souvent utiles, mais elles entraînent aussi des effets d’aubaine et ne favorisent pas nécessairement l’emploi local. Mieux vaut donc parfois privilégier des mesures plus qualitatives – comme la mise à disposition de compétences, le soutien à l’insertion par l’activité économique (IAE), le transfert de savoir-faire ou l’aide aux initiatives conjointes des entreprises – dont les conséquences seront plus durables et plus fortes. Enfin, il convient d’éviter la concurrence entre petites conventions, qui conduit au saupoudrage.
Nous nous battons tous les jours pour préserver des emplois. L’État n’est pas impuissant : il dispose de marges de manœuvre et d’instruments – participation, reconversion, recherche d’alternatives, développement des compétences, transitions sécurisées – qui lui permettent de mener une politique intelligente et efficace. Nous ne pourrons certes pas gagner tous les combats dans ce domaine, mais sans notre action – sécurisation de l’emploi, politique des filières, rénovation des procédures des PSE, mesures de relocalisation –, beaucoup d’emplois auraient été détruits au cours des derniers mois. Je ne doute pas, mesdames et messieurs les députés, que vous avancerez vous-mêmes des propositions nous permettant d’améliorer si nécessaire les dispositifs déjà en place.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Nous avons proposé au bureau de la MEC de travailler sur la prévention et l’accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi avant que ne soit négocié l’Accord national interprofessionnel (ANI) ; le vote de la loi de sécurisation de l’emploi qui a transposé celui-ci nous a donc conduits à revoir quelque peu notre projet, certaines propositions que nous aurions été amenés à formuler figurant dans ce texte.
Monsieur le ministre, de quels moyens disposent les DIRECCTE pour accompagner l’application de cette loi ? Vous avez indiqué qu’elles apprécieront la qualité des PSE, mais une inquiétude s’exprime sur leur capacité à remplir cette mission, du fait notamment du transfert à venir des anciennes directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) aux conseils régionaux.
Nous sommes également préoccupés par l’absence, pour apprécier ces plans, d’un guide méthodologique qui permettrait de se fonder sur des critères objectifs. Nous croyons savoir qu’un travail a été mené pour combler cette lacune : pouvez-vous nous en dire plus ?
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le sujet délicat des indemnités supralégales. Nous souhaiterions que la part de celles-ci soit la moins importante possible afin de faire passer l’intérêt des territoires et l’intérêt général avant l’intérêt individuel. Mais notre proposition de plafonner ce montant – qu’il soit fixe ou indexé sur le SMIC – se heurte au principe de la liberté contractuelle, de sorte que nous réfléchissons à une mesure fiscale ou sociale qui le limiterait. Une telle disposition pourrait cependant conduire à un durcissement de la négociation, les salariés cherchant à raisonner en indemnité nette. Jusqu’où pourrions-nous aller dans notre volonté de plafonnement sans aller contre la liberté contractuelle ?
Au cours des précédentes auditions, nous nous sommes aperçus des difficultés rencontrées par les entreprises pour discuter en amont avec les salariés des reconversions sur les postes en tension ; cela conduit à repousser ce dialogue pour ne pas faire naître dans l’esprit des salariés l’idée qu’un PSE serait imminent. Il y a donc lieu de conduire un travail approfondi en vue d’améliorer l’anticipation : quelles sont vos pistes de réflexion sur ce sujet ?
Nos collègues Gérard Cherpion et Gaëtan Gorce avaient déposé en 2009 une proposition de loi visant à instituer une obligation de revitalisation des territoires en cas de licenciements diffus. Ces derniers ne pourraient-ils pas être pris en compte dans l’obligation de participation des entreprises au plan de revitalisation du territoire ?
M. le ministre. Les DIRECCTE n’ont pas découvert les PSE lorsqu’elles ont reçu compétence d’homologuer ces plans. Déjà très impliquées dans cette procédure, elles formulaient des observations à l’entreprise. Il n’y aura donc pas de surcroît considérable de travail, mais la nécessité d’adopter une nouvelle démarche intellectuelle : c’est sur cet aspect que nous souhaitons insister. J’ai ainsi mis en place un accompagnement de nos services, notamment par l’installation d’un nouveau système d’information et par l’adoption d’un plan de formation ambitieux qui bénéficiera à près de 250 de nos agents, ainsi que par la création d’un groupe d’appui national reposant sur la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et sur la direction générale du travail (DGT), afin d’assurer un soutien juridique et opérationnel et de favoriser l’harmonisation des pratiques. Les DIRECCTE doivent donc s’organiser pour utiliser au mieux les compétences disponibles et pourront être aidées pour ce faire par le groupe d’appui. Enfin, une grille de lecture commune assurera une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire pour que, tout en s’adaptant aux situations locales, l’administration donne des réponses identiques aux situations comparables.
Madame Louwagie, le Gouvernement souhaite comme vous plafonner les indemnités supralégales. Le principe de liberté contractuelle vous empêchera de limiter leur montant, mais l’administration, qui juge du contenu du PSE, refusera un plan qui se limiterait à des chèques. Les salariés souhaitent parfois que les indemnités constituent le cœur du PSE, mais de tels dispositifs n’ont plus aucune utilité au bout de deux ans s’ils n’ont pas été assortis de mesures en faveur de la formation ou du retour à l’emploi. Il ne faut certes pas priver de la possibilité de percevoir de telles indemnités certaines catégories de personnels répondant à des conditions spécifiques – âge ou très faible mobilité –, mais les DIRECCTE doivent veiller à éviter une surenchère préjudiciable à l’individu comme à la collectivité.
La question de l’anticipation est décisive. Si le dialogue sur les difficultés de l’entreprise a été repoussé trop longtemps – que ce soit du fait du patron ou des salariés –, le coût en termes de licenciements s’accroît ; en sens inverse, plus on anticipe les évolutions et plus les mesures de transition et de mobilité seront de qualité. Lorsqu’une entreprise parle de GPEC, on imagine aussitôt qu’elle se trouve en très mauvaise posture, alors que ce sujet devrait justement être abordé très en amont de toute difficulté. La loi de sécurisation de l’emploi comporte donc des dispositions qui visent à faire de la GPEC une pratique courante de la vie de l’entreprise et obligent les partenaires sociaux à discuter de cette question avant que les problèmes ne deviennent insurmontables. Nous devons mener une action pédagogique auprès des acteurs sociaux pour que ce changement – demandé par les chefs d’entreprise comme par les représentants des salariés – se concrétise rapidement. L’anticipation et la GPEC ne sont d’ailleurs pas seulement utiles pour prévenir les problèmes : elles peuvent aussi aider à maîtriser une phase de développement qui emporte des conséquences pour les salariés en termes de mobilité et d’acquisition de compétences.
Certaines grandes entreprises – notamment dans le secteur des services – procèdent à des licenciements d’ampleur affectant dans des proportions diverses les bassins d’emploi où elles sont implantées. L’élargissement de l’obligation de revitalisation aux entreprises qui effectuent ces licenciements diffus rétablirait une égalité de responsabilité entre elles ; cela nécessiterait la définition d’un seuil national cohérent avec la notion d’impact significatif qui fonde la logique de la revitalisation. Le Gouvernement serait intéressé par les propositions que vous pourriez émettre sur le sujet.
Mme Martine Pinville. Monsieur le ministre, vous insistez sur l’anticipation, démarche qu’il est en effet important de développer. À cette fin, et pour enrichir les PSE, ne serait-il pas utile d’avoir une connaissance fine des emplois non pourvus existant dans chaque bassin ? Il semble qu’ils se comptent en dizaines de milliers.
M. Philippe Vigier. Alors que les PSE « montent en puissance », les plans de revitalisation sont restés à un niveau assez faible. Ainsi le plan social récemment adopté chez Ethicon, à Auneau, consacre dix fois moins d’argent à la revitalisation – environ 2,5 millions d’euros – qu’aux primes supralégales qui permettent d’acheter la paix sociale. D’autre part, s’il est judicieux d’aider les salariés ayant trouvé un emploi moins bien rémunéré que le précédent, l’introduction dans les PSE de mesures de formation concurrençant celles que mettent en œuvre les régions ou l’introduction de primes de mobilité dans un accord qui a un caractère global me paraissent très contestables. Se pose également un problème de « traçabilité », une partie des salariés changeant de région par exemple.
En outre, les cabinets recrutés pour conduire les plans de revitalisation sont de qualité très inégale ; un rapport rédigé il y a deux ans démontrait que leurs résultats variaient dans une proportion de un à cinq ! L’encadrement et le suivi doivent impérativement être améliorés, de manière à mieux maîtriser les délais et les coûts, qui peuvent varier les uns et les autres du simple au triple, sans lien avec l’efficacité constatée.
Si cette politique concerne bien plusieurs ministères, il importe de désigner un chef de file qui ne peut être selon moi que le ministère de l’emploi, d’autant que la validation des PSE relève des DIRECCTE.
Il faut certes anticiper, mais nous, élus, sommes bien démunis en la matière : on est prompt à nous opposer le délit d’entrave. Pour cette raison, en Eure-et-Loir, alors qu’une procédure juridique bloquait toute évolution depuis deux ans, nous n’avons pas pu proposer aux salariés d’une entreprise des reconversions ou des formations qui leur auraient permis d’occuper des emplois ouverts à une centaine de kilomètres. Soixante-dix d’entre eux auraient ainsi pu occuper des postes correspondant à leurs compétences et disponibles à peu de distance dans le département.
Mme Isabelle Le Callennec. S’agissant de la prévention des licenciements, monsieur le ministre, pouvez-vous faire le point sur les accords de compétitivité qui ont pu être signés depuis la promulgation de la loi sur la sécurisation de l’emploi ? Dans la mesure où ils préexistaient à celle-ci, quels changements a entraînés l’application de cette loi ? Nous avions plaidé pour que ces accords incitent les entreprises à adopter une attitude offensive, au lieu d’être purement défensifs : est-ce une option que vous avez retenue ?
Nous ne devons pas attendre, en effet, que se produisent des drames humains comme celui de l’usine Goodyear à Amiens, où les difficultés s’accumulaient depuis des années. Il convient donc de travailler en faveur d’une culture de la mobilité, professionnelle et géographique, ce qui nécessite un changement de discours : plutôt que d’inciter les salariés à tenir bon jusqu’à ce qu’ils obtiennent un chèque aussi élevé que possible, mieux vaut insister sur les emplois qui leur sont ouverts à proximité. Renouons donc avec la démarche qui inspirait le contrat de sécurisation des parcours : aidons ces salariés à faire le deuil de leur entreprise et à chercher du travail dans d’autres entités qui ont besoin de leurs compétences ! L’article 10 de l’ANI visait à faciliter la mobilité géographique en prévoyant une convention entre l’État et Action Logement, ce que la loi de sécurisation de l’emploi a repris, mais en se tenant peut-être en retrait : des actions sont-elles réellement menées dans ce domaine, sachant que nombre de salariés refusent des emplois éloignés de leur domicile pour une question de logement ?
M. le ministre. Le problème des emplois non pourvus doit être appréhendé dans sa globalité, madame Pinville. Nous devons traiter à la fois l’urgence et l’avenir.
L’urgence : j’ai demandé à l’ensemble des acteurs locaux – fédérations professionnelles, organisations syndicales, DIRECCTE et préfets – de déterminer le nombre d’emplois actuellement vacants – correspondant à des postes précisément décrits dans une fiche, ouverts, mais non occupés. Ils l’ont estimé à 30 000. Dans chaque région, un comité de pilotage, placé sous la double autorité du préfet de région et du président du conseil régional, travaille à l’organisation des formations nécessaires pour 30 000 personnes identifiées par Pôle emploi comme disposant des compétences leur permettant d’occuper ces emplois après une formation d’un à six mois. Nous souhaitons que l’effort soit poursuivi à un rythme équivalent l’année prochaine, afin de pourvoir au total 100 000 emplois. Pôle emploi estime qu’entre 120 000 et 130 000 emplois par an pourraient ne plus être vacants grâce à ce dispositif de formation.
Pour le futur, nous allons conduire une réforme de la formation professionnelle. En effet, que celle-ci soit tournée vers les jeunes – compétence régionale – ou vers les chômeurs – responsabilité principalement assumée par l’État même si le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et les partenaires sociaux financent des formations –, une rénovation s’avère nécessaire pour parvenir à des solutions durables, pour permettre le repérage des emplois et de ceux qui peuvent les occuper, et pour développer les programmes de formation nécessaires. Au-delà de la sécurisation individuelle des parcours, c’est un enjeu essentiel dont j’ai saisi les partenaires sociaux, qui commenceront à se réunir le 24 septembre pour préparer cette réforme ; ce travail débouchera sur un projet de loi que je vous présenterai au début de l’année prochaine. Un saut extraordinaire a été effectué grâce à la loi de 1971 qui a institué la formation professionnelle : présentée par un gouvernement de droite mais à la suite d’une impulsion donnée par M. Jacques Delors, elle a fait l’unanimité. Cependant, cette loi remonte à une époque où le niveau d’éducation était beaucoup plus bas qu’aujourd’hui et le chômage quasi inexistant. La situation étant tout autre aujourd’hui, il nous faut un nouveau dispositif, tenant compte à la fois de l’élévation générale des compétences et d’un taux de chômage élevé. Cela s’impose d’autant plus que les défauts de la formation professionnelle telle qu’elle est actuellement organisée expliquent en partie le maintien du chômage à un taux de 7 à 8 % même en période de croissance dans notre pays.
M. le président Olivier Carré. Je partage depuis longtemps ce diagnostic, monsieur le ministre !
M. le ministre. Madame Le Callennec, je comprends que vous continuiez à faire référence aux accords compétitivité-emploi : il s’agissait en effet des termes utilisés par M. Nicolas Sarkozy au début de l’année 2012. Mais la loi nous oblige dorénavant à parler d’accords de maintien de l’emploi. Cette appellation exprime d’ailleurs bien leur caractère défensif, puisque l’objectif est de cesser de réduire le nombre de salariés dès que surviennent des difficultés économiques. Il faut dorénavant agir sur d’autres variables, telles que l’organisation du travail ou les rémunérations, à l’exemple de ce qui a été fait dans le secteur automobile en Allemagne : chez Volkswagen, lors des creux de l’activité, le temps de travail et les salaires ont été réduits en contrepartie du maintien de l’emploi. Le redressement de la situation ayant ensuite permis le versement de primes, il s’avère que les salariés sont au total gagnants sur les quatre dernières années.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, compte tenu des délais légaux, deux accords de maintien de l’emploi seulement ont été signés : ils sont le fait, en Loire-Atlantique, de l’entreprise Walor où étaient précédemment prévus des licenciements, mais où les salariés ont pu conserver leur emploi en échange d’une nouvelle organisation du travail, et, en Alsace, de l’entreprise Behr. Mais beaucoup d’autres accords de ce type sont en cours de négociation.
La dimension offensive de la politique de l’emploi repose sur la volonté que manifeste l’entreprise d’anticiper, y compris en acceptant d’ouvrir le débat sur les évolutions prévisionnelles de son activité. Renault a adopté cette stratégie en négociant un plan visant à prévenir des difficultés. La loi favorise ces démarches en privilégiant l’accord majoritaire.
S’agissant de la mobilité, l’objectif réside, là encore, dans la sécurisation de l’emploi ; il s’agit de prévoir les mouvements, d’implantation ou de regroupement d’activités, et de préparer – « à froid », bien entendu – des accords de mobilité pour répondre à ces évolutions. Ces accords peuvent être signés par des organisations représentant au moins 30 % des salariés, à condition que ne s’y opposent pas d’autres organisations représentant une majorité de ces mêmes salariés – ce mode de ratification différant de celui des accords de maintien de l’emploi qui, compte tenu des contreparties salariales qui peuvent être requises, doivent recueillir l’agrément de syndicats ayant obtenu les suffrages d’au moins 50 % des personnels. Très attendu par les entreprises et souhaité par les syndicats, le dispositif a néanmoins été critiqué par certains comme susceptible de déboucher sur une obligation de mobilité ; tel n’est pas son objet, qui est d’accompagner les mobilités en les anticipant.
Quant à la question du logement, elle ne peut être résolue par la loi mais nous devons en effet réfléchir aux moyens de lever ce qui est un des principaux freins à la mobilité – et je sais que les organisations patronales s’en préoccupent aussi de leur côté.
Monsieur Vigier, je ne peux qu’approuver une bonne part de vos réflexions et suggestions.
M. Christophe Castaner, rapporteur. Dans le triptyque constitué des filières, des entreprises et des territoires, c’est le changement qui fait difficulté ; ainsi il n’est pas une seule filière en France qui échappe à la nécessité d’une profonde restructuration, et ce bouleversement se répercute dans l’entreprise où il suscite des inquiétudes.
L’inquiétude tient aussi à l’incapacité d’ouvrir un dialogue serein sur les difficultés à venir : on a mentionné l’appréhension que suscite la GPEC, mais on sait aussi que l’ouverture d’une procédure collective est vécue comme une première étape conduisant à la disparition de l’entreprise. La Mission avancera à ce propos une proposition en faveur des entreprises placées sous sauvegarde de justice : pour une société de BTP, le fait d’être exclue des marchés publics équivaut à une condamnation à mort.
Cette question de la capacité à accepter le changement se pose aussi pour les territoires et ne peut là encore être réglée que par un surcroît d’anticipation. Je ferai quatre suggestions un peu techniques dans cette perspective.
L’obligation de contribuer aux opérations de revitalisation ne concerne aujourd’hui que les entreprises de plus de 1 000 salariés : ne pourrait-on abaisser ce seuil à 250 salariés ?
L’entreprise Lejaby constitue l’exemple d’une conversion réussie grâce, notamment, à la mobilisation du FNE-Formation. Or, la suppression des crédits alloués aux cellules de reclassement a fait passer le budget de celui-ci de 38 millions d’euros en 2010 à 24 millions d’euros en 2013. Il conviendrait aujourd’hui de conforter ce fonds, et ce pour renforcer non seulement les actions de formation, mais aussi l’approche collective. En effet, si la plupart des acteurs reconnaissent les aspects positifs du CSP, le reproche lui est fait de privilégier une approche individuelle alors que les cellules de reclassement offraient un espace collectif dont les salariées de Lejaby, par exemple, ont tiré avantage pour prendre un nouveau départ.
Il nous paraîtrait également utile de ressusciter le Fonds national de revitalisation des territoires (FNRT) en étendant sa compétence aux bassins en difficulté qui ne bénéficient pas de conventions de revitalisation.
Enfin, les procédures européennes sont certes complexes, mais comment peut-on accepter, dans la situation économique actuelle, que n’aient été mobilisés l’année dernière que 40 % des crédits du FEM, doté d’un montant pourtant déjà faible – 500 millions d’euros pour l’ensemble des pays de l’Union européenne ?
M. le ministre. S’agissant du FEM, j’ai souligné les contradictions, à la fois de ceux qui n’en voulaient pas mais qui l’utilisaient et de ceux qui le réclamaient sans en profiter. Vous avez raison de dénoncer le paradoxe d’une faible consommation des crédits du fonds dans une période de difficultés économiques. Cela étant, il faut aussi prendre en compte l’inadaptation des critères d’attribution à la situation de certains pays – dont le nôtre. C’est pourquoi nous avons insisté pour que ces critères soient revus dans le cadre de la nouvelle programmation européenne.
S’agissant du FNRT, un rapport de l’Inspection générale des finances de 2011 a conclu que le prêt à la revitalisation des territoires (PRT) n’avait pas apporté la preuve de son utilité par rapport aux autres prêts participatifs gérés par Oséo, dont les caractéristiques sont proches. Cela dit, je serai très attentif aux propositions que vous avancerez sur le sujet.
Je vois bien ce qui vous incite à demander d’abaisser à 250 salariés le seuil de l’obligation de revitalisation : les PSE concernant des entreprises de plus de 1 000 salariés sont rares dans bon nombre de départements. Cependant, la mesure reviendrait à imposer une nouvelle charge aux entreprises de taille intermédiaire – que nous cherchons au contraire à conforter – et ce sans conséquences financières importantes, donc sans grand bénéfice pour la revitalisation. Le Gouvernement est donc sceptique sur l’intérêt d’une telle proposition.
Nous avons relancé le FNE-Formation, dont les crédits atteignent 24 millions d’euros en 2013. C’est certes moins que les 38 millions d’euros de 2010, mais cette année avait été celle d’un pic lié à la crise. De 5 millions d’euros en 2004, puis de 7 millions en 2007, ce fonds n’était d’ailleurs monté qu’à 21 millions en 2009. On ne peut donc parler de baisse ; en outre, le nombre des bénéficiaires potentiels n’a pas cessé d’augmenter. Il s’agit d’un bon outil qu’il convient sans doute d’adapter aux circonstances.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure. Comme l’a dit mon collègue rapporteur, nos interlocuteurs se déclarent satisfaits du CSP – à l’exception de la perte de l’aspect collectif –, mais qu’en est-il des tests actuellement menés dans des bassins d’emploi en vue d’en étendre le bénéfice à des titulaires de CDD ou de contrats précaires, et éventuellement à des salariés d’entreprises sous-traitantes ?
M. le ministre. Des expérimentations sont en effet conduites pour tester l’ouverture des CSP aux contrats précaires au lieu qu’ils soient réservés aux seuls salariés licenciés. Nous déciderons de cette extension une fois l’évaluation de ces essais connue.
M. le président Olivier Carré. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d’avoir répondu à nos questions. Nous espérons pouvoir auditionner prochainement le ministre du redressement productif.
M. Jean-Pierre Gorges. Ce serait utile pour clarifier les compétences sur ce sujet au sein de l’État.
M. le ministre. Les DIRECCTE regroupent les services du ministère du redressement productif et ceux de mon ministère dans les régions – ce qui permet une unification des points de vue et des réponses apportées –, et elles assument le rôle du chef de file.
M. le président Olivier Carré. Mais, s’ils paient de leur personne, les commissaires au redressement productif n’ont pas tous la même conception de leur propre rôle. Sans doute cela tient-il à la fois à la diversité des territoires comme à celle de leur passé professionnel…
M. le ministre. Vous en débattrez avec M. Montebourg mais ces commissaires ont joué un rôle incontestablement positif, ne serait-ce que parce que les entreprises ont trouvé en eux des interlocuteurs clairement identifiés.
*
* *
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () En pratique, elles sont souvent amenées à le faire : environ 35 % des PSE sont élaborés dans des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, c’est-à-dire dans des entreprises défaillantes dont l’état de cessation des paiements a été constaté par le Tribunal de commerce.
3 () Les ruptures amiables intervenant dans le cadre de plans de départs volontaires sont donc assimilées au licenciement pour motif économique. De ce fait, on ne peut pas les isoler statistiquement des licenciements économiques.
4 () Ce dispositif permet de mutualiser les moyens humains, notamment d’expertise, et financiers (souvent par des crédits à taux zéro), des grandes entreprises au profit des PME.
5 () Comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle.
6 () M. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement (BPI), audition devant la Commission des finances le mercredi 15 mai 2013.
7 () JP Aubert, audition du 28 février 2013.
8 () APLD=activité partielle de longue durée.
9 () Pervenche Bérès, 16 octobre 2012, interview donnée au journal en ligne « Metis Europe ».
10 () Les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) ont pour « mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Ils sont notamment chargés des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques ». Ils sont composés « de représentants de l’État dans la région, des assemblées régionales, des organisations de salariés et d’employeurs ainsi que des chambres régionales d’agriculture, de commerce et d’industrie et de métiers ».
11 () Il convient d’ailleurs de noter que le taux de participation de fonds privés ne peut être inférieur à celui de l’État.
© Assemblée nationale