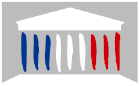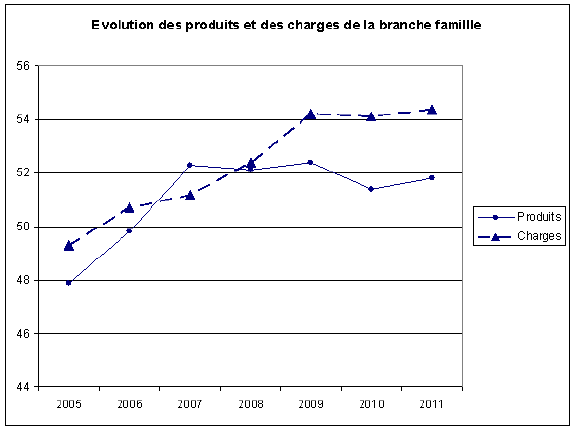Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2014.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et
de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
sur le financement de la branche famille,
ET PRÉSENTÉ PAR
M. Jérôme GUEDJ,
Député.
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. LA BRANCHE FAMILLE, QUI CONTRIBUE AU MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS, CONNAÎT UNE DÉGRADATION DE SA SITUATION FINANCIÈRE 11
A. LA BRANCHE FAMILLE : UN MAILLON ESSENTIEL DU MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS 11
1. Un modèle social qui favorise la natalité et l’activité des femmes 11
2. Un modèle social qui fait de la politique familiale un outil de redistribution des revenus et de lutte contre la pauvreté 12
3. Une politique familiale qui va au-delà du versement d’allocations familiales 15
B. LA FRAGILISATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA BRANCHE FAMILLE 16
1. La diversification des recettes de la branche famille a entraîné une fragilisation de son financement 16
2. L’apparition d’un déficit conjoncturel 21
a. La branche famille connaît aujourd’hui un déficit préoccupant 21
b. L’évolution de la situation financière de la branche famille à moyen terme fait débat 25
C. LA NÉCESSITÉ D’UN FINANCEMENT PÉRENNE COMPATIBLE AVEC LE DYNAMISME DES DÉPENSES 28
II. SI LA BRANCHE FAMILLE A CONNU UNE UNIVERSALISATION DE SES DÉPENSES, LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES EST JUSTIFIÉE AU TITRE DE L’OBJECTIF DE CONCILIATION ENTRE LA VIE FAMILIALE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 31
A. SI LA BRANCHE FAMILLE A CONNU UNE UNIVERSALISATION DE SES DÉPENSES… 32
B. … LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES AU FINANCEMENT DE LA BRANCHE EST JUSTIFIÉE PAR LES MÉCANISMES DONT ELLES BÉNÉFICIENT AU TITRE DE LA CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE 35
1. La diversification des objectifs de la politique familiale : favoriser la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle 35
2. La participation des entreprises au financement de la branche famille : asseoir la légitimité des partenaires sociaux dans sa gouvernance 39
C. LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES À L’INVESTISSEMENT DE LA NATION EN FAVEUR DES FAMILLES 40
III. L’ALLÉGEMENT DES COTISATIONS PATRONALES FAMILIALES S’INSCRIT DANS UNE ÉVOLUTION ENGAGÉE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ET VISANT À ATTÉNUER LA PART DE CES COTISATIONS DANS LES COÛTS SALARIAUX 41
A. UNE ÉVOLUTION ENGAGÉE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ET VISANT À ATTÉNUER LA PART DES COTISATIONS PATRONALES FAMILIALES DANS LES COÛTS SALARIAUX 41
1. Le financement de la branche famille par des cotisations patronales : une spécificité française 41
2. Une baisse continue des cotisations patronales familiales depuis 1945 42
3. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : un allégement complémentaire du coût du travail pour les entreprises 45
B. L’ALLÉGEMENT DES COTISATIONS DES ENTREPRISES DANS LE CADRE DU PACTE DE RESPONSABILITÉ 48
C. UNE PRISE EN CHARGE CROISSANTE DU FINANCEMENT DE LA BRANCHE FAMILLE PAR LES MÉNAGES 49
IV. UNE RÉFORME QUI DOIT PRENDRE EN COMPTE LES EFFETS LIMITÉS DES BAISSES DE COTISATIONS SOCIALES SUR L’EMPLOI ET L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA NOUVELLE RECETTE AFFECTÉE À LA BRANCHE FAMILLE 53
A. LES DÉBATS THÉORIQUES SUR LE COÛT DU TRAVAIL ET LES EXPÉRIENCES PASSÉES NE DÉMONTRENT PAS DE CORRÉLATIONS ÉVIDENTES ENTRE LA BAISSE DES COTISATIONS SOCIALES ET LES CRÉATIONS D’EMPLOI 53
1. Les cotisations patronales familiales : un poids limité sur le coût du travail 53
2. Le lien entre les cotisations sociales et le coût du travail 55
a. La corrélation entre niveau de cotisations patronales et coût du travail est faible 55
b. Les enseignements de la comparaison entre la France et l’Allemagne 56
3. Le coût du travail et la compétitivité des entreprises 59
4. La baisse des cotisations sociales patronales permettent-elles de stimuler l’emploi ? 62
5. L’allégement des cotisations patronales dans le cadre du Pacte de responsabilité : quel impact sur l’emploi ? 66
B. SI LA BUDGÉTISATION DE LA BRANCHE FAMILLE DOIT ÊTRE EXCLUE, UNE CLARIFICATION DE SON FINANCEMENT DOIT ÊTRE ENVISAGÉE 67
1. La budgétisation : une « fausse bonne idée » 68
2. Une clarification nécessaire du financement 70
C. QUELLE RECETTE DE SUBSTITUTION POUR LA BRANCHE FAMILLE ? 71
1. Transférer le financement de la branche famille sur les ménages 72
a. Un allégement de cotisations familiales patronales compensé par une augmentation de la TVA 72
b. Un allégement de cotisations familiales patronales compensé par une augmentation de la CSG 74
2. Transférer le financement de la branche famille sur la fiscalité écologique 77
3. Réaménager les prélèvements sociaux des entreprises 78
4. La grande absente des débats : la fiscalité du capital et du patrimoine au travers d’une réforme de l’assiette de la CSG 82
D. TOUT TRANSFERT VERS LES MÉNAGES DOIT S’ACCOMPAGNER D’UNE PROGRESSIVITÉ DE L’ASSIETTE SUBSTITUTIVE 83
E. DE NÉCESSAIRES CONTREPARTIES À L’ALLÉGEMENT DES COTISATIONS DES ENTREPRISES 86
1. Les « trente-cinq heures », un exemple de contreparties « réussies » 87
2. Des options peu efficaces si elles ne sont pas assorties de « sanctions » 87
CONCLUSION 91
POSTFACE 93
CONTRIBUTION DE M. PIERRE MORANGE, COPRÉSIDENT DE LA MISSION D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 99
TRAVAUX DE LA COMMISSION 105
ANNEXES 115
ANNEXE 1 : COMPOSITION DE LA MISSION 115
ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 117
ANNEXE 3 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 121
Le 19 octobre 2012, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS), présidée par Pierre Morange et Jean-Marc Germain, a confié un rapport sur le financement de la branche famille de la sécurité sociale au groupe socialiste, républicain et citoyen, et Jérôme Guedj en a été désigné rapporteur.
Les coprésidents ont sollicité, en application de l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières, l’expertise de la Cour des comptes. Compte tenu des réformes nombreuses qu’a connues la branche famille, la Cour des comptes a, en premier lieu, remis un état des lieux du financement de la branche famille (1) à Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales, en novembre 2012.
Dans un second temps, la MECSS a saisi la Cour des comptes d’une demande d’étude relative à l’impact sur la croissance et l’emploi d’une suppression des cotisations familiales et de leur remplacement par différentes taxes : la taxe sur la valeur ajoute (TVA), la contribution sociale généralisée (CSG), une taxe environnementale ou une cotisation sur la valeur ajoutée. À la demande de la Cour, la direction générale du Trésor a effectué, sur la base du modèle MÉSANGE, plusieurs simulations permettant d’appréhender les effets macroéconomiques de la substitution de ces quatre taxes à tout ou partie des cotisations famille. Un second rapport sur ces simulations a été transmis à la MECSS par la Cour des comptes en mai 2013 (1).
Le choix de cette thématique s’inscrit dans une démarche plus large souhaitée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, de repenser la question du financement de notre système de protection sociale. En témoigne la création, par un décret du 20 septembre 2012, du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) qui a, tout au long des dix-huit derniers mois, produit une abondante littérature sur cette question et donc, a fortiori, contribué à la réflexion sur le financement de la branche famille.
Ce rapport qui devait être – conformément à la mission de la MECSS – un travail d’évaluation et de propositions pour assurer à la branche un financement pérenne dans une période de dégradation de sa situation financière, n’a pu totalement s’exonérer du présent et, notamment, des choix opérés par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui ont pu, directement ou indirectement, affecter la question du financement de la protection sociale en général et celui de la branche famille en particulier depuis le début de la législature.
Ainsi, l’adoption, par la loi de finances rectificative pour 2012 (2), du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) – qui représente une dépense fiscale de 20 milliards d’euros – a indirectement interrogé le financement de la branche famille. En effet, en se substituant aux allégements de cotisations, le CICE s’est, de fait, combiné aux allégements existant – notamment les allégements dits « Fillon » – qui portent, pour l’essentiel sur les cotisations patronales familiales.
De même, la réforme des retraites a aussi, de manière directe, touché aux recettes de la branche famille puisque son financement a reposé sur un transfert d’une fraction des cotisations patronales familiales (0,15 point) vers la branche vieillesse de la sécurité sociale. Ce transfert n’a pas été compensé par un nouveau prélèvement social sous forme de cotisations, mais par une contribution du budget de l’État un montant de 2,1 milliards d’euros par la loi de finance pour 2014. C’est donc, à l’occasion de la réforme des retraites, un accroissement de la budgétisation du financement du financement de la branche qui s’est dessiné.
La question du financement de la branche famille a enfin connu son rebondissement le plus important à l’occasion des annonces du Président de la République relatives au Pacte de responsabilité. En effet, lors de sa conférence de presse du 13 janvier 2014, le Président de la République a annoncé la suppression de la totalité des cotisations patronales familiales acquittées par les employeurs, soit une baisse de 35 milliards d’euros. S’il a depuis été précisé que ce montant incluait les 20 milliards d’euros du CICE, il n’en demeure pas moins très significatif que ce soit sur les cotisations patronales familiales, et donc sur la branche famille, que ce soit porté le choix du gouvernement.
De manière sous-jacente, c’est la question de l’utilité et de la pertinence du financement par les entreprises de la branche famille qui est clairement posée. C’est également celle, très concrète et dans des proportions massives, de son financement, puisque, une fois déduits les allégements relevant du CICE, c’est entre 10 et 15 milliards d’euros de recettes qui sont nécessaires pour compenser cette baisse des cotisations employeurs.
L’objet du présent rapport est donc de contribuer à l’évaluation et à la réflexion prospective quant au financement de la branche famille qui est devenue, au fil du temps, le cœur des propositions relatives à la réforme du financement de la protection sociale. Réforme du financement qui s’inscrit non plus dans une simple démarche de mise en cohérence, mais bien dans la mise en œuvre d’une politique de l’offre visant à baisser le coût du travail pour restaurer la compétitivité et l’emploi. Sans être l’objet central de ce rapport, le Pacte de responsabilité comme le CICE seront donc nécessairement interrogés dans leurs postulats en tant qu’ils président à la refonte, en cours, du financement de la branche famille.
Depuis le mois de novembre 2012, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale a procédé à 28 auditions et entendu la plupart des acteurs institutionnels et universitaires ayant travaillé sur la question du financement de la branche famille de la sécurité sociale. Elle s’est également appuyée sur les travaux de la Cour des comptes et du Haut conseil du financement de la protection Sociale.
Afin de couvrir l’ensemble des questions soulevées par le financement de la branche famille, le présent rapport est composé de quatre parties. La première établit un état des lieux de la branche famille, de ses objectifs, de son utilité et de son financement (I). La deuxième partie s’intéresse à la pertinence de la participation des entreprises au financement de la politique familiale (II). La troisième partie montre les évolutions à l’œuvre depuis trente ans dans le financement de la branche dans une perspective d’allégement du coût du travail (III). La quatrième partie interroge les réformes possibles en analysant les impacts économiques et financiers attendus d’une diminution des cotisations patronales famille sur la compétitivité et l’emploi en fonction des recettes alternatives (IV).
*
* *
I. LA BRANCHE FAMILLE, QUI CONTRIBUE AU MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS, CONNAÎT UNE DÉGRADATION DE SA SITUATION FINANCIÈRE
Comme l’a rappelé le Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, dans un discours du 3 mars 2013, la branche famille de la sécurité sociale contribue au financement du modèle social français : « La réforme de la politique familiale vise à assurer la pérennité, la consolidation, le renforcement de l’équité du modèle social français (…) Pour y parvenir, il faut réformer le modèle social français en le pérennisant dans ses financements, en le rendant plus juste dans sa mise en œuvre, et en étant plus solidaire pour assurer son financement. »
A. LA BRANCHE FAMILLE : UN MAILLON ESSENTIEL DU MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS
1. Un modèle social qui favorise la natalité et l’activité des femmes
La branche famille tient une place essentielle au sein du modèle social français notamment parce qu’elle contribue de façon décisive non seulement au dynamisme de la natalité mais aussi à un niveau élevé d’activité des femmes en facilitant la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle.
La corrélation négative entre le taux de fécondité et le taux d’emploi des femmes, observée dans le passé, n’a désormais plus cours dans la plupart des pays occidentaux. Certains économistes ont même montré une inversion de la corrélation entre ces deux indicateurs (3) et des études, notamment menées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), démontrent le lien entre le dynamisme des politiques publiques en faveur des familles et un taux de fécondité élevé ainsi qu’une participation importante des femmes sur le marché du travail.
Ainsi, alors que la France se place après l’Irlande en matière de fécondité avec un taux de 2,03 enfants par femme en 2010 (4), elle est loin d’afficher un faible taux d’emploi des femmes au sein des pays de l’Union européenne comme le montre le tableau suivant :
TAUX D’EMPLOI DES 25-49 ANS SELON LE NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE EN 2009
(En %)
État |
Ensemble |
Aucun enfant |
1 enfant |
2 enfants |
3 enfants ou plus | |||||
total |
femmes |
total |
femmes |
total |
femmes |
total |
femmes |
total |
femmes | |
Allemagne |
81,8 |
77,1 |
83,2 |
83,7 |
81,2 |
73,5 |
78,1 |
65,5 |
63,9 |
42,5 |
France |
81,9 |
76,4 |
81,4 |
80,4 |
82,9 |
76,0 |
80,6 |
69,5 |
68,2 |
50,4 |
Irlande |
72,4 |
67,6 |
77,1 |
81,5 |
75,4 |
70,0 |
69,9 |
58,9 |
59,5 |
43,1 |
Italie |
72,2 |
59,9 |
74,2 |
67,3 |
76,3 |
61,0 |
71,9 |
52,6 |
61,6 |
37,1 |
Danemark |
85,3 |
83,0 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
Royaume-Uni |
80,3 |
74,4 |
83,6 |
84,0 |
81,8 |
72,2 |
76,9 |
63,6 |
57,8 |
39,0 |
UE (27 pays) |
78,5 |
72,0 |
79,7 |
78,6 |
79,0 |
68,3 |
75,9 |
61,9 |
64,3 |
45,9 |
Champ : Personnes âgées de 25 à 49 ans. Pour les familles avec enfants, le plus jeune est âgé de moins de 6 ans. Les données pour le Danemark ne sont pas disponibles selon le nombre d’enfants à charge.
Source : SESPROS/Eurostat 2011 – Calculs : DSS/6C.
Parmi les principaux objectifs de la politique familiale, figure, en effet, celui de faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Depuis les années 1990, cette politique mobilise une part croissante des moyens de la branche, soit sous forme d’allocations versées à différents titres aux parents, soit sous forme de prestations de service versées aux établissements d’accueil de jeunes enfants, soit encore par le biais d’aides à l’investissement. L’emploi des femmes a ainsi connu une progression importante : chez les femmes de 25 à 49 ans, le taux d’activité est passé de 59 % en 1975 à 84 % en 2011 (5).
2. Un modèle social qui fait de la politique familiale un outil de redistribution des revenus et de lutte contre la pauvreté
Avec 11,2 millions titulaires de droits aux différentes prestations, la branche famille contribue à la fois à la redistribution des revenus mais aussi à la lutte contre la pauvreté.
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (6), les prestations familiales participent pour 26 % à la réduction des inégalités de niveau de vie :
– si les prestations familiales sans condition de ressources ont un pouvoir redistributif limité par l’absence de ciblage, elles participent pourtant pour près de 16 % à la réduction des inégalités de niveau de vie, dont 11 % pour les seules allocations familiales. Ceci s’explique d’abord par leur importance financière : les prestations familiales sans condition de ressources représentent 39 % de l’ensemble des prestations sociales. Leur efficacité en matière de redistribution est renforcée par le fait que les ménages qui ont des enfants sont plus nombreux dans les quintiles inférieurs de la distribution ;
– les prestations familiales sous conditions de ressources ont a priori un pouvoir redistributif important du fait de leur ciblage mais les montants distribués sont globalement plus faibles : 16 % de l’ensemble des prestations sociales. Elles opèrent donc une redistribution à hauteur de seulement 10 % des revenus.
Par ailleurs, l’action en faveur des familles vulnérables et les dispositifs de lutte contre les exclusions ont acquis à partir des années 1970 une place croissante dans les dépenses de la branche famille. Cette mission est essentielle : selon les dernières données disponibles, la part des enfants vivant dans des familles en situation de pauvreté est passée de 17,7 % en 2003 à 19,5 % en 2011. Cette part atteint 41 % pour les foyers monoparentaux.
Outre les prestations servies sous conditions de ressources, qui représentent près de 25 % des prestations servies par les caisses d’allocations familiales (CAF), et celles qui sont modulées en fonction du revenu du foyer, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) est chargée du versement de minima sociaux, tels que le revenu de solidarité active (RSA) majoré ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et finance une partie des aides au logement. Cette dimension « sociale » de l’action de la branche famille a d’ailleurs été rappelée par M. Philippe Didier-Courbin, adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale, lors de son audition : « La branche famille contribue à [la] politique d’action et de cohésion sociales, en finançant des opérations qui relèvent de son offre globale de services mais également en agissant comme prestataire de services pour l’État, comme gestionnaire de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, et pour les départements, comme gestionnaire du revenu de solidarité active, le RSA. »
Ainsi 6,6 millions des allocataires de la CNAF sont des familles avec enfants à charge. 5,2 millions sont des personnes isolées ou des couples sans enfant. Comme le montre le tableau suivant, les prestations de lutte contre la précarité ont représenté 32 % des dépenses de la CNAF en 2012 :
DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE EN 2012 (1)
(en millions d’euros)
Prestations |
Dépenses |
% du total |
Prestations et action sociale en faveur des familles |
53 388 |
68 % |
1.– Prestations directes et action sociale en faveur des familles |
44 093 |
56 % |
– Prestations petite enfance |
15 191 |
19 % |
Prestations d’accueil du jeune enfant |
12 893 |
16 % |
dont primes |
647 |
1 % |
dont allocation de base |
4 308 |
5 % |
dont complément libre choix d’activité |
2 064 |
3 % |
dont complément de garde |
5 875 |
7 % |
Action sociale petite enfance |
2 296 |
n.s. |
– Aides au logement en faveur des familles |
8 596 |
11 % |
Prestations légales logement |
8 468 |
11 % |
Action sociale logement |
128 |
n.s. |
– Autres aides directes aux familles |
20 306 |
26 % |
Allocations familiales |
12 652 |
16 % |
Complément familial |
1 653 |
2 % |
Allocation de soutien familial |
1 285 |
2 % |
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé |
773 |
1 % |
Allocation de présence parentale |
61 |
n.s. |
Allocation de rentrée scolaire |
1 870 |
2 % |
Action sociale hors petite enfance et hors logement |
1 555 |
2 % |
Autres prestations (dont frais de tutelle) |
457 |
1 % |
2.– Prestations indirectes en faveur des familles |
9 296 |
12 % |
Assurance vieillesse des parents au foyer |
4 516 |
6 % |
Majoration pension de vieillesse |
4 498 |
6 % |
Congé de paternité |
280 |
n.s. |
Prestations de lutte contre la précarité |
25 626 |
32 % |
1.– Revenus garantis et compléments |
17 738 |
22 % |
Revenu de solidarité active |
10 042 |
13 % |
Allocation aux adultes handicaps et compléments |
7 604 |
10 % |
Revenu de solidarité |
68 |
n.s. |
Anciennes prestations (RMI, API, expérimentation RSA) |
6 |
n.s. |
Contrats aidés et dispositif de retour à l’emploi |
18 |
n.s. |
2.– Aides au logement en faveur des personnes sans enfant |
7 888 |
10 % |
Ensemble des prestations |
79 014 |
100 % |
(1) Les dépenses décrites recouvrent les prestations familiales versées par les CAF et les autres organismes débiteurs des prestations familiales (caisses de la MSA, EDF-GDF, RATP…) et les prestations versées par les CAF comme opérateurs (pour l’État et les conseils généraux). Elles n’incluent pas les dépenses des caisses agricoles lorsqu’elles agissent comme opérateurs ni les dépenses de Mayotte.
Source : Caisse nationale des allocations familiales.
3. Une politique familiale qui va au-delà du versement d’allocations familiales
Selon la CNAF (7), les dépenses de protection sociale de la fonction « famille/enfants » (8) représentent en France 2,5 % de son PIB. Cela place le pays en dixième position au sein de l’Union européenne qui affiche un taux de 2,1 % du PIB en moyenne.
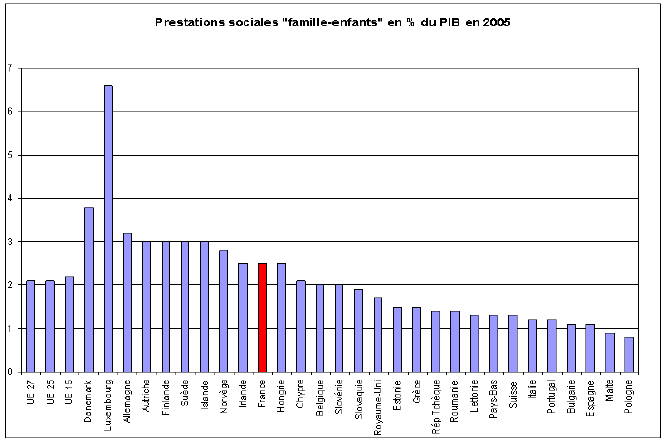 Source : Caisse nationale des allocations familiales.
Source : Caisse nationale des allocations familiales.
Par conséquent, du strict point de vue du versement des allocations familiales, la France est loin d’avoir le régime le plus généreux de l’Union européenne. En Allemagne – alors que taux de fécondité est de 1,3 enfant par femme – une famille perçoit 184 euros par mois, quel que soit son niveau de revenu, dès le premier enfant. En France, il faut un minimum de deux enfants pour toucher une aide de 126 euros, avec toutefois une aide plus importante pour les familles nombreuses. Avec 747 euros de montant annuel versé pour un enfant en 2010, soit 2 % du salaire moyen, la France arrive selon les calculs de l’OCDE derrière la plupart des pays européens (9).
Mais la politique familiale française ne peut être réduite au simple versement de prestations : la politique fiscale – notamment le quotient familial – et le développement de services (modes de garde, places en crèche, scolarisation des enfants…) occupent une place essentielle. En prenant en compte ces éléments, la France a dépensé, selon l’OCDE, 4 % de son PIB en 2009 en faveur de la famille contre 2,6 % pour la moyenne des pays les plus riches.
B. LA FRAGILISATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA BRANCHE FAMILLE
Originellement conçues comme des « sursalaires » alloués par certains employeurs à leurs salariés, l’obtention des prestations familiales est longtemps restée subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle. L’ordonnance du 4 octobre 1945, qui intègre les prestations familles dans l’organisation générale de la sécurité sociale, d’inspiration bismarckienne, a mis en place un système de financement qui prend en charge les risques dans un cadre professionnel. Cette origine explique que la politique familiale ait été financée par des cotisations patronales.
1. La diversification des recettes de la branche famille a entraîné une fragilisation de son financement
Le financement de la branche famille a connu, depuis les années quatre-vingt-dix, deux évolutions notables :
– la première, avec l’affectation, à compter de 1991, d’une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) (10), est une diversification de ses ressources destinée à mieux mettre en cohérence sa structure de financement avec l’universalisation des prestations versées ;
– la seconde est la fiscalisation accrue de son financement sous forme d’attribution d’impôts et de taxes affectées qui apparaît comme la conséquence des allégements de cotisations sociales.
Ces évolutions ont cependant fragilisé le financement de la branche famille.
● En premier lieu, parce qu’elles ont renforcé la dépendance de la branche aux revenus d’activité et donc l’ont rendu plus sensible aux évolutions de l’économie française.
Comme l’a souligné le président de la sixième chambre de la Cour des comptes, M. Antoine Durrleman, lors de son audition par la MECSS : « Si nous estimons ce financement fragile, c’est d’abord parce qu’étant très largement dépendant des revenus d’activité, il est particulièrement sensible à la conjoncture économique. Les cotisations patronales, qui représentent 65 % des ressources de la branche, ne sont pas les seules en cause : si l’on y ajoute l’assiette " revenus d’activité " de la CSG et la taxe sur les salaires affectées à la branche famille, on arrive à un total de plus de 80 % des ressources directement tributaires des revenus d’activité. Au lieu de consolider la branche, les évolutions de son financement l’ont ainsi au contraire rendue encore plus dépendante du contexte économique. »
Comme le montre le graphique suivant, le ralentissement de la croissance a, en effet, pesé sur la progression des cotisations sociales, qui ont connu un taux de croissance compris entre 0,7 % et 2,2 % de 2009 à 2011 alors que cette augmentation était comprise entre 2,2 % et 4,1 % entre 2002 et 2008. De même, malgré son assiette très large la CSG reste, à titre principal, une ressource provenant des revenus d’activité – la part de CSG sur les revenus d’activité ayant varié de 73 % en 2002 à 70 % en 2011 – et a donc subi les effets de la crise économique (11).
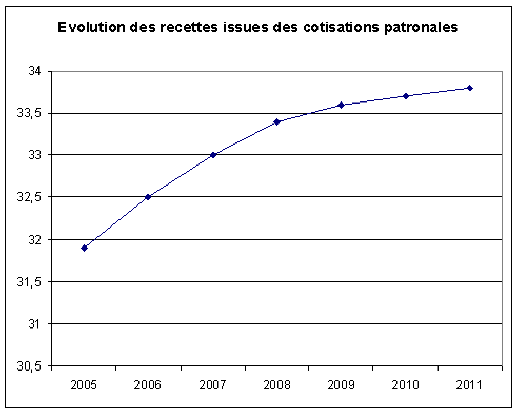
● En second lieu, à compter de 2011, les allégements généraux de cotisations patronales ont été compensés par l’attribution d’un « panier » de recettes fiscales attribué pour « solde de tout compte » ; or, les recettes attribuées à la branche famille – dont le périmètre a beaucoup varié au fil des lois de financements de la sécurité sociale – connaissent une progression peu dynamique pour certaines d’entre elles.
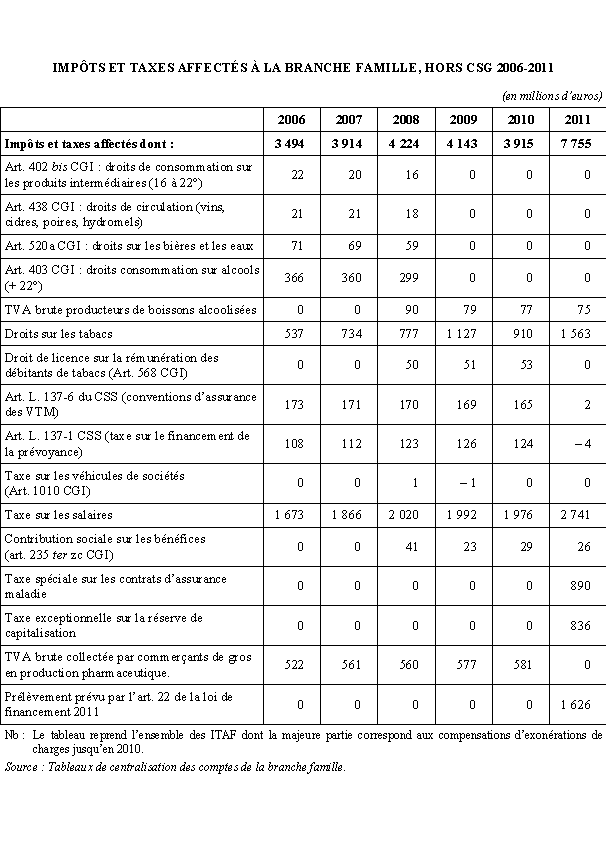
C’est le cas, notamment, des trois recettes fiscales affectées à la branche famille en compensation de la perte de 0,28 point de CSG transféré de la branche famille à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (12) :
– le produit de 3,5 points de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) des contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » ;
– un prélèvement exceptionnel sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance, dont le montant s’est élevé à 835 millions d’euros en 2011 et en 2012 ;
– le produit de l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euro des contrats d’assurance-vie multi-supports – le « préciput » assurance vie. Il a rapporté 1,6 milliard d’euros en 2011 ; mais, compte tenu de la durée de vie de ces contrats, cette somme va décroître pour s’annuler à partir de 2020.
PRÉVISIONS SUR L’ÉVOLUTION DES RECETTES DU « PRÉCIPUT » ASSURANCE-VIE
(en millions d’euros)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 626 |
1 446 |
1 264 |
1 084 |
904 |
723 |
541 |
362 |
179 |
0 |
En 2013, la CNAF a perdu le rendement de l’« exit tax » – taxe non pérenne n’ayant de rendement qu’en 2011 et 2012 – et a vu le rendement du « préciput » diminuer. Pour compenser ces pertes de recettes, la CNAF a reçu les cotisations et contributions sur les primes d’assurance automobile dont bénéficiait la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en 2011 et 2012, soit 1,1 milliard d’euros, mais a perdu une fraction des droits sur les tabacs pour un montant de 350 millions d’euros. Au total, les recettes destinées à compenser la perte de CSG ont diminué, en 2013, de 320 millions d’euros.
Certes, les mesures prises depuis 2012 ont permis de donner des recettes plus dynamiques à la branche famille. Comme le montre le tableau suivant – qui récapitule les produits, pour 2013 et 2014, de chacune des recettes affectées à la CNAF par les différentes dispositions financières adoptées de fin 2011 à fin 2012 –, la branche famille aura, en 2013, bénéficié d’un supplément de recette de plus de 660 millions d’euros au titre des mesures adoptées dans la loi de finances rectificative pour 2012 (13) et la loi financement de la sécurité sociale pour 2013 (14), au lieu de seulement 218 millions d’euros de recettes supplémentaires au titre des deux lois de financement précédentes.
De même, en 2014, les mesures adoptées depuis le début de la législature continueront à procurer 803 millions d’euros de recettes nouvelles à la branche, alors que le solde des mesures favorables et défavorables en matière de recettes issues des lois de financement pour 2011 et 2012 représente seulement 52 millions d’euros.
Produit prévisionnel, pour 2013 et 2014, de chacune des recettes affectées à la CNAF par les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, initiales et rectificatives, pour 2011, 2012 et 2013
(en millions d’euros)
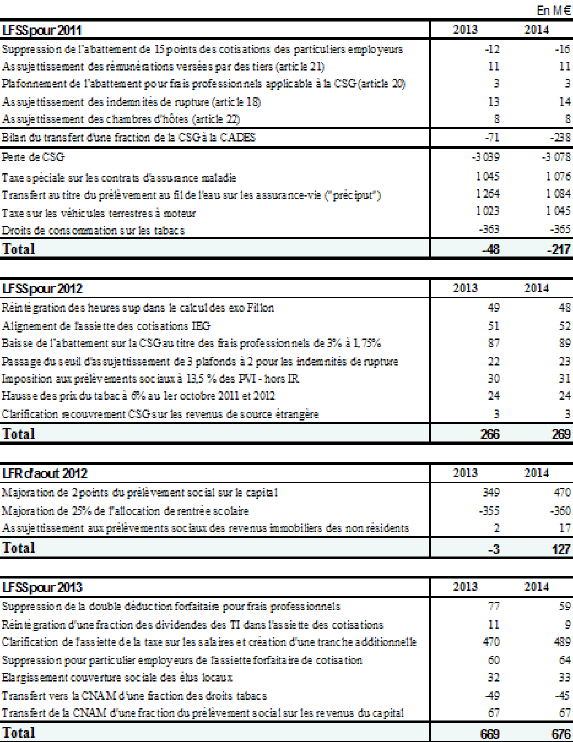
Cependant, malgré l’apport des dernières lois de financement de la sécurité sociale, le rythme de croissance des recettes de la branche famille décroît depuis 2010 (+ 4 % entre 2010 et 2011, + 3,3 % entre 2011 et 2012 et + 2 % entre 2012 et 2013).
Ces réformes ont donc conduit, à la fois, à une augmentation de la part des impôts et taxes affectés qui est passée de 0,8 % des recettes de la branche famille en 2005 à 6,6 % en 2006 et 12,1 % en 2013, mais aussi à une fragilisation des recettes de la branche famille.
De nombreux interlocuteurs entendus par la mission, ont regretté cette évolution. Ainsi, M. François Fondard, président de l’Union nationale des associations familiales (UNAF), a constaté : « Ce financement est (…) fragile, car la branche famille se retrouve à la merci des tours de passe-passe opérés chaque année en lois de finances et de financement de la sécurité sociale – tels que le retrait de certaines ressources et la compensation de la perte qui en résulte par un panier de taxes, à l’affectation desquelles ne semblent présider aucune logique ni aucune vision à moyen terme. »
Ce constat a été aussi partagé par le président du conseil d’administration de la CNAF, M. Jean-Louis Deroussen, qui a regretté « le développement d’une fiscalisation forte mais fragmentée de la branche au travers d’une multiplication de recettes d’appoint peu lisibles et, surtout, dépendantes d’assiettes assez fragiles, dont certaines ont même vocation à disparaître. Il en résulte qu’il faut se reposer chaque année la question de la réaffectation de nouvelles recettes. Cette situation est préoccupante au regard de la stabilité nécessaire au financement de la branche famille ».
Les représentants des organisations syndicales entendus par la mission, ont également fait part de leurs inquiétudes : Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a souligné la « complexité » du financement de la branche famille et « l’affectation de recettes non pérennes ». De même, M. Jean-Yves Delannoy, délégué national pour le secteur de la protection sociale de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), a tenu à alerter les membres de la MECSS sur le fait que « le déficit de la branche, qui était jusqu’alors repris par la CADES, ne l’est plus à compter de l’exercice 2012 et ne pourra dès lors que s’accumuler ».
2. L’apparition d’un déficit conjoncturel
a. La branche famille connaît aujourd’hui un déficit préoccupant
La branche famille bénéficie, à législation constante, de conditions d’équilibre plus favorables que les autres branches de la sécurité sociale pour des raisons démographiques (15), mais aussi parce que la revalorisation des prestations familiales suit le rythme de l’évolution des prix à la consommation hors tabac, alors que les recettes évoluent comme les salaires. Ce différentiel favorable dans le rythme de progression des charges et des produits de la branche a ainsi permis le financement d’importantes réformes de la politique familiale au cours des décennies 1980 et 1990, notamment en faveur des modes de garde des jeunes enfants.
Pourtant cette branche connaît depuis 2008 une dégradation continue de ses comptes :
ÉVOLUTION DU SOLDE DE LA BRANCHE FAMILLE
de 1998 à 2017
(en milliards d’euros courants)
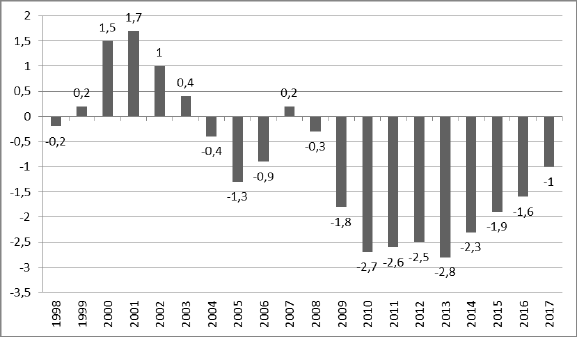
Cette situation est d’abord imputable à la crise économique, qui s’est traduite par une diminution des recettes sous l’effet de la dégradation de l’activité économique et de l’emploi.
Elle s’explique également par la progression plus rapide des charges de la branche par rapport aux recettes.
● Les produits de la branche ont progressé de 28 % en euros courants entre 2002 et 2011, soit une augmentation de près de 14 % en euros constants. Cette progression a été plus rapide entre 2002 et 2007 (+ 23,9 %) que par la suite, ceux-ci ayant connu une quasi-stagnation de 2007 à 2010, année au cours de laquelle ils ont même régressé de 1,1 % (16).
RECETTES DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
(en milliards d’euros constants 2010)
Type de recettes |
1978 |
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
2008 |
2010 |
2011 |
Produits dont : |
29,7 |
37,1 |
37,5 |
43,6 |
47,9 |
52,1 |
51,4 |
51,4 |
Cotisations (1) |
28,4 |
35,2 |
24,9 |
29,4 |
31,9 |
33,4 |
33,7 |
33,8 |
Compensations d’exonération par l’État |
0 |
0,6 |
3,3 |
3,3 |
3,5 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
CSG |
0 |
0 |
8,1 |
10,2 |
11,2 |
12,4 |
12,2 |
9,2 |
Impôts et taxes affectés |
0 |
0,9 |
0,1 |
0,2 |
04 |
4,3 |
4,2 |
7,6 |
(1) Hors cotisations prises en charge par l’État.
Source : Caisse nationale des allocations familiales.
● Parallèlement, les charges de la branche famille ont connu une progression particulièrement dynamique entre 2002 et 2007 (+ 26,6 %) et, malgré un ralentissement de leur progression à compter de 2008, elles ont connu une augmentation de 23 % en euros constants entre 2002 et 2011.
CHARGES DE LA BRANCHE FAMILLE DEPUIS 1978 (1)
(en milliards d’euros constants 2010)
Type de charges |
1978 |
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
2008 |
2010 |
2011 |
Charges dont : |
28,3 |
36,3 |
44,9 |
41,9 |
49,3 |
52,4 |
54,1 |
54,4 |
Prestations |
24,9 |
29,2 |
33,1 |
35,5 |
38,6 |
40,5 |
34,4 |
34,2 |
Transferts aux org de sécurité sociale |
0,4 |
4 |
9 |
4 |
6,8 |
7,2 |
8,1 |
8,9 |
Action sociale (2) |
1,4 |
1,8 |
2 |
2,5 |
3,6 |
3,7 |
3,5 |
3,7 |
Autres transferts (3) |
0,4 |
3,1 |
3,7 |
3,9 |
3,8 |
4 |
4 |
4,1 |
Gestion |
1,3 |
1,4 |
1,6 |
1,5 |
2,2 |
2,1 |
2,6 |
2,6 |
(1) Les prestations remboursées par l’État (AAH, API) ont été neutralisées.
(2) Hors Fonds d’investissement de la petite enfance et opérations en capital.
(3) Contribution de la branche au Fonds national des allocations logement.
Source : Cour des comptes.
Cette progression est due essentiellement à des mesures nouvelles, notamment en faveur de la garde d’enfant.
Ainsi, les allocations pour la garde d’enfant ont connu une progression en euros courants de 59 % entre 2002 et 2011 du fait de la création puis de la montée en charge de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) (17), du développement du complément de mode de garde (18) et de l’augmentation du financement des équipements d’accueil du jeune enfant.
Selon la Cour des comptes, le montant moyen des aides versées a progressé de 40 % passant de 293 euros en 2003 à 410 euros en 2009, soit une progression nettement supérieure à celle de l’inflation. La CNAF estime qu’au total la création de la PAJE a entraîné un surcroît de dépenses de 2,86 milliards d’euros constants en 2010 par rapport à l’état du droit antérieur. Ce « surcoût » est très supérieur à ce qui avait été estimé lors de la création de la prestation (19).
Mais cette progression des charges de la branche famille est aussi due aux transferts de charges opérés, dans les années 2000, au détriment de la branche famille et au bénéfice d’autres branches de la sécurité sociale, en particulier de la branche vieillesse. Les plus significatifs en termes financiers sont la prise en charge des cotisations au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et la majoration de pension pour les parents ayant élevé au moins trois enfants. Entre 2008 et 2011, la dépense au titre de l’AVPF a représenté plus de 4 milliards d’euros chaque année, tandis que celle relative à la majoration de pension a pratiquement doublé sur la même période.
ÉVOLUTION ANNUELLE DES DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE
(en milliards d’euros)
Type de dépenses |
2012 |
2013 (prévisions) |
2014 (prévisions) | ||
Prestations |
40,1 |
41,0 |
2,3 % |
41,8 |
2,1 % |
Prestations légales nettes |
35,7 |
36,4 |
1,9 % |
36,9 |
1,4 % |
Prestations extra-légales nettes |
4,3 |
4,6 |
5,7 % |
4,9 |
7,5 % |
Transferts |
13,6 |
14,0 |
3,0 % |
14,3 |
2,2 % |
entre régimes de base |
4,8 |
4,9 |
1,8 % |
5,0 |
2,0 % |
vers le FSV |
4,5 |
4,6 |
2,5 % |
4,7 |
2,0 % |
Autres |
4,3 |
4,5 |
4,9 % |
4,6 |
2,7 % |
charges de gestion courante |
2,9 |
2,9 |
0,0 % |
2,9 |
1,3 % |
Total |
56,6 |
58,0 |
2,4 % |
59,2 |
2,1 % |
Source : Cour des comptes.
Comme le montre le graphique suivant, l’effet de ciseau entre l’évolution modérée de recettes de la branche et celle – très dynamique – des charges de la branche aboutit à un déficit qui est devenu constant depuis 2008.
b. L’évolution de la situation financière de la branche famille à moyen terme fait débat
Les différentes analyses prospectives publiées sur l’évolution du financement de la branche famille aboutissent à des constats divergents.
Ainsi, dans une note sur la situation financière de la famille à l’horizon 2025 (20), le Haut Conseil de la famille considère, en retenant l’hypothèse d’une stabilisation de la natalité à son niveau de 2009 et dans le cadre du scénario macroéconomique retenu pour les projections du Conseil d’orientation des retraites (21), que le déficit de la branche devrait se réduire régulièrement jusqu’en 2017, année où la branche devrait retrouver un excédent courant. La situation financière de la branche resterait toutefois négative, en raison de la dette accumulée entre 2008 et 2016. En cas d’affectation des excédents de la branche au remboursement des déficits cumulés sur le passé, elle devrait retrouver une situation financière créditrice à compter de 2024.
Lors de son audition par la MECSS, le président délégué du Haut Conseil de la famille, M. Bertrand Fragonard, a confirmé que ces projections lui semblaient toujours d’actualité : « Nous garderons l’échéance de 2025 : nous avons en effet retenu cette date parce que nous souhaitons qu’au-delà de la période de déficit dans laquelle nous sommes engagés, nous puissions prendre en compte celle du retour à l’équilibre – vers 2017-2018 – puis à l’excédent de la branche. Selon nos estimations, celui-ci devait s’élever à 7 milliards d’euros à cette échéance. Or je suis convaincu que si nous sortons de la crise, nous aurons toujours un excédent en 2025. »
Au contraire, la Cour des comptes, dans le rapport remis à la MECSS en novembre 2012 (22), considère que si « une part de la dégradation de la situation financière de la branche tient à plusieurs accidents de croissance successifs et à une forte dynamique des charges, les perspectives à moyen et long termes ne permettent pas d’envisager un retour à l’équilibre du solde à l’horizon 2020, sous l’hypothèse d’une croissance de la masse salariale de 3,5 % par an ». Elle considère notamment que les travaux de prospective du Haut Conseil de la famille s’appuient sur des hypothèses (23) désormais obsolètes car ne prenant pas en compte la crise économique intervenue depuis 2010. La Cour fonde ses prévisions sur le faible dynamisme des nouvelles recettes attribuées à la branche famille par rapport à la CSG et sur la probable progression dynamique des charges à l’avenir, comme cela a été le cas ces dernières années. La Cour conclut, par conséquent, que « la viabilité financière de la branche n’apparaît (…) pas assurée à moyen et long terme », compte tenu de l’effet de ciseau entre les charges et les produits et que ces difficultés financières, bien que « significativement aggravées par la dégradation de la conjoncture économique, n’en révèlent pas moins un déséquilibre structurel ».
En conséquence, les perspectives à moyen et long termes de la branche, telles qu’établies par la Cour sous l’hypothèse d’une croissance de la masse salariale de 3,5 %, montrent que son déficit devrait se stabiliser à 2 milliards d’euros à l’horizon 2020, soit une accumulation de dette de l’ordre de 20 milliards d’euros entre 2011 et 2020.
Le directeur de la sécurité sociale, M. Thomas Fatome, a, quant à lui, considéré lors de son audition que les hypothèses de la Cour des comptes étaient trop pessimistes et que le déficit de la branche famille devrait se résorber à moyen terme : « La Cour des comptes retient une hypothèse d’évolution de la masse salariale plus pessimiste. Pour notre part, nous construisons les projets de loi de finances, les PLFSS [projets de loi de financement de la sécurité sociale] et la programmation pluriannuelle sur les hypothèses retenues par le Gouvernement, soit une augmentation de la masse salariale de 2,3 % en 2013 puis un retour à 4 % en 2014. Nous prenons également en compte des facteurs structurels : certaines dépenses de la branche famille connaîtront un rythme annuel d’augmentation inférieur à 3 %. À titre d’exemple, la montée en charge de la PAJE est derrière nous. Si l’évolution de la masse salariale est au rendez-vous, on peut donc tabler sur un retour à l’équilibre de la branche. »
Dans un rapport sur les perspectives à moyen-long terme des régimes de protection sociale (24), le Haut Conseil du financement de la protection sociale, s’est, quant à lui, fondé sur les projections réalisées par le Haut Conseil de la famille, tout en intégrant une actualisation des hypothèses économiques de court terme (2014-2017) sur lesquelles sont fondées les lois financières pour 2014. Comme le montre le tableau suivant, dans les cinq scénarios envisagés, la branche famille se retrouve excédentaire en 2020 et le reste jusqu’en 2060, y compris dans le scénario le plus pessimiste en matière d’hypothèses macroéconomiques.
SOLDE DE LA BRANCHE FAMILLE À L’HORIZON DE 2060
(en % du PIB)
Scénario |
2011 |
2020 |
2025 |
2030 |
2040 |
2050 |
2060 |
Scénario A’ : taux de chômage de 4,5 % et gains annuels de productivité du travail à 2 % |
– 0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
1,2 |
Scénario A : taux de chômage de 4,5 % et gains annuels de productivité du travail à 1,8 % |
– 0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
Scénario B : taux de chômage de 4,5 % et gains annuels de productivité du travail à 1,5 % |
– 0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
Scénario C : taux de chômage de 7 % et gains annuels de productivité du travail à 1,3 % |
– 0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
Scénario C’ : taux de chômage de 7 % et gains annuels de productivité du travail à 1 % |
– 0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
Source : Haut Conseil du financement de la protection sociale.
Votre Rapporteur considère qu’il est particulièrement ardu de faire une analyse prospective sur le long terme – compte tenu des incertitudes pesant sur l’évolution de l’activité économique – et de trancher ce débat.
Ce qui est certain en revanche, c’est que la situation financière de la branche famille est aujourd’hui dégradée et que la conjoncture économique actuelle ne laisse pas présager une amélioration de cette situation dans les prochaines années, comme le montrent les prévisions du Gouvernement dans le programme de qualité et d’efficience annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
PRÉVISION D’ÉVOLUTION DU SOLDE DE LA BRANCHE FAMILLE
(en milliards d’euros)
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Solde de la CNAF |
– 2,8 |
– 2,3 |
– 1,9 |
– 1,6 |
– 1,0 |
Source : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
C. LA NÉCESSITÉ D’UN FINANCEMENT PÉRENNE COMPATIBLE AVEC LE DYNAMISME DES DÉPENSES
Compte tenu de la progression dynamique des dépenses de la branche famille ces dernières années, il apparaît aujourd’hui nécessaire de lui garantir un financement pérenne et compatible avec le dynamisme des dépenses.
Ce financement doit être, en premier lieu, stable, comme l’a souligné, lors de son audition par la MECSS, M. Jean-Louis Rey, directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) : « L’idéal, c’est d’utiliser une assiette dynamique et relativement indifférente à la conjoncture. Deux répondent à cette exigence : la masse salariale et la consommation. En revanche, l’impôt sur les sociétés est un chiffon rouge, en raison de son extrême volatilité, très dangereuse pour un financement de trésorerie. Pour pouvoir honorer nos engagements, nous avons besoin d’une recette régulière, prévisible et stable. »
Par ailleurs, ce financement doit garantir des recettes autonomes à la branche famille.
En effet, comme le montre M. Antoine Math, chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales, dans un article publié sur ce sujet en juillet 2013 (25), l’évolution de la branche famille depuis 1945 illustre combien son financement par des ressources dynamiques affectées à la branche, évoluant au même rythme que la masse salariale quand les prestations évoluent comme les prix, a pu permettre de dégager des excédents et de donner des marges de manœuvre, y compris en périodes de crise ou de forte concurrence de besoins concurrents (vieillesse, santé), c’est-à-dire quand les prestations familiales auraient pu être la cible idéale de restrictions budgétaires. En alimentant un budget distinct de celui de l’État, les cotisations ont également procuré une autonomie du système, en rendant a priori plus difficiles pour l’État les possibilités d’utilisation des excédents. A contrario, le financement croissant par des taxes affectées rend la branche famille plus dépendante des arbitrages annuels et limite les marges de manœuvre pour faire évoluer ses prestations.
Enfin, ce financement devra garantir l’équilibre de la branche alors que la nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) 2013-2017, signée entre l’État et la CNAF le 16 juillet 2013, prévoit une progression importante du Fonds nationale d’action sociale avec un taux moyen d’évolution de 7,5 % sur la période 2013-2017 et un montant total de 6,673 milliards d’euros en 2017 (26).
Ainsi, M. Henri Sterdyniak, directeur du département « économie de la mondialisation » de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), a souligné, lors de son audition, l’erreur qui consisterait à résoudre la question du financement de la branche famille par une baisse des prestations : « Il y a quelques années, j’ai déjà eu l’occasion d’intervenir sur ces sujets devant une commission présidée par M. Yves Bur. Celle-ci avait malheureusement recommandé une réduction des dépenses " famille " pour résoudre la question du financement de la branche. (…) Je crois que cette piste doit être écartée. Les familles ont besoin de plus de prestations. Le nombre d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté en France. Il faut que les prestations familiales et le revenu de solidarité active (RSA) soient revalorisés et indexés, non pas sur les prix – ce qui aboutit à la paupérisation des familles – mais sur les salaires. »
II. SI LA BRANCHE FAMILLE A CONNU UNE UNIVERSALISATION DE SES DÉPENSES, LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES EST JUSTIFIÉE AU TITRE DE L’OBJECTIF DE CONCILIATION ENTRE LA VIE FAMILIALE ET LA VIE PROFESSIONNELLE
La branche famille a connu un mouvement d’universalisation de ses dépenses qui a conduit, dès 1978, à accorder les prestations familiales à l’ensemble de la population sous seule condition de résidence et sans condition d’activité professionnelle.
Cette évolution pose la question de son financement. Elle a, en effet, conduit les organisations professionnelles d’employeurs à demander la suppression des cotisations patronales familiales au motif que les dépenses de la branche ne répondent plus à une logique assurantielle. Le second argument
– d’ordre économique – repose sur le fait que les cotisations pèsent sur le coût du travail et la compétitivité des entreprises.
Ainsi, lors de son audition par la MECSS, M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) a rappelé que « la CGPME, comme l’ensemble des confédérations patronales interprofessionnelles, milite de longue date pour qu’une partie au moins des cotisations patronales d’allocations familiales soit remplacée par une autre ressource, notamment la TVA. Cette position ancienne repose sur deux éléments qui diffèrent des propositions du Président : l’abaissement, et non la suppression, des cotisations pour les entreprises, d’une part, et le financement par une autre ressource, et non par des économies, d’autre part. Nous l’avons défendue fin 2011 dans un texte dont l’ambition, plus vaste, était une baisse globale des cotisations patronales et de certaines cotisations salariales ».
Ce débat n’est pas nouveau. Cette réforme avait été déjà envisagée, pour les mêmes motifs, par le Président François Mitterrand en novembre 1982 (27) : « Prenons par exemple les allocations familiales. Est-il normal que les entreprises en supportent le poids ? Cela résulte, il est vrai d’une longue tradition française. N’est-ce pas plutôt l’affaire de la Nation dans son ensemble que de concevoir et de soutenir une grande politique familiale ? (…) Le transfert de financement des neuf points que représentent les allocations familiales devra être achevé dans les cinq ans qui viennent. L’opération se fera par priorité et le plus vite possible pour les entreprises les plus exposées à la concurrence internationale. C’est, en tout cas, conforme au bon sens, à l’équité et à mes engagements de mai 1981. » Cette réforme ne sera cependant pas mise en place.
Votre Rapporteur considère que l’argument économique relatif au niveau élevé des prélèvements pesant sur les entreprises n’est pas décisif alors que la participation des entreprises au financement de la branche est justifiée par les mécanismes dont elles bénéficient au titre de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
A. SI LA BRANCHE FAMILLE A CONNU UNE UNIVERSALISATION DE SES DÉPENSES…
Les allocations familiales ont deux origines distinctes : l’une se trouve dans le secteur de la fonction publique et des services publics où des sursalaires familiaux ont été instaurés dès le XIXe siècle (28), l’autre a pour origine l’initiative prise par le patronat démocrate-chrétien du Nord de la France qui a mis en place un dispositif similaire pour compenser les charges familiales des ouvriers. Ces prestations ont ensuite été généralisées à l’ensemble des actifs en 1932 et 1939, puis, dans le cadre de la création de la sécurité sociale en 1945, aux chômeurs, aux malades, aux veuves et aux femmes de prisonniers.
Le mouvement de généralisation est achevé avec la loi du 4 juillet 1975 qui dispose que l’ouverture des droits à prestations n’est plus conditionnée, à compter du 1er janvier 1978, à l’activité professionnelle ou aux cotisations mais à la résidence régulière sur le territoire français. Ainsi, contrairement aux régimes d’allocation chômage ou de retraite où les cotisations ouvrent droit aux prestations, la plupart des prestations familiales ne sont pas conditionnées par une cotisation préalable.
Cette généralisation s’est accompagnée d’une uniformisation des prestations – celles des exploitants et salariés agricoles et des indépendants ayant été alignées sur celles des salariés du secteur privé – et d’une concentration de leur gestion par les caisses d’allocations familiales (29).
La Cour des comptes, dans la communication transmise à la MECSS (30), souligne l’universalité de cette branche : « La branche famille a, de fait, un caractère universel qui se traduit, d’une part, par son unicité puisqu’elle porte dans ses comptes la totalité des prestations familiales, y compris lorsqu’elles sont versées par un autre régime ou une entreprise à statut particulier, et des produits affectés au financement du risque famille et, d’autre part, par l’universalité des droits à prestations, qui ne sont plus conditionnés depuis le 1er janvier 1978 par l’exercice d’une activité ni le paiement de cotisations mais par la seule résidence régulière sur le territoire national. »
Ainsi, l’action en faveur des familles vulnérables est devenue une mission essentielle de la CNAF à partir des années soixante-dix Ces dépenses, bien que minoritaires au sein de la branche, du fait du poids historique des dépenses d’entretien (allocations familiales, complément familial…), relèvent davantage d’une logique de solidarité que d’une logique assurancielle. Ainsi en 2012, 22 % des dépenses de la branche famille sont des compléments de revenus et 10 % sont des aides au logement en faveur de personnes sans enfants.
RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE EN 2012 (1)
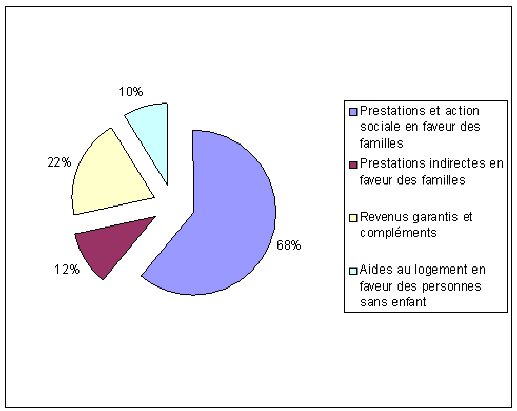
Quant aux dépenses d’entretien, principalement les allocations familiales et le complément familial, elles relèvent moins du principe de couverture d’un « risque » que de celui d’une compensation du coût lié à la charge d’enfant, voire d’égalisation du taux d’effort des familles.
Comme le souligne le rapport d’étape du Haut Conseil du financement de la protection sociale (31), cette diversification s’est accompagnée d’une diversification progressive des finalités de la branche famille : « Aux prestations versées sans conditions de ressources pour compenser des charges de famille (des travailleurs d’abord, des ménages résidant en France ensuite), sont d’abord venues s’ajouter des prestations davantage axées sur la mère et la maternité (allocation de salaire unique, allocation de maternité) puis, surtout, des prestations aux finalités plus " sociales ", versées sous conditions de ressources (allocations en faveur du logement, allocation de parent isolé), ainsi que des prestations ayant pour objectif de permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle (allocations permettant de réduire ou d’interrompre l’activité professionnelle pour élever un enfant, allocations pour frais de garde d’enfant). »
C’est cette évolution qu’a constatée M. Louis Gallois, commissaire général à l’investissement, lors de son audition par la MECSS : « Aujourd’hui, les choses ont changé. Il est normal que les entreprises assument le coût de la protection assurantielle dès lors qu’elle est en lien direct avec leur activité – c’est notamment le cas de l’assurance chômage et d’une partie de l’assurance maladie, à l’exception de la couverture maladie universelle (CMU) –, mais la protection relevant de la solidarité nationale doit, elle, être financée par l’impôt. Or la politique familiale me semble incluse dans cette dernière catégorie. Son financement ne doit donc pas être assuré par les entreprises, sauf à placer celles-ci dans une situation concurrentielle défavorable. »
Cependant, cet argument n’est pas totalement recevable.
En effet, dès la création de la sécurité sociale en 1945, les prestations familiales avaient perdu leur caractère de sursalaire – leur montant étant dissocié du niveau des cotisations pour ne dépendre que du nombre d’enfant – et les allocations avaient été étendues à une grande partie de la population (32). La loi de généralisation de la sécurité sociale du 4 juillet 1975, qui a supprimé les conditions d’activité professionnelle requise pour bénéficier des prestations familiales, n’a donc fait qu’entériner un état de fait existant, sans pour autant que le financement de la branche suscite alors des interrogations.
Par ailleurs, c’est précisément pour prendre en compte l’universalisation de la branche que la CSG a été créée et affectée à la branche famille et que les cotisations patronales ont été baissées en 1991.
C’est ce qu’a rappelé le directeur du budget, M. Julien Dubertret, lors de son audition par la mission : « Cette branche est marquée par une universalisation croissante des prestations et une diversification et une fiscalisation également croissantes des recettes. Les prestations familiales ont été universalisées en 1978 avec la suppression de toute condition d’activité professionnelle, ce qui leur a fait perdre toute dimension contributive. Après différentes étapes, l’aide personnalisée au logement (APL) est par ailleurs créée en 1977 : ce " bouclage des aides au logement ", qui confirmait l’universalisation des prestations, s’est traduit par un ressaut très important des dépenses. Parallèlement, on a assisté à une diminution de la part des cotisations dans les recettes, à une hausse de la CSG et à l’apparition et à la croissance des impôts et taxes affectés. La branche famille est donc de plus en plus universelle du côté des prestations comme des recettes. »
Enfin, comme le montre M. Antoine Math dans son article précité (33), même en considérant que toutes les dépenses répondraient à une seule logique d’universalité, justifier ainsi leur suppression n’est pas très convaincant dès lors que n’existe pas davantage de logique entre les prestations et les taxes affectées qui compensent les allégements de cotisations sociales. Parmi les taxes affectées entre 2006 et 2013, M. Antoine Math cite ainsi la TVA brute collectée auprès des commerçants de gros en production pharmaceutique, la taxe spéciale sur les contrats de santé, divers droits sur les tabacs et sur les alcools, la taxe sur le financement de la prévoyance, la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation, la taxe sur les véhicules terrestres à moteur et la taxe sur les salaires… c’est-à-dire une taxe qui porte sur le travail !
B. … LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES AU FINANCEMENT DE LA BRANCHE EST JUSTIFIÉE PAR LES MÉCANISMES DONT ELLES BÉNÉFICIENT AU TITRE DE LA CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE
1. La diversification des objectifs de la politique familiale : favoriser la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle
Par ailleurs, l’approche des organisations professionnelles patronales néglige la diversification accrue des objectifs de la politique familiale.
En effet, depuis les années 1990, la politique familiale s’est infléchie vers une meilleure prise en compte de la conciliation entre vie familiale et professionnelle des salariés.
Parmi les quatre principaux objectifs que le programme de qualité et d’efficience « famille », annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale, assigne à la politique familiale, figure notamment, au troisième rang, celui de « faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ». Cette politique prend la forme de versements d’allocations, de prestations de service versées aux établissements d’accueil de jeunes enfants et d’aides à l’investissement.
De ce point de vue, la situation française peut encore être améliorée, notamment au regard du taux d’activité des femmes dans les pays de l’Europe du nord.
Ainsi, en 2012, en moyenne sur l’année, 66,6 % des femmes de 15 à 64 ans ont été actives, soit neuf points de moins que les hommes, dont le taux s’élève à 75,3 % (34). Selon l’INSEE (35), si les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail, elles interrompent leur activité plus fréquemment que les hommes, notamment pour s’occuper de leurs enfants. Les écarts de taux d’activité entre hommes et femmes restent donc importants aux âges où les personnes ont de jeunes enfants à charge. En 2010, entre 30 et 35 ans, par exemple, 18 % des femmes sont inactives (36), contre 4 % des hommes.
L’emploi féminin est, par ailleurs, marqué par le temps partiel. En 2010, 31 % des femmes salariées travaillent à temps partiel, contre 7 % de leurs collègues masculins. Cette proportion est passée de 24 à 31 % entre 1990 et 2010. L’importance du temps partiel dans l’emploi féminin s’explique, pour une large part, par leurs contraintes de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle (37). En 2010, 9 % de femmes étaient situation de sous-emploi, contre seulement 3 % des hommes.
Dans le rapport précité sur le financement de la branche famille, la Cour des comptes a actualisé les données présentées à ce sujet par le rapport de notre ancien collègue Yves Bur (38) en 2009, qui avait cherché à récapituler selon deux hypothèses (39), les contributions de la branche famille à la conciliation de la vie familiale et professionnelle.
La Cour des comptes estime que les dépenses relatives à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale sont comprises dans une fourchette comprise entre 10 et 15 milliards d’euros, soit entre 25 et 38 % des prestations légales et d’action sociale servies par la branche ou encore entre 19 et 29 % de l’ensemble des charges techniques de la branche (52,8 milliards d’euros).
En termes de financement, ces montants représentent de l’ordre de 1,4 à 1,8 point de cotisation patronale « famille ». La Cour des comptes conclut : « Ces actions ont un impact positif sur le taux d’activité et contribuent ainsi au dynamisme global du marché du travail et à l’augmentation de la croissance potentielle. Les entreprises bénéficient directement au premier chef de la politique ainsi conduite en termes de meilleure productivité individuelle de leurs salariés ayant la charge d’enfants. »
PRESTATIONS FAMILIALES DESTINÉES À LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE FAMILIALE EN 2011
(Hypothèse basse)
(en milliards d’euros)
Charges |
2011 |
Prestations légales |
6 486 |
Compléments de libre choix d’activité : |
611 |
– dont complément optionnel |
22 |
– dont complément à taux partiel |
589 |
Complément du libre choix du mode de garde : |
5 875 |
– pour l’emploi d’un assistant maternel |
5 475 |
– pour l’emploi d’un garde à domicile |
400 |
Actions collectives sanitaire et sociale |
3 428 |
– dont crédits d’action sociale destinés à la garde des jeunes enfants |
2 402 |
– dont crédits d’action sociale destinés à l’accueil périscolaire (contrat « enfant et jeunesse », champ jeunesse) |
1 026 |
Total |
9 914 |
Source : Cour des comptes.
PRESTATIONS FAMILIALES DESTINÉES À LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE FAMILIALE EN 2011
(Hypothèse haute)
(en milliards d’euros)
Charges |
2011 |
Prestations légales |
11 441 |
Allocations de base de la PAJE et primes |
4 955 |
Compléments de libre choix d’activité : |
611 |
– dont complément optionnel |
22 |
– dont complément à taux partiel |
589 |
Complément du libre choix du mode de garde : |
5 875 |
– pour l’emploi d’un assistant maternel |
5 475 |
– pour l’emploi d’un garde à domicile |
400 |
Actions collectives sanitaire et sociale |
3 428 |
– dont crédits d’action sociale destinés à la garde des jeunes enfants |
2 402 |
– dont crédits d’action sociale destinés à l’accueil périscolaire (contrat « enfant et jeunesse », champ jeunesse) |
1 026 |
Total |
14 869 |
Source : Cour des comptes.
Parmi les personnes auditionnées par la MECSS, hormis les représentants des organisations professionnelles d’employeurs, votre Rapporteur a pu constater le consensus se dégageant autour de la nécessaire implication des entreprises dans le financement de la politique familiale, au moins au titre de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. L’avis des organisations syndicales auditionnées par la MECSS était unanime sur ce sujet.
M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes a confirmé, lors de son audition, les conclusions de la Cour des comptes sur ce sujet : « La légitimité de la participation des entreprises au financement de certaines prestations familiales découle de l’intérêt que les employeurs peuvent avoir à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Cette question se pose en termes nouveaux du fait de l’évolution de notre société. Au fondement de la politique familiale mise en place - volontairement – par les entreprises, il y avait l’idée que le versement d’un sursalaire permettrait à la femme de rester au foyer : désormais, il s’agit de faire en sorte que la femme et l’homme puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, grâce, bien sûr, au système de prestations, mais surtout au développement de l’accueil de la petite enfance, politique continue et ambitieuse qui va connaître de nouveaux développements à la suite de la signature avec la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de la convention d’objectifs et de gestion (COG) pour la période 2013-2017. »
Le président du conseil d’administration de la de la CNAF, M. Jean-Louis Deroussen a partagé le même point de vue : « Pour la CNAF, le fait que les entreprises soient parties prenantes dans le financement de la branche famille a tout son sens. En effet, au travers des prestations financières et des aides à la parentalité, en particulier en matière d’accueil des jeunes enfants, la politique familiale permet aux salariés de concilier vie professionnelle et vie familiale. » Le président de l’Union nationale des associations familiales, M. Antoine Fondart dresse le même constat : « L’UNAF considère cependant que le financement de la branche famille par des cotisations patronales pourrait trouver sa légitimité dans le fait qu’elles représentent la participation des employeurs à l’effort fourni par les salariés pour concilier vie familiale et vie professionnelle. En cela, il ne s’agit pas de charges sociales mais bien de la contribution des entreprises à une politique publique dont elles sont très directement bénéficiaires. »
C’est aussi le point de vue adopté par le directeur de la sécurité sociale, M. Thomas Fatome, lors de son audition : « Certains observateurs ou partenaires sociaux estiment que les entreprises n’ont pas à financer la branche famille. Je suis d’un avis plus nuancé : il faut prendre en considération tous les apports de la politique familiale, en termes de taux d’activité des femmes, de natalité, d’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, de conditions de travail dans l’entreprise… Il ne me paraît donc pas illégitime que les employeurs soient mis à contribution pour financer la branche famille. Certes, un débat politique doit déterminer à quelle hauteur, et selon quelles modalités, mais les évolutions, je l’ai dit, ont déjà été massives depuis trente ans. Il me semblerait en tout cas quelque peu illogique que les entreprises ne participent pas du tout au financement de la branche famille. »
Enfin, le Haut Conseil du financement de la protection sociale est parvenu à la même conclusion (40) :« Le maintien d’une fraction de cotisations acquittées par les employeurs peut apparaître comme une contrepartie de l’intérêt que les entreprises trouvent à la politique familiale française, qui permet l’articulation des responsabilités familiales et professionnelles des parents de jeunes enfants au travers d’une offre diversifiée de services et de structures d’accueil. »
2. La participation des entreprises au financement de la branche famille : asseoir la légitimité des partenaires sociaux dans sa gouvernance
La participation des entreprises au financement de la branche famille pose aussi la question de la gouvernance de la branche.
Lors de son audition par la MECSS, M. Christian Pineau, chef du service des affaires sociales de l’Union professionnelle artisanale (UPA), a considéré que les employeurs devraient rester impliqués dans la gouvernance de la branche : « Toutefois, à la question de savoir si, les cotisations patronales à la branche famille étant supprimées, il serait encore légitime pour les entreprises de continuer de s’occuper de la politique familiale, je répondrais oui. En effet, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée est un sujet de préoccupation quotidien, surtout pour les petites entreprises. Le fait que la vie privée des salariés puisse être en totale articulation avec leur vie professionnelle est capital pour des entreprises qui ont un lien très étroit avec leurs salariés – c’est le cas de celles que je représente, qui n’ont qu’un ou deux salariés. Ce n’est donc pas parce que les entreprises ne participeraient plus au financement de la branche famille que, pour autant, elles n’auraient plus intérêt à accompagner, voire à gérer la politique familiale en continuant de siéger au sein des organismes de gestion de la branche famille. »
Votre Rapporteur trouve étonnant que les organisations professionnelles d’employeurs se sentent trop peu impliquées dans la politique familiale pour en assurer une partie du financement tout en considérant que cette politique les concerne assez pour qu’ils participent à sa gestion et à sa gouvernance…
Maintenir une participation des entreprises, même résiduelle, au financement de la politique familiale, est aussi un moyen d’asseoir la légitimité des partenaires sociaux dans la gouvernance de la branche famille.
C. LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES À L’INVESTISSEMENT
DE LA NATION EN FAVEUR DES FAMILLES
Pour mieux prendre en compte l’implication des entreprises dans la politique familiale, il faut aussi prendre en compte l’ensemble des dépenses consacrées à la famille en France, au-delà des dépenses de la branche famille.
M. Antoine Math, dans son article précité (41), évalue les dépenses annuelles de la société pour les enfants de moins de 20 ans à environ 14,1 % du PIB, soit de l’ordre de 17 800 euros par enfant. En y ajoutant une valorisation des soins et tâches domestiques dont bénéficient les enfants, c’est-à-dire le temps nécessaire consacré par les parents (42), le coût total peut être estimé à environ 23,4 % du PIB, soit près de 30 000 euros par enfant.
Une bonne partie de ces coûts est prise en charge par des dépenses publiques, évaluées à 180 milliards d’euros (43). 56 % sont des dépenses d’éducation, 11 % des dépenses en nature de santé et 33 % d’autres dépenses sociales usuellement classées dans la politique familiale (44).
En ajoutant d’autres contributions des employeurs estimées à environ 20 milliards d’euros (45), M. Antoine Math évalue que la contribution totale des entreprises serait de l’ordre de 55 milliards d’euros, soit 19 % des dépenses pour les enfants hors tâches domestiques ou près de 12 % des dépenses pour les enfants en incluant les tâches domestiques. Il conclut : « Les entreprises contribuent donc pour un dixième – c’est un ordre de grandeur – aux dépenses nécessaires pour produire, éduquer et former enfants et futurs salariés, et pour permettre à leurs salariés d’être disponibles malgré leurs obligations parentales. Un tel constat ne permet pas de conclure à une contribution excessive des entreprises. »
III. L’ALLÉGEMENT DES COTISATIONS PATRONALES FAMILIALES S’INSCRIT DANS UNE ÉVOLUTION ENGAGÉE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ET VISANT À ATTÉNUER LA PART DE CES COTISATIONS DANS LES COÛTS SALARIAUX
Le Président de la République, dans sa conférence de presse du 14 janvier dernier, a annoncé la mise en place d’un Pacte de responsabilité, qui doit permettre d’alléger les charges des entreprises, notamment par une baisse ou une suppression des cotisations sociales patronales. Cette réforme s’inscrit dans une évolution engagée depuis les années quatre-vingt-dix et visant à diminuer le coût du travail en baissant les cotisations sociales.
A. UNE ÉVOLUTION ENGAGÉE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ET VISANT À ATTÉNUER LA PART DES COTISATIONS PATRONALES FAMILIALES DANS LES COÛTS SALARIAUX
1. Le financement de la branche famille par des cotisations patronales : une spécificité française
Comme votre Rapporteur l’a montré précédemment, les prestations familiales, originellement conçues comme des « sursalaires » alloués par certains employeurs à leurs salariés, sont longtemps restées subordonnées à l’exercice d’une activité professionnelle. Cette origine explique que la politique familiale ait été financée par des cotisations patronales.
Ce financement est une particularité de la France même au sein des pays qui ont adopté un modèle bismarckien de financement de la sécurité sociale comme l’a rappelé le président de la sixième chambre de la Cour des comptes, M. Antoine Durrleman, lors de son audition par la mission : « Financer la politique familiale essentiellement par des cotisations patronales est une spécificité française qu’on ne retrouve pas à l’étranger, notamment en Allemagne, pays le plus proche du nôtre en termes d’organisation de la protection sociale. En Allemagne, la politique familiale – qui représente 3 % du PIB – est adossée non à la sécurité sociale mais directement au budget de l’État. Elle passe surtout par des prestations et très peu par des services, alors que notre politique combine les deux logiques. Nos dispositifs de garde des jeunes enfants ou de prise en charge des moins de dix-huit ans au sein de différentes structures d’animation et d’accompagnement n’ont pas d’équivalents en Allemagne. »
En effet, une majorité de pays européens financent la politique familiale par l’impôt. Seuls quelques pays, dont la France, s’écartent de ce schéma. Dans cinq pays de l’Union européenne, les allocations familiales sont financées par un système mixte d’impôts et de cotisations. Il s’agit de la France, de la Belgique, du Luxembourg, de Malte et de l’Autriche. Enfin, seuls deux pays ont recours exclusivement aux cotisations : la Grèce, où la charge est répartie entre employeurs et salariés, et l’Italie, où elle est à la charge unique des employeurs.
2. Une baisse continue des cotisations patronales familiales depuis 1945
En 1946, le taux des cotisations sociales « famille » s’élevait à 16,75 %, mais leur plafonnement les rendait dégressives. L’évolution du financement de la politique familiale est ensuite marquée par une baisse régulière des cotisations familiales au bénéfice des branches maladie et vieillesse, et en même temps par leur déplafonnement progressif qui a fait disparaître la dégressivité, comme le montre le tableau suivant :
ÉVOLUTION DU TAUX DES COTISATIONS SOCIALES « FAMILLES » DEPUIS 1946
1946 |
1974 |
1989 |
1990 |
1991 |
2014 |
16,75 % |
9 % |
8 % (1) |
7 % (2) |
5,4 % (3) |
5,25 % |
(1) dont 4,5 % plafonnés et 3,5 % déplafonnés.
(2) rémunérations déplafonnées pour les cotisations patronales de salariés.
(3) rémunérations déplafonnées.
Cette baisse des taux s’est accompagnée, comme il a été évoqué précédemment, d’une fiscalisation des recettes de la branche famille et une diminution de la part corrélative des cotisations sociales dans le financement de la politique familiale. En effet, depuis les années 1990, la structure du financement de la branche famille a évolué du fait, d’une part, de la création de la CSG en 1991 et de l’affectation à la branche famille, depuis cette date, d’une fraction du produit de cet impôt et, d’autre part, des exonérations de cotisations patronales d’allocations familiales prises en charge par le budget de l’État à partir de la loi du 27 juillet 1993 (46).
Cette politique d’exonération des cotisations patronales a conduit à un taux réel de cotisation des entreprises bien inférieur au taux affiché de 5,4 % en 2013 et 5,25 % en 2014.
C’est ce qu’a rappelé Mme Marie-Madeleine Pattier, administratrice de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) à la Caisse nationale des allocations familiales, lors de son audition par la MECSS : « J’observe qu’on parle toujours de 5,4 % de cotisations patronales en oubliant qu’au fil des années, ce taux a été abaissé à 1,3 % ou à 1,6 %, selon la taille de l’entreprise, pour les salaires égaux à 1,1 SMIC. Il n’est encore que de 4,8 % quand on en arrive à 1,5 SMIC, de sorte que le taux de cotisation moyen, pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, s’établit à 2,6 %, loin donc des 5,4 % annoncés. Nous aimerions que l’on dise les choses telles qu’elles sont, d’autant que le MEDEF sait fort bien ce que lui coûtent ces cotisations. »
C’est aussi ce que souligne la Cour des comptes dans le rapport final sur le financement de la branche famille remis à la MECSS en constatant que cette participation allégée des entreprises à la politique familiale n’est généralement pas prise en compte dans le débat politique (47) : « Ce mouvement est cependant resté très peu lisible : la cotisation affichée demeure identique quel que soit le niveau de rémunération, alors même que celle effectivement acquittée n’est plus proportionnelle mais progressive sur les bas salaires. Ce désajustement tend à fausser le débat sur les charges pesant effectivement sur les entreprises. »
En effet, les premiers allégements généraux de cotisations sociales ont concerné la branche famille, la loi du 27 juillet 1993 ayant instauré un allégement de 5,4 % de la cotisation patronale « famille » dégressif jusqu’à 1,2 SMIC. De nouveaux allégements ont été mis en place par les lois du 4 août 1995 relative à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale (48) et du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (49). L’ensemble de ces dispositifs ont été fusionnés par la loi du 12 juin 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi (50) qui a créé la réduction générale de cotisations sociales patronales dite « réduction Fillon » (51).
L’évolution des allégements de cotisations sociales patronales
La branche famille a été la première concernée par les allégements généraux. La loi du 27 juillet 1993 a ainsi instauré un allégement de 5,4 % de la cotisation patronale famille dégressif jusqu’à 1,2 SMIC.
La loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle de décembre 1993 prévoyait une extension progressive de cet allégement vers les hauts salaires à compter de janvier 1995. La loi du 4 août 1995 relative à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale a cependant étendu les allégements, appelés « ristourne dégressive Juppé », à l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale. Un nouvel allégement est ensuite créé qui fusionne les dispositifs de 1993 et 1995 avec un taux de 18,2 % dégressif linéairement jusqu’à 1,33 SMIC.
Une nouvelle vague d’allégements a par la suite accompagné la réforme du temps de travail en 2000 avant que tous ces dispositifs soient fusionnés par la loi du 12 juin 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi qui crée la réduction générale de cotisations sociales patronales dite « réduction Fillon » (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).
La montée en puissance de ces allégements généraux de cotisations, a fortement modifié le profil des prélèvements sociaux :
– au niveau du SMIC, les entreprises sont aujourd’hui exonérées de la totalité – pour les entreprises de moins de vingt salariés – ou de la quasi-totalité – pour les entreprises de vingt salariés et plus – des cotisations patronales de sécurité sociale. Parmi les cotisations patronales de sécurité sociale, la cotisation à la branche « accidents du travail » est la seule qui reste due intégralement au niveau du salaire minimum (52). Avec cette cotisation, les seuls prélèvements obligatoires à la charge des employeurs au niveau du salaire minimum sont les cotisations au profit des régimes conventionnels (UNEDIC, AGIRC-ARRCO), ainsi que des contributions au profit d’organismes divers (53) et la contribution de solidarité pour l’autonomie ;
– le barème des cotisations est à présent fortement progressif jusqu’au point de sortie des allégements généraux en faveur des bas salaires. Il n’est que légèrement dégressif au-delà du plafond, le différentiel de prélèvement social étant relativement faible de part et d’autre. Toutefois, pour des rémunérations extrêmement élevées, le taux moyen de prélèvement social décroît de manière importante en raison du plafonnement des cotisations de chômage et AGIRC.
EFFET DE L’ALLÉGEMENT GÉNÉRAL SUR LES BAS SALAIRES
AU 1ER JANVIER 2014
(Cas d’une entreprise de 20 salariés ou plus)
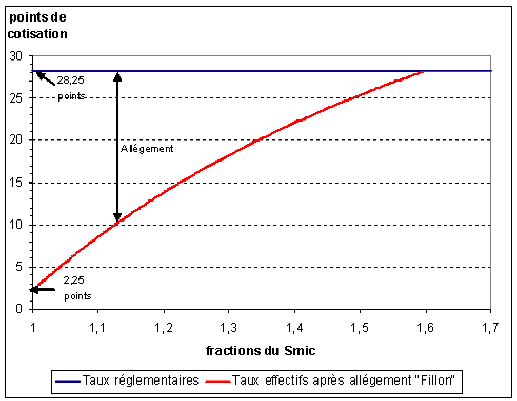
Source : annexe V au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Les exonérations générales de cotisations sur les salaires compris entre 1 et 1,6 SMIC représentent ainsi 3,9 milliards d’euros, soit 13 % du montant total des cotisations sociales « famille » auxquelles s’ajoutent les exonérations ciblées en faveur de certaines parties du territoire (zones franches, zones de revitalisation rurale…) ou de certains publics (contrats aidés, etc.).
La Cour des comptes évalue qu’en 2013, ce sont 35 % de la masse salariale et 56 % des effectifs en équivalents temps plein pour lesquels le taux de 5,4 % n’est de facto pas appliqué et pour lesquels le taux des cotisations effectivement payées par les entreprises au titre de la branche famille est d’un point inférieur au taux nominal.
Pour les salaires situés entre 1 et 1,6 SMIC, le taux de cotisation moyen effectivement acquitté s’élève à 2,6 %.
COTISATION FAMILLE DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS ET DE PLUS DE 20 SALARIÉS EN 2013
Cotisation |
SMIC |
1,1 SMIC |
1,2 SMIC |
1,3 SMIC |
1,4 SMIC |
1,5 SMIC |
> 1,6 SMIC |
Dans les entreprises de moins de 20 salariés |
0 |
1,3 |
2,4 |
3,3 |
4,1 |
4,8 |
5,4 |
Dans les entreprises de plus de 20 salariés |
0,4 |
1,6 |
2,6 |
3,5 |
4,2 |
4,8 |
5,4 |
Source : Cour des comptes.
Une telle baisse de la participation des entreprises a d’ailleurs conduit la Cour des comptes (54) à recommander, à plusieurs reprises, l’intégration des « allégements Fillon » au barème afin de « mettre fin à l’affichage d’un niveau de prélèvement sur les salaires plus élevé qu’il n’est en réalité ce qui fausse l’appréciation des acteurs économiques sur la compétitivité du pays » (55).
3. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : un allégement complémentaire du coût du travail pour les entreprises
Dans son rapport intitulé Le pacte pour la compétitivité et l’industrie française, remis au Gouvernement le 5 novembre 2012, M. Louis Gallois, proposait notamment de « créer un choc de compétitivité en transférant une partie significative des charges sociales jusqu’à 3,5 SMIC, de l’ordre de 30 milliards d’euros, soit 1,5 point de PIB, vers la fiscalité et la réduction de la dépense publique », ce transfert devant concerner à hauteur de deux tiers sur les cotisations patronales.
Dans son prolongement, a été créé par l’article 66 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qui a pour objet « l’amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement ».
Ce crédit d’impôt s’élève à 4 % de la masse des salaires inférieurs à 2,5 SMIC pour ce qui concerne les rémunérations versées en 2013 et 6 % en 2014. Il correspond à un allégement global du coût du travail de 20 milliards d’euros par an en régime de croisière, avec une montée en charge sur trois ans (56).
Peuvent bénéficier du CICE : les entreprises employant des salariés et soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) d’après leur bénéfice réel ; les entreprises dont le bénéfice est exonéré transitoirement, en vertu de certains dispositifs d’aménagement du territoire ou d’encouragement à la création et à l’innovation ; les organismes partiellement soumis à l’IS, comme les coopératives ou les organismes HLM, uniquement au titre de leurs salariés affectés à une activité soumise à l’IS.
Bien que proche dans son effet d’une baisse des cotisations assises sur la masse salariale, le mécanisme du CICE présente des différences notables dans les premières années de mise en œuvre, à la fois pour les entreprises et pour l’État. Ainsi, le crédit d’impôt est calculé sur la base de l’impôt de l’année N qui est payé en N+1. Il n’est donc pas supporté par les finances publiques dès l’année de sa création mais seulement à compter de l’année suivante. En revanche, un dispositif de préfinancement bancaire permet aux entreprises de bénéficier d’un préfinancement de leur créance sur l’État.
Les avances au titre du préfinancement du CICE
Selon les données du Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), les avances au titre du préfinancement qui sont proposées par Bpifrance et les banques commerciales sont les suivantes :
– Au 20 septembre 2013, Bpifrance a reçu 10 000 demandes de préfinancement, pour un montant total de 920 millions d’euros. Sur ce total, 680 millions d’euros de préfinancement ont été accordés. Pour l’année 2013, le Comité de suivi table sur 1 milliard d’euros accordés. Près de 60 % de l’ensemble des dossiers reçus par Bpifrance concernent des demandes inférieures à 25 000 euros. Celles-ci représentent 7 % des 920 millions d’euros de préfinancement sollicités ;
– la montée en charge a été tardive pour les banques commerciales. Au 30 juillet 2013, des certificats de créance ont été délivrés pour 119 dossiers aux banques commerciales, pour un montant de préfinancement d’environ 45 millions d’euros.
Le choix d’un crédit d’impôt permet d’éviter d’avoir à toucher à plusieurs types de cotisations au niveau du SMIC, où le taux de prélèvements obligatoires résiduel – hors cotisation à la branche « accidents du travail-maladies professionnelles » – n’est que de 17,9 % répartis entre une dizaine de bénéficiaires, et de faire porter le financement intégralement par le budget de l’État, le CICE s’analysant comme une nouvelle et importante dépense fiscale impactant le rendement de l’impôt sur les sociétés.
Lors de son audition, Mme Selma Mahfouz, membre du Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, a donné aux membres de la MECSS les premières estimations sur la mise en place du CICE. Celles-ci sont détaillées dans l’encadré suivant.
Premier bilan de la mise en place du CICE
Avec un seuil à 2,5 SMIC, le CICE couvre 65,7 % de la masse salariale des entreprises. Les micro-entreprises sont celles qui, en proportion de leur masse salariale, bénéficient le plus du CICE, puisque 82,5 % de leur masse salariale déclarée entre dans le champ du CICE contre 56 % pour les grandes entreprises. Le ciblage du dispositif est donc large.
S’agissant des secteurs, la part de la masse salariale entrant dans le champ du dispositif est de 63 % pour l’industrie manufacturière. Dans la mesure où celle-ci représente une part importante de la masse salariale totale en France (19 %), elle devrait bénéficier de 18 % du montant total de l’effort budgétaire que constitue le CICE, soit 13 milliards en 2013 et 20 milliards en 2014.
Pour le secteur de l’hébergement et de la restauration, 90 % de la masse salariale entrent dans l’assiette. Mais comme il ne représente que 4 % de la masse salariale totale, il devrait bénéficier de 5 % de l’effort budgétaire total du CICE.
Il existe également des différences régionales. En Île-de-France, 45 % de la masse salariale entrent dans le champ du CICE. Pour toutes les autres régions, ce taux est d’environ 70 %, avec un pic à 81 % pour le Limousin. Cela s’explique par le fait que les salaires sont plus élevés en moyenne en Île-de-France.
Par ailleurs, 46 % de la masse salariale des entreprises exportant plus de 35 % de leur chiffre d’affaires sont éligibles au CICE, contre 80 % pour les entreprises non exportatrices.
Enfin, 38 % du montant total du CICE bénéficieront aux entreprises non exportatrices, 35 % à celles dont les exportations représentent moins de 5 % de leur chiffre d’affaires et 27 % à celles exportant plus de 5 % de leur chiffre d’affaires.
Source : INSEE sur la base des données tirées des déclarations annuelles des données sociales pour 2011.
Dans le rapport final sur le financement de la branche famille remis à la MECSS (57), la Cour des comptes constate que la mise en place du CICE contribue à fausser davantage le débat sur les charges pesant effectivement sur les entreprises : « L’institution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi accroît encore ce brouillage dès lors que ce dernier poursuit la même finalité que la politique d’allégement des charges des entreprises sans s’articuler clairement avec elle. »
Pour clarifier le débat, la Cour fait l’hypothèse que le CICE est un instrument de compensation du poids des prélèvements sociaux portant sur les entreprises pour montrer l’impact cumulé des deux mécanismes détaillé dans le tableau suivant :
TAUX DES PRINCIPAUX PRÉLÈVEMENTS SUR LA MASSE SALARIALE
APRÈS PRISE EN COMPTE DU CICE
Cotisations sociales |
Entreprises de plus de 20 salariés | ||||||
SMIC |
1,1 SMIC |
1,2 SMIC |
1,3 SMIC |
1,4 SMIC |
1,5 SMIC |
> 1,6 SMIC < 2,2 SMIC (2) | |
Sécurité sociale dont (1) |
4,6 |
10,9 |
16,2 |
20,6 |
24,4 |
27,7 |
30,6 |
Famille (3) |
0,4 |
1,6 |
2,6 |
3,5 |
4,2 |
4,8 |
5,4 |
Régimes compl. de vieillesse |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
Assurance chômage |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Autres contributions |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Sous total |
20,3 |
26,6 |
31,9 |
36,3 |
40,1 |
43,4 |
46,3 |
CICE |
– 6 |
– 6 |
– 6 |
– 6 |
– 6 |
– 6 |
– 6 |
Total |
14,3 |
20,6 |
25,9 |
30,3 |
34,1 |
37,4 |
40,3 |
(1) y compris accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP).
(2) montant du plafond de la sécurité sociale.
(3) cotisation calculée au prorata des taux de cotisation initiaux toutes branches confondues.
Source : Cour des comptes – direction générale du Trésor, direction de la sécurité sociale (DSS).
La Cour constate que, si on complète cette hypothèse d’une affectation spécifique à la couverture des cotisations patronales familiales, ce tableau met en évidence que le CICE ferait plus qu’en annuler, économiquement, l’incidence résiduelle en deçà de 2,5 SMIC.
B. L’ALLÉGEMENT DES COTISATIONS DES ENTREPRISES DANS LE CADRE DU PACTE DE RESPONSABILITÉ
Le Pacte de responsabilité, annoncé par le Président de la République le 14 janvier dernier, doit permettre « d’alléger les charges des entreprises, réduire leurs contraintes et en contrepartie permettre plus d’embauche et davantage de dialogue social ». Il comprend quatre volets :
– la poursuite de l’allégement du coût du travail pour les entreprises et les travailleurs indépendants d’ici 2017 ;
– la mise en place d’une « trajectoire de prélèvements obligatoires pour les entreprises » à l’horizon 2017 ;
– la « réduction du nombre de normes et de procédures coûteuses et inutiles » pour simplifier et faciliter la vie des entreprises ;
– des contreparties qui porteront sur le travail des seniors, la qualité de l’emploi, la modernisation du dialogue social et la création d’emplois.
Ce Pacte s’inscrit donc dans la continuité des politiques menés depuis les années quatre-vingt-dix et visant à réduire le coût du travail.
Le Premier ministre a d’ores et déjà annoncé que les 20 milliards d’euros du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) seraient conservés. En effet, la transformation du CICE en un allégement de cotisations sociales serait particulièrement complexe, le CICE étant calculé sur les bénéfices des entreprises de l’année précédente, alors que les allégements de cotisations s’appliquent dès leur entrée en vigueur. À cause de ce décalage dans le temps, transformer le CICE en baisses de cotisations aurait donc des conséquences sensibles tant pour la trésorerie des entreprises que pour les finances publiques.
S’agissant des 10 milliards d’euros restant, ils pourraient prendre la forme d’un relèvement des seuils des allégements « réductions Fillon » pour concentrer l’effort sur les bas salaires.
C. UNE PRISE EN CHARGE CROISSANTE DU FINANCEMENT DE LA BRANCHE FAMILLE PAR LES MÉNAGES
Des analyses récentes font apparaître une augmentation de la prise en charge par les ménages du financement des risques sociaux en France et au sein de l’Union européenne.
Une étude réalisée par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) (58) du ministère chargé des affaires sociales montre ainsi que, de 1990 à 2006, le financement de la protection sociale a évolué pour presque tous les risques, dans le sens d’une progression de la part des impôts et taxes affectés due principalement au développement de la CSG et aux mesures de compensation des exonérations de cotisations patronales. La DREES constate ainsi que « les modifications des taux de prélèvements ont transféré 33 milliards d’euros de l’assiette des salaires vers d’autres assiettes ».
Cette évolution s’observe également dans les autres pays européens. Dans l’Union européenne à quinze, entre 1996 et 2009, la part dans le PIB des contributions publiques affectées au financement de la protection sociale a, elle aussi, fortement augmenté (+ 3 points de PIB), tandis que celle des cotisations à la charge des employeurs restait quasiment stable (+ 0,2 point de PIB) et celle des cotisations des assurés était en baisse (– 0,85 point de PIB). La structure du financement s’en est, dès lors, trouvée globalement déformée, le poids des contributions publiques s’étant ainsi accru.
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
(hors transferts)
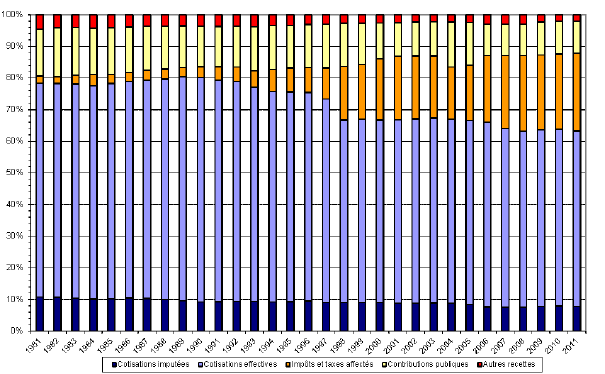
Source : Haut Conseil du financement de la protection sociale.
Lors de son audition par la mission, le directeur de la sécurité sociale, M. Thomas Fatome a souligné cette baisse de la part des cotisations sociales dans le financement de la branche famille : « Il est d’abord intéressant de noter que la part des cotisations patronales représenterait, avec l’adoption du PLFSS, 61,7 % du total des recettes de la branche famille, puisque ce taux diminue sous l’effet de la baisse de 0,15 point des cotisations patronales, compensée par l’affectation de recettes nouvelles et par l’apport du milliard d’euros lié à la baisse du quotient familial. C’est une étape supplémentaire d’une évolution structurelle longue : au début des années 1990, la branche famille était financée à 90 % par des cotisations patronales ; aujourd’hui, nous sommes tout juste au-dessus de 60 %. »
ÉVOLUTION DE LA PART DES COTISATIONS DANS LE FINANCEMENT
DE LA BRANCHE FAMILLE
1990 |
1995 |
2013 |
2014 |
95 % |
66 % |
64 % |
61,7 % |
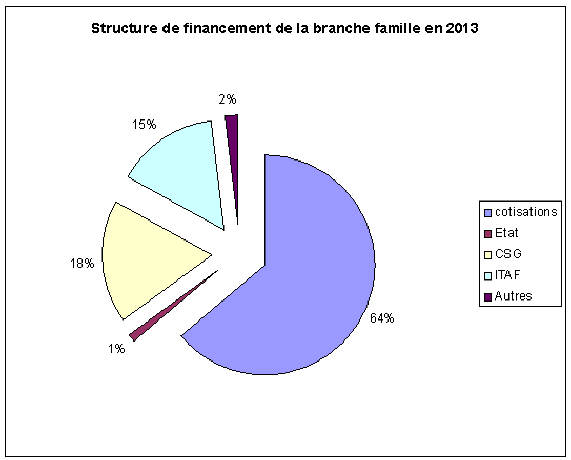
Comme le souligne la Cour des comptes (59), cette évolution a conduit à faire peser – sans que cela soit très visible – une part croissante du financement de la branche famille sur les ménages : « En termes d’agents économiques, ces évolutions ont cependant eu pour effet de ramener de 100 % en 1990 à 70 % les prélèvements dont les entreprises sont directement redevables pour financer la branche famille, les ménages supportant le reste du financement. La création de la CSG puis la généralisation des mesures compensées d’allégements de cotisations se sont traduites par un transfert de plus de 13 milliards d’euros en 2012 des entreprises vers les ménages. Cette évolution est cependant brouillée et la réalité du financement de la branche, d’ores et déjà assuré pour une part importante par les ménages, est de fait peu intelligible. »
IV. UNE RÉFORME QUI DOIT PRENDRE EN COMPTE LES EFFETS LIMITÉS DES BAISSES DE COTISATIONS SOCIALES SUR L’EMPLOI ET L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA NOUVELLE RECETTE AFFECTÉE À LA BRANCHE FAMILLE
Les annonces du Président de la République, dans sa conférence de presse du 14 janvier, sont lourdes de conséquences pour la branche famille puisque ce sont 30 milliards d’euros – ou 10 milliards d’euros si les 20 milliards d’euros du CICE sont « recyclés » dans la suppression des cotisations patronales familiales – qu’il s’agira de combler chaque année pour assurer son financement si les cotisations patronales « famille » sont supprimées.
Au fondement de cette décision, il y a la question du coût du travail qui pénaliserait l’emploi et la compétitivité : la baisse du coût du travail pourrait agir comme une forme de dévaluation monétaire à l’échelle de l’économie française dans une zone euro impuissante à agir sur cette question. Il est donc utile de se pencher l’impact des cotisations sociales sur le coût du travail, l’emploi et la compétitivité.
A. LES DÉBATS THÉORIQUES SUR LE COÛT DU TRAVAIL ET LES EXPÉRIENCES PASSÉES NE DÉMONTRENT PAS DE CORRÉLATIONS ÉVIDENTES ENTRE LA BAISSE DES COTISATIONS SOCIALES ET LES CRÉATIONS D’EMPLOI
1. Les cotisations patronales familiales : un poids limité sur le coût du travail
Un des arguments économiques avancés pour justifier la baisse de cotisations sociales familles est celui d’un excès de charge pesant sur les entreprises. Cet argument peut être cependant réfuté.
Ainsi, lors de son audition, M. Gérard Cornilleau, directeur adjoint au département des études de l’OFCE, a remis en question l’idée d’un poids excessif de la fiscalité sur le travail : « La situation actuelle est à mon sens très différente de celle des années 1970-1980. À cette époque, il existait un véritable déséquilibre dans le partage du revenu en faveur des salaires, et tout ce qui allait dans le sens d’un allégement du coût du travail était bienvenu. Aujourd’hui, en revanche, l’équilibre général du partage du revenu est plutôt trop favorable au profit. Dès lors, il ne semble pas forcément pertinent de viser systématiquement l’allégement du coût du travail. Mais nous faisons partie d’une Union monétaire dont la gestion laisse à désirer : chaque pays peut s’engager à sa guise dans une politique de déflation salariale. Si nous cédons à cette surenchère avec certains de nos partenaires européens, ce sera, je crois, une politique " perdant-perdant ". »
De même, M. Antoine Math, dans son article précité (60), souligne que la part des cotisations patronales dans la valeur ajoutée des sociétés a diminué de façon continue passant de 19 % en moyenne dans les années 1980 à 17,7 % dans les années 1990, et 16,6 % en 2012. De même, le total des impôts et cotisations sociales à la charge des employeurs dans la valeur ajoutée des entreprises a baissé, de 26,2 % en moyenne dans les années 1980 à 23,8 % en 2010 avant d’atteindre 25,5 % en 2012.
M. Antoine Math conclut : « Dans ces conditions, faire porter l’effort sur les ménages, par une augmentation de leurs prélèvements (impôt sur le revenu, CSG, TVA…) ou une réduction des dépenses qui leur sont destinées, apparaît discutable. D’autant que les employeurs vont encore voir leur prélèvement fortement diminuer avec le crédit d’impôt compétitivité emploi, 10 milliards d’euros en 2014 puis 20 à partir de 2015, venant s’ajouter aux avantages fiscaux consentis lors du précédent quinquennat (suppression de la taxe professionnelle, extension du crédit impôt recherche). En dépit du discours dominant, les entreprises ont non seulement été largement épargnées des efforts mais largement favorisées. La baisse des cotisations sociales famille peut difficilement se justifier par l’argument d’une pression fiscale trop élevée. »
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS ET IMPÔTS DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES EN % DE LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE
(en %)
Année |
Cotisations sociales employeurs |
Impôts |
Total |
Moyenne 1980-1989 |
19 |
7,1 |
26,2 |
Moyenne 1990-1999 |
17,7 |
8,1 |
25,8 |
2000 |
19 |
7,1 |
26,2 |
2001 |
17,7 |
8,1 |
25,8 |
2002 |
16,5 |
9,3 |
25,9 |
2003 |
16,4 |
9,7 |
26 |
2004 |
16,5 |
8,9 |
25,4 |
2005 |
16,5 |
8,3 |
24,8 |
2006 |
16,3 |
8,6 |
24,9 |
2007 |
16 |
9,2 |
25,2 |
2008 |
16 |
9,9 |
25,9 |
2009 |
15,7 |
9,9 |
25,5 |
2010 |
15,6 |
9,9 |
25,6 |
2011 |
16,1 |
7,7 |
23,8 |
2012 |
16,1 |
7,8 |
23,8 |
Source : INSEE – Comptabilité nationale.
De même M. Christian Chavagneux, dans un article consacré au Pacte de responsabilité (61), constate que, selon les secteurs, le coût du travail représente entre 20 et 25 % du coût de production total. Selon les données de l’INSEE, en 2012, le total des rémunérations versées par les entreprises (62) s’est élevé environ à 700 milliards d’euros. Sur ce total, les cotisations patronales représentent 170 milliards d’euros, soit 25 % du coût salarial, et les cotisations familiales environ 35 milliards d’euros, soit 5 % du coût du travail. La suppression des cotisations « famille » représenterait donc une baisse de 5 % du coût du travail, soit une baisse très limitée de 1,2 % des coûts de production.
Ces données ont conduit Mme Anne Eydoux, chercheuse au Centre d’études de l’emploi, à conclure devant la MECSS que les cotisations « famille » représentent « peu par rapport aux 170 milliards d’euros de cotisations payés par les employeurs et même une goutte d’eau dans la somme des coûts de production des entreprises ».
2. Le lien entre les cotisations sociales et le coût du travail
a. La corrélation entre niveau de cotisations patronales et coût du travail est faible
La théorie économique montre l’absence de lien univoque entre le coût du travail et l’emploi. En effet, si dans une perspective libérale, la baisse des salaires et des cotisations stimule la demande de travail, dans une perspective keynésienne, à l’inverse, une hausse des salaires, lorsqu’elle stimule la demande et notamment la consommation, peut avoir des effets positifs sur la production et sur l’emploi. Selon la théorie néokeynésienne des salaires d’efficience, une hausse des salaires peut améliorer la productivité des salariés, plus motivés.
Par ailleurs, le taux des cotisations sociales des employeurs n’est pas un déterminant significatif du coût du travail, comme l’a montré dès 1990, une étude réalisée par MM. Jean-Philippe Cotis et Abderrahim Loufir (63). Ces deux économistes ont, en effet, démontré que les salaires nets s’ajustent immédiatement aux augmentations de cotisations salariales et vraisemblablement à bref délai aux hausses de cotisations patronales : par conséquent, ni les cotisations salariales ni les cotisations employeurs n’influent à moyen terme le coût du travail.
Ainsi, le Conseil d’analyse stratégique (CAS) a montré, dans une note réalisée en 2008 (64), l’absence de corrélation entre le coût du travail et le taux de cotisations patronales et plus généralement le prélèvement socio-fiscal sur les salaires dans les trente pays de l’OCDE. Les auteurs de l’étude constatent une corrélation légèrement positive pour les salariés rémunérés au bas de l’échelle des salaires (deux tiers du salaire moyen) – l’existence de planchers de rémunération limitant sans doute les possibilités de substitution entre les cotisations sociales et le salaire net – et concluent que si le financement de la protection sociale entraîne un handicap compétitif, ce n’est donc que pour les bas salaires et dans des proportions limitées.
De même, l’INSEE, dans un document réalisé pour le compte du Haut Conseil du financement de la protection sociale (65), constate « qu’à moyen ou long terme, le taux de cotisations sociales employeur n’est pas un déterminant significatif du coût horaire dans l’Union européenne » et « qu’à long terme seul le niveau global de taxe compte, pas la répartition entre cotisations sociales employeurs, cotisations sociales salariales et impôt sur le revenu ». En 2008, dans certains pays où les cotisations sociales à la charge des employeurs représentent une part plus faible qu’en France (Allemagne, Danemark, Pays-Bas, notamment), les salaires horaires bruts sont souvent, malgré tout, plus élevés.
Il apparaît ainsi que des pays peuvent avoir des niveaux de cotisations sociales très différents et présenter pourtant des niveaux de coût salarial similaire.
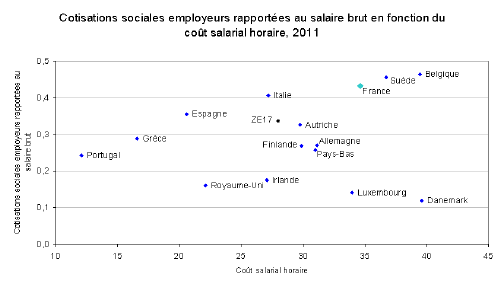
Source : Haut conseil de financement de la protection sociale
b. Les enseignements de la comparaison entre la France et l’Allemagne
Le coût horaire du travail en France a connu entre 1996 et 2011 une croissance proche de la médiane européenne dans l’industrie et inférieure dans les services marchands.
COÛT HORAIRE DE LA MAIN-D’œUVRE DANS L’ENSEMBLE MARCHAND (1)
Troisième trimestre 2013
(en euros)
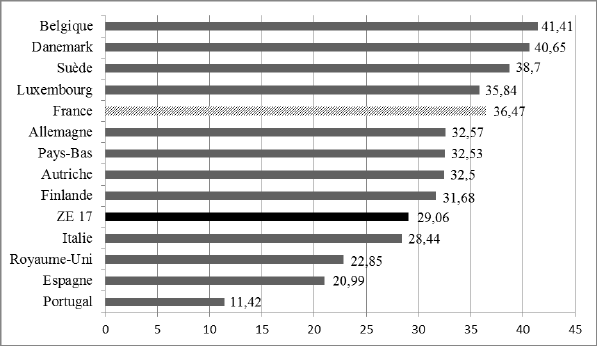
(1) Ensemble des branches marchandes.
Source : Eurostat.
En revanche, c’est par rapport à l’Allemagne que l’évolution des coûts salariaux horaires a été plus forte en France au cours des quinze dernières années : ces coûts ont progressé de 58 % en France entre 1996 et la mi-2012, au lieu de 25 % en Allemagne au cours de la même période, et ne sont plus désormais dans l’industrie manufacturière inférieurs à ceux de l’industrie allemande comme en début de période.
Cette évolution a conduit à une inversion du différentiel de coût dont bénéficiait initialement la France par rapport à l’Allemagne. Alors qu’en moyenne, le coût horaire du travail était inférieur de 13 % en France en 1996, il est supérieur de 9 % environ en 2013.
Cette tendance a affecté l’ensemble des branches d’activité, mais se traduit en 2013 par un écart de coût horaire du travail entre la France et l’Allemagne surtout marqué dans les services (35,3 euros, contre 29,9 euros, respectivement), tandis que les données relatives à l’industrie font apparaître une parité des coûts dans ce secteur entre les deux pays (37,1 euros et 37,3 euros, respectivement).
ÉVOLUTION COMPARÉE DU COÛT HORAIRE DU TRAVAIL
EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE (1996-2013)
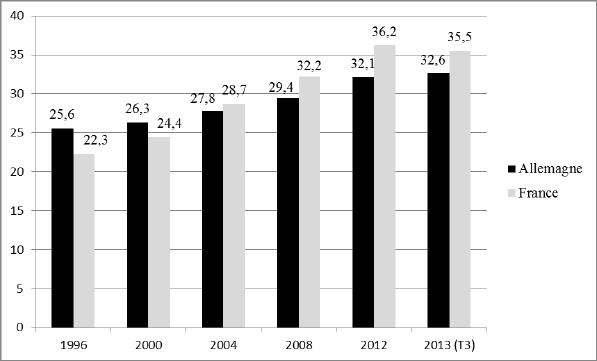
Source : Eurostat.
En France, la part des cotisations sociales acquittées par les employeurs dans l’ensemble du coût du travail est relativement élevée (32 % en 2013, contre 22 % en Allemagne). Il est donc utile d’examiner si des évolutions différentes de ces cotisations ont pu contribuer aux divergences d’évolution du coût du travail, en particulier avec ce dernier pays.
Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (66), l’évolution des cotisations sociales à la charge des employeurs n’explique qu’une part limitée de ces évolutions divergentes du coût salarial horaire. Certes, en Allemagne, la part des cotisations sociales à la charge des entreprises a diminué entre 1996 et 2013 (de 25,4 % à 21,2 % du coût total du travail), pendant qu’elle est restée relativement stable en France (32,1 % en 2013 contre 32,9 % en 1996), sous l’effet notamment de la stabilité des taux des cotisations de sécurité sociale.
ÉVOLUTION DE LA PART DES COTISATIONS SOCIALES À LA CHARGE DES EMPLOYEURS DANS LE COÛT TOTAL DU TRAVAIL EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
(1996-2013)
(Ensemble marchand)
(en pourcentages)
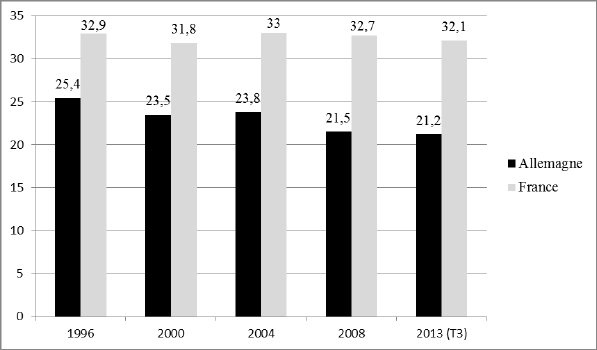
Source : Eurostat.
Toutefois, selon le Haut Conseil, « c’est essentiellement l’écart de progression des salaires bruts entre 1996 et 2013 suite aux politiques de modération salariale en Allemagne au début des années 2000 qui a contribué à la disparition du différentiel de coût du travail dont la France bénéficiait il y a une vingtaine d’années ».
3. Le coût du travail et la compétitivité des entreprises
L’ensemble des acteurs économiques et politiques constatent aujourd’hui la perte de compétitivité de l’économie française intervenue ces dernières années. Ainsi, alors que la balance commerciale était proche de l’équilibre en 2002, un déséquilibre important est apparu depuis lors, qui a culminé à 87 milliards d’euros en 2011. Ce déséquilibre est particulièrement marqué avec les États membres de l’Union européenne (67) et singulièrement avec l’Allemagne (68), mais il est également important avec certains pays émergents.
Dans son rapport remis au Premier ministre sur ce sujet en novembre 2012, M. Louis Gallois constate (69) : « Tous les indicateurs le confirment : la compétitivité de l’industrie française régresse depuis 10 ans et le mouvement semble s’accélérer. La diminution du poids de l’industrie dans le PIB français est plus rapide que dans presque tous les autres pays européens ; le déficit croissant du commerce extérieur marque nos difficultés à la fois vis-à-vis des meilleures industries européennes et face à la montée des émergents. » Cette situation est liée, pour l’industrie, à des causes structurelles – faiblesses de la recherche, de l’innovation et de la formation, flux de financement insuffisamment orientés vers le tissu industriel, tissu industriel insuffisamment solidaire, mauvais fonctionnement du marché du travail – mais aussi à ce que M. Louis Gallois qualifie de « cercle vicieux prix/hors prix ».
Le cercle vicieux prix/hors prix
dans le « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française »
Selon le « rapport Gallois », l’industrie française n’a pas une spécialisation internationale sectorielle très différente de celle de l’Allemagne. Hormis certaines niches, elle est plutôt positionnée, à la différence de son concurrent allemand, sur le milieu de gamme en matière de qualité et d’innovation et elle est, de ce fait, très exposée à la concurrence par les prix, alors même que ses coûts sont relativement élevés par rapport aux autres pays européens. L’industrie française se trouve, dès lors, prise en étau entre, d’une part, l’industrie allemande positionnée sur un segment de gamme supérieur et qui, de ce fait, est moins sensible au facteur prix (d’autant plus que l’Allemagne a fait des efforts significatifs sur les coûts, notamment par le transfert d’une partie des cotisations sociales sur la fiscalité et une politique de modération salariale au long de la décennie) et, d’autre part, des pays émergents et certains pays d’Europe du Sud ou de l’Est, qui bénéficient de coûts unitaires de production plus faibles que l’industrie française.
Confrontée à cette concurrence, l’industrie française a été conduite à préserver sa compétitivité-prix au détriment de sa compétitivité hors-prix : afin de conserver des prix compétitifs, les industries françaises ont été contraintes de rogner leurs marges, qui ont baissé de 30 % à 21 % sur la période 2000-2011, alors qu’elles progressaient de 7 points en Allemagne.
Cette évolution a eu pour conséquence de dégrader leur taux d’autofinancement (64 % en France en 2012 contre 85 % en 2000 et près de 100 % en moyenne dans la zone euro). La productivité globale des facteurs n’a pas progressé en France au cours de la dernière décennie du fait de l’insuffisance d’investissements de productivité et d’innovation dans le processus de production. Pour les mêmes raisons, les entreprises françaises ont perdu du terrain sur les facteurs « hors prix » – innovation, qualité, service – par rapport aux meilleures industries européennes et ne parviennent pas, sauf exception (luxe, aéronautique, nucléaire, pharmacie, certains produits agroalimentaires…) à monter en gamme.
C’est ce qui a conduit M. Louis Gallois à proposer de créer un choc de compétitivité en transférant une partie significative des cotisations sociales jusqu’à 3,5 SMIC – de l’ordre de 30 milliards d’euros, soit deux tiers de cotisations patronales et un tiers de cotisations salariales – vers la fiscalité et la réduction de la dépense publique. Comme il l’a souligné lors de son audition devant la MECSS, l’objectif était surtout de rétablir les marges des entreprises et leur compétitivité : « En disant cela, je ne parle pas du " coût du travail " en général – l’expression ne figure d’ailleurs à aucun moment dans mon rapport –, mais des marges des entreprises, qui sont aujourd’hui totalement insuffisantes. On se focalise sur les entreprises du CAC 40, mais celles-ci réalisent la plus grosse part de leurs marges à l’étranger. Dans l’industrie, les niveaux de marge sont parmi les plus faibles d’Europe, et au plus bas depuis 1985, ce qui constitue un obstacle majeur au développement des entreprises. C’est pourquoi j’ai jugé nécessaire de leur donner un ballon d’oxygène en ne faisant pas porter sur elles autrement que par l’impôt le poids des charges de solidarité. »
Pourtant, l’effet du niveau des cotisations sociales sur la compétitivité des entreprises ne semble pas décisif.
En effet, la compétitivité prix dépend aussi d’autres facteurs que les seuls coûts : si l’on compare la France et l’Allemagne, les faibles performances de la première en matière de compétitivité sont essentiellement liées à des facteurs de compétitivité hors coûts et les pertes de marché des entreprises françaises sont principalement dues à ces facteurs hors coûts (effort insuffisant d’innovation, faible spécialisation dans les produits de haute technologie, effacement de la politique industrielle impulsée par l’État).
Lors de son audition par la MECSS, M. Benjamin Gallezot, adjoint au directeur général de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) du ministère du redressement productif, a souligné que si la France présentait des lacunes en matière de compétitivité prix, c’était aussi le cas en matière de compétitivité « hors prix » : « Quant à la compétitivité hors prix, elle s’appuie sur l’innovation, domaine dans lequel l’effort public est plus important en France que chez nos partenaires européens et asiatiques, en contraste avec l’effort privé qui est plutôt moins important chez nous. Cet effort public demeure néanmoins trop axé sur l’amont et pas assez sur l’aval si bien qu’en dépit d’une lente amélioration, nous conservons un retard très significatif dans l’intégration amont-aval, notamment vis-à-vis de l’Allemagne ou du Japon. (…) Outre la recherche-développement, la compétitivité hors prix dépend également de l’innovation non technologique – c’est-à-dire du design et du marketing : or, une fois encore, nos entreprises sont moins investies en ce domaine que dans d’autres pays, raison pour laquelle le Plan innovation met l’accent sur cet aspect. » Ses conclusions rejoignent donc celles du Haut Conseil du financement de la protection sociale qui souligne, dans son point d’étape de février dernier (70), que « les coûts de production [jouent] un rôle important mais loin d’être exclusif dans la formation de la compétitivité des entreprises ».
Dans une étude publiée en 2010, la Commission européenne a montré que les pays dont les coûts unitaires du travail dans l’industrie ont beaucoup augmenté entre 1997 et 2007 ont connu une évolution des exportations similaire à celle observée dans les pays dont les coûts unitaires ont peu augmenté voire diminué et conclut de ses analyses que les coûts du travail ne peuvent être la cause des évolutions de la balance commerciale des pays européens (71).
Par ailleurs, s’agissant de la compétitivité-coût, Mme Anne Eydoux, lors de son audition par la MECSS, a considéré que « les cotisations sociales employeur ont un lien également lâche avec la compétitivité. En effet, la compétitivité prix des entreprises ne dépend pas du seul coût du travail ». Pour étayer son propos celle-ci a fait référence à une étude de M. Laurent Cordonnier (72), qui montre que le coût du capital pèse de plus en plus lourd dans le coût total. Cette étude estime ce surcoût à 95 milliards d’euros en 2011, soit la moitié de la formation brute de capital fixe (73) et 15 % du coût du travail. Dans son article précité, M. Antoine Math relève que ces 95 milliards d’euros représentent près de trois fois les cotisations sociales employeur pour la branche famille et la totalité des mêmes cotisations pour les branches famille et maladie réunies.
4. La baisse des cotisations sociales patronales permettent-elles de stimuler l’emploi ?
Les allégements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires ont été mis en place à partir de 1993 afin de réduire le coût du travail peu qualifié sans diminuer la rémunération nette des travailleurs concernés.
Au fil du temps, le ciblage du dispositif des allégements a beaucoup évolué, avec un taux maximal d’exonération augmentant progressivement de 5,5 % en 1993 à 26 % aujourd’hui (74) tandis que le seuil de sortie était rehaussé de 1,2 à 1,6 SMIC, avec un pic temporaire au-delà pour les aides associées à la réduction du temps de travail.
La direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) (75) du ministère chargé du travail a évalué, pour le compte du Haut Conseil du financement de la protection sociale, que les allégements mis en place entre 1993 et 1997 ont permis de créer ou de sauvegarder entre 200 000 et 400 000 emplois, soit un coût brut par emploi compris entre 20 000 et 40 000 euros (76). Après prise en compte des cotisations sociales et des moindres dépenses de minima sociaux et d’allocations chômage générées par le surcroît d’emploi, le coût net serait compris entre 8 000 et 28 000 euros environ.
Lors de son audition par la MECSS, M. Antoine Magnier, directeur de la DARES, a souligné qu’il était moins aisé d’évaluer l’effet sur l’emploi des vagues d’exonérations suivantes, les allégements ayant été moins concentrés au niveau du salaire minimum et les effets d’aubaine ayant été probablement plus importants (77) : « Si l’on fait l’hypothèse favorable – sans doute trop favorable – que l’effet sur l’emploi des deuxième et troisième vagues, mises en œuvre entre 1999 et 2005, est équivalent à celui de la première, l’on peut considérer que 600 000 à 1,1 million d’emplois ont bénéficié du dispositif pris dans son ensemble. Si l’on estime – selon une hypothèse plus modérée, étayée notamment par une étude empirique conduite à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) il y a quelques années – que le rendement des deuxième et troisième vagues a été de moitié inférieur à celui de la première, l’effet global ne concerne plus que 400 000 à 800 000 emplois. »
Selon la simulation macroéconomique réalisée pour l’OFCE par MM. Éric Heyer et Mathieu Plane en 2012 (78), le nombre d’emplois créés en cinq ans par le dispositif « Fillon » est d’environ 500 000. Il convient néanmoins, selon eux, de relativiser ce chiffre, puisqu’il ne tient pas compte du financement du dispositif. Si la baisse des recettes de cotisations est financée par des recettes supplémentaires, selon le mode de financement, le bilan est plutôt de 250 000 à 300 000 emplois créés en cinq ans. Dans l’hypothèse d’une réaction de partenaires commerciaux qui adopteraient un dispositif similaire, on tombe à une fourchette de 70 000 à 170 000 emplois créés.
Les baisses de cotisations sociales ont donc eu un impact sur la création d’emplois. Mais on est en droit de s’interroger sur le coût du dispositif et sur l’efficacité de cette politique pour les secteurs les plus concernés par la concurrence internationale.
En effet, Mme Anne Eydoux a rappelé à la MECSS le coût élevé de la politique de baisse des cotisations : « Selon l’étude de Brigitte Roguet et Bruno Garoche, publiée en 2013 sous l’égide de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), en 2010, les allégements de cotisations sur les bas salaires représentaient environ 22 milliards d’euros auxquels on peut ajouter les 4,5 milliards d’euros d’exonérations pour les heures supplémentaires. Aussi, pour quelque 300 000 emplois créés en cinq ans, le dispositif a coûté très cher : plus de un point de produit intérieur brut (PIB) de dépenses publiques engagées. »
PERTES DE RECETTES RÉSULTANT DES EXONÉRATIONS ET EXEMPTIONS D’ASSIETTE
DE COTISATIONS ET DE CONTRIBUTIONS (2010-2014)
(en milliards d’euros)
Type d’allégements |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Allégements généraux et heures sup |
25,1 |
24,2 |
23,6 |
21,2 |
21,0 |
Exonérations ciblées compensées |
4,0 |
3,4 |
3,1 |
3,4 |
3,3 |
Exonérations ciblées non compensées |
3,1 |
3,0 |
3,2 |
3,4 |
3,8 |
Exemptions d’assiette |
8,8 |
9,2 |
8,0 |
6,3 |
6,6 |
Total des pertes de recettes |
41,0 |
39,8 |
37,9 |
34,4 |
34,7 |
Sources : annexe 5 des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, 2012, 2013 et 2014.
Au niveau microéconomique, le coût unitaire des 300 000 emplois créés (79) par ces baisses de cotisations est de 75 000 euros pour des emplois généralement peu qualifiés et précaires, ce qui représente un coût bien plus élevé qu’un emploi aidé par exemple. Si on rapporte ce coût au SMIC, cela signifie que chaque création de poste rémunéré au niveau du SMIC « coûte » 25 000 euros à l’entreprise et que cet emploi génère en fait un profit de 50 000 euros à l’entreprise.
Par ailleurs, selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, le barème des allégements généraux en faveur des bas salaires, qui est fortement dégressif avec le niveau de rémunération, a pour effet de les concentrer sur les secteurs employant une main-d’œuvre peu qualifiée : ainsi, 90 % du montant de ces exonérations bénéficient à des salariés rémunérés moins de 1,3 SMIC. Il s’ensuit que la dépense totale d’allégement se concentre sur quelques secteurs d’activité présentant de forts effectifs de salariés rémunérés au voisinage du SMIC : en 2010, six secteurs absorbent 69 % des dépenses totales d’exonération, alors qu’ils représentent 55 % de l’emploi et 46 % de la masse salariale totale du secteur concurrentiel. Ces six secteurs, sont, par ordre décroissant de leur part dans les masses d’exonération, le commerce, les activités de services administratifs et de soutien, la construction, l’hébergement-restauration, les transports et l’action sociale.
Inversement, les activités industrielles se caractérisent à la fois par une part faible dans la masse des exonérations et un taux d’exonération apparent peu élevé : ce taux est ainsi de 4,6 % dans la métallurgie et tombe à 1,8 % dans l’industrie de transport – dont l’automobile – et à 1,6 % dans la chimie, pour une moyenne de 4,7 % tous secteurs confondus.
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ASSIETTE SALARIALE ET DES EXONÉRATIONS, ET TAUX D’EXONÉRATION APPARENT (SECTEUR CONCURRENTIEL)
Secteur concurrentiel Montants 2011 |
Cotisations exonérées |
Assiette salariale |
Taux d’exo apparent |
Part des exo. bas salaires |
Effectifs annuels moyens |
Salaire moyen par tête | ||
en M€ |
en % |
en M€ |
en % |
en % |
en % |
X1000 |
en € | |
AZ-Agriculture, sylviculture et pêche |
45 |
0,2 |
295 |
0,1 |
15,1 |
15,5 |
14 |
1 723 |
BZ-Ind. extractives |
35 |
0,1 |
811 |
0,2 |
4,3 |
55,9 |
25 |
2 697 |
CA-Ind. agro-alimentaires |
878 |
3,4 |
12 566 |
2,5 |
7 |
75,6 |
501 |
2 089 |
CB-Habillement, textile et cuir |
211 |
0,8 |
3 076 |
0,6 |
6,9 |
87,8 |
116 |
2 204 |
CC-Bois et papier |
288 |
1,1 |
5 933 |
1,2 |
4,9 |
74,5 |
205 |
2 412 |
CD-Cokéfaction et raffinage |
3 |
0,0 |
617 |
0,1 |
0,5 |
30,2 |
12 |
4 210 |
CE-Ind. chimique |
76 |
0,3 |
5 742 |
1,1 |
1,3 |
70,8 |
141 |
3 385 |
CF-Ind. pharmaceutique |
23 |
0,1 |
3 537 |
0,7 |
0,7 |
71,5 |
81 |
3 648 |
CG-Ind. des plastiques |
321 |
1,3 |
9 270 |
1,8 |
3,5 |
79,2 |
303 |
2 551 |
CH-Métallurgie |
506 |
2,0 |
12 493 |
2,5 |
4 |
67,4 |
408 |
2 553 |
CI-Fabric. de produits info., électro. et optiques |
98 |
0,4 |
6 023 |
1,2 |
1,6 |
65,6 |
140 |
3 575 |
CJ-Fabric. d’équipements électriques |
98 |
0,4 |
4 193 |
0,8 |
2,3 |
74,4 |
122 |
2 854 |
CK-Fabric. de machines et équipements n.c.a. |
161 |
0,6 |
6 505 |
1,3 |
2,5 |
65,4 |
188 |
2 883 |
CL-Fabric. de matériels de transport |
201 |
0,8 |
13 955 |
2,8 |
1,4 |
62 |
361 |
3 222 |
CM-Ind. du meuble ; réparat. et installat. de machines |
397 |
1,6 |
8 532 |
1,7 |
4,6 |
67,5 |
281 |
2 531 |
DZ-Prod. et distrib. d’électricité, de gaz |
30 |
0,1 |
7 476 |
1,5 |
0,4 |
21,2 |
171 |
3 646 |
EZ-Prod. et distrib. d’eau ; assainissement |
181 |
0,7 |
4 787 |
1,0 |
3,8 |
65,9 |
173 |
2 308 |
FZ-Construction |
3 091 |
12,1 |
36 056 |
7,2 |
8,6 |
70,4 |
1 490 |
2 017 |
GZ-Commerce ; réparation auto.-moto. |
5 372 |
21,1 |
78 216 |
15,6 |
6,9 |
82,5 |
3 036 |
2 147 |
HZ-Transports et entreposage |
1 938 |
7,6 |
39 177 |
7,8 |
4,9 |
79,7 |
1 381 |
2 364 |
IZ-Hébergement et restauration |
2 201 |
8,6 |
19 249 |
3,8 |
11,4 |
78,6 |
1 009 |
1 591 |
JA-Edition et Audiovisuel |
151 |
0,6 |
9 110 |
1,8 |
1,7 |
59,2 |
226 |
3 362 |
JB-Télécommunications |
56 |
0,2 |
5 552 |
1,1 |
1 |
47,3 |
150 |
3 087 |
JC-Activ. informatiques |
209 |
0,8 |
14 671 |
2,9 |
1,4 |
53,3 |
340 |
3 598 |
KZ-Activ. financières et d’assurance |
337 |
1,3 |
33 807 |
6,7 |
1 |
73,1 |
757 |
3 721 |
LZ-Activ. immobilières |
305 |
1,2 |
6 941 |
1,4 |
4,4 |
86,6 |
248 |
2 334 |
MA-Activ. juridiques, de conseil et d’ingénierie |
745 |
2,9 |
36 464 |
7,3 |
2 |
63 |
905 |
3 359 |
MB-Recherche et développement |
37 |
0,1 |
6 026 |
1,2 |
0,6 |
40,2 |
157 |
3 206 |
MC-Autres activ. scientifiques et techniques |
247 |
1,0 |
6 054 |
1,2 |
4,1 |
81,1 |
208 |
2 428 |
NZ-Activ. de services admin. et de soutien |
3 320 |
13,0 |
38 939 |
7,7 |
8,5 |
85,2 |
1 820 |
1 783 |
OZ-Administration publique |
51 |
0,2 |
7 758 |
1,5 |
0,7 |
77,1 |
181 |
3 577 |
PZ-Education |
322 |
1,3 |
6 454 |
1,3 |
5 |
74,7 |
304 |
1 769 |
QA-Activ. pour la santé humaine |
646 |
2,5 |
13 554 |
2,7 |
4,8 |
75,8 |
548 |
2 061 |
QB-Action sociale et héberg. médico-social |
1 617 |
6,3 |
19 327 |
3,8 |
8,4 |
46,7 |
1 054 |
1 528 |
RZ-Arts, spectacles et activ. récréatives |
293 |
1,2 |
6 439 |
1,3 |
4,6 |
72,4 |
280 |
1 913 |
SZ-Autres activ. de services |
976 |
3,8 |
12 707 |
2,5 |
7,7 |
65,4 |
568 |
1 863 |
UZ-Activ. extra-territoriales |
3 |
0,0 |
309 |
0,1 |
0,9 |
79,9 |
6 |
4 291 |
Total |
25 465 |
100,0 |
502 621 |
100,0 |
5,1 |
74,7 |
17 909 |
2 339 |
Source : ACOSS – URSSAF - données en période d’emploi mises à jour en septembre 2012.
Le Haut Conseil du financement de la protection sociale conclut : « La politique d’exonération concentre donc l’aide publique sur des secteurs fortement employeurs de main-d’œuvre non qualifiée, mais probablement peu exposés à la concurrence internationale, même en tenant compte des phénomènes d’externalisation de la production qui amènent certaines entreprises à recourir aux prestataires de ces secteurs. » (80)
5. L’allégement des cotisations patronales dans le cadre du Pacte de responsabilité : quel impact sur l’emploi ?
Dans un point d’étape sur la clarification du financement de la protection sociale publié en mars (81), le Haut Conseil du financement de la protection sociale a étudié trois scénarios « test » d’allégement des cotisations sociales patronales, additionnels aux actuels allégements « Fillon », pour un montant voisin de 10 milliards d’euros :
– dans le premier scénario, le taux de cotisations sociales patronales serait uniformément diminué de deux points sur l’ensemble des salaires ;
– dans le second scénario, l’allégement serait concentré sur les salaires moyens et se traduirait par une modification de la pente de l’actuel allégement « Fillon » et un décalage du « point de sortie » des allégements de 1,6 à 2,09 SMIC ;
– enfin, un troisième scénario accentuerait la dégressivité de l’allégement pour en concentrer davantage les effets sur les bas salaires en augmentant de 7,4 points du taux d’exonération au niveau du SMIC, avec un « point de sortie » porté de 1,6 à 1,75 SMIC.
Trois modes de financement ont par ailleurs été envisagés pour compenser cette réduction des cotisations sociales patronales : une hausse des impôts, répartie selon la structure fiscale actuelle, une hausse de la TVA, et une hausse de la CSG.
Des simulations « macroéconomiques test » réalisées par la direction générale du Trésor, l’INSEE et l’OFCE permettent de mesurer l’impact attendu sur l’emploi du Pacte de responsabilité en fonction du scénario retenu :
– les effets d’un allégement uniforme de deux points des cotisations sociales acquittées par les employeurs seraient, si l’on ne tient pas compte de sa compensation financière, potentiellement favorables, mais relativement circonscrits sur l’activité (entre 0,3 et 0,8 point de PIB à cinq ans selon les modèles et les scénarios) comme sur l’emploi (entre 134 000 et 214 000 emplois créés ou préservés) ;
– l’impact estimé sur l’emploi est plus élevé lorsque l’allégement est concentré sur les salaires modestes, mais avec une ampleur qui diffère selon les simulations : un allégement privilégiant les salaires moyens engendrerait 5 000 à 37 000 emplois de plus qu’un allégement uniforme, mais les effets d’un allégement concentré sur les bas salaires s’étageraient selon les estimations de moins de 15 000 à 160 000 emplois supplémentaires ;
– le financement des allégements réduit sensiblement les effets obtenus sur l’activité et l’emploi, quel que soit le prélèvement ou le mode de financement considéré : les effets estimés sur le PIB à cinq ans seraient ramenés à un impact compris entre 0,0 et + 0,2 point de PIB selon les modèles pour un allégement uniforme de 10 milliards d’euros, avec un impact sur l’emploi compris entre 30 000 et 81 000 selon les scénarios considérés.
B. SI LA BUDGÉTISATION DE LA BRANCHE FAMILLE DOIT ÊTRE EXCLUE, UNE CLARIFICATION DE SON FINANCEMENT DOIT ÊTRE ENVISAGÉE
De nombreux interlocuteurs entendus par la MECSS ont considéré qu’il n’y avait pas de recette fiscale « miracle » alternative aux cotisations patronales.
C’est le cas notamment du président délégué du Haut Conseil de la famille, M. Bertrand Fragonard qui a affirmé lors de son audition : « La recherche d’une " assiette miracle " me laisse toujours dubitatif. Pour le Haut Conseil, l’" assiette miracle " est une assiette possédant le dynamisme souhaité. » Le directeur du budget, M. Julien Dubertret, a fait part du même point de vue : « S’agissant de la fiscalisation de la branche famille, il faut savoir qu’il n’y a pas de miracle en matière de ressources fiscales. En effet, contrairement à la branche maladie, qui peut bénéficier de taxes comportementales, il n’existe pas de recettes qui, par nature, sont destinées à la famille. »
La Cour des comptes dans son étude prospective partage le même constat : « Les résultats de ces simulations macroéconomiques ne permettent pas de confirmer un bénéfice significatif du basculement du financement de la branche famille de cotisations assises sur la masse salariale vers d’autres assiettes malgré des hypothèses de transfert allant de 6,6 milliards d’euros à 23 milliards d’euros. Quelles que soient les limites intrinsèques à la simulation macroéconomique, qu’il convient de ne pas sous-estimer, ils font apparaître que seule une évolution du financement non compensée intégralement par un autre prélèvement, c’est-à-dire associée à un redéploiement des ressources rendu possible par une baisse des dépenses, a un effet sensible sur la croissance. »
Compte tenu de ce constat, certaines organisations syndicales prônent le statu quo et le maintien des cotisations familiales patronales.
M. Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral de la CGT, a ainsi rappelé à la MECSS la position de son syndicat : « La politique familiale a vocation à être financée par des cotisations sociales, qui sont un élément du salaire socialisé. C’est pourquoi nous avons une position très critique à l’égard d’une baisse des cotisations des employeurs accompagnée d’un transfert de la charge sur d’autres assiettes : ce serait en réalité une baisse de salaire. Pour nous, il est essentiel que la politique salariale tienne compte des coûts liés à l’éducation des enfants. »
De même, M. Patrick Brillet, administrateur de Force ouvrière à la CNAF, a rappelé l’opposition de son organisation syndicale à une baisse des cotisations patronales : « Nous tenons à rappeler notre opposition au fait de lier le financement de la protection sociale à la notion de compétitivité des entreprises. Il ne peut être question pour nous de remplacer des cotisations patronales par des prélèvements sur les salaires, que ceux-ci passent par la cotisation ou, comme la CSG, par l’impôt. »
Par conséquent, des scénarios alternatifs peuvent aussi être envisagés : si le premier scénario, qui consisterait en une budgétisation du financement de la branche famille, ne semble pas pertinent, un second scénario, qui prendrait la forme d’une clarification du financement de la branche famille tout en maintenant inchangés les prélèvements sur les ménages et les entreprises peut être tout à fait envisagé.
1. La budgétisation : une « fausse bonne idée »
La fiscalisation croissante des recettes de la branche famille et la recherche de recettes alternatives aux cotisations patronales posent la question de la pertinence d’une éventuelle budgétisation du financement de la branche famille.
Cette budgétisation partielle ou totale ne rencontrerait pas d’obstacle juridique : aucun principe constitutionnel ou organique ne s’y opposerait, sous réserve qu’un financement suffisant soit garanti pour assurer la pérennité des missions. En effet, dans une décision n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010 (82), le Conseil constitutionnel a imposé au législateur de garantir des recettes à la branche famille en cas de transferts de recettes à une autre branche.
En outre, cette réforme pourrait être conduite dans le cadre d’une loi ordinaire, en créant un programme ou une mission au sein du budget général, sans qu’il soit nécessaire de modifier une loi organique.
Un tel mode de financement rapprocherait le financement de la politique familiale de celui d’autres politiques publiques sans lien étroit avec les entreprises, mais contribuant tout autant à leur compétitivité, comme en matière d’éducation nationale et d’enseignement supérieur. Par ailleurs, une telle évolution pourrait contribuer à faciliter une approche consolidée de la politique familiale par l’État.
Cependant, votre Rapporteur considère qu’une telle réforme n’est ni nécessaire, ni pertinente.
Elle n’est pas nécessaire, parce qu’elle ne résoudrait pas la question du financement de la politique familiale qui pourrait être soumis aux contraintes budgétaires de l’État.
Par ailleurs, la difficulté de l’État à piloter certaines dépenses d’intervention dans le domaine social montre qu’un effet de meilleure régulation n’est pas nécessairement assuré, d’autant que la dilution du solde, actuellement identifié au sein de la branche, dans celui du budget de l’État pourrait avoir des conséquences en termes de suivi, et de responsabilisation des gestionnaires de la branche. Comme l’a souligné le directeur de la sécurité sociale, M. Thomas Fatome, lors de son audition, « la direction de la sécurité sociale est très dubitative quant à un schéma de budgétisation. On voit mal quel pourrait être l’apport en termes de pilotage de la dépense et de lisibilité, et une telle évolution serait difficilement acceptable par les partenaires sociaux. Le conseil d’administration de la CNAF et le réseau des CAF ont montré leur capacité à s’adapter, que ce soit pour faire face à la crise ou pour prendre en charge de nouvelles prestations ».
Cette évolution ne serait pas non plus pertinente car elle mettrait fin à l’architecture de la sécurité sociale telle qu’elle a été conçue en 1945 en remettant en cause la gouvernance de la branche par les partenaires sociaux.
Le président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, M. Jean-Louis Deroussen, a rappelé à la MECSS, l’intérêt d’une gestion paritaire de la politique familiale : « On voit bien, par ailleurs, qu’un financement assuré exclusivement par dotation budgétaire serait susceptible de remettre en cause la légitimité d’une gestion paritaire de la protection sociale. En tout état de cause, l’intérêt d’une gestion de la branche par toutes les parties prenantes me paraît indéniable en ce qu’elle lui permet de bénéficier de l’éclairage, tant des bénéficiaires des prestations que des entreprises. »
2. Une clarification nécessaire du financement
Votre Rapporteur considère que la réforme du financement de la branche famille pourrait s’inscrire dans une réforme plus globale du financement de la protection sociale en mettant en adéquation ses recettes avec le caractère universel de la branche, tout en maintenant le niveau actuel des prélèvements sur les entreprises et les ménages.
Ainsi, le Haut Conseil du financement de la protection sociale, dans son rapport d’étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale (83),a envisagé, dans cette optique, divers scénarios basés sur la constance du montant global des prélèvements supportés par les entreprises et les ménages, comme l’a rappelé Mme Mireille Elbaum, présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale : « En définitive, le cas d’espèce est bien la branche famille en raison de l’universalisation des prestations et de son mode de financement. Ce contexte nous a conduits à examiner plusieurs scénarios de modification possibles du financement de la branche famille allant dans le sens d’une réduction de la part incombant aujourd’hui aux cotisations employeurs, scénarios à répartition constante des financements. Toutes les branches – y compris la branche vieillesse, contributive – bénéficient d’un certain nombre d’impôts et taxes affectés. C’est ainsi que nous avons envisagé les permutations possibles entre les impôts et taxes affectés à la branche vieillesse et les cotisations sociales patronales de la branche famille. Nous avons aussi pensé qu’il serait logique que le produit des taxes comportementales soit réaffecté à la branche maladie, ce qui nous a tout naturellement amenés à envisager des scénarios de permutation à trois. »
Trois scénarios sont donc proposés (84) :
– un premier scénario, procédant de façon bilatérale entre la branche famille et la branche vieillesse, échangerait des cotisations à la charge des employeurs et des impôts et taxes. Ce scénario présente néanmoins des difficultés techniques – c’est-à-dire un risque de pertes de ressources liées au fait que certains régimes n’ont pas la capacité, sans mesures correctrices spécifiques, de restituer des recettes fiscales au régime général – et n’apporterait cependant pas de solution au problème de l’hétérogénéité des impôts et taxes affectés à la branche famille ;
– le deuxième scénario consiste en une réaffectation des recettes fiscales entre les branches famille et maladie, complétant le transfert de cotisations sociales patronales de la branche famille vers la branche vieillesse ; il se heurte aux mêmes difficultés techniques que le premier scénario ;
– le troisième scénario consiste en un transfert de cotisations sociales patronales de la branche famille vers la branche vieillesse, une diminution des cotisations sociales vieillesse à la charge des salariés, et une augmentation de la CSG au bénéfice de la branche famille : dans ce cas, la réforme pourrait prendre la forme d’une diminution des cotisations sociales patronales au titre de la branche famille qui serait compensée par une hausse des cotisations sociales patronales vieillesse, assortie d’une réduction des cotisations d’assurance vieillesse à la charge des salariés, elle-même compensée par une augmentation à due concurrence de la CSG.
Ces scénarios, qui consistent en une réallocation des prélèvements sociaux existants entre les branches de la protection sociale, permettraient d’améliorer la cohérence entre ces ressources et les dépenses qu’elles financent, en particulier dans le domaine de la politique familiale.
C. QUELLE RECETTE DE SUBSTITUTION POUR LA BRANCHE FAMILLE ?
Dans le cadre de ses travaux, comme on l’a souligné en introduction, la MECSS a saisi la Cour des comptes d’une demande d’étude relative à l’impact sur la croissance et l’emploi d’une suppression des cotisations familiales et de leur remplacement par différentes taxes : la TVA, la CSG, une taxe environnementale ou une cotisation sur la valeur ajoutée.
À la demande de la Cour, la direction générale du Trésor a effectué, sur la base du modèle MÉSANGE, plusieurs simulations permettant d’appréhender les effets macroéconomiques de la substitution des quatre assiettes différentes à tout ou partie des cotisations famille, les niveaux retenus étant une baisse de 5,4 points, 3,4 points ou 2 points de cotisation.
Les hypothèses retenues pour les simulations effectuées par la direction du Trésor
Plusieurs hypothèses – identiques pour toutes les simulations – ont été retenues :
– le champ retenu pour les allégements de cotisations est identique à celui des allégements généraux de charges ;
– les allégements simulés s’ajoutent aux allégements existants jusqu’à extinction de la cotisation famille sans mise en place de cotisations négatives. Ce choix implique une diminution, plus ou moins importante selon les montants de cotisations transférés, du niveau de progressivité de la cotisation famille ;
– lorsque les allégements de cotisations sont ciblés, la borne haute a été placée de telle sorte que seuls les hauts salaires, au-delà de 2,3 SMIC avec un biseau jusqu’à 2,7 SMIC, soient exclus du bénéfice de la mesure. Ce choix limite l’impact en termes d’emplois de la baisse mais permet d’en faire bénéficier le plus grand nombre de secteurs économiques et en particulier ceux qui sont les plus exposés à la concurrence internationale.
1. Transférer le financement de la branche famille sur les ménages
a. Un allégement de cotisations familiales patronales compensé par une augmentation de la TVA
Le premier scénario envisagé est celui d’une augmentation de la TVA destinée à compenser la baisse des cotisations patronales. Plusieurs économistes entendus par la MECSS se sont montrés favorables à un tel financement de la branche famille.
C’est notamment le cas de M. Christian Saint-Étienne : « Même si on a fait un épouvantail de la TVA sociale – que d’aucuns appellent " TVA emplois " –, elle reste une mécanique très efficace. Sa mise en place en Allemagne au 1er janvier 2007 a d’ailleurs bien aidé le pays à traverser la crise survenue à partir de 2008, en permettant aux entreprises d’augmenter leurs fonds propres. Sur les trois points de hausse, un point a été consacré à la baisse des cotisations sociales et deux à la réduction de l’impôt sur les sociétés : on peut donc parler aussi bien de " TVA compétitivité " que de " TVA sociale ". Or l’économie allemande s’est fort bien portée de sa création. (…) En outre, une telle mesure serait cohérente compte tenu de ce que nous apprennent les statistiques de l’Union européenne : le poids des prélèvements obligatoires sur la consommation, contrairement à ce que pensent les Français, est plutôt plus faible que la moyenne, tandis que leur poids sur la production est nettement supérieur. »
Une telle option a fait l’objet de multiples études au cours des dernières années. La logique qui sous-tend une telle réforme est de faire contribuer la consommation, facteur historiquement très dynamique de la croissance française, au financement de la protection sociale et de taxer davantage un élément faiblement contributif à ce financement, à savoir les importations.
Néanmoins, une augmentation de la TVA peut avoir un effet négatif sur la consommation et la croissance si les entreprises ne répercutent pas la totalité de la baisse de leurs coûts dans leurs prix hors taxe. Les exemples étrangers, détaillés dans l’encadré ci-dessous, mettent en évidence les incertitudes pesant sur l’impact économique d’une telle mesure.
Les exemples danois et allemand
Le Danemark a mis en place une « TVA sociale » en 1987 dans le cadre d’un ensemble de mesures fiscales et budgétaires visant à restaurer sa compétitivité extérieure. La hausse de la TVA a donc été associée à des hausses des impôts locaux et sur le revenu et à un effort de stabilisation des dépenses sociales et de modération salariale. Si ces mesures ont effectivement permis une reprise des exportations et des gains de parts de marché, elles se sont également accompagnées d’une phase de récession de deux ans et d’une accélération de l’inflation.
Plus récemment, en 2007, l’Allemagne a également fait le choix d’une hausse du taux de TVA de trois points (de 16 % à 19 %) pour financer, à hauteur de 1,2 point, son régime d’assurance chômage afin d’éviter une hausse de la cotisation chômage. Cette décision s’inscrivait dans le cadre d’un processus de modération salariale entamé depuis le début des années 2000 et encore en cours en 2007. L’activité économique a progressé de 0,1 à 0,2 point du fait de cette mesure en 2006, puis s’est contractée de 0,5 point en 2007. L’ajustement des prix aurait été sur un plan macroéconomique plus rapide dans les secteurs des services que dans ceux produisant des biens et services.
Source : Cour des comptes.
Dans le rapport remis à la MECSS (85), la Cour des comptes détaille les effets de deux hausses possibles de TVA :
– le premier scénario porte sur un montant de 16,6 milliards d’euros (3,4 points de cotisation maximum) et concerne l’ensemble des salaires de façon uniforme. Les résultats de la simulation font apparaître que l’écart d’activité est négatif à moyen et long terme. Malgré un effet positif sur la balance commerciale principalement lié au recul des importations, le caractère récessif de la hausse de la TVA l’emporte. L’effet initialement positif sur l’emploi est neutralisé au bout de deux ans.
BAISSE DE 3,4 POINTS MAXIMUM FINANCÉE PAR UNE HAUSSE DE LA TVA
( % en écart au compte central)
Données économiques |
1 an |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
10 ans |
PIB |
– 0,14 |
– 0,12 |
– 0,17 |
– 0,21 |
– 0,23 |
– 0,17 |
Consommation des ménages |
– 0,26 |
– 0,24 |
– 0,32 |
– 0,37 |
– 0,39 |
– 0,38 |
Investissement des SNF et EI |
– 0,2 |
– 0,5 |
– 0,4 |
– 0,4 |
– 0,4 |
– 0,4 |
Exportations |
– 0,01 |
– 0,04 |
– 0,05 |
– 0,06 |
– 0,04 |
0,08 |
Importations |
– 0,4 |
– 0,2 |
– 0,2 |
– 0,3 |
– 0,3 |
– 0,3 |
Balance commerciale (en points du PIB) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Emploi (en milliers) |
23 |
18 |
0 |
– 8 |
– 4 |
20 |
Taux de chômage |
– 0,1 |
– 0,1 |
0 |
0 |
0 |
– 0,1 |
Prix de la consommation des ménages |
1,1 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,3 |
Prix des exportations |
0 |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,2 |
– 0,2 |
– 0,5 |
Prix des importations |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,2 |
– 0,4 |
Source : direction générale du Trésor, Cour des comptes.
– le second scénario s’inscrit dans le cadre d’une baisse des cotisations plus limitée (6,6 milliards d’euros) et ciblée (salaires compris entre 1 SMIC et 2,3 SMIC avec « effet de biseau » (86)). L’impact récessif de la réforme apparaît non significatif tandis que l’effet sur l’emploi est faible mais positif. Le modèle ne montre pas d’effet sur la balance commerciale.
BAISSE DE 2 POINTS MAXIMUM (DE 0 À 2 POINTS)
AVEC SORTIE EN BISEAU ENTRE 2,3 ET 2,7 SMIC
FINANCÉE PAR UNE HAUSSE DE LA TVA
(% en écart au compte central)
Données économiques |
1 an |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
10 ans |
PIB |
– 0,05 |
– 0,02 |
– 0,03 |
– 0,04 |
– 0,04 |
– 0,02 |
Consommation des ménages |
– 0,09 |
– 0,05 |
– 0,07 |
– 0,09 |
– 0,09 |
– 0,09 |
Investissement des SNF et EI |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
Exportations |
0 |
0 |
0 |
0,01 |
0,02 |
0,07 |
Importations |
– 0,1 |
– 0,1 |
0 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
Balance commerciale (en points du PIB) |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
Emploi (en milliers) |
19 |
29 |
27 |
25 |
26 |
35 |
Taux de chômage |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
Prix de la consommation des ménages |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
Prix des exportations |
0 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,2 |
Prix des importations |
0 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,2 |
Source : direction générale du Trésor, Cour des comptes.
b. Un allégement de cotisations familiales patronales compensé par une augmentation de la CSG
Plusieurs interlocuteurs de la MECSS se sont prononcés en faveur d’un transfert des cotisations sociales vers la CSG. Compte tenu de l’assiette très large de cette ressource, une telle réforme mettrait en adéquation les recettes de la branche avec le caractère universel de ses dépenses tout en permettant de financer la branche famille par une contribution ayant une assiette très large, qui ne frappe pas les seuls revenus de l’activité mais également les revenus de remplacement et les revenus du capital.
Par ailleurs, une telle augmentation de la CSG aurait des effets macroéconomiques se rapprochant de ceux liés à une augmentation de la TVA à long terme mais sans être inflationniste à court terme. Les gains de compétitivité et les créations d’emplois pourraient être plus élevés, malgré la pression plus importante sur le pouvoir d’achat des ménages, à la condition cependant que cette réforme s’accompagne d’une modération de l’évolution des salaires.
M. Gilbert Cette, membre du Conseil d’analyse économique, a ainsi noté les avantages d’un financement de la branche famille par la CSG : « Je préconise une assiette large allant jusqu’à la fiscalisation. Pour moi, la CSG est le véhicule idéal, et la TVA le second best. (…) Le basculement vers la CSG [ferait] payer les ménages, mais de manière plus directe, plus claire et plus transparente, en accord avec une stratégie de très long terme de fiscalisation du financement de la protection sociale. »
De même, un tel scénario, envisagé par le Haut Conseil du financement de la protection sociale, a reçu l’approbation de la CFDT comme l’a indiqué Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de cette organisation syndicale, devant la MECSS : « Nous avions retenu un scénario conduisant à une baisse de 3,2 points des cotisations patronales, compensée par une hausse de la CSG. Cependant, alors que le scénario du Haut Conseil était neutre, ou en tout cas ne prévoyait pas de changement majeur du niveau des prélèvements, nous pensons, nous, que si le transfert s’opère sur la CSG, il faudrait élargir l’assiette à d’autres revenus que ceux du travail, en premier lieu aux revenus du capital et, peut-être, à certains revenus de remplacement. »
Les résultats des simulations réalisées par la direction du Trésor (87) sont les suivants :
– dans le premier scénario, la baisse des cotisations famille est intégrale (23 milliards d’euros) et homogène. L’impact récessif de la mesure est sensible à court terme (– 0,55 point de PIB et – 0,46 point de PIB à deux et trois ans en écart au compte central) (88) mais peu significatif à long terme (– 0,17 point de PIB en écart au compte central à dix ans). Il est lié à la diminution de la demande non compensée par les créations d’emplois. Cet effet n’est pas contrebalancé par la légère amélioration de la balance commerciale ;
SUPPRESSION DES COTISATIONS FAMILLE FINANCÉE PAR UNE HAUSSE DE LA CSG
( % en écart au compte central)
Données économiques |
1 an |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
10 ans |
PIB |
– 0,32 |
– 0,55 |
– 0,46 |
– 0,39 |
– 0,31 |
– 0,17 |
Consommation des ménages |
– 0,86 |
1,42 |
– 1,42 |
– 1,41 |
– 1,33 |
– 0,38 |
Investissement des SNF et EI |
– 0,1 |
– 1,0 |
– 0,7 |
– 0,4 |
– 0,3 |
– 0,4 |
Exportations |
0,05 |
0,23 |
0,38 |
0,50 |
0,57 |
0,08 |
Importations |
– 0,7 |
– 1,3 |
– 1,1 |
– 1,1 |
– 1,1 |
– 0,3 |
Balance commerciale (en points du PIB) |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
Emploi (en milliers) |
34 |
35 |
3 |
– 13 |
0 |
20 |
Taux de chômage |
– 0,1 |
– 0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
– 0,1 |
Prix de la consommation des ménages |
– 0,3 |
– 1,0 |
– 1,6 |
– 2,0 |
– 2,2 |
0,3 |
Prix des exportations |
– 0,3 |
– 1,0 |
– 1,4 |
– 1,6 |
– 1,8 |
– 0,5 |
Prix des importations |
– 0,2 |
– 0,7 |
– 0,9 |
– 1,1 |
– 1,1 |
– 0,4 |
Source : direction générale du Trésor, Cour des comptes.
– le deuxième scénario reprend la version basse de la diminution des cotisations (6,6 milliards d’euros). La mesure est neutre pour le niveau général de l’activité malgré le recul de la consommation des ménages. Son effet déflationniste est moins marqué et le niveau des emplois créés, bien que faible, est supérieur. L’effet sur la balance commerciale est quasi nul.
BAISSE DE 2 POINTS MAXIMUM AVEC SORTIE EN BISEAU ENTRE 2,3 ET 2,7 SMIC
FINANCÉE PAR UNE HAUSSE DE LA CSG
(% en écart au compte central)
Données économiques |
1 an |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
10 ans |
PIB |
– 0,08 |
– 0,12 |
– 0,08 |
– 0,05 |
– 0,02 |
0,02 |
Consommation des ménages |
– 0,23 |
– 0,35 |
– 0,32 |
– 0,32 |
– 0,29 |
– 0,24 |
Investissement des SNF et EI |
0,0 |
– 0,3 |
– 0,1 |
– 0,1 |
0,0 |
0,0 |
Exportations |
0,02 |
0,09 |
0,15 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
Importations |
– 0,2 |
– 0,3 |
– 0,3 |
– 0,3 |
– 0,3 |
– 0,3 |
Balance commerciale (en points du PIB) |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Emploi (en milliers) |
21 |
37 |
36 |
32 |
35 |
35 |
Taux de chômage |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
Prix de la consommation des ménages |
– 0,1 |
– 0,3 |
– 0,4 |
– 0,6 |
– 0,6 |
– 0,8 |
Prix des exportations |
– 0,1 |
– 0,3 |
– 0,4 |
– 0,5 |
– 0,5 |
– 0,5 |
Prix des importations |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,3 |
– 0,3 |
– 0,3 |
– 0,4 |
Source : Cour des comptes.
2. Transférer le financement de la branche famille sur la fiscalité écologique
Les taxes comportementales et environnementales visent à modifier les habitudes de consommation ou à compenser les effets négatifs de ces habitudes pour les structures publiques qui les supportent et non pas seulement à produire une ressource publique.
La fiscalité environnementale reste peu développée en France par rapport à d’autres pays européens : elle représente 4 % du total des prélèvements obligatoires en France, soit un niveau sensiblement inférieur à la moyenne des autres États de l’Union européenne (6 %). Il existe donc un potentiel pour un développement de ce type de fiscalité.
Néanmoins, comme l’a souligné M. Henri Sterdyniak, lors de son audition, cette évolution n’est sans soulever des incertitudes : « Le problème est que l’on ignore quel sera le produit de cette taxation, laquelle dépend de décisions prises au niveau mondial ou européen et sera déjà utilisée pour soutenir certains secteurs en difficulté ou pour venir en aide aux ménages les plus pauvres. Par conséquent, mieux vaut disjoindre la question du financement de la branche " famille " et le débat sur l’écologie et la taxe carbone. Si d’aventure cette taxe venait à procurer des revenus importants, je préférerais que l’affectation d’une partie de ces revenus à la branche " famille " ne soit pas directe. »
Les résultats des simulations demandées par la Cour des comptes (89) montrent que les effets de la mise en œuvre de taxes environnementales sont légèrement moins négatifs que ceux de la TVA sur la consommation des ménages. Ceci tient au fait que les taxes environnementales pèsent davantage sur les produits importés que sur les produits nationaux. En revanche, elles n’ont pas d’impact sur le solde de la balance commerciale.
Dans le cas d’une baisse de cotisations non ciblée, l’effet sur l’emploi serait peu significatif. Dans le cas d’une baisse plus modeste des cotisations (6,6 milliards d’euros excluant les plus hauts salaires), l’impact positif sur le nombre d’emplois, qui varie de 21 000 à 35 000 à cinq ans, n’est cependant pas suffisant pour stimuler la croissance et l’investissement des entreprises.
3. Réaménager les prélèvements sociaux des entreprises
Comme il a été souligné précédemment, la contribution des entreprises au financement de la branche famille semble légitime au titre de la politique de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Par ailleurs, les politiques d’allégement des cotisations sociales ont déjà conduit à réduire le poids des cotisations sociales pesant sur les entreprises en transférant le financement de la protection sociale vers les ménages.
C’est pourquoi, une réforme du financement de la branche famille pourrait aussi consister à maintenir la participation financière des entreprises tout en changeant ses modalités afin que ce financement pèse moins sur l’emploi.
L’instauration d’une cotisation sur la valeur ajoutée consisterait à remplacer une fraction des cotisations sociales patronales par un prélèvement assis sur la valeur ajoutée. L’assiette de ce prélèvement étant plus large que celle des cotisations sociales, son taux serait plus bas, et il pèserait donc moins directement sur le travail. À titre d’illustration, 2 points de cotisations patronales, dont le produit représente 8,63 milliards d’euros, correspondent à 0,91 point de cotisation sur la valeur ajoutée sur l’ensemble des entreprises.
La problématique du passage d’une cotisation patronale assise sur la seule masse salariale à un prélèvement ayant pour assiette la valeur ajoutée n’est pas nouvelle. Elle a été évoquée dès 1975 par le rapport de la « commission Granger », chargée par le ministre du travail de rechercher « un aménagement de l’assiette des charges sociales assumées par les entreprises pour tenir compte de l’ensemble des éléments d’exploitation ». Cette idée a d’abord été écartée au cours des années soixante-dix et quatre-vingt au profit des opérations de déplafonnement répondant aux mêmes logiques d’élargissement d’assiette et de limitation des cotisations sociales des entreprises de main-d’œuvre peu qualifiée.
L’idée a été réexaminée dans les années quatre-vingt-dix, une fois le déplafonnement réalisé, notamment par le rapport sur la réforme des cotisations patronales remis au Premier ministre par M. Jean-François Chadelat en 1997, ou celui de M. Edmond Malinvaud en 1998 (90). Ces travaux ont notamment souligné l’importance des allégements ciblés sur les bas salaires mis en œuvre depuis 1993.
Une baisse des cotisations sociales compensée par la création d’une cotisation sur la valeur ajoutée produirait deux effets distincts :
– en réduisant le coût du travail, la baisse des cotisations sociales employeurs stimulerait la demande de travail des entreprises et réduirait leurs coûts de production. Ces deux évolutions provoqueraient respectivement une augmentation du revenu des ménages et une baisse des prix à la consommation, dont les effets conjugués induiraient une progression de la consommation des ménages favorable à la croissance ;
– parallèlement cependant, la création de la cotisation sur la valeur ajoutée, qui reposerait aux deux tiers sur les salaires, compenserait partiellement la réduction du coût du travail induite par la baisse des cotisations sociales, et induirait en outre un accroissement du coût du capital qui pourrait réduire l’investissement.
La mise en place de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (dans le cadre de la création de la contribution économique territoriale
– CET – en remplacement de la taxe professionnelle, et à côté de la cotisation foncière des entreprises - CFE), a, pour la première fois, institué un prélèvement sur ce type d’assiette, avec notamment pour objectifs un soutien à l’emploi et une aide aux secteurs industriels.
La Cour des comptes considère cependant qu’une taxation de la valeur ajoutée est « une option à risque ».
Elle n’a cependant testé qu’une hypothèse : celle d’un basculement intégral de toutes les cotisations sociales payées par les entreprises relevant du périmètre des allégements généraux de cotisations sociales sur la même assiette de la valeur ajoutée brute que la CVAE, soit 23 milliards d’euros. La Cour constate que « la simulation donne des résultats très peu significatifs les deux premières années mais qui s’amplifient les années suivantes. Globalement, l’effet de la substitution est dépressif tant pour l’emploi que pour l’investissement, la consommation ou la croissance. Après cinq ans, l’écart par rapport à la situation de statu quo s’élève à près de - 0,5 point pour le PIB, – 69 000 emplois et un effet nul sur la balance commerciale ». Ces effets négatifs seraient dus notamment à une augmentation de la pression fiscale sur les investissements – qui pèserait sur la formation brute de capital fixe – et à la diminution de la progressivité des prélèvements sur les salaires, la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée envisagée portant de façon uniforme sur la masse salariale et provoquant, par conséquent, un renchérissement du coût du travail pour les bas salaires.
ESTIMATION DES EFFETS MACROÉCONOMIQUES
D’UNE SUPPRESSION DES COTISATIONS FAMILLE
FINANCÉE PAR UN TRANSFERT SUR LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE
( % en écart au compte central)
Données économiques |
1 an |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
10 ans |
PIB |
– 0,7 |
– 0,13 |
– 0,25 |
– 0,36 |
– 0,45 |
– 0,67 |
Consommation des ménages |
– 0,02 |
– 0,11 |
– 0,21 |
– 0,31 |
– 0,39 |
– 0,53 |
Investissement des SNF et EI |
– 0,7 |
– 0,6 |
– 0,8 |
– 1,0 |
– 1,2 |
– 1,5 |
Exportations |
– 0,02 |
– 0,12 |
– 0,24 |
– 0,34 |
– 0,43 |
– 0,61 |
Importations |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,3 |
– 0,3 |
– 0,1 |
Balance commerciale (en points du PIB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 0,1 |
Emploi (en milliers) |
– 7 |
– 17 |
– 31 |
– 51 |
– 69 |
– 92 |
Taux de chômage |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
Prix de la consommation des ménages |
– 0,1 |
– 0,1 |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
Prix des exportations |
0 |
– 0,1 |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
Prix des importations |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
Prix de production |
– 0,1 |
– 0,1 |
0 |
0,1 |
0,3 |
0,7 |
Source : direction générale du Trésor, Cour des comptes.
Cependant, comme l’a rappelé, M. Gérard Cornilleau, directeur adjoint au département des études de l’OFCE, « les simulations régulièrement produites par la direction du Trésor », compte tenu notamment de l’utilisation du modèle MÉSANGE, « pénalisent sans doute le scénario d’un transfert vers une assiette sur la valeur ajoutée : d’autres hypothèses conduisent à des résultats plus favorables ».
En effet, MÉSANGE est un modèle néokeynésien mais, à long terme, d’inspiration plutôt libérale. Dans ce modèle, tout ce qui nuit au capital est défavorable à l’emploi. En effet, le capital étant considéré comme totalement mobile, toucher à sa fiscalité apparaît automatiquement comme une incitation pour les entreprises à diminuer leurs investissements, ce qui a des conséquences négatives pour l’emploi, tout comme le fait de remplacer un allégement ciblé sur les bas salaires par une hausse générale du coût du travail.
Pourtant, selon certains économistes, notamment dans l’hypothèse de cotisations négatives et de la neutralisation de la mesure pour les bas salaires, le transfert sur la cotisation assise sur la valeur ajoutée pourrait avoir des effets positifs sur l’emploi.
Ainsi, les estimations réalisées dans le cadre du rapport du groupe de travail sur la cotisation sociale employeurs de 2006 (91), également réalisées par la direction générale du Trésor, neutralisaient l’effet défavorable de la réforme sur les bas salaires en simulant des cotisations négatives. Elles mettaient en évidence un impact positif sur l’emploi à court terme. À plus long terme en revanche, le rapport concluait à un effet au mieux nul sur l’emploi, à la condition que soit maintenue la progressivité des cotisations.
Le rapport constatait, par ailleurs, qu’une telle réforme bénéficie essentiellement aux activités intensives en main-d’œuvre – au détriment des activités fortement capitalistiques – et aux petites et moyennes entreprises – au détriment des entreprises présentant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros.
Simulations du rapport du groupe de travail sur l’élargissement de l’assiette des cotisations employeurs de sécurité sociale (juin 2006)
Le rapport souligne qu’en cas de création d’une taxe sur la valeur ajoutée, la baisse des cotisations sociales employeurs diminue le coût du travail, ce qui stimule la demande de travail des entreprises. Le surcroît de revenu des ménages favorise la consommation (+ 0,1 % la première année, + 0,3 % la deuxième), qui est également soutenue par la baisse des prix à la consommation (- 0,4 % la première année et - 0,8 % la seconde année) rendue possible par la contraction des coûts unitaires salariaux.
La hausse de la demande intérieure engendre une hausse des importations supérieure à la hausse des exportations qui découle de la baisse des prix à la production, ce qui impacte légèrement la balance commerciale (- 0,1 % du PIB les deux premières années). Dans ce contexte expansionniste, l’investissement est encouragé (+ 0,4 % par rapport au compte central la première année et + 0,6 % la seconde). Le PIB est supérieur de 0,1 % à sa valeur de compte central la première année et de 0,3 % la deuxième.
La création de la CVA induit une hausse du coût du travail, qui toutefois ne compense que partiellement la baisse des cotisations sociales. Les effets de la baisse du coût du travail qui viennent d’être décrits sont donc atténués.
Parallèlement, le coût du capital s’accroît, la CVA pesant en partie sur la rémunération du capital. Du fait de la baisse des cotisations sociales, le coût relatif travail/capital diminue pour les entreprises, qui arbitrent en substituant du travail au capital. Par suite, l’emploi progresse au détriment de l’investissement, tandis que le revenu disponible brut des ménages et la consommation augmentent.
L’effet économique favorable sur l’emploi constaté les premières années s’estompe, la réforme se révélant neutre voire légèrement négative pour l’emploi à long terme.
En revanche, l’investissement diminue, ce dont résulte, l’emploi étant inchangé, une baisse du PIB. Dès lors que la substitution exerce un effet récessif sur le PIB, il sera nécessaire de compenser l’allégement de cotisations sociales par une hausse plus qu’équivalente du nouveau prélèvement (bouclage ex post), faute de quoi la réforme se traduira par une dégradation du solde des finances publiques.
Il faut noter que l’instauration d’une cotisation sur la valeur ajoutée nette a des effets moins récessifs sur l’activité économique et sur l’investissement, pour un impact équivalent en termes d’emploi.
4. La grande absente des débats : la fiscalité du capital et du patrimoine
au travers d’une réforme de l’assiette de la CSG
Étrangers au financement de la protection sociale jusqu’au début des années 1980, les revenus du capital perçus par les ménages y contribuent à présent de manière significative. Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont, en effet, la CSG (dont le taux est de 8,2 % sur ces revenus), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (dont le taux est de 0,5 %), le prélèvement social sur les revenus du capital (dont le taux est de 4,5 %), la contribution sociale pour l’autonomie (dont le taux est de 0,3 %), et le prélèvement de solidarité (dont le taux est de 2 %) soit un total de 15,5 %.
Au total, ces différents prélèvements sociaux représentent 20,3 milliards d’euros en 2013, dont 7,5 % sont attribués à la CNAF.
Le Haut Conseil du financement de la protection sociale, dans son rapport d’étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale (92), constate que les mesures prises en 2012 et 2013 ont accru de façon importante le rendement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. En euros courants, les prélèvements sur les revenus du patrimoine ont procuré aux régimes de protection sociale des ressources en progression de 54 % entre 2010 et 2013.
LE RENDEMENT DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS DU CAPITAL
(en milliards d’euros)
Rendement |
Variation | ||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 (1) |
2011 |
2012 |
2013 (1) | |
Taux de prélèvements |
12,1 % |
13,5 % |
15,5 % |
15,5 % |
– |
– |
– |
Rendement total |
13 |
16,4 |
19,4 |
20,4 |
25,8 % |
18,5 % |
5,2 % |
dont patrimoine |
5,5 |
5,9 |
7,1 |
8,2 |
6,7 % |
19,9 % |
16,2 % |
dont placement |
7,5 |
10,5 |
12,3 |
10,2 |
39,8 % |
17,8 % |
–1,2 % |
(1) Prévisions.
Source : Haut Conseil du financement de la protection sociale.
Cette forte croissance s’explique à la fois par un élargissement de l’assiette des revenus du patrimoine assujettis aux prélèvements sociaux, et par une majoration des taux de ces prélèvements. S’agissant de l’assiette des prélèvements sur les revenus du capital, peuvent être citée les mesures suivantes :
– en 2011, l’imposition au premier euro des plus-values en cas de cession de valeurs mobilières et l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euro des contrats d’assurance-vie multi-supports ;
– en 2012, la modification de l’assujettissement des plus-values immobilières, hors résidence principale (révision de la chronique d’abattement en fonction de la durée de détention).
S’agissant des taux de ces prélèvements, peuvent être cités :
– la création, en 2010, de la contribution au Fonds national des solidarités actives, au taux initial de 1,1 % ;
– le relèvement du taux du prélèvement social sur les revenus du capital, de 2 % en 2010 à 2,2 % en 2011, 3,4 % au 1er janvier 2012 et 5,4 % au 1er juillet 2012.
Selon le Haut Conseil, le taux d’imposition économique de certains revenus du patrimoine (intérêts, revenus fonciers, dividendes, plus-values assujetties) atteignait ou dépassait 60 % en 2012 : il a donc considéré que les mesures concernant les prélèvements sociaux sur le patrimoine devaient concerner plutôt l’assiette que les taux.
Pourraient être donc privilégiées certaines réformes tendant à réduire les éléments de revenus du patrimoine qui échappent actuellement aux prélèvements sociaux. C’est le cas notamment l’appréhension des plus-values mobilières et immobilières au moment du décès du détenteur ou d’une donation : actuellement, ces plus-values sont certes intégrées à la valeur successorale assujettie aux droits de mutation à titre gratuit, mais ne subissent pas les prélèvements sociaux avant la donation ou la succession.
D. TOUT TRANSFERT VERS LES MÉNAGES DOIT S’ACCOMPAGNER D’UNE PROGRESSIVITÉ DE L’ASSIETTE SUBSTITUTIVE
Les prélèvements sociaux sur le revenu des ménages ne contribuent que faiblement à la réduction des inégalités. En raison de leur faible progressivité – voire leur dégressivité au-delà d’un certain plafond –, ils pèsent plus lourdement sur les ménages à bas revenus d’activité.
Le tableau ci-dessous confirme la faible progressivité des prélèvements sociaux acquittés par les ménages. Hormis pour les deux premiers déciles de niveau de vie où il avoisine 10 %, le ratio des cotisations et contributions sociales à la charge des personnes protégées au revenu disponible par unité de consommation du ménage oscille entre 15 % et 19 %, et diminue même à 17 % dans le dernier décile, en raison du plafonnement de certaines cotisations sociales.
RAPPORT DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
AU REVENU DISPONIBLE PAR UNITÉ DE CONSOMMATION DES MÉNAGES EN 2012
(en euros annuels)
Décile de revenu disponible par unité de consommation |
Ensemble des ménages | ||||||||||
1er |
2e |
3e |
4e |
5e |
6e |
7e |
8e |
9e |
10e | ||
Revenu disponible moyen par UC |
9 130 |
12 590 |
14 910 |
17 000 |
19 100 |
21 330 |
23 950 |
27 430 |
33 200 |
56 790 |
23 600 |
Cotisations patronales par UC |
11 % |
18 % |
23 % |
25 % |
29 % |
33 % |
35 % |
36 % |
36 % |
32 % |
31 % |
Cotisations salariales et contributions sociales (CSG et CRDS) par UC |
8 % |
11 % |
14 % |
15 % |
17 % |
18 % |
19 % |
19 % |
19 % |
17 % |
17 % |
Total des cotisations et contributions par UC rapporté au revenu disponible |
18 % |
30 % |
37 % |
41 % |
48 % |
51 % |
54 % |
55 % |
56 % |
49 % |
48 % |
Source : programme de qualité et d’efficience « Financement » annexé au projet de loi de financement pour 2014, d’après ERFS 2010, modèle INES (Insee-Drees), législation 2012 ; calculs DREES.
Ainsi, dans un point d’étape publié en mars dernier, le Haut Conseil du financement de la protection sociale (93) constate que « la progressivité modeste des cotisations et contributions sociales à la charge des personnes protégées contre les risques couverts par des dispositifs de protection sociale peut laisser penser que des marges existent pour l’augmenter sans accroître le produit total de ces prélèvements, et majorer encore la contribution de la protection sociale à la réduction des inégalités de revenu » .
Les voies d’une progressivité plus importante des prélèvements sociaux acquittés
par les ménages
Plusieurs scénarios sont évoqués par le Haut Conseil du financement de la protection sociale :
– le premier est fondé sur l’introduction d’une progressivité des cotisations sociales acquittées par les salariés, sous forme d’abattements à la base, de réductions forfaitaires ou d’une modulation des taux. Si cette solution est simple à mettre en œuvre, elle risque de rendre encore plus illisible les barèmes des prélèvements sociaux ;
– dans le deuxième scénario, la CSG pourrait se substituer aux cotisations maladie ou vieillesse, « soit directement, soit avec un aménagement des cotisations sociales patronales permettant une baisse des cotisations salariales vieillesse et une augmentation de la CSG affectée à la branche famille ». Sur cette piste pèse cependant l’hypothèque constitutionnelle quant au niveau « confiscatoire » des impositions, notamment en cas d’augmentation de la CSG sur les revenus du patrimoine ;
– le troisième scénario, privilégié par le Haut Conseil, consiste en l’accroissement de la progressivité de la CSG, soit en augmentant la progressivité de l’ensemble de ses composantes, soit en supprimant tout ou partie de la déductibilité de l’impôt sur le revenu d’une fraction de la CSG.
Votre Rapporteur considère, en effet, qu’une évolution plus pertinente que la hausse de la CSG est de la rendre progressive. Cette mesure permettrait de rendre, de manière substantielle, du pouvoir d’achat aux catégories populaires et moyennes sans accroître le déficit public et garantirait des recettes pérennes à la branche famille.
C’est pourquoi, votre Rapporteur a déposé un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 afin de rendre la CSG progressive. La réforme proposée consistait à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG, sans distinction entre les retraités et les actifs et entre les revenus du capital et les revenus du travail :
– les taux bas (soit une exonération ou un taux de 3,8 %) dont bénéficient aujourd’hui les retraités pauvres seraient appliqués à l’ensemble des individus ayant des revenus bruts annuels inférieurs à 13 324 euros, c’est-à-dire aux 30 % des personnes les moins favorisées ;
– un taux de 5,5 %, soit une baisse de 2 points par rapport au taux actuel de 7,5 %, serait appliqué aux personnes dont les revenus sont situés entre 13 324 euros et le revenu médian ;
– le taux de 7,5 %, qui est aujourd’hui la norme, continuerait à s’appliquer pour les revenus légèrement supérieurs au revenu médian ;
– un taux de 9 %, soit une hausse de 1,5 point par rapport au taux actuel de 7,5 %, serait appliqué aux personnes dont les revenus sont supérieurs à 29 817 euros.
Cependant une telle réforme impose de tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, ce dernier, dans sa décision du 19 décembre 2000, a déclaré contraire à la Constitution un dispositif de réduction dégressive de CSG qui accordait aux plus bas salaires une diminution de CSG en jugeant contraire à l’égalité devant l’impôt le fait de ne pas tenir compte de l’ensemble des revenus et de la composition du foyer fiscal dans la détermination du droit à cette réduction de CSG.
Mettre en place une CSG progressive : la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Dans sa décision n° 2000- 437 DC du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a censuré la minoration de la CSG des ménages percevant les salaires inférieurs à 1,4 SMIC (« ristourne dégressive ») au motif qu’elle ne tenait compte « ni des revenus des contribuables autres que ceux tirés d’une activité, ni des revenus des autres membres du foyer, ni des personnes à charge de celui-ci », eu égard à l’objectif poursuivi, qui consistait à lutter contre les trappes à inactivité et donc impliquait qu’il soit tenu compte de l’ensemble des revenus du ménage.
Une réforme de la CSG qui, dans un objectif affiché de redistribution et d’accroissement de la progressivité globale des prélèvements, consisterait à appliquer des taux différents à raison du revenu devrait donc, compte tenu de cette jurisprudence, tenir compte de l’ensemble des revenus du foyer et de la situation de famille.
Tirer les conséquences de cette jurisprudence dans un barème progressif de la CSG sur les revenus d’activité implique que la détermination du taux de CSG applicable aux différents niveaux de revenu d’activité prenne en compte le revenu global du foyer fiscal et sa composition.
C’est pourquoi, un second amendement, déposé au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 par votre Rapporteur, a proposé de mettre en place un dispositif de correction « conjugale » intervenant en année N+1 à la suite de la déclaration de revenus dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Ce mécanisme peut donner lieu à un « changement de tranche » pour l’un ou l’autre des membres du couple et donc à une correction de CSG due.
Cette correction se ferait en déduction ou en addition sur le montant d’impôt sur le revenu à payer. La correction « familiale » prendrait la forme d’une réduction forfaitaire de CSG par enfant ou personne à charge financée par la suppression de la prime pour l’emploi qui est avantageusement remplacée par la CSG progressive.
E. DE NÉCESSAIRES CONTREPARTIES À L’ALLÉGEMENT DES COTISATIONS DES ENTREPRISES
Dans le cadre du Pacte de responsabilité, la baisse des cotisations patronales doit s’accompagner de contreparties, notamment en matière de création d’emploi.
Cependant, l’accord signé entre les trois syndicats majoritaires (CFDT, CGC-CFE et CFTC) et les organisations patronales le 6 mars dernier est davantage une feuille de route qu’un véritable accord qui impose des contreparties aux entreprises en échange de la baisse de 30 milliards d’euros du coût du travail. En effet, en échange de la baisse de trente milliards d’euros du coût du travail, le texte prévoit de « demander aux branches professionnelles » d’ouvrir « des discussions » ou « des négociations sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes d’emploi ».
Un premier bilan devrait être dressé avant l’été. Par la suite, des « critères » et des « modalités de suivi et d’évaluation des objectifs » pourront être décidés dans chaque branche avant la fin de l’année. Un observatoire national tripartite suivra le déploiement du Pacte, mais il ne fera que « s’assurer de la cohérence de la trajectoire de baisse des prélèvements avec les engagements » adoptés dans les branches. En revanche, l’accord ne prévoit pas que les aides pourraient être retirées si les engagements n’étaient pas tenus.
Cet accord illustre la volonté des organisations patronales de ne pas fixer d’engagements précis et chiffrés, notamment en matière de création d’emplois. La table ronde avec les organisations patronales (MEDEF, CGPME, UPA) organisée dans le cadre de la MECSS a montré leur opposition à toute contrepartie autre qu’incantatoire…
Mme Valérie Corman, directrice de la protection sociale du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), a clairement affirmé cette position, lors de son audition par la MECSS : « S’agissant des contreparties, c’est en termes d’impact sur la compétitivité des allégements de charges qu’il faut raisonner. Ces mesures permettront-elles de restaurer la compétitivité des entreprises ? Il est impossible d’avancer des objectifs chiffrés, c’est-à-dire de traduire mécaniquement par exemple 1 milliard de baisses des cotisations en un nombre déterminé de créations d’emplois. La restauration de la compétitivité des entreprises aura, certes, un impact positif en matière de créations d’emplois – c’est l’objectif du MEDEF –, mais cette restauration passe avant tout par la capacité à innover et à investir. N’attendez pas de moi que je vous donne un objectif chiffré. »
1. Les « trente-cinq heures », un exemple de contreparties « réussies »
Votre Rapporteur est convaincu que seule la mise en place de contreparties objectives et vérifiables permettra aux baisses de cotisations sociales d’avoir un impact significatif en matière de création d’emplois.
L’exemple des lois sur la réduction du temps de travail est, de ce point de vue, éclairant. S’il est difficile de distinguer l’impact sur l’emploi des allégements de cotisations de leur contrepartie qui a été la mise en place des trente-cinq heures : on ne peut néanmoins que constater le bilan positif en matière de création d’emploi de cette réforme. Ainsi, selon le bilan dressé par la DARES et repris par l’INSEE, les lois « Aubry » ont créé 350 000 emplois.
Lors de son audition par la mission, Mme Anne Eydoux a partagé le même constat : « J’en viens aux trente-cinq heures. Il a fallu attendre 2005 pour disposer d’un bilan : mitigé sur les conditions de travail, il est plutôt favorable en termes de création d’emplois. La France a très bien résisté, notamment en matière d’emploi, au ralentissement des années 2000 qui n’a pas donné lieu à une récession, alors que ce fut le cas en Allemagne. Il est possible que les trente-cinq heures aient joué un rôle en la matière. »
2. Des options peu efficaces si elles ne sont pas assorties de « sanctions »
Le bénéfice des allégements généraux de cotisations sociales est déjà conditionné par plusieurs contreparties :
– le premier dispositif mis en œuvre a trait à l’obligation incombant à l’employeur en matière de négociation sur les salaires (94). Les entreprises et groupes de cinquante salariés et plus dans lesquelles un ou plusieurs délégués syndicaux ont été désignés doivent procéder à cette négociation annuelle. En l’absence de preuve d’engagement d’une telle négociation, l’employeur est tenu, au titre de l’année considérée, de déclarer et payer une pénalité correspondant à 10 % des allégements appliqués au cours de l’année. Les allégements relevant du champ de cette pénalité sont l’allégement général ainsi que les allégements applicables dans certaines zones géographiques. Lorsque l’employeur n’a pas rempli cette obligation au titre de la troisième année consécutive, le taux de la pénalité est de 100 % ;
– Un second dispositif, prévu par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 (95), est lié à la mise en œuvre des contrats de génération (96).
Il concerne les entreprises et groupes d’au moins trois cents salariés qui ont l’obligation d’être couverts par un accord collectif ou un plan d’action relatif au contrat de génération.
En cas d’absence d’accord ou de plan d’action, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est amenée à prononcer une pénalité plafonnée à 1 % des gains et rémunérations versées au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise ou le groupe n’a pas été couvert par un accord ou un plan d’action. La pénalité est arrêtée et liquidée par la DIRECCTE, elle est recouvrée par les URSSAF. Par ailleurs, l’entreprise ou le groupe est également tenu de transmettre annuellement une évaluation de la mise en œuvre de l’accord collectif ou du plan d’action. En l’absence de transmission de cette évaluation, la DIRECCTE peut prononcer une pénalité de 1 500 euros par mois de retard de transmission, ladite pénalité étant également recouvrée par les URSSAF. Ce dispositif a été introduit récemment et n’a donc pas donné lieu, à ce stade, à mise en œuvre des modalités de sanction et de recouvrement.
La mise en place de contreparties objectives susceptibles d’être contrôlées et de donner lieu à des sanctions est donc possible.
Dans une version « minimaliste », ces contreparties peuvent prendre la forme d’une obligation de négociation comme c’est le cas actuellement pour certains dispositifs d’allégements de cotisations sociales.
Une telle forme de contrepartie a été préconisée par M. Louis Gallois, commissaire général à l’investissement, qui a souligné, lors de son audition, que « le Pacte de responsabilité pourrait être employé comme levier pour obtenir, dans chaque branche, une négociation sur ce que j’appellerais des " contrats de progrès " – car ils seraient conclus au bénéfice de tout le monde – sur l’apprentissage, la formation professionnelle, le recrutement de jeunes, de seniors ou de chômeurs de longue durée, etc. L’État pourrait ainsi définir une liste de thèmes sur lesquels il souhaite voir les partenaires sociaux négocier ».
M. Christian Saint-Étienne a proposé, lors de son audition, un dispositif similaire : « Il reste à éviter que les entreprises ne se contentent de profiter de l’avantage donné sans rien faire d’autre. » Celui-ci a donc préconisé que la baisse des cotisations patronales ait pour contrepartie un renforcement significatif des obligations des entreprises en termes de formation en alternance et d’apprentissage afin de créer un million d’apprentis en cinq ou sept ans : « La mesure revient à réduire de 5 % la masse salariale. Il est donc aisé de calculer le gain " en cash " qu’elle représenterait pour chaque entreprise. On ne pourrait donc, en effet, peut-être pas prévoir une proportionnalité stricte, mais au moins établir un lien entre l’avantage reçu et le nombre d’apprentis à engager. »
Dans une version « maximaliste », ces contreparties pourraient prendre une forme plus contraignante pour les entreprises.
À titre d’exemple, le coprésident de la MECSS, M. Jean-Marc Germain, a déposé un amendement au projet de loi sur la formation professionnelle et la démocratie sociale, prévoyant qu’au moins 1 point sur les 6 % (soit 1 euro sur 6) du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi vienne abonder directement les comptes personnels de formation des salariés, au-delà du quota des 20 heures annuelles de formation prévues par la loi.
La réforme du financement de la branche famille est essentielle car elle permettra d’assurer la pérennité et la consolidation du modèle social français.
En effet, si la diversification de son financement, notamment par la création de la CSG, a répondu à l’universalisation de la branche, elle a aussi contribué, par l’attribution de recettes peu dynamiques, à fragiliser son financement et à provoquer l’apparition d’un déficit conjoncturel. Compte tenu de la progression dynamique des dépenses de la branche famille ces dernières années, il apparaît aujourd’hui nécessaire de lui garantir un financement stable, autonome et compatible avec le dynamisme des dépenses.
Pour garantir ce financement pérenne, la contribution financière des entreprises apparaît légitime, au moins au titre de la politique tendant à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle qui représente entre 10 et 15 milliards d’euros ou de l’ordre de 1,4 à 1,8 point de cotisation patronale « famille ». Hormis les organisations patronales, l’ensemble des personnes entendues par la MECSS – organisations syndicales, président de la CNAF, directeur de la sécurité sociale, Cour des comptes – a considéré que la participation des entreprises au financement de la branche famille devait être maintenue.
La suppression de cette contribution apparaît d’autant moins justifiée que la participation effective des entreprises au financement de la politique familiale n’a cessé de baisser depuis 1945, notamment du fait des différentes politiques d’allégements de cotisations sociales menées depuis les années quatre-vingt-dix. Cette politique a conduit à un taux réel de cotisation des entreprises bien inférieur au taux affiché de 5,4 % en 2013 et 5,25 % en 2014. La création du CICE – qui contribue à un allégement supplémentaire du coût du travail de 20 milliards d’euros par an – et le Pacte de responsabilité – qui devrait prendre la forme d’un relèvement des seuils des allégements « Fillon » – s’inscrivent donc dans la continuité de ces politiques, qui ont conduit, in fine, à transférer une part croissante du financement de la branche famille sur les ménages.
Si, dans le cadre du Pacte de responsabilité, les cotisations patronales devaient connaître une nouvelle réduction, nous devrions nécessairement nous interroger, s’agissant de la recherche de recettes nouvelles sur d’autres modalités de participation financière des entreprises – notamment par une cotisation sur la valeur ajoutée – sur la fiscalité du capital et du patrimoine et sur la progressivité des prélèvements sociaux, notamment de la CSG. Par ailleurs, cette réforme devra nécessairement s’accompagner de contreparties objectives susceptibles d’être contrôlées notamment en matière de créations d’emplois.
Depuis le début des travaux de la mission au mois de novembre 2012, de nombreuses réformes ont eu un impact sur la branche famille et le coût du travail : peuvent être citées, à titre d’exemple, la création du CICE, la réforme des retraites et la réforme du quotient familial.
La réforme de grande ampleur du Pacte de responsabilité, annoncée par le Président de la République lors de sa conférence de presse du 13 janvier 2014, est aujourd’hui à l’ordre du jour. Alors que la MECSS a achevé ses travaux, les premiers contours de cette réforme ont été précisés en deux temps par le Premier ministre Manuel Valls : dans un premier temps lors de sa déclaration de politique générale, le 8 avril dernier puis, dans un second temps, par ses annonces concernant le plan d’économies de 50 milliards d’euros à l’issue du Conseil des ministres du 16 avril.
Celui-ci a confirmé l’objectif inscrit dans le Pacte de responsabilité de réduction de 30 milliards d’euros du coût du travail d’ici 2016 : ce dernier sera diminué de 10 milliards d’euros supplémentaires, s’ajoutant aux 20 milliards d’euros du CICE :
– à compter du 1er janvier 2015, les cotisations patronales au niveau du SMIC seront supprimées et les allégements « Fillon », qui permettent de réduire les cotisations pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, seront renforcés, pour éviter un effet de « trappe à bas salaires », soit un allégement des cotisations de 4,5 milliards d’euros ;
– pour les salaires jusqu’à 3,5 fois le SMIC, ce qui couvre plus de 90 % des salariés, les cotisations famille seront baissées de 1,8 point au 1er janvier 2016, soit 4,5 milliards d’euros d’allégements supplémentaires ;
– enfin, pour compenser l’impossibilité pour les artisans et les indépendants de bénéficier du CICE, ceux-ci devraient bénéficier d’une baisse de plus de 3 points des cotisations familiales dès 2015, soit un milliard d’euros d’allégement.
Le Premier ministre a indiqué que cet allégement de 30 milliards d’euros représenterait au total : « l’équivalent des cotisations famille comme l’avait dit le Président de la République, le 14 janvier dernier ».
La déclaration de politique générale du 8 avril 2014 :
les annonces en matière de fiscalité des entreprises
Parallèlement à la baisse des cotisations sociales, le Premier ministre a annoncé une baisse de la fiscalité des entreprises :
– la contribution sociale de solidarité des sociétés, dite C3S, dont s’acquittent 300 000 entreprises, sera progressivement supprimée d’ici 2017. Cela représentera environ 6 milliards d’euros de marges supplémentaires, dont 1 milliard d’euros dès 2015 ;
– l’impôt sur les sociétés sera progressivement diminué avec la suppression dès 2016 de la surtaxe instaurée lors du précédent quinquennat. Le taux normal de cet impôt atteindra 28 % en 2020, avec une étape intermédiaire en 2017 ;
– enfin, plusieurs dizaines de petites taxes complexes et de faible rendement seront également supprimées dans le but de simplifier le système fiscal.
Au total, la diminution de la fiscalité des entreprises s’élèvera à 8,5 milliards en 2017. Mais les sociétés, dont les résultats seront améliorés par la baisse des charges et des impôts sur la production, paieront environ 3 milliards d’impôts en plus en 2017.
Par ailleurs, dans le cadre du Pacte de solidarité annoncé par le Président de la république le 31 mars, le Premier ministre a annoncé 5 milliards d’euros de mesures fiscales et sociales pour « améliorer le pouvoir d’achat des salariés les plus modestes » à l’horizon 2017. En 2015, les cotisations salariales jusqu’à 1,3 SMIC seront diminuées pour améliorer le salaire net des salariés concernés de 500 euros par an, soit l’équivalent de la moitié d’un treizième mois. Cette diminution devrait, semble-t-il, concerner les cotisations vieillesse et une partie des cotisations sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Par ailleurs, le Premier ministre a plaidé en faveur d’un allégement de la fiscalité pesant sur les ménages modestes et en particulier « ceux qui sont entrés dans le champ de l’impôt sur le revenu ces dernières années alors même que leur situation ne s’était pas améliorée ».
Pour financer ces réformes, le Premier ministre a annoncé, à l’issue du Conseil des ministres du 16 avril, un plan d’économie de 50 milliards d’euros d’ici 2017 dont les mesures sont détaillées en l’encadré suivant.
Le plan d’économie annoncé par le Premier ministre Manuel Valls
Le Premier ministre a annoncé, le 16 avril dernier, que le plan d’économies de 50 milliards d’euros devrait concerner :
– l’État, à hauteur de 18 milliards d’euros, notamment par la maîtrise des dépenses de fonctionnement des ministères (dépenses immobilières, systèmes d’information) et le gel du point d’indice des fonctionnaires. Les effectifs des ministères, hors éducation nationale, sécurité et justice continueront de diminuer ainsi que ceux des agences (hors Pôle emploi et universités) ;
– les collectivités territoriales à hauteur de 11 milliards d’euros, notamment par une clarification des compétences des collectivités et un renforcement de leur efficacité ;
– les dépenses d’assurance maladie à hauteur de 10 milliards d’euros d’ici 2017, notamment par des économies sur les dépenses de chirurgie ambulatoire, de médicaments ;
– la gestion du système social à hauteur de 11 milliards d’euros, notamment grâce aux mesures d’économie déjà prises à hauteur de 2,9 milliards d’euros (réforme des retraites, accord conclu pour les retraites complémentaires, réforme de la politique familiale) et par la non-revalorisation des prestations sociales jusqu’en octobre 2015 : pensions du régime de retraite de base (1,3 milliard d’euros), retraites complémentaires qui relèvent des partenaires sociaux (2 milliards d’euros), autres prestations sociales (0,7 milliard d’euros), à l’exception de tous les minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation adulte handicapé), qui continueront d’augmenter au rythme de l’inflation. Les engagements de revalorisation exceptionnelle décidés dans le Plan pauvreté de janvier 2013 pour le RSA, le complément familial et l’allocation de soutien familial sont confirmés. Mais ces revalorisations seront décalées d’une année.
La nouvelle convention d’assurance-chômage, devait permettre de rétablir l’équilibre financier de l’UNEDIC à l’horizon 2017 (2 milliards d’euros au total). Enfin, la poursuite de la modernisation de la politique familiale devrait permettre 0,8 milliard d’euros d’économies. Enfin, les caisses de sécurité sociale devront dégager 1,2 milliard d’économies, grâce à la dématérialisation et à une meilleure articulation entre les différents organismes.
Le Premier ministre a précisé que l’allégement du coût du travail pour les entreprises « ne pénalisera en rien le financement de la politique familiale, qui se verra affecter d’autres recettes pérennes ». En revanche, les contours de ces recettes n’ont pas encore été précisés.
L’annonce de ces réformes appelle plusieurs réflexions de votre Rapporteur.
La première porte sur la question du coût du travail qui fait de la branche famille et de son financement une variable d’ajustement. Votre Rapporteur continue de penser que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi souffre de l’absence de ciblage, en particulier pour les secteurs exposés souffrant d’un déficit de compétitivité avéré. Cette absence de ciblage conduit à des effets d’aubaine importants dans des secteurs tels que la grande distribution (3 milliards d’euros), le BTP (2 milliards d’euros) ou les professions réglementées (près de 1 milliard d’euros). Son financement par le biais d’une hausse de la TVA et un gel des prestations sociales, c’est-à-dire par deux mesures affectant le pouvoir d’achat des ménages est probablement contre-productif : comment justifier le gel des pensions de retraite pour financer la baisse de l’impôt sur les sociétés d’un notaire, d’un cabinet d’architecte ou d’un médecin ? À l’heure où des marges de manœuvre sont recherchées, il semble que des mesures de neutralisation de l’impact du CICE – comme celles annoncées par le Gouvernement concernant les cliniques privées – pourraient utilement être pensées dans un souci de justice et de bonne gestion.
La deuxième est qu’il est indispensable de garantir à la branche famille des recettes pérennes, autonomes et suffisamment dynamiques. Trop de lois de financements de la sécurité sociale ont procédé – à l’exemple de celle de 2011 – à des « bricolages » financiers sans garantir à la branche famille des recettes suffisantes et durables.
La diminution des cotisations patronales et salariales, dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, peut être, dès lors, l’occasion de réformer le financement des différentes branches de la sécurité sociale afin de leur garantir des recettes cohérentes et durables, à l’instar des différents scénarios proposés par le Haut Conseil du financement de la protection sociale.
Par ailleurs, alors que le plan d’économie annoncé le 16 avril dernier prévoit 0,8 milliard d’euros d’économies dues à la poursuite de la modernisation de la politique familiale et 1,2 milliard d’euros d’économies à la charge des caisses de sécurité sociale, votre Rapporteur tient à rappeler le rôle essentiel des dépenses de la branche famille pour favoriser la natalité et permettre une redistribution des revenus. Ces dépenses doivent être préservées, afin de garantir la cohésion sociale dans un contexte de crise économique.
En outre, malgré la baisse des cotisations patronales famille, il est essentiel de maintenir la participation des employeurs au financement de la branche famille, au titre de la politique tendant à concilier la vie familiale et professionnelle. La suppression totale de la participation des employeurs au financement d’une politique publique qui concerne directement les entreprises, constituerait un précédent préoccupant pour les autres dépenses de sécurité sociale.
Enfin, toute baisse du coût du travail sur l’efficacité de laquelle votre Rapporteur s’est précédemment interrogé ne saurait être avoir d’effet réel sur l’emploi que si elle est accompagnée de véritables contreparties de la part des entreprises. Les engagements pris par les employeurs n’ont été que peu précisés dans l’accord signé le 5 mars dernier entre les partenaires sociaux. La conférence sociale, qui devrait se tenir dès juin 2014, devra être l’occasion de préciser ces engagements.
*
* *
La mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale a adopté le présent rapport lors de sa première réunion du mardi 29 avril 2014.
Comme le prévoit l’article L.O. 111-9-3 du code de la sécurité sociale, elle notifiera les préconisations du présent rapport au Gouvernement et aux organismes de sécurité sociale concernés, lesquels seront tenus d’y répondre dans un délai de deux mois, et assurera le suivi de ses conclusions.
CONTRIBUTION DE M. PIERRE MORANGE,
COPRÉSIDENT DE LA MISSION D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Par son universalité, la branche famille représente un point d’aboutissement de notre système de protection sociale. Elle en subit également toutes les évolutions.
À ce double titre, la branche famille forme un laboratoire dans lequel se prépare l’avenir de notre protection sociale. L’importance des missions qui lui incombe mais aussi la conjoncture de crise économique et les différentes réformes qui l’ont touchée depuis le début de nos travaux en novembre 2012 – réforme du quotient familial, création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, baisse de cotisations sociales – illustrent la pertinence du choix que notre mission a effectué sous la précédente législature de se pencher sur le financement de cette branche.
La loi du 4 juillet 1975, qui dispose que l’ouverture des droits à prestations n’est plus subordonnée, à compter du 1er janvier 1978, à l’exercice d’une activité professionnelle ou au paiement de cotisations mais à la résidence régulière sur le territoire français, a donné un caractère universel aux prestations familiales. En réponse à cette universalisation, le législateur a mis en place la CSG qui assure une partie du financement de la branche. Mais aujourd’hui, alors que la question de la productivité et de l’allégement des charges est au cœur du débat public, la part cumulée des prélèvements sur l’activité dans le financement de la branche famille reste très importante, puisqu’elle s’élève à 80 %.
On assiste, de surcroît, à un effet de ciseaux entre la croissance importante des charges liée à l’augmentation des prestations – notamment en matière d’accueil du jeune enfant – et l’évolution modérée des recettes : cette évolution aboutit à une fragilisation du financement de la branche famille, la Cour des comptes évoquant dans son rapport d’étape un « financement brouillé » et la « difficulté de soutenabilité » de la politique familiale.
*
* *
Or, ce rapport ne tranche pas la question de l’affectation d’une recette pérenne et dynamique à la branche famille, pas plus d’ailleurs que le Premier ministre ne l’a fait, lors de sa déclaration de politique générale, alors qu’il a annoncé une baisse importante des cotisations patronales famille.
Pourtant, l’attribution d’une fraction de TVA – qui constitue une recette dynamique et durable – à la branche famille constitue une réforme pertinente et recommandée par plusieurs économistes auditionnés par la MECSS.
C’est le cas notamment de M. Christian Saint-Étienne qui a indiqué à la mission lors de son audition : « Même si on a fait un épouvantail de la TVA sociale – que d’aucuns appellent " TVA emplois " –, elle reste une mécanique très efficace. Sa mise en place en Allemagne au 1er janvier 2007 a d’ailleurs bien aidé le pays à traverser la crise survenue à partir de 2008, en permettant aux entreprises d’augmenter leurs fonds propres. Sur les trois points de hausse, un point a été consacré à la baisse des cotisations sociales et deux à la réduction de l’impôt sur les sociétés : on peut donc parler aussi bien de " TVA compétitivité " que de " TVA sociale ". Or l’économie allemande s’est fort bien portée de sa création. »
C’est aussi le cas du commissaire général à l’investissement, M. Louis Gallois, qui a indiqué que ses travaux sur la compétitivité l’avaient amené à préférer cette option : « Comme vous le savez, je n’avais pas proposé le système qui est devenu le CICE, mais un transfert de cotisations sociales sur la fiscalité. J’avais suggéré d’opter pour la CSG, mais uniquement faute de pouvoir exprimer clairement ma préférence en faveur d’une hausse de la TVA, le sujet étant tabou à l’époque. »
Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport sur le financement de la branche famille, la TVA présente plusieurs avantages : c’est une recette assise sur une assiette particulièrement large, la consommation intérieure traditionnellement forte en France, elle a un rendement élevé à faible taux et un effet souvent comparé à une dévaluation, permettant de gagner rapidement en compétitivité prix, au moins sur les marchés exposés à la concurrence. En effet, les exportations qui ne sont pas taxées bénéficient de la baisse des charges, les importations voient leur prix s’accroître du fait de l’augmentation de TVA.
Le risque d’augmentation des prix, à la suite d’une hausse de taux de la TVA, paraît limité : quand, en Allemagne, le taux de TVA a été relevé de trois points, l’augmentation des prix qui s’en est suivie n’a pas dépassé 0,4 %. Le rapport du secrétaire d’État à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques sur la TVA sociale, remis au Premier ministre en septembre 2007, indiquait ainsi : « Un tel transfert réduirait les coûts de production en France et augmenterait le prix des importations. Il apparaît donc favorable à la compétitivité de l’économie française » (97).
*
* *
En outre, le rapport ne propose pas de pistes de réformes concrètes pour améliorer le rapport coût-efficacité de la branche famille et n’évoque aucune mesure d’économies ou de rationalisation budgétaire.
Pourtant, de nombreux rapports, notamment celui de notre ancien collègue Yves Bur, ont plaidé, pour une rationalisation des dépenses, dans le respect des principes d’universalité et de solidarité des prestations.
En outre, je rappelle que le Premier ministre, M. Manuel Valls, a annoncé que, dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros, la poursuite de la modernisation de la politique familiale devrait permettre de réaliser 0,8 milliard d’euros d’économies et que les caisses de sécurité sociale devraient dégager 1,2 milliard d’économies, grâce à la dématérialisation et à une meilleure articulation entre les différents organismes.
Enfin, le rapport de la Cour des comptes montre bien que l’impact sur l’économie française d’un transfert des cotisations sociales sur une nouvelle recette fiscale est d’autant plus positif que ce transfert de recettes est financé par une réduction des dépenses publiques.
Elle a donc souligné que, dans le cadre de notre réflexion sur la pérennité du financement de la branche famille, il convenait de ne pas négliger la question des gisements d’économies potentielles – elle nous en a d’ailleurs transmis une liste « à la Prévert ». Parmi eux, elle a notamment évoqué le RSA et l’APL qui représentent des volumes budgétaires conséquents. C’est pourquoi la MECSS a formulé à leur sujet des préconisations qui se sont traduites sous forme d’amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale précédents, visant au contrôle de l’éligibilité à ces prestations, et dont la mise en application n’est pas encore tout à fait effective.
La Cour des comptes a aussi mentionné plusieurs pistes de réformes dans les différents rapports sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS) :
– dans le RALFSS de 2010, elle a proposé d’évaluer les dépenses fiscales bénéficiant aux parents isolés en vue de les réorienter vers les familles monoparentales les plus défavorisées. En effet, sur les 415 millions d’euros de cette dépense fiscale, 25 % profitent aux 10 % les plus aisés, dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 46 000 euros par an. Un recentrage de la mesure représenterait une économie de plus de 100 millions par an ;
– dans le RALFSS de 2007, la Cour a recommandé la forfaitisation du supplément familial de traitement versé aux agents publics, qui représente 1,5 milliard d’euros et qui croît avec l’indice de rémunération jusqu’aux échelles lettres, de sorte qu’un professeur agrégé bénéficie d’un supplément familial de traitement bien plus élevé qu’un agent administratif ou un ouvrier de service ;
– enfin, la Cour a plusieurs fois recommandé la fiscalisation des majorations de pensions pour les parents de trois enfants, qui permettrait de dégager 500 à 600 millions au profit de l’État.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de porter une attention particulière aux systèmes d’information. Dans le paysage particulièrement touffu de notre protection sanitaire et sociale, l’absence d’interconnexion et de coordination des systèmes d’information ne laisse aucune possibilité de rationalisation et de traçabilité de l’effort public en faveur de la solidarité.
La MECSS a ainsi posé aux différentes branches des questions sur leurs systèmes informatiques et a reçu une réponse partielle de la branche famille. Pourtant, les licences coûtent environ 30 millions d’euros annuels à la seule branche famille, qui pourrait utiliser des systèmes libres.
De même, le mécanisme permettant le croisement de tous les fichiers des organismes sociaux – le répertoire national commun de la protection sociale – ne permet que le contrôle de l’éligibilité aux droits et n’est mis en œuvre qu’au cas par cas. Or, il ne s’agit pas seulement de vérifier l’éligibilité aux droits, mais aussi de vérifier les montants attribués. En outre, aucun croisement automatique n’a lieu avec les fichiers des services fiscaux – alors que ce serait un des meilleurs moyens de lutte contre la fraude fiscale, évaluée entre 40 et 50 milliards d’euros, ou contre la fraude sociale, évaluée à 20 milliards d’euros par la Cour des comptes – et avec les fichiers des collectivités territoriales.
Certes, ce dispositif n’est pas la pierre philosophale. Mais il aurait au moins un effet démultiplicateur sur la bonne utilisation de l’énergie publique au service de nos concitoyens.
Enfin, rappelons qu’en matière de rationalisation de dépenses de sécurité sociale, la MECSS avait proposé, dans son premier rapport en novembre 2005 (98), la mise en place d’un guichet unique, sur le modèle de ce qui existe dans les départements d’outre-mer et pour le RSA. Par ailleurs, une réflexion pourrait aussi être utilement menée sur la nécessaire convergence entre le régime général et les régimes de la fonction publique.
*
* *
Enfin, le rapport ne contient aucune proposition pour améliorer la compétitivité de notre économie, alors même que cette problématique est cruciale aujourd’hui et qu’elle est profondément liée à celle du coût du travail, comme en témoignent les orientations du Gouvernement en matière de baisse du coût du travail.
Ainsi que l’a rappelé M. Benjamin Gallezot, adjoint au directeur général de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) du ministère du redressement productif, lors de son audition, la politique industrielle visant à favoriser la compétitivité de la France ne peut omettre la compétitivité coût : « Nous considérons la compétitivité comme un tout : il nous semble en effet simpliste, voire biaisé, de distinguer artificiellement la compétitivité coût de la compétitivité hors coût et de soutenir qu’il ne faut faire porter l’effort que sur l’une ou l’autre, car elles sont extrêmement liées. »
Ainsi, dans un rapport publié en novembre 2013 sur la compétitivité française (99), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) constate que si la productivité horaire des salariés compte parmi les plus élevées de l’OCDE, il y a eu, en France, « un recul prononcé du nombre d’heures travaillées », dû en grande partie au passage aux trente-cinq heures en 2000, « recul tout juste compensé par des gains de productivité horaire ». L’OCDE note aussi qu’à l’inverse de l’Allemagne, les salaires ont augmenté plus vite que la productivité, ce qui a détérioré la compétitivité coût relative de la France, ce qui explique la dégradation continue du solde commercial.
Compte tenu de ce constat alarmant de l’OCDE, une augmentation du temps de travail hebdomadaire à trente-neuf heures hebdomadaire, à salaire inchangé, semble indispensable : elle permettrait de maintenir le pouvoir d’achat des salariés, de réduire le coût du travail et de diminuer l’écart de compétitivité avec l’Allemagne qui s’est creusé entre 2000 et 2012.
*
* *
Une réflexion stratégique est aujourd’hui indispensable, à la fois pour améliorer la compétitivité de la France mais aussi pour assurer des sources de financement plus pérennes et plus dynamiques à la branche famille et optimiser et rationaliser ses dépenses. Il ne s’agit pas de rationner les prestations familiales, mais de faire en sorte qu’elles soient plus efficientes et plus justes pour répondre aux idéaux de la République et à la stratégie démographique nationale.
La Commission des affaires sociales a examiné le rapport d’information de M. Jérôme Guedj en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur le financement de la branche famille au cours de sa séance du mercredi 30 avril 2014.
M. Jean-Marc Germain, coprésident de la MECSS. Je tiens à souligner le plaisir que j’ai eu à travailler avec Jérôme Guedj : l’Histoire faisant parfois preuve de ruse, je ne serai pas surpris que nous le revoyions revenir parmi nous dans quelque temps. Je me réjouis également de la qualité de son travail au sein de la MECSS et du climat dans lequel nous avons travaillé : ce sujet est aujourd’hui au cœur de l’actualité et ce rapport apporte un éclairage riche et utile sur le financement de la sécurité sociale, la compétitivité et l’emploi alors que se met en place le Pacte de responsabilité. Je tiens aussi à saluer la position du coprésident Pierre Morange qui a accepté que la MECSS se penche, contrairement à ses habitudes, sur un sujet peu consensuel et très politique. Son excellente contribution, annexée au rapport, témoigne de la multiplicité des points de vue sur ce sujet.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Nous sommes réunis ce matin pour examiner le rapport la MECSS sur le financement de la branche famille, rapport que la mission a adopté hier. Je tiens à rappeler avant tout les conditions particulières dans lesquelles nous avons conduit nos travaux. En effet, compte tenu des réformes nombreuses qu’a connues la branche famille, nous avons décidé de procéder en deux temps. En premier lieu, la Cour des comptes a remis un état des lieux du financement de la branche famille à la MECSS en novembre 2012.
Dans un second temps, la MECSS a précisé ses demandes et saisi la Cour des comptes d’une demande d’étude relative à l’impact sur la croissance et l’emploi d’une suppression des cotisations familiales et de leur remplacement par différentes taxes : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la contribution sociale généralisée (CSG), une taxe environnementale ou une cotisation sur la valeur ajoutée. À la demande de la Cour, la direction générale du Trésor a effectué, sur la base du modèle MESANGE, plusieurs simulations permettant d’appréhender les effets macroéconomiques de la substitution de ces quatre taxes à tout ou partie des cotisations famille. Un second rapport sur ces simulations a été transmis à la MECSS par la Cour des comptes en mai 2013.
Les réformes intervenues depuis lors – notamment la mise en place du Pacte de responsabilité – ont nécessité des auditions complémentaires et expliquent le calendrier atypique de cette mission. Alors que la MECSS prévoyait un travail prospectif et technique, le sujet a été très vite au cœur de l’actualité avec la mise en place du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, la réforme du quotient familial et la mise en place du Pacte de responsabilité.
Des vingt-huit auditions menées depuis un an et demi, la mission a tiré plusieurs réflexions, que le rapport – qui vous est soumis aujourd’hui – s’attache à détailler.
Le financement de la branche famille a connu, depuis les années quatre-vingt-dix, deux évolutions notables. La première est une diversification de ses ressources – destinée à mieux mettre en cohérence sa structure de financement avec l’universalisation des prestations versées – avec l’affectation, à compter de 1991, d’une fraction de la CSG. La seconde est la fiscalisation accrue de son financement sous forme d’attribution d’impôts et de taxes affectés qui apparaît comme la conséquence des allégements de cotisations sociales.
Ces évolutions ont cependant fragilisé le financement de la branche famille. En premier lieu, parce qu’elles ont renforcé la dépendance de la branche aux revenus d’activité et donc l’ont rendue plus sensible aux évolutions de l’économie française : en prenant en compte la CSG et la taxe sur les salaires, plus de 80 % des ressources de la branche sont directement tributaires de ces revenus. En second lieu, les allégements généraux de cotisations patronales ont été compensés par l’attribution d’un « panier » de recettes fiscales qui connaissent une progression peu dynamique pour certaines d’entre elles. C’est le cas, notamment, des trois recettes fiscales affectées à la branche famille en compensation de la perte de 0,28 point de CSG transféré de la branche famille à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Ces réformes ont donc conduit, à la fois, à une augmentation de la part des impôts et taxes affectés – qui est passée de 0,8 % des recettes de la branche famille en 2005 à 12,1 % en 2013 – mais aussi à une fragilisation de ses recettes.
Ainsi, la branche famille connaît depuis 2008 une dégradation continue de ses comptes. Étant donné la progression dynamique des dépenses de la branche ces dernières années, il apparaît aujourd’hui nécessaire de lui garantir un financement pérenne et compatible avec ce dynamisme.
Le second constat est que les personnalités auditionnées par la MECSS, à l’exception notable des organisations patronales, ont unanimement considéré que la participation des entreprises au financement de la branche famille est justifiée par l’objectif de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Dans le rapport transmis à la MECSS, la Cour des comptes estime que les dépenses relatives à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale représentent entre 10 et 15 milliards d’euros, soit entre 25 et 38 % des prestations légales et d’action sociale servies par la branche. En termes de financement, ces montants représentent de l’ordre de 1,4 à 1,8 point de cotisation patronale « famille ».
La participation des entreprises au financement de la branche famille pose aussi la question de la gouvernance de la branche. Je trouve ainsi étonnant que les organisations professionnelles d’employeurs se sentent trop peu impliquées dans la politique familiale pour en assurer une partie du financement tout en considérant que cette politique les concerne assez pour qu’ils participent à sa gestion et à sa gouvernance…
Le troisième constat est que la politique actuelle d’allégement des cotisations patronales familiales s’inscrit dans une évolution engagée depuis plus de trente ans et visant à atténuer la part de ces cotisations dans les coûts salariaux. Le sujet des allégements de cotisations patronales est aussi vieux que la branche famille elle-même !
En 1946, le taux des cotisations sociales « famille » s’élevait à 16,75 %, mais leur plafonnement les rendait dégressives. L’évolution du financement de la politique familiale est ensuite marquée par une baisse régulière des cotisations familiales. Cette baisse des taux s’est accompagnée d’un développement des exonérations de cotisations patronales d’allocations familiales prises en charge par le budget de l’État à partir de la loi du 27 juillet 1993. Cette politique a conduit à un taux réel de cotisation des entreprises bien inférieur au taux affiché de 5,4 % en 2013 et 5,25 % en 2014. La Cour des comptes évalue qu’en 2013, ce sont 35 % de la masse salariale et 56 % des effectifs en équivalents temps plein pour lesquels le taux de 5,4 % n’est de facto pas appliqué et pour lesquels le taux des cotisations effectivement payées par les entreprises au titre de la branche famille est d’un point inférieur au taux nominal. Pour les salaires situés entre 1 et 1,6 SMIC, le taux de cotisation moyen effectivement acquitté s’élève à 2,6 %.
La réforme du financement de la branche famille doit prendre en compte les effets relativement limités des baisses de cotisations sociales sur l’emploi et l’impact économique de la nouvelle recette affectée à la branche famille
Un des arguments économiques avancés pour justifier la baisse de cotisations sociales famille est celui d’un excès de « charges » pesant sur les entreprises et d’un impact sur la compétitivité des entreprises. Or, la suppression des cotisations « famille » représente une baisse de 5 % du coût du travail, soit une baisse très limitée de 1,2 % des coûts de production. En outre, le taux des cotisations sociales des employeurs n’est pas un déterminant significatif du coût du travail. Ainsi, le Conseil d’analyse stratégique a montré, dans une note réalisée en 2008, l’absence de corrélation entre le coût du travail et le taux de cotisations patronales et plus généralement le prélèvement socio-fiscal sur les salaires dans les trente pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Trois questions me semblent essentielles aujourd’hui. La première concerne l’impact de la baisse des cotisations sociales sur l’emploi.
Selon la simulation macroéconomique réalisée pour l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) par Éric Heyer et Mathieu Plane en 2012, le nombre d’emplois créés en cinq ans par le dispositif « Fillon » est d’environ 500 000. Il convient néanmoins, selon eux, de relativiser ce chiffre, puisqu’il ne tient pas compte du financement du dispositif. Si la baisse des recettes de cotisations est financée par des recettes supplémentaires, selon le mode de financement, le bilan est plutôt de 250 000 à 300 000 emplois créés en cinq ans. Dans l’hypothèse d’une réaction des partenaires commerciaux qui adopteraient un dispositif similaire, on tombe à une fourchette de 70 000 à 170 000 emplois créés.
La deuxième interrogation concerne la recette de substitution aux cotisations patronales pour la branche famille. Le rapport de la Cour des comptes et l’ensemble des personnes auditionnées ont conclu à l’absence de « recette miracle » pour financer la branche famille.
Une réforme du financement de la branche famille peut consister à maintenir la participation financière des entreprises tout en changeant ses modalités afin que ce financement pèse moins sur l’emploi. Il pourrait prendre la forme d’une cotisation sur la valeur ajoutée. De même, comme l’ont montré les travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale, pourraient être privilégiées certaines réformes tendant à réduire les éléments de revenus du patrimoine qui échappent actuellement à la CSG. C’est le cas notamment de l’appréhension des plus-values mobilières et immobilières au moment du décès du détenteur ou d’une donation.
Vous n’êtes pas sans savoir que je considère qu’une évolution plus pertinente que la hausse de la CSG est de la rendre progressive. Cette mesure permettrait de rendre, de manière substantielle, du pouvoir d’achat aux catégories populaires et moyennes sans accroître le déficit public et garantirait des recettes pérennes à la branche famille. J’ai d’ailleurs déposé un amendement proposant une telle réforme au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
S’agissant du Pacte de responsabilité, je continue de penser que le CICE souffre de l’absence de ciblage, en particulier pour les secteurs exposés souffrant d’un déficit de compétitivité avéré. Cette absence de ciblage conduit à des effets d’aubaine importants dans des secteurs tels que la grande distribution, le bâtiment et les travaux publics ou les professions réglementées.
En outre, il est indispensable aujourd’hui de garantir à la branche famille des recettes pérennes, autonomes et suffisamment dynamiques. Trop de lois de financements de la sécurité sociale ont procédé – à l’exemple de celle de 2011 – à des « bricolages » financiers sans garantir à la branche famille des recettes suffisantes et durables.
Enfin, toute baisse du coût du travail ne saurait être avoir d’effet réel sur l’emploi que si elle est accompagnée de véritables contreparties de la part des entreprises. Les engagements pris par les employeurs n’ont été que peu précisés dans l’accord signé le 5 mars dernier entre les partenaires sociaux. La conférence sociale, qui devrait se tenir dès juin 2014, devra être l’occasion de préciser ces engagements.
Le rapport, qui vous est soumis aujourd’hui, est quelque peu atypique car il ne cherche pas à obtenir un consensus comme c’est le cas habituellement des rapports de la MECSS mais à apporter un éclairage nouveau en prenant comme point de départ, non pas le coût du travail, mais les besoins de financement de la branche famille. Ce rapport illustre ainsi la façon dont j’ai vécu mon travail de parlementaire pendant vingt-deux mois et, alors que mes fonctions de parlementaires prendront fin demain soir, je tiens à remercier l’ensemble des parlementaires de la commission des affaires sociales avec lesquels j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler.
Mme Bérengère Poletti. Je tiens tout d’abord à remercier M. Jérôme Guedj pour son travail au sein de la MECSS et de l’Assemblée. Mon propos reprendra en grande partie les réflexions que notre collègue Pierre Morange, qui ne pouvait être présent ce matin et s’en excuse, a exprimées dans une contribution, en tant que coprésident de la MECSS.
Montrée en exemple dans le monde entier, la politique familiale de la France est reconnue comme étant une politique efficace pour le bien des familles et de leurs enfants. Jusqu’à présent, elle permettait une redistribution horizontale des ressources selon la taille des familles qui faisait consensus. Mais ce consensus est en train de voler en éclat.
Et de fait, la situation de notre pays change comme en témoignent l’asphyxie de nos entreprises face au coût du travail et à la complexité du droit, le chômage battant des records historiques, la déshérence de notre tissu industriel et le poids de la dette. Dans ce contexte, le financement de la branche famille doit être renouvelé et réinventé.
Pour mémoire, la part cumulée des prélèvements sur l’activité dans le financement de la branche famille reste très importante, puisqu’elle s’élève à 80 %. De plus, il faut constater « l’effet ciseaux » qui résulte de la croissance importante des charges liée à l’augmentation des prestations et l’évolution modérée des recettes : cette évolution aboutit à une fragilisation du financement de la branche famille, la Cour des comptes évoquant dans son rapport d’étape un « financement brouillé » et la « difficulté de soutenabilité » de la politique familiale.
En clair, les entreprises s’acquittent chaque année de 35 milliards d’euros de cotisations familiales, ce qui représente 62 % du financement de la branche famille, le reste provenant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de divers impôts et taxes. Malgré ces ressources, la branche famille affiche un déficit de 2,8 milliards d’euros qui devrait être contenu à 3,2 milliards d’euros en 2014.
Dans ce contexte, le rapport qui nous est aujourd’hui présenté, ne répond pas aux enjeux actuels.
Premièrement, ce rapport ne tranche pas la question de l’affectation d’une recette pérenne et dynamique à la branche famille, pas plus d’ailleurs que le Premier ministre ne l’a fait, lors de sa déclaration de politique générale, alors qu’il a annoncé une baisse importante des cotisations patronales famille.
Si ces annonces sont suivies d’actes : nous disons « chiche » !
Mais considérant les habitudes prises par cette majorité en matière de politique familiale, on ne peut que s’interroger : le ciblage des baisses de charges sur les cotisations famille signe-t-il un nouveau désengagement de l’État envers les familles ?
La réforme des allocations familiales effectuées dans le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 représente un effort de 1,5 milliard d’euros pour les familles des classes moyennes.
Le Premier ministre a tenu à rassurer l’Assemblée en assurant que la branche famille se verrait attribuer de nouvelles sources pérennes. Lesquelles ? Comme le reste des baisses de cotisations et impôts, les baisses de cotisations familiales risquent d’être financées par l’emprunt et la dette. Dans ce contexte, le rapport évacue l’attribution d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – qui constitue une recette dynamique et durable – à la branche famille, alors que c’est une réforme pertinente et recommandée par plusieurs économistes auditionnés par la MECSS : M. Christian Saint-Étienne, M. Louis Gallois et même la Cour des comptes.
Deuxièmement, ce rapport ne propose pas non plus de pistes de réformes concrètes pour améliorer le rapport coût-efficacité de la branche famille et n’évoque aucune mesure d’économies ou de rationalisation budgétaire.
Pourtant, de nombreux rapports, notamment celui de notre ancien collègue Yves Bur, ont plaidé, pour une rationalisation des dépenses, dans le respect des principes d’universalité et de solidarité des prestations.
En outre, je rappelle que le Premier ministre, M. Manuel Valls, a annoncé que, dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros, la poursuite de la modernisation de la politique familiale devrait permettre de réaliser 0,8 milliard d’euros d’économies et que les caisses de sécurité sociale devraient dégager 1,2 milliard d’euros d’économies, grâce à la dématérialisation et à une meilleure articulation entre les différents organismes.
Dans ce cadre, la MECCS a fait par le passé plusieurs propositions en matière de rationalisation des dépenses touchant aux systèmes d’information ou à la mise en place d’un guichet unique.
Troisièmement, ce rapport ne contient aucune proposition pour améliorer la compétitivité de notre économie, alors même que cette problématique est cruciale aujourd’hui et qu’elle est profondément liée à celle du coût du travail, comme en témoignent les orientations du Gouvernement en matière de baisse du coût du travail.
Clairement, nous avons affaire à un rapport inachevé : pourtant, une réflexion stratégique est aujourd’hui indispensable, à la fois pour améliorer la compétitivité de la France mais aussi pour assurer des sources de financement plus pérennes et plus dynamiques à la branche famille et optimiser et rationaliser ses dépenses.
C’est pourquoi le groupe UMP votera la publication de ce rapport, en précisant que nous sommes contre ses conclusions.
M. Jean-Patrick Gille. Je souhaite, à mon tour, insister sur la qualité des travaux et regretter le départ de notre collègue Jérôme Guedj. Je me félicite que notre commission se penche sur ces sujets et que la question de la réforme du financement de la protection sociale ne soit pas uniquement traitée par la commission des finances.
Depuis les années 2000, le financement de la branche famille est fragilisé et cette branche se retrouve déficitaire alors que ce n’était pas inéluctable. La question centrale qui se pose est celle-ci : les cotisations patronales doivent-elles être gardées pour financer la branche famille ? Après avoir longtemps défendu ce principe, je pense que les arguments en faveur de cette solution sont faibles, au regard des exonérations de prélèvements mis en place comme le crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). De mon côté, je préfère un financement assuré par la contribution sociale généralisée (CSG), ce qui permettrait d’élargir l’assiette en incluant une partie du patrimoine, associé à une réflexion sur le quotient familial. Je ne préconise pas pour autant de créer une fiscalité propre à la famille. Par ailleurs, la gestion continuera d’être assurée par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Mme Jacqueline Fraysse. Dans un contexte où les choix économiques du Président de la République sont fort éloignés de ceux de son programme présidentiel, j’ai craint que ce rapport ne se limite à une reprise et une justification du credo gouvernemental qui assure que la réduction du coût du travail améliore la compétitivité et favorise l’emploi. Je me réjouis qu’un travail sérieux ait été mené : il met à mal toutes ces idées dominantes et démonte des vérités dites indépassables qui servent des intérêts.
Trois points doivent être relevés. Le premier est le rappel opportun, dans un contexte de mise en cause de notre modèle social, de la réussite de notre politique familiale qui, avec un taux de fécondité important, permet le renouvellement des générations et un taux d’emploi important de femmes avec enfant. Les entreprises sont les premières à bénéficier du renouvellement de la force de travail et du taux d’emploi des femmes. Le deuxième est la participation des entreprises au financement de la branche famille, tout en le relativisant puisqu’elle représente un dixième du coût de la politique familiale. Enfin, le rapport dénonce cette corrélation, trop vite établie, entre une baisse des cotisations sociales et les créations d’emploi. Depuis des années, les projets de loi de financement de la sécurité sociale ont accordé 30 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales aux entreprises, sans que pour autant le chômage ait diminué. À l’heure où le Gouvernement cherche 50 milliards d’euros d’économies, il serait bien inspiré de se pencher sur ces exonérations accordées sans discernement, reconduites chaque année sans qu’aucune amélioration ne soit constatée sur le front de l’emploi. Néanmoins, je regrette que le rapport n’évoque pas la limitation du coût du capital pour le rééquilibrer avec le coût du travail. Cette dernière expression est d’ailleurs paradoxale, car on oublie que le travail produit de la richesse. Les économistes distinguent un surcoût du capital, estimé à 100 milliards par an, ce qui se fait au détriment des salariés, de la recherche et de l’investissement productif. Cette situation doit être corrigée, c’est pourquoi, le groupe GDR propose une proposition de loi relative à la modulation des contributions des entreprises qui sera examinée le 22 mai prochain. Elle répond, en partie, aux préoccupations du rapporteur qui souhaite des contreparties de la part du patronat face à ces exonérations. Je salue, de nouveau, ce travail sérieux qui permet de faire avancer la réflexion et le groupe GDR votera la publication du rapport.
M. Denys Robiliard. Je souhaite moi aussi saluer l’implication dans sa fonction de député de notre collègue Jérôme Guedj et je dois dire que nombreux sont ceux qui regrettent son départ !
Pour en revenir au rapport dont nous débattons, je tenais à saluer la qualité de ce travail qui dresse un tableau très complet des différentes options pour financer la branche famille. De plus, le document qui nous est soumis se lit avec plaisir, sa rédaction est de grande qualité tout en étant précise.
Je voudrais faire deux observations suite aux différentes interventions. Mme Bérengère Poletti a rappelé un rapport précédent présenté par M. Yves Bur qui a été longtemps rapporteur pour la loi de financement de la sécurité sociale. Ses préconisations étaient très différentes de celles du rapport de M. Guedj car pour lui la rationalisation de la gestion allait de pair avec une baisse du niveau des prestations. L’objectif de notre rapporteur est bien différent, il s’agit de trouver des modes de financement pérennes pour conforter la politique familiale.
Il faut garder en mémoire certaines données chiffrées significatives. La moyenne des prestations familiales par enfant en France est plus faible que dans plusieurs pays européens. En revanche, les sommes consacrées à la politique familiale sont beaucoup plus conséquentes que celles de nos homologues européens puisqu’elles atteignent 4,1 % du PIB contre 2,6 % pour la moyenne des pays européens. En effet notre politique familiale est particulièrement diversifiée et va bien au-delà des prestations familiales comme l’illustre, par exemple, le quotient familial.
Certains graphiques présentés dans le rapport sont particulièrement parlants et illustrent parfaitement l’efficacité de la politique familiale, notamment pour encourager l’activité professionnelle des femmes. Le taux d’activité des femmes sans enfant est plus faible en France qu’en Allemagne mais pour les femmes ayant un enfant le taux d’activité atteint 76 % en France contre 73 % en Allemagne et la différence s’accroît pour les femmes avec deux enfants : 69 % en France et 65 % en Allemagne et pour les femmes ayant trois enfants ce taux atteint 50,4 % en France et 42 % en Allemagne.
Ce rapport éclaire très bien les différentes options possibles pour financer la politique familiale. Actuellement notre système présente un paradoxe qui le fragilise : il est financé à 80 % par des ressources assises sur les revenus salariaux alors qu’il finance des prestations universelles. Il est sans doute pertinent que les employeurs continuent à financer ces dépenses mais il faudrait alors considérer que les cotisations tant patronales que salariales sont un salaire différé. Dans ces conditions, si nous optons pour une baisse des cotisations, cette baisse devrait être en partie au moins redistribuée aux salariés puisqu’il s’agit d’un salaire indirect.
Ce rapport me paraît tout à fait pertinent car il invite à engager une réflexion de fond sur notre fiscalité pour trouver de nouveaux modes de financement de la politique familiale. Nous devons réfléchir à la mise en place notamment d’une CSG progressive avec un prélèvement à la source. D’autres solutions se dégageront peut-être, il faut examiner toutes les possibilités sans a-priori.
Mme Valérie Boyer. Le groupe UMP est d’accord pour la publication de ce rapport mais nous estimons que ce travail est inachevé car il ne tire pas toutes les conséquences de ses constatations et ne propose pas de sources de financement suffisamment pérennes.
Ce rapport devra faire figurer en annexe la contribution de M. Pierre Morange qui constitue une réflexion importante sur le financement de la branche famille.
M. Jean Patrick Gille, président. Je vous rassure sur ce point, la contribution de Pierre Morange figurera bien dans le rapport. Je vous invite à passer au vote pour autoriser la publication de ce rapport.
*
La commission autorise, à l’unanimité, le dépôt du rapport d’information sur le financement de la branche famille en vue de sa publication.
ANNEXE 1 : COMPOSITION DE LA MISSION
Présidents
M. Jean-Marc Germain (SRC)
M. Pierre Morange (UMP)
Membres
Groupe SRC
Mme Gisèle Biémouret
Mme Martine Carrillon-Couvreur
M. Jérôme Guedj
Groupe UMP
M. Jean-Pierre Door
Mme Isabelle Le Callennec
Mme Bérengère Poletti
M. Dominique Tian
Groupe UDI
M. Hervé Morin
M. Francis Vercamer
Groupe Écolo
M. Jean-Louis Roumegas
Groupe RRDP
Mme Dominique Orliac
Groupe GDR
M. Jean-Philippe Nilor
ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Pages
– Présentation de la communication d’étape de la Cour des comptes à la MECSS sur « le financement de la branche famille » : M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, M. Michel Braunstein, conseiller maître, M. Noël Diricq, conseiller maître, et Mme Loguivy Roche, conseiller référendaire 121
– M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé, et Mme Carole Bousquet, chef du bureau de la synthèse financière 129
– M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille, et Mme Élizabeth Le Hot, secrétaire générale 139
– M. Philippe Didier-Courbin, chef du service des politiques sociales et médico-sociales, adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales et de la santé, et Mme Florence Lianos, sous-directrice de l’enfance et de la famille 150
– Mme Mireille Elbaum, présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale, et M. Laurent Caussat, secrétaire général 157
– M. Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, et M. Hervé Drouet, directeur 163
– Présentation du rapport définitif de la Cour des comptes à la MECSS sur « le financement de la branche famille » : M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, M. Michel Braunstein, conseiller maître, et M. Noël Diricq, conseiller maître 171
– M. Gilbert Cette, directeur des analyses microéconomiques et structurelles de la Banque de France, membre du Haut Conseil du financement de la protection sociale, M. Gérard Cornilleau, directeur adjoint au département des études de l’Observatoire français des conjonctures économiques, membre du Haut Conseil du financement de la protection sociale, et M. Henri Sterdyniak, directeur du département Économie de la mondialisation de l’Observatoire français des conjonctures économiques 179
– M. Julien Dubertret, directeur du budget au ministère de l’économie
et des finances 189
– Mme Mireille Elbaum, présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale, M. Laurent Caussat, secrétaire général, et M. Fabrice Lenseigne, secrétaire général adjoint 197
– M. François Fondard, président de l’Union nationale des associations familiales, et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires 202
– M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé 208
– Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), et M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral, M. Jean-Yves Delannoy, délégué national pour le secteur de la protection sociale de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), et Mme Justine Vincent, chargée d’études économiques, Mme Marie-Madeleine Pattier, administratrice de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), M. Michel Coronas, administrateur de la Confédération générale du travail (CGT) à la CNAF, et M. Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral, MM. Patrick Brillet et Didier Aubossu, administrateurs de Force ouvrière (FO) à la CNAF 215
– M. Christian Saint-Étienne, économiste, professeur titulaire de la chaire d’économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers 231
– M. Antoine Magnier, directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et M. Benoît Ourliac, chef de la mission d’analyse économique 239
– M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille, et Mme Lucie Gonzalez, secrétaire générale 243
– M. Jean-Louis Rey, directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), et M. Alain Gubian, directeur financier 250
– Mme Anne Eydoux, chercheuse au Centre d’études de l’emploi 257
– M. Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, et M. Daniel Lenoir, directeur général 265
– M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), Mme Valérie Corman, directrice de la protection sociale du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), et M. Christian Pineau, chef du service des affaires sociales de l’Union professionnelle artisanale (UPA) 270
– Mme Selma Mahfouz, commissaire générale adjointe à la stratégie
et à la prospective, membre du Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, Mme Claire Bernard et M. Antoine Naboulet, chargés de mission 281
– M. Benjamin Gallezot, adjoint au directeur général de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services du ministère du redressement productif, M. François Magnien, sous-directeur de la prospective, des études économiques et de l’évaluation, et M. Tristan Diefenbacher, chef du bureau de la compétitivité et du développement des entreprises 288
– M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour
des comptes, M. Noël Diricq, conseiller maître, et Mme Loguivy Roche, conseillère référendaire 297
– M. Louis Gallois, commissaire général à l’investissement,
et M. Jean-Régis Catta, chef de cabinet 302
ANNEXE 3 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Présentation de la communication d’étape de la Cour des comptes à la MECSS sur « le financement de la branche famille » : M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, M. Michel Braunstein, conseiller maître, M. Noël Diricq, conseiller maître, et Mme Loguivy Roche, conseiller référendaire
M. le coprésident Pierre Morange. Nous accueillons aujourd’hui, pour une audition portant sur la présentation du rapport d’étape de la Cour des comptes relatif au financement de la branche famille, M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, M. Michel Braunstein, conseiller maître, M. Noël Diricq, conseiller maître, et Mme Loguivy Roche, conseiller référendaire.
Vous êtes ici chez vous, madame, messieurs, tant la MECSS et la Cour des comptes ont pris l’habitude de travailler ensemble depuis 2004. Je vous prie d’excuser l’absence de mon collègue Jean-Marc Germain, coprésident de cette mission, qui accompagne le Président de la République à la cérémonie de signature des premiers contrats d’avenir.
Je vous remercie, monsieur le président Durrleman, d’avoir bien voulu, dès aujourd’hui, faire la présentation du rapport d’étape que la Cour des comptes nous a remis ce lundi. Avant d’aborder la question précise du financement de la branche famille, je rappelle le calendrier de nos travaux.
Sous la précédente législature, la MECSS avait fait deux demandes d’enquête à la Cour des comptes. Au mois de juillet dernier, celle-ci a répondu à la première d’entre elles, relative aux arrêts de travail et aux indemnités journalières pour cause de maladie. La MECSS s’est saisie de cette communication et a nommé rapporteure Mme Bérengère Poletti, qui commencera ses auditions le 22 novembre prochain en accueillant de nouveau le président Durrleman. Les travaux de la mission sur cette question dureront jusqu’au début de l’année prochaine.
La seconde demande de la MECSS à la Cour des comptes concernait le sujet plus délicat du financement de la branche famille. Notons, étant donné la conjoncture de crise et l’importance des missions qui incombent à cet organisme, la pertinence des choix que notre mission a effectués sous la précédente législature, dans le respect de la règle d’unanimité. La nature du sujet exige un calendrier particulier. Il a en effet paru opportun à la Cour comme à la MECSS de procéder en deux étapes. La première phase, très courte, commence avec la remise du rapport d’étape et vient s’intercaler avant le début des travaux sur les arrêts de travail. Elle permettra à la MECSS d’indiquer à la Cour des comptes les orientations à privilégier dans son travail sur le rapport définitif qu’elle devra remettre au mois de mars ou avril prochain. Nous procéderons à quelques auditions liminaires : la Cour des comptes, puis le directeur de la sécurité sociale, aujourd’hui ; le président délégué du Haut Conseil à la famille, M. Bertrand Fragonard, et la directrice générale de la cohésion sociale, Mme Sabine Fourcade, la semaine prochaine. Nous clôturerons cette première étape le jeudi 13 décembre par l’audition du président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF.
Ce calendrier est justifié par la labilité du contexte. Nous ne savons pas encore quelle forme exacte prendront les réformes annoncées, et nos travaux devront s’ajuster aux propositions de l’exécutif et à la réponse législative à laquelle elles donneront lieu. D’ici au 13 décembre, nous aurons une vision plus claire de la suite à donner à la réflexion sur le financement de la branche famille.
En attendant, grâce à la diligence de la Cour des comptes, nous bénéficions, avec ce rapport d’étape, d’une base solide de travail. J’en tirerai, pour ma part, quelques enseignements essentiels. Par son universalité, la branche famille représente la quintessence de notre système de protection sociale, dont elle subit toutes les évolutions. À ce titre, elle constitue un laboratoire pour l’avenir du système entier, ce qui rend particulièrement important, pour la MECSS, de s’y pencher.
La Cour des comptes souligne que le financement de la branche famille souffre d’une certaine fragilité, son rapport d’étape évoquant un « financement brouillé » et la « difficulté de soutenabilité » de la politique familiale. Avant de vous laisser la parole pour vous permettre d’expliquer comment vous en êtes arrivés à ce grave constat, je vous pose tout de suite les questions qui me sont venues à la lecture de votre rapport.
En quoi les évolutions passées ont-elles fragilisé le financement de la branche famille ? Comment la progression des charges de la branche famille a-t-elle conduit à l’apparition d’un déficit structurel ? Compte tenu du caractère universel de ses prestations, trouvez-vous opportun que les cotisations patronales constituent la principale source de financement de la branche famille ? Un consensus semble se dégager sur la nécessité de trouver des ressources pérennes, dynamiques et lisibles, adossées à une assiette large, qui se substitueraient au « financement brouillé » actuel, particulièrement délicat à gérer dans un contexte d’endettement et de crise économique.
Une comparaison internationale pourrait nourrir la réflexion au sein de la MECSS. Comment le financement de la politique familiale est-il assuré dans les autres pays européens ? Existe-t-il une particularité de la France dans ce domaine ?
Enfin, afin de faire le meilleur usage possible de la substantifique moelle de vos travaux, nous souhaiterions que votre deuxième rapport comprenne une liste exhaustive des préconisations déjà formulées par la Cour des comptes en matière de rationalisation des dépenses et de financement de la branche famille.
M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes. Les travaux de la Cour des comptes dressent un état des lieux du financement de la branche famille à partir d’une perspective historique : celle de sa décorrélation progressive du monde du travail dont elle est issue.
La politique familiale de le France a une double origine : le monde de la fonction publique et des services publics d’une part, où des sursalaires familiaux ont été instaurés dès le XIXe siècle, et celui de l’entreprise privée d’autre part, le patronat démocrate chrétien du Nord de la France faisant appel au même dispositif pour compenser les charges familiales des ouvriers. Cette double origine a progressivement donné lieu à la mise en place, dans les années 1930, de mécanismes mutualisés de versement des sursalaires familiaux. En 1939, le code de la famille consacre la dissociation entre les notions de sursalaire et de prestations familiales, et le versement de ces dernières est étendu à tous les actifs. La sécurité sociale créée en 1945 reprend cet acquis en l’intégrant à un système global de protection sociale d’inspiration bismarckienne – et non beveridgienne – qui consiste à prendre en charge les risques dans un cadre professionnel. La famille étant certes un risque heureux, mais également une charge et une dépense supplémentaire, la sécurité sociale inclut et élargit le dispositif de prestations familiales.
Cette origine explique que la politique familiale ait été d’emblée entièrement financée par des cotisations patronales. Dans les années d’immédiat après-guerre, leur taux s’élève à 16,75 %, mais leur plafonnement les rend dégressives. L’évolution du financement de la politique familiale est ensuite marquée par une baisse régulière des cotisations familiales au bénéfice des branches maladie et vieillesse, et en même temps par leur déplafonnement progressif qui fait disparaître la dégressivité. Ce double mouvement est achevé dans les années 1980, avant que les années 1990 ne marquent un changement de paradigme. La création en 1991 de la contribution sociale généralisée, la CSG, permet de basculer 23 % des recettes de la branche sur ce nouveau prélèvement qui frappe un éventail très large de revenus. Ce changement majeur signe le début d’une réforme qui reste inaboutie dans la mesure où, lorsque la CSG a été augmentée, les nouvelles recettes ont été affectées à d’autres branches de la sécurité sociale.
Entre 1991 et 2010, la branche famille est ainsi alimentée essentiellement par deux sources : des cotisations patronales déplafonnées dont le taux reste constant à 5,4 % et une CSG dont le taux également constant est de 1,08 % sur les revenus d’activité et de 1,10 % sur les revenus du capital. La structure du financement est alors solide. Cette logique de financement à deux piliers, certes inégaux, est ensuite perturbée par la politique d’allégement des charges sociales et sa nécessaire compensation. La branche famille bénéficie ainsi, plus qu’aucune autre, des apports d’une fiscalité affectée, mais cette fiscalisation rampante tient plus des circonstances que d’une véritable cohérence.
Le financement de la branche famille repose ainsi aujourd’hui sur trois piliers : les cotisations patronales, la CSG et la fiscalité affectée.
Les cotisations, qui gardent le taux de 5,4 % et restent entièrement assises sur les salaires, représentent quelque 65 % du financement de la branche, soit 33 milliards d’euros environ.
La CSG représente un pilier fragilisé. À partir de 2010, une part de ses recettes affectées à la branche famille est en effet transférée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES, dans le cadre des reprises organisées du déficit de la sécurité sociale. Deux contraintes organiques et constitutionnelles expliquent ce transfert : d’une part, la CADES ne pouvant plus être prolongée, l’amortissement de la dette doit impérativement être achevé avant 2025 ; d’autre part, ne peuvent être affectées à la CADES que des ressources pérennes et à base large. Plutôt que d’augmenter le taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, fixé à 0,5 % depuis 1996, le choix des pouvoirs publics fut de basculer sur la CADES 0,28 point de CSG. Le poids de ce prélèvement dans l’architecture de financement de la branche famille a par conséquent diminué, passant de 25 à 18 %.
La part de la fiscalité affectée a, au contraire, très fortement progressé pour représenter aujourd’hui 15 % de ses ressources, soit 8 milliards d’euros environ. Ce troisième pilier constitue un « terrain miné ». Un tableau figurant à la page 29 du rapport montre en effet l’extrême instabilité de l’affectation des taxes, leur extraordinaire diversité et leur incohérence. Jusqu’à cette année, une part des taxes sur le tabac était ainsi affectée au financement de la branche famille et non à l’assurance maladie, aberration désormais corrigée. Au-delà des incohérences, la pérennité de certaines taxes n’est pas assurée dans la mesure où leur assiette est vouée à disparaître. C’est notamment le cas des taxes affectées à la branche famille en 2010, en compensation du transfert de CSG au bénéfice de la CADES.
L’évolution récente du dispositif, fruit d’une série de décisions ponctuelles, témoigne de l’interruption du mouvement de réforme. L’abaissement du poids des cotisations patronales avait été continu jusque dans les années 1990. La mise en place de la CSG au début des années 1990 a esquissé une nouvelle voie, mais son extension au bénéfice d’autres branches n’a pas permis de la suivre. Les décisions prises depuis visent à parer à l’urgence en assurant, année après année, un équilibre ou un moindre déséquilibre de la branche, mais ne s’inscrivent plus dans une perspective de réforme. C’est pourquoi nous qualifions le financement de la branche famille de « brouillé ».
Si nous estimons ce financement fragile, c’est d’abord parce qu’étant très largement dépendant des revenus d’activité, il est particulièrement sensible à la conjoncture économique. Les cotisations patronales, qui représentent 65 % des ressources de la branche, ne sont pas les seules en cause : si l’on y ajoute l’assiette « revenus d’activité » de la CSG et la taxe sur les salaires affectées à la branche famille, on arrive à un total de plus de 80 % des ressources directement tributaires des revenus d’activité. Au lieu de consolider la branche, les évolutions de son financement l’ont ainsi au contraire rendue encore plus dépendante du contexte économique.
La fragilité du financement s’explique également par un effet de ciseaux entre la croissance des charges et celle des produits. Longtemps, la branche famille a fait figure de bon élève au sein du système de sécurité sociale, dégageant systématiquement des excédents – fruit d’une démographie constante et d’un produit intérieur brut (PIB) en progression – qu’il s’agissait alors de ne pas laisser grossir à l’excès. Les mécanismes de régulation internes à la branche y contribuaient également : depuis 1995, l’évolution des prestations et des plafonds pour les prestations sous condition de ressources est ainsi indexée non plus sur les salaires, mais sur l’inflation. Entre 1978 et 1992, le système n’a connu que deux années de déficit. Depuis 1992, en revanche, il en a connu douze. La croissance des produits s’est en effet ralentie, alors que celle des charges s’est accélérée, moins sous l’effet de la démographie – les allocations sont restées stables ou faiblement croissantes – qu’à cause de la création de nouvelles allocations extrêmement dynamiques, destinées en particulier à aider à la garde des enfants. En même temps, des transferts importants ont été opérés depuis la branche famille vers d’autres branches de la sécurité sociale, notamment vers la branche vieillesse, par le biais de l’assurance vieillesse des parents au foyer, l’AVPF, et vers le Fonds de solidarité vieillesse, par le biais des majorations de pensions pour enfants. L’effet structurel de ciseaux qui en résulte se traduit par un déficit régulier et aussi important que celui des autres branches de la sécurité sociale. Son montant – 2 600 millions d’euros en 2011 – semble a priori modeste par rapport à ceux de la branche maladie ou vieillesse, largement supérieurs. Mais rapporté aux charges de la branche, il représente 4,7 %, chiffre très proche de celui de l’assurance maladie qui dépasse légèrement 5 %.
Le problème de soutenabilité durable de la branche famille doit ainsi être l’horizon de toute réflexion sur son financement. Cette logique suppose de s’intéresser non seulement aux recettes, mais également aux dépenses de la branche, l’objectif de leur maîtrise devant s’imposer ici comme ailleurs. Dans le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, le RALFSS, la Cour des comptes montre ainsi que des économies peuvent être dégagées dans le domaine des prestations familiales sous condition de ressources, en particulier sur le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant, la PAJE. Une deuxième piste de réforme porte sur l’articulation des mécanismes fiscaux et des prestations sociales au sein de la politique familiale dont le poids global, évalué à 3,8 % du PIB, excède la seule branche famille qui n’en représente que 2,8 %. Améliorer la gestion du dispositif pourrait également se révéler bénéfique : le RALFSS de septembre 2011 montre ainsi que la complexité du système des prestations familiales est source de coûts supplémentaires.
Le rapport d’étape permet de mettre l’état des lieux en perspective avec l’histoire de la branche et les tendances lourdes qui l’affectent. C’est à la lumière de cette évolution, responsable du décalage structurel entre les produits et les ressources de la branche, qu’il faut envisager la réforme possible de son financement.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels remèdes peut-on apporter à ces failles ? Plutôt que de se reprocher les erreurs passées, le sujet invite plutôt à se tourner vers l’avenir pour tenter de retrouver un financement en adéquation avec les charges de cette branche à prétention universelle. Au-delà des mesures incontournables d’économie, faut-il recourir aux recettes pourvues d’une assiette large, telles que la CSG – qui présente l’inconvénient d’être adossée à l’activité et donc à la conjoncture économique – ou la taxe sur la valeur ajoutée – qui risque de produire des effets négatifs sur la consommation ?
L’hypothèse d’une budgétisation est également à étudier, dans la mesure où le renouvellement des générations s’inscrit dans une stratégie d’intérêt national. Un foyer sur deux ne payant pas d’impôts, il convient toutefois de s’interroger sur les capacités contributives de la Nation. Avez-vous d’ores et déjà des éléments de réflexion sur ce scénario ?
M. Antoine Durrleman. Financer la politique familiale essentiellement par des cotisations patronales est une spécificité française qu’on ne retrouve pas à l’étranger, notamment en Allemagne, pays le plus proche du nôtre en termes d’organisation de la protection sociale. En Allemagne, la politique familiale – qui représente 3 % du PIB – est adossée non à la sécurité sociale mais directement au budget de l’État. Elle passe surtout par des prestations et très peu par des services, alors que notre politique combine les deux logiques. Nos dispositifs de garde des jeunes enfants ou de prise en charge des moins de dix-huit ans au sein de différentes structures d’animation et d’accompagnement n’ont pas d’équivalents en Allemagne.
La réflexion sur l’évolution du système de financement de la branche famille peut s’organiser autour de deux modèles.
Le premier – auquel on se limite généralement – consiste à l’envisager dans le cadre d’une organisation structurelle inchangée. La sécurité sociale reste alors pilotée par les partenaires sociaux qui tirent leur légitimité de ce que son financement est encore assuré à hauteur de deux tiers par les éléments de salaire différé que représentent les cotisations patronales. En restant dans cette logique – qui préside à l’organisation de la CNAF et du réseau des caisses d’allocations familiales, les CAF –, et au-delà des efforts d’économie et de régulation de la dépense, il faut trouver des ressources suffisamment dynamiques pour compenser la croissance des charges. Sans avoir complètement exploré cette question difficile, nous sommes convaincus que la quête de la recette miracle s’apparenterait à celle du Graal. Il faudra nécessairement faire appel à un mélange de recettes, qu’on peut concevoir de différentes façons. Un financement à assiette large serait cohérent avec la logique universaliste de la branche, telle qu’elle a été mise en place à partir de 1978. La CSG, initialement destinée à la branche famille, obéissait à l’origine à cette considération. Mais aujourd’hui que ce robinet arrose beaucoup de platebandes, il a perdu de sa logique contributive. Au-delà du niveau de la CSG, la répartition de son produit constitue une question en soi qui mérite d’être explorée.
La deuxième piste de réflexion, toujours à cadre inchangé, est de distinguer, à l’intérieur de la branche famille, différentes catégories de prestations. Si la branche obéit depuis toujours à une volonté de redistribution horizontale, entre familles avec et sans enfants, elle porte de plus en plus, depuis les années 1970, une logique de redistribution verticale, entre familles aux niveaux de revenus différents. Dès lors, les prestations familiales sous condition de ressources devraient-elles être financées d’une manière différente de celles qui sont universelles ? Cette distinction peut-elle servir d’élément de structuration d’un dispositif de financement différencié ?
Plusieurs pistes sont donc possibles à organisation inchangée : chercher à construire, rebus sic stantibus, un système de recettes en adéquation avec la dynamique de la branche, ou bien distinguer des blocs de prestations aux logiques de financement différentes.
Le deuxième terme de l’alternative consiste à changer de paradigme pour ne plus affecter à la branche des ressources dédiées, mais la financer par des dotations de l’État, la CNAF et les CAF continuant à piloter le réseau. Il ne s’agit plus, dès lors, de spécifier des ressources pour des types de dépenses particuliers, mais de consacrer une partie du budget de l’État – alimenté par les prélèvements les plus divers – à la branche famille, pour financer les prestations familiales, à la manière de ce qui se fait déjà pour l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, et une partie des aides au logement. Ce modèle se rapprocherait davantage du système allemand.
Nous n’avons étudié en détail aucune de ces solutions, restant au niveau d’un état des lieux. Mais nous indiquons en fin de rapport les différentes pistes possibles, bien plus nombreuses que celles qu’on a l’habitude d’évoquer.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Je vous remercie pour cette présentation éclairante. Nous avons récemment reçu des parlementaires allemands qui nous ont interrogés sur nos politiques sociales, et en particulier familiales. Le système allemand exclut en effet les services, se concentrant sur les prestations. En tout état de cause, la natalité française n’est certainement pas étrangère à ces aides à la garde des enfants, et il est important d’en tenir compte. Notre système touche aujourd’hui à ses limites, et il faudra le dépasser. À nous d’élaborer des propositions concrètes à partir de cet état des lieux que vous avez dressé. Mais la comparaison avec l’Allemagne ne nous est pas forcément défavorable : les députées allemandes – il s’agissait surtout de femmes – regardaient ainsi notre modèle avec envie, considérant qu’il fallait s’en inspirer.
M. Antoine Durrleman. Nous nous sommes limités à l’analyse du financement de la branche famille. Par sa continuité, sa prévisibilité pour les familles et par la diversité de ses modes d’action, la politique familiale est évidemment un élément clé de notre force démographique. Mais elle n’explique pas à elle seule la natalité. Notre société est accueillante, et si les familles françaises ont autant d’enfants, c’est en grande partie en raison de l’évolution du droit civil. Depuis plus de trente ans, le code civil napoléonien connaît en effet une révolution silencieuse, jamais reconnue comme telle, qui consacre la reconnaissance d’une pluralité de modèles familiaux, alors que le modèle familial reste beaucoup plus traditionnel en Allemagne. Cette évolution joue un grand rôle dans notre dynamisme démographique.
Cependant, nous n’avons pas analysé la politique familiale en tant que telle car on sait qu’il ne faut y toucher que d’une main tremblante.
M. le coprésident Pierre Morange. Cette mise en perspective conduit à relativiser l’importance des prestations familiales, même si elles restent essentielles. Notre collègue Marie-Françoise Clergeau l’avait d’ailleurs souligné dans son rapport sur l’évaluation de la politique familiale, et en particulier de la PAJE. Les sociologues auditionnés avaient alors évoqué cette révolution silencieuse liée au code civil. Nos collègues parlementaires allemands restent néanmoins fascinés par notre modèle, et tout particulièrement par le système de la prise en charge au sein des maternelles, qui n’existe pas en Allemagne et qui suscite l’admiration.
Mme Gisèle Biémouret. Vous avez mentionné la possibilité de dégager des économies en simplifiant la gestion de la branche. Les modèles de prise en charge des enfants et les structures d’accueil – centres de loisir associés à l’école, les CLAE, centres aérés associatifs ou communaux – sont en effet très variables selon les départements, voire les communes, et il faudrait peut-être en envisager l’harmonisation.
En même temps, en tant qu’élue du département rural du Gers, je constate que la CAF incite les communes, même les plus petites, à mettre en place des micro-crèches et autres modes de garde, alors qu’elles ne peuvent pas forcément en assumer le coût. Prendre en charge toutes ces structures au niveau des communautés de communes serait peut-être plus efficace en termes financiers.
M. Antoine Durrleman. Nous menons en ce moment, avec les chambres régionales des comptes, une enquête sur les modes d’accueil de la petite enfance, de zéro à trois ans, qui devrait aboutir l’an prochain. Des études de terrain dans les communes et les départements, au sein des CAF, de la direction générale de la cohésion sociale du ministère chargé des affaires sociales, de la CNAF et de la direction de la sécurité sociale, tentent de mettre en lumière le fonctionnement du système, les problèmes rencontrés et les solutions possibles. Nous constatons en effet la politique incitative et volontariste des CAF dont le budget d’action sociale a augmenté ces dernières années de 7 à 8 % par an. Nous nous intéressons au fonctionnement des différentes structures, à la participation des parents, à l’articulation entre scolarisation pré-maternelle et modes de garde, dans l’espoir d’apporter sur l’ensemble de ces sujets des éclairages novateurs.
M. Michel Braunstein, conseiller maître à la sixième chambre de la Cour des comptes. L’enquête permettra notamment d’élucider un point qui nous intrigue depuis quelques années, à savoir le taux d’occupation des crèches de 70 %.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur Braunstein, pourriez-vous également préciser les sommes susceptibles d’être dégagées par une rationalisation des modes de gestion ?
M. Michel Braunstein. Nous avons donné des indications chiffrées. Le CMG représente quelque 5 milliards d’euros, dont environ 200 millions profitent au premier décile et 1,2 milliard au dernier. L’ensemble des prestations sous condition de ressources dessinent une courbe en U qui montre que les familles les plus favorisées sont aidées à la même hauteur que les familles les plus défavorisées.
Il n’y a quasiment pas un RALFSS où nous n’aurions pas évoqué les sujets relatifs à la famille. Dans le RALFSS de 2010, nous avons ainsi proposé d’évaluer les dépenses fiscales bénéficiant aux parents isolés en vue de les réorienter vers les familles monoparentales les plus défavorisées. Seules 600 000 d’entre elles, sur un total de 1,4 million, bénéficiaient d’une aide fiscale, les autres ne payant pas d’impôts. Sur les 415 millions d’euros de cette dépense fiscale, 25 % profitaient aux 10 % les plus aisés, dont le revenu fiscal de référence était supérieur à 46 000 euros par an. Parmi les bénéficiaires, nous avons même mentionné le cas d’un ménage isolé qui avait un revenu fiscal de référence de 17 millions d’euros par an.
Dans le RALFSS de 2007, nous recommandions la forfaitisation du supplément familial de traitement versé aux agents publics, qui représente 1,5 milliard d’euros et qui croît avec l’indice de rémunération jusqu’aux échelles lettres, de sorte qu’un professeur agrégé bénéficie d’un supplément familial de traitement bien plus élevé qu’un agent administratif ou un ouvrier de service.
M. Antoine Durrleman. Une véritable trace de sursalaire !
M. Michel Braunstein. Enfin, depuis dix ans, la Cour a plusieurs fois recommandé la fiscalisation des majorations de pensions pour les parents de trois enfants, qui permettrait de dégager 500 à 600 millions au profit de l’État. Nous avons même envisagé la forfaitisation de la majoration, car 10 % appliqués aux revenus d’un ménage d’agrégés représentent bien plus que 10 % appliqués à ceux d’un ménage d’agents de catégorie C.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie pour ce rappel synthétique. Sans vouloir préjuger les priorités du futur rapport définitif, j’insiste sur la nécessité d’y inclure une comparaison avec nos voisins européens.
Quel est votre sentiment sur les différents scénarios ? Parmi les hypothèses, vous avez évoqué des taxations de type environnemental ; quelle serait la pertinence de ce type de prélèvements, souvent évoqués en lien avec les préoccupations écologiques et la nécessité de mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement économique ? J’ai cru comprendre que vous les jugiez fragiles, les taxes de type comportemental ayant par définition vocation à disparaître, dans la mesure où leur objectif est de changer le comportement taxé. Les estimez-vous suffisamment stables ?
M. Antoine Durrleman. Dans la structure globale de nos prélèvements obligatoires, la fiscalité environnementale pèse bien moins lourd que dans d’autres pays, y compris l’Allemagne.
M. le coprésident Pierre Morange. Ses produits y sont-ils affectés à des dispositifs à vocation sociale ?
M. Antoine Durrleman. Il n’y a pas d’affectation d’impôts à la sécurité sociale en Allemagne ; elle bénéficie uniquement de dotations budgétaires et de prélèvements à base professionnelle, les impôts alimentant le budget des Länder et du Bund.
Au cours des dernières années, la Suède a fait très fortement basculer sa taxation du travail sur la taxation environnementale, cette dernière ayant été durcie et diversifiée pour constituer un ensemble de recettes qui jouit d’une certaine stabilité. L’Allemagne, elle, a choisi un autre mode de dégrèvement du travail en transférant une partie des charges patronales sur la TVA.
M. le coprésident Pierre Morange. Mais a-t-on suffisamment de recul pour évaluer ce modèle étranger ? Certes, l’assiette du prélèvement est suffisamment diversifiée pour lui donner une durabilité, mais dans la mesure où sa vocation comportementale est clairement affichée, cette assiette ne reste-t-elle pas fragile ? Ces taxes ne scient-elles pas la branche sur laquelle elles sont assises ?
M. Antoine Durrleman. Les émissions de CO2 en Suède ont baissé de 20 % pendant que le PIB augmentait de 25 %. La diminution de l’assiette – positive en soi – a donc été compensée par le dynamisme économique, et je n’ai pas le sentiment que le système de protection sociale suédois soit à l’agonie.
M. le coprésident Pierre Morange. Le souci de compétitivité pousse malgré tout la Suède à accomplir de gros efforts en matière de rationalisation de la dépense publique.
L’état des lieux que vous avez effectué nourrira notre réflexion. Nous procéderons à plusieurs auditions complémentaires afin de vous proposer, d’ici à la fin de l’année, quelques axes directeurs pour la rédaction du rapport définitif. Le temps est compté, le cadre législatif mouvant, et nous devrons tenir compte des mesures que le Gouvernement risque de prendre. Il ne faut pas se contenter de faire des rapports intellectuellement brillants, mais tâcher de traduire notre réflexion en propositions concrètes qui serviront le travail législatif.
M. Antoine Durrleman. À la suite du dépôt du rapport de M. Gallois, le Premier ministre a saisi mardi le Haut Conseil du financement de la protection sociale d’une demande d’expertise quant au financement de la branche famille, que le Haut Conseil devra fournir pour le 1er mai prochain ; il serait judicieux de coordonner nos travaux.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce haut conseil, tout juste mis en place au mois de septembre, a déjà proposé une note synthétique de quelque quatre-vingts pages. Il faudra impérativement veiller à la coordination entre les travaux de la Cour des comptes, de la MECSS, du Haut Conseil et du Gouvernement lui-même qui compte s’en inspirer. Le « rapport Gallois » s’inscrit également dans cette logique d’analyse des recettes pouvant contribuer au financement de notre protection sociale. Les questions de compétitivité-coût et de compétitivité hors coût sont en effet indissociables.
M. Antoine Durrleman. Comptez-vous auditionner la présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale ?
M. le coprésident Pierre Morange. Ce sera une audition incontournable.
*
* *
Audition de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé, et Mme Carole Bousquet, chef du bureau de la synthèse financière
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé, et Mme Carole Bousquet, chef du bureau de la synthèse financière.
La Cour des comptes vient de nous présenter son rapport d’étape sur un thème que notre mission avait choisi lors de la précédente mandature, le financement de la branche famille de la sécurité sociale. Elle rendra son rapport définitif en mars prochain. Dans l’intervalle, nous souhaitons affiner notre réflexion sur la situation de la branche, c’est pourquoi nous avons souhaité vous auditionner.
M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé. Le rapport d’étape de la Cour des comptes retrace l’histoire des modes de financement de la branche famille, puis aborde les projections financières pluriannuelles. Nous partageons son analyse rétrospective de la diversification des recettes de la branche depuis le début des années 1990. Aujourd’hui, on constate en effet une stabilisation de la part des différents financements : environ deux tiers sont issus des cotisations sociales, 18 % de la CSG et 15 % d’impôts et taxes affectés.
La Cour estime que l’évolution de ce financement a été subie, notamment en matière d’affectation de recettes fiscales. Nous voudrions nuancer cette analyse. Comme les autres branches de la sécurité sociale, la CNAF bénéficie d’un panier de recettes compensant les allégements de charges successifs. Cette évolution de son mode de financement a conduit à abaisser le coût du travail et je crois qu’il faut la lire de façon positive : depuis de nombreuses années, l’État recherche des recettes qui ne pèsent pas sur le coût de travail tout en permettant de financer les différentes branches de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si le rapport de certaines de ces recettes avec la sécurité sociale peut sembler indirect, on constate tout de même que 50 % d’entre elles sont liées à la taxe sur les salaires, ce qui est cohérent au regard du financement de la protection sociale. Il en va de même pour les recettes issues de la taxation du tabac ou pour certains prélèvements sociaux.
Il faut donc faire la part des choses. On ne peut affirmer, au motif qu’elle s’est faite au fil de l’histoire, que la fiscalisation n’a pas de sens et qu’elle se résume à une accumulation de recettes sans cohérence. Si l’on regarde le détail de la composition du panier de recettes, plusieurs contributions sont tout à fait logiquement affectées aux différentes branches.
La Cour remarque ensuite que l’opération de reprise des déficits du régime général par la CADES s’est traduite par une baisse des recettes issues de la CSG et par l’affectation d’autres recettes à la branche famille. Il conviendrait à cet égard de distinguer une analyse centrée sur l’opération elle-même, qui a en effet pour conséquence une perte globale pour la branche famille dans la mesure, notamment, où certaines de ces recettes ne sont pas pérennes, et une analyse de l’ensemble des recettes affectées à la branche au moment de cette opération puis en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012, en loi de finances rectificative pour 2012 et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2013. Autant le bilan est négatif pour l’opération CADES stricto sensu, avec une perte de l’ordre de 450 millions d’euros en 2013, autant il apparaît globalement favorable à la branche famille lorsque l’on considère tous les prélèvements qui lui ont été affectés. L’apport de recettes par la LFSS pour 2012 s’établit à environ 700 millions d’euros, dont 500 millions issus de la taxe sur les salaires. Le Gouvernement l’a souligné dans ses différentes présentations du PLFSS pour 2013 : il a la volonté claire d’apporter à la branche famille des recettes complémentaires permettant de limiter l’impact de la perte de CSG due à l’opération CADES. Il convient donc de tempérer la vision de la Cour selon laquelle cette opération aurait provoqué une fragilisation importante de la branche : cette évolution a été compensée par l’affectation de recettes substantielles.
M. le coprésident Pierre Morange. En réponse à nos questions, la Cour a estimé que certaines recettes destinées à compenser les 0,28 point de CSG affectés à la CADES, notamment les prélèvements sur les produits assurantiels, allaient connaître une réduction « en sifflet ». On ne peut contester cette précarisation. S’il y a bien compensation à l’euro près pour l’année en cours, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, l’interrogation soulevée pour les années suivantes n’est pas que métaphysique. De la question des ressources financières dépend la légitimité d’une politique familiale.
M. Thomas Fatome. Dans la préparation du PLFSS pour 2013 et les arbitrages concernant l’affectation des recettes aux différentes branches, la direction de la sécurité sociale a veillé à ce que la branche famille reçoive un montant substantiel de recettes compensant l’opération CADES. De ce point de vue, le projet pour 2013 est pleinement satisfaisant puisque le solde est positif. Dans une perspective pluriannuelle, nous devrons continuer d’examiner comment faire bénéficier la branche de contributions complémentaires car la question se posera.
Les projections figurant en annexe du PLFSS montrent en effet que le déficit se maintiendra, en dépit d’un redressement substantiel puisque l’horizon de déficit est d’un peu plus de 1 milliard d’euros en 2017 et que le retour à l’équilibre, si l’on prolonge des tendances, aurait lieu en 2020.
M. le coprésident Pierre Morange. Ces chiffres sont adossés sur des prévisions économiques quelque peu fragiles !
M. Thomas Fatome. La Cour des comptes retient une hypothèse d’évolution de la masse salariale plus pessimiste. Pour notre part, nous construisons les projets de loi de finances, les PLFSS et la programmation pluriannuelle sur les hypothèses retenues par le Gouvernement, soit une augmentation de la masse salariale de 2,3 % en 2013 puis un retour à 4 % en 2014.
Nous prenons également en compte des facteurs structurels : certaines dépenses de la branche famille connaîtront un rythme annuel d’augmentation inférieur à 3 %. À titre d’exemple, la montée en charge de la PAJE est derrière nous. Si l’évolution de la masse salariale est au rendez-vous, on peut donc tabler sur un retour à l’équilibre de la branche. A contrario, dès lors que l’on retient des hypothèses inférieures à celles du Gouvernement, il est évident que toutes les branches rencontreront des problèmes de financement. Quelle que soit l’évolution des assiettes, notre système de protection sociale a besoin d’une croissance économique lui permettant de financer ses dépenses.
Bref, les prévisions du Gouvernement, moins pessimistes que celles que retient la Cour, permettent d’envisager une réduction du déficit et un retour vers l’équilibre de la branche famille.
M. le coprésident Pierre Morange. La loi de 1975 a donné un caractère universel aux prestations familiales. Depuis 1991, une partie du financement de la branche est assurée par la CSG, qui a vocation à devenir un élément central se substituant aux cotisations adossées uniquement sur l’activité. Mais aujourd’hui, alors que la question de la productivité et de l’allégement des charges est au cœur du débat public, la part cumulée des prélèvements sur l’activité dans le financement de la branche famille s’élève à 80 %.
On assiste par ailleurs à un effet de ciseaux entre la croissance des charges liée à l’augmentation des prestations et l’évolution des recettes, sachant que les hypothèses sur lesquelles s’appuient les prévisions sont pour le moins optimistes au vu la situation financière internationale.
Ces questions font l’objet d’un large consensus. En conséquence, n’est-il pas temps de mener une réflexion stratégique pour assurer des sources de financement plus pérennes et plus dynamiques et pour optimiser et rationaliser la dépense publique dans le domaine de la famille ? Il ne s’agit pas de rationner la prestation, mais de faire en sorte qu’elle soit plus efficiente et plus juste pour répondre aux idéaux de la République et à la stratégie démographique nationale. Quelles sont les pistes explorées par la direction de la sécurité sociale ?
M. Thomas Fatome. Le pacte de compétitivité présenté par le Gouvernement vise précisément à soutenir l’activité et l’emploi, donc à accroître la masse salariale, ce qui consolidera sans doute les prévisions en matière de recettes.
Concernant la branche famille, les sujets de réformes posés concernent trois aspects.
Premièrement, le mode de financement est un point prioritaire de la réflexion du Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui a récemment été saisi par le Premier ministre.
M. le coprésident Pierre Morange. Confirmez-vous la date de livraison des conclusions du Haut Conseil ?
M. Thomas Fatome. Mai 2013.
Deuxièmement les dépenses. À la suite de la conférence sociale, des travaux de concertation vont s’engager entre les partenaires sociaux sur différents sujets, dont la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Parallèlement, la ministre déléguée chargée de la famille a souhaité lancer une concertation avec l’ensemble des usagers de la branche famille sur le service public rendu aux familles, en particulier en matière de garde d’enfants.
Troisièmement les objectifs fixés dans la convention d’objectifs et de gestion (COG). Les négociations que nous avons engagées avec la CNAF sur la nouvelle COG ne portent pas, bien entendu, sur les prestations légales, mais sur le Fonds national d’action sociale (FNAS), dont les dépenses sont assez dynamiques puisque la précédente COG se fondait sur un rythme de progression annuelle de 7,5 %, et sur le Fonds national de gestion administrative (FNGA), qui assure les coûts de gestion de la branche.
M. le coprésident Pierre Morange. Fixerez-vous des objectifs précis en termes de rationalisation ? La MECSS a eu l’occasion de traiter le sujet des coûts de gestion. Nous avons participé assez efficacement, je crois, à une amélioration de ces coûts pour l’assurance maladie et nous souhaitons qu’il en soit de même pour la branche famille.
M. Thomas Fatome. La précédente COG avait fixé à la branche des missions en augmentation, notamment la gestion du revenu de solidarité active (RSA). Il a fallu faire face au choc de la crise économique, qui a provoqué un afflux important. La montée du chômage constitue une pression sur les CAF en matière d’accueil du public et de traitement des dossiers des minima sociaux.
Après le bilan approfondi qui a été fait de la précédente COG, nous sommes entrés dans une phase de dialogue technique avec les équipes de la CNAF pour identifier les paramètres classiques de négociation – prévision des départs en retraite, productivité des caisses, etc. À ce stade, je n’ai pas mandat précis de négociation concernant les coûts de gestion. La direction de la sécurité sociale met bien entendu l’accent sur la nécessaire contribution de la branche famille, comme des autres branches, aux efforts réalisés en matière de coûts de gestion par l’ensemble de la sécurité sociale, et ce dans le cadre général fixé pour l’État et ses opérateurs.
M. le coprésident Pierre Morange. Quand pensez-vous parvenir à des objectifs quantifiés ?
M. Thomas Fatome. Avant la signature de la convention d’objectifs et de gestion au premier trimestre 2013.
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS aura donc l’occasion de revenir sur le sujet et de s’assurer de la mise en œuvre des préconisations qu’elle a formulées au sujet, par exemple, de l’allocation de parent isolé ou des allocations logement, et qui ont trouvé, depuis, une traduction législative. La bonne utilisation des deniers publics exige en effet que l’on justifie d’un isolement économique pour bénéficier d’une aide. J’ai d’ailleurs adressé une question écrite à ce sujet – à laquelle il n’a toujours pas été répondu – car je souhaite que l’on effectue un bilan de la mise en œuvre de la disposition votée lors de l’examen du PLFSS pour 2012.
Une attention particulièrement aiguë devrait être portée, dans le cadre des COG, aux systèmes informatiques. La MECSS a déjà abordé plusieurs fois ce sujet. Vous le savez, les systèmes d’information de l’assurance maladie ne sont pas encore totalement efficients et la date de leur mise à niveau, nous a dit M. Van Roekeghem l’année dernière, a été repoussée à 2014.
Je ne m’inquiète pas de l’échéancier par obsession personnelle, mais parce qu’il est illusoire de s’assurer de la bonne utilisation de l’argent public si l’on n’a pas la maîtrise de l’information. Dans le paysage particulièrement touffu de notre protection sanitaire et sociale, l’absence d’interconnexion et de coordination des systèmes d’information ne laisse aucune possibilité de rationalisation et de traçabilité de l’effort public en faveur de la solidarité républicaine.
M. Thomas Fatome. Le rapport de la Cour des comptes a relevé cette année des progrès dans le pilotage des systèmes d’information à la CNAF. Il faut également souligner que les différentes adaptations, tant en termes de construction de référentiels unifiés au niveau national que d’offre de téléservices aux familles sur les sites caf.fr et mon-enfant.fr, permettent de déployer une offre assez satisfaisante.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans ma circonscription, c’est totalement inopérant. Au-delà de ce cas local, il ne serait peut-être pas inintéressant de prévoir un audit sur ces questions dans le cadre de la COG.
M. Thomas Fatome. Les systèmes d’information seront une priorité de la COG. Cela étant, les personnes qui cherchent une offre de garde peuvent aujourd’hui savoir, sur le site mon-enfant.fr, quelles sont les assistantes maternelles à proximité et les géolocaliser. Progressivement, l’offre de services s’enrichit, dépassant la seule détermination du droit à prestations et du versement.
Ajoutons que la précédente COG a été menée au moment de la départementalisation des CAF, dont le pilotage n’a pas été une mince affaire même s’il s’est déroulé dans de bonnes conditions à la fois en termes de dialogue social et de services aux assurés. Avec les caisses départementales, nous avons désormais un paysage stabilisé.
M. le coprésident Pierre Morange. Est-il prévu que la prochaine COG mette un accent particulier sur l’articulation entre les espaces territoriaux départementaux et les caisses d’allocations familiales, notamment pour la gestion de la population bénéficiant du RSA ? Dans bien des cas, on n’a pas l’impression d’un suivi très individualisé.
M. Thomas Fatome. Il faut savoir ce que l’on demande aux CAF.
M. le coprésident Pierre Morange. Mon propos n’est pas d’exiger d’elles de nouvelles missions dont elles n’en ont pas forcément les moyens, mais de m’assurer que la COG fixe des objectifs de rationalisation et de coordination. Il est inutile de créer des comités Théodule : nous savons tous que si l’on faisait fonctionner correctement l’ensemble des organisations existantes, on n’aurait besoin d’aucun moyen supplémentaire. Voilà pourquoi il me semble judicieux d’exiger des différents acteurs une coordination périmétrique dans le champ de l’action sociale relevant de la compétence de la branche famille.
M. Thomas Fatome. Nous rencontrons en effet ces sujets dans le partenariat avec les conseils généraux. Les CAF deviennent aussi des acteurs importants en matière de politique du logement. Elles ont besoin de s’ancrer dans des partenariats locaux.
S’agissant du RSA, il ne leur est demandé que de le liquider, ce qu’elles font. Certains conseils généraux demandent davantage dans le cadre de partenariats plus approfondis. Si cela peut fonctionner ainsi, il faut s’en féliciter. Mais les responsabilités des uns et des autres doivent rester bien identifiées.
Pour en revenir à vos interrogations sur les recettes et les dépenses de la branche famille, je ne crois pas, je le répète, à une assiette miracle, et ce quelle que soit la branche. La diversification des modes de financement a un sens au regard de l’universalité des prestations mais elle restera connectée de près ou de loin à l’évolution de la richesse nationale, donc à une dépense.
La direction de la sécurité sociale tient à ce qu’un lien soit maintenu entre une contribution des employeurs et le financement de la branche famille. Pour certains, les entreprises n’ont aucune raison de contribuer à cette branche. Il y aura probablement un débat, dans le cadre des travaux du Haut Conseil, pour savoir si la part de l’employeur est trop importante ou non et si l’on peut envisager des évolutions. Néanmoins, dans la mesure où la politique familiale représente un apport à la croissance économique, à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et plus généralement à la démographie de notre pays, il ne semble pas illégitime que les entreprises continuent de participer au financement de la branche. Une mesure drastique, outre les difficultés de financement qu’elle entraînerait, poserait un problème de cohérence. Mais il s’agit là d’arbitrages très politiques qui interviendront au regard des conclusions du Haut Conseil. Les organisations syndicales tiennent elles aussi au maintien de la contribution des employeurs au financement de la branche famille.
M. le coprésident Pierre Morange. Parmi les différentes hypothèses, il y a non seulement l’adoption d’une assiette plus large, plus stable et plus lisible, mais aussi la budgétisation totale ou partielle, à l’instar de ce qui se fait outre-Rhin. La direction de la sécurité sociale a-t-elle réalisé un comparatif européen qui pourrait étayer nos réflexions ?
M. Thomas Fatome. Je vérifierai s’il existe un benchmark européen récent.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons mandaté la Cour des comptes pour un tel travail mais rien n’interdit de croiser les informations.
M. Thomas Fatome. Toujours est-il que la direction de la sécurité sociale est très dubitative quant à un schéma de budgétisation. On voit mal quel pourrait être l’apport en termes de pilotage de la dépense et de lisibilité, et une telle évolution serait difficilement acceptable par les partenaires sociaux. Le conseil d’administration de la CNAF et le réseau des CAF ont montré leur capacité à s’adapter, que ce soit pour faire face à la crise ou pour prendre en charge de nouvelles prestations.
L’idée sur laquelle se fonde cette hypothèse est que l’universalité des prestations justifie une affectation au budget de l’État, mais sa réalisation présenterait des inconvénients considérables. Mis à part la satisfaction intellectuelle, on distingue mal les avantages que cela pourrait avoir pour la conduite des politiques publiques aujourd’hui assumée par la sécurité sociale.
Enfin, la budgétisation totale de la branche famille interdirait une logique de gestion globale des risques de la sécurité sociale, où, même si les difficultés financières des dernières années ne le laissent pas apparaître, la branche famille devrait plutôt dégager des excédents tandis que la branche retraite et la branche maladie sont structurellement soumises à une pression croissante.
M. le coprésident Pierre Morange. Cela étant, les impôts et taxes affectés ou la CSG sont, de fait, des produits fiscaux affectés pour partie au financement de la branche famille.
M. Thomas Fatome. Certes, mais la CSG est par nature entièrement affectée à la sécurité sociale.
Nous avons sur ces sujets un désaccord de fond avec la Cour des comptes. Celle-ci considère que l’affectation de recettes fiscales à la sécurité sociale pose une question car ces revenus, selon elle, reviennent naturellement à l’État : c’est méconnaître que certains impôts et taxes affectés ont vocation à financer directement la sécurité sociale. Nous avons lutté de longues années pour qu’il en aille ainsi de l’ensemble des droits sur le tabac, ce qui est le cas aujourd’hui. L’article 3 du PLFSS pour 2013 clarifie également différentes recettes croisées entre l’État et la sécurité sociale. Il est légitime que le produit des taxes dites « comportementales » revienne à cette dernière. Il est tout aussi légitime que la branche famille, qui est partie intégrante de la sécurité sociale, reçoive des recettes fiscales sans que cela soulève pour autant la question de la budgétisation.
Pour en revenir aux dépenses, outre les facteurs qui vont dans le sens d’une modération structurelle, de nombreux travaux réalisés ces dernières années permettent d’envisager des économies. La concertation consécutive à la conférence sociale apportera un éclairage à ce sujet. Le complément de libre choix d’activité (CLCA) fait également l’objet d’une réflexion qui peut avoir un impact financier, selon que l’on envisage de le resserrer ou non, ou de le répartir davantage entre l’homme et la femme.
M. le coprésident Pierre Morange. Le resserrement de la période du congé parental moyennant une augmentation de la prestation est un thème ancien. Avez-vous élaboré des simulations économiques ?
M. Thomas Fatome. Nous avons effectué des travaux techniques sur les différents scénarios pour le Haut Conseil de la famille et nous les avons mis à jour. Nous les transmettrons volontiers à votre Mission, sachant que le Gouvernement a choisi de soumettre ce sujet à la concertation.
M. le coprésident Pierre Morange. Existe-t-il d’autres éléments concernant les dépenses ?
M. Thomas Fatome. À ce stade, il n’y a pas de décisions concernant des mesures d’économies. La branche famille délivre à la fois la prestation universelle des allocations familiales, des prestations de garde d’enfants, des prestations d’action sociale liées aux crèches. Beaucoup de leviers sont donc disponibles. Le Gouvernement fait de l’action en faveur des familles les plus vulnérables une priorité, comme le montre la revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire. Il y a dès lors des arbitrages à faire en matière de redistribution verticale ou d’objectifs concernant la garde d’enfants.
Nous sommes néanmoins attentifs à un point : si la dépense publique en matière de politique familiale est assurément élevée par comparaison avec les autres pays européens, on ne saurait la déconnecter de performances très satisfaisantes en termes de démographie ou de taux d’activité des femmes. On ne peut avoir une vision seulement budgétaire des dépenses de la branche famille, il faut également considérer leur impact très fort sur la redistribution – comme l’ont démontré les travaux de l’INSEE, notamment – mais aussi sur la démographie, donc sur croissance économique de notre pays.
M. le coprésident Pierre Morange. Quoi qu’il en soit, voyez-vous une hiérarchie dans les mesures d’économies éventuelles pour combler le déficit ?
M. Thomas Fatome. L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a traité dans un travail récent un sujet que le rapport de la Cour des comptes ne développe pas et qui relève de la problématique de mise en cohérence des politiques de l’État et des politiques de la branche famille : la question des allocations logement et du partage financier entre l’État et la branche. L’IGAS estime à juste titre que le pilotage de ces dépenses n’est pas pleinement satisfaisant, ne serait-ce qu’en termes de travail administratif. C’est pourquoi, d’ailleurs, la CNAF s’emploie à affiner ses prévisions en coordination avec le ministère du logement.
Il me semble donc qu’une éventuelle mise à plat des domaines de rationalisation ne doit pas oublier le champ des prestations logement, où il existe des partages historiques entre le financement par l’État et le financement par la branche famille selon que les prestations correspondent à des allocations sans enfants ou avec enfants.
À l’heure actuelle, la direction de la sécurité sociale n’a pas de mandat politique pour avancer sur ce point auquel on ne pense pas toujours s’agissant de la branche famille mais pour lequel la question des relations et des financements croisés entre l’État et la sécurité sociale se pose. Ce pourrait être un thème des prochains travaux de la Cour des comptes.
M. le coprésident Pierre Morange. J’ai adressé récemment une question écrite à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre délégué chargé du budget pour attirer leur attention sur le fait que le mécanisme permettant le croisement de tous les fichiers des organismes sociaux, désormais opérationnel, ne permet que le contrôle de l’éligibilité aux droits et n’est mis en œuvre qu’au cas par cas. Je réitère la demande que j’avais faite lors de la modification législative qui avait institué ce répertoire : il ne s’agit pas seulement de vérifier l’éligibilité aux droits, il s’agit aussi de vérifier les montants attribués. Sans la connaissance de ces montants, comment juger de la pertinence de l’attribution des moyens publics pour répondre aux objectifs sanitaires et sociaux ?
En outre, aucun croisement automatique n’a lieu avec les fichiers du fisc, alors que ce serait un des meilleurs moyens de lutte contre la fraude fiscale, évaluée entre 40 et 50 milliards d’euros.
Enfin, quand la sécurité sociale sera-t-elle capable d’échanger des informations avec les systèmes sociaux des collectivités territoriales ? Les compétences des régions, départements et communes en la matière aboutissent à une multitude d’actions. Il ne s’agit pas ici d’en contester la pertinence mais, lorsque chaque acteur ignore ce que font les autres acteurs, cela se traduit par une inefficience.
Vous mentionniez, par exemple, le partage des compétences en matière d’aides au logement. Sans interconnexion des données de la branche famille et des collectivités territoriales, on est condamné à l’échec compte tenu de l’effet de ciseaux que j’évoquais.
Certes, ce dispositif n’est pas la pierre philosophale. Mais il aurait au moins un effet démultiplicateur sur la bonne utilisation de l’énergie publique au service de nos concitoyens.
M. Thomas Fatome. Comme vous le savez, le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) au déploiement duquel nous travaillons a deux objectifs : vérifier que les personnes qui ont droit à des prestations y ont bien accès...
M. le coprésident Pierre Morange. ...et mettre en évidence les zones d’ombre : certaines zones de précarité sont scandaleusement ignorées de la République. Seul le croisement des données permettra de les identifier et d’apporter des réponses au lieu de faire, dans certains cas, de mauvaises attributions.
M. Thomas Fatome. Il y a en effet deux aspects : l’accès aux droits et la lutte contre la fraude. Le déploiement des outils se poursuit. C’est une entreprise qui nécessite un investissement important et qui a quelques années derrière elle.
M. le coprésident Pierre Morange. Je confirme ce dernier point : la disposition législative remonte à 2006 !
M. Thomas Fatome. Le répertoire existe et il fonctionne.
M. le coprésident Pierre Morange. Quand y intégrerez-vous les montants versés ?
M. Thomas Fatome. Ce point fait partie des travaux que nous avons engagés avec les caisses. Cela dit, dans la mesure où nous disposons la plupart du temps de l’information sur les droits de l’assuré et sur les prestations dont il bénéficie, nous pouvons en déduire automatiquement les montants.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourtant, l’accès direct aux montants améliorerait grandement la lisibilité et la traçabilité des dossiers.
M. Thomas Fatome. Ce n’est pas totalement neutre.
M. le coprésident Pierre Morange. Je n’ai pas dit que c’était neutre. Sur le plan technique, néanmoins, la difficulté ne semble pas insurmontable.
M. Thomas Fatome. Aucune ne l’est.
M. le coprésident Pierre Morange. « Là où il y a une volonté, il y a un chemin. » Étant de nature tenace, je ne vous lâcherai pas ni sur la question des montants, ni sur l’articulation avec les collectivités territoriales, ni sur l’automaticité du croisement avec le fisc.
M. Thomas Fatome. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a validé ces mécanismes. Nous privilégions pour notre part des croisements ciblés avec les données fiscales, par exemple pour détecter des logements fictifs en recueillant les données du cadastre ou encore pour lutter contre le travail illégal.
Le partage des données avec les collectivités locales est pleinement justifié mais le débat dépasse les frontières de la sécurité sociale. La CNIL sera sans doute très vigilante.
M. le coprésident Pierre Morange. Je le sais d’autant mieux j’ai rapporté le projet de répertoire national commun de la protection sociale devant elle. Elle a validé le croisement des fichiers avec les collectivités dans la mesure où les personnels qui traitent ces informations sont habilités de façon nominale et où les règles de confidentialité sont strictement assurées.
J’insiste sur ce sujet car il existe des zones d’ombre en matière de politique familiale. Il est anormal que certaines familles monoparentales, faute d’information, ne puissent revendiquer leurs droits. Du fait de leur connaissance du terrain, les collectivités disposent de l’information. Si je souhaite que l’interconnexion se fasse, c’est pour que les idéaux de la République soient une réalité au quotidien.
Je vous remercie d’avoir bien voulu répondre à nos questions sur un sujet particulièrement mouvant, puisqu’il est au cœur des préoccupations de l’exécutif et du Parlement.
Audition de M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille, et Mme Élizabeth Le Hot, secrétaire générale
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille (HCF), et Mme Élisabeth Le Hot, secrétaire générale, dans le cadre de nos travaux sur le financement de la branche famille.
La Cour des comptes nous a transmis un premier rapport sur le sujet, faisant le constat d’un déficit structurel de la branche et d’une fiscalisation croissante de son financement. Elle nous communiquera un rapport définitif au vu des commandes complémentaires que nous lui passerons.
Quelle est votre analyse du déficit actuel ? Estimez-vous, comme la Cour, qu’il est structurel ? Quelles en sont les causes ? Comment pourrait évoluer la branche, tant en termes de dépenses que de recettes ? Quelle est votre position au sujet du grand débat sur le financement de la sécurité sociale ?
Je rappelle que deux séries de réflexions sont en cours. La première concerne la compétitivité du pays – qui a donné lieu à l’annonce d’un crédit d’impôt compétitivité emploi de 20 milliards d’euros assis sur la masse salariale inférieure à 2,5 SMIC et dont le Président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu’elle n’interfère pas dans les discussions avec les partenaires sociaux sur la sécurité sociale, même si les deux peuvent converger. D’où la question de savoir comment rendre le prélèvement social le plus neutre possible à cet égard. La seconde série de réflexions engagées porte sur les financements les plus adaptés à la nature des prestations, sachant que le caractère universel de celles-ci a justifié leur fiscalisation croissante – ce qui suscite la crainte récurrente des partenaires sociaux de voir ainsi réduire leur légitimité à intervenir dans le débat, voire dans la gestion des organismes.
Plusieurs démarches s’imbriquent, qui compliquent le calendrier : les premières mesures prises à la suite du rapport remis par M. Louis Gallois, la commande du Premier ministre au Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui doit rendre ses conclusions début mars, les travaux de la MECSS et le rapport que la Cour des comptes doit également nous remettre en mars.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelles sont vos réflexions pour améliorer le rapport coût-efficacité de la branche ? Je rappelle que le Président de la République, lors de sa dernière conférence de presse, a évoqué la nécessité d’un effort budgétaire à hauteur de 12 milliards d’euros par an pour l’État, le système de protection sociale et les collectivités territoriales, et que de nombreux rapports ont été réalisés sur ce sujet, notamment celui de notre ancien collègue Yves Bur, qui a plaidé pour une assiette de prélèvement plus large et une rationalisation des dépenses, dans le respect des principes d’universalité et de solidarité des prestations.
M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille. Je m’exprimerai à titre personnel, le HCF n’ayant jamais traité des recettes. D’abord, ses réflexions ont été bloquées par le « rapport Bur », qui, à ma connaissance, n’a jamais été publié. Puis le décret régissant le HCF a été modifié et l’analyse de cet aspect a été supprimée de ses attributions, qui portent essentiellement sur l’équilibre financier de la branche.
De plus, sur beaucoup de points, je ne suis pas en phase avec les préoccupations d’une partie de ses membres, notamment sur le caractère pérenne et la nature des recettes.
En effet, le problème principal est moins la nature de celles-ci que leur niveau. La question essentielle est de savoir combien l’État veut affecter à la branche.
En ce qui concerne l’équilibre financier, nous avons réalisé en septembre 2010 un rapport sur son évolution jusqu’en 2025. Mais nous allons devoir le revoir pour tenir compte des travaux en cours, notamment les vôtres : nous pourrons vous transmettre la version définitive probablement en février prochain.
Cet exercice est en effet assez simple : la branche n’est pas compliquée et repose sur une évolution lente, dépendant du taux de natalité – dont l’effet se diffuse sur vingt ans –, de l’écart entre les salaires et les prix et du dynamisme général de l’économie.
Nous garderons l’échéance de 2025 : nous avons en effet retenu cette date parce que nous souhaitons qu’au-delà de la période de déficit dans laquelle nous sommes engagés, nous puissions prendre en compte celle du retour à l’équilibre – vers 2017-2018 – puis à l’excédent de la branche. Selon nos estimations, celui-ci devait s’élever à 7 milliards d’euros à cette échéance. Or je suis convaincu que si nous sortons de la crise, nous aurons toujours un excédent en 2025.
A contrario, une approche limitée à l’échéance de 2017 ou 2018 ferait seulement apparaître un déficit, incitant ainsi à s’interroger sur une réduction de dépenses – alors que si l’on montre que la branche connaîtra un excédent, la question principale devient : que fait-on de celui-ci ? Le laisse-t-on à la branche ou non ?
Celle-ci est en effet structurellement faite pour créer de l’excédent : à cet égard, la communication de la Cour n’est peut-être pas aussi pertinente qu’on pourrait le penser. Sans doute cela est-il lié à ce qu’elle a retenu un horizon de temps trop court.
De fait, les prestations évoluent globalement comme les prix alors que les recettes progressent plutôt comme le produit intérieur brut (PIB), dont le taux est tendanciellement supérieur à celui des prix de 1,5 à 2 points par an. De plus, le nombre de familles nombreuses diminue, ce qui, dans le système progressif que nous avons, favorise les excédents : si nous n’avions que des familles d’un enfant, nous n’aurions d’ailleurs plus d’allocations familiales ! En outre, quand le revenu global des ménages augmente d’un point plus vite que les prix, on perd des allocataires – que ce soit pour l’allocation de rentrée scolaire (ARS), le complément familial (CF) ou les aides au logement – dans la mesure où les plafonds sous lesquels on sert les prestations sous conditions de ressources évoluent comme l’inflation.
Seul un rebond de la natalité pourrait nous écarter de cette trajectoire excédentaire : si le nombre annuel de naissances passait de 830 000 à 850 000 ou 900 000, on assisterait à une nette augmentation des dépenses les trois premières années – du fait de l’importance de nos prestations liées à l’accueil du jeune enfant –, qui se diffuserait ensuite au cours des quinze années suivantes. C’est la raison pour laquelle nous établissons nos prévisions à partir du scénario central de l’INSEE en prévoyant un certain nombre de variantes, selon qu’on aurait 10 000 naissances de plus ou de moins. On ne peut guère anticiper des ruptures brutales sur ce point.
Cela dit, des erreurs sont possibles. En 1993-1994, nous avions aussi établi notre cadrage en fonction des prévisions de l’INSEE, qui anticipait 710 000 naissances : or, à peine avons-nous voté la loi relative à la famille du 25 juillet 1994 que celles-ci se sont accrues, passant de 720 000 en 1993 à 830 000 aujourd’hui.
J’aurais aimé demander aux membres du HCF ce qu’ils souhaiteraient faire de l’excédent prévu : leur position est a priori de le garder, ce qui, comme je leur ai dit, est un pari aléatoire. Si la situation financière de la protection sociale n’est pas bonne, qu’on n’arrive pas à mieux maîtriser les dépenses d’assurance maladie et qu’on décide d’aider davantage les personnes dépendantes ou pauvres, il est possible que ce surplus soit redéployé. Cela pourrait se traduire notamment par le fait de transférer à la branche le financement du congé de maternité, comme c’est déjà le cas pour le congé de paternité.
On a ainsi transféré en 2000, sous le gouvernement de Lionel Jospin, les charges de retraite du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sur la branche famille à hauteur de 4,5 milliards d’euros. Cela a scandalisé les associations familiales, qui y ont vu un moyen de neutraliser l’excédent potentiel de la branche. Aucun gouvernement n’est revenu sur ce transfert.
La question, dès lors, est de savoir si, compte tenu de ce potentiel financier, nous faisons le meilleur emploi de nos fonds – en situation de crise, mais aussi en période d’excédent.
Je rappelle que lorsqu’on est en excédent, on appauvrit en termes relatifs les familles par rapport au seuil de pauvreté ou au revenu médian, les prestations et les plafonds étant indexés sur les prix. Cette règle d’indexation ne me paraît pas optimale, dans la mesure où elle traite tout le monde de la même façon : pour une famille de deux enfants, la non-indexation des allocations familiales sur les salaires fait perdre globalement 1,5 point par an en termes de richesse relative, soit quelques euros chaque année ou 15 à 20 euros au bout de quatre à cinq ans ; alors que, pour une famille de trois ou quatre enfants, disposant d’un revenu primaire plus bas que la moyenne, plus exposée au chômage, avec un taux d’activité féminine plus faible, les prestations familiales et de logement représentant 40 % du revenu global, la perte est de quelques dizaines d’euros par an. Ce faisant, on tend à désarmer les familles nombreuses à revenu moyen ou modeste que l’on veut précisément protéger.
Cette indexation sur les prix, qui a été imposée à la branche depuis l’origine, a été pratiquée par tous les gouvernements, ce qui a pour conséquence de réduire au fil du temps l’efficacité de la politique familiale. J’ai donc proposé que l’on réfléchisse à une modification de la structure de cette politique : cela serait d’autant plus justifié si la contrainte financière était plus durable que prévu.
Je ne pense pas à cet égard qu’on augmentera les recettes de la branche à long terme : je crois même qu’on la diminuera – sous la forme du prélèvement de l’excédent que j’ai évoqué.
Nous n’avons pas réussi à avoir une réponse unanime au sein du HCF à ce sujet, car les syndicats et l’Union nationale des associations familiales (UNAF) n’ont pas voulu réfléchir à des hypothèses qu’ils rejettent par principe, souhaitant au contraire la sécurisation, voire l’accroissement des recettes.
Il nous faudrait travailler sous contrainte et que le Gouvernement dise au HCF de lui préciser comment il souhaite rétablir l’équilibre à l’horizon 2017 et ce qu’il ferait si les recettes n’augmentaient pas, sans allégement des charges indues, notamment le FSV. Or le président de l’UNAF voudrait au contraire que l’on sorte les charges de ce dernier de la branche famille pour avoir une politique familiale dynamique et revenir ainsi sur le péché capital que constitue l’indexation durable des prestations sur les prix.
En 2010, nous avons fait nos projections à recettes constantes : nous ferons a priori de même pour notre prochain exercice prospectif.
Mme Isabelle Le Callennec. Avez-vous fait des simulations dans l’hypothèse où les prestations seraient indexées sur les salaires ?
M. Bertrand Fragonard. Oui, ce serait très coûteux : cela reviendrait globalement à accroître de manière cumulée le montant global des prestations de 1,5 point par an, soit une augmentation de l’ordre de 8 % au bout de cinq ans. D’autant que cela conduirait aussi à indexer les plafonds : or, chaque fois qu’on augmente d’un point le revenu moyen par rapport aux prix, nous économisons entre 0,5 et 1,1 point des prestations sous condition de ressources – l’ARS, le CF et la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) –, dans la mesure où davantage de personnes dépassent les plafonds du fait de la progression des salaires.
Une telle mesure, révolutionnaire, condamnerait la branche à un déficit structurel.
Les mouvements familiaux souhaiteraient naturellement une indexation plus favorable, mais elle n’a jamais eu lieu. Ainsi, la loi du 12 juillet 1977 instituant le complément familial comportait un article – auquel j’ai travaillé –, prévoyant une indexation sur le PIB, le SMIC ou tout autre variable, pour ne pas parler ostensiblement des prix, mais on s’est quand même aligné sur ceux-ci !
Par ailleurs, les responsables budgétaires de la protection sociale doivent pallier les déficits croissants touchant les autres branches – qu’il s’agisse des retraites ou de l’assurance maladie – et faire face au besoin de financement de la dépendance ou de la lutte contre la pauvreté.
Il y a donc lieu de définir le type de politique familiale que l’on veut par rapport aux autres politiques sociales, ce qui permettrait de fixer une enveloppe financière, au sein de laquelle des choix pourraient être faits.
M. le coprésident Pierre Morange. Cette réflexion doit aller de pair avec celle portant sur l’assiette des prélèvements, qui ne doit pas conduire à tuer la poule aux œufs d’or !…
M. Bertrand Fragonard. Il nous faudra définir des priorités pour les dépenses : défendre les classes moyennes ou populaires ne revient pas au même que cibler les jeunes familles ou les familles monoparentales.
S’agissant des recettes, j’entends la position des partenaires sociaux et des associations au sujet de l’opportunité d’affecter tel ou tel prélèvement à telle ou telle dépense.
Ils craignent d’abord une budgétisation de la branche, voire une étatisation de la gestion de la sécurité sociale. Il faut bien toutefois considérer la situation actuelle : le conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) n’a pas son mot à dire sur les prestations, qui sont décidées au préalable, et le seul domaine où la branche a une autonomie concerne l’action sociale. En outre, je vois mal un gouvernement expliquer qu’il va supprimer les caisses d’allocations familiales (CAF) et faire gérer les prestations par les services fiscaux. Les partenaires sociaux disposent d’un véritable pouvoir de décision surtout pour l’assurance chômage et les retraites complémentaires.
Cette crainte traduit peut-être le fait que les gouvernements n’ont pas avec eux un dialogue aussi constant sur la politique familiale que sur la retraite par exemple. Elle fait plus écho à un changement symbolique qu’à une modification de fond.
Les partenaires sociaux redoutent aussi d’être trompés : la « tuyauterie » du financement de la sécurité sociale est tellement compliquée qu’elle fait perdre toute visibilité et sécurité juridique.
Selon moi, il n’existe aucune sécurité juridique pour quiconque, même si d’aucuns peuvent la souhaiter : le Parlement peut changer comme il veut l’ensemble des paramètres de ce qu’il veut. Certes, il peut sanctuariser certaines dispositions par la loi organique, comme ce fut le cas pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), mais on voit bien que cela ne peut constituer une garantie absolue. De toute façon, il est toujours possible de changer le point de cotisation ou l’assiette des prélèvements – les gouvernements le font régulièrement.
Il n’y a guère plus de visibilité, sauf pour quelques spécialistes. Mais si l’on modifie tel canal de financement, on peut rarement le cacher longtemps au Parlement et à l’opinion publique. Après l’opération de transfert de 0,28 point de contribution sociale généralisée (CSG) vers la CADES, le Parlement a ainsi exigé qu’on lui précise l’évolution des recettes de substitution de la branche famille jusqu’en 2017 : le rapport de la Cour des comptes a montré qu’elles baissaient, un débat parlementaire a eu lieu, le Conseil constitutionnel s’est prononcé, à la suite de quoi la direction de la sécurité sociale a indiqué qu’elle apporterait chaque année une compensation. Cela dit, cette prévision, qui est à mon avis sincère et la meilleure qui soit aujourd’hui, n’a pas plus de validité qu’une ligne de cotisation de sécurité sociale.
Il n’en reste pas moins que les gestionnaires ont ce sentiment de défiance, ce qui n’est pas sain. Il faut donc que soient produites des prévisions de long terme – les schémas de programmation budgétaires servent à cela. De manière générale, les documents publiés par les administrations sont sincères et réalistes.
Sur la nature des recettes, on a commencé par dire que certaines branches étaient foncièrement contributives – les retraites ou l’assurance chômage – et devaient donc logiquement être financées par des cotisations, contrairement à d’autres, universalistes, dites de solidarité, pour lesquelles d’autres sources de financement ont leur place.
Vous remarquerez que ce débat est né lorsqu’on a voulu stabiliser les cotisations patronales. Quand, en 1976, on a sorti les prestations familiales de la logique contributive, personne ne s’est demandé s’il fallait changer la nature des recettes : ce n’est qu’après, sous le gouvernement de Raymond Barre, lorsqu’on a souhaité opérer cette stabilisation, qu’on a décidé de réserver ces cotisations prioritairement aux régimes contributifs et nourri une réflexion sur le fait que les autres branches pourraient avoir plus de recettes fiscales. D’où l’idée récente selon laquelle, si l’on devait alléger les cotisations, elles devraient porter sur les allocations familiales – ce qui crée à juste titre beaucoup de nervosité chez les partenaires sociaux.
Mais il s’agit d’une construction intellectuelle : si vous me demandiez de justifier l’inverse, je pourrais sans doute y arriver ! L’allégement pourrait tout aussi bien porter sur les cotisations de l’assurance maladie, qui est tout autant universelle, depuis la création de la couverture maladie universelle (CMU), que la branche famille.
Reste à savoir, si on allégeait les cotisations, quelles seraient les recettes de substitution, ce qui pose la question du changement d’assiette – qui peut porter sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la fiscalité écologique ou tout autre prélèvement. Il ne m’appartient pas de l’apprécier.
Toujours est-il que le Gouvernement a préféré créer un crédit d’impôt pour réduire le coût du travail plutôt que baisser les cotisations patronales. Du coup, plus personne ne considère la nature du financement de la branche comme un problème.
Il faut en fait distinguer trois types de débats : le débat intellectuel sur la nature des recettes, qui est intéressant au regard de la philosophie du droit ; celui sur les moyens que l’on souhaite donner à chaque branche de sécurité sociale ; celui, enfin, sur les assiettes de substitution en cas d’allégement des cotisations.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous eu une réflexion particulière sur le choix entre le crédit d’impôt et l’allégement des cotisations ?
M. Bertrand Fragonard. Il n’appartient pas au HCF d’en débattre. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale, auquel je participe, n’en délibère pas non plus, puisque ce n’est plus sa fonction. D’ailleurs, à peine a-t-il été créé par le gouvernement précédent qu’on avait déjà décidé de mettre en place la TVA sociale et, à peine l’a-t-on récemment relancé, qu’on a déjà décidé qu’on recourrait à un crédit d’impôt !
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous des informations sur les modèles macroéconomiques tels que le modèle Mesange, étudiant les différents scénarios de financement ?
M. Bertrand Fragonard. Non. Ma réflexion porte sur ce que nous ferons pour la branche dans les années à venir : il suffit que le Gouvernement m’indique sur quelle hypothèse d’évolution des recettes il souhaite que nous travaillions. À défaut, je partirai de celle selon laquelle elles évolueront comme le PIB.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Le débat est moins fermé que vous ne le dites. Le choix du crédit d’impôt repose sur deux raisons principales : d’une part, ne pas préjuger du débat sur le financement de la protection sociale et, d’autre part, envoyer aux entreprises un signal d’amélioration de la compétitivité dès le 1er janvier 2013 en en reportant le financement à 2014 pour tenir compte des contraintes budgétaires. Dès lors, la question de savoir comment pérenniser le système de protection sociale en 2014-2015 et au-delà reste entière, sachant que beaucoup d’organisations syndicales sont attachées à la structure du financement actuel.
Je ne pense pas qu’il y ait un problème d’écart de coût du travail avec la Chine ou les pays en développement – ni avec l’Allemagne, l’écart dans ce cas n’ayant pas d’impact sur les coûts de production –, mais plutôt de capacité d’investissement des entreprises, de recherche et de formation des salariés.
En revanche, se pose la question du rapport entre le coût du capital et celui du travail en France, qui détermine le choix de recourir à une machine plutôt qu’à un service – à des caméras de surveillance, par exemple, plutôt qu’à des agents dans les transports en commun. Je suis partisan d’une neutralité fiscale en la matière, qui permettrait d’éviter certains effets pervers.
La CFDT partage cette approche. Quant à la CGT, elle est favorable à une modulation des taux de cotisation en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée, mais cela revient mathématiquement quasiment au même.
En tout cas, il faut que nous ayons cette réflexion.
M. Bertrand Fragonard. Je rappelle que les attributions du HCF ont été réduites à cet égard, même si ces questions sont fondamentales.
Je continue à penser que le débat sur la nature des recettes aura moins d’actualité depuis que le Gouvernement a fait le choix du crédit d’impôt. Se poseront en revanche la question de savoir ce que l’on met autour de celui-ci – qu’il s’agisse de le subordonner à des obligations ou de conditionner certaines exonérations – ainsi que celle de son financement.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle est votre analyse sur l’évolution des dépenses ?
M. Bertrand Fragonard. J’attends les signaux du Gouvernement sur la politique familiale. L’augmentation de l’ARS, qui porte sur 400 millions d’euros, en est un. Si elle ne se traduit pas par une modification structurelle, elle constitue une bonne opération, car elle a permis, pour un montant limité, de cibler les classes moyennes avec un impact significatif – soit 700 ou 1 000 euros de plus au mois de septembre pour des familles de deux ou trois enfants. Un deuxième signal implicite a porté sur le quotient familial, que l’on veut légèrement réduire, sans le réformer en profondeur. Lorsqu’il avait évoqué le sujet lors de sa campagne électorale, le Président de la République avait d’ailleurs précisé qu’il le conserverait tout en le plafonnant à 2 000 euros.
Je rappelle à cet égard que ce plafonnement existe depuis 1981, que le Conseil constitutionnel a reconnu sa validité et que son niveau a plus ou moins été élevé ou réduit selon que le gouvernement était de droite ou de gauche. Or, le quotient familial correspond aujourd’hui à celui prévalant sous le gouvernement de Lionel Jospin actualisé en fonction de l’inflation. On observe donc une grande continuité dans ce domaine : la mesure prise ne modifie pas véritablement la politique familiale.
Il en va différemment de la question de savoir ce que l’on fait du statut fiscal − s’agissant non seulement du quotient familial, mais aussi du quotient conjugal, grand oublié du débat politique. De même que de celle touchant à la variation des prestations familiales en fonction de la taille de la famille, de l’âge des enfants ou du revenu.
Sur la taille de la famille, nous poursuivons depuis 1945 une politique constante tendant à accroître l’aide totale en fonction du nombre d’enfants, ce qui me paraît bien. En 1981, alors que la gauche était porteuse de l’idée de l’égalité des allocations familiales quel que soit le rang, le Gouvernement s’y est assez vite refusé et le débat n’a quasiment plus jamais reparu. De même, si M. Sarkozy avait évoqué l’idée d’une allocation au premier enfant lors de sa campagne de 2007, après son élection, le débat a été clos. Quel gouvernement serait prêt en effet à consacrer un budget de 2,5 milliards pour donner 60 euros à toutes les familles d’un enfant alors qu’un enfant sur cinq vit dans une famille pauvre ?
D’ailleurs, l’un des rares votes du HCF a été que, dans la conjoncture actuelle, il n’était pas prioritaire de retenir cette mesure. Cela veut bien dire qu’elle ne verra pas le jour.
En ce qui concerne l’âge, la politique conduite s’inscrit également dans la continuité, en faveur des familles jeunes. À la fois parce que cela incite celles-ci à avoir d’autres enfants et pour favoriser la compatibilité entre la vie professionnelle des femmes et leur vie privée. Or, les signaux adressés par le Président de la République dans sa campagne électorale vont dans le même sens, qu’il s’agisse de la volonté de renforcer l’école maternelle pour les tout-petits – où l’on a perdu 150 000 places en onze ans – ou d’amplifier l’effort en faveur des équipements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Mais là encore, il faudra trouver les financements.
Pour ce qui est des revenus, il n’y a eu, en dehors de la mesure sur le quotient familial, aucune mesure de structure annoncée par le Gouvernement. Ce chantier n’a donc pas été ouvert. Je rappelle que lorsque certains responsables de l’ancienne majorité ont évoqué l’idée de placer les allocations familiales sous conditions de ressources, ils ont été très vite rappelés à l’ordre.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Nous avions essayé en 1997…
M. Bertrand Fragonard. Et même réussi… pour un an ! Cette opération est d’ailleurs révélatrice tant en termes de méthode que de fond.
En effet, Lionel Jospin l’avait annoncée dans son discours d’investiture alors que le dossier n’était pas instruit et qu’on lui avait livré une information tronquée – en minimisant le coût sur la base d’un calcul portant sur une famille de deux enfants. Si on lui avait fourni une évaluation pour une famille de quatre enfants, il aurait peut-être davantage hésité. Or huit jours après l’annonce, il avait déjà modifié la mesure, le plafond de 25 000 francs devant augmenter avec la taille de la famille et le nombre de revenus.
Puis, après avoir été critiqué par les mouvements familiaux, il est revenu en arrière et, au passage, a modifié le quotient familial, récupérant ainsi à peu près ce qu’il avait perdu en rétablissant le régime des allocations familiales. Au bout du compte, il a obtenu une meilleure structure du système de prestations.
Je rappelle à cet égard que le Conseil constitutionnel n’approuverait probablement pas une offensive radicale sur le quotient familial.
Dans la note publique que nous avons rédigée sur ce sujet, nous avons décrit toutes les possibilités de réforme et exposé toutes les données permettant à chacun de faire ses choix. Le Gouvernement ne s’est pas encore prononcé à cet égard.
À mon avis, certains chantiers de la protection sociale sont plus prioritaires que d’autres, tels la dépendance, la lutte contre la pauvreté, le veuvage précoce ou les invalides. Il faut partenir à réduire considérablement les dépenses d’assurance maladie.
En ce qui concerne la branche famille, nous avons écrit que le statu quo est sans doute la politique la moins courageuse et la moins positive, car elle aboutit à désindexer tout le monde. En même temps, je comprends que l’on ne veuille pas procéder à une réforme structurelle tant qu’on n’a pas précisé les perspectives financières. Cette question est cruciale.
La prévision de déficit la plus récente pour 2017 est de 1,2 milliard d’euros. Plusieurs moyens permettraient de récupérer cette somme immédiatement, à commencer par le gel des prestations, qui revient à toucher tout le monde. Le gouvernement précédent a d’ailleurs fixé l’évolution de celles-ci à un point de moins que celle des prix et décalé de trois mois la date de paiement.
A contrario, une réforme structurelle consisterait à voir par exemple dans quelle mesure on pourrait renforcer les EAJE, mieux aider les adolescents, ou davantage soutenir les familles modestes ou pauvres.
Il faut donc faire des choix : il est paradoxal de dire en même temps que nous avons une bonne politique familiale et qu’un enfant sur cinq vit dans une famille pauvre !
Le Gouvernement m’a demandé d’animer un atelier sur les familles modestes : vous verrez mes positions à titre personnel sur la politique familiale à cet égard. En tout cas, si l’on veut faire un effort pour ces familles, il faut savoir quel décile on cible. Je penche pour les trois premiers plutôt que le premier. Une politique sociale limitée aux plus pauvres serait en effet rejetée par l’opinion…
Quant au HCF, je rappelle qu’il n’est saisi d’aucune demande, le décret le recomposant n’ayant pas encore été publié – ce qui ne nous empêche pas de travailler.
M. le coprésident Pierre Morange. S’est-il penché sur la question des disparités territoriales, qui sont choquantes, même si l’on comprend que les collectivités territoriales cherchent à lutter contre la pauvreté de certaines régions ?
Par ailleurs, qu’en est-il de la fragilité et de l’hétérogénéité des systèmes d’information ?
M. Bertrand Fragonard. La ministre déléguée chargée de la famille nous a demandé de réfléchir sur ce thème des disparités territoriales, qui concerne toute une série d’équipements et de services centrés sur l’enfance et l’adolescence, où elles sont très fortes. Il s’agit d’un sujet difficile, sur lequel va influencer la réforme des rythmes scolaires, qui rebat les cartes en ce qui concerne les charges des communes.
Nous avons rappelé qu’il ne suffisait pas d’avoir un plan de 200 000 places de garde − même s’il a été honorablement géré –, si l’on supprimait dans le même temps 150 000 places à l’école maternelle…
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS, notamment notre collègue Marie-Françoise Clergeau, avait aussi fait ce constat.
M. Bertrand Fragonard. Nous sommes en faveur du développement des équipements collectifs, c’est-à-dire les écoles maternelles et les EAJE. Le Gouvernement peut utiliser la convention d’objectifs et de gestion (COG) pour donner au Fonds national d’action sociale (FNAS) de la CNAF les moyens d’assumer une extension de ses missions, mais il faut également avoir l’appui des autres financeurs que sont les communes, à qui on demande aussi d’améliorer l’aide aux adolescents et de s’ajuster à la modification des rythmes scolaires.
Cela pose la question de ce que l’on peut demander à celles-ci compte tenu du principe de leur autonomie de gestion.
M. le coprésident Pierre Morange. Il faut aussi tenir compte d’un autre partenaire, que sont les parents d’élèves, certains d’entre eux préférant pour des raisons de coût mettre leur enfant à deux ans et demi à l’école maternelle plutôt qu’à la crèche ou au jardin d’enfant.
M. Bertrand Fragonard. Nous avons estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accroître la gratuité dans les établissements de garde et avons d’ailleurs voté en ce sens. Nous accordons la priorité à l’offre : or pour qu’il y ait plus de crèches, il faut que les familles payent. Le taux d’effort des familles pour les établissements d’accueil nous paraît à cet égard très cohérent.
En outre, nous avons dit au gouvernement précédent qu’il fallait arrêter la suppression de places à l’école maternelle.
Enfin, nous avons considéré que les déclarations du Président Hollande pendant sa campagne électorale tendaient à remonter l’âge de la scolarité à deux ans et à poursuivre le plan de développement des modes de garde.
Sur ce point, les syndicats et mouvements associatifs qui soutiennent le gouvernement préfèrent, comme les familles, que l’on fasse un peu plus de crèches, plutôt que de renforcer l’assistance maternelle.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Beaucoup sont davantage en faveur de l’école que des crèches.
M. Bertrand Fragonard. Cela n’est pas évident. On peut d’ailleurs se demander si, en accroissant le nombre de places à l’école, on soulagerait la grande section des EAJE. De manière générale, les Français choisissent de mettre leurs enfants à la crèche, puis à l’école maternelle, ce qui pose un problème de financement.
La branche famille peut assumer celui-ci : il revient au Gouvernement d’en décider. Il sera d’ailleurs obligé de définir au printemps, dans le cadre de la COG, le montant du FNAS, ce qui nous donnera une indication sur l’ambition du programme des EAJE – laquelle ne sera sans doute pas inférieure à celle du gouvernement précédent.
Quant aux communes, elles vont devoir prendre en compte, au-delà de leurs problèmes financiers généraux, non seulement la modification des rythmes scolaires, mais aussi l’avancée de l’âge d’entrée à l’école maternelle et la poursuite des efforts sur les EAJE.
À cet égard, je ne crois pas que le souhait spontané du HCF d’obliger les intercommunalités à faire des crèches sera réalisé. Ce serait d’ailleurs très difficile à organiser : les premiers contacts que nous avons eus avec la direction générale des collectivités locales (DGCL) à ce sujet attestent de sa part une certaine prudence, compte tenu du débat politique actuel sur la nouvelle vague de décentralisation.
Sur les systèmes d’information, je ne me prononcerai pas, en raison de l’accord politique entre le Premier ministre et le président de la CNAF sur le partage des compétences entre celle-ci et le HCF.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est dommage.
M. Bertrand Fragonard. Cela étant, les CAF ont des capacités tout juste suffisantes : outre qu’on les charge de multiples tâches de gestion, elles subissent les effets de la crise.
Beaucoup veulent leur confier d’autres missions afin de mieux accompagner les familles vulnérables, améliorer la gestion des dispositifs d’accès au droit ou le taux de recours… : je suis d’accord à condition qu’elles en aient les moyens. La première recommandation que je ferai dans l’atelier que j’aurai à animer sur les familles modestes sera d’ailleurs de créer des emplois publics dans les CAF.
Nous ne gagnerions rien à ce que celles-ci se mettent à fermer un peu plus qu’elles ne le font déjà !
M. le coprésident Pierre Morange. Cela renvoie à la question des coûts de gestion, que la MECSS a déjà abordée ainsi qu’à la problématique du guichet unique.
M. Bertrand Fragonard. Les coûts de gestion des organismes de la sécurité sociale ne sont pas chers. Je rappelle que ceux-ci disposent de masses financières et de prérogatives de puissance publique importantes, et qu’ils font établir l’essentiel des opérations de recettes par les entreprises : il est normal que l’Urssaf ait 1 % de frais de gestion. Pourrait-elle travailler à 10 % moins cher ? Peut-être, mais cela ne réglerait pas le déficit de la sécurité sociale. De plus, les économies sur les frais de gestion sont parfois difficiles à réaliser.
Tant qu’on ne change pas le type de dépenses que les branches ont à gérer, on ne peut substantiellement réduire les coûts. Or, on fait l’inverse : comme nos moyens financiers sont limités, on cible toutes les politiques, en changeant de curseur tous les six mois. On a ainsi institué un tarif d’électricité : celui-ci a été considérablement amélioré grâce au décret de mars 2012, qui permet de le gérer de façon quasi automatique, mais voilà qu’on me demande maintenant si on ne pourrait pas changer le dispositif – ce qui interfère d’ailleurs avec la proposition de loi actuellement en discussion !
Il ne faut pas non plus négliger le fait que chaque ministre veuille avoir sa loi, son dispositif. À cet égard, si j’estime pertinente la mesure prise par le Gouvernement sur l’ARS, son souhait de tenir davantage compte de la situation de l’enfant dans le cycle scolaire et de différencier une somme de 400 euros par an en fonction, non seulement de l’âge, mais du niveau d’étude, sollicitera davantage les caisses.
Beaucoup de simplifications seraient possibles : pourquoi avons-nous par exemple, pour aider la scolarité des enfants, à la fois des bourses, une ARS et un crédit d’impôt ?
Par ailleurs, nombre d’actions gagneraient à être amplifiées : on ne fait par exemple pas assez pour lutter contre la fraude et favoriser l’accès au droit. Or, dans les deux cas, cela demande de la main-d’œuvre. Mais si le responsable budgétaire accepte éventuellement quelques créations d’emploi pour lutter contre la fraude parce qu’il pense que c’est rentable, il rechignera beaucoup plus à le faire pour favoriser l’accès au droit – même s’il admet que c’est légitime – pour ne pas créer de dépenses supplémentaires.
Cela étant, on ne peut continuer éternellement à avoir un non-recours au revenu de solidarité active (RSA) de 50 %.
M. le coprésident Pierre Morange. Ces charges administratives montrent bien combien la question des systèmes d’information et le croisement des données automatisées sont essentiels, tant au regard de la lutte contre la fraude que pour l’accès au droit.
Les pistes de simplification que vous avez évoquées pourraient être étudiées par la MECSS.
M. Bertrand Fragonard. Je vous communiquerai un dossier sur ce point.
Je rappelle à ce sujet que nous aidons les familles à avoir des enfants en faisant un gros effort financier, tout en leur donnant ensuite un crédit d’impôt : pourquoi ne pas supprimer ce dernier et améliorer le paiement des prestations, d’autant que la somme en jeu − 100 millions d’euros – est relativement faible ?
Cela étant, les simplifications sont souvent difficiles à mener à bien, comme en témoigne par exemple la fusion des bourses des écoles et de l’ARS, qui a permis d’économiser 300 équivalents temps plein (ETP) à l’éducation nationale : elle a duré deux ans, puis les syndicats d’enseignants ont fait part de leur mécontentement et les parents d’élèves de leur souhait de garder les bourses, moyennant quoi la mesure a été supprimée.
Les grandes simplifications ne portent pas sur la gestion quotidienne, mais sur l’architecture des branches. Pourquoi avons-nous autant de régimes sociaux, alors que cela crée par exemple, en matière de retraites, le problème lancinant des polypensionnés, que les gouvernements essaient tour à tour de résoudre ?
Nous payons le péché originel de la pluralité des régimes que nous avons acceptée à la fin des années 1940. Seule la branche famille est à peu près homogène à cet égard, à l’exception du cas de la Mutualité sociale agricole (MSA) – même si les relations avec elle sont très bonnes.
Pour le reste, on peut toujours souhaiter que la productivité dans la chaîne de gestion des caisses s’améliore, ce qui est d’ailleurs le cas. Peut-on aller plus vite dans ce domaine ? Vraisemblablement… jusqu’à ce qu’on arrive à la limite des capacités des caisses – sachant qu’une grande grève à la sécurité sociale coûterait très cher !
M. le coprésident Pierre Morange. Je me souviens d’avoir obtenu le non-renouvellement d’un départ à la retraite sur deux au sein de l’assurance maladie, lequel, après avoir été mal accueilli au départ, a fini par être bien accepté par les syndicats – ce qui a permis de diminuer de 12 000 salariés les effectifs de la branche. Cette mesure était liée à l’époque à la dématérialisation des feuilles de maladie.
M. Bertrand Fragonard. Les caisses ont dans l’ensemble plutôt progressé en termes de gestion. Mais je ne crois pas au fantasme selon lequel on pourrait radicalement baisser les coûts en la matière sans changement d’architecture.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Lorsque j’ai rédigé le rapport d’évaluation de la précédente COG pour le compte de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), on nous avait fortement suggéré de rester à moyens constants alors qu’il fallait mettre en œuvre le RSA. Un tel scénario serait difficilement tenable aujourd’hui ; je suis même étonné que le climat social demeure aussi apaisé au sein de la branche famille.
M. Bertrand Fragonard. Cela est sans doute lié au fait qu’à force de fréquenter des familles pauvres, les personnels ont du mal à se mettre en grève… Mais il ne faut pas trop tirer sur la corde ! À cet égard, l’implosion qualitative des caisses, qu’elle se traduise par des fermetures ponctuelles ou une augmentation de l’absentéisme, ne serait pas préférable à la grève. La prochaine conférence de lutte contre la pauvreté aura à traiter de ces questions.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Je vous remercie.
*
* *
Audition de M. Philippe Didier-Courbin, chef du service des politiques sociales et médico-sociales, adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales et de la santé, et Mme Florence Lianos, sous-directrice de l’enfance et de la famille
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Nous accueillons maintenant M. Philippe Didier-Courbin, chef du service des politiques sociales et médico-sociales, adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale, et Mme Florence Lianos, sous-directrice de l’enfance et de la famille à la direction générale de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales et de la santé.
Mme Sabine Fourcade, directrice générale de la cohésion sociale, dont l’audition était initialement prévue, se trouve en effet empêchée par un problème de santé. Nous lui adressons nos vœux de prompt rétablissement.
La MECSS a commandé à la Cour des comptes une étude sur le financement de la branche famille. Un rapport d’étape lui a été remis la semaine dernière. Il analyse l’évolution des dépenses et des recettes sans se prononcer, à ce stade, sur ce qu’elles pourraient être à l’avenir, ni sur les perspectives de réforme.
Or les questions que nous nous posons sont à la fois rétrospectives et prospectives. Nous cherchons d’abord à identifier les causes du déficit de la branche famille. La Cour des comptes considère que ce déficit est structurel. Le président délégué du Haut Conseil de la famille, que nous avons entendu ce matin, estime au contraire qu’un excédent et un remboursement de la dette peuvent être envisagés d’ici à 2025. Nous aimerions avoir votre analyse sur ce point.
J’en viens à la prospective. Comment financer la branche famille en fonction de l’évolution prévisible des dépenses ? La décision d’alléger de 20 milliards d’euros les charges sociales des entreprises sous forme de crédit d’impôt déconnecte le problème de la compétitivité de celui du financement de la sécurité sociale. Cependant, le Président de la République et le Premier ministre ont précisé que cette décision permettait de ne pas préjuger les conclusions du débat qui s’ouvre au sein du Gouvernement, du Haut Conseil du financement de la protection sociale et du Parlement. La question des ressources de la branche famille est d’ailleurs depuis longtemps liée à celle de la compétitivité puisque les premiers allégements de cotisations employeurs, décidées par M. Édouard Balladur, étaient à la charge de cette branche, la perte de recettes étant compensée par le budget de l’État. Cette fiscalisation n’a fait ensuite que s’accentuer, comme la Cour des comptes l’a mis en lumière. Ce mouvement doit-il se poursuivre ? Faut-il au contraire rechercher, pour ce financement de la protection sociale, d’autres assiettes, du côté de la valeur ajoutée par exemple, puisqu’il semble désormais exclu de s’en tenir à des cotisations patronales exclusivement assises sur les salaires ? En bref, quel est selon vous le financement optimal de la protection sociale ?
D’autre part, question qui est aujourd’hui sujet de débat entre les partenaires sociaux, comment évoluerait le lien entre des recettes dont la nature aurait été modifiée et des prestations familiales qui conserveraient leur caractère universel ?
L’objectif de la MECSS est de parvenir sur tous ces points d’ici l’été 2013 à un diagnostic qui soit consensuel et à des propositions qui pourraient l’être moins, en fonction des sensibilités politiques. Ce travail s’appuiera sur nos auditions, sur le rapport final de la Cour des comptes, prévu pour le printemps, et sur celui du Haut Conseil du financement de la protection sociale, attendu pour le début du mois de mars 2013.
Cela étant, ces grandes questions ne sont pas exclusives d’une curiosité quant au fonctionnement de la branche famille : la gestion de ses prestations permet-elle d’atteindre les objectifs recherchés ? Des économies sont-elles possibles sur certains postes, au profit d’autres ?
M. le coprésident Pierre Morange. Nous souhaitons en effet disposer d’une évaluation exhaustive de l’efficience des prestations fournies. Les nombreux rapports récents sur la politique de la famille montrent que la question des recettes ne peut être dissociée de celle des dépenses mais, s’il faut certes rationaliser et optimiser ces dernières, cela ne peut être au détriment des objectifs fixés à la politique familiale, notamment de la correction des inégalités existant au sein de la communauté nationale.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. La préparation de la quatrième convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’État et la CNAF sera l’occasion de vérifier si cette démarche de contractualisation est un outil efficace de pilotage de la branche famille par l’État et de la centaine de caisses d’allocations familiales, les CAF, par la CNAF. On a en effet pu nourrir quelques doutes à cet égard…
M. Philippe Didier-Courbin, adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale. La direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, n’a pas pour mission de suivre la politique familiale dans sa globalité, mais de travailler à la bonne articulation entre l’action des caisses comme prestataires d’allocations aux familles et la politique plus générale d’action sociale et de cohésion sociale – qui comprend l’appui aux familles et personnes vulnérables, l’action en faveur de l’égalité entre hommes et femmes et la politique du handicap.
La branche famille contribue à cette politique d’action et de cohésion sociales, en finançant des opérations qui relèvent de son offre globale de services mais également en agissant comme prestataire de services pour l’État, comme gestionnaire de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, et pour les départements, comme gestionnaire du revenu de solidarité active, le RSA. Enfin, les CAF versent les prestations familiales. Ces fonctions sont distinctes et le positionnement et les attentes de l’État envers la CNAF diffèrent selon qu’on considère l’une ou l’autre.
Dans leur rôle de prestataires de services, les caisses ne sont d’ailleurs pas que des opérateurs rémunérés ; elles observent aussi les publics qui bénéficient de ces prestations et cette autre fonction est également précieuse pour la DGCS.
Notre direction générale ne possède pas d’expertise particulière sur le financement de la branche famille. J’observe simplement que, quelle que soit leur nature, ces recettes dépendront toujours de l’activité économique. Mais l’intérêt d’une remarque aussi générale est sans doute limité et je vous renvoie donc pour cette matière à l’exposé de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale.
Cependant, il est un point sur lequel le sujet nous intéresse : la branche famille doit pouvoir non seulement piloter et financer des prestations, mais également être en capacité de conduire une politique d’action sociale pour laquelle la DGCS propose des orientations, à l’occasion de l’évaluation et de la négociation des COG. C’est dans ce cadre que se confronte la politique familiale, qui a un caractère quasi universel, avec l’action sociale qui, elle, vise des publics précis ou s’applique à des situations spécifiques ou dans des territoires particuliers.
Il n’est pas du ressort de la DGCS de décider si l’universalité de la politique familiale doit être ou non remise en cause. En revanche, nous avons notre mot à dire sur la définition de l’offre de services de la CNAF et des CAF, à travers la négociation de la convention d’objectifs et de gestion.
L’élaboration de la future COG n’en est actuellement qu’au stade des échanges techniques entre la DGCS, la CNAF et la direction de la sécurité sociale. Ces discussions interviennent au moment où se tiennent les ateliers thématiques chargés de préparer la conférence de lutte contre la pauvreté et les exclusions et où Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille, vient de lancer une consultation sur les services offerts aux familles. La conférence aura lieu les 10 et 11 décembre prochains et la consultation « autour des familles », selon l’appellation retenue par la ministre déléguée, devrait également déboucher sur des propositions avant la fin de l’année. Les conclusions de l’une et de l’autre influeront indéniablement sur les choix stratégiques qui seront retenus dans la COG. Cependant, sans attendre, nous pouvons nous appuyer sur d’autres éléments pour préparer cette convention.
En premier lieu, s’agissant du bilan de la COG 2009-2012 dressé par l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, des trois grandes priorités de cette convention relevant de la compétence de la DGCS – l’accueil du jeune enfant, l’accompagnement de la mise en œuvre du RSA et celui de la réforme de l’AAH –, une seule, la première, était très directement liée à la politique familiale, les autres ressortissant de la politique d’action et de cohésion sociales. Il ressort de l’analyse de l’IGAS que les objectifs chiffrés, en matière d’accueil collectif des jeunes enfants, sont en passe d’être atteints et que les résultats sont excellents en ce qui concerne les assistantes maternelles ; en revanche, l’accueil en école maternelle n’a cessé de se restreindre depuis plusieurs années. Il y a là un déséquilibre qui ne pourra être corrigé que par une action combinée des caisses et de l’État, puisque c’est ce dernier qui a la charge des écoles maternelles. D’autre part, si, comme je l’ai dit, les objectifs chiffrés semblent atteints pour la création de places en structures d’accueil collectif, la couverture du territoire demeure très inégale et, malgré des efforts, les réponses apportées ne sont pas assez diversifiées, ni adaptées aux situations particulières. C’est d’ailleurs un constat qui vaut pour bon nombre d’autres actions : les résultats globaux peuvent paraître satisfaisants mais le traitement des cas spécifiques est souvent insuffisant.
Nous disposons également d’un bilan des actions d’appui à la parentalité. Là, le problème tient avant tout à la multiplicité des dispositifs : appui à la scolarité, réseaux d’appui à la parentalité, médiation familiale… Tous ont leur raison d’être, mais un effort de coordination serait souhaitable. À qui s’en remettre pour cela ? Comme l’État définit de grandes orientations dans ce domaine et participe au financement à travers ses services déconcentrés ou à travers les préfets, il reste présent dans le pilotage de ces actions, mais celles-ci bénéficient aussi de financements importants des caisses et, pour certaines, de la contribution de collectivités locales volontaires.
Au niveau national, une première réponse à ce besoin de coordination a consisté en la création d’un comité national d’appui à la parentalité, réunissant des représentants de tous les acteurs concernés, mais le pilotage local reste à constituer et des interrogations demeurent à cet égard. Le rôle de l’État financeur étant modeste, cela justifie-t-il la présence des préfets et des services de la cohésion sociale ? Ne peut-on se reposer uniquement sur les présidents des caisses et sur les présidents des conseils généraux ? Toutefois, s’agissant de l’appui à la scolarité ou de dispositifs centrés sur les territoires relevant de la politique de la ville, un tel désengagement ne serait probablement pas très prudent. Il faut donc que nous réussissions ce niveau ce à quoi nous sommes parvenus au niveau national avec la CNAF et avec l’Association des départements de France.
Cette coordination ne doit d’ailleurs pas se résumer à une réunion annuelle en vue de s’accorder sur les actions à financer : elle doit aussi porter sur le lancement de nouvelles actions dont la nécessité serait apparue, sur l’information des publics pour les aider à s’orienter entre tous les dispositifs existants – ce qui suppose de définir les moyens de toucher l’usager : le choix de la localisation des services, par exemple, n’est pas anodin. Les problèmes de relations entre parents et enfants ne se posent pas qu’aux familles en difficultés sociales ou financières, certes, et il est exclu de ne viser que celles-là, mais il faut néanmoins analyser finement les situations locales pour déterminer dans quelle mesure il convient de cibler des publics particuliers… L’État peut faire valoir des considérations générales, mais ces choix-là ne peuvent être arrêtés qu’au niveau local.
M. le coprésident Pierre Morange. Pour en revenir à la question posée par le rapporteur, pouvez-vous évaluer l’efficacité des COG ? L’État utilise-t-il correctement cet outil pour s’assurer que ce qui a été convenu entre les parties est effectivement appliqué ? Si tel n’est pas le cas, quelles mesures correctrices sont prises ?
M. le rapporteur. Dans la convention qui s’achève, par exemple, il était demandé à la branche de réunir les conditions lui permettant d’obtenir une certification de la Cour des comptes. Celle-ci avait en effet relevé une insuffisance du pilotage et du contrôle interne. Comment l’État est-il intervenu pour faire appliquer ce point ?
M. le coprésident Pierre Morange. Comme rapporteur d’une mission d’information sur la gouvernance et le financement des structures associatives, j’avais constaté que ces dernières contribuaient fortement à la politique de la famille mais, dans votre rôle de contrôle et d’audit, veillez-vous à leur transparence financière ? Je rappelle en effet qu’au-delà de 153 000 euros de subvention annuelle, leurs comptes doivent être certifiés et publiés au Journal officiel, et qu’elles doivent rembourser à l’État le traitement des fonctionnaires mis à leur disposition.
M. Philippe Didier-Courbin. À la différence de la direction de la sécurité sociale, nous ne suivons pas de près le fonctionnement des caisses, à une exception près : leur activité comme prestataires de services. Cela concerne la gestion de l’allocation aux adultes handicapés, pour laquelle nous entretenons un dialogue étroit avec la CNAF. En ce qui concerne les actions entrant dans le cadre de la COG, notre contrôle porte surtout sur la réalisation des objectifs fixés : ainsi, pour l’accueil du jeune enfant, grâce aux informations qui nous remontent régulièrement, nous avons pu constater que les objectifs quantifiés étaient atteints, mais qu’il convenait de fixer des orientations d’ordre qualitatif dans la COG qui vient, par exemple pour privilégier certaines modalités d’accueil. Je crois donc pouvoir affirmer que nous suivons l’application de la COG et en tirons les conséquences, en liaison avec l’IGAS notamment.
Nous opérons de la même manière pour ce qui est de l’aide à la parentalité. Les actions prévues sont menées, les différents dispositifs sont financés. Nous nous attachons à identifier les points à améliorer et cette évaluation a, comme je l’ai dit, montré la nécessité d’une plus grande coordination au niveau local, en particulier pour déterminer s’il convient ou non de « cibler » certains territoires ou publics particuliers.
Mme Florence Lianos, sous-directrice de l’enfance et de la famille à la direction générale de la cohésion sociale. À la demande conjointe de la direction de la sécurité sociale et de la DGCS, la CNAF a notablement amélioré ses systèmes de remontée d’information, ce qui nous permet maintenant de connaître en temps réel l’état d’avancement de tous les projets. Comme vous le savez, les différents programmes d’investissement de la CNAF, d’une grande technicité, s’étalent dans le temps. S’agissant des établissements d’accueil du jeune enfant par exemple, nous disposons désormais d’informations actualisées sur leur état d’avancement et sur le nombre de places occupées.
Nous tenons des réunions trimestrielles avec la direction de la sécurité sociale et avec la direction du Budget. Ce suivi a été renforcé après le rapport de 2009 de l’IGAS et de l’IGF, qui montrait un dépassement du budget du Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS).
J’ajoute que le système d’information de la CNAF sera encore amélioré grâce au programme OMEGA, qui nous permettra de disposer en temps réel de toutes les données physiques et financières en matière d’action sociale.
M. le coprésident Pierre Morange. À ce propos, avez-vous un agenda précis des travaux relatifs au partage des données ? En effet, les interconnexions de fichiers permettent actuellement de contrôler l’éligibilité aux droits, mais non la juste attribution des allocations.
Mme Florence Lianos. S’agissant des rapprochements de fichiers, nous n’avons pas vraiment d’expertise – en tout cas pour ce qui concerne l’action sociale.
M. Philippe Didier-Courbin. Au cours des années précédentes, la CNAF a fait preuve d’une grande réactivité en adaptant son système d’information pour accompagner la mise en place du RSA, ainsi que la réforme de l’AAH avec le dispositif Cristal. La manière dont elle a géré tout cela a permis d’éviter des dysfonctionnements alors même que beaucoup d’interrogations subsistaient à propos de ces réformes – y compris sur le résultat précis à atteindre. Elle a su s’adapter à des choix politiques qui ont évolué au fil du temps : cela lui a demandé un travail très important et je dois dire que les relations entre elle et nous ont parfois été tendues, car nous avions à cœur les uns et les autres de respecter les délais.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous souhaiterions disposer du bilan de la dernière COG, afin d’avoir une idée précise des inflexions, quantitatives et qualitatives, qu’il faudra apporter dans la prochaine – et d’être en mesure de vérifier, le moment venu, qu’elles l’auront bien été.
M. Philippe Didier-Courbin. En matière d’accueil de la petite enfance, comme je l’ai dit, nous n’avons pas de souci majeur, le suivi ayant été satisfaisant.
Pour d’autres dispositifs, qui engagent d’ailleurs des financements moindres, je pense que le suivi s’attachera à vérifier que les nouvelles cibles – en termes de zones comme de publics – sont bien atteintes. Mais, pour l’instant, ces nouvelles cibles n’ont pas encore été arrêtées.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous avez surtout parlé de la politique familiale et de la prise en charge du jeune enfant, mais peu du RSA et d’autres prestations…
M. Philippe Didier-Courbin. Nous menons bien évidemment une réflexion sur le suivi du RSA et de l’AAH.
Pour l’AAH, nos interlocuteurs principaux ne sont pas les caisses : elles versent l’argent et nous n’avons pas d’exemples de difficulté particulière les concernant. L’essentiel du travail conduit depuis des mois est réalisé en amont, pour tenir compte de la modification des règles d’attribution et de l’évolution du montant de l’allocation qui a mécaniquement entraîné l’augmentation des publics touchés et, enfin, pour réfléchir aux conditions dans lesquelles les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les équipes techniques évaluent l’éligibilité à cette allocation.
Les travaux conduits dans le prolongement de la loi Blanc ont constitué une première étape. Il nous appartient à présent, à suite du changement de Gouvernement, de réfléchir à la nouvelle étape de la décentralisation, qui pourrait se traduire par une modification du statut des MDPH et donc des conditions dans lesquelles les droits sont attribués.
La réforme de l’AAH a conduit à une appréciation beaucoup plus fine qu’auparavant de la capacité de travail des personnes, ce qui a débouché sur une réglementation nouvelle. Nous venons, en lien avec la direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique, de fournir aux services déconcentrés de la cohésion sociale les outils nécessaires pour qu’ils puissent, d’une part, mesurer exactement les modifications que cette nouvelle réglementation va entraîner dans les conditions d’attribution de l’AAH, et, d’autre part, fournir eux-mêmes des éléments à leurs collègues des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ce qui est une nouveauté. En effet, les services en charge de l’action sociale n’intervenaient guère jusqu’ici pour éclairer les équipes techniques et les membres des commissions des droits sur les conditions dans lesquelles est attribuée l’AAH, notamment au titre de l’article 35-2 de la loi du 30 juin 1975 – c’est-à-dire pour les personnes dont le handicap est compris entre 50 % et 80 % et pour lesquelles il est difficile de faire la part entre ce qui est lié aux effets du handicap et ce qui tient à leur environnement économique.
Bref, des travaux sont lancés, des outils existent, des référentiels sont diffusés, mais tout cela concerne moins les caisses que les maisons départementales, les équipes techniques et les membres des commissions des droits.
M. le coprésident Pierre Morange. Il nous reste à vous remercier, madame, monsieur. Nous aurons certainement l’occasion de vous revoir une fois que la prochaine convention d’objectifs et de gestion aura été adoptée.
Audition de Mme Mireille Elbaum, présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale, et M. Laurent Caussat, secrétaire général
M. le coprésident Jean-Marc Germain. La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale travaillant depuis longtemps sur le financement de la branche famille, la Cour des comptes lui a récemment remis un rapport d’étape qui a vocation à être complété, compte tenu notamment de la saisine du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) par le Premier ministre, le 6 novembre dernier. La même question est posée : comment assurer un financement de la branche famille qui lui permette de répondre à sa vocation et qui ne handicape pas la compétitivité de l’économie ?
Nous allons demander à la Cour des comptes de compléter son étude selon les orientations que nous lui fixerons sous quinze jours. Au préalable, nous avons souhaité entendre Mme Mireille Elbaum, présidente du Haut Conseil, afin qu’elle nous fasse part des premières conclusions de ses travaux et de ses pistes de réflexion pour l’avenir.
Nous voulons que notre travail sur la branche famille constitue un apport complémentaire de celui des études en cours. Notre rapporteur sur le financement de la branche famille, M. Jérôme Guedj, étant également membre du HCFPS, nous espérons éviter les redondances et contribuer utilement aux décisions qui devront intervenir par la suite, notamment dans le cadre des futures lois de financement de la sécurité sociale.
M. le coprésident Pierre Morange. La présente audition va en effet nous servir à affiner notre commande à la Cour des comptes, dont le rapport nous sera remis en mars ou en avril prochain.
Nos calendriers de travail étant parallèles et nos objectifs communs, pouvez-vous préciser votre périmètre de réflexion et nous indiquer quels sont les sujets dont vous considérez qu’ils ne sont pas pertinents ?
M. Jérôme Guedj, rapporteur. La saisine du Haut Conseil par le Premier ministre vient conforter l’opportunité de nos propres travaux sur le financement de la branche famille.
Mme Mireille Elbaum, présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale. L’état des lieux du financement de la protection sociale, que nous avons présenté au Gouvernement le 31 octobre dernier, porte sur l’ensemble des branches, ou plus exactement des risques, et des régimes de la sécurité sociale. Il atteste que, en 2007 et 2008, la branche famille était en équilibre alors que des déficits subsistaient dans les autres branches.
Nos travaux se prolongeront jusqu’à l’automne 2013, selon une approche globale. Les projections de dépenses et de ressources seront établies à long terme. Pour répondre à la lettre de saisine du Premier ministre, nous allons nous efforcer de clarifier les principes de financement des branches, selon qu’elles abritent des politiques de solidarité nationale ou qu’elles sont plutôt tournées vers la prise en charge de droits individuels contributifs.
Cette distinction entre les notions de droits contributifs et de solidarité nationale emporte en effet d’importantes conséquences concrètes pour les négociations sociales et pour les décisions relatives au financement de la protection sociale.
Le concept de « contributivité » peut simplement viser les régimes d’assurance dont le financement est assuré par des cotisations professionnelles ou bien refléter l’étroitesse des liens entre les contributions versées et les droits ouverts. En découlent les notions d’universalité et de redistribution. C’est pourquoi la distinction traditionnelle entre assurance et solidarité nous semble à la fois contingente et discutable.
La clarification qu’il nous est demandé d’opérer va nous amener à mesurer l’impact redistributif des prélèvements et des prestations en nous interrogeant sur leur universalité, car l’assiette du financement des branches maladie et famille, sans rompre le lien avec le principe contributif, a été élargie à l’ensemble des revenus. On a également affecté à ces branches un certain nombre d’impôts et de taxes. Enfin, des dépenses à la charge des collectivités locales se sont traduites par de nouveaux recours à la fiscalité.
Le rapport d’étape que nous remettrons en avril ou en mai prochain comportera donc, pour les différents risques sociaux, des scénarios exploratoires d’évolution en fonction des constats que nous aurons établis sur la « contributivité » et sur la redistribution. Dans le cadre de cet exercice, nous ne nous pencherons pas spécialement sur la branche famille. Les problèmes de la protection sociale doivent être abordés globalement, si l’on veut tenir compte des spécificités de certains risques, comme ceux de la dépendance, ou de l’articulation entre chômage et exclusion. Dans bien des domaines, les frontières entre assurance et solidarité se sont avérées fluctuantes au gré des besoins de financement. Nous allons approfondir, sur le plan technique, les particularités des différents risques et les modalités de la redistribution sociale, mais toujours dans une perspective globale.
M. le coprésident Pierre Morange. Votre travail horizontal sur le financement de la protection sociale devant envisager différents scénarios, avec quel recul et selon quelle prospective entendez-vous les dérouler ? Nous avons en effet relevé quelques divergences entre l’option retenue par la Cour des comptes qui, inquiète d’un financement qu’elle qualifie de « brouillé » et de « fragile », étend sa perspective jusqu’en 2018 ou 2020, et celle de M. Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil de la famille (HCF) qui, plus serein en raison de la dynamique des produits et des charges, va jusqu’en 2025. Quel est votre propre terme ?
Mme Mireille Elbaum. Notre rapport d’étape, contenant des analyses historiques et institutionnelles, comportera aussi des comparaisons internationales en matière de redistribution et fera le point des ressources mobilisables, hors cotisations et contribution sociale généralisée (CSG), telles que les taxes environnementales et comportementales.
Nous engagerons parallèlement un exercice de projection, à moyen et à long terme, des besoins de financement. Des travaux sur ce thème auront alors été déjà remis, notamment par les autres hauts conseils, et nous ferons en sorte que les nôtres viennent les compléter. C’est ainsi que le Conseil d’orientation des retraites (COR) publiera ses propres projections le 19 décembre prochain, selon des hypothèses communes, sur la base desquelles les autres hauts conseils, dont le HCF, pourront s’appuyer. Le travail le plus lourd ressortira bien sûr de la branche maladie.
Je souhaite que, dans un souci d’homogénéité avec les travaux du Comité de politique économique européen, l’ensemble de ces projections vise l’horizon 2060, avec des étapes probablement décennales, en tout cas pour les risques vieillesse et santé, car il faut bien reconnaître que l’exercice est plus difficile pour la branche famille, puisque les dépenses résulteront de naissances à venir. La réunion du Haut Conseil qui se tiendra le 21 décembre prochain devrait lancer cette opération.
En juin 2013, nous examinerons les projections faites par le COR et nous en discuterons avec les partenaires sociaux. La question des intervalles de projections sera également abordée. Puis nous laisserons travailler le HCF et le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), avant de procéder, à moyen comme à long terme, aux additions en fonction des différents scénarios retenus, c’est-à-dire à leur agrégation. Cela permettra de dégager le futur profil de l’ensemble de la protection sociale. Il nous reviendra aussi de procéder, dans un souci de cohérence, à des projections particulières dans les secteurs ne disposant pas d’un haut conseil, tels la dépendance, le chômage et l’exclusion.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Certes, mais quand finirez-vous vos travaux ?
Mme Mireille Elbaum. À l’automne 2013. Ce sont les branches maladie et vieillesse qui posent les plus grandes difficultés dans la réalisation d’une synthèse générale, car il faut prendre en compte bien des éléments incertains, telles l’évolution du chômage et celle de la morbidité, et envisager une palette particulièrement large de scénarios possibles en fonction de l’évolution des dépenses hospitalières, qu’elles soient prises en charge par l’assurance maladie de base ou par les assurances complémentaires.
Le COR ayant alors produit ses scénarios, les projections relatives à la branche famille devraient être établies au premier trimestre 2013 sur la base des nouvelles hypothèses arrêtées en commun et permettre ainsi au HCFPS de procéder à l’agrégation voulue de façon transversale : il n’est pas question d’ajouter une superstructure de plus pour cela.
Nous espérons, en nous fondant sur la lettre du Premier ministre, clarifier le fait que, si le financement de la branche famille dépend moins des cotisations sociales et davantage de la CSG, cela n’implique pas forcément un allégement des cotisations des employeurs. On a eu tendance, en effet, à confondre le projet de TVA sociale du précédent gouvernement et une réduction des charges sociales. Le gouvernement actuel a proposé un allégement des cotisations, à hauteur de 20 milliards d’euros, par la voie fiscale. Cela doit-il se traduire, pour la branche famille, par un allégement supplémentaire ? Oui, si l’on a recours à d’autres types de recettes, par exemple une augmentation de la CSG ; non, si l’on vise la neutralité du partage des charges entre les entreprises et les ménages. Seule la réduction des cotisations pesant sur les employeurs peut avoir un effet macro-économique, faute de quoi il ne s’agit que de modifications institutionnelles et juridiques.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Tout cela confirme ce que je dis depuis longtemps. Ce n’est pas une réforme du financement de la protection sociale qu’il faut faire, mais deux : celle des cotisations salariales et celle des cotisations patronales. Dans ces conditions, avec le crédit d’impôt, les partenaires sociaux peuvent craindre de perdre leur contrôle sur la sécurité sociale.
M. le rapporteur. Vous interdisez-vous de réfléchir à une budgétisation, au moins partielle, des dépenses de la branche famille ?
Mme Mireille Elbaum. Nous ne nous interdisons rien a priori mais la notion de budgétisation me semble relativement imprécise au regard des impôts et taxes déjà affectés à la branche famille. Cela nous renvoie aussi, une fois de plus, à la nature juridique de la CSG, entre impôt et cotisation obligatoire. Mais les partenaires sociaux, que nous n’avons pas encore consultés sur ce point, ont probablement des points de vue disparates. Il n’en reste pas moins que l’universalisation du financement des charges de la branche famille va de pair avec un élargissement de l’assiette des financements à l’ensemble des revenus.
Jusqu’ici, on a plutôt réservé la budgétisation à des charges considérées comme relevant de la solidarité et non pas de l’assurance.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous savons bien que le financement de la protection sanitaire et sociale repose sur des mécanismes complexes faisant largement appel aux vases communicants entre branches comme entre régimes.
Je voudrais revenir sur ma question initiale : vous interdisez-vous certaines pistes de réforme du financement de la protection sociale ?
Établirez-vous des comparaisons européennes ?
Mme Mireille Elbaum. Les membres du Haut Conseil peuvent tout évoquer à leur guise. Mais nous souhaitons prendre le temps nécessaire à une réflexion en profondeur, incluant les éléments historiques de la protection sociale, notamment de la branche famille, et les comparaisons européennes en matière de solidarité sociale.
Les scénarios exploratoires que nous établirons au printemps prochain pour les différentes branches appelleront d’autres demandes de la part des partenaires sociaux. Nous pourrons alors dessiner un panorama des positions prises par les uns et par les autres, qui retraceront inévitablement certaines divergences.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. La présentation de scénarios à moyen et long terme en mai prochain sera-t-elle suivie d’une phase de préconisations concrètes ?
Mme Mireille Elbaum. Nous traçons des perspectives, en fonction des scénarios correspondants, puis nous approfondissons certaines hypothèses. Élaborer des préconisations susceptibles d’inspirer le Gouvernement ne relève pas directement du rôle du HCFPS. Nous nous limitons, comme le COR, à éclairer les données du débat afin de faciliter les décisions du Gouvernement et du Parlement.
M. le coprésident Pierre Morange. J’observe cependant que la lettre du Premier ministre du 6 novembre dernier vous demande de formuler des préconisations « sur les options d’évolution des assiettes de financement des différents risques ».
Essayant de rattraper un certain retard en matière de réflexion stratégique sur le financement de la protection sanitaire et sociale, il serait bon que ces préconisations soient connues suffisamment en avance sur le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Mme Mireille Elbaum. Les différents hauts conseils feront connaître leurs projections en temps voulu. Nous agrégerons ensuite les données qui en résulteront.
M. Laurent Caussat, secrétaire général du Haut Conseil du financement de la protection sociale. La troisième des quatre missions figurant dans le décret du 20 septembre 2012 relatif au HCFPS consiste à « examiner l’efficacité des règles de gouvernance et d’allocation des recettes de l’ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ». De tels termes nous octroient une grande marge de manœuvre tout en laissant entendre que nous devons nous situer dans le cadre du système existant.
Mme Mireille Elbaum. Ma prudence provient de ce qu’il revient aux membres du HCFPS de décider quelles hypothèses ils souhaitent examiner et, éventuellement, retenir. Mais les différences d’appréciation qu’ils ont déjà exprimées rendent évidemment aléatoire le dépôt de préconisations de la part de l’institution sur la réforme du financement de la protection sociale. Les différents scénarios prospectifs feront inévitablement l’objet de divergences. Comme le COR pour les retraites, nous nous limiterons donc probablement à mettre en évidence des besoins de financement ainsi que certains problèmes particuliers, avant de procéder, par la suite, à l’évaluation des réformes intervenues entre-temps. N’attendons pas des hauts conseils qu’ils donnent plus que ce qu’ils ont.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Pourriez-vous cependant étudier l’idée d’un transfert des cotisations patronales sur une cotisation à la valeur ajoutée (CVA) ?
Mme Mireille Elbaum. La lettre du Premier ministre encadre notre mission selon le principe de neutralité du partage des charges entre les ménages et les entreprises. L’étude de la CVA, que demanderont probablement les partenaires sociaux, pourrait s’y insérer. Mais elle a déjà été réalisée en 2006 par l’administration, à la demande du Président de la République de l’époque. Nous pourrons bien sûr vérifier si elle reste d’actualité. Elle portait notamment sur l’opportunité de transferts sectoriels, sur la prise en compte spécifique des très petites entreprises, enfin sur le problème plus global de la taxation du capital. Certains partenaires sociaux ont évoqué de nouveau les pistes ainsi tracées.
M. le coprésident Pierre Morange. Il y eut également, en 2010, un rapport de notre collègue Yves Bur sur le financement de la politique de la famille, qui comportait des scénarios de transfert de financements.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire général, nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions.
Audition de M. Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, et M. Hervé Drouet, directeur
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Mes chers collègues, nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui M. Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), et M. Hervé Drouet, directeur, accompagnés de Mme Patricia Chantin, chargée des relations avec le Parlement.
Le Haut Conseil du financement de la protection sociale a remis fin octobre au Premier ministre une note dressant un état des lieux du financement de la protection sociale en France. Sa présidente, Mme Mireille Elbaum, que nous avons auditionnée la semaine dernière, nous a fait part du calendrier à venir : une première étape au mois de mai verra le recensement des prestations contributives et non contributives, et pour les premières l’analyse de leur caractère redistributif ; une deuxième étape en novembre apportera des projections cohérentes à moyen et long termes. La MECSS, pour sa part, devra présenter les moyens permettant d’assurer la stabilité du prélèvement afin de couvrir les besoins des familles, de rendre celui-ci non pénalisant pour la compétitivité de notre pays, et enfin de garantir sa cohérence avec la nature des prestations.
Nos auditions précédentes ont mis en évidence un déficit structurel de la branche famille, mais un excédent à l’horizon 2020, ainsi qu’une évolution du financement de cette dernière vers la fiscalité.
Enfin, la question de la gouvernance se heurte à celle relative à la compétitivité, les partenaires sociaux ayant réaffirmé à maintes reprises leur attachement aux prélèvements sur les revenus du travail.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans le prolongement de son rapport d’étape, la Cour des comptes nous remettra un rapport définitif au mois d’avril. Si cette dernière note « un financement brouillé et fragilisé » de la branche famille, M. Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil de la famille, prédit un retour à l’équilibre financier vers 2017-2018 et un excédent à l’horizon 2025.
Nous aimerions vous entendre sur la gouvernance, sur les systèmes informatiques, ainsi que sur les marges de manœuvre budgétaires au regard de la rationalisation indispensable de la dépense publique, sachant en particulier, comme l’a souligné M. Bertrand Fragonard, « qu’un enfant sur cinq vit dans une famille pauvre » dans notre pays aujourd’hui.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. La MECSS souhaite connaître la position de la CNAF sur le financement de la branche famille : ses évolutions récentes, ses éléments de fragilité, mais aussi la piste évoquée consistant à faire porter la politique familiale par le budget de l’État. Enfin, nous pourrions aborder l’épineuse question de la certification des comptes de la branche famille.
M. Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). La branche famille de la sécurité sociale trouve son origine dans le versement d’un sursalaire aux travailleurs ayant des charges de famille. Le but originel des prestations familiales est de garantir, aux couples avec des enfants à charge, un niveau de vie identique à celui des couples sans enfant.
Durant les quarante premières années de son existence, le budget de la branche famille était équilibré, voire excédentaire grâce à la revalorisation des recettes assises sur les salaires et l’indexation des prestations familiales sur les prix. Ces excédents ont permis de revaloriser des prestations, et même d’en créer de nouvelles – la dernière en date étant la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Les dépenses pouvaient alors être supérieures aux recettes, car l’équilibre financier était rétabli à moyen terme. Au final, la branche famille affichait sur la durée un solde nul.
Dans la mesure où elle était excédentaire, la branche famille a contribué par la suite au financement d’autres branches de la sécurité sociale qui, elles, étaient déficitaires. C’est ainsi qu’elle a financé une succession de dépenses nouvelles et, en premier lieu, celles du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour le financement de la majoration de pensions pour enfants, d’abord à hauteur de 50 %, puis de 70 %, et enfin à 100 % lorsqu’elle est revenue à l’équilibre. Ainsi, le déficit de 2,6 milliards d’euros de la branche famille correspond au montant qui était à la charge du FSV.
En définitive, si la branche famille n’avait pas connu une progression de ces transferts vers d’autres branches, elle serait encore à l’équilibre. Dans ce contexte, la question fondamentale est de savoir ce que doit financer la branche famille et quels sont ses objectifs. En effet, si elle fait des efforts pour être à l’équilibre, va-t-on lui demander des efforts supplémentaires ? Le financement de la majoration de pensions pour enfants se comprend, mais la branche devra-t-elle contribuer, par exemple, à l’assurance maladie des grands-parents ?
Actuellement, les deux tiers des ressources de la branche proviennent des cotisations assises sur les salaires, le taux de cotisation patronal étant de 5,4 %. Cette construction a un sens pour le conseil d’administration, même si les organisations patronales mettent en avant le poids que représentent les cotisations sociales pour les entreprises et donc sur la compétitivité. Après la tentative de TVA sociale, un autre dispositif devrait être créé. Mais lequel ?
La part d’impôt dans le financement de la branche famille se justifie par le caractère universel des allocations familiales. D’où la légitimité de l’apport de la contribution sociale généralisée (CSG). Toutefois, la branche a vu la part de CSG dont elle était bénéficiaire amputée au bénéfice de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). En compensation, la CNAF a bénéficié de nouvelles taxes. Au final, où est la lisibilité ? Si les pouvoirs publics assignaient des objectifs clairs à la branche famille, en évitant des changements incessants de financement, celle-ci pourrait construire un système pérenne et revenir à l’équilibre.
Aujourd’hui, la branche famille se caractérise par son universalité et son unicité, même si certaines entreprises telles que les industries électriques et gazières, la SNCF et la RATP, dont le taux de cotisation est inférieur au droit commun, continuent à gérer les prestations de leurs bénéficiaires. Cela dit, le taux de cotisation des premières passera de 5,2 % à 5,4 % au 1er janvier 2013.
Un des objectifs de la branche famille est de favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Pour autant, les foyers dont les revenus sont très élevés ont-ils réellement besoin de 120 euros tous les mois au titre des allocations familiales ? La branche famille doit-elle privilégier les familles pauvres, sachant qu’il existe des prestations sous condition de ressources ? Au sein du conseil d’administration de la CNAF, certaines organisations syndicales de salariés prônent une action sociale concentrant les aides sur les familles les plus vulnérables, d’autres préconisent de conserver le caractère universel de la branche. Ces questions méritent d’être posées au regard de la fixation des orientations et du financement de la branche famille.
Pour notre part, nous souhaitions la création d’un conseil d’orientation des politiques familiales, qui aurait permis avec l’ensemble des acteurs – parlementaires, associations familiales, etc. – de définir les orientations de la politique familiale. Finalement, c’est un Haut Conseil de la famille qui a été installé, dont l’action est davantage axée sur la dimension financière.
Dans ce contexte, le conseil d’administration de la CNAF prend acte des évolutions. Certes, nous avons accueilli favorablement la revalorisation de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), car cette dépense de 386 millions d’euros est destinée à améliorer la situation des familles. Néanmoins, son versement à l’ensemble des familles concernées est-il la bonne solution ? Ne conviendrait-il pas d’adapter les sommes versées au coût réel de la scolarité, qui diffère entre un jeune scolarisé dans un lycée professionnel par rapport à un élève de primaire qui va à l’école de son quartier et pour lequel les parents ont moins de frais en termes de déplacements, de restauration scolaire et d’hébergement ? En la matière, nous souhaiterions être associés aux orientations qui sont prises plutôt qu’être mis devant le fait accompli.
La compétitivité des entreprises sera améliorée, nous dit-on, si les cotisations assises sur les salaires, qui représentent 66 % des recettes de la branche famille, sont supprimées. N’oublions pas néanmoins que les petites entreprises bénéficient d’ores et déjà d’une exonération, compensée par l’État. Aussi la suppression du principe des cotisations, et donc la suppression des compensations d’exonérations par l’État, aura-t-elle pour conséquence de faire supporter par les familles – probablement par la CSG ou d’autres taxes – ce que les entreprises ne payent plus. Pour la CNAF, le fait que les entreprises soient parties prenantes dans le financement de la branche famille à tout son sens. En effet, au travers des prestations financières et des aides à la parentalité, en particulier en matière d’accueil des jeunes enfants, la politique familiale permet aux salariés de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Enfin, dans son rapport d’étape de novembre 2012, la Cour des comptes parle d’un « financement brouillé » de la branche famille. Pour ma part, je dirai qu’il est plutôt obscur au vu des éléments que je viens de souligner.
M. Hervé Drouet, directeur de la CNAF. Dans son rapport, la Cour des comptes souligne une fragilisation des équilibres financiers de la branche en raison, d’une part, du brouillage de sa structure de financement et, d’autre part, de l’accélération du rythme de progression des charges. Notre analyse n’est pas tout à fait celle-là. Selon M. Bertrand Fragonard lui-même, président du Haut Conseil de la famille, le mécanisme d’équilibre joue à long terme dès lors que la dynamique des dépenses est liée aux évolutions démographiques, même si les aides sont concentrées sur les enfants de moins trois ans. En effet, les recettes étant indexées sur la richesse nationale et les prestations sur l’inflation, le différentiel entre le rythme naturel de progression des charges et le rythme naturel de progression des dépenses permet à la branche famille de rester structurellement excédentaire à dépenses constantes. En réalité, ce qui pèse sur le solde de la branche aujourd’hui, c’est l’affaissement des recettes dû à la crise économique, mais surtout l’affectation de dépenses nouvelles en vertu des choix des pouvoirs publics, qui ne correspondent pas forcément aux priorités qu’aurait souhaitées le conseil d’administration de la CNAF pour la branche.
Depuis l’origine, la politique familiale de notre pays est caractérisée par une grande continuité. Selon nous, elle doit s’appuyer sur un financement stable pour pouvoir s’inscrire dans la durée et jouer sur la structuration des comportements – le choix d’avoir un enfant est un choix structurant dans un modèle de vie.
Une des caractéristiques de la sécurité sociale est de bénéficier de recettes affectées : historiquement les cotisations, auxquelles s’est ajoutée en 1991 pour la branche famille la CSG, ressource très dynamique assise majoritairement sur les revenus d’activité. Or cette force de notre modèle de financement est mise à mal par le développement d’une fiscalisation forte mais fragmentée de la branche au travers d’une multiplication de recettes d’appoint peu lisibles et, surtout, dépendantes d’assiettes assez fragiles, dont certaines ont même vocation à disparaître. Il en résulte qu’il faut se reposer chaque année la question de la réaffectation de nouvelles recettes. Cette situation est préoccupante au regard de la stabilité nécessaire au financement de la branche famille.
C’est la raison pour laquelle la pertinence de l’éternel débat sur le financement de la politique familiale par le budget de l’État m’échappe. En effet, si l’on considère que cette politique doit être conduite dans la durée et bénéficier de financements pérennes et suffisamment dynamiques, son financement par dotations budgétaires impliquerait chaque année un débat et un vote en loi de finances sur le montant des ressources de la branche famille, ce qui conduirait à les fragiliser. Pour la CNAF, comme pour la direction de la sécurité sociale (DSS), qui partage notre analyse, l’affectation de recettes est plus sécurisante pour le financement de la politique familiale, mais également plus responsabilisante pour les opérateurs en termes de pilotage.
M. le coprésident Pierre Morange. La Cour des comptes ayant évoqué les systèmes d’information de la sécurité sociale dans son rapport de septembre 2012, pouvez-vous nous parlez du vôtre ?
M. Hervé Drouet. Les règles d’indexation, le ciblage et l’éligibilité des dépenses relèvent de décisions politiques. Il incombe ensuite aux caisses d’allocations familiales (CAF) d’appliquer au mieux la réglementation au titre de l’accès aux droits, tout en s’attachant à maîtriser les risques financiers attachés à la gestion de masses financières considérables, qui s’élèvent à 76 milliards d’euros.
M. le coprésident Pierre Morange. Votre qualité de gestionnaire ne vous interdit pas, certes, de mener des réflexions stratégiques. Néanmoins, dans une logique de rationalisation et d’optimisation de la dépense publique, quels moyens pourraient constituer des marges de manœuvre supplémentaires dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (COG) ?
Au regard de l’extrême complexité de notre système de protection sociale, la Cour des comptes a souligné la nécessité pour la branche famille d’améliorer les systèmes d’information par la dématérialisation des processus, afin d’assurer un versement des prestations à la hauteur définie par la Représentation nationale. Pourriez-vous nous parler du système d’information dénommé « mainframe », qui date des années quatre-vingt. Quel en est le coût annuel pour la branche famille ?
M. Hervé Drouet. Il faut distinguer plusieurs sujets : le traitement des prestations par les agents liquidateurs, les démarches des usagers en lien avec les autres services publics et l’obtention d’informations de la branche famille par nos partenaires.
Le rapport de la Cour des comptes constate que la branche famille dispose d’un système d’information qui répond aux finalités qui lui sont assignées et qui a su évoluer dans des délais rapides pour ce qui concerne des prestations récentes. Ainsi, le revenu de solidarité active (RSA) a été mis en place dans des délais record : la loi a été votée en décembre 2008 et les premiers paiements sont intervenus le 5 juillet 2009. Je pense que très peu de grandes organisations sont capables de déployer un projet informatique de cette ampleur.
La départementalisation du réseau des CAF a été parfaitement maîtrisée, alors que tous les domaines applicatifs ont été fusionnés – bases allocataires, bases comptables, bases logistiques.
Nous développons des fonctionnalités sur internet, en particulier avec « caf.fr », ce qui nous a amenés à réécrire les deux tiers de notre applicatif principal de traitement des prestations, dénommé « Cristal ». Ainsi, notre applicatif unique nous permet de traiter l’ensemble des prestations, mais il est extrêmement lourd dans la mesure où il incorpore 17 000 règles de gestion pour 19 prestations, la plupart sous condition de ressources, à destination de 11 millions d’allocataires et 30 millions d’ayants droit. D’ailleurs, en dépit de leur lourdeur au regard du nombre d’allocataires et de la complexité des prestations gérées, la performance des systèmes d’information de la sécurité sociale est indéniable dans la mesure où aucun incident majeur ne les a affectés jusqu’à présent.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est le coût annuel du système d’information pour la branche famille ?
M. Hervé Drouet. Compte tenu de notre charge de travail, en très forte croissance du fait de la fragilisation des allocataires par la crise économique, nous avons besoin d’un système productif permettant aux techniciens conseils d’exécuter les tâches le plus rapidement possible et avec le maximum de fiabilité au regard de la maîtrise des risques financiers.
Pour être productif aujourd’hui, il faut être capable de dématérialiser le traitement à la source, c’est-à-dire de récupérer directement une donnée certifiée auprès de nos partenaires – comme nous le faisons avec la direction générale des finances publiques (DGFIP) pour les ressources et avec IDEAL (intégration des demandes d’aides au logement), instrument de demande d’aide au logement en ligne mis à la disposition des gros bailleurs –, mais aussi d’offrir des téléprocédures aux allocataires, ce que nous faisons avec le site « caf.fr ».
Conformément aux règles de droit, nous avons besoin d’informations de nature différente pour calculer une prestation. Or nous ne pouvons jamais collecter des informations exhaustives auprès d’un tiers professionnel, comme l’assurance maladie peut le faire avec SESAM-Vitale. Nous devons toujours les collecter directement auprès de l’allocataire. Or ces informations ne sont pas toujours dématérialisables – le papier ou le contact physique est encore nécessaire – et, surtout, elles peuvent donner lieu à des corrections. Ce problème de maîtrise des risques est propre à la branche famille.
Enfin, la gestion de l’ensemble des organismes de sécurité sociale et des différentes parties prenantes doit également être optimisée. C’est toute la problématique du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) et des plateformes d’échanges que nous avons montées avec les départements pour le RSA.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous nous confirmez que la CNAF est désormais interconnectée avec les départements pour le RSA ?
M. Hervé Drouet. Oui.
M. le coprésident Pierre Morange. Et pour l’ensemble des prestations sociales des différentes collectivités territoriales ?
M. Hervé Drouet. Non.
Le fichier commun des organismes de protection sociale nous permet, à partir des identités certifiées, de vérifier les prestations touchées par chaque allocataire et ensuite, dans une logique de portail, de consulter le système du gestionnaire pour obtenir les données relatives au compte de l’allocataire.
De plus, nous avons mis en place avec les départements une plateforme d’échanges relative aux données de gestion du RSA : ceux-ci se connectent sur un extranet et récupèrent toutes les informations nécessaires à leur propre gestion.
Enfin, notre dispositif CAFPRO permet à des professionnels extérieurs de se connecter sur notre système pour faire des requêtes individuelles. Cette habilitation est ouverte à tout professionnel de collectivité. Par contre, les croisements de fichiers des collectivités locales ne sont pour l’instant pas possibles.
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS ne nie pas la complexité du système de la CNAF, qui a su faire preuve d’une capacité d’adaptation remarquable s’agissant du RSA. Ce qu’elle veut connaître, c’est le coût du système actuel. En outre, des réflexions sont-elles menées sur les systèmes alternatifs, dits « systèmes ouverts », jugés par certains moins onéreux ?
M. Hervé Drouet. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes a critiqué l’organisation territoriale de nos systèmes d’information. Ces critiques sont déjà prises en compte au travers de projets visant à regrouper les centres de production sur les différents domaines applicatifs. Cette gestion des personnels nous permet de déployer des techniciens attachés à la production vers des fonctions de conception, de développement et d’accompagnement de projet. Ce travail de concentration de nos filières de production devra être soutenu dans le cadre de la prochaine convention d’objectifs et de gestion.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Monsieur le directeur, vous n’avez toujours pas répondu à la question du coût !
M. Hervé Drouet. La branche famille utilise la technologie mainframe, avec deux filières centrales pour deux opérateurs, Bull et IBM. Ce choix remonte à la mise en place du dispositif Cristal, c’est-à-dire à la fin des années quatre-vingt-dix. Auparavant, les systèmes d’information étaient régionaux. Cette nationalisation de l’informatique sur la base de la technologie mainframe a été réalisée dans les autres univers publics. Nous avons lancé une réflexion pour évoluer vers l’open source afin d’optimiser la production.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est le coût de mainframe pour la branche famille ?
M. Hervé Drouet. Je vous communiquerai ultérieurement le plan d’équipement informatique…
M. le coprésident Pierre Morange. Une trentaine de millions d’euros, comme je l’ai entendu dire ?
M. Hervé Drouet. C’est à peu près cela.
M. le coprésident Pierre Morange. Pour les systèmes ouverts, le montant serait-il du même ordre ou bien moindre ?
M. Hervé Drouet. Les systèmes ouverts sont beaucoup moins coûteux puisque ce ne sont pas des systèmes propriétaires. Les expertises devront en affiner le montant au regard de la problématique du basculement d’un système vers un autre.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce montant sera-t-il deux fois moindre, six fois moindre… ?
M. Hervé Drouet. Cela dépendra des options retenues. L’expertise n’est pas achevée.
M. le coprésident Pierre Morange. Lancerez-vous une procédure de dialogue compétitif ?
M. Hervé Drouet. Oui.
M. le coprésident Pierre Morange. Et pourquoi un dialogue compétitif plutôt qu’un appel d’offres ?
M. Hervé Drouet. La décision n’est pas encore prise. Ces sujets seront traités dans le cadre de la prochaine COG. Nous expertisons actuellement les différentes options possibles pour lancer ensuite un appel au marché dans les meilleures conditions.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans quels délais ?
M. Hervé Drouet. D’ici à la prochaine COG, qui devrait être finalisée au premier trimestre de l’année prochaine.
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS souhaiterait que vous lui communiquiez par écrit le coût du système d’information de la CNAF.
M. le rapporteur. La budgétisation des recettes de la branche famille risquerait, selon vous, de fragiliser ces dernières. Pensez-vous que ce serait le cas pour les allocations logement et le RSA ?
M. Jean-Louis Deroussen. Le RSA est cofinancé par les départements et l’État et versé par les CAF. Ces dernières sont-elles de simples guichets ou peuvent-elles se voir confier le soin d’accompagner le versement ? La question se pose.
M. le rapporteur. Je peux le comprendre pour les prestations sous condition de ressources, mais plus difficilement pour les allocations familiales.
M. Jean-Louis Deroussen. Je pense à tous les services complémentaires liés au versement des prestations, sachant que la famille doit être envisagée dans sa globalité. En effet, il n’est pas nécessaire d’être pauvre pour être en situation de rupture familiale ou pour avoir besoin d’un service d’accueil du jeune enfant. Le versement d’un minimum social ou d’une prestation familiale devrait être accompagné d’une offre de services. Cette dimension de l’accompagnement va au-delà du simple versement financier.
Mme Isabelle Le Callennec. Dans votre propos liminaire, vous avez indiqué que les priorités des pouvoirs publics ne sont pas forcément celles que vous auriez retenues. Quelles seraient vos priorités ?
De plus en plus de prestations sont accordées sous condition de ressources. S’agit-il d’une tendance lourde due aux effets de la crise et à l’augmentation de la pauvreté ? Peut-on imaginer que toutes les prestations seront, à terme, versées sous condition de ressources ?
M. Jean-Louis Deroussen. Le conseil d’administration de la CNAF dans son ensemble est très attaché au caractère universel des allocations familiales.
Par contre, nous aurions souhaité débattre dans le cadre d’une réflexion approfondie sur l’allocation de rentrée scolaire, afin que les besoins soient mieux ciblés en fonction de la situation des familles et du type de scolarité.
De la même manière, il ne serait pas inintéressant de réfléchir à une meilleure solvabilisation en matière d’allocations logement, sachant que le coût pour se loger diffère considérablement entre Paris et la province, et d’aides au logement pour les étudiants, qui sont versées quelles que soient les ressources des parents.
Bref, profitons de la connaissance du terrain acquise par les administrateurs des CAF pour rendre plus efficiente la fourniture de nos prestations.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Messieurs, je vous remercie.
Présentation du rapport définitif de la Cour des comptes à la MECSS sur « le financement de la branche famille » : M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, M. Michel Braunstein, conseiller maître, et M. Noël Diricq, conseiller maître
M. le coprésident Pierre Morange. Nous accueillons ce matin M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, M. Michel Braunstein, conseiller maître, et M. Noël Diricq, conseiller maître.
Je vous souhaite la bienvenue, messieurs, et vous remercie d’avoir accepté de nous présenter le rapport définitif de la Cour des comptes sur le financement de la branche famille. Vous nous direz quelles sont les hypothèses d’évolution du financement de la famille et évoquerez les neufs scénarii de transfert que vous avez étudiés.
M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes. Nous nous trouvons une nouvelle fois devant vous pour évoquer le financement de la branche famille. Après avoir dans un premier temps établi un état des lieux, nous avons, à votre demande, examiné la combinatoire entre le financement de la branche famille, la politique des allégements de charges et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), étudié un certain nombre de scenarii de transfert et envisagé l’hypothèse de la budgétisation en examinant les avantages et les inconvénients de ce scénario alternatif.
Le financement de la branche famille a connu d’importantes évolutions depuis le début des années 1990 puisqu’il se trouvait au cœur des réformes successives du financement de la protection sociale. La branche famille a été très directement concernée par la création de la contribution sociale généralisée (CSG), qui s’est traduite par d’importants transferts de financement des entreprises vers les ménages, et, dès 1993, elle a été la première touchée par la politique d’allégement de charges sociales.
Ces mesures ont entraîné la baisse de la part relative du financement direct de la branche famille par les entreprises sur une longue période – cette part est actuellement stabilisée aux environs de 64 %. La participation réelle des entreprises est inférieure à ce que les chiffres laissent apparaître. Le taux de 5,4 %, qui est maintenu, ne correspond pas à la réalité. Les entreprises du secteur privé financent la branche à hauteur de 23 milliards d’euros – en laissant de côté la participation des administrations publiques et des travailleurs indépendants. La réalité est donc plus obscure que l’apparence et c’est ce que nous avons cherché, dans un premier temps, à mettre en lumière.
À ce dispositif d’allégement des charges – qui consiste à faire varier le taux réel de la cotisation famille, selon le niveau du salaire, entre 0 et 5,4 %, ce qui l’apparente à un dispositif social – a été récemment superposé un dispositif fiscal : le CICE.
Mais ces mécanismes d’égale puissance, qui représentent l’un et l’autre près de 20 milliards d’euros, ne couvrent pas exactement les mêmes périmètres. Le premier s’applique aux salaires inférieurs à 1,6 SMIC et le second aux salaires inférieurs à 2,5 SMIC, et leurs modes de financement sont très différents. La politique d’allégement des charges est financée par l’attribution à la protection sociale, à titre définitif, d’un panier de taxes et d’impôts affectés, tandis que le CICE fait l’objet d’un financement budgétaire qui sera équilibré par des économies, une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et un nouveau recours à la fiscalité environnementale.
Sous un angle purement économique, dès lors qu’il couvre expressément et spécifiquement le financement de la branche famille, nous pourrions considérer que le CICE répond à la question de la charge qui pèse sur les entreprises. Mais ce n’est qu’une hypothèse d’école puisque le CICE, à la différence du dispositif d’allégement de charges, n’est pas affecté à la prise en charge d’un type de cotisation spécifique.
La question de la suppression de toute participation directe des entreprises au financement de la branche famille doit être parfaitement éclairée au regard de la diversification accrue des objectifs de la politique familiale, en particulier celui de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Cet objectif, l’un des quatre définis par la loi de financement de la sécurité sociale comme devant être ceux de la politique familiale, mobilise de plus en plus de moyens de la part de la branche famille ainsi que des moyens budgétaires par le biais de la dépense fiscale.
Nous avons étudié les sommes que représentent les prestations qui concourent directement à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle en partant de deux hypothèses : toutes deux montrent que 10 à 15 milliards d’euros sont consacrés directement à cet objectif important pour les entreprises.
Ce point mérite une analyse approfondie car la question d’un allégement complémentaire des charges pesant sur les entreprises se pose différemment selon la manière dont il est traité, la contribution des entreprises pouvant passer par des prélèvements généraux – c’est le cas de la formation initiale – ou par le versement de cotisations affectées – le versement transport, ou encore l’action en faveur du logement – par le biais desquelles les entreprises participent à des politiques nationales dont elles sont les bénéficiaires directes.
Nous avons donc cherché dans un premier temps à éclairer la participation des entreprises au financement de la branche famille, le nouveau contexte né de la création du CICE, et la légitimité – ou l’illégitimité – de la contribution des entreprises au financement de la branche famille au regard des objectifs de celle-ci. Dans un deuxième temps, nous avons étudié différents scénarii de transfert de l’assiette de ce financement.
Le premier scénario maintient le financement par les entreprises mais en modifie l’assiette, qui ne serait plus la masse salariale mais la valeur ajoutée. Nous avons étudié ce scénario en nous basant sur l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui a été substituée à la taxe professionnelle.
Le deuxième scénario transfère le financement sur la TVA, ce qui revient à le faire supporter par d’autres agents économiques que l’entreprise.
Le troisième scénario bascule le financement sur la CSG.
Le quatrième scénario prévoit le recours à la fiscalité environnementale.
Ces différentes assiettes ont en commun un certain nombre de caractéristiques. Le prélèvement de substitution doit en effet avoir une certaine dynamique, en lien avec celle des prestations, son assiette doit être assez large pour permettre un rendement élevé à faible taux et son recouvrement doit être aisé – il ne s’agit pas d’ajouter des complexités à un système social déjà très complexe.
Nous avons demandé à la direction générale du Trésor (DGT) du ministère de l’économie d’étudier différents scénarii pour ces quatre prélèvements correspondant à des transferts compris entre 6 et 23 milliards d’euros. La DGT a utilisé MESANGE (modèle économétrique de simulation et d’analyse générale de l’économie) pour parvenir à ses conclusions qui montrent qu’il n’existe pas d’« assiette miracle ».
L’élargissement des cotisations des entreprises à la totalité de la valeur ajoutée sous forme d’une cotisation additionnelle à la CVAE, ce qui a été mis en place en Italie, aurait un effet peu significatif sur l’emploi. En outre, en pesant sur l’investissement, elle pourrait dégrader à long terme la croissance potentielle de l’entreprise.
Le basculement sur la TVA, qui a été partiellement mis en œuvre en Allemagne, aurait un effet récessif sur la consommation – qui ne serait pas compensé par un recul des importations – et peu d’effets sur l’emploi.
Le transfert sur la CSG, quant à lui, pourrait avoir des effets positifs, mais ceux-ci seraient d’autant plus importants que ce transfert est ciblé sur les bas salaires.
Enfin, l’instauration d’une taxe sur l’énergie, comme cela a été fait en Suède, aurait des effets limités mais néanmoins plus favorables que le basculement sur la TVA.
Il apparaît qu’aucune de ces simulations ne permet de mettre en lumière un prélèvement de substitution qui aurait un impact significatif sur la croissance et sur l’emploi. Seule une diminution, non entièrement compensée, des cotisations à la charge des employeurs aurait un tel impact. Mais tous ces scénarii, quels qu’ils soient, exigent une maîtrise rigoureuse de la dépense et un effort méthodique d’efficience.
Quant à la budgétisation, elle permet une approche consolidée plus cohérente de la politique familiale, en particulier au regard de l’articulation des dépenses fiscales et des prestations familiales. Sur le plan technique, c’est une opération relativement simple qui ne rencontre pas d’obstacles majeurs, ni juridiques ni financiers.
En revanche, ses inconvénients ne sauraient être sous-estimés. En effet, dans la mesure où elle remet en cause le modèle de sécurité sociale hérité de 1945, qui a intégré la politique familiale dans le champ de la sécurité sociale, elle nous invite à nous poser la question du caractère limitatif des enveloppes budgétaires et de leur gestion ainsi que celle, sous-jacente, de la légitimité des partenaires sociaux dans la gouvernance d’une branche qui ne serait plus alors que l’opératrice de l’État.
Voilà les éclairages que nous avons souhaité apporter au Parlement, dans la limite de nos investigations et sans entrer dans le débat engagé par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) concernant le réaménagement des recettes des différentes branches de la sécurité sociale en vue de faire mieux coïncider la logique, contributive ou universelle, de chacune d’entre elles, et la nature de leurs ressources. Le Haut Conseil a remis son rapport au Premier ministre il y a une dizaine de jours.
Vous trouverez en annexe de notre rapport un certain nombre de recommandations antérieures de la Cour des comptes en matière de politique familiale, sous l’angle des prestations familiales et des outils fiscaux de cette politique.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Je me réjouis de la qualité de vos analyses et de vos simulations, dont vous soulignez également les limites.
Les transferts sur la CSG sont moins pénalisants pour l’emploi à long terme, tous les économistes sont d’accord sur ce point, mais leur impact sur la consommation est moins bien maîtrisé et leurs conséquences en termes de justice sociale nous sont mal connues.
Dans la mesure où nous ne savons pas modéliser de manière satisfaisante les effets négatifs de la fiscalité écologique, il est normal que celle-ci soit perçue comme une solution plus intéressante, encore faut-il qu’elle n’ait pas d’impact sur la production.
Vous portez un jugement négatif, dans le cadre du premier scénario que vous présentez, sur le transfert intégral des cotisations famille du secteur privé sur l’assiette de la CVAE. Mais, dans le modèle MESANGE, le capital étant considéré comme totalement mobile, toucher à sa fiscalité apparaît automatiquement comme une incitation pour les entreprises à diminuer leurs investissements, ce qui a des conséquences négatives pour l’emploi, tout comme le fait de remplacer un allégement ciblé sur les bas salaires par une hausse générale du coût du travail, d’où, si on lit trop vite vos résultats, une image par trop négative de ce que pourrait produire un transfert sur l’assiette de la CVAE. Pourtant, selon certains économistes, notamment dans l’hypothèse de cotisations négatives et de la neutralisation de la mesure pour les bas salaires, le transfert sur la cotisation assise sur la valeur ajoutée pourrait avoir des effets positifs sur l’emploi. Pour éviter l’effet négatif du transfert intégral sur l’assiette de la CVAE, il pourrait être envisagé d’étendre l’allégement général de cotisations à d’autres branches de la sécurité sociale, voire aux régimes de retraite complémentaire ou à l’UNEDIC. Est-il envisageable de présenter un dérivé du premier scénario qui prendrait en compte cette remarque ?
Autre question. Comment s’extraire du modèle MESANGE ? L’administration et les différents instituts de prévision ont-ils la capacité de recourir à d’autres modèles ? MESANGE est en effet un modèle néokeynésien mais, à long terme, d’inspiration plutôt libérale. Dans ce modèle, tout ce qui nuit au capital est défavorable à l’emploi. Ce modèle présente donc des effets pervers. De nombreux économistes ont travaillé sur d’autres modèles, certes beaucoup plus difficiles à évaluer quantitativement, mais qui conduisent à des résultats très différents.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Je vous remercie pour la qualité de votre rapport qui correspond parfaitement à la commande formulée par la mission. Vos simulations font apparaître qu’il n’existe pas d’« assiette miracle », ce qui nous invite à nous interroger sur les prérequis du modèle utilisé, qui s’inscrit dans une logique selon laquelle il n’y a pas d’alternative à des baisses de cotisations patronales non compensées, celles-ci n’étant concevables que dans l’hypothèse d’une diminution des prestations servies ou d’un accroissement de l’efficience. Cette position contredit les intuitions de tous les acteurs quant à l’évolution du financement de la branche famille. Je vous poserai donc la même question que Jean-Marc Germain.
Par ailleurs, le scénario de la budgétisation semble avoir votre préférence, même si vous ne le mentionnez pas clairement. En avez-vous identifié les risques, en termes d’évolution de la dépense publique ?
Le Haut Conseil du financement de la protection sociale vient de remettre ses travaux au Premier ministre. Ses préconisations se présentent sous forme de trois scénarios. Un premier scénario prévoit un « échange » entre la branche famille et la branche vieillesse de cotisations à la charge des employeurs contre des impôts et taxes ; le deuxième envisage des réaffectations importantes d’impôts et taxes aujourd’hui attribués aux branches famille et maladie de façon à concentrer sur cette dernière l’ensemble des taxes à visée comportementale ; le troisième est fondé sur une augmentation de la CSG en remplacement des cotisations patronales pour la famille.
Quel regard portez-vous sur ces différents scénarii ?
M. le coprésident Pierre Morange. Je salue à mon tour la qualité du rapport que vous nous avez présenté.
L’annexe 5 de votre rapport retrace l’ensemble des préconisations de la Cour des comptes en faveur d’économies potentielles et de la rationalisation des postes de dépenses affectées à la branche famille. Vous serait-il possible d’actualiser ces préconisations en fonction des récentes décisions gouvernementales, qui conduisent en particulier à la baisse du plafond du quotient familial ?
M. Antoine Durrleman. Le modèle économique que nous avons utilisé a sa logique propre et de toute façon il n’en existait pas d’autre dans l’administration. Les laboratoires universitaires d’économie, comme ceux des écoles d’économie de Toulouse ou de Paris, disposent de modèles différents, mais nous n’avons pas eu la possibilité de les solliciter. Il est clair que ces sujets nécessitent des regards croisés et que la sensibilité des modèles à différentes hypothèses peut faire varier les conclusions.
Nous avons cherché à documenter, comme vous le souhaitiez, des exemples étrangers, mais nous avons rencontré un certain nombre de difficultés. Ces exemples font toutefois apparaître que les basculements produisent des effets, à la fois structurels et conjoncturels, mais nous n’avons pas été en mesure d’analyser ce qui résulte du basculement lui-même, de son quantum, et ce qui résulte de la conjoncture dans laquelle il a été effectué.
Lorsque nous avons abordé cette analyse, nous étions totalement « agnostiques », nous avons donc étudié les scénarii de substitution tels qu’ils nous ont été présentés. Mais la problématique du transfert sur la valeur ajoutée des entreprises, que nous connaissons depuis plus de trente ans, nous a appris qu’il faut avant tout bien connaître la nature de l’investissement à prendre en compte et définir précisément ce qu’est la valeur ajoutée. Nous avons refusé d’entrer dans ce débat sur le sexe des anges, considérant que le Parlement l’avait déjà tranché.
Pour des raisons de simplification, nous avons proposé l’instauration d’une cotisation additionnelle à la CVAE, dont l’assiette porte sur la valeur brute des investissements – mais elle pourrait aussi bien porter sur leur valeur nette, ce qui aurait peut-être abouti à un autre résultat. Mais nous n’avons pu le démontrer, notre exercice n’étant qu’un éclairage.
En matière de budgétisation, nous sommes tout aussi agnostiques. Ce que nous avons cherché à montrer, c’est que sous un angle purement technique, il n’existe pas de différence incommensurable entre le scénario de fiscalisation intégrale et celui de budgétisation. En réalité, ce n’est qu’une question de tuyau. Celui-ci peut déboucher dans une branche, sous le contrôle de l’État qui pèse fortement sur la gouvernance et les objectifs de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), ou déboucher dans le budget de l’État, à charge pour lui d’affecter les ressources à une politique publique – ce qu’est par nature la politique familiale, du fait de son caractère universel et parce qu’elle n’a plus aucun lien, depuis 1978, avec l’exercice d’une activité professionnelle. Les deux scénarii diffèrent sur le plan philosophique, mais sous l’angle financier, à quelques nuances près, ils ne sont pas réellement différents. Lorsque l’on affecte des recettes spécifiques à une branche et que la croissance des dépenses est peu dynamique, cela crée des excédents que l’on peut envisager de mobiliser, mais ce n’est pas le cas en période de déficit de la branche famille.
Inversement, le fait que l’État gère des enveloppes de prestations ne signifie nullement que ces enveloppes soient mieux tenues que si elles étaient dévolues à une branche prestataire. Il n’y a pas de différence radicale entre l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), pourtant l’une provient du budget de l’État et l’autre est une prestation familiale, et toutes deux sont versées par les caisses d’allocations familiales (CAF). Ces différences relèvent plus de la philosophie et de notre approche de la politique familiale. Dans le cas d’une fiscalisation intégrale, la question du rôle des partenaires sociaux se poserait de la même façon puisque leur présence au sein de la branche famille se justifie par le fait que son financement est assuré par des prélèvements sur la masse salariale.
Nous avons naturellement pris connaissance des scénarii du HCFPS. Encore une fois, sur un plan philosophique, il est assez logique de poursuivre le mouvement historique initié en 1945 et qui conduit à faire mieux concorder la nature des prélèvements et l’objectif de chacune des branches. Le chemin a été interrompu du fait de la politique d’allégement des charges qui a brouillé de manière récurrente la problématique, mais il peut sembler légitime de le reprendre pour des raisons de clarté et de cohérence propres à assurer la légitimité de la protection sociale.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. L’une des variantes du premier scénario prévoyant le transfert des cotisations sur l’assiette de la CVAE consisterait à transférer sur d’autres branches les allégements de charges sur les bas salaires, afin de neutraliser un effet très contre-productif du scénario, dû au fait que l’on remplace un allégement sur les bas salaires par un prélèvement sur une part de la valeur ajoutée qui pèse de manière proportionnelle sur l’ensemble des salaires.
M. Antoine Durrleman. Une telle simulation nécessiterait de saisir la direction générale du Trésor.
Nous avons fait au cours des dernières années un certain nombre de propositions en vue de maîtriser les dépenses de la branche famille, dont certaines ont été récemment prises en compte par les pouvoirs publics à l’occasion de la rénovation de la politique familiale annoncée par le Premier ministre.
La première de ces propositions concerne les aides à la garde des enfants. La Cour, constatant que la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) reposait sur des paramètres mal calés, ce qui a produit des dérives de coût et des effets d’aubaine, a fait des observations aux pouvoirs publics. Ceux-ci les ont pris en compte en diminuant, à compter d’avril 2014, l’aide aux ménages dont les revenus sont supérieurs à un certain plafond.
Le complément de libre choix d’activité (CLCA) provoquait un effet d’aubaine pour les familles aux revenus situés dans la tranche supérieure des revenus. La Cour a donc proposé de le recentrer sur les publics les moins aisés. Le Gouvernement vient de donner suite à cette suggestion en supprimant la majoration dont bénéficiaient les ménages les plus aisés.
Enfin, la Cour s’est intéressée l’an dernier au complément de libre choix du mode de garde en vue d’en limiter les effets d’aubaine. Nous n’avons pas étudié l’opportunité de le plafonner mais avons conclu à la nécessité de le réexaminer.
La Cour s’est également intéressée à l’articulation entre les prestations en espèces et les dépenses fiscales. Elle a eu l’occasion, à différentes reprises, de démontrer que le cumul des prestations familiales et des aides fiscales revenait à accorder des aides substantielles aux ménages à revenus élevés ainsi qu’aux ménages à revenus bas, au détriment des catégories intermédiaires.
En revanche, la Cour n’a pas analysé l’articulation entre les outils fiscaux et les outils sociaux de la politique familiale. Elle s’apprête à réaliser une enquête sur ce point et a déjà commencé à travailler sur différents points.
Le premier d’entre eux est la demi-part supplémentaire pour les parents isolés. Cet avantage fiscal bénéficie essentiellement, malgré le plafonnement mis en place, à des contribuables qui disposent de revenus élevés.
Le second point qui a appelé son attention est la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables vivant seuls et qui ont eu des enfants. Bien que cette mesure ait déjà fait l’objet de certains ajustements, une part importante de la dépense bénéficie aux contribuables les plus aisés, puisque 22 % de la dépense est versée à 10 % de contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 53 000 euros.
La question du quotient conjugal pour les veufs ayant eu des enfants a été examinée en 2009, mais la Cour s’interroge sur le bien-fondé de cet avantage dans la mesure où il se surajoute à la demi-part accordée aux parents isolés.
La Cour des comptes s’est également interrogée sur le supplément familial versé aux fonctionnaires. Cet avantage, que l’État employeur consent aux agents publics, représente pour les trois fonctions publiques 1,3 milliard d’euros, mais les prestations croissent avec l’indice de rémunération et le plafonnement n’intervient qu’à un niveau de salaire élevé puisqu’il est fixé au niveau de l’« échelle lettre ».
La Cour a examiné à plusieurs reprises les avantages familiaux de retraite – cette question se retrouve à l’ordre du jour à la suite du rapport de Mme Yannick Moreau. Considérant que la majoration de 10 % pour les parents de trois enfants et plus augmente avec le montant des pensions et qu’au surplus cet avantage n’est pas fiscalisé, la Cour a suggéré de le fiscaliser ou de le forfaitiser.
Enfin, constatant que les crédits d’action sociale représentent une somme importante pour la branche famille, la Cour, dans un référé de mai 2013, a appelé l’attention du Gouvernement sur la manière dont sont mobilisés les 1,5 milliard d’euros annuels de crédits d’action sociale en faveur de la jeunesse. Dès 2006, la Cour avait préconisé de cibler cet effort sur les publics et les territoires les plus fragiles avant de constater, dans une enquête réalisée en 2012, que les inégalités territoriales s’étaient considérablement accrues. Les crédits affectés au département de la Lozère sont passés de 68 euros en 2006 à 79 euros en 2011, tandis que ceux affectés au département de la Haute-Garonne passaient de 352 à 496 euros. La Cour avait suggéré de redéployer ces crédits vers les populations et les territoires les plus fragiles. Il ne faut pas oublier que, dans un certain nombre de cas, la branche famille n’est qu’un financeur d’appoint et ne pèse pas en faveur d’une politique véritablement ciblée. Dans la mesure où ce n’est pour elle qu’une mission secondaire, la CNAF n’a pas le même poids vis-à-vis de ses partenaires en matière de politique en direction de la jeunesse que lorsqu’il s’agit d’améliorer les dispositifs d’aide à la garde des jeunes enfants.
M. Gérard Bapt. La Cour avait chiffré le coût du complément de libre choix du mode de garde, mais lorsque Pascal Terrasse et moi-même avons proposé de le supprimer pour les familles disposant de ressources supérieures à un certain montant, nous avons fait l’objet de nombreuses critiques. Quelle est votre position sur ce dispositif ?
Quelles sont les économies, selon vous, que nous pourrions réaliser sur les systèmes d’information ?
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS a engagé un travail sur ce dernier thème. Les grands systèmes de type mainframe seront bientôt abandonnés au profit de systèmes ouverts. Reste à choisir les modalités de la mise en concurrence des acteurs : dialogue compétitif ou procédure d’appels d’offres conforme au code des marchés publics. Compte tenu du volume financier que représente l’opération, il serait sage de privilégier cette dernière procédure.
M. Antoine Durrleman. S’agissant du complément de libre choix du mode de garde, nous avions cherché à identifier le volume de la dépense que représente la suppression de l’aide aux déciles supérieurs de l’impôt sur le revenu, mais nous n’avions fait aucune proposition concernant le niveau de plafonnement ou le quantum d’économies réalisées, considérant que cela n’était pas le rôle de la Cour des comptes.
Les économies de gestion sont un sujet important en partie lié au regroupement des caisses d’allocation familiale. C’est un point que nous entendons étudier dans un avenir proche. En matière d’économies de gestion, il convient de tenir compte de la réintégration dans les caisses d’allocations familiales d’un certain nombre d’allocataires qu’elles ne prennent actuellement pas en charge. Les fonctionnaires d’État et les fonctionnaires territoriaux ont déjà basculé vers les caisses ainsi que les agents des industries électriques et gazières ; les agents de la SNCF et de la RATP basculeront dans les années qui viennent, ce qui augmentera la productivité des caisses et diminuera corrélativement les coûts de gestion.
En ce qui concerne l’informatique et les modes de gestion informatisés, nous transmettrons au Parlement avant le 30 juin l’acte de certification des comptes du régime général de la sécurité sociale. Je reconnais qu’en dépit d’importantes difficultés, la branche famille a fait un effort certain pour améliorer un certain nombre de processus.
M. le coprésident Pierre Morange. La commission des affaires sociales diligentera dans quelques mois une mission d’information sur la gestion et le fonctionnement des CAF. Celle-ci viendra compléter l’enquête que la MECSS a menée en 2004 sur le coût de gestion de la sécurité sociale.
M. le rapporteur. Le HCFPS indique dans son dernier rapport que les dispositifs d’exonération tels que ceux qui s’appliquent dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou les zones franches urbaines (ZFU) conduisent quasiment à des emplois francs. Avez-vous le sentiment que le financement de la branche famille passe par une réforme du CICE et une mise en cohérence de ces dispositifs ?
M. Antoine Durrleman. L’évaluation a été demandée par le Parlement lui-même, mais la mesure sera réellement déployée entre 2014 et 2017. Cette évaluation devra prendre en compte non seulement le CICE lui-même mais également son articulation avec le dispositif d’allégement de charges. La Cour conseille de resituer le crédit d’impôt dans une politique globale car c’est bien un allégement de charges, financé par un effort d’économies à hauteur de la moitié des 20 milliards d’euros qu’il coûtera, à hauteur de 6 milliards par de la TVA et de 3 milliards par de la fiscalité environnementale. Il est vraisemblable que transférer une part des charges des entreprises vers la fiscalité environnementale et la TVA dopera l’effet des allégements de charges. Les modalités de substitution ne sont pas sans lien avec les conclusions des analyses du modèle MESANGE.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous remercions pour la pertinence de vos réponses.
Audition de M. Gilbert Cette, directeur des analyses microéconomiques et structurelles de la Banque de France, membre du Haut Conseil du financement de la protection sociale, M. Gérard Cornilleau, directeur adjoint au département des études de l’Observatoire français des conjonctures économiques, membre du Haut Conseil du financement de la protection sociale, et M. Henri Sterdyniak, directeur du département Économie de la mondialisation de l’Observatoire français des conjonctures économiques
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Votre audition s’inscrit dans les travaux que nous avons lancés il y a plusieurs mois dans le but de faire des préconisations sur le financement de la branche « famille » de la sécurité sociale. La Cour des comptes nous a remis le rapport que nous lui avions commandé sur le sujet.
Dans le même temps, plusieurs chantiers et réformes sont en cours. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale mène une réflexion sur les logiques des différentes branches et sur les relations entre les prestations et les modes de financement ; il émettra dans les prochains mois des propositions fondées sur des simulations à très long terme.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 prévoit par ailleurs une baisse des cotisations « famille » des entreprises, en contrepartie de la hausse des cotisations « vieillesse » qui résulte de la réforme des retraites.
On le voit, le cadre juridique se modifie en même temps que nos travaux se poursuivent. Nous souhaitons pouvoir apporter notre contribution à la réflexion en février ou mars 2014, avant l’élaboration du PLFSS pour 2015 qui devrait mettre en place les réformes proposées par la majorité.
Pour la branche « famille » comme pour d’autres domaines, la question principale est d’identifier la meilleure assiette de prélèvement, tant pour les entreprises que pour les ménages. Le débat relatif à la taxe sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) dans le projet de loi de finances pour 2014 en témoigne : faut-il s’en tenir à des cotisations assises sur la masse salariale, passer à une assiette correspondant à la valeur ajoutée, ou encore adopter une solution mixte ? Concernant les ménages, faut-il basculer vers une contribution sociale généralisée (CSG) progressive ? Dans chaque cas de figure, quelles sont les conséquences sur la situation économique et sur l’emploi ?
S’agissant de la protection sociale, se pose également la question de la conformité des financements avec la logique de chaque branche. Les organisations syndicales sont très attachées à cet aspect que notre mission considère, pour sa part, comme moins fondamental.
La Cour des comptes s’en est tenue à une approche classique – peut-être trop classique – des conséquences des assiettes et des modes de prélèvement possibles sur l’emploi et la croissance. Elle s’en explique d’ailleurs dans son rapport en soulignant les limites des modèles utilisés. C’est pourquoi nous avons souhaité prendre également l’avis d’économistes experts de ces sujets.
La MECSS, je le rappelle, est une instance paritaire où la majorité et l’opposition sont représentées à égalité. Son objectif est avant tout de bien poser les termes du débat et d’ouvrir les champs du possible.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Nous souhaitons recueillir votre avis sur les différentes hypothèses de financement de la branche « famille » examinées par la Cour des comptes : assiette sur la valeur ajoutée des entreprises, utilisation de la fiscalité écologique, recours à la TVA, fiscalisation pure et simple. La réflexion sur ce sujet n’est-elle pas l’occasion de faire avancer l’idée d’une CSG progressive ? Quel est votre sentiment sur les réformes en cours de la branche « famille » ?
M. Gérard Cornilleau, directeur adjoint au département des études de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), membre du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Les analyses macroéconomiques du rapport de la Cour des comptes sont en effet classiques. On y retrouve les simulations régulièrement produites par la direction du Trésor. Les variantes proposées pénalisent sans doute le scénario d’un transfert vers une assiette sur la valeur ajoutée : d’autres hypothèses conduisent à des résultats plus favorables.
La Cour reprend également les évaluations menées lors de la mise en place du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). L’OFCE a une vision un peu différente puisqu’il estime à 150 000 et non à 360 000 le nombre d’emplois susceptibles d’être créés par ce dispositif.
La situation actuelle est à mon sens très différente de celle des années 1970-1980. À cette époque, il existait un véritable déséquilibre dans le partage du revenu en faveur des salaires, et tout ce qui allait dans le sens d’un allégement du coût du travail était bienvenu. Aujourd’hui, en revanche, l’équilibre général du partage du revenu est plutôt trop favorable au profit. Dès lors, il ne semble pas forcément pertinent de viser systématiquement l’allégement du coût du travail. Mais nous faisons partie d’une Union monétaire dont la gestion laisse à désirer : chaque pays peut s’engager à sa guise dans une politique de déflation salariale. Si nous cédons à cette surenchère avec certains de nos partenaires européens, ce sera, je crois, une politique « perdant-perdant ». Il est néanmoins malaisé, dans le contexte actuel, de soutenir un tel point de vue.
Pour en venir à la structure du financement de la protection sociale, le Haut Conseil a permis des évolutions sur le plan des principes. Désormais, l’accord est quasi général autour de l’idée, ancienne, qu’il faut distinguer les prestations contributives, assises sur des cotisations, et les prestations générales – typiquement celles de la branche « maladie » –, qui relèvent plutôt de l’impôt. Reste à en tirer les conséquences ! Pour l’instant, on envisage des dispositifs très complexes mais pas de véritable rupture. On oppose des arguments juridiques à l’idée d’un « grand soir » des cotisations sociales. Pour ma part, je regrette qu’on n’en parle pas plus.
M. Henri Sterdyniak, directeur du département Économie de la mondialisation de l’OFCE. Il y a quelques années, j’ai déjà eu l’occasion d’intervenir sur ces sujets devant une commission présidée par M. Yves Bur. Celle-ci avait malheureusement recommandé une réduction des dépenses « famille » pour résoudre la question du financement de la branche.
M. le rapporteur. Un peu comme la Cour des comptes aujourd’hui.
M. Henri Sterdyniak. Je crois que cette piste doit être écartée. Les familles ont besoin de plus de prestations. Le nombre d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté en France. Il faut que les prestations familiales et le revenu de solidarité active (RSA) soient revalorisés et indexés, non pas sur les prix – ce qui aboutit à la paupérisation des familles – mais sur les salaires.
Le Gouvernement a commis une erreur économique, sociale et politique en déclarant au début de l’année qu’il était absolument nécessaire de récupérer 2 milliards sur la branche « famille » et que les familles à revenu moyen étaient favorisées par le système. Il faut au contraire sécuriser les ressources de la branche et le pouvoir d’achat des familles pauvres et au revenu moyen. Quelle que soit la réforme adoptée, on doit prendre des engagements précis pour éviter de soumettre ces ressources aux aléas de l’économie.
La branche « famille » est aujourd’hui financée à hauteur de 34 milliards d’euros par des cotisations sociales patronales, dont 24 milliards sont à la charge des entreprises du secteur privé. Le reversement à la branche « vieillesse » s’élève à 9 milliards d’euros.
Compte tenu de ces données, quatre scénarios de réforme sont envisageables.
Le premier, le plus intéressant sur le plan économique, repose sur l’idée que la branche « famille » doit être financée par un impôt. Si l’on ne veut plus peser sur les salaires, il faut taxer la valeur ajoutée, soit en utilisant l’assiette de la contribution locale sur la valeur ajoutée des entreprises, soit en introduisant un impôt sur l’EBE.
Cette proposition a donné lieu à des travaux contradictoires. Les keynésiens l’applaudissent dans la mesure où cette substitution d’assiette du travail au capital favorise les secteurs utilisant beaucoup de main-d’œuvre. Telle était, traditionnellement, la position de l’OFCE. À l’opposé, la direction de la prévision du ministère de l’économie et des finances considère que, sur le long terme, le taux de chômage équivaut au taux de chômage naturel et que de telles dispositions n’auront pas d’incidence sur l’emploi, réduiront l’investissement et la productivité et, au total, appauvriront la France. On peut néanmoins douter de la pertinence de l’hypothèse du plein emploi à très long terme. En outre, le basculement vers la valeur ajoutée ou l’EBE nuirait à l’industrie, qui, par définition, utilise beaucoup de machines, et ne contribuerait pas à créer des emplois à bas salaire et peu qualifiés comme on le souhaite actuellement. Cette première piste semble donc fragile.
Le deuxième scénario est celui, très sympathique, du recours à la taxation écologique. Le problème est que l’on ignore quel sera le produit de cette taxation, laquelle dépend de décisions prises au niveau mondial ou européen et sera déjà utilisée pour soutenir certains secteurs en difficulté ou pour venir en aide aux ménages les plus pauvres. Par conséquent, mieux vaut disjoindre la question du financement de la branche « famille » et le débat sur l’écologie et la taxe carbone. Si d’aventure cette taxe venait à procurer des revenus importants, je préférerais que l’affectation d’une partie de ces revenus à la branche « famille » ne soit pas directe.
Le troisième scénario est celui de la TVA sociale, c’est-à-dire le remplacement de points de CSG par une hausse de la TVA. Curieusement, les entreprises considèrent que la TVA ne représente pas une charge pour elles, contrairement aux cotisations. La substitution de la TVA aux cotisations patronales pour la famille aurait le grand avantage de fournir à la branche une ressource stable : il suffirait de décider, par exemple, que trois points de TVA lui sont affectés. Mais il s’agit d’une fiction économique. La TVA étant déductible de l’investissement, elle ne pèse pas sur les machines ; elle pèse lourd, en revanche, sur les secteurs qui emploient beaucoup de main-d’œuvre. En économie fermée, donc, il y a très peu de différence entre la TVA et les cotisations sociales des employeurs. Le seul avantage serait un gain de compétitivité pour les entreprises françaises au départ, mais la perte de pouvoir d’achat des retraités et des salariés pourrait l’annuler rapidement.
Notons qu’un tel dispositif existe déjà sous la forme du CICE, financé à hauteur de 20 milliards d’euros l’année prochaine. Une solution au problème serait donc de supprimer le CICE, d’affecter ces ressources ainsi que 30 milliards de TVA à la branche famille et de supprimer les cotisations familiales patronales. Ce serait beaucoup plus simple pour les entreprises. Certes, on ne concentrerait plus la dépense sur les emplois jusqu’à un certain niveau de salaire, mais il me semble néfaste de maintenir des systèmes trop compliqués.
Le quatrième scénario, selon moi excessivement complexe et irréalisable, consiste à remplacer les cotisations familiales par de la CSG, le principe étant que les prestations familiales sont un transfert entre les personnes qui n’ont pas d’enfants et celles qui en ont. Dans ce cas de figure, on supprime les cotisations familiales patronales, les employeurs augmentent les salaires de 5,4 % – de quelle façon, c’est un autre problème ! –, on augmente de 5,4 points la CSG acquittée par les salariés, puis, comme on se dit qu’il n’y a pas de raison que seuls les salaires soient touchés, on rabaisse le taux de CSG qui leur est applicable et on augmente la CSG sur les pensions de retraite et les rentes.
Le dispositif, on le voit, ne rapporte rien aux entreprises. Il pèse encore plus sur les revenus du capital déjà soumis à une CSG de 15,8 %, ce qui est un trait spécifique du système français. Enfin, il prend quatre à cinq points de CSG de plus aux retraités, déjà mis à contribution cette année dans le cadre de la réforme des retraites. C’est la réforme préconisée par la CFDT : prendre de l’argent aux retraités et aux rentiers pour le donner aux salariés, sans aucun effet sur l’emploi.
Certains, qui ont lu de mauvais livres, considèrent que ce serait l’occasion de réaliser une grande réforme fiscale rendant la CSG progressive. Le problème est que le système français est déjà extrêmement redistributif. Les plus pauvres ne paient pas d’impôts, ils reçoivent le produit de différents prélèvements, ils paient de la CSG mais bénéficient du RSA ou de la prime pour l’emploi, ils reçoivent des allocations logement. Dans le même temps, les plus riches acquittent un impôt sur le revenu dont le taux s’est sensiblement accru, paient de la CSG, tandis que leurs employeurs paient des cotisations « maladie » et « famille » importantes, la France taxe les revenus du capital beaucoup plus fortement que les autres pays européens. Dans ces conditions, une grande réforme fiscale accentuant encore la redistributivité du système me semble illusoire.
On l’aura compris, ma préférence va au troisième scénario.
M. le coprésident Pierre Morange. Votre solution consiste à optimiser l’existant, en l’occurrence les dernières mesures gouvernementales, et à offrir à la branche « famille » un financement pérenne à supposer que la consommation reste stable. Quelle serait néanmoins l’incidence macroéconomique d’une augmentation de trois points de la TVA sur le pouvoir d’achat, l’emploi et le chômage à court, moyen et long termes ?
M. Henri Sterdyniak. L’idée n’est pas d’augmenter la TVA mais d’affecter à la branche trois points du taux existant.
Les 20 milliards d’euros transférés aux entreprises au titre du CICE seront financés pour moitié par des économies sur les dépenses publiques et pour moitié par une hausse de la TVA et une affectation de la taxation écologique. L’OFCE a publié une évaluation montrant que l’impact de la réforme sur le produit intérieur brut (PIB) serait nul mais que son effet sur l’emploi serait légèrement favorable, les entreprises étant incitées à utiliser plus de travail et moins de capital. Si, l’année prochaine, on dit aux entreprises qu’elles ne bénéficieront plus du CICE mais que leurs cotisations « famille » seront supprimées, je pense qu’elles s’en trouveront soulagées car cela leur simplifiera la vie. On assistera, certes, à un petit glissement entre les entreprises à bas salaires et les entreprises à salaires plus élevés. Mais il est établi que les entreprises exportatrices versent des salaires relativement élevés. Une baisse des charges en la matière contribuera donc à les aider.
Les réformes actuelles n’ont pas donné aux entreprises l’impression qu’on a allégé leurs cotisations sociales. On l’a pourtant fait, mais en compliquant à l’excès leur fiscalité.
M. le rapporteur. La proposition d’utiliser les recettes correspondant au CICE pour supprimer les 5,4 % de cotisations familles des entreprises rejoint ce que dit en filigrane la Cour des comptes lorsqu’elle relève que la superposition du mécanisme du CICE, qui vise les emplois rémunérés jusqu’à 2,5 SMIC, et de la progressivité du taux de cotisation appliqué aux entreprises – différence entre les entreprises de moins de vingt et de plus de vingt salariés, exonérations successives entre 1 SMIC et 1,6 SMIC – aboutit, en l’occurrence, à une quasi-disparition des cotisations patronales.
Au regard des mécanismes de financement du CICE – à savoir 10 milliards d’euros de baisse de la dépense publique, 6 milliards d’euros d’augmentation de la TVA, 2 à 3 milliards d’euros issus d’une fiscalité écologique putative –, la suppression des cotisations patronales que vous suggérez équivaut à la budgétisation du financement de la branche. Selon vous, cette suppression n’est pas incongrue dans la mesure où les prestations sont universalisées. Pour la Cour des comptes, cela ne va pas de soi. La Cour estime en effet à 12 à 13 milliards d’euros – sur les quelque 50 milliards d’euros versés par la branche « famille » – le montant des prestations destinées à concilier la vie familiale et la vie professionnelle, favorables, on le sait, au taux d’emploi des femmes. Elle considère qu’il n’est pas illégitime que les entreprises, qui retirent un bénéfice de ces dispositifs, continuent à contribuer au financement de la branche famille.
M. Gérard Cornilleau. Le problème est que ce raisonnement peut être tenu sur de multiples sujets : les entreprises profitent non seulement de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, mais aussi de la santé de leurs salariés, des systèmes de transport, etc. On ne peut, sur ce motif, faire financer par les entreprises l’ensemble des dépenses sociales et des équipements publics ! In fine, rappelons-le, les entreprises ne font que transférer la charge soit sur leurs actionnaires, soit sur leurs salariés – sous forme de réduction du salaire net –, soit sur leurs clients. Croire qu’elles paient est une grande illusion. Comme je l’ai dit dans une formule qui m’a été reprochée, l’entreprise est un ectoplasme. Certes, elle crée de la richesse en combinant du travail et du capital, mais on ne peut l’utiliser pour des financements durables.
En revanche, les prélèvements sur les entreprises sont justifiés dès lors qu’ils visent à infléchir leurs comportements. On peut, par exemple, moduler les cotisations « chômage » de manière à encourager les bonnes pratiques. De même, la fiscalité écologique doit être à la charge des entreprises puisqu’il leur est possible d’y échapper si elles adoptent de meilleurs comportements.
En matière familiale, on est loin de ce schéma : il s’agit plutôt, comme l’a dit Henri Sterdyniak, de transferts entre les ménages. Or, du fait de son histoire, le système est complexe et traîne des anomalies que l’on pourrait corriger. Pendant longtemps, par exemple, les pensions de retraites n’ont pas été soumises à cotisations, ce qui permettait, en retour, d’avoir des taux de cotisations « retraite » plus faibles. Si l’on souhaite tout neutraliser, il faudrait annoncer le jour où l’on transfère les cotisations familiales employeur vers la CSG que l’on augmente aussi le montant des retraites, donc les cotisations retraite, et que l’on abaisse les cotisations maladie dont on aura, par le fait, élargi l’assiette.
Je suis conscient qu’une telle remise à plat est très difficile à réaliser. On a maintenu bien d’autres incongruités, comme l’abattement de 10 % pour frais professionnels sur les montants des retraites ! Mais j’espère que le Haut Conseil essaiera de mener ce travail de fond en dépit des réticences.
Pour en revenir à la branche « famille », c’est la sécurisation des prestations, et non celle des ressources, qui a toujours été le sujet principal. Du fait d’une indexation défaillante, cette branche génère structurellement des excédents. Mais cela ne nous exonère pas de trouver le moyen de sécuriser les ressources !
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Votre raisonnement semble implacable si l’on s’en tient à la seule branche « famille ». Mais si l’on considère l’ensemble du financement de la protection sociale, la question de l’assiette des prélèvements sur les entreprises reste ouverte – sans parler du financement des collectivités locales par la cotisation sur la valeur ajoutée. Indépendamment de la question de l’affectation des ressources, comment établir une assiette aussi large et efficace que possible en matière de prélèvements sur les entreprises ?
Par ailleurs, je ne crois pas que les prélèvements soient trop progressifs en France. Les entreprises bénéficient toujours de « niches » fiscales. L’idée qu’elles représentent les intérêts conjoints des salariés et des actionnaires est démentie par les vingt dernières années, durant lesquelles les actionnaires et les très hauts salaires ont capturé 99 % de la valeur ajoutée. L’alternative entre la taxation des entreprises et la taxation des ménages est illusoire. En réalité, soit on taxe les actionnaires et les hauts dirigeants, soit on taxe les ménages, le problème étant plus celui du coût du capital que celui du coût du travail.
J’ai donc un autre scénario en tête : créer une assiette patronale large – valeur ajoutée nette ou addition de la masse salariale et de l’impôt sur les sociétés –, cibler le CICE sur l’industrie et rendre la CSG progressive. On peut bien, comme M. Sterdyniak le préconise, utiliser le financement du CICE pour supprimer la cotisation « famille » patronale, mais il n’est pas possible d’étendre ce modèle à l’ensemble du financement de la protection sociale.
M. le coprésident Pierre Morange. Le rapport de M. Yves Bur sur le financement de la branche famille préconisait une solution médiane, acceptable économiquement et socialement. Quelles seraient les conséquences, dans ces domaines, de la simplification du dispositif que vous proposez et de la nouvelle affectation des ressources du CICE ? Comment ce dispositif pourrait-il s’articuler avec un éventuel élargissement de l’assiette des prélèvements ?
M. Henri Sterdyniak. Nous nous devons de prendre pour point de départ la situation économique de la France et nous demander comment favoriser l’emploi ; dans cette perspective, l’essentiel n’est pas de savoir s’il est légitime que les entreprises participent au financement des crèches. Nous sommes malheureusement dans une zone euro incapable de définir une stratégie macroéconomique cohérente et d’impulser la demande et dont les pays membres doivent se battre les uns contre les autres pour se faire les moins-disants en matières sociale et salariale. Nous sommes aussi à une époque où les capitalistes, devenus de plus en plus gourmands, demandent des taux de rentabilité élevés et n’investissent pas. Tout cela pose évidemment des problèmes difficiles au Gouvernement. Il a choisi de créer le CICE, destinant ainsi 20 milliards d’euros à l’ensemble des entreprises. On peut penser que cette somme aurait été mieux employée en faveur d’une politique industrielle fine, dotée des moyens nécessaires à son objet : rebâtir le tissu industriel en aidant les entreprises industrielles qui en ont besoin. Mais les contraintes européennes amènent à choisir le second best, une solution de repli. Et dans ce cadre, le CICE, étant donné son ciblage douteux, est plus compliqué et sans doute moins efficace que ne l’aurait été la simple suppression des cotisations « famille ».
Le débat économique de fond est le suivant : faut-il remplacer les cotisations sociales employeur et, éventuellement, diverses autres impositions par une contribution sociale assise sur l’excédent brut d’exploitation ? J’y suis très favorable car cette mesure est la seule qui permette de taxer spécifiquement les entreprises trop capitalistiques et d’aider les secteurs qui emploient beaucoup de main-d’œuvre – ce que la TVA sociale ne fait pas. Mais elle frapperait l’industrie, et elle paraît d’autant plus difficile à « vendre » que la taxation devrait porter sur le brut. Je n’ignore pas que, selon le schéma théorique dans lequel on se place, cette proposition est considérée, au choix, comme stupide ou comme la meilleure qui soit.
Pour ce qui concerne les ménages, on est allé au bout de ce que l’on peut prélever sur les hauts revenus. Des mesures restent à prendre mais, à chaque fois, ce sera très dur. Ainsi, l’absence de taxation des loyers fictifs est scandaleuse, mais comment dire aux propriétaires qu’ils devront désormais régler 15 % de prélèvements sociaux sur le montant du loyer qu’ils ne payent pas ? La mesure est redistributive, mais difficile à faire accepter. Une autre bonne mesure consiste à supprimer les privilèges associés au plan d’épargne en actions (PEA) et à l’assurance-vie, et une autre encore à décider que donations et héritages doivent purger les plus-values. Ces trois mesures procureraient de l’argent qui pourrait être redistribué aux plus pauvres, mais elles sont difficiles à mettre en musique. Une fois ces quelques milliards récupérés auprès des plus riches, il n’y aurait aucun problème à dire que le RSA n’est pas assez élevé pour les familles avec un ou deux enfants et qu’il faut repenser le complément familial en leur faveur parce qu’elles ne demandent pas le RSA auquel elles ont droit. Mais cela suppose pour commencer de procéder à la récupération auprès des plus riches et, dans le contexte actuel, je vois mal les trois mesures que j’ai décrites annoncées.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Vous avez évoqué des solutions qui, pour ne pas avoir un impact négatif sur le pouvoir d’achat, supposent d’augmenter les salaires, ajoutant qu’un tel schéma est impossible. Est-ce si sûr ? Après tout, lors du passage aux 35 heures, on a agi sur les salaires. M. Gilbert Cette, qui vient de nous rejoindre, nous donnera son avis.
M. Gilbert Cette, directeur des analyses microéconomiques et structurelles de la Banque de France, membre du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Je tiens à préciser que je m’exprime en mon nom personnel. La question du financement de la protection sociale doit s’apprécier à l’aune de l’équité et à celle de l’efficacité économique. S’agissant de l’équité, assez nombreux sont ceux qui, depuis assez longtemps, jugent logique que les prestations universelles non contributives soient financées sur l’assiette la plus large ; sinon, on aboutit à l’aberration que l’effort contributif diffère selon la structure d’un même revenu, alors que les droits sont identiques. Cela concerne la branche « famille », soit quelque 5,5 % de prélèvements sociaux sur la masse salariale, et aussi l’assurance maladie, soit plus de 13 %.
M. le coprésident Pierre Morange. Permettez-moi d’apporter une nuance : les prestations étaient historiquement universelles, mais la redistribution a été concentrée, ces vingt dernières années, sur les ménages les plus modestes – ce qui se défend parfaitement.
M. Gilbert Cette. C’est exact, mais je brosse le tableau de la situation à grands traits. À raison de dix-huit à dix-neuf points de prélèvements sur la masse salariale – contribution « famille » et contribution « maladie » confondues –, on atteint des sommes considérables, si bien que la modification brutale du mode de financement des prestations universelles non contributives entraînerait des bouleversements phénoménaux. Aborder la chose de manière progressive en se concentrant d’abord sur les 5,5 % de contribution « famille » n’est donc pas une mauvaise approche.
Pour ce qui est de l’efficacité économique, on a cherché récemment à réduire le coût du travail parce qu’on est amené à considérer que les problèmes de compétitivité de notre économie sont pour partie liés au coût du travail et que le manque d’innovation des entreprises françaises tient aussi à une rentabilité moyenne insatisfaisante. La comparaison du taux d’épargne des entreprises des grands pays industrialisés montre que la France est en bas de la liste. Cette orientation date du début des années 2000 ; elle n’est pas due à la crise, le problème est beaucoup plus structurel et inquiétant. Le souci de baisser le coût du travail reflète le désir d’aider les entreprises à financer dans le long terme leurs efforts d’innovation – c’est la compétitivité hors coût – et, éventuellement, à faire de la compétitivité coût à court terme, sachant que ce que l’on ne fait pas avec l’un, on le fait en partie avec l’autre, mais que l’on ne peut agir sur tous les tableaux simultanément.
Le « rapport Gallois » ayant fortement souligné cette situation, des dispositions ont été prises, dont l’instauration du CICE. Ce dispositif conduit à se poser la question facétieuse « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? », puisqu’un transfert équivalent aurait pu prendre pour forme la fiscalisation d’une partie de la protection sociale. On voit bien l’intérêt du CICE : il a un effet immédiat et son coût pour les finances publiques est décalé à 2014 et 2015. Mais, outre que le dispositif est complexe, il n’est pas certain qu’il remplisse complètement l’objectif visé et que le comportement des agents soit le même que si l’on avait choisi la baisse directe du coût du travail. Il y a par ailleurs un effet de seuil. Le plafond de rémunération conditionnant le crédit d’impôt, parce qu’il est fixé à 2,5 SMIC, complique encore l’édifice, un seul euro versé au-delà de ce plafond majorant le coût annuel du travail de 2 500 euros par salarié concerné. Or la rémunération des chercheurs est généralement supérieure à 2,5 SMIC. Le crédit impôt recherche (CIR) est une bonne mesure, mais il y a une percussion entre ce dispositif, qui aide les efforts de recherche, et le CICE, qui peut les dissuader par cet effet de seuil en faveur des salariés les moins qualifiés et au détriment des salariés très qualifiés, dont les chercheurs.
Fallait-il cibler le dispositif vers l’industrie, productrice de biens exportables directement exposée à la concurrence ? Ce n’est pas très simple à concevoir et, a priori, cela ne s’impose pas. En effet, dans la branche manufacturière, les coûts directs en travail – entre 30 et 35 % des coûts de production – sont égaux au coût indirect en travail, celui des emplois de service mobilisés pour produire des produits manufacturiers. C’est dire que si des mesures réduisent le coût du travail dans les services, la baisse se répercutera dans le secteur manufacturier et sa compétitivité en bénéficiera.
En résumé, le CICE est certes un second best, mais c’est mieux que rien. On pouvait faire un petit peu mieux et j’imagine qu’à l’avenir il faudra simplifier le dispositif, le rendre plus cohérent avec les objectifs d’équité et plus conforme à une stratégie de long terme pour le financement de la sécurité sociale.
Enfin, le CICE comme le basculement d’une partie du financement de la protection sociale vers les ménages ressortissent à la dévaluation fiscale. Or, les dévaluations peuvent avoir un effet favorable sur la compétitivité, mais il n’est que temporaire ; après quelques années, le gain compétitif est perdu et l’on est ramené à la situation dans laquelle on se serait trouvé sans l’avantage lié à la dévaluation fiscale. Cela signifie que le basculement d’assiette et le CICE doivent être articulés avec des politiques d’amélioration structurelle de la compétitivité. Parce que les politiques structurelles ont des effets progressifs, décalés dans le temps, ces dispositifs servent en quelque sorte à faire la soudure, mais en rester là ne procurerait qu’un avantage transitoire.
M. le rapporteur. Il est frustrant d’entendre qu’il serait impossible de réformer le financement de la protection sociale pour soutenir l’activité et l’emploi. La Cour des comptes explique qu’il n’y a pas d’assiette miracle. Laquelle privilégiez-vous ?
M. Gilbert Cette. Je préconise une assiette large allant jusqu’à la fiscalisation. Pour moi, la CSG est le véhicule idéal, et la TVA le second best. Mais, dans tous les cas, quelqu’un doit payer le gain compétitif et, comme il a été dit, le basculement pur et simple de la cotisation employeur vers la CSG pèserait sur le pouvoir d’achat des salariés, des retraités et des revenus du capital. Pour ce qui est des salaires, la dynamique salariale, en France, est relativement bonne au regard de ce qu’elle est dans les autres pays, et plusieurs études font état de sa résistance en dépit de la hausse du taux de chômage. Pour ce qui concerne le niveau de taxation des revenus du capital, je pense, comme Henri Sterdyniak, que la France a fait fort ; nous faisons figure d’exception en ce domaine. Enfin, on sait que la suppression de certaines niches relatives aux revenus du capital créerait des difficultés : ainsi, l’encours élevé de l’assurance-vie en France nous aide à placer plus facilement, et dans des conditions plus favorables, les émissions d’obligations renouvelables du Trésor. Je ne dis pas qu’il ne faut pas faire disparaître les niches, mais il faut garder à l’esprit que, lorsqu’on instaure une taxe, les agents économiques réagissent à cette taxation.
Les 6 milliards d’euros de TVA alloués au financement du CICE sont bel et bien payés par les ménages. On verra quel sera le contour précis de la taxe écologique, mais l’on sait déjà qu’à partir de 2015 les ménages payeront aussi la plus grande partie de ce basculement-là. Ils supporteront encore la réduction de 10 milliards d’euros des dépenses. Ce n’est pas forcément un mauvais choix si l’on partage le diagnostic posé par M. Louis Gallois, que je fais mien. Néanmoins, le basculement vers la CSG aurait, de même, fait payer les ménages, mais de manière plus directe, plus claire et plus transparente, en accord avec une stratégie de très long terme de fiscalisation du financement de la protection sociale.
M. le coprésident Pierre Morange. Les dévaluations fiscales ont, avez-vous dit, des conséquences éphémères. Quelle est selon vous la durée de leurs effets bénéfiques ?
M. Gilbert Cette. Les instruments macroéconomiques dont nous disposons nous amènent à penser que l’effet maximal est atteint en un à trois ans. Après quoi on observe une décrue qui conduit à une quasi-disparition de tout effet après six à sept ans.
M. le rapporteur. La baisse des cotisations patronales pour la branche « famille » est destinée à compenser l’augmentation des cotisations pour la branche « vieillesse ». Comme les dépenses de la branche « famille » ne baisseront pas, il y a un engagement de compensation par le budget de l’État, y compris par le biais de la hausse de la TVA prévue pour s’appliquer le 1er janvier 2014. Cela correspond-il au mouvement que vous appelez de vos vœux ?
M. Gilbert Cette. Nul ne l’ignore, il existe un problème d’acceptabilité de l’impôt pour beaucoup de citoyens. Essayer de réduire ce refus passe par une certaine transparence et par la simplification des dispositifs. Définir des financements spécifiquement consacrés à la protection sociale et affichés comme tels facilite l’acceptation de ces prélèvements par les ménages.
M. le rapporteur. Voilà qui ne plaide pas en faveur d’une fiscalisation « anonymisée ».
M. Gilbert Cette. De fait, les financements fléchés, tels la CSG, amènent les citoyens à comprendre les orientations des grandes masses fiscales. C’est pourquoi il serait sensé de développer des prélèvements redistributifs tels que l’impôt sur le revenu pour financer des politiques spécifiques de réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté, les prélèvements généraux tels que la TVA étant davantage employés à financer les activités régaliennes de l’État. Afficher des prélèvements sociaux finançant des prestations sociales facilite la compréhension d’un système complexe et donc, à terme, une plus grande acceptation de la fiscalité. On en est loin, puisque l’on va vers des dispositifs toujours plus obscurs, dont celui que vous avez décrit.
M. Gérard Cornilleau. Il est paradoxal qu’une redistribution assez forte, comme elle l’est en France, s’accompagne d’une telle incompréhension de cette redistribution. L’une des raisons en est évidemment la complexité du système, et refuser de le simplifier au motif que l’on ne peut plus accentuer la redistribution me paraît erroné. Il faut distinguer système et barème : le système doit être simplifié pour qu’il soit mieux compris et ainsi mieux accepté, mais cela n’empêche pas de revoir le barème. On peut très bien parvenir au même niveau de redistribution avec un système structuré différemment et, par exemple, augmenter la CSG et la fusionner avec l’impôt sur le revenu sans que cela modifie fondamentalement le niveau de redistribution. Je pense également qu’un élément central de simplification est bien l’affectation des cotisations aux prestations contributives. On se félicitera d’avoir échappé – de peu, semble-t-il – au financement, qui aurait été tout à fait anormal, de la branche « vieillesse » par la CSG ; les cotisations sont versées par les seuls bénéficiaires à terme du dispositif, les salariés.
Je suis très favorable à l’opération consistant à augmenter les salaires bruts et supprimer les cotisations patronales pour que le coût du travail et le salaire net demeurent inchangés. Mais l’on me dit que l’État n’a pas le droit de s’immiscer dans le contrat de travail… Je le déplore, mais je ne suis pas juriste.
Des réformes sont possibles, qui peuvent être menées dans la durée, mais elles doivent se faire à partir d’un schéma de reconstruction d’un système qui a beaucoup vieilli.
M. le coprésident Pierre Morange. J’observe que lorsqu’il s’est agi de réduire le temps de travail, l’État est bel et bien intervenu dans le contrat de travail. Cette rhétorique me semble fragile.
M. le rapporteur. Et maintenant, messieurs, que faire ?
M. Henri Sterdyniak. À mon sens, la situation est ingérable en raison d’une dynamique européenne perverse. La France s’est engagée à réduire de 80 milliards d’euros les dépenses publiques d’ici 2017, ce qui est absolument impossible sans provoquer des drames légitimes. Nous avons signé le pacte budgétaire, mais l’Europe ne réussit pas à repartir et nos contraintes sont si lourdes que l’on ne peut prendre aucune autre mesure d’allégement en faveur des entreprises que celle qui a déjà été prise : le CICE. Il s’agit donc maintenant de faire vivre cette mesure au mieux en disant qu’elle correspond à la suppression des cotisations pour la branche « famille ».
M. le rapporteur. Qu’en est-il alors de la nécessité de favoriser la compétitivité prix des entreprises exposées à la concurrence ? M. Louis Gallois insiste sur ce sujet.
M. Henri Sterdyniak. C’est fait : on a donné aux entreprises 20 milliards d’euros qui s’ajoutent au crédit impôt recherche et à la baisse de la taxe professionnelle. On peut difficilement faire plus, sauf à modifier la politique européenne. L’Union ne peut avoir une stratégie d’austérité et demander en plus aux pays membres de se faire de la concurrence fiscale et sociale ; cela finit par coincer. Il faudra dresser le bilan du CICE et sécuriser les ressources de la branche « famille » en lui fournissant des ressources stables – dire que tant de points de TVA ou de CSG, ou la taxe sur les salaires, lui sont affectés à tout jamais. On peut espérer obtenir des recettes par la montée en puissance de la fiscalité écologique, le renforcement de la lutte contre l’optimisation fiscale à l’échelle internationale et, peut-être, la suppression des quelques niches fiscales injustifiées qui demeurent. Mais, étant donné tout ce qui a déjà été fait, cela ne rapportera pas grand-chose, et les ressources de la branche famille ne doivent pas dépendre de cela.
Mme Bérengère Poletti. Il serait incontestablement plus clair pour tous que la fraction du produit de la TVA finançant le CICE finance directement les prestations familiales. Le circuit actuel est mal compris parce que peu lisible.
M. Gilbert Cette. C’est vrai, mais il est difficile de faire apparaître sur les factures une TVA ventilée en rubriques. La TVA est une recette fiscale qui se fond dans un ensemble plus vaste. Je souscris aux propos d’Henri Sterdyniak. De toute politique économique on attend des effets par des signaux prix, et l’on sait que l’instabilité des dispositifs est contre-productive : elle entraîne à la fois la démultiplication des effets d’aubaine et l’atténuation des effets de substitution. Or, si l’on prend pour exemple les allégements de cotisations sur les bas salaires, on constate un changement par an en moyenne depuis le début des années 1990 ! Le CICE est un second best, mais maintenant qu’il a été annoncé, on peut se demander si l’on ne perdrait pas plus à le modifier pour l’améliorer qu’à le conserver en l’état. Pour cette raison, il est peut-être opportun d’en faire le bilan dans trois ou quatre ans et d’y revenir alors. On ne doit pas réviser les dispositifs de ce type trop fréquemment. Le CIR a aussi été modifié tous les ans depuis sa création, ce qui complique les investissements en recherche, stratégiques pour les entreprises.
M. le rapporteur. Et ce qui entraîne des effets d’aubaine relevés par la Cour des comptes, et qu’elle relèvera à terme pour le CICE…
M. Henri Sterdyniak. S’il est dit que le CICE s’appliquera à toutes les entreprises et sur tous les salaires, les entreprises seront plus satisfaites qu’elles ne le sont du dispositif prévu, horriblement compliqué et, pour tout dire, ingérable.
M. le coprésident Pierre Morange. Messieurs, nous vous remercions pour ces analyses particulièrement lucides d’un sujet complexe.
*
* *
Audition de M. Julien Dubertret, directeur du budget au ministère de l’économie
et des finances
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Julien Dubertret, directeur du budget au ministère de l’économie et des finances.
Monsieur le directeur, la MECSS a déjà effectué plusieurs auditions relatives au financement de la branche famille, sans oublier sa commande à la Cour des comptes d’un rapport d’évaluation comparative des différentes assiettes de prélèvement permettant de financer la politique de la famille. Or telle fut la conclusion en demi-teinte du rapport : comme aucun mode de prélèvement – CSG, TVA, fiscalité écologique – n’offre d’avantage particulier en termes de dynamique économique, il convient, pour résoudre le déficit de la branche famille, de dégager des économies.
M. le rapporteur. Le PLFSS pour 2014 prévoit notamment une baisse de 0,15 % de la cotisation patronale destinée au financement de la branche famille. Pouvez-vous nous présenter en détail les modalités de financement de cette branche prévues dans le PLFSS ? Quelles sont par ailleurs les pistes de réforme du financement de la branche famille sur lesquelles vous travaillez actuellement ? La Cour des comptes évoque une éventuelle fiscalisation pleine et entière de cette branche : serait-elle à vos yeux envisageable, d’autant que le pendant d’une telle évolution serait une budgétisation des dépenses de la branche famille relevant de la solidarité, comme la lutte contre la pauvreté, les aides aux personnes en difficulté ou les aides au logement – la liste n’est pas exhaustive ?
M. Julien Dubertret, directeur du budget au ministère de l’économie et des finances. Je tiens tout d’abord à préciser que je n’ai aucun mandat particulier sur la question délicate de la budgétisation : c’est pourquoi je n’y répondrai qu’en termes de faisabilité.
M. le coprésident Pierre Morange. Votre audition prend la suite d’une table ronde d’économistes réunissant M. Gilbert Cette, M. Gérard Cornilleau et M. Henri Sterdyniak. À leurs yeux, il convient d’opter pour une solution relativement simple : consacrer les sommes aujourd’hui affectées au CICE à une diminution équivalente de la contribution des entreprises au financement de la politique de la famille, contribution qui s’élève à l’heure actuelle à 5,4 %. Une telle solution aurait pour avantage de conférer à ce financement une plus grande lisibilité et une plus grande pérennité tout en créant un mécanisme plus efficace en termes de compétitivité des entreprises.
M. Julien Dubertret. Je commencerai par les grands équilibres.
Il convient tout d’abord de rappeler le fort dynamisme sur le très long terme des dépenses de la politique familiale, qui n’ont pas été bridées, bien au contraire, puisque le déficit du régime perdure en dépit de recettes croissantes. J’arrive donc aux mêmes conclusions que la Cour des comptes : il faut maîtriser les dépenses.
Cette branche est marquée par une universalisation croissante des prestations et une diversification et une fiscalisation également croissantes des recettes. Les prestations familiales ont été universalisées en 1978 avec la suppression de toute condition d’activité professionnelle, ce qui leur a fait perdre toute dimension contributive. Après différentes étapes, l’aide personnalisée au logement (APL) est par ailleurs créée en 1977 : ce « bouclage des aides au logement », qui confirmait l’universalisation des prestations, s’est traduit par un ressaut très important des dépenses. Parallèlement, on a assisté à une diminution de la part des cotisations dans les recettes, à une hausse de la CSG et à l’apparition et à la croissance des impôts et taxes affectés. La branche famille est donc de plus en plus universelle du côté des prestations comme des recettes.
En dépit de la diversification et de la fiscalisation croissante des recettes, le financement de la branche reste très largement assis sur les revenus d’activité – plus de 80 %. Du reste, la CSG est un impôt très largement assis sur les revenus d’activité. Sur le long terme, les recettes de la branche famille évoluent comme le PIB, l’évolution de la masse salariale étant proche de celle du PIB, voire, par moments, un peu plus favorable.
Dans son rapport annuel sur la loi de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes souligne l’apport supplémentaire considérable de la CSG, qui n’est pas une simple recette de substitution, puisque, « toutes choses égales par ailleurs, la création de la CSG procure ainsi à la sécurité sociale des recettes supérieures de 24 milliards d’euros, soit 1,2 point de PIB, à ce qu’elles auraient été tendanciellement à architecture de financement inchangée ». La CSG est une recette excellente, surtout si on la compare aux précédentes. Il n’est pas vrai de dire que les recettes de la branche famille auraient été maltraitées – la Cour des comptes elle-même se risque parfois à l’affirmer.
M. le rapporteur. Quelle est la part des revenus du capital ?
M. Julien Dubertret. Je ne saurais vous le dire avec exactitude : elle est en tout cas minoritaire puisque la CSG est assise à plus de 80 % sur les revenus d’activité.
La CSG a été une « bonne affaire ».
Ma remarque vaut d’ailleurs pour la sécurité sociale d’une manière générale : on ne peut pas dire que les dépenses de la sécurité sociale aient été bridées par un dynamisme insuffisant des recettes. Aussi convient-il de relativiser les critiques sur la mise en place en 2011 du préciput, qui a entraîné un transfert de recettes décroissantes. C’est en toute connaissance de cause que la mesure a été prise, compte tenu du bon dynamisme des autres recettes et du fait que les prestations de la branche famille sont moins dynamiques que celles des branches vieillesse ou maladie.
Les dépenses, quant à elles, ont évolué beaucoup plus vite que l’inflation. Un rapport récent affirme que l’indexation des prestations familiales sur la seule inflation conduirait à une dégradation tendancielle de la part des prestations familiales dans le PIB : je pense que l’analyse est un peu courte. En réalité, la croissance de l’ensemble des dépenses de la branche famille est quasiment égale à celle du PIB sur le long terme. Il n’y a donc aucune raison d’indexer les prestations sur un autre facteur que les prix. En effet, si tel était le cas, compte tenu des nombreuses créations de prestations, on se retrouverait avec une croissance des dépenses très supérieure au PIB.
Si, de 1978 à 1990, la part des prestations légales de la branche famille dans le PIB baisse de 2,3 % à 1,8 %, en revanche, depuis 1990, cette part est constante puisqu’elle est toujours de 1,8 % en 2012. Quant au nombre d’enfants de zéro à dix-neuf ans éligibles aux prestations familiales, il est de 16,2 millions en 1991 et de 16,1 en 2012. La part de la richesse nationale consacrée aux familles est donc stable. Aussi ne saurait-on prétendre qu’il y ait eu un effort particulier de maîtrise de ces dépenses ou que les règles d’indexation utilisées auraient été défavorables à la politique familiale. De nombreuses mesures ont été mises en œuvre successivement. J’en citerai quelques-unes : hausses régulières de l’âge limite d’accès aux prestations familiales – il est passé de quatorze à vingt ans –, fréquentes revalorisations ponctuelles de prestations, majoration des allocations familiales en 1981, hausse de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire en septembre 2012, plans de revalorisation jusqu’en 2018 du complément familial de l’allocation de soutien familial lancés dans le cadre du Plan pauvreté, création de la prestation d’accueil du jeune enfant en 2005, croissance très forte du fonds national d’action sociale – la liste n’est pas exhaustive. Notons toutefois que ces nouvelles prestations répondent plus souvent à une politique d’empilement qu’à une redéfinition complète de la branche famille. C’est pourquoi celle-ci mériterait d’être appréhendée selon la méthode de la modernisation de l’action publique, conduisant, pour une plus grande efficacité, à une remise à plat de la politique familiale après évaluation.
Pour résumer, je dirai que la politique familiale se traduit par un fort dynamisme des dépenses, la constance remarquable de leur part dans le PIB, des recettes favorables et, malgré tout, par un déficit qui, sans être négligeable, n’est pas très important si on le rapporte au total de la branche famille – 55 milliards de dépenses. Il pourrait donc être traité sans trop de difficultés via une maîtrise des dépenses, puisque la branche famille fait déjà l’objet de recettes très généreuses.
S’agissant de la fiscalisation de la branche famille, il faut savoir qu’il n’y a pas de miracle en matière de ressources fiscales. En effet, contrairement à la branche maladie, qui peut bénéficier de taxes comportementales, il n’existe pas de recettes qui, par nature, sont destinées à la famille. L’évolution du financement de la branche famille vers une plus grande fiscalisation fait toutefois l’objet d’un relatif consensus, qu’il s’agisse de la Cour des comptes, du Haut Conseil de la famille, des employeurs ou des organisations familiales et syndicales, à l’exception notable de la CGT et de la CGT-FO.
Le débat sur le financement de la branche famille est lié au débat sur le coût du travail en France, les cotisations familiales étant exclusivement acquittées par les employeurs. Quelles ressources conviendrait-il de substituer à ces cotisations alors que, comme je le disais, il n’existe pas de recettes pouvant être par nature affectées à la famille ? Je note toutefois que les différentes propositions de réforme du financement de la branche ont souvent pour dénominateur commun une fiscalisation accrue.
La piste d’un accroissement net des recettes fiscales est à exclure compte tenu des engagements très clairs du Gouvernement en termes de trajectoire des finances publiques. L’article liminaire du projet de loi de finances prévoit le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques et le Gouvernement a déclaré que, dans le retour à l’équilibre structurel d’ici à la fin du quinquennat, l’effort devait porter intégralement sur la dépense. Autant il est possible d’imaginer des redistributions de recettes, autant il est impossible de s’orienter vers une hausse nette des prélèvements obligatoires au profit de telle ou telle administration publique. La création d’un nouveau prélèvement devrait donc s’accompagner de la suppression ou de la diminution équivalente d’un autre prélèvement afin de ne pas augmenter le taux de prélèvement obligatoire (TPO). Or la fiscalité écologique est fléchée vers le CICE et il convient de regarder avec prudence les éventuelles marges de manœuvre offertes par la fiscalité du capital, compte tenu notamment de la décision du Conseil constitutionnel de 2012 et d’une interprétation récente du Conseil d’État, lesquelles invitent à la prudence. La seule solution serait donc de substituer une recette existante à la cotisation des employeurs à la branche famille.
S’agissant des conséquences macroéconomiques de la substitution d’une ressource alternative aux cotisations patronales familiales, il convient de distinguer deux cas : la ressource de substitution a pour origine un prélèvement fiscal ou une baisse des dépenses. Le CICE est financé à la fois par une hausse des recettes et par une baisse des dépenses. Une baisse de prélèvement financée par une diminution des dépenses a incontestablement à long terme un effet favorable sur la compétitivité de l’économie. Une baisse des dépenses est, après tout, une substitution de ressources.
Le gage en recettes, quant à lui, mobilise un modèle économétrique valable uniquement sur le court terme car construit sur l’adéquation de l’offre et de la demande : je ne suis pas certain qu’un tel modèle intègre sur le long terme les effets notamment sur la modification de la compétitivité de l’offre si, par exemple, on substitue la TVA aux cotisations patronales. Je doute qu’il soit pertinent d’utiliser un modèle reposant sur une mécanique de flux valable à court terme pour évaluer des effets structurels qui, par définition, ne peuvent être mesurés que sur le long terme.
M. le coprésident Pierre Morange. Les mécaniques de flux n’ont d’effet positif que sur une période de trois à cinq ans : on retourne au point de départ au bout de six ou sept ans. C’est pourquoi elles ne peuvent servir que de mesures intérimaires, le temps de la mise en œuvre des mesures structurelles.
M. Julien Dubertret. En termes de compétitivité internationale, on peut aussi comparer de telles mesures à une dévaluation, laquelle n’a que des effets transitoires si elle ne s’accompagne pas d’autres dispositions, notamment en termes de contrainte sur l’évolution des prix, de maîtrise de la masse monétaire pour éviter tout risque d’inflation, ou d’accroissement de la concurrence. L’histoire nous invite à réfléchir aux mesures additionnelles qui doivent accompagner nos décisions économiques, afin d’en garantir les effets sur le long terme.
La fiscalisation croissante du financement de la branche famille a franchi cette année une étape supplémentaire. La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) se voit en effet attribuer environ 2 milliards d’euros de ressources fiscales complémentaires. Un milliard permet de compenser la baisse des cotisations sociales patronales. Un autre milliard contribue à combler son déficit et équivaut aux effets du plafonnement supplémentaire du quotient familial.
En 2014, grâce à un mécanisme de compte d’avances sur le budget de l’État, des recettes de TVA nettes sont réaffectées à la sécurité sociale et fléchées vers la seule branche maladie qui en cède une partie à la CNAF. Cette dernière récupéra globalement 2 milliards d’euros grâce à l’affectation de la taxe sur les véhicules de sociétés, pour un montant atteignant presque 900 millions d’euros, aux contributions sur les stock-options, pour près de 500 millions d’euros, aux prélèvements sur les jeux et paris, pour 230 millions d’euros, et à la modification de la répartition de la CSG entre branches qui lui rapportera quasiment 800 millions d’euros – dans le même temps, le prélèvement social sur le capital est recentré sur la branche maladie au détriment de la branche famille pour plus de 450 millions d’euros.
M. le rapporteur. Ce financement est-il lié aux effets de la hausse de la TVA à partir du 1er janvier 2014 ?
M. Julien Dubertret. Les deux questions sont distinctes. La répartition des ressources entre les administrations publiques ne dépend pas du surplus de TVA attendu du fait du relèvement des taux.
Dans le cadre de la mise en place du CICE, le partage de recettes entre l’État et la sécurité sociale, et entre les branches de la sécurité sociale, doit faire l’objet d’une clarification. Une part de TVA était jusqu’à présent affectée directement à la sécurité sociale ; désormais, elle transite par un compte de concours financier retracé au budget de l’État, ce qui permet à la représentation nationale et aux Français de disposer d’une information complète.
M. le rapporteur. Je crois que 3 milliards d’euros de recettes sont dirigés vers le PLFSS à la suite de la hausse de la TVA. Un lien peut donc être établi entre cette dernière et les transferts dont bénéficie la CNAF.
M. Julien Dubertret. L’augmentation de la TVA permet de financer le CICE. Sans rapport avec cela, il a paru opportun de compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale. Il est vrai que, pour des raisons de lisibilité, la TVA a été retenue comme unique outil de transfert, et qu’elle a été fléchée vers la seule branche « maladie » dans un souci de simplification. Ces opérations ont été inscrites dans un compte de concours financier soumis au vote du Parlement. Si vous le souhaitez, je pourrai vous transmettre la liste détaillée des transferts vers la CNAF en 2014.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous nous avez montré que les solutions résidaient dans la maîtrise des dépenses. Où se trouvent selon vous les gisements d’économies ?
M. Julien Dubertret. Nous travaillons sur le sujet et nous explorons de nombreuses pistes, mais il est encore prématuré d’en faire état.
J’en viens à la budgétisation qui est, en quelque sorte, la forme ultime de la fiscalisation. Le caractère non contributif et universel des prestations n’est-il pas le fondement de l’universalité budgétaire ? Cela dit, il ne m’appartient pas de me prononcer en opportunité.
Trois éléments peuvent toutefois justifier à mon sens une budgétisation.
La budgétisation améliore la lisibilité des comptes publics. Pourquoi maintenir dans une cellule séparée une dépense presque comme les autres, qui peut être pilotée comme le budget de l’État ? Je note d’ailleurs qu’en disposant de deux textes financiers distincts, un PLF et un PLFSS, la France fait figure d’exception parmi les pays développés. En général, les régimes assurantiels, vieillesse et accidents du travail, sont retracés dans des caisses séparées, sans même parfois être couverts par un projet de loi. La maladie et la famille sont en revanche couramment prises en charge dans le budget des États.
La budgétisation simplifie la conduite de la politique fiscale. Le partage d’un impôt entre plusieurs types d’administrations rend son éventuelle réforme complexe. La concentration des recettes et des dépenses dans le budget général faciliterait la réflexion et les évolutions fiscales.
La budgétisation est susceptible de permettre un meilleur pilotage. En tout état de cause, aujourd’hui, la dynamique des dépenses familiales est beaucoup plus rapide que celle des dépenses budgétisées. Cela dit, la question reste politique et il faut savoir quelle part de la richesse nationale nous voulons attribuer à la politique familiale.
À ma connaissance, la budgétisation partielle ou totale ne rencontre pas d’obstacle juridique. Aucun principe constitutionnel ou organique ne s’y oppose, sous réserve qu’un financement suffisant soit garanti pour assurer la pérennité des missions. Cette évolution peut passer par une loi ordinaire sans qu’il soit nécessaire de modifier une loi organique. Un objectif de dépenses serait toutefois maintenu dans le PLFSS.
En termes de finances publiques, il ne me semble pas que la nature des dépenses de la CNAF soit un obstacle à un pilotage sous une norme de dépense ou sur le budget de l’État. Ce dernier pilote déjà un très grand nombre de dépenses de guichet sous norme pour un montant d’environ 40 milliards d’euros – certains dispositifs, comme les aides au logement, sont même cofinancés par la CNAF. La variété de dynamique et de nature des dépenses de la caisse permet d’envisager, si on le souhaite, une forme de contrainte gérée en interne. De plus, si l’on ne tient pas compte des choix de dépenses supplémentaires, la dynamique naturelle des dépenses de la branche famille n’est pas très rapide, même si elle l’est plus que celle du budget de l’État.
La budgétisation pourrait utiliser trois types de supports : le budget général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux.
La création d’un budget annexe des prestations familiales nécessiterait une modification de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Cela dit je ne vois guère le sens qu’aurait le choix d’un cadre assez rigide qui correspond à des opérations industrielles et commerciales.
On pourrait penser à un compte d’affectation spéciale (CAS) si l’on voulait créer une sorte d’« isolat », et maintenir une dynamique de dépenses liée à celle des recettes. Dans ce cas, il faudrait également modifier la LOLF car, en l’état, les CAS supposent l’existence d’un lien direct entre recettes et dépenses.
Sans modifier la loi organique, il est enfin possible de créer un programme ou une mission au sein du budget général. Cette solution ne remettrait pas en cause fondamentalement la gouvernance actuelle de la branche. La modification du support ne ferait pas de la CNAF un opérateur de l’État, et elle est compatible avec sa gestion paritaire. Quelle contrainte sur l’évolution des dépenses familiales les gouvernements voudront-ils imposer dans ce cadre ? La question n’est plus technique ; elle relève de choix politiques.
M. le rapporteur. Durant la campagne qui a permis son élection, le Président de la République s’est engagé à fusionner l’impôt sur le revenu et la CSG d’ici à la fin du quinquennat. L’introduction d’une progressivité de la CSG à rendement constant peut constituer une étape préalable à son rapprochement avec l’impôt sur le revenu. Quelle réflexion cette progressivité vous inspire-t-elle ?
M. Julien Dubertret. Nous ne nous interdisons de réfléchir à aucun sujet mais je ne mène actuellement aucune réflexion spécifique sur cette question. Il est demandé au directeur du budget que je suis de travailler au redressement des finances publiques sur les trois prochaines années en actionnant uniquement le levier de la dépense. Si la réforme que vous décrivez devait être mise en œuvre, ce serait pour des vertus proprement et uniquement fiscales, afin de répartir différemment l’impôt, et non pour dégager des ressources supplémentaires. Le ministre délégué chargé du budget lui-même ou la direction de la législation fiscale seront plus à même que moi de répondre à vos questions sur la réforme fiscale.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie pour votre présence et pour les réponses que vous nous avez apportées.
Audition de Mme Mireille Elbaum, présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale, M. Laurent Caussat, secrétaire général, et M. Fabrice Lenseigne, secrétaire général adjoint
M. le coprésident Pierre Morange. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui Mme Mireille Elbaum, présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFPS), accompagnée de M. Laurent Caussat, secrétaire général, et M. Fabrice Lenseigne, secrétaire général adjoint.
Madame la présidente, dans le cadre de la mission qui vous a été confiée par le Gouvernement sur le financement de la protection sociale, nous croyons savoir que vous devriez fournir un certain nombre de réflexions pour le début de l’année prochaine, en particulier sur la branche famille et le coût du travail. Pouvez-vous nous faire part de vos premières conclusions ?
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Le rapport d’étape « sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale », remis le 7 juin, comporte des pistes intéressantes sur la branche famille. D’abord, le HCFPS estime nécessaire de répondre aux enjeux de clarification du financement de la protection sociale. Ensuite, il présente un certain nombre de pistes sur l’introduction de davantage de progressivité dans le prélèvement, la limitation des mesures dérogatoires, les prélèvements sur les revenus du patrimoine, la fiscalité environnementale et les taxes comportementales.
Madame la présidente, une budgétisation plus avancée du financement de la branche famille vous paraît-elle pertinente ?
Quelles sont les pistes pour une articulation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) avec les exonérations de cotisations sur les bas salaires dites « Fillon » ?
M. le coprésident Pierre Morange. Selon M. Sterdyniak et deux autres économistes auditionnés la semaine dernière, les quelque 20 milliards d’euros au titre du dispositif CICE pourraient être mieux identifiés en prenant la forme d’exonérations de cotisations patronales pour le financement de la politique de la famille. Quel est votre sentiment sur ce sujet ?
Mme Mireille Elbaum, présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFPS). Ce sujet n’a pas été examiné par le HCFPS, mais pourra l’être s’il fait l’objet d’une saisine.
Nous avons travaillé sur la clarification du financement et la diversification des ressources de tous les régimes de protection sociale, et non de la seule branche famille, considérant cette dernière comme un cas spécifique. En effet, les transferts doivent être envisagés sous l’angle de l’ensemble des branches.
Ce travail a été réalisé à ressources constantes pour les régimes de protection sociale et à prélèvements constants supportés par les entreprises et les ménages. Aussi n’avons-nous pas traité à proprement parler de la question de l’allégement net du coût du travail pesant sur les entreprises. En effet, à la suite à la création du CICE, ce que nous a demandé le Premier ministre est de présenter des pistes de clarification et de diversification.
Notre rapport s’inscrit donc dans le cadre qui nous a été fixé, c’est-à-dire sans prendre en compte les effets macroéconomiques d’un allégement net du coût du travail. En effet, si les incidences macroéconomiques possibles des différentes pistes de clarification et de diversification se situent à la marge, les effets de l’allégement net du coût du travail et de son financement s’apprécient en termes de compétitivité, de croissance et d’emploi. Sur ce sujet, nous nous sommes donc contentés d’un simple rappel.
Actuellement, le HCFPS mène un travail sur les besoins de financement des régimes de protection sociale à long terme, sur la base des travaux conduits par le Conseil d’orientation des retraites (COR), le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) et le Haut Conseil de la famille (HCF). En prenant en compte les nouvelles mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014, ce travail, dont les conclusions seront rendues en janvier, nous fournira une vision globale de la protection sociale, en abordant plusieurs problématiques, en particulier les moyens du retour à l’équilibre à long terme, la dynamique de l’endettement, les modes d’indexation à législation constante, etc.
Le processus d’universalisation des droits aux prestations familiales a conduit à une situation originale de la branche famille. Nous avons remis en question la classification qui nous était proposée dans la lettre de saisine du Premier ministre nous demandant de distinguer les mécanismes d’assurance et les mécanismes de solidarité. Comme l’a montré notre travail, la solidarité et la redistribution sont au cœur de l’ensemble de notre protection sociale, tant au plan économique que du point de vue de la jurisprudence communautaire et, par conséquent, la distinction entre assurance et solidarité est pour le moins contingente et discutable dans ce travail de clarification des modes de financement.
Selon nous, un critère fondé sur le degré d’universalisation des droits garantis aux personnes couvertes paraît plus pertinent pour guider la réflexion sur la clarification et les principes de financement à l’échelle de l’ensemble de la protection sociale. Les assurances sociales assurent une solidarité et une redistribution, mais conservent une notion de contributivité au regard du lien entre contributions dans le cadre d’un régime professionnel et prestations reçues, même si ce lien est souvent très détendu par les mécanismes de solidarité. En outre, des critères de résidence donnent droit à un certain nombre de prestations, caractérisées par une unicité de gestion et de barème. Ainsi, un seul type de prestation est attribué à l’ensemble des citoyens ou des résidents dans le cadre d’un régime unifié. Notre constat est donc que le financement des prestations familiales s’est certes diversifié, mais reste encore assuré à hauteur de 65 % par des cotisations employeurs.
Le système de retraite français répond clairement à une logique contributive. Un raisonnement à l’échelle non plus des branches, mais des risques, montre que le chômage, l’exclusion renvoient à plusieurs dimensions, de même que la maladie avec une branche maladie orientée vers l’universalisation, mais une couverture complémentaire de plus en plus professionnalisée. En définitive, le cas d’espèce est bien la branche famille en raison de l’universalisation des prestations et de son mode de financement.
Ce contexte nous a conduits à examiner plusieurs scénarios de modification possibles du financement de la branche famille allant dans le sens d’une réduction de la part incombant aujourd’hui aux cotisations employeurs, scénarios à répartition constante des financements. Toutes les branches – y compris la branche vieillesse, contributive – bénéficient d’un certain nombre d’impôts et taxes affectés. C’est ainsi que nous avons envisagé les permutations possibles entre les impôts et taxes affectés à la branche vieillesse et les cotisations sociales patronales de la branche famille. Nous avons aussi pensé qu’il serait logique que le produit des taxes comportementales soit réaffecté à la branche maladie, ce qui nous a tout naturellement amenés à envisager des scénarios de permutation à trois.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce mouvement est déjà engagé depuis quelque temps.
Mme Mireille Elbaum. Certes, mais une partie de la fiscalité sur le tabac est affectée à la branche famille.
M. le rapporteur. À l’inverse, vous proposez de réaffecter une partie des impôts et taxes de la branche vieillesse à la branche famille.
Mme Mireille Elbaum. Ou à la branche maladie, d’où une permutation à trois.
Néanmoins, le premier scénario de clarification est limité par le montant des impôts et taxes affectés à la branche vieillesse, puisque nous raisonnons à financement constant. Aussi seule une partie des cotisations employeurs famille serait-elle concernée. Au demeurant, une partie des membres du HCFPS considère justifié de laisser une part des cotisations employeurs à la branche famille pour marquer l’intérêt des entreprises à la politique familiale française qui permet un haut niveau de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et la mobilisation dans de bonnes conditions de la main-d’œuvre féminine.
Une troisième famille de scénarios consisterait en une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) au bénéfice de la branche famille, avec un transfert de cotisations sociales patronales de la branche famille vers la branche vieillesse et une diminution des cotisations sociales vieillesse à la charge des salariés.
M. le rapporteur. Ce serait, selon vous, plus simple que le mécanisme cher à Henri Sterdyniak consistant à augmenter uniformément les rémunérations brutes.
Mme Mireille Elbaum. Si l’augmentation des rémunérations brutes est très séduisante sur le papier, la direction générale du travail (DGT), à laquelle nous avons demandé de l’étudier, estime que l’absence de motif d’intérêt général suffisant pour remettre en cause l’ensemble des contrats individuels de travail et la négociation sur les salaires entraîne un risque d’inconstitutionnalité. En effet, compte tenu de la progressivité des cotisations sociales employeurs, retenir cette piste impliquerait de modifier les clauses de rémunération de l’ensemble des contrats de travail existants pris individuellement. En outre, une telle disposition ne pourrait concerner les contrats de travail futurs s’ils portent sur des rémunérations supérieures au salaire minimum.
M. le coprésident Pierre Morange. Si je résume votre propos, la distinction entre assurantiel et solidarité peut difficilement être retenue. Une clarification s’impose pour rendre tout son sens à notre système de protection sociale. Le curseur des prélèvements patronaux peut être placé en regard de la participation minimale des entreprises au titre de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Et la piste évoquée par M. Sterdyniak, sur laquelle la DGT émet des réserves sur le plan constitutionnel, serait pour le moins complexe. Pour toutes ces raisons, la clarification d’un mécanisme assez peu lisible constituerait une piste pertinente, avec une traduction au niveau de la branche famille.
Selon la Cour des comptes, il existe des gisements d’économies considérables. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale a-t-il travaillé sur ces pistes ?
Mme Mireille Elbaum. Comme le Conseil d’orientation des retraites, Le HCFPS va se situer avant tout dans une dynamique de long terme, à horizon 2020-2025.
M. le coprésident Pierre Morange. M. Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil de la famille, a relativisé le déficit de la branche famille à l’horizon 2020-2025, la considérant structurellement équilibrée pour des raisons de dynamique démographique.
Mme Mireille Elbaum. Une grande part des déficits est liée à la problématique des recettes, et l’ensemble des dépenses de la protection sociale a tendance à s’infléchir. Dans une perspective de long terme, il faut s’interroger sur l’écart entre la dynamique tendancielle des dépenses et celle des recettes. Dans ce cadre, ce n’est pas un secret de dire que le sujet est celui de la santé. En matière de retraites, les projections du COR montrent à long terme, dans les scénarios plutôt favorables économiquement, un écart relativement limité – lequel sera réduit grâce aux mesures de rééquilibrage de la réforme des retraites. Or selon les premiers travaux que nous a remis le HCAAM, cet écart est assez substantiel en matière de maladie et il existe même un lien positif entre les dépenses de maladie et la croissance économique. Par conséquent, le redressement spontané dans un scénario favorable pour les retraites ne joue pas de la même façon en matière de maladie.
M. le coprésident Pierre Morange. Les projections élaborées par le HCAAM jusqu’en 2060 sont contestées par certains car elles sont adossées à des hypothèses économiques relativement optimistes.
D’autre part, il semble difficile de faire des analyses sur la base des données en matière de natalité et de mortalité car ces dernières sont très instables sur une échelle d’un demi-siècle.
Mme Mireille Elbaum. Nous allons reprendre les projections du HCAAM et du COR. Les cinq scénarios du COR fournissent une palette extrêmement large des conséquences induites par un ralentissement ou une reprise de la croissance. Nous allons appréhender l’ensemble de ces scénarios pour en évaluer l’impact plus ou moins favorable sur l’équilibre à long terme de la protection sociale. Mais je répète que l’amélioration de la croissance économique a un impact plus favorable sur les finances des retraites et du chômage que sur les finances de la maladie.
Il existe une déconnexion très forte entre les prestations familiales et le revenu moyen des actifs. Aussi est-il raisonnable d’examiner les perspectives sinon d’une indexation, du moins d’un mode de revalorisation globale différent. Les dernières évolutions économiques ne remettent pas en cause la palette des scénarios que nous décrivons.
Quant aux projections de long terme pour le risque famille, elles sont difficiles à réaliser puisqu’elles concernent des personnes qui ne sont pas nées. Néanmoins, même si les scénarios économiques sont sources d’incertitude, j’ai tendance à penser que les projections à 2060 ont un sens pour le débat économique et social peut être aussi important que les projections à moyen terme dans un environnement économique fluctuant.
M. le rapporteur. Selon la Cour des comptes, le financement de la branche famille par les cotisations patronales est pertinent au regard de la part des dépenses consacrées par cette dernière à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale – la Cour chiffre à 13 milliards d’euros la somme consacrée par la branche famille aux modes de garde. Cet argument vous paraît-il recevable, sachant que toutes les dépenses de protection sociale ont indirectement, selon certaines personnes auditionnées, des effets en matière de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ?
Mme Mireille Elbaum. Je ne crois pas légitime de vous donner mon sentiment personnel. Ces arguments ont été discutés au sein du HCFPS qui les a jugés fondés. Néanmoins, dans cette volonté de clarification et de simplification, la recomposition des impôts et taxes affectés entre les branches ne pourra être réalisée en totalité sans un « big bang » avec la CSG et les cotisations vieillesse des salariés. Il serait peut-être intéressant de procéder à une clarification pour une partie, avant de décider d’aller jusqu’au bout.
En tout état de cause, notre analyse devra être réactualisée au vu des décisions prises dans le cadre de la réforme des retraites et du PLFSS 2014, dont certaines clarifications sont inspirées de nos propositions et d’autres ne les reprennent pas entièrement. Lors de la réforme des retraites, la question a été posée de savoir si un signal devait être envoyé aux salariés en baissant leurs cotisations vieillesse. Cette question se pose d’ailleurs également pour les employeurs.
M. le coprésident Pierre Morange. Comme l’a souligné M. Fragonard, un enfant sur cinq vit dans la précarité. La budgétisation, en permettant de concilier dynamique démographique et logique de redistribution, n’est-elle pas en définitive la solution ?
Mme Mireille Elbaum. Il me semble que la notion de budgétisation devrait, elle aussi, être clarifiée. Tous les risques sociaux ont un lien avec la lutte contre la pauvreté, qu’ils soient financés de façon assurantielle ou par d’autres types de financement. La question de fond n’est pas la source de financement, elle est de savoir si l’on veut des ressources identifiées qui ont un lien avec ce risque, ou si c’est le budget de l’État qui doit le financer.
M. le coprésident Pierre Morange. Le HCFPS a-t-il progressé dans cette réflexion ?
Mme Mireille Elbaum. Non, il a considéré le risque famille comme faisant partie des risques sociaux de la protection sociale. Dans ce cadre, la branche famille est financée essentiellement par les cotisations patronales, mais aussi par toute une série d’impôts et taxes affectés.
M. le rapporteur. Les scénarios de clarification que vous proposez sont-ils susceptibles de monter en puissance ou nécessiteront-ils – pour reprendre votre expression – un « big bang » ? Je pense plus particulièrement au scénario du transfert de cotisations patronales de la branche famille vers la branche vieillesse, de la réduction des cotisations vieillesse à la charge des salariés et de l’augmentation de la CSG au bénéfice de la branche famille.
Mme Mireille Elbaum. La première question sera de savoir s’il faut baisser les cotisations vieillesse des salariés pour le principe, alors que le risque vieillesse est important.
La seconde question sera de déterminer à quelle hauteur la CSG serait augmentée en contrepartie. En effet, cette mesure signifierait un alourdissement du prélèvement sur les revenus du patrimoine, des chômeurs et des retraités. Or la fiscalité des revenus du patrimoine a considérablement été accrue ces dernières années. En outre, on peut se demander s’il faut accroître le prélèvement sur les chômeurs dans la période actuelle. Enfin, s’il est séduisant d’utiliser cette marge de manœuvre potentielle s’agissant des retraités, le risque est celui d’une complexité accrue des prélèvements.
M. le rapporteur. L’Assemblée vient d’adopter un amendement de notre collègue Jean-Marc Germain demandant au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard en particulier des objectifs de progressivité des prélèvements sociaux et fiscaux.
Votre rapport aborde la question de la CSG progressive. Tout en en présentant les difficultés, vous estimez qu’une clarification, y compris au niveau européen, entre ce qui relève de l’impôt et ce qui relève de la cotisation permettrait de faire avancer les choses et d’exclure tout problème constitutionnel. Vous mentionnez également les moyens qui permettraient d’introduire une progressivité.
Dans la palette des scénarios dont vous disposez, lequel a vocation à introduire une plus grande progressivité ? En particulier, en cas de réduction des cotisations vieillesse compensée par une augmentation de la CSG, l’enjeu ne serait-il pas d’introduire concomitamment une CSG progressive ?
M. le coprésident Pierre Morange. Comptez-vous rendre vos conclusions au mois de janvier ?
Mme Mireille Elbaum. Vous disposerez simplement des projections à la mi-janvier. Comme je l’ai dit, les transferts entre branches changent le constat – le PLFSS en cours de discussion prévoit d’affecter à la branche famille une part accrue de CSG et de taxes sur les stocks-options.
Notre système de protection sociale est très redistributif, en raison essentiellement de l’importance des prestations sociales : prestations en nature, notamment d’assurance maladie, prestations sous conditions de ressources et prestations sans conditions de ressources. Une progressivité plus importante des prélèvements donne lieu à réflexion puisque, paradoxalement, ce sont les cotisations employeurs qui sont progressives. Les membres du HCFPS ont considéré que notre système est avant tout basé sur des effets redistributifs via les prestations et que la progressivité des cotisations employeurs découle logiquement de l’objectif en matière d’emploi.
À l’avenir, le vieillissement de la population nous amènera probablement à envisager des prélèvements supplémentaires sur les ménages avec davantage de progressivité. Rendre la CSG progressive impliquerait de prendre en compte l’ensemble des revenus du ménage, alors que la force de cette contribution actuellement est l’automaticité du prélèvement à partir de la fiche de paie. Ainsi, même si cette piste paraît souhaitable, le risque d’inconstitutionnalité fait qu’il est plus facile actuellement d’envisager la progressivité à travers les cotisations sociales.
M. le coprésident Pierre Morange. Merci, madame la présidente.
*
* *
Audition de M. François Fondard, président de l’Union nationale des associations familiales, et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui M. François Fondard, président de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires à l’UNAF, que nous souhaiterions interroger sur le financement de la politique de la famille et sur les scénarios de réforme envisagés par l’UNAF. Je cède donc dès à présent la parole au rapporteur, M. Jérôme Guedj.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Je sais que vous ne manquerez pas de mentionner l’état actuel de la situation, et notamment la fragilisation du financement de la branche famille, mais je vous propose de centrer votre exposé liminaire sur les points suivants : est-il opportun que les cotisations patronales continuent à représenter plus des deux tiers des sources de financement de la branche famille alors que les prestations servies sont universelles ? Est-il pertinent d’affecter des taxes à cette branche ? Parmi les scénarios de réforme, une fiscalisation des recettes de la branche vous paraît-elle une évolution nécessaire ? La budgétisation de certaines dépenses relevant de la solidarité est-elle souhaitable ? La CSG actuelle – à taux unique – est-elle la recette la plus adaptée pour financer la branche famille ? Les perspectives d’introduction d’une progressivité de cette contribution vous semblent-elles intéressantes ou vous inquiètent-elles au contraire ? L’attribution de recettes fiscales complémentaires est-elle envisageable ?
Vous l’aurez compris, notre réflexion porte uniquement sur les recettes de la branche famille, et non sur la maîtrise des dépenses que le tarissement de ces recettes pourrait rendre nécessaire.
M. François Fondard, président de l’Union nationale des associations familiales (UNAF). Je vous remercie, monsieur le président et monsieur le rapporteur, d’avoir invité l’UNAF à se prononcer sur le financement de la branche famille et ses évolutions possibles. Je commencerai par évoquer l’évolution de ses recettes et de son financement, puis je répondrai à vos questions.
La branche famille est financée par trois types de ressources. La première provient des cotisations sociales patronales, qui représentent actuellement 65 % des recettes de la branche, soit 33 milliards d’euros dont 23 milliards issus des entreprises du secteur privé, et 10 milliards du secteur public et de régimes particuliers. Quant au taux de cotisation consacré à la branche famille, il n’a cessé de diminuer au fil des décennies, souvent au profit des autres branches. Et ce mouvement se poursuivra en 2014 puisque le taux actuel de 5,4 % sera diminué de 0,15 point afin de compenser une augmentation du même ordre de la cotisation patronale vieillesse. En outre, compte tenu de la politique d’allégement des coûts sur les bas salaires, ces 5,4 points de cotisation ne correspondent plus désormais qu’à un taux nominal : ainsi la cotisation patronale sur les salaires inférieurs à 1,65 SMIC s’étale-t-elle de 1,3 % pour 1,1 SMIC à 4,8 % pour 1,5 SMIC dans les entreprises de moins de vingt salariés et, pour les mêmes niveaux de SMIC, respectivement entre 1,6 % et 4,8 % dans les entreprises de plus de vingt salariés. Ainsi, pour les salaires situés entre 1 SMIC et 1,6 SMIC, le taux de cotisation moyen effectif s’élève à 2,6 %. Et ce mouvement pourrait se poursuivre avec l’instauration du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qui vise à un allégement du coût du travail pour la masse salariale correspondant aux salaires de moins de 2,5 SMIC.
La deuxième source de recettes est issue d’une partie du produit de la CSG, dont la branche famille a bénéficié dès son instauration en 1991. Le taux de CSG affecté à la branche famille est resté stable jusqu’en 2010 : il était jusqu’alors de 1,08 % pour la CSG assise sur les revenus d’activité salariée et de 1,1 % pour la CSG assise sur les revenus du capital. Puis, en 2011, 0,28 point de la part de CSG affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a été transféré à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). De ce fait, la CSG ne représente plus qu’environ 18 % des produits de la branche famille, soit 9,7 milliards d’euros en 2012, alors qu’elle en constituait 24 % en 2010. Cela étant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 prévoit une augmentation de la part de CSG revenant à la CNAF, portant son taux à 0,87 %, quelle que soit l’assiette, hormis celle des jeux. L’adoption de cette mesure apporterait à la branche famille une recette supplémentaire de 791 millions d’euros.
Enfin, troisième et dernière source de financement, les impôts et taxes affectées ont vu leur part progresser fortement parmi les ressources de la branche famille, notamment en raison de la compensation des allégements de cotisations sur les bas salaires. Ainsi la fiscalité représente-t-elle désormais 15 % des ressources de la branche, soit environ 8 milliards d’euros. Et entre 2006 et 2011, jusqu’à seize impôts et taxes ont vu une part de leur produit affecté à un moment donné à la branche famille. Ce paquet fiscal est en constante évolution – comme l’illustre une nouvelle fois le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui, outre la CSG, prévoit le transfert de recettes supplémentaires issues d’une demi-douzaine de taxes et contributions diverses pour un montant de 1,6 milliard d’euros.
Je vais à présent tenter d’apporter des réponses à vos interrogations.
S’agissant de la pertinence du financement de la branche famille par les cotisations patronales, les arguments avancés par les représentants des entreprises en faveur de la suppression totale de la cotisation patronale de 5,4 % versée à la branche famille sont principalement de deux ordres : ils citent, d’une part, le handicap de compétitivité-prix qu’induit cette cotisation pour les entreprises et, d’autre part, la disparition depuis 1978 de toute condition d’activité professionnelle pour pouvoir bénéficier des prestations familiales – la substitution d’une logique de solidarité nationale à celle de la solidarité professionnelle justifiant selon les représentants patronaux un financement de la branche par l’impôt. Si ces arguments sont recevables, l’UNAF considère cependant que le financement de la branche famille par des cotisations patronales pourrait trouver sa légitimité dans le fait qu’elles représentent la participation des employeurs à l’effort fourni par les salariés pour concilier vie familiale et vie professionnelle. En cela, il ne s’agit pas de charges sociales mais bien de la contribution des entreprises à une politique publique dont elles sont très directement bénéficiaires. Il s’agirait ainsi de refonder la légitimité de ces cotisations, qui ne repose plus sur sa logique historique.
La Cour des comptes relève d’ailleurs dans son rapport de mai 2013 à la MECSS sur le financement de la branche famille que « ces actions ont un impact positif sur le taux d’activité et contribuent ainsi au dynamisme global du marché du travail et à l’augmentation de la croissance potentielle. Les entreprises bénéficient directement au premier chef de la politique ainsi conduite en termes de meilleure productivité individuelle de leurs salariés ayant la charge d’enfants ».
Dans le même rapport, la Cour des comptes présente un tableau actualisé de données fournies dans le projet de rapport de M. Yves Bur, récapitulant l’ensemble des prestations familiales tendant à favoriser la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. S’appuyant pour ce faire sur une hypothèse haute et sur une hypothèse basse qui ne prend en considération que les prestations destinées aux seuls actifs, la Cour souligne que « Les dépenses concernées sont très loin d’être négligeables. Elles se situent pour 2011 dans une fourchette d’un peu plus de 10 à près de 15 milliards d’euros, à comparer à un total de prestations légales et d’action sociale servies par la branche la même année de 38,7 milliards d’euros, soit entre 25 et 38 % de ce total ou encore entre 19 et 29 % de l’ensemble des charges techniques de la branche (52,8 milliards d’euros) ». La Cour ajoute qu’« en termes de financement, ces montants représentent de l’ordre de 1,4 à 1,8 point de cotisation patronale famille. Ces actions ont donc un impact positif sur le taux d’activité et contribuent ainsi au dynamisme global du marché du travail et à l’augmentation de la croissance potentielle. Les entreprises bénéficient directement au premier chef de la politique ainsi conduite en termes de meilleure productivité individuelle de leurs salariés ayant la charge d’enfants ». L’UNAF ajoute qu’en termes de gouvernance, c’est précisément ce lien avec l’activité professionnelle qui justifie l’actuelle organisation institutionnelle des caisses d’allocations familiales, caractérisée par la présence de représentants des employeurs et de salariés dans les conseils d’administration.
Vous nous interrogez également sur la pertinence du financement de la branche famille par des taxes affectées. Historiquement, l’UNAF a toujours plaidé en faveur d’un financement par des cotisations sociales, s’appuyant en cela sur un raisonnement plus concret et pragmatique que théorique : le financement par cotisation est simple, lisible et facilement compréhensible ; il s’agit d’un financement affecté qui ne risque pas d’être remis en cause chaque année au gré des lois de finances et de financement de la sécurité sociale ; les cotisations sont perçues par la branche recouvrement de la sécurité sociale ; enfin, ce mode de financement ne fait pas intervenir le budget de l’État.
Plus récemment, avec la généralisation des aides familiales et l’apparition de prestations familiales sous conditions de ressources à objet redistributif, l’UNAF a admis le principe d’un financement par la solidarité nationale – c’est-à-dire par l’impôt – de certaines prestations de sécurité sociale non contributives ou dites de solidarité. Elle a notamment jugé acceptable le basculement de la part salariale des cotisations sociales vers la CSG – contribution qui présente l’avantage de reposer sur une assiette plus large que les cotisations sociales, englobant les revenus de remplacement et ceux du capital. Le produit de la CSG, comme celui des cotisations, est affecté à la sécurité sociale selon des clés de répartition par branche et cette contribution est prélevée par les Urssaf. Elle est en revanche moins lisible que les cotisations du fait de l’application de taux réduits et de taux différant selon les assiettes concernées.
Le recours à la CSG est cohérent avec la généralisation progressive de la branche famille, mais aussi de l’assurance maladie qui bénéficie de 70 % des recettes tirées de la CSG. La difficulté réside cependant dans le fait que cette contribution finance plusieurs postes de dépenses concurrents : non seulement ces deux branches de la sécurité sociale mais aussi le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la CADES.
Quant à la TVA, peut-elle contribuer au financement de la branche famille, sachant qu’en 2013, 8,7 milliards d’euros de TVA nette seront rétrocédés à la branche maladie de la sécurité sociale en remplacement des TVA « sectorielles » qui pesaient auparavant sur les produits pharmaceutiques et les fournisseurs de tabac ? L’UNAF juge inacceptable de compenser une éventuelle baisse des cotisations patronales par une augmentation de la TVA : car non seulement cela aurait un effet récessif sur la consommation des ménages mais en outre, cela ne ferait qu’amplifier le mouvement de fiscalisation des ressources de la branche famille. Qui plus est, la TVA n’est pas familialisée.
Plus fondamentalement, tout renforcement de la fiscalisation des ressources de la branche famille porte en lui un risque de budgétisation d’une part importante de ses recettes – évolution à laquelle l’UNAF est opposée. Il est certes possible d’y affecter certaines recettes fiscales, à l’image des taxes « comportementales » dont le produit est reversé à l’assurance maladie. Mais il convient d’assurer un minimum de cohérence entre cette fiscalité affectée et les différentes finalités de la branche famille.
En ce qui concerne les scénarios de réforme, l’UNAF juge envisageable le transfert partiel des cotisations sociales sur d’autres ressources, à condition que ces dernières soient suffisamment dynamiques pour garantir la pérennité du financement de la branche famille. Cela supposerait que leur indexation soit elle-même dynamique, ce qu’il est difficile de garantir dans la mesure où elle est soumise aux aléas des besoins de financement de l’État. Comme nous l’avons déjà souligné, nous sommes très réticents au financement de la branche famille par la TVA, impôt qui pèse lourdement sur les familles et qui conserve un caractère anti-redistributif. Il nous paraîtrait donc plus acceptable d’augmenter une nouvelle fois la part de la CSG dans le financement de la branche famille, même s’il est regrettable que ce prélèvement ne tienne pas compte des charges familiales.
Quant à savoir si la fiscalisation des recettes de la branche famille est une évolution nécessaire, il est indispensable mais non moins préoccupant que le budget de l’État finance la compensation de toute nouvelle exonération de charges car cela suppose une réduction des interventions de l’État dans d’autres domaines – ce qui peut s’avérer tout aussi préjudiciable aux familles. Qui plus est, on peut douter que la compensation des exonérations de cotisations ayant été instaurées depuis 1993 ait véritablement été intégrale.
Plus encore, la démultiplication des impôts et taxes affectés au financement de la branche famille est telle que celui-ci est devenu illisible et fragile : illisible tout d’abord, comme en témoigne par exemple l’article 15 du PLFSS qui prévoit l’affectation à la branche famille de la taxe perçue sur les appels des jeux télévisés ou en ligne – recette amenée à se tarir dans la mesure où l’État mène par ailleurs une politique de prévention de l’addiction aux jeux en ligne. On peut par ailleurs s’interroger quant à la pertinence de l’affectation d’une telle taxe à la branche famille. Illisible, ce financement est également fragile, car la branche famille se retrouve à la merci des tours de passe-passe opérés chaque année en lois de finances et de financement de la sécurité sociale – tels que le retrait de certaines ressources et la compensation de la perte qui en résulte par un panier de taxes, à l’affectation desquelles ne semblent présider aucune logique ni aucune vision à moyen terme.
En l’état actuel du financement de la branche famille, l’attribution de recettes fiscales complémentaires ne permet plus de compenser la progression dynamique de certaines prestations, dont celles liées à la petite enfance qui correspondent à une dépense de l’ordre de 12 milliards d’euros – somme comparable à celle que représentent les allocations familiales. De plus, la branche famille a fait l’objet de transferts importants au bénéfice du FSV et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). De sorte que si, entre 1978 – année de la généralisation des prestations familiales à l’ensemble de la population – et 1992, la branche famille n’a été déficitaire qu’à deux reprises, elle l’a en revanche été une douzaine de fois depuis cette date. Enfin, la pérennité de la crise économique a révélé l’une des faiblesses de notre système de financement de la branche famille – comme des autres branches de la sécurité sociale – qui repose sur les cotisations patronales et sur la CSG, c’est-à-dire sur une assiette salariale. De ce fait, l’essentiel des recettes de la branche famille dépend très largement de la conjoncture économique.
Si l’on explique généralement le succès de la politique familiale par sa permanence et sa continuité, la fragilité du financement du système des prestations familiales fait peser une lourde hypothèque sur la poursuite de la performance de cette politique. Il est donc indispensable d’allouer des recettes complémentaires à la branche famille même si, en période de crise, l’UNAF fait preuve d’une attitude responsable, consentant aux efforts nécessaires au rétablissement de la branche. La politique familiale ayant fait la preuve de son efficacité, elle ne doit pas être remise en cause par une action qui s’appuierait uniquement sur un ajustement des dépenses.
Enfin, vous nous interrogez quant à l’éventualité d’une budgétisation de certaines dépenses de la branche famille relevant de la solidarité : si une telle solution est simple à appliquer sur les plans juridique, technique et financier, elle ferait cependant sortir la politique familiale du champ de la sécurité sociale, ce qui constituerait une remise en cause très significative du modèle institué en 1945. Une telle évolution ne paraît pas souhaitable à l’UNAF – pas même une sélection de certaines dépenses de la branche relevant de la solidarité, qui conduirait à revenir à une prise en charge des majorations de pension pour enfants à charge par le FSV et à s’interroger sur la nature exacte de certaines prestations familiales.
En conclusion, je rappellerai que le déficit de la branche famille est artificiel et que cette dernière ne serait pas dans une telle situation s’il ne lui avait pas fallu supporter le poids des majorations de pension.
M. le rapporteur. Nous vous remercions pour la précision de vos réponses. Vous semblez accorder du crédit aux analyses de la Cour des comptes sur la part des dépenses supportées par la branche qui permettent la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle : comment pourrait-on, selon vous, compenser une diminution de 1,8 point de cotisations patronales affectées à la branche famille ? Je précise à cet égard qu’une compensation par le budget de l’État correspond davantage à une fiscalisation qu’à une budgétisation – fiscalisation que l’on constate notamment dans le PLFSS 2014 qui prévoit une baisse de 0,15 point des cotisations patronales pour la branche famille, en compensation de l’augmentation des cotisations vieillesse des mêmes employeurs.
M. le coprésident Pierre Morange. La Cour des comptes conclut ses deux rapports commandés par la MECSS en affirmant que la solution à la question du financement de la branche famille réside plutôt dans la recherche d’économies que dans la définition d’une nouvelle assiette de prélèvements qui ne pénaliserait pas trop la compétitivité des entreprises par un alourdissement du coût du travail. L’UNAF a-t-elle des propositions à formuler quant aux gisements d’économie possibles, sachant que tant la Cour des comptes que la MECSS en ont identifié deux : le revenu de solidarité active (RSA) et l’aide personnalisée au logement (APL) ?
M. François Fondard. Considérant qu’une part du financement de la branche famille doit continuer à incomber aux entreprises au titre de leur contribution à l’effort de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, nous évaluons à environ 2 % les cotisations devant restant à leur charge, contre 5,4 % actuellement. Cependant, sachant que l’État compense déjà à hauteur de 2,8 % les exonérations de cotisations familiales des employeurs, notamment les exonérations de charges sur les bas salaires et pour l’aide à domicile, le reste à charge de cotisations des entreprises est de 2,6 %, de telle sorte que le reste à compenser serait assez faible. Il convient cependant que ces compensations soient bien identifiées.
M. le coprésident Pierre Morange. Tenez-vous compte dans ce calcul du CICE ?
M. François Fondard. Non.
M. le coprésident Pierre Morange. Il me paraît important de le souligner pour la pédagogie de nos débats.
M. François Fondard. Absolument, d’autant plus qu’au titre de ce crédit d’impôt, sont prévues des compensations de charges jusqu’à 2,5 SMIC, ce qui signifie que la participation des employeurs au financement de la branche famille va encore diminuer en deçà des 2,6 % et, par conséquent, que le débat sur la diminution des cotisations patronales n’a plus lieu d’être.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous donnez ainsi davantage de crédit au dernier scénario, évoqué dans un article très récent du journal Les Échos, de basculement du CICE sur une baisse de charges au titre de l’objectif de réduction du coût du travail.
M. François Fondard. Certes, mais le mécanisme du CICE tiendra compte d’une partie des compensations d’exonérations de cotisations déjà prises en charge par l’État. Il nous faudra donc calculer à quoi cela correspond exactement.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans le second rapport commandé par la MECSS à la Cour des comptes, cette dernière fait état des marges de manœuvre extrêmement limitées dont nous disposons quant au mode idéal de financement de la branche famille. La Cour considère en effet que ni la CSG ni la TVA ni encore une taxe écologique ne présentent d’avantage relatif particulier en termes d’impact sur le coût du travail. De telles conclusions nous ayant laissé sur notre faim, nous avons donc demandé à plusieurs économistes s’ils les partageaient. La Cour des comptes a également souligné que dans le cadre de notre réflexion sur la pérennité du financement de la branche famille, il convenait de ne pas négliger la question des gisements d’économies potentiels – elle nous en a d’ailleurs transmis une liste « à la Prévert ». Parmi eux, elle a notamment évoqué le RSA et l’APL qui représentent des volumes budgétaires conséquents. C’est pourquoi la MECSS, s’appuyant sur la notion de dépendance économique, a formulé à leur sujet des préconisations qui se sont traduites sous forme d’amendements aux PLFSS précédents, visant au contrôle de l’éligibilité à ces prestations, et dont la mise en application n’est pas encore tout à fait effective. Qu’en pensez-vous ?
M. François Fondard. L’UNAF considère qu’il n’y a pas lieu de réaliser des économies sur le RSA dans la mesure où cette prestation est particulièrement importante pour les 14,1 % de la population qui vivent sous le seuil de pauvreté. Non seulement le RSA et l’APL nous paraissent indispensables à ces familles mais il conviendrait même de les renforcer. Cela étant, nos moyens budgétaires sont limités.
M. le coprésident Pierre Morange. Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause le RSA ou l’APL. Une réflexion a même été engagée sur l’éventuelle fusion entre le RSA, la prime pour l’emploi (PPE) et d’autres dispositifs. En revanche, nous songeons à exercer un contrôle de l’éligibilité à ces prestations.
M. François Fondard. On s’aperçoit que si l’essentiel des publics ayant droit au RSA socle le perçoivent effectivement, près de 60 % des publics éligibles au RSA activité ne réclament pas leur droit à prestation, compte tenu de la complexité du dispositif, et notamment de celle des formulaires à remplir. Il est néanmoins important d’exiger un minimum d’informations aux demandeurs afin de vérifier leur éligibilité à ces prestations. S’il s’agit d’éviter la fraude, la CNAF a cependant montré dans ses rapports que cette fraude restait très minoritaire.
Pour avoir également travaillé au sein du Haut Conseil de la famille sur les aides au logement relevant du budget de l’État, l’UNAF s’est aperçue que l’aide à la pierre, familiale et individuelle il y a de nombreuses années, est devenue une aide fiscale à la construction de logements à disposition future des familles – tous les ministres du logement ayant institué leur propre dispositif. Or, compte tenu des sommes conséquentes qu’elles représentent, il conviendrait d’en évaluer l’efficacité : si elle est certes avérée en termes de construction de logements, elle ne l’est pas nécessairement en termes d’accessibilité des familles à la propriété.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous remercions, monsieur le président, d’avoir répondu à nos questions de manière aussi synthétique et exhaustive. Nous n’hésiterons pas à vous auditionner à nouveau, notre objectif étant avant tout d’établir un état des lieux, compte tenu des craintes qui s’expriment quant à la pérennité de la branche famille : une pérennité qui suppose un engagement financier de la Nation en termes d’espèces sonnantes et trébuchantes.
*
* *
Audition de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé
M. le coprésident Pierre Morange. Nous accueillons maintenant M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé.
Monsieur le directeur, nous voudrions vous demander de dresser un état des lieux du financement de la branche famille, mais aussi de nous faire part de vos réflexions, sur les recettes comme sur les dépenses. Il existe de multiples mécanismes de compensation pour les entreprises : que reste-t-il finalement à leur charge ? D’autre part, la presse a évoqué une transformation du CICE en baisse de cotisations sociales : qu’en pensez-vous ?
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Nous souhaiterions également connaître le sentiment de la direction de la sécurité sociale (DSS) sur les perspectives de plus grande fiscalisation du financement de la branche famille.
M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé. Il est d’abord intéressant de noter que la part des cotisations patronales représenterait, avec l’adoption du PLFSS, 61,7 % du total des recettes de la branche famille, puisque ce taux diminue sous l’effet de la baisse de 0,15 point des cotisations patronales, compensée par l’affectation de recettes nouvelles et par l’apport du milliard d’euros lié à la baisse du quotient familial. C’est une étape supplémentaire d’une évolution structurelle longue : au début des années 1990, la branche famille était financée à 90 % par des cotisations patronales ; aujourd’hui, nous sommes tout juste au-dessus de 60 %.
L’article 15 du PLFSS, qui vient d’être voté, peut donner l’impression d’une grande complexité des tuyaux de financement de la sécurité sociale : c’est inhérent à la diversité des recettes, mais aussi au choix – pertinent – de limiter les recettes partagées entre l’État et la sécurité sociale. Longtemps, les flux croisés entre l’État et la sécurité sociale étaient multiples : nous nous rappelons tous ces tableaux abominables avec des flèches dans tous les sens… Il n’y a plus aujourd’hui qu’une seule recette partagée : la TVA nette. Cela nous oblige à procéder à des réaffectations de recettes entre les caisses de la sécurité sociale : il y a donc un peu de tuyauterie, suivant l’expression consacrée, mais c’est tout de même une clarification des champs respectifs des recettes de l’État et de la sécurité sociale.
Quant aux perspectives, vous ne serez pas surpris d’apprendre que la DSS rejoint le diagnostic de la Cour des comptes et estime que, pour réfléchir au financement de la branche famille, il faut d’abord s’efforcer de ramener ses comptes à l’équilibre. C’est le but des mesures annoncées par le Premier ministre au mois de juin, et intégrées au PLFSS : représentant près de 800 millions d’euros nets d’économies à l’horizon 2017, elles permettront d’améliorer substantiellement l’équilibre de la branche. En 2017, le déficit sera d’un milliard d’euros, contre un peu moins de 3 milliards en 2013 : c’est un effort considérable. Les prestations de la branche famille sont moins dynamiques que l’évolution de ses recettes : si la croissance se révèle conforme aux prévisions, elle pourra donc revenir à l’équilibre.
Aux efforts sur les dépenses s’ajoute une amorce de désendettement, puisque, compte tenu de l’amélioration du solde de la branche retraite et du FSV à l’horizon 2018, l’article 14 du PLFSS intègre les déficits de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de la CNAF dans le champ des reprises de la CADES.
Mme Mireille Elbaum vous a certainement fait part de façon détaillée des travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFPS), et je n’y reviens pas. Le Haut Conseil continuera à réfléchir en 2014, mais nous disposons déjà là d’une base de travail substantielle qui a mis en avant des notions et des diagnostics, qui ne sont pas consensuels, mais dont nous pourrons discuter avec les partenaires sociaux.
À ce stade, nous n’avons été saisis d’aucune demande de réflexion sur un éventuel transfert du CICE vers des baisses de cotisations. Aujourd’hui, le CICE est déconnecté de la mécanique des cotisations sociales : il est possible de savoir dans quelle mesure les allégements généraux et le CICE permettent de réduire les charges fiscales et sociales des entreprises, mais on ne peut pas facilement aller beaucoup plus loin.
Sur une éventuelle budgétisation accrue de la branche famille, je suis très réservé. La Cour des comptes le dit : cela n’apporterait rien en termes de lisibilité ou de responsabilité ; cela ne renforcerait pas notre crédibilité à assurer un équilibre de la branche, puisqu’il n’existerait plus d’équilibre… Nous comprenons la difficulté de piloter des prestations « de guichet » – allocation aux adultes handicapés (AAH) par exemple – mais la budgétisation ne nous paraît pas une réponse pertinente aux problèmes rencontrés.
Certains observateurs ou partenaires sociaux estiment que les entreprises n’ont pas à financer la branche famille. Je suis d’un avis plus nuancé : il faut prendre en considération tous les apports de la politique familiale, en termes de taux d’activité des femmes, de natalité, d’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, de conditions de travail dans l’entreprise… Il ne me paraît donc pas illégitime que les employeurs soient mis à contribution pour financer la branche famille. Certes, un débat politique doit déterminer à quelle hauteur, et selon quelles modalités, mais les évolutions, je l’ai dit, ont déjà été massives depuis trente ans. Il me semblerait en tout cas quelque peu illogique que les entreprises ne participent pas du tout au financement de la branche famille.
M. le rapporteur. Pour compenser le milliard d’euros que représente la baisse de 0,15 point des cotisations patronales, de nouvelles ressources – fiscales – ont été attribuées à la branche famille : quelles sont-elles précisément ?
M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé. À l’horizon 2017, nous serons d’ailleurs à une baisse de 0,30 point, soit 2 milliards d’euros.
L’étude d’impact de l’article 15 du PLFSS pour 2014 présente ces modifications : la baisse des cotisations familles représente une perte de 1,159 milliard d’euros pour la branche. Pour la compenser, nous modifions les clés de répartition des allégements généraux entre les différentes branches, ce qui rapporte 194 millions ; la taxe sur les véhicules de société, initialement affectée à la Mutualité sociale agricole (MSA), est transférée à la CNAF, ce qui représente 893 millions d’euros ; la contribution sur les stock-options ainsi que celle sur les jeux et les paris, à hauteur respectivement de 489 et 231 millions d’euros, sont également affectées à la CNAF. Nous modifions la répartition des recettes de la CSG, ce qui bénéficie à la CNAF à hauteur de 791 millions d’euros. En revanche, dans le cadre de la simplification de la répartition des recettes entre les branches, la branche famille perd 471 millions d’euros de prélèvements sur le capital, et 53 millions d’euros de taxes sur les salaires.
Nous avons bien conscience qu’une telle présentation donne une impression d’extrême complexité. Mais il faut regarder l’article 15 dans son ensemble : les réaffectations de recettes que nous opérons entre CNAM, CNAF, FSV et CNAV simplifient l’affectation de différents prélèvements – forfait social, prélèvement social sur le capital… Les droits sur le tabac sont également rendus à la MSA, qui en était historiquement bénéficiaire.
M. le rapporteur. Le Haut Conseil a présenté plusieurs scénarios d’évolution, dont certains modifieraient largement notre système. Quel est le regard de la DSS sur ces propositions qui, il faut bien l’avouer, paraissent très complexes au profane ? Quelle est la faisabilité des clarifications proposées ?
M. Thomas Fatome. C’est un sujet délicat, qui paraît technique mais qui est in fine politique, puisqu’il s’agit d’opérer des choix de financement de différentes branches, de répartition de la charge du financement entre différents acteurs, d’équilibre entre pouvoir d’achat et compétitivité également.
Il nous semble donc qu’il faut aller plus loin dans l’analyse de ces différents sujets, et bien mesurer leurs possibles conséquences pour la feuille de paie des salariés, puisqu’il s’agit de jouer sur les cotisations sociales et sur la CSG. Pour éviter une baisse de pouvoir d’achat, le rapport du Haut Conseil évoque d’ailleurs la piste d’une augmentation généralisée des rémunérations, ce qui paraît juridiquement très compliqué.
Je ne voudrais pas donner l’impression de botter en touche, mais le sujet est extrêmement complexe, et en tout état de cause, il faudrait bien mesurer les conséquences de clarifications massives. Il n’existe pas, comme l’a écrit Malinvaud il y a longtemps déjà, d’assiette miracle, ni d’ailleurs plus généralement de solutions miracle. Là encore, le retour à l’équilibre nous ouvrirait de plus grandes marges de manœuvre pour aborder ces sujets.
M. le coprésident Pierre Morange. La légitimité de la participation des entreprises au financement de la branche famille fait plutôt consensus. Du fait des compensations, elle est d’ailleurs plutôt de 2,6 % que de 5,4 %, initialement définis dans les textes : la Cour des comptes rappelle donc de façon insistante qu’il faudrait intégrer les différentes exonérations dans les budgets.
Dans le rapport que la MECSS lui a commandé, la Cour conclut que les différents scénarios de modifications des assiettes et des prélèvements auraient des effets plus ou moins similaires sur le coût du travail. Il est donc nécessaire de dégager plutôt des économies !
Parmi les gisements d’économies, la MECSS, comme la Cour, estiment qu’il faudrait s’intéresser à certaines prestations – dont le principe est naturellement légitime, et qu’il ne s’agit pas de remettre en question – dont le volume financier est important : il nous semble nécessaire de mieux contrôler notamment l’attribution du RSA et de l’APL. Certaines modifications législatives ont été récemment effectuées, à la suite des préconisations de la MECSS : en avez-vous déjà mesuré l’efficacité ?
M. Thomas Fatome. Je commence par rappeler que certaines prestations sont gérées par les caisses d’allocations familiales pour le compte de l’État.
Le directeur général de la CNAF a fait récemment le point sur la lutte contre la fraude. La branche est très attentive à ce sujet, inscrit dans la convention d’objectifs et de gestion (COG), et obtient des résultats, tant en exploitant les données dont elle dispose que par des contrôles sur place. Depuis plusieurs années, l’ensemble des acteurs agissent, notamment par le partage de fichiers. Le plan de redressement des comptes de la branche famille intègre d’ailleurs 100 millions d’euros obtenus par la lutte contre la fraude à l’horizon 2016.
M. le coprésident Pierre Morange. La procédure de requête systématique, avec croisement automatique des fichiers fiscaux, doit permettre de contrôler non seulement la légitimité de l’ouverture des droits, mais surtout l’intégration des sommes reçues. Les contrôles en seraient grandement améliorés… Des promesses de mise en œuvre d’un tel dispositif ont été faites sous la législature précédente : cela permettrait, en réaffectant certaines sommes, de mieux répondre aux situations des allocataires qui en ont vraiment besoin. C’est un problème que je continuerai d’évoquer tant qu’il ne sera pas réglé.
En matière de prestations légales, avez-vous identifié des gisements d’économies ?
M. Thomas Fatome. Je crains de vous décevoir, monsieur le président… Nous sortons d’un travail assez approfondi sur ces sujets, dans le cadre des travaux du Haut Conseil de la famille présidé par Bertrand Fragonard ; le Premier ministre a déjà annoncé des mesures au mois de juin dernier. Notre priorité est – cela ne vous étonnera pas – le vote et l’application du PLFSS, qui prévoit un montant substantiel de 800 millions d’euros d’économies.
La DSS, certes très attentive aux problèmes budgétaires, est très attachée à ce que d’éventuelles mesures d’économie ne remettent pas en cause la structure de nos politiques familiales et des prestations, qui peuvent certes être jugées complexes mais ne répondent pas si mal aux objectifs pour lesquelles elles ont été conçues – redistribution, garde d’enfants…
En dehors du domaine des prestations légales, la COG signée avec la branche famille prévoit une croissance des crédits de 7,5 % en moyenne par an – effort considérable pour nos finances publiques. Mais c’est, je crois, un investissement pertinent : si l’on devait faire des économies, il faudrait néanmoins préserver la logique et l’efficacité des politiques familiales.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans mon esprit, il ne s’agit pas de diminuer les crédits, mais bien de mieux les utiliser.
M. Thomas Fatome. C’est ce que nous faisons avec le PLFSS pour 2014 : par exemple, nous augmentons le complément familial et l’allocation de soutien familial, nous ajustons les conditions de versement de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)… Nous allons donc dans le sens que vous souhaitez : le recentrage des aides sur les familles qui en ont le plus besoin. Nous verrons s’il est possible d’aller encore plus loin.
M. le rapporteur. L’Assemblée vient d’adopter un amendement de Jean-Marc Germain selon lequel le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur la réforme du financement de la protection sociale. Il s’agit notamment de s’interroger sur la progressivité du prélèvement social. La DSS y réfléchit-elle de son côté ?
Dans le contexte européen, quelle est par ailleurs votre doctrine sur la définition de la CSG comme cotisation ou comme imposition ?
M. Thomas Fatome. La CSG, dans l’ensemble, n’est pas dénuée de progressivité – vous le savez, les différents taux, les différentes exonérations, la non-déductibilité partielle de l’impôt sur le revenu… constituent des éléments de progressivité. C’est évidemment là un sujet délicat, qui doit donner lieu à un débat politique.
Nous considérons aussi que le débat doit prendre en considération à la fois les recettes et les dépenses : aujourd’hui, les prestations françaises sont extrêmement redistributives, et pas seulement grâce à des prestations ciblées. Peut-on dès lors financer un système de dépenses très redistributif avec un prélèvement qui cesserait d’être, comme l’actuelle CSG, large et assez peu redistributif ? Cela me paraît très difficile.
Enfin, je suis assez favorable à la définition de la CSG comme cotisation que propose le Haut Conseil : cela fait le lien avec son affectation. C’est l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), alors que le Conseil constitutionnel considère que la CSG appartient aux « impositions de toutes natures ». Il faudrait donc, en droit, faire évoluer le statut de la CSG. Nombre de nos prélèvements ont un statut mixte – c’est également le cas du forfait social ; le critère de l’affectation, qui est celui adopté par la CJUE, nous semble présenter certaines vertus.
M. le coprésident Pierre Morange. J’en reviens à la nécessité de dégager des économies, ce qui veut dire aussi rationaliser la dépense publique. La MECSS a posé avec une certaine insistance des questions sur des sujets qui peuvent sembler marginaux, mais qui permettraient d’améliorer l’efficience de la dépense publique.
Nous avons ainsi posé aux différentes branches des questions sur leurs systèmes informatiques, mais nous n’avons reçu à peu près aucune réponse. Nous n’avons reçu qu’une réponse très partielle de la branche famille, après avoir pourtant très lourdement insisté sur le sujet lors d’une audition. Les licences coûtent tout de même quelque 30 millions d’euros annuels à la seule branche famille, qui pourrait pourtant utiliser des systèmes libres. Nous aimerions donc être tenus au courant du « dialogue compétitif » en cours – on peut d’ailleurs se demander si c’est vraiment la procédure la plus pertinente. Nous attendons également les réponses des autres branches.
Nous souhaitons donc très ardemment que la DSS appuie notre demande. Dans le cas inverse, je me devrais de me saisir de mes pouvoirs spéciaux de contrôle sur pièces et sur place. Et soyez assuré que je n’hésiterais pas une seule seconde !
M. Thomas Fatome. Je transmettrai le message.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels systèmes informatiques utilise la DSS ? Les préoccupations sont-elles les mêmes ?
M. Thomas Fatome. Nous sommes modestement 240 agents, et notre système informatique est géré par la direction informatique du ministère.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est donc un sujet de moindre importance, mais je souhaiterais néanmoins quelques informations.
Notre rapport sur le financement de la branche famille devrait être rendu au mois de mars. Nous serons attentifs à tous les éléments complémentaires que vous jugeriez utile de nous transmettre, notamment à propos des systèmes informatiques mais surtout de la systématisation des échanges de données entre les organismes sanitaires et sociaux et le fisc. Je souhaiterais donc que vous nous fournissiez un échéancier précis de la mise en œuvre de cet engagement des pouvoirs publics. La lutte contre la fraude fiscale et sociale est, je crois, un objectif qui fait consensus.
M. Thomas Fatome. Comptez sur nous. S’agissant du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) auquel vous faites allusion, sa montée en charge se poursuit, et nous serons à même de vous en rendre compte.
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS y attache un très grand prix.
Merci, monsieur le directeur.
Audition de Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), et M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral, M. Jean-Yves Delannoy, délégué national pour le secteur de la protection sociale de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), et Mme Justine Vincent, chargée d’études économiques, Mme Marie-Madeleine Pattier, administratrice de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), M. Michel Coronas, administrateur de la Confédération générale du travail (CGT) à la CNAF, et M. Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral, MM. Patrick Brillet et Didier Aubossu, administrateurs de Force ouvrière (FO) à la CNAF
M. le coprésident Pierre Morange. La Mission d’évaluation s’est saisie de la question du financement de la branche famille. C’est à ce titre que nous accueillons ce matin les représentants des principales organisations syndicales de salariés : Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), et M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral ; M. Jean-Yves Delannoy, délégué national pour le secteur de la protection sociale de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), et Mme Justine Vincent, chargée d’études économiques ; Mme Marie Madeleine Pattier, administratrice de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; M. Michel Coronas, administrateur de la Confédération générale du travail (CGT) à la CNAF, et M. Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral, et MM. Patrick Brillet et Didier Aubossu, administrateurs de Force ouvrière (FO) à la CNAF.
Je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. Je vous prie d’excuser Jean-Marc Germain, coprésident, retenu en séance publique où est actuellement examiné le projet de loi de finances.
Nous avons procédé à un certain nombre d’auditions après avoir pris connaissance des deux rapports de la Cour des comptes analysant l’évolution de la branche famille et son déficit. Comment appréciez-vous l’impact des différentes réformes qui ont affecté cette branche et en quoi, selon vous, ont-elles fragilisé sa situation financière ?
Comment analysez-vous les réflexions en cours concernant l’assiette des prélèvements ? Que pensez-vous de l’éventuelle budgétisation, voire de la fiscalisation du financement de cette branche ?
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Dans le cadre de notre réflexion sur les perspectives du financement de la branche famille, il était important pour nous d’entendre sur le sujet les partenaires sociaux, garants du fonctionnement paritaire de notre système de protection sociale – nous auditionnerons dans les prochaines semaines les organisations patronales – et de connaître le point de vue de ceux qui pilotent la branche famille sur les dépenses, sur leur évolution et sur les choix opérés par les pouvoirs publics, ainsi que sur la structure et les modalités du financement de la branche.
Quel est votre jugement rétrospectif sur l’évolution de ce financement ? Quelle analyse faites-vous de sa structure actuelle et de la part prépondérante qu’y occupent encore les cotisations patronales, compte tenu du caractère universel de la politique familiale ?
Les organisations que vous représentez siègent au Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFPS). Quel est votre sentiment sur les diverses pistes de réforme, en particulier sur celles que la Cour des comptes a mentionnées dans son rapport daté de mai dernier ? Lesquelles vous semblent les plus pertinentes ? Comment pourraient-elles s’articuler avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ?
M. le coprésident Pierre Morange. Je précise que nous avons demandé à la Cour des comptes de préciser quels seraient les prélèvements et les assiettes les plus pertinents. Si je résume à gros traits la réponse donnée dans son second rapport, il n’y aurait selon elle que peu d’avantages à modifier l’assiette du financement : la résorption du déficit de la branche passerait avant tout par la réalisation d’économies.
Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la Confédération française démocratique du travail (CFDT). Notre position étant quelquefois déformée, je commencerai par préciser la façon dont la CFDT conçoit le financement de la branche famille.
Nous sommes très attachés au maintien du caractère universel des politiques familiales, mais nous pensons qu’il n’est pas exclusif d’une contribution à une politique de redistribution, même si certains soutiennent que telle n’est pas leur vocation. Ce caractère universel permet de s’assurer le consentement de nos concitoyens à un financement qui se fait via les cotisations et l’impôt, dans la mesure où ils ont le sentiment que ces politiques pourront leur bénéficier un jour ou l’autre, mais la redistribution également est un enjeu à caractère universel, de même d’ailleurs que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, le soutien à l’autonomie et l’accès des femmes au marché du travail.
Pour nous, les évolutions passées du financement des politiques familiales se caractérisent surtout par leur complexité et par l’affectation de recettes non pérennes. Ainsi l’affectation de 0,28 point de contribution sociale généralisée (CSG) à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a été compensée par des recettes budgétaires. Autre exemple plus récent : on s’est engagé auprès des employeurs à compenser l’augmentation de 0,15 point de leurs cotisations « retraite », mais nous ne savons pas d’où viendront les recettes qui seront utilisées à cette fin, si ce n’est qu’elles seront essentiellement d’origine budgétaire et nous n’avons aucune assurance quant à leur caractère pérenne. Cette compensation, tout comme le CICE, illustre le mélange de plus en plus accentué de recettes issues de cotisations et de ressources fiscales, ce qui brouille la lisibilité du dispositif et fait peser un risque d’instabilité sur les financements.
Nous pensons qu’au-delà de la branche famille, et plus largement de la politique familiale, il convient de clarifier le financement de la protection sociale dans son ensemble. Les prestations de nature assurantielle, qui se traduisent par le versement de revenus de remplacement – vieillesse, chômage, indemnités journalières en cas de maladie – devraient relever essentiellement d’un financement issu des cotisations sur les revenus du travail, puisqu’un revenu de remplacement doit avoir un lien intime avec le revenu que percevait la personne lorsqu’elle était en activité.
En revanche, les prestations à caractère plus universel – maladie, à l’exception des indemnités journalières, famille, perte d’autonomie – doivent, de ce fait, relever d’un financement plus large. En cas de perte d’autonomie par exemple, tous les citoyens devraient avoir droit à une aide, par le biais de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) ou par tout autre moyen. Nous espérons que cette aide sera rapidement instaurée dans le cadre d’une réforme de la prise en charge de la perte d’autonomie, mais, en tout état de cause, il n’est pas normal que seuls les revenus du travail salarié financent ce risque.
S’agissant de la branche famille, la CFDT est favorable à ce qu’elle bénéficie d’une partie – mais d’une partie seulement – des cotisations patronales. Il est indéniable en effet que les entreprises bénéficient dans une certaine mesure des politiques familiales, notamment de celles qui visent à faciliter la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et à favoriser l’accès des femmes à l’emploi, qui constituent un atout pour la compétitivité de notre pays. Dès lors, rien ne justifie que les employeurs soient totalement exonérés de leur financement.
Il existe des marges de manœuvre en matière de transfert d’un outil vers l’autre, mais nous insistons – et c’est même pour nous une condition sine qua non – pour que ces transferts se fassent dans le cadre d’un scénario global de réaménagement du financement des prestations sociales garantissant le maintien du pouvoir d’achat des salariés. Nous exprimons les plus vives réserves à l’égard des projets du patronat qui, présentés parfois de façon caricaturale, consisteraient à transférer les 5,4 points de cotisations familiales sur la fiscalité – peu importerait le support – et à laisser ainsi les salariés payer un peu plus de CSG, par exemple, tandis que l’économie réalisée permettrait d’alléger le coût du travail pour le plus grand bénéfice des employeurs. Parmi les scénarios proposés par le Haut Conseil, nous sommes donc plutôt en faveur du scénario n° 3.2 qui prévoit ce réaménagement global préservant le pouvoir d’achat des salariés.
Autre point important à nos yeux : nous souhaitons que l’affectation de l’outil fiscal utilisé pour ces transferts soit garantie à la protection sociale. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous préférons la CSG à tout autre outil, en particulier à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Nous avons cru comprendre, bien que la communication du Gouvernement ne soit pas très claire à ce sujet, que le projet de taxation de l’excédent brut d’exploitation visait aussi à faire payer aux entreprises l’exonération de 0,15 point de cotisation. Ce dispositif ne nous convient pas car il n’est pas fléché vers la protection sociale et ne garantit pas la pérennité des ressources. Nous préférons un scénario de transfert qui, même s’il est plus complexe techniquement, garantirait la pérennité du financement de la protection sociale et le pouvoir d’achat des salariés.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel serait le volume de cotisations concernées par le transfert ?
Mme Véronique Descacq. Nous vous communiquerons l’avis que nous avons rendu au HCFPS. Nous avions retenu un scénario conduisant à une baisse de 3,2 points des cotisations patronales, compensée par une hausse de la CSG. Cependant, alors que le scénario du Haut Conseil était neutre, ou en tout cas ne prévoyait pas de changement majeur du niveau des prélèvements, nous pensons, nous, que si le transfert s’opère sur la CSG, il faudrait élargir l’assiette à d’autres revenus que ceux du travail, en premier lieu aux revenus du capital et, peut-être, à certains revenus de remplacement. Agir sur l’assiette permettrait une économie, mais l’utilisation de celle-ci doit, selon nous, faire l’objet d’un débat. Il ne va pas de soi en effet qu’elle serve intégralement et sans condition à accroître les marges des entreprises. Nous voulons pouvoir vérifier qu’elle sera affectée à la compétitivité, si cela sert l’investissement, ou au financement d’autres risques relevant de la protection sociale, comme le risque chômage. Nous savons en effet que l’assurance chômage aurait besoin de recettes nouvelles pour réduire son déficit.
Conformément à la formule « investissement productif, investissement social » que nous avons mise en avant lors de la Conférence sociale qui s’est tenue en juin dernier, nous devons donc débattre de l’affectation de cette économie afin d’éviter, comme nous le proposent de façon très caricaturale les organisations d’employeurs, qu’elle ne serve qu’à réduire le coût du travail.
Si la branche famille est déficitaire depuis plusieurs années, la raison en est simple : c’est qu’on lui a affecté la charge de payer les avantages familiaux liés à la retraite. Si nous nous réjouissons que ces avantages soient désormais fiscalisés, encore que nous aurions préféré que cette fiscalisation soit fléchée vers la branche famille, nous estimons qu’ils restent trop anti-redistributifs. Nous avons donc insisté, lors de la préparation de la réforme des retraites, pour que soit accélérée leur forfaitisation.
Nous souhaitons également, dans le cadre d’une réforme fiscale globale, poser la question de la suppression du quotient familial et du quotient conjugal qui, en dehors du fait qu’ils privent le budget de l’État de recettes, sont tout aussi anti-redistributifs, sans oublier que le quotient familial a des effets pervers sur l’emploi des femmes. Mais cette suppression ne sera possible que dans le cadre d’une réforme globale, faute de quoi elle ferait peser une charge trop lourde sur les ménages à revenus moyens.
M. Jean-Yves Delannoy, délégué national pour le secteur de la protection sociale de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC). Nous insistons nous aussi sur le caractère universel des politiques familiales et sur leur fonction redistributive, mais le consentement à leur financement nous paraît fortement ébranlé. Notre rencontre intervient en effet dans un contexte de burn out fiscal pour les classes moyennes. Il faudra trouver des remèdes à cette situation.
Je commencerai mon propos en jetant un regard rétrospectif sur le financement de la branche famille. En septembre 2012, la CFE-CGC a été la seule organisation à voter contre l’augmentation de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire, non parce qu’elle s’opposait à cette mesure mais parce qu’elle refusait son financement qui, après avoir été assuré la première année par l’État, a par la suite pesé sur le quotient familial. Pour les mêmes raisons, la CFE-CGC n’a pas voté le rapport remis au Premier ministre par M. Bertrand Fragonard.
Nous nous réjouissons de l’arbitrage qui a abouti à écarter la mise sous conditions de ressources des allocations familiales, qui était l’une des hypothèses de ce rapport. Le plafond du quotient familial, qui était déjà passé de 2 330 euros à 2 000 euros, a été fixé en 2013 à 1 500 euros. Cette baisse, qui atteint de plein fouet les familles, nous apparaît contraire au principe de redistribution.
Nous vous alertons d’autre part sur le fait que le déficit de la branche, qui était jusqu’alors repris par la CADES, ne l’est plus à compter de l’exercice 2012 et ne pourra dès lors que s’accumuler.
Nous sommes, nous aussi, attachés à la pérennisation des recettes de la branche famille, mais il semble que nous n’en prenions pas le chemin. Nous nous réjouissons toutefois de voir que les allocations familiales ne sont pas encore fiscalisées.
En revanche, la compensation de la baisse de 0,15 point des cotisations patronales par un transfert de TVA nous inquiète. Je rappelle à ce propos que la CFE-CGC, dans une note sur le financement de la protection sociale, proposait la création d’une cotisation sociale sur la consommation, ce qui aurait permis de taxer les produits importés.
Enfin, nous attendons, nous aussi, beaucoup des travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale et nous souhaitons une remise à plat du financement de la branche famille. Nous sommes prêts à y contribuer.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle est la position de chacune de vos organisations syndicales sur le CICE ? Plusieurs économistes que nous avons auditionnés récemment proposent de consacrer les 20 milliards d’euros engagés dans ce cadre à des exonérations de cotisations patronales. Quel est votre sentiment sur ce point ?
M. Jean-Yves Delannoy. Nous souhaitons, à la CFE-CGC, que soit retenue la proposition de M. Louis Gallois qui tendait à porter le plafond d’éligibilité de 2,5 à 3,5 salaires minimum interprofessionnels de croissance (SMIC).
M. le rapporteur. Mais dans un rapport qui préconisait, non un crédit d’impôt, mais une baisse des cotisations, répartie dans la proportion de deux tiers à un tiers entre les cotisations patronales et les cotisations salariales…
Mme Marie-Madeleine Pattier, administratrice de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Je tiens avant tout à rappeler l’attachement de la CFTC à la gestion paritaire de la branche famille ainsi qu’à l’universalité des allocations familiales, qui ne fait toutefois pas obstacle au versement de prestations en fonction de caractéristiques propres à certaines familles.
Pour ce qui est de l’évolution du financement de la branche, j’évoquerai tout d’abord les dépenses pour constater que nous gérons de plus en plus de prestations qui ne sont pas strictement liées à la famille. Je prendrai pour exemple l’instruction des dossiers du revenu de solidarité active (RSA). Lorsque les caisses d’allocations familiales instruisaient ceux du revenu minimum d’insertion (RMI), la branche famille percevait une ressource couvrant cette charge. Depuis l’instauration du RSA, ce n’est plus le cas alors même que cette instruction demande un travail encore plus complexe.
M. le rapporteur. Vous parlez des frais de gestion ?
Mme Marie Madeleine Pattier. En effet.
M. le coprésident Pierre Morange. Cette question est très souvent évoquée. Quel est le coût de la gestion de cette prestation ? La Cour des comptes donnant la priorité à la réalisation d’économies, il serait intéressant pour la Mission d’évaluation de le connaître pour évaluer celles qui pourraient être faites sur ce poste, qui ne relève pas des missions premières de la branche.
Mme Marie-Madeleine Pattier. Je vous ferai parvenir cette information par écrit.
La branche famille assume en outre la charge de la protection juridique des majeurs, dont un grand nombre pourtant n’ont pas charge d’enfant, et celle de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Nous avons du mal à établir un lien avec la branche famille – et nous trouvons d’ailleurs d’autant plus critiquable, dans le second cas, le transfert de 0,15 point de cotisations patronales de la branche famille à la branche vieillesse !
Pour en venir maintenant aux recettes, j’observe qu’on parle toujours de 5,4 % de cotisations patronales en oubliant qu’au fil des années, ce taux a été abaissé à 1,3 % ou à 1,6 %, selon la taille de l’entreprise, pour les salaires égaux à 1,1 SMIC. Il n’est encore que de 4,8 % quand on en arrive à 1,5 SMIC, de sorte que le taux de cotisation moyen, pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, s’établit à 2,6 %, loin donc des 5,4 % annoncés. Nous aimerions que l’on dise les choses telles qu’elles sont, d’autant que le MEDEF sait fort bien ce que lui coûtent ces cotisations.
Nous restons attachés au financement par les cotisations patronales dans la mesure où la branche famille a pour mission de faciliter la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Si la France a l’un des meilleurs taux d’emploi des femmes, elle le doit en partie à ce dispositif et, plutôt que de réduire des recettes qui permettent aux femmes de travailler de plus en plus nombreuses, il serait préférable de tendre vers l’égalité des salaires.
La CFTC s’est toujours élevée contre les exonérations multiples et variées, qui ne sont pas compensées ou ne le sont qu’avec retard, après que la branche famille a versé les prestations correspondantes, ce qui entraîne pour elle le paiement d’agios. Et c’est précisément parce que tout nous paraît préférable à de nouvelles exonérations que nous sommes prêts à tenter l’expérience du CICE.
M. Michel Coronas, administrateur de la Confédération générale du travail (CGT) à la CNAF. Je rappelle que le taux des cotisations familiales a été par le passé bien plus élevé qu’il ne l’est aujourd’hui. Les cotisations ont fait l’objet de substantiels allégements, notamment de modulations en fonction des niveaux de salaire, comme cela vient d’être rappelé.
Il est faux de soutenir que le déficit de la branche famille serait structurel : il est dû à l’attribution d’un certain nombre de charges qui devraient normalement relever d’autres branches de la sécurité sociale, en particulier de la branche « retraites ». Dès lors, la nécessité de remettre à plat le financement de la branche perd une grande part de sa justification. Je ne nie pas pour autant qu’il y ait des choses à revoir : ainsi il est fortement question de fiscaliser la bonification de 10 % accordée aux retraités ayant élevé au moins trois enfants mais, bizarrement, c’est la branche vieillesse qui devrait bénéficier du produit de la mesure, et non la branche famille qui finançait cette majoration. Ce point mériterait d’être changé – mais c’est de la responsabilité du législateur.
Nous sommes bien sûr attachés à l’universalité des prestations familiales dans la mesure où elle est étroitement liée à l’acceptabilité de l’effort fiscal. Il faut mettre les familles au premier plan, et la première redistribution, qui est d’ailleurs à l’origine de la création de la branche, doit être orientée au profit de celles qui ont charge d’enfants : toutes les études démontrent qu’il y a une différence de niveau de vie entre elles et celles qui n’ont pas d’enfant. En revanche, il faut éviter la confusion : pour faire de la redistribution fiscale, il existe d’autres outils.
En ce qui concerne l’évolution de la branche, il nous semble qu’on s’engage progressivement dans une direction opposée au paritarisme, conduisant à transformer la CNAF en agence de l’État. En effet, la caisse est de plus en plus chargée de mettre en œuvre des politiques de l’État. Nous souhaiterions plus de clarté en la matière. Il est normal que les politiques qui relèvent de l’État bénéficient d’un financement de celui-ci, mais celles qui sont négociées entre les partenaires sociaux doivent rester dans le cadre de la branche famille de la sécurité sociale.
Nous ne contestons pas la nécessité de réformer la fiscalité des entreprises. Mais nous espérons qu’il ne s’agira pas de nouveaux allégements car ceux-ci sont déjà nombreux, qu’il s’agisse du crédit impôt recherche ou du crédit d’impôt pour la compétitivité, sur lequel nous sommes plus que réservés car il est appliqué sans discernement et sans critères de sélection. Nous sommes plutôt favorables à une modulation de cette fiscalité en fonction des richesses que les entreprises apportent réellement à l’économie nationale et à la sécurité sociale. Il conviendrait notamment d’établir une distinction entre les entreprises en fonction de la part de la valeur ajoutée qu’elles consacrent aux salaires et de leur comportement en matière d’emploi. Nous devrions être plus sélectifs dans notre gestion du régime de cotisations. Cette position est d’ailleurs corroborée par le constat de certaines pratiques d’optimisation fiscale, qui permettent aux entreprises concernées d’occulter une partie de leurs bénéfices et, ainsi, de ne pas contribuer comme elles le devraient à l’effort qui est demandé à tous.
M. Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral de la CGT. Nous sommes comme tous ici très attachés au maintien de l’universalité des prestations familiales et nous considérons que la meilleure façon de garantir cette universalité est de continuer à considérer la branche famille comme un élément à part entière de la sécurité sociale. Il est important de poser ce principe au vu de certains débats actuels.
Il en découle que la politique familiale a vocation à être financée par des cotisations sociales, qui sont un élément du salaire socialisé. C’est pourquoi nous avons une position très critique à l’égard d’une baisse des cotisations des employeurs accompagnée d’un transfert de la charge sur d’autres assiettes : ce serait en réalité une baisse de salaire. Pour nous, il est essentiel que la politique salariale tienne compte des coûts liés à l’éducation des enfants.
D’autres éléments plaident dans le même sens. D’une part, nous considérons que la protection sociale est un élément du développement durable dans la mesure où le bien-être des générations futures en dépend fortement. D’autre part, comme l’a rappelé Mme Descacq, les entreprises ont une responsabilité sociale à l’égard de leurs salariés, celle de contribuer à leur bien-être.
Pour toutes ces raisons, nous sommes attachés à la logique actuelle. Pour nous, la question n’est pas de faire évoluer le financement de la branche famille, mais bien plutôt d’opérer une réforme d’ensemble du financement de la sécurité sociale, réforme dont l’élément principal serait la modulation des cotisations.
Autre point important : nous devrions nous interroger sur les évolutions possibles de la CSG, en particulier de ses différentes assiettes, et éventuellement envisager, dans ce cadre, l’instauration d’une contribution sociale assise sur les revenus financiers des entreprises et dont le niveau pourrait, selon nous, être relativement élevé.
En ce qui concerne le rapport du Haut Conseil, même si ses conclusions ne nous conviennent pas, nous aurions pu être d’accord avec l’idée d’une clarification du financement, mais j’observe que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 fait exactement l’inverse. On a rarement fait pire en matière de complexité des circuits de financement que dans ce texte, qui prévoit une série de transferts de branche à branche mais surtout un transfert de TVA entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour un montant de près de 2 milliards d’euros. En outre, en ce qui concerne la branche famille, de très fortes incertitudes pèsent sur la façon dont sera compensée la baisse de 0,15 point de la cotisation « famille », baisse à laquelle nous sommes hostiles. Le projet de loi de financement de la protection sociale (PLFSS), de ce point de vue, va dans le mauvais sens.
Quant au CICE, nous le voyons comme un substitut à une augmentation des exonérations de cotisations sociales au-dessus du plafond actuel de 1,6 SMIC. Dans la mesure où nous sommes hostiles à ces exonérations, nous ne pouvons que nous montrer critiques à l’égard de ce crédit d’impôt qui aura pour effet d’en porter le montant de 30 à 50 milliards d’euros. D’autre part, si l’objectif était d’améliorer la compétitivité de l’industrie, on passera à côté de la cible, puisque les bénéficiaires de ce dispositif ne seront pas nécessairement les secteurs ouverts à la concurrence internationale.
Il nous semble donc que cette mesure ne va pas dans le bon sens et qu’il vaudrait bien mieux engager une réforme d’ensemble du financement de la protection sociale, dans le cadre de laquelle on traiterait cette question des exonérations – mais aussi celle des exemptions d’assiette diverses et variées, y compris en ce qui concerne l’épargne salariale.
M. Patrick Brillet, administrateur de Force ouvrière (FO) à la CNAF. Je me réjouis de la volonté qui s’exprime de garantir notre système de sécurité sociale face aux tentatives de privatisation. Nous pensons qu’il est utile notamment, dans ce contexte et pour toutes les raisons évoquées par les intervenants précédents, d’insister sur la nécessité de préserver la branche famille.
Force ouvrière considère que l’on ne peut traiter du financement de la protection sociale sans faire référence à la politique menée aussi bien au niveau national qu’au niveau européen, politique de rigueur et d’austérité qui affecte fortement les comptes des régimes sociaux, à la fois en affaiblissant leurs recettes et en accroissant leurs dépenses. Ce sujet n’est pas directement traité dans le PLFSS, mais il fait l’objet des travaux du HCFPS, que nous entendons suivre attentivement.
Nous tenons à rappeler notre opposition au fait de lier le financement de la protection sociale à la notion de compétitivité des entreprises. Il ne peut être question pour nous de remplacer des cotisations patronales par des prélèvements sur les salaires, que ceux-ci passent par la cotisation ou, comme la CSG, par l’impôt.
En ce qui concerne le financement de la branche famille, problème central aujourd’hui, nous souhaitons que soit organisée une grande concertation pour déterminer ce qui relève de la solidarité salariale, qui doit être financée par des cotisations, et ce qui relève de la politique publique, qui doit être financée par des impôts, mais nous ne pouvons souscrire à une approche guidée par le souci d’alléger le coût du travail.
Nous l’avons souvent dit, il est possible de trouver des ressources, par exemple en supprimant les exonérations de cotisations patronales et en soumettant à cotisation des rémunérations qui en sont actuellement exemptées. Nous demandons aussi que la part non compensée des exonérations soit immédiatement déduite des allégements généraux, de sorte que les comptes de la sécurité sociale ne souffrent plus de cette forme insupportable de crédit aux entreprises.
Nous sommes favorables, bien évidemment, au maintien du caractère universel des prestations et à l’action menée en faveur de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Le déficit que connaît cette branche – 2,8 milliards d’euros en 2013, 2,3 milliards en 2014 – a, selon nous, un caractère artificiel, dans la mesure où il résulte d’exonérations de cotisations sociales, mais aussi de transferts de charges. La branche famille doit en effet supporter des dépenses induites par le transfert de politiques publiques. Mme Pattier a donné l’exemple du RSA, mais la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la CNAF prévoit également des actions relevant de la politique de la ville ou de la lutte contre la pauvreté. Certes, la Caisse est depuis toujours un acteur important de cette lutte, mais il n’en demeure pas moins que certaines actions, comme les « 100 000 rendez-vous des droits » tendent à déborder de son champ d’activité et occasionnent des frais.
Le PLFSS pour 2014 prévoit un système de vases communicants en matière de réaffectation de recettes : le produit de divers contributions et prélèvements – CSG, prélèvements sur les paris, concours et jeux – est versé à la branche famille par l’intermédiaire de la branche maladie. Or nous considérons que nombre de ces recettes n’ont pas un caractère pérenne, ce qui risque d’aggraver encore le déficit de la branche, malgré l’optimisme manifesté au cours de la discussion du projet.
S’agissant des cotisations patronales, la diminution de 0,15 point, sur 5,4 %, des cotisations familiales payées par les entreprises, pour compenser la hausse du même ordre des cotisations vieillesse consécutive à la réforme des retraites, nous apparaît comme un transfert de cotisations patronales vers les cotisations salariales, ce que Force ouvrière ne saurait accepter.
Concernant le financement direct, nous doutions déjà de la pérennité des compensations existantes, mais nous sommes encore plus inquiets s’agissant de celles qui doivent être accordées par l’État dans les années à venir. Nous souhaitons l’ouverture d’une discussion sur ce point en attendant les conclusions du HCFPS.
Mme Marie-Madeleine Pattier. Je précise que la CFTC est favorable à une réforme du financement, non de la seule branche famille ou même de la sécurité sociale, mais de tous les régimes de protection sociale, qu’il s’agisse du volet fiscal ou du volet cotisations. Nous avons en effet du mal à voir les effets du « choc de simplification ».
M. le coprésident Pierre Morange. Quand vous faites état, monsieur Brillet, d’un processus de privatisation rampante de la protection sociale, pensez-vous au rôle joué par les complémentaires santé en matière d’assurance maladie ou plutôt au financement de la branche famille, pour laquelle ce risque de privatisation est pourtant bien moins souvent évoqué ?
M. Patrick Brillet. Je parlais de la sécurité sociale en général, car nous sommes très attachés à son organisation actuelle. Cela étant, sur ce sujet, les propos tenus par la ministre ont permis de lever une partie des inquiétudes que nous avions exprimées.
Les cotisations patronales destinées à la branche famille représentent plus de 30 milliards d’euros. Les alléger tout en maintenant les autres exonérations de charges sociales aboutirait à faire peser une double charge sur les salariés.
Mme Véronique Descacq. Je reviens sur le dispositif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, sur lequel nous sommes plus que réservés. Tout d’abord, il a été décidé sans concertation avec les partenaires sociaux, préjugeant ainsi des résultats du débat sur le financement de la protection sociale. Nous participions d’ailleurs à la deuxième réunion du HCFPS lorsque nous avons vu s’afficher sur nos téléphones mobiles les dépêches d’agence annonçant la création de ce CICE. Sur le financement de la protection sociale comme sur la question du coût du travail, les partenaires sociaux n’ont ainsi pas eu leur mot à dire.
Ce qui nous gêne en outre dans ce dispositif, c’est que son application est systématique. La CFDT a toujours dit que les exonérations de charges sur les salaires devaient entraîner des contreparties. Il faut, soit n’octroyer de tels avantages aux employeurs qu’à certaines conditions, soit contrôler l’utilisation qui en est faite. Or, l’attribution du CICE n’est soumise à aucune condition.
Certes, l’accord national interprofessionnel de janvier 2013 comporte une avancée dans la mesure où les représentants du personnel peuvent, via la base de données unique, exiger de l’entreprise qu’elle s’explique sur l’utilisation qu’elle fait de ces fonds publics. Mais cela reste insuffisant. Il faudrait exiger que l’argent ainsi donné aux employeurs soit effectivement consacré à l’investissement, que ce soit dans l’innovation et la recherche ou dans la qualification des salariés. Nous ne comprenons pas le choix des pouvoirs publics de prodiguer cette aide sans contrepartie.
M. le rapporteur. Notre collègue Jean-Marc Germain a déposé deux amendements, que je soutiens, destinés à modifier les modalités du CICE. L’un tend à en subordonner l’octroi à la conclusion d’un accord d’entreprise sur les conditions d’utilisation de cet avantage fiscal ; le deuxième prévoit de consacrer un sixième de l’allégement à l’abondement du droit individuel à la formation des salariés.
Mme Véronique Descacq. C’est pourquoi nous sommes opposés à toute forfaitisation des exonérations de charges, qui empêche de les soumettre à condition.
D’une façon générale, il convient de rappeler aux entreprises que la protection sociale ne représente pas un coût pour la société, mais concourt, par bien des aspects, à leur performance et à leur compétitivité.
M. le coprésident Pierre Morange. Tous ici vous avez exprimé le souci de garantir des ressources pérennes à la branche famille, comme d’ailleurs à toutes les autres branches de la sécurité sociale. Outre le fait que le CICE n’est pas ciblé sur l’investissement ou sur les secteurs économiques voués à l’exportation, que pensez-vous de l’assiette de son financement, dont on ne peut pas dire qu’elle soit d’une grande stabilité ? Je ne parle pas de la CSG ou des prélèvements sur certains produits financiers, mais des économies budgétaires attendues, qui représentent 40 % du total et qui, à ce jour, restent hypothétiques.
Mme Véronique Descacq. Nous sommes contraints de prendre acte de ces modalités, puisque nous n’avons pas été consultés. Notre souci principal n’est pas de vérifier si les recettes supposées financer le CICE sont pérennes, mais plutôt de nous demander comment les fonds publics ainsi mis à la disposition des entreprises pourraient contribuer à un projet susceptible de faire consensus au sein du pays, à savoir la mutation de notre système productif vers une économie de la performance et de la qualité. Par conséquent, nous ne contestons pas nécessairement l’utilité de ce crédit d’impôt, mais au moins ses modalités.
M. le coprésident Pierre Morange. Si je vous pose la question, c’est qu’un certain nombre d’intervenants ont souligné le caractère instable des ressources mobilisées. Il est légitime de s’en préoccuper dans le cadre d’un débat sur le financement de la branche famille, dans la mesure où celle-ci s’est vu attribuer, au cours des ans – et par des gouvernements de tous bords – des missions qui ne relèvent pas toujours de la politique familiale.
Mme Véronique Descacq. À vrai dire, nous attendons avec impatience la lettre de mission que le Premier ministre doit adresser au Haut Conseil du financement de la protection sociale, car nous considérons que ce sujet fait pleinement partie de son champ de compétence.
M. le rapporteur. Je note qu’en dépit de vos différences d’approche, vous avez tous, à des degrés divers, insisté sur l’idée que le financement de la branche famille ne pouvait être appréhendé indépendamment d’une réforme plus globale de la protection sociale.
Il existe aussi un relatif consensus pour faire du principe de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale une justification du financement par les entreprises de la branche famille – encore que certains d’entre vous jugeront sans doute l’argument secondaire, arguant que le financement de la sécurité sociale doit par essence s’appuyer sur des cotisations patronales.
D’autre part, vous aspirez tous à une clarification du système – à cet égard, le rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale est intéressant malgré la complexité de ses propositions –, tout en craignant, hormis peut-être la CGC, les effets d’un « big bang » en ce domaine. Quel serait selon vous le mécanisme de financement idéal de la branche famille ?
Enfin, plusieurs d’entre vous ont souligné le risque, en cas de budgétisation, de faire de la CNAF une agence de l’État. Ne devrait-on pourtant pas budgétiser les missions qui semblent relever des politiques assumées par ce dernier – lutte contre les exclusions, aide au logement – ou dont l’appartenance au champ de la politique familiale fait débat, comme l’accompagnement des familles les plus vulnérables ? Cette orientation est-elle pour vous un tabou, ou au contraire peut-elle constituer un moyen de clarifier le fonctionnement de la branche famille et de revivifier le paritarisme ?
Mme Véronique Descacq. En tout état de cause, nous souhaitons maintenir une part de cotisations patronales dans le financement de la branche famille – de l’ordre d’un point et demi à deux points –, afin d’éviter une déconnexion totale entre les politiques familiales et le fonctionnement des entreprises.
Mais, selon nous, l’outil idéal, c’est la CSG, parce que son assiette est large. Il me semble normal, en effet, que tous les revenus contribuent au financement de la branche.
M. le rapporteur. Réagissant au rapport du Haut Conseil, vous avez suggéré de compenser la diminution des cotisations sociales patronales au titre de la branche famille par une hausse des cotisations sociales patronales vieillesse et par une augmentation de 1,6 point de CSG sur les seuls revenus d’activité. Pourquoi cette dernière restriction – et comment serait-il possible de l’appliquer ?
M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral de la CFDT. Dans la mesure où il existe plusieurs taux de CSG, il est possible de ne faire jouer que celui qui s’applique aux salariés. Le scénario du transfert entre cotisations et contribution sociale généralisée ne concerne d’ailleurs que ces derniers. Il se traduit par une augmentation de 1,6 point de la CSG sur les salaires, par une baisse de 1,6 point de la cotisation vieillesse, par une hausse de la cotisation patronale vieillesse à hauteur de la réduction appliquée sur la branche famille, soit 3,2 %, et par un échange d’impôts et de taxes affectées entre les trois branches afin d’affecter en priorité le produit des taxes comportementales à l’assurance maladie.
Bien entendu, étendre aux autres assiettes la hausse de la CSG donnerait des marges de manœuvre qui pourraient être employées soit au profit des salariés – c’est-à-dire de l’investissement social –, soit à celui de la compétitivité des entreprises, grâce à un soutien aux investissements, à la recherche, à la formation et à l’innovation.
S’agissant de la baisse de 0,15 point des charges familiales patronales, je remarque que les ressources permettant de la compenser sont, pour les trois quarts, prélevées sur les ménages. C’est pourquoi nous y sommes opposés.
Par ailleurs, nous avons tous oublié de rappeler que la branche famille avait vocation à être excédentaire, dans la mesure où ses prestations sont en général indexées sur le coût de la vie tandis que ses ressources sont principalement assises sur la masse salariale qui, pour le moment, augmente plus vite que l’inflation. Or, depuis quelques années, à chaque fois que le budget de la branche famille s’approche de l’équilibre, on la fait replonger dans le déficit, soit en lui retirant des recettes, soit en lui attribuant des charges supplémentaires.
La situation de la CADES permet d’appuyer mon propos. Plutôt que de maintenir le transfert à la CADES des déficits de la branche famille, on pourrait réaffecter à cette dernière une partie des ressources attribuées à la caisse. Mais tout se passe comme si l’on préférait qu’il y ait déficit, parce que cela donne des arguments pour réclamer à la branche de nouvelles réductions des dépenses. Ce n’est pas une manière très honnête de procéder.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous rejoignez ainsi les propos de M. Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil de la famille, qui affirmait qu’en raison de la dynamique démographique, le déficit actuel avait une vocation naturelle à se résorber à l’horizon 2020.
Revenons-en à la question du rapporteur sur la redéfinition du périmètre de la branche famille, pour éventuellement le limiter aux missions relevant strictement de la politique familiale. La budgétisation des missions annexes progressivement rattachées à la branche famille vous paraît-elle souhaitable à cet égard ?
M. le rapporteur. En réalité, une grande part des prestations versées par la CNAF sont déjà budgétisées. C’est le cas du RSA, notamment. Je pensais à certaines prestations versées sous conditions de ressources par la branche famille, dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté, par exemple : on peut estimer qu’elles ne relèvent pas vraiment de ses missions, ou au contraire considérer que la branche famille n’a pas seulement pour but de compenser les dépenses occasionnées par la présence d’enfants, mais aussi d’opérer une redistribution verticale.
Mme Véronique Descacq. Les politiques familiales ne doivent pas nécessairement abandonner l’objectif de compenser les charges liées à la présence d’enfants. Cette compensation ne nous choque pas, même si nous estimons qu’elle devrait prendre une forme plus égalitaire car, aujourd’hui, certains instruments comme le quotient familial ou les avantages familiaux de retraite ont un caractère nettement anti-redistributif. En outre, contrairement à mon collègue, je ne pense pas qu’il soit juste de dire que les familles nombreuses sont toujours pénalisées par rapport aux familles sans enfant. Au contraire, les nouvelles niches de pauvreté concernent moins les familles nombreuses que les femmes seules élevant un ou deux enfants, par exemple. Cela tient à l’importance que représente le logement dans le patrimoine et au fait que les familles nombreuses sont plus souvent propriétaires d’un grand logement.
En résumé, la compensation de la charge représentée par l’enfant est plutôt bien assurée, voire quelquefois surévaluée selon la taille de la famille. En revanche, les politiques familiales ont laissé se développer d’insupportables niches de pauvreté. Or nous considérons que de telles politiques doivent combiner redistribution horizontale et redistribution verticale. C’est pourquoi nous avons, contrairement à d’autres, approuvé les réformes intervenues cette année, qui nous semblent préserver l’économie générale des politiques familiales tout en faisant légèrement glisser le curseur vers la redistribution verticale.
Dès lors, nous ne sommes absolument pas choqués de voir une partie des missions de la branche famille s’orienter vers la lutte contre la pauvreté, car cette dernière politique doit être largement transversale. Outre le soutien de la politique familiale, elle implique de mener des actions en matière d’accès à la santé et justifierait un changement dans les règles d’attribution des retraites, qu’il s’agisse des avantages familiaux ou des pensions de réversion. On ne peut plus, comme dans la période de l’après-guerre, gérer une telle politique « en silos ».
Je reviens sur le « financement idéal ». Le scénario proposé par le Haut Conseil a l’avantage de relever d’une approche systémique et de répondre autant à la question de la clarification du financement qu’à celle du maintien du pouvoir d’achat des salariés. Si l’on devait raisonner dans le cadre de la seule branche famille, un transfert de cotisations sur la CSG ne pourrait s’envisager que s’il s’accompagne d’une augmentation du salaire brut, afin de préserver le pouvoir d’achat. Soit on procède à une réforme systémique touchant à l’ensemble des champs de la protection sociale, soit on change la façon dont sont calculés le salaire brut et le salaire super-brut.
M. Patrick Brillet. Pour Force ouvrière, les cotisations sociales doivent conserver une place centrale dans le financement de la branche. Nous tenons d’autant plus à l’affirmer que la réduction de 0,15 point de la cotisation patronale nous semble le prélude à d’autres décisions du même genre. En outre, elle aura nécessairement des conséquences sur le montant des cotisations à la charge des salariés. Il ne saurait donc être question pour FO d’accepter cette orientation.
Cela fait longtemps que la branche famille participe à d’autres politiques publiques : on a évoqué la lutte contre la pauvreté, mais on pourrait également citer l’insertion sociale. Nous ne sommes donc pas opposés à la prise en charge par la branche de missions qui, au fond, font partie de son cœur de métier : paiement de prestations, accompagnement des familles défavorisées – monoparentales ou non –, etc. Mais la signature de la dernière convention d’objectifs et de gestion tend à mélanger les genres et à transformer la politique familiale en une politique sociale, et donc à faire du réseau des caisses d’allocations familiales une agence de l’État, un instrument de politique publique. Cela ne correspond pas à sa vocation.
La gestion du RSA a été attribuée à la CNAF en raison de son savoir-faire, de sa connaissance des publics concernés et de son réseau de guichets de proximité, ce qui pouvait parfaitement se comprendre. Le problème, c’est que la branche famille n’a pas été accompagnée dans cette démarche. De deux choses l’une : soit on s’est trompé d’acteur, soit on l’a choisi à bon escient, mais sans lui donner les moyens nécessaires pour assumer ses nouvelles missions.
Il risque d’en être de même s’agissant des politiques de lutte contre la pauvreté ou d’accès aux droits, auxquelles nous sommes bien évidemment favorables : en multipliant ainsi les responsabilités de la branche famille, on risque de l’empêcher d’accomplir sa mission.
M. Jean-Yves Delannoy. Les rythmes scolaires font partie des sujets dont la branche famille s’est saisie et qui relèvent naturellement de sa compétence. Mais nous entendons veiller strictement à ce que la réforme en cours ne revienne pas à lui attribuer une nouvelle charge non compensée. La convention d’objectifs et de gestion, en faveur de laquelle la CFE-CGC a voté, prévoit certes une augmentation des crédits du Fonds national d’action sociale, qui contribue au financement des activités périscolaires, mais il faudra prendre garde à rester dans les limites de l’enveloppe.
M. le coprésident Pierre Morange. L’un d’entre vous a-t-il cherché à évaluer ce que pourrait coûter la réforme des rythmes éducatifs ?
M. Jean-Yves Delannoy. La convention d’objectifs et de gestion prévoit une enveloppe spécifique pour financer les dépenses supplémentaires.
Mme Justine Vincent, chargée d’études économiques à la CFE-CGC. Nous approuvions les propositions de M. Louis Gallois et avons donc été déçus par la création du CICE. Le problème n’est pas tant d’avoir privilégié la formule du crédit d’impôt par rapport aux exonérations de charge, il tient plutôt au fait que ce dispositif n’est pas, comme M. Gallois le préconisait, ciblé vers l’industrie. En outre, comme tout le monde, nous regrettons que le versement de ce crédit d’impôt ne soit lié à aucune contrepartie et que son utilisation ne fasse l’objet d’aucun contrôle. Cela risque de compromettre son efficacité. Enfin, le plafond retenu – 2,5 SMIC – nous pose problème, car il est source d’effets de seuil et ne permet pas de privilégier l’industrie.
La question est donc moins de transformer le CICE en dispositif d’exonération de charges – d’autant qu’il faudrait, avant de le modifier, disposer d’un plus grand recul sur son application – que de contrôler son utilisation.
Mme Marie-Madeleine Pattier. En ce qui concerne le mode de financement idéal, nous restons très attachés, à la CFTC, au système de cotisations. Le problème est l’existence d’exonérations et la variété des taux. Sur ce point également, la simplification ne saute pas aux yeux.
Nous sommes évidemment favorables à ce que la branche famille participe à la lutte contre la pauvreté. Le problème est que chacun agit dans son coin. Ainsi, alors qu’une personne disposant d’un certain niveau de ressources pourra bénéficier à la fois des aides de la CNAF, de celles des centres communaux d’action sociale et de celles des régions, une autre, en gagnant dix euros de plus, pâtira d’un effet de seuil et sera privée de toute aide. De même, certains projets en cours sont sources d’effets de seuil radicaux.
Nous étions favorables au RSA au nom du principe « à revenus égaux, mêmes droits ». Mais comme M. Martin Hirsch l’a lui-même reconnu, plus on propose de mesures spécifiques à ses bénéficiaires, plus on rend difficile la sortie du dispositif.
Par ailleurs, je maintiens que les familles nombreuses, qu’elles soient ou non monoparentales, sont plus facilement touchées par la pauvreté. À niveau de revenu égal, la situation n’est pas la même quand il faut faire vivre deux personnes ou quand il faut en faire vivre six ou plus.
Je l’ai dit, nous sommes attachés aux cotisations. Mais nous sommes également favorables à l’outil fiscal, dès lors que celui-ci reste stable et a un sens. La lutte contre la pauvreté ne relève pas seulement de la branche famille, car celle-ci pratique l’action sociale, et non l’aide sociale. Les aides individuelles octroyées par les CAF ont un caractère ponctuel : si le problème reste entier après une ou deux interventions, il n’est plus de notre ressort. Faut-il créer une nouvelle prestation ? Nous savons bien le faire, mais beaucoup moins simplifier celles qui existent.
Il convient donc de maintenir le niveau de cotisations et éviter les transferts incessants d’une branche à une autre. À cet égard, le PLFSS pour 2014 est particulièrement difficile à décrypter.
Bien sûr, sans enfants, il ne peut y avoir d’assurance maladie, ni de retraites : c’est pour cette raison, je suppose, que le budget de la branche famille est ponctionné dès qu’il connaît un excédent, et qu’il est toujours mis à contribution pour combler les déficits des branches les plus dépensières…
M. le rapporteur. Je n’ai pas l’intention d’assurer le service après-vente du PLFSS, mais je rappelle qu’une partie des transferts opérés correspond aux recommandations contenues dans le rapport du Haut Conseil et répond à un souci de clarification. Il est vrai que l’article 15, qui organise l’ensemble de ces transferts, n’est pas d’une lecture aisée…
Mme Marie-Madeleine Pattier. En outre, nous en avons reçu le texte très tard !
M. le rapporteur. J’admets qu’il a fait l’objet de nombreuses discussions. Mais je ne voudrais pas laisser dire que ce dernier projet de loi de financement a rajouté de la complexité. Cela étant, ce n’est ni le moment ni le lieu pour avoir ce débat.
M. Michel Coronas. En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, je souhaite appeler l’attention sur une bizarrerie juridique : un décret de 2011 autorise, au nom de la fongibilité des dépenses, la CNAF à récupérer sur le RSA des indus versés au titre d’autres allocations. Ainsi, alors même que la notion de reste à vivre est supposée avoir une valeur essentielle en matière de lutte contre la précarité – elle est notamment prise en compte en cas de saisie sur salaire ou dans les procédures de surendettement –, il est possible, dans ce cas précis, de réduire le montant du RSA touché par des personnes qui ne disposent que de cette ressource, au point de leur laisser à peine de quoi vivre. Nous avons saisi le Premier ministre et la CNAF afin que ce décret soit abrogé et qu’il soit mis un terme à cette anomalie. En matière de lutte contre pauvreté, il convient d’abord de « balayer devant sa porte ».
M. Pierre-Yves Chanu. Nous avons toujours été opposés à une budgétisation de la branche famille, dont le « cœur de métier » doit rester financé par des cotisations. En revanche, sur la question du périmètre de ses missions, le débat n’a rien de tabou. En matière de logement par exemple, la réorientation de l’aide à la personne vers l’aide à la pierre est une position constante de la CGT depuis la fin des années soixante-dix. Il y a donc matière à discussion.
Notre syndicat n’est pas hostile à l’idée d’attribuer des aides publiques aux entreprises. Mais le problème du CICE, outre l’absence de ciblage et de contrôle de son usage, est qu’il coûte cher : 20 milliards d’euros. L’étude d’impact évalue à 300 000 le nombre d’emplois dont il doit entraîner la création, ce qui porte à 70 000 euros le coût de chaque emploi créé ! Il nous paraîtrait préférable de recourir à d’autres formes d’aide publique, par exemple en dotant la Banque publique d’investissement de crédits supplémentaires ou en créant un livret d’épargne industrie.
M. le coprésident Pierre Morange. Merci, mesdames et messieurs, d’avoir répondu à notre invitation. N’hésitez pas, le cas échéant, à nous faire parvenir des contributions écrites susceptibles de nourrir notre rapport.
Audition de M. Christian Saint-Étienne, économiste, professeur titulaire de la chaire d’économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. La MECSS a inscrit à son programme, il y a tout juste un an, un rapport sur le financement de la branche famille. Depuis, le sujet est revenu de plus d’une façon sur le devant de la scène, via la réforme du quotient familial ou les débats sur le financement de la protection sociale. En outre, la Cour des comptes nous a remis en mai un rapport sur le sujet. Nous lui avions notamment demandé de tester plusieurs hypothèses de transfert de financement sur une ressource fiscale – taxe sur la valeur ajoutée (TVA), contribution sociale généralisée (CSG), fiscalité environnementale, impôt sur la valeur ajoutée des entreprises. La Cour a conclu à l’absence de formule miracle et préconise davantage un effort sur les dépenses.
Nous souhaitons donc connaître votre avis sur le sujet. Considérez-vous qu’il faut, comme beaucoup le préconisent, cesser d’asseoir le financement de la branche famille sur les cotisations sociales, compte tenu du caractère universel des prestations qu’elle dispense ? Quelle serait la meilleure assiette, sachant que nous n’avons aucun tabou en ce domaine ? Quel impact la fiscalisation croissante de la protection sociale devrait-elle avoir sur la gouvernance de ses branches ? Enfin, sachant que les mécanismes du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE – viennent percuter les exonérations de cotisations sociales patronales existantes – jusqu’à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) –, quelle doit être l’articulation entre le CICE et le financement de la protection sociale ?
M. Christian Saint-Étienne, économiste, professeur titulaire de la chaire d’économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Il importe de replacer la question du financement de la branche famille dans une réflexion plus générale. Depuis plusieurs années, je souligne la nécessité d’opérer une distinction fondamentale entre la protection sociale personnelle et la protection sociale universelle. La première ouvre des droits proportionnés aux cotisations versées, et concerne donc les retraites – à l’exception du minimum vieillesse –, le chômage et, dans une certaine mesure, l’invalidité. Il n’est pas envisageable de la financer autrement que par des cotisations sociales. Je sais que pour équilibrer le financement du système de retraite, certains suggèrent de faire appel à des taxes sur l’activité plutôt que d’allonger la durée de cotisation, mais une telle politique serait suicidaire. Il est économiquement, socialement, politiquement et philosophiquement illogique d’asseoir le financement du chômage et de la retraite sur autre chose que les salaires de leurs bénéficiaires directs.
À l’inverse, la protection sociale universelle ne doit pas être financée par des prélèvements sur les salaires. Les dépenses de santé, les prestations familiales, les prestations d’invalidité et de retraite sans lien avec des cotisations et tout ce qui relève de la lutte contre la pauvreté, comme le revenu minimum d’insertion (RMI) et le revenu de solidarité active (RSA), doivent faire l’objet de financements directs et universels.
Dès lors se pose une deuxième question : la protection sociale universelle doit-elle être financée par l’impôt sur le revenu, par la CSG ou par la TVA ?
S’agissant de la santé, de la famille et de l’invalidité, il convient selon moi de ne recourir qu’à des impôts proportionnels comme la CSG ou la TVA. C’est pourquoi l’hypothèse d’une fusion entre impôt sur le revenu et CSG me paraît relever de l’impasse idéologique – j’en débats d’ailleurs depuis des années avec M. Thomas Piketty. Faire de la contribution sociale généralisée un impôt progressif serait une erreur historique.
La CSG finance essentiellement des dépenses à caractère universel comme la santé. Or si, il y a trente ans, on pouvait encore affirmer que les plus éduqués bénéficiaient plus des services de soin, parce qu’ils en connaissaient mieux les portes d’accès, les écarts de consommation entre classes sociales se sont depuis considérablement réduits. La CSG étant proportionnelle, une personne qui gagne dix fois plus d’argent qu’une autre paiera également dix fois plus d’impôt. Elle versera donc dix fois plus pour des services de soins délivrés de façon égale. Dès lors, l’usage de la CSG pour financer une prestation universelle a déjà un caractère extrêmement progressiste.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Selon vous, l’universalité doit entraîner la proportionnalité. On pourrait objecter que les dépenses d’éducation, qui ont un caractère universel, sont financées par l’impôt sur le revenu dans le cadre du budget de l’État.
M. Christian Saint-Étienne. Sur la durée, ceux qui bénéficient des niveaux de salaire les plus élevés sont aussi ceux qui disposent du capital humain le plus élevé. Or ce capital provient en grande partie de l’éducation. Ces personnes n’ayant pas payé pour leur éducation – puisqu’en France, elle est généralement gratuite –, il n’est pas illogique qu’elles sur-financent par la suite une politique dont elles ont tiré plus de profit au départ. Cela justifie donc que l’éducation – et notamment l’éducation supérieure – soit financée par un impôt progressif comme l’impôt sur le revenu. Mais les dépenses familiales et de santé, qui relèvent de la protection sociale universelle, doivent être financées par un impôt proportionnel.
S’agissant de la lutte contre la pauvreté, la question de son financement peut faire l’objet d’un débat. Si on a la volonté de mener une « politique de gauche », entre guillemets, on peut faire le choix de l’impôt sur le revenu. Dans cette perspective, les classes moyennes supérieures, ceux qui ont un revenu ou un capital important, financeraient dans de plus grandes proportions l’aide aux personnes en grande difficulté. Ce serait cohérent dans la mesure où le total des mesures de lutte contre la pauvreté et pour l’insertion dans le marché du travail – RMI, RSA, etc. – ne doivent pas coûter plus de trois points de PIB.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Tout dépend si vous incluez dans ce champ les prestations sous conditions de ressources de la branche famille ?
M. Christian Saint-Étienne. Non, je les place plutôt dans la politique familiale. En tout état de cause, si l’on tient compte des aides accordées par les conseils généraux, les dépenses ne dépassent pas 40 milliards d’euros, soit plutôt deux points de PIB. Dans ces conditions, une mesure emblématique, de gauche, consisterait à financer par les cotisations la protection sociale personnelle – parce que le montant de la prestation dépend de celui de la cotisation –, et par un impôt proportionnel la protection sociale universelle. Dans un tel système, chacun financerait en proportion de son revenu les prestations de santé, qui sont d’un accès égal. Et de toute façon, si elles ne le sont pas, la solution ne viendra pas de la fiscalité mais de l’éducation et de la transparence du fonctionnement du système de santé. Quant à la famille, elle bénéficierait d’une politique redistributrice.
C’est d’ailleurs une autre raison de s’opposer à la CSG progressive : il ne faut pas confondre redistribution horizontale et verticale. La politique familiale relève de la redistribution horizontale, laquelle va des gens sans enfants vers les gens qui ont la charge d’enfants, et doit donc être financée par un prélèvement proportionnel.
Quant aux prestations familiales sous conditions de ressources, leur financement par la CSG aurait également un caractère extrêmement progressiste, au sens qu’il serait très redistributif.
Il résulte de tout cela que la branche famille ne peut être financée que par la contribution sociale généralisée ou par la taxe sur la valeur ajoutée. La mobilisation de toute autre forme d’impôt ne serait en effet pas justifiée.
Une fois ce principe admis, le débat devient plus technique pour choisir entre la CSG, qui ne s’applique qu’aux revenus nationaux, et la TVA, qui a l’avantage de toucher les importations. Même si on a fait un épouvantail de la TVA sociale – que d’aucuns appellent « TVA emplois » –, elle reste une mécanique très efficace. Sa mise en place en Allemagne au 1er janvier 2007 a d’ailleurs bien aidé le pays à traverser la crise survenue à partir de 2008, en permettant aux entreprises d’augmenter leurs fonds propres. Sur les trois points de hausse, un point a été consacré à la baisse des cotisations sociales et deux à la réduction de l’impôt sur les sociétés : on peut donc parler aussi bien de « TVA compétitivité » que de « TVA sociale ». Or l’économie allemande s’est fort bien portée de sa création. L’idée selon laquelle la TVA est un mauvais impôt est donc extrêmement dangereuse.
Quand, en Allemagne, le taux de TVA a été relevé de trois points, l’augmentation des prix qui s’en est suivie n’a pas dépassé 0,4 %. La tentative d’instaurer en France une TVA sociale a souffert d’un manque de pédagogie : on a laissé les gens croire qu’une augmentation de trois points du taux de la taxe équivalait à une hausse des prix de même grandeur. C’est oublier que la mesure pourrait permettre de financer la suppression des 5,4 % de cotisations familiales payées par les entreprises sur les salaires, et donc de réduire les coûts de production de 3 % – sachant qu’en comptabilité nationale, la part des rémunérations dans la valeur ajoutée productive représente 60 %. Cela revient donc à une dévaluation de 3 %. Un tel résultat peut paraître minime, mais dans un contexte où le secteur productif est extrêmement affaibli, il constituerait un message important.
En outre, une telle mesure serait cohérente compte tenu de ce que nous apprennent les statistiques de l’Union européenne : le poids des prélèvements obligatoires sur la consommation, contrairement à ce que pensent les Français, est plutôt plus faible que la moyenne, tandis que leur poids sur la production est nettement supérieur.
Dès lors, un basculement sur la TVA du financement de la branche famille aurait plusieurs avantages. Il permettrait tout d’abord de faire porter sur la consommation une partie du poids de la protection sociale, sans effet négatif sur les consommateurs, sinon une augmentation des prix de l’ordre de 0,3 % – j’y reviendrai. Une telle opération pourrait être dangereuse en période d’inflation, mais aujourd’hui, alors que l’on craint que le pays n’entre dans une période déflationniste, le moment est idéal.
L’effet net de la mesure est donc facile à calculer. Sur un prix de 100, l’application d’un taux de TVA de 20 % à partir du 1er janvier – si du moins cette décision n’est pas remise en cause – donne un prix toutes taxes comprises de 120. Dans la mesure où la suppression de la part de 5,4 % de la part de cotisation familiale patronale permet de réduire le prix hors taxes à 97, le prix toutes taxes comprises, compte tenu de l’application de la TVA à un taux de 23 %, serait inférieur à 120. L’augmentation du taux de TVA n’aurait donc en réalité pas d’effet sur les prix.
Malgré tout, on peut s’attendre à un effet résiduel consistant en une augmentation générale des prix d’au plus 0,3 %. Mais si l’on considère le panier moyen de la ménagère, cette augmentation, seul effet négatif de la mesure, représenterait un surcoût annuel d’environ 150 euros. Il est donc possible de la compenser en versant aux 10 millions de ménages les plus affectés une prestation d’environ 10 euros par mois, qui coûterait en tout 1 milliard d’euros par an.
L’affectation à la branche famille de l’augmentation de 7 à 10 % du taux réduit de TVA et une augmentation de 3 % du taux normal permettraient donc de compenser la suppression de la part patronale des cotisations sociales familiales, qui représente 34 milliards d’euros. Le surplus éventuellement nécessaire pourrait être apporté par la CSG.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Vous êtes donc favorable à un basculement total des cotisations sociales patronales. Nous avons organisé la semaine dernière une table ronde avec les représentants des organisations de salariés, et certains d’entre eux, au diapason de la Cour des comptes, considéraient qu’en dépit du caractère universel des prestations familiales, leur financement par des cotisations patronales gardait une légitimité dans la mesure où une partie des dépenses de la branche famille – que la Cour des comptes évalue à entre 13 et 15 milliards d’euros – permet la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Il est vrai que d’autres ne jugent pas l’argument pertinent, estimant que certaines dépenses en matière de maladie pouvaient avoir la même fonction. Qu’en pensez-vous ?
M. Christian Saint-Étienne. Il est vrai que les principaux bénéficiaires de cet élément de conciliation sont plutôt les classes populaires, dont on dit souvent qu’elles sont frappées de façon plus que proportionnelle par la TVA. Mais aujourd’hui, notre économie souffre de l’effondrement du système industriel, dont un des aspects principaux est la chute de la production automobile, due à la prédilection des consommateurs pour les modèles étrangers. Une augmentation de TVA pèserait essentiellement sur le prix des Mercedes, des BMW et des Audi : je ne vois donc pas en quoi elle nuirait aux classes populaires, surtout si on la compense par une prestation de 100 euros réservée aux 10 millions de ménages ayant les revenus les plus faibles. L’opération serait donc totalement neutre pour les classes populaires, mais pas pour les personnes qui consomment essentiellement des biens importés – alors même que nous produisons désormais des automobiles de qualité. Elle serait donc à fois économiquement efficace et socialement juste. Ce serait en outre le meilleur moment de la réaliser.
Certains proposent de ne consacrer qu’en partie le produit de ces trois points supplémentaires de TVA à une baisse des cotisations employeurs, afin de réduire également celles des salariés, de façon à augmenter leur revenu. C’est oublier que le niveau du chômage est le principal problème auquel est confronté notre pays. La meilleure mesure sociale à prendre est donc de rendre aux demandeurs d’emploi leur dignité en leur procurant un travail.
Vous savez qu’en France, le système favorise largement les insiders. L’intérêt du mécanisme que je propose est aussi qu’il représente une main tendue aux outsiders, à qui la baisse du coût du travail permettrait de retrouver un emploi.
De plus, il s’agit d’une mesure élégante, car claire, lisible, compréhensible. Quelqu’un comme vous, monsieur le rapporteur, pourrait facilement en présenter les enjeux à la télévision. De fait, la pédagogie devrait jouer un rôle central dans cette affaire.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Il ne faudrait en effet pas manquer de pédagogie pour défendre ce qui n’est autre qu’un transfert net, au nom de la compétitivité, de la protection sociale depuis les employeurs vers les ménages.
M. Christian Saint-Étienne. J’allais justement évoquer les contreparties envisageables.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Je serais intéressé de les connaître. Votre collègue M. Henri Sterdyniak, qui se trouvait à votre place il y a quelques semaines, disait qu’une telle mesure devait s’accompagner d’une augmentation du salaire brut…
M. Christian Saint-Étienne. Mais, à nouveau, cela favoriserait les insiders au détriment des outsiders. Je le répète, dans notre monde moderne, le seul moyen de garder sa dignité est d’avoir un travail. À l’heure où le système productif s’effondre, nous devons donc tout faire pour que ceux qui ont encore un emploi ne le perdent pas et que ceux qui n’en ont pas en retrouvent un. Le mécanisme que je propose est favorable aux outsiders, dont personne ne défend jamais les intérêts.
Il reste à éviter que les entreprises ne se contentent de profiter de l’avantage donné sans rien faire d’autre. Cela étant, compte tenu de la puissance des donneurs d’ordre et de la distribution, une part significative de cette baisse des coûts de production se traduira par une réduction des prix hors taxes, qui redonnera de la compétitivité à la France. Je ne crois pas que les entreprises, même si elles le souhaitaient, puissent se borner à augmenter leurs profits.
Pour autant, il faudrait rester vigilant, d’où la contrepartie que je propose. Comme vous le savez, un autre de nos grands problèmes est l’échec depuis vingt-cinq ans de notre système éducatif, qui laisse toujours 20 % des jeunes sans formation et sans diplôme. Le nombre d’apprentis, qui était monté à 400 000, est à nouveau en baisse. Il faudrait se donner pour objectif d’atteindre le million d’apprentis en cinq ou sept ans. C’est pourquoi une baisse des charges de l’ampleur que j’ai évoquée – plus de 30 milliards d’euros, je le rappelle – devrait, en contrepartie, s’accompagner d’un renforcement significatif des obligations des entreprises en termes de formation en alternance et d’apprentissage. Bien entendu, cela exige une réflexion globale sur l’éducation, car les réticences des entreprises ne sont pas le seul frein au développement de l’apprentissage. Nous devons mettre au point un système très incitatif. Malheureusement, le Gouvernement a pris récemment une mesure allant plutôt dans le sens inverse.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Vous parlez de contrepartie, mais elle ne serait pas très contraignante. Les entreprises devraient-elles employer un nombre d’apprentis proportionnel à leur masse salariale ou à leur taille, de la même façon qu’elles doivent recruter un nombre déterminé de travailleurs en situation de handicap ?
M. Christian Saint-Étienne. La mesure revient à réduire de 5 % la masse salariale. Il est donc aisé de calculer le gain « en cash » qu’elle représenterait pour chaque entreprise. On ne pourrait donc, en effet, peut-être pas prévoir une proportionnalité stricte, mais au moins établir un lien entre l’avantage reçu et le nombre d’apprentis à engager.
J’en viens au rôle joué par la CSG. Il est essentiel de mettre fin au déficit de la branche santé : on ne peut pas s’accommoder d’une situation dans laquelle, depuis dix ans, le déficit évolue entre 12 et 15 milliards d’euros. Il faut poursuivre la restructuration du système, voire l’accélérer, mais aussi assumer la demande des Français en matière de santé et consacrer un point de CSG au financement de la branche.
Dans certaines régions, l’accès direct aux services de santé est de plus en plus difficile. De nombreux spécialistes sont favorables à un nouveau maillage du territoire s’accompagnant d’une multiplication des maisons de santé et d’une réduction de la taille du système hospitalier. Il me paraît donc nécessaire de ne pas recourir à la CSG pour financer la branche famille, mais de la garder en réserve comme source de financement des dépenses de santé.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. D’autant qu’il faut tenir compte de la montée en puissance du risque de perte d’autonomie, que vous n’avez pas mentionné en opérant votre distinction fondamentale entre protection personnelle et universelle. Je suppose que dans votre logique, le maintien de l’autonomie relève plutôt de la protection universelle.
M. Christian Saint-Étienne. Absolument.
Quant à la CSG, elle mériterait également que l’on fasse preuve de pédagogie à son sujet. Je ne supporte plus l’affirmation selon laquelle cet impôt étant proportionnel, tout le monde paie de la même façon. Non : une personne qui gagne 10 000 euros par mois paye dix fois plus que celle qui en gagne 1 000 !
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. On ne peut pas le nier, sauf à faire preuve d’une très grande mauvaise foi.
M. Christian Saint-Étienne. Je ne suis pourtant pas sûr que soit aussi clair pour tous les hommes politiques, à gauche comme à droite.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Venons-en au CICE, cette réforme qui, en cherchant à baisser massivement les coûts du travail, touche indirectement au financement de la protection sociale.
M. Christian Saint-Étienne. Si la réforme que je propose était appliquée, ce serait le bon moment pour transformer le CICE en véritable mécanisme de baisse de charges.
Je ne suis pas sûr qu’une augmentation de TVA de trois points soit suffisante pour collecter 34 milliards d’euros.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. En effet, dans la mesure où chaque point de TVA supplémentaire rapporte entre 9 et 10 milliards d’euros.
M. Christian Saint-Étienne. Voilà : 6 milliards d’euros si on augmente le taux général, et 4 milliards d’euros si on augmente le taux intermédiaire. Il manque donc 4 milliards d’euros.
Or le CICE vise à alléger, à terme, le coût du travail de 6 %, pour un montant de 20 milliards d’euros en rythme de croisière. On pourrait le remplacer par une baisse des charges de l’ordre de 4 à 5 %, si bien qu’il ne coûterait plus que 15 milliards d’euros à l’État. Ce dernier pourrait donc employer les 5 milliards d’euros restant pour compléter le financement de la suppression des charges familiales versées par les entreprises, dans le cas où l’augmentation du taux de TVA ne serait pas suffisante.
Dans mon rapport pour le Conseil d’analyse économique de 2005, puis dans un livre sur la fiscalité que j’ai publié en 2011, je me suis interrogé sur les conséquences, en matière de gouvernance, d’une réorganisation du régime général fondée sur la distinction entre protection sociale personnelle et universelle. Dans une telle perspective, et pour ce qui concerne la branche famille, un financement par la TVA implique que l’État redevienne l’acteur principal.
Cela poserait la question du rôle joué par les syndicats. Nous savons que ces derniers sont attachés au paritarisme et à la cogestion du système de protection sociale parce que cela leur permet d’offrir des postes à leurs militants. C’est pourquoi, de même qu’il serait nécessaire de disposer de syndicats puissants, il faudrait s’interroger sur leur financement et, peut-être, imaginer un système de financement public comparable à celui des partis politiques.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Au nom de la mission d’intérêt général qu’ils accomplissent.
M. Christian Saint-Étienne. Dans une telle perspective, une gestion par les syndicats ne se justifierait que pour ce qui concerne la protection sociale individuelle – c’est-à-dire la retraite et les indemnités de chômage. Tout ce qui relève de la protection universelle serait géré par l’État. Nous renforcerions ainsi la cohérence du système en termes de financement, de missions et de gouvernance. La distinction entre protection individuelle et universelle est donc, je le répète, une clé de ce dossier.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Un des points forts de la proposition que vous formulez est son effet attendu en matière de lutte contre le chômage, qui reste la première priorité. Mais au-delà de 1,6 fois le SMIC, êtes-vous certain de l’impact des exonérations de charges sociales sur l’emploi ?
M. Christian Saint-Étienne. Ce qui est certain, c’est que le secteur productif français est exsangue. La France compte 3 millions d’entreprises, mais beaucoup sont des entreprises unipersonnelles ou de petites entreprises artisanales. Quant aux 35 entreprises industrielles du CAC 40, leur capital est détenu à moitié par des étrangers, et elles réalisent 70 % de leur activité et 90 % de leurs profits hors de France. Ces entreprises sont importantes par leur participation à la structuration des filières – et c’est pourquoi il est nécessaire d’en conserver le contrôle –, mais pas en raison de la part qu’elles représentent dans la production française. En réalité, 200 000 entreprises de taille inférieure à celles du CAC 40 font l’essentiel du PIB marchand national.
Or le taux de marge de ces entreprises est inférieur de 40 % à celui de leurs compétiteurs d’Allemagne, d’Angleterre et d’Italie du Nord. Et je ne parle pas de l’Espagne, qui connaît un rebond de ses marges, au point que son taux est devenu supérieur à celui des États-Unis. C’est d’ailleurs pourquoi on voit des entreprises fermer leurs usines en France, en Belgique et en Allemagne pour en ouvrir au-delà des Pyrénées. L’Espagne est en train de devenir la nouvelle Europe centrale et a vu ses exportations connaître un sursaut exceptionnel grâce à la baisse du coût du travail. Certes, celle-ci a eu un coût social colossal, puisqu’elle s’est traduite par un taux de chômage de 28 %. Mais l’exemple espagnol montre qu’une réduction du coût du travail de 3,6 à 4 % peut avoir un impact phénoménal sur la productivité, la profitabilité et les investissements.
La réforme que je propose serait un message très positif adressé aux chefs d’entreprise à l’heure où ils sont plutôt déboussolés : elle prouverait que l’on cherche vraiment à mettre l’accent sur la production. Et par rapport au cas espagnol, elle aurait l’avantage de permettre d’obtenir les mêmes résultats sans passer par une phase de chômage très élevé.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Une autre commission de l’Assemblée a reçu M. Louis Gallois il y a quelques jours, un an après la publication de son rapport sur la compétitivité. La baisse du coût du travail permise par le CICE est tout de même significative, puisqu’elle représentera, à terme, 20 milliards d’euros.
M. Christian Saint-Étienne. Seulement à partir de 2015 ! Pour l’instant, cela ne dépasse pas 5 ou 6 milliards d’euros.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Bien sûr. Mais ce crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi a, depuis l’origine, un caractère ambigu que reflète d’ailleurs son titre : l’objectif prioritaire est-il l’emploi ou la compétitivité ?
M. Christian Saint-Étienne. Les deux sont liés. La solution que je propose aurait, à mon avis, un effet très puissant sur l’emploi, d’autant qu’elle bénéficierait aux outsiders. La compétitivité a certes pour objectif de retrouver des profits, mais pour investir et développer l’emploi.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Mais le théorème de Schmidt a-t-il jamais été vérifié ?
M. Christian Saint-Étienne. En Allemagne, cela a globalement fonctionné. Contrairement à ce que prétendent de nombreux économistes, le gain de compétitivité obtenu par l’Allemagne ne s’explique pas par les réformes Hartz, mais par l’instauration de la TVA sociale et par les mesures prises entre 1998 et 2004 pour réduire la charge fiscale pesant sur les entreprises. Aujourd’hui, l’écart de charges fiscales et sociales entre la France et l’Allemagne équivaut à six points de PIB. Or l’écart de marges entre les entreprises françaises et allemandes est du même ordre. La réforme que je propose permettrait de réduire, en un seul coup, cet écart de près d’un tiers – entre 1,6et 1,7 point de PIB. Elle serait puissante, non seulement en raison de ses effets directs sur la compétitivité, mais aussi parce qu’elle ferait basculer une partie du poids du financement de la protection sociale sur les importations.
Certes, mes collègues diraient qu’à moyen et long terme, une telle réforme ne changerait rien. C’est vrai dans une économie fermée, mais le basculement de certains coûts sur les importations est bien un élément de compétitivité à court terme.
Il n’existe pas de réponse objective à la question que vous posez de l’effet sur l’emploi du mécanisme évoqué. Permettrait-il de créer 200 000, 300 000, 400 000 emplois ? Personne ne peut le dire. Je pense en tout cas qu’il pourrait en sauver beaucoup.
La suppression de la part patronale des cotisations familiales équivaut à une baisse de charges de 35 milliards d’euros. Si on y ajoute les 15 milliards d’euros résultant de la transformation du CICE en mécanisme d’exonération, on obtient 50 milliards d’euros, soit la moitié de ce que représente l’écart de compétitivité – se traduisant en écart de profitabilité – entre les entreprises françaises et allemandes. Or si l’État fait un effort suffisant pour réduire cet écart de 50 %, ce sera aux entrepreneurs de faire le reste.
Pour être efficace, il n’est donc pas nécessaire de parler de « remise à plat » de la fiscalité, comme l’a fait le Premier ministre pour réaliser un coup politique. Il suffit de prendre la décision que j’ai évoquée : suppression des cotisations patronales finançant la branche famille et financement de la branche santé par la CSG. Ce serait déjà une modification significative du système fiscal, bénéficiant de surcroît aux outsiders et favorable à la compétitivité. Et compte tenu des effets d’une telle réforme sur la production, les entreprises devraient, en contrepartie, s’engager à développer l’apprentissage et la formation en alternance, mais également en matière d’investissement. Une telle politique pourrait donner des effets puissants en deux ou trois ans.
Nous disposons, pour l’engager, d’une fenêtre de tir limitée à environ six mois. En effet, dans une période marquée par un risque de déflation, une augmentation de TVA à hauteur de trois points ne poserait pas de problème. En outre, nous sommes en début de phase de reprise, un moment où il est particulièrement utile de redonner de la compétitivité aux entreprises qui vont bénéficier d’une demande extérieure importante.
D’ailleurs, ce n’est pas la demande qui a manqué aux entreprises françaises au cours des dix dernières années – car si l’on excepte les années de crise, la demande mondiale a fortement augmenté pendant cette période. Le phénomène essentiel est l’effondrement productif : notre économie a atteint son dernier point haut – en termes de parts de marché dans les exportations comme selon d’autres critères – vers 1998 ou 1999. Au cours des quinze dernières années, la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB a baissé de 30 % et la part des exportations françaises dans les exportations mondiales, de 43 %. Le secteur productif a donc subi un choc d’une violence inouïe. Le CICE a constitué un premier signal, mais une réforme globale comme celle que j’ai évoquée pourrait nous entraîner dans un nouveau cycle, et après quinze années pendant lesquelles la production a chuté, nous faire connaître dix ans de hausse. Le moment est idéal pour agir, en raison du risque de déflation.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Je vous rejoins sur ce point.
M. Christian Saint-Étienne. Cela étant, le Président de la République et le Premier ministre feront ce qu’ils voudront.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. C’est la Ve République !
Monsieur Saint-Étienne, je vous remercie.
*
* *
Audition de M. Antoine Magnier, directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et M. Benoît Ourliac, chef de la mission d’analyse économique
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Dans le cadre de nos travaux sur le financement de la branche famille, nous entendons les directions concernées du ministère des affaires sociales et de la santé et celles du ministère des finances. Après avoir reçu la direction du budget et celle de la sécurité sociale, nous auditionnerons bientôt la direction générale du Trésor et la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services. Nous avons souhaité bénéficier aujourd’hui de l’expertise de la belle direction qu’est la DARES, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, au sein du ministère du travail.
Messieurs, quels sont, parmi les travaux que vous avez conduits au cours des dernières années, ceux qui peuvent intéresser le financement de la branche famille ? Sur le fondement de ces travaux, quelle serait selon vous la meilleure assiette de financement de cette branche universelle ?
Quel a été l’effet sur l’emploi des dispositifs d’exonération de cotisations sociales instaurés ces dernières années ? C’est l’un des enjeux de notre réflexion, en lien avec le CICE. Plus généralement, la question du financement de la branche famille est indissociable de celle du financement de la protection sociale et même, désormais, de la réforme fiscale. Les réformes du financement de la protection sociale, tournées vers l’emploi, ont-elles atteint leurs objectifs en la matière ?
M. Antoine Magnier, directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Le champ de compétence de la DARES couvre l’emploi, le travail et la formation professionnelle. Nous ne sommes pas des experts du financement de la protection sociale et ce n’est pas non plus mon cas à titre personnel. Nous nous intéressons donc essentiellement à son effet sur le marché du travail et, en particulier, sur l’emploi. C’est à ce titre que nous participons aux travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale, présidé par Mme Mireille Elbaum.
Les principales études que nous avons menées au cours des dernières années sur ces questions ou en lien avec elles concernent par conséquent l’effet du dispositif d’allégement des cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Aux travaux, émanant de différentes équipes de recherche, que nous avons suscités s’ajoutent les synthèses des études existantes auxquelles nous procédons régulièrement avec la direction générale du Trésor. La dernière mise à jour de ce type date du début 2012 ; elle a débouché sur la publication, conjointe avec la direction générale du travail (DGT), de deux documents, l’un assez fouillé, l’autre plus synthétique.
Au-delà de ces travaux de synthèse, nous n’avons pas développé d’outil de simulation permettant d’évaluer l’effet de modifications du financement de la protection sociale. Nous ne disposons pas d’outils macroéconométriques, fins ou lourds, comparables à ceux de la direction générale du Trésor. Nous n’avons pas non plus conçu d’instrument mesurant les conséquences redistributives de telles dispositions ; elles ne relèvent pas directement de notre domaine de compétence.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Au cours des vingt dernières années, la part du financement de la branche famille assise sur les cotisations patronales est passée de 85 %, voire 90 %, à 60 % environ, au gré de la montée en puissance de la CSG et des exonérations de cotisations patronales – en particulier sur les bas salaires, jusqu’à 1,6 SMIC. Est-il possible de mesurer, toutes choses égales par ailleurs, l’effet de ces dernières sur l’emploi, au moment où il est question de transformer le CICE en une exonération plus massive de cotisations sociales ?
M. Antoine Magnier. La principale conclusion des travaux de synthèse à laquelle nous procédons avec la direction générale du Trésor est que ce dispositif a eu un effet favorable important sur l’emploi. Toutefois, les différentes évaluations – certaines ex ante, d’autres ex post, ainsi que des microsimulations – conduisent à des résultats assez dispersés et portent surtout sur la première vague d’allégements de cotisations sociales patronales, entre 1993 et 1997. Il en ressort que cette première vague, mise en œuvre sous le gouvernement Juppé en 1995 et 1996, pour 6,5 milliards d’euros, a permis de créer ou de sauvegarder entre 200 000 et 400 000 emplois.
Il est moins aisé d’évaluer les vagues d’exonérations suivantes. La deuxième a accompagné la réduction du temps de travail afin d’en atténuer ou d’en compenser l’effet sur les coûts salariaux unitaires pour les entreprises, parallèlement aux gains de productivité et à la modération salariale induite qui étaient attendus de la mesure. La troisième a été lancée dans le cadre de la réforme Fillon de 2003, pour tenir compte de la convergence vers le haut des minima salariaux multiples issus de la réduction du temps de travail. Les travaux portant sur cette troisième vague – nous en avons suscités – sont beaucoup moins nombreux et se heurtent à de plus grandes difficultés méthodologiques que ceux qui évaluaient les effets de la première.
Si l’on fait l’hypothèse favorable – sans doute trop favorable – que l’effet sur l’emploi des deuxième et troisième vagues, mises en œuvre entre 1999 et 2005, est équivalent à celui de la première, l’on peut considérer que 600 000 à 1,1 million d’emplois ont bénéficié du dispositif pris dans son ensemble. Si l’on estime – selon une hypothèse plus modérée, étayée notamment par une étude empirique conduite à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) il y a quelques années – que le rendement des deuxième et troisième vagues a été de moitié inférieur à celui de la première, l’effet global ne concerne plus que 400 000 à 800 000 emplois.
En ce qui concerne le financement de la protection sociale, ces études, comme la plupart des travaux universitaires menés en France et à l’étranger, appellent l’attention sur la progressivité des prélèvements et sur l’effet que pourrait avoir toute mesure de modification de ce financement sur le coin fiscalo-social pesant sur les plus bas salaires. Selon la plupart des travaux empiriques, la sensibilité de l’emploi à son coût est d’autant plus forte que les salaires sont faibles, surtout en France, où il existe un salaire minimum et où celui-ci peut être considéré comme relativement élevé par comparaison avec d’autres pays. Car si le salaire minimum fait obstacle à l’adéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre touchant certains publics peu qualifiés, la variation des prélèvements fiscaux et sociaux devrait avoir un effet non négligeable sur les possibilités d’emploi de ces publics. Mais ce phénomène s’observe même dans les pays où il n’existe pas de salaire minimum, ou dans lesquels il est jugé relativement bas.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Parmi les éléments de comparaison internationale, disposez-vous de données relatives au financement des politiques familiales, à leur assiette et à leur effet sur l’emploi ?
M. Antoine Magnier. Nous n’avons pas mené de travaux sur le financement de la politique familiale en tant que telle. Sur celui de la protection sociale, vous connaissez nos principales conclusions puisque vous avez entendu certains de nos collègues ainsi que Mme Mireille Elbaum. La France fait partie d’un groupe de pays où le financement de la protection sociale repose encore largement sur les cotisations sociales, même si leur part a sensiblement diminué, par opposition aux pays anglo-saxons, notamment, où le financement repose sur la fiscalité.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. La part des effets d’aubaine que créent ces exonérations est-elle constante ?
M. Antoine Magnier. Si les travaux mesurant les conséquences sur l’emploi de la première vague d’exonérations permettent d’en apprécier du même coup l’effet d’aubaine, nous manquons d’études sur les deuxième et troisième vagues. Sur les trois que nous avions financées, une seule propose des résultats sur lesquels nous puissions nous appuyer.
Lors de la première vague, les allégements ont été plutôt concentrés au niveau du salaire minimum, à une époque où le coût du travail à ce niveau était relativement élevé par rapport à son coût au niveau du salaire médian. Les études suggèrent que ce dispositif a eu un effet significatif sur l’emploi et entraîné moins d’effets d’aubaine que d’autres politiques générales de réductions fiscales ou sociales, notamment sectorielles. Sans aucun doute, le rapport coût-efficacité de cette première vague est satisfaisant, voire très satisfaisant au regard d’autres dispositifs de réduction du coût du travail.
Lors des deuxième et troisième vagues, les allégements ont été moins concentrés au niveau du salaire minimum. Voilà pourquoi on a tendance à considérer que leur rendement a été moindre et les effets d’aubaine plus importants. Le ciblage du dispositif sur les bas salaires explique l’effet sur l’emploi.
M. Benoît Ourliac, chef de la mission d’analyse économique. Il convient de distinguer deux types d’effets d’aubaine. On évalue le premier en se demandant quels emplois auraient été créés ou viables en l’absence d’allégements. Tout porte à croire que ces emplois sont plutôt ceux sur lesquels la demande de travail des entreprises n’est pas contrainte. Elle l’est a priori à proximité du salaire minimum, où, avec les allégements généraux, les entreprises peuvent proposer des postes qui n’auraient pas été créés ou rentables sans eux. En revanche, plus on s’élève dans la distribution des salaires, plus cet effet d’aubaine risque d’augmenter. Pour des salaires équivalents à 1,5 ou 2 SMIC, l’impact des allégements est moindre car la demande de travail des entreprises est moins contrainte : elles peuvent jouer sur les salaires.
Le second effet d’aubaine est lié au rôle de la négociation salariale. La réduction des cotisations patronales entraîne un transfert aux entreprises, mais celui-ci ne se traduit pas par une diminution du coût du travail si les salariés en récupèrent une partie par le jeu de la négociation salariale. Or le pouvoir de négociation des salariés est proportionnel à leur niveau de salaire. Pour le dire de manière caricaturale, un salarié au SMIC ne dispose d’aucune marge de négociation : malgré les allégements, il restera au SMIC, de sorte que l’effet sur le coût du travail d’une baisse de cotisations sociales sera maximal. Dès lors, plus les allégements sont ciblés sur les bas salaires, plus leur impact sur le coût du travail est important et plus leur effet sur l’emploi sera significatif.
M. Antoine Magnier. En d’autres termes, pour les publics pour lesquels le salaire minimum entrave l’ajustement de l’offre et de la demande, l’effet d’une mesure d’allégement du coût du travail est maximal. Dans les autres cas, le fruit de la mesure peut être partagé, par le truchement des négociations salariales, entre hausse de salaires et réduction du coût du travail.
Nous pourrons vous transmettre un document que nous avons préparé pour le Haut Conseil du financement de la protection sociale et où ce phénomène est illustré par des schémas.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Avez-vous commencé à étudier la transformation envisagée du CICE en exonération de cotisations sociales ? À défaut, quel est votre sentiment à ce sujet ?
M. Antoine Magnier. Nous n’avons pas travaillé sur cette hypothèse. Lorsque le CICE a été instauré, il nous a semblé devoir concerner aussi les plus bas salaires, pour les raisons que nous venons d’exposer.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Vous faites partie du comité de suivi du CICE au sein du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.
M. Antoine Magnier. En effet, mais nous n’avons pas été sollicités pour conduire des travaux sur une éventuelle adaptation de ce dispositif.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Dans le rapport sur le financement de la branche famille qu’elle nous a remis avant l’été, la Cour des comptes a étudié à notre demande quatre scénarios touchant l’assiette, en s’appuyant sur le modèle MESANGE (modèle économétrique de simulation et d’analyse générale de l’économie) développé par la direction générale du Trésor, et en a notamment évalué l’effet sur l’emploi. Le premier transfère l’assiette à la valeur ajoutée des entreprises, le deuxième à la TVA, le troisième à la CSG et le quatrième à la fiscalité environnementale. À vos yeux, quelle est l’assiette qui permet de soutenir la compétitivité tout en créant des emplois, en fonction des différents niveaux de rémunération ?
M. Antoine Magnier. Je rappelle que, sur ce sujet, nous ne disposons pas d’un outil de simulation macroéconomique comparable à MESANGE. Il ressort de nos études et de notre participation à différents groupes de travail au cours des dernières années, en particulier dans le cadre du Conseil d’orientation pour l’emploi en 2006 et 2007, qu’il n’existe pas d’assiette miracle, du moins à moyen terme. L’on peut toutefois juger économiquement efficace d’étendre l’assiette de prélèvement au-delà des seules cotisations sociales, notamment en mettant à contribution d’autres revenus que ceux des salariés. Cela permettrait d’atténuer le coin fiscalo-social qui pèse sur le travail et peut entraîner des effets défavorables sur l’emploi lorsque sa hausse n’est pas contrebalancée par une baisse du salaire net, du fait de la négociation salariale.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. D’aucuns estiment que l’avantage de compétitivité dont bénéficie l’Allemagne s’explique par le basculement massif d’une partie des cotisations patronales vers la TVA auquel elle a procédé voici quelques années. Qu’en pensez-vous ?
M. Antoine Magnier. Cela nous paraît être un facteur secondaire. À nos yeux, le redressement de la compétitivité allemande s’explique principalement par la période de forte modération des salaires qui a duré de la fin des années 1990 à ces toutes dernières années. Elle a pris différentes formes et s’est illustrée par l’accroissement de la pauvreté au travail pour certains publics.
M. Benoît Ourliac. En outre, le produit de la hausse de TVA n’a pas été intégralement affecté à la baisse des cotisations sociales : les sommes en jeu, relativement faibles, ne suffisent absolument pas à expliquer l’évolution divergente des coûts salariaux unitaires en France et en Allemagne pendant cette période, qui résulte bien plutôt de l’évolution des salaires, laquelle a été atypique en Allemagne. Ce point ne fait guère débat parmi les économistes.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Merci, messieurs.
*
* *
Audition de M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille, et Mme Lucie Gonzalez, secrétaire générale
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille.
Monsieur le président délégué, il y a un an, nous vous avons auditionné sur le financement de la branche famille. Depuis, le Haut Conseil de la famille (HCF) a rendu son rapport en avril et le Gouvernement a pris des décisions au titre du quotient familial. Parallèlement, des réflexions sont engagées sur l’avenir du crédit impôt compétitivité emploi (CICE) et la réforme de la politique fiscale, notamment sur l’introduction d’une plus grande progressivité.
La Cour des comptes a également remis à la MECSS à la fin du mois de mai le rapport que celle-ci lui a commandé à la fin de l’année 2012 : or, aux yeux de la Cour des comptes, il n’existe pas d’assiette miracle pour financer la branche famille : la seule nécessité est de réduire ses dépenses pour résorber son déficit – le sujet était au cœur de votre rapport. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale a également produit un rapport au mois de juin, lequel propose différents scénarios de mécanismes de transfert.
Quel est l’état de la réflexion du Haut Conseil de la famille et de la vôtre sur l’opportunité de maintenir les cotisations patronales comme principale source de financement de la branche famille, compte tenu du caractère universel des prestations, ainsi que sur les taxes qui sont affectées à cette branche ?
M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille. Depuis le décret de juin dernier qui a refondu ses missions, le HCF a perdu la compétence que lui avait attribuée le décret d’octobre 2008 en matière de financement. Sa seule mission est désormais de réfléchir à l’avenir financier de la branche. Il est vrai que le haut conseil n’a jamais pu exercer la compétence plus large qui lui avait été initialement attribuée, à savoir réfléchir sur la nature des recettes, en raison à la fois de la publication du rapport de M. Yves Bur sur le financement de la branche famille et de la création du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFPS).
Le HCF se préoccupe donc de l’équilibre financier de la branche : l’essentiel de sa compétence consiste à réfléchir aux besoins financiers de la politique familiale.
La seule position officielle adoptée par le haut conseil a porté sur le niveau et le dynamisme de la recette : à ses yeux, en cas de changement d’assiettes, il faut, d’une part, respecter le principe de la compensation pour ne pas affaiblir le potentiel financier de la branche, et, d’autre part, vérifier régulièrement que les recettes qui seront éventuellement substituées aux cotisations patronales auront le même dynamisme de moyen terme. J’ai transmis à Mme la présidente du HCFPS la position unanime sur ces deux points des membres du haut conseil, le MEDEF mettant toutefois plus l’accent sur la baisse des cotisations patronales, sans prendre position contre la position du haut conseil.
Certes, l’affectation à la branche famille de 1 milliard d’euros résultant du plafonnement du quotient familial fait bouger en direction de l’impôt sur le revenu (IR) la ligne de partage des recettes entre cotisations, CSG et impôt, mais c’est de manière peu spectaculaire. J’ai transmis aux membres du haut conseil une note sur les mesures de transfert et d’ajustement prévues dans l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale : je n’ai jusqu’à présent été saisi d’aucune observation ni de demande de débat, ce qui pourrait laisser à penser – c’est une hypothèse – que les membres du haut conseil considèrent que le redéploiement opéré dans le cadre de l’article 15 ne contrevient pas à l’idée d’une compensation honorable dont le principe avait été retenu par le Conseil constitutionnel il y a quelques années. C’est d’autant plus remarquable que les partenaires sociaux et les mouvements familiaux sont d’ordinaire inquiets de l’obscurité qui accompagne habituellement tout mouvement brownien affectant les recettes – vous devez le savoir pour avoir auditionné le président de l’Union nationale des associations familiales (UNAF). Je tiens à souligner que, lors du transfert de 0,28 point vers la CSG, le haut conseil avait dénoncé le fait que les recettes affectées, équilibrées en début de période, étaient par la suite destinées à fléchir. Le Conseil constitutionnel a du reste par la suite rappelé qu’il ne convient pas d’affaiblir le potentiel de la branche famille.
Toutefois, alors que, selon les prévisions actuelles, la branche famille est en déficit pour quelques années encore, les décisions sur la reprise de sa dette permettront de la soulager : un apport substantiel de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est en effet prévu en 2016 et en 2017. La dette que la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) serait amenée à rembourser à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) serait dès lors limitée à quelque 5 milliards d’euros, dans le cadre, évidemment, des prévisions financières actuelles sur la période 2014-2018 – celles-ci peuvent naturellement évoluer. La branche famille reviendra à l’équilibre puis à l’excédent plus rapidement que si elle avait dû assumer directement sa dette.
Quant à la baisse de 0,15 point de la cotisation patronale, elle est compensée exactement par un jeu de recettes.
Il convient de distinguer les réflexions sur la nature de la recette de celles sur le niveau de celle-ci.
S’agissant de la nature de la recette, la tendance actuelle est de réfléchir à la baisse des cotisations patronales : tous les scénarios envisagés comprennent une telle baisse, qui répond à une double motivation, l’une doctrinale, l’autre d’opportunité économique.
Sur le plan doctrinal, il convient de déterminer s’il est possible de déduire de la nature de la dépense la nature idéale de la recette – ce qui rejoint la question, assez ancienne, de l’assiette idéale du financement de la branche famille. Ne serait-il pas plus logique de financer la branche famille par des impôts de solidarité nationale que par des cotisations professionnelles ? En effet, d’une part, les prestations sont généralisées depuis 1976 – les prestations augmentant même de manière inversement proportionnelle à l’activité professionnelle – et, d’autre part, les prestations sont déconnectées du salaire qui sert d’assiette à la cotisation – il en est de même de la branche maladie. La seconde motivation, c’est la baisse du coût du travail grâce à l’allégement des cotisations sociales, l’instrument idéal étant la baisse des cotisations patronales à la branche famille. Les analyses, surtout des organisations patronales, convergent donc en ce sens, alors même que personne ne sait à l’heure actuelle si une telle baisse des cotisations patronales se traduirait par un abaissement du coût du travail ou par des transferts entre branches.
Le récent rapport de l’HCFPS évoque cette option qui appelle, à mes yeux, quatre observations.
Premièrement, sur le plan de la doctrine, il faut rappeler que les solidarités nationale et professionnelle se croisent : l’entreprise n’est pas indifférente à la politique familiale. La Cour des comptes précise dans son rapport que le financement de la branche famille doit conserver un socle de cotisations patronales parce qu’une partie des prestations participe à l’amélioration de la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale. Les chiffrages de l’UNAF ou de la CNAF conduiraient d’ailleurs à une diminution des cotisations patronales très supérieure à ce qui est actuellement envisagé. De plus, pour passer d’une telle conception, somme toute arbitraire, à une analyse factuelle, il conviendrait de décomposer l’ensemble des prestations pour distinguer celles qui ont un lien avec l’entreprise de celles qui n’en ont pas. Où situer, par exemple, la part des recettes qui financent les droits familiaux de retraite ? Les entreprises, faut-il le rappeler, sont indissociables de la construction des recettes. Conviendrait-il de laisser aux cotisations patronales la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et tout ce qui concerne les modes de garde des enfants ? Ou le congé de paternité ? Ou encore les centres de loisirs sans hébergement (CLSH) ? Une telle piste de réflexion ne me semble pas très productive – je le dis à titre personnel. Toutefois, le HCF pourrait toujours étudier, à la demande du Premier ministre, une hypothèse de reclassement des prestations sur un tel critère.
Deuxièmement, l’option, même compensée, de la baisse des cotisations patronales est contestée par les partenaires familiaux, qui voient dans le glissement vers la budgétisation une double menace. La première concerne la gouvernance : les points de cotisation et leur affectation sont vécus par les partenaires familiaux comme une sécurité alors que le jour où l’État deviendrait le financeur principal, il n’aurait de cesse de baisser le potentiel financier de la branche famille. À mes yeux, cette crainte n’est pas fondée puisque le taux actuel de la cotisation patronale n’offre pas de plus grande sécurité juridique et politique qu’une décision du Parlement. La seconde menace, c’est de voir l’État évincer les partenaires sociaux de la gouvernance de la branche, leur participation au conseil d’administration étant liée, à leurs yeux, à la nature de la recette. Encore faudrait-il pouvoir mesurer le pouvoir réel des partenaires sociaux dans la branche famille : or celui-ci est menu. L’histoire des cinquante dernières années montre que le pouvoir de décision a appartenu au Gouvernement, puis au Parlement, la chronologie des débats du conseil d’administration de la CNAF révélant qu’il n’est saisi que lorsque les décisions sont déjà publiées. Du reste, les partenaires sociaux n’attendent pas la délibération de la CNAF pour discuter des enjeux : ils le font en amont.
Troisièmement, de nombreux partenaires sont partisans d’un recours à la CSG en raison de l’universalité des prestations – toutefois, la non-familialisation de la CSG laisse perplexe l’UNAF. Quant à la TVA, beaucoup estiment qu’elle est antifamiliale car régressive en termes de pouvoir d’achat. Les familles ayant, dit-on, un taux d’épargne plus faible – cela mériterait d’être nuancé –, la TVA pèse directement sur leur budget. Quant aux autres recettes possibles, les partenaires du haut conseil se retrouveraient, à mon sens, sur l’idée que le sujet principal est leur nature et leur dynamisme.
Quatrièmement, la remise à plat fiscale annoncée par le Premier ministre aura un impact direct sur le financement de la branche famille. Si les problèmes considérables posés par la fusion entre l’impôt sur le revenu et la CSG ont déjà été étudiés dans le rapport de M. Didier Migaud, l’instauration d’une CSG progressive non familialisée en poserait tout autant. Quant à l’évolution des charges sociales pesant sur les entreprises, si elle était retenue, elle renverrait à un besoin de financement. Cette remise à plat a en tout cas pour effet de geler toutes les réflexions déjà en cours.
S’agissant du niveau des recettes, à court et moyen termes, le haut conseil s’arc-boute sur l’idée qu’en phase de déficit il ne faut absolument pas perdre de recettes – c’est pourquoi l’opération de reprise prévue dans le PLFSS le rassure.
Le problème du niveau de la recette se posera de façon centrale à partir de 2020, lorsque la CNAF, à législation constante, sera revenue à l’équilibre puis dégagera un excédent croissant, qui pourrait devenir massif. Deux grandes options seront alors possibles – le choix qui sera fait rétroagissant sur la nature de la recette : conserver à la branche famille son potentiel financier et la laisser dépenser l’excédent spontané dont elle bénéficiera à législation constante, ou ne lui laisser qu’une partie de son excédent, via une diminution de ses recettes, en vue d’aider au rééquilibrage des finances publiques. L’avenir de la politique familiale se jouera donc davantage à partir de 2020 que dans les prochaines années, dont le cheminement est bien balisé : il ne pourrait être modifié qu’à l’occasion de la remise à plat de la fiscalité.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Il est certain que la remise à plat de la fiscalité – d’aucuns ont évoqué un big bang – ne sera pas sans incidence sur le financement de la branche famille.
Vous avez évoqué les réserves de la Cour des comptes quant à une budgétisation intégrale : les cotisations patronales se justifient à ses yeux au titre de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. La cour évoque une fourchette entre 13 milliards et 15 milliards d’euros.
M. Bertrand Fragonard. Le congé maternité est un exemple flagrant d’une telle conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Nous avons reçu les organisations syndicales. Sur les 5,4 points de cotisations patronales en direction de la branche famille, la CFDT souhaite en maintenir 3,2 et augmenter de 2,2 points les cotisations vieillesse. Quid alors de la baisse du coût du travail ?
Partagez-vous la lecture de la Cour des comptes en termes d’absence d’« assiette miracle » ? C’est le modèle macroéconomique MESANGE qui a servi de base à la réflexion de la Cour des comptes et de la direction du Trésor.
M. Bertrand Fragonard. La recherche d’une « assiette miracle » me laisse toujours dubitatif. Pour le haut conseil, l’« assiette miracle » est une assiette possédant le dynamisme souhaité. Le Premier ministre a d’ailleurs retenu, dans sa lettre de mission pour mon rapport, le principe d’une progression des recettes sur la période envisagée au moins équivalente au PIB.
Cette assiette ne doit pas non plus être susceptible d’être rapidement mitée : or c’est un des risques de la fusion de la CSG et de l’impôt sur le revenu – la mauvaise assiette chassant la bonne. Il faut souligner que le système des recettes est, depuis une trentaine d’années, de plus en plus utilisé pour infléchir la vie économique.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. La logique « pikettyste » a pour préalable l’élagage des niches existantes.
M. Bertrand Fragonard. Quelle est la probabilité politique de l’option « Piketty » alors qu’on se contente de chasser les anciennes niches par de nouvelles ?
Je suis plus intéressé par le montant que par la nature de la recette. Convient-il de flécher toutes les recettes ? Durant très longtemps, les finances publiques ont reposé sur la non-affectation des recettes : or on tourne de plus en plus le dos à ce principe, si bien que chacun croit avoir une créance sur les recettes de l’État, ce qui est discutable en termes de doctrine. Il faut toutefois prendre conscience du fait que les conséquences économiques sur le budget des familles des différentes options – TVA, CSG familialisée ou non, impôt sur le revenu – ne sont pas neutres. Un prélèvement sur le tabac ou l’alcool n’aurait aucune conséquence sur la politique familiale contrairement à une fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG, qui se heurtera à la question des quotients conjugal et familial.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Quelques parlementaires, dont je fais partie, ont déposé à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 un amendement visant à mettre en place une CSG progressive, amendement aussitôt complété par un second relatif à la familialisation de celle-ci. Il n’y aucun obstacle juridique. C’est la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les définitions du prélèvement et de la cotisation qui nous a « mis dans la nasse ».
M. Bertrand Fragonard. J’ai été auditionné par M. Migaud dans le cadre du rapport de la Cour des comptes : j’ai alors bien souligné que la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG soulèvera la question de la familialisation du nouvel ensemble puisque la CSG n’est ni conjugalisé ni familialisé, contrairement à l’impôt sur le revenu. Ce serait un problème majeur pour la politique familiale, même si des effets redistributifs peuvent être prévus dans le cadre de l’impôt sur le revenu – c’est ce qui s’est passé avec le plafonnement du quotient familial qui finance l’ensemble des prestations familiales.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Qu’en est-il du débat sur une budgétisation des dépenses de la branche famille relevant de la solidarité ?
M. Bertrand Fragonard. Ou bien les recettes de la branche famille sont directement assurées par le budget de l’État ou bien seulement quelques dépenses sont sorties de la branche famille pour être assurées par le budget « prestations » du ministère chargé des affaires sociales ou de la solidarité. Mais quelles dépenses choisir puisque, comme je l’ai souligné d’entrée de jeu, les prestations familiales n’ont pas de lien direct avec les revenus professionnels ? Toutes peuvent donc être considérées comme l’expression d’une solidarité élargie. Pourquoi les allocations familiales, qui sont déconnectées du revenu, ne ressortiraient-elles pas de la solidarité au même titre que les prestations logement ? Je ne discerne pas bien la logique d’un tel tri. Les partenaires sociaux verraient dans cette opération l’amorce d’une baisse de l’effort, laquelle n’est pas exclue, puisque, comme je l’ai déjà souligné, le vrai problème à partir des années 2020 sera de déterminer si on laisse ou non à la branche son excédent, lequel pourrait être vidé par la diminution de certaines dépenses et des recettes correspondantes. La même opération conduite dans la branche vieillesse créerait des difficultés tout aussi considérables : les minima de pension constituent-il une œuvre de solidarité plus importante que la diminution du taux de remplacement avec le revenu ? Cela revient indirectement à laisser dans l’obscurité les vraies questions : faut-il maintenir à la branche famille ses recettes actualisées à hauteur du PIB ? Conviendra-t-il, à compter de 2020, de lui conserver son excédent ? La budgétisation serait vécue de façon agressive par les milieux familiaux qui n’y verraient, je le répète, que l’occasion d’une diminution des prestations.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. D’autant que cette budgétisation n’évacuerait en rien la question de la gestion de proximité des prestations puisque le réseau des caisses d’allocations familiales (CAF) perdurerait.
M. Bertrand Fragonard. Le RMI, géré par les CAF, dépendait de l’État. Même si les prestations dites de solidarité étaient dans la main de l’État, elles continueraient d’être gérées par les CAF.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. C’est déjà le cas des aides au logement, qui sont assurées sur le budget de l’État, et du RSA – les conseils généraux n’en financent que la partie non compensée. Seules les prestations familiales sous conditions de ressources pourraient faire l’objet d’une forme de budgétisation si on considérait qu’elles relèvent de la solidarité nationale.
M. Bertrand Fragonard. Pour moi, le vrai sujet, c’est le montant et la destination des recettes de la branche famille.
Faut-il déclasser la PAJE et le complément familial, ainsi que l’allocation de rentrée scolaire ? En revanche, l’allocation de soutien familial ne sera pas déclassée alors que, massivement perçue par des ménages aux revenus modestes, elle est un exemple parfait de redistribution au profit des moins aisés. Le critère des conditions de ressources n’est donc pas pertinent. Que deviendrait le complément de libre choix d’activité (CLCA) ?
Pourquoi s’ingénier à faire compliqué quand on peut faire simple ? Cela permettrait-il d’occulter les vrais problèmes ? La gestion par l’État de la politique familiale est à la fois une chance et un risque : une chance s’il gère bien, un risque s’il est obsédé par la baisse des prélèvements obligatoires et se contente de rogner le budget des prestations familiales en raison du poids de l’assurance maladie. La gestion des aides au logement est, sur ce point, loin d’être exemplaire – je pense notamment à leur gel qui a, du reste, fait l’objet d’amendements au projet de loi de finances. La question est : veut-on modifier les prestations familiales à l’intérieur d’une enveloppe donnée ? S’agissant du statut fiscal des familles – les prélèvements portant sur les ménages –, qu’en sera-t-il de la TVA, de l’impôt sur le revenu et de la CSG ? Tels sont les enjeux de la politique familiale. De toute façon, que les prestations soient budgétisées ou non, c’est l’État qui, aujourd’hui, arbitre leur répartition par voie réglementaire, les partenaires sociaux n’ayant aucune prise sur elles. Seule l’action sociale fait l’objet d’un cadrage financier macroéconomique dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion (COG) avant d’être inscrite dans une loi de finances.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. D’aucuns proposent de consacrer le montant du crédit impôt compétitivité emploi à une baisse sèche des cotisations patronales. Sur les 34 milliards d’euros de la politique familiale, 14 milliards d’euros demeureraient alors à la charge des entreprises, les 20 milliards d’euros restants étant compensés par le budget de l’État, via notamment une augmentation de la TVA pour 6 milliards d’euros. Au lieu de baisser, comme prévu, de 6 % l’impôt sur les sociétés, l’État baisserait de 3,2 % ou de 3,5 % les cotisations patronales à destination des familles.
Se trouve évidemment posée la question, soulignée par la Cour des comptes, du cumul, pour l’entreprise, du bénéfice des exonérations de charges sociales jusqu’à 1,6 SMIC et du CICE jusqu’à 2,5 SMIC, sans compter les avantages des entreprises situées en zones franches urbaines.
M. Bertrand Fragonard. Il ne m’appartient pas en tant que président délégué du Haut Conseil à la famille de juger la politique d’exonérations de charges sociales. La seule chose que je soulignerai, c’est que la nature de la recette visant à compenser une baisse très importante des cotisations patronales risquerait d’avoir un impact sur le budget des ménages : 10 milliards d’euros de recettes n’ont pas la même incidence sur le pouvoir d’achat des familles s’ils sont perçus via la CSG ou via la TVA. Les dernières analyses du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) incitent les associations familiales à considérer la TVA comme récessive, même s’il convient de relativiser les conclusions du CPO, qui ne sont pas aussi catégoriques, puisqu’il est toujours possible de jouer sur les taux réduits, majorés ou intermédiaires de TVA.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. La MECSS avait demandé à la Cour des comptes de réfléchir à des assiettes alternatives, comme le recours à la fiscalité environnementale. L’attribution de recettes fiscales complémentaires à la branche famille vous paraît-elle envisageable ?
M. Bertrand Fragonard. À titre personnel, je réponds non, en raison de l’absence de toute marge. La priorité pour le haut conseil est de consolider le niveau de recettes actuel. Le président de l’UNAF, lors de son audition, a émis le vœu d’un arbitrage plus favorable aux familles : je formule le même vœu mais ce ne peut être qu’à prélèvements constants – une contrainte que les partenaires sociaux et familiaux esquivent généralement. Si des fonctions sont sous-développées, comme la dépendance, il convient, pour trouver des marges et en l’absence de toutes recettes dégagées par une éventuelle croissance, de se tourner vers la branche maladie. Si la branche famille peut redevenir excédentaire, c’est que les prestations familiales sont indexées sur les prix alors que les recettes évoluent comme les salaires : mais cela revient à accepter l’appauvrissement relatif des familles. Il appartient au Gouvernement et au Parlement d’arbitrer entre les priorités. Il est évident que la législation actuelle appauvrit en termes relatifs les familles, d’où la revendication de l’UNAF. Plus le pays s’enrichit, plus les familles doivent supporter la charge financière d’élever leurs enfants. Les allocations familiales ne représenteront plus rien en 2060 – nous faisons des projections pour le HCFPS à cet horizon –, voire dans vingt ou trente ans seulement. Conviendra-t-il de continuer de verser des prestations, dont la valeur relative en équivalent salaire diminue comme neige au soleil, ou de les restructurer ? Vaudra-t-il mieux indexer la totalité des prestations ou construire plus de crèches et augmenter le nombre des actions en direction des jeunes ? Le budget social est loin d’être à l’optimum ! Je le répète : la dépendance me semble prioritaire.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Je vous rejoins sur ce point.
Bertrand Fragonard. Oui, mais la clé du budget social, chacun le sait, c’est la dépense maladie. Si nous n’arrivons pas à la maîtriser, il faudra arbitrer entre le taux de prise en charge de l’assurance maladie et d’autres priorités. Dans le rapport que j’ai remis au précédent gouvernement sur la dépendance, je m’étais astreint à ne pas formuler de propositions de dépenses trop importantes : j’ai été déçu qu’aucune n’ait été reprise. J’attends donc avec beaucoup d’intérêt le projet de loi sur la dépendance.
En l’absence de recettes additionnelles, il ne sera pas possible de faire l’impasse d’une redéfinition des prestations familiales. À quoi, notamment, faudra-t-il consacrer un excédent éventuel : à des services, à des prestations universelles mieux indexées ou aux familles les plus modestes ? N’oublions pas qu’un enfant sur cinq vit en France sous le seuil de pauvreté.
M. Bertrand Fragonard. Je vous remercie, monsieur le président.
*
* *
Audition de M. Jean-Louis Rey, directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), et M. Alain Gubian, directeur financier
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Dans le cadre du débat sur la recherche d’un financement optimum de la branche famille, nous avons le plaisir de recevoir MM. Jean-Louis Rey, directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), et Alain Gubian, directeur financier.
Merci, messieurs, d’avoir répondu à notre invitation. Il nous apparaissait important, au-delà des réflexions théoriques, voire doctrinaires, de demander à l’acteur concerné au premier chef par les sources de financement de la branche son avis sur la question.
Pourriez-vous nous présenter rapidement la mission de l’ACOSS dans ce domaine ? Quel regard portez-vous sur l’évolution des recettes, notamment celles issues des cotisations sociales ?
M. Jean-Louis Rey, directeur de l’ACOSS. L’ACOSS pilote le réseau des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), actuellement en cours de régionalisation : au 1er janvier 2014, les 22 URSSAF seront toutes régionales.
L’ACOSS a une triple mission : recouvrer les cotisations et les contributions sociales, répartir les fonds collectés entre les différentes branches du régime général, gérer la trésorerie de la sécurité sociale. En 2012, elle a collecté 441 milliards d’euros, dont 80 % au titre des recettes du régime général et 20 % pour le compte de tiers – l’UNEDIC étant notre principal client extérieur. Elle compte 9,6 millions de cotisants – entreprises, travailleurs indépendants, particuliers employeurs – et 900 partenaires attributaires. Il s’agit d’un petit réseau, qui emploie 14 000 personnes, pour un coût de gestion très faible : 0,29 %. L’année dernière, nous avons géré 1 850 milliards d’euros de flux de trésorerie.
Nos résultats en matière de recouvrement sont tout à fait honorables : les restes à recouvrer sont très faibles, et ce malgré la conjoncture.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Pour ce qui concerne le financement de la branche famille, vous assurez le recouvrement des cotisations patronales, mais aussi celui de la CSG. Avez-vous des observations à faire sur les aspects proprement techniques ? Un type de prélèvement pose-t-il plus de difficultés qu’un autre ?
M. Jean-Louis Rey. Deux données doivent être prises en considération : l’évolution de l’assiette, c’est-à-dire la masse salariale, et le reste à recouvrer.
En 2013, la croissance de la masse salariale sera relativement faible : 1,3 %, contre 2,2 % en 2012 et 3,6 % en 2011 ; nous sommes sur une pente descendante, mais la situation n’a rien à voir avec celle de 2009, quand on a observé, pour la première fois dans l’histoire de la sécurité sociale, un recul, à hauteur de 1,3 %.
Ce résultat recouvre deux composantes : l’emploi est en baisse de 0,6 % ; en revanche, le salaire moyen par tête a augmenté de 1,8 %. Notre référence, c’est la moyenne des dix années qui ont précédé la crise de 2008, durant lesquelles le taux de croissance de la masse salariale a oscillé entre 3,7 % et 4 %, principalement sous l’effet de la hausse des rémunérations, mais avec une composante « emploi » positive, de 1,2 à 1,3 % par an en moyenne. Nous en sommes très éloignés.
Le reste à recouvrer est mesuré quinze mois après l’échéance, dans le seul secteur privé ; il sera cette année de 0,87 %, après avoir été de 0,83 % l’année dernière et de 0,74 % en 2011. Malgré l’épisode récessif, sa dégradation reste donc réduite. Cela signifie que les entreprises ont abordé cette séquence avec une trésorerie bien plus favorable qu’en 2008-2009.
Cela va-t-il durer ? Rien n’est moins évident. Il faudrait que la reprise se fasse sentir. Toutefois, les chiffres restent satisfaisants. Cela découle aussi d’une politique de recouvrement efficace, grâce à un comportement adapté des URSSAF, qui accompagnent les entreprises en difficulté.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Vous êtes le premier collecteur de prélèvements obligatoires du pays, devant l’État. Qui vient ensuite ?
M. Jean-Louis Rey. L’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), pour 54 milliards d’euros. Ensuite viennent les structures de financement de la formation professionnelle, tels les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ou les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA).
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Afin d’optimiser le système, pourrait-on envisager de confier la collecte de ces fonds à d’autres organismes ?
M. Jean-Louis Rey. Je sais que, dans le cadre de la discussion sur la réforme du financement de la formation professionnelle, une partie du patronat souhaiterait nous confier le recouvrement des contributions.
J’en viens au financement de la branche famille. Elle est essentiellement assurée par les cotisations patronales, à hauteur de 64 % en 2012. Mais attention : tout n’est pas versé par le secteur privé ; seuls 22 milliards d’euros le sont, auxquels s’ajoutent quelque 4 milliards d’euros de cotisations des travailleurs indépendants. L’ensemble représente moins de 50 % du financement de la branche ; on est loin de la situation d’il y a vingt ans, lorsque le financement était presque totalement assuré par les cotisations patronales du secteur privé.
Ce financement a deux légitimations : la participation du patronat, à travers la politique familiale, à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, essentielle pour les entreprises ; et les répercussions positives de la politique familiale, qui permet, même si c’est un handicap en termes d’emploi, de faire entrer chaque année 200 000 jeunes sur le marché du travail.
En tant que directeur de l’ACOSS, je n’ai pas d’opinion sur le mode de financement de la politique familiale. En revanche, en tant que gestionnaire de la trésorerie de la sécurité sociale, je me dois d’insister sur le fait que toutes les recettes ne se valent pas.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Lesquelles vous permettraient de remplir au mieux vos missions ?
M. Jean-Louis Rey. L’idéal, c’est d’utiliser une assiette dynamique et relativement indifférente à la conjoncture. Deux répondent à cette exigence : la masse salariale et la consommation. En revanche, l’impôt sur les sociétés est un chiffon rouge, en raison de son extrême volatilité, très dangereuse pour un financement de trésorerie. Pour pouvoir honorer nos engagements, nous avons besoin d’une recette régulière, prévisible et stable.
Cela signifie qu’affecter une partie des recettes de la TVA à la sécurité sociale – nous devrions bénéficier de 9 milliards d’euros pour l’exercice 2013 – ne pose aucun problème en termes de gestion de trésorerie. En revanche, la contribution sociale sur les bénéfices, assise sur l’impôt sur les sociétés, était pour nous un sujet de préoccupation, dans la mesure où nous ne savions jamais avec certitude quel serait son rendement ; heureusement, elle ne pesait que très peu dans notre financement.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. La TVA est collectée par le canal de l’État ; mais les 9 milliards d’euros utilisés pour financer les organismes de protection sociale transitent-ils par vous ?
M. Jean-Louis Rey. Oui ; la TVA est recouvrée par la direction générale des finances publiques (DGFIP) et une fraction nous est versée, que nous introduisons dans nos circuits de trésorerie. Nous en assurons la répartition.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Un financement principal de la protection sociale par la TVA ou par la fiscalité d’État déposséderait-il l’ACOSS d’une partie de ses prérogatives ?
M. Jean-Louis Rey. Oui, bien sûr. Les réseaux sont spécialisés par assiette : l’ACOSS s’occupe de l’assiette sociale, essentiellement salariale, et le réseau de la DGFIP des autres assiettes. Nos réseaux ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires. Si l’on change de mode de financement, cela aura forcément des répercussions sur l’ACOSS.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Une fiscalisation du financement de la protection sociale aurait par conséquent une incidence sur l’organisation du recouvrement ?
M. Jean-Louis Rey. C’est à tort que l’on parle de « fiscalisation du financement de la protection sociale ». La CSG est un impôt, et pourtant il a été créé pour financer la sécurité sociale – j’en sais quelque chose, puisque je suis l’un des auteurs de cette réforme, il y a vingt ans. Tout le monde l’assimile à une cotisation sociale, mais, juridiquement, c’est un impôt, qui pèse 92 milliards d’euros, soit le tiers des recettes du régime général !
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Dans son rapport daté du mois de juin, le Haut Conseil du financement de la protection sociale estime que la nature juridique de la CSG a souvent été un obstacle à son évolution. Les récentes annonces du Premier ministre relatives à la convergence de l’impôt sur le revenu et de la CSG, ainsi qu’à la conjugalisation et à la familialisation de l’impôt, conduiront peut-être à une clarification que d’aucuns jugent nécessaire, eu égard à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l’Union européenne. Qu’en pensez-vous ?
M. Jean-Louis Rey. Je ne peux qu’être d’accord avec cette opinion, puisque c’est moi qui ai écrit cette partie du rapport !
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. On dit communément que la CSG est un impôt dont l’assiette est vertueuse, parce qu’elle est très peu mitée par les exonérations et les niches fiscales. Existe-t-il néanmoins des marges de progression ?
M. Jean-Louis Rey. La CSG résultait d’un compromis politique : à sa création, en 1990, le contexte n’était pas favorable à une très large assiette. Cependant, un consensus politique est rapidement apparu sur la nécessité d’élargir progressivement celle-ci. Cette trajectoire linéaire n’a jamais été contrariée, contrairement à celle de l’impôt sur le revenu, né mité et qui a eu une histoire chaotique.
Que reste-t-il à faire ? Dans le domaine des prélèvements sur les revenus du capital, il conviendrait d’intégrer l’épargne dite « populaire » – l’épargne subventionnée. Pour ce qui concerne la contribution sur la masse salariale, il ne reste plus grand-chose à faire depuis que l’on a mis en place le forfait social. En revanche, il faudrait aligner les taux appliqués aux revenus de remplacement, et notamment aux pensions de retraite.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Combien y en a-t-il aujourd’hui ?
M. Jean-Louis Rey. Sur les pensions de retraite, trois : 0 %, 3,8 % et 6,6 %. Cela pose deux problèmes.
D’une part, il existe des effets de seuil importants, d’autant plus qu’ils dépendent d’un critère exogène, en l’espèce du niveau de l’impôt sur le revenu. Dans mes précédentes fonctions, j’avais d’ailleurs participé à la conception d’un système susceptible d’y remédier.
D’autre part, il faudra tôt ou tard aligner les taux, et que les retraités versent la même contribution que les actifs, à parité de revenus. La question aurait dû être réglée depuis longtemps !
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Pour en revenir à la branche famille, collectez-vous la totalité de ses ressources, hormis les taxes affectées ?
M. Jean-Louis Rey. Nous recouvrons 90 % de la CSG ; le reste, qui provient des revenus du capital, est collecté par les services de la DGFIP.
La CSG ne dispose pas d’une assiette unique. En réalité, il s’agit d’un concept politique, qui n’a pas d’existence juridique. Le terme n’est d’ailleurs pas utilisé dans le texte du code de la sécurité sociale ; il n’apparaît que dans l’intitulé du chapitre. Ce qu’on appelle « CSG » recouvre quatre contributions différentes, dont les taux varient : la contribution sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement ; celle sur les revenus du patrimoine ; celle sur les produits de placement ; celle sur les sommes engagées et les produits réalisés à l’occasion de jeux.
M. Alain Gubian, directeur financier de l’ACOSS. L’ensemble des versements sont toutefois centralisés à l’ACOSS, puis répartis entre les différentes branches de la sécurité sociale, dont la branche famille.
M. Jean-Louis Rey. Nous sommes en effet le seul interlocuteur de celle-ci.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Êtes-vous concernés par les exonérations de cotisations patronales ?
M. Jean-Louis Rey. C’est nous qui les gérons. Nous procédons aux recouvrements en appliquant les exonérations, et nous produisons toutes les données statistiques sur le sujet. Nous faisons aussi des simulations : l’annualisation de la réduction « Fillon » a ainsi été décidée sur la base de simulations produites par le service de M. Alain Gubian.
M. Alain Gubian. Autre exemple : le recentrage des exonérations dans les départements d’outre-mer, prévu par le projet de loi de finances pour 2014, a fait l’objet de simulations de notre part.
Les données individuelles sur les cotisants fournies par les entreprises sont des outils qui n’ont pas d’équivalent ailleurs. Notre capacité à répondre aux demandes est de ce fait très grande.
C’est la même chose pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : les données nous remontent automatiquement via les déclarations des entreprises, soit dans la version agrégée, soit dans la déclaration automatisée des données sociales (DADS). Cela permet d’évaluer l’impact d’une mesure en examinant quelles catégories de cotisants seront concernées. Nous réalisons les études de simulation à la demande des administrations intéressées.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Quel est votre rôle en matière de CICE ?
M. Jean-Louis Rey. Nous sommes chargés de tout ce qui concerne les obligations déclaratives, puisque l’assiette du CICE a pour référence la masse salariale.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. C’est vous qui transmettez les données aux services fiscaux ?
M. Jean-Louis Rey. Oui.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Et vous vérifiez qu’elles sont cohérentes avec les DADS ?
M. Jean-Louis Rey. Oui.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Et c’est également vous qui allez étudier l’effet de seuil des 2,5 SMIC et les conséquences que celui-ci pourrait avoir sur les salariés ?
M. Jean-Louis Rey. Tout à fait.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. La gestion du CICE a-t-elle un coût pour vous ?
M. Jean-Louis Rey. Non, mais c’est une source de difficultés, dans la mesure où les modalités de déclaration ont changé à cette occasion. Pour les cotisations sociales, les entreprises font des déclarations mensuelles non cumulatives ; pour le CICE, en revanche, les déclarations sont cumulatives : en octobre, l’entreprise doit déclarer la masse salariale concernée sur les dix premiers mois de l’année. C’est une approche qui n’est pas toujours bien comprise – même si la situation tend à s’améliorer.
M. Alain Gubian. Pour nous, c’est une assiette de plus à gérer – mais ce serait la même chose s’il s’agissait d’une exonération de cotisations sociales. Nous transmettons chaque mois les informations à la DGFIP. Le dernier mois, on cumule l’ensemble des données de l’année : le montant figurant sur le bordereau de cotisation doit être le même que celui indiqué ultérieurement sur la déclaration d’impôt sur les sociétés ; Bercy peut vérifier que les chiffres concordent.
Une seule et même politique de communication est menée par nos deux institutions, afin que les cotisants n’aient pas d’hésitation sur la procédure à suivre. Les difficultés que nous rencontrons devraient être transitoires.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. On envisage une réforme du CICE, voire son remplacement par un allégement des cotisations patronales. Cela vous paraîtrait-il plus simple ?
M. Jean-Louis Rey. Sur le plan de la gestion, oui. En revanche, il faudrait impérativement compenser cette perte de 20 milliards d’euros par des prélèvements stables et prévisibles.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Et s’il y avait une compensation incluse dans le budget de l’État ?
M. Jean-Louis Rey. Cela passera nécessairement par des recettes affectées, sinon il faudrait augmenter les prélèvements obligatoires de façon exponentielle. 20 milliards d’euros, c’est une somme considérable : il faut prévoir des recettes solides.
M. Alain Gubian. Il ne faudrait surtout pas que la perte de recettes soit compensée par une augmentation de l’impôt sur les sociétés, car cela nous mettrait en grande difficulté !
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Les cotisations patronales représentaient, avant la montée en puissance de la CSG, jusqu’à 90 % des recettes de la branche famille ; aujourd’hui, leur part n’est plus que des deux tiers. Cela a-t-il eu des répercussions sur la trésorerie ? Y a-t-il des incidents de trésorerie dans le financement de la branche famille ?
M. Jean-Louis Rey. Non, mais c’est parce que nous menons une politique préventive. Par exemple, à la suite du transfert de dettes à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et de la reprise par celle-ci des déficits de la branche vieillesse du régime général, il avait été prévu que la CADES nous verserait les sommes correspondantes très précisément le 10 juin. Jusqu’au dernier moment, nous sommes restés dans l’incertitude ; or l’enjeu était l’échéance d’un versement des pensions de vieillesse. Voilà le type de problèmes de « back-office » auquel nous pouvons être confrontés, mais dont personne n’a connaissance ; je ne sais pas comment on pourrait gérer, politiquement, un tel incident. Notre trésorerie demande une gestion extrêmement fine et attentive, en raison des fortes contraintes qui pèsent sur elle, puisqu’il faut que l’ensemble des caisses qui versent des prestations soient alimentées au bon moment et à la bonne hauteur.
Nous avons donc mis en place une politique de financement, pour l’essentiel par le marché. Nous empruntons en moyenne 20 milliards par jour, à des taux d’intérêt extrêmement bas – 0,1 % –, ce qui nous permet de limiter le coût du crédit à quelque 20 millions d’euros sur l’année. Les deux tiers des opérations se font sur le marché ; plus de 60 % de notre financement est assuré soit par des billets de trésorerie, soit par des euros commercial papers. La Caisse des dépôts et consignations ne prendra en charge cette année que 10 % de notre financement : c’est un instrument cher et peu flexible ; nous préférons aller sur le marché, qui est beaucoup plus rentable et efficace.
Une partie du financement est également assuré par la mutualisation des trésoreries sociales, les acteurs de la sphère sociale n’ayant pas toujours au même moment la même situation de trésorerie ; nous captons les excédents pour financer la trésorerie du régime général.
Il s’agit donc d’un univers complexe et fragile. Avant d’en réformer le financement, il faut toujours penser aux conséquences sur la trésorerie, c’est-à-dire sur le versement des prestations.
M. Alain Gubian. Les enjeux en termes de prévision sont très importants : tous les jours, nous devons savoir ce qui entre et ce qui sort. Quand une recette est incertaine, cela nous oblige à emprunter davantage et à avoir des soldes excédentaires inutilement élevés : c’est coûteux. C’est pourquoi il est important que les baisses de cotisations sociales soient compensées par des recettes stables. Nous devons pouvoir garantir toutes les échéances, au premier rang desquelles le versement des prestations de vieillesse, soit 9 milliards d’euros à débourser en un jour ; si la recette correspondante était aléatoire, cela poserait un problème ! Il nous faudrait alors emprunter des sommes considérables.
M. Jean-Louis Rey. Les taux d’intérêt sont très bas depuis environ deux ans, mais cela n’a pas été toujours le cas : en 2008, nous avions ainsi dépensé 800 millions d’euros en intérêts pour financer la trésorerie.
M. Alain Gubian. Aujourd’hui, le stock de dettes est de l’ordre de 20 milliards d’euros. Lorsque les taux d’intérêt sont de 0,1 %, le coût n’est que de 20 millions d’euros, mais s’ils grimpent jusqu’à 4 % – ce qui n’est pas rare –, la facture atteint alors 800 millions. Or tout peut bouger très vite.
M. Jérôme Guedj, président, rapporteur. Messieurs, je vous remercie. Nous tiendrons compte de votre invitation à préserver la trésorerie.
Audition de Mme Anne Eydoux, chercheuse au Centre d’études de l’emploi
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Notre sujet est d’une actualité brûlante. Le Président de la République a fixé un cap assez clair : la disparition des cotisations patronales de la branche famille de la sécurité sociale. Quid, dans cette perspective, du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ? La direction indiquée, conforme aux conclusions de la Cour des comptes, est celle d’une simplification radicale donc d’une éventuelle disparition de ce dispositif. Quid dès lors d’éventuelles contreparties – auxquelles tient la gauche.
Nous serons heureux de vous entendre sur ces questions, madame Eydoux, l’une des spécificités du Centre d’études de l’emploi (CEE) étant précisément sa capacité à anticiper.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Nous avions demandé à la Cour des comptes de réfléchir aux assiettes alternatives à la masse salariale : taxe sur la valeur ajoutée (TVA), contribution sociale généralisée (CSG), fiscalité écologique, valeur ajoutée des entreprises… La question se pose à nouveau de l’impact sur l’emploi de la suppression, envisagée par le Président de la République, des cotisations sociales à la charge des employeurs.
Vous êtes-vous posé la question de savoir ce que pourrait donner un financement de la branche famille par les entreprises, mais qui ne serait plus assis sur la masse salariale ?
Enfin, les exonérations de cotisations patronales, dans le passé, ont fait l’objet de contreparties, notamment en termes de création d’emplois – je pense au passage aux trente-cinq heures. Quel regard portez-vous sur ces mécanismes ?
Mme Anne Eydoux, chercheuse au Centre d’études de l’emploi. Ma présentation s’intitule : « Cotisations familiales, faut-il les supprimer pour créer des emplois ? » Je m’appuierai ici surtout sur un texte d’Antoine Math publié à la fin de l’année 2013 dans la Revue de droit sanitaire et social.
Les charges ou cotisations patronales mettraient les entreprises en difficulté face à la concurrence mondiale, les empêchant de recruter une main-d’œuvre trop chère. On a déjà accordé des avantages aux entreprises, parfois assortis de contreparties – vous avez évoqué les trente-cinq heures –, parfois non – ce fut le cas du CICE créé en 2013 et qui équivaut à une baisse des cotisations sociales sous forme de réduction d’impôts de l’ordre de 20 milliards d’euros pour 2014. Il est donc aujourd’hui question de supprimer les cotisations sociales des employeurs qui financent à hauteur des deux tiers la branche famille – à savoir 35 milliards d’euros à l’horizon 2017 en incluant le CICE –, ce qui représenterait in fine 15 milliards d’euros d’économies ou 15 milliards d’euros à trouver.
Cela se traduit par une perte de légitimité de la cotisation – ainsi Michel Sapin estime qu’il n’y a pas de raison que les cotisations sociales des employeurs financent la branche famille. L’idée est que la baisse du coût du travail pourrait jouer le rôle d’une dévaluation monétaire impossible au sein de la zone euro, stimulant par ce biais la création d’emplois. Il conviendra, dans cette optique, de comparer la France et l’Allemagne dont le modèle est très souvent cité pour avoir si bien rebondi après la crise de 2009, l’emploi ayant très bien résisté.
J’examinerai d’abord, d’un point de vue théorique, la question de la baisse des cotisations sociales des employeurs destinée à stimuler l’emploi. On s’interrogera ensuite sur le fait de savoir si cette baisse est favorable à l’emploi et quelles leçons on peut tirer des évaluations. Un troisième point sera consacré au principe d’une contribution des employeurs au financement de la politique familiale. Puis il s’agira de savoir si les employeurs sont écrasés par les charges patronales. Enfin on se demandera ce qui se passera si l’on supprime les cotisations sociales des employeurs ?
Les arguments favorables à la baisse des cotisations sociales des employeurs destinée à stimuler l’emploi sont surtout économiques et sans doute plus fragiles qu’il n’y paraît. On peut les résumer en un syllogisme – libéral en l’occurrence – dont les prémisses seraient les suivantes : les cotisations sociales employeur pèsent sur le coût du travail ; or celui-ci nuit à la compétitivité coût ou à la compétitivité prix des entreprises, et nuit donc à l’emploi, la baisse du coût du travail réduisant le coût de la main-d’œuvre et permettant aux employeurs de recruter davantage. Conclusion : il faut diminuer les cotisations sociales des employeurs pour abaisser le coût du travail et accroître la compétitivité des entreprises et créer des emplois.
Ces arguments sous-tendant une politique de l’offre sont discutables. On sait, depuis longtemps, que les liens sont lâches entre les cotisations sociales des employeurs et le coût du travail, de même qu’entre le coût du travail et la compétitivité des entreprises – la Commission européenne a démontré que les performances commerciales des pays européens entre 1997 et 2007 ne dépendaient pas de l’évolution des coûts unitaires du travail dans l’industrie. Les liens sont lâches, enfin, entre le coût du travail et l’emploi.
On sait, depuis les années 1990, que le taux des cotisations sociales des employeurs n’est pas un déterminant significatif du coût du travail, comme l’a montré en 2008 une étude d’Yves Chassard et Jean-Louis Dayan menée pour le CEE dans les trente pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon les auteurs, « si le financement de la protection sociale engendre un handicap compétitif, ce n’est donc que pour les bas salaires et dans des proportions limitées ».
Les cotisations sociales employeur ont un lien également lâche avec la compétitivité. En effet, la compétitivité prix des entreprises ne dépend pas du seul coût du travail. Une étude, au chiffrage controversé, de Laurent Cordonnier et d’autres membres du Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSÉ), montre que le coût du capital pèse de plus en plus lourd dans le coût total, les auteurs évoquant à ce sujet le surcoût du capital imputable aux dérives des normes de rendement financier imposées aux entreprises. Ils estiment ce surcoût à 95 milliards d’euros en 2011, soit la moitié de la formation brute de capital fixe (qui sert à l’investissement productif) et 15 % du coût du travail. Dans son article précité, Antoine Math relève que ces 95 milliards d’euros représentent près de trois fois les cotisations sociales employeur pour la branche famille et la totalité des mêmes cotisations pour les branches famille et maladie réunies.
La compétitivité prix dépend aussi et surtout d’autres facteurs que les seuls coûts : la qualité des produits, l’innovation, l’adaptation à la demande. Si l’on compare la France et l’Allemagne, les faibles performances de la première en matière de compétitivité sont essentiellement liées à des facteurs de compétitivité hors coûts.
L’absence de lien univoque entre coût du travail et emploi se retrouve même dans la théorie économique. Dans une perspective néoclassique, libérale, la baisse des salaires et des cotisations stimule la demande de travail des entreprises et, éventuellement, l’offre de travail des travailleurs diminuera, car ils ne voudront pas travailler à bas prix. Dans une perspective keynésienne, à l’inverse, une hausse des salaires, lorsqu’elle stimule la demande et notamment la consommation, peut avoir des effets positifs sur la production et sur l’emploi. Selon la théorie néokeynésienne des salaires d’efficience, une hausse des salaires peut améliorer la productivité des salariés, plus motivés.
La baisse des cotisations sociales employeur peut donner l’apparence d’une synthèse entre ces courants en permettant d’abaisser le coût du travail, donc de stimuler la demande de travail des entreprises, dans une perspective libérale, sans forcément diminuer les salaires et donc sans peser sur la demande – quoique tout dépende de l’impact d’une telle mesure sur les prestations familiales, par exemple.
Deuxième point de cette présentation : quelle est la leçon des évaluations, après vingt ans d’exonérations de cotisations sociales employeur sur les bas et moyens salaires ? Dès 1993 en effet, un dispositif prévoyait l’exonération totale des cotisations d’allocations familiales jusqu’à 1,1 salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et une exonération de moitié entre 1,1 et 1,2 SMIC. Une série de réformes, dont le « dispositif Fillon » à partir de 2003, ont ensuite eu tendance à élargir ces exonérations à d’autres cotisations, allant jusqu’à des salaires inférieurs à 1,6 SMIC.
Les évaluations du « dispositif Fillon » ont donné des résultats contrastés. Certaines estiment qu’il a créé entre 400 000 et 800 000 emplois en cinq ans, mais elles ne tiennent pas compte des effets induits, comme la nécessité de compenser la baisse des recettes et l’éventualité d’une réaction de nos partenaires commerciaux.
Selon la simulation macroéconomique réalisée pour l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) par Éric Heyer et Mathieu Plane en 2012, le nombre d’emplois créés en cinq ans est d’environ 500 000. Il convient néanmoins, selon eux, de relativiser ce chiffre, puisqu’il ne tient pas compte du financement du dispositif. Si la baisse des recettes de cotisations est financée par des recettes supplémentaires, selon le mode de financement, il va falloir revoir à la baisse le nombre d’emplois créés pour aboutir au chiffre de 250 000 à 300 000 emplois en cinq ans. Dans l’hypothèse d’une réaction de partenaires commerciaux qui adopteraient un dispositif similaire, on tombe à une fourchette de 70 000 à 170 000 emplois créés.
L’estimation de l’OFCE, qui fait autorité, tourne autour de 300 000 emplois créés.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Il n’y a pas d’impact « Fillon » proprement dit – il faut prendre en compte plusieurs dispositifs successifs : « Balladur », « Juppé », les trente-cinq heures… L’estimation que vous citez fait l’hypothèse de la suppression de l’allégement jusqu’à 1,6 SMIC, n’est-ce pas ?
Mme Anne Eydoux. Il s’agit plutôt de l’ordre de grandeur estimé des emplois que ces réductions ont pu créer.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Mais comment intègre-t-on les trente-cinq heures, assorties de vraies contreparties, dans cette évaluation ? Ces chiffres tiennent-ils compte des trente-cinq heures ou non ?
Mme Anne Eydoux. Non.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Si l’on supprimait l’allégement « Fillon » – soit 20 milliards d’euros –, combien perdrions-nous d’emplois ?
Mme Anne Eydoux. Selon l’étude de Brigitte Roguet et Bruno Garoche, publiée en 2013 sous l’égide de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), en 2010, les allégements de cotisations sur les bas salaires représentaient environ 22 milliards d’euros auxquels on peut ajouter les 4,5 milliards d’euros d’exonérations pour les heures supplémentaires. Aussi, pour quelque 300 000 emplois créés en cinq ans, le dispositif a coûté très cher : plus de un point de produit intérieur brut (PIB) de dépenses publiques engagées. Antoine Math estime que chaque emploi créé ou sauvegardé coûterait chaque année au moins 75 000 euros. Cela pour des emplois, note-t-il, à bas salaires, de qualité incertaine et mis à la disposition des entreprises privées plutôt qu’au service de l’intérêt général – ils coûtent plus cher que des emplois de fonctionnaires.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Les emplois payés au SMIC, charges comprises, coûtent environ 20 000 euros, n’est-ce pas ?
Mme Anne Eydoux. Je pense qu’Antoine Math a ramené les 22 milliards d’euros aux 300 000 emplois créés. Les allégements de cotisations tiennent compte de la hausse des taux de marge des entreprises. Antoine Math a pris au mot la logique de baisse des coûts pour créer des emplois.
M. le rapporteur. Il rapporte deux éléments différents : le coût global des allégements de cotisations rapporté aux créations d’emplois. Il n’y a pas que 300 000 emplois qui sont concernés par ces allégements.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Cela signifie que, si l’aide publique de 20 milliards d’euros représente 75 000 euros par emploi créé, non seulement elle finance 100 % de l’emploi créé, soit 20 000 euros, mais elle permet aux entreprises de bénéficier du reste, soit 55 000 euros par emploi.
Mme Anne Eydoux. Que peut-on attendre de la suppression des cotisations familiales ? Pas grand-chose en termes de création d’emplois parce que les bas salaires sont déjà exonérés. Les nouvelles baisses vont donc concerner des salaires plus élevés avec des effets incertains et limités en matière de création d’emplois. En termes de coût, une telle mesure représente 15 milliards d’euros si l’on intègre le CICE.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. La presse rapportait ce matin que, comme les allégements de charges se calculent avant impôt sur les sociétés, le gain net de l’opération sera plutôt de l’ordre de 10 milliards d’euros, voire un peu moins. On transforme en effet le CICE, calculé après impôt sur les sociétés, en une baisse des charges qui augmentera les bénéfices et donc le produit de l’impôt sur les sociétés.
M. le rapporteur. L’argument est le suivant : la suppression des cotisations patronales pour la branche famille va potentiellement augmenter l’assiette et donc le rendement de l’impôt sur les sociétés. La baisse globale du coût du travail ne sera donc pas de 15 milliards d’euros puisqu’il faudra les amputer du montant de l’augmentation de l’impôt sur les sociétés.
Mme Anne Eydoux. C’est peu par rapport aux 170 milliards d’euros de cotisations payés par les employeurs et même une goutte d’eau dans la somme des coûts de production des entreprises.
On a donc affaire à une politique de l’offre qui va renforcer les marges des entreprises plutôt qu’à une politique susceptible de créer un choc de compétitivité.
Parmi les arguments invoqués pour la suppression des cotisations sociales patronales, on relèvera celui, politique, de la cohérence du financement de la branche famille, selon lequel les prestations familiales ne sont pas réservées aux salariés, mais sont universelles et doivent donc être financées par l’impôt – est-il légitime, pour reprendre les termes de Michel Sapin, de faire financer la branche famille par les employeurs ? Selon un second argument, patronal, les entreprises françaises seraient écrasées par les charges – notamment familiales – comparativement à leurs voisines.
La théorie économique classique à la Ricardo, mais aussi, surtout, marxiste, s’est exprimée sur le premier point. Sur la reproduction de la force de travail, comme les théories classiques, le marxisme considère que le salaire permet d’assurer l’entretien et la reproduction du travailleur et de sa famille. Marx parle de la force de travail. Si on actualise cette théorie – comme le fait la CGT –, on peut dire que la cotisation employeur est un élément du salaire et qu’elle permet une socialisation de la reproduction de la force de travail, notamment par la politique familiale. De ce point de vue, il est bien légitime que les employeurs contribuent au financement de la politique familiale. Ils ont en effet intérêt à disposer d’une main-d’œuvre abondante, jeune, éduquée, intérêt à la reproduction de la force de travail. Ils tirent bénéfice d’une forte fécondité, que la société investisse dans l’éducation et la formation des futurs travailleurs, bénéfice qui va bien au-delà du financement des politiques de conciliation entre travail et famille de leurs salariés.
Antoine Math s’est demandé si les employeurs contribuaient trop à la politique familiale. Les cotisations sociales employeur représentent bien 35 milliards d’euros, à savoir près des deux tiers des dépenses de la branche famille ; mais les dépenses d’éducation des enfants ne se limitent pas à ce chiffre : l’investissement de la nation en faveur des familles va bien au-delà – Antoine Math évoque 120 milliards d’euros en 2008, soit près de 6 % du PIB (selon le Haut Conseil de la famille). Dans cette perspective, les entreprises ne contribuent plus que pour un dixième à la politique familiale. Si l’on tient compte de l’ensemble des dépenses de consommation finale imputables à la production et à l’éducation des enfants, on arrive à 14 % du PIB. Si l’on valorise les soins procurés aux enfants au sein de la famille – il s’agit des tâches parentales –, on atteint 23 % du PIB. La contribution des employeurs à la reproduction sociale est donc en réalité bien moindre que les deux tiers susmentionnés. Antoine Math en conclut que cette contribution n’est pas excessive.
Pour ce qui est du second argument, en vertu duquel les entreprises seraient écrasées de charges en France, Antoine Math montre que l’évolution de la part des cotisations sociales employeur dans la valeur ajoutée n’a cessé de diminuer : elle était de 19 % dans les années 1980, 17,5 % dans les années 1990, pour tomber à 15,6 % en 2008 avant de remonter à 16,6 % en 2012. Le raisonnement reste valable si l’on ajoute les impôts payés par les sociétés. Aussi, conclut Antoine Math, en dépit du discours dominant, les entreprises ont été largement favorisées par les évolutions récentes. La baisse des cotisations sociales des employeurs peut difficilement se justifier par l’argument d’une pression fiscale trop élevée.
Venons-en à la comparaison entre les systèmes français et allemand. Les deux relèvent d’une logique bismarckienne : la cotisation contribue pour beaucoup au financement de la protection sociale même si l’on assiste, dans les deux pays, à une tendance à la fiscalisation.
Une note du Trésor montre un moindre effort de dépenses de protection sociale par rapport au PIB en Allemagne : 31 % contre 33 % en France. Le financement par cotisation rapporté au PIB est un peu inférieur outre-Rhin. Les cotisations sociales seraient, selon cette note, moins lourdes en Allemagne, mais les indicateurs fournis ne permettent pas de l’affirmer. J’ai en revanche trouvé que le taux de cotisation des entreprises en Allemagne, de 19 %, serait un peu plus élevé qu’en France, mais je n’en suis pas sûre.
Reste que si les taux de cotisation dans les deux pays sont comparables, la grande différence est qu’ils sont beaucoup plus progressifs en France : pour les salaires avoisinant le SMIC, ils sont très faibles, bien inférieurs à ce qu’ils sont en Allemagne. Pour les salaires plus élevés, en revanche, du fait de la progressivité, les taux sont plus élevés en France. Autre différence : il n’y a pas de cotisation famille en Allemagne parmi les cotisations sociales employeur, mais des cotisations maladie, vieillesse…
En outre, la politique familiale de l’Allemagne est bien différente et constitue un vrai point noir pour ce pays. Même si les structures collectives se sont développées depuis les années 1990 et surtout 2000, les jeunes enfants leur sont nettement moins confiés qu’en France. Dans la partie occidentale de l’Allemagne, on considère qu’il est bon pour l’enfant que sa mère reste avec lui à la maison. Aussi de nombreuses mères diplômées ont-elles renoncé à la maternité. On peut donc difficilement prendre exemple sur la politique familiale allemande et sur son financement, d’autant que la démographie y est en berne et que, s’il y a moins de chômage des jeunes qu’ici, c’est parce qu’il y a moins de jeunes. En outre, le financement du risque vieillesse et des retraites pose des problèmes d’une autre ampleur que ceux constatés en France.
La compétitivité allemande vient-elle de moindres cotisations sociales employeur ? Les coûts du travail ne sont pas l’explication puisqu’ils sont plus élevés en Allemagne, notamment dans les industries exportatrices et en particulier pour les biens d’équipement. C’est donc la compétitivité hors coût qu’il faut considérer. Guillaume Duval montre bien que, pendant la crise, les exportations se sont effondrées avant de rebondir. Il faut également tenir compte des retombées positives de la réunification allemande qui a ouvert les marchés de l’Europe de l’Est à l’Allemagne, laquelle a aussi misé sur des industries qui correspondent à la demande mondiale, comme le secteur des biens d’équipement pour les pays émergents.
Comment, ensuite, expliquer les récentes performances de l’Allemagne en matière d’emploi alors que, dans les années 2000, elle était considérée comme l’homme malade de l’Europe à cause d’un taux de chômage élevé, le PIB chutant même en 2009 de manière plus marquée qu’en France ? Si l’emploi a très bien résisté outre-Rhin, le chômage partiel y a augmenté plus fortement, contribuant à soutenir l’emploi industriel masculin. L’autre face du miracle de l’emploi est l’explosion des « mini-jobs » après les « réformes Schröder ». On compte environ 7,5 millions de ces emplois, essentiellement féminins et présents surtout dans les services, rémunérés à moins de 450 euros par mois. Ils ne sont pas exonérés de cotisations sociales des employeurs, mais de cotisations salariales, alors que la France a bien plus misé sur la baisse des cotisations sociales des employeurs.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. On évoque souvent en ce moment le taux de marge, de 28 % en France, minimum historique, mais de 42 % en Allemagne. J’ai entendu dire que ces chiffres étaient largement erronés parce qu’ils comparaient des choux et des carottes. Avez-vous sur ce point des données corrigées des variations idéologiques ?
Mme Anne Eydoux. Je n’en ai pas et préfère donc ne pas commenter.
J’en viens aux trente-cinq heures. Il a fallu attendre 2005 pour disposer d’un bilan : mitigé sur les conditions de travail, il est plutôt favorable en termes de création d’emplois.
La France a très bien résisté, notamment en matière d’emploi, au ralentissement des années 2000 qui n’a pas donné lieu à une récession, alors que ce fut le cas en Allemagne. Il est possible que les trente-cinq heures aient joué un rôle en la matière. Si l’Allemagne a si bien résisté à la crise de 2008, selon l’économiste du travail Steffen Lehndorff, ce n’est pas grâce aux « réformes Schröder », mais à ce qui restait du modèle allemand : la cogestion, la flexibilité interne qui a permis d’éviter le licenciement des salariés par le biais du chômage partiel. Or les trente-cinq heures sont aussi un dispositif de flexibilité interne : on agit sur le temps de travail pour préserver l’emploi.
L’histoire montre que le financement de la branche famille par la cotisation donne des marges de manœuvre ; il a permis une socialisation de la reproduction sociale, mais aussi ce que Gøsta Esping-Andersen appelle une « démarchandisation du travail », c’est-à-dire le fait de soustraire les travailleurs à la concurrence sur le marché dans leurs moyens de survie. Avec une branche famille largement financée par la cotisation, nous avons un budget relativement autonome par rapport à celui de l’État, et peut-être, donc, à certains moments, protégé des coupes. Surtout, à partir des années 1950, ce financement par la cotisation a permis de dégager des excédents, sauf dans les périodes de crise, comme en 2008-2013, et lorsque des dépenses familiales nouvelles ont été engagées, comme avec la montée en charge de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) au début des années 2000. Cette série d’excédents a permis soit de financer d’autres besoins sociaux, maladie ou vieillesse, soit de financer de nouvelles dépenses familiales.
En outre, puisque les prestations familiales sont indexées sur les prix alors que les cotisations évoluent avec la masse salariale, le pouvoir d’achat des prestations familiales a baissé par rapport à l’évolution des salaires. Comment compenser aujourd’hui la baisse des cotisations sociales des employeurs ? Depuis les années 2000, la branche famille est déficitaire du fait de dépenses combinées à une hausse de la natalité. Certaines coupes dans les prestations n’ont pas suffi dans un contexte de crise et on peut penser qu’à législation constante les dépenses devraient croître.
Comment envisager l’avenir du financement de la branche famille ? La suppression des cotisations sociales des employeurs fait suite à une baisse de la CSG affectée à cette branche. Allons-nous passer à des impôts et taxes affectés ? Ces prélèvements sont d’une autre nature et, souvent, ne sont pas pérennes. Si les financements sont fragilisés, s’ils se réduisent, va-t-il falloir couper dans les prestations familiales ? Le débat sur la mise sous conditions de ressources des allocations familiales est peut-être annonciateur. Reste que la politique familiale française est un de nos points forts si, de nouveau, on établit une comparaison avec l’Allemagne.
L’idée que les cotisations sociales employeur pour la branche famille n’ont plus de raison d’être n’a pas de fondement économique solide. Il n’y a pas de raisons d’éliminer toute contribution des entreprises à la reproduction sociale. La baisse du coût du travail et, a fortiori, celle des cotisations sociales famille ne peuvent tenir lieu de politique industrielle et de politique de compétitivité. La suppression de ces cotisations soulève donc davantage de problèmes qu’elle n’en résout : elle fragilise le financement de la branche famille ; les impôts et taxes affectés destinés à compenser les baisses de ces cotisations sont soumis aux décisions de l’État et à la conjoncture – or nous nous trouvons dans un contexte qu’il faut bien qualifier de rigueur budgétaire sinon d’austérité –, davantage que les prélèvements assis sur les salaires. L’inscription de la branche famille dans le budget de l’État, déjà envisagée par plusieurs rapports, pose problème ; selon Antoine Math, « elle viendrait altérer la capacité de la branche à dégager des ressources autonomes, pérennes et dynamiques, ce que sont les cotisations sociales employeur et la CSG, qui ont permis dans le passé d’opposer une meilleure résistance face à la concurrence des autres besoins sociaux et aux difficultés budgétaires de l’État ».
M. le rapporteur. Nous vous remercions pour la qualité de votre présentation et pour les arguments stimulants que vous avez livrés à notre réflexion.
Je reprends ma question initiale : le statu quo serait-il à vos yeux préférable ? N’y aurait-il aucun effet dépressif, défavorable, au financement des entreprises assis sur la seule masse salariale ? Avez-vous des hypothèses quant à des assiettes alternatives : cotisation sur la valeur ajoutée, TVA, CSG, financement sur une fiscalité écologique gouvernementale ?
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Quelles seraient selon vous les contreparties les plus efficaces en matière d’emploi, puisque le Président de la République, tout en engageant la France dans cette voie, a insisté sur cette notion dont il faut préciser toutefois le contenu ? Avec les trente-cinq heures, c’était relativement simple : un critère objectif pouvait être appliqué à toutes les entreprises.
Mme Anne Eydoux. Je n’ai pas étudié l’hypothèse d’assiettes alternatives. On peut y réfléchir, mais, je l’ai dit, les liens sont lâches entre cotisations sociales des employeurs et coût du travail et entre coût du travail et compétitivité des entreprises. En matière de politique économique, on ferait bien de se référer au principe suivant : à chaque objectif, un instrument. Or l’allégement des cotisations sociales des employeurs n’est pas le bon instrument pour créer des emplois et pour stimuler la compétitivité de l’industrie française. On peut réfléchir à ces questions d’assiette, reste que la politique engagée aura des effets marginaux.
M. le rapporteur. Vous soutenez que l’allégement, la suppression des cotisations n’est pas la bonne solution ; vous parlez d’effets marginaux ; vous considérez donc que le statu quo, c’est-à-dire le financement à hauteur des deux tiers de la branche famille par une cotisation des employeurs de 5,25 %, serait satisfaisant ?
Mme Anne Eydoux. Je suis d’accord avec Antoine Math sur ce point. Pour ce qui est du financement et des réformes de la branche famille, il vaut mieux cibler des objectifs liés aux prestations familiales et aux politiques familiales.
Pour le reste, en effet, dans le cadre des trente-cinq heures, aux termes de la loi, la baisse du coût du travail était la contrepartie de la baisse du temps de travail. Ici, les cotisations sociales des employeurs vont être supprimées pour tous, mais des contreparties vont-elles être demandées aux employeurs et, dans l’affirmative, lesquelles ? Pouvons-nous les obliger à créer des emplois ? Je l’ignore.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. On pourrait exiger, de manière analogue aux trente-cinq heures, un accord de branche et un accord d’entreprise aux termes desquels les partenaires sociaux définiraient les contreparties : embauche de dix personnes, d’un commercial pour l’aide à l’exportation, investissement dans une nouvelle machine qui permettra à terme la création de nouveaux emplois... Et, si aucun accord d’entreprise n’est signé, il n’y aurait pas de suppression de la cotisation famille, comme c’est le cas pour les accords d’égalité professionnelle ou pour les contrats de génération : s’il n’y a pas d’accord, est prévue une pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale.
Dès lors qu’on supprime la cotisation et qu’il n’est plus question d’exonération, doit-on se priver de la capacité d’imposer des contreparties ? Ensuite, quel contenu leur donner pour éviter l’évaporation que vous avez signalée ? Ainsi avait-on précisé que le CICE ne devait pas servir à baisser les salaires, augmenter les dividendes ou la rémunération des dirigeants, mais à investir dans la recherche, l’innovation et la formation. Or le maillon faible du système est l’absence de sanction si ces affectations ne sont pas respectées.
Mme Anne Eydoux. Le maillon faible sera peut-être ici le même : on peut imaginer des négociations pour définir les contreparties à apporter à la suppression des cotisations sociales des employeurs, mais rien n’empêche que, dans le cadre de ces négociations, on fasse passer pour contrepartie des investissements qui auraient de toute façon été réalisés, des emplois qui auraient de toute façon été créés… La logique des accords d’égalité professionnelle est intéressante, car elle rend visibles les inégalités, mais, si l’on prend le contenu des accords en termes d’inégalités de salaires, qui est souvent un point d’achoppement, le contenu est bien mince. La négociation n’est pas forcément mauvaise, inutile en elle-même, puisqu’elle aurait en l’occurrence l’avantage de rendre visibles ces contreparties, mais il ne faut pas penser qu’elles s’en trouveraient nécessairement renforcées.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Nous vous remercions pour votre contribution.
*
* *
Audition de M. Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, et M. Daniel Lenoir, directeur général
M. le coprésident Jean-Marc Germain. L’objet de notre mission d’évaluation est devenu d’une actualité on ne peut plus brûlante depuis l’annonce par le Président de la République de la suppression de la part patronale des cotisations familiales. Même si la MECSS a l’habitude de conduire des évaluations de long terme, nous considérons que le Parlement doit participer au débat public, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous pencher sur une question dont nous nous doutions qu’elle ferait l’actualité.
L’annonce présidentielle bouscule quelque peu le cadre de notre réflexion, puisque le champ de nos travaux était beaucoup plus large et portait sur les questions d’assiette, de gouvernance ou de légitimité de la dépense. Cette mesure ambitieuse faisait partie de notre champ de réflexion, la Cour des comptes ayant déjà envisagé ce scénario. Le Président de la République a laissé entendre que la solution de la suppression de la part patronale des cotisations familiales accompagnée de la suppression du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) avait sa préférence, tout en se disant ouvert à la discussion. Celle-ci impliquera les organisations patronales et syndicales ainsi que les collectivités locales ; le Parlement y sera associé. Le Président de la République a également souhaité que la question des contreparties fasse l’objet d’un « grand compromis social » – ce sont ses termes.
Nous aimerions savoir comment vous réagissez à ces annonces. Une telle mesure vous ferait nécessairement dépendre d’autres sources de financement : avez-vous des préférences en la matière ? Aurait-elle un impact sur la gouvernance de la branche famille ?
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Nous sommes en effet très désireux de connaître votre réaction à l’annonce du Président de la République, puisque vous êtes les gestionnaires de ces ressources qui sont appelées à disparaître. Il ne s’agit pas de recommencer le débat théorique sur la légitimité du financement de la branche famille par les entreprises – je rappelle à ce propos que la Cour des comptes a estimé que, les prestations de la branche famille visant à permettre la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, la contribution des entreprises à son financement à hauteur d’une dizaine de milliards d’euros serait justifiée.
C’est sur l’avenir que nous comptons vous interroger aujourd’hui. Quel serait selon vous le financement alternatif idéal ? Une fiscalisation plus poussée du financement de la branche vous semble-t-elle souhaitable ? Quelles incidences aura ce changement du mode de financement sur la gouvernance de la branche famille ? Craignez-vous une ressource moins dynamique, susceptible de mettre en péril le maintien du niveau des prestations ? Il ne faut pas oublier que l’année qui vient de s’écouler a vu la baisse du plafond du quotient familial et la perte de 0,15 point de la cotisation patronale sur les retraites.
Avez-vous le sentiment que la suppression de la part patronale peut être compensée par des économies sur les dépenses de la branche famille ? Pour reprendre des termes utilisés par le Président de la République, ces dépenses souffrent-elles d’excès, d’abus ou de redondances dont la suppression permettrait de compenser au moins en partie le coût de la mesure annoncée ? J’ai conscience du caractère quelque peu provocateur de cette dernière question !
M. Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Il faut bien reconnaître que les annonces du Président de la République nous ont un peu pris de court et que cette audition, prévue de longue date, acquiert de ce fait une autre dimension. Quand un budget se trouve amputé de 60 % de ces recettes, cela pose nécessairement de nombreuses questions.
Il est vrai qu’un tel scénario était dans l’air. Voilà déjà quelques années que les entreprises contestent la légitimité de leur participation au financement de la branche famille, alors que, à l’origine de la sécurité sociale, elles demandaient que la dimension familiale de la vie de leurs salariés soit prise en compte.
Cette annonce intervient en outre à un moment où les conditions de l’équilibre budgétaire de la branche sont bouleversées par les efforts d’économie qui nous ont déjà été demandés, puisque nous devons accélérer le rythme de réduction du déficit de la branche. À cela s’ajoute la perte de 0,15 point de cotisations patronales transféré vers le financement de la branche vieillesse. À ce propos, le débat reste ouvert quant à la légitimité de transférer à la branche famille une charge relevant initialement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), aggravant de ce fait les difficultés financières de la branche.
S’il existait des recettes idéales, je pense qu’on les aurait déjà trouvées ! Au vu de la créativité qui a été déployée pour compenser, par le biais de l’affectation du produit de taxes sur les véhicules de société, sur les paris en ligne ou sur les jeux télévisés, la perte de la part de CSG qui a été transférée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale et du 0,15 point de cotisations patronales, je ne doute pas qu’on saura trouver des dispositifs compensatoires. Quant à savoir s’il s’agit d’un mode de financement idéal, c’est une autre question.
L’intérêt du mode de financement actuel, assuré à hauteur de près de 80 % par la CSG et des prélèvements assis sur les revenus du travail, c’est son dynamisme, qui équilibre celui de nos dépenses, la revalorisation des recettes venant compenser l’évolution du coût de la vie. Ce dynamisme fait défaut à une dotation budgétaire. C’est pourquoi nous souhaiterions qu’un véritable débat soit engagé sur les moyens à mettre en œuvre pour retrouver des recettes dynamiques, via notamment la CSG, puisque celle-ci a été conçue à l’origine pour contribuer au financement de la sécurité sociale.
Nous ne pouvons que nous interroger, quand on nous annonce d’un côté que le budget de la branche sera amputé de 60 % de ses recettes, tout en assurant de l’autre que le niveau des prestations sera maintenu – Mme Marisol Touraine l’a encore répété hier lors de ses vœux aux forces vives. Nous avons du mal à convaincre nos allocataires que de tels miracles sont possibles. Il est vrai que 10 milliards par an, cela ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval !
La solution de la fiscalisation du financement de la branche a déjà été débattue, pour être généralement écartée. Si le Premier ministre a demandé au Haut Conseil du financement de la protection sociale de réfléchir sur l’opportunité de continuer à asseoir le financement de la branche famille sur les revenus du travail, il lui demande aussi de réfléchir aux moyens de maintenir un haut niveau de protection sociale. Voilà une équation quelque peu complexe.
On voit bien, par ailleurs, qu’un financement assuré exclusivement par dotation budgétaire serait susceptible de remettre en cause la légitimité d’une gestion paritaire de la protection sociale. En tout état de cause, l’intérêt d’une gestion de la branche par toutes les parties prenantes me paraît indéniable en ce qu’elle lui permet de bénéficier de l’éclairage, tant des bénéficiaires des prestations que des entreprises. Comme vous l’avez rappelé, la Cour des comptes a mesuré le retour sur investissement de la cotisation patronale à la branche famille. Des prestations comme les aides à la garde d’enfant ou au logement, par exemple, assurent aux salariés les conditions de travail les plus favorables possibles.
M. Daniel Lenoir, directeur général de la CNAF. Il va de soi que le regard du directeur général, qui est chargé d’ordonnancer la dépense, diffère de celui du président du conseil d’administration.
Tout le monde sait que le montant des économies que la branche famille est susceptible de réaliser ne suffira pas à couvrir la perte de recettes attendue, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la ministre a dit très clairement hier soir qu’elle serait intégralement compensée, comme l’a été la perte de 0,15 point de cotisation patronale. Voyons cependant ce qui peut être fait en matière de réduction des dépenses, puisque le Président de la République a également évoqué cette piste.
Les prestations légales constituant l’essentiel des charges de la branche, un plan d’économies suppose nécessairement leur moindre revalorisation : c’est mathématique, d’autant que l’amélioration de l’accès aux droits est un des objectifs que nous assigne la convention d’objectifs et de gestion (COG) qui nous lie à l’État, ce qui signifie une augmentation du nombre des prestations distribuées.
Dès ma prise de fonctions, j’ai fait de la lutte contre les abus et les fraudes aux prestations une de mes priorités, non pas tant en raison de leur coût financier, comme je l’ai encore répété la semaine dernière devant votre commission des affaires sociales, que parce que toute fraude, aussi minime soit-elle, est un « coup de canif » dans le principe de solidarité et nuit gravement au consentement à la solidarité. Grâce à une amélioration considérable de nos capacités de détection, nous avons augmenté le montant des fraudes détectées de 20 % entre 2011 et 2012, pour parvenir à 120 millions d’euros. À mon avis, il est possible d’atteindre, voire de dépasser l’objectif de 100 millions d’euros supplémentaires fixé par la COG, le montant estimé des fraudes étant de l’ordre de 700 millions d’euros. Mais, quand bien même ces objectifs seraient atteints, ces montants ne sont pas à la mesure de l’enjeu.
Quant aux indus, ils représentent un coût de 2 milliards au total, dont nous récupérons une grande partie. Le nombre de ceux qui trouvent leur origine dans des erreurs internes est appelé à diminuer, la gestion de la branche ayant beaucoup progressé. Mais la plupart sont générés par la réglementation elle-même. J’avais proposé à ce propos que le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) se penche sur la question de la date d’effet des droits. J’espère que cette question sera examinée par le CIMAP qui doit se réunir en juin. Reste que, là encore, les marges d’économie sont faibles à l’échelle des milliards d’euros dont la perte devra être compensée.
On ne peut pas non plus rogner beaucoup les dépenses d’action sociale, surtout que la COG nous fixe des objectifs ambitieux en la matière, qui sont des objectifs de politique publique. De telles politiques ne recèlent pas des gisements d’économies comme il en existe dans la branche maladie, où on sait qu’il y a des dépenses inutiles. Il s’agit là de dépenses nécessaires. Je voudrais vous en citer trois exemples.
On connaît l’ampleur des besoins en matière d’accueil de la petite enfance, qui souffre d’immenses inégalités territoriales et sociales, et l’essentiel des 2 milliards d’euros supplémentaires prévus par la COG sera affecté au financement des dispositifs d’accueil de la petite enfance. On ne peut pas rogner sur cette dépense sans remettre en cause cette politique. En dépit de tous nos efforts pour maintenir un niveau de prestation suffisant, on sait que le reste à charge est important, notamment pour les familles les plus modestes.
Autre exemple, la CNAF finance des dispositifs d’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires sur la partie « activités périscolaires ». Il ne nous est déjà pas possible de satisfaire à toutes les demandes des communes, notamment pour des raisons financières.
La COG nous fixe également des objectifs ambitieux en matière d’aide à la parentalité, via notamment la médiation familiale. Dans le même temps, l’État se désengage de cette action en supprimant les crédits du programme 106 qui y étaient affectés, contraignant la branche famille à prendre le relais. On sait que les besoins sont considérables, ce dispositif apprécié étant paradoxalement beaucoup moins développé dans notre pays que dans les autres pays européens. Dans le cadre de la préparation du projet de loi « famille » Mme Bertinotti, ministre déléguée à la famille, nous a fait savoir sa volonté de généraliser ce dispositif. Tout cela a un coût.
Ces exemples vous permettent de mesurer qu’on ne peut pas réaliser d’économies significatives sur les fonds destinés à l’action sociale, qui représentent désormais 10 % des dépenses de la branche famille.
Il reste les frais de gestion. Notre COG impose à la branche famille de réaliser des efforts de productivité et d’efficience. Cela se traduit notamment par le non-remplacement de départs en retraite dans les caisses, alors que celles-ci subissent une demande croissante des allocataires du fait de l’augmentation de la précarité. Cet engagement sera tenu, mais on ne pourra aller plus loin que si le chantier de la simplification avance très vite. En tout état de cause, le coût total des frais de gestion représentant moins de 2 milliards d’euros, le montant des économies réalisables est faible.
S’agissant des ressources, je n’ai pas à m’exprimer sur la pertinence de tel ou tel prélèvement. Ce qui me semble important, c’est d’assurer à la branche famille un financement stable et lisible. De ce point de vue, je préfère nettement la solution des ressources affectées plutôt que celle de la dotation budgétaire, soumise au principe d’annualité.
Supprimer la part patronale des cotisations familiales n’exonère pas d’une réflexion sur la forme que pourrait prendre la participation des entreprises au financement de la branche famille, eu égard aux effets bénéfiques de l’action de celle-ci pour la vie économique et des entreprises, que la Cour des comptes évalue entre 12 et 14 milliards d’euros. Ce principe de mutualisation des bénéfices ne nuit pas à la compétitivité, au contraire.
Je pense, comme Jean-Louis Deroussen, que la branche famille doit bénéficier d’une ressource dynamique. Surtout, le mode de financement de la branche doit avoir du sens, car, comme le consentement à l’impôt, le consentement à la solidarité suppose que le citoyen comprenne pour quoi il paie. Affecter le produit d’une taxe sur l’alcool à l’assurance maladie, cela a du sens : on accepte de contribuer aux dépenses qu’entraîne notre consommation. Selon ce principe, l’affectation de la CSG à la branche famille se justifie, car elle a un rapport direct avec la famille, ce qui n’est pas le cas de la taxe sur les véhicules de société. C’est une question de démocratie : le prélèvement doit favoriser le consentement à la solidarité.
S’agissant de la gouvernance de la branche famille, il me semble important de maintenir à la tête des caisses un conseil d’administration paritaire, afin de permettre aux parties prenantes dans chaque département, échelon des politiques sociales, de participer à la gestion de ces politiques : c’est ce qui donne du poids et de la pertinence aux politiques des CAF. Il est très important par exemple que les schémas territoriaux prévus en matière de développement des structures d’accueil de la petite enfance puissent être élaborés en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
M. le rapporteur. M. Jean-Louis Rey, directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), nous a indiqué lors de son audition que la recette idéale pour la trésorerie de la sécurité sociale était régulière, prévisible et stable. Il a ajouté que deux assiettes étaient susceptibles d’assurer des recettes dynamiques : la masse salariale et la consommation. Il considère en revanche qu’il faut éviter une ressource assise sur les entreprises, le rendement de l’impôt sur les sociétés (IS) étant trop erratique. Auditionné l’année dernière, M. Drouet, le prédécesseur de M. Lenoir, avait, comme vous, jugé la fiscalisation risquée et dit sa préférence pour des recettes affectées. Une fois qu’on a dit ça, que fait-on ? Une augmentation de la CSG serait contraire à l’engagement du Président de la République de ne pas compenser la suppression des cotisations patronales par une augmentation de la seule fiscalité des ménages. Sachant que vos ressources proviennent de la CSG pour 10 milliards d’euros environ, des cotisations pour 34 milliards d’euros et de divers impôts et taxes affectées pour un peu moins de 10 milliards d’euros, quel mode de financement préféreriez-vous au regard de ces exigences de régularité, de prévisibilité et de stabilité, et si possible de légitimité ?
M. Jean-Louis Deroussen. C’est précisément le problème : si l’on supprime la contribution des entreprises au financement de la branche, la seule solution alternative de financement est d’augmenter la part des ménages, soit par une augmentation de la CSG, ce qui signifie une baisse de la rémunération nette des salariés, soit par une augmentation de la TVA. Or on affirme que les ménages ne seront pas pénalisés et que les prestations seront préservées. C’est pourquoi nous nous interrogeons.
On nous dit qu’il s’agit d’augmenter la compétitivité des entreprises, ces 30 milliards d’allégements de charges devant permettre, si l’on en croit le président du MEDEF, de créer 1 million d’emplois sur cinq ans. Dans l’hypothèse d’un salaire annuel de 30 000 euros, on retrouve les 30 milliards d’euros. Finalement, on demande aux salariés de payer eux-mêmes leur salaire !
Ce que nous souhaitons, c’est une contribution au financement de la politique familiale qui ait du sens pour les familles, mais aussi pour les entreprises. Le « retour sur investissement » significatif dont celles-ci bénéficient, selon l’évaluation de la Cour des comptes, justifie qu’elles continuent à participer au financement de cette politique.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Puisqu’il s’agit, non pas d’augmenter ni de créer des prélèvements, mais d’affecter des prélèvements existants, d’où viendrait cet accroissement de la part de la CSG dans le financement de la branche famille, sinon du FSV ou de la branche maladie ? Cela n’aurait pas beaucoup de sens.
S’agissant de recettes fiscales, vous avez souligné la volatilité de l’IS. Quant aux autres impôts assis sur la production, ils sont plutôt affectés aux collectivités locales, par le biais de la cotisation sur la valeur ajoutée ou de la taxe professionnelle. Reste la TVA et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, pour ne retenir que les prélèvements dont le rendement est à la hauteur de l’enjeu. On peut aussi imaginer un mixte de ces prélèvements.
M. Daniel Lenoir. Je ne crois pas que le sujet du financement de la branche famille puisse être dissocié d’une réflexion sur le financement de la protection sociale dans son ensemble, et c’est d’ailleurs la mission que le Premier ministre a assignée au Haut Conseil du financement de la protection sociale. Il est impossible d’affecter un seul prélèvement à ce financement, mais une clarification du mode de financement des branches me semble urgente : il est pour le moins discutable de faire financer les pensions de retraite par la branche famille.
Du strict point de vue de la branche famille, il faut maintenir une contribution des entreprises, même si elle n’est pas assise sur les salaires. Celles-ci doivent en effet contribuer au financement d’une politique dont elles tirent bénéfice, qu’il s’agisse du dynamisme démographique de notre pays ou de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Le reste du financement sera nécessairement assuré par des prélèvements sur les ménages. Quant à l’arbitrage entre la CSG et la TVA, il dépendra également du mode de financement des autres branches. Pour ma part, je ne suis pas par principe opposé à une diminution de la part de la CSG affectée à la branche maladie et une affectation systématique des contributions comportementales à cette branche, parce qu’elle aurait du sens. Cela dit, je suis incapable, à la place où je suis, de voir quels flux entre ces vases communicants seraient susceptibles d’assurer l’équilibre financier des branches, car c’est bien l’objectif.
M. le rapporteur. En un mot, vous êtes dans l’expectative. Je suppose que ce n’était pas le scénario que vous envisagiez ?
M. Jean-Louis Deroussen. Non. Nous nous attendions certes à une diminution de la cotisation des entreprises, mais pas à sa suppression brutale.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Le Président de la République a laissé le débat ouvert et la consultation annoncée de l’ensemble des parties prenantes me semble de bonne méthode. Je vous remercie.
*
* *
Audition de M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), Mme Valérie Corman, directrice de la protection sociale du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), et M. Christian Pineau, chef du service des affaires sociales de l’Union professionnelle artisanale (UPA), accompagné de Mme Caroline Duc, chargée des relations
avec le Parlement
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Cette audition est particulièrement d’actualité. La MECSS, qui a pour habitude de s’affranchir de l’agenda parlementaire, s’est intéressée à dessein à la question du financement de la branche famille, convaincue qu’elle se poserait au cours du quinquennat. Déjà le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été l’occasion d’une réflexion sur le sujet et, plus généralement, sur la protection sociale. Les perspectives tracées par le Président de la République donnent au sujet un relief particulier, mais n’enlèvent rien à notre questionnement, qui est désormais plus cadré.
La suppression des cotisations familiales à la charge des entreprises, voulue par le Président de la République, s’inscrit dans un débat plus vaste sur la baisse des charges associant les représentants des employeurs et des salariés, les collectivités territoriales et le Parlement. Le Président de la République a dit sa préférence pour cette voie, mais il n’a pas fermé la porte à d’autres solutions. Si le maintien du CICE devait être demandé de manière unanime, cette option pourrait être étudiée, tout en sachant que l’on ne peut à la fois supprimer les cotisations familiales et maintenir le CICE.
Le Président a également ouvert un débat nouveau sur les contreparties, avec l’annonce de la mise en place d’un observatoire des contreparties.
Nous souhaiterions donc connaître vos réflexions sur le financement de la branche famille, mais aussi vos réactions au cadre nouveau proposé par le Président de la République.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. La nature de cette audition a changé – c’est un euphémisme – depuis la conférence de presse du Président de la République.
La réflexion de la MECSS poursuit deux objectifs : l’établissement d’un état des lieux et la définition de projets alternatifs, si tant est que la situation actuelle l’exige. Dans cette perspective, nous avons saisi la Cour des comptes, qui a remis son rapport en juin dernier, afin qu’elle évalue l’impact des cotisations familiales à la charge des entreprises et les scénarios alternatifs.
Je souhaiterais vous interroger sur quatre points : dès lors que les prestations familiales revêtent désormais un caractère universel et ne sont plus conditionnées par l’activité professionnelle, le financement par des cotisations patronales de la branche famille ne serait plus justifié. En réponse à cet argument régulièrement avancé par les organisations patronales, la Cour des comptes fait valoir que, sur les 55 milliards d’euros que représentent les prestations servies par la branche famille, 12 à 14 milliards contribuent à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Compte tenu du lien subsistant entre activité et prestations familiales, une partie de ces dernières pourrait donc légitimement être financée par les entreprises. Le Président a cependant tranché cette question en annonçant la suppression des cotisations. Quel est votre avis sur ce point ?
Comment envisagez-vous la mise en œuvre de la suppression des cotisations familiales ? Quel en sera l’impact économique en termes de création d’emplois ?
Quelles peuvent être, selon vous, les modalités des contreparties ?
Quel sort doit-on réserver au CICE ? Deux options s’offrent à nous : maintenir le CICE et l’accompagner d’une baisse des cotisations patronales de 10 milliards d’euros ou abandonner le CICE et supprimer intégralement les cotisations familiales.
M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). Cette audition est d’une particulière acuité au lendemain des annonces du Président de la République. Je rappelle que la CGPME, comme l’ensemble des confédérations patronales interprofessionnelles, milite de longue date pour qu’une partie au moins des cotisations patronales d’allocations familiales soit remplacée par une autre ressource, notamment la TVA. Cette position ancienne repose sur deux éléments qui diffèrent des propositions du Président : l’abaissement, et non la suppression, des cotisations pour les entreprises, d’une part, et le financement par une autre ressource, et non par des économies, d’autre part. Nous l’avons défendue fin 2011 dans un texte dont l’ambition, plus vaste, était une baisse globale des cotisations patronales et de certaines cotisations salariales.
Mais les choses ont changé depuis, avant même les annonces du Président de la République. Ainsi la hausse de la TVA que nous prônions pour financer la baisse des cotisations patronales d’allocations familiales a-t-elle été préemptée pour réduire le déficit et financer une partie du CICE. En outre, les prélèvements sur les ménages et les entreprises ont augmenté depuis dix-huit mois.
Le Président de la République semble faire le choix clair d’une suppression intégrale des cotisations patronales d’allocations familiales d’ici à 2017. Nous en prenons acte, car cela va dans le sens de ce que nous souhaitions. Nous nous interrogeons néanmoins sur la manière dont cette suppression des 5,25 points de cotisations – et non 5,40 comme l’affirment certains – sera financée. Le Président a dit qu’elle serait compensée par des économies sur le budget de l’État, sans alourdir les prélèvements sur les ménages. Cette solution serait souhaitable, mais on peut douter qu’elle intervienne d’ici à 2017. Un doute existe également sur le calendrier, en particulier sur le terme de la réforme : est-ce la fin de l’année 2017 ou l’élection présidentielle ? Notre principale interrogation porte sur la capacité à dégager les économies nécessaires pour financer la baisse des cotisations patronales même si nous accueillons favorablement l’intention affichée.
Nous avons compris que, dans l’esprit du Président de la République, la baisse des charges de 30 milliards d’euros inclut le CICE : elle se décompose en 20 milliards pour le CICE en année pleine et 10 milliards supplémentaires. Quant à l’idée de transformer le CICE en allégement de charges, si elle est certainement la meilleure sur le plan théorique, je m’interroge sur sa faisabilité technique. En effet, le CICE est un crédit d’impôt qui porte sur les salaires de 1 à 2,5 SMIC tandis que les cotisations familiales portent sur tous les salaires. En choisissant cette voie, vous risquez de vous heurter, outre les difficultés techniques, à des problèmes de cohérence et de compréhension de la part des entreprises.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Une manière très simple de procéder consiste à supprimer à la fois le CICE et les cotisations familiales. Êtes-vous favorables à cette solution ou privilégiez-vous le maintien du CICE accompagné d’un allégement des cotisations patronales d’allocations familiales à hauteur de 10 milliards ?
M. le rapporteur. Il faut se souvenir que les emplois ciblés ne sont pas les mêmes selon l’option choisie. En effet, les salaires jusqu’à 1,6 SMIC sont exonérés de cotisations familiales au travers d’un mécanisme dégressif, tandis que l’exonération de charges prévue par le CICE porte sur les salaires jusqu’à 2,5 SMIC. La Cour des comptes souligne à cet égard que l’articulation entre le CICE, l’« allégement Fillon » et d’autres exonérations ciblées peut avoir pour effet un subventionnement du salaire net, au-delà même des cotisations patronales.
M. Georges Tissié. Nous souhaitons le maintien de l’allégement général de charges dont la portée n’est significative que jusqu’à 1,3 SMIC en raison de sa forte dégressivité. La suppression de l’« allégement Fillon » changerait considérablement la donne, convenez-en. En résumé, les interrogations ne manquent pas.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Ce que j’ai compris, c’est que 10 milliards supplémentaires de baisses des charges seront financés par des économies sur les dépenses de l’État. Pour le reste, le débat est ouvert et les questions sont nombreuses. Doit-on maintenir les deux systèmes ? Comment articuler la suppression des cotisations familiales avec l’« allégement Fillon » pour la partie qui peut être considérée comme affectée à la branche famille ? Le Président de la République n’a pas voulu trancher, laissant place à la négociation. Mais, si vous supprimez la partie de l’« allégement Fillon » correspondant à la branche famille et le CICE, le surcroît d’allégement de charges profiterait aux plus hauts salaires, supérieurs à 2,5 SMIC, comme l’a dit Jérôme Guedj. Nous souhaitons avoir des éclaircissements de votre part sur ces questions.
Mme Valérie Corman, directrice de la protection sociale du Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Je m’associe aux propos de M. Tissié. Le MEDEF était partisan d’une baisse des charges pesant sur le coût du travail avec un système de « double hélice », c’est-à-dire une baisse de la part patronale et de la part salariale. Mais le contexte a évolué, M. Tissié l’a rappelé, à la faveur des hausses de charges, de la CSG, etc.
Vous engagez un débat sur l’affectation des 10 milliards de baisses de charges supplémentaires, alors que nous souhaitons discuter de l’ampleur de la baisse. C’est en effet une nécessité absolue, comme le prouve la comparaison avec nos voisins, au premier rang desquels figure notre principal concurrent, l’Allemagne. Les dépenses de protection sociale représentent 33,1 % du PIB en France, ce qui fait de notre pays le champion d’Europe. Quant à la part des cotisations pesant sur le travail, elle est de 30 % en France, contre 23 % en Allemagne. Pour restaurer la compétitivité des entreprises françaises, le président Gattaz l’a dit, il faut donc réduire les charges pesant sur les entreprises, à hauteur de 50 milliards au titre de la protection sociale et 50 milliards au titre de la fiscalité. Il n’est pas sérieux de s’enfermer dès maintenant dans un débat sur l’articulation entre le CICE et la baisse annoncée par le Président de la République. L’ampleur de la baisse devra nécessairement être supérieure aux 10 milliards d’euros annoncés. L’ambition affichée par le MEDEF de créer 1 million d’emplois a besoin, pour se réaliser, d’un mouvement d’ampleur de baisse des charges.
Nous nous réjouissons que le Président de la République partage notre analyse sur la nécessité d’une baisse du coût du travail et d’une simplification de la vie des entreprises. Il reste néanmoins à préciser l’ampleur des baisses de charges, les contreparties attendues et le calendrier.
Nous sommes membres du Haut Conseil du financement de la protection sociale qui étudie diverses hypothèses et scénarios. Nous ne savons pas encore ce qui sortira de ses travaux.
Compte tenu des économies déjà programmées dans le cadre du retour à l’équilibre des finances publiques et de l’ampleur souhaitable de la baisse, il nous paraissait plus simple de procéder à un transfert des cotisations familiales vers la TVA. Nous ne renonçons pas à cette perspective.
L’ampleur de la baisse de charges doit être significative pour avoir les effets escomptés sur la compétitivité des entreprises et sur l’emploi.
Je n’entrerai pas dans le débat sur la mise en œuvre des annonces du Président de la République, car tout dépendra de l’ampleur de la baisse et du calendrier.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Vous dites que la baisse des charges est insuffisante, mais nous faisons plus en trois ans – 30 milliards d’euros – que sur les vingt dernières années – 20 milliards depuis les « allégements Balladur ». Quant au calendrier, il est connu : la baisse sera de 20 milliards d’euros en 2015 et de 30 milliards en 2017. Sur le volume, les choses sont donc cadrées.
Mme Valérie Corman. Oui, mais ce volume n’est pas à la hauteur des enjeux.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. La plupart des entreprises ne bénéficieront des premiers effets du CICE qu’à partir du mois de mai. Elles peuvent évaluer leurs charges jusqu’en 2017 en s’appuyant sur le montant prévu pour la suppression des cotisations familiales. Le cadre est donc connu.
En revanche, il n’est pas neutre de passer du CICE à un allégement de charges, car l’aide ne s’adresse pas aux mêmes entreprises et ne porte pas sur les mêmes salaires. Ce problème est particulièrement aigu pour les commerçants et les artisans ainsi que les secteurs qui emploient de nombreux salariés au SMIC.
Malgré tout, les incertitudes sont aujourd’hui moins nombreuses qu’il y a trois ou quatre jours.
Mme Valérie Corman. La comparaison avec l’Allemagne demeure un élément du débat.
Le caractère universel des prestations familiales me semble un argument valable pour justifier la demande des organisations patronales. Nous ne nions pas que la politique familiale a un effet sur l’emploi des femmes. La France a la chance d’avoir un fort taux d’emploi des femmes qualifiées et, dans le même temps, un bon taux de natalité, même s’il a tendance à baisser. Il ne faut pas renoncer à la politique familiale au risque, comme en Allemagne, de voir les femmes diplômées choisir entre enfants et travail au profit de ce dernier. La politique familiale est essentielle, mais il n’y a pas de raison que les entreprises la financent par une cotisation alors qu’elles paient aussi des impôts.
M. Georges Tissié. Je ne suis pas sûr que la majorité de nos adhérents aient saisi la problématique de l’ampleur des allégements de charges et de leur mise en œuvre : pour nous qui sommes plongés dans ces questions, les éléments du débat ne sont déjà pas clairs ; ils le sont encore moins pour les chefs d’entreprises de moins de cinquante salariés…
Mme Valérie Corman. En effet, les petites entreprises n’ont pas encore mesuré l’impact du CICE.
Pour le MEDEF, il faut à la fois maintenir le CICE et baisser de 30 milliards les cotisations familiales, pour parvenir à un abaissement de charges total de 50 milliards d’euros.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. M. Gattaz parle de 100 milliards.
Mme Valérie Corman. Oui, car il faut ajouter la baisse de la fiscalité, à hauteur de 50 milliards. Ces chiffres sont inspirés de la comparaison avec l’Allemagne.
Vous parlez d’emploi, mais il faut d’abord restaurer la compétitivité des entreprises, ce qui ne peut pas se faire sans des mesures d’ampleur. Le MEDEF promet une action vigoureuse pour créer 1 million d’emplois, mais il a besoin pour cela de mesures fortes de baisse du coût du travail.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Vous dites qu’il faut 100 milliards de baisse de charges diverses sur les entreprises pour que ces dernières créent 1 million d’emplois. Cela signifie qu’un emploi privé coûte 100 000 euros, là où un emploi public en coûte 30 000, soit trois fois moins. Que répondez-vous à ceux qui plaident en faveur d’un autre équilibre entre emploi public et emploi privé ?
Mme Valérie Corman. Ce raisonnement fait abstraction d’une chose essentielle : l’efficience de notre système de protection sociale, qui est aujourd’hui très coûteux.
Le Président de la République l’a dit, la baisse des dépenses doit être l’une de nos priorités. Le niveau des dépenses de protection sociale – 33,1 % du PIB – est inquiétant. Selon les projections du Haut Conseil du financement de la protection sociale, à législation constante et dans l’hypothèse la plus optimiste, la poursuite de cette tendance conduit à recreuser le déficit et à placer la dette à un niveau qui n’est pas supportable. Il est indispensable de diminuer les dépenses et d’améliorer l’efficience de notre système de protection sociale. À un certain niveau de dépense, il n’existe plus de bonne assiette. Nous devons réussir à nous rapprocher de la moyenne européenne de pourcentage de PIB pour la protection sociale.
M. Christian Pineau, chef du service des affaires sociales de l’Union professionnelle artisanale (UPA). Mon intervention s’inscrira dans la continuité des deux précédentes, puisque nous avons, sur ce sujet au moins, une communauté de vues avec nos amis du MEDEF et de la CGPME.
Depuis des années, nous formulons les mêmes revendications et les mêmes demandes en nous appuyant sur les mêmes arguments : nous les aurions réitérés aujourd’hui à l’identique si cette audition s’était déroulée avant la conférence de presse du Président de la République. C’est un fait, depuis le mardi 14 janvier, la situation a un peu évolué. Nous avons écouté avec attention les annonces du Président de la République relatives à la suppression des cotisations familiales à la charge des entreprises en vue d’enclencher une baisse du coût du travail. Toutefois, cette suppression n’est malheureusement prévue qu’à l’horizon de 2017, ce qui est un peu loin.
Nous avons également pris acte de la volonté du Président de la République de financer cette baisse des charges sociales par une baisse de la dépense publique et non pas par un accroissement de la pression fiscale pesant sur les ménages, ce qui aurait nui à leur pouvoir d’achat et donc à l’activité économique des entreprises : n’oublions pas que les ménages sont les premiers clients des entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.
Ces annonces présidentielles nécessitent des clarifications en termes de calendrier et de méthode, d’autant que deux scénarios sont identifiés, si l’on reste sur un volume de 30 milliards d’euros d’allégements de charges : soit le CICE est maintenu et son montant – 20 milliards – est cumulé avec une baisse des cotisations familiales à hauteur de 10 milliards, soit le CICE est supprimé. Comme les travailleurs indépendants n’entrent pas dans le champ du CICE, si celui-ci est maintenu, il conviendra de l’élargir aux travailleurs indépendants afin qu’ils puissent bénéficier eux aussi de l’abaissement des charges afin de leur permettre de se développer et donc de créer des emplois. Si le CICE est supprimé, demeure la question de la période courant jusqu’à 2017, durant laquelle nous demandons que le CICE s’ouvre aux travailleurs indépendants : c’est à cette seule condition que l’ensemble des entreprises profitera pleinement des annonces du Président de la République. Actuellement, la situation des travailleurs indépendants est pénalisante.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Quelle solution aurait votre préférence ? Le crédit d’impôt ou la baisse des cotisations ?
M. Christian Pineau. Peu importe la mécanique choisie : l’objectif doit être d’atteindre un allégement de 30 milliards d’euros des charges pesant sur les entreprises afin d’abaisser le coût du travail et de leur permettre de créer encore plus d’emplois grâce au développement de leur activité économique. Je rappelle que les entreprises que je représente sont déjà reconnues comme créatrices d’emplois.
Certes, les cotisations patronales aux allocations familiales ont déjà été réduites : toutefois, le passage de 5,40 % à 5,25 % ne s’est pas traduit par un allégement des charges puisqu’il n’avait pour objet que de compenser la hausse des cotisations d’assurance vieillesse. La question du financement de la branche famille s’inscrit dans une réflexion plus générale sur le financement de la protection sociale, ce que rappelle la lettre de saisine que le Premier ministre a adressée à la présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale : il faut clarifier l’ensemble des financements des branches.
S’agissant de la branche famille, nous soulignons depuis des années l’inadéquation entre son financement, encore assis pour les deux tiers sur les revenus d’activités, et la logique d’universalisation des droits qui est la sienne.
Toutefois, à la question de savoir si, les cotisations patronales à la branche famille étant supprimées, il serait encore légitime pour les entreprises de continuer de s’occuper de la politique familiale, je répondrais oui. En effet, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée est un sujet de préoccupation quotidien, surtout pour les petites entreprises. Le fait que la vie privée des salariés puisse être en totale articulation avec leur vie professionnelle est capital pour des entreprises qui ont un lien très étroit avec leurs salariés – c’est le cas de celles que je représente, qui n’ont qu’un ou deux salariés. Ce n’est donc pas parce que les entreprises ne participeraient plus au financement de la branche famille que, pour autant, elles n’auraient plus intérêt à accompagner, voire à gérer la politique familiale en continuant de siéger au sein des organismes de gestion de la branche famille.
M. Georges Tissié. S’il s’avérait que la baisse nette se limitait finalement à 10 milliards d’euros, ce serait pour nous une grande déception. Les effets de la mesure s’en trouveraient évidemment limités, car une telle réduction ne serait pas suffisamment incitative à la création d’emplois.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Au 31 décembre 2017, la baisse sera concrètement, pour les entreprises, de 30 milliards par rapport au 1er janvier 2014 : comment pouvez-vous affirmer qu’une telle baisse sera insuffisante pour créer des emplois ? Si tel était le cas, il conviendrait de faire d’autres choix. N’oublions pas que notre réflexion actuelle ne porte pas sur le delta entre les 20 milliards du CICE et l’objectif des 30 milliards d’allégement de charges, puisque, le CICE commençant à peine en ce début d’année 2014 à entrer en application dans les grandes entreprises, et assez peu dans les petites, ses bénéfices ne sont pas encore effectifs. Notre réflexion porte donc bien sur 30 milliards de baisses concrètes des charges des entreprises sur trois exercices budgétaires. Je tiens à rappeler que, sur les vingt dernières années, ces baisses n’ont atteint que 20 milliards, les mesures accompagnant les trente-cinq heures comprises. Cette baisse de 30 milliards ne saurait donc avoir qu’un effet massif, qui justifie la question des contreparties concrètes.
Quels engagements pouvez-vous prendre en matière de contreparties ? J’avais défendu – sans succès, il est vrai – l’idée de conditionner l’octroi du CICE à des accords de branche ou d’entreprise. Une telle démarche me semble préférable à la fixation de critères qui ne sont pas nécessairement adaptés à toutes les entreprises.
Envisagez-vous de prendre des mesures opérationnelles ?
Mme Valérie Corman. Les baisses n’atteindront pas 30 milliards nets, car nous assistons à des augmentations de charges, je pense notamment aux mesures relatives à la pénibilité qui coûteront 2 à 2,5 milliards ou à l’augmentation du forfait social.
S’agissant des contreparties, c’est en termes d’impact sur la compétitivité des allégements de charges qu’il faut raisonner. Ces mesures permettront-elles de restaurer la compétitivité des entreprises ? Il est impossible d’avancer des objectifs chiffrés, c’est-à-dire de traduire mécaniquement par exemple 1 milliard de baisses des cotisations en un nombre déterminé de créations d’emplois. La restauration de la compétitivité des entreprises aura, certes, un impact positif en matière de créations d’emplois – c’est l’objectif du MEDEF –, mais cette restauration passe avant tout par la capacité à innover et à investir. N’attendez pas de moi que je vous donne un objectif chiffré.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Sans parler d’objectif chiffré, comment envisagez-vous de concrétiser l’idée même de contreparties ?
Mme Valérie Corman. Nous demandons nous-mêmes des précisions en la matière. Nous ne saurions en tout cas prendre aucun engagement chiffré.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. La deuxième loi sur les trente-cinq heures devait se traduire par des objectifs fixés et vérifiés par les partenaires sociaux eux-mêmes : ce type de mécanisme vous paraît-il envisageable ?
Mme Valérie Corman. Il n’a jamais fait ses preuves.
Nous ne disposons pas des précisions suffisantes pour évaluer l’impact du dispositif. Les entreprises françaises sont dans une situation très inquiétante – un diagnostic que le Président de la République partage lui-même. Le nombre des créations d’entreprises diminue, tandis que celui des défaillances augmente. Le chômage est à un niveau élevé. Il faut mener une action proportionnelle à la gravité de la situation.
M. Georges Tissié. Nous attendons en effet que le Gouvernement précise son schéma sur le « comment », pour reprendre votre mot, monsieur le président. En tout état de cause, nous ne pouvons formuler aucun objectif chiffré de créations d’emplois par branche professionnelle et encore moins par entreprise. C’est une vision mécanique de l’économie qui ne fonctionne pas. C’est pourquoi nous sommes réticents à donner ne serait-ce qu’un objectif global de créations d’emplois.
Il faut tout de même rappeler que, en 2012 et 2013, la France a perdu entre 160 000 et 170 000 emplois nets – le chiffre de l’INSEE risque même d’être plus élevé encore. Nous partons donc de très loin.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. La création de 1 million d’emplois grâce au pacte de responsabilité a été évoquée.
M. Georges Tissié. Nous n’avons jamais donné un tel chiffre.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Ces six derniers mois ont vu des créations nettes d’emplois.
M. Georges Tissié. Non. L’emploi subit toujours des pertes nettes.
Je tiens à insister particulièrement sur le point suivant : le système des allégements de charges doit être lisible, significatif et stable. Or – le gouvernement actuel n’est pas le seul à pouvoir être critiqué sur le sujet – les systèmes d’allégements ont été rarement lisibles, ils ont été souvent peu significatifs et, surtout, ils n’ont jamais été stables. Or la stabilité des systèmes, à trois, voire cinq ans, est essentielle pour les TPE-PME.
M. le rapporteur. C’est un argument pour le maintien du CICE.
Le Président de la République a évoqué, outre les créations d’emplois, différentes autres contreparties possibles, notamment en termes de revalorisation du salaire net, de qualité au travail, d’emploi des seniors ou des jeunes. Qu’en pensez-vous ?
La suppression des cotisations familiales patronales représente 1 000 euros par an pour un salarié payé 1 500 euros nets par mois et 1 900 euros par an pour un salarié payé 2 300 euros nets par mois. Estimez-vous ces montants suffisamment significatifs pour avoir un impact sur la compétitivité des entreprises ? En effet, rapporté au coût total du travail – 700 milliards d’euros, dont 180 milliards de cotisations patronales –, un allégement de 10 milliards d’euros peut sembler très modeste. Il convient par ailleurs de rappeler que le coût du travail n’entre pas seul dans le coût de production : la compétitivité dépend aussi du coût de l’énergie ou de celui du capital. L’effort pour financer une mesure qui vous paraît aussi peu significative n’est-il finalement pas plus important que le bénéfice attendu pour les entreprises qui ont, vous l’avez rappelé, besoin de remplir leurs carnets de commandes ? La baisse, si elle se traduit par un prélèvement sur les ménages, pourrait, elle aussi, avoir un impact. Vous dites que seule une baisse de 100 milliards d’euros permet de créer un choc de compétitivité. Dans ces conditions, une mesure à 10 milliards vaut-elle le coup ? Ne vaudrait-il pas mieux consacrer cette somme à autre chose ?
Avez-vous enfin des préférences en termes de financements alternatifs pour la branche famille ? Quelles ressources conviendrait-il de substituer aux cotisations patronales ?
M. le coprésident Jean-Marc Germain. La question est celle des ressources affectées : faut-il se tourner vers l’État ou la sécurité sociale ?
Mme Valérie Corman. Recourir à la TVA nous semblerait la mesure la plus cohérente avec une politique de l’offre, car c’est celle qui aurait le moins d’effet récessif. Telle est notre proposition.
La question du financement de la branche famille ne saurait toutefois être traitée indépendamment de celle de l’ensemble du financement de la protection sociale, qui doit être cohérent. Il convient de financer le système assuranciel via les cotisations – je pense notamment à l’assurance vieillesse – et de financer par de la CSG et de l’impôt affecté la branche famille qui relève d’une logique universelle. Continuer à ne s’occuper que du financement de la branche famille aura pour seul effet de perpétuer l’inquiétude sur la pérennité de son financement.
Toute ressource fiscale peut donc être envisagée, à condition qu’elle soit cohérente avec le dispositif d’ensemble du financement de la protection sociale.
M. Georges Tissié. Il n’est pas possible de raisonner par morceaux, y compris pour les recettes de la branche famille.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. J’imagine volontiers que, à quelques semaines de la conclusion de trois années de travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale, vous devez commencer à avoir une petite idée sur la question, même si les annonces du Président de la République ont quelque peu modifié la donne, sans la bouleverser néanmoins.
M. Christian Pineau. Il m’est d’autant moins possible de vous répondre précisément sur la question des taxes ou impôts qui doivent être affectés à la branche famille en cas de suppression des cotisations patronales que ce débat, comme vous l’avez rappelé, s’inscrit dans une réflexion plus large, conduite au sein du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Cette instance ayant été créée précisément pour mener cette réflexion, laissons-la aller à son terme. Du reste, ses conclusions ne feront pas nécessairement consensus. En effet, si tous les membres du Haut Conseil ont le même objectif – pérenniser le financement de la branche famille –, tous ne sont pas d’accord sur la manière d’y arriver.
La seule chose que je puisse vous dire pour le moment est que, si nous avons vu passer de nombreux rapports sur le financement de la protection sociale, nous n’avons toujours pas trouvé l’assiette miracle. Sachez en tout cas que les débats, encore en cours au sein du Haut Conseil et qui ne portent pas que sur le financement de la branche famille, sont de qualité.
Quant aux contreparties, nous avons besoin de précisions sur le calendrier et la méthode. N’attendez pas d’engagements immédiats de notre part sur le sujet. Des discussions doivent être menées avec le Premier ministre et les ministres concernés. Je ne doute pas que, au terme de ces échanges, nous parviendrons à faire des annonces.
M. le rapporteur. La suppression des cotisations familiales à la charge des entreprises pourrait se traduire, en l’absence de contreparties, par une augmentation des bénéfices des entreprises : celles-ci financeront alors elles-mêmes une partie de l’allégement grâce à l’accroissement du rendement de l’impôt sur les sociétés.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Pouvez-vous chiffrer ce mécanisme ?
M. Georges Tissié. Je n’irai pas jusqu’à le chiffrer, mais Mme Corman a raison, l’allégement n’atteindrait pas les 10 milliards. La question est vraiment complexe.
Mme Valérie Corman. Et demande à être encore travaillée !
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Le Parlement devra se prononcer.
M. Georges Tissié. Le fera-t-il sur un texte de principe ou sur le détail du dispositif ?
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Le Parlement se prononcera sur le détail, c’est sa mission, puisqu’il lui appartient de voter la trajectoire budgétaire dans son ensemble et l’évolution de la fiscalité des entreprises et des ménages en particulier.
Auparavant, il devra accorder – ou refuser – sa confiance au Gouvernement sur le fondement du discours du Premier ministre, qui donnera, à cette occasion, les précisions nécessaires sur la mise en place du dispositif annoncé par le Président de la République.
M. le rapporteur. Assurément, le support juridique sera le projet de loi de finances pour 2015 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Sans oublier la loi de programmation des finances publiques, qui obéit à une logique pluriannuelle.
Mesdames et messieurs, je vous remercie.
Audition de Mme Selma Mahfouz, commissaire générale adjointe à la stratégie
et à la prospective, membre du Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, Mme Claire Bernard et M. Antoine Naboulet, chargés de mission
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Nous recevons aujourd’hui Mme Selma Mahfouz, commissaire générale adjointe à la stratégie et à la prospective, membre du Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), accompagnée de Mme Claire Bernard et de M. Antoine Naboulet, chargés de mission.
Dans le cadre de son travail sur le financement de la branche famille, la MECSS s’est vu remettre au mois de mai 2013 un rapport de la Cour des comptes sur ce sujet. L’actualité nous invite à poursuivre notre réflexion, le Président de la République ayant annoncé que les cotisations familiales patronales seraient supprimées et que toutes les options étaient sur la table concernant le CICE.
Le Comité de suivi du CICE a remis son premier rapport en octobre 2013. Nous aimerions vous entendre, madame Mahfouz, sur plusieurs questions : les entreprises et les secteurs bénéficiaires du CICE, le coût du dispositif, ses effets sur le comportement des entreprises et, enfin, les pistes d’évolution.
Je précise que le Haut Conseil du financement de la protection sociale doit rendre fin février un premier rapport sur la diversification des ressources de la protection sociale, sur la base de l’analyse d’une quinzaine de scénarios présentant des projections jusqu’en 2060.
Mme Selma Mahfoud, commissaire générale adjointe à la stratégie et à la prospective, membre du Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Je m’exprimerai aujourd’hui en tant que membre du Comité de suivi du crédit d’impôt compétitivité, et non comme commissaire générale adjointe à la stratégie et à la prospective.
Instauré par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012, le CICE est la première des trente-cinq mesures du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, annoncées par le Premier ministre le 6 novembre 2012, à la suite du « rapport Gallois ».
Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le CICE a pour objet « l’amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement ».
Le CICE est calculé à partir de l’ensemble de la masse salariale des salariés dont les rémunérations brutes n’excèdent pas 2,5 fois le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ces rémunérations sont celles qui servent au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le CICE est un crédit d’impôt. Il s’élève à 4 % de la masse des salaires inférieurs à 2,5 SMIC pour ce qui concerne les rémunérations versées en 2013. À partir de 2014, cette proportion sera de 6 %.
Peuvent bénéficier du CICE : les entreprises employant des salariés et soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) d’après leur bénéfice réel ; les entreprises dont le bénéfice est exonéré transitoirement, en vertu de certains dispositifs d’aménagement du territoire ou d’encouragement à la création et à l’innovation ; les organismes partiellement soumis à l’IS, comme les coopératives ou les organismes HLM, uniquement au titre de leurs salariés affectés à une activité soumise à l’IS.
Le mécanisme de base du CICE veut que les entreprises imputent le crédit d’impôt dont elles bénéficient au titre des salaires versés une année donnée sur le solde d’impôt qu’elles déclarent l’année suivante. Cependant, un système de préfinancement, sur lequel je reviendrai, a été mis en place.
Conformément à la loi, un comité de suivi a été mis en place le 25 juillet 2013 avec pour mission de suivre la mise en œuvre et d’évaluer les effets de ce dispositif. Il réunit notamment les huit partenaires sociaux représentatifs au niveau national interprofessionnel, les représentants des administrations compétentes, des experts et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
La mission du Comité est double. Il s’agit d’abord de constituer un lieu de concertation et de suivi du CICE et de ses effets immédiats. Il s’agit ensuite de définir, dans la concertation, les modalités d’une évaluation du CICE transparente et indépendante.
La première étape du travail réalisé par les membres du Comité a consisté à répertorier les questions qu’ils souhaitent voir traitées dans le cadre du suivi et de l’évaluation du CICE. Ces questions relèvent de trois registres : quelles sont les entreprises bénéficiaires du CICE ? Quels sont les effets du CICE sur les comportements d’entreprise, en termes d’emploi, de prix, de salaires, d’investissement ? Quel est l’impact du CICE au niveau macroéconomique ?
De premiers résultats partiels pourront être produits en 2014 et 2015, s’agissant de l’exercice d’évaluation microéconomique. Pour ce qui concerne l’analyse macroéconomique, les résultats définitifs des évaluations ne pourront être livrés avant 2016.
M. le rapporteur. L’article 66 de la loi du 29 décembre 2012 a prévu qu’un comité de suivi régional est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du CICE dans chacune des régions. Ces instances ont-elles été mises en place ?
Lors de la création du CICE, la représentation nationale n’a pas retenu les contreparties, mais a voté par voie d’amendement des dispositions interdisant l’utilisation du CICE pour augmenter les bénéfices distribués et les rémunérations des dirigeants. La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi prévoit que le comité d’entreprise est consulté chaque année sur l’utilisation par l’entreprise du CICE. Avez-vous prévu de regarder si ces instances de représentation du personnel se sont d’ores et déjà emparé de cette disposition ?
Je précise qu’une mission composée de parlementaires en mission auprès du Premier ministre a rédigé un rapport en décembre 2013 sur les éventuelles distorsions de concurrence que le différentiel de fiscalité peut entraîner, notamment avec le CICE.
Mme Selma Mahfouz. La loi a effectivement prévu la mise en place de comités de suivi régionaux, afin de permettre les remontées d’information sur la vérification par les représentants du personnel – comités d’entreprise et délégués du personnel – de l’utilisation du CICE. Au mois d’octobre 2013, date de la remise de notre rapport, nous n’avions pas de remontées d’informations. Il faut en effet prendre en compte le temps nécessaire à la montée en charge du dispositif.
M. Antoine Naboulet, chargé de mission. À ce stade, nous n’avons pas d’informations concernant la mise en place de ces structures, qui devraient faire l’objet d’un décret.
Mme Selma Mahfouz. Outre des études sur les données individuelles, le Comité de suivi a prévu de procéder à des études qualitatives, sous forme de monographies d’entreprises, permettant d’obtenir des informations sur l’implication des institutions représentatives du personnel et sur l’appropriation du dispositif par les entreprises. Il est en effet intéressant de comparer l’impact d’un dispositif sur le processus décisionnel des entreprises, autrement dit de savoir si le CICE et la réduction de cotisations sociales ont les mêmes effets en termes de recrutements ou de décisions financières. À ce stade, nous procédons au recensement des questions.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Le législateur a souhaité un fléchage du CICE vers la recherche, l’innovation, la formation, ainsi que l’interdiction de son utilisation pour financer une hausse des bénéfices distribués et des rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans les entreprises. Avez-vous mis en place un système de remontée d’informations statistiques ?
Le ministère des finances et le ministère du travail ont-ils défini une doctrine au regard d’une éventuelle saisine par les délégués du personnel sur une utilisation non conforme du CICE ? En clair, au cas où des représentants du personnel estimeraient que le CICE a été utilisé pour financer une augmentation des dividendes, quelle serait la réponse des administrations concernées ?
Mme Selma Mahfouz. La mise en place des dispositifs de contrôle relève des administrations concernées.
L’utilisation du CICE constitue en effet un nouveau thème d’info-consultation des instances représentatives du personnel, qui disposent le cas échéant d’un droit d’alerte si l’information fournie est jugée insuffisante. Cette obligation s’impose aux entreprises à compter du 1er juillet 2014. En outre, cette information figurera également dans la base de données unique (BDDU) prévue par la loi du 14 juin 2013.
M. Antoine Naboulet. La mise en place des dispositions sur l’information et le droit d’alerte des représentants du personnel est très récente. La base de données unique n’en est qu’au stade de la conception dans les entreprises puisque le décret dont elle fait l’objet est paru le 31 décembre 2013.
La façon dont les élus vont se mobiliser autour du suivi est encore floue, dans la mesure où les entreprises n’ont encore rien perçu. Et la question même de l’évaluation au sein des entreprises n’est pas encore stabilisée.
Nous n’avons pas eu d’échanges avec les administrations, notamment la direction générale du Trésor, sur l’éventualité de sanctions, voire d’une récupération de la trésorerie dégagée, en cas d’utilisation abusive du CICE. J’ignore si elles ont commencé à élaborer des doctrines en la matière.
Mme Selma Mahfouz. Le respect de la loi ne relève pas du Comité de suivi. Sur ce point, je vous renvoie à la direction générale du travail.
Les travaux qualitatifs, sous forme de monographies d’entreprises ou d’entretiens ouverts, permettront d’explorer le volet « info-consultation » du CICE. En outre, des questions pourraient être ajoutées sur l’utilisation du CICE et l’information des représentants du personnel dans l’enquête REPONSE (Relations professionnelles et négociations d’entreprise) menée par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail. Pour l’heure, il nous faut construire tous ces outils d’observation et d’évaluation.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Nous ne pouvons que vous inviter à être offensifs sur ce plan, dans la mesure où l’objectif du CICE est de doper la compétitivité du pays à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation et de développement à l’international. Pour évaluer l’efficacité du dispositif en termes économiques et d’emplois, les remontées d’informations sont fondamentales.
Mme Selma Mahfouz. Cela suppose une certaine stabilité du dispositif. À partir du moment où il se met en place, des analyses complètes ne seront pas disponibles avant quelques années puisque, pour l’instant, nous sommes dans les appels à idées en lien avec l’administration et des équipes de chercheurs.
M. le rapporteur. Sans compter un questionnement sur le devenir de votre comité de suivi si le CICE est dans la « besace » de la remise à plat de la fiscalité.
Mme Selma Mahfouz. Une certaine visibilité est en effet nécessaire.
M. le rapporteur. Des interrogations se sont exprimées sur le fait que les 20 milliards d’euros du CICE bénéficieraient à des secteurs non soumis à la concurrence internationale, comme la grande distribution ou le bâtiment et les travaux publics. Dans le droit fil du rapport de décembre 2013 de la mission parlementaire sur « l’impact de la mise en œuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif », je vous invite à regarder si l’effet d’aubaine n’est pas le plus important pour les professions libérales, comme les notaires ou les architectes, qui sont des professions réglementées et non exposées à la concurrence internationale.
Mme Selma Mahfouz. Avec un seuil à 2,5 SMIC, le CICE couvre 65,7 % de la masse salariale des entreprises.
M. le rapporteur. Mais avec des disparités très fortes par secteur et par territoire. En Île-de-France, à peine 45 % de la masse salariale est concernée, contre 65 % en moyenne au niveau national.
Mme Selma Mahfouz. Les micro-entreprises sont celles qui, en proportion de leur masse salariale, bénéficient le plus du CICE, puisque 82,5 % de leur masse salariale déclarée entre dans le champ du CICE, contre 56 % pour les grandes entreprises. Le ciblage du dispositif est donc large.
Les différences sectorielles sont en effet importantes. Néanmoins, la distinction entre secteur exposé à la concurrence internationale et secteur abrité ne reflète pas toute la réalité de la compétitivité qui repose sur le secteur exposé. En effet, le coût du travail dans le secteur abrité pèse indirectement sur le secteur exposé à la concurrence à travers plusieurs intrants, l’énergie, les services immobiliers, les services aux entreprises. Ainsi, le coût du travail élevé d’une entreprise de service se répercute sur les marges et sur la compétitivité d’une entreprise industrielle.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Cet argument est limité si l’on considère que, dans un marché libre, les entreprises françaises peuvent faire appel à des entreprises allemandes, par exemple, dont les « intrants » sont moins chers.
Mme Selma Mahfouz. Peu de services aux entreprises sont délocalisables. Une entreprise industrielle ne fera pas appel à une entreprise de nettoyage allemande. Une distinction trop tranchée entre secteur exposé à la concurrence internationale et secteur abrité passerait sous silence une partie de la compétitivité du secteur exposé.
S’agissant des secteurs, la part de la masse salariale entrant dans le champ du dispositif est de 63 % pour l’industrie manufacturière. Dans la mesure où celle-ci représente une part importante de la masse salariale totale en France (19 %), elle devrait bénéficier de 18 % du montant total de l’effort budgétaire que constitue le CICE, soit 13 milliards en 2013 et 20 milliards en 2014.
Pour le secteur de l’hébergement et de la restauration, 90 % de la masse salariale entrent dans l’assiette. Mais comme il ne représente que 4 % de la masse salariale totale, il devrait bénéficier de 5 % de l’effort budgétaire total du CICE.
Il existe également des différences régionales. En Île-de-France, 45 % de la masse salariale entrent dans le champ du CICE. Pour toutes les autres régions, ce taux est d’environ 70 %, avec un pic à 81 % pour le Limousin. Cela s’explique par le fait que les salaires sont plus élevés en moyenne en Île-de-France.
Tous ces résultats sont des estimations réalisées par l’INSEE sur la base des données tirées des déclarations annuelles des données sociales (DADS) pour 2011.
Par ailleurs, 46 % de la masse salariale des entreprises exportant plus de 35 % de leur chiffre d’affaires sont éligibles au CICE, contre 80 % pour les entreprises non exportatrices.
Enfin, 38 % du montant total du CICE bénéficieront aux entreprises non exportatrices, 35 % à celles dont les exportations représentent moins de 5 % de leur chiffre d’affaires et 27 % à celles exportant plus de 5 % de leur chiffre d’affaires.
M. le rapporteur. La première imputation du CICE interviendra en avril ou mai 2014 ?
Mme Selma Mahfouz. Oui, à la fin de l’année fiscale pour les entreprises.
M. le rapporteur. Cela signifie que les données sur la distribution du CICE seront consolidées à partir de cette date.
Mme Claire Bernard, chargée de mission. Nous tablons sur des données consolidées à partir de l’été 2014.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Connaissez-vous le montant global des avances au titre du préfinancement ?
M. le rapporteur. Ce montant a-t-il évolué depuis la publication de votre rapport ?
Mme Selma Mahfouz. Le préfinancement est proposé par Bpifrance et les banques commerciales.
Pour l’heure, nous ne disposons que des données concernant Bpifrance. Au 20 septembre 2013, celle-ci a reçu 10 000 demandes de préfinancement, pour un montant total de 920 millions d’euros. Sur ce total, 680 millions d’euros de préfinancement ont été accordés. Pour l’année 2013, nous pouvons donc tabler sur 1 milliard d’euros accordés. Après une période de mise en place, le dispositif est monté en charge avant l’été, notamment à destination des petites entreprises, grâce à des actions de communication. Près de 60 % de l’ensemble des dossiers reçus par Bpifrance concernent des demandes inférieures à 25 000 euros. Celles-ci représentent 7 % des 920 millions d’euros de préfinancement sollicités.
M. le rapporteur. C’est la possibilité du préfinancement en 2013 qui a plaidé pour la création d’un crédit d’impôt.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. L’estimation de 1 milliard d’euros inclut-elle les banques commerciales ?
M. Antoine Naboulet. L’objectif de préfinancement était de 2 milliards pour 2013 : 1 milliard pour Bpifrance, 1 milliard pour les banques commerciales. Il semblerait que la contribution des banques commerciales au préfinancement ait été modeste, pour des raisons qui restent à éclaircir.
Mme Selma Mahfouz. La montée en charge a été tardive et nous n’avons pas de retour d’informations en ce qui concerne la fin de l’année – nos informations sont donc partielles. Au 30 juillet 2013, des certificats de créance ont été délivrés pour 119 dossiers aux banques commerciales, pour un montant de préfinancement d’environ 45 millions d’euros. À ce stade, nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles la contribution des banques commerciales a été très limitée.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. La possibilité d’un financement tout court, c’est-à-dire la perspective d’un crédit d’impôt en mai 2014, a dû permettre aux entreprises d’aller voir leur banque en 2013 en vue d’un financement de leurs projets. Avez-vous des informations à ce sujet ? Cet élément apparaît-il dans leur bilan en 2013 ? A-t-il facilité leur capacité de financement propre ?
Mme Selma Mahfouz. Cela apparaît certainement dans leur bilan, puisqu’il s’agit d’une créance certaine. Mais, à ce stade, nous n’avons pas de remontées permettant de savoir si ce mécanisme a facilité l’accès au crédit des entreprises en 2013.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Le système bancaire étant assez concentré, il est sans doute possible d’avoir une vision de la politique des banques au travers des instructions qu’elles ont données à leurs services commerciaux. Pour l’année 2013, on considère que les entreprises ont été davantage contraintes par leur carnet de commandes que par l’accès au crédit.
Mme Selma Mahfouz. Il peut être, en effet, intéressant de voir si les organismes financiers ont donné des instructions. À l’heure où je vous parle, nous n’avons pas de retours.
M. Antoine Naboulet. Nous avions cherché à entrer en contact avec la Fédération bancaire française pour connaître sa vision, mais n’avons pas eu de retour jusqu’à fin 2013. C’est effectivement un sujet que le Comité de suivi peut inscrire à l’ordre du jour de ses prochaines séances.
M. le rapporteur. Dans son rapport sur le financement de la branche famille de mai 2013, la Cour des comptes souligne une « articulation problématique » entre le CICE et les exonérations de cotisations sociales existantes, essentiellement les « allégements Fillon » jusqu’à 1,6 fois le SMIC, et précise que « la question d’une reconsidération d’ensemble des deux dispositifs ne pourra sans doute que se poser ». Le Président de la République a évoqué plusieurs scénarios, dont une transformation pure et simple du CICE ou encore un maintien de celui-ci. À votre connaissance, certains secteurs ou certains territoires verraient-ils un intérêt au maintien du CICE ?
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Selon le rapport de la Cour des comptes, il existe un consensus pour reconnaître aux allégements de charges ou aux dispositifs analogues des vertus lorsqu’ils sont ciblés sur les bas salaires. Or les hypothèses évoquées induisent des effets contre-intuitifs liés notamment à une réduction ou une disparition des allégements ciblés sur les bas salaires, si bien que la transformation du dispositif reviendrait plutôt à un allégement de charges complémentaire ciblé sur les hauts salaires, donc de moindre efficacité par rapport aux modèles utilisés couramment à Bercy.
Mme Selma Mahfouz. Le Comité de suivi du CICE ne s’est pas interrogé sur ce sujet, qui n’entre pas dans ses missions. Il n’a donc rien à dire à ce stade.
Néanmoins, en changeant de casquette dans le cadre de cette audition, je peux vous dire que le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) réfléchit à ces questions, d’une part, en tant que membre du Haut Conseil du financement de la protection sociale, dont vous avez auditionné des membres, d’autre part, dans le cadre de sa réflexion sur la France dans dix ans, sujet sur lequel il a été chargé de la rédaction d’un rapport. Dans une optique à dix ans, la question de l’évolution des dispositifs de soutien à l’emploi – allégements de cotisations sociales et CICE – peut être appréhendée d’une façon plus prospective, c’est-à-dire indépendamment des débats immédiats.
Les questions qui se posent sont celles du ciblage en termes de salaire. Comme je l’ai dit, le CICE couvre 65 % de la masse salariale des entreprises ; il n’est donc pas ciblé sur les bas salaires, il va jusqu’à 2,5 fois le SMIC. Pour ce qui est des allégements, qui vont jusqu’à 1,6 fois le SMIC, une grande partie est concentrée sur les salaires inférieurs à 1,3 SMIC. Le point de départ des allégements a reposé sur le constat d’une vraie rigidité à la baisse du coût du travail au niveau du salaire minimum. Ce débat s’est déplacé avec le CICE, pour lequel se posent les questions du ciblage et du champ.
Le Comité de suivi s’est demandé si un crédit d’impôt et une baisse de cotisations sociales avaient les mêmes conséquences en termes de comportements d’embauche des entreprises. C’est un thème que nous aimerions approfondir.
M. le rapporteur. Le CICE est financé par une baisse de la dépense publique, une hausse de la TVA et, à terme, une fiscalité écologique. La suppression envisagée des cotisations familiales patronales le sera par la seule baisse de la dépense publique. De ces différentes modalités, dépendront les effets macroéconomiques. Dans son rapport d’étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale, le Haut Conseil du financement de la protection sociale identifie quatre familles de scénarios, assortis de variantes, soit quinze scénarios au total, tout en soulignant la nécessité de tenir compte des modalités de financement de chacun d’entre eux.
Mme Selma Mahfouz. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale va s’attacher à éclaircir les effets des différentes modalités de prélèvements. J’attire votre attention sur la difficulté à procéder à ce type de comparaison ; il faut trouver un équilibre entre simplicité analytique et réalisme. Les modalités du nouveau barème résultant d’une fusion éventuelle auront un impact. Ce sera au Haut Conseil de fournir les éléments d’analyse et de compréhension des différents scénarios.
M. le rapporteur. En conclusion, le Comité de suivi est en situation d’attente pour l’instant.
Mme Selma Mahfouz. Le Comité de suivi doit se réunir une fois par trimestre. La prochaine réunion sera l’occasion de dresser un bilan sur ces sujets.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Merci beaucoup de cette audition très utile.
*
* *
Audition de M. Benjamin Gallezot, adjoint au directeur général de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services du ministère du redressement productif, M. François Magnien, sous-directeur de la prospective, des études économiques et de l’évaluation, et M. Tristan Diefenbacher, chef du bureau de la compétitivité et du développement des entreprises
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Nous vous remercions d’avoir accepté cette audition qui s’inscrit dans le cadre d’une réflexion engagée depuis plusieurs mois par la mission d’évaluation et de contrôle du financement de la sécurité sociale (MECSS) sur le financement de la branche famille, dans un contexte en constante évolution. Il s’agit pour nous tout autant de garantir le financement de la branche famille à l’aide de ressources qui soient conformes à leur usage – et ainsi de favoriser le consentement à l’impôt – que d’identifier le prélèvement le plus favorable à l’économie française et à l’emploi. Nous nous appuyons pour ce faire sur un rapport de la Cour des comptes ainsi que sur les différentes auditions auxquelles nous avons procédé.
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) étant étroitement lié à notre thème d’étude – a fortiori depuis que des discussions ont été ouvertes sur son articulation avec les cotisations familiales patronales –, nous avons souhaité examiner de plus près son fonctionnement et en dresser un premier bilan. Il est entendu que nous ne vous demandons pas de formuler des propositions en lieu et place de vos ministres de tutelle mais d’éclairer notre mission d’évaluation qui rendra son rapport dans quelques semaines.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Si nous avons souhaité vous auditionner, c’est que nous souhaitons mesurer l’impact du financement de la branche famille sur la compétitivité des entreprises, sachant que le rapport que nous a remis la Cour des comptes présente plusieurs scénarios de financement alternatifs, ainsi que leur impact sur l’emploi en fonction de l’assiette retenue : TVA, CSG, cotisations sur la valeur ajoutée ou fiscalité environnementale. Nous nous sommes en outre interrogés sur les prérequis du modèle MESANGE (modèle économétrique de simulation et d’analyse générale de l’économie).
Mais notre questionnement va désormais plus loin pour porter également sur les scénarios envisagés depuis les dernières annonces du Président de la République sur la suppression des cotisations familiales pour les entreprises et les travailleurs indépendants d’ici à 2017.
Quel est selon vous l’impact des exonérations de cotisations sociales sur l’emploi et la compétitivité ? Quelle part faites-vous entre l’effet réel et les effets d’aubaine qu’elles sont susceptibles d’induire, en lien avec le CICE ?
M. Benjamin Gallezot, adjoint au directeur général de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) du ministère du redressement productif. Je commencerai par cadrer mon propos en rappelant, comme vous l’avez fait vous-mêmes, que nous nous trouvons dans un environnement relativement mouvant. De surcroît, des travaux sur le sujet qui nous occupe sont aujourd’hui en cours au sein du Haut Conseil de financement de la protection sociale ainsi que dans le cadre du dialogue sur le Pacte de responsabilité. Nous vous fournirons donc pour notre part des réponses de deux ordres : nous vous présenterons tout d’abord notre vision des déterminants de la compétitivité en général, compte tenu, notamment, des débats sur la compétitivité coût et la compétitivité hors coût. Puis nous aborderons la question des assiettes et plages de cotisation envisageables. Je précise que la DGCIS n’est pas directement compétente sur les sujets liés aux modes de financement alternatifs de la branche famille – tels que la TVA ou la CSG – et au bouclage macroéconomique, même si nous avons apporté notre contribution à la réflexion en cours, notamment en utilisant d’autres modèles que MESANGE. La question centrale pour nous consiste à déterminer sur quelles plages de revenus doivent porter les baisses de coût du travail – l’impact n’étant pas le même sur les différents secteurs d’activité, selon les choix retenus.
Sur le premier point, nous considérons la compétitivité comme un tout : il nous semble en effet simpliste, voire biaisé, de distinguer artificiellement la compétitivité coût de la compétitivité hors coût et de soutenir qu’il ne faut faire porter l’effort que sur l’une ou l’autre, car elles sont extrêmement liées. Nous préférons d’ailleurs parler de compétitivité prix que de compétitivité coût, la première renvoyant à la fois au coût unitaire des facteurs de production et à leur productivité : or, pour obtenir des prix compétitifs, il convient d’agir sur ces deux leviers en même temps. Si le coût du travail constitue une composante importante de la compétitivité coût, je ne reviendrai cependant pas sur le diagnostic établi à ce sujet dans le « rapport Gallois ». Je me contenterai de rappeler qu’à cet égard, la dynamique de ces dix dernières années a plutôt été défavorable à la France, si on la compare à celle de ses concurrents. En tout état de cause, si le coût du travail est un élément déterminant pour la compétitivité des entreprises, le coût des autres facteurs de production, et notamment du capital et de l’énergie, entre également en ligne de compte. La Banque publique d’investissement (BPI) joue d’ailleurs un rôle majeur en la matière, permettant de réduire le coût d’investissement des entreprises qui éprouvent des difficultés à obtenir des crédits bancaires.
La deuxième composante de la compétitivité prix réside dans l’amélioration de la productivité. Or, ici encore, la France accuse un retard relativement inquiétant en matière d’investissement de l’industrie et des services dans les techniques de production les plus efficaces. Différents indicateurs nous permettent de le constater, tels que le niveau d’investissement des entreprises dans la rénovation des matériels ou dans la robotique. Cela s’explique en partie par un manque de capital, mais est également dû à un problème méthodologique. Il conviendrait donc de faire en sorte que les entreprises françaises adoptent les méthodes de production les plus efficaces possible, c’est-à-dire qu’elles procèdent à du lean manufacturing, car il est souvent possible d’accroître sensiblement la compétitivité des entreprises en réduisant la quantité d’intrants et de matières premières nécessaires à la production. Si l’on ne peut séparer ces différentes variables, c’est que le niveau insuffisant des investissements des entreprises industrielles – et, dans une certaine mesure, du secteur des services – s’explique aussi par la faiblesse de leur taux de marge. De fait, les entreprises, parce qu’elles ont « le nez dans le guidon », essaient de produire avec les outils dont elles disposent sans avoir les capacités financières suffisantes pour réinvestir.
Quant à la compétitivité hors prix, elle s’appuie sur l’innovation, domaine dans lequel l’effort public est plus important en France que chez nos partenaires européens et asiatiques, en contraste avec l’effort privé qui est plutôt moins important chez nous. Cet effort public demeure néanmoins trop axé sur l’amont et pas assez sur l’aval si bien qu’en dépit d’une lente amélioration, nous conservons un retard très significatif dans l’intégration amont-aval, notamment vis-à-vis de l’Allemagne ou du Japon. Le crédit d’impôt recherche (CIR) constitue donc un outil de financement public capital pour les entreprises et un facteur crucial de choix d’investissement pour les entreprises étrangères.
Outre la recherche-développement, la compétitivité hors prix dépend également de l’innovation non technologique – c’est-à-dire du design et du marketing : or, une fois encore, nos entreprises sont moins investies en ce domaine que dans d’autres pays, raison pour laquelle le Plan innovation met l’accent sur cet aspect.
En résumé, il nous faut donc progresser sur toutes les composantes de la compétitivité tant elles sont liées entre elles, la capacité des entreprises à investir dans la recherche-développement ou l’innovation non technologique dépendant des marges qu’elles sont en mesure de dégager.
J’en viens à présent au financement de la branche famille et à l’impact des cotisations sociales sur la compétitivité.
Le débat sur le calibrage du CICE, auquel nous avons participé, a notamment porté sur le choix de la plage de salaire sur laquelle le faire porter : il s’agit là d’un débat complexe, ces choix pouvant avoir des effets différents à court, moyen et long termes. À court terme, l’impact sur l’emploi est plus élevé lorsque les baisses de cotisations portent sur les bas salaires. À moyen-long terme en revanche, lorsque l’on intègre d’autres paramètres que l’emploi, tels que l’équilibre de la balance commerciale et la croissance à très long terme, le diagnostic s’avère beaucoup plus mitigé : le fait de faire porter les allégement sur des plages de salaire situées au-delà de 2 ou 2,5 SMIC a un impact important sur la compétitivité externe. L’arbitrage en la matière est donc assez délicat à opérer. Or, si le débat a déjà été tranché en ce qui concerne le CICE, il va être rouvert au sujet des allégements de charges sociales.
La simplicité et la visibilité des dispositifs retenus constituent également des enjeux essentiels, non seulement pour les entrepreneurs français mais aussi pour les investisseurs étrangers, qui raisonnent le plus souvent en termes de taux nominaux et de grands blocs économiques. Or, en dépit des réductions existantes, notre taux d’imposition sur les sociétés nous est défavorable dans les comparaisons internationales et l’on observe le même phénomène en ce qui concerne les cotisations sociales. Le CICE n’affectant pas directement le niveau de celles-ci mais seulement le montant de l’impôt sur les sociétés (IS), il n’a pas été pleinement pris en compte par les investisseurs étrangers ni même par les entrepreneurs français. Il n’est donc pas aussi visible qu’une baisse des cotisations sociales. Voilà qui illustre à quel point la capacité des entreprises à comprendre, à s’approprier et à utiliser un dispositif constitue un facteur-clef de son efficacité.
Il nous paraît difficile de dresser un bilan du CICE dans la mesure où il s’agit d’un dispositif fiscal, c’est-à-dire à effet différé. De fait, les entreprises n’en auront pas forcément perçu les gains financiers immédiats en 2013. Qui plus est, certains entrepreneurs l’ont jugé complexe, croyant qu’il ne les concernait pas ou redoutant qu’on leur en retire le bénéfice au terme de contrôles fiscaux. En d’autres termes, non seulement le CICE est moins visible qu’une baisse de cotisations sociales mais en outre, sa complexité a été surestimée par les entreprises. Quant aux entrepreneurs faiblement assujettis à l’IS, ils ont cru que la mesure ne les concernait pas, ce qui est faux puisqu’il s’agit d’un crédit d’impôt. Il nous paraît donc tout à fait opportun d’envisager l’adoption d’un dispositif plus simple, quitte à bouleverser les circuits de financement de la sécurité sociale. Les masses financières concernées sont d’ailleurs assez comparables puisque le CICE représente une vingtaine de milliards d’euros sur la durée de l’exercice contre une trentaine de milliards pour les cotisations sociales, dont vingt-cinq milliards sur le même champ. Et encore une fois, une baisse de cotisations sociales, même de moindre importance que l’aide apportée par le CICE, aura un effet plus favorable que celui-ci sur celles des entreprises qui ne sont pas aperçues qu’elles pouvaient bénéficier de ce crédit d’impôt. Le nouveau dispositif envisagé suscite d’ailleurs davantage d’intérêt que le CICE en son temps. Il y a, par conséquent, un décalage entre les pronostics que l’on peut réaliser sur les éventuels gagnants et perdants d’une réforme et la réalité du terrain, compte tenu de l’effet psychologique et de l’effet de confiance de ces mesures.
M. François Magnien, sous-directeur de la prospective, des études économiques et de l’évaluation de la DGCIS du ministère du redressement productif. Nous avons évalué les effets que pourrait avoir la suppression des cotisations familiales patronales et du CICE annoncée par le Président de la République. Les masses financières concernées sont effectivement assez comparables sur le champ auquel s’applique le CICE : les cotisations familiales patronales, nettes d’exonération sur les bas salaires, représentent 23 milliards d’euros sur les 500 à 520 milliards d’euros de masse salariale, contre un CICE de 20 milliards. Selon nos calculs, la mesure aurait un effet de transfert vers les secteurs dans lesquels les salaires sont relativement plus élevés, dans la mesure où ils ont assez peu bénéficié du CICE et encore moins d’allégements sur les bas salaires. Les services mixtes destinés à la fois aux entreprises et aux particuliers, tels que les services bancaires et informatiques, de même que l’industrie seraient particulièrement favorisés par le Pacte de responsabilité.
M. Benjamin Gallezot. La substitution de la suppression des cotisations familiales patronales au CICE n’étant cependant que l’un des scénarios parmi d’autres, je ne voudrais pas que vous pensiez que telle est la position définitivement retenue par le Gouvernement.
M. le rapporteur. Qui plus est, le CICE n’est-il pas censé rester en vigueur en 2014, voire en 2015 ?
M. Benjamin Gallezot. Nous saurions d’autant moins nous prononcer pour le moment avec précision sur ce point que le Gouvernement a décidé d’en faire débattre les partenaires sociaux. Il y aura en tout cas des effets de biseau à gérer : le CICE étant un dispositif fiscal, il conviendra, à partir de 2015, d’éviter les effets de double compte d’une année sur l’autre et d’articuler la montée en charge dans le temps du crédit d’impôt avec la baisse de cotisations sociales qui s’appliquera progressivement, elle aussi. En tout état de cause, une fois le dispositif définitivement retenu, il conviendra d’en assurer la visibilité et la lisibilité pour les entreprises.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Comme l’a rappelé Jérôme Guedj, le crédit d’impôt est ouvert au mois le mois depuis le 1er janvier 2014 si bien qu’en mai 2015, sauf à adopter une mesure fiscale rétroactive d’annulation du CICE, il faudra bien verser les quelque 18 à 19 milliards d’euros prévus aux entreprises.
M. Benjamin Gallezot. C’est pourquoi j’ai parlé de dispositif progressif.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Il aurait fallu que la loi de finances prévoie un gel du CICE en 2014 à 12 milliards d’euros, soit à 4 %, afin d’éviter la montée en charge évoquée. Une mesure rétroactive me semble en revanche assez complexe à appliquer car une fois que des entreprise auront annoncé à leur banque qu’elles recevront en mai 2015 une aide liée au CICE au titre de l’exercice 2014 pour pouvoir contracter un emprunt et intégrer les montants en jeu dans leurs bénéfices, le coup sera parti.
M. Benjamin Gallezot. Vous avez raison. C’est pourquoi il nous faudra être capables de gérer l’évolution parallèle de ces deux dispositifs.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Cela représente en effet un taux de 4 % au titre de 2013 et de 6 % au titre de 2014, soit un montant de 19 milliards d’euros en 2015.
M. le rapporteur. J’avais cru comprendre à l’écoute des propos du ministre du travail que le CICE resterait en vigueur en 2015 et que ce ne serait qu’à partir de 2016 que l’on basculerait éventuellement d’un dispositif à l’autre…
M. François Magnien. Ma réflexion portait plutôt sur les masses financières en jeu en rythme de croisière, au-delà de la période transitoire qui vient d’être évoquée.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Quels seront alors les secteurs pénalisés ?
M. François Magnien. Ceux des services aux particuliers, notamment, où les salaires se situent plutôt en bas de l’échelle, de telle sorte qu’ils bénéficient largement des « exonérations Fillon » sur les cotisations familiales ainsi que du CICE.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Malgré le passage de l’aide apportée de 20 à 23 milliards d’euros, ces secteurs verraient donc leurs avantages fiscaux diminuer…
M. François Magnien. En régime de croisière, dans l’hypothèse où le CICE serait supprimé en même temps que les cotisations familiales, il semblerait effectivement que le secteur des services aux particuliers y perde. Je précise toutefois qu’il s’agirait là d’un effet immédiat et spontané, toutes choses égales par ailleurs.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Avez-vous tenu compte du fait que ces aides puissent donner lieu à contrepartie sous forme d’embauche et que, dans ce cas, il n’y aurait d’augmentation ni du taux de marge ni du bénéfice des entreprises ni donc de leur impôt sur les sociétés ?
M. François Magnien. Non car s’il importe d’avoir en tête des grandes masses chiffrées, il reste que nos calculs ne correspondent pas à la réalité économique mais à une simple comparaison. Pour apprécier les effets macroéconomiques de telles mesures, il nous faudrait utiliser un modèle, comme MESANGE par exemple.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Cela n’est pourtant pas négligeable ! Car si la substitution d’une exonération de charges de 23 milliards d’euros à un crédit d’impôt de 20 milliards se traduit purement et simplement par une augmentation du bénéfice des entreprises, compte tenu du fait que le taux d’imposition sur les sociétés s’élève à 30 %, les recettes de l’IS augmenteront de 6 milliards d’euros. Il conviendrait alors de relativiser les hausses dont vous nous avez parlé.
M. Benjamin Gallezot. S’il est vrai que nous n’avons pas intégré cet effet fiscal dans nos calculs, il ne sera cependant pas le même sur toutes les entreprises : certaines amélioreront leurs marges tandis que d’autres baisseront leurs prix. Ainsi celles qui souhaitent récupérer des parts de marché à l’extérieur feront-elles en sorte qu’une partie de cette baisse de cotisations sociales se traduise par une baisse de leurs prix et leurs marges seront alors compressées. Mais encore faut-il que les entreprises aient la capacité de le faire. D’autres paramètres entrant par ailleurs en ligne de compte, je ne suis pas certain que l’on puisse déterminer les effets mécaniques de la mesure sur l’IS.
L’un des facteurs majeurs pour déterminer sur quelles plages de salaire faire reposer la suppression des cotisations familiales est celui de l’exposition des secteurs concernés à la concurrence internationale. Si une exonération sur les bas salaires peut exercer un effet positif sur la création d’emplois, la conjoncture extérieure peut également exercer une certaine influence : une amélioration de la compétitivité n’aura pas le même effet dans des secteurs industriels desservant par essence une demande internationale au taux de croissance élevé que dans des secteurs à plus bas salaires, non exposés à la concurrence internationale et dépendant d’une demande intérieure soumise à la conjoncture française. L’effet étant assez subtil, nous avons pris le parti de proposer plusieurs modèles de simulation au Haut Conseil de financement de la protection sociale afin d’évaluer les différents comportements induits par la mesure selon les différents paramètres pris en compte.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Si je comprends bien, vous estimez que les multinationales sont confrontées à un problème d’offre, leur objectif étant de conquérir des parts de marché puisque la demande est importante, tandis que les petites et moyennes entreprises (PME) font face à un double problème d’offre et de demande…
M. Benjamin Gallezot. La plupart des PME industrielles sont très exposées à la concurrence internationale et très ouvertes sur le marché international. Le cas des grands groupes est différent : leur développement est fortement axé sur l’international mais ils investissent aussi beaucoup dans les capacités de production à l’international. Ce ne sont donc pas forcément eux qui sont les plus sensibles à la baisse du coût du travail, contrairement aux grosses PME et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui sont souvent sous-traitantes de grands groupes français ou étrangers, et qui réalisent souvent 50 à 60 % de leur activité à l’export. Le secteur des services, et notamment des services à la personne, qu’il relève de grands groupes ou de PME, est en revanche beaucoup plus concentré sur la demande intérieure.
M. François Magnien. D’où l’importance d’appuyer nos simulations macroéconomiques sur différents modèles qui prennent en compte les différents secteurs concernés, seul moyen d’apprécier les effets de l’exposition des entreprises à la concurrence internationale.
M. Tristan Diefenbacher, chef du bureau de la compétitivité et du développement des entreprises de la DGCIS du ministère du redressement productif. Nous avons été saisis par plusieurs secteurs fortement bénéficiaires du CICE, tels que les transports et la construction, qui se sont plaints du fait que le CICE et les baisses de charges ne produisaient pas d’effets sur leurs marges dans la mesure où leurs prix de vente étaient contractuellement indexés sur l’évolution de leur masse salariale.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Le CICE n’a pourtant aucun lien avec les salaires, grâce à un amendement dont je suis l’auteur.
M. Tristan Diefenbacher. Toutefois, d’un point de vue statistique, il s’agit d’une baisse de charges.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Il est vrai, en revanche, que les contrats, de délégation de service public par exemple, comprennent généralement des clauses de répercussion en cas d’évolution réglementaire de la fiscalité, qu’elle soit favorable ou défavorable au groupe concerné.
M. Tristan Diefenbacher. Le CICE ayant été pris en compte dans l’indice du coût du travail de ces secteurs, ceux-ci ont été contraints de les répercuter sur leurs prix, ce qui n’est d’ailleurs pas forcément une mauvaise chose dans la mesure où il ne s’agit pas toujours de secteurs qui investissent beaucoup mais où la compétitivité prix est importante. Ces secteurs ne sont cependant pas exposés à la concurrence internationale.
Par ailleurs, une grande entreprise qui a le choix d’investir en France ou à l’étranger tiendra compte de la notion de rentabilité qui dépend des charges à supporter et donc en grande partie du coût du travail. Cela étant, si ce paramètre a un impact sur son arbitrage, il n’en aura pas sur la création d’emploi ou d’activité en France, du moins, pas à court terme. L’entreprise aura plutôt à choisir soit de moderniser son usine française, soit de la laisser tourner telle quelle, soit encore de moderniser ou de créer une usine à l’étranger.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Nous vous remercions d’avoir clarifié les termes du débat sans vous abriter derrière le fait que des arbitrages soient actuellement en cours. Nous allons à présent vous poser quelques questions.
On nous indique que les taux de marge sont de 28 % en France contre 40 % en Allemagne. Or, j’ai cru comprendre que ces chiffres étaient largement exagérés. D’ailleurs, s’ils correspondaient à la réalité, plus aucun investisseur, pas même français, n’investirait le moindre euro dans notre pays. Mais à force de répéter nous-mêmes ces chiffres, nous contribuons à dissuader les investisseurs internationaux d’investir chez nous, du fait de cet effet psychologique sur lequel vous avez vous-mêmes insisté tout à l’heure. Disposeriez-vous par conséquent de chiffres précis sur ce point ?
Je partage d’autre part en grande partie votre vision de la compétitivité, n’ayant jamais guère cru aux effets prix du coût du travail dans les secteurs industriels : sans doute pourrait-on exporter davantage ou mieux servir la demande nationale si l’on parvenait à diviser par deux le coût du travail. Mais l’on parle ici de faire baisser de 4 à 6 % les salaires bruts, soit de 4 % la masse salariale. Or, compte tenu du poids des salaires dans la valeur ajoutée, le gain obtenu ne représenterait qu’1 ou 2 % de baisse à répercuter sur les prix, ce qui n’augmentera pas le niveau des ventes. Il est en revanche évident que nous accusons un retard important en matière de recherche-développement et de design, éléments auxquels j’ajouterais la formation, alors même que l’effet de levier qu’ils permettraient de créer est considérable : une aide de 30 milliards d’euros en ce domaine nous permettrait ainsi de passer du dixième ou du quinzième au troisième rang européen en la matière. Je crois beaucoup à une telle mesure, raison pour laquelle j’ai insisté en tant que parlementaire pour que le CICE soit clairement orienté vers des dépenses de formation, d’investissement et de recherche, même si nous n’avons pas assorti cette préconisation de sanctions.
Vous nous avez dit grand bien du CIR, et d’ailleurs, toutes les entreprises technologiques étrangères que nous rencontrons sur le terrain nous disent elles-mêmes que c’est grâce à lui qu’elles viennent s’installer en France. Ce crédit d’impôt fait en effet de la France l’un des pays les plus compétitifs pour faire de la recherche, dans la mesure où le coût du travail y est à peine plus cher et que l’on y bénéficie d’un microclimat tout à fait favorable à l’innovation technologique. Il fait donc consensus, même si le Parlement s’interroge sur les dérives auxquelles il a pu donner lieu. C’est pourquoi la MECSS a envisagé l’hypothèse d’un rapprochement entre le CICE et le CIR, en fléchant certaines dépenses. On pourrait alors cibler les allégements de charges sur d’éventuelles évolutions des cotisations familiales patronales, qu’il s’agisse de les réduire, de les supprimer ou de les transférer sur d’autres assiettes. Avez-vous comparé l’efficacité du CICE à celle du CIR ?
M. le rapporteur. Vous avez parfaitement raison d’insister sur les facteurs de compétitivité prix et hors prix. Quelle proportion du coût de production le coût du travail – qui s’élève environ à 700 milliards d’euros, salaires et cotisations confondus – représente-t-il, compte tenu du coût de l’énergie et du capital ?
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Le CICE ayant probablement été pris en compte dans la comptabilité de 2013 des entreprises, il a sans doute dû leur permettre – au-delà de ce que la BPI a pu préfinancer – d’accéder plus facilement au crédit et donc d’améliorer leurs résultats de l’an dernier. Disposez-vous d’éléments microéconomiques et macroéconomiques sur ce point ?
M. Benjamin Gallezot. Nous vous transmettrons un graphique dont les chiffres proviennent de la Banque de France, présentant l’évolution des taux de marge entre 1996 et 2012 pour les PME, les ETI et les grandes entreprises. Le dernier chiffre dont nous disposons date de 2012 et s’élève à 22 % en excédent brut d’exploitation sur la valeur ajoutée. Si je ne dispose pas ici des taux de marge observés dans d’autres pays sur ce même périmètre, nous pourrons bien sûr vous les communiquer. Je ne me prononcerai pas sur l’écart précis que vous nous avez présenté mais toutes les sources confirment en effet l’existence d’un écart et d’une dynamique défavorable à la France.
En ce qui concerne les effets d’amélioration du CICE sur le bilan comptable des entreprises, nous ne disposons pas encore de chiffres pour 2013 mais nous les établirons au fur et à mesure que les informations nous parviendront.
Vous avez raison de souligner que le CICE a exercé un effet positif sur l’accès des entreprises au financement, même si nous n’avons pas encore constaté de changement radical dans la perception qu’ont les entreprises de leur difficulté à y accéder. Ce sujet est d’ailleurs très controversé, les entreprises et les banques se livrant à un dialogue de sourds – les premières accusant les secondes de trop « serrer la vis » c’est-à-dire de trop baisser le crédit, ces dernières répondant que ce n’est pas le cas mais que la demande qui leur est adressée est plus faible. Nous constatons pour notre part l’importance de la dimension qualitative : les ratios ont certes leur importance, mais l’on peut en dire autant du type d’entreprise concerné. Une entreprise industrielle œuvrant dans un secteur de production difficile car exposé à la concurrence internationale, même si elle a des ratios de solvabilité corrects, comparables à ceux d’une entreprise de services, aura plus de mal à obtenir un crédit : le banquier se dira en effet qu’elle dépend d’un ou deux marchés et de grands donneurs d’ordres susceptibles de les remettre en cause tandis qu’une entreprise de services travaille sur un marché plus stable.
Quant à la main-d’œuvre, elle représente environ 30 % des coûts de production des moyennes et grandes entreprises. On a donc tendance à se dire que faire baisser ces 30 % de 5 points ne représente pas grand-chose. Mais, fort heureusement, ces entreprises réalisent encore une partie de leurs achats dans le tissu industriel français. Or, ces achats représentent eux aussi une part importante des coûts de production. C’est pourquoi, si l’on prend en compte la part de la main-d’œuvre sur l’ensemble de la chaîne de la valeur ajoutée, on s’apercevra qu’une baisse de 5 points du coût du travail n’est pas négligeable, sachant que les entreprises se battent sur les marchés à quelques pourcents près. Il est vrai qu’elles se battent aussi sur le type de produits qu’elles offrent. Mais une baisse d’1 ou 2 % du coût du travail n’est pas négligeable pour une PME qui, offrant une production standard – même de bonne qualité –, aura à se battre avec un concurrent espagnol ou allemand.
Il convient également de prendre en compte la dynamique de long terme qu’une telle baisse peut entraîner : perdant quelques pourcents année après année, nous avons peu à peu creusé un écart important. Au cours des dix dernières années, l’évolution des salaires, y compris dans l’industrie, a été plus dynamique en France que chez certains de nos concurrents qui, à l’inverse pour certains, comme les Allemands, ont accompli un réel effort sur leurs charges sociales.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Cela était vrai jusqu’en 2011. Mais, en 2012, les choses se sont sensiblement inversées en Allemagne.
M. Benjamin Gallezot. Certes, mais il s’agit pour nous d’appréhender des processus de long terme, surtout dans le secteur industriel. Et s’il est vrai que le mouvement s’est inversé en Allemagne, il importe que nous renversions nous aussi la tendance.
Nous n’avons pas particulièrement songé à rapprocher le CICE du CIR car nous sommes très attachés à la stabilité du CIR, dont les investisseurs tiennent vraiment compte dans leurs arbitrages. Sans doute peut-on l’améliorer mais je ne pense pas qu’il soit opportun de le bouleverser. Encore nous faudrait-il d’abord nous assurer que la nouvelle configuration retenue sera vraiment effective avant de transformer un dispositif aussi connu et aussi efficace.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Vous nous dites qu’il y a moins de robots en France qu’en Allemagne. Si l’on réallouait 5 milliards d’euros du CICE au CIR pour financer la robotisation des usines françaises, ne démultiplierait-on pas considérablement l’efficacité de la dépense fiscale ?
M. Benjamin Gallezot. C’est d’une certaine manière ce qui a été fait puisque le CIR a vu son champ étendu à des dépenses d’innovation et que la loi de finances pour 2014 prévoit des dispositions spécifiques en faveur de la robotisation. Nous plaidons par ailleurs en faveur d’un élargissement du CIR à la recherche-développement aval. Quant aux arbitrages budgétaires à opérer entre CICE et CIR pour y parvenir, ils nous dépassent. Et si le CICE est conduit à évoluer dans le cadre du Pacte de responsabilité, il ne sera plus possible de l’appareiller avec le CIR.
M. le rapporteur. J’ai aussi compris la remarque de Jean-Marc Germain comme une invitation à appliquer au CICE les conditions d’obtention du CIR, soit la justification de dépenses de recherche.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Je songeais effectivement à cela mais aussi à simplifier les choses, puisqu’à l’exception d’une évolution du CIR, toutes les hypothèses sont sur la table, qu’il s’agisse de maintenir le CICE et de le compléter par un nouvel allégement de charges, de remplacer l’ensemble par un allégement de charges ou encore d’étendre le CICE. Ne nous interdisons pas d’envisager un scénario alternatif consistant à doubler le CIR pour soutenir l’innovation dans les domaines du design et de la robotique, où toute aide aura un impact majeur sur l’industrie française, compte tenu des écarts flagrants qui nous séparent de nos partenaires. On pourrait alors simplifier les autres dispositifs existants via des allégements de charges, compte tenu de l’importance de la lisibilité de ces mécanismes sur le plan international. Si je présente moi-même cette hypothèse, c’est parce qu’elle est assez peu souvent évoquée, y compris au Parlement – le débat sur le CIR ayant été pollué par la question de l’optimisation fiscale, alors même que nous sommes tous convaincus de l’utilité de ce dispositif pour notre pays.
M. Benjamin Gallezot. Nous serons bien entendu amenés à adresser des propositions à nos ministres sur ce sujet. Cela étant, il nous faut toujours trouver un bon équilibre entre la simplicité, la sécurité et la prévisibilité des mesures proposées. Or, les systèmes faisant l’objet d’un contrôle a posteriori présentent des inconvénients de ce point de vue. S’ils nous permettent de nous assurer de la bonne affectation de la dépense, ils induisent a contrario une forte insécurité pour les entreprises, qui risque d’annihiler leur effet d’entraînement. La tâche des fonctionnaires chargés d’effectuer ces contrôles n’est d’ailleurs pas toujours aisée. Il conviendrait donc de trouver un équilibre entre le recours au contrôle et la conclusion – au sein des entreprises, au niveau des branches et dans l’ensemble de notre économie – d’un pacte entre les employeurs et les organisations syndicales. Dans un système idéal, la qualité même du dialogue social devrait nous permettre de nous assurer de la pertinence des investissements réalisés sans pour autant entraîner d’insécurité pour les entreprises.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Lorsque nous avons présenté au patronat l’idée de subordonner le bénéfice d’allégements de charges ou la suppression de cotisations patronales à la conclusion d’un accord d’entreprise, de branche ou des deux à la fois, il ne s’est guère montré enthousiaste, alors même que cela permettrait aux employeurs et aux organisations syndicales de déterminer ex ante, par codécision, de la meilleure manière d’utiliser l’aide fiscale, plutôt que de subir un contrôle ex post.
M. Benjamin Gallezot. On se heurte cependant à une difficulté : si la France a une tradition bien rodée de dialogue social sur les salaires et les conditions de travail, il nous reste bien du chemin à parcourir en ce qui concerne la stratégie d’investissement de l’entreprise, contrairement à ce qui se passe en Allemagne, par exemple. C’est pourquoi nous essayons pour notre part de mettre tout le monde d’accord sur ces questions d’investissement industriel au sein du Conseil national de l’industrie, qui réunit les organisations syndicales et professionnelles.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Nous vous remercions de vos éclaircissements très précis et argumentés. Ils nous seront très utiles, compte tenu du contexte évolutif dans lequel nous nous trouvons.
Audition de M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour
des comptes, M. Noël Diricq, conseiller maître, et Mme Loguivy Roche, conseillère référendaire
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Madame, messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir accepté de vous prêter à cette nouvelle audition.
Nous procédons aujourd’hui à d’ultimes entretiens avant de clore nos travaux avec l’audition de la ministre de la famille : nous rendrons notre rapport au mois d’avril. Si nous avons souhaité vous entendre à nouveau, c’est pour évoquer avec vous le contexte, qui, avec le « pacte de responsabilité », donne une dimension nouvelle à notre réflexion.
M. le coprésident Pierre Morange. La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) se trouve en effet aujourd’hui à la pointe de l’actualité – mais il est de tradition que la sixième chambre de la Cour des comptes vienne clore la série de nos auditions.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Il reste que la présente audition se justifie surtout par le télescopage entre les conclusions du rapport que vous nous avez remis en mai 2013, les annonces faites au début de l’année par le Président de la République et les pistes actuellement explorées.
Dans votre rapport, vous indiquiez qu’il était légitime que les entreprises participent au financement de la branche famille, dans la mesure où les prestations servies contribuent, à hauteur de 10 à 15 milliards d’euros, à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Pourtant, d’aucuns estiment que l’universalisation de la branche famille justifierait la fin d’un financement largement assis sur les cotisations patronales – sachant que la part de ces dernières ne cesse de diminuer.
Vous souligniez également que le dispositif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) s’articulait mal avec la politique d’allégement des cotisations, avec parfois des phénomènes de superposition. On se demande aujourd’hui si le CICE sera fondu dans la baisse générale des cotisations familiales ou si les deux dispositifs subsisteront en parallèle. Que pensez-vous de ces deux scénarios possibles ?
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Avez-vous réfléchi aux éventuelles contreparties d’une baisse des charges et évalué les effets attendus du pacte de responsabilité sur l’emploi ?
M. le coprésident Pierre Morange. Au-delà de la réflexion quelque peu théorique quant à la légitimité de la participation des entreprises à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, l’objectif du pouvoir exécutif est prioritairement de renforcer la compétitivité des entreprises. Dans ce schéma, quelle pourrait être la place des partenaires sociaux dans la gestion du régime assurantiel ?
M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes. La légitimité de la participation des entreprises au financement de certaines prestations familiales découle de l’intérêt que les employeurs peuvent avoir à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Cette question se pose en termes nouveaux du fait de l’évolution de notre société. Au fondement de la politique familiale mise en place – volontairement – par les entreprises, il y avait l’idée que le versement d’un sursalaire permettrait à la femme de rester au foyer : désormais, il s’agit de faire en sorte que la femme et l’homme puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, grâce, bien sûr, au système de prestations, mais surtout au développement de l’accueil de la petite enfance, politique continue et ambitieuse qui va connaître de nouveaux développements à la suite de la signature avec la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de la convention d’objectifs et de gestion (COG) pour la période 2013-2017.
Assez paradoxalement, cette question ancienne revient à l’ordre du jour. Évidemment, les entreprises ont une vision différente, selon laquelle une politique publique universelle devrait être financée dans le cadre d’une redistribution générale, sans fiscalité affectée. Cependant, force est de constater que, dans certains cas, comme en matière de transport, il existe bien un lien direct entre un financement d’entreprise et une politique publique particulière. C’est pourquoi il nous est apparu légitime d’essayer de calculer, sur la base d’hypothèses que nous avons décrites clairement, ce que pourrait représenter le montant de cette contribution : entre 10 et 15 milliards d’euros.
Cette question n’est pas sans lien avec celle soulevée par le président Morange. Maintenir une participation des entreprises, même résiduelle, au financement de la politique familiale, est aussi un moyen d’asseoir la légitimité des partenaires sociaux dans la gouvernance de la branche famille – car l’avis du représentant de l’Union professionnelle artisanale (UPA), qui considère qu’un financement par d’autres sources n’empêcherait pas les partenaires sociaux de participer à la gouvernance des caisses, n’est guère partagé par les autres personnes que vous avez auditionnées.
La question de l’articulation entre le CICE et les allégements généraux de charges est majeure. Techniquement, les administrations ont fait en sorte que les deux dispositifs soient aussi bien ajustés que possible ; néanmoins, ils se superposent largement, sont d’une grande complexité et ont des temporalités différentes ; nous avions d’ailleurs exprimé à demi-mot le souhait que le dispositif du CICE soit réévalué le moment venu – et le plus tôt sera le mieux, car une fois que les habitudes sont prises, il n’est pas aisé de changer les dispositifs. Une réarticulation soulèverait déjà le problème de l’année de transition, puisque le CICE fait l’objet d’une montée en charge progressive sur trois ans et qu’un arrêt brutal du dispositif aurait des effets importants. En outre, il faudrait se poser la question du profilage de ce qu’il restera de cotisations sociales : celles-ci étant presque inexistantes pour les salaires voisins du SMIC dans les entreprises de moins de 20 salariés, c’est en montant dans l’échelle des salaires que l’effet des allégements jouera à plein. Quoi qu’il en soit, la complexité des dispositifs actuels est susceptible de fragiliser la protection sociale, et l’appel à la clarté que nous avions lancé l’an dernier reste d’actualité.
Le Haut Conseil du financement de la protection sociale a saisi à bras-le-corps le sujet ; il en est à l’analyse technique des deux dispositifs, sans exclure a priori aucun scénario.
Dans ces conditions, quid des contreparties ? D’abord, il convient de rappeler que les allégements de charges sociales sont soumis à des conditions, alors que le CICE ne fait l’objet que d’un contrôle par les comités de suivi. En cas de remise à plat des deux dispositifs, il serait logique de conserver les éléments de conditionnalité liés aux allégements de charges.
M. le rapporteur. Pourriez-vous les expliciter ?
M. Antoine Durrleman. Citons par exemple l’obligation de négocier les salaires, les conditions auxquelles la signature d’un emploi d’avenir est soumise ou la possibilité de revenir sur les allégements de charges en cas de travail illégal au sein de l’entreprise.
Se pose ensuite la question d’éventuelles contreparties en créations d’emplois ; on peut imaginer toutes sortes de conditions possibles, mais la Cour n’a pas étudié la question. En revanche, il est certain que, d’une manière générale, les dispositifs d’insertion dans l’emploi par l’intermédiaire de l’entreprise, par exemple dans le cadre des contrats aidés, débouchent plus certainement sur un emploi durable que d’autres types de mesures.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Quid du crédit d’impôt recherche (CIR) ?
M. Antoine Durrleman. La Cour a examiné ce dispositif, et elle a considéré qu’il avait eu des effets – qui restent à documenter plus solidement. Toutefois, elle n’a pas établi de lien entre le crédit d’impôt recherche et la création d’emplois de chercheurs – si tel est le sens de votre question.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Dans l’objectif d’accroître la performance des entreprises françaises, on dispose actuellement de deux outils : le CICE et le crédit d’impôt recherche, auxquels s’ajoute une extension des allégements de charges.
Une simplification radicale serait de supprimer le CICE et le remplacer par des allégements de charges supplémentaires ; il faudrait alors bien en évaluer les effets sur les bas et les hauts salaires en fonction de la stratégie économique retenue.
Une autre option serait de transformer une partie du CICE en crédit d’impôt recherche, qui fait l’objet d’une forme de contrepartie, puisque n’y sont éligibles qu’un certain nombre de dépenses très précises.
Plus généralement, un des scénarios envisageables serait, vu le retard de la France en matière d’automatisation et de machines à commandes numériques, d’étendre certains dispositifs en jouant sur les effets de seuil ou sur le niveau des aides – tout en luttant contre les risques d’optimisation fiscale de la part des grands groupes –, de remplacer les autres par des exonérations de cotisations familiales patronales et de conserver un socle de cotisations d’une dizaine de milliards d’euros, qui correspondrait à la contribution des entreprises à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle.
Ce constat illustre ma question – qui, malheureusement, est rarement soulevée dans le débat public. Sur le terrain, les chefs d’entreprise ne cessent de souligner l’importance du crédit d’impôt recherche ; si l’on choisit la France pour investir dans la recherche et l’innovation, c’est qu’il existe chez nous, avec les universités, les laboratoires pharmaceutiques, les hôpitaux et le crédit d’impôt recherche, un écosystème particulièrement favorable.
Voilà qui devrait alimenter la réflexion sur les scénarios possibles et les formes de conditionnalité ou de contrepartie à envisager. Plutôt que des objectifs de résultats, en nombre d’emplois à créer, on pourrait fixer des objectifs de moyens, découlant de l’analyse de nos déficiences par rapport aux autres économies européennes.
M. Antoine Durrleman. Ce qui est certain, c’est que le sujet a un lien avec la politique de recherche et la stratégie d’investissement. L’objectif du CICE est certes l’emploi – son nom même l’indique –, mais aussi la modernisation et l’investissement. Or, dans notre pays, la stratégie d’investissement n’est traditionnellement pas au cœur du dialogue social.
La question des contreparties soulève aussi celle de la modernisation négociée. Le célèbre rapport d’Antoine Riboud, Modernisation, mode d’emploi, mériterait sans doute une relecture de ce point de vue.
M. le coprésident Pierre Morange. Comme vous le rappeliez, monsieur le président, une réforme efficace est une réforme simple et lisible. Vous avez évoqué la possibilité de réorienter le dispositif des emplois d’avenir au profit de l’ensemble des acteurs économiques, y compris le secteur concurrentiel, plutôt que de le limiter aux seuls secteurs associatif ou public. La Cour a-t-elle examiné ce scénario ? Il pourrait être mis en relation avec les conclusions du rapport que Jeanine Dubié et moi-même venons de remettre, au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC), sur l’adéquation entre l’offre et les besoins en matière de formation professionnelle.
M. Antoine Durrleman. La Cour a étudié, non pas les emplois d’avenir spécifiquement, mais l’ensemble des contrats aidés – et cela à plusieurs reprises, puisqu’il s’agit d’une politique continue, qui a un effet anticyclique extrêmement puissant. Toutes les analyses concordent : lorsque les entreprises accueillent des populations fragiles en mettant en œuvre les dispositifs d’accompagnement nécessaires, souvent avec l’aide des pouvoirs publics, cela débouche davantage sur des emplois durables que dans le cas d’autres formes d’aides à l’insertion. Ce n’est pas nouveau : le crédit initiative emploi et ses avatars avaient obtenu le même résultat. Cela suppose toutefois que des entreprises acceptent d’accueillir ce type de populations et qu’elles déploient des dispositifs d’accompagnement spécifiques.
Le constat est le même pour les formations en alternance, qui favorisent l’insertion durable dans l’emploi. La question des contreparties se pose donc non seulement en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs, via la congruence d’un certain nombre d’outils de politique publique.
M. le rapporteur. Comment financer l’exonération des cotisations patronales ? En commençant nos travaux, nous avions envisagé d’autres assiettes que la seule masse salariale, mais vous avez indiqué dans votre rapport qu’il n’existait pas d’assiette miracle et qu’il valait mieux privilégier un « effort méthodique d’économies ». Vous avez ajouté qu’une mobilisation des ressources budgétaires aurait des conséquences « qui ne sauraient être sous-estimées » – sans toutefois les évaluer avec précision.
La piste aujourd’hui retenue est une contribution budgétaire via la diminution de la dépense publique. Pensez-vous qu’une telle politique sera sans conséquences sur l’emploi – en d’autres termes, qu’elle sera conforme à l’objectif même de l’exonération des cotisations patronales ?
M. Antoine Durrleman. Question difficile ! Tout dépend de ce sur quoi porteront les économies – ce que l’on ignore encore. Toutefois, le modèle MESANGE – modèle économétrique de simulation et d’analyse générale de l’économie – montre assez clairement que la meilleure façon de favoriser la croissance et à l’emploi est un financement par un effort d’économies. L’idéal serait sans doute d’associer cet effort à une forme de taxation environnementale. Ce fut d’ailleurs, pour une grande part, la stratégie de financement du CICE. Cela étant, le modèle MESANGE n’est pas l’alpha et l’oméga de la pensée économique !
M. le coprésident Jean-Marc Germain. La piste environnementale a fait long feu…
Vous n’êtes donc pas d’accord avec les simulations de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), qui estime qu’un allégement de 20 milliards d’euros permettrait de créer 500 000 emplois au total, et 350 000 emplois nets en cas de financement par des impôts « intelligents », ou 250 000 emplois nets en cas de financement par une réduction de la dépense ?
D’aucuns considèrent que la stratégie de baisse du coût du travail est une forme de dévaluation compétitive de la France par rapport à ses partenaires européens ; mais l’OFCE craint que si ceux-ci réagissent de la même façon, cela ne provoque une guerre des prix, auquel cas l’estimation serait plutôt de 69 000 emplois créés. Qu’en pensez-vous ?
M. Antoine Durrleman. Nous n’avons pas étudié le travail de l’OFCE. Nous avons travaillé en liaison avec la direction générale du Trésor. Je ne me prononcerai donc pas sur ce point.
Ce qui est sûr, c’est que la compétitivité prix n’est qu’un élément parmi d’autres ; sans relais, son effet est en général limité dans le temps. Il faut mettre en œuvre des stratégies plus fortes, comme le crédit d’impôt recherche, si l’on veut retrouver une vraie dynamique de croissance, au-delà de l’effet éphémère sur les prix qu’aurait un allégement du coût du travail. Voilà pourquoi il convient de veiller à la bonne articulation de l’ensemble des politiques publiques, et pas seulement des outils d’allégement du coût du travail. De ce point de vue, il serait intéressant d’inclure le crédit d’impôt recherche dans la réflexion.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous avez fait un inventaire à la Prévert des économies potentielles. Pensez-vous que celles-ci seront suffisantes pour financer les allégements de charges et participer à l’effort collectif de réduction de la dépense publique – sachant que la protection sociale représente 46 % de celle-ci – ou faudrait-il privilégier des interventions plus ciblées, comme celles que la MECSS a promues par le passé – par exemple en matière de lutte contre la fraude sociale –, et qui n’ont été que partiellement mises en œuvre dans les précédentes lois de financement de la sécurité sociale ?
M. Antoine Durrleman. Ce que nous constatons, c’est que le pilotage de la dépense sociale est extrêmement fin et que les objectifs fixés par les pouvoirs publics s’inscrivent progressivement dans les faits. Pourtant, les déficits restent importants. Sans doute est-ce lié à la conjoncture économique et à l’insuffisance des recettes, mais notre système de protection sociale dispose de marges d’efficacité importantes, qu’il serait bon d’utiliser. Nous l’avons montré pour plusieurs secteurs, et nous avons été entendus par les pouvoirs publics, par exemple avec la réforme de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et le recalage de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Il existe en matière d’assurance maladie des gisements d’économies importants, qui concernent aussi bien les soins de ville que la médecine hospitalière ; la Cour vous a notamment présenté des hypothèses sur la chirurgie ambulatoire, qui impliqueraient de changer à la fois de modèle organisationnel et de modèle culturel.
M. le coprésident Pierre Morange. Le développement de la chirurgie ambulatoire permettrait en effet d’engendrer quelque 5 milliards d’euros d’économie, mais cela est réfuté par une organisation représentative du monde hospitalier public. Il existe donc de fortes résistances. Il faudrait une accélération de l’impulsion !
M. le rapporteur. Monsieur le président, parlons clair : estimez-vous qu’il existe encore une marge de manœuvre au sein de la branche famille ?
M. Antoine Durrleman. Je ne sais pas.
La politique familiale est un bloc. Or on examine généralement la situation de la branche famille sous le seul angle des prestations, sans nécessairement articuler celles-ci avec la politique fiscale. Certaines préconisations que la Cour a faites en matière de fiscalité ont déjà été prises en compte ; il ne faut pas penser qu’en matière de politique familiale, les marges d’action soient considérables. On ne peut pas imaginer que la suppression du financement de la branche famille des entreprises puisse être compensée par des économies suffisantes.
Le discours traditionnel sur l’équilibrage automatique de la branche famille, qui serait obtenu grâce à des recettes naturellement dynamiques et à des prestations naturellement étales, est démenti par les faits. Il est erroné de croire que les prestations sont indexées sur les prix tandis que les recettes sont indexées sur le PIB et les salaires, car la part des recettes de la branche famille véritablement indexées sur le PIB et les salaires est de moins en moins élevée. Je comprends que, pour les partenaires sociaux, la compensation de la suppression du financement de la branche famille par les entreprises soit une question importante, mais il s’agit d’un faux problème, dans la mesure où la part du financement de la branche famille assise sur la masse salariale est de plus en plus réduite. Voilà ce que nous souhaiterions mettre en avant.
M. le rapporteur. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale a été saisi de quatorze scénarios différents. Tout le champ des possibles est embrassé – y compris la progressivité de la contribution sociale généralisée (CSG) ! Peut-on concevoir une réforme du financement de la branche famille, avec une exonération des cotisations patronales, indépendamment d’une réforme globale du financement de la protection sociale ?
M. Antoine Durrleman. C’est l’œuf et la poule !
Je pense que la réforme de la branche famille n’entraîne pas nécessairement une remise en cause de l’architecture globale du financement de la protection sociale, mais qu’elle pourrait être l’occasion d’une telle réforme. C’est un choix stratégique à faire.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Si le scénario retenu est de supprimer les cotisations patronales, je vois mal comment cela pourrait servir d’exemple au financement de l’ensemble de la protection sociale !
Merci, monsieur le président, pour votre contribution à nos travaux.
M. Antoine Durrleman. C’est nous qui remercions la MECSS de nous y avoir associés.
*
* *
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à l’investissement,
et M. Jean-Régis Catta, chef de cabinet
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Je vous remercie, monsieur Gallois, d’avoir répondu à notre invitation. J’imagine que vous êtes souvent amené à parler de compétitivité devant des commissions parlementaires.
M. Louis Gallois, commissaire général à l’investissement. Mais c’est la première fois que j’évoque le financement de la branche famille, un sujet dont je ne suis pas spécialiste.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Vous l’êtes sans le savoir, d’une certaine façon.
Les travaux de la MECSS sur le financement de la branche famille s’inscrivent dans un mouvement engagé dès la précédente législature et ont connu de nombreux rebondissements. Lorsque nous avons saisi la Cour des comptes de cette question, le « rapport Gallois » n’avait pas encore été remis, et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) n’existait pas. Il sera d’ailleurs peut-être supprimé avant que nous n’ayons rendu nos conclusions…
Dans ce contexte un peu mouvant, votre audition prend d’autant plus d’importance, car les questions restent les mêmes. L’initiative lancée par le Président de la République sur le « pacte de responsabilité » se situe d’ailleurs au cœur de nos travaux. Nous avons exploré tous les modes de financement possibles pour la branche famille, qu’il s’agisse de redistribuer l’assiette ou d’économiser sur les dépenses, avec la préoccupation d’améliorer la compétitivité du pays et de créer de l’emploi, tout en maintenant un haut niveau de protection sociale et en préservant la politique familiale. Nous souhaitons donc avoir votre avis sur ce sujet.
Le pacte de responsabilité consisterait en une réduction des charges d’environ 30 milliards d’euros pesant sur les entreprises. Quelle serait la meilleure façon de consacrer cet effort à une amélioration de la compétitivité et de l’emploi ? À l’heure où la France connaît un retard dans les domaines de la robotisation ou des machines à commande numérique, par exemple, on peut se demander si un renforcement du crédit d’impôt recherche ne serait pas une solution à privilégier. S’agissant du CICE, la question est de savoir s’il faut en conserver l’existence tout en étendant les possibilités d’exonération ou bien le faire basculer vers une exonération totale de cotisations patronales. Avons-nous vraiment besoin, en effet, de trois instruments différents, sachant qu’il faut également rechercher les moyens de concentrer leurs effets sur tel ou tel secteur ?
L’autre question qui se pose est celle des contreparties. À l’effort demandé aux Français sous la forme d’une réduction des dépenses doit correspondre une politique judicieusement choisie. Certes, il convient de tenir compte de la diversité des entreprises et de leurs besoins – certaines doivent accroître leurs exportations, d’autres développer la recherche, d’autres encore simplement remplacer une machine –, mais il faut aussi éviter que la « subvention » ne soit détournée vers les hautes rémunérations ou les dividendes, voire captée par des tiers – en particulier les donneurs d’ordre dans le cas d’entreprises sous-traitantes.
Enfin, il convient de réfléchir à la place du dialogue social dans le nouveau dispositif. M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, vient de nous rappeler qu’en contrepartie de certains allégements de charges, les entreprises se voient obligées de négocier sur certains thèmes tels que la formation professionnelle, l’égalité entre les femmes et les hommes ou les contrats de génération. Faute d’une telle négociation, dont le contenu est libre, une pénalité est appliquée, sous la forme d’une réduction de l’allégement proportionnelle à la masse salariale. Un tel dispositif vous paraît-il de nature à répondre à la diversité des besoins des entreprises tout en concentrant l’effet du pacte de responsabilité sur l’appareil productif ?
M. le coprésident Pierre Morange. Le chef de l’État a rappelé à juste titre la nécessité de trouver plusieurs dizaines de milliards d’euros d’économies budgétaires. Par ailleurs, il envisage une réduction des cotisations familiales patronales plus drastique que prévu. Mais on sait que les réformes structurelles ne génèrent des économies qu’après un certain délai. Le seul moyen d’obtenir des résultats rapidement est le coup de rabot, avec toute la rusticité et la dureté qui peuvent caractériser une telle méthode. Quelle solution préconisez-vous ? Faut-il modifier l’assiette et financer la politique familiale par les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou de la contribution sociale généralisée (CSG) ?
Rappelons que le CICE doit être financé par des économies dont le contour n’a, pour l’instant, pas été précisé.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Au moment même où nous terminons avec vous ce cycle d’auditions, des propositions sont mises sur la table qui s’inspirent largement du pacte de compétitivité – si ce n’est dans leurs modalités, du moins s’agissant des montants considérés. Vous n’êtes pas, dites-vous, un spécialiste du financement de la branche famille, mais la question du financement de la protection sociale et de son impact sur l’emploi et la compétitivité vous concerne.
Pour notre part, nous avons recherché les assiettes pouvant se substituer aux cotisations patronales familiales dans le cas où celles-ci seraient partiellement ou totalement supprimées : CSG, TVA, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, fiscalité environnementale, etc. Il n’existe cependant pas de recette miracle.
Dans votre rapport, vous avez proposé une baisse de 30 milliards d’euros des cotisations sociales qui concerneraient pour deux tiers les cotisations patronales et pour un tiers les cotisations salariales – pas dans la branche famille, puisque les cotisations salariales familiales n’existent pas, mais peut-être en matière de retraite.
M. Louis Gallois. Je pensais plutôt à l’assurance maladie.
M. le rapporteur. S’agissant du financement, vous pensiez recourir à la fiscalité pesant sur les ménages : TVA ou CSG. Êtes-vous toujours favorable à ce modèle, partiellement repris par le CICE, ou faut-il privilégier une baisse de la dépense ?
Par ailleurs, l’impact d’une baisse des cotisations sociales sur la création d’emplois et la nécessité de prévoir ou non des contreparties font l’objet d’un débat. Quel est votre sentiment sur ce point ?
M. Louis Gallois. Sur les sujets que vous évoquez, je ne dispose d’aucun mandat et je ne peux donc livrer que le fruit de mes réflexions personnelles.
Comme vous le savez, je n’avais pas proposé le système qui est devenu le CICE, mais un transfert de cotisations sociales sur la fiscalité. J’avais suggéré d’opter pour la CSG, mais uniquement faute de pouvoir exprimer clairement ma préférence en faveur d’une hausse de la TVA, le sujet étant tabou à l’époque.
Par ailleurs, ma proposition différait du CICE sur plusieurs points. Tout d’abord, elle aurait eu un impact sur les finances publiques dès 2013, un exercice budgétaire très difficile à boucler, tandis que le CICE – et cela constitue un de ses avantages – faisait reporter la charge sur l’année 2014. Ensuite, l’allégement que je préconisais devait s’appliquer aux salaires jusqu’à 3,5 fois le SMIC, contre 2,5 fois pour le CICE. En effet, je visais avant tout la compétitivité, tandis que le Gouvernement a davantage recherché un effet sur l’emploi, ce qui est une préoccupation légitime. Enfin, tandis que je suggérais d’appliquer un allégement de charges avant impôt, le Gouvernement a fait le choix du crédit d’impôt.
Il faut souligner que si l’impact net du CICE est bien de 20 milliards d’euros, le gain après impôt, pour les entreprises, d’un basculement des cotisations familiales sur la fiscalité serait, lui, inférieur à 30 milliards. Il serait à cet égard intéressant de demander à la direction générale des finances publiques de le calculer.
À mes yeux, la compétitivité est un élément clé, et l’emploi ne viendra que d’un renforcement de l’offre. C’est pourquoi je suis convaincu de la nécessité de renforcer la compétitivité de notre pays et, dans ce but, de viser un peu plus haut dans l’échelle des salaires que ne l’a fait le CICE. Lorsque j’ai préparé mon rapport, j’ai demandé à l’INSEE de tester l’impact d’une réduction des charges selon le niveau de salaire pris en compte : deux fois le SMIC, deux fois et demie, etc. Le résultat est que la part de l’industrie augmente significativement lorsque l’on passe de 2,5 à 3,5 SMIC – au-delà, le gain est marginal. Or il me paraissait préférable de privilégier l’industrie par rapport à des secteurs employant une main-d’œuvre à faible revenu.
Au moment de la création du système de sécurité sociale, en 1945, l’entreprise était la seule matière réellement imposable, on n’opérait aucune distinction entre l’effort de solidarité nationale et l’effort assurantiel, et l’environnement économique n’était pas du tout marqué par la concurrence internationale. Aujourd’hui, les choses ont changé. Il est normal que les entreprises assument le coût de la protection assurantielle dès lors qu’elle est en lien direct avec leur activité – c’est notamment le cas de l’assurance chômage et d’une partie de l’assurance maladie, à l’exception de la couverture maladie universelle (CMU) –, mais la protection relevant de la solidarité nationale doit, elle, être financée par l’impôt. Or la politique familiale me semble incluse dans cette dernière catégorie. Son financement ne doit donc pas être assuré par les entreprises, sauf à placer celles-ci dans une situation concurrentielle défavorable.
En disant cela, je ne parle pas du « coût du travail » en général – l’expression ne figure d’ailleurs à aucun moment dans mon rapport –, mais des marges des entreprises, qui sont aujourd’hui totalement insuffisantes. On se focalise sur les entreprises du CAC 40, mais celles-ci réalisent la plus grosse part de leurs marges à l’étranger. Dans l’industrie, les niveaux de marge sont parmi les plus faibles d’Europe, et au plus bas depuis 1985, ce qui constitue un obstacle majeur au développement des entreprises. C’est pourquoi j’ai jugé nécessaire de leur donner un ballon d’oxygène en ne faisant pas porter sur elles autrement que par l’impôt le poids des charges de solidarité.
Pour autant, l’impact en termes de création d’emplois d’une réduction du coût du travail me semble impossible à évaluer. On peut certes présumer qu’une entreprise embauchera plus facilement un employé s’il lui coûte moins cher pour un même niveau de salaire net. Mais ceux qui tentent de calculer le nombre de recrutements induits par les allégements de charges se trompent souvent : on l’a vu dans le secteur de la restauration.
L’impact est toutefois probablement plus fort sur les bas salaires que sur les emplois industriels. À cet égard, la suppression des « allégements Fillon » aurait probablement un effet négatif sur l’emploi.
Il ne faut de toute façon pas se faire d’illusions : dans l’industrie, un surcroît d’embauches ne peut venir que d’une augmentation des besoins en main-d’œuvre, laquelle résulterait d’un accroissement de la demande. Et la demande, interne comme externe, n’augmentera que le jour où l’industrie sera capable d’y répondre, ce qui n’est en grande partie pas le cas aujourd’hui.
Dans la mesure où on ne peut mesurer les effets d’un allégement de charges sur l’emploi, il paraît difficile de l’assortir de contreparties, d’autant que le gain pour les entreprises, par rapport aux 20 milliards d’euros nets du CICE, ne serait pas très important, de l’ordre de 5 ou 6 milliards d’euros.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Il est vrai que, sur les 30 milliards d’euros consacrés au pacte de responsabilité, 5 milliards d’euros concerneraient les entrepreneurs indépendants, qui n’emploient aucun salarié. Le gain n’a donc rien de massif.
M. Louis Gallois. Pour autant, je peux comprendre que l’on reporte sur le futur système une demande de contreparties qui, dans le cas du CICE, n’avait pas été satisfaite. C’est d’ailleurs en partie de ma faute, puisque j’avais estimé qu’elles seraient très difficiles à mettre en place. En particulier, il paraît malaisé d’exiger un volume global d’embauches. Sur ce point, l’exemple du secteur de la restauration doit nous inciter à rester prudents.
En revanche, le pacte de responsabilité pourrait être employé comme levier pour obtenir, dans chaque branche, une négociation sur ce que j’appellerais des « contrats de progrès » – car ils seraient conclus au bénéfice de tout le monde – sur l’apprentissage, la formation professionnelle, le recrutement de jeunes, de seniors ou de chômeurs de longue durée, etc. L’État pourrait ainsi définir une liste de thèmes sur lesquels il souhaite voir les partenaires sociaux négocier.
Il me paraît en effet plus réaliste d’inciter ainsi chaque branche à négocier sur des sujets précis plutôt que de fixer des engagements en termes de recrutements. En effet, qu’appelle-t-on une création d’emploi dans une branche ? M. Gattaz a évoqué le chiffre d’un million : c’est à peu près le nombre d’emplois créés chaque année en France. Mais dans le même temps, il s’en détruit à peu près autant – le solde net est de 20 000 à 25 000 emplois. Pour définir une contrepartie, il faudrait donc se donner un point de comparaison, par exemple le nombre d’emplois existant au 1er janvier. Mais le connaît-on vraiment ?
Je suis donc personnellement sceptique quant à la possibilité de poser des exigences en matière d’emplois. En revanche, des engagements précis pourraient être pris sur les thèmes que j’ai déjà évoqués, ce qui, de surcroît, irait dans le sens d’un développement du dialogue social, au niveau des branches comme à celui des entreprises.
Dans mon rapport, j’avais suggéré que chaque dirigeant soit amené à expliquer devant le comité d’entreprise ce qu’il compte faire de l’argent obtenu. Bien sûr, dans cette hypothèse, rien ne permettrait aux sceptiques de distinguer les mesures déjà prévues des projets rendus possibles par les allégements de charges supplémentaires. Mais au moins, un débat serait organisé sur ce sujet. Plus généralement, il ne m’apparaîtrait pas malsain de prévoir dans chaque comité d’entreprise une discussion sur l’application à l’entreprise de l’accord de branche.
En ce qui concerne les économies budgétaires, je n’ai pas, sur ce sujet non plus, de compétences particulières. Mais s’il faut les réaliser avant 2017, je ne vois pas comment on pourrait éviter le coup de rabot. Car M. Morange a raison : une réforme structurelle – la fusion entre département et région, par exemple – a des coûts immédiats, mais ses effets en termes d’économies réalisées sont lointains. Le Gouvernement va donc se retrouver dans une situation extrêmement déplaisante, consistant à promouvoir des réformes structurelles désagréables sans espérer pouvoir tirer profit de leurs effets financiers. C’est en tout cas vrai pour les années 2015 et 2016, car il n’est pas impossible que des réformes structurelles engagées dès aujourd’hui puissent porter leurs fruits dès 2017. Mais les seules mesures à effet rapide relèvent du coup de rabot : déremboursement de médicaments, application de conditions de ressources à certaines prestations sociales, plafonnement des primes des fonctionnaires, etc. Ce qui est certain, c’est que nous ne devons pas attendre : les réformes structurelles doivent être lancées, ne serait-ce que pour mettre le pays sur une trajectoire d’économies.
Comment financer la suppression des cotisations familiales patronales si ce n’est par des économies budgétaires ? Je suis frappé de voir s’exprimer en France une telle résistance à l’idée d’augmenter la TVA. Le taux actuel, 20 %, n’est pourtant pas le plus élevé d’Europe, loin de là – la moyenne s’établit à 21 %, me semble-t-il. Or, en tenant compte des 20 milliards d’euros du CICE, il ne faudrait trouver que 6 ou 7 milliards d’euros pour financer le pacte de responsabilité, soit l’équivalent d’un point de TVA. Mais, je le répète, la résistance est très forte. Curieusement, une augmentation de la CSG paraît plus indolore, alors qu’elle n’est pas beaucoup plus juste. Pour en faire un impôt de « plein exercice » et compte tenu de sa puissance, il faudrait sans doute rendre cette contribution plus progressive, et peut-être réfléchir à la façon dont elle s’applique aux retraités.
Encore une fois, la somme à trouver pour compléter le financement de la suppression des cotisations familiales n’est pas très élevée, surtout si on la compare aux plus de 50 milliards d’euros d’économies que la Cour des comptes appelle à obtenir d’ici à 2017.
Pour ma part, et bien qu’il m’ait fallu du temps pour me convertir à cette idée, je crois également nécessaire de réduire la dépense publique, même s’il faut éviter de le faire de façon trop brutale. D’ailleurs, réaliser 50 ou 60 milliards d’économies revient moins à réduire la dépense qu’à enrayer son augmentation. Il est en effet indispensable de maîtriser l’augmentation de l’endettement, car lorsque la dette d’un pays dépasse 93 ou 94 % de son produit intérieur brut, il devient extrêmement fragile, se met dans la main des marchés financiers et perd toute autonomie dans la gestion de sa politique économique. Il faut donc amener le déficit des finances publiques à un niveau tel qu’il n’entraîne plus un accroissement de la dette, soit environ 2 % du PIB.
J’avais d’ailleurs expliqué à M. Gattaz – et cela ne lui avait pas fait plaisir – que les entreprises ne pouvaient espérer bénéficier de la plus grosse part des économies réalisées. Sur les 50 milliards d’économies, au moins 40 doivent en effet être consacrés en priorité à la réduction du déficit plutôt qu’à la baisse des charges. Le Gouvernement n’aura pas le choix. C’est d’ailleurs le schéma qui semble avoir été retenu.
Je finirai par le crédit d’impôt recherche, un mécanisme auquel je suis personnellement très attaché, et dont toutes les analyses montrent qu’il constitue un succès remarquable. Ainsi, sachant que l’industrie, outre-Rhin, est deux fois plus importante qu’en France, l’intensité de recherche des entreprises françaises est comparativement supérieure à celle des entreprises allemandes. En outre, le CIR a permis à notre pays de traverser la crise sans connaître un effondrement de la recherche privée.
Dans les grandes entreprises – comme celle que j’ai dirigée, EADS –, le crédit d’impôt recherche n’a pas tant permis d’accroître l’effort de recherche qu’à le maintenir en France. En effet, dans la compétition très forte à laquelle se livrent les pays pour attirer les centres de recherche, le CIR représente un des rares atouts dont dispose la France. Sans lui, nous aurions été en grande difficulté par rapport à la Grande-Bretagne, qui n’hésite pas à dérouler le tapis rouge : terrain gratuit, formation professionnelle des personnels, etc. Il est donc important de ne pas déstabiliser ce crédit d’impôt – je crois d’ailleurs savoir que le Président de la République s’est engagé en ce sens.
M. le rapporteur. Vous avez jugé – peut-être un peu rapidement – que le financement de la politique familiale par les entreprises ne se justifiait plus dans la mesure où cette politique relève de la protection sociale universelle et donc de la solidarité nationale. Sur ce point, qui fait débat, la Cour des comptes estime qu’une partie des dépenses concernées – à hauteur de 10 ou 15 milliards –, parce qu’elles permettent de concilier la vie professionnelle et de la vie familiale, doivent être assumées par les entreprises.
M. Louis Gallois. Le débat est légitime : dans toute politique sociale, il y a certainement un élément qui concerne les entreprises. J’ai cité le cas de la CMU, qui me semble relever de la solidarité nationale plutôt que de l’assurance, mais pour d’autres politiques, c’est l’inverse.
M. le rapporteur. Les indemnités journalières, par exemple.
M. Louis Gallois. Quant aux allocations familiales, même si elles me semblent relever en grande partie de la solidarité nationale, on peut admettre, en effet, qu’elles permettent à un certain nombre de personnes d’occuper un emploi malgré leurs obligations familiales. Pour autant, en termes d’égalité entre hommes et femmes, nous sommes encore loin du compte : de nombreuses femmes sont conduites à occuper des emplois précaires pour des raisons familiales.
M. le coprésident Pierre Morange. En tant que grand capitaine d’industrie, vous avez été amené, au cours de votre vie professionnelle, à mener des négociations avec les partenaires sociaux. Selon vous, quel rôle devraient jouer ces derniers dans le cas où la politique familiale ne serait plus financée par une participation patronale ? Auraient-ils la même légitimité à assurer la gestion de la branche famille dans le cadre du paritarisme ?
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Vous avez dit que les contreparties pourraient être trouvées sous la forme d’accords de branche. On peut le comprendre s’ils sont d’application directe et visent, par exemple, à fixer des objectifs quantifiés de formation que l’on pourrait atteindre en mutualisant les moyens grâce à une cotisation. Mais il ne faudrait pas se contenter d’engagements comparables à celui de Nicolas Sarkozy lorsqu’il a voulu porter de 400 000 à 800 000 le nombre d’apprentis. On peut toujours fixer un nombre d’apprentis à recruter dans un secteur donné, mais si on ne précise pas les moyens pour y parvenir, à quoi bon ? Quand les PME n’ont pas de commandes, elles n’embauchent pas – ni salariés, ni apprentis.
C’est pourquoi je crains que les accords de branche ne soient verbeux. La négociation doit porter sur les leviers dont dispose la branche, et donc sur des accords d’application directe.
Vous avez par ailleurs évoqué l’obligation, pour le chef d’entreprise, de justifier la façon dont sera utilisé l’argent. Une disposition de cet ordre a été incluse dans le CICE par amendement parlementaire : le chef d’entreprise doit expliquer ses choix devant son comité d’entreprise, qui dispose de moyens d’expertise pour vérifier ses dires. Il lui est même possible de saisir le comité régional de suivi du crédit d’impôt, où siègent des représentants de l’administration du travail et de l’administration fiscale. Cependant, ce système de recours reste peu contraignant, puisqu’il ne prévoit aucune sanction. Écarteriez-vous d’emblée l’idée d’aller un peu plus loin qu’un dispositif d’information et de consultation, et de faire porter la négociation sur l’usage même des capitaux rendus disponibles – modernisation des machines, recrutement de commerciaux ou de chercheurs, etc. ? Ce qui compte, en effet, ce sont les moyens employés pour stabiliser l’entreprise et lui permettre de gagner des marchés.
Dès lors, trois solutions s’offrent à nous. La première consiste à définir des critères très précis de façon à limiter les usages possibles de l’argent obtenu ; la deuxième, à mettre un inspecteur des impôts ou du travail derrière chaque entreprise, mais cela ne semble ni possible, ni souhaitable ; la troisième, à faire confiance à ceux qui font tourner l’entreprise, dirigeants comme salariés, en considérant qu’ils sont les mieux à même de déterminer le bon usage de cet argent.
On pourrait ainsi faire dépendre le bénéfice des allégements de charges complémentaires de la conclusion d’un accord d’entreprise, en recourant au mécanisme, déjà bien rodé, qui a été mis en place en matière d’égalité entre femmes et hommes : négociation avec les syndicats pour les grandes entreprises, accords de branche pour les plus petites, dont certaines options sont directement applicables.
M. le coprésident Pierre Morange. M. Germain a fait allusion aux promesses faites lors de la législature précédente, mais on pourrait également évoquer la baisse de 20 % des crédits affectés à l’apprentissage. Cela montre bien l’importance, dans ce domaine, d’assurer un engagement pérenne.
M. Louis Gallois. Le paritarisme, monsieur Morange, s’est beaucoup sclérosé au fil du temps. Il s’est transformé en ce qu’il n’aurait jamais dû être : un système de cogestion fondé sur le souci de ne déplaire à personne, si bien que chacun laisse faire l’autre. Il faut donc le refonder.
Par ailleurs, en ce qui concerne les allocations familiales, dès lors que l’État en assume le coût, il devient nécessaire de trouver de nouveaux modes de gestion. Certes, il paraît important que les partenaires sociaux y restent associés, mais avec une marge de manœuvre réduite par rapport aux branches financées par des cotisations patronales et salariales. Il revient à l’État de réorganiser le système.
S’agissant des accords de branche, monsieur Germain, je suis un peu moins pessimiste que vous sur leurs résultats. Tout d’abord, dans les domaines qui relèvent de la branche, comme la formation professionnelle, l’impact d’un accord est direct. Quant à l’apprentissage, il s’agit d’une question plus vaste et qui reste pour l’instant sans réponse. Dans ce domaine, nous ne savons pas où nous allons : 8 % de baisse en 2013, alors que le pacte de compétitivité s’était donné des ambitions relativement modérées en termes de croissance de l’apprentissage. J’avais proposé le recrutement de 800 000 apprentis, mais Mme Parisot, alors patronne du Medef, avait jugé cet objectif irréaliste. À ce niveau, nous serions pourtant encore loin des ratios allemands.
En tout état de cause, il convient de régler ce problème de manière globale, et l’accord de branche pourrait nous y aider. Mais il faudrait aussi éviter de prendre des mesures fiscales dissuasives telles que la suppression de l’indemnité compensatrice, et résoudre les problèmes de logement ou de transport des apprentis. Une mobilisation est également nécessaire pour que les jeunes de seize ans n’aient pas à chercher eux-mêmes une entreprise d’accueil. Il est en tout cas essentiel que ce thème fasse partie des contreparties – ou plutôt des accords de progrès – négociées dans chaque branche.
Par ailleurs, rien n’empêche de fixer dans chaque branche des quotas d’embauche, ou du moins des valeurs indicatives sur lesquelles pourraient s’appuyer les négociations menées au sein des entreprises. Le dialogue social fonctionne à deux niveaux : celui de la branche, qui donne les orientations, et celui des entreprises, qui permet de les concrétiser.
En revanche, je suis sceptique quant aux sanctions, car je ne vois pas comment elles pourraient être appliquées à des millions d’entreprises. Il est facile de sanctionner les entreprises de plus de 5 000 salariés, qui ne sont guère nombreuses. Mais il en va tout autrement pour la multitude de PME et de TPE françaises, sauf à mobiliser une armée de contrôleurs. Je n’ai rien contre l’idée de faire planer l’ombre de sanctions, mais je crains que leur généralisation ne puisse être effectuée qu’au prix d’une énorme bureaucratie.
Cela étant, les entreprises resteront soumises à ce qu’Arnaud Montebourg appelle le « jugement de l’opinion publique », un jugement dont les représentants du secteur de la restauration ont mesuré l’importance depuis que tout le monde a compris à quel point le Gouvernement s’était fait « rouler » en acceptant de réduire le taux de TVA. Si les conditions sont réunies, une pression s’exercera pour que soient respectés les engagements négociés dans les branches.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Pourquoi ne pas négocier à l’échelle de l’entreprise, plutôt que de se contenter d’une information-consultation ?
M. Louis Gallois. La négociation dans les branches doit être déclinée dans les entreprises, ce qui n’empêche pas une négociation au sein de l’entreprise elle-même. Certains sujets s’y prêtent, d’autres non.
Par ailleurs, on ne peut laisser le chef d’entreprise complètement désarmé. Vous avez cité l’embauche d’un chercheur ou d’un responsable des ventes : de telles décisions relèvent de la responsabilité du chef d’entreprise, elles ne se négocient pas avec les syndicats. À chacun son métier. On peut négocier sur l’apprentissage ou la formation professionnelle, demander que les allégements de charges ne servent pas à augmenter les dividendes ou les rémunérations des dirigeants, mais pas entrer à ce point dans le détail.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Il est cependant possible de demander aux entreprises de négocier, dans le cadre donné par la branche, sur les moyens d’améliorer leur compétitivité, avec obligation de parvenir à un accord. C’est ce qui se passe avec les contrats de génération : la négociation ne vise pas à désigner les salariés concernés, mais à rechercher comment faire de la place aux jeunes, garder les seniors – quitte à adapter leur poste – et organiser la transmission des connaissances. L’obtention d’un accord d’entreprise serait la condition posée à l’accès aux 10 milliards d’euros d’effort public supplémentaire. C’est en effet ex ante qu’il faut discuter de leur usage, plutôt que de critiquer ex post les décisions prises par les chefs d’entreprise.
M. Louis Gallois. Ce qui me rend hésitant, c’est l’expression : « accord d’entreprise ». Tout d’abord, et vous l’avez admis vous-même, un tel accord a un sens dans les grandes entreprises, mais beaucoup moins dans les TPE et PME, qui constituent l’essentiel du tissu industriel français. Non seulement il ne fait pas partie de leur tradition, mais elles ont besoin, pour toute négociation, d’aller chercher les partenaires sociaux à l’extérieur. Je serais favorable à une obligation de consultation s’appuyant sur l’accord de branche – car les branches constituent le bon niveau pour de telles discussions, même si leur nombre est beaucoup trop élevé en France –, voire à une déclinaison de ces accords dans les entreprises sous le regard des partenaires sociaux, mais je ne sais pas s’il faut aller jusqu’à réclamer la conclusion d’un accord d’entreprise, sans parler d’en faire la condition pour bénéficier des allégements supplémentaires. La sanction serait de toute façon difficile à appliquer, puisque, dans une telle hypothèse, certaines entreprises devraient payer les cotisations familiales et d’autres non. Mais ce n’est qu’une opinion personnelle.
M. le coprésident Jean-Marc Germain. Merci, monsieur le commissaire général, pour cet entretien très utile qui conclut, avec l’audition de la ministre concernée, nos travaux sur le financement de la branche famille.
1 () Communication disponible sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/mecss/mecss_index.asp.
2 () Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
3 () O. Thévenon, « Les politiques familiales des pays développés : des modèles contrastés », Populations et sociétés, n° 448, septembre 2008.
4 () L’Irlande a un taux de fécondité de 2,07 enfants par femme depuis 2008.
5 () INSEE, Marché du travail - Séries longues, 2012.
6 () Marie-Cécile Cazenave, Jonathan Duval, Tania Lejbowicz, Juliette Stehlé, La redistribution : état des lieux en 2012, INSEE.
7 () Caisse nationale des allocations familiales, Comparaison européenne des aides aux familles, janvier 2009.
8 () Il s’agit des dépenses consacrées spécifiquement par les États à la famille et aux enfants dans le cadre de la protection sociale. Ces données sont rassemblées par Eurostat dans un cadre harmonisé, le Système européen de statistiques intégrées de protection sociale (SESPROS).
9 () L’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande et la Suisse arrivent en tête avec plus de 2 000 euros annuels versés pour un enfant, ce chiffre étant supérieur à 1 100 euros pour la Belgique, les Pays-Bas et les pays nordiques.
10 () Créée par les articles 127 à 135 de la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 pour 1991.
11 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, rapport d’étape, état des lieux, communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, novembre 2012.
12 () Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
13 () Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
14 () Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
15 () Le nombre d’enfant moyen par famille de deux enfants et plus (nombre d’enfants à partir duquel sont versées les prestations familiales) a reculé de 1,2 % depuis 2000 et la part totale des familles de trois enfants et plus dans le total des familles est passé de 21,4 % en 1990 à 18,3 % en 2008.
16 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, rapport d’étape, état des lieux, communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, novembre 2012.
17 () Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
18 () Versé sans condition de ressources mais modulé en fonction des ressources.
19 () Entre 820 millions d’euros et 1,2 milliard d’euros.
20 () Projection de la situation financière de la branche à l’horizon 2025, note adoptée par le Haut Conseil de la famille le 9 septembre 2010.
21 () Croissance de long terme de 1,5 % par an et taux de chômage diminuant jusqu’à 4,5 %.
22 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, rapport d’étape, état des lieux, communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, novembre 2012.
23 () Validées dans le cadre du Comité d’orientation des retraites.
24 () Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport sur les perspectives de financement à moyen-long terme des régimes de protection sociale, janvier 2014.
25 () A. Math, « Le financement de la politique familiale : faut-il supprimer les cotisations sociales de la branche famille ? », Revue de droit sanitaire et social, n° 6, novembre-décembre 2013.
26 () Ce montant va permettre la création nette, sur 5 ans, de 100 000 solutions d’accueil collectif pour les enfants de moins de 3 ans. La branche participera également au développement de l’accueil individuel pour assurer la prise en charge de 100 000 enfants supplémentaires en 5 ans.
27 () Discours du 8 novembre 1982, Marseille.
28 () Dans le secteur public, l’État instaura en 1860 par circulaire impériale un supplément familial de traitement au bénéfice des marins et inscrits maritimes. Des avantages analogues furent créés pour les salariés des chemins de fer et de la Poste.
29 () Ne restent en dehors du champ de compétence des CAF que les exploitants et salariés agricoles (Mutualité sociale agricole – MSA), les employés de la RATP et de la SNCF, ainsi que les fonctionnaires en poste à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.
30 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, rapport d’étape, état des lieux, communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, novembre 2012.
31 () Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport d’étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale, 7 juin 2013.
32 () Personnes en incapacité pour accident du travail, chômeurs, familles rurales françaises, travailleurs indépendants, pensionnés, en cas de maladie ou de maternité, aux invalides et aux veuves.
33 () A. Math, « Le financement de la politique familiale : faut-il supprimer les cotisations sociales de la branche famille ? », Revue de droit sanitaire et social, n° 6, novembre-décembre 2013.
34 () INSEE, enquêtes Emploi du 1er au 4e trimestre 2012.
35 () INSEE, Femmes et Hommes – Regards sur la parité, édition 2012.
36 () Au sens de l’activité professionnelle.
37 () Elle est aussi liée aux types d’emplois qu’elles occupent car le recours au temps partiel est fréquent dans les métiers peu qualifiés du tertiaire, exercés surtout par des femmes.
38 () M. Yves Bur, Rapport au Premier ministre sur l’évolution du financement de la branche famille, décembre 2009 (non publié).
39 () L’hypothèse basse ne reprenant que les prestations destinées aux seuls actifs.
40 () Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport d’étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale, 7 juin 2013.
41 () A. Math, « Le financement de la politique familiale : faut-il supprimer les cotisations sociales de la branche famille ? », Revue de droit sanitaire et social, n° 6, novembre-décembre 2013.
42 () Les « dépenses en nature » des parents.
43 () Soit 8,9 % du PIB et 11 200 euros par enfant.
44 () Prestations familiales, action sociale et subventions aux modes de garde, suppléments d’aide au logement et de RSA pour les enfants, aide sociale à l’enfance…
45 () Part des cotisations employeurs maladie affectées aux dépenses de soins pour les enfants ou à la maternité, dépenses d’éducation en particulier à travers la taxe d’apprentissage, prestations et services directement aux familles.
46 () Loi n° 93–935 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage.
47 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, second cahier, mai 2013.
48 () Loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale.
49 () Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
50 () Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.
51 () La réduction porte sur 26 points de cotisations pour l’ensemble des branches de sécurité sociale au niveau du SMIC, elle décroît avec la progression du salaire et s’annule à 1,6 SMIC (loi de finances initiale du 30 décembre 2004). Elle est majorée de 2,1 points dans les entreprises de moins de 20 salariés (loi de finances initiale du 21 décembre 2007).
52 () Elle reflète la sinistralité de l’entreprise et n’a pas, à ce titre, vocation à donner lieu à exonération.
53 () Fonds national d’aide au logement, taxe d’apprentissage, participation à la formation professionnelle, participation à l’effort de construction et, le cas échéant, versement transport.
54 () Cour des comptes Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne, Rapport public thématique, mars 2011.
55 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, second cahier, mai 2013.
56 () 10 milliards d’euros dès la première année, puis 5 milliards d’euros supplémentaires par an au cours des deux années suivantes.
57 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, second cahier, mai 2013.
58 () DREES, La protection sociale en France et en Europe en 2010, n° 170, juin 2012.
59 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, rapport d’étape, état des lieux, communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, novembre 2012.
60 () A. Math, « Le financement de la politique familiale : faut-il supprimer les cotisations sociales de la branche famille ? », Revue de droit sanitaire et social, n° 6, novembre-décembre 2013.
61 () C. Chavagneux, Pourquoi le Pacte de responsabilité n’améliorera pas les marges des entreprises et ne créera pas d’emploi, blog sur alternatives-economiques.fr.
62 () Salaires nets et cotisations salariales et patronales.
63 () P. Cotis et A. Loufir, « Formation des salaires, salaire d’équilibre et incidence des cotisations sur le coût du travail », Économie et Prévision, n° 92-93, 1990.
64 () Y. Chassard et J-L Dayan, « Le modèle social européen est-il soluble dans la mondialisation », La note de veille, n° 109, Conseil d’analyse stratégique, 2008.
65 () Haut Conseil du financement de la protection sociale, « Le coût de la main-d’œuvre, comparaison européenne 1996-2011 », État des lieux du financement de la Protection sociale en France, tome II, octobre 2012.
66 () Point d’étape des travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale relatifs à l’évolution du financement de la protection sociale, février 2014.
67 () Il est de 42 milliards d’euros en 2012.
68 () Il est de 18 milliards d’euros en 2012.
69 () M. Louis Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, 5 novembre 2012.
70 () Point d’étape des travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale relatifs à l’évolution du financement de la protection sociale, février 2014.
71 () European Commission, European Competitiveness Report, 2010.
72 () L. Cordonnier, T. Dallery, V. Duwicquet, J. Melmies, F. Vandevelde, Le coût du capital et son surcoût. Sens de la notion, mesure et évolution, conséquences économiques, rapport de l’Agence d’objectifs IRES, 2013.
73 () Qui sert à l’investissement productif.
74 () 28,1 % dans les entreprises de moins de 20 salariés depuis le 1er juillet 2007.
75 () DARES, Les allégements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, pour le Haut Conseil du financement de la protection sociale.
76 () En euros de 2009.
77 () Mises en œuvre dans le cadre de la réduction du temps de travail et dans le cadre de la réforme « Fillon » en 2003.
78 () É. Heyer et M. Plane, « Impact des allégements de cotisations patronales des bas salaires sur l’emploi, l’apport des modèles macroéconomiques », Revue de l’OFCE, Débats et politiques, 2012.
79 () Hypothèse médiane.
80 () C’est notamment le cas des activités de services administratifs et de soutien et des activités de transport.
81 () Point d’étape sur l’évolution du financement de la protection sociale, « Les résultats de simulations macro-économiques "test" », Haut Conseil du financement de la protection sociale, mars 2014.
82 () Décision n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010 relative à la loi organique relative à la gestion de la dette sociale.
83 () Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport d’étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale, 7 juin 2013.
84 () L’ensemble des scénarios envisagés par le Haut Conseil du financement de la protection sociale sont détaillés dans l’annexe 1 du présent rapport.
85 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, second cahier, mai 2013.
86 () Il s’agit d’un dispositif visant à éviter les effets de seuil en prévoyant une baisse progressive des cotisations sociales entre 1 et 2,3 SMIC.
87 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, second cahier, mai 2013.
88 () L’évolution de l’économie en l’absence des réformes constitue un « compte central » ou compte de référence. L’évolution simulée de l’économie suite à une réforme constitue une variante, le plus souvent analysée en écart au compte central.
89 () Cour des comptes, Le financement de la branche famille, second cahier, mai 2013.
90 () Rapports au Premier ministre de Jean-François Chadelat sur la réforme des cotisations patronales, (juin 1997) et d’Edmond Malinvaud sur les cotisations sociales à la charge des employeurs (juillet 1998).
91 () Y. Benard, B. Delpal, JB. Nicolas, Rapport du groupe de travail sur l’élargissement de l’assiette des cotisations employeurs de sécurité sociale, Conseil d’orientation pour l’emploi, juin 2006.
92 () Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport d’étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale, 7 juin 2013.
93 () Saisi par le Premier ministre le 19 décembre 2013.
94 () Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
95 () Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération.
96 () Ce dispositif se substitue au dispositif « accords seniors » pour lequel une pénalité a été instituée à compter du 1er janvier 2010 à la charge des entreprises non couvertes par un accord ou un plan d’action relatif au recrutement ou au maintien dans l’emploi des salariés âgés. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, reposait sur une pénalité mensuelle de 1 % des gains et rémunérations versées en cas d’absence d’accord, ledit accord pouvant être conclu au niveau de la branche.
97 () M. Éric Besson, TVA sociale, rapport au Premier ministre, septembre 2007.
98 () M. Jean-Pierre Door, Rapport d’information déposé par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en conclusion des travaux de la MECSS sur l’organisation et le coût de gestion des branches de la sécurité sociale, XIIe législature, n° 2680, novembre 2005.
99 () OCDE, France : redresser la compétitivité, novembre 2013.
© Assemblée nationale