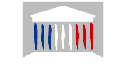
N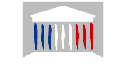
° 2592
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 février 2015.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ
DES CHANCES ENTRE HOMMES ET LES FEMMES,
sur le projet de loi (n° 2302) relatif à la santé,
PAR
Mmes Catherine COUTELLE et Catherine QUÉRÉ,
Députées
——
(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.
La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est composée de : Mme Catherine Coutelle, présidente ; Mme Conchita Lacuey, Mme Monique Orphé, M. Christophe Sirugue, Mme Marie-Jo Zimmermann, vice-président-e-s ; Mme Édith Gueugneau ; Mme Cécile Untermaier, secrétaires ; Mme Laurence Arribagé ; Mme Marie-Noëlle Battistel ; Mme Huguette Bello ; Mme Brigitte Bourguignon ; Mme Marie-George Buffet ; Mme Pascale Crozon ; M. Sébastien Denaja ; Mme Sophie Dessus ; Mme Marianne Dubois ; Mme Virginie Duby-Muller ; Mme Martine Faure ; M. Guy Geoffroy ; Mme Claude Greff ; Mme Françoise Guégot ; Mme Sonia Lagarde ; Mme Geneviève Levy ; Mme Sandrine Mazetier ; M. Jacques Moignard ; Mme Dominique Nachury ; Mme Maud Olivier ; Mme Bérengère Poletti ; Mme Barbara Pompili ; Mme Josette Pons ; Mme Catherine Quéré ; Mme Barbara Romagnan ; M. Gwendal Rouillard ; Mme Maina Sage ; Mme Sylvie Tolmont ; M. Philippe Vitel.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
PREMIÈRE PARTIE : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE SANTÉ ET MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX FEMMES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE SOINS 9
I. LA SANTÉ DES FEMMES : UN PORTRAIT CONTRASTÉ 9
A. DES ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX FEMMES 9
1. Un avantage féminin en termes d’espérance de vie mais avec davantage d’incapacités et une moins bonne santé perçue 9
2. Une évolution des comportements peu favorables à la santé des femmes : progression du tabagisme et de l’obésité 13
3. Des pathologies particulières et des vulnérabilités plus grandes face à certains risques en matière notamment de santé au travail 15
B. DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 21
1. Des situations de précarité qui concernent davantage les femmes et en particulier les mères célibataires 22
2. Une surreprésentation des femmes parmi les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et des renoncements aux soins plus souvent déclarés 23
3. De fortes inégalités sociales entre femmes, en particulier pour le suivi des grossesses, l’obésité et les dépistages de cancers féminins 24
II. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE POUR AMÉLIORER LA PRÉVENTION, L’ÉGAL ACCÈS AUX SOINS ET LA PRISE EN CHARGE 29
A. PLUSIEURS MESURES DU PROJET DE LOI SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LES FEMMES 29
1. Une rénovation profonde du cadre de la politique de santé 29
2. Le renforcement de la prévention : parcours éducatif en santé, information nutritionnelle et mesures de lutte contre le tabagisme 31
3. Des mesures pour faciliter au quotidien les parcours de santé, améliorer l’accès aux soins et adapter les compétences des sages-femmes et des infirmier-e-s 35
B. DES MESURES COMPLÉMENTAIRES POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION DU GENRE DANS LA POLITIQUE DE SANTÉ 39
1. Adapter le pilotage des politiques de santé 39
2. Améliorer l'accès aux soins et à la prévention et préciser les compétences des sages-femmes 44
3. Adapter la prise en charge des femmes en tenant compte de leurs spécificités dans les diagnostics et traitements et améliorer l’accompagnement des parturientes 45
DEUXIÈME PARTIE : CONFORTER LES AVANCÉES EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 49
I. AMÉLIORER L’ACCÈS À L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG) SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 49
A. L’AVORTEMENT : UN CHOIX ET UN DROIT DONT LA PLEINE EFFECTIVITÉ SE HEURTE ENCORE À CERTAINES DIFFICULTÉS 49
1. Les principales évolutions intervenues en matière de recours à l’IVG 50
2. Le développement de la méthode médicamenteuse 56
3. La persistance de difficultés d’accès à l’IVG liées notamment à l’organisation de l’offre de soins et au parcours des femmes 60
B. DES AVANCÉES MAJEURES SUR LA PÉRIODE RÉCENTE 70
1. Les mesures mises en œuvre depuis 2012 pour conforter le droit des femmes à disposer de leur corps 70
2. La résolution réaffirmant le droit fondamental à l’IVG en France et en Europe, adoptée par l’Assemblée nationale le 26 novembre 2014 71
3. La possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG médicamenteuses, prévue par le projet de loi, et le plan d'action national pour améliorer l’accès à l’avortement présenté en janvier 2015 72
C. LES RECOMMANDATIONS DE LA DÉLÉGATION 75
1. Améliorer et simplifier le parcours des femmes qui souhaitent avorter 75
2. Améliorer l’organisation de l’offre de soins et élargir les possibilités de pratiquer des IVG chirurgicales sous anesthésie locale 78
3. Éclairer les zones d’ombre 82
II. FACILITER L’ACCÈS À LA CONTRACEPTION ET DÉVELOPPER LES ACTIONS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 83
A. PRATIQUES CONTRACEPTIVES EN FRANCE ET ÉVOLUTION RÉCENTE 83
1. Un modèle contraceptif en voie d’évolution 83
2. Des obstacles encore à lever notamment s’agissant des mineures 86
B. LA CONTRACEPTION D’URGENCE 92
1. Une solution de rattrapage au succès grandissant 92
2. Des conditions d’accès simplifiées par le projet de loi 95
III. RENFORCER LE DÉPISTAGE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST) 100
A. UNE PLUS GRANDE VULNÉRABILITÉ DES FEMMES AUX IST 100
B. LES MESURES PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI 101
TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION 105
I. COMPTES RENDUS DES AUDITIONS DE LA DÉLÉGATION 105
Audition de Mme Francoise Laurant, présidente de la commission "Santé, droits sexuels et reproductifs" du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), ancienne présidente du Planning familial 105
Audition de Mme Dominique Henon, membre du CESER d'Île-de-France, ancienne conseillère du Conseil economique, social et environnemental (CESE) et rapporteure de la Délégation aux droits des femmes du CESE sur la santé des femmes en France 114
Audition de Mme Nathalie Bajos, socio-démographe, directrice de recherche, responsable de l’équipe "Genre, santé sexuelle et reproductive" (INSERM-INED) 126
Table ronde avec des représentant-e-s du Collège national des sages-femmes (CNSF), de l'Association nationale des centres d'IVG et de contraception (ANCIC), du réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie (REHVO) et du Syndicat national des infirmier-e-s conseiller-e-s de santé (SNICS) 134
Audition de Mme Véronique Séhier, coprésidente du Mouvement français pour le Planning familial, et de Mme Danielle Gaudry, membre du bureau national 153
Audition de M. François Bourdillon, directeur général de l’Institut national pour la prévention et l’éducation à la santé (INPES) et de l'Institut de veille sanitaire 160
Table ronde avec des réprésentant-e-s de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et des médecins du travail 171
Audition de M. Claude Evin, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France et ancien ministre 183
Audition de Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 193
II. EXAMEN DU RAPPORT EN DÉLÉGATION 203
SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 213
ANNEXES 217
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 217
ANNEXE 2 : TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIFS DE TYPE « PASS CONTRACEPTION » MIS EN PLACE DANS SEPT RÉGIONS 221
Adopté en Conseil des ministres le 15 octobre 2014, le projet de loi relatif à la santé (n° 2302) porte une politique de santé structurante et novatrice au cœur du pacte républicain pour faire progresser la solidarité et la justice sociale. Il marque la volonté de conforter l’excellence du système français et de relever les défis liés à la prise en charge des maladies chroniques, au vieillissement de la population et aux difficultés financières d’accès aux soins. Il s’agit également de répondre aux enjeux de simplification des organisations et d’efficience de la gestion des ressources. Comportant 57 articles, le projet de loi se fonde essentiellement sur trois axes :
– prévenir avant d’avoir à guérir et pour cela, des nouvelles mesures sont nécessaires pour faire reculer le tabagisme, lutter contre l’image positive de la cigarette et de l’ivresse chez les jeunes et concourir à la prévention de l’obésité, par la diffusion d’une information nutritionnelle simplifiée ; par ailleurs, chaque enfant aura désormais la possibilité d’être suivi par un médecin traitant, et l’éducation pour la santé sera renforcée, tandis que la création d’un grand institut de santé publique contribuera à développer une forte culture en la matière ;
– faciliter la santé au quotidien, à travers notamment la généralisation du tiers payant à partir de 2017, mais aussi l’élargissement des tarifs sociaux pour les soins d’optique et de prothèses dentaires et auditives à tous les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), soit un million de foyers de plus qu’aujourd’hui, ainsi que l’organisation de l’information du public sur la santé dans le cadre d’un service public ;
– innover pour conforter l’excellence du système de santé : pour cela, outre la rénovation du service public hospitalier et la généralisation de l’engagement des établissements dans des projets médicaux communs de territoire, la réforme vise à donner aux professionnels des outils pour mieux travailler ensemble, avec la création du service territorial de santé au public ainsi que la refondation du dossier médical partagé (DMP). Par ailleurs, le projet de loi crée le cadre d’un exercice en pratique avancée pour les professions paramédicales et l’organisation d’un système national des données de santé.
Deux dispositions du projet de loi concernent directement les femmes et les jeunes filles, avec la possibilité donnée aux infirmier-e-s scolaires de délivrer la contraception d’urgence (article 3) et aux sages-femmes de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse (article 31). Ces mesures s’inscrivent dans la continuité des actions volontaristes engagées, sous l’impulsion de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Mme Marisol Touraine, pour conforter le droit des femmes à disposer de leur corps. Par ailleurs, au-delà des mesures visant à faciliter l’accès à la contraception et l’avortement, le projet de loi comporte des dispositions qui n’apparaissent pas comme des mesures spécifiques en direction des femmes, mais qui auront un impact positif sur la santé et l’accès aux soins des femmes, comme l’a souligné la ministre lors de son audition.
C’est pourquoi la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a souhaité être saisie de ce projet de loi important par la commission des Affaires sociales, à la fin du mois de novembre 2014 (1). Outre l’examen des dispositions prévues par ce texte, il est apparu nécessaire de saisir cette occasion pour, d’une part, dresser le bilan de l’accès à la contraception et à l’IVG, comme la délégation l’avait prévu dès l’automne 2012 (2), en s’inscrivant ainsi dans la continuité des travaux engagés sur ces questions sous les précédentes législatures (3). Il convenait, d’autre part, d’examiner certaines problématiques spécifiques à la santé des femmes, ce qui suppose notamment de prendre en compte le clivage social grandissant au sein même de la population féminine, en adoptant donc une double approche sexuée et sociale.
Dans cette perspective, une vingtaine de personnes ont été entendues, au cours de neuf réunions de la délégation, en apportant des éclairages complémentaires sur ces questions : expertes, professionnel-le-s de santé (sages-femmes, infirmier-e-s scolaires, médecin généraliste, gynécologues), représentantes du Planning familial, responsables d’organismes publics, tels que l’Institut national pour la prévention et l’éducation à la santé (INPES), l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh). La délégation a conclu ses travaux par l’audition de M. Claude Evin, ancien ministre et directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, et de la ministre Marisol Touraine (cf. la liste des personnes auditionnées en annexe n° 1).
Vos rapporteures ont par ailleurs entendu la présidente du Conseil national de l’ordre des sages-femmes ainsi que le président de la Fédération nationale des centres de santé, et adressé un questionnaire aux présidents de région concernant les dispositifs de « Pass contraception » (cf. le tableau comparatif en annexe n° 2).
Au terme de ces travaux, la délégation a adopté le présent rapport ainsi qu’une série de recommandations concernant la prévention, l’accès aux soins et la prise en charge des femmes (première partie) ainsi que la santé sexuelle et reproductive (seconde partie).
PREMIÈRE PARTIE : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE SANTÉ ET MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX FEMMES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE SOINS
Si les femmes bénéficient d’un atout sur le plan de la santé en termes d’espérance de vie, la comparaison de leur santé avec celle des hommes, à partir des principaux indicateurs et données épidémiologiques, livre un tableau finalement contrasté, avec des enjeux spécifiques mais aussi la persistance d’inégalités sociales de santé (I).
Outre les dispositions sur la pilule du lendemain et l’avortement, qui seront examinées dans la seconde partie du présent rapport, le projet de loi relatif à la santé comporte plusieurs mesures qui, sans viser spécifiquement les femmes, sont néanmoins susceptibles d’avoir un impact positif sur leur santé, et que vos rapporteures proposent de compléter sur quelques points (II).
I. LA SANTÉ DES FEMMES : UN PORTRAIT CONTRASTÉ
Si plusieurs spécificités générales peuvent être identifiées concernant la santé des femmes comparativement à celle des hommes (A), il existe aussi une forte hétérogénéité au sein même de la population féminine, en lien avec les inégalités sociales et territoriales de santé (B).
A. DES ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX FEMMES
Si les femmes vivent plus longtemps (1), cet avantage doit être relativisé, compte tenu notamment de l’évolution de leurs comportements de santé, en matière de tabagisme par exemple (2), mais aussi de pathologies particulières et d’une plus grande vulnérabilité par rapport à certains risques de santé (3).
1. Un avantage féminin en termes d’espérance de vie mais avec davantage d’incapacités et une moins bonne santé perçue
L’avantage féminin en matière de santé apparaît dans la plupart des indicateurs issus de sources administratives, comme le souligne une étude récente de la DREES (4). En particulier, l’espérance de vie des femmes, qui est de 85,4 ans en 2014, soit l’une des plus élevées en Europe – avec des disparités régionales : elle varie ainsi de 82,8 ans dans le Nord-Pas-de-Calais à 85,5 ans en Île-de-France – est sensiblement plus élevée que celle des hommes. Elles bénéficient également d’un taux de mortalité plus faible à chaque âge. Depuis plusieurs années, on constate cependant une réduction de l’écart entre femmes et hommes concernant l’espérance de vie à la naissance, et cet écart est encore plus resserré en termes d’espérance de vie en bonne santé (cf. infra).
ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE PAR SEXE EN 1994, EN 2004 ET EN 2014
Femmes |
Hommes |
Écart femmes-hommes | |
1994 |
81,9 ans |
73,6 ans |
8,3 ans |
2004 |
83,8 ans |
76,7 ans |
7,1 ans |
2014 (résultats provisoires) |
85,4 ans |
79,2 ans |
6,2 ans |
Lecture : L’espérance de vie correspond à la durée de vie moyenne d’une génération fictive qui aurait tout au long de son existence les conditions de mortalité par âge de l’année considérée. Ainsi, dans les conditions de mortalité de 2014, une femme vivrait en moyenne 85,4 ans et un homme 79,2 ans.
Sources : DREES (février 2015)
Par ailleurs, les femmes sont moins souvent en affection de longue durée (ALD) à âge donné, tandis que le taux d’hospitalisation en court séjour en médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie) des femmes est, à âge égal, comparable à celui des hommes jusqu’à 50 ans et inférieur au-delà, si l’on ne tient pas compte des hospitalisations liées à la maternité (5).
Cette plus grande longévité s’explique, pour partie, par des comportements de santé qui restent globalement plus favorables. Par exemple, la consommation d’alcool à risque est deux à trois fois moins fréquente que chez les hommes, dont le taux de décès par cancers des voies aérodigestives supérieures, cirrhoses alcooliques et psychoses alcooliques était quatre fois plus élevé en 2008. On estimait ainsi à 12 500 le nombre de décès attribuables à l’alcool chez les femmes en 2009 (5 % de la mortalité totale), contre 36 500 décès chez les hommes (13 %).
FRÉQUENCE DE L’USAGE QUOTIDIEN D’ALCOOL
AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS PAR ÂGE ET PAR SEXE EN 2010
(en %)
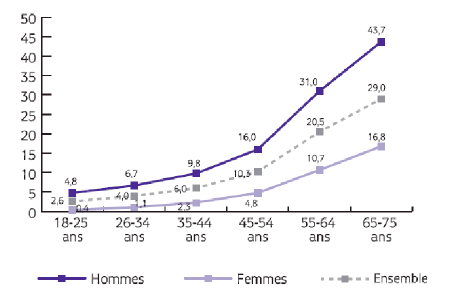
Source : INPES (Baromètre santé 2010)
Par ailleurs, si la proportion de fumeuses quotidiennes est élevée (26 % des 15-75 ans) et représente un enjeu majeur de santé publique (cf. infra), elle reste inférieure à celle des fumeurs quotidiens (32 %). Enfin, il est à noter que les hommes ont un taux de mortalité par mort violente supérieur de 2,3 à celui des femmes, parmi lesquelles les comportements agressifs et dangereux sont globalement moins répandus (6).
En outre, des études suggèrent que les femmes repèreraient plus systématiquement et précocement leurs maladies, compte tenu de leur plus grande proximité avec le système de soins, à travers leur vie reproductive ou la santé de leurs enfants et proches. Tout au long de leur vie, les femmes sont ainsi plus nombreuses à déclarer consulter des médecins généralistes, pour partie en raison des suivis médicaux liés à la contraception, la grossesse et la ménopause (7). Il convient d’ailleurs de s’interroger sur l’influence des représentations sociales en la matière, qu’il s’agisse du rôle supposé de la femme en tant que gestionnaire de la santé du groupe familial ou, plus largement, des responsabilités, qui de fait leur incombent encore largement, en matière de soins à la personne (care).
Vos rapporteures soulignent toutefois l’importance de dépasser une approche, par trop simpliste, de la santé des femmes, qui serait appréciée à la seule aune de l’espérance de vie à la naissance, et donc de démonter l’idée reçue selon laquelle les femmes sont en meilleure santé que les hommes, comme l’a justement fait valoir la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes lors de son audition, et ce pour au moins trois raisons.
Tout d’abord, si les femmes vivent plus longtemps, elles passent une partie de ces années supplémentaires avec des maladies, des incapacités et en situation de dépendance, comme l’illustre le graphique ci-après, et sont par ailleurs plus concernées par l’isolement. Ainsi, à 65 ans, hommes et femmes peuvent espérer vivre une petite dizaine d’années sans se sentir limités dans les activités du quotidien. Mais les femmes vivent en moyenne trois à quatre années de plus que les hommes avec des difficultés, notamment dans l’accomplissement des tâches domestiques, et deux années de plus avec des gênes dans les activités de soins personnels – une situation assimilable à une forme sévère de dépendance (8).
Cette situation serait en partie liée à des différences dans la fréquence et la nature des maladies touchant les hommes et les femmes. En effet, selon une étude récente de l’Institut national des études démographiques (INED), les femmes déclarent en moyenne davantage de maladies sources d’incapacités, telles que des maladies ostéo-articulaires ou des troubles anxio-dépressifs, tandis que les hommes ont plus d’accidents et de maladies cardiovasculaires ou de cancers, certes invalidants mais caractérisés aussi par un fort risque de décès (9).
ÉCART ENTRE L’ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE ET L’ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES EN 2010
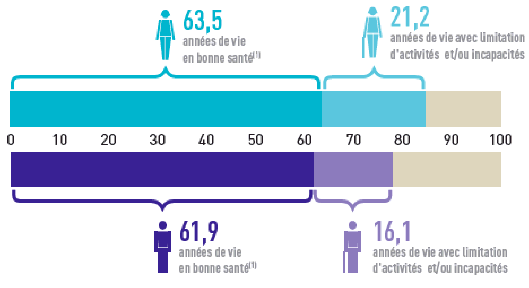
Source : ministère des Droits des femmes (2014)
D’autre part, les résultats des enquêtes auprès des ménages livrent un diagnostic moins favorable puisqu’à âge égal, les femmes se déclarent en moins bonne santé que les hommes.
SANTÉ PERÇUE PAR SEXE ET PAR CLASSE D’ÂGE EN 2010
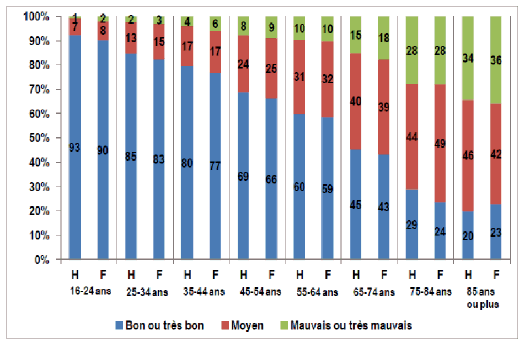
Source : enquête européenne sur les revenus et les conditions de vie (SILC-2010)
Enfin, la plus grande longévité des femmes doit être tempérée par l’évolution de leurs comportements de santé, d’une part, et par des pathologies et vulnérabilités particulières, d’autre part.
2. Une évolution des comportements peu favorables à la santé des femmes : progression de l’obésité et tabagisme
Le tabac, l’alcool et la nutrition sont des déterminants majeurs de santé. À cet égard, Mme Dominique Henon, auteure d’un rapport sur La santé des femmes en France au titre de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du CESE en 2010, a souligné, lors de son audition, le développement de comportements à risque chez les femmes, concernant notamment la consommation de tabac, et qui se traduisent par un accroissement du cancer du poumon, des maladies chroniques et des pathologies cardiovasculaires.
En effet, l’usage quotidien du tabac est particulièrement élevé chez les femmes en âge de procréer, comme le souligne l’étude d’impact du présent projet de loi : il concerne 20 % des 15-19 ans, 38 % des 20-25 ans, 35 % des 26-34 ans et 34 % des 35-44 ans. L’impact sanitaire et social est majeur : le tabac est à l’origine de 73 000 décès par an, soit 200 personnes par jour, et représente la première cause évitable de mortalité et la première cause de cancers. Chez les femmes, le directeur général de l’INPES, M. François Bourdillon, a attiré l’attention de la délégation sur le croisement prochain des courbes de décès par cancer du sein et du poumon, lors de son audition par la délégation.
EN 2015, LE CANCER DU POUMON TUERA PLUS QUE LE CANCER DU SEIN
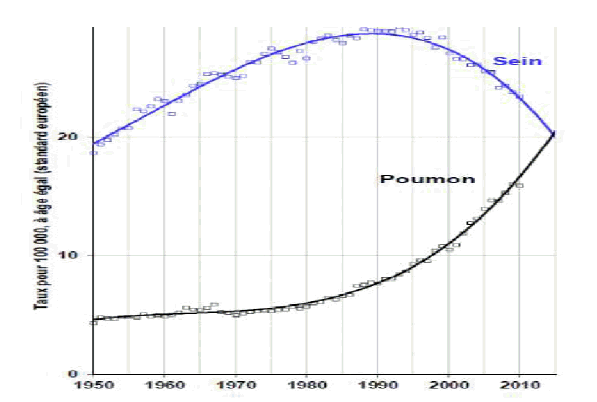 Source : intervention de M. Bourdillon lors d’un colloque organisé en 2013 par la Haute Autorité de santé sur la santé des femmes (office français de prévention du tabagisme, Bertrand Dautzenberg)
Source : intervention de M. Bourdillon lors d’un colloque organisé en 2013 par la Haute Autorité de santé sur la santé des femmes (office français de prévention du tabagisme, Bertrand Dautzenberg)
À cet égard, la ministre Marisol Touraine a fait observer lors de son audition, que depuis quarante ans, le nombre de fumeuses a stagné, alors que le nombre de fumeurs a été divisé par deux, en relevant également que 17 % des femmes restent fumeuses au troisième trimestre de grossesse, soit une proportion plus élevée que d’autres pays. Par ailleurs, les jeunes filles semblent attirées par l’image « émancipatrice » de la cigarette.
Par ailleurs, si, la consommation de boissons alcoolisées reste plus importante chez les hommes (10), il est à noter que l’usage régulier d’alcool des adolescentes a progressé entre 2008 et 2011 (de 4 % à 5,6 %, à 17 ans). Les alcoolisations ponctuelles importantes (au moins 6 verres en une seule occasion au cours du dernier mois précédant l’enquête) concernent près d’un tiers des jeunes dès la fin de l’adolescence, et la moitié des étudiants déclarent avoir connu au moins une ivresse dans l’année en 2010, et ces usages d’alcools à risque ponctuel ont augmenté de manière très prononcée chez les jeunes femmes (11). S’agissant des femmes enceintes, on estime les syndromes d’alcoolisation fœtale entre 700 et 3 000 enfants par an, c’est-à-dire 5 pour 1 000 naissances, ce qui est loin d’être anodin, comme l’a précisé M. François Bourdillon. Il convient par ailleurs de rappeler que l’alcool est la première cause non génétique et évitable de handicap mental des nouveau-nés (12).
Enfin, en matière de nutrition, il apparaît que si les femmes sont plus attentives à leur alimentation et sont moins souvent en surpoids que les hommes , l’obésité concerne davantage les femmes (15,7 % de la population féminine en 2012, contre 14,3 % des hommes) et progresse depuis quelques années, phénomène caractérisé par des disparités sociales importantes et plus marquées chez les femmes (cf. infra), ce qui les expose à un risque accru de maladies chroniques (diabète, cancers, maladies cardiovasculaires, etc.) dans les catégories populaires ainsi que chez les enfants.
RÉPARTITION DE LA POPULATION MASCULINE ET FÉMININE PAR NIVEAU D’INDICE DE MASSE CORPORTELLE (IMC) DEPUIS 1997
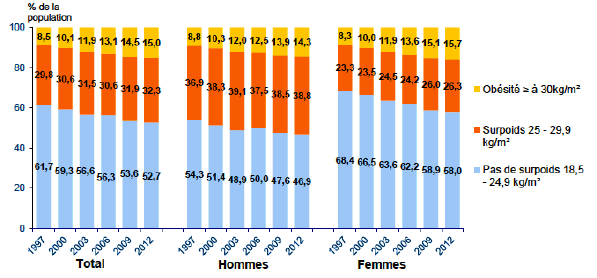
Source : enquête OBEPI-Roche 2012
En 2010, on considérait ainsi qu’un quart des décès féminins prématurés pourrait être évité par une réduction des comportements à risque (alcool, tabac, conduites dangereuses…), ce qui implique des actions volontaristes en matière de prévention, d’éducation à la santé et de prise en charge, et c’est précisément l’un des axes centraux de ce projet de loi.
3. Des pathologies particulières et des vulnérabilités plus grandes face à certains risques en matière notamment de santé au travail
● Des pathologies spécifiques, en particulier les cancers féminins
En 2012, le nombre de décès par cancer en France était estimé à 148 000, dont 85 000 hommes et 63 000 femmes (13). Pour les femmes, le cancer du sein se situe en tête de la mortalité, avec 11 900 décès, devant le cancer du poumon (8 600 décès) et le cancer colorectal (8 400 décès), comme l’illustre le graphique ci-dessous. Le taux de mortalité par cancer du sein chez la femme diminue néanmoins depuis près de quinze ans.
CLASSEMENT DES CANCERS PAR MORTALITÉ ESTIMÉE EN 2012 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR LOCALISATIONS SELON LE SEXE
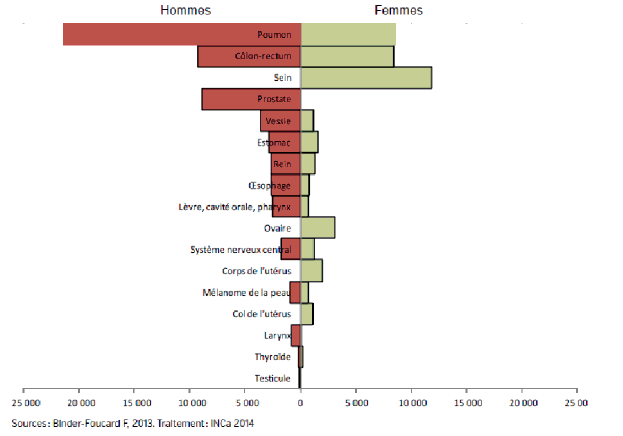
Source : Institut national du cancer (InCA, 2014)
À cet égard, Mme Dominique Henon a fait état de travaux de recherche selon lesquels le cancer du sein et le travail pourraient être liés, en indiquant que le Danemark a reconnu le cancer du sein comme une maladie professionnelle et que le travail de nuit mérite donc d’être étudié sous l’angle de la santé.
Par ailleurs, si le cancer du col de l'utérus poursuit sa décroissance en termes d’incidence et de mortalité, on estime en France métropolitaine en 2012 à près de 3 000 le nombre de nouveaux cas et à 1 100 celui des décès par ce cancer (14). Or il est possible d’agir très précocement contre ce cancer, grâce au dépistage par frottis, et la vaccination contre le virus HPV constitue un moyen complémentaire au dépistage pour agir face au cancer du col de l'utérus.
Les femmes peuvent aussi être confrontées à d’autres problèmes spécifiques de santé, tels que le cancer de l’ovaire, l’endométriose, à ce jour non guérissable et invalidante, qui mériterait d’être reconnue comme une maladie chronique, et qui peut entraîner une infertilité, ou encore l’hémorragie de la délivrance : 254 femmes sont ainsi décédées des suites de leur grossesse ou de leur accouchement entre 2007 et 2009, et environ 50 % de ces décès sont considérés comme évitables, selon une étude récente de l’INSERM (15).
● Des vulnérabilités plus grandes par rapport à certains risques de santé
Les femmes sont de fait davantage concernées par certaines problématiques de santé, et vos rapporteures soulignent en particulier l’importance de quatre d’entre elles :
– les troubles de l’alimentation tels que l’anorexie, qui concerne entre 30 000 et 40 000 personnes, dont 90 % de femmes et des jeunes files selon le rapport précité du CESE (2010) : c’est une des pathologies psychiatriques qui entraîne une forte mortalité, soit par complications, soit par suicide ;
– l’impact des violences faites aux femmes sur leur santé (violences physiques, sexuelles, sexistes, harcèlement, viols, etc.): en effet, un ouvrage récent (16) indique que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a étudié l’impact de ces violences en termes de santé publique et qu’il en ressort que les femmes victimes de violence perdent entre une et quatre années de vie en bonne santé et que les violences conjugales sont responsables du doublement des dépenses totales annuelles de santé des femmes ; par ailleurs, selon Mme Caroline Rey-Salmon, pédiatre des hôpitaux, médecin légiste et coordinatrice des unités médico-judiciaires (UMJ) de l’Hôtel-Dieu, 35% des femmes qui passent aux urgences seraient victimes de violences, elles ne déclarent pas les violences subies et seulement 2% des femmes battues sont identifiées comme telles à cette occasion (17) ; en outre, des études indiquent que moins de 10 % des personnes assurant avoir été victimes de violences sexuelles ou physiques au sein du couple ont porté plainte entre 2010 et 2013 ; enfin, selon un rapport du CESE publié en novembre 2014 (18) , le coût global lié aux violences conjugales serait estimé à environ 2,5 milliards d’euros, dont 483 millions d’euros de soins de santé ;– une vulnérabilité plus grande face aux risques d’infections sexuellement transmissibles (IST) – sur ce point, cf. infra dans l’analyse des dispositions du projet de loi ;
– enfin, l’anxiété et la dépression, qui semblent concerner davantage les femmes, mais aussi les risques psychosociaux et, au-delà plus largement les problématiques en termes de santé au travail, avec une progression importante des maladies professionnelles chez les femmes, et dans une moindre mesure des accidents du travail.
Sur le premier point, il apparaît que les femmes ont un risque accru de connaître un trouble dépressif, comme cela a été évoqué notamment par Mme Dominique Henon et M. François Bourdillon : ce risque serait de 1,5 à 2 fois plus élevé que les hommes (19), mais leurs troubles sont davantage dépistés et pris en charge. Par ailleurs, la ministre Marisol Touraine a souligné que les femmes déclarent deux fois plus souvent que les hommes subir de l’anxiété. Les tentatives de suicide sont par ailleurs plus fréquentes chez les femmes (elles représentent deux tiers des tentatives de suicide hospitalisées) mais se traduisent moins fréquemment par un décès (20).
Il conviendrait toutefois d’approfondir l’analyse des causes susceptibles d’expliquer de tels écarts entre hommes et femmes : en particulier, peut-il y avoir, même inconsciemment, des stéréotypes et représentations sociales qui conduisent des médecins à diagnostiquer davantage de dépressions chez les femmes ? Et dans quelle mesure cette plus grande fragilité sur le plan de la santé mentale peut-il s’expliquer également, pour partie, par les difficultés liées à l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle et la « double journée » des femmes, voire des représentations sociales culpabilisantes ou négatives – sur la carrière des femmes, les diktats de la « mère parfaite », etc. – mais aussi le harcèlement et les violences physiques, sexuelles et sexistes, y compris en milieu de travail ?
Sur le second point, on observe de fait des disparités entre femmes et hommes en matière de santé au travail, comme l’illustre l’infographie ci-après. Ainsi, comme l’a souligné Mme Florence Chappert, responsable du projet « Genre, santé et conditions de travail » à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), si les accidents du travail ont globalement baissé entre 2001 et 2012, ils progressent nettement pour les femmes (+ 20,3%). et, de façon encore plus marquée, pour les maladies professionnelles, qui progressent près de deux fois plus rapidement pour les femmes (+ 170 %) que pour les hommes sur la même période. Ces données sont issues d’une étude que l’ANACT a pris l’initiative de publier en 2014 (21), à partir d’une analyse sexuée et longitudinale des données sur la sinistralité publiées par la CNAMTS.
Certains secteurs d’activité sont plus particulièrement concernés (cf. tableau ci-après) et, pour les salariées, il s’agit en particulier des services de santé, de nettoyage et de travail temporaire. La pénibilité des métiers exercés majoritairement (par exemple, porter une personne âgée pour les aides à domicile) est aussi moins souvent prise en compte que pour les métiers occupés par des hommes.
SINISTRALITÉ AU TRAVAIL ET DISPARITÉS FEMMES-HOMMES
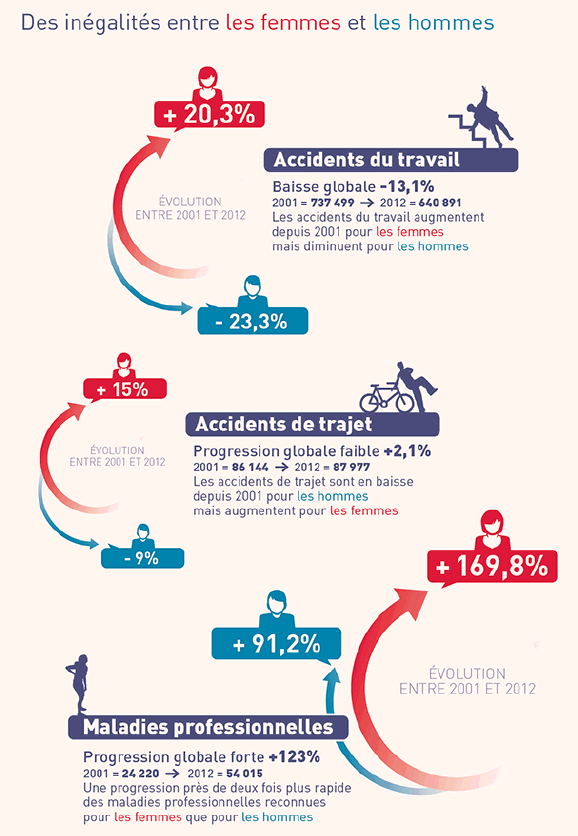
Source : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), avril 2014
ACCIDENTS DU TRAVAIL, ACCIDENTS DE TRAJET ET MALADIES PROFESSIONNELLES : BRANCHES LES PLUS ACCIDENTOGÈNES ET RÉPARTITION SELON LE SEXE EN 2012
Accidents du travail |
Accidents de trajet |
Maladies professionnelles | |
Hommes |
Bâtiments et travaux publics (BTP) industries transports, eau, gaz, électricité. |
Services, commerces et industries de l’alimentation et ceux de la santé, action sociale, nettoyage et travail temporaire |
Bâtiments et travaux publics (BTP) Métallurgie. |
Femmes |
Services de santé, nettoyage et travail temporaire et les services, commerces et industries de l’alimentation |
Services de santé, nettoyage et travail temporaire Secteurs de la banque, assurances et administrations. |
les services, commerces, et industries de l'alimentation services, santé, nettoyage et travail temporaire. |
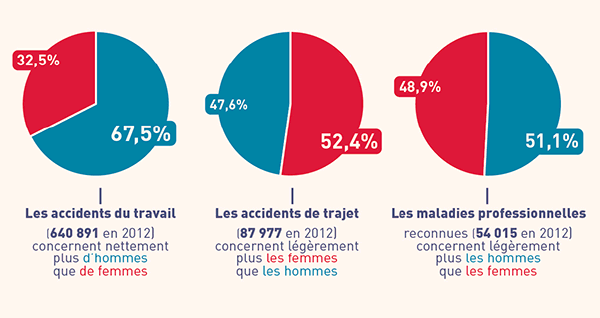
Source : ANACT (avril 2014)
Cette étude au regard du genre, par risque et par secteur, permet d’avancer que les différences constatées en termes de sinistralité des femmes et des hommes renvoient pour une grande partie à une exposition différenciée liée à des métiers distincts. Il convient également de souligner la problématique liée aux temps partiels, avec par exemple pour les aides à domicile plusieurs interventions chez différents employeurs et des risques d’accidents liés à la multiplication des trajets dans la même journée. Les politiques de santé et sécurité au travail pourraient mobiliser ce « regard genré » pour progresser dans la prévention de la sinistralité pour toutes et tous, ce qui implique de remédier au préalable aux lacunes actuelles en matière de données sexuées (cf. infra). En tout état de cause, il apparaît ainsi que les femmes et les hommes ne sont pas confrontés aux mêmes risques professionnels.
Concernant plus spécifiquement les risques psychosociaux (RPS), une étude publiée en 2014 (22) par le Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST), en s’appuyant sur l’enquête SUMER 2010 (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels), comporte plusieurs enseignements intéressants concernant les RPS et le genre. Il apparaît en effet que la probabilité pour les femmes d’être exposées à la tension au travail (23) est supérieure à celle des hommes. La surexposition des femmes aux RPS par rapport aux hommes se vérifie dans toutes les catégories socioprofessionnelles, et ce sont les ouvrier-e-s et les employé-e-s qui sont le plus exposées à la tension au travail, et non les cadres. Cela peut concerner des métiers d’accueil ou de médiation ou encore des métiers répétitifs, avec peu d’initiative et aucune autonomie en termes de temps.
SALARIÉS « TENDUS » PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE SELON LE SEXE EN 2010
Femmes |
Hommes | |
Cadres professions intellectuelles |
18,7 % |
15,4 % |
Professions intermédiaires |
28,8 % |
22,8 % |
Employés administratifs |
35,9 % |
33,1 % |
Employés de service |
30,2 % |
29,4 % |
Ouvriers qualifiés |
33,2 % |
25 % |
Ouvriers non |
36,7 % |
30,2 % |
Ensemble |
30,9 % |
24,4 % |
Source : enquête SUMER 2010 (étude précitée du LEST sur les risques psychosociaux et le genre, avril 2014)
Ce rapport met par ailleurs en évidence que les familles professionnelles à prédominance féminine présentent à la fois une surexposition aux RPS et une santé mentale fragilisée. En effet, les sept familles professionnelles, qui présentent l’état de santé mentale le plus dégradé sont majoritairement occupées par des femmes, par exemple les femmes de ménage, employées de banque etc (24). À l’autre pôle du spectre des professions ventilées selon leur état de santé mentale, les dix professions déclarant la santé mentale la meilleure sont à prédominance masculine, à l’exception des infirmier-e-s (25). Cela illustre ainsi l’importance de mener des actions volontaristes en faveur de la mixité des métiers, l’une des trois priorités fixées pour 2014 par le dernier comité interministériel aux droits des femmes (CIDFF).
B. DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
Plus exposées à la précarité (1), les femmes sont corrélativement surreprésentées parmi les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et déclarent plus souvent des renoncements aux soins (2). Par ailleurs, elles restent un groupe marqué par des disparités selon la position sociale, concernant par exemple l’obésité ou le recours aux dépistages (3).
1. Des situations de précarité qui concernent davantage les femmes et en particulier les mères célibataires
Les femmes sont plus touchées par la précarité que les hommes, avec nécessairement des répercussions sur leur accès aux soins (26). En 2011, le taux de pauvreté des femmes de moins de 65 ans excède celui des hommes d’1,3 point.
LES MÈRES SEULES PLUS TOUCHÉES PAR LA PAUVRETÉ
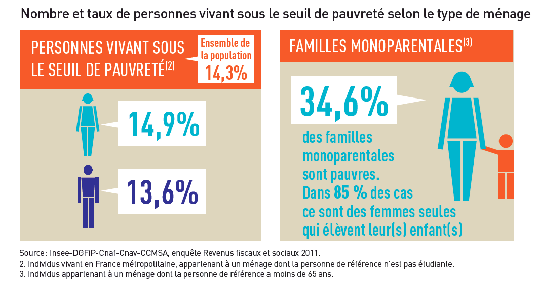
Source : ministère des droits des femmes (Chiffres-clés édition 2014, Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes)
Cet écart est encore plus important dans deux tranches d’âge : les jeunes femmes de 18-29 ans (taux de pauvreté de 21 %, contre 17,7% pour les hommes) et les femmes âgées de 75 ans et plus (12,5 % contre 8,5 %). Il convient à cet égard de rappeler que les femmes ont perçu une pension de retraite inférieure de 26 % à celles des hommes en 2012 (27). La question des femmes âgées avec de petites retraites, en situation d’isolement, est particulièrement importante.
Par ailleurs, une famille monoparentale sur trois est sous le seuil de pauvreté, et dans près de neuf cas sur dix, ce sont des mères qui élèvent seules leur(s) enfant(s). Les familles monoparentales dont la mère est inactive sont encore plus touchées puisque 68 % d’entre elles sont pauvres. Ce niveau de précarité a également une incidence concernant le revenu de solidarité active (RSA), dont 57 % des bénéficiaires sont des femmes.
2. Une surreprésentation des femmes parmi les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et des renoncements aux soins plus souvent déclarés
Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle forment une population plus jeune (28) mais aussi plus féminine que la population globale couverte par le régime général : on comptait ainsi 55 % de femmes contre 45 % d’hommes en 2011. Les bénéficiaires de la CMU-C sont par ailleurs en moins bonne santé que le reste de la population : 10,3 % d’entre eux sont par exemple inscrits en affection de longue durée (ALD) (29).
DONNÉES SEXUÉES CONCERNANT LES BÉNÉFICIAIRES DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE (CMU-C)
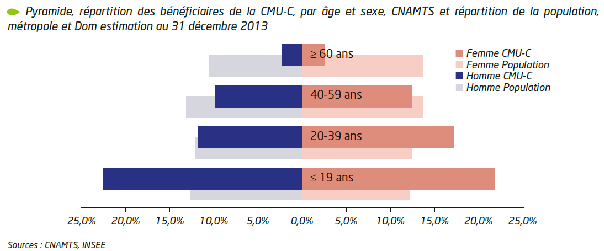
La couverture maladie universelle (CMU) et la couverture complémentaire universelle complémentaire (CMU-C), mises en place depuis le 1er janvier 2000, assurent une couverture maladie gratuite, sous conditions de ressources, aux personnes résidant en France de manière stable et régulière.
Source : Fonds CMU (rapport d’activité, 2014)
Les femmes sont également surreprésentées parmi les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), dispositif destiné aux personnes dont les ressources dépassent de moins de 35% le plafond d’attribution de la CMU-C afin d’en atténuer les effets de seuil. En effet, selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, la part des femmes parmi les bénéficiaires de l’ACS du régime général s’élevait à près de 57 %.
Comme pour les hommes, le renoncement aux soins croît lorsque les ressources financières diminuent. Cependant, comme cela a été souligné à plusieurs reprises au cours des travaux de la délégation, le renoncement apparaît plus élevé chez les femmes (16,5 %) que chez les hommes (11,7%), même s’il conviendrait de réactualiser ces données (étude publiée par la DREES en 2009 sur la santé des femmes, à partir de données portant sur l’année 2006).
Le rapport précité de Mme Dominique Henon (CESE, 2010) indiquait par ailleurs que 35,1 % de femmes renoncent aux soins par manque de moyens, 16,9 % y renoncent pour cause de délais trop longs pour obtenir un rendez-vous, 13,2 % préfèrent attendre de voir si les choses vont aller mieux d’elles-mêmes. Enfin, 12,1 % de femmes indiquaient renoncer aux soins par manque de temps en raison d’obligations professionnelles ou familiales (30). En effet, les cheffes de famille monoparentale n’ont pas toujours le temps, ni les moyens de prendre soin de leur santé, devant s’occuper seules de leur(s) enfant(s) et préférant s’assurer de la bonne santé de ces derniers.
La majorité des renoncements concerne les soins les moins bien remboursés par l’assurance-maladie. Les renoncements concernent en premier lieu les soins buccodentaires (45 % chez les femmes, 52 % chez les hommes). Les femmes renoncent toutefois plus fréquemment que les hommes à des soins de spécialistes, essentiellement l’ophtalmologie, la gynécologie et la dermatologie.
3. De fortes inégalités sociales entre femmes, en particulier pour le suivi des grossesses, l’obésité et les dépistages de cancers féminins
Les femmes forment un groupe marqué par une grande hétérogénéité, la plupart des indicateurs d’inégalités de santé suivant la hiérarchie sociale, qu’il s’agisse de l’espérance de vie ou d’autres problématiques de santé comme l’obésité. L’espérance de vie d’une ouvrière, inférieure à celle d’une cadre, est toutefois supérieure à celle d’un homme cadre, comme l’illustre le graphique ci-dessous.
ESPÉRANCE DE VIE À 35 ANS DES FEMMES ET DES HOMMES CADRES ET OUVRIER-E-S
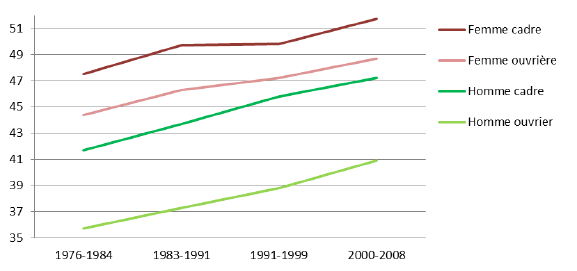
Source : graphique réalisé d’après les données de l’INSEE (2011) pour la France métropolitaine
● L’obésité : un marqueur social
Si le surpoids concerne toutes les catégories socio-professionnelles, il est inversement proportionnel au niveau d’instruction et l’obésité apparaît comme un marqueur social important, avec des disparités plus marquées pour les femmes que pour les hommes. Ainsi, selon l’étude d’impact du présent projet de loi (31), la prévalence de l’obésité chez les femmes de faible niveau socio-économique est de 35,1 % contre 17,6 % chez les hommes de la même population.
L’écart entre les catégories socio-professionnelles s’est largement creusé : depuis 1992, l’obésité augmente beaucoup plus vite chez les agriculteurs et les ouvriers que chez les cadres et professions intellectuelles supérieures. Chez les femmes, elle est largement corrélée à des caractéristiques socioéconomiques moins favorables (32), les plus touchées par l’obésité étant les ouvrières (20,8 %) et les personnes n’ayant jamais travaillé (18,9 %), loin devant les employées (14,6 %) et les cadres (6,8 %). Or la prévalence du diabète est fortement associée à celle de l’obésité (33). Les femmes ayant un niveau d’études inférieur au baccalauréat ont deux fois plus de risque d’être en surpoids ou obèses que celles ayant fait au moins trois années d’études supérieures (34). L’obésité est aussi beaucoup plus répandue chez les bénéficiaires de la CMU-C, 15 % d’entre eux étant concernés, contre 9 % pour le reste de la population.
Selon une étude du Centre d’analyse stratégique (CAS) publiée en 2010 (35), au-delà de la position sociale, c’est surtout la trajectoire sociale qui serait un facteur explicatif pertinent de situations de surpoids. Ainsi, le stress au travail, l’expérience du chômage ou les processus de précarisation –caractéristiques qui affectent un grand nombre de femmes – ont un impact non négligeable. Ces situations s’accompagnent souvent d’une modification des pratiques alimentaires liée à la perte des rythmes journaliers et au besoin de compenser les incertitudes et les angoisses du quotidien.
Pour les plus défavorisés, les produits recommandés (légumes, fruits, poisson, etc.) sont peu accessibles et les experts interrogés par la Commission sur la prévention de l’obésité, ont établi qu’en dessous de 3,50 € par personne et par jour, il est impossible d’accéder à une alimentation équilibrée (36). On considère en effet qu’un euro permet d’acheter l’équivalent de 76 kcal de fruit ou de légume, contre 384 kcal d’un autre aliment. Il y a donc une rationalité économique dans le choix de ce type d’aliment, au rendement énergétique plus important, au détriment des fruits et légumes dont les nutriments sont pourtant essentiels pour la santé.
Par ailleurs, de génération en génération, on devient obèse de plus en plus jeuneet aujourd'hui, en classe de CM2, les enfants d’ouvriers sont dix fois plus victimes d’obésité que les enfants de cadres, ce qui alerte sur la nécessité d’une prévention précoce, et ce d’autant plus que l’augmentation depuis 15 ans de l’obésité est plus nette chez les femmes, notamment les jeunes âgées de 18 à 25 ans.
● Des disparités sociales dans le suivi médical de grossesse
Pour toutes les grossesses, un suivi médical régulier et le plus précoce possible est recommandé afin d’identifier et réduire les facteurs de risques pouvant atteindre la mère ou l’enfant. Il repose notamment sur la déclaration de grossesse, qui doit être adressée à l’organisme d’assurance maladie avant la fin de la 14ème semaine de grossesse ainsi que sept visites prénatales, pour une grossesse menée à terme. L’enquête nationale périnatale de 2010 présente une analyse de la surveillance prénatale des mères selon leurs caractéristiques socio-professionnelles, leur nationalité, leur âge et leur situation familiale. Elle confirme l’influence d’un gradient social dans les différentes dimensions du suivi prénatal des mères : déclaration de grossesse, préparation à la naissance et suivi régulier grâce à des consultations mensuelles et des échographies (37).
Il apparaît que d’importantes disparités sociales de suivi de grossesse s’ajoutent aux inégalités sociodémographiques dans les facteurs de risques. Ainsi, davantage de femmes jeunes ou issues de classes sociales défavorisées ont un suivi médical insuffisant. En effet, 7,8% de femmes enceintes n’ont pas déclaré leur grossesse au 1er trimestre, mais cette proportion est deux fois plus élevée pour les femmes sans emploi. Les personnes relevant de la CMU ou de l’aide médicale d’État (AME) et les femmes au foyer sont aussi particulièrement concernées, comme l’indique le tableau ci-dessous. En outre, 8 % des femmes ayant déclaré tardivement leur grossesse ont eu moins de trois échographies, contre 1 % pour celles ayant déclaré dans les délais (38).
Par ailleurs, la part des femmes ayant eu moins de 7 visites prénatales est inversement proportionnelle au niveau d’études : ainsi, 17 % des femmes ayant un niveau primaire n’ont pas effectué le nombre recommandé de visites, contre 5 % chez les femmes ayant un diplôme supérieur au baccalauréat. Parmi les femmes ayant eu moins de sept visites prénatales, 12 % bénéficient de la CMU ou de l’AME. On observe ce même type d’écart en ce qui concerne la préparation à la naissance (39).
SUIVI MÉDICAL DE GROSSESSE ET DÉCLARATION TARDIVE DE GROSSESSE EN 2010
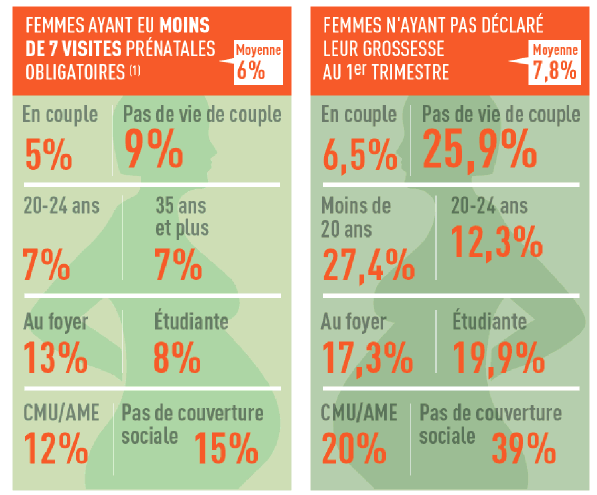
Source : ministère des droits des femmes, « Chiffres-clés de l’égalité entre les femmes et les hommes » (2014)
Enfin, les enquêtes nationales périnatales permettent de constater des différences concernant la prématurité et le poids de naissance selon le niveau d’études et le groupe social de la mère (40). En 2010, la part d’enfants prématurés était ainsi deux fois moins importante parmi les femmes cadres (3,7 %) que parmi les femmes ouvrières (6,1 %) ou personnels de service (7,9 %), et la part de prématurés a baissé parmi les femmes cadres mais augmenté parmi les ouvrières et employées comme personnels de service. Quant aux enfants de petits poids à la naissance, 3,6 % des femmes cadres ont accouché d’un enfant de moins de 2,5 kg contre 6,5 % des femmes ouvrières et 6,9 % des femmes sans profession.
● Un recours inégalitaire aux dépistages du cancer du sein et de l’utérus
Le recours aux actes de prévention secondaire (dépistage) constitue un autre exemple des inégalités sociales de santé entre les femmes. Concernant tout d’abord le cancer du sein, sa prévalence est plus élevée chez les femmes les plus diplômées, car elles ont des facteurs de risque plus importants, notamment des grossesses plus tardives. Toutefois, le taux de survie est plus élevé, en raison notamment d’un meilleur dépistage et d’une prise en charge plus précoce.
Intégralement pris en charge, le dépistage organisé du cancer du sein s’adresse à toutes les femmes de 50 à 74 ans, qui sont invitées tous les deux ans à réaliser une mammographie. Toutefois, les femmes disposant de faibles ressources réalisent deux fois moins de contrôles par mammographie que les autres femmes dans la même tranche d’âge : la gratuité de l’examen ne parvient donc pas à lever tous les obstacles. Or les risques sont aggravés dans certaines situations. Le rapport précité du CESE sur Femmes et précarité (2013) indique à cet égard qu’une étude réalisée par les chercheurs de l’INSERM, dont les résultats ont été publiés en juin 2012 dans l’International journal of cancer, montre que le risque de cancer du sein est augmenté d’environ 30 % chez les femmes ayant travaillé de nuit par rapport aux autres femmes. Serait en cause une perturbation du rythme circadien (contrôlant l’alternance veille/sommeil) qui régule de très nombreuses fonctions biologiques et qui serait altéré chez les femmes travaillant la nuit ou ayant des horaires décalés. Or, au cours des vingt dernières années, le nombre de femmes travaillant la nuit, occasionnellement ou habituellement, a doublé, passant de 500 000 en 1991 à un million en 2009.
Une annexe au PLFSS pour 2015 (41) précise à cet égard que le taux de participation au dépistage du cancer du sein est plus élevé chez les femmes vivant en couple (90,9 % contre 80,1 % pour les femmes célibataires) et celles ayant un niveau d’études baccalauréat ou équivalent (93,6 % contre 86,3% pour un niveau inférieur au baccalauréat). Des travaux antérieurs de l’INSEE sur La santé des plus pauvres (42) ont également montré que parmi les femmes de 40 ans et plus appartenant à des ménages modestes, 34 % n’avaient jamais fait de mammographie (contre 19 % des autres femmes de 40 ans et plus).
Concernant, d’autre part, le cancer du col de l’utérus, le test de dépistage se fait par frottis cervico-utérin, qui est recommandé tous les trois ans pour les femmes âgées de 25 à 65 ans. Le niveau socio-économique est un facteur influençant le recours au frottis, plus important parmi les femmes actives, plus diplômées et particulièrement les femmes cadres, tandis que les femmes sans assurance complémentaire déclarent moins fréquemment avoir pratiqué un frottis dans les trois ans (43). D’une manière générale, la pratique d’examens de prévention reste peu fréquente chez les femmes les moins favorisées. En effet, 12 % des femmes à bas revenus, âgées de 20 à 70 ans, n’ont jamais réalisé de frottis, soit deux fois plus que dans le reste de la population et seules 7,8 % des femmes de 25 à 65 ans respectent l’intervalle conseillé de trois ans.
Vos rapporteures saluent à cet égard les mesures prévues par le Plan cancer pour 2014-2019, sous l’impulsion du président de la République et de la ministre Marisol Touraine, en vue notamment de permettre à chaque femme de 25 à 65 ans l’accès à un dépistage régulier du cancer du col utérin via un programme national de dépistage organisé. Il est également prévu d’améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin antipapillomavirus en renforçant la mobilisation des médecins traitants et en diversifiant les accès, notamment avec gratuité, pour les jeunes filles concernées.
Au-delà de la diminution de la morbidité et de la mortalité liées au cancer du col de l’utérus, il s’agit de réduire les inégalités sociales de santé, à laquelle contribuent les campagnes de dépistage généralisé, qui contribuent à réduire les inégalités sociales de santé, comme l’a souligné, de façon générale, le directeur général de l’INPES. En tout état de cause, permettre aux femmes précaires d’accéder aux actes de prévention constitue un enjeu majeur de santé publique.
II. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE POUR AMÉLIORER LA PRÉVENTION, L’ÉGAL ACCÈS AUX SOINS ET LA PRISE EN CHARGE
Déposé le 15 octobre 2014, le projet de loi relatif à la santé vise à rassembler les acteurs de la santé autour d’une stratégie partagée (titre liminaire), renforcer la prévention et la promotion de la santé (titre Ier) et faciliter au quotidien les parcours de santé des Français-e-s (titre II). Il s’agit par ailleurs d’innover pour garantir la pérennité de notre système de santé (titre III) et de renforcer l’efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire (titre IV), avec enfin diverses mesures de simplification et d’harmonisation (titre V).
Outre les mesures relatives à la contraception d’urgence et l’IVG médicamenteuse, qui seront présentées dans la seconde partie, plusieurs avancées du projet de loi pourraient avoir un impact plus particulièrement positif pour les femmes (A). Des mesures complémentaires pourraient être envisagées pour mieux intégrer la dimension du genre dans les politiques de santé (B).
A. PLUSIEURS MESURES DU PROJET DE LOI SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LES FEMMES
L’étude d’impact du projet de loi met en exergue plusieurs dispositions du projet de loi, concernant notamment le pilotage des politiques de santé (1) ainsi que le développement de la prévention et de l’éducation à la santé (2). Les mesures prévues pour faciliter les parcours de soins et lutter contre les freins financiers à l’accès aux soins de tous méritent d’être saluées de ce point de vue (3)
1. Une rénovation profonde du cadre de la politique de santé
● Le pilotage national des politiques de santé (article 1er)
Le projet de loi rénove profondément le cadre général de la politique de santé, en tirant toutes les conséquences de la mise en œuvre de la loi de santé publique de 2004 (44), dont la révision quinquennale n’a pas eu lieu. De fait, la centaine d’objectifs de santé publique portés par le rapport annexé à cette loi n’ont pu être maîtrisés et appropriés par les acteurs autrement que comme un inventaire disparate, faute de finalités partagées et hiérarchisées.
Il s’agit par ailleurs de remédier aux défaillances du pilotage des politiques de santé, liées notamment au cloisonnement historique entre, schématiquement, le pilotage de l’État pour la prévention, la sécurité sanitaire et les soins hospitaliers, et, d’autre part, le pilotage par l’assurance maladie en matière de soins de ville, de remboursement et d’indemnisation.
Aux termes de l’article 1er du projet de loi, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé constitue l’une des trois finalités de la Stratégie nationale de santé (SNS), qui déterminera de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Préalablement à l’adoption ou la SNS, le Gouvernement devra procéder à une consultation publique sur ses objectifs et priorités, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Elle fera également l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle, dont les résultats seront rendus publics.
L’étude d’impact du projet de loi souligne à cet égard que les inégalités de santé observées entre les hommes et les femmes sont le fait principalement de déterminants liés aux conditions de vie, de travail et aux comportements individuels et collectifs face à la santé. Selon l’étude d’impact, « l’approche générale des enjeux de politiques publiques en santé présentée dans cet article, le rappel parmi les finalités de la réduction des inégalités de santé et l’importance accordée aux déterminants de santé doivent contribuer à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes ». Il conviendrait cependant d’aller plus loin que cette seule référence générale aux inégalités sociales et territoriales de santé parmi les finalités de la SNS, pour inclure des dispositions visant plus spécifiquement la santé des femmes (cf. infra).
● Le pilotage régional des politiques de santé (articles 38 et 39)
Le titre IV du projet de loi vise notamment à renforcer l’animation territoriale conduite par les agences régionales de santé (ARS). En particulier, sur la base des constats posés par le retour d’expérience des premiers projets régionaux de santé (PRS), des recommandations de la Cour des comptes et afin de faciliter la mise en œuvre de la Stratégie nationale de santé, il est proposé de renforcer le caractère stratégique et l’opérationnalité de la programmation régionale en simplifiant et assouplissant ces projets.
Cette réforme importante des PRS, en rupture avec une approche segmentée de l’organisation régionale (schéma régional de prévention, d’organisation des soins et d’organisation médico-social) pourrait avoir un impact très positif s’agissant de divers dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des femmes qui relèvent justement d’une articulation forte entre prévention et soins (santé sexuelle par exemple). L’étude d’impact soulève par ailleurs l’enjeu de l’articulation entre les secteurs sanitaires, médico-social et social, comme l’accompagnement des femmes enceintes en situation de précarité sociale ou la prise en charge des femmes de victimes de violences.
2. Le renforcement de la prévention : parcours éducatif en santé, information nutritionnelle et mesures de lutte contre le tabagisme
Le titre Ier du projet de loi (articles 2 à 11) a pour objet d’affirmer dans la loi que la responsabilité de l’État en matière de santé commence par la prévention et l’action sur les déterminants de santé. À ce titre, il vise notamment à soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé ainsi que les services de santé au travail et les initiatives en faveur de ceux qui sont le plus éloigné-e-s des soins, en matière de dépistage et de politique de réduction des risques.
Plusieurs dispositions de cette section présentent un intérêt particulier pour les jeunes filles et les femmes, outre l’article 3 du projet de loi, qui lève les restrictions existantes en matière d’accès à la contraception d’urgence (« pilule du lendemain ») des élèves du second degré auprès de l’infirmerie scolaire, dont les dispositions sont présentées dans la seconde partie du présent rapport.
● La promotion de la santé en milieu scolaire (article 2)
Comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi, le renouvellement des cadres d’action en promotion de la santé passe en premier lieu par une intervention engagée auprès de la jeunesse car en matière de santé, et particulièrement d'inégalités, tout se joue dès le plus jeune âge.
Dans ce sens, l’article 2 du projet de loi a notamment pour objet de préciser que les actions de promotion de la santé en milieu scolaire sont conduites conformément aux orientations nationales de la politique de santé. Partant du constat que les inégalités de santé sont influencées par des facteurs multisectoriels, la promotion de la santé se développera ainsi pour tous les enfants et adolescent-e-s, quel que soit leur état de santé ou le lieu de leur scolarisation. Ces actions doivent débuter dès le plus jeune âge et s'échelonner tout au long de la vie scolaire, constituant ainsi un réel « parcours éducatif en santé », en vue de permettre à toutes et tous d’apprendre à prendre soin de soi et des autres et d’éviter les conduites à risque (tabac, alcool, drogue).
La promotion de la santé à l’école et tout au long du parcours scolaire de l’enfant et du jeune pourrait avoir un impact positif sur l’égalité entre les femmes et les hommes, en renforçant tout d’abord l’information des jeunes sur les pratiques à risque, notamment dans le domaine des relations entre les femmes et les hommes (violences, rapports sexuels non désirés ou non protégés, impacts cumulés de facteurs de risques par exemple). Par ailleurs, comme l’a indiqué la ministre Marisol Touraine, lors de son audition par la délégation, l’inclusion dans les deux volets de ce parcours éducatif en santé de la vie affective et sexuelle, avec l’éducation à la sexualité, puis la question des violences envers autrui pourraient contribuer à lutter plus efficacement contre les comportements et les violences sexistes et sexuelles et à promouvoir le droit à disposer de son corps.
● Les mesures de lutte contre l’alcoolisation massive (article 4)
L’article 4 du projet de loi vise à renforcer les moyens de lutter contre les nouvelles pratiques de la jeunesse en matière d’alcoolisation massive, connues sous le nom de « binge drinking », comme l’a évoqué la ministre Marisol Touraine lors de son audition par la délégation.
L’exposé des motifs du projet de loi souligne à cet égard que depuis plusieurs années, les usages à risque et les ivresses sont en hausse notamment chez les jeunes : à 17 ans, un jeune sur trois déclare avoir été ivre au moins trois fois dans l’année, et l’on observe le développement de séances d’alcoolisation massive chez les mineurs et les jeunes majeurs.
La législation française apparaît aujourd’hui inadaptée pour répondre à ce phénomène. Cet article du projet de loi a notamment pour objectif de mieux réprimer l’incitation à l’ivresse dont de jeunes majeurs ou des mineurs sont susceptibles d’être l’objet lors de séances de bizutage, selon l’exposé des motifs. Or le bizutage peut donner lieu à des humiliations et des insultes sexistes.
Par ailleurs, comme l’a rappelé la ministre lors de son audition, le « binge drinking » est une pratique très préoccupante qui ne touche pas que les hommes. On sait en effet que les établissements de santé reçoivent de très jeunes filles – lycéennes et étudiantes – en coma éthylique à la suite d’une alcoolisation massive et rapide pratiquée lors de soirées festives organisées par des associations ou leur établissement d’enseignement.
● L’amélioration de l’information nutritionnelle (article 5)
Comme souligné précédemment, la prévalence de l’obésité est plus élevée chez les femmes et progresse depuis plusieurs années, s’agissant en particulier pour des femmes vivant dans des milieux défavorisés, avec des risques accrus en termes de maladies chroniques (diabète, cancers, maladies cardiovasculaires)
L’article 5 prévoit d’agir sur le sujet de l’information nutritionnelle en tant qu’outil de réduction des inégalités sociales de santé publique. En effet, depuis plus d’une décennie, de nombreux comités d’experts nationaux et internationaux recommandent, en se fondant sur divers types de travaux scientifiques (expérimentaux, épidémiologiques et de terrain) la mise en place, sur la face avant des emballages des aliments, d’un système d’information nutritionnelle ou un logo complémentaire à l’étiquetage informatif (qui lui est, en général, en face arrière des emballages). L’objectif est de permettre une différenciation sur le plan nutritionnel des produits entre catégories et au sein d’une même catégorie, dans le but de faciliter in fine un apport nutritionnel de meilleure qualité pour chacun, notamment pour les personnes dont le niveau d’éducation ne permet pas une analyse complète des étiquetages nutritionnels et qui sont également les plus vulnérables sur le plan de la santé et de la nutrition.
Pour réduire les inégalités sociales en matière d’accès à une alimentation équilibrée, il est nécessaire que l’information nutritionnelle puisse devenir pour tous un élément du choix alimentaire, au même titre que le prix, la marque ou la présentation, et aider chacun dans ses choix pour sa santé. Plus largement, il s’agit d’orienter la population vers des comportements plus favorables à la santé et de créer des environnements propices à une nutrition adaptée.
Dans ce sens, le projet de loi pose le principe, dans le code de la santé publique, d’une information nutritionnelle synthétique, simple, accessible par toutes et tous, étant précisé que la mise à disposition de cette information sera volontaire de la part des producteurs et distributeurs, comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi (45) – un point que vos rapporteures proposent de modifier (cf. infra). Cette information nutritionnelle pourra être utilisée pour le développement d’une pédagogie efficace afin de former, dans le cadre scolaire ou périscolaire, les enfants consommateurs, et pour un affichage visuel, volontaire, simple à comprendre par tous, applicable sur une base complémentaire à celui déjà mis en œuvre en application de la réglementation européenne. Une information facilement compréhensible pour des personnes de faible niveau d’éducation doit permettre de réduire les inégalités sociales de santé, en particulier chez les femmes qui jouent un rôle important comme prescriptrice dans l’alimentation des ménages.
● La politique de réduction des risques en direction des usager-e-s de drogues et le dépistage des maladies transmissibles (articles 7 à 9)
Les mesures prévues par le projet de loi en matière de réduction des risques, à travers notamment l’expérimentation de salles de consommation à moindre risque, doivent être replacées dans le contexte d’une forte croissance de la proportion de femmes polyconsommatrices de drogues illicites, selon l’étude d’impact du projet de loi. Il convient à cet égard de préciser qu’en 2012, 20 % des usagers fréquentant les centres de soins en addictologie ou les accueils à bas-seuil (programme bus-méthadone à Paris par exemple) sont des femmes (46). Cette proportion minoritaire semble aussi corrélée à une plus grande difficulté d’accès pour ces femmes au secteur spécialisée, et les femmes accueillies en centre de soin présentent des profils toxicologiques relativement lourds, caractérisés par des proportions élevées de polyconsommatrices de drogues (47).
Elles se caractérisent également par une fréquente co-morbidité psychiatrique. Parmi toutes ces femmes toxicodépendantes, quatre sur dix ont déjà tenté de se suicider. Elles sont relativement nombreuses, tous profils confondus, à avoir connu au moins un épisode d’incarcération. Les différentes sources disponibles traduisent une grande détresse sociale et familiale des femmes toxicodépendantes et une importante prise de risque, en matière d’usage de drogues ou de sexualité couplée à une vulnérabilité physiologique accrue.
En outre, l’article 7 du projet de loi vise à conforter la pratique des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et des tests rapides pour le dépistage de maladies infectieuses transmissibles ; il s’agit d’une mesure intéressante alors que les femmes sont plus vulnérables aux infections sexuellement transmissibles (IST) que les hommes (cf. infra).
Il convient par ailleurs de prendre en compte les problématiques particulières liées à la santé des femmes victimes de la prostitution, comme l’a souligné un rapport récent (48) de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ainsi que le rapport d’information présenté par Mme Maud Olivier et adopté par la délégation en septembre 2013 (49).
● Des mesures de lutte contre le tabagisme
À la demande du président de la République lors de la présentation du Plan Cancer 2014-2019, Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, a présenté en conseil des ministres, le 25 septembre 2014, un plan ambitieux pour lutter contre le fléau du tabagisme en France. Ce programme national de réduction du tabagisme (PNRT) comprend des mesures importantes articulées autour de trois axes d’intervention prioritaires : protéger les jeunes, aider les fumeurs à arrêter et agir sur l’économie du tabac (cf. encadré ci-après). Les mesures d’ordre législatif du PNRT doivent être inscrites dans le projet de loi de santé par amendements, à l’occasion de son examen au Parlement.
Par ailleurs, la transposition par la France de la « directive tabac » de 2014 (50) permettra l’application de mesures telles que l’agrandissement des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, l’interdiction de la publicité pour les cigarettes électroniques (sauf sur les lieux de vente) et l’interdiction des arômes perceptibles dans les cigarettes – une avancée intéressante alors que les cigarettes sucrées incitent davantage les jeunes et les femmes à fumer.
Les mesures prévues par le Programme national de réduction du tabagisme (PNRT)
Axe 1 – Pour protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme
1. Adopter les paquets de cigarettes neutres pour les rendre moins attractifs.
2. Interdire de fumer en voiture en présence d’enfants de moins de 12 ans.
3. Rendre non fumeurs les espaces publics de jeux pour enfants.
4. Encadrer la publicité pour les cigarettes électroniques et interdire le vapotage dans certains lieux publics.
Axe 2 – Pour aider les fumeurs à arrêter de fumer
5. Diffuser massivement une campagne d’information choc.
6. Impliquer davantage les médecins traitants dans la lutte contre le tabagisme.
7. Améliorer le remboursement du sevrage tabagique.
Axe 3 – Pour agir sur l’économie du tabac
8. Créer un fonds dédié aux actions de lutte contre le tabagisme (prévention, sevrage, information).
9. Renforcer la transparence sur les activités de lobbying de l’industrie du tabac.
10. Renforcer la lutte contre le commerce illicite de tabac.
Source : dossier de presse du ministère sur le PNRT (25 septembre 2014)
Enfin, l’article 33 du projet de loi élargit les possibilités de prescription des substituts nicotiniques concernant les médecins du travail, les infirmier-e-s et les sages-femmes (cf. infra). L’ensemble de ces mesures contribueront à lutter contre le tabagisme des jeunes filles et des femmes, qui a progressé de plus de trois points entre 2005 et 2010 (51) avec, là encore, des inégalités sociales, le tabagisme se concentrant de plus en plus dans les milieux défavorisés (52).
3. Des mesures pour faciliter au quotidien les parcours de santé, améliorer l’accès aux soins et adapter les compétences des sages-femmes et des infirmier-e-s
Certaines dispositions du titre II « Faciliter au quotidien les parcours de santé » et du titre III « Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé » méritent d’être soulignées au regard de leur impact potentiel sur les femmes. Elles concernent la création d’un service territorial de santé au public (STSP), les mesures de lutte contre les freins financiers à l’accès aux soins (généralisation du tiers payant en particulier) et les compétences de professsionnel-le-s de santé.
● La création d’un service territorial de santé au public (STSP)
Les articles 12 à 14 du projet de loi ont pour objet de créer un service territorial de santé au public, outil central de l’organisation des soins à l’échelle des territoires. En effet, il est apparu nécessaire de concevoir une nouvelle organisation territoriale prenant davantage en compte les besoins des usagers et favorisant une prise en charge coordonnée et pluri-professionnelle des personnes malades ou en situation de handicap et de perte d'autonomie. Le STSP a pour objectif la mise en place, à la suite d’un diagnostic partagé sur la situation du territoire, d’une organisation accessible, lisible et organisée au service des patients dont les parcours de santé nécessitent une coordination complexe. Il s’agit en particulier d’organiser l’offre de prévention et les soins de proximité, notamment pour les patients atteints d’une maladie chronique, en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale ainsi que les personnes en situation de perte d’autonomie ou présentant un risque de perte d'autonomie du fait de l’âge ou d’un handicap.
S’il s’adresse à l’ensemble de la population, le STSP pourrait contribuer à réduire les inégalités entre femmes et hommes aux différents âges de la vie, par son adaptation aux difficultés concrètes des populations sur un territoire. Par exemple, des actions territoriales plus déterminées pourront être menées sur les risques sanitaires liés à l’association entre tabac et pilule chez les femmes, lesquelles nécessitent l’implication et la coordination de nombreux acteurs (médecin généraliste, consultations spécialisées, hospitalières ou libérales, services de protection maternelle et infantile – PMI –, services de santé scolaire ou de santé au travail), qui pourraient être facilitées par le STSP. Dans un autre domaine, la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des femmes victimes de violence pourra être renforcée et mieux coordonnée dans ce cadre. Des actions en lien avec certains risques professionnels pourront également être envisagées, selon l’étude d’impact du projet de loi.
● Les mesures de lutte contre les barrières financières à l’accès aux soins, à travers notamment la généralisation du tiers payant (articles 18 à 20)
Ces trois articles du projet proposent plusieurs mesures visant à améliorer l’accès aux soins avec : la mise en œuvre de dispositifs permettant de mieux lutter contre les refus opposés aux bénéficiaires de la CMU, de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME (tests de situation) ; l’encadrement des tarifs des prestations d’optique et de soins dentaires prothétiques et orthodontiques délivrés aux bénéficiaires de l’ACS ; la généralisation du tiers payant pour les consultations de ville.
En effet, de nombreux Français renoncent à aller chez le médecin parce qu’ils ne peuvent pas avancer les frais, et d’autres se rendent aux urgences des hôpitaux parce qu’ils y bénéficient du tiers payant alors que dans certains cas, ils auraient pu aller directement chez leur généraliste ou spécialiste en ville. D’après les différentes études réalisées, le renoncement aux soins pour des raisons financières, y compris à cause de cette avance de frais chez le médecin, concernerait environ un tiers des Français.
C’est donc pour garantir l’accès aux soins de toutes et tous que l’article 18 du projet de loi organise prévoit la généralisation du tiers payant pour les consultations d’ici 2017. Il convient à cet égard de rappeler que ce système est en vigueur dans la quasi–totalité des pays européens – 24 sur 28 pays de l’Union européenne – selon un rapport récent de l’IGAS (53). En outre, le tiers payant est déjà généralisé notamment par les pharmaciens, les biologistes et les infirmiers de ville, et également pratiqué pour 30 % des actes médicaux en ville, et pour tous les bénéficiaires de la CMU-C (54).
La LFSS pour 2015 a par ailleurs prévu une première étape, avec l’extension du tiers payant aux bénéficiaires de l’ACS. L’étude d’impact de ce projet de loi soulignait d’ailleurs que, dans la mesure où l’ACS bénéficie aux personnes les plus modestes (revenus inférieurs au seuil de pauvreté fixé à 977 euros par mois en 2011) et que les femmes sont surreprésentées au sein de cette population (près de 57 % des bénéficiaires de l’ACS du régime général en 2012), « la mesure bénéficiera indirectement davantage à ces dernières et permettra tout particulièrement d’améliorer l’accès aux soins des femmes ».
Soulignant que les femmes renoncent plus fréquemment aux soins que les hommes, la ministre Marisol Touraine a évoqué en particulier la situation des mères célibataires qui font face à des difficultés financières et ont du mal à avancer les frais de la consultation du médecin de leur enfant, lors de son audition par la délégation le 10 février 2015, en soulignant qu’agir pour rendre les soins plus accessibles, c’est agir en faveur de la santé des femmes.
Si elle doit naturellement être assortie de garanties techniques pour éviter des contraintes trop lourdes pour les médecins, la généralisation du tiers payant permettra ainsi de simplifier l’accès de tous à des soins de premier recours et de limiter le renoncement aux soins pour des raisons financières. Loin de se limiter aux personnes les plus modestes et qui, à ce titre, sont éligibles aux dispositifs d’aide à l’accès aux soins, ce phénomène touche d’ailleurs, plus largement, l’ensemble des personnes en situation de vulnérabilité, que leurs revenus se situent au-dessus des seuils d’éligibilité ou qu’elles soient fragilisées par des situations de rupture.
Vos rapporteures soutiennent pleinement cette mesure qui renforcera la justice sociale en matière de santé et permettra par exemple aux femmes souhaitant avorter de ne pas avoir à avancer de frais. Il conviendrait par ailleurs de développer les actions d’information pour mieux faire connaître le dispositif à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), qui se caractérise par un phénomène de non-recours important (55).
● Le service public d’information en santé (article 21)
Le projet de loi prévoit la création d’un service public, placé sous la responsabilité de la ministre en charge de la santé, qui aura pour mission la diffusion la plus large et gratuite des informations relatives à la santé. Dans ce cadre, comme l’a suggéré Mme Edith Gueugneau lors de l’audition de la ministre Marisol Touraine, il conviendra de veiller à intégrer les informations concernant les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, pour favoriser leur repérage et leur accompagnement.
● Le renforcement des compétences des professionnel-le-s de santé en matière de substituts nicotiniques et de vaccination (articles 31 et 33)
Dans le contexte du programme national de réduction du tabagisme, qui passe par une mobilisation des professionnels de santé et une multiplication des intervenants au plus près des fumeurs, l’article 33 du projet de loi vise, d’une part, à permettre aux médecins du travail et aux infirmier-e-s de prescrire des substituts nicotiniques. D’autre part, il donne la possibilité aux sages-femmes de les prescrire à l’entourage de la femme enceinte afin d’améliorer le déroulement de la grossesse et de protéger la santé de l’enfant. Il convient à cet égard de rappeler qu’il existe 22 000 sages-femmes en exercice, dont 98 % de femmes, dont environ 300 sages-femmes tabacologues (56).
Par ailleurs, l’article 31 du projet de loi étend les compétences des sages-femmes en matière d’IVG médicamenteuse (cf. infra) et de vaccination. L’objectif est qu’elles puissent participer efficacement à la mise en œuvre de la politique vaccinale et faciliter l’accès à la vaccination de l’entourage de la parturiente et du nouveau-né, selon la stratégie dite du « cocooning » autour de l’enfant recommandée par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) pour la coqueluche. Les sages-femmes seront ainsi autorisées à pratiquer les vaccinations pour ces personnes de l’entourage du nouveau-né.
Au-delà de leur impact sur la santé des femmes et des enfants, vos rapporteures se félicitent des dispositions prévues par ces deux articles du projet de loi, en ce qu’elles concourent au renforcement des compétences et donc à la reconnaissance de professions qui sont aujourd’hui majoritairement exercées par des femmes. Celles-ci représentent en effet environ 88 % des infirmier-e-s et des sages-femmes (57).
Ce projet de loi comporte ainsi des réformes importantes pour améliorer la prise en charge et la santé des femmes, comme l’a souligné la ministre Marisol Touraine, lors de son audition, avec des mesures qui les concernent très directement (IVG et contraception), mais aussi d’autres qui n’apparaissent pas comme des mesures spécifiques en leur direction, mais qui n’en auront pas moins un impact positif sur leur santé et leur accès aux soins.
B. DES MESURES COMPLÉMENTAIRES POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION DU GENRE DANS LA POLITIQUE DE SANTÉ
1. Adapter le pilotage des politiques de santé
Aux termes de l’article 1er du projet de loi, la Stratégie nationale de santé déterminera, de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie (article L. 4111-1 du code de la santé publique).
Par ailleurs, dans le cadre de la territorialisation de la politique de santé, l’article 38 du projet de loi prévoit que le projet régional de santé (PRS) définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, « les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé (ARS) dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre » (article L. 1434-1 du même code).
Cet article du projet de loi modifie également les dispositions relatives aux contrats pluriannuels d’objectifs et moyens (CPOM), signés par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées avec chaque directeur d’ARS (58) (article L. 4111-2 du même code), afin notamment de préciser que « ce contrat définit les objectifs et priorités d’actions » de l’ARS (59).
Afin d’améliorer le pilotage des politiques de santé et mieux prendre en compte les enjeux spécifiques aux femmes, il convient de veiller à l’intégration d’objectifs spécifiques aux femmes dans ces documents de cadrage stratégique et de programmation.
Vos rapporteures soulignent par ailleurs l’importance de développer les liens entre la politique de santé, la santé au travail et la médecine scolaire, notamment au sein des commissions de coordination des politiques publiques dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile, placées auprès des ARS, et plus largement, d’organiser la prise en charge autour des patient-e-s. Il est important d’opérer des décloisonnements et de veiller à la prise en charge coordonnée et à l’orientation des personnes ainsi qu’à la démocratie locale.
Recommandation n° 1 : Intégrer des objectifs spécifiques sur les femmes dans la Stratégie nationale de santé et dans les plans régionaux de santé (PRS).
Lors de son audition par la délégation, la ministre Mme Marisol Touraine a rappelé que des données sexuées existent et permettent ainsi d’adapter les stratégies de stratégies de santé en fonction du sexe.
Cependant, certaines d’entre elles ne sont pas actualisées très régulièrement, par exemple le Baromètre Santé de l’INPES, qui permet notamment de connaître la proportion de femmes fumeuses n’est publié que tous les cinq ans, et la dernière édition date de 2010, ce qui ne permet pas un pilotage suffisamment réactif sur ces questions. Dans d’autres domaines, il semblerait que les données qui sont parfois utilisées dans le débat public soient de fait un peu datées, telles que les statistiques concernant la situation contraceptive de femmes ayant recours à l’IVG (2007) ou bien celles issues de l’enquête réalisée sur les renoncements aux soins chez les femmes en 2006. Or il est bien évident que la situation peut avoir évolué sensiblement sur ces questions depuis une dizaine d’années.
Au-delà de ces statistiques brutes, il existe aussi des études approfondies et de grande qualité publiées par la DREES, en particulier celle réalisée sur La santé des femmes, mais qui date toutefois de 2009, ou L’état de santé de la population (février 2015). Les annexes aux projets de loi de finances (PLF) et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) comportent également des indicateurs et éléments d’analyse. Cependant, l’ensemble de ces données sont éparses et, d’autre part, elles ne répondent que partiellement à l’enjeu de pilotage et de renforcement de l’efficacité de l’action publique, sur des priorités politiques clairement définies, à partir d’un tableau de bord adapté.
À cet égard, comme l’a souligné le directeur général de l’INPES, M. François Bourdillon, il est très important de se doter pour l’avenir de moyens épidémiologiques, et de « poser régulièrement des balises tous les deux ou trois ans » pour essayer de marquer l’importance de problématiques de santé, car « sans données, il n’y a pas de politique publique possible, dans la mesure où le problème n’est pas identifié : c’est parce que l’on identifie le problème que l’on construit, derrière, une politique publique adaptée ».
Vos rapporteures formulent en conséquence la recommandation suivante.
Recommandation n° 2 : Publier tous les deux ans un « Baromètre Santé des femmes », avec une sélection d’indicateurs correspondant à des priorités de santé publique (tabagisme, renoncement aux soins chez les femmes, IVG, etc.).
Lors de son audition par la délégation, Mme Florence Chappert, responsable du projet « Genre, santé et conditions de travail » à l’ANACT, a fait état de difficultés persistantes des différents acteurs concernés à produire et publier des données sexuées en santé et sécurité au travail (SST). En effet :
– au niveau national : si l’ANACT a pris l’initiative de publier depuis trois ans les données sexuées relatives aux accidents de travail et de trajet et maladies professionnelles des 18 millions de salariés couverts par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), cette dernière ne les publie toujours pas dans son rapport de gestion ; par ailleurs, le troisième plan Santé au travail prévoit de rassembler et de mettre en perspective les données de santé au travail (orientation n° 6), sans comporter pas de mention particulière concernant la production de données sexuées en santé et sécurité au travail ;
– au niveau régional : quelques caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en Bretagne notamment, voire les services déconcentrés (60) ont produit des données en santé et sécurité au travail ce qui pourrait être fait de manière plus systématique pour alimenter les plans régionaux en santé au travail ;
– au niveau des entreprises : les seules données non sexuées des bilans sociaux sont souvent celles de la santé et de sécurité au travail, telles que l’absentéisme, et c’est exceptionnellement que les rapports de situation comparée incluent des indicateurs selon le sexe dans ce domaine, selon Mme Chappert. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes y pallie néanmoins en prévoyant un neuvième domaine d’indicateurs obligatoires en santé et sécurité au travail, distinct de celui des conditions de travail (61).
En outre, les dispositions actuelles du code du travail ne prévoient pas d’obligation concernant la production de données selon le sexe dans les rapports annuels des médecins du travail : ainsi, par exemple, les logiciels informatiques des médecins ne prévoient pas de croiser les données recueillies avec le sexe pour synthétiser leurs résultats. Pour remédier à cette lacune, il conviendrait de modifier en ce sens l’article D. 4624-42 du code du travail, aux termes duquel « Le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail », voire de porter ce principe au niveau législatif (en modifiant dans ce cas l’article L. 4624-1 du même code, relatif aux missions du médecin du travail).
Recommandation n° 3 : Développer le recueil et la publication régulière de données sexuées en matière de santé au travail en s’appuyant notamment sur le rapport de gestion de la CNAMTS et sur les rapports annuels des médecins du travail.
Pour favoriser l’égalité femmes-hommes mais aussi la prise en compte de certains enjeux de santé plus spécifiques aux femmes, leur représentation au sein des organismes publics dans le domaine de la santé, et des instances de direction en particulier, constitue un enjeu important.
Dans ce domaine, il est à noter que le nombre de femmes occupant des emplois de direction au sein de la fonction publique hospitalière est en augmentation. Au 31 décembre 2011 (62), le taux de féminisation de ces emplois était de 45 %. En effet, si le corps des directeurs d’hôpital reste composé majoritairement d’hommes, le corps des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social a amorcé une féminisation significative ces dernières années, avec un effectif en croissance régulière.
Toutefois, les femmes restent nettement sous-représentées dans les instances de direction des principaux établissements et agences sanitaires.
UNE SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES AUX POSTES DE DIRECTION DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS ET AGENCES SANITAIRES
Organismes |
Nombre total |
Dont femmes |
Taux de féminisation |
Directeurs généraux et directrices générales des agences régionales de santé (ARS) |
26 |
6 |
23,08 % |
Directeurs généraux et directrices générales des principales agences sanitaires (INPES, INVS, InCA etc. *) |
9 |
1 |
11,1 % |
Haute Autorité de santé (HAS), autorité publique indépendante : – Président ou présidente du collège – Directeur général ou directrice générale – Membres du collège |
9 |
0 |
0 % |
Principales caisses d’assurance maladie (CNAMTS, MSA, RSI) : – Directeur général ou directrice générale |
3 |
0 |
0 % |
* Agence de la biomédecine (ABM), Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Établissement français du sang (EFS), Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (PRUS), Institut national du cancer (InCA), INPES, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), Institut national de veille sanitaire (InVS)
Source : tableau réalisé d’après les informations disponibles en janvier 2015
La ministre Marisol Touraine a toutefois souligné son attachement à « la parité [qui] reste une de [ses] grandes préoccupations » et les progrès intervenus concernant par exemple la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui est désormais dirigée par une femme. En outre, les directions d’hôpitaux comptaient 19 % de femmes en 2012, mais ce taux est passé à 35 % à la fin de l’année 2013 (63), par exemple au CHU de Reims.
La ministre a également rappelé que la Haute Autorité de santé faisait partie des structures qui seront amenées à se conformer aux dispositions de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 74 de la loi n° 2011-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes ». Au regard des travaux parlementaires et de la position du Conseil constitutionnel sur ce point (64), cette disposition est parfaitement applicable au collège de la HAS, en tant qu’autorité publique indépendante.
Particulièrement attachées à la mise en œuvre de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, vos rapporteures souhaitent la publication rapide de cette ordonnance afin de promouvoir une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein d’organismes tels que la HAS.
Recommandation n° 4 : Améliorer l’accès des femmes aux postes de direction dans les différentes instances sanitaires et publier rapidement l’ordonnance prévue par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes concernant les autorités administratives indépendantes (AAI).
Au cours de son audition par la délégation, M. Claude Evin, directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, ancien ministre (65), a évoqué une initiative particulièrement intéressante prise par l’ARS, visant à consulter les femmes sur leur expérience de recours à une IVG, sous la forme de questionnaires anonymes en ligne. À cet égard, Mme Anne-Gaëlle Daniel, chargée de mission sur la périnatalité et l’IVG, a fait état d’une sorte de paradoxe dans ce domaine, dans la mesure où des associations et des professionnels témoignent de difficultés mais l’ARS ne reçoit aucune plainte, signalement ou réclamation, ce qui illustre bien l’intérêt de ce type d’initiative.
« Améliorer le parcours IVG : l’ARS Île-de-France donne la parole aux femmes »
« L’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France invite les femmes (ou leur entourage et les professionnels concernés) à témoigner anonymement, via un bref questionnaire en ligne, de leur expérience de recours à une interruption volontaire de grossesse. Élaboré en partenariat avec les acteurs du champ de l’orthogénie, ce questionnaire vise à mieux comprendre et évaluer les éléments favorables à une bonne prise en charge et les difficultés auxquelles les femmes sont fréquemment confrontées.
Les réponses au questionnaire fourniront des éléments d’appréciation de la qualité du parcours proposé en Ile-de-France et des obstacles rencontrés par les femmes en termes d’accès et de réalisation de l’IVG. Elles mettront en lumière le vécu des patientes ou toute complication identifiée dans leurs démarches. Le délai de prise en charge, l’information prodiguée sur la méthode proposée ou la distance entre le domicile et le lieu d’avortement font notamment partie des thématiques abordées.
Une première analyse des témoignages recueillis, prévue pour septembre 2015, sera adressée aux acteurs du champ de l’IVG en Ile-de-France et publiée parallèlement sur le site de l’ARS. Ce questionnaire est réalisé dans le cadre du projet régional visant à Favoriser la réduction des inégalités d’accès à l’avortement (FRIDA), au travers duquel l’ARS réaffirme les droits des patientes et la place des femmes dans le système de santé. »
Source : communiqué de l’ARS d’Île-de-France (14 janvier 2015)
Au-delà de l’IVG, il serait souhaitable de consulter davantage les femmes et, au-delà les patient-e-s, en vue de mieux identifier certaines difficultés et pouvoir ainsi améliorer la qualité de la prise en charge et l’efficacité des politiques publiques.
Recommandation n° 5 : Mieux associer les femmes à l’évaluation et à la conception des politiques de santé grâce à des questionnaires en ligne, etc.
1. Améliorer l’accès aux soins et à la prévention et préciser les compétences des sages-femmes
En premier lieu, vos rapporteures sont très attachées à la mise en œuvre rapide du tiers payant, qui renforcera la justice sociale en matière de santé. En vue d’améliorer la prévention, dans le domaine de la nutrition en particulier (cf. supra) et l’accès aux soins, elles formulent les deux recommandations suivantes.
Recommandation n° 6 : Renforcer la justice sociale en matière de santé par la généralisation du tiers payant avec les solutions techniques adaptées dès que possible.
Recommandation n° 7 : Rendre obligatoire le logo nutritionnel prévu par le projet de loi.
Les représentantes de l’Ordre des sages-femmes entendues par vos rapporteures ont fait observer que le projet de loi prévoyait simplement la possibilité pour les sages-femmes de « pratiquer » les vaccinations de la femme, du nouveau-né ainsi que les personnes de son entourage (par exemple le conjoint), sans qu’il soit fait mention d’une possibilité de prescription.
Sur ce point, il convient toutefois de rappeler que, selon le principe posé par l’article L. 4151-4 du code de la santé publique (66), les sages-femmes peuvent prescrire les médicaments figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et parmi lesquels figurent des vaccins.
Quels sont les vaccins que les sages-femmes sont habilitées à prescrire ?
Conformément à l'article L. 4151-4 du code de la santé publique, les sages-femmes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 12 octobre 2011). À ce titre, l’arrêté prévoit que les sages-femmes sont habilitées à prescrire :
– auprès des femmes : les vaccins sous forme monovalente ou associés contre les pathologies suivantes : tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire), rubéole, hépatite B, grippe et vaccin préventif contre les lésions de col de l'utérus (HPV) ;
– auprès des nouveau-nés : vaccin et immunoglobulines anti-hépatite B ; BCG.
Source : article L. 4151-4 du code de la santé publique et Ordre des sages-femmes
Pour lever toute ambiguïté, la rédaction de l’article 31 du projet de loi pourrait dès lors être aménagée afin d’indiquer que les sages-femmes peuvent « prescrire et pratiquer » les vaccinations, et ce notamment pour le conjoint.
Les représentantes des sages-femmes entendues par vos rapporteures ont par ailleurs souhaité que la possibilité ouverte par l’article 33 du projet de loi en matière de prescription de substituts nicotiniques du projet de loi ne soit pas limitée à une durée de 28 jours après l’accouchement, comme le laisserait penser, selon elles, le terme de « nouveau-né », mais soit ouverte pendant toute la période post-natale des deux premiers mois.
Recommandation n° 8 : Préciser les compétences des sages-femmes en matière de vaccination et de prescription de substituts nicotiniques :
– en précisant à l’article 31 du projet de loi que les sages-femmes peuvent « prescrire et » pratiquer des vaccinations pour les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage du nouveau-né ou assurent sa garde ;
– en prévoyant, à l’article 33, que la prescription de substituts nicotiniques soit possible pendant les deux premiers mois suivant l’accouchement
2. Adapter la prise en charge des femmes en tenant compte de leurs spécificités dans les diagnostics et les traitements et améliorer l’accompagnement des parturientes
Mme Dominique Henon a souligné lors de son audition que les maladies de l’appareil circulatoire font l’objet d’une prise en charge d’urgence moins systématique que chez les hommes, liée à une mauvaise appréciation du risque, en particulier dans les cas d’infarctus, où les symptômes ressentis par les femmes relèvent plus de nausées et de douleurs dans les mâchoires, diffèrent de ceux des hommes (le symptôme qui apparait plus fréquemment chez les hommes est la douleur thoracique).
En effet, une étude sur la prise en charge de l’infarctus, réalisée cette fois en France dans la région de Franche-Comté en 2006 et 2007, a montré que le manque d’évaluation des traitements appliqués aux femmes peut avoir des conséquences dramatiques en termes de mortalité, d’autant plus que les symptômes de la même pathologie peuvent être différents de ceux des hommes. Le docteur François Schiele, chef du service de cardiologie à l’hôpital universitaire de Besançon, principal auteur de l’étude, a ainsi révélé que les femmes victimes d’un infarctus en meurent deux fois plus que les hommes (67).
Cette étude menée auprès de 3000 hommes et femmes hospitalisés à la suite d’une crise cardiaque a montré que celles-ci avaient eu beaucoup moins d’angiographies ou d’angioplasties que les hommes. Pour le docteur Schiele, il convient de réfléchir à une surveillance et à des traitements plus spécifiques chez les femmes en formant les médecins à affiner leur diagnostic et la prise en charge correspondante.
Il convient également de tenir compte du risque hormonal dans le déclenchement d’un infarctus ; à cet égard, une initiative intéressante « Cœur-artères-femmes » a d’ailleurs été mise en place à Lille début 2013 (68).
Dans la mesure où l’attention portée à la symptomatologie permet de détecter la pathologie le plus tôt possible pour mieux la traiter, il conviendrait dès lors d’améliorer la formation initiale et continue des médecins afin qu’ils puissent établir un diagnostic tenant compte des symptômes spécifiques aux femmes.
Au-delà du diagnostic et de la symptomatologie, les médecins doivent aussi être mieux formés à effectuer des interventions médicales qui tiennent compte des spécificités physiologiques et biologiques des femmes. Par exemple, le « stent », petit ressort métallique destiné à maintenir une artère ouverte, fonctionne parfaitement chez une femme mais demande un geste particulier, car les artères des femmes sont plus fines et sinueuses, comme l’a précisé Mme Dominique Henon.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 51 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit que la formation initiale et continue des médecins, mais aussi des personnels médicaux et paramédicaux, notamment, comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique, et vos rapporteures sont particulièrement attachés à la mise en œuvre de ces dispositions.
Recommandation n° 9 : Améliorer la formation des médecins, initiale et continue, et des professionnel-le-s de santé pour mieux prendre en compte les spécificités des femmes dans les diagnostics et les traitements.
Lors de son audition par la délégation, Mme Dominique Henon a également évoqué la question de la représentation des femmes dans les essais cliniques de médicaments. En effet, « nous nous sommes rendu compte que celles-ci étaient largement sous-représentées dans la recherche médicale, et que les différences biologiques entre hommes et femmes avaient une incidence sur l’action des traitements et les prises en charge. À titre d’exemple, au regard des différences de poids moyen entre les deux sexes, un traitement pré-dosé pourrait être excessif pour une femme au vu de la surreprésentation des hommes dans les cohortes sollicitées pour réaliser un essai clinique ».
En indiquant que cette exclusion des femmes des essais thérapeutiques a sans doute été dictée par le souci de les protéger dès lors qu’elles pourraient ignorer un début de grossesse, Mme Henon a également indiqué que, selon le professeur Simon, chef du service de prévention cardiovasculaire de l’hôpital européen Georges Pompidou, la proportion des femmes dans les essais cliniques n’est que de 30 % en moyenne.
Sur ce point, la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Mme Marisol Touraine, a cependant rappelé qu’aux termes de la réglementation européenne, les essais cliniques doivent porter sur un échantillon représentatif de la population, c’est-à-dire aussi bien sur les hommes que sur les femmes et les enfants. Or les essais cliniques, qui peuvent durer plusieurs mois, ne peuvent être réalisés sur des femmes enceintes. Par conséquent, les laboratoires préfèrent faire appel à des hommes pour ne pas être amenés à interrompre des essais cliniques en cas de survenue d’une grossesse, selon la ministre, qui ne s’est pas prononcée en faveur de l’introduction d’éléments nouveaux dans la loi, puisque le droit prévoit déjà que les essais doivent concerner également les femmes. Selon la ministre, « nous devons donc réfléchir à cette question, sachant que ces essais sont moins pratiqués sur les femmes pour des raisons de protection de la santé des femmes enceintes ».
Il conviendrait en tout état de cause de disposer de davantage d’informations sur les conditions pratiques de réalisation des essais cliniques (durée moyenne et médiane, etc.) ainsi que la représentation de femmes dans ces tests.
Recommandation n° 10 : Diligenter une mission d’évaluation sur les conditions d’essais cliniques de médicaments et la représentation des femmes dans ces tests.
Lancé en 2010 par l’Assurance maladie sous forme d’expérimentations, le programme d’accompagnement du retour à domicile (PRADO) vise à favoriser le suivi d’une mère et de son enfant par une sage-femme libérale dans le cadre d’un retour plus précoce au domicile après accouchement. Il concerne des femmes ayant accouché par voie basse d’un enfant unique, sans complication, et fonctionne sur la base du volontariat. La parturiente est informée d’être suivie après la naissance à domicile par une sage-femme libérale si une sortie précoce s’avère possible. Les femmes sont satisfaites à 90 % du service proposé, en particulier l’organisation des 2 visites de sage-femme à domicile, comme cela a été souligné lors des auditions de vos rapporteures.
En tout état de cause, quels que soient les moyens et professionnel-le-s de santé concerné-e-s, vos rapporteures soulignent l’importance de promouvoir un accompagnement de qualité pour permettre aux parturientes de quitter la maternité et revenir chez elles dans de bonnes conditions.
Recommandation n° 11 : Développer un accompagnement de qualité en direction des parturientes pour faciliter le retour à domicile après la sortie de la maternité.
DEUXIÈME PARTIE : CONFORTER LES AVANCÉES EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
La question des droits sexuels et reproductifs illustre bien le concept de « troisième génération des droits des femmes », qui vise à passer d’une égalité en droits à une égalité de faits.
Alors que 2015 sera marqué par le vingtième anniversaire de la grande Conférence de Pékin (69) et, en France, par les 40 ans de la promulgation de la loi Veil, vos rapporteures saluent les avancées prévues par le présent projet de loi en matière de santé sexuelle et reproductive, et proposent de les prolonger pour mieux conforter le droit à l’avortement (I) et l’accès à la contraception (II) ainsi que renforcer le dépistage des infections sexuellement transmissibles (III).
I. AMÉLIORER L’ACCÈS À L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG) SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Le droit à l’avortement est un acquis majeur et un droit fondamental des femmes et le fruit d’un long combat pour leur droit à disposer de leur corps, qui est une condition indispensable pour la construction de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et d’une société de progrès. Cependant, ce droit reste fragile et, en pratique, l’accès à une IVG est parfois problématique (A).
Plusieurs avancées majeures sont intervenues depuis 2012 (B) et trouvent un prolongement dans le présent projet de loi, à travers les dispositions prévues en matière d’IVG médicamenteuse (article 31), qui pourraient être approfondies et complétées sur quelques points (C).
A. L’AVORTEMENT : UN CHOIX ET UN DROIT DONT LA PLEINE EFFECTIVITÉ SE HEURTE ENCORE À CERTAINES DIFFICULTÉS
Il convient tout d’abord de rappeler les principales évolutions intervenues concernant le recours à l’avortement (1) et la méthode utilisée, avec une progression de l’IVG par voie médicamenteuse depuis plusieurs années (2).
Par ailleurs, aujourd’hui encore, le recours à l’IVG se heurte à différents obstacles et correspond parfois à un « parcours du combattant » pour les femmes (3).
1. Les principales évolutions intervenues en matière de recours à l’IVG
En 2012, près de 219 200 IVG ont été réalisées en France, dont 207 000 en métropole, et ce nombre est relativement stable depuis une dizaine d’années, selon une étude récente de la DREES (70). Depuis 1975, année de la légalisation de l’avortement en France, le recours à l’IVG a d’abord baissé, grâce à une meilleure diffusion de la contraception, puis s’est ensuite stabilisé. Sur la période récente, le nombre d’IVG a baissé en 2011 et en 2012, par rapport à 2010, comme l’illustre le graphique ci-dessous.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’IVG DEPUIS 1990
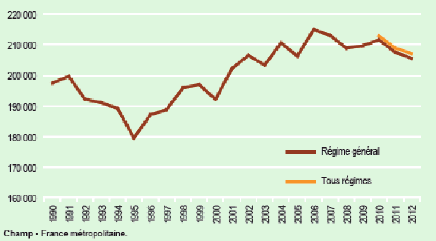
En 2012, on comptait 14,5 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en France métropolitaine et 25,3 dans les départements d’outre–mer (DOM), ces taux étant relativement stables depuis 2006.
ÉVOLUTION DU TAUX DE RECOURS À L’IVG DEPUIS 1990
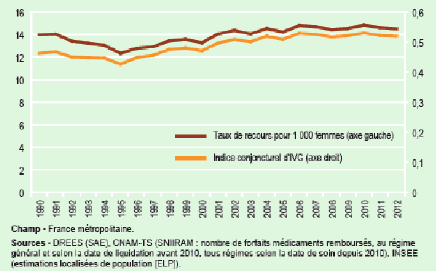
Source : DREES (étude précitée de juin 2014)
Les écarts régionaux perdurent : on observe ainsi des recours à l’IVG plus élevés dans les DOM, mais aussi en Île-de-France et dans le sud de la France. En France métropolitaine, le recours est par exemple deux fois plus élevé en Provence-Alpes-Côte d’Azur que dans les Pays de la Loire.
Un recours plus fréquent à l’IVG dans les départements d’outre-mer
Les territoires d’outre-mer ont des taux d’IVG plus élevés qu’en métropole (où celui est de 14,5 IVG pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans). En 2012, le taux de recours était ainsi de 19,4 IVG pour 1 000 femmes à La Réunion, plus de 25 en Guyane (26,7 IVG pour 1 000 femmes) et en Martinique (25,3), et jusqu’à 37,5 IVG pour 1 000 femmes en Guadeloupe. Pa ailleurs, la fréquence du recours à l’IVG au cours de la vie s’élève 60 % contre 36 % en métropole.
S’agissant plus particulièrement des mineures, on observe également un écart significatif entre la moyenne métropolitaine (9,9 IVG pour 1 000 jeunes filles âgées de 15 à 17 ans) et celle des DOM, hors Mayotte, qui s’élève à 23,8 IVG , et jusqu’à 31,8 en Guadeloupe (cf. les données détaillées dans le tableau présenté ci-après).
L’étude d’impact du projet de loi relatif à la santé souligne à cet égard que « l’amélioration de l’accès à la contraception d’urgence », prévue par l’article 3, « doit avoir un impact positif sur le nombre de grossesses non désirées dans ces territoires ».
Comme le souligne un rapport récent (71) du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), l’IVG est un événement assez courant de la vie sexuelle et reproductive de femmes, puisqu’on estime que près d’une femme sur trois aura recours à l’IVG au cours de sa vie (72). Par ailleurs, le nombre d’IVG en 2011 correspondait à 0,53 IVG par femme, selon une étude de l’Institut national des études démographiques (INED) publiée en janvier 2015 (73).
FRÉQUENCE DU RECOURS À UNE IVG AU COURS DE LA VIE
![]()
![]()
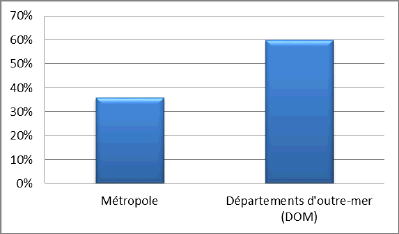
Source : données de la DREES 2007-2009, estimation INED 2011 (ministère des droits des femmes, 2014)
LES IVG DANS LES RÉGIONS EN 2012
Régions |
Nombre d’IVG |
Proportion d’IVG ( ‰) | ||||
IVG hospitalières (SAE) |
Forfaits remboursés en centres de santé, établissements de PMI et de planification familiale |
Forfaits remboursés en ville |
Total des IVG réalisées |
IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans |
IVG pour 1000 femmes mineures de 15 à 17 ans | |
Île-de-France |
40 756 |
751 |
12 502 |
54 009 |
18,0 |
11,3 |
Champagne-Ardenne |
3 181 |
0 |
130 |
3 311 |
11,4 |
9,2 |
Picardie |
4 897 |
0 |
441 |
5 338 |
12,4 |
12,1 |
Haute- Normandie |
4 393 |
6 |
817 |
5 216 |
12,6 |
9,8 |
Centre |
5 992 |
87 |
518 |
6 597 |
12,2 |
8,3 |
Basse-Normandie |
3 542 |
0 |
161 |
3 703 |
12,0 |
9,1 |
Bourgogne |
3 826 |
0 |
220 |
4 046 |
12,0 |
10,1 |
Nord – Pas-de-Calais |
11 882 |
0 |
757 |
12 639 |
13,5 |
12,7 |
Lorraine |
5 996 |
167 |
121 |
6 284 |
12,0 |
9,5 |
Alsace |
4 620 |
0 |
170 |
4 790 |
11,1 |
8,9 |
Franche-Comté |
2 709 |
0 |
497 |
3 206 |
12,6 |
10,0 |
Pays de la Loire |
8 369 |
0 |
45 |
8 414 |
10,7 |
7,8 |
Bretagne |
7 197 |
18 |
476 |
7 691 |
11,3 |
7,5 |
Poitou-Charentes |
3 905 |
0 |
350 |
4 255 |
11,6 |
8,9 |
Aquitaine |
8 164 |
372 |
1 761 |
10 297 |
14,5 |
9,5 |
Midi-Pyrénées |
8 131 |
63 |
907 |
9 101 |
14,3 |
8,8 |
Limousin |
1 883 |
0 |
3 |
1 886 |
12,8 |
10,7 |
Rhône-Alpes |
16 591 |
185 |
2 381 |
19 157 |
13,2 |
8,2 |
Auvergne |
2 967 |
3 |
233 |
3 203 |
11,5 |
8,7 |
Languedoc-Roussillon |
9 541 |
5 |
934 |
10 480 |
18,0 |
12,5 |
PACA |
17 273 |
330 |
4 597 |
22 200 |
20,7 |
13,4 |
Corse |
1 133 |
15 |
149 |
1 297 |
18,8 |
11,9 |
France métropolitaine |
176 948 |
2 002 |
28 170 |
207 120 |
14,5 ‰ |
9,9 ‰ |
Guadeloupe |
2 674 |
0 |
1 039 |
3 713 |
37,5 |
31,8 |
Martinique |
2 388 |
0 |
11 |
2 399 |
25,3 |
24,4 |
Guyane |
1 133 |
0 |
511 |
1 644 |
26,7 |
27,0 |
La Réunion |
3 196 |
0 |
1 084 |
4 280 |
19,4 |
19,0 |
Mayotte |
1 342 |
0 |
140 |
1 482 |
nd |
0 |
Total DOM (hors Mayotte) |
9 391 |
0 |
2 645 |
12 036 |
25,3 ‰ |
23,8 ‰ |
FRANCE ENTIÈRE (hors Mayotte) |
186 339 |
2 002 |
30 815 |
219 156 |
14,9 ‰ |
10,5 ‰ |
SAE : Statistique annuelle des établissements de santé - PMI : Protection maternelle et infantile
Sources : DREES (étude précitée de juin 2014)
Il ressort également de cette étude de l’INED qu’en 2011 les femmes ont eu recours à l’IVG à 27,5 ans en moyenne, en légère baisse par rapport à 1975, où l’âge moyen à l’IVG était de 28,6 ans.
Les femmes de 20 à 24 ans restent les plus concernées, avec un taux de recours de 27 IVG pour 1 000 femmes, tandis que les taux diminuent légèrement chez les moins de 20 ans sur la période récente (cf. graphique ci-dessous). Lors de son audition par la délégation, Mme Dominique Henon a souligné que si, depuis quelques années, le nombre d’IVG est relativement stable, il a augmenté régulièrement parmi les mineures et les jeunes femmes de moins de vingt ans (CESE, 2010). En tout état de cause, les données ci-dessous, issues d’une étude récente de la DREES, font apparaître une progression significative du recours à l’IVG chez les jeunes filles de 15 à 17 ans entre 2000 et 2010.
ÉVOLUTION DU TAUX DE RECOURS À L’IVG SELON L’ÂGE ENTRE 1990 ET 2012
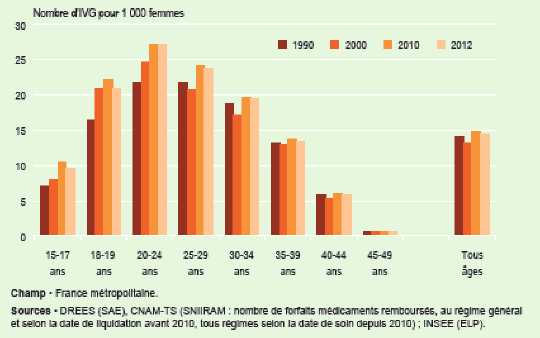
Source : DREES (étude précitée de juin 2014)
Par ailleurs, avec l’augmentation de la part des IVG médicamenteuses (cf. infra), la durée moyenne de grossesse au moment de l’IVG diminue : elle s’établit ainsi à 6,4 semaines de grossesse en 2011, contre 7,1 en 2002, comme l’illustre le graphique ci-après (INED, 2015).
Il apparaît, d’autre part, qu’avec le développement de la contraception, la fréquence du recours à l’IVG a diminué entre 1976 et 1995 (l’indice conjoncturel passant de 0,66 à 0,43 IVG par femme en moyenne au cours de la vie, avant d’augmenter pour atteindre 0,53 IVG par femme). On observe également une augmentation continue de la proportion d’IVG répétées depuis 1975 (cf. graphique ci-après). Cependant, la proportion de femmes ayant recours plus d’une fois à l’IVG reste faible en France : 9,5 % des femmes ont recours deux fois à l’IVG et 4,1 % trois fois ou plus.
RÉPARTITION DES IVG SELON LE STADE DE LA GROSSESSE ET ÉVOLUTION DU NOMBRE D’AVORTEMENT PAR FEMME SELON LE RANG DE L’IVG
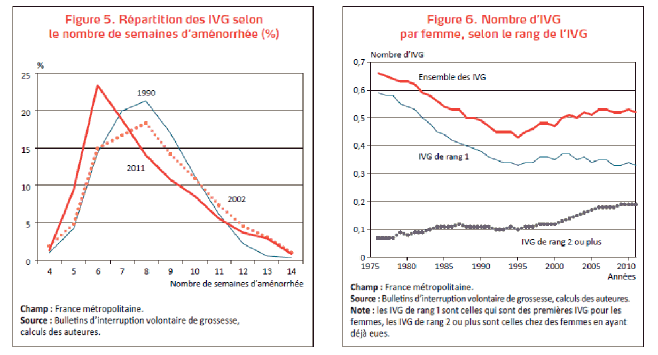 Source : INED (« Un recours moindre à l’IVG mais plus souvent répété », Population et sociétés, janvier 2015).
Source : INED (« Un recours moindre à l’IVG mais plus souvent répété », Population et sociétés, janvier 2015).
À cet égard, il convient de souligner que le recours à l’avortement ne s’explique pas principalement par une absence de couverture contraceptive : d’après l’enquête réalisée par la DREES (74) sur les femmes ayant eu recours à une interruption de grossesse en 2007, deux IVG sur trois concernaient une femme utilisant une méthode contraceptive, et dans près de 30 % des cas, il s’agissait de la pilule, comme l’a souligné Mme Dominique Henon lors de son audition. Par ailleurs, seules 3 % des femmes de 15 à 49 ans, ni enceintes, ni stériles, ayant des rapports hétérosexuels et ne voulant pas d’enfants, n’utilisaient aucune méthode de contraception en France en 2013, selon l’enquête Fécond.
Outre le fait qu’aucune méthode de contraception n’est efficace à 100 %, y compris en cas d’utilisation correcte et régulière (75), les échecs contraceptifs restent donc nombreux et peuvent résulter par exemple de l’oubli d’une pilule, de la rupture d’un préservatif, d’un déplacement, mauvaise mise en place ou expulsion d’un dispositif intra-utérin (DIU ou stérilet), du décollement du patch contraceptif ou déplacement d’un diaphragme ou cape cervicale pendant le rapport, etc.
Cependant, comme l’a notamment souligné Mme Dominique Henon (76), on peut comprendre que sur quarante ans d’une vie de gestion de sa contraception, l’oubli d’un comprimé fasse aussi partie de la vie. Dans le même sens, Mme Nathalie Bajos, socio-démographe et responsable de l’équipe de recherche INED-INSERM « Genre, santé sexuelle et reproductive », a fait observer que « le risque zéro n’existe pas dans le domaine de la contraception, comme il n’existe dans aucun domaine de la santé publique. De la même manière que toute personne peut oublier une fois dans sa vie de prendre son traitement médical, toutes les femmes entre dix-sept ans, âge du premier rapport sexuel, et cinquante ans, âge moyen de la ménopause, oublient au moins une fois de prendre leur pilule ! ».
SITUATION CONTRACEPTIVE AVANT L’IVG
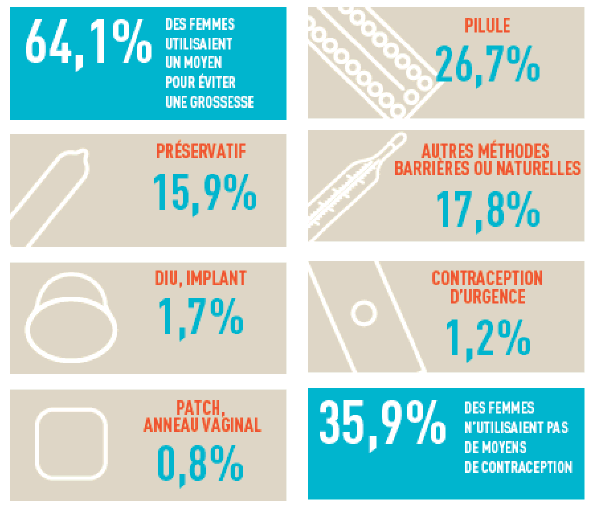
Source : DREES, enquête sur les IVG en 2007 (infographie du ministère des droits des femmes, 2014)
Par ailleurs, Mme Nathalie Bajos a fait observer que le nombre globalement stable d’IVG dissimule en réalité un double phénomène :
– d’un côté, une baisse des grossesses non prévues, grâce à la diffusion des méthodes de contraception ;
– et de l’autre, une augmentation du recours à l’IVG en cas de grossesse non désirée. En d’autres termes, moins de femmes ont une grossesse non prévue, mais lorsque c’est le cas, elles l’interrompent plus souvent, et cette probabilité n’a cessé d’augmenter à la faveur de ce que les démographes appellent la « jeunesse sexuelle (77) ».
En effet, si l’âge médian du premier rapport sexuel est relativement stable depuis trente ans (17,2 ans pour les garçons et 17,6 ans pour les filles), l’âge du premier enfant a, quant à lui, reculé. Par rapport aux années 70, quatre années supplémentaires séparent aujourd’hui le premier rapport sexuel du premier enfant, cette période de jeunesse sexuelle étant caractérisée par la fréquence des rapports sexuels et une grande fertilité chez les femmes. De surcroît, avec l’évolution de la scolarité féminine, l’entrée massive des femmes sur le marché du travail, mais aussi la contraception et l’avortement, la vie sexuelle des femmes s’est fortement diversifiée : en 1972, plus de 60 % d’entre elles avaient leur premier rapport sexuel avec leur futur mari, et elles ne sont plus que quelques pour cent dans ce cas aujourd’hui.
Le risque d’avoir deux grossesses non prévues plutôt qu’une est beaucoup plus élevé par rapport aux générations des années 70, en lien également avec ces quatre années supplémentaires de jeunesse sexuelle, d’où la progression du nombre de femmes qui recourent une seconde fois à l’IVG. Ce phénomène est observé dans d’autres pays industrialisés, et les femmes se présentant pour une deuxième IVG sont d’ailleurs plus souvent sous contraception, avec des méthodes efficaces, que celles se présentant pour une première IVG (78).
Ainsi, comme l’a souligné Mme Nathalie Bajos, la stabilité du taux de recours à l’IVG n’est le signe ni d’un échec des politiques de contraception, ni d’une irresponsabilité des femmes. Elle reflète en réalité une évolution sociale et démographique liée notamment à l’allongement de la période de jeunesse sexuelle, mais aussi la volonté de choisir le moment d’être parent, dans un contexte de progression du travail des femmes sur une longue période. En tout état de cause, l’avortement est un droit fondamental et l’expression d’un libre choix : il ne doit pas faire l’objet d’entraves, voulues ou « inconscientes » et les femmes doivent aussi pouvoir choisir le type d’IVG pratiquée.
2. Le développement de la méthode médicamenteuse
Il existe aujourd’hui différentes méthodes d’interruption de grossesse :
– l’IVG chirurgicale, également appelée IVG instrumentale ou par aspiration, qui ne peut être pratiquée qu’en établissement de santé jusqu’à la fin de la douzième semaine de grossesse (article L. 2212-1 du code de la santé publique), et qui peut avoir lieu sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale ;
– la technique médicamenteuse (RU 486 ou mifégyne), autorisée depuis 1989 et qui était d’abord réservée aux établissements de santé. La loi « Aubry-Guigou » du 4 juillet 2001 (79) et ses textes d’application de juillet 2004 ont permis aux femmes de recourir à une IVG médicamenteuse dans le cadre de la médecine de ville. Cet acte doit être effectué sous la surveillance d’un gynécologue ou d’un médecin généraliste justifiant d’une expérience professionnelle adaptée et travaillant en réseau avec un établissement de santé avec lequel il a passé une convention. Ces IVG peuvent être pratiquées jusqu’à 5 semaines de grossesse (soit 7 semaines après le début des dernières règles) ou 7 semaines lorsqu’elles sont réalisées en établissement de santé (soit 9 semaines d’aménorrhée).
Par ailleurs, depuis mai 2009 (80), les centres de santé et les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) réalisent également des IVG médicamenteuses.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTEURS, DÉLAIS ET MÉTHODES D’IVG EN FRANCE
IVG médicamenteuses |
IVG chirurgicales jusqu’à la fin de la 12ème semaine | |||
Jusqu’à 5 semaines |
Jusqu’à 7 semaines |
Sous anesthésie locale |
Sous anesthésie générale | |
Établissements de santé |
X |
X |
X |
X |
Centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) |
X |
|||
Centres de santé |
X | |||
Médecins libéraux (gynécologues, généralistes) |
X | |||
Comme l’a rappelé la ministre Marisol Touraine, lors de son audition par la délégation, les IVG médicamenteuses représentent aujourd’hui plus de la moitié des avortements pratiqués en France. En 2012, leur proportion s’élevait ainsi à près de 57 %, comme l’illustre le graphique ci-après.
RÉPARTITION DES IVG PAR TYPE DE MÉTHODE EN 2012 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
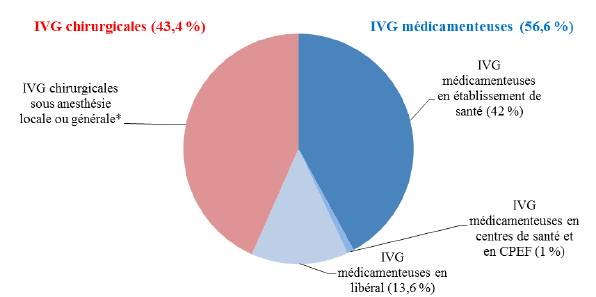
* Les IVG chirurgicales sous anesthésie générale représentaient 34 % des IVG pratiquées en 2012 et celles sous anesthésie locale 11 % des IVG pratiquées, selon le rapport précité du HCEfh.
Source : graphique réalisé d’après les données chiffrées de l’étude précitée de la DREES (juin 2014)
La hausse progressive du nombre des IVG médicamenteuses en ville ainsi qu’en centres de santé et en CPEF depuis 2009 s’accompagne, depuis le début des années 2000, d’une baisse du nombre des IVG chirurgicales pratiquées dans les établissements de santé (hôpitaux et privés), alors que le nombre des IVG médicamenteuses en établissement de santé a continué de s’accroître avant de se stabiliser depuis 2005 (cf. tableau infra).
En outre, si la méthode utilisée dépend, en principe, du choix de la femme qui souhaite avorter et du stade de la grossesse, il a été souligné au cours des travaux de la délégation que, dans la pratique, les femmes n’ont pas toujours le libre choix de la technique utilisée (cf. infra), faute notamment que toutes les méthodes soient disponibles dans un établissement ou à proximité de la patiente (curetage ou aspiration par anesthésie locale, générale ou IVG par voie médicamenteuse, en ville ou à l’hôpital). Il s’agit là de l’une des difficultés qui demeurent en matière d’accès à l’IVG, en lien avec la question plus large de l’organisation de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire.
LES IVG SELON LA MÉTHODE ET LE MODE D’EXERCICE EN 2012
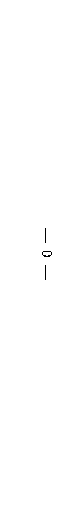
En France métropolitaine
2001 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||
Secteur public |
IVG chirurgicales |
90 450 |
77 854 |
79 244 |
79 849 |
77 824 |
75 729 |
74 517 |
71 741 |
69 756 |
IVG médicamenteuses |
44 550 |
66 320 |
67 505 |
68 019 |
68 209 |
68 637 |
71 190 |
71 967 |
72 537 | |
Secteur privé |
IVG chirurgicales |
49 713 |
36 563 |
33 676 |
29 289 |
26 158 |
25 292 |
22 876 |
21 525 |
20 093 |
IVG médicamenteuses |
17 467 |
20 566 |
20 640 |
17 952 |
16 629 |
16 908 |
16 279 |
15 276 |
14 562 | |
Ensemble des établissements |
IVG chirurgicales |
140 163 |
114 417 |
112 920 |
109 138 |
103 982 |
101 021 |
97 393 |
93 266 |
89 849 |
IVG médicamenteuses |
62 017 |
86 886 |
88 145 |
85 971 |
84 838 |
85 545 |
87 469 |
87 243 |
87 099 | |
IVG médicamenteuses en ville |
5 008 |
13 945 |
18 034 |
13 945 |
20 171 |
26 613 |
26 827 |
28 170 | ||
IVG médicamenteuses en centres de santé ou en CPEF |
718 |
1 466 |
1 651 |
2 002 | ||||||
Dans les départements d’outre-mer (DOM)
2001 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||
Secteur public |
IVG chirurgicales |
6 625 |
5 551 |
5 654 |
5 400 |
5 687 |
5 347 |
5 479 |
5 124 |
3 895 |
IVG médicamenteuses |
3 309 |
4 119 |
3 854 |
3 974 |
3 691 |
3350 |
3 083 |
3 485 |
3 655 | |
Secteur privé |
IVG chirurgicales |
2 941 |
1 302 |
1 421 |
1 714 |
1 339 |
1 322 |
1 182 |
889 |
942 |
IVG médicamenteuses |
556 |
1 566 |
1 641 |
1 242 |
1 199 |
883 |
931 |
1 093 |
899 | |
Ensemble des établissements |
IVG chirurgicales |
9 566 |
6 853 |
7 075 |
7 114 |
7 026 |
6 669 |
6 661 |
6 013 |
4 837 |
IVG médicamenteuses |
3 865 |
5 685 |
5 495 |
5 216 |
4 890 |
4 233 |
4 014 |
4 578 |
4 554 | |
IVG médicamenteuses en ville |
545 |
953 |
1 343 |
1 707 |
1 961 |
2 375 |
2 582 |
2 645 | ||
IVG médicamenteuses en centres de santé ou en CPEF |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
La pratique des IVG médicamenteuses en centres de santé, centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) est possible depuis mai 2009 Pour les IVG hors établissements hospitaliers,
les données sont selon la date de liquidation et pour le régime général avant 2010, selon la date de soin et pour tous les régimes depuis janvier 2001.
Champ : DOM, hors Mayotte.
Sources : DREES (SAE) ; CNAM-TS (SNIRAM, forfaits médicaments de ville) ; étude précitée de la DREES de juin 2014
3. La persistance de difficultés d’accès à l’IVG liées notamment à l’organisation de l’offre de soins et au parcours des femmes
Le rapport précité du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les homes (HCEfh), publié en novembre 2013, comporte une analyse approfondie et de grande qualité des différents obstacles qui demeurent en matière d’accès à l’IVG sur l’ensemble du territoire, et dont Mme Françoise Laurent, présidente de la commission « Santé, droits sexuels et reproductifs » du HCEfh, a présenté les principales conclusions, lors de son audition par la délégation (81). Sans reprendre l’ensemble de ces développements détaillés dans le cadre du présent rapport, vos rapporteures soulignent plus particulièrement certaines difficultés, évoquées au cours des travaux de la délégation.
● Une offre de soins en baisse face à une demande globalement stable
En 2011, les établissements de santé dotés de services de gynécologique-obstétrique ou de chirurgie, ou plus rarement d’un pôle spécifique, pratiquaient 86 % des IVG en 2011, soit 100 % des IVG chirurgicales et 75 % des IVG médicamenteuses (82). Cependant, la fermeture d’établissements publics et le désengagement du privé ont conduit à une forte concentration de l’offre de soins sur un nombre restreint d’établissements publics.
En effet, plus de 130 établissements de santé pratiquant l’IVG ont fermé ces dix dernières années, soit 5 % des établissements publics et 48 % des établissements privés pratiquant l’IVG, comme l’illustre le graphique ci-après.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS PRATIQUANT L’IVG EN FRANCE ENTRE 2000 ET 2011
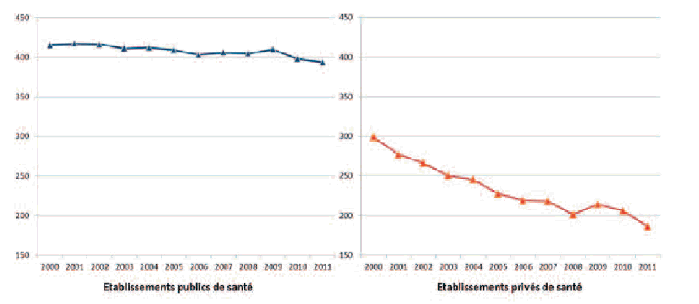
Source : rapport du HCEFh (données issues de la statistique annuelle des établissements de santé SAE), in rapport précité du HCEfh (2013)
Alors que la demande reste stable, cette diminution a conduit à une forte concentration de la pratique de l’IVG sur les établissements restants : une étude publiée en 2009 montrait ainsi que 5 % des établissements réalisaient 23 % des IVG et, entre 2000 et 2011, les régions ont vu le nombre d’IVG pratiquées par établissement de santé augmenter en moyenne de 11 % (HCEfh, 2013), cette augmentation représentant même 24 % en Île-de-France. Or cette concentration de l’offre peut entraîner des effets d’étranglement et de file d’attente, avec des délais pour les prises de rendez-vous.
La diminution du nombre d’établissements de santé pratiquant cette activité s’explique pour partie par la sous-valorisation de l’IVG, qui a conduit notamment à un désengagement du privé sur une activité moins rentable, voire déficitaire, mais aussi par les restructurations hospitalières intervenues dans le secteur public, avec notamment la fermeture de maternités de petite taille.
S’agissant de l’offre d’IVG médicamenteuse en médecine de ville, les médecins libéraux conventionnés pratiquaient 24 % des IVG médicamenteuses en 2011, soit 13 % du nombre total d’IVG. Cependant, la pratique, encore relativement récente (décret de 2004 pris en application de la loi de juillet 2001), se développe de manière limitée mais aussi disparate, avec de grandes différences selon les régions (83). Ainsi, les médecins réalisent plus de 12 % des IVG dans certaines régions, telles que l’Aquitaine, l’Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’azur, la Réunion, Mayotte), alors que dans d’autres régions, moins de 1 % des IVG, voire aucune, sont réalisées en cabinet libéral (Pays-de-la Loire, Limousin, Corse, Martinique, Alsace, Guadeloupe).
À cet égard, il est à noter que le nombre de conventions signées par des médecins libéraux avec les établissements de santé ne fait pas l’objet d’un recensement systématique et centralisé, et il en va de même concernant celles signées par des centres de santé et les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF), qui par ailleurs ne réalisent aujourd’hui que 1 % des IVG.
De plus, si 42 % des médecins conventionnés étaient des généralistes en 2009 et 57 % des gynécologues obstétriciens (84), de nombreux bassins de vie n’ont pas de gynécologue, comme le fait apparaître la carte ci-dessous. Ceci soulève aussi, plus largement, le problème de la démographie médicale, avec la baisse dans de nombreuses spécialités de médecine (37 % des gynécologues partiront par exemple à la retraite dans les cinq ans), mais aussi une répartition inégale des professionnel-le-s de santé sur l’ensemble des territoires et l’émergence de « déserts médicaux ».
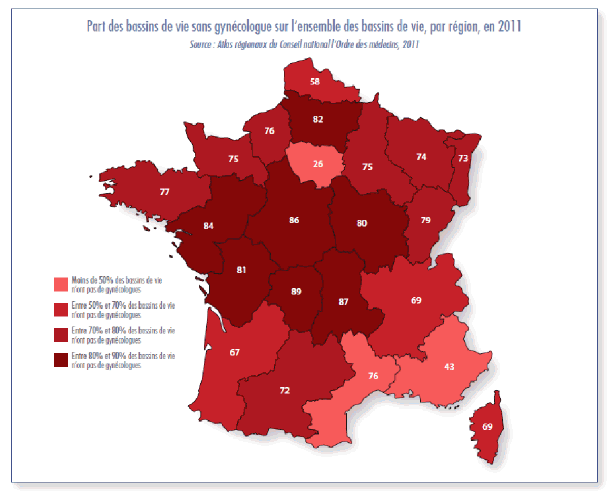
Lecture : Dans le Limousin, 89 % des bassins de vie n’ont pas de gynécologue.
Source : Atlas régionaux du Conseil national de l’ordre des médecins, 2011 (rapport précité du HCEfh de 2013)
Ce phénomène de vieillissement du corps médical est aggravé par le départ à la retraite des « générations militantes ». Comme le soulignait déjà un rapport d’information adopté par la Délégation aux droits des femmes en 2008 (85), la génération des médecins qui a mis en œuvre la loi Veil et qui est à l’origine de la création des centres autonomes d’IVG va prochainement partir à la retraite et la relève de ces médecins n’est pas assurée pour la pratique d’un acte considéré trop souvent comme « peu attractif ». L’accueil peut aussi être peu « encourageant » d’où l’importance de la formation dans ce domaine mais aussi des enquêtes réalisées auprès des femmes, comme cela a fait en Île-de-France dans le cadre du projet FRIDA.
Le rapport précité du HCEfh souligne par ailleurs le manque de personnel et les restrictions budgétaires, la formation insuffisante des professionnel-le-s de santé, qui conduit à des représentations empreintes d’une approche conservatrice de l’IVG, ainsi que les difficultés liées à un métier sous-estimé au statut peu valorisé. En particulier, Mme Sophie Eyraud, médecin généraliste et présidente de l’Association nationale des centres d’IVG et de contraception (ANCIC), ainsi que Mme Françoise Laurant, membre du HCEfh et ancienne présidente du Planning familial, ont souligné lors de leur audition les difficultés particulières liées au statut de praticien hospitalier et aux modalités de recrutement des praticiens contractuels dans les établissements, avec des contraintes liées au temps de présence minimal dans l’établissement (86). Il semblerait par ailleurs que le mode de facturation de l’IVG, par forfait, sous-évalue son coût réel.
En outre, plusieurs personnes auditionnées par la délégation ont soulevé la question de la « clause de conscience », dont le HCEfh et des associations féministes telles qu’Osez le féminisme ainsi que le Planning familial souhaitent la suppression. En effet, l’article L. 2212-8 du code de la santé publique, issu de la loi Veil de 1975, dispose qu’ « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse », étant précisé qu’il doit informer sans délai l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. De la même manière, aucune sage-femme, infirmier-e ou auxiliaire médical-e n’est tenu-e de concourir à une interruption de grossesse. Aux termes du même article, un établissement de santé privé peut refuser que des IVG soient pratiquées dans ses locaux.
Or l’article R. 4127-47 du code de la santé publique prévoit déjà, de façon générale, qu’« un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles », hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le ou la patient-e et transmettre un médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. Des dispositions analogues sont prévues pour les sages-femmes et les infirmier-e-s.
Les dispositions concernant spécifiquement la clause de conscience pour l’IVG suscitent des réserves en ce que, symboliquement, elle concourt à en faire un droit à part. Mme Françoise Laurant a ainsi évoqué « la redondance » de ces dispositions, en estimant qu’« y insister dans cet article, c’est signifier que ce droit n’est pas un droit normal ». Il en va d’ailleurs de même pour le délai de réflexion de sept jours que vos rapporteures préconisent de supprimer.
● Des difficultés rencontrées par des femmes concernant le choix de la méthode, la confidentialité et certains frais liés à une IVG
Les femmes qui souhaitent avorter doivent pouvoir choisir librement la technique utiliser au regard de leur situation et de leurs préférences personnelles, ainsi que des avantages et des inconvénients de chacune d’elles.
Or, en pratique, le choix de la technique d’IVG n’est pas toujours garanti. Une enquête publiée en 2011 montrait ainsi que, parmi les IVG réalisées en établissement, seules 44 % des femmes affirmaient avoir eu le choix de la méthode et une sur dix disait ne pas avoir été consultée sur celle-ci (87). Cela peut tenir notamment à l’avancement de la grossesse, qui ne permet plus d’envisager une IVG médicamenteuse – d’où l’importance de garantir un accès rapide et de proximité à l’IVG chirurgicale – mais aussi au fait que tous les établissements de santé ne pratiquent pas les deux techniques. En outre, les IVG chirurgicales, même sous anesthésie locale, ne peuvent aujourd’hui être réalisées qu’en établissement de santé. Il conviendrait d’assouplir cette restriction (cf. infra).
Par ailleurs, comme l’a souligné Mme Sophie Eyraud, médecin généraliste et présidente de l’Association nationale des centres d’IVG et de contraception (ANCIC), l’IVG médicamenteuse en ville ne convient pas à toutes les femmes. En particulier, les femmes qui souhaitent avorter dans le secret, sans que leur conjoint ou leur famille n’en soit informé, mais aussi les femmes isolées ou en situation très précaire peuvent souhaiter effectuer une IVG en établissement de santé, pour ne pas vivre l’interruption de grossesse à domicile, qui peut s’accompagner de douleurs et de saignements notamment, et bénéficier d’un accompagnement à l’hôpital, y compris le cas échéant d’une assistante sociale.
Il en va de même pour le choix de la méthode d’anesthésie pour les IVG par aspiration, qui lui aussi n’est pas toujours garanti, comme le soulèvent plus d’un tiers des ARS, selon le rapport précité du HCEfh.
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE CHACUNE DES MÉTHODES *
Méthode |
Délais / Lieux |
Processus |
Avantages |
Inconvénients |
IVG médicamenteuse |
Jusqu’à 7 semaines de grossesse dans les établissements de santé Jusqu’à 5 semaines pour les médecins de ville et les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) |
1er rendez-vous : prise de Mifégyne (stoppe le développement de l’embryon). 2ème rendez-vous : 36 à 48 heures plus tard : prise de prostaglandines (provoque les contractions de l’utérus pour expulser l’embryon par voies naturelles, 2-4 heures |
Méthode non invasive À domicile Méthode faisable rapidement après le choix |
Durée du processus (plusieurs jours) Expulsion chez soi (parfois) Charge psychologique ** Douleur et pénibilité (effets secondaires : hémorragies, vomissements, diarrhées, nausées, maux de ventre, voire perte de vue) Une aspiration est parfois nécessaire (3 à 5 % d’échec de l’IVG médicamenteuse) |
IVG par aspiration Anesthésie locale |
Jusqu’à 12 semaines de grossesse, en établissement de santé |
Durée de l’intervention : 15-20 minutes (anesthésie, dilatation du col de l’utérus, aspiration) Pré et post-intervention : 1 à 2 h |
Moins douloureuse Moins d’hémorragies Durée totale du processus plus rapide Conscience |
À l’hôpital Anesthésie |
IVG par aspiration Anesthésie générale |
Jusqu’à 12 semaines de grossesse, en établissement de santé |
Intervention : Pré et post-intervention : 1 à 2 heure(s) |
Moins douloureuse Moins d’hémorragies Durée totale du processus plus rapide Inconscience |
À l’hôpital Anesthésie Davantage de complications possibles *** Récupération plus longue |
* Sur ce sujet, voir : Henshaw RC, Naji SA, Russell IT, Templeton AA. Comparison of medical abortion with surgical vaccum aspiration. Women’s preferences and acceptability of treatment. BMJ 1993; 307 (6906) : 714-7. ** IGAS, La prise en charge des interruptions volontaires de grossesse, Octobre 2009, pages 39 et 136. *** Organisation mondiale de la santé (OMS), Avortement médicalisé : Directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de santé, 2004 et Immediate complications of surgical abortion, Gynecol Bostet Biol Reprod (Paris), 2006, M. Gelly, Centre de contraception et d’IVG, Hôpital Louis-Mourier, Colombes.
Source : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh, rapport précité de novembre 2013)
La confidentialité n’est pas toujours assurée non plus, en particulier pour les mineures ou les jeunes majeures ainsi que pour les femmes ayant droit d’un assuré. En particulier, les relevés de remboursement de l’assurance maladie ne permettent pas d’assurer une totale confidentialité dans la mesure une codification de l’acte d’IVG y est inscrite et les actes associés non pris en compte par le remboursement y figurent également.
LE PARCOURS D’IVG POUR LES FEMMES
![]()
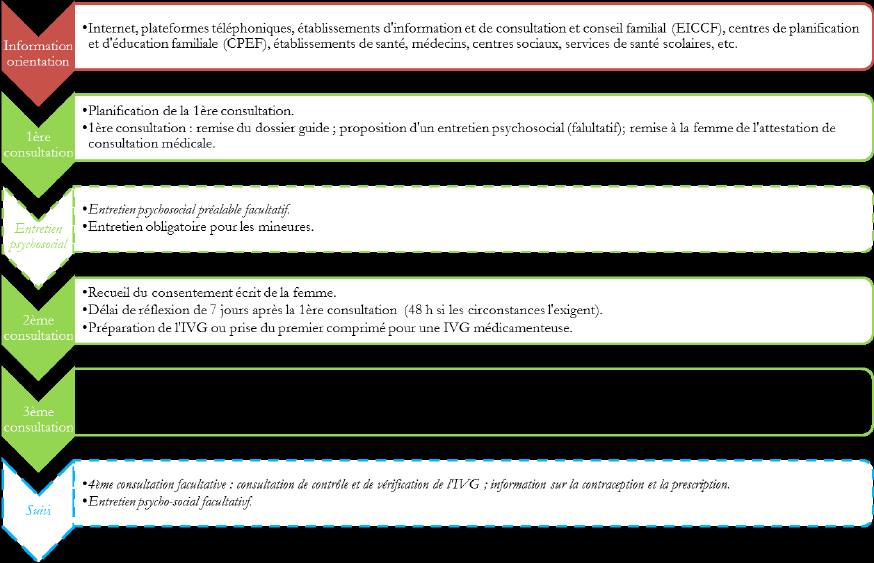
Enfin, parmi les obstacles qui demeurent pour certaines femmes en matière d’accès à l’IVG, il convient d’évoquer aussi la question des coûts afférents, puisque malgré le remboursement à 100 % des frais de soins, de surveillance et d’hospitalisation inhérents à l’IVG depuis mars 2013, la prise en charge de l’ensemble de l’acte n’est pas totale (88). Par exemple, il a été souligné qu’elle ne couvre pas la première consultation médicale préalable et les actes complémentaires éventuellement nécessaires, telles que l’échographie ou des analyses de biologie médicale. Les femmes en situation de précarité, qui ne disposent pas nécessairement d’une mutuelle ou complémentaire, peuvent dès lors rencontrer des difficultés à financer le reste à charge, et même tout simplement à faire l’avance de frais pour une consultation en ville, d’où l’intérêt, là encore, de développer le tiers payant.
Le tarif et la prise en charge d’une IVG
Le coût d’une IVG peut varier en fonction de la méthode utilisée, du type d’établissement, du mode d’anesthésie et de la durée d’hospitalisation. Mais les frais relatifs à l’IVG sont pris en charge par l’assurance maladie. Depuis le 31 mars 2013, l’IVG est prise en charge à 100 % par l’assurance maladie dans le cadre d'un forfait.
– L’IVG médicamenteuse en médecine de ville (cabinet médical, centre de santé, centre de planification et d’éducation familiale – CPEF) est remboursée par l’assurance maladie à 100 % sur la base d’un tarif forfaitaire fixé à 191,74 euros. Ce prix comprend : la 2ème consultation médicale préalable ; les deux consultations médicales de prise des médicaments, les médicaments et la consultation médicale de contrôle. Il ne comprend pas la première consultation médicale préalable ni les actes complémentaires éventuellement nécessaires (analyses de biologie médicale, échographie), pris en charge dans les conditions habituelles.
– L’IVG médicamenteuse en établissement de santé (hôpital, clinique) est remboursée par l’Assurance Maladie à 100 % sur la base d’un tarif forfaitaire fixé à 257,91 euros. Ce prix comprend : les analyses de laboratoire préalables à l’IVG ; les 2 consultations médicales de prise des médicaments, les médicaments et la consultation médicale de contrôle. Il ne comprend pas les deux consultations médicales préalables, facturables en sus et prises en charge dans les conditions habituelles.
– L’IVG chirurgicale est remboursée par l’Assurance Maladie à 100 % sur la base d’un tarif forfaitaire variable (de 437,03 euros à 644,71 euros) en fonction de l’établissement de santé (hôpital ou clinique), du type d’anesthésie (locale ou générale) et de la durée de l’hospitalisation. Ce prix comprend : les analyses préalables à l’IVG ; l’anesthésie locale ou générale, l’acte d’IVG et la surveillance, l’accueil et l’hébergement. Il ne comprend pas les deux consultations médicales préalables et la consultation médicale de contrôle, facturables en sus et prises en charge dans les conditions habituelles. Le forfait journalier n’est pas facturable. La complémentaire santé peut éventuellement prendre en charge tout ou partie des frais qui ne sont pas remboursés par l’Assurance Maladie.
– Les cas particuliers. L’IVG est prise en charge à 100 % dans le cadre d’un tarif forfaitaire avec dispense totale d’avance de frais pour : les jeunes filles mineures non émancipées sans consentement parental ; les femmes bénéficiaires de la CMU complémentaire ; les femmes bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME).
Source : CNAMTS (site Ameli, 2014)
Mme Sophie Eyraud coprésidente de l’ANCIC, a souligné, lors d’un séminaire sur la santé des femmes organisé en février 2013 (89), que les examens complémentaires, tels que le bilan biologique, qui sont parfois demandés pèsent sur les inégalités économiques, en relevant l’absence de protocole officiel et le fait que les recommandations de la Haute Autorité de santé ne semblent que peu appliquées. Ainsi, le fait de demander une échographie de datation aux femmes pour leur premier rendez-vous « constitue un obstacle important dans l’accès à l’IVG », selon Mme Eyraud, qui soulignait également les questions spécifiques posées par la prise en charge des femmes en situation de précarité en matière d’IVG.
Mme Françoise Laurant, présidente de la commission Santé, droits sexuels et reproductifs du HCEfh, a dès lors préconisé d’appliquer la prise en charge à 100 % de l’IVG à tous les actes qui lui sont associés, telle l’échographie de datation, en soulignant que la question est d’une particulière importance car le non-remboursement intégral des examens complémentaires pose de graves problèmes aux mineures qui ne peuvent se confier à leur famille, ainsi qu’aux femmes défavorisées.
Vos rapporteures se félicitent des mesures annoncées en janvier 2015 par la ministre Marisol Touraine et la secrétaire d’État chargée des droits des femmes, Mme Pascale Boistard, en vue d’améliorer la prise en charge financière de l’IVG (cf. infra).
● Des difficultés d’information et des délais qui peuvent être longs
Le manque de moyens et de personnels contribue à rendre le parcours de soins parfois difficile et peu accessible pour les femmes, mais aussi les délais entre la demande de première consultation et la date de celle-ci, avec des délais d’attente qui peuvent ensuite entraîner des refus de prise en charge. Il convient à cet égard de rappeler que seuls les médecins peuvent aujourd’hui assurer la première consultation et recueillir la demande d’IVG.
De fait, comme cela est indiqué clairement sur le site internet dédié du ministère chargé des affaires sociales, certains établissements sont surchargés et les délais peuvent être très longs. Or ceci peut avoir de lourdes conséquences pour les femmes dont la grossesse est déjà à un stade avancé.
Par ailleurs, les médecins n’ont pas toujours à leur disposition les éléments nécessaires pour orienter les femmes vers les structures adéquates (liste de leurs collègues pratiquant les IVG médicamenteuses par exemple). Au-delà des difficultés concernant les outils dédiés à l’orientation et à l’information (internet, plateforme téléphonique) – avec toutefois des progrès récents (par exemple, le site www.ivg.gouv.fr) ou prévus dans le cadre du plan national sur l’IVG de janvier 2015, cf. infra – on observe également des limites dans le pilotage des politiques de santé mais aussi un manque de données sur certains aspects, auxquels il conviendrait de remédier.
En outre, Mme Sophie Eyraud, coprésidente de l’ANCIC, a souligné lors de son audition que, lorsqu’une femme arrive à 13 semaines plus cinq jours d’aménorrhée, il faudrait que des procédures d’urgence soient mises en place dans les établissements de santé pour que l’IVG soit pratiquée dans les temps – et que la femme ne soit pas obligée d’aller à l’étranger. Or ce n’est pas encore le cas partout, selon Mme Eyraud, qui a souhaité que la loi soit appliquée.
Par ailleurs, comme l’a souligné Mme Sophie Eyraud, coprésidente de l’Association nationale des centres d’interruption de grossesse et de contraception (ANCIC) et médecin généraliste (90), les services qui pratiquent l’IVG sont identifiés sous différentes terminologies (orthogénie, régulation des naissances, centre de planification, gynécologie, IVG), qui génèrent un manque de lisibilité de l’offre. Il conviendrait d’explorer les voies possibles pour y remédier.
En tout état de cause, le parcours des femmes doit être simplifié, parallèlement aux mesures susceptibles de répondre aux difficultés constatées pour l’accès aux services d’IVG dans l’organisation territoriale des soins.
● La stigmatisation du recours à l’IVG et certaines difficultés, aujourd’hui encore, à accepter le principe même d’une sexualité des femmes déconnectée des enjeux reproductifs
Mme Nathalie Bajos, directrice de recherche à l’INSERM, a évoqué la question de la stigmatisation du recours à l’IVG et, finalement, de la légitimité des femmes à se retrouver dans cette situation. La norme voudrait, en effet, que les femmes n’aient plus besoin de recourir à l’IVG, puisque de multiples méthodes de contraception efficaces et très accessibles sont proposées. Derrière cette idée que les IVG devraient être rarissimes, il y a un rappel à l’ordre sur la sexualité des femmes, selon Mme Bajos, liée au fait qu’on a toujours du mal à penser que les femmes peuvent avoir une sexualité totalement déconnectée des enjeux reproductifs. « Si les pratiques sexuelles ont énormément évolué en France depuis 1970, les représentations de la sexualité n’ont quant à elles pas du tout changé. D’un côté, la sexualité masculine est pensée dans le registre du désir, du plaisir et du nécessaire assouvissement de besoins sexuels par nature plus importants que les femmes ; de l’autre, la sexualité féminine reste pensée dans le registre de l’affectivité et de la conjugalité ».
En réalité, cette opposition entre « sexualité féminine » et « sexualité masculine » ne fait que refléter les inégalités entre les femmes et les hommes qui existent dans les autres sphères sociales. En effet, « la sphère de la sexualité, de la contraception et de l’avortement n’est pas autonome des autres sphères sociales. Or l’idéal égalitaire dans la sphère de la sexualité n’existe pas, comme si celle-ci absorbait les tensions que suscite la montée de l’idéal égalitaire dans les sphères professionnelle et familiale, même si les pratiques ne suivent pas toujours dans ce domaine ».
B. DES AVANCÉES MAJEURES SUR LA PÉRIODE RÉCENTE
Le Gouvernement a fait de la santé des femmes et plus particulièrement de la garantie d’accès à l’IVG une de ses priorités, pour laquelle plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre (1). L’Assemblée nationale a par ailleurs réaffirmé récemment le droit fondamental à l’IVG en France et en Europe (2). D’autres avancées sont prévues par le projet de loi relatif à la santé ainsi que par le plan d’action gouvernemental, présenté le 16 janvier 2015, afin de faciliter l’accès à l’IVG sur l’ensemble du territoire (3).
1. Les mesures mises en œuvre depuis 2012 pour conforter le droit des femmes à disposer de leur corps
En juillet 2012, une instruction ministérielle concernant le droit à l’avortement a été envoyée aux directeurs généraux et aux directrices générales des agences régionales de santé (ARS) ainsi qu’aux directeurs et directrices d’établissements de santé pour rappeler la nécessité de mettre en place, au plan régional, un dispositif garantissant un accès à l’IVG pour toute femme souhaitant y recourir, notamment pendant la période estivale.
En décembre 2012, conformément à l’engagement pris par le Président de la République, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 (91) a prévu le remboursement à 100 % de l’acte d’IVG par la sécurité sociale. Ainsi, depuis le 31 mars 2013, les frais de soins, de surveillance et d’hospitalisation liés à une IVG par voie instrumentale ou médicamenteuse sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie. La suppression de la participation des assurées aux frais de soins sur les actes d’IVG a permis de lever un frein financier, dans l’objectif d’améliorer la prise en charge des femmes en situation de grossesse non désirée et de conforter l’accès effectif à l’IVG. En 2013, cette prise en charge représentait pour l’État un effort annuel estimé à 13,5 millions d’euros. Il s’agit ainsi d’une avancée importante, néanmoins, même si plusieurs personnes auditionnées par la délégation ont relevé que cette prise en charge ne prend pas en compte la totalité des frais, par exemple les échographies de datation (cf. supra).
Le gouvernement a décidé parallèlement de revaloriser significativement le tarif de l’IVG pour les établissements de santé, jusque-là très inférieur aux coûts supportés par ceux-ci. Le rapport précité de l’IGAS, publié en 2009, avait d’ailleurs souligné que, pour l’IVG chirurgicale, le tarif de référence devrait être à un niveau comparable à celui d’un acte techniquement similaire comme la prise en charge de la fausse couche spontanée (FCS). L’arrêté du 25 mars 2013 (92) a ainsi permis une mise en cohérence du tarif avec les coûts (93), en vue de concourir à l’organisation d’une offre de prise en charge susceptible de mieux répondre aux besoins des femmes, tant en termes de délai que de qualité.
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a par ailleurs permis :
– de supprimer la notion de situation de « détresse » dans le cadre d’une demande d’IVG, qui n’avait plus aucun rapport avec les pratiques et les faits, et parce qu’il n’y a aucun jugement à porter sur les femmes qui souhaitent avorter ; l’article L. 2212-1 du code de la santé publique dispose ainsi désormais que la femme enceinte « qui ne veut pas poursuivre une grossesse » peut demander à un médecin l’IVG ;
– d’étendre le délit d’entrave à l’IVG à toute action visant à bloquer l’accès à l’information (94).
Enfin, sous l’impulsion des ministres Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem, un site a été mis en place en septembre 2013 (www.ivg.gouv.fr) pour permettre la diffusion d’une information objective sur Internet et dont la fréquentation est un succès. Il s’agit en effet d’éviter que des femmes qui sont à la recherche d’informations soient confrontées à des sites classés en tête des moteurs de recherche, créés par des personnes ou des associations qui sont en fait opposées à l’avortement.
1. La résolution réaffirmant le droit fondamental à l’IVG en France et en Europe, adoptée par l’Assemblée nationale le 26 novembre 2014
Sous l’impulsion de votre présidente et du président Claude Bartolone, une proposition de résolution visant à réaffirmer le droit à l’interruption volontaire de grossesse a été déposée en novembre 2014 et cosignée par tous les présidents de groupe de l’Assemblée nationale (95).
Adopté par l’Assemblée nationale à une très large majorité le 26 novembre 2014, soit quarante ans jour pour jour après le début des débats parlementaires sur la loi Veil, ce texte souligne que le droit universel des femmes à disposer librement de leur corps est une condition indispensable pour la construction de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et d’une société de progrès. Il affirme également la nécessité de garantir l’accès des femmes à une information de qualité et à l’avortement sûr et légal.
Article unique de la proposition de résolution visant à réaffirmer le droit fondamental à l’IVG en France et en Europe, adoptée par l’Assemblée nationale le 26 novembre 2014
« L’Assemblée nationale (…) Réaffirme l’importance du droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes, en France, en Europe et dans le monde ;
Rappelle que le droit universel des femmes à disposer librement de leur corps est une condition indispensable pour la construction de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et d’une société de progrès ;
Affirme le rôle majeur de la prévention, et de l’éducation à la sexualité, en direction des jeunes ;
Affirme la nécessité de garantir l’accès des femmes à une information de qualité, à une contraception adaptée, et à l’avortement sûr et légal ;
Souhaite que la France poursuive son engagement au niveau européen, comme international, en faveur d’un accès universel à la planification familiale »
Les difficultés qui demeurent en matière d’accès à l’IVG ont également été évoquées au cours de l’examen en séance de la proposition de résolution, qui a eu lieu en présence de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Mme Marisol Touraine, et de la secrétaire d’État chargée des droits des femmes, Mme Pascale Boistard, et au cours duquel a été annoncée la présentation par le Gouvernent d’un plan national d’action pour améliorer l’accès à l’IVG, en janvier 2015.
3. La possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG médicamenteuses, prévue par le projet de loi, et le plan d'action national pour améliorer l’accès à l’avortement présenté en janvier 2015
● La mesure prévue par le projet de loi concernant l’IVG médicamenteuse
Le projet de loi relatif à la santé, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 15 octobre 2014, prévoit, dans son article 31, de donner la possibilité aux sages-femmes de réaliser des IVG par voie médicamenteuse. Par l’augmentation de l’offre sur tout le territoire, cette mesure permettra ainsi aux femmes d’accéder plus facilement à l’IVG. Elle poursuit également l’objectif d’une meilleure reconnaissance du rôle des sages-femmes dans le système de santé.
Plusieurs personnes auditionnées ont salué cette avancée, notamment les représentantes de l’ANCIC, du Planning familial et de l’Ordre des sages-femmes. Au cours des travaux de la délégation, il a toutefois été souligné également que les femmes devaient pouvoir choisir la méthode et qu’il convenait de veiller à ne pas privilégier le développement de l’une au détriment d’une autre et maintenir une offre de soins en matière d’IVG chirurgicale.
Par exemple, Mme Nathalie Bajos, directrice de recherche à l’INSERM, a regretté que seul l’avortement médicamenteux soit évoqué dans le projet de loi, même si faciliter l’accès à l’IVG médicamenteuse en permettant aux sages-femmes de réaliser cet acte est « une excellente mesure de santé publique ». En effet, « le choix entre IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale est essentiel pour les femmes. Or dans un contexte de restrictions budgétaires, on peut craindre que l’IVG médicamenteuse soit renvoyée vers la sphère du privé, alors qu’elle constitue une avancée majeure pour les femmes ».
Sur ce point, la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Mme Marisol Touraine, a précisé clairement devant la délégation que les dispositions prévues par le projet de loi visaient à garantir, sur tout le territoire, l’accès à l’IVG, en élargissant l’offre et « sans chercher à favoriser cette méthode davantage que la méthode instrumentale ».
● Les mesures prévues par le plan gouvernemental présenté en janvier 2015
Le 16 janvier 2015, à la veille du quarantième anniversaire de la promulgation de la loi Veil, la ministre Marisol Touraine, et la secrétaire d’État chargée des droits des femmes, Mme Pascale Boistard, ont présenté un programme national d’action pour améliorer l’accès à l’IVG sur l’ensemble du territoire, qui comporte des avancées majeures. Ce plan se fonde sur trois axes :
– mieux informer les femmes sur leurs droits : dans ce sens, il est prévu la mise en place d’un numéro d’appel sur la sexualité, la contraception et l’IVG ainsi que le lancement en septembre 2015 d’une campagne d’information, qui portera sur la sexualité, la contraception et le droit d’interrompre une grossesse non désirée, avec l’appui de l’INPES, ainsi que la création d’un portail web sur la sexualité, la contraception et l’IVG (96) ;
– simplifier et améliorer le parcours des femmes qui souhaitent avorter, à travers la formalisation d’une procédure pour les IVG de 10 à 12 semaines de grossesse, l’amélioration de la prise en charge de l’IVG (cf. l’encadré ci-dessous), la publication d’un guide sur l’IVG médicamenteuse à destination des femmes (97) ainsi que l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques professionnelles à destination des professionnel-le-s de santé (98) ;
Une amélioration de la prise en charge financière de l’IVG (janvier 2015)
Le forfait de prise en charge de l’IVG en ville et celui de l’IVG en établissement de santé seront harmonisés. Des actes demandés aux femmes, actuellement non pris en charge à 100 % par la sécurité́ sociale, seront désormais intégralement remboursés : les examens de biologie médicale (IVG en ville), l’échographie de datation pré-IVG (IVG en ville et en établissement de santé), la consultation de recueil du consentement (IVG en établissement de santé), les examens de biologie de suivi (IVG en ville) et l’échographie de contrôle (IVG en ville). Le forfait de l’IVG en ville ne recouvre pas les mêmes actes que le forfait de l’IVG en établissement de santé. Les femmes ne bénéficient donc pas, sur l’ensemble du territoire, de la même prise en charge. Depuis 2013, le forfait est remboursé à 100% par la sécurité́ sociale. L’amélioration de la prise en charge financière permettra d’assurer la gratuité complète de l’IVG et des actes afférents, quel que soit le lieu de réalisation de l’IVG. Cette mesure fera l’objet d’un décret en Conseil d’État. Elle sera mise en œuvre à l’automne 2015.
Sources : ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (dossier de presse du plan national d’action pour améliorer l’accès à l’IVG, 16 janvier 2015)
– garantir une offre diversifiée sur l’ensemble du territoire : pour cela, le plan national d’action prévoit la formalisation d’un plan dans chaque région pour l’accès à l’avortement (cf. infra), la possibilité pour les centres de santé de réaliser des IVG instrumentales ainsi que des mesures visant à faciliter le recrutement des praticiens contractuels dans les établissements. Il est également prévu de mettre en place une commission sur les données et la connaissance de l’IVG et d’améliorer le recueil des données afin de rendre plus performant et efficient le suivi de l’activité d’IVG et d’évaluer ce programme d’action national. Dans ce sens, le recueil PMSI (programme de médicalisation des systèmes d’information) sera amélioré et les enquêtes ad hoc seront renouvelées.
Les mesures importantes mises en œuvre depuis 2012 marquent ainsi l’engagement du Gouvernement pour assurer aux femmes le plein exercice de leurs droits. Pour conforter et prolonger ces avancées, vos rapporteures préconisent plusieurs mesures afin de simplifier le parcours des femmes souhaitant avorter et répondre à certaines difficultés dans l’organisation de l’offre des soins.
C. LES RECOMMANDATIONS DE LA DÉLÉGATION
Pour compléter les différentes mesures mises en œuvre ou annoncées depuis 2012, vos rapporteures formulent plusieurs recommandations afin de faciliter les parcours des femmes (1), améliorer l’offre de soins (2) et développer les connaissances (3), et d’abord, parce que défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c’est reconnaître les droits fondamentaux de l’humanité tout entière, comme l’a souligné avec force la ministre Marisol Touraine devant la représentation nationale (99). Autrement dit, l’émancipation de chacune et de chacun n’est pas une option : c’est notre responsabilité à toutes et à tous.
1. Améliorer et simplifier le parcours des femmes qui souhaitent avorter
S’agissant de la phase d’information et d’orientation jusqu’aux premières consultations, deux obstacles majeurs pourraient être levés dans la procédure actuelle pour permettre un accès plus simple et rapide à l’IVG. L’enjeu est non seulement d’éviter un allongement des délais, d’autant que tous les établissements ne pratiquent pas des IVG entre 10 et 12 semaines de grossesse et refusent parfois l’accès aux femmes dont le terme est jugé trop avancé, mais aussi de ne pas culpabiliser ou infantiliser les femmes qui souhaitent avorter.
● L’obligation d’une première consultation réalisée par un-e médecin et permettant la délivrance d’une attestation
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre sa grossesse peut « demander à un médecin » une IVG, qui ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la douzième semaine. Par ailleurs, « le médecin sollicité par une femme » en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels (article L. 2212-3 du même code). Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions de dispositions légales, la liste et les adresses d’organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 (dans lesquels ont lieu les entretiens psychosociaux facultatifs ou obligatoires s’il s’agit d’une mineure) et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse. Aux termes du même article, les ARS doivent assurer la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
Par ailleurs, si la femme renouvelle sa demande d’IVG, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4 précités, « le médecin doit lui demander une confirmation écrite » après l’expiration d’un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé (sur le délai de réflexion, cf. infra), conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2212-5 du même code.
Concrètement, la première consultation correspond à un rendez-vous d’information : dans ce cadre, la femme qui souhaite avorter est informée notamment de la possibilité de rencontrer d’autres professionnel-le-s (sage-femme, conseilller-e conjugal et familial, psychologue, etc.) et des modalités de l’intervention (choix de la méthode et, le cas échéant, de l’anesthésie) et
Ce premier rendez-vous ne revêt donc aucun caractère médical, comme le souligne le rapport précité du HCEfh. À cet égard, Mme Françoise Laurant, présidente de la commission Santé, droits sexuels et reproductifs du Haut Conseil, a souligné qu’au cours de ce rendez-vous, on explique aux femmes les méthodes d’IVG possibles et on répond à leurs questions ; or l’expérience montre que lorsqu’il a lieu avec un médecin, l’entretien ne dure parfois qu’une dizaine de minutes, mais une heure quand d’autres professionnels de santé sont à l’écoute. Outre cela, élargir le spectre des interlocuteurs autorisés par la loi à intervenir à ce stade permettrait de gagner entre 8 et 15 jours, selon Mme Laurant, qui a souligné l’importance particulière de cette recommandation.
De façon convergente, Mme Danielle Gaudry, membre du bureau national du Planning familial a dit regretter que le présent projet limite l’action des sages-femmes à l’IVG médicamenteuse. En effet, « Actuellement, une première consultation pour une demande d’IVG réalisée auprès d’une sage-femme n’est pas reconnue comme première consultation, et la consultation post-IVG n’est pas autorisée aux sages-femmes. Or ces professionnel-le-s savent faire des choses beaucoup plus compliquées, comme les consultations de déclaration de grossesse ou encore les consultations post-natales. Il convient donc de réfléchir aux nouvelles missions des sages-femmes et à leur parcours de formation. Je précise que la formation des médecins est légère dans ce domaine. »
Mme Sophie Eyraud, coprésidente de l’ANCIC, a également fait observer qu’en matière d’IVG, le délai de réflexion part du moment où la femme en a fait la demande à un médecin, or cela ralentit le parcours de soins, en estimant que la première demande pourrait être recueillie par n’importe quel professionnel travaillant dans un centre d’orthogénie. Le premier rendez-vous de consultation en vue d’une IVG pourrait même faire partir le délai de cette période de réflexion
Recommandation n° 12 : Permettre à des professionnel-le-s qualifié-e-s non médecins, telles que les sages-femmes et les infirmier-e-s, de réaliser la première consultation pour une demande d’IVG et de délivrer l’attestation correspondante.
● Le délai de réflexion de sept jours imposé entre les deux premières consultations.
Aux termes de l’article L. 2212-5 du code de la santé publique, si la femme renouvelle sa demande d’IVG, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4 précités, « le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu’après l'expiration d'un délai d’une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu’après l’expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d’une semaine prévu ci-dessus. »
Ces dispositions ont également été critiquées au cours des travaux de la délégation. Ainsi, Mme Sophie Eyraud a jugé que la durée actuelle de ce délai de réflexion, de sept jours, était infantilisante. À cet égard, Mme Françoise Laurant a préconisé de supprimer l’obligation d’un délai de réflexion d’une semaine entre les deux premières consultations avant une IVG, en soulignant, d’une part, qu’il s’agissait de revenir sur une obligation, ressentie par les femmes comme infantilisante et qui, de surcroît, leur fait perdre une semaine. Les textes en vigueur prévoyant qu’en cas d’urgence, le délai de réflexion peut être ramené à 48 heures, on comprend que cette obligation faite aux femmes est de l’ordre du symbole, non une pièce maîtresse du dispositif, selon Mme Laurant.
La difficulté en l’espèce ne tient pas seulement au fait qu’il a pour effet d’allonger le délai de parcours de l’IVG, en imposant une même durée pour toutes, y compris celles qui sont parfaitement certaines de leur décision, mais aussi qu’il concourt à faire de l’avortement un acte médical à part, au même titre d’ailleurs que les dispositions spécifiques relatives à la clause de conscience.
À cet égard, il convient de rappeler qu’aucun délai de réflexion n’est imposé pour les autres actes médicaux, sauf l’assistance médicale à la procréation (AMP), la stérilisation à visée contraceptive et les opérations à visée esthétique. Pour les actes chirurgicaux, les médecins doivent laisser un délai de réflexion à leurs patients afin qu’ils puissent prendre leur décision en toute connaissance de cause, mais la durée de ce délai est laissée à l’appréciation des chirurgiens. Le rapport précité du HCEfh souligne par ailleurs qu’aucun délai n’est exigé en matière d’IVG dans de nombreux pays européens, comme le Danemark, la Norvège, la Suède, la Suisse, l’Autriche ou encore l’Angleterre.
Au demeurant, avant de s’informer et de s’engager dans le parcours de soins, il semble que les femmes ont déjà largement réfléchi à l’intervention et n’ont donc pas besoin d’un délai d’attente supplémentaire. Au surplus, le laps de temps dans les faits entre les dates des deux premières consultations tiendra lieu de délai de réflexion, sans qu’il soit besoin d’imposer une durée précise. Pour l’ensemble de ces raisons, vos rapporteures préconisent donc de supprimer l’obligation du délai de réflexion telle qu’est prévue par l’article L. 2212-5 du code de la santé publique.
Recommandation n° 13 : Supprimer l’obligation du délai de réflexion entre la première et la deuxième consultation pour une IVG et supprimer les dispositions spécifiques issues de la loi de 1975 prévoyant qu’un médecin n’est pas tenu de pratiquer une IVG, compte tenu des dispositions déjà prévues par le code de la santé publique qui donne le droit aux médecins de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
En tout état de cause, il est essentiel de fluidifier l’entrée dans le parcours de soins pour les femmes qui souhaitent avorter, et notamment pour éviter les refus de prise en charge, voire le dépassement du délai légal de 12 semaines, et que des femmes ne soient contraintes à envisager, comme ultime recours, de se rendre dans certains pays étrangers où les délais pour recourir à une IVG sont plus longs qu’en France, par exemple aux Pays-Bas (22 semaines), en Suède (18 semaines), en Espagne, en Angleterre (24 semaines) ou encore en Finlande (16 semaines). Il conviendrait par ailleurs de mieux garantir la confidentialité en ne faisant pas apparaître sur les relevés de remboursement de l’assurance maladie l’acte d’IVG (codification), les actes associés et la participation forfaitaire pour toute femme qui le souhaite.
2. Améliorer l’organisation de l’offre de soins et élargir les possibilités de pratiquer des IVG chirurgicales sous anesthésie locale
● Élargir les possibilités de pratiquer des IVG chirurgicales sous anesthésie locale, en développant l’offre en dehors des établissements de santé
Comme l’a indiqué à la délégation la ministre Marisol Touraine, un amendement gouvernemental sera déposé sur le projet de loi de relatif à la santé afin de donner aux centres de santé la possibilité de réaliser des IVG instrumentales, dans le prolongement du programme d’action national présenté en janvier dernier.
La possibilité pour les centres de santé de réaliser des IVG instrumentales : la mesure annoncée en janvier 2015
La moitié des IVG sont réalisées en ville. Or, la méthode médicamenteuse ne correspond pas au choix de toutes les femmes, qui doivent pouvoir faire un choix éclairé. La possibilité pour les médecins en centres de santé de réaliser des IVG instrumentales permettra de renforcer l’offre de proximité et de proposer un réel choix de la méthode aux femmes qui souhaitent interrompre une grossesse. Selon l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS, 2009), l’extension des lieux de pratique de l’IVG instrumentale en Belgique a permis la dédramatisation de cette méthode d’IVG et l’organisation de la formation des jeunes médecins par des médecins de la génération militante des années 1970.
Les médecins exerçant en centres de santé pourront réaliser des IVG instrumentales dans les conditions techniques et de sécurité nécessaires, qui seront définies par la Haute Autorité de santé (HAS). La Haute Autorité de Santé (HAS) sera saisie afin d’élaborer un cahier des charges sur les conditions techniques et de sécurité nécessaires. Cette mesure fera l’objet d’un amendement au projet de loi relatif à la santé.
Source : ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (dossier de presse du plan national d’action pour améliorer l’accès à l’IVG, 16 janvier 2015)
Le président de la Fédération nationale des centres de santé, M. Richard Lopez, entendu par vos rapporteures, s’est prononcé en faveur de l’extension de cette mesure aux centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF). Interrogée sur ce point, la ministre ne s’y est pas déclarée opposée par principe, à la condition toutefois que les centres répondent à l’ensemble des conditions techniques et de sécurité nécessaires, telles qu’elles seront définies par la Haute Autorité de santé.
Avec cette même réserve, il pourrait être envisagé d’étendre aux maisons de santé pluridisciplinaires ainsi qu’aux sages-femmes ce type d’IVG, en vue d’élargir l’offre de proximité, par le développement de l’IVG par aspiration hors des établissements de santé, comme c’est le cas dans de nombreux autres pays, notamment la Belgique, et faciliter ainsi l’accès à l’avortement pour les femmes.
Recommandation n° 14 : Permettre la pratique des IVG instrumentales par anesthésie locale dans les centres de santé mais aussi les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF), les maisons de santé pluridisciplinaires et par les sages-femmes, sous réserve qu’ils répondent au cahier des charges défini par la Haute Autorité de santé concernant les conditions techniques et de sécurité nécessaires.
● Renforcer l’implication des agences régionales de santé (ARS) dans l’organisation de l’offre de soins en matière d’IVG
Selon Mme François Laurant, l’accès à l’IVG demeure un parcours du combattant, dont la difficulté a été renforcée par le regroupement des établissements hospitaliers, qui contraint certaines femmes souhaitant une IVG à se rendre à plus de 200 kilomètres de leur domicile. Le rétablissement de la proximité de l’accès à l’IVG est apparu au HCEfh comme une condition essentielle pour garantir à la fois l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire et les bonnes pratiques.
C’est pourquoi le rapport précité de novembre 2013 a préconisé de mettre en place un moratoire sur la fermeture des centres d’IVG et de faire respecter l’article R. 2212-4 du code de la santé publique qui impose la pratique à tous les établissements disposant d’un service de gynécologie ou de chirurgie, en restaurant notamment l’activité d’IVG dans les établissements de santé dans lesquels elle a été arrêtée afin de revenir à une offre de proximité à la hauteur des besoins sur l’ensemble du territoire.
Vos rapporteures soulignent à cet égard le rôle stratégique des agences régionales de santé (ARS) pour améliorer l’organisation de l’offre de soins en matière d’IVG au niveau territorial.
ORGANIGRAMME DES ACTEURS DE L’IVG
![]()
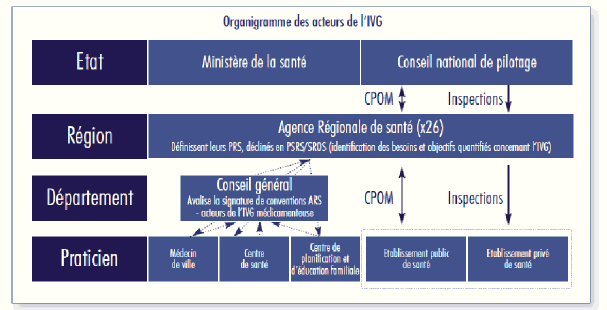
Source : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh)
Or, les différents outils contractuels et de programmation conclus entre les ARS, les établissements de santé et l’État, ne définissent pas d’objectifs précis pour l’activité d’IVG. En effet, au niveau régional, seule l’élaboration du SROS (schéma régional d’organisation des soins) se voit imposer des orientations nationales et une sélection d’indicateurs en lien avec l’IVG. Pour autant, le SROS ne propose aucune norme dans la pratique de l’IVG : les indicateurs ne sont pas adossés à des objectifs chiffrés ni nationalement, ni régionalement (100). Par ailleurs, il n’existe aucune disposition prévoyant l’obligation que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), conclus entre les ARS et les établissements de santé, comporte des dispositions en matière d’IVG. Au niveau régional, il semblerait également que le contrôle soit très limité sur l’obligation légale faite aux établissements de santé de pratiquer les IVG lorsqu’ils disposent de lits en gynécologie ou en chirurgie. Au niveau national, les CPOM liant l’État aux ARS ne mentionnent pas non plus l’IVG, selon le rapport précité.
Vos rapporteures tiennent toutefois à saluer excellente initiative prise par l’ARS d’Île-de-France, à travers le projet régional pour favoriser la réduction des inégalités d’accès à l’avortement (FRIDA) qu’a évoqué lors de son audition M. Claude Evin, directeur général de l’ARS et ancien ministre (101). Lancé en avril 2014, celui-ci se fonde sur trois axes :
– une meilleure connaissance et compréhension de la situation francilienne en matière d’IVG, s’appuyant notamment sur un questionnaire en ligne (cf. supra), mais aussi un site internet permettant aux femmes de connaître les structures proches de leur domicile ainsi qu’une plateforme d’aide à l’orientation des patientes destinées aux professionnel-le-s de ville) ;
– un renforcement de l’offre d’IVG du point de vue qualitatif et quantitatif ; dans le cadre des négociations contractuelles en cours avec les établissements (CPOM), l’ARS a notamment rappelé l’obligation de service public confiée par la loi aux établissements disposant d’une autorisation d’obstétrique, et fixé un objectif en termes de volume d’activité IVG réalisé, afin d’avoisiner la proportion observée de 1 IVG pour 3,5 accouchements ;
– une amélioration de la coordination des parcours de prise en charge existants, à travers par exemple la définition par l’ARS d’une nouvelle procédure attribuant aux réseaux périnatals une mission de relais afin de faciliter la prise en charge des femmes dont la situation est complexe ou le terme proche du délai légal.
Le programme d’action national, présenté le 16 janvier 2015, prévoit d’ailleurs la formalisation d’un plan pour l’accès à l’avortement dans chaque région, sur le modèle des expériences régionales réussies telles que le programme FRIDA, et dont les principales caractéristiques sont présentées dans l’encadré ci-dessous.
La formalisation d’un plan pour l’accès à l’avortement dans chaque région
La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes donnera l’instruction à chaque agence régionale de santé (ARS) de formaliser un plan régional pour l’accès à l’avortement. Un plan régional type sera élaboré au niveau national, sur le modèle des expériences régionales réussies, par exemple le programme FRIDA de l’ARS d’Île-de-France. Le plan régional type prévoira l’intégration de l’activité d’IVG dans les contrats d’objectifs et de moyens (CPOM) qui lient les ARS aux établissements de santé. Les orientations nationales seront élaborées avec l’appui de l’ARS Île-de-France et diffusées avant l’été 2015.
Pourquoi cette mesure ? L’accès à l’avortement implique que toutes les femmes soient prises en charge, dans le respect de la loi, toute l’année, sur l’ensemble du territoire. Les enquêtes réalisées auprès des ARS en 2012 et 2013, ainsi que les enseignements des programmes d’inspection des établissements de santé, ont montré plusieurs difficultés liées à l’organisation de l’activité. Parallèlement, le nombre d’établissements de santé réalisant des IVG s’est réduit ces dernières années et n’a pas été totalement compensé par l’augmentation de l’offre de ville. Les ARS ont d’ores et déjà reçu l’instruction de maintenir l’IVG dans l’offre de soins de gynécologie obstétrique. Chaque ARS devra désormais traduire cet engagement volontariste par une série d’actions concrètes.
Sources : ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (dossier de presse du plan national d’action pour améliorer l’accès à l’IVG, 16 janvier 2015)
Dès lors, il pourrait être envisagé de prévoir expressément dans le code de la santé publique que les CPOM, conclus entre les ARS et les établissements de santé, intègrent l’activité d’IVG. Ces contrats pluriannuels devraient également inclure des objectifs chiffrés. Il s’agit également de faire en sorte que tous les choix de méthode soient proposés dans chaque établissement de santé pratiquant l’IVG. Vos rapporteures soulignent enfin l’importance d’un renforcement de l’offre d’IVG, sur le plan qualitatif et quantitatif et de développer la coordination des soins et des professionnels, pour une meilleure prise en charge des patients, en s’appuyant notamment sur les réseaux de santé (exemple du réseau ville-hôpital pour l’orthogénie – REHVO – en Île-de-France). Il s’agit également de veiller au respect de l’obligation légale faite aux établissements de santé de pratiquer les IVG lorsqu’ils disposent de lit en gynécologie ou en chirurgie (cf. supra).
Parallèlement, il conviendrait naturellement de veiller à ce que les prochains contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, conclus par chaque ARS avec les autorités de tutelle, intègrent bien les enjeux relatifs à l’organisation des soins en matière d’IVG.
Recommandation n° 15 : Renforcer l’offre d’IVG sur le plan qualitatif et quantitatif, en prévoyant dans la loi le principe de plans d’actions régionaux et en veillant à l’intégration de l’activité d’IVG dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé.
3. Éclairer les zones d’ombre
Pour améliorer le pilotage de l’action publique, vos rapporteures jugent essentiel d’améliorer les connaissances en matière d’IVG, en particulier sur des sujets peu connus aujourd’hui et qui pourraient par exemple porter sur la situation contraceptive des femmes ayant recours à l’IVG (pour réactualiser les données de l’enquête précitée portant sur l’année 2007), l’estimation du nombre de domiciliées en France allant avorter à l’étranger ainsi que sur le nombre des médecins qui pratiquent l’IVG, et le nombre de ceux qui la pratiquent dans le délai de 10 à 12 semaines de grossesse.
Il s’agit également de mieux connaître les pratiques actuelles concernant la clause de conscience, les IVG réalisées par des mineures sans autorisation parentale, la répartition des actes entre les différents métiers des professionnel-le-s impliqué-e-s dans les procédures d’IVG (médecins, infirmières, sages-femmes, etc.), les enjeux de la démographie médicale en termes d’accès et l’exercice du droit à l’IVG ou encore les difficultés d’accès à l’IVG des femmes étrangères en grande précarité.
Ces études pourraient être réalisées dans le cadre de la Commission sur les données et la connaissance de l’IVG, dont la ministre Marisol Touraine a annoncé récemment la création. Pilotée par la DREES, elle réunira les principaux producteurs de données mais aussi les professionnel-le-s de terrain et les associations spécialisées.
En tout état de cause, il convient de remédier rapidement au déficit de moyens humains et financiers en matière de recherche sur l’IVG, clairement identifié par le HCEfh (102), en relevant notamment qu’il n’existe aujourd’hui en France aucun-e chercheur-e à temps plein sur le sujet. Les organismes de recherche (INSERM-INED,-CNRS), ainsi que les laboratoires universitaires devraient pouvoir effectuer des recherches financées sur l’IVG.
Dans l’évaluation des politiques publiques, il serait par ailleurs souhaitable de prendre en compte autant que possible l’avis des premières concernées, c’est-à-dire les femmes ayant demandé une IVG, pour en tirer tous les enseignements. Il convient par ailleurs d’améliorer les connaissances dans ce domaine concernant non seulement la France métropolitaine, mais aussi les collectivités d’outre-mer.
Recommandation n° 16 : Développer et financer des études et recherches pour mieux connaître les pratiques actuelles en matière d’IVG, notamment en outre-mer, concernant le nombre de médecins qui pratiquent l’IVG et le nombre de ceux qui la pratiquent dans le délai de 10 à 12 semaines, la clause de conscience, l’estimation du nombre de femmes se rendant à l’étranger, les avortements concernant des mineures sans autorisation parentale, le rôle des différents professionnel-le-s de santé, etc.
II. FACILITER L’ACCÈS À LA CONTRACEPTION ET DÉVELOPPER LES ACTIONS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
A. PRATIQUES CONTRACEPTIVES EN FRANCE ET ÉVOLUTION RÉCENTE
1. Un modèle contraceptif en voie d’évolution
D’après le Baromètre santé 2010, 90,2 %des femmes sexuellement actives au cours des 12 derniers mois, non stériles, ayant un partenaire homme, non enceintes et ne cherchant pas à avoir un enfant utilisent une méthode de contraception ; 2,1 % en utilisent une de manière irrégulière et 7,7 % n’utilisent aucun moyen de contraception.
La contraception orale est de loin le contraceptif le plus utilisé par les femmes. Ainsi, parmi les femmes qui déclarent « faire quelque chose pour éviter une grossesse » en 2010, 55,5 % utilisent la pilule. Elles sont 70,8 % chez les moins de 35 ans.
C’est chez les jeunes que l’usage de la pilule est le plus important. En 2010, 78,9 % des jeunes femmes de 15 à 19 ans qui ont recours à un moyen contraceptif l’utilisent et 83,4 % des 20-24 ans. Son utilisation diminue ensuite au profit du dispositif intra-utérin (DIU), mais elle reste majoritaire jusqu’à 45 ans. Ainsi, 43,4 % des femmes âgées de 35 à 44 ans ont recours à la pilule.
Implant, patch, anneau et injection de progestatifs sont encore peu utilisés (4,7 % des femmes). Ce sont les femmes âgées de 25 à 34 ans qui y ont le plus souvent recours (6,2 %).
PRINCIPALES MÉTHODES CONTRACEPTIVES* UTILISÉES PAR LES FEMMES
ÂGÉES DE 15 À 49 ANS EN 2010
(en %)
Stérilisation |
Stérilet |
Implant, patch, anneau, injection |
Pilule |
Préservatif |
Méthodes locales |
Méthodes naturelles | |
15-19 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-49 ans Total |
- - 0,5 4,0 2,2 |
- 3,7 20,3 38,2 26,0 |
2,8 5,4 6,2 3,8 4,7 |
78,9 83,4 63,4 41,0 55,5 |
18,3 7,2 8,7 11,1 10,3 |
- - 0,1 0,2 0,1 |
- 0,3 0,8 1,7 1,2 |
* Lorsque plusieurs méthodes étaient citées, la plus « sûre » selon les critères de l’OMS a été retenue ; ainsi c’est la méthode apparaissant la plus à gauche dans le tableau qui a été privilégiée.
Source : Baromètre santé 2010
La situation française se caractérise donc par un taux de couverture contraceptive élevé et par la place prédominante occupée par la contraception orale.
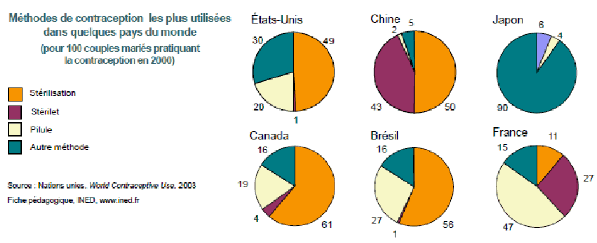
La norme contraceptive qui prévaut dans la société française se caractérise par l’utilisation du préservatif, seul ou en association avec la pilule, à l’entrée dans la sexualité. Les femmes l’abandonnent ensuite dès lors que la relation s’installe, au profit de la pilule seule, qui devient le principal mode de contraception utilisé par les femmes de moins de 45 ans. L’utilisation de la pilule diminue de façon progressive au bénéfice du dispositif intra utérin (DIU). Le DIU n’est le plus souvent prescrit que lorsque le nombre d’enfants souhaité est atteint. Ce dernier devient ainsi la méthode de contraception la plus utilisée à partir de 45 ans.
● Les évolutions en cours
Les pilules contraceptives de 3e et 4e génération ont fait l’objet d’un débat médiatique en France à partir de décembre 2012 à propos du risque de thrombose veineuse profonde associé à leur utilisation. Elles ont cessé d’être remboursées par la Sécurité sociale depuis mars 2013. L’enquête Fécond réalisée par l’Inserm et l’Ined permet d’étudier l’impact de ces événements sur les pratiques contraceptives et les représentations de la pilule en comparant la situation quelques mois après leur survenue avec celle qui prévalait auparavant (en 2010).
Nathalie Bajos, entendue par la délégation, a dans un article récent (103) tiré les enseignements de cette crise de la pilule en France.
Le premier enseignement de cette étude est qu’aucune désaffection vis-à-vis de la contraception n’a été observée mais les méthodes utilisées ont évolué. Près d’une femme sur cinq déclare avoir changé de méthode depuis le débat médiatique de 2012-2013 sur les pilules. Le recours à la pilule a baissé passant de 50 à 41% entre 2010 et 2013. Cette baisse concerne quasi exclusivement les pilules incriminées dans le débat, celles dites de 3e et 4e génération qui représentent désormais 10% des méthodes utilisées contre 19 % en 2010. Le ministère des affaires sociales et de la santé indique pour sa part que de décembre 2012 à août 2013, les ventes globales de contraceptifs oraux combinés de 3e et 4ème génération ont diminué de 36,6 % comparativement à celles reportées sur la période décembre 2011-août 2012.
Selon l’enquête Fécond, les transferts vers des pilules de 2e génération ont été de faible ampleur (23 % en 2013 contre 22 % en 2010). Mais le ministère des affaires sociales observe, quant à lui, que de décembre 2012 à septembre 2013, les ventes de pilules de première et deuxième génération augmentent avec une hausse de 24,3 % sur les 9 mois considérés par rapport à la même période de l’année précédente.
Les femmes ont adopté d’autres méthodes de contraception, notamment le stérilet, le préservatif ou le retrait. Si la pilule reste donc aujourd’hui la méthode contraceptive la plus utilisée en France, les pratiques sont désormais plus diversifiées.
Le deuxième enseignement est que la baisse du recours à la pilule concerne les femmes de tous âges mais qu’elle est particulièrement marquée chez les moins de 30 ans. Les femmes sans aucun diplôme ont davantage que les autres délaissé les pilules récentes au profit des méthodes les moins efficaces (dates, retrait). Plus largement, tandis que les femmes n’ayant pas de difficultés financières ont opéré un transfert partiel des nouvelles pilules vers les contraceptifs oraux les plus anciens, celles dans une situation difficile se sont en partie tournées vers les méthodes dites naturelles.
Une rupture s’est produite concernant la prescription du stérilet. La réticence des médecins français à ne pas le proposer aux femmes jeunes ou sans enfant semble pour la première fois avoir diminué en partie grâce à une demande des femmes elles-mêmes. L’augmentation des ventes de stérilets de décembre 2012 à août 2013 atteindrait 45,1 % selon le ministère des affaires sociales et de la santé. Il y a incontestablement un assouplissement de la norme contraceptive qui rythme et structure l’usage des méthodes selon l’âge et le nombre d’enfants.
Le troisième enseignement est que l’image de la pilule se détériore.
On peut tout d’abord observer que les générations les plus jeunes sont de moins en moins sensibles aux enjeux sociaux et politiques qu’a représenté la disponibilité d’une méthode de contraception permettant aux femmes, pour la première fois dans l’histoire, de pouvoir maîtriser elles-mêmes leur fécondité.
Le débat sur les pilules de 3e et 4e génération semble avoir terni l’image sociale et symbolique de la pilule. Ainsi en 2013, 37 % des femmes sont tout à fait d’accord avec l’idée selon laquelle « la pilule permet aux femmes d’avoir une sexualité plus épanouie »alors qu’elles étaient 44 % à le penser en 2010. Des écarts entre groupes sociaux sont aussi enregistrés. En revanche, son caractère contraignant ou ses effets supposés sur le corps ne sont pas plus souvent évoqués en 2013 qu’en 2010 (environ une femme sur trois est tout à fait d’accord avec l’idée que la pilule est contraignante et une sur quatre avec l’idée qu’elle fait grossir).
2. Des obstacles encore à lever notamment s’agissant des mineures
● Des obstacles persistants
Le recours à la contraception d’urgence et la stabilité du nombre d’IVG (voir plus loin) montrent que des difficultés persistent en matière de contraception.
Une première difficulté réside dans l’observance. En effet, l’efficacité contraceptive dépend de l’observance des utilisatrices, laquelle est elle-même étroitement liée à leur niveau d’adhésion à la méthode et à l’adaptation de celles-ci à leurs besoins et à leur mode de vie.
Les problèmes d’observance expliquent pour une large part la différence entre l’efficacité optimale (obtenue dans les essais) de la contraception et son efficacité constatée en utilisation pratique, différence d’autant plus significative que la méthode nécessite des conditions d’observance rigoureuses.
EFFICACITÉ PRATIQUE DE DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CONTRACEPTION SELON L’OMS
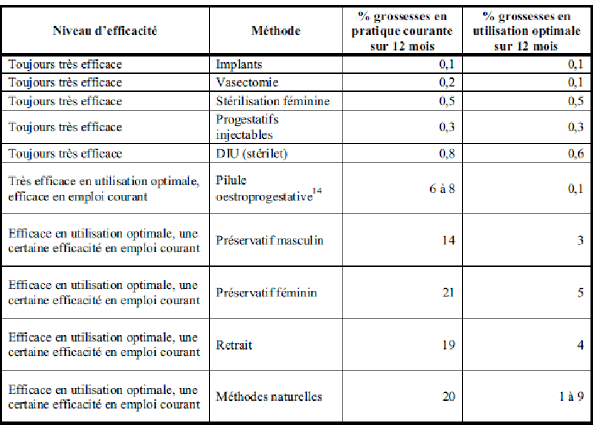 Source : OMS
Source : OMS
Dès lors, étant donné le taux élevé de couverture contraceptive en France, il semble que plus qu’un problème d’accès, la contraception se heurte à une possible inadéquation entre les méthodes utilisées et les conditions de vie quotidienne des femmes. Il est donc important que la prescription d’une méthode de contraception prenne en compte les conditions de vie de la femme, et que la femme participe activement au choix de sa contraception. Les éléments de dialogue et d’aide au choix de la méthode la plus adaptée (104), rappelée dans les recommandations de l’ANAES (actuellement HAS) de 2004 (105) doivent faire partie intégrante de la consultation. Plus près de nous en 2013, la Haute autorité de santé, à la demande de la ministre des affaires sociales et de la santé, a élaboré de nouvelles recommandations de bonnes pratiques destinées aux professionnels de santé prescripteurs pour leur permettre de mieux adapter les prescriptions aux besoins des couples et des femmes. Les fiches mémo visent à fournir aux professionnels de santé des outils permettant de trouver la méthode contraceptive qui convient le mieux.
En mars 2013, la ministre Marisol Touraine a demandé à l’INPES de déployer une campagne de communication afin de faire connaître la diversification des méthodes contraceptives. A l’occasion de la journée mondiale de la contraception, le 26 septembre 2013, l’Inpes a rediffusé les spots radio « la contraception qui vous convient existe » sur des stations à forte audience jeunes. La brochure « choisir sa contraception » téléchargeable sur le site de l’INPES et le site www.choisirsacontraception.fr proposent une information complète sur la contraception et répondent à des questions pratiques.
De ce point de vue, les évolutions récentes mentionnées plus haut de diversification des méthodes employées vont dans le bons sens, et témoignent d’une progressive prise de conscience des prescripteurs et des utilisateurs.
Des marges importantes de progression demeurent pour une meilleure adéquation des méthodes utilisées aux besoins des femmes et des couples. Cela plaide pour une amélioration de la formation initiale et continue des professionnels de santé appelés à prescrire des contraceptifs, les sages-femmes en particulier, voyant leurs compétences s’étendre avec le projet de loi santé.
Recommandation n° 17 : Améliorer la formation initiale et continue des personnels médicaux appelés à prescrire des contraceptifs.
Une deuxième difficulté souvent citée pour l’accès à la contraception est l’obstacle financier.
De ce point de vue, il convient de mentionner certaines décisions récentes qui modifient l’appréhension de cette question. En effet, alors que la contraception gratuite pour les mineures de 15 à 18 ans était une des promesses du candidat François Hollande pendant la campagne présidentielle, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a introduit cette mesure, entrée en vigueur fin mars 2013. Sont concernés les pilules de 1ère et 2ème génération, l’implant contraceptif hormonal et le stérilet auparavant remboursés à 65%. En revanche, ce qui n’était pas remboursé auparavant ne l’est pas davantage après. Il s’agit du patch contraceptif, de l’anneau vaginal, la cape cervicale, les préservatifs. Les pilules de 3ème et 4ème génération ont été déremboursées dès mars 2013 en raison du risque sanitaire encouru.
Par ailleurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a inscrit une nouvelle mesure en faveur des jeunes filles : bénéficier du tiers payant pour les consultations et les examens de biologie nécessaires à la prescription de leur contraception avec une dispense de frais pour la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Cette mesure préfigure la généralisation du tiers payant prévu dans le projet de loi santé.
Le contexte financier apparaît donc plus favorable, mais il reste que certaines méthodes alternatives à la pilule comme le patch ou l’anneau ne sont toujours pas remboursées, ce qui constitue un frein à leur utilisation. Or, le régime de prise en charge financière n’est évidemment pas neutre quant à l’orientation de la demande et ou la prescription contraceptive vers certains types de produits.
Il faut aussi rappeler que certains jeunes majeurs cumulent aussi les difficultés. Le taux de chômage important des 20-24 ans, la précarisation des étudiants, le coût et l’absence de remboursement de certains contraceptifs par l’Assurance maladie constituent des freins réels pour des jeunes qui ne bénéficient plus des conditions d’accès gratuit réservées aux mineures.
Il conviendrait d’étudier la possibilité d’étendre le principe de la gratuité au-delà de 18 ans jusqu’à 25 ans pour les jeunes dépourvus de couverture autonome et en faisant la demande.
Une troisième difficulté réside dans le respect de la confidentialité.
Depuis la loi du 4 juillet 2001 (article 24), « le consentement des titulaires de l’autorité parentale, ou le cas échéant, du représentant légal n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs aux personnes mineures ».
Mais, de fait, les circuits de remboursement ne permettent pas le respect de la confidentialité pour les utilisatrices qui sont ayants droit d’un assuré social dont elles dépendent ; en clair des jeunes filles par rapport aux parents ou des femmes par rapport à leur conjoint ou partenaire. Dans certains contextes familiaux, la crainte de voir figurer la trace d’une consultation et d’une prescription sur le relevé adressé par la caisse de sécurité sociale et/ou la mutuelle peut constituer un véritable obstacle. Le financement de la consultation peut donc entrer en conflit avec le respect de la confidentialité.
Seuls l’anonymat et la gratuité peuvent permettre à certains adolescents de faire une démarche souvent difficile. Pour pallier cette difficulté, la gratuité des contraceptifs pour les mineures prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, a été assortie d’un dispositif « secret » permettant, si la jeune fille le souhaite, de ne pas faire figurer la mention de délivrance sur le décompte des parents. Un amendement à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 adopté par le Parlement demande au gouvernement un rapport sur l’application des dispositions existantes et les conditions de leur effectivité concernant la gratuité de la contraception pour les mineures. L’IGAS a été missionné par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes afin d’éclairer les termes de ce débat. La Délégation aux droits des femmes se félicite de cette nouvelle perspective.
Une quatrième difficulté réside sans doute dans l’accessibilité des centres de planification. Seuls les centres de planification permettent d’apporter une réponse immédiate, gratuite et confidentielle aux problèmes de contraception pour certaines catégories de personnes : jeunes et personnes en difficulté sociale.
Le rapport de l’IGAS de 2009 sur la prévention des grossesses non désirées relevait déjà que la réponse apportée par les centres de planification n’est pas disponible partout. La densité des structures d’information et de planification familiale varie fortement d’un territoire à l’autre : ainsi d’après ce rapport, on recensait en 2002 plus de 30 CPEF pour 10 000 femmes de 15 à 49 ans en Seine-Saint-Denis contre 2,8 dans le Pas-de-Calais et 2,1 en Loire- Atlantique.
Le mode de fonctionnement et les horaires d’ouverture de ces centres n’offrent pas non plus la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins de la population, contrainte par des horaires scolaires ou professionnels (fermeture le soir et le week-end). Et encore faut-il connaître leur existence et leur localisation.
Recommandation n° 18 : Harmoniser la couverture géographique des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) et améliorer leur couverture horaire et leur communication sur Internet en fournissant des informations pratiques sur les lieux, horaires et prestations.
● Le problème particulier de la contraception des mineur-e-s
La Délégation aux droits des femmes s’intéresse depuis longtemps à la question de la contraception des mineur-e-s et en 2011, Mme Bérengère Poletti, membre de la délégation, avait consacré un rapport à cette question (106).
Certains des constats dressés en 2011 demeurent hélas, d’actualité.
Ainsi, concernant l’importante question de l’éducation à la sexualité, on sait que depuis l’adoption de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption de grossesse et à la contraception, une information et une éducation à la sexualité sont obligatoirement dispensées « dans les écoles, les collèges, et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène » (article L. 312-16 du code de l’éducation). La mise en œuvre des trois séances annuelles d’éducation à la sexualité a été précisée par la circulaire n°2003-027 du 17 février 2003 qui laisse une grande liberté aux équipes éducatives. Des intervenants extérieurs qualifiés peuvent être sollicités dans ce cadre : c’est le cas du Planning familial entendu par la Délégation qui est très impliqué dans cette action.
Pour autant et malgré la qualité de cette circulaire très complète, soulignée par l’ensemble des acteurs éducatifs, il semble que l’enseignement de la sexualité à l’école ne soit pas toujours assuré. Cet enseignement est dispensé de manière disparate selon les académies et les établissements plus ou moins motivés, et rencontre parfois l’hostilité des parents d’élèves. Quand les séances ont lieu, elles sont parfois traitées par le professeur de SVT qui met l’accent sur la reproduction sans s’attarder sur l’éducation à la sexualité. Bref, l’éducation véritable à la sexualité en milieu scolaire reste très perfectible, bien que largement encadrée par les textes.
Comme il a été indiqué, des campagnes d’information sur la contraception ont eu lieu avec un impact positif sur les jeunes de même des sites d’information ont été mis en place et des acteurs comme le Planning ont incontestablement une action forte en direction des jeunes. Néanmoins, cette information doit sans cesse être renouvelée pour toucher les nouvelles générations arrivant à l’âge d’une sexualité active.
Par ailleurs, les mineurs sont évidemment confrontés aux obstacles analysés plus haut dans l’accès à la contraception. Point positif, la compétence de la prescription contraceptive a été étendue aux sages-femmes par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ce texte a également ouvert la possibilité du renouvellement d’une ordonnance de contraceptifs oraux par les pharmaciens et par les infirmiers.
Pour aller vers une contraception anonyme et gratuite à destination des mineur-e-s, plusieurs régions ont mis en place des dispositifs originaux communément appelés « Pass Contraception ».
Dans ce domaine, la région Poitou-Charentes a fait figure de précurseur en mettant en place en 2009 le Pass Contraception, dispositif d’accès anonyme et gratuit.
En Île-de-France, le Pass est proposé dans les lycées d’enseignement général et technologique, professionnels, centres de formation d’apprentis et en instituts de formation sanitaire et sociale. Le Pass se présente sous forme d’un chéquier permettant d’accéder à un suivi médical (consultations et analyses) et à la délivrance de tous types de contraceptifs pour une durée maximale de six mois. Pour obtenir le Pass, il faut s’adresser à l’infirmerie ou au référent santé de son établissement.
Dans les Pays de la Loire, le Pass est proposé dans les lycées, les centres de formation d’apprentis, les établissements régionaux d’enseignement adapté et les maisons familiales rurales mais aussi dans les missions locales, maisons de santé pluridisciplinaires et pharmacies diffusant le Pass, dans les centres de planification et d’éducation familiale ; il est remis aux moins de 20 ans qui le demandent. Il se présente sous forme de chéquier et permet d’accéder à deux consultations médicales (2 coupons), d’analyses médicales pour la contraception et/ou le dépistage d’IST (1 coupon), de la délivrance de contraceptifs pour une durée moyenne d’un an (4 coupons).
La région Languedoc-Roussillon a également mis en place un Pass basé sur les mêmes principes ainsi que la région PACA et la région de Haute-Normandie a prévu la mise en place d’un Pass contraception au cours du premier trimestre 2015.
La Délégation aux droits des femmes a interrogé les différents conseils régionaux pour connaître les dispositifs mis en place par les régions, afin d’encourager la contraception anonyme et gratuite des mineur-e-s. On trouvera en annexe un tableau récapitulatif des réponses obtenues.
Ces expériences parfois récentes ne semblent pas s’accompagner de la baisse du recours à la contraception d’urgence et à l’IVG.
1. Une solution de rattrapage au succès grandissant
● Définition et conditions d’utilisation
La contraception d’urgence ne remplace pas une contraception régulière. Elle constitue une méthode de rattrapage à utiliser après un rapport sexuel, en cas d’échec ou d’absence de contraception car diverses circonstances exposent au risque d’une grossesse non désirée (oubli de pilule, rupture de préservatif, rapport imprévu non protégé). La contraception d’urgence s’apparente à une forme de prévention secondaire et permet d’éviter le recours éventuel à l’interruption volontaire de grossesse.
La forme la plus connue est la « pilule du lendemain ». Il s’agit d’une contraception hormonale au lévonorgestrel qui se présente sous la forme d’un comprimé à prendre le plus tôt possible et au plus tard dans les 72 heures (3 jours après le rapport sexuel non protégé). Il empêche la nidification de l’embryon dans la paroi utérine. Il est délivré en pharmacie avec ou sans ordonnance.
Son efficacité dépend de son délai d’utilisation : elle est estimée à 95 % dans les 24h suivant le rapport, à 85 % entre 24 et 48h, à 58 % entre 49 et 72 heures.
Un nouveau produit Ellaone à l’ulipristal-acétate a été commercialisé à partir d’octobre 2009 et remboursé depuis septembre 2010. Il est utilisable jusqu’à 5 jours après un rapport et ne doit pas être utilisé simultanément au lévonorgestrel.
Le prix élevé d’Ellaone (23,59€ en 2014 contre 7,41€ pour le Norlevo et 6,07 pour le générique levonorgestrel) et sa délivrance uniquement sur ordonnance ont conduit la Haute autorité de santé à rendre un avis d’amélioration mineure du service médical rendu par rapport à Norlevo, en soulignant que l’intérêt de santé publique pour Ellaone ne peut être que faible.
La contraception d’urgence hormonale pâtit de la méconnaissance de son délai réel d’efficacité induit par ce nom abusif de « pilule du lendemain ». Une partie des jeunes femmes ne l’utilise pas ou hésite lorsque le rapport sexuel est considéré « trop loin » du lendemain.
Un dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre peut également être utilisé après un rapport non protégé dans un délai maximum de 120 h (5 jours) avec un taux d’échec de 0,1 à 0, 2 % qui est considéré comme la méthode la plus efficace en cas de rapport non protégé. Il a l’inconvénient d’être moins accessible que la contraception d’urgence hormonale puisqu’il suppose obligatoirement une intervention médicale.
● Évolution de la consommation
Les données du marché de l’industrie pharmaceutique compilées par le Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques (GERS) permettent d’estimer à près de 1,3 million le nombre de boîtes de contraception d’urgence vendues au cours de l’année 2011.
Depuis sa mise sur le marché et son accès libre en pharmacie (1999), l’utilisation de la contraception d’urgence est en constante augmentation, elle a doublé en dix ans entre 2000 et 2011 et tend à se stabiliser depuis 2009.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BOÎTES DE CONTRACEPTION D’URGENCE
VENDUES EN FRANCE DE 1999 À 2011
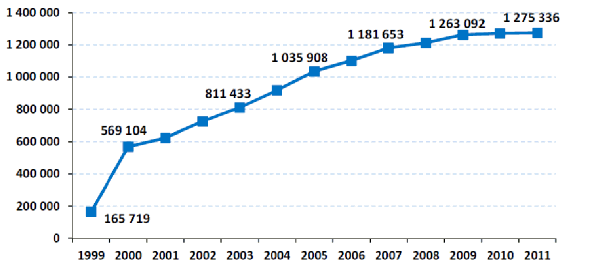
Source : GERS
Depuis 2007, la part du générique augmente. Ellaone ne représente qu’une petite partie de la consommation de contraception d’urgence, son utilisation étant liée à une prescription médicale.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BOÎTES DE CONTRACEPTION D’URGENCE
VENDUES EN FRANCE DE 1999 À 2011
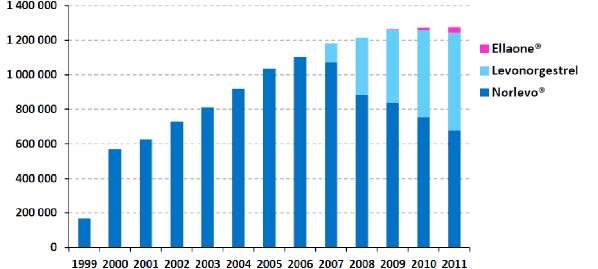
Source : GERS
Dans le dernier Baromètre santé de 2010, 24 % des femmes de 15 à 49 ans, ayant déjà eu des rapports sexuels, déclarent avoir utilisé la contraception d’urgence au moins une fois au cours de leur vie (8,8 % en 2000 et 14,4 % en 2005.
Le recours à la contraception d’urgence est plus élevé chez les femmes les plus jeunes : 43 % chez les 15-24 ans.
RECOURS À LA CONTRACEPTION D’URGENCE
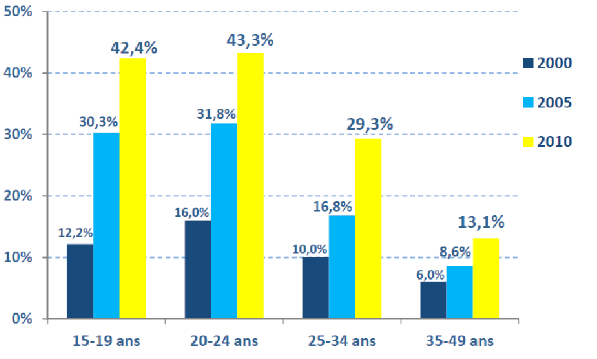 Sources : Baromètres santé 2000 – 2005 – 2010, INPES
Sources : Baromètres santé 2000 – 2005 – 2010, INPES
2. Des conditions d’accès simplifiées par le projet de loi
● Un accès libre en pharmacie
À la différence de la contraception hormonale régulière, la contraception d’urgence peut être délivrée en pharmacie sans prescription médicale obligatoire. En effet, la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence prévoit que « les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d’emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire ». Cette situation peut d’ailleurs sembler paradoxale et la délégation a pu remarquer au cours des auditions qu’elle a menées, que certains proposent la vente libre des micro-progestatifs dont la molécule est la même que celle utilisée pour la contraception d’urgence. Cette question pourrait être étudiée par la Haute autorité de santé.
Recommandation n° 19 : Prévoir la réalisation par la Haute Autorité de santé d’une étude sur la possibilité et la pertinence de mettre en vente libre dans les pharmacies les micro-progestatifs.
La loi de décembre 2000 autorise la délivrance de la contraception d’urgence à titre gratuit par les pharmaciens aux mineures désirant garder le secret. En application de cette mesure, le décret du 9 janvier 2002 met en place une filière directe de remboursement par l’assurance maladie aux pharmaciens des boîtes délivrées à ce titre. La délivrance gratuite aux mineures est néanmoins subordonnée à un entretien préalable avec le pharmacien chargé de vérifier les conditions d’utilisation et de fournir toutes les informations utiles. Il doit remettre une documentation sur la mise en place d’une contraception régulière et sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et communiquer les coordonnées du centre de planification le plus proche. Le décret précise que la condition de minorité ouvrant droit à la délivrance gratuite est justifiée par simple déclaration orale de l’intéressée (article 2).
Le nombre de boîtes de contraception d’urgence délivrées aux mineures dans ce dispositif est en constante augmentation : il est passé de 50 000 en 2002 à plus de 360 000 en 2010.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BOÎTES DE CONTRACEPTION D’URGENCE REMBOURSÉES PAR L’ASSURANCE MALADIE
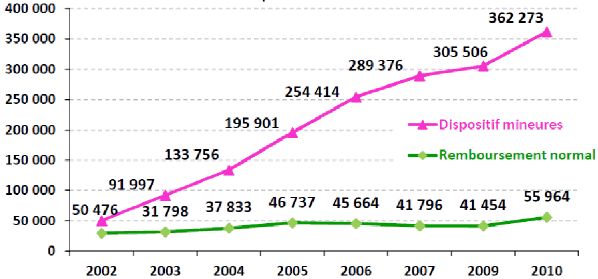
Sources : CNAMTS pour 2002-2007 et SNIIRAM pour 2009 et 2010
Peu de données chiffrées récapitulent l’activité des centres de planification et d’éducation familiale en matière de délivrance de la contraception d’urgence. Dans un rapport sur ces organismes en 2011 (107), l’IGAS souligne une offre très inégalement répartie sur le territoire.
Les pharmaciens sont donc au centre du dispositif de prévention des grossesses non désirées à travers la contraception d’urgence.
Ainsi que le relevait le rapport de l’IGAS sur ce thème réalisé en 2009, les officines de pharmacie offrent une couverture géographique plus complète et plus dense qu’aucune autre structure sanitaire ou sociale, notamment en milieu rural. Elles offrent un accès de proximité, sans rendez-vous, sur une grande amplitude horaire. Le rôle du pharmacien est important en matière d’information et de conseil. Cette responsabilité du pharmacien est précisée par la réglementation pour les jeunes mineures. Selon les termes du décret du 9 janvier 2002, « la délivrance par le pharmacien est précédée par un entretien visant à s’assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d’urgence et aux conditions d’utilisation de cette contraception. L’entretien permet également au pharmacien de fournir à la mineure une information sur l’accès à une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur l’intérêt d’un suivi médical ».
Le rapport de l’IGAS de 2009 (108) dressait un bilan mitigé au regard des éléments recueillis sur le terrain. L’accès à la contraception d’urgence a très nettement progressé mais sa délivrance s’effectue rarement dans les conditions prescrites par la réglementation et l’accompagnement fait gravement défaut. Une enquête alors réalisée en Alsace dans le cadre de la mission de l’IGAS auprès de 462 pharmacies révélait un bilan positif mais des difficultés d’application.
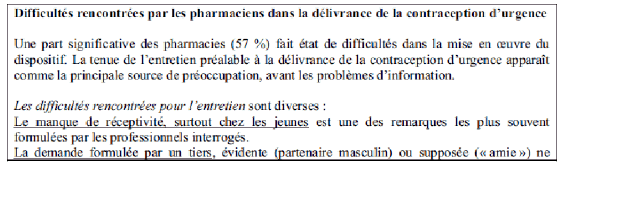
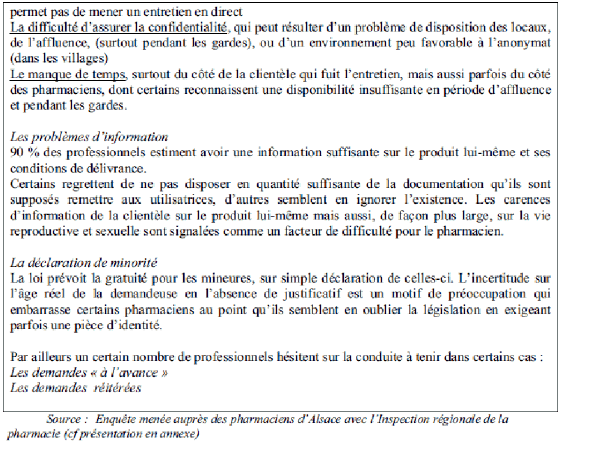
Plus récemment en 2011, le CRIPS (Centre régional d’information et de prévention du sida) PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) a réalisé une enquête auprès de 600 jeunes lycéen-ne-s et apprenti-e-s de la région PACA sur leurs connaissances, représentations et utilisation de la contraception d’urgence (109). Sur les 77 jeunes déclarant s’être déjà procuré la contraception d’urgence dans une pharmacie, 82 % des utilisatrices étaient mineures et 65 % l’ont dit au pharmacien.
La délivrance a été refusée à 2 mineures, la carte d’identité a été demandée dans 13 % des cas et 7 % des utilisatrices ayant déclaré être mineures ont dû payer la contraception d’urgence. Si la situation s’améliore, des efforts restent encore à faire en matière d’information et de formation des pharmaciens.
● La délivrance par les infirmier-e-s scolaires facilitée par le projet de loi
La contraception d’urgence depuis la loi du 13 décembre 2000 peut aussi être administrée par les infirmières dans les établissements d’enseignement du second degré pour les élèves mineures et majeures. Mais la loi précise que cette délivrance destinée à répondre aux cas d’urgence et de détresse, se fait à titre exceptionnel lorsqu’un médecin ou un centre de planification n’est pas immédiatement accessible. Les infirmières doivent s’assurer de l’accompagnement psychologique de l’élève et veiller à la mise en œuvre d’un suivi médical.
Un protocole national sur la contraception d’urgence en milieu scolaire annexé au décret du 27 mars 2001 pris en application de la loi détermine les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. Il prévoit que l’infirmier propose à l’élève d’entrer en contact avec ses parents mais que l’élève peut le refuser.
Alors que la délivrance aux mineures par les pharmaciens a augmenté de façon très importante, les chiffres de l’Éducation nationale montrent une stabilité de la délivrance par les infirmiers scolaires depuis 2003. Ce constat interroge sur l’information des élèves et sur l’image qu’ils ont de l’institution scolaire en tant que recours dans ce type de situation. Le taux de couverture de la demande par les infirmeries scolaires a néanmoins beaucoup augmenté puisqu’en 2010, 87 % des demandes justifiées ont été satisfaites d’après le graphique suivant.
DÉLIVRANCE DE LA CONTRACEPTION D’URGENCE EN MILIEU SCOLAIRE
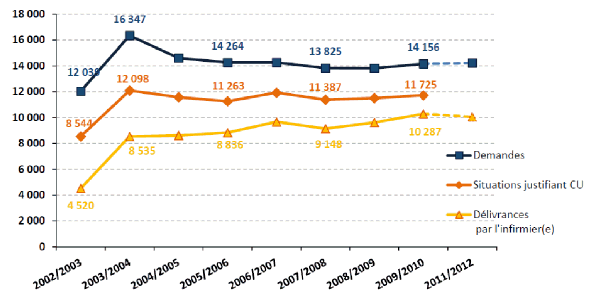 * Années 2010-2012 : données incomplètes
* Années 2010-2012 : données incomplètes
Source : DGESCO
Il convient de noter que l’accès à la contraception d’urgence pour les étudiantes a été renforcé avec le décret du 24 juillet 2012 qui en autorise la délivrance gratuite au sein des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé. En 2013, la HAS a recommandé d’élargir la délivrance de la pilule de contraception d’urgence au lévonorgestrel aux élèves/étudiant-e-s/ apprenti-e-s dans tous les établissements d’enseignement et de formation indépendamment de la présence d’un personnel sanitaire.
L’article 3 du projet de loi relatif à la santé lève les restrictions existantes sur l’accès à la contraception d’urgence des élèves du second degré auprès de l’infirmerie scolaire ainsi que l’explique l’exposé des motifs du projet de loi. Restreindre la délivrance de la contraception d’urgence aux cas d’urgence et de détresse caractérisés tel que l’énonce la loi apparaît trop restrictif et crée en pratique des situations inéquitables entre territoires, alors même que l’efficacité du médicament est liée à une prise rapide. En pleine cohérence avec la levée de ces restrictions en matière d’accès à l’IVG dans la loi du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’article 3 lève ces restrictions. Ainsi au 3ème alinéa de l’article L.5134-1 du code de la santé publique, les mots « si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible » ainsi que les mots « et de détresse caractérisés » sont supprimés. Cette proposition est d’ailleurs conforme à une recommandation du rapport de l’Igas d’octobre 2009 sur la prévention des grossesses non désirées, comme le rappelle l’étude d’impact associée au projet de loi.
Le financement sera assuré par l’établissement scolaire qui reçoit une dotation globale de fonctionnement qui relève de la compétence des collectivités territoriales et non par l’assurance maladie.
● Anticiper l’urgence ?
Dans son rapport de 2009 sur la prévention des grossesses non désirées, l’IGAS avait dans une recommandation pris position pour encourager la prescription et la délivrance de la contraception d’urgence « à l’avance ». Il s’agissait de s’assurer la disponibilité à l’avance du produit « pour le cas où », comme c’est le cas par exemple des médicaments utilisés pour les crises de migraine. La Haute Autorité de santé (HAS) a été saisie par la Direction générale de la santé (DGS) afin d’évaluer la pertinence et les risques d’une prescription à l’avance d’une contraception d’urgence à titre systématique. En avril 2013, la HAS a produit des recommandations dans l’objectif de répondre à la question posée.
La HAS rappelle que la contraception d’urgence n’est pas un dispositif isolé mais une méthode de contraception de « rattrapage » qui s’inscrit dans le cadre général de la santé sexuelle et reproductive. Elle préconise d’améliorer l’information sur la contraception d’urgence.
La HAS ne recommande cependant pas la prescription et la délivrance à l’avance de la pilule de contraception d’urgence en routine à titre systématique. En effet, selon elle, les études disponibles n’ont pas démontré l’efficacité d’une telle stratégie pour diminuer l’incidence des grossesses non prévues à l’échelle populationnelle. La HAS recommande d’envisager une prescription à l’avance de la pilule de contraception d’urgence au cas par cas dans certaines situations. Ces situations ne peuvent pas être caractérisées a priori. Elles peuvent inclure les situations suivantes : les femmes ayant des difficultés d’accès à la contraception d’urgence (par exemple difficulté d’accès à une pharmacie, difficultés financières), les femmes voyageant à l’étranger, les femmes utilisant comme méthode contraceptive le préservatif ou d’autres méthodes moins efficaces.
Vos rapporteures formulent enfin les deux recommandations suivantes :
Recommandation n° 20 : Encourager le développement d’initiatives de type « Pass contraception » dans les régions.
Recommandation n° 21 : Rendre effective l’application de la circulaire de 2003 en inscrivant dans les programmes obligatoires et les horaires d’enseignement l’éducation à la sexualité.
III. RENFORCER LE DÉPISTAGE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)
A. UNE PLUS GRANDE VULNÉRABILITÉ DES FEMMES AUX IST
Si l’incidence du Sida chez les femmes reste inférieure à celle observée chez les hommes, la part des femmes a progressivement augmenté depuis le début de l’épidémie pour plusieurs raisons. Comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, elles présentent des risques accrus d’infection par le VIH au cours d’un rapport sexuel en raison de facteurs biologiques et de leur vulnérabilité socio-économique entraînant des difficultés tant dans l’accès à l’information et à la prévention, que dans la négociation de la prévention avec leurs partenaires (110).
INCIDENCE CUMULÉE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST) DECLARÉES DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, PAR SEXE ET PAR ÂGE (2010)
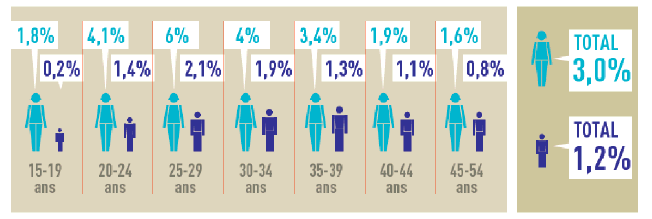
Source : INPES, Baromètre Santé 2010 (Les chiffres clés du ministère des droits des femmes, édition 2014)
Les femmes sont également plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir contracté une infection sexuellement transmissible (IST). L’augmentation des IST témoigne d’un relâchement des comportements sexuels de prévention pour les femmes comme pour les hommes. Les cas de nouveaux diagnostics concernent principalement les femmes âgées de 25 à 29 ans. À tous les âges, les femmes sont plus touchées que les hommes par l’incidence cumulée des IST, comme l’illustre l’infographie ci-dessous. Les femmes qui ont contracté une IST ne ressentent pas forcément de symptômes, ce qui augmente le risque de transmission notamment du VIH.
B. LES MESURES PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI
L’article 7 du projet de loi a pour objet de conforter la pratique des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et des autotests pour le dépistage de maladies infectieuses transmissibles. Les TROD donnent un résultat en moins d’une demi-heure et offrent, par leur simplicité et souplesse d’utilisation, la possibilité d’aller à la rencontre des populations concernées. Le projet de loi ouvre la possibilité qu’ils soient pratiqués par des professionnel-le-s de santé ou par du personnel relevant de structures de prévention ou associatives, ayant reçu une formation adaptée. C’est dans cet esprit que leur utilisation a été développée à ce jour. L’article 7 consolide et élargit l’expérience acquise à titre expérimental dans le cadre de la promotion du dépistage du VIH, suivant les recommandations du Conseil national du sida (CNS) et de la Haute Autorité de santé en faveur de la banalisation de la proposition de dépistage du VIH, requise par le contexte épidémiologique actuel.
Par ailleurs, en raison des évolutions techniques prévues à court et moyen termes en matière de TROD pour les hépatites virales B et C et les infections sexuellement transmissibles (IST), l’article prévoit la possibilité d’un recours aux TROD pour le dépistage de l’ensemble des maladies infectieuses transmissibles.
Cet article prévoit également la mise à disposition d’autotests de détection pour les personnes les plus exposées aux maladies infectieuses transmissibles. Réalisés directement par les intéressés, ils sont délivrés sans prescription médicale sous forme de kit. La délivrance se fera en pharmacie mais également au sein d’autres structures et opérateurs afin de pouvoir toucher certaines populations exposées et particulièrement vulnérables. Cette mesure répond aux recommandations du Conseil national du sida (2012) et du Comité consultatif national d’éthique (CCNE, 2013) qui, considérant l’importance de l’enjeu d’améliorer la précocité du dépistage en France, les propriétés des autotests, la place qu’ils sont susceptibles de prendre dans l’offre de dépistage et leur rapport bénéfices-risques, se sont prononcés en faveur de la mise à disposition des autotests de dépistage de l’infection par le VIH.
Comme le souligne l’exposé des motifs du présent projet de loi, les autotests ne peuvent se substituer à l’offre existante car ils proposent un résultat qui doit être confirmé par un test biologique conventionnel. Leur diffusion doit d’adresser prioritairement aux populations fortement exposées au risque de transmission du VIH, dans le cadre d’une distribution assurée par différents opérateurs pertinents (association, centres d’information, de dépistages et de diagnostic, médecine générale) à partir des acquis de la mise en place des TROD. La mise à disposition des autotests doit s’accompagner d’une promotion plus générale du dépistage du VIH.
Vos rapporteures saluent l’ensemble de ces dispositions, qui permettront de faciliter l’accès au dépistage, et notamment des personnes les plus éloignées du système de santé.
Mme Véronique Séhier, coprésidente du Planning familial, a cependant regretté, lors de son audition par la délégation le 13 janvier 2015, que le projet de loi évoque par exemple les centres de dépistage (CDAG) et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) comme lieux de ressources, mais pas les centres de planification. Selon Mme Danielle Gaudry, membre du bureau national, la « loi Calmat » de 1990 indique pourtant que les centres de planification assurent le dépistage et le traitement des IST.
En effet, aux termes de l’article L. 2311-5 du code de la santé publique, les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) « peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies ».
Dans le sens de cette observation, il pourrait être envisagé de modifier la rédaction de l’article 7 du projet de loi (article L. 3121-2-2 nouveau du code de la santé publique), qui définit les catégories d’établissements et d’organismes (111) habilités à délivrer des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection des maladies infectieuses transmissibles. Il conviendrait d’étudier la possibilité d’étendre aux centres de planification le champ des dispositions prévues par l’article 7 du projet de loi en vue de renforcer le dépistage des infections sexuellement transmissibles.
Enfin, en matière de santé sexuelle et reproductive, et comme l’a justement fait observer Mme Bérengère Poletti (112), il convient de prendre en compte les difficultés qui peuvent être rencontrées par les femmes ayant recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Les traitements peuvent en effet être contraignants et fatigants, mais aussi de nature à compliquer leur vie professionnelle.
I. COMPTES RENDUS DES AUDITIONS DE LA DÉLÉGATION
Audition de Mme Francoise Laurant, présidente de la commission Santé, droits sexuels et reproductifs du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), ancienne présidente du Planning familial
Compte rendu de l’audition du 1er octobre 2014
Mme la présidente Catherine Coutelle. Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation. En avril 2013, la ministre des droits des femmes, préoccupée par les disparités régionales dans l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et par les faiblesses de l’information publique dans ce domaine, alors que les sites anti-IVG proliféraient sur Internet, a demandé au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes une étude à ce sujet.
Après un premier volet concernant l’information sur l’IVG sur Internet, en septembre, le Haut Conseil a remis à la ministre, en novembre 2013, un rapport relatif à l’accès à l’IVG dans les territoires, contenant 34 recommandations. Notre Délégation entend poursuivre les travaux engagés par Mme Ségolène Neuville, qui avait été désignée rapporteure sur l’accès à la contraception et à l’IVG. Aussi, je vous saurais gré de commenter celles des recommandations contenues dans le rapport que vous jugez les plus importantes, de nous dire lesquelles ont déjà été suivies d’effet et quelles difficultés persistent, 40 ans après le vote de la loi Veil.
Mme Françoise Laurant, présidente de la commission Santé, droits sexuels et reproductifs du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie à mon tour ; en voulant nous entendre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos travaux. Certaines des recommandations que nous avons rédigées supposent des mesures législatives, d’autres relèvent de politiques nationales ou de stratégies des agences régionales de santé (ARS) ; certaines, enfin, supposent des financements.
Nous les avons classées en quatre chapitres. Le premier a une forte portée symbolique, puisqu’il tend à faire de l’IVG un droit à part entière. De fait, à ce jour, l’IVG n’est pas considérée de cette manière en France : on accepte de répondre à la demande des femmes qui veulent exercer ce droit mais on leur fait comprendre qu’il serait mieux qu’elles ne le demandent pas. Aussi, la première de nos recommandations était de remplacer, dans l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, la phrase : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse », par la phrase : « La femme qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse peut demander à un-e médecin de l’interrompre ». Grâce à vous, cette disposition à grande valeur symbolique a été adoptée lors de l’examen de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ; nous vous remercions d’avoir tenu compte de nos travaux, comme vous l’avez fait en élargissant à l’entrave à l’information le champ d’application du délit d’entrave à l’IVG.
De nouvelles modifications législatives seront nécessaires pour que certaines autres recommandations puissent être suivies. Ainsi de la deuxième, qui est de supprimer l’obligation du délai de réflexion de 7 jours prévu entre les deux premières consultations nécessaires avec un médecin avant une IVG. Il ne s’agit pas de supprimer le délai de réflexion mais une obligation ressentie par les femmes comme infantilisante et qui, de surcroît, leur fait perdre une semaine. Les textes en vigueur prévoyant qu’en cas d’urgence, le délai de réflexion peut être ramené à 48 heures, on comprend que cette obligation faite aux femmes est de l’ordre du symbole, non une pièce maîtresse du dispositif.
De même, la troisième recommandation tend à supprimer de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique, les dispositions relatives à la clause de conscience – une redondance, puisque le recours à cette clause est déjà accordé de manière générale à tout le personnel soignant pour l’ensemble des actes médicaux. Y insister dans cet article, c’est signifier que ce droit n’est pas un droit « normal ». En l’état, le projet de loi sur la santé ne dit mot à ce sujet.
Le deuxième chapitre contient des recommandations tendant à développer un dispositif public national d’information et de communication portant sur la sexualité, la contraception et l’avortement ; la région Île-de-France mène une campagne de ce type.
Le troisième chapitre vise au développement d’un accès simple à l’IVG. Si, au contraire des velléités qui se manifestent dans d’autres États européens, on imagine difficilement des tentatives visant à la remise en cause juridique de ce droit en France, l’accès à l’IVG demeure dans notre pays un parcours du combattant, parcours dont la difficulté a été renforcée par le regroupement des établissements hospitaliers, qui contraint certaines femmes souhaitant une IVG à se rendre à plus de 200 km de leur domicile. Le rétablissement de la proximité de l’accès à l’IVG nous est apparu comme une condition essentielle pour garantir à la fois l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire et les bonnes pratiques.
À cette fin, nous recommandons en particulier de permettre à des personnels de santé qualifiés, médecins ou non médecins – sages-femmes, infirmières, conseillers conjugaux et familiaux – de réaliser le premier rendez-vous et de délivrer la première attestation prévue par la loi. Au cours de ce rendez-vous, on explique aux femmes les méthodes d’IVG possibles et on répond à leurs questions ; or l’expérience montre que lorsqu’il a lieu avec un médecin, l’entretien ne dure parfois qu’une dizaine de minutes, mais une heure quand d’autres professionnels de santé sont à l’écoute. Outre cela, élargir le spectre des interlocuteurs autorisés par la loi à intervenir à ce stade permettrait de gagner entre 8 et 15 jours. La neuvième recommandation a donc une importance particulière.
La dixième tend en outre à permettre aux femmes majeures de remplir elles-mêmes l’attestation de première demande d’IVG dans le cas où elles éprouvent des difficultés à obtenir le premier rendez-vous. Nous nous sommes inspirés, pour cette proposition, de la loi en vigueur en Belgique, où l’on n’impose pas aux femmes un rendez-vous de ce type.
Mais pour raccourcir le parcours du combattant encore imposé aux femmes qui veulent une IVG, il faut faire davantage. En premier lieu, il faut restaurer l’activité d’IVG dans les établissements de santé dans lesquels elle a été arrêtée soit à la suite de la restructuration des hôpitaux et en particulier des maternités, soit par fermeture. C’est l’objet de la onzième recommandation, par laquelle nous demandons, au minimum, l’instauration d’un moratoire sur les fermetures de centres IVG et le respect de l’article R. 2212-4 du code de la santé publique qui impose la pratique de l’IVG à tous les établissements disposant d’un service de gynécologie ou de chirurgie. De telles dispositions ne sont pas d’ordre législatif : elles relèvent de la politique de santé, et donc des ARS. Ainsi, s’il est un centre emblématique qui n’aurait pas dû arrêter l’activité IVG alors même que nous poursuivions nos travaux, c’est celui de la maternité des Lilas, en banlieue parisienne.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Ce centre a finalement été sauvé.
Mme Françoise Laurant. Il ne déménage plus, certes, mais les financements continuent de manquer ! Nous tenions à défendre les établissements innovants et respectueux des femmes. Certaines ARS, ayant lu notre rapport, ont dressé la liste des centres IVG qui ont fermé et des établissements qui n’exercent plus l’activité depuis longtemps alors même qu’ils ont un service de chirurgie ou une maternité, pour essayer de les convaincre de la reprendre ; mais les choses ne se feront pas du jour au lendemain.
Dans la même perspective, la treizième recommandation tend à permettre l’IVG par aspiration, sous anesthésie locale, dans les centres de santé, les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) et les maisons médicales pluridisciplinaires. Cette possibilité existe en Belgique – et dans un rapport consacré à l’application de la loi du 4 juillet 2001, l’IGAS soulignait la nécessité de se référer aussi aux procédures suivies à l’étranger. Ce système suppose bien sûr l’intervention de médecins spécifiquement formés à ce geste.
La vingt-troisième recommandation est d’appliquer la prise en charge à 100 % de l’IVG à tous les actes qui lui sont associés, telle l’échographie de datation. La question est d’une particulière importance car le non-remboursement intégral des examens complémentaires pose de graves problèmes aux mineures qui ne peuvent se confier à leur famille, ainsi qu’aux femmes défavorisées.
Le quatrième chapitre du rapport traite de la gouvernance aux niveaux national et régional.
Au plan national, il convient de créer un « Plan national sexualités-contraception-IVG », en l’absence duquel les progrès seront lents. Un programme de santé publique de ce type, comme il en a été défini un pour lutter contre le cancer, devrait annoncer une stratégie et décrire les financements qui lui sont associés – y compris les moyens existants. Cette mesure, qui fait l’objet de la vingt-cinquième recommandation, relève de la loi.
La vingt-sixième recommandation tend à la création d’un Observatoire national sexualités-contraception-IVG ; la vingt-neuvième détaille l’ensemble des données nécessaires au suivi et à l’évaluation de la prise en charge de l’IVG. L’appareil statistique actuel est, pour le moins, rudimentaire. Le recueil de certaines données a même été supprimé – ainsi du délai qui court entre le premier et le deuxième rendez-vous – et certaines questions sont omises : ainsi, on est incapable de déterminer si les méthodes d’IVG utilisées correspondent effectivement aux demandes exprimées.
Par la trente et unième recommandation, nous invitons le Parlement à inscrire l’accès à l’IVG dans son programme d’évaluation des politiques publiques.
Au plan régional, la trente-deuxième recommandation tend à ce qu’il soit exigé des ARS l’inscription de l’activité IVG dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) qui les lient aux établissements de santé. Cette activité figure actuellement dans très peu de CPOM, même lorsque les établissements ont un service de gynécologie-obstétrique.
La trente-troisième recommandation tend à la création, sur le modèle des anciennes commissions régionales de la naissance, de « commissions régionales sexualités-contraception-IVG » indépendantes de l’administration, où siégeraient des représentants des associations et des professionnels et où les femmes pourraient dire ce qu’elles pensent. Cet outil de coordination régional permettrait le suivi attentif de l’activité IVG.
Telles sont les principales recommandations qui figurent dans le rapport. Le ministère n’a pas encore apporté de réponse, mais peut-être l’anniversaire de loi Veil lui en donnera-t-il l’occasion. Toutefois, les ARS ont eu à connaître du rapport et l’ARS d’Île-de-France a défini un projet régional destiné à favoriser la réduction des inégalités d’accès à l’avortement, dit programme FRIDA.
Je traiterai ultérieurement de notre étude en cours sur la contraception. Le Haut Conseil s’est autosaisi de ce sujet qui implique l’éducation à la sexualité à l’école et hors l’école – et c’est tout sauf facile.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, nous ne sommes pas revenus sur la référence expresse à la clause de conscience concernant l’IVG pour ne pas donner à penser que nous la supprimions, tout en la sachant redondante avec d’autres dispositions.
On sait qu’en matière de santé les femmes consultent davantage que les hommes les sites électroniques. Le site www.ivg.gouv.fr est à présent installé. Quel jugement portez-vous sur son fonctionnement et son utilité ?
Mme Françoise Laurant. Ce site reprend le chapitre consacré à l’IVG qui figure sur le site du ministère de la santé. Au moins dispose-t-on maintenant d’une réponse publique officielle aux questions que se posent les femmes, mais le référencement du site sur les moteurs de recherche dépend du volume de consultation, et l’on constate des disparités régionales ; dans la région Rhône-Alpes par exemple, c’est toujours le site ivg.net qui apparaît en premier. La création du site n’a pas encore produit tous ses effets. Or les sites anti-IVG ne donnent d’information ni sur la procédure à suivre, ni sur les lieux où se rendre, ou bien ils procurent des renseignements délibérément faux ; de plus, les femmes qui appellent les numéros de téléphone indiqués trouvent des interlocuteurs chaleureux. C’est pourquoi nous appelions à la création d’un numéro de téléphone national d’information à quatre chiffres, anonyme et gratuit, renvoyant vers les plateformes téléphoniques régionales. Le Planning familial a pour projet d’en créer un.
Mme Claire Guiraud, responsable des études et de la communication, en charge du suivi de la commission Santé, droits sexuels et reproductifs du HCEfh. Par ailleurs, la veille et l’animation du site www.ivg.gouv.fr restent à parfaire : la référence à la « situation de détresse » est demeurée après que la loi en a disposé autrement, et la liste des numéros de téléphone des CPEF n’est pas à jour.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous appellerons l’attention du ministère sur l’animation du site. La douzième recommandation du rapport souligne la nécessité de faire respecter l’article R. 2212-4 du code de la santé publique disposant que tous les établissements doivent pratiquer l’IVG, et ce jusqu’à 12 semaines de grossesse. Pourquoi cette insistance ?
Mme Françoise Laurant. Parce que de nombreux établissements, n’appliquant pas la loi de 2001, n’interviennent pas au-delà de 10 semaines de grossesse, et même de 9 semaines à Vienne, dans l’Isère. Cela a pour résultat que des femmes doivent aller à Lyon ou à Grenoble. Cela exaspère les établissements grenoblois.
Mme la présidente Catherine Coutelle. L’inégalité d’accès à l’IVG selon les territoires est impressionnante. Le rapport fait état de ce que 5 % des établissements publics et 48 % des établissements privés pratiquant l’IVG, soit plus de 130 établissements, ont fermé entre 2000 et 2011. Comment expliquer cette évolution ?
Mme Françoise Laurant. Pour les établissements privés, ce mouvement s’explique par une rentabilité de l’activité jugée insuffisante. Les établissements publics ont quant à eux réduit le nombre des IVG pratiquées en raison de la faiblesse du forfait, à comparer à la tarification des fausses couches spontanées. La revalorisation récente du « forfait IVG » a légèrement détendu la situation, mais tout n’est pas réglé. Ainsi, lorsque le forfait était bas, les établissements hospitaliers parisiens disaient aux femmes de faire tous examens et analyses hors l’hôpital ; après que le forfait IVG a été augmenté, certains hôpitaux n’y ont pas réintégré l’ensemble de ces actes, comme ils le devraient. Dans les grands établissements hospitaliers, ce sont les services financiers qui traitent avec l’assurance maladie, et certains ne sont pas au courant. C’est à l’ARS qu’il revient de faire savoir exactement ce qui est pris en charge dans le cadre du forfait. En bref, la diminution de l’activité IVG est sans doute due à une question financière.
Mme la présidente Catherine Coutelle. La carte qui figure en page 53 du rapport indique la part d’IVG médicamenteuses en ville par rapport au nombre total d’IVG pratiquées par région. Comment s’expliquent les grandes disparités relevées ?
Mme Françoise Laurant. Les médecins libéraux doivent être volontaires, formés et agréés. Ceux-là sont rares. De plus, certains gynécologues ne se font agréer que pour pouvoir pratiquer une IVG médicamenteuse au cas où l’une de leurs patientes habituelles le leur demanderait, mais ils n’en font pas d’autres.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Seriez-vous favorable à l’allongement du délai autorisé pour pratiquer une IVG médicamenteuse en ville ?
Mme Françoise Laurant. Oui : il devrait être aligné sur le délai autorisé en établissement de santé.
Mme Bérengère Poletti. La prudence s’impose sur ce point, car les femmes dans ce cas sont souvent seules.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Ne peut-on en effet craindre des abus qui pourraient conduire à des hémorragies ?
Mme Françoise Laurant. Les motivations, et donc les pratiques, varient. Dans une grande ville, une jeune Maghrébine demandera une IVG médicamenteuse en pensant, à tort, qu’elle pourra ainsi avorter chez elle sans que personne ne se rende compte de rien. Si elle se rend dans un centre de planification, on lui expliquera pourquoi mieux vaut pour elle l’hôpital que cette solution ; un médecin de ville pourra le lui dire aussi, mais l’on ne sait rien de ce qui se dit dans un cabinet libéral.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Le ministère favoriserait-il le développement de l’IVG médicamenteuse en ville ? Cela doit-il être encouragé ou doit-on voir là un risque pour la santé des femmes ?
Mme Françoise Laurant. Dès l’origine, le ministère a poussé à l’IVG médicamenteuse, mais pas forcément à l’hôpital.
Mme Claire Guiraud. Le tableau figurant en page 49 du rapport montre que les IVG médicamenteuses représentaient, en 2012, 55 % du total des IVG.
Mme Françoise Laurant. C’est que cela coûte moins cher qu’une IVG chirurgicale. Puisque le délai autorisé est court, davantage d’IVG médicamenteuses seraient pratiquées en ville, dans les zones éloignées des hôpitaux, s’il y avait plus de médecins installés en cabinets libéraux ; mais un médecin de campagne isolé ne se lancera pas seul dans cette activité. Un peu plus d’IVG médicamenteuses seraient peut-être pratiquées en zones rurales s’il existait des réseaux permettant aux médecins de se former. Je ne pense pas que le ministère cherche à ce qu’il y ait davantage d’IVG médicamenteuses en ville.
Mme Bérengère Poletti. Comment articuler les données figurant respectivement en pages 49 et 53 du rapport ?
Mme Françoise Laurant. Toutes signalent la disparité de l’offre de soins, qui dépend du contexte local. Ainsi, pendant certaines périodes, les IVG médicamenteuses représentent 50 % du total des IVG dans l’Ain ; pourquoi cela ? Parce que les anesthésistes ne veulent pas faire les IVG chirurgicales. On note toutefois une tendance à l’uniformisation des pratiques.
Mme Bérengère Poletti. Il n’a pas de méthode idéale, et beaucoup dépend de la manière dont la femme est reçue, si bien que le choix de la méthode dépend plus du professionnel de santé que de la femme. Si l’IVG médicamenteuse est correctement expliquée et faite en établissement de santé, les femmes ne seront pas effrayées comme elles risqueront de l’être si elles se trouvent seules chez elles pour subir une épreuve terrible sur les plans psychologique et physique. Étant donné l’évolution défavorable de la démographie médicale, même s’ils le souhaitent, les médecins n’ont plus le temps de parler avec les femmes. Enfin, certains médecins choisissent de réserver cette possibilité à leur patientèle.
Pour ces raisons, il me semble pertinent d’élargir aux sages-femmes l’autorisation de pratiquer les IVG médicamenteuses – tout en conservant une clause de conscience explicite pour ne pas susciter de réactions adverses.
Mme Françoise Laurant. Mais, vous le savez, la clause de conscience est générale, et elle demeure. En raison d’un blocage imputable à l’Ordre des médecins, la liste des médecins de ville habilités à pratiquer une IVG médicamenteuse n’est pas connue, alors que la loi avait prévu qu’elle le soit. Or les textes ne disposent pas qu’une IVG médicamenteuse puisse être faite à domicile par n’importe quel médecin ; autant dire qu’une sérieuse dose d’obstination est requise pour en trouver un qui le fasse.
D’autre part, les femmes doivent, en théorie, pouvoir prendre une décision éclairée et demander à ce que l’on suive la méthode d’IVG qu’elles ont choisie. Mais cela se passe rarement ainsi, faute que toutes les méthodes soient disponibles. Cela pose un gros problème quand on essaye d’expliquer à une femme qui réclame une IVG médicamenteuse ce qui est possible pour elle et ce qui ne l’est pas. L’IVG médicamenteuse ne devrait pas être présentée comme une panacée, mais les femmes auxquelles elle convient devraient pouvoir la choisir. Or les regroupements d’établissements hospitaliers ont eu pour conséquence l’allongement des files d’attente, si bien que le délai de neuf semaines de grossesse est souvent dépassé. Il en résulte que ces femmes doivent recourir à une IVG chirurgicale alors même qu’elles avaient entrepris la procédure à temps pour pouvoir choisir une IVG médicamenteuse en établissement hospitalier.
Mme Bérengère Poletti. C’est bien pourquoi il faut étendre l’habilitation aux sages-femmes.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Selon vous, l’important allongement des files d’attente est-il dû à un engorgement réel ou est-il volontaire ?
Mme Françoise Laurant. Il arrive que certains secrétariats d’établissements hospitaliers indiquent aux femmes que l’on ne peut les accueillir, et leur suggèrent de se rendre en Espagne…
Mme la présidente Catherine Coutelle. Est-ce faute de disponibilités ou parce que ces établissements ne veulent pas faire d’IVG ?
Mme Françoise Laurant. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux… Cela peut être parce que des médecins sont en vacances et qu’ils ne sont pas remplacés.
Mme Bérengère Poletti. Le nombre de praticiens hospitaliers qui pratiquaient des IVG est en chute libre. Dans le département des Ardennes, il n’y a plus de gynécologue libéral et il est impossible d’obtenir un rendez-vous à l’hôpital sans attendre des semaines et parfois des mois. Dans ce contexte, l’éventualité d’une urgence devient très préoccupante, y compris quand il s’agit d’accéder à une IVG. Le problème ne fera que s’aggraver avec les départs à la retraite des gynécologues-obstétriciens dans les cinq ans à venir, les plus jeunes n’ayant pas la même sensibilité que leurs aînés à ces problèmes.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Les gynécologues-obstétriciens militants sont, me semble-t-il, partis à la retraite il y a un certain temps déjà. Il n’en reste pas moins que la chute du nombre de gynécologues exerçant en ville est impressionnante.
Mme Françoise Laurant. Les premiers militants sont certainement tous morts ! Depuis lors, la profession s’est fortement féminisée, et les médecins qui pratiquent les IVG en établissements hospitaliers le font bien souvent en qualité de vacataires si médiocrement rémunérés que cela en est dissuasif. Aussi recommandons-nous de revoir et d’unifier le statut des praticiens extérieurs travaillant dans les établissements de santé publics et de ne pas leur imposer de seuil de temps de présence minimal. Rien ne justifie que ces vacataires travaillent presque gratuitement. Certains médecins généralistes veulent répondre aux besoins de leurs patientes, dont l’IVG. Ils ne veulent pas cantonner leur exercice à cela, mais ils seraient disposés à faire des vacations. La très inquiétante diminution de l’offre de soins impose donc aussi de revoir la rémunération des praticiens.
Mme la présidente Catherine Coutelle. La féminisation de la profession a-t-elle un effet favorable ou défavorable à l’IVG ? Cela a-t-il des conséquences idéologiques perceptibles ? Le discours de certains médecins est très défavorable à l’IVG.
Mme Françoise Laurant. Beaucoup de ceux qui se sont battus jadis en faveur de l’IVG culpabilisent les femmes au motif qu’elles n’utiliseraient pas de moyens contraceptifs. Le personnel médical et paramédical méconnaît le fait que deux tiers des femmes qui demandent une IVG utilisent une méthode contraceptive théoriquement efficace – si ce n’est qu’une enquête menée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) fait état de bien des pilules oubliées…
Mme Bérengère Poletti. Aux pilules oubliées s’ajoutent les effets des interactions médicamenteuses et le fait que l’efficacité des micropilules n’est pas de 100 % si elles ne sont pas absorbées avec une régularité de métronome.
Mme Françoise Laurant. Les médecins qui prescrivent des traitements destinés à soigner des maladies chroniques veillent à décrire leurs effets secondaires ou à mettre en garde contre un oubli. C’est rarement fait pour la contraception orale. De plus, l’idée que l’on se fait généralement d’un médicament est que son effet dure un certain temps après qu’il a été ingéré. Or, en matière contraceptive, un oubli a des effets graves, et il n’est pas certain que toutes les femmes en aient conscience. Tout le monde ne peut informer sur la contraception, ni même tout médecin.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Il résulte de tout cela que le taux d’IVG est stable en France, et même en progression chez les plus jeunes.
Mme Françoise Laurant. La légère progression à laquelle vous faites allusion a été attribuée à la polémique relative aux pilules de troisième génération, certains médecins ayant dit à leurs patientes d’arrêter ce traitement sans leur proposer de contraception alternative. Mais la courbe a de nouveau baissé.
Mme Bérengère Poletti. Pourquoi le rapport parle-t-il de « sexualités » ? La sexualité n’est-elle pas un tout ?
Mme Françoise Laurant. Parce qu’il s’agit d’organiser des campagnes d’information visant à faire évoluer les mentalités.
J’en viens à nos travaux en cours relatifs à la contraception, car le droit à la contraception ne peut être séparé du droit à l’IVG : ce sont deux facettes du droit à disposer de son corps. La France est l’un des pays les plus « contraceptés » du monde, mais les méthodes utilisées ne sont pas forcément bien adaptées à chaque femme ; c’est fâcheux. De plus, dans certaines zones géographiques et pour certains groupes de population, l’accès à la contraception est mauvais. L’ INPES est beaucoup intervenu à ce sujet depuis 2008, en lançant des campagnes successives, mais le message à faire passer est compliqué : il s’agit de faire comprendre que la liberté sexuelle s’accompagne de contraintes. Ce n’est pas sur le plan de la réduction des risques que l’on doit se placer mais sur le plan de l’éducation à la sexualité, pour favoriser la santé sexuelle telle que définie de manière positive par l’OMS en 2006.
Autrement dit, en cette matière, on a besoin de médecins car de nombreuses méthodes contraceptives demandent des connaissances ou des gestes médicaux, mais tout commence par le choix d’avoir recours à la contraception. L’important est donc de sensibiliser à la contraception. Pour les jeunes, cela doit se faire à l’école et hors l’école ; pour les immigrants, des politiques spécifiques sont nécessaires, qui peuvent commencer à leur arrivée sur le territoire.
Le dispositif repose sur les centres de planification créés par la loi Neuwirth de 1967. Ils ont été conçus pour permettre la délivrance de conseils par des médecins compétents en cette matière – lesquels, à l’époque, n’étaient pas nombreux. Mais aussitôt supprimée l’obligation d’autorisation parentale pour venir consulter et instaurée la gratuité des consultations, ces centres se sont très vite tournés vers les jeunes, si bien que de fait, les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) forment le socle de la diffusion de la contraception – car l’assurance maladie ne rembourse pas tous les contraceptifs.
Les pratiques diffèrent beaucoup selon les conseils régionaux, qui ont la compétence légale à ce sujet. L’ennui est que, contrairement à ce qui vaut pour les centres de protection maternelle et infantile (PMI), la loi n’établit pas quel doit être le nombre de CPEF par département ; il en résulte que, dans un département donné, il peut n’y avoir qu’une vacation de planification des naissances par semaine… La première mesure à prendre devrait être de définir un nombre de consultations de PMI et un nombre de vacations de planification des naissances en tous lieux. Ces vacations sont gérées par les hôpitaux, les communes et, pour 10 %, par les associations, dont beaucoup par le Planning familial. Mais la plupart des CPEF sont rattachés à une administration et fonctionnent de manière… administrative.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Cet enchevêtrement fait aussi que de nombreuses femmes confondent CPEF et Planning familial.
Mme Françoise Laurant. En 1956, Mme Lagroua Weill-Hallé, docteur de profession, créait l’association « La Maternité heureuse », devenue en 1961 le Mouvement français pour le planning familial, terme qui a ensuite été repris dans la loi Neuwirth.
La très forte diversité des politiques régionales entraîne de grandes inégalités d’accès à la contraception – certains départements ne comptent qu’un seul CPEF. Sous la pression des associations, beaucoup de régions ont créé des Pass contraception, dispositifs qui permettent l’accès à une contraception gratuite. Selon les cas, ces Pass permettent l’accès à tous les contraceptifs, ou seulement à ceux que rembourse l’assurance maladie : ce qui n’était pas une compétence locale l’est devenu. Je souligne pour finir qu’il convient aussi de mobiliser les hommes sur la contraception.
Mme Bérengère Poletti. En matière de contraception, le discours, pour être compris doit être simple, clair, et le même en tous lieux. De plus, on n’est pas encore parvenu à l’anonymat complet, puisque même en cas de tiers payant, les courriers de l’assurance maladie arrivent chez les parents des mineures, ce qui est dangereux pour certaines. Nous reparlerons de ces questions lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Mme la présidente Catherine Coutelle. De plus, il n’y a pas de Pass contraception dans toutes les régions.
Mme Bérengère Poletti. J’ai envoyé à tous les pharmaciens de ma circonscription un questionnaire leur demandant s’ils connaissaient l’existence de ce dispositif. Vingt pour cent d’entre eux m’ont répondu ; il ressort de leurs réponses que la plupart ne sont pas au courant, et très peu nombreux sont ceux qui délivrent des contraceptifs aux mineures.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Madame, je vous remercie pour ce travail approfondi, qui me permet de réaffirmer toute l’utilité du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Audition de Mme Dominique Henon, membre du CESER d’Île-de-France, ancienne conseillère et rapporteure du Conseil economique, social et environnemental (CESE) sur la santé des femmes en France
Compte rendu de l’audition du mardi 2 décembre 2014
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Madame Hénon, vous êtes ici au titre du Conseil économique, social et environnemental (CESE), pour lequel vous avez fait en 2010 un rapport sur La santé des femmes en France. Ce rapport a attiré notre attention à la veille de l’examen du projet de loi relatif à la santé, adopté en conseil des ministres le 15 octobre 2014, qui devrait venir dans l’hémicycle au premier trimestre 2015 et dont l’ambition est de changer le quotidien des patients et des professionnels de santé, et de faire un système de santé prêt à affronter le XXIe siècle.
Nous souhaiterions connaître les préconisations que vous avez été amenée à faire dans votre rapport, ainsi que les lacunes que vous auriez pu observer dans le projet de loi que nous allons bientôt examiner. Il existe plusieurs travaux sur la santé des femmes, dont votre rapport, sur lesquels nous pensons nous appuyer pour enrichir le projet.
Mme Dominique Hénon, membre du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) d’Île-de-France, ancienne conseillère du CESE et rapporteure de la Délégation aux droits des femmes du CESE sur la santé des femmes. Merci de votre accueil. Je suis ravie de vous présenter les travaux du CESE, auxquels j’ai contribué pendant cinq ans au sein de sa Délégation aux droits des femmes et à l’égalité. À cet égard, je me félicite de la convergence qui existe entre les Délégations aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, du Sénat et du CESE, qui permettent de donner une belle visibilité à ce dossier, et de consacrer le thème de l’égalité dans nos débats de société. Nos travaux se nourrissent les uns des autres, et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Le rapport que je vais vous présenter aujourd’hui a déjà quatre ans et depuis, de nombreuses avancées ont eu lieu. Je tiens à souligner que 2013 a été une année charnière sur un certain nombre de points en termes de prise en charge de la santé des femmes. J’y reviendrai au fil de ma présentation.
En 2010, on pouvait dire que la santé des femmes présentait un portrait contrasté, avec notamment :
– un développement des moyens permettant la maîtrise de la fécondité, mais un taux d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) qui augmente chez les mineures et les jeunes femmes de moins de vingt ans ;
– un taux de survie en augmentation pour les femmes atteintes de cancers du sein, mais une augmentation de cette pathologie, sans explication réellement prouvée à ce jour ;
– une volonté affichée dans le plan national « nutrition et santé » d’informer et de former à de bonnes habitudes alimentaires, mais le développement du surpoids et de l’obésité chez les femmes des catégories sociales les plus défavorisées ;
– une progression de l’entrée des femmes sur le marché du travail, mais dans leur grande majorité, celles-ci occupent des emplois peu qualifiés, à temps partiel, entraînant des inégalités sociales et professionnelles et ayant un impact très négatif sur leur santé ;
– une diminution de l’écart d’espérance de vie entre les deux sexes, signe positif pour les hommes, mais négatif pour les femmes, car en lien avec le développement de comportements à risque ;
– une longévité accrue pour les femmes, mais une situation d’isolement pour la majorité d’entre elles, situation à laquelle elles doivent faire face avec une retraite inférieure à près de 40 % à celle des hommes.
Nous avons organisé nos travaux en nous appuyant sur les différents temps de la vie, en commençant par l’adolescence.
Globalement, l’adolescence est une période de bonne santé, mais non exempte de risques puisque soumise à de nombreux changements sur le plan physique, social et affectif, susceptibles d’induire une consommation de produits psychoactifs. En la matière, le comportement des filles tend à se rapprocher de celui des garçons, qu’il s’agisse de consommation d’alcool ou de cannabis. Par ailleurs, les troubles du comportement alimentaire, qui sont classés parmi les affections psychiatriques, touchent à 90 % les filles. L’anorexie, entre autres, entraîne une forte mortalité, soit par complications, soit par suicide.
C’est à ce moment de la vie que l’on aborde la sexualité et la gestion de la fécondité. Nous avons pointé le fait que le rôle des parents était fondamental dans cette approche, mais que la collaboration avec l’école était primordiale. La circulaire d’application de la loi du 4 juillet 2001, en date du 16 juillet 2003, détaille les modalités de mise en œuvre de l’éducation à la sexualité dans les écoles et les collèges. Cette circulaire est parfaite mais malheureusement, faute de disponibilités ou d’effectifs suffisants, sa mise en pratique est très inégale selon les établissements, les volontés politiques et les endroits où se situent les établissements.
Le manque d’informations ou de connaissances est particulièrement marqué chez les très jeunes femmes en termes d’accès à la contraception, et la non-reconnaissance sociale de la sexualité dans certains milieux rend problématique l’inscription dans une démarche contraceptive.
Nous avons noté que la contraception d’urgence demeurait un recours, dont l’usage était en augmentation sur les cinq précédentes années, mais que cette contraception d’urgence n’avait pas pour autant fait régresser le nombre d’IVG. La prévention des grossesses précoces passe par l’amélioration de l’information et de l’éducation des jeunes filles, au moment où elles commencent leur vie sexuelle, associées à un accès facilité aux moyens de contraception – c’est un thème récurrent.
Nous nous sommes ensuite intéressés à la femme adulte, dont la santé est impactée par des vulnérabilités spécifiques.
Il existe encore des obstacles à une démarche contraceptive sereine. Si 73 % des femmes entre 15 et 54 ans utilisent une méthode contraceptive, la pilule est la plus courante, quel que soit l’âge. Bien qu’au fil du temps une très grande diversification des méthodes de contraception se soit développée, l’état de connaissance de la population et l’information faite auprès des médecins ne suit pas encore l’évolution de l’ensemble des techniques proposées. La disparité dans la prise en charge du remboursement des différentes modes de contraception disponibles constitue un obstacle évident à leur diffusion. On a pu souligner que dans les deux précédentes années, une campagne d’information, largement diffusée sur les murs du métro, avait pu permettre d’ouvrir un peu les esprits sur ce qu’est une bonne contraception.
Si, depuis quelques années, le nombre d’IVG est relativement stable, autour de 14 pour 1 000 femmes, il augmente régulièrement parmi les mineures et les jeunes femmes de moins de vingt ans. Seul un tiers des femmes ayant eu recours à l’IVG en 2007 n’utilisait aucune contraception. A contrario, plus de 60 % d’entre elles en utilisaient – dont 30 % la pilule. Les causes d’échec évoquées sont essentiellement : les oublis, les erreurs, les accidents. Mais on peut comprendre que sur quarante ans d’une vie de gestion de sa contraception, l’oubli d’un comprimé fasse aussi partie de la vie. Et cela doit être envisagé dans l’approche que l’on a sur ce moment de la vie.
Nous avons vu que la plus grande longévité des femmes était tempérée par le développement des comportements à risque : consommation de tabac, d’alcool, qui vient impacter la réduction de l’écart d’espérance de vie entre hommes et femmes. Ces comportements se traduisent par un accroissement du cancer du poumon, des maladies chroniques et des pathologies cardiovasculaires. Une maladie de l’appareil circulatoire reste la première cause de mortalité chez les femmes, avec une particularité : une prise en charge d’urgence moins systématique que chez les hommes, liée à une mauvaise appréciation du risque, en particulier dans les cas d’infarctus, où les symptômes ressentis par les femmes relèvent plus de nausées et de douleurs dans les mâchoires, alors que le symptôme qui apparait plus couramment chez les hommes est la douleur thoracique. Voilà pourquoi le diagnostic d’urgence peut ne pas être posé. En la matière, les mentalités évoluent doucement. Reste qu’un quart des décès féminins prématurés pourrait être évité par une réduction des comportements à risque : tabac, alcool, etc.
À âge, formation et situation identiques, les femmes sont plus sensibles au stress et à la dépression : différentes sources de données mettent en évidence qu’une femme présente 1,5 à 1,8 fois plus de risques qu’un homme de vivre un épisode dépressif. Ces inégalités face à la dépression seraient dues en partie à des conditions économiques et sociales qui exposent davantage les femmes aux troubles dépressifs dans la sphère privée, en particulier les mères de famille monoparentale, ou dans la sphère professionnelle : emplois peu qualifiés, à faible latitude décisionnelle, temps partiel subi. Sans oublier les femmes cadres, à responsabilités, qui doivent gérer une vie professionnelle intense et une vie privée.
Au cours de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, il a bien été mis en avant que les femmes connaissaient un risque accru de subir des violences. Je pense qu’un certain nombre de messages sont vraiment passés, mais on ne peut pas nier le fait qu’en matière de violences, être femme expose, et être femme et jeune surexpose. L’ampleur des violences intrafamiliales est par ailleurs sous-évaluée, leur visibilité se focalisant sur les issues tragiques ; or le quotidien peut aussi être dramatique.
Les liens entre les violences subies et certaines caractéristiques de l’état de santé des victimes sont statistiquement significatifs : angoisse, anxiété, repli sur soi, tentatives de suicide, et ces manifestations sont majorées lorsque le contexte biographique est difficile. Le CESE a d’ailleurs adopté récemment, après cette journée du 25 novembre, un rapport très important contre toutes les violences faites aux femmes.
Enfin, d’autres violences telles que l’excision, les mariages forcés, la traite des êtres humains ou la maltraitance sur personnes âgées ont des effets lourds de conséquences sur la santé des femmes qui les subissent.
Nous avons observé ensuite que les femmes étaient exposées d’une façon particulière aux atteintes à la santé au travail. L’enquête SUMER (surveillance médicale des expositions aux risques professionnels) qui a été menée par des médecins du travail nous montre que 58 % des troubles musculo-squelettiques (TMS) touchent les femmes, notamment dans l’industrie agroalimentaire, la grande distribution et les services aux personnes. L’explication avancée est que les postes de travail qu’elles occupent majoritairement impliquent rapidité, précision, mouvements répétitifs et positions assises prolongées. L’apparition des TMS augmente avec l’âge, ce qui plaide en faveur d’une réflexion sur les conditions de travail soutenables tout au long de la vie – surtout si nous devons être amenés à travailler plus longtemps.
Près d’une femme sur trois est exposée à des tensions au travail, contre un homme sur cinq. Ces écarts sont encore plus importants pour la catégorie des ouvriers et employés. En effet, les femmes sont plus souvent confrontées que les hommes à du harcèlement moral ou sexuel, à des menaces ou à des intimidations de la part de la clientèle ou des usagers. La violence dans l’organisation du travail est également répandue dans de nombreux emplois féminins : surcharges, cadences rapides, manque de formation, changements imprévus d’horaires.
Les conséquences à long terme sur l’état de santé des conditions de travail défavorables demeurent malheureusement peu évaluées, que ce soit en matière de TMS ou d’exposition à des substances nocives, contrairement au Canada où l’on s’est saisi à bras-le-corps de cette problématique et où l’on commence à avoir des idées un peu plus précises sur ce que signifie travailler en bonne santé en étant une femme.
Des chercheuses de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) comme Annette Leclerc et Monique Kaminski ont beaucoup étudié les inégalités sociales au travail. Leurs conclusions et leurs recherches prouvent que travailler dans de bonnes conditions est favorable à la santé. Cela rejoint la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon laquelle la réduction des inégalités sociales passe par l’accès à l’emploi, un bon statut dans l’emploi, un maintien dans l’emploi avec adaptation en cas de problème de santé et une réduction aux expositions aux risques professionnels. Tous les avis convergent pour laisser penser que l’accès à l’emploi est une condition de santé, en particulier pour les femmes.
Nous nous sommes intéressés également aux localisations les plus fréquentes des cancers chez les femmes. Le cancer du sein occupe la première place des causes de mortalité par cancer ; viennent ensuite les cancers du côlon et du rectum et, en troisième position, le cancer du poumon. Depuis 1980, chez les femmes, l’incidence des cancers augmente, mais la mortalité diminue. La moitié des cas supplémentaires de cancers détectés chez les femmes depuis trente ans sont des cancers du sein, notamment chez les jeunes femmes de moins de 45 ans, sans explication à ce jour.
J’attire votre attention sur les travaux de recherche qui ont prouvé que cancer du sein et travail de nuit pouvaient être liés. En 2007, le Danemark s’est saisi de cette question au travers des travaux du CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) et a reconnu le cancer du sein comme maladie professionnelle. En France, des études ont émergé en 2012. Vous les retrouverez dans la revue « Travail et changement » de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) où l’on commence à travailler sur cet aspect qui me semble très important dans la mesure où le travail de nuit augmente, particulièrement chez les femmes. Et si le travail de nuit génère des symptômes et des pathologies chez les femmes, il n’y a pas de raison qu’il ne génère pas autre chose chez les hommes. Le travail de nuit mérite donc d’être étudié sous l’angle de la santé.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La question a été soulevée en 2010, à l’occasion de la dernière réforme sur la retraite. Je m’étais alors inspirée d’une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) portant sur les cancers du sein chez les infirmières et les hôtesses de l’air.
Mme Dominique Hénon. Je crois qu’il faut vraiment creuser cette question, à laquelle je me suis intéressée en tant que syndicaliste. Mais comment faire la preuve du lien entre travail de nuit et cancer du sein, en l’absence de travaux précis ?
Par ailleurs, ce moment de la vie s’accompagne, pour certaines, d’une évolution du surpoids et de l’obésité. La progression de l’obésité en France est devenue une priorité de santé publique. En France, 41 % des femmes âgées de 18 à 74 ans sont en situation de surpoids et d’obésité, avec une obésité sévère touchant davantage les femmes que les hommes, et une surreprésentation dans les populations dont le niveau de formation initiale est moindre. Si le surpoids touche toutes les catégories, il reste, d’une manière générale, inversement proportionnel au niveau d’instruction. Les disparités sociales sont plus marquées chez les femmes touchées par l’obésité que chez les hommes. Le diabète est fréquemment associé à l’obésité, avec toutes les conséquences que l’on connaît en termes de prise en charge lourde et d’incapacités. L’obésité peut même affecter la situation sociale des adultes – difficulté d’accès ou de maintien dans l’emploi, stagnation professionnelle, stigmatisation.
Nous avons observé également les maladies chroniques, qui ont un retentissement sur le bien vieillir. Les pathologies cardiovasculaires arrivent en tête, avec le développement du cholestérol, de l’hypertension, le dépôt de plaques d’athéromes qui peuvent entraîner des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Or les femmes sont les plus touchées par les pathologies cardiovasculaires. L’ostéoporose nous est apparue également comme une problématique à regarder de plus près, puisque, compte tenu de la sensibilité particulière des femmes à cette affection, des dépistages plus systématiques devraient être organisés à partir de la ménopause, afin d’éviter des fractures.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous l’avions demandé au moment de l’examen de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, mais en vain.
Mme Dominique Hénon. Cet examen n’est pas encore passé dans les mœurs. Il faut dire qu’il est cher et que pour qu’il soit pris en charge par la sécurité sociale, les médecins ont beaucoup de cases à remplir !
Nous avons regardé ensuite la longévité, et la diminution de l’écart de vie en bonne santé entre les femmes et les hommes. En France, l’espérance de vie à la naissance des femmes, qui était en 2012 de 84,8 ans, est l’une des plus élevées au monde. Elle est sensiblement supérieure à celle des hommes, qui était, cette même année, de 78,4 ans. En revanche, l’écart d’espérance de vie en bonne santé se réduit, en raison des comportements à risque. Les hommes y gagnent, et les femmes y perdent.
Les motifs d’une espérance de vie plus élevée chez les femmes font débat. Est-ce que ce sont des raisons biologiques, des comportements plus favorables à la santé, un rapport plus favorable à la médecine ? Le CESE a constaté au fil de ses travaux que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer consulter un médecin. Elles recourent davantage aux examens de prévention, en particulier ceux qui leur sont spécifiques. Les périodes liées à la fécondité sont enfin l’occasion de bilans de santé. Mais les hommes, en adoptant peu à peu des comportements plus favorables à leur santé comblent progressivement l’écart d’espérance de vie.
Au vu des tendances sociodémographiques actuelles, le vieillissement de la population devrait s’accentuer, et cette progression devrait connaître un pic d’ici à 2030. En 2050, un Français sur trois sera âgé de soixante ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. Ces perspectives attirent l’attention sur un phénomène majeur des prochaines décennies et sur les politiques de prévention permettant le bien vieillir, c’est-à-dire en meilleure santé possible.
Pour les gérontologues, le processus de vieillissement est hétérogène et s’il n’est pas possible d’influencer les facteurs génétiques, il est par contre possible de modifier les facteurs d’environnement tels que les facteurs socioéconomiques, ainsi que les progrès de la médecine de prévention et l’accès aux soins.
Les femmes sont particulièrement vulnérables aux maladies cardiovasculaires. La prévalence augmente avec l’âge et si cette pathologie est traitée, on diminue de 40 % l’incidence des accidents vasculaires cérébraux, cause importante de décès et de dépendance, dont le coût social et humain est très lourd.
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont les maladies les plus fréquentes de dépendance. Nous avons auditionné le professeur Françoise Forette, qui est directrice de la Fondation nationale de gérontologie. À cette occasion, celle-ci a souligné que le taux global de dépendance était en fait peu élevé : 7 % de la population totale de plus de soixante ans. Cela veut dire que 93 % de cette population est autonome. Cette approche méritait d’être soulignée. En revanche, la prévalence de la maladie d’Alzheimer augmente après 80 ans, et touche davantage les femmes que les hommes – avec un écart de l’ordre de deux tiers/un tiers. Mais comme les femmes vivent plus longtemps, on recense un nombre de femmes plus important.
Nous sommes sortis du déroulement de la vie des femmes pour regarder plus précisément la représentation des femmes dans la recherche médicale et les essais cliniques. Nous nous sommes rendus compte que celles-ci étaient largement sous-représentées dans la recherche médicale, et que les différences biologiques entre hommes et femmes avaient une incidence sur l’action des traitements et les prises en charge. À titre d’exemple, au regard des différences de poids moyen entre les deux sexes, un traitement pré-dosé pourrait être excessif pour une femme au vu de la surreprésentation des hommes dans les cohortes sollicitées pour réaliser un essai clinique.
Cette exclusion des femmes des essais thérapeutiques a sans doute été dictée par le souci de les protéger dès lors qu’elles pourraient ignorer un début de grossesse. C’est en tout cas la politique qui a été avancée par la Food and Drug Administration (FDA) dans les années soixante-dix pour les exclure des essais de phase I. Mais en fait, la pratique s’est étendue, et l’on a sorti les femmes des essais cliniques.
Une étude, qui a fait l’objet d’une communication lors d’un congrès sur la santé cardiovasculaire en 2008, faisait état d’une sous-représentation marquée dans les populations sollicitées, alors que les femmes constituent 53 % des patients atteints par ces pathologies cardiovasculaires. Par ailleurs, une étude sur la prise en charge de l’infarctus, réalisée en Franche-Comté, a montré que le manque d’évaluation des traitements appliqués aux femmes pouvait avoir des conséquences dramatiques en matière de mortalité, d’autant que les symptômes de la même pathologie peuvent être différents de ceux des hommes. Et pour les médecins qui ont mené cette étude, il convient de réfléchir à une surveillance et à des traitements plus spécifiques chez les femmes en formant les médecins à la prise en charge correspondante. Il a ainsi précisé que le stent, le petit ressort métallique destiné à maintenir une artère ouverte, fonctionne parfaitement chez une femme mais demande un geste particulier, car les artères des femmes sont plus fines et sinueuses.
Selon un article tout à fait récent rédigé par un cardiologue, les crises cardiaques augmentent chez les femmes, mais les hommes restent les principales cibles des messages de prévention. Et le professeur Simon, chef du service de prévention cardiovasculaire de l’hôpital européen Georges Pompidou, souligne que la proportion des femmes dans les essais cliniques n’est que de 30 % en moyenne. Plusieurs pistes commencent à se dégager, pour réintroduire une représentation plus fidèle à la population, et en particulier aux besoins spécifiques des femmes.
Nous avons également étudié le renoncement aux soins, qui devient de plus en plus fréquent par manque de temps ou d’argent, et qui apparaît plus élevé chez les femmes : 16,5 % de femmes renoncent aux soins, quand les hommes y renoncent à hauteur de 11,7 %. Les soins les moins bien remboursés par l’assurance maladie sont à l’origine de la majorité des renoncements : les soins bucco-dentaires, l’optique et tout ce qui nécessite une avance de frais.
Ce renoncement concerne aussi le recours aux examens de dépistage et de prévention. Ainsi, parmi les femmes de quarante ans ou plus appartenant à des ménages modestes, 34 % n’ont jamais réalisé de mammographie, contre 19 % des autres femmes dans la même tranche d’âge. Il en est de même pour le frottis permettant de dépister le cancer du col de l’utérus : 12 % des femmes disposant de faibles ressources, âgées de 20 à 70 ans, n’en ont jamais réalisé. C’est deux fois plus que dans le reste de la population, ce qui a fait dire au corps médical que le cancer de l’utérus était le cancer de la femme pauvre. J’ai trouvé cela dramatique. En revanche, je tiens à saluer l’avancée qui consiste à prendre en charge à 100 % tous les trois ans le dépistage du cancer de l’utérus. Il s’agit d’une mesure récente, adoptée en 2013.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Le projet de loi prévoit que le tiers payant s’appliquera à tout le monde. Cela provoque une opposition chez certains praticiens, mais je pense que cela constitue une amélioration pour les personnes aux revenus modestes. Par ailleurs, cela devrait permettre de désengorger l’hôpital.
Mme Dominique Hénon. Après avoir fait ces constats, nous avons dégagé des préconisations.
Nous sommes revenus sur l’adolescence. Nous pensons que pour les filles, l’éducation à la santé est aussi un facteur d’émancipation, et que les moyens dédiés aux services de médecine scolaire doivent être renforcés afin d’aider infirmières et personnels éducatifs à repérer en amont les signes de mal être physique et psychique, ce qui permettrait de cibler les bilans effectués par les médecins sur les élèves en difficulté. Il convient de réorganiser et de soutenir les infirmières scolaires qui pour nous sont au cœur d’un dispositif de soutien de la jeunesse. Il semble que le projet de loi s’en préoccupe.
Mme Édith Gueugneau. On manque cruellement d’infirmières dans les établissements scolaires.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Aujourd’hui, 100 postes de médecins scolaires ne sont pas pourvus, alors même que 10 postes supplémentaires devraient encore être créés. Je pense que l’on devrait s’interroger sur la raison de ce manque d’attractivité.
Mme Dominique Hénon. Je crois que vous posez le problème de la bonne façon.
Il nous est apparu que pendant l’adolescence, la prévention du surpoids était essentielle, et que la promotion de la santé alimentaire passait par l’amélioration du repérage du rebond d’adiposité précoce. En effet, l’indice de masse corporelle (IMC) ne doit pas varier entre la marche et six ans et s’il augmente, il est prédictif d’une situation d’obésité ou de surpoids à l’âge adulte. D’où l’intérêt d’une meilleure coordination entre les services de la protection maternelle infantile (PMI), la médecine scolaire et le médecin généraliste. Cette meilleure coordination me semble être assurée dans le projet de loi.
Mme Édith Gueugneau. N’oublions pas la restauration scolaire, qui doit offrir des menus équilibrés.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Quand il n’y a pas de frites, les trois quarts de la nourriture sont jetés !
Mme Dominique Hénon. D’où l’intérêt de passer par le jeu et des ateliers d’alimentation, qui rendent ludique l’approche des légumes. C’était notre deuxième préconisation.
Il nous est aussi apparu que le développement, dans le cursus, d’activités sportives non sexuées – c’est-à-dire proposées systématiquement aux deux sexes – et suffisamment diversifiées ne pouvait que renforcer la prévention de l’obésité et amener les jeunes à prendre goût et plaisir à une activité physique soutenue. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes comporte des dispositions concernant la féminisation des instances dirigeantes des fédérations sportives. Maintenant, il faut que le phénomène « redescende » et que les activités sportives soient proposées aux deux sexes.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Selon une étude, les professeurs de gymnastique solliciteraient beaucoup moins les filles que les garçons, quand ils ne les laissent pas de côté. En un mot, on ne force pas trop les filles à faire du sport.
Mme Dominique Hénon. Nous avons pensé aussi que la prévention des conduites à risque s’imposait, ce qui suppose que l’on rende effectif le contrôle de l’interdiction des ventes d’alcool et tabac aux mineurs.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Il y a de très nombreux contrôles dans les grandes surfaces.
Mme Dominique Hénon. Votre remarque est intéressante. Je n’en étais pas persuadée moi-même.
Cela suppose que l’on renforce l’information sur les risques physiques, psychiques et de désocialisation induits par la consommation de produits stupéfiants, et que l’on mette en place des programmes d’aide pour les parents. En outre, à l’occasion de notre enquête, nous avons constaté que les jeunes avaient rarement conscience que la consommation de cannabis était interdite par la loi.
En dernier lieu, il conviendrait de mettre en place une véritable politique d’éducation à la sexualité. L’application de la circulaire que j’évoquais devrait être effective.
S’agissant de la maîtrise de la sexualité et de la fécondité, nous sommes revenus sur des préconisations qui passaient par la facilitation de l’accès aux méthodes contraceptives pour les jeunes filles. Nous avons remarqué que certains hôpitaux s’étaient dotés de structures du type « Info Ados » qui passaient par un numéro de téléphone et qui permettaient aux jeunes de s’informer anonymement. De leur côté, certaines régions se sont dotées d’un « Pass contraception ».
Mme Catherine Quéré, corapporteure. La région Poitou-Charentes a été la première à le faire.
Mme Dominique Hénon. Malheureusement, ce dispositif est inégalement développé selon les territoires.
Il faudrait ensuite renforcer les missions des services de médecine préventive universitaire et accélérer leur transformation en centres de santé. La situation de nos jeunes étudiants et étudiantes en matière de santé est dramatique, surtout pour les filles. Ce dispositif tarde à se mettre en place. Les raisons en sont sans doute économiques, mais les conséquences sociales sur la vie de nos futurs professionnels sont énormes.
Il faudrait enfin développer la formation des professionnels de santé sur l’ensemble des moyens contraceptifs et en améliorer la prise en charge. La formation des médecins, qui bénéficient maintenant d’une formation continue, mériterait d’être revue en ce domaine.
Bien sûr, nous souhaitons que l’on conforte l’exercice du droit à l’IVG et que l’on veille à son accompagnement. Cette intervention doit être pratiquée dans la sécurité et la dignité, ce qui est encore discutable dans les services dont l’éthique n’impose pas une approche médicale protégeant la santé de la femme.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Le problème vient aussi de ce que depuis l’instauration de la tarification à l’activité (T2A), l’IVG ne rapporte rien aux hôpitaux.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Grâce à Mme Marisol Touraine, l’IVG est prise en charge à 100 % et le tarif payé aux hôpitaux et cliniques lorsqu’ils pratiquent une IVG a été revalorisé et correspond à celui prévu pour une fausse couche. Ce dispositif a été mis en place en 2013.
Mme Dominique Hénon. La revalorisation de l’acte a permis de réinscrire officiellement l’activité d’IVG dans les groupements hospitaliers. À l’hôpital Tenon, où de grands mouvements avaient suivi la fermeture du centre d’IVG, trois lits sont maintenant disponibles, avec deux infirmières et deux aides-soignantes pour prendre l’activité en charge.
Il faudrait donc intégrer l’IVG dans l’offre de soins en l’inscrivant dans le plan national stratégique et dans le projet régional de santé comme une activité médicale à part entière.
J’en viens aux actions visant à promouvoir pour améliorer la santé des femmes au travail.
Il nous a semblé important, au vu de la forte prévalence des troubles musculo-squelettiques, d’imposer la prise en compte du genre dans la définition des normes ergonomiques, ainsi que le développement de recherches sur le travail féminin.
L’existence d’outils expérimentaux facilite la traçabilité d’exposition aux risques. Des mutuelles ont pris des initiatives en ce sens. Par exemple, la femme peut prendre l’habitude de noter sur un petit carnet qu’elle est exposée à tel risque, pendant tant de temps, sur tel poste. En effet, l’obligation de faire des fiches d’exposition professionnelle est loin d’être remplie dans tous les établissements, pas plus que dans les fonctions publiques. Certaines mutuelles incitent donc les femmes à prendre en charge la traçabilité des risques auxquels elles sont exposées : bruit, changements horaires, stress, produits chimiques, etc.
Pour nous, le rapport de situation comparée devrait être enrichi d’indicateurs renseignant sur les liens existant entre les emplois occupés par les femmes et les hommes, et leur état de santé. Le document unique d’évaluation des risques (DUER) devrait être renseigné par genre, et devrait permettre au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de s’intéresser plus particulièrement au travail féminin dans l’entreprise. Enfin, l’accord interprofessionnel du 26 mars 2010 sur la prévention du harcèlement et des violences au travail, dont tout un chapitre concerne les femmes, devrait être décliné le plus largement possible dans les entreprises et les fonctions publiques.
Nous avons bien sûr souhaité que l’on renforce la prise en charge médicale des femmes victimes de violences. Il conviendrait de mieux sensibiliser les professionnels de santé en intégrant cette problématique dans les modules obligatoires de formation et en diffusant largement les guides pratiques élaborés sur le sujet. Mais au-delà, deux moments clé de contact avec le système de santé devraient être mis à profit pour repérer et prendre en charge les victimes : le suivi des grossesses et le premier accueil dans un service hospitalier lié à des situations laissant présager des violences. On sait bien que si la femme n’est pas questionnée, elle ne viendra pas systématiquement déclarer qu’elle est victime de violences. Tout cela passe par un système de formation.
Pour favoriser un vieillissement en bonne santé, il faudrait rendre opérationnelle la « consultation médicale de longévité » lors du départ en retraite, prévue dans le plan national « Bien vieillir 2007-2009 ». Cette consultation, qui a du mal à s’imposer, vise à repérer les fragilités qui viendront impacter la vie de la personne après soixante ans. Et au vu de ce diagnostic, elle met en place des mesures de correction. Cela passe par un accueil avec un médecin gériatre, un éducateur sportif, un nutritionniste. L’objectif de cette consultation est mettre en place des bonnes pratiques, et d’accompagner cette rupture majeure que constitue la retraite.
Il faut aussi, on l’a déjà dit, mettre en place une surveillance et des traitements plus spécifiques pour les femmes souffrant de pathologies cardiovasculaires car elles en sont les premières victimes devant les hommes, améliorer le dépistage de l’ostéoporose et encourager le recours aux consultations mémoire.
Répondre aux besoins du grand âge nécessite également de promouvoir un environnement facilitant le maintien à domicile. Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, où cette dimension était très présente, a permis de faire progresser cette idée. Mais bien sûr, il conviendra de s’assurer des financements que suppose la mise en œuvre de la loi.
Il faut enfin soutenir les aidants familiaux qui sont majoritairement des femmes, développer les situations qui entretiennent le lien social et privilégier des maisons de retraite médicalisées intégrées dans les quartiers et favorisant les solidarités.
Voilà ce que nous avons été amenés à repérer et à préconiser au sein de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du CESE. C’est un dossier que nous avons porté avec passion.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Merci de ces propos qui étaient fort intéressants. Nous ne referons pas ce travail, mais nous alimenterons notre réflexion par vos remarques pour apporter à la loi des éléments qui n’y sont pas pour l’instant. Nous en discuterons avec le ministère.
J’observe que lors de la précédente législature, Mme Valérie Boyer avait déposé une proposition de loi concernant les sites qui pouvaient encourager l’anorexie ; elle n’avait pas été votée. Ce projet de loi évoque l’obésité, mais pas l’anorexie, qui touche à 90 % les jeunes filles. Je pense moi aussi que l’infirmière scolaire, qui est à même de s’apercevoir du changement d’apparence des jeunes filles, a un rôle prépondérant à jouer dans la lutte contre cette maladie.
Mme Édith Gueugneau. Je voulais évoquer, parmi la vingtaine de grandes orientations de ce projet de loi, la mise en œuvre du plan « tabac » : le taux de mortalité des pathologies liées au tabagisme diminue pour les hommes et augmente pour les femmes. Avez-vous des préconisations particulières à nous faire en la matière ?
Ensuite, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, le texte prévoit la création d’un numéro d’appel pour joindre un médecin à toute heure. Comment, selon vous, ce dispositif pourrait-il venir compléter les outils déjà existants ? Il me semble par ailleurs que vous n’avez pas suffisamment souligné les violences intrafamiliales, qui sont très importantes.
Enfin, dans le milieu rural, d’où je viens, la précarité est encore plus importante. Comment y remédier ? De très nombreuses femmes renoncent aux soins ou échappent aux campagnes de prévention, ce serait-ce que parce qu’elles ne peuvent pas se déplacer. Avez-vous des préconisations à faire ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je voudrais savoir ce que vous pensez des paquets neutres. Nous serions les seuls en Europe à adopter cette mesure. Seule l’Australie l’a prise. Les professionnels du tabac nous ont dit que ce serait contreproductif. Je n’ai pas d’avis sur la question. A-t-on établi le caractère dissuasif d’une telle mesure ? N’oublions pas que l’augmentation du prix du tabac a eu pour effet de développer la contrebande. C’est ainsi, par exemple, que des cars entiers partent vers l’Espagne et reviennent chez nous pour 30 euros. La dépense est vite amortie.
Mme Dominique Hénon. Je n’ai pas lu d’études sur le paquet neutre, mais vous soulevez une question qui mérite d’être étudiée. Je vais y regarder de plus près, même si, personnellement, je suis pour l’éradication de la consommation de tabac et le développement de la capacité de prescrire des substituts nicotiniques. Le projet de loi prévoit que le médecin du travail comme les sages-femmes pourront prescrire ces substituts, et cela constitue selon moi un progrès.
Ensuite, nous sommes favorables à tout ce que l’on pourra mettre à la disposition des femmes victimes de violence. Le numéro d’appel a, entre autres, l’avantage de gommer les disparités existant entre les milieux ruraux et urbains. À Paris, des commissariats entiers sont sensibilisés à cette problématique et des lieux d’accueil sont mis en place. Mais en milieu rural, d’autres solutions doivent être envisagées, et ce numéro peut en être une.
Vous évoquez fort justement la précarité en milieu rural, où le déficit en médecins est par ailleurs très marqué. Le projet de loi propose d’étendre la capacité des personnels paramédicaux à poser des diagnostics et à agir. Je pense que dans ces milieux ruraux, le fait de favoriser la prise en charge de la santé sur un champ plus large devrait permettre de rendre le discours de santé plus accessible aux femmes éloignées des centres. Une infirmière libérale peut tout à fait orienter ou dédramatiser, ou conseiller, ou inciter. Le glissement de la fonction médicale qui semble se dessiner – comme cela s’est produit dans certains pays anglo-saxons – va dans le bon sens au vu du déficit de médecins actuellement à disposition sur le territoire français. Cela permettrait aussi de revaloriser ces métiers et de permettre aux personnels paramédicaux, moyennant une formation, de jouer un rôle important, en particulier dans les régions moins bien dotées que d’autres.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Le regroupement des professionnels de santé se développe et les maisons de santé se multiplient. Dans ma circonscription, une sage-femme s’est installée à 30 kilomètres de la ville où se trouve le centre hospitalo-universitaire (CHU). Cela représente une nette amélioration pour les femmes pendant leur grossesse et juste après leur accouchement. Cela leur évite 60 kilomètres pour une visite au CHU. Cela leur apporte un certain confort et elles bénéficient d’un meilleur suivi.
Une telle solution serait d’autant plus adaptée qu’il semblerait que l’on envisage de raccourcir la durée des séjours en maternité à une ou deux journées après l’accouchement. Or ce ne serait possible, selon moi, que si les femmes sont bien entourées à leur retour à domicile.
Mme Dominique Hénon. Déjà, dans le milieu hospitalier, on trouvait qu’un séjour de deux jours et demi était vraiment très court, surtout lorsqu’il y a d’autres enfants à la maison. Pour ma part, je pense qu’une telle réduction ne serait pas raisonnable, mais que si elle était adoptée, elle devrait effectivement s’accompagner d’un renforcement du rôle de la sage-femme. Cela deviendra évident.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. J’ai eu l’occasion de discuter, au niveau local, de la distinction existant entre une maison de santé et un centre de santé. Dans une maison de santé, les médecins s’installent ensemble ; ils peuvent être aidés par les collectivités qui, par exemple, mettent à leur disposition des locaux qu’ils leur louent ; cela reste de la médecine libérale, regroupée et organisée. Dans les centres de santé, qui sont l’équivalent des anciens dispensaires, les médecins, salariés, sont rémunérés de la même façon quel que soit le nombre d’actes qu’ils dispensent, et les patients ne paient rien. Ces centres sont d’un accès plus facile et les visites durent plus longtemps. Ils constituent un progrès dans les quartiers difficiles et dans les zones avec universités. Sans doute conviendrait-il de transformer les services de médecine universitaire en centres de santé. Avez-vous étudié la question ?
Mme Dominique Hénon. Non, mais c’est effectivement un bon sujet d’étude.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Merci d’avoir présenté votre rapport, qui était fort intéressant. Nous allons nous en inspirer et creuser un certain nombre de pistes. Comme vous l’avez dit, nos trois délégations font ensemble du bon travail. Récemment, j’ai été auditionnée, avec la Délégation du Sénat, par une commission du CESE. Et nous continuerons bien sûr à échanger sur nos travaux, pour nous appuyer les unes sur les autres.
Audition de Mme Nathalie Bajos, socio-démographe, directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), responsable de l’équipe « Genre, santé sexuelle et reproductive » de l’INSERM-INED (Institut national des études démographiques)
Compte rendu de l’audition du 10 décembre 2014
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Madame Bajos, vous avez rendu plusieurs rapports sur la santé des femmes et écrit de nombreux articles sur la contraception. Vous êtes coauteur d’un rapport du Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCEFH) relatif à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Nous souhaitons vous entendre sur le projet de loi relatif à la santé, qui sera examiné par l’Assemblée au premier semestre 2015. Il ne s’agit pas pour nous de faire un rapport sur toutes les questions relatives à la santé des femmes, nous souhaitons savoir de quelle manière nous pourrions enrichir le projet de loi, qui comporte deux dispositions sur la santé sexuelle et reproductive : l’accès à la contraception d’urgence des élèves du second degré auprès de l’infirmerie scolaire, et la possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG médicamenteuses. Nous aimerions par ailleurs améliorer le texte sur le plan de la prévention. Nous voudrions également vous entendre sur le sujet de la santé sexuelle et reproductive.
Mme Nathalie Bajos, socio-démographe, directrice de recherche à l’INSERM, responsable de l’équipe « Genre, santé sexuelle et reproductive ». Je vous remercie de me permettre de faire entendre la voix de la recherche sur ce sujet. Dans un premier temps, j’aborderai les enjeux contemporains en matière de santé sexuelle et reproductive, en me focalisant sur les questions de contraception et de recours à l’interruption volontaire de grossesse. En qualité notamment de présidente de la commission santé publique et science de l’homme de l’Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS), je suis en effet très impliquée dans les recherches sur la sexualité et la prévention du VIH. Dans un second temps, je ferai quelques remarques à propos du projet de loi relatif à la santé, sur lequel je me suis penchée.
Les recherches dont je vais vous parler sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) – INED (Institut national des études démographiques) comprenant des sociologues, des démographes, mais aussi des médecins, des épidémiologistes et des économistes. Le travail de cette équipe, que je dirige, s’inscrit ainsi dans une perspective de santé publique, en s’appuyant sur une problématique générale de réduction des inégalités sociales, tout en privilégiant une approche en termes de genre.
S’agissant de la contraception, la situation a changé récemment en raison de ce que l’on a appelé « la crise de la pilule », c’est-à-dire de la controverse importante fin 2012, début 2013, à propos des pilules de troisième et quatrième générations. À la demande de Mme Touraine, nous avons effectué une recherche visant à mesurer l’impact de cette crise, ce qui nous a permis de constater la résurgence d’inégalités sociales marquées en matière d’accès à la contraception.
En effet, depuis sa légalisation, la contraception a connu une diffusion croissante et régulière des méthodes les plus efficaces – pilule, stérilet. En revanche, à partir de l’année 2000, nous avons constaté une baisse du recours à la pilule globalement compensée par l’adoption d’autres méthodes de contraception hormonale – implant, patch, anneau vaginal, tout aussi efficaces que la pilule, voire plus –, hormis chez les jeunes femmes en situation socio-économique difficile, qui se sont ainsi retrouvées avec une couverture contraceptive moins efficace. Ainsi, cette baisse du recours à la pilule ne fait que traduire les effets de la crise économique.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Pourquoi en 2000 ? La croissance a été plus forte en France à cette époque-là. L’étude américaine dont les résultats ont montré une augmentation du cancer du sein chez les femmes sous pilule a-t-elle eu une incidence sur le recours à cette méthode contraceptive ?
Mme Nathalie Bajos. La baisse du recours à la pilule dans les années 2000 a touché essentiellement les personnes âgées de 20 à 24 ans, en particulier les jeunes femmes qui ne vivent plus chez leurs parents et qui connaissent une situation sociale et financière difficile. Au demeurant, le taux de chômage féminin pour cette classe d’âge a crû de manière continue et beaucoup plus importante que chez les femmes plus âgées.
À la fin de l’année 2012 et au début de l’année 2013, cette baisse s’est accentuée très nettement en raison du débat médiatique et politique autour de la pilule. Comme l’a montré une thèse réalisée par une de mes doctorantes, cette problématique était abordée dans les médias tous les jours durant cette période.
Cette crise a provoqué, non pas un recul de la contraception d’une manière générale, puisque la proportion de femmes ayant recours à la contraception reste stable, mais une modification des pratiques contraceptives. En effet, plus d’une femme sur cinq déclare avoir modifié sa contraception en raison des événements médiatiques et politiques, les transferts vers de nouvelles méthodes s’étant opérés de manière très différenciée selon le milieu social. Les femmes issues des milieux sociaux les plus favorisées ont opté soit pour des pilules de deuxième génération, soit pour des méthodes très efficaces comme le stérilet ou d’autres méthodes hormonales, tandis que les femmes issues d’un milieu social moins favorisé se sont tournées vers des méthodes dont l’efficacité est beaucoup moins importante, en particulier les méthodes dites « naturelles ». Ainsi, le recours aux méthodes contraceptives est aujourd’hui marqué par des déterminants socio-économiques, alors qu’une forte homogénéisation sociale était à l’œuvre auparavant. Ce transfert vers d’autres méthodes est d’autant plus marqué que les femmes disposent de faibles ressources, celles en situation précaire étant plus nombreuses à arrêter la pilule.
Il faut en outre noter un phénomène générationnel important : toutes les femmes concernées par la contraception à partir des années 2000 ont commencé leur vie sexuelle à l’ère de la « pilule facile », à l’inverse de celles qui se sont battues pour l’accès à la contraception. Ce faisant, la conscience de l’enjeu de liberté que représente l’accès à la contraception a disparu chez les générations les plus récentes.
Les contraintes de la pilule ont toujours existé, y compris pour les générations pionnières qui se sont interrogées sur ses effets secondaires et son lien présumé avec certains cancers, mais elles ont été reléguées au second plan au regard de l’apport extraordinaire que représentait l’accès à une contraception féminine. Françoise Héritier, collègue qui m’est très chère et femme remarquable, a qualifié la contraception médicalisée de révolution dans la mesure où elle a permis aux femmes, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, de maîtriser leur maternité.
En résumé, la situation actuelle se caractérise, d’un côté, par les effets de la crise économique, de l’autre, par des enjeux normatifs où les contraintes prennent le dessus sur l’enjeu de liberté. Si la crise a eu autant d’effets en France, c’est parce qu’elle est arrivée sur un terreau propice à des modifications du modèle contraceptif.
En termes de santé publique, le coût de la contraception et la formation des professionnels sont deux enjeux majeurs.
Ce n’est pas tant le prix des méthodes contraceptives que l’avance du prix d’une consultation qui peut représenter un frein à la démarche d’entrée dans la contraception. Les femmes se sont détournées, non pas de la démarche contraceptive, mais de certaines méthodes de contraception. Cette situation renvoie à la question de la gratuité.
Les jeunes utilisent le préservatif au commencement de leur sexualité – méthode préconisée pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles (IST), en particulier le VIH. Grâce à l’augmentation en quelques années du recours au préservatif lors du premier rapport sexuel et dans les premières phases de la vie sexuelle, cette méthode a donné des résultats spectaculaires en matière de santé publique. Les jeunes femmes et les jeunes hommes ont donc parfaitement intégré le message préventif, le préservatif étant utilisé, y compris comme méthode de contraception, par un grand nombre d’entre eux. Or l’achat de préservatifs pèse très lourd dans le budget d’un adolescent ou d’un jeune adulte, ce qui peut faire obstacle à une contraception régulière. Cette difficulté est accentuée par le fait qu’un certain nombre de jeunes, quelle que soit leur configuration familiale, ne souhaitent pas parler de sexualité – et donc de contraception – avec leurs parents. D’où, là encore, la question de la gratuité, à laquelle s’ajoute celle de la confidentialité. Les jeunes ont le plus souvent une activité sexuelle sur de courtes périodes, mais de façon intense. Au cours des enquêtes, ils nous disent utiliser le préservatif, mais ajoutent ne pas toujours en avoir parce que cela coûte cher.
La formation des professionnels de santé – médecins, sages-femmes, infirmières scolaires – est également un enjeu crucial. En effet, des campagnes pour la contraception ont été lancées récemment, mais malheureusement toujours à destination des femmes, les hommes étant oubliés. Ensuite, la formation des futurs médecins généralistes en matière de contraception et d’avortement est très insuffisante – elle se limite à quelques heures le plus souvent. Or 15 % des femmes sont suivies par un généraliste pour les questions de santé reproductive : elles appartiennent aux milieux populaires, celles issues de milieux favorisés consultant un gynécologue. Enfin, cette formation est souvent assurée dans des colloques par l’intermédiaire de soutiens de l’industrie pharmaceutique. On peut donc parler d’un marché de la contraception, et il est d’autant plus important que des millions de femmes sont concernées par la contraception, 98 % ayant des rapports hétérosexuels.
Dans ce contexte, les femmes françaises ne se voient pas proposer les méthodes de contraception dans toute leur diversité lors d’une consultation, contrairement aux femmes britanniques par exemple. Comme le montre la thèse d’une de mes étudiantes comparant notre système à celui de la Grande-Bretagne, le professionnel britannique présente à ses patientes la palette des méthodes contraceptives et leur explique l’efficacité de chacune d’entre elles, ce qui permet aux femmes de choisir la mieux adaptée à leur vie affective, sexuelle et sociale.
J’insiste sur la formation des médecins car, depuis dix ans, des rapports officiels remis à des membres du gouvernement mettent l’accent sur les dangers psychiques de l’IVG, notamment un rapport sur la sexualité des adolescents, remis récemment par des professionnels de la santé à Mme Bougrab, selon lequel l’IVG engendrerait des troubles psychiques, et le taux de suicide chez les jeunes femmes y ayant recours serait quatre fois plus élevé que pour celles n’y ayant pas recours. Or la littérature internationale est formelle sur ce point : le recours à l’IVG n’est en aucun cas à l’origine de troubles psychiques, mais les femmes souffrant de troubles psychiques y ont recours plus souvent.
Je voudrais maintenant aborder deux points très importants à mes yeux : le paradoxe de la stabilité du recours à l’IVG, d’une part, et la stigmatisation persistante du droit de recours à l’IVG en France, d’autre part.
Je vous indique d’abord que le bon indicateur pour évaluer l’efficacité d’une politique de contraception n’est pas le taux d’IVG, mais le nombre de grossesses non prévues. De nos jours, les grossesses non prévues sont de moins en moins nombreuses, car les échecs de contraception sont en diminution grâce à la diffusion de la contraception efficace. Dans le même temps, la probabilité de recourir à l’IVG augmente en cas de grossesse non prévue. Statistiquement, ces deux tendances s’annulent puisque, d’un côté, moins de femmes ont une grossesse non prévue, et, de l’autre, en cas de grossesse non prévue, elles l’interrompent plus souvent. Or la probabilité d’interrompre une grossesse non prévue n’a cessé d’augmenter au fil du temps à la faveur de ce que les démographes appellent la « jeunesse sexuelle ».
En effet, si l’âge médian du premier rapport sexuel est relativement stable depuis trente ans – il se situe à 17,2 ans pour les garçons et à 17,6 ans pour les filles –, l’âge du premier enfant a quant à lui reculé. Par rapport aux années 70, quatre années supplémentaires séparent aujourd’hui le premier rapport sexuel du premier enfant, cette période de jeunesse sexuelle étant caractérisée par la fréquence des rapports sexuels et une grande fertilité chez les femmes. De surcroît, grâce à l’évolution de la scolarité féminine, l’entrée massive des femmes sur le marché du travail, mais aussi la contraception et l’avortement, la vie sexuelle des femmes s’est fortement diversifiée. En 1972, plus de 60 % d’entre elles avaient leur premier rapport sexuel avec leur futur mari ; elles ne sont plus que quelques pour cent dans ce cas aujourd’hui. De la même manière, si une femme de vingt-trois ans avait auparavant de fortes chances de prolonger sa grossesse, cela n’est plus vrai aujourd’hui où la norme sociale de la maternité est un premier enfant pas trop tôt. Ainsi, les femmes entre dix-sept ou dix-huit ans et vingt-huit à trente ans ont, de nos jours, des rapports sexuels et des relations affectives qui ne se prêtent pas à la parentalité. Enfin, en cas de grossesse non prévue, la probabilité de recourir l’IVG pour une étudiante de dix-huit ans à Henri IV sera de 99,9 %, tandis qu’une jeune fille du même âge en BTS à Sarcelles aura plus de chance de poursuivre sa grossesse qui lui apportera un statut social.
Par ailleurs, si le nombre de femmes se présentant pour une première IVG est en baisse, toujours grâce à la diffusion de la contraception efficace, celui des femmes se présentant pour une deuxième IVG, voire plus, est par contre en augmentation. Ce phénomène est observé dans tous les pays industrialisés, pour la raison que je viens d’expliquer : durant les quatre années supplémentaires de jeunesse sexuelle, le risque d’avoir deux grossesses non prévues plutôt qu’une est beaucoup plus élevée par rapport aux générations des années 70, si bien que le nombre de grossesses non prévues est statistiquement plus élevé. Au demeurant, les femmes se présentant pour une deuxième IVG sont plus souvent sous contraception, avec des méthodes efficaces, que celles se présentant pour une première IVG.
Par conséquent, la stabilité du taux de recours à l’IVG n’est le signe ni d’un échec des politiques de contraception, ni d’une irresponsabilité des femmes. Elles reflètent en réalité une évolution sociale et démographique liée à l’allongement de la période de jeunesse sexuelle.
Second point : la stigmatisation du recours à l’IVG. Comme le montrent clairement les résultats de nos enquêtes auprès des femmes, mais aussi des hommes et des professionnels de santé – généralistes et gynécologues –, le droit à l’IVG n’est nullement remis en cause en France, contrairement à certains pays européens, en particulier l’Espagne. Il est donc considéré dans notre société comme un droit fondamental, seule une infime minorité de la population, certes à la visibilité sociale forte, le remettant en cause.
Ce qui pose problème en revanche, c’est la légitimité des femmes à se retrouver dans cette situation. La norme voudrait, en effet, que les femmes n’aient plus besoin de recourir à l’IVG, puisque de multiples méthodes de contraception efficaces et très accessibles sont proposées. Or le risque zéro n’existe pas dans le domaine de la contraception, comme il n’existe dans aucun domaine de la santé publique. De la même manière que toute personne peut oublier une fois dans sa vie de prendre son traitement médical, toutes les femmes entre dix-sept ans, âge du premier rapport sexuel, et cinquante ans, âge moyen de la ménopause, oublient au moins une fois de prendre leur pilule !
Derrière cette idée que les IVG devraient être rarissimes, il y a un rappel à l’ordre sur la sexualité des femmes. Finalement, on a toujours du mal à penser que les femmes peuvent avoir une sexualité totalement déconnectée des enjeux reproductifs. Si les pratiques sexuelles ont énormément évolué en France depuis 1970, les représentations de la sexualité n’ont quant à elles pas du tout changé. D’un côté, la sexualité masculine est pensée dans le registre du désir, du plaisir et du nécessaire assouvissement de besoins sexuels par nature plus importants que les femmes ; de l’autre, la sexualité féminine reste pensée dans le registre de l’affectivité et de la conjugalité.
En réalité, cette opposition entre sexualité féminine et sexualité masculine ne fait que refléter les inégalités entre les femmes et les hommes qui existent dans les autres sphères sociales. En effet, la sphère de la sexualité, de la contraception et de l’avortement n’est pas autonome des autres sphères sociales. Or l’idéal égalitaire dans la sphère de la sexualité n’existe pas, comme si celle-ci absorbait les tensions que suscite la montée de l’idéal égalitaire dans les sphères professionnelle et familiale, même si les pratiques ne suivent pas toujours dans ce domaine.
J’en viens maintenant au projet de loi relatif à la santé.
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) avait préconisé la suppression du code de la santé publique de la notion de « détresse » pour une femme voulant demander une IVG, ce dont le législateur a tenu compte. Par contre, la disposition sur la clause de conscience du professionnel de santé n’a aucune raison d’être maintenue dans le code, puisqu’elle existe déjà pour tout professionnel de santé. Cette disposition, comme celle sur le délai de réflexion, maintient l’IVG comme un droit pas comme les autres. La suppression de ces dispositions nous semble importante.
À l’article 31 du projet de loi, je regrette que seul l’avortement médicamenteux soit évoqué. Par contre, faciliter l’accès à l’IVG médicamenteuse en permettant aux sages-femmes de réaliser cet acte est une excellente mesure de santé publique. En effet, le choix entre IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale est essentiel pour les femmes. Or dans un contexte de restrictions budgétaires, on peut craindre que l’IVG médicamenteuse soit renvoyée vers la sphère du privé, alors qu’elle constitue une avancée majeure pour les femmes.
L’article 3 du projet de loi lève les restrictions sur la contraception d’urgence, ce qui est également une excellente mesure. Par contre, cette disposition devrait, non pas être restreinte aux élèves du second degré auprès de l’infirmerie scolaire, mais être étendue à tous les lieux de vie des jeunes, comme les associations de quartier. Faute de quoi, les groupes sociaux défavorisés, où les jeunes gens sont plus concernés par les difficultés contraceptives, ne verront pas leur situation s’améliorer. Je regrette également que cet article vise uniquement la contraception d’urgence : ce n’est pas en favorisant uniquement l’accès à cette méthode que l’on pourra faire baisser le nombre de grossesses non prévues outre-mer, où le problème majeur est l’accès à la contraception efficace !
Voilà pourquoi je plaide pour une approche globale sur les questions de contraception, d’avortement, de violences sexuelles et d’éducation à la sexualité. Les pays qui promeuvent une éducation à la sexualité fondée sur le respect de l’autre, la découverte, le plaisir, et où les risques liés à la sexualité sont abordés en tenant compte des rapports de genre – au sens scientifique du terme – dès la plus tendre enfance, sont moins concernés par les grossesses non prévues et les infections sexuellement transmissibles. Ces pays ont ainsi de meilleurs indicateurs de santé sexuelle et reproductive, même si la situation en France est loin d’être catastrophique comparée à celle d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, le Canada ou encore les États-Unis. Mais je persiste à penser que notre pays peut faire mieux.
M. Jacques Moignard. Votre conclusion, sur l’éducation et la prévention, est très rassurante. En effet, si l’IVG et la prescription de la pilule contraceptive sont des actes médicaux, la santé ne relève pas uniquement des professionnels de santé. Il reste beaucoup à faire en matière d’éducation à la santé sexuelle et reproductive, et les intervenants ne doivent pas être les seuls médecins, infirmières ou sages-femmes.
Mme Sophie Dessus. En milieu rural, les jeunes sont très éloignés de l’information, du fait de l’absence d’associations et de lieux de formation. Or en raison de la pression sociale, ils se sentent souvent obligés de faire leur preuve en ayant un acte sexuel le plus tôt possible… Comment accompagner nos jeunes et leur apporter les informations dont ils ont besoin ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Marisol Touraine a lancé l’année dernière une campagne de communication sur la contraception. Connaît-on l’impact de ce genre de campagne ?
Mme Nathalie Bajos. Je suis totalement d’accord avec vous : ce n’est pas parce que les méthodes de contraception les plus efficaces sont médicales et que le recours à l’IVG relève d’une pratique médicale qu’il faut médicaliser ces questions. Aussi l’éducation à la sexualité au sens large est-elle un enjeu central : elle doit aborder le corps, le désir, le plaisir, le respect de l’autre, tout autant que les risques liés à la sexualité. À cet égard, savoir comment parler de sexualité aux jeunes et quelles personnes sont les mieux placées pour le faire est une question primordiale. L’immense majorité des médecins ne sont pas formés pour en parler, or on peut faire des ravages en parlant mal de sexualité à des jeunes. La question de l’homophobie est également très importante. Ainsi, l’éducation à la sexualité impose une réflexion sur son contenu, sa forme, et les acteurs qui pourraient la promouvoir au sein des institutions scolaires.
Qu’ils soient en milieu rural ou en plein cœur d’une métropole, les jeunes devraient pouvoir bénéficier d’une éducation à la sexualité qui leur fournisse une véritable information et les moyens de pouvoir vivre une sexualité comme ils le souhaitent et sans contraintes. Un problème supplémentaire se pose pour les jeunes en milieu rural pour l’accès à la contraception, en particulier d’urgence, parce qu’ils doivent se rendre à la pharmacie du village où tout le monde connaît tout le monde. En Corse, par exemple, les jeunes font des kilomètres pour trouver une pharmacie éloignée de leur domicile et où personne ne connaît leurs parents…
Toutes les campagnes de communication réalisées par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) sont évaluées. Les campagnes ont vocation à modifier des normes et des représentations, mais à elles seules, elles ne modifieront pas les pratiques, ce qui impose parallèlement des actions ciblées réalisées avec les personnes concernées. En matière de tabac, par exemple, les campagnes conçues uniquement par des agences de communication parisiennes valorisent l’image du non-fumeur, mais les personnes arrêtant de fumer sont issues des milieux sociaux les plus favorisés, d’où un accroissement des inégalités sociales.
Les campagnes ne servent donc à rien si elles ne sont pas assorties d’actions efficaces, mais elles resteront essentielles, ne serait-ce que parce qu’il faudra toujours rappeler aux nouvelles générations l’enjeu fondamental que représente la contraception.
Pour ce qui est de la méthode, faire peur n’est pas la bonne solution car cela provoque des réactions de blocage et empêche les messages de passer. On l’a vu pour le VIH : les campagnes qui suscitent la peur ne modifient pas les comportements.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je regrette également que, sur la santé sexuelle et reproductive, le projet de loi relatif à la santé n’aborde que la contraception d’urgence et l’IVG médicamenteuse.
Des gynécologues m’ont alertée sur le fait que de plus en plus de femmes seraient orientées vers une IVG médicamenteuse, sans qu’elles aient vraiment le choix entre les deux types d’IVG. Qu’en pensez-vous ?
Mme Nathalie Bajos. Il est essentiel que les femmes continuent à avoir le choix entre IVG chirurgicale et IVG médicamenteuse et, pour cette dernière, le choix entre structure de santé et domicile. D’où l’importance d’une approche globale de la contraception. Pourquoi limiter l’article 31 à l’avortement médicamenteux ?
De la même manière, pourquoi limiter l’intervention des infirmières à la contraception d’urgence ? Ces professionnelles gagneraient à être formées à l’éducation à la sexualité car elles peuvent être des interlocutrices formidables pour des jeunes qui ont besoin d’informations sur la sexualité, qui sont victimes d’homophobie ou qui ont subi des violences.
Cela étant dit, j’ai entendu dire que Mme Touraine préparait un plan sur l’IVG.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Mme la ministre fera des annonces sur l’IVG le 17 janvier 2015, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la loi Veil.
Nous n’arrivons pas à introduire les termes de « santé sexuelle et reproductive » dans les lois. J’ai moi-même tenté de faire introduire les termes de « droits sexuels et reproductifs » dans le cadre de la proposition de résolution sur l’IVG, mais il a fallu y renoncer pour que l’ensemble des groupes parlementaires accepte de signer ce texte. C’est pourquoi j’apprécie votre approche scientifique et sociologique. L’idéal d’égalité ne se retrouve pas dans la sexualité : on entend encore dire que la prostitution est le plus vieux métier du monde…
Mme Nathalie Bajos. L’approche du texte de loi amènera forcément des déconvenues. Ce n’est pas en promouvant la contraception d’urgence que l’on fera baisser les grossesses non prévues dans les outre-mer, où leur nombre est très élevé. Les grossesses non prévues diminueront si l’on favorise l’accès à la contraception dans sa globalité. Certes, la contraception d’urgence est très peu utilisée en France, mais l’isoler des autres méthodes contraceptives ne constitue pas une bonne stratégie de santé publique.
Je termine en disant qu’un rapport a été publié récemment sur la situation aux Antilles et en Guyane. Nous pourrons vous le communiquer.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Merci beaucoup, madame, pour cette contribution très intéressante.
Table ronde avec des représentant-e-s du Collège national des sages-femmes (CNSF), de l'Association nationale des centres d'IVG et de contraception (ANCIC), du réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie (REHVO) et du Syndicat national des infirmier-e-s conseiller-e-s de santé (SNICS)
Compte rendu de l’audition, sous forme de table ronde, du 16 décembre 2014
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. La Délégation aux droits des femmes s’est saisie du projet de loi relatif à la santé qui devrait être examiné en séance publique au cours des prochains mois.
Je vous précise que, dans le cadre de la Délégation, nous n’avons pas l’intention de rédiger un rapport d’information sur l’ensemble des questions relatives à la santé des femmes. Nous nous appuierons, notamment, sur les rapports existants, comme celui de Mme Dominique Hénon, ancienne membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) – que nous avons précédemment auditionnée – qui s’intitule « La santé des femmes en France ».
Nous souhaitons aujourd’hui aborder avec vous deux aspects du projet de loi, qui figurent dans deux articles, à savoir la contraception pour les mineures et l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse. Plus généralement, selon vous, quels points de ce projet de loi mériteraient d’être approfondis ou complétés ?
Mme Sophie Eyraud, coprésidente de l’Association nationale des centres d’interruption volontaire de grossesse (ANCIC), médecin généraliste. L’ANCIC est une association de professionnels de santé s’occupant des interruptions de grossesse et de la contraception. Créée en 1979, peu de temps après la loi Veil, l’ANCIC regroupe des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des secrétaires, des conseillères conjugales et familiales et des psychologues.
Nous sommes ravis que l’article 3 du projet de loi relatif à la santé lève les restrictions à la contraception d’urgence des élèves du second degré auprès de l’infirmière scolaire, à savoir notamment les cas de « détresse caractérisés ». En revanche, nous avons remarqué que par manque de formation, les infirmières – et notamment les infirmières scolaires – n’usaient pas du droit de prescrire une contraception. Pour cette raison, des jeunes se retrouvent en rupture de contraception. Il faudrait donc vraiment que les infirmières soient formées.
Ensuite, en matière d’IVG, le délai de réflexion part du moment où la femme en a fait la demande à un médecin. Or cela ralentit le parcours de soins. Nous estimons que la première demande pourrait être recueillie par n’importe quel professionnel travaillant dans un centre d’orthogénie. Le premier rendez-vous de consultation en vue d’une IVG pourrait même faire partir le délai de cette période de réflexion.
Enfin, il y a très longtemps que nous sommes favorables à ce que l’IVG médicamenteuse puisse être assurée par les sages-femmes. Cela permettra d’améliorer l’accès aux soins. Mais j’ai lu aussi que cela permettrait de réduire le nombre d’IVG (instrumentales) pratiquées dans les établissements de santé. Or l’objectif est tout de même que les femmes aient le choix de la méthode. Il n’est pas question de faire du tout médicamenteux, comme les tutelles semblent le souhaiter. L’IVG médicamenteuse ne convient pas à toutes les femmes. D’abord, celles qui sont dans le secret ou connaissent des conditions sociales difficiles ont absolument besoin d’aller à l’hôpital, dans un établissement de santé, pour rencontrer une assistante sociale et bénéficier d’un accompagnement. Ensuite, les IVG médicamenteuses ne sont possibles que jusqu’à sept semaines d’aménorrhée, c’est-à-dire cinq semaines de grossesse. Enfin, vivre une IVG médicamenteuse n’est pas toujours facile. Pourtant, des gynécologues obstétriciens ne souhaitant pas faire d’IVG instrumentales, certains services pratiquent des IVG médicamenteuses jusqu’à quatorze semaines, ce qui peut constituer une véritable maltraitance pour les femmes.
Nous pensons donc qu’il faut continuer à faire des IVG instrumentales et à former des généralistes à cette fin ; actuellement, les centres d’IVG fonctionnent essentiellement avec eux, car les gynécologues obstétriciens répugnent à pratiquer cette méthode. Nous pensons également qu’il faudrait permettre aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales, car elles sont tout à fait compétentes.
S’il n’y a plus de gens formés à l’IVG instrumentale (par aspiration), les femmes n’auront plus le choix. Aujourd’hui, nous rencontrons déjà des problèmes de recrutement. Mais ce n’est pas parce les jeunes ne veulent pas en faire, c’est parce que la vacation est très mal rémunérée.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. J’ai cru comprendre que Mme Marisol Touraine avait revalorisé l’acte d’IVG, dont le tarif était inférieur à celui d’une fausse couche, au point que certaines unités d’IVG avaient fermé.
Mme Sophie Eyraud. Le forfait hospitalier a en effet été réévalué. Mais le problème porte ici sur le niveau de rémunération des praticiens de l’IVG. Lorsque les médecins sont payés à la vacation, ils refusent le poste. Pour que ce soit intéressant, il faudrait qu’ils aient le statut de praticien hospitalier contractuel. Mais cela suppose qu’ils passent au moins 40 % de temps à l’hôpital. Or la plupart des médecins qui font des IVG sont des médecins libéraux qui ne peuvent pas se le permettre. La vacation est d’ailleurs un frein à l’ensemble de la médecine sociale, qu’il s’agisse d’alcoologie, d’IVG ou d’autres domaines.
Par ailleurs, la clause de conscience est un vrai problème. Selon nous, il faudrait la supprimer de la loi, dans la mesure où elle s’applique déjà à tout acte médical.
Je voudrais maintenant revenir sur le délai de réflexion de sept jours, qui constitue un frein à l’accès à l’IVG pour toutes les femmes, en particulier celles qui arrivent à 14 semaines d’aménorrhée. En fait, l’important est que les femmes puissent réfléchir et assister à un entretien où elles bénéficient d’une écoute particulière, s’agissant d’un acte qui peut leur poser problème.
Certaines femmes sont ambivalentes et ne sont pas certaines de leur décision tout de suite, tandis que d’autres le sont. J’observe d’ailleurs que ce délai de réflexion varie selon les pays européens : en France il est de sept jours, dans d’autres pays il est de trois jours, et parfois il n’y en a pas.
Nous voudrions également que la loi soit appliquée. Quand une femme arrive à 13 semaines plus cinq jours d’aménorrhée, il faudrait que des procédures d’urgence soient mises en place dans les établissements de santé pour que l’IVG soit pratiquée dans les temps – et que la femme ne soit pas obligée d’aller à l’étranger. Or ce n’est pas encore le cas partout.
Enfin, je pense que l’on pourrait faire des IVG instrumentales hors des établissements de santé. Des expérimentations sont en cours, sous anesthésie locale. Cela se fait beaucoup en Belgique. C’est une voie intéressante à explorer.
Mme Laurence Danjou, gynécologue et coprésidente de l’ANCIC. Il faut se battre sur tous les terrains, pour que toutes les possibilités restent ouvertes aux femmes et que les structures disposent des moyens suffisants.
Comme l’a dit Sophie Eyraud, l’ANCIC est une association de professionnels qui remplit plusieurs missions. Elle combat pour l’application du droit à l’IVG. Elle fait de la formation. Nous organisons tous les deux ans une journée de formation pour tous les professionnels que l’on a cités. Nous produisons des documents de formation sur les IVG médicamenteuses hors hospitalisation, et sur les IVG sous anesthésie locale. Nous venons de rénover notre site internet qui propose maintenant une entrée « grand public », une entrée « professionnels » et une entrée « vie de l’association ».
Nous avons fait un travail sur l’homme et l’IVG, parce que nous pensons utile que celui-ci puisse s’impliquer, s’il le souhaite. Nous allons travailler sur l’hymen, à la suite de nombreuses demandes de jeunes filles. Nous nous battons avec nos associations pour le maintien du droit à l’avortement, pour le maintien des structures, pour que les professionnels aient leur place et que ce droit soit exercé dans de bonnes conditions. Or ce n’est pas simple. Les difficultés ne manquent pas. Certains hôpitaux fonctionnent un peu n’importe comment, et je pense qu’en matière d’IVG, la maltraitance des femmes perdure.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Quelle est votre représentativité ?
Mme Laurence Danjou. Nous n’avons pas beaucoup d’adhérents réguliers, sans doute 170 à 180. Mais lorsque nous organisons des journées, nous réunissons facilement 400 personnes.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Votre association serait-elle capable de dresser un tableau de la situation actuelle dans les hôpitaux ?
Mme Laurence Danjou. Pas objectivement dans toutes les régions. Nous pouvons signaler des dysfonctionnements dans certains endroits que nous connaissons bien. Mais nous n’avons pas la capacité de faire une étude point par point.
Mme Sophie Eyraud. Même les agences régionales de santé (ARS) n’y parviennent pas !
Mme Laurence Danjou. Même en Île-de-France, où nous sommes très présents, nous n’avons pas de visibilité partout.
Mme Sophie Gaudu, gynécologue-obstétricienne, cheffe de service à la maternité des Bluets et présidente du réseau entre l’hôpital et la ville pour l’orthogénie (REHVO). J’ai plusieurs casquettes : médecin hospitalier, cheffe de service de la maternité des Bluets, qui est une grosse maternité et un important centre d’IVG (1 200 par an) ; coordinatrice du diplôme inter-universitaire (DIU) « Régulation des naissances » à Paris, qui a été le premier diplôme universitaire de contraception et d’avortement ; présidente du réseau REHVO, un réseau de santé financé par l’ARS d’Île-de-France, chargé de faciliter l’accès à l’IVG médicamenteuse sur l’ensemble des sept départements de la région, l’accès à la contraception et le travail en partenariat avec des professionnels de santé en ce domaine.
Ce réseau, créé il y a dix ans, réunit 23 établissements de santé, principalement publics – un seul privé –, environ 350 médecins qui exercent soit en libéral, soit comme salariés dans une soixantaine de centres de santé et de planification. Parmi ces praticiens qui réalisent des IVG dans leur cabinet, on compte 50 % de généralistes et 50 % de gynécologues. Enfin, les praticiens du réseau font chaque année environ 7 000 IVG hors établissement de santé. Actuellement, en Île-de-France, les IVG hors établissement de santé représentent entre 20 et 25 % des IVG de la région – soit 12 000 en 2012, sur 56 000 IVG.
Le réseau REHVO développe aussi des outils à destination des patientes. En 2013, nous avons lancé un site internet permettant, à partir de son code postal et de la méthode choisie, de trouver le praticien le plus proche de chez soi – praticien dont les coordonnées ont été vérifiées. Nous venons de développer ce site à la demande du ministère des Droits des femmes. Nous l’avons lancé le 26 novembre 2014 sur cinq régions, et nous espérons rapidement pouvoir l’étendre à l’ensemble du territoire.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. C’est la date du vote, par l’Assemblée nationale, de la résolution réaffirmant le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse en France et en Europe.
Mme Sophie Gaudu. Il est utile de se laisser porter par l’actualité !
Le sens même de la mission du REHVO est de faciliter l’accès aux soins dans le domaine de l’IVG et de la contraception. En ce sens, les axes fondamentaux du projet de loi relatif à la santé sont porteurs pour l’IVG et la contraception. Ce texte vise en effet à réduire les inégalités d’accès aux soins, favoriser la prévention auprès des jeunes, faciliter le parcours de soins et l’exercice de pratiques avancées pour les personnels de santé qui ne sont pas médecins. À de nombreux articles du texte, nous pourrions intercaler certaines de nos propositions.
Je vais commencer – et je m’exprime ici en tant que médecin hospitalier – par la clause de conscience. La maternité des Bluets étant gérée dans un esprit favorable à l’émancipation des femmes, il est clair que je n’engage aucun médecin refusant de pratiquer des IVG. Cela fait partie du cahier des charges.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Quand la clinique embauche un médecin, a-t-elle le droit de lui demander s’il va ou non appliquer cette clause de conscience ? Celui-ci a-t-il le droit de ne pas répondre ?
Mme Sophie Gaudu. Cela fait partie des missions de son contrat. S’il signe le contrat, il fera des IVG. Cela étant, tout médecin a le droit de refuser un soin, pour autant qu’il confie le patient ou la patiente à un confrère.
À la réflexion, l’IVG étant une mission de service public – la maternité des Bluets est elle-même un établissement participant au service public –, pour assurer aux femmes une égalité d’accès aux soins, un hôpital public ne devrait pas pouvoir recruter un praticien hospitalier qui refuse de pratiquer des IVG. Si ce médecin ne veut pas faire d’IVG, qu’il aille ailleurs, en clinique privée.
Ce serait un signal fort qui protégerait mes collègues chefs de service. Personnellement, je peux me permettre d’agir ainsi, car je suis soutenue par ma direction. Mais mes collègues chefs de service qui travaillent en banlieue parisienne ont vraiment du mal à recruter.
La loi pourrait donc disposer que pour travailler dans les hôpitaux publics, on ne peut pas faire jouer la clause de conscience pour s’abstenir de pratiquer des IVG, dans la mesure où les IVG font partie de l’offre de soins. Le médecin qui est embauché à l’hôpital Saint-Joseph, à Paris, s’engage, quant à lui, à ne pas pratiquer d’IVG : il s’agit en effet d’un hôpital confessionnel participant au service public, au conseil d’administration duquel siège toujours un représentant de l’archevêque de Paris. À l’inverse, le médecin embauché dans un hôpital de la République française comme gynécologue s’engagerait à faire des IVG. Cette proposition est sans doute un peu hardie, mais je vous la soumets.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Quels services seraient concernés ?
Mme Sophie Eyraud. Les services de gynécologie obstétrique et les services de chirurgie faisant des IVG.
Mme Sophie Gaudu. L’IVG est l’acte de chirurgie ou de soins le plus fréquemment pratiqué sur les femmes. Cela signifie que lorsque l’on est gynécologue à l’hôpital, on est amené à en faire. Or, à l’heure actuelle, en Île-de-France, à certains endroits, il est difficile d’accéder à l’IVG. Une telle disposition protégerait les patientes.
Après la clause de conscience, j’en viens au recueil de la première demande. Dans la loi de 1975 revalidée en 2001, cette demande doit être faite auprès d’un médecin. Or dans le projet de loi relatif à la santé, à l’article 31, il est prévu d’ajouter, après le mot « médecin », les mots « ou une sage-femme ».
Que ce soit dans le chapitre consacré à l’exercice avancé des personnels paramédicaux, dans le chapitre relatif à l’autonomie des patients ou dans le chapitre portant sur la démocratie sanitaire, il me semble que l’on pourrait préciser que les infirmières des centres de planification et des centres de santé, ainsi que les personnels de certaines associations, comme les centres de planning familial ou les centres de santé associatifs, sont à même – dans la mesure, bien sûr, où ce sont des gens formés – de recueillir la première demande.
Que la première demande ne soit pas forcément recueillie et signée par un médecin ou une sage-femme faciliterait et accélèrerait grandement l’accès aux soins. En effet, dans le domaine de l’IVG, la lecture de la loi et des contraintes est à géométrie variable, et il y a des abus de pouvoir à toutes les étapes du parcours. Pour avoir été pendant plus de dix ans, responsable de plusieurs centres d’IVG à l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris), j’ai constaté qu’à certains endroits, les patientes étaient envoyées chez le médecin de proximité pour obtenir ce document de première demande. Cela n’a aucun sens quand on sait que la conseillère conjugale qui avait reçu la patiente avait déjà commencé à lui expliquer les méthodes et que, dans les faits, elle avait très clairement recueilli une demande de sa part. D’ailleurs, dans de nombreux services, la demande formulée auprès d’un personnel du centre fait démarrer le délai de réflexion ; cela fait partie du protocole.
Passons à la contraception déléguée, sujet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Le projet de loi relatif à la santé prévoit en effet un exercice en pratique avancée pour certaines professions paramédicales, et notamment les infirmières.
J’observe que nous n’avons rien inventé en la matière : nos collègues et amis canadiens ont en effet mis en place depuis longtemps « l’ordonnance collective », qui permet à des infirmières d’initier des contraceptions – après une formation – dans le cadre d’un partenariat avec des médecins, pharmaciens, etc. Le système est très structuré. Les Américains ont également commencé à travailler sur la question. À l’heure où nous renforçons les contrôles pour la prescription de pilule, l’Association des gynécologues obstétriciens américains recommande la vente libre de la pilule. Nous sommes très en retard dans cette réflexion.
Quoi qu’il en soit, cette contraception déléguée permettrait de faciliter l’accès aux soins. Elle concernerait des praticiens installés sur la totalité du territoire, qu’il s’agisse des infirmières, des pharmaciens ou des sages-femmes – lesquelles ont déjà un droit de primo prescription. Je précise que dans nos centres, les infirmières initient les premières contraceptions, dans le cadre d'une pratique structurée, sur la base d’un protocole de soins. Ce serait plus particulièrement bénéfique pour la classe d’âge 18-24 ans, chez qui on observe un recul d’accès à la contraception à cause de la première consultation médicale.
Dès 2005, j’avais ouvert le DIU aux sages-femmes, persuadée que cela faisait partie de leurs missions et qu’elles seraient amenées à délivrer cette prescription. Je pense que l’extension à d’autres professionnels de santé volontaires et formés serait vraiment un plus. D’ailleurs, au sein de notre réseau, nous avons développé un volet contraception, et nous essayons de mettre en rapport les professionnels de ce domaine.
Voilà pourquoi je pense que la contraception déléguée fait partie des sujets qui pourraient être clairement exprimés dans la future loi, sous la rubrique « Exercice en pratique avancée ».
Enfin, ce pourrait être l’occasion d’une grande révolution. Je vous ai dit que nos confrères américains s’étaient prononcés pour la vente libre de la pilule et des oestroprogestatifs. Actuellement, en France, la pilule de la contraception d’urgence est en vente libre, suite à une initiative de Mme Ségolène Royal. C’est une molécule qui s’appelle le lévonorgestrel, exactement la même que celle des pilules microprogestatives. Ces dernières sont absolument sans danger et n’ont absolument pas besoin d’être délivrées sur prescription médicale. Le « délistage », c’est-à-dire le retrait de la liste des médicaments à prescription médicale obligatoire, et la vente libre des microprogestatifs faciliteraient énormément l’accès aux soins et à la contraception pour les jeunes et les moins jeunes.
Actuellement, les seuls contraceptifs gratuits sans ordonnance sont le retrait et le préservatif qui est une contraception masculine. Il n’y a aucune contraception féminine en vente libre, à part les préservatifs féminins, très peu utilisés, et les ovules. Les microprogestatifs sont sans danger et très peu chers (3,50 euros les trois plaquettes).
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Ne pourrait-on pas nous objecter que les jeunes filles ont d’abord besoin d’être informées ?
Par ailleurs, certains ont envisagé la mise en vente libre des pilules dans les supermarchés. Je suppose que vous pencheriez plutôt pour la pharmacie ou la parapharmacie ?
Mme Sophie Gaudu. Vous voulez connaître le fond de ma pensée ? Je pencherais plutôt pour le supermarché. Mais je n’irai pas jusqu’à le proposer.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Cette micro pilule est souvent la première pilule. En tant que professionnels, imaginez-vous que la jeune fille puisse y recourir elle-même, sans autre information ni conseil ?
Mme Sophie Gaudu. Je pense que la pilule est d’usage plus facile quand on débute sa vie amoureuse. En outre, l’efficacité du préservatif est directement corrélée à l’expérience de l’opérateur. Plus il est jeune, plus les accidents sont nombreux.
Mme Sophie Eyraud. Et surtout, l’usage du préservatif est très difficile à négocier.
Mme Sophie Gaudu. Avec le préservatif, le taux d’échec est de 14 grossesses par an pour 100 femmes. Avec un microprogestatif, il tombe à 2 : c’est tellement mieux que rien, et mieux que le préservatif ! Et surtout, le microprogestatif renforce l’autonomie des femmes. Bien entendu, il existe des pilules plus efficaces. Mais la question n’est pas là. Ce serait un vrai progrès que le microprogestatif soit en vente libre en pharmacie – avec un support papier explicatif, bien sûr.
S’il est en vente libre en pharmacie, il sera aussi accessible en « e-pharmacie ». Ce serait apprécié par les patientes qui n’ont pas accès à la pharmacie ou qui habitent en zone rurale ou dans les petites villes et ont du mal à se rendre chez le pharmacien local pour acheter leur pilule. En outre, il est beaucoup moins dangereux que l’ibuprofène ou le paracétamol, qui sont en vente libre. Vous ne pouvez pas vous suicider avec 22 plaquettes de microprogestatifs – vous serez juste malade – mais c’est tout à fait possible avec du paracétamol !
La mise en vente libre de ce médicament, qui est sans danger et donnerait de l’autonomie et de la liberté aux femmes, marquerait votre mandature.
Mme Béatrice Gaultier, secrétaire générale du Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (SNICS). Le SNICS est un syndicat national, majoritaire, représentant les infirmiers conseillers de santé qui travaillent dans l’éducation nationale. Près de 64 % de nos collègues ont voté pour nous, avec un taux de participation de près de 70 %. Sur un corps de 7 500 infirmières, nous comptons environ 2 000 adhérents.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Et vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible ! Je demande qu’il y ait des infirmières scolaires partout. Je pense que lorsque l’on crée des postes dans l’éducation nationale, on devrait puiser, sur ce contingent, des postes d’infirmiers et d’infirmières. En effet, ceux-ci jouent un rôle essentiel en matière d’éducation et de prévention, et leur présence permet d’améliorer les résultats scolaires.
M. Christian Allemand, secrétaire général adjoint du SNICS. Je pense que vous avez raison. On compte 7 400 infirmières pour 7 800 établissements du second degré. Mais il faut savoir que les infirmières de l’éducation nationale travaillent aussi dans le premier degré et dans l’enseignement supérieur.
Mme Béatrice Gaultier. Il y a 55 000 écoles et deux millions d’étudiants.
M. Christian Allemand. Le soin infirmier est en lien direct avec la réussite scolaire des élèves. Mais n’oublions pas que le premier interlocuteur d’un enfant, c’est un autre enfant, et pas l’infirmière scolaire comme on l’entend souvent. Si une jeune fille de quatrième a peur d’être enceinte, toutes ses copines ont peur aussi. Et si l’on ne peut pas lui apporter une réponse immédiate, ses amies en pâtiront de la même façon.
Ma collègue va intervenir sur des propositions à peu près similaires à celles des autres intervenants. Pour ma part, je pense que nous devons avoir le souci de répondre plus vite aux élèves, de les insérer dans un processus de réussite scolaire et, en même temps, dans une démarche d’éducation. Tout à l’heure, vous parliez d’accompagnement, d’éducation et d’information. Je pense que l’infirmerie de l’éducation nationale est un lieu où ce qui y est dit y reste. On a trop tendance à penser que l’éducation à la santé à titre collectif peut remplacer l’éducation à la santé à titre individuel. Mais ce n’est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes règles, ni les mêmes objectifs.
Dans l’enseignement public, chaque enfant devrait avoir au moins droit à cela. Parce que dans l’enseignement privé sous contrat, et ma collègue en parlera, il en va autrement. Je pense en particulier à la contraception d’urgence et à l’éducation à la sexualité.
Mme Béatrice Gaultier. Je voudrais revenir sur un des combats du SNICS : la contraception d’urgence. En raison de fortes résistances, les rédacteurs du texte de loi de l’époque avaient posé des conditions – une détresse caractérisée, pas de médecin à proximité, etc. – pour que l’on autorise les infirmières de l’éducation nationale à délivrer ce type de contraception.
Nous en étions les fervents défenseurs parce que nous connaissions les problématiques des jeunes en matière de sexualité – rapports non protégés, rupture du préservatif ... Nous sommes des interlocuteurs pour les jeunes – après leurs pairs, bien sûr – et nous pouvons leur apporter des réponses, dans un cadre protégé, sous couvert du secret professionnel. Je remercie d’ailleurs les intervenants précédents pour leurs propos, qui m’ont fait du bien. Il y a encore bien des réserves vis-à-vis de la contraception d’urgence.
Nous nous réjouissons que l’article 3 du projet de loi relatif à la santé corrige une rédaction par trop « ringarde ». Certes, les statistiques sont décevantes, le suivi est imparfait et nous voudrions pouvoir procéder à des évaluations. Malgré tout, on a pu démontrer que dans les collèges et les lycées, l’infirmière de l’éducation nationale était sollicitée par les jeunes souhaitant avoir recours à la contraception d’urgence. Et c’est bien sûr l’occasion pour elle de faire de l’information et de l’éducation à la sexualité.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. L’article 3 du projet de loi prévoit d’ores et déjà de supprimer de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique les mots : « si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible, » ainsi que les mots : « à titre exceptionnel et » et les mots : « et de détresse caractérisés ».
Mme Béatrice Gaultier. Nous y sommes favorables, en revanche, au sujet du renouvellement de la contraception orale, on est au milieu du gué et les choses ne se mettent pas en place.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Ce que je comprends du texte du projet de loi, c’est que vous ne seriez utilisées, vous les infirmières scolaires, que pour la contraception d’urgence.
M. Christian Allemand. Il y a eu un battage médiatique avec bien des fantasmes sur la sexualité des enfants qui a beaucoup freiné les choses dans le domaine de la contraception d’urgence. Depuis, les infirmières ont le droit de renouveler une prescription. Aujourd’hui, n’importe quelle famille, n’importe quel enseignant et bien des élèves savent que l’accès à la contraception d’urgence est libre en infirmerie. Mais le renouvellent de la contraception orale par les infirmières est peu ou pas connu et peu ou pas médiatisé ; de plus, il doit être accompagné d’une formation. Cela, ni le ministère de l’éducation nationale, ni le ministère de la santé et encore moins la direction générale de l’offre de soins (DGOS), ne l’ont proposé. Il en va de même pour la pilule microprogestative.
Les autotests de dépistage pourraient également être mis à disposition dans les infirmeries. Nous avons d’ores et déjà des tests de grossesse. En fait, cela a été alourdi par des procédures, même si, finalement, les choses ne se sont pas mal passées. Mais cela pourrait être mieux, pour les enfants, pour leurs partenaires et, aussi, en termes de réussite scolaire. Car tout le monde ne peut bénéficier de l’anonymat des grandes villes et choisir d’aller dans une pharmacie sans être reconnu. Pour ma part, j’exerce dans un petit collège situé aux pieds du mont Ventoux, dans un village de 1 200 habitants et tous les enfants du plateau d’Albion y sont scolarisés. Or les enfants ont besoin d’ombre pour se construire ; permettons-leur de se construire dans une certaine part d’ombre mais en les accompagnant.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Qu’en est-il des établissements privés sous contrat ?
M. Christian Allemand. La loi dite Debré prévoit la rémunération des personnels enseignants par l’éducation nationale ; pour les personnels non enseignants, un forfait est alloué et l’établissement choisit d’embaucher ou non des personnels de santé ou d’éducation. Les infirmiers de l’éducation nationale, eux, sont des fonctionnaires ayant vocation à exercer dans les établissements publics locaux d’enseignement. Aujourd’hui, tout ce qui a trait à l’éducation à la sexualité ou à la contraception d’urgence n’est pas obligatoire dans les établissements privés sous contrat. On imagine facilement les pressions dont pourrait faire l’objet une infirmière de l’éducation nationale qui voudrait délivrer ce type d’information dans certains de ces établissements. La loi pourrait élargir cette obligation.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous souhaitons ouvrir des fronts mais petit à petit.
M. Christian Allemand. Cependant, cela pose de vrais problèmes dans les milieux ruraux. Je prendrais pour exemple deux académies, celles de Nantes et de Rennes ; dans cette dernière, la moitié des élèves relèvent de l’enseignement privé sous contrat.
Mme Laurence Danjou. J’ai entendu dire par des fonctionnaires travaillant dans le domaine de la contraception en milieu scolaire que les moyens étaient nettement insuffisants.
M. Christian Allemand. Le budget pour ces moyens existe, il y a une ligne budgétaire pour les médicaments en milieu scolaire sur laquelle sont imputés les produits concernés. Au tout début, la difficulté rencontrée par des collègues a été le refus de certains pharmaciens de délivrer les prescriptions, ou des chefs d’établissement refusant l’acquisition. Cela n’est pas vraiment le sujet. La question de fond est de rendre obligatoire tout ce qu’il y a autour de l’éducation à la sexualité et d’offrir un soignant, une présence derrière une porte.
Mme Laurence Danjou. Dans le cadre de l’ANCIC, nous avons travaillé avec des personnels de l’éducation nationale au sujet des mineures en situation de demander une IVG et de la possibilité de les accompagner dans leur démarche. Savez-vous si les autorités de tutelle ont évolué dans leur réflexion à ce sujet ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Lorsque les jeunes filles viennent vous voir, évoquent-elles la question de l’IVG ? Êtes-vous l’une des premières entrées ?
M. Christian Allemand. Nous sommes sollicités. Mais l’éducation nationale, particulièrement la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) ont préféré considérer que, si une infirmière souhaite assumer le rôle d’adulte référent, elle ne peut le faire qu’à titre individuel. En effet, sa position statutaire ne lui permet pas de faire sortir un élève de l’établissement sans un ordre de mission ; se pose aussi la question de la substitution partielle à l’autorité parentale. Cette façon de voir, strictement administrative, a occulté la vraie question de l’accompagnement qui est la levée du secret. La situation demeure inchangée à ce jour.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Dans ce contexte et au titre d’une démarche effectuée à titre individuel, les parents ne peuvent-ils pas se retourner contre vous ou êtes-vous couverts ? Aucun de vos collègues n’a fait l’objet de poursuite de la part de familles ?
Mme Sophie Gaudu. Sauf dans les lieux où, par abus de pouvoir institutionnel, on note le nom de l’accompagnant majeur, nous ne notons pas ce nom, nous nous bornons à attester que l’intéressée était bien accompagnée par un majeur.
M. Christian Allemand. Même dans les bassins d’habitation les plus reculés, je n’ai jamais été témoin de plaintes émanant d’une famille. Les problèmes rencontrés relèvent plus du domaine administratif et de couverture, comme toujours dans l’éducation nationale.
Mme Sophie Gaudu. Il existe une importante inégalité territoriale dans la réalisation des IVG médicamenteuses dans les centres de planification départementaux. Un système compliqué veut qu’une décision du conseil général soit prise à cet effet. Ce dernier est le responsable juridique des centres de planification, c’est donc lui qui signe les conventions et mandate les salariés pour la réalisation de l’acte. Si je prends l’exemple de l’Île-de-France, les centres de planification départementaux réalisent des IVG médicamenteuses dans les départements de Paris et de Seine-Saint-Denis et pas du tout dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine. La couleur politique du conseil général influe sur la décision. Ce qui est vrai en Île-de-France se vérifie sur l’ensemble du territoire national. Cette inégalité concerne l’accès aux centres de planification ou aux centres de santé avec le tiers payant ou en pleine gratuité.
Mme Sophie Eyraud. En ce qui concerne les centres de santé, ce sont les maires qui sont responsables, donc la décision est prise par le conseil municipal.
Mme Sophie Gaudu. Il faudrait que la réalisation des IVG médicamenteuses puisse être imposée aux départements, j’ignore dans quel article du projet de loi cette proposition pourrait prendre place mais cela constituerait un réel progrès.
Mme Maud Olivier. Vous avez oublié de mentionner l’Essonne, département pionnier dans ce domaine, dont je suis conseillère générale. À l’époque où j’étais maire, l’ARS nous avait imposé la présence d’un échographe dans les centres de santé où des IVG médicamenteuses devaient être effectuées. Nous nous en sommes dotés avec un financement partiel de la région mais je m’interroge toujours sur le bien-fondé de cette exigence. Il serait souhaitable que cette ambiguïté soit levée, quitte à modifier la circulaire, car cela est très coûteux et risque de limiter les initiatives.
Mme Sophie Eyraud. Si tel était le cas, tous les médecins de ville devraient se doter d’un échographe, ce qui est impossible.
Il est vrai que l’Essonne est très pionnière et nous avons signé beaucoup de conventions ensemble. Le réseau a formé la totalité des personnels des centres de planification du département, y compris ceux qui ne souhaitaient pas pratiquer d’IVG afin qu’ils soient en mesure d’accompagner et de répondre aux patientes en demande. Cela a permis d’augmenter considérablement l’offre de soins dans un département où les choses étaient particulièrement difficiles.
Mme Laurence Danjou. Si l’échographie est utile, aucun texte ne l’impose dans la pratique de l’IVG médicamenteuse.
Mme Maud Olivier. Donc vous considérez que l’absence d’échographe ne pose pas de problème de sécurité ?
Mme Sophie Eyraud. J’ai pratiqué des IVG à l’hôpital Béclère de Clamart pendant vingt-cinq ans sans échographe, il n’y en a eu qu’à partir de l’an 2000.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je vous remercie, nous allons maintenant laisser parler les représentant-e-s du Collège national des sages-femmes.
Mme Sophie Guillaume, sage-femme cadre supérieur à l’hôpital Necker, présidente du Collège national des sages-femmes de France (CNSF). Créé en 2001, le CNSF est la société savante de la profession et regroupe l’ensemble des modes d’exercice de la profession. Je partage tout ce que j’ai entendu jusqu’à présent. Le collège s’est emparé de la problématique de l’accès aux soins et, depuis 2002, le numerus clausus des sages-femmes a été augmenté dans la perspective de l’élargissement du champ de compétence de notre profession. La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) du 22 juillet 2009 prévoit le suivi gynécologique de prévention par les sages-femmes. Malgré cette augmentation de nos effectifs, beaucoup de femmes et de jeunes filles ignorent qu’elles peuvent avoir recours à nous. Nous nous sommes mobilisés contre cette invisibilité des sages-femmes sans recevoir une écoute favorable. Cela est d’autant plus regrettable que le collège est un interlocuteur des pouvoirs publics, des sociétés savantes et des autres professions de santé du champ de la santé de la femme et du nouveau-né puisque nous sommes l’interface entre les deux.
M. Adrien Gantois, sage-femme, membre du CNSF. Je suis membre du collège, sage-femme à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis à mi-temps et sage-femme dans une maison de santé pluridisciplinaire au Pré-Saint-Gervais dans le département de Seine-Saint-Denis. Je veux remercier les intervenants pour leur engagement dans l’accompagnement vers l’accès des jeunes femmes à l’IVG. J’ai entendu parler d’anesthésie locale et d’autres méthodes que l’IVG médicamenteuse, pourquoi ne pas englober l’ensemble des pratiques sous le nom d’IVG ambulatoire afin de ne pas restreindre le choix de la femme souhaitant recourir à l’IVG ?
Je prends l’exemple d’une patiente. Elle est étudiante à Sciences Po, elle a vingt-quatre ans et vient dans une maison de santé pluriprofessionnelle pour y rencontrer son médecin traitant au sujet d’un petit rhume. Elle fait état de trois IVG ; le réflexe du médecin est de l’envoyer voir la sage-femme qui se trouve au bout du couloir. L’entretien laisse apparaître chez la jeune femme une méconnaissance de la contraception mais aussi des angoisses et des incertitudes quant à ses désirs propres et sa construction sexuelle ainsi que son autonomie de femme. Cette histoire est révélatrice de la société d’aujourd’hui. Le recours à l’interruption volontaire de grossesse stagne depuis 2006 malgré une augmentation constante de la couverture contraceptive : 222 000 IVG par an ont été pratiquées en France dont 27 pour 1 000 chez les femmes de vingt à vingt-quatre ans. De plus, le recours à l’IVG concerne plus fréquemment les femmes âgées de moins de vingt-cinq ans ou mineures avec 13 500 IVG en 2009.
On observe un réel problème lié à l’observance des moyens de contraception puisque 75 % des femmes déclarent y avoir recours mais les échecs demeurent fréquents ; sans compter qu’une femme sur dix utilise un moyen de contraception naturel, ce chiffre date de 2014. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 23 % des filles françaises âgées de quinze ans ont déjà connu un rapport sexuel et seulement 41 % des adolescents utilisent un préservatif lors de leur premier rapport sexuel. Ses chiffres sont consternants, et nous interrogent. Que faisons-nous ? Donnons-nous les bonnes informations à ces jeunes filles ? Connaissent-elles vraiment les moyens de contraception ? À ce sujet, je partage l’avis des infirmières scolaires : elles devraient être plus nombreuses afin que ces jeunes femmes puissent être autonomes.
Notre stratégie de prévention doit donc être repensée puisque le taux d’IVG demeure constant malgré les dispositifs mis en place. Nous proposons donc une consultation gynécologique personnalisée pour l’information des jeunes filles dès l’âge de quinze ans. Il s’agit de les amener à la conscience de leur santé sexuelle. Ce dernier concept, défini par l’OMS, est proche de celui de santé reproductive. Il s’agit de la capacité à contrôler le comportement sexuel et reproductif en accord avec l’éthique personnelle et sociale et d’une délivrance de la peur, la honte et la culpabilisation, des fausses croyances et de tout autre facteur psychologique susceptible d’inhiber ou d’interférer sur les relations sexuelles. La santé reproductive, de son côté, nécessite une absence de troubles, de dysfonctions organiques, de maladies ou d’insuffisances susceptibles d’interférer avec la fonction sexuelle et reproductive.
Si la notion de santé sexuelle était incluse dans nos stratégies de prévention, on donnerait plus d’autonomie aux individus et cela limiterait les violences faites aux femmes. Il s’agit de faire de la sexualité quelque chose de positif, un sujet sans tabou dont on peut parler avec des professionnels aguerris comme les médecins, les infirmières scolaires et les sages-femmes. Il faut ensuite améliorer la connaissance de la contraception qui est encore aujourd’hui balbutiante. Les jeunes femmes doivent pouvoir bénéficier d’une consultation en dehors de toute contrainte familiale ou pécuniaire, c’est pourquoi nous demandons la prise en charge à 100 % à l’instar du bilan bucco-dentaire effectué chez les adolescents.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La contraception est remboursée à 100 % sauf la visite médicale, cette question serait réglée si la vente libre en supermarché était autorisée.
Mme Sophie Guillaume. Ces propositions sont recevables mais cela reviendrait à laisser les gens conduire sans avoir reçu les leçons de conduite. Ce qui importe, c’est d’éclairer le choix des jeunes filles.
Formée dans les années 1990, j’ai participé pendant de longues années à des formations dans des collèges et toute notre approche consistait à présenter la sexualité de façon positive. Certes, il est possible d’axer la prévention sur les risques de grossesse non désirée ou les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA, au risque de faire peur. Or le goût du risque, caractéristique de l’adolescence, ne doit pas être oublié. Depuis 2006, nous nous sommes livrés à un matraquage préventif, par voie d’affiches notamment et nous constatons que le nombre d’IVG stagne. Nous devons travailler avec des sexologues afin de répondre aux situations de violence car aujourd’hui l’acte sexuel est banalisé et il y a beaucoup de grossesses non désirées. Certes, l’accès libre ou les actions telles l’accompagnement par un majeur sont des démarches positives mais nous devons conduire en amont une réflexion globale allant au-delà.
M. Christian Allemand. Je m’interroge sur la nécessité d’opposer éducation, information, accompagnement, prise en charge et soins. Je me souviens que, lors de mes premières années de formation en sexologie, des questions posées à des participants montraient, de leur part, une méconnaissance de leur propre anatomie. Ainsi, éducation n’est pas synonyme d’appropriation et, plutôt que de segmenter et créer des prés carrés, il faut conjuguer les approches, même si j’ai bien entendu les propos de Mme Gaudu.
Aujourd’hui, un enfant, un adolescent ou un jeune adulte doit disposer autour de lui d’un réseau au sein duquel il va trouver ce qui lui correspond. S’agissant de la stagnation du nombre d’IVG, Mme Gaudu nous expliquera la règle de trois.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Vous évoquez une consultation vers l’âge de quinze ans. Rafraîchissez-moi la mémoire, dans le cadre de la médecine scolaire obligatoire, il fut un temps où il y avait une visite en maternelle et une en primaire. Cela se termine-t-il avec le collège ?
M. Christian Allemand. Depuis l’après-guerre jusqu’à l’amendement dit « Pécresse », il n’y avait qu’une seule visite obligatoire à l’âge de six ans. L’amendement a prévu des visites aux âges de six, neuf, douze et quinze ans ; cela n’a jamais été appliqué puisque la visite de six ans n’était déjà pas réalisée. En revanche, la loi de refondation de l’école propose des choses intéressantes. Pour l’enfant de six ans, période de latence, il serait procédé à une visite susceptible d’être faite même par un médecin de ville. À douze ans est prévu un examen de dépistage, examen infirmier en fait, correspondant à l’âge d’entrée au collège. Entre-temps, des suivis seront effectués par les professionnels de santé. Des discussions sont toujours en cours entre l’éducation nationale et le ministère de la santé. Mais, après le collège, plus rien n’est prévu jusqu’au statut d’étudiant ou d’élève orienté.
Mme Sophie Eyraud. La loi HPST prévoyait qu’une consultation de prévention anonyme et gratuite serait prise en charge à 100 %, à l’adolescence, cela n’a jamais été appliqué. En tant que généralistes, nous utilisons les visites destinées à délivrer des certificats pour la pratique sportive pour faire de la prévention auprès des adolescents.
Mme Sophie Gaudu. Au sujet de la consultation à l’adolescence, l’article 16 du projet de loi relatif à la santé concerne le parcours coordonné de l’enfant et la prévention de l’obésité et des addictions ; à cela pourrait être ajoutée la préentrée dans la sexualité. Aujourd’hui, lorsque l’enfant a treize ans, la sécurité sociale envoie aux parents une proposition de bilan bucco-dentaire pris en charge à 100 %, pourquoi ne pas proposer la même chose pour l’entrée dans l’adolescence ?
Au sujet de la règle de trois, on constate que le nombre d’IVG pratiquées reste stable mais le nombre des femmes ne cessant pas d’augmenter, le nombre d’IVG par femme diminue de façon constante depuis un certain nombre d’années, cela en particulier chez les plus jeunes depuis 2006. Les âges concernés sont de vingt ans, puis vingt-quatre à trente ans. Dans la mesure où l’âge de la première maternité ne cesse pas de reculer, et que les motivations sociales de ce recul évoluent, le nombre des IVG pratiquées ne diminue pas.
Mme Sophie Eyraud. Nathalie Bajos, sociologue, a montré que, socialement, une femme est aujourd’hui plus libre de choisir l’interruption d’une grossesse imprévue qu’il y a trente ans.
Mme Laurence Danjou. Il n’y a pas lieu de privilégier un moyen plus qu’un autre. La contraception microprogestative peut apporter une réponse à une situation ponctuelle d’urgence et la femme peut, par la suite, prendre le temps de s’informer et faire ses choix.
M. Adrien Gantois. Il s’agit juste de proposer un service de plus, à l’instar de ce qui existe pour le soin bucco-dentaire. Cela serait une bonne chose pour les jeunes femmes comme pour les jeunes hommes.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Lors de l’examen du projet de loi HPST, Mme Bérengère Poletti, sage-femme de formation, qui avait fait un rapport sur les grossesses précoces, avait déposé un amendement proposant que les sages-femmes puissent procéder à l’IVG médicamenteuse. Cela avait déclenché des réactions violentes de la part de membres de la profession. Pouvez-vous me dire si ce débat a évolué ?
M. Adrien Gantois. De fait, cinq sages-femmes sur 20 000 avaient créé un groupuscule pro-life bénéficiant de beaucoup d’argent et de moyens de communication et ont donné une fausse image de la profession. Le rejet de cet amendement a constitué une énorme déception pour les sages-femmes.
Mme Sophie Guillaume. Dans le cadre du suivi gynécologique de prévention, très peu de jeunes femmes viennent consulter les sages-femmes qui, du fait de l’augmentation du numerus clausus, connaissent le chômage. Situation absurde puisque trop de femmes restent sans accès aux premières visites ni aux soins.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je connais le cas d’une jeune sage-femme qui s’est installée dans une petite commune, à trente kilomètres de la première ville et du premier hôpital et dont le rôle est considérable. Elle pratique les visites pré et postnatales, elle évite des déplacements et rassure ses patientes. Mais il a fallu qu’elle accepte de s’installer en milieu relativement isolé.
Mme Sophie Guillaume. Je rappelle que nous sommes la seule profession qui a accepté des mesures de régulation. Je souhaite citer l’exemple de la mère d’une aide-soignante du service dans lequel j’exerce et dont le gynécologue est parti en retraite. Au détour d’une grève et d’un manque de médecins dans le service, cette personne a découvert la sage-femme et s’en est trouvée pleinement satisfaite. Cela illustre bien qu’il faut privilégier la pluri professionnalité ; or sans vouloir tenir de propos corporatistes, il existe des ressources non exploitées.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Cela montre qu’il y a un problème de non information alors que bien des services sont à rendre.
Mme Laurence Danjou. Il faut rappeler que l’installation de sages-femmes ne suffit pas et que, dans le cas d’une IVG médicamenteuse, en situation d’urgence, la patiente ne doit pas se trouver à plus d’une heure d’un centre de soins. Il faut maintenir un maillage territorial et ne pas fermer trop de petites structures.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je ne partage pas complètement votre opinion. Un plateau technique suffisant est nécessaire et l’expérience a montré qu’un chirurgien qui n’opère que deux fois dans le mois est dangereux. Je suis défavorable au maintien des petites maternités sous-équipées.
Je souhaitais vous interroger sur le délai de réflexion de sept jours pour une interruption volontaire de grossesse : est-il toujours d’actualité, est-il toujours pertinent ?
Mme Sophie Eyraud. Le temps nécessaire à la décision est variable, certaines femmes sont décidées très tôt, d’autres non. L’enjeu est de laisser le temps à la réflexion et à l’information, en aucun cas il ne faut précipiter les choses. En revanche, la durée standard de sept jours est infantilisante.
Mme Sophie Gaudu. Je souhaiterais me faire l’avocat du diable des mauvaises pratiques institutionnelles en rappelant que, dans beaucoup d’endroits, ces sept jours sont comptés à partir de la première rencontre avec le médecin du centre, même s’il y a eu une consultation préalable en ville. L’interruption volontaire de grossesse est une pratique extrêmement réglementée et la lecture institutionnelle de cette réglementation est très coercitive.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous avons indiscutablement un problème de délais qui, d’ailleurs, se trouve à l’origine de bien des départs à l’étranger ; questions de coordination, délais d’attente involontaires ou non… Les situations sont très différentes d’un centre à l’autre.
M. Adrien Gantois. En ce qui concerne l’installation d’échographes, il est vrai que la datation a son utilité et que, dans les zones sous-dotées, une incitation pourrait être imaginée pour leur installation dans les centres, par le biais d’une aide du conseil général par exemple. Bientôt les maisons de santé professionnelles vont se multiplier et devront financer cet équipement. Il faudra songer à les aider.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Quelle est votre position sur la clause de conscience, même si nous ne voulons pas nécessairement rouvrir un débat comme cela s’est produit lorsque nous avons supprimé la notion d’état de détresse – ce qui m’a ramenée quarante ans en arrière. Nous ne souhaitons pas nous entendre dire que nous forçons les médecins. Nous savons tous pourtant qu’il y a redondance et que tous les personnels médicaux jouissent de cette clause de conscience. Le film récent sur Simone Veil montre comment et pourquoi elle a été conduite à introduire ces termes dans la loi, elle n’avait pas le choix. Faut-il aujourd’hui les supprimer alors que certains voudraient revenir sur cet acquis – on a vu ce qui s’est passé en Espagne ? Je souhaiterais avoir votre sentiment à ce sujet.
M. Adrien Gantois. La décision revient au législateur, si le retrait risque de faire capoter la loi, nous préférons le maintien, dans le cas contraire, le retrait a notre préférence.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. J’ai discuté avec une collègue qui souhaitait déposer un amendement en ce sens. Dans le contexte du débat sur l’IVG tel qu’il se déroule actuellement, un amendement de suppression de la clause de conscience, alors que celle-ci demeurerait de toute façon, risquerait d’être très visible, voire d’être vécu comme une provocation. Le cas échéant, nous prendrions nos responsabilités. Je vous demande donc votre avis : une telle suppression vous paraît-elle utile ?
Mme Sophie Gaudu. Si vous me donnez le choix entre rouvrir le front de la clause de conscience et la vente libre des microprogestatifs, je préfère la vente libre des microprogestatifs. L’adoption de votre amendement serait un plus. L’IVG est un acte dont le statut a été rendu exceptionnel par la déclaration obligatoire, le paiement au forfait et la soumission à la clause de conscience, avec cette redondance, et donc un acte auquel on pourrait spécifiquement se soustraire alors que l’on peut se soustraire à tout. Cette clause devient à géométrie variable : des confrères acceptent d’aller jusqu’à huit semaines, d’autres jusqu’à dix semaines, d’autre jusqu’à quatorze. Par ailleurs, certains, jusqu’à huit ou dix semaines, pratiquent l’aspiration et, entre douze et quatorze semaines, refont du médicamenteux.
Cette double clause de conscience fait que certains se permettent de faire n’importe quoi dans le domaine de l’interruption volontaire de grossesse ; sa suppression constituerait une réelle avancée.
Mme la présidente Catherine Coutelle, rapporteure. L’Assemblée nationale a adopté quasiment à l’unanimité, ce qui n’était pas évident, une résolution, en faisant référence à tous les textes en vigueur, y compris la loi de 2014, et réaffirmant que l’IVG est un droit fondamental. Il y a eu débat cependant, car cette notion n’est pas encore acceptée par tous.
Mme Maud Olivier. Les esprits sont frileux ; la fin de vie a été évoquée récemment et la loi dispose que les directives anticipées s’imposent aux médecins. Ainsi, la volonté du patient s’impose au corps médical. Le parallèle pourrait être fait pour dire que le corps appartient à la femme et que sa volonté s’impose donc dans les mêmes conditions, particulièrement pour un acte tel que l’interruption volontaire de grossesse.
Mme Sophie Gaudu. J’appelle votre attention sur le fait que, pour certains praticiens, si une échographie pratiquée à la douzième semaine de la grossesse met en évidence un doute sur la normalité du fœtus, la patiente est obligée de passer par un centre de diagnostic prénatal et n’a plus le droit de demander une IVG, même si elle est avant quatorze semaines. Certes, en tant que praticiens, nous ne pouvons que souhaiter que ces patientes puissent disposer de l’ensemble des investigations nécessaires liées au doute sur la normalité du fœtus qu’elles portent. Cependant, on conçoit mal à quel titre on accorderait une IVG à une femme qui s’est engagée dans ce parcours alors qu’on la refuserait à une femme qui la demande pour cause d’anormalité manifeste du fœtus.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Vous dites que cette situation est due au fait que la patiente n’a pas manifesté sa volonté d’avorter avant d’avoir eu connaissance du doute d’anormalité du fœtus et que certains médecins en déduisent qu’elle ne peut plus le faire, y compris à douze semaines ?
Mme Sophie Gaudu. En revanche, si le centre de diagnostic prénatal conclut à un risque d’une particulière gravité, l’intéressée aura le droit à une IVG mais dans le cadre d’une interruption médicale de grossesse. On se trouve là à la frontière de l’autonomie des femmes à décider de leur corps et de leur avenir – la suppression de la clause de conscience irait à cet égard dans le bon sens. Ce débat a beaucoup agité la communauté médicale. D’ailleurs, les actes récents d’un colloque du collège des gynécologues obstétriciens évoquent encore la notion d’interruption volontaire de grossesse illégale. Je me suis insurgée contre cette notion, on entre dans le cadre du refus de soin.
Mme Maud Olivier. Quels seraient les textes à modifier pour mettre un terme à de telles situations ?
Mme Sophie Eyraud. Cela ne relève pas de textes existants ; il s’agit d’une exégèse faite par certains praticiens.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Donc le droit existe mais il est mal appliqué.
Mme Sophie Guillaume. Pour travailler dans un centre de diagnostic anténatal, je peux dire que, si une échographie montre un risque d’anormalité, les choses deviennent très compliquées pour la patiente. Certaines se rendent alors dans un centre d’IVG et nous ne leur demandons pas si elles viennent d’un centre de diagnostic prénatal.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous avons reçu de nombreux témoignages faisant état d’abus de pouvoir : pressions, accusations ou culpabilisation. On demande à la femme si elle a bien réfléchi ou on lui montre l’échographie. Tout cela n’est pas dans la loi.
Mme Laurence Danjou. Les médecins des centres de diagnostic prénatal qui se livrent à ce genre de pratiques se mettent en dehors de la loi. S’ils peuvent émettre des réserves au titre de l’éthique et demander à la patiente de réfléchir, ils n’en sont pas moins tenus d’adresser celle-ci à un confrère pour pratiquer l’IVG. Aux termes de la loi, la femme n’a pas à justifier son choix ; ces praticiens créent donc une notion d’interruption volontaire de grossesse illégale.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. On constate donc que des femmes candidates à l’IVG subissent encore des pressions, on assiste à des phénomènes de régression.
Mme Sophie Guillaume. Cela s’est vu à l’occasion du débat relatif à l’allongement du délai. La France a un délai de quatorze semaines, certains pays comme la Hollande ont un délai qui s’étend jusqu’à vingt-deux semaines.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Une réflexion devrait-elle être menée sur l’allongement du délai ?
Mme Sophie Eyraud. Pourquoi pas ? Nous serions déjà satisfaites si le délai légal de quatorze semaines était correctement appliqué.
Mme Sophie Gaudu. Dans ces conditions, nous pourrions établir l’échelle de nos préférences, d’abord les microprogestatifs, ensuite la clause de conscience et enfin les délais !
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La question de la formation des médecins reste posée. Nous avons reçu le témoignage d’une femme qui avait dépassé les délais car son généraliste n’avait pas su lui donner les bonnes informations. Nous avons pensé qu’il faudrait imposer dans tous les cabinets médicaux une fiche récapitulative comportant notamment ce type d’information.
Mme Sophie Gaudu. Cette fiche existe, elle est obligatoire et réactualisée, c’est la loi.
Mme Maud Olivier. En Essonne, nous avons mené une expérimentation concernant des jeunes femmes qui avaient des grossesses précoces, avec des stages de trois à quatre semaines, non seulement sur la procréation, mais aussi sur les droits etc., et nous nous sommes aperçus que ces femmes ne savaient pas comment elles étaient faites, et en particulier comment est fait leur appareil reproducteur. Cela ne m’étonne donc guère que des grossesses précoces puissent survenir dans ces conditions. Dès lors, comme nous évoquions tout à l’heure la question des infirmiers scolaires, ne pourrait-il y avoir aussi une formation pour ces jeunes filles en milieu scolaire, concernant notamment l’éducation à l’anatomie ? Cette question se pose notamment dans les banlieues populaires.
Mme Sophie Eyraud. Normalement, les textes prévoient trois interventions par an dans les classes d’âge et par an. Mais dans les faits, depuis la loi de 2001, il n’y a rien. Quand je faisais des interventions en milieu scolaire, en lien avec l’infirmière scolaire mais nous nous n’étions pas assez nombreux et on ne touchait qu’une seule classe d’âge, en quatrième ou troisième. En Canada et en Hollande, ils commencent en primaire.
Mme Maud Olivier. Et pendant ces séances, on parle plus des maladies sexuellement transmissibles (MST) que de sexualité, sinon de plaisir.
M. Christian Allemand. Le problème vient de ce qu’on n’a pas créé de droit opposable dans ce domaine. Des enseignants de sciences de la vie et de la terre (SVT) participent parfois à des séances d’éducation à la sexualité, mais comment fait-on pour intérioriser l’information délivrée ? C’est une vraie question. Il faut certes des apprentissages de savoirs mais il faut aussi passer au savoir-être et au savoir-faire. L’apprentissage collectif ne peut remplacer l’apprentissage individuel à l’école ou à l’extérieur. Une porte doit être ouverte pour accompagner de manière professionnelle mais sans médicaliser.
La circulaire sur l’éducation sexuelle à l’école est formidable, il faut la rendre véritablement obligatoire, l’intention n’est pas suffisante. Le problème est : comment faire pour inclure cette éducation dans les enseignements, l’emploi du temps ? Un droit opposable éviterait certains positionnements.
Mme Maud Olivier. On peut aussi faire intervenir des associations.
M. Christian Allemand. Certes, mais le problème ne porte pas sur les intervenants mais sur l’emploi du temps des élèves et les différents enseignements.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Y-a-t-il des réticences des parents ?
M. Christian Allemand. Il peut y avoir des approches différentes selon les établissements et la sociologie. Le parcours peut être un peu compliqué mais apporte des garanties, avec des associations agréées notamment. Si on crée un droit opposable, on lèverait ces problèmes.
Mme Laurence Danjou. En matière d’IVG chirurgicale, un protocole d’expérimentation va être mis en place à la Pitié-Salpêtrière pour permettre aux sages-femmes de le pratiquer.
M. Adrien Gantois. Pour l’IVG médicamenteux, cela est acquis. Nous proposons de parler d’IVG ambulatoire.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. En pratique, la femme choisit-elle vraiment la méthode ?
Mme Sophie Eyraud. Sincèrement, non, c’est induit par le centre qui fait l’intervention, le choix se fait en fonction de la porte d’entrée – si elles s’adressent à un médecin de ville ou à un établissement, etc.– et de la méthode pratiquée dans l’établissement. Cela était d’ailleurs ressorti d’une étude qui avait été réalisée par une sociologue de l’INSERM, dans le cadre du réseau REHVO dont je suis également vice-présidente.
De la même manière, la prescription d’un dispositif intra-utérin (stérilet) chez les nullipares, c’est-à-dire les femmes qui n’ont jamais eu d’enfant, est encore peu fréquente.
Mme Laurence Danjou. Il faut néanmoins tendre à cela, au choix de la méthode. Le centre dans lequel j’exerce propose d’ailleurs quatre méthodes d’IVG (par voie médicamenteuse avec les femmes à domicile, d’autres où elles sont hospitalisées, sous anesthésie locale et IVG chirurgicales).
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Mesdames, messieurs, nous vous remercions pour vos interventions fort intéressantes sur ces questions
Audition de Mme Véronique Séhier, coprésidente du Mouvement français pour le Planning familial, et de Mme Danielle Gaudry, membre du bureau national
Compte rendu de l’audition du 13 janvier 2015
Présidence de Mme Conchita Lacuey,vice-présidente
Mme Conchita Lacuey, présidente. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd’hui Mme Véronique Séhier, coprésidente, avec Carine Favier, du Mouvement français pour le Planning familial, et Mme Danielle Gaudry, membre du bureau national, qui vont nous exposer leur point de vue sur le projet de loi relatif à la santé. Ce plaisir est d’autant plus grand qu’elles nous font l’honneur d’être parmi nous à quelques jours de l’anniversaire de la loi Veil sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Le droit à l’avortement a évolué depuis quarante ans, nous avons su le consolider et le réaffirmer, et nous ne devons jamais le considérer comme acquis. La ministre de la santé a permis la prise en charge à 100 % de l’IVG : c’était une des promesses fortes de François Hollande en faveur du droit des femmes.
Madame Séhier, militante depuis 1978, vous avez été élue coprésidente du Planning familial début février 2013. Également membre du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), vous êtes particulièrement impliquée dans la lutte contre les stéréotypes et les violences de genre. Vos remarques et analyses sur les sujets que vous traitez au quotidien nous sont donc très précieuses.
Le projet de loi relatif à la santé, qui sera examiné à la fin du premier trimestre de cette année, s’inscrit dans la continuité de certains articles de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il comporte des dispositions relatives à la réduction des inégalités de santé, à l’accès aux soins et à la prévention. Il propose, par exemple, de lever les restrictions existantes sur l’accès à la contraception d’urgence des élèves du second degré auprès de l’infirmerie scolaire, et de faciliter l’accès à l’IVG par voie médicamenteuse en permettant aux sages-femmes de réaliser cet acte.
Nous allons donc écouter vos pistes de réflexion et vos propositions. Mais avant tout, j’ai une pensée particulière pour Simone Iff qui nous a quittés récemment. Élue à la tête du Mouvement français du Planning familial en 1973, Simone Iff a mené toute sa vie un combat avec les femmes et pour les femmes, et nous ne pouvons que saluer sa participation essentielle à la lutte pour le droit à l’avortement, à la lutte contre le viol et les violences faites aux femmes. Membre du cabinet de la ministre des droits de la femme, Yvette Roudy, de 1981 à 1986, elle fut en particulier à l’initiative de la création de la permanence « Viol, Femme, Information ». Militante, féministe déterminée et passionnée dans sa défense des droits des femmes, dans son combat pour leur émancipation, pour l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les stéréotypes, ses idées continueront à nous guider car elles sont les préalables indispensables à la construction d’une société libre et égalitaire.
Mme Véronique Séhier, coprésidente du Mouvement français pour le Planning familial. Nous vous remettrons le DVD d’un film que le Planning familial a réalisé à l’occasion de l’université d’été que nous avons tenue en mai 2014, dans lequel Simone Iff témoigne de son expérience et de ses combats.
Dans le cadre du projet de loi relatif à la santé, il nous semble important de renforcer la prévention et la promotion de la santé, de lutter contre les inégalités, notamment en milieu scolaire, de dépasser le décloisonnement entre prévention, soins et sécurité sanitaire, mais aussi de renforcer la démocratie sanitaire. Cette approche globale, le Planning familial la défend depuis longtemps, ce qui nous avait amenés à remettre à Mme Catherine Coutelle et à M. Christophe Sirugue un document illustrant le millefeuille qui prévaut actuellement dans la prise en charge des personnes.
En matière de sexualité, cette approche globale doit inclure à la fois la prévention et l’accès aux structures. Ainsi, une jeune fille qui vient demander une contraception doit également pouvoir bénéficier d’un dépistage. Or actuellement, il y a des lieux pour le dépistage et des lieux pour l’accès à la contraception, sans compter l’existence d’inégalités territoriales très importantes en matière d’avortement.
La place des sages-femmes est essentielle, mais nous regrettons que le projet de loi limite leur action à l’IVG médicamenteuse. En effet, certains territoires vont souffrir d’un déficit important de médecins, en raison des départs en retraite, en particulier en milieu rural.
Nous nous sommes appuyés sur la Conférence nationale de santé (CNS), dans le cadre de laquelle des jeunes ont travaillé plus particulièrement sur certaines recommandations, que nous n’avons pas retrouvées dans la loi.
Une question importante est de savoir comment va s’articuler cette loi avec la réforme territoriale. La santé sexuelle, entendue au sens de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), intègre toutes les questions relatives à la sexualité, mais aussi à l’éducation, aux stéréotypes, tout ce qui permet aux femmes et aux hommes de vivre leur sexualité de façon libre et épanouie, de faire les choix qui leur conviennent. D’où la nécessité de travailler à la fois sur l’éducation, la prévention et l’accès aux soins.
La loi de 2001 prévoit l’éducation à la sexualité depuis le plus jeune âge, c’est-à-dire dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, avec un volet contraception pour les mineures, dans la confidentialité si elles le souhaitent. Or cette loi n’est pas réellement appliquée, car les centres de planification, qui dépendent des conseils généraux, se répartissent de façon très inégale sur le territoire : ces derniers s’investissent en effet de manière très différente sur la question de la sexualité des jeunes, qui est un sujet tabou chez certains partenaires.
Dans ce contexte, un grand nombre de jeunes n'ont pas accès à la contraception gratuite en centre de planification. Ce problème se pose de manière aiguë pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans en situation de précarité. En effet, comme le montre l’enquête de Nathalie Bajos de mai 2014, des personnes arrêtent leur contraception pour des raisons économiques.
Ainsi, l’accès à la contraception est problématique non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les femmes en difficulté financière. Elle l’est aussi pour les femmes ayants droit d’un concubin ou d’un père, qui ne souhaitent pas que leur contraception soit connue. Dans les territoires ruraux, le fait de devoir présenter sa carte Vitale au médecin ou à la pharmacie du village est un frein à l’accès à la contraception. Ce qui pose la question de la confidentialité.
Le projet de loi de santé prévoit la généralisation du tiers payant, ce qui constitue un réel progrès, mais nous regrettons qu’il n’aille pas jusqu’au bout en matière de confidentialité. J’ajoute que la contraception devrait être gratuite, car le reste à charge constitue un frein à l’accès à la contraception pour les femmes qui n’ont pas de mutuelle.
Mme Danielle Gaudry, membre du bureau national du Planning familial. Le droit à la confidentialité s’applique à la contraception, mais aussi au traitement des infections sexuellement transmissibles (IST). Or les femmes ayants droit, qu’elles soient jeunes majeures ou sans droit propre, se trouvent dans une situation problématique dans la mesure où des documents (bordereaux ou sur le site Ameli de l’Assurance maladie) assurent une traçabilité de l’acte. Ainsi, dans la plupart des établissements hospitaliers, conformément à la règle de l’ « identito-vigilance », lorsqu’une personne se présente à l’accueil pour une hospitalisation, on lui ressort l’historique de ses hospitalisations. Cela signifie que la confidentialité n’existe plus car la personne accompagnante ou la famille peut découvrir un acte que la jeune femme souhaitait garder confidentiel. Nous avons souligné ce problème auprès d’agences régionales de santé (ARS), qui nous renvoient sur les caisses primaires d’assurance (CPAM) et les hôpitaux
Mme Véronique Séhier. Le projet de loi relatif à la santé comporte un volet sur le dépistage des IST. Il cite les centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) comme lieux de ressources, mais pas les centres de planification. Or certains centres de planification permettent une prise en charge globale.
Mme Danielle Gaudry. La « loi Calmat » de 1990 indique pourtant que les centres de planification assurent le dépistage et le traitement des IST.
Présidence de Mme Catherine Coutelle, présidente.
Mme Véronique Séhier. Selon nous, les questions d’accès à la contraception et d’accès aux soins ne devraient pas être trop médicalisées. Nous pensons utile de s’appuyer sur des lieux existants où des professionnels formés, notamment sur leurs propres représentations par rapport à la sexualité des jeunes, pourraient accueillir les personnes afin de répondre à leurs questions et de les orienter correctement. Cette piste rejoint les dispositions du projet de loi relatives au service territorial de santé. Dans les territoires ruraux, ces lieux pourraient être les maisons de santé notamment. En travaillant en réseau, ces personnes ressources, volontaires et formées, recevraient les personnes dans les mêmes conditions que dans un centre de planification ou un CDAG. Des expériences de ce type sont menées en Alsace et dans l’Hérault.
Le problème actuellement est que toutes ces questions sont appréhendées à des niveaux différents. La contraception relève des conseils généraux, qui s’en saisissent ou pas, puisqu’elle est intégrée dans leur politique de protection maternelle et infantile (PMI). Une piste consisterait donc à séparer ce qui relève de la protection maternelle et infantile de ce qui relèverait d’une politique de santé sexuelle – les femmes ne sont pas que des mères ou des futures mères !
J’insiste sur l’importance de l’approche globale pour permettre une prise en charge à la fois de la contraception, des IST et de l’IVG. Car les conseils généraux ne se saisissent pas de la politique de planification familiale de la même manière, si bien que les politiques départementales peuvent être très hétérogènes au sein d’une même région. Cela entraîne des inégalités importantes sur le territoire.
Le VIH-sida et l’IVG relèvent de l’État, mais certains conseils généraux se sont saisis de cette compétence. Celle-ci est donc totalement morcelée, si bien que certaines jeunes filles ne peuvent pas avoir accès à la contraception et au dépistage dans le même lieu. Sans compter les inégalités, certains lieux de dépistage étant accessibles facilement, quand d’autres ne sont ouverts que deux fois par mois deux heures l’après-midi.
Mme Danielle Gaudry. Comme Véronique Séhier l’a souligné, nous regrettons que le projet de loi de santé limite l’action des sages-femmes à l’IVG médicamenteuse. Actuellement, une première consultation pour une demande d’IVG réalisée auprès d’une sage-femme n’est pas reconnue comme première consultation, et la consultation post-IVG n’est pas autorisée aux sages-femmes. Or ces professionnel-le-s savent faire des choses beaucoup plus compliquées, comme les consultations de déclaration de grossesse ou encore les consultations post-natales. Il convient donc de réfléchir aux nouvelles missions des sages-femmes et à leur parcours de formation. Je précise que la formation des médecins est légère dans ce domaine.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. L’IVG instrumentale doit être réalisée en établissement, et non dans un cabinet.
Mme Véronique Séhier. Actuellement, la loi exige qu’elle soit réalisée à l’hôpital. En Belgique, les centres de planning familial réalisent à la fois les IVG médicamenteuses et les IVG par aspiration, grâce à une convention avec un établissement hospitalier. Cet acte ne nécessite pas un plateau technique important. Cette réponse de proximité permet aux femmes de ne pas faire des kilomètres pour accéder à l’IVG de leur choix.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Existe-t-il des évaluations sur les risques ?
Mme Danielle Gaudry. Selon les dernières recommandations de l’OMS en matière de bonnes pratiques, l’IVG ne requiert pas de plateau technique lourd, et cet acte peut être réalisé par les professions de santé intermédiaires. Dans un grand nombre de pays, comme les Pays-Bas ou la Belgique, la plupart des IVG chirurgicales sont pratiquées non en établissement hospitalier, mais dans des centres de santé. Des conventions sont passées entre ces centres de planification ou centres de santé et les établissements hospitaliers, lesquels s’engagent à prendre en charge les femmes en cas de complications.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Notre pays comporte très peu de centres de santé et ils sont essentiellement situés en centre urbain.
Mme Danielle Gaudry. De nombreux établissements de proximité ont vu leur service de chirurgie fermer, mais ont maintenu les soins primaires. Or l’IVG est un soin de santé primaire. C’est une piste que je vous soumets.
Mme Véronique Séhier. L’idéal serait des lieux de proximité et de prise en charge globale, qui traitent de la contraception et du dépistage, tout en assurant la confidentialité.
La confidentialité est une question cruciale. Le tiers payant est une bonne piste pour réduire les inégalités, mais les jeunes mineures doivent présenter la carte Vitale de leurs parents, ce qui constitue un frein à l’accès à la contraception. Dans un territoire rural que je connais, où le centre de planification ne fonctionne pas, faute de personnels, des médecins, avec lesquels nous avons travaillé sur la sexualité des jeunes, sont prêts à accueillir dans leur cabinet les jeunes dans les mêmes conditions que dans un centre de planification, mais ils ne peuvent pas le faire dans la confidentialité.
Je rappelle que les centres de planification sont censés accueillir des personnes mineures, mais aussi des personnes qui souhaitent préserver la confidentialité ou qui n’ont pas accès aux soins pour des raisons diverses.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Il faudrait peut-être imaginer pour les mineures une carte Vitale personnelle.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. On pourrait étendre le Pass contraception à toutes les régions !
Mme Véronique Séhier. Quand bien même ils ont déjà parlé de sexualité avec leurs parents, les jeunes n’ont pas envie de parler avec eux de leurs premiers rapports sexuels au moment où ils se produisent – ils en parlent plus tard. Nous avons même rencontré dans des centres du Planning familial des jeunes désireux d’échapper à la pression de la mère leur demandant de prendre la pilule dès leur seizième année. Il est très important de prévoir des espaces de liberté qui garantissent la confidentialité pour tous et toutes sur les questions de sexualité.
Mme Danielle Gaudry. Dans le cas d’une IVG pratiquée en médecine de ville, des dispositions légales prévoient une prise en charge totalement anonyme et gratuite pour les jeunes filles mineures sans consentement parental. Pour ce faire, la feuille de soins remplie par le médecin et le relevé de remboursement transmis par l’assurance maladie sont aménagés de façon à préserver la confidentialité de l’acte d’IVG. Ainsi, la feuille de soins ne comporte pas le nom de la jeune fille, mais un numéro spécifique anonyme IVG – un code par département, qui permet ensuite au médecin d’être payé de la première consultation pour une IVG. Le médecin informe les patientes de ces modalités lors de la première consultation médicale préalable. Ce dispositif est donc payé par le département, qui se fait ensuite rembourser en partie. Pourquoi ne pas appliquer ce dispositif à la contraception ?
Mme Véronique Séhier. Le codage existe également en pharmacie pour la contraception d’urgence gratuite. Les pharmaciens peuvent ensuite être remboursés.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Êtes-vous favorable à l’accès aux pilules progestatives sans ordonnance pour les jeunes filles ?
Mme Danielle Gaudry. Il n’y a pas de contre-indication à ces pilules, ni de suivi spécifique.
Mme Véronique Séhier. Parmi les professionnels de proximité, les infirmières scolaires ont un rôle à jouer, à condition que les établissements scolaires aient les budgets nécessaires pour acheter les contraceptions d’urgence.
J’insiste sur l’importance de s’appuyer sur des professionnels. Car si des jeunes vont sans problème s’adresser à l’infirmière scolaire pour demander une contraception d’urgence, d’autres refusent de le faire par crainte d’une rupture de confidentialité. D’où l’importance des réseaux de proximité. Il s’agirait de repérer autour d’un établissement scolaire les professionnels volontaires qui exerceraient dans les mêmes conditions que dans les centres de planification et vers lesquels seraient orientés les jeunes. D’autant que certaines jeunes femmes souhaitent un mode de contraception non visible – implant ou stérilet –, ce qui nécessite une intervention médicale. Ainsi, différentes solutions seraient offertes aux jeunes.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Ne pensez-vous pas utile de prévoir, en début d’année scolaire, une intervention pour informer les jeunes lycéens de l’aide que peut leur apporter l’infirmière scolaire et de leur droit à la confidentialité ?
Mme Véronique Séhier. Les séances d’éducation à la sexualité dans les établissements scolaires sont aussi des espaces d’information.
Mme Conchita Lacuey. Quelles difficultés rencontrez-vous en milieu scolaire ?
Mme Véronique Séhier. Une pétition de l’association Droit de naître demandant de mettre fin à l’intervention du Planning familial en milieu scolaire, au prétexte qu’il fait la promotion de l’avortement, a été envoyée à Mme Vallaud-Belkacem.
À l’heure actuelle, l’éducation à la sexualité dans les établissements est dispensée plutôt en direction des élèves de quatrième et de troisième en lien avec le chapitre sur la fécondation. Le Planning familial intervient à la demande des établissements. Ce travail d’information doit intégrer non seulement les questions de sexualité, mais aussi l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité entre les différentes sexualités, la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle.
Certains établissements ont inscrit ce travail dans leur projet d’établissement. Pour avoir travaillé avec plusieurs d’entre eux, j’ai pu constater des avancées grâce à l’investissement des enseignants. Il faut donc encourager les proviseurs et les principaux à mener de telles actions, car l’infirmière scolaire ne peut pas tout faire toute seule. Les blagues homophobes dans les couloirs, par exemple, c’est l’affaire de tout l’établissement et non d’une seule personne.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Cette action dans les établissements est d’autant plus importante qu’elle peut permettre d’éviter des suicides !
Mme Véronique Séhier. J’ai évoqué tout à l’heure la réforme territoriale car, à l’heure actuelle, certains conseils généraux et régionaux s’investissent beaucoup plus que d’autres en faveur des séances d’éducation à la sexualité dans les établissements, ce qui génère des inégalités territoriales très importantes. Il n’est pas admissible que des jeunes n’aient pas accès à cette information. De la même manière, les plateformes téléphoniques sur l’avortement et la contraception n’existent pas dans toutes les régions.
Il est donc important que l’information circule par divers moyens. Certaines personnes privilégieront le contact téléphonique, d’autres préféreront faire des recherches sur Internet, d’autres encore auront besoin de rencontrer des adultes en capacité de répondre à leurs questions. D’où la nécessité d’avoir des professionnels formés et volontaires. Des médecins et des sages-femmes sont prêts aujourd’hui à s’investir. Le problème est de trouver les méthodes permettant d’appliquer cette politique publique sur l’ensemble du territoire, quels que soient les financeurs. La loi devrait s’appliquer de la même manière partout !
Conformément à la législation, les femmes étrangères ont, elles aussi, accès à l’IVG. Or la loi ne s’applique pas de la même façon d’un hôpital à l’autre, certaines femmes se voyant demander de payer l’intervention.
Mme Danielle Gaudry. Au surplus, ces femmes ne bénéficient pas de l’aide médicale d’État (AME), car certains hôpitaux ne font pas la démarche, préférant demander aux femmes le paiement de l’acte par chèque, ce qu’elles ne peuvent pas faire puisqu’elles sont généralement sans papiers. Ce sont donc les associations qui établissent les chèques. Je précise que le ministère a rappelé à l’ordre les hôpitaux de Marseille sur ce sujet.
Mme Véronique Séhier. Nous vous enverrons notre document qui montre le millefeuille des dispositifs existants.
En résumé, les questions de santé sexuelle doivent faire l’objet d’une approche globale, afin de permettre un accès égal aux droits. Ces questions ne se limitent pas aux soins, elles concernent aussi bien la prévention, que l’éducation, l’accès aux soins et aux traitements, et le dépistage.
Par conséquent, nous aimerions que le projet de loi soit amélioré sur plusieurs points. S’agissant de l’infirmerie scolaire, il ne devrait pas se limiter à la contraception d’urgence. S’agissant des IST, il nous semble très important de citer les centres de planification qui sont justement des lieux permettant un accès à la santé sexuelle. Sur l’IVG, il faudrait prévoir un accès dans la proximité et reconnaître la place des sages-femmes pour toutes les IVG – médicamenteuses et par aspiration –, car il est indispensable de garantir aux femmes le droit de choisir la méthode. Cela éviterait que les IVG médicamenteuses jusqu’à un terme très avancé se multiplient, ce qui suppose de renforcer la formation des professionnels. Enfin, le projet de loi doit prendre en considération, en plus des mineures, les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans qui peuvent renoncer à des soins et à la contraception pour des raisons d’inégalités sociales et économiques.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Qu’en est-il des services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS) ?
Mme Véronique Séhier. Ils délivrent uniquement la contraception d’urgence.
Mme Danielle Gaudry. La médecine universitaire est uniquement préventive. En dehors de la contraception d’urgence, les étudiants ne bénéficient pas de prescriptions. Il faudrait donc revoir les missions des SIUMPSS.
Mme Véronique Séhier. Toutefois, les SIUMPSS qui ont ouvert un centre de planification sont devenus des centres de santé. Le développement de cette formule sur tout le territoire serait une bonne chose.
La santé des étudiants est une grande préoccupation, mais il ne faut pas oublier tous les autres, les jeunes en apprentissage notamment. Voilà pourquoi nous prônons une approche globale renforcée pour le projet de loi de santé.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Merci beaucoup, mesdames.
Audition de M. François Bourdillon, directeur général de l’Institut national pour la prévention et l’éducation à la santé (INPES) et de l’Institut de veille sanitaire (InVS), vice-président du Conseil national du sida
Compte-rendu de l’audition du 27 janvier 2015
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Monsieur le directeur général, merci d’être venu nous parler de la problématique « santé et femmes », sur laquelle vous avez coordonné deux ouvrages : Mieux prendre en compte la santé des femmes et Violences faites aux femmes et santé.
Les femmes ont une plus grande longévité que les hommes, et l’on a tendance à penser qu’elles sont en meilleure santé plus longtemps. Mais cela ne correspond pas à leur ressenti. En outre, il y a de grandes disparités parmi les femmes, selon leur origine et leur niveau de ressources. Pour certaines, l’accès aux soins est plus difficile que pour les hommes. Enfin, il y a des maladies spécifiques aux femmes.
Nous voudrions enrichir le projet de loi relatif à la santé dans plusieurs domaines susceptibles d’intéresser les femmes : la prévention, la santé reproductive, le vieillissement, certaines maladies spécifiques ou mal prises en compte. Nous nous sommes aperçus, par exemple, à l’occasion du débat sur les retraites, lorsque l’on a discuté du critère de pénibilité, que les postures féminines ne sont pas considérées de la même façon que les postures masculines. C’est ainsi qu’une aide-soignante travaillant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne dit jamais qu’elle fait un métier pénible, alors même qu’elle peut porter des personnes de 80 kg ; en revanche, un homme travaillant dans le bâtiment considère qu’il fait un métier pénible parce qu’il porte des sacs qui sont lourds. Mais nous savons également que l’Institut national pour de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) réalise des campagnes de prévention. C’est un aspect important, qui mériterait peut-être d’être développé dans le projet de loi.
M. François Bourdillon, directeur général de l’INPES et de l’Institut de veille sanitaire (InVS). Merci, madame la présidente, pour votre invitation à venir parler de la santé des femmes. C’est un sujet important en termes de santé publique, à mon sens très insuffisamment porté. Précédemment, dans le cadre de la chaire « santé » de Sciences Po, nous nous étions dit, Didier Tabuteau et moi-même, qu’il fallait formaliser un certain nombre de savoirs : d’où les deux séminaires, que j’ai présidés en 2012 et 2013, concernant la santé des femmes, d’une part, et les violences faites aux femmes, d’autre part.
Je me permettrai de faire d’abord une synthèse sur ma vision de la santé des femmes, puis j’aborderai plus spécifiquement ce que fait l’INPES en matière de prévention et de santé.
Vous l’avez souligné, on a d’abord une vision positive de la santé des femmes. Celles-ci ont une plus grande espérance de vie, et des comportements plus favorables à la santé. Est-ce que les obligations liées à la santé reproductive font qu’elles vont voir plus souvent le médecin et qu’elles sont plus attentives à leur corps ? En tout cas, elles mangent moins. Maintenant, sont-elles ou se perçoivent-elles en bonne santé ? Il peut y avoir un décalage entre la santé réelle et la santé ressentie. Peut-être se sentent-elles plus souvent malades que les hommes, ce qui expliquerait qu’elles consultent davantage ? Les épisodes dépressifs sont en effet plus fréquents chez les femmes.
Précisons tout de même que si j’ai fait une distinction entre les hommes et les femmes, je pourrais aussi en faire une entre les femmes, et en fonction des catégories professionnelles. Il y a un vrai gradient d’inégalité entre les classes socioéconomiques les moins favorisées et les plus favorisées. Cette inégalité est toujours défavorable pour les premières, sauf peut-être pour l’alcool, car les femmes de catégories socioprofessionnelles les plus élevées boivent davantage que les autres.
Souvent, quand on parle santé des femmes, on pense santé reproductive. Je préfère procéder autrement et commencer par le problème du tabagisme. L’année 2015 – ou 2016 – sera probablement celle où se croiseront la courbe des cancers du poumon et celle des cancers du sein. En d’autres termes, les cancers du poumon vont devenir plus fréquents que les cancers du sein. Je vous laisserai le document que j’avais préparé pour la Haute autorité de santé (HAS), et où figurent ces courbes.
C’est un vrai souci, dans la mesure où les femmes rattrapent les hommes en matière de tabagisme. Elles sont pratiquement autant, dès le plus jeune âge, à entrer dans le tabac – en 2010, entre douze et quinze ans, 5,2 % de filles et 4,9 % de garçons. Nous aurons probablement les nouveaux chiffres dans quelques semaines, à l’INPES, qui donneront les consommations par tranche d'âge. Le phénomène est toutefois très inquiétant, surtout quand on connaît les conséquences que peut avoir chez les femmes la consommation de tabac – cancers, maladies cardiovasculaires, et prématurité concernant les femmes enceintes.
L’alcoolisme pose lui aussi un vrai problème de santé publique, d’ailleurs très minimisé dans notre pays. Certes, les femmes consomment clairement moins d’alcool que les hommes. Reste que l’on estime les syndromes d’alcoolisation fœtale entre 700 et 3 000 enfants par an, c’est-à-dire 5 pour 1 000 naissances, ce qui est loin d’être anodin.
Après le tabac et l’alcool, venons-en à la nutrition. L’augmentation de la prévalence de l’obésité – comme chez les hommes et les garçons – constitue une menace pour l’avenir des femmes concernées.
Avant de rentrer dans les problématiques de santé reproductive – même si cela a à voir avec le système génital – j’aborderai la question du dépistage des cancers, ceux du sein et de l’utérus étant l’un et l’autre très fréquents.
Nous avons une politique affirmée de dépistage des cancers féminins. Le dépistage du cancer du sein touche aujourd’hui 53 % des femmes dans le système organisé par les pouvoirs publics, et 10 à 11 % dans le système libéral – plus le niveau social augmente, et plus les femmes sont nombreuses à s’adresser au système libéral. Ce dispositif permet de dépister tôt et donc de faire traiter les personnes concernées. Par ailleurs et surtout, le dépistage organisé est un outil majeur de réduction des inégalités sociales de santé, dans la mesure où toute femme peut y accéder gratuitement avec des critères de qualité très largement définis. Des polémiques sont nées, notamment sur les risques de « surdiagnostic », mais honnêtement je crois que c’est une bonne politique qu’il faut soutenir.
J’observe toutefois que les inégalités de santé peuvent être aussi bien géographiques que sociales ; elles vont même souvent de pair. Par exemple, la personne qui habite à une heure trente du lieu de rendez-vous, si elle veut s’y rendre, risque de perdre une demi-journée de travail. C’est ce qui amène certaines femmes, les moins favorisées, à ne pas se faire dépister.
J’en viens à la santé reproductive et au problème posé par les grossesses non désirées et les interruptions volontaires de grossesse (IVG). On compte environ 225 000 IVG par an, ce qui est considérable. Selon les associations féministes, c’est parce que nous sommes dans un pays où les IVG sont possibles que leur nombre est élevé. Reste que ce nombre nous interpelle sur la qualité et les modes de contraception. Or – en dehors des généralistes et des gynécologues obstétriciens – on a eu longtemps beaucoup de mal à en parler officiellement dans notre pays, et l’INPES s’en est tardivement préoccupé. Je crois qu’avant 1980, il n’y a pas eu de parole sur la contraception, et que la première campagne de l’INPES sur le sujet remonte à 2007.
À partir de ce moment-là, la parole a été portée régulièrement et de manière positive et changeante. Il est en effet très important de sortir du message « éducation sanitaire » classique du dépliant, et de centrer la communication sur des thématiques en variant celles-ci.
C’est ainsi que la campagne de 2007 disait : « La meilleure contraception, c’est celle que l’on choisit ». Celle de 2008 était centrée sur les adolescents. Celle de 2009 affichait : « Les enjeux de la contraception interpellent aussi les hommes ». Ensuite, il y eut une campagne adressée aux adolescents sur les risques de grossesse précoce.
Le slogan de celle de 2012 était : « Certaines femmes pensent à leur pilule, quoi qu’il arrive. Vous avez tendance à l’oublier : il existe d’autres dispositifs plus adaptés. » On commençait en effet à se dire qu’il existait d’autres contraceptifs que la pilule. La campagne de mai 2013 visait d’ailleurs à informer sur la diversité en matière d’offre contraceptive, avec pour slogan : « La contraception qui vous convient existe ». Et le slogan de celle de juillet 2014 était : « Elle a osé changer de contraception. Cela commence toujours par un dialogue ».
Cela montre le travail d’organisation de l’INPES. Son site, très dynamique, permet à tout un chacun de s’informer et de trouver de l’information. On n’est pas loin de ce que l’on va retrouver dans la loi sur le service public d’information en santé (SPIS), avec un système d’information en santé pour les usagers. Selon moi, notre site à l’INPES sur la contraception pourrait faire partie de ce nouveau portail d’information pour les usagers du système de santé.
À côté de la vision « contraception », il y a une vision « santé sexuelle », au sens positif du terme, centrée sur les adolescents et les adolescentes qui entrent dans la sexualité. D’où la mise en place du site www.onsexprime.fr, et des webséries : « PuceauX » ou « Questions d’ados », où l’on aborde la première fois, comment cela se passe, avec des outils relativement ludiques. Mais il faut aller sur le site pour se rendre compte de ce que cela donne.
Toute une série de modules peuvent être accrochés à ces sites. Je pense au module « les recettes du plaisir », qui donne une vision très positive de la sexualité, qui n’est pas uniquement basée sur les gonocoques, les chlamydias et autres infections sexuellement transmissibles (IST), et au module « puberté ». Pour autant, il ne faut pas baisser la garde devant les IST et continuer d’informer, notamment sur le VIH, qui est la plus grave d’entre elles.
L’INPES a franchi un cap important en faisant de la communication ciblée sur la diversité, par exemple sur l’orientation sexuelle – et donc sur l’homosexualité et les lesbiennes – ou sur les migrants. Je ne pense pas que cela ait suscité de scandale ou d’opprobre de la part de la société, alors qu’il s’agit de parole publique.
Ensuite, il y a des questions plus compliquées que j’aime bien porter, comme le dépistage des IST, que l’INPES essaie de développer. On y a testé quelque chose d’assez original, le site « Chlamyweb », où on utilise l’outil internet pour promouvoir l’autodépistage : les femmes, lorsqu’elles sont atteintes de chlamydia, n’ont pas de symptôme ; donc, elles se dépistent elles-mêmes. Elles envoient leur prélèvement au laboratoire qui donnera les résultats. Cette stratégie a multiplié par quatre le nombre de résultats positifs. Selon moi, de telles procédures permettraient de limiter ce type d’IST et de réduire demain le nombre des cas de stérilité. En effet, les IST et leur évolution à bas bruit sont une des raisons de la diminution de la fertilité.
J’observe que jusqu’à présent, on a beaucoup parlé des jeunes, de leur entrée dans le tabagisme et des risques de grossesse précoce. Mais nous sommes en train de construire par ailleurs un module « activité physique », qui intéresse aussi nos anciens. L’activité physique permet de diminuer l’ostéoporose et de lutter contre le vieillissement. Dans ce cadre, nous pourrions mettre au point une communication ciblée sur les femmes qui, en ce domaine, présentent des caractéristiques différentes de celles des hommes.
Enfin, ma collaboratrice, Mme Jennifer Davies, vous a préparé un document reprenant toutes les campagnes de contraception. Je tiens à insister sur le fait que l’INPES, sur ce type de communication, a un vrai savoir-faire. C’est un savoir-faire de parole publique, très différent de la parole militante que je respecte beaucoup, qui a sa place, mais qui est complémentaire. J’observe que sur ces questions sensibles d’IVG et de contraception, la parole de l’État, qui est une parole construite et qui a trouvé un certain équilibre à travers l’expertise, n’est pas la même que celle d’une communauté militante – dans un sens comme dans l’autre. Comme vous le savez, quel que soit le domaine, des propos d’une redoutable violence s’expriment parfois sur les sites internet.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Monsieur le directeur général, vous avez commencé par dire que dans le domaine de la santé publique, le sujet « santé et femmes » était méconnu. Connaît-on le nombre de recherches menées sur le sujet en France et en Europe ? Quels aspects mériteraient d’être abordés ou approfondis ? Peut-on parler d’une inégalité à l’égard des femmes, s’agissant de la recherche en santé ?
En revanche, vous n’avez pas du tout parlé de la santé au travail. Au moment du débat sur les retraites, nous avions cité une étude, de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) me semble-t-il, selon laquelle le travail de nuit favorisait les cancers du sein. Peut-on considérer qu’il existe un sujet santé des femmes au travail ?
Par ailleurs, vous avez terminé sur la parole publique et sur vos campagnes de communication. C’est intéressant, mais j’aimerais savoir si, au-delà, vous mesurez l’impact de ces campagnes ? J’avais assisté à celle de mai 2013, suite à la crise liée aux pilules de quatrième génération, qui avait provoqué une chute de l’utilisation de la pilule….
M. François Bourdillon. … et une modification des modes de contraception. Son impact a été totalement mesuré.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Ma permanence se trouve dans une zone d’éducation prioritaire (ZEP). Une association a fait des enquêtes, qui portaient notamment sur des femmes retraitées et âgées, logées depuis longtemps dans des logements sociaux. Or ces femmes ont énormément de difficultés d’accès à la santé, soit pour des raisons financières, soit par crainte de parler à un médecin. De la même façon, les femmes isolées en milieu rural ont du mal à consulter en matière de contraception comme en cas de violences. L’INPES s’est-il penché sur les différences sociales d’accès à la santé ? Comment améliorer cet accès ?
Enfin, selon vous, les femmes sont plus sujettes à la dépression. Peut-être est-ce le cas. Mais si les médecins dépistaient davantage de dépressions chez les femmes que chez les hommes ? N’ont-ils pas davantage tendance à dire à celles qu’ils n’arrivent pas à soigner qu’elles sont dépressives, ce qu’ils ne diraient pas à un homme ? C’est peut-être aussi le regard du médecin sur les maladies des femmes qui est en cause.
M. François Bourdillon. Il est toujours très compliqué d’interpréter les enquêtes de santé parce qu’elles sont anonymes et basées sur les diagnostics ou la santé perçue. Et encore faut-il, en santé mentale, porter les bons diagnostics et ne pas les porter par excès. Dans ce domaine, on ne dispose pas de preuve biologique ou de la preuve radiologique de l’imagerie, et on peut toujours avoir une certaine suspicion sur le diagnostic porté. Toujours est-il que très classiquement, dans les ouvrages de psychiatrie, on considère que les femmes font plus de dépressions que les hommes. Je n’en dirai pas plus car je ne suis pas psychiatre, mais médecin de santé publique. J’ajoute tout de même qu’il existe de nombreuses inégalités marquées entre les deux sexes, dans un sens comme dans l’autre. Par exemple, l’usage d’héroïne concerne trois quarts d’hommes pour un quart de femmes ; la proportion est la même pour les troubles de l’apprentissage.
Mais je m’aperçois que je n’ai pas parlé de la violence faite aux femmes, alors que j’ai écrit un ouvrage à ce sujet. Ces violences, qui sont très fréquentes et causent de nombreux décès, sont un vrai problème de santé publique. L’augmentation du nombre d’appels au 3919 permet de se rendre compte du phénomène. Elle permet aussi de mesurer la politique publique mise en place.
En épidémiologie, il faut de vrais échantillonnages pour mesurer l’ampleur d’un problème. Quand vous lancez une politique publique ou des campagnes de prévention, vous générez, soit de la notoriété autour d’une campagne, soit du trafic sur la téléphonie « santé », soit du trafic sur internet. Pour autant, est-ce un succès de campagne ? C’est toute la difficulté.
Il est donc très important de continuer à faire des coupes transversales régulières pour mesurer l’ampleur du problème, et parallèlement, quand on fait une campagne d’information et d’éducation pour la santé, de mesurer sa notoriété et le trafic qu’elle génère. À chaque fois, on doit isoler un élément de la politique de prévention pour connaître son impact. C’est la cohérence de l’ensemble qui fera la différence.
Je pourrais prendre l’exemple du tabac, qui est un vrai problème chez les femmes. On a construit des politiques, qui ont été plus ou moins dynamiques selon les périodes. Nous venons d’avoir les résultats des comportements des Français en matière de tabagisme : il y a dans notre pays un tiers de fumeurs, ce qui est littéralement catastrophique. C’est un échec de la politique publique.
Il est très important de se doter pour l’avenir de moyens épidémiologiques, et de poser régulièrement des balises – pas tous les mois, comme pour la sécurité routière, mais tous les deux ou trois ans – pour essayer de marquer l’importance des problématiques de santé des femmes. Sans données, il n’y a pas de politique publique possible, dans la mesure où le problème n’est pas identifié. Regardez ce que vient de faire l’Observatoire national du suicide, avec les données de l’InVS, de l’INPES et de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) : c’est parce que l’on identifie le problème que l’on construit, derrière, une politique publique adaptée.
C’était une des raisons des deux séminaires de Sciences Po dont je vous ai précédemment parlé. J’avais souhaité réunir une trentaine de personnes pendant quelques jours pour essayer de formaliser, dans un corpus général, l’ensemble des données relatives à la santé des femmes et aux violences faites aux femmes.
Je le reconnais, dans mon Traité de santé publique, il n’y avait pas de chapitre relatif aux femmes. Il a fallu attendre 2012, à la chaire « santé » de Sciences Po, pour que je commence à m’intéresser plus spécifiquement à la santé des femmes. J’ai alors découvert auprès de mes collègues, médecins et non médecins, y compris les gens du planning, un champ incroyablement vaste et complètement méconnu.
Les violences faites aux femmes constituent un vrai problème de santé publique, non enseigné. Le premier qui l’a fait est le professeur Roger Henrion, de la maternité Port-Royal qui, au moment de prendre sa retraite, a pris conscience de leur existence, alors qu’il était passé à côté pendant toute sa carrière d’obstétricien. Et il est devenu le porte-flambeau de violences qu’il n’interrogeait pas et qu’il ne regardait pas. Or un médecin qui ne cherche pas ne trouve pas.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Peut-être avez-vous entendu parler d’une sage-femme qui a aidé une jeune femme parce qu’elle avait constaté, au moment de l’accouchement, que celle-ci avait subi des violences ? Personnellement, j’ai du mal à comprendre. Quand une femme a des coups sur la totalité du corps ou qu’elle consulte une première fois parce qu’elle s’est cassé le bras, et une autre fois parce qu’elle a un œil au beurre noir, personne ne s’interroge ? J’ai également entendu parler d’une petite fille qui avait été violée et littéralement massacrée, ce dont pas un professionnel de santé ne s’était aperçu. C’est l’ambulancier, alerté par les pleurs de l’enfant, qui a prévenu les urgences de l’hôpital.
M. François Bourdillon. Mais il s’agit de cas extrêmes, que l’on identifie. L’Observatoire du droit des femmes a sorti un film de formation, absolument remarquable et que je vous recommande de regarder. Il raconte l’histoire d’une femme en pleurs, désespérée, qui va consulter. Il montre la manière spécifique avec laquelle les médecins peuvent interroger certains patients qui ne se dévoileraient pas d’eux-mêmes. En l’occurrence, cette femme s’était plainte de douleurs abdominales, une symptomatologie tout à fait fonctionnelle, et la consultation aurait pu se terminer avec du Spasfon et des antispasmodiques. C’est parce que le médecin l’a interrogée d’une façon spécifique qu’il a commencé à approfondir et que la femme s’est livrée et a raconté ce qui lui arrivait. Car c’est terrible de raconter, et je vous parle avec une expérience clinique : si vous ne lui tendez pas la perche, la femme ne vous parlera pas. Bien sûr, à partir du moment où elle vous parle, vous savez que vous allez vous retrouver dans des positions extrêmement inconfortables – signalement ou pas, devoir d’accompagnement, etc. Cela terrorise certains docteurs qui ne sont pas armés et qui ne savent pas où s’adresser. Voilà pourquoi toute la politique publique de violences faites aux femmes doit être construite et portée. Mais c’est loin d’être une affaire simple.
Vous m’avez également interrogé sur l’accès aux soins. Il convient de porter au bénéfice de Ségolène Royal le « Pass’contraception » qu’elle a institué en Poitou-Charentes pour permettre à tout un chacun, les filles surtout, de pouvoir consulter en ce domaine. Et avec quel succès ! À tel point qu’un certain nombre d’autres régions s’en sont emparées, élargissant parfois le « Pass’contraception » en « Pass’santé », pour que les adolescents, y compris en milieu rural, puissent consulter. Cela montre que, malgré l’aide médicale d’État (AME), les aides à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et tout un dispositif qui fonctionne de façon plutôt satisfaisante, certains obstacles persistent : l’obligation d’une avance financière, et pour les adolescents, le manque de confidentialité. En effet, il faut rappeler qu’une adolescente ou un adolescent est sur la carte Vitale de ses parents, que le remboursement se fera sur le compte de ses parents, ce qui, dans certaines situations, peut être compliqué. Ce point mériterait d’être mis en évidence.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. J’ai une question à vous poser, sur laquelle nous nous sommes interrogés. À partir de quel âge parle-t-on d’adolescence ? Tous les dispositifs – contraception, etc. – débutent à partir de quinze ans. Mais tout à l’heure, sur un autre sujet, vous nous avez parlé d’adolescents de douze ans. J’ai été auditionnée par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et il semble que tout le monde prennent comme référence l’âge de quinze ans, considéré comme étant l’âge de la maturité sexuelle.
Qu’en pensez-vous ? Est-ce que le fait de permettre aux jeunes de bénéficier plus tôt de ces dispositifs ne risque pas d’être mal pris par les parents ? Ils pourraient penser qu’on encourage leurs enfants à avoir des rapports sexuels plus tôt.
Mme Édith Gueugneau. Monsieur le directeur général, dans un avis sollicité par la ministre de la santé en 2013, le Conseil national du sida (CNS) a estimé que la sensibilité des autotests serait relativement moins satisfaisante que celle des autres tests. Pouvez-vous nous préciser dans quelles proportions ? Quels sont, d’après vous, les outils « à distance » les plus efficaces ?
Ensuite, combien de personnes supplémentaires ce dispositif permettra-t-il de dépister ? Pensez-vous qu’il permette de dépister plus facilement le VIH chez les femmes, qui se sentent malheureusement moins exposées ?
Enfin, quel est, selon vous, l’impact que les salles de consommation à moindre risque peuvent avoir sur les femmes ? Car c’est un outil de prévention majeur, qui a fait ses preuves à l’étranger.
M. François Bourdillon. Il est bien compliqué de préciser l’âge de l’adolescence. Honnêtement, il est très fluctuant. C’est un peu comme en épidémiologie, avec les intervalles de confiance qui permettent d’identifier le degré de certitude d’un résultat. Dans les départements français d’Amérique ou les départements d’outre-mer, l’âge de la sexualité est plus bas qu’en métropole, et les grossesses chez les mineures sont assez fréquentes. Cela nous invite à porter une attention très particulière sur certaines populations spécifiques.
Cela m’amène à évoquer le « parcours éducatif en santé », instauré par la ministre de la santé dans le projet de loi. Il vise à éduquer les enfants en santé tout au long de leur parcours scolaire, et de leur donner des compétences psychosociales : pour les filles, savoir dire non à un garçon ; dire non à une cigarette, ce qui est tout aussi important, etc. Il faudrait pouvoir aller au-delà du cours de biologie reproductive et donner une vision dédramatisée de la sexualité ; celle-ci ne se limite pas au risque de VIH et d’IST, c’est aussi un plaisir de la vie. C’est tout ce savoir qu’il faudra construire demain. C’est le travail des enseignants.
Mais il y a aussi, derrière, le travail des infirmières scolaires. Celles-ci peuvent délivrer une contraception d’urgence, et doivent pouvoir orienter les élèves. Le dispositif mérite d’être soutenu et accompagné. L’infirmerie est un lieu de parole, notamment dans les lycées professionnels et dans les zones rurales. Les infirmières scolaires sont des professionnelles de santé qui, bien formées, peuvent apporter un certain nombre de réponses aux enfants.
J’ai envie de dire qu’il faudrait sortir de l’éducation sanitaire classique pour rentrer dans une éducation de parcours de santé permettant de renforcer les compétences psychosociales des élèves.
Madame la députée, vous m’avez parlé des autotests, et donc du dépistage du VIH. J’ai parlé tout à l’heure des « Chlamyweb », c’est-à-dire du dépistage à distance par internet, qui me paraissaient apporter une certaine modernité dans les rapports de dépistage.
Le dépistage du VIH a été construit dès le début sur un paradigme fort qui est son caractère volontaire : vous avez pris un risque, vous le savez, vous voulez connaître votre sérologie, vous allez voir votre médecin ou vous allez vous faire dépister dans un centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG). Dans un centre de dépistage anonyme et gratuit, vous verrez un médecin qui vous dira quels risques vous avez pris. Cet échange est un moyen de renforcer le discours préventif sur l’utilisation du préservatif ou d’autres modes de protection. J’observe que le dispositif de dépistage anonyme et gratuit est plus performant que le dispositif général chez les médecins – même si ceux-ci effectuent aujourd’hui 85 % des tests.
Pour autant, on a remis en cause le dogme du dépistage volontaire, et l’on s’est demandé si l’on était capable de proposer des tests à des populations que l’on ne touchait pas.
On a d’abord essayé de voir si, avec des tests rapides, qui peuvent être faits au bout du doigt par des professionnels de santé ou des personnes du milieu associatif, on toucherait la communauté homosexuelle, la communauté migrante, certaines femmes qui ne se dépisteraient pas, voire les personnes défavorisées. Je me rappelle qu’à la Pitié-Salpétrière, dans le cadre de la consultation PASS (permanence d’accès aux soins de santé) buccodentaire, on avait proposé des tests rapides. On n’avait pas dépisté de VIH, mais 6 hépatites dans la matinée, ce qui nous avait laissés pantois. Cela prouve l’intérêt de la démarche.
Aujourd’hui, les outils deviennent de plus en plus performants. Les meilleurs tests – sensibilité, spécificité – sont des tests sanguins. Les tests rapides sont quant à eux de très bonne valeur et, en tout cas, n’ont guère que deux à trois ans de retard par rapport aux tests les plus efficaces. On a fait tellement de progrès qu’on peut envisager des tests qui seront faits de manière individuelle pour se dépister : les fameux autotests qui doivent vous permettre de vous dépister chez vous – tests radiculaires à l’aide de la salive ou sanguin, au bout du doigt. Une question se pose néanmoins. Vous faites votre test à trois heures du matin et il est positif : que faites-vous ?
La question est difficile, mais un certain nombre d’éléments amènent à penser que ce type de dépistage a une place, et qu’il faut l’occuper. Aujourd’hui, tout un pan de la population, en particulier dans la communauté homosexuelle masculine, ne se fait pas dépister. Cela est dû au fait, comme on l’a évoqué à de multiples reprises au sein du Conseil national du sida (CNS), que dans des petites villes on hésite à se rendre au laboratoire parce qu’on est connu – on risque de se faire repérer et identifier dès que l’on en passe la porte.
L’argument du CNS est qu’il faut développer l’ensemble de la palette de dépistage. Pour ma part, je suis très favorable au développement des autotests. Maintenant, un accompagnement s’impose – dépliants, numéros d’appel, téléphonie santé – si l’on veut que le dispositif fonctionne.
Maintenant, la question des salles de consommation à moindre risque, qui figure dans le projet de loi relatif à la santé et suscite un débat passionnant, n’est pas spécifique aux femmes. Pour moi, en tant que professionnel de santé publique, ces salles de consommations font partie de la palette. Ce n’est pas le dispositif majeur, mais pour les personnes les plus « désinsérées » et les plus en difficulté, c’est une bouée de sauvetage qui a fait preuve de son efficacité. D’ailleurs, honnêtement, leur création ne constitue pas une vraie transgression de la loi de 1970. Personnellement, j’y suis très favorable.
Enfin, je connais moins le sujet de la santé au travail même si, de par mon expérience clinicienne, j’y suis assez sensible. De nombreuses aides-soignantes ou aides à domicile qui portent les personnes âgées souffrent de lombalgies car elles ne sont pas taillées pour faire ce travail. Pour autant, faut-il que cette catégorie de salariés bénéficie d’un compte personnel de prévention de la pénibilité ? Cela mérite d’être expertisé.
À l’InVS, cinquante personnes se penchent sur la santé au travail. Un de leurs métiers est d’identifier l’exposition aux risques. Sont surtout visés les polluants et les produits toxiques, mais ce type de contraintes pourrait parfaitement être intégré dans le suivi de certaines de nos cohortes. Je pourrais demander que l’on sorte des statistiques concernant les femmes pour essayer d’estimer les matrices « emploi-expositions à risques » et identifier ces contraintes.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Vous nous avez dit tout à l’heure que chez les femmes, le cancer du poumon allait passer devant le cancer du sein. Vous y voyez l’échec de toutes les campagnes anti-tabac qui ont été précédemment menées. En effet, les jeunes fument beaucoup. Il suffit de faire la sortie d’un lycée pour constater que les trottoirs sont devenus des cendriers. Certains autres pays ont-ils réussi dans leur politique de lutte contre le tabac ?
S’agissant de l’obésité, fait-on suffisamment pour limiter la consommation de sucre ? Est-on assez intransigeant ? S’agissant de l’alcool, j’ai le sentiment qu’on n’a pas fait assez pour limiter la consommation de boissons énergisantes. Celles-ci, très sucrées et un peu alcoolisées, habituent à l’alcool.
Certes, derrière ces produits, il y a des lobbies très puissants. Est-ce que l’INPES a lancé des campagnes d’information ? Comment faire pour lutter contre le tabagisme ? En ce domaine, où en sont les jeunes filles ?
Mme Édith Gueugneau. Je m’inquiète surtout des drogues. En tant que responsable politique et en tant que parent, je trouve que l’on n’en parle pas suffisamment. Des actions sont menées dans les collèges et les parents ont leur mot à dire. Mais les collectivités peuvent aussi servir de relais, car le ministère ne peut pas tout faire. J’aimerais savoir où en est la politique de prévention.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Lors de la précédente législature, nous avions traité d’un sujet, l’anorexie, qui touche davantage les filles que les garçons – à 80 ou 90 %. Les infirmières scolaires sont les premières à pouvoir détecter les filles victimes d’anorexie ou de boulimie – parce que les deux sont souvent liées. A-t-on mené des campagnes contre l’anorexie ? J’ai l’impression que c’est un sujet dont on ne parle plus, mais il peut être gravissime pour les jeunes filles, qu’il faut parfois séparer de leur famille.
M. François Bourdillon. Vous m’avez posé de nombreuses questions.
Contre le tabagisme, on a fait beaucoup, mais aussi pas assez parce que l’on n’a pas tout mis en cohérence. Je suis désespéré de voir que les Anglais sont tombés à 21 % de fumeurs, les Australiens à 19 % et que nous-mêmes, sur la même période, nous en sommes toujours à un tiers de fumeurs. C’est catastrophique ! La seule mesure qui ait vraiment fonctionné, ces dernières années, c’est l’augmentation du prix du paquet de cigarettes sous Jacques Chirac, dans le cadre du premier plan cancer. Cette augmentation, de l’ordre de 40 %, a provoqué une diminution des ventes de tabac – mais pas de la fraude, ni des achats transfrontaliers.
Quand je suis arrivé à l’INPES, j’ai trouvé qu’il était inacceptable de devoir attendre tous les cinq ans les baromètres santé pour connaître la vraie consommation de tabac. Il faudrait au moins que l’on fasse le point deux fois par an sur le nombre de fumeurs dans notre pays, et qu’on le fasse par classe d’âge, pour pouvoir mesurer l’impact de nos campagnes anti-tabac. Le fait que notre ministre de la santé ait construit le premier Plan national de réduction du tabagisme est toutefois une grande première, et j’espère que l’on va pouvoir rejoindre le peloton de tête des pays industrialisés qui luttent contre le tabac. Je rappelle que le tabagisme provoque 73 000 morts par an dans notre pays et que, dans les années qui viennent, ce sera le premier cancer chez les femmes, avant le cancer du sein.
Nous devons réagir, tout en étant conscients que ce que l’on investira cette année ne sera visible que dans vingt ans. Mais la longueur du délai fait que l’on reste dans la toute-puissance, que souvent les politiques ne sont pas suffisamment portées, et que les jeunes qui rentrent dans le tabagisme ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu’ils sont en train de faire, en particulier à cause du pouvoir addictif du tabac.
Les campagnes anti-tabac ne porteront leurs fruits qu’avec un plan coordonné, appuyé, porté politiquement par de nombreux acteurs, dont l’INPES qui intervient à travers plusieurs dispositifs : des campagnes nationales ; sa téléphonie santé, « tabac info service » ; le coaching anti-tabac, qui permet d’inciter à l’arrêt du tabac, via les smartphones. Donc il y a une politique très portée par l’INPES sur le tabac.
J’observe que ce qui se fait sur le tabac n’est pas fait sur l’alcool. Pour des raisons très culturelles, spécifiques à notre pays, il est très difficile de lancer des campagnes contre l’alcool, même si l’INPES a un site dédié à l’alcool.
À l’inverse, nous avons depuis 2001 une politique portée sur la nutrition, avec des plans nationaux nutrition-santé (PNNS) successifs, qui ont créé beaucoup d’élan. Mais parfois son rythme a ralenti sous la pression des lobbies, notamment agroalimentaires.
Dans le projet de loi relatif à la santé, l’instauration du logo nutritionnel – cinq couleurs qui permettent de classer les aliments et donc de s’orienter – constitue une bonne mesure. Mais il ne suffit pas d’avoir, dans ce domaine, des politiques nationales portées par des campagnes, voire par d’excellents sites internet – je pense au programme « mangez, bougez » de l’INPES qui touche 500 000 personnes par an. Il faut aller plus loin, avoir une politique à l’école, de circuit court alimentaire et de menus équilibrés dans les cantines, et surtout d’activités physiques. On a parlé des rythmes scolaires, mais personne ne s’est préoccupé de l’activité physique de nos jeunes, alors que toutes les études montrent qu’ils courent beaucoup moins qu’à une certaine époque, et que c’est une des raisons de l’obésité. Il faudrait utiliser le temps périscolaire pour essayer de faire bouger nos enfants.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. D’après une étude portant sur l’attitude des professeurs d’éducation physique au collège, quand les filles commencent à bouder la gymnastique, on les met de côté. On ne les incite pas à faire de la gymnastique, car il y a une vraie relation sexuée au sport. Il faudrait revoir la formation des maîtres, parce qu’il n’y a pas de raison que les filles ne fassent pas du sport comme les garçons.
M. François Bourdillon. Le parcours éducatif en santé, qui figure dans la loi portant refondation de l’école, se retrouve dans le projet de loi relatif à la santé. L’INPES aura à porter cette question, notamment en développant les compétences et la formation des enseignants dans ce domaine. Il y a beaucoup à faire à l’école, parce que c’est l’endroit de tous les savoirs de demain.
L’une de vous a abordé les problèmes liés aux drogues. Comme je l’ai dit, la consommation de drogue est très marquée en termes de genre : trois quarts de garçons, un quart de filles – ce qui reste considérable. Cela justifie la création de sites d’information.
Pour le cannabis, qui est la drogue la plus fréquemment consommée, il faut développer des techniques de repérage précoce et d’intervention brève – sortes de rappels à la loi faits par les soignants pour essayer de faire prendre conscience aux jeunes de la réalité de leur consommation, pour qu’ils prennent du recul et se disent qu’ils sont en train de franchir certaines bornes.
En ce domaine, je crois beaucoup à la prévention. Il faut agir très tôt, très en amont, et ne pas attendre que l’enfant ait décroché de l’école, que l’on aille voir la psychologue et le médecin pour essayer de réparer les dégâts. On peut rétablir le dialogue assez fortement. C’est le sens de la dernière campagne de l’INPES, « consultation jeunes consommateurs » que j’ai lancée il y a maintenant dix jours et qui passe à la télévision en ce moment. Elle vise à informer les jeunes qu’il existe des professionnels spécialistes de l’écoute, capables de leur trouver un certain nombre de solutions avant qu’il ne soit trop tard.
Je terminerai par la question qui m’a été posée sur les troubles du comportement alimentaire, en l’occurrence l’anorexie. Cette maladie est d’ordre psychiatrique. De la même façon que pour les conduites addictives, si l’on veut pouvoir agir, il faut repérer et orienter précocement les jeunes.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Monsieur le directeur général, je vous remercie.
Table ronde sur les femmes et la santé au travail avec des réprésentant-e-s de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et des médecins du travail (3 févier 2015)
Compte-rendu de l’audition, sous forme de table ronde, du 3 février 2015
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Mesdames, messieurs, la délégation s’est saisie du projet de loi relatif à la santé au regard des enjeux spécifiques liés à la santé des femmes. Dans ce cadre, nous avons souhaité vous entendre sur la santé au travail et les femmes. J’ajoute que nous avons déjà eu l’occasion d’auditionner des responsables de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) au cours de précédents travaux de la délégation.
Si la santé au travail s’améliore pour les hommes, cela n’est pas forcément le cas pour les femmes : il serait donc intéressant d’en connaître les raisons. Par ailleurs, à l’occasion des débats sur le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, nous avions discuté de l’invisibilité des problèmes de santé des femmes au travail. Un métier pénible est rarement décrit ou considéré comme tel par les femmes.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous présenter brièvement les organismes que vous représentez mais je souhaiterais avant tout que vous réagissiez par rapport au contenu du projet de loi relatif à la santé et que vous nous fassiez part de vos éventuelles suggestions de modifications.
Mes cher-e-s collègues, je vous précise également que Mme Véronique Massonneau, qui est aujourd’hui parmi nous, va remplacer Mme Barbara Pompili au sein de notre délégation. Mesdames, Messieurs, je vous laisse à présent la parole.
Mme Florence Chappert, responsable du projet « Genre, santé et conditions de travail » à l’ANACT. Je vous remercie d’avoir invité l’ANACT à faire part de son point de vue. Ce n’est pas vraiment par rapport au projet de loi relatif à la santé que je souhaitais apporter des éléments complémentaires à ceux que nous avions déjà présentés car, à notre sens, il ne contient quasiment rien au sujet de la santé au travail. En effet, seul un article y est consacré : il s’agit de l’article 6 portant sur les conditions d’exercice des collaborateurs médecins non spécialistes en médecine du travail. Il n’y a pas de disposition spécifique sur la prise en compte de la santé des femmes au travail.
J’exprime, au nom de l’ANACT, le point de vue d’un praticien de l’intervention en entreprise, notre mission consistant en effet à réaliser des diagnostics et des interventions, lesquelles sont la plupart du temps liées à un problème de santé au travail et dans de nombreux cas cela concerne la santé des femmes (sur-absentéisme, risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, usure professionnelle). Nous n’intervenons pas en raisonnant du point de vue de la réparation et de l’indemnisation mais de la prévention primaire, à travers des actions relatives à l’organisation du travail. Depuis cinq ans, nous intégrons à notre travail une approche genrée – même si l’on n’utilise plus le terme de « genre » dans les entreprises, mais plutôt celui d’« égalité ».
Nous avons fait le constat que la prise en compte du genre en matière d’exposition aux risques professionnels et de paramètres tels que les différences entre les parcours, les métiers, les contraintes de travail ou encore l’impact différencié des risques sanitaires sur les femmes et les hommes, permettaient d’affiner nos diagnostics et nos recommandations. In fine, cela permet d’améliorer les plans de prévention des risques ou les plans d’amélioration des conditions de travail et ce, au bénéfice de tous, pas uniquement des femmes.
Je voudrais mettre en avant plusieurs points.
Le premier concerne les lacunes persistantes en termes de production de données sexuées en santé et sécurité au travail (SST). Cela fait trois ans que l’ANACT publie, de son propre chef, des données relatives à l’évolution de la sinistralité des 18 millions de salariés relevant de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs (CNAMTS), qui ne les publie toujours pas dans son rapport de gestion. Par ailleurs, j’appelle votre attention sur le fait que le groupe d’orientation du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT), qui a produit un document en décembre dernier dans le cadre de la préparation du troisième « plan santé au travail », qui devrait être présenté prochainement, prévoit, dans son orientation n° 6, de rassembler et de mettre en perspective les données de santé au travail. Il y a quinze points de recommandations, mais aucune mention particulière sur la production de données sexuées en santé et sécurité au travail. Il conviendrait d’y remédier.
À l’échelle régionale – je veux parler des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) –, les données sexuées sont très rares. Pourtant, là encore, cela pourrait être développé pour alimenter les plans régionaux en santé au travail.
Au niveau des entreprises, les données sont souvent sexuées dans les bilans sociaux, à l’exception de celles qui concernent la santé et sécurité au travail. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a toutefois prévu, pour les rapports de situation comparée (RSC), un neuvième domaine d’indicateurs en santé et sécurité au travail, ce qui va conduire les entreprises de de moins et de plus de 300 salariés à produire ce type de données. Nous constatons cependant une lacune lorsque nous intervenons en entreprise : les rapports annuels des médecins du travail ne font pas apparaître de données sexuées. Il me semble par ailleurs que le code du travail ne prévoit aucune obligation de produire des données sexuées. Il est regrettable que la loi du 4 août 2014 n’ait pas apporté de corrections à ce problème.
Nous avons en revanche constaté des progrès en ce qui concerne les enquêtes sur les conditions de travail de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail. Désormais, toutes les enquêtes sont traitées selon le sexe et intègrent mieux la question du genre, avec en particulier des données sur la situation familiale et le « hors travail », les risques liés aux difficultés de conciliation des temps ou aux emplois à prédominance féminine et la prise en compte d’éléments tels que le manque d’autonomie, les exigences émotionnelles, les conflits éthiques, l’insécurité de l’emploi par exemple. Dans le cadre de ces enquêtes sur les conditions de travail, deux sujets sont encore absents : les risques liés à la discrimination et au sexisme.
Il y a un biais dans certaines enquêtes, comme l’enquête SUMER (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels). Cette enquête se caractérise en effet par une sous-représentation des femmes, dans la mesure où les personnes interrogées sont « piochées » dans l’agenda des médecins. Au total, il y a 42 % de femmes parmi les 30 000 ou 50 000 personnes enquêtées. Malgré le redressement opéré dans le cadre de cette enquête, il y a un biais non négligeable.
Je voudrais faire état d’un dernier point sur les données : les études épidémiologiques des organismes de recherche sont faites toutes choses égales par ailleurs. Or nous avons constaté, à plusieurs reprises, que, dans les entreprises, il faut raisonner toutes choses inégales par ailleurs – les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois, n’ont pas les mêmes parcours, etc. Les études faites toutes choses égales par ailleurs masquent un certain nombre de contraintes propres aux femmes. Une étude sur l’absentéisme réalisée à partir de l’enquête SUMER montre d’ailleurs que les analyses faites toutes choses égales par ailleurs ne font pas apparaître de différences selon le sexe s’agissant des facteurs de contraintes au travail mais que ces facteurs apparaissent en revanche lorsque les femmes et les hommes sont étudiés séparément.
En ce qui concerne les données elles-mêmes, l’écart continue de se creuser, entre les femmes et les hommes, concernant les accidents du travail. Nous avons désormais les chiffres correspondant à la période 2000-2013. Le nombre d’accidents du travail continue de diminuer : il a baissé de 17 % en treize ans, et cela est tant mieux. Il y a toutefois une asymétrie : les accidents de travail des hommes ont diminué de 29 % tandis que ceux des femmes ont augmenté de 25 %. On notera que les deux tiers des accidents du travail concernent des hommes.
Il y a trois grands secteurs « accidentogènes » pour les femmes. Il s’agit tout d’abord de la santé et l’action sociale, du nettoyage et du travail temporaire ; les accidents de travail des hommes ont diminué, entre 2001 et 2012, de 27 % et ceux des femmes ont augmenté de 60 %. Par ailleurs, dans les activités de services, banques, assurances, les accidents de travail des hommes ont baissé de 15 %, ceux des femmes ont cru de 24 %. Enfin, s’agissant du commerce non alimentaire, on observe également une progression de 16 % pour les femmes, tandis que les accidents du travail ont diminué de 16 % sur la même période.
Mme Véronique Massonneau. J’aurais une explication à l’augmentation des accidents du travail des femmes travaillant dans le secteur des services, des banques et assurances : souvent, elles occupent des postes d’accueil et sont en première ligne face aux clients, avec lesquels les relations peuvent être compliquées, voire conflictuelles.
Mme Florence Chappert. Cela est exact. Le problème se pose aussi dans les call centers où des cas de malaises sont recensés sans être toutefois assimilés à des accidents du travail.
En ce qui concerne les accidents de trajet, la situation n’est pas meilleure : ils ont augmenté, de façon globale, de 6 % entre 2001 et 2013, mais cette progression représente en moyenne 24 % s’agissant des femmes. Cette augmentation atteint même 50 % pour les femmes travaillant dans les services, la santé, le nettoyage, le travail temporaire.
Par ailleurs, les maladies professionnelles ont crû deux fois plus vite pour les femmes que pour les hommes. Cela étant, on observe une baisse depuis deux ans, qui est liée, d’une part, au nouveau critère du tableau n° 57 des maladies professionnelles – il s’agit surtout de troubles musculo-squelettiques (TMS) – et, d’autre part, aux effets positifs de la prévention. Étant précisé qu’il y a par ailleurs beaucoup de sous-déclaration concernant les maladies professionnelles et beaucoup de traitement par la médecine de ville.
Nous menons actuellement un projet de recherche en partenariat avec une université et une grande entreprise sur l’absentéisme différencié des femmes et des hommes. Les enquêtes montrent que l’absentéisme des femmes est supérieur de l’ordre de 30 % à 40 % – une petite part (10 % seulement) étant due à l’absentéisme avant le congé maternité.
De plus, un fort écart dans l’exposition au stress au travail continue d’exister entre les femmes et les hommes. Cet écart a diminué mais l’exposition à la tension au travail a globalement augmenté, ainsi que le montre la dernière enquête SUMER.
Je voudrais dire un mot de la question de la prévention. Depuis la loi du 4 août 2014, dont l’article 20 dispose que les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs doivent être évalués en tenant compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe, certains services de médecine du travail témoignent d’un intérêt pour la prévention ; par ailleurs, du côté des entreprises, il y a des préoccupations financières liées à la montée de l’absentéisme – phénomène général qui touche toutefois plus les femmes que les hommes.
Nous faisons le constat que les femmes sont entrées sur le marché du travail pour y occuper des postes dans des secteurs en croissance peu ou moyennement qualifiés mais très fortement exposés aux contraintes de rythme, aux exigences émotionnelles, au manque d’autonomie… Il y a une sous-évaluation persistante de l’exposition au risque et à la pénibilité dans ces emplois. Cette invisibilité relève, à nos yeux, d’une méconnaissance des contraintes et des pénibilités auxquelles sont exposées les femmes : lorsque nous intervenons en entreprise, nous nous rendons compte que les postes les plus pénibles ne sont pas ceux des hommes mais plutôt ceux des femmes.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Lors de la discussion du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, j’avais pris, à ce sujet, deux exemples frappants. Dans les abattoirs, les femmes occupent des postes très répétitifs, à la différence des hommes qui portent des carcasses – certes lourdes – et qui se déplacent fréquemment. De même, dans les imprimeries, les femmes sont généralement affectées à des postes statiques et répétitifs qui les exposent à davantage de souffrances au travail. Nous avions donc demandé que, dans le cadre de la renégociation des conditions de travail, les partenaires sociaux s’emparent de ce sujet afin de redéfinir les postes de travail dont l’ergonomie a été principalement pensée pour les hommes.
Mme Florence Chappert. Nous constatons en effet que les systèmes de travail n’ont pas été suffisamment transformés : ainsi la hauteur des machines continue-t-elle de poser problème, notamment pour les femmes petites et les hommes grands.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. De fait, la redéfinition de la hauteur des machines bénéficie à tout le monde, au-delà des femmes.
Mme Florence Chappert. L’ANACT demande aux médecins du travail de réaliser des courbes de moyennes des tailles des hommes et des femmes, dont la forme en dos de chameau fait apparaître un important étalement des tailles qui joue un rôle important dans les métiers très physiques.
De notre point de vue, la différence biologique des sexes est complètement niée, et ce à deux titres. En premier lieu, la mise à l’écart, au stade de la prévention, de la question de la charge physique et de la force musculaire conduit à ignorer que certains métiers demeurent physiques. En second lieu, la prévention dans les secteurs mixtes ou à prédominance féminine, plus récente que dans les secteurs à prédominance masculine, est, pour cette raison, moins poussée et affinée. Nous pensons donc que cet article de la loi de 2014 peut aider à faire prendre conscience des différences de conditions d’exposition des femmes et des hommes et à mieux les intégrer dans les documents uniques d’évaluation des risques (DUER) et dans les plans de prévention.
Cette meilleure prise en considération risque toutefois de défavoriser les femmes sur le marché du travail si elle ne s’accompagne pas d’une analyse détaillée de l’organisation du travail permettant de mieux comprendre les origines de ces écarts, c’est-à-dire non seulement la différence des sexes mais aussi celle des morphologies, des aptitudes, des postes et des parcours. À défaut, ces données sexuées ne feront que révéler une surexposition des femmes aux accidents du travail et aux troubles musculo-squelettiques, encourageant les responsables d’entreprises, consciemment ou inconsciemment, à ne plus embaucher de femmes, notamment de petite taille, comme les hommes corpulents sont victimes de discrimination à l’embauche dans les pays d’Amérique du Nord où l’obésité a pris le pas sur la question de la différence des sexes.
Il nous apparaît donc nécessaire de mettre ce sujet à plat dans les entreprises, à défaut de quoi la discrimination fondée sur des critères de santé ira croissante, avec aussi la montée en puissance des inaptitudes qui causent de nombreux problèmes dans l’organisation du travail.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je vous remercie pour ces éléments. Nous allons maintenant entendre les représentant-e-s des médecins du travail qui, à la lumière de leur expérience de terrain, pourront préciser s’ils confirment les éléments qui viennent d’être évoqués ou s’ils ont des points de vue différents sur ces questions.
Mme Nadine Khayi, membre du bureau de l’association Santé et médecine au travail (A-SMT). Nous partageons beaucoup des constats qui ont été dressés par Mme Florence Chappert, en particulier celui de la faiblesse des dispositions portant sur la santé au travail dans le projet de loi relatif à la santé.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Quel est le dernier texte législatif à avoir modifié les règles relatives à la santé au travail ?
Mme Nadine Khayi. Il s’agit de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, qui a réformé les services de santé au travail.
Nous sommes particulièrement préoccupés par les mesures de simplification qui avaient été envisagées par le Gouvernement concernant la suppression de la visite médicale périodique des médecins du travail auprès des salariés, compte tenu des difficultés rencontrées par les médecins en sous-effectifs pour remplir correctement leurs missions. Si les médecins ne voyaient plus régulièrement les salariés, nous redoutons qu’ils ne puissent plus identifier les risques professionnels, alerter sur la santé dans les entreprises, formuler des préconisations sur les adaptations de postes nécessaires et faire des signalements individuels.
Comme l’indiquait Mme Chappert, les rapports annuels de santé de la médecine du travail ne comportent pas de données sexuées car la réglementation actuelle ne l’exige pas et les services de santé n’ont pas l’habitude d’agréger celles qu’ils collectent.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je regrette qu’il faille que la loi intervienne pour exiger la publication de données sexuées et ce, quel que soit le domaine concerné. J’ai d’ailleurs dû de nouveau déposer un amendement en ce sens au le projet de loi pour la croissance et l’activité afin de demander la publication de données sexuées sur les clients des transports par car urbain, à la grande surprise de certains de mes collègues qui se demandent pourquoi la loi devait intervenir dans cette matière.
J’ai également récemment écrit au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui communique très peu de données sexuées sur les agents publics territoriaux. Or comment mettre en œuvre des lois visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans la fonction publique, si l’on ne dispose pas de tels chiffres ?
Enfin, je trouve catastrophique et invraisemblable que nous n’osions plus parler de « genre » car si l’on s’exprime en termes d’égalité, tout le monde ne va pas comprendre la même chose.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Dans ces conditions, les médecins du travail ne pourraient-ils pas d’eux-mêmes prendre l’initiative d’inclure des données sexuées dans les rapports annuels qu’ils publient ?
Mme Nadine Khayi. Cela doit être possible.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Cette situation est pour le moins paradoxale : le sexe est, à la différence de la race ou de l’ethnie par exemple, une information largement demandée et qui peut être recueillie, mais trop rarement agrégée et publiée.
Mme Nadine Khayi. De fait, rien ne garantira que les données sexuées qui figurent dans nos logiciels et dans les rapports annuels seront reprises et agrégées au niveau national.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. En tant que médecin du travail, constatez-vous, dans les entreprises que vous visitez au quotidien, des différences entre les femmes et les hommes en matière de santé au travail ?
Mme Nadine Khayi. Les problématiques propres aux femmes et aux hommes sont naturellement différentes dans la mesure où les activités qu’ils occupent respectivement le sont aussi. Mais il me paraît compliqué de tirer des conclusions générales d’une expérience personnelle sans travail d’agrégation des informations collectées. L’enquête SUMER constitue une étude intéressante à cet égard, en reprenant les risques relevés au niveau national afin d’en tirer les conclusions pertinentes.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. À propos de la discrimination qu’évoquait tout à l’heure Mme Chappert, je milite depuis longtemps pour que le congé maternité ne soit plus considéré comme une maladie. En effet, la règle actuelle conduit à une surreprésentation des femmes dans les statistiques de l’absentéisme pour cause de maladie au sein des entreprises. La question de la maternité ne pourrait-elle donc pas figurer dans les statistiques autrement que sous la forme d’une maladie ?
Mme Florence Chappert. Le congé maternité stricto sensu ne figure pas dans les données que nous analysons. En revanche, les arrêts maladie antérieurs à la maternité, comme les congés pathologiques, sont présents dans ces statistiques mais nous prenons soin de les retirer afin de procéder à une analyse de statistiques portant exclusivement sur l’absentéisme hors maladies avant la maternité. Toutefois, même avec ces précautions, l’écart entre le taux d’absentéisme des femmes et celui des hommes reste très important – supérieur à 40 % environ.
Comment expliquer cette situation ? Il nous faut écarter l’explication fondée sur un critère extraprofessionnel : le fait d’avoir vécu une séparation ou d’être divorcé ou veuf, seul autre motif extraprofessionnel générant davantage d’absence au travail, est associé à un fort absentéisme pour les femmes et pour les hommes. L’absentéisme des femmes n’est pas davantage déterminé par le nombre d’enfants. Toutes absences confondues (absences de longue durée, maladies ordinaires, accidents du travail, etc.), plus une personne a un nombre important d’enfants, moins elle est susceptible d’être absente, cela en raison de l’effet âge qui permet de cumuler les arrêts longue maladie. Le taux d’absentéisme lié aux maladies ordinaires atteint un petit pic chez les personnes qui ont un enfant de moins de seize ans, mais baisse lorsqu’elles ont deux enfants – cela correspond à la situation de la famille stable qui s’est organisée – et atteint un nouveau petit pic lorsqu’elles ont trois enfants.
En conclusion, l’absentéisme plus élevé des femmes ne s’explique pas par le nombre d’enfants à charge mais, dans une mesure très limitée, par la situation familiale et, plus principalement, par les conditions générales de travail et d’activité, notamment le manque de perspectives professionnelles ou les situations de harcèlement.
Mme Nadine Khayi. Je souhaite revenir sur l’avis d’inaptitude au travail. On avance souvent qu’un tel avis gênerait les employeurs, mais en réalité il nuit surtout aux salariés qui sont souvent privés d’emploi. De leur côté, les employeurs retrouvent aisément un salarié pour occuper le poste concerné. Il y a d’ailleurs eu une levée de boucliers de leur part contre les propositions des médecins en matière d’adaptation de poste de travail. Les employeurs souhaiteraient en effet que l’avis du médecin se borne à l’aptitude ou l’inaptitude, sans préconisation d’adaptation du poste. Ce serait la voie la plus rapide vers la sortie de l’emploi pour le salarié. Le nombre des avis d’inaptitude explose comme en témoignent les chiffres de 2014, encore plus importants que ceux de 2013.
Or le rôle du médecin du travail est de formuler des restrictions à l’emploi du salarié et des propositions d’adaptation du poste de travail. L’employeur peut procéder à ces adaptations ou réaffecter le salarié à un autre poste, ou bien encore décider la rupture de son contrat de travail. Dans les petites entreprises de moins de dix salariés, les inaptitudes conduisant à des ruptures de contrat de travail sont d’autant plus nombreuses que les réaffectations sont malaisées.
Mme Véronique Massoneau. Lors des travaux législatifs sur le compte pénibilité, il avait été envisagé d’inciter les employeurs à réaffecter les salariés sur des postes présentant moins de pénibilité. Or il était apparu que les entreprises se sont de plus en plus recentrées sur les métiers de leur cœur d’activité, supprimant ou externalisant les métiers annexes et réduisant de ce fait les possibilités de reclassement en interne pour un salarié souffrant de la pénibilité de son poste de travail.
Mme Nadine Khayi. En effet, non seulement ces externalisations réduisent les possibilités de mobilité interne des salariés, mais de plus les métiers concernés – qui auparavant pouvaient constituer des alternatives à des postes de travail pénibles – sont eux-mêmes devenus particulièrement difficiles. Le cas du nettoyage en est un bon exemple. Aujourd’hui ce métier a été scindé en des fonctions spécifiques (carreaux, sols, etc.) et les salariés sont dédiés à une seule tâche répétitive. La diversité des activités a disparu et la pénibilité s’en trouve accrue.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. De fait, la recrudescence des accidents du travail dans des métiers tels que le nettoyage ne résulte pas d’une plus grande dangerosité de la fonction mais d’une intensification des tâches et de leur répétition.
M. Jean-Michel Sterdyniak, secrétaire général du Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SPNST). Cependant la dangerosité de ces fonctions a également augmenté du fait de leur externalisation. Une étude de notre syndicat sur ce sujet montre que le déport des métiers de la propreté en dehors des horaires normaux de travail a entraîné une augmentation des accidents de trajet et des agressions physiques. Ainsi, le secteur de la propreté est le deuxième plus concerné par les accidents mortels de la route (après le secteur du transport), ce qui peut sembler surprenant de prime abord mais résulte de la cascade de conséquences liées à l’externalisation de cette activité.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Il y a eu des expérimentations sous la houlette de la Fédération des entreprises de propreté, notamment à Nantes, afin d’inciter les entreprises à faire procéder au ménage en continu ou au cours de la journée, en particulier par la signature d’une charte de développement des prestations de propreté en journée. Ces initiatives ont montré que la productivité ne s’en ressentait pas pour les entreprises, tandis que la pénibilité et les risques d’agressions diminuaient.
Malheureusement, les donneurs d’ordre ne se soucient pas assez des conséquences indirectes de leurs décisions. Il y a quelques années, j’ai rencontré le cas d’une direction départementale du travail qui recourait à une prestation pour une durée de deux heures et avait demandé son fractionnement en deux prestations d’une heure. On trouve souvent ce genre de logiques propres au donneur d’ordre qui ne prennent pas en compte les conséquences sur le prestataire.
M. Jean-Michel Sterdyniak. On ne peut pas comprendre les problèmes de santé au travail, si on ne prend pas du recul sur ce qu’est la médecine du travail en France. On cite souvent en modèles les pays scandinaves en matière de risques professionnels, sans mesurer à quel point les approches politiques de la santé au travail ont été différentes en France et dans ces pays. En France, notre politique s’est structurée autour de la médecine du travail et d’un système d’aptitude au poste et de réparation des préjudices liés au travail. Dans les pays scandinaves, la politique est centrée sur la création de conditions de travail saines et salubres afin de prévenir les risques ainsi que sur la formation tout au long de la vie.
Pourquoi en France l’inaptitude prend-elle une telle place ? Avec une politique volontariste d’amélioration des conditions de travail, les problèmes d’aptitude, qui concernent avec plus d’acuité les femmes, se poseraient différemment. Lorsqu’un médecin impose une restriction interdisant, par exemple, à un salarié souffrant du dos de porter des charges supérieures à 25 kilogrammes, il laisse entendre qu’un autre salarié peut le faire et donc également nuire à sa santé. Ce système conduit à une impasse.
Or les femmes souffrent encore davantage de ce système. En tant que médecin du travail, j’observe que notre société est encore très marquée par la différenciation sexuelle.
C’est encore souvent la femme qui supporte la double journée de travail ou qui interrompt son activité lorsque les enfants sont malades. Le temps partiel subi concerne ainsi principalement les femmes, tout comme le temps partiel choisi, sans pour autant diminuer les horaires de travail cumulés des femmes. De même, les métiers sont eux-mêmes marqués par la différenciation. Par exemple, s’il y a de plus en plus de femmes médecins, en revanche les infirmières et aides-soignantes demeurent très majoritairement des femmes. Il s’agit de métiers dits du care, dans lesquels il est culturel de ne pas se plaindre, et où l’on demande à cette population majoritairement féminine d’accomplir des tâches physiquement difficiles, comme porter des patients. Finalement, on constate une recrudescence de troubles musculo-squelettiques déclarés chez cette population, face à laquelle la médecine du travail ne peut que prononcer des restrictions ou des inaptitudes, qui ne résolvent rien.
Il y a des exemples étrangers, aux États-Unis notamment, de cliniques spécialisées ayant prohibé le port de patients à la suite de condamnations civiles, et dans lesquelles le transport de personnes est intégralement robotisé. En France, on tient à ce sujet un discours sur le risque de déshumanisation du métier car il est culturel que l’aide-soignante ne se plaigne pas. Je n’ai jamais entendu l’argument de la déshumanisation pour des métiers masculins !
En Seine-Saint-Denis, une étude de surveillance des cancers professionnels a été réalisée à l’initiative du groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle (GISCOP 93) et de l’Université Paris XIII. Cette étude repose sur des tentatives de reconstitution de carrières de personnes atteintes de cancers du poumon afin de déterminer leur exposition professionnelle à des agents cancérogènes. Or cette étude montre une prévalence des métiers de la propreté – anciennement femmes de ménage – dans les cancers du poumon, qui est inexplicable par le tabagisme… Personne ne peut y apporter d’explication satisfaisante en raison de l’absence de suivi des risques professionnels encourus par les femmes. Après recherches, il apparaît pourtant que l’utilisation des monobrosses dans le nettoyage et le ponçage de sol en plastiques, dans la composition desquels entrait de l’amiante, entraîne ou a entraîné une surexposition des femmes de ménage à de telles substances nocives. Or si l’on entend volontiers parler des risques encourus par les garagistes en raison des plaquettes de frein amiantées, il n’est jamais fait état des femmes de ménage ou des repasseuses exposées à l’amiante.
Face au mécontentement des professionnels de santé, les mesures de simplification annoncées ont été retirées du projet de loi, ce qui est une bonne chose car l’idée de réserver le suivi médical aux personnes exerçant un métier dangereux aurait conduit à en exclure les femmes. Le suivi médical de l’ensemble des salariés est essentiel car il est l’occasion pour eux de nous exposer leurs difficultés. Si l’on supprimait ce suivi, les problèmes de violences sexuelles faites aux femmes au travail, sur lesquelles j’ai conduit une enquête en 2007, seraient masqués alors qu’ils sont bien plus répandus que ce que l’on pourrait penser.
La fin de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude médicale serait catastrophique, 120 000 personnes étant licenciées chaque année pour inaptitude médicale et 240 000 personnes se retrouvant en réalité chaque année sans emploi à la suite de problèmes de santé, si l’on prend en compte les personnes contraintes de démissionner ou d’accepter une rupture conventionnelle.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Sait-on combien de décisions d’aptitude avec restrictions sont prises chaque année ?
M. Jean-Michel Sterdyniak. Il y en aurait environ un million par an assorties de restrictions significatives, par exemple, l’interdiction de porter des charges de plus de 15 kg.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Dispose-t-on de données sexuées ?
M. Jean-Michel Sterdyniak. Non mais les femmes sont beaucoup plus fréquemment concernées que les hommes, en raison de leur surreprésentation dans certains secteurs d’activité, comme la santé, le secteur social et l’aide à domicile. De plus, les médecins du travail prennent des décisions d’inaptitude pour des questions de harcèlement, de stress, qui touchent beaucoup plus les femmes car elles exercent les métiers les moins autonomes.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Quels étaient les résultats de votre enquête de 2007 sur les violences sexuelles faites aux femmes au travail, qui portait sur un département ?
M. Jean-Michel Sterdyniak. Une femme sur deux est victime de blagues sexistes, 22 % de harcèlement sexiste et 5 % d’agression ou de viol. Ces chiffres concernent la Seine-Saint-Denis, où sont implantées beaucoup d’entreprises de haut niveau, mais ils sont similaires pour l’Essonne, d’après une étude réalisée il y a deux ans.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les femmes ne parlant pas spontanément de ces violences, les médecins du travail sont-ils formés pour les détecter ?
Mme Nadine Khayi. Il n’existe pas de formation générale des médecins du travail sur ces questions. La difficulté qu’ont les femmes à s’exprimer peut s’expliquer par leur entrée tardive dans le monde du travail et par le fait qu’elles exercent des métiers où elles sont isolées. Leur attitude de retrait face aux agressions qu’elles subissent peut aussi être mise en relation avec le fait qu’elles exercent souvent des métiers où elles effacent les traces des autres et où leur travail est invisible.
M. Jean-Michel Sterdyniak. Seulement 1 % des femmes parlent au médecin du travail des harcèlements sexistes dont elles sont victimes. Celui-ci doit donc être attentif pour détecter les cas qui se présentent à lui. Le niveau actuel du chômage peut dissuader les salariés de parler de leurs difficultés au travail. De plus, les phénomènes de harcèlement sexiste sont source de culpabilité pour les victimes.
Mme Catherine Quéré, corapporteure : Les femmes parlent-elles plus facilement lorsque le médecin du travail est une femme ? Lorsque celui-ci est salarié de l’entreprise, la communication n’est-elle pas encore plus difficile ?
Mme Nadine Khayi. Tout dépend de la relation de confiance entre la salariée et le médecin du travail, que celui-ci soit payé directement par l’entreprise, en service autonome, ou indirectement, en service inter-entreprises. Mais cette relation de confiance suppose d’abord qu’il existe une relation, ce qui est de plus en plus rare, du fait de l’espacement très important des visites périodiques des salariés. Après une première visite, il arrive que nous ne les revoyions que lorsqu’ils ont changé d’entreprise et qu’ils ne nous parlent qu’à ce moment-là des violences sexuelles, des agressions et des gestes déplacés dont ils ont été victimes dans leur précédent poste.
Mme Florence Chappert. Dans une entreprise dans laquelle nous intervenons, qui compte plus de 100 000 salariés, sur 70 000 salariés examinés par an lors de visites médicales, 25 % font l’objet de décisions d’inaptitude, partielle ou totale, ou d’aptitude avec aménagements. Cette situation s’explique par l’organisation du travail. L’entreprise ne voulant pas licencier les salariés inaptes, les encadrants sont confrontés à de grandes difficultés car il n’existe plus de « postes doux » du fait de l’intensification du travail. Les aménagements sont source d’inéquités, les autres salariés voyant leurs charges s’alourdir.
Selon l’enquête SUMER, contrairement aux hommes, les femmes ne mettent pas en relation leur état de santé avec leur travail mais avec d’autres facteurs. De ce fait, elles continuent à travailler le plus longtemps possible puis elles craquent : dans l’entreprise où nous intervenons, 80 % de l’absentéisme des femmes concerne des absences de plus de trente jours dans l’année et parmi-celles-ci, 80 % sont d’un seul bloc. Il peut s’agir de graves problèmes de dos, de troubles musculo-squelettiques ou de déprime.
M. Jean-Michel Sterdyniak. La distinction entre service autonome et service inter-entreprises n’est pas toujours pertinente car dans les grandes entreprises, qui emploient directement un médecin du travail, il existe un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des délégués du personnel qui peuvent aider les salariés lorsqu’ils sont en difficulté. Les problèmes de harcèlement sexiste sont bien plus dramatiques dans les petites entreprises où les victimes n’ont aucun recours et sont souvent obligées de démissionner.
Mme Florence Chappert. Lorsque nous intervenons en entreprise, les médecins du travail sont nos meilleurs alliés sur les questions de santé des femmes. Il est donc regrettable que leur fonction ne soit pas davantage valorisée. Par ailleurs, il est inquiétant de voir leurs effectifs diminuer, sinon leur rôle remis en cause.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. C’est vrai, et pourtant les enjeux liés à la prévention et à l’adaptation des postes de travail sont importants, ne serait-ce que sur le plan financier : vous avez évoqué le chiffre de 20 % des salariés d’une entreprise en inaptitude, mais c’est colossal ! Dans les entreprises qui travaillent sur ces sujets, les salariés sont en meilleure condition mais leur compétitivité et leur productivité sont aussi renforcées. Il en va d’ailleurs de même en matière d’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, où les difficultés rencontrées, par exemple, pour la garde d’un enfant malade peuvent également entraîner un stress. Si les entreprises s’impliquaient davantage en faveur de cette articulation entre le travail et la vie personnelle, il y aurait moins de stress au travail. En réalité, tout le monde est gagnant avec le développement de ce type d’initiatives mais il s’agit d’une véritable révolution copernicienne !
Mme Nadine Khayi. Je dis souvent, de manière un peu caricaturale, qu’au lieu d’évoquer une inaptitude au poste, il faudrait plutôt évoquer une inaptitude du poste à recevoir quelqu’un.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. En effet. Je viens d’ailleurs de visiter une entreprise qui va fabriquer des compteurs électriques à la chaîne, et qui compte notamment des femmes parmi les salariés. Un travail a été fait sur l’ergonomie, par exemple la hauteur des postes, et tout le monde s’en porte mieux, hommes comme femmes. On pourrait aussi évoquer les éviers des cantines scolaires, dont la hauteur peut contraindre le personnel de l’établissement à faire la vaisselle courbé en deux...
M. Jean-Michel Sterdyniak. Cela montre bien que la prévention doit se faire dès le stade de la conception.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Absolument.
M. Jean-Michel Sterdyniak. J’ai commencé ma carrière dans un service autonome dans une entreprise et il y avait un atelier dans lequel travaillaient des femmes originaires du Portugal et les machines, tout comme la maison-mère, étaient allemandes. Naturellement les salariées qui travaillaient sur ces machines avaient des douleurs dans les épaules ou les coudes ; cela aurait dû être anticipé et mieux pris en compte.
Mme Nadine Khayi. De ce que j’entends parfois auprès de salariés ou d’employeurs, c’est tant qu’on n’en a pas besoin de la médecine du travail qu’on estime qu’elle ne sert à rien, mais cela s’inverse lorsqu’un besoin survient, le problème étant qu’alors la question ne doit pas se poser uniquement en termes d’inaptitude.
Mme Véronique Massoneau. Concernant le rôle des médecins du travail, en tant qu’élue dans un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), j’ai eu l’occasion d’accompagner des salariés, suite à une demande de rendez-vous, et cela a toujours été très intéressant.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Dans une collectivité, les médecins du travail jouent également un rôle important.
Mme Florence Chappert. Le jugement du médecin du travail sur l’organisation du travail est souvent très pertinent. Dans l’enquête SUMER, on a d’ailleurs pu croiser l’appréciation portée sur l’organisation du travail et son caractère jugé favorable ou délétère avec l’état de santé des personnes concernées, et cela coïncide parfaitement. En tout état de cause, ce regard externe du médecin est très important, quand bien même il ne serait pas un expert en conception.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je vous remercie pour vos propos très intéressants.
Audition de M. Claude Evin, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île de France et ancien ministre
Compte-rendu de l’audition du 11 février 2015
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons, car nous sommes très intéressés par votre vision de la santé en France en général et en Île-de-France en particulier, et par les préconisations que vous pourriez faire.
L’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France mène une action tellement exemplaire en termes de santé sexuelle et reproductive, que la ministre de la santé a annoncé, lors de la présentation du programme national d’action visant à améliorer l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en janvier 2015, la formalisation d’un plan pour l’accès à l’avortement dans chaque région, dont les orientations nationales seront élaborées avec l’appui de l’ARS d’Île-de-France et diffusées avant l’été 2015. Dans le cadre du projet régional FRIDA, vous avez engagé plusieurs actions intéressantes afin notamment de donner la parole aux femmes, ce qui n’est pas si fréquent, et plus largement d’améliorer les connaissances en matière d’IVG, mais aussi de renforcer l’offre en Île-de-France, du point de vue qualitatif et quantitatif.
Par ailleurs, j’aimerais avoir votre avis sur le projet de loi relatif à la santé sur lequel nous travaillons. Avez-vous une vision un peu générale de la santé des femmes ? Selon des rapports publiés récemment, les femmes sont davantage concernées, par certaines maladies et problématiques de santé, comme le tabagisme ou l’obésité qui révèle en outre des inégalités sociales importantes. L’ARS d’Île-de-France a-t-elle travaillé sur ces sujets et mène-t-elle des politiques spécifiques dans le domaine de la santé des femmes ?
Au cours de nos auditions, nous avons constaté, d’une part, qu’il faudrait renforcer les actions de prévention à l’école et, d’autre part, que nous manquions de données sexuées sur la santé au travail. La ministre de la santé a rappelé hier, lors de son audition par la délégation, que la santé à l’école est du ressort de l’éducation nationale, tandis que la santé au travail relève du ministère du travail et qu’elle-même s’occupe de la santé au sens strict. Ne doit-on pas prendre en compte le citoyen, malade ou en bonne santé, dans sa globalité, dans tous les domaines de sa vie ? J’ai du mal à imaginer un parcours de santé découpé en tranches, surtout si l’on oublie les temps de vie consacrés au travail et à la formation.
M. Claude Evin, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France. Madame la présidente, je vais d’abord répondre à votre deuxième série de questions, ce qui me permettra de situer l’IVG dans la démarche d’ensemble de l’agence.
Grâce aux ARS, nous pouvons appréhender de manière plus globale certains problèmes de santé auxquels est confrontée la population car, lors de leur création, le législateur avait souhaité l’élaboration de projets régionaux de santé (PRS). Dans ce cadre, en 2011 et 2012, nous avons recueilli des données qui font apparaître des situations particulières, notamment de très grandes inégalités sociales et territoriales de santé. Selon les territoires, nous constatons la prévalence de telle ou telle pathologie touchant plus particulièrement les femmes ou les hommes. Nous avons ainsi identifié des territoires où la prévalence des cancers du sein et du poumon chez la femme était particulière.
Dans notre projet régional de santé, nous affichons l’objectif de réduire ces inégalités sociales et territoriales de santé et nous ciblons nos politiques de manière à y parvenir. Prenons l’exemple de la mortalité infantile. En Seine-Saint-Denis, le taux de mortalité infantile est deux fois supérieur au taux moyen régional, qui est lui-même plus élevé que le taux moyen national. Nous avons développé un programme spécifique, piloté par Mme Anne-Gaëlle Daniel, pour pouvoir traiter ce problème. Nous adaptons nos politiques en fonction des situations, notamment d’inégalité, que nous avons mises en évidence. C’est un travail au long cours dont je ne peux pas encore vous donner les résultats.
Vous m’avez aussi interrogé sur la santé au travail et la santé scolaire. C’est vrai qu’elles ne sont pas dans les compétences du ministère de la santé ; elles ne sont pas non plus directement du ressort des ARS. Cependant, dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le législateur a prévu une coordination des politiques publiques et deux commissions présidées par le directeur général de l’ARS : l’une, qui concerne le secteur médico-social, assure une articulation avec les collectivités territoriales partenaires ; l’autre, dédiée à la prévention, aborde les thèmes de la santé scolaire et de la santé au travail.
Dans cette dernière commission siègent les acteurs concernés par la prévention, notamment les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et les services de la santé au travail. Pour ma part, j’aimerais que nous abordions ce thème de la santé au travail. Je constate que l’administration a parfois tendance à considérer que la santé au travail concerne uniquement les maladies professionnelles et les accidents du travail. Ces sujets sont très importants mais il y en a d’autres qui mériteraient d’être plus travaillés, même si l’ARS s’en préoccupe.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les statistiques montrent que les femmes sont plus souvent soignées pour dépression que les hommes et qu’elles sont aussi davantage touchées par la hausse des accidents du travail. Le manque d’articulation avec la santé au travail peut poser un problème pour appréhender ce genre de phénomènes.
M. Claude Evin. Quelle attention l’ARS porte-t-elle à la santé des femmes ? Nous y sommes très attentifs dans le cadre de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Nous ciblons prioritairement les populations ayant une prévalence particulière de pathologies et certains territoires. Cette préoccupation se retrouve lorsque nous menons, dans le cadre des politiques publiques, des campagnes de dépistage de cancers.
En ce qui concerne l’IVG, l’agence a deux objectifs : disposer d’une capacité de réponse qui soit à la hauteur des besoins identifiés ; faire en sorte que les femmes connaissent les lieux où elles peuvent se rendre.
Nous dialoguons avec les établissements de santé pour nous assurer que les moyens qu’ils déploient correspondent aux engagements qu’ils ont pris dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). En tant que directeur général d’ARS, je suis aussi chargé d’évaluer les chefs d’établissement. Lors des dernières évaluations, j’ai reçu une trentaine de directeurs – ceux qui sont à la tête des établissements les plus importants – et je les ai à chaque fois interrogés sur l’attention portée à la réalisation effective d’une activité d’IVG. Les chefs d’établissement étant souvent confrontés à des difficultés venant des praticiens hospitaliers, il est nécessaire de veiller à l’effectivité de la mise en œuvre des mesures.
Nous voulons aussi que les femmes susceptibles d’avoir recours à une IVG disposent d’une bonne information, notamment en ce qui concerne les lieux où elles pourront être prises en charge. Nous avons donc lancé le projet FRIDA, ce qui signifie « favoriser la réduction des inégalités d’accès en matière d’avortement ». Il s’agit de faciliter l’identification des lieux qui pratiquent l’IVG mais aussi d’assurer la fluidité et la permanence de l’offre, y compris pendant les vacances. Les différents centres nous informent via un système déclaratif, ce qui nous permet de voir comment se répartissent les moyens, notamment pendant ces périodes difficiles que sont les vacances. Le site « www.ivglesadresses.org » permet de visualiser de manière dynamique les lieux de prise en charge possibles. Nous avons aussi créé un questionnaire en ligne pour que les femmes et les professionnels puissent témoigner sur les difficultés rencontrées et participer ainsi à l’amélioration du parcours d’IVG.
Mme Anne-Gaëlle Daniel, chargée de mission sur la périnatalité, l’IVG et la contraception à l’ARS d’Île-de-France. Nous faisons face à une sorte de paradoxe dans ce domaine : les professionnels et les associations témoignent de difficultés mais nous ne recevons aucune plainte, signalement ou réclamation.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Un centre de planning familial s’est adressé à moi pour savoir si l’État ne pourrait pas créer un fonds destiné à aider les femmes qui sont hors délais légaux à aller faire leur IVG à l’étranger, en me citant des cas très précis concernant notamment des mineures. J’ai répondu qu’il serait difficile de créer un fonds d’État pour financer une pratique illégale, mais il est effectivement paradoxal que vous ne receviez pas de plainte, étant donné tous les problèmes qui existent : dépassement de délai, refus concernant les mineures, clause de conscience invoquée par les médecins.
À cet égard, vous avez souligné les difficultés rencontrées par les chefs d’établissement. Nous n’en sommes certes plus à la génération de médecins militants qui ont pratiqué des avortements à une époque où ce n’était pas légal, mais cette intervention fait partie du métier d’obstétricien. Est-ce que les médecins invoquent davantage la clause de conscience ou est-ce qu’ils ne sont tout simplement pas intéressés ?
Mme Martine Pinville. Comment travaillez-vous avec les collèges et les lycées où nombre de jeunes filles sont désireuses d’avoir accès à une IVG ? On constate souvent un déficit d’infirmières et de médecins qui seraient en mesure de les accompagner. Il est important d’avoir une vision globale du parcours d’une jeune femme qui peut solliciter des IVG aux différentes étapes de sa vie, à partir de l’âge de quatorze ou quinze ans.
M. Claude Evin. Nous intervenons par le biais de financement d’actions, et non pas directement dans les établissements.
Mme Anne-Gaëlle Daniel. Nous finançons des actions de sensibilisation et d’information du planning familial sur l’éducation sexuelle, les violences et la contraception, dans le milieu scolaire. Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF), financés par les conseils généraux, se rendent dans les collèges et les lycées de leur territoire. Avec le conseil régional, nous travaillons sur le « pass contraception ».
Mme Martine Pinville. Je continue à m’interroger sur le manque de coordination et de vision globale, notamment dans ce domaine, et sur les différences qui peuvent exister d’un territoire à l’autre. Les rectorats et les ARS passent parfois des conventions afin d’adapter les politiques aux besoins constatés, mais je ne suis pas sûre que l’accompagnement soit suffisant dans tous les lycées.
M. Claude Evin. L’ARS, qui n’a pas de compétence directe en matière de santé scolaire et de santé au travail, intervient dans ces domaines par le biais de la commission de coordination des politiques publiques. Dans ce cadre, nous conduisons une action globale sur la santé des jeunes d’Île-de-France. Elle mobilise notamment l’éducation nationale et la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) mais, pour l’heure, elle n’inclut pas d’opération particulière sur l’accès à l’IVG. En revanche, nous travaillons avec le conseil régional sur le « pass contraception ».
Mme Martine Pinville. Je ne dis pas que rien n’est fait mais que, sur cette thématique comme sur d’autres, il manque souvent une coordination globale, y compris avec le planning familial. À un moment donné, il faut que tout le monde se retrouve autour d’une table, qu’il y ait un pilote et que les choses soient écrites. C’est vrai pour l’IVG mais aussi pour la santé de l’enfant, etc.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Pour essayer d’y voir clair, nous avons adressé un questionnaire aux régions en ce qui concerne le « pass contraception ». De son côté, la ministre a pris des dispositions en matière de contraception, et notamment pour que les infirmières scolaires délivrent la pilule dite du lendemain, mais nous ne savons pas qui la paie. Il peut y avoir des difficultés de coordination. La ministre a aussi confié une mission à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) afin de mieux cerner les difficultés, en particulier celles qui sont liées à l’anonymat, que rencontrent les mineures. Se pose aussi la question de l’âge. En matière de contraception et d’avortement, on se réfère à l’âge de la majorité sexuelle, quinze ans. Est-ce que cela vous semble être le bon âge ?
M. Claude Evin. Je ne pense pas qu’il y ait d’étude épidémiologique en la matière.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. S’agissant de FRIDA, j’estime qu’il est très intéressant d’avoir donné la parole aux femmes grâce au questionnaire en ligne. Pour pallier la diminution du nombre de centres, vous avez aussi créé une plateforme d’orientation destinée aux professionnels. Si les doléances ne remontent pas à l’ARS, elles arrivent à nous : on nous soumet le cas de femmes qui perdent du temps parce que leur médecin généraliste est incapable de leur donner rapidement les informations nécessaires, et qui finissent par dépasser les délais légaux. Vous avez senti ce besoin. Tout à l’heure, j’ai essayé le site « www.ivglesadresses.org » mais je n’ai pas réussi à trouver l’information pour la région Poitou-Charentes qui ne semble pas couverte, contrairement à la Bretagne. Ce n’est pas très commode pour une habitante de Loudun, par exemple, qui voudrait recourir à une IVG.
M. Claude Evin. C’est effectivement un sujet qui occupe les ARS et qui les conduit, indépendamment de la problématique de l’IVG, à souhaiter la création de plateformes régionales d’information des patients. La ministre souhaite que sa future loi intègre la création d’un système d’information national. Avec les ARS des Pays-de-la-Loire et de Rhône-Alpes, nous pilotons le projet « GPS Santé » dont le but est de répondre au problème que vous soulevez.
Mme Anne-Gaëlle Daniel. Le site « www.ivglesadresses.org » fonctionne depuis deux ans en Île-de-France et le secrétariat chargé des droits des femmes vient d’accorder un financement qui va permettre de l’étendre à l’échelle nationale. En plus de ce site destiné au grand public, nous avons développé une plateforme professionnelle, accessible par code, qui permet d’avoir une vision plus précise du nombre de femmes qui peuvent être accueillies à chaque étape de prise en charge, depuis la consultation jusqu’aux différents types d’IVG – médicamenteuse ou instrumentale, sous anesthésie locale ou générale.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Cette plateforme est-elle à la disposition des médecins libéraux ?
Mme Anne-Gaëlle Daniel. En effet. Nous l’avons testée l’été dernier et nous retravaillons sur ses fonctionnalités afin de la rendre encore plus opérationnelle. Son avantage est de permettre un contact direct entre professionnels, alors que le site destiné au grand public donne des numéros de standard. Or la prise de rendez-vous, le premier contact avec un secrétariat, est un élément clef et critique dans l’accès à l’IVG. D’une manière générale, les fonctions de secrétariat font l’objet de restructurations dans les établissements de santé, ce qui aboutit à une mutualisation et à une sorte de premier filtre. En matière d’IVG, il serait préférable que les femmes tombent sur une personne formée qui sache leur répondre. Même dans les gros centres qui fonctionnent bien en Île-de-France, on me dit qu’il est difficile de répondre au téléphone autant qu’il serait nécessaire. Si les femmes se rendent directement sur place, elles obtiennent un rendez-vous.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous avons évoqué hier avec la ministre la question du délai de réflexion d’une semaine en matière d’IVG et nous envisageons de présenter un amendement au projet de loi relatif à la santé pour supprimer cette obligation, afin de répondre à une demande forte des femmes et des associations. J’espère que l’amendement sera adopté parce que ce délai de réflexion n’existe que pour les IVG et les opérations de chirurgie esthétique. On peut penser que les femmes qui demandent une IVG ont réfléchi et qu’elles sont déterminées.
Je voudrais revenir un instant sur la nécessité de veiller à l’effectivité de la mise en œuvre des mesures, que vous rappelez aux chefs d’établissement dans le cadre des CPOM et des évaluations. Vous rappelez l’obligation de service public confiée par la loi aux établissements ayant une autorisation d’obstétrique. Les cliniques privées sont-elles concernées ?
M. Claude Evin. Non, seulement les hôpitaux publics.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Ce sont donc majoritairement les cliniques privées qui ont fermé leurs centres d’IVG.
Mme Anne-Gaëlle Daniel. En fait, c’est la fermeture de maternités privées qui entraîne celle des centres qui s’y trouvent. Cela étant, le niveau de l’offre a été maintenu en Île-de-France.
M. Claude Evin. Le nombre de centres a diminué en raison de la fermeture de maternités privées mais la capacité de prise en charge des IVG a augmenté dans certains hôpitaux comme Saint-Louis et Aulnay-sous-Bois. À Saint-Denis, le centre médical de la femme, Artémis, a ouvert en septembre. Les capacités d’accueil ont été maintenues en Île-de-France.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Vos statistiques indiquent que près d’une femme sur quatre réalise son IVG hors établissement de santé en Île-de-France. Où les réalisent-elles ?
Mme Anne-Gaëlle Daniel. Elles ont recours à une IVG médicamenteuse en ville. Grâce au Réseau entre la ville et l'hôpital pour l’orthogénie (REVHO), nous avons pu déployer cette activité en ville qui est très importante mais encore centrée sur quelques départements.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. L’ARS favorise ce type d’IVG ?
Mme Anne-Gaëlle Daniel. Oui, nous finançons ce réseau de santé.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous voulons que les femmes aient vraiment le choix, c’est-à-dire qu’elles disposent de l’information nécessaire pour se déterminer. Il ne faudrait pas qu’il y ait une orientation systématique vers l’IVG médicamenteuse.
Mme Anne-Gaëlle Daniel. Ce n’est pas le cas. Nous avons aussi repositionné les établissements sur les IVG instrumentales qu’ils sont les seuls aujourd’hui à pouvoir pratiquer, et nous nous adapterons aux décisions de Mme la ministre concernant la possibilité pour les centres de santé de réaliser des IVG instrumentales sous anesthésie locale.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Hier, je l’ai interrogée sur la place des centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) dans le dispositif. Elle m’a indiqué qu’ils ne pourraient pratiquer des IVG instrumentales que sous réserve de se conformer au cahier des charges défini par la Haute Autorité de santé. Quoi qu’il en soit, nous allons proposer des amendements en ce sens.
Mme Anne-Gaëlle Daniel. Cette ouverture aux CPEF nous permettrait d’avoir plus de candidats. Nous allons profiter de l’occasion pour mettre en place un programme de formation ville-hôpital sur l’IVG instrumentale sous anesthésie locale, qui est insuffisamment pratiquée dans les établissements de santé alors qu’elle peut convenir aux femmes, compte tenu de sa rapidité.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Quelles sont les réticences qui empêchent un recours plus large à cette méthode ?
Mme Anne-Gaëlle Daniel. Les professionnels connaissent mal les conditions techniques nécessaires à sa réalisation : très peu de médecins savent qu’elle peut se pratiquer en salle blanche. Il faut former et rassurer pour lever les difficultés d’organisation liées à l’accès au bloc et à la mobilisation des anesthésistes. Il faut garder la possibilité de pratiquer des IVG sous anesthésie générale mais, quand elle se passe dans de bonnes conditions, l’anesthésie locale présente beaucoup d’avantages pour les femmes : elles ressentent peu de douleurs et ressortent très rapidement.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous nous intéressons aussi au Programme d’accompagnement au retour à domicile (PRADO) qui a été mis en place dans le cadre de conventions avec des hôpitaux. En général, les femmes redoutent de se retrouver seules trop rapidement et sans accompagnement. L’ARS d'Île-de-France applique-t-elle ce programme ?
M. Claude Evin. L’assurance maladie, qui cherche à réduire la durée moyenne de séjour en institution, a créé ces programmes PRADO dans trois domaines : la naissance, la chirurgie orthopédique et certaines interventions en cardiologie. La prise en charge sécurisée à domicile doit être développée car son intérêt dépasse le seul aspect économique. Je n’ai pas de chiffres concernant l’application de PRADO en Île-de-France. Nous nous préoccupons naturellement du suivi du patient qui sort de l’hôpital et de la femme qui sort de la maternité, en prenant en compte l’ensemble de leurs besoins qu’ils soient sanitaires, sociaux ou liés à la fourniture de services.
La maternité de Saint-Denis, qui a une démarche assez originale en matière de suivi post-natal, a mis en place des accompagnements à domicile par du personnel hospitalier, hors programme PRADO. Cette maternité dynamique s’adapte à son environnement social.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Après l’accouchement, les mères ont envie de rentrer chez elles tout en ressentant des angoisses, quand ce n’est pas un baby blues. Le suivi doit prendre en compte les inégalités sociales et territoriales.
Dans le cadre de précédents travaux à l’Assemblée nationale, je m’étais étonnée de la tendance à dépister la surdité des enfants dès la maternité et à les appareiller précocement. On m’avait alors rétorqué qu’il fallait procéder de cette manière parce que certains enfants « disparaissaient », c'est-à-dire qu’ils n’étaient plus suivis dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI) ou autres. Constatez-vous que certaines familles ne suivent pas du tout le parcours prévu, passant par les vaccinations et les visites médicales obligatoires ?
M. Claude Evin. Nous n’avons pas de statistiques générales mais, dans le cadre du programme de réduction de la mortalité infantile (REMI) en Seine-Saint-Denis, nous nous sommes penchés sur cette question. En partenariat avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), nous avons réalisé des études assez approfondies et sophistiquées, en nous intéressant tant au suivi de la grossesse qu’au retour de la maternité.
Mme Anne-Gaëlle Daniel. Les études menées en Seine-Saint-Denis avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) portent essentiellement sur l’activité libérale car les centres de PMI ne télétransmettent pas leurs données. Il peut y avoir des enfants non suivis. Nous travaillons beaucoup avec les réseaux de santé en périnatalité sur les territoires, afin d’encadrer les retours de maternité. Ces réseaux coopèrent avec les CPAM et les sages-femmes libérales dont ils soutiennent l’installation pour pallier les inégalités territoriales.
Si l’accompagnement est bien fait, les centres de PMI peuvent prendre le relais. À Saint-Denis, nous avons créé le dispositif « sortie accompagnée » parce que les services de la PMI ont parfois du mal en entrer au domicile de certaines familles. Les parents ouvriront plus facilement leur porte à une personne rencontrée à la maternité, laquelle pourra introduire le professionnel de la PMI.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les personnels de la PMI vont dans les familles ?
Mme Anne-Gaëlle Daniel. Oui, c’est la spécificité des PMI, notamment en Seine-Saint-Denis où des moyens importants y sont consacrés. Les sages-femmes de la PMI vont au domicile pendant la grossesse et les puéricultrices prennent le relais après l’accouchement. Les services de la PMI reçoivent les certificats de santé délivrés à la sortie de maternité et ils peuvent proposer des visites aux familles, en fonction de facteurs de risques prédéterminés, des moyens dont ils disposent et des priorités qu’ils ont établies. Les propositions de visite se font sur la base de ces indicateurs sociaux et médicaux, mais les familles sont libres de les refuser.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les services de la PMI s’occupent-ils de la santé des femmes, et pas seulement au moment où elles sont mères ?
Mme Maud Olivier. Pour ma part, je voudrais revenir sur les fermetures de maternités. Dans l’Essonne, l’IGAS mène une enquête sur la maternité de Dourdan qui pourrait être fermée au profit de l’hôpital d’Étampes. Plus généralement, le rapport de la Cour des comptes estime que la question de la fermeture ne devrait pas se poser pour les maternités qui réalisent plus de 500 accouchements par an, dont fait partie celle de Dourdan. Qu’en pensez-vous, considérant les problématiques d’égalité et d’accès aux soins précédemment évoquées ? Le département de l’Essonne est très urbain au nord mais très rural au sud où est située la ville de Dourdan, ce qui implique une plus grande difficulté pour les femmes à se rendre dans une autre maternité.
M. Claude Evin. L’ARS d’Île-de-France n’a pas de position de principe sur le sujet. En ce qui concerne le cas que vous évoquez, je vous ferais observer que les sites de Dourdan et d’Étampes, qui sont à vingt-cinq minutes l’un de l’autre, ont fusionné dans un même établissement.
Le problème déterminant n’est pas la taille mais la démographie médicale, ce dont je me suis expliqué, y compris publiquement, avec les élus : la maternité est le dernier service de ce site à fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; elle ne parvient pas à recruter des anesthésistes permanents et elle doit recourir à des intérimaires, ce qui la fragilise.
Pour ma part, je considère que cette maternité n’est pas sûre. Fin 2013, un enfant y est mort. L’accident était lié au fait que l’organisation de la garde nocturne n’était pas sécurisée, ce qui m’a amené à suspendre l’activité. La réouverture a été autorisée en janvier 2014, mais la direction rencontre toujours de grandes difficultés à recruter des anesthésistes et il n’y a qu’un seul pédiatre pour assurer la garde. Imaginons qu’une nuit, il y ait à la fois un enfant en insuffisance respiratoire au service des urgences et un accouchement difficile…
C’est donc un problème de sécurité qui se pose. La maternité de Dourdan procède à 400 accouchements par an, tandis que celle d’Étampes en fait 1 000 à 1 100. Plus que la proximité, il faut rechercher la sécurité de la prise en charge qui implique évidemment une rapidité d’intervention si nécessaire. Depuis le mois de juillet 2014, cinquante-huit événements indésirables ont été recensés dans cette maternité, dont la moitié était liée à l’organisation : quand on a affaire à des intérimaires, les procédures ne sont pas respectées comme elles le sont avec du personnel permanent.
Mme Maud Olivier. C’est donc un problème de gestion des ressources humaines ?
M. Claude Evin. C’est un problème de recrutement d’anesthésistes. Certains refusent de se déplacer quand ils sont appelés car ils sont intérimaires.
Mme Maud Olivier. Il n’y a pas de déontologue ?
M. Claude Evin. D’une manière générale, l’organisation des soins est déterminée par la démographie médicale : il faut pouvoir constituer des équipes suffisamment étoffées pour assurer les gardes. Ce n’est pas un problème de seuil d’activité mais d’organisation. Compte tenu de la concurrence qui existe entre les établissements, un anesthésiste pourra avoir des exigences élevées pour aller assurer des gardes à Dourdan et, en plus, il ne restera pas. J’espère que nous n’aurons pas de problème à la maternité de Dourdan.
Mme Maud Olivier. Ne s’agit-il pas de praticiens de l’hôpital public ?
M. Claude Evin. Ce ne sont pas des praticiens hospitaliers. Ils ont un diplôme d’anesthésiste et ils font des prestations en fonction de l’attrait des établissements.
Mme Maud Olivier. Il est très clair que, quelle que soit la spécialité, il y a pléthore de médecins dans le sud de la France et pénurie dans le Limousin ou d’autres régions sinistrées.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous en revenons à vos propos sur l’inégalité territoriale.
M. Claude Evin. Ces inégalités existent, y compris dans une région comme l’Île-de-France, même si les distances à parcourir sont beaucoup moins grandes qu’ailleurs.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. S’agissant d’inégalité sociale, les femmes peuvent renoncer à des soins pour cause de précarité, notamment quand elles sont âgées ou cheffes de famille monoparentale. J’espère que la généralisation du tiers payant sera maintenue dans la future loi, et que nous trouverons les moyens techniques de le faire sans complications.
En Île-de-France, il existe des centres de santé qui sont plutôt urbains. Est-ce lié à la démographie médicale précédemment évoquée ? Cette formule est intéressante dans les zones où il existe des difficultés d’accès aux soins, y compris en présence de médecins libéraux. Quelle est votre politique en la matière ? L’ARS donne-t-elle un agrément ? Combien existe-t-il de centres en Île-de-France ? Comment sont-ils financés ?
M. Claude Evin. Il y a environ 300 centres de santé en Île-de-France, dont certains sont exclusivement dentaires. Cette région a une vieille tradition en la matière, née sous l’influence des municipalités communistes de la couronne parisienne. Certains centres ont été créés et gérés directement par des mairies, tandis que d’autres ont été implantés par des mutuelles ou des associations.
Le projet de loi relatif à la santé contient une disposition sur l’habilitation à légiférer par ordonnance qui concerne les centres de santé. Depuis la loi de 2009, nous ne les agréons plus. Ils doivent nous transmettre leur projet médical et cela peut conduire à des situations difficiles lorsqu’un centre de santé ne respecte pas certains engagements. Nous sommes alors assez démunis car il faut vraiment démontrer que la prise en charge des patients est mise en danger pour obtenir une décision de fermeture qui, en plus, sera difficile à mettre en œuvre. L’ARS ne les finance pas, leur rémunération étant assurée dans le cadre d’une convention spécifique avec l’assurance maladie. Ils sont aussi soutenus par les collectivités quand ils ont du mal à faire face à leurs charges de secrétariat, de location de locaux et autres. Pour notre part, nous travaillons avec les gestionnaires de ces centres sur la recherche d’une meilleure efficience.
Ces centres de santé ne sont qu’un mode d’exercice parmi d’autres et, en Île-de-France comme ailleurs, se sont développées des maisons de santé pluri-professionnelles. Leur statut juridique est variable – société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ou autres – mais elles regroupent des professionnels libéraux. Nous participons au financement de l’évaluation des besoins de soins et de l’organisation d’une nouvelle structure.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les femmes apprécient ce mode d’installation qui leur permet de partager le travail et les gardes.
M. Claude Evin. En fait, c’est une aspiration des jeunes professionnels qui sont à la recherche d’une organisation qui leur permette de concilier leurs vies privée et professionnelle. En outre, avec la montée des maladies chroniques, les médecins généralistes sont de plus en plus confrontés à des situations complexes et ils ressentent davantage le besoin de travailler en équipe.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Existe-t-il une coordination des ARS ?
M. Claude Evin. Tous les mois, les ARS se réunissent pour une journée et demie de travail au ministère de la santé. Il existe des échanges entre les directeurs et les équipes des différentes ARS.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les ARS ont-elles étudié le projet de loi à venir ? Ont-elles des observations à faire ou des contributions à apporter ?
M. Claude Evin. Le collège des directeurs généraux d’ARS a été auditionné par plusieurs rapporteurs en novembre dernier car plusieurs sujets nous concernent directement.
M. Jacques Moignard. L’ARS d’Île-de-France est-elle un modèle ?
M. Claude Evin. Je ne suis pas le mieux placé pour répondre mais je peux rappeler que la région Île-de-France regroupe 18 % de la population française et qu’elle est plus grande que la Belgique ou que la Suisse. Nos moyens sont supérieurs à ceux dont peuvent disposer d’autres régions et notre capacité d’initiative se traduit dans les programmes évoqués au début de l’audition : FRIDA, « ivglesadresses », GPS santé. Cela étant, d’autres agences pilotent aussi des projets qui sont ensuite largement diffusés.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes va demander aux autres ARS d’élaborer des plans pour l’accès à l’avortement dans chaque région, en s’appuyant sur des expériences régionales réussies telles que le programme FRIDA que vous avez lancé en Île-de-France.
Je pense que la loi doit donner cette mission aux ARS de manière explicite. Nous allons avoir une réforme territoriale, mais nous constatons que l’égalité entre les femmes et les hommes a plus de mal à se concrétiser dans les territoires. Chaque fois que nous le pourrons, nous intégrerons cet aspect dans la loi.
Je vous remercie de votre contribution précieuse à nos travaux.
Audition de Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Compte-rendu de l’audition, ouverte à la presse, du 10 février 2015
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Merci infiniment, madame la ministre, d’avoir répondu favorablement à notre invitation pour évoquer le projet de loi relatif à la santé, qui comporte des dispositions sur la contraception d’urgence et l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Ces dispositions viennent compléter les excellentes mesures que vous avez prises depuis 2012 pour améliorer la situation des femmes.
La santé des femmes soulève d’autres questions spécifiques. Je pense aux inégalités sociales car les femmes en situation précaire sont exclues de l’accès aux soins. À cet égard, la généralisation du tiers payant est une excellente mesure.
Je pense également à la difficulté d’obtenir des données sexuées. Certains organismes ne peuvent nous fournir ces données sexuées, ce qui ne veut pas dire qu’elles n’existent pas.
L’éducation à la sexualité est également une question majeure. Elle doit être renforcée, en commençant par rendre effective l’application de la loi de 2001 et de la circulaire de 2003.
Enfin, le tabac, l’obésité et l’alcool sont des problématiques majeures. Cette année, pour la première fois en France, le nombre de décès de femmes dus au cancer du poumon devrait dépasser ceux qui sont liés au cancer du sein.
Nous allons vous écouter, madame la ministre, sur cette vision transversale de la santé, avant de vous poser un certain nombre de questions.
Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. J’ai déjà eu l’occasion, en tant que ministre des Affaires sociales et de la santé, de m’exprimer devant la Délégation aux droits des femmes. C’est donc la première fois, et j’en suis très heureuse, que je viens devant vous à la fois comme ministre de la santé et ministre des droits des femmes. Vous pouvez être certaines que je suis très attentive à la situation des femmes, qui constitue une de mes priorités depuis mon arrivée aux responsabilités.
Le projet de loi relatif à la santé concerne particulièrement les femmes, mais il ne s’agit pas d’un projet pour les femmes. Il vise à améliorer la prise en charge et la santé de nos concitoyens, grâce à un renforcement de la prévention et de la médecine de proximité. Il prévoit également de mieux accompagner nos concitoyens, notamment par des associations et grâce à des procédures comme l’action de groupe en santé.
Ainsi, le projet de loi de santé englobe l’ensemble des dimensions que recouvre la politique de santé et fixe le cadre des réformes structurantes dont notre système de santé a besoin pour faire face aux défis actuels : le vieillissement de la population et l’émergence des maladies chroniques.
Il existe des enjeux de santé spécifiques aux femmes.
Il convient d'abord de battre en brèche l’idée reçue selon laquelle les femmes sont en meilleure santé que les hommes. Certes, les femmes vivent en moyenne plus longtemps – bien que l’écart entre l’espérance de vie des femmes et celle des hommes tende à se réduire. Au-delà, il faut écouter les femmes : elles perçoivent leur santé de manière plus négative que les hommes. Or elles ont moins spontanément recours aux professionnels de santé.
Les femmes présentent des vulnérabilités particulières, comme le stress et la dépression. Elles déclarent deux fois plus que les hommes subir de l’anxiété. Elles sont également les premières touchées par les violences, en particulier les violences conjugales, le viol ou le harcèlement sexuel, qui ont des impacts physiques et psycho-traumatiques importants.
Ensuite, les femmes développent de plus en plus de comportements à risque. Le nombre de fumeuses a stagné depuis quarante ans, alors que le nombre de fumeurs a été divisé par deux. Depuis 1990, le taux de mortalité dû au tabac a baissé chez les hommes, tandis qu’il a doublé chez les femmes. Le croisement des courbes de mortalité entre cancer du sein et cancer du poumon reflète cette évolution. J’ajoute que les comportements à risque des Françaises sont plus importants que ceux des femmes d’autres pays : elles sont, par exemple, 17 % à fumer lorsqu’elles sont enceintes, taux beaucoup plus élevé que celui de la Grande-Bretagne.
Enfin, les femmes renoncent plus fréquemment aux soins que les hommes : elles sont 16,5 % à y renoncer, contre 11,7 % des hommes. Ce renoncement concerne également les examens de prévention et de dépistage, notamment chez les femmes en situation précaire.
Sur la base de ces constats, la loi de santé doit permettre d’améliorer la santé des femmes.
Je voudrais m'arrêter sur deux types de mesures : celles qui concernent très directement les femmes et celles qui, si elles n’apparaissent pas comme des mesures spécifiques en direction des femmes, auront un impact positif sur la santé et l’accès aux soins des femmes.
En ce qui concerne les mesures spécifiques aux femmes, plusieurs dispositions visent à faciliter l’accès des femmes à la contraception et à l’avortement, dans le droit fil de l’action que j’ai engagée depuis 2012.
En effet, évoquer les enjeux liés à la santé des femmes implique d’évoquer leur santé sexuelle et reproductive. À ce sujet, je tiens à rappeler qu'elles ont des droits, qu’il s'agit de conforter et de garantir, à l’heure où nous célébrons les quarante ans de l’adoption de la loi Veil.
Depuis 2013, la contraception est gratuite pour les mineures, et l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est remboursée à 100 % par l’Assurance maladie. J’ai également fait revaloriser l’acte d’IVG, puisque sa faible rémunération n’encourageait pas cette activité dans certains établissements. En outre, la loi du 4 août 2014 a supprimé la notion de « détresse » et étendu le délit d'entrave à l'information sur l’avortement. Enfin, il y a quelques semaines, j’ai annoncé des mesures visant à améliorer l’accès à l’IVG.
Deux articles du projet de loi relatif à la santé améliorent la situation des femmes.
L'article 3 lève les conditions restrictives à la délivrance par les infirmières scolaires de la contraception d’urgence aux lycéennes. Actuellement, cette délivrance est restreinte aux cas exceptionnels et de détresse. Cette disposition est diversement appliquée sur le territoire et peut retarder l'accès à la contraception d'urgence. Or, plus la contraception d’urgence est prise tôt, plus grande est son efficacité. L'article 3 supprime donc les conditions restrictives mentionnées dans le code de la santé publique.
L'article 31 ouvre aux sages-femmes la possibilité de réaliser une IVG médicamenteuse. Les IVG médicamenteuses représentent aujourd'hui plus de la moitié des IVG pratiquées en France. Il ne s’agit en aucun cas de favoriser cette méthode par rapport à la méthode instrumentale : l’enjeu est de faciliter l’accès à l’IVG sur tout le territoire. En élargissant l’offre, cette mesure y contribuera.
Dans la même logique, un amendement gouvernemental sera déposé pour élargir aux centres de santé la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse instrumentale.
Deuxième type de mesures prévues par le projet de loi : celles qui auront un impact positif sur la santé et l'accès aux soins des femmes.
La première mesure est le tiers payant.
Comme je l’ai souligné, les femmes renoncent plus fréquemment aux soins que les hommes, faute de pouvoir avancer les frais de la consultation. Nous savons bien que cette situation concerne plus particulièrement les familles monoparentales, c’est-à-dire les mères célibataires qui font face à des difficultés financières et ont du mal à avancer les frais de la consultation pour elle-même ou leur(s) enfant(s). C'est aussi à elles que je pense lorsque je dis qu’il faut rendre les soins de proximité plus accessibles.
Ainsi, agir pour rendre les soins plus accessibles, c’est agir en faveur de la santé des femmes.
Deuxième mesure au cœur du projet de loi : le parcours de prévention et l’éducation à la santé.
La promotion de la santé à l’école permet de renforcer l’information des jeunes sur les pratiques à risques. Je veux bien entendu parler des violences, des rapports sexuels non désirés ou non protégés, ou encore des impacts cumulés de facteurs de risques.
Le parcours éducatif en santé donnera lieu à la mise en place de groupes de travail pour intégrer dans ce dispositif l’éducation à la sexualité déjà prévue par la loi.
Ainsi, l’inclusion dans le projet de loi de ce parcours éducatif en santé permettra, avec l’éducation à la sexualité, l’information sur la vie affective et sexuelle et sur les violences envers autrui, de lutter efficacement contre les comportements et les violences sexistes et sexuelles, mais aussi de promouvoir le droit à disposer de son corps.
J’ajoute que les mesures d’ordre législatif du Programme national de réduction du tabagisme sont inscrites dans le projet de loi de santé.
Toujours au titre de la prévention, l’article 4 du projet de loi vise à lutter contre le « binge drinking », pratique très préoccupante qui ne touche pas que les hommes. On sait en effet que les établissements de santé reçoivent de très jeunes filles – lycéennes et étudiantes – en coma éthylique à la suite d’une alcoolisation massive et rapide pratiquée lors de soirées festives organisées par des associations ou leur établissement d’enseignement.
Mesdames les députées, vous l’avez compris : ce projet de loi a pour objectif de rendre plus effective l’égalité d’accès à la santé. Je serai très attentive à vos propositions visant à enrichir ce texte. Le travail que nous avons d’ores et déjà effectué ensemble s’est révélé très fructueux, et j’espère que nous pourrons continuer dans ce sens.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Madame la ministre, la stratégie nationale de santé déclinera-t-elle des objectifs sexués ?
Les essais cliniques sont majoritairement réalisés sur des hommes jeunes, dont la corpulence est en moyenne plus élevée que celles des femmes. Or certains dosages peuvent ne pas convenir aux personnes de corpulence moindre et aux femmes âgées. Comment remédier à ce problème ?
Nous nous félicitons de votre action en matière d’IVG et de contraception. Cependant, comment pouvons-nous faciliter l’accès à la contraception pour les jeunes filles, en particulier grâce à l’anonymat – c’est-à-dire sans l’accord des parents – et une information efficace ?
Nous avons supprimé la notion de « détresse » concernant l’IVG. Pensez-vous possible de supprimer le délai de réflexion d’une semaine, qui peut être un frein à l’accès à l’IVG dans de bonnes conditions ? En outre, comment garantir aux femmes le choix entre les deux méthodes – médicamenteuse et instrumentale ? Les IVG instrumentales pourront-elles être réalisées dans les centres de planification ? D’une façon générale, quels moyens permettront de remédier aux inégalités territoriales en matière d’accès à l’IVG ?
Mme Édith Gueugneau. Ce beau projet de loi va permettre d’améliorer la santé des Français, grâce à une stratégie nationale de prévention innovante. Je tiens à vous apporter mon entier soutien, madame la ministre, après les nombreuses critiques, parfois ignobles, dont vous avez fait l’objet.
Vous êtes pleinement engagée pour faire aboutir cette réforme qui va faciliter l’accès à la santé pour tous. Le tiers payant est une avancée majeure pour nos concitoyens, tout particulièrement en milieu rural où certaines personnes ne se soignent plus en raison de problèmes de mobilité en plus de la difficulté à avancer les frais de la consultation.
Mercredi dernier s’est déroulée la journée mondiale de lutte contre le cancer. Comment renforcer l’information et la sensibilisation sur le cancer du sein ?
L’article 42 du projet de loi prévoit la création d’un Institut national de prévention, de veille et d’intervention en santé publique. Cet institut jouera-t-il un rôle de prévention en matière de violences faites aux femmes ? Et le service public d’information en santé, dont la mise en œuvre est prévue à l’article 21, fournira-t-il des informations sur les associations d’aide aux femmes victimes de violences ?
Mme la ministre. Madame la présidente, les données sexuées existent. Je vous en ai citées sur le cancer dû au tabac. Je peux vous dire également que les femmes sont moins touchées par les cancers que les hommes, puisque 155 000 femmes le sont chaque année, contre 200 000 hommes, et que cette maladie tue chaque année 63 000 femmes, contre 85 000 hommes. Il existe également des données sexuées sur l’obésité. Nous disposons donc d’éléments qui permettent d’adapter les stratégies de santé en fonction du sexe.
Aux termes de la réglementation européenne, les essais cliniques doivent porter sur un échantillon représentatif de la population, c’est-à-dire aussi bien sur les hommes que sur les femmes et les enfants. Or les essais cliniques, qui peuvent durer plusieurs mois, ne peuvent être réalisés sur des femmes enceintes. Par conséquent, les laboratoires préfèrent faire appel à des hommes pour ne pas être amenés à interrompre des essais cliniques en cas de survenue d’une grossesse. Je ne suis pas favorable à l’introduction d’éléments nouveaux dans la loi, puisque le droit prévoit déjà que les essais doivent concerner également les femmes. Nous devons donc réfléchir à cette question, sachant que ces essais sont moins pratiqués sur les femmes pour des raisons de protection de la santé des femmes enceintes.
Faciliter l’accès à l’IVG passe par le développement de l’offre, d’où la possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG médicamenteuses, et pour les centres de santé des IVG instrumentales dans certaines conditions. La Haute Autorité de santé (HAS) fixera les règles et les procédures propres à garantir la sécurité des femmes. Les centres de planification pourront ainsi réaliser des IVG dès lors que les conditions fixées seront respectées.
À titre personnel, j’entends votre demande sur le délai de réflexion pour une IVG. Nous aurons l’occasion d’en rediscuter.
Madame Gueugneau, merci de votre soutien. Le plan cancer a notamment comme objectifs de renforcer la prévention et le dépistage, en particulier des cancers féminins, sachant que le cancer du sein dépisté à temps peut être guéri dans neuf cas sur dix. Des mesures ont été prises dès cette année, qui visent à étendre les campagnes de dépistage aux femmes de moins cinquante ans et de plus de soixante-quinze ans qui présentent un risque identifié par leur médecin traitant.
Je suis tout à fait favorable à ce que le service public d’information en santé puisse fournir des informations sur les associations d’aide aux femmes. Nous verrons s’il est nécessaire d’inscrire cela dans la loi.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Lors des auditions, il a été souligné que les rapports annuels de la médecine du travail notamment ne comportent aucune donnée sexuée. En réalité, ces données existent, mais il faut les rendre publiques. On sait que les femmes qui portent des personnes âgées toute la journée déclarent ne pas exercer un métier pénible, contrairement aux hommes qui transportent des sacs par exemple. Sur ce point, il y a donc une inégalité de reconnaissance préjudiciable aux femmes.
Mme la ministre. Je peux vous répondre sur la santé publique, mais pas sur la médecine du travail qui relève du ministère du travail. Mais je vais regarder s’il existe des données sexuées de la médecine du travail sur les différentes pathologies professionnelles.
Mme Maud Olivier. Madame la ministre, je tiens à vous apporter tout mon soutien après les attaques inacceptables dont vous avez été victime.
Une étude réalisée en 2006-2007 sur 3 000 hommes et femmes hospitalisés au centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a montré une inégalité de traitement dans la prise en charge de l’infarctus. En effet, les femmes hospitalisées à la suite d’une crise cardiaque ont été moins nombreuses à bénéficier d’une angiographie ou d’une angioplastie que les hommes ; les dosages proposés ont été les mêmes que pour les hommes, alors qu’ils ne sont pas toujours adaptés – on sait que les anticoagulants provoquent plus souvent des saignements abondants chez les femmes. Cette étude a également montré que les femmes victimes d’un infarctus en meurent deux fois plus que les hommes, car les temps de réaction des services d’urgence sont beaucoup plus longs face aux femmes dont les symptômes sont plus souvent des manifestations nauséeuses et des douleurs dans les mâchoires, et non une douleur thoracique comme chez les hommes.
Pensez-vous possible une meilleure prise en compte de l’infarctus chez les femmes, en particulier grâce à une formation plus adaptée à la pathologie féminine ?
Malgré les décisions importantes que vous avez prises, madame la ministre, 15 % à 20 % des postes de médecine scolaire sont encore vacants, et certains médecins ont en charge plus de 17 000 élèves. Or les médecins devraient être en première ligne pour aider les élèves victimes de harcèlement scolaire. Le manque de médecins scolaires est clairement une entrave à la réussite éducative et un facteur d’inégalités.
Par ailleurs, un article de presse a révélé que des touchers vaginaux étaient pratiqués par des internes en médecine sur des patientes endormies. Cette information a été démentie par l’hôpital mis en cause, mais elle a été corroborée par de nombreux témoignages. Madame la ministre, une mise au point s’impose sur les conditions de l’apprentissage des futurs médecins pour mettre un terme à cette pratique.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Une étude canadienne avait déjà démontré cette différence de taux de mortalité entre les hommes et les femmes victimes d’infarctus en raison de mauvais diagnostics.
Mme la ministre. Il est en effet plus difficile de diagnostiquer un infarctus chez une femme. La Haute Autorité de santé est chargée de définir des recommandations à destination des professionnels de santé. Il s’agira donc de former les médecins, notamment urgentistes et les médecins régulateurs, à cette problématique.
La médecine scolaire dépend de l’Éducation nationale, de la même manière que la médecine du travail relève du ministère du travail. Les acteurs – infirmières et médecins scolaires et partenaires sociaux – sont attachés à leur cadre de rattachement. Néanmoins, mon souhait est que les enjeux de santé publique soient transversaux : la lutte contre le tabagisme, par exemple, devrait être relayée en milieux scolaire et professionnel. Il faut donc lever les obstacles qui subsistent.
La loi de 2002 relative aux droits des malades prévoit expressément qu’aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient, y compris dans le cadre d’une formation universitaire. Par conséquent, si des pratiques de toucher vaginal ou rectal sont constatées, il appartient aux professionnels de signaler ces faits et aux patients de porter plainte. Je précise que, dorénavant, un grand nombre de centres de formation universitaire utilisent des mannequins « intelligents », c’est-à-dire qui réagissent aux gestes pratiqués par les étudiants ou praticiens en formation et permettent ainsi d’évaluer la dextérité de ces derniers.
Mme Martine Faure. Madame la ministre, les enfants des femmes seules ont eux-mêmes un accès aux soins beaucoup plus difficile. La situation est ainsi bien plus complexe pour les familles monoparentales.
D’autre part, j’aimerais savoir si le parcours éducatif en santé dépendra de l’Éducation nationale ou du ministère de la santé. L’idéal serait qu’il relève des deux.
Mme Virginie Duby-Muller. Madame la ministre, j’ai moi-même été très choquée par l’attaque sexiste dont vous avez été victime. Je condamne fermement ces méthodes dont font encore l’objet un certain nombre de femmes en politique.
Un des axes de votre loi est de prévenir avant d’avoir à guérir. L’objectif est louable puisque la prévention est un enjeu majeur, en particulier en matière de cancers féminins. Pourtant, les crédits territoriaux de prévention confiés aux agences régionales de santé (ARS) sont inférieurs à 200 millions d’euros par an, soit 0,1 % des dépenses de l’Assurance maladie. N’y voyez-vous pas une incohérence car, malgré l’affichage de cette priorité depuis trois ans, les financements de proximité pour la prévention ont diminué. Envisagez-vous une évolution de ces crédits ?
Mme Suzanne Tallard. Madame la ministre, j’insiste à mon tour sur le nécessaire lien entre votre ministère et le ministère de l’Éducation nationale en matière de prévention, en particulier au regard de la situation des jeunes filles.
Comme notre collègue, je pense qu’une mère qui prend soin de sa santé, c’est aussi un enfant mieux soigné.
Par ailleurs, les intoxications médicamenteuses chez les personnes âgées ne sont pas rares. Aussi les essais cliniques devraient-ils mettre en avant les dosages différenciés pour les personnes âgées, voire très âgées.
Mme la ministre. Je ne peux que vous entendre sur la nécessaire transversalité entre mon ministère et celui de l’Éducation nationale, avec laquelle se construira précisément le parcours éducatif en santé. Les deux ministères travaillent conjointement pour définir des objectifs et voir comment l’Éducation nationale pourra les intégrer : l’éducation à la santé doit aussi pouvoir être réalisée à l’occasion d’un cours de français, par exemple, avec l’étude d’un texte qui porte sur la santé. In fine, le succès de la démarche reposera sur les professionnels de l’Éducation nationale.
Les crédits de prévention ont légèrement diminué, mais ils sont ciblés sur des actions prioritaires. Nous maintenons des enveloppes supplémentaires pour les régions dans lesquelles les indicateurs de santé sont les plus médiocres, ainsi que les crédits affectés aux dépistages, notamment du VIH. En réalité, une part des crédits d’État a été transférée vers les crédits de l’Assurance maladie, lesquels ont donc augmenté significativement au travers des fonds d’intervention dans les régions. En tout cas, je puis vous assurer que les associations de santé ont vu leurs crédits de prévention maintenus en 2014.
S’agissant des personnes âgées, le problème est moins celui des essais cliniques que celui de la multiplication des prescriptions médicales. En effet, des interactions médicamenteuses entraînent des risques, en particulier chez les personnes âgées qui prennent plusieurs médicaments. Ainsi, les médicaments sont responsables de décès chez les personnes âgées, alors qu’ils soignent lorsqu’ils sont pris isolément. À cet égard, le rôle du médecin traitant est primordial : c’est lui qui peut regarder toutes les ordonnances des différents médecins prescripteurs du patient. Les pharmaciens eux-mêmes ont un rôle clé, en pouvant contacter le médecin pour signaler que trop de médicaments sont délivrés à la même personne.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Les dispositions du texte sur le développement et le soutien à l’exercice coordonné à travers les centres de santé ou les maisons de santé sont très importantes au regard de l’égalité professionnelle au sein des professions médicales. Ce renouveau de l’exercice médical va en effet permettre des avancées significatives en matière de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
L’année dernière, un épisode malheureux s’est produit en matière de parité, je pense à la composition de la Haute Autorité de santé, dont le collège a été renouvelé sans femme. Une réflexion est-elle engagée sur la parité au sein des organes de gouvernance des agences sanitaires ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Mme la ministre, je sais que vous êtes très sensible à cette dernière question. On ne compte que six femmes directrices d’ARS sur vingt-six agences, une femme contre neuf hommes à la tête d’une des principales agences sanitaires, aucune femme au sein du collège de la Haute Autorité de santé qui compte huit membres, ni aucune directrice dans les principales caisses de sécurité sociale.
Mme Maina Sage. Selon une enquête menée outre-mer, la consommation de tabac chez les femmes progresse dans les territoires ultramarins – où elle baisse chez les hommes –, alors qu’elle stagne en métropole. Il est donc important de s’interroger sur les causes de ces différences de comportement, malgré les campagnes de prévention et les politiques fiscales dissuasives. À cet égard, je pense que le tabac est encore un signe d’émancipation pour beaucoup de femmes. Je suis en outre très inquiète de la banalisation de l’utilisation de la cigarette électronique dans nos territoires ultramarins, notamment chez les non-fumeurs et les non-fumeuses de tabac.
Cette problématique n’est évidemment pas sans conséquences sur les dépenses de santé. En Polynésie française, le coût de la protection sociale généralisée dépasse cette année 1 milliard d’euros, dont la moitié concerne les maladies, et un quart les maladies dues au tabac et au diabète.
Madame la ministre, quelle politique de prévention envisagez-vous en la matière, y compris pour la cigarette électronique dont la promotion n’est pas interdite ?
La seconde problématique outre-mer est l’obésité. Selon moi, les femmes ont un rôle prescriptif au sein de la famille en matière de comportements alimentaires, car ce sont souvent elles qui décident des menus et qui éduquent leurs enfants en matière d’alimentation. Par conséquent, outre la nécessité d’adapter les programmes alimentaires dès l’école et d’accompagner les familles vers un équilibre alimentaire, notamment grâce à l’utilisation des produits locaux, il faut que les politiques nationales de prévention prennent en compte la place de la femme en matière de nutrition.
Par ailleurs, l’éclatement de la politique de santé entre l’Éducation nationale et le ministère de la santé est un problème. Il me semble donc indispensable de mettre au point des plateformes de concertation pour faire converger ces politiques car on ne peut pas, d’un côté, promouvoir la santé et une bonne éducation alimentaire, et, de l’autre, ne pas adapter les programmes alimentaires pour les cantines.
En tout état de cause, nous resterons attentifs aux déclinaisons outre-mer des dispositions en matière de prévention.
Mme Linda Gourjade. Madame la ministre, je m’associe aux encouragements qui vous sont apportés.
Où en êtes-vous de vos discussions avec les médecins généralistes, qui sont encore très réticents face au tiers payant ?
L’hospitalisation à domicile suscite des mécontentements car, en facilitant la proximité, on laissera au secteur privé les zones rurales, voire les soins plus difficiles. En outre, le programme d’accompagnement du retour à domicile (PRADO), qui permet notamment le suivi à domicile par l’hôpital après l’accouchement, pose la question de la coordination entre les services de maternité et la protection maternelle et infantile (PMI).
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Le PRADO maternité devrait être déployé sur tout le territoire, car les femmes restent moins longtemps qu’auparavant à la maternité et elles peuvent se retrouver angoissées une fois rentrées chez elles. Elles ont donc besoin de conseils pour s’occuper de leur bébé, d’où le rôle très important des sages-femmes. Or ces professionnelles peuvent vacciner les mères et leurs enfants, mais pas l’entourage de ces derniers. Ne pensez-vous pas utile que le projet de loi prévoie qu’elles puissent le faire ?
En outre, madame la ministre, j’aimerais savoir qui finance la « pilule du lendemain » délivrée dans les lycées : le ministère de la santé ou le ministère de l’Éducation nationale ?
Mme Maud Olivier. Madame la ministre, vous avez indiqué que les centres de santé pourront réaliser des IVG médicamenteuses. Devront-ils comporter un échographe ?
Mme la ministre. Sur cette dernière question, la Haute Autorité de santé définira la procédure pour la pratique des IVG instrumentales : les centres de santé n’entrant pas dans ce cadre ne pourront pas pratiquer cet acte.
La parité reste une de mes grandes préoccupations. La loi comportera certainement, par le biais d’un article de renvoi aux ordonnances, des dispositions relatives à la réorganisation des agences sanitaires. Par ailleurs, la Haute Autorité de santé fait partie des structures qui seront amenées à se conformer aux dispositions de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Je vous indique par ailleurs que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sont désormais dirigées par une femme. En outre, les directions d’hôpitaux comptaient 19 % de femmes en 2012, mais ce taux est passé à 35 % à la fin de l’année 2013.
L’Assurance maladie poursuit le déploiement du PRADO maternité, qui s’appuie largement sur les sages-femmes libérales. Certains établissements, comme le CHU de Reims, n’ont pas souhaité s’engager dans cette démarche, mais la direction de ce dernier est depuis peu assurée par une femme, et peut-être celle-ci va-t-elle revoir la situation.
Il faut distinguer l’hospitalisation à domicile, qui est une projection de l’hôpital à domicile, et la prise en charge hors établissement par des professionnels de santé libéraux, laquelle constitue le cœur du projet de loi. La prise en charge hors établissement permettra à des professionnels de santé libéraux de s’occuper de patients chez eux dans des conditions satisfaisantes, ce qui répond à la logique de la médecine et de la chirurgie ambulatoires.
En France, le temps d’hospitalisation après un accouchement varie entre trois et quatre jours en moyenne, soit un jour de plus par rapport aux pays voisins. L’expérimentation du PRADO permettra de déterminer les cas pour lesquels le maintien en établissement est nécessaire – ou pas. L’objectif est d’accompagner les patients, et non de les laisser rentrer chez eux avec un sentiment d’insécurité. Au demeurant, la chirurgie ambulatoire n’est proposée que lorsque les personnes sont en mesure de bénéficier d’un accompagnement, qui parfois peut se limiter à la présence d’une personne à domicile la première nuit après l’intervention. Il ne s’agit donc pas de fragiliser les patients, après un accouchement ou un autre type d’acte réalisé en milieu hospitalier, il s’agit de permettre une prise en charge plus confortable à domicile, parfois plus rassurante, dès lors que les garanties de sécurité et d’accompagnement sont apportées.
Dans la suite des dispositions que j’ai prises visant à encadrer la publicité de la cigarette électronique, le projet de loi permettra l’interdiction de la publicité de l’e-cigarette dans les mêmes conditions que l’interdiction en faveur du tabac. Sans pouvoir me prononcer sur l’innocuité de la cigarette électronique, les études en la matière étant contradictoires, je peux dire que les risques sont différents de ceux du tabac pour des raisons évidentes. En revanche, cette cigarette contribue effectivement à la banalisation du geste et elle est un signe d’émancipation aux yeux des jeunes femmes. Je reste donc très attentive sur ce sujet, sans nier le fait que ce produit apporte à l’heure actuelle une réponse à des fumeurs souhaitant décrocher du tabac. Pour autant, même si la cigarette électronique est préférable à la cigarette tout court, il vaut mieux ne pas fumer du tout qu’utiliser la cigarette électronique.
Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015, le législateur a adopté un amendement prévoyant que le gouvernement remettra au Parlement avant le 1er octobre 2015 un rapport sur l’accès à la délivrance de la contraception aux mineurs d’au moins quinze ans de manière anonyme et gratuite.
Par ailleurs, j’ai chargé l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d’une mission visant à identifier les freins techniques à l’anonymisation. Pour l’interruption volontaire de grossesse, par exemple, la difficulté est de discriminer les publics – mineures et ayants droit – qui souhaitent garder le secret, car décréter l’anonymat pour toutes les IVG, au nombre de 210 000 par an, empêchera la traçabilité nécessaire à l’Assurance maladie pour assurer le suivi des patientes, par exemple en cas d’accidents en série liés à l’utilisation d’un produit. Ainsi, les données techniques de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) rendent difficile l’anonymisation de certains publics, mais je ne doute pas qu’il sera possible de lever ces freins.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La Délégation a interrogé l’ensemble des régions sur leurs actions en matière de contraception, et nous intégrerons leurs réponses dans notre rapport. En outre, je me bats pour que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoie un volet sur l’égalité entre les femmes et les hommes sur les sujets qui nous intéressent.
Madame la ministre, j’ai beaucoup apprécié l’ensemble de vos réponses. Je tiens à vous redire mon entier soutien à la suite des attaques ignominieuses que vous avez subies. Je trouve incompréhensibles les propos tenus par certains milieux médicaux. Je pense que vous avez été victime, en tant que ministre de la santé et en tant que femme, de ces campagnes inqualifiables. Je redis par ailleurs avec la plus grande fermeté que nous ne pouvons laisser faire l’apologie du viol dans les salles de garde des internes en médecine !
Enfin, nous réaffirmons que le tiers payant constitue un progrès considérable. Certes, les médecins sont préoccupés par la complexité en matière de mutuelles notamment, et nous le comprenons, mais des considérations techniques ne doivent pas empêcher ce progrès immense dont les femmes seront les premières bénéficiaires.
Madame la ministre, nous vous remercions infiniment et nous resterons à vos côtés pour mener ce combat.
II. EXAMEN DU RAPPORT EN DÉLÉGATION
La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes s’est réunie, le mercredi 18 février 2015, pour examiner le rapport présenté par Mmes Catherine Coutelle et Catherine Quéré, sur le projet de loi relatif à la santé (n° 2302).
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Mes chères collègues, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a souhaité être saisie du projet de loi relatif à la santé, qui sera examiné prochainement par l’Assemblée nationale, à partir de la mi-mars en commission des Affaires sociales et au début du mois d’avril en séance publique.
Mme Catherine Quéré, corapporteure, vous présentera les grandes lignes du projet de rapport d’information qui vous a été communiqué ainsi que les recommandations correspondant à la première partie de celui-ci, concernant certaines thématiques relatives à la santé des femmes en matière de prévention, d’accès aux soins et de prise en charge. Je vous présenterai par ailleurs les recommandations relevant de la seconde partie du rapport consacrée à la santé sexuelle et reproductive. Nous pourrons ensuite échanger sur les recommandations susceptibles d’être adoptées.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Le projet de loi relatif à la santé se fonde essentiellement sur trois axes : prévenir avant d’avoir à guérir, faciliter la santé au quotidien et innover pour conforter l’excellence du système de santé. Deux dispositions de ce texte concernent directement les femmes et les jeunes filles, avec la possibilité donnée aux sages-femmes de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse et la levée des restrictions concernant la délivrance de la contraception d’urgence par les infirmier-e-s scolaires.
Le droit des femmes à disposer de leur corps doit être conforté. C’est notamment pourquoi la délégation a souhaité travailler sur ce projet de loi important. Elle en a été saisie par la commission des Affaires sociales à la fin du mois de novembre 2014. Dans cette perspective, nous avons auditionné une vingtaine de personnes au cours de neuf réunions de la délégation. Au terme de nos travaux, ce rapport comporte une vingtaine de recommandations portant, d’une part, sur la prévention, l’accès aux soins et la prise en charge des femmes, et, d’autre part, sur la santé sexuelle et reproductive.
Sur le premier axe, et pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et mieux prendre en compte les enjeux spécifiques aux femmes, nous formulons tout d’abord cinq recommandations visant à adapter le pilotage des politiques de santé :
– en intégrant des objectifs spécifiques sur les femmes dans la Stratégie nationale de santé et dans les plans régionaux de santé (PRS) : c’est l’objet de la première recommandation ;
– en publiant tous les deux ans un « Baromètre Santé des femmes », avec une sélection d’indicateurs correspondant à des priorités de santé publique, comme le tabagisme, le renoncement aux soins chez les femmes ou encore l’accès à l’IVG (recommandation n° 2) ;
– en développant le recueil et la publication régulière de données sexuées en matière de santé au travail – au cours de nos travaux, il est en effet apparu un manque de données sexuées dans ce domaine – en s’appuyant notamment sur le rapport de gestion de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et sur les rapports annuels des médecins du travail (recommandation n° 3) ;
– en améliorant l’accès des femmes aux postes de direction dans les différentes instances sanitaires – il y a beaucoup de progrès à faire – et publiant rapidement l’ordonnance prévue par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes concernant les autorités administratives indépendantes (AAI) : tel est l’objet de la quatrième recommandation ;
– enfin, en associant mieux les femmes à l’évaluation et à la conception des politiques de santé, notamment grâce à des questionnaires en ligne (recommandation n° 5).
En deuxième lieu, nous proposons d’améliorer la prévention et l’accès aux soins à travers trois mesures :
– renforcer la justice sociale en matière de santé par la généralisation du tiers payant avec les solutions techniques adaptées dès que possible (recommandation n° 6) ;
– rendre obligatoire le logo nutritionnel prévu par ce texte (recommandation n° 7) ;
– préciser les compétences des sages-femmes en matière de vaccination et de prescription de substituts nicotiniques en prévoyant , à l’article 31 du projet de loi, que les sages-femmes pourront « prescrire et » pratiquer des vaccinations pour les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage du nouveau-né ou assurent sa garde et à l’article 33, que la prescription de substituts nicotiniques soit possible pendant les deux premiers mois suivant l’accouchement (recommandation n° 8).
En dernier lieu, nous formulons trois préconisations visant à adapter la prise en charge en tenant compte des spécificités des femmes dans les diagnostics et les traitements :
– améliorer la formation des médecins, initiale et continue, et des professionnels de santé pour mieux prendre en compte les spécificités des femmes dans les diagnostics et les traitements (recommandation n° 9) ;
– diligenter une mission d’évaluation sur les conditions d’essais cliniques de médicaments et la représentation des femmes dans ces tests (recommandation n° 10) ;
– et développer un accompagnement de qualité en direction des parturientes pour faciliter le retour à domicile après la sortie de la maternité (recommandation n° 11). Puisque les femmes sortent désormais des maternités au bout de deux ou trois jours, il nous a semblé important de développer l’accompagnement de ces femmes à domicile.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Avant de vous présenter la deuxième partie du rapport consacrée à la santé sexuelle et reproductive, je souhaite insister sur plusieurs points.
Tout d’abord, le projet de loi comporte plusieurs dispositions qui ne sont pas spécialement destinées aux femmes mais qui contribueront à améliorer leur santé. Je salue à cet égard Mme Monique Orphé, rapporteure de la Délégation aux outre-mer sur ce texte, qui pourra utilement compléter nos réflexions sur la question de la santé des femmes outre-mer.
Nous sommes partis d’un constat partagé : les femmes ont une espérance de vie plus élevée que celle des hommes et – chose intéressante que j’ai découverte au cours de nos travaux – ce constat vaut également quelle que soit la situation sociale des intéressées, puisque mêmes les femmes ouvrières ont une espérance de vie plus longue que celle des hommes occupant des fonctions de cadre. Mais si les femmes vivent plus longtemps, elles ne bénéficient pas de cette longévité en bonne santé.
Par ailleurs, les femmes sont plus touchées par la précarité et la pauvreté que les hommes, en particulier les familles monoparentales et les femmes touchant de petites retraites, et renoncent à se faire soigner pour des raisons financières. Nous souhaitons donc, à travers ce texte, améliorer l’accès à la santé afin de rompre avec les inégalités qui caractérisent aujourd’hui l’accès aux soins, inégalités sociales et territoriales, car il y a des territoires dans lesquels il est plus difficile de se faire soigner que d’autres.
Pour ces raisons, nous tenons particulièrement au tiers payant généralisé. Je n’ignore pas que cette mesure suscite des inquiétudes compte tenu de certaines difficultés, liées notamment aux mutuelles et à la complexité du dispositif, auxquelles craignent d’être exposées les médecins, mais une question d’ordre technique ne doit pas empêcher une avancée bénéficiant au plus grand nombre. J’ajoute qu’il est inexact d’affirmer que la généralisation du tiers payant conduira les patients à considérer que la médecine est gratuite. En effet, notre système de sécurité sociale est fondé sur l’idée que tout revenu et salaire doit contribuer à son financement : dans ces conditions, ce sont bien les cotisations sociales, salariales et patronales, qui financent les soins d’un salarié.
En outre, comme l’a indiqué Mme Catherine Quéré, nous avons constaté, à notre grande surprise, une connaissance insuffisante de la situation des femmes en matière de santé au travail.
La médecine du travail n’est quasiment pas abordée par ce texte et l’on constate aujourd’hui un cloisonnement concernant notamment la médecine scolaire, qui relève de l’éducation nationale, et la médecine du travail, qui dépend du ministère du travail. Ce cloisonnement devrait être remis en cause car force est de constater que le patient peut relever successivement de la médecine scolaire, lorsqu’il est à l’école ou à l’université, puis de la médecine du travail lorsqu’il exerce une activité salariée, et peut également avoir recours à la médecine libérale.
Pourquoi existe-t-il un manque de données sexuées sur la santé au travail ? Les médecins du travail que nous avons auditionnés nous ont indiqué que les statistiques qu’ils pouvaient faire remonter sur cette question n’étaient pas exploitées au niveau national aux fins de comparaison de la santé des femmes au travail avec celle des hommes. C’est pourtant un sujet essentiel. Je rappelle par exemple, et peut-être Mmes Bérengère Poletti, Marie-Noëlle Battistel et Brigitte Bourguignon s’en souviennent-elles, qu’à l’occasion de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites, nous avions constaté que le travail de nuit favorisait le cancer du sein chez les femmes. Certains pays l’ont d’ailleurs reconnu comme une maladie professionnelle.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. À propos du tiers payant, nous nous sommes aperçues que beaucoup de femmes ne se font pas soigner parce qu’elles ne peuvent pas avancer l’argent nécessaire au paiement des soins. Plus précaires que les hommes, les femmes pâtissent donc davantage qu’eux de l’absence de généralisation du tiers payant…
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. … et cela contribue à engorger les urgences où il n’y a pas d’avance de frais à faire. Voilà quel a été notre état d’esprit et je vous renvoie, pour plus de précisions, au rapport qui présente de nombreux éléments d’information et données très intéressantes sur la santé des femmes, en adoptant une vision large de ces questions, avec une double approche sexuée et sociale.
J’en viens à la seconde partie du rapport qui traite plus spécifiquement de la santé sexuelle et reproductive qui, initialement, avait particulièrement retenu notre attention compte tenu des avancées prévues par le projet de loi dans ce domaine. Je tiens toutefois à souligner que, comme le montre toute la première partie de ce rapport, notre travail ne s’est pas concentré uniquement sur les questions de santé sexuelle et reproductive.
Nous voulons accompagner et conforter les avancées qui ont été réalisées dans ce domaine, en particulier depuis 2012, et je me souviens également des travaux engagés par notre collègue Bérengère Poletti il y a quelques années dans le cadre de deux rapports d’information adoptés par la délégation sur ces questions.
Nous préconisons tout d’abord d’améliorer l’accès à l’avortement sur l’ensemble du territoire en simplifiant le parcours des femmes et en renforçant l’offre de soins. On s’aperçoit en effet que le parcours qui mène à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est toujours compliqué : il n’est pas simple d’obtenir des informations et beaucoup de centres d’IVG ont fermé. Je ne connais pas la situation outre-mer, mais sur le territoire métropolitain, plus de la moitié des cliniques privées ont fermé leur centre d’IVG au cours des dix dernières années. Le rapport dont vous disposez comporte des précisions chiffrées sur ce point.
Nous voulons que l’accès à l’IVG soit clair et simple. Je note d’ailleurs qu’aucun organisme n’est expressément dénommé « centre d’IVG » : il serait bon d’indiquer plus clairement quels sont les endroits où l’on pratique l’IVG pour améliorer leur visibilité.
Nous proposons par ailleurs de permettre à des professionnel-le-s qualifié-e-s non médecins, telles que les sages-femmes et les infirmier-e-s, de réaliser la première consultation pour une demande d’IVG et de délivrer l’attestation correspondante (recommandation n° 13).
La proposition suivante vise, d’une part, à supprimer l’obligation du délai de réflexion entre la première et la deuxième consultation pour une IVG et, d’autre part, à supprimer les dispositions spécifiques issues de la loi du 17 janvier 1975 qui prévoient qu’un médecin n’est pas tenu de pratiquer une IVG, compte tenu des dispositions déjà prévues par le code de la santé publique qui donnent le droit aux médecins, de façon générale, de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
La suppression de l’obligation du délai de réflexion entre la première et la deuxième consultation pour une IVG avait été évoquée dans le cadre de discussions sur le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans laquelle elle n’a pas été inscrite. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), qui a publié un rapport très complet sur l’accès à l’IVG, l’appelle de ses vœux, ainsi qu’un certain nombre d’associations et de professionnels. Il n’est pas normal que, pour cet acte uniquement, on impose un délai de sept jours aux patientes.
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, portée par Mme Najat Vallaud-Belkacem a supprimé la référence à une « situation de détresse ». Nous demandons aujourd’hui de supprimer l’obligation du délai de réflexion. La suppression de cette obligation n’implique pas la disparition des visites médicales. Si, lors de la première visite médicale, une femme est décidée à recourir à une IVG, le professionnel ou la professionnelle de santé (médecin, infirmier-e, sage-femme) lui expliquera alors les démarches à effectuer et les différentes possibilités de pratiquer une IVG (soit médicamenteuse, soit instrumentale). La femme reviendra pour une seconde visite au cours de laquelle soit l’IVG médicamenteuse sera pratiquée, soit, s’il s’agit d’une IVG instrumentale, des analyses médicales seront effectuées en vue de cette IVG. La suppression de cette obligation évitera simplement à des femmes d’avoir à effectuer une première visite médicale pour faire part de leur souhait de recourir à une IVG avant de revenir sept jours plus tard pour une deuxième visite médicale où elles signent un document constatant la volonté exprimée une semaine plus tôt.
De façon générale, je respecte totalement ce qu’avait décidé Mme Simone Veil lors du vote de la loi de 1975. Elle a eu raison de prévoir certaines mesures pour permettre l’adoption de cette loi qui a nécessité des concessions, et parmi lesquelles cette obligation d’un délai de réflexion d’une semaine, mais aussi les dispositions relatives à la « clause de conscience » en matière d’IVG.
Nous vous soumettons la proposition de supprimer ces dispositions spécifiques issues de la loi de 1975, qui prévoient qu’un médecin n’est pas tenu de pratiquer une IVG, dans la mesure où d’autres dispositions du code de la santé publique octroient déjà aux médecins le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Le code de la santé publique et le code de déontologie des professions médicales reconnaissent en effet aux médecins, infirmiers et sages-femmes une clause dite « de conscience » à portée générale. Pour faciliter l’adoption de la loi de 1975, Mme Simone Veil avait négocié l’inscription, dans cette loi, d’une « clause de conscience » spécifique à l’IVG. Lors de nos travaux, il est en effet apparu que ces dispositions pouvaient concourir à faire de l’IVG un acte médical à part. Par ailleurs, il nous semble important, de façon générale, de lever certains freins en matière d’accès à l’avortement et d’éviter l’allongement des délais à travers différentes mesures.
Nous proposons de supprimer ces dispositions spécifiques à l’IVG en maintenant par ailleurs la clause de conscience à portée générale reconnue aux médecins et à d’autres professionnel-le-s de santé, qui peuvent refuser de pratiquer un acte médical.
Nous recommandons par ailleurs de permettre la pratique des IVG instrumentales par anesthésie locale dans les centres de santé, mais aussi dans les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF), dans les maisons de santé pluridisciplinaires ainsi que par les sages-femmes, sous réserve qu’ils répondent au cahier des charges défini par la Haute autorité de santé concernant les conditions techniques et de sécurité nécessaires (proposition n° 14).
Dans le cadre du plan national pour améliorer l’accès à l’IVG, la ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Mme Marisol Touraine, a déjà annoncé que les centres de santé auront la possibilité de pratiquer les IVG instrumentales, mais les maisons de santé et les centres de planification n’ont pas été mentionnés.
Les centres de planification dépendent en grande majorité des conseils généraux, et, en très faible part, du Planning familial, avec lequel ils ne se confondent pas. Tous les centres du planning familial ne sont pas des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF), et inversement. Il s’agit en fait d’ajouter les maisons de santé, les CPEF et les sages-femmes à la liste des personnes et organismes habilités à pratiquer des IVG instrumentales. Nous préconisons par ailleurs :
– de renforcer l’offre d’IVG sur le plan qualitatif et quantitatif, en prévoyant dans la loi le principe de plans d’actions régionaux et en veillant à l’intégration de l’activité d’IVG dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé (recommandation n° 15) ;
– de développer et financer des études et recherches pour mieux connaître les pratiques actuelles en matière d’IVG (proposition n° 16), car nous connaissons assez mal le nombre de médecins qui pratiquent l’IVG et le nombre de ceux qui la pratiquent dans un délai de 10 à 12 semaines. Il semblerait qu’il y ait des refus de pratiquer l’IVG passée la dixième semaine, mais la loi ne l’interdit qu’après la douzième semaine. Nous connaissons aussi insuffisamment les pratiques en matière de « clause de conscience » ainsi que l’estimation du nombre de femmes qui se rendent à l’étranger et du nombre de mineures qui avortent sans autorisation parentale.
Ce rapport propose, d’autre part, une série de mesures visant à faciliter l’accès à la contraception et à développer les actions d’éducation à la sexualité.
Il nous semble tout d’abord nécessaire améliorer la formation initiale et continue des personnels médicaux appelés à prescrire des contraceptifs (proposition n° 17). Je me souviens que notre collègue Bérengère Poletti avait indiqué à la délégation qu’on constatait en la matière une certaine méconnaissance ou, à tout le moins, une indication de contraceptifs centrée sur la « pilule » et qu’il ne paraissait pas toujours important aux professionnels de santé de présenter les différentes possibilités en matière de contraception, et notamment les solutions les mieux adaptées aux diverses situations des femmes.
Par ailleurs, nous préconisons :
– d’harmoniser la couverture géographique des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) et d’améliorer leur communication sur Internet en fournissant des informations pratiques sur les lieux, horaires et prestations (proposition n° 18) ;
– de prévoir la réalisation par la Haute Autorité de santé (HAS) d’une étude sur la possibilité et la pertinence de mettre en vente libre dans les pharmacies les micro-progestatifs (proposition n° 19). En l’absence d’étude, nous n’avons pas voulu recommander directement cette mise en vente libre. J’y serais personnellement assez favorable. Cependant, même pour l’usage de micro-progestatifs, une visite médicale peut être nécessaire, notamment pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes de circulation sanguine ou autre. Il convient donc de disposer d’informations plus précises sur ce point. En tout état de cause, la mise en vente libre constituerait une simplification notable : c’est toujours compliqué pour les jeunes filles d’aller demander la délivrance de pilules. Mais nous souhaitons nous assurer qu’il n’y ait pas de contre-indications importantes.
À cet égard, je précise que nous avons pris l’initiative d’interroger les régions sur les initiatives qu’elles avaient pu prendre en matière de contraception et le rapport d’information comporte ainsi des informations inédites sur les dispositifs de type « Pass contraception ». Je pense qu’il s’agit d’une action importante et, dans le cadre de la réforme territoriale en cours d’examen par le Parlement, il faudrait que l’on souligne le rôle des régions dans ce domaine, à l’égard des lycées en particulier. Des changements de majorité dans certains territoires peuvent conduire à des orientations différentes et à considérer que ce rôle n’est plus prioritaire ou nécessaire.
Notre dernière préconisation vise à rendre effective l’application de la circulaire de 2003 en inscrivant l’éducation à la sexualité dans les programmes obligatoires et les horaires d’enseignement. Nous constatons toutes et tous que cette éducation à la sexualité n’est pas, pour l’instant, très suivie d’effets, non pas par manque de lois et de circulaires, dont tous s’accordent à dire qu’elles sont très bien faites, mais par une mise en œuvre insuffisante. Cette éducation à la sexualité nous apparaît aujourd’hui prioritaire pour le développement d’une relation respectueuse entre filles et garçons. Tant que cette éducation est laissée à l’appréciation des établissements, sa mise en œuvre risque de dépendre de la bonne volonté des acteurs. Nous pensons qu’en l’inscrivant dans les programmes obligatoires d’enseignement, elle sera plus effective.
Mme Bérengère Poletti. Concernant la mise en place du tiers payant, c’est un sujet qui fait débat et politique et, si je soutiens l’objectif d’un accès gratuit aux soins, cela ne doit pas conduire à retirer du temps médical par rapport au temps administratif.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les obstacles administratifs ou techniques ne doivent pas entraver la mise en place du tiers payant.
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Les pharmaciens ont le même problème mais ils ont, me semble-t-il, un centre de gestion avec des informations sur les différentes mutuelles. Les médecins pourraient s’organiser pareillement.
Mme Bérengère Poletti. On ne va pas refaire ici le débat sur le tiers payant. Je voulais seulement rappeler que le temps médical est quelque chose d’important. Je remercie la présidente d’avoir rappelé que le projet de loi relatif à la santé s’adresse aux femmes et aux hommes mais alors les recommandations ne doivent pas laisser ces derniers de côté. Pourquoi la recommandation n°5 ne vise-t-elle qu’à associer les femmes à l’évaluation des politiques de santé grâce à des questionnaires ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous avons auditionné M. Claude Evin, directeur général de l’ARS d’Île-de-France et ancien ministre, qui a mis en place un programme régional pour favoriser la réduction des inégalités d’accès à l’avortement (FRIDA). Dans ce cadre, un questionnaire en ligne a été lancé pour recueillir l’avis des femmes en matière de recours à l’IVG en Île-de-France et cette initiative nous a semblé très intéressante. C’est notamment pourquoi cette recommandation visait les femmes, mais évidemment, nous sommes favorables à l’association des hommes et des patient-e-s à l’évaluation et à la conception des politiques de santé.
Mme Bérengère Poletti. Concernant les compétences des sages-femmes en matière de vaccins et de substituts nicotiniques, il me semble que des médecins ont fait part de leur opposition à la possibilité pour les pharmaciens et les sages-femmes de pratiquer des vaccinations.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Dans le projet de loi, il est prévu que les sages-femmes puissent prescrire des substituts nicotiniques à l’entourage de la femme enceinte pour protéger la santé de l’enfant.
Mme Bérengère Poletti. Il peut y avoir des réticences en matière de délégation de tâches, même si des médecins peuvent aussi se plaindre dans le même temps de leur charge de travail. Sur la recommandation n° 11 visant à développer l’accompagnement des parturientes, j’ai noté que la sécurité sociale a développé ces pratiques, surtout à partir du deuxième enfant, mais pour le premier enfant, je ne suis pas favorable aux sorties précoces.
Il y a une autre problématique qui n’est pas abordée dans ce rapport, c’est tout ce qui est lié à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Il faut pratiquer des analyses de sang, les femmes sont fatiguées car le traitement est agressif, la vie professionnelle devient compliquée, existe-t-il des rapports sur ces aspects-là ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. On peut rajouter quelque chose sur ce thème dans le corps du rapport, mais en effet, le projet de loi n’évoque pas cette thématique.
Mme Edith Gueugneau. Cela crée aussi un effet discriminatoire sur l’embauche et le maintien dans l’emploi. Il y a généralement plusieurs essais, des arrêts de travail et tout cela se révèle pénalisant pour décrocher un contrat à durée indéterminée (CDI).
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. En effet.
Mme Bérengère Poletti. Cela contribue à créer une notion de « grossesse précieuse », car la femme est souvent arrêtée plus tôt dans sa grossesse. Le traitement est dur et le profil est en effet défavorable pour accéder à un CDI.
Concernant la recommandation n° 12, cela signifie –t-il que les infirmiers feraient des diagnostics de grossesse ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La première consultation pour une demande d’IVG ne vise pas à fournir une attestation de grossesse : la femme sait qu’elle est enceinte puisqu’elle présente cette demande. Elle commence ses démarches ce jour-là et cela marque le début du parcours.
Mme Bérengère Poletti. Les sages-femmes sont compétentes sur toutes les questions relatives à la grossesse ; les infirmiers c’est plus douteux, ils ont d’autres compétences. Dès lors, pourquoi inclure les infirmiers dans cette recommandation ?
Concernant la recommandation n° 13, je n’ai pas de blocage pour revenir sur l’obligation du délai de réflexion d’une semaine mais la suppression de la clause de conscience me pose problème. En effet, on essaie, dans le cadre de ce projet de loi, d’étendre les compétences des sages-femmes pour leur permettre de pratiquer l’IVG médicamenteuse, mais si, dans le même temps, on devait supprimer la clause de conscience, on brandit un véritable épouvantail. Si l’on tient le discours selon lequel cette clause de conscience existe en fait déjà de manière générale mais qu’en même temps on dit on la retire pour lever un frein, ce qui suggère qu’on souhaite finalement accroître la contrainte sur le médecin pour pratiquer cet acte, c’est pour le moins contradictoire. Il faut faire attention à l’argumentaire qu’on utilise.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La loi Veil introduit la clause de conscience pour l’IVG, mais celle-ci existe déjà dans le code de déontologie médicale et dans le code de la santé publique. Je m’interroge d’ailleurs sur les cas dans lesquels les médecins peuvent la faire valoir en dehors de l’IVG.
Mme Bérengère Poletti. Il y a la fin de vie.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. En effet. Les associations et le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) nous disent que la clause de conscience est spécifique à l’IVG et qu’il y a redondance avec la clause générale de conscience du code de la santé publique. Il y a un mouvement anti-IVG et des médecins invoquent cette clause de conscience spécifique. Il y a aussi de l’entrave à l’IVG. On voudrait donc lever ce qui nous paraît comme une redondance et un frein.
Mme Bérengère Poletti. C’est un argumentaire ambigu. Il a été dit que la société se raidit et que des professionnels se refusent à pratiquer cet acte, pour des convictions religieuses notamment, mais c’est aussi le contexte qui les y pousse, et non la loi. Si par ailleurs on dit que de toute façon la loi prévoit que les médecins peuvent faire valoir cette clause de conscience, l’argument ne tient pas ; cela va être compliqué de revenir dessus et, en tout état de cause, ce n’est pas le meilleur moment.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Le contexte est défavorable après les débats sur le mariage pour tous. Mais nous avons quand même enlevé la condition de détresse pour l’IVG. Je vois bien que les débats renaissent avec virulence et s’il l’on peut souhaiter avancer avec prudence, peut-être la situation est-elle mûre aujourd’hui pour toiletter les textes. C’est une proposition que je vous soumets.
Mme Bérengère Poletti. C’est un épouvantail qui va susciter beaucoup de réactions, cela n’est pas souhaitable.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La Délégation aux droits des femmes n’est-elle pas dans son rôle de le proposer ? Cela ne signifie d’ailleurs pas nécessairement qu’il y aura un amendement en ce sens.
Mme Monique Orphé. En effet.
Mme Marie-Noëlle Battistel. En même temps, si on enlève la clause spécifique, on reste dans le cadre général pour l’ensemble de la profession. Le problème est plutôt que ce n’est pas le moment ?
Mme Bérengère Poletti. C’est agiter un chiffon rouge, mais pour quel résultat ? Concrètement, les freins en matière d’accès à l’IVG ne tiennent pas à cela. Il y a une crispation de la société sur ces questions. J’ai peur que vous obteniez le résultat inverse de celui recherché.
Mme Conchita Lacuey. Oui, peut-être. Mais en même temps pourquoi viser spécialement les femmes et l’acte d’IVG ? S’il est nécessaire de toiletter les textes, à un moment donné il faut y aller !
Mme Catherine Quéré, corapporteure. Si nous sommes interpellées sur ce sujet, il s’agira de rappeler que la clause générale sera maintenue, il ne faut pas soulever un problème qui n’existe pas.
Mme Monique Orphé. Sur la recommandation n° 16 relative aux études et recherches sur la pratique de l’IVG, je voudrais dire que dans les départements d’outre-mer (DOM), l’IVG devient parfois un moyen de contraception, avec des taux plus élevés qu’en métropole. Par exemple, en Guadeloupe, on compte de l’ordre de 31 IVG pour 1 000 jeunes filles de 15 à 17 ans. Il faut approfondir l’analyse des causes de recours à l’IVG, j’avais d’ailleurs reçu une chercheuse travaillant sur le VIH et sur les grossesses précoces en Guyane, car on manque de données dans les DOM. Sur les grossesses précoces, elles sont deux fois plus élevées dans les DOM. Il faut une vraie recherche sur ces sujets-là pour pouvoir mener ensuite des actions appropriées.
En outre, la suppression de la clause de conscience des médecins peut avoir un intérêt. Constate-ton d’ailleurs un refus massif des médecins dans ce domaine ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. En effet, les chiffres outre-mer et en métropole sont très différents, comme le font apparaître les chiffres présentés dans le rapport.
Mme Monique Orphé. De même, le taux de mortalité infantile est bien plus élevé outre-mer alors même qu’il existe des moyens modernes de prévention, notamment à la Réunion. Sur ce point encore, nous manquons de données.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous proposons de rajouter à la recommandation n°16 la mention suivante : « et notamment outre-mer ».
Mme Bérengère Poletti. La recommandation n° 18 prévoit notamment l’harmonisation de la couverture géographique des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF). Il apparaît en outre essentiel d’harmoniser et d’améliorer leurs horaires d’ouverture. Par exemple, il est anormal qu’en Guadeloupe, ces centres ferment à 17 heures.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous pouvons modifier la recommandation n° 18 pour y faire référence.
Mme Bérengère Poletti. Enfin, le « Pass contraception » constitue une mesure très intéressante. En revanche, les retours ne sont pas toujours satisfaisants.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Selon l’enquête que nous avons réalisée, 110 jeunes ont sollicité des dispositifs de ce type en 2012 dans la région Champagne-Ardennes.
Mme Bérengère Poletti. Il nous faut connaître le nombre de contraceptifs délivrés par le biais de ces coupons pour en mesurer l’efficacité réelle.
Mme Monique Orphé. S’agissant de l’éducation à la sexualité, se pose la question des jeunes qui n’y ont pas accès, notamment du fait de leur déscolarisation ou de leur milieu culturel. Peut-être faudrait-il favoriser des campagnes de publicité sur ce point.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La ministre avait lancé une grande campagne de communication relative à la contraception il y a quelques années. Mais effectivement, cela pourrait être utile.
La Délégation adopte le présent rapport ainsi que les recommandations ci-après.
SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTÉ ET MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX FEMMES
§ Adapter le pilotage des politiques de santé
1. Intégrer des objectifs spécifiques sur les femmes dans la Stratégie nationale de santé et dans les plans régionaux de santé (PRS).
2. Publier tous les deux ans un « Baromètre Santé des femmes », avec une sélection d’indicateurs correspondant à des priorités de santé publique (tabagisme, renoncement aux soins chez les femmes, IVG, etc.).
3. Développer le recueil et la publication régulière de données sexuées en matière de santé au travail en s’appuyant notamment sur le rapport de gestion de la CNAMTS et sur les rapports annuels des médecins du travail.
4. Améliorer l’accès des femmes aux postes de direction dans les différentes instances sanitaires et publier rapidement l’ordonnance prévue par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes concernant les autorités administratives indépendantes (AAI).
5. Mieux associer les femmes à l’évaluation et à la conception des politiques de santé grâce à des questionnaires en ligne, etc.
§ Améliorer la prévention et l’accès aux soins
6. Renforcer la justice sociale en matière de santé par la généralisation du tiers payant avec les solutions techniques adaptées dès que possible.
7. Rendre obligatoire le logo nutritionnel prévu par le projet de loi.
8. Préciser les compétences des sages-femmes en matière de vaccination et de prescription de substituts nicotiniques :
– en précisant à l’article 31 du projet de loi que les sages-femmes peuvent « prescrire et » pratiquer des vaccinations pour les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage du nouveau-né ou assurent sa garde ;
– en prévoyant, à l’article 33, que la prescription de substituts nicotiniques soit possible pendant les deux premiers mois suivant l’accouchement.
§ Adapter la prise en charge en tenant compte des spécificités des femmes dans les diagnostics et les traitements
9. Améliorer la formation des médecins, initiale et continue, et des professionnel-le-s de santé pour mieux prendre en compte les spécificités des femmes dans les diagnostics et les traitements.
10. Diligenter une mission d’évaluation sur les conditions d’essais cliniques de médicaments et la représentation des femmes dans ces tests.
11. Développer un accompagnement de qualité en direction des parturientes pour faciliter le retour à domicile après la sortie de la maternité.
CONFORTER LES AVANCÉES EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
§ Améliorer l’accès à l’avortement sur l’ensemble du territoire : simplifier le parcours des femmes, renforcer l’offre de soins et éclairer les zones d’ombre
12. Permettre à des professionnel-le-s qualifié-e-s non médecins, telles que les sages-femmes et les infirmier-e-s, de réaliser la première consultation pour une demande d’IVG et de délivrer l’attestation correspondante.
13. Supprimer l’obligation du délai de réflexion entre la première et la deuxième consultation pour une IVG et supprimer les dispositions spécifiques issues de la loi de 1975 prévoyant qu'un médecin n’est pas tenu de pratiquer une IVG, compte tenu des dispositions déjà prévues par le code de la santé publique qui donne le droit aux médecins de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
14. Permettre la pratique des IVG instrumentales par anesthésie locale dans les centres de santé mais aussi les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF), les maisons de santé pluridisciplinaires et par les sages-femmes, sous réserve qu’ils répondent au cahier des charges défini par la Haute Autorité de santé concernant les conditions techniques et de sécurité nécessaires.
15. Renforcer l’offre d’IVG sur le plan qualitatif et quantitatif, en prévoyant dans la loi le principe de plans d’actions régionaux et en veillant à l’intégration de l’activité d’IVG dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé.
16. Développer et financer des études et recherches pour mieux connaître les pratiques actuelles en matière d’IVG, notamment outre-mer, concernant le nombre de médecins qui pratiquent l’IVG et le nombre de ceux qui la pratiquent dans le délai de 10 à 12 semaines, la clause de conscience, l’estimation du nombre de femmes se rendant à l’étranger, les avortements concernant des mineures sans autorisation parentale, le rôle des différents professionnel-le-s de santé, etc.
§ Faciliter l’accès à la contraception et développer les actions d’éducation à la sexualité
17. Améliorer la formation initiale et continue des personnels médicaux appelés à prescrire des contraceptifs.
18. Harmoniser la couverture géographique des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) et améliorer leur couverture horaire et leur communication sur Internet en fournissant des informations pratiques sur les lieux, horaires et prestations.
19. Prévoir la réalisation par la Haute Autorité de santé d’une étude sur la possibilité et la pertinence de mettre en vente libre dans les pharmacies les micro-progestatifs.
20. Encourager le développement d’initiatives de type « Pass contraception » dans les régions.
21. Rendre effective l’application de la circulaire de 2003 en inscrivant dans les programmes obligatoires et les horaires d’enseignement l’éducation à la sexualité.
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
I. PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA DÉLÉGATION
● Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh)
– Mme Françoise Laurant, présidente de la commission « Santé, droits sexuels et reproductifs » du HCEfh, ancienne présidente du Planning familial
– Mme Claire Guiraud, responsable des études et de la communication, chargée du suivi de la commission « Santé, droits sexuels et reproductifs »
● Conseil économique, social et environnemental (CESE)
– Mme Dominique Henon, conseillère au Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) d’Île-de-France, ancienne membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et rapporteure sur La santé des femmes en France (2010) de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du CESE
● Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
– Mme Nathalie Bajos, socio-démographe, directrice de recherche à l’INSERM, responsable de l’équipe « Genre, santé sexuelle et reproductive » de l’INSERM-INED (Institut national des études démographiques)
● Association nationale des centres d’interruption volontaire de grossesse et de contraception (ANCIC)
– Mme Sophie Eyraud, médecin généraliste, coprésidente
– Mme Laurence Danjou, gynécologue, coprésidente
● Réseau entre l’hôpital et la ville pour l’orthogénie (REHVO)
– Mme Sophie Gaudu, gynécologue-obstétricienne, présidente du REHVO et cheffe de service à la maternité des Bluets
● Syndicat national des infirmier-e-s conseiller-e-s de santé (SNICS)
– Mme Béatrice Gaultier, secrétaire générale
– M. Christian Allemand, secrétaire général adjoint
● Collège national des sages-femmes de France (CNSF)
– Mme Sophie Guillaume, présidente, sage-femme
– M. Adrien Gantois, membre du bureau du CNSF, sage-femme
● Planning familial
– Mme Véronique Séhier, coprésidente du Mouvement français du Planning familial
– Mme Danielle Gaudry, membre du bureau national
● Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
– M. François Bourdillon, directeur général par intérim de l’INPES, directeur général de l’Institut national de veille sanitaire (InVS), vice-président du Conseil national du sida, médecin de santé publique
– Mme Jennifer Davies, chargée des relations internationales à l’INPES
● Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)
– Mme Florence Chappert, responsable du projet « Genre, santé et conditions de travail » à l’ANACT
● Association Santé et médecine au travail (A-SMT)
– M. Alain Randon, secrétaire adjoint de l’A-SMT, médecin du travail
– Mme Nadine Khayi, membre du bureau de l’association Santé et médecine au travail (A-SMT), médecin du travail
● Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SPNST)
– M. Jean-Michel Sterdyniak, secrétaire général
● Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France
– M. Claude Evin, directeur général, ancien ministre
– Mme Anne-Gaëlle Daniel, chargée de mission périnatalité à la direction de la santé publique
● Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes
– Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
II. PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURES
● Fédération nationale des centres de santé (FNCS)
– M. Richard Lopez, président, médecin
● Conseil national de l’Ordre des sages-femmes
– Mme Marie-Josée Keller, présidente, sage-femme
– Mme Anne-Marie Curat, trésorière, sage-femme
– M. Jean-Marc Delahaye, chargé des relations institutionnelles
ANNEXE 2 : TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIFS DE TYPE « PASS CONTRACEPTION »
MIS EN PLACE DANS SEPT RÉGIONS
Sont présentées ci-après, sous forme de tableau synthétique, les réponses au questionnaire adressé par les rapporteures, en décembre 2014, aux présidents de conseil régional, pour ce qui concerne les sept régions suivantes.
Bourgogne |
Champagne-Ardennes |
Haute-Normandie |
Languedoc Roussillon |
Limousin |
Provence-Alpes-Côte d’azur |
Poitou-Charentes | |
Intitulé et date de création |
Parcours santé-contraception (Rentrée 2014) |
Pass contraception (Voté le 22 décembre 2010) |
Pass Région Santé (1er trimestre 2015) |
Pass contraception (adopté en octobre 2012 ; mis en œuvre en mai 2013) |
Pass contraception (octobre 2013 ; lancement du dispositif 2e trimestre 2014) |
PASS santé + prévention contraception (mars 2013) |
Pass contraception (2009) |
Cibles Cibles (suite) |
Jeunes filles et garçons mineurs scolarisés dans un établissement public relevant du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture |
Jeunes filles et garçons (mineurs) des lycées du ressort de l’académie de Reims qui pour des raisons financières, sociales, géographiques, familiales, rencontrent des difficultés d’accès à la contraception |
Tous les titulaires de la carte Région et de la carte Région liberté : lycéens, apprentis, jeunes de moins de 26 ans en formation professionnelle, étudiants en 1ère année d’études supérieures |
Filles et garçons mineurs et majeurs des établissements scolaires : – lycées généraux, techniques agricoles, professionnels – CAF – E2C (113) – MFR (114) – IRTS (115) |
Filles et garçons de moins de 18 ans, scolarisés dans les lycées, publics et privés sous contrat, de la région (enseignement général, technologique et professionnel, lycées agricoles, MFR, EREA (116)), jeunes en CFA, ou encore jeunes de moins de 18 ans suivis par les missions locales Environ 30 000 jeunes éligibles |
Jeunes filles et garçons de moins de 26 ans, résidant en Provence-Alpes-Côte d’Azur et pouvant justifier d’un des statuts suivants : lycéen -ne-s, apprenti-e--s, étudiant-e-s, stagiaires de la formation profes-sionnelle, en service civique, accompagné par une mission locale, inscrit à Pôle emploi |
Jeunes filles et garçons des : – lycées privés et publics ; – centres de formation des apprentis (CFA) ; – maisons familiales et rurales (MFR) ; – établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA). |
Bénéficiaires |
Jeunes filles bénéficiant d’un accès autonome, anonyme et gratuit à la contraception Pass renouvelable |
Filles mineures ou majeures, dès lors qu’elles ont moins de 26 ans et qu’elles sont scolarisées |
– Jeunes filles scolarisées dans la région, mineures ou majeures – Jeunes filles mineures de la région | ||||
Lieux de diffusion Lieux de diffusion (suite) |
Par l’intermédiaire de l’infirmière scolaire du lycée ou du référent santé de l’établissement |
→ Chéquiers accessibles par le biais des personnels de santé de l’éducation nationale (infirmiers et médecins scolaires) 156 établis-sements : – lycées – de la FR-MFR (117) – de la DRAAF (118) – des missions locales – des écoles de la 2ème chance – des directions régionales de la protection judiciaire de la jeunesse (DRPJJ) de la Marne, des Ardennes, de l’Aube et de la Haute-Marne – des CFA (119) → Sur le site internet de la région → application smartphone « superCApps »
→forums associatifs |
Onglet « Jeunes » sur le site lacarteregion.com |
Pass disponible dans les lycées publics généraux, techniques, professionnels et agricoles du Languedoc-Roussillon Distribué dans les établissements scolaires par les infirmiers scolaires et les référents santé. Distribution laissée à l’appréciation du professionnel Large communication en direction des jeunes : flyers, affiches… |
Diffusion par tous les intervenants au contact des jeunes au niveau éducatif : communauté éducative scolaire, professionnels des CPEF et des associations intervenant en milieu scolaire sur l’éducation à la sexualité et la vie affective, professionnels d’insertion des missions locales – Chéquier remis par l’infirmière scolaire ou le médecin scolaire après entretien avec le jeune – par les professionnels des autres structures ne disposant pas systématiquement de personnel médical ou paramédical (missions locales, CFA, établissements d’enseignement privé) – site Belim (service proposé aux jeunes par la Région Limousin) – CRIJ (120) |
Commande d’un chéquier sur le site internet dédié. |
– établissements scolaires – permanences et interventions (bus itinérant) des associations du Mouvement français du Planning familial (MFPF) – cabinets médicaux libéraux |
Portée (nombre de bénéficiaires, pass délivrés, etc.) Portée (suite) |
9 jeunes filles se sont vu délivrer un chéquier |
Depuis janvier 2012, 110 jeunes ont sollicité un chéquier |
300 chéquiers distribués |
30 visites du site internet par jour ; 275 appels par mois sur le numéro vert ; dizaines de séances d’information auprès des profes-sionnels de santé partenaires ; 2 000 prestations par an |
Au 15 octobre 2014 : 1 079 pass’ contraception délivrés Moyenne d’âge : 17 ans et un mois | ||
Caractéristiques |
Accès anonyme et gratuit à l’ensemble de l’offre contraceptive. Dispositif anonyme et gratuit ne nécessitant ni carte d’identité, ni carte vitale, ni attestation d’affiliation à une mutuelle |
Anonymat, confidentialité, proximité, gratuité de la contraception orale des jeunes mineures de Champagne-Ardenne |
Accès gratuit et anonyme à un suivi médical |
Accès à une contraception anonyme, gratuite et de proximité, garantie par l’accompagnement des professionnels de santé. Ordonnances nominatives pour les prescriptions d’analyses médicales et de contraceptifs. En cas de prescription d’analyses médicales, la restitution des résultats doit être faite uniquement à l’intention du médecin pour éviter toute rupture de l’anonymat |
Accès à la contraception confidentiel, anonyme, gratuit et de proximité |
Confidentiel, gratuit, sans carte vitale afin d’éviter un remboursement sur la sécurité sociale des parents |
– Confidentialité : l’info des parents est laissée à l’appréciation de la jeune fille – Gratuité : pas d’avance de frais par les bénéficiaires : pas de retour de frais sur la sécurité sociale des parents – Proximité : établissements scolaires ou lors des permanences Possibilité de se rendre chez n’importe quel professionnel de santé |
Format |
Pochette/chéquier composé(e) de 7 coupons : 215 € Valable 12 mois à compter de sa délivrance |
Chéquier comportant 8 coupons permettant l’accès préventif à la santé et à la contraception. |
Chéquier avec coupons Valeur maximale du chéquier : – 173 € avec pilule, patch ou anneau vaginal – 268 € avec implant ou stérilet |
Chéquier numéroté non nominatif comportant des coupons de gratuité Montant maximal : 153€ |
Chéquier d’un montant maximum de 345€ Chaque coupon fait office de paiement lors de chaque passage chez un professionnel de santé |
Chéquier d’un montant maximum de 409 € | |
Prise en charge Prise en charge (suite) |
– 2 consultations médicales – 1 prise de sang – 1 séance d’analyses médicales – délivrance, d’une part, de contraceptifs pendant 1 an et, d’autre part, d’1 contraception d’urgence par l’intermédiaire des pharmacies – délivrance de préservatifs masculins pour un montant max de 10€ |
– 2 visites médicales – 1 prise de sang – 1 visite d’ana-lyses médicales – 2 x 3 mois de délivrance de contraceptifs – 1 remise de préservatifs |
– 2 consultations médicales – 1 prise de sang – 1 séance d’analyses médicales – 1 délivrance de contraceptifs (3 mois pour pilule, patch ou anneau vaginal, 3 ans pour implant ou stérilet) –1 renouvellement de contraceptifs (que pour 3 mois) |
– 1ère consultation médicale (médecin généraliste, gynécologue, sage-femme) – 1 prélèvement sanguin – 1 visite d’analyses biologiques – 1ère délivrance de contraceptifs pour 3 mois – 2nde consultation médicale ou, à défaut, renouvellement de la prescription de contraceptifs par un infirmier diplômé d’État – renouvellement de la délivrance des contraceptifs pour 6 mois – délivrance de préservatifs |
– 3 consultations médicales en lien avec la contraception et les infections sexuellement transmissibles (IST) – prescription d’un contraceptif |
– 2 consultations médicales – 1 prise de sang – 1 séance d’ana-lyses médicales – 1 délivrance de contraceptifs, renouvelable | |
Paiement |
Remise du coupon au professionnel, lequel envoie le coupon au service vie scolaire et lycéenne du conseil régional. La région procède au paiement du professionnel de santé par mandat administratif. |
Remise du coupon par l’étudiant au professionnel qui le joint à la facture et l’envoie à la région pour être remboursé. |
Professionnels remboursés directement par la région dans les 10 jours |
Remise du coupon par le lycéen. Renvoi du coupon par le professionnel à la région. Remboursement par virement uniquement. Les coupons font office de facture |
Après remise du coupon, les professionnels de santé (médecins, sages-femmes, infirmiers, laboratoires, pharmaciens) se feront rembourser les actes et produits délivrés |
– Chaque coupon fait office de paiement lors de chaque passage chez un professionnel de santé – Professionnels payés directement par la région | |
Partenaires Partenaires (suite) |
– Rectorat – Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) |
Rectorat de l’académie de Reims |
Rectorat, professionnels de santé, infirmières scolaires, représentants lycéens |
Partenaires institutionnels : – Région – ARS du Limousin – Départements – Assurance-maladie – Éducation nationale/ rectorat et DRAAF Partenariats opérationnels non institutionnels : – CPEF (121) – associations d’éducation pour la santé – médecins généralistes, sages-femmes, phar-maciens, infirmiers |
Environ 950 professionnels de santé |
Convention signée avec chaque établissement et la région depuis 2011, avec le rectorat depuis 2014 | |
Extension du programme |
Les partenaires en lien avec l’ARS s’engageront dans le développement d’actions de formation-action incluses dans un plan régional. Formations destinées à des personnels d’enseignement et d’éducation mais aussi aux personnes au contact des jeunes dans différents cadres, afin de développer des actions de terrain. |
– formation de professionnels |
– Création en 2011 du Fonds régional d’accès à la contraception (FRAC) : vacations de professionnels libéraux ou associations de santé dans les établissements scolaires dépourvus de personnel de santé scolaire – La région aide la FR-MFR et la CRMA (122) pour la mise en place d’une formation qualifiante « édu-cation à la vie » – La région soutient le MFPF des Deux-Sèvres : rencontre des personnes vivant dans des zones rurales | ||||
Coût |
La prise en charge des factures des professionnels de santé depuis janvier 2012 s’élève à 2 095,65 € |
Coûts prévisionnels directs : 76 500 €. Le niveau maximal d’activité pourrait être atteint au bout de 3 ans avec une hypothèse de remise annuelle de 1 000 chéquiers, soit au maximum 153 000 € et plus vraisemblablement un coût moyen se situant à environ 50 % du montant total du chéquier soit 76 500 € + coûts indirects du dispositif (123). |
FRAC (124) : 700€ par établissement et par année scolaire Depuis 2010, en cumulé : 32 305,96€ |
1 () Courrier adressé par Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des Affaires sociales, le 26 novembre 2014, en réponse à la demande adressée par votre présidente, le 19 novembre 2014.
2 () Mme Ségolène Neuville avait ainsi été désignée rapporteure sur l’accès à la contraception et l’IVG, lors de la réunion de la délégation du 2 octobre 2012.
3 () Rapports d’information de Mme Bérengère Poletti sur la contraception des mineures (mai 2011) et sur l’application de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’IVG et à la contraception (octobre 2008), rapport de Mme Danielle Bousquet sur le projet de loi relatif à l’IVG et la contraception (2000) et rapport de Mme Marie-Françoise Clergeau sur la proposition de loi sur la contraception d’urgence (2000).
4 () La santé des femmes en France, Études et résultats n° 834, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Nathalie Fourcade, avec la collaboration de Lucie Gonzalez, Sylvie Rey et Marie Husson (mars 2013), et L’état de la santé de la population, DREES (février 2015).
5 () Selon l’étude précitée de la DREES (2013).
6 () Données 2008-2010 du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’INSERM.
7 () Étude précitée de la DREES (2013).
8 () La dépendance : aujourd’hui l’affaire des femmes, demain davantage celle des hommes ?, Population et Sociétés, Bonnet C., Cambois E., Cases C., Gaymu J., n° 483 (2011).
9 () Les inégalités de genre sous l’œil des démographes, Christelle Hamel, Wilfried Rault et l’unité de recherche « Démographie, genre et société » de l’INED, Population et sociétés, n° 517 (décembre 2014).
10 () En 2010, à âge adulte, les hommes étaient trois fois plus nombreux à consommer quotidiennement de l’alcool (18 % contre 6 %).
11 () Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), « L’alcool, toujours un facteur de risque majeur pour la santé en France », 7 mai 2013.
12 () Mieux prendre en compte la santé des femmes, sous la direction de M. François Bourdillon et Marie Mesnil, Presses de Sciences Po, collection « Séminaires », mars 2013.
13 () Les cancers en France, Institut national du cancer (InCA), 2014.
14 () Selon les données de l’Institut national du cancer (InCA).
15 () Mortalité maternelle en France, INSERM, novembre 2013.
16 () Mieux prendre en compte la santé des femmes, sous la direction de Marie Mesnil et François Bourdillon, actes du séminaire organisé à Paris par la chaire Santé de Sciences Po, mars 2013 (intervention de Mme Caroline Rey-Salmon, pédiatre des hôpitaux, médecin légiste, coordinatrice des urgences médico-judicaires de l’Hôtel-Dieu de Paris).
17 () Mieux prendre en compte la santé des femmes, mars 2013.
18 () Combattre toutes les violences faites aux femmes : des plus visibles aux plus insidieuses, Mme Pascale Vion, rapporteure de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil économique, social et environnemental (CESE), novembre 2014.
19 () À âge, formation, situation conjugale et professionnelle identiques (« Troubles dépressifs » in La santé des femmes en France, DREES, 2009). D’après le Baromètre santé 2010 de l’INPES, 10 % des femmes de 15 à 75 ans ont connu u épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois, contre 6 % des hommes.
20 () Le taux standardisé de suicide des femmes est trois fois inférieur à celui des hommes.
21 () Photographie statistique des accidents de travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles en France selon le sexe entre 2001 et 2012, ANACT (avril 2014).
22 () Les RPS au regard du genre, étude commandée par l’ANACT et réalisée par deux chercheurs du Laboratoire d’économie et de sociologie au travail (LEST-Université de Marseille), avril 2014.
23 () Un-e salarié-e est considéré-e comme exposé à une situation de « tension au travail » s’il a dans son travail à la fois un faible latitude décisionnelle et une forte demande psychologique.
24 () Parmi ces familles professionnelles, quatre sont des professions d’ouvrières ou d’employées : employées de la Poste, ouvrières de l’industrie, femmes de ménages et employées de la banque. Les deux autres sont les professions intermédiaires de la fonction publique et la profession de cadre de la banque.
25 () Parmi elles, les cadres de la fonction publique, ingénieurs et cadres d’industrie, qui se caractérisent par une exposition faible aux RPS et une forte exposition au travail. Les auteurs s’étonnent d’y trouver aussi les ouvriers du bâtiment, des travaux publics et les conducteurs du transport de voyageurs.
26 () Voir également sur ce point le rapport du Secours catholique sur La pauvreté au féminin, publié en 2009.
27 () Retraites : les femmes perçoivent une pension inférieure de 26% à celle des hommes en 2012, Études et résultats n° 904, DREES,(janvier 2015). Selon cette étude, avec 967 euros bruts par mois en moyenne, la pension de droit direct des femmes est inférieure de 40 % en moyenne à celle des hommes (1 617 euros). La prise en compte des avantages accessoires, de la réversion et du minimum vieillesse réduit les écarts de pensions entre les hommes et les femmes. Au final, les femmes perçoivent une pension inférieure de 26 %.
28 () L’âge moyen des bénéficiaires est de 27 ans et près des trois quarts des personnes ont moins de 40 ans.
29 () Pour le reste de la population, ce taux est de 13,1%, mais si cette population avait la même structure d’âge et de sexe que la population bénéficiaires de la CMU-C, il serait de 5,7 % (CNAMTS, 2011).
30 () INSEE, 2005 (cité dans le rapport sur La santé des femmes en France, CESE, 2010).
31 () Étude Abena 2 (2011-2012),
32 () La santé des femmes en France, rapport précité de Mme Dominique Hénon, CESE, 2010.
33 () Dans l’enquête décennale 2002-2003 de l’INSEE, la prévalence du diabète était de 1,8 % chez les femmes cadres et de 9,7 % chez les ouvrières.
34 () Étude nationale nutrition santé (ENNS), 2006-2009.
35 () Lutte contre l’obésité : repenser les stratégies préventives en matière d’information et d’éducation, note du Centre d’analyse stratégique (CAS) n° 166, mars 2010.
36 () Femmes et précarité, rapport de Mme Evelyne Duhamel et M. Henri Joyeux, rapporteurs de la Délégation aux droits des femmes du Conseil économique, social et environnemental (CESE), février 2013.
37 () Surveillance de la grossesse en 2010 : des inégalités sociodémographiques, DREES, juillet 2013.
38 () Surveillance de la grossesse en 2010 : des inégalités sociodémographiques, DREES, juillet 2013.
39 () Parmi les primipares, 92 % des cadres ont suivi une préparation contre 58 % des ouvrières non qualifiées et 40 % des femmes sans profession. En outre, parmi les femmes ayant suivi une préparation, le nombre de séances est plus élevé pour les catégories les plus aisées, passant ainsi de 6,2 séances en moyenne chez les femmes cadres, contre 5,6 chez les ouvrières et 4,8 chez les femmes sans profession(DREES, 2013, ibidem).
40 () Béatrice Blondel, chercheuse à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 2009.
41 () Programme de qualité et d’efficience (PQE) « Maladie », annexe n° 1 au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015.
42 () La santé des plus pauvres, Thibaut de Saint Pol, division des conditions de vie des ménages, INSEE Premières n° 1161, octobre 2007.
43 () Mieux prendre en compte la santé des femmes, sous la direction de François Bourdillon et Marie Mesnil, actes du séminaire organisé par chaire santé de Sciences Po du 6 au 8 février 2013.
44 () Loi n° 2004-806 du 6 août 2004.relative à la politique de santé publique.
45 () La forme que prendra cette information pourra s’appuyer sur des recommandations dont les modalités d’établissement sont renvoyées à un décret d'application. Ces recommandations devront se fonder sur une analyse scientifique ; c’est pourquoi, il est prévu qu'elles soient établies après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES).
46 () Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) : données RECAP 2012.
47 () Selon l’association Fédération addiction (OFDT, Les usages de drogues féminins).
48 () Prostitutions : les enjeux sanitaires, Mmes Claire Aubin et Danielle Jourdain-Meninnger et M. Julien Emmanuelli, membres de l’IGAS, décembre 2012.
49 () Rapport d’information de n° 1360 fait par Mme Maud Olivier, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel, septembre 2013.
50 () Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes.
51 () La prévalence du tabagisme régulier chez les femmes de 15 à 75 ans est passée de 23 % en 2005 à 26 % en 2010, selon les données de l’INPES (Baromètres santé 2005 et 2010).
52 () La cigarette du pauvre. Enquête auprès des fumeurs en situation précaire, P. Peretti-Watel, Presses de l’EHESP, Rennes, 2012.
53 () Évaluation de la seconde année de mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, F. Chérèque, C. Abrossimov et M. Khennouf (janvier 2015).
54 () Selon le dossier de presse sur le projet de loi relatif à la santé (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes), octobre 2014.
55 () Malgré sa montée en charge, le non-recours à l’ACS est important : seules 22 % des personnes éligibles auraient fait valoir leur droit en 2011 (Fonds CMU, 2012).
56 () Selon le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes.
57 () La répartition des hommes et des femmes par métiers, DARES Analyses n° 79, décembre 2013.
58 () Article L. 1433-2 du code de la santé publique. Le CPOM est conclu pour une durée de quatre ans et il est révisable chaque année.
59 () Le projet de loi préciser que « Ce contrat définit les objectifs et priorités d'actions de l’ARS pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et des plans ou programmes nationaux de santé, déclinés dans le projet régional de santé (…). Il comporte un volet consacré à la maîtrise des dépenses de santé qui fixe des objectifs chiffrés d'économies. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est révisable chaque année. Il fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs. »
60 () Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
61 () Un groupe de travail issu du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle doit travailler à le préciser pour les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur ou supérieur à 300, selon Mme Chappert.
62 () Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2012-2013, ministère de la fonction publique, direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).
63 () Voir le compte rendu de l’audition de la ministre, le 10 février 2015.
64 () Décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
65 () Voir le compte rendu de l’audition du mercredi 11 février 2015 en annexe au présent rapport.
66 () Aux termes de cet article, « Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
67 () La santé des femmes en France, rapport de Mme Dominique Henon au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du CESE, 2010.
68 () Ce programme a été mis en place début 2013 à l’initiative du professeur Claire Mounier-Véhier présidente de l’Association de Cardiologie du Nord-Pas-de-Calais et s’adresse à des femmes sujettes à risques de maladies cardio-vasculaire. Il s’agit d’un parcours de santé coordonné autour des trois étapes de la vie hormonale des femmes, afin d’obtenir une meilleure connaissance du profil de ces femmes. L’objectif est afin de faire prendre conscience au corps médical de l’importance du risque hormonal dans le déclenchement d’infarctus. Pour ce faire, l’accent est mis sur une coopération de l’ensemble des praticiens (cardiologues, gynécologues, obstétriciens ou encore médecins généralistes) afin de repérer les repérer les femmes à risque, et prévenir plus efficacement la maladie cardiovasculaire. Ce programme est actuellement en cours d'évaluation afin de déterminer un possible déploiement à l'échelle du territoire.
69 () Déclaration et programme d’action de Pékin, adopté en septembre 1995 à la suite de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui a regroupé près de 189 pays et 17 000 participants.
70 () Les interruptions volontaires de grossesse en 2012, DREES, Études et résultats, n° 884 (juin 2014).
71 () Accès à l’IVG dans les territoires, rapport n° 2013-1104-SAN-009 du HCEfh, novembre 2013.
72 () Les enjeux contemporains de la légalisation de l’avortement, Nathalie Bajos et Michèle Ferrand, Revue française des affaires sociales, 2011.
73 () Un recours moindre à l’IVG mais plus souvent répété, Magali Mazuy, Laurent Toulemon, Eliodie Baril, Population et sociétés, n° 518, janvier 2015.
74 () Les femmes ayant recours à l’IVG : diversité des profils des femmes et des modalités de prise en charge, Annick Vilain, Revue française des affaires sociales, 2011.
75 () Voir sur ce point le tableau présenté page 27 du rapport de la Haute Autorité de santé (HAS), État des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une contraception adaptée, avril 2013.
76 () Voir le compte rendu de l’audition du 2 décembre 2014 en annexe au présent rapport.
77 () Voir le compte-rendu en annexe de l’audition de Mme Nathalie Bajos par la délégation, le 10 décembre 2014.
78 () Selon Mme Nathalie Bajos, directrice de recherche à l’INSERM.
79 () Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
80 () Décret n° 2009-516 du 6 mai 2009 relatif aux IVG par voie médicamenteuse, pris en application de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008.
81 () Voir le compte rendu de l’audition du 1er octobre 2014, en annexe au présent rapport.
82 () Les interruptions volontaires de grossesse en 2011, DREES, Études et résultats, n° 843 (juin 2013) ; rapport précité du HCEfh de novembre 2013.
83 () Rapport précité du HCEfh (pages 52 et suivantes), novembre 2013.
84 () La prise en charge des interruptions volontaires de grossesse en 2011, Claire Aubin, Danièle Jourdain-Menninger, Laurent Chambaud, inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2009.
85 () Rapport d’information n° 1206 de Mme Bérengère Poletti, au nom de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, sur l’application de la loi du 4 juillet 2001, octobre 2008.
86 () Mme Sophie Eyraud a ainsi soulevé « le problème (du) niveau de rémunération des praticiens de l’IVG. Lorsque les médecins sont payés à la vacation, ils refusent le poste. Pour que ce soit intéressant, il faudrait qu’ils aient le statut de praticien hospitalier contractuel. Mais cela suppose qu’ils passent au moins 40 % de temps à l’hôpital. Or la plupart des médecins qui font des IVG sont des médecins libéraux qui ne peuvent pas se le permettre. La vacation est d’ailleurs un frein à l’ensemble de la médecine sociale, qu’il s’agisse d’alcoologie, d’IVG ou d’autres domaines. »
87 () Les femmes ayant recours à l’IVG, Annick Vilain, Revue française des affaires sociales, 2011.
88 () Voir sur ce point le rapport précité du HCEfh de novembre 2013 (pages 75 à 77).
89 () Mieux prendre en compte la santé des femmes, rapport précité publié en mars 2013.
90 () Intervention de Mme Sophie Eyraud, lors du séminaire organisé par la chaire Santé de Sciences Po en février 2013, in rapport précité sous la direction de F. Bourdillon et M. Mesnil, Mieux prendre en compte la santé des femmes, mars 2013.
91 () Article 50 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et décret n° 2013-248 du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale pour les frais liés à une IVG et à l’acquisition de contraceptifs par les mineures.
92 () Arrêté du 26 mars 2013 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’IVG.
93 () Le tarif payé aux établissements de santé pour le forfait d’IVG chirurgicales est revalorisé de 50 % dans le secteur public. Dans le secteur privé, seule la partie hébergement a été revalorisée (DREES, 2014).
94 () L’article L. 2223-2 du même code prévoit ainsi qu’ « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 : - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ; - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir ou s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. »
95 () Proposition de résolution n° 2360 visant à réaffirmer le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse en France et en Europe, présentée par Mme Catherine Coutelle, M. Bruno Le Roux, M. Christian Jacob, M. Philippe Vigier, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. André Chassaigne et plusieurs de leurs collègues, et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 novembre 2014.
96 () Pour poursuivre l’amélioration de la qualité des informations disponibles, déjà engagée à travers www.ivg.gouv.fr, ce portail web d’information sera créé et constituera une porte d’entrée vers d’autres sites existants, qui seront rénovés et enrichis pour l’occasion. Ce portail améliorera la lisibilité et l’accessibilité des informations, actuellement hétérogènes, voire parcellaires.
97 () Un guide sur l’IVG médicamenteuse sera réalisé et mis à disposition de femmes qui choisissent cette méthode. Il comprendra toutes les informations utiles au bon déroulement de l’avortement, en complémentarité avec celles fournies par l’équipe médicale, et sera réalisé en partenariat avec les associations spécialisées, les professionnels et les réseaux de santé. Ce guide permettra de répondre aux difficultés propres à l’IVG médicamenteuse, notamment le défaut d’accompagnement et d’information des femmes.
98 () Les sociétés savantes concernées seront saisies afin d’élaborer des guides de bonnes pratiques, qui seront diffusés aux professionnel-le-s de santé recevant les femmes souhaitant interrompre une grossesse. Ils permettront d’améliorer les pratiques professionnelles, qui ne doivent ni influencer le choix des femmes, ni les culpabiliser.
99 () Compte rendu de la séance publique du mercredi 26 novembre 2014.
100 () Selon le rapport précité du HCEfh de novembre 2013.
101 () Voir le compte-rendu de l’audition du 11 février 2015 en annexe au présent rapport.
102 () Rapport précité sur l’IVG (volet 2 : accès à l’IVG dans les territoire).
103 () « La crise de la pilule en France : vers un nouveau modèle contraceptif ? », Population et sociétés, n° 511 mai 2014.
104 () OMS, modèle BERGER.
105 () Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme, Anaes-Afssaps-Inpes/Service des recommandations professionnelles de l’Anaes/Décembre 2004
106 () Rapport d’information n° 3444 de Mme Bérengère Poletti « Contraception des mineures : un paradoxe » de mai 2011.
107 () Les organismes de planification, de conseil et d’éducation familiale : un bilan, Aubin, Branchu, Veilleribière, Sitruk, IGAS 2011.
108 () La prévention des grossesses non désirées : contraception et contraception d’urgence, Aubin, Jourdain-Menninger, Chambaud, IGAS 2009.
109 () Contraception d’urgence : connaissances, représentations, accès et utilisation. Enquête auprès des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, B. Reboulot Nice, université de Nice-Sophia-Antipolis-UFR Médecine 2011.
110 () Étude d’impact du présent projet de loi et ministère des droits des femmes, 2014, et
111 () Parmi lesquels les établissements de santé, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARRUD), par exemple.
112 () Voir le compte rendu de la réunion de la délégation du mercredi 18 février 2015.
113 () Écoles de la deuxième chance.
114 () Maisons familiales rurales.
115 () Institut régional du travail social.
116 () Établissements régionaux d’enseignement adaptés.
117 () Fédération régionale des maisons familiales rurales.
118 () Direction régionale de l’alimentation, de l‘agriculture et de la forêt.
119 () Centres de formation des apprentis.
120 () Centre régional information jeunesse.
121 () Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF).
122 () Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA).
123 () Estimation des coûts indirects du dispositif (s’ajoutant aux coûts directs liés aux actes et produits) : impression des chéquiers, de l’ordre de 3 € par chéquier soit 6 000 € pour l’impression de 2 000 chéquiers dans un premier temps, à répartir dans les lieux de diffusion, auxquels ajouter les frais postaux (500 €) ; gestion et suivi du dispositif, de l’ordre de 20 000 € ; information et communication : 10 000 € au lancement (impressions…) puis au moins 1 000 € par an.
124 () Fonds régional d’accès à la contraception (FRAC).
© Assemblée nationale