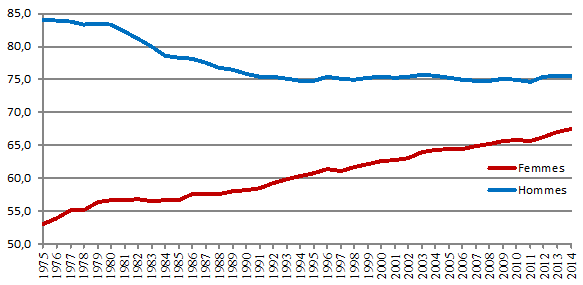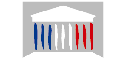
N° 3629
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 avril 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (1), SUR LE PROJET DE LOI
visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n° 3600),
PAR
Mmes Marie-Noëlle BATTISTEL et Catherine COUTELLE,
Députées
——
(1) La composition de la délégation figure au verso de la présente page.
La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est composée de : Mme Catherine Coutelle, présidente ; Mme Conchita Lacuey, Mme Monique Orphé, M. Christophe Sirugue, Mme Marie-Jo Zimmermann, vice-président.e.s ; Mme Édith Gueugneau ; Mme Cécile Untermaier, secrétaires ; Mme Laurence Arribagé ; Mme Marie-Noëlle Battistel ; Mme Huguette Bello ; Mme Brigitte Bourguignon ; Mme Marie-George Buffet ; Mme Pascale Crozon ; M. Sébastien Denaja ; Mme Marianne Dubois ; Mme Virginie Duby-Muller ; Mme Martine Faure ; M. Guy Geoffroy ; Mme Claude Greff ; Mme Françoise Guégot ; Mme Chaynesse Khirouni ; Mme Sonia Lagarde ; Mme Geneviève Levy ; Mme Véronique Massonneau ; Mme Sandrine Mazetier ; Mme Dominique Nachury ; Mme Maud Olivier ; Mme Bérengère Poletti ; Mme Josette Pons ; Mme Catherine Quéré ; Mme Barbara Romagnan ; M. Gwendal Rouillard ; Mme Maina Sage ; Mme Sylvie Tolmont ; M. Philippe Vitel.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
PREMIÈRE PARTIE : DES PROGRÈS À APPROFONDIR EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 9
I. FEMMES ET HOMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL : DES DISPARITÉS PERSISTANTES MALGRÉ CERTAINS PROGRÈS 9
A. DES INÉGALITÉS D’ACCÈS À L’EMPLOI : UNE PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ FÉMININE QUI PRÉSENTE DES LIMITES 9
1. Des écarts de taux d’activité et d’emploi entre les femmes et les hommes qui tendent à diminuer 9
2. Des taux d’activité féminins qui varient toutefois fortement selon la configuration familiale, en lien avec un partage toujours inégalitaire des tâches domestiques et des responsabilités parentales 12
3. Des écarts d’emploi bien plus marqués en équivalent temps plein, près de 80 % des emplois à temps partiel étant occupés par des femmes 14
B. DES INÉGALITÉS DANS L’EMPLOI : PRÉCARITÉ, SÉGRÉGATION PROFESSIONNELLE ET PLAFOND DE VERRE 15
1. Précarité dans l’emploi et surreprésentation des femmes parmi les bas salaires 15
2. Une répartition sexuée des métiers : un emploi féminin concentré sur douze familles professionnelles souvent peu valorisées 16
3. Écarts de rémunération et plafond de verre 18
II. DES MESURES IMPORTANTES MISES EN œUVRE DEPUIS 2012 20
A. POUR FAVORISER L’INSERTION DES FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 21
1. En facilitant l’articulation des temps de vie professionnels et familiaux, pour soutenir l’emploi des mères et un meilleur partage des tâches 21
2. En accompagnant les demandeuses d’emploi et en engageant des actions spécifiques en direction de femmes plus éloignées de l’emploi 22
3. En soutenant l’entreprenariat féminin 26
B. POUR FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 26
1. Garantir l’effectivité des droits et lutter contre la précarité dans l’emploi 27
2. Les actions d’accompagnement et de promotion de l’égalité professionnelle 29
3. La lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 32
C. POUR DÉVELOPPER LA MIXITÉ DES EMPLOIS 33
1. Lutter contre les stéréotypes de sexe dans le système éducatif 33
2. Mettre en œuvre un plan d’action volontariste sur la mixité des métiers 34
SECONDE PARTIE : UNE RÉFORME QUI DOIT ÊTRE L’OCCASION DE FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ RÉELLE DANS LE MONDE DU TRAVAIL 38
I. DES « PRINCIPES ESSENTIELS DU DROIT DE TRAVAIL » DONT LA RÉDACTION DOIT ÊTRE AMÉLIORÉE AU REGARD DE L’OBJECTIF D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 40
II. LE TEMPS DE TRAVAIL 52
A. LE TRAVAIL DES FEMMES À TEMPS PARTIEL 52
1. Analyse du phénomène 52
2. Les mesures du projet de loi concernant la durée du délai de prévenance, les majorations pour heures complémentaires et la durée minimale de travail 59
B. LES AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL 63
1. La durée maximale du temps de travail 63
2. Le forfait jours 65
3. Le temps de repos quotidien 66
4. Les astreintes 67
5. Les congés 68
III. LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EN ENTREPRISE ET L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 70
A. LE NOUVEAU CADRE DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE 70
1. Le dispositif issu de la loi du 17 août 2015 : le regroupement des négociations autour de trois blocs, dont l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, et l'adaptation des règles de négociation sur la périodicité des accords 70
2. Une progression du nombre d’accords collectifs et de plans d’action sur l’égalité professionnelle 76
B. LE PROJET DE LOI ET LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 80
1. Des règles de négociation plus souples : la périodicité des NAO, dont celle sur l'égalité professionnelle, la durée de vie, la légitimité et la publicité des accords 80
2. Former les négociateurs à l’égalité professionnelle 83
3. La question de l’inversion de la hiérarchie des normes 84
C. PRÉCISER LA PROCÉDURE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 86
1. Clarifier quatre étapes de la négociation collective sur l’égalité professionnelle 86
2. Renforcer un droit du processus de négociation en veillant au principe de loyauté 89
IV. SÉCURISER LES PARCOURS, ADAPTER LE DROIT DU TRAVAIL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ET MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL : DES ENJEUX AUSSI EN TERMES D’ÉGALITÉ 92
A. LA CRÉATION DU COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ, UNE AVANCÉE SOCIALE MAJEURE POUR SÉCURISER LES PARCOURS 92
1. La création du compte personnel d’activité 92
2. Les recommandations de la Délégation en vue d’améliorer l’accès des salarié.e.s à temps partiel à la formation dans le cadre du CPA 94
B. TÉLÉTRAVAIL ET « DROIT À LA DÉCONNEXION » : TRAVAUX RÉCENTS DE LA DÉLÉGATION ET AVANCÉES DU PROJET DE LOI 97
1. Le droit à la déconnexion 98
2. Le télétravail et le travail à distance 99
C. LA RÉFORME DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL 100
1. Les dispositions prévues par le projet de loi 100
2. Les inquiétudes exprimées concernant l’impact de la réforme et la santé des femmes dont les risques sont toujours minorés 102
V. COMPLÉTER CE TEXTE POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, HARCÈLEMENTS ET AGISSEMENTS SEXISTES 104
A. LUTTER PLUS EFFICACEMENT CONTRE LES HARCÈLEMENTS, SEXUEL OU MORAL, ET LES TRAITEMENTS DISCRIMINATOIRES 104
1. Harmoniser les règles de preuve pour les actions en justice engagées suite à un harcèlement, sexuel ou moral, ou à une discrimination 104
2. Prévoir l’obligation pour l’entreprise de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement sexuel ou moral 106
3. Instituer un plancher d’indemnisation pour les licenciements discriminatoires, liés notamment au sexe, à la grossesse ou à la situation familiale, et licenciements consécutifs au harcèlement sexuel 107
B. CONSOLIDER L’INSERTION RÉCENTE DANS LE CODE DU TRAVAIL D’UN ARTICLE RELATIF AUX AGISSEMENTS SEXISTES 109
1. Préciser le régime de preuve applicable à l’agissement sexiste 111
2. Prévoir le rappel obligatoire dans le règlement intérieur des entreprises des dispositions de la loi relatives à l’agissement sexiste 112
3. Prendre en compte l’agissement sexiste comme facteur de risques pour la santé des salariées pour promouvoir la mise en œuvre d’actions de prévention 113
TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION 117
RECOMMANDATIONS ADOPTÉES 187
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 191
INTRODUCTION
« Le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes demande une mobilisation sans cesse réaffirmée », comme l’a souligné la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Mme Myriam El Khomri, lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Si les femmes représentent aujourd’hui environ 48 % de la population active, le monde du travail reste marqué par de profondes inégalités. En effet, les femmes représentent environ 82 % des emplois à temps partiels et plus des deux tiers des travailleur.se.s pauvres, et gagnent encore 19 % de moins que les hommes (en équivalent temps plein), avec une part « non expliquée » – la plus inadmissible – d’environ 10 %.
Par ailleurs, 27 % des femmes occupent des postes peu qualifiés d’employé.e.s ou d’ouvrier.e.s, soit près de deux fois plus que les hommes (15 %), et plus globalement, une véritable « ségrégation professionnelle » demeure : plus de la moitié de l’emploi féminin se concentre ainsi sur une dizaine de métiers (sur près de 90), qui sont souvent peu valorisés. Plus exposées à la précarité dans l’emploi, elles sont aussi confrontées au « plafond de verre » pour l’accès aux postes à responsabilité, avec des déroulements de carrières moins favorables. Elles sont aussi exposées aux harcèlements sexuels, agissements sexistes et discriminations, directes ou indirectes, à raison du sexe ou de la parentalité.
En dépit de 40 ans de lois sur l’égalité professionnelle, celle-ci n’est pas encore réalisée. Depuis 2012, une démarche nouvelle a été engagée pour transformer l’égalité des droits en égalité réelle : les droits des femmes sont devenus une politique publique à part entière, autonome et visible, mais qui a aussi vocation à être intégrée dans l’ensemble des politiques publiques de l’État.
Pour y veiller, et au regard de l’importance des enjeux liés au travail et à l’emploi pour promouvoir l’autonomie des femmes et l’égalité réelle, la Délégation aux droits des femmes s’est saisie, depuis le début de cette législature, de plusieurs projets de loi concernant le travail, et relatifs au harcèlement sexuel (1), à la sécurisation de l’emploi (2), à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (3) (volet sur l’égalité professionnelle), à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale (4), et, récemment, du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (5). La Délégation a également publié un rapport d’information thématique sur le dispositif relatif aux obligations des entreprises en matière d’égalité (6).
Dans le prolongement de ces travaux, la Délégation a souhaité être saisie du projet de loi (n° 3600) visant à « instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », qui a été adopté en Conseil des ministres le 24 mars 2016. Dans cette perspective, une série d’auditions ont été organisées avec des représentantes d’associations féministes ou œuvrant sur le terrain pour promouvoir l’insertion professionnelle des femmes, expert.e.s et membres du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), représentant.e.s d’organisations syndicales de salarié.e.s et de l’Union professionnelle artisanale (UPA). Ce cycle d’auditions s’est conclu par l’audition de la ministre Mme Myriam El Khomri, le 30 mars 2016.
La Délégation a aussi pu s’appuyer sur l’avis rendu par le CSEP sur l’avant-projet de loi, le 11 mars 2016, et qui faisait état de plusieurs réserves sous l’angle de l’égalité professionnelle.
Examiné le 5 avril 2016, le présent rapport analyse tout d’abord les principales caractéristiques de l’emploi et du travail des femmes afin de pouvoir mieux appréhender l’impact du présent projet de loi, et tenter de pallier ainsi les carences de l’étude d’impact sur ce point. Il rappelle également les nombreuses avancées intervenues dans ce domaine depuis 2012.
Dans une seconde partie, le présent rapport examine les différentes mesures du projet de loi sur lesquelles l’attention de la Délégation a été appelée. Celles-ci concernent principalement les principes essentiels du droit du travail qui doivent guider la réécriture de la partie législative du code du travail (article 1er), les dispositions relatives aux temps de travail, s’agissant plus particulièrement de celles relatives au temps partiels (articles 2 à 5), ainsi que la réforme du dialogue social, compte tenu de ses impacts sur la négociation collective en entreprise sur l’égalité professionnelle (articles 10 à 18). Vos rapporteures ont également examiné les dispositions du projet de loi relatives au compte personnel d’activité (articles 21 et 22), au droit à la déconnexion et au télétravail (articles 25 et 26) ainsi qu’à la médecine du travail (article 44). Par ailleurs, ce projet de loi doit être complété afin notamment de clarifier les modalités de négociation collective sur l’égalité, suite à la loi du 17 août 2015, et de renforcer la lutte contre les agissements sexistes, harcèlements sexuels et discriminations.
La constante du travail de la Délégation est d’améliorer le droit du travail qui « spontanément » creuse les inégalités, et donc de ne pas rester à droit constant et de renforcer la capacité des négociateurs à s’emparer et à défendre l’égalité professionnelle dans toutes les discussions.
PREMIÈRE PARTIE : DES PROGRÈS À APPROFONDIR EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
La persistance de disparités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail (I) a conduit les pouvoirs publics à prendre un ensemble de mesures afin de permettre aux femmes de choisir librement leur orientation, de lever les freins qu’elles rencontrent en matière d’insertion sur le marché du travail et de lutter contre les différentes inégalités dans l’emploi (II).
I. FEMMES ET HOMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL : DES DISPARITÉS PERSISTANTES MALGRÉ CERTAINS PROGRÈS
La situation respective des femmes et des hommes sur le marché du travail a fait l’objet d’analyses approfondies dans le cadre de précédents rapports de la Délégation aux droits des femmes (7). Sans reprendre ici l’ensemble de ces développements, il convient néanmoins de rappeler et d’actualiser les principaux constats relatifs à l’emploi des femmes, pour pouvoir mieux appréhender l’impact du présent projet de loi.
Il apparaît ainsi que si les disparités tendent à se réduire, comme le souligne une étude récente de la DARES (8), avec en particulier la progression du taux d’activité des femmes, même si la configuration familiale influe toujours sensiblement sur celui-ci (A), les emplois occupés restent très différents, en lien avec la persistance d’une ségrégation professionnelle, d’écarts de rémunération et plus largement d’inégalités dans l’emploi (B).
A. DES INÉGALITÉS D’ACCÈS À L’EMPLOI : UNE PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ FÉMININE QUI PRÉSENTE DES LIMITES
Si l’écart des taux d’activité des femmes et des hommes a diminué régulièrement (1), la situation est en réalité bien plus contrastée selon la configuration familiale, en lien avec le partage toujours inégalitaire des responsabilités parentales et domestiques au sein des couples (2). Par ailleurs, l’accès des femmes à l’emploi s’est fait bien plus souvent à temps partiel (3).
1. Des écarts de taux d’activité et d’emploi entre les femmes et les hommes qui tendent à diminuer
En 2013, les femmes représentaient 48 % de la population active et l’écart avec le taux d’activité des hommes a diminué significativement, comme l’illustre le graphique ci-après, pour atteindre environ 8 points en 2014. Cette progression est d’ailleurs assez sensible sur la période récente : le taux d’activité des femmes a ainsi progressé de près de 2 points entre 2011 et 2014 (1,8 points).

![]()
ÉVOLUTION DES TAUX D’ACTIVITÉ (%) DES FEMMES ET DES HOMMES (15-64 ANS)
Lecture : en moyenne en 2014, 13 744 000 femmes de 15 ans ou plus sont actives (en emploi au chômage), soit 51,8 % de l'ensemble des femmes de 15 ans ou plus. France métropolitaine, personnes de 15 ans ou plus |
Source : graphique réalisé d’après les données de l’INSEE (enquête emploi 2014, séries longues)
Par ailleurs, le taux de chômage est passé pour la première fois sous celui des hommes au troisième trimestre 2012, et est resté inférieur tout au long de l’année 2013 (9,7 %, contre 10 % pour les hommes).
SITUATIONS D’ACTIVITÉ, DE CHÔMAGE ET D’EMPLOI SELON LE SEXE (EN %)
2003 |
2013 | |||
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes | |
Part de chômage (15-64 ans) |
5,6 |
5,7 |
7,6 |
6,5 |
Taux de chômage (ensemble des actifs) – 15-29 ans – 30-54 ans – 55 ans ou plus |
7,4 13,6 5,8 4,4 |
9 14,2 7,9 4,3 |
10 18,6 7,7 7,5 |
9,7 18,2 7,8 6,5 |
Part du halo autour du chômage, dont : – 15-29 ans |
2,2 nd |
3,7 nd |
2,7 3,7 |
3,6 4,5 |
Taux d’emploi (15-64 ans) – 15-29 ans – 30-54 ans – 55-64 ans |
70 50,6 88,6 40,9 |
58,3 42,7 73,6 33,3 |
67,8 46,9 86,3 48,4 |
60,4 41,1 77,4 43,0 |
Lecture : en moyenne, en 2013, 67 % des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives, dont 60,4 % en emploi et 6,5 % au chômage (part de chômage) ; 3,6 % sont dans le halo autour du chômage ; parmi celles qui sont en emploi, 9,7 % sont en sous-emploi et parmi les actives, 9,7 % sont au chômage (taux de chômage). Ménages de France métropolitaine.
Source : « Femmes et hommes sur le marché du travail : les disparités se réduisent mais les emplois occupés restent très différents », DARES Analyses n° 17 (mars 2015)
Cependant, au-delà des seuls chômeur.se.s au sens du BIT, 3,6 % des femmes entre 15 et 64 ans étaient inactives en 2013 mais souhaitaient travailler et faisaient donc partie du « halo autour du chômage » (9), contre 2,7 % des hommes. Sous cet angle, la situation des femmes reste ainsi plus défavorable que les hommes, contrairement à ce qu’indique le seul examen du taux de chômage (« taux de chômage et de halo » de 14,3 % en 2013, contre 13,2 % des hommes).
Concernant le taux d’emploi (soit la différence entre le taux d’activité et le taux de chômage), on observe également une réduction des écarts femmes-hommes, comme l’illustre le graphique ci-dessous. Ainsi, alors qu’en 2010, le taux d’emploi des femmes de 20 à 64 ans était 64,8 %, les différentes mesures mises en œuvre depuis 2012 ont contribué à accroître ce taux d’emploi des femmes à 66,2 % en 2014, soit une progression de 1,1 point en seulement deux ans, alors qu’entre 2008 et 2012, ce taux avait baissé d’un point (10).
ÉVOLUTION DES ÉCARTS DE TAUX D’EMPLOI ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN POINTS DE POURCENTAGE EN FRANCE ET DANS CERTAINS PAYS EUROPÉENS (2010-2014)
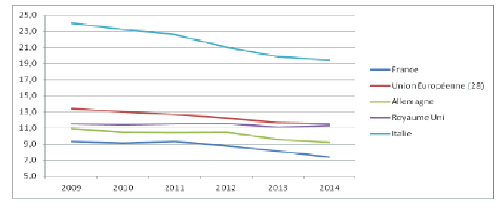
Source : Eurostat (rapport du Gouvernement au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, juin 2015)
L’écart de taux d’emploi entre les femmes et les hommes est ainsi plus faible en France que dans l’Union européenne (8,1 points, contre 11,6 points en moyenne en 2013), et le taux d’activité des femmes est aussi supérieur de 3 points en France par rapport à la moyenne européenne. Si l’on observe donc des progrès significatifs sur la période récente, il n’en reste pas moins nécessaire de poursuivre les efforts en matière d’emploi, et donc d’autonomie des femmes, par rapport notamment à des pays comme la Suède ou le Danemark.
Il s’agit là d’un enjeu majeur, en termes de justice et de progrès social, mais aussi en termes de croissance et de compétitivité. Ainsi, selon un rapport de l’OCDE paru fin 2012 (11), si la parité entre les sexes dans la participation au marché du travail était réalisée au cours des 20 prochaines années, cela conduirait à une augmentation de 5,2 % de la population active et à une hausse annuelle de 0,4 point du taux de croissance du PIB par habitant, soit une augmentation du PIB de 9,4 % entre 2010 et 2030.
2. Des taux d’activité féminins qui varient toutefois fortement selon la configuration familiale, en lien avec un partage toujours inégalitaire des tâches domestiques et des responsabilités parentales
Si le taux de femmes actives sans enfant est assez proche de celui des hommes, celui-ci baisse sensiblement dès le second enfant, et fortement au troisième, particulièrement quand les enfants sont en bas âge. La proportion de femmes à temps partiel s’accroît aussi avec le nombre d’enfants. Les taux d’emploi féminins varient ainsi fortement avec le nombre et l’âge des enfants, alors que les taux d’emploi masculins sont bien moins pénalisés par la configuration familiale. La différence entre les taux d’activité selon le sexe est la plus élevée lorsqu’elles ont au moins deux enfants dont le plus jeune est âgé de moins de 3 ans.
TAUX D’ACTIVITÉS COMPARÉS DES FEMMES ET DES HOMMES AYANT UN OU PLUSIEURS ENFANTS DONT LE PLUS JEUNE EST ÂGÉ DE MOINS DE 3 ANS (EN %)
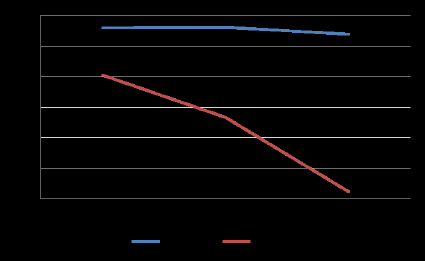
Source : graphique réalisé d’après les données présentées dans le programme de qualité et d’efficience (PQE) de la branche Famille, annexe 1 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016 (octobre 2015)
Cette situation a trait pour partie à l’existence du congé parental et de la prestation versée en cas d’interruption totale activité ou de réduction du temps du travail pour s’occuper d’un enfant en bas en charge, et qui est presque exclusivement pris par des femmes, d’où l’importance de la réforme engagée par la loi du 4 août 2014 (cf. infra).
Plus largement, le partage inégalitaire des tâches au sein des couples et les difficultés d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle restent un obstacle important à l’insertion professionnelle et à la carrière des femmes. Ainsi, M. Saïd Darwane, conseiller national de l’UNSA et membre du CSEP, a souligné lors de son audition que « Le temps de travail constitue le premier facteur discriminant entre les femmes et les hommes, car ces dernières assument toujours 80 % des tâches ménagères et leur temps reste beaucoup plus contraint que celui des hommes ». Mme Rachel Silvera, économiste, sous-directrice du groupe de recherche « Marché du travail et genre » (MAGE) et membre du CSEP a aussi souligné que « ce sont toujours les femmes qui subissent les contraintes familiales : elles consacrent une heure et demie de plus que les hommes, en moyenne, aux tâches quotidiennes. Leur temps contraint, c’est-à-dire le temps de travail plus le temps domestique, est plus important, dans notre pays, que celui des hommes. La situation est différente dans les pays nordiques (12) ». Cette pression est encore plus forte pour les familles monoparentales, qui sont composées à environ 85 % de mères.
Ainsi, selon une enquête publiée en octobre 2015 (13), les femmes effectuaient encore très majoritairement les tâches ménagères et parentales. (respectivement 71 et 65 %, en précisant que cette étude retenait une acception large des temps domestique, en incluant par exemple des tâches dites de semi-loisirs, tels que le jardinage et le bricolage, et en excluant aussi le temps consacré aux personnes adultes). De 1985 à 2010, le temps quotidien moyen consacré par les hommes aux tâches domestiques n’a ainsi augmenté que de 9 minutes.
TEMPS DOMESTIQUE ET PARENTAL QUOTIDIENS MOYENS DES FEMMES
ET DES HOMMES EN 2010 (EN MINUTES PAR JOUR EN MOYENNE)
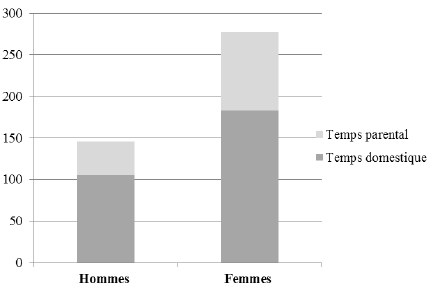
Lecture : en 2010, les hommes ont consacré en moyenne 105 minutes par jour aux activités domestiques (contre 183 pour les femmes) et 41 minutes aux activités parentales (contre 95 pour les femmes). Champ : hommes et femmes âgés de 18 à 60 ans, hors ménages complexes. Pour le temps parental, avec un enfant de moins de 18 ans dans le ménage.
Source : graphique réalisé d’après les données présentées dans l’étude « Le temps domestique et parental des hommes et des femmes : quels facteurs d’évolutions en 25 ans ? », Clara Champagne, Ariane Pailhé et Anne Solaz (INED et INSAE), Économie et Statistiques n° 478, INSEE (octobre 2015)
Si les écarts entre femmes et hommes se réduisent un peu, c’est davantage lié au fait qu’une part croissante des tâches s’est déplacée à l’extérieur des ménages. Toutefois, ce sont aussi les femmes qui ont assumé cette externalisation, en occupant les postes créés dans le secteur du ménage, de l’aide à la personne, de l’accueil des jeunes enfants, des activités récréatives ou de la restauration.
On observe ainsi une forme de régime libéral dans lequel les femmes les plus aisées se déchargent sur d’autres femmes (sur des métiers de fait peu valorisés), tandis que les hommes continuent de limiter leur implication dans les tâches les moins gratifiantes et les plus chronophages au quotidien (préparer le repas, donner le bain, etc.), et qui sont donc davantage susceptibles d’avoir un impact sur l’activité professionnelle.
De fait, les mères continuent d’assumer la majorité des tâches ménagères et des responsabilités familiales, concernant les enfants mais aussi les ascendants, ce qui pèse nécessairement sur leur activité professionnelle, et se traduit par des interruptions de carrière et des journées de travail plus courtes, avec, à la clé, des inégalités de salaire et la persistance d’un « plafond de verre ». Autrement dit, ces difficultés d’articulation des temps de vie liés à la « double journée des femmes », constituent encore aujourd’hui l’une des principales causes des inégalités de sexe dans la sphère professionnelle.
3. Des écarts d’emploi bien plus marqués en équivalent temps plein, près de 80 % des emplois à temps partiel étant occupés par des femmes
Outre l’impact de la configuration familiale, une autre limite de la progression de l’activité féminine tient à la part importante des emplois occupés à temps partiel : l’écart des taux d’emploi est ainsi bien plus important avec les hommes, lorsqu’il est calculé en équivalent temps plein (ETP). Ainsi, 31 % des femmes en emploi travaillaient à temps partiel en 2013, contre seulement 7 % des hommes, et pour une part significative d’entre elles, il s’agit en réalité de temps partiel subi. En effet, près de 10 % des femmes sont en situation de sous-emploi, c’est-à-dire qu’elles souhaiteraient travailler davantage d’heures et sont disponibles pour le faire (14), contre seulement 4 % des hommes (sur le temps partiel, voir l’analyse détaillée dans la seconde partie du présent rapport).
ÉVOLUTION DES ÉCARTS DE TAUX D’EMPLOI ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET DE TAUX D’EMPLOI EN ETP DE 2003 À 2011
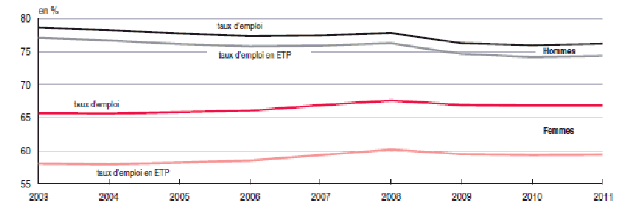
Source : INSEE Première n° 1462, « Le taux d’emploi des hommes et des femmes : des écarts plus marqués en équivalent temps plein », Hélène Guedj, division des études sociales de l’INSEE (août 2013)
Enfin, concernant les inégalités d’accès à l’emploi, vos rapporteures soulignent l’importance de prendre en compte la situation des femmes handicapées, et d’examiner notamment les modalités d’attribution et de calcul des aides sociales telles que l’allocation pour adultes handicapés (AAH).
B. DES INÉGALITÉS DANS L’EMPLOI : PRÉCARITÉ, SÉGRÉGATION PROFESSIONNELLE ET PLAFOND DE VERRE
Les femmes sont particulièrement exposées à la précarité dans l’emploi (1), ce qui tient pour partie à la répartition sexuée des métiers (2) mais aussi aux écarts de rémunération persistants (3), en dépit de certains progrès récents.
1. Précarité dans l’emploi et surreprésentation des femmes parmi les bas salaires
Comme l’a souligné Mme Sandra Gidon, directrice de l’Association d’accompagnement global contre l’exclusion (ADAGE), l’emploi ne protège plus de la précarité, et c’est particulièrement le cas pour les femmes.
En effet, en termes de « pauvreté économique » (identifiée par un revenu individuel d’activité inférieur au seuil de pauvreté), un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur les femmes et la précarité, publié en mars 2013, les femmes représentaient environ 70 % des travailleurs pauvres sont des femmes, soit plus de 2,5 millions de personnes. Il conviendrait toutefois de réactualiser ces estimations dans la mesure où ces chiffres étaient issus d’une enquête portant sur des données datant de 2008.
TAUX DE PAUVRETÉ ÉCONOMIQUE SELON LE SEXE
Femmes |
Hommes |
Ensemble | |
Effectifs (millions) |
2,58 millions |
1,173 million |
3,75 millions |
Incidence (%) |
21,9 % |
8,9 % |
31,3 % |
Composition (%) |
68,7 % |
21,9 % |
100 % |
Sources : « Les travailleurs pauvres », Sophie Ponthieux, Émilie Raynaud (INSEE), travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2007-2008, et rapport précité du CESE sur les femmes et la précarité (mars 2013)
Plus globalement, les femmes sont davantage exposées au risque de précarité et de pauvreté : leur taux de « pauvreté monétaire » est supérieur à celui des hommes, en particulier chez les jeunes femmes (20 % contre 13,7 %) et dans les familles monoparentales, qui sont dans de 80 % des mères seules avec enfant(s) (34,4 % en moyenne, mais 66,4 % lorsque les mères sont inactives).
TAUX DE PERSONNES VIVANT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ (*)
SELON L’ÂGE ET LE SEXE EN 2013 (PAUVRETE MONÉTAIRE)
Hommes |
Femmes | |
Personnes vivant sous le seuil de pauvreté (seuil à 60 %) en moyenne |
13,6 % |
14,3 % |
Jeunes (18-29 ans) |
13,7 % |
20 % |
Familles monoparentales (dont environ 85 % de mères seules avec enfants) |
Taux de pauvreté de 34,4 % | |
Pères : 27,5 % |
Mères actives : 27,8 % Mères inactives : 66,4 % | |
(*) Seuil à 60 % de la médiane des revenus. Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.
Source : INSEE (DGFIP, CNAF, CNAV, CCMSA, enquête revenus fiscaux et sociaux 2013) et ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes
Cette précarité dans l’emploi tient également à une proportion plus importante de femmes en contrats à durée déterminée (CDD), comme l’a souligné la ministre Myriam El Khomri.
En effet, les femmes salariées ont un peu plus souvent un contrat temporaire, intérim ou CDD, que les hommes (13,9 % contre 13,1 % en 2013) : elles sont plus souvent en CDD (12,6 % contre 10,0 %), mais moins souvent intérimaires (1,3 % contre 3,1 %). L’écart femmes-hommes sur la probabilité d’être en contrat temporaire est fluctuant, mais a tendance à se réduire légèrement sur le long terme. Ce résultat reflète d’abord la part prépondérante des femmes dans le tertiaire, qui recourt de façon importante aux CDD, alors que les hommes sont majoritaires dans l’industrie ou la construction, qui privilégient l’emploi intérimaire en cas de recours à des contrats temporaires. En tout état de cause, les femmes sont plus souvent recrutées en CDD que les hommes. Selon une étude récente de la DARES (15), les embauches de femmes se font à 86,7 % en CDD, contre 79,9 % pour les hommes, et en 2013, le taux d’entrée en CDD pour les femmes est de 61,4 % et pour les hommes de 38,9 %.
Enfin, comme cela a été souligné lors des travaux de la Délégation, la précarité dans l’emploi est liée également au temps partiel subi, aux horaires atypiques, temps de déplacement et temps d’inactivité contraints (aide à domicile) des emplois peu qualifiés deux fois plus fréquents, et surtout des salaires horaires inférieurs à ceux des hommes liés pour partie à la concentration des femmes sur un nombre limité de métiers souvent peu valorisés, autrement dit à la persistance d’une « ségrégation professionnelle ».
2. Une répartition sexuée des métiers : un emploi féminin concentré sur douze familles professionnelles souvent peu valorisées
Les femmes et les hommes se répartissent encore très inégalement dans les différents métiers. Ainsi, la part des femmes approche ou dépasse les 90 % dans huit métiers : trois métiers de services aux particuliers (aides à domiciles et aides ménagères, qui comptent par exemple plus de 97 % de femmes, assistantes « maternelles », employé.e.s de maison), ainsi que chez les secrétaires et secrétaires de direction, les coiffeur.se.s ou esthéticien.ne.s, les infirmier.e.s et les aides-soignant.e.s.
LES 20 MÉTIERS CONTRIBUANT LE PLUS À L’INDICE DE SÉGRÉGATION PROFESSIONNELLE EN 2011
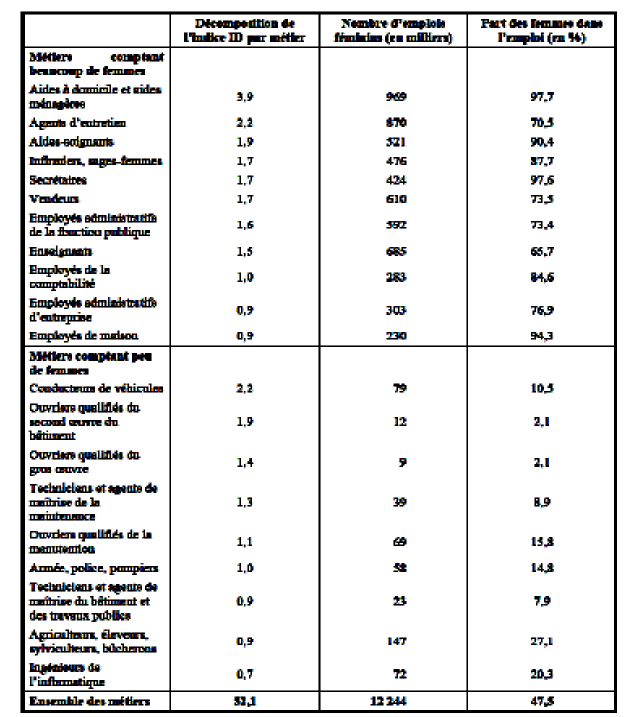
Indice de ségrégation professionnelle (ID): mesure de la distribution des hommes et des femmes dans les différents métiers (16). Champ : France métropolitaine.
Source : DARES (« La répartition des femmes et des hommes par métiers », décembre 2013)
Près de la moitié des femmes se concentrent ainsi dans une dizaine de métiers dix métiers (sur 87). En revanche, la dispersion des hommes est plus importante : les dix professions qui concentrent le plus d’hommes n’emploient que 31 % d’entre eux (17). L’indicateur de « ségrégation professionnelle » s’élevait ainsi à 51,6 en 2013, ce qui signifie que pour aboutir à une répartition égalitaire des femmes et des hommes dans les différents métiers, il faudrait que 51,6 % des femmes ou des hommes changent de métiers.
Certes, l’indice de ségrégation professionnelle, après avoir été proche de 56 de 1982 à1997, a diminué ensuite assez régulièrement, perdant 2 points au cours des dix dernières années. Cependant, comme l’a rappelé la ministre Mme Myriam El Khomri lors de son audition, 27 % des femmes ont des postes peu qualifiés d’employé.e.s ou d’ouvrier.e.s, contre 15 % des hommes. Entre 2003 et 2013, la part des emplois peu qualifiés a peu varié aussi bien pour les femmes que pour les hommes et l’écart femmes-hommes s’est stabilisé. De fait, les femmes travaillent toujours davantage dans les métiers les moins rémunérateurs : les salaires horaires des métiers « féminins » (11,3 euros de l’heure) étaient inférieurs en moyenne de 18,9 % à ceux des métiers « masculins » en 2012 (14,0 euros de l’heure).
On observe ainsi la permanence d’un traitement différencié et inégalitaire des femmes et des hommes sur le marché du travail, s’agissant des écarts de rémunération et d’un accès plus difficile aux postes à responsabilité (« plafond de verre », cf. infra), mais aussi de la nature de même des emplois exercés (« parois de verre »), et c’est précisément pourquoi la mixité des métiers constitue un enjeu central pour construire l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
3. Écarts de rémunération et plafond de verre
En 2013, les femmes gagnaient environ 24 % de moins que les hommes. Une fois prises en compte les différences de volumes horaires de travail (temps partiel), les femmes salariées du privé ou d’une entreprise publique avaient un salaire moyen en équivalent-temps plein inférieur de 19 % à celui des hommes.
Cet écart de rémunérations tient, d’une part, aux différences interprofessionnelles liées à l’inégale répartition des femmes et des hommes par métiers, et d’autre part, aux inégalités intraprofessionnelles (au sein de chaque famille de métiers) entre les femmes et les hommes. Elles résultent pour partie des caractéristiques individuelles des salariés ou des entreprises qui les emploient. Une partie de cet écart de salaire horaire entre les femmes et les hommes s’explique par des différences de caractéristiques (niveau de diplôme, expérience professionnelle, catégorie socioprofessionnelle, statut de l’emploi, secteur d’activité taille de l’entreprise, spécialité de formation, interruptions de carrière, métier, niveau de responsabilité…).
À secteur d’activité, âge, catégorie socioprofessionnelle et temps de travail identiques, l’écart de salaire femmes/hommes diminue entre 2012 et 2013 et passe sous les 10 % (9,9 % en 2013). La partie « non expliquée » de cet écart, autrement dit la part la plus inacceptable, « peut être le reflet de pratiques de discrimination salariale ou de processus inégalitaires jouant en défaveur des femmes à divers moments de la carrière, voire en amont de la vie professionnelle (18) ».
ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : LE POIDS DE CHAQUE COMPOSANTE EN 2012
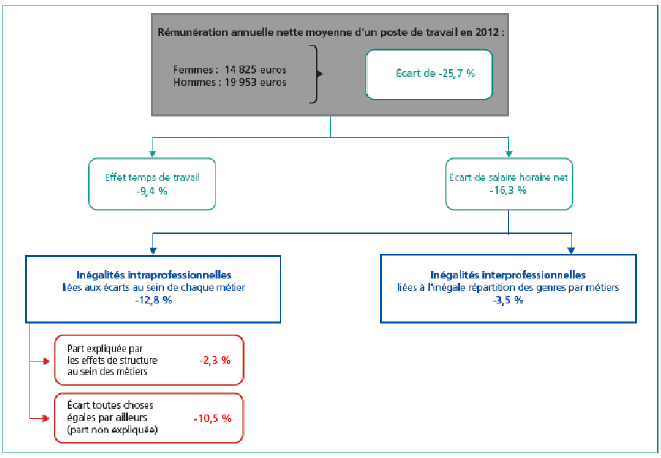
Source : « Ségrégation professionnelle et écarts de salaires femmes-hommes », DARES Analyses n° 82 (novembre 2015)
Vos rapporteures tiennent toutefois à souligner les progrès intervenus dans ce domaine : l’écart salarial entre les femmes et les hommes baisse de façon régulière depuis 2008 (baisse de 2,5 points en dix ans) et a notamment diminué de 0,2 point entre 2012 et 2013. Par ailleurs, les écarts de salaire diminuent deux fois plus vite en France que dans la moyenne Union européenne.
DES ÉCARTS DE SALAIRES QUI DIMINUENT DE DEUX FOIS PLUS VITE EN FRANCE QU’EN EUROPE
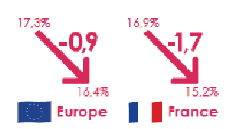
Lecture : entre 2008 et 2013, l’écart de salaire horaire net a diminué de 0,9 point en Europe, contre 1,7 point en France
Source : Eurostat (ministère des droits des femmes, octobre 2015)
Cependant, l’écart de rémunérations reste important et croît avec le salaire : il est de 8 % pour les revenus les plus faibles et de 22 % pour les revenus les plus élevés. Une partie de cet écart résulte des différences de postes entre les hommes et les femmes. En 2013, la probabilité qu’un homme en emploi occupe une profession « supérieure » plutôt qu’un autre emploi est de 1,5 fois celle d’une femme. Par ailleurs, alors que 48 % de l’ensemble des emplois sont occupés par des femmes en 2013, on compte seulement 26 % de femmes parmi les cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.
À cet égard, Mme Carole Cano, représentante de la CFE-CGC a souligné lors de son audition la nécessité d’agir sur l’accès des femmes aux postes à responsabilité, en rappelant que « 23 % des hommes cadres occupent un poste à « forte responsabilité » contre 11 % des femmes cadres. Alors que les écarts de responsabilité entre hommes et femmes sont faibles en début de carrière, ils s’accroissent progressivement à partir de 35 ans. Entre 45 et 49 ans, 30 % des hommes cadres ont atteint un poste à forte responsabilité (direction générale, direction d’une entité, direction d’un service) contre 14 % des femmes. Le plafond de verre qui empêche les femmes d’accéder aux postes les plus élevés dans la hiérarchie est toujours présent (19 ».
Si les disparités femmes-hommes dans le monde du travail restent significatives, on observe toutefois une réduction des inégalités relatives au sous-emploi, à l’accès aux professions « supérieures », à la ségrégation professionnelle et aux salaires, comme le montre une étude récente de la DARES (20) – évolution positive à laquelle les différentes mesures engagées par les pouvoirs publics depuis quelques années ont clairement contribué.
II. DES MESURES IMPORTANTES MISES EN œUVRE DEPUIS 2012
Trois axes stratégiques structurent la politique publique de l’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi : l’insertion des femmes sur le marché du travail (1), l’égalité professionnelle (2) et la mixité des filières de formation et des métiers (3). Sur chacun de ces trois axes, de nombreuses mesures, dont les principales sont rappelées ci-après, ont été prises pour faire progresser l’égalité réelle, et vos rapporteures se félicitent qu’un certain nombre de ces mesures se soient inscrites dans le prolongement des recommandations de la Délégation.
A. POUR FAVORISER L’INSERTION DES FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
1. En facilitant l’articulation des temps de vie professionnels et familiaux, pour soutenir l’emploi des mères et un meilleur partage des tâches
Plusieurs mesures ont été prises pour faciliter l’articulation des temps de vie des parents, soutenir l’insertion professionnelle des femmes et limiter l’impact de la maternité sur leurs carrières.
● Développer l’accueil des jeunes enfants
Le Gouvernement s’est fixé l’objectif de soutenir la création de 275 000 solutions d’accueil supplémentaires pour les jeunes enfants entre 2013 et 2017. La convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre l’État et la CNAF le 16 juillet 2013, a engagé la branche Famille de la sécurité sociale autour d’ambitions fortes pour toujours mieux accompagner toutes les familles et lever les freins à l’emploi. Elle fixait ainsi l’objectif de 100 000 places d’accueil nouvelles au sein des établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) et 100 000 places supplémentaires d’enfants accueillis par des assistant.e.s maternel.le.s. S’y ajoutent 75 000 places nouvelles pour les enfants de moins de trois ans à l’école maternelle. Une attention particulière aux enfants de familles modestes ou en insertion.
Quant à la mise en œuvre de ce plan, évoquée au cours des auditions, vos rapporteures soulignent qu’entre 2012 et 2014, 42 700 nouvelles places en crèche ont été créées selon un bilan présenté en octobre 2015. La Délégation suit naturellement avec attention de ce plan ambitieux, qui représente un effort budgétaire important, en rappelant qu’une partie de celui-ci dépend, non pas de l’État et de la branche Famille (CNAF), mais des collectivités territoriales.
● Réformer le congé parental pour favoriser un meilleur partage des responsabilités familiales
Afin de rééquilibrer les responsabilités parentales au sein du couple et favoriser l’emploi des femmes, le législateur a réformé la prestation liée au congé parental en encourageant chacun des deux parents à prendre une durée minimale de congé parental à temps plein ou partiel. Suite à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, deux décrets du 30 décembre 2014 (21) ont précisé les modalités d’application de cette nouvelle prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPAREE), qui remplace le complément de libre choix d’activité (CLCA, versé au parent qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant).
Une période de congé est réservée à chaque parent et celle-ci est perdue s’il n’en demande pas le bénéfice (22) : l’effet attendu est une augmentation de la proportion de pères prenant un congé et une diminution de la durée moyenne d’éloignement du marché du travail des mères.
● Préparer le retour à l’emploi après un congé parental
Dans cette perspective, l’accord-cadre national signé le 28 juin 2013 entre Pôle Emploi, les ministères chargés des droits des femmes et du travail, prévoyait, dans un de ses axes de travail, une anticipation du retour à l’emploi des allocataires du CLCA. Dans un premier temps, 28 actions expérimentales dans quatre régions des neuf « territoires d’excellence » (cf. infra), portant sur la sensibilisation et l’accompagnement. Dans un second temps, une convention généralisant ces expérimentations a été conclue le 11 avril 2014 entre l’État, la CNAF et Pôle Emploi en faveur du retour à l’emploi des familles bénéficiant du CLCA ou allocataires de la PREPARE. Les CAF délivrent ainsi aux parents concernés, des renseignements sur les modes d’accueil et les prestations dont ils peuvent bénéficier, notamment dans le cadre de réunions d’information collectives. Pour les familles les plus fragiles et les plus éloignées de l’emploi, les CAF proposent aussi des rendez-vous individuels avec un.e travailleur.se social.e. Pôle Emploi propose par ailleurs une orientation pour renforcer les techniques de recherche d’emploi, une évaluation des compétences ainsi qu’un appui à l’élaboration d’un projet professionnel pour une première entrée sur le marché du travail ou une reconversion.
Enfin, dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, ont été introduites des dispositions prévoyant un entretien professionnel après un congé parental ou une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant (23). Vos rapporteures se félicitent que les recommandations adoptées par la Délégation aux droits des femmes aient ainsi été suivies d’effets.
2. En accompagnant les demandeuses d’emploi et en engageant des actions spécifiques en direction de femmes plus éloignées de l’emploi
● Accompagner les femmes en recherche d’emploi
Un accord national, signé entre Pôle Emploi, les ministères chargés des droits des femmes et du travail, pour une durée de 18 mois, a prévu quatre axes de travail, présentés ci-après.
Accompagner les femmes en recherche d’emploi : l’accord-cadre signé en avril 2015 par Pôle Emploi et les ministères des droits des femmes et du travail
La nouvelle convention a prévu le maintien, en les précisant, de certaines initiatives : contribuer à renforcer la mixité des emplois dans les actions de recrutement, de formation et d’insertion dans les territoires ; faciliter le retour à l’emploi des femmes ; contribuer à l’amélioration de la qualité des emplois des femmes (activité réduite et chômage récurrent) en agissent sur les freins à l’emploi en lien avec les acteurs de l’insertion sur les territoires) ; soutenir l’enteprenariat féminin. La convention présente également plusieurs évolutions en matière de : formation (le module de formation des conseiller.e.s est paru dans le plan de formation 2015 de Pôle Emploi et doit désormais se déployer ; une des conditions de réussite de cette formation passe par la formation des managers ; celle-ci est prévue par le nouvel accord et devrait être dispensée par l’université du management) ; diagnostics sexués (ces diagnostics représentent un objectif de veille important pour début 2015) ; communication (un plan de communication interne et externe est à convcevoir, faire vivre et nourrir à partir d’intiatives locales), etc. L’accord-cadre a vocation à être décliné sur l’ensemble du territoire.
Source : rapport du Gouvernement au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) sur le bilan des actions menées en matière d’égalité professionnelle (juin 2015)
● Engager des actions spécifiques en direction de certains publics
Certaines femmes connaissent des difficultés plus importantes en termes d’accès à l’emploi. C’est pourquoi différentes actions ont été menées afin d’accompagner les femmes domiciliées dans les quartiers prioritaires de la ville, ainsi que les femmes de 16 à 25 ans suivies par les missions locales, outre certains publics confrontés à des multi-discriminations, notamment les femmes immigrées.
– L’accompagnement des jeunes femmes par les missions locales
Partie intégrante du service public de l’emploi, les 446 missions locales réparties sur l’ensemble ont pour missions de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans (L. 5311-1 et suivants du code du travail). En 2013, plus de 1,4 million de jeunes y ont été accueilli.e.s et 593 000 d’entre eux ont trouvé un emploi. Le principe de l’égalité femmes-hommes a été réaffirmé dans le protocole des missions locales, conclu en 2010.
Par ailleurs, le ministère chargé et des droits des femmes et le Conseil national des missions locales (24) (CNML) se sont rapprochés en 2015 en vue de préparer un accord-cadre, qui pourra prévoir les points suivants : la mise en place de diagnostics sexués sur les territoires ; la création d’une formation destinée aux conseiller.e.s de missions locales sur les questions d’égalité, de mixité et de lutte contre les discriminations et les violences ; la sensibilisation des instances dirigeantes ; une contractualisation territoriale et l’identification, le cas échéant, d’un.e référent.e égalité dans les missions locales ; des actions en matière d’accompagnement social (prévention des grossesses, lutte contre les violences), d’égalité et de mixité professionnelle , de lutte contre les stéréotypes) ; des expérimentations dans le domaine de l’entreprenariat féminin (25).
– L’égalité entre les femmes et les hommes dans la politique de la ville
Entre 2013 et 2014, dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), le réseau des droits des femmes et de l’égalité a accompagné le développement d’actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Au total, 19 régions ont mis en place des actions soutenues dans le cadre des CUCS (26). Ces actions s’organisent principalement autour de trois thématiques : l’accès à l’emploi (47 actions en 2014) ; la lutte contre les violences (32 en 2014) ; l’accès aux droits (31 en 2014). Par ailleurs, plusieurs actions ont porté sur les champs suivants : égalité entre les filles et les garçons, sport, loisirs, conférences, accès aux dispositifs de santé…
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a instauré une nouvelle génération de contrats de ville, conclus en 2015 entre l’État et les territoires pour une durée minimale de trois ans. Ces contrats sont déclinés sur trois volets intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques (« cohésion sociale », avec une priorité au soutien des familles monoparentales, « cadre de vie et renouvellement urbain » et « développement de l’activité économique et de l’emploi »). Dans le cadre de ces contrats de ville, au sein des quartiers prioritaires, l’égalité femme-hommes hommes est un axe transversal, au même titre que la jeunesse et la lutte contre les discriminations. Créé en 2014, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) veille à la lutte contre les inégalités femmes-hommes et à l’application des textes relatifs à cette question.
Afin de promouvoir l’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes dans les CUCS, puis dans les nouveaux quartiers prioritaires de la ville, le ministère des droits des femmes a mis en place un partenariat avec le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, à travers la signature d’une convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013-2015.
La convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires (2013-2015)
signé par les ministres chargé.e.s des Droits des femmes et de la Ville
Le 19 février 2013, le Comité interministériel des villes a souligné (décision 14) : la volonté d’intégrer la dimension de lutte contre les inégalités femmes-hommes dans les quartiers en irriguant et en renforçant l’ensemble des politiques sectorielles de droit commun ; la nécessité de mieux cerner les problématiques spécifiques des femmes dans les quartiers en recourant à une évaluation d’impact et en s’assurant de l’accès des femmes des quartiers prioritaires aux actions d’information sur les droits des femmes. Le 21 mai 2013, le ministère des Droits des femmes et le ministère délégué à la Ville ont signé une convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires pour 2013-2015. La coordination et le suivi de la convention interministérielle est assurée par un comité de pilotage mis en place par les deux ministères, avec le service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE), le ministère délégué à la ville, le CGET et le CNIDFF. Quatre objectifs opérationnels ont été actés par la convention triennale :
a) Développer l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les quartiers prioritaires de la ville. L’approche intégrée consiste à investir l’ensemble des politiques publiques à travers le prisme de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette logique transversale est un « volet obligatoire » des contrats de ville. Développer l’approche intégrée suppose au préalable la réalisation d’un diagnostic territorial fondé sur la collecte de données sexuées. À ce titre, les instructions gouvernementales sont venues préciser la nécessité de recueillir de telles données afin de comprendre les logiques d’inégalités et d’adapter en réponse l’action publique aux spécificités du territoire. Par ailleurs, pour chaque dispositif, des « clauses d’impact sur l’égalité femmes-hommes » ainsi que des objectifs assortis d’indicateurs sont définis. Axe fort de l’approche intégrée, le diagnostic territorial est enrichi par une enquête participative de terrain. Les acteurs publics souhaitent donner voix au chapitre à un groupe restreint de femmes en se basant sur la méthodologie des « marches exploratoires ». Cette enquête affine de manière qualitative le diagnostic territorial et s’inscrit dans les logiques participatives de co-construction.
b) Décliner dans les quartiers prioritaires les mesures du Comité interministériel aux droits des femmes De concert avec les partenaires sociaux et régionaux, les Territoires d’excellence » sont reconduits pour expérimenter les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’association des contrats de services civiques aux actions de sensibilisation est recentrée sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Leurs missions se concentrent sur les stéréotypes de sexe, le développement de l’éducation à l’égalité dans les services publics, le sport et la vie associative.
c) Soutenir le développement de l’activité économique des femmes des quartiers Le Fonds de Garantie pour l’Initiative des Femmes (FGIF) finance un programme d’aide à la création d’entreprises, notamment pour les femmes de quartiers. Cette disposition relative à l’entreprenariat s’inscrit dans le cadre du troisième pilier du contrat de ville, destiné notamment à promouvoir l’entreprenariat.
d) S’assurer de l’accès des femmes des quartiers prioritaires aux actions d’information sur les droits des femmes L’accès aux droits dans les quartiers prioritaires est un enjeu fondamental : les actions d’information des femmes sur leurs droits menées par le CNIDFF et son maillage local sont particulièrement soutenues.
Sous l’autorité du/de la préfet.e de région, le secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) définit en lien avec la délégation aux droits des femmes (DDF) le plan régional stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes et veille notamment à la déclinaison régionale de la convention signée entre le ministère des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes et celui de la ville. Assistés des chargé.é.es de mission départementales.aux des droits des femmes, les préfet.e.s de département ont la responsabilité de concevoir et d’exécuter les prochains contrats de ville 2014-2020. Les 4 objectifs opérationnels de la convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013-2015, ont vocation à y être traduits et appuyés.
Source : rapport précité au CSEP (juin 2015)
Lors de son audition, la ministre Myriam El Khomri a d’ailleurs souligné « le rôle majeur que tiennent les femmes en matière de développement et de cohésion sociale », en évoquant « d’exceptionnelles initiatives de terrain portées des femmes en matière d’insertion par l’emploi et aussi de développement économique, dans les villes comme dans les campagnes ». Elle a aussi souligné rencontrer « constamment des femmes qui entreprennent, qui osent, qui connaissent des carrières brillantes, affirment leurs droits et prennent enfin la place qui est la leur. »
3. En soutenant l’entreprenariat féminin
En France, les femmes ne représentent qu’environ 30 % des créateurs d’entreprise et cette situation n’a quasiment pas évolué depuis les dix dernières années. Les créatrices d’entreprise ont moins facilement accès au crédit bancaire (34 % des femmes démarrent avec moins de 4 000 euros) et sont aussi confrontées aux problématiques d’articulation des temps de vie. Elles préfèrent souvent créer leur entreprise une fois que leurs enfants sont autonomes (27), créent essentiellement des TPE (ce sont à 70 % des entreprises individuelles) et sont plus souvent auto-entrepreneures.
Face à ce constat, le Gouvernement a lancé en 2013 un plan pour l’entreprenariat au féminin fixant pour objectif un taux de 40 % de femmes parmi les créateurs d’entreprise en 2017. Ce plan, réalisé en partenariat avec BPI France, France Active, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), plusieurs réseaux bancaires et chambres consulaires, s’organise autour de trois piliers :
– la sensibilisation des femmes, à travers par exemple la semaine de sensibilisation à l’entreprenariat au féminin, qui a permis de sensibiliser plus de 10 000 jeunes en 2015 (avec 100 000 entrepreneur.se.s dans les collèges, lycées et établissements d’enseignement) et le site « ellesentreprennent.fr » ;
– l’accompagnement : 14 réseaux d’accompagnement, généralistes ou spécialisés (pour les femmes de plus de 45 ans, sur le secteur du numérique, etc.) ont signé une convention pour la promotion de l’entreprenariat au féminin ;
– le financement : le Fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF) offre aux femmes une sécurité pour contracter des prêts auprès de banques. Le plafond de la garantie a été augmenté de 27 000 € à 45 000 € en 2015; quatre banques ont conventionné avec l’État pour améliorer le suivi des femmes. Il a été mobilisé en 2015 autour de trois enjeux majeurs : le développement de l’entreprenariat des femmes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans les zones rurales, et le développement de la reprise d’activité.
B. POUR FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Pour faire progresser l’égalité professionnelle et salariale, il s’agit tout d’abord de garantir l’effectivité de droits (1), mais aussi de développer les actions d’accompagnement des entreprises et de promotion de l’égalité (2). Des mesures ont aussi été prises en matière de sexisme et de harcèlement sexuel (3).
1. Garantir l’effectivité des droits et lutter contre la précarité dans l’emploi
L’effectivité des droits des femmes sur le marché du travail se mesure tout au long du parcours professionnel en termes de recrutement, d’égalité salariale, d’accès à la formation, de déroulement de carrières, et d’accès aux postes à responsabilité. Ceci suppose en premier lieu de veiller au respect par les entreprises de leurs obligations en matière d’égalité professionnelle.
● Sanctionner les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle
Dès l’automne 2012, la Délégation aux droits des femmes a travaillé sur le projet de décret d’application, très attendu, de la loi du 9 novembre 2010 sur les retraites, qui prévoyait de sanctionner financièrement les entreprises de plus de 50 salarié.e.s ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle (28). Ce décret, publié le 19 décembre 2012, prévoit notamment d’augmenter le nombre des domaines d’action sur lesquels devront porter les accords ou plans d’action. Ainsi, à ce jour, les entreprises d’au moins 50 salariés non couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, par un plan d’action intégré au rapport de situation comparée (RSC) sont soumises à une pénalité financière. Vos rapporteures saluent cette avancée importante, dont le bilan chiffré, présenté dans la seconde partie du présent rapport, s’avère très positif : le nombre d’entreprises couvertes par un accord ou plan d’action a ainsi très sensiblement progressé sur la période récente (cf. infra).
● Mobiliser le levier de la commande publique
Comme cela a été rappelé au cours des travaux des rapporteures, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu que les entreprises qui souhaitent accéder à un marché public, à un contrat de concession de travaux publics, aux contrats de partenariat ou aux délégations de service public, doivent respecter leurs obligations en matière d’égalité professionnelle (29), depuis le 1er décembre 2014. Si l’entreprise ne s’est pas mise en situation de respecter ses obligations de négocier en matière d’égalité professionnelle, elle doit le faire avant la date de clôture de la période de consultation. Il lui incombe alors, à la date à laquelle elle soumissionne, de réaliser ou d’engager la régularisation de sa situation et ainsi d’établir, attestations utiles à l’appui, un « commencement d’exécution ».
● Lutter contre la précarité dans l’emploi : l’adoption de mesures en faveur des temps partiels dans le cadre de loi du 14 juin 2013
Comme l’a souligné la ministre Myriam El Khomri lors de son audition, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, faisant suite à l’accord national interprofessionnel conclu en 2013, a « permis des avancées majeures notamment en instaurant une durée minimale du travail à temps partiel de 24 heures par semaine. Cela permet de lutter contre la précarité au travail qui frappe particulièrement les femmes. Cette même loi a permis de mettre en place une modulation des cotisations d’assurance chômage sur les contrats courts pour inciter au recours au CDI plutôt qu’au CDD ».
● Faire progresser les droits en matière d’accès à la formation continue
Pour favoriser l’accès effectif des femmes à la formation continue, plusieurs initiatives ont été prises, en particulier, sur le plan législatif :
– la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, dont la Délégation a été saisie, a prévu que « la région favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières » ; des dispositions en faveur de la mixité dans les centres de formation des apprentis (CFA) ont aussi été prévues ;
– la loi du 4 août 2014 précitée prévoit la possibilité de mobiliser les fonds de la formation professionnelle pour la promotion de la mixité dans les entreprises, la sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et l’égalité professionnelle (sur les actions mises en œuvre par l’AFPA à ce titre, cf. infra).
● Réviser les classifications de branche
En application de l’article 5 de la loi du 4 août 2014 précitée (L. 3221-6 du code du travail), à l’issue des négociations sur les classifications de branche, les partenaires sociaux devront remettre à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au CSEP un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et les bonnes pratiques. Dans le cadre des négociations sur les classifications, il s’agit d’examiner les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin d’identifier et de corriger ceux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés.e.s.
En présentant les travaux en cours au CSEP sur cette question, Mme Rachel Silvera a évoqué les « discriminations véhiculées par les classifications professionnelles » et souligné « qu’au nom du principe (…) "à travail de valeur égal, salaire égal", les classifications professionnelles peuvent constituer un outil de revalorisation des emplois à prédominance féminine ». Vos rapporteures soulignent à cet égard l’importance de la révision des classifications pour faire progresser l’égalité professionnelle et la mixité des métiers.
● Briser le plafond de verre
La loi du 4 août 2014 a permis à cet égard deux avancées majeures :
– l’obligation de compter 30 % de femmes dans les flux de nominations aux postes de cadres dirigeants de la fonction publique a été ramenée de 2017 à 2016, et le taux de 40 % en 2017, parce que l’État doit être exemplaire dans ce domaine ; le colloque organisé par la Délégation, le 2 mars 2016, a permis de mesurer l’ensemble des progrès intervenus depuis 2012 ;
– en prévoyant, concernant les dispositions introduites par la « loi Copé-Zimmermann » du 27 janvier 2011, que dès le 1er janvier 2017, les conseils des sociétés anonymes (SA) et des sociétés à commandite par actions (SCA) cotées en bourse devront présenter au moins 40 % de femmes dans leur conseil d’administration ou de surveillance, et à compter de 2010 pour les SA et SCA non cotées de plus de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires net ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros devront remplir cette obligation à compter de 2020.
Vos rapporteures soulignent à cet égard que la France a progressé de 5,7 points entre 2012 et 2014 en matière de féminisation des instances dirigeantes des entreprises, ce qui la place au premier rang européen (30,3 % en 2014, contre 24,6 % en 2012).
2. Les actions d’accompagnement et de promotion de l’égalité professionnelle
La politique publique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fondée sur la valorisation des bonnes pratiques et l’incitation des différents acteurs et actrices à aller au-delà de la simple conformité à la loi, vers des pratiques innovantes, en s’appuyant notamment sur la labellisation, le conventionnement, les expérimentations ou l’organisation d’évènements dédiés.
● Diffuser aux entreprises les informations relatives à leurs nouvelles obligations légales et réglementaires
Hébergé par le site du ministère chargé des droits des femmes, le site « egapro.fr » a été créé en 2012, en lien avec les partenaires sociaux. Afin d’informer les entreprises, et plus particulièrement les PME et TPE, de leurs nouvelles obligations suite à la loi du 4 août 2014, ce site a fait l’objet d’une première refonte, en lien avec le CSEP, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et la direction générale du travail (DGT).
Par ailleurs, au niveau territorial, les délégations régionales aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) et les services déconcentrés du ministère du travail (DIRECCTE et leurs unités territoriales) mènent plusieurs actions innovantes afin de diffuser les informations relatives aux nouvelles obligations légales et réglementaires des entreprises, par exemple l’organisation de sessions de formation à destination des agents de contrôle et les journées de sensibilisation auprès des acteurs et actrices de l’entreprise pour les accompagner dans la négociation.
● Développer différentes actions d’accompagnement des entreprises
L’ANACT et son réseau régional (ARACT) a mené différentes actions visant à faire monter en compétence les acteurs de l’entreprise sur les questions de management et d’égalité. En 2013 et 2014, 33 actions de sensibilisation et formation à l’égalité professionnelle en lien avec l’amélioration des conditions de travail ont ainsi été organisées, avec des sessions ou ateliers de sensibilisation, formation et formation action réalisées par le réseau à destination des entreprises et branches professionnelles (70 %) ainsi que des institutionnels et acteurs relais, organisations syndicales et patronales, consultants.
Par ailleurs, 49 accompagnements d’entreprise sur l’égalité professionnelle, individuels ou collectifs ; dans ce dernier cas, il s’agit d’actions consistant à accompagner les entreprises, représentées le plus souvent par un binôme direction/instance représentative du personnel (IRP), par exemple pour l’élaboration du rapport de situation comparée (RSC) et la préparation de la négociation d’un accord). Le réseau ANACT-ARACT des actions en matière d’élaboration et de diffusion d’outils et de supports sur l’égalité professionnelle à destination des entreprises et de leurs partenaires, d’études relatives à l’analyse des accords et plans d’action égalité et à l’analyse des conditions de travail et de la santé au travail selon le sexe, en lien avec la DRDFE et la DIRRECTE, et d’animation de réseaux et de développement de partenariats sur l’égalité professionnelle.
L’expérimentation des « territoires d’excellence », prévue par la grande conférence sociale de juillet 2012, a été mise en place dans neuf régions, et donné lieu à la signature de conventions-cadres entre le/la préfet.e de région, le/la président.e du conseil régional et les partenaires locaux (DIRECCTE, Pôle Emploi, rectorat, etc.), en présence de la ministre chargée des droits des femmes.
Les « territoires d’excellence pour l’égalité professionnelle »
Expérimentation lancée dès 2012 avec 9 régions, le programme « Territoires d’excellence pour l’égalité professionnelle » part du constat que l’égalité nécessite la mobilisation de tous (entreprises, collectivités, citoyens). Il est piloté par l’État et les régions, responsables de la formation et des politiques économiques sur leurs territoires. Cette première vague a permis la réalisation de 230 actions dans 7 400 entreprises, ayant bénéficié à 170 000 personnes. Devant ce succès, le dispositif a été généralisé en 2014 à toutes les régions volontaires. En octobre 2015, 6 nouvelles régions avaient signé une convention avec l’État, portant à 15 le nombre de régions « territoires d’excellence ». La quasi-totalité des nouvelles régions définies par la réforme territoriale votée en juillet 2015 sont ainsi couvertes par ces actions, qui concernent la mixité des métiers, l’insertion et l’accès à l’emploi des femmes et l’égalité salariale dans les entreprises, et plus particulièrement dans les petites et moyennes entreprises.
Ces expérimentations avaient pour but de créer une dynamique territoriale pour atteindre l’égalité professionnelle. Animées par la DRDFE, ces expérimentations étaient structurées en trois volets : réaliser l’égalité professionnelle dans les TPE-PME par une effectivité du droit ; développer la mixité des filières de formation et des métiers ; lutter contre l’éloignement de l’emploi des bénéficiaires du congé parental. Huit nouveaux territoires d’excellence ont été relancés en 2015-2016.
Concernant le « volet 1 » relatif à l’égalité professionnelle dans les PME-TPE, les actions sont principalement destinées aux entreprises et visent à promouvoir les accords en matière d’égalité professionnelle (accompagnement des employeurs à la rédaction du RSC, formation des IRP pour mener les négociations dans les entreprises et dans les branches), favoriser les actions sur l’amélioration des conditions de travail comme un levier de performance et de compétitivité (formation des conseiller.e.s et des formateurs contre les stéréotypes sexistes, développement des aptitudes managériales des femmes…). Dans ce cadre, 90 actions ont ainsi été menées sur l’égalité professionnelle, concernant 44 000 bénéficiaires dans 7 460 entreprises pour des actions de sensibilisation, dont 90 % de PME et de TPE, et 500 entreprises pour des actions d’accompagnement.
Le bilan intermédiaire des neuf territoires d’excellence, réalisé en décembre 2014, a mis en évidence la pertinence de ce dispositif auprès des bénéficiaires, avec par ailleurs deux intérêts complémentaires : un effet de levier important (ratio de 1 à 5 entre le montant investi dans le cadre du programme budgétaire n° 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » et le montant total consacré à chaque action) ; un intérêt opérationnel grâce à la mise en relation de nombreux partenaires institutionnels privés et associatifs à un niveau territorial efficace.
Vos rapporteures saluent cette démarche innovante et partenariale, qui a notamment permis d’expérimenter de nouveaux modes d’accompagnement des entreprises, comme l’illustrent les deux exemples ci-après.
Deux exemples d’expérimentations dans le cadre des « territoires d’excellence »
Les « clusters de l’égalité » en Bretagne. Cette expérimentation, menée par l’ARACT Bretagne, en direction des entreprises, notamment les PME et les TPE, avait pour objet de développer la négociation en matière d’éalité professionnelle et d’accompagner les entreprises bretonnes en faveur de la qualité de l’emploi. Cette expérimentation a associé un représentantt de la direction des ressources humaines et un représentant des salarié.e.s dans la formation et la conduite des négociations relatives à l’égalité professionnelle.
Un bilan réussi de l’accompagnement des entreprises en matière de sensibilisation à la culture de l’égalité professionnelle et d’accords dans la région Midi-Pyrénées. Un appel à projets FSE cofinancé par l’État en partenariat avec la région a eu pour objectif d’accompagner individuellement ou collectivement des entreprises (cible prioritaire PME-TPE) en vue de la signature d'un accord et/ou de la réalisation d'un plan d'action. Les entreprises participantes issues de tous les secteurs professionnels du territoire ont effectué les réalisations suivantes : l’élaboration de fiches méthodologiques et d’outils ; la réalisation d’un rapport de situation comparée (RSC), d’accords collectifs et/ou plans d’action pour l'égalité professionnelle ou l’amélioration d'accords dans les entreprises accompagnées ; des séances de sensibilisation des salarié-es (encadrement, RH, salariés) ; le recrutement de femmes dans des métiers où elles sont minoritaires dans l'entreprise.
● Valoriser les bonnes pratiques
Le label « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » a été créé en 2004 afin de mettre en valeur les bonnes pratiques des organismes privés et publics et favoriser le dialogue social en réunissant sur ce sujet les organisations syndicales et l’employeur.e autour d’une démarche commune et partagée. En octobre 2015, 51 organismes étaient labellisés représentant 493 000 salarié.e.s. Délivré par l’AFNOR (Association française de normalisation), ce label permet aux entreprises de bénéficier d’un audit et de passer en revue l’ensemble de leur processus de ressources humaines, afin d’améliorer l’égalité.
La rénovation du label « Égalité » a été engagée en 2015 : il bénéficie désormais d’un dossier commun avec le label « diversité » et d’un audit commun si les entreprises le désirent. Ainsi, tout en maintenant la spécificité des deux labels, il sera plus simple pour une entreprise d’être labellisée. Tous les ministères devraient être labellisés d’ici fin 2016.
En outre, l’État a signé des conventions « Engagement pour l’égalité entre les hommes et les femmes » avec 27 grandes entreprises (30) ayant pris des initiatives positives en matière d’égalité professionnelle. Chaque convention présente trois objectifs principaux : l’égalité professionnelle dans l’entreprise, et dans les PME-TPE avec lesquelles elles travaillent, la mixité professionnelle, l’articulation des temps de vie personnels. Sur ce dernier axe, sont par exemple prévues des actions en matière de lutte contre l’éloignement de l’emploi des bénéficiaires du congé parental, notamment par la mise en place d’entretiens, l’encouragement à l’implication des pères dans la vie familiale, l’information des parents sur les nouvelles dispositions de la loi du 4 août 2014, etc. Les bonnes pratiques identifiées dans ce réseau d’entreprises seront valorisées dans le cadre de groupes de travail élargis, associant les entreprises du SBF 120 ainsi que les PME-TPE avec lesquelles elles travaillent.
● Amplifier la mobilisation de la société sur l’ensemble du territoire
Organisée chaque année depuis 2013, en octobre, à l’initiative du ministère des droits des femmes, la « semaine de l’égalité professionnelle » est organisée afin de donner encore davantage de visibilité à cette question et d’amplifier la mobilisation de la société pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. De nombreux évènements ont été organisés sur cette thématique sur l’ensemble du territoire.
3. La lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
● Le harcèlement sexuel et moral
La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel visait à pallier le vide juridique créé le 4 mai 2012 par l’abrogation avec effet immédiat, par le Conseil constitutionnel, de l’article 222-33 du code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel, au motif que la disposition n’était pas conforme au principe de légalité des délits et des peines. Une nouvelle définition plus large et plus précise du harcèlement sexuel, conforme au droit européen et assortie de sanctions plus lourdes, a ainsi été retenue (31). La loi homogénéise également, sur les plans civil et pénal, les dispositions législatives relatives au harcèlement moral, élargit la protection contre les discriminations et renforce l’obligation de prévention qui incombe à l’employeur.
Vos rapporteures se félicitent à cet égard du lancement récent d’une mission d’évaluation sur l’application de la loi du 6 août 2012 par les député.e.s Pascale Crozon et Guy Geoffroy, membres de la commission des Lois et par ailleurs membres de la Délégation aux droits des femmes.
● Les agissements sexistes : de nouvelles dispositions introduites récemment dans le code du travail
Dans le prolongement du rapport du CSEP sur le sexisme au travail (février 2015), la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dont la Délégation a été saisie, a permis d’introduire dans le code du travail de nouvelles dispositions relatives aux agissements sexistes (32), et vos rapporteures proposent de compléter cette avancée pour renforcer la lutte contre les discriminations et le sexisme au travail.
C. POUR DÉVELOPPER LA MIXITÉ DES EMPLOIS
Lors du Comité interministériel aux droits des femmes qui s’est réuni en janvier 2014, un objectif volontariste a été fixé dans ce domaine par le Premier ministre : passer à un tiers d’emplois mixtes d’ici à 2025, contre 12 % alors. Pour atteindre cet objectif, la politique de mixité professionnelle vise à lutter contre les stéréotypes de sexe dans le système éducatif (1) et dans la vie active (2), en s’appuyant sur des actions de sensibilisation des différents acteurs, des expérimentations territoriales, la mise en place de plans dédiés par secteur d’activité ainsi que des aides financières spécifiques.
1. Lutter contre les stéréotypes de sexe dans le système éducatif
L’action du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche s’inscrit dans le cadre de la convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, signée pour la période 2013-2018, dont le troisième axe prioritaire vise à « favoriser une plus grande mixité des filières de formation à tous les niveaux d’étude ». Elle prévoit notamment des actions en matière de connaissances (statistiques sexuées sur les parcours scolaires), d’orientation, avec une vigilance particulière sur le message véhiculé dans l’information délivrée sur les métiers et filières de formation, et de formation des corps d’inspection concernés et des chefs des services académiques d’information et d’orientation. Chaque année, cette action fait l’objet d’un échange avec le service des droits des femmes et de l’égalité sur la base d’une feuille de route présentant des éléments de bilan et de perspective.
Le nouveau parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnelle (PIIODMEP), inscrit dans la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation du 8 juillet pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013, sera un levier important dans l’accompagnement des choix d’orientation, de sensibilisation aux stéréotypes en matière de formation et de métiers. Le ministère chargé de l’éducation nationale généralise ainsi le « Parcours avenir », qui permettra à tous les jeunes, de la sixième à la terminale, d’expérimenter un parcours personnalisé donnant accès à la diversité des métiers qu’il ou elle peut exercer.
Diverses autres actions ont été mises en œuvre dans ce domaine, telles que l’organisation d’évènements nationaux (semaine école-entreprise, semaine de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat féminin, etc.) ou encore des actions de professionnalisation des acteurs de l’orientation sur la mixité des métiers.
Enfin, au-delà de la question particulière de la mixité des filières de formation, vos rapporteuses se félicitent de l’introduction d’un enseignement spécifique sur l’égalité filles-garçons dans le tronc commun de toutes les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) pour les 25 000 enseignant.e.s en formation initiale, sur la base de modules fournis par le ministère de l’éducation nationale. Pour progresser en matière d’égalité en milieu professionnel, il est en effet essentiel, en amont, de lutter contre les inégalités et les stéréotypes dès le plus jeune âge.
2. Mettre en œuvre un plan d’action volontariste sur la mixité des métiers
Le Gouvernement a lancé en mars 2014 une plateforme d’actions pour la mixité des métiers avec une trentaine de partenaires regroupant des entreprises, des associations, des fédérations professionnelles, des organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA) et des collectivités territoriales, et qui les engage à :
– faire évoluer vers la mixité dix secteurs d’activité porteurs d’emplois pour l’économie française, notamment l’accueil de la petite enfance, le grand âge, les services à la personne, le numérique, l’énergie, les transports, la sécurité et le développement durable ;
– faire de la révision quinquennale des classifications de branche un levier de progrès pour la mixité ;
– agir sur les causes de la non-mixité, concernant en particulier sur l’équilibre des temps de vie et les organisations de travail ;
– mettre la question de la mixité au cœur du nouveau service public régional de l’orientation ; avec l’association des régions de France (ARF), le ministère de l’Éducation nationale a inscrit les questions de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la mixité des métiers dans l’accord-cadre État-régions prévu par la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle et conclu le 28 novembre 2014 ;
– rendre toutes les orientations professionnelles possibles ; les recteurs et rectrices sont chargé.e.s d’établir un plan d’actions au sein de l’académie ; les établissements d’enseignement supérieur se fixent des objectifs de mixité, notamment pour les filières très peu mixtes ; les mesures de la plateforme d’actions peuvent s’appuyer sur les actions déjà mises en œuvre dans les académies, avec les services académiques d’information et d’orientation, les personnes référentes école-entreprise, les chargé.e.s de mission égalité, etc. ;
– développer une communication positive et partagée dans le cadre d’une campagne de communication lancée en juillet 2014, avec un logo utilisable par l’ensemble des partenaires ;
Un comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises afin d’assurer le suivi des actions mises en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de cette plateforme d’actions pour la mixité des métiers, et qui comprennent en particulier, outre celles relatives à l’orientation et à la formation initiale évoquées plus haut :
– la mise en place de plans sectoriels métiers : en octobre 2015, cinq plans sectoriels (transport, petite enfance, autonomie, bâtiment et services à la personne) avaient ainsi été signés depuis 2014 ; ces plans, élaborés avec les acteurs du secteur (OPCA, fédérations professionnelles) fixent des objectifs de mixité à cinq ans et prévoient des actions pour les atteindre, notamment la valorisation de tous les métiers auprès des jeunes filles et garçons lors du processus d’orientation et auprès du grand public pour favoriser une réelle liberté de choix ; les plans métiers engagent aussi les entreprises à mieux accueillir les femmes et les hommes et à se doter de plans pour l’égalité professionnelle ;
– les conventions conclues par l’État avec 27 grandes entreprises (cf. supra), dont l’un des trois objectifs principaux porte sur la mixité professionnelle ; ces entreprises travaillent notamment au développement de la mixité dans les filières scolaires du primaire au supérieur, dans toutes les filières, et donc dans les métiers, et mettent en place des actions telles que le mentorat ou le tutoring ;
– le deuxième volet des « territoires d'excellence » vise à développer la mixité dans les filières de formation et dans l’emploi (33), avec pour objectifs de favoriser l’accès des femmes à la formation professionnelle et continue, aux postes à responsabilité, de réduire les écarts de rémunération avec les hommes et de favoriser l’articulation des temps de vie. Des expérimentations relatives à la mixité dans la formation professionnelle ont par exemple été mises en œuvre concernant les métiers de l’industrie, du bâtiment et des services techniques en Île–de-France, et dans les métiers du transport et de la logistique en Aquitaine.
D’autres initiatives ont par ailleurs été prises dans ce domaine :
– avec l’appui du SDFE,Pôle emploi a conçu et déployé un module de formation de deux jours à destination des conseiller.e.s sur l’ensemble du territoire, pour renforcer l’égalité professionnelle et accompagner la mixité des emplois : cette formation vise à identifier les enjeux liés à la mixité des métiers, réfléchir aux stéréotypes et infléchir sur les pratiques professionnelles des équipes, des entreprises, des recruteur.e.s et des demandeur.se.s d’emploi ; plusieurs actions territoriales ont aussi été menées (34) ;
– plusieurs contrats pour la mixité des emplois et la mixité professionnelle (COMEEP), ouvrant droit à des aides financières, ont été signés ;
Des aides financières dans le cadre des contrats pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (COMEEP)
Ce contrat, conclu au nom de l’État par le préfet de région, est ouvert aux entreprises sans condition de seuil d’effectif et peut concerner tous les employeurs de droit privé, notamment les associations, sociétés civiles, commerciales, coopératives. Il concerne les salariées en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou en mission d’intérim d’au moins 6 mois. Les actions éligibles doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ou l’établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l’adoption de mesures de sensibilisation, d’embauche, de formation, de promotion ou d’amélioration des conditions de travail. L’État prend en charge une partie du coût de la réalisation des actions éligibles, et au maximum : 50 % pour les coûts d’investissement en matériel liés à la modification de l’organisation et des conditions de travail ou bien les coûts de formation et les coûts des actions de sensibilisation dans l’entreprise ; 30 % des dépenses de rémunération des salariés bénéficiant d’actions de formation pendant la durée de la réalisation du contrat.À titre d’exemple, plusieurs conventions dans le secteur des transports en Île-de-France, plusieurs conventions dans le secteur des transports ont été signées au cours des trois dernières années et ont abouti à de nombreux recrutements dans le cadre des COMEEP : en 2013 dans le transport de voyageurs, 213 recrutements et formations de femmes aux métiers de conductrices de voyageurs ont été opérés ; dans le transport sanitaire, plus de 30 femmes ont été formées au métier d'ambulancière et recrutées ; en 2014, une convention dans le secteur du transport de marchandises a été signée.
Source : rapport précité au CSEP (juin 2015)
– les moyens de la formation professionnelle ont également mobilisés, suite notamment aux dispositions introduites par la loi du 4 août 2014 (cf. supra).
La mobilisation des fonds de la formation professionnelle en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dans le cadre de la Plateforme sur la mixité des métiers, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a construit une journée de sensibilisation sur la mixité à destination des professionnel.le.s, en particulier des chargé.e.s de recrutement et des formateurs.trices. L’objectif est de les sensibiliser et d’outiller les équipes afin de les aider à mieux accompagner les stagiaires femmes, à travailler avec les groupes sur les postures, les stéréotypes liés au sexe, les recours possibles en cas de discrimination. Par ailleurs, l’AFPA a mis en place des outils d’aide à l’orientation et de sécurisation des projets professionnels : « Evolution 21 » est centré sur les compétences transversales et permet aux femmes de repérer leurs compétences et d’envisager des mobilités possibles ; « Copilote sept » met en perspective les besoins d’emplois dans le domaine choisi. Il constitue un élément sécurisant pour les projets. Dans le cadre du programme Européen « devin vert, devin tech, devin mobilité », des portraits pour la mixité ont été réalisés : une opératrice régleuse en outillage ; un homme, assistant de vie ; une plaquiste ; des menuisières... Les entretiens filmés portent sur la perception par l’équipe de formation et les autres stagiaires de choix non traditionnels. Ils illustrent également la façon dont les métiers liés aux nouvelles technologies sont porteurs de diversité et favorisent l’accès des femmes aux métiers traditionnellement masculins. Enfin, l’AFPA propose une information régulière sur les évolutions de la loi sur la formation professionnelle, les accords et les notions liées à l’égalité professionnelle, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et les congés liés à la parentalité.
Enfin, la ministre Mme Myriam El Khomri a souligné, lors de son audition le 30 mars 2016, que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi « a apporté des progrès majeurs, en renforçant la parité dans les institutions représentatives du personnel (IRP) », et « dans les conseils de prud’hommes, et en mettant l’égalité professionnelle au cœur du dialogue social en entreprise ».
*
* *
Vos rapporteures saluent l’ensemble des actions volontaristes et transversales ainsi mises en œuvre pour faire progresser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, et qui doivent se prolonger dans le cadre de la réforme importante du droit du travail prévue par le présent projet de loi.
SECONDE PARTIE :
UNE RÉFORME QUI DOIT ÊTRE L’OCCASION DE FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ RÉELLE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Le projet de loi (n° 3600) visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, adopté en Conseil des ministres le 24 mars 2016, est organisé autour de sept titres :
– le titre Ierrelatif à la refondation du code du travail, fait des principes dégagés par le comité présidé par M. Robert Badinter (cf. infra) la base des travaux de la commission de refondation qui devra proposer la rédaction de la nouvelle partie législative du code du travail, selon une architecture donnant plus de place à la négociation collective ; il procède également à cette réécriture pour la partie du code relative au temps de travail et aux congés ; il convient à cet égard de rappeler les travaux menés par la Délégation aux droits des femmes sur la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013, ainsi que sur la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;
– le titre II contient les dispositions relatives à la négociation collective : il réforme les règles de révision et de dénonciation des accords, instaure le principe d’accords majoritaires, réforme les règles de la représentativité patronale et permet d’engager un mouvement indispensable de restructuration des branches professionnelles, en donnant au ministre chargé du travail des pouvoirs accrus en la matière ; il conforte par ailleurs les acteurs et les actrices du dialogue social, notamment en ce qui concerne les moyens et la formation des syndicats ;
– le titre III a pour objectifs, d’une part, la sécurisation des parcours professionnels, avec la création du compte personnel d’activité (CPA) pour l’ensemble des actives et des actifs, quel que soit leur statut, et, d’autre part, l’adaptation du droit du travail à l’ère du numérique, avec en particulier la reconnaissance d’un « droit à la déconnexion » et la réforme du cadre du télétravail – sujets sur lesquels la Délégation aux droits des femmes a travaillé récemment, dans le cadre du projet de loi pour une République numérique (35) et du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (36), et antérieurement, de la réforme de la formation professionnelle (37) ;
– le titre IV réunit plusieurs dispositions dont l’objectif est de favoriser l’emploi, notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME) : il comporte en particulier un article relatif à la définition du motif économique du licenciement et prévoit la création d’un service d’appui aux entreprises de moins de 300 salarié.e.s ainsi qu’une réforme visant à faciliter l’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
– le titre V procède à une réforme de la médecine du travail, concernant notamment les conditions de reconnaissance de l’inaptitude ;
– le titre VI comporte de nouvelles dispositions en matière de lutte contre le détachement illégal ;
– le titre VII réunit des dispositions diverses, concernant l’inspection du travail ainsi que les indus et périodes non déclarées pour les allocations chômage.
Compte tenu de l’ampleur de cette réforme du travail, qui comporte 52 articles représentant près de 140 pages (et près de 600 pages en comptant l’exposé des motifs et l’étude d’impact), et des délais resserrés liés au calendrier d’examen de ce texte en commission, les rapporteures ont concentré leurs travaux sur les différentes thématiques sur lesquelles l’attention de la Délégation aux droits des femmes a été appelée dans le cadre de ses auditions. Elle a aussi pu s’appuyer sur l’avis rendu par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) sur l’avant-projet de loi, le 11 mars 2016, qui formule un certain nombre de réserves.
Le présent texte appelle ainsi plusieurs observations, sur des sujets variés, sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes. Vos rapporteures formulent en conséquence une série de recommandations concernant les « principes essentiels du droit du travail » (I) ainsi que les dispositions relatives aux temps de travail et aux congés (II), concernant en particulier les emplois à temps partiels, qui sont à plus de 80 % occupés par des femmes. Il convient par ailleurs d’analyser l’impact sur les femmes et l’égalité professionnelle de la réforme de la négociation collective en entreprise (III), mais également du CPA, en vue de favoriser l’accès des femmes à la formation continue, de l’adaptation du droit du travail au numérique, au regard notamment de ses enjeux en termes d’articulation des temps de vie, ainsi que des dispositions relatives à la médecine du travail (IV).
Enfin, de nouvelles dispositions pourraient être introduites ou réintroduites, à la faveur de cette réforme, pour lutter plus efficacement contre le harcèlement sexuel ou moral, et plus largement les discriminations à raison du sexe ou de la parentalité, d’une part, et consolider l’insertion récente dans le code du travail de dispositions relatives à l’interdiction des agissements sexistes, d’autre part (V).
À titre liminaire, vos rapporteures regrettent que l’étude d’impact du présent projet de loi ne comporte pas davantage de données sexuées et de développements sur l’égalité femmes-hommes, et formulent donc la recommandation suivante.
Recommandation n° 1 : pour assurer l’égalité professionnelle, la Délégation aux droits des femmes demande l’élaboration systématique d’une étude d’impact chiffrée sur les conséquences des projets de loi et la mise en œuvre effective des dispositions prévues en la matière par la circulaire du Premier ministre du 23 août 2012 (38).
I. DES « PRINCIPES ESSENTIELS DU DROIT DE TRAVAIL » DONT LA RÉDACTION DOIT ÊTRE AMÉLIORÉE AU REGARD DE L’OBJECTIF D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
A. LES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI
Par une lettre de mission du 24 novembre 2015, le Premier ministre a confié à un comité présidé par M. Robert Badinter, le soin de dégager « les principes juridiques les plus importants » du droit du travail. La démarche du comité s’est inspirée de celle du Conseil d’État, lorsqu’il énonce un principe général du droit, ou de la Cour de Cassation, lorsqu’elle s’appuie sur un principe fondamental. Le comité a ainsi procédé à une analyse des dispositions actuelles, de la Constitution, du code du travail, de la jurisprudence et des textes internationaux, pour dégager soixante et un grands principes, dans huit grands domaines (39).
L’identification de ces principes constitue la première étape d’une réforme de grande ampleur du code du travail qui sera engagée sur deux ans. Celle-ci vise à donner une part plus grande à la négociation collective, en réécrivant les dispositions du code en trois niveaux : les dispositions législatives impératives auxquelles il n’est pas possible de déroger (ordre public), les dispositions ouvertes à la négociation et les dispositions qui s’appliquent en l’absence d’accord (dispositions supplétives).
Ces grands principes, dégagés « à droit constant », guideront ce travail de refondation du code du travail, qui sera mené par une commission d’expert.e.s et de praticien.ne.s des relations sociales. Celle-ci proposera au Gouvernement une réécriture intégrale du code du travail dans un délai de deux ans. L’article 1er du projet de loi prévoit par ailleurs que les partenaires sociaux devront être associés aux travaux de cette commission, c’est-à-dire les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national. L’étude d’impact précise à cet égard qu’ils seront auditionnés et tenus informés de l’avancée des travaux de la commission.
Les « principes essentiels du droit du travail » définis à l’article 1er du projet de loi, qui reprennent à l’identique ceux proposés par le comité Badinter (40), constitueront le socle de l’ordre public du nouveau code du travail et guideront la commission de refondation du code du travail. L’option retenue consiste à faire d’eux des lignes directrices pour le travail de refondation du code du travail, et non plus de les inscrire en préambule du code du travail, comme le prévoyait initialement l’avant-projet de loi.
La définition de principes fondamentaux du droit du travail est ainsi la première pierre d’une réforme de grande ampleur engagée par le Gouvernement, qui vise à donner plus de place à la négociation collective, « en donnant en particulier plus de marges de manœuvre au niveau de l’entreprise », comme le précise l’étude d’impact du projet de loi.
B. LES RECOMMANDATIONS DE LA DÉLÉGATION
Dans son avis sur l’avant-projet de loi, le CSEP, dont la Délégation aux droits des femmes a entendu plusieurs membres (41), a fait part de plusieurs réserves sur certains principes essentiels, auxquelles vos rapporteures souscrivent largement.
Certes, la portée des principes essentiels définis est bien différente de celle prévue par l’avant-projet de loi, puisque désormais ils ne sont plus inscrits dans le code du travail, en préambule, mais ont vocation à irriguer le travail de réécriture du code qui sera mené par la commission précitée. Vos rapporteures n’en estiment pas moins nécessaire de modifier sensiblement leur rédaction, de façon à mieux prendre en compte la dimension du genre mais aussi l’état actuel du droit et des textes européens et internationaux applicables en ce domaine.
● Un principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes insuffisamment garanti et qui fait l’impasse sur les mesures positives
Aux termes du 4° de l’article 1er du projet de loi, « Le principe d’égalité s’applique dans l’entreprise. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être respectée ». Cette rédaction paraît contestable à double titre.
D’une part, le terme « respectée » renvoie à l’idée « d’observer ce qui a valeur de règles », « de ne pas porter atteinte », « de s’abstenir de » : autrement dit, il implique une démarche de conformité à la règle, sans dynamique positive de recherche d’égalité, comme l’a souligné à juste titre l’avis précité du CSEP. Or l’égalité entre les femmes et les hommes constitue l’un des principes fondateurs de l’Union européenne que les États membres doivent « assurer » – terme signifiant « rendre sûr », qui vise à « procurer à quelqu’un quelque chose de sûr, à lui en garantir le bénéfice ». Ce terme devrait donc être privilégié au 4° de l’article 1er.
D’autre part, l’application du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est indissociable des mesures positives qui peuvent l’accompagner, comme le soulignent l’article 157 du TFUE, dont les dispositions sont rappelées ci-dessous (paragraphe 4) et les directives en matière d’égalité femmes-hommes, telles que la directive 2006/54/CE (42).
Le principe d’égalité femmes-hommes en droit européen : les dispositions prévues par l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
« 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. »
Source : article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, ex-article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, TCE)
En droit interne, l’article L. 1142-4 du code du travail (43) prévoit la possibilité de prendre des mesures temporaires au seul bénéfice des femmes. Plus largement, on pourrait aussi évoquer les dispositions visant une représentation équilibrée des hommes et des femmes – et qui, de fait, bénéficient aujourd’hui à ces dernières – au sein des conseils d’administration et, depuis la loi précitée du 17 août 2015, au sein des instances représentatives (IRP) dans l’entreprise (pour les élections professionnelles des membres du comité d’entreprise et des délégué.e.s du personnel, la loi impose désormais le respect d'une composition équilibrée des listes ainsi que l’alternance femme/homme en tête de liste).
Recommandation n° 2 : mieux définir le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
→ En réécrivant le principe défini au 4° de l’article 1er du projet de loi de la façon suivante : « Le principe d’égalité s’applique dans l’entreprise. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être assurée. Ce principe ne fait pas obstacle à l’intervention, de manière temporaire, de mesures positives visant à corriger des inégalités entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, dans les conditions prévues par la loi. »
● Une interdiction des discriminations qui ne prend pas en compte la question de l’accès à l’emploi
Le 5° de l’article 1er du projet de loi pose le principe selon lequel « Les discriminations sont interdites dans toutes relations de travail ».
Ce faisant, il semble restreindre le champ d’application du principe de non-discrimination aux seules relations de travail, dont la définition par l’Organisation internationale du travail (OIT) exclut le recrutement. Il convient à cet égard de rappeler que le principe de non-discrimination s’applique également à l’accès à l’emploi, et donc au recrutement. Or cette précision est particulièrement importante pour l’accès à l’emploi des femmes, dont on sait bien le « soupçon de maternité » qui pèse sur elles, quand ce ne sont pas explicitement des questions qui leur sont posées lors d’un entretien d’embauche sur leurs projets familiaux, et qui ne sont pas seulement déplacées mais illégales. Au surplus, le principe défini au 5° ne mentionne pas précisément la nature et les motifs de discriminations. Aussi vos rapporteures formulent-elles la recommandation suivante.
Recommandation n° 3 : prendre en compte l’accès à l’emploi dans la définition du principe essentiel du droit du travail relatif à l’interdiction des discriminations.
→ En réécrivant ainsi le principe défini au 5° : « Les discriminations sont interdites dans l’accès à l’emploi et dans toutes les relations de travail. »
À cet égard, M. Michel Miné, professeur de droit du travail au CNAM et membre du CSEP, a estimé, lors de son audition par la Délégation sur l’avant-projet de loi, le 8 mars 2016, que la formule, « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être respectée. » devrait figurer avec le cinquième principe, relatif aux discriminations, et non au quatrième.
Selon lui, « La difficulté réside dans la complexité de notre droit du travail, qui comporte deux régimes d’égalité : celui de l’égalité entre tous les salariés (…) et celui constitué par les règles de non-discrimination » – cette distinction emportant des conséquences en matière de réparation et de preuve. « Ainsi, le régime juridique de la non-discrimination est plus fort que celui de l’égalité. L’article 4 devrait plutôt mentionner l’égalité de traitement, qui est applicable à toutes les personnes, sans références particulières à une quelconque caractéristique, et l’article 5, les règles de non-discrimination, dont celle de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce discours n’est pas purement académique, car lorsque des entreprises sont poursuivies pour atteinte à l’égalité professionnelle, elles le sont sur le terrain de la discrimination, mais leurs avocats – qui font bien leur travail – cherchent à amener le magistrat sur le terrain de l’égalité de traitement, bien moins protecteur des salariés que celui de la non-discrimination. Aussi la rédaction de l’avant-projet peut-elle être source de confusion, car l’article 4 vise à la fois la règle de l’égalité de traitement entre tous les salariés et celle de l’égalité professionnelle, c’est-à-dire de non-discrimination entre les femmes et les hommes. »
Faire figurer cette disposition à l’article 5 aurait un autre avantage : cela permettrait d’en prévoir l’application « dans toute relation de travail », et pas uniquement dans les relations salariales. La portée juridique de ces dispositions est toutefois sensiblement différente à présent que ce principe ne figure plus dans le code du travail, contrairement à ce qui était prévu dans l’avant-projet de loi.
● Des interrogations sur la liberté d’expression des convictions religieuses en entreprise
Aux termes du 6° de l’article 1er du projet de loi, « La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».
À cet égard, la CFE-CGC, lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes et dans une contribution écrite adressée dans le prolongement de celle-ci, a évoqué l’apparition dans les entreprises d’agissements différenciés selon le sexe, avec « des attitudes qui consistent à refuser de serrer la main à une femme, parce que c’est une femme, à refuser d’obéir au manager si le manager est une femme, une résurgence de propos et d’attitudes sexistes… ». Plus largement, la CFE-CGC regrette le clivage opéré entre salarié.e.s du public et du privé ainsi que le fait de laisser à l’entreprise le soin de déterminer les « nécessités du bon fonctionnement », qui pourrait entraîner pour les salarié.e.s du privé des inégalités de traitement selon l’entreprise dans laquelle ils/elles travaillent.
Il convient néanmoins de rappeler que les principes définis par le comité Badinter, dont celui-ci, qui est repris à l’identique à l’article 1er du projet de loi, ont été dégagés à droit constant.
Pour le syndicat Force ouvrière (44), outre le fait que l’entreprise doit rester un lieu neutre sur les questions politiques et religieuses, le principe fondamental d’égalité entre les femmes et les hommes ne saurait être remis en cause sous couvert de pratiques religieuses (refus de travailler avec une femme, ou d’avoir une femme comme supérieure hiérarchique…), et vos rapporteures partagent cette analyse.
Lors de l’examen du présent rapport, la Délégation s’est prononcée en faveur de la suppression de cet alinéa.
Recommandation n° 4 : supprimer le 6° de l’article 1er du projet de loi, aux termes duquel « La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».
● Un même « principe essentiel du droit du travail » relatif aux harcèlements moral et sexuel qui soulève aussi des interrogations
Le septième grand principe défini à l’article 1er du projet de loi est défini de la façon suivante : « Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime protégée ». Selon M. Michel Miné, cette rédaction soulève des problèmes analogues à celui posé par les quatrième et cinquième principes relatifs à l’égalité et à la non-discrimination : en effet, le principe relatif au harcèlement sexuel ne devrait pas, selon lui, figurer avec l’interdiction du harcèlement moral, mais avec celui concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En d’autres termes, « il ne paraît pas pertinent de placer au sein du même article le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Une fois encore, deux régimes juridiques distincts se côtoient : le harcèlement moral est un régime juridique particulier ne faisant aucune référence à la caractéristique des personnes, alors que le harcèlement discriminatoire (…) comprend le harcèlement sexuel et se trouve être beaucoup plus fort que le harcèlement moral : une nouvelle fois, il y a un risque de confusion ». Il a aussi jugé ce principe « incomplet, car ne visant pas les autres formes de harcèlement susceptibles d’être liées à la race, l’ethnie, l’âge ou la couleur de la peau, etc., pourtant mentionnées dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ».
● Un principe de « conciliation » entre la vie professionnelle et la vie familiale en deçà des exigences des textes européens et internationaux
Le 9 ° de l’article 1er du projet de loi définit le principe essentiel du droit du travail suivant : « La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale est recherchée dans la relation de travail ».
Comme l’a souligné M. Claude Raoul, secrétaire confédéral de la CFTC, auditionné par la Délégation le 23 mars 2016(45), « la façon dont le texte pose ce principe de la conciliation, qui " est recherchée dans la relation de travail" est en deçà de ce qui est prévu dans les textes européens et internationaux. La CFTC prône un droit social fondamental à la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle par une obligation d’aménagement raisonnable des rythmes et des horaires de travail, notamment en cas de problèmes familiaux. Ce droit est prévu dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE et la Convention OIT n°156. Il ne suffit pas de rappeler ce principe fondamental ; il faut au contraire en préciser le contenu pour qu’en pratique, cela devienne réellement un droit pour chaque salarié.e. De plus, derrière cette question de la conciliation, on trouve les enjeux sociétaux les plus importants du moment : le bien-être au travail et l’équilibre psychologique de tous, l’éducation des enfants, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. »
Pour FO (46), au mieux, l’article ne fait que rappeler une évidence, puisque le droit à une vie privée et familiale est garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), et au pire, il risque de légitimer une action a minima, créant une obligation de moyen sans plancher. Ainsi, l’employeur qui aura proposé de souscrire à une charte ou un télétravail qui aura été refusé par le/la salarié.e, voire un forfait jour, pourrait être considéré comme ayant recherché une articulation : le risque serait alors, selon ce syndicat, que la vie familiale continue d’être restreinte de manière disproportionnée par un raisonnement qui privilégie l’activité professionnelle en raison des nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.
En tout état de cause, le mot de « conciliation » est rejeté par nombre de chercheuses et de chercheurs, estimant que cela induit une tension, une incompatibilité entre les deux sphères et donc un aménagement de l’une, la sphère privée au bénéfice de l’autre, la sphère publique. Comme le disait Simone de Beauvoir, « je déteste ce mot, j’ai horreur de la conciliation, je ne veux pas concilier (47) ». Le mot « articulation » ou d’« équilibre » des temps de vie doivent donc être privilégiés, et ce sont de fait ces termes qui sont plutôt aujourd’hui utilisés en sciences humaines ou par les associations féministes en particulier.
Recommandation n° 5 : poser un principe plus ambitieux en matière d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, également plus conforme aux textes européens et internationaux.
→ En réécrivant le principe défini au 9 de l’article 1er du projet de loi, par exemple de la façon suivante : « L’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale est prise en compte dans la relation et l’organisation du travail ».
● Une présentation négative de la grossesse et de la maternité
Le 17° de l’article 1er du projet de loi pose le principe suivant : « La grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des mesures spécifiques autres que celles requises par l’état de la femme. La salariée a droit à un congé pendant la période précédant et suivant son accouchement ». La rédaction, très perfectible, de ce principe appelle plusieurs observations :
– d’une part, la première phrase semble sous-entendre que pendant la grossesse et la maternité, les femmes enceintes bénéficieraient ou souhaiteraient bénéficier d’avantages indus, sans lien avec leur grossesse ;
– en outre, rédigée dans une forme négative, elle ne correspond pas à la philosophie de la directive européenne de 1992 (48) concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, qui implique au contraire une démarche positive ;
– par ailleurs, la deuxième phrase ne nomme pas le congé « maternité » ;
– celle-ci fait aussi l’impasse sur le principe fondamental posé par l’article L. 1225-4 du code du travail, issu de la directive 92/85/CE précitée, concernant l’interdiction de licenciement de la femme enceinte ou accouchée, sauf exception prévue par la loi, pendant la période de protection légale qui correspond à la grossesse, au congé maternité et aux quatre semaines qui suivent le congé maternité – période qu’une proposition de loi adoptée récemment par l’Assemblée nationale (49), en première lecture, le 10 mars 2016, prévoit de porter à dix semaines ;
– de plus, la référence à « l’état de la femme » pose problème, comme l’a souligné à juste titre Force ouvrière et l’avis du CSEP précité. En effet, la directive 2006/54 prévoit que le principe d’égalité ne fait pas obstacle « aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité (50)». La possibilité de déroger à l’égalité de traitement en faveur des femmes a toutefois été limitée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) à la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse, d’une part, et à la protection des rapports particuliers entre la mère et son enfant au cours de la période qui suit l’accouchement, d’autre part (51).
Or, dans cet alinéa du projet de loi, seul l’état de la femme est mentionné, mais ce que recouvre précisément ce terme reste très incertain : est-ce l’état de grossesse, de maternité, l’état biologique ou encore l’état de santé de la femme ? Est-ce l’état de la femme en général ou l’état de la femme comprise spécifiquement ? Cela justifierait-il des mesures différentes selon les femmes ? En outre, cet alinéa ne fait pas référence à l’état de l’enfant.
En définitive, alors que toutes les études menées ces dernières années, montrent que la maternité est l’un des facteurs majeurs à l’origine des inégalités professionnelles subies par les femmes, et alors que les discriminations liées à la grossesse sont à l’origine d’un nombre très élevé de réclamations auprès du Défenseur des droits, la rédaction proposée par le présent texte semble clairement minimiser les discriminations subies par les femmes dans le monde du travail en raison de leur grossesse et de leur maternité.
Recommandation n° 6 : réécrire le principe concernant la grossesse et la maternité, pour ne pas en présenter une vision négative et pour mieux tenir compte du droit existant.
→ En réécrivant le principe défini au 17° de l’article 1er du projet de loi de la façon suivante : « Pendant la grossesse et la maternité, les salariées bénéficient de mesures spécifiques, notamment en cas de risques pour leur santé et leur sécurité. La salariée a droit à un congé maternité pendant la période précédant et suivant son accouchement. Pendant la grossesse et la maternité, la salariée ne peut être licenciée, sauf exceptions prévues par la loi ».
● Une absence de prise en compte du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Le 31° de l’article 1er du projet de loi pose le principe suivant : « L’employeur assure l’égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ». Cependant, si le principe d’égalité doit s’appliquer dans l’entreprise (4° de l’article 1er) dans toutes les relations de travail, et donc y compris en matière de rémunération, il ne saurait être confondu, selon l’avis du CSEP précité, avec le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévu à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (cf. encadré supra) et à l’article L. 3221-2 du code du travail, aux termes duquel « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
La rédaction proposée, qui propose de remplacer « entre les femmes et les hommes » par « entre salariés », témoigne d’une certaine méconnaissance de la construction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, en particulier des écarts de rémunération, et en tout état de cause ne prend pas suffisamment en compte un principe fondamental de l’Union européenne. En effet, la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes demeure importante, comme vos rapporteures l’ont souligné dans la première partie du présent rapport. De fait, femmes et hommes n’occupent pas les mêmes emplois : 18 métiers, regroupés dans 12 familles professionnelles, recouvrent la moitié de l’emploi des femmes. Elles sont donc concentrées dans peu de métiers et ceux-ci sont le plus souvent moins rémunérés. Le moindre prix accordé aux métiers exercés par les femmes s’explique notamment par les biais sexistes, eux-mêmes fondés sur des systèmes de représentation stéréotypés, qui imprègnent les systèmes d’évaluation et classification des emplois.
Parvenir à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nécessite donc de s’assurer qu’à travail identique, femmes et hommes perçoivent la même rémunération, mais surtout, puisqu’en majorité ils n’occupent pas les mêmes emplois, de s’assurer qu’à travail différent mais de valeur égale, femmes et hommes perçoivent la même rémunération. L’intérêt du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour « un travail de valeur égale » est précisément qu’il permet de comparer des emplois a priori non comparables, au sein d’une même entreprise ou d’une même convention collective.
Au cours de son audition par la Délégation, Mme Rachel Silvera, économiste, sous-directrice du groupe de recherche « Marché du travail et genre » (MAGE) et membre du CSEP (52), a ainsi souligné qu’ « au nom du principe " à travail de valeur égal, salaire égal ", les classifications professionnelles peuvent constituer un outil de revalorisation des emplois à prédominance féminine. À l’instar de pays ou de territoires comme le Québec, l’égalité doit être favorisée dans les classifications professionnelles, qui ne sont pas à considérer comme neutres : selon les méthodes et critères utilisés, la " pesée " des emplois peut différer selon qu’il s’agit d’emplois à prédominance masculine ou féminine. »
Ce point a aussi été souligné par le Défenseur des droits, qui a été auditionné par la Délégation en juin 2015, en rappelant la publication d’un guide pour l’évaluation non-discriminante des emplois à prédominance féminine, et vos rapporteures saluent cette initiative et la qualité des travaux ainsi menés.
Notion de « salaire égal pour un travail de valeur égale »
et évaluation non-discriminante des emplois à prédominance féminine » : la position et les actions du Défenseur des droits
« Plus de 50 ans après son introduction dans le droit français, le principe bien connu " un salaire égal pour un travail égal " est loin d’être une réalité : encore cette année, l’écart de rémunération moyen selon le sexe plafonne à 24 % dans le secteur privé. S’il constitue le fondement de l’égalité de rémunération au travail, ce principe rencontre une difficulté majeure d’application entre les hommes et les femmes qui n’occupent pas les mêmes emplois. Les classifications professionnelles prennent en effet peu en compte dans l’évaluation des emplois les compétences jugées " naturellement " féminines ou la pénibilité des emplois féminins. Ces biais sexistes se retrouvent également dans les régulières actons de pesée de l’emploi : rédaction des offres d’emploi et de fiches de postes, élaboration des grilles d’entretien pour les embauches, contenu de l’entretien annuel d’évaluation, décisions de promotion…
Le Défenseur des droits a publié en 2013 un guide par lequel il souhaite favoriser l’effectivité du principe salaire égal pour un travail de valeur " comparable " qui tient compte de la situation de ségrégation professionnelle des femmes. Ce guide et sa méthodologie ont fait l’objet d’une large diffusion accompagnée au cours de l’année 2014 de nombreuses interventions. »
Source : Défenseur des droits (extrait du dernier rapport d’activité publié en 2015)
Vos rapporteures soulignent l’importance de diffuser ce guide plus largement et proposent de réécrire le trente et unième principe essentiel du droit du travail de la façon suivante.
Recommandation n° 7 : réécrire le principe relatif au principe d’égalité de rémunération pour viser explicitement les inégalités entre les femmes et les hommes.
→ En réécrivant le principe défini au 31° de l’article 1er du projet de loi de la façon suivante : « L’employeur assure l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale entre les femmes et les hommes » (et non plus « entre les salariés »).
● Une exigence de parité non prévue par le projet de loi concernant la commission de refondation du code du travail
La préparation de ce projet de loi s’est appuyée sur les travaux de la mission sur les accords collectifs confiée à M. Jean-Denis Combrexelle (53), président de la section sociale du Conseil d’État et ancien directeur général du travail, et à M. Robert Badinter, sur les principes essentiels du droit du travail (54), et qui ont donné lieu à la remise de deux rapports au Premier ministre en septembre 2015 et janvier 2016.
Vos rapporteures observent toutefois qu’au sein de ces deux commissions (composés de professeur.e.s, acteurs économiques, etc.), les femmes n’étaient que peu représentées, avec :
– seules quatre femmes sur seize membres pour la mission Combrexelle (55) ;
– s’agissant de la mission Badinter, ce « comité des sages composé de figures les plus reconnues en matière de droit social », selon le ministère du travail (56), si l’on excepte les deux femmes rapporteures du groupe de travail, on comptait seulement une femme sur les six autres membres (57). On peut aussi relever qu’en l’occurrence, il s’agissait d’une professeure de droit à l’université Paris II – Assas qui était déjà membre de la commission Combrexelle (c’était aussi le cas d’un autre membre de la mission). Or sur ces questions, il n’est pas sans intérêt de veiller à diversifier les profils et les âges et de croiser les analyses.
On aurait pu imaginer aussi qu’un.e membre du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), notamment au sein des personnalités qualifiées, participe à ces travaux, ce qui n’a pas été le cas.
Il existe pourtant, bien évidemment, de nombreuses femmes expertes des questions sociales en France, ce que la simple consultation de la composition de l’IGAS, de la section sociale du Conseil d’État, du CSEP, du HCEfh, de la liste des personnes auditionnées par la Délégation aux droits des femmes depuis 2012 ou bien encore du site internet « Les expertes », précisément créé à cette fin, suffiraient à démontrer, si tant est que certain.e.s puissent encore en douter…
Il convient également de rappeler l’esprit de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dont l’article 74 prévoyait que « Lorsqu’une personne est appelée, en application d’une loi ou d’un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres (…) dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un ».
Cette représentation déséquilibrée des femmes et des hommes au sein des deux missions précitées pourrait contribuer à expliquer la prise en compte insuffisante de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernant les principes essentiels du droit du travail, voire plus largement différentes dispositions prévues par ce texte. L’une des personnes auditionnées lors de l’audition des syndicats a ainsi estimé que le texte « oublie complètement la dimension de l’égalité femmes-hommes (58) ». Au surplus, il est à noter que l’étude d’impact, s’agissant de l’article 1er du projet de loi relatif aux principes essentiels du droit du travail, ne comporte aucun développement sur l’égalité femmes-hommes. C’est pourquoi vos rapporteures formulent la recommandation suivante.
Recommandation n° 8 : prévoir la composition paritaire de la commission de refondation qui sera chargée de proposer une réécriture de la partie législative du code du travail, ainsi que l’association du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) aux travaux de la commission de refondation.
→ En complétant le premier alinéa de l’article 1er par la phrase suivante : « Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes ».
Enfin, vos rapporteures notent avec intérêt selon que selon le principe essentiel défini au 37° de l’article 1er du projet de loi, « les salariés à temps partiel », qui sont des femmes dans plus de 80 % des cas, « bénéficient des mêmes droits dans l’entreprise que les autres salariés ». Pourtant, le projet de loi laisse inchangées plusieurs dispositions du code du travail, qui conduisent de fait à restreindre l’accès des salarié.e.s à temps partiel à la formation notamment (cf. infra). Plus largement, cela conduit à examiner l’impact sur l’égalité femmes-hommes des dispositions du présent projet de loi relatives au temps de travail.
A. LE TRAVAIL DES FEMMES À TEMPS PARTIEL
À l’heure actuelle, lorsque l’on parle de travail à temps partiel, bien souvent on pense « femmes » ; en effet, ce sont les femmes qui occupent majoritairement ce type d’emploi. Dans les pages qui suivent, nous allons expliciter ce point ; puis, nous verrons en quoi le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs modifie – pas nécessairement dans un sens plus favorable – le régime du travail à temps partiel.
On peut distinguer trois grandes caractéristiques pour le travail féminin à temps partiel : c’est un mode de travail qui prend son essor dans les années 80 ; il correspond rarement un choix librement exercé ; enfin, il se caractérise souvent par des horaires atypiques et par des salaires peu élevés.
a. L’essor du travail féminin à temps partiel remonte aux années 80
En France, le travail à temps partiel n’a pas toujours constitué une composante essentielle de l'activité féminine. C’est à temps plein que les femmes ont investi massivement le marché du travail à partir du début des années 1960 et ce travail à temps plein a constitué l’une des principales caractéristiques de la croissance du travail féminin « à la française » lors des Trente Glorieuses.
CROISSANCE DE LA POPULATION ACTIVE FÉMININE ET DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL
À TEMPS PARTIEL FÉMININ DE 1980 À 2010
Croissance de la population active féminine |
Développement du travail à temps partiel féminin | |||
Effectifs (en milliers) |
Taux d’activité (en %) |
Effectifs (en milliers) |
Part dans l’emploi (en %) | |
1980 |
9 189 |
41,7 |
1 487 |
17,2 |
1985 |
10 081 |
44,0 |
1 938 |
21,8 |
1990 |
11 042 |
46,3 |
2 220 |
23,6 |
1995 |
11 793 |
47,9 |
2 833 |
28,9 |
1997 |
11 979 |
48,1 |
3 052 |
30,9 |
2005 |
12 896 |
64,6 |
3 554 |
30,7 |
2006 |
13 025 |
64,7 |
3 592 |
30,3 |
2007 |
13 158 |
65,0 |
3 651 |
30,8 |
2008 |
13 297 |
65,3 |
3 658 |
30,1 |
2009 |
13 465 |
65,9 |
3 598 |
29,6 |
2010 |
13 603 |
66,2 |
3 725 |
30,6 |
Source : Margaret Maruani, Directrice de recherche au CNRS
L’essor du travail féminin à temps partiel remonte très précisément au début des années 1980. À cette date, l’effectif des femmes travaillant à temps partiel atteignait près de 1,5 million de personnes. Il est passé à 3,7 millions de personnes aujourd'hui.
● Depuis 1980, la législation a accompagné, voire favorisé le développement du travail à temps partiel.
Les lois du 23 décembre 1980 pour le secteur public et du 28 janvier 1981 pour le secteur privé se sont attachées à donner un statut aux salariés à temps partiel et ont constitué les premières incitations au développement de cette forme d’emploi. Par la suite, l'ordonnance du 26 mars 1982 et le décret du 20 juillet 1982 ont suivi la même ligne incitative. Il en est allé de même pour de nombreux autres textes intervenus ultérieurement, mais qui n’ont pas infirmé les grands principes posés pour cette modalité d’emploi au cours de la période 1980-1981.
Il convient néanmoins de signaler qu’en 2013 et en 2014 une amodiation significative a été prévue pour le régime du travail à temps partiel. Le but poursuivi a été de faire en sorte que le travail à temps partiel corresponde à une durée minimale, afin que, par ce biais, un revenu minimum soit également garanti en faveur du salarié. Un plancher de 24 heures hebdomadaires a donc été introduit dans la réglementation, et la Délégation aux droits des femmes s’est mobilisée pour soutenir ces dispositions. Les deux textes de référence pour cette durée minimale du travail à temps partiel sont la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
La loi du 14 juin 2013 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2014, la durée du travail à temps partiel sera d’au moins 24 heures par semaine – ou son équivalent sur le mois – sauf cas dérogatoires énumérés limitativement, ou convention, ou accord de branche étendu autorisant une durée du travail inférieure dans la branche. La délégation s’était mobilisée sur cet objectif. Les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014 et prévoyant une durée du travail de moins de 24 heures hebdomadaires se poursuivront jusqu’au 1er janvier 2016, mais les salariés pourront, dans cet intervalle de temps, demander que la durée minimale du temps de travail leur soit appliquée. Les employeurs ne pourront s’y opposer, sauf contraintes particulières liées à l’activité économique de leurs entreprises. La loi du 20 décembre 2014, puis l’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015, assouplissent ce dispositif. Les deux textes créent de nouvelles dérogations au seuil minimal des 24 heures hebdomadaires, seuil qui ne devient obligatoire que pour les contrats à temps partiel conclus depuis le 1er juillet 2014, ainsi que pour les contrats conclus entre le 1er et le 21 janvier 2014. Ils suppriment, pour les autres contrats, l’échéance de mise en conformité au 1er janvier 2016 et ils remplacent le droit au bénéfice de la durée minimale par une priorité d’accès à un emploi d’au moins 24 heures à la demande du salarié.
Au total, à la différence d'autres formes de contrat de travail correspondant à des emplois atypiques – tel que le contrat d’intérim –, le contrat de travail à temps partiel, depuis qu’il s’est développé au début des années 80, a toujours été conforté par le législateur. Ce dernier, cependant, s’est efforcé, à une période récente, de garantir un revenu minimum au travailleur à temps partiel.
● Le travail à temps partiel n’a pas la même signification pour les hommes et pour les femmes.
L'enquête « Emploi » de 2010 dénombre près de 4,6 millions de personnes travaillant à temps partiel, dont 3,7 millions de femmes et 870 000 hommes. Ainsi, 31 % des femmes et 6 % des hommes ayant un emploi sont à temps partiel. Ces chiffres évoluent très peu en 2014. À cette date, ce sont 30,8 % des femmes et 7,8 % des hommes qui travaillent à temps partiel.
TEMPS PARTIEL SELON LE SEXE ET LA DURÉE DU TEMPS PARTIEL EN 2014 (EN %)
2014 | ||||
Femmes |
Hommes |
Ensemble |
Part des femmes | |
Temps complet |
69,2 |
92,2 |
81,1 |
41,1 |
Temps partiel (1) |
30,8 |
7,8 |
18,9 |
78,6 |
Moins de 15 heures |
4,7 |
1,4 |
3,0 |
75,1 |
De 15 à 29 heures |
16,0 |
4,2 |
9,8 |
78,1 |
30 heures ou plus |
9,3 |
1,6 |
5,3 |
84,4 |
Non renseigné |
0,9 |
0,6 |
0,8 |
58,2 |
Ensemble |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
48,2 |
Effectifs (en milliers) |
12 424 |
13 378 |
25 802 |
/// |
/// : Résultat non significatif.
(1) : Y compris les personnes n’ayant pas déclaré d’horaires habituels.
Lecture : en moyenne en 2014, 16,0 % des femmes ayant un emploi travaillent à temps partiel entre 15 et 29 heures par semaine. 78,1 % des personnes travaillant à temps partiel entre 15 et 29 heures par semaine sont des femmes.
Champs : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge courant).
Source : Insee, enquête Emploi.
En ce qui concerne les hommes, le travail à temps partiel est pratiqué par les moins de 25 ans et les plus de 60 ans. Il concerne donc un certain nombre d’étudiants, de stagiaires, de jeunes en début d'insertion professionnelle et de préretraités. S’agissant des femmes, le travail à temps partiel est pratiqué à tout âge ; cependant, il est exercé de façon plus accentuée chez les moins de 25 ans et les plus de 60 ans.
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL* SELON L’ÂGE, FRANCE, 2010 (EN %)
Hommes |
Femmes | |
15-24 ans |
13,0 |
35,3 |
25-49 ans |
4,7 |
29,6 |
50-64 ans |
7,8 |
31,0 |
65 et plus |
49,0 |
58,9 |
Total |
6,5 |
30,6 |
*Au sens du BIT
Source : Eurostat, Enquête sur les forces de travail, extraction 2010, données trimestrielles (premier trimestre).
À la lecture de ces tableaux, on voit qu’au-delà des différences quantitatives, le temps partiel n'a pas le même sens pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, le travail à temps partiel constitue une solution transitoire, soit en attendant de disposer d’un poste exercé à temps plein (pour les plus jeunes), soit en attendant de sortir définitivement du marché du travail (pour les plus âgés). Indépendamment de ces deux cas de figure, le recours au travail à temps partiel reste résiduel. Pour les femmes, on observe que ce type de travail peut être une donnée constante qui s’imposera à elles tout au long de leur vie. En tout cas, ce n'est pas dans les classes d'âge où les femmes pourraient se trouver en situation d’avoir des enfants que le travail à temps partiel est utilisé de la manière la plus fréquente. Par suite, ainsi que le note Mme Margaret Maruani (59), on ne peut qu’être frappé par le fait que ces données viennent contredire l'image d'un travail à temps partiel « massivement choisi par les mères de famille ».
LES RAISONS DU TEMPS PARTIEL DÉCLARÉES PAR LES SALARIÉ.E.S (EN %)
Raison du temps partiel |
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
Pour exercer une autre activité professionnelle, ou suivre des études ou une formation |
23,8 |
8,3 |
10,8 |
Pour raison de santé |
8,1 |
4,5 |
5,0 |
N’a pas trouvé d’emploi à temps plein |
37,0 |
30,7 |
31,7 |
Pour s’occuper des enfants ou d’un autre membre de la famille |
6,8 |
35,4 |
30,9 |
Pour disposer de temps libre ou faire des travaux domestiques |
11,2 |
15,4 |
14,7 |
Pour une autre raison |
13,1 |
5,7 |
6,9 |
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Champ : ensemble des salarié.e.s à temps partiel.
Source : DARES - Premières Synthèses, n°39-3, septembre 2007.
Par ailleurs, une autre caractéristique du travail féminin à temps partiel est constituée par l'adéquation très forte qui existe entre temps partiel et concentration des emplois. La pratique du temps partiel est, non seulement, une pratique qui relève plutôt des femmes, mais, en outre, une pratique concentrée dans certains groupes socioprofessionnels. Plus de la moitié des femmes travaillant à temps partiel sont employées. Parmi les ouvrières qui pratiquent le travail à temps partiel, une sur deux réalise des travaux de ménage pour une entreprise de nettoyage. Enfin, dans le secteur privé, la plupart des employées travaillant à temps partiel, lorsqu'elles ne font pas du nettoyage, sont vendeuses ou caissières. En fait, le travail à temps partiel s'est développé là où il y a beaucoup de femmes, dans des secteurs où les femmes sont particulièrement employées.
b. Pour les salariées la pratique du temps partiel est rarement un choix
Compte tenu de l’importance du développement, ces trente dernières années, du travail à temps partiel, et spécialement du travail à temps partiel effectué par les femmes, l’une des interrogations majeures qui se pose aux décideurs politiques est, bien évidemment, celle de la cause d’un essor aussi significatif. Qu'est-ce qui a fait s'envoler les chiffres du travail à temps partiel ? Comment est-on passé de 1,5 à 4,6 millions d’emplois de ce type (dont 3,7 millions d’emplois féminins) ? Est-ce la « demande » des salarié.e.s ou celle des employeur.e.s qui a produit ce mouvement ?
● Influence sur le sous-emploi
Le sous-emploi – au sens où le BIT l’entend et où l'INSEE en effectue la mesure – comprend les personnes qui travaillent involontairement moins que la durée normale du travail dans leur activité et qui étaient à la recherche d’un travail supplémentaire ou disponibles pour un tel travail (60).
LA PROGRESSION DU SOUS-EMPLOI, FRANCE, 1990-2010 (EFFECTIFS EN MILLIERS)
Hommes |
Femmes |
Ensemble | |
1990 |
263 |
638 |
901 |
1995 |
435 |
984 |
1 419 |
2000 |
377 |
1 040 |
1 417 |
2001 |
354 |
984 |
1 339 |
2002 |
316 |
924 |
1 240 |
2003 |
298 |
910 |
1 208 |
2004 |
311 |
971 |
1 282 |
2005 |
329 |
978 |
1 307 |
2006 |
322 |
1 004 |
1 327 |
2007 |
332 |
1 083 |
1 416 |
2008* |
300 |
947 |
1 247 |
2009 |
400 |
980 |
1 380 |
2010 |
480 |
1 080 |
1 560 |
* À partir de 2008, la formulation de la question sur le souhait de travailler plus d’heures – question qui est utilisée pour le calcul du sous-emploi – ainsi que la définition du sous-emploi ont été modifiées pour se rapprocher du concept BIT. D’une part, le souhait d’effectuer un plus grand nombre d’heures est désormais exprimé, comme pour la mesure du chômage BIT, pour une semaine donnée et non plus à un horizon déterminé. Cette modification rend impossible les comparaisons avec les niveaux précédents. D’autre part, ne sont plus comptées dans le sous-emploi les personnes à temps partiel souhaitant travailler plus d’heures recherchant un emploi mais n’étant pas disponibles.
Sources : INSEE, enquêtes « Emploi » de 1990 à 2008 (données corrigées de la rupture de série en 2002), et INSEE enquête « Emploi » (données CVS en moyenne trimestrielle (premier trimestre 2009 et 2010)
En 2011, la France comptait 1,3 million de personnes en situation de sous-emploi, dont plus de 900 000 femmes et 400 000 hommes. Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, le sous-emploi baisse significativement par rapport à 2010. Cependant, même avec cette baisse, les femmes représentent 73,4 % des personnes en sous-emploi. Les femmes sont donc touchées massivement par ce phénomène.
● Les demandeuses d’emploi sont soumises à la pression du chômage
Une étude effectuée par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) permet d'apporter un début de réponse. À partir de l'enquête « Emploi du temps » de l'INSEE, réalisée en 1998 et publiée en 2002, Mme Jennifer Bué, chargée de recherches à la DARES, a tenté de distinguer les emplois à temps partiel créés par les employeurs et ceux demandés par les salarié.e.s. Même si la question demeure libellée autour de l'opposition choix/imposition, les résultats donnent un aperçu relativement précis des circonstances qui sont à l'origine des créations de postes à temps partiel.
Pour la majorité des salarié.e.s, le temps partiel est décidé par l'employeur, à l'embauche. Comme on l’a déjà vu plus haut en examinant d’autres statistiques, le temps partiel « choisi » pour s'occuper des enfants reste minoritaire, y compris chez les femmes. Dans la majeure partie des cas, la décision d’accepter un contrat à temps partiel est donc une décision relativement contrainte. Il y a une forte pression du chômage qui s’exerce sur le demandeur ou la demandeuse d’emploi et c’est cette pression qui l’incite à accepter la proposition qui lui est faite par l’employeur.
CATÉGORIES DE TEMPS PARTIEL* (EN %)
Temps partiel |
Hommes |
Femmes |
Ensemble (sur une base 100) |
– d'embauche |
70 |
49 |
52 |
– choisi pour les enfants |
6 |
34 |
30 |
– choisi pour d'autres raisons |
24 |
17 |
18 |
*La question se décompose en quatre interrogations distinctes : « Votre temps partiel vous a-t-il été imposé par l'employeur à l'embauche ? Vous a-t-il été imposé par votre employeur alors que vous étiez à temps complet ? L’avez-vous choisi vous-même pour vous occuper de vos enfants ? L'avez-vous choisi vous-même pour d'autres raisons ? »
Source : DARES, enquête « Emploi du temps » de l'INSEE, 1998, Premières Informations et premières synthèses, n° 08-2, février 2002.
● Les demandeuses d’emploi sont également confrontées à la politique de gestion des entreprises dans certains secteurs de l’économie
Compte tenu de ce qui précède, force est de reconnaître que, dans un certain nombre de secteurs de l’économie, ce sont les entreprises elles-mêmes qui créent la demande de travail à temps partiel. Cette demande se concentre massivement dans le commerce, l'hôtellerie, la restauration, les services aux particuliers et aux entreprises. Dans ces secteurs, si le travail à temps partiel occupe une place aussi importante, c'est parce que le recrutement se fait d'emblée à temps partiel. Pour nombre d'emplois peu ou pas qualifiés, l’employeur embauche presque toujours à temps partiel pour ensuite, éventuellement, transformer le contrat de travail en un temps plein. Cela ne signifie pas que tous les salarié.e.s sont embauchés à temps partiel, mais que tous les emplois à temps partiel résultent d’une embauche.
Dans ce système, les demandeurs ou les demandeuses d’emploi doivent nécessairement s’adapter au mode de gestion des entreprises. Le passage du temps partiel au temps plein se fait toujours dans le même sens : les responsables du personnel gèrent des « listes d'attente » de salariés à temps partiel qui souhaitent un poste à temps plein, et non l'inverse.
c. Le travail à temps partiel se caractérise par des horaires souvent atypiques et par des salaires peu élevés
Quelles contraintes les femmes rencontrent-elles dans la gestion de leur temps quotidien et dans celle de leurs horaires de travail lorsqu’elles sont employées à temps partiel ? Quelles rémunérations peuvent-elles espérer ?
L’image du travail à temps partiel choisi est généralement associée à celle d’une certaine souplesse dans le temps d’activité. En revanche, lorsque le travail à temps partiel est le produit d'une décision de l'employeur, la gestion du temps quotidien et des horaires de travail échappe bien souvent aux salariés. En outre, le travail à temps partiel se conjugue très fréquemment avec des horaires atypiques. Ainsi en est-il des vendeuses ou des caissières qui ne travaillent que quatre ou cinq heures par jour – mais en effectuant des horaires alternés, une ou deux heures le matin et deux ou trois heures en fin de journée ; ou qui travaillent principalement la nuit ; ou qui travaillent le week-end. Ainsi en est-il des femmes de ménage qui font les bureaux de 6 à 9 heures le matin ; ou qui les font de 6 à 9 heures le soir. Par ailleurs, les responsables du personnel combinent souvent, dans leur mode de gestion de la main d’œuvre, des contrats de travail à temps partiel comportant une amplitude horaire courte et l’attribution de nombreuses heures supplémentaires.
Plus les femmes ont des temps de travail restreints au départ, plus elles sont enclines à accepter des heures supplémentaires attribuées souvent au jour le jour, en fonction de besoins connus au dernier moment. On débouche ainsi sur des horaires de travail très extensibles, décalés, qui requièrent une grande disponibilité. Les conséquences vont au-delà du temps de travail lui-même. Bien loin de permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, cette forme de temps partiel aboutit, dans de nombreux cas, à une remise en cause de la vie privée. Elle entraîne aussi des coûts supplémentaires non négligeables (notamment en matière de garde d'enfants).
Le travail à temps partiel pèse très fortement sur les salaires. Certes, il paraît évident qu’à un temps de travail partiel ne peut répondre qu’un salaire également partiel. Toutefois, le problème est double :
– les salaires horaires des travailleurs à temps partiel sont plus bas que ceux des travailleurs à temps plein ; les derniers chiffres dont on dispose, pour des salaires nets de tout prélèvement, montrent l’importance de cet écart :
SALAIRE HORAIRE À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL (EN EUROS)
Temps plein |
Temps partiel | |
2012 |
14,58 |
12,32 |
2013 |
14,64 |
12,23 |
Sources : INSEE, DADS, fichier semi-définitif.
– les revenus mensuels du travail à temps partiel sont bien souvent très bas, non seulement parce que le temps de travail est moins élevé que pour un contrat à temps plein, mais aussi parce que ce temps de travail s'effectue généralement sur des emplois peu ou pas qualifiés, et donc mal rémunérés.
En 2011, le salaire mensuel net moyen des salariés à temps partiel est de 996 euros, contre 1 997 euros pour ceux à temps complet (61). Toutefois, la moitié des salariés à temps partiel déclarent percevoir un salaire mensuel net, primes et compléments compris, inférieur à 850 euros. Le salaire mensuel net moyen est encore plus faible pour les salariés à temps partiel « subi ». Leur salaire moyen (746 euros) correspond à un peu plus des deux tiers de celui des autres personnes à temps partiel. Par ailleurs, la moitié d’entre eux gagnent moins de 719 euros, notamment du fait d’une plus faible durée hebdomadaire moyenne (22 heures contre 23,9 heures pour les autres salariés à temps partiel).
La forte progression des bas et très bas salaires (moins de 790 euros en 2011) constatée depuis le début des années 1980, ainsi que leur forte féminisation, sont étroitement liées à la multiplication des emplois à temps partiel.
2. Les mesures du projet de loi concernant le travail à temps partiel
Le projet de loi comporte trois mesures qui sont susceptibles de poser problème aux salariés, et singulièrement aux femmes, comme cela a notamment été évoqué dans l’avis du CSEP sur l’avant-projet de loi (62). Ces trois mesures sont les suivantes :
– tout d’abord, les horaires du contrat de travail pourront être modifiés par l’employeur avec un délai de prévenance qui, dans les cas les plus fréquents, passera de sept jours à trois jours (article L. 3123-24 nouveau) ;
– d’autre part, la durée minimale du contrat de travail, soit 24 heures par semaine, ne s’appliquera qu’en l’absence d’un accord de branche (L. 3123-27) ;
– enfin, les heures complémentaires correspondant à un travail effectué au cours d’une durée comprise entre un dixième et un tiers du temps de travail prévu par le contrat sont en principe rémunérées avec une majoration horaire de 25 % ; cependant, une convention ou un accord de branche peut moduler cette majoration (à la hausse ou à la baisse) ; en cas de diminution, la majoration ne peut être inférieure à 10 % (article L. 3123-21 nouveau).
Par ailleurs, si la première version du projet de loi supprimait l’obligation pour l’employeur – en cas de mise en place d’un emploi à temps partiel dans une entreprise où il n’y a pas de représentation du personnel – d’informer l’inspecteur du travail, cette obligation a été rétablie dans le texte actuel (63).
a. La durée du délai de prévenance
Actuellement, l’article L. 3123-21 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. L’article L. 3123-22 du code du travail indique, par ailleurs, qu’un accord collectif peut ramener ce délai à trois jours ouvrés.
Le présent projet de loi intègre le délai de prévenance au sein d’un article L. 3123-24 nouveau du code du travail. Selon cet article, un accord d’entreprise ou un accord de branche peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. En cas d’accords collectifs, ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et les entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur à trois jours pour les cas d’urgence définis par les accords d’entreprise ou les accords de branche. Le délai de trois jours devient donc le délai de droit commun, sachant que les accords collectifs peuvent évidemment prévoir un délai plus long (jusqu’à sept jours).
Par ailleurs, les accords collectifs peuvent aussi prévoir des contreparties pour les salariés lorsque le délai de prévenance, après négociation des accords, passe de sept jours à trois jours.
Enfin, le projet de loi n’indique pas quel est le délai de prévenance lorsqu’il n’y a pas d’accords d’entreprise ou d’accords de branche. On peut penser qu’en attendant la négociation d’un tel accord, le précédent délai de droit commun persiste (sept jours) à titre d’usage. Toutefois, il est certain que – dans la logique du texte qui veut favoriser la négociation collective – le cas doit devenir résiduel.
Au total, lorsqu’il y aura un accord collectif, les horaires du contrat de travail à temps partiel pourront donc être modifiés trois jours à l’avance par l’employeur, au lieu de sept jours – sauf accord collectif moins favorable – comme c’est le cas aujourd’hui. Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes – surtout si l’on songe que ce sont elles et leurs enfants qui constituent la grande majorité des familles monoparentales.
Recommandation n° 9 : rétablir un délai de prévenance de sept jours pour les modifications dans la répartition de la durée du travail intervenant dans le cadre des contrats à temps partiel, avec possibilité de dérogation limitée à trois jours dans le cadre d’un accord collectif.
b. Les majorations pour heures complémentaires lorsque celles-ci dépassent un dixième de la durée totale du contrat
Le projet de loi ne revient pas sur le dispositif intégré dans le code du travail (article L. 3123-19) par l’article 12 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ; ce dispositif prévoit que la majoration de la rémunération des heures complémentaires correspondant à un temps de travail additionnel compris entre le dixième et le tiers du temps de travail total est égale à 25 % du prix de l’heure de base, sauf si un accord de branche prévoit une majoration différente ; dans ce cas, l’accord collectif ne peut pas prévoir une majoration inférieure à 10 % (article L. 3123-21 nouveau du code du travail).
Toutefois, il est à craindre que la reprise de cette disposition – dans un contexte où, désormais, l’accord collectif se voit reconnaître une primauté incontestable sur les dispositions légales – ait pour conséquence, plus que par le passé, d’entraîner une moindre rémunération des heures complémentaires effectuées entre le dixième et le tiers des heures prévues dans le contrat de travail – rémunération dont la majoration pourrait bien passer alors de 25 à 10 %.
Pour éviter ce phénomène – qui serait particulièrement préjudiciable aux femmes dans la mesure où, comme on l’a vu plus haut, leur rémunération horaire est déjà très souvent inférieure à celle consentie aux hommes – il serait donc souhaitable que les accords de branche ne puissent pas moduler les heures complémentaires en dessous de 25 %.
Recommandation n° 10 : prévoir que les accords de branche ne peuvent pas moduler la majoration de la rémunération des heures complémentaires correspondant à un temps de travail additionnel compris entre le dixième et le tiers du temps de travail total en dessous de 25 % du prix de l’heure de base.
c. La durée minimale de travail fixée par la loi
L’article L. 3123-14 du code du travail dispose que la durée de travail d’un contrat à temps partiel doit au minimum être de 24 heures par semaine, ou l’équivalent mensuel de cette durée, ou l’équivalent de cette durée calculé sur une période définie par un accord collectif.
Cet article constitue la recodification des dispositions concernant le seuil minimum des 24 heures contenues dans la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et dans la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Ces deux lois avaient prévu l’instauration de ce seuil minimum pour tous les contrats de travail à temps partiel conclus du 1er au 21 janvier 2014, puis à partir du 1er juillet 2014. Il existe cependant des dérogations à ce principe. L’entreprise peut employer un salarié moins de 24 heures par semaine :
– dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat d’intérim d’une durée maximale de 7 jours, ou motivé par le remplacement d’un salarié absent ;
– lorsqu’un étudiant de moins de 26 ans en fait la demande du fait de ses études ;
– lorsque l’employeur embauche un salarié d’une entreprise d’intérim ou d’une association intermédiaire dans le cadre d’un dispositif d’insertion ;
– lorsqu’un salarié doit travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sur décision du médecin traitant et du médecin du travail ;
– lorsqu’un salarié handicapé en fait la demande à son employeur ;
– et enfin, lorsqu’un salarié adresse à l’employeur une demande écrite et motivée invoquant des contraintes personnelles ou le souhait de cumuler plusieurs activités pour un total d’au moins 24 heures hebdomadaires ; en ce cas, les horaires doivent être regroupés par journées ou demi-journées.
Par ailleurs, l’article L. 3123-14-3 dispose qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée du travail minimale inférieure à 24 heures hebdomadaires. Les accords collectifs doivent, en ce cas, comporter des garanties concernant la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités pour travailler au moins 24 heures.
L’article L. 3123-27 nouveau du code du travail prévoit, en effet, que c’est à défaut d’un accord de branche – visé à l’article L. 3123-19 nouveau du même code – que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif). Cela revient à dire que la durée minimum du travail à temps partiel fixée par la loi a un caractère supplétif ; elle ne s’applique qu’à défaut d’un accord de branche – ce dernier, accompagné par un accord d’entreprise, devant aussi garantir aux salariés, si le temps de travail est inférieur à 24 heures, un certain nombre d’aménagements afin de leur permettre, le cas échéant, de cumuler plusieurs activités.
Lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes, la ministre, Mme Myriam El Khomri, a indiqué à cet égard que « pour ce qui est du temps partiel, le projet de loi sanctuarise la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel sauf accord de branche, comme aujourd’hui, (…) rien n’est changé à l’équilibre de la loi sur la sécurisation de l’emploi. De même concernant les délais de prévenance ou le taux de majoration des heures complémentaires : nous sommes totalement à droit constant ».
Recommandation n° 11 : établir un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations aux 24 heures et supprimer le caractère supplétif de la loi pour la fixation de la durée minimum du temps de travail lors d’un contrat à temps partiel.
B. LES AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL
Dans les pages qui suivent, nous examinerons cinq thèmes en liaison avec le temps de travail, thèmes dont le projet de loi s’est saisi et pour lesquels il a souhaité apporter des modifications par rapport à la règlementation existante : la durée maximale du temps de travail ; le forfait jours ; le temps de repos quotidien ; les astreintes et les congés.
Les mesures contenues dans le projet de loi et relevant de ces cinq thèmes ont un lien direct avec la vie des femmes dans la mesure où les dispositifs ont une incidence non négligeable sur l’organisation de leur journée. Plus que jamais les femmes, toujours confrontées à l’inégal partage des tâches domestiques et familiales, devront déployer tous leurs efforts pour articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
1. La durée maximale du temps de travail
Il convient de distinguer le temps de travail hebdomadaire et quotidien.
● Le temps de travail hebdomadaire
Actuellement, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf s’il existe un accord de branche portant cette durée à 46 heures au maximum (article L. 3121-36 du code du travail). Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine (article L. 3121-35).
La première version du projet de loi prévoyait (dans l’article L. 3121-22 nouveau du code du travail) d’allonger la période sur laquelle la durée maximale du temps de travail hebdomadaire est calculée (44 heures au maximum par semaine sur seize semaines et non plus douze). Mais la deuxième version a finalement maintenu la période de douze semaines (article L. 3121-21 nouveau).
En cas d’accord d’entreprise ou de branche, il est possible de faire passer la durée maximale du temps de travail à 46 heures en moyenne, toujours sur douze semaines (article L. 3121-22 nouveau du code du travail). Il peut en aller de même, à titre dérogatoire, sans accord collectif. En ce cas, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire est autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État (article L. 3121-23 nouveau). Enfin, à titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dépassements de la durée de 46 heures peuvent être autorisés pendant des périodes déterminées dans des conditions prévues par décret (article L. 3121-24 nouveau du code du travail).
Au total, en ce qui concerne le temps de travail hebdomadaire, le projet de loi s’efforce principalement d’assouplir le passage de la durée maximale de 44 à 46 heures en prévoyant le recours à l’ensemble des accords collectifs existants, et non plus seulement le recours à l’accord de branche.
● Le temps de travail quotidien
L’article L. 3121-34 du code du travail prévoit que la durée maximum du temps de travail quotidien est de 10 heures. En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée peut atteindre 12 heures au maximum, après avis favorable de l’inspection du travail. Par ailleurs, l’article L. 3121-33 du code du travail prévoit qu’une pause de 20 minutes doit être accordée toutes les 6 heures de travail.
Le projet de loi, sans remettre en cause ces différentes prescriptions, accroît en pratique les possibilités offertes à l’employeur d’obtenir des dérogations – constantes ou ponctuelles – lui permettant de faire passer la durée maximale quotidienne du temps de travail au-delà de 10 heures. Ainsi :
– l’article L. 3121-17 nouveau du code du travail prévoit que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret ;
– le même article indique que des exceptions à la durée maximale quotidienne du travail peuvent être également instituées en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
– enfin, l’article L. 3121-18 nouveau indique qu’un accord collectif peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Par ailleurs, l’article L. 3121-15 nouveau maintient une pause d’une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Au total, de même que le projet de loi facilite le glissement du temps de travail hebdomadaire de 44 à 46 heures, il facilite le glissement du temps de travail quotidien au-delà du seuil de 10 heures. Cette flexibilité accrue risque d’aboutir à ce que les femmes, qui doivent déjà être plus flexibles au travail, le soient encore plus dans l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.
L’article L. 3121-43 du code du travail prévoit qu’un certain nombre d’employé.e.s peuvent conclure avec leur employeur.e une convention de forfait jours sur l’année, convention qui permet de décompter la durée de leur travail non plus en heures mais en jours. Ces employé.e.s sont, soit des cadres qui disposent d’une certaine indépendance dans la fixation de leurs horaires de travail, soit des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui – de la même manière que les cadres – possèdent une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
L’article L. 3121-39 du code du travail dispose que la mise en œuvre du forfait jours suppose l’existence, au préalable, d’un accord collectif qui fixe les caractéristiques principales de ce forfait. Ensuite, la convention individuelle conclue entre l’employé et le chef d’entreprise adapte les dispositions de l’accord collectif au cas de chaque salarié.
L’article L. 3121-44 du code du travail précise que, dans le cas du forfait jours, le nombre maximum de jours travaillés est limité à 218 jours.
Cependant, l’article L. 3121-45 du code du travail permet au/à la salarié.e qui le souhaite, en accord avec son employeur.e, de renoncer à ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. En ce cas, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre de jours maximum prévu par l’accord collectif. À défaut de dispositions sur ce point dans l’accord collectif, le nombre de jours maximum est de 235. En pratique, néanmoins, la plupart des accords collectifs fixent le nombre maximum de jours travaillés à 285 jours.
Enfin, l’article L. 3121-48 du code du travail indique que les salarié.e.s ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
– l’article L. 3121-10 du code du travail qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
– l’article L. 3121-34 du même code qui prévoit que la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures, sauf circonstances exceptionnelles validées par l’inspecteur du travail ;
– l’article L. 3121-35 qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;
– et enfin, l’article L. 3121-36 qui dispose que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines ou 46 heures si un accord de branche le prévoit.
Le présent projet de loi n’introduit pas de changements notables dans la réglementation du forfait jours, règlementation qui figure désormais dans l’article L. 3121-51 nouveau du code du travail, ainsi que dans les articles qui suivent. On notera cependant que l’article L. 3121-62 nouveau du code du travail tient compte, dans le cadre du forfait jours, de la création du droit à la déconnexion (article L. 2242-8 nouveau) – droit qui permet à un.e salarié.e d’interrompre, à un moment donné, le suivi de ses outils numériques afin de préserver ses périodes de repos. Par suite, l’article L. 3121-62 nouveau indique que l’accord collectif indispensable pour autoriser une convention individuelle de forfait jours doit aussi, désormais, préciser les modalités selon lesquelles le/la salarié.e pourra exercer son droit à la déconnection.
Par ailleurs, on rappellera que la première version du projet de loi (article L. 3121-65 dans l’avant-projet) prévoyait, pour les entreprises de moins de 50 salariés, la possibilité de mettre en place des forfaits jours sans accord collectif. Cette disposition a été retirée de la seconde version du projet. Désormais, même dans les entreprises de moins de 50 salarié.e.s, les employé.e.s ne pourront être soumis au forfait jours qu’à la condition qu’un accord d’entreprise ou de branche le permette.
On ne peut que se réjouir de ce retrait dans la mesure où une décision unilatérale de l’employeur visant à instituer le forfait jours dans les entreprises de moins de 50 salarié.e.s aurait certainement eu un impact sur la vie professionnelle des femmes. En effet, dans les PME, une femme sur trois est cadre.
Enfin, on remarquera, pour conclure, que le système du forfait jours n’est pas très favorable pour les femmes. En effet, très souvent, si l’employeur.e leur propose un tel forfait, les femmes ne peuvent l’accepter en raison de l’inégal partage des tâches au sein des couples ; et ensuite, lorsque le temps des promotions arrive, les conséquences négatives de ce refus se font ressentir. De la sorte, le forfait jours alimente le fameux « plafond de verre ».
3. Le temps de repos quotidien
L’article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout.e salarié.e bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Cette disposition s’applique également en cas de forfait jours ; en effet, l’article L. 3131-1 précité ne figure pas au nombre des dispositions qui se trouvent écartées du fait du dispositif du forfait.
L’article 3131-2 indique qu’un accord collectif peut déroger à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut d’accord collectif et en cas de travaux urgents, en raison d’un accident ou d’une menace d’accident, ou de surcroît exceptionnel d’activité.
Le présent projet de loi reprend ces dispositions, sans changements significatifs, dans les articles L. 3131-1, L. 3131-2 et L. 3131-3 nouveaux du code du travail.
L’article L. 3121-5 du code du travail prévoit l’existence de périodes d’astreinte. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le/la salarié.e, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’article L. 3121-7 du code précise que les accords collectifs fixent le mode d’organisation des astreintes ainsi que leur compensation qui peut être, soit financière, soit sous forme de repos. À défaut d’accord collectif, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur, après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail. L’article L. 3121-8 du code dispose que la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le ou la salarié.e en soit averti.e au moins un jour franc à l’avance.
Enfin, l’article L. 3121-6 du code prévoit que le temps d’astreinte – exception faite de la durée d’intervention – est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien, telle qu’elle figure dans l’article L. 3131-1. Cela revient à dire que, si la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, la durée totale de l’astreinte est considérée comme un temps de repos. Le temps de l’astreinte, sauf intervention, est donc imputé sur la durée minimale du repos quotidien qui est de 11 heures.
Dans les articles L. 3121-8 et suivants (nouveaux) relatifs aux astreintes, le présent projet de loi reprend les grands traits du dispositif qui vient d’être décrit. On note cependant deux différences :
– l’article L. 3121-8 nouveau du code du travail supprime le délai de prévenance de 15 jours ; il indique simplement que le/la salarié.e doit être prévenu.e des périodes d’astreinte « dans un délai raisonnable » ;
– par ailleurs, le même article définit comme étant un principe d’ordre public le fait que la période d’astreinte donne lieu, pour le salarié, à une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les modalités pratiques de cette contrepartie sont renvoyées à un accord collectif (article L. 3121-10 nouveau). À défaut d’accord, c’est l’employeur qui fixe la compensation, après consultation du comité d’entreprise ou des délégué.e.s du personnel et information de l’inspecteur du travail (article L. 3121-11 nouveau).
Enfin, il est clair que la diminution, de fait, du délai de prévenance en cas d’astreinte peut poser aux femmes un problème réel. En effet, compte tenu de l’inégal partage des responsabilités familiales, elles doivent pouvoir être informées des modifications de leur emploi du temps dans des délais précis et non de manière aléatoire.
Le code du travail comprend aujourd’hui 16 congés spécifiques, instaurés par le législateur pour répondre à des besoins particuliers. Ils couvrent des thématiques liées à des évènements familiaux de manière ponctuelle (décès ou mariage du parent) ou plus longue (accompagnement d’un proche atteint d’une grave maladie), à l’exercice d’un mandat syndical ou mutualiste, à des engagements associatif, humanitaire, politique ou citoyen, en lien avec un projet de création d’entreprise ou tout autre projet personnel justifiant.
Au cours des travaux de la Délégation ainsi que dans l’avis du CSEP précité (11 mars 2016), a été soulevée la question de l’impact des mesures prévues par le projet de loi en matière de congés.
L’article 3 du projet de loi vise à clarifier le régime de congés et de donner beaucoup plus de marges à la négociation, notamment d’entreprise, suivant la nouvelle architecture retenue pour le code du travail. La recodification propose une nouvelle architecture des congés, ceux-ci se trouvent classés de manière plus rationnelle en trois grandes catégories dans un objectif de lisibilité : les « congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle », ceux liés à l’engagement associatifs et militant, et enfin ceux liés au parcours professionnel.
À cet égard, dans la contribution écrite adressée à la Délégation, dans le prolongement de l’audition organisée le 22 mars 2016, la CFTC a souligné « concernant les congés spécifiques » avoir « accueilli positivement le fait que soient institués des “congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle” qui, ont l’intérêt de réunir sous un même chapitre des congés qui existent déjà actuellement ».
Les dispositions supplétives sont rédigées à droit constant. La loi détermine ainsi en cas d’absence d’accord la durée des congés conformément aux dispositions actuelles du code. De même les conditions d’ancienneté et les modalités du renouvellement sont également inscrites dans la loi. Sont en revanche renvoyées à des dispositions réglementaires les délais de prévenance, les modalités de plafonnement du nombre de salariés pouvant prendre un même congé de manière simultanée ainsi que les modalités de saisine du bureau du conseil des prud’hommes. Ces dispositions supplétives ne sont pas le plancher sur la base duquel les négociations doivent être entamées. Elles sont ce que le droit doit être lorsque les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord.
PRINCIPES DE RÉPARTITION ENTRE DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC ET NÉGOCIATION
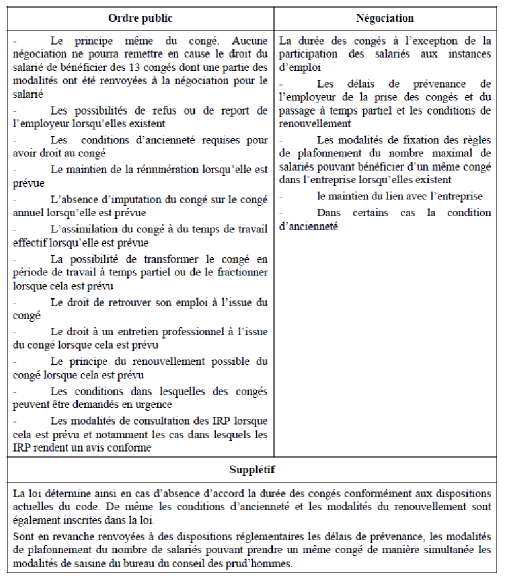
Source : étude d’impact du projet de loi (mars 2016)
Par ailleurs, un ajustement est opéré pour les congés pour événements familiaux. Le projet de loi harmonise le nombre de jours accordés en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur (aujourd’hui, 1 jour de congé est accordé) sur le nombre de jours accordés en cas de décès d’un enfant, d’un conjoint ou d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité (soit 2 jours). Le tableau présenté page 63 récapitule les mesures prévues par le projet de loi concernant les durées des congés, comparativement à la durée actuelle.
Lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes, la ministre, Mme Myriam El Khomri, a précisé avoir « souhaité indiquer que, s’agissant des congés pour événements familiaux (mariages, naissances, décès), qui sont des congés payés essentiels pour tous, l’accord ne puisse pas descendre en dessous des durées aujourd’hui prévues par la loi – et (…) même souhaité harmoniser vers le haut les congés pour décès car, dans les moments les plus douloureux de la vie, le tri qu’opère aujourd’hui le code du travail ne [lui] semblait pas acceptable ».
Sans préjudice d’autres améliorations susceptibles d’être apportées aux dispositions du projet de loi relatives aux congés d’ici l’examen de ce texte en séance publique, vos rapporteures formulent d’ores et déjà la recommandation suivante.
Recommandation n° 12 : modifier la rédaction du projet de loi pour faire référence aux « congés d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle » à l’article 3 du projet de loi, et remplacer le mot de « conciliation » par celui d’ « articulation » à l’article 2.
Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi prévoit expressément un renvoi à la négociation concernant les jours fériés et chômés. En effet, aujourd’hui, le code du travail ne dispose pas expressément que les jours qui sont à la fois fériés et chômés sont définis par accord collectif. La définition des jours fériés continuera à relever de l’ordre public, mais le projet de loi prévoit désormais de façon expresse le renvoi à la négociation quant à la définition des jours fériés et chômés (à l’exception du 1er mai, seul jour férié et chômé par détermination de la loi).
III. LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EN ENTREPRISE ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
A. LE NOUVEAU CADRE DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE
1. Le dispositif issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi
Depuis leur création en 1982 dans le cadre des réformes sociales opérées par les lois Auroux, les obligations de négocier dans l’entreprise se sont développées. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de douze obligations de négocier qui doivent être respectées par l’employeur et ce, selon des périodicités qui peuvent être différentes : l’obligation peut ainsi être annuelle ou triennale selon les thématiques (64).
Ainsi, les négociations sur les salaires effectifs ou la durée et l’organisation du travail doivent être engagées tous les ans (65), alors que la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques (GPEC) ne doit l’être que tous les trois ans (66). Par ailleurs, sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’obligation est d’abord annuelle, puis devient triennale lorsqu’un accord a été conclu.
Jugeant cet « empilement » des négociations obligatoires générateur d’un risque de saturation de l’agenda social de l’entreprise, non favorable à un dialogue social de qualité, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a opéré un regroupement de ces obligations de négocier et rationalisé leur périodicité.
a. Le regroupement des négociations autour de trois blocs : la rémunération et le temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois
Avant la loi du 17 août 2015, des regroupements avaient déjà été facilités dans le domaine de l’emploi. Ainsi, la loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération a permis le regroupement de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques (GPEC) avec celle sur le contrat de génération dans les entreprises d’au moins 300 salarié.e.s. La négociation sur la mobilité interne à l’entreprise prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi peut elle aussi être abordée en même temps que celle sur la gestion des emplois.
Reprenant une des dispositions posées par les partenaires sociaux dans l’ANI du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail (67), la loi du 5 mars 2014 (68) a posé le principe selon lequel « un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de “qualité de vie au travail” (…) de tout ou partie de certaines négociations obligatoires ». La conclusion d’un tel accord, pour une durée maximale de trois ans, a pour effet de suspendre l’obligation de négocier annuellement pour les négociations qui ont fait l’objet du regroupement. Cette possibilité n’a cependant été ouverte par le législateur qu’à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2015.
La loi du 17 août 2015 visait, d’une part, à regrouper les obligations de négocier dans trois blocs structurants, en reprenant ce qui était déjà prévu à titre expérimental sur la qualité de vie au travail, et à permettre, d’autre part, l’adaptation de leur architecture et de leur périodicité. Cette mesure, qui ne concerne que les obligations de négocier, ne remet pas en cause la possibilité de négocier sur d’autres thèmes, de manière ponctuelle ou récurrente.
Ainsi, quel que soit l’effectif de l’entreprise, deux obligations de négocier chaque année sont instituées (L. 2242-1), qui portent respectivement sur :
– la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
– l’égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail ;
– par ailleurs, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) doit être engagée tous les trois ans dans les entreprises occupant au moins trois cents salarié.e.s (69).
Dans le cadre des travaux menés sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, la Délégation a veillé à ce que la dimension de l’égalité femmes-hommes soit bien intégrée dans chacun de ces trois blocs.
● La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur les salaires fait l’objet d’un traitement spécifique en raison de son rôle central dans l’entreprise. Cette négociation, qui peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts, porte sur :
– les salaires effectifs ;
– la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
– l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires (entreprises ayant reçu l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ») ; la même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
– le « suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes » (article L. 2242-5 du code du travail).
● La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (EP-QVT)
Au cœur de cette négociation figure l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La négociation doit porter sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salarié.e.s à temps partiel, ainsi que de mixité des emplois.
Cette négociation s’appuie sur les données de la base de données économiques et sociales (BDES, ou base de données unique – BDU). La loi du 17 août 2015 prévoit en effet une nouvelle rubrique intitulée « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (70) », qui doit comprendre :
– un diagnostic et une analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
– une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, ainsi que des données relatives à l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.
Cette négociation porte également sur l’application de la dérogation qui permet en cas d’emploi exercé à temps partiel ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d’assiette n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération. La négociation doit aussi porter sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
En l’absence d’accord prévoyant les mesures précitées, deux mesures correctives sont prévues concernant :
– d’une part, la négociation annuelle sur les salaires effectifs, qui devra porter également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
– d’autre part, l’établissement par l’employeur d’un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.
L’employeur doit aussi élaborer une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression qui seront définis par décret. Cette synthèse est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle doit également être tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
Le regroupement des négociations ne met en cause aucun des dispositifs actuels prévoyant des pénalités en cas d’absence de négociations, en particulier en matière d’égalité professionnelle. L’article L. 2242-9 du code du travail, tel qu’issu de la loi du 17 août 2015, rappelle donc que les entreprises d’au moins 50 salarié.e.s sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action.
Par ailleurs, d’autres thèmes sont évoqués dans le cadre de la négociation obligatoire sur la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail dans l’entreprise, suite à la loi du 17 août 2015, et rappelés ci-après.
Le champ de la négociation obligatoire en entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (EP-QVT)
Cette négociation annuelle porte sur :
– l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salarié.e.s ;
– les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (cf. supra) et l’application de la dérogation précitée en cas d’emploi à temps partiel et de maintien des cotisations au titre de l’assurance vieillesse ;
– le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;
– les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
– les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleur.se.s en situation de handicap, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
– les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par la loi (c’est-à-dire sur la base des garanties minimales devant être mises en place d’ici le 1er janvier 2016), d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou d’entreprise
– l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
La négociation sur l’EP-QVT peut également porter sur la prévention de la pénibilité.
Source : articles L. 2242-8 et L. 2242-12 du code du travail
● La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et sur la mixité des métiers dans les entreprises
L’article L. 2242-13 du code du travail prévoit une obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers pour les entreprises occupant au moins 300 salarié.e.s. Cette négociation doit être engagée notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences telles qu’elles sont discutées avec le comité d’entreprise, lors de la consultation obligatoire sur ce thème (prévue à l’article L. 2323-10). La négociation porte sur les thèmes suivants.
Le champ de la négociation triennale sur la GPEC et la mixité des métiers dans les entreprises de plus de 300 salarié.e.s
1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation (CPF), de validation des acquis de l’expérience (VAE), de bilan de compétences, ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord. La négociation peut également porter sur le contrat de génération.
Source : articles L. 2242-13 et L. 2242-14 du code du travail
b. L’adaptation des règles de négociation concernant la périodicité des accords
Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d’entreprise majoritaire (71) peut modifier la périodicité de chacune des négociations pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de :
– trois ans pour les deux négociations annuelles ;
– cinq ans pour la négociation triennale.
Ce type d’accord peut aussi adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires. Dans le cas où l’accord modifie la périodicité (72) :
– de la négociation sur les salaires effectifs : une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée, et l’employeur y fait droit sans délai ;
– de la négociation sur l’égalité professionnelle : l’entreprise échappe à la pénalité financière pendant la durée prévue par l’accord.
Enfin, la loi du 17 août 2015 prévoit une entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux négociations annuelles obligatoires 1er janvier 2016. Une mesure transitoire est instaurée pour les entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif : à l’articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle ; à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l’emploi des travailleurs handicapés. Ces entreprises ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues par la nouvelle règlementation qu’à l’expiration de cet accord, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.
2. Une progression du nombre d’accords collectifs et de plans d’action sur l’égalité professionnelle
a. Une hausse du nombre d’accords de branche en 2014
Le nombre d’accords de branche conclus sur le thème de l’égalité professionnelle enregistre une hausse en 2014 : 140 textes à comparer aux 122 conclus en 2013. Ces textes se répartissent entre 6 accords traitant spécifiquement de l’égalité professionnelle et salariale et 134 accords abordant ce thème.
NOMBRE D’ACCORDS DE BRANCHE ABORDANT LE THÈME DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DE TEXTES (INTERPROFESSIONNELS, PROFESSIONNELS, NATIONAUX OU INFRANATIONAUX)
Années |
Accords spécifiques égalité professionnelle |
Accords de branche abordant le thème de l’égalité, à l’exclusion des accords spécifiques |
Nombre et % d’accords de branche abordant le thème de l’égalité |
Nombre total d’accords |
2007 |
9 |
24 |
33 (3,2 %) |
1 038 |
2008 |
19 |
34 |
53 (4,5 %) |
1 215 |
2009 |
35 |
75 |
110 (9,5 %) |
1 161 |
2010 |
37 |
112 |
149 (12,8 %) |
1 161 |
2011 |
27 |
140 |
167 (13,5 %) |
1 241 |
2012 |
19 |
164 |
183 (14,5 %) |
1 264 |
2013 |
9 |
113 |
122 (2,1 %) |
1 006 |
2014 |
6 |
134 |
140 (14,3 %) |
979 |
Lecture : en 2007, 9 accords spécifiques, c’est-à-dire traitant exclusivement ou à titre principal du thème de l’égalité professionnelle, ont été conclus. 24 accords abordant ce thème à titre secondaire ont été conclus. Au total, 33 accords ont porté sur le thème de l’égalité professionnelle en 2007, soit 3,2 % des 1 038 accords de branche conclus
Source : ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, BDCC)
Si le nombre d’accords conclus sur le thème de l’égalité professionnelle est en hausse en 2014, le nombre d’accords spécifiques, c’est-à-dire traitant exclusivement ou à titre principal de l’égalité professionnelle et salariale a continué en revanche à diminuer cette année, comme c’est le cas depuis 2010.
Parmi les accords abordant le thème de l’égalité conjointement à un autre thème, la plupart concernent la négociation sur les salaires. Outre le rappel des obligations légales, plusieurs accords établissent un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes et, plus particulièrement, des écarts de rémunération. Le thème de l’égalité est également abordé dans des accords relatifs à d’autres thèmes susceptibles d’influer sur les causes structurelles des inégalités salariales entre les femmes et les hommes : la formation professionnelle, la diversité et l’égalité des chances, les classifications, la gestion des âges et des compétences, le temps partiel.
b. Une tendance dynamique concernant les accords d’entreprise grâce à la mobilisation de l’administration et de l’inspection du travail
Une instruction spécifique de l’autorité centrale de l’inspection du travail a donné des précisions en terme d’objectifs et de méthodologie d’action, notamment de contrôle, avec comme objectif de déployer un dispositif efficace sur l’ensemble du territoire dans un cadre qui assure l’homogénéité de l’action. Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) établissent chaque année des plans d’action qui intègrent l’ensemble des leviers à leur disposition notamment pour veiller au respect des obligations de négociation au sein des entreprises sur ce thème :
– la sensibilisation et l’information des entreprises les moins outillées, en particulier les PME ;
– le suivi : le dépôt des plans d’action et les accords font l’objet d’un suivi fin et d’une analyse plus exhaustive du niveau d’engagement des entreprises sur ce thème ;
– le contrôle : des actions de contrôle ont été menées tant sur l’existence d’accords ou de plans d’action que sur le contenu de ces documents, afin de s’assurer non seulement de l’engagement et de l’aboutissement d’une démarche en la matière mais également de la réalité des mesures envisagées (existence d’objectifs de progression, des mesures de nature à les atteindre et d’indicateurs de suivi de réalisation).
Tous les outils mis à la disposition du système d’inspection du travail sont mis en œuvre (lettres d’observation, mise en demeure et, en cas d’absence de volonté de mise en conformité, l’engagement de la procédure de pénalité 1 %).
Au 15 août 2015, 37,5 % des entreprises assujetties sont couvertes par un accord d’entreprise ou un plan d’action, ainsi que le montre le graphique ci-après. Cette donnée globale couvre des réalités différentes en fonction de la taille des entreprises : 82 % des entreprises de plus de 1 000 salariés, 65 % des entreprises de 299 à 999 salariés et 33 % des entreprises de 50 à 299 salariés sont couvertes.
Le nombre d’accords égalité et de plans d’action déposés depuis le 1er janvier 2013 progresse de façon régulière.
ÉVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE GLOBAL
![]()
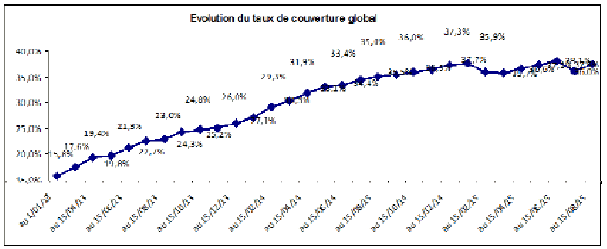
Source : ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, feuille de route pour l’égalité femmes-hommes (février 2016)
MONTÉE EN CHARGE DU DÉPÔT DES ACCORDS ET PLANS D’ACTION![]()
![]()
![]()
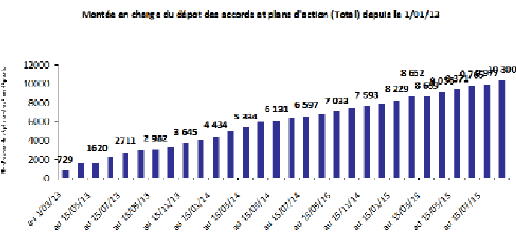
Au 15 août 2015, 2 002 mises en demeure avaient été adressées aux entreprises, et 61,8 % des mises en demeure étaient arrivées à échéance soit par arrivée du terme de 6 mois, soit par régularisation de l’entreprise dans le délai.
L’analyse de leur suivi montre l’efficacité de cette procédure dans la mesure où 58,8 % d’entre elles ont permis une régularisation de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations, sans engagement de la pénalité. Les mises en demeure touchent 2 % des accords ou plans déposés (part stable depuis plus d’un an).
Lorsque ce n’est pas le cas, 5,3 % des mises en demeure arrivées à échéance ont donné lieu à pénalité. Les autres dossiers sont soit en cours d’instruction pour examiner les suites à donner (pénalité ou accompagnement particulier lorsque l’entreprise rencontre des difficultés), soit donnent lieu à des mesures particulières (nouveau délai, abandon suite à la disparition de l’entreprise ou du seuil d’assujettissement…).
![]()
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MISES EN DEMEURE
![]()
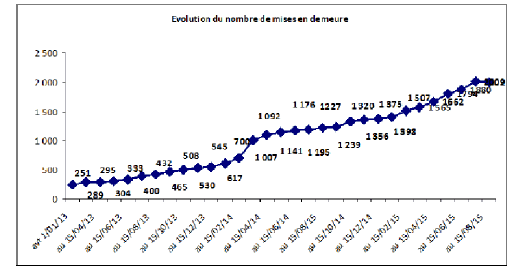
Au 15 août 2015, 66 décisions de pénalités financières avaient été prises à la suite de mises en demeure. Le taux moyen constaté de pénalité est de 0,68 % de la masse salariale. Enfin, il convient de noter qu’à ce jour, 59 % des pénalités prononcées ont permis une régularisation de la situation de l’entreprise. Le montant cumulé des pénalités au 15 août 2015 est de 391 311 €.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCISIONS DE PÉNALITÉS
![]()
![]()
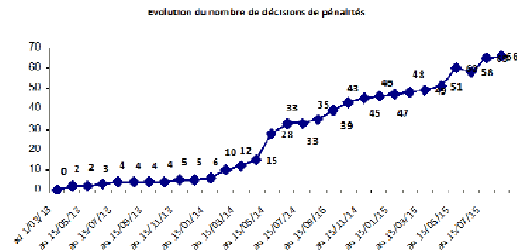
Ces données du ministère du travail montrent une tendance favorable et témoignent de l’efficacité du dispositif de sanctions. Néanmoins, de nombreuses entreprises ne sont toujours pas couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et des disparités sont constatées selon les régions, selon M. Michel Miné. Par ailleurs, la qualité du contenu des accords laisse parfois à désirer. Vos rapporteures préconisent une augmentation des moyens mis à la disposition des DIRECCTE afin de poursuivre une action efficace sur la durée.
Recommandation n° 13 : renforcer les moyens des DIRECCTE afin d’accompagner, de contrôler et de sanctionner les entreprises en matière d’égalité professionnelle.
B. LE PROJET DE LOI ET LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
1. Des règles de négociation plus souples
a. La périodicité des négociations annuelles obligatoires (NAO) dont celle sur l’égalité professionnelle
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord, ou à défaut de plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la loi du 17 août 2015 permet à un accord d’entreprise majoritaire de modifier la périodicité de chacune des négociations pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de 3 ans pour les deux négociations annuelles et de 5 ans pour la négociation triennale.
Avec le présent projet de loi, une souplesse supplémentaire est introduite : un accord de branche pourra ainsi prévoir que la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (EP-QVT) ait lieu tous les trois ans dans toutes les entreprises couvertes – et il en est de même pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, y compris en l’absence d’accord d’entreprise. Les négociations triennales pourront devenir quinquennales et celles prévues tous les cinq ans pourront avoir lieu tous les sept ans. La périodicité des négociations pourra donc être définie au niveau de la branche.
Les syndicats entendus par la Délégation ont été presque unanimes, à l’exception de la CFDT, pour considérer que ces dispositions fragilisaient la négociation sur l’égalité professionnelle et que plus généralement que la dimension de l’égalité entre les femmes et les hommes était singulièrement absente du projet de loi sur le travail. Pour la CFE-CGC qui regrette au passage la dilution de la négociation sur l’égalité professionnelle dans la qualité de vie au travail, espacer la négociation sur l’égalité femmes-hommes ne va pas dans le sens de la lutte contre les inégalités. En effet, selon ce syndicat, qu’elle se situe au niveau de la branche ou de l’entreprise, la négociation collective est un vecteur primordial pour faire bouger les lignes. Elle permet de déterminer les objectifs à atteindre en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de définir les moyens pour les atteindre, ainsi que les modalités de suivi.
La deuxième version du projet de loi prévoit cependant qu’en l’absence de conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle, l’employeur restera tenu d’établir chaque année le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-8.
La Délégation aux droits des femmes s’inquiète cependant de voir qu’un employeur, qui aura certes mis en place un plan d’action unilatéral, pourra attendre si un accord de branche le prévoit, trois ans pour rouvrir la négociation sur l’égalité professionnelle et aussi la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, ce qui risque de ne pas faciliter la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes rappelés dans ce rapport.
Recommandation n° 14 : prévoir que la négociation sur l’égalité professionnelle et la négociation sur les rémunérations ne puissent devenir triennales à la suite d’un accord de branche que si l’entreprise a conclu un accord sur l’égalité.
La loi du 17 août 2015 prévoyait déjà qu’on puisse modifier la périodicité des négociations annuelles obligatoires dont celle sur l’égalité professionnelle par accord majoritaire d’entreprise. Avec le projet de loi, cette possibilité sera ouverte après un accord de branche. Compte tenu des enjeux importants, il faut réserver cette possibilité de modifier par accord de branche la périodicité des NAO aux entreprises couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle.
b. La durée de vie des accords
Jusqu’à présent, le code du travail prévoyait qu’un accord avait une validité permanente sauf disposition différente prévue dans l’accord (accord à durée déterminée) ou dénonciation par l’une des parties. Selon l’étude d’impact du projet de loi, ce principe n’incite pas les partenaires sociaux à renégocier des accords signés précédemment et constitue un facteur d’empilement des normes conventionnelles souvent devenues sans objet. Aussi, avec le présent projet de loi, les règles changent. L’ensemble des accords d’entreprise auront une durée de 5 ans maximum et à expiration, les accords cesseront de s’appliquer et cela même s’il n’y a pas de nouvel accord conclu. Cependant, il restera possible de conclure un accord pour une durée indéterminée à condition que cette précision figure expressément dans l’accord.
Mais, selon la CGT, ces dispositions sont particulièrement préoccupantes pour les accords sur l’égalité professionnelle qui font partie des accords qui potentiellement peuvent avoir le contenu le plus positif pour les salarié.e.s, dans la mesure où le rapport de force sera du côté de l’employeur qui pourra plus facilement imposer une renégociation de l’accord sur des bases plus faibles, l’accord précédent étant automatiquement périmé.
La CGT fait également remarquer qu’en cas de dénonciation d’un accord par l’employeur, il n’y aura plus de garantie de maintien des « avantages acquis » jusqu’à ce qu’il y ait un nouvel accord. La renégociation commencera tout de suite sans attendre les 3 mois de préavis actuels. Selon le syndicat, le pouvoir unilatéral de l’employeur est renforcé puisqu’il peut imposer quand il veut une renégociation sans que les salarié.e.s aient la garantie que tant qu’il n’y a pas d’accord, ce sont les dispositions antérieures qui continuent à s’appliquer.
Le projet de loi prévoit de renforcer la légitimité des accords d’entreprise par le déploiement progressif de la règle de l’accord majoritaire c’est-à-dire signé par des organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés par les salarié.e.s contre 30 % aujourd’hui.
Cependant, la loi prévoit aussi d’introduire un principe de consultation directe des salarié.e.s pour les accords signés par les organisations représentant au moins 30 % des salariés (référendum). Si une majorité de salarié.e.s valide l’accord par référendum, l’accord peut s’appliquer. Or, la CGT comme certaines associations féministes observent que dans de nombreux secteurs professionnels, les femmes sont minoritaires et on peut craindre que la volonté de la majorité exprimée par référendum se fasse au détriment des minorités et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, des mesures de mobilité ou d’augmentation du temps de travail n’ont pas le même impact sur les femmes et les hommes du fait de l’inégal partage des tâches au sein des couples.
Il convient de noter que le Conseil d’État a proposé de n’appliquer le dispositif du référendum des salarié.e.s qu’aux seuls accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés dans un premier temps, le dispositif étant ensuite élargi à tous les autres accords au plus tard le 1er septembre 2019. Cette disposition a été intégrée dans la dernière version du projet de loi (article 10).
Un millier de textes conventionnels (conventions collectives, accords et avenants) sont conclus chaque année par les acteurs sociaux dans les branches professionnelles. Ces textes précisent ou complètent les règles qui régissent les conditions de travail entre employeurs et salariés, voire créent des dispositions nouvelles. Pour être effectives, ces règles doivent être connues des salarié.e.s et d’ores et déjà, les conventions collectives de branche nationales étendues sont disponibles sous forme d’une version consolidée sur Internet.
D’une manière générale, la délégation est favorable à la publicité des accords notamment sur l’égalité professionnelle, surtout quand ils sont innovants, dans le cadre d’accords de groupe comme le souligne l’étude d’impact ; elle est en faveur de leur diffusion sur le site du ministère du travail ou du ministère des droits des femmes.
Avec le projet de loi, le gouvernement fait un choix ambitieux : les accords seront rendus accessibles à tous à travers une base de données publique nationale et gratuite. Néanmoins, cette exigence d’accessibilité du droit conventionnel doit être conciliée avec la protection des intérêts de l’entreprise. Certains accords peuvent contenir des informations sensibles sur sa situation ou sa stratégie. Il est donc prévu que l’employeur puisse s’opposer à la publicité d’un accord d’entreprise s’il estime que la diffusion de celui-ci peut porter préjudice à l’entreprise. Certains syndicats comme la CGT ont considéré que cette capacité de l’employeur.e à s’opposer à la publication de l’accord était contraire au paritarisme et que la transparence devait être de mise.
2. Former les négociateurs à l’égalité professionnelle
La négociation sur l’égalité professionnelle présente un caractère bien spécifique et il apparaît que les négociateurs et les négociatrices en charge de cette mission doivent à la fois être sensibilisé.e.s à cette problématique et convaincu.e.s de son importance. La représentante de la CFE-CGC entendue en audition faisait remarquer que la plupart des négociateurs de l’égalité professionnelle au niveau de la branche étaient des hommes….Les négociateurs doivent donc pouvoir bénéficier d’une formation spécifique pour entamer cette négociation.
Précisément, le projet de loi prévoit, à l’article 18, la mise en place plusieurs mesures pour améliorer la formation des acteurs et des actrices du dialogue social. Il prévoit d’abord que le comité d’entreprise peut décider, par une délibération, de contribuer au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux présents dans l’entreprise sur sa subvention de fonctionnement. Il prévoit aussi, de manière novatrice comme le souligne l’exposé des motifs, la possibilité d’organiser des formations communes avec les représentant.e.s d’organisations syndicales de salarié.e.s et d’employeur.e.s.
Cette nouvelle possibilité est une opportunité qui doit être saisie pour former les partenaires sociaux à la négociation sur l’égalité professionnelle.
Recommandation n° 15 : former les partenaires sociaux aux spécificités de la négociation sur l’égalité professionnelle en utilisant les nouvelles possibilités offertes par le projet de loi.
Recommandation n° 16 : veiller à l’équilibre de la représentation des TPE/PME où les femmes sont majoritairement représentées pour les négociations des accords collectifs de branche.
3. La question de l’inversion de la hiérarchie des normes
Le titre II du projet de loi s’intitule : « Favoriser une culture du dialogue et de la négociation », et l’ambition affichée par ce texte est de renforcer le dialogue social. Selon l’exposé des motifs, « une place sans précédent est donnée à la négociation collective. Le rôle de la loi qui reste essentiel, est recentré sur ce qui est strictement nécessaire à la protection de l’ordre public ».
Aujourd’hui, c’est le principe du plus favorable qui prévaut en application de la hiérarchie des normes, comme l’ont rappelé les syndicats (73) : la loi prime sur l’accord de branche qui, en principe, prime sur l’accord d’entreprise, sauf si l’accord de branche ou d’entreprise sont plus favorables. Des exceptions à ce principe général ont néanmoins déjà été introduites par la loi ainsi que le rappelle l’étude d’impact. La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social autorise les accords d’entreprise à déroger aux conventions de branche dans un sens moins favorable aux salariés notamment en matière de durée du travail et la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a confirmé cette évolution.
Dans le présent projet de loi, qui parie sur le dialogue social, la hiérarchie des normes est inversée et désormais c’est l’accord d’entreprise qui prévaut sur l’accord de branche ou même la loi, même quand il est moins favorable. La loi ne fixe plus les normes applicables mais délègue cette compétence aux accords d’entreprise, ensuite elle n’a plus qu’un rôle supplétif. La CGT note par ailleurs que le projet de loi étend les possibilités de négociation dans les entreprises où il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel (IRP) à des salarié.e.s mandaté.e.s, qui sont susceptibles de subir plus facilement la pression de leur employeur.e.
Cette volonté de privilégier le dialogue entre les partenaires sociaux est louable mais semble sous-estimer que la négociation est aussi un rapport de force où les partenaires ne sont pas toujours à égalité. Le contrat de travail lui-même consacre un « lien de subordination juridique permanent ». Aussi l’inversion de la hiérarchie des normes risque d’être défavorable aux salarié.e.s les plus précaires et aux femmes, qui travaillent dans les entreprises sous-traitantes, les PME et TPE, et dans lesquelles les organisations syndicales sont moins implantées.
D’autant que, comme le fait remarquer la CFE-CGC, les femmes très nombreuses dans les TPE et PME ne bénéficient pas forcément des accords d’entreprise, en revanche, les accords conventionnels de branche leur sont applicables, ce qui constitue un socle de droits pour elles. Or, comme le fait remarquer la CFDT, ce n’est pas parce qu’on est dans une petite entreprise que l’on doit avoir de « petits » droits sociaux.
Du côté patronal, l’UPA entendue en audition, est également hostile à l’inversion de la hiérarchie des normes, pour des raisons pratiques : les TPE/PME n’ont pas les moyens notamment humains pour négocier des accords d’entreprises qui nécessitent de solides compétences en droit du travail et le chef d’entreprise-artisan a d’autres priorités que la négociation. Selon l’UPA, c’est la branche qui constitue le bon niveau pour négocier des accords et qui permet en même temps de réguler la concurrence en organisant les conditions de travail d’un même secteur. Il convient également de rappeler que 98 % des entreprises françaises comptent moins de 50 salarié.e.s.
Devant les inquiétudes suscitées par ce texte, la deuxième version du projet de loi a institué un nouvel article, qui semble vouloir rappeler le rôle de garde-fou joué par les branches (article 13). Ainsi, il est inséré dans le code du travail un nouvel article L. 2232-5-1 ainsi rédigé : « La négociation de branche vise à définir les garanties s’appliquant aux salariés employés par les entreprises d’un même secteur ou d’une même forme d’activité et à réguler la concurrence entre les entreprises de ce champ ».
L’article L. 2232-9 est également modifié pour renommer les commissions paritaires d’interprétation, qui règlent les difficultés d’interprétation des accords de branche en commissions paritaires permanentes de négociation et qui représenteront la branche dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Elles devront établir un rapport annuel d’activité transmis à la commission nationale de la négociation collective (CNNC), dont les missions sont aujourd’hui définies à l’article L. 2271-1 du code du travail.
Les principes essentiels du droit du travail, qui devront guider les travaux de réécriture de la partie législative du code du travail, sont essentiels pour rappeler les fondamentaux du droit du travail. Car, dans ce débat très vif sur la hiérarchie des normes, il est bon de rappeler quelles sont au XXIe siècle, les fonctions du code du travail, ainsi que l’a souligné M. Michel Miné lors de son audition. Selon lui, ces principes fondamentaux sont autant de réponses et de repères bienvenus par rapport à un droit du travail qui serait entièrement négocié. Le code du travail doit fixer des limites qui sont en fait relatives aux droits humains, car le bon fonctionnement de l’entreprise ne saurait constituer la référence ultime.
C. PRÉCISER LA PROCÉDURE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
1. Clarifier quatre étapes de la négociation collective sur l’égalité professionnelle
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a modifié l’articulation des différentes étapes de la négociation collective tout en en conservant les éléments essentiels. Ainsi, quatre étapes peuvent être identifiées, lesquelles présentent des imprécisions de forme mais aussi des incohérences sur le fond, qui fragilisent l’équilibre d’ensemble et rendre ces dispositions peu intelligibles pour les négociateurs. Pour être efficace, rendons claires les étapes :
a) L’élaboration de la base de données économiques et sociales (BDES), qui recueille les données relatives à la situation comparée des femmes et des hommes. L’article L. 2323-8 précise que ces « informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent les perspectives sur les trois années suivantes » ; ces « perspectives » portant sur trois ans au sein de la BDES ne sont pas cohérentes avec le contenu du plan d’action tel que prévu à l’article L. 2242-8. Cette BDES est à mettre en rapport avec l’ancien rapport de situation comparée (RSC), qui comportait deux parties : des indicateurs chiffrés et un plan d’action reposant sur les données de l’année écoulée et déterminant des objectifs de progression pour l’année à venir.
b) La consultation, qui repose sur les informations et indicateurs chiffrés de la BDES ainsi que sur l’accord égalité ou le plan d’action précité : en effet, le code du travail prévoit l’organisation d’une consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, qui porte notamment sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (L. 2323-15). En vue de cette consultation, l’employeur.e met à la disposition du comité d’entreprise, « les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 », c’est-à-dire figurant dans la BDES, « ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action (…) en faveur de l'égalité professionnelle » (L. 2323-17). Il est étonnant de donner à la consultation l’accord ou la consultation qui résulte ou non de la négociation.
c) La négociation sur l’égalité professionnelle et désormais la qualité de vie au travail (article L. 2242-8, cf. supra), qui s’appuie sur les données mentionnées à l’article L. 2323-8 (BDES), aboutit soit à un accord, soit à un plan unilatéral de l’employeur.
d) La sanction financière, le cas échéant, si les entreprises ne respectent pas leurs obligations (cf. supra), ces dispositions restant inchangées suite à la loi du 17 août 2015 précitée (L. 2242-9).
Des précisions semblent devoir être apportées pour rendre cohérent le dispositif d’ensemble. Ainsi, à l’article L. 2323-8 relatif à la BDES, il est question de « diagnostic et analyse sur la situation respective » des femmes et des hommes, tandis qu’à l’article L. 2323-17 sur la consultation, il est question des « informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes ». Afin de faciliter la lisibilité des textes et de mettre en évidence le lien qui existe entre eux, il conviendrait d’en harmoniser le vocabulaire.
Recommandation n° 17 : harmoniser le vocabulaire utilisé pour nommer les éléments figurant dans la BDES et la procédure de consultation et de négociation.
Les indicateurs chiffrés qui figuraient dans le RSC et sont désormais repris dans la BDES sont à la base de la consultation du comité d’entreprise et de la négociation entre les partenaires sociaux. Il est important d’utiliser le même vocabulaire à toutes les phases de la négociation collective en retenant l’expression de « situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise ».
Par ailleurs, avant la loi du 17 août 2015, les articles relatifs à la consultationet à la négociation (74) prévoyaient qu’elles devaient s’appuyer sur le rapport de situation comparée (RSC), composé d’une analyse avec des indicateurs chiffrés et d’un plan d’action élaboré par l’employeur comprenant les objectifs de l’année écoulée, ceux de l’année à venir, les moyens pour les atteindre et leur coût.
L’obligation faite à l’employeur de soumettre son plan d’action à la consultation et à la négociation a donc disparu. Cette modification risque d’avoir un impact négatif sur la qualité de la consultation et de la négociation.
Il convient à cet égard de rappeler le contenu du plan d’action : ce plan d’action détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir en matière d’égalité professionnelle, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant atteindre l’égalité professionnelle et évalue leur coût. Ce plan d’action doit porter sur un nombre minimum de domaines prévu par décret. En cas d’échec de la négociation, ce plan d’action pouvait être repris pour constituer le plan d’action unilatéral de l’employeur.
Or, aujourd’hui, l’article L. 2323-17 relatif à la consultation, s’il impose toujours de consulter le comité d’entreprise sur les informations et indicateurs chiffrés, prévoit que désormais la consultation portera sur l’accord ou à défaut le plan d’action. La référence à la consultation sur l’accord ou le plan d’action unilatéral de l’employeur n’a pas de sens au stade de la consultation. Comment consulter en étape n°2 sur la base d’un document conçu en étape n°3 ?
Il est en revanche nécessaire de soumettre à la consultation, non seulement les éléments figurant dans la BDES mais également le plan d’action de l’employeur. Il faudrait donc réintroduire la référence au plan d’action à l’article L. 2323-17 relatif à la consultation. De même, l’article L. 2242-8 relatif à la négociation devrait être modifié afin de prévoir l’obligation que celle-ci s’appuie sur les éléments d’information de la BDES mais aussi sur le plan d’action.
Recommandation n° 18 : introduire dans les éléments soumis par l’employeur à la consultation et à la négociation, le plan d’action de l’employeur et en définir le contenu.
L’ancien RSC contenait une analyse de la situation dans l’entreprise et un plan d’action, celui-ci doit aussi être soumis pour avis lors de la phase de consultation et lors de la négociation entre les partenaires.
Actuellement, l’article L. 2242-8 relatif à la négociation ne prévoit de porter à la connaissance des salarié.e.s que la synthèse du plan d’action unilatéral établi par l’employeur, à défaut d’accord. En revanche, cet article ne dit rien sur l’obligation d’informer les salarié.e.s sur l’existence et le contenu synthétique de l’accord, lorsqu’il en existe un. Il convient donc de préciser qu’en cas d’accord, la synthèse de l’accord doit être portée à la connaissance des salarié.e.s.
Recommandation n° 19 : porter à la connaissance des salarié.e.s non seulement la synthèse du plan d’action unilatéral de l’employeur en cas d’échec de la négociation mais aussi la synthèse de l’accord lui-même en cas de succès.
En cas d’échec de la négociation collective sur l’égalité professionnelle, l’employeur doit porter à la connaissance de ses salarié.e.s une synthèse du plan d’action unilatéral qu’il compte mettre en œuvre pour faire progresser l’égalité dans l’entreprise. Mais paradoxalement, rien n’est prévu en cas de succès et de signature d’un accord, celui-ci devrait logiquement aussi être porté à la connaissance de salarié.e.s.
Par ailleurs, la Délégation observe que de nombreux décrets d’application de la loi du 17 août 2015 n’ont pas encore été publiés, en particulier, les deux décrets attendus sur la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la consultation annuelle sur la politique sociale, qui devaient venir préciser le contenu des informations mises à disposition du comité d’entreprise. Or, cela devrait certainement entraîner des évolutions concernant le contenu de la BDES. De la même façon, le décret sur les indicateurs et objectifs de progression du plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes attendu pour décembre 2015 n’a toujours pas été publié. Ce retard accumulé est évidemment préjudiciable à une bonne application de la loi et ne permet pas d’apprécier le fonctionnement de la BDES et la manière dont elle peut être utilisée en remplacement du RSC. Cette situation rend difficile un bilan d’application des mesures voulues par le législateur et crée une forme d’insécurité juridique pour tous les acteurs.
Les décrets restant à paraître devront prendre en compte les demandes de « remise en ordre » de la Délégation.
2. Renforcer un droit du processus de négociation en veillant au principe de loyauté
M. Michel Miné lors de son audition par la délégation a soulevé des observations qui nous paraissent pertinentes.
La loi du 17 août 2015 a modifié un nombre non négligeable de règles organisant le processus de négociation. Un droit des accords collectifs a vu le jour en France, des dispositions déterminent ce sur quoi peuvent porter ces accords, ou comment deux accords peuvent s’articuler ensemble – accord d’entreprise et accord de branche par exemple. En revanche, le droit n’a pas précisé le processus de négociation, alors que certains de nos voisins l’ont fait. Or le contenu de l’accord qui sera signé in fine dépend évidemment des modalités de la négociation collective. Les rares dispositions existant dans ce domaine sont issues des lois dites « Auroux », et plus précisément de la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, et concernent le lieu de négociation, le nombre de réunions devant être tenues ainsi que les informations à communiquer. Au fil du temps, ce droit a été construit par la jurisprudence, les acteurs sociaux ayant, au cours de certaines négociations, saisi le juge afin d’obtenir des précisions.
Or, la loi du 17 août 2015 est revenue sur un certain nombre de progrès en matière de processus de négociation. Par exemple, la jurisprudence avait établi que, lorsqu’une négociation a lieu entre l’employeur et les organisations syndicales, les élu.e.s du personnel – le comité d’entreprise (CE) notamment – devaient être consulté.e.s afin de pouvoir participer à la discussion. Il avait également été décidé que le CE devait être consulté en cas de dénonciation d’un accord précédemment conclu.
Dans ces deux cas, la loi a supprimé sa consultation car selon l’étude d’impact qui était jointe au projet de loi, « l’intérêt de la consultation du comité d’entreprise n’apparaît plus comme avéré du fait du renforcement du lien entre comité d’entreprise et délégué syndical, et de la mesure de représentativité des organisations syndicales. Cette consultation apparaît comme une mesure formelle qui n’apporte pas d’effet utile à la procédure, dès lors que les acteurs de la négociation pour les salariés sont souvent élus au comité d’entreprise et que la mesure de l’audience des organisations syndicales est calée sur les résultats des élections du comité d’entreprise ». Le processus de la négociation d’entreprise s’en trouve amoindri, et les parties les plus faibles fragilisées ; cela va à l’encontre de la loyauté de la négociation.
Il convient de rappeler qu’en 1981, l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la convention n° 154 concernant la promotion de la négociation collective, dont l’une des recommandations prévoit que les négociateurs ont accès aux informations leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. Il serait bon que la France ratifie cette convention.
Si le droit du travail doit procéder de plus en plus de la négociation collective – sujet sur lequel les opinions peuvent diverger –, celle-ci doit se doter d’un véritable régime juridique. Ce droit ne doit pas simplement être celui des accords collectifs : le législateur doit poser des règles propres à favoriser la loyauté de la négociation, à faire que les armes soient égales pour tous et que la consultation soit authentique. Il s’agit d’éviter une situation où un acteur informerait l’autre de ses projets et où le second acteur n’aurait qu’une faible marge de manœuvre. Cette question apparaît essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie sociale.
Le titre II du projet de loi, intitulé « Favoriser une culture du dialogue et de la négociation », peut recueillir l’assentiment ; des dispositions relatives à la loyauté ainsi qu’à divers éléments de la concertation y sont d’ailleurs présentes.
De ce point de vue le droit à l’expertise légale pour l’information du comité d’entreprise revêt une particulière importance. En effet, la loi du 17 août 2015 a regroupé les consultations obligatoires (voir plus haut) mais a aussi renforcé le droit à l’expertise légale du comité d’entreprise, chacune des consultations obligatoires étant assortie d’un droit à l’expertise légale pour assister le comité d’entreprise en vue de sa consultation. Le choix de l’expert-comptable est opéré par un vote du comité et le financement est à la charge de l’entreprise. De ce point de vue, la loi du 17 août 2015 permet de sécuriser le travail de l’expert du comité d’entreprise notamment sur les questions de formation ou d’égalité professionnelle, pour lesquelles la jurisprudence n’était pas claire à ce jour. L’expert peut ainsi aider à préparer la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, faire un diagnostic sur la situation de l’entreprise au regard de l’égalité professionnelle et recommander des voies d’amélioration. Notons que si ce droit à l’expertise légale du comité d’entreprise concerne l’expert-comptable, le comité d’entreprise reste libre de faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux ; le recours à l’expert donnant lieu à une délibération du comité d’entreprise. Contrairement à l’expert-comptable, l’expert libre ne dispose que des documents détenus par le comité d’entreprise.
Un dernier point doit ici retenir l’attention : pour que les femmes ne soient pas exclues du processus de négociation, les horaires choisis par les partenaires sociaux doivent être compatibles avec la nécessité d’articuler la vie professionnelle et la vie personnelle.
Enfin, vos rapporteures soulignent le rôle important du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) dans sa fonction d’analyse et de conseil. Créée par le législateur en 1983 (75), il est sollicité régulièrement par le Gouvernement, depuis 2012, sur les différents textes et politiques mises en place en matière d’égalité professionnelle (loi sur le harcèlement sexuel, grande conférence sociale ou décret concernant les pénalités aux entreprises ne respectant pas leurs obligations, par exemple). Ses missions sont aujourd’hui définies par les articles D. 1145-1 et suivants du code du travail (76) (partie réglementaire), qui précisent également ses modalités de fonctionnement et sa composition. Sur ce dernier point, le CSEP comprend sept représentant.e.s de l’État, trois directeurs.trices d’établissement public (Pôle Emploi, ANACT, AFPA), neuf représentants des salarié.e.s, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national (CGT, CFDT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC), neuf représentant.e.s des employeur.e.s (notamment du MEDEF, UPA et CGPME), ainsi que neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience (article D. 1145-7).
Outer la mission de nature juridique, de consultation préalable sur la législation, le CSEP a vu ses missions étendues et son fonctionnement modifié. Par décret du 30 avril 2013 (77), le champ des travaux du CSEP a ainsi été élargi à l’articulation des temps, les modes de garde, les congés familiaux, les systèmes de représentation dans l’entreprise, le harcèlement sexuel et moral, la formation initiale et continue et la diversification des choix professionnels des filles et des garçons, la création et la reprise d’entreprises par les femmes. Par ailleurs, ses missions d’évaluation des politiques d’égalité professionnelle ont été renforcées ; un rapport est remis tous les deux ans au CSEP par le/la ministre chargé des droits des femmes. Enfin, le CSEP est également une force de proposition, ses membres peuvent faire des recommandations d’actions et de mesures pour améliorer l’égalité professionnelle. Pour cela, ils peuvent se fonder sur des recherches.
Le Conseil dispose désormais d’une secrétaire générale qui a pour mission de proposer un programme de travail, d’animer les travaux des commissions et groupes de travail du CSEP et de rendre compte de l’état d’avancement du programme décidé. Brigitte Grésy a été nommée à cette nouvelle fonction et, à ce titre, est membre de droit du HCEfh .Par décret en date du 5 juin 2015 (78), le CSEP a été renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015. Au regard du rôle essentiel du CSEP pour le législateur, en particulier grâce à ses avis détaillés et de grande qualité, vos rapporteures formulent la recommandation suivante.
Recommandation n° 20 : renforcer le positionnement et les moyens du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et prévoir la publicité systématique de ses travaux.
IV. SÉCURISER LES PARCOURS, ADAPTER LE DROIT DU TRAVAIL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ET MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL : DES ENJEUX AUSSI EN TERMES D’ÉGALITÉ
Lors de son audition par la Délégation (79), la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Mme Myriam El Khomri, a souligné que « ce projet comporte des avancées importantes qui profiteront aux femmes », en évoquant en particulier le compte personnel d’activité (A), une avancée majeure pour la sécurisation des parcours des salarié.e.s, et les dispositions en faveur du télétravail, ainsi que le droit à la déconnexion (B) et, plus largement sur ce texte, que « la politique bénéficiera à toutes les personnes éloignées des emplois stables et donc aux femmes ». Il convient néanmoins de veiller à la prise en compte de la pénibilité et des risques de santé dans les métiers à prédominance féminine, dans le cadre notamment de la réforme de la médecine du travail engagée par ce projet de loi (C).
A. LA CRÉATION DU COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ, UNE AVANCÉE SOCIALE MAJEURE POUR SÉCURISER LES PARCOURS
Le titre III du projet de loi, loi, intitulé « Sécuriser les parcours et construire les bases d’un nouveau modèle social à l’ère du numérique », comporte deux chapitres, dont le premier porte sur la création du compte personnel d’activité.
1. La création du compte personnel d’activité
Depuis le début du quinquennat, les salarié.e.s ont été doté.e.s de nouvelles protections, attachées à la personne et non à l’emploi afin de les accompagner tout au long de leur parcours professionnel, à travers notamment la création du compte personnel de formation (CPF), les droits rechargeables à l’assurance chômage, la généralisation de la complémentaire santé et la portabilité de la prévoyance.
S’inscrivant dans le prolongement de ces avancées sociales, l’article 21 du projet de loi prévoit la mise en place du compte personnel d’activité (CPA), qui vise à donner à chaque travailleur.se la capacité de construire son parcours professionnel dans un monde du travail en constante évolution. Le CPA ne concernera pas que les salariés mais l’ensemble des actifs et actives, y compris les agent.e.s publics (article 22) et les travailleur.se.s indépendant.e.s, garantissant ainsi la portabilité des droits, quels que soient les changements d’emploi et de statut. Il s’agit ainsi d’une nouvelle manière de protéger les actives et les actifs, avec une entrée en vigueur du CPA prévue au 1er janvier 2017.
Conformément à la loi du 17 août 2015 précitée (article 38), une négociation interprofessionnelle a été engagée, à l’issue de laquelle les partenaires sociaux ont abouti à une position commune le 8 février 2016. Si cette position n’a pas encore de validité, faute de signature d’une organisation représentative d’employeurs, le projet de loi en tient compte pour définir le contenu du CPA.
Sans entrer dans le détail de ce nouveau dispositif, il convient de préciser que le CPA comprendra deux dispositifs existants, le compte personnel de formation (CPF), qui fait l’objet de plusieurs modifications, et le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), ainsi qu’un nouveau « compte engagement citoyen », qui valorisera l’engagement en tant que réserviste, l’exercice de responsabilités associations importantes ou le rôle de maître d’apprentissage. Comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, le Gouvernement a ainsi fait le choix de la mise en œuvre d’une politique pragmatique : l’étape du 1er janvier 2017 « repose sur un socle réaliste (le CPF et le C3P), renforcé de la valorisation de l’engagement citoyen porté par l’appui et le financement des pouvoirs publics, tout en ouvrant sur des objectifs ambitieux reposant sur des droits et des publics nouveaux ».
Le CPA pose ainsi les bases d’un droit universel à la formation, bénéficiant en premier lieu aux personnes sans diplôme. Les jeunes sorti.e.s sans diplôme du système éducatif se verront doter d’un capital formation permettant de bénéficier financer le nombre d’heures nécessaires à la réalisation d’une formation qualifiante, ce droit relevant de la compétence des régions. Pour les salarié.e.s peu qualifiés, les droits à la formation seront augmentés de 24 à 40 heures par an, avec un plafond porté de 150 heures à 400 heures, ce qui permettra à ces salarié.e.s d’accéder à un niveau supplémentaire de qualification au bout de dix ans.
Afin de renforcer les capacités d’action des personnes pour construire leurs parcours professionnels, de nouveaux usages des droits sont créés. Outre les formations aujourd’hui éligibles au CPF, les titulaires du CPA pourront ainsi accéder à l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à l’accompagnement à la création d’entreprise et au bilan de compétences. Le compte personnel de formation sera étendu aux travailleurs indépendants (80). Chaque titulaire sera informé des droits inscrits sur son compte et pourra les utiliser via un service en ligne gratuit géré par la Caisse des dépôts et consignations. Le CPA donnera également accès à une offre de services associés, ayant trait notamment à l’information sur les droits sociaux et à la sécurisation des parcours professionnels, qui s’appuie sur des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.
Par ailleurs, l’article 22 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à l’application du CPA aux agents publics : ainsi, chaque agent public sera doté d’un CPA, qui garantira la portabilité des droits entre employeurs publics et en cas de changements entre secteur public et secteur privé (81).
2. Les recommandations de la Délégation en vue d’améliorer l’accès des salarié.e.s à temps partiel à la formation dans le cadre du CPA
Lors de son audition par la Délégation, la ministre Myriam El Khomri a souligné que le compte personnel d’activité (CPA), « qui permettra à tous les actifs – hommes, femmes, à la recherche d’un emploi, salariés, indépendants ou entrepreneurs – de bénéficier des mêmes droits et des mêmes protections, indépendamment de son statut », représente une « avancée sociale majeure, et qui bénéficiera en particulier aux femmes qui présentent des parcours professionnels plus accidentés et qui sont, plus souvent que les hommes, en situation de précarité ». Au cours des travaux de la Délégation, deux aspects ont été évoqués en lien avec l’impact de ce nouveau dispositif sur l’égalité femmes-hommes.
● Le contenu du compte personnel d’activité (CPA)
Si l’étude d’impact ne comporte aucune donnée sexuée, ni même aucun développement relatif aux femmes, vos rapporteures rappellent, d’une part, que l’étude d’impact de la loi du 17 août 2015 précitée (qui prévoyait l’ouverture d’une négociation interprofessionnelle sur ce point), que « la construction du CPA devra tenir compte de l’objectif » d’égalité entre les femmes et les hommes (82), et, d’autre part, que le rapport présenté par Mme Sandrine Mazetier, rapporteure de la Délégation en mai 2015, soulignait les enjeux en termes d’égalité de ce dispositif, en formulant une recommandation en ce sens (83).
Par ailleurs, au cours des auditions menées sur le présent projet de loi, Mme Marie-Andrée Séguin, secrétaire confédérale de la CFDT chargée de l’égalité professionnelle, a rappelé que « la CFDT a défendu la mise en place d’un dispositif permettant de regrouper des droits attachés à la personne, quel que soit son statut. Aujourd’hui, les parcours professionnels sont hachés, soit volontairement – la personne souhaite changer de vie et donc se réorienter – soit de façon subie, à la suite d’un licenciement notamment. (…) Le CPA est donc un bon outil, mais il reste à construire. Selon nous, il devrait s’appuyer sur le principe d’un accompagnement global portant sur l’ensemble des problématiques de sécurisation : projet professionnel, accès au logement, garde d’enfants, congés, etc. En effet, les nouveaux modes de travail engendrent des besoins, d’où l’intérêt de garanties offertes par un compte personnel d’activité tout au long du parcours de vie. ».
Mme Carole Cano a également souligné que « pour la CFE-CGC, il est nécessaire d’aller plus loin dans la constitution de droits nouveaux pour les salariés dans le cadre de ce nouveau dispositif, particulièrement en matière d’égalité hommes-femmes et de conciliation des temps de vie. Cette évolution pourrait concerner la création d’un compte temps généralisé à l’ensemble des salariés, transférable tout au long de la carrière, afin d’offrir des marges de manœuvre aux salariés en termes d’équilibre des temps de vie – temps de travail, temps familial, temps de formation, temps d’engagement associatif, temps syndical et, éventuellement, temps politique ». Selon elle, « en rendant possible une meilleure répartition des temps tout au long de la vie, un tel dispositif offrirait de nombreux avantages (84) », notamment pour « donner plus d’autonomie et de liberté d’action aux personnes », et qu’ « en offrant des possibilités nouvelles aux personnes en matière de répartition des temps sociaux tout au long de la carrière, le CPA pourrait favoriser l’égalité professionnelle ».
Vos rapporteures soulignent l’intérêt de poursuivre la réflexion sur ces questions et notent au demeurant, concernant l’articulation des temps de vie (qui constituait le « scénario 2 » du rapport de France Stratégie sur le CPA, publié en octobre 2015), que les partenaires sociaux ont prévu en 2016 des discussions concernant l’harmonisation des droits aux différents types de congés et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Concernant le contenu du CPA, vos rapporteures rappellent par ailleurs que la Délégation, dans le cadre de ses travaux sur le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite (85), avait salué comme une « avancée majeure » la création du compte personnel de prévention de la pénibilité, en attirant toutefois « l’attention sur la prise en compte des facteurs de pénibilité dans les emplois majoritairement occupés par des femmes » et formulé des recommandations en ce sens (86). Cette question rejoint certaines interrogations relatives à l’impact de la réforme de la médecine du travail prévue par le projet de loi (cf. infra) ainsi que les enjeux liés à la classification des métiers.
● Les modalités d’abondement du compte personnel de formation (CPF), qui sera intégré au CPA, pour les salarié.e.s à temps partiel
Aujourd’hui, le compte personnel de formation est alimenté en fonction des heures travaillées : ainsi, un.e salarié.e à temps plein acquiert 24 heures par an jusqu’à un crédit de 120 heures, puis 12 heures par an, dans la limite de 150 heures. S’agissant des salarié.e.s à temps partiel, une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée, en application des dispositions prévues par l’article L. 6323-11 du code du travail, inchangées par le présent projet de loi.
La loi du 5 mars 2014 précitée a consacré l’existence d’un financement spécifiquement dédié au CPF à hauteur d’au moins 0,2 % de la masse salariale dans toutes les entreprises de 10 salarié.e.s et plus. L’étude d’impact précise que le CPF a fait l’objet de 2,8 millions de comptes activés et 280 000 personnes ont d’ores et déjà mobilisé leurs heures en vue d’un projet de formation professionnelle, ce qui représente 4 millions d’heures. Elle ne comporte en revanche aucune donnée sexuée et, au-delà, ne comporte aucun développement relatif aux femmes concernant le CPA.
Évoquant les modalités d’abondement du compte pour les salariés à temps partiel, Mme Sophie Binet, responsable de la commission égalité de la CGT, a estimé qu’« il faut prévoir un abondement du CPA pour ouvrir des droits sociaux aux salariés à temps partiel sur la base d’un temps plein. Nous sommes favorables au financement du dispositif par l’employeur – avec éventuellement des dispositifs de mutualisation au niveau de la branche, pour ne pas défavoriser les TPE-PME –, de façon à renchérir le coût des temps partiels et à inciter à recruter sur des temps pleins ou tout au moins sur des temps supérieurs à 24 heures (87) ».
Cette question du prorata temporis avait déjà été évoquée dans le cadre des travaux menés par la Délégation en janvier et février 2014 sur le projet de loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale. Sous l’impulsion de la rapporteure, Mme Ségolène Neuville, la Délégation s’était ainsi prononcée en faveur d’une modification de ce texte pour donner aux salarié.e.s à temps partiel les mêmes droits en matière d’accès à la formation (88).
Interrogée sur ce point, la ministre Myriam el Khomri a notamment fait valoir les difficultés qu’il y aurait à distinguer le temps partiel subi ou choisi. D’autres pistes pourraient également être envisagées sur ce point, notamment à des abondements complémentaires au niveau des branches ou encore, plutôt qu’un alignement total des droits avec les temps complets, une proratisation avec une majoration de 20 ou 30 % (par exemple, non pas 12 heures, au lieu de 24, pour un.e salarié.e à mi-temps, mais 15 heures par exemple). Une autre piste encore pourrait être de moduler le montant du financement dédié au financement du CPF (au moins 0,2 % de la masse salariale dans toutes les entreprises de plus de 10 salarié.e.s), notamment pour celles qui recourent de façon importante aux CDD et/ou aux temps partiels.
En tout état de cause, vos rapporteures soulignent la nécessité d’améliorer les droits à la formation pour les salarié.e.s à temps partiel et d’examiner l’ensemble des moyens envisageables en ce sens, et ce d’autant plus, que selon l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) constate une baisse du nombre de femmes formées, alors que le volume total de stagiaires a augmenté en 2014.
NOMBRE ET POURCENTAGE DE FEMMES FORMÉES
2012 |
2013 |
2014 |
29,3 % |
30,6 % |
28,9 % |
43 109 |
42 957 |
40 825 |
Source : rapport du Gouvernement au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur le bilan des actions mises en œuvre en matière d’égalité professionnelle entre 2012 et 2015 (juin 2015)
La Délégation sera par ailleurs attentive à la mise en œuvre du compte personnel d’activité, dont le suivi requiert la publication régulière de données sexuées, et sur chacune de ses composantes, notamment le CPF et le C3P.
Recommandation n° 21 : améliorer les modalités d’abondement du compte personnel de formation (CPF), qui sera intégré dans le compte personnel d’activité (CPA), pour les salarié.e.s à temps partiel.
Enfin, en matière d’accompagnement et de sécurisation des parcours, vos rapporteures saluent la généralisation de la « Garantie jeunes », prévue par l’article 23 du projet de loi, en regrettant, là encore, de ne pouvoir disposer de données sexuées quant aux bénéficiaires de ce dispositif, lancé à titre expérimental en octobre 2013, et qui couvrirait aujourd’hui environ 35 000 jeunes.
B. TÉLÉTRAVAIL ET « DROIT À LA DÉCONNEXION » : LES TRAVAUX RÉCENTS DE LA DÉLÉGATION ET LES AVANCÉES DU PROJET DE LOI
La Délégation aux droits des femmes a adopté, le 15 décembre 2015, un rapport d’information sur le projet de loi pour une République numérique (89), et plus largement sur les femmes et le numérique, qui comportait notamment une analyse approfondie du télétravail et évoquait par ailleurs les risques d’envahissement de la vie privée par la sphère professionnelle liés aux technologies digitales, en soulignant la nécessité d’un droit à la déconnexion (90).
À cet égard, le titre III du projet de loi, intitulé « Sécuriser les parcours et construire les bases d’un nouveau modèle social à l’ère du numérique », comporte précisément des dispositions sur le télétravail et le droit à la déconnexion.
Ce principe a été pris en compte de manière parcellaire par les partenaires sociaux dans le cadre d’accords interprofessionnels, notamment celui du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle (91) Ce principe est aussi partiellement reconnu par les tribunaux : dans un arrêt du 17 février 2004 la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi estimé que : « le fait de n’avoir pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier un licenciement disciplinaire pour faute grave. »
Conformément à la feuille de route issue de la Conférence sociale d’octobre 2015 qui souligne l’importance d’explorer les voies de la reconnaissance d’un droit à la déconnexion, l’article 25 du projet de loi prévoit l’organisation d’une négociation dans les entreprises sur les modalités d’exercice d’« un droit à la déconnexion », dans l’objectif de mieux protéger les salarié.e.s dont les conditions de travail sont impactées par le développement des outils du numérique. Il s’agit ainsi de trouver avec les partenaires sociaux le juste équilibre entre activité professionnelle, droit à la déconnexion et vie personnelle.
Cette question sera abordée dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (cf. supra). À défaut d’accord, l’employeur.e définira les modalités d’exercice par le/la salarié.e de son droit à la déconnexion, et les communiquer par tout moyen aux salarié.e.s. Dans les entreprises d’au moins 300 salarié.e.s, ces modalités feront l’objet d’une charte, après avis des institutions représentatives du personnel, afin de prévoir notamment les actions de formation et de sensibilisation des salarié.e.s et de l’encadrement à l’usage de ces outils numériques.
Les modalités d’exercice de ce droit seront évidemment variables selon les entreprises, leurs organisations, leurs enjeux leur mode de fonctionnement et celui de leur management. Chaque entreprise devra donc construire son propre système de gouvernance en fonction de sa culture, de ses métiers, et de ses salarié.e.s.
L’étude d’impact du projet de loi souligne à cet égard qu’ « en favorisant une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, cette mesure aura des conséquences positives sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises ». Dans ce sens, la ministre Myriam El Khomri a souligné lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes, que le droit à la déconnexion « permettra de mieux tracer la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle à l’heure du numérique. C’est un dispositif innovant et qui souligne la volonté du Gouvernement de préserver la vie en dehors du travail, pour les femmes comme pour les hommes ».
2. Le télétravail et le travail à distance
L’objectif du projet de loi est de favoriser le développement du télétravail, en invitant les partenaires sociaux à discuter de ce sujet dix ans après l’ANI de 2006 (92), à un moment où les plateformes collaboratives, le coworking et les travailleurs nomades n’existaient pas encore. Il s’agit en effet de prendre en compte les évolutions de la société et des outils numériques, les nouveaux modes de travail, l’articulation entre vie privée et vie personnelle, outre le droit à la déconnexion.
Les partenaires sociaux doivent se saisir à nouveau de ce sujet pour favoriser les bonnes pratiques, réguler celles qui le sont moins, s’accorder sur des éléments de prospective à même d’accompagner la transformation numérique et permettre des expérimentations – sans définir au niveau de la loi un cadre unique du télétravail et du travail à distance, pour tenir compte de la diversité des situations vécues dans les entreprises dans l’organisation collective du travail.
En cohérence avec la place éminente donnée au dialogue social par le projet de loi, la mesure retenue prévoit qu’une concertation sur le sujet doit être engagée avant le 1er octobre 2016 avec les partenaires sociaux, qui pourront s’ils le souhaitent ouvrir une négociation. Ils pourront ainsi définir le cas échéant le cadre conventionnel qui leur paraît le plus adapté à la réalité économique et sociale des entreprises. Ce n’est que dans un second temps, et si cela s’avère nécessaire, qu’un nouveau cadre législatif qu’il reste à définir pourrait être inséré dans le code du travail, selon l’étude d’impact.
Cette concertation portera également sur l’évaluation de la charge de travail des salarié.e.s en forfait jours, la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques pour mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l’opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés. Cette phase de dialogue social pourrait être l’occasion de recenser de bonnes pratiques en matière d’organisation du travail à distance et d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Concernant cet article, l’étude d’impact du projet de loi, dont vos rapporteures regrettent qu’elle ne comporte pas de données sexuées, souligne qu’« en favorisant une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, cette mesure aura des conséquences positives sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises », et mentionne par ailleurs que les salarié.e.s pourraient « réaliser des économies de carburants ou de garde d’enfants ». Évoquant des « avancées importantes qui profiteront aux femmes », la ministre Myriam El Khomri a évoqué en particulier ces « dispositions en faveur du télétravail qui permettront de mieux prendre en compte certaines nouvelles modalités de travail et apporteront plus de souplesse aux salariés, tout en préservant la dimension collective du travail ».
Vos rapporteures saluent l’introduction, dans ce projet de loi, de dispositions relatives au droit à la déconnexion, qui avait été évoqué dans le rapport adopté par la Délégation aux droits des femmes en décembre 2015, lequel analysait également le télétravail et ses enjeux.
C. LA RÉFORME DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
1. Les dispositions prévues par le projet de loi
Le titre V du projet de loi, intitulé « Moderniser la médecine du travail », repose sur trois axes principaux :
– consacrer au niveau de la loi, de manière claire, les principes ayant vocation à régir la surveillance individuelle de l’état de santé des travailleurs, dans une visée préventive et en vue de favoriser leur maintien en emploi ;
– adapter le suivi médical des travailleurs de nuit et celui des salarié.e.s en CDD et des salariés temporaires ;
– préciser les conséquences de l’inaptitude sur le contrat de travail et le reclassement du salarié (93).
L’article 44 réforme ainsi le suivi des salarié.e.s par la médecine du travail, pour mieux cibler les moyens sur les salarié.e.s exposé.e.s à des risques particuliers. Il supprime la visite médicale d’aptitude systématique à l’embauche renforce le suivi personnalisé des salarié.e.s tout au long de leur carrière, en reconnaissant ce droit aux salariés intérimaires et titulaires de contrats courts. Faisant suite à la loi du 17 aout 2015 précitée et au rapport remis par le député Michel Issindou (94), la réforme part du constat d’une perte d’efficacité des services de santé au travail (SST) en raison de la baisse démographique des médecins du travail. Le Conseil national de l’Ordre des médecins constate ainsi une baisse annuelle moyenne de 11,2 % de médecins du travail au niveau national sur les 7 dernières années avec d’importantes disparités au niveau des territoires. De ce fait, un écart s’est creusé entre les obligations réglementaires de visites médicales et le nombre de celles réellement effectuées.
Les nouvelles modalités de suivi individuel de l’état de santé des salarié.e.s
« Le projet de loi prévoit une nouvelle architecture des visites médicales :
– Il ancre dans la loi le principe selon lequel tout salarié, quel que soit son contrat de travail bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé. Celui-ci est réalisé par le médecin du travail et les professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail (notamment le collaborateur médecin et l’infirmier). L’effectivité de ce suivi individuel de l’état de santé des salariés sera confortée grâce à l’allocation de ces nouvelles ressources.
– Ce suivi commence par une visite d’information et de prévention réalisée après l’embauche par l’un des professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire.
– Ces visites permettent d’identifier des salariés pour lesquels le médecin du travail va proposer un suivi renforcé, que les risques particuliers résultent de leur état de santé ou des caractéristiques de leur poste.
– Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou celles de leurs collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, bénéficient d’une surveillance médicale renforcée de leur état de santé, qui comporte un examen d’aptitude réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Cet examen est indispensable dans un objectif de prévention des risques graves d’atteinte à la santé ou la sécurité. Il est réalisé par le médecin du travail sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin, ce qui peut être le cas, par exemple dans le secteur des transports.
– Pour protéger la santé d’un salarié, le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d’aménagement de poste. Cette possibilité existe déjà. Le projet en clarifie les termes. Par ailleurs le projet de loi valorise les échanges du médecin du travail avec les salariés et l’employeur. L’aide apportée à l’employeur pour mettre en œuvre les propositions du médecin est formalisée.
– La déclaration d’inaptitude devient explicitement la solution de dernier recours.En effet, l’inaptitude n’intervient qu’après une étude de poste et des échanges avec le salarié et l’employeur que le médecin du travail constate que l’aménagement de poste ne suffit plus ou que le changement de poste devient indispensable pour préserver la santé du salarié.
Le projet de loi conforte donc la place du médecin du travail dans ses missions, d’autant plus qu’elle oriente prioritairement son action sur les salariés exposés aux risques les plus importants, justifiant la mobilisation des compétences et du savoir-faire de cette discipline de spécialistes. Ce faisant, il est de nature à renforcer l’attractivité de la discipline, seul réel levier à même d’inverser la tendance démographique actuelle. »
Source : étude d’impact du présent projet de loi (mars 2016)
La réforme de la médecine du travail vise ainsi à mieux prioriser la réalisation des visites d’embauche ainsi que le suivi des salarié.e.s affecté.e.s à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité. Si le projet de loi ne précise pas quels sont les « risques particuliers », un décret en Conseil d’État définira les modalités d’identification des postes à risque.
2. Les inquiétudes exprimées concernant l’impact de la réforme et la santé des femmes dont les risques sont toujours minorés
Les auditions par la Délégation de représentant.e.s d’organisations syndicales et d’associations féministes ont mis en lumière des inquiétudes quant à l’impact de la réforme de la médecine du travail sur les femmes, s’agissant principalement de son premier axe relatif aux modalités de suivi individuel de l’état de santé des salarié.e.s. M. Saïd Darwane, conseiller national de l’UNSA et membre du CSEP, a ainsi souligné que « le suivi est concentré sur les seuls salariés à risque [et] la visite d’aptitude d’embauche est supprimée dans le projet de loi. Or la pénibilité et les risques professionnels des métiers à prédominance féminine sont sous-évalués, si bien que ces métiers risquent de ne plus bénéficier du suivi médical. (…) Ensuite, sur les conditions de travail, nous préconisons la mise en place d’indicateurs sur les risques professionnels et la pénibilité due au caractère répétitif des tâches. On sait en effet que les tâches répétitives à prédominance féminine sont nombreuses. »
À cet égard, l’ANACT a mis en place le projet « Genre, santé et conditions de travail » qui a pour mission d’analyser les données de santé au travail au regard du genre. Dans ce cadre, le rapport publié en 2014 (95) relève qu’entre 2001 et 2012 les accidents du travail ont augmenté pour les femmes (96) (+20,3 %), ainsi que les accidents de trajet (+15 %) et les maladies professionnelles reconnues (+169,8 %). Si l’on regarde par secteur, ce sont les activités de types santé, nettoyage, travail temporaire qui enregistre la progression la plus forte (97).
On observe aussi, par exemple, une plus grande exposition des femmes aux risques psychosociaux, ou aux troubles musculo-squelettiques (déclarés à 58 % par des femmes, soit un risque d’exposition de 22 % supérieur à celui des hommes). On pourrait d’ailleurs évoquer aussi le partage inégal des tâches au sein des couples et la « double journée » des femmes, qui en soi constituent une source de tensions, voire de risques pour la santé physique et psychique.
En tout état de cause, il existe une exposition différente entre les femmes et les hommes liée à l’exercice de métiers différents, mais aussi une sous-évaluation de l’exposition aux risques professionnels des femmes dans leurs emplois, d’où l’importance de dispositifs de prévention adaptés et efficaces dans les secteurs à prédominance féminine. A contrario, la pénibilité des métiers à prédominance masculine, tels que le bâtiment et les travaux publics, est de fait mieux reconnue.
Qu’il s’agisse du compte personnel de prévention de la pénibilité (cf. supra) ou de la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail prévue par le projet de loi, vos rapporteures soulignent la nécessité de prendre en compte les risques de santé et la pénibilité dans les métiers majoritairement exercés par des femmes, par exemple s’agissant des aides à domicile (qui portent des personnes âgées, avec aussi différents trajets dans la même journée, etc.), secrétaires (troubles musculo-squelettiques) ou encore des caissières, qui porteraient en moyenne jusqu’à 5 tonnes par jour, selon la contribution d’une organisation syndicale au rapport précité du CSEP.
La Délégation aux droits des femmes s’était d’ailleurs déjà saisie de cette question dans le cadre notamment de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, dont l’article 8 a prévu, à l’initiative de la Délégation, que « Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l'application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail » (dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité). « Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes. »
En outre, la question de la santé au travail avait fait l’objet d’une étude approfondie dans le cadre du projet de loi relatif à la santé, dont la Délégation avait également été saisie. À son initiative, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a notamment permis d’introduire de nouvelles dispositions dans le code du travail (98) prévoyant le recueil de données sexuées dans le rapport annuel d’activité établi par le médecin du travail.
Cette avancée récente devrait permettre de mieux suivre l’impact de la réforme de la médecine du travail prévue par le présent projet de loi, et notamment le nombre de femmes et d’hommes affecté.e.s à des postes présentant des risques postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou celles de leurs collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, et qui bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée.
Enfin, au cours des auditions des syndicats, il a été souligné l’importance du rôle des médecins du travail, et notamment concernant les violences sexistes et sexuelles au travail, et corrélativement de leur formation dans ce domaine et concernant aussi la pénibilité dans les secteurs à prédominance féminine.
Recommandation n° 22 : veiller à la prise en compte des risques pour la santé et la sécurité des salarié.e.s dans les métiers majoritairement exercés par les femmes dans le cadre de la réforme de la médecine du travail.
V. COMPLÉTER CE TEXTE POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, HARCÈLEMENTS ET AGISSEMENTS SEXISTES
Lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes le 16 juin 2015, le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, avait indiqué que « sur le harcèlement sexuel au travail, nous avons réalisé une enquête dont les résultats ont été publiés en mars 2014. Comme le montre cette enquête inédite, 20 % des femmes actives déclarent avoir été confrontées personnellement à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle, 20 % des Français déclarent connaître au moins une personne ayant été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail, et 30 % des personnes concernées déclarent avoir gardé un silence total à la suite de ces faits (99) ».
À cet égard, vos rapporteures formulent une série de propositions pour lutter plus efficacement contre le harcèlement sexuel ou moral et les discriminations à raison du sexe ou de la parentalité (A) mais aussi les agissements sexistes (B).
A. LUTTER PLUS EFFICACEMENT CONTRE LES HARCÈLEMENTS, SEXUEL OU MORAL, ET LES TRAITEMENTS DISCRIMINATOIRES
1. Harmoniser les règles de preuve pour les actions en justice engagées suite à un harcèlement, sexuel ou moral, ou à une discrimination
Comme l’a souligné l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), dont la déléguée générale a été entendue par la Délégation (100), dans une procédure prud’homale, il est le plus souvent difficile pour la partie demanderesse d’obtenir des preuves directes, qui se trouvent entre les mains de la défense (par exemple, les bandes d’enregistrement, échanges de mails professionnels, etc.). C’est typiquement le cas lorsqu’une salariée est brutalement arrêtée par son médecin traitant et ne peut plus retourner au travail, et c’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’établir la preuve d’une discrimination ou d’un harcèlement sexuel qui se caractérisent par leur opacité.
C’est pourquoi « le droit européen a prévu une répartition de la charge de la preuve entre salarié.e.s et employeurs afin d’établir un équilibre concernant les actions en reconnaissance d’une discrimination, et partant pour rendre les recours efficaces, transposée en droit interne », selon l’AVFT (101).
En droit interne, l’article L. 1134-1 du code du travail, relatif aux actions en justice, fixe les règles de preuve en matière de discriminations de la façon suivante : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
En revanche, l’article L. 1154-1 du même code relatif à la preuve du harcèlement sexuel ou moral, prévoit que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il y a donc une différence sensible de rédaction concernant les règles entre le contentieux des discriminations et celui du harcèlement, qu’il soit sexuel ou moral. En effet, si les formulations « laisser supposer » et « permettre de présumer » sont très proches, il n’en va pas de même concernant le fait que la personne « présente » ou « établit » des « éléments de faits » ou « des faits ». Or ceci peut avoir une incidence sur les chances de succès d’une procédure judiciaire.
En effet, il est de plus en plus fréquent, selon l’AVFT, qu’au cours des procédures sociales pour harcèlement sexuel, les employeurs arguent de cette différence de rédaction pour faire valoir la nécessité de rapporter des preuves directes du harcèlement sexuel (« les faits »), là où les victimes d’autres discriminations n’auraient qu’à établir un faisceau de présomption composé de preuves indirectes (« les éléments de faits »), alors même que l’intention du législateur européen était précisément que les salarié.e.s n’aient pas à rapporter une preuve complète. Outre le fait que cette différence n’apparaît pas justifiée dans la mesure où le harcèlement sexuel n’est pas plus simple à prouver qu’une différence de traitement discriminatoire, elle est aussi illégale selon cette association, en ce qu’elle constitue notamment une violation du principe d’équivalence (102).
Il conviendrait par conséquent d’aligner le régime probatoire du harcèlement sexuel sur celui des discriminations, ce qui permettrait de renforcer l’arsenal juridique civil en matière de harcèlement sexuel, et de compenser, le cas échéant, l’« ineffectivité chronique de la répression (au sens pénal) » évoquée par l’AVFT. La mission d’évaluation précitée de Mme Pascale Crozon et de M. Guy Geoffroy, sur la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, pourrait utilement faire la lumière sur ce dernier point et confirmer ou non cette analyse.
Recommandation n° 23 : harmoniser les règles de preuve en matière de discrimination et de harcèlement sexuel ou moral.
→ en modifiant l’article L. 1154-1 du code du travail, relatif à la preuve du harcèlement sexuel ou moral, en prévoyant que la personne candidate à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le/la salarié.e « présente des éléments de fait laissant supposer » l’existence d’un harcèlement sexuel ou moral (et non plus « établit des faits »), en reprenant ainsi la formulation retenue à l’article L. 1134-1 concernant les discriminations.
2. Prévoir l’obligation pour l’entreprise de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement sexuel ou moral
Dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, l’Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté des dispositions visant à généraliser à tous les licenciements fautifs résultant de discrimination ou de harcèlement l’obligation de prévoir le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par le/la salarié.e injustement licencié.e, dans la limite de six mois d’indemnités.
Dans le droit actuel, cette mesure s’applique à une liste limitative de cas : lorsque ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (103) ou lorsqu’un licenciement collectif pour motif économique est intervenu sans respecter la procédure de validation ou d’homologation prévue (104) ; lorsqu’un licenciement est intervenu en représailles d’une action en justice intentée par un salarié s’estimant victime d’une discrimination (105).
En dehors de ces situations, le juge ne peut pas ordonner ce remboursement. Or il existe de nombreux autres cas de licenciements fautifs qui s’avèrent être des actes discriminatoires et qui sont reconnus comme tels lorsque les prud’hommes en ont été saisis. Si tou.te.s les salarié.e.s sont potentiellement concerné.e.s, les femmes en sont les principales victimes, en particulier du harcèlement sexuel.
L’article 7 de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, telle qu’adoptée définitivement par le Parlement en juillet 2014, permettait précisément de combler cette lacune. Cependant, cet article avait été introduit en deuxième lecture au Sénat, malgré la règle de l’entonnoir (106), et a de ce fait été censuré par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 31 juillet 2014.
Lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes en juin 2015, le Défenseur des droits a soutenu clairement « le rétablissement de l’article 7 et de l’article 10 de la loi du 4 août 2014, censurés par le Conseil constitutionnel (…), dispositions (…) dont l’une prévoyait le remboursement par l’employeur des indemnités versées par Pôle emploi, sanction à [ses] yeux efficace ».
Recommandation n° 24 : prévoir l’obligation pour l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la personne licenciée suite à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel.
→ En complétant le présent projet de loi par un article additionnel reprenant les dispositions qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2014 dans le cadre de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 7, censuré uniquement pour des raisons de procédure parlementaire).
3. Instituer un plancher d’indemnisation pour les licenciements discriminatoires, liés notamment au sexe, à la grossesse ou à la situation familiale, et licenciements consécutifs au harcèlement sexuel
Lors de son audition par la Délégation, le 23 mars 2016, l’AVFT a également proposé de réintroduire, dans le cadre du présent projet de loi, un autre article de la loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes telle qu’adoptée par le Parlement en juillet 2014, et qui avait été également censuré par le Conseil constitutionnel, pour des raisons de procédure parlementaire (méconnaissance de la « règle de l’entonnoir » évoquée plus haut).
Cet article 10 de la loi visait à étendre aux licenciements jugés discriminatoires, liés à la grossesse notamment ou à des faits de harcèlement sexuel, l’octroi d’une indemnité équivalente à au moins douze mois de salaire. Il était aussi prévu que cette indemnité soit due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du même code. Il convient par ailleurs de rappeler que cette procédure existe actuellement lorsque la nullité du licenciement découle de la violation de la procédure de licenciement économique, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail (107).
L’article 10 précité était issu d’un amendement qui avait été soutenu par le Gouvernement, la ministre des Droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ayant souligné en séance qu’ « au-delà de la protection concrète que cela assurera aux salariées en question, l’adoption de ces mesures contribuera à envoyer un message de fermeté en matière de lutte contre le harcèlement et de protection des intérêts de la femme enceinte. Or, nous le savons, le nombre de salariées enceintes qui subissent ce type de mésaventures est plutôt en augmentation (108) ».
Vos rapporteures proposent en conséquence de compléter le présent projet de loi en réintroduisant ces dispositions adoptées par le Parlement en 2014. Il s’agirait ainsi d’insérer un nouvel article L. 1235-3 (109), qui disposerait que :
« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1 » (discrimination à raison du sexe, âge, origine, situation familiale, handicap, etc.), « L. 1153-1 » (harcèlement sexuel) « et L. 1225-5 » (licenciement d’une femme enceinte) « et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
S’il n’y a pas en droit français de dommages et intérêts « punitifs », comme l’a souligné Marylin Baldeck, il s’agit ainsi, à travers l’ensemble de ces mesures, de veiller non seulement à la juste réparation du préjudice pour la salariée, mais aussi à ce les employeurs aient ainsi une incitation plus forte à mener des politiques de prévention des harcèlements sexuels et de discriminations, à raison du sexe, de la grossesse et de la situation familiale en particulier, et qu’ils prennent les mesures appropriées lorsque ce type de cas survient dans l’entreprise – autrement dit, d’instituer de nouvelles protections pour les actives et les actifs, pour reprendre l’intitulé du présent projet de loi.
Recommandation n° 25 : instaurer une « indemnisation-plancher » correspondant aux salaires des 12 derniers mois pour tout.e salarié.e licencié.e en raison d’un motif discriminatoire (sexe, grossesse, situation familiale, etc.) ou d’un harcèlement sexuel.
→ En complétant le projet de loi pour réintroduire les dispositions qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2014 dans le cadre de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 10, censuré pour des raisons de procédure).
B. CONSOLIDER L’INSERTION RÉCENTE DANS LE CODE DU TRAVAIL D’UN ARTICLE RELATIF AUX AGISSEMENTS SEXISTES
Une enquête réalisée en 2013 auprès de 15 000 personnes dans neuf grandes entreprises a permis de montrer à quel point le sexisme en milieu professionnel est répandu : 80 % des salariées interrogées considéraient ainsi que les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes dans le monde du travail.
Les résultats d’une enquête réalisée en 2013 auprès de 15 000 salarié.e.s :
les chiffres clés illustrant les tensions liées au sexisme en milieu professionnel
80 % des femmes salariées considèrent que, dans le monde du travail, les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes.
90 % des femmes salariées considèrent qu’il est plus facile de « faire carrière » pour un homme.
54 % des femmes salariées estiment avoir rencontré un frein professionnel en raison de leur sexe (c’est-à-dire pas augmentées, promues, choisies pour une mission, embauchées ou formées).
93 % des femmes salariées considèrent que les réflexions et attitudes sexistes peuvent modifier le comportement des salariés (et 86 % des hommes).
35 % des femmes cadres au niveau national considèrent que leur entreprise a abordé le sujet du sexisme.
26 % des femmes salariées considèrent que les entreprises s’impliquent suffisamment pour faire reculer les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes (19 % des femmes cadres au niveau national).
Source : chiffres de l’enquête sur les relations professionnelles entre les femmes et les hommes lancée, en juin 2013, dans neuf grandes entreprises françaises, par l’institut de sondage LH2 pour le CSEP (17 décembre 2013)
Les travaux du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) sur le sexisme, qui ont donné lieu à la publication d’un rapport en mars 2015 (110), ont permis de faire apparaître les manifestations polymorphes du sexisme ordinaire, mais également la difficulté qu’ont les personnes concernées à y faire face et les répercussions importantes sur celles-ci.
LES CONSÉQUENCES DU SEXISME DANS LE MONDE PROFESSIONNEL (EN %)
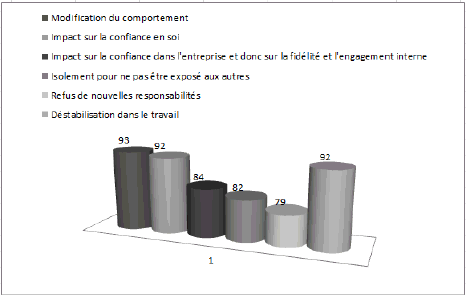
Source : chiffres de l’enquête sur les relations professionnelles entre les femmes et les hommes lancée, en juin 2013, dans neuf grandes entreprises françaises, par l’institut de sondage LH2 pour le CSEP
Le sexisme a également des répercussions sur la santé et la performance des femmes qui en sont les victimes (cf. encadré infra). Ce rapport a par ailleurs analysé les instruments juridiques existants et leur capacité ou non à appréhender ce phénomène ainsi que les politiques en matière de ressources humaines ou de management mises en œuvre au sein des entreprises en la matière. Il formulait enfin une série de recommandations à destination des pouvoirs publics et des acteurs et des actrices de l’entreprise afin de construire des outils efficaces à même de prévenir ce type de comportements dans l’entreprise.
Dans le prolongement de ce rapport du CSEP de grande qualité ainsi que des travaux et des amendements présentés par Mme Sandrine Mazetier, rapporteure de la Délégation aux droits des femmes sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (111), vos rapporteures préconisent de consolider l’insertion dans le code du travail de dispositions relatives aux agissements sexistes, grâce à la loi du 17 août 2015 précitée, à travers plusieurs mesures concernant le régime de preuve qui leur est applicable (1), le contenu du règlement intérieur des entreprises (2) et les mesures de prévention en matière de santé et sécurité au travail (3).
Et d’abord, parce que comme l’avait souligné justement la ministre Marisol Touraine, lors de la remise du rapport du CSEP sur le sexisme au travail, « Nous devons combattre la loi du silence pour que s’applique la loi de la République. Nous ne pourrons réaliser l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes tant que ces comportements perdureront. »
1. Préciser le régime de preuve applicable à l’agissement sexiste
Dans le prolongement des recommandations du CSEP, et avec l’appui de la Délégation aux droits des femmes, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a permis d’introduire dans le code du travail un nouvel article L. 1142-2-1, aux termes duquel : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Il convient de rappeler que cette disposition résulte de la codification de l’article 1er relatif aux discriminations directes ou indirectes à raison de critères prohibés (112), dont le sexe, de la loi du 27 mai 2008 (113), lui-même issu de la transposition de plusieurs directives, dont la directive 2002/73/CE en matière d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi.
Vos rapporteures préconisent de consolider cette insertion récente dans le code du travail, en précisant tout d’abord le régime de preuve applicable en cas d’action en justice concernant des agissements sexistes en milieu professionnel.
En effet, en cas de litige relatif à une discrimination fondée sur le sexe (114), le régime de preuve applicable est celui de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 du code du travail (115), et qui prévoit notamment que la personne « présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte » (cf. supra). Or cet article L. 1144-1 n’a pas été modifié suite à l’insertion d’un nouvel article relatif à l’agissement sexiste (L. 1142-2-1).
Cet article L. 1144-1 du code du travail relatif à l’application de l’aménagement de la charge de la preuve en cas de litige portant sur les dispositions relatives à l’égalité professionnelle, ne vise donc actuellement que l’article L. 1142-1 relatif à l’interdiction des inégalités de traitement en raison du sexe et l’article L. 1142-2 relatif aux exigences professionnelles essentielles et déterminantes à raison du sexe.
Vos rapporteures proposent par conséquent de revoir la rédaction de l’article L. 1144-1 pour qu’il vise explicitement ce nouvel article, de sorte que le régime de preuve applicable en cas de litige concernant un agissement sexiste soit celui de l’aménagement de la charge de la preuve (116).
Recommandation n° 26 : préciser le régime de la preuve applicable aux actions en justice relatives aux agissements sexistes en milieu professionnel (régime de l’aménagement de la preuve, comme pour les discriminations liées au sexe).
→ en modifiant l’article L. 1144-1 du code du travail, pour faire référence au nouvel article L. 1142-2-1 relatif à l’interdiction des agissements sexistes tel qu’issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
2. Prévoir le rappel obligatoire dans le règlement intérieur des entreprises des dispositions de la loi relatives à l’agissement sexiste
Le règlement intérieur est un instrument pertinent pour instaurer une culture non sexiste au sein de l’entreprise, avec son corollaire, le pouvoir de sanction de l’employeur. C’est pourquoi il conviendrait de prévoir dans la loi l’obligation de rappeler dans le règlement intérieur les dispositions prévues par loi en matière d’agissement sexiste sur le lieu de travail, comme c’est déjà le cas en matière de harcèlement moral et sexuel.
En effet, le code du travail définit aujourd’hui précisément le contenu du règlement intérieur (117). Il doit ainsi exclusivement fixer les mesures d’application de la règlementation en matière de santé et sécurité dans l’entreprise, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, et rappeler les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés « et les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel » (article L. 1321-2 du code du travail).
Il convient donc d’enrichir le contenu du règlement intérieur par le rappel des dispositions prévues par le code du travail afin de lutter contre les agissements sexistes – et c’est là une question importante pour promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cette modification serait d’autant plus bienvenue que les partenaires sociaux, dans l’accord national interprofessionnel (ANI) signé en 2010 sur le harcèlement et les violences au travail, ont considéré que « les entreprises doivent clairement affirmer que le harcèlement et la violence au travail ne sont pas admis, la violence étant entendue comme allant du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d’agression verbale, d’agression comportementale, notamment sexiste, d’agression physique (118)…».
Le rappel dans le règlement intérieur de l’entreprise des dispositions du code du travail relatives aux agissements sexistes permettrait ainsi de développer la prévention dans ce domaine. En effet, cette disposition conduira, d’une part, à améliorer l’information des salarié.e.s puisque le règlement intérieur doit être affiché sur les lieux de travail. D’autre part, elle permettrait l’émergence d’un dialogue dans l’entreprise autour de l’agissement sexiste, dans la mesure où le règlement intérieur doit être soumis pour avis au comité d’entreprise (CE) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Recommandation n° 27: prévoir l’obligation de rappeler dans le règlement intérieur des entreprises les dispositions prévues par la loi en matière d’agissement sexiste, comme c’est le déjà le cas pour les dispositions légales en matière de harcèlement sexuel.
→ En modifiant en ce sens le 2° de l’article L. 1321-2 du code de travail, pour faire référence au nouvel article L. 1142-2-1 relatif à l’interdiction des agissements sexistes.
3. Prendre en compte l’agissement sexiste comme facteur de risques pour la santé des salariées pour promouvoir la mise en œuvre d’actions de prévention
Le sexisme au travail constitue un facteur de stress et peut avoir des effets délétères sur la santé des personnes qui le subissent au quotidien. Il est donc proposé que la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail intègre cette dimension dans les principes généraux de prévention, comme cela est actuellement le cas en matière de harcèlement moral et sexuel.
En effet, il est essentiel que le sexisme dans les relations de travail soit pris en compte de façon sérieuse dans l’évaluation des risques, dans la mesure où il touche très clairement de manière différenciée les femmes et les hommes, et en vue de mettre en œuvre des actions de prévention adaptées.
Les effets du sexisme au travail sur la santé et la performance
« L’exposition au sexisme ordinaire n’est pas sans conséquence à la fois sur la confiance en soi et donc la performance, et sur le bien-être et la santé des personnes qui en sont les cibles. L’impact du sexisme sur les performances a déjà été évoqué, rappelant en cela les résultats de l’enquête CSEP/LH2 : 93 % des femmes salariées considèrent que les réflexions et attitudes sexistes peuvent modifier leur comportement au travail, 92 % pensent qu’elles ont un impact sur la confiance en soi et 92 % qu’elles déstabilisent le travail de ceux qui le subissent. Enfin, 53 % des femmes disent avoir été très affectées par des comportements de sexisme.
Mais le sexisme a également un impact négatif sur le bien-être car il agit comme un « stresseur », néfaste pour la santé physique et mentale (Bry, 2014). Les effets sur la santé ont notamment été mis en évidence par le centre pour le leadership éthique de Melbourne. Ce dernier a réalisé une méta-analyse portant sur 103 travaux en psychologie sociale dans le monde (principalement aux États-Unis, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Norvège, aux Pays-Bas). Cette étude vise à comparer l’impact du sexisme plus fréquent mais moins intense (comme faire des blagues et des commentaires sexistes, ignorer les opinions des femmes au cours des réunions, suggérer que les femmes ne sont pas adaptes aux métiers à prédominance mascline) avec d’autres expériences considérées comme plus graves au travail, comme le harcèlement sexuel.
Les résultats montrent que les formes du sexisme, explicite ou implicite, d’intensité plus ou moins variable, sont tout aussi nocives pour le bien-être des femmes au travail et génèrent des problèmes de santé mentale et physique et de l’insatisfaction dans leur emploi et dans leurs relations professionnelles. Quelles que soient les méthodologies utilisées, les études montrent que plus les femmes sont exposées à des évènements sexistes, plus elles rapportent de hauts niveaux de détresse psychologique. De plus, si les effets négatifs sont incontestables pour la cible visée par les actes sexistes, ilest important d’insister sur le fait qu’être témoin/spectateur d’incidents sexistes génère également un stress particulier (bystander stress) pour les collègues ou les autres personnels de l’organisation. Une exposition indirecte semble avoir des impacts sur la santé quasiment semblables aux conséquences observées chez les femmes directement exposées. »
Source : Conseil supérieur de l’égalité professionnel (CSEP), « Le sexisme dans le monde du travail » (mars 2015)
Il convient à cet égard de rappeler que l’article L. 4121-3 du code du travail, tel que modifié par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, fait désormais obligation à l’employeur d’évaluer tous les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de tenir compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
Aujourd’hui, le code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur.se.s. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions de formation et d’information ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (L. 4121-1). Par ailleurs, les employeurs doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires précitées sur le fondement de neuf grands principes généraux en matière de prévention (L. 4121-2), notamment « 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ».
Compte tenu de l’état du droit et de l’insertion de l’article L. 1442-2-1 relatif à l’interdiction de tout agissement sexiste sur le lieu de travail, il est indispensable de prendre en compte les facteurs ambiants liés à ce type de comportements, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne salariée qui en est victime, d’affecter sa santé, physique ou mentale, et de polluer l’environnement de travail. Vos rapporteures préconisent en conséquence de modifier en ce sens le 7° de l’article L. 4121-2 précité.
Recommandation n° 28 : inclure les risques liés aux agissements sexistes dans les principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé des salarié.e.s.
→ En complétant en ce sens le 7° de l’article L. 1321-2 du code de travail, s’agissant des relations sociales et de l’influence des facteurs ambiants, pour faire référence aux risques liés aux agissements sexistes, comme c’est déjà le cas pour le harcèlement sexuel.
Par ailleurs, comme l’avait suggéré la secrétaire générale du CSEP, Mme Brigitte Grésy, lors du colloque sur les femmes et la fonction publique d’État, organisé par la Délégation aux droits des femmes le 2 mars 2016, il conviendrait d’élargir à la fonction publique le champ d’application des dispositions relatives aux agissements sexistes introduites par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Enfin, Mme Sophie Binet, pilote de la commission égalité de la CGT, a indiqué lors de son audition par la Délégation, que « Plus globalement, sur l’égalité femmes-hommes, nous demandons que la question du sexisme et des violences relève du dialogue social dans l’entreprise. Dans le cadre de la négociation sur l’égalité dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, certains représentants de branches patronales nous ont dit ne pas voir le rapport entre cette question et celle de l’égalité femmes hommes ! C’est vous dire la difficulté… Mais nous avons réussi à les convaincre, puisqu’un chapitre dédié est intégré dans l’accord ». Il pourrait être envisagé dans ce sens de compléter le champ de la négociation en entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, tel que défini par l’article L. 2242-8 du code du travail (cf. supra).
Recommandation n° 29 : inclure la question du sexisme et des violences au travail dans le champ de la négociation collective sur l’égalité professionnelle.
Enfin, vos rapporteures formulent la recommandation suivante.
Recommandation n° 30 : modifier le titre du projet de loi pour ne pas « invisibiliser » les femmes, en faisant également référence aux actives.
I. COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
– Audition d’expert.e.s, membres du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) : M. Michel Miné, professeur de droit du travail au CNAM, et Mme Rachel Silvera, économiste, sous-directrice du groupe de travail « Marché du travail et genre » (MAGE) et maîtresse de conférence à l’université Paris Ouest (mardi 8 mars 2016) 118
– Audition de représentant.e.s d’organisations syndicales de salarié.e.s : CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC et UNSA (mardi 22 mars 2016) 132
– Audition de représentantes d’associations : Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), Association d’accompagnement global contre l’exclusion (ADAGE) et Force femmes (mercredi 23 mars 2016) 151
– Audition de Mme Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social (mercredi 30 mars 2016) 164
– Examen du présent rapport d’information par la Délégation aux droits des femmes (mardi 5 avril 2016) 181
I. COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Audition de M. Michel Miné, professeur de droit du travail au CNAM, et de Mme Rachel Silvera, économiste, sous-directrice du groupe de recherche « Marché du travail et genre » (MAGE), membres du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP)
Compte rendu de l’audition du mardi 8 mars 2016
Mme la présidente Catherine Coutelle. Avant de commencer nos travaux, je souhaite rendre hommage à notre collègue Sophie Dessus, membre de la délégation, brutalement décédée des suites d’une longue maladie dont nous avons été informés tardivement. Sophie était une femme souriante, pétulante et agréable ; au nom de notre délégation, j’exprime à ses proches toutes nos condoléances.
En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, nous souhaitions entamer un cycle d’auditions portant sur l’avant-projet de la loi devant être soutenue par Myriam El Khomri, et qui ambitionne de « refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective ». Nous aurions voulu, dans un premier temps, entendre les syndicats, car le texte devait être présenté demain au Conseil des ministres. Cette présentation ayant été reportée, nous ne disposons aujourd’hui que d’un avant-projet ; de ce fait, beaucoup de gens s’expriment à son sujet, alors qu’une incertitude plane sur le contenu réel du texte.
En ce jour, nous recevons donc M. Michel Miné, professeur de droit du travail au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), que la délégation a déjà entendu en d’autres occasions, et Mme Rachel Silvera, économiste, maîtresse de conférence à l’université Paris Ouest-Nanterre-la Défense, sous-directrice du groupe de recherche « Marché du travail et genre » (MAGE) ; tous deux sont d’éminents connaisseurs du droit du travail et de l’égalité professionnelle. Cela sera l’occasion de les interroger sur les perspectives du texte du Gouvernement, mais aussi de faire le point sur des mesures que nous avons adoptées, je pense notamment au minimum hebdomadaire de 24 heures – fruit de notre long combat sur les temps partiels –, à la redéfinition des métiers et qualifications ou encore à la médecine du travail. Ces dispositions sont réparties dans divers textes de loi ou accords, tels l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi et la loi du 14 juin 2013, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, ou la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen ».
Le rapport de situation comparée (RSC) nous a beaucoup préoccupés. Je rappelle qu’il n’a pas disparu : moins visible aujourd’hui, il a été fondu dans la base de données économiques et sociales (BDES), également appelée base de données unique (BDU) et dont la mise en place était prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Les acteurs sociaux se sont-ils emparés de cet instrument ? Certains directeurs des ressources humaines (DRH) m’ont fait part de la relative complexité du dispositif.
Enfin, nous nous demandons si les accords pour l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (EP-QTV) produisent leurs effets, et comment les négociations se déroulent au sein des entreprises ?
M. Michel Miné, professeur de droit du travail au CNAM, membre du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP). Il est toujours agréable de pouvoir alimenter la réflexion des élus ; au regard des perspectives ouvertes par le projet de loi à venir, la date est fort bien choisie pour cette rencontre. Les questions que vous m’avez adressées sont de deux ordres : les premières portent sur l’effectivité des mesures législatives relatives à l’égalité professionnelle, les secondes sur les éléments du projet de loi réformant le code du travail qui concernent les droits des femmes – quand bien même le texte définitif ne sera connu que le 24 mars.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoyait une durée de travail hebdomadaire minimale de 24 heures pour les temps partiels. La mesure comportait un certain nombre de dérogations individuelles ou résultant d’accords signés dans le cadre de conventions collectives. Un premier bilan des accords passés dans les branches professionnelles en matière de travail à temps partiel a été dressé : on ne peut qu’être alarmé par leur contenu. Dans la plupart des cas, en effet des dispositions dérogatoires sont adoptées, qui de fait conduiront à priver les femmes du bénéfice de cette durée minimale de 24 heures.
Nombre d’accords fixent une durée minimale de 16 heures, et certains d’entre eux vont bien au-delà des dérogations permises par la loi, si bien que, pour certains métiers, la durée minimale se trouve réduite à 2 heures hebdomadaires. Une étude plus approfondie serait nécessaire pour examiner chacune des conventions collectives et les professions concernées ainsi que la pertinence des dérogations ; en tout état de cause, de nombreuses situations ne sont pas satisfaisantes sur le plan du droit. Il est donc d’autant plus surprenant que certains de ces accords aient fait l’objet d’un arrêté d’extension pris par le ministre du travail sans qu’aucune réserve ne soit émise. Le ministre du travail a en effet la possibilité de prendre un arrêté dont l’effet est de rendre obligatoire un accord de branche pour toutes les entreprises du secteur professionnel concerné, même non adhérentes de l’organisation patronale signataire. Depuis 1982, les accords dérogatoires en matière de temps de travail se sont développés, et la procédure de l’arrêté d’extension permet au ministre de vérifier la légalité du contenu des accords collectifs : c’est là sa deuxième fonction.
En définitive, on constate que, pour la majorité des salariés à temps partiel, la durée minimale de 24 heures ne sera pas appliquée dans les secteurs d’activité concernés. La loi n’a donc pas atteint son objectif.
En outre, la loi a prévu d’autoriser des compléments d’heures par avenant. Ainsi, des accords de branche offrent à l’employeur la possibilité de proposer au salarié de signer un avenant le conduisant à effectuer des heures complémentaires dérogeant au droit commun qui régit les heures complémentaires. Il faut garder présent à l’esprit le fait que, depuis la loi du 14 juin 2013, les heures complémentaires sont majorées : de 10 % jusqu’à un certain niveau, de 25 % ensuite. Or, dans certains accords de branche, il est possible que ces heures complémentaires ne soient pas majorées. Cette pratique est contraire au droit européen car, la majorité des employés à temps partiel étant des femmes, elle n’est pas neutre en termes de genre : elle défavorise les femmes et pourrait être attaquée devant le juge du contrat pour discrimination indirecte. À ce titre, les accords collectifs concernés pourraient être attaqués devant le tribunal de grande instance.
Je ne prétends pas que les parties signataires de ces accords soient animées d’intentions malignes mais, du fait même de cette discrimination indirecte – que le droit européen est susceptible de qualifier comme telle – certains salariés ne sont pas remplis de leurs droits et, d’autre part, des entreprises se trouvent en situation d’insécurité juridique.
L’analyse juridique est la même pour le forfait jours, mais ce ne sont pas les mêmes populations qui sont concernées. Si les salariés à temps partiel connaissent mal leurs droits, ceux qui sont au forfait jours sont souvent des cadres disposant de ressources culturelles, voire économiques, les rendant à même de saisir le juge, ce dont témoigne le volume du contentieux relatif au forfait jours.
Mme Rachel Silvera. Je ne suis pas juriste, mais chercheuse en économie et en sociologie du travail. Devant le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), la ministre chargée du travail a indiqué qu’il existait soixante accords de branche dérogatoires. La loi du 13 juin 2013 a beau prévoir des contreparties pour les salariés qui relèvent d’accords dérogatoires conduisant à des durées de travail très inférieures à 24 heures, ces contreparties semblent minimes. Je ne dispose pas d’études systématiques, mais il m’a été rapporté qu’un repos compensatoire a été attribué dans quelques cas. Bien souvent, la coupure maximale de deux heures dans la journée n’est pas observée dans le travail à temps partiel, et cette situation est entérinée par certains accords collectifs ! Au regard de la précarité dans laquelle se trouvent les femmes travaillant à temps partiel, le bilan de l’application de la durée minimale de 24 heures de travail est négatif.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Quel est le nombre total de branches ?
Mme Rachel Silvera. On en dénombre aujourd’hui environ sept cents.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Soixante branches sur sept cents ont donc conclu des accords dérogeant à la règle des 24 heures hebdomadaires ; les autres négocieront – ou non. Dans les métiers comme le magasinage, la manutention, le gardiennage de navires, garde maritime, certains de nos interlocuteurs ont évoqué une durée de dix-sept heures et demie ; sur quelles bases une telle durée peut-elle être fondée ?
M. Michel Miné. Ce type d’accords est le résultat de compromis discutés entre les acteurs sociaux. En l’espèce, il s’agit de la moitié de 35 heures ; à cet égard, la lecture de la convention pour la branche de la propreté, qui emploie beaucoup de salariés à temps partiel et recourt massivement aux dérogations, est riche d’enseignements.
La loi du 17 août 2015 a intégré dans la BDES les informations auparavant contenues dans le rapport de situation comparée (RSC). Cependant, le décret d’application d’un article de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui devait notamment prévoir des indicateurs de santé et de sécurité au travail ainsi que de déroulement des carrières, n’a toujours pas été publié. La situation est pour le moins singulière, puisque des textes viennent modifier des dispositions législatives pour lesquelles les décrets d’application sont encore attendus ! Dans ces conditions, il est impossible d’établir des bilans de l’application des dispositions concernées.
Il s’agit là d’une question technique, à laquelle on peut penser que le Gouvernement apportera prochainement une solution, mais les acteurs sociaux, organisations syndicales ou DRH, travaillent aujourd’hui à partir de textes incomplets. Cette situation est cause d’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs.
La loi du 17 août 2015 a remis en cause un nombre non négligeable de règles organisant le processus de négociation. C’est là un sujet d’actualité, qui concerne le futur projet de loi que vous allez examiner prochainement.
Un droit des accords collectifs a vu le jour en France, des dispositions déterminent ce sur quoi peuvent porter ces accords, ou comment deux accords peuvent s’articuler ensemble – accord d’entreprise et accord de branche, par exemple. En revanche, le droit n’a pas précisé le processus de négociation, alors que certains de nos voisins l’ont fait ; or, le contenu de l’accord qui sera signé in fine dépend évidemment des modalités de la négociation collective. Les rares dispositions existant dans ce domaine proviennent des lois dites « Auroux », ou plus précisément de la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, et concernent le lieu de négociation, le nombre de réunions devant être tenues ainsi que les informations à communiquer. Au fil du temps, ce droit a été construit par la jurisprudence, les acteurs sociaux ayant, au cours de certaines négociations, saisi le juge afin d’obtenir des précisions.
Ce qui n’est pas satisfaisant, c’est que la loi du 17 août 2015 est revenue sur un certain nombre de progrès du droit réalisés dans le domaine du processus de négociation ; j’en donnerai deux exemples. La jurisprudence avait établi que, lorsqu’une négociation a lieu entre l’employeur et les organisations syndicales, les élus du personnel – le comité d’entreprise (CE) notamment – devaient être consultés afin de pouvoir participer à la discussion. Il avait également été décidé que le CE devait être consulté en cas de dénonciation d’un accord précédemment conclu. Dans ces deux cas, la loi a supprimé sa consultation. Le processus de la négociation d’entreprise s’en trouve amoindri, et les parties les plus faibles fragilisées ; cela va à l’encontre de la loyauté de la négociation.
De son côté, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes comportait des dispositions permettant aux négociateurs de demander et d’obtenir des informations complémentaires portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. La loi du 17 août 2015 a supprimé cette mesure.
En 1981, l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la convention n° 154 concernant la promotion de la négociation collective, dont l’une des recommandations prévoit que les négociateurs ont accès aux informations leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. Il serait bon que la France ratifie ce document.
Mme la présidente Catherine Coutelle. J’avoue ma surprise, car je me souviens avoir débattu sur ce sujet à l’occasion de l’examen de la loi du 17 août 2015. Notre délégation avait demandé l’association d’experts aux négociations pour lesquelles il est recouru aux informations contenues dans la BDES ; cette mesure a-t-elle été supprimée ?
M. Michel Miné. Je vous rassure, elle figure bien dans la loi. La difficulté provient du fait que les négociateurs avaient la capacité de demander des informations complémentaires sans nécessairement recourir aux services d’un expert. Certaines des dispositions favorisant une plus grande élaboration de la négociation ont été supprimées ; il ne s’agit pas à proprement parler d’une interdiction, mais une base légale utile a disparu. Ces éléments, dont la consultation du comité d’entreprise, figuraient dans la loi du 13 novembre 1982 et n’ont pas été repris dans la loi du 17 août 2015.
La situation sur laquelle je souhaite appeler votre attention est rarement évoquée. Il s’agit d’un domaine du droit très peu développé en France, et qui concerne le processus de négociation. Si nous souhaitons que le droit du travail procède de plus en plus de la négociation collective – sujet sur lequel les opinions peuvent diverger –, nous devons doter celle-ci d’un véritable régime juridique. Ce droit ne doit pas simplement être celui des accords collectifs : le législateur doit poser des règles propres à favoriser la loyauté de la négociation, à faire que les armes soient égales pour tous et que la consultation soit authentique. Il ne faudrait pas tomber dans une situation où un acteur informerait l’autre de ses projets et où le second acteur n’aurait qu’une faible marge de manœuvre. Cette question est très importante pour la démocratie sociale.
L’avant-projet de loi traite de la loyauté de la négociation ; ce terme est repris du code civil, car le juge a été conduit à considérer que la négociation doit être de bonne foi. Il s’agit certes d’une collaboration conflictuelle, impliquant des divergences d’intérêt, mais où tous les acteurs veulent aboutir à un accord ; la loi doit préciser ce qui, dans le cadre de cette loyauté, est permis ou non. Il nous revient à tous de bâtir un droit de la négociation collective. Jusqu’à présent, le juge pouvait frapper de nullité un accord résultant d’une concertation déloyale, quand bien même son contenu serait conforme à la loi ; c’est là l’application de règles relevant du droit civil.
Le titre II de l’avant-projet de loi, « Favoriser une culture du dialogue et de la négociation », peut recueillir l’assentiment ; des dispositions relatives à la loyauté ainsi qu’à divers éléments de la concertation y sont d’ailleurs présentes. Malheureusement, il est également prévu que, nonobstant l’absence de certaines d’entre eux, l’accord sera valable. Il serait choquant que la loi elle-même vienne limiter la loyauté de la négociation ; si le législateur veut sous-traiter aux acteurs sociaux la production du droit, la moindre des choses est qu’il garantisse la loyauté de la négociation.
Mme Rachel Silvera. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, si elle permet toujours le recours à une expertise pour épauler le comité d’entreprise, conditionne cette intervention à l’accord de l’employeur.
Mme Sandrine Mazetier. Lors de l’examen de la loi du 17 août 2015, nous avions prévu, au bénéfice du comité d’entreprise, le financement d’une expertise équivalente à celle dont dispose l’employeur dans le domaine des documents comptables. Nous sommes à l’origine de cette disposition, qui, à ma connaissance, n’est pas facultative.
Mme Rachel Silvera. En tout état de cause, les accords à venir seront placés sous le double sceau de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail. Il y a là menace d’une certaine dilution de l’égalité professionnelle, au moment même où cette notion commençait à être reconnue comme obligatoire par les partenaires sociaux ; j’ai déjà évoqué ce fait devant l’Assemblée nationale. J’observe par ailleurs que l’égalité professionnelle a été le parent pauvre de l’ANI du 11 janvier 2013.
Mme la présidente Catherine Coutelle. C’est bien la loi du 17 août 2015 qui a supprimé, aux fins de simplification de la procédure de concertation, la négociation spécifique sur l’égalité professionnelle. Nous l’avons réintroduite dans les trois temps de la négociation de façon à ce que le sujet soit bien abordé à chaque fois.
M. Michel Miné. Trop souvent, les négociations souffrent de l’absence d’un diagnostic de départ établissant l’état des lieux. Ainsi les partenaires discutent de bonne foi, mais en ignorant à quoi ils s’attaquent ; or, une négociation pertinente sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes nécessite une évaluation préalable de la situation. Je conçois qu’une entreprise ne puisse pas régler une telle question d’une année sur l’autre, mais il est toujours possible de dresser un bilan approfondi portant sur une question donnée. Il pourrait ainsi être décidé d’un commun accord que les partenaires sociaux étudient la situation des salariés employés à temps partiel au sein de l’entreprise, car la question aurait été identifiée. Pour des raisons similaires, le même exercice pourrait concerner la formation professionnelle qualifiante. L’absence d’évaluation préalable conduit à l’adoption d’accords dont le contenu est faible : j’ai pu constater qu’un certain nombre d’entre eux, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, n’étaient qu’un catalogue de bonnes intentions ou la reprise, sous une autre formulation, d’articles du code du travail.
D’autres accords ont une réelle consistance, je pourrais citer l’accord d’entreprise conclu au journal Le Figaro. Il comporte des dispositions portant sur la réduction des écarts de salaire entre femmes et hommes : les données sont chiffrées, correspondent à des situations concrètes, et des délais d’application sont mentionnés.
Il est prévu que les entreprises établissent désormais une synthèse de l’accord d’entreprise ou du plan d’action et la publient sur leur site internet. La consultation de ces documents montre la relative vacuité de certains d’entre eux. On peut toutefois rester optimiste et considérer qu’il s’agit là d’une première étape : une concertation a eu lieu, un plan d’action décidé, les partenaires se sont rencontrés pour débattre d’une question précise. Cependant, il faut pouvoir aller plus loin et, à cette fin, un processus plus contraignant doit être déterminé.
Mme Barbara Romagnan. Si j’entends bien votre propos, des dérogations non autorisées par la loi ont été adoptées, et, de surcroît, des arrêtés d’extension les ont rendues obligatoires dans des entreprises qui n’étaient pas parties à la négociation.
Mme Sandrine Mazetier. Cette pratique reviendrait à inverser le contrôle de légalité, en étendant à des entreprises des dispositions dérogatoires à la loi.
M. Michel Miné. Une entreprise qui n’est pas adhérente à une organisation syndicale patronale, et qui n’a donc pas participé à la négociation, peut appliquer cette dérogation ; cela ne signifie pas pour autant que l’arrêté d’extension incite ces entreprises à des pratiques illégales. Un accord de branche étendu est de double nature : à la fois conventionnelle, car son contenu a été négocié par les partenaires sociaux, et réglementaire, car un texte de droit public le rend obligatoire pour l’ensemble des entreprises du secteur d’activité visé par le texte. Bien entendu, cela ne se limite pas au champ de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Mme Sandrine Mazetier. C’est précisément parce que les négociations portant sur l’égalité professionnelle ou les plans d’action étaient laborieuses qu’il a été jugé utile de doter les comités d’entreprise d’une capacité d’expertise financée par l’employeur. Certains de nos interlocuteurs ont considéré que beaucoup restait à faire. Ainsi avons-nous dû livrer bataille pour que la publicité des synthèses des accords collectifs soit maintenue dans le texte.
Une des analyses de l’avant-projet de loi considère que l’accès aux données sera supprimé, alors que nous avions fait en sorte que toutes les informations figurant dans le rapport de situation comparée soient reportées dans la BDU et rendues accessibles à des acteurs qui, jusque-là, n’avaient pas cette possibilité – des membres du CE qui ne sont pas représentants syndicaux, par exemple. Cette ouverture, avec un accès plus large aux données, n’est-elle pas de nature à inciter des entreprises à établir des comparaisons diachroniques ? Par ailleurs, l’abolition par la loi du 17 août 2015 du monopole d’accès détenu par certains acteurs sur ces informations vous paraît-elle susceptible d’améliorer la prise en compte de la question de l’égalité professionnelle ?
M. Michel Miné. Je partage pleinement votre analyse. La possibilité ouverte au comité d’entreprise de recourir à une expertise constitue une avancée positive, particulièrement en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’ouverture de l’accès aux données de la BDU à tous les élus quel que soit leur mandat, ainsi qu’aux délégués syndicaux, est très positive.
Les discussions relatives à des sujets comme l’égalité professionnelle se heurtent toujours à des pesanteurs sociologiques ainsi qu’à des stéréotypes. Lorsque les acteurs n’utilisent pas tous les outils mis à leur disposition, cela révèle un manque de formation. Nous le constatons, Rachel Silvera et moi-même, dans nos enseignements respectifs : un partenaire social non formé au droit de la négociation sur la question de l’égalité professionnelle passera à côté du sujet. Beaucoup, par exemple, considèrent qu’en matière de rémunération la règle applicable est : « à travail égal, salaire égal entre femmes et hommes ». Or la règle véritable, qui date de 1919, est : « à travail de valeur égale, rémunération égale ». L’article 427 du traité de Versailles du 28 juin 1919, qui a – entre autres – fondé l’OIT, a été rédigé avec la conviction que la misère des peuples était cause des guerres, et que l’une des causes de cette misère était la trop faible rémunération du travail des femmes. Cela résonne de façon assez tragique lorsque l’on observe la réalité d’aujourd’hui.
Il faut donc garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu’ils effectuent un « travail de valeur égale ». Lorsque les partenaires sociaux abordent la négociation, ils commencent par regarder quels sont les emplois identiques occupés par des femmes et par des hommes, et se limitent à cette question. En général, un écart de 4 % est constaté, et la négociation se fonde sur cette base, alors que, comme pourra vous le confirmer Rachel Silvera, cet écart est beaucoup plus élevé.
La question de la motivation des acteurs peut aussi se poser. Il faut que les partenaires sociaux réalisent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit constituer une préoccupation de premier plan, et non un « supplément d’âme » auquel on se consacrera lorsque l’on en aura le temps.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Dans l’avant-projet de loi, plusieurs sujets concernent particulièrement les femmes : la flexibilité qui semble devoir être étendue, les durées maximales, les repos fractionnés, les astreintes, les heures complémentaires. Une autre question est celle de la durée de vie des accords collectifs, qui serait de cinq ans, ainsi que celle de la périodicité de négociations qui pourrait passer à trois ans : cela est-il favorable ou défavorable aux femmes ?
Dans le domaine de l’égalité, il est singulièrement difficile de faire bouger les lignes, ce que peu de gens sont prêts à admettre. L’une de mes connaissances vient de rendre un rapport sur le conseil général de son département : il en ressort qu’un différentiel de traitement de 15 % demeure dans la fonction publique, et personne ne comprend pourquoi, puisque cela n’avait jamais été mis en évidence.
M. Michel Miné. J’en viens à la question des principes essentiels. Selon la terminologie du rapport remis au mois de janvier dernier par M. Badinter, les principes essentiels du droit du travail sont visés par certaines dispositions de l’avant-projet de loi. Des discussions très techniques vont se dérouler, qui auront trait à ces notions fondamentales : l’articulation entre l’accord d’entreprise, l’accord de branche et la loi, etc. Il n’est dès lors pas superflu de s’interroger sur les fonctions du droit du travail : à quoi sert un code du travail dans la France du XXIe siècle ?
Ces principes essentiels apportent des éléments de réponse, ils donnent des repères, alors qu’un courant de pensée voudrait que le droit du travail soit toujours plus négocié. Dans ces conditions, il est impérieux de donner un cadre, donc des limites, aux acteurs de la négociation ; ces principes essentiels sont inspirés par les fondamentaux du droit du travail, qui, eux-mêmes, prennent leur source dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Ils doivent déterminer les contours de la relation de travail, et être déclinés par les négociateurs, car ils n’ont pas une vocation simplement décorative : ils doivent avoir une existence concrète. Ce sera la tâche de la Commission supérieure de codification, mais aussi celle du législateur et, in fine, des partenaires à la négociation.
Ces principes sont aujourd’hui malmenés par un certain nombre de contraintes figurant dans la lettre de mission adressée aux rédacteurs, à qui on a demandé une rédaction de principes à droit constant – ce qui signifie que leur capacité d’initiative a été bridée. Ces rédacteurs ont été contraints d’avaliser des régressions intervenues au cours des dernières années dans le droit du travail ; il leur a encore été demandé d’ignorer les principes internationaux. Si, avec raison, ils se sont partiellement affranchis de ce carcan, il me semble toutefois que les formulations relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes pourraient être améliorées tout en conservant leur substance ; à cet égard, il faut relever que les délais impartis ont été extrêmement courts. Le législateur ne doit pas hésiter à s’emparer de ce travail réalisé par des experts de haut niveau afin de l’améliorer.
Dans le champ de l’égalité entre les femmes et les hommes, les articles 4 et 5 présentent quelques difficultés. Ainsi, l’article 4 figurant dans le préambule relatif aux principes essentiels du droit du droit du travail, définis à l’article 1er du projet de loi, dispose : « Le principe d’égalité s’applique dans l’entreprise. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être respectée », et l’article 5 : « Les discriminations sont interdites dans toute relation de travail. » La difficulté réside dans la complexité de notre droit du travail, qui comporte deux régimes d’égalité : celui de l’égalité entre tous les salariés – fondé sur le principe « à travail égal, salaire égal », qui concerne tous les individus sans qu’il soit fait appel à quelque référence que ce soit – et celui constitué par les règles de non-discrimination. La chose est certes difficile à admettre, mais ces deux régimes juridiques obéissent à des règles différentes : ils n’ont pas les mêmes ambitions en termes d’exigence et de réparation, et ne prévoient pas le même processus pour leur application.
Aussi, le régime juridique de la non-discrimination est plus fort que celui de l’égalité. Le régime de l’égalité étant une déclinaison du principe républicain d’égalité, on pourrait l’imaginer très puissant, mais, dans les faits, c’est simplement le principe de l’égalité entre tous les salariés qui s’applique. L’article 4 devrait plutôt mentionner l’égalité de traitement, qui est applicable à toutes les personnes, sans références particulières à une quelconque caractéristique, et l’article 5, les règles de non-discrimination, dont celle de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ce discours n’est pas purement académique, car lorsque des entreprises sont poursuivies pour atteinte à l’égalité professionnelle, elles le sont sur le terrain de la discrimination, mais leurs avocats – qui font bien leur travail – cherchent à amener le magistrat sur le terrain de l’égalité de traitement, bien moins protecteur des salariés que celui de la non-discrimination. Aussi la rédaction de l’avant-projet peut-elle être source de confusion, car l’article 4 vise à la fois la règle de l’égalité de traitement entre tous les salariés et celle de l’égalité professionnelle, c’est-à-dire de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
L’article 5 dispose que les discriminations sont interdites dans toute relation de travail. Cela signifie que la non-discrimination n’est pas limitée aux relations de travail salarié ; il s’agit d’une question importante car l’avant-projet de loi, par endroits, vise des relations de travail qui ne sont pas strictement salariées. Déplacer la mention de l’égalité professionnelle à l’article 5 permettrait de fixer la règle d’égalité professionnelle dans toute relation de travail même si, au sens strict, elle n’est pas salariée.
L’article 7 pose un problème comparable. Il dispose en effet que « Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime protégée ». Il ne paraît pas pertinent de placer au sein du même article le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Une fois encore, deux régimes juridiques distincts se côtoient : le harcèlement moral est un régime juridique particulier ne faisant aucune référence à la caractéristique des personnes, alors que le harcèlement discriminatoire peut, pour sa part, être qualifié de discrimination par harcèlement. Ce dernier régime comprend le harcèlement sexuel et se trouve être beaucoup plus fort que le harcèlement moral : une nouvelle fois, il y a un risque de confusion. Aussi cet article me semble-t-il incomplet, car ne visant pas les autres formes de harcèlement susceptibles d’être liées à la race, l’ethnie, l’âge ou la couleur de la peau, etc., pourtant mentionnées dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Ces remarques portant sur les principes essentiels fondamentaux prétendent concourir à l’amélioration des rédactions : la suite de l’avant-projet donne d’ailleurs l’impression que ces notions ont été simplement plaquées en tête du texte, sans conséquence sur le contenu des articles suivants. Ces principes essentiels sont pourtant destinés à être déclinés dans des règles ; à cet égard, le législateur doit faire preuve de pédagogie.
Une autre difficulté va se faire jour au sujet du temps de travail. Les choses étant, il est vrai, complexes, certains acteurs de la négociation confondent ce qui existe déjà dans le code du travail, et que l’avant-projet de loi reprend, avec ce qu’il apporte de nouveau dans ce domaine. Cela rend le débat confus puisque ce texte est critiqué, à juste titre, sur certains points, mais que toutes les observations formulées ne sont pas pertinentes. Ainsi, le code du travail dispose depuis des années qu’un accord d’entreprise permet le passage de la journée de travail de 10 à 12 heures ; à cet égard, l’avant-projet de loi n’innove en rien. Les exemples de ce genre pourraient être multipliés à l’envi.
Inversement, un certain nombre de critiques portant sur le droit actuel peuvent être appliquées à l’avant-projet de loi. À ce titre, la question du forfait jours se pose, car deux pôles concentrent les difficultés dans le temps de travail des femmes : le temps partiel et les durées de travail excessives. Pour des raisons sociologiques bien connues, tenant en particulier à la répartition des tâches ménagères au sein du couple, le forfait jours a des incidences négatives sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce régime a été critiqué par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) ; le droit français n’est donc pas conforme à la Charte sociale européenne, ce qui a donné lieu à des contentieux, et la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que les dispositions d’au moins douze conventions collectives ne garantissaient pas le respect de la santé, notamment du fait de cette non-conformité.
Cette situation est très insatisfaisante pour les salariés puisque, dans certains cas, les dérogations concernées peuvent aboutir à des durées de travail excessives. Ainsi peuvent-ils être conduits à travailler légalement jusqu’à 76 heures par semaine sans percevoir la moindre majoration de rémunération pour heures supplémentaires ! Les femmes sont en outre susceptibles d’être victimes de discrimination indirecte puisque, dans un même service, des salariés peuvent travailler sans limites alors que d’autres, du fait de contraintes personnelles, n’ont pas cette possibilité. L’employeur confiera fatalement les tâches et les dossiers les plus intéressants à ceux qui n’ont pas de limites horaires.
Par ailleurs, le forfait jours peut mettre les employeurs dans une situation d’insécurité juridique : alors qu’ils appliquent, au titre du code du travail, des conventions de branche et des accords d’entreprise qui leur sont conformes, ils peuvent néanmoins être condamnés au titre de l’absence de rémunération des heures supplémentaires ainsi que de durée du travail excessive. Loin d’améliorer leur sécurité juridique, l’avant-projet de loi autorise, qui plus est, l’extension du forfait jours aux entreprises de moins de 50 salariés où n’a été conclu aucun accord collectif. En d’autres termes, l’insécurité juridique se voit étendue, et j’insiste sur le fait qu’elle concerne les salariés comme les employeurs.
La situation est la même pour les salariés lorsqu’ils sont en astreinte sur leur temps de repos ; une fois de plus, le droit français n’est pas conforme au droit européen. La situation va même être aggravée, puisqu’est prévu le fractionnement du droit au repos de onze heures, ce qui est contraire à la directive européenne.
Le régime juridique des heures d’équivalences permet de comptabiliser de façon très particulière le temps de présence par rapport au temps de travail effectif. De fait, le premier doit être plus important que le second ; dans certaines branches, il était acquis que 39 heures de présence équivalaient à 35 heures de travail effectif. À l’occasion d’une affaire française, il a été considéré que ce régime des heures d’équivalence était contraire au droit européen ; malgré cela, il est toujours prévu par notre code du travail. Une fois encore, la situation n’est satisfaisante ni pour le salarié, ni pour l’employeur. Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier la sociologie de l’action judiciaire, car le volume du contentieux est très variable selon les professions considérées.
Le régime des congés payés français, s’il ne regarde pas directement la question de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, n’est pas non plus conforme en ce qui concerne les salariés ayant pris des arrêts de travail pour cause de maladie. Dans certaines limites, le droit européen considère que ces salariés ne doivent pas subir de réduction de leurs droits à congés payés : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a signifié par son arrêt du 20 janvier 2009. De son côté, la chambre sociale de la Cour de cassation, à l’occasion de son rapport annuel, est parfois conduite à demander au législateur de mettre le droit national en conformité avec le droit européen. L’examen prochain du projet de loi présenté par le Gouvernement pourrait constituer l’occasion de régulariser la situation du droit du travail français sur un certain nombre de points.
Votre délégation nous a demandé si certaines autres dispositions de l’avant-projet de loi appelaient des réserves de notre part : c’est effectivement le cas en ce qui concerne les informations partagées par les négociateurs. La loyauté de la négociation est ici en cause, car l’information doit être partagée le plus largement possible ; il est singulier que l’une des parties soit conduite à devoir argumenter pour obtenir une information afin d’être à même de négocier en toute connaissance de cause. Dans un certain nombre de cas, la rédaction de l’avant-projet de loi est de nature à provoquer des crispations entre les partenaires sociaux ; il n’organise pas un climat de négociation confiant.
Vous nous avez aussi interrogés sur les dispositions en vigueur en matière de sanctions financières applicables à l’encontre des entreprises non couvertes par un accord ou un plan d’action d’égalité professionnelle. Nous sommes au début d’un processus, et les entreprises sanctionnées sont celles qui refusent absolument la négociation et dans lesquelles la situation est bloquée. Par la suite, il sera nécessaire de rechercher la faute en prenant pour base des critères plus qualitatifs, par l’évaluation du contenu des accords et plans d’action.
J’appelle l’attention de la délégation sur le fait que l’intensité de l’engagement des services de l’État est variable selon les régions concernées, ce que montrent les statistiques. Il faudrait s’interroger sur les politiques suivies et l’origine de ce phénomène : je m’interroge par exemple sur la manière dont les préfets se sont saisis de la question.
Mme Rachel Silvera. Ces données proviennent de la direction générale du travail (DGT) et sont régulièrement présentées au CSEP ; j’ai en ma possession celles publiées à la fin de l’année 2015.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Ces statistiques sont établies par régions ; nous n’avons pas obtenu du ministère la liste des sociétés pénalisées.
Mme Rachel Silvera. Je dispose de ces éléments, mais ils ne sont pas publics…
M. Michel Miné. Il faut rappeler que la pénalité financière ne sanctionne pas le fait que l’entreprise n’appliquerait pas l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, mais le fait qu’elle n’a pas négocié un accord conformément à la loi dans ce domaine. L’ordonnance du 10 décembre 2015 prévoit qu’une entreprise pourra demander auprès de l’administration un rescrit social actant de sa situation de conformité avec la loi. Toutefois, ce rescrit portera sur l’existence d’un accord, non sur la suppression de toute discrimination à l’égard des femmes, ce qui ne manquera pas d’être source de contentieux.
L’article 30 de l’avant-projet de loi prévoit un barème contraignant, limitant les indemnités fixées par le juge des prud’hommes en cas de licenciement injustifié. Cette disposition contrecarre les règles de droit civil organisant la réparation intégrale du préjudice ; en d’autres termes, le droit du travail dérogerait au droit commun, en faisant du salarié un justiciable de second ordre. Cela reviendrait, de façon paradoxale, à garantir la sécurité juridique d’un licenciement illégal, l’auteur de la faute sachant par avance ce qu’il risque ! L’article s’appliquerait aussi aux procédures de licenciement économique annulées par le juge, ainsi qu’aux licenciements motivés par une inaptitude consécutive à un accident du travail lorsque l’obligation de reclassement n’a pas été respectée.
Ces dispositions, éminemment critiquables, seront au demeurant source d’insécurité juridique pour les employeurs, car il faudra prévoir des dérogations, notamment en matière de discrimination, puisque le droit européen proscrit le plafonnement des indemnisations. Cela signifie un abondant contentieux fondé sur la discrimination ou le non-respect des droits fondamentaux ; pourrait en outre être invoqué, à l’occasion de bien des licenciements, le droit constitutionnel à l’emploi. Cet article est donc insatisfaisant sur le fond comme dans sa rédaction.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Cet article est probablement le plus fragile du texte…
M. Michel Miné. Effectivement, il cristallise les critiques.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Je vous remercie une nouvelle fois, monsieur Miné pour votre excellent travail et votre dévouement à la cause des femmes.
M. Michel Miné. Je vous souhaite un excellent travail pour les semaines à venir.
Mme Rachel Silvera. Michel Miné et moi avons présenté nos avis sur l’avant-projet de loi au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) ; j’ignore ce qu’il en est de leur publication.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous avons déjà pris connaissance de l’avis d’un syndicat qui l’a rendu public. Vos analyses sont toujours bienvenues, et le CSEP nous avait déjà beaucoup aidées lors de l’examen de la loi relative au dialogue social et à l’emploi.
Mme Rachel Silvera. Cet avant-projet de loi porte une contradiction : il affiche en préambule l’objectif d’égalité professionnelle, mais le sujet n’y est jamais abordé de façon transversale, alors même que bien des dispositions législatives ont été adoptées dans ce domaine. Il me semblait que, conformément à des approches européennes relativement bien intégrées par le droit français, l’idée de transversalité, de gender mainstreaming, était devenue centrale.
Ma première interrogation porte sur la place des accords de branche vis-à-vis de la loi. Il est courant d’entendre évoquer une inversion de la hiérarchie des normes ; au-delà des conséquences d’ordre général, ce ne sera pas sans conséquence sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est notoire que les emplois les plus souvent occupés par des femmes constituent le maillon faible de la négociation collective et de la protection syndicale. Cette situation se vérifie le plus souvent au sein des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que de certains secteurs d’activité comme l’aide à domicile ou, dans une moindre mesure, le commerce, la restauration, etc. Les chiffres ne sont malheureusement pas disponibles, mais nous savons que la couverture conventionnelle concerne surtout les grandes entreprises.
Les femmes étant plus présentes dans les TPE et PME, elles sont, de façon indirecte, plus fragilisées ; en l’absence de suivi et de contrepartie, cette situation est dommageable.
Par ailleurs, l’avant-projet de loi risque de dégrader encore plus les conditions relatives au temps de travail en favorisant des durées maximales élevées, entérinées par des accords d’entreprise et de branche. Il est prévu, je le rappelle, qu’elles puissent être atteintes durant seize semaines au lieu de douze, et que le temps de travail puisse être calculé sur trois ans au lieu d’un an. Les femmes travaillant à temps partiel ne pourront pas allonger celui-ci, ce qui ne leur permettra pas de connaître une réelle autonomie financière. Par ailleurs, les allongements du temps de travail – le forfait jours étant le cas extrême – dégradent la situation des femmes, particulièrement de celles qui sont cadres, car ce sont toujours les femmes qui subissent les contraintes familiales : elles consacrent une heure et demie de plus que les hommes, en moyenne, aux tâches quotidiennes. Leur temps contraint, c’est-à-dire le temps de travail plus le temps domestique, est plus important, dans notre pays, que celui des hommes. La situation est différente dans les pays nordiques.
Les annonces faites à propos de ce projet de loi promettaient plus de sécurité pour les femmes dans un contexte de « flexisécurité », avec le compte personnel d’activité (CPA) et le droit à la déconnexion, mais le texte ne va pas assez loin. Il est sibyllin au sujet du CPA ; le transfert et la conservation des droits à la formation est une bonne mesure, mais elle devrait être étendue aux autres droits, qui mériteraient d’être accrus, tel le compte épargne-temps. Le volet sécurité de l’avant-projet de loi, dans la version dont j’ai eu connaissance, n’est pas suffisant.
Par ailleurs, rien, dans le texte, ne garantit le respect par l’employeur du droit à la déconnexion ; il semble même qu’une contrainte supplémentaire serait susceptible de peser sur le salarié.
Les dispositions de l’avant-projet de loi, en l’état, ne pourront que conduire à une aggravation de la discrimination indirecte qui frappera tant les femmes cadres que celles occupant des emplois à temps partiel ou précaires.
Depuis longtemps, je m’intéresse tout particulièrement au bilan des accords collectifs ; avec Jacqueline Laufer, nous avions analysé les quarante premiers accords passés au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On peut constater un très net progrès car, depuis, plus de 10 000 de ces accords ont été signés. La loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dite « loi Roudy », avait abouti à une quarantaine de plans d’égalité. D’après la DGT, le taux de couverture par des accords sur l’égalité est d’environ 38 %, avec des variations considérables en fonction de la taille des entreprises puisque 83 % des entreprises de plus de 1 000 salariés sont couvertes, pour 33 % des entreprises de moins de 300 salariés.
Le nombre des mises en demeure s’élève aujourd’hui à plus de 2 045 et celui des sanctions à 81, ce qui tend à prouver l’efficacité de ce régime applicable en l’absence d’accord. La situation est moins satisfaisante dans le domaine de l’égalité des rémunérations, mais les chiffres eux-mêmes doivent être examinés avec la plus grande circonspection, puisque, selon le mode de calcul retenu – choix des indicateurs, prise en compte ou non des primes, par exemple – l’écart observé peut varier entre 4 % seulement et le niveau communément reconnu, c’est-à-dire 25 %. Il est donc difficile de progresser en toute connaissance de cause, même si l’on constate une érosion des écarts de salaire.
Ainsi que l’a indiqué Michel Miné, le contenu de bien des accords est pauvre et ne fait que rappeler les principes posés par la loi. La direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) a commandé à une équipe de l’École normale supérieure (ENS), pilotée par Sophie Pochic, du Centre Maurice-Halbwachs, une étude qui portera sur le contenu des accords collectifs d’entreprise et des plans d’action unilatéraux sur l’égalité professionnelle ainsi que sur leur mise en œuvre. Ce travail sera fondé sur une analyse statistique globale des accords sur l’égalité professionnelle, puis d’un suivi qualitatif d’un certain nombre de ceux-ci à partir d’un échantillon raisonné.
Dans mon analyse des quarante premiers accords collectifs sur l’égalité professionnelle, j’avais distingué quatre degrés croissants d’engagement : le simple rappel des principes ; la mise en place d’outils statistiques pertinents permettant de poser un diagnostic partagé ; l’évolution de la proportionnalité au moment du recrutement, en étant attentif au nombre de femmes candidates ainsi qu’à leurs qualifications ; l’engagement d’actions positives visant à corriger les inégalités sur la base de mesures chiffrées, avec une évaluation à terme.
Mme Maud Olivier. Le conseil général de l’Essonne avait mis en œuvre le curriculum vitae (CV) anonyme, et l’enquête conduite pendant six mois a mis en évidence une nette augmentation des entretiens d’embauches, non seulement pour les personnes d’origine étrangère, mais également pour les femmes. Pensez-vous qu’il serait judicieux d’inscrire cette pratique du CV anonyme dans la loi ?
Mme Rachel Silvera. Il me semble que les avis sont très partagés sur le CV anonyme, qui aujourd’hui n’est plus qu’optionnel. Je suis assez réservée quant à son utilisation en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : les accords d’entreprise les plus probants que j’ai évoqués identifiaient et favorisaient en effet le sexe sous-représenté. L’accord conclu à Aéroports de Paris prévoyait ainsi – ce qui n’est plus le cas – qu’à compétences égales, le recrutement favoriserait le sexe sous-représenté. La loi permet en effet de le faire de façon provisoire, mais cette pratique est l’exact contraire du CV anonyme ! Au reste, tout dépend du champ concerné et des méthodes de recrutement de l’employeur au regard de ses méthodes de recrutement ; s’il est vrai que, dans les entreprises où règne une forte discrimination, le CV anonyme peut être une solution, d’autres outils pertinents existent néanmoins.
Mme Sandrine Mazetier. Pouvez-vous nous donner des éléments relatifs aux classifications professionnelles ?
Mme Rachel Silvera. Il s’agit d’un chantier très complexe dont les évolutions sont très lentes. Il y a quelques années, avec Séverine Lemière, j’ai piloté une étude pour le Défenseur des droits et rédigé un guide favorisant la réflexion relative aux discriminations véhiculées par les classifications professionnelles. Au nom du principe précédemment rappelé par Michel Miné, « à travail de valeur égal, salaire égal », les classifications professionnelles peuvent constituer un outil de revalorisation des emplois à prédominance féminine.
À l’instar de pays ou de territoires comme le Québec, l’égalité doit être favorisée dans les classifications professionnelles, qui ne sont pas à considérer comme neutres : selon les méthodes et critères utilisés, la « pesée » des emplois peut différer selon qu’il s’agit d’emplois à prédominance masculine ou féminine. Nous avons toujours cherché à associer les partenaires sociaux à cette démarche, mais nous n’avons pas eu gain de cause, ni fait l’unanimité. Toutefois, l’article 19 de l’ANI prévoyait la constitution d’un groupe paritaire chargé de réfléchir à une méthodologie propre à inciter les branches à intégrer l’égalité dans la négociation des classifications professionnelles. Ce groupe s’est réuni pendant un an et a publié une note méthodologique qui a été présentée au CSEP en décembre dernier.
Le processus est lent, mais la note a le mérite d’exister ; je ne suis pas sûre que, comme ils devaient s’y engager, les partenaires sociaux l’aient utilisée et diffusée... Le CSEP a, depuis, constitué son propre groupe de travail, qui réunit des représentants de la DGT, des partenaires sociaux ainsi que des personnalités qualifiées, dont moi-même. Ce groupe de travail procède à des auditions, et quelques branches professionnelles ont été retenues afin d’approfondir l’analyse. À terme, une session de sensibilisation et, peut-être, de formation des négociateurs de branche est envisagée.
En fait, nous sommes en train de refaire tout le travail accompli pour le Défenseur des droits, mais, cette fois, avec l’ensemble des partenaires sociaux ; nous avançons, certes lentement, mais nous avançons. Une hypothèque pèse toutefois sur le Conseil, dont l’effectif se résume à sa secrétaire générale et à une personne chargée de l’ensemble des dossiers – et qui est actuellement très mobilisée par l’avis sur l’avant-projet de loi, ce qui a conduit à ajourner une fois de plus la réunion du groupe de travail.
Mme Sandrine Mazetier. Vous avez indiqué qu’Aéroports de Paris avait renoncé à ses dispositions de positive action en matière de recrutement.
Mme Rachel Silvera. Je n’ai malheureusement pas eu d’information supplémentaire. Je n’ai pu que constater la disparition de ces principes dans les accords portant sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes. Il me semble que, lorsque l’on adopte ce type de dispositions, on s’engage dans le but d’aboutir à une amélioration ; j’imagine que les résultats n’ont pas été au rendez-vous. Il est probable que le chiffrage qui avait été retenu, avec des quotas, s’est révélé impossible à respecter : un échéancier beaucoup plus souple serait nécessaire.
Je rappelle enfin que la périodicité des accords collectifs, notamment sur l’égalité, constitue un réel sujet : les négociations sur les salaires risquent de devenir triennales, il faut donc rester vigilant sur ces échéances susceptibles d’influer sur l’égalité professionnelle.
Audition de représentant.e.s d’organisations syndicales de salarié.e.s (CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC et UNSA)
Compte rendu de l’audition du mardi 22 mars 2016
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous continuons les travaux de la Délégation sur le projet de loi visant à « instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ».
Mesdames et messieurs les représentants et représentantes des syndicats de salariés et chargés de l’égalité femmes-hommes, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons à désigner un ou une rapporteur d’information, puisque j'ai souhaité que la Délégation se saisisse de ce projet de loi. J'ai reçu la candidature de Marie-Noëlle Battistel qui, au regard de la charge importante, a proposé qu’elle et moi soyons corapporteures.
Pourquoi cette saisine de la Délégation aux droits des femmes sur le projet de loi présenté par Myriam El Khomri ? Je rappelle que la population active française est composée à 48 % de femmes. Or, au regard de la résistance des inégalités entre les femmes et les hommes en matière d'égalité professionnelle, et alors que 80 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, quarante ans de lois nous ont enseigné deux choses. D’abord, l’égalité femmes-hommes au travail n’avance que si l’on s'en occupe ; autrement dit, tous les salariés ne sont pas égaux devant le travail, et les femmes le sont moins encore que les hommes. Ensuite, si l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne fait pas l'objet de mesures spécifiques, au mieux, elle fait du surplace, au pire, elle perd du terrain. D'ailleurs, l’Europe demande depuis 2006 aux États des mesures spécifiques, avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
Sans préjuger des résultats de nos travaux, j’affirme donc comme préalable que nous saisir de ce projet de loi, c'est être déterminés à l'améliorer pour une prise en compte plus forte de l'égalité femmes-hommes. Certains syndicats ici représentés demandent le retrait du texte, d'autres y voient des avancées au travers de la négociation. Je souhaite que cette audition permette à chaque syndicat de formuler des propositions d'amélioration concrètes, qu'il nous appartiendra de retenir ou non en tant que recommandations et, in fine, sous forme d'amendements éventuels.
Cela étant dit, je dois reconnaître que l'exercice auquel nous vous avons demandé de vous prêter est compliqué, et je vous remercie de l’avoir accepté. En effet, vous allez nous faire part de vos observations sur un projet de loi qui n'a pas encore été présenté en Conseil des ministres – il le sera jeudi.
Je tiens cependant à souligner trois points. Premièrement, le sujet des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes n'est pas nouveau. Depuis 2012, nous avons renforcé l'égalité dans chaque texte. Vous allez nous faire part des avancées observées et des problèmes qui demeurent sur le terrain, en plus de vos remarques sur le projet de loi. Deuxièmement, le projet de loi a largement circulé, dans sa première version, mais aussi dans sa version amendée, transmise au Conseil d'État, que nous pouvons tenir comme celle sur laquelle nous travaillons ici. Troisièmement, vous avez déjà pu vous prononcer au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), certes, sur la première version, mais j'imagine que vos propositions formulées à ce stade pourront inspirer vos observations sur la deuxième version de l’avant-projet de loi.
À propos de l'avis du CSEP, je veux dire ici mon mécontentement. J'ai demandé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que cet avis soit communiqué à la Délégation aux droits des femmes. À l'heure où je vous parle, j'en attends toujours la réception annoncée. J'ai heureusement pu en avoir connaissance par une transmission non officielle. Une communication en bonne et due forme permettrait au Parlement d'accomplir son travail correctement et à la Délégation de mener à bien ses missions. Je saisis l’occasion pour indiquer que nous ferons le nécessaire, dans le cadre d’une évolution de son organisation, pour que le CSEP soit pérenne et puisse émettre librement des avis aisément consultables par le législateur. Notre réflexion est identique pour le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), qui souhaite être pérennisé – dans sa communication du 8 mars, le Président de la République a souhaité sa consécration par l’inscription dans la loi, afin de le pérenniser. J’y insiste, les avis de ces deux instances nous sont extrêmement précieux dans le cadre de nos travaux.
Ces précisions faites, avant de vous donner la parole, je vous propose que nos travaux se déroulent de la façon suivante. Dans un premier temps, chaque syndicat prendra la parole pendant dix minutes. Je souhaiterais bien sûr que vos prises de parole sur le projet de loi se concentrent sur la question de l'égalité femmes-hommes – un questionnaire vous a été envoyé en préparation de cette audition. Dans un second temps, les députées et députés membres de la Délégation vous poseront des questions visant à préciser vos propos ou à aborder d'autres aspects.
Mais avant tout, je signale la présence parmi nous aujourd’hui de M. Alain Ballay, suppléant de Mme Sophie Dessus, décédée brutalement, qui était membre de cette Délégation et dont l’engagement pour les droits des femmes n’a jamais faibli.
Mme Marie-Andrée Seguin, secrétaire nationale chargée de la politique en matière d’égalité professionnelle et de la condition féminine de la CFDT. Madame la présidente, je me réjouis de la volonté d’œuvrer pour la pérennité des instances que vous venez de citer, au travers desquelles nous pouvons défendre l’égalité professionnelle réelle.
Le projet de loi dont nous allons discuter aujourd’hui a été profondément modifié par rapport à celui sur lequel nous nous sommes positionnés au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP). La nouvelle mouture renforce le dialogue social et la négociation collective, elle permet la reconnaissance du fait syndical dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et elle accorde une place accrue à la négociation en entreprise. Doit-on avoir peur de la négociation en entreprise ? Peut-on douter de la capacité des équipes à négocier dans une entreprise ? Pour la CFDT, qui se bat depuis longtemps pour le renforcement de la place et du rôle du syndicat dans l’entreprise, la réponse est non. La réorganisation des relations sociales autour d’un ordre public social, un rôle de la branche réaffirmé, un renforcement de la négociation d’entreprise, le mandatement dans les plus petites entreprises, toutes ces mesures sont de nature à amplifier le dialogue social et la négociation collective au plus près des réalités des entreprises et des salariés, hommes et femmes.
Pour la CFDT, les politiques économiques, les négociations et l’action sont indissociables de la question de l’égalité professionnelle : il s’agit de concevoir l’égalité en permanence, et en amont, en impliquant tous les acteurs.
Comme nous ne cessons de le répéter, le dialogue social est un enjeu de compétitivité, de progrès social, car il est un moyen pour les entreprises de s’adapter à leur environnement, tout en tenant compte des intérêts et des aspirations des salariés. Le projet de loi en l’état ne diminue pas les droits des femmes, mais offre une opportunité de faire avancer l’égalité professionnelle à la fois par la négociation et par le mandatement – en plus de la représentation accrue des femmes dans les instances représentatives du personnel (IRP), grâce à la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. En l’occurrence, négocier dans les entreprises le temps de travail et les contreparties à d’éventuels assouplissements – plutôt que d’en rester aux sempiternelles contreparties financières – permet de mieux prendre en compte les questions de conciliation des temps. L’égalité professionnelle ne se résume pas à la réduction des inégalités salariales, elle concerne tous les sujets liés au travail. Même si elles demeurent nombreuses, les inégalités professionnelles ont été réduites ces dernières années, grâce à plusieurs évolutions législatives.
Dois-je rappeler que c’est par le dialogue social et la négociation au niveau interprofessionnel que les conditions des femmes se sont améliorées au fil du temps ? Que depuis 2012 un certain nombre de dispositifs négociés par les partenaires sociaux – complémentaire santé, règles sur le travail à temps partiel, mise en place du compte personnel de formation (CPF) – ont amélioré les conditions de vie et de travail de milliers de salariés, notamment des femmes ? En outre, la loi Rebsamen a introduit l’obligation de la parité pour les listes aux élections professionnelles, mesure pour laquelle la CFDT s’est battue, et qui va conduire à une présence significativement accrue des femmes aux tables des négociations. Dans les entreprises à majorité féminine, les représentants du personnel seront très majoritairement des femmes. La CFDT se refuse à considérer que ces femmes ne seraient pas en capacité de négocier. Par ailleurs, le dispositif du mandatement dans les très petites entreprises (TPE), dans lesquelles les femmes sont majoritaires, permettra de promouvoir les femmes aux responsabilités syndicales et ainsi de porter des revendications sur l’égalité professionnelle, pour peu que les organisations syndicales s’engagent dans cette voie.
Néanmoins, le changement culturel que requière la pratique du dialogue social ne se décrète pas, il se construit. Ce changement concerne les employeurs, les syndicalistes et les salariés. Dans ce nouveau contexte, ces derniers adapteront progressivement leur vote aux élections professionnelles et choisiront les organisations syndicales en mesure de construire des majorités et d’obtenir des évolutions favorables pour eux et pour leur entreprise.
Vous l’avez compris, pour la CFDT, ce projet en l’état ne porte pas directement atteinte à l’égalité professionnelle. J’apporterai des précisions lors des échanges qui vont suivre.
Mme Sophie Binet, membre de la direction confédérale de la CGT, chargée de l’égalité femmes-hommes. Nous regrettons l’absence d’étude d’impact sur ce projet de loi. Certes, les modifications apportées à ce texte sont bienvenues, mais elles demeurent insuffisantes.
En premier lieu, la philosophie même du projet de loi pose problème. Le préambule indique que des limitations peuvent être apportées aux droits fondamentaux si elles sont justifiées par les « nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise ». D’une façon générale, ce préambule tel qu’il est rédigé prouve que leurs rédacteurs ne connaissent rien à la problématique de l’égalité professionnelle.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Ce qui constituait un préambule du code du travail deviendra un article de loi posant des principes qui serviront de base à la réécriture de la partie législative du code du travail. Il nous faudra donc être vigilants sur les termes assez surprenants qu’il contient : égalité professionnelle « respectée », alors que l’Europe affiche une politique visant à « assurer » l’égalité ; « conciliation » entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, au lieu d’« articulation » comme nous le souhaiterions ; dispositions concernant l’« état de la femme » à propos de la grossesse et de la maternité...
Mme Sophie Binet. En second lieu, l’inversion de la hiérarchie des normes introduite par le projet de loi aura des conséquences particulièrement dangereuses pour les salariées.
D’abord, la négociation par le salarié mandaté sera dérogatoire avec ce projet de loi. Or les femmes sont plus nombreuses dans les TPE-PME, où les organisations syndicales sont moins représentées. Par conséquent, la CGT prône le développement de la négociation, non pas de façon dérogatoire en entreprise, mais au niveau de la branche pour créer une sécurité sociale professionnelle. Dans le même ordre d’idée, il faut lutter contre la discrimination syndicale – se syndiquer est un facteur de discrimination pour 30 % des salariés –, mais aussi renforcer les droits et la représentation des salariés des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME), avec par exemple des commissions des TPE en charge de l’égalité professionnelle.
Ensuite, cette inversion de la hiérarchie de normes aboutit à généraliser les logiques de dumping social et de low cost, avec des logiques de concurrence qui s’accroîtront entre les entreprises.
Plus grave : cette inversion de la hiérarchie des normes fait de la négociation en entreprise le lieu de la négociation des régressions, et non plus le lieu où peuvent être négociés des accords de conquête qui permettent d’obtenir des droits supplémentaires grâce à la loi ou un accord de branche. L’égalité professionnelle a avancé grâce à la loi, avec les obligations de négociation et les sanctions. Or renvoyer la négociation au niveau de l’entreprise sera dangereux en particulier pour les femmes.
Par ailleurs, ce projet de loi induit des reculs pour les droits des salariés, mais je vais axer mon propos sur ceux qui concernent particulièrement les femmes. L’inversion de la hiérarchie des normes s’applique d’abord au chapitre du temps de travail, mais ce projet de loi n’est qu’une première étape, les autres chapitres du code du travail seront concernés par la suite. Ce projet de loi finalise le détricotage des 35 heures, initié par la loi Fillon. En effet, la modulation du temps de travail passe d’un an à trois ans ! Or ces accords de modulation s’appliquent aussi bien pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel, lesquels sont déjà très pénalisés par huit avenants relatifs aux compléments d’heures. Par conséquent, cette période de référence reculera d’autant le déclenchement des heures supplémentaires. En outre, la période maximale de modulation du temps de travail par décision unilatérale de l’employeur passe de quatre à neuf semaines. Ces dispositions pénaliseront donc particulièrement les femmes.
Toujours au chapitre temps de travail, les dispositions concernant les salariés à temps partiel nous inquiètent au plus haut point. D’ores et déjà, la rémunération des heures complémentaires des salariés à temps partiel est discriminatoire par rapport à celle des salariés à temps plein – avec des majorations de 10 % à 25 %, contre 25 % à 50 %. Or le projet de loi prévoit désormais que le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 %, ce qui suppose une baisse de la rémunération des salariés à temps partiel. De la même manière, le texte prévoit que les changements d’horaire des salariés à temps partiel sont possibles dans un délai de prévenance de trois jours – au lieu de sept jours, sauf s’il y a un accord de branche, qui ne peut fixer une durée inférieure à trois jours.
Par ailleurs, le Gouvernement recule sur les congés familiaux, qui ne sont plus définis dans la loi mais par accord d’entreprise. Or les aidants familiaux sont essentiellement des femmes. Quant aux règles des congés payés actuellement définies dans la loi – interdiction pour l’employeur de modifier les dates des congés payés un mois avant le départ du salarié, prise en compte de la situation familiale des salariées pour définir les dates de congés payés –, elles ne sont plus garanties dans le texte.
Au chapitre du dialogue social, ce projet de loi introduit également des reculs très graves.
D’abord, il introduit une validité de cinq ans pour les accords d’entreprise. Jusqu’à présent, le maintien des avantages acquis prévalait jusqu’à ce qu’il y ait un nouvel accord ; avec ce texte, l’accord est périmé automatiquement au bout de cinq ans sans maintien des avantages acquis. Or actuellement, le patronat est tenté de nous faire renégocier sur une base plus faible les accords sur l’égalité professionnelle qui arrivent à terme.
Ensuite, avec ce projet de loi, la périodicité des négociations annuelles obligatoires (NAO) peut devenir triennale. La loi Rebsamen permet que les négociations annuelles soient seulement organisées tous les trois ans sous réserve qu’il y ait un accord majoritaire d’entreprise. Demain, il suffira d’un accord de branche pour que les négociations annuelles deviennent triennales, ce qui aura un impact très négatif pour l’égalité femmes-hommes, en reculant d’autant les mesures de suppression des inégalités salariales et les mesures en faveur de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.
Enfin, avec ce projet de loi, l’employeur peut s’opposer, sur décision unilatérale, à la publication d’un accord.
Dernier chapitre que je veux aborder : les licenciements.
Nous trouvons choquant que le patronat et le Gouvernement aient refusé de bouger sur la question des plans sociaux d’entreprise (PSE).
Plus grave : les accords de compétitivité dits « offensifs » élargissent considérablement la possibilité pour les entreprises de licencier, puisque le texte prévoit qu’elles peuvent le faire en vue du « développement » de l’emploi même en l’absence de difficulté économique. Ces accords de compétitivité offensifs peuvent imposer aux salariés des clauses de mobilité, une augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire, une modification du rythme de travail, autant de dispositions pénalisantes pour les femmes en raison des inégalités en matière de répartition des temps familiaux. En outre, si un salarié refuse de voir son contrat de travail modifié suite à un tel accord, il sera licencié selon les règles du licenciement pour motif personnel. Or une étude a montré que 50 % des femmes qui arrêtent de travailler pour élever leurs enfants avaient auparavant des horaires atypiques – travail de nuit, du soir ou le week-end. Ainsi, ce type de disposition est particulièrement défavorable aux femmes, en les fragilisant considérablement par rapport à leur droit au travail.
M. Claude Raoul, secrétaire confédéral de la CFTC. Malgré quarante de lois sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, celle-ci n’est toujours pas acquise. Si ce projet de loi reste en l’état, il faudra encore attendre une dizaine d’années. Les évolutions du texte sont certes satisfaisantes, mais il faut aller plus loin.
La CFTC observe que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes apparaît dans le « préambule » de l’avant-projet de loi à l’article 4, qui pose le principe d’égalité dans l’entreprise, alors qu’elle devrait figurer à l’article 5, qui interdit les discriminations dans toute relation de travail. En effet, confondre ces deux principes juridiques, dont les portées sont très différentes en matière de preuve comme de réparation, pourrait être préjudiciable pour les femmes victimes de discrimination à l’emploi. De surcroît, l’égalité entre les femmes et les hommes n’apparaît nulle part dans les autres articles du texte, alors que nombre de dispositions qu’il prévoit impacteront très différemment les femmes et les hommes.
En particulier, les mesures mettant en place une flexibilité accrue du temps de travail seront très défavorables aux salariées en termes de conciliation des temps, laquelle repose encore très largement sur les femmes.
D’abord, si la période d’appréciation de la durée maximale de travail est portée de douze à seize semaines, comme le texte le prévoit, il est évident que cette souplesse apportée à l’entreprise aura des conséquences très négatives sur les femmes qui travaillent et qui doivent en même temps assumer des responsabilités familiales importantes – solution d’accueil pour les jeunes enfants, scolarisation pour les plus âgés, solutions d’aide au maintien à domicile des personnes malades, handicapées ou en perte d’autonomie.
Ensuite, le texte prévoit de faciliter la mise en place d’horaires individualisés et l’aménagement du temps de travail, ce qui permettra plus de flexibilité dans l’organisation du travail en fonction des besoins des entreprises. Or aucune contrepartie tenant compte des besoins des salariées n’est prévue. Quant aux heures supplémentaires, le texte ouvre la possibilité de les rendre plus nombreuses et beaucoup moins bien rémunérées, ce qui s’apparente à une double peine pour les femmes.
Je vous apporterai des éléments complémentaires tout à l’heure dans le cadre de nos échanges, sur la base du questionnaire que vous nous avez envoyé.
Mme Carole Cano, vice-présidente du Syndicat national des cadres de l’assurance, de la prévoyance et de l’assistance (SNCAPA), de la CFE-CGC. Au nom de mon organisation comme à titre personnel, je suis très satisfaite de votre remarque sur les instances qui travaillent à l’égalité professionnelle, madame la présidente, étant moi-même membre du CSEP.
Alors que l’objectif du Gouvernement est de créer un nouveau modèle social capable de s’adapter au travail qui se transforme, celui-ci oublie complètement la dimension de l’égalité femmes-hommes. Dans son discours du 14 mars dernier, le Premier ministre déclarait que le projet de loi avait pour but de réformer notre marché du travail, de casser les inégalités qui le caractérisent, de donner plus de souplesse aux entreprises et plus de protections aux salariés. Or aucune des dispositions du projet de loi ne casse les inégalités entre les hommes et les femmes ; au contraire, la CFE-CGC estime que le texte installe ces inégalités dans la durée.
Les femmes sont majoritaires à occuper des emplois à temps partiel, elles sont très nombreuses dans les petites et moyennes entreprises et sont souvent moins bien rémunérées que les hommes. Or avec ce projet de loi, elles se trouveront encore une fois défavorablement impactées, en particulier à cause des dispositions relatives au temps de travail et à la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires.
La dimension de l’égalité professionnelle, qui avait déjà été mise à mal par le fait de la lier à la négociation sur la qualité de vie au travail, n’est pas ou peu prise en compte dans le texte. Pourtant, celle-ci est encore loin d’être atteinte.
Les « nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise » ne doivent pas amener à détériorer la santé du salarié ou de la salariée, ou intervenir au détriment de l’articulation des temps de vie.
Le renforcement des décisions unilatérales de l’employeur et la remise en cause de la hiérarchie des normes constituent des régressions en matière d’égalité professionnelle.
Le recours au référendum pour entériner la validité d’un accord d’entreprise qui recueillerait un engagement de 50 % des suffrages n’incite pas non plus à un dialogue social de qualité.
Les changements proposés pour la médecine du travail ne garantissent plus le suivi médical. Pour les femmes qui occupent des emplois dont la pénibilité et/ou les risques sont beaucoup moins visibles que dans les filières dites « masculines », ces changements risquent, encore une fois, de façon indirecte de peser sur leur santé.
Le projet de loi fragilise la négociation sur l’égalité professionnelle, tant au niveau de la branche – qui se fera tous les cinq ans – que dans l’entreprise, qui se fera tous les trois ans. La négociation sur les salaires – aujourd’hui annuelle dans la branche comme dans l’entreprise – pourrait devenir triennale dans la branche et dans l’entreprise. Or en différant la négociation sur l’égalité hommes-femmes et celle sur les salaires, le Gouvernement freine la lutte contre les inégalités salariales. À l’heure où les femmes sont moins payées que les hommes, il est primordial de dynamiser la négociation collective en la matière. Qu’elle soit au niveau de la branche ou de l’entreprise, la négociation collective est un vecteur primordial pour faire bouger les lignes. Elle permet de définir les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures qui permettent de les atteindre avec un suivi et des indicateurs.
Ces dispositions sont à mettre en perspective avec le mouvement de restructuration des branches engagé et accéléré par le Gouvernement. Il est reproché aux branches d’avoir une activité atone, d’où le chantier de réduction du nombre de branches. Or allonger la périodicité des négociations obligatoires de branche va à l’encontre du renforcement du dialogue social dans les branches, souhaité par le Gouvernement.
Pour ce qui concerne la remise en cause de la hiérarchie des normes, le texte renforce les décisions unilatérales de l’employeur. Or actuellement, les femmes, très nombreuses dans les PME, ne bénéficient pas forcément des accords d’entreprise – alors que les accords conventionnels leur sont applicables, ce qui constitue un socle de droits pour elles.
Par ailleurs, aux termes de l’article 37 du préambule, « les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits dans l’entreprise que les autres salariés ». Or l’article L. 3123-29 du code du travail indique que « le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. »
Si la CFE-CGC ne doute pas des compétences des femmes en tant que négociatrices, elle doute de la possibilité pour elles d’exercer ces droits pour la simple raison que 82 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes qui, je le répète, sont majoritaires dans les petites entreprises. Comment exercer ces droits si elles ne peuvent utiliser qu’un tiers de leur temps de travail ? La formation, l’engagement et l’investissement nécessaires pour des femmes qui vont devoir prendre en main ces sujets de façon immédiate nécessitent qu’elles puissent y consacrer du temps. En revanche, pourquoi devraient-elles y sacrifier leur vie personnelle ? Une réécriture du code du travail aurait dû rétablir une égalité de traitement, ou au moins une égalité de droits.
Les articles sur l’augmentation du temps de travail, les délais de prévenance, la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et les congés, sont incompatibles avec le 9° du préambule qui pose le principe de la recherche, dans la relation de travail, de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et avec celui posé par le 39° de l’article 1er du projet de loi, aux termes duquel « l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les domaines liés au travail ».
La deuxième version du projet de loi prévoit, dans le cadre de la négociation d’entreprise, un minimum garanti pour la durée des congés pour événements familiaux. Ainsi, les accords d’entreprise en question ne pourront plus déterminer une durée inférieure à la durée légale. Il s’agit là d’une demi-avancée puisqu’un accord d’entreprise pourra toujours porter la durée des autres congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en dessous des dispositions légales.
Le projet de loi supprime les avantages individuels acquis au profit d’un simple maintien de rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Les avantages individuels acquis sont donc limités aux seuls aspects de la rémunération, et la nouvelle définition écarte notamment les droits individuels à congé.
La CFE-CGC plaide pour une reprise dans la loi des critères de la jurisprudence, qui vont plus loin que la seule rémunération, avec une possibilité par accord collectif de compléter ces critères légaux de façon plus favorable.
Le renforcement des décisions unilatérales de l’employeur, particulièrement en matière de temps de travail, ne prend pas en compte les conséquences sexuées. Le partage des tâches n’est pas encore équilibré en France. Les femmes, qui constituent la majeure partie des familles monoparentales, doivent déjà gérer leurs heures de travail par rapport aux gardes d’enfant. Comment les mères pourraient-elles concilier leurs obligations avec l’augmentation du temps de travail du fait d’une modulation calculée sur trois ans ? Ces dispositions seraient particulièrement défavorables aux femmes.
La rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et l’étalement possible de la comptabilisation du temps de travail sur trois ans feraient subir la double peine aux femmes au regard de l’articulation des temps de vie, mais aussi du fait que les heures supplémentaires ne seraient pas forcément rémunérées, alors que les femmes auraient la charge supplémentaire des gardes d’enfant.
Par ces dispositions sur le temps, la durée, l’organisation du travail, ce projet de loi induit des discriminations indirectes qui vont accentuer les inégalités entre les femmes et les hommes en termes de rémunération comme d’évolution de carrière. Ces changements risquent encore une fois de façon indirecte de peser sur la santé des femmes qui exercent des métiers dont la pénibilité et/ou les risques sont beaucoup moins visibles que dans les filières masculines.
Je souhaite insister sur le sixième principe posé par le préambule qui concerne la liberté de manifester ses convictions religieuses. Au-delà du clivage qui serait créé entre les salariés du public et les salariés du privé, ces derniers pourraient se voir traités différemment selon l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Il serait également problématique de laisser à l’entreprise le soin de déterminer les nécessités de son « bon fonctionnement » – la conviction religieuse n’est pas un sujet d’entreprise, mais un sujet de société. En outre, et alors que le fait de se prévaloir de convictions religieuses est un danger lorsque cela aboutit à traiter différemment les salariés selon le genre, cet article ne ferait que renforcer ce à quoi on assiste déjà dans certaines entreprises : refus de serrer la main à une femme, refus d’obéir à une femme manager.
Enfin, la possibilité de modification unilatérale du contrat de travail en vue de la préservation de l’emploi, entraînant en cas de refus du salarié un licenciement individuel pour cause réelle et sérieuse, est particulièrement défavorable aux femmes qui seront les premières à subir ces décisions de leurs employeurs. Alors que les femmes subissent déjà de fortes contraintes, la flexibilité qui sera exigée risque ainsi de générer encore plus de précarité pour les salariées.
M. Saïd Darwane, conseiller national de l’UNSA. Pour l’UNSA, les rectificatifs au projet de loi visant à instituer de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs apportent de premiers équilibrages en faveur des salariés. Néanmoins, nous continuerons à agir pour une meilleure prise en compte de nos revendications au travers de ce texte.
En effet, le projet de loi ne prend pas en compte l’égalité entre les femmes et les hommes. Les mesures qui relèvent de l’inversion de la hiérarchie des normes fragiliseront particulièrement les femmes, car la négociation en entreprise est moins solide que celle au niveau de la branche. De plus, en cas de dénonciation d’un accord par l’employeur, le maintien des avantages acquis ne sera plus garanti tant qu’il n’y aura pas un nouvel accord.
Ce texte comporte trop de dispositions qui s’apparentent à des régressions pour les droits des salariés. Aussi est-il impératif de modifier ou de retirer certaines d’entre elles, notamment l’article 30 bis sur le licenciement économique et l’article 12 sur la validation des accords avec recours au référendum des salariés. Faute d'être retirées ou modifiées, ces mesures auront des conséquences défavorables en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et accroîtront la fragilité des femmes, notamment dans les PME et les TPE.
Dans un premier temps, seuls les accords sur la durée du travail, le repos ou les congés, le développement et la préservation de l’emploi, pourront être validés par référendum, mais cette mesure serait étendue à tout type d’accord au maximum au 1er septembre 2019.
L’UNSA s’oppose à cette disposition. Pour nous, l’entreprise est d’abord un lieu de travail où l’efficacité et la cohésion entre les salariés doivent régner au travers d’une démocratie sociale apaisée. Or celle-ci pourrait être mise à mal par des référendums qui aboutiraient à cliver les salariés et, à terme, à affaiblir la démocratie représentative. Une telle situation serait particulièrement dangereuse, surtout dans des secteurs professionnels où les femmes sont minoritaires. La majorité exprimée par référendum pourrait se faire au détriment de l’égalité entre les femmes et les hommes sachant que les mesures de mobilité ou d’augmentation du temps de travail n’ont pas le même impact sur les femmes que sur les hommes du fait des inégalités persistantes en matière de répartition des tâches familiales.
Le temps de travail constitue le premier facteur discriminant entre les femmes et les hommes, car ces dernières assument toujours 80 % des tâches ménagères et leur temps reste beaucoup plus contraint que celui des hommes. Nous déplorons le calcul du temps de travail sur trois ans par accord, au lieu d’un an, car un tel lissage permettra d’éviter le paiement des heures supplémentaires. De plus, le paiement des heures supplémentaires pourra être revu à la baisse par accord d’entreprise jusqu’à 10 %, au lieu de 25 % et 50 % actuellement. Cette mesure aura une incidence sur le pouvoir d’achat des salariés dont les salaires sont les plus bas, si bien que les personnes les plus touchées seront les femmes. En raison des contraintes domestiques et familiales qui pèsent sur les femmes, ces modulations seront encore plus incompatibles avec les horaires des modes d’accueil. Par conséquent, les femmes seront dans l’impossibilité d’accepter de tels horaires et subiront des risques de licenciement accrus.
Au surplus, alors que l’égalité professionnelle vise à favoriser l’emploi pour les femmes, les entreprises pourraient renoncer à recruter des femmes de peur qu’elles ne puissent accepter cette pression temporelle, ce qui aura pour conséquence la remise en cause du droit au travail des femmes. Toutes ces mesures sont incompatibles avec la recherche de l’articulation des temps et avec les obligations de sécurité et de protection de la santé qui incombent à l’employeur.
En ce qui concerne les licenciements, la nouvelle mouture du projet de loi indique que « ne pourront constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement pour procéder à des suppressions d’emplois ». Pour l’UNSA, cette nouvelle rédaction n’est pas acceptable : nous en demandons le retrait. L’avant-projet de loi passe à côté de ce qui pourrait être une amélioration pour les salariés, à savoir un resserrement au seul motif économique réel. En cas de refus de modification de leur contrat de travail et de leurs horaires, le motif de licenciement sera réputé acquis pour motif individuel. Cela touchera particulièrement les femmes qui, du fait des charges qu’elles assument, auront beaucoup moins de possibilité d’adaptation. Ces mesures sont particulièrement graves car elles remettent en cause le droit au travail des femmes et risquent de renvoyer à la maison les plus précaires d’entre elles qui ne pourront pas s’adapter à la flexibilité ou à la mobilité imposée.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. L’étude d’impact du projet de loi devrait être publiée très prochainement.
Vous avez insisté sur l’inversion de la hiérarchie des normes et sur la nécessité de renforcer la négociation au niveau de la branche. Or dans le cadre de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la sécurisation de l’emploi, dix-sept branches ont négocié des temps partiels inférieurs à 24 heures. Ce sont les syndicats qui négocient ces dérogations au niveau des branches. Je n’accuse personne, mais j’aimerais comprendre pourquoi les négociateurs n’ont pas priorisé les 24 heures, alors que les temps partiels sont majoritairement occupés par des femmes.
Mme Sophie Binet. C’est bien la preuve que renvoyer les dérogations à la négociation de branche ou d’entreprise aboutit à aggraver la situation des femmes.
En réalité, ce sont 60 accords dérogatoires qui ont été conclus pour les temps partiels, dont certains prévoient une à deux heures hebdomadaires, sans satisfaire aux contreparties minimales exigées par la loi – horaires réguliers ou qui permettent aux salariés de cumuler plusieurs activités. Les organisations syndicales avaient fait barrage à ces accords dérogatoires, mais le délai pour conclure ces accords a été prolongé grâce au Gouvernement – le ministère de travail a décidé de rallonger le délai de négociation jusqu’au 30 juin 2014, ayant jugé qu’il n’y avait pas assez de dérogations sur la règle des 24 heures. Ensuite, la règle de validité des accords est toujours de 30 % ; nous sommes favorables aux 50 %, ce qui éviterait des accords de ce type.
En outre, ces accords sont étendus sur décision du ministère du travail, alors que la majorité des organisations syndicales s’est prononcée contre leur extension car ils ne satisfont pas aux contreparties exigées par la loi – d’ailleurs, la CGT en a signés très peu. Enfin, la CGT demande depuis longtemps la présentation au CSEP d’un bilan qualitatif de ces accords ; nous attendons toujours.
Sur le terrain, nous observons que la durée moyenne des temps partiels continue à baisser dans un certain nombre de secteurs, notamment l’aide à domicile où des contraintes supplémentaires sont sans cesse imposées aux femmes aides à domicile dont le temps de travail est divisé par deux – on leur demande de faire en quarante-cinq minutes ce qu’elles faisaient en une heure trente – avec des amplitudes horaires supplémentaires. Ainsi, la situation continue à se dégrader pour les temps partiels.
Je rappelle que les politiques d’exonération de cotisations sociales sont centrées sur les bas salaires et bénéficient directement aux emplois précaires et aux temps partiels. Cela fait des années que nous demandons le réexamen de ces exonérations, en particulier le calcul des cotisations des temps partiels sur la base d’un temps plein, notamment dans le cadre de la négociation sur l’assurance chômage. En effet, parmi les 43 % de demandeurs d’emploi indemnisés, 23 % de femmes touchent des indemnités inférieures à 400 euros par mois du fait des temps partiels. Les femmes représentent près de 80 % des salariés à temps partiel et sont les principales bénéficiaires des minima sociaux.
Mme Carole Cano. La CFE-CGC a été signataire de l’ANI du 11 janvier 2013, dans un objectif de sécurisation du parcours professionnel des salariés, particulièrement ceux à temps partiel. Depuis, de très nombreux accords de branche ont dérogé aux 24 heures – qui devraient constituer un plancher. Or non seulement ces accords dérogatoires ne prévoient pas de majoration salariale pour les heures comprises dans le cadre des avenants de compléments d’heures, mais ils prévoient un délai de prévenance inférieur à sept jours. Plus grave : ils ne prévoient pas de limitation du volume de complément d’heures, non plus qu’un nombre maximal d’avenants pouvant être conclus par an et par salarié. Sur ce sujet, le ministère est relativement mou… La CFE-CGC s’oppose fermement à l’extension de tous ces accords, y compris de ceux dont elle est signataire.
Concernant la négociation, la parité n’est pas atteinte – loin de là – ni dans les organisations patronales, ni dans les organisations syndicales. En clair, la majorité des négociateurs de branche sont des hommes, et les femmes sont tellement peu représentées qu’on les oublie ou qu’on les sacrifie – la signature est facile puisqu’elles ne sont pas là pour se défendre... Comme je le disais tout à l’heure, l’article du code du travail qui les limite dans leur mandat ne va pas les aider à se faire représenter et à défendre leurs droits.
Mme Marie-Andrée Seguin. Avant l’article 12 de la loi du 14 juin 2013, issu de la négociation sur la sécurisation pour l’emploi, il n’y avait rien pour les salariés à temps partiel Nous sommes donc partis de rien. Il faut reconnaître le manque de volonté du patronat de négocier ces accords. Néanmoins, à ce jour, 34 accords de branche sont étendus, ce qui représente plus de 78 % de salariés. Le problème est maintenant de donner une réalité aux contreparties pour améliorer les conditions de travail des salariés à temps partiel et permettre aux femmes qui le souhaitent d’augmenter leurs horaires hebdomadaires ou de travailler à temps plein.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous aimerions également vous entendre sur le compte personnel d’activité (CPA).
Mme Marie-Andrée Seguin. Dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels, la CFDT a défendu la mise en place d’un dispositif permettant de regrouper des droits attachés à la personne, quel que soit son statut. Aujourd’hui, les parcours professionnels sont hachés, soit volontairement – la personne souhaite changer de vie et donc se réorienter – soit de façon subie, à la suite d’un licenciement notamment. Selon le projet de loi, le compte personnel d’activité (CPA) sera constitué du compte personnel de formation (CPF) et du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).
Le CPA est donc un bon outil, mais il reste à construire. Selon nous, il devrait s’appuyer sur le principe d’un accompagnement global portant sur l’ensemble des problématiques de sécurisation : projet professionnel, accès au logement, garde d’enfants, congés, etc. En effet, les nouveaux modes de travail engendrent des besoins, d’où l’intérêt de garanties offertes par un compte personnel d’activité tout au long du parcours de vie.
Mme Carole Cano. Si le Gouvernement a repris les points principaux de la position commune du 8 février dernier sur le CPA, pour la CFE-CGC, il est nécessaire d’aller plus loin dans la constitution de droits nouveaux pour les salariés dans le cadre de ce nouveau dispositif, particulièrement en matière d’égalité hommes-femmes et de conciliation des temps de vie. Cette évolution pourrait concerner la création d’un compte temps généralisé à l’ensemble des salariés, transférable tout au long de la carrière, afin d’offrir des marges de manœuvre aux salariés en termes d’équilibre des temps de vie privée vie professionnelle – temps de travail, temps familial, temps de formation, temps d’engagement associatif, temps syndical et, éventuellement, temps politique.
En rendant possible une meilleure répartition des temps tout au long de la vie, un tel dispositif offrirait de nombreux avantages. Il permettrait de concrétiser l’objectif fixé de donner plus d’autonomie et de liberté d’action aux personnes. En offrant des possibilités nouvelles aux personnes en matière de répartition des temps sociaux tout au long de la carrière, le CPA pourrait favoriser l’égalité professionnelle. Pour rappel, l’équilibre des temps de vie est considéré comme important ou très important par 93 % des salariés, par 96 % des professions intermédiaires, dont 75 % déclarent manquer de temps pour leur vie personnelle. Enfin, un tel dispositif constituerait un outil d’attractivité pour les PME face aux grandes entreprises, mais permettrait aussi un allègement des charges administratives, voire des charges financières.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Qui abonderait le dispositif ?
Mme Carole Cano. Cela pourrait fonctionner comme pour le compte épargne temps (CET), avec un abondement de l’employeur et du salarié.
M. Claude Raoul. La CFTC accueille favorablement la mise en œuvre du CPA, telle que prévue dans le projet de loi. Ce point reprend comme convenu les conclusions de la position commune du 8 février 2016, dont nous sommes signataires. Ce combat n’est pas nouveau pour nous. Déjà en 2006, dans son statut du travailleur, la CFTC revendiquait la sécurisation des parcours de vie pour tous et posait le principe de droits attachés à la personne dont la continuité serait assurée tout au long de la vie. Ce sujet, auquel la CFTC est très attachée, figurait à nouveau dans la motion d’orientation adoptée lors de son congrès de 2015.
Si, dans la première version du projet de loi, le CPA a été réduit à sa plus simple expression, la CFTC a apprécié de le voir légèrement étoffé dans la saisine rectificative. Le texte adjoint au compte existant un compte d’engagement citoyen pour l’exercice d’activités bénévoles, limitativement défini. Ce compte permet d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation, financées par l’État, une commune ou certains établissements publics, et des jours de congé attribués par l’employeur pour l’exercice de ces activités. La reconnaissance et l’encouragement de l'engagement citoyen correspondent aux revendications de la CFTC, tout comme la revalorisation de la fonction de maître d’apprentissage.
La CFTC défend la logique d’un fonctionnement par étape et une vision de long terme pour le développement de ce compte. Pour qu’il soit à l’avenir plus conforme à sa vision d’un dispositif plus ambitieux, elle espère donc que cette première étape sera complétée par d’autres améliorations qui pourraient élargir le périmètre du CPA au compte épargne temps, à la conciliation des temps de vie, à la validation des acquis de l’expérience (VAE). La CFTC demande qu’une négociation interprofessionnelle s’engage à cet effet.
Mme Sophie Binet. Cela fait plus de quinze ans que la CGT défend une sécurité sociale professionnelle. Le but est de maintenir le contrat de travail des salariés et de garantir l’exercice des droits, quels que soient le contrat de travail et l’employeur. Cette proposition a été élargie à une proposition que nous portons d’un nouveau statut du travail salarié qui trouve tout son sens avec la révolution numérique et l’émergence de nouvelles formes de travail – injustement regroupées sous la dénomination « travail indépendant » car il existe une forme de subordination économique.
Pour ce qui concerne le CPA, le salarié devrait avoir des droits à la formation tout au long de la vie et une qualification reconnue et portable quel que soit l’employeur, mais aussi des droits individuels garantis collectivement. Nous sommes en effet favorables à un dispositif collectif, qui ressemble au système par répartition des retraites. Dans le même ordre d’idées, nous n’étions pas favorables aux critères individuels pour le compte pénibilité, nous avions défendu des critères collectifs permettant une reconnaissance de la pénibilité par branche professionnelle.
Pour autant, des questions se posent à propos du CPA. Quels droits nouveaux en matière de formation ? Quels financements ? Pour l’heure, le CPA s’apparente plus à une coquille vide qu’à des droits nouveaux. Au surplus, le projet de loi introduit un recul sur la qualification, puisque le contrat de professionnalisation n’est plus forcément qualifiant.
Enfin, une approche genrée, notamment sur la question des temps partiels, est indispensable. Il faut prévoir un abondement du CPA pour ouvrir des droits sociaux aux salariés à temps partiel sur la base d’un temps plein. Nous sommes favorables au financement du dispositif par l’employeur – avec éventuellement des dispositifs de mutualisation au niveau de la branche, pour ne pas défavoriser les TPE-PME –, de façon à renchérir le coût des temps partiels et à inciter à recruter sur des temps pleins ou tout au moins sur des temps supérieurs à 24 heures.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous aimerions également vous entendre sur les premiers accords collectifs sur l’égalité professionnelle conclus suite à la loi Rebsamen du 17 août 2015, dans le cadre des trois « blocs » de négociation – salaires, égalité professionnelle et qualité de vie au travail, gestion des emplois et des parcours professionnels –, ainsi que sur la base de données économiques et sociales (BDES), appelée communément base de données uniques (BDU).
Mme Carole Cano. Les dispositions relatives au regroupement des négociations obligatoires en entreprise sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Nous avons donc peu de recul pour dresser un premier bilan. D’autre part, par exception, les entreprises couvertes au 1er janvier 2016 par un accord relatif à la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations, et à l’emploi des travailleurs handicapés, sont dispensées de négocier sur ces différents thèmes jusqu’au terme de l’accord en cours, et ce jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
Pour autant, à la lecture des accords, je constate qu’à partir du moment où l’égalité professionnelle est liée à un autre sujet, c’est toujours au détriment de celle-ci. Or si l’on veut améliorer réellement les conditions de travail et de vie des femmes salariées, l’égalité professionnelle ne pas être soluble : c’est un sujet spécifique, qui doit rester à part.
Pour l’instant, j’observe que le document relatif à l’égalité professionnelle est intégré dans la base de données économiques et sociales (BDES), accessible à toutes les IRP. Le risque à terme est de ne plus créer ce document – qui reprenait le rapport de situation comparée (RSC) avec tous les outils et indicateurs – et d’intégrer séparément tous les éléments relatifs à l’égalité. Or le rapport de situation comparée reste un outil indispensable pour les négociateurs, aussi bien en entreprise que dans la branche, car il permet d’établir à la fois un état de lieux, des comparaisons et un diagnostic sur la base d’objectifs au plus près des besoins des salariés, et entreprise par entreprise.
Mme Dominique Marchal, secrétaire confédérale de la CFDT. Concernant l’intégration du RSC dans la BDES, le décret d’application n’est pas publié. De la même façon, il n’y a pas de décret sur la définition de la négociation relative à l’égalité professionnelle au sein de la négociation sur la qualité de vie au travail (QVT). Dans ces conditions, nous ne pouvons pas négocier sur l’ « égalité professionnelle – QVT ».
Mme Sophie Binet. S’agissant des décrets d’application sur les carrières et l’évaluation sexuée en matière de santé et sécurité au travail, nous étions satisfaits des dispositions relatives à la santé et la sécurité, mais pas de la version a minima pour les carrières. En intersyndical, nous avions rédigé une proposition d’indicateurs qui permettait d’identifier les inégalités de carrière entre les femmes et les hommes, mais aussi toutes les autres discriminations, à partir de cohortes de salariés, en fonction de leur niveau de qualification, de leur âge et de leur salaire. Cette rédaction n’a malheureusement pas été retenue en raison de l’opposition du patronat.
Dans le cadre des débats sur la loi Rebsamen, nous avions proposé un droit d’expertise dédié sur l’égalité femmes-hommes. Ce droit d’expertise dédié existe, mais il est conditionné à l’accord de l’employeur pour les entreprises de plus de 300 salariés – le veto de l’employeur rend ce droit inutilisable. Or ce droit est plus que jamais nécessaire du fait de l’absence d’évolution en matière d’égalité femmes-hommes depuis des années.
Sur la dynamique de négociation, de nombreuses entreprises ne sont toujours pas couvertes par un plan d’action ou un accord. Dans la moitié des cas, ce sont des plans d’action unilatéraux – dont le contenu est plus faible que les accords. Quant aux accords, au mieux, ils se limitent à reprendre la loi, et au pire, ils sont en dessous de la loi sur les notions de « travail de valeur égale » ou de « discrimination indirecte ». Par conséquent, il faut renforcer les moyens de l’inspection du travail pour appuyer les IRP sur ces sujets. Certes, les sanctions ont dopé les négociations. Mais il est dommage que les sanctions ne soient pas liées à une obligation de conclure – elles sont liées à une obligation d’ouvrir des négociations. Surtout, nous regrettons qu’elles ne soient plus liées à une obligation de résultat, telle qu’elle avait été prévue dans la loi de 2006, puis supprimée en 2010.
Enfin, les impacts de la loi El Khomri sont très négatifs sur la négociation relative à l’égalité femmes-hommes. D’où notre inquiétude sur ce sujet, comme je m’en suis expliquée tout à l’heure.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Le législateur avait prévu l’envoi des plans d’action aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Mme Sophie Binet. Cette disposition importante de la loi de 2014 ne s’applique pas, car le décret sur le rescrit n’est pas publié, me semble-t-il.
Mme Marie-Andrée Seguin. Je partage ce constat. Il faut donner plus de moyens aux DIRECCTE.
Le projet de loi prévoit une concertation sur le télétravail. Ce point est très important.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Le télétravail peut être une fausse bonne idée d’articulation entre vie professionnelle et vie familiale, car les femmes se remettront au travail le soir, sans compter qu’elles seront isolées.
Comme l’a montré une étude, un cadre homme aura plutôt tendance à décider seul de travailler à distance , sans en référer à sa hiérarchie, contrairement à une femme cadre qui en fait la demande, car elle pense que ses supérieurs vont imaginer qu’elle fera autre chose à la maison que travailler… Les femmes s’autocensurent elles-mêmes.
Les salariés à temps partiel ont des horaires très flexibles. Or on demande aux femmes une flexibilité accrue. J’entends le besoin de mobilité, mais les choses sont très compliquées. J’ai moi-même été témoin du drame de la fermeture de l’entreprise Aubade dans une petite ville de la Vienne, où les femmes travaillaient de mères en filles, pour des salaires qui ne leur permettaient même pas d’acheter les soutiens-gorge qu’elles fabriquaient.
En dehors de ce projet de loi, avez-vous des propositions à faire pour améliorer l’égalité professionnelle ?
M. Claude Raoul. La CFTC a récemment été consultée sur une proposition de loi visant à faire passer de quatre à dix semaines la période de protection contre le licenciement après un congé de maternité. Où en est ce texte ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Cette proposition de loi a été transmise au Sénat, après avoir été adoptée la semaine dernière à l’Assemblée nationale.
Mme Marie-Andrée Seguin. Dans le même ordre d’idée, nous souhaiterions l’ajout dans la loi de l’interdiction pour l’employeur de la conclusion de ruptures conventionnelles avec les femmes en congé de maternité. Nous ne critiquons pas le dispositif des ruptures conventionnelles, mais nous jugeons indispensable de protéger les femmes en congé de maternité.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La maternité est source de discrimination, à l’embauche comme dans le travail. Les employeurs préfèrent embaucher des hommes plutôt que des jeunes femmes de trente ans. Et je connais une jeune femme à temps partiel à qui son employeur, qui ne peut pas la licencier parce qu’elle est enceinte, lui a fait signer un contrat de travail abaissant sa durée hebdomadaire de vingt heures à quinze heures…
Mme Maud Olivier. Que pensez-vous du curriculum vitae (CV) anonyme ? Au niveau d’une collectivité territoriale, on s’est aperçu qu’il permettait d’augmenter le nombre de rendez-vous et d’embauches de femmes.
Mme Sophie Binet. La CGT n’est pas défavorable au CV anonyme, même si ce n’était pas une de nos propositions dans le cadre de la concertation sur les discriminations. En revanche, nous avons défendu des propositions très précises, partagées par toutes les organisations syndicales puis par toutes les associations. Ces propositions qui visent à lutter contre les discriminations à l’embauche sont au nombre de quatre.
Premièrement, mettre en place un registre d’embauche, par exemple, dans les entreprises de plus de 50 salariés, contenant un recueil sexué des candidatures, ce qui permettrait de faire des comparaisons par rapport aux recrutements. On pourrait ensuite y intégrer des données du type « résident en zone urbaine sensible (ZUS) / hors ZUS», pour vérifier que les recrutements ne sont pas discriminatoires. En expérimentant ce registre à la SNCF pour les conducteurs de train, nous avons démontré que, malgré des candidatures féminines, à hauteur de 5 %, aucune femme n’était recrutée ; ce registre a donc permis de féminiser ce métier.
Deuxièmement, élargir le droit d’alerte des délégués du personnel aux embauches. En effet, notre droit d’alerte en matière de discriminations fonctionne actuellement pour les seuls salariés en poste.
Troisième proposition : la mise en place d’un référent lutte contre les discriminations dans toutes les entreprises, qui serait chargé de tenir ce registre.
Quatrième proposition : la remise d’une notification de leurs droits aux candidats à l’embauche lors de leurs entretiens, précisant l’interdiction pour le recruteur de leur demander s’ils fument, s’ils ont des enfants, etc., et comportant les numéros à contacter en cas de non-respect de ces droits. Il y a, en effet, un gap entre la loi et la façon dont se déroulent les entretiens d’embauche.
Ces propositions, reprises dans le rapport du groupe de travail sur les discriminations publié en mai 2015, ont rencontré peu de succès. Car ce qui prévaut aujourd’hui, c’est la mutualisation des bonnes pratiques, et non les mesures coercitives.
Plus globalement, sur l’égalité femmes-hommes, nous demandons que la question du sexisme et des violences relève du dialogue social dans l’entreprise. Dans le cadre de la négociation sur l’égalité dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, certains représentants de branches patronales nous ont dit ne pas voir le rapport entre cette question et celle de l’égalité entre les femmes et les hommes ! C’est vous dire la difficulté… Mais nous avons réussi à les convaincre, puisqu’un chapitre dédié est intégré dans l’accord.
Ensuite, nous demandons le déploiement des dispositifs d’accueil de la petite enfance – les places promises en crèche ne sont toujours pas au rendez-vous. Or la garde des jeunes enfants est le premier frein qui pèse sur les femmes.
Enfin, si nous sommes demandeurs de discussions sur le télétravail, nous sommes par contre totalement défavorables au fractionnement des onze heures de repos – question renvoyée à la concertation –, en contradiction totale avec le droit européen et les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité. En effet, le fractionnement des onze heures de repos pénalisera les femmes, particulièrement les cadres qui sont les premières à se remettre au travail le soir. Par conséquent, la réduction de la charge de travail, facteur d’égalité femmes-hommes, doit être mise à l’ordre du jour.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. S’agissant des dispositifs d’accueil de la petite enfance, il y a eu des améliorations, mais aussi des retards de la part de certaines collectivités locales.
Mme Carole Cano. S’agissant des CV anonymes, si les compétences n’ont pas de sexe, on constate que passé le premier rendez-vous, ces compétences deviennent sexuées. En clair, les CV anonymes permettent de franchir une étape, mais ne permettent pas un recrutement égalitaire – ce ne sont pas forcément les femmes qui sont engagées.
J’en viens aux autres améliorations possibles.
Pour notre confédération, la question salariale constitue la pièce maîtresse de la lutte contre les inégalités hommes-femmes. En effet, les inégalités salariales perdurent, le salaire des femmes cadres est en moyenne moins important que celui des hommes cadres, et plus on monte dans la hiérarchie, plus l’écart est important. En définitive, la loi de 2006 qui prévoyait l’égalité salariale réelle en 2010 n’a pas abouti – elle est même abrogée de fait.
Pourtant, la réduction des inégalités salariales est de nature à résoudre d’autres déséquilibres. À commencer par l’usage quasi exclusivement féminin du congé parental. Actuellement, le congé parental est pris par le parent dont le salaire est le plus faible, autrement dit par les femmes puisqu’elles gagnent en moyenne moins que les hommes. Tendre vers l’équilibre des salaires entre les femmes et les hommes amènerait davantage d’hommes à s’arrêter de travailler pour élever leurs enfants, si bien que les contraintes qui pèsent actuellement sur les femmes – retour au travail difficile, évolution professionnelle freinée – pèseraient sur les deux et finiraient par disparaître à terme.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La loi permet désormais le partage du congé parental.
Mme Carole Cano. Certes, mais il ne peut y avoir équité tant que l’inégalité salariale perdure. La mère prendra six mois, mais le père ne les prendra pas forcément.
Ensuite, la promotion des femmes à des postes à responsabilité est indispensable.
Alors que les écarts de responsabilité entre les hommes et les femmes sont faibles en début de carrière, ils s’accroissent progressivement à partir de trente-cinq ans. Entre quarante-cinq et quarante-neuf ans, 30 % des hommes cadres ont atteint un poste à forte responsabilité – direction générale, direction d’une entité ou direction d’un service –, contre 14 % de femmes. Au total, seules 11 % des femmes cadres occupent un poste à forte responsabilité, contre 23 % des cadres hommes. Le plafond de verre qui empêche les femmes d’accéder aux postes les plus élevés dans la hiérarchie est toujours présent. Pour que les femmes puissent accéder aux fonctions supérieures, mais aussi occuper des postes à responsabilité comme des postes de décisions, il faut percer ce plafond de verre.
Cela passe – encore une fois – par la réforme du congé parental d’éducation, qui actuellement peut éloigner de l’emploi les personnes qui en bénéficient, le plus souvent les femmes, puisque seuls 3 % des hommes prennent ce congé. La CFE-CGC propose une réduction à un an de l’indemnisation du congé parental, à hauteur de 80 % du salaire – à ce jour, l’indemnisation peut aller jusqu’à 530 euros. En outre, chacun des deux parents devrait pouvoir exercer ses droits pendant quatre mois sans pouvoir les transférer. Une telle mesure, en permettant aux femmes de bénéficier d’une véritable égalité des chances dans leur déroulement de carrière, contribuerait à la réduction des inégalités.
Il faudrait également réformer le congé de paternité. Aujourd’hui, le dispositif est peu attractif car la rémunération n’est pas assurée, si bien que peu de pères prennent les onze jours. La CFE-CGC revendique depuis des années le maintien intégral du salaire pour le congé de paternité.
Par ailleurs, il faudrait aller plus loin dans l’équilibre des genres dans les organes dirigeants. Convaincus de l’apport positif de l’équilibre des genres dans les organes dirigeants, la CFE-CGC soutient les avancées de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui concernent la mixité des genres dans les organes décisionnels. La mixité des genres doit se retrouver dans tous les organes délibérants.
L’État doit être exemplaire concernant les organes décisionnels des entreprises où il est actionnaire principal : il serait ainsi plus légitime à prendre des initiatives contraignantes pour toutes les entreprises. En outre, la CFE-CGC considère que le non-respect de l’équilibre des genres par les entreprises doit entraîner une sanction. Car c’est la seule façon de faire progresser l’égalité. Cette sanction doit être civile, et non pécuniaire, pour avoir un véritable impact sur la gouvernance. Ainsi, nous prônons la nullité des délibérations des organes dirigeants lorsqu’une entreprise refuse délibérément de s’inscrire dans cette démarche méthodologique. Grâce à cette sanction, la Suède a pu atteindre le quota de 40 % de femmes en moins de trois ans !
Enfin, s’agissant des temps partiels, il faut les rendre plus attractifs, car ils concernent essentiellement les femmes – seuls 7 % d’hommes travaillent à temps partiel. Il faut également accorder aux temps partiels les mêmes droits que les temps pleins, y compris en matière d’exercice de mandats syndicaux.
M. Saïd Darwane. Le CV anonyme permet de décrocher un entretien d’embauche. Il permet aussi, en interpellant les responsables des ressources humaines, une prise de conscience sur l’inégalité de traitement des salariés. Ainsi, le CV anonyme constitue un des leviers de lutte contre les discriminations. L’UNSA a expérimenté ce dispositif en 2006 pour l’accès aux stages des jeunes en bac professionnel et dans les filières BTS et DUT, dans le bassin d’emploi Lille-Roubaix, ce qui a fait émerger un dialogue très constructif entre les entreprises et les établissements d’enseignement.
Nos propositions d’amélioration portent, d’abord, sur la médecine du travail. Actuellement, le suivi est concentré sur les seuls salariés à risque. La visite d’aptitude d’embauche est supprimée dans le projet de loi. Or la pénibilité et les risques professionnels des métiers à prédominance féminine sont sous-évalués, si bien que ces métiers risquent de ne plus bénéficier du suivi médical. Nous pensons donc nécessaire d’augmenter le nombre de médecins du travail, mais aussi de renforcer leur formation sur les violences sexistes et sexuelles et la pénibilité dans les secteurs à prédominance féminine.
Ensuite, sur les conditions de travail, nous préconisons la mise en place d’indicateurs sur les risques professionnels et la pénibilité due au caractère répétitif des tâches. On sait en effet que les tâches répétitives à prédominance féminine sont nombreuses.
Mme Marie-Andrée Seguin. L’égalité passe par la mixité des métiers. Mais il faut aussi réfléchir à la revalorisation des métiers dits « féminins », afin de les rendre plus attractifs – lorsque les femmes ont investi un secteur professionnel, les salaires stagnent… Par conséquent, la reconnaissance et la classification des métiers à prédominance féminine sont essentielles pour réduire les écarts salariaux.
Ensuite, il faut sanctionner les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord. Car seul le « bâton » fonctionne.
Enfin, l’organisation du travail dans les entreprises doit être négociée. Cela permettrait une amélioration des conditions de travail, mais aussi une reconnaissance des femmes au sein des entreprises.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Merci beaucoup, mesdames, messieurs.
Audition de représentantes d’associations :
Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), Association d’accompagnement global contre l’exclusion (ADAGE) et Force Femmes
Compte rendu de l’audition du mercredi 23 mars 2016
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs sera présenté demain en conseil des ministres. Plusieurs modifications ont déjà été apportées à l’avant-projet de loi par rapport à la première version transmise au Conseil d’État.
Certaines des associations que vous représentez m’ont alertée sur l’impact de dispositions prévues par ce texte sur les femmes et l’égalité dans le monde du travail. Nous souhaiterions donc vous entendre sur ces sujets et recueillir vos observations sur l’avant-projet de loi – au moins sur le texte initial et, si possible, sur la version modifiée de celui-ci – ainsi que sur les améliorations que proposez. Ainsi, nous pourrons regarder ensuite si elles ont été prises en compte dans le projet de loi qui sera présenté demain et, dans le cas contraire, s’il convient de modifier celui-ci par voie d’amendements. Il nous faut en effet travailler, dans des délais resserrés, sur une version non encore stabilisée de ce texte.
Mme Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF). Je précise tout d’abord que mon propos porte sur l’avant-projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs et que nous avons essayé de prendre en compte les dernières annonces du Premier ministre. Si ce texte constitue une entreprise de précarisation générale pour tous les salariés de droit privé, certaines dispositions auront des conséquences particulières pour les femmes, parce qu’elles sont plus souvent concernées que les hommes par les emplois précaires, les temps partiels et les salaires les plus bas, et parce que ce sont aussi elles qui constituent, avec leurs enfants, la grande majorité des familles monoparentales.
Il est d’ailleurs révélateur que le rapport du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) n’ait pas été rendu public. Il n’y a pas non plus d’étude sur l’impact de ces dispositions sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
L’inversion de la hiérarchie des normes constitue l’un des axes de ce projet de loi, en proposant de faire primer les accords d’entreprise sur les accords de branche ou la loi. Or les femmes sont surtout présentes dans les entreprises sous-traitantes et dans les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME), par exemple dans le commerce et l’aide à domicile, où il y a moins d’implantation syndicale, et donc moins de possibilité de négocier et de se mobiliser. Faire primer les accords d’entreprise entraînera donc une baisse des droits et des garanties dans les secteurs à prédominance féminine. S’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle, la durée de vie des accords serait limitée à cinq ans, sans garantie de maintien des avantages acquis en l’absence de nouvel accord.
L’avant-projet de loi multiplie aussi les dérogations aux règles relatives au temps de travail : les temps d’astreinte pourraient ainsi être décomptés des temps de repos ; par ailleurs, des accords d’entreprise pourraient déroger à la durée maximale de travail de quarante-quatre heures, pour la porter à quarante-six heures sur douze semaines. Or ce sont les femmes qui prennent très majoritairement en charge les tâches domestiques, l’éducation des enfants et l’accompagnement des personnes dépendantes : si ces mesures sont adoptées, elles devront donc concilier ces contraintes personnelles avec une durée de travail plus importante. Il y a des femmes qui travaillent trop et d’autres pas assez. L’extension du forfait jours, prévue par l’avant-projet de loi dans les entreprises de moins de 50 salariés, risque d’instaurer comme norme le présentéisme, qui concourt au plafond de verre. Or cette norme se fait au détriment des femmes qui, en raison des contraintes familiales qui leur incombent, ne peuvent être présentes aussi longtemps que les hommes sur leur lieu de travail. Et cela pourra se faire d’ailleurs avec le simple accord d’un salarié mandaté, et l’on connaît la fragilité de ce dispositif : il peut s’agir par exemple de la secrétaire de l’employeur.
Concernant les temps partiels, les dispositions sur la durée minimale de vingt-quatre heures, prévues par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, avec toutefois plusieurs possibilités de dérogation, notamment par un accord de branche, seraient de fait assouplies puisque l’avant-projet de loi prévoit que cette durée minimale serait désormais fixée par les accords de branche. Ce n’est qu’en l’absence d’accord que cette durée minimale serait de vingt-quatre heures. En outre, nous craignons que le taux de majoration des heures complémentaires soit de 10 %, et non de 25 % à partir d’un dixième des heures prévues dans le contrat, comme c’est le cas actuellement. Par ailleurs, les changements d’horaires seraient possibles avec un délai de prévenance de trois jours, alors que dans l’état actuel du droit, ce délai est de sept jours, sauf si un accord de branche ou d’entreprise prévoit une durée inférieure.
De même, les femmes seront davantage affectées par la disposition du projet de loi prévoyant que la durée minimale de congés légaux sera déterminée par un accord d’entreprise ou de branche. C’est le cas du congé de solidarité familiale, qui est accordé en cas de pathologie grave d’un membre de sa famille, et ce congé pour accompagner un proche en fin de vie est pris très majoritairement par les femmes. Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, pourrait déterminer la durée maximale de ce congé et le nombre de renouvellements possibles, alors qu’actuellement ce congé est d’une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il en va de même pour le congé de proche aidant, qui permet d’accompagner une personne âgée dépendante ou un proche en situation de handicap. En outre, alors qu’un employeur ne peut changer aujourd’hui les dates de congés payés d’un de ses salariés un mois avant leur commencement, l’avant-projet de loi permet qu’un accord collectif, dans l’entreprise ou dans le secteur, réduise ce délai.
Ce texte accroît par ailleurs la flexibilité du travail en permettant une modulation du temps de travail sur une période allant jusqu’à trois ans actuellement, au lieu d’un an actuellement. En l’absence d’accord, elle ne pourra dépasser un mois, comme c’est le cas aujourd’hui, sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui pourront aller jusqu’à seize semaines sous réserve d’un accord validé par un salarié mandaté. Là encore, les femmes, qui doivent très souvent concilier leur vie professionnelle avec des impératifs familiaux, par exemple aller chercher les enfants à l’école, ne seront donc plus en mesure de maîtriser leurs horaires.
Si le Gouvernement a renoncé au fractionnement du repos quotidien de onze heures, l’article 26 du projet de loi prévoit qu’une concertation sera engagée avant le 1er octobre 2016 « sur le développement du télétravail et du travail à distance » et qu’elle portera également sur « l’évaluation de la charge de travail des salariés en forfait jours, la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques pour mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l’opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés ». La réforme du repos quotidien est donc encore envisagée.
L’avant-projet de loi prévoit aussi de réformer la médecine du travail. Il propose de supprimer la visite d’aptitude obligatoire et de centrer le suivi médical sur les salariés dits à risques. Or les risques et la pénibilité des métiers à prédominance féminine sont sous-évalués : c’est le cas par exemple de professions comme les caissières de supermarché ou les aides à domicile. On mesure donc l’impact d’une telle réforme sur la santé de ces salariées.
Cet avant-projet de loi, qui répond aux volontés du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), part du principe que pour créer des emplois, il faut faciliter les licenciements, ce que nous trouvons aberrant. C’est pourquoi nous ne pouvons que le combattre et exiger son retrait, et nous serons dans la rue le 31 mars pour porter cette revendication.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je donne à présent la parole à Mme Sandra Gidon, directrice de l’association ADAGE, qui accompagne des publics fragilisés en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Mme Sandra Gidon, directrice de l’Association d’accompagnement global contre l’exclusion (ADAGE). Je vous remercie tout d’abord de m’avoir invitée, Mme la présidente, à un moment où nous avons certaines inquiétudes en matière d’égalité professionnelle, concernant en particulier le non-remplacement à la préfecture de région d’Île-de-France de la chargée de mission qui s’occupait de l’égalité professionnelle, dont la mission va être intégrée dans les attributions de la personne chargée de l’accès aux droits et des violences, ainsi que la transformation, à la mairie de Paris, de la mission « égalité femmes-hommes » en un poste de chargé de mission « égalité, insertion et inclusion ».
Je souhaite ici évoquer notre expérience de terrain : ADAGE est une jeune association, même si nous avions travaillé auparavant dans le domaine de l’insertion, qui accueille environ trois cents femmes par an, et nous salarions environ quinze personnes dans notre chantier d’insertion.
En 2012, nous avons été stupéfaits de constater que, pour la première fois, une femme salariée par notre association avait été contrainte de dormir dehors avec son fils. De fait, l’emploi ne protège plus de la pauvreté. Par ailleurs, en voyant revenir des femmes plus fréquemment, nous avons décidé de mener une étude, en 2014 et 2015, sur une cohorte de cent trente femmes, et ces données chiffrées sont très préoccupantes. Ainsi, sur environ 60 % de sorties positives en emploi, on observe une diminution de l’ordre de 50 % des embauches en contrat à durée indéterminée (CDI), tandis que le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) de moins de six mois était environ 2,5 fois plus élevé.
Des femmes sont donc en CDD de trois ou quatre mois, et cette précarité les expose à des difficultés particulières en termes de logement et à des temps de transports importants. Pourtant, ces femmes sont prêtes à faire de grands sacrifices pour travailler. Je peux citer l’exemple de cette femme ingénieure des eaux et forêts qui a un trajet de deux heures et demie pour aller travailler. En outre, le renouvellement des papiers constitue un obstacle au maintien dans l’emploi, et il devient par ailleurs de plus en plus difficile de maintenir des droits entre deux CDD.
Dans le projet de loi présenté par Mme Myriam El Khomri, j’ai vu qu’il était beaucoup question du temps de travail, mais le temps des femmes en situation de précarité est occupé par les temps de transports, les démarches administratives et la santé, notamment. Avant, un emploi permettait de sortir de la pauvreté et de sécuriser un parcours, en permettant la mobilité sociale, l’accès à un logement, aux droits, à la santé, etc., mais aujourd’hui, le travail est source d’insécurité. Actuellement, beaucoup de femmes ont des plannings à la semaine, par exemple dans le domaine de la distribution et des services à la personne, où il y a aussi du travail au noir : comment organiser sa vie familiale quand on ne connait pas son planning au-delà d’une semaine ? Une aide-comptable me disait par exemple récemment qu’elle avait espéré que son CDD serait transformé en CDI et qu’elle avait tout fait pour s’insérer dans une entreprise, mais que son contrat ne serait malheureusement pas renouvelé et qu’elle craignait de ce fait de ne pas pouvoir payer les frais de scolarité de son fils à la rentrée. Par ailleurs, les droits changent entre deux CDD, et comme ailleurs les aides à l’emploi sont concentrées sur les bas salaires, ces personnes sont souvent rémunérées au SMIC.
Sur les cent trente femmes que nous avons suivies, 12 % ne savent pas lire et un tiers ont au moins le baccalauréat et jusqu’à bac +5 – et lorsque l’on voit le type de postes auxquels elles accèdent ensuite, il y a clairement une déqualification : autrement dit, les femmes acceptent le premier emploi pour sortir de la misère, et cela nous inquiète beaucoup. Par ailleurs, de plus en plus d’employeurs proposent à des femmes de travailler avec le statut d’auto-entrepreneur. Autrement dit, il n’y a plus de garanties et, plus généralement, trouver en emploi n’est plus automatiquement synonyme d’amélioration des conditions de vie.
Par ailleurs, la réforme de la formation professionnelle n’est pas bénéfique pour nos publics qui ont besoin d’une formation, qui ne soit pas forcément qualifiante ou très spécialisée. Ainsi, la préparation aux concours d’aide-soignante et d’auxiliaire de puériculture n’est pas considérée comme une formation qualifiante et n’est pas prise en charge financièrement par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Un mot également sur la réforme de l’économie sociale et solidaire, qui a favorisé les grosses structures alors que nous sommes une petite structure, et nous tenons à le rester. Il nous est ainsi souvent proposé de développer plusieurs chantiers d’insertion, alors que nous souhaitons n’en avoir qu’un seul.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les grosses structures sont-elles favorisées par la loi ou par sa mise en œuvre par des collectivités locales ou des acteurs de terrain ? Pourquoi vous est-il demandé de vous développer ?
Mme Sandra Gidon. Parce que nous obtenons de bons résultats, parce que c’est la tendance actuelle et qu’il n’y a plus ainsi qu’un interlocuteur... La loi réformant le secteur de l’économie sociale et solidaire a en effet favorisé les grosses structures. L’insertion par l’activité économique est l’un de nos outils, et nous sommes confrontés à des difficultés, comme c’est le cas pour plusieurs chantiers d’insertion.
Il convient par ailleurs de souligner l’importance des enjeux liés à la fracture numérique en termes d’accès à l’emploi et de maintien dans l’emploi. Quand des femmes sont hébergées à l’hôtel ou dans des conditions indignes, elles n’ont pas d’ordinateur ni de tablette, et elles n’ont pas forcément accès à internet, or il est aujourd’hui important de maîtriser les compétences numériques dans l’emploi. Pour les personnes précaires, c’est une réelle difficulté. Plus généralement, les femmes que nous accueillons veulent travailler, elles sont formidables de dignité et de courage, et nous vous invitons d’ailleurs à venir les rencontrer,
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Merci de cette proposition. Je comprends que l’association est implantée uniquement à Paris ?
Mme Sandra Gidon. L’idée est plutôt de rester une petite structure qui accueille peu de gens, mais à taille humaine, et d’essaimer nos pratiques, à travers la formation des professionnels notamment. Par exemple dans le cadre de notre chantier d’insertion, nous avons accueilli des personnes venant de Lille ou du Sud de la France. A contrario, la fusion ANPE – Assedic a suscité des inquiétudes, et certains craignent d’ailleurs aujourd’hui une privatisation. En tout état de cause, quand il n’y a plus que de très grandes agences, et qu’il est difficile de joindre par téléphone un conseiller de Pôle Emploi, cela pose des difficultés pour les personnes en situation de précarité.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Merci de ce témoignage très intéressant sur ces femmes qui cherchent à travailler et doivent surmonter un certain nombre de difficultés– logement, transports, enfants, etc. – outre la recherche d’emploi.
Mme Sandra Gidon. Mais c’est aussi la dégradation des conditions de travail qui nous préoccupe : c’est terrible d’aider une femme à retravailler, alors que ses conditions de vie ne s’améliorent pas, et cela conduit nécessairement à réinterroger notre travail.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Il est vrai que notre société comprend différents types de travailleurs, et notamment des personnes en contrat en CDI et à temps plein, tandis que les femmes beaucoup plus précarisées et à temps partiel, avec des difficultés pour accéder au CDI ou au temps plein. Et pour certaines personnes, le travail est déjà très flexible, pour d’autres beaucoup moins – c’est toujours le problème dans l’écriture de la loi qui s’applique à tous. Pour les femmes, et du moins certaines d’entre elles, on constate déjà une grande flexibilité dans le travail mais aussi que ce sont les moins flexibles dans le domaine personnel, du fait des contraintes horaires liées à l’école, la crèche, etc. : c’est le problème, bien connu, de la « double journée ». Cependant, une partie de cette journée ne peut se moduler aisément.
Mme Sandra Gidon. À cet égard, je précise que nous avons 30 % de CDI et 70 % de CDD. Ces problématiques touchent tout le monde.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La jeunesse est très sensible à la loi, même si rien ne la concerne spécifiquement et directement, mais aujourd’hui on sait que les jeunes n’entrent sur le marché du travail qu’en CDD, avec des contrats courts renouvelés, des stages, etc., et il est difficile dans ces conditions de louer un appartement et de se stabiliser.
Mme Sandra Gidon. Il me semble que cela touche également les parents de ces jeunes qui sont dans la rue. En tout cas, dans les quartiers, on ressent un grand désespoir des jeunes et il peut être difficile de voir des parents qui ont beaucoup travaillé être malmenés sur le plan professionnel après cinquante ans.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Il est vrai que cela inquiète les parents, en particulier lorsqu’ils ont eu confiance dans la formation initiale et les diplômes, alors que cela ne débouche pas nécessairement aujourd’hui sur un emploi stable en CDI.
Mme Elise Moison, déléguée générale de Force femmes. L’association Force femmes accompagne les femmes de plus de 45 ans au chômage, et qui sont donc confrontées à une double discrimination, de l’âge et du genre, qui peut être très violente. En moyenne, les femmes suivies par l’association ont 52 ans et sont au chômage depuis un an ; il s’agit donc globalement des parents de ces enfants que vous évoquiez. Par ailleurs, la plupart d’entre elles sont seules. La question du partage des tâches ne se pose donc pas, car il leur incombe de les assumer intégralement. Par ailleurs, trop souvent, il s’agit de femmes seules avec des enfants à charge qui ne reçoivent pas de pensions alimentaires notamment. Des questions juridiques se cumulent alors avec le « mille-feuille » de problématiques auxquelles elles peuvent être confrontées en lien avec l’emploi, la garde d’enfants, la mobilité professionnelle ou géographique ou encore les problèmes de santé, ce qui n’est pas chose rare chez une femme de 52 ans en moyenne.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Cependant, les enfants sont plus grands.
Mme Élise Moison. Certes les enfants sont plus grands, mais il faut tout d’abord souligner que l’âge de 52 ans est une moyenne et nous avons quand même une fois tous les deux mois environ une femme accompagnée d’un enfant qui attend dans la salle d’attente, parce qu’il est âgé de cinq ou six ans seulement. Par ailleurs, même si les enfants sont plus grands, ils sont toujours présents et coûtent toujours chers – je pense par exemple à la situation d’une personne seule avec trois adolescents à charge.
Depuis dix ans, nous accompagnons vers l’emploi les femmes plus de 45 ans. Concernant la question des diplômes et du niveau académique– même si, pour ce public, on parle plutôt d’expériences et de compétences –, il s’agit d’une population qui a quand même un niveau de bac + 2 en moyenne. Je précise que l’association a accueilli environ 20 000 femmes dans les dix villes où nous sommes présents. En Île-de-France, qui représente environ 50 % de notre activité, c’est même un niveau bac + 4 ou bac + 5. Cette question du niveau académique est donc devenue un non-sujet.
Ces femmes ont notamment pour atouts l’expérience, la capacité de recul, l’organisation et l’autonomie, mais leur profil est associé à d’importants stéréotypes : en caricaturant à peine, elles peuvent envoyer 400 curriculum vitae pour recevoir finalement deux réponses négatives. C’est donc très démobilisant, avec aussi un risque d’isolement et de perte de confiance en soi, voire de perte de repères, avec une définition parfois floue du projet professionnel. Des jeunes peuvent avoir des difficultés à compléter leur CV pour ce qui concerne leurs expériences, mais pour nous, une difficulté importante tient à la prise en compte de vingt, vingt-cinq ou trente d’expériences professionnelles sur une page de CV. Et lorsqu’elles se présentent à Force femmes – ou dans d’autres associations qui proposent un accompagnement vers l’emploi, même si elles sont encore trop peu nombreuses – ces femmes nous disent que personne ne les a jamais vraiment aidées et qu’elles ont seulement reçu un SMS de Pôle Emploi six mois auparavant…
Il y a donc un besoin important d’accompagnement pour la définition du projet professionnel et la connaissance du marché de l’emploi, mais aussi leur apporter un appui concernant les passerelles et les formations. Par exemple, que faire lorsque tel métier n’existe plus ou que le secteur d’activité est bouché ? Environ la moitié des femmes que nous accompagnons ont été licenciées. Environ un quart des femmes sont accueillies suite à une fin de mission, mais les trois quarts sont là suite à un licenciement pour motifs économiques. Par ailleurs, contrairement à ce que certains peuvent penser, seulement 2 % des femmes environ que nous accompagnons n’ont jamais travaillé.
En direction de ces femmes qui se retrouvent au chômage, l’association est centrée sur l’accompagnement vers l’emploi – nous ne sommes pas un chantier d’insertion – mais on voit à quel point le millefeuille des problématiques connexes vient compliquer la recherche d’emplois. Il peut s’agir de problèmes de logement, de surendettement, voire malheureusement de prostitution, ou encore de santé et d’addictions. La question des violences doit toutefois être mise à part, car elles ne surviennent pas dans le cadre de cette perte d’emplois.
Nous proposons un accompagnement intensif de recherche d’emploi, et nous avons ainsi suivi 20 000 femmes en dix ans dans une dizaine de villes en France. Force Femmes s’appuie sur un réseau de 600 bénévoles, qui sont des spécialistes des ressources humaines, car nous sommes partis du principe qu’il s’agit de compétences et d’une expertise bien précises, avec la volonté d’être utiles au plus vite, notamment parce qu’il s’agit de ce que nous appelons une « génération sandwich », au sens où elles ont à la fois des enfants et des parents à charge. On voit ainsi de plus en plus de femmes qui nous disent qu’elles ne pourront plus venir à l’association car elles doivent s’occuper d’un ascendant. Il s’agit là d’une question importante.
Une autre problématique tient à la mobilité géographique : en raison des charges familiales, les déplacements sont compliqués. J’insiste sur le fait que ces femmes sont globalement prêtes à faire beaucoup de concessions pour retrouver un emploi mais, contrairement à un ou une jeune, elles doivent assumer la charge d’enfants et de parents. La précarité financière n’est peut-être pas si importante dans l’absolu, mais le salaire perçu doit permettre de nourrir toute une famille. D’après l’enquête que nous avons menée auprès de 1 200 femmes, 95 % d’entre elles sont prêtes à faire des concessions pour retrouver un emploi – 62 % sur la durée de contrat et 68 % sur le salaire et parmi elles, 60 % sont prêtes à réduire leur salaire de 10 % et jusqu’à 40 %. Par ailleurs, 55 % sont prêtes à reprendre une formation courte et 36 % une formation longue. Cependant, l’accès à l’information pose problème ; on observe une perte de repères par rapport aux circuits d’information et de financement de ces formations.
Pour conclure, nous souhaitons alerter sur l’émergence de nouvelles situations précaires : on voit de plus en plus, comme cela a été évoqué précédemment, des personnes retrouver un emploi, puis revenir à l’association parce qu’elles l’ont perdu, des ruptures conventionnelles, des personnes embauchées en CDI, mais auxquelles il est mis fin au contrat de travail à la fin de la période d’essai, car cela coûte moins cher qu’un CDD avec une prime de précarité.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. En période d’essai ?
Mme Elise Moison. La période d’essai peut être de huit mois pour un cadre, avec un renouvellement. Par ailleurs, nous voyons de plus en plus de femmes à la retraite qui viennent nous voir et, après réflexion, nous avons décidé de les accompagner – les deux critères généraux fixés par l’association sont d’être inscrite à Pôle Emploi et d’être âgée de plus de 45 ans. Il y a là une nouvelle forme de précarité, avec des personnes qui n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins, en raison du faible montant de leur retraite, et doivent donc retrouver un emploi.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Concernant les pensions alimentaires, je tiens à rappeler que nous avons mis en place une garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA), qui va être généralisée cette année : il s’agit d’un fonds de garantie chargé de verser une aide, avec ainsi une forme d’assurance pour qu’un minimum de pension alimentaire soit versé à la personne, et de récupérer ensuite auprès de la personne concernée une pension non versée.
Mme Elise Moison. Il faudrait cependant communiquer sur ce dispositif.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La généralisation a été annoncée récemment ; la caisse d’allocations familiales (CAF) prendra en charge ce dispositif et un complément d’environ 100 euros sera versé, avec récupération auprès du mauvais payeur. La ministre souhaite d’ailleurs créer une agence de recouvrement des pensions.
Mme Elise Moison. C’est un sujet important.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les femmes devraient ainsi être assurées de percevoir une pension alimentaire, quelle que soit leur situation ou la mauvaise volonté de l’ancien conjoint.
Je donne à présent la parole à la déléguée générale de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). Je serais d’ailleurs intéressée de connaître votre analyse sur la mise en œuvre des dispositions introduites dans le cadre de loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen ».
Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). L’AVFT est spécialisée sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu professionnel. Pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, parmi les femmes qui s’adressent à ces associations, il y en a certainement qui ont été exclues de l’emploi parce qu’elles ont été victimes de violences au travail. Concernant le projet de loi Travail, l’AVFT souscrit globalement aux critiques qui ont été émises sur ce texte, depuis qu’il a été rendu public, en particulier sur la philosophie générale du projet au regard des droits des salariés.
Dans mon intervention, je vais cependant mettre l’accent sur les dispositions les plus problématiques comme l’indemnisation des licenciements illégaux. Nous travaillons en effet depuis plusieurs années sur l’indemnisation des femmes victimes de harcèlement sexuel et les licenciements illégaux, sur le plan civil, pénal et social. Le rapport à l’argent est difficile pour les associations et les victimes, et ce que celle-ci veulent d’abord obtenir, c’est la condamnation de leur agresseur. Néanmoins, l’argent est nécessaire pour se reconstruire et se projeter dans l’avenir.
Dans la première version du projet de loi, un plafonnement des indemnités était prévu sauf en cas de licenciements discriminatoires. Cela ne signifie pas pour autant que cette première version ne posait pas de difficultés, dans la mesure où le juge avait la possibilité, et non l’obligation, d’aller au-delà des plafonds, alors même que les licenciements discriminatoires sont considérés comme les plus attentatoires aux libertés fondamentales, et qu’ils doivent donc être particulièrement bien réparés par le juge.
Certes, les plafonds ont disparu pour tous les licenciements dans la version modifiée du texte mais le plancher n’est pas revenu. La suppression du minimum légal d’indemnisation équivalent à six mois de salaires pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse pose problème et, par ailleurs, le Gouvernement n’a pas réintroduit les dispositions prévoyant un plancher d’indemnisation spécifique de douze mois de salaires pour les licenciements nuls, et plus particulièrement les licenciements discriminatoires.
Il convient à cet égard d’abord de rappeler que, dans le droit actuel, il y a deux types de licenciements illégaux : les licenciements sans cause réelle et sérieuse et les licenciements nuls. Les premiers sont de droit commun, et concernant les salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté et qui travaillent dans les entreprises de moins de 11 salariés, aucun minimum d’indemnisation n’est prévu par le code du travail : il appartient donc au juge d’apprécier la réalité du préjudice subi et d’indemniser en fonction la personne. En revanche, si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté ou s’il travaille dans une entreprise de plus de 11 salariés, l’indemnisation ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ce plancher est une garantie de l’effectivité des droits des salariés, mais les victimes de harcèlement sexuel ne sont pas concernés par exemple, non plus que les salariés qui ont pu témoigner en leur faveur. Et si j’évoque dans mon intervention le harcèlement sexuel, l’analyse peut être étendue aux victimes de licenciements discriminatoires, puisque le principe est le même. J’en viens donc aux licenciements nuls, pour lesquels la loi ne dit rien : il n’y a pas de plancher d’indemnisation.
C’est la chambre sociale de la Cour de Cassation qui a pallié ce manque en fixant un plancher égal aux six derniers mois de salaires, si la personne ne réintègre pas l’entreprise suite à un licenciement nul, et cette garantie s’applique quelle que soit l’ancienneté de la personne et quel que soit le nombre de salariés dans l’entreprise. Cette jurisprudence constante a ainsi institué une protection plus importante pour les victimes d’un licenciement discriminatoire, et c’est parfaitement logique car ce sont les licenciements qui sont considérés comme les plus graves et les plus attentatoires à l’ordre public. D’une certaine manière, la chambre sociale a mis en place une ébauche de dommages et intérêts que l’on pourrait qualifier de « punitifs », même si cette notion est étrangère au droit français, en matière de licenciement discriminatoire ou attentatoire à une liberté fondamentale. Ainsi, selon cette jurisprudence, même un salarié qui aurait moins de six mois d’ancienneté et qui seraient victimes d’un licenciement discriminatoire, requalifié en licenciement nul, devait être indemnisé à hauteur d’au moins six mois de salaire. Cela a par exemple été le cas d’un salarié victime d’un licenciement discriminatoire lié à son état de santé, et qui avait un mois et demi d’ancienneté, sur lequel la Cour de Cassation a été conduite à se prononcer.
La raison de cette jurisprudence est que ces licenciements sont des violations d’une particulière gravité. La jurisprudence a même précisé que, si la personne ne souhaitait pas être réintégrée dans l’entreprise suite à un licenciement discriminatoire, l’employeur devait verser les salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas quitté l’entreprise, à partir de la rupture du contrat de travail jusqu’à la décision de justice, et que les juridictions n’avaient pas le droit de soustraire à ces sommes les revenus de remplacements, y compris les nouveaux salaires qu’elle aurait pu percevoir dans un nouvel emploi. J’insiste sur ces exemples pour souligner qu’il s’agit là d’un droit dérogatoire par rapport au droit commun.
Le droit du travail procède d’une codification régulière de la jurisprudence de la Cour de cassation pour garantir les droits, et c’est bien cela que nous attendons du législateur aujourd’hui. C’est cette logique qui avait conduit au dépôt en 2014 d’un amendement au projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, à l’adoption duquel vous aviez grandement contribué Mme la présidente, et le législateur avait considéré que six mois n’était même pas assez et porté le plancher d’indemnisation à douze mois de salaires, et introduit par ailleurs des dispositions visant à prévoir le remboursement par l’employeur condamné des salaires qui auraient étés perçus en l’absence de licenciement.
Notre expérience à l’association nous montre que ce minimum légal de six mois de salaires, qui est remis en cause par le projet de loi, n’est pas assez dissuasif pour contraindre les entreprises à mettre en place la prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise, alors qu’il s’agit d’une obligation légale. Nous avons d’ailleurs du mal à donner des exemples d’entreprises vertueuses en la matière. De fait, le procès devant les conseils de prud’hommes ne leur coûte pas assez cher. Pour changer la donne, la seule solution est de veiller à ce que les entreprises encourent le risque d’être condamnées à des dommages et intérêts dissuasifs, avec une sanction ainsi dotée d’un pouvoir normatif. On ne peut pas compter uniquement sur l’évolution des comportements et le développement d’actions de sensibilisation pour attendre, encore des dizaines d’années, que les choses changent et que les femmes soient rétablies dans leurs droits. En outre, le minimum de six mois ne répare pas le cataclysme entraîné par les violences sexuelles au travail pour les victimes, les atteintes à la santé, l’impact sur la vie de famille, la perte de chance de retrouver un emploi, voire une forte désocialisation.
L’amendement que vous aviez soutenu, Mme la présidente, a été abrogé par le Conseil constitutionnel, mais uniquement pour pour méconnaissance de la procédure législative. Il pourrait donc être réintroduit à la faveur de ce projet de loi. Plusieurs engagements avaient d’ailleurs été pris pour réintroduire ces dispositions dès qu’un véhicule législatif s’y prêterait – la loi Rebsamen, notamment, aurait pu être amendée en ce sens – mais cela n’a pas été le cas. Mme Pascale Boistard avait pourtant indiqué que le sujet n’était pas de savoir s’ils seront réexaminés, mais quand.
Concernant ce projet de loi, s’agissant des licenciements discriminatoires et des licenciements prononcés dans un contexte de harcèlement sexuel, on ne passe donc pas d’un plancher de six mois à zéro, mais en fait de douze mois de salaires à zéro. Or l’incitation au développement d’une politique de prévention n’est crédible que s’il y a des sanctions. Je rappelle par ailleurs que ce projet de loi, dans son article 1er, pose le principe général selon lequel « Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime protégée ».
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. En matière de harcèlements, disposez-vous de données concernant les cas ayant fait l’objet de condamnations, et suite notamment aux dispositions introduites par le législateur ?
Mme Marilyn Baldeck. Nous n’avons pas connaissance d’un recensement des procédures sociales. Il en va différemment en matière pénale, avec l’annuaire statistique de la justice qui décompte les procédures. Néanmoins, je peux vous indiquer que l’AVFT est de plus en plus saisie par des victimes, qui vont de plus en plus devant les prud’hommes, et pour plusieurs raisons sans doute. L’agenda législatif et médiatique, avec l’affaire Dominique Strauss-Kahn en 2011 et la loi de 2012 sur le harcèlement sexuel, a pu contribuer à mieux identifier ces questions. Cependant, notre association peut répondre à toutes les demandes tout au long de l’année. Nous intervenons auprès des salariés avec des résultats satisfaisants en termes de condamnation de l’employeur, mais pas sur l’indemnisation. Or ce qui nous intéresse, c’est l’effet démultiplicateur de notre action, autrement dit l’effet collectif et politique. Encore une fois, ça ne coûte pas assez cher à l’employeur, et ce n’est pas assez dangereux pour lui, pour qu’on puisse observer un réel changement de regard, sinon de paradigme, sur ces questions.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. J’ai eu connaissance de cas où des femmes qui avaient engagées des poursuites aux prud’hommes avaient eu beaucoup de mal à établir la preuve des faits contre leur employeur, et cela m’avait laissé penser qu’il était très compliqué d’arriver au terme de ce type de procédures, mais je note avec intérêt, en vous écoutant, que des condamnations ont pu intervenir donc dans ce domaine.
Mme Marilyn Baldeck. C’est précisément la question de la preuve que je souhaitais évoquer ensuite, mais je vais d’abord répondre sur les nouvelles dispositions législatives. La principale amélioration apportée a trait à l’instauration dans le code du travail d’une obligation de sanction des salariés auteurs d’harcèlement sexuel, ce qui est une première dans le code du travail. Pour nous c’est une disposition particulièrement intéressante mais nous n’avons pas encore eu l’occasion de l’utiliser devant un conseil de prud’homme. Nous n’avons pas encore fait la demande d’indemnisation spécifique à un employeur pour ne pas avoir sanctionné le harceleur, mais ça va venir. Pensiez-vous à d’autres dispositions de la loi Rebsamen ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Comment les femmes qui poursuivent pour harcèlement arrivent à fournir assez de preuves ? Porter plainte peut parfois être très difficile pour elles.
Mme Marilyn Baldeck. Il faut bien distinguer deux choses : d’une part, la preuve en matière de harcèlement sexuel devant le tribunal correctionnel, dans le cadre d’une procédure où la partie visée est le harceleur, et, d’autre part, le harcèlement sexuel devant le conseil de prud’homme, car les règles applicables dans les deux cas sont complètement différentes. Concernant le harcèlement sexuel en matière pénale, la preuve de l’infraction repose sur l’accusation, et donc en bonne sur la victime qui porte plainte, et ce n’est donc pas la chose la plus aisée. Néanmoins quand les magistrats se donnent la peine de faire un travail en profondeur, en analysant un faisceau d’indices concordants et ne s’arrêtent pas à l’absence de témoignage direct, on arrive à avoir des décisions qui sont intéressantes, mais il est évident qu’elles sont assez rares.
Il en va différemment en matière de droit du travail. Sous l’influence du droit européen, le droit français a prévu des règles de preuves qui sont plus souples pour les salariés, et que l’on désigne par le terme d’aménagement de la charge de la preuve. Il s’agit d’une certaine manière d’organiser un partage de la preuve entre la salariée, qui allègue des agissements de harcèlement sexuel, et l’employeur.
Néanmoins, c’est justement la formulation juridique dans le code du travail de cette règle de preuve qui pose problème, parce qu’elle est moins favorable que la règle de preuve qui existe pour toutes les discriminations. Pour celles-ci, l’article L. 1134-1 du code du travail dispose en effet que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ». C’est au vu de ces éléments qu’il incombe à de la défense, en l’occurrence l’employeur, de prouver que sa décision, généralement de licenciement, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ce dispositif est destiné aux discriminations lié à l’orientation sexuelle, au handicap, à l’état de santé, à l’appartenance à une ethnie, etc.
Les dispositions du code du travail relatives aux règles de preuve en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sont sensiblement différentes. En lisant rapidement, on peut avoir l’impression que ces dispositions sont analogues : le code du travail prévoit ainsi que dans ce type de cas, la personne « établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement». Cependant, entre « établir des faits » et « présenter des éléments de faits », il existe une différence sensible quant aux règles de preuves. Il est d’ailleurs de plus en plus fréquent que des avocats de l’employeur jouent sur cette différence pour rejeter les éléments que nous apportons dans les procédures. Là où les victimes d’autres discriminations n’auraient à établir qu’un faisceau de présomption de preuves indirectes, il existe pour les victimes de harcèlement sexuel une exigence probatoire accrue. Or cela va à l’encontre du droit européen qui prévoit que les victimes n’aient pas à apporter une preuve complète. On va donc se retrouver avec des employeurs qui vont dire « on n’a pas de témoin direct », « on n’a pas de caméra de surveillance » ou autre, alors que l’intention du législateur européen était de faciliter le recours des victimes.
On peut d’ailleurs se demander d’où vient cette différence de régime entre discrimination et harcèlement. En procédant à des recherches sur ce point, nous nous sommes rendus compte que la loi du 9 novembre 2001 relative à la charge de la preuve en cas de discriminations – loi qui transposait une directive européenne de 1997 – a introduit une disposition dans le code du travail qui prévoit que la victime d’une discrimination doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination. Il s’agit du régime le plus favorable. A ensuite été adoptée la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a créé le délit de harcèlement moral et qui doit préciser le régime de preuve applicable en la matière. Jusqu’ici, le régime est le même pour le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les discriminations, donc tout va bien. Mais en janvier 2003 le législateur, dans le cadre de la loi portant sur la négociation collective en matière de licenciement, décide de renforcer le régime de preuve uniquement pour les victimes de harcèlement moral et sexuel. La différence ainsi introduire est non seulement scandaleuse mais aussi illégale, et pour deux raisons.
Premièrement, elle viole le principe d’équivalence issu du droit européen. En vertu de celui-ci, les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union européenne doivent être encadrées par le principe dit d’équivalence, qui impose que ces modalités ne soient pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne. Il faut alors se demander si les recours en matière de discrimination et les recours en matière de harcèlement moral ou sexuel sont similaires. Pour nous, ils sont identiques puisque le harcèlement sexuel fait partie du champ des discriminations dans le droit européen. Il en est de même en droit interne, dans la mesure où la loi du 27 mai 2008 intègre dans le champ des discriminations des agissements à connotation sexuelle. D’un point de vue juridique, les notions de harcèlement sexuel et de discrimination se recouvrent : il existe donc une violation du principe d’équivalence. Le législateur français n’avait pas le droit en 2003 d’instituer une notion de différence de traitement juridique entre les deux charges de la preuve. Nous pourrions même considérer que c’est une discrimination indirecte puisqu’en prévoyant des règles de preuves moins favorables pour le harcèlement sexuel, ce sont massivement les femmes qui en sont lésées.
Le principe de non régression a également été méconnu. En droit interne, le législateur ne peut revenir sur le dispositif applicable pour introduire une disposition moins favorable : or, pendant un an, le droit de la preuve du harcèlement sexuel a été calqué sur celui des discriminations, et le législateur n’avait donc pas le droit de revenir dessus.
En outre, la situation des personnes salariées du secteur privé victimes de harcèlement sexuel diffère de celle des agents de la fonction publique. Le droit applicable à ces derniers est bien équivalent aux discriminations. Le Conseil d’État a ainsi rappelé, dans un arrêt du 11 juillet 2011, qu’il appartient à l’agent public de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il n’y a donc aucune raison qu’il existe des régimes de preuves différents pour les salariés du privé et pour les agents de la fonction publique. Pour l’ensemble de ces raisons, il nous semble donc important d’aligner les règles de preuve en matière de harcèlement sexuel et de discrimination.
Par ailleurs, l’article L. 1132-1 du code du travail relatif à l’interdiction des discriminations doit s’articuler avec la loi du 27 mai 2008, qui est aussi une loi de lutte contre les discriminations. Le choix du législateur a été de faire du bricolage, puisque l’article précité du code du travail renvoie à la loi du 27 mai 2008 plutôt que de reprendre, en les codifiant, ces dispositions. Le résultat est surprenant puisque, pour que la discrimination soit constituée en application de cet article, il faut que les agissements à connotation sexuelle subis par une personne, et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soient également reconnus comme des agissements à motivation sexiste. La combinaison des deux dispositions a créé une bizarrerie juridique, liée au fait que l’on a procédé par renvoi : autrement dit, il s’agit d’une discrimination encore plus discriminatoire, qui s’apparente à un harcèlement sexuel à raison du sexe. Cette situation fait porter sur la victime une charge de la preuve plus compliquée, puisqu’elle est tenu de présenter des éléments sur, non pas un, mais deux éléments discriminatoires, relatifs aux faits du harcèlement sexuel et au caractère sexiste de celui-ci. Or ni le droit européen, ni la loi du 27 mai 2008 ne posait cette exigence. Il nous semble donc nécessaire de clarifier ces dispositions.
Pour conclure, j’ai participé hier à la réunion du groupe de dialogue au ministère du travail sur le projet de loi concernant recours collectif en matière de discrimination, qui correspond me semble-t-il au projet de loi pour une justice de XXIe siècle, dont l’intitulé a été modifié. L’une des interrogations au centre des débats portait sur les structures qui ont un droit d’agir pour représenter un groupe discriminé devant le juge. Tous les débats se focalisaient sur la question de savoir s’il devait s’agir d’une prérogative syndicale ou s’il devait être ouvert à des associations et, le cas échéant, lesquelles et dans quelles conditions.
L’arbitrage qui a été rendu nous inquiète. Dans le projet de loi initial, les syndicats étaient les seuls susceptibles de représenter des groupes discriminés. Compte tenu du peu d’intérêt porté par les syndicats sur les questions relatives au sexisme, nous nous sommes dit que les femmes n’allaient jamais être représentées dans les groupes discriminés et que de fait, il leur sera impossible de faire valoir leur droit par le biais d’un recours collectif. Le droit d’agir des associations a été introduit mais limité aux discriminations à l’embauche, ce qui revient à ne nous donner aucun droit, puisque nous ne sommes pas saisies pour les discriminations à l’embauche. Mais même cette toute petite chose a été supprimée lors de l’examen de ce texte en première lecture au Sénat. Il en résulte qu’actuellement la possibilité de représenter des groupes discriminés est limitée organisations syndicales. Cette décision est aussi le reflet du groupe de travail, qui s’est réuni pendant presque deux ans au ministère du travail, dans la mesure où aucune association de défense des droits des femmes n’a été invitée. Si l’AVFT a néanmoins pu être présente, grâce à une sorte de « coup d’État » qui n’a pas été simple, les associations ont de fait été écartées du projet.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Merci pour ces informations, j’avoue que nous n’arrivons pas toujours à suivre toutes les évolutions, en particulier concernant le dernier point que vous évoquez, et j’entends votre inquiétude. Je vous remercie toutes pour votre engagement et vos interventions.
Audition de Mme Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Compte rendu de l’audition du mercredi 30 mars 2016
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Madame la ministre, merci d’avoir accepté de venir devant la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale ; nous y sommes très sensibles.
Vous savez le rôle que la loi confère à notre Délégation, ainsi que notre attachement à l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment à cet objectif si difficile à atteindre, malgré quarante ans de lois depuis Yvette Roudy : l’égalité salariale et professionnelle.
Vous savez aussi que, malgré le principe « pour un même travail ou un travail de valeur égale, salaire égal », deux chiffres disent ce qu’il en est, en France, dans la réalité : 24 % d’écart moyen de salaire entre femmes et hommes, du fait notamment de salaires différents à l’embauche, dont 10 % inexpliqués et inadmissibles. Par ailleurs, environ 80 % des emplois à temps partiels sont occupés par des femmes.
Si l’on ajoute le fait que le partage des tâches domestiques reste mal assuré entre les femmes et les hommes, et qu’une mauvaise articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pénalise plus la carrière des femmes que celle des hommes – c’est le fameux « plafond de verre » qui entrave leur accès aux postes de responsabilité –, vous comprendrez aisément que notre délégation se saisisse de votre texte afin d’émettre ses recommandations et de faire adopter si possible, in fine, des amendements.
Je suis au regret de constater que, malheureusement, l’étude d’impact du projet de loi ne nous aura guère éclairés, et c’est peu dire, quant à son impact sur l’égalité professionnelle : en dépit de la circulaire publiée en 2012 par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, il y est consacré en tout et pour tout six lignes sur 400 pages, ce que je trouve déplorable.
Pour autant, nous abordons ce projet de loi, comme tout autre, dans un esprit positif, avec la volonté de co-construire avec le Gouvernement toutes les améliorations possibles. Je vous sais personnellement sensible à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, et je veux rappeler que, depuis 2012, beaucoup a déjà été fait en la matière.
Sur chaque texte touchant au droit du travail, dont on aurait tort de considérer qu’il concerne à l’identique les femmes et les hommes, nous avons inlassablement défendu nos amendements : nous ne voulons en aucun cas qu’il y ait recul. Parce que l’égalité entre les femmes et les hommes n’avance que si on la traite spécifiquement, nous vous proposons l’expertise de notre délégation pour tenter d’améliorer ensemble ce qui nous paraît pouvoir et devoir l’être.
J’entends la demande de flexibilité et de souplesse des entreprises dans un monde du travail en mutation, mais nous ne voulons pas que cette flexibilité accrue pénalise les plus précaires des travailleurs, les moins flexibles dans leur vie personnelle, c’est-à-dire les travailleuses.
Nous avons reçu des membres du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), les représentantes et représentants des syndicats, des associations investies dans l’égalité professionnelle, et nous sommes donc heureux de vous entendre pour parachever ce cycle d’auditions.
La Délégation examinera le rapport d’information sur ce projet de loi mardi prochain, le 5 avril.
Mme Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Je suis heureuse de présenter à votre Délégation le projet de loi instituant de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs et, plus largement, d’évoquer avec vous l’égalité entre les femmes et les hommes. Parce que ce combat me tient particulièrement à cœur, j’ai voulu, depuis ma prise de fonctions au ministère du travail, que l’on tienne les femmes pour prioritaires au moment de lancer le plan de 500 000 actions de formation supplémentaires destinées aux demandeurs d’emploi, ou encore la Grande École du numérique. C’est le sens de mon engagement politique ; il vaut aussi pour le sort des femmes dans les quartiers dit populaires – et vous savez l’importance du rôle qu’elles y jouent. Ce n’est pas sans une pointe de fierté que, ce matin même, j’ai présenté en conseil des ministres l’ordonnance relative à la désignation des conseillers prud’hommes, qui met enfin en œuvre le principe de parité entre les femmes et les hommes, suite à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Nous progressons donc par petites touches, mais je n’ignore pas le chemin qu’il nous reste à parcourir. Je sais que, malgré nos efforts, être une femme aujourd’hui signifie souvent, à poste équivalent, être moins bien rémunérée qu’un homme : l’écart des salaires, en 2016, est toujours de 19 %. Être une femme, c’est toujours devoir faire face, davantage que les hommes, au temps partiel subi. Être une femme, c’est aussi affronter une double journée de travail. Être une femme, c’est connaître des difficultés persistantes pour trouver une place en crèche ou un mode de garde d’enfant, problème qui affecte plus gravement les familles monoparentales, dont on sait qu’elles ont une femme à leur tête dans 80 % des cas, et davantage encore dans les quartiers populaires. Être une femme, c’est enfin subir des remarques et des comportements sexistes, y compris sur les lieux de travail. Nous le savons, les stéréotypes au travail ont malheureusement la vie dure, et les mécanismes sociaux empêchant les femmes de bénéficier des mêmes opportunités que leurs collègues hommes font que les plafonds de verre existent toujours, qu’il s’agisse du déroulement des carrières, de l’accès à des emplois stables et de qualité ou de la question centrale de la conciliation entre vie personnelle, parentalité et vie professionnelle.
Mais je sais aussi, pour l’avoir constaté alors que j’étais secrétaire d’État chargée de la politique de la ville, et encore lors de ma visite récente à la mission locale des Ulis avec Mme la députée Maud Olivier, le rôle majeur que tiennent les femmes en matière de développement et de cohésion sociale. J’ai eu à connaître d’exceptionnelles initiatives de terrain portées par des femmes en matière d’insertion par l’emploi dans l’économie sociale et solidaire et aussi de développement économique, dans les villes comme dans les campagnes ; je continuerai de les soutenir. Je rencontre constamment des femmes qui entreprennent, qui osent, qui connaissent des carrières brillantes, affirment leurs droits et prennent enfin la place qui est la leur.
Le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes demande une mobilisation sans cesse réaffirmée. Je fais immédiatement mon mea culpa au sujet de l’étude d’impact : il est exact, madame la présidente, que pour ce qui est de l’analyse, sur ce plan, de la négociation sociale, et en particulier des accords d’entreprise, il n’y a pas encore d’évolution. Peut-être la loi, en imposant la transparence sur tous les accords, nous permettra-t-elle de les apprécier de manière plus générale et ainsi de progresser. Aujourd’hui, 27 % des femmes ont des postes peu qualifiés d’employées ou d’ouvrières contre 15 % des hommes, et elles sont employées en contrat à durée déterminée (CDD) presque deux fois plus souvent qu’eux. C’est contre ces inégalités que je veux agir, notamment par le biais du projet de loi que je vais vous présenter.
Avant d’en venir à ce texte, je souhaite toutefois rappeler que nous avons permis des avancées importantes en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le monde du travail – des progrès réalisés avec l’appui de votre Délégation, dont les observations ont parfois tout du « poil à gratter », mais ce rôle est essentiel. Je rappelle en premier lieu que la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a considérablement renforcé les obligations des entreprises relatives à la mise en œuvre des actions en faveur de l’égalité, par le biais de la négociation. Elle a aussi réformé le congé parental, notamment pour encourager les pères à en bénéficier et favoriser de la sorte l’égalité dans les couples. Je salue à ce sujet la proposition de loi de Mme la députée Dominique Orliac, qui va considérablement améliorer la protection contre le licenciement des mères à l’issue de leur congé maternité et de leur conjoint à compter de l’arrivée de l’enfant.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a permis une avancée majeure : une durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel de 24 heures. Cette disposition vise à combattre la précarité au travail, qui frappe particulièrement les femmes. Le texte a aussi permis de mettre en place une modulation des cotisations d’assurance chômage sur les contrats courts pour inciter les employeurs à opter pour le contrat à durée indéterminée (CDI) plutôt que pour le CDD. Comme vous le savez, une négociation est en cours sur la nouvelle convention d’assurance-chômage, et certains des partenaires sociaux portent cette question ; c’est à eux qu’il revient de négocier, mais il sera important de faire dans ce cadre un premier bilan de cette disposition.
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui a suscité de nombreux débats, a finalement apporté des progrès majeurs en renforçant la parité dans les instances représentatives du personnel (IRP), les conseils d’administration et les conseils de prud’hommes, et en mettant l’égalité professionnelle au cœur du dialogue social en entreprise.
Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs s’inscrit dans la continuité de ces textes.
Il présente une forte cohérence, fondée sur la conviction que j’ai exposée hier à la commission des Affaires sociales de votre assemblée : il faut créer un mouvement profond qui fasse franchir à notre démocratie sociale une étape nouvelle, pour la rendre plus forte et plus efficace. C’est par la négociation au plus près du terrain que se nouent les bons compromis, favorables à la compétitivité de notre économie et à la protection des salariés – et donc aussi des femmes. Je le redis devant vous : s’il n’y a pas d’accord, c’est le droit actuel qui continuera de s’appliquer. Nous voulons donner dans un même mouvement plus de moyens aux acteurs du dialogue social et plus de place à la négociation collective. Loin d’opposer négociation et droits des femmes, je pense au contraire que c’est par le dialogue social que l’on peut, aussi, améliorer leurs droits.
Certains voient dans le renvoi à l’accord d’entreprise un danger pour la protection des salariés. Trois raisons font que je ne partage pas cette analyse.
D’abord, ces accords devront être majoritaires ; alors que des modulations de temps de travail sont aujourd’hui possible avec l’accord de 30 % des représentants des salariés, la modulation reposera, demain, sur un consensus social beaucoup plus fort qu’il ne l’est présentement. Ensuite, dans les matières les plus sensibles – telle la durée minimale hebdomadaire de 24 heures pour le travail à temps partiel –, l’accord de branche restera prépondérant. Enfin, si nous pensons qu’un accord négocié par des syndicats signifie la diminution des droits des salariés, c’est que nous ne sommes pas mûrs pour une démocratie sociale digne de ce nom, et ce n’est pas ma vision des choses. Je considère que la démocratie sociale est à la croisée des chemins et que pour renforcer la légitimité des accords il faut renforcer le pouvoir de les négocier.
Je veux être tout à fait claire : je ne porterais tout simplement pas cette loi si je pensais qu’elle est, d’une façon ou d’une autre, contraire à l’intérêt et aux droits des femmes.
Au-delà de la philosophie d’ensemble que je viens d’exposer, le projet de loi que je vous présente tend à sanctuariser un certain nombre d’acquis essentiels. Tout d’abord, le principe même de l’égalité professionnelle, figurant parmi les grands principes issus des travaux de la commission Badinter, qui guideront la réécriture du code du travail devant s’achever en 2019. Je sais que votre Délégation souhaite proposer des amendements à ces principes, et j’y serai particulièrement attentive.
Ensuite, pour ce qui est du temps partiel, le projet de loi sanctuarise la durée minimale de 24 heures hebdomadaire pour les salariés à temps partiel sauf accord de branche, comme aujourd’hui. J’insiste sur le fait que rien n’est changé à l’équilibre de la loi sur la sécurisation de l’emploi.
De même, pour ce qui est des délais de prévenance ou du taux de majoration des heures complémentaires, nous sommes totalement à droit constant. Dans le cadre de la concertation avec les partenaires sociaux, il y a eu des demandes de réécriture visant à ce que l’on puisse déroger aux accords sur le temps partiel, mais nous n’avons rien modifié.
En ce qui concerne l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle, qui est, je le sais, un outil puissant en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, la loi clarifie aussi les choses. En effet, suite aux remarques faites par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), j’ai souhaité qu’il soit précisé dans la saisine rectificative envoyée au Conseil d’État que, lorsque la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes devient triennale et qu’aucun accord n’est conclu sur ce sujet, l’obligation d’élaborer tous les ans un plan d’action demeure. Il va également de soi que cette loi ne remet pas en cause les pénalités financières prévues en cas de manquements en la matière.
Sur ce point, il n’y a pas de relâchement, bien au contraire. Les services de mon ministère sont plus que jamais mobilisés pour que la législation soit appliquée, et je me suis engagée devant vous à ce que soit effectuée, si vous le souhaitez, une évaluation précise de la situation. À ce jour, 83 % des entreprises de plus de 1 000 salariés sont couvertes par un accord ou un plan d’action. Nous devons encore progresser, mais il faut aussi rappeler ces chiffres, qui montrent que les choses changent sur le terrain grâce à l’action du Gouvernement, mais aussi et surtout du fait d’une mobilisation croissante de l’ensemble des acteurs concernés, notamment les petites entreprises. Nous devons, au moyen de la formation des partenaires sociaux et en nous appuyant sur l’Union professionnelle artisanale (UPA), veiller à ce qu’un plus grand nombre de petites entreprises bénéficient de l’action de formation.
Enfin et toujours pour préciser les choses, j’ai souhaité indiquer dans la saisine rectificative envoyée au Conseil d’État que, s’agissant des congés pour événements familiaux – mariages, naissances, décès –, qui sont des congés payés essentiels pour tous, l’accord ne pourrait pas descendre en dessous des durées aujourd’hui prévues par la loi. Cette disposition n’est pas tout à fait dans l’esprit du rapport de Jean-Denis Combrexelle, mais nous avons prévu ces dispositions, et il m’a paru nécessaire d’harmoniser vers le haut les congés pour décès car, dans les moments les plus douloureux de la vie, le tri qu’opère aujourd’hui le code du travail ne me semble pas acceptable.
Au-delà des acquis que le projet de loi sanctuarise, ce projet comporte des avancées importantes qui profiteront aux femmes. Je pense bien sûr en premier lieu au compte personnel d’activité (CPA), conçu pour tenir compte du monde du travail tel qu’il est aujourd’hui. Chacun sait que l’on n’entre plus dans une entreprise à dix-huit ans pour en ressortir à l’âge de la retraite, et que la vie professionnelle est faite de ruptures et de changements de statut – de salarié, on devient auto-entrepreneur, ou l’inverse –, d’une alternance de périodes d’activité et de chômage. Dans ce contexte, il m’a semblé important de permettre à tous les actifs – hommes, femmes, salariés ou à la recherche d’un emploi, indépendants ou entrepreneurs – de bénéficier des mêmes droits et des mêmes protections, indépendamment de leur statut. C’est une avancée sociale majeure et qui bénéficiera en particulier aux femmes, qui présentent des parcours professionnels plus accidentés et qui sont, plus souvent que les hommes, en situation de précarité. Avec le CPA, nous avons décidé d’abonder le compte des salariés les moins qualifiés – qui se trouvent être surtout des femmes – en faisant passer leurs droits à la formation de 24 à 40 heures par an.
Le plan « 500 000 actions de formation supplémentaires » prévu pour les demandeurs d’emploi en 2016 bénéficiera également en grande partie aux femmes, ainsi que la Garantie Jeunes. Enfin, pour aider les femmes à accéder à certains métiers, ce qui leur est parfois difficile, j’ai demandé que le label de qualité de la Grande École du numérique prévoie le recrutement d’au moins 30 % de femmes.
Je pense aussi au droit à la déconnexion, qui permet de mieux tracer la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle à l’heure du numérique. Le dispositif innovant proposé par le Gouvernement souligne sa volonté de préserver la vie en dehors du travail, pour les femmes comme pour les hommes, et constitue une avancée majeure qui devra faire l’objet de négociations au sein des entreprises.
Enfin, les dispositions en faveur du télétravail permettront de mieux prendre en compte certaines nouvelles modalités de travail et apporteront plus de souplesse aux salariés, tout en préservant la dimension collective du travail, qui me semble importante.
Cette politique bénéficiera à toutes les personnes éloignées des emplois stables, donc aux femmes. Je ne suis pas la seule à le dire : ce que nous souhaitons en apportant plus de clarté et de visibilité aux chefs d’entreprise – notamment de petites et moyennes entreprises (PME) et de très petites entreprises (TPE) –, c’est encourager l’emploi durable, notamment en CDI, car à l’heure actuelle, neuf embauches sur dix se font en CDD.
Même si tous les économistes ne sont pas d’accord, certains parmi les plus réputés – Jean Tirole, prix Nobel d’économie, et Philippe Aghion, pour ne citer qu’eux – ont souligné que le fait de donner de la visibilité aux chefs d’entreprise sur la rupture des contrats, en particulier des CDI, avait pour effet d’encourager l’emploi durable, ce dont les personnes les moins qualifiées, les jeunes et les femmes, c’est-à-dire ceux qui se trouvent souvent durablement exclus du monde du travail, et ne font que collectionner les CDD courts – nous sommes le deuxième pays de l’Union européenne utilisateur de CDD de moins d’un mois – doivent bénéficier. En février dernier, on a assisté à la bascule en catégorie A de nombreuses personnes inscrites à Pôle Emploi et appartenant à la catégorie C – les personnes ayant exercé une activité réduite longue, c’est-à-dire de plus de 78 heures au cours du mois.
Voici, mesdames et messieurs les députés, ce que je souhaitais préciser devant vous aujourd’hui. Je pense que notre échange sera également l’occasion de vous faire part des autres actions portées par mon ministère en faveur de la mixité des métiers, notamment dans le cadre de l’Euro 2016, où je souhaite féminiser le corps de la sécurité, et dans le domaine du numérique.
C’est en ne cédant rien sur les droits fondamentaux et, au contraire, en créant de nouveaux droits et protections, que nous voulons apporter la souplesse qui permettra à notre économie d’être plus dynamique et plus créatrice d’emplois durables.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je vous remercie, madame la ministre. Lors des auditions effectuées en vue de la rédaction de son rapport d’information sur le projet de loi pour une République numérique, la Délégation a rencontré les fondateurs et responsables de l’école 42 et de l’école Simplon : ces derniers se sont déclarés sensibles à l’objectif consistant à recruter au moins 30 % de femmes, ce qui nous a semblé très important, car la mixité des métiers fait partie des combats que nous menons.
J’admets la philosophie générale du projet, qui consiste à laisser le plus large champ à la négociation et à donner un rôle supplétif à la loi. Cela étant, j’aurais aimé des progrès en ce qui concerne le temps partiel, les embauches, les jours fériés. Dans les négociations, les femmes sont moins représentées, et on en parle moins. Nous craignons donc que la négociation, si elle permet souplesse et adaptation à la réalité des entreprises, ne leur soit pas favorable. Le manque de formation, le manque d’intérêt, le fait qu’elles occupent souvent les emplois les plus précaires ne nous rassurent pas.
Mme Marie-Noëlle Battistel, corapporteure. Merci, madame la ministre, d’être à notre écoute ce soir. Nous comptons bien entendu sur votre oreille attentive, car nous vous savons attachée à l’égalité entre les hommes et les femmes.
Vos propos introductifs, longs et finalement très précis, me coupent un peu l’herbe sous le pied, car vous avez d’ores et déjà répondu à certaines questions, mais nous craignons tout de même, à la lecture du texte, qu’un certain nombre de mesures ne risquent d’accentuer l’inégalité professionnelle. De ce point de vue, l’étude d’impact nous laisse sur notre faim, ne nous éclairant guère sur les effets que pourraient avoir les dispositions du texte pour les femmes.
Le CSEP a rendu un avis sur l’avant-projet de loi. Quelles suites donnerez-vous à un certain nombre de ses remarques, en particulier sur les principes essentiels du droit du travail énumérés à l’article premier, à ses inquiétudes concernant « une remise en cause de la hiérarchie des normes et des modalités de dialogue social qui fragilise la négociation sur l’égalité professionnelle » ou encore certains inquiétudes concernant « une flexibilité accrue du temps de travail défavorable à l’articulation des temps personnels et familiaux, pris en charge majoritairement par les femmes » ?
Concernant le compte personnel d’activité (CPA), des avancées sont-elles envisageables concernant les modalités d’abondement pour les salariés à temps partiel ? On pourrait d’ailleurs ouvrir une petite parenthèse sur le temps partiel saisonnier, qui ne concerne pas seulement les femmes mais qui les concerne de plus en plus en plus, notamment dans l’économie du tourisme.
S’agissant de la durée minimale hebdomadaire de 24 heures du contrat de travail, nous ne sommes pas tout à fait rassurés, malgré vos propos, et je voudrais savoir si vous avez dressé un bilan de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui visait notamment à protéger les salariés à temps partiel.
De même, à la suite à la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, où la négociation collective sur l’égalité professionnelle en est-elle, d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif ? La mise en œuvre de cette loi prendra du temps. Nous voudrions donc savoir quels seront plus généralement, cette année, vos principaux axes de travail pour faire progresser l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Vous avez annoncé avoir signé aujourd’hui une ordonnance qui donne un signe fort sur la question de la parité, mais d’autres dispositions sont-elles prévues pour l’année 2016 ?
Mme Catherine Quéré. Vous avez également anticipé presque toutes mes questions, madame la ministre ! Je voulais parler de la loi du 17 août 2015 et du compte personnel d’activité (CPA), mais en fait vous nous avez répondu. Le CPA est une avancée sociale majeure. Votre ministère dispose-t-il de données sexuées sur les bénéficiaires du compte personnel de formation (CPF) ? Et quelles sont les avancées envisageables en ce qui concerne les modalités d’abondement applicables aux salariés à temps partiel ?
Mme Maud Olivier. La question du temps partiel nous préoccupe effectivement, nombre de dérogations à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures étant déjà possibles. Si la question est renvoyée à des accords d’entreprise, je serai extrêmement inquiète. En effet, ces métiers exercés à temps partiel, où les femmes sont surreprésentées, sont des métiers peu qualifiés. Les femmes concernées, qui vivent déjà dans une grande précarité, font donc peu d’heures dans leur entreprise et ne sont pas syndiquées ni organisées pour négocier.
M. Christophe Premat. Je vous prie par avance de m’excuser, madame la ministre, car je ne suis pas sûr de pouvoir rester pour entendre votre réponse.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous vous la transmettrons, cher collègue !
M. Christophe Premat. Merci !
Je vous remercie, madame la ministre, pour votre présentation.
Effectivement, le compte personnel d’activité, c’est très important, d’abord parce que des comptes annexes s’y greffent, comme le compte engagement citoyen ; il y aussi le compte épargne temps. Nous avons aussi évoqué la pénibilité, et la Délégation avait procédé à des auditions sur la pénibilité dans le travail saisonnier, dans le milieu rural. Nous avions identifié des zones difficiles.
Sur ces questions, j’ai forcément à l’esprit l’exemple des pays d’Europe du Nord, qui font partie de ma circonscription d’élection. Il n’y a pas forcément, dans ces pays un compte personnel d’activité ainsi dénommé, mais il y a une pratique très similaire. Je pense notamment au congé de maternité ou de paternité – qui ne devrait pas forcément être appelé « congé », le lexique ayant son importance. Dans ces pays, la revalorisation du congé de paternité est une condition de l’égalité professionnelle, et les compétences développées par quelqu’un dans son « travail » de père ou de mère peuvent être valorisées – même si la réalité est sans doute moins « rose » et plus complexe…
Cette approche comparée doit nous inciter à un recentrage des droits sur la personne, afin de lui permettre de maîtriser sa vie, ses conditions d’existence. Il faudrait aussi envisager la question des jours fériés et celle de la garde des enfants d’un couple. Travaillons-y, et n’oublions pas l’équité, mais je me félicite de cette avancée qu’est le CPA, pour laquelle l’expérience des pays scandinaves peut être éclairante.
Il serait intéressant, enfin, de pouvoir davantage prendre en compte l’internationalisation des parcours professionnels. L’activation du compte personnel d’activité pourrait permettre de régler la question de la validation des acquis professionnels des personnes résidant à l’étranger, qui ne sont pas reconnus aujourd’hui. Je ne veux pas empiéter sur le projet de loi qui nous a été promis sur ce sujet par Mme Valter. Mais ce serait une bonne nouvelle de pouvoir avancer.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Quel est le terme employé dans les pays nordiques pour désigner le congé de maternité ou de paternité ?
M. Christophe Premat. On parle d’« expérience parentale » ou de « parentalité ».
Mme Marie-Noëlle Battistel, corapporteure. Dans les TPE et les PME, la négociation des accords d’entreprise n’est pas facile. C’est pourquoi ces entreprises ont tendance à se reposer sur les accords de branche. Comment comptez-vous surmonter cette difficulté ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. À notre grande surprise, lors de son audition, l’Union professionnelle artisanale (UPA) nous a fait part de son opposition très forte aux accords d’entreprise, arguant de l’absence de personnes qualifiées pour les négocier.
Nous avons tenté, non sans mal, de rédiger un amendement sur les 24 heures – la durée minimale de travail du salarié à temps partiel –, car nous ne sommes pas complètement rassurés. Je me mets à la place d’un employeur confronté à la complexité infinie du droit du travail, et je comprends qu’il ne souhaite pas avoir à négocier d’accord.
Mme Maud Olivier. Dans le précédent projet de loi relatif au dialogue social, nous avions provoqué une levée de boucliers en cherchant à éviter l’effet miroir dans la représentation syndicale, en vertu duquel celle-ci reflète la proportion d’hommes et de femmes dans l’entreprise. Pourtant, nous considérons que les femmes sont capables de défendre tous les salariés de l’entreprise, aussi bien les femmes que les hommes.
Le projet de loi ne va pas aider à résoudre ce problème. C’est dommage. Ainsi, les négociateurs pour les TPE au niveau interrégional seront-ils inévitablement des hommes, et l’opposition reste vive à la parité dans la représentation syndicale.
Mme la ministre. Entre la version 1 et la version 2 du projet de loi, le rôle de la branche a été considérablement réaffirmé, confortant ainsi les petites entreprises qui considèrent, je les comprends, la branche comme le niveau approprié de la négociation.
Le projet de loi prévoit une nouveauté : les accords-types de branche. Par exemple, une branche signe un accord sur un forfait en jours qui fixe le nombre de jours travaillés entre 215 et 220. Le chef d’entreprise peut le mettre en œuvre avec l’accord du salarié au sein de l’entreprise. Ces accords, qui peuvent porter sur nombre de sujets, permettent de donner de la souplesse aux entreprises, tout en garantissant qu’ils sont négociés au bon niveau : le choix de la branche permet d’éviter le dumping social et de trouver des interlocuteurs pour négocier. Il faut des négociateurs formés et représentatifs pour faire vivre la nouvelle forme de démocratie sociale que le projet de loi instaure.
Parallèlement, le projet de loi renforce le mandatement, sur lequel la pédagogie reste à faire dans notre pays. Son objet est considérablement élargi afin de permettre aux salariés de l’entreprise – il ne s’agit pas de désigner un représentant d’un syndicat qui serait extérieur à l’entreprise – d’être mandatés par les syndicats pour négocier et signer des accords. Je sais que cette démarche trouve peu d’écho favorable auprès des chefs de petites entreprises. Il me semble pourtant important de continuer à travailler sur ces outils du dialogue social.
Les principes définis par le comité Badinter ne figureront ni aujourd’hui, ni demain dans le code du travail. Ce n’est qu’à l’issue des travaux de la commission chargée de la refondation de la partie législative du code du travail que des décisions seront prises quant à ces principes.
Quant aux suites à donner à l’avis du CSEP, je suis plutôt ouverte à des propositions d’amélioration.
Ainsi, s’agissant du principe d’égalité – qui figure au 4° de l’article 1er –, je rejoins le CSEP lorsqu’il recommande d’écrire que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est assurée, et non pas respectée, dans l’entreprise. Je suis donc favorable à un éventuel amendement de votre part sur ce point.
De même, je partage l’avis du CSEP sur le dix-septième principe, qui dispose que « la grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des mesures spécifiques autres que celles requises par l’état de la femme ». Cette formulation est par trop négative.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Je dirais même archaïque.
Mme la ministre. Ces propositions sont issues du comité présidé par Robert Badinter, dont je connais l’engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. En tout état de cause, ce principe parait rédigé d’une façon négative et il me semble également important de rappeler l’interdiction de licencier des femmes enceintes ou venant d’accoucher. À cet égard, je soutiens la proposition de loi déposée par Mme Orliac visant à prolonger la période légale d'interdiction de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour les femmes à l'issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité.
Concernant le 31e principe, la rédaction proposée par le CSEP restreint selon moi la portée du principe « à travail égal, salaire égal ». Ce principe fondateur du code du travail s’applique évidemment entre femmes et hommes, mais aussi, plus généralement, entre salariés.
Contrairement à ce que semble redouter le CSEP, le projet de loi ne remet nullement en cause la hiérarchie des normes ni les modalités du dialogue social. Nous aurions pu, comme certains pays en ont décidé, proposer une dérégulation et laisser les personnes face au contrat de travail. Ce n’est absolument pas le choix que nous avons fait : nous proposons de réaffirmer les différents niveaux de régulation – la loi, l’accord de branche et l’accord d’entreprise – en rappelant que, s’il n’y a pas d’accord, c’est l’état actuel du droit qui s’applique. Inverser la hiérarchie des normes reviendrait à faire de l’accord et du contrat de travail des outils de régulation de droit commun et à leur donner une prééminence par rapport à la loi. Ce n’est pas le chemin que nous avons pris. Nous donnons certes des marges de négociation supplémentaires aux accords d’entreprise sur des sujets qui relèvent du quotidien, comme l’organisation du travail ou le temps de travail, mais la loi réaffirmera le rôle de la branche pour garantir un socle de droits, notamment en matière de classifications, de salaire, de protection sociale complémentaire et de durée minimale des contrats à temps partiel. Dans l’ensemble de ces champs, les accords de branche continueront à s’imposer aux accords d’entreprise et la loi restera partout protectrice puisqu’en l’absence d’accord, c’est elle qui s’appliquera.
Le projet de loi ne remet pas non plus en cause l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle. À la suite des remarques du CSEP, j’ai en effet modifié le texte dans le cadre de la saisine rectificative. Je pense que le dispositif est clair, puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune interrogation de votre part.
J’en viens maintenant aux critiques exprimées par la rapporteure, qui redoute une flexibilité accrue du temps de travail, défavorable à l’articulation des temps personnels et familiaux pris en charge majoritairement par les femmes. Avant toute chose, est-il normal que ce soient encore et toujours les femmes qui prennent en charge les obligations familiales ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Non mais c’est un fait.
Mme la ministre. Certes. Cela étant dit, soyez rassurée : ce projet de loi ne signera pas l’avènement d’une flexibilité accrue du temps de travail. En aucun cas le texte ne revient, par exemple, sur l’avancée que constitue la fixation à 24 heures de la durée hebdomadaire minimale du travail à temps partiel. La règle demeurera demain la même qu’aujourd’hui : à défaut d’accord de branche étendu, le minimum de 24 heures s’appliquera. Nous n’avons rien changé à la loi en vigueur.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous voudrions rendre le temps partiel le plus coûteux possible pour l’employeur, car il en est fait un usage abusif. Vous l’avez dit vous-même, la France est sans doute le pays qui recourt le plus au travail à temps partiel – qui concerne d’ailleurs aussi les hommes. Des proches m’ont cité des exemples de cliniques qui emploient des salariés à temps partiel pendant trois à cinq jours, puis qui les réemploient à temps partiel quinze jours après, multipliant ces temps partiels bien au-delà de trois ou quatre fois pour assurer des remplacements : cela ne me paraît guère légal.
Lors de l’examen de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, faisant suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, nous souhaitions que la durée minimale du travail à temps partiel soit de 24 heures. Puis, au terme de la discussion que nous avons eue avec le Gouvernement, nous avons accepté deux exceptions : la première, en cas de demande du salarié – exception qui peut présenter une certaine hypocrisie dans la mesure où le temps partiel peut être imposé à l’embauche – et la seconde, si un accord de branche le prévoit. Or, on constate que soixante des accords de branche qui ont été négociés prévoient un temps de travail inférieur à 24 heures. Cela signifie que les partenaires sociaux, lorsqu’ils négocient, acceptent, pour les femmes, de fixer des temps partiels très bas. J’entends bien que la philosophie, courageuse, du Gouvernement consiste à faire toute confiance à la négociation. Mais dans ce cas, rendons la syndicalisation obligatoire pour la massifier et assurer une meilleure représentativité des organisations syndicales. Pour l’instant, les accords de branche ne me semblent pas protecteurs pour les femmes. Il conviendrait d’organiser une négociation salariale qui prenne vraiment en compte l’inégalité entre les femmes et les hommes. Vous avez effectivement laissé la possibilité aux accords de branche de déroger à la règle des vingt-quatre heures, à l’article L. 3123-2 du code du travail qui figure à la page 60 du projet de loi : je conseille à tout le monde de lire ce texte même s’il est très compliqué.
Mme la ministre. S’il l’est, c’est parce que, dans un souci de transparence, nous avons réécrit tous les articles du code du travail relatifs au temps de travail et aux congés, même ceux qui ne sont pas modifiés, en suivant l’architecture préconisée par Jean-Denis Combrexelle dans son rapport : l’ordre public venant en premier lieu, puis le champ de la négociation collective et, enfin, les dispositions supplétives. Certains ont affirmé que le projet de loi permettait de travailler 60 heures par semaine et de dépasser 12 heures de travail par jour : nous n’avons fait que reprendre les 125 pages du code qui traitent du temps de travail, et beaucoup de personnes découvrent la réalité du droit du travail à cette occasion. En dehors de la question des 24 heures, la section du code consacrée au travail à temps partiel n’est absolument pas modifiée. Nous restons entièrement à droit constant.
Mme Maud Olivier. Certes mais, dans le passé, les accords de branche et d’entreprise ne pouvaient être que plus favorables que la loi. Aujourd’hui, nous ne sommes plus du tout dans la même philosophie : la loi s’appliquera a minima en l’absence d’accord mais si un accord de branche est négocié, il pourra déroger à la loi dans un sens moins favorable que celle-ci.
Mme la ministre. Nous sommes un des pays d’Europe les plus protecteurs en matière de travail à temps partiel. Le projet de loi n’instaure pas les « mini-jobs » à l’allemande, ni les contrats « zéro heure » à la britannique – même si beaucoup de pays ont résorbé leur chômage grâce à une augmentation importante du travail à temps partiel.
Mme Maud Olivier. Ils ont beaucoup de travailleurs pauvres.
Mme la ministre. Tout à fait. La France a fait un autre choix – que nous maintenons bien évidemment. Je peux vous dire que lors des concertations qui ont eu lieu, j’ai opposé un refus catégorique à ceux qui souhaitaient modifier les dispositions relatives au temps partiel dans le cadre du rapport Combrexelle, comme nous le faisons concernant la modulation du temps de travail. Mais, la France étant le deuxième pays utilisateur des contrats à durée déterminée, nous avons quand même des questions à nous poser. Nous devons impérativement mettre un terme à la réticence, réelle ou ressentie, des employeurs à embaucher des salariés en contrat à durée indéterminée.
Les accords de branche, souvent négociés par les représentants syndicaux et patronaux issus des grands groupes, ne permettent pas aux petites entreprises de s’adapter. Il faut donc que nous arrivions à réaffirmer le rôle protecteur de la branche pour les petites entreprises mais aussi à leur accorder certaines souplesses dans la négociation. Je sais qu’il y a aujourd’hui une forme de rejet « culturel » du mandatement et que, malheureusement, les citoyens de notre pays manquent de confiance envers les syndicats. Mais nous sommes à la croisée des chemins. Élargir le champ de la négociation au plus près du terrain pour aider les entreprises à mieux s’adapter aux pics d’activité permet aussi de re-légitimer ces acteurs de terrain. N’ayons pas une vision idyllique de notre pays, car, encore une fois, si nous avons la législation la plus protectrice qui soit en matière de travail à temps partiel, nous sommes le deuxième pays utilisateur de CDD, ce qui explique que nombre de personnes se trouvent durablement dans une spirale infernale.
La loi du 14 juin 2013, dont vous m’avez demandé de dresser un bilan, a permis de conférer des droits aux salariés travaillant à temps partiel tout en offrant plus de souplesse aux entreprises. À ce jour, une soixantaine d’accords de branche ont été déposés auprès de mes services, couvrant un peu moins de la moitié des salariés à temps partiel en France. Actuellement, lorsque des accords de branche prévoient une durée minimale inférieure à 24 heures, ils doivent prévoir des contreparties au profit des salariés, notamment en termes de regroupement d’horaires. Je souhaiterais d’ailleurs que, dans le cadre du plan « 500 000 actions de formation supplémentaires », nous lancions des expériences de regroupement d’heures de travail et d’heures de formation semblables à celles qu’a pu mener Pascale Gérard dans le champ des services à la personne lorsqu’elle était vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Nous sommes en train de vérifier s’il serait possible de le faire. Par ailleurs, les accords qui dérogent aux règles relatives aux coupures doivent prévoir des contreparties financières ou sous forme de repos. Mes services, lorsqu’ils contrôlent la légalité de l’extension des accords, sont extrêmement vigilants sur ces points précis.
Bref, si la loi de sécurisation de l’emploi a apporté des garanties nouvelles aux salariés à temps partiel en leur permettant d’accéder aux droits sociaux, des souplesses ont dans le même temps été accordées aux entreprises, sous forme de dérogations dans les secteurs où il n’est pas possible d’aller jusqu’à 24 heures de travail. La question des groupements d’employeurs s’étant posée, un des articles du projet de loi vise à ce que les entreprises puissent bénéficier d’aides à l’emploi dans le cadre de ces groupements, qu’il nous faut, je crois, favoriser encore davantage – et pas seulement dans le domaine agricole. Je vous invite donc à proposer des améliorations en la matière.
Enfin, je me suis engagée à fournir au CSEP d’ici à cinq mois un bilan détaillé des sanctions qui auront été appliquées, bilan que je pourrai aussi venir vous présenter. Nous sommes en train d’examiner quelques accords de branche semblant poser problème.
En matière de travail saisonnier, le projet de loi constitue une avancée majeure puisqu’il en sécurise la définition. Cela fait suite à des travaux parlementaires menés récemment dans le cadre du Comité interministériel de la montagne, qui s’est tenu le 25 septembre 2015 et auquel a participé Mme la rapporteure. Nous invitons également les partenaires sociaux à négocier sur les clauses de reconduction des contrats de travail saisonnier. À défaut de négociation, il est prévu que l’État puisse intervenir par ordonnance. Je pense que cela protégera également les femmes.
Mme Marie-Noëlle Battistel, corapporteure. Qu’en est-il des droits à la formation pour les saisonniers, parmi lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Vous avez dit, madame la ministre, que le CPA bénéficierait aux salariés les moins qualifiés, en leur ouvrant 40 heures par an de droits à la formation au lieu de 24 heures. Nous voudrions également obtenir par amendement un abondement du compte personnel de formation pour les salariés à temps partiel, qui ont davantage besoin de formations pour obtenir un emploi plus qualifié, accéder à un temps plein, ou encore changer d’emploi. Cela vous semble-t-il possible ?
Mme la ministre. Aujourd’hui, 50 % de femmes bénéficient du compte personnel de formation. Si je partage votre volonté de sécuriser les parcours professionnels des personnes à temps partiel, prévoir un abondement spécifique en leur faveur soulève un certain nombre de questions. Ces abondements devraient-ils être réservés aux personnes à temps partiel subi ? Et comment distinguer les personnes pour lesquelles il s’agit d’un temps partiel choisi ? Surtout, comment financer les abondements, alors que la ressource est proportionnelle au temps travaillé ? Je pense que la négociation de branche pourrait prévoir de tels abondements comme contreparties aux temps partiels, en lien avec les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), car je ne vois pas comment nous pourrions écrire cela dans la loi.
Mme la rapporteure. Si je comprends bien, une cotisation majorée pour les salariés à temps partiel viendrait abonder le compte, ce qui constituerait un bonus en matière de droits à la formation.
Mme la ministre. La difficulté est de distinguer entre temps partiel subi et temps partiel choisi, sachant que la cotisation est basée sur le temps travaillé.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Certes, mais beaucoup de temps partiels dits « choisis » sont en réalité occupés par des femmes qui ne peuvent pas faire autrement : certaines ne trouvent pas de solution de garde pour leurs enfants ; d’autres ne trouvent pas de travail à temps plein – j’ai connu une femme à temps partiel qui faisait, cinq jours par semaine, 50 kilomètres aller-retour pour se rendre à l’hôpital où elle travaillait et qui dépensait tout son revenu d’activité pour faire garder ses enfants.
Mme la ministre. Je suis prête à vous aider sur ce point technique : la personne qui travaille au sein de mon cabinet sur le compte personnel d’activité peut vous rencontrer avant le débat en séance publique. Ce sujet doit être relié au plan « 500 000 actions de formation supplémentaires », car je souhaite que les personnes à temps partiel subi bénéficient d’une formation leur permettant de développer leurs compétences et d’accéder ainsi plus facilement à l’emploi.
Monsieur Premat, la loi, par le dispositif du CPA, garantira le financement du parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE), ce qui permettra à la fois de construire le parcours professionnel des personnes et de retracer l’ensemble des compétences qu’elles ont acquises. Le dispositif est en effet trop rigide encore.
Mme Maud Olivier. Aux termes du projet de loi, la modulation du temps de travail sera négociée, si bien qu’elle pourra porter sur une durée plus longue. Par conséquent, les femmes à temps partiel devront obéir à des impératifs de flexibilité accrue. Les temps partiels ne pourraient-ils pas bénéficier d’un taux de majoration des heures complémentaires plus important que les 10 % prévus dans le texte ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous déposerons un amendement portant le taux de majoration à 25 % dès la première heure complémentaire.
Mme la ministre. Aux termes de la « version 2 » du projet de loi – celle que j’ai présentée en conseil des ministres –, la modulation au-delà d’une année ne sera possible que par accord de branche. Par conséquent, l’accord d’entreprise devra prévoir une période « haute » pour le paiement mensuel des heures supplémentaires. Ainsi, le projet de loi prévoit deux dispositions qui permettent de limiter l’impact sur le pouvoir d’achat des salariés : l’autorisation par accord de branche ; une période « haute » dans le cadre de l’accord d’entreprise, afin de ne pas attendre la fin de la période de travail pour payer les heures supplémentaires. Concernant les heures complémentaires, la majoration de 10 % dès la première heure constituait une nouveauté de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous avions effectivement obtenu que ces heures complémentaires soient payées dès la première heure, avec une majoration de 10 % ou 25 % pour les heures accomplies au-delà d’une certaine limite. À présent, nous attendons une simplification du droit par l’instauration d’une majoration de 25 % dès la première heure.
Mme Catherine Quéré. La question des femmes est-elle un sujet pour les syndicats ?
Mme la ministre. Je ne vous cache pas que, dès ma nomination, j’ai été impressionnée du faible nombre de syndicats au sein desquels les femmes exercent des responsabilités importantes. D’ailleurs, au dernier congrès de la CFTC, j’ai assisté à un « putsch » de femmes contre des désignations à forte majorité masculine. Et du côté patronal, c’est exactement la même chose. Néanmoins, certains syndicats commencent à fixer des règles en matière d’égal accès aux postes de responsabilité. La CFDT, par exemple, a un bureau strictement paritaire. Mais il reste d’immenses progrès à faire.
Lorsque nous abordons des sujets très opérationnels, tels que la gestion du fait religieux en entreprise – nous travaillons depuis trois mois à l’élaboration d’un guide en la matière –, le plan « 500 000 actions de formation supplémentaires » ou le dernier bilan sur la santé au travail, on constate que les questions concernant les femmes commencent à poindre.
Au CSEP, les représentants des syndicats sont bien souvent des femmes. Mais, d’une manière générale, les choses restent très « genrées ».
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous en sommes bien conscients. C’est d’ailleurs parfois nous qui avons alerté les partenaires sociaux sur certains points. On a un peu le sentiment que les femmes salariées sont les variables d’ajustement, car elles sont moins défendues que d’autres salariés dans les négociations. C’est ce qui nous inquiète. Si l’on peut changer cette culture, ce sera une très bonne chose.
S’agissant du compte personnel de prévention de la pénibilité, nous avions soulevé la question de la classification des métiers. Nous savons tous que certains métiers souvent exercés par des femmes sont aussi pénibles que des métiers réputés pénibles exercés par des hommes, tels que les métiers du bâtiment. Tel est le cas par exemple pour les personnes qui travaillent dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et sont amenées à soulever des patients parfois très lourds, ou encore des caissières, qui peuvent être affectées par des maladies musculaires – elles-mêmes ne disent d’ailleurs pas qu’elles exercent un métier « pénible » au sens où on l’entend dans la loi. Afin que l’on continue à porter la même attention aux questions concernant les femmes, il faudrait que la médecine du travail conserve la place et l’importance qu’elle a aujourd’hui. Or on se demande si tel sera bien le cas.
Je signale à votre attention, madame la ministre, que nous travaillons à une simplification des modalités de négociation en matière d’égalité professionnelle. Vous avez indiqué dans vos propos introductifs que vous étiez attentive à cette question. Nous y avions déjà beaucoup travaillé lors de l’examen de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, ce qui avait suscité des crispations assez fortes.
Pour ma part, je comprends l’utilité de la base de données unique, appelée « base de données économiques et sociales » (BDES), car les données étaient trop fragmentaires et dispersées, et on ne s’y retrouvait pas. Je le dis et le répète : nous avons réintroduit dans la BDES tous les éléments qui figuraient dans le rapport de situation comparée. Cela a été une bagarre, une lutte, mais nous y sommes parvenus.
Par contre, lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, l’employeur peut présenter le plan d’action qu’il est tenu de négocier sans mettre à disposition l’ensemble des données chiffrées qui figuraient dans le rapport de situation comparée. Nous voudrions remettre de l’ordre dans tout cela, non pas en bousculant la loi, mais en reprenant et en simplifiant les dispositions existantes. Nous vous soumettrons donc des amendements en ce sens, madame la ministre. Rappelons que le décret prévu par la loi Rebsamen sur ce point n’est pas encore paru.
Mme la ministre. Je m’exprimerai le moment venu sur ces amendements.
Vous avez parlé de biais de sexe ou de genre dans certains métiers. Selon moi, le point le plus important, c’est la manière dont on accompagne les branches professionnelles dans la renégociation des classifications. La ministre des affaires sociales et moi-même avons demandé au CSEP d’engager un travail sur ces classifications. L’objectif central à mes yeux, c’est que les partenaires sociaux de branche négocient des classifications exemptes de tout biais à l’égard des femmes – dans certains métiers, les salaires restent inférieurs au SMIC. Il faut qu’on parvienne à le faire de façon régulière et à brève échéance. Cela soulève la question de notre capacité à redynamiser la négociation au niveau des branches. Nous y répondons dans le projet de loi en donnant une existence juridique aux commissions permanentes de branche et, surtout, en restructurant les branches professionnelles. Si nous passons de 700 à 200 branches, cela aura un impact majeur en termes de négociations.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Dans l’étude d’impact, il est précisé qu’un certain nombre de branches sont dormantes : il n’y a pas eu de négociation au niveau de ces branches depuis des années. Je partage tout à fait votre avis en ce qui concerne les classifications. On constate des inégalités entre des métiers équivalents. La notion importante est celle de « travail de valeur égale ». Certains métiers qui demandent plusieurs années de formation sont moins valorisés lorsqu’ils sont exercés par des femmes que lorsqu’ils le sont par des hommes.
Mme Catherine Quéré. Vous avez évoqué un travail en cours sur le fait religieux en entreprise. De quoi s’agit-il exactement ?
Mme la ministre. Nous avons entamé ce travail à la suite des attentats du 13 novembre, à la demande des partenaires sociaux, demande qui émanait autant des représentants des salariés que de ceux des employeurs. Ces derniers, en effet, sont parfois un peu désemparés face à certaines demandes de leurs salariés. Nous nous sommes réunis à trois reprises pour dresser la liste des questions qui peuvent se poser. Il s’agit de questions très concrètes, « pratico-pratiques » : sur quelle base un employeur peut-il se fonder pour refuser une demande de mise à disposition d’un local ? Comment gère-t-il la situation lorsqu’un salarié lui demande un jour qui n’est pas un jour férié et qu’il ne peut pas le lui donner compte tenu de la charge de travail, alors même qu’il a accordé un jour à un salarié d’une autre confession un mois auparavant ? Nous faisons l’état du droit et de la jurisprudence et essayons de répondre à chacune de ces questions.
Mme Maud Olivier. Cela fait-il partie du projet de loi ? N’introduit-on pas une possibilité de négocier sur ces questions ?
Mme la ministre. Absolument pas. Dans le projet de loi figure, au 6° de l’article 1er, un principe issu des travaux de la commission Badinter. Certains l’ont instrumentalisé en disant qu’il favorisait le communautarisme religieux, alors même qu’il ne change rien au droit existant. Ainsi que je l’ai indiqué hier devant la commission des affaires sociales, je suis tout à fait prête à ce que l’on fasse évoluer cet alinéa dans le cadre du débat parlementaire, mais ne faisons pas croire que le projet de loi modifie le droit actuel.
Quand nous avons discuté du fait religieux en entreprise, nous avons abordé aussi la question de certaines femmes.
Mme la rapporteure. Je voudrais poser une question sur le délai de prévenance, s’agissant de la modification des congés et de la durée du travail à temps partiel. Il me semble que cette disposition pénalisera plus particulièrement les femmes, notamment dans les familles recomposées où la garde des enfants et l’organisation familiale sont plus compliquées.
Mme la ministre. En ce qui concerne le temps partiel, le délai ne change pas.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Il était de sept jours, avec la possibilité de le ramener à trois jours par la négociation. Dans le projet de loi, il est fixé à trois jours, avec la possibilité de négocier autrement. C’est, en tout cas, ce que nous avons compris.
Mme la ministre. Non, ce n’est pas cela.
Mme la rapporteure. Le délai reste donc fixé à sept jours, mais peut être réduit à trois jours s’il y a accord.
Mme la ministre. Ce sont exactement les mêmes règles qu’aujourd’hui. Le délai de prévenance, en cas de modification des horaires des salariés à temps partiel, ne peut être inférieur à trois jours. À défaut d’accord, il est de sept jours.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. C’est la réécriture en trois étages qui nous gêne, car elle semble privilégier le délai de trois jours. J’entends votre logique, madame la ministre, mais j’ai du mal à y adhérer.
Mme la ministre. Il faut avoir confiance dans le dialogue social.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Avec ce que vous venez de nous dire sur les délégations…
Mme Marie-Noëlle Battistel, corapporteure. On a observé que ce n’était pas possible dans un certain nombre d’entreprises.
Mme la ministre. Les syndicats signeront ou ne signeront pas. S’il n’y a pas d’accord, la norme, pour le délai de prévenance, est de sept jours. Nous avons élargi l’objet de la négociation pour renforcer la possibilité de développer des accords. Je rappelle qu’un accord, aujourd’hui, peut être signé par des syndicats représentant ensemble 30 % des salariés, et que, demain, il faudra qu’ils en représentent 50 %.
Ce projet de loi incite à la confiance dans les acteurs du dialogue social : chefs d’entreprise, représentants des salariés, syndicats. C’est la philosophie de cette loi.
Mme Catherine Quéré. Pourquoi avoir ajouté la possibilité d’un délai de trois jours ?
Mme la ministre. Je le répète, c’est déjà le cas aujourd’hui. À défaut d’accord, ce sera sept jours. Peut-être y aura-t-il ainsi plus souvent des délais de prévenance de sept jours.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Cela revient à inverser le système puisqu’aujourd’hui le délai de prévenance est de sept jours, avec la possibilité de le ramener à trois jours en cas d’accord. En proposant un délai compris entre trois et sept jours, vous donnez une sorte de « permis » pour un délai de trois jours. C’est cela ce qui nous gêne. La règle souhaitable est de fixer à au moins à sept jours le délai de prévenance, lorsqu’il s’agit de temps partiel ou de familles monoparentales. La règle de base doit prévoir un délai de sept jours, éventuellement négociable, mais avec des contreparties.
Mme la ministre. C’est précisément l’objectif. Élargir l’objet de la négociation, c’est négocier en offrant des contreparties.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Avec un délai de prévenance de trois jours, il faut assurer la gratuité de la garde d’enfants.
Mme la ministre. Aujourd’hui, on peut avoir un accord dont les signataires représentent 30 % des salariés, sans que cela semble vous choquer, alors que, demain, il faudra 50 %, faute de quoi le délai de sept jours s’imposera.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Si, madame la ministre, cela nous choque. Nous ne souhaitons pas légiférer à droit constant, mais à droit amélioré, concernant les droits des femmes. Dans ce cadre, il y a le droit à la garde d’enfants, que nous avons inscrit dans la loi Macron.
Nous avons bataillé pour obtenir cette disposition. Si nous avons « accepté » le travail du dimanche, c’est à condition que l’employeur paie au salarié, pour le décalage du soir ou le dimanche, le trajet de retour jusqu’à son domicile et la garde d’enfants. Nous considérons qu’il s’agit d’une dégradation des conditions de travail, peut-être nécessaire dans certains cas, mais à condition qu’il y ait des contreparties. Nous ne sommes pas forcément favorables au droit constant. Cela étant, je sais, madame la ministre, que vous êtes très attentive au travail de notre délégation.
Nous avions promis de ne pas dépasser vingt heures trente. Les femmes sont à l’heure, car elles savent ce que c’est que d’avoir des contraintes !
J’en profite pour dire que je suis très favorable, madame la ministre, aux accords de méthode qui figurent dans votre texte. Il faut en finir avec le présentéisme, les négociations de nuit et tout ce qui convient aux hommes mais pas aux femmes – à moins que les hommes ne se transforment en baby-sitters toutes les nuits pendant que leurs femmes négocieront ! Le présentéisme et la longueur des réunions sont un réel facteur d’exclusion des femmes qui voudraient s’élever dans la hiérarchie.
De la même façon, dans notre mode de fonctionnement, les congés parentaux pris par les hommes sont mal vus. Il faut changer tout cela, peut-être par la négociation, mais les mentalités ne changeront pas sous le seul effet de la négociation.
Je vous remercie, Madame la ministre, de votre écoute et de vos réponses.
La Délégation examine le présent rapport d’information, au cours de réunion du mardi 5 avril 2016, sous la présidence de la présidente Catherine Coutelle.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous examinons aujourd’hui le rapport sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, dont la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes s’est saisie.
Dans le cadre de ces travaux, nous avons auditionné des associations, des syndicats, des chercheurs et, la semaine dernière, Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
À cet égard, j’observe que, pour la seconde fois, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) fut la seule organisation patronale à ne pas avoir répondu à notre invitation ; il a dû juger suffisante sa présence aux auditions organisées par la commission saisie au fond. Soit le MEDEF n’est pas capable d’envoyer des personnes à deux séances différentes, soit, cette dernière hypothèse me paraissant la plus probable, il s’intéresse moins à une moitié des salariés des entreprises qu’à l’autre.
Mme Marie-Noëlle Battistel, corapporteure. Le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes est un combat qui demande une mobilisation sans cesse réaffirmée, comme l’a souligné la ministre Mme Myriam El Khomri, lors de son audition par notre Délégation le 30 avril dernier. Si les femmes représentent aujourd'hui 48 % de la population active, le monde du travail reste marqué par de profondes inégalités. En effet, les femmes occupent environ 82 % des emplois à temps partiel et plus des deux tiers des travailleurs pauvres. Même si les écarts de salaire diminuent deux fois plus vite en France qu’en Europe, elles gagnent encore 19 % de moins que les hommes en équivalent temps plein, avec une part dite non expliquée, la plus inadmissible, d’environ 10 %.
Par ailleurs, 27 % des femmes occupent des postes peu qualifiés d’employés ou d’ouvriers, soit près de deux fois plus que les hommes (15 %), et, plus globalement, une véritable ségrégation professionnelle demeure ; plus de la moitié de l'emploi féminin se concentre ainsi sur une dizaine de métiers, qui s’avèrent souvent peu valorisés. Plus exposées à la précarité dans l’emploi, elles sont aussi confrontées à un plafond de verre pour l’accès aux postes à responsabilité. Elles sont également plus concernées par les discriminations, directes ou indirectes, à raison du sexe ou de la parentalité, les harcèlements sexuels et les agissements sexistes.
En dépit de 40 ans de lois sur l’égalité professionnelle, celle-ci n’est pas encore réalisée. Depuis 2012, la France a engagé une démarche nouvelle pour transformer l’égalité des droits en égalité réelle : les droits des femmes sont devenus une politique publique à part entière, autonome et visible, mais qui a aussi vocation à être intégrée dans l'ensemble des politiques publiques de l’État.
Pour y veiller et pour promouvoir l'autonomie des femmes et l'égalité réelle au regard de l'importance des enjeux liés au travail et à l'emploi, la Délégation aux droits des femmes s’est saisie, depuis le début de cette législature, de plusieurs projets de loi concernant le travail, et relatifs au harcèlement sexuel, à la sécurisation de l'emploi, à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, et, récemment, du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. La Délégation a également publié en janvier 2013 un rapport d’information thématique sur le dispositif relatif aux obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle.
Dans le prolongement de ces travaux, la Délégation a souhaité être saisie du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 24 mars dernier.
Dans cette perspective, des auditions ont été organisées avec des représentantes d'associations féministes ou œuvrant sur le terrain pour promouvoir l'insertion professionnelle des femmes, des experts, membres du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), des représentants et représentantes d’organisations syndicales de salariés et de l’Union professionnelle artisanale (UPA). Seul le MEDEF a décliné notre invitation, comme Mme la présidente l’a rappelé. Ce cycle de rencontres s’est conclu par l’audition de la ministre Mme Myriam El Khomri. La Délégation a également pu s'appuyer sur l'avis rendu le 11 mars 2016 par le CSEP sur l’avant-projet de loi, qui faisait état de plusieurs réserves sous l'angle de l’égalité professionnelle.
Si nous avons disposé de très peu de temps pour mener ces travaux, le rapport est très complet et procède tout d’abord à l’analyse des principales caractéristiques de l’emploi et du travail des femmes, afin de pouvoir mieux appréhender l'impact du projet de loi pour tenter de pallier les carences de l’étude d'impact sur ce point. Il rappelle également les nombreuses avancées intervenues depuis 2012 en matière d’égalité professionnelle.
Le rapport examine dans une seconde partie les différentes mesures du projet de loi sur lesquelles l’attention de la Délégation a été appelée. Celles-ci concernent principalement les principes essentiels du droit du travail qui doivent guider la réécriture de la partie législative du code du travail (article 1er), les dispositions relatives aux temps de travail, s'agissant plus particulièrement de celles relatives au temps partiel (articles 2 à 5), ainsi que la réforme du dialogue social, compte tenu de ses impacts sur la négociation collective en entreprise sur l'égalité professionnelle (articles 10 à 18). Nous avons également étudié les dispositions du projet de loi relatives au compte personnel d'activité (CPA) – (articles 21 et 22), au droit à la déconnexion et au télétravail (articles 25 et 26), la médecine du travail (article 44), ainsi que d’autres thématiques susceptibles d’enrichir ce projet de loi, concernant par exemple la lutte contre les agissements sexistes en milieu professionnel.
Nous formulons trente recommandations pour améliorer le droit du travail pour renforcer la lutte contre les inégalités ; par ailleurs, une trentaine d’amendements ont été déposés pour l’examen cette semaine du projet de loi par la commission des Affaires sociales.
Nous demandons tout d’abord l’élaboration systématique d’une étude d’impact chiffrée sur les conséquences des projets de loi et la mise en œuvre effective des dispositions prévues en la matière par la circulaire du Premier ministre du 23 août 2012. Cette requête concerne d’ailleurs l’ensemble des projets de loi qui sont souvent accompagnés d’études d’impact lacunaires.
Nous formulons plusieurs recommandations sur les principes essentiels du droit du travail, qui devront guider le travail de réécriture de la partie législative du code du travail : mieux définir le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; prendre en compte l’accès à l’emploi dans la définition du principe relatif à l'interdiction des discriminations ; poser un principe plus ambitieux et plus conforme aux textes européens et internationaux en matière d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ; réécrire le principe concernant la grossesse et la maternité, afin de ne pas en présenter une vision négative et de mieux tenir compte du droit existant ; réécrire le principe relatif au principe d'égalité de rémunération pour viser explicitement les inégalités entre les femmes et les hommes. Nous préconisons également de prévoir, d’une part, la composition paritaire de la commission de refondation qui sera chargée de proposer une réécriture de la partie législative du code du travail et, d’autre part, d’associer le CSEP aux travaux de cette commission.
En matière de temps de travail et de repos, nous suggérons quatre pistes : rétablir un délai de prévenance de sept jours ; prévoir que les accords de branche ne peuvent pas moduler la majoration de la rémunération des heures complémentaires ; établir un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif des accords de branche prévoyant des dérogations aux 24 heures ; modifier la rédaction du projet de loi pour faire référence aux congés d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle, en supprimant le terme de conciliation.
Concernant la négociation collective sur l’égalité professionnelle, il nous semble nécessaire de renforcer les moyens des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) afin d’accompagner, de contrôler et de sanctionner les entreprises en matière d’égalité professionnelle, et de prévoir que la négociation sur l’égalité professionnelle et celle sur les rémunérations ne puissent devenir triennales à la suite d’un accord de branche que si l’entreprise a conclu un accord sur l'égalité. En outre, il est important de former les partenaires sociaux aux spécificités de la négociation sur l'égalité professionnelle en utilisant les nouvelles possibilités offertes par le projet de loi et, par ailleurs, de veiller à l'équilibre de la représentation des très petites (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) où les femmes sont majoritairement représentées pour les négociations des accords collectifs de branche.
Nous proposons également d’harmoniser le vocabulaire utilisé pour nommer les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales (BDES) et dans la procédure de consultation et de négociation, d’introduire dans les éléments soumis par l’employeur à la consultation et à la négociation, le plan d’action et en définir le contenu, et de porter à la connaissance des salariés non seulement la synthèse du plan d'action unilatéral de l'employeur en cas d'échec de la négociation, mais aussi la synthèse de l'accord lui-même en cas de succès. Il convient enfin de renforcer le positionnement et les moyens du CSEP et de veiller à la publicité systématique de ses travaux.
Deux autres recommandations portent sur l’amélioration des modalités d'abondement du compte personnel de formation (CPF), qui sera intégré dans le compte personnel d’activité (CPA), pour les salariées et salariés à temps partiel, et sur la prise en compte, dans le cadre de la réforme de la médecine du travail, des risques pour la santé et la sécurité des salariés dans les métiers majoritairement exercés par les femmes.
Nous avançons également plusieurs propositions dans le domaine des discriminations, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes : harmoniser les règles de preuve en matière de discrimination et de harcèlement sexuel ou moral ; prévoir l’obligation pour l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la personne licenciée suite à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel ; instaurer une indemnisation plancher correspondant aux salaires des 12 derniers mois pour tout salarié licencié en raison d’un motif discriminatoire ou d’un harcèlement sexuel.
Il conviendrait par ailleurs de préciser le régime de la preuve applicable aux actions en justice relatives aux agissements sexistes en milieu professionnel, de prévoir l’obligation de rappeler dans le règlement intérieur des entreprises les dispositions prévues par la loi en matière d’agissements sexistes, mais aussi d’inclure les risques liés à ces agissements dans les principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés, et d’intégrer la question du sexisme et des violences au travail dans le champ de la négociation collective sur l’égalité professionnelle. Nous proposons enfin de modifier le titre du projet de loi pour faire également référence aux « actives », afin que les femmes ne soient pas invisibles.
Mme Barbara Romagnan. Concernant la seizième recommandation que venez d’évoquer, relative à l’équilibre de la représentation des TPE et des PME, où les femmes sont majoritairement représentées pour les négociations des accords collectifs de branche, la présentation me semble plus claire dans le corps du rapport.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La loi procédera à un rééquilibrage de la représentation patronale, à hauteur de 80 % pour le MEDEF et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CPGME), et 20 % pour les TPE. Nous n’arrivons pas à connaître la proportion de femmes dans les TPE et les petites entreprises, mais on nous a dit qu’elles y étaient majoritaires. Elles sont donc moins protégées et moins représentées que les salariés des grandes entreprises, qui disposent de délégués syndicaux, de comités d’entreprise (CE) et de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dans les PME, le texte améliore la situation en proposant le mandatement pour la négociation, mais l’UPA nous a dit souhaiter négocier au niveau des branches et non des entreprises, car les moyens humains sont insuffisants dans les petites structures. Nous souhaitons éviter la sous-représentation de ces petites entreprises, afin que les femmes soient défendues.
L’article 1er pose les principes du droit selon lesquels le code du travail sera réécrit. Nous avons avancé des propositions sur la grossesse, l’égalité professionnelle et l’articulation entre les vies au travail et familiale. Je vous demande de nous soutenir, car il n’est pas certain que l’on obtienne gain de cause, et nous avons besoin d’une commission paritaire pour réécrire le code du travail, les commissions Combrexelle et Badinter ayant été majoritairement composées d’hommes. Or il existe des expertes dans ce domaine, le CSEP en comptant notamment plusieurs.
Mme Maud Olivier. J’ai cosigné tous les amendements déposés en commission par les rapporteures. Cependant, je m’interroge sur la formulation de la recommandation qui propose de prévoir que les accords de branche ne puissent pas moduler la majoration de la rémunération des heures complémentaires : la rédaction ne pourrait-elle être clarifiée ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Nous avons mené ce combat dès l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, car les premières heures complémentaires n’étaient pas rémunérées avant cette date. Dans le cadre du présent projet de loi, nous souhaitons que toute heure complémentaire soit payée avec une majoration de 25 %.
Mme Maud Olivier. Concernant les principes essentiels du droit du travail, le projet de loi introduit des dispositions relatives à la manifestation de convictions religieuses en entreprise, qui me dérangent.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Le onzième alinéa de l’article 1er du projet de loi, correspondant au sixième grand principe, dispose en effet que : « La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».
Mme Maud Olivier. Cela me pose problème au regard de l’emploi des femmes.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Ce n’est pas le salarié qui embauche, et les dispositions précitées sont relatives à la liberté pour le salarié, à l’intérieur de l’entreprise, de manifester ses convictions, y compris religieuses. Le rapport d’information évoque les cas où des salariés de certaines entreprises pourraient refuser de serrer la main de collègues et de travailler au même poste que des femmes – on nous a cité l’exemple des transports. Dans ces situations, le salarié entrave le bon fonctionnement de l’entreprise.
Mme Maud Olivier. Certains salariés sont des directeurs. L’introduction du fait religieux dans l’entreprise me choque.
Mme Pascale Crozon. Je suis d’accord avec Mme Maud Olivier et ne comprends pas pourquoi le texte parle de religion.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Il y aura sûrement des amendements à cette disposition. L’article 1er énonce ce qui servira à réécrire le code du travail pendant deux ans et ne touche donc pas au code du travail. Cette entreprise de réécriture se fera à droit constant. La disposition avec laquelle vous exprimez votre désaccord, mesdames Olivier et Crozon, correspond en principe au droit actuel.
Mme Maud Olivier. Profitons de ce projet de loi pour la supprimer ! Souvenons-nous des hôtesses de l’air qui refusaient de porter le voile pour un vol vers Téhéran : Air France a pu trouver des volontaires, mais s’il n’y en avait pas eu, ces hôtesses auraient pu perdre du salaire.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Si elles refusent de porter le voile, ce n’est justement pas par conviction religieuse !
Mme Maud Olivier. C’est valable dans les deux sens.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Vous souhaitez donc que nous proposions de supprimer le onzième alinéa du premier article ?
Mme Viviane Le Dissez. Absolument. Il n’est pas nécessaire de stigmatiser une nouvelle fois le fait religieux.
Mme Marie-Noëlle Battistel, corapporteure. Nous lisions cette disposition comme une garantie apportée au salarié d’exprimer ses convictions religieuses. Il n’en reste pas moins que l’opportunité de maintenir la dimension religieuse dans la loi se pose.
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. J’ajoute qu’il a été souligné lors de nos travaux que cette disposition a pour effet de créer une différence entre les salariés du privé et ceux du public. Il est donc décidé de proposer la suppression du onzième alinéa de l’article 1er.
Ce rapport présente le grand avantage de mettre en valeur le travail effectué par la Délégation, en rappelant les textes de loi relatifs au travail sur lesquels elle est intervenue et a obtenu des améliorations. Nous veillons à ce que l’on ne revienne pas sur ces progrès et tâchons d’en défendre de nouveaux.
Mme Viviane Le Dissez. La dernière recommandation propose d’insérer le terme d’« actives » dans le titre du projet de loi. Je soutiens cette suggestion et souhaiterais même inverser les mots « actifs » et « entreprises ». Le projet de loi viserait alors à « instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les actives et les actifs et pour les entreprises ».
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Les libertés concernant plutôt les entreprises et les protections les salariés, peut-être serait-il plus opportun d’en rester à la recommandation initiale.
Mme Maud Olivier. Lorsqu’un accord sur l’égalité professionnelle est conclu dans une entreprise, a-t-elle l’obligation d’élaborer un rapport de situation comparée ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui transposait l’ANI de janvier 2013, a créé une base de données unique (BDU) pour que les entreprises ne se perdent plus dans les demandes d’information. Néanmoins, la partie relative à l’égalité professionnelle et au rapport de situation comparée (RSC) n’avait pas été insérée dans la BDU. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen, a procédé à cette intégration, en reprenant les différents items du RSC dans la BDU ou base de données économiques et sociales (BDES), et la Délégation aux droits des femmes s’était d’ailleurs mobilisée pour la préservation des fonctions du RSC.
Je rappelle que l’employeur d’une entreprise de plus de 50 salariés devait établir un rapport de situation comparée, et mettre à disposition des données et un diagnostic de situation comparée. Une fois les données connues, la consultation débutait, puis les négociations s’engageaient pour définir un plan d’action ou un plan unilatéral en l’absence d’accord. Nous souhaitons clarifier et remettre de l’ordre dans les différentes étapes du processus, car les dispositions issues de la loi Rebsamen ont conduit à un schéma compliqué dans lequel l’employeur est censé présenter à la consultation un plan en principe issu de la négociation. Nous pourrions également introduire la notion de bilan, voire de rapport, de situation comparée.
Mme Maud Olivier. Pour les TPE, les femmes peuvent être accompagnées par une personne mandatée et nommée par un syndicat pour les négociations, mais cette opportunité existe au niveau de la branche et non à celui de l’entreprise, n’est-ce pas ?
Mme la présidente Catherine Coutelle, corapporteure. Pas tout à fait. Les TPE emploient majoritairement des femmes, bien que nous ignorions la proportion exacte. Le mandatement d’un salarié constitue l’une des avancées du texte. Beaucoup d’entreprises ne comptent pas de délégué du personnel, y compris dans les moyennes et les grosses entreprises où les salariés pouvant assumer cette fonction craignent les discriminations. Dans les petites entreprises, le projet de loi prévoit la possibilité pour un salarié à l’intérieur de l’entreprise d’être mandaté par un membre extérieur nommé par un syndicat. Le salarié pourra, à l’intérieur de l’entreprise, demander des conseils au syndicat qu’il aura mandaté pour donner son accord au résultat de la négociation – il s’agissait là d’une revendication de la CFDT. Dans certaines branches, les TPE ne seront pas représentées alors qu’elles emploient des salariés et notamment des femmes. Je veux bien suivre le pari du Gouvernement et inciter au développement de la discussion, mais chacun doit démontrer une culture de la négociation : on doit reconnaître le rôle des syndicats et ceux-ci doivent accepter de négocier, c’est-à-dire de gagner sur certains points et de perdre sur d’autres.
La Délégation adopte le rapport d’information et les recommandations ci-après.
1. – Pour assurer l’égalité professionnelle, la Délégation aux droits des femmes demande l’élaboration systématique d’une étude d’impact chiffrée sur les conséquences des projets de loi et la mise en œuvre effective des dispositions prévues en la matière par la circulaire du Premier ministre du 23 août 2012.
« Principes essentiels du droit du travail »
2. – Mieux définir le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
→ En réécrivant le principe défini au 4° de l’article 1er du projet de loi de la façon suivante : « Le principe d’égalité s’applique dans l’entreprise. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être assurée. Ce principe ne fait pas obstacle à l’intervention, de manière temporaire, de mesures positives visant à corriger des inégalités entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, dans les conditions prévues par la loi. »
3. – Prendre en compte l’accès à l’emploi dans la définition du principe essentiel du droit du travail relatif à l’interdiction des discriminations.
→ En réécrivant ainsi le principe défini au 5° : « Les discriminations sont interdites dans l’accès à l’emploi et dans toutes les relations de travail. »
4. – Supprimer le 6° de l’article 1er du projet de loi, aux termes duquel « La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».
5. – Poser un principe plus ambitieux en matière d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, également plus conforme aux textes européens et internationaux.
→ En réécrivant le principe défini au 9 de l’article 1er du projet de loi, par exemple de la façon suivante : « L’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale est prise en compte dans la relation et l’organisation du travail ».
6. – Réécrire le principe concernant la grossesse et la maternité, pour ne pas en présenter une vision négative et pour mieux tenir compte du droit existant.
→ En réécrivant le principe défini au 17° de l’article 1er du projet de loi de la façon suivante : « Pendant la grossesse et la maternité, les salariées bénéficient de mesures spécifiques, notamment en cas de risques pour leur santé et leur sécurité. La salariée a droit à un congé maternité pendant la période précédant et suivant son accouchement. Pendant la grossesse et la maternité, la salariée ne peut être licenciée, sauf exceptions prévues par la loi ».
7. – Réécrire le principe relatif au principe d’égalité de rémunération pour viser explicitement les inégalités entre les femmes et les hommes.
→ En réécrivant le principe défini au 31° de l’article 1er du projet de loi de la façon suivante : « L’employeur assure l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale entre les femmes et les hommes » (et non plus « entre les salariés »).
8. – Prévoir la composition paritaire de la commission de refondation qui sera chargée de proposer une réécriture de la partie législative du code du travail, ainsi que l’association du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) aux travaux de la commission de refondation.
→ En complétant le premier alinéa de l’article 1er par la phrase suivante : « Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes ».
Temps de travail et de repos
9. – Rétablir un délai de prévenance de sept jours pour les modifications dans la répartition de la durée du travail intervenant dans le cadre des contrats à temps partiel, avec possibilité de dérogation limitée à trois jours dans le cadre d’un accord collectif.
10. – Prévoir que les accords de branche ne peuvent pas moduler la majoration de la rémunération des heures complémentaires correspondant à un temps de travail additionnel compris entre le dixième et le tiers du temps de travail total en dessous de 25 % du prix de l’heure de base.
11. – Établir un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations aux 24 heures, et supprimer le caractère supplétif de la loi pour la fixation de la durée minimum du temps de travail lors d’un contrat à temps partiel.
12. – Modifier la rédaction du projet de loi pour faire référence aux « congés d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle » à l’article 3 du projet de loi, et remplacer le mot de « conciliation » par celui d’ « articulation » à l’article 2.
Négociation collective sur l’égalité professionnelle
13. – Renforcer les moyens des DIRECCTE afin d’accompagner, de contrôler et de sanctionner les entreprises en matière d’égalité professionnelle.
14. – Prévoir que la négociation sur l’égalité professionnelle et la négociation sur les rémunérations ne puissent devenir triennales à la suite d’un accord de branche que si l’entreprise a conclu un accord sur l’égalité.
La loi du 17 août 2015 prévoyait déjà qu’on puisse modifier la périodicité des négociations annuelles obligatoires dont celle sur l’égalité professionnelle par accord majoritaire d’entreprise. Avec le projet de loi, cette possibilité sera ouverte après un accord de branche. Compte tenu des enjeux importants, il faut réserver cette possibilité de modifier par accord de branche la périodicité des NAO aux entreprises couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle.
15. – Former les partenaires sociaux aux spécificités de la négociation sur l’égalité professionnelle en utilisant les nouvelles possibilités offertes par le projet de loi.
16. – Veiller à l’équilibre de la représentation des TPE/PME où les femmes sont majoritairement représentées pour les négociations des accords collectifs de branche.
17. – Harmoniser le vocabulaire utilisé pour nommer les éléments figurant dans la BDES et la procédure de consultation et de négociation.
Les indicateurs chiffrés qui figuraient dans le RSC et sont désormais repris dans la BDES sont à la base de la consultation du comité d’entreprise et de la négociation entre les partenaires sociaux. Il est important d’utiliser le même vocabulaire à toutes les phases de la négociation collective en retenant l’expression de « situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise ».
18. – Introduire dans les éléments soumis par l’employeur à la consultation et à la négociation, le plan d’action de l’employeur et en définir le contenu.
L’ancien RSC contenait une analyse de la situation dans l’entreprise et un plan d’action, celui-ci doit aussi être soumis pour avis lors de la phase de consultation et lors de la négociation entre les partenaires.
19. – Porter à la connaissance des salarié.e.s non seulement la synthèse du plan d’action unilatéral de l’employeur en cas d’échec de la négociation mais aussi la synthèse de l’accord lui-même en cas de succès.
En cas d’échec de la négociation collective sur l’égalité professionnelle, l’employeur doit porter à la connaissance de ses salarié.e.s une synthèse du plan d’action unilatéral qu’il compte mettre en œuvre pour faire progresser l’égalité dans l’entreprise. Mais paradoxalement, rien n’est prévu en cas de succès et de signature d’un accord, celui-ci devrait logiquement aussi être porté à la connaissance de salarié.e.s.
20. – Renforcer le positionnement et les moyens du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et prévoir la publicité systématique de ses travaux.
Compte personnel d’activité (CPA) et médecine du travail
21. – Améliorer les modalités d’abondement du compte personnel de formation (CPF), qui sera intégré dans le compte personnel d’activité (CPA), pour les salarié.e.s à temps partiel.
22. – Veiller à la prise en compte des risques pour la santé et la sécurité des salarié.e.s dans les métiers majoritairement exercés par les femmes dans le cadre de la réforme de la médecine du travail.
Discriminations, harcèlement sexuel et agissements sexistes
23. – Harmoniser les règles de preuve en matière de discrimination et de harcèlement sexuel ou moral.
→ en modifiant l’article L. 1154-1 du code du travail, relatif à la preuve du harcèlement sexuel ou moral, en prévoyant que la personne candidate à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le/la salarié.e « présente des éléments de fait laissant supposer » l’existence d’un harcèlement sexuel ou moral (et non plus « établit des faits »), en reprenant ainsi la formulation retenue à l’article L. 1134-1 concernant les discriminations.
24. – Prévoir l’obligation pour l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la personne licenciée suite à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel.
→ En complétant le présent projet de loi par un article additionnel reprenant les dispositions qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2014 dans le cadre de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 7, censuré uniquement pour des raisons de procédure parlementaire).
25. – Instaurer une « indemnisation-plancher » correspondant aux salaires des 12 derniers mois pour tout.e salarié.e licencié.e en raison d’un motif discriminatoire (sexe, grossesse, situation familiale, etc.) ou d’un harcèlement sexuel.
→ En complétant le projet de loi pour réintroduire les dispositions qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2014 dans le cadre de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 10, censuré pour des raisons de procédure).
26. – Préciser le régime de la preuve applicable aux actions en justice relatives aux agissements sexistes en milieu professionnel (régime de l’aménagement de la preuve, comme pour les discriminations liées au sexe).
→ En modifiant l’article L. 1144-1 du code du travail, pour faire référence au nouvel article L. 1142-2-1 relatif à l’interdiction des agissent sexistes tel qu’issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
27. – Prévoir l’obligation de rappeler dans le règlement intérieur des entreprises les dispositions prévues par la loi en matière d’agissement sexiste, comme c’est le déjà le cas pour les dispositions légales en matière de harcèlement sexuel.
→ En modifiant en ce sens le 2° de l’article L. 1321-2 du code de travail, pour faire référence au nouvel article L. 1142-2-1 relatif à l’interdiction des agissements sexistes.
28. – Inclure les risques liés aux agissements sexistes dans les principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé des salarié.e.s.
→ En complétant en ce sens le 7° de l’article L. 1321-2 du code de travail, s’agissant des relations sociales et de l’influence des facteurs ambiants, pour faire référence aux risques liés aux agissements sexistes, comme c’est déjà le cas pour le harcèlement sexuel.
29. – Inclure la question du sexisme et des violences au travail dans le champ de la négociation collective sur l’égalité professionnelle.
30. – Modifier le titre du projet de loi pour ne pas invisibiliser les femmes, en faisant également référence aux « actives ».
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA DÉLÉGATION ET PAR LES RAPPORTEURES
1. Personnes auditionnées par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
● Expert.e.s
– M. Michel Miné, professeur de droit du travail au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), membre du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), ancien inspecteur du travail.
– Mme Rachel Silvera, économiste, maîtresse de conférences à l’université Paris Ouest – Nanterre – La Défense, sous-directrice du groupe de recherche « Marché du travail et genre » (MAGE) et membre du CSEP.
● Organisations syndicales de salarié.e.s
– Mme Marie-Andrée Seguin, secrétaire nationale chargée de la politique en matière d’égalité professionnelle et de la condition féminine, de la CFDT.
– Mme Dominique Marchal, secrétaire confédérale de la CFDT.
– Mme Lucie Lourdelle, secrétaire confédérale de la CFDT.
– Mme Sophie Binet, membre de la direction confédérale chargée de l’égalité femmes-hommes, secrétaire générale adjointe de l’UGICT-CGT (cadres et techniciens).
– Mme Céline Verzeletti, membre de la direction confédérale en charge des questions des femmes, de la CGT.
– Mme Carole Cano, vice-présidente du Syndicat national des cadres de l’assurance, de la prévoyance et de l’assistance (SNCAPA), de la CFE-CGC.
– Mme Barbara Reginato, conseillère technique, de la CFE-CGC.
– M. Claude Raoul, secrétaire confédéral de la CFTC.
– M. Saïd Darwane, conseiller national de l’UNSA.
● Associations
– Mme Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF).
– Mme Élise Moison, déléguée générale de Force femmes.
– Mme Sandra Gidon, directrice de l’Association d’accompagnement global contre l’exclusion (ADAGE).
– Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT).
● Ministre
– Mme Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
2. Personnes auditionnées par les rapporteures
● Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP)
– Mme Brigitte Grésy, secrétaire générale.
● Union professionnelle artisanale (UPA)
– M. Pierre Burban, secrétaire général.
– M. Christian Pineau, chef du service des relations du travail et de la protection sociale.
1 () Rapport d’information n° 67 de Mme Ségolène Neuville au nom de la Délégation (juillet 2012).
2 () Rapport d’information n° 837 de M. Christophe Sirugue et de Mme Ségolène Neuville (mars 2013).
3 () Rapport d’information n° 1655 de Mmes Brigitte Bourguignon, Catherine Coutelle, Edith Gueugneau, Monique Orphé et Barbara Romagnan, au nom de la Délégation (décembre 2013).
4 () Rapport d’information n° 1753 de Mme Ségolène Neuville, au nom de la Délégation (29 janvier 2014).
5 () Rapport d’information n° 2774 de Mme Sandrine Mazetier, au nom de la Délégation (19 mai 2015).
6 () Rapport d’information n° 629 de Mme Cécile Untermaier, au nom de la Délégation (17 janvier 2013).
7 () Rapports d’information de la Délégation mentionnés dans l’introduction du présent rapport.
8 () Femmes et hommes sur le marché du travail : les disparités se réduisent, mais les emplois occupés restent très différents, DARES Analyses n° 17 (mars 2015).
9 () Le « halo» regroupe les personnes qui n’ont pas d’emploi, qui souhaitent travailler, mais qui ne sont pas considérées comme au chômage selon les normes du BIT, car elles ne sont pas disponibles dans les deux semaines ou n’ont pas effectué de démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent.
10 () Selon le ministère des droits des femmes (dossier de presse du octobre 2015 ; source : INSEE, 2013).
11 () Inégalités femme-hommes : il est temps d’agir !, rapport de l’OCDE, décembre 2012.
12 () Voir le compte rendu de l’audition du mardi 8 mars 2016, en annexe au présent rapport.
13 () « Le temps domestique et parental des hommes et des femmes : quels facteurs d’évolutions en 25 ans ? », Clara Champagne, Ariane Pailhé et Anne Solaz, Économie et Statistiques n° 478, INSEE (octobre 2015)
14 () Le « sous-emploi » inclut également les personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude (chômage technique ou partiel).
15 () Les mouvements de main d’œuvre en 2013 : forte augmentation des entrées en CDD dans le tertiaire, DARES Analyses n° 94 (décembre 2014).
16 () L’indice utilisé ici est l’ « indice de dissimilarité de Duncan et Duncan (ID) ». L’indice ID vaut 0 % lorsqu’il y a une parfaite égalité (l’emploi des femmes est distribué par métier exactement de la même manière que celui des hommes) et 100 % lorsqu’il y a une dissimilarité complète (les hommes et les femmes sont dans des métiers totalement différents).
17 () La répartition des femmes et des hommes par métiers : une baisse de la ségrégation depuis 30 ans, DARES Analyses n° 79, décembre 2013.
18 () Femmes et hommes sur le marché du travail, DARES Analyses n° 17 (mars 2015).
19 () Compte rendu de l’audition du mardi 22 mars 2016, en annexe au présent rapport.
20 () DARES Analyses n° 17 (mars 2015).
21 () Décrets n° 2014-1705 et n° 2014-1708 du 30 décembre 2014.
22 () Sa durée est portée à un an (contre six mois avant) pour le premier enfant si le congé est partagé entre le père et la mère. Pour les enfants suivants, la durée est de deux ans pour l’un des parents, un an pour l’autre.
23 () Aux termes de l’article L. 6315-1 du code du travail, « Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Au cours de cet entretien, l'employeur et le salarié organisent le retour à l'emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière. À la demande du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d'éducation. »
24 () Le CNML est une instance de concertation entre les élus et l’État (composé de représentant.e.s des régions, des départements, des communes et des président.e.s des missions locales),
25 () Selon le rapport précité du Gouvernement au CSEP (juin 2015).
26 () De nature transversale, ces actions ont été cofinancées par l’État (préfets de région) et ses partenaires (services déconcentrés de l’État, collectivités, organismes publics –CAF, Pôle emploi, missions locales…).
27 () Les créatrices d’entreprises ont moins souvent un enfant à charge que les créateurs (52 % contre 62 %).
28 () Rapport d’information n° 629 de Mme Cécile Untermaier sur l’application du dispositif relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle (janvier 2013).
29 () C’est à dire ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive depuis moins de 5 ans pour discrimination, quel que soit le motif de discrimination, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive depuis moins de 5 ans pour violation des dispositions concernant l’égalité professionnelle, avoir respecté ses obligations de négocier sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
30 () Par exemple, Accenture, Accor, Air France, SNCF, Areva, Axa France, BNP Paribas, Carrefour, Casino, etc.
31 () Soit « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » et « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, qu’il soit recherché au profit de l’auteur ou d’un tiers » (article 222-33 du code pénal).
32 () « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » (article L. 1142-1-1 du code du travail).
33 () Selon un bilan établi en juin 2015, 20 actions ont été menées sur l’égalité professionnelle en matière de formation continue : elles ont concerné 1 953 bénéficiaires, soit 98 en moyenne par action.
34 () Par exemple, en région Centre, Pôle emploi de Pithiviers a organisé des actions pour une meilleure mixité dans les filières de formation, telles que les « rencontres profession’ELLES » pour la réinsertion des femmes sur des métiers dits masculins. En Bretagne, lors des rencontres de l’emploi organisées par les agences (contact direct entre demandeur.se.s d’emploi et entreprises), une répartition équilibrée des candidats (femmes/hommes) a systématiquement été proposée ; en outre, des animations favorisant la mixité des métiers auprès des conseiller.e.s et/ou des demandeur.se.s d’emploi, des entreprises et des différents partenaires ont été organisées avec l’appui des chargé.e.s de mission départementales aux droits des femmes.
35 () Rapport d’information n° 3348 de Mme Catherine Coutelle, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi (n°3318) pour une République numérique (15 décembre 2015).
36 () Rapport d’information n° 2774 de Mme Sandrine Mazetier, au nom de la Délégation, sur le projet de loi (n° 2739) relatif au dialogue social et à l’emploi (19 mai 2015), pour ce qui concerne le compte personnel d’activité.
37 () Rapport d’information n° 1753 de Mme Ségolène Neuville, au nom de la Délégation, sur le projet de loi (n° 1721) relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (29 janvier 2014).
38 () Circulaire du 23 août 2012 relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes.
39 () Libertés et droits de la personne au travail ; formation, exécution et rupture du contrat de travail ; rémunération ; temps de travail ; santé et sécurité au travail ; libertés et droits collectifs ; négociation collective et dialogue social ; contrôle administratif et règlement des litiges.
40 () Rapport au Premier ministre du comité sur les principes essentiels du droit du travail, conclusions de la mission de M. Robert Badinter (26 janvier 2016).
41 () Voir les comptes rendus de l’audition M. Michel Miné, professeur de droit du travail, et de Mme Rachel Silvera, économiste (mardi 8 mars 2016) et de l’audition des représentant.e.s d’organisations syndicales de salarié.e.s (mardi 22 mars 2016), en annexe au présent rapport.
42 () Dans son article 3, la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail prévoit ainsi que « Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. »
43 () Aux termes de l’article L. 1142-4 du code du travail, « Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures résultent : 1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ; 2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ; 3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
44 () Selon l’avis sur l’avant-projet de loi adressé par Force ouvrière au CSEP (11 mars 2016).
45 () Convention n° 156 de l’OIT concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (entrée en vigueur en 1983).
46 () Avis de Force ouvrière sur l’avant-projet de loi au CSEP (11 mars 2016).
47 () Femmes-hommes : des inégalités à l’égalité ?, « La conciliation : le privé est politique », Annie Junter, Problèmes politiques et sociaux n° 968, La Documentation française, janvier 2010.
48 () Directive n° 92/85/CE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
49 () Proposition de loi de Mme Dominique Orliac et plusieurs de ses collègues visant à prolonger la période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité, adoptée par l’Assemblée nationale le 10 mars 2016.
50 () Article 28 de la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
51 () CJCE, 12 juill. 1984, Hofmann, aff. 184/83, Rec. 3047.
52 () Voir le compte rendu de l’audition du mardi 8 mars 2016 de Mme Rachel Silvera, économiste, maîtresse de conférence à l’université Paris Ouest-Nanterre-la Défense, sous-directrice du MAGE, en annexe.
53 () La négociation collective, le travail et l’emploi, rapport au Premier ministre de M. Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil d’État, France Stratégie (septembre 2015).
54 () Rapport au Premier ministre du comité sur les principes essentiels du droit du travail, conclusions de la mission de M. Robert Badinter (26 janvier 2016).
55 () Soit : Paul-Henri Antonmattei, professeur de droit à l'université de Montpellier 1 et avocat, Yves Barou, président de l’AFPA, Andreas Botsch, conseiller spécial du Président, Confédération allemande des syndicats, Sylvie Brunet, professeure associée, Kedge Business School, membre du CESE, Annette Jobert, Directrice de recherche au CNRS, membre de l'IDHE, Françoise Favennec-Héry, professeur de droit à l'université Paris-II – Panthéon-Assas, Sylvie Peretti, directrice de l’organisation et des ressources humaines, Lafarge France, Pierre Cahuc, économiste, professeur à l’Ensae-CREST et à l'École polytechnique, Michel Didier, président de COE–REXECODE, Pierre Ferracci, président du groupe ALPHA, Henri-José Legrand, Avocat, LBBA, Antoine Lyon-Caen, professeur de droit à l'université de Paris-Ouest- Nanterre La Défense, Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit à Paris-I-Sorbonne, Henri Rouilleault, Consultant, Jean-Dominique Simonpoli, Directeur général de l’Association Dialogues, et Tiziano Treu, Ancien ministre, professeur émérite en droit du travail à l’université de Milan.
56 () Communiqué du ministère du travail du 24 novembre 2015.
57 () Soit : Olivier Dutheillet de Lamothe, président honoraire de la section sociale du Conseil d’État, ancien membre du Conseil constitutionnel, Françoise Favennec-Hery, professeur de droit à l’université Panthéon-Assas (Paris 2) Jean-Yves Frouin, président de la chambre sociale de la Cour de cassation, Alain Lacabarats, ancien Président de la chambre sociale de la Cour de cassation, Antoine Lyon-Caen, professeur émérite de l’université Paris Ouest Nanterre, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Yves Robineau, président honoraire de la section de l’intérieur du Conseil d’État, président adjoint de la section sociale du Conseil d’État – les deux rapporteures étaient Gaëlle Dumortier, conseiller d’État, et Laurence Pécaut-Rivolier, inspectrice générale adjointe des services judiciaires.
58 () Compte rendu de l’audition du mardi 22 mars 2016.
59 () Dans son livre, Travail et emploi des femmes, Éditions La Découverte, Paris, 2011.
60 () C'est ce que l'on appelle le sous-emploi visible, c'est-à-dire celui qui se déclare et qui peut être comptabilisé comme tel.
61 () En France, les données sur les salaires du travail partiel sont très récentes. Il a fallu attendre 1997 pour que les premiers chiffres sur les rémunérations du travail à temps partiel soient publiés – l’organe de publication étant la DARES qui élabore ses statistiques à partir des « enquêtes Emploi » de l’INSEE.
62 () Voir la section intitulée « Le temps partiel : des dispositions qui fragilisent les acquis de la loi de sécurisation de l’emploi de 2013 », dans l’avis du CSEP précité (11 mars 2016).
63 () Article L. 3123-26 du code du travail.
64 () Par ailleurs, en matière de protection sociale complémentaire, l’obligation disparaît une fois l’accord conclu.
65 () Articles L. 2242-5 et suivants du code du travail.
66 () Article L. 2242-15 et suivant du code travail.
67 () Accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 sur la politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle (article 13).
68 () Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (article 33).
69 () Il s’agit des entreprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salarié.e.s et des entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France.
70 () Article L. 2323-8 nouveau du code du travail (1° bis).
71 () Pour rappel, est dit majoritaire l’accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
72 () Article L. 2242-20 du code du travail.
73 () Compte rendu de l’audition des organisations syndicales de salarié.e.s (mardi 22 mars 2016).
74 () Anciens articles L.2323-47, L.2323-57 et L. 2242-5 du code du travail.
75 () Article 17 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (L. 330-2 du code du travail).
76 () Concernant ses missions, le code du travail précise notamment que le CSEP « participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » (D. 1145-1), « est consulté : 1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe » (D. 1145-2). Par ailleurs, il « peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ses travaux peuvent notamment porter sur l'articulation des temps, les modes de gardes, les congés familiaux, les systèmes de représentation dans l'entreprise, le harcèlement sexuel et moral, la formation initiale et continue et la diversification des choix professionnels des filles et des garçons, la création et la reprise d'entreprises par les femmes » (D. 1145-3).
77 () Décret n° 2013-371 du 30 avril 2013 relatif au CSEP.
78 () Décret n° 2015-626 du 5 juin 2015 renouvelant certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
79 () Compte rendu de l’audition du mercredi 30 mars 2016, en annexe au présent rapport.
80 () Ceux-ci bénéficieront désormais, comme les salariés, d’un droit quantifié à un nombre d’heures de formation qui est alimenté chaque année, dans la limite de 150 heures. Les formations sont prises en charge par les fonds d’assurance-formation de non-salariés, qui perçoivent le produit de la contribution à la formation professionnelle des indépendants. Les conseils d’administration de ces fonds définissent la liste des formations éligibles. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2018.
81 () Les garanties applicables aux agents publics concernant la formation et la protection de la santé et de la sécurité au travail seront renforcées. L’ordonnance devra être prise dans les neufs mois suivant la promulgation de la présente loi. Elle sera précédée d’une négociation avec les organisations syndicales de fonctionnaires.
82 () L’étude d’impact soulignait également qu’ « en lui-même (sic), l’individualisation d’un certain nombre de droits devrait également favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. Le diagnostic préalable à la définition du dispositif permettra de mieux cerner les situations et les événements de la vie qui créent des fragilités dans les parcours des femmes : temps partiel subi, parent isolé, impact de la maternité sur une carrière, par exemple ».
83 () Rapport d’information de Mme Sandrine Mazetier, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi (n° 2739) relatif au dialogue social et à l’emploi (19 mai 2015).
84 () Selon Mme Cano, il « permettrait de concrétiser l’objectif fixé de donner plus d’autonomie et de liberté d’action aux personnes. En offrant des possibilités nouvelles aux personnes en matière de répartition des temps sociaux tout au long de la carrière, le CPA pourrait favoriser l’égalité professionnelle. Pour rappel, l’équilibre des temps de vie est considéré comme important ou très important par 93 % des salariés, par 96 % des professions intermédiaires, dont 75 % déclarent manquer de temps pour leur vie personnelle. Enfin, un tel dispositif constituerait un outil d’attractivité pour les PME face aux grandes entreprises, mais permettrait aussi un allègement des charges administratives, voire des charges financières ».
85 () Rapport d’information n° 1396 de Mme Catherine Coutelle au nom de la Délégation, septembre 2013.
86 () Dans le cadre du rapport précité, la Délégation avait ainsi adopté la recommandation suivante : « Si la délégation considère que la création du compte personnel de pénibilité constitue une avancée majeure, elle attire l’attention sur la prise en compte des facteurs de pénibilité dans les emplois majoritairement occupés par des femmes. Elle demande qu’un rapport soit effectué, analysant la prise en compte, par le droit du travail, des facteurs de pénibilité propres aux emplois majoritairement occupés par les femmes. Elle appelle les organisations syndicales à se saisir de cette question et demande qu’elle soit obligatoirement traitée lors des renégociations des conventions collectives de branche. » (recommandation n° 8).
87 () Compte rendu de l’audition du mardi 22 mars 2016, en annexe au présent rapport.
88 () Dans le cadre du rapport d’information précité sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (Mme Ségolène Neuville, rapporteure), la délégation avait notamment adopté la recommandation suivante : « Donner les mêmes droits aux salarié-e-s à temps partiel concernant l’alimentation du compte personnel de formation, sans préjudice des abondements complémentaires (suppression du principe du prorata temporis à l’article 1er du projet de loi) » (recommandation n° 1).
89 () Femmes et numérique : dépasser les écueils, saisir les opportunités, rapport d’information n° 3348 de Mme Catherine Coutelle au nom de la Délégation aux droits des femmes (décembre 2015).
90 () Comme cela avait été évoqué dans le rapport de M. Bruno Mettling, remis à la ministre Mme Myriam El Khomri en septembre 2015, Transformation numérique et vie au travail.
91 () Son article 17, intitulé « Promouvoir une gestion intelligente des technologies de l’information et de la communication au service de la compétitivité des entreprises, respectueuse de la vie privée des salariés », prévoyait ainsi que les entreprises : « rechercheront, après avoir recueilli l’avis des salariés sur l’usage des TIC dans l’entreprise, les moyens de concilier vie personnelle et vie professionnelle en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l’entreprise et des fonctions exercées, par l’institution, par exemple, de temps de déconnexion, comme cela se pratique déjà dans certaines entreprises.»
92 () Accord national interprofessionnel (ANI) du 6 octobre 2006 relatif au télétravail.
93 () Le projet de loi renforce le dialogue entre le/la salarié.e et le/la médecin du travail et clarifie les voies de recours contre les avis d’inaptitude. Il clarifie également les conséquences sur le contrat de travail de l’avis d’inaptitude.
94 () Rapport sur l’aptitude et la médecine du travail remis par le député Michel Issindou, Christian Ploton (membre de la DRH du groupe Renault), Sophie Fantoni-Quinton (professeur de médecine du travail), Anne-Carole Bensadon et Hervé Gosselin (IGAS) en mai 2015.
95 () Photographie statistique des accidents de travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles en France selon le sexe entre 2001 et 2012, Florence Chappert et Patricia Therry, ANACT, 2014.
96 () Pour les hommes, durant cette même période, les maladies professionnelles ont augmenté (+ 91.2 %), mais une baisse des accidents de travail (- 23.3 %) et des accidents de trajet (- 9 %).
97 () Avec une progression de 59.8 % d’accidents du travail, de 38 % des accidents de trajet et 312 % des maladies professionnelles pour les femmes.
98 () L’article L. 4624-1 du code du travail tel qu’issu de la loi du 26 janvier 2016 précitée prévoit ainsi que « Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail. »
99 () Compte rendu de l’audition du 16 juin 2015 de M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, disponible en ligne sur le site de la Délégation aux droits des femmes.
100 () Compte rendu de l’audition du 23 mars 2016 de représentantes d’associations, notamment Marylin Baldeck, déléguée générale de l’AVFT, et contribution écrite adressée aux rapporteures le 25 mars 2016.
101 () Contribution écrite adressée par l’AVFT à la Délégation aux droits des femmes le 19 janvier 2016, dans le cadre des travaux menées sur les violences faites aux femmes.
102 () Les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union européenne sont en effet encadrées par le principe d’équivalence, qui impose que ces modalités « ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ». Or les recours en matière de harcèlement sexuel ne seulement « similaires », ils font juridiquement partie du champ des discriminations en droit européen et en droit interne, selon l’AVFT.
103 () Articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail.
104 () Article L. 1235-10 du code du travail.
105 () Article L. 1134-4 du code du travail.
106 () La « règle de l’entonnoir » interdit d’introduire une nouvelle disposition par voie d’amendement au stade de la deuxième lecture sauf si elle est destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle (voir notamment, Conseil constitutionnel, décision n° 2005-532 du 19 janvier 2006, considérant n° 26).
107 () « Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ».
108 () Compte rendu de la séance publique du Sénat du 17 avril 2014.
109 () Dans le chapitre Ier « Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement » du titre III, relatif à la rupture de contrat à durée indéterminée (CDI), du livre II du code du travail.
110 () Le sexisme dans le monde du travail. Entre déni et réalité, rapport n° 2015-1 du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), Mme Brigitte Grésy, secrétaire générale du CSEP et corapporteure, et Mme Marie Becker, corapporteure (6 mars 2015).
111 () Rapport d’information de Mme Sandrine Mazetier, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi (n° 2739) relatif au dialogue social et à l’emploi (19 mai 2015) et amendements présentés en séance en première lecture.
112 () « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d'autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2 ».
113 () Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
114 () Telle que définie par les articles L. 1142-1 et suivants du code du travail.
115 () Aux termes de l’article L. 1144-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
116 () Il conviendrait pour cela de modifier la rédaction de l’article L. 1144-1 du code du travail relatif aux actions en justice pour y faire référence aux litiges relatifs à l’application des dispositions L. 1142-1, L. 1142-2 « et L. 1142-2-1 ».
117 () Conformément aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code du travail, modifiés par la loi du 4 août 1982 concernant les libertés des travailleurs dans l’entreprise.
118 () Au 1° de l’article 2 de l’ANI du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et aux violences au travail.
© Assemblée nationale