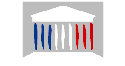
N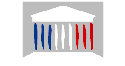
° 3900
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 juin 2016
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 4 mars 2015,
sur « la diplomatie et la défense des frontières maritimes de la France –
Nos frontières maritimes : pour un projet politique à la hauteur des enjeux »
et présenté par
M. Paul GIACOBBI et M. Didier QUENTIN
Députés
SOMMAIRE
___
Pages
SYNTHÈSE DU RAPPORT 13
INTRODUCTION 19
PREMIÈRE PARTIE : UN CONTEXTE MARITIME MONDIAL DYNAMIQUE, MAIS DONT LA SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ SONT DE PLUS EN PLUS FRAGILISÉES 25
I. UN MONDE DE PLUS EN PLUS MARITIME QUI IMPOSE DES EFFORTS DE SÉCURITÉ ACCRUS 25
A. UN ESPACE MARIN TRÈS LARGEMENT SOUS LA JURIDICTION ET DONC LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS CÔTIERS 25
1. Une tendance de long terme consacrée par la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) en 1982 25
2. Six espaces maritimes ou sous-marins dont cinq sous juridiction des États côtiers, avec des statuts très différents 27
a. Le point de départ des délimitations : la ligne de base 27
b. Les eaux intérieures 27
c. La mer territoriale 27
d. La zone contiguë 28
e. La zone économique exclusive (ZEE) 28
f. La haute mer 29
g. Les facultés d’extension du plateau continental 30
h. La prolongation en mer des frontières terrestres : la négociation entre États 34
i. Schéma récapitulatif 34
3. Des différends encore assez nombreux, mais réglés le plus souvent par la négociation et très exceptionnellement par le juge ou par arbitrage 35
a. D’autres sources du droit de la mer à côté de la CNUDM 35
b. Des zones encore contestées mais sans tension 35
c. Des exemples très connus d’arbitrage ou de décisions de la Cour internationale de Justice 35
d. La question des eaux et titres historiques 37
B. LE TRANSPORT MARITIME AU CœUR DE LA MONDIALISATION 38
1. Une liberté de navigation garantie sur toutes les eaux, y compris la mer territoriale 38
2. La croissance du transport maritime 39
3. Une dépendance vis-à-vis de routes et de quelques points stratégiques bien identifiés : les détroits et les canaux transocéaniques 40
4. Le rôle clef de l’Organisation maritime internationale en matière de sécurité et de trafic maritime 42
5. Le développement des réseaux sous-marins pour l’énergie et les télécommunications 43
C. DES MENACES CROISSANTES SUR LA SÉCURITÉ DES MERS 44
1. La piraterie : une préoccupation constante, mais qu’il est possible d’endiguer 44
a. L’état des lieux 44
b. Les succès décisifs obtenus par la communauté internationale dans le golfe d’Aden et l’océan Indien 45
c. Le rôle de l’OMI 46
d. Le rôle de l’ONU : le rapport de M. Jack Lang sur les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes 47
2. Les trafics d’êtres humains et les migrations illégales : une expansion préoccupante, notamment en Méditerranée 47
3. Les autres activités illégales et trafics illicites : drogues, armes et produits interdits 48
II. UNE GÉOPOLITIQUE MARITIME EN MOUVEMENT 51
A. LA REDISTRIBUTION DES PUISSANCES MILITAIRES NAVALES 51
1. Les termes de la suprématie américaine 51
2. Le développement rapide et spectaculaire de la marine chinoise, et la course aux armements en Extrême-Orient 52
a. La marine chinoise : l’acquisition rapide de capacités de haute mer 52
b. Les effets d’imitation des pays voisins en réaction aux risques d’hégémonie chinoise 55
3. Le retour de la marine russe 56
4. Le rétablissement capacitaire programmé du Royaume-Uni 57
5. L’incertitude sur le maintien de la supériorité technologique occidentale 59
B. L’OUVERTURE ANNONCÉE DE L’ARCTIQUE : DES TENSIONS SANS HEURT MAJEUR, MAIS QUI SOULÈVENT PLUSIEURS QUESTIONS IMPORTANTES DE DROIT MARITIME 59
1. Des enjeux réels, bien que de faible intensité pour l’instant 59
2. Un dialogue entre riverains, et même au-delà, au sein du Conseil de l’Arctique 61
a. Un dialogue essentiel même si limité 61
b. Le modèle de l’Antarctique en contrepoint 63
3. La question du statut des passages maritimes du Nord-Est et du Nord-Ouest : eaux intérieures ou détroits 64
4. Les revendications, notamment de la Russie, sur le plateau continental et la question de la nature de la dorsale de Lomonossov 66
III. UNE SOURCE D’INQUIÉTUDE MAJEURE : LA TENSION EN MER DE CHINE 71
A. UN CONTEXTE SPÉCIFIQUE 71
1. Un arrière-plan géographique, historique et géopolitique complexe 71
a. Une tension entre la Chine et ses voisins 71
b. Une interprétation du droit de la mer extensive de la part de tous les pays riverains : le cas des lignes de base 73
c. Des frontières maritimes encore imprécises 73
2. Deux questions séparées, l’une au Nord avec le Japon, l’autre au Sud, avec notamment les Philippines et le Vietnam, mais soulevant les mêmes questions 74
3. Les termes du litige au Nord : les Senkaku 76
4. Les termes du litige au Sud : les Paracels et les Spratleys 78
a. Des conflits de souveraineté dès l’époque coloniale 78
b. Les Paracels après 1945 79
c. Les Spratleys après 1945 80
d. Un arrière-plan économique et pétrolier 81
e. Un enjeu stratégique certain 82
B. LA POSITION DE LA CHINE 82
1. Des arguments d’ordre historique 82
2. La recherche d’une interprétation du droit de la mer toujours favorable à la plus grande extension possible des eaux sous juridiction chinoise, dans un contexte géographique compliqué 84
3. La recherche d’un contrôle effectif des eaux par la construction d’îles semi-artificielles et d’infrastructures, et l’amorce de leur militarisation 86
C. DES RÉACTIONS INTERNATIONALES PARFOIS FERMES ET TOUJOURS FONDÉES SUR LE DROIT 87
1. Une procédure d’arbitrage, intentée par les Philippines et en cours, bien que refusée par la Chine 87
2. Les réactions des États-Unis et des pays de l’ASEAN 89
a. Les déclarations et protestations politiques 89
b. Les missions des navires de l’US Navy dans le cadre du programme Liberté de navigation 90
c. Le survol de la zone par l’US Air Force 91
3. Une communauté internationale qui ne peut rester indifférente en raison de l’importance du trafic maritime et aérien dans la zone 91
D. UN CERTAIN APAISEMENT, MÊME SI LIMITÉ, SUR LES SENKAKU À PARTIR DE 2014 91
DEUXIÈME PARTIE : MANIFESTER ENFIN UNE VOLONTÉ POLITIQUE À LA HAUTEUR DES ESPACES MARITIMES ET DES ATOUTS DE LA FRANCE 93
I. UN ESPACE MARITIME EXCEPTIONNELLEMENT ÉTENDU ET DIVERSIFIÉ GRÂCE À L’OUTRE-MER, MAIS PARFOIS CONTESTÉ VOIRE MENACÉ 93
A. ONZE MILLIONS DE KILOMÈTRES CARRÉS SOUS JURIDICTION FRANÇAISE, DANS TOUS LES OCÉANS 93
1. La zone économique exclusive de la France 93
a. La deuxième superficie maritime du monde 93
b. La prédominance de l’Outre-mer, et principalement du Pacifique 95
c. Une superficie sous-marine encore plus vaste grâce aux extensions du plateau continental 97
d. Des frontières méconnues avec des pays éloignés 98
2. Les ZEE : des délimitations bien avancées, mais non encore achevées pour différents motifs 99
a. Des délimitations d’espaces maritimes toujours en cours 99
b. Le cas des ZEE 99
c. Les discussions avec les pays limitrophes 100
d. La négociation avec l’Espagne dans le golfe du Lion 101
B. LES EXTENSIONS DU PLATEAU CONTINENTAL : QUELQUES DEMANDES ENCORE EN INSTRUCTION OU EN ATTENTE 102
1. Une procédure encadrée par le droit de la mer 102
2. Un enjeu économique 102
3. La mise en place du programme Extraplac au début des années 2000 103
4. Des dossiers déposés pour un enjeu de l’ordre de 1,8 million de kilomètres carrés 104
5. Quelques renoncements fondés sur des motifs d’ordre géologique, mais parfois politique 105
a. Les territoires ultramarins n’ayant pas fait l’objet de demande 105
b. Le cas de Clipperton : les relations avec le Mexique en arrière-plan 106
6. Les premiers résultats : les décrets du 25 septembre 2015 106
7. La question des modalités de l’extension du plateau continental dans le golfe de Gascogne et la mer Celtique, à la frontière des eaux sous juridiction de l’Irlande, du Royaume-Uni, de l’Espagne et de la France 107
8. Un dossier à ne pas négliger : la demande d’extension du plateau continental au titre de Saint-Pierre-et-Miquelon 108
C. DES ESPACES CONTESTÉS VOIRE MENACÉS 114
1. Une souveraineté française qui n’est pas toujours acceptée ni officiellement reconnue sur certaines îles dans l’océan Indien et dans le Pacifique 114
a. Tromelin 114
b. Les Îles Éparses du canal du Mozambique 115
c. Matthew et Hunter dans le Pacifique sud 117
d. Clipperton dans le Pacifique central 118
2. Un risque permanent d’activités illégales dans les ZEE outre-mer 118
a. Des activités facilitées par certaines technologies 118
b. La pêche illégale 119
c. Les risques et infractions environnementaux 120
d. Les recherches clandestines de gisements miniers ou d’hydrocarbures 123
e. Les autres activités illégales et trafics 123
f. L’immigration clandestine à Mayotte 124
II. DES ATOUTS MAÎTRES 125
A. UNE VISION STRATÉGIQUE PERTINENTE, BIEN ÉTABLIE, RÉCEMMENT RENOUVELÉE ET QUI NE DEMANDE QU’À ÊTRE MISE EN œUVRE 125
1. Le livre bleu de 2009 : un document ancien mais encore très actuel 125
a. Investir dans l’avenir 125
b. Développer une économie durable de la mer 126
c. Promouvoir la dimension maritime des outre-mer 126
d. Affirmer la place de la France dans le contexte international 127
2. La stratégie nationale de sureté des espaces maritimes adoptée par le CIMer du 22 octobre 2015 127
3. Les autres décisions du CIMer du 22 octobre 2015 131
4. Des comparaisons internationales qui ne sont pas au désavantage de la France 132
a. Le Canada : une priorité claire relevant d’une stratégie maritime intégrée 132
b. Les États-Unis 133
c. Le Royaume-Uni 134
B. UNE CAPACITÉ DE COORDINATION AVÉRÉE GRÂCE À DES INSTRUMENTS ESSENTIELS : LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MER ET L’ACTION DE L’ETAT EN MER, MAIS AUSSI L’ADMINISTRATION DES TAAF 137
1. Le Secrétaire général de la mer et le CIMer 137
a. Le secrétaire général de la mer et le secrétariat général de la mer 137
b. Le comité interministériel de la mer (CIMer) 137
c. Une coordination administrative comparativement moins achevée au Royaume-Uni 138
2. L’action de l’État en mer, enrichie depuis 2010 d’une fonction garde-côtes 139
3. L’administration des Terres australes et antarctiques françaises 142
C. UNE MARINE NATIONALE DE TRÈS HAUT NIVEAU, MAIS SURENGAGÉE 144
1. L’une des principales marines du monde par ses capacités et ses engagements 144
2. Un instrument « dual » au cœur de l’action de l’État en mer 145
3. Une présence outre-mer permanente 147
a. Une mission maintenue malgré des réductions capacitaires avérées 147
b. Des exigences comparativement plus fortes que pour la Royal Navy 149
D. DES COMPÉTENCES JURIDIQUES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE PREMIER ORDRE 149
1. La diplomatie française 149
a. La création du poste d’ambassadeur chargé des océans 149
b. Une compétence technique avérée au sein de services 150
2. L’Institut français de recherche pour l’exploitation des mers (Ifremer) 150
3. Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) 151
4. La protection environnementale : les aires marines protégées 152
a. Dix ans d’expérience de l’Agence des aires marines protégées 152
b. Une intégration programmée dans la future Agence française pour la biodiversité 152
E. DEUX POINTS D’APPUI MAJEURS : L’UNION EUROPÉENNE ET, EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, L’OTAN 153
1. L’Union européenne : une vision maritime globale et intégrée, jusqu’à la sécurité 153
a. L’Union européenne, puissance maritime 153
b. La dimension économique : la croissance bleue 154
c. La stratégie de sûreté maritime de 2014 155
d. Une mutualisation des moyens pour les approches maritimes : un instrument utile même s’il est imparfait pour la crise migratoire 156
2. L’OTAN : un instrument essentiel de coopération maritime pour le haut du spectre, mais aussi pour les phénomènes de moindre intensité comme la crise migratoire 156
III. CINQ ORIENTATIONS ESSENTIELLES À METTRE EN œUVRE POUR DES RÉSULTATS PLUS TANGIBLES 159
A. ASSURER LA CONTINUITÉ DE L’IMPULSION POLITIQUE 159
1. Porter la culture maritime jusqu’au plus haut niveau de l’État 159
a. Mettre fin à la dichotomie actuelle entre le niveau politique et le niveau administratif 159
b. Nommer systématiquement un conseiller mer au sein du cabinet du Premier ministre 159
c. Inscrire les questions maritimes dans les priorités de l’agenda international de la France et les évoquer systématiquement à l’occasion de la semaine des ambassadeurs 160
d. Organiser chaque année un débat parlementaire d’orientation sur les questions maritimes 160
2. Renforcer encore la gouvernance 161
a. Aller au-delà de la coordination actuelle 161
b. Renforcer la fréquence des CIMER et de l’actualisation de la stratégie maritime de la France 162
c. Actualiser et mettre en cohérence les textes relatifs aux délimitations maritimes : l’ordonnance prévue par la proposition de loi sur l’économie bleue 162
d. Veiller de manière constante à l’adéquation des textes aux enjeux 163
B. MENER UNE STRATÉGIE D’INFLUENCE AU NIVEAU EUROPÉEN ET AU NIVEAU INTERNATIONAL POUR DÉGAGER LES PRIORITÉS QUI S’IMPOSENT 164
1. Un enjeu immédiat au sein de l’Union européenne : une dimension maritime pour la nouvelle stratégie européenne de sécurité 164
2. L’amélioration de la coordination au sein de l’OTAN : la proposition française de cadre maritime global 166
3. Veiller à la présence française dans les organisations et instances internationales touchant au maritime 166
4. Porter dans les instances internationales le message de la coopération et de l’échange d’informations et développer les accords de coopération mutuelle en matière de sécurité et de lutte contre les activités illégales 167
C. CONSERVER DANS LA DURÉE LES MOYENS BUDGÉTAIRES NÉCESSAIRES 168
1. Éviter de renouveler le cas du programme Extraplac, aux moyens inférieurs à ceux comparativement dégagés par les autres pays 168
2. Garantir le renouvellement et le rétablissement des capacités de la présence et de la surveillance maritime outre-mer 168
3. Fournir un effort suivi sur le satellite 169
4. Prévoir l’expertise et l’expérimentation du recours aux drones en complément des moyens aéromaritimes 171
D. ENGAGER AVEC CERTAINS PAYS DES MODES DE COOPÉRATION OFFRANT DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ 172
1. De nouvelles bases pour notre présence ultramarine 172
2. Des accords de coopération à appliquer dès lors qu’ils évitent tout risque de « détricotage » de la présence française outre-mer 172
a. L’accord de pêche entre la France et le Mexique pour Clipperton : un dispositif qui n’exclut pas une réaffirmation en parallèle de la présence française 172
b. L’accord de cogestion pour Tromelin : un blocage au niveau politique 174
3. Une coopération forte à envisager pour les îles Éparses du canal de Mozambique, vis-à-vis de Madagascar voire d’autres pays voisins 176
a. La réflexion en cours 176
b. Mettre à l’étude la création d’une grande collectivité française de l’océan Indien 177
4. Lever les craintes d’un éventuel début d’érosion de la souveraineté, prélude à sa renonciation 178
E. METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE D’AVENIR TOURNÉE VERS L’EXPLOITATION ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLES DES OCÉANS ET DES FONDS MARINS, POUR RENOUVELER LES TERMES DE LA PRÉSENCE FRANÇAISE DANS TOUS LES OCÉANS 179
1. Faire des espaces marins la vitrine politique et technologique de la France dans la nouvelle géo-écologie mondiale 179
a. Le tournant de l’accord sur le climat : la nouvelle dimension environnementale de la structuration de la société internationale 179
b. Anticiper les dispositions du futur instrument international sur la biodiversité marine 180
c. Placer d’emblée les espaces marins et sous-marins sous juridiction française dans la transition économique et l’exploitation durable 180
2. Deux exemples à suivre d’activités durables 181
a. Les énergies renouvelables en mer : un développement en cours 181
b. L’exploitation des algues : des perspectives à concrétiser 182
3. Avancer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale relative à l’exploration et à l’exploitation minières des grands fonds marins 182
a. Une connaissance assez précise du type de ressources, mais encore incertaine sur les localisations et les quantités exploitables 182
b. Des explorations en nombre encore réduit 184
c. Une capacité technique avérée d’intervention des opérateurs français dans les grands fonds : les deux contrats conclus avec l’AIFM 185
d. La stratégie nationale d’exploration et d’exploitation minières des grands fonds marins : un outil pertinent 187
4. Faire jouer les synergies européennes sur la recherche et les technologies marines et sous-marines 188
a. Un secteur de très haute technologie qui ne concerne qu’un nombre réduit de pays 188
b. Développer et rendre visible le volet Recherche de la stratégie maritime européenne 189
c. Aller vers un « Airbus » de la recherche, de l’exploration et de l’exploitation sous-marine 190
5. Développer d’ores et déjà les outils de base de la perspective environnementale d’exploitation des espaces maritimes ultramarins 191
a. Valoriser la démarche française d’une exploitation soucieuse de l’environnement 191
b. Promouvoir la labellisation « durable » des produits 192
c. Développer les aires marines protégées au fur et à mesure des progrès des moyens de surveillance 192
TRAVAUX DE LA COMMISSION 195
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION 195
ANNEXES 205
ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS 205
Les espaces maritimes jouent un rôle de plus en plus important. D’une part, la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 a renforcé les droits des États côtiers sur la mer. Elle leur a ainsi reconnu certaines compétences et facultés sur la zone économique exclusive (ZEE), qui s’étend jusqu’à 200 milles marins vers le large, bien au-delà de la limite des 12 milles qui marque la mer territoriale. Elle leur a également donné une faculté d’extension du plateau continental au-delà de ces mêmes 200 milles, lorsque les conditions géologiques sont réunies. D’autre part, placé au cœur de la mondialisation, le transport maritime est en pleine expansion. La convention de 1982 a réaffirmé la liberté de mers et la liberté de navigation, y compris le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et le droit de passage dans les détroits.
Cependant, plusieurs évolutions doivent être considérées avec une grande attention.
D’abord, la sécurité des mers se dégrade. La piraterie connaît un renouveau, même si elle peut être efficacement combattue, comme dans la Corne de l’Afrique. Le développement croissant des autres activités et trafics illicites, qui va jusqu’aux trafics d’êtres humains et aux migrations illégales, est tout aussi préoccupant. Ce sont autant de menaces suivies par les États, mais aussi par les organisations internationales, en particulier l’Organisation maritime internationale (OMI).
Ensuite, la géopolitique maritime évolue. La suprématie reste certes acquise à la marine américaine, garante de la liberté des mers, mais le développement de la marine de guerre chinoise, qui n’est plus une flotte côtière, « d’eaux jaunes », et devient une flotte de haute mer, « d’eaux bleues », est aussi rapide que spectaculaire. La marine russe est pour sa part en plein renouveau. Le développement des flottes militaires n’est pas limité à ces deux pays. En Asie, notamment, et en Australie, mais aussi au Royaume-Uni, entre autres, l’heure est à l’acquisition de capacités nouvelles.
Par ailleurs, la fonte des glaces ouvre en Arctique de nouveaux espaces avec certains désaccords, que ce soit sur le régime des passages du Nord-Ouest et du Nord-Est, sur lequel la Russie et le Canada ont leur propre vision, qui n’est pas celle des éventuels usagers, et sur le partage des extensions du plateau continental.
Enfin, la situation en mer de Chine suscite certaines inquiétudes. Dans un contexte historique, géographique et politique compliqué, deux litiges de souveraineté opposent la Chine et ses voisins. L’un est au Nord, avec le Japon, à propos des îles Senkaku. L’autre est en mer de Chine du Sud, à propos des deux archipels des Spratleys et des Paracels, et oppose globalement à la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei. Ils sont sources d’incidents.
Fondée sur des arguments d’ordre historiques et sa situation précoloniale de suzeraineté, mais aussi sur une interprétation extensive du droit de la mer et la recherche d’un contrôle effectif des eaux par la construction, et parfois la militarisation, d’îles semi-artificielles et d’infrastructures, la position de la Chine suscite des réactions internationales. Celles-ci sont fermes et fondées sur le droit. Au Nord, la réaction du Japon a été soutenue par les États-Unis. Au Sud, une procédure d’arbitrage, encore en cours, a été intentée par les Philippines. L’ASEAN et les États-Unis ont marqué leur désapprobation et protesté. La marine américaine, l’US Navy, et l’US Air Force font régulièrement des missions sur place pour réaffirmer les principes de la liberté des mers et la liberté de survol.
La communauté internationale ne peut pour sa part rester insensible aux événements qui tendent à mettre en cause le droit international et qui interviennent dans un espace aussi important sur le plan stratégique et par lequel transite en outre une large part du commerce mondial.
Dans un tel contexte, et eu égard aux enjeux, il est impératif que la France affirme une volonté politique à la hauteur de l’importance de ses espaces maritimes et de ses atouts.
Avec environ 11 millions de kilomètres carrés placés sous sa juridiction, notre pays détient, en effet, la deuxième superficie maritime du monde, juste après les États-Unis. S’y ajoutent, potentiellement, 1,8 million de kilomètres carrés supplémentaires de fonds marins grâce aux éventuelles extensions du plateau continental, ce qui n’est pas le cas pour les États-Unis qui n’ont pas ratifié la CNUDM. L’essentiel des espaces maritimes français est situé outre-mer, à raison de 97 %, et principalement dans le Pacifique (4,8 millions de kilomètres carrés) et dans l’océan Indien (2,67 millions). Ces espaces, qui donnent lieu à des frontières méconnues, notamment avec l’Australie dans l’océan Indien et dans le Pacifique, ainsi qu’avec l’Afrique du Sud, sont encore en cours de délimitation. Toutes les notifications à l’ONU ne sont pas encore intervenues. Cela ne fait cependant pas obstacle à l’application des lois françaises dans les espaces concernés. Délimiter est parfois long et difficile, par exemple avec l’Espagne pour la ZEE en Méditerranée, dans le golfe du Lion. Les demandes françaises d’extension du plateau continental n’ont, en l’état, abouti que pour la Martinique, la Guadeloupe, les îles Kerguelen et la Nouvelle-Calédonie, ce qui représente 579 000 kilomètres carrés. La demande conjointe avec l’Irlande, le Royaume-Uni et l’Espagne en mer Celtique a été acceptée par la commission des limites du plateau continental, mais la répartition de l’espace concerné fait l’objet de négociations avec nos trois pays voisins. La demande d’extension du plateau continental relative à Saint-Pierre-et-Miquelon mérite une mention particulière. Elle est tout à fait fondée et sa contestation par le Canada ne doit pas conduire à un déni de droits en défaveur de la France. Ce point a explicitement été exclu du champ de l’arbitrage de 1992 sur la ZEE. Le droit international n’exclut pas non plus a priori l’hypothèse d’une discontinuité entre la ZEE française et l’extension du plateau continental, d’autant que l’île de Sable qui permet au Canada d’intercaler une partie de sa ZEE est, comme son nom l’indique, mouvante, et qu’elle pourrait ainsi disparaître dans le futur, par exemple en cas d’élévation du niveau des océans.
Plus éloignés de la métropole que ne le sont leurs équivalents britanniques, les espaces maritimes ultramarins de la France sont parfois contestés. Notre souveraineté est ainsi mise en question dans l’océan Indien pour les îles Éparses du Canal de Mozambique et Tromelin, ainsi que pour Mayotte. Dans le Pacifique, deux îlots, Matthew et Hunter, au large de la Nouvelle-Calédonie, nous sont contestés par le Vanuatu et l’île de Clipperton, qui a pourtant fait l’objet d’un arbitrage en 1931 en faveur de la France, fait l’objet d’ambiguïtés de la part du Mexique, qui a contesté la délimitation de la ZEE, même si l’accord de pêche bilatéral de 2007 au profit de l’armement mexicain, avec des licences gratuites, permet de régulariser dans une certaine mesure la situation.
Par ailleurs, ces espaces maritimes ultramarins sont en permanence soumis au risque d’activités illégales. Qu’il s’agisse de la pêche illégale, des infractions environnementales, de la recherche minière, gazière ou pétrolière, des autres trafics, notamment des trafics de drogue et d’armes, et de l’immigration clandestine, comme à Mayotte, la vigilance des services concernés doit être constante. Tel est d’autant plus le cas que l’exercice de l’interlope est facilité par les progrès de la technologie embarquée sur tous les navires.
Pour faire face, notre pays n’est pas démuni, mais détient, au contraire, plusieurs atouts maîtres de très grande qualité. D’abord, il dispose d’une vision stratégique pertinente avec le Livre bleu de 2009, toujours d’actualité, et la stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes d’octobre dernier. Ensuite, il a mis en place une capacité de coordination avérée et même enviée, avec les outils essentiels que sont le secrétaire général de la mer (le SGMer), le comité interministériel de la mer (le CIMer), l’action de l’État en mer (l’AEM), et aussi l’administration des Terres australes et antarctiques françaises (les TAAF). Par ailleurs, la Marine nationale est de très haut niveau, même si elle est sous tension, car engagée au-delà de son contrat opérationnel, et si elle doit faire face à des ruptures temporaires de capacités connues concernant notamment les patrouilleurs outre-mer. Notre pays bénéficie également de compétences de tout premier ordre, non seulement en matière juridique et diplomatique au sein du ministère des affaires étrangères, mais aussi en matière scientifique et technique au sein de l’Ifremer et du SHOM (service hydrographique et océanographique de la marine), et dans le domaine environnemental, avec l’Agence des aires marines protégées, bientôt intégrée dans l’Agence pour la biodiversité qui sera bientôt mise en place. La France dispose en outre de deux points d’appui majeurs avec, d’une part, l’Union européenne, en particulier le programme croissance bleue et la stratégie de sûreté maritime de 2014, même si elle est amoindrie par le Brexit et, d’autre part, en matière de sécurité, l’OTAN.
La France pourrait très certainement tirer un meilleur parti de ces différents avantages.
Obtenir des résultats plus tangibles exige de mettre en œuvre cinq orientations.
En premier lieu, il convient de porter la culture maritime au plus haut niveau de l’État et d’assurer la continuité de l’impulsion politique. Plusieurs mesures apparaissent nécessaires pour mettre fin à la dichotomie actuelle entre le politique et l’administratif : nommer systématiquement un conseiller mer au sein du cabinet du Premier ministre ; inscrire les questions maritimes parmi les priorités de l’agenda international, et les évoquer à l’occasion de la semaine des ambassadeurs ; organiser chaque année un débat d’orientation au Parlement sur les questions maritimes ; améliorer la gouvernance en renforçant le SGMer, en augmentant la fréquence des réunions du CIMer, lesquelles auraient lieu au moins une fois par an, et en veillant en permanence à la cohérence des textes aux enjeux maritimes.
En deuxième lieu, il est indispensable, comme dans d’autres domaines, de mener au niveau européen et au niveau international, une stratégie d’influence selon quatre volets : veiller à la dimension maritime dans la mise en œuvre de la future stratégie européenne de sécurité ; améliorer le rôle de l’OTAN selon la proposition française de cadre maritime global, pour renforcer le rôle d’information de son commandement maritime ; veiller à la place de la France et des Français dans les organisations internationales relevant des secteurs maritimes, notamment à l’OMI ; porter dans ces mêmes instances internationales le message de la coopération et de l’échange d’informations face aux risques et menaces d’activités illégales, et développer en appui les accords de coopération bilatérale.
En troisième lieu, il convient de conserver dans la durée les moyens nécessaires notamment pour le renouvellement et le développement des capacités de présence et de surveillance outre-mer, en anticipant la mise en œuvre du programme BATSIMAR, en fournissant un effort suivi sur le satellite et recourant, après expertise et expérimentation, au drone. Le cas du programme Extraplac qui a réussi, mais dont les moyens ont été très limités comparativement aux autres pays, ne doit pas faire précédent.
En quatrième lieu, il apparaît opportun, en cohérence avec le renouvellement des termes de notre présence ultramarine, de mettre en œuvre des modes de coopération offrant des perspectives de développement partagé. Dans la même ligne que l’accord de pêche avec le Mexique pour Clipperton et l’accord de cogestion pour Tromelin, non encore ratifié, mais en évitant tout risque de « détricotage », il apparaît à ce stade opportun d’envisager dans l’océan Indien une coopération forte avec Madagascar, voire avec d’autres pays voisins, sur les îles Éparses du Canal du Mozambique. La réflexion est en cours. Elle est nécessaire et conduit clairement à se poser la question de la création d’une grande collectivité territoriale de l’océan Indien, coiffant les collectivités actuelles, pour constituer la base solide qu’exigerait une telle intégration des espaces français de l’océan Indien dans leur environnement régional.
En cinquième lieu, il est impératif de faire des espaces marins la vitrine de la France dans la nouvelle géo-écologie mondiale qui se met en place dans le sillage de l’accord de Paris du 15 décembre dernier. Il convient ainsi de mettre en œuvre une stratégie d’avenir tournée vers la mise en exploitation et le développement durables des océans et des fonds marins. Les perspectives sont immenses qu’il s’agisse des énergies marines, y compris de l’éolien en mer, de l’utilisation des algues dans tous les domaines, qui vont de l’alimentation aux nouveaux matériaux, ou encore de l’exploration et de l’exploitation des ressources minières (nodules polymétalliques, sulfures et amas sulfureux, ainsi qu’encroûtements cobaltifères), et non seulement en hydrocarbures, des grands fonds marins. Il faut donc mettre en œuvre la stratégie nationale relative à l’exploration et à l’exploitation minières des grands fonds marins, adoptée en octobre dernier, par le CIMer. Il est également essentiel de développer notre effort de recherche dans ce secteur de pointe aux perspectives prometteuses en jouant les synergies européennes, en rendant opératoire et visible le volet maritime de la recherche européenne, qui ne l’est actuellement pas, et en allant éventuellement jusqu’à la création d’un « Airbus » européen de la recherche, de l’exploration et de l’exploitation sous-marine, de manière que l’Europe s’affirme comme leader dans un domaine d’excellence où peu de pays disposent actuellement d’opérateurs capables d’intervenir. Enfin, il convient de se situer dès maintenant dans la perspective environnementale de mise en exploitation des espaces ultramarins, d’une part, en valorisant, par une labellisation, la démarche française d’exploitation durable et, d’autre part, en créant ou en étendant au fur et à mesure du développement des moyens de surveillance, les aires marines protégées. Ces dernières constituent, dans le contexte international actuel, favorable à la préservation de l’environnement, pour un pays aux moyens limités comme le nôtre mais doté d’un espace maritime équivalent à celui des États-Unis, un outil finalement économe pour affirmer notre droit et préserver notre influence.
Mesdames, Messieurs,
L’histoire maritime de la France n’est pas celle de sa géographie. Cette dernière est de tout premier ordre au carrefour et au débouché de la masse continentale européenne, avec deux façades de choix : l’une sur l’Atlantique, jusqu’à la mer du Nord ; l’autre sur le bassin occidental de la Méditerranée.
Or, si l’on excepte les Vénètes, vaincus par César, et les Normands, notre pays n’a été l’hôte d’aucune puissance maritime dominante.
Son histoire maritime est au contraire marquée par des fluctuations, avec quelques périodes brillantes mais assez brèves, dont l’une à la fin du XVIIe siècle, à la suite des efforts de Colbert, et une autre pendant la guerre d’Indépendance américaine. C’est la grande différence avec la Grande-Bretagne, devenue durablement une très grande puissance maritime, une fois dominée d’abord la marine espagnole à la fin du XVIe, sous Elizabeth Ière, puis la flotte néerlandaise au XVIIe, à l’occasion du conflit qui a suivi les Actes de navigation de Cromwell.
Cette divergence de destins n’est pas uniquement le résultat de l’insularité de l’une et de la continentalité de l’autre, mais d’éléments plus complexes.
En premier lieu, les atouts de la double façade maritime de la France appellent quelques nuances. Les ports naturels en eaux suffisamment profondes pouvant accueillir en sécurité les bâtiments de guerre, dont le gabarit s’accroît à partir du XVIIe siècle, y sont peu nombreux : Toulon, Brest, Brouage, vite remplacé par Rochefort. Ce n’est qu’à la fin de l’Ancien régime et sous l’Empire que Cherbourg comble le manque flagrant d’un port, face à l’Angleterre, dans la Manche. Brest est très bien placée, mais seule la navigation à vapeur la libère de contrainte des vents d’Ouest dominants qui rendent toujours difficile les sorties d’escadre.
De même, séparée par la péninsule ibérique, la double façade entraîne le partage des moyens entre deux flottes, l’une dans l’Atlantique, l’autre dans la Méditerranée, rendant toute concentration longue et difficile, puisqu’il faut franchir le détroit de Gibraltar. Pour être une puissance maritime dominante, la France aurait donc dû déployer sur le long terme un effort supérieur au Royaume-Uni sur l’Atlantique, tout en conservant des moyens suffisants en Méditerranée, ce qu’elle n’a pas fait. Puissance continentale exposée qui plus est sur plusieurs fronts, elle a aussi été contrainte de donner la priorité à l’armée de terre.
En outre, dès la mise en place de l’inscription maritime – ou plus exactement des procédures qui y conduiront – en 1669, il apparaît que le nombre de marins est trop faible. Héritage des Gaulois, les Français sont trop terriens. En temps de guerre, c’est l’arbitrage aussi difficile que permanent entre les équipages des navires de guerre et ceux de commerce.
En deuxième lieu, notre pays a connu plusieurs désastres qui ont marqué les esprits, même si aucun n’a atteint l’ampleur du naufrage de l’Invincible Armada. Pendant la Guerre de Sept ans, la défaite des récifs des Cardinaux le 20 novembre 1759, dans la baie de Quiberon, achève ses premières ambitions coloniales et maritimes, dont le traité de Paris, en 1763, prend acte. Plus tard, Aboukir en 1798, mais surtout Trafalgar en 1805, mettent fin aux espoirs maritimes de l’Empire et rendent impossible une paix durable et à notre avantage avec le Royaume-Uni, faute de pouvoir y débarquer l’armée réunie au Camp de Boulogne. Enfin, le redressement de l’Entre-deux-guerres, opéré grâce à Georges Leygues, ministre de la Marine de 1925 à 1933, qui a obtenu la priorité budgétaire, est anéanti par le sabordage de Toulon.
Sur le plan commercial, nos différentes compagnies des Indes n’ont pas connu la même fortune que leurs homologues anglais et même néerlandais.
En troisième lieu, l’ambition politique a manqué de constance. C’est regrettable, car, à chaque fois qu’elle a été au rendez-vous, les résultats ont été très encourageants.
François Ier fonde Le Havre et permet à notre pays de s’établir en Amérique du Nord avec les expéditions de Verrazzano et Jacques Cartier. Richelieu, observant la puissance navale anglaise lors du siège de La Rochelle et la richesse commerciale des Pays-Bas, engage les premiers efforts, lesquels permettent de s’établir dans les Caraïbes, en Guyane et dans l’océan Indien. Colbert porte l’ambition maritime à son plus haut niveau et permet à notre marine de faire pièce à celle des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Il a, le premier, une vision d’ensemble de la question. L’ordonnance de 1669 « sur le fait des Eaux et Forêts » vise à reconstituer la ressource en bois. Après la Guerre de Sept ans, le redressement, entamé avec Choiseul, porte ses fruits pendant la guerre d’Indépendance américaine. Grâce à l’alliance espagnole, les succès navals contre l’Angleterre sont brillants, notamment la victoire de la baie de la Chesapeake, suivie d’une opération combinée et de la victoire terrestre de Yorktown.
Au XIXe siècle, le climat de paix consécutif au Congrès de Vienne permet les grandes expéditions géographiques et scientifiques, avec notamment le débarquement de Dumont d’Urville sur la terre ferme, en Antarctique, en Terre-Adélie, en 1840, ainsi que l’expansion dans l’océan Indien, à Mayotte en 1841 et Obock dès 1862, en bordure de la mer Rouge, et dans le Pacifique, d’abord aux Marquises et à Tahiti, en 1843, mais aussi en Nouvelle-Calédonie en 1853. La volonté politique des Amiraux, soutenus notamment par Jules Ferry, permet l’expansion en Indochine à partir de la Cochinchine. L’administration des colonies relève du ministre de la Marine, comme sous l’Ancien régime. Îles et ports outre-mer sont autant de points d’appui essentiels pour le ravitaillement de la flotte en charbon, dès lors que la vapeur remplace la voile.
Le Second Empire aussi est marqué par une véritable vision stratégique de la France et du monde, avec une perception très précise de l’enjeu maritime caractérisé par le percement du Canal de Suez et les études sur celui de Panama. C’est dans cette perspective qu’en 1858, la France prend officiellement possession de Clipperton, sur la voie transocéanique qui mène en Chine, et surtout au Japon, lequel s’est ouvert en 1853 sous la pression d’une expédition américano-européenne. La Marine française permet également de mener une politique extérieure active avec notamment les expéditions de Crimée, en 1854, du Liban, en 1860, et du Mexique, de 1863 à 1867.
À la fin du siècle, la France cesse cependant d’être la deuxième puissance maritime du Monde. Elle est dépassée par les nouvelles puissances industrielles, les États-Unis et l’Allemagne, et même le Japon. Après la Première guerre mondiale, en 1922, le traité naval de Washington limitant les armements maritimes de ses cinq signataires, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France et l’Italie (les restrictions concernant l’Allemagne sont celles du traité de Versailles), relègue sur le plan des principes la flotte de guerre française au rang de celle de l’Italie, laquelle n’a de marine qu’en Méditerranée. Il consacre ainsi la suprématie des deux puissances anglo-saxonnes.
Après 1945, la flotte française se reconstruit, sur une page largement blanche, avec des équipements alliés, notamment deux porte-avions anglais, ou pris aux vaincus. L’effort est appréciable. Suez en montre cependant les limites tant pour le soutien que pour l’aviation –les avions à réaction doivent décoller de Chypre, car ils ne sont pas adaptés aux porte-avions de l’époque.
C’est sous la Ve République que la France renoue avec sa vocation navale, mais uniquement sur le plan militaire et stratégique. La décolonisation fait que la France redevient, outre-mer, essentiellement maritime, avec des points d’appui dans tous les océans. Ensuite, sa flotte connaît une modernisation sans précédent avec la concentration des efforts sur la capacité de projection, notamment les porte-avions, et l’acquisition de la dimension nucléaire à double titre : la propulsion nucléaire et la création de la force océanique stratégique avec les sous-marins nucléaires lance-engins (SNLE), chargés d’assurer la dissuasion. C’est le 28 janvier 1972 que le premier d’entre eux quitte, pour sa première mission opérationnelle, la base de l’Île-Longue dont la construction a commencé en 1965, dans la rade de Brest. D’une manière générale, si le nombre n’est pas le même, la qualité technique de la marine nationale tient parfaitement la comparaison avec les autres grandes flottes.
Cependant, dans le même temps, après un redressement très significatif dans l’Après-guerre, la flotte française de commerce recule. Le développement du commerce mondial bénéficie en effet dès les années 1960 aux pavillons de complaisance et ensuite, avec la mondialisation qui prend corps à partir des années 1990, aux nouvelles puissances économiques émergentes, dont la Chine. La création du pavillon Kerguelen en 1986, depuis devenu le Registre international français, n’a pas enrayé la tendance.
Par deux fois dans les dernières décennies, une grande ambition maritime est affirmée. D’abord, en 1981, avec la désignation d’un ministre de la mer, M. Louis Le Pensec, par le président de la République, François Mitterrand. Ensuite, en 1995, lorsqu’est créé le secrétariat général de la mer, par le président de la République, M. Jacques Chirac. M. Didier Quentin, votre co-rapporteur, est alors nommé secrétaire général de la mer.
À un moment clef de notre histoire, où la mondialisation rebat les atouts des rapports de puissance non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan géopolitique, l’ampleur des espaces maritimes sous juridiction française pose une nouvelle fois, et très clairement, la question du niveau de notre ambition pour la mer.
Avec environ 11 millions de kilomètres carrés d’eaux sous juridiction et environ 12 millions de fonds et de sous-sols sous-marins reconnus comme tels, notre pays détient la deuxième surface maritime du Monde, juste derrière les États-Unis. Il pourra même être au-delà une fois l’ensemble des dossiers relatifs aux fonds marins réglés, car les États-Unis n’ont pas encore accès aux extensions du plateau continental, faute d’avoir ratifié la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
La France ne saurait donc en aucun cas ne pas se montrer à la hauteur du double défi qui se pose à elle.
Le premier est d’ordre scientifique, technique, économique et écologique. Ces immenses espaces maritimes et sous-marins qui représentent 20 fois la superficie de la métropole offrent une perspective d’entrée dans les grands enjeux du siècle que sont l’exploration des océans et des fonds marins pour leur mise en exploitation dès lors qu’il faudra faire face à l’éventualité très probable d’une pénurie des ressources terrestres. Celle-ci ne saurait naturellement intervenir que dans le respect des grandes ambitions collectives environnementales autour desquelles se structure de plus en plus la communauté internationale. Cette dernière passe progressivement selon la notion identifiée par M. Hubert Védrine, de la géopolitique à la géo-écologie.
Le deuxième enjeu est d’ordre politique. Le monde maritime est en pleine transformation. L’ancien Tiers Monde est très rapidement remplacé par les pays émergents. Les rapports de puissance changent. Tel est notamment le cas avec le retour rapide, après une longue éclipse d’un siècle et demi, de la Chine. Les plus grands pays sont, pour la plupart, déterminés à se donner les moyens non seulement économiques, mais également scientifiques, techniques et même militaires de la maîtrise de leur destin et de leur influence sur le monde. Dans ces efforts, la dimension maritime est essentielle, non seulement pour la Chine et la Russie, mais aussi pour l’Inde ou encore le Brésil. L’acquisition de cette dimension maritime n’est pas neutre car elle s’accomplit en grande partie en bousculant les normes juridiques internationales en grande partie perçues comme le reflet d’une époque révolue où la domination occidentale était trop importante pour que ces règles ne soient intrinsèquement déséquilibrées en leur défaveur.
Le Général de Gaulle, visionnaire comme très souvent, ne s’y était pas trompé, puisque dans l’un de ses derniers grands discours, prononcé à Brest en 1969, il déclarait : « L’activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche de l’exploitation de la mer, et naturellement, les ambitions des Etats chercheront à dominer la mer pour en contrôler l’activité et les ressources ».
Créée en 2015, la présente mission d’information a pu mener plusieurs auditions. Celles-ci ont été complétées par deux déplacements. Le premier est intervenu, en septembre 2015, à Bruxelles, siège de la Commission européenne, mais aussi de l’OTAN, deux relais essentiels des capacités maritimes françaises. Le second a eu lieu en février 2016, au Royaume-Uni, afin d’avoir un point de comparaison avec l’autre grande puissance maritime européenne.
Ces travaux ont permis de confirmer, ce qui est à la fois rassurant mais aussi un peu inquiétant, que la modestie des résultats de notre pays en matière maritime n’est pas une question de moyens, ni de compétences, ni de capacités.
La France dispose en effet de l’ensemble des compétences administratives, scientifiques, juridiques et techniques qui lui permettraient d’affirmer sa vocation maritime.
Si tel n’est pas le cas, c’est en raison d’un manque de constance quant à l’impulsion politique qui doit présider à une telle ambition.
Une telle lacune est d’autant plus regrettable que les espaces maritimes ouvrent des perspectives environnementales, scientifiques, techniques et de coopération avec les pays en développement qui permettraient à notre pays d’entrer de plain-pied dans le monde futur tel qu’il s’esquisse.
PREMIÈRE PARTIE : UN CONTEXTE MARITIME MONDIAL DYNAMIQUE, MAIS DONT LA SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ SONT DE PLUS EN PLUS FRAGILISÉES
I. UN MONDE DE PLUS EN PLUS MARITIME QUI IMPOSE DES EFFORTS DE SÉCURITÉ ACCRUS
A. UN ESPACE MARIN TRÈS LARGEMENT SOUS LA JURIDICTION ET DONC LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS CÔTIERS
1. Une tendance de long terme consacrée par la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) en 1982
La mer proche de la terre ferme a été très tôt perçue comme une prolongation du territoire sur laquelle pouvait s’exercer tout ou partie de la souveraineté des États riverains. En droit, la terre domine la mer, mais le droit international, né du droit maritime, est fondé sur la liberté de navigation qui inclut au moins deux principes : celui du libre passage dans les détroits, même s’ils sont compris dans les eaux territoriales, et celui du libre passage inoffensif dans ces mêmes eaux territoriales.
La question clef de la largeur et de la délimitation de cette zone de souveraineté a été posée dès 1610 par les Pays-Bas, qui ont revendiqué la portée du canon, et été réglée avec davantage de précision au XVIIIe siècle, en 1782, lorsque l’italien Galiani l’a fixée à 3 milles marins (5,556 kilomètres environ). Très tôt, des demandes d’extension sont formulées. Les pays scandinaves souhaitent obtenir 4 milles nautiques. Ensuite, les riverains de la Méditerranée revendiquent 6 milles marins et la Russie est la première à aller jusqu’à la limite des 12 milles, en 1912. Pour l’essentiel, ce sont les grandes puissances maritimes qui s’opposent à de telles extensions, invoquant le principe de la liberté des mers, contre les puissances côtières.
Avec la codification du droit maritime après la Première guerre mondiale, la délimitation maritime se fixe d’abord sur ces bases, puis évolue et s’enrichit vers une territorialisation croissante. La convention de Genève de 1923 sur le droit de la mer est remplacée, en 1958, à l’issue de la Conférence des Nations unies sur le droit de la mer, à Genève, par quatre conventions qui définissent la base de la segmentation actuelle :
– la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë (zone est dans le prolongement de la mer territoriale), entrée en vigueur en 1964 ;
– la convention sur la haute mer, entrée en vigueur en 1962 ;
– la convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, entrée en vigueur en 1966 ;
– la convention sur le plateau continental, entrée en vigueur en 1964.
Cette dernière est essentielle. Les progrès de la science ont permis d’entrevoir dès la fin de la Seconde guerre mondiale les possibilités d’exploiter les fonds marins qui sont dans le prolongement de la masse continentale émergée.
Le président Truman utilise le premier la notion de plateau continental, dans sa proclamation du 28 septembre 1945. L’objectif est pour les États-Unis d’exploiter les gisements et les mines qui seraient dans la continuité de ceux exploités à terre.
C’est au même moment que commence à poindre la question de l’exploitation économique des mers dans une zone plus vaste que la mer territoriale, exiguë avec ses douze milles marin.
Dès 1947, le Chili et le Pérou revendiquent pour la pêche un domaine maritime d’au moins 200 milles marins, de manière à réduire les eaux internationales, et sont suivis par plusieurs autres États d’Amérique latine, puis d’Afrique, dans les décennies qui suivent.
Les négociations qui ont eu lieu à ce sujet lors de la troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer conduisent à la reconnaissance de la notion de zone économique exclusive par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUD), dite convention de Montego Bay, du 10 décembre 1982, après neuf ans de travaux. Elle est entrée en vigueur en 1994.
La CNUDM est le socle actuel du droit maritime, et elle est très largement acceptée. Comme l’indique la carte suivante, très peu de pays ne l’ont pas signée ni ratifiée. Tous les grands pays l’ont ratifiée, à l’exception des États-Unis en raison, pour l’essentiel, d’une réticence du Sénat américain à s’engager sur le plan juridique.
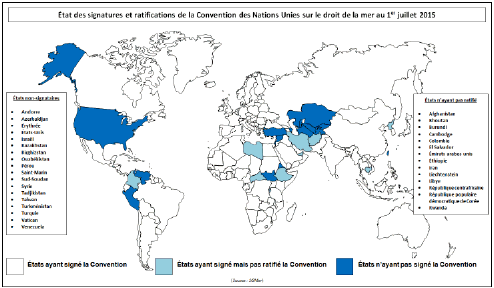
Source : SG Mer
2. Six espaces maritimes ou sous-marins dont cinq sous juridiction des États côtiers, avec des statuts très différents
La distinction entre les différents segments de l’espace maritime sous juridiction des États côtiers repose sur la distance à la terre ferme. Plus l’on s’éloigne de la côte, moins les compétences des États sont étendues.
a. Le point de départ des délimitations : la ligne de base
La délimitation des différentes zones maritimes part de la ligne de base. C’est une construction géométrique qui suit d’une manière simplifiée, sans en reproduire toute la complexité, le tracé des côtes.
La ligne de base normale est la laisse de basse mer, « telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier » (c’est-à-dire les cartes du Service hydrographique et océanographique de la marine -SHOM- pour la France).
Toutefois, pour les côtes profondément découpées ou bordées d’îlots, ainsi que pour les deltas et les baies suffisamment profondes, des lignes de base droites ne s’écartant pas de la direction générale de la côte permettent de simplifier son tracé. Le choix de chaque portion demande une étude précise et argumentée des différentes possibilités. La CNUDM consacre 10 articles au tracé de la ligne de base.
Les eaux intérieures sont celles situées entre la ligne de base et la côte. Les ports, havres, les rades, estuaires, baies historiques en font partie. La souveraineté de l’État côtier y est complète. L’enjeu de la ligne de base est donc dans certains cas pour lui d’interpréter les textes de la manière la plus favorable.
La première des zones maritimes sous juridiction de l’État côtier, la plus proche de la terre ferme, est la mer territoriale, communément appelée « eaux territoriales ».
Elle peut s’étendre jusqu’à 12 milles marins (22,224 kilomètres environ) au-delà de la ligne de base. L’État côtier y exerce sa souveraineté et peut prendre les mesures législatives et réglementaires dans les domaines suivants, notamment : sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime, pêche, conservation des ressources biologiques, préservation de l’environnement et maîtrise de la pollution, recherche scientifique, prévention des infractions en matières fiscale, douanière, sanitaire ou d’immigration.
La souveraineté s’exerce sur les eaux, les fonds et le sous-sol marins, ainsi que sur l’espace aérien surjacent.
L’État côtier doit cependant respecter le droit de passage inoffensif des navires étrangers, qui est l’un des éléments de la liberté des mers. Il ne peut pas percevoir de droit de passage, mais uniquement une rémunération pour les services particuliers éventuellement rendus au navire concerné.
Il peut a contrario prendre les mesures pour empêcher un passage qui n’est pas inoffensif.
Il peut exercer dans certains cas sa juridiction pénale sur ces mêmes navires étrangers, notamment en cas d’infraction de nature à troubler l’ordre dans la mer territoriale ou la sécurité du pays. L’exercice de sa juridiction civile est limité, pour les navires de passage, aux mesures d’exécution ou conservatoires liées aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues par eux. Pour les navires venant des eaux intérieures ou stationnant dans la mer territoriale, elle est un peu plus étendue.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les navires à propulsion nucléaires et ceux transportant des substances radioactives ou intrinsèquement dangereuses ou nocives.
Les navires de guerre et les navires d’État utilisés à des fins non commerciales font l’objet d’un régime particulier. Ils bénéficient d’immunités. L’État côtier peut demander à un navire de guerre qui ne respecte pas ses lois et règlements relatif au passage dans ses eaux de quitter immédiatement sa mer territoriale.
Au-delà de la mer territoriale, la zone contiguë peut s’étendre sur une largeur de 12 milles marins également, soit jusqu’à 24 milles (44,448 kilomètres environ) de la ligne de base. La notion est apparue dans les années 1920 aux États-Unis pour faciliter la mise en œuvre de la prohibition et la lutte contre la contrebande, celle venant notamment des Bahamas ou du Canada.
L’État côtier n’y exerce sur les navires qu’une compétence limitée aux contrôles nécessaires à la prévention des infractions en matières fiscale, douanière, sanitaire ou d’immigration. Il peut également, dans le cadre d’un droit de poursuite, réprimer les infractions commises dans ces mêmes matières sur son territoire ou dans la mer territoriale.
e. La zone économique exclusive (ZEE)
La reconnaissance de la zone économique exclusive (ZEE) a été le grand apport de la CNUDM en 1982. La ZEE s’étend jusqu’à 200 milles nautiques (soit 370 kilomètres environ) en partant de la ligne de base. L’État côtier y dispose de compétences finalisées, avec des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents.
L’État côtier a également un droit de compétence. Il a juridiction sur la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, dont il peut ainsi autoriser et réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation, ainsi que sur la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin.
Ce n’est donc pas un espace marin patrimonial comme la mer territoriale mais bien un espace où l’État côtier doit tenir compte des droits et obligations des autres États qui bénéficient de certaines libertés afférentes à la haute mer : liberté de navigation et de survol ; liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve que leurs tracés soient agréés par l’État côtier.
Comme pour les autres zones maritimes, la délimitation de la ZEE vers la haute mer est un acte unilatéral de la part des États. La simple délimitation en droit interne permet d’appliquer les règles de la législation nationale.
Cependant, pour la ZEE comme pour tout autre espace maritime, la délimitation d’un pays n’est opposable aux autres États que si elle a fait l’objet d’une publicité auprès du secrétariat général des Nations unies.
C’est pour la ZEE que c’est le plus délicat, car, en raison de sa taille, des pays sans frontières terrestres se découvrent des frontières maritimes et les négociations ne portent pas uniquement sur le prolongement en mer des frontières terrestres.
Au-delà des zones sous juridiction des États côtiers s’étend la haute mer, qui représente 64 % de la surface des océans, lesquels représentent 72 % de la surface terrestre. La haute mer est ouverte à tous les États, y compris ceux qui n’ont pas de littoral.
Le principe est la liberté de navigation et de survol, ainsi que sous certaines réserves ou condition, de pêche, de recherche scientifique, et même de pose de câbles et de pipelines et de construction d’îles artificielles ou autres installations.
La notion de haute mer libre ne concerne que la seule colonne d’eau, mais pas les fonds marins.
En effet, sous la haute mer, au-delà de la ZEE et sous réserve des éventuelles extensions du plateau continental au profit de l’État côtier, s’étend la zone internationale des fonds marins, que la convention de 1982 appelle « la zone ». Celle-ci est déclarée patrimoine commun de l’humanité.
Elle relève de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), organisation internationale autonome, qui a été créée conformément à la CNUDM et à l’accord de 1994 relatif à l’application de sa partie XI. L’AIFM est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les États parties à la Convention, conformément au régime établi pour les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, peuvent obtenir des permis d’exploration et de recherche.
g. Les facultés d’extension du plateau continental
Les limites posées par le droit de la mer et la géologie ne coïncidant pas nécessairement, la question des droits de l’État côtier sur les fonds et sous-sols marins qui seraient le prolongement de la masse continentale au-delà de 200 milles marins, s’est naturellement posée lors de la troisième conférence sur le droit de la mer.
Celle-ci a été réglée avec la reconnaissance de la faculté pour les États de revendiquer des extensions de plateau continental sur la base de critères géologiques précis, dans certaines limites. Les droits portent alors sur le fond et le sous-sol marins, mais en aucun cas sur les eaux surjacentes qui restent de la haute mer.
La notion de plateau continental étendu, de plateau continental juridique, est définie, à l’article 76 de la CNUDM, lequel précise que le plateau continental de l’État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur « toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale ».
Son dispositif est très complexe, comme on peut le constater à la lecture de l’encadré ci-joint.
Convention des Nations-unies sur le droit de la mer – Article 76
« Définition du plateau continental
« 1. Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.
« 2. Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.
« 3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l’État côtier ; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.
« 4. a) Aux fins de la Convention, l’État côtier définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par :
« i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental ;
ou
« ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.
« b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.
« 5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.
« 6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu’elle comporte.
« 7. (…) »
Par conséquent, lorsque le rebord externe de la marge continentale et la limite des 200 milles marins, ne coïncident pas, ce qui est le plus souvent le cas, la délimitation intervient toujours en faveur de l’État côtier, puisque le dispositif de l’article 76 prévoit :
– que le plateau continental de l’État s’étend en tout état de cause aux fonds et sous-sols marins jusqu’à la limite des 200 milles, même lorsque le rebord externe de la marge continentale est en-deçà (dans ce cas, le plateau continental juridique va au-delà de la géophysique) ;
– qu’il peut s’étendre au-delà de la limite des 200 milles lorsque sont réunies un certain nombre de conditions géologiques, morphologiques et géophysiques.
Pour définir, et revendiquer, la limite extérieure du plateau continental ainsi étendu, l’État côtier doit s’appuyer sur le tracé d’au moins quatre lignes de référence.
Deux de ces lignes reposent sur des critères géologiques et sont fixées, d’une part, par référence aux points fixes extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental (critère de Gardiner), et d’autre part, à 60 milles de ce même pied du talus (critère de Hedberg).
Cependant, l’extension ainsi opérée selon celui de ces deux critères qui est le plus favorable, ne peut excéder 350 milles marins (685 kilomètres environ) à partir de la ligne de base, sauf si c’est au-delà que se situe la limite des 100 milles marins (185,2 kilomètres environ) à partir de la courbe de profondeur (l’isobathe) correspondant à 2 500 mètres.
Les schémas suivants permettent de visualiser ces éléments.
Le premier d’entre eux, établi par l’Ifremer, montre l’articulation des critères géologiques et du critère des 350 milles marins.
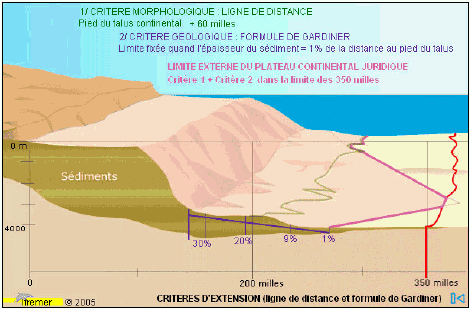
Le second, établi par le département d’État américain, montre la mise en jeu des deux lignes de distance.
Lignes pour l’extension du plateau continental
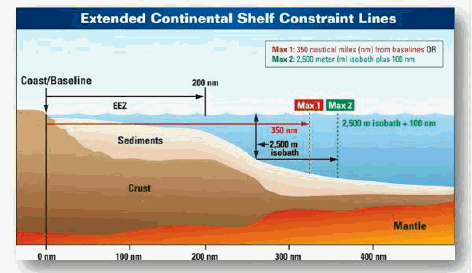
Source : Department of State. États-Unis.
Il faut par ailleurs mentionner le cas particulier des dorsales sous-marines, en présence desquelles aucune extension au-delà de 350 milles nautiques n’est possible.
L’extension du plateau continental intervient à la demande des États côtiers, selon une procédure stricte, car elle vise à réduire la surface des zones qui constituent, avec leurs ressources, le patrimoine commun de l’humanité.
La demande d’un pays doit ainsi être transmise à la Commission des limites du plateau continental (CLPC), qui adresse des recommandations sur les limites extérieures (les litiges entre pays ne relèvent pas de ses compétences et la conduisent à surseoir à statuer.)
Les limites ainsi fixées sur la base de ces recommandations sont définitives et obligatoires.
C’est le 13 mai 1999 que la CLPC a émis les Directives scientifiques et techniques auxquelles doit se conformer l’État côtier pour fixer la limite extérieure du plateau continental revendiqué.
Un délai de dix ans, venant à échéance le 13 mai 2009, a été fixé pour le dépôt des dossiers.
En 2008, cette date a été maintenue mais un aménagement de procédure est intervenu. A été autorisé le simple dépôt d’une information préliminaire pour permettre aux pays demandeurs, notamment aux pays en développement, de sauvegarder leurs droits.
Pour les pays qui ratifient la convention après 1999, le délai de dix ans court à compter de la ratification.
Soixante-dix-sept demandes d’extension ont été au total déposées, dont certaines sont subdivisées en plusieurs dossiers.
h. La prolongation en mer des frontières terrestres : la négociation entre États
Les frontières terrestres entre les États se prolongent en mer, et l’un des enjeux est de les fixer. Les négociations entre les pays concernés portent alors sur le point de départ et ensuite les modalités du tracé latéral vers la pleine mer, avec plusieurs approches possibles : prolongement de la direction générale de la frontière terrestre ; ligne perpendiculaire à la direction générale des côtes ; application de la méthode de l’équidistance ou de la ligne médiane, dans les cas peu rares où le tracé côtier est complexe et n’est pas linéaire. S’y ajoutent ensuite des éléments de circonstance relevés par la jurisprudence. Les premiers éléments ont été donnés dès 1909 par la Cour permanente d’arbitrage entre la Suède et la Norvège, nouvellement indépendante, dans l’affaire des îlots des Grisbadarna.
Le schéma suivant permet de récapituler les différentes zones maritimes.
Les différentes zones maritimes
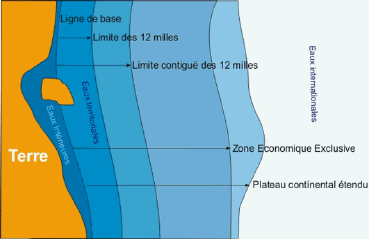
Ces différentes délimitations donnent lieu à négociation et tracé conjoint avec les autres États, éventuellement après arbitrage, lorsque la largeur de la mer ne permet pas à chaque État côtier d’étendre comme il le souhaite sa délimitation.
Tel est notamment le cas pour la ZEE.
Ces négociations, qui s’ajoutent à celles sur le prolongement en mer des frontières terrestres, rappellent l’importance d’une maîtrise du droit maritime par un pays.
3. Des différends encore assez nombreux, mais réglés le plus souvent par la négociation et très exceptionnellement par le juge ou par arbitrage
a. D’autres sources du droit de la mer à côté de la CNUDM
La CNUDM n’est pas la seule source du droit international applicable aux espaces maritimes. D’abord, le droit coutumier, constitué au fil de la pratique des États, demeure. Des coutumes respectées et avérées peuvent se révéler importantes dans des régions où les pratiques diffèrent des normes internationales. Ensuite, plusieurs dispositions d’ordre sectoriel relèvent des conventions internationales autres notamment en matière de pollution et de protection environnementale, ainsi qu’en matière de sécurité. Enfin, certains espaces relèvent d’un régime particulier. C’est le cas des eaux situées sous le 60e degré de latitude Sud, couvertes par le traité sur l’Antarctique.
b. Des zones encore contestées mais sans tension
Le droit maritime n’étant pas d’application simple et la frontière ne pouvant être fixée de manière aussi simple et nette que sur terre, il y a encore des différends entre pays, qui se règlent de manière pacifique.
Lors de l’entretien qu’il a bien voulu accorder aux rapporteurs, S.E. M. Lawrence Cannon, ambassadeur du Canada, a ainsi rappelé que l’existence de divergences avec les États-Unis dans la mer de Beaufort, et que les deux pays sont convenus d’un dialogue technique sur la frontière et le plateau continental et d’un gel des explorations de pétrole et de gaz, le temps de leur résolution.
De même avec le Danemark, au large du Groenland, le différend sur deux petites zones dans la mer de Lincoln a fait l’objet d’un règlement de principe en 2012, et la revendication par le Danemark de l’île de Hans dans le canal de Kennedy ne nuit pas à la qualité des relations entre les deux pays.
Le Canada est un exemple parmi d’autres, et il serait possible de mentionner d’autres pays. Les rapporteurs s’en tiennent à celui-ci, car il a été évoqué avec clarté et simplicité.
c. Des exemples très connus d’arbitrage ou de décisions de la Cour internationale de Justice
Parmi les exemples d’arbitrage, le plus connu est celui du Canal de Beagle, entre l’Argentine et le Chili, rendu par la couronne anglaise, par la Reine d’Angleterre, sur proposition d’une cour arbitrale en 1977. Ensuite, les difficultés entre les deux pays ont conduit à des tensions, avec une médiation du Vatican en 1978. Ce n’est qu’en 1984, après la chute de la Junte en Argentine, que le traité de paix et d’amitié entre les deux pays, signé au Vatican, conduit à un règlement du conflit attribuant les îles au Chili mais une grande partie des droits maritimes à l'Argentine.
Pour ce qui est de la Cour de Justice, plusieurs arrêts sont emblématiques des difficultés de l’application du droit maritime avant même la CNUDM ou après sa signature sont souvent cités.
Il faut ainsi mentionner l’arrêt sur le Plateau continental de la mer du Nord, du 20 février 1969, qui juge, à propos de son partage entre les États côtiers, que le principe de l’équidistance n’a pas une base coutumière, mais conventionnelle (la convention de 1958 prévoit cette règle, mais l’Allemagne ne l’a pas ratifiée), qui rejette aussi la demande allemande de parts justes et équitables, qui estime, en effet, que chaque partie a, par principe, droit aux zones de plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son territoire sous la mer et qu’il ne s'agit donc pas de répartir ou de partager ces zones, mais de les délimiter.
L’arrêt dit également que les délimitations en cause devront être fixées par voie d’accord entre les parties conformément à des principes équitables. Les facteurs à prendre en compte sont alors mentionnés : comme en l’espèce l’équidistance aurait conduit à des incontestables iniquités, la Cour a recommandé de prendre en compte la configuration générale des côtes des parties et la présence de toute caractéristique spéciale ou inhabituelle, ainsi que la structure physique et géologique et les ressources naturelles des zones de plateau continental en cause, de même que le rapport raisonnable entre l’étendue des zones de plateau continental relevant de chaque État et la longueur de son littoral mesurée suivant sa direction générale, compte-tenu, en outre, des effets actuels ou éventuels de toute autre délimitation du plateau continental dans la même région.
Ensuite, l’arrêt du 3 juin 1985, Affaire du Plateau continental
(Jamahiriya arabe libyenne/Malte) est assez compliqué, puisqu’il reconnaît la valeur du droit coutumier, avant l’entrée en vigueur de la CNUDM, lie la ZEE et la souveraineté sur le plateau continental sous-jacent et reconnaît ainsi l’importance de la distance à la côte. Il fixe au regard des circonstances géographiques et géologiques particulières, de manière très précise la délimitation entre les deux pays.
Ultérieurement, l’arrêt Qatar c. Bahreïn du 16 décembre 2001 sur la souveraineté sur plusieurs îles et un haut fonds découvrant, ainsi que sur le tracé de la frontière maritime, se fonde, sur le premier point, sur des éléments historiques dont certains antérieurs à la période du protectorat britannique et considère, sur le second point, qu’il n’existe aucune circonstance particulière conduisant à l’ajustement de la ligne d’équidistance. Plus précisément, la Cour ne retient pas l’argument de Bahreïn selon lequel l’existence de certains bancs d’huîtres perlières situés au nord de Qatar et exploités dans le passé de façon prédominante par des pêcheurs bahreïnites, ni l’argument du Qatar selon lequel il y aurait une différence sensible entre les longueurs des côtes des Parties justifiant une correction appropriée. Elle indique en outre que des considérations d’équité exigent de ne pas donner d’effet à la formation maritime de Fasht al Jarim pour établir la ligne de délimitation.
d. La question des eaux et titres historiques
Un certain nombre de litiges reposent sur la notion d’eaux ou de droits historiques, qui ne sont pas traités mais ne sont pas non plus niés par la CNUDM.
Celle-ci reconnaît d’ailleurs toute leur valeur à propos des baies historiques. Son article 10, relatif aux lignes de base des baies dont un seul État est riverain, ne s’applique expressément pas aux baies historiques.
Dans un article de la revue Estudios Socio-Jurídicos de janvier 2003, intitulé Eaux et baies historiques, Ricardo Abello Galvis rappelle que la notion d’eaux historiques est bien plus large que celle de baie historique, qu’elle concerne notamment les droits de pêche, que personne n’en met en doute l’existence, mais que les contours du régime dont elles font l’objet sont difficiles à définir.
Une étude précise en a été faite par la commission du droit international, mandatée par l’Assemblée générale des Nations unies, après que la conférence de Genève de 1958 l’eut saisie de l’intérêt d’une telle vue d’ensemble.
Comme l’observe l’article précité, « de cette façon la Commission a clarifié l’existence d’eaux historiques. En premier lieu, la notion de baies historiques fait partie du concept général d’eaux historiques, alors qu’auparavant elle constituait une notion autonome. En deuxième lieu, et comme conséquence de l’existence d’eaux historiques, des eaux considérées comme mer territoriale peuvent être revendiquées comme des eaux intérieures. »
La notion d’eaux historiques repose sur l’existence d’un régime coutumier, à défaut de cadre conventionnel. Cela vaut aussi pour les baies. La Cour de Justice Centraméricaine dans sa décision de 1917 a dit que le Golfe de Fonseca, entre le Honduras, le Nicaragua et Salvador, était une baie historique parce que les trois pays pouvaient faire valoir les deux éléments suivants : « …une possession séculaire ou immémoriale accompagnée de l’animus domini, une possession pacifique et continue acceptée par les autres nations ».
L’étude précitée rappelle qu’il faut deux éléments : des comportements des États susceptibles de constituer des précédents ; l’élément psychologique ou l’opinio juris.
En outre, parmi les conditions nécessaires à la revendication d’espaces maritimes, l’article précité rappelle que figurent les titres historiques ainsi définis par M. Yehuda Blum dans Historic Titles in International Law La Haye, Martinus Nijhoff, 1965 : « the historic title is the outcome of a lengthy process comprising a long series of acts, omissions and patterns of behaviour which, in their entirety, and through their cumulative effect, bring such a title into being and consolidate it into a title valid in international law ». Le titre historique est donc la conséquence d’un processus de consolidation avec une série d’actes, de comportements, et aussi d’omissions, qui, dans l’ensemble et par leurs effets cumulés, conduisent à la constituer.
La notion est exigeante car les « conditions qui sont requises de façon sine qua non pour que cette consolidation historique devienne un titre historique sont : la possession effective, l’acquiescement et l’écoulement du temps ». L’acquiescement est défini comme une reconnaissance tacite manifestée par un comportement unilatéral que l’autre partie peut interpréter comme un consentement. C’est notamment le cas pour le silence d’un État.
B. LE TRANSPORT MARITIME AU CœUR DE LA MONDIALISATION
1. Une liberté de navigation garantie sur toutes les eaux, y compris la mer territoriale
L’expansion du secteur maritime bénéficie de la liberté de circulation, qui est l’un des fondements du droit maritime depuis le XVIIe siècle.
Celle-ci n’a pas été aisément admise. En arrière-plan des travaux de Grotius, qui publie Mare Liberum (De la liberté des mers) en 1609, sans nom d’auteur, se trouve la rivalité des Pays-Bas avec les puissances coloniales d’alors qui fondent leur richesse sur le monopole du commerce avec les colonies, sur l’exclusif. Il s’agit de l’Espagne et du Portugal, mais aussi, plus tard, du Royaume-Uni lorsque Cromwell fait adopter l’Acte de navigation.
La liberté des mers s’est ensuite imposée, notamment sous l’impulsion du Royaume-Uni qui en perçoit les avantages lorsqu’il est devenu la première puissance navale, commerciale et de guerre. Elle est reconnue depuis longtemps par le droit international, et actuellement la CNUDM, non seulement pour la haute mer, mais également pour les eaux sous juridictions, y compris les eaux territoriales.
Pour la haute mer, l’article 87 de la CNUDM reconnaît le principe de la liberté de son usage.
La même liberté vaut dans les eaux sous juridiction, ZEE et zone contiguë notamment, mais pas uniquement. Ainsi l’article 17 de la convention reconnaît-il à tous les navires des autres États, côtiers ou non, le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, l’article 24 interdit-il d’imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet de restreindre ou d’empêcher l’exercice de ce droit ou d’exercer des discriminations, et l’article 26 prohibe-t-il la perception d’un droit de passage, sauf en contrepartie de services rendus (« rémunération de services particuliers rendus à ce navire »).
L’article 38 de la convention reconnaît également le droit de passage en transit dans les détroits. Certains détroits relèvent cependant d’un régime spécifique. Tel est le cas du Bosphore et des Dardanelles avec la convention de Montreux de 1936, concernant le régime des Détroits, qui fixe également les conditions relatives à la Mer noire.
L’article 53 de la convention prévoit de manière similaire un droit de passage archipélagique.
Par ailleurs, la convention de Genève de 1923 sur le régime international des ports maritimes garantit l’accès et l’égalité de traitement aux navires étrangers, ainsi d’ailleurs que la publication préalable des droits et taxes y afférant.
Au-delà de ces éléments juridiques, la libre circulation maritime a pour condition la sécurité du transport et le libre-passage effectif dans les eaux internationales ou sous juridiction, notamment dans les détroits.
Celle-ci est de fait garantie par la plus grande puissance navale sur le plan militaire, les États-Unis actuellement, après l’avoir été par le Royaume-Uni.
2. La croissance du transport maritime
Comme l’a relevé d’emblée le chef d’état-major de la Marine, l’Amiral Bernard Rogel, lors de son entretien avec les rapporteurs, le monde actuel est marqué par la part croissante du maritime.
La mondialisation économique a un impact direct sur les échanges maritimes. 90 % du commerce mondial se fait par la voie maritime. Cette « maritimisation » se traduit très directement dans les chiffres du transport maritime. Le tonnage transporté a atteint 9,842 milliards de tonnes en 2014, alors qu’il était de 2,6 milliards en 1970 et de 5,98 milliards en 2000, selon le rapport de la CNUCED sur le commerce maritime international en 2014, publié en octobre dernier. Le transport maritime représente d’ailleurs 2,5 % environ des émissions mondiales de CO2, soit l’équivalent des émissions de l’Inde.
Les perspectives sont autour de 14 milliards en 2020, mais pourraient être surévaluées en raison de l’actuel ralentissement de la croissance mondiale.
Le coût du fret a également très fortement chuté depuis son niveau le plus haut en 2008. L’indice de référence Dry Baltic est passé de 1 510 en 2008 à 853 dans la première moitié de 2015. Il a encore chuté l’an dernier et au début de cette année en raison des surcapacités résultant de l’importance des mises en chantier entre 2007 et 2012, notamment pour les vraquiers et les pétroliers, et de la réduction de la demande chinoise. Il était de l’ordre de 630 au moment de la rédaction du présent rapport.
La flotte commerciale mondiale a atteint 1,75 milliard de tonnes de port en lourd au 1er janvier 2015, en croissance de 3,5 % par rapport à l’année précédente.
Les quelque 89 500 navires se répartissaient de la manière suivante par pavillon : 8 351 pour Panama (20,13 % du tonnage mondial), 3 143 pour le Libéria (11,65 % du tonnage mondial), 2 580 pour les Îles Marshall (10,02 % du tonnage mondial), 2 425 pour Hong Kong (8,62 % du tonnage mondial), et 3 689 pour Singapour (6,58 % du tonnage mondial).
Dans l’ensemble, les cinq premiers pavillons représentent 57 % du tonnage mondial.
Pour l’Europe, les deux pavillons les plus importants viennent immédiatement après, avec Malte au sixième rang (1 895 navires et 4,69 % du tonnage mondial) et la Grèce au septième rang (1 484 vaisseaux et 4,50 % du tonnage mondial).
La France a immatriculé 670 navires, soit 0,39 % du tonnage mondial, et se situe au 31ème rang mondial, après le Royaume-Uni au 15ème rang, le Danemark, au 17ème rang, l’Allemagne, au 21ème rang, les Pays-Bas et la Belgique, aux 27 et 28ème rangs, notamment.
Il faut également compter avec la taille croissante des navires mis à l’eau. La taille des porte-conteneurs a triplé en vingt ans passant, pour les plus grands, de 6 000 à 18 000 conteneurs ou équivalents vingt pieds (EVP), et même à 19 000 pour les plus récents d’entre eux.
Pour être exhaustif, il faut relever la concentration de la construction navale civile. Sur les 63 662 navires livrés en 2014, 22 851 ont été construits en Chine, 21 872 en Corée du Sud, dont 9 135 porte-conteneurs, et 13 392 au Japon.
3. Une dépendance vis-à-vis de routes et de quelques points stratégiques bien identifiés : les détroits et les canaux transocéaniques
Le commerce mondial n’utilise pas la totalité des espaces maritimes, mais emprunte quelques grandes voies.
Celles-ci sont matérialisées par les tracés lumineux de la carte suivante, éditée par l’Organisation maritime internationale (OMI).
Les grandes routes maritimes
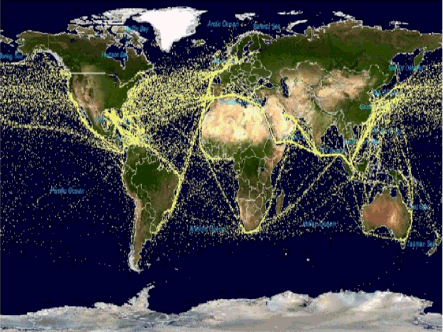
Source : Organisation maritime internationale (OMI)
Ces grandes routes maritimes sont très dépendantes des quelques points de passage, les plus sensibles que sont les détroits et canaux transocéaniques. Ils sont suivis de près en ce qui concerne notamment le pétrole.
La carte suivante, publiée par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (Energy information administration – EIA) montre l’importance de sept d’entre eux pour le transit pétrolier.
Le plus sensible est le détroit d’Ormuz, autrefois qualifié par le Secrétaire d’État américain, Cyrus Vance, de « veine jugulaire » de l’Occident, et par lequel transitent 17 millions de barils jour de pétrole, plus du tiers des exportations quotidiennes mondiales (40 millions de barils jours en 2014). Il a fait l’objet de menaces de minages par l’Iran, dans le passé, ce qui explique une présence maritime ancienne et permanente des États-Unis et du Royaume-Uni.
Viennent ensuite le détroit de Malacca, qui alimente l’Asie orientale, Bab-el-Mandeb et Suez, les points d’entrée et de sortie de la Mer rouge, et d’accès direct à la Méditerranée, sans contourner l’Afrique, et aussi le canal de Panama. Ils sont essentiels non seulement au trafic pétrolier, mais aussi aux relations commerciales avec la Chine dans son rôle d’Atelier du monde.
Points névralgiques du transport pétrolier mondial
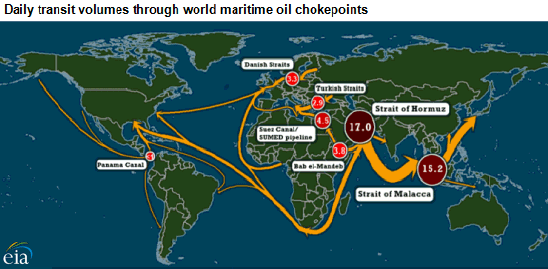
Source : Energy Information Administration (EIA)
4. Le rôle clef de l’Organisation maritime internationale en matière de sécurité et de trafic maritime
Comptée parmi les institutions spécialisées des Nations unies, l’Organisation maritime internationale (OMI) a été créée en 1948 et a son siège à Londres depuis 1958. Cent soixante-dix pays, dont la France, en sont membres. Trois sont associés. De nombreuses institutions internationales et ONG y ont le statut d’observateur.
Son budget annuel est de l’ordre de 30 millions de livres sterling, et financé par une cotisation largement fondée sur le tonnage de la flotte sous pavillon. Par conséquent, les plus gros contributeurs sont Panama (18,1 % du budget), le Libéria (10,4 %), les Îles Marshall (7,2 %), Singapour (5,4 %), le Royaume-Uni (4,6 %) et les Bahamas (4,4 %).
Son secrétariat international comprend 300 personnes, sous l’autorité d’un secrétaire général.
Ses travaux concernent la sécurité et l’efficacité du transport maritime, ainsi que la protection des océans. Ils sont effectués non seulement dans le cadre de l’assemblée générale et du conseil, lequel comprend 40 membres, mais aussi dans le cadre de ses cinq comités : le comité de la protection du milieu marin, le comité de la sécurité de la navigation, avec plusieurs sous-comités, le comité juridique, initialement constitué pour traiter les questions de droit soulevées par l’accident du Torrey Canyon en 1967, le comité de la coopération technique et le comité de la simplification des formalités.
Plusieurs conventions servent de base aux travaux de l’OMI parmi lesquelles la convention dite SOLAS (Safety Of Life At Sea) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, de 1974, qui couvre 162 pays et 98,6 % du tonnage mondial, la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (161 parties et 98,59 % du tonnage mondial), la convention Marpol (Pollution marine) de 1973.
L’OMI n’a pas de mandat lui permettant d’exercer des compétences de police, mais elle joue un rôle essentiel pour la coopération technique en matière de normes et de sécurité avec les pays qui en ont besoin.
Elle établit et diffuse aussi les règles, codes de conduite et guides de bonnes pratiques sur les questions touchant à la liberté des mers, notamment en matière de lutte contre la piraterie, de sécurité et de défense de l’environnement.
Ainsi que l’a confirmé lors du déplacement à Londres de la mission, l’amiral Frederick J. Kenney (Etats-Unis), directeur des affaires juridiques et des relations extérieures de l’OMI, la lutte contre la piraterie a fait l’objet de la collecte d’informations et de l’attention de la part de l’organisation depuis 1983. Ce point est développé ci-après.
L’OMI est également chargée des modalités du trafic maritime dans les eaux sous juridiction des États. Par exemple, le projet dispositif de séparation du trafic (DST) pour le canal de Corse, réglementation du trafic maritime international pour la protection du canal de Corse, établi par la France et l’Italie, lui est soumis. Il relève du comité de la sécurité maritime. Une décision positive est intervenue lors de la 96e session de ce comité, du 11 au 20 mai derniers, permettant la mise en œuvre de la séparation du trafic.
5. Le développement des réseaux sous-marins pour l’énergie et les télécommunications
Depuis le premier câble sous-marin en 1850 et la pose du premier câble transocéanique en 1858, les fonds marins ont été équipés d’un réseau complet de télécommunications. En 2014, on comptait environ 263 câbles. La carte suivante, établie par Telegeography, permet de visualiser ceux utilisés pour Internet.
Les liaisons transocéaniques pour les télécommunications
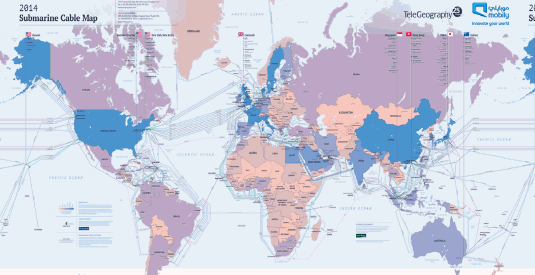
Source : Telegeography
Les liaisons énergétiques, soit les gazoducs et oléoducs, soit les interconnexions électriques se sont aussi développées, mais dans une bien moindre mesure, et surtout en Méditerranée et dans les mers qui bordent l’Europe.
Le réseau le plus développé est celui des gazoducs de desserte de l’Europe, comme le montre la carte suivante, qui a peu évolué depuis 2005.
La desserte européenne par gazoduc
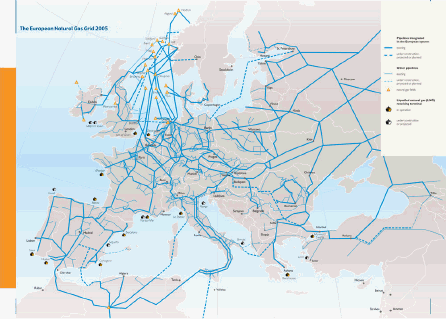
Source : Gaz naturel suisse
Cette utilisation croissante des liaisons sous-marines est un enjeu essentiel en termes de sécurité, mais aussi de prévention des risques de pollution.
C. DES MENACES CROISSANTES SUR LA SÉCURITÉ DES MERS
1. La piraterie : une préoccupation constante, mais qu’il est possible d’endiguer
C’est à partir des années 1980 que la piraterie est revenue au premier rang des préoccupations des armateurs et des pays, et qu’elle a été inscrite à l’agenda de l’OMI.
D’abord circonscrite à la mer de Chine méridionale ainsi qu’aux détroits de Malacca et de Singapour, la piraterie a connu une très forte expansion au cours des années 2000 au large de la Somalie, favorisée par l’effondrement de cet État, dans le golfe d’Aden et dans l’ensemble de l’océan Indien, où elle a été maîtrisée. Elle se développe maintenant dans le Golfe de Guinée. Elle est présente dans les Caraïbes.
Établie par l’International Chamber of Commerce et le Bureau maritime international (BMI), la carte suivante, simplifiée, permet de visualiser l’ampleur de la piraterie et des attaques à main armée contre les navires.
Actes de piraterie et attaques à main armée contre les navires

Source : International Chamber of Commerce
Pour 2015, le centre sur la piraterie du BMI a recensé 246 incidents en 2015, soit 1 de plus qu’en 2014. 55 % de ces incidents se sont produits dans le Sud-Est asiatique. 14 incidents ont concerné le Nigéria, mais ce nombre est considéré comme inférieur à la réalité en raison d’un défaut de déclaration. Des abordages de pétroliers par des hommes armés avec prises d’otages sont intervenus.
b. Les succès décisifs obtenus par la communauté internationale dans le golfe d’Aden et l’océan Indien
La piraterie dans le golfe d’Aden et dans la partie Nord-Est de l’océan Indien a été éradiquée. Aucun incident n’a été enregistré en 2015, mais la vigilance demeure tant que la situation n’est pas rétablie en Somalie.
C’est le résultat du déploiement de trois actions navales conjointes, à partir notamment de Djibouti où les États-Unis et le Japon ont créé des bases qui se sont ajoutées à celle de la France.
L’une a été prise par l’Union européenne, l’opération EU NAVFOR Somalie/Atalante. L’action commune a été décidée par le Conseil le 10 novembre 2008, après la mise en place quelques semaines auparavant d’une cellule européenne de coordination de lutte contre la piraterie maritime.
La zone d’opération s’est étendue du Sud de la mer Rouge au Seychelles, couvrant les accès au golfe d’Aden sur une large partie de l’océan Indien.
Elle a consisté en des missions d’accompagnement des navires du programme alimentaire mondial en Somalie (PAM), ainsi que des missions de présence et de dissuasion y compris dans les eaux territoriales somaliennes jusqu’au littoral, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.
Une dizaine de pays y ont participé et neuf nations ont apporté une contribution opérationnelle permanente à l’opération : les Pays-Bas, l’Espagne, l’Allemagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Suède, la Belgique et le Luxembourg. Les moyens sont intervenus en rotation.
La France a assuré le déploiement d’une frégate et la participation, ponctuelle, d’un avion de patrouille maritime ATL 2, basé à Djibouti. Elle a apporté également un soutien aux autres pays à partir de sa base de Djibouti.
Pour sa part, l’OTAN a organisé une opération similaire, Allied Protector de mars à août 2009, puis Ocean Shield, laquelle a assuré le déploiement de navires américains, canadiens, mais aussi européens, venant des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du Danemark (en raison de son opt out vis-à-vis de la politique étrangère et de sécurité commune) et de la Norvège, qui n’appartient pas à l’Union européenne. Partenaire de l’OTAN, la Corée du Sud y a aussi pris part.
En outre, la CTF151 (Combined Task Force), force multinationale, a été mise en place à partir de 2009 également à partir du quartier général de la Ve Flotte américaine, à Manama, à Bahreïn. En 2013, elle comprenait des navires venant d’Australie, du Pakistan, du Royaume-Uni, des États-Unis et de Turquie.
Des bâtiments russes, indiens, japonais, chinois sont également intervenus pour mettre fin à la piraterie.
L’OMI contribue à la lutte contre la piraterie. Elle tient le Système mondial intégré de renseignements maritimes (GISIS en anglais), qui recense les actes de piraterie.
De plus, elle apporte un soutien aux États Membres qui en font la demande contre la piraterie, les vols à main armée à l’encontre des navires et les autres activités maritimes illicites.
Des codes de conduites ont été mis en place. Le code de conduite concernant la répression des actes de piraterie et des vols à main armée à l’encontre des navires dans l’océan Indien occidental et dans le golfe d’Aden, également appelé code de conduite de Djibouti, a été adopté le 29 janvier 2009. Le nombre total de signataires est actuellement de 20 pays.
De même inspiration, le code de conduite relatif à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l’Ouest et du Centre a été adopté en juin 2013.
L’OMI met actuellement en œuvre une stratégie visant à améliorer la sûreté maritime en Afrique de l’Ouest et du Centre, conformément aux accords régionaux en matière de sûreté maritime.
d. Le rôle de l’ONU : le rapport de M. Jack Lang sur les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes
L’ONU est engagée elle aussi dans la lutte contre la piraterie, qui est une menace sur la sécurité non seulement régionale, mais aussi internationale.
C’est dans cette perspective que M. Jack Lang, ancien ministre et ancien professeur de droit international, a remis le 18 janvier 2011, en qualité de conseiller spécial du secrétaire général, un rapport sur les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes, permettant d’améliorer de manière essentielle, dans le cadre de ses vingt-cinq propositions, le volet judiciaire et pénitentiaire des actions entreprises par la communauté internationale, notamment. Ce rapport est disponible sur le site de l’ONU (https://daccess-ods.un.org/TMP/3522995.4123497.html)
2. Les trafics d’êtres humains et les migrations illégales : une expansion préoccupante, notamment en Méditerranée
Les trafics d’êtres humains et les migrations illégales ont pris une ampleur inédite en Méditerranée au point d’ébranler plusieurs des éléments fondamentaux de l’Union européenne, dont le système de Schengen.
Ils ont exigé la mise en œuvre de moyens maritimes exceptionnels tant vis-à-vis de la Libye, qui s’est effondrée à la suite de l’incapacité du pays à constituer un État autour d’un gouvernement stable après la chute du Colonel Khadafi et est devenue le point de passage de l’Afrique vers l’Europe, qu’en mer Égée, en raison de l’importance des réfugiés syriens de la guerre civile et des autres migrants venant de plus loin, y compris d’Afghanistan.
L’ampleur a été telle, avec, selon l’Organisation internationale pour les migrations, plus d’un million de migrants arrivés par la mer en Europe en 2015, et venant soit de Libye, soit d’Asie, notamment de Syrie, ou d’ailleurs en passant de la Turquie en Grèce, que d’importants moyens maritimes ont dû être déployés.
En Méditerranée centrale, la marine italienne a mis en œuvre en octobre 2013 l’opération Mare Nostrum, opération militaire décidée par le président du Conseil, Enrico Letta, à la suite du drame de Lampedusa, pour récupérer en mer les immigrés clandestins. En mer en effet, toute personne en difficulté devient un naufragé qu’il convient de secourir.
Elle a en partie été remplacée par l’opération Triton, opération de recherche et de sauvetage de l’agence européenne Frontex, lancé le 1er novembre 2014. Celle-ci intervient techniquement jusqu’à 138 milles nautiques de la Sicile et déploie jusqu’à quatre avions, un hélicoptère, six patrouilleurs, douze navires de moindre gabarit. Son budget a été triplé en avril 2015, pour atteindre 9 millions d’euros par mois. Pour sa part, la marine italienne poursuit aussi sa propre opération Mare Sicuro. Celle-ci a un triple objectif : lutter contre le terrorisme, contre les flux illégaux et protéger les intérêts (énergétiques) italiens, avec 5 navires et plusieurs sous-marins déployés au large des côtes libyennes pour protéger les 7 plateformes pétrolières du groupe ENI ; faire des opérations de sauvetage et jouer un rôle de dissuasion voire de renseignement.
En complément, le Conseil a approuvé le 18 mai 2005 une opération militaire PSDC visant à démanteler le modèle économique des réseaux de trafic de clandestins et de traite des êtres humains et le 22 juin l’opération EUNAVFOR MED-Sophia.
Après une première phase de simple surveillance et d’évaluation des réseaux, la deuxième phase a été lancée en octobre dernier qui permet la fouille et, si nécessaire, le déroutement des embarcations suspectes. Au total, neuf navires, dont cinq frégates, ont été déployés, sous commandement italien, par l’Italie, avec le porte-aéronefs Cavour, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et la France, avec le Courbet. Plusieurs aéronefs sont également déployés. Vingt-quatre États membres y contribuent. Selon un rapport semestriel présenté le 9 février, le premier bilan de la phase 2 de l’opération est le suivant : 9000 migrants sauvés, 70 embarcations neutralisées et 50 trafiquants arrêtés.
Pour ce qui concerne la mer Égée, en complément des opérations de l’Agence européenne Frontex, une mission d’appui de l’OTAN a été créée, à la suite d’une initiative conjointe de l’Allemagne et de la Turquie. Le 11 février dernier, les ministres alliés de la Défense ont fait droit à cette demande et décidé d’utiliser le 2ème groupe maritime permanent de l’OTAN (SNMG2) pour surveiller ces flux migratoires en coopération avec Frontex et les garde-côtes des deux pays. Les travaux se sont immédiatement portés sur les aspects opératoires de cette mission d’appui, notamment les nouvelles règles d’engagement. Le groupe maritime concerné, alors sous commandement allemand, comprenait un navire ravitailleur allemand et quatre frégates déployées par le Canada, la Grèce, l’Italie et la Turquie.
Les trafics d’êtres humains et les migrations illicites frappent également les autres mers et océans, en particulier dans les Caraïbes, mais relèvent de moyens plus légers, tels que ceux des garde-côtes aux États-Unis.
3. Les autres activités illégales et trafics illicites : drogues, armes et produits interdits
Chargé du suivi de la criminalité au niveau international, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime met en évidence dans ses différents rapports l’utilisation de la voie maritime. Établie par les administrations américaines, la carte suivante permet de visualiser l’importance de ces différentes routes maritimes par rapport aux routes terrestres pour les seuls trafics de drogue et d’êtres humains.
Carte des trafics maritime illicites
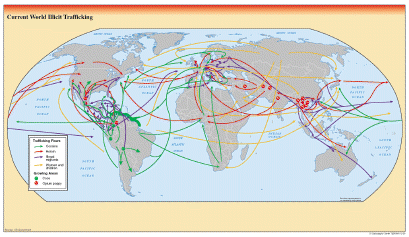
Il faut faire une mention à part à la pêche illégale, sans l’autorisation de l’État côtier, notamment, dans les espaces vides de l’océan Indien et du Pacifique.
II. UNE GÉOPOLITIQUE MARITIME EN MOUVEMENT
A. LA REDISTRIBUTION DES PUISSANCES MILITAIRES NAVALES
1. Les termes de la suprématie américaine
La liberté des mers est garantie par la marine américaine, l’US Navy, dont le tonnage, supérieur à 3 millions de tonnes, à raison de 430 navires environ, dépasse de très loin celui des deux marines suivantes, la marine russe et la chinoise.
Avec 14 sous-marins nucléaires lance-engins, 54 sous-marins d’attaque, et 10 porte-avions, notamment, elle surclasse en capacité toutes les autres. Son budget annuel est de l’ordre de 140 milliards de dollars, auxquels s’ajoutent 25 milliards pour le corps des marines. C’est plus de deux fois le budget de la défense russe et du même ordre de grandeur que le budget de la défense chinois.
L’US Navy bénéficie de points d’appui essentiels dans le monde qui assurent sa présence non seulement dans le Pacifique, avec notamment la base de Guam et celle d’Okinawa, et dans l’Atlantique, mais aussi dans l’océan indien grâce notamment à la base de Diego Garcia, louée au Royaume-Uni, au cœur de l’archipel des Chagos qui constitue le British Indian Ocean Territory (BIOT). Les États-Unis ont également une base à Djibouti, qui a été ouverte pour la lutte contre la piraterie dans l’ancien établissement français de camp Lemonnier.
Présentée dans le cadre des documents budgétaires publics sur le site de Internet de l’US Navy, la carte suivante montre le déploiement actuel et ses points d’appui face aux menaces ou aux éléments appelant une vigilance.
Points d’appui de la marine américaine
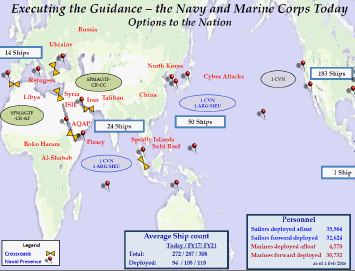
Source : US Navy
L’US Navy a opéré un grand effort d’efficacité, puisque le nombre total de navire a fortement diminué depuis 20 ans, passant de 450 à 272 navires, alors que le nombre de vaisseaux déployés est resté dans le même ordre de grandeur, passant de 108 à 92. Corrélativement, le nombre de jours déployé en mer s’est accru. C’est ce qu’indique le diagramme suivant.
Nombre de navires total, nombre déployé et durée des missions
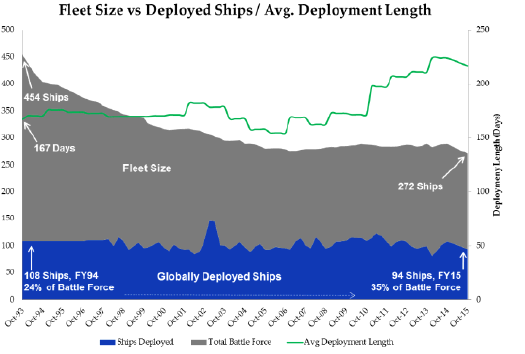
Source : US Navy
La répartition de la flotte américaine a été modifiée dans le cadre du « pivot » ou du rééquilibrage vers l’Asie, annoncé par le président Obama, puis la Secrétaire d’État Hilary Clinton en novembre 2011, avec l’objectif d’une concentration de près des deux-tiers de la flotte dans la zone Asie-Pacifique en 2020.
2. Le développement rapide et spectaculaire de la marine chinoise, et la course aux armements en Extrême-Orient
a. La marine chinoise : l’acquisition rapide de capacités de haute mer
Lors de son entretien avec les rapporteurs, le chef d’état-major de la marine, l’amiral Bernard Rogel, a indiqué combien chacun de ses homologues pouvait envier son collègue chinois, compte tenu du nombre de navires dont il reçoit chaque année livraison.
Le développement de la marine chinoise, qui cesse d’être une marine côtière, « d’eaux jaunes », pour devenir un véritable marine de haute mer, « d’eaux bleues », est en effet spectaculaire. Il est lié à un budget de défense dont il est estimé qu’il a quadruplé en dix ans.
C’est le fruit d’une véritable révolution stratégique. De 1949, jusqu’aux années 1980, la stratégie maritime de la République populaire de Chine a été défensive, orientée vers la protection de ses côtes vis-à-vis d’une possible invasion. Ensuite, en parallèle d’ailleurs avec les premières réformes économiques et la création des zones économiques spéciales, et la transition a été opérée vers une doctrine de « défense active des mers proches », c’est-à-dire de la mer de Chine jusqu’aux archipels qui la bordent, du Japon jusqu’aux Philippines.
La Chine évolue maintenant vers une nouvelle stratégie, celle des opérations dans les mers plus lointaines, dans le Pacifique et aussi dans l’Océan indien. C’est clairement le complément, comme l’a observé Mme Valérie Niquet, à la stratégie commerciale du « collier de perles » et la branche maritime de la « Nouvelle route de la Soie » avec des points d’appui entre Singapour et l’Afrique, notamment au Sri Lanka et au Pakistan.
Publiée en mai 2015, la stratégie militaire de la Chine mentionne la nécessité de développer une marine moderne à la mesure de ses intérêts et de sa sécurité, de la préservation de sa souveraineté et de ses droits et intérêts maritimes, ainsi que la protection des intérêts de sécurité outre-mer pour l’accès à l’énergie et aux autres ressources, la protection des lignes de communication maritimes, la protection des ressortissants et des intérêts économiques chinois à l’étranger .
Il est fait état de l’attention portée par la marine chinoise à la projection de puissance et de la capacité de protéger en haute mer. Sur le plan opérationnel, il est insisté sur le niveau de préparation militaire et l’entraînement pour y parvenir. En novembre dernier, la construction d’une base chinoise à Djibouti a été annoncée, à proximité du port. Elle s’ajoutera aux bases française, américaine et japonaise.
Les trois flottes, celle de la Mer de l’Est (Shanghaï) celle du Sud (Zhanjiang) et celle du Nord (Qingdao) sont en voie de modernisation rapide.
Les constats des différents interlocuteurs de la mission, notamment l’amiral Bernard Rogel et Mme Valérie Niquet, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, sont corroborés de manière très précise par les données et les chiffres mentionnés dans l’étude du service de recherche du Congrès américain, qui vient d’être publiée (Congressional Research Service – China Naval Modernisation : implications for U.S. Naval Capabilities – Background and Issue for Congress, par M. Ronald O’Rourke, spécialiste des questions navales – 21 décembre 2015).
Les tableaux de synthèse, établis à partir des données de l’Office de renseignement naval (Office of Naval Intelligence – ONI) dans le cadre de son rapport 2013 et du rapport annuel au Congrès du Département de la Défense, montrent en effet que la marine chinoise détient environ 300 navires de combat.
La progression du nombre d’unités à l’horizon 2020 est estimée par l’ONI spectaculaire pour les frégates, passant de 49 en 2010 à 54-58 unités en 2020, ainsi que pour les sous-marins nucléaires lance-engins, passant de 3 en 2010, à 4 ou 5 en 2020.
Les chiffres des mises à l’eau sont encore plus importants, car la mise en service des nouvelles unités s’accompagne du retrait d’unités plus anciennes. Dans l’ensemble, ce sont environ 15 unités qui sont mises à l’eau chaque année.
L’ONI estime ainsi que pour les sous-marins d’attaque, à propulsion nucléaire, comme à propulsion classique (diesel), les destroyers et les frégates, le taux des unités moderne aura doublé en 2020, pour approcher ou atteindre 100 %.
Le tableau suivant récapitule ces éléments.
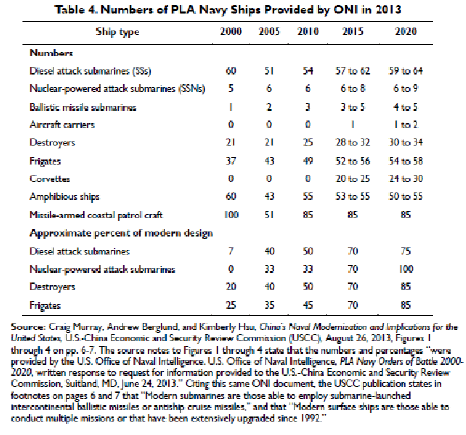
Plusieurs programmes sont emblématiques.
La construction d’un second porte-avions a été annoncée le 31 décembre dernier. Il s’agit d’un bâtiment de conception chinoise, alors que l’actuel Liaoning, a été construit il y a plus d’un quart de siècle en Union soviétique, inachevé et racheté en 1998 à l’armée ukrainienne. La mise en production en série de l’appareil embarqué J-15 a été annoncée en décembre 2014. Le 13 mai dernier, le développement d’un appareil à décollage vertical a été annoncé.
Les mises en service de frégates se font sauf exception au rythme de 3 à 4 unités par an, depuis le début de la décennie, et celles de destroyers sont de 2 ou 3 unités depuis 2013. Ce rythme est prévu pour se maintenir, avec même un pic de 5 unités programmées pour 2017.
Le nombre des sous-marins de conception moderne, de tous types, est passé de 31 en 2010, à 39 en 2014, et deux programmes de missiles anti-navire, l’un balistique, l’autre de croisière, sont en cours.
La recherche et développement porte surtout sur la conception de porte-avions, destroyers, corvettes et d’une certaine catégorie de navires amphibies.
En tonnage, la marine chinoise est la troisième du monde, juste derrière la flotte russe, s’approchant du million de tonnes.
La Chine a récemment fait la démonstration de la capacité de sa flotte à sortir de son environnement proche ou de ses routes commerciales. En effet, en septembre dernier, le Wall Street Journal a révélé que cinq navires militaires chinois – 3 frégates, 1 navire de débarquement et 1 autre de ravitaillement – croisaient moment en mer de Béring, à proximité des îles Aléoutiennes, situées au sud-ouest de l’Alaska et sous souveraineté américaine en même temps qu’une visite du président Obama en Alaska et dans les jours qui ont précédé la visite officielle du président Xi Jinping aux États-Unis.
Le développement de la marine chinoise ne peut être mentionné sans faire référence aux actuelles tensions en Mer de Chine, dues aux revendications chinoises et mentionnées ci-après.
b. Les effets d’imitation des pays voisins en réaction aux risques d’hégémonie chinoise
Publié en avril 2015, la note établie par l’Institut de recherche sur la paix du (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) a montré la croissance des dépenses militaires dans la zone Asie-Pacifique.
Dans un note plus détaillée du 7 mai 2015 (Zachary Abuza, Analyzing Southeast Asia’s Military Expenditures), le Centre pour les études internationales et stratégiques (Center for International & Strategic Studies – CSIS), relève que les pays voisins de la Chine accroissent tous leurs budgets de défense : les Philippines, la Malaisie, le Vietnam, et surtout l’Indonésie, avec un plan de 15 milliards de dollars supplémentaires d’ici 2020, destiné à doubler l’effort de défense de 0,8 % à 1,5 % du PIB.
Le Japon notamment n’est pas resté inerte face à la progression de la puissance chinoise. Cantonnées dans un strict rôle défensif depuis la défaite de 1945, les forces d’auto-défense japonaises ont vu leur rôle accru en septembre dernier, dans le cadre d’une nouvelle interprétation de la Constitution, qui leur permet d’intervenir à l’extérieur dans le cadre d’opération de légitime défense collective, c’est-à-dire conjointement avec leurs alliés. La stratégie de défense japonaise met d’ailleurs toujours au premier plan l’alliance avec les États-Unis.
Avec 42 milliards de dollars, le budget de la défense est en hausse de 2 %, dans la continuité de sa remontée depuis 2012. L’acquisition de moyens nouveaux a été annoncée, notamment six avions furtifs F 35, des avions et hélicoptères de patrouille et de surveillance maritime, ainsi que deux destroyers équipées du système de défense anti-missile Aegis.
La marine japonaise est actuellement la quatrième du monde, avec 450 000 tonnes, selon les estimations courantes, et le lancement du premier de deux destroyers porte-hélicoptères prévu, l’Izumo, de 19 500 tonnes, en mai 2015, a rappelé sa modernisation. Il s’ajoute aux trois porte-hélicoptères d’assaut de 8 500 tonnes.
Un effort substantiel intervient également sur les sous-marins d’attaque, dont le nombre devrait passer de 16 à 22, et sur les forces amphibies.
En outre, il a modifié en 2014, avec les États-Unis ses règles internes pour être en mesure d’exporter des armements.
Plus éloignée, mais néanmoins consciente des enjeux géopolitiques, l’Australie a publié en février dernier son troisième Livre blanc en 7 ans, lequel prévoit de relever substantiellement l’effort de défense, qui passerait de 21 milliards d’euros à 38 milliards à l’horizon 2025-2026, et s’établirait au-delà de 2 % du PIB. L’effort est prévu pour porter principalement sur les forces navales, avec l’acquisition de sous-marins d’attaque, de frégates, de destroyers, de patrouilleurs, ainsi que d’avions de surveillance maritime.
Sur les sous-marins, l’Australie a conclu avec DCNS en avril dernier un contrat pour 12 unités pour remplacer 6 unités datant des années 1990. Le contrat porte sur un montant total estimé à 34 milliards d’euros, selon les informations publiées.
Le Viet Nam vient pour sa part de bénéficier de la décision des États-Unis de lever l’embargo sur les exportations d’armes, décision annoncée le 23 mai à Hanoï par le président Obama lors de sa visite officielle.
Enfin, comme l’a observé Mme Valérie Niquet lors de son audition, l’Inde suit avec une grande attention les initiatives de la Chine.
3. Le retour de la marine russe
Avec près de 850 000 tonnes en 2014, dont 13 sous-marins nucléaires lance-engins, 31 sous-marins nucléaires d’attaque, et porte-avions, la marine russe est la deuxième du monde.
Avec l’objectif plus ou moins affiché et plus ou moins réaliste de retrouver un niveau similaire à celui qu’elle avait durant la période soviétique, elle a opéré un important effort de modernisation depuis le début de la décennie.
Initialement, le plan d’État 2011-2020 pour la défense, a programmé environ 500 milliards d’euros pour la modernisation de ses forces armées, dont environ 120 milliards pour ses forces navales, parmi lesquels 56 milliards pour la construction de nouvelles unités.
Il a prévu de doter les forces navales russes de surface de 54 nouveaux bâtiments de surface, à raison de 20 frégates, 20 corvettes, 10 patrouilleurs lance-missiles et 4 grands bâtiments amphibies, ainsi que 96 bâtiments de soutien, de 2 avions et de 54 hélicoptères. Fin 2013, 41 bâtiments de surface avaient été commandés, parmi lesquels les deux BPC de type Mistral commandés à la France et dont le contrat a finalement été annulé l’an dernier.
La modernisation de 65 bâtiments de combat et 74 navires de soutien alors en service, dont le porte-aéronefs Amiral Kouznetsov, a été programmée, avec le remplacement des avions embarqués Su-33 par des MiG-29K/KUB, de 4ème génération. Pour les brise-glace, une flotte de 40 unités à propulsion nucléaire est prévue.
En ce qui concerne les forces sous-marines, 8 sous-marins stratégiques, 7 sous-marins multi-rôle et 6 à 10 sous-marin à propulsion classique (diesel ou électrique) sont prévus.
Il a été révélé le 28 janvier 2014, que les sous-marins russes allaient être recouverts d’un nouveau revêtement pour améliorer leur furtivité.
La réalisation de ce programme s’est heurté à différentes difficultés d’ordre technique et financiers, d’abord en raison des sanctions et ensuite en raison de la chute des cours du pétrole, et ainsi du gaz naturel.
La priorité a été donnée aux sous-marins, aux sous-marins nucléaires lance-engins comme aux sous-marins d’attaque, puis à la défense côtière, reportant d’autant l’acquisition de capacités de haute mer et de projection. Ainsi, le porte-avions de grand tonnage a été annoncé pour après 2030 et les premiers destroyers lourds à propulsion nucléaire pour le milieu de la prochaine décennie.
Les capacités russes ne doivent en aucun cas être sous-estimées, comme le montre le tir de plusieurs missiles de croisière sur le théâtre syrien, en octobre dernier, à partir d’un vaisseau basé dans la Mer caspienne. L’objectif était uniquement de faire une démonstration des capacités techniques, car les besoins opérationnels en Syrie n’exigeaient pas une telle opération.
4. Le rétablissement capacitaire programmé du Royaume-Uni
Avant la Première guerre mondiale, le Royaume-Uni fixait ses capacités navales militaires conformément au Naval Defence Act de 1889 prévoyant le critère du « two-power standard », selon lequel l’armement global devait être au moins égal à la somme des deuxième et troisième puissances navales réunies.
La situation a profondément changé. Après la révision de 2010 et les réductions budgétaires, avec un budget de la défense diminuant de 8 %, la marine britannique a connu une forte régression.
De 2010 à 2015, la Royal Navy a connu une baisse de 33 % de ses porte-avions et navires amphibies et de 17 % de ses frégates et destroyers.
Après le retrait des avions Harrier en 2010, il a également été prévu une période d’au moins dix années sans aviation embarquée. C’est une rupture capacitaire d’autant plus marquée que le pays n’a plus d’avion patrouilleur maritime.
En définitive, le recul a été tel que l’ensemble de la flotte est inférieur à celle qui a été déployée en 1982 pour reprendre la Géorgie du Sud et les Malouines à l’Argentine.
Un changement complet d’orientation vient d’intervenir. Comme l’a confirmé lors du déplacement de la mission à Londres, l’Amiral Hine (1), Assistant Chief of the Naval Staff, en poste à l’état-major de la Marine, la révision opérée en 2015 de la stratégie de défense et de sécurité du Royaume-Uni (Strategic Defence and Security Review 2015 ou SDSR 2015) a été un succès pour la marine britannique, la Royal Navy. Certains commentateurs extérieurs ont considéré que le pays revenait ainsi dans la course. Le First Sea Lord , Sir George Zambellas, a qualifié le résultat de nouveau départ.
Dans le cadre d’un programme d’équipement de 178 milliards de livres sterling sur dix ans, et d’un relèvement du budget de la défense de 0,5 point au-dessus de l’inflation, les deux porte-avions ont été confirmés et la capacité opérationnelle du premier d’entre eux, le HMS Queen Elizabeth, l’a été pour 2020. Les patrouilleurs actuels vont être remplacés, avec un objectif d’au moins six unités en service, contre trois actuellement. Le renouvellement des sous-marins nucléaires stratégiques est programmé pour une entrée en service du premier dans les premières années de la décennie 2030. La Royal Navy prévoit d’armer dix-neuf frégates et destroyers. Huit unités de la nouvelle frégate de type 26 vont être construites, contre treize initialement prévu, avec une entrée en service au milieu de la prochaine décennie, mais, en contrepartie, un nouveau type semblable plus léger va être conçu selon le même schéma que pour la frégate de taille intermédiaire (FTI) française. Les hélicoptères vont continuer à être modernisés. Différents navires de soutien, notamment les ravitailleurs, sont confirmés. Les effectifs sont prévus pour être accrus, notamment ceux basés à Gibraltar.
5. L’incertitude sur le maintien de la supériorité technologique occidentale
Le développement des capacités militaires maritimes russes et chinoises repose non pas sur des acquisitions à l’étranger, mais sur des constructions nationales au sein des chantiers navals du pays.
Les nouvelles productions, les nouveaux projets et les mises en chantier permettent ainsi de constater l’écart technologique avec les pays occidentaux.
Constatant la réduction de cet écart, non seulement dans la marine, mais également dans les autres secteurs de la défense, le Secrétaire à la Défense, M. Chuck Hagel a annoncé en novembre 2014 une initiative pour l’innovation en matière de défense (Defense Innovation Initiative), et d’un point de vue opératoire, le département de la défense (Department of Defense – DoD) y a associé la stratégie du troisième offset (Third Offset Strategy) pour le maintien de la supériorité américaine et plus largement, de leurs alliés, en particulier ceux de l’OTAN.
Le 10 février dernier, l’Institut international pour les études stratégiques (International Institute for Strategic Studies - IISS), basé à Londres, a publié des conclusions qui vont dans le même sens, et sont préoccupantes à deux titres.
D’abord, la supériorité technologique s’érode clairement face aux deux acteurs majeurs que sont la Chine et la Russie, en particulier dans les nouveaux domaines de la cybersécurité et de la cyberdéfense, ainsi que des drones.
Ensuite, les groupes non étatiques bénéficient d’un accès très facile à certaines technologies, ce qui leur permet de mener avec davantage d’efficacité leurs actions terroristes et leurs stratégies de guerre asymétrique ou de guerre hybride.
En matière maritime, il faut aussi veiller à ce que cet écart ne se réduise pas dans des proportions préjudiciables.
B. L’OUVERTURE ANNONCÉE DE L’ARCTIQUE : DES TENSIONS SANS HEURT MAJEUR, MAIS QUI SOULÈVENT PLUSIEURS QUESTIONS IMPORTANTES DE DROIT MARITIME
1. Des enjeux réels, bien que de faible intensité pour l’instant
Sans qu’il soit nécessaire d’y consacrer d’importants développements, puisque le sujet a été récemment traité par le rapport d’information n° 2704 présenté le 8 avril 2015, par MM. Hervé Gaymard et Noël Mamère, députés, en conclusion d’une mission d’information sur les enjeux écologiques, économiques et géopolitiques du changement climatique en Arctique et en Antarctique, il faut rappeler que le recul de la banquise autour du pôle Nord ouvre des perspectives et, comme l’ont si bien exprimé nos collègues, « des appétits ».
L’exploitation économique à grande échelle de cette zone par essence fragile, souvent annoncée, n’apparaît cependant pas imminente pour trois raisons.
D’abord, les conditions climatiques y restent très rudes, les vents violents et la mer agitée, et les solutions techniques à mettre en œuvre pour exploiter les ressources naturelles sont particulièrement coûteuses.
Le récent effondrement des prix du pétrole, passés en deux ans de 100 dollars le baril à un peu plus de 30 dollars avant de remonter autour de 50 dollars au moment de la rédaction du présent rapport, rappelle, qu’une fois passées les grandes vagues spéculatives qui peuvent propulser cette matière première vers des sommets temporaires, les prix de long terme ne sont pas compatibles avec de tels projets extrêmes.
On a d’ailleurs assisté, sur un plan plus général, à une forte baisse de l’ensemble des prix de matières premières depuis trois ans, à la suite du retour à une vision plus réaliste des perspectives de l’expansion économique de la Chine.
Ensuite, l’activité la plus aisée, qui est la pêche, reste assez marginale, malgré une certaine expansion. Les ressources sont mal connues, sauf près des accès de l’océan glacial, où les pratiques de pêche sont anciennes, et la présence de glaces dérivantes pose des problèmes techniques majeurs.
L’approche des pays riverains reste prudente. En juillet 2015, les pays du Conseil de l’Arctique, les États-Unis, la Russie, le Danemark, l’Islande, le Canada, la Norvège, la Finlande et la Suède ont interdit la pêche dans les eaux neutres de l’Arctique dans la zone de fonte des glaces.
Par ailleurs, sur l’initiative de Greenpeace, plusieurs entreprises commerciales viennent de souscrire à un accord de limitation dans les eaux du Spitzberg.
Il gèle les aires de pêche au chalut autour du Svalbard (Spitzberg) et exige avant toute ouverture de nouvelles zones une cartographie précise de leurs fonds marins afin de déterminer leur fragilité.
Il a été paraphé par les organisations professionnelles des deux flottes dominantes de la région, Fiskebåt pour la Norvège et Karat pour la Russie, et a été signé par deux grands groupes de transformation du poisson européens, le danois Espersen et le britannique Young’s Seafood, ainsi que par la chaîne américaine de restauration rapide McDonald’s et les enseignes de distribution britanniques Tesco, Sainsbury’s et Marks and Spencer.
Enfin, pour ce qui concerne le gain de temps permis par les deux voies de passage des ports de l’Europe vers l’Asie, et plus généralement des ports de l’Atlantique Nord vers ceux du Pacifique, il est réel dans toutes les hypothèses, mais il doit être mis en balance avec des conditions de navigation particulièrement difficiles dans la zone concernée.
Le tableau suivant, présenté dans le cadre du rapport précité, met très précisément en évidence les réductions de trajet entre les grands ports.
Exemples de distances entre les ports de l’hémisphère nord selon la route choisie
(en km)
Par le canal de Panama |
Par le passage du Nord-Ouest |
Par le passage du Nord-Est |
Par le canal de Suez et le détroit de Malacca | |
Rotterdam-Singapour |
28 994 |
19 900 |
19 641 |
15 950 |
Rotterdam-Shanghai |
25 588 |
16 100 |
15 793 |
19 550 |
Rotterdam-Vancouver |
16 350 |
14 330 |
13 200 |
28 400 |
Rotterdam-Los Angeles |
14 490 |
15 120 |
15 552 |
29 750 |
New York-Shanghai |
20 880 |
17 030 |
19 893 |
22 930 |
New York-Hongkong |
21 260 |
18 140 |
20 985 |
21 570 |
New York-Singapour |
23 580 |
19 540 |
23 121 |
19 320 |
Source : données extraites de « Géopolitiques arctiques : pétrole et routes maritimes au cœur des rivalités régionales ? », par Frédéric Lasserre, in Critique internationale, 2010/4 (n° 49) in rapport précité n° 2704 de MM. Hervé Gaymard et Noël Mamère, députés.
Comme observé dans le rapport précité, « le passage du Nord-Est est effectivement plus court pour les liaisons entre l’Europe du nord (Rotterdam) et la plupart des ports du Pacifique, que ce soit du côté asiatique ou du côté nord-américain. Pour la Chine (Shanghai), le gain est de l’ordre de 4 000 kilomètres, soit 20 %, par rapport à la route classique par Suez et Singapour. Le passage du Nord-Ouest est également susceptible de réduire d’environ 3 000 kilomètres, soit 15 %, la route entre le nord-est des États-Unis (New-York) et la Chine ».
L’économie des droits de passage actuellement acquittés pour le canal de Panama et celui de Suez doit, en outre, être prise en compte.
En tout état de cause, les perspectives restent éloignées, car le trafic demeure en l’état des plus modestes avec pour le passage du Nord-Est, au Nord de la Russie 71 en 2013 et 28en 2014, à rapprocher des quelques 50 navires par jour qui passent par le Canal de Suez.
2. Un dialogue entre riverains, et même au-delà, au sein du Conseil de l’Arctique
a. Un dialogue essentiel même si limité
Le Conseil de l’Arctique est issu de l’idée exprimée par M. Michael Gorbatchev, alors secrétaire général du parti communiste de l’Union soviétique, à l’occasion d’un discours dans lequel il souhaitait la création d’une vraie « zone de paix et de coopération fructueuse » entre les États de l’Arctique.
En 1991, a ainsi été définie une stratégie de protection de l’environnement arctique (SPEA) par les huit pays arctiques, à savoir les cinq riverains de l’océan glacial (les États-Unis, la Russie, le Canada, le Danemark et la Norvège) et les trois États relevant de la zone arctique (la Suède, la Finlande et l’Islande).
C’est ultérieurement qu’a été établi en 1996, par la déclaration d’Ottawa, le Conseil de l’Arctique (Arctic Council), forum intergouvernemental visant à promouvoir la coopération, la coordination et l’interaction entre les États arctiques sur des sujets communs, et en particulier sur le développement durable et la sauvegarde de l’environnement arctique. La déclaration d’Ottawa a été signée par les huit États arctiques. Elle prévoit la participation des différentes communautés représentant les peuples premiers et les habitants de l’Arctique.
L’Arctique étant bordé par les très grandes puissances, c’est une instance de dialogue essentielle, mais les questions politiques de fond n’y sont pas abordées.
Plusieurs États non arctiques mais y ayant des intérêts y sont associés avec le statut d’observateur permanent.
La France bénéficie de ce statut depuis 2000, de même que les Pays-Bas, la Pologne, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni.
Puis, selon l’expression de M. Michel Rocard, ambassadeur chargé des négociations internationales pour les pôles arctique et antarctique, le Conseil s’est élargi aux « usagers de l’Arctique » et c’est ainsi qu’en 2013, la Chine, l’Inde, l’Italie, le Japon, la République de Corée et Singapour ont obtenu le statut d’État observateur.
Il faut mentionner cependant une limite importante, soulignée par S. E. M. Alain Leroy, secrétaire général du Service européen d’action extérieure : l’Union européenne n’a pas encore le statut d’observateur permanent au Conseil arctique, en raison d’oppositions.
En 2013, sa candidature a été accueillie de manière certes affirmative, mais dans l’attente d’une décision finale.
Celle du Canada est en principe levée, même s’il a été confirmé lors de l’entretien qu’il a bien voulu accorder à la mission par S.E. M. Lawrence Cannon, ambassadeur du Canada en France qu’il reste des traces d’un manque de sensibilité passé de la Communauté européenne vis-à-vis d’activités traditionnelles exercées par certaines des Premières nations. La question centrale a été celle de la commercialisation des produits dérivés du phoque.
La Russie est maintenant identifiée comme le point de blocage.
Pour ce qui concerne son fonctionnement et ses résultats, le Conseil de l’Arctique est estimé par M. Michel Rocard comme perfectible par rapport à la gouvernance internationale en place pour l’Antarctique.
b. Le modèle de l’Antarctique en contrepoint
L’Antarctique a fait l’objet de revendications territoriales dès avant la Première guerre mondiale, mais c’est dans l’Entre-deux-guerres que celles-ci se sont manifestées, les progrès techniques favorisant les expéditions et permettant l’établissement de bases scientifiques. Le Royaume-Uni, déjà solidement établi dans les mers australes, et après leur émancipation, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que l’Argentine et le Chili, en raison de leur proximité, la France, en raison de la découverte de Terre-Adélie dès 1840 et la Norvège, pour ses intérêts baleiniers, ont manifesté leur intérêt.
Après la Seconde guerre mondiale, les revendications ont continué à s’exprimer sans trouver de solution, notamment en raison de leur recoupement, recoupement d’autant plus paradoxal qu’une large part du continent n’était revendiquée par personne. Mais c’est surtout l’intérêt scientifique du continent qui a prévalu, avec parfois des arrière-pensées militaires dans le contexte de l’époque de la recherche des armes nouvelles. Durant l’Année géophysique internationale, de juillet 57 à décembre 58, 12 pays ont réalisé un très grand nombre d’observations géophysiques en installant 40 bases sur le continent et 20 bases sur les îles. À la suite de contacts directs entre les autorités des États-Unis et celles d’Union soviétique, et pour éviter que le continent ne soit l’objet de tensions et ne puisse servir à l’établissement de bases militaires, le traité sur l’Antarctique a été conclu en 1959. Il a été signé à l’origine par douze pays : l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Chili, les États-Unis, le France, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l’URSS dont le successeur actuel est la Russie, et le Royaume-Uni. Il est entré en vigueur en 1961. Actuellement, il a été ratifié par 53 pays. Il est articulé selon quatre éléments :
– le gel des revendications territoriales, qui restent en l’état ;
– l’autorisation des seules activités pacifiques et la démilitarisation du continent, avec l’interdiction de mesures militaires comme du déploiement et d’essai d’armes de toutes sortes, y compris d'armes nucléaires. Sont également interdits l’établissement de bases militaires, ainsi que toute explosion nucléaire et l’élimination de déchets radioactifs ;
– la liberté de la recherche scientifique et la coopération avec notamment l’échange et la diffusion des observations et les résultats scientifiques de l’Antarctique seront échangés et rendus librement disponibles ;
– l’absence de frontières et un système d’inspection ouvert à toutes les parties du traité.
Le traité sur l’Antarctique a donné lieu à deux conventions et un protocole :
– la convention de Londres de 1972 pour la protection des phoques de l’Antarctique ;
– la Convention de 1982 sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique ;
– le protocole de Madrid, du 4 octobre 1991, relatif à la protection de l’environnement, entré en vigueur en 1998, organisant la protection d’ensemble de l’environnement et des écosystèmes dépendants associés. L’Antarctique est désigné comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science. Des mesures rigoureuses de conservation et de gestion de l’environnement sont prévues. Il s’agissait, notamment sur l’initiative du Gouvernement français, de faire échec au projet de Wellington permettant une mise en exploitation du continent.
La gouvernance est assurée par la réunion consultative du traité de l’Antarctique (RCTA), qui comprend les parties dites consultatives (les douze premiers signataires et les dix-sept pays qui ont ultérieurement adhéré au traité et mènent des activités scientifiques sur le continent), qui participent aux délibérations, ainsi que les vingt-quatre parties dites non consultatives, qui ne prennent pas part aux délibérations.
En outre, y participent comme observateurs le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR), la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) et le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux (COMNAP) et des experts. La RCTA tient une session par an, d’une semaine.
3. La question du statut des passages maritimes du Nord-Est et du Nord-Ouest : eaux intérieures ou détroits
Les deux États riverains des passages par le Nord de l’Atlantique vers le Pacifique ont soulevé la question de l’interprétation des dispositions de la CNUDM relatives à la ligne de base.
C’est une question essentielle, car en dépend le statut des eaux qui forment les routes maritimes des passages du Nord-Ouest et du Nord-Est, et par conséquent la faculté pour l’État riverain, d’une part, de contrôler la navigation, voire de l’interdire et, d’autre part, de percevoir, ou non, un droit de passage. S’il ne peut être perçu de droit sur un navire étranger au titre du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, aucune disposition ne l’exclut pour les eaux intérieures.
Du point de vue de la géographie, l’article 7 de la CNUDM précise, en effet, que : « là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base ».
On peut donc s’écarter de la côte en présence d’îles côtières et tracer ainsi une ligne de base fondée sur des « points appropriés ».
Le Canada estime ainsi que le passage du Nord-Ouest est formé d’eaux intérieures, où sa souveraineté s’exerce et où il dispose d’un droit inconditionnel de règlementation. Il revendique ainsi le droit de contrôler et éventuellement refuser le passage de tout navire étranger. Il invoque à l’appui de ses positions des éléments historiques. En 1970, le Canada a ainsi promulgué la loi pour la prévention de la pollution des eaux de l’Arctique, qui a étendu sa mer territoriale de trois à douze milles nautiques, et qui permet au gouvernement canadien de définir les normes des navires qu’il autorise à accéder aux eaux arctiques sur une profondeur de 100 milles nautiques.
Depuis 1982, il invoque aussi l’article 234 de la CNUDM qui précise que, dans des mers recouvertes de banquise, les États peuvent adopter unilatéralement des règlements particuliers non discriminatoires, dans la limite de leur ZEE, afin de réglementer le trafic maritime et dans le but de prévenir toute pollution marine. Il ne concerne cependant pas les navires de guerre, qui relèvent des immunités prévues à l’article 236, vis-à-vis des règles de protection de l’environnement.
L’archipel et leurs eaux représentent 3,9 millions de kilomètres carrés.
Deux traversées ont marqué l’histoire récente de ce passage : celle du pétrolier américain Manhattan, en 1969 ; celle du brise-glace Polar Sea sans demande d’autorisation au gouvernement canadien, en août 1985.
Pour sa part, la Russie développe les mêmes approches que le Canada.
D’abord, comme le montre la carte suivante, il fixe ses lignes de base de manière à inclure dans ses eaux intérieures plusieurs détroits entre la Sibérie et les îles de l’océan Arctique : Nouvelle-Zemble, Terre du Nord et Nouvelle-Sibérie.
Les lignes de base du Canada et de la Russie dans l’Arctique
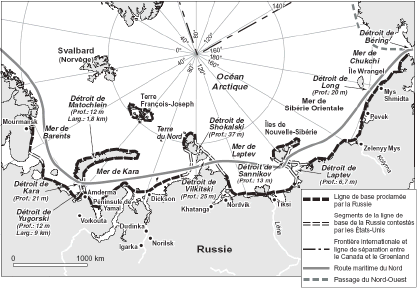
Source : Frédéric Lassere – Université de Laval - Québec
D’autre part, il invoque aussi le droit de réglementer la navigation dans leurs ZEE, pour des motifs de protection de l’environnement, sur le fondement de l’article 234 de la convention qui le prévoit cette possibilité spécifiquement pour les zones recouvertes par les glaces.
La plupart des autres pays, dont la France et les État-Unis ne reconnaissent pas totalement le tracé de telles lignes de base et donc la revendication du statut d’eaux intérieures qui en découle.
Le 3 de l’article 7 prévoit en effet que le tracé des lignes de base ne s’éloignera pas de manière appréciable de la direction générale de la côte.
C’est le statut des détroits internationaux, avec droit de passage en transit sans aucune entrave, qui doit s’appliquer, conformément à l’article 38 de la convention.
En 1988, le Canada et les États-Unis ont conclu un accord par lequel les seconds se sont engagés à demander l’autorisation de passage avant chaque traversée. Celle-ci n’est jamais refusée. Ils n’ont pas pour autant reconnu les positions juridiques du Canada.
4. Les revendications, notamment de la Russie, sur le plateau continental et la question de la nature de la dorsale de Lomonossov
L’Arctique soulève aussi de manière très complexe la question de la délimitation des autres zones maritimes prévues par la CNUDM.
Si la délimitation des mers territoriales et des ZEE a été opérée, avec quelques petits litiges persistants, mais sans grande friction, tel n’est pas le cas pour les éventuelles extensions du plateau continental.
La raison en est la présence de la dorsale de Lomonossov, chaîne sous-marine qui relie, en passant sous le pôle Nord, la Sibérie à une zone située à la jonction de l’archipel arctique canadien et du Groenland.
Son tracé est donné par le schéma suivant, et permet selon l’interprétation que l’on retient de la convention, d’alimenter les revendications de la Russie et du Canada, ainsi que du Danemark, au titre du Groenland.
L’Arctique central et la dorsale de Lomonossov
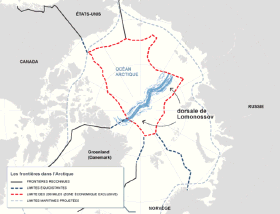
Source : Radio Canada
Sur le plan du droit, ce sont les paragraphes 5 et 6 de l’article 76 de la CNUDM qui sont concernés.
Si le paragraphe 5 permet dans certains cas l’extension du plateau continental au-delà de la ligne des 350 milles marins depuis la « ligne de base », cette limite des 350 milles est impérative dans le cas d’une extension « sur une dorsale sous-marine ».
La Russie revendique l’essentiel de la dorsale. En déposant en 2007, à plus de 4 000 mètres de profondeur, un drapeau russe à l’aplomb du pôle Nord, elle a voulu affirmer sa souveraineté tout en montrant sa capacité de réaliser un exploit technique.
C’est, dès 2001, qu’elle a formellement déposé sa demande à la CLPC. Dès 2002, cette dernière a demandé la recherche d’éléments supplémentaires et la révision de la demande. C’est ce qu’a fait la Russie en juillet dernier, avec une demande révisée portant sur une étendu sous-marine de 1,191 millions de kilomètres carrés, qui s’étend vers l’ouest sur une mince bande du bassin de Nansen finissant sur la délimitation maritime avec la Norvège, dans l’Arctique central le long de la dorsale de Lomonossov en englobant le pôle Nord géographique, et à l’Est dans la plaine abyssale des Tchouktches, le long de la dorsale de Mendeleïev. La carte en est la suivante.
Carte de la demande révisée d’extension du plateau continental par la Russie
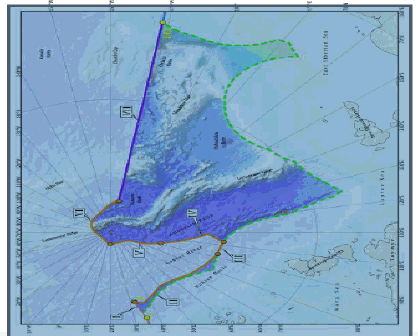
Le Canada et le Danemark ont fait une démarche similaire en 2013 et 2014. La carte suivante permet de visualiser la demande danoise.
La demande danoise d’extension du plateau continental du Groenland
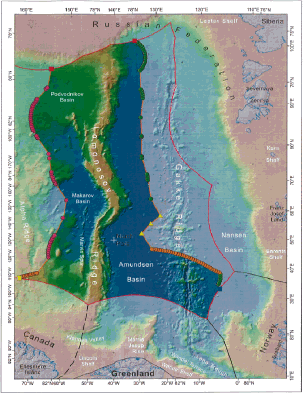
Source : Commission des limites du plateau continental, décembre 2014.
Selon les éléments recueillis lors de l’audition de S.E. M. Lawrence Cannon, ambassadeur du Canada en France, les éléments préliminaires ont seulement été déposés. Le dossier sera présenté ultérieurement.
La Norvège, en dépit de sa souveraineté sur l’archipel du Spitzberg (Svalbard), même si celle-ci est encadrée, s’est limitée à présenter en 2006, des demandes qui se situaient dans la limite de sa ZEE de 200 milles. Celles-ci ont été approuvées en 2009 par la CLPC.
Les États-Unis, riverains de l’Arctique par l’Alaska, sont dans une situation spécifique. Ils ont signé mais n’ont pas ratifié la convention de Montego Bay, en dépit de plusieurs prises de position favorables, notamment en sein des différentes Administrations successives, en raison de la réticence du Sénat vis-à-vis des instruments internationaux réputés entraver la souveraineté des États-Unis. Ils ne sont pas en situation d’en utiliser les outils et notamment de déposer une revendication à la CLPC.
Néanmoins vigilants sur leurs intérêts, ils ont estimé infondée la demande russe d’extension du plateau continental de 2001 en arguant que les dorsales de Lomonosov et de Mendeleïev seraient des dorsales « océaniques » séparées des continents et non des dorsales « sous-marines » susceptibles de fonder une revendication de plateau continental. Cet élément, s’il était confirmé, fragiliserait aussi les revendications canadiennes et danoises.
III. UNE SOURCE D’INQUIÉTUDE MAJEURE : LA TENSION EN MER DE CHINE
1. Un arrière-plan géographique, historique et géopolitique complexe
a. Une tension entre la Chine et ses voisins
La tension en mer de Chine est d’une gravité particulière, pour plusieurs raisons.
D’abord, elle concerne une puissance émergente en pleine ascension économique et politique, la Chine, et des puissances de moindre importance, dont l’une autrefois dominante, le Japon. En outre, pour la Chine, c’est le rétablissement d’une situation correspondant à des facteurs objectifs. Après une longue éclipse de presque deux siècles, elle retrouve le premier rang mondial. Historiquement, elle a subordonné l’ensemble de ses voisins par des liens de vassalité, d’une nature que le droit ne reconnaît cependant plus pour notre époque. Il convient aussi de relever que la première étape de son relèvement a consisté à mettre fin aux « traités inégaux » imposés par les puissances européennes, les États-Unis et aussi le Japon au XIXème siècle. Ensuite, les différends en mer de Chine portent sur deux archipels, le Spratleys et les Paracels, constitués d’îles et îlots, dont la nature et la consistance peuvent, habilement présentées, soulever d’importantes questions juridiques qui mettent directement en évidence les souplesses, failles ou imprécisions, selon le point de vue que l’on retient, du droit de la mer et des traités internationaux.
Il faut, là-encore, relever que l’attitude de la Chine est spontanément réservée vis-à-vis d’un droit international qui a été élaboré, de son point de vue, sous influence occidentale.
En outre, il faut rappeler qu’en arrière-plan, se trouve la question chinoise, c’est-à-dire la coexistence de deux Chine, la République populaire de Chine, et Taïwan, qui prétendent, toutes les deux, représenter la totalité du pays, sur le plan international, depuis 1949 et la défaite des armées du Kouo-Min-Tang et de Tchang Kai Check sur le continent.
Certes, chacun est puissamment armé, et Taïwan bénéficie de la garantie des États-Unis, mais la vision des grands enjeux territoriaux et maritime de l’ensemble de la Chine est sensiblement la même de part et d’autre du détroit de Formose tant que n’intervient aucune menace militaire de l’un contre l’autre.
Enfin, il faut rappeler la situation géographique particulière de la Chine, qui n’a accès à la mer libre qu’à travers une double ceinture, ou double chaîne, d’archipels.
D’abord, la mer de Chine est bordée par une double série d’archipels qui vont du Japon, qui est lui-même un archipel, jusqu’à l’Indonésie en passant par la Malaisie et les Philippines, ainsi que par Taïwan. L’accès à la mer des Philippines, située au-delà cette ceinture, est assez étroit. Le canal de Bashi est de moins de 200 kilomètres, au Sud de Taïwan, et l’archipel des Ryūkyū se prolonge plus au Sud que le Nord de Taïwan. Moins de 400 kilomètres séparent ainsi le point le plus méridional du Japon du point le plus septentrional des Philippines.
Ensuite, il y a à l’Est le second chapelet d’îles, lequel est constitué du Nord vers le Sud, par les Îles Mariannes, les Îles Carolines et les Îles de l’Amirauté. Cet ensemble délimite entre le Japon et la Papouasie-Nouvelle Guinée la bordure de la mer des Philippines. Une partie des Mariannes est sous le contrôle des États-Unis.
La carte suivante permet de visualiser ces éléments.
Les deux chapelets d’îles entre la Chine continentale et le Pacifique
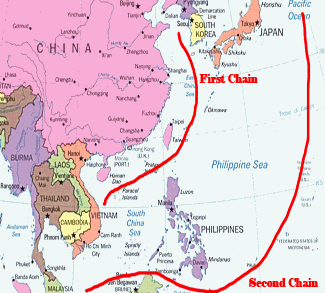
Source : Geopolitical Monitor
La Chine, qui dépend de plus en plus de ses approvisionnements extérieurs, notamment en hydrocarbures, se vit donc comme en situation potentiellement très difficile en cas d’embargo.
Sur le plan géopolitique, la Chine a également des relations difficiles avec ses voisins. La Guerre froide a légué une organisation, l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN), fondée à Bangkok en 1967 par cinq pays (Indonésie, Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande), pour éviter ce que l’on appelait à l’époque la subversion communiste, et éviter aussi dans une approche neutraliste d’être entraînés dans la guerre du Vietnam. Celle-ci s’est étendue ensuite au Vietnam en 1995, puis au Cambodge et au Laos. Elle regroupe maintenant tous les pays du flanc Sud de la Chine.
Avec le Viet Nam, les relations de la Chine restent marquées par les conflits allant de 1979 au début des années 1990.
Ainsi, comme l’a observé Mme Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, l’objectif de la Chine est de redonner sa juste place au pays, sur fond de rivalité régionale et même au-delà.
Ses voisins perçoivent par conséquent cet objectif comme une ambition hégémonique.
a. Une interprétation du droit de la mer extensive de la part de tous les pays riverains : le cas des lignes de base
Comme le relève M. Robert Beckman dans un article de janvier 2013 intitulé The UN Convention of the Law of the Sea and the maritime disputes in the South China Sea, publié par l’American Society of International Law, la conformité des lignes de base des différents pays riverains de la mer de Chine a été mise en doute par des tiers, notamment par les États-Unis. Des rectifications ont été opérées, mais elles ne semblent pas toujours conformes au droit. L’article mentionne cependant que les lignes de base établies selon les modalités prévues pour les États archipélagiques sont conformes au droit pour l’Indonésie et, depuis la révision de 2009, pour les Philippines.
En tout état de cause, il faut observer que la fixation des lignes de base ne fait pas l’objet de contestations entre les États riverains de la mer de Chine méridionale. Il y a donc un accord entre eux sur ce point.
Le principal enjeu est pour eux d’appliquer le plus loin possible le régime des eaux intérieures qui permet, comme on l’a vu, de règlementer le droit de passage des navires.
a. Des frontières maritimes encore imprécises
Comme l’indique l’article précité, les frontières maritimes restent encore imprécises en mer de Chine méridionale.
En 2009, la Malaisie et le Viet Nam ont précisé les limites extérieures de leur ZEE pour déposer leur demande d’extension du plateau continental, avant la date limite du 13 mai. Leur demande conjointe a été déposée le 6 mai.
Le lendemain, le 7 mai, le Viet Nam a déposé une demande séparée pour la partie Nord de la mer de Chine du Sud, qui la concerne seule.
La Chine et les Philippines ont protesté par notes verbales contre ces demandes, et ont demandé à la CLPC de ne pas les examiner en raison du différend territorial. Aucune instruction n’a donc été opérée.
En 2009, à l’occasion de la révision des lignes de base, les Philippines ont placé le récif de Scarborough et les îles revendiquées par elles sous le régime de l’article 121 de la CNUDM, relatif à la ZEE entourant les îles.
La Chine, de même que Taiwan, a revendiqué sa ZEE et l’extension du plateau continental. Cependant, en 1996, lorsque la Chine a publié ses lignes de base pour le continent, elle n’a pas publié de carte faisant indiquant la ZEE revendiquée. Taïwan a fait de même.
En 2012, la Chine a elle aussi déposé une demande d’extension du plateau continental « concernant une partie de la mer de Chine orientale », sans préjudice « aux futures demandes de la Chine sur le tracé de la limite extérieure du plateau continental de la mer de Chine orientale et autres mers ».
Tous ces dossiers sont, en l’état, gelés.
Le contentieux sur les archipels des Paracels et des Spratleys complique clairement la situation, mais celle-ci serait déjà difficile sans elles avec la nécessité de prévoir des délimitations bilatérales en nombre.
2. Deux questions séparées, l’une au Nord avec le Japon, l’autre au Sud, avec notamment les Philippines et le Vietnam, mais soulevant les mêmes questions
Au Nord, la Chine revendique les îles Diaoyu/Senkaku pour étendre sa ZEE, en reportant d’autant sa ligne de base à l’Est, selon un tracé simple.
Au Sud, elle revendique deux archipels, celui des Paracels et celui des Spratleys, et même si l’on voulait être très précis, quatre archipels, car chacun d’entre eux est lui-même divisé en deux sous-ensembles.
Le tracé des revendications chinoises au Sud est complexe. La Chine le présente en neuf traits accompagnant la note verbale N° CML/17/2009 adressée le 7 mai 2009 à l’ONU pour présenter officiellement ses demandes.
Ce tracé en neuf traits est alors défini comme la ligne médiane qui partage équitablement la mer entre les territoires insulaires et maritimes chinois et les autres États côtiers. En raison de sa forme, les autres riverains l’appellent la « langue de buffle ».
Les revendications chinoises en mer de Chine
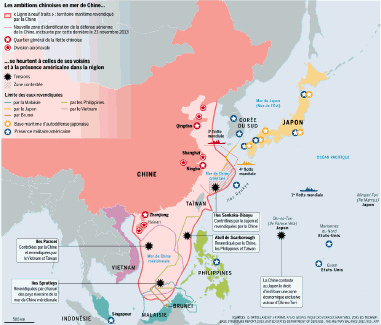
Source : mentionnée en légende
Ce tracé a fait l’objet d’une rectification non officielle avec la publication en janvier 2013, par Sinomap press, d’un nouveau tracé en dix traits, que la carte suivante récapitule.
La ligne en dix traits
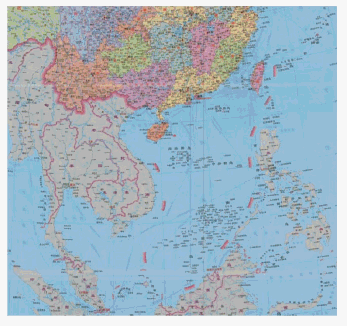
Source : Sinomap presse
Le différend avec le Japon est distinct de celui de la mer de Chine méridionale, au-delà du fait que le premier est purement bilatéral tandis que le second est multilatéral.
Trois éléments conduisent à ne pas les considérer comme totalement indépendants l’un vis-à-vis de l’autre.
D’une part, ils reposent sur la même démarche. S’appuyant notamment sur des éléments archéologiques qu’elle revendique mettre au jour, la Chine demande son rétablissement dans ses droits historiques. Elle le fait, éventuellement, à côté d’un droit international dont elle estime qu’il a été largement établi sans elle. De ce point de vue, la République populaire de Chine peut invoquer que ce n’est qu’à la fin de l’année 1971 qu’elle a été admise à représenter le pays à l’ONU.
Ensuite, chacun des conflits se traduit par des conflits relatifs à la présence de bateaux, souvent des navires de pêche, mais pas seulement, dans « des eaux traditionnellement chinoises » dans les zones contestées et par des incidents maritimes.
Cependant, dans l’ampleur et la portée de ces incidents, la Chine a la maîtrise du jeu. Elle peut parfaitement opérer par bascule en déportant la tension d’un point à l’autre, sachant qu’elle n’aura face à elle ni les mêmes pays, ni non plus les mêmes sensibilités. Le seul point commun est la vigilance des États-Unis en arrière-plan.
Enfin, l’objectif du pays de montrer sa capacité à mobiliser le droit, de même que la force et le fait accompli, si nécessaire et selon les circonstances, d’une manière très pragmatique.
3. Les termes du litige au Nord : les Senkaku
Avec le Japon, le litige porte sur les îles que les Chinois appellent Diaoyu, et les Japonais Senkaku.
A la base, il y a l’expansion japonaise en mer de Chine au XIXème siècle, avec d’abord l’annexion en 1879 des îles Ryuku. Celle-ci intervient à la suite de l’arbitrage de l’ancien président des Etats-Unis, Ulysses S. Grant. Ensuite, c’est la descente vers le Sud avec l’annexion de Taïwan et des Pescadores, à l’issue de la guerre sino-japonaise qui s’est achevée en 1895 avec le traité de Shimonseki. Enfin, c’est le reflux après la Seconde guerre mondiale qui s’achève par la capitulation sans condition du Japon en août 1945.
Sur le plan du droit, la difficulté vient d’abord de ce que le traité de San Francisco du 8 septembre 1951, qui met fin à la guerre avec les États-Unis et un grand nombre de pays, dont la France, n’est pas signé par la Chine, qui n’a pas été invitée à la négociation, ni même, d’ailleurs par l’Union soviétique. On est en pleine guerre de Corée.
Pour ce qui concerne la Chine nationaliste, ce n’est que le 28 avril 1952 qu’est signé le traité de paix entre la République de Chine et le Japon, qui met fin à l’état de guerre.
La difficulté vient ensuite de ce que le traité de San Francisco reste assez général, indiquant dans son article 2 que le Japon renonce à tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores, au b), ainsi d’ailleurs qu’aux Spratly et aux Paracels, au point f). Le point a) concerne la Corée et les îles attenantes nommément désignées, le point c) les Kouriles et la partie Sud de Sakhaline, revenant sur les gains du traité de Portsmouth de 1905 concluant la guerre russo-japonaise, le point d) les îles et territoires sous mandat de la SDN, et le point e) les revendications japonaises sur l’Antarctique, auxquelles il met fin.
Enfin, l’administration des îles Senkaku est confiée au Japon en 1972 en application de l’accord de 1971 signé avec les États-Unis qui met fin au régime de l’administration civile américaine des îles Ryuku, sans les mentionner explicitement.
C’est au même moment que la revendication chinoise, ou plutôt les revendications chinoises, puisque Pékin et Taipei partagent le même point de vue, commencent. Plus précisément, elles sont revendiquées depuis 1969 par la République de Chine (Taiwan) qui les rattache à la ville de Toucheng dans le comté de Yilan, et depuis 1971 par la République populaire de Chine (Chine continentale) qui les rattache à Taïwan pour laquelle ce territoire est une province de la Chine devant revenir sous l’autorité du gouvernement central.
Sur le fond, le différend porte en fait sur les éventuelles ressources que recèlerait le sous-sol marin. La présence de champs d’hydrocarbures dans les eaux entourant les îles convoitées est mentionnée en 1969 dans le rapport du comité des Nations Unies pour la coordination de la prospection des ressources minérales au large des côtes asiatiques. Non loin des îles Senkaku/Diaoyu, les champs de gaz de Shirakaba/Chunxiao, Kusunoki/Duanqiao, Asunaro/Lonjing et Kashi/Tianwaitian sont déjà en cours d’exploitation par la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), comme le rappelle en 2012 M. Jean-Emmanuel Medina publié dans la revue Géopolitique (Japon-Chine : Senkaku/Diaoyu, les enjeux du conflit territorial).
La question n’empêche cependant ni l’établissement en 1972 de relations diplomatiques entre le Japon et la Chine, ni la signature, en 1978, du traité de paix et d’amitié qui normalise leurs relations sur le plan du droit.
En l’état, la Chine fonde sa revendication sur le fait que les îles litigieuses auraient été mentionnées comme chinoises dans des écrits anciens, selon la notion de droits historiques, et qu’elles ont été détachées de Taïwan lors de l’expansion du Japon. L’absence de population rend la question encore plus complexe.
Depuis, quelques années, des incidents navals et aériens sont intervenus et ont donné lieu à déclarations officielles. Le rachat de trois des îles à leur propriétaire privé à la fin de l’année 2012 a également été un moment de tension. Il n’appartient pas au présent rapport d’en reprendre ici le détail.
Les États-Unis soutiennent la position du Japon, et le président Obama alors en visite d’État au Japon, a indiqué en avril 2014 que les îles étaient couvertes par l’article 5 du traité bilatéral de sécurité.
Pour le Japon, il s’agit non seulement d’un enjeu de souveraineté, mais éventuellement d’un enjeu de sécurité énergétique. Après la catastrophe de Fukushima, le pays a en effet dû recourir aux hydrocarbures pour assurer la continuité de son approvisionnement énergétique.
En 2012, la République populaire de Chine a refusé en 2012 une négociation tripartite, puis en 2013 une négociation bilatérale, et en novembre 2013, elle a unilatéralement instauré une zone aérienne d’identification (ZAI) sur une grande partie de la mer de Chine orientale, entre la Corée du sud et Taïwan, englobant le petit archipel litigieux.
La création de zone aérienne s’est traduite par la mise en place de règles très strictes que doivent observer tous les avions qui la traversent, sous peine d’intervention des forces armées. Ils doivent notamment fournir leur plan de vol précis, afficher clairement leur nationalité, et maintenir des communications radio leur permettant de « répondre de façon rapide et appropriée aux requêtes d’identification » des autorités chinoises.
4. Les termes du litige au Sud : les Paracels et les Spratleys
a. Des conflits de souveraineté dès l’époque coloniale
En mer de Chine méridionale, le différend porte sur les archipels des Paracels et des Spratleys. Il s’agit de deux archipels traditionnellement sans population permanente.
Le plus au Nord, celui des Paracels, fait l’objet de revendications concurrentes de la Chine (et plus précisément tant par la République populaire de Chine que par Taïwan), du Vietnam et des Philippines.
Le plus au Sud, celui des Spratleys, donne lieu à des revendications également concurrentes de la Chine et du Vietnam, ainsi que des Philippines, de Bruneï et de la Malaisie.
L’arrière-plan historique a été exposé dans un article de 1939 publié par M. Claudius Madrolle dans la revue Politique étrangère. C’est dans l’Entre-deux-guerres que ces groupes d’îles ont pris leur importance, après avoir été dédaignés, même si les Paracels ont fait l’objet d’une prise de possession de la part du roi d’Annam en 1806. Celui-ci était alors sous suzeraineté chinoise.
De très nombreux géographes reconnaissent d’ailleurs au XIXe siècle les îles Paracels comme dépendantes de l’Annam. Tel est le cas de Dubois de Jancigny, dans le volume de l’Univers, Histoire et Description de tous les peuples Japon, Indo-Chine, Ceylan etc., qu’édite Firmin-Didot en 1850. Son auteur a été envoyé en mission par le Gouvernement français de l’époque en Extrême-Orient de 1841 à 1846.
C’est dans l’Entre-deux-guerres qu’est apparu le rôle de ces îles en matière navale, en matière aérienne et, aussi dans le domaine météorologique. La France a fait installer un phare sur l’une d’entre elles en 1937 et une station météorologique sur une autre en 1938. Le 3 juillet 1938, le ministère des affaires étrangères fait part de la prise de possession des îles par la France. Le Japon émet des réserves. Dans sa stratégie de conquête de la Chine, il utilisera d’ailleurs certaines d’entre elles comme points d’appui contre l’île de Hainan.
S’agissant des Spratleys, qui ont également été connues des marins sous le nom d’îles des Tempêtes, la France les fait reconnaître par une canonnière en 1930, fait poser des bornes de prise de possession en avril 1933 et fait publier la notification de l’annexion au Journal officiel en juillet 1933. Le Japon émet en 1938 des réserves, lors de la notification, car il invoque exploiter un gisement de phosphate depuis 1917. Le 4 avril 1939, la France émet une note de protestation, qui est rejetée par le Japon, et propose même un arbitrage. Cette proposition restera sans suite.
Dans un ouvrage intitulé Ce qu’il faut savoir sur la mer de Chine méridionale, publié par l’Institut national d’études sur la mer de Chine méridionale, et remis à vos rapporteurs, il est indiqué que la Chine a alors émis les protestations nécessaires.
Pendant la Seconde guerre mondiale, le contrôle japonais sur les deux archipels est complet. En 1945, c’est à la Chine qu’il revient de procéder au désarmement des troupes japonaises.
Le traité de San Francisco de 1951 indique, comme on l’a vu, que le Japon renonce à tous droits, titres et revendications du Japon sur ces archipels, et ce point est explicitement repris dans le traité de 1952 entre le Japon et la Chine nationaliste, lequel n’évoque que les droits titres et revendications susceptibles de concerner la Chine. Les éventuels droits de la Chine sont maintenus, mais pour autant qu’ils aient été fondés.
Ensuite, la situation diffère selon les deux archipels.
Pour les Paracels, la France, au nom de l’Annam, et la Chine, alors dirigée par Tchang Kai Check, sont en conflit, et celui-ci est réglé de fait par la défaite nationaliste en 1949. La proposition française de recourir à un arbitrage international n’est pas retenue. En 1950, Mao Tsé Toung fait retirer toute présence militaire sur l’archipel. Celui-ci revient ensuite en totalité au Sud-Vietnam, car situé au Sud du 17ème parallèle, lequel constitue la ligne de démarcation établie par les accords de Genève en 1954. Mais en 1956, à la faveur du départ définitif des Français, les Chinois reviennent s’installer sur le groupe Amphitrite. Le Sud Vietnam proteste. Et en 1974, la Chine parachève son installation.
Les Paracels ne font l’objet que de revendications chinoises, de la République populaire comme de Taiwan, et vietnamiennes.
Pour les Spratleys, la situation est plus complexe. Les Vietnamiens revendiquent la totalité de l’archipel au nom de la succession de la France qui avait officiellement établi sa souveraineté. À la suite des accords de Genève, le Sud-Vietnam, en avait pris possession en y installant des troupes. Après la réunification du pays, en 1975, ce sont des unités communistes qui s’y établissent. La Chine commence à s’y établir à partir de 1988, par faits accomplis. Les Philippines, qui revendiquent aussi l’archipel, et le Vietnam protestent.
Les Philippines invoquent des preuves historiques parfois jugées plus ou moins fondées et une période d’occupation des Spratleys, lorsque profitant du départ des Japonais, un aventurier, Tomas Cloma y débarqua en 1956 et prit possession de l’archipel, ensuite cédé à son Gouvernement, le rebaptisant Kalayaan.
L’adoption de la CNUDM en 1982 conduit la Malaisie et Brunei à entrer dans ce jeu diplomatique, et militaire, complexe. Leurs ZEE respectives atteignent, en effet, le sud de l’archipel, ce qui les conduit à revendiquer les émergences touchées. La Malaisie entre en conflit avec les Philippines, le Vietnam et la Chine et Brunei avec le Vietnam et la Chine.
Sur le plan du droit international, les prétentions malaisiennes et brunéiennes ne vaudraient que si les eaux généraient des droits à souveraineté territoriale, ce qui n’est pas le cas. Avant 1982, aucun de ces deux pays n’était d’ailleurs, semble-t-il, partie aux contentieux.
Enfin, il faut mentionner les récifs de Scarborough revendiqués par la Chine et par les Philippines.
Dans l’ensemble, ainsi, on constate la revendication de la totalité de l’archipel par la Chine, la revendication du Vietnam et des revendications très partielles des trois autres pays : Brunei, les Philippines et la Malaisie.
En l’état, chacun des pays concerné occupe certaines îles, notamment Taiwan, ce qui rend la situation difficile.
La carte suivante permet de visualiser les revendications et établissements en 2010.
Les revendications en mer de Chine du Sud
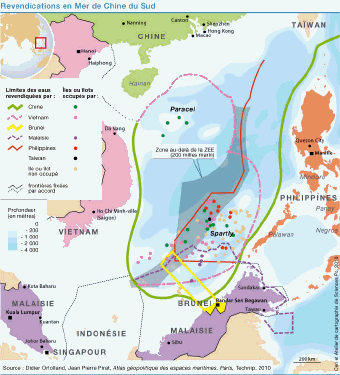
a. Un arrière-plan économique et pétrolier
Il va de soi que l’intérêt des revendications ne tient pas uniquement à la faculté d’y exercer la souveraineté, et à établir des bases navales ou militaires avancées, mais à la capacité de disposer d’une ZEE étendue et potentiellement riche en ressources naturelles, pêche et hydrocarbures dans un premier temps.
Il y a déjà de manière récurrente des litiges de pêche, comme l’a indiqué aux rapporteurs Mme Valérie Niquet.
L’enjeu essentiel est pour l’instant celui des hydrocarbures, mais en 2013, l’Agence américaine d’informations sur l’énergie (Energy information administration) a donné des estimations assez faibles. Il n’y aurait ainsi pas de pétrole au large des îles Spratleys et du gaz naturel en quantité assez limitée. Le sous-sol serait encore moins riche pour ce qui concerne les Paracels. L’essentiel des ressources de la mer de Chine méridionale serait près des côtes continentales.
Cependant, en mai 2015, un forage de la compagnie chinoise China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) à proximité des îles Paracels a été à l’origine de tensions, entraînant une réaction du Viet Nam.
En juillet dernier, concernant un autre forage, une autre compagnie chinoise, la China National Petroleum Corporation (CNPC), a fait état d’indices de pétrole.
La Chine met en avant une approche coopérative. Dans le fascicule précité, sur Ce qu’il faut savoir sur la mer de Chine méridionale, il est indiqué que les compagnies pétrolières chinoises, du Vietnam et des Philippines ont engagé en 2005, avec l’accord de leurs gouvernements respectifs, une coopération sismique pour des travaux conjoints dans certaines zones.
a. Un enjeu stratégique certain
Les archipels de la mer de Chine méridionale recèlent deux enjeux stratégiques majeurs.
D’abord, c’est une voie de communication maritime essentielle entre les pays d’Asie et entre l’Europe et l’Extrême-Orient, aux abords du détroit de Malacca. Au total, 90 % du commerce extérieur chinois et un tiers du commerce international y transitent.
Ensuite, le nombre des îles et des îlots présente sur le plan militaire des avantages indéniables, notamment parce qu’ils offrent un environnement permettant de manœuvrer en toute discrétion des unités marines ou sous-marines.
Du point de vue de la Chine, cet élément est essentiel. Les archipels lui donnent une profondeur stratégique facilitant le déploiement de ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins basé sur l’île de Hainan.
1. Des arguments d’ordre historique
Lors de sa venue à Paris, le 26 janvier 2016, S.E. M. Zhou Jian, représentant pour les affaires frontalières et maritimes du ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine est venu présenter les arguments de la Chine.
D’abord, sur le plan territorial, la Chine invoque que les Spratleys ont toujours été chinoises, de même que les Paracels, et que la Chine en a récupéré la souveraineté lorsqu’elle a reçu la capitulation des troupes japonaises qui y étaient stationnées en 1945. Elle observe en se fondant sur les cartes anciennes publiées par le Royaume-Uni et sur les cartes plus récentes publiées par elle-même, ainsi que par les États-Unis, le Japon et la France, que ces territoires était considérés comme chinois, et que jusqu’au début des années 1970, aucune contestation de la souveraineté chinoise n’est intervenue.
Ensuite, la Chine observe qu’il y a toujours eu des pêcheurs chinois dans la zone. Celle-ci est donc une zone de pêche traditionnelle.
Pour ce qui concerne les Philippines, elle invoque que leur territoire a été défini par le traité de Paris, en 1898, entre les États-Unis et l’Espagne, le traité de Washington de 1900, visant à le clarifier, et une convention de 1920, et que les îles ne sont pas mentionnées.
Vis-à-vis du Vietnam, la Chine a publié une déclaration dans laquelle les Xisha (Paracels) et Nansha (Spratleys) figuraient dans son territoire et le Premier ministre du Vietnam d’alors a adressé une note à son homologue Zhou Enlai confirmant son approbation. Les manuels scolaires ont été à une époque dans le même sens au Vietnam.
En ce qui concerne la délimitation des frontières maritimes, des pays ont procédé par actes unilatéraux, ce qui a multiplié les contentieux.
La politique chinoise vise à régler les problèmes de manière pacifique et amicale entre États souverain. La Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale signée en novembre 2002 par la Chine avec les pays de l’ASEAN indique que les parties se sont engagées à régler leurs litiges par la négociation.
La Chine est parfaitement cohérente dans ses revendications.
En effet, elle appuie ses revendications sur des éléments historiques bien antérieurs remontant aux époques impériales anciennes, notamment sur des manuscrits uniques. Ainsi, la Chine met en avant des références écrites remontant aux dynasties Sung (XIIe siècle) et Qing (XVIIIe siècle) et même des éléments plus anciens. L’administration officielle mise en place par la Dynastie des Han, vers 210 avant notre ère, sur l’île de Hainan, aurait inclus les archipels. Par la suite, au Xe siècle, la flotte des Song aurait commencé à patrouiller régulièrement dans les îles de Xisha et les gouvernements impériaux successifs auraient délivré des permis de pêche pour cette zone.
Elle a toujours refusé de reconnaître les pertes territoriales imposées par les puissances coloniales, les puissances européennes et le Japon. L’Annam, à qui les îles étaient, comme on l’a vu attribuées par les observateurs, était sous suzeraineté chinoise avant l’accord de Tientsin de 1884, qui a permis à la France d’établir son protectorat sur l’Annam et le Tonkin, puisqu’il précisait que la Chine s’engage à « respecter dans le présent et dans l’avenir, les traités directement intervenus ou à intervenir entre la France et la Cour de Hué ».
Néanmoins, c’est aussi un élément potentiel de fragilité de la position chinoise, dès lors que l’absence de continuité de l’occupation est implicitement reconnue. C’est comme on l’a vu un élément qui peut être essentiel dans le domaine des droits historiques. Il implique alors pour la Chine la remise en cause non seulement de l’ordre colonial, mais aussi de celui qui lui a succédé.
Sur le plan intérieur, la Chine a en 1992 affirmé dans la loi sur les eaux territoriales la possession des deux archipels.
En résumé, la Chine fonde ses revendications territoriales sur des « droits historiques » définis par la ligne des neufs traits, ajoute aussi qu’elle n’a jamais remis en cause la liberté de navigation et de survol dans la région et invoque qu’elle a ratifié la CNUDM (ce que les États-Unis n’ont pas fait).
2. La recherche d’une interprétation du droit de la mer toujours favorable à la plus grande extension possible des eaux sous juridiction chinoise, dans un contexte géographique compliqué
Chacun des ensembles, Paracels et Spratleys, comprend un grand nombre d’îles, îlots, récifs, bancs de sable, hauts fonds, qu’ils soient découvrants ou non, de taille et de nature très diverses, ce qui rend complexe la question de l’application pratique des dispositions de la CNUDM.
Les Paracels comprennent une quinzaine d’îlots ainsi qu’un grand nombre d’atolls et de récifs (environ trente-cinq émergences) s’étendant sur 15 000 kilomètres carrés environ. La plus grande des îles, l’île Boisée, fait 2,1 kilomètre carrés.
Pour les Spratleys, on retient habituellement, selon les critères retenus, de 190 à 600 îlots, rochers, récifs, hauts fonds et bancs de sable s’étendant sur plus de 410 000 kilomètres carrés. C’est un ensemble émietté. La superficie totale des treize émergences les plus importantes fait moins de 1,7 kilomètres carrés.
C’est donc le domaine d’élection des différentes dispositions de la CNUDM qui distingue :
– les îles, définies à l’article 121 comme des étendues naturelles de terre entourées d’eau, et qui engendrent leur propre ZEE et éventuellement des extensions du titre du plateau continental, à l’exception des « rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre » ;
– les hauts fonds découvrants (Low-tide elevation) que le 1 de l’article 13 de CNUDM définit ainsi : « par « hauts-fonds découvrants », (…) les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute », et qui permettent de reporter la ligne de base lorsqu’ils sont dans la limite des 12 milles nautiques. Deux arrêts de la Cour internationale de justice en ont précisé les termes. D’abord, la différence entre ce qui est en-deçà et ce qui est au-delà de la limite des 12 milles a été fixée, dans l’arrêt du 16 mars 2001, Qatar c. Bahreïn. La Cour a relevé que la CNUDM ne donnait aucune indication s’il s’agit ou non de territoires, qu’il n’y a pas non plus de pratique suffisamment établie pour déterminer si une règle coutumière permet ou non leur appropriation, et que leur régime juridique tel que fixé par la convention était très différent de celui des îles. Ensuite, l’arrêt du 9 novembre 2012 Nicaragua c. Colombie, a explicitement rappelé que les « hauts‑fonds découvrants ne peuvent faire l’objet d’appropriation », et ce, bien que l’« État côtier exerce sa souveraineté sur les hauts‑fonds découvrants situés dans sa mer territoriale, puisqu’il exerce sa souveraineté sur la mer territoriale elle-même ». Leur intérêt est ainsi de permettre le report, sur leur laisse de basse mer, de la ligne de base lorsqu’ils sont à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale ;
– les îles artificielles, installations et infrastructures, qui n’engendrent par elle-même aucune zone maritime. Elles bénéficient seulement conformément au paragraphe 4 de l’article 60 de la CNUDM, de « zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation ». Le paragraphe 5 les limite en principe à une largeur de 500 mètres. En revanche, pour ce qui concerne la ZEE et le plateau continental, l’État côtier de construire, d’autoriser et de règlementer ces éléments artificiels.
De même que les autres pays riverains d’ailleurs, la Chine en retient la lecture qui lui est la plus favorable et ne sort pas non plus de l’ambiguïté en déterminant parmi ces émergences lesquelles sont des îles et lesquelles n’en sont pas, et ainsi lesquelles peuvent générer autour d’elles des droits souverains.
En revendiquant la totalité des eaux soit au titre de la mer territoriale, soit au titre de la zone économique exclusive, d’archipels à la géographie très complexe, elle joue habilement sur les éventuelles failles de la CNUDM.
La complexité atteint dans certains cas des raffinements inouïs. Il faut mentionner Zhongsha Qundao, « archipel constitué d’un assemblage tout à fait artificiel des récifs (sic) de Scarborough, du haut-fond de Truro et du banc Macclesfield ».
Le récif de Scarborough est situé dans le centre-est de la mer de Chine méridionale, au large de l’île philippine de Luçon, à 220 kilomètres. Il s’agit d’un atoll, de forme triangulaire, qui possède un lagon d’une superficie d’environ 150 kilomètres carrés. Cette superficie ne doit pas faire illusion, car le récif est presque intégralement recouvert à marée haute. Il est aujourd’hui revendiqué par la Chine, les Philippines et Taïwan. Il est militairement occupé depuis 2012 par la Chine.
Comme le relève le général (c.r.) Daniel Schaeffer, membre du groupe de réflexion Asie21, qui, dans une note publiée le 20 septembre 2014 sur le site Diploweb (La revue diplomatique), « la façon dont les eaux territoriales pourraient se déterminer à partir des élévations pouvant être considérées comme des îles authentiques dans les Paracels et dans les Spratleys ne permettraient certainement pas de couvrir 80 % de la superficie de la mer de Chine du Sud comme prétendent le faire les Chinois. »
L’enjeu sous-marins de ces émergences est aussi très précis, car la zone comprend des hauts-fonds non-découvrants, susceptibles d’une exploitation économique, parmi lesquels le banc Macclesfield, dans le prolongement des îles Paracels, le haut-fond de Truro (Truro shoal en anglais), à mi-distance entre le banc Macclesfield et Luçon, le haut-fond de Reed (Reed bank) situé au Nord-est de l’archipel des Spratleys, les hauts-fonds de Luconia (Luconia shoal) et de James (James shoal), situés à quelque 100 milles marins au nord de l’État malais de Sarawak, lui-même dans la partie Nord de Bornéo.
C’est dans ces circonstances qu’il faut apprécier les éléments invoqués par la Chine, et aussi les constructions d’infrastructures auxquelles elle a procédé au cours de ces deux dernières années.
3. La recherche d’un contrôle effectif des eaux par la construction d’îles semi-artificielles et d’infrastructures, et l’amorce de leur militarisation
C’est au cours de l’année 2015 que les images satellites ont montré l’ampleur de la construction des infrastructures dans le cadre d’une véritable poldérisation de plusieurs bancs de sable et de récifs autour des îles Spratleys/ Nansha, avec notamment des installations portuaires et même aéroportuaires, avec des pistes d’atterrissage.
Depuis, le phénomène s’est accentué, caractérisant ce que l’on appelle la technique du « salami » marquée par l’enchaînement de faits accomplis.
Les autorités chinoises ont décrit ces travaux comme relevant de leurs responsabilités et de leurs obligations concernant la recherche et le sauvetage en mer, la prévention des catastrophes naturelles, notamment, et aussi comme autant d’opportunité de coopération économique.
Cependant, il a été précisé que les bases correspondantes seraient à usage mixte, civil et militaire, ce qui reporte d’autant la frontière stratégique du pays à proximité des autres pays revendiquant ces îlots ou dont la possession contrarie les visées en application du droit de la mer.
Dans l’ensemble, sept îlots ont fait l’objet d’opérations de remblaiement, des pistes d’envol sont décelées sur trois d’entre eux. Sur quatre autres, des plateformes pour hélicoptères et des radars ont été mis en place.
La volonté ensuite des autorités chinoises de protéger autour de ces îlots artificiels une zone d’une largeur de 12 milles marins, a montré que l’objectif était également de créer des droits de juridiction sur les eaux environnantes et des ZEE. Ce n’est pas ce que prévoit le droit de la mer. L’article 121 sur le régime des îles engendrant des ZEE prévoit qu’il s’agit uniquement d’étendues naturelles entourées d’eau et qui restent découvertes à marée haute.
Les îles artificielles, dont le cas est prévu parmi les dispositions relatives à la ZEE, de même que les installations ou ouvrages, donnent uniquement le droit à l’État côtier d’établir, comme on l’a vu, des « zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation. » Ces zones ne peuvent excéder 500 mètres.
En février dernier, des images satellites ont d’ailleurs décelé l’installation missiles sol-air et de système radar dans l’une des Paracels, l’île de Yongxing, appelée sinon Woody ou l’île Boisée (par la France), introduisant d’ailleurs une certaine différence entre les deux archipels.
Cette voie de la militarisation a provoqué une réaction internationale forte.
Celle-ci a été d’autant plus significative que Taiwan s’est sur ce point séparé de la République populaire.
Cependant, la Chine invoque avoir implanté des installations « à vocation pacifique » et ne pas participer à la militarisation de la région. Comme tout État, elle n’assurerait que la sécurisation de ses intérêts.
C. DES RÉACTIONS INTERNATIONALES PARFOIS FERMES ET TOUJOURS FONDÉES SUR LE DROIT
1. Une procédure d’arbitrage, intentée par les Philippines et en cours, bien que refusée par la Chine
La Cour permanente d’arbitrage de La Haye s’est déclarée compétente le 29 octobre dernier, pour statuer sur les zones litigieuses en mer de Chine méridionale.
La saisine est intervenue le 22 janvier 2013, lorsque les Philippines ont adressé une notification et un mémoire en demande « concernant le différend avec la Chine sur la juridiction maritime des Philippines dans la mer occidentale des Philippines » à la Chine. Le 19 février 2013, la Chine a présenté une note diplomatique aux Philippines dans laquelle elle décrit « la position de la Chine envers les questions de la mer de Chine méridionale » et rejette et renvoie la notification des Philippines.
Intervenue à l’unanimité des cinq juges arbitres, dont M. Jean-Pierre Cot, la sentence reconnaissant la compétence de la Cour a relevé que l’arbitrage porte sur le rôle des « droits historiques » et la source des droits maritimes dans la mer de Chine méridionale, le statut de certains éléments maritimes en mer de Chine méridionale et les droits maritimes qu’ils peuvent générer, et la légalité de certaines actions menées par la Chine en mer de Chine méridionale que les Philippines estiment être en violation de la Convention. Le cœur de la question est donc le statut juridique des îlots et récifs susceptibles, ou non de générer des droits au profit des États qui les revendiquent.
Les Philippines ont bien souligné qu’elles ne demandaient pas au Tribunal de se prononcer sur la question de la souveraineté quant aux éléments maritimes en mer de Chine méridionale revendiqués par les Philippines et la Chine. Les Philippines n’ont pas non plus demandé au Tribunal de délimiter la frontière maritime entre les deux États.
La Chine a déclaré à plusieurs reprises qu’elle « n’accepte pas l’arbitrage introduit unilatéralement par les Philippines et n’y participe pas ». Toutefois, la Chine, notamment par la publication en décembre 2014 d’une « Note de position du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de la compétence dans l’arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale initié par la République des Philippines » (« Note de position de la Chine »), a exprimé clairement sa position selon laquelle le Tribunal n’est pas compétent pour connaître des conclusions des Philippines.
Ainsi, elle dénonce la procédure engagée par les Philippines sur la base de plusieurs arguments : le tribunal saisi n’a pas vocation à statuer sur les revendications territoriales (ce jugement ne doit précisément pas porter sur ce point ; l’action des Philippines est contraire à un accord bilatéral passé avec les Philippines qui privilégiait le règlement des différends bilatéraux (les Philippines contestent l’existence d’un tel accord) ; sur la base de l’article 298 de la CNUDM et de la déclaration chinoise de 2006, elle se réserve le droit de ne pas participer à des décisions d’arbitrage.
Comme l’a indiqué en substance M. Zhou Jiang à la mission, lors de sa venue à Paris, la position de la Chine est la « non-acceptation et la non-participation » vis-à-vis de cet arbitrage international demandé unilatéralement par les Philippines. La Chine a tout lieu de se méfier de cet arbitrage pour des raisons historiques car le peuple chinois a subi trop d’injustices territoriales (octroi de territoires au Japon par le Traité de Versailles qui a conduit à la révolution du 4 mai 1919 ; appel à la justice internationale de Tchang Kai Chek qui a accepté l’enquête internationale commandée par la SDN suite à l’incident du 18 septembre 1931 en Mandchourie ; négociations sur le traité de San Francisco dont la Chine a été exclue). C’est pourquoi la Chine a présenté une déclaration sur le fondement de l’article 298 du droit de la mer par laquelle elle n’accepte pas les procédures obligatoires prévues par la Convention en matière de définition de la souveraineté. La France a d’ailleurs fait de même.
Selon la Chine, en agissant unilatéralement, les Philippines ont violé le consensus sur le principe de négociation bilatérale qui avait pourtant été affirmé dans des déclarations des deux pays. Les Philippines veulent en fait transformer la question posée en une question sur la façon d’appliquer la Convention sur le droit de la mer dans le but de régler les différends bilatéraux de façon multilatérale. En effet, dans les enceintes multilatérales, les Philippines chercheraient à s’appuyer sur le Japon et les États-Unis. Or, pour régler un différend territorial, il faut la volonté des deux parties.
Selon M. Zhou, le droit de la mer comporte une lacune en matière de procédure obligatoire de règlement des différends : les conditions pour initier cette procédure ne sont pas « suffisantes ». Certaines parties peuvent s’en servir pour élargir leur juridiction et non pour obtenir une bonne application de la convention. Leur objectif est d’ordre politique et non juridique. Au final, l’initiative des Philippines n’aidera pas à résoudre le différend entre les deux pays. L’équipe des avocats des Philippines est d’ailleurs formée d’Américains.
Il n’est pas neutre d’observer que Taïwan partage dans l’ensemble les mêmes positions puisque le président Ma Ying-jeou s’est rendu sur l’île de Taiping (Itu Aba), dans l’archipel des Spratleys. C’est une île qui dispose d’eau potable et est donc habitable.
L’absence d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure et c’est ainsi que la procédure a continué malgré l’absence de la Chine.
Ainsi, le litige a connu une certaine extension puisque le 24 novembre, le Tribunal a permis aux gouvernements de l’Australie, de la République d’Indonésie, du Japon, de la Malaisie, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam d’envoyer des délégations, de petite taille, en qualité d’observateurs.
Ultérieurement, le Royaume-Uni a pu également le faire, mais cela a été refusé aux États-Unis, car ils ne sont pas partie à la CNUDM, comme on l’a vu.
Les audiences ont eu lieu en novembre 2015 et se sont achevées le 30 novembre. La Cour a prévu de rendre sa sentence en 2016.
Récemment, un nouvel élément, d’origine universitaire, est venu compléter l’argumentaire chinois : le professeur Wu Shicun, directeur de l’Institut national d’études sur la Mer de Chine méridionale, a estimé que les décisions de la Cour d’arbitrage n’avaient été appliquées que dans un tiers des cas et a estimé qu’un refus de la Chine d’appliquer la future décision ne serait pas pour autant un défi à l’ordre international.
2. Les réactions des États-Unis et des pays de l’ASEAN
a. Les déclarations et protestations politiques
Sur le plan politique, les différentes actions de poldérisation, construction d’infrastructures et déploiement ont donné lieu à protestation de la part des autorités américaines, et aussi des pays riverains membres de l’ASEAN, en faisant référence au droit et à la liberté de navigation et de trafic aérien.
Notamment, le secrétaire à la défense américain, M. Ashton Carter, a appelé dès le mois de mai 2015 un «arrêt immédiat et durable» des travaux de construction par Pékin d’îles semi-artificielles en mer de Chine méridionale.
Les États-Unis ne prennent pas position sur la question de la souveraineté, mais encouragent le respect du droit, de la liberté de navigation et le règlement pacifique des conflits. Le fond de l’argumentaire est le suivant : la force et le fait accompli ne sont pas le droit.
De même, après l’annonce du déploiement de lance-missiles sur l’île Boisée, le président Obama a indiqué que les États-Unis continueraient à voler, naviguer, et opérer partout où le droit international le permet et qu’ils soutiendraient le droit les autres pays à faire de même.
C’est une position partagée, même s’il y a des nuances, par les autres riverains de la mer de Chine du Sud.
Ainsi, le dernier sommet entre les États-Unis et l’ASEAN, à Sunnylands les 15 et 16 février derniers, s’est conclu par une déclaration conjointe mentionnant notamment la reconnaissance par les 10 pays de l’ASEAN du principe de non-militarisation et l’affirmation d’un attachement partagé au « respect intégral des processus légaux et diplomatiques », selon les principes universellement reconnus de la CNUDM.
Sans qu’il soit utile de rappeler ici les différentes étapes du soutien des États-Unis aux riverains, ce qui sortirait du cadre du présent rapport, il convient de rappeler que les rapprochements s’opèrent sans cesse. Les Philippines ont ainsi conclu avec les États-Unis un nouvel accord qui permet aux forces américaines de bénéficier de nouveaux points d’appui aux Philippines, tout en livrant des équipements de défense d’occasion. Le dossier de la mer de Chine du Sud n’est sans doute pas non plus absent des raisons qui ont conduit le président Obama à lever l’embargo total sur la vente des armes au Vietnam.
En réaction à cette mobilisation, la Chine mobilise elle-aussi les pays qui lui sont favorables, parmi lesquels le Laos ou encore le Togo.
a. Les missions des navires de l’US Navy dans le cadre du programme Liberté de navigation
Lors d’une audition au Sénat, le 23 février dernier, le commandant en chef du commandement de l’US Navy pour le Pacifique, l’amiral Harry B. Harris Jr, a déclaré, dans les même termes que ceux précédemment évoqués, que les États-Unis vont naviguer, voler et opérer partout où le droit international le permet.
Sur le plan opérationnel, en octobre dernier, le navire lance-missiles USS Lassen appartenant à la VIIe flotte s’est approché à moins de 12 mille marins du récif Subi, dans l’archipel des Spratleys, en mer de Chine méridionale. Il n’a pas arrêté sa course en dépit d’avertissements émis par deux navires de guerre chinois.
Pour les responsables militaires américains, c’était un exercice légal pour réaffirmer la liberté de navigation dans des eaux internationales, une mission que l’Amérique dit mener depuis des décennies à travers le monde dans le cadre de son programme Freedom of Navigation (FONOPS).
Moins médiatisée, une nouvelle opération du même type a été conduite le 30 janvier dans les Paracels, notamment au sein des 12 miles au large de l’île de Triton, par l’USS Curtis Wilbur.
Au début du mois de mars 2016, l’US Navy a envoyé un groupe aéronaval dans le Pacifique occidental et en mer de Chine du Sud, en continuité d’une présence affichée depuis des décennies. Le 10 mai dernier, une nouvelle opération a été opérée par la marine américaine. Le destroyer USS William P. Lawrence s’est approché du récif de Fiery Cross, dans les Spratleys, contrôlé depuis plus de vingt ans par la Chine, mais revendiqué par les Philippines, le Viet Nam et Taiwan. C’est sur ce récif que la Chine a fait atterrir deux avions civils en janvier dernier sur la piste d’atterrissage de la base aéronavale qu’elle a aménagé.
a. Le survol de la zone par l’US Air Force
Le ministère chinois de la Défense a dénoncé le 19 décembre 2015 « une grave provocation militaire » après le survol, le 10 décembre au matin, de deux bombardiers américains B-52, entrés sans autorisation dans l’espace aérien des « îles Nansha et des eaux territoriales adjacentes ». L’un des deux appareils s’était approché à moins de deux milles marins, plus près que prévu, d'un îlot artificiel construit par la Chine.
Indiquant se renseigner à ce sujet, en raison d’un éventuel écart de trajectoire dû à la météo, le porte-parole du ministère américain de la Défense, Mark Wright a indiqué que pour cette mission, il n'y avait aucune intention de voler à moins de douze milles nautiques de toute installation. C’est une fin de non recevoir à toute reconnaissance d’une mer territoriale autour d’un îlot artificiel.
3. Une communauté internationale qui ne peut rester indifférente en raison de l’importance du trafic maritime et aérien dans la zone
La communauté internationale ne peut rester insensible à la tension dans cette partie du monde.
C’est en effet tant pour le trafic maritime que pour le trafic aérien une voie de passage vitale pour l’Asie du Sud-est mais aussi la Chine, le Japon et la Corée.
La libre circulation doit être assurée et la sécurité des transports également.
La mer de Chine du Sud est empruntée par 60 000 navires en moyenne par an, soit six fois le trafic de Panama et un quart du fret mondial. 80 % des approvisionnements chinois en hydrocarbures y transitent.
De même, l’ampleur du trafic aérien est telle qu’une zone d’identification aérienne semblable à celle des îles Senkaku aurait des conséquences très importantes pour le trafic.
D. UN CERTAIN APAISEMENT, MÊME SI LIMITÉ, SUR LES SENKAKU À PARTIR DE 2014
Sur les îles Senkaku, la situation reste difficile, notamment parce que la Chine reste sur sa position et que les intrusions chinoises dans les eaux sous contrôle effectif du Japon autour des îles Senkaku/Diaoyu ont progressivement pris de l’ampleur. D’abord effectués par des chalutiers ou assimilés, ils l’ont ensuite été par des navires des administrations civiles maritimes chinoises, puis, en décembre 2015, par une frégate de la plus militarisée des agences de garde-côtes chinoises.
Cela rend nécessaire pour le Japon de développer ses marques de présence.
Les tensions ont diminué depuis la publication d’une « déclaration en quatre points » entre le président Xi Jinping et le premier ministre Shinzo Abe, le 10 novembre 2014, en marge du sommet de l’APEC. Cet apaisement répond à des motifs certainement pragmatiques, compte tenu des relations économiques entre les deux pays et à l’intérêt pour la stabilité régionale dans un environnement déjà difficile en raison de la Corée du Nord. Mais, la posture reste cependant fondamentalement la même de la part de la Chine.
DEUXIÈME PARTIE : MANIFESTER ENFIN UNE VOLONTÉ POLITIQUE À LA HAUTEUR DES ESPACES MARITIMES ET DES ATOUTS DE LA FRANCE
I. UN ESPACE MARITIME EXCEPTIONNELLEMENT ÉTENDU ET DIVERSIFIÉ GRÂCE À L’OUTRE-MER, MAIS PARFOIS CONTESTÉ VOIRE MENACÉ
A. ONZE MILLIONS DE KILOMÈTRES CARRÉS SOUS JURIDICTION FRANÇAISE, DANS TOUS LES OCÉANS
1. La zone économique exclusive de la France
a. La deuxième superficie maritime du monde
C’est au titre de la CNUDM, qu’elle a ratifié en 1996, en application de la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995, que la France détient un domaine maritime de tout premier ordre.
Sa zone économique exclusive (ZEE), établie selon les dispositions prévues aux articles 57 et suivants de la convention, s’étend en effet sur plus de 10 millions de kilomètres carrés. 11 millions est l’ordre de grandeur régulièrement avancé, soit seize fois la superficie terrestre de la métropole et de l’outre-mer (675 000 kilomètres carrés).
La part européenne de la ZEE de la France ne représente qu’au plus 349 000 kilomètres carrés (sa délimitation est encore en cours).
C’est non pas par les extensions maritimes de sa masse continentale, mais par ses îles ultramarines que la France détient ainsi une telle superficie.
En effet, comme on le voit avec Clipperton, une île d’une superficie très faible engendre une superficie de ZEE de 434 000 kilomètres carrés.
C’est tout l’enjeu de la détention d’îles répondant, comme on l’a vu, aux critères de l’article 121de la CNUDM : des émergences naturelles qui ne soient pas de simples rochers ne se prêtant pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre.
Selon les statistiques couramment publiées, notre pays est au deuxième rang des espaces maritimes, juste derrière les États-Unis (qui n’ayant pas ratifié la CNUDM ne peuvent d’ailleurs pas juridiquement avoir une ZEE fondée sur le droit international), comme l’indique le tableau suivant.
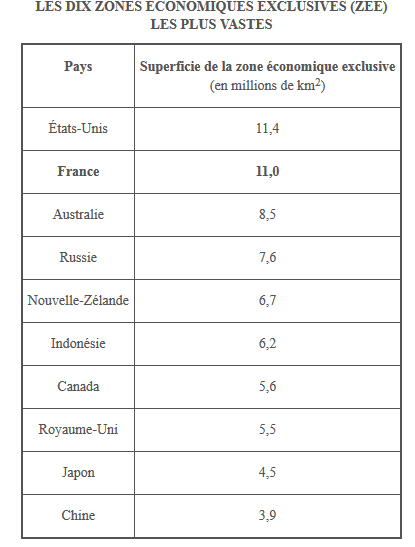
Source : Sénat, rapport n° 616 (2011-2012) de M. Serge Larcher, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 27 juin 2012, sur la proposition de résolution visant à obtenir en application de l’article 73 quinquies, la prise en compte par l’Union européenne des réalités de la pêche des régions ultrapériphériques françaises
Ensuite, viennent les grandes puissances maritimes, entre 5 et 8,5 millions de kilomètres carrés : l’Australie, la Russie, le Royaume-Uni, le Canada, catégorie à laquelle on peut aussi rattacher le Japon, à raison de 4,5 millions de kilomètres carrés.
Pour sa part, l’Union européenne est considérée, par l’intermédiaire de ses États membres avoir une superficie maritime de l’ordre de 23 millions de kilomètres carrés. C’est de loin la première du monde, mais il faut distinguer trois catégories de ZEE : les ZEE du continent européen, les ZEE des régions ultrapériphériques ou RUP (Antilles, Guyane et Mayotte, Canaries et Açores), qui relèvent du régime européen avec des adaptations, et les ZEE des PTOM, essentiellement les collectivités territoriales françaises du Pacifique, le Groenland, les territoires ultramarins néerlandais et britanniques, associés à l’Union européenne.
La ZEE sous juridiction française représente ainsi presque 50 % des eaux sous juridiction des pays membres de l’Union européenne.
a. La prédominance de l’Outre-mer, et principalement du Pacifique
Au total, la ZEE française est essentiellement outre-mer, à raison de 97 %.
Elle est même, pour l’essentiel, dans le Pacifique, à raison des deux-tiers (6,87 millions de kilomètres-carrés).
La Polynésie représente une ZEE de 4,8 millions de kilomètres carrés, à elle seule, la Nouvelle-Calédonie 1,36 million de kilomètres carrés, et Wallis-et-Futuna, 266 000. S’y ajoute l’île de Clipperton qui engendre à elle seule une ZEE de 434 000 kilomètres carrés.
C’est ensuite dans l’océan Indien que la France détient une ZEE étendue, à raison d’un quart du total (2,67 millions de kilomètres-carrés), dont 1,61 million pour les îles australes (Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam), et le reste pour La Réunion, Mayotte, et les îles éparses (Tromelin, Europa, Bassa da India, Juan de Nova et Glorieuses). Plus précisément, ces dernières représentent ensemble 692 000 kilomètres carrés.
Le détail de ces éléments, exprimé en pourcentage pour être plus parlant, est le suivant.
Tailles respective de la ZEE française
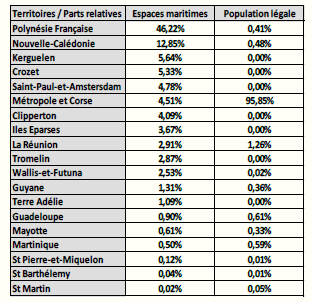
Source : SGMer
La carte suivante, éditée par le SHOM, permet de visualiser la localisation sur le planisphère des ZEE françaises.
Carte de la ZEE sous juridiction française
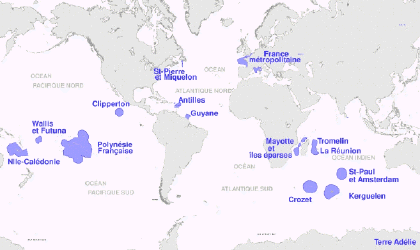
Source : SHOM
D’un point de vue géostratégique, les espaces maritimes français sont donc immenses, mais très éloignés. Ils sont assez réduits dans l’Atlantique, et notamment, notre pays est totalement absent de l’Atlantique Sud, où c’est le Royaume-Uni qui est bien établi, comme l’indique la carte suivante :
Carte de la ZEE du Royaume-Uni, des dépendances de la Couronne et des territoires d’outre-mer
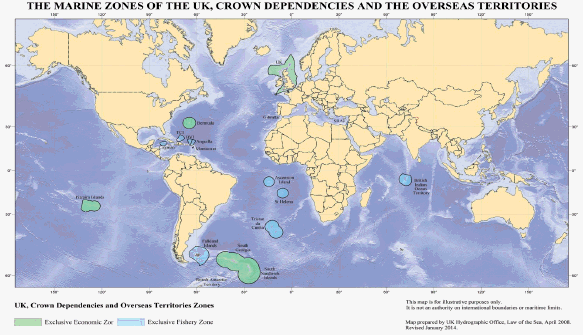
Source : Home Office
C’est le résultat de l’histoire navale avec un contrôle très étroit de l’Atlantique par le Royaume-Uni grâce à des points d’appui insulaires, en l’absence de possessions en Amérique latine et avant que la colonisation de l’Afrique ne commence vraiment dans la seconde moitié du XIXe siècle.
C’est comparativement une contrainte forte pour la marine française, car elle doit déployer en permanence des moyens suffisants sur place, ce qui n’est pas le cas pour la Royal Navy, qui peut intervenir plus vite.
a. Une superficie sous-marine encore plus vaste grâce aux extensions du plateau continental
Au-delà de la limite des 200 milles nautiques, les droits des pays sur le plateau continental ne concernent que les fonds marins et leurs sous-sols, et non les eaux surjacentes. Ces extensions du plateau continental font l’objet de la procédure prévue à l’article 76 de la CNUDM, comme on l’a vu.
La géologie n’est pas défavorable à la France.
En octobre dernier, et pour les seules demandes d’extension validées, elle a pu adjoindre à son espace maritime 579 000 kilomètres carrés, dont 423 000 pour les seules îles Kerguelen.
A total, l’enjeu de toutes les extensions de plateau continental est estimé pour la France à 1,8 voire 2 millions de kilomètres carrés, d’une façon peut-être un peu optimiste. Ce n’est qu’une fois toutes les demandes instruites que la superficie des fonds marins sous juridiction française pourra être précisément établie.
De même que pour les ZEE, dont elles constituent le prolongement, ces extensions sont pour l’essentiel situées dans l’océan Indien et le Pacifique. La carte suivante récapitule leur localisation géographique.
Les extensions possibles du plateau continental sous juridiction française
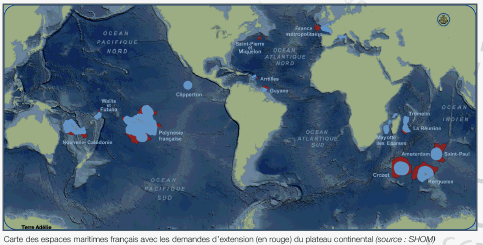
Source : SHOM
a. Des frontières méconnues avec des pays éloignés
Outre-mer, la délimitation des espaces maritimes et des extensions de plateau continental fait apparaître des frontières maritimes ou sous-marines aussi étendues que méconnues avec des grands pays.
L’archipel des Crozet donne ainsi lieu à une frontière avec l’Afrique du Sud.
Avec l’Australie, la convention de délimitation a été opérée et il y a deux frontières distinctes : l’une dans la mer de Corail, avec la Nouvelle-Calédonie ; l’autre séparant l’archipel français des Kerguelen et celui des îles Heard-et-MacDonald, dans l’océan Indien.
De même, les îles Glorieuses donnent lieu à une frontière maritime entre la France et les Seychelles.
Dans l’ensemble, la France a des frontières terrestres avec six pays, mais des frontières maritimes ou sous-marines avec trente-deux pays, dont l’essentiel dans le Pacifique, ainsi que dans les Caraïbes et, également, dans l’Océan indien.
Le tableau suivant récapitule ces éléments.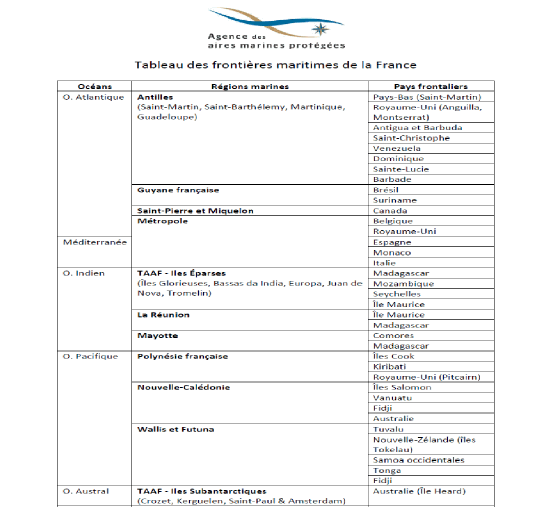
Source : Agence des aires marines protégées
2. Les ZEE : des délimitations bien avancées, mais non encore achevées pour différents motifs
a. Des délimitations d’espaces maritimes toujours en cours
La délimitation des espaces maritimes français est toujours en cours pour deux raisons. D’une part, elle n’est pas achevée partout y compris en ce qui concerne les lignes de base. Tel est notamment le cas pour les îles Éparses. D’autre part, elle est parfois difficile en raison des négociations bilatérales nécessaires pour les fixer. Tel est le cas pour les ZEE pour lesquels l’enjeu est le plus fort compte tenu de l’importance des superficies concernées. Enfin, la mer est un espace qui évolue et il faut en permanence repréciser les lignes de base lorsque la configuration des côtes change.
Selon les éléments publiés par le SHOM, 21 accords bilatéraux de délimitation de frontières maritimes ont été établis. Deux frontières sont encore en cour de fixation, trois sont partielles et six délimitations ne sont pas commencées.
Dans le cas le plus simple, la délimitation de la zone économique exclusive vers la haute mer se fait sur la base d’un constat unilatéral à partir des lignes de base. C’est ce qui se produit lorsque l’éloignement des côtes des autres États est tel que l’espace est suffisant. Lorsque tel n’est pas le cas, des négociations bilatérales sont nécessaires.
De telles négociations bilatérales sont également nécessaires pour fixer le prolongement en mer des frontières terrestres. C’est aussi le cas pour les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone contigüe, mais là encore, compte tenu des superficies en jeu, c’est pour la ZEE que la question est la plus difficile.
Deux modalités sont prévues en l’absence de critères prévus par la CNUDM :
– d’une part, il s’agit du principe ancien de l’équidistance, notion qui fait cependant l’objet d'applications et d’interprétations variées. Plusieurs méthodes existent pour la déterminer et des débats ont notamment lieu sur le point à partir duquel la distance aux côtes est calculée ;
– d’autre part, il est d’usage que la règle de l'équidistance soit assortie de la prise en compte d’autres considérations telles que la longueur relative des côtes des deux États demandeurs ou plus généralement la prise en considération de « circonstances spéciales », avec le recours à l’équité et à des principes équitables. Tel a été le cas dans trois arrêts : l’arrêt du 20 février 1969, affaires du Plateau continental de la mer du Nord, l’arrêt du 12 octobre 1984 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, et l’arrêt du 3 juin 1985, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte).
La délimitation n’est internationalement opposable aux autres États que lorsqu’elle a été notifiée aux Nations unies.
Cependant, les lois nationales y sont applicables quand bien même cette procédure n’a pas été accomplie, ce qui permet ainsi d’appliquer le droit français dans ces espaces en l’absence de délimitation notifiée.
La pratique française veut que les textes nationaux ou les cartes marines du SHOM soient déposées auprès de l’ONU (division du droit de la mer) afin d’accomplir l’obligation de publicité.
Même si elles figurent unilatéralement sur des cartes françaises, certaines délimitations ne sont pas définies car la négociation n’est pas ouverte.
En l’état, les notifications à l’ONU ont été faites pour la Méditerranée, Saint-Pierre-et-Miquelon, Clipperton, les îles Éparses, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et Mayotte.
a. Les discussions avec les pays limitrophes
Des discussions et négociations sont en cours avec de nombreux pays limitrophes par la mer. Leur durée provient non seulement de la complexité des situations, mais également de la préférence tout à fait justifiée de la France pour la négociation plutôt que pour la solution arbitrale.
Ces importants délais ne signifient pas que les situations soient figées ou sans solution. Bien au contraire, des accords sont régulièrement conclus.
La France a ainsi conclu en 2015 deux accords délimitant ses eaux territoriales et sa ZEE : l’un avec l’Italie le 21 mars et l’autre avec Fidji et Tuvalu, au mois de septembre.
De même, avec les Pays-Bas, la France a délimité de nouvelles frontières les 26 et 27 mars 2015. Les rencontres des délégations franco-néerlandaises à Philipsburg sur l’île de Saint-Martin aux Antilles ont en effet permis d’aboutir au tracé de délimitations au Sud-Ouest et au Sud-Est de cette île franco-néerlandaise.
Pour ce qui concerne la négociation avec les îles Tonga, le principe de l’équidistance est acquis pour la délimitation des frontières avec la Polynésie française.
Avec le Suriname également, les 7 et 8 avril, à Cayenne, la session de négociation a établi des avancées notables pour le tracé de la ligne de délimitation à partir de l’embouchure du fleuve Maroni.
En l’état, les principales négociations ou démarches sont les suivantes.
Avec le Royaume-Uni, la délimitation de la mer territoriale n’est pas achevée entre Guernesey et Aurigny, et le Cotentin. Des contacts informels ont eu lieu, mais il n’y a pas de démarche officielle dans un contexte institutionnel complexe.
Au Antilles, les démarches entreprises avec Antigua-et-Barbuda ainsi que Saint-Christophe-et-Niévès sont restées à ce stade sans réponse.
a. La négociation avec l’Espagne dans le golfe du Lion
La négociation de la délimitation de la ZEE avec l’Espagne dans le golfe du Lion exige des développements particuliers.
Le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 a créé en Méditerranée une ZEE se substituant à la zone de protection écologique. Il a ainsi été nécessaire de procéder à la délimitation des ZEE avec les deux pays voisins.
Alors que la frontière a été délimitée, comme on l’a vu, avec l’Italie en mars 2015, les discussions se poursuivent avec l’Espagne en ce qui concerne la délimitation maritime entre les deux États. Plusieurs sessions informelles ont eu lieu depuis plusieurs années sans aboutir à un accord.
L’Espagne conteste en effet les coordonnées transmises à l’ONU. Elle estime que le tracé français n’est pas conforme au droit.
La carte suivante, établie par le SHOM, montre le tracé retenu par notre pays.
Délimitation de la ZEE en Méditerranée
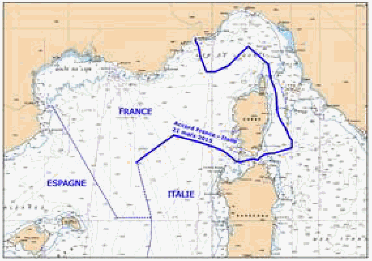
Source : SHOM
C’est la descente de la ZEE vers le Sud que conteste l’Espagne. Elle souhaiterait remonter vers le Nord en s’appuyant sur le cap de Creus, très proche de la frontière française, et en invoquant la seule équidistance. La France souhaite spontanément conserver la zone de protection écologique qu’elle avait délimitée et peut invoquer les règles, complexes, du droit de la mer en matière de délimitation.
B. LES EXTENSIONS DU PLATEAU CONTINENTAL : QUELQUES DEMANDES ENCORE EN INSTRUCTION OU EN ATTENTE
La question de l’extension du plateau continental a fait l’objet, en octobre 2013, d’un avis très complet du Conseil économique, social et environnemental, présenté par M. Gérard Grignon et intitulé « L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la France ».
1. Une procédure encadrée par le droit de la mer
Les extensions du plateau continental se font comme on l’a vu en application de l’article 76 de la CNUDM.
Les demandes sont présentées par les États et examinées par la commission des limites du plateau continental (CLPC), qui a été mise en place en 1997. Celle-ci est constituée de vingt-et-un membres, choisis pour leurs compétences en géophysique, en hydrographie ou en géologie. Actuellement, l’un de ses membres, M. Walter R. Roest, originaire des Pays-Bas, a été présenté par la France. Il a été expert à l’Ifremer et a été, notamment, le directeur scientifique du programme Extraplac. Les membres de la CLPC sont élus par les États parties à la CNUDM pour un mandat de cinq ans. Ils peuvent être réélus. La composition de la commission se fonde sur la représentation géographique. La commission tient ses sessions à New York, pour une durée maximale de six mois. Il y a trois sessions par an de six semaines chacune, en pratique. La commission se divise en trois sous-commissions, de chacune sept membres dont les travaux sont en anglais.
La CLPC examine les dossiers présentés par l’État membre demandeur, sur le plan technique, géologique et bathymétrique, pour déterminer si les critères fixés par la convention, sont bien respectés. Il s’agit de vérifier si les critères pertinents sont ou non remplis. Ainsi que l’a souligné M. Elie Jarmache, chef de la délégation française auprès de la commission, c’est une procédure « très administrative ». Ce n’est pas une négociation.
La commission formule des recommandations sur le tracé des limites extérieures de leur plateau continental, avec les grands fonds marins, qui relèvent comme on l’a vu de l’Autorité internationale des fonds marins. Elle ne se prononce pas sur les litiges entre les États et donc ne fait pas de recommandation sur les dossiers concernés.
L’État côtier jouit sur toute la superficie du plateau continental étendu des mêmes droits que ceux dont il bénéficie en-deçà des 200 milles marins.
Ce sont des droits souverains aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles, minérales ou biologiques – les espèces sédentaires uniquement (article 77 de la CNUDM). L’État côtier peut notamment y autoriser et réglementer les forages (article 81 de la CNUDM). S’il n’explore pas le plateau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès (article 77 de la CNUDM).
L’État côtier jouit également sur son plateau continental du droit exclusif de construire, d’autoriser et réglementer l'exploitation d'installations et d’ouvrages utilisés à des fins économiques, et sur lesquels il exerce sa juridiction exclusive (article 80 de la CNUDM). Par ailleurs, si tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental, leur tracé doit être agréé par l’État côtier (article 79 de la CNUDM). Enfin, l’État côtier a le droit de réglementer, d’autoriser et de mener des recherches scientifiques marines sur son plateau continental (article 246 de la CNUDM).
3. La mise en place du programme Extraplac au début des années 2000
Lorsque la France a ratifié en 1996 la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), elle a fait le choix de déposer des demandes d’extension du plateau continental.
Chargée de vérifier la validité des demandes au niveau international, la Commission des limites du plateau continental (CLPC) a adopté en 1999 ses directives scientifiques, ouvrant ainsi une période de dix ans pour le dépôt des dossiers.
La date limite de dépôt a été ainsi fixée au 13 mai 2009.
En 2008, cette date a été maintenue mais un aménagement de procédure est intervenu. A été autorisé le simple dépôt d’une information préliminaire pour permettre aux pays demandeurs, notamment aux pays en développement, de sauvegarder leurs droits.
En 2002, après un délai de trois ans, une réunion interministérielle fixe les contours du programme d’Extension raisonnée du plateau continental (Extraplac) : un financement public annuel, de l’ordre de 2,3 millions d’euros, sanctuarisé jusqu’en 2009, et complété par des contributions en nature de l’Ifremer et du SHOM, ce qui a permis d’échapper à la règle de l’annualité budgétaire et aux aléas de l’arbitrage périodique ; un comité de pilotage confié au Secrétaire général pour la mer (SG mer), assisté d’un groupe scientifique et technique coordonné par l’Ifremer, avec notamment la participation du SHOM.
Ces éléments sont repris et précisés par le comité interministériel de la mer (CIMER) du 29 avril 2003.
Le 28 janvier 2010, une réunion interministérielle a prolongé la partie budgétaire du programme, avec des sommes moindres jusqu’en 2018, pour tenir compte des demandes non encore traitées par la CLPC ou des dossiers ayant simplement fait l’objet du dépôt d’une information préliminaire. Au total, le budget devrait être de l’ordre de 25 millions d’euros.
4. Des dossiers déposés pour un enjeu de l’ordre de 1,8 million de kilomètres carrés
La France a déposé au total neuf demandes et trois informations préliminaires, dont une a été cependant retirée ensuite, celle de Clipperton.
Les demandes déposées ont été les suivantes :
– la demande relative au golfe de Gascogne et à la mer Celtique, conjointement préparée par la France, l’Irlande, l’Espagne et le Royaume Uni et déposée le 19 mai 2006. La recommandation de la CLPC a été émise le 24 mars 2009 ;
– la demande relative à la Guyane, déposée le 22 mai 2007. La CLPC a émis sa recommandation le 2 septembre 2009 ;
– la demande relative à la Nouvelle-Calédonie, déposée le 22 mai 2007. La recommandation émise le 2 septembre 2009 concerne une partie seulement du dossier : l’extension au sud-ouest. À la demande de la France, la CLPC n’a pas examiné le dossier relatif au sud-est, en raison du différend provoqué par le Vanuatu qui conteste la souveraineté française sur les îles Matthew et Hunter ;
– la demande relative aux Antilles, déposée le 5 février 2009. La CLPC a émis sa recommandation, le 19 avril 2012 ;
– la demande relative aux Kerguelen, déposée le 5 février 2009. La recommandation de la CLPC a été émise le 19 avril 2012. En même temps que la demande relative aux Kerguelen, par une note du 5 février 2009 de la mission permanente de la France auprès des Nations Unies, la France a réservé ses droits de déposer une demande à l’avenir pour la Terre-Adélie en rappelant les principes et les objectifs partagés par le Traité de l’Antarctique et la CNUDM ;
– la demande conjointe pour l’archipel des Crozet et les îles du Prince Édouard, déposée par la France et l’Afrique du Sud, le 6 mai 2009, pour une extension de 541 288 kilomètres carrés. Aucun accord de délimitation n’a encore été conclu entre les deux pays. La demande a été présentée lors de la session de la CLPC de juillet et août 2013. L’instruction a commencé en 2014 et pourrait s’achever à relativement bref délai ;
– la demande relative à La Réunion, déposée le 8 mai 2009 auprès de la CLPC. Elle a été présentée lors de la session de la CLPC de juillet et août 2013. Portant le numéro 40 dans l’ordre du dépôt des demandes, l’examen de ce dossier ne devrait pas s’effectuer avant la fin de la décennie. Elle porte sur 63 798 kilomètres carrés. Son instruction pourrait commencer en fin d’année 2016 ou en 2017 ;
– la demande relative aux îles Saint-Paul-et-Amsterdam, déposée par la France le 8 mai 2009 auprès la CLPC. Elle a été présentée lors de la session de la CLPC de juillet et août 2013. Portant également le numéro 40, elle ne devrait pas être examinée avant la fin de la décennie. Elle porte sur une extension de 341 852 kilomètres carrés ;
– la demande conjointe relative à Wallis-et-Futuna, déposée le 7 décembre 2012 à la CLPC par la France, Tuvalu et la Nouvelle-Zélande pour le compte du territoire non-autonome de Tokelau, pour une superficie de 17 329 kilomètres carrés. Elle porte le numéro 62 et a été présentée lors de la session de la CLPC de juillet et août 2013. L’examen de la demande ne devrait pas débuter avant un grand nombre d’années, les trois États devant s’entendre sur un accord de délimitation maritime.
Il faut également mentionner les deux informations préliminaires :
– celle relative à Saint-Pierre-et-Miquelon a été transformée en demande en avril 2014. Elle fait l’objet de développement au 8 ci-après ;
– celle relative à la Polynésie française a fait l’objet de travaux conduits par l’Ifremer en 2012 et 2015, et elle doit faire l’objet d’une demande formelle au cours de l’année 2016, après exploitation de la campagne scientifique de l’an dernier.
Au total, l’extension des fonds et sous-sols sous-marins sous juridiction française pourrait atteindre 1,8 million de kilomètres carrés.
5. Quelques renoncements fondés sur des motifs d’ordre géologique, mais parfois politique
a. Les territoires ultramarins n’ayant pas fait l’objet de demande
Certaines côtes n’offrent pas la possibilité d’une extension du plateau continental, pour des raisons géologiques, en l’absence de marge continentale, ou en raison de la proximité d’autres pays qui interdit toute extension au-delà de la ZEE, voire parfois, de la mer territoriale.
C’est le cas pour la Méditerranée, où l’on n’atteint pas les 400 milles marins, mais aussi de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, en raison de la configuration de l’arc caraïbe.
Mais pour ce qui concerne les îles Éparses et Mayotte, aucune demande n’a été déposée en raison des enjeux de souveraineté précédemment exposés.
Comme l’observe M. Gérard Grignon dans son avis précité du Conseil économique, social et environnemental, on peut s’interroger sur Europa : « l’étude théorique menée par le SHOM en 2003 ayant indiqué la possibilité d’une extension de 10 000 kilomètres carrés au seul sud d’Europa alors que le Mozambique a déposé une demande le 7 juillet 2010. Cette demande couvre le plateau continental au sud des 200 milles d’Europa, celui auquel la France a renoncé, l’IFREMER étant officiellement cité comme ayant apporté son assistance au Mozambique par une participation à la collecte et à l’analyse de données additionnelles. »
a. Le cas de Clipperton : les relations avec le Mexique en arrière-plan
Comme le rappelle dans son rapport précité M. Gérard Grigon, Clipperton a fait l’objet en 2009 d’une information préliminaire, mais celle-ci a ensuite été retirée sans explication.
A priori, une extension portant 25 000 kilomètres carrés aurait été possible, et elle l’aurait été sans conflit frontalier puisque les côtes du Mexique sont à 700 milles marins.
La souveraineté française sur l’île n’est pas discutable depuis l’arbitrage de 1931 rendu par le roi d’Italie.
Pour ce qui concerne la capacité de l’île à donner droit à une ZEE, on peut remarquer qu’elle a été habitée en diverses périodes, d’abord pour l’exploitation économique du guano, exploitation qui a été à l’origine du conflit avec le Mexique et de la demande d’arbitrage, et ensuite au cours de la Seconde guerre mondiale lorsque les États-Unis y ont établi une base militaire.
En outre, l’accord de pêche avec le Mexique conclu en 2007 fonctionne à la satisfaction des deux pays, comme on le verra ci-après.
Enfin, selon les études de l’Ifremer, la zone beaucoup plus vaste et largement explorée de Clarion-Clipperton est riche en nodules et potentiellement en terres rares.
Mais la question de Clipperton reste sensible. En 2012, à la suite de la publication par la France de sa ZEE sur Clipperton sur le site Internet de la division du droit de la mer de l’ONU, le Mexique a déposé une note verbale de protestation, dont il s’est ensuite engagé à examiner le retrait.
On ne peut oublier que dans un tout autre domaine, les relations avec le pays ont été difficiles pendant toute la période de détention de Mme Florence Cassez, entre 2010 et le début de l’année 2013.
6. Les premiers résultats : les décrets du 25 septembre 2015
C’est au cours de l’année 2015 que les premiers résultats du programme Extraplac et des demandes d’extension du plateau continental se sont concrétisés.
Les quatre décrets nos 1180 à 1183 du 25 septembre 2015 fixent en effet les limites extérieures du plateau continental de la France, au large du territoire de la Martinique et de la Guadeloupe, de la Guyane, des îles Kerguelen et de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les quatre premiers intervenus en la matière.
Il faut rappeler que les droits de l’État côtier ne portent que sur les fonds marins et leur sous-sol, et non pas sur les eaux surjacentes, qui demeurent du domaine de la haute mer.
Au total, ce sont 579 000 kilomètres carrés de fonds marins qui ont été concernés.
Le détail est le suivant :
– pour la Guyane, la demande française a été déposée le 22 mai 2007. La CLPC a émis sa recommandation le 2 septembre 2009, pour une extension de 72 000 kilomètres carrés ;
- pour les Îles Kerguelen, la demande française a été déposée le 5 février 2009. La CLPC a émis sa recommandation le 19 avril 2012, pour une extension de 423 000 kilomètres carrés ;
– pour la Martinique et Guadeloupe, la demande française a été déposée le 5 février 2009. La CLPC a émis sa recommandation le 19 avril 2012 pour une extension de 8 000 kilomètres carrés ;
– pour la Nouvelle-Calédonie, la demande française a été déposée le 22 mai 2007. La CLPC a émis sa recommandation le 2 septembre 2009, pour une extension de 76 000 kilomètres carrés.
Il reste un dossier accepté par la CLPC qui ne peut faire l’objet d’une validation, faute d’accord entre les quatre demandeurs : la demande conjointe relative au golfe de Gascogne et à la mer Celtique, présentée par la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Irlande, pour une surface totale de 84 000 kilomètres carrés.
7. La question des modalités de l’extension du plateau continental dans le golfe de Gascogne et la mer Celtique, à la frontière des eaux sous juridiction de l’Irlande, du Royaume-Uni, de l’Espagne et de la France
La CLPC a rendu son avis le 24 mars 2009, en se prononçant sur une extension globale de 84 000 kilomètres carrés, selon la carte ci-jointe.
Extension du plateau continental en mer Celtique
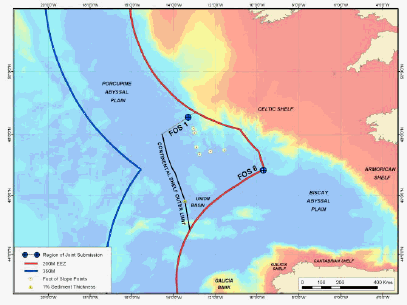
La limite est en retrait des 350 milles marins, comme on le voit. La ligne supérieure correspond à la limite avec la demande d’extension concernant la seule Irlande.
Les négociations sont encore en cours et pour ce qui concerne la France et l’Espagne, le dossier est différent de celui de la ZEE en Méditerranée, mais il est clair que leur règlement est, d’un point de vue politique, au moins partiellement lié.
Pour la France, les rapporteurs sont d’avis que l’enjeu essentiel est d’éviter d’être enclavée, et d’avoir ainsi une délimitation avec la zone des grands fonds marins.
8. Un dossier à ne pas négliger : la demande d’extension du plateau continental au titre de Saint-Pierre-et-Miquelon
La ZEE de Saint-Pierre-et-Miquelon est de 12 400 kilomètres carrés seulement, et a une forme très étroite semblable à celle d’une poêle à frire, comme l’indique la carte suivante.
La ZEE de Saint-Pierre-et-Miquelon
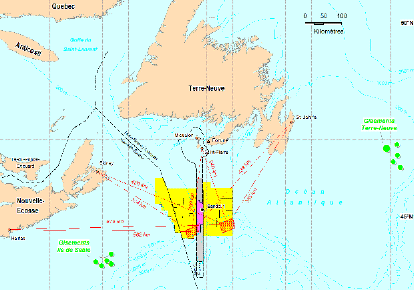
Source : Assemblée nationale – rapport d’information n°1312 sur la délimitation des frontières maritimes entre la France et le Canada, présenté par Mme Annick Girardin et M. Louis Guédon.
Elle a été fixée par un arbitrage du tribunal de New York du 10 juin 1992.
Cet arbitrage avait été décidé trois ans auparavant, le 30 mars 1989. Le Canada et la France avaient, en effet, conclu un accord instituant un tribunal d’arbitrage chargé d’établir la délimitation des espaces maritimes entre les deux pays à défaut de pouvoir se mettre d’accord à la suite de la fixation en 1976 de la zone de pêche canadienne et en 1977 de la zone économique française
L’article 2 de l’accord d’arbitrage indiquait que le tribunal était chargé « de procéder à la délimitation entre les parties des espaces maritimes relevant de la France et de ceux relevant du Canada » et d’établir « une délimitation unique qui commandera à la fois tous droits et juridictions que le droit international reconnaît aux Parties dans les espaces maritimes susvisés ». Cette délimitation serait effectuée à partir du point 1 et du point 9 « de la délimitation visée à l’article 8 de l’accord du 27 mars 1972 et décrite dans son annexe ». On rappellera que l’accord de 1972 est un accord de pêche qui a été conclu à la suite de la délimitation par chaque pays de la mer territoriale.
Le tribunal, dont le siège était établi à New York, comptait cinq membres : M. Prosper Weil, nommé par le Gouvernement français, M. Allan E. Gotlieb, nommé par le Gouvernement canadien, M. Gaetano Arangio-Ruiz, M. Oscar Schachter et M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, qui le préside.
L’article 10 précisait que « la sentence du Tribunal sera définitive et obligatoire », mais que chaque partie « pourra, dans les trois mois suivant la notification de la sentence, déférer au Tribunal toute contestation entre les parties en ce qui concerne l’interprétation et la portée de ladite sentence. »
La décision, rendue par 3 voix contre 2, a été perçue comme injuste à deux titres. D’abord, la France n’a obtenu que le cinquième de ce qu’elle demandait. Ensuite, large de 10,5 milles marin, la partie plus éloignée de la côte ne permet pas la pêche industrielle et laisse en fait la faculté aux pêcheurs des espaces voisins la faculté d’y procéder.
La France demandait l’application du principe de l’équidistance, et le Canada a demandé l’application du principe de non-empiétement, signifiant que la délimitation doit laisser à un État les espaces qui constituent le prolongement naturel ou l’extension vers le large de ses côtes, et du critère de la nécessité de tenir compte de la longueur des côtes afin d'éviter des résultats disproportionnés. Par définition, le critère de la longueur des côtes bénéficiait au Canada.
La sentence a été commentée et il n’y a pas lieu de revenir ici sur le fond. Il faut cependant rappeler que la France a commis, face à un pays où les autorités connaissent fort bien la question jusqu’au plus haut niveau de l’État, plusieurs erreurs, comme l’ont indiqué Mme Annick Giradin et M. Louis Guesdon dans le rapport d’information n° 1312 du 10 décembre 2008, présenté au nom de la commission des affaires étrangères, sur « la délimitation des frontières maritimes entre la France et le Canada »:
« L’accord de 1989 constitue une première erreur dans cette procédure, à laquelle vient s’ajouter l’insuffisante préparation du Gouvernement français en vue de l’arbitrage lui-même. « Dès l’origine, l’affaire était mal engagée puisque la France avait malheureusement accepté dans le compromis d’arbitrage, d’une part d’attribuer la majorité des sièges à des juges américains et d’autre part, de fixer le siège du tribunal à New York. […] L’administration française a peut-être considéré cette affaire avec trop de légèreté ». Les responsables politiques de l’archipel soulignent également le professionnalisme des défenseurs canadiens dans cette affaire et dénoncent une étude tardive du dossier côté français.
« Enfin, comme le fait observer Mme Geneviève Burdeau, la sentence arbitrale intervient à une période charnière pour le droit international puisqu’elle se situe peu avant l’entrée en vigueur de la convention précitée de 1982 [la CNUDM]. La jurisprudence en matière de délimitation n’est alors pas clairement établie, écartelée entre le droit coutumier et les principes définis dans la convention ; le tribunal s’inscrit dans cette incertitude. À titre d’exemple, le tribunal a refusé d’appliquer la règle de l’équidistance – sur laquelle reposait l’argumentation française – alors que celle-ci constitue aujourd’hui une méthode utilisée avec constance par la Cour internationale de justice. »
La France a su d’une manière pragmatique dépasser les aspects négatifs de cet arbitrage et une coopération a été engagée avec le Canada dans plusieurs domaines. D’une part, il faut mentionner l’accord relatif au développement de la coopération régionale entre Saint-Pierre-et-Miquelon et les Provinces atlantiques canadiennes. D’autre part, l’accord de pêche du 27 mars 1972 a fait l’objet en 1994 d’un accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche, et des accords de mise en œuvre interviennent régulièrement, le dernier en 2014. Enfin, en matière d’hydrocarbures, l’accord de 2005 sur l’exploration et l’exploitation des champs d’hydrocarbures transfrontaliers, ratifié par la France, n’a pas encore été ratifié par le Canada. Lors de l’entretien qu’il a bien voulu accorder aux rapporteurs, S.E. M. Lawrence Cannon, Ambassadeur du Canada, a indiqué que « le Canada poursuit ses efforts en vue de la ratification, mais doit tenir compte du processus législatif de nos États fédérés, de nos Provinces ».
Cette question de la coopération en matière d’hydrocarbures, pourtant clef pour le développement de l’archipel, reste en suspens, mais elle n’est pas la seule.
Il faut en effet mentionner la question de l’extension du plateau continental, puisque l’arbitrage l’a laissée entièrement ouverte.
En effet, le tribunal a décliné sa compétence pour trancher la question, pourtant abordée par la France. D’abord, le compromis d’arbitrage le priait de « procéder à la délimitation entre les Parties des espaces maritimes de la France et de ceux relevant du Canada ». Ensuite, il a été bien précisé que « refuser de se prononcer sur la thèse française en se fondant sur l'absence de compétence du Tribunal ne saurait signifier ni ne saurait être interprété comme préjugeant, acceptant ou refusant les droits que la France, ou le Canada, peut revendiquer sur un plateau continental au-delà de 200 milles marins. »
Or, la morphologie et la géologie se prêtent à une telle extension au profit de la France, et non du Canada.
Le continuum géologique dans l’ensemble de la région a en effet été reconnu par la Cour internationale de justice en 1984 dans l’affaire Golfe du Maine. Il correspond au critère du prolongement naturel du territoire terrestre « jusqu’au rebord externe de la marge continentale » défini par l’article 76 CNUDM.
C’est donc à bon droit que la France a déposé en 2009 auprès de la commission des limites du plateau continental une information préliminaire pour préserver ses droits, puis en avril 2014 une demande d’extension du plateau continental.
La carte suivante en récapitule les éléments.
Carte de la demande d’extension du plateau continental au large
de Saint-Pierre-et-Miquelon
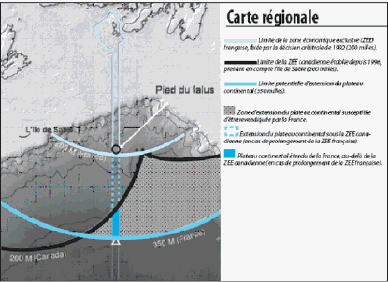
Source : Assemblée nationale – rapport précité sur la délimitation des frontières maritimes entre la France et le Canada présenté par Mme Annick Girardin et M. Louis Guédon
Le Canada a fait savoir dès 2009 qu’il rejetait toute revendication française. Il a également, aussitôt la demande déposée en avril 2014, déposé une objection, comme le règlement intérieur de la CLPC lui permet. Mais cela ne fait pas obstacle à la demande d’examen. La France a en retour fait une réponse sur un différend maritime entre les deux pays.
Le Canada invoque la présence de l’île de Sable, qui est un banc de sable de grande taille et de forme mouvante situé à 290 kilomètres au Sud-Est des côtes de la Nouvelle-Ecosse et qui a été fort opportunément classée réserve naturelle pour les oiseaux migrateurs en 1977. Inhabitée car à proprement parler inhabitable, l’île est peuplée par des chevaux dont l’origine est réputée inconnue, mais elle est utilisée par le Canada pour reporter considérablement à l’Est sa ligne de base. Elle a été reconnue par la loi canadienne de 1996 sur les océans comme le point de départ de la ligne de base. La France n’a jamais contesté le rôle de l’île de Sable dans la délimitation des eaux territoriales et des zones de pêche canadiennes. C’est regrettable car, comme le montre la carte ci-dessus, cela a pour effet d’enclaver la ZEE française en la bornant vers le large.
Dans cette configuration, les eaux internationales se situent à 300 milles marins des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon et 100 milles de zone maritime sous juridiction canadienne séparent donc la zone économique française de la haute mer proprement dite et de la zone sur laquelle porte la revendication française de plateau continental étendu.
Le débat juridique n’est cependant pas clos car seule la France peut revendiquer une partie des fonds marins au titre des demandes d’extension du plateau continental.
Deux approches sont juridiquement envisageables : la théorie du « saute-mouton » en vertu de laquelle les droits français s’interrompent sous la ZEE canadienne pour renaître sur la portion du prolongement naturel du territoire au-delà ; l’hypothèse de la superposition de deux zones maritimes relevant de souverainetés distinctes, les droits français sur un plateau continental sous la ZEE canadienne n’étant pas absents.
Cette seconde approche est clairement plus étayée.
D’une part, des cas de fonds marins relevant d’un État et une colonne d’eau surjacente sous la juridiction d’un autre État ont été relevés, et il faut observer que les dispositions de la convention de 1982 n’excluent pas une telle hypothèse. D’ailleurs, les zones contestées donnent souvent lieu à des accords de gestion commune avec le cas échéant création d’une structure commune chargée de la gestion (Japon/Corée, Timor/Australie, Thaïlande/Malaisie etc.) ou des solutions plus souples comme dans le golfe Persique.
D’autre part, elle est parfaitement cohérente avec la nature fluctuante des côtes et des îles servant à établir la ligne de base.
En effet, elle permet de garantir les droits de la France non seulement sur l’extension du plateau continental, mais également la ZEE si par hypothèse, l’île de Sable venait à disparaître sous l’effet d’une modification des conditions naturelles. Sa structure de sable, sa longueur de 41 kilomètres environ et sa faible largeur, de 1,5 kilomètre au mieux, l’apparentent un effet davantage à un banc émergé qu’à une véritable île. Elle peut de ce fait être considérée comme particulièrement vulnérable à la montée des eaux telle que la prédisent les experts pour le siècle actuel.
Dans une telle hypothèse en effet, la France se verrait rétablie dans ses droits sur l’intégralité de la ZEE de Saint-Pierre-et-Miquelon vers le large et la jonction avec le plateau continental étendue serait ainsi naturellement opérée. Les droits français sur la ZEE ne sont en l’état qu’au mieux recouverts par ceux générés au profit du Canada par l’île de Sable. Il n’y a aucune raison que ceux sur le plateau continental, exclusifs et non contestables, soient par conséquent déniés à la France dans les circonstances actuelles.
Le dossier suit d’ailleurs son cours puisque selon les éléments communiqués lors de la rédaction du présent rapport, il devrait être présenté en juillet devant la CLPC. L’objection du Canada empêche cependant tout examen au fond de cette demande.
C. DES ESPACES CONTESTÉS VOIRE MENACÉS
1. Une souveraineté française qui n’est pas toujours acceptée ni officiellement reconnue sur certaines îles dans l’océan Indien et dans le Pacifique
Sans même avoir à évoquer le cas de Mayotte, toujours revendiquée par les Comores en dépit du référendum de 1976, cinq îles ou groupes d’îles font l’objet d’une contestation de souveraineté.
C’est essentiellement dans l’océan Indien, dans le Canal de Mozambique, que la présence française fait l’objet de questionnements. Comme l’a indiqué aux rapporteurs M. Serge Ségura, ambassadeur chargé des océans, certains pays africains, sans aller jusqu’à contester la souveraineté française, comprennent cependant mal la présence française dans la région.
Île d’1 kilomètre carré, très difficilement accessible par la mer, à l’Est de Madagascar et au Nord de La Réunion, Tromelin est revendiquée par Maurice.
Tromelin est mentionnée comme partie du territoire national à l’article 14 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, comme partie constitutive des TAAF, elles-mêmes citées à l'article 72-3 de la Constitution.
La France peut cependant invoquer sa souveraineté originaire en se fondant sur la découverte géographique en 1722 de ce territoire sans maître. Les actes de souveraineté et d’administration n’ont donné lieu avant l’indépendance de Maurice à aucune protestation britannique.
La présence française est effective et continue, en particulier depuis mai 1954, après l’installation des équipes françaises de Météo France qui y séjournent depuis de façon permanente sous l’autorité du préfet de La Réunion, puis du préfet des TAAF.
Maurice estime que le Traité de Paris du 30 mai 1814 par lequel la France a cédé à la Grande-Bretagne l’Île de France et ses dépendances incluait Tromelin et qu’elle en est entrée en possession lors de son accession à l’indépendance en 1968, même si c’est depuis 1976 que la revendication est officielle.
En dépit de l’accord de cogestion du 7 juin 2010, en attente de ratification, la France a, par une note verbale en date du 17 mai 2011 publiée sur le site des Nations unies (Division des océans et du droit de la mer), revendiqué sa souveraineté sur Tromelin et réaffirmé ses droits sur la ZEE adjacente, en se référant à la publication d’une liste de coordonnées géographiques de points définissant les limites extérieures de la ZEE de Tromelin et de La Réunion.
Maurice a rappelé à ce sujet qu’elle avait « une pleine et entière souveraineté sur l'île de Tromelin, y compris ses zones maritimes ».
L’enjeu de cette île est bien entendu sa ZEE de plus de 280 000 kilomètres carrés, aujourd’hui riche en poissons, mais qui pourrait aussi recéler des hydrocarbures.
a. Les Îles Éparses du canal du Mozambique
Sont administrativement désignées comme les Îles Éparses, quatre îles ou groupes d’îles situées dans le canal de Mozambique, et Tromelin.
Les Îles Éparses du canal du Mozambique sont constituées de quatre éléments.
Au Nord de Mayotte, les îles Glorieuses sont un archipel inhabité composé de deux îles sablonneuses entourées par une barrière de corail et de plusieurs récifs coralliens. L’archipel à une superficie de 7 kilomètres carrés. La prise de possession intervient le 23 août 1892, par le capitaine de vaisseau Richard, commandant du navire Primauguet. Rattachées administrativement à Mayotte en 1895, elles le furent ensuite à Madagascar à partir de 1912. Elles abritent aujourd’hui un Parc naturel marin. Celui-ci, quatrième parc marin français et deuxième de l’océan Indien, a été créé par décret, le 22 février 2012. Situé à l’entrée du canal du Mozambique, élément essentiel à la biodiversité mondiale, le parc s’étend jusqu’à la limite de la ZEE. Sa superficie est de plus de 43 000 kilomètres carrés.
Au Sud de Mayotte, on trouve d’abord Juan de Nova, (4,4 kilomètres carrés), que l’acte du 31 octobre 1897 (en exécution de la loi du 6 août 1896), a déclaré dépendance française et rattaché administrativement à Madagascar, où son rattachement à l’une des provinces de l’île a ensuite été modifié à plusieurs reprises. Au large de Juan de Nova, la France a accordé des permis d’exploration d’hydrocarbures par deux arrêtés publiés au Journal officiel du 30 décembre 2008.
L’île a connu une exploitation économique (phosphate et guano) des années 1920 aux années 1970. Une station météorologique y est créée en 1973, ainsi que l’établissement d’un petit camp militaire, tout comme aux Glorieuses et Europa. Aujourd’hui, un gendarme et quatorze militaires assurent la souveraineté française sur l’île. Ce détachement est ravitaillé par air, grâce à la piste d’atterrissage construite dès 1934.
Plus au Sud, au débouché du canal du Mozambique, l’île de Bassas da India est un atoll circulaire d’une superficie de 0,2 kilomètre carré et culminant à une très faible altitude, de 2,4 mètres. La faune et la flore y sont donc très limitées.
Enfin, un peu plus au Sud encore, l’île Europa (28 kilomètres carrés) doit son nom au vaisseau qui y échoua en décembre 1774. Le Français Brué tenta de la faire appeler « Ile d’Europe » en 1828, mais il n’y parvint pas. En 1860, des colons français, les Rosiers, s’y installent avec quelques animaux de ferme. On ne sait pas quand ils décidèrent de quitter l’île, mais les animaux qu’ils y ont abandonnés sont retournés à l’état sauvage. De même que pour Juan de Nova et Bassas da India, l’acte du 31 octobre 1897 (en exécution de la loi du 6 août 1896), a déclaré Europa dépendance française et l’a rattaché administrativement à Madagascar, où son rattachement à une province a aussi été modifié à plusieurs reprises.
Les Îles Éparses sont revendiquées par Madagascar depuis son indépendance, intervenue le 26 juin 1960. Celles qui lui étaient rattachées pour des raisons administratives, en ont été, en effet, détachées par le décret du 1er avril 1960, « plaçant les Îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India sous l'autorité du ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer », lequel en a ensuite, en septembre 1960, confié l’administration au préfet de La Réunion. Les autorités malgaches invoquent le principe de l’intégrité territoriale des entités décolonisées. La question a été portée devant l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et l’ONU. L’Assemblée générale des Nations-Unies a adopté le 12 décembre 1979 une résolution qui, partant du principe d’intégrité territoriale mentionné supra, invitait le gouvernement français à négocier avec Madagascar la rétrocession de ces îles. La question est régulièrement évoquée dans la vie politique malgache, notamment lors des campagnes électorales. Les revendications malgaches ont cependant toujours été exprimées avec modération.
L'enjeu est et celui de la ZEE qui représente potentiellement un espace maritime de 425 000 kilomètres carrés, soit les deux tiers du canal du Mozambique. La carte suivante illustre ces éléments.
Les îles Éparses
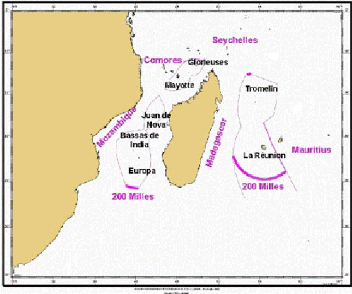
Source : Les zones économiques exclusives ultramarines : le moment de vérité - Rapport du Sénat n° 430 (2013-2014) de MM. Jean-Étienne Antoinette, Joël Guerriau et Richard Tuheiava, fait au nom de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer - 9 avril 2014
a. Matthew et Hunter dans le Pacifique sud
La souveraineté de la France sur les îles de Matthew et Hunter est contestée par le Vanuatu, à environ 300 kilomètres à l’Est de la Nouvelle-Calédonie.
La première est inhabitée et a une superficie de 0,7 kilomètre carré. Sa souveraineté - anglaise ou française - resta longtemps incertaine, du fait de l’indifférence pour cet ensemble rocheux, escarpé et aride.
L’île Hunter, d’une superficie d’un kilomètre carré, est elle aussi inhabitée.
Localisation de Matthew et Hunter
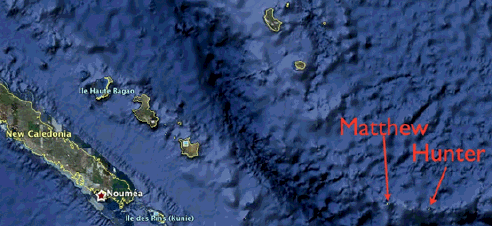
Source : site Internet Archives kaledosphèrere à partir de Google Earth
La France a annexé les deux îles en 1929, mais, en 1965 le Royaume-Uni les a occupées, les a déclarées rattachées au condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, avant qu’elles ne soient réoccupées par la France en 1975.
En 1980, le Vanuatu, État indépendant succédant aux Nouvelles-Hébrides, a déclaré sa souveraineté sur les deux îles, laquelle n’a pas été reconnue par la France. Les Forces armées françaises visitent l’île régulièrement pour réaffirmer la souveraineté de la France sur ces territoires et, en 1981, Météo France a installé une station automatique sur Matthew.
Selon les éléments communiqués aux rapporteurs, le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie a pris une position conforme à la déclaration de Déclaration de Kéamu émanant en 2009 du FLNKS et considérant la souveraineté du Vanuatu sur les deux îles. Cette position ne représente pas du tout la position de la France, mais pourrait être exploitée a contrario par le Vanuatu comme une expression du droit historique par une autorité française.
a. Clipperton dans le Pacifique central
Clipperton est constitué d’un atoll entourant un lagon de 9 kilomètres carrés, à 1 280 kilomètres des côtes mexicaines. L’île n’est pas habitée, mais a fait l’objet d’une exploitation économique pour le guano, par une entreprise américaine au XIXe siècle, et les États-Unis y ont établi une base pendant la Seconde guerre mondiale.
La France en pris possession en 1858. Sa souveraineté a été reconnue par un arbitrage international rendu entre la France et le Mexique en 1931 par le Roi d’Italie, Victor-Emmanuel III.
Depuis la révision de 2008, l’île est explicitement mentionnée au dernier alinéa de l’article 72-3 de la Constitution.
Malgré une reconnaissance de la souveraineté française en 1959 par le Mexique, celle-ci fait régulièrement l’objet de remises en cause dans ce pays.
L’intérêt de Clipperton est sa ZEE, d’une superficie de 434 000 kilomètres carrés, créée en mars 1978 mais qui ne fut mise en exploitation qu’à partir d'août 2005, date à laquelle l'accès par des pêcheurs français fut donc possible après accord des autorités françaises (Haut-commissariat de Polynésie française).
Particulièrement poissonneuses, les eaux qui entourent Clipperton ont fait l’objet de l’accord franco-mexicain du 29 mars 2007, entré en vigueur le 1er mai 2007, qui permet aux navires de pêche mexicains de bénéficier de licences gratuites.
Cet accord de pêche, « négocié » par le ministère des Affaires étrangères, a été très critiqué sur trois points : les licences sont gratuites et l’accord ne mentionne aucune contrepartie ; l’accord permet de pêcher sans limites, alors que ses homologues fixent habituellement des quotas par espèces et selon les types de navires spécifiques autorisés ; il est particulièrement long, à raison d’une durée de 10 ans reconductible alors que les accords de pêche récents limitent la durée entre 3 et 5 ans.
On peut en outre observer que pour ce qui concerne la notification à l’ONU de la ZEE de Clipperton, le Mexique a contesté, en 2015, la liste des coordonnées transmises par la France.
2. Un risque permanent d’activités illégales dans les ZEE outre-mer
a. Des activités facilitées par certaines technologies
Comme l’a remarqué l’amiral Bernard Rogel, l’exercice des activités illégales tire parti du progrès technique. Naviguer en haute mer n’exige plus des capacités de marin remarquables, comme dans les temps plus anciens. Les progrès des instruments de bord, des technologies de communication, et des bateaux rapides, les go fast, accompagnent un développement sans précédent des trafics.
La pêche illégale concerne toutes les eaux sous juridiction, mais elle concerne plus particulièrement les eaux ultramarines.
Il faut rappeler que les eaux de la métropole et des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) relèvent de la politique commune de la pêche. Celle-ci fixe les règles de gestion des flottes de pêches et les totaux admissibles de captures (TAC) (possibilités de pêche), qui sont des limites de captures (exprimées en tonnes ou en chiffres) fixées pour la plupart des stocks commerciaux de poissons. La Commission européenne prépare ses propositions en s’appuyant sur les avis scientifiques concernant l’état des stocks délivrés par des organes consultatifs tels que le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Les TAC sont ensuite répartis entre les États membres sous la forme de quotas nationaux.
Les territoires d’outre-mer et leur ZEE, comme pour les territoires dépendant du Royaume-Uni, des Pays-Bas et du Danemark et relevant du régime des PTOM, sont hors politique commune de la pêche.
Les principales zones de pêche illégale sont outre-mer, et concernent particulièrement la France (la Guyane, la Polynésie, Clipperton, les îles australes de l’océan Indien, Tromelin, et les îles du canal du Mozambique), comme l’indique la carte suivante.
Carte des principales zones de pêche illégale
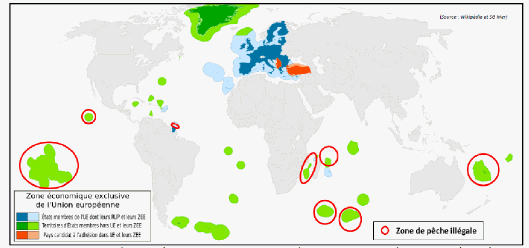
Source : SGmer
Les ZEE des îles australes de l’océan Indien ont fait l’objet d’un véritable pillage des ressources en légine, poisson des eaux très profondes et très apprécié au Japon et a ux États-Unis, notamment grâce aux moyens satellitaires et à la coopération avec l’Australie, ainsi qu’aux patrouilles.
Dans le Pacifique, la pêche illégale concerne les abords de Clipperton et aussi les bordures extérieures de la ZEE polynésienne, où elle est le fait des armements asiatiques.
Dans le Canal de Mozambique, il est fait état d’une croissance de la pêche illégale.
En 2014, la Marine nationale a constaté 32 infractions, toutes dans les îles Éparses, dont 27 à la suite d’arraisonnements et 5 au moyen d'un avion de surveillance maritime F50M. En outre, la pêche illicite partant de Madagascar et visant notamment les holothuries augmente depuis 2012. Par ailleurs, il a été constaté que de nombreux touristes se livraient à une pêche illicite ou à la plongée sous-marine sans respect de la réglementation des TAAF.
Récemment, le 21 février 2016, la frégate de surveillance Floréal, en mission de surveillance maritime a contrôlé un navire de pêche qui naviguait dans les eaux françaises de Juan de Nova ce qui a permis de mettre au jour une tonne et demie de poissons (jeunes requins, mérous, bonites et autres barracudas) ainsi que trois cents litres d’holothuries en saumure (concombres des mers protégés) prisés par la clientèle asiatique.
Dans le Pacifique, une procédure judiciaire à la pêche illégale a été ouverte contre un palangrier asiatique découvert le 30 octobre 2013 par un avion de patrouille maritime, alors qu’il pêchait dans une partie de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie. Ce navire, qui disposait d’une licence de pêche délivrée par le Vanuatu, a été dérouté sur Nouméa, puis saisi.
En Guyane, la situation est également très préoccupante avec 20 à 30 navires par jour qui se prêtent à la pêche illégale. En 2014, 65 navires ont été arraisonnés.
a. Les risques et infractions environnementaux
Les risques sur l’environnement et les infractions environnementales concernent aussi les eaux ultramarines, même si c’est dans une moindre proportion eue les eaux européennes de la France ; le trafic maritime y est, en effet, moins dense que dans la Manche.
Outre les risques de pollution, les infractions environnementales concernent aussi les espèces protégées.
La biodiversité, très riche, des espaces ultramarins en fait des cibles. Les îles Éparses sont ainsi aujourd’hui exposées à la capture de tortues vivantes.
Certains espaces maritimes font l’objet d’une protection renforcée : les aires marines protégées, qui appellent un développement particulier. Il faut rappeler que la notion d’aire marine protégée est la traduction en droit interne de plusieurs engagements internationaux de la France et des dispositions de plusieurs textes européens.
Les aires marines protégées sont créées par l’État. Des instances de gouvernance sont prévue pour en assurer la gestion et pour une bonne intégration des acteurs maritimes à la décision (comité de pilotage Natura 2000, conseil d’administration de parcs nationaux, comité de gestion de terrains du Conservatoire du littoral, notamment). La superficie d’une aire marine protégée est variable.
La loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux a défini six catégories d’aires marines protégées répondant chacune à des objectifs propres tout en étant complémentaires : les parties marines des parcs nationaux, des réserves naturelles, des aires de protection de biotope et des sites Natura 2000 ; les parties du domaine public maritime confiées au Conservatoire du littoral et les parcs naturels marins. L’arrêté du 3 juin 2011 complète cette liste par neuf nouvelles catégories. À l’exception de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage, elles relèvent autant d’une reconnaissance internationale que d’une nouvelle démarche de protection :
– les sites RAMSAR au titre de la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, les sites du patrimoine mondial UNESCO et les réserves de biosphère ;
– les sites au titre des conventions de Barcelone (Méditerranée), OSPAR (Atlantique Nord Est), Nairobi (Afrique de l’Est), Carthagène (Antilles) et CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique) ;
– les ou plutôt la réserve nationale de chasse et de faune sauvage avec partie marine du Golfe du Morbihan.
Parmi les aires marines protégées, le parc naturel marin est la catégorie qui répond au niveau d’exigence le plus développé. Il a pour objet non seulement la qualité des écosystèmes, la protection des espèces et habitats patrimoniaux ou ordinaires, la qualité des eaux marines, mais aussi l’exploitation durable des activités et les valeurs ajoutées sociale, économique, scientifique et éducative, de même que le maintien du patrimoine maritime culturel.
Par conséquent, l’État dispose d’une gamme complète d’outils susceptibles de s’articuler sur un même territoire et de se combiner par mer régionale avec pour résultat, la formation d’un réseau cohérent d’aires marines protégées. L’essentiel des aires marines protégées sont situées outre-mer, à raison de 302 634 kilomètres carrés sur un total de 390 809 kilomètres carrés, comme l’indique le tableau suivant.
Répartition des aires marines protégées entre la métropole et l’outre-mer
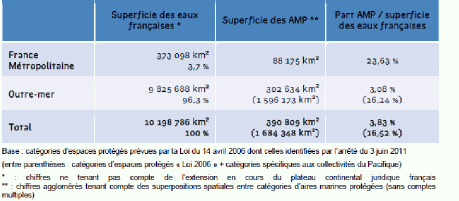
Source : Agence des aires marines protégées
Comme l’indique la carte suivante, il s’agit d’espaces essentiels dans le Pacifique, dans l’océan Indien et, aussi, dans la zone caraïbe.
Carte des aires marines protégées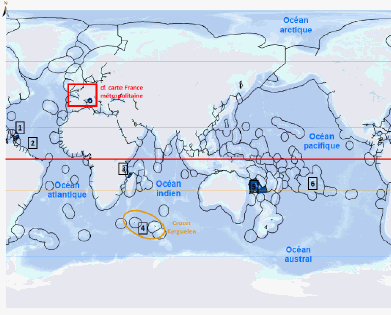
Source : Agence des aires marines protégées
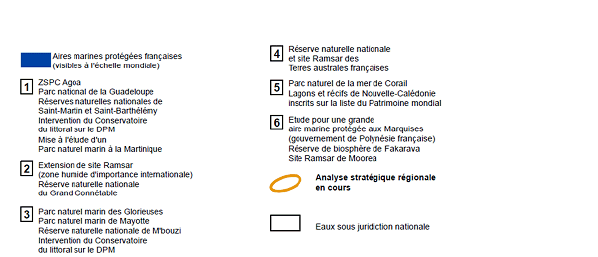
a. Les recherches clandestines de gisements miniers ou d’hydrocarbures
La prospection illégale dans les ZEE françaises a déjà été constatée.
En 2013 ainsi, dans celle de l’île d’Europa, la frégate de surveillance Nivôse a appréhendé un navire étranger de prospection sismique, qui était accompagné d’un autre bâtiment. Aucune autorisation n’ayant pu être produite, le navire a été sommé de quitter les eaux sous juridiction française.
La recherche sismique non autorisée en vue d'une possible exploitation des ressources énergétiques offshore a déjà été signalée dans la ZEE de Juan da Nova.
La richesse en hydrocarbures du canal de Mozambique, déjà avérée au large des côtes de l’État du Mozambique, est le motif de cette présence illégale.
D’autres zones ultramarines pourraient également être concernées.
a. Les autres activités illégales et trafics
Les espaces maritimes sont les espaces de tous les trafics, notamment trafics d’armes dans l’Océan indien et en Asie orientale, et aussi le trafic de stupéfiants avec une voie maritime mise au jour par la France pour les productions venant d’Afghanistan, dans le Pacifique sud entre l’Amérique du Sud et l’Australie, et dans les Caraïbes.
La carte suivante permet de visualiser rapidement ces risques.
Les voies maritimes des trafics de stupéfiants
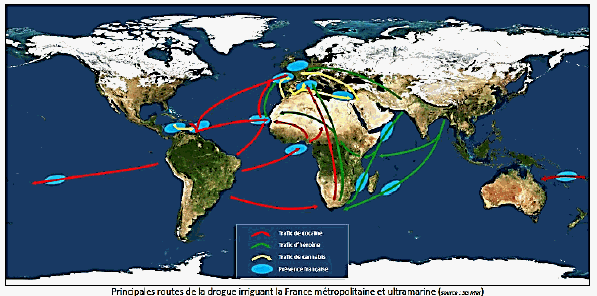
Source : SGMer
a. L’immigration clandestine à Mayotte
L’immigration clandestine par la voie maritime est particulièrement préoccupante à Mayotte puisque chaque année des milliers de Comoriens tentent de rejoindre ce département d’outre-mer. Au total, on estime que 40 % des 250 000 habitants de l’île sont des clandestins.
Environ 10 000 à 13 000 migrants sont secourus en mer chaque année, 500 passeurs appréhendés, et 18 000 personnes sont reconduites à la frontière.
A. UNE VISION STRATÉGIQUE PERTINENTE, BIEN ÉTABLIE, RÉCEMMENT RENOUVELÉE ET QUI NE DEMANDE QU’À ÊTRE MISE EN œUVRE
1. Le livre bleu de 2009 : un document ancien mais encore très actuel
La France dispose d’une véritable vision d’ensemble, stratégique et coordonnée, des actions à mener en matière maritime. Elle en dispose même depuis plusieurs années, ce qui ne manque pas d’alerter sur les insuffisances de l’impulsion politique pour sa mise en œuvre.
En effet, adopté par le Comité interministériel de la mer (CIMER) du 8 décembre 2009, le Livre bleu définit une Stratégie nationale pour la mer et les océans. Issue du Grenelle de la mer, celle-ci est articulée selon quatre axes :
– investir dans l’avenir ;
– développer une économie durable de la mer ;
– promouvoir la dimension maritime des outre-mer ;
– affirmer la place de la France dans le contexte international.
Le Livre bleu prévoit pour ce premier volet quatre séries d’actions :
– mieux connaître, pour mieux les gérer, la mer et les océans : l’objectif est de faire de la recherche marine française « le cœur d’une véritable politique océanographique », notamment grâce à la couverture progressive des zones maritimes françaises par des cartographies et des inventaires des ressources marines ;
– protéger l’environnement marin, avec trois principaux champs d’action : la protection des écosystèmes et de la biodiversité, notamment grâce à la mise en œuvre de la « stratégie nationale pour les aires marines protégées » (AMP) menée par l’Agence des aires marines protégées avec pour objectif le classement de 10 % des zones sous juridiction française en 2012 (à la date de la rédaction du présent rapport, il est prévu que les attributions de l’Agence des aires marines protégées soient reprises par l’Agence française pour la biodiversité) ; l’éducation et la formation aux métiers de la mer, par une « stratégie globale de formation aux métiers actuels et futurs de la mer » ; des initiatives pour susciter chez les Français la passion de la mer, en particulier pour les sensibiliser dès leur plus jeune âge et tout au long de leur scolarité, par exemple en développant les partenariats entre les établissements secondaires et les grands employeurs maritimes.
a. Développer une économie durable de la mer
Le Livre bleu décline plusieurs séries d’actions :
– la valorisation durable des ressources naturelles, selon les principes d’une « gestion durable des ressources publiques » du milieu marin et océanique. Trois types de ressources marines sont distinguées : les ressources biologiques (les ressources halieutiques, mais aussi la biomasse issue des cultures marines), les ressources énergétiques et les ressources minérales (métaux et hydrocarbures) ;
– une pêche et une aquaculture durables, avec la mise en place d’« écolabels » pour les « pêcheries durables » et d’un « comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes » pour « favoriser un esprit de partage dans une maison commune entre scientifiques, pêcheurs et société civile », notamment en vue d’éviter la surpêche ;
– une construction navale innovante et compétitive, avec la mention du « maintien d’une industrie de construction navale nationale de navires civils et militaires [qui] passe par une spécialisation dans la construction de navires nécessitant une haute technologie » ;
– assurer la mutation du transport maritime, en renforçant le pavillon national, en faisant valoir la qualité des standards de sécurité et de protection sociale attachés au registre international français (RIF), et en accélérant la mutation environnementale du transport part le « report modal » des modes de transport polluants vers le transport maritime (« autoroutes de la mer », cabotage à courte et moyenne distance, transport maritime interurbain – « tramways côtiers écologiques » – et mise en réseau des ports) ;
– disposer de ports de dimension internationale ;
– faire définir une stratégie pour les activités maritimes de plaisance et de loisir par l’État et les collectivités territoriales, pour concilier le développement de ces activités et les exigences de préservation du littoral.
a. Promouvoir la dimension maritime des outre-mer
Le Livre bleu consacre à ces volets plusieurs développements articulés autour des éléments suivants :
– la place des collectivités territoriales ultramarines, acteurs de la politique maritime nationale , l’objectif étant que les zones maritimes outre-mer bénéficient d’abord aux populations des collectivités territoriales d’outre-mer et contribuent à leur développement économique et social ;
– les enjeux liés à la préservation de l’environnement marin outre-mer : la « biodiversité exceptionnelle » des outre-mer constituant un « atout considérable », mais conférant à la France une responsabilité particulière. L’objectif est un renforcement de la gouvernance partenariale des plans d’action locaux de la stratégie nationale de la biodiversité et de l’initiative française pour les récifs coralliens ;
– les ressources marines des outre-mer, avec la gestion durable des ressources biologiques des outre-mer (algues, ressources halieutiques, bioressources et biotechnologies associées), élément qui implique des moyens de surveillance et de contrôle adaptés, avec l’exploitation des ressources énergétiques renouvelables marines de ces territoires, suffisantes pour couvrir leurs besoins en énergie électrique, et les ressources minérales sous-marines, qui offrent de réelles perspectives de développement économique, tant pour les hydrocarbures que les métaux.
a. Affirmer la place de la France dans le contexte international
Pour affirmer la place de la France dans le contexte maritime international, le Livre bleu recommande que la France se positionne :
– d’abord comme acteur au sein de la gouvernance internationale avec deux objectifs principaux pour l’action diplomatique de la France en matière maritime : la protection globale des océans et de leurs ressources ; la préservation des intérêts nationaux et européens ;
– ensuite comme moteur de la construction de la politique maritime intégrée de l’Union européenne (la « politique maritime intégrée »).
Il recommande aussi que la France :
– exerce pleinement ses responsabilités, délimite plus précisément les zones placées sous sa juridiction et y déploie des moyens juridiques et techniques lui permettant d’assurer ses missions de police ;
– conforte sa capacité d’action en termes de défense et de sécurité puisqu’il lui revient, y compris hors des zones placées sous sa juridiction, d’assurer la protection des voies d’approvisionnement maritime de l’Europe et de ses territoires ultramarins.
2. La stratégie nationale de sureté des espaces maritimes adoptée par le CIMer du 22 octobre 2015
Le 22 octobre dernier, le Comité interministériel de la mer (CIMer) a adopté en complément une stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes, elle aussi très complète.
Elle présente en effet l’ensemble des orientations et mesures nécessaires à une grande ambition maritime. S’inscrivant dans le prolongement du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, cette stratégie vise également à apporter une vision complémentaire à la stratégie de sûreté maritime adoptée en 2014 au niveau de l’Union européenne.
Trois objectifs majeurs sont ainsi définis :
– la liberté des mers, précisée comme étant l’utilisation libre, sûre et durable de la mer ;
– l’affirmation du rang de la France comme grande puissance maritime ;
– la volonté d’un développement économique par la mer.
Ensuite, après l’analyse du contexte stratégique international et des risques et menaces géographiques, la stratégie nationale de sûreté maritime définit six actions.
La première est intitulée « Maîtriser nos espaces maritimes ». Elle est déclinée selon plusieurs axes. Le deux premiers visent à donner un cadre à l’action de l’État en mer, en intensifiant le recours à ce mode d’organisation et en le faisant davantage connaître sur la scène européenne et internationale.
Trois autres visent à « Faire respecter les limites de nos espaces maritimes » : conforter les travaux de délimitation en s’appuyant sur l’expertise du SHOM ; poursuivre par la diplomatie la résolution des différends dans les zones contestées ; renforcer la visibilité de la France par une présence et une administration effectives.
Ensuite, cinq autres concernent la surveillance de nos espaces maritimes : le partage de l’information avec nos partenaires et alliés dans tous les bassins, y compris outre-mer ; la poursuite du diagnostic sur les besoins en matière satellitaire ; le recours après expertise et expérimentation aux outils complémentaires issus des nouvelles technologies, drones et radars de nouvelles générations ; l’implication des acteurs du secteur privé dans la veille ; la consolidation du rôle du centre de situation maritime national et d’analyse du centre opérationnel de la fonction garde côte.
En outre, trois autres visent à faire valoir les droits de la France dans les eaux placées sous sa juridiction : maintenir la cohérence entre les priorités de la surveillance et l’intervention, et les capacités ; consolider et adapter le corpus juridique aux nouveaux risques et aux nouvelles menaces ; assurer les suites diplomatiques et judiciaires consécutives aux violations des espaces français.
Enfin, quatre autres concernent la prévention des menaces maritimes contre le territoire : renforcer la sûreté des ports ; associer l’ensemble des acteurs à l’appréciation de la menace ; travailler sur la résilience des ports avant un événement majeur ; réévaluer régulièrement les scénarii de menaces et les mesures pour y répondre.
La deuxième action est intitulée « protéger nos ressortissants et nos navires ».
Quatre axes d’effort concernent la lutte contre la piraterie : adapter l’action de la France à la menace pour assurer une flexibilité dans ses interventions ; garantir la piraterie au plus près de son épicentre ; promouvoir le partage d’informations ; favoriser l’appropriation régionale des enjeux, avec l’appui de la communauté internationale ; s’assurer de la poursuite et de la condamnation effective des pirates et de leurs commanditaires.
Quatre autres axes visent à prévenir le terrorisme maritime : développer l’échange du renseignement dans le domaine maritime ; optimiser le contrôle des flux embarquant (passagers, équipage, véhicule, fret) ; approfondir la coopération avec les acteurs du secteur privé ; mettre en œuvre les nouvelles solutions technologiques de sécurisation du secteur maritime et du fret ; réévaluer la menace en liaison avec les acteurs du monde maritime.
Enfin, trois axes visent l’anticipation des cybermenaces : mobiliser les principaux acteurs concernés par les systèmes d’information du transport maritime ; identifier et corriger les vulnérabilités des systèmes critiques et assurer une veille cyberspécifique ; encourager la prise en compte de la cybersécurité ; inscrire cette action dans le cadre de la coopération entre alliés et partenaires européens ; mener une réflexion sur la résilience et les fonctionnements en mode dégradé.
La troisième action, dédiée à la « lutte contre les trafics illicites en mer », prévoit plusieurs axes d’effort ainsi conçus.
Au titre de la déstabilisation du trafic de stupéfiants, il est envisagé d’adapter notre corpus maritime au niveau de la menace et à l’évolution de ses modes d’action, de renforcer la coopération avec les partenaires étrangers de la France tant sur le plan diplomatique qu’au niveau opérationnel, de concentrer les efforts sur les flux maritimes notamment dans les territoires ultramarins, et de maintenir la priorité au renseignement et au ciblage, en corrélation avec les moyens d’interception.
S’agissant de la lutte contre les trafics d’arme et les biens contribuant à la prolifération, les trois axes d’efforts visent le développement des actions de coopération avec les pays partenaires, l’extension du champ du traité sur le commerce des armes, entré en vigueur en 2014, qui devrait être universel et des mesures pour aider à sa mise en œuvre, et la promotion des bonnes pratiques avec le secteur privé.
Enfin, sur le thème de la traite des êtres humains et des trafics de migrants, les cinq actions envisagées sont les suivantes : conforter le dispositif de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte ; renforcer l’échange d’informations sur les navires suspects et l’évolution des filières ; confirmer la contribution de la France à Frontex ; maintenir une capacité propre de surveillance et d’intervention, notamment en Méditerranée ; détecter l’émergence de nouvelles routes, notamment outre-mer, pour adapter notre dispositif.
La quatrième action est intitulée « Défendre nos intérêts économiques »¸ est articulée de la manière suivante.
Au titre de la garantie des approvisionnements stratégiques de la France, deux axes d’effort sont identifiés : analyser l’évolution des flux stratégiques ; adapter le dispositif de la France à toute nouvelle menace sur les routes existantes ou futures.
Ensuite, pour ce qui concerne la protection des infrastructures énergétiques et de communication, les axes d’effort sont l’intégration des enjeux de sécurité nationale dans la planification spatiale marine, la prise en compte des risques de sûreté pour le développement des nouvelles infrastructures énergétiques et l’évaluation régulière de la vulnérabilité des infrastructures de communication.
Par ailleurs, la préservation de l’environnement et des ressources passerait par la mise en place d’accords de coopération avec les pays voisins, la consolidation du cadre règlementaire de la recherche scientifique marine, le renforcement de la présence et des actions de la France dans les zones les plus exposées à la prédation et au pillage, et le renforcement de la présence française dans les organisations régionales de gestion de la pêche, qui sont extra-européennes.
Enfin, sur l’anticipation des changements climatiques et leurs impacts sur la sûreté maritime, quatre axes sont envisagés : engager au niveau interministériel une analyse des risques et les conséquences du changement climatique pour l’action de l’État en mer ; améliorer la capacité d’appréciation des situations maritimes d’urgence, particulièrement outre-mer, et avec une coopération internationale pour le partage d’information ; appuyer l’entrée en vigueur en 2017 et la mise en œuvre du code polaire ; maintenir des moyens adéquats dans les zones à risque.
La cinquième action vise à « Promouvoir un domaine maritime international sûr », autour de trois principes structurants :
– contribuer au respect du droit de la mer, en affirmant l’attachement de la France aux grands principes de la CNUDM, en continuant à promouvoir sa bonne application, comme celle des instruments internationaux permettant de lutter contre les crimes commis en mer, et en encourageant la conclusion d’accords régionaux ou bilatéraux pour son application ;
– promouvoir l’action et l’influence de la France auprès des partenaires de la France, en favorisant le détachement d’experts maritimes au sein des organisations, institutions et forums internationaux, en sensibilisant le réseau diplomatique et consulaire aux enjeux maritimes, en appuyant le développement de la gouvernance maritime dans les zones d’intérêt stratégique, et en favorisant l’adoption de cadre législatifs permettant une répression effective des infractions commises en mer ;
– renforcer les coopérations maritimes avec les États tiers, en concentrant les efforts de la France sur les collectivités et départements d’outre-mer pour favoriser la signature d’accords techniques bilatéraux en matière d’action de l’État en mer, en assurant la promotion des coopérations opérationnelles avec les États dans les zones où nous partageons des intérêts communs, et en étudiant la possibilité de disposer d’officiers de liaison au sein des administrations garde-côtes des pays partenaires.
La sixième et dernière action, intitulée « Préparer l’avenir », est structurée d’abord autour de l’amélioration de la Gouvernance, avec trois axes : faire vivre la stratégie ; conforter le cadre interministériel de l’action de l’État en mer ; renforcer la cohérence de la fonction des garde-côtes.
Ensuite, deux axes sont évoqués pour compléter le corpus juridique de la France : clarifier le cadre législatif et règlementaire et adapter la législation à l’évolution des risques et des menaces.
Par ailleurs, deux autres axes visent à développer l’utilisation de nouveaux outils technologiques : s’engager dans l’ère numérique et renforcer l’utilisation des outils de surveillance satellites, radars et drones. Pour ce qui concerne l’accroissement de l’efficacité opérationnelle, les actions envisagées sont les suivantes : renforcer l’échange de renseignement, mieux animer l’information d’intérêt maritime et optimiser l’emploi des moyens. Un volet est également consacré au développement de l’association des acteurs du secteur privé du monde maritime pour la promotion, d’un côté, d’un monde maritime sûr et, de l’autre côté, de l’expérience et du savoir-faire français.
Enfin, le dernier volet vise à inscrire l’action de la France dans un cadre multilatéral de coopération, en se fondant sur les stratégies développées dans le cadre de l’Union européenne, en portant la voix de la France au sein des instances internationales dédiées à la sûreté maritime et en assurant le développement et l’interconnexion des centres de partage et de fusion de l’information dans le monde.
3. Les autres décisions du CIMer du 22 octobre 2015
Le CIMER du 22 octobre dernier a décidé plusieurs orientations essentielles à la mise en œuvre de notre stratégie maritime.
Celles-ci témoignent clairement tant par leur nombre et leur exhaustivité que par leur précision d’une vision qui ne demande qu’à être mise en œuvre.
Le détail en est, en effet, le suivant :
– hisser les grands ports maritimes au niveau de leurs principaux concurrents européens en renforçant leur compétitivité et en leur donnant de nouvelles perspectives de développement ;
– favoriser la compétitivité des armateurs et des chantiers navals en assurant la transition écologique de la flotte pour améliorer les conditions d’exploitation des navires ;
– soutenir le renouvellement des flottes de pêche pour préparer l’avenir et l’installation des jeunes, avec des technologies innovantes ;
– soutenir l’aquaculture française pour réduire notre dépendance aux importations, relocaliser des emplois et favoriser le développement durable ;
– se doter d’une planification à moyen et long terme pour l’exploitation des grands fonds marins, afin d’ouvrir les zones prometteuses aux industriels, tout en assurant la prise en compte de la dimension environnementale ;
– développer de manière transparente et concertée les outils permettant la coexistence des différents usages de la mer ;
– améliorer la sûreté des espaces et des activités maritimes. Renforcer la lutte contre les trafics maritimes illicites ;
– pérenniser le modèle de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et renforcer les capacités publiques d’intervention en mer ;
– poursuivre le renouvellement des moyens navals de haute mer, en intégrant les enjeux maritimes outre-mer, notamment la préservation du milieu et la lutte contre les trafics illicites ;
– compte-tenu des enjeux maritimes outre-mer, notamment pour la préservation du milieu et la lutte contre les trafics illicites, poursuivre le renouvellement des moyens navals de haute mer ;
– soutenir le développement des ports outre-mer en favorisant leur intégration dans leur environnement régional.
4. Des comparaisons internationales qui ne sont pas au désavantage de la France
a. Le Canada : une priorité claire relevant d’une stratégie maritime intégrée
La mer est pour le Canada une priorité indiscutable. Avec plus de 200 000 kilomètres, c’est le pays qui dispose de la plus grande longueur de côtes au monde.
Il a opté en 1997 pour une stratégie maritime intégrée dans le cadre de la loi sur les océans adoptée en janvier de la même année.
Celle-ci porte sur les trois océans qui la borde, l’Atlantique, l’Arctique et le Pacifique.
Elle est la base juridique de la stratégie pour les océans de 2002 et le Plan d’action du Canada pour les océans de 2005.
Les objectifs affichés dans ce cadre sont clairement transversaux. Ils visent en effet le développement durable des océans et de leurs ressources, avec notamment la sauvegarde de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin et l’application du principe de la précaution sur la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources marines afin de protéger ces ressources et de préserver l’environnement marin, avec un accent sur les possibilités de diversification et de croissance économique au profit de tous les Canadiens et, en particulier, des collectivités côtières.
C’est aussi le cadre d’une coopération entre les différents acteurs, le ministre des Pêches et des Océans, mais aussi les autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées.
Le rattachement au ministère de la pêche conduit cependant à une certaine sectorisation marquée dans la stratégie ministérielle de développement durable des pêches et des océans pour la période 2013-2016.
Les États-Unis ont déployé une politique maritime intégrée en 2004 pour régir contre l’abandon des océans dénoncé notamment dans un ouvrage de référence de Donovan Gibson, The Abandoned Ocean : A History of United States Maritime Policy University of South Carolina Press, 2001.
En juillet 2010, le président Obama a réinvesti le sujet en engageant les Etats-Unis à exercer un leadership au niveau international en la matière.
Celle-ci a plusieurs volets, avec notamment une dimension énergétique et environnementale, développée par le secrétaire d’Etat John Kerry sur les énergies marines renouvelables dans son discours au World Ocean Summit en 2014 et aussi une dimension militaire avec l’annonce en 2014, également, d’une nouvelle révision de la stratégie maritime fondée notamment sur l’évolution des questions de sécurité, la cyberguerre, l’Arctique et les enjeux stratégiques du réchauffement climatique.
Le Gouvernement a présenté au parlement en mai 2014 la stratégie nationale du Royaume-Uni pour la sécurité maritime.
Celle-ci fait l’objet d’une coordination entre les quatre ministres signataires : M. William Hague, secrétaire d’État pour les affaires étrangères et le Commonwealth, Mme Theresa May, secrétaire d’État à l’intérieur (Home Secretary), M. Phil Hammond, secrétaire d’État pour la défense, et M. Patrick McLoughling, secrétaire d’État pour les transports,
La stratégie prend d’abord acte, de manière très pragmatique, de l’importance du secteur maritime pour le Royaume-Uni, non seulement en raison du commerce international, mais également en raison de l’importance des activités d’exploitation de la mer, en particulier la pêche et la production d’énergie.
Ce dernier point est essentiel car, comme l’a confirmé le déplacement au Royaume-Uni, la mer reste une importante ressource sur le plan énergétique : les éoliennes y sont implantées au moment même où les gisements d’hydrocarbures sont en voie d’épuisement.
Cinq objectifs prioritaires sont identifiés par la stratégie de sécurité maritime du Royaume-Uni :
– la promotion de la sécurité maritime au niveau international et du respect des règles du droit international ;
– le développement des capacités de gouvernance des pays situés dans les zones maritimes d’importance stratégique ;
– la protection du Royaume-Uni, de ses citoyens, de ses intérêts économiques, ainsi que des navires sous pavillon du Royaume-Uni, ou bien de ses territoires et dépendances (Red Ensign Group) ;
– la sécurité des axes maritimes commerciaux et de ravitaillement en énergie ;
– la protection des populations du Royaume-Uni et des territoires d’outre-mer vis-à-vis des activités illégales, y compris le crime organisé et le terrorisme.
Dans cette perspective, cinq actions sont envisagées pour améliorer la sécurité maritime :
– mieux comprendre l’environnement maritime, en harmonisant les points de vue grâce à l’échange de renseignements et au renforcement des relations avec le secteur privé et les pays partenaires ;
– influencer, en coopérant avec les pays partenaires, en opérant dans le cadre bilatéral comme en défendant les initiatives régionales, y compris en contribuant à la stratégie européenne de sécurité maritime ;
– prévenir, en augmentant le partage du renseignement et les échanges de bonnes pratiques avec les pays partenaires, ainsi qu’en aidant à la mise en place de capacités dans les régions d’importance stratégique : l’Asie du Sud-Est, le golfe Arabo-persique, le golfe d’Aden, la mer Rouge, la mer Méditerranée, les Caraïbes et le golfe de Guinée ;
– protéger, avec un effort sur les technologies de la sécurité ;
– répondre, en coordonnant davantage des actions des différentes instances compétentes en la matière au sein du Royaume-Uni.
Le dernier volet de la stratégie est dédié à l’amélioration de la coordination administrative. Il l’organise à plusieurs niveaux, selon les modalités évoquées au c. du 1 du E ci-après.
De manière particulièrement méthodique, la stratégie nationale de sécurité maritime du Royaume-Uni fait l’objet de précisions. Tel est d’abord le cas quant à son articulation avec la stratégie nationale de sécurité. Elle ne concerne ainsi pas la défense du royaume (Defense of the Realm) ni les campagnes maritimes. Ensuite, elle ne concerne pas non plus le sauvetage et le secours en mer (Maritime Safety). Elle respecte, enfin, les compétences du département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Department for Environment Food & Rural Affairs - DEFRA), ainsi que des gouvernements délégués d’Ecosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord pour les inondations et l’érosion côtière, de même que celles de l’Agence pour les questions maritimes et les garde-côtes pour la sécurité et le sauvetage en mer, ainsi que la lutte contre la pollution.
A titre de complément, il faut rappeler que le ministère de la défense publie une contribution concernant les territoires d’outre-mer intitulée Overseas Territories - The Ministry of Defence’s Contribution, laquelle aborde, d’une manière plus détaillée que ne le fait le Livre blanc français, les éléments de la présence britannique dans chacun des territoires ou groupes de territoires d’outre-mer.
Il faut rappeler que le Royaume-Uni dispose de quatorze territoires d’outre-mer, dont deux sont spécifiques : l’Antarctique, en raison du gel des revendications territoriales par le traité précité de 1959, et interdisant sa militarisation ; les bases souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia à Chypre, qui sont en bord de mer, qui génèrent des droits sur les espaces maritimes attenants, au profit Royaume-Uni.
La carte suivante donne la localisation des ZEE du Royaume-Uni et de ses territoires d’outre-mer.
ZEE du Royaume-Uni, des dépendances de la Couronne et des territoires d’outre-mer
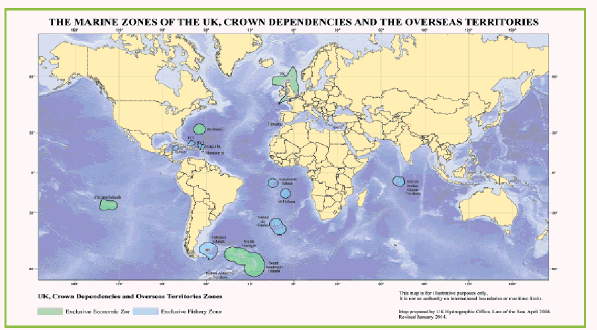
Source : Ministry of Defence
La superficie totale est, hors Antarctique, de 5,96 millions de kilomètres carrés (2,3 millions de miles carrés).
Si la présence maritime de la Royal Navy sera évoquée ci-après, pour comparaison avec la Marine nationale, il faut simplement mentionner que quatre territoires d’outre-mer du Royaume-Uni ont une vocation militaire avec la présence importante de troupes : les îles de l’Atlantique Sud, pour l’essentiel les Malouines (1 300 militaires, avec en outre 50 civils et 700 contractuels) ; Gibraltar, avec une garnison de 900 personnes ; le Territoire britannique de l’océan Indien (British Indian Ocean Territory- BIOT), où quelque 40 militaires anglais viennent en soutien des 2 500 soldats et contractuels américains stationnés sur la base de Diego Garcia ; Chypre avec les deux bases souveraines où sont stationnés les 2 700 personnels civils et militaires des Forces britanniques de Chypre (British Forces Cyprus-BFC), et les 900 membres de la Royal Air Force (RAF).
Le Royaume-Uni a fait plusieurs demandes d’extension du plateau continental.
Outre la demande conjointe avec l’Irlande sur Hatton-Rockhall au large de des îles britanniques, la plus importante en cours concerne les îles Malouines, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.
Lors du déplacement de la mission à Londres, au FCO, il a été indiqué que la recommandation, négative, de la CLPC, du 15 avril 2010, relative à l’île d’Ascension continuait à être suivie avec attention. La CLPC a relevé que l’île émergeait directement de la plaine abyssale (deep ocean floor) et qu’aucune extension ne pouvait être validée au-delà de 200 milles, mais le Royaume-Uni observera attention la décision relative à l’Islande qui se trouve sur la dorsale océanique, compte tenu du fait qu’Ascension est juste à côté de celle-ci.
B. UNE CAPACITÉ DE COORDINATION AVÉRÉE GRÂCE À DES INSTRUMENTS ESSENTIELS : LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MER ET L’ACTION DE L’ETAT EN MER, MAIS AUSSI L’ADMINISTRATION DES TAAF
1. Le Secrétaire général de la mer et le CIMer
a. Le secrétaire général de la mer et le secrétariat général de la mer
Le Secrétariat général de la mer a été créé en 1995, en l’absence de désignation d’un ministre de la mer, par le décret n° 95-1232 du 22 novembre. Il est chargé d’un rôle transversal de coordination tout à fait essentiel, car plusieurs ministères sont concernés par les affaires maritimes.
À sa tête, le Secrétaire général de la mer (SGMer) est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission d’animer et de coordonner les travaux d’élaboration de la politique du Gouvernement en matière maritime, de proposer les décisions qui en découlent et de s’assurer de la mise en œuvre de la politique arrêtée.
Le SGMer exerce également une mission de contrôle, d’évaluation et de prospective. Il assure la coordination du suivi des textes relatifs à la mer et propose les adaptations nécessaires, compte tenu de l’évolution du droit international et européen.
Le SGMer est associé à l’élaboration des politiques concernant la mer et le littoral, et veille à ce que les décisions du Gouvernement soient conçues et mises en œuvre en étroite concertation avec l’ensemble des professionnels concernés, afin d’assurer le développement harmonieux des différentes activités maritimes.
Le SGMer anime et coordonne aussi l’action des préfets maritimes et délégués du Gouvernement outre-mer (DDG outre-mer) pour l’action de l’État en mer.
Le SGMer assure enfin la préparation et le suivi de l’exécution des délibérations du Comité interministériel de la mer (CIMer), sous l’autorité du Premier ministre.
a. Le comité interministériel de la mer (CIMer)
La coordination au niveau national de l’action de l’État en mer est assurée, depuis 1978, par un comité interministériel de la mer (CIMer), « chargé de délibérer sur la politique du Gouvernement dans le domaine de la mer sous ses divers aspects nationaux et internationaux et de fixer les orientations de l’action gouvernementale dans tous les domaines de l’activité maritime. »
Présidé par le Premier ministre, le CIMer réunit les ministres de l’économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de l’industrie, de l’environnement, les ministres chargés de l’outre-mer, du budget, de l’équipement et des transports, de la pêche, du tourisme, de l’aménagement du territoire, de la recherche et, en tant que de besoin, d’autres membres du Gouvernement.
a. Une coordination administrative comparativement moins achevée au Royaume-Uni
Le déplacement au Royaume-Uni a permis de mesurer, notamment au département des transports, combien l’exemple français du SGMer y était apprécié.
Même si la question de la coordination est d’une moindre ampleur qu’en France compte tenu de la tradition maritime qui continue à imprégner les esprits, elle se pose dans des termes voisins et a été partiellement résolue par la stratégie nationale pour la sécurité maritime de mai 2014.
En effet, deux instances ont été instituées : d’une part, un groupe de travail au niveau ministériel sur la sécurité maritime (Ministerial Working Group on Maritime Security) ; d’autre part, un groupe de hauts fonctionnaires pour coordonner le travail intergouvernemental qu’exigent les décisions des ministres, avec, en outre, une instance pour la consultation des acteurs du secteur privé. Le Conseil national de sécurité (National Security Council) est aussi réuni lorsque cela s’avère nécessaire. Il peut confier des travaux au groupe de travail ministériel.
C’est le fruit d’une évolution récente. En effet, le groupe de travail ministériel est issu du groupe de travail ministériel sur la lutte contre la piraterie, dont les compétences ont été étendues. Il est présidé par un représentant du département des affaires étrangères et du Commonwealth (Forein and Commonwealth Office-FCO). Il a trois missions : superviser la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité maritime ; veiller, d’une manière plus générale, à la sécurité maritime ; coordonner et mener les politiques de sécurité dans le domaine maritime au niveau international et au niveau national.
Pour sa part, le comité national de la sécurité maritime (National Maritime Security Committee), auquel a été joint le groupe national de surveillance maritime (National Maritime Oversight Group), a deux déclinaisons : l’une pour les représentants du gouvernement, à savoir les hauts-fonctionnaires ; l’autre pour les entreprises.
Trois réunions par an au minimum sont prévues pour le comité national de sécurité maritime, au niveau des hauts-fonctionnaires. La présidence en est assurée par un représentant du département des transports.
Le schéma suivant récapitule ces éléments :
La Gouvernance de la sécurité maritime au Royaume-Uni
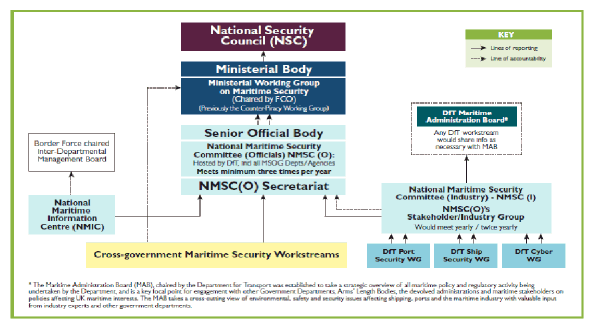
Source : The UK National Strategy for Maritime Security – Mai 2014
2. L’action de l’État en mer, enrichie depuis 2010 d’une fonction garde-côtes
C’est dans les années 1970 qu’est apparue l’action de l’État en mer (AEM), dans sa forme moderne, afin de répondre à l’extension des espaces maritimes et à la croissance considérable des activités humaines, non seulement le transport et la pêche, mais aussi la plaisance et l’exploitation des minéraux.
À l’occasion de la création des zones économiques exclusives en 1976, l’État n’a pas opté pour la création d’une structure de garde-côtes spécialisée, mais s’est engagé dans la voie de l’autorité unique en mer et de la polyvalence des moyens des différentes administrations intervenant en mer.
L’action de l’État en mer (AEM) est une modalité d’organisation administrative et opérationnelle qui confie à une autorité administrative unique (le préfet maritime en métropole et le délégué du gouvernement pour l’AEM assisté du commandant de zone maritime, pour l’outre-mer) la réalisation des plusieurs missions bien identifiées (les 45 missions de l’AEM sont fixées par l’arrêté du 22 mars 2007) aux administrations disposant de moyens d’intervention, et qui donne la capacité à toutes les administrations intervenant en mer d’y constater les infractions en mer dans un large spectre.
L’AEM s’exerce dans le cadre de dix zones maritimes (3 en métropole, 6 outre-mer et 1 ne comprenant pas d’espaces maritimes français).
La zone maritime comprend des espaces placés sous la juridiction de la France (eaux intérieures, mer territoriale, zone économique) mais aussi la haute mer sur laquelle la France peut exercer certaines attributions, soit à l’égard de ses propres navires, soit à l’égard des navires étrangers en application des conventions internationales (piraterie, lutte contre le narcotrafic et l’immigration clandestine).
Chacune d’entre elles se voit définir un tribunal compétent.
La carte suivante permet d’en visualiser les contours.
Zones maritimes françaises
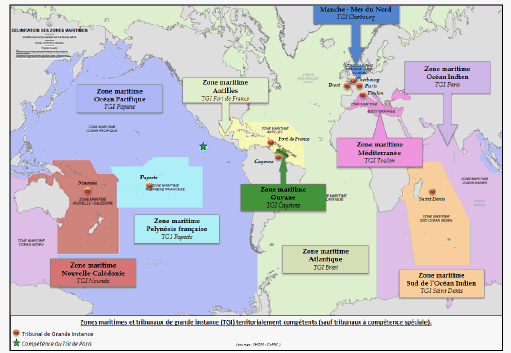
Source : SGMer
Depuis plus de deux siècles, le préfet maritime (ou le DDG outre-mer) représente l’autorité de l’État en mer. À la fois chef militaire et responsable d’administration civile, il coordonne l’action en mer des différentes administrations concernées et la mise en œuvre de leurs moyens.
Pour remplir ses missions, le préfet maritime s’appuie sur les centres opérationnels existants de chaque administration (COM, CROSS) et sur les moyens mis à disposition par les autres administrations au titre de son pouvoir de coordination. Et en tant qu’autorité administrative, il dispose de pouvoirs de police et réglementaires.
Le concept français d’organisation de l’action de l’Etat en mer a été renforcé en 2010 avec la création d’une fonction garde-côtes destinée à renforcer la cohérence de cette organisation à l’échelon national. Annoncée par le Président de la République lors de son discours du Havre du 16 juillet 2009 et définie dans le Livre bleu sur la stratégie nationale pour la mer et les océans, la fonction celle-ci est entrée officiellement en vigueur le 8 décembre 2009, lors d’un comité interministériel de la mer présidé par le Premier ministre.
Parmi les déclinaisons de la fonction garde-côtes, il faut noter :
– l’institution d’un comité directeur des administrations dont les moyens concourent à l’action de l’État en mer chargé de proposer les priorités d’action et de se pencher sur la politique des moyens ;
– la création au niveau central (SG Mer) d’un centre opérationnel de la fonction garde-côtes, point d’entrée des nouveaux systèmes de surveillance maritime (EUROSUR par exemple) et doté de fonctions de veille et d’analyse des événements maritimes au profit des autorités gouvernementales et des représentants de l’État en mer ;
– l’élaboration d’un format global inter-administrations des moyens nécessaires à la fonction garde-côtes ainsi qu’à l’identification et à l’animation de démarches d’optimisation capacitaire.
Pour être très précis, les missions de l’action de l’État en mer, définie par arrêté en 2007 concernent les domaines suivants :
– la sécurité maritime (recherche et sauvetage en mer ; sauvegarde de la vie humaine en mer ; préservation du milieu maritime et côtier, dont la gestion des espaces protégés ; préservation de la sécurité de la navigation et des dessertes maritimes) ;
– la sûreté maritime, avec les dispositifs de prévention, de protection et de réaction à opposer aux actes de terrorisme et de piraterie ;
– la lutte contre les pollutions accidentelles et volontaires, notamment les rejets en mer ;
– le contrôle des pêches ;
– la lutte contre les trafics illicites ;
– la lutte contre l’immigration illégale par voie maritime, sous l’égide de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle du contrôle des frontières extérieures (FRONTEX) ;
– la délimitation des territoires et espaces maritimes – le SGMer participe aux politiques de détermination et de défense des délimitations des territoires et espaces maritimes de la France ;
– l’extension des limites du plateau continental, avec un programme national placé sous la coordination du SGMer qui préside un comité de pilotage interministériel et assure la conduite de la délégation française pour la défense des demandes d’extension devant la commission des limites du plateau continental des Nations unies (CLPC).
Il faut ajouter la gestion du patrimoine marin et des ressources publiques marines, ainsi que pour les unités en mer la police douanière, fiscale et économique. La marine nationale peut notamment exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir ou réprimer les infractions aux lois et règlements douaniers et fiscaux et apporter sa contribution à la défense des intérêts économiques dans les eaux placées sous souveraineté française ainsi que dans la zone contiguë qui s’étend jusqu’à 24 milles des lignes de base.
Si la marine nationale, qui fait l’objet d’un développement à part au C ci-après, est l’épine dorsale du dispositif en termes opérationnels, d’autres administrations interviennent aussi, notamment :
– la direction générale des douanes et droits indirects, qui relève du ministère chargé du budget, engagée dans l’action de l’État en mer depuis des décennies et dont le cœur de métier est le contrôle des marchandises, ce qui implique une activité de contrôle des navires en mer ;
– la direction des affaires maritimes, qui participe aux missions de sauvetage en mer, à la protection des ressources halieutiques, à la prévention des pollutions et à la surveillance des aires marines protégées, et s’appuie sur ses sept centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), cinq en métropole et deux outre-mer, et ses unités nautiques, composées d’une soixantaine de bâtiments ;
– la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) n’est pas une administration, mais une association, créée il y a un plus d’un siècle, qui bénéfice depuis 1986 d’une subvention publique, à hauteur de 30 % de ses ressources.
3. L’administration des Terres australes et antarctiques françaises
L’administration des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) est un exemple d’administration d’un espace essentiellement maritime, à raison d’une ZEE de 2,39 millions de kilomètres carrés et 423 000 kilomètres carrés d’extension du plateau continental au large des Kerguelen.
Il faut rappeler que les TAAF sont, depuis 1955, une collectivité territoriale, avec trois particularités. D’abord, il n’y a pas de population permanente. Ensuite, son territoire est constitué d’îles fort éloignées les unes des autres dans l’océan Indien et si la terre Adélie a une dimension continentale, c’est un désert de glace et le traité de 1959 sur l’Antarctique, qui gèle comme on l’a vu, les revendications territoriales, rend l’exercice d’une souveraineté tout à fait virtuel. Enfin, elle est administrée par un préfet, administrateur des TAAF à partir du territoire d’une autre collectivité ultramarine, La Réunion. Depuis 2000, le siège des TAAF est en effet à Saint-Pierre.
Les TAAF sont formées de cinq districts, dont quatre sont uniquement insulaires et maritimes : l’archipel des Kerguelen ; l’archipel de Crozet ; les îles Saint-Paul et Amsterdam ; les îles Éparses (rattachées aux TAAF depuis la loi du 21 février 2007), qui rassemblent, comme on l’a vu, les îles de l’archipel des Glorieuses, ainsi que Juan de Nova, Europa et Bassas da India, situées dans le canal du Mozambique, ainsi que Tromelin, située au nord de La Réunion. Le cinquième district est la Terre-Adélie.
Aujourd’hui, les différentes TAAF n’abritent plus que des scientifiques ou des militaires. Les scientifiques sont surtout en terre Adélie, dans la base Dumont d’Urville, située sur l’île des Pétrels, à 5 kilomètres du continent, qui peut accueillir jusqu’à cent personnes et où une trentaine restent pendant l’hiver austral, ainsi qu’aux Kerguelen, dans la base de Port-aux-Français et à Crozet. Une station météorologique est établie sur Amsterdam : la base Martin de Viviès.
Dans les îles Éparses, les stations météorologiques créées à partir de 1949 sont largement automatisées. Depuis 1973, des détachements des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) sont installés sur les îles de la Grande Glorieuse, Juan de Nova et Europa. Il s’agit chaque fois d’une quinzaine d’hommes, relevés généralement toutes les six semaines. Un gendarme est aussi présent sur chacun de ces sites. C’est la marque de la souveraineté française. Il s’agit aussi d’éviter toute colonisation « sauvage ».
Les TAAF sont ainsi selon la formule de M. Michel Rocard, ambassadeur chargé des négociations internationales sur les pôles, une collectivité essentiellement dédiée à l’aménagement, aux infrastructures et au transport.
L’administration des TAAF est assurée par un préfet qui s’appuie sur un conseil consultatif constitué de personnalités qualifiées. En l’absence de population permanente en effet, la collectivité n’a pas d’assemblée élue et le préfet est à la fois le représentant de l’État et l’exécutif de la collectivité.
Leur dimension maritime fait que les TAAF doivent assurer le ravitaillement des îles Crozet, Kerguelen et Amsterdam sont ravitaillées depuis La Réunion par le Marion-Dufresne II, avec en général quatre rotations par an. Le Marion-Dufresne appartient à la collectivité des TAAF et est opéré par la CMA-CGM. C’est un cargo et un pétrolier, mais aussi un porte-hélicoptères et un navire de recherche océanographique doté de plusieurs systèmes pour la manipulation d’engins et matériels lourds, d’un sondeur multifaisceaux et d’un carottier sédimentaire géant. Il a connu cette année une opération de rénovation.
Par ailleurs, les missions de souveraineté, essentiellement la lutte contre la pêche illicite dans la ZEE, sont assurées par le commandement des forces armées de la zone sud de l’océan Indien (COMSUP-FASZOI). La base réunionnaise de Port-des-Galets accueille plusieurs bâtiments de la Marine nationale : deux frégates de surveillance dotées chacune d’un hélicoptère Panther, deux patrouilleurs, un bâtiment de transport léger, une vedette côtière de la gendarmerie maritime. Certains de ces navires sont affectés à des missions de patrouille. Par ailleurs, dans le cadre du plan régional de surveillance des pêches établi en partenariat entre la Commission de l’océan Indien et l’Union européenne, l’administration des affaires maritimes met en œuvre un patrouilleur hauturier, l’Osiris, qui est propriété des TAAF. Plusieurs des bâtiments militaires ou civils de surveillance maritime présents dans la zone devraient être désarmés en 2015 ou 2016. Le patrouilleur L’Albatros de la Marine nationale a été désarmé en 2015. Le désarmement du bâtiment de transport léger (Batral) La Grandière et de l’Osiris est prévu.
La flotte fait actuellement l’objet de renouvellements importants.
Le Marion Dufresne a fait l’objet de lourds travaux de rénovation pour lesquels la collectivité a procédé à un emprunt de 10 millions d’euros.
Par ailleurs, l’administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), l’Institut Polaire Paul Emile Victor (IPEV) et la Marine nationale ont initié un partenariat au début de 2014 afin de remplacer deux navires (l’Astrolabe et l’Albatros) qui arrivent en fin de vie par un navire neuf conçu pour opérer dans un environnement austral et arctique. Il s’agit d’un navire logistique et de patrouille, brise-glace, d’une longueur de 72 mètres et d’une largeur de 16 mètres pouvant accueillir à bord jusqu’à 60 personnes, transporter 1 200 tonnes de fret et qui peut disposer d’un hélicoptère. Il serait aussi dénommé l’Astrolabe et devrait entrer en service en 2017.
C. UNE MARINE NATIONALE DE TRÈS HAUT NIVEAU, MAIS SURENGAGÉE
1. L’une des principales marines du monde par ses capacités et ses engagements
Sur le plan international, la France est considérée comme une puissance de premier plan, mais pas au même niveau que les États-Unis qui sont très au-dessus.
Elle est dans cette catégorie avec la Russie, la Chine et le Japon, qui la dépassent en tonnage, mais pas sur le plan technologique – c’est même le contraire sur bien des points –, ainsi que le Royaume-Uni et l’Inde.
Les capacités de la Marine nationale permettent d’assurer la présence de la France sur tous les océans, et aussi les opérations extérieures, dont certaines sur le très haut du spectre, en Méditerranée et dans le golfe Arabo-persique comme on le constate à propos des frappes aériennes contre Daech.
Les principaux équipements sont le porte-avions Charles de Gaulle, les 4 sous-marins nucléaires lance engin, les 6 sous-marins nucléaires d’attaque, les 3 BPC Mistral, les 16 frégates actuellement en service, dont les 2 de défense anti-aérienne, les 5 de lutte anti-sous-marine et les 2 multi-missions.
Il faut aussi mentionner les 11 bâtiments de guerre des mines, les 3 pétroliers ravitailleurs, les 9 patrouilleurs de haute mer et les 6 frégates de surveillance.
Le niveau d’engagement de la Marine nationale est particulièrement élevé, comme l’a indiqué l’Amiral Bernard Rogel.
Le contrat opérationnel a prévu la présence sur un ou deux théâtres. Actuellement, c’est sur quatre à cinq théâtres, hors dissuasion, que la Marine nationale est présente : les mesures de réassurance de l’OTAN dans l’Atlantique Nord ; la Méditerranée orientale, avec en outre la nouvelle mission de l’OTAN pour les migrants ; Corymbe dans le Golfe de Guinée ; l’Océan indien aux approches du détroit de Bab el Mandeb ; la Méditerranée centrale avec les opérations de l’Union européenne Triton et Sophia.
L’effectif de la marine nationale, apprécié par le plafond des emplois autorisés, est de 36 041 pour 2016.
2. Un instrument « dual » au cœur de l’action de l’État en mer
Comme on l’a vu, la Marine nationale participe à l’action de l’État en mer et assure la défense maritime territoire.
En 2003, cette dualité a été réglée par le concept de sauvegarde maritime
C’est maintenant la notion de posture permanente de sauvegarde maritime (PPSM) qui est utilisée.
Étant la première contributrice à la fonction « garde-côtes », la marine nationale est un acteur majeur de l’AEM. Toutes unités confondues, un quart de son activité et environ 4 % de son budget y sont consacrés. Elle fournit notamment le volet hauturier des capacités aéromaritimes. La gendarmerie maritime, quant à elle, assure l’interface entre la mer et la terre et consacre la totalité de son activité en mer à l’AEM.
En termes de ressources humaines, la marine et la gendarmerie maritime engagent respectivement 10 % et 51 % de leurs effectifs au sein d’un dispositif permanent de surveillance et de protection immédiate des approches maritimes et portuaires.
Les moyens aéronavals affectés à l’AEM comprennent notamment les patrouilleurs et hélicoptères de service public de la marine nationale, ainsi que les six patrouilleurs et 24 vedettes côtières de la gendarmerie maritime.
L’AEM comprend naturellement les opérations de secours en mer, auxquelles tous les bâtiments et aéronefs de la marine ont vocation à participer. Un dispositif spécifique et permanent d’alerte aérienne existe, constitué d’avions de surveillance ou de patrouille maritime et de cinq détachements d’hélicoptères. Chaque année, la marine porte secours à plus d’une personne en mer par jour.
La marine met par ailleurs en œuvre plusieurs dispositifs d’alerte, allant du contre-terrorisme maritime à la sécurité maritime et à la protection de l’environnement. Au titre de ces deux dernières missions, elle mobilise :
– quatre remorqueurs affrétés (les Abeille) dont la mission est d’empêcher des navires en difficulté de s’échouer sur nos côtes. En 2014, cinq navires de charge ont été assistés (16 en 2013) ;
– quatre bâtiments spécialisés dans la lutte contre les pollutions sont également affrétés.
La marine nationale s’est par ailleurs dotée d’un Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution (CEPPOL) dont la mission générale est de préparer la marine à ses responsabilités environnementales tout en apportant un soutien et une expertise aux autorités maritimes et aux responsables opérationnels lors des opérations de lutte antipollution.
La marine nationale et la gendarmerie maritime participent aussi à la politique nationale de contrôle des pêches. En métropole, la marine fournit son concours aux plans européens de contrôle des pêches hauturières. Outre-mer, elle s’appuie davantage sur la surveillance satellitaire pour optimiser l’emploi des unités de contrôle. En Guyane, il s’agit en outre d’un maintien de l’ordre public en mer. En tout, la marine nationale et la gendarmerie maritime réalisent plus de 65 % des déroutements de navires de pêche illégaux.
La marine nationale fournit le segment hauturier (y compris le volet coercitif) du dispositif interministériel de lutte contre le trafic de drogue. Dans le cadre d’un renforcement de la coopération interministérielle et internationale, elle est représentée dans les deux centres internationaux de coordination. Elle est également partenaire du Centre de coordination et lutte anti-drogue pour la Méditerranée (CECLAD-M, à Nanterre). Si les quantités de stupéfiants saisies en mer varient d’une année à l’autre, la marine nationale contribue en moyenne à 65 % du volume total des saisies en mer.
Les forces navales concourent à l’effort européen de contrôle des frontières maritimes en engageant chaque année des moyens aéromaritimes dans les opérations coordonnées par l’agence Frontex, comme l’opération Triton par exemple depuis fin 2014. Outre-mer, la lutte contre l’immigration clandestine requiert une mobilisation permanente de moyens de la marine nationale et de la gendarmerie maritime à Mayotte. Depuis 2012, plus de 2 800 migrants illégaux y sont interceptés chaque année, et 169 passeurs ont été arrêtés en 2014 (environ 130 en 2013 et 2012).
3. Une présence outre-mer permanente
a. Une mission maintenue malgré des réductions capacitaires avérées
La richesse de l’espace maritime français pouvant susciter des convoitises, la préservation des capacités de protection des approches maritimes outre-mer est indispensable.
Pour l’exercice de ces missions de souveraineté, les moyens maritimes et aéromaritimes déployés sont cependant vieillissants en réduction. Ils sont ainsi sous tension. Le cas de l’océan Indien est très parlant. Les moyens des Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) ont été partiellement engagés, à raison de l’une de leurs deux frégates, dans l’opération Atalanta de lutte contre la piraterie au large de la Corne de l’Afrique.
Cette situation de réduction temporaire de capacités est connue. Elle est issue du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 qui n’a pas inscrit le renouvellement de la flotte des patrouilleurs dans ses priorités. Ce renouvellement n’a donc été prévu qu’à l’horizon 2018, dans le cadre du programme BATSIMAR.
Le déficit actuel est de trois bâtiments sur neuf ; il sera de six sur neuf à l’horizon 2020.
En Polynésie française, l’équipement est constitué de la frégate de surveillance Prairial (embarquant un hélicoptère Alouette III), et d’un seul patrouilleur, l’Arago, puisque La Tapageuse a été désarmée en 2013. Le bâtiment de soutien Révi sera remplacé à la fin de 2016 par le B2M Bougainville, du patrouilleur côtier de gendarmerie Jasmin, de deux avions de surveillance maritime de type Guardian et de deux hélicoptères de service public de type Dauphin utilisés dans un cadre interministériel.
Pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la marine nationale dispose de la frégate de surveillance Vendémiaire (embarquant un hélicoptère Alouette III), des patrouilleurs La Moqueuse et La Glorieuse et de deux avions de surveillance maritime de type Guardian. La mise en service du B2M d’Entrecasteaux est en cours.
Pour l’océan Indien, les moyens de la Marine nationale sont basés à La Réunion et sont constitués de deux frégates de surveillance, le Nivose et le Floreal, équipées de moyens héliportés, ainsi que d’un seul patrouilleur, le Malin, puisque La Rieuse a été retirée du service actif en 2011. Le 3ème B2M, Le Champlain, devrait remplacer l’actuel navire de soutien dans les prochaines années.
S’agissant de la Guyane, le patrouilleur La Capricieuse sera remplacé par les deux patrouilleurs légers guyanais (PLG) prévus pour être livrés l’un en fin d’année et l’autre en 2017.
Pour les Antilles, les deux frégates de surveillance Ventôse et Germinal ne sont accompagnées d’aucun patrouilleur mais du bâtiment de transport léger (BATRAL) Dumont d’Urville, qui a repris la mer au mois d’août 2011 après une période d’entretien majeur. Celui-ci devrait être remplacé par le 4ème B2M.
À Saint-Pierre, est basé le patrouilleur Fulmar.
Cet enjeu majeur d’une limitation des moyens eu égard aux besoins devenu d’autant plus important que l’équivalent d’une « nouvelle France métropolitaine » a été créé avec la récente extension de 579 000 kilomètres carrés de notre plateau continental, qui a eu pour conséquence l’extension parallèle de nos droits souverains sur les ressources qui y sont associées et qui doivent être protégées.
La loi de programmation militaire a prévu plusieurs améliorations notamment la livraison des BSAH et l’acquisition d’un quatrième B2M, mais il paraît essentiel de faire du programme BATSIMAR une priorité absolue afin d’assurer des livraisons dès la première année de la prochaine programmation, et idéalement dès 2020-2021, soit une avancée de trois ans.
Cet objectif intervient clairement dans un environnement contraint comme le rappelle le tableau suivant, qui récapitule les capacités avec mention des retraits prévus du service actif pour les bâtiments de la Marine nationale.
Présentation des forces navales françaises
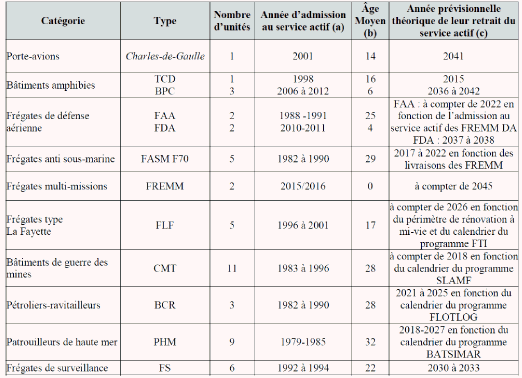
Source : Avis n° 3096 présenté par M. Gwendael Rouillard, député, au nom de la commission de la défense et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2016 – mission Défense- préparation et emploi des forces – marine.
a. Des exigences comparativement plus fortes que pour la Royal Navy
Lors du déplacement de la mission d’information à Londres, l’Amiral Nick Hine, Assistant Chief of the Naval Staff, a rappelé que trois déploiements réguliers sont opérés par la Royal Navy.
L’un concerne l’Atlantique Sud et l’Afrique de l’Ouest, en protection des intérêts britanniques. Il s’agit d’un navire de guerre, destroyer lance missile ou frégate, avec un navire d’escorte.
Par ailleurs, un navire auxiliaire est déployé en permanence dans les Caraïbes pour la patrouille de l’Atlantique Nord, avec d’autres bâtiments si nécessaire. Tel est le cas pour la lutte contre la drogue notamment. Cette présence est complétée, de mai à novembre, par un destroyer pour l’aide aux populations pendant la saison des cyclones.
Enfin, de manière permanente, un patrouilleur de type Offshore Patrol Vessel (OPV) est affecté aux Malouines. Cette présence navale permanente est complétée pour les opérations de la patrouille de l’Atlantique Sud par une frégate ou un destoyer, ainsi qu’un pétrolier.
On ne peut qu’observer que l’essentiel de la ZEE ultramarine à couvrir est concentrée sur l’Atlantique, dans des zones aisément accessibles pour la Royal Navy, puisque les territoires de l’Océan indien n’exigent par définition pas de patrouilles renforcées, car utilisés pour la base américaine de Diego Garcia.
D. DES COMPÉTENCES JURIDIQUES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE PREMIER ORDRE
a. La création du poste d’ambassadeur chargé des océans
C’est en septembre dernier qu’a été créé le poste d’ambassadeur chargé des océans. M. Serge Segura, ancien ambassadeur de France au Mozambique y a été nommé.
Comme celui-ci l’a expliqué aux rapporteurs, c’est une fonction transversale qui permet d’avoir une vision plus large que celle des directions, dont la direction des affaires juridiques et la direction du développement durable de la direction de la mondialisation. Le champ couvert est immense avec notamment les questions environnementales et les questions économiques de la mise en valeur futur des océans et des fonds marins.
Dans l’organigramme, l’ambassadeur chargé des océans est rattaché directement au secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
a. Une compétence technique avérée au sein de services
Le ministère des affaires étrangères dispose avec la sous-direction du droit de la mer, au sein de la direction des affaires juridiques d’une compétence avérée et internationalement reconnue.
La diplomatie française dispose également d’une compétence tout aussi appréciée avec la délégation française auprès de la commission des limites du plateau continental, conduite par M. Elie Jarmache, avec un très grand savoir-faire, une grande continuité et une grande clairvoyance.
Cette connaissance du droit de la mer est indispensable pour la présentation des dossiers qui comprennent non seulement une part technique, mais également une part juridique et aussi une part de négociation pour les délimitations avec les autres États riverains.
2. L’Institut français de recherche pour l’exploitation des mers (Ifremer)
L’Ifremer est un établissement public créé en 1984 par la fusion du Centre national pour l’exploitation des océans (CNEXO) et de l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes (ISPTM).
Institut intégré de recherches marines, il conduit les recherches fondamentales et appliquées, les actions d’expertise et les actions de développement technologique pour connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation durable, améliorer les méthodes de surveillance, prévision, évolution, protection et mise en valeur du milieu marin et côtier, et favoriser le développement socio-économique du monde maritime.
Ses ressources se sont établies à 234 millions d’euros en 2014 et son effectif était de 1 432 salariés à la fin de cette même année.
Le contrat d’objectifs 2014-2017 vise notamment à consolider la place de la recherche française en Europe et sur la scène internationale, notamment par les coopérations, à dynamiser la recherche sur les sciences marines, en partenariat avec les universités et le secteur économique, ainsi qu’à simplifier et optimiser la flotte océanographique française et contribuer à la croissance bleue.
C’est l’Ifremer qui est chargé de l’exploration des fonds et sous-sols marins en vue de leur éventuelle exploitation.
Les navires de l’Ifremer à la disposition de la communauté scientifique sont le Pourquoi pas, l’Atalante et le Thalassa, comme navires hauturiers, et le Thatia, l’Europe et l’Haliotisci, comme navires côtiers.
3. Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Héritier du premier service hydrographique créé dans le monde en 1720, le service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), est un établissement public administratif.
Placé sous la tutelle du ministère de la Défense, il publie l’ensemble des ouvrages nautiques, notamment les cartes marines, pour le compte de la France. Il a également une mission de soutien à la Défense, ainsi qu’aux politiques publiques de la mer et du littoral.
Plus précisément, il a pour mission de connaître et décrire l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir l’évolution et d’assurer la diffusion des informations correspondantes.
Ses activités sont soutenues par une fonction majeure, la constitution des bases de données de référence caractérisant l’environnement géophysique, maritime et littoral.
Le SHOM, établi à Brest, ainsi qu’à Toulouse, Saint-Mandé, Nouméa et Papeete. Il dispose d’un budget un budget annuel de 55,8 millions d’euros (2014) dont 4,5 millions de recettes commerciales, et d’un peu plus de 500 emplois (521 selon son site Internet), hors équipages de navires. Il a conclu un contrat d’objectif et de performance pour la période 2013-2016.
Comme le rappelle ce dernier, l’activité du SHOM repose sur des navires spécialisés ou polyvalents sur lesquels ils mettent en œuvre les systèmes d’acquisition et de traitement de données : trois bâtiments hydrographiques de 2e classe (BH2) Borda, La Pérouse, Laplace, armés par la Marine nationale et employés par le Groupe hydrographique de l’Atlantique (GHA), les baliseurs polyvalents Louis Hénin et Eugène Morignat, mis à disposition du groupe océanographique du Pacifique (GOP) par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le bâtiment hydrographique et océanographique (BHO) Beautemps-Beaupré armé par la Marine nationale et employé par le groupe océanographique de l’Atlantique (GOA), le navire océanographique (N/O) Pourquoi pas ?, armé par un équipage civil, et également employé par le GOA. En fonction de sa disponibilité, la convention d’utilisation du navire partagé par l’Ifremer et la Marine nationale prévoit un élargissement à d’autres porteurs.
Pour ce qui concerne le présent rapport, l’activité du SHOM concerne surtout la fixation des lignes de base. Celles-ci sont mises à jour. La dernière a eu lieu récemment, et est intervenue dans le cadre du décret n° 2015-958 du 31 juillet 2015 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au territoire de la France métropolitaine et de la Corse. Il remplace celui du 19 octobre 1967.
Le SHOM a également pris part au programme Extraplac, notamment avec le BHO Beautemps-Beaupré.
Enfin, le SHOM met en ligne sur son site Internet les limites maritimes des espaces sous juridiction française, qui sont ainsi accessibles au public sous forme numérique et géospatiale.
4. La protection environnementale : les aires marines protégées
a. Dix ans d’expérience de l’Agence des aires marines protégées
Créée par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, l’Agence des aires marines protégées a plusieurs missions.
Celles-ci sont ainsi présentées : l’appui aux politiques publiques de création et de gestion d’aires marines protégées sur l’ensemble du domaine maritime français, l’animation du réseau des aires marines protégées, le soutien technique et financier aux parcs naturels marins, le renforcement du potentiel français dans les négociations internationales.
L’Agence des aires marines protégées est notamment chargée de l’appui à la création et à la gestion des aires marines protégées, quel que soit leur type. Elle assure un rôle de fédération des gestionnaires d’aires marines protégées.
Par ailleurs, l’Agence est de manière systématique en charge de la gestion des parcs naturels marins créés, en mettant à disposition du conseil de gestion, les moyens financiers et humains nécessaires.
Le budget de l’Agence s’est établi à 21 millions d’euros en 2014.
L’Agence a apporté son appui à l’ensemble des gestionnaires d’aires marines protégées. Elle est gestionnaire ou co-gestionnaire de certaines d’entre elles comme les parcs naturels marins, certains sites Natura 2000, la zone spécialement protégée Agoa (convention de Carthagène), la réserve naturelle de la Belle Henriette.
Elle a donc une expérience essentielle acquise dans la gestion de 391 000 kilomètres d’aires marines protégées recensées fin 2014.
a. Une intégration programmée dans la future Agence française pour la biodiversité
Le projet de loi encore en cours d’examen devant le Parlement, relatif à la biodiversité a prévu le regroupement de plusieurs structures administratives, dont l’Agence française pour la biodiversité (AFB).
Elle aura pour mission la gestion d’aires protégées, ainsi que le développement de connaissances, encore insuffisantes en matière de biodiversité, et de formation et de communication.
L’AFB sera pourvue d’un conseil scientifique et technique ainsi que d’un comité d’orientation thématique dédié au milieu marin.
Est prévue l’intégration dans la nouvelle agence des établissements suivants : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ; Parcs nationaux de France (PNF) ; le groupement d’intérêt public Atelier technique des espaces naturels (ATEN) ; l’Agence des aires marines protégées (AAMP).
E. DEUX POINTS D’APPUI MAJEURS : L’UNION EUROPÉENNE ET, EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, L’OTAN
1. L’Union européenne : une vision maritime globale et intégrée, jusqu’à la sécurité
a. L’Union européenne, puissance maritime
En dépit de son élargissement progressif à l’Europe centrale et orientale, essentiellement continentale, l’Union européenne dispose actuellement, avec vingt-huit pays membres, dont le Royaume-Uni, tous les éléments d’une puissance maritime de premier plan :
– elle compte 23 États côtiers et 26 États de pavillon ;
– ses États membres contrôlent un littoral de plus de 90 000 kilomètres, bordant deux océans et quatre mers, en plus des territoires d’outre-mer ;
– ils comptent plus de 1 200 ports de commerce, plus de 8 100 navires de plus de 500 tonnes de jauge brute battant leur pavillon, 4 300 compagnies maritimes enregistrées, 764 grands ports et plus de 3 800 installations portuaires ;
– 80 opérateurs de sécurité enregistrés ont été désignés par les États membres ;
– 90 % du commerce extérieur de l’Union et 40 % de son commerce intérieur se font par transport maritime ;
– au niveau mondial, les fréteurs européens assurent la gestion de 30 % des navires et de 35 % du tonnage du transport maritime – notamment 55 % des navires porte-conteneurs et 35 % des navires-citernes, soit 42 % de la valeur du commerce maritime dans le monde ;
– plus de 400 millions de passagers transitent chaque année par les ports de l’Union ;
– plus de 20 % du tonnage mondial est enregistré sous pavillon des États membres de l’Union et plus de 40 % de la flotte mondiale est sous le contrôle d'entreprises de l’Union européenne ;
– 22 accords de partenariat dans le domaine de la pêche (APP) ont été conclus avec des pays tiers ;
– en 2011, la flotte de pêche de l’Union représentait 83 014 navires, soit 1 696 175 tonnes de jauge brute ; elle est présente dans le monde entier.
En outre, comme l’a relevé le Conseil économique, social et environnemental : « avec une zone économique exclusive de près de 7 millions de km2, dont 917 000 pour la France, auxquels il convient d'ajouter 16 millions de km2 de zones ultramarines hors Union européenne dont les 2/3 pour notre pays, l'Europe dispose d'un formidable potentiel halieutique » (La future politique commune des pêches », Avis du Conseil économique, social et environnemental, Mme Joëlle Prévot-Madère, janvier 2012).
Au total, ce sont donc 23 millions de kilomètres carrés dont dispose l’Union européenne par l’intermédiaire ses États membres.
Le départ du Royaume-Uni modifiera ces paramètres, compte tenu du poids de sa flotte commerciale, qui est la première de celles des États membres, et de la superficie des eaux placées sous sa juridiction (5,5 millions de kilomètres carrés, soit un quart environ du total qui vient d’être évoqué). L’impact en est impossible à évaluer au moment de la rédaction du présent rapport, car il dépendra du calendrier et des modalités de ce départ, ainsi que des éventuels accords de coopération qui seront passés.
a. La dimension économique : la croissance bleue
L’Union européenne a dans le domaine économique une vision maritime qui ne se limite pas à la pêche, et par voie de conséquence aux décisions relatives aux quotas de prises et aux capacités de l’armement.
Elle a en effet élaborée une vision économique d’ensemble, la stratégie dite « Croissance bleue », présentée dans la communication de la Commission européenne du 13 septembre 2012, et intitulée « La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime » (COM/2012/0494 final).
Celle-ci se définit comme une stratégie à long terme visant une croissance durable dans les secteurs marin et maritime dans leur ensemble dès lors que sont mis en valeurs leur potentiel en matière d’innovation et de croissance.
L’objectif est d’aller au-delà de l’actuelle économie «bleue» qui représente 5,4 millions d'emplois et une valeur ajoutée brute de près de 500 milliards d'euros par an, mais qui n’exploite pas toutes les potentialités du secteur maritime.
Cette stratégie est articulée selon les trois volets suivants :
– la politique maritime intégrée, avec une meilleure connaissance du milieu marin, l’aménagement de l’espace maritime en y développant des activités durables, et une surveillance maritime intégrée pour donner aux autorités une meilleure connaissance de ce qui se passe en mer ;
– des stratégies par bassin maritime, pour adapter les objectifs d’ensemble selon les facteurs climatiques, océanographiques, économiques, culturels et sociaux. Sont distingués les bassins suivants : mers Adriatique et Ionienne ; océan Arctique ; océan Atlantique ; mer Baltique ; mer Noire ; mer Méditerranée ; et mer du Nord ;
– une approche ciblée sur quelques secteurs d’activité considérés comme à haut potentiel : l’aquaculture ; le tourisme côtier ; les biotechnologies marines ; l’énergie marine ; l’exploitation minière des fonds marins.
Considérée comme la contribution de la politique maritime intégrée à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, cette stratégie souffre des mêmes défauts, à savoir une visibilité insuffisante et l’incapacité à dégager des priorités réelles.
C’est dans ce domaine que la France peut agir avec efficacité en œuvrant en faveur des priorités d’avenir, et notamment de la recherche sous-marine.
Ce point est suffisamment essentiel pour être développé ci-après.
a. La stratégie de sûreté maritime de 2014
L’Union européenne a adopté en juin 2014 une stratégie de sûreté maritime. Il s’agit pour être plus précis d’une première approche stratégique conjointe.
L’objectif est de donner un cadre commun aux autorités compétentes au niveau national et européen afin de donner une cohérence à leurs politiques et pour apporter une réponse européenne aux menaces et aux risques maritimes.
Il s’agit de protéger les intérêts maritimes stratégiques de l’Union européenne, ainsi que de renforcer les liens entre la sécurité intérieure et extérieure dans le domaine maritime, de même que la coopération civile et militaire.
Les grands objectifs suivants :
– sur le plan conceptuel, déterminer et présenter les principaux intérêts maritimes stratégiques de l’Union ;
– sur le plan opérationnel, identifier les menaces, les défis et les risques maritimes pour ces intérêts stratégiques ;
– et en pratique, organiser la réponse, c’est-à-dire définir les objectifs, les principes ainsi que les domaines d'intérêt commun qui constituent le pilier du cadre commun, pour assurer la cohérence entre les diverses politiques et stratégies maritimes spécifiques.
Le document recense ensuite les différentes actions possibles, mais sans non plus dégager des priorités claires.
a. Une mutualisation des moyens pour les approches maritimes : un instrument utile même s’il est imparfait pour la crise migratoire
La question de l’actuelle crise migratoire dépasse clairement le cadre du présent rapport, et elle fait d’ailleurs l’objet de travaux séparés au sein de la commission des affaires étrangères.
Il est cependant clair qu’en dépit de toutes les améliorations qui peuvent lui être apportées, le dispositif européen, avec notamment Frontex, en Méditerranée centrale et en mer Egée permet une intervention mutualisée et coordonnée des moyens maritimes pour éviter les désastres humanitaires et éviter aussi que deux États, dont l’un aux moyens extrêmement limités, la Grèce, ne se trouvent seuls en première ligne pour faire face à l’afflux.
De même, il est clair que le règlement de la question ne peut reposer uniquement sur la seule création de barrières à l’efficacité douteuse, l’histoire montrant que les migrations ne sont en aucun cas empêchées par les murs.
2. L’OTAN : un instrument essentiel de coopération maritime pour le haut du spectre, mais aussi pour les phénomènes de moindre intensité comme la crise migratoire
Dès son origine, l’Alliance atlantique a eu une forte dimension maritime. Elle a été la coalition des pays maritimes ayant un libre accès aux océans contre la première puissance continentale d’alors, l’Union soviétique, et son objectif de mainmise sur l’Europe.
Actuellement, la dimension maritime de l’OTAN a deux volets : éviter toute menace maritime en mer ou venant de la mer ; garantir la sécurité des routes commerciales.
L’OTAN a structuré des forces navales permanentes de dissuasion multinationales, qui mènent à bien un programme pré-établi d’exercices, de manœuvres et d’escales, et peuvent être rapidement déployées en périodes de crise ou de tension. Elles se répartissent en quatre groupes : les deux groupes maritimes permanents OTAN (SNMG1 et SNMG2) et les deux groupes permanents OTAN de lutte contre les mines (SNMCMG1 et SNMCMG2). Ceux-ci font partie de la force de réaction rapide de l’Alliance (la NRF). Ils sont constitués, par rotation, de forces nationales.
Par ailleurs, l’OTAN a mené quatre opérations maritimes. Toujours en cours depuis octobre 2001, l’opération Active Endeavour a pour but de déjouer, de détecter et démanteler la menace terroriste en Méditerranée, dans le prolongement de la réaction aux attentats du 11 septembre 2001. Maintenue en raison de son succès, elle est actuellement en cours de transformation en une opération plus vaste en Méditerranée centrale. Depuis 2009, l’opération Ocean Shield contribue, comme on l’a vu, à l’action internationale visant à réprimer la piraterie. En 2011, l’opération Unified Protector a servi de cadre à la projection de puissance depuis la mer et pour imposer un embargo maritime sur les armes à l’encontre de la Libye.
Pour aller au-delà et s’adapter à l’importance croissante de l’enjeu maritime, l’OTAN a adopté en janvier 2011 une stratégie d’ensemble, la stratégie maritime de l’Alliance. Quatre domaines ont été identifiés. Les trois premiers sont les « tâches fondamentales », définies dans le concept stratégique: la dissuasion et la défense collective des Alliés, la gestion de crise et la sécurité coopérative avec les pays partenaires. Un quatrième domaine y a été ajouté : la sûreté maritime.
Pour ce qui concerne la dissuasion et défense collective, il s’agit de dissuader contre l’agression. L’objectif opérationnel est de pouvoir déployer rapidement ses forces maritimes, de contrôler les lignes de communication maritimes, de préserver la liberté de navigation et de mener des activités de lutte contre les mines.
Pour la gestion de crises, l’enjeu est certes d’ordre logistique, avec en particulier l’apport de forces ou d’une aide humanitaire, mais il s’agit aussi d’imposer des embargos sur les armes, de conduire des opérations d’interdiction maritime et de lutter contre le terrorisme.
Dans le cadre de la sécurité coopérative, par ailleurs, les forces maritimes de l’OTAN s’engagent auprès des pays partenaires sur la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que sur la prévention des conflits. Il y a complémentarité avec d’autres acteurs clés du milieu maritime, comme l’ONU et l’Union européenne.
C’est certainement dans le domaine de la sûreté maritime que la stratégie maritime de l’Alliance est en l’état la plus opératoire. Il s’agit en effet de veiller sur les communications maritimes d’importance vitale et de garantir la liberté de navigation. Cela se traduit par la surveillance, le partage de l’information, l’interdiction maritime et les contributions à la sécurité énergétique, y compris la protection des infrastructures critiques.
De manière assez novatrice, comme on l’a vu, l’OTAN a fait droit à une demande conjointe de l’Allemagne et de la Turquie d’une mission navale en mer Égée.
Ainsi, les navires du 2ème groupe maritime permanent de l’OTAN (SNMG2) ont entamé à partir du mercredi 9 mars, la surveillance des flux migratoires dans les eaux territoriales de la Grèce. La nouvelle zone d’activité du groupe couvre dorénavant les eaux territoriales de la Grèce et de la Turquie.
III. CINQ ORIENTATIONS ESSENTIELLES À METTRE EN œUVRE POUR DES RÉSULTATS PLUS TANGIBLES
A. ASSURER LA CONTINUITÉ DE L’IMPULSION POLITIQUE
1. Porter la culture maritime jusqu’au plus haut niveau de l’État
a. Mettre fin à la dichotomie actuelle entre le niveau politique et le niveau administratif
À l’issue de leurs travaux, les rapporteurs ne peuvent que regretter de se voir confirmer par les faits dans leur intuition d’origine : l’insuffisance de l’effort maritime de la France résulte essentiellement d’un découplage entre l’attention qu’est en mesure d’y porter le niveau administratif, avec l’outil exceptionnel qu’est le SGMer, et celle que lui porte le niveau politique.
C’est très certainement une constante française dont notre pays n’aurait que des avantages à se départir.
L’exemple le plus patent est la question de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lequel on constate une forte dissymétrie entre l’attention constante qui lui est portée au niveau du Gouvernement canadien, et la connaissance plus épisodique que l’on constate au niveau français.
a. Nommer systématiquement un conseiller mer au sein du cabinet du Premier ministre
La dichotomie entre le politique et l’administratif, sur les questions maritimes, est illustrée par la structuration habituelle du cabinet du Premier ministre.
Il n’y a pas systématiquement un conseiller Mer au cabinet du Premier ministre. Il n’y a donc pas de relais, de lien entre le niveau politique du Premier ministre et le SGMer. C’est une spécificité qui nuit au suivi politique permanent des questions maritimes. Elle empêche parfois d’apporter les réponses ayant l’autorité nécessaire aux fortes attentes du monde maritime, lequel aspire à des messages plus clairs.
Il convient par conséquent de prévoir au sein du cabinet du Premier ministre la désignation systématique d’un conseiller pour la mer, à l’instar du conseiller pour les affaires intérieures.
Il ne paraît pas à ce stade opportun que le SGMer soit simultanément le conseiller mer du Premier ministre, étant préférable d’éviter le risque d’une confusion des rôles et des niveaux d’intervention.
a. Inscrire les questions maritimes dans les priorités de l’agenda international de la France et les évoquer systématiquement à l’occasion de la semaine des ambassadeurs
Instituée en 1993, la conférence des ambassadeurs « réunit, chaque année, tous les chefs de missions diplomatiques français de par le monde et offre l’occasion aux plus hautes autorités de l’État et au Ministre des Affaires étrangères de donner leurs orientations pour le travail des représentants de la France à l’étranger et auprès des organisations internationales pour l’année à venir », conformément à la définition officielle qu’en donne le ministère.
En 2015, ce rendez-vous de très haut niveau a été intitulé « semaine des ambassadeurs », non pas simplement par volonté d’un renouvellement sémantique, mais parce qu’au « fil des années notre exercice annuel commun s’est diversifié, enrichi », ainsi que l’a indiqué le ministre des affaires étrangères et du développement international, M. Laurent Fabius.
C’est le moment où sont évoquées les grandes priorités de l’agenda international de la France.
On doit regretter que la question maritime n’y soit pas nécessairement abordée de manière transversale et ne fasse pas l’objet d’un traitement similaire aux sujets qui sont abordés au plus haut niveau comme l’an dernier, la lutte contre le terrorisme, les questions migratoires, la COP 21 et la diplomatie économique.
Certes l’actualité et le changement d’optique du ministère, avec la volonté d’en faire l’un des fers de lance de la promotion de l’économie française, justifient pleinement ce choix.
On doit cependant considérer que les intérêts de long terme de notre pays conduisent à systématiquement y placer la diplomatie des frontières et des espaces maritimes, de manière que celle-ci s’inscrive parmi les fondamentaux de sa diplomatie, ce qui n’est pas actuellement le cas.
L’exemple de la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la diplomatie française pour la conférence Paris Climat 2015, pour la COP 21, montre que la capacité de mobilisation de la diplomatie française est réelle.
a. Organiser chaque année un débat parlementaire d’orientation sur les questions maritimes
Pour assurer le lien entre le niveau politique et le niveau administratif en matière maritime, il apparaît aussi opportun de prévoir l’organisation chaque année d’un débat parlementaire d’orientation sur les questions maritimes.
L’intérêt de ce débat serait double : non seulement il contraindrait le Gouvernement à la continuité du pilotage de la politique maritime au plus haut niveau, mais aussi il permettrait d’évoquer en séance publique des questions essentielles qui sont actuellement évoquées dans le cadre trop restreint de la procédure des questions écrites.
2. Renforcer encore la gouvernance
a. Aller au-delà de la coordination actuelle
Le secteur maritime est intrinsèquement difficile à piloter. D’abord, il fait intervenir plusieurs ministères et même au sein des services du ministère chargé de la mer, la gestion s’est organisée verticalement par métier ou par activité, les ports, le transport, la pêche, le littoral, le statut des marins, sans qu’il y ait véritable interaction ni recherche de cohérence. Ensuite, c’est une politique qui s’exerce sur un domaine géographique particulièrement étiré qui concerne la Baie de Somme, le Bassin d’Arcachon, la Côte d’Azur, la protection des coraux en Nouvelle Calédonie, la lutte contre la pêche illicite en Guyane et la lutte contre l’immigration illégale en Méditerranée ou aux Comores. Enfin, c’est un secteur en plein renouvellement, car aux activités traditionnelles s’ajoutent la protection du milieu et des espèces, l’exploitation des grands fonds marins, les énergies marines renouvelables et l’exploration des bio-ressources. C’est également une politique qui doit être tournée vers l’avenir.
Il est possible d’aller au-delà des résultats positifs de la création du SGmer en 1995 et de la création du grand ministère de l’écologie et du développement durable, auquel est rattachée la mer, depuis 2006, pour gommer ce qui reste des approches verticales et que se manifeste notamment, mais pas uniquement, dans la diversité des organismes consultatifs : le Conseil national de la mer et des littoraux (CNML), créé à l’issue du Grenelle de la mer mais rarement réuni, et dont le secrétariat est assuré par la DATAR ; le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM), compétent pour le transport, les ports et les sujets économiques en général, et dont le secrétariat est assuré par un secrétaire général ; le Conseil supérieur des gens de mer compétent en matière de statut social des marins et de protection sociale ; les organismes de façade avec quatre Conseils maritimes de façade en métropole et quatre Conseils maritimes ultramarins outre-mer.
Le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) d’évaluation de la politique maritime (novembre 2013) avait présenté trois scénarios : la création d’une direction générale de la mer au sein du ministère de l’écologie et du développement durable ; la création d’une délégation à la mer et au littoral au sein du MEDDE ; le renforcement du SGMer.
Le CIMER de décembre 2013 a opté pour la création de la délégation à la mer et au littoral, consistant à mettre en place une structure légère de coordination entre les différentes directions du ministère ayant des compétences dans le domaine maritime.
La délégation a été créée en 2014. Ce n’est le 2 mars 2016 qu’a été nommée comme déléguée à la mer et au littoral Mme Catherine Chabaud, navigatrice.
Il en résulte une dichotomie qui pourrait être réglée par le rattachement du poste de délégué au SGMer, dans le cadre d’une réorganisation du secrétariat général avec la désignation de deux adjoints : l’un pour remplir les fonctions de délégué et prendre en charge les dossiers économiques et environnementaux ; l’autre pour les questions relatives à l’action de l’État en mer.
Pour ce qui concerne les instances consultatives, la première mesure à prévoir consiste à prévoir un secrétariat conjoint et intégré du CSMM et du CNML, secrétariat rattaché au SGMer, pour mettre davantage de cohérence entre les programmes de travail des deux instances, qui ont en commun plusieurs de leurs membres, et assurer la coordination avec les autres domaines du secteur maritime.
a. Renforcer la fréquence des CIMER et de l’actualisation de la stratégie maritime de la France
La chronologie de ses réunions montre que le CIMER se réunit au mieux tous les deux ans, si l’on excepte le cas de l’année 2000 au cours de laquelle deux réunions ont été organisé.
La chronologie est en effet la suivante : 996 ; 1998 ; 2000, avec deux réunions ; 2003 ; 2004 ; 2009 ; 2011 ; 2013 ; dernièrement 2015.
Ces rendez-vous sont trop espacés pour permettre un pilotage au plus haut niveau de la stratégie maritime de la France qui soit à la hauteur des enjeux.
Les réunions du CIMER devraient au moins être annuelles.
Cela permettrait notamment d’actualiser si ce n’est la stratégie maritime, le Livre bleu, au moins la stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes publiée en octobre dernier et qui comprend comme on l’a vu de nombreuses pistes opérationnelles dont la teneur recommande qu’elles fassent l’objet d’un suivi régulier et précis.
a. Actualiser et mettre en cohérence les textes relatifs aux délimitations maritimes : l’ordonnance prévue par la proposition de loi sur l’économie bleue
Actuellement, les textes sur les délimitations des différents espaces maritimes de la France sont antérieurs à la convention de 1982 sur le droit de la mer.
Ainsi, les limites extérieures de la mer territoriale reposent sur la loi n°71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, celles de la ZEE ont été fixées par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, et les quatre décrets précités du 25 septembre 2015 définissant les limites extérieures du plateau continental ont fait référence à loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, qui fait elle-même référence à la convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental.
Seules comme on l’a vu, les lignes de base ont fait l’objet d’un nouveau texte d’ensemble, le décret n° 2015-958 du 31 juillet 2015, mais celui-ci ne concerne que la partie européenne de la France maritime, à savoir la France métropolitaine et la Corse.
Dans le même esprit, il est nécessaire pour la clarté du droit que ces différentes zones fassent l’objet de textes nationaux indiquant les compétences de l’État et les différentes possibilités pour les opérateurs privés d’y opérer des activités spécifiques.
La stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes du 22 octobre dernier a annoncé qu’une ordonnance interviendrait en la matière. Celle-ci a été explicitement prévue à l’article 23 de la proposition de loi pour l’économie bleue, présentée par M. Arnaud Leroy.
L’objectif est une mise à jour complète de la base juridique de la fixation des limites maritimes.
Il s’agit en effet de préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique et le plateau continental.
C’est en effet nécessaire notamment pour assurer la crédibilité de ces limites vis-à-vis de nos partenaires et voisins maritimes.
a. Veiller de manière constante à l’adéquation des textes aux enjeux
Lors des différentes auditions, il est apparu, comme le fait la stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes, que la législation nationale exigeait des évolutions pour mieux y organiser les activités licites, notamment minières, et aussi, à l’opposé, pour réprimer ou prévenir les activités illicites.
De telles évolutions ne vont pas nécessairement de soi et peuvent donner lieu à débat.
C’est ce que l’on a vu à propos de la lutte contre la piraterie, pour l’adoption de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires prévoyant l’autorisation, pour les armateurs, de recourir à des services de protection privée dûment agréés et contrôlés par l’État. Il y avait en arrière-plan les craintes du recours à un éventuel mercenariat. Néanmoins, avec toutes les précautions nécessaires, une telle évolution était indispensable.
De même, est récemment intervenue en matière de lutte contre les trafics illégaux, la faculté de dissociation entre le navire et la cargaison illégale.
Dans le cadre d’une modification de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer, l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prévoit, en effet, que la « destruction des stupéfiants peut être prise en cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d'hygiène satisfaisantes à bord du bâtiment de l’État ayant procédé aux opérations de contrôle »
Par ailleurs, le projet de loi relatif à la biodiversité, encore en cours d’examen, prévoit dans son actuel article 40 un nouveau régime d’autorisation des activités sur le plateau continental et la zone économique exclusive, encadrant les activités d’exploration ou d’exploitation sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, inspiré du régime existant pour le domaine public maritime.
Des sanctions doivent être prévues en cas d’infraction à ce régime et elles devraient ensuite intervenir par décret.
De même, le projet d’ordonnance précité relatif aux espaces maritimes devrait prévoir un renforcement des peines de contravention prévues en cas de non-respect d’un arrêté du préfet maritime. Le niveau actuel de la peine, celui de la contravention de première classe, apparaît clairement comme insuffisant, et il convient de le relever.
B. MENER UNE STRATÉGIE D’INFLUENCE AU NIVEAU EUROPÉEN ET AU NIVEAU INTERNATIONAL POUR DÉGAGER LES PRIORITÉS QUI S’IMPOSENT
1. Un enjeu immédiat au sein de l’Union européenne : une dimension maritime pour la nouvelle stratégie européenne de sécurité
L’actuelle stratégie européenne de sécurité, dite stratégie Solana, a été établie en 2003 sous l’égide de M. Javier Solana, ancien secrétaire général de l’OTAN, et alors Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.
Légèrement révisée, de manière limitée en 2008, elle est actuellement en cours de révision, après un premier examen par le Conseil européen le 28 juin.
En effet, le Conseil européen de juin 2015 a demandé à la Haute Représentante, Mme Federica Mogherini d’élaborer une nouvelle stratégie en matière de politique étrangère et de sécurité.
L’objectif doit être de donner enfin à l’Union européenne la capacité de se projeter et de se concevoir comme un acteur global.
Celui-ci sera donc atteint dès lors que la stratégie européenne de sécurité sera l’instrument permettant à l’Union européenne de se constituer en acteur global.
Comme l’a relevé S.E. M. Pierre Sellal, ce n’est qu’une question de volonté politique et il appartient par conséquent à l’Union européenne de se donner les moyens de devenir un tel acteur global.
Il convient, par conséquent, de veiller à ce que la dimension maritime y soit intégrée.
Elle devrait nécessairement l’être en raison de l’importance de la question des migrants en Méditerranée, mais il convient de veiller que tant son texte que sa mise en œuvre soient en matière maritime à la hauteur des 23 millions de kilomètres carrés de ZEE sous le contrôle des États membres.
Dans cette métamorphose de l’Union vers une Europe puissance, de la nécessité de laquelle seuls certains pays ont eu pour l’instant conscience, la dimension maritime joue en un rôle essentiel :
– d’abord, les frontières communes de l’Union sont essentiellement maritimes, sauf à l’Est, avec l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie, le cas de la Norvège, allié dans le cadre de l’OTAN étant à part ;
– ensuite, cette réflexion est à même de faire prendre conscience aux 22 États membres qui n’ont pas d’établissement ultramarins, de l’importance de la dimension maritime mondiale. Si seuls le Royaume-Unis, les Pays-Bas, le Danemark et la France ont des pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union européenne, l’Espagne et le Portugal ont conscience des enjeux maritimes mondiaux grâce à leurs régions ultrapériphériques (RUP), des Canaries, des Açores et de Madère, qui sont dans l’Union européenne selon les mêmes modalités que les départements français d’outre-mer. L’enjeu est de dépasser ce noyau ;
– enfin, l’Union européenne, première puissance commerciale du monde, ne peut ignorer les océans qui sont le support de la mondialisation.
Il convient clairement pour la France de veiller à ce que le maritime soit pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie.
2. L’amélioration de la coordination au sein de l’OTAN : la proposition française de cadre maritime global
De manière que l’OTAN reste bien dans le haut du spectre et ne soit pas absorbée par des tâches qui ne relèvent pas de ses missions, la France a présenté aux Alliés une initiative politique pour un « cadre maritime global », visant à optimiser et à simplifier l’utilisation des ressources navales de l’Alliance.
Il s’agit d’abord de permettre une amélioration de la connaissance de la situation maritime (dans les zones d’intérêt stratégique de l’Alliance – Atlantique nord-ouest, Méditerranée, mer Noire, Nord de l’océan Indien, Grand Nord –, en facilitant les échanges entre marines alliées, qu’elles soient ou non engagées dans des opérations de l’OTAN, et en augmentant le nombre et le type d’informations transmises par les bâtiments alliés au commandement maritime MARCOM, situé à Northwood au Royaume-Uni.
Il s’agit également d’un recentrage des activités d’entraînement dans le haut du spectre pour répondre également aux pertes de savoir-faire, ainsi que d’une complémentarité renforcée avec l’Union européenne, qui a sa propre stratégie maritime.
De manière concrète, MARCOM et les marines des Alliés auraient une meilleure connaissance de la situation maritime.
3. Veiller à la présence française dans les organisations et instances internationales touchant au maritime
La stratégie d’influence d’un pays repose sur la présence auprès des instances et organisations internationales ayant une compétence en matière maritime, et dans ces instances.
Les délégations représentant la France ont pour objectif de défendre et de faire valoir le point de vue français.
La présence de Français au sein des organisations internationales a trois objectifs : faire vivre le français comme langue officielle et comme langue de travail, avec la présence des autres pays francophones ; faire partager l’approche française des différentes questions ; mieux faire connaître sa culture dans un domaine particulier.
De ce point de vue, les rapporteurs ont pu constater au cours des entretiens une présence française incertaine dans son futur au sein de la commission de délimitation du plateau continental, et une présence trop réduite au sein de l’OMI.
Comme l’a relevé S.E. Mme Nicole Taillefer, représentante permanente de la France auprès de l’OMI, il n’y a pas de Français aux postes clefs et il y en a d’une manière générale un nombre très réduit au sein de l’organisation.
Il faut en outre insister sur le rôle que peut revendiquer la France sans risquer de voir sa légitimité contestée au sein de la CLPC, où il faut rappeler l’importance de la présence de M. Walter Roest, qui a été l’un des artisans du programme Extraplac, comme de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM).
En l’état, on constate avec satisfaction que, selon le site de l’autorité, la présence de la France est assurée au sein du conseil de l’AIFM, parmi les pays du groupe dit B, jusqu’à la fin de l’année 2018. La question se posera au-delà donc de l’année 2018.
Il serait, de ce point de vue, essentiel que notre pays adopte une stratégie d’ensemble recensant les organisations touchant au domaine maritime et suive avec précision la présence française et la présence francophone.
4. Porter dans les instances internationales le message de la coopération et de l’échange d’informations et développer les accords de coopération mutuelle en matière de sécurité et de lutte contre les activités illégales
Pour la lutte contre les trafics maritimes illicites, y compris la pêche maritime, l’accès au renseignement est essentiel.
Compte tenu de la limitation des données nationales, en raison de l’impossibilité de couvrir par des moyens maritimes et aéromaritimes eux-mêmes limités la totalité des espaces sous juridictions, la coopération internationale et l’échange de renseignements sont essentiels.
Une telle coopération dans l’échange de renseignements a d’ailleurs montré toute son efficacité dans la lutte contre la piraterie dans la corne de l’Afrique.
Elle doit par conséquent être promue dans les différentes enceintes internationales ou régionales auxquelles participe la France.
Le point d’aboutissement d’une telle action est la conclusion d’accords de coopération mutuelle en matière de sécurité et de lutte contre les activités illégales pour renforcer l’efficacité des actions opérationnelles engagées en la matière.
C. CONSERVER DANS LA DURÉE LES MOYENS BUDGÉTAIRES NÉCESSAIRES
1. Éviter de renouveler le cas du programme Extraplac, aux moyens inférieurs à ceux comparativement dégagés par les autres pays
La comparaison des données habituellement avancées montre que la France a certes connu le succès avec le programme Extraplac, mais qu’elle l’a fait en mesurant et en limitant les moyens qu’elle était prête à y engager, avec un budget total de l’ordre de 25 millions d’euros.
Comme l’ont indiqué plusieurs observateurs, notamment M. Gérard Grignon, les enveloppes sont supérieures pour le Danemark, entre 40 et 100 millions au total, 100 à 150 millions pour le Canada, 200 pour la Russie et même 600 à 750 millions pour le Japon, avec pourtant des surfaces bien moindres.
Il est vrai que la situation aurait pu être pire car la force du programme Extraplac a été de garantir un financement sur la durée, et actuellement, tel est le cas jusqu’en 2018.
Cependant, l’effort global de la France a été très précisément dosé pour ne pas dire mesuré, alors que la question était prioritaire.
Ce cas ne doit pas faire précédent, car la réalisation du programme ne doit pas occulter que si cela a été suffisant pour opérer la délimitation, les espaces sous-marins sous juridiction française sont encore très peu connus.
L’indispensable effort de connaissance et d’inventaire reste donc encore largement à faire.
2. Garantir le renouvellement et le rétablissement des capacités de la présence et de la surveillance maritime outre-mer
La Marine nationale déploie en permanence des navires pour assurer sa présence. Comme l’a indiqué l’Amiral Bernard Rogel, la réduction du budget de la défense depuis plusieurs années a entraîné des reports dans le renouvellement des équipements, lesquels se traduisent par des réductions et même ruptures de capacités. Ces ruptures sont en principe temporaires.
Pour la métropole, ces réductions ou ruptures ont des conséquences très dommageables.
Pour l’outre-mer, c’est encore davantage le cas, car c’est la présence visible de la France sur ses espaces maritimes sous juridiction qui disparaît.
L’actualisation de la LPM a permis des avancées salutaires, avec la livraison des BSAH (bâtiment de surveillance et d’assistance hauturiers) en métropole et l’acquisition d’un quatrième B2M (bâtiment multi-missions) pour l’outre-mer. Les B2M sont des patrouilleurs hauturiers parfois surnommés « couteaux suisses » de la Marine nationale : ils sont destinés à assurer l’ensemble des actions de l’État en mer : la surveillance et la protection des intérêts français dans les zones économiques exclusives (ZEE), la sauvegarde et l’assistance au profit des populations notamment en cas de catastrophes naturelles, la projection de forces de police ou de gendarmerie dans le cadre de la lutte contre l’immigration illégale, le narcotrafic, la piraterie ou encore la police des pêches.
Au total, les quatre B2M – trois commandés en 2013, et un dans la LPM actualisée – sont destinés à l’outre-mer (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Antilles et La Réunion), et les deux patrouilleurs légers (PLG), commandés en 2014, sont destinés à La Guyane.
Néanmoins, la livraison de ces équipements ne règle pas la question des patrouilleurs de surveillance et d’intervention maritime qui vont faire l’objet de ruptures capacitaires entre le moment des retraits du service déjà intervenus pour trois d’entre eux, et à intervenir pour encore quatre d’entre eux.
Ce renouvellement doit en l’état intervenir au cours de la prochaine décennie, et plus précisément à partir de 2024, dans le cadre du programme « bâtiment de surveillance et d’intervention maritime » (BATSIMAR).
Le calendrier prévu laisse présager que les quatre bases les plus importantes d’outre-mer (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Antilles et La Réunion) passeront un temps variable sans aucun navire intermédiaire entre la frégate et le B2M, et auront ainsi pour ce qui concerne les bases du Pacifiques, deux navires uniquement (la frégate et le B2M), contre 4 dans le cadre de la dotation normale, en l’absence des deux patrouilleurs.
Eu égard à l’importance de la zone couverte, puisque l’essentiel de la ZEE française est dans le Pacifique à raison de 6,2 millions de kilomètres carrés, c’est extrêmement préjudiciable.
Cela représente environ un navire pour 2,5 millions de kilomètres carrés en Polynésie.
Il est clair que le programme devra être pour le moins garanti et probablement accéléré par la prochaine loi de programme militaire, pour l’après 2019, et qu’il serait opportun de l’avancer de trois ans, à 2021, sauf à prendre le risque d’une perte de crédibilité de la présence française dans le Pacifique.
3. Fournir un effort suivi sur le satellite
En matière de surveillance maritime, le satellite est un instrument qui présente trois avantages majeurs :
– il couvre la haute mer avec réactivité, contrairement aux patrouilles maritimes et aériennes ;
– les satellites optiques et radar se complètent pour offrir une couverture jour et nuit, indépendamment de la couverture nuageuse ;
– les satellites commerciaux assurent une forte capacité pour revisiter certaines zones.
C’est dans cette perspective que l’état-major de la marine a été mandaté en 2013 par le SGMer pour piloter un groupe de travail sur l’emploi des satellites en la matière.
À l’issue de l’expérimentation conduite en 2014 et 2015, la Marine nationale a passé un contrat pour la phase d’utilisation opérationnelle, par un guichet unique de la constellation des satellites (une quinzaine) relevant du programme Trimaran
Ses résultats ont été tels en matière de lutte contre les narcotrafiquants et les pollutions maritimes aux Antilles, ainsi que de suivi de la pêche illégale au large de la Guyane, que l’expérience a été pérennisée.
Elle s’avère particulièrement utile non seulement pour l’espace caraïbe, mais aussi pour l’Océan indien, et pour le Pacifique. « Trimaran » ouvre en effet de nouvelles possibilités en matière de contrôle des pêches dans les poches de haute mer. Il permettra notamment d’identifier les pêcheurs qui cherchent à dissimuler leur position en n’activant pas leur balise AIS, et d’optimiser ainsi, grâce à un meilleur ciblage, l’emploi des moyens de contrôle navals et aériens dans une zone géographique très vaste.
Par ailleurs, il faut mentionner que le programme européen Copernicus d’observation de la terre, conduit par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne, a un volet maritime.
L’Agence spatiale européenne a également un service appelé CleanSeaNet de détection des pollutions fondé sur l’utilisation de satellites à imagerie radar. En cas de pollution des eaux, l’État concerné reçoit un message d’alerte dans les trente minutes, ce qui permet pour la France, au préfet maritime de dépêcher un aéronef dans les meilleurs délais.
Une autre expérimentation de surveillance satellitaire (dispositif OER) a été conduite dans le Pacifique sud en 2014 et a permis notamment d’analyser avec précision l’activité maritime autour de l’île de Clipperton.
La difficulté du satellite tient à son coût, et au fait qu’il ne remplace pas totalement les patrouilles maritimes, dans la mesure où le l’essentiel tient aux interceptions.
Il est clair que l’effort financier sur le satellite doit être poursuivi, notamment si l’on en venait un jour à exploiter les sous-sols marins, pour éviter les pillages.
Dans cette perspective, comme cela a été indiqué aux rapporteurs, il convient très certainement de prévoir la modernisation des stations de réception de données, et la création de nouvelles stations, pour améliorer la réactivité et ainsi la performance opérationnelle des systèmes de surveillance par satellite.
4. Prévoir l’expertise et l’expérimentation du recours aux drones en complément des moyens aéromaritimes
Pour la surveillance des espaces marins, les moyens aéromaritimes, avions et hélicoptères sont actuellement largement utilisés, mais ils sont limités.
Comme le rappelle le Gouvernement, régulièrement interrogé sur les moyens de surveillance outre-mer, des avions Falcon 50 mènent également des actions de surveillance conjointes avec les navires de la Marine nationale à partir de La Réunion pour la surveillance des espaces maritimes des TAAF.
Pour ce qui concerne le Pacifique, en Polynésie française, la frégate de surveillance embarque un hélicoptère Alouette III et deux avions de surveillance maritime de type Guardian et deux hélicoptères de service public de type Dauphin utilisés dans un cadre interministériel.
Pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la frégate de surveillance embarque elle-aussi un hélicoptère Alouette III et deux avions de surveillance maritime de type Guardian sont déployés.
La limite de ces moyens est évidente compte tenu de la surface à couvrir.
De même que pour cela a été fait pour le renseignement militaire terrestre, le recours aux drones doit par conséquent être envisagé.
Le drone ne peut se substituer aux moyens actuels qui restent nécessaires en cas d’intervention, mais ils permettent d’élargir le champ visible et ainsi de démultiplier l’efficacité de moyens de surveillance trop peu nombreux.
La stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes prévoit d’ailleurs l’expertise et l’expérimentation de cette solution, tant pour les drones basés à terre que pour les drones embarqués, en liaison notamment avec des projets de régulation de leur utilisation dans l’espace aérien.
L’utilisation de drones a d’ailleurs été expérimentée sur le patrouilleur de haute mer L’Adroit.
Pour ce qui concerne l’outre-mer, où les contraintes d’insertion dans le trafic aérien sont moindres, le recours aux drones d’observation est a priori très intéressant, mais il implique aussi que la zone couverte soit suffisamment large ou le trafic suffisant pour que la faculté d’observation ne repose pas sur une part trop large de hasard.
D. ENGAGER AVEC CERTAINS PAYS DES MODES DE COOPÉRATION OFFRANT DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ
1. De nouvelles bases pour notre présence ultramarine
Pour être pleinement déployée, la stratégie ultramarine de la France doit avoir trois dimensions.
La première, la plus ancienne, est fondée sur une logique quasi-territoriale de présence, soit en raison de l’importance de la population dans les îles et territoires concernés, soit en raison d’un intérêt particulier justifiant des établissements scientifiques, comme c’est le cas dans les îles les plus méridionales des TAAF, soit encore en raison d’un intérêt commercial ou stratégique.
La seconde approche correspond à une approche fondée sur les flux. L’objectif est d’être présent là où les courants commerciaux marins passent, de manière à pouvoir en bénéficier. Il est aussi d’être en mesure de surveiller les routes maritimes utilisées par les trafics dont la destination ultime est l’Europe.
La troisième dimension est la plus novatrice et vise à développer des coopérations permettant d’insérer les territoires ultramarins dans leur contexte régional en faisant du lien avec la métropole non plus un instrument de face à face, mais au contraire un point de communication privilégié avec les États de la région.
2. Des accords de coopération à appliquer dès lors qu’ils évitent tout risque de « détricotage » de la présence française outre-mer
a. L’accord de pêche entre la France et le Mexique pour Clipperton : un dispositif qui n’exclut pas une réaffirmation en parallèle de la présence française
Comme on l’a vu, l’accord sur les activités de pêche des navires mexicains dans les 200 milles marins entourant l’île de Clipperton a été signé entre la France et le Mexique le 29 mars 2007.
Il est la base juridique qui permet au gouvernement français d’octroyer chaque année, sur la demande du gouvernement mexicain, des licences de pêche gratuites aux navires mexicains intéressés et inscrits au registre de la Commission interaméricaine sur le thon tropical (CIATT).
Cette organisation régionale de gestion des pêches est habilitée à gérer les thons et les espèces apparentées dans l’essentiel de l’océan Pacifique. Il s’agit de la zone située entre les cinquantièmes parallèles Nord et Sud, allant de la frontière entre les États-Unis et le Canada jusqu’au Sud du Chili, et de la côte américaine jusqu’au 150e méridien Ouest, lequel passe par la pointe Sud de l’Alaska et laissant Hawaï à l’Ouest avant de rejoindre Tahiti.
La France et le Mexique sont tous deux membres de cette commission.
Pour la France, les gouvernements successifs ont considéré que l’accord constitue une forme de reconnaissance de la ZEE française par le Mexique, et qu’il contribue à la bonne qualité des relations diplomatiques franco-mexicaines.
Sur le plan de la pêche, on doit regretter que les eaux riches en thon rouge ne soient exploitées par des armements venus de Polynésie, voire des Antilles.
Les navires doivent recevoir une autorisation de pêches chaque année et respecter les obligations déclaratives en matière de communication des volumes capturés, ainsi que les règles de la CIATT. Celles-ci portent notamment sur les modalités de captures, la gestion des stocks, la surveillance et le contrôle. L’activité s'exerce dans le cadre des plafonds de captures et d'effort de pêche octroyés au pavillon mexicain. Les senneurs actifs doivent embarquer des observateurs désignés par l’organisation, les éventuelles infractions relevées étant portées à la connaissance du comité de surveillance de la CIATT, auquel la France participe.
Les navires sont soumis aux contrôles opérés par les frégates de surveillance basées en Polynésie française, mais dont il est clair que la venue est trop peu fréquente, même s’il est indiqué que la France « fait procéder de manière régulière à une patrouille de surveillance en haute-mer et dans la zone économique exclusive ».
Le volume des captures a été variable. D’environ 2 500 à 3 000 tonnes de captures en 2008 et 2009, il est passé à environ 8 000 tonnes en 2010 et 2011. Les captures sont redescendues à des niveaux plus limités en 2012 et 2013, de 3 000 et 1 700 tonnes. Cette situation s’expliquerait par les mouvements interannuels des stocks de thonidés tropicaux et l’évolution de la distribution des captures dans l'océan Pacifique oriental, relevées dans les publications du comité scientifique de la CIATT.
Le bilan d'étape à mi-parcours, prévu par l’accord, est intervenu en juillet 2014.
À cette occasion, la France a obtenu que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, puisse disposer des données de capture de l’année sur le point de s’achever, lorsqu’il attribue les licences pour l'année à venir.
La partie mexicaine a accepté d’examiner toute forme de coopération permettant de dissuader les activités de pêche illicite dans les eaux de Clipperton.
La France a par ailleurs souligné que disposer des informations fournies par satellite permettrait de les confronter avec celles figurant dans ses bases de données afin de pouvoir détecter avec certitude la présence dans la zone de Clipperton de navires sans licence. Les deux pays sont donc convenus de commencer à travailler sur une procédure commune d’échange d’informations.
En parallèle à cet accord, un régime d'autorisations délivrées par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française pour l’accès à la zone économique exclusive (ZEE) de Clipperton a été établi en 2013, dans le cadre du décret n° 2010-728 du 29 juin 2010 fixant les conditions dans lesquelles des navires battant pavillon d'un État étranger peuvent être autorisés à pêcher dans la zone économique située au large de l’île de Clipperton. Il permet d’octroyer jusqu’à huit licences à des navires palangriers ou canneurs contre une contrepartie financière, dans un cadre technique arrêté par le préfet. Ce régime contribue au développement de la pêche en Polynésie française et aux activités d’observation et d’évaluation de la ressource autour de Clipperton, dès lors que des licences sont demandées.
S’agissant de la surveillance, une autre expérimentation de surveillance satellitaire (dispositif OER) a été conduite comme on l’a vu dans le Pacifique sud en 2014 et a permis notamment d’analyser avec précision l’activité maritime autour de l’île.
Dans l’ensemble, l’accord de pêche représente certes une concession au Mexique, mais il a permis à la France de reprendre « la main » en donnant un cadre légal à des activités qui étaient jusque-là clandestines et les améliorations qui viennent d’être évoquées doivent être mises en œuvre et même complétées jusqu’à l’obtention d’un cadre rigoureux.
Il est également très clair que le point de vue de M. Philippe Folliot, chargé par le Premier ministre d’une mission de réflexion et d’évaluation sur l’avenir de ce territoire et sa place dans le dispositif global mis en œuvre par la France pour la surveillance de ses eaux territoriales, qui souhaite une présence française à Clipperton, doit être défendu.
Il peut d’autant plus l’être que l’accord n’est pas exclusif, bien au contraire, d’une réaffirmation de la présence française sur place dès lors que les circonstances scientifiques ou autres s’y prêteront. Comme l’a indiqué aux rapporteurs M. Philippe Folliot, des projets peu coûteux peuvent être envisagés.
C’est dans cette même perspective qu’il faut comprendre les projets élaborés par le Dr Enric Sala, explorateur du National Geographic, en coopération avec l’Université de Polynésie française en vue de la création d’une réserve marine à Clipperton.
a. L’accord de cogestion pour Tromelin : un blocage au niveau politique
En 2010, la France a conclu avec l’île Maurice un accord-cadre sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants. Cet accord a fait et fait toujours débat.
Le projet de loi visant à en autoriser la ratification a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, mais il n’a pu être discuté en raison de fortes oppositions.
Il organise une cogestion « relative à » Tromelin sur les questions économiques, scientifiques et environnementales relatives à l'île et à ses espaces maritimes environnants, dans des limites convenues entre les deux parties. L’accord est ainsi assorti de trois conventions techniques portant sur la gestion des ressources halieutiques, la protection environnementale et la recherche archéologique.
L’étude d’impact du projet de loi autorisant l’approbation de l'accord-cadre précise bien que la France refuse de mettre en question sa souveraineté : « il ne saurait être question que la France renonce à la souveraineté sur Tromelin non seulement sur le principe mais aussi parce que cela pourrait avoir un impact sur les autres différends relatifs à des possessions françaises d’outre-mer, en particulier celui avec Madagascar à propos des Îles Éparses situées dans le canal du Mozambique. Il ne saurait en tout état de cause être question que la France s’engage dans une procédure faisant intervenir un tiers (médiation ou procédure arbitrale ou juridictionnelle). C’est pourquoi a été privilégié un projet de cogestions sectorielles et géographiquement circonscrites qui a abouti à l’accord signé avec Maurice le 7 juin 2010 ».
C’est appréciable, mais on peut tout autant regretter que cette rédaction fasse aussi explicitement référence aux différends existants dans la zone et aux modalités de leur règlement.
Sur le fond, ce sont les modalités de la gestion des ressources halieutiques qui ont suscité des réserves.
Ainsi, dans sa question écrite n° 29 097 au ministère des Affaires étrangères, posée le 11 juin 2013, M. Gilbert Le Bris, député, a estimé que : « Si l’accord stipule dans son article 2 que "rien dans (le texte) ni aucun acte en résultant ne peut être interprété comme un changement de la position française ou mauricienne sur la question de la souveraineté ou des compétences territoriales et maritimes", on peut cependant s’étonner de ce qui peut s’apparenter à un partage de souveraineté dans un contexte international difficile et un secteur maritime français sensible. De plus, il est regrettable qu’aucune durée de validité de cet accord cadre sur la cogestion économique, scientifique et environnementale n’ait été définie au préalable ».
Certes, comme le précise l’article 13, cet accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
Mais une telle configuration n’est pas totalement satisfaisante.
D’abord, la rédaction de l’article 13 qui indique que la dénonciation de l’accord ne remet pas en cause les droits et obligations des parties résultant de la mise en œuvre du présent accord sauf si les parties en décident autrement d’un commun accord, qui implique un effet de cliquet.
Ensuite, Maurice délivre de son côté à des navires asiatiques des licences portant sur l'ensemble de sa ZEE, y compris celle qu'elle revendique au titre de Tromelin. L’arraisonnement par la marine nationale en octobre 2004 de deux bateaux japonais munis de ces licences a occasionné une vive tension. Depuis lors, selon les éléments disponibles, Maurice délivre toujours des licences de pêche pour l'ensemble de sa ZEE, mais y mentionne par précaution que la ZEE de Tromelin est une zone de souveraineté contestée,comme l’indique l’étude d'impact du projet de loi, ce qui est, en principe, de nature à dissuader les navires étrangers d’y pêcher.
Enfin, il est vrai que l’étude d’impact apporte aussi les précisions suivantes, en principe de nature à rassurer : « La convention sur la cogestion des ressources halieutiques dans les espaces maritimes environnants de l’île est plus ambitieuse : il s’agit de mettre en œuvre une politique commune de la pêche dans des espaces maritimes qui incluent la mer territoriale, où, selon la convention des Nations unies sur le droit de la mer, s’exerce la souveraineté entière de l’État côtier. Rien n’empêche la France de gérer avec un autre État les ressources halieutiques se trouvant en partie dans sa mer territoriale, comme elle l’a fait dans l'Accord franco-britannique relatif à la pêche dans la Baie de Granville signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000. L’accord-cadre institue un régime de cogestion sectorielle, où certaines compétences dans des domaines bien spécifiés sont mises en commun, sans que cela puisse être interprété comme l’acceptation par la France d’un partage avec les autorités mauriciennes de l’ensemble des attributs de la souveraineté sur l’île de Tromelin. D’autre part, la France ne pourra se voir imposée une décision dès lors qu’elle participe au consensus nécessaire. Ainsi, l’accord ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de l'exercice de la souveraineté ».
Pour autant, compte tenu des doutes sur cette argumentation, le projet de loi n’a toujours pas été adopté à ce jour, la première lecture devant l’Assemblée nationale prévue selon la procédure simplifiée pour mars 2013 ayant été ajournée in extremis à la suite de l’intervention de notre collègue député Philippe Folliot.
Sur le fond cependant, la philosophie de cet accord est bonne, car il ne peut être question de maintenir hors de leur environnement les collectivités d’outre-mer.
3. Une coopération forte à envisager pour les îles Éparses du canal de Mozambique, vis-à-vis de Madagascar voire d’autres pays voisins
La perspective d’une coopération voire d’une cogestion paraît adaptée pour les îles Éparses vis-à-vis de Madagascar, comme l’a indiqué aux rapporteurs, lors de son audition, M. Serge Segura, ambassadeur chargé des océans. Le Gouvernement y est favorable. Comme indiqué dans la réponse du Gouvernement du 12 janvier dernier à la question écrite n° 91465 de M. Laurent Furst, député, la France est « disposée à ouvrir avec Madagascar des discussions sur ces réservoirs de biodiversité à l’écosystème vulnérable et à nouer avec ses voisins d’éventuelles collaborations, en particulier sur les aspects scientifiques ou environnementaux liés aux menaces qui pèsent sur ces îles, à l’image de ce qui a été fait avec Maurice s’agissant de Tromelin ».
La diplomatie française est donc encline à rechercher une solution négociée de cogestion, mais sous réserve de ne rien concéder quant à la souveraineté.
L’exposé des motifs du projet de loi précité de ratification de l’accord avec Maurice sur Tromelin peut servir de référence à cet égard : « cet accord [sur Tromelin] pourrait contribuer à la solution d’autres contentieux dans la même zone en servant de référence sur le fond ou sur la méthode employée. Quatre des cinq États membres de la Commission de l’océan Indien (COI), Madagascar, Maurice, Comores et France (Réunion) n’ont pas pu trouver de consensus concernant la souveraineté sur certaines îles de l’océan Indien ainsi que sur la délimitation et le contrôle de leurs zones économiques exclusives (ZEE). Cela concerne les îles du canal du Mozambique (Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Glorieuses) et une île au nord-ouest de La Réunion : Tromelin (…). Le présent accord pourrait inspirer d’autres accords susceptibles d’aplanir les difficultés tout en contournant l’obstacle du différend sur la souveraineté du territoire concerné ».
Il est certain qu’un tel schéma permettrait de sortir avec Madagascar de l’actuelle situation de blocage dans un sens parfaitement conforme au droit international et dans un esprit de dialogue que la France tend à incarner.
Elle pourrait même trouver tout son sens si elle intervenait dans une perspective plus large de coopération régionale avec l’ensemble des pays de la région dans le cadre d’une approche globale du développement d’une zone qui, à part Maurice, reste largement à l’écart du développement.
a. Mettre à l’étude la création d’une grande collectivité française de l’océan Indien
Faisant référence au projet dont lui aurait fait part M. André Thien Ah Koon, ancien député, M. Michel Rocard a évoqué la perspective d’un grand projet de coopération et ainsi de développement des collectivités de l’océan Indien et de leurs voisins.
Ce projet exigerait au préalable une adaptation institutionnelle d’envergure avec la création d’une collectivité « régionale » comprenant La Réunion, Mayotte et les TAAF. Cette collectivité serait dotée de compétences larges permettant d’organiser une coopération avec l’ensemble des pays environnants.
La coopération se ferait non plus de la métropole vers les pays africains ou de l’océan Indien, mais en utilisant le savoir-faire et les compétences locales, selon un schéma d’ailleurs applicables aux Antilles.
Plus que toutes autres, les îles de l’Océan indien s’y prêtent en raison de la qualité de leur environnement marin et de leur biodiversité et également parce que c’est là que les perspectives d’une exploitation durable et raisonnée des océans semblent prendre corps en raison de la richesse probable des sous-sols marins.
Un tel projet devrait naturellement associer les entreprises françaises en pointe sur le secteur de la recherche, de l’exploration et de l’exploitation sous-marines, qui trouveraient là un levier pour le développement de leur savoir-faire et de leurs compétences techniques.
4. Lever les craintes d’un éventuel début d’érosion de la souveraineté, prélude à sa renonciation
À l’arrière-plan de la question de l’érosion de la souveraineté se trouve la crainte de sa perte à plus ou moins longue échéance. C’est l’interrogation et même les craintes sur un éventuel « début de détricotage », notamment exprimées par M. Philippe Folliot.
Une telle crainte est fondée sur une illusion conceptuelle, celle que les îles et les espaces ultramarins de la France sont les derniers « confettis » de l’empire ou de l’Union française.
Une telle conception est erronée à trois points de vue.
En premier lieu, il n’y pas, en arrière-plan, la question de la libre détermination des populations qui a été à l’origine de la décolonisation, puisqu’il s’agit d’îles qui ne sont pas historiquement peuplées.
En deuxième lieu, un transfert de souveraineté laisserait sans réponse la question de l’exploitation durable et dans des conditions conformes au droit international et aux exigences de la nouvelle géo-écologie qui prend corps, selon la formule d’Hubert Védrine, des espaces maritimes et sous-marins concernés.
En troisième lieu, une telle exploitation ne peut se faire sans raisonner sur l’insertion des activités correspondantes dans leur environnement régional, à l’heure de la mondialisation. Ce serait un contresens complet que de considérer que les ressources correspondantes sont destinées au seul marché national ou au seul marché européen.
L’intérêt de l’économie française dans le nouveau contexte économique est d’exporter davantage, y compris des matières premières ou des produits maritimes ultramarins directement vers l’ensemble du monde.
En définitive, la tension actuelle est une tension classique entre des pays qui s’affirment et souhaitent se développer et des pays à une phase ultérieure de leur développement, mais elle appelle spontanément une solution coopérative régionale, l’intérêt bien compris de la France comme de ses voisins ultramarins étant d’organiser dans la région et de la manière la plus avantageuse possible la chaîne de la valeur ajoutée. C’est un complément à l’aide classique au développement avec la faculté de faire appel à des projets partagés.
Autant la question ne se pose pas pour Clipperton faute de pouvoir envisager une coopération avec le Mexique, qui est membre de l’OCDE et dispose des compétences financières et techniques, autant elle se pose clairement pour Madagascar, et aussi pour Maurice.
Dans cette perspective, il est confirmé qu’il est tout à fait pertinent de conclure des accords qui ne peuvent être que des accords entre États plutôt que des accords avec des acteurs privés dont on ne peut garantir qu’ils auront la même attention pour le développent des territoires à proximité des zones marines et sous-marines concernées.
E. METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE D’AVENIR TOURNÉE VERS L’EXPLOITATION ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLES DES OCÉANS ET DES FONDS MARINS, POUR RENOUVELER LES TERMES DE LA PRÉSENCE FRANÇAISE DANS TOUS LES OCÉANS
1. Faire des espaces marins la vitrine politique et technologique de la France dans la nouvelle géo-écologie mondiale
a. Le tournant de l’accord sur le climat : la nouvelle dimension environnementale de la structuration de la société internationale
Comme l’observe M. Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères, dans le dernier ouvrage qu’il a publié, intitulé Le monde au défi, l’accord de Paris sur le climat de décembre dernier montre l’importance du lien écologique comme lien essentiel entre les peuples du monde. À ses yeux, le nouveau concept de « géo-écologie » sera une « utopie constructive » ouverte à tous les peuples, dans leur diversité. C’est qu’une nouvelle dimension, par essence coopérative, s’ajoutent à la géopolitique et à la géo-économie, par nature plus conflictuelles, qui structurent actuellement la communauté internationale.
Il convient de se placer dans la même perspective pour les territoires ultramarins et les espaces maritimes de la France, en particulier pour les plus étendus d’entre eux dans l’océan Indien et dans le Pacifique, pour renouveler les bases de sa légitimité de sa présence d’une manière qui renforce l’efficacité du droit international.
Tel est d’autant plus le cas que les Nations unies préparent de manière tout à fait pertinente un projet d’instrument multilatéral sur la biodiversité marine en haute mer.
a. Anticiper les dispositions du futur instrument international sur la biodiversité marine
S’appuyant sur le constat que les écosystèmes marins de la haute mer sont menacés par le développement des activités humaines, la pollution et les dérèglements climatiques, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 15 juin 2015 la résolution 69/292 qui lance le processus de négociation sur la biodiversité marine au-delà des zones sous juridiction des États¸ dit processus « BBNJ » (Biodiversity Beyond National Jurisdictions).
L’objectif est de compléter pour la haute mer, au-delà de 200 milles marins, certaines dispositions de la CNUDM sans porter atteinte aux compétences des organisations internationales existantes : l’OMI ; les organisations régionales de gestion des pêches ; l’AIFM.
Son champ d’application devrait concerner les ressources génétiques marines et le partage des avantages de leur utilisation ; la réglementation de certaines zones maritimes par le biais d’aires marines protégées ; des études d’impact environnementales et des études stratégiques environnementales pour les activités menées en haute mer ; le renforcement des capacités des États en développement et les transferts à leur profit des technologies marines.
Les quatre sessions du comité préparatoire devraient déboucher à la fin de l’année 2017 sur des recommandations à l’Assemblée générale des Nations unies en faveur de l’ouverture d’une conférence intergouvernementale, en vue de sa décision fin 2018. Le futur accord devra établir un cadre juridique de gouvernance globale pour les océans valable pour plusieurs décennies. Les négociations actuellement en cours sont assez difficiles sur la question de la pêche.
a. Placer d’emblée les espaces marins et sous-marins sous juridiction française dans la transition économique et l’exploitation durable
Même si le futur accord international ne concernera que les seuls espaces qui ne sont pas sous la juridiction des États, il est clair que l’exploitation des ressources océaniques et sous-marines des ZEE et des extensions du plateau continental, annoncée depuis plusieurs décennies, n’interviendra que sous haute vigilance internationale.
Il convient ainsi de prévoir d’emblée de placer sous le sceau de l’exploration et de l’exploitation durables des espaces marins et sous-marins français.
Pour ces derniers, il s’agit non pas d’une contrainte, mais de se placer dans la continuité de ce qui est prévu pour les grands fonds marins par l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), qui a prévu des conditions d’exploitation dans le cadre d’un code minier, ou plus précisément, du « code d’exploitation minière ».
Il s’agit d’un ensemble de règles, réglementations et procédures élaborées par l’AIFM pour réglementer la prospection, l’exploration et l’exploitation des minéraux marins.
Les contractants sont également choisis avec soin ce qui implique un savoir-faire avéré et une réputation permettant de considérer qu’ils respecteront les règles du plan de gestion de l’environnement prévu par le règlement de gestion de l’environnement. En outre, les entreprises contractantes doivent rendre des rapports en suivant les lignes directrices prévues.
2. Deux exemples à suivre d’activités durables
a. Les énergies renouvelables en mer : un développement en cours
Les ressources énergétiques issues de la mer font l’objet d’une mutation essentielle. Longtemps réservés à l’exploitation des hydrocarbures, les espaces maritimes font en effet l’objet d’un intérêt nouveau avec le développement des énergies renouvelable, l’éolien en mer, davantage accepté par les populations qu’à terre, et l’hydrolien pour l’essentiel.
Comme on l’a vu, le Royaume-Uni est un exemple de cette mutation, puisque l’épuisement naturel des gisements de la mer du Nord est remplacé par le développement spectaculaire des projets éoliens en mer.
Les énergies renouvelables en mer sont un pôle d’excellence de l’Europe. Le Global Wind Energy Council (GWEC) a constaté que 91% des capacités y sont installées, essentiellement en mer du Nord, en mer Baltique, en mer d’Irlande et dans la Manche. Dans le reste du monde, seuls deux projets chinois sont recensés.
Les pays riverains de la mer du Nord sont les plus avancés. Sur une capacité mondiale déployée de 8,8 mégawatts à la fin de l’année 2014, l’essentiel l’était en effet au Royaume-Uni, à raison de 4,494, au Danemark et en Allemagne, à raison de 1,27 et 1,05 respectivement.
L’enjeu est essentiel pour le futur. Les estimations montrent que les capacités totales atteignent environ 7 fois la demande européenne en énergie et six fois la demande américaine.
Les coûts de production tendent à diminuer. Selon une étude réalisée en liaison avec Crown Estate, qui gère au Royaume-Uni, les droits sur les fonds marins et perçoit donc les redevances correspondantes, ils pourraient baisser jusqu’à atteindre 90 euros le mégawatt heure vers 2030.
Plusieurs projets ont cependant dû être abandonnés en 2015 en raison de la baisse des subventions prévues à partir de 2014, mais aussi de l’opposition des populations riveraines.
a. L’exploitation des algues : des perspectives à concrétiser
Les algues marines ont un potentiel important pour cinq secteurs majeurs de l’économie :
– la chimie : les algues sont également un moyen efficace de produire à grande échelle des molécules dont l’intérêt est déjà connu. On cite ainsi le glycérol, ou encore de colorants comme la béta-carotène ou l’astaxanthine. Le jus d’algues est l’un des engrais de plus en plus répandu en jardinerie, en raison de son caractère biologique ;
– les biomatériaux, notamment en raison de leur résistance et de leur malléabilité ;
– la santé et la biomédecine, notamment pour les nouveaux médicaments ou de nouvelles thérapies, largement fondés sur leur potentiel antibactérien ou antiviral, voire anticancéreux ;
– l'agro-alimentaire, notamment grâce à leur certification « agriculture biologique », comme agents de saveur et de texture, ainsi par les possibilités de leur incorporation directe dans les aliments au fur et à mesure que les goûts évoluent. Les qualités nutritionnelles des algues sont avérées, en raison de la concentration de minéraux, macroéléments et oligo-éléments.
– la protection de l’environnement, grâce à la capacité de certaines d’entre elles à piéger les rejets.
L’enjeu est encore largement devant nous car, selon le Livre bleu, une grande partie de ces biotechnologies bleues ne devraient devenir industriellement et commercialement exploitables qu’au cours de la prochaine décennie, 2020-2030. Ce n’est donc que dans le futur que ce secteur devrait connaître sa croissance.
3. Avancer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale relative à l’exploration et à l’exploitation minières des grands fonds marins
a. Une connaissance assez précise du type de ressources, mais encore incertaine sur les localisations et les quantités exploitables
À côté des hydrocarbures et des produits de la mer, les minerais sont la troisième grande ressource des espaces maritimes. Leur exploitation, annoncée il y a déjà plusieurs décennies, a été reportée en raison d’une part des difficultés techniques de leur exploitation, et par conséquent, de leur coût, mais aussi en raison du développement spectaculaire du recyclage qui a considérablement accru le potentiel des ressources terrestres et a, par conséquent, reculé d’autant les « limites de la planète ».
Parmi ces ressources, il faut d’abord mentionner les amas sulfureux ou sulfures hydrothermaux considérés comme les ressources les plus immédiatement disponibles, présents dans les volcans sous-marins actifs ou récents, avec des teneurs fortes en cuivre, en zinc, en mercure, mais aussi en métaux stratégiques à potentiel technologique élevé et pour lesquels des risques de pénurie existent tels que l’indium, le germanium, le cadmium, l’antimoine, le sélénium, le molybdène et les terres rares.
Pour leur part, les encroûtements cobaltifères sont surtout constitués de fer et de manganèse, mais sont aussi riches en cobalt et souvent en platine. Plusieurs terres rares, ainsi que du titane, du thallium, du zirconium, du tellure et du molybdène, peuvent être trouvés à des concentrations intéressantes.
Pour leur part, les nodules polymétalliques, concrétions d’une dizaine de centimètres de diamètre, qui jonchent les fonds océaniques, sont par définition plus variés. Ceux localisés au nord de l’île de Clipperton sont riche en fer, manganèse, cuivre, nickel et cobalt. Il y a aussi des éléments plus rares qui les font considérer comme les réserves stratégiques pour les métaux de base comme pour certains métaux rares.
Enfin, il y a le cas des placers continentaux, dépôts sédimentaires des plateaux continentaux, encore peu connus. On mentionne près de Terre Neuve, des dépôts riches en chrome. Par ailleurs, le Brésil a procédé à un inventaire du potentiel de ses eaux en ressources minérales. Des concentrations intéressantes en scandium, vanadium, titane et zirconium ont été relevées.
Leur localisation et les quantités disponibles et exploitables restent encore imprécises.
D’une part, comme l’indique la carte suivante, les espaces de localisations possibles sont encore très vastes avec des possibilités de trouver des hydrocarbures au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guyane et dans le Canal du Mozambique, et la faculté de trouver des ressources minérales dans le Pacifique.
Les ressources minérales des fonds marins sous juridiction française
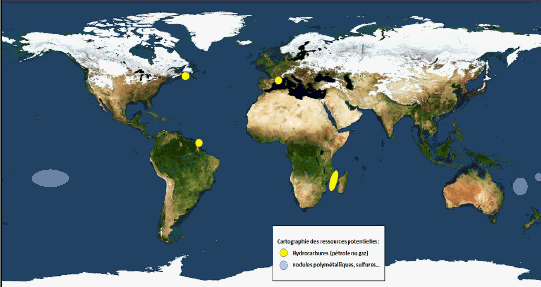
Source : SGMer
Des indications ont été fournies dans une étude de l’Ifremer, publiée en 2011, intitulée les ressources minérales marines profondes : synthèse d’une étude prospective à l’horizon 2030. Des éléments un peu plus précis ont été mentionnés dans le rapport d’information précité n° 430 (2014) de MM. Jean-Étienne Antoinette, Joël Guerriau et Richard Tuheiava, au nom de la Délégation sénatoriale à l’outre-mer.
Ainsi, des configurations propres aux sulfures hydrothermaux ont été identifiées à Wallis-et-Futuna, dans les îles de Hunter et Matthew, dans les îles Saint Paul et Amsterdam, dans l’archipel des Crozet et les îles Kerguelen, ainsi qu’à Mayotte, aux Antilles et en Polynésie.
Les encroûtements cobaltifères sont présents dans les volcans anciens et atolls immergés, c'est-à-dire des environnements situés en général loin des continents dans des zones où les taux de sédimentation sont très faibles. C’est le cas de l'archipel des Tuamotu (Polynésie française), des îles Kerguelen, de Mayotte et des Îles Éparses.
On ne dispose cependant pas d’éléments plus précis sur les localisations, les quantités disponibles, et par conséquent sur les différents coûts d’extraction et d’exploitation.
C’est largement en raison du faible nombre de permis demandés et donc délivrés, en raison notamment des résultats incertains.
a. Des explorations en nombre encore réduit
Les explorations concernant les fonds marins sous juridiction française sont en nombre très réduits et leurs résultats n’ont pas toujours été pour l’instant à la hauteur des attentes.
La ZEE des TAAF a fait l’objet de délivrance de deux permis de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux ont été délivrés le 22 décembre 2008 par arrêté du ministre chargé des mines pour une durée de 5 ans dans la ZEE de Juan de Nova (les blocs dits « Juan de Nova maritime profond » et « Juan de Nova Est »).
S’agissant du permis « Juan de Nova maritime profond », deux campagnes d'exploration ont eu lieu dans les conditions définies par arrêtés du préfet, administrateur supérieur des TAAF. Les sociétés South Atlantic Petroleum JDN SAS et Marex Petroleum Corporation ont déposé une demande de prolongation de ce permis pour une nouvelle durée de 5 ans. La prolongation du permis « Juan de Nova maritime profond » jusqu'au 30 décembre 2018 a été obtenue par arrêté du 21 septembre 2015.
S’agissant du permis de « Juan de Nova Est », la société Jupiter Petroleum, considérant le faible potentiel de la zone explorée, a retiré sa demande de prolongation de permis en août 2015. Cependant, la partie Sud, au vu des travaux menés présente de forts intérêts. Deux autres demandes de permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux ont été déposées pour la ZEE d’Europa et sont en cours d'instruction.
Pour ce qui concerne Wallis et Futuna, des campagnes d’exploration des fonds marins de la ZEE ont été conjointement menées à partir de 2010 dans le cadre d’un partenariat public privé associant le ministère de l’écologie et du développement durable, l’Agence des aires marines protégées, l’Ifremer, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), ainsi que Technip, Eramet et Areva.
Les résultats ont été jugés prometteurs, avec la localisation de plusieurs dépôts sulfureux, mais l’exploitation ne peut en l’état être envisagée en raison de la nécessité d’une réforme du code minier.
a. Une capacité technique avérée d’intervention des opérateurs français dans les grands fonds : les deux contrats conclus avec l’AIFM
L’AIFM qui gère les grands fonds marins a délivré à plusieurs opérateurs des permis d’exploration délivrés. Le plus grand nombre concerne la zone dite de Clarion Clipperton comprise entre les deux failles du même nom, et qui s’étend globalement de Clipperton jusqu’à Hawaï et aux îles Kiribati.
Plus précisément, l’AIFM a conclu avec vingt-quatre entrepreneurs, des contrats de 15 ans pour l’exploration des nodules polymétalliques, les sulfures polymétalliques et les agrégats ferromanganèses riches en cobalt dans les grands fonds marins.
Quinze de ces contrats sont pour l’exploration des nodules polymétalliques dans la zone de fracture Clarion - Clipperton (14) et dans le bassin central de l’océan indien (1). Il y a cinq contrats pour l'exploration des sulfures polymétalliques dans la dorsale sud-ouest indienne, la dorsale centrale indienne, et la dorsale médio-atlantique ainsi que quatre contrats pour l’exploration des encroûtements riches en cobalt dans l’océan Pacifique occidental.
En application du règlement, chaque entrepreneur a le droit exclusif d'explorer une zone initiale ne s’étendant pas au-delà de 150 000 kilomètres carrés.
Les bénéfices tirés de la future exploitation des ressources devront faire l’objet d’un partage équitable, notamment en faveur des États en développement.
Chaque contractant est tenu de proposer un programme pour faciliter la formation des ressortissants des pays en développement
La localisation géographique de ces permis d’exploration dans la zone de Clarion-Clipperton est la suivante :
Carte des explorations dans la zone de Clarion-Clipperton
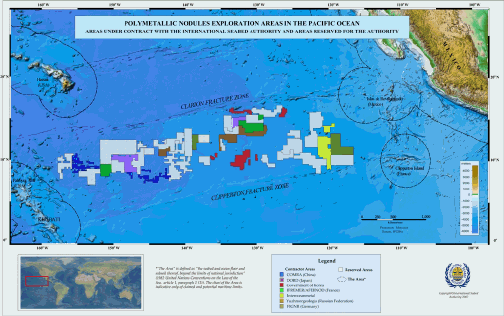
Source : AIFM
L’Ifremer, contractant pour le compte de l’État, dispose de deux permis pour deux zones en partie centrale et occidentale.
Le premier de ces permis a été délivré en 2001 pour 15 ans et prend fin cette année. Le Gouvernement a fort heureusement décidé d’en demander la prolongation, dans une logique d’entretien des droits tant que les technologies ne sont pas encore parvenues à maturité.
Par ailleurs, l’Ifremer a conclu en novembre 2014 avec l’AIFM un second permis, de 15 ans également, pour l’exploration pour des sulfures polymétalliques sur la dorsale volcanique médio-atlantique, selon la localisation suivante.
Localisation des explorations dans la zone médio-atlantique
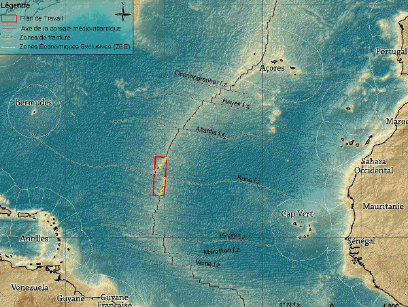
Source : Ifremer
En l’état, la France a décidé de se limiter à ces deux permis dans la zone internationale, compte tenu des potentialité de ses propres fonds marins.
a. La stratégie nationale d’exploration et d’exploitation minières des grands fonds marins : un outil pertinent
Le CIMer du 22 octobre dernier a, de manière tout à fait pertinente, adoptée une stratégie nationale relative à l’exploration et à l’exploitation minières des grands fonds marins.
L’objectif est de développer un modèle français permettant d’assurer si possible l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement en matières premières du pays, de répondre à ses besoins industriels et de structurer une filière complète industrielle et de prestations de services.
L’enjeu est la capacité de notre pays à s’insérer dans une filière d’excellence exigeante emblématique du siècle.
Cette stratégie visant à constituer une filière d’approvisionnement doit être mise en œuvre. Elle comprend en effet trois volets essentiels.
Le premier est la recherche et l’exploration. Il faut d’abord améliorer la connaissance des gisements possibles compte tenu de ce que les perspectives d’une mise en exploitation ne sont qu’à dix ou vingt ans.
Cela exige notamment la mobilisation des acteurs de la recherche marine en France, qui sont essentiellement les organismes publics scientifiques : l’IFREMER, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), les universités françaises (Université Pierre et Marie Curie, Aix-Marseille Université, Université de Bretagne occidentale, notamment) et l’Institut physique du globe de Paris.
Le deuxième volet concerne les conditions de l’exploitation dans le futur.
Il s’agit, d’une part, de développer les technologies adaptées pour l’exploration et de développer les compétences les outils d’exploitation. L’enjeu est immense avec en particulier la mise au point et le développement de plateformes intégrées, capables d’intervenir à très grande profondeur et automatisées permettant l’extraction du minerai, le pompage à la surface et le prétraitement métallurgique avant un traitement métallurgique ultérieur en usine.
Il s’agit, d’autre part, de développer une filière technologique et industrielle dans un secteur en devenir dans lesquels les entreprises françaises sont bien placées grâce à l’ancienneté et à l’excellence de la recherche scientifique marine, aux campagnes déjà réalisées (Pacifique, Wallis et Futuna. Plusieurs acteurs industriels de premier plan (Eramet, Technip, DCNS, Bourbon, Louis Dreyfus Armateurs, Comex). Cette offre française est d’ailleurs, pour l’essentiel, regroupée au sein du Cluster Maritime Français, via un groupe de travail très actif auquel participent les pôles de compétitivité mer Bretagne Atlantique et Méditerranée.
Le troisième volet vise la création de l’environnement juridique et fiscal approprié. La question de l'environnement juridique est importante, car il convient de définir avec les autorités compétentes des collectivités du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna) les conditions d’un développement industriel et minier. La réforme du code minier est importante. Elle est actuellement engagée, mais n’a pas encore abouti à Wallis-et-Futuna.
4. Faire jouer les synergies européennes sur la recherche et les technologies marines et sous-marines
a. Un secteur de très haute technologie qui ne concerne qu’un nombre réduit de pays
La recherche en matière marine et plus encore en matière sous-marine est un domaine de très haute technologie qui ne peut concerner qu’un petit nombre d’opérateurs disposant d’un savoir-faire spécifique dans un nombre limité de pays.
Les contractants de l’Autorité internationale des fonds marins sont ainsi peu nombreux et proviennent, pour l’essentiel, des pays suivants : le Royaume-Uni ; la Belgique ; l’Allemagne ; l’Inde ; la France, avec l’Ifremer ; la Russie ; le Japon ; la Chine ; la Corée ; le Brésil ; Singapour. Il faut y ajouter les États-Unis et le Canada, via des participations indirectes. Sont aussi mentionnés les Pays-Bas et l’Australie.
Depuis 1999, les États-Unis ne prennent en effet plus part aux explorations, faute d’avoir ratifié la convention de 1982.
Par ailleurs, il faut également citer l’intervention indirecte pour le cas pour les trois opérateurs basés dans de petits États qui sont aussi mentionnés comme contractants par l’AIFM, à Kiribati, Tonga et Nauru. Tonga Offshore Mining Limited est ainsi détenu par des intérêts canadiens. Il en est de même de Nauru Ocean Resources Inc.
On peut faire également le même constat pour la prospection pétrolière offshore.
Les causes en sont connues : les équipements doivent être très sophistiqués pour fonctionner sans présence humaine à distance ou avec une présence réduite au minimum, et doivent fonctionner dans des conditions extrêmes de pression voire de température, à proximité des sources hydrothermales.
Ce constat est le même pour les autres des nouvelles technologies du secteur maritime, y compris les activités plus traditionnelles qui sont en plein renouvellement comme la pêche, l’aquaculture ou la culture d’algues.
Dans ce domaine de très haute technologie, l’Europe a une carte à jouer.
a. Développer et rendre visible le volet Recherche de la stratégie maritime européenne
Il y a une recherche maritime européenne.
Le 7ème PCRD 2006-2013 a été ainsi structuré autour de plusieurs thèmes dont la gestion durable de l’espace maritime, pour mieux comprendre l’impact des activités humaines, l’initiative Océan de demain, l’initiative ERA-NET et ERA-NET+ pour appuyer la coordination et l’ouverture mutuelle des programmes de recherche nationaux et régionaux, dans un esprit ascendant : les réseaux de scientifiques se mettent en action, dans des champs thématiques spécifiques, pour coordonner leurs activités, dont l’un appelé BONUS pour la région baltique, l’autre SeasEra pour coordonner les financements de vingt organisations de recherche marine, dans les bassins de l’Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire.
Dans le cadre du programme Océan de demain, 31 projets ont été menés, sur les années 2010-2013, mobilisant 195,6 millions d’euros prenant en compte les différents aspects.
Il faut aussi mentionner en dehors du programme de recherche, mais en parallèle, le programme « Connaissance du milieu marin 2020 », mené par la direction des affaires maritimes, qui vise à compiler des données marines en provenance de diverses sources.
Le huitième programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » a prévu plusieurs volets qui concernent la recherche marine, notamment la sécurité alimentaire et l’énergie, mais sans approche spécifique.
Comme l’a indiqué lors de la mission à Bruxelles M. Jacques Fuchs, de la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne, la démarche actuelle repose sur trois piliers : l’innovation, de manière à conduire très directement à la valorisation des travaux par l’industrie ; les stratégies régionales de bassin maritime, avec l’identification d’enveloppe précise pour des programmes dédiés tels que le développement des éoliennes en mer ; les sciences et la société, de manière à appréhender les conséquences de la pression croissante de la population sur les côtes.
Pourtant, on ne peut que ressentir une déception face à des dispositifs complexes, aux financements mesurés, peu visibles et aux résultats incertains.
L’exemple de la recherche minière sous-marin en est une illustration, il y a deux projets en cours, l’un sur le développement des technologies nécessaires à l’exploration sous-marine, et l’autre, le projet MIDAS, selon l’acronyme anglais (Managing Impact of Deep Sea Resource Exploitation), pour minimiser l’impact environnemental. Lancé en 2013 et pour trois ans, le projet MIDAS bénéficie pour trois ans d’un budget de 12 millions d’euros dont 9 fournis par l’Union européenne dans le cadre du programme européen de recherche et développement.
C’est très modeste.
Il appartient donc à l’Europe de structurer son effort de recherche et de faire apparaître dans le cadre d’un grand programme individualisé la recherche sur les technologies marine et sous-marine, pour qu’elle vienne en appui des compétences nationales qui, sont comme on l’a vu, de premier plan.
Il est en effet paradoxal que la coopération plus directe entre les pays européens et les pays partenaires en matière de recherche martine, l’initiative de programmation conjointe «des mers et des océans sains et productifs (Joint Programming Initiative « Healthy and Productive Seas and Oceans » (JPI Oceans), donne quant à elle des résultats plus visibles.
Il s’agit d’une coopération intergouvernementale. Son objectif est de renforcer la coopération transfrontalière, la coordination, et l’intégration des programmes de recherche des États membres et associés qui bénéficient d’un financement public, dans un nombre limité de domaines. Ce mode de coopération a vocation à devenir aussi important que le Programme Cadre européen (FP7, Horizon 2020) dans le paysage de l’espace européen de la recherche, la recherche nationale représentant jusqu’à 85 % des dépenses publiques accordées à la recherche en Europe.
L’initiative « Des mers et des océans sains et productifs» (JPI Oceans) regroupe 20 États-membres et pays associés qui investissent dans les sciences marines, couvrant ainsi l’ensemble des bassins maritimes européens (Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Pologne, Roumanie, Espagne, Suède, Turquie et Grande-Bretagne).
Un Agenda Stratégique de Recherche et d’Innovation (SRIA) et un plan de mise en œuvre sont actuellement développés et les premières « actions pilotes » ont été lancées en 2013 selon trois directions :
– l’utilisation des infrastructures de pêche pour la collecte de données et la surveillance en mer du Nord ;
– l’impact écologique des micro-plastiques sur l’environnement marin ;
– l’approche écologique de l’exploitation des ressources minérales profondes.
a. Aller vers un « Airbus » de la recherche, de l’exploration et de l’exploitation sous-marine
Dans l’ensemble, peu de pays sont au niveau européen en capacité de faire face au défi de la recherche, de l’exploration et de l’exploitation sous-marines.
Si l’on s’en tient aux contractants de l’AIFM, on en observe quatre : la France ; l’Allemagne ; la Belgique ; le Royaume-Uni. D’autres pays, comme la Bulgarie, la Slovaquie et la Pologne sont conjointement intervenus avec la Russie, pour la délivrance d’un permis en 2001.
Pour prendre l’ascendant sur les autres pays ayant ce type de capacité, notamment le Japon, la Russie, la Corée, l’Inde, le Canada et les États-Unis et s’affirmer comme leader mondial, une coopération européenne peut être envisagée.
Elle doit même l’être si l’on considère que l’importance des besoins de financements, de technologie et de connaissances scientifiques et si l’on anticipe la question des futures normes environnementales et techniques qui ne manqueront pas d’intervenir dans ce secteur nouveau en développement.
La stratégie nationale précitée relative à l’exploration et à l’exploitation minières des grands fonds marins mentionne qu’un « rapprochement a été déjà initié avec l’Allemagne en ce domaine au travers d’une déclaration d’intention pour la partie publique, et au travers d’un mémoire d’entente (MOU) signé entre les industriels français et allemands pour la partie privée ».
Cette amorce de coopération doit être clairement poursuivie et idéalement, elle devrait déboucher comme plusieurs interlocuteurs des rapporteurs l’ont souligné, vers la création d’un « Airbus » européen de l’exploration et de l’exploitation minière des océans.
5. Développer d’ores et déjà les outils de base de la perspective environnementale d’exploitation des espaces maritimes ultramarins
a. Valoriser la démarche française d’une exploitation soucieuse de l’environnement
L’exploration et l’exploitation des fonds marins s’inscrit dans une logique durable qui doit d’ores et déjà être valorisée comme l’un des éléments constitutifs d’un modèle français soucieux du respect des grands objectifs internationaux en matière d’environnement.
En effet, comme l’indique la stratégie précitée, une expertise collective menée à la demande des ministères chargés de la recherche et de l’environnement par le CNRS et l’IFREMER concernant l’exploration. Elle conclut notamment à un besoin de recherches sur les écosystèmes et l’environnement des grands fonds, afin d’être mieux à même d’en prévoir les impacts.
Les travaux vont d’abord commencer sur des « zones pilotes permettant, au travers d'études et de suivis à long terme, le développement de protocoles efficaces et réalistes afin de mesurer les impacts potentiels d'une exploitation future. »
L’évaluation et le suivi des impacts environnementaux sont prévus. Les projets d’exploration et d’exploitation devront se conformer aux prescriptions du code minier et du code environnemental lorsque le chantier est situé dans la ZEE, et aux recommandations de l’AIFM lorsqu’il s’agit de projets en haute-mer.
Dans un souci de protection des ressources naturelles et de la biodiversité marine, il sera procédé à une évaluation initiale de l’environnement, puis à la réalisation d’études d’impacts environnementaux, et, par conséquent, à la mise en place de mesures de réduction des impacts ainsi que des suivis environnementaux périodiques.
Ce sont autant d’éléments que la France peut parfaitement valoriser au niveau international.
a. Promouvoir la labellisation « durable » des produits
La grande sensibilité aux enjeux environnementaux exige de développer la labellisation « durable » des produits qui seraient issus de la mise en exploitation des espaces maritimes ultramarins, de manière à bien afficher les garanties dont sont en principe assorties les conditions de leur production.
Lors des auditions, le cas de la légine, ce poisson des mers australes particulièrement apprécié de certaines clientèles étrangères, américaine et japonaise, notamment a été cité.
La légine est actuellement labellisée MSC (Marine Stewardship Council), ce qui est en principe une garantie de pêche durable. Néanmoins, l’actuelle polémique des organisateurs de ce label avec certains scientifiques dont les remarques n’ont pas été prises en compte interdit aux rapporteurs de le citer en exemple, faute de pouvoir se prononcer sur le fond du dossier.
Cependant, il faut retenir la pertinence de la démarche dès lors, naturellement, que le niveau d’exigence du label est bien garanti.
a. Développer les aires marines protégées au fur et à mesure des progrès des moyens de surveillance
Dans la perspective des nouveaux enjeux environnementaux internationaux, le développement des aires marines protégées tient clairement une place de choix.
La création d’aires marines protégées est prévue comme on l’a vu, pour la haute mer, dans le cadre des travaux sur le futur accord international relatif à la biodiversité marine, avec un double objectif : protéger la biodiversité ; prévenir la surexploitation des ressources naturelles, notamment la surpêche.
Il va de soi que l’efficacité de ces aires sera d’autant plus forte que des aires marines protégées seront également crées dans les espaces les plus proches des côtes, ceux sous la juridiction des États.
La France a déjà fait beaucoup dans ce domaine et elle peut faire davantage. Cependant, pour rester crédible, elle ne doit créer outre-mer de nouvelles aires marines protégées qu’au fur et à mesure du développement des moyens de surveillance, notamment satellitaires, afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures d’intervention et d’interception propres à garantir le respect des règles environnementales.
La création d’une aire marine protégée dans le contexte international actuel, plus favorable à la préservation de l’environnement, constitue pour un pays aux moyens limités comme le nôtre mais doté d’un espace maritime équivalent à celui des États-Unis, un outil finalement économe pour affirmer notre droit et préserver notre bien.
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION
La commission des affaires étrangères a examiné le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 29 juin 2016.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Nous examinons maintenant le rapport de la mission d’information sur la diplomatie et la défense des frontières maritimes de la France, dont MM. Paul Giacobbi et Didier Quentin sont co-rapporteurs.
M. Didier Quentin. Avec environ 11 millions de kilomètres carrés placés sous sa juridiction, la France détient la deuxième superficie maritime du monde, juste après les États-Unis qui possèdent 11,3 millions de kilomètres carrés, soit 300 000 kilomètres carrés d’écart environ. S’y ajoutent, potentiellement, 1,8 million de kilomètres carrés supplémentaires de fonds marins, grâce aux éventuelles extensions du plateau continental. Or, ce n’est pas le cas pour les États-Unis, qui n’ont pas ratifié la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.
Les espaces maritimes jouent un rôle de plus en plus important. D’une part, la convention de 1982 a renforcé les droits des États côtiers sur la mer. Elle leur a ainsi reconnu certaines compétences et facultés sur la zone économique exclusive (ZEE), qui s’étend jusqu’à 200 milles marins vers le large, bien au-delà de la limite des 12 milles qui marque la mer territoriale. Elle leur a également donné une faculté d’extension du plateau continental, au-delà de ces mêmes 200 milles, lorsque les conditions géologiques sont réunies. D’autre part, placé au cœur de la mondialisation, le transport maritime est en pleine expansion. La convention de 1982 a réaffirmé la liberté des mers et la liberté de navigation, y compris le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et le droit de passage dans les détroits.
Le Général de Gaulle, visionnaire comme très souvent, ne s’y était pas trompé, puisque dans l’un de ses derniers grands discours, prononcé à Brest en 1969, il déclarait : « L’activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche de l’exploitation de la mer, et naturellement, les ambitions des Etats chercheront à dominer la mer pour en contrôler l’activité et les ressources ». Nous y sommes…
Il convient également de rappeler que l’essentiel des espaces maritimes français est situé dans nos outre-mer, à raison de 97%, et principalement dans le Pacifique (4,8 millions de kilomètres carrés) et dans l’océan Indien (2,67 millions). Ces espaces, qui donnent lieu à des frontières méconnues, notamment avec l’Australie dans l’océan Indien et dans le Pacifique, ainsi qu’avec l’Afrique du Sud, sont en cours de délimitation.
Toutes les notifications à l’ONU ne sont pas encore intervenues. Cela ne fait cependant pas obstacle à l’application des lois françaises dans les espaces concernés. Établir des délimitations est parfois long et difficile, comme c’est le cas avec l’Espagne pour la ZEE en Méditerranée, dans le golfe du Lion.
Les demandes françaises d’extension du plateau continental n’ont, en l’état, abouti que pour la Martinique, la Guadeloupe, les îles Kerguelen et la Nouvelle-Calédonie, ce qui représente 579 000 kilomètres carrés. La demande conjointe avec l’Irlande, le Royaume-Uni et l’Espagne en mer Celtique a été acceptée par la Commission des limites du plateau continental, mais la répartition de l’espace concerné fait l’objet de négociations avec nos trois pays voisins.
La demande relative à Saint-Pierre-et-Miquelon mérite une mention particulière. Elle est tout à fait fondée et sa contestation par le Canada ne doit pas conduire à un déni de droits, en défaveur de la France. Ce point a explicitement été exclu du champ de l’arbitrage de 1992 sur la ZEE. Le droit international n’interdit pas non plus a priori l’hypothèse d’une discontinuité entre la ZEE française et l’extension du plateau continental, d’autant plus que l’île de Sable, qui permet au Canada d’intercaler une partie de sa ZEE, est, comme son nom l’indique, mouvante, et qu’elle pourrait ainsi disparaître dans le futur, par exemple en cas d’élévation du niveau des océans.
Plus éloignés de la métropole que ne le sont leurs équivalents britanniques, les espaces maritimes ultramarins de la France sont parfois contestés. Notre souveraineté est ainsi mise en cause dans l’océan Indien pour les îles Éparses du Canal de Mozambique (Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova), ainsi que pour Tromelin et Mayotte, aujourd’hui 101ème département français, et dont la population s’est prononcée, à plusieurs reprises, à de très larges majorités pour son maintien dans la République !
Dans le Pacifique, deux îlots, Matthew et Hunter, au large de la Nouvelle-Calédonie, nous sont contestés par le Vanuatu et l’île de Clipperton l’est d’une certaine manière par le Mexique, alors qu’un arbitrage en 1931 s’était positionné en faveur de la France. Ce dernier fait l’objet de critiques ambigües de la part de Mexico, qui a contesté la délimitation de la ZEE, même si l’accord de pêche bilatéral de 2007 au profit de l’armement mexicain, avec des licences gratuites, permet de régulariser dans une certaine mesure la situation. Je me permets, à cet égard, de signaler l’excellent rapport rédigé par notre collègue, Philippe Folliot, qui a été parlementaire en mission sur le devenir de l’Ile de la Passion et qui s’intitulait : « Valoriser Clipperton par l’implantation d’une station scientifique à caractère international ».
Par ailleurs, ces espaces maritimes ultramarins sont, en permanence, soumis aux risques d’activités illégales ou « limites »... Qu’il s’agisse de la pêche illicite, des infractions environnementales, de la recherche minière, gazière ou pétrolière, des autres trafics, notamment des trafics de drogue et d’armes, et de l’immigration clandestine, comme à Mayotte, la vigilance des services concernés doit être constante. Tel est d’autant plus le cas que l’exercice de l’interlope (de la contrebande) est facilité par les progrès de la technologie embarquée sur tous les navires.
Dans ce contexte, il importe de prendre en compte plusieurs évolutions avec une grande attention.
Premièrement, la sécurité des mers se dégrade. La piraterie connaît un renouveau, même si elle peut être efficacement combattue, comme dans la Corne de l’Afrique, avec l’opération européenne Atalante de lutte contre la piraterie maritime au large des côtes somaliennes, qui est un véritable succès, dans le cadre de la force navale européenne (Eunavfor). Le développement croissant des autres activités et trafics illicites, qui va jusqu’aux trafics d’êtres humains et aux migrations illégales, est tout aussi préoccupant. Ce sont autant de menaces surveillées par les États, mais aussi par les organisations internationales, en particulier l’Organisation maritime internationale (OMI).
Deuxièmement, la géopolitique maritime évolue. La suprématie reste, certes, à la marine américaine, garante de la liberté des mers ; mais le développement de la marine de guerre chinoise, qui n’est plus une flotte côtière, « d’eaux jaunes », et devient une flotte de haute mer, « d’eaux bleues », est aussi rapide que spectaculaire. Le Chef d’état-major de la marine française, la « Royale », nous a avoué, avec une nuance d’envie dans la voix, que les Chinois fabriquaient chaque année une quinzaine d’unités, et pas des vedettes garde-côte… La marine russe est, pour sa part, en plein renouveau. Le développement des flottes militaires n’est pas limité à ces deux pays. En Asie, notamment, et en Australie, mais aussi au Royaume-Uni, entre autres, l’heure est à l’acquisition de capacités nouvelles. Pour ce qui est de l’Angleterre, en ces temps de Brexit, il y a peut-être un certain avenir pour une coopération franco-anglaise dans ce domaine.
Troisièmement, la fonte des glaces ouvre en Arctique de nouveaux espaces, avec certains désaccords, que ce soit sur le régime des passages du Nord-Ouest et du Nord-Est, sur lequel la Russie et le Canada ont leurs propres visions, différentes de celles des éventuels usagers, et sur le partage des extensions du plateau continental.
Quatrièmement, la situation en Mer de Chine suscite beaucoup d’inquiétudes. Dans un contexte historique, géographique et politique compliqué, deux litiges de souveraineté opposent la Chine à ses voisins.
L’un est au Nord, avec le Japon, à propos des îles Senkaku. L’autre est en Mer de Chine du Sud, et concerne les deux archipels des Spratleys et des Paracels. La Chine se dresse ainsi contre le Viet Nam, les Philippines, la Malaisie et le Brunei. Ces deux différends sont sources d’incidents, avec un vrai risque d’escalade.
Fondée sur des arguments d’ordre historique, notamment sur sa situation précoloniale de suzeraineté, mais aussi sur une interprétation extensive du droit de la mer, ainsi que sur la recherche d’un contrôle effectif des eaux par la construction, et parfois la militarisation, d’îles semi-artificielles et d’infrastructures – il est même question de centrales nucléaires en mer ! -, la position de la Chine suscite des réactions internationales, très fermes et fondées sur le droit.
Au Nord, la réaction du Japon a été soutenue par les États-Unis. Au Sud, une procédure d’arbitrage, encore en cours, a été intentée par les Philippines. L’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les États-Unis ont marqué leur désapprobation et ont protesté. Les armées américaines, l’US Navy, et l’US Air Force font régulièrement des missions sur place, pour réaffirmer les principes de la liberté des mers et la liberté de survol.
La communauté internationale ne peut, pour sa part, rester insensible à des événements qui tendent à mettre en cause le droit international et qui interviennent dans un espace aussi important sur le plan stratégique, et par lequel transite, en outre, une très large part du commerce mondial.
Au regard de ces enjeux, il est impératif que la France affirme une volonté politique, à la hauteur de l’importance de ses espaces maritimes et de ses ressources. Eric Tabarly disait « La mer, pour les Français, c’est ce qu’ils ont dans le dos quand ils regardent la plage ! » ou bien encore : « Les Gaulois sont d’indécrottables terriens… ». Notre pays possède des atouts de premier plan, et à travers lui l’Union européenne. Il serait temps de valoriser davantage ces atouts, grâce notamment à une vision stratégique pertinente comme avec le Livre bleu de 2009, toujours d’actualité, et à la stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes d’octobre dernier.
Avant de laisser le soin à Paul Giacobbi de vous présenter ces atouts et les priorités qu’il conviendrait de mettre en œuvre sur les moyens et longs termes, je me permets d’émettre un vœu à l’aube de la campagne présidentielle que nous allons bientôt connaître.
A deux reprises, en 1981 avec François Mitterrand et le programme élaboré par M. Louis Le Pensec, et en 1988/1995 avec Jacques Chirac, qui avait été pilotin dans sa jeunesse, il a été question de redonner « une grande ambition maritime » à la France. Malheureusement, cette brillante idée, pour reprendre une expression chère à notre ancien Président, a fait « pschitt… ».
J’espère qu’il n’en sera pas de même dans le proche avenir et je serais tenté de lancer un SOS : « France, n’oublie pas ta mer… ».
M. Paul Giacobbi. Cette mission d’information est partie du constat que la considération accordée par les pouvoirs publics, jusqu’au sommet de l’Etat, sur les questions maritimes n’était pas excessive, pour rester dans l’euphémisme. Les comparaisons sont éclairantes. Ici même, l’un des ministres des affaires étrangères, et non des moindres puisqu’il a été l’un des plus brillants et des plus remarquables, M. Laurent Fabius, avait indiqué qu’il n’avait pas des connaissances très étendues en matière de droit maritime. Je n’imagine pas la même remarque de la part du ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine ou de celle de M. John Kerry, qui connaît fort bien ces questions. Lorsque le Président de la République s’est rendu au Canada, le Premier ministre de l’époque, M. Harper, est tout de suite intervenu avec précision sur la question de Saint-Pierre-et-Miquelon, même s’il savait avoir en partie tort sur le plan juridique. L’intérêt pour la question maritime est beaucoup plus soutenu à l’étranger.
Le paradoxe est que nous avons le premier domaine maritime du monde ou presque. Si l’on compte, l’espace maritime, « la colonne d’eau », nous avons un peu moins que les Etats-Unis (environ 300 000 kilomètres carrés de moins), mais si l’on compte le seul plateau continental, les fonds marins, nous avons ou nous en aurons davantage très rapidement, en raison des demandes d’extension du plateau continental qui n’emportent pas juridiction sur la colonne d’eau.
C’est essentiel pour les ressources du futur, qui sont moins la pêche et les ressources énergétiques, que les ressources minières des fonds marins. Il s’agit des nodules polymétalliques, mais aussi des terres rares qui sont essentiels aux équipements issus de nouvelles technologies comme les téléphones portables. Ces terres rares sont actuellement fournies par la Chine, pour l’essentiel. L’exploitation des fonds marins, notamment au large de Wallis-et-Futuna, pourrait nous y donner un accès direct dans le futur.
Notre pays n’a pas en fait de véritable volonté politique. Didier Quentin a rappelé les occasions manquées. A part essentiellement Colbert et le président Chirac, peu de dirigeants politiques français ont eu une ambition maritime. Ni l’un ni l’autre n’a d’ailleurs abouti. L’un de nos dirigeants les plus entreprenants, Napoléon, qui aurait d’ailleurs pu être marin, s’il n’était pas devenu artilleur, n’a pas eu de succès sur mer. Cela s’est même très mal terminé à Trafalgar. Il y a peut-être des raisons historiques à une telle situation, et nous pourrions en débattre, mais le constat est là.
Ce n’est pas une question de moyens, car nous avons tous les éléments qu’il faut pour mener une grande politique maritime. Nous avons une expertise scientifique parfaitement au niveau pour ce qui concerne les fonds marins, avec l’Ifremer et le Service hydrographique et océanographique de la Marine, le SHOM. Nous avons des juristes de grands talents, et il faut regretter qu’ils n’aient pas toujours été bien utilisés, notamment pour Saint-Pierre-et-Miquelon. L’arbitrage a été accepté dans des conditions insensées et suivi de France avec des moyens insuffisants. Nous avons trouvé après plusieurs années le moyen de relancer le dossier et il faut dire que le Canada est très ennuyé.
Le seul domaine dans lequel nos moyens sont insuffisants est celui des navires patrouilleurs, des navires régaliens notamment dans le Pacifique avec 4,6 millions de kilomètres carrés à couvrir. Cela a des conséquences importantes par exemple avec des visites tous les deux ans environ à Clipperton. Si l’île était par hypothèse possession de la République populaire de Chine, la situation serait tout autre avec d’importantes infrastructures. Ce serait une sorte de porte-avions géant.
Notre coordination administrative est également excellente, avec le secrétaire général de la mer, le SGMer et elle est même, d’une certaine manière, admirée au Royaume-Uni, où la situation est assez compliquée et où le pragmatisme contribue à compenser une moins bonne organisation.
Il nous manque donc la volonté. Nous faisons donc cinq propositions et pour l’essentiel, elles ne concernent pas les moyens. Elles ne sont donc pas coûteuses.
La première vise à porter la culture maritime au plus haut niveau de l’Etat et à assurer la continuité de l’impulsion politique. Il va falloir d’une certaine manière « amariner » nos dirigeants. La matière doit être considérée avec sérieux et les connaissances maritimes doivent être diffusées. L’étendue de notre superficie maritime, notamment, doit être mieux connue. D’un point de vue pratique, la réduction de la dichotomie entre le niveau politique et le niveau administratif passe d’abord par la nomination systématique d’un conseiller mer au cabinet du ministre, ainsi que par l’inscription des questions maritimes parmi les priorités de notre agenda international, notamment en les évoquant lors de la semaine des ambassadeurs, de même que par l’organisation, chaque année, d’un débat d’orientation au parlement sur les questions maritimes, par un renforcement du SGMer et par la réunion au moins une fois par an du Comité interministériel de la mer (CIMer).
La deuxième proposition vise à mener une stratégie d’influence aux niveaux européen et international, notamment au sein de l’Union européenne et de l’OTAN, sur les enjeux maritimes, et à assurer dans les organisations compétentes, comme l’Organisation maritime internationale (OMI), notre présence. Ce n’est pas inutile. L’OMI a pris récemment une décision, qui n’était pas acquise d’avance, sur le dispositif de séparation du trafic dans le canal de Corse, idée notamment défendue par la ministre, Mme Ségolène Royal.
La troisième proposition vise à garantir les moyens minimum nécessaires pour nos capacités de surveillance maritime. Il ne s’agit pas seulement des navires, mais aussi des moyens satellitaires qui renouvellent les modalités de la surveillance. Le programme Extraplac d’extension du plateau continental a été mené à bien, mais il l’a été avec des moyens très limités, comparativement à ceux des autres pays, et il ne peut constituer une référence sur le plan budgétaire.
La quatrième proposition vise à développer la coopération sur le plan régional. C’est la piste ouverte par l’accord de pêche avec le Mexique et celle de l’accord non encore ratifié avec Maurice sur Tromelin. Il faut le faire en évitant tout « détricotage ». Des perspectives existent avec d’autres pays notamment Madagascar. Il faut que la France montre qu’elle peut aider les pays voisins de ses outre-mer et que la présence française est un atout et non une source de difficultés.
Enfin, la dernière orientation concerne la protection environnementale, qui prend de plus en plus d’importance au niveau international. Il s’agit notamment des mesures protection la qualité environnementale et biologique des espaces maritimes, avec les outils que sont les parcs marins ou les aires marines protégées, y compris en pleine mer. L’Agence française pour la biodiversité aura un rôle essentiel à jouer outre-mer. A elles seules, les îles Marquises ont une biodiversité du même ordre que la métropole, Corse comprise. Les pays étrangers font des parcs naturels pour affirmer leur présence et protéger leur souveraineté. C’est le cas du Canada pour l’île de Sable, ou encore du Royaume-Uni pour les Malouines, mais aussi de l’Argentine et du Chili.
Pour un pays aux moyens limités comme le nôtre mais doté d’un espace maritime équivalent à celui des États-Unis, c’est un outil finalement économe pour affirmer notre droit et préserver nos possessions.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Je remercie les co-rapporteurs pour leur travail. Il porte sur un sujet extrêmement important qui ne pose pas seulement des problèmes complexes de droit.
M. Jean-Pierre Dufau. Je félicite également les co-rapporteurs. Il s’agit d’un sujet essentiel. Nous avons des droits, mais aussi des devoirs concernant notre domaine maritime. Je dirai donc qu’anticipant la montée des eaux et le changement climatique, nos collègues nous invitent à élever le niveau de la politique maritime.
M. Pierre Lellouche. Je n’ai pas l’esprit à faire de l’humour, car le sujet est grave. Nous n’avons pas de politique maritime et le constat du déclin de la puissance française est navrant. L’effet conjugué de l’action de la CGT dans les ports, de la fiscalité concernant la marine marchande et du désarmement unilatéral de la « Royale » nous a fait perdre nos instruments historiques de puissance. Même nos entreprises se sont retirées : Alstom a ainsi réussi à vendre les Chantiers de l’Atlantique aux Coréens et depuis ceux-ci gagnent beaucoup d’argent… Il ne reste donc que la CMA-CGM. La « Royale » a vu fondre ses effectifs et, alors que l’on aurait dû disposer de dix-sept frégates de premier rang, on en aura tout au plus dix et encore en prenant en compte deux frégates anti-aériennes. Cela en fait une par million de kilomètres carrés. Que pouvons-nous surveiller avec ces moyens ?
Michel Rocard, en tant qu’ambassadeur chargé de la négociation internationale pour les pôles, a essayé avec beaucoup de vigueur de faire en sorte que la France prenne part aux négociations sur les passages qui s’ouvrent dans l’océan Arctique. Tous les pays limitrophes s’y sont opposés, à commencer par ceux qui sont européens, Norvège et Danemark. Ceux-là savez faire respecter leur souveraineté. Et je n’évoquerai même pas l’action de la Chine en mer de Chine du Sud.
Mais nous, nous n’avons aucun moyen de défendre notre domaine. Nous risquons de subir un jour une grave humiliation, si nous ne nous dotons pas de ces moyens. Réinventer une politique maritime serait un bel enjeu pour demain : nous devrions peut-être distribuer le rapport aux candidats à l’élection présidentielle. Je le répète, car c’est un point de désaccord avec les rapporteurs, c’est avant tout une affaire de moyens.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. C’est une très bonne idée. Nous allons voir comment nous pourrions cosigner une lettre adressée aux candidats et dans un premier temps diffuser le rapport à des personnalités choisies.
M. Jean-Paul Bacquet. Je félicite aussi nos collègues pour leur rapport.
Quelles sont les zones les plus conflictuelles actuellement s’agissant du droit maritime ? Quelles pourraient être les conséquences de la disparition de certaines îles du fait de la montée des eaux ?
Rotterdam a effectivement pris la place de Marseille. C’est notre avenir économique qui est en jeu et ceux qui prennent cela avec le sourire ont tort.
M. Paul Giacobbi. Sur les zones de conflit, il faut distinguer celles sur lesquelles il y a une question juridique. C’est par exemple le cas du passage du Nord, le Canada considérant que certaines eaux sont à eux pour des raisons historiques. Ils ont probablement tort sur le plan du droit, mais les choses se passent bien.
Un conflit dont on parle rarement mais qui est sérieux est celui entre l’Iran est les riverains sur le détroit d’Ormuz, ce qui est très important, plus de 40 % du pétrole mondial passant par ce détroit. C’est un chenal assez étroit et quand on connaît les tensions entre l’Iran et les pays sunnites qui sont de l’autre côté, c’est important.
L’endroit « chaud » est en réalité la mer de Chine méridionale. Il y a des îles qui, à l’évidence, n’appartiennent pas à la République populaire de Chine. Il y a un débat juridique « un peu tiré par les cheveux », sur les eaux historiques, des puissance riveraines pour la plupart modestes, une puissance qui s’affirme, le Vietnam, et parfois des gens qui ont « du culot », comme les Philippins, qui ont attrait la Chine devant la Cour permanente d’arbitrage établie par un traité, qui a reconnu sa compétence même si la Chine n’a pas accepté l’arbitrage.
Les Chinois sont pris entre deux feux : soit ils ne vont pas devant la Cour, ne reconnaissant pas sa compétence et ne peuvent pas se défendre, soit ils se défendent mais ils devront alors reconnaître sa compétence.
Il y a aussi des puissances qui ne se défendent pas, comme les États-Unis qui font périodiquement une note verbale très ferme suite à un acte des Chinois, mais cela ne va pas plus loin. Les Indiens ont parfois fait une acquisition radar sur un bâtiment chinois mais ça s’est arrêté là.
Il y a donc une affirmation très nette de la puissance chinoise, les Chinois n’hésitant pas à construire sur des îlots désert afin d’y revendiquer leur souveraineté.
Il se trouve qu’environ le tiers des marchandises mondiales passe par cette zone. Il faut se souvenir que le droit international est né le jour où les Portugais ont voulu empêcher les Néerlandais de passer par ces détroits. Ces derniers souhaitant les emprunter pour des raisons commerciales, on a alors affirmé le principe de libre navigation dans les détroits, qui s’applique maintenant partout sauf dans les Dardanelles, détroit qui fait l’objet d’un régime spécial et de limitations, et dans lequel les sous-marins ne peuvent pas passer puisque des filets y ont été installés.
Pour résumer, il y a beaucoup de litiges. Certains se posent entre gens de bonne compagnie comme entre l’Espagne et nous, ou avec l’Irlande et le Royaume-Uni, mais ce sont des discussions juridiques qui se concluront de façon pacifique. Il y a des endroits un peu plus tendus comme les passages du Nord, mais cet endroit est encore peu fréquenté et n’est pas aujourd’hui une réalité du commerce international.
La situation dans le détroit d’Ormuz peut devenir sérieuse, mais la situation vraiment problématique est celle de la mer de Chine méridionale. Vu d’ici, c’est une question anecdotique, mais si quelqu’un tirait par erreur sur un bateau chinois, même par erreur, cela pourrait dans le pire des cas provoquer une guerre.
M. Didier Quentin. Concernant la marine marchande, souvenons-nous que nous avions la deuxième du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais seulement la trente et unième aujourd’hui. Rendons hommage à M. Jean-Yves Le Drian qui avait réglé le problème des dockers.
Concernant Clipperton, si les Mexicains débarquaient 200 fusiliers marins, je ne suis pas sûr que nous aurions un équivalent français de Margaret Thatcher susceptible de réagir de la même façon. C’est pour cela que nous essayons de collaborer, par exemple avec l’Ile Maurice en signant des accords de cogestion de l’Île Tromelin, et peut-être aussi avec Madagascar.
Concernant les ports, le premier port du monde, en termes de conteneurs, est aujourd’hui celui de Singapour. Le Havre et Marseille sont à un ou deux millions d’équivalent vingt pieds, Singapour est à vingt ou vingt-cinq millions. Ce sont des chiffres vertigineux.
Je voudrais terminer par une anecdote. Quand La Pérouse a constitué ses bateaux pour l’expédition qui lui a été fatale, un concours a été organisé pour recruter les officiers et les hommes prenant place à bord. Parmi les candidats figurait un jeune officier brillant qui a réussi toutes les épreuves sauf l’astronomie, qui était une épreuve éliminatoire. Cet officier était Napoléon Bonaparte. L’expédition aurait-elle réussi s’il avait réussi l’épreuve ? Tout laisse en fait penser que le bateau a en fait disparu vers 1789 au large de la Nouvelle-Calédonie ou de l’Australie.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Vous avez su nous intéresser, et c’est un sujet majeur. Pour avoir vu des photos des installations aériennes construites par la Chine sur certaines îles, c’est effectivement préoccupant pour la sécurité du monde.
La commission autorise la publication du rapport d’information à l’unanimité.
ANNEXE N° 1 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS
1) À Paris
– M. Pierre Boussaroque, directeur-adjoint, direction des affaires juridiques, ministère des affaires étrangères, et M. Olivier Guyonvarch, sous-directeur du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles (14 avril 2015)
– M. Michel Aymeric, secrétaire général de la mer (5 mai 2015)
– M. Gérard Grignon, ancien député, membre du Conseil économique, social et environnemental, auteur d’un rapport sur l’extension du plateau continental, en 2013 (13 mai 2015)
– Mr Gilles Lericolais, directeur, direction des Affaires Européennes et Internationales de l’Ifremer, et M. Benoit Loubrieu, responsable technique et scientifique du programme Extraplac (20 mai 2015)
– Amiral Bernard Rogel, chef d’Etat major de la marine (3 juin 2015)
– Mme Valérie Niquet, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (17 juin 2015)
– M. Elie Jarmache, chargé de mission au Secrétariat général de la Mer, chef de la délégation française auprès de la commission des limites du plateau continental de l’ONU (1er juillet 2015)
– M. Nicolas Regaud, conseiller, direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) au ministère de la défense (1er juillet 2015)
– M. Bruno Frachon, directeur général du service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), accompagné de Mme Dominique Carval, spécialiste en matière de délimitations maritimes (8 septembre 2015)
– Mme Cécile Pozzo di Borgo, préfet des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), accompagnée de M. Cédric Marteau, directeur de la conservation du patrimoine naturel des TAAF (13 octobre 2015)
– Mme Rosa Delia Gomez Duran, conseillère, et M. Javier Ignacio Santander, secrétaire, à l’ambassade de la République d’Argentine en France (19 janvier 2016)
– S.E. M. Zhou Jian, représentant pour les affaires frontalières et maritimes du ministère des affaires étrangères de la République de Chine, chef d’une délégation accompagnée notamment de Mme Li Ping, conseillère politique à l’ambassade de Chine (26 janvier 2016)
– M. Serge Segura, ambassadeur chargé des océans (10 février 2016)
– M. Philippe Folliot, député du Tarn (8 mars 2016)
– M. Michel Aymeric, secrétaire général de la mer (27 avril 2016)
– Son Exc. M. Lawrence Cannon, ambassadeur du Canada en France, accompagné de M. Cyrille Sanchez, attaché politique à l’ambassade (25 mai 2016)
– M. Michel Rocard, ancien Premier ministre, ambassadeur chargé des négociations internationales pour les pôles arctique et antarctique (7 juin 2016)
2) A Bruxelles (mardi 15 septembre 2015)
– M. Alain Le Roy, secrétaire général Service Européen d'Action Extérieure (SEAE)
– M. Iain Shepherd, expert confirmé auprès de l’unité chargée de la politique maritime Atlantique, les régions ultrapériphériques et l’Arctique, direction générale des affaires maritime et de la pêche
– Mme Ana Gomes, députée européenne (PT), rapporteur, sous la précédente législature, sur la dimension maritime de la politique de sécurité et de défense commune
– S.E. M. Pierre Sellal, Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne
– S.E. M. Jean-Baptiste Mattei, Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l’OTAN
– Amiral Charles-Édouard de Coriolis, Représentant militaire permanent de la France auprès de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne
– M. Jacques Fuchs, unité ressources maritimes, direction générale de la recherche et de l'innovation
– Mme Ana Teresa Caetano, gestionnaire de programmes de recherche, ressources marines
3) A Londres (les 17 et 18 février 2016)
– S.E. Mme Sylvie Bermann, Ambassadeur de France au Royaume-Uni
– S.E. Mme Nicole Taillefer, Ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de l'Organisation maritime internationale
– M. Tim Abraham, Department of Energy and Climate Change
– M. Douglas Wilson, Deputy Head of Legal Directorate, and Lowri Mai Griffiths, Maritime Policy Unit, Foreign and Commonwealth Office, Legal Directorate
– M. Doug McLellan, Border Force Maritime Command
– Contre-amiral Patrick Chevallereau, attaché de défense au Royaume-Uni
– M. Ian Woodman, Director of Maritime, Department of Transport, ainsi que M. Paul McLeod, Department for Environment, Food and Rural Affairs
– M. Frederick J. Kenney, Director of Legal and External Affairs, International Maritime Organization
– Rear Admiral Nicholas Hine, Assistant Chief of the Naval Staff (ACNS), Ministry of Defence
1 () L’Amiral Hine a précédemment été entre 2012 et 2015 conseiller pour la politique de défense auprès du Trésor (Defence Policy Advisor to HM Treasury), ce qui a facilité le réengagement budgétaire en faveur de la Royal Navy.
© Assemblée nationale