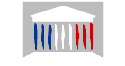
N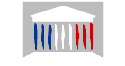
° 3903
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juin 2016
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 4 mars 2015 (1)
sur la crise ukrainienne et l’avenir des relations entre la Russie et l’Union européenne et la France
Président
M. Thierry MARIANI
Rapporteur
M. Jean-Pierre DUFAU
Députés
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information est composée de : M. Thierry MARIANI, président ; M. Jean-Pierre DUFAU, rapporteur ; Mmes Marie-Line REYNAUD et Odile SAUGUES, et MM. Jean-Luc BLEUNVEN, Philippe COCHET et Jean-Claude MIGNON
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 11
PREMIÈRE PARTIE : L’UKRAINE, LA DIFFICULTÉ DE SURMONTER UNE DOUBLE CRISE NATIONALE ET ÉCONOMIQUE 13
I. L’UKRAINE INDÉPENDANTE, UNE VIE POLITIQUE INSTABLE 13
A. UNE IDENTITÉ NATIONALE QUI RESTE EN DÉBAT 13
B. UNE VIE POLITIQUE POLARISÉE, INSTABLE ET PARFOIS VIOLENTE 15
C. LES LENDEMAINS DE LA RÉVOLUTION DE « MAÏDAN » : UNE LARGE MAJORITÉ EUROPÉENE, ATLANTISTE ET RÉFORMISTE 17
D. LE PRÉSENT : LE RETOUR DE L’INSTABILITÉ POLITIQUE 19
II. UN PAYS QUI AFFRONTE DEUX CRISES SÉVÈRES 21
A. LA CRISE NATIONALE 21
1. L’annexion illégale de la Crimée par la Russie 21
a. La situation particulière de la Crimée 21
b. Une annexion rondement menée 21
c. Une opération contraire au droit international 22
d. Une prise en main rapide par la Russie 23
e. Mais de très grandes difficultés économiques 23
2. Le Donbass : une situation qui apparaît largement bloquée 24
a. Le rejet du changement de pouvoir à Kiev par la population « agissante » du Donbass 24
b. Le conflit armé et l’implication de la Russie 25
c. Le processus de Minsk 26
d. L’actualité : une cessez-le feu qui n’est toujours pas acquis 28
e. Une situation humanitaire et économique toujours très difficile 29
f. Un processus politique pour le moment bloqué 31
3. La réaction de la nouvelle majorité : relance de l’intégration euro-atlantique et « combat pour les valeurs » 36
a. L’accord d’association 36
i. Les clauses politiques : un accord qui ne préjuge pas d’une adhésion future de l’Ukraine à l’Union européenne 37
ii. Les clauses économiques : vers une intégration à l’espace économique européen 38
b. Le souhait d’une libéralisation rapide des visas 39
c. La relance du rapprochement avec l’Alliance atlantique 40
B. LA CRISE ÉCONOMIQUE 41
1. Une économie déjà assez peu performante avant la crise actuelle 41
2. Les effets de la crise actuelle 43
a. Une récession massive en 2014 et 2015 43
b. La crise monétaire et financière 43
c. Des conséquences lourdes sur la situation des finances publiques 44
3. Un soutien financier international massif, mais conditionnel 45
4. Des échanges extérieurs de plus en plus tournés vers l’Union européenne 47
a. Le commerce entre l’Ukraine et l’Union européenne 48
b. Vers une guerre commerciale avec la Russie ? 49
c. La fin de la dépendance vis-à-vis du gaz russe ? 50
III. DE NOMBREUSES RÉFORMES, MAIS UNE MISE EN œUVRE DIFFICILE 53
A. LES RÉFORMES DÉMOCRATIQUES, AU CONFLUENT DES ENJEUX INTERNES ET INTERNATIONAUX 53
1. De nombreuses mesures adoptées ou en cours d’adoption 53
2. Mais une réforme constitutionnelle qui reste à parachever 54
a. Un volet « décentralisation » bloqué à cause de la question du Donbass 54
b. Un volet judiciaire en cours de finalisation 56
3. Un exécutif confronté à la corruption endémique, aux « oligarques » et aux groupes armés radicaux 56
4. Des risques de dérive du « combat pour les valeurs » et de l’affirmation nationale ? 57
B. DES RÉFORMES ÉCONOMIQUES SOUS LA DICTÉE DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 59
1. L’alignement sur « l’acquis communautaire » 59
2. Les mesures de rigueur budgétaire 59
3. Mais aussi des réformes qui patinent 60
DEUXIÈME PARTIE : LA RUSSIE, UN PARTENAIRE DIFFICILE MAIS INCONTOURNABLE 63
I. QUELS MOYENS POUR LA NOUVELLE AFFIRMATION INTERNATIONALE DE LA RUSSIE ? 63
A. DES FACTEURS DE PUISSANCE QUI RESTENT 63
1. Le territoire et, dans une moindre mesure, la population 63
2. Les reliquats de la superpuissance soviétique 64
a. Le statut international hérité de la victoire de 1945 64
b. La parité de l’armement nucléaire stratégique avec les États-Unis 65
3. Une puissance militaire restaurée 65
a. Une armée qui a retrouvé son efficacité 66
b. Une armée réformée et bénéficiant d’investissements massifs 67
c. L’importance des exportations d’armements 69
B. MAIS UNE ÉCONOMIE FRAGILISÉE 69
1. La récession, après la croissance forte des années 2000 69
2. L’héritage des années de croissance : des équilibres macro-économiques solides 70
3. Les facteurs des difficultés actuelles 71
a. Un facteur conjoncturel massif : la baisse des cours internationaux des hydrocarbures 71
b. Des difficultés accompagnées et accentuées par l’effondrement interne du crédit 71
c. Les effets réels mais difficiles à quantifier de la crise politique avec l’Occident et des sanctions et contre-sanctions 72
d. Les problèmes structurels récurrents de l’économie russe 73
4. Les conséquences des difficultés actuelles 76
a. Un appauvrissement du peuple russe 76
b. Une large perte de confiance dans la monnaie et l’économie russes, qui pèse sur les flux de financement 76
c. Une perte de « rang » parmi les puissances économiques 78
d. Un manque de confiance pour les années qui viennent 80
C. L’ÉNERGIE : UN FACTEUR DE PUISSANCE REMIS EN CAUSE ? 81
1. La Russie reste une superpuissance énergétique 81
a. Les hydrocarbures 81
b. Les autres sources d’énergie 81
c. Les autres ressources naturelles 82
2. Les hydrocarbures, facteur déterminant d’interdépendance avec l’Europe 82
a. La situation présente : une interdépendance écrasante 82
b. La difficile réduction de l’interdépendance entre l’Union européenne et la Russie 86
i. L’Union européenne engagée dans la transition énergétique 86
ii. La Russie à la recherche de débouchés à l’est 88
c. Un rapport de forces qui penche en faveur de l’Europe ? 90
D. LE SYSTÈME POLITIQUE : UN PRÉSIDENT QUI RESTE POPULAIRE 91
1. Une approbation massive de la politique du président russe, sur fond d’exaltation patriotique 91
2. Un système sous contrôle 94
a. Une législation sur mesure 94
b. Une opposition divisée et plus ou moins crédible 96
E. LE « SOFT POWER » RUSSE : UNE CAPACITÉ D’ATTRACTION QUI RESTE RELATIVE 99
1. La volonté de développer une contre-propagande face à ce qui serait un usage délibéré et hostile des politiques d’influence par les pays occidentaux 99
2. Un concept à géométrie variable : le « monde russe » 101
3. L’affirmation de « valeurs » différentes 101
4. L’église orthodoxe, vecteur d’influence ? 102
II. UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE TOURNÉE CONTRE LES ÉTATS-UNIS ET L’EUROPE ? 105
A. LE DÉBAT SUR LES RESSORTS DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ACTUELLE DE LA RUSSIE 105
1. Une réaction aux « agressions » des États-Unis et de l’Europe ? 105
a. Le « grand malentendu » 105
b. L’élargissement à l’est de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne, violation de promesses des dirigeants américains et européens ? 106
c. Les « révolutions de couleur » et l’exportation de la démocratie, complot occidental contre la Russie, voire contre la paix du monde ? 108
2. L’influence des courants de pensée conservateurs, voire réactionnaires 109
3. La constance des préoccupations sécuritaires 110
4. Le poids des facteurs internes 110
B. LE CONSTAT GÉNÉRAL : UNE DIPLOMATIE DE PUISSANCE ASSEZ CLASSIQUE 111
1. Une diplomatie souvent opportuniste et habile 111
2. Finalement, une conception « traditionnelle » des relations internationales : souveraineté, puissance, prédominance régionale 112
C. UNE CONFRONTATION CONTRÔLÉE AVEC LES ÉTATS-UNIS ET L’UNION EUROPÉENNE 113
1. Les sanctions économiques, instrument à double tranchant 114
a. Des sanctions adoptées en coordination par un « bloc occidental » 114
b. Les sanctions européennes, un dispositif gradué 114
i. Les mesures diplomatiques 114
ii. Les sanctions ciblées contre des personnes ou des entreprises 115
iii. Les sanctions générales prises en réaction à l’annexion illégale de la Crimée 115
iv. Les sanctions économiques générales 116
v. Les contre-sanctions russes 116
c. Un coût économique nécessairement partagé entre « sanctionneurs » et « sanctionné » 117
i. Les sanctions et contre-sanctions pèsent surtout sur la situation économique de la Russie 117
ii. Un coût des sanctions partagé entre les pays occidentaux 119
d. Les enjeux politiques des sanctions 122
i. Les termes du débat sur l’opportunité de sanctionner la Russie 122
ii. Une efficacité difficile à mesurer 123
iii. Le lien établi avec l’application des accords de Minsk : les sanctions restent-elles équitables dans le contexte actuel ? 126
2. Une politique russe plus constructive concernant le conflit du Donbass ? 126
3. La Syrie : une coopération inévitable avec les États-Unis, malgré les divergences 130
D. LA RECHERCHE DE NOUVELLES ALLIANCES ET SES LIMITES 131
1. Le voisinage : de la communauté postsoviétique à l’Union eurasiatique 131
a. De la Communauté des États indépendants à l’Union eurasiatique 132
i. Les diverses tentatives d’intégration de l’espace postsoviétique 132
ii. La marche vers l’Union eurasiatique 133
iii. Une construction manifestement inspirée de la construction européenne 133
b. Les limites de l’Union eurasiatique 134
i. Une construction purement économique et technocratique 134
ii. Un périmètre insuffisant pour être très efficace du point de vue économique 134
iii. Les conséquences de la trop forte prédominance russe dans l’Union eurasiatique 136
iv. La crise ukrainienne, révélatrice des limites de l’Union eurasiatique 137
v. Un processus qui marque l’abandon de toute idée de communauté « postsoviétique » ? 138
2. L’Asie comme alternative à l’Europe et aux États-Unis ? 142
a. L’Organisation de coopération de Shanghai, outil de coopération institutionnelle avec les pays asiatiques 143
b. L’organisation des BRICS, affirmation d’un monde multipolaire, mais aussi et surtout de la nouvelle puissance chinoise 143
c. Avec la Chine, un partenariat plus qu’une alliance 146
d. Le maintien de bonnes relations avec les rivaux asiatiques de la Chine 150
E. LE PROCHE-ET-MOYEN-ORIENT : LE GRAND RETOUR DE LA RUSSIE 152
1. L’intervention en Syrie, première intervention militaire extérieure de la Russie hors de l’ex-URSS 154
a. L’insistance sur la fidélité aux alliances, la légitimité et la légalité internationale, par opposition à l’exportation aventureuse de la démocratie 154
b. L’affirmation de la puissance russe et le retour dans le « grand jeu » international 155
c. Des intérêts nationaux à préserver 156
i. Les bases dans les « mers chaudes » 156
ii. La crainte de la contagion djihadiste en Russie et en Asie centrale 157
d. Quels objectifs tactiques ? 157
e. Les résultats indéniables d’une intervention limitée 159
f. Mais aussi une intervention qui a mis en lumière un certain isolement russe 160
2. L’Iran, allié mais aussi concurrent 160
3. Des efforts intenses en direction des pays arabes sunnites 162
a. Un allié traditionnel, l’Égypte 162
b. Des relations suivies avec les monarchies malgré les rivalités pétrolières et géopolitiques 162
4. La Turquie : d’un partenariat prometteur à la crise 163
5. Les Kurdes : des relations anciennes réactivées dans le contexte présent de crise avec la Turquie 165
TROISIÈME PARTIE : PLUS QUE JAMAIS, LA FRANCE DOIT AIDER AU RÉTABLISSEMENT D’UN PARTENARIAT EUROPÉEN AVEC LA RUSSIE 167
I. LE BLOCAGE DES RELATIONS RUSSO-EUROPÉENNES 167
A. POURTANT, DES COMPLÉMENTARITÉS ET DES INTÉRÊTS COMMUNS INDÉNIABLES 167
1. Une communauté d’intérêts sur le long terme 167
2. Un facteur de rapprochement à court-moyen terme, la priorité à la lutte contre le terrorisme islamiste 168
B. LA CRISE UKRAINIENNE : L’UNION EUROPÉENNE PEUT-ELLE JOUER UN RÔLE POSITIF ? 169
1. Avant la crise : les maladresses du Partenariat oriental 169
a. L’échec global de la Politique européenne de voisinage 169
b. Le Partenariat oriental, déclinaison de la Politique de voisinage à l’est 170
c. L’offre faite à l’Ukraine d’un accord d’association trop rigide 171
d. Une politique qui a irrité la Russie 172
2. La gestion de la crise : une action propre de l’Union qui tend à se résumer à la politique de sanctions, à l’aide financière à l’Ukraine et aux « bons offices » sur les questions gazières 172
3. Une opinion européenne profondément divisée 174
C. LES PROBLÈMES RÉCURRENTS 176
1. La question énergétique 176
2. La question des valeurs démocratiques 178
3. La libéralisation des visas 179
D. L’INCAPACITÉ À RELANCER UN PARTENARIAT 181
1. Un accord de partenariat qui n’est toujours pas renouvelé 181
a. Un accord de partenariat et de coopération arrivé à expiration 181
b. Un instrument au champ moins global, le Partenariat pour la modernisation 181
c. Des relations gelées dans le cadre des sanctions 182
2. La question récurrente de la reconnaissance de l’Union eurasiatique comme partenaire de négociation 182
E. CONCLUSION : UNE POSITION ACTUELLE DE L’UNION TRÈS RÉSERVÉE, L’« ENGAGEMENT SÉLECTIF » VIS-À-VIS DE LA RUSSIE 183
II. VALORISER LES BONNES RELATIONS DE LA FRANCE AVEC LES DEUX PAYS 185
A. LA FRANCE ET L’UKRAINE : UNE RELATION RANIMÉE PAR L’ENGAGEMENT RÉSOLU DE NOTRE PAYS DANS LA RÉSOLUTION DU CONFLIT DU DONBASS 185
1. Des relations politiques devenues très étroites 185
2. Une coopération militaire limitée par la position politique de la France 186
3. Des échanges économiques assez modestes 186
4. Les échanges humains 187
5. La présence culturelle 188
B. LA FRANCE ET LA RUSSIE : UNE AMITIÉ CONSERVÉE MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 188
1. Le maintien des relations politiques 188
2. Des échanges commerciaux en baisse du fait des difficultés économiques de la Russie et des sanctions 190
a. France et Russie sont l’une pour l’autre des partenaires commerciaux moyennement importants 190
b. Des exportations françaises diversifiées et souvent à fort contenu technologique 192
c. Des exportations russes dominées par les hydrocarbures 192
d. Des échanges commerciaux en forte diminution 193
i. Des échanges pratiquement divisés par deux en trois ans 193
ii. Quel impact de l’embargo agro-alimentaire russe ? 194
iii. Quel impact des autres sanctions ? 195
3. Une forte implantation des entreprises françaises en Russie 196
a. La France, premier investisseur étranger en flux en Russie depuis 2014 ? 196
b. Une présence française très diversifiée 198
c. Des banques françaises assez engagées vis-à-vis de la Russie 199
d. Des investissements russes en France encore limités 200
4. Les échanges humains 200
5. La présence culturelle 201
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 203
TRAVAUX DE LA COMMISSION 213
CONTRIBUTION PRÉSENTÉE PAR M. THIERRY MARIANI, PRÉSIDENT DE LA MISSION 233
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES PAR LA MISSION 237
Au tout début de l’année 2014, la commission des affaires étrangères avait déposé, suite aux travaux conjoints de Mme Chantal Guittet et de M. Thierry Mariani, un rapport d’information (1) sur le « partenariat avec la Russie » qui appelait la France à jouer un « rôle moteur » pour inciter l’Union européenne à améliorer ses relations avec ce grand pays. En effet, la conviction des co-rapporteurs était que l’Union européenne ne devrait pas laisser ses relations avec la Russie se figer, même si ses relations devenaient progressivement plus difficiles dans un contexte de « durcissement » graduel de la politique étrangère aussi bien que de la politique intérieure de l’exécutif russe.
Depuis lors, une série d’événements majeurs s’est déroulée : l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovytch a refusé de signer l’accord d’association que lui proposait l’Union européenne ; suite à cette décision, le peuple ukrainien l’a renversé, révolution qui a conduit à l’établissement de gouvernants réformistes et pro-européens à Kiev (et à la signature de l’accord d’association) ; la Russie a annexé brutalement la Crimée et soutenu massivement le mouvement séparatiste qui se développait dans la région du Donbass, entraînant un conflit qui a fait plus de 9 000 morts et n’est toujours pas achevé ; la Russie a par ailleurs engagé, en Syrie, sa première intervention militaire significative hors des frontières de l’ancienne URSS (depuis la fin de celle-ci).
Deux ans après la révolution de Maïdan, l’annexion de la Crimée par la Russie et le déclenchement du conflit du Donbass, la situation apparaît certes un peu apaisée, mais surtout largement bloquée.
En Ukraine, les espérances suscitées par la révolution de Maïdan se heurtent à la difficulté de sortir d’un quart de siècle de gestion publique défaillante, caractérisée par la corruption endémique, le pouvoir excessif acquis par les « oligarques » et la conflictualité de la vie politique. De plus, les événements ont plongé l’économie ukrainienne, qui était déjà assez peu performante auparavant, dans une crise économique et financière sans précédent ; sur les deux exercices 2014 et 2015 cumulés, la récession a atteint 16 %. Il faut espérer que l’installation en avril 2016 d’un nouveau gouvernement, après plusieurs mois de crise interne de la majorité arrivée au pouvoir en 2014, permettra la reprise des réformes qui sont absolument nécessaires pour le redressement du pays et pour son rapprochement des « standards » européens.
S’agissant du conflit du Donbass, l’implication personnelle des plus hauts responsables français et allemands et, derrière eux, des diplomaties des deux pays a permis, dans le cadre du « processus de Minsk », un apaisement fragile et relatif des combats, mais la solution politique reste à mettre en place, bien que des « feuilles de route » très claires décrivent la marche à suivre.
Enfin, les relations entre l’Union européenne et la Russie sont au point mort. La politique actuelle de l’Union, en tant que telle, vis-à-vis de la Russie ne se limite certes pas aux sanctions politiques et économiques prises contre ce pays suite à son action en Crimée et dans le Donbass, mais le fait est que ces sanctions, plus petit dénominateur commun trouvé entre les États membres de l’Union, dominent complétement cette politique. Elle apparaît donc comme essentiellement « négative », quand, individuellement, certains États membres européens, dont la France, donnent une image plus « positive », par exemple en s’entremettant dans le conflit du Donbass. Inévitablement, la prolongation des sanctions et contre-sanctions, sans qu’elles ne débouchent sur des résultats politiques concrets et alors qu’elles entraînent (par définition) des coûts économiques, conduit les opinions publiques européennes, très divisées, à les remettre en cause.
Le moins que l’on puisse dire est donc que les sujets d’irritation mutuelle entre l’Union européenne et la Russie se sont multipliés. Et pourtant, auditionné le 26 avril 2016 par la commission des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères Jean-Marc Ayrault n’a pu que réaffirmer cette réalité : « la Russie est un partenaire de la France. Il n’est, selon nous, pas possible de considérer autrement ce grand pays, cette grande nation, qui veut jouer son rôle sur la scène internationale (…) ». Comment, en effet, la France et plus généralement l’Union européenne pourraient-elles ignorer le pays le plus vaste et le plus peuplé du continent européen, pourvoyeur en outre d’une part considérable de l’énergie fossile qu’elles utilisent ?
La France a pu conserver des relations politiques de bon niveau avec la Russie, du fait notamment de son implication dans la résolution du conflit du Donbass (et malgré la suspension de certains formats habituels de concertation dans le cadre des sanctions européennes). La qualité de ces relations est attestée par la solution amiable et raisonnable qui a été trouvée pour dénouer le contrat de vente des deux navires de guerre Mistral, lequel ne pouvait pas être exécuté dans le contexte présent. En revanche, la politique des sanctions et contre-sanctions et surtout les difficultés économiques que connaît la Russie suite à la baisse des cours des hydrocarbures ont entraîné une forte baisse des échanges humains et économiques. De 2012 à 2015, les échanges commerciaux bilatéraux ont pratiquement été divisés par deux. Pour autant, les entreprises françaises, très implantées en Russie, n’ont pas, pour le moment, désinvesti massivement de ce pays.
Il y a donc des enjeux considérables et, sans doute, des opportunités pour notre pays pour faciliter la pacification des relations Union européenne-Russie et la recherche d’un nouveau partenariat. C’est du moins dans cet esprit que s’inscrit le présent rapport d’information : comment, sans rompre la solidarité européenne ni renoncer au soutien au mouvement démocratique ukrainien, contribuer à ce nouveau partenariat ?
PREMIÈRE PARTIE : L’UKRAINE, LA DIFFICULTÉ DE SURMONTER UNE DOUBLE CRISE NATIONALE ET ÉCONOMIQUE
Votre rapporteur salue naturellement le mouvement démocratique qui s’est concrétisé en février 2014 par la révolution de « Maïdan ». Mais force est de constater que l’euphorie consécutive à cet événement a depuis lors cédé la place à un certain désabusement, tant dans les pays européens que dans l’opinion publique ukrainienne. Le pays est, il est vrai, confronté à de très grandes difficultés, non seulement parce qu’il a perdu le contrôle d’une partie de son territoire (Crimée et régions séparatistes du Donbass), mais aussi parce qu’il subit une très grave crise économique, son PIB s’étant contracté de 16 % en deux ans (2014-2015). Dans un tel contexte, il n’est sans doute pas très surprenant que la nouvelle majorité pro-européenne et porteuse de réformes démocratiques ait du mal à conserver son unité et, a fortiori, à conduire à terme son programme réformiste. Mais, dans ce contexte de fragilisation politique, l’insuffisance des progrès dans des domaines aussi essentiels que, par exemple, la lutte contre la corruption est aujourd’hui inquiétante, car c’est l’avenir du pays qui est en jeu.
I. L’UKRAINE INDÉPENDANTE, UNE VIE POLITIQUE INSTABLE
L’Ukraine, vaste pays d’une taille assez comparable à celle de la France – officiellement 45 millions d’habitants sur 603 000 km2 dans les frontières internationalement reconnues, donc Crimée incluse –, est revenue à l’indépendance en 1991, à la fin de l’URSS. Sa vie politique est pluraliste et démocratique, mais a aussi été jusqu’à présent caractérisée par l’instabilité et parfois une certaine violence, le tout sur fond de corruption et de truquage présumé des élections. Depuis les années 2000, elle est fortement polarisée entre les partisans du rapprochement avec l’Union européenne (et le monde occidental plus généralement) et ceux du maintien des liens historiques avec la Russie. Les résultats électoraux étant souvent contestés, les alternances entre les camps ont souvent eu lieu dans un climat « révolutionnaire » et été accompagnées de violences.
A. UNE IDENTITÉ NATIONALE QUI RESTE EN DÉBAT
Cette polarisation de la vie politique oblige au préalable à évoquer la question de l’identité de l’Ukraine.
Le caractère paradoxal de l’identité ukrainienne est bien résumé par une formule du professeur Daniel Beauvois, qui rappelle que « l’Ukraine est sans doute le seul pays du monde dont le nom même traduit une ambiguïté, qui érige sa marginalité en identité. Elle semble avoir intériorisé les interventions de ses voisins à un point tel qu’elle se dit U-kraïna, c’est à dire le pays de la marge, des confins » (2).
Après avoir été le siège au Haut Moyen-Âge (Xème-XIIème siècles) du premier État « russe », dit la « Rous », à Kiev, l’Ukraine, qui n’était plus un État souverain, a longtemps été tiraillée entre les influences polonaise, à l’ouest, et russe, à l’est. Dans sa partie occidentale, des régions comme celle de Lviv et l’Ukraine subcarpathique n’ont jamais été rattachées à l’empire des tsars et n’ont rejoint l’URSS (donc l’Ukraine soviétique) qu’en 1945, après avoir été polonaises et/ou austro-hongroises. Au centre, Kiev a été annexée par la Russie en 1686 et cette région était appelée « Petite Russie » dans l’empire des tsars. Quant à l’Ukraine du sud et du sud-est, y compris la Crimée, elle a été colonisée à partir de la fin du XVIIIème siècle par la Russie, après que celle-ci eut conquis le khanat tatar de Crimée, qui était vassal de l’empire Ottoman : elle est alors devenue la « Nouvelle Russie ». C’est dans ce contexte qu’aujourd’hui encore les nationalistes russes, inscrits dans la vision traditionnelle d’un empire multiculturel, ou du moins « panslave », ont quelque difficulté à admettre que l’Ukraine coupe les ponts avec la Russie.
L’identité de l’Ukraine moderne s’est largement fondée sur la conscience de parler une langue spécifique, distincte du russe, qui a conduit au XIXème siècle à un nationalisme dont les revendications ont d’abord été identitaires : la définition et la promotion d’une langue littéraire ukrainienne. Cependant, autre contradiction, dans l’Ukraine actuelle, qui reprend les frontières de la république soviétique d’Ukraine, la langue ukrainienne ne s’impose pas partout : elle domine à l’ouest, mais la part des personnes qui déclaraient lors du recensement de 2001 le russe comme langue maternelle atteignait 77 % en Crimée et plus de 90 % à Sébastopol, 75 % dans la région de Donetsk, 69 % dans celle de Louhansk, entre 25 % et 48 % dans les autres régions du sud et du sud-est ukrainien, et encore 25 % à Kiev (voir la carte ci-après).
De plus, d’après une étude de 2003, si l’on regarde non la langue maternelle, mais la langue principalement utilisée, c’est alors plus de 90 % des habitants du Donbass et près de 85 % de ceux des régions du sud de l’Ukraine qui privilégiaient le russe. Juste après l’indépendance, en 1992, l’ukrainien était parlé dans 37 % des ménages en Ukraine, le russe par 29 % et 32 % des Ukrainiens déclaraient utiliser l’une ou l’autre langue selon les circonstances (3). Depuis, l’ukrainien a progressé du fait d’une politique active de promotion, notamment dans le système scolaire, laquelle a d’ailleurs contribué au mécontentement des populations des régions majoritairement russophones ; mais il n’en reste pas moins que de nombreux Ukrainiens soit restent russophones, soit parlent couramment les deux langues, passant de l’une à l’autre, voire les mélangeant dans un parler intermédiaire appelé « sourjik ».
Les russophones (langue maternelle) en Ukraine
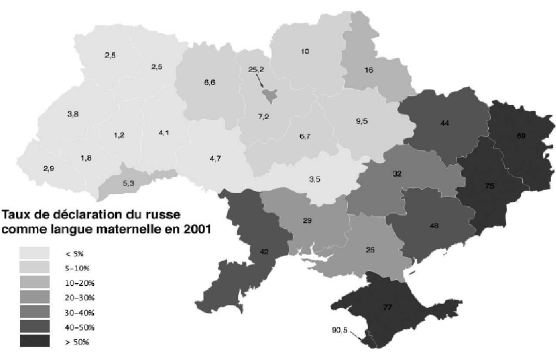
Source : Denis Stoumen, « Les populations russophones d’Ukraine : une minorité linguistique ? », in « Gestion des minorités linguistiques dans l’Europe du XXIème siècle », aux éditions Lambert Lucas.
B. UNE VIE POLITIQUE POLARISÉE, INSTABLE ET PARFOIS VIOLENTE
La carte électorale de l’Ukraine a longtemps fait apparaître une césure traversant le pays du nord-est au sud-ouest, fortement corrélée à la carte de la russophonie, comme on peut le constater en comparant la carte présentée supra avec celle du vote pour M. Viktor Ianoukovytch en 2010 ci-après.
Le vote pour M. Viktor Ianoukovytch en 2010
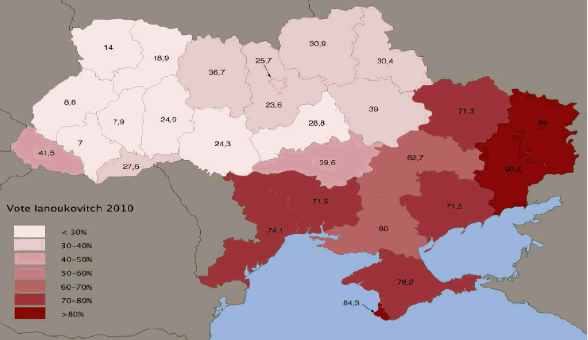
Même source que la carte précédente.
Les partis et candidats les plus « pro-occidentaux » dominaient à l’ouest et au nord d’une ligne (sous des appellations évolutives : Roukh, Parti démocrate d’Ukraine, Notre Ukraine…), tandis qu’à l’est et au sud l’emportaient les « pro-russes » ou nostalgiques de l’URSS (Parti communiste d'Ukraine, Parti socialiste, Parti des régions…).
À cette première particularité de la scène politique ukrainienne est venu se superposer le jeu des oligarques. Les partis politiques ont en effet été dominés, dès le début, par une puissante oligarchie née sur les décombres de l’URSS et organisée en plusieurs clans politico-régionaux.
Troisième particularité, la grande volatilité des groupes politiques a toujours rendu difficile la formation de majorités stables. Au fil des scissions et des recompositions, la plupart des partis initiaux ont disparu et la fluidité des affiliations partisanes continue à caractériser la classe politique ukrainienne.
Enfin, les alternances politiques se sont généralement passées dans un climat violent, voire révolutionnaire, sur fond de contestation de résultats électoraux souvent dénoncés comme frauduleux.
Après une décennie de présidence de M. Leonid Koutchma, marquée par un certain souci d’équilibre entre le rapprochement avec l’Occident et la Russie, le scrutin présidentiel de 2004, opposant MM. Viktor Ioutchenko et Viktor Ianoukovytch, a ainsi débouché sur la « révolution orange », où la rue a contesté victorieusement la victoire électorale revendiquée par le second.
Finalement élu, le président Ioutchenko a promu en politique intérieure une construction nationale et identitaire basée sur la reconstitution du passé ukrainien et le développement de la langue ukrainienne, et en politique étrangère un rapprochement avec l’OTAN et l’Union européenne. Cependant, les divisions du camp « orange » au pouvoir ont paralysé cette présidence et M. Viktor Ianoukovytch, candidat du Parti des régions, implanté dans l’est du pays, a pris sa revanche en remportant l’élection présidentielle de 2010.
La présidence de M. Ianoukovytch a à son tour été marquée par des dérives : irrégularités électorales, présidentialisation du régime, pressions sur les médias, corruption endémique, « justice sélective » visant les adversaires politiques comme Mme Ioulia Tymochenko ou M. Iouri Loutsenko.
Dans le même temps, dans le cadre du Partenariat oriental, la négociation d’un accord d’association avec l’Union européenne avait été engagée, le président Ianoukovytch croyant habile de louvoyer entre l’Union et la Russie pour tirer le meilleur parti de cette mise en concurrence. Mais la dégradation de la situation politique en Ukraine a conduit l’Union européenne, dès fin 2011, à conditionner la signature définitive de l’accord d’association, paraphé le 30 mars 2012, à une amélioration du système électoral, à la fin de la « justice sélective » et à la poursuite des réformes de gouvernance, ce qui a fait durer les négociations. Finalement, la décision prise par le président Ianoukovytch, fin novembre 2013, à quelques jours du sommet du Partenariat oriental à Vilnius, de ne pas signer l’accord d’association a été à l’origine de la nouvelle révolution qui l’a emporté :
– cette décision a déclenché dans le pays des manifestations de masse, en particulier à Kiev, qui ont conduit à l’occupation de la place Maïdan ;
– le pouvoir a vainement tenté de reprendre la main par la force en janvier 2014 avec l’adoption de lois « liberticides » et l’usage des armes à feu par la police pour la première fois le 22 janvier, causant douze morts – au total, les événements de janvier-février 2014 auraient fait, selon un décompte du Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, au moins 117 tués et 2 295 blessés ;
– dans une situation de plus en plus incontrôlable, il faut saluer la médiation des ministres des affaires étrangères français, allemand et polonais, qui a permis le 21 février 2014 la signature d’un accord de sortie de crise entre le président et l’opposition, prévoyant la formation d’un gouvernement d’union nationale, une réforme constitutionnelle et ensuite une nouvelle élection présidentielle ;
– finalement, comme souvent dans les périodes révolutionnaires, cet accord n’a pas été appliqué, le parlement ukrainien – la Rada – ayant dès le 22 février démis le président Ianoukovytch, qui a ensuite pris la fuite.
C. LES LENDEMAINS DE LA RÉVOLUTION DE « MAÏDAN » : UNE LARGE MAJORITÉ EUROPÉENE, ATLANTISTE ET RÉFORMISTE
Après une période de transition assez courte, le processus démocratique a permis de mettre en place de nouveaux gouvernants dotés, au moins dans un premier temps, d’une solide assise électorale, ce qui n’allait pas de soi vu les traditions de division de la classe politique ukrainienne et sa mauvaise réputation.
Le 25 mai 2014, l’industriel Petro Porochenko, réputé pour ses compétences d’homme d’affaires et ses positions modérées (il avait été ministre du président Ioutchenko comme du président Ianoukovytch), a été élu président d’Ukraine, avec 54,7 % des voix, dès le premier tour de l’élection présidentielle anticipée qui l’opposait notamment à Mme Ioulia Tymochenko et à M. Oleh Liachko.
Les élections législatives anticipées du 26 octobre 2014 ont permis l’élection de 423 députés pour 450 sièges à pourvoir, 27 sièges étant laissés vacants car correspondant aux territoires non contrôlés de Crimée et du Donbass. Ce scrutin a entraîné une profonde recomposition du paysage politique, même si le changement des étiquettes politiques ne doit pas cacher une certaine continuité des hommes, puisque près de 180 députés sortants ont été réélus.
Mais le fait est que le vote a permis de dégager, dans un premier temps, une forte majorité parlementaire pro-européenne : cinq partis pro-européens, qui ont obtenu ensemble plus des deux tiers des voix, détenaient une large majorité d’environ 300 députés et ont pu alors former une coalition gouvernementale :
– le Bloc Petro Porochenko, naturellement proche du Président (145 députés) ;
– le Front populaire de M. Arseni Iatseniouk (82 députés), issu de la scission en 2014 du parti Batkivchtchyna de Mme Ioulia Tymochenko ;
– le parti Samopomitch (« Auto-assistance »), implanté en particulier dans l’ouest du pays (Lviv) et affichant des valeurs proches de la démocratie chrétienne (30 députés) ;
– le Parti radical d’Oleh Liachko, populiste mais pro-européen (21 sièges) ;
– le parti Batkivchtchyna (19 sièges).
Cette majorité était donc composite, regroupant des populistes et des modérés, des représentants de l’oligarchie traditionnelle et des réformateurs issus de la société civile, sans oublier 19 députés anciens combattants revenus du front du Donbass.
L’opposition parlementaire, constituée des anciens partisans de M. Viktor Ianoukovytch, a formé le Bloc d’opposition, avec 42 sièges et de solides positions dans les régions russophones de l’est et du sud du pays (à Kharkiv, 13 des 14 députés élus de la région, à Odessa, 8 des 11 députés…).
Il est à noter que les partis ultra-nationalistes Svoboda et Pravy Sektor, n’ayant pas atteint les 5 % des suffrages, n’ont pas eu d’élus à la proportionnelle (mais en ont conservé quelques-uns élus au scrutin majoritaire, le système électoral étant mixte). Pour la première fois depuis l’indépendance et pour la même raison, le Parti communiste est également absent de la Rada.
L’accord de coalition acté le 21 novembre 2014 plaçait au premier plan la défense de la souveraineté ukrainienne, qui devrait selon ce texte passer par une intégration à l’OTAN, et le renforcement de la capacité de défense du pays, reprenait l’engagement de poursuivre les réformes pour mettre l’Ukraine aux standards européens (en vue de pouvoir présenter une candidature à l’adhésion à l’horizon 2020) et donnait également la priorité au renforcement de l’État de droit.
M. Arseni Iatseniouk, leader du second parti de la majorité, le Front populaire, est devenu premier ministre.
Déclenchée par un choix politique lié à l’intégration européenne – celui du président Ianoukovytch de ne finalement pas signer l’accord d’association –, même si ses fondements se trouvent sans doute d’abord dans l’échec précédent de la classe politique ukrainienne à unifier et gouverner efficacement (et honnêtement) le pays, la révolution de Maïdan a donc conduit à lier intimement, dans le programme de la nouvelle majorité, intégration européenne et réformes : ces dernières correspondent à un agenda démocratique interne, mais visent aussi à se mettre aux standards européens ; du point de vue des gouvernants actuels de l’Ukraine, les deux points ne sont pas dissociables.
D. LE PRÉSENT : LE RETOUR DE L’INSTABILITÉ POLITIQUE
Cependant, dans le contexte présent de très grandes difficultés politiques, militaires, économiques et sociales, la majorité issue des élections d’octobre 2014 s’est progressivement délitée, ce qui a conduit à une crise ouverte en ce début d’année 2016.
Dans le même temps, la popularité de l’exécutif ukrainien s’est rapidement dégradée : selon un sondage publié en juin 2015 (4), 62 % des Ukrainiens désapprouvaient alors la gestion économique du président Petro Porochenko, contre 22 % qui l’approuvaient ; pour la gestion des questions liées à la corruption, ces taux étaient respectivement de 61 % et 27 % ; la politique du président était également désapprouvée par la grande majorité des sondés en ce qui concerne les relations avec la Russie et la gestion du conflit du Donbass. Il n’y a que concernant les relations avec l’Union européenne qu’une majorité d’entre eux se déclaraient satisfaits.
Deux phénomènes se sont progressivement amplifiés :
– une cohabitation de plus en plus conflictuelle entre le président Petro Porochenko et le premier ministre Arseni Iatseniouk ;
– un éclatement de la majorité parlementaire, trois des cinq partis de la coalition, Samopomitch, Batkivchtchyna et le Parti radical, se mettant à contester de plus en plus ouvertement des orientations majeures de l’exécutif (notamment concernant la résolution de la crise du Donbass par les « accords de Minsk » et la réforme constitutionnelle qu’ils prévoient – voir infra).
Cela s’est traduit par le rejet du volet « décentralisation » de la réforme constitutionnelle le 31 août 2015 à la Rada par la plupart des députés de ces formations, puis par le départ du Parti radical de la coalition gouvernementale, qui ne comptait dès lors plus que 273 élus. Ce vote sur la révision constitutionnelle s’est également accompagné d’affrontements de rue qui ont montré la puissance des groupes nationalistes radicaux.
Ensuite, les élections locales d’octobre 2015 se sont globalement déroulées dans le calme et conformément aux standards internationaux. Mais, malgré la présentation de listes communes par les partisans du président Petro Porochenko, du premier ministre Arseni Iatseniouk et du maire de Kiev Vitali Klitschko, la majorité au pouvoir a obtenu des résultats mitigés. Des partis plus ou moins extrémistes, comme Svoboda, ont obtenu des scores assez élevés. Par ailleurs, la permanence du pouvoir des oligarques locaux s’est manifestée à travers les résultats de nouveaux partis à assise souvent régionale, qui accroissaient la dispersion des voix ; il en est ainsi, par exemple, du parti UKROP (Union des patriotes d'Ukraine), sponsorisé par M. Ihor Kolomoïsky, ancien gouverneur de Dnipropetrovsk.
L’affaiblissement de l’exécutif ukrainien s’est poursuivi en ce début d’année 2016, avec la renonciation à faire voter en lecture définitive la révision constitutionnelle prévue dans le cadre du « processus de Minsk » (voir infra), puis, le 3 février, la démission du ministre de l’économie, M. Aivaras Abromavicius, d’origine lituanienne, pour protester contre la corruption ambiante (et plus précisément les pressions de proches du président Petro Porochenko pour placer leurs alliés à la tête d’entreprises). Ce départ avait été précédé en octobre 2015 par celui de plusieurs hauts fonctionnaires d’origine étrangère recrutés pour mettre de l’ordre dans l’administration et déçus par les blocages rencontrés.
Enfin, la crise entre les deux têtes de l’exécutif est devenue ouverte le 16 février 2016, quand le président Petro Porochenko est intervenu à la Rada pour demander la démission du premier ministre (ainsi que du procureur général, lequel s’est exécuté). Certes, la motion de censure déposée dans la foulée contre le gouvernement n’a pas été adoptée (elle n’a recueilli que 194 voix quand 226 étaient requises), du fait de l’absence ou de l’abstention de nombreux députés du propre parti du Président (!), ainsi que de ceux du Bloc d’opposition et d’autres groupes liés à certains « oligarques ». Mais le départ de la coalition gouvernementale, dans les jours qui ont suivi, des partis Batkivchtchyna et Samopomitch a virtuellement mis fin à celle-ci en la privant de majorité parlementaire (le Président et le Premier ministre ne disposant plus que de 217 élus, quand la majorité est à 226).
Après deux mois de crise parlementaire, un nouveau gouvernement a été investi le 14 avril 2016. Il est dirigé par M. Volodymyr Hroïsman, précédemment président de la Rada (et considéré comme proche du président Porochenko), et soutenu par une coalition fragile, constituée principalement du Bloc Petro Porochenko et du Front populaire, auxquels se sont ajoutées de petites formations (« Renaissance » et « Volonté du peuple ») nécessaires pour atteindre une étroite majorité de 227 députés sur 450. Certains députés des deux grands partis de la coalition se sont refusés à soutenir le nouveau gouvernement, qui a cependant annoncé un ambitieux programme de réformes destinées à renforcer la lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique.
II. UN PAYS QUI AFFRONTE DEUX CRISES SÉVÈRES
Outre la crise parlementaire, qui n’en est en quelque sorte que la conséquence, l’Ukraine affronte aujourd’hui deux crises très graves, une crise nationale, avec la perte de contrôle du gouvernement central sur la Crimée et une partie de la région du Donbass, et une crise économique et financière.
1. L’annexion illégale de la Crimée par la Russie
a. La situation particulière de la Crimée
La Crimée possède dans l’espace ukrainien plusieurs caractéristiques qui la désignaient en quelque sorte au destin qui est le sien actuellement, sans naturellement que cela ne justifie en quoi que ce soit le coup de force contraire au droit international qui y a été opéré :
– étant une péninsule (d’une superficie de 27 000 km2), c’est la région dont l’identité géographique est la plus marquée, avec une frontière naturelle évidente ;
– c’est aussi la région la plus fortement russophone du pays, avec 77 % de personnes dont le russe est la langue maternelle (en 2001), et même plus de 90 % à Sébastopol. En 2001, les « Russes ethniques » (personnes généralement dotées de la citoyenneté ukrainienne, mais se déclarant d’origine nationale russe au recensement) représentaient 58 % de la population, devançant les « Ukrainiens ethniques » (24 %) et les Tatars de Crimée (12 %) ;
– Sébastopol est le siège historique de la flotte russe de la mer Noire (et l’était resté dans l’Ukraine indépendante) ;
– du temps de l’URSS, elle n’a été rattachée à l’Ukraine qu’en 1954, après avoir dépendu de la république soviétique de Russie.
b. Une annexion rondement menée
Juste après la révolution de Maïdan (dès la nuit du 26 au 27 février 2014), dans le cadre d’une opération ensuite publiquement assumée par le président Vladimir Poutine, des hommes armés cagoulés, en uniformes militaires mais sans insignes, se sont emparés du siège du parlement et du gouvernement locaux à Simféropol. Les choses sont ensuite allées très vite :
– le 1er mars 2014, la Douma russe a autorisé le président Vladimir Poutine à recourir « aux forces armées russes sur le territoire de l’Ukraine » ;
– le 16 mars, un referendum local a entériné la victoire présentée comme écrasante – mais invérifiable – de la demande de rattachement à la Russie ;
– le traité rattachant la Crimée et la ville de Sébastopol à la Russie a été signé le 18 mars à Moscou et, le 20 mars, un décret présidentiel russe a reconnu les deux entités comme « sujets » de la Fédération de Russie.
c. Une opération contraire au droit international
En annexant la Crimée, la Russie a non seulement violé les principes fondamentaux du droit international, mais aussi ses engagements particuliers pris vis-à-vis de l’Ukraine au titre de la non-prolifération nucléaire
Cette annexion va à l’encontre d’engagements internationaux fondamentaux, donc des principes du droit international, posés dans des textes fondateurs. On doit ainsi rappeler que, selon le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations-Unies, « les membres de l’organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
De même, selon l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, dite conférence d’Helsinki, en 1975, « les États participants [l’ensemble des États européens, URSS incluse, les États-Unis et le Canada] respectent mutuellement leur égalité souveraine et leur individualité ainsi que tous les droits inhérents à leur souveraineté et englobés dans celle-ci, y compris, en particulier, le droit de chaque État à l’égalité juridique, à l’intégrité territoriale, à la liberté et à l’indépendance politique (…). Ils considèrent que leurs frontières peuvent être modifiées, conformément au droit international, par des moyens pacifiques et par voie d’accord ». Les frontières ne sont donc pas nécessairement intangibles, mais leur éventuelle modification doit être négociée.
Les actions de la Russie portent aussi atteinte à la crédibilité du dispositif international de non-prolifération nucléaire. Lorsqu’un État, dans ce cadre, accepte de renoncer à l’arme nucléaire, il est légitime qu’il demande des garanties de sécurité et la crédibilité de ces garanties est essentielle. Or, l’Ukraine nouvellement indépendante, détenant sur son territoire d’importants stocks d’armes nucléaires ex-soviétiques, a souhaité obtenir de telles garanties quand elle a décidé de s’en défaire et d’adhérer au Traité de non-prolifération (TNP). Un « mémorandum sur les assurance de sécurité en lien avec l’accession de l’Ukraine au traité de non-prolifération des armes nucléaires » fut donc signé à Budapest, le 5 décembre 1994, dans lequel les trois « parrains » du TNP, États-Unis, Grande-Bretagne et Russie (5) (en tant qu’État successeur de l’URSS), réaffirmaient leur engagement à respecter l’indépendance, la souveraineté et les frontières existantes de l’Ukraine, à s’abstenir de la menace ou de l’usage de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de ce pays, de même que de toute coercition économique. Cette formulation n’est évidemment pas présente par hasard dans ce texte, car à l’époque il existait en Crimée un puissant mouvement autonomiste pro-russe.
d. Une prise en main rapide par la Russie
La prise en main par la Russie a ensuite été rapide. Si 18 000 à 20 000 des 2 millions d’habitants de la Crimée l’ont quittée dans les jours suivant l’annexion, tous les autres habitants résidant régulièrement dans la péninsule sont devenus citoyens russes sauf si, dans un délai d’un mois, ils avaient déposé une déclaration formelle dans laquelle ils déclaraient refuser la nationalité russe. Il semble qu’au moins 98 % des habitants de la Crimée se soient vus délivrer un passeport russe. Seules 3 500 personnes auraient refusé formellement la nationalité russe tout en restant sur place.
L’élite politique locale s’est rapidement reconvertie, passant en masse des partis ukrainiens au parti majoritaire en Russie, le parti Russie unie. Les médias ont également été pris en main et une loi de circonstance punit désormais de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison les critiques de l’appartenance de la Crimée à la Russie dans les médias audiovisuels.
Les principales résistances viennent de la communauté des Tatars de Crimée, dont plusieurs militants ont été l’objet d’enlèvements illégaux. Le 10ème rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, publié début juin 2015 par le Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, dresse un tableau inquiétant de la situation en Crimée : obligations nouvelles d’enregistrement des médias et des groupes religieux, de sorte de les contrôler ; limitation des droits des personnes qui refusent de prendre la nationalité russe ; persécutions contre les opposants et les médias indépendants. Le 26 avril 2016, la « cour suprême » de Crimée a mis hors-la-loi la représentation traditionnelle des Tatars de Crimée, le Mejlis, pour « extrémisme », sur des bases qui semblent très discutables : selon ce qu’ont indiqué des représentants d’ONG aux membres de la mission qui se sont rendus à Moscou fin mars 2016, le parquet russe avait assimilé l’objet par nature identitaire de cette organisation à une sorte d’incitation à la discrimination ou à la haine raciale.
e. Mais de très grandes difficultés économiques
Pour une partie de la population, celle qui bénéficie de salaires ou d’allocations dépendant du budget national (fonctionnaires, retraités…), l’annexion a entraîné un effet d’aubaine, car les montants de ces prestations ont été alignés sur le niveau en vigueur en Russie, bien plus élevé qu’en Ukraine.
Cependant, les perspectives économiques de la région sont défavorables :
● Avant l’annexion, l’activité touristique, essentielle pour l’économie locale, reposait à 70 % sur les touristes venus du reste de l’Ukraine, désormais disparus, de sorte que l’on est passé de 6 millions de touristes annuels auparavant à 2,3 millions durant l’été 2014.
● Par ailleurs, compte tenu des difficultés économiques de la Russie, le budget fédéral russe aura du mal à honorer les annonces faites en matière d’investissements publics (notamment la construction d’un pont traversant le détroit de Kertch, essentielle pour relier matériellement la Crimée à la Russie), tandis que les sanctions occidentales dissuadent les investisseurs privés, même russes. Dans ce contexte, il n’est pas certain que la promulgation en juillet 2014 d’une loi fédérale russe autorisant la Crimée à développer des activités de jeux d’argent (réservées en Russie comme en France à certains territoires) ait les effets de relance attendus.
● Surtout, la Crimée subit durement les conséquences de la rupture de ses approvisionnements traditionnels, qui provenaient essentiellement de l’Ukraine. Mme Emmanuelle Armandon rappelle ainsi que de l’ordre de 85 % de l’eau utilisée en Crimée, ou de l’électricité, provenaient avant l’annexion du reste de l’Ukraine, ainsi qu’environ 80 % des produits alimentaires (6). L’adoption, tant du côté ukrainien que russe, de mesures restrictives entraîne des problèmes d’approvisionnement, qui auraient notamment causé une forte inflation (Mme Armandon cite des taux compris entre 20 % et 50 % pour les coûts des transports, de l’électricité et de divers produits alimentaires). Les problèmes ont été aggravés par le « blocus civil » de la ligne de démarcation entre l’Ukraine et la Crimée par des activistes issus de la communauté tatare et des groupes nationalistes ukrainiens à partir du 20 septembre 2015, puis par le sabotage des lignes électriques alimentant la Crimée depuis l’Ukraine dans la nuit du 21 au 22 novembre 2015. Enfin, le gouvernement ukrainien a décidé à compter du 15 janvier 2016 un blocus commercial quasi-total de la péninsule.
Un article publié dans la presse russe (7) fait état de la situation très difficile de la plupart des grandes entreprises de Crimée, qui seraient menacées de faillite du fait de la perte de leurs approvisionnements et débouchés traditionnels, de l’effondrement de l’activité portuaire compte tenu de l’interdiction faite aux navires européens d’y faire escale, de la disparition des clients étrangers pour les entreprises de transport aérien ou maritime et de l’exclusion des banques locales des systèmes de paiements internationaux.
2. Le Donbass : une situation qui apparaît largement bloquée
Les événements survenus dans le Donbass, vaste bassin minier et industriel très urbanisé, sont d’une nature très différente de ceux de Crimée.
a. Le rejet du changement de pouvoir à Kiev par la population « agissante » du Donbass
Dans un premier temps, ces événements ont pris la forme d’une contestation populaire non organisée du changement de pouvoir à Kiev fin février 2014 : il faut rappeler qu’en 2010, le Donbass avait voté à 90 % pour le président Ianoukovytch. Dès le 1er mars 2014, des milliers de personnes ont manifesté à Donetsk pour rejeter la légitimité des nouvelles autorités de Kiev. Ils ont ensuite pris possession de dépôts d’armes et de bâtiments administratifs et policiers, puis, le 7 avril, proclamé la « république populaire de Donetsk », le scénario étant comparable dans la région voisine de Louhansk. On a donc assisté à une révolution par le bas dirigée par des chefs de guerre improvisés assistés d’élus locaux promus « ministres » des nouvelles « républiques ».
b. Le conflit armé et l’implication de la Russie
Nouvellement élu, le président Porochenko a déclenché à la fin du printemps 2014 l’« opération antiterroriste », qui visait à reprendre le contrôle des villes du Donbass, lesquelles étaient presque toutes tombées aux mains des séparatistes. L’engagement de l’armée ukrainienne a alors changé le rapport de force, le gouvernement central reprenant le contrôle de la partie occidentale et septentrionale du Donbass (Sloviansk, Kramatorsk, Sieverodonetsk, Lyssytchansk…).
De l’avis général, c’est alors que les militaires russes sont entrés en action, ce qui a conduit dans les derniers jours d’août 2014 à une vigoureuse contre-offensive séparatiste : l’avancée de l’armée ukrainienne a été stoppée et une poussée séparatiste a été effectuée vers la mer d’Azov et la ville de Marioupol, sans cependant prendre celle-ci.
La présence militaire russe dans le Donbass a pu représenter jusqu’à 10 000 à 15 000 hommes selon l’OSCE, 10 000 selon les autorités ukrainiennes (sur un total d’environ 40 000 combattants du côté séparatiste), qui s’occupaient de missions d’entraînement, mais assuraient aussi de nombreux postes de commandement, ainsi que la mise en œuvre d’armements complexes comme les systèmes sol-air. Les autorités ukrainiennes ont affirmé à plusieurs occasions avoir capturé des combattants russes, notamment des forces spéciales (Spetsnaz). La Russie aurait également envoyé beaucoup de matériel, y compris de l’armement lourd, prélevé sur ses stocks énormes de matériels plus ou moins obsolètes : selon les autorités ukrainiennes, 500 à 700 blindés, une centaine de lance-roquettes multiples… Avec l’apaisement des combats, la Russie semble avoir progressivement allégé sa présence militaire directe dans le Donbass.
C’est aussi durant l’été 2014 que les « institutions » des deux « républiques populaires » séparatistes se sont stabilisées, avec l’arrivée au pouvoir en août de MM. Alexandr Zakhartchenko et Igor Plotnitski, respectivement à Donetsk et Louhansk, ensuite entérinée par les élections locales organisées (illégalement du point de vue ukrainien) le 2 novembre 2014.
Il faut enfin rappeler, pendant la même période, la destruction le 17 juillet 2014 du vol MH17 de Malaysian Airlines, qui a causé la mort de 298 personnes, principalement des Néerlandais, des Malais et des Australiens. Le Bureau d’enquête néerlandais a publié son rapport officiel le 13 octobre 2015. Ce rapport confirme que l’avion a été détruit par un missile sol-air de fabrication russe, mais le lieu d’où il a été tiré (sous contrôle séparatiste ou ukrainien ?) reste discuté.
C’est suite à l’offensive séparatiste d’août 2014 et au coup d’arrêt donné à la reconquête ukrainienne qu’un premier protocole a pu être signé le 5 septembre 2014 à Minsk, comprenant un cessez-le-feu et un volet politique et complété le 19 septembre par un mémorandum qui en précisait les dispositions sécuritaires. Cette signature a été permise par l’implication de la communauté internationale, à travers l’OSCE, mais surtout par celle du « couple franco-allemand » dans le cadre du « format Normandie » de discussions quadripartites (France, Allemagne, Russie et Ukraine).
Le 16 septembre 2014, la Rada a adopté la loi portant sur le « régime particulier d’autogestion locale » et temporaire des districts du Donbass sous contrôle séparatiste, censée appliquer le volet politique du protocole de Minsk.
Cependant le cessez-le-feu n’a pas été respecté et, en particulier, les séparatistes ont poussé leur avantage : par rapport à la ligne de cessez-le-feu du 19 septembre 2014, ils ont conquis jusqu’en février 2015 environ 1 500 km2, notamment dans la zone de Debaltseve, qui formait un saillant empêchant la liaison directe entre Louhansk et Donetsk, mais aussi au sud de cette dernière ville et dans la zone disputée de son aéroport.
La reprise du processus de Minsk, permise par la très forte implication personnelle du Président de la République française, a débouché, à l’occasion d’un sommet de ces dirigeants avec leurs homologues russe et ukrainien les 11 et 12 février 2015, sur ce que l’on appelle les accords de « Minsk 2 », qui correspondent en fait à deux documents :
– une déclaration conjointe des quatre chefs d’État ou de gouvernement, prévoyant notamment un « mécanisme de suivi » en « format Normandie » ;
– un « Paquet de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk », signé par les représentants de l’OSCE, de l’Ukraine, de la Russie et des deux « républiques populaires » séparatistes dans le cadre du Groupe de contact tripartite (GCT) qui les réunit.
Les accords de « Minsk 2 » s’inscrivent dans la continuité de ceux de « Minsk 1 » tout en tirant les leçons de la non-application de ceux-ci ? C’est pourquoi les chefs d’État ont manifesté leur engagement personnel par la publication de leur déclaration conjointe, tandis que le « paquet de mesures » précisait les obligations de chacun en fixant la séquence dans laquelle les différentes mesures devaient s’inscrire : ce lien entre le calendrier du processus politique et les progrès sur le terrain était censé rétablir une certaine confiance entre les parties.
Ces accords ont été endossés par les Nations-Unies avec le vote de la résolution 2202 du Conseil de sécurité.
Le dispositif de Minsk 2 traite de l’ensemble des questions militaires, humanitaires et politiques en détaillant leur enchaînement : cessez-le feu, retrait des armes lourdes hors de portée de tir, rôle de l’OSCE (8), dialogue préalable aux élections locales à organiser dans les zones séparatistes, amnistie, libération de tous les prisonniers et otages, sécurisation de l’aide humanitaire, rétablissement des liens socio-économiques entre l’Ukraine et les zones séparatistes (notamment quant au versement des pensions de retraite), reprise du contrôle de la frontière avec la Russie par le gouvernement ukrainien, départ des formations armées étrangères et des mercenaires, réforme constitutionnelle en Ukraine pour permettre une décentralisation prenant en compte les particularités des zones séparatistes…
Le « paquet de mesures » du 12 février est précis quant au calendrier des plus importantes des dispositions à mettre en œuvre et leurs modalités :
– il prévoit d’abord un « cessez-le-feu immédiat et universel », lequel n’a dès le début pas été respecté (les séparatistes ayant en particulier poursuivi leur offensive sur Debaltseve plusieurs jours en février 2015) et n’est toujours pas pleinement assuré, ainsi que le retrait de toutes les armes lourdes de la ligne de front ;
– la réforme constitutionnelle en Ukraine devra prendre en compte les particularités des zones séparatistes, ce en accord avec les représentants séparatistes. Elle devra permettre l’adoption dans la foulée d’une législation permanente sur le statut spécial des ex-zones séparatistes (la loi de septembre 2014 ne prévoyant qu’un statut temporaire pour trois ans) qui inclura notamment un « droit à l’autodétermination linguistique », une participation des responsables locaux à la désignation des juges et procureurs, la création de milices populaires locales, une possibilité de « collaboration transfrontalière » avec les régions avoisinantes de Russie…
– le dialogue sur les modalités des futures élections locales dans les zones séparatistes doit être entamé dès le lendemain du retrait effectif des armes lourdes et conduit avec les représentants des « républiques populaires » séparatistes ;
– mais ces élections devront être conduites selon la législation ukrainienne et dans le respect des standards de l’OSCE et sous son contrôle ;
– le rétablissement du contrôle du gouvernement ukrainien sur les 400 kilomètres de frontière entre la Russie et les zones séparatistes, enjeu essentiel pour mettre fin au soutien militaire russe à celles-ci, doit commencer le lendemain des élections locales.
L’échéance prévue pour la mise en œuvre de toutes ces mesures était la fin 2015.
Enfin, une architecture institutionnelle a été mise en place pour faciliter le respect de ce calendrier serré de négociations, avec la création, outre le Groupe de contact trilatéral pour le règlement de la crise ukrainienne (OSCE, Russie, Ukraine), de quatre groupes de travail thématiques portant sur les questions sécuritaires, politiques, humanitaires et économiques, auxquels participent en outre les séparatistes.
d. L’actualité : une cessez-le feu qui n’est toujours pas acquis
Les clauses militaires du « paquet » de Minsk 2 n’ont été que partiellement mises en œuvre à partir de février 2015. Le cessez-le-feu qu’il comprenait n’ayant pas été vraiment respecté, il a dû être renouvelé le 1er septembre 2015, avec un succès réel dans un premier temps. De plus, début octobre 2015, l’Ukraine et les séparatistes prorusses ont annoncé un accord sur le retrait des armes de calibre inférieur à 100 millimètres dans une zone de 15 kilomètres de part et d’autre de la ligne de front, sur le modèle de l’accord théoriquement en vigueur pour les armes lourdes, à mettre en œuvre sous 41 jours. Enfin, un accord de déminage a été passé.
Ces résultats ne doivent pas occulter la poursuite d’affrontements à bas niveau d’intensité. Dès novembre 2015, les tirs et incidents armés ont à nouveau commencé à augmenter. L’indiscipline généralisée des unités combattantes, des deux côtés, voire le degré d’alcoolisation, sont souvent présentés comme à l’origine de ces tirs sporadiques. Cela dit, le maintien de « points chauds » actifs peut aussi servir des intérêts tactiques : il pourrait notamment servir de prétexte à une reprise plus généralisée des combats que l’un des camps jugerait opportune. Dans la période la plus récente, selon nos diplomates se basant sur des constats de l’OSCE (9), la très grande majorité des incidents seraient déclenchés par des tirs du côté séparatiste.
Le nombre des victimes civiles et militaires des affrontements a certes diminué, mais n’est malheureusement jamais tombé à zéro, comme le montre le graphique ci-après, tiré du dernier rapport des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme en Ukraine.
Victimes des affrontements en Ukraine, décompte des Nations-Unies (2015-2016)
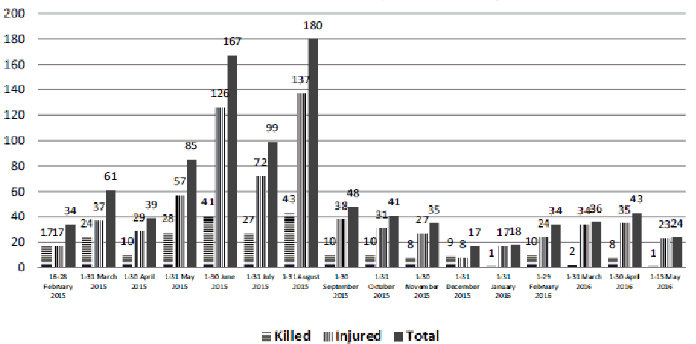
Source : « Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016 », Haut-commissariat aux droits de l’homme.
Au total, d’après le dernier décompte du Haut-commissariat des Nations-Unies à la mi-mai 2016, le nombre de victimes du conflit depuis février 2014 approcherait les 31 000 (au moins), dont au moins 9 371 morts et 21 532 blessés.
De plus, les observateurs de l’OSCE ne peuvent toujours pas ou difficilement accéder à certaines zones, notamment aux abords de la frontière entre les zones séparatistes et la Russie.
Lors de la réunion ministérielle en « format Normandie » du 11 mai 2016, plusieurs mesures ont fait l’objet d’un accord de principe – il reste à les appliquer : la pérennisation du cessez-le-feu assez bien respecté depuis début mai ; un désengagement des troupes dans les « points chauds » où ont lieu la plupart des violations du cessez-le-feu ; la création de zones démilitarisées ; le retrait effectif de toutes les armes autres que légères, y compris celles d’un calibre inférieur à 100 millimètres ; l’accélération du déminage, qui a déjà commencé dans 8 des 12 zones prévues…
e. Une situation humanitaire et économique toujours très difficile
La situation humanitaire et économique reste très difficile, voire « désastreuse » selon les mots de notre ambassadeur en Russie, S. E. Jean-Maurice Ripert (10). Le Donbass est une région très urbanisée, densément peuplée : avant le conflit, les régions de Donetsk et de Louhansk, qui le constituent, avaient globalement plus de 6 millions d’habitants. On compte aujourd’hui près de 2 millions de personnes déplacées, réfugiées principalement dans le reste de l’Ukraine ou en Russie. Selon la source précitée, la « situation sanitaire [est] absolument dramatique, avec des épidémies de sida et de tuberculose, notamment dans les prisons, où il n’y a plus aucun personnel médical. (…) il risque d’y avoir des morts par milliers ».
Outre les victimes directes des affrontements mentionnées supra, il faut rappeler les exactions qui ont été commises. Le conflit du Donbass ne présente certes pas le caractère inexpiable d’autres conflits civils comme celui en cours en Syrie : les combattants faits prisonniers, en règle générale, ne sont pas exécutés et les civils ne sont pas délibérément visés, les villes ne sont pas systématiquement détruites. Mais, comme l’illustre bien la destruction du vol de la Malaysian Airlines, il apparaît que les combattants ne prennent pas vraiment de précautions pour épargner les cibles civiles. Par ailleurs, les ONG de défense des droits de l’homme ont documenté, dans les deux camps, des cas assez nombreux – plusieurs centaines sans doute au printemps 2014 – d’arrestations arbitraires (qui ont même concerné plusieurs équipes de l’OSCE en avril-mai 2014), de mauvais traitements et de torture, de rançonnement, voire d’exécutions sommaires (11).
La situation des prisonniers faits de part et d’autre reste également problématique. Certes des échanges ont été effectués : par exemple, 138 soldats ukrainiens et 52 combattants séparatistes ont été libérés le 21 février 2015. Mais tous les prisonniers ne l’ont pas été : en novembre 2015, les autorités ukrainiennes évoquaient encore 148 prisonniers ukrainiens qui seraient détenus illégalement dans le Donbass « occupé ». S’y ajoutent quelques cas emblématiques de prisonniers ukrainiens détenus en Russie, même si la pilote et députée Nadiya Savtchenko, condamnée le 21 mars 2016 à 22 ans de prison par un tribunal russe pour son rôle allégué dans l’« assassinat » de deux journalistes russes tués en juin 2014 dans la zone des combats, a ensuite été libérée, le 25 mai, dans le cadre d’une échange de prisonniers.
Une région industrielle telle que le Donbass ne pouvant pas fonctionner si les voies d’approvisionnement et d’exportation de sa production sont coupées, l’économie tourne au ralenti, même s’il semble que des « arrangements » locaux permettent d’éviter le pire – par exemple de maintenir allumées des installations à feu continu comme les hauts-fourneaux de Marioupol afin d’éviter des dommages irréparables. Dans le contexte du cessez-le-feu, la ligne de front peut être franchie par les civils, mais le gouvernement ukrainien organise une sorte de blocus économique des zones séparatistes : limitation des points de passage, non-versement des pensions et salaires en zone séparatiste, rapatriement systématique des administrations et services publics (établissements d’enseignement, hôpitaux…) de Donetsk et Louhansk vers les parties du Donbass qu’il contrôle. L’introduction par le gouvernement ukrainien, le 21 janvier 2015, d’un système d’autorisation pour entrer et sortir de la zone de conflit est critiquée dans le 10ème rapport du Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, car elle restreint la liberté de circulation, rend plus difficile la livraison de l’aide humanitaire et engendre de la corruption (il semble effectivement que la délivrance des laissez-passer soit en pratique tarifée).
Les parties des régions de Donetsk et Louhansk restées sous administration ukrainienne comptaient au printemps 2015 environ 650 000 réfugiés enregistrés, auxquels les administrations locales, elles-mêmes réfugiées depuis les capitales provinciales perdues, ne pouvaient apporter qu’une aide limitée : hébergement dans des bâtiments préexistants (écoles, centres de vacances…) et versement d’allocations minimes (au mieux l’équivalent de 35 euros par mois). L’un des problèmes principaux semble être l’approvisionnement en médicaments, notamment ceux nécessaires pour soigner les maladies chroniques dans une population qui compte beaucoup de retraités (le Donbass étant une région industrielle en déclin). Plus généralement, les autorités locales insistent sur l’impossibilité pour ces régions de survivre sans l’aide du gouvernement central et l’aide internationale et humanitaire.
f. Un processus politique pour le moment bloqué
Dans le cadre du processus de Minsk, les questions politiques sont débattues au sein d’un groupe de travail ad hoc, dont l’animation a été confiée à notre compatriote l’ancien ambassadeur Pierre Morel.
La question de l’organisation des futures élections locales, prévues dans les accords de Minsk, est essentielle, car seules ces élections peuvent adouber des dirigeants légitimes à Donetsk et Louhansk. Or, il est clair que les modalités d’organisation de ces élections sont susceptibles de modifier grandement leur résultat, de sorte que les deux camps se sont positionnés sur cette question, et leurs positions restent très éloignées.
● Le 17 mars 2015, comme le lui demandait le « paquet de mesures » de « Minsk 2 », la Rada a adopté une loi sur ce point, qu’elle a complétée par deux résolutions. Ces textes fixent des conditions à l’organisation des élections locales non prévues par le « paquet de mesures », voire peut-être contraires à certaines de ses dispositions :
– ces élections, qui seraient organisées conformément à la législation ukrainienne et aux standards de l’OSCE, ne devraient avoir lieu qu’après le départ de tous les combattants étrangers ;
– les zones séparatistes sont qualifiées de « territoires occupés » jusqu’au retrait de toutes les formations armées illégales et des mercenaires étrangers et jusqu’au rétablissement du contrôle du gouvernement ukrainien sur l’intégralité de la frontière avec la Russie. Or, le fait de définir les zones séparatistes comme « territoires occupés » notamment du fait de l’absence de contrôle de la frontière peut même être interprété comme reportant nécessairement les élections locales après la reprise du contrôle de cette frontière, alors même que le texte de « Minsk 2 » prévoit exactement le contraire (la reprise de contrôle de la frontière doit commencer le lendemain des élections, donc celles-ci doivent avoir lieu avant) ;
– l’application du statut spécial des zones séparatistes (prévu par la loi du 16 septembre 2014) serait reportée après la tenue de ces élections ;
– il est demandé aux Nations-Unies et à l’Union européenne de déployer une force de paix.
● De leur côté, les séparatistes ont adopté le 13 mai 2015 leur propre « loi » électorale « taillée sur mesure » pour assurer leur reconduction, puisqu’elle écartait, sinon du corps électoral, au moins de l’éligibilité, les 2 millions de déplacés et interdisait aussi la participation des principaux partis nationaux d’Ukraine. Ils ont alors annoncé des élections pour le 18 octobre et le 1er novembre.
● Le sommet tenu à Paris le 2 octobre 2015 en « format Normandie » entre les dirigeants français, allemand, russe et ukrainien a débouché, sans qu’un accord écrit ne soit formalisé, sur le report sine die des élections susmentionnées prévues par les autorités de fait séparatistes. En contrepartie, la séquence des actions à mettre en œuvre a été précisée, ainsi que l’a rappelé en audition devant la commission, le 30 mars 2016, l’ambassadeur Jean-Maurice Ripert (12) : « la première étape, c’est l’application des points des accords qui auraient dû entrer en vigueur dans la foulée de leur signature, à savoir l’observation stricte du cessez-le-feu, le retrait de l’ensemble des armes lourdes et la libre circulation de la mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur l’ensemble du territoire, notamment dans le Donbass. La deuxième échéance, c’est l’adoption par Kiev d’une loi constitutionnelle. La troisième phase, c’est la tenue d’élections dans le Donbass après l’adoption d’une loi électorale et d’une loi d’amnistie négociées entre les séparatistes, Kiev et la Russie, sous l’égide de l’OSCE. Enfin, le dernier point, c’est le rétablissement du contrôle de l’Ukraine sur sa frontière extérieure avec la Russie ». Comprenant une immunité pour les candidats à ces élections, la loi électorale pour le Donbass devrait être débattue avec les séparatistes dans le cadre du groupe de travail sur les questions politiques, puis votée par la Rada. Les élections auraient lieu dans les trois mois suivant ce vote et le statut spécial entrerait alors en vigueur, d’abord à titre provisoire, puis définitivement une fois les nouvelles institutions locales en place et reconnues. Cette loi électorale est donc une pierre angulaire du processus, car de son adoption et de son application dépendront l’entrée en vigueur de l’amnistie et du statut spécial.
● Cependant, la situation reste bloquée depuis. En effet, les divergences restent profondes quant à plusieurs points essentiels pour l’organisation des élections :
– la définition du territoire concerné. La ligne qui délimite en principe les zones d’application du statut spécial est la ligne de contact du mémorandum de Minsk du 19 septembre 2014, alors que les séparatistes ont conquis des territoires ensuite et pourraient « légitimer » ces avancées en les intégrant dans le champ couvert par les élections locales ;
– la participation des personnes déplacées au scrutin (électorat et éligibilité), à laquelle s’opposent les séparatistes, l’élément de négociation possible étant la durée de résidence dans la région ;
– les partis autorisés à y participer. Les séparatistes voudraient en effet en exclure les partis nationaux ukrainiens, bien que les élections doivent se dérouler selon la législation ukrainienne ;
– la participation des médias ukrainiens à la campagne électorale, elle aussi contestée par les séparatistes ;
– le mode de scrutin, selon qu’il devrait plus ou moins reprendre celui appliqué de droit commun pour les élections locales ukrainiennes ;
– le mode de contrôle des élections, avec la reconnaissance ou non d’une compétence de la commission électorale centrale ukrainienne ;
– le statut des « présidents » des républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk, MM. Zakharchenko et Plotnisky, qui se considèrent comme des « chefs d’État » et non des élus locaux, de sorte que, selon eux, les élections locales ne devraient pas remettre en cause leurs mandats respectifs.
Auditionnée le 2 février 2016 par la commission des affaires étrangères (13), Mme Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères et du développement international, a mis en exergue le blocage sur le processus politique et en particulier les élections : « c’est sur le volet politique que le bât blesse, de manière évidente. Le groupe de travail chargé des questions politiques présidé par l’ambassadeur Pierre Morel a travaillé d’arrache-pied – il s’est réuni plus de trente fois depuis le mois de mai 2015 – pour, notamment, mettre au point la loi électorale qui doit régir les élections dans le Donbass. Toutes les parties sont représentées dans ce groupe : les Ukrainiens, les séparatistes et les Russes. Ce travail n’a pas été inutile : on connaît désormais les positions des uns et des autres sur tous les sujets, et les points de blocage sont très clairement établis. En revanche, les positions sont encore maximalistes de part et d’autre. (…) il faut maintenant que les deux parties décident, au lieu de seulement se reprocher des comportements inamicaux ou irresponsables (…) ».
Auditionné à son tour le 27 avril 2016 par la commission des affaires étrangères, M. Pierre Morel, président du groupe de travail sur les questions politiques dans le cadre des accords de Minsk, a aussi fait état de cette situation de blocage, malgré les propositions de compromis raisonnable qu’il avait mises sur la table concernant notamment la loi électorale à appliquer pour les élections dans le Donbass ; il a évoqué « une situation de rejet mutuel indéfinie » (14).
● À Kiev, l’exécutif ukrainien n’a pas été en mesure de tenir l’engagement pris concernant la réforme constitutionnelle sur la décentralisation, dont le texte comportait la reconnaissance permanente du futur spécial des zones séparatistes après leur réintégration à l’Ukraine.
Le 31 août 2015, le vote en première lecture de cette réforme avait provoqué de violents incidents devant la Rada, causant 3 morts et 140 blessés, ainsi que le départ d’un des partis de la coalition gouvernementale.
Le texte, conformément à la constitution ukrainienne, devait être adopté en seconde lecture définitive avec une majorité qualifiée des deux tiers (300 députés) durant la session qui arrivait à terme le 2 février 2016. Faute d’une telle majorité, l’exécutif ukrainien a renoncé à solliciter ce vote. La Rada a adopté fin janvier une loi destinée à gagner du temps : afin d’éviter à avoir à recommencer tout le processus législatif, elle autorise le report du vote sur le texte existant de la révision constitutionnelle à la session parlementaire suivante, qui s’achèvera en septembre 2016, donnant ainsi un délai de six mois supplémentaires pour l’adoption de cette réforme. Mais rien ne permet de penser que d’ici cette échéance la majorité requise aura été réunie.
Le président Petro Porochenko a tenté de concilier ce report avec les engagements de Minsk 2 en proposant une nouvelle feuille de route qui ferait de l’amélioration des conditions sécuritaires un préalable à l’organisation des élections dans le Donbass. L’adoption de la révision constitutionnelle serait alors l’achèvement du processus politique, en contrepartie du rétablissement du contrôle de l’Ukraine sur sa frontière avec la Russie.
Cependant, dans le contexte de crise politique interne de février 2016, le premier ministre Arseni Iatseniouk et d’autres leaders politiques ont encore compliqué les perspectives de la révision constitutionnelle en souhaitant que son adoption définitive soit subordonnée à un referendum.
L’amnistie pour les « événements » est une autre question sensible sur laquelle les positions seront difficiles à concilier. La Rada a certes voté une loi d’amnistie, mais en en excluant les crimes de sang.
● Lors de la réunion ministérielle en « format Normandie » tenue le 3 mars 2016, les quatre ministres français, allemand, russe et ukrainien ont appelé à une accélération du processus de mise en œuvre des accords de Minsk, demandant notamment l’établissement d’ici le 30 avril 2016 d’un mécanisme de prévention et de règlement des incidents armés, l’accès sans restriction de l’aide humanitaire et la libération de tous les prisonniers à la même échéance, enfin la tenue des élections locales dans le Donbass d’ici la fin du premier semestre 2016. Les diplomaties française et allemande promeuvent donc l’idée d’avancées sur les questions sécuritaires, en s’efforçant de pousser la Russie à plus s’y impliquer (voire à faire des gestes unilatéraux), avec l’argument suivant : les dirigeants politiques ukrainiens seraient ainsi mis au pied du mur sur la tenue de leurs engagements politiques (vote de la révision constitutionnelle et des lois sur l’autonomie du Donbass, les élections locales et l’amnistie).
La délégation de la présente mission qui s’est rendue à Moscou fin mars 2016 a pu, quant à elle, discuter avec les officiels russes de la dernière proposition de leur pays : l’établissement de « zones de sécurité » prioritaires pour traiter les « points chauds » de la ligne de front (les quelques zones d’affrontements récurrents comme par exemple le village de Chirokino). Cette proposition est intéressante sous réserve qu’elle ne serve pas de prétexte à « laisser de côté » les autres zones, et notamment à pérenniser le non-accès de l’OSCE à de vastes parties des régions séparatistes de Donetsk et Louhansk.
Pour le reste, les personnalités russes rencontrées, tout en s’inscrivant clairement dans la démarche de Minsk, n’ont pas fait preuve d’une grande ouverture à des concessions supplémentaires de la partie russe. De leur point de vue, c’est avant tout aux autorités ukrainiennes de tenir leurs engagements politiques (constitutionnels et législatifs).
*
Quelles sont les chances d’obtenir de réelles avancées dans les mois qui viennent ? On ne peut pas exclure un blocage durable, non seulement du fait de la crise politique interne à Kiev, mais aussi parce que de puissants intérêts risquent de converger pour faire échouer le processus politique :
– le pouvoir russe pourrait préférer le maintien d’un statu quo qui affaiblirait durablement l’Ukraine et freinerait son intégration euro-atlantique, même s’il peut aussi trouver son compte dans une réintégration du Donbass dans une Ukraine plus ou moins « fédéralisée » où la région pourrait disposer d’une faculté de blocage aux effets comparables ;
– ce maintien du statu quo et donc d’une situation tendue pourrait aussi servir les intérêts, notamment électoraux, d’un exécutif russe dont la popularité est principalement fondée sur sa politique étrangère qui exalte la fibre patriotique ;
– il semble que, dans certains milieux russes, on craigne qu’un règlement dans le Donbass ne ramène l’attention sur la Crimée (le fait est que le président ukrainien a déclaré qu’il comptait bien, après avoir repris le contrôle du Donbass, reprendre celui de la Crimée…) ;
– ce même exécutif pourrait enfin être tenté de parier sur un futur changement de pouvoir en Ukraine, suite à des élections, compte tenu de l’impopularité actuelle des dirigeants ukrainiens et de la crise qui a fait exploser la majorité parlementaire « pro-européenne » issue de la révolution de Maïdan ;
– les dirigeants séparatistes ne peuvent que craindre une solution politique qui conduirait vraisemblablement à les écarter à terme, même si ce n’est pas immédiat ;
– la lassitude pourrait s’installer dans l’opinion publique ukrainienne, avec la tentation d’abandonner le Donbass à son sort. Les observateurs font remarquer que la question suscite une indifférence croissante dans le pays et, en particulier, tient une place de moins en moins importante dans les médias ;
– les milieux nationalistes de Kiev pourraient considérer que le maintien d’une situation de tension sert leurs intérêts, notamment électoraux, voire les dirigeants ukrainiens actuels voir dans le maintien de l’état de guerre de fait la seule excuse invocable quant à leurs autres échecs (crise économique et blocage des réformes internes, notamment contre la corruption…). On peut aussi craindre une poussée populiste.
Ces supputations illustrent la complexité de la situation et du jeu des acteurs. Le risque est réel de voir le Donbass connaître le même destin que les autres « conflits gelés » de l’ex-URSS : les combats cesseraient plus ou moins, mais il n’y aurait pas d’avancée politique, de sorte que les entités séparatistes constitueraient des États de facto, mais dépourvus de reconnaissance internationale et isolés.
3. La réaction de la nouvelle majorité : relance de l’intégration euro-atlantique et « combat pour les valeurs »
Confrontés à l’annexion unilatérale et contraire au droit international de la Crimée et au séparatisme dans le Donbass, les nouveaux gouvernants de l’Ukraine ont réagi en relançant vigoureusement leur rapprochement avec l’Union européenne et l’Alliance atlantique.
Tout d’abord, ils ont naturellement signé l’accord d’association avec l’Union européenne, dont le refus final par le président Ianoukovytch en novembre 2013 avait provoqué les événements de Maïdan :
– ses dispositions générales et politiques ont été signées le 21 mars 2014 à Bruxelles ;
– ses autres dispositions, notamment économiques, le 27 juin 2014 à Bruxelles.
Le 16 septembre 2014, il a été approuvé par la Rada (le même jour que par le Parlement européen). Le processus de ratification de l’accord s’est poursuivi sans encombre dans la plupart des États membres. En France, le projet de loi de ratification a été successivement approuvé par le Sénat et l’Assemblée nationale les 7 mai et 25 juin 2015. Cependant, aux Pays-Bas, après un vote parlementaire favorable à la ratification, un groupe « euro-sceptique » a obtenu l’organisation d’un referendum (la Constitution autorisant depuis 2015, à l’initiative de 300 000 citoyens, un referendum sur une loi déjà votée) à portée consultative, organisé le 6 avril 2016. Après une campagne beaucoup moins centrée sur l’Ukraine que sur les problèmes généraux de la construction européenne, le « non » l’a emporté à près de 62 %. Comme, par ailleurs, la participation a légèrement dépassé la barre des 30 % qui conditionne la validité du referendum, ce résultat obligera, si les Pays-Bas veulent cependant ratifier l’accord, à un nouveau vote parlementaire. Le gouvernement néerlandais a engagé un processus de consultations avec ses partenaires européens.
L’accord comprend des clauses politiques de portée générale, des clauses de coopération sectorielle de nature générique et des clauses économiques beaucoup plus détaillées et exigeantes.
i. Les clauses politiques : un accord qui ne préjuge pas d’une adhésion future de l’Ukraine à l’Union européenne
L’une des grandes ambiguïtés du Partenariat oriental, dans le cadre duquel s’inscrivent les accords d’association signés en 2013-2014 avec l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, concerne les perspectives européennes des pays signataires, qui divisent les États membres de l’Union : les uns s’en tiennent aux textes fondateurs du Partenariat oriental, qui est un élément de la Politique européenne de voisinage, donc de la politique étrangère de l’Union ; pour d’autres, en revanche, l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont naturellement vocation à adhérer un jour à l’Union.
Cette tension se retrouve dans le texte du préambule de l’accord d’association avec l’Ukraine :
– d’un côté, ce document qualifie l’Ukraine de « pays européen », met en exergue ses « aspirations européennes », ses « valeurs communes » partagées avec les États membres de l’Union, « l’importance qu’attache l’Ukraine à son identité européenne » et le « fort soutien de l’opinion publique ukrainienne en faveur du choix du pays de se tourner vers l’Europe » ;
– de l’autre, il rappelle que l’accord d’association « ne préjuge pas de l'évolution des relations entre l’UE et l’Ukraine ».
Pour le reste, les clauses politiques de l’accord avec l’Ukraine se distinguent peu de celles des autres accords d’association passés par l’Union européenne : elles rappellent l’attachement commun des deux parties aux grands principes des droits de l’homme, de la démocratie, de l’économie de marché, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, du droit international, etc. ; elles prévoient une « convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité », ainsi que des coopérations dans un grand nombre de politiques publiques sectorielles.
Enfin, prenant acte de la pratique des sommets annuels Ukraine-Union européenne, dont la 17ème édition a eu lieu à Kiev le 27 avril 2015, l’accord d’association les institutionnalise avec une périodicité annuelle.
ii. Les clauses économiques : vers une intégration à l’espace économique européen
Le volet économique de l’accord d’association, très étoffé, établit en fait avec l’Ukraine un accord de libre-échange « complet et approfondi » tel que l’Union en promeut désormais. Il conduit en fait à une quasi-intégration économique de l’Ukraine à l’Union, puisqu’il conduira non seulement à supprimer pratiquement tous les obstacles aux échanges économiques mutuels, mais aussi à un large alignement de l’Ukraine sur le corpus des réglementations européennes, l’« acquis communautaire ».
L’accord ne traite donc pas que de tarifs douaniers, mais de toutes les autres questions liées au commerce : les procédures douanières, les obstacles dits « techniques » au commerce qui concernent notamment les normes techniques et les évaluations de conformité à ces normes, les règles sanitaires et phytosanitaires, la liberté d’établissement des entreprises et de prestation de services, les paiements et la circulation des capitaux, la réglementation des marchés publics, le droit de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle…
En matière douanière, il prévoit la libéralisation des échanges pour 99,1 % des lignes tarifaires en valeur commerciale pour l’Ukraine et pour 98,1 % pour l’Union européenne. Le calendrier de diminution des droits de douane est asymétrique afin de prendre en compte les différences de développement économique entre l’Union européenne et l’Ukraine. Cette dernière bénéficiera en outre pendant quinze ans de la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde si on industrie automobile est gravement menacée par les importations depuis l’Union. Cette dernière maintiendra quant à elle, comme avec ses autres partenaires commerciaux, des règles dérogatoires pour l’importation de divers produits agricoles et agro-alimentaires, avec notamment des contingents tarifaires (quotas d’importations à droits nuls au-delà desquels sont imposés des droits de douane dissuasifs) pour les céréales, la viande de porc, de bœuf et de volaille, les produits laitiers, les sucres et produits à base de sucre, etc.
Dans le domaine des réglementations, l’Ukraine s’est engagée par l’accord à s’aligner sur l’Union dans de nombreux secteurs, avec des échéances variables. L’accord fait aussi en sorte que les réglementations portent le moins possible atteinte au commerce tout en atteignant leurs objectifs légitimes, avec par exemple l’établissement de systèmes d’alerte et de consultation rapides en matière sanitaire et phytosanitaire.
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, sensible pour l’Union européenne, l’Ukraine s’est notamment engagée à reconnaître et à protéger un très grand nombre d’indications géographiques protégées (appellations) européennes, mais pourra, durant une période de transition de dix ans, continuer à utiliser pour ses produits nationaux certaines appellations génériques préexistantes, notamment « champagne », « cognac », « armagnac » et « calvados ».
b. Le souhait d’une libéralisation rapide des visas
La libéralisation du régime des visas de court séjour avec l’espace Schengen est l’un des objectifs du Partenariat oriental les plus attendus par la population ukrainienne, d’autant que la Moldavie voisine bénéficie depuis le 28 avril 2014 du régime sans visas avec cet espace.
Cette question n’est pas traitée dans l’accord d’association. Des accords de facilitation des visas (allégement des procédures) et de réadmission ont été signés entre l’Union et l’Ukraine dès le 18 juin 2007 et sont en vigueur depuis début 2008. S’agissant de la suppression des visas de court séjour, un plan d’action est appliqué depuis le 22 novembre 2010, comprenant deux phases (adaptation législative et réglementaire, puis évaluation de la mise en œuvre effective) ponctuées de rapports de progrès réguliers ; la première phase ayant été validée, l’Ukraine est entrée dans la seconde phase du plan d’action depuis le 23 juin 2014.
Le sommet du Partenariat oriental à Riga le 21 mai 2015 n’a pas débouché sur les avancées rapides espérées par les Ukrainiens, mais sa déclaration finale laissait espérer à l’Ukraine (et à la Géorgie) la suppression des visas de court séjour Schengen début 2016. Selon ce document, les parties au sommet ont hâte de voir l’Ukraine (et la Géorgie) remplir pleinement leurs engagements pris dans le cadre des plans d’action en cours pour la libéralisation des visas et saluent l’intention de la Commission européenne d’évaluer d’ici fin 2015 le respect de ces engagements, lequel devrait permettre de conclure le processus. On peut lire ce document comme un engagement des Européens à ne pas mettre d’obstacles politiques à la levée de l’obligation de visa dès lors que les conditions techniques (portant notamment sur des procédures fiables et rigoureuses de contrôle des frontières et de délivrance des passeports) seront remplies.
Le 18 décembre 2015, la Commission européenne a publié en conséquence sa sixième et dernière évaluation du processus ukrainien de préparation à la libéralisation des visas (15). Ce rapport étant très positif, la Commission a alors annoncé qu’elle proposerait prochainement au Conseil de prendre la décision de libéralisation concernant l’Ukraine (ainsi que la Géorgie et le Kosovo). C’est chose faite depuis le 20 avril 2016. C’est maintenant au Conseil d’examiner la question. Faute d’un consensus suffisant entre États membres, la décision, envisagée un temps pour ce mois de juin, pourrait être repoussée à l’automne.
c. La relance du rapprochement avec l’Alliance atlantique
S’agissant de l’OTAN, l’Ukraine a établi des relations de coopération avec cette organisation en devenant membre du Partenariat pour la paix depuis 1994 (comme alors la plupart des ex-républiques soviétiques, Russie comprise). Une commission OTAN-Ukraine a été créée en 1997 pour développer ce partenariat.
Lors du sommet de l’OTAN à Bucarest en avril 2008, il a été acté sur le principe que l’Ukraine et la Géorgie deviendraient membres de l’organisation, tout en repoussant cette adhésion à une échéance indéterminée.
Après son élection en février 2010, le Président Ianoukovytch a changé de cap en faisant adopter par la Rada, en juillet 2010, le statut « hors blocs », une loi de neutralité interdisant toute participation de l’Ukraine à une alliance militaire.
La coalition gouvernementale issue des élections législatives d’octobre 2014 a naturellement pris le contre-pied de cette position et déclaré vouloir relancer le processus d’adhésion à l’OTAN. Le président Porochenko a notamment fait part le 24 novembre 2014 de sa volonté d’organiser un referendum à ce sujet et une loi annulant la loi « hors blocs » a été votée par la Rada le 24 décembre 2014.
*
En conflit de fait avec la Russie, mais sans qu’il y ait état de guerre entre les deux pays, ni même rupture globale des relations existantes, la majorité au pouvoir à Kiev ne présente pas la situation actuelle comme une guerre civile avec des régions séparatistes, mais pas vraiment non plus comme une guerre avec la Russie : ce serait plutôt une lutte contre des « terroristes » totalement manipulés par l’étranger (Moscou) – contre lesquels est engagée une « opération antiterroriste » – et plus globalement un combat pour les valeurs démocratiques occidentales et le droit international. Ce combat opposerait l’Ukraine non au peuple russe, mais au pouvoir en place à Moscou, lequel incarnerait l’antithèse de ces valeurs et voudrait à tout prix faire échouer l’expérience démocratique ukrainienne, dont il craindrait la contagion dans la société russe.
Cette présentation permet de susciter ou du moins de solliciter tout naturellement la solidarité des pays européens et occidentaux. En interne, elle semble avoir permis, pour un temps au moins, une certaine réunification nationale dans une Ukraine traditionnellement divisée.
1. Une économie déjà assez peu performante avant la crise actuelle
Les ex-républiques soviétiques ont, de manière générale, connu un effondrement économique dans les années 1990 avant un rétablissement dans les années 2000. En Ukraine, les années 2000 ont été une période de forte croissance, avec des taux annuels oscillant entre 3 % et près de 12 % et une moyenne annuelle supérieure à 7 % sur la période 2000-2007.
Mais ensuite, l’économie ukrainienne a durement subi la crise financière de 2008-2009. Le PIB a baissé de 15 % en 2009 et, dans les années suivantes, la reprise a été faible : l’année 2011 a vu une croissance supérieure à 5 %, mais après une année 2010 et avant des années 2012 et 2013 de croissance voisine de zéro, de sorte que l’économie ukrainienne n’avait pas retrouvé, à la veille des événements de Maïdan, son niveau d’avant la crise financière.
Dans l’espace post-soviétique, on observe une situation assez différente entre les États dotés de larges ressources naturelles, principalement en hydrocarbures – la Russie, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan –, et les autres, dont l’Ukraine. Aujourd’hui, le PIB par habitant de l’Ukraine, évalué en parité de pouvoir d’achat (16), est voisin de 8 000 dollars.
Comme on le voit sur le graphique ci-après, cette situation place l’Ukraine :
– dans une position à peine médiane dans l’ex-URSS, loin derrière les plus riches des États post-soviétiques, tels que la Russie et le Kazakhstan, où la richesse par habitant est trois fois plus élevée, et même désormais légèrement derrière la Géorgie et l’Arménie, ce qui n’était pas le cas il y a peu d’années ;
– plus loin encore de la France, présentée ici comme élément de comparaison illustrant le niveau de vie en Europe occidentale, et même des différents États membres d’Europe centrale mitoyens du pays (Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie).
L’analyse du commerce extérieur ukrainien (voir infra) montre également que l’Ukraine est insérée à un niveau médiocre dans les chaînes de valeur internationales : ses exportations sont principalement constituées de matières premières ou de biens semi-transformés, produits agricoles, minerais et produits sidérurgiques.
Le PIB per capita ramené en parité de pouvoir d’achat : comparaison de la situation de l’Ukraine avec ses voisins et avec les autres ex-républiques soviétiques
(en dollars courants, données pour 2015)
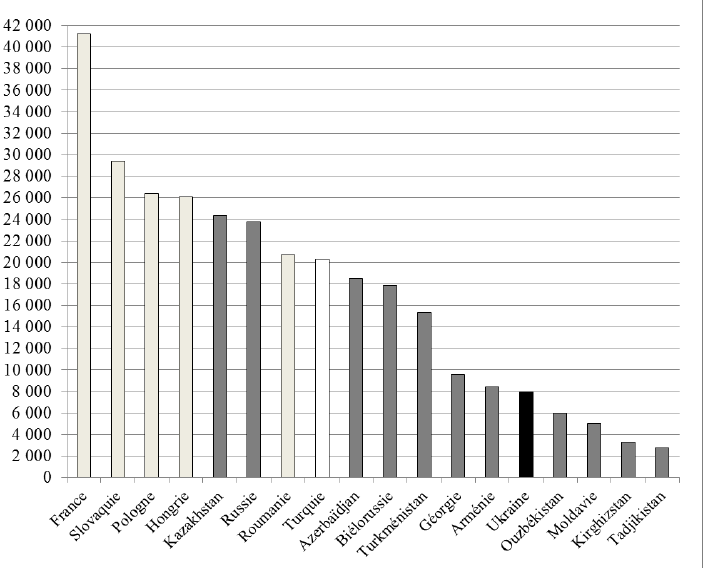
Source : graphique élaboré à partir des données de la base du FMI, données d’octobre 2015.
Les classements internationaux sur la compétitivité mettent également en lumière les performances médiocres de l’économie ukrainienne, liées notamment au niveau de corruption.
Dans le classement Doing Business pour 2016 de la Banque mondiale, qui est censé mesurer l’adaptation de l’environnement réglementaire au lancement et au développement des PME, l’Ukraine arrive 83ème sur 189, soit un gain de treize places par rapport à l’année précédente (la Russie est 51ème).
Selon le Competitiveness Report 2015-2016 du World Economic Forum, l’Ukraine arrive au 79ème rang mondial sur 140 pour la compétitivité (la Russie est 45ème). Les domaines où les performances relatives de l’Ukraine sont les plus médiocres sont la situation macro-économique (134ème rang mondial), ce qui n’est pas surprenant dans le contexte actuel de forte récession, mais aussi le fonctionnement des institutions (130ème rang).
Enfin, dans le classement de l’ONG Transparency International sur la « corruption perçue » pour 2015, l’Ukraine occupe un médiocre 130ème rang sur 168 pays, rang qui la classe plus mal que la Russie (119ème), seules trois républiques d’Asie centrale obtenant un score pire dans l’espace postsoviétique.
2. Les effets de la crise actuelle
La crise politique actuelle a encore dégradé cette situation déjà médiocre.
a. Une récession massive en 2014 et 2015
L’Ukraine a connu une très forte récession économique en 2014 (– 6,6 %) et 2015 (– 9,9 %). Cette récession semble avoir atteint son paroxysme fin 2014-début 2015 et certaines prévisions font maintenant apparaître une stabilisation, voire une croissance légèrement positive en 2016 (1,5 % selon les dernières estimations du FMI), mais à partir du niveau très bas touché après deux années de récession.
L’impact de la guerre dans le Donbass est massif. La production industrielle, largement localisée dans l’est du pays, a baissé de plus de 10 % en 2014. Avant le conflit, le Donbass représentait 16,5 % du PIB et près de 15 % de la population du pays. Il s’agissait d’un pôle industriel majeur, qui fournissait 50 % du charbon, 45 % des biens métallurgiques et 30 % de l’énergie thermique produits en Ukraine. La seule région de Donetsk représentait 12 % du PIB du pays, 18,5 % de sa production industrielle et 19 % de ses exportations de biens. Indépendamment même des troubles politiques et de la guerre, la seule « amputation » de l’Ukraine de la Crimée et d’une partie du Donbass réduit donc massivement le PIB ukrainien.
b. La crise monétaire et financière
La monnaie nationale, la hryvnia (ou grivna), s’est dépréciée d’environ 60 % face à l’euro entre décembre 2013 et avril 2016. Ceci a des effets catastrophiques pour les ménages et les entreprises endettés en devises, qui sont très nombreux : plus de la moitié des emprunts, qu’il s’agisse de ceux des particuliers, des entreprises ou de l’État, seraient ainsi « dollarisés ».
L’inflation, qui était nulle en 2012 et 2013 dans un contexte de stagnation, explose avec la dépréciation monétaire et la hausse des tarifs de l’énergie (destinée à réduire leur subventionnement implicite par le déficit) : 12 % en 2014, puis 49 % en 2015 et peut-être 15 % à 20 % en 2016 selon diverses prévisions !
Le taux d’investissement rapporté au PIB, déterminant pour l’avenir économique, est tombé à environ 15 % en 2015, ce qui insuffisant, alors qu’il s’élevait à 21-22 % en 2010-2012. Le chômage est passé en deux ans de 7 % à plus de 9 % de la population.
Le secteur bancaire reste très fragile : il a subi de lourdes pertes en 2014, puis 2015, et près de 70 établissements ont été mis en faillite ou déclarés insolvables depuis le début 2014. Le taux de créances douteuses pourrait être de 40 %, voire 50 %, dépassant largement les provisions constituées. La situation de l’un des principaux établissements du pays, considéré comme « systémique », suscite des inquiétudes, du fait de l’importance de son portefeuille de « prêts liés ». Selon certaines estimations, les coûts de restructuration du secteur bancaire pourraient représenter quelque 7,5 % du PIB.
c. Des conséquences lourdes sur la situation des finances publiques
Enfin, la situation des finances publiques apparaît très difficile, même si l’on note un début de rétablissement :
– le déficit public était déjà structurellement élevé avant la crise actuelle : constamment entre 4 % et 5 % du PIB depuis 2012 ;
– les difficultés sont naturellement accrues par l’effet de la récession (baisse des recettes fiscales) et par la nécessité de financer l’effort de guerre. Selon des annonces faites par le président Petro Porochenko dans son discours prononcé à la Rada le 4 juin 2015, l’effort de défense devrait passer de moins de 1 % du PB en 2013 et 2,7 % en 2014 à 5 % en 2015 ; les effectifs de l’armée devraient être portés à 250 000, contre 168 000 en 2013 ;
– s’y ajoute l’effet de la dépréciation de la monnaie. En effet, la dette publique est en grande partie contractée en devises et, du fait de la chute de la hryvnia, la valeur convertie en devises du PIB ukrainien s’effondre (exprimé en dollars, le montant brut du PIB diminuerait de moitié de 2013 à 2015) ; cela entraîne une très rapide dégradation du ratio dette/PIB, dont on sait qu’il est l’indicateur le plus commun de la soutenabilité d’une dette publique : alors que celui-ci était encore de 40 % en 2013, il aurait atteint 80 % fin 2015.
Par ailleurs, les chiffres concernant le déficit public et la dette n’intègrent pas les comptes du monopole public gazier Naftogaz, qui a généré à lui seul des pertes évaluées à 5,6 % du PIB en 2014. En les prenant en compte, le déficit public global pour 2014 aurait représenté plus de 10 % du PIB.
Toutefois, après ces constats sévères, il faut souligner depuis un an un réel redressement des finances publiques : le déficit budgétaire officiel est passé de 4,5 % du PIB en 2014 à 1,2 % en 2015 et celui de Naftogaz de 5,6 % à 3,2 %. Le budget voté pour 2016 prévoit un déficit public égal à 3,7 % du PIB et un déficit de Naftogaz ramené à 0,3 % de celui-ci.
Les réserves de change se sont effondrées de 60 % au cours de l’année 2014 : à la fin de cette année, elles s’élevaient à 6,2 milliards d’euros, soit seulement de quoi financer 1,4 mois d’importations. Elles se sont ensuite quelque peu redressées, atteignant 13,4 milliards de dollars en janvier 2016, soit plus de trois mois d’importations.
3. Un soutien financier international massif, mais conditionnel
• L’Union européenne
En tant que pays du « voisinage » européen, l’Ukraine bénéficie depuis longtemps de fonds communautaires significatifs.
Sur la période de programmation budgétaire 2007-2013, les crédits engagés par l’Union européenne au profit de l’Ukraine au titre de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) se sont élevés à plus de 900 millions d’euros.
Pour la période 2014-2020, le soutien programmé de l’Union à l’Ukraine est beaucoup plus considérable, puisqu’il est évalué à près de 13 milliards d’euros et comprendrait :
– deux premiers programmes d’assistance macro-financière représentant au total 1,61 milliard d’euros ;
– une nouvelle assistance macro-financière de 1,8 milliard d’euros décidée le 31 mars 2015, dont 0,6 milliard déjà décaissé – au total, plus de 2,2 milliards d’euros d’assistance macro-financière européenne ont d’ores et déjà été déboursés ;
– 1,4 milliard d’euros d’assistance budgétaire et technique, principalement dans le cadre de l’Instrument européen de voisinage (IEV, qui a succédé à l’IEVP) – en 2014, l’Ukraine a perçu effectivement 314 millions d’euros de fonds provenant de l’IEV, bien au-delà de la dotation initialement programmée, grâce au déblocage exceptionnel de reliquats antérieurs ;
– une mobilisation possible des prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) jusqu’à 8,9 milliards d’euros.
Il est également à noter qu’un instrument financier spécifique est destiné aux trois pays signataires d’accords d’association, Ukraine, Géorgie et Moldavie : dans le cadre du Fonds d’investissement en faveur de la politique de voisinage, 150 millions d’euros de subventions communautaires pourraient être débloquées sur 2015-2017, ce qui est censé susciter, par effet de levier, jusqu’à 1,5 milliard d’euros d’investissements dans les trois pays.
• Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale
L’Ukraine bénéficie aussi du soutien du FMI, même si, dans le passé, ses relations avec cette institution ont souvent été difficiles : un plan de soutien accordé en novembre 2008 suite à la crise financière avait dû finalement être annulé, l’Ukraine ne respectant pas les engagements de réformes qui vont toujours avec ce type de soutien ; un second plan conclu en juillet 2010 a de même été suspendu.
Face au risque croissant de défaut du pays, le FMI a décidé en mars 2014 d’un nouveau programme de 17,5 milliards de dollars pour 2014-2018 dans le cadre d’un effort de la communauté internationale évalué à 41 milliards de dollars sur cette période (soit l’équivalent de presque la moitié du PIB annuel de l’Ukraine).
Le FMI a confirmé son soutien à l’Ukraine en modifiant ses règles internes pour que le non-remboursement à la Russie, fin 2015, du prêt de 3 milliards de dollars qu’elle avait consenti fin 2013 (le président Ianoukovytch étant alors encore en place) n’empêche pas la poursuite des versements de l’institution (auparavant, le FMI ne pouvait pas soutenir des pays enregistrant des arriérés vis-à-vis de créanciers officiels).
De son côté, la Banque mondiale a mis en place des soutiens importants (1,3 milliard de dollars en 2014, un milliard en 2015), notamment pour des réformes structurelles concernant en particulier le secteur financier (renforcement du fonds de garantie des dépôts, amélioration de la solvabilité du système bancaire…).
• Les créanciers privés
Enfin, la dette contractée auprès de créanciers privés a également été restructurée : l’accord conclu en octobre 2015 prévoit une réduction de 20 % de la dette souveraine détenue par des opérateurs étrangers (3,6 milliards sur un total de 18 milliards de dollars) et le rééchelonnement du solde. 2,8 milliards de dollars de dette étrangère d’entreprises publiques ukrainiennes ont également été restructurés.
• Les engagements bilatéraux
Plusieurs pays, tels que l’Allemagne, le Japon et les États-Unis, ont annoncé des engagements bilatéraux importants au bénéfice de l’Ukraine, pour un montant global qui serait d’environ 4 milliards de dollars.
• Des aides internationales en partie bloquées du fait de l’absence d’avancée des réformes
Il faut néanmoins souligner que les aides internationales sont conditionnées à des engagements sur la politique monétaire, la consolidation budgétaire et les réformes structurelles (en particulier la lutte contre la corruption et la réforme du secteur énergétique).
Le FMI, désappointé par l’évolution interne du pays, a récemment mis en garde très ouvertement les autorités ukrainiennes : le 10 février 2016, Mme Christine Lagarde, directrice générale de l’institution, a publié un communiqué à cet égard très significatif, où elle manifestait son inquiétude face à la lenteur des réformes destinées à améliorer la gouvernance et combattre la corruption en Ukraine. Elle constatait que l’Ukraine risquait de retomber dans ses schémas passés de politiques économiques vouées à l’échec. Elle se demandait en conséquence comment le programme de soutien du FMI pourrait continuer s’il n’y avait pas de substantiels nouveaux efforts de réforme (17).
Pour le moment, après le versement par le FMI de 6,5 milliards de dollars sur les 17,5 milliards prévus, la tranche de 1,7 milliard qui devait être versée en septembre 2015 est toujours bloquée. Une nouvelle tranche d’assistance macro-financière de l’Union européenne est également gelée. Le 18 mai 2016, toutefois, le FMI a publié un communiqué qui laisse envisager un prochain déblocage (en juillet ?) de son aide.
4. Des échanges extérieurs de plus en plus tournés vers l’Union européenne
Dans le contexte de la crise avec la Russie et de la signature de l’accord d’association avec l’Union européenne, il n’est pas étonnant que le commerce extérieur ukrainien s’oriente de plus en plus vers l’ouest.
L’Union et la Russie sont traditionnellement les deux grands partenaires commerciaux de l’Ukraine et, en 2013 encore, leurs poids respectifs dans les échanges extérieurs du pays étaient voisins : durant cet exercice, l’Union européenne a été la source ou la destination de 31 % des flux commerciaux ukrainiens, juste devant la Russie, à 27 %.
En 2014, toutefois, les choses ont commencé à évoluer fortement : la Russie n’a plus représenté qu’un peu moins de 21 % des échanges extérieurs de l’Ukraine, contre 35 % pour l’Union.
Les principaux partenaires commerciaux de l’Ukraine en 2014
(part des partenaires en % des montants totaux du commerce ukrainien)
Importations : en % du total |
Exportations : en % du total |
Commerce total : en % du total | |||
Union européenne |
38,7 |
Union européenne |
31,6 |
Union européenne |
35,2 |
Russie |
23,3 |
Russie |
18,2 |
Russie |
20,8 |
Chine |
9,9 |
Turquie |
6,6 |
Chine |
7,5 |
Biélorussie |
7,3 |
Égypte |
5,3 |
Biélorussie |
5,2 |
États-Unis |
3,6 |
Chine |
5 |
Turquie |
4,5 |
Source : Commission européenne, DG Commerce, « Ukraine, Trade with world ».
a. Le commerce entre l’Ukraine et l’Union européenne
En 2015, les flux commerciaux entre l’Union européenne et l’Ukraine ont représenté 26,7 milliards d’euros (s’agissant des biens), avec un léger déséquilibre en faveur de l’Union (13,9 milliards d’euros d’exportations vers l’Ukraine pour 12,8 milliards d’importations depuis ce pays). Dans le contexte créé par la crise politique et économique de l’Ukraine, ces flux ont fortement baissé par rapport à 2013 : les ventes ukrainiennes dans l’Union se sont effritées de plus de 8 %, tandis que les exportations de l’Union vers l’Ukraine ont chuté de 42 % en deux ans, de sorte que l’excédent bilatéral traditionnel de l’Union a été réduit de 10 milliards d’euros à 1 milliard de 2013 à 2015.
Les importations européennes depuis l’Ukraine sont dominées par trois types de produits :
– les produits agricoles (34,9 % du total des importations européennes en 2015) ;
– le fer et l’acier (21,1 % de ces importations) ;
– les minerais et combustibles (14,2 %), notamment le charbon.
Parmi les produits industriels importés d’Ukraine, outre ceux de la sidérurgie susmentionnés, il faut signaler les équipements électriques, qui représentent 6,9 % des importations communautaires depuis ce pays en 2015.
Les exportations communautaires vers l’Ukraine sont diversifiées, avec cependant, comme partout, un poids prépondérant des produits de la chimie-pharmacie et des machines et équipements de transport, qui ensemble forment la moitié de ces exportations.
L’Union européenne est le premier partenaire commercial de l’Ukraine, mais dans l’autre sens, compte tenu de la disproportion des poids économiques, l’Ukraine n’est pas un partenaire commercial majeur pour l’Union. En 2015, elle n’était en effet que le 29ème partenaire commercial de l’Union (prise comme un bloc commercial), représentant environ 0,8 % de ses flux commerciaux (extra-communautaires). À titre de comparaison, la Russie a été la même année le 4ème partenaire extérieur de l’Union, avec 210 milliards d’euros d’échanges, soit huit fois plus qu’avec l’Ukraine.
b. Vers une guerre commerciale avec la Russie ?
Compte tenu de l’importance des liens économiques entre l’Ukraine et la Russie et dans un souci de conciliation, il avait été décidé de reporter au 1er janvier 2016 l’entrée en vigueur du volet commercial et économique de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine. Ce délai a permis la tenue de négociations tripartites (Union européenne, Ukraine et Russie) sur les questions commerciales, mais sans résultat.
En conséquence, le volet commercial de l’accord d’association est appliqué depuis le 1er janvier 2016, sans qu’un compromis ait été trouvé avec la Russie. Celle-ci, arguant d’un prétendu risque de déferlement sur son sol de produits européens via l’Ukraine, a immédiatement suspendu le régime de libre-échange qu’elle avait avec l’Ukraine en vertu d’un accord passé en 2011 dans le cadre de la Communauté des États indépendants (CEI). L’Ukraine a pris au même moment la même mesure à l’encontre de la Russie.
Dans la foulée, les deux pays ont annoncé réciproquement un certain nombre de mesures restrictives : la Russie a étendu à l’Ukraine l’embargo agro-alimentaire qu’elle applique par ailleurs aux pays occidentaux qui ont pris des sanctions économiques contre elle, tandis que l’Ukraine interdisait l’importation de divers produis russes (viande, poisson, vodka, chocolat, café, cigarettes, cosmétiques, équipements pour chemins de fer et locomotives, etc.). Les flux commerciaux désormais interdits représentaient auparavant à peu près le même montant dans les deux sens : un peu moins de 120 millions de dollars (18). De plus, la Russie a établi un régime discriminatoire pour les exportations ukrainiennes vers le Kazakhstan via le territoire russe (obligation de transiter par la Biélorussie et de conditionner les produits dans des containers scellés, suivi par GPS…).
Globalement, l’ensemble de ces mesures qui ressemblent de plus en plus à une guerre commerciale pourraient coûter de 600 millions à un milliard de dollars à l’économie ukrainienne.
Il faut rappeler par ailleurs que l’Ukraine a également, de son côté, décidé un blocus commercial quasi-total contre la Crimée, tandis que les livraisons de gaz russe sont à nouveau suspendues depuis le 25 novembre 2015, officiellement non pour des raisons politiques mais de non-paiement d’arriérés (voir infra)…
Les deux pays ont également suspendu leurs liaisons aériennes et l’accès à leurs espaces aériens respectifs (pour des « raisons de sécurité »…).
Enfin, le dernier épisode de cette « guerre économique » est le déclenchement de la « guerre des camions » : à partir du 12 février 2016, des activistes ukrainiens se sont mis à bloquer le transit des poids lourds immatriculés en Russie aux frontières entre l’Ukraine et les pays de l’Union européenne. Ce blocus a ensuite été endossé par le gouvernement ukrainien et la Russie a, à son tour, fermé ses frontières aux camions ukrainiens le 14 février.
c. La fin de la dépendance vis-à-vis du gaz russe ?
Il est enfin un domaine où l’Ukraine a longtemps été très dépendante de la Russie, mais où la situation évolue rapidement, c’est celui de l’approvisionnement gazier.
En 2010-2012, avant la crise, l’Ukraine consommait chaque année 50 à 54 milliard de m3 de gaz : la production nationale étant stable à environ 19 milliards de m3, 30 à 35 milliards de m3 devaient être achetés. Les volumes consommés et importés ont toutefois fortement diminué, en raison des difficultés économiques et politiques, à partir de 2013 : les importations ukrainiennes (par gazoduc) ont représenté 27 milliards de m3 en 2013, 18 milliards en 2014 et 16 milliards en 2015, année où la consommation nationale est tombée à 29 milliards de m3 (19).
Les relations ukraino-russes concernant le gaz ont toujours été compliquées et conflictuelles, les Russes accusant communément les Ukrainiens de détourner une partie du gaz transitant par leur territoire vers l’Europe et de ne pas régler leurs arriérés, les Ukrainiens reprochant aux Russes des prix jugés inamicaux et des contrats considérés comme léonins. C’est ainsi qu’entre 2006 et 2009, plusieurs « guerres du gaz », accompagnées de coupures dans l’approvisionnement, avaient déjà opposé les deux pays.
Dans le contexte de crise politique de 2014, la Russie a cessé ses fournitures de gaz à l’Ukraine après l’échec des négociations gazières Union européenne/Russie/Ukraine, le 16 juin 2014. Les positions des uns et des autres étaient en effet restées très éloignées : les Russes proposaient un prix de marché de 485 dollars pour 1 000 m3, avec une remise discrétionnaire possible l’abaissant à 385 dollars ; les Ukrainiens demandaient un prix commercial moyen de l’ordre de 340 dollars.
Toutefois, un accord provisoire est intervenu au mois d’octobre 2014 pour « passer » l’hiver 2014-2015 – l’hiver est la période où l’appoint des livraisons russes est vital pour l’Ukraine. En conséquence, les livraisons de gaz russe ont repris le 9 décembre 2014, à des prix modérés (entre 340 et 380 dollars pour 1 000 m3), en contrepartie de quoi l’entreprise ukrainienne Naftogaz a soldé une partie de sa dette des années antérieures vis-à-vis de Gazprom : 3,1 milliards de dollars ont été versés à ce titre, tandis que le solde réclamé par Gazprom, soit 2,4 milliards de dollars, étant contesté, est soumis à un arbitrage international (20). Au printemps 2015, cet accord a été reconduit, avec même un prix du gaz abaissé en répercussion de la baisse des prix du pétrole. Les livraisons ont cessé en juillet 2015, mais ont repris le 12 octobre.
Cependant, depuis la mi-2014, l’Ukraine bénéficie de flux rebours (rétrocessions de gaz alors que normalement le sens de transit est est-ouest), sur la base de contrats court terme, depuis la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. La BEI et la BERD ont mis en place des financements pour faciliter le développement de ces nouveaux flux. Globalement, les importations de gaz russe par l’Ukraine ont presque été divisées par quatre de 2013 à 2015, passant de 25 milliards de m3 à 7 milliards. Le gaz russe a cessé d’être prépondérant dans les approvisionnements ukrainiens.
C’est dans ce contexte que, le 25 novembre 2015, les livraisons de gaz russe ont encore une fois été interrompues, pour des raisons différentes selon les deux parties : en l’absence de prépaiement de quantités supplémentaires selon Gazprom ; parce que, grâce aux flux rebours, l’Ukraine n’aurait plus besoin de ces livraisons selon son gouvernement…
Les sempiternelles passes d’armes russo-ukrainiennes sur le gaz se sont poursuivies en janvier 2016, avec la décision ukrainienne de relever d’environ 60 % le tarif de transit du gaz russe par son territoire vers l’Europe centrale, puis l’amende d’environ 3 milliards d’euros infligée par l’homologue ukrainien de l’Autorité de la concurrence à Gazprom pour abus de position dominante.
III. DE NOMBREUSES RÉFORMES, MAIS UNE MISE EN œUVRE DIFFICILE
La révolution de février 2014 a entraîné une accélération incontestable des réformes destinées à rapprocher l’Ukraine des standards européens, ce dont ont rendu compte la Commission européenne et la Haute représentante dans un « rapport de progrès » (21), même si ce document pointe aussi les limites du processus et les progrès encore à réaliser.
Les nombreuses réformes engagées s’inscrivent tout à la fois dans un agenda politique interne (démocratisation, modernisation, préparation à une candidature à l’Union européenne…) et dans des engagements internationaux (pris vis-à-vis de l’Union européenne dans le cadre de l’accord d’association, mais aussi du FMI ou encore dans le cadre des accords de Minsk).
A. LES RÉFORMES DÉMOCRATIQUES, AU CONFLUENT DES ENJEUX INTERNES ET INTERNATIONAUX
1. De nombreuses mesures adoptées ou en cours d’adoption
S’agissant de la mise en œuvre des réformes concernant les droits fondamentaux, les libertés et plus généralement la gouvernance, plusieurs lois importantes ont été adoptées en 2014 :
– une loi sur l’indépendance des juges ;
– une loi sur l’indépendance des médias audiovisuels publics ;
– deux « paquets » de mesures anti-corruption en mai puis octobre 2014, comprenant un alourdissement et une extension du champ des sanctions, l’institution d’un contrôle externe des déclarations de patrimoine, une meilleure protection des « lanceurs d’alerte », la création d’un bureau national anti-corruption et d’une agence nationale de prévention, etc. ;
– des mesures facilitant la lutte contre les discriminations.
Le document européen susmentionné relève toutefois des insuffisances, notamment l’absence de progrès sur la réforme des forces de l’ordre et leur responsabilité, alors même que les abus policiers sont considérés comme un réel problème en Ukraine. Il appelle aussi l’Ukraine à concentrer ses efforts, durant l’année à venir, sur plusieurs priorités, dont la réforme de la justice, l’harmonisation de la législation électorale, la réglementation du financement des partis politiques, la mise en œuvre effective des mesures anti-corruption, le lancement d’une réforme globale des administrations et le processus de décentralisation (voir infra).
Certains de ces chantiers, par exemple la refondation de la fonction publique, comprenant la généralisation des recrutements par concours, et des administrations sont en cours. La police a également été réformée.
En matière de lutte contre la corruption et les abus de pouvoir, quelques actions spectaculaires ont été décidées, comme, fin mars 2015, la démission forcée du gouverneur de Dnipropetrovsk, le puissant « oligarque » Ihor Kolomoïsky, et l’arrestation des principaux cadres du service de gestion des situations d’urgence.
Dans son discours prononcé à la Rada le 4 juin 2015, le président Petro Porochenko a également annoncé que les moyens du bureau national anti-corruption allaient être renforcés pour lutter contre les abus de la police de la route et qu’une loi protégeant les témoins de faits de corruption serait proposée.
2. Mais une réforme constitutionnelle qui reste à parachever
La réforme constitutionnelle est au confluent des enjeux internes et externes du pays, car sa mise en œuvre fait partie des engagements signés à Minsk pour résoudre politiquement la crise du Donbass.
Elle a été préparée par une commission constitutionnelle consultative, composée de 72 membres (anciens présidents, députés, magistrats, représentants de la société civile), assistés de 13 experts étrangers. Le décret instituant cette commission lui avait assigné trois priorités :
– la décentralisation ;
– l’amélioration du système de protection des droits fondamentaux ;
– la réforme du système judiciaire.
La commission a entamé ses travaux le 6 avril 2015 et les a achevés le 17 juin 2015. Ses propositions ont été transmises pour avis à la Cour constitutionnelle et à la Commission de Venise. Celle-ci a rendu son avis préliminaire sur le volet structure territoriale et administration locale le 24 juin, et son avis préliminaire sur le volet concernant le pouvoir judiciaire le 24 juillet.
a. Un volet « décentralisation » bloqué à cause de la question du Donbass
Selon le rapport de progrès précité de la Commission européenne, le processus de décentralisation doit répondre à un ensemble complexe de caractéristiques actuelles du système ukrainien : une centralisation excessive, notamment en matière budgétaire ; des administrations locales souvent faibles et corrompues ; enfin une implication insuffisante de la population. Il est donc nécessaire pour des raisons internes générales de gouvernance.
Mais sa mise en œuvre est encore complexifiée par l’incidence de la crise du Donbass et de l’application des accords de Minsk, puisque ceux-ci prévoient aussi une décentralisation accrue spécifique aux régions séparatistes. De plus, même en dehors du Donbass, des questions telles que le droit – ou non – de choisir au niveau local la (les) langue(s) utilisée(s) dans l’administration dépassent largement les enjeux de bonne gouvernance et sont éminemment politiques.
Cette mise en œuvre est également complexifiée par la nécessité d’une révision constitutionnelle préalablement à l’examen de la plupart des mesures de décentralisation.
Quelques lois ont cependant déjà été adoptées, portant notamment sur le développement régional, la fusion volontaire des communes, l’accroissement des transferts budgétaires vers les collectivités locales (autonomie financière) et le nouveau mode d’organisation des élections locales (en vue de celles tenues en octobre 2015).
Le texte révisant la constitution ukrainienne prévoit quant à lui des réformes bien plus importantes, qui présentent une certaine parenté avec la décentralisation « à la française » opérée dans notre pays à partir de 1982 :
– l’établissement d’un système à trois niveaux de collectivités locales (régions, districts et communes) ;
– la suppression du système actuel de confusion entre les fonctions exécutives exercées localement au nom de l’État central et des collectivités locales. Dans le nouveau système, les fonctions exécutives de l’administration nationale seront clairement séparées de celles des collectivités. Les conseils municipaux, de districts et régionaux éliront indépendamment leurs propres organes exécutifs ;
– l’institution d’un corps de préfets chargés de coordonner l’action de l’État dans les collectivités locales et du contrôle de légalité de leurs actes ;
– la garantie par l’État de ressources financières suffisantes aux collectivités locales.
Par ailleurs, le projet de révision constitutionnelle inscrit dans les dispositions transitoires de la constitution ukrainienne la possibilité d’établir au moyen d’une loi ordinaire un régime particulier d’autonomie locale dans certains districts des régions de Donetsk et de Louhansk : cette disposition vise naturellement à satisfaire l’exigence, posée dans les accords de Minsk, d’une consécration constitutionnelle du statut particulier des zones séparatistes lorsqu’elles auront été réintégrées à l’Ukraine.
Le vote de ce texte par la Rada en première lecture le 31 août 2015 a, du fait de ce dernier point, été difficile : il a certes été adopté par 265 voix (la majorité requise étant de 226), mais a été rejeté par la plupart des députés de trois des cinq partis de la coalition d’alors (Batkyvchtchyna, Samopomitch et le Parti radical). Le 1er septembre, le Parti radical a quitté la coalition. Par ailleurs, des affrontements suscités par des groupes populistes et nationalistes devant la Rada ont fait 4 morts et plus de 130 blessés.
Cependant, pour être adoptée définitivement, la révision constitutionnelle doit faire l’objet d’un second vote à la majorité qualifiée des deux tiers (300 voix), lequel devait avoir lieu durant la session parlementaire achevée le 2 février 2016. Comme il a été expliqué supra, l’exécutif ukrainien a renoncé à solliciter ce vote et la Rada a seulement voté une loi donnant un délai supplémentaire de six mois pour l’adoption de la réforme.
b. Un volet judiciaire en cours de finalisation
Le volet constitutionnel concernant la réforme de la justice avance également assez lentement. Il a été voté en première lecture en février 2016 et devrait être soumis au vote définitif d’ici l’été 2016.
Il répond pourtant à une urgence, au regard de l’obsolescence du système judiciaire ukrainien, de son manque d’indépendance et de son niveau de corruption. La réforme de la justice est sans doute un préalable nécessaire à toute lutte efficace contre la corruption.
Les modifications constitutionnelles proposées visent à distendre les liens entre les juges et le système politique, tout en accroissant leur responsabilité quant aux décisions qu’ils rendent. Elles comprennent un certain nombre de points qui ont été appréciés positivement par la Commission de Venise, tels que la suppression de la nomination des juges par la Rada ou la réforme du parquet (suppression de la possibilité pour la Rada d’exprimer sa défiance au procureur général ; suppression de ses compétences de supervision non pénales…). La Commission de Venise a toutefois pointé quelques problèmes qui demeurent, notamment le pouvoir de révocation des juges par le président et les conditions de nomination des membres du conseil supérieur de la justice.
3. Un exécutif confronté à la corruption endémique, aux « oligarques » et aux groupes armés radicaux
Il faut par ailleurs observer que les réformes engagées pour rapprocher l’Ukraine des « standards » européens de bonne gouvernance et de lutte contre les dérives telles que la corruption se heurtent à une réalité : le système oligarchique et clientéliste est profondément enraciné en Ukraine depuis près de vingt ans.
Les entreprises contrôlées par les « oligarques » emploient des centaines de milliers d’Ukrainiens ; ils contrôlent les principales télévisions et une partie des autres médias, financent les partis et les campagnes électorales (en l’absence de financement public), voire créent de toutes pièces des nouveaux partis à leur service, conservent toujours de nombreux relais à la Rada et dans les élites politiques et administratives du pays…
Le bras-de-fer entre le pouvoir central et certains oligarques est maintenant engagé : l’un des plus puissants d’entre eux, M. Ihor Kolomoïsky, a été contraint à renoncer à ses fonctions de gouverneur de Dnipropetrovsk le 25 mars 2015, suite à des accusations d’implication dans des activités criminelles concernant son entourage.
La nomination comme gouverneur d’Odessa, le 30 mai 2015, de l’ancien président géorgien Mikheïl Saakachvili, à la place d’un oligarque local réputé proche de M. Kolomoïsky, s’inscrit dans la même démarche. Le programme de M. Saakachvili, inspiré de ses réalisations en Géorgie, vise à simplifier radicalement les démarches administratives (notamment les procédures douanières, Odessa étant le principal port ukrainien) pour tout à la fois faciliter la vie des citoyens et des entreprises et réduire la corruption, tout en économisant des fonds publics avec le limogeage de centaines de fonctionnaires.
Au niveau central, la difficulté du combat contre la corruption et pour une gouvernance vraiment nouvelle est illustrée, on l’a vu, par la démission à l’automne 2015 de plusieurs hauts fonctionnaires d’origine étrangère recrutés pour « mettre de l’ordre », puis par celle, le 3 février 2016, du ministre de l’économie, M. Aivaras Abromavicius, d’origine lituanienne, qui a accéléré la crise politique.
La nécessaire remise en ordre du pays est également compliquée par l’existence de groupes armés paramilitaires et la diffusion des armes dans la société. La guerre dans le Donbass a été largement menée par des bataillons de volontaires souvent financés par des oligarques bien connus. Ils sont certes en cours d’intégration à la garde nationale, mais ce processus est long. En dehors même du Donbass, l’Ukraine compte son lot de groupes nationalistes prêts à faire le coup de poing quand ce n’est pas le coup de feu. En juillet 2015, des affrontements armés ont ainsi éclaté dans la ville de Moukatcheve, en Transcarpathie (Ukraine occidentale), entre des membres du groupe d’extrême-droite Pravy Sektor, une bande locale et la police, les militants de Pravy Sektor expliquant qu’il s’agissait de mettre fin à la contrebande de cigarettes, orchestrée selon eux par des personnalités politiques locales. Cela a conduit à une épreuve de force à Kiev même entre plusieurs milliers de manifestants de Pravy Sektor et le pouvoir central qui a demandé le désarmement des miliciens du groupe.
4. Des risques de dérive du « combat pour les valeurs » et de l’affirmation nationale ?
Le pouvoir ukrainien est aussi amené à faire des concessions aux tendances les plus nationalistes. Certaines mesures prises ou lois adoptées dans cette optique, au nom du « combat pour les valeurs » occidentales, de la rupture avec le passé soviétique et de l’affirmation nationale (contre la Russie), peuvent susciter quelques interrogations.
On se souvient que l’une des premières mesures consécutives à la chute du président Ianoukovytch avait été le vote d’abrogation par la Rada, dès le 23 février 2014, de la loi du 3 juillet 2012 sur les « principes fondamentaux de la politique linguistique de l’État », laquelle donnait une reconnaissance locale aux langues minoritaires dès lors qu’elles étaient parlées par 10 % au moins de la population d’un territoire : cette loi, emblématique de la présidence de M. Ianoukovytch, améliorait le statut du russe, qui devenait une sorte de seconde langue officielle dans toutes les régions partiellement russophones du pays ; elle avait en son temps suscité l’opposition très vive des nationalistes ukrainiens.
Ce vote d’abrogation n’a pas eu d’effet juridique, car le président ukrainien par intérim Olexandr Tourtchinov a refusé de le valider. Mais le mal était fait : la menace d’abrogation de la loi qui reconnaissait les droits linguistiques des russophones a certainement joué un rôle très important dans le déclenchement dans l’est ukrainien des mouvements populaires qui ont finalement conduit au conflit du Donbass.
D’autres lois plus récemment adoptées paraissent, de même, appeler quelques réserves, même si la France n’a guère de leçons à donner quant aux lois « mémorielles », y compris pénales, qui font aussi débat chez nous.
La Rada a ainsi adopté en avril 2015 plusieurs lois mémorielles, que le président Porochenko a promulguées en mai.
L’une d’elles est une loi dite de « décommunisation » (22) qui condamne au même degré le communisme et le nazisme et interdit toutes manifestations, monuments et commémorations rattachés à ces systèmes : si les statues de Lénine ont maintenant pour la plupart été déboulonnées, de nombreuses rues, voire villes, restent à débaptiser en application de cette loi. La représentante de l’OSCE pour la liberté des médias, Mme Dunja Mijatović, a fait le 18 mai 2015 une déclaration critique sur ce texte, craignant que les interdictions vagues et largement définies qu’il comporte n’entravent la liberté d’expression, notamment dans les médias (23).
Une autre de ces lois mémorielles sanctionne désormais durement (jusqu’à cinq ans de prison et la fermeture possible des médias en cause) les « falsifications de l’histoire » concernant les « combattants de l’indépendance ukrainienne au XXème siècle », ce qui vise à protéger la mémoire d’organisations comme l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) et l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), actives durant la Seconde guerre mondiale et dans les années qui ont suivi. Or, si ces groupes ont combattu l’envahisseur nazi (encore que certains de leurs membres soient accusés de collaboration), ils ont également affronté l’Armée rouge et la résistance polonaise. Surtout, ils sont considérés par de nombreux historiens comme coupables, dans le cadre d’opérations de « purification ethnique », du massacre dans les campagnes d’Ukraine occidentale d’au moins plusieurs dizaines de milliers de Polonais, ainsi que de nombreux Juifs, entre 1942 et 1944.
Il faut enfin signaler, dans le climat de nationalisme, le meurtre en avril 2015 de deux journalistes ukrainiens connus pour leurs positions d’opposition, voire pro-russes, MM. Oles Buzina et Sergei Sukhobok, qui a également été condamné par l’OSCE (24).
B. DES RÉFORMES ÉCONOMIQUES SOUS LA DICTÉE DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
1. L’alignement sur « l’acquis communautaire »
Plusieurs dispositions allant dans le sens de l’alignement sur « l’acquis communautaire », tel que l’accord d’association le prévoit, et plus généralement la modernisation de l’économie ont été adoptées en 2014 et 2015 :
– une loi sur les marchés publics, qui n’est cependant pas considérée par les instances européennes comme pleinement compatible avec la législation communautaire, mais est jugée allant dans le bon sens ;
– une loi encadrant les aides publiques aux entreprises ;
– des lois sur les standards, la métrologie, les évaluations de conformité, ainsi que plus généralement une stratégie sur l’évolution du système de réglementation jusqu’en 2018 ;
– une loi sur les banques présentant un risque systémique ;
– des lois sur la sécurité alimentaire et l’identification des animaux ;
– une loi sur les privatisations (futures), destinée à en améliorer la transparence ;
– fin 2015, une réforme fiscale visant notamment à alléger très fortement les charges des entreprises.
2. Les mesures de rigueur budgétaire
Des mesures budgétaires très rigoureuses ont été décidées en 2014 : réduction de 3 % des emplois publics – 20 % pour les fonctions administratives – dès 2015, réduction des pensions des fonctionnaires… Le budget 2015 comprenait des coupes considérables dans les dépenses sociales. La Rada a également adopté un budget sérieux pour 2016, calé sur les exigences des bailleurs de fonds internationaux ; malgré la récession économique très forte, il est ainsi prévu une baisse du déficit budgétaire (à 3,7 % du PIB contre 4,2 % en 2015).
À plus long terme, une réforme du système de retraites, dont le déficit atteint aujourd’hui 2,5 % du PIB, est programmée. De même, la question du déficit chronique massif de l’entreprise nationale Naftogaz a enfin été prise à bras le corps : le prix du gaz à la consommation a augmenté de 285 % en avril 2015 !
On doit naturellement s’interroger sur les conséquences sociales de ces mesures. Dans son discours précité à la Rada du 4 juin 2015, le président Petro Porochenko a envisagé la mise en place d’un système d’indexation des salaires et des pensions sur l’inflation et annoncé le dépôt d’un projet de loi pour aider les plus démunis à faire face à l’augmentation des tarifs des services de base. Au cours de l’été 2015, le programme d’assistance aux ménages démunis a effectivement été fortement étendu.
Par ailleurs, la banque centrale a pris des mesures de contrôle des mouvements internationaux de capitaux.
3. Mais aussi des réformes qui patinent
Dans son rapport de progrès précité, la Commission européenne cite encore un certain nombre de domaines où les choses n’évoluent pas assez vite.
Sur les questions énergétiques également, la mise en œuvre des obligations contractées par l’Ukraine en tant que membre de la Communauté de l’énergie apparaît lente. La crise a même amené le gouvernement à prendre des mesures renforçant le contrôle des approvisionnements, lesquelles ne vont évidemment pas dans le sens de la libéralisation qui est l’axe directeur de la politique communautaire de l’énergie. Il semble que le processus législatif de réforme du marché du gaz (suppression du monopole) soit bien lancé et une nouvelle commission de régulation du secteur de l’énergie a été établie, mais les mesures nécessaires pour garantir son indépendance et ses prérogatives sont en retard. Si un plan national sur les énergies renouvelables a été adopté, il n’existe toujours pas de stratégie globale concernant le changement climatique.
Par ailleurs, le président Porochenko a certes annoncé son intention de privatiser l’essentiel des entreprises publiques, dont seulement 200 – sur 1 800 – auraient vocation à rester publiques, mais ces privatisations ne sont toujours pas vraiment engagées.
Enfin et surtout, la réforme des forces de l’ordre et de la justice reste peu avancée, alors qu’elle conditionne la mise en place d’une action efficace contre la corruption endémique et les abus de toutes sortes. S’agissant des institutions spécifiquement « anti-corruption » dont la création a été décidée en 2014 (bureau national anti-corruption, parquet spécialisé, agence nationale de prévention…), leur mise en place est lente et elles ne sont pas vraiment opérationnelles faute de moyens et de soutien politique. La réforme des services fiscaux et douaniers, pléthoriques et affublés d’une très mauvaise réputation, est une autre priorité, que le nouveau gouvernement en place depuis avril 2016 semble prendre à cœur.
*
D’après des observateurs étrangers, l’économie ukrainienne a atteint son « point bas » en 2015, les indicateurs devenant ensuite un peu moins catastrophiques. Cependant, un véritable redressement ne sera possible que si les incertitudes politiques (crise du Donbass et crise parlementaire à Kiev) sont dépassées et si des résultats significatifs sont obtenus dans la réforme de la justice et de la police, la lutte contre la corruption et les abus des « oligarques », l’assainissement du secteur financier et la réforme du secteur énergétique.
Il faut espérer que le nouveau gouvernement investi en avril 2016, qui s’est donné pour priorité la relance des réformes internes, en particulier celles relatives à la lutte contre la corruption et à la moralisation de la vie publique, obtiendra les résultats attendus.
DEUXIÈME PARTIE : LA RUSSIE, UN PARTENAIRE DIFFICILE MAIS INCONTOURNABLE
Après avoir pris progressivement ses distances, dans les années 2000, vis-à-vis d’un « camp occidental » qu’elle identifiait de plus en plus comme uni dans une forme d’hostilité à son égard et porteur de valeurs différentes, la Russie s’est lancée à partir de 2014 dans une politique étrangère « décomplexée » de puissance, parfois agressive. Cela a été, successivement, l’annexion de la Crimée, le soutien aux séparatistes du Donbass, l’intervention militaire en Syrie.
Avant de revenir sur les ressorts de ces choix qui isolent, au moins en partie, la Russie, votre rapporteur pense qu’il est utile de se poser la question des moyens dont dispose le pays pour cette nouvelle politique de puissance.
I. QUELS MOYENS POUR LA NOUVELLE AFFIRMATION INTERNATIONALE DE LA RUSSIE ?
S’agissant des déterminants de la puissance russe, certains sont inscrits dans l’histoire et la géographie et demeureront. Mais les moyens du pays pourraient être amoindris du fait de ses difficultés économiques, liées à un statut de superpuissance pétrolière et gazière qui signifie richesse et influence, mais aussi dépendance à un seul type d’exportations et donc fragilité.
A. DES FACTEURS DE PUISSANCE QUI RESTENT
1. Le territoire et, dans une moindre mesure, la population
La Russie a conservé la plus grande part du territoire de l’URSS – 17 millions de km2 sur 22 millions –, bien que la fin de l’URSS ait souvent ramené le pays à ses frontières du XVIIème ou du XVIIIème siècles :
– le rattachement définitif de Kiev (aujourd’hui capitale de l’Ukraine indépendante) à l’empire russe remontait à 1686 ;
– celui des rives de la Baltique, comprenant les territoires actuels de l’Estonie et d’une grande partie de la Lettonie, avait été acté en 1721 ;
– c’est dans le dernier tiers du XVIIIème siècle que la Russie, avec les partages successifs de la Pologne et les victoires contre l’empire Ottoman, avait pris le contrôle de ce qui allait devenir les territoires de l’Ukraine occidentale et méridionale (y compris la Crimée en 1792), de la Biélorussie et de la Lituanie, tout en commençant à coloniser les contreforts septentrionaux du Caucase et à exercer un protectorat sur la Géorgie, qui sera annexée en 1801. La conquête des régions caucasiennes et de l’Asie centrale s’est poursuivie au XIXème siècle.
La Russie actuelle détient plus de 11 % des terres émergées du monde et reste le pays le plus vaste, loin devant le Canada, les États-Unis et la Chine (qui tous les trois approchent les 10 millions de km2).
Cet immense territoire place la Russie aux confins de l’Europe occidentale, mais aussi du Moyen-Orient et de l’Asie orientale. Elle jouxte donc deux des foyers majeurs de l’activité économique, ainsi que la région du monde qui reste l’épicentre de la plupart des tensions internationales.
Si la Russie est peu densément peuplée et a une démographie fragile, elle n’en conserve pas moins la 9ème population mondiale.
Les dix premiers pays du monde par la population
(pour 2015, en millions)
1 |
Chine |
1 375 |
2 |
Inde |
1 293 |
3 |
États-Unis |
321 |
4 |
Indonésie |
255 |
5 |
Brésil |
204 |
6 |
Pakistan |
190 |
7 |
Nigeria |
179 |
8 |
Bangladesh |
160 |
9 |
Russie |
146 |
10 |
Japon |
127 |
Source : base de données du FMI, données d’octobre 2015.
Dans l’espace européen, la Russie, même en s’en tenant à la seule « Russie d’Europe » (à l’ouest de l’Oural), est le pays le plus vaste et le plus peuplé. En effet, avec 146 millions d’habitants au total, dont les trois quarts vivant en « Russie d’Europe », elle devance largement l’Allemagne (82 millions), la Turquie, si on la considère européenne (78 millions), la France, le Royaume-Uni et l’Italie (toutes les trois entre 66 et 60 millions).
2. Les reliquats de la superpuissance soviétique
a. Le statut international hérité de la victoire de 1945
Parmi les attributs de la puissance que la Russie a reçus en héritage de l’Union soviétique, il y a d’abord le statut international tel qu’il a été fixé en 1945 – en particulier, l’appartenance au groupe des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations-Unies, dotés du droit de veto.
b. La parité de l’armement nucléaire stratégique avec les États-Unis
Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité sont aussi devenus, on le sait, les cinq puissances nucléaires « traditionnelles », dont deux, les États-Unis et l’Union soviétique, s’étaient lancées dans une course aux armements forcenée qui les a conduites à développer des arsenaux nucléaires énormes et à peu près équivalents.
La Russie, ayant conservé l’arsenal soviétique, a veillé, malgré ses difficultés économiques et budgétaires énormes des années 1990, à maintenir une forme de parité avec les États-Unis dans ce domaine. La modernisation de l’armement nucléaire reste aujourd’hui une priorité.
Il est évidemment assez difficile de connaître le nombre d’armes nucléaires détenues par les différents pays, mais, si l’on recoupe les évaluations, il apparaît que les États-Unis et la Russie conserveraient chacun plus de 2 000 têtes nucléaires opérationnelles (et environ 10 000 en comptant celles qui ne sont pas directement placées sur des lanceurs), quand ce nombre serait au maximum de 300 pour chacune des autres puissances nucléaires avérées (Chine, France, Royaume-Uni, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord, laquelle a tout au plus une poignée d’armes).
Dès les années 1960, les deux superpuissances avaient également développé un dialogue exclusif sur la limitation de ces arsenaux. Ces négociations dites « SALT » puis SALT 2 », puis « START », qui ont débouché sur une série de traités bilatéraux successifs, se sont poursuivies entre les États-Unis et la Russie après 1991, même si elles ont dès lors suscité moins d’attentes et de craintes que n’en suscitaient les discussions américano-soviétiques à l’apogée de la Guerre froide. C’est ainsi avec la Russie que les États-Unis ont signé en 1993 le traité « START 2 », qui n’a jamais été appliqué du fait des divergences des deux puissances sur la défense anti-missile, puis en 2002 le traité « SORT », enfin en avril 2010 le « nouveau traité START », ces traités prévoyant des réductions successives et paritaires des arsenaux stratégiques des deux parties.
Tant pour les moyens disponibles que pour la diplomatie particulière que leur existence entraîne, la Russie s’inscrit donc dans l’exacte continuité de la superpuissance soviétique en ce qui concerne l’armement nucléaire.
3. Une puissance militaire restaurée
La superpuissance militaire dans le domaine conventionnel était un autre attribut de l’Union soviétique, du moins sur le papier lorsque l’on comparait les effectifs et les matériels du Pacte de Varsovie et de l’OTAN. C’est l’époque où l’on spéculait sur le petit nombre de jours, voire d’heures, qu’il faudrait aux chars soviétiques pour submerger les défenses de l’OTAN.
La vérité était peut-être différente. Toujours est-il qu’à la fin de l’URSS, puis dans les années qui ont suivi, la réalité de la puissance de l’ex-Armée rouge a été durement mise en cause : elle a été confrontée à un sous-investissement massif, dans le contexte des très grandes difficultés économiques du moment, et son image a été dégradée par la publicité donnée, avec l’ouverture démocratique, à ses dysfonctionnements internes (corruption, mauvais traitements infligés aux appelés).
Plus généralement, l’inadaptation aux défis contemporains d’une armée de masse, reposant toujours sur la conscription, est apparue au grand jour. Les années 1990 ont aussi été marquées par les guerres de Tchétchénie, où l’armée russe a été pour le moins peu convaincante. Pour vaincre des combattants redoutables, certes, mais représentant une petite région séparatiste, la Russie a dû payer un prix humain et moral considérable : deux guerres (1994-1996 et 1999-2000), soit plusieurs années de combats ; entre 4 700 et 12 000 soldats russes tués, selon les estimations divergentes, durant la seconde guerre ; et surtout l’emploi de méthodes de « guerre totale » inacceptables (bombardements massifs – Grozny a été rasé –, probablement 100 000 à 300 000 civils tués pour un million d’habitants, enlèvements, torture et exécutions extrajudiciaires des opposants présumés…).
a. Une armée qui a retrouvé son efficacité
Les choses ont cependant changé depuis lors et la capacité militaire apparaît à nouveau comme un élément central de la puissance russe.
Au bilan lamentable des guerres de Tchétchénie et mitigé de celle de Géorgie en 2008, on peut opposer la remarquable réussite, techniquement parlant, du « coup » de Crimée les 26-27 février 2014 : l’occupation en quelques heures, sans violence, de tous les lieux stratégiques de la péninsule par ces militaires sans insignes que l’on a appelé les « hommes en vert » ou les « hommes polis ».
Dans le Donbass, l’appui apporté par les militaires russes – là-aussi pas officiellement présents – a permis aux séparatistes de reprendre durant l’été 2014 une grande partie du terrain qu’ils avaient dû céder face à l’offensive de l’armée ukrainienne.
L’année suivante, 2015, aura enfin vu, avec la campagne aérienne en Syrie, le lancement de la première opération militaire de la Russie hors des frontières de l’ex-URSS (hormis quelques participations très limitées à des opérations onusiennes) depuis le désastre d’Afghanistan dans les années 1980. Cette opération a été l’occasion de montrer au monde les nouvelles capacités militaires de la Russie, avec par exemple l’usage de bombardiers stratégiques décollant de son territoire pour bombarder la Syrie ou de tirs de missile à longue portée depuis des navires déployés en mer Caspienne, ou encore l’implication de ses forces spéciales dans la reprise de Palmyre contre Daesh…
b. Une armée réformée et bénéficiant d’investissements massifs
Après la guerre de Géorgie de 2008, certes gagnée, mais contre un adversaire faible et avec des insuffisances opérationnelles, la Russie a lancé un plan massif de remise à niveau de sa défense, tout en réformant complétement ses concepts stratégiques (25) : la doctrine de sécurité nationale a cessé de privilégier l’hypothèse d’une guerre conventionnelle de grande ampleur, qui exigerait une mobilisation générale, pour envisager plutôt celle de conflits locaux localisés dans l’« étranger proche ». Pour cela, il a été décidé de se doter d’unités moins nombreuses, mais plus professionnalisées, plus mobiles et en état d’alerte permanent, bref plus opérationnelles. La priorité est notamment donnée aux forces aéroportées (avec une volonté déclarée d’en doubler les effectifs d’ici 2020), aux forces spéciales et à la défense anti-aérienne. Les exercices et les inspections ont été multipliés…
Les effectifs ont été drastiquement réduits, puisque l’on est passé de 4 à 5 millions d’hommes du temps de l’URSS, et encore 2,1 millions en 1994, à 0,8 million aujourd’hui.
Le service militaire n’a pas été supprimé, mais sa durée a été ramenée à un an. Depuis 2015, les conscrits sont moins nombreux dans l’armée russe que les engagés volontaires. Les rémunérations des soldats de métier ont été largement revalorisées, ce qui facilite le recrutement et élève le niveau (il semble qu’en 2014, pour la première fois, le nombre de candidats à l’engagement volontaire ait dépassé le nombre de postes offerts, permettant une sélection).
C’est au fond, avec un certain retard, une évolution assez comparable à celle des armées occidentales après la fin de la Guerre froide.
Par ailleurs, des investissements considérables ont été engagés : le budget de la défense a doublé, en roubles, de 2011 à 2015. Dans cet ensemble, les moyens d’équipement ont pratiquement quintuplé de 2008 à 2014.
En conséquence, comme l’indique le graphique ci-dessous, la Russie est désormais le 3ème ou le 4ème pays au monde pour le montant des dépenses militaires, derrière (et certes loin) les États-Unis et la Chine, mais sensiblement au niveau de l’Arabie Saoudite (derrière la Russie en 2014, mais devant en 2015) et devant les deux autres membres permanents du Conseil de sécurité, la France et le Royaume-Uni, ou encore l’Inde.
Part dans les dépenses militaires mondiales des quinze premiers pays pour ces dépenses (2014)
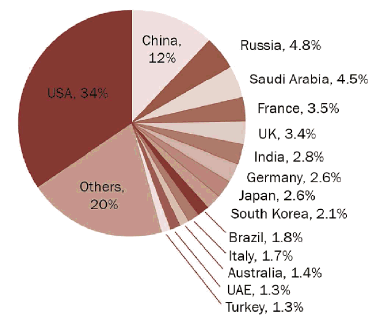
Source : SIPRI.
La Russie fait également partie du petit groupe des pays consacrant plus de 4 % de leur PIB aux dépenses militaires, présenté sur le graphique ci-après.
Pays consacrant aux dépenses militaires plus de 4 % de leur PIB
(en % du PIB)
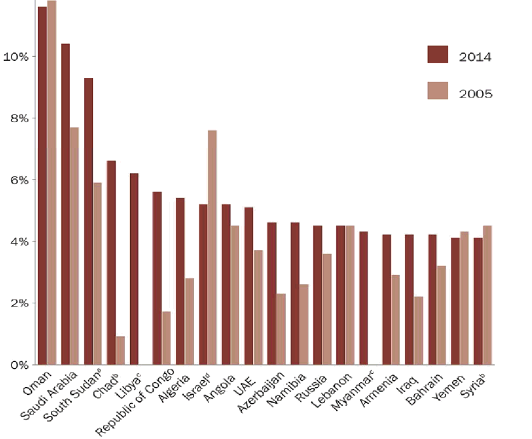
Source : SIPRI.
L’analyse de la composition de ce groupe des pays qui dépensent beaucoup pour leur défense en pourcentage de leur PIB est intéressante. On voit qu’il s’agit essentiellement de pays en situation de guerre civile (Libye, Irak, Syrie, Yémen, Soudan du Sud…), de pays qui affrontent le terrorisme ou des guérillas locales (Algérie, Myanmar, Liban…) ou de pays en situation de conflit constant, même s’il est plus ou moins « gelé », avec un ou plusieurs voisins (Israël, Arménie, Azerbaïdjan…). Pour le reste, ce groupe comprend les pétromonarchies du Golfe, qui ont des moyens financiers considérables et sont dans un environnement régional effectivement très inquiétant, et la Russie.
La Russie est donc la seule « grande puissance » et l’un des rares pays à consentir un tel niveau d’effort de défense alors qu’il n’est pas sous la menace directe et massive, en toute objectivité, de voisins agressifs, de groupes terroristes ou de rebelles armés.
c. L’importance des exportations d’armements
Le haut niveau d’investissements militaires, soutenant le complexe militaro-industriel, permet aussi à la Russie de rester un très gros exportateur d’armements. D’après le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), la Russie a été sur la période 2010-2014 le deuxième exportateur mondial, avec 27 % du total mondial, juste derrière les États-Unis (31 % du total), loin devant la Chine, l’Allemagne et la France (à environ 5 % du marché mondial chacune). Ces exportations russes ont augmenté de 37 % entre 2005-2009 et 2010-2014.
En 2014, les ventes russes en la matière ont été, selon des estimations divergentes, de 10 à 13 milliards de dollars. Elles constituent donc, comme pour la France, un apport significatif au commerce extérieur russe.
Les ventes d’armes sont aussi l’un des outils de la diplomatie russe qui lui permet d’entretenir des liens étroits avec certains partenaires. Elles semblent en effet assez concentrées sur quelques pays, pour lesquels la Russie est souvent un fournisseur très prédominant. D’après le SIPRI, sur 2010-2014 :
– trois pays, Inde, Chine et Algérie, auraient absorbé 60 % des exportations russes d’armements ;
– la Russie aurait fourni 70 % des importations d’armements de l’Inde et 61 % de celles de la Chine.
B. MAIS UNE ÉCONOMIE FRAGILISÉE
1. La récession, après la croissance forte des années 2000
Les années consécutives à la fin de l’URSS avaient été marquées par un véritable effondrement économique, suivi d’un retour à une croissance forte qui a accompagné les premières années du président Poutine – arrivé au pouvoir en 1999 – à la tête de l’exécutif. De 2000 à 2008, la croissance moyenne a été de 7 % par an, ce qui a conduit à une augmentation de plus de 80 % du PIB en neuf ans. Cette croissance a été permise par la remise en ordre du pays à laquelle il a été procédé, mais aussi et surtout par l’évolution des cours internationaux des hydrocarbures (le prix du baril de pétrole étant passé du début des années 2000 à 2008 de moins de 30 dollars à près de 100 dollars) et l’augmentation régulière de la production russe d’hydrocarbures.
Ensuite, si la crise financière a durement été ressentie en Russie (7,8 % de récession en 2009), les années 2010 et 2011 ont été marquées par une bonne reprise, avec une croissance annuelle supérieure à 4 %, avant que la machine ne se grippe.
En effet, l’économie russe est graduellement rentrée, à partir de 2012, en ralentissement (1,3 % de croissance en 2013 ; 0,7 % en 2014), puis a connu une brutale dégradation : le PIB russe a reculé de 3,7 % en 2015. L’année 2016 devrait aussi être une année de récession, dont l’ampleur dépendra principalement de l’évolution des cours des hydrocarbures (le FMI, dans ses dernières prévisions de mai 2016, anticipe une récession de 1,5 % ; la banque centrale russe a fait état d’une fourchette de 1 % à 3 % de récession selon la conjoncture pétrolière).
2. L’héritage des années de croissance : des équilibres macro-économiques solides
Même si l’économie russe est aujourd’hui en difficulté, elle conserve certains atouts structurels construits pendant la période antérieure en matière de fondamentaux économiques :
– certes un assez fort déficit des finances publiques en 2015 (3,5 % du PIB) et un budget 2016 déjà mis à mal par la baisse des cours du pétrole (le budget a été conçu avec un déficit de 3 %, mais sur la base d’un baril de pétrole à 50 dollars, et non aux alentours de 30 ou 40 dollars ; le FMI, dans ses dernières prévisions, anticipe un déficit public pour 2016 atteignant 4,4 % du PIB) ;
– mais, ce déficit venant après des années d’excédents ou de faibles déficits budgétaires, un endettement public limité (en-deçà de 20 % du PIB) – le déficit public restant financé par le fonds public de réserve, lequel pourrait toutefois être épuisé d’ici la fin 2016 ;
– grâce aux exportations d’hydrocarbures et malgré la baisse des cours, une balance des transactions courantes qui reste confortablement excédentaire (l’excédent représentant 4 % à 5 % du PIB).
La Russie n’est donc pas un pays « en faillite ».
3. Les facteurs des difficultés actuelles
a. Un facteur conjoncturel massif : la baisse des cours internationaux des hydrocarbures
Les exportations de la Russie reposent massivement sur les hydrocarbures : pétrole, gaz et produits pétroliers raffinés en ont représenté en 2014 plus de 72 %, pour un montant de 288 milliards de dollars, la Russie étant le deuxième exportateur mondial de ces produits, juste derrière l’Arabie Saoudite et devant les États-Unis. Les métaux et produits métalliques constituent le second poste des exportations de la Russie (8,1 % du total de celles-ci).
Les hydrocarbures fourniraient également environ la moitié des ressources budgétaires selon les chiffres communément admis.
L’aggravation brutale de la situation économique du pays est donc d’abord imputable à l’effondrement des cours internationaux du pétrole qui a débuté à la mi-2014 et a ramené le prix moyen international du baril de plus de 100 dollars à moins de 50 dollars, avec même un point bas vers 27 dollars début 2016, suivi depuis lors d’un relatif redressement, puisque l’on est revenu en juin 2016 aux alentours de 50 dollars.
Sur les marchés du gaz, également stratégiques pour la Russie, la situation est plus complexe, car les flux existants sont conditionnés par l’existence d’infrastructures lourdes (gazoducs ou installations de liquéfaction, réservoirs de stockage) : les contrats sont donc passés à long terme et les différents marchés restent en partie déconnectés (par exemple, le gaz est beaucoup moins cher que partout ailleurs en Amérique du Nord depuis 2009 du fait de la production massive de « gaz de schiste »). Cependant, la baisse du pétrole ne peut à terme que se répercuter sur le gaz, notamment le gaz russe, et les signes sont déjà là :
– les indices relatifs au prix moyen d’importation du gaz en Allemagne (ce pays étant le premier acheteur de gaz russe) et au prix de gros du gaz au Royaume-Uni ont respectivement baissé de 15 % et 23 % de 2013 à 2014 (26) ;
– depuis début 2015, les prix du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie, qui demeuraient très élevés (suite à l’accident de Fukushima qui a amené le Japon à augmenter massivement ses importations d’hydrocarbures), ont pratiquement étaient divisés par deux, du fait de l’indexation de nombreux contrats à long terme sur les prix du pétrole !
b. Des difficultés accompagnées et accentuées par l’effondrement interne du crédit
Après la crise financière de 2009, la reprise économique russe avait été très largement portée par le développement du crédit à la consommation, quasi-inexistant auparavant. Mi-2012, on était ainsi sur un rythme annuel d’augmentation de 60 % de la distribution de crédits. La banque centrale a ensuite pris des mesures de restriction et les taux d’intérêt ont augmenté.
Les chocs conjoncturels des hydrocarbures et de la crise ukrainienne sont venus accentuer la tendance au repli de l’activité de crédit, ce repli accentuant à son tour les difficultés. Au premier semestre 2015, on constatait ainsi une baisse de 80 % de la production de crédit sur certains segments (crédits consommation…), l’activité de prêts hypothécaires ayant quant à elle perdu 40 % en glissement annuel (27).
c. Les effets réels mais difficiles à quantifier de la crise politique avec l’Occident et des sanctions et contre-sanctions
La responsabilité de la crise politique provoquée par les événements d’Ukraine, et plus particulièrement des sanctions économiques adoptées par les pays occidentaux à l’encontre de la Russie à partir de 2014 (28), dans les difficultés actuelles de ce pays est une question complexe. Il est clair que la Russie subit d’abord l’effet de la baisse des cours des hydrocarbures, mais, selon certaines analyses, il ne faut pas négliger l’impact des sanctions et plus généralement de la perte de confiance des investisseurs face aux risques d’une politique étrangère aventureuse.
Selon le FMI (29), l’impact des sanctions (et contre-sanctions prises par la Russie) sur le PIB russe pourrait à court terme être de 1 % à 1,5 %. À moyen terme, si les sanctions se prolongeaient, la perte cumulée de richesse nationale pourrait atteindre 9 % du PIB selon la même source ! Selon la Commission européenne, les sanctions imposées par l’Union (sans tenir compte des sanctions imposées par les États-Unis et d’autres alliés et partenaires) auraient un impact négatif de – 0,6 % sur la croissance du PIB russe en 2014, puis de – 1,1 % en 2015 (contre 0,2 % à 0,3 % sur le PIB communautaire).
Les sanctions occidentales frappent la Russie par plusieurs canaux :
– en renchérissant fortement le coût du crédit en Russie, du fait de l’interdiction faites aux banques publiques russes et à certaines grandes entreprises, notamment du secteur énergétique, de se financer sur les marchés occidentaux ;
– en réduisant la confiance internationale dans l’économie russe (d’où notamment la baisse du rouble, la hausse des taux d’intérêts exigé par les créanciers…) ;
– en impactant les exportations russes (avec une réduction des exportations de la Russie vers l’Union européenne estimée à 4 %, soit 2 % des exportations totales de la Russie) ;
– en obligeant l’industrie militaire russe à renoncer à certaines productions et exportations pour lesquelles elle dépendait de composants importés des pays occidentaux (désormais interdits de vente à la Russie) ;
– à terme, en pesant sur la capacité du pays à maintenir et développer sa production pétrolière (avec l’interdiction de la vente de certaines technologies dans ce domaine), dont l’avenir repose sur des gisements difficiles à exploiter, notamment parce que situés off-shore et/ou dans le grand nord, pour lesquels le pays a besoin des technologies occidentales.
Par ailleurs, l’embargo russe décidé à titre de contre-sanction sur diverses importations alimentaires serait, d’après des analyses de l’administration russe elle-même, responsable du tiers de l’inflation élevée actuelle : les importations depuis les pays sanctionnés n’ont pas pu être totalement substituées par d’autres sources d’approvisionnement ou l’ont été à des coûts plus élevés.
d. Les problèmes structurels récurrents de l’économie russe
Conjoncturellement, la récession russe actuelle est donc due à la baisse des cours des hydrocarbures et dans une moindre mesure aux conséquences de la crise politique avec les pays occidentaux.
Mais, plus fondamentalement, elle illustre aussi les insuffisances structurelles de l’économie russe, lesquelles expliquent sa dépendance aux exportations pétrolières et gazières, donc sa sensibilité aux cours du pétrole. En effet, les produits industriels et services russes restent en général peu compétitifs sur les marchés internationaux, ce qui explique la prépondérance des exportations primaires (hydrocarbures et matières premières). Sur les marchés mondiaux des biens et services technologiques, la Russie n’est puissante que dans quelques « niches », comme les armements (voir supra), le nucléaire civil – fin 2014, Rosatom revendiquait plus de 100 milliards de dollars de commandes étrangères, correspondant à 23 réacteurs –, ou encore certains logiciels (avec 7 milliards de dollars d’exportations en 2015).
L’OCDE a publié en janvier 2014 une étude économique consacrée à la Russie (30) qui recensait un certain nombre de ces problèmes structurels. Ce document a l’intérêt d’avoir été rédigé alors que l’économie russe connaissait un ralentissement, mais avant la crise actuelle. Il met en exergue les faiblesses suivantes :
– dans les années 2000, l’évolution de la productivité du travail n’a pas suivi la croissance du PIB russe ; cette productivité reste trois fois moins élevée que dans les pays les plus avancés (moyenne de la moitié supérieure des pays de l’OCDE) ;
– l’efficacité énergétique reste très faible, entraînant un formidable gâchis de combustibles (et donc des rejets excessifs de CO2 contribuant à l’effet de serre). L’intensité énergétique, mesurée par la quantité d’énergie nécessaire pour produire une quantité donnée de PIB, donc de biens divers, est plus que médiocre en Russie : il y faut trois fois plus d’énergie qu’en France ou en Allemagne pour y produire la même quantité de richesse (unité de PIB) !
– le degré des inégalités est très élevé, qu’il s’agisse de la répartition des revenus entre les individus ou des inégalités régionales (mesurées par la dispersion des PIB par habitant selon les régions). Dans les indicateurs d’inégalités, la Russie n’est surpassée en général que par une poignée de pays tels que l’Afrique du Sud et des pays latino-américains ;
– la situation démographique est défavorable ;
– la corruption reste endémique, y compris dans le système judiciaire ;
– le poids de l’État dans l’économie, à travers le degré de réglementation des marchés et la puissance des entreprises publiques, reste très élevé ;
Poids des entreprises publiques parmi les dix plus grandes entreprises des pays
(en %)
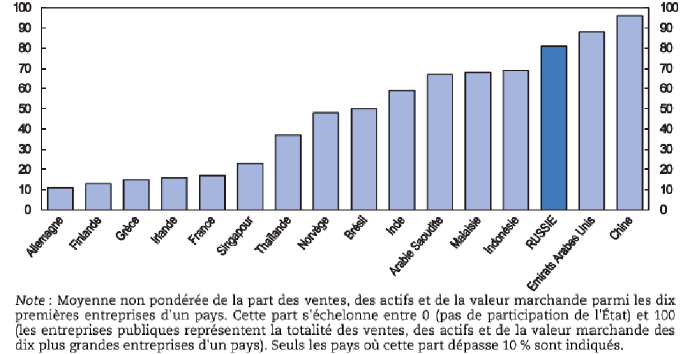
– les PME ne représentent en Russie que 25 % de l’emploi, contre en moyenne 50 % dans les pays de l’OCDE ;
– des mesures protectionnistes limitent encore le commerce extérieur et les investissements étrangers ;
– les infrastructures de transport sont médiocres.
D’autres indicateurs internationaux recoupent ces observations.
● Les statistiques comparatives montrent que le taux moyen d’investissement dans l’économie, facteur déterminant de croissance future, est plutôt faible en Russie : il est comparable à celui des vieux pays industriels (mais traditionnellement les pays à fort PIB par habitant ont un taux d’investissement plus faible) et très en-deçà de celui des grands pays asiatiques.
Taux d’investissement (rapporté au PIB) en 2016, pour les quatorze premières économies mondiales
(en %)
Chine |
41,8 |
Inde |
32,8 |
Corée du Sud |
26,9 |
Australie |
25 |
Canada |
23,2 |
Japon |
21,8 |
Russie |
21,3 |
Espagne |
20,9 |
États-Unis |
20,4 |
France |
20,4 |
Allemagne |
19,2 |
Brésil |
19,1 |
Royaume-Uni |
18,1 |
Italie |
16,8 |
Source : base de données du FMI – données d’avril 2016.
● Les statistiques sur le développement du crédit, qui est consubstantiel au fonctionnement des économies modernes, montrent de même un certain retard russe, par exemple en comparaison des autres pays « BRIC » : le taux de pénétration (crédits) ne s’élevait qu’à 57,5 % du PIB en Russie fin 2014, contre 169 % en Chine, 108 % au Brésil et 75 % en Inde (31).
● Dans le dernier classement Doing Business 2016 de la Banque mondiale, censé évaluer l’adéquation de l’environnement législatif et réglementaire des pays au développement des entreprises, la Russie n’est classée que 51ème sur 189, même si c’est un gain de onze places par rapport à l’année précédente.
● Selon le Competitiveness Report 2015-2016 du World Economic Forum, la Russie arriverait au 45ème rang mondial sur 140 pays pour la compétitivité globale. En regardant dans le détail, on voit que le score de la Russie est quelque peu amélioré par la taille considérable de son marché intérieur, mais qu’elle est très médiocrement classée sur d’autres critères tels que le fonctionnement du système financier ou celui des institutions.
● S’agissant de la corruption, la Russie obtient dans le classement 2015 sur la « corruption perçue » de Transparency International un 119ème rang mondial (sur 168) qui la classe derrière les autres pays « BRICS » (l’Afrique du Sud étant 61ème, le Brésil et l’Inde 76èmesex-aequo et la Chine 83ème).
4. Les conséquences des difficultés actuelles
a. Un appauvrissement du peuple russe
En 2015, les salaires réels (inflation déduite) auraient diminué en moyenne de 9,5 %. En glissement annuel, la perte de pouvoir d’achat des ménages était évaluée à 10,9 % en octobre 2015. La part de la population vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de près de moitié depuis fin 2014 : près de 23 millions de Russes, soit plus de 15 % de la population, sont concernés.
Le chômage reste toutefois modéré (selon le FMI, 6,5 % des actifs en 2016 contre 5,2 % en 2014, mais c’était plus de 10 % en 2000), sans doute du fait du contexte démographique de pénurie de main d’œuvre russe et de la priorité donnée, dans les entreprises, au licenciement des salariés étrangers (venus d’Asie centrale et du Caucase), souvent en situation irrégulière.
De plus, comme en 2014, ce pourraient être 150 000 à 200 000 Russes qui auraient en 2015 quitté leur pays pour s’établir en Europe occidentale ou en Amérique du nord.
Des personnalités auditionnées par la mission ont toutefois mis en avant la résilience du peuple russe face aux problèmes économiques. Les Russes ont connu dans les années 1990 une catastrophe économique sans commune mesure avec la situation actuelle, puis une récession brève mais brutale après la crise financière de 2008. Ils savent donc s’adapter, mieux sans doute que les habitants de l’Europe de l’ouest, à la crise en acceptant des restrictions drastiques de leur train de vie – c’est l’autre versant de la culture de l’« argent facile » qui les amenait à dépenser sans compter et sans économiser pendant les années de croissance.
b. Une large perte de confiance dans la monnaie et l’économie russes, qui pèse sur les flux de financement
Mi-juin 2016 par rapport à janvier 2014, le rouble russe avait perdu près de 50 % de sa valeur face au dollar et près de 40 % face à l’euro.
Comme l’illustrent les deux courbes infra, les évolutions de la devise russe sont étroitement corrélées au cours international du pétrole : l’une et l’autre ont commencé à plonger en juillet 2014, pour atteindre un premier point bas en janvier 2015, avant un redressement relatif jusqu’en mai 2015, une nouvelle dégradation durant l’été, une très légère reprise en octobre, une nouvelle baisse depuis lors, enfin une petite reprise en ce printemps 2016.
Évolution du taux de change rouble/dollar sur deux ans
En dollars pour un rouble
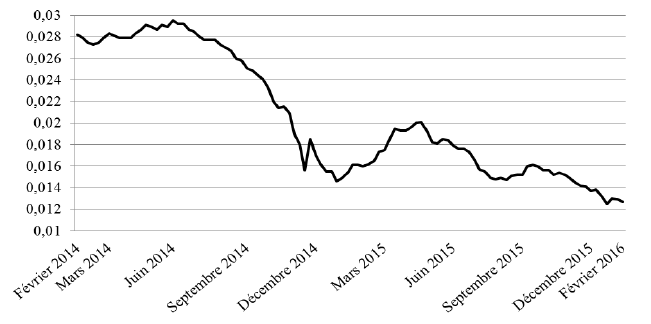
Évolution du cours du pétrole « Brent » sur deux ans
(moyenne mensuelle à Londres)
En dollars
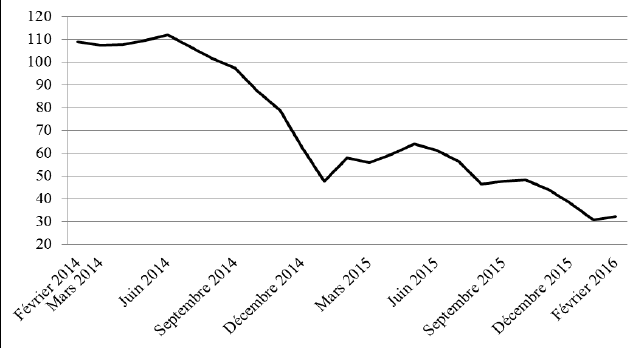
Source : ministère de l’environnement.
Cette dépréciation du rouble gomme certes certains effets de la baisse des cours internationaux du pétrole (exprimés en roubles, ceux-ci se maintiennent : les pouvoirs d’achat internes des producteurs d’hydrocarbures, et donc de l’État qui les taxe, sont ainsi préservés), ce pourquoi la banque centrale l’a acceptée en renonçant à défendre sa monnaie. Mais elle renchérit aussi considérablement les importations.
Par ailleurs, la dépréciation pourrait avoir un effet dévastateur sur les entreprises et ménages endettés en devises étrangères. Heureusement, la part de ces crédits « dollarisés » reste minoritaire en Russie (environ 25 % du portefeuille de crédits) et les ménages, notamment, sont très peu concernés.
Les capitaux fuient la Russie : les flux sortants nets sont passés de 61 à 154 milliards de dollars (soit près de 10 % du PIB) de 2013 à 2014. Les réserves de change s’effritent : elles sont tombées de 510 à 354 milliards de dollars de fin 2013 à avril 2015. S’agissant des investissements directs étrangers, qui sont une composante des mouvements de capitaux et sont très importants pour la croissance future et la modernisation de l’économie, les flux entrant en Russie nets des désinvestissements sont passés, selon la banque centrale de Russie, de 69 milliards de dollars en 2013 à 23 milliards en 2014 et à peine plus d’un milliard sur les trois premiers trimestres de 2015.
Enfin, l’inflation, nourrie notamment par la baisse du rouble, mais aussi par les embargos décidés par la Russie contre certains produits agricoles occidentaux (et désormais également turcs), a dépassé 15 % en 2015 (contre 5 % à 7 % en moyenne précédemment).
c. Une perte de « rang » parmi les puissances économiques
La récession en cours et surtout la dépréciation du rouble ont fait reculer la Russie dans la hiérarchie des grandes économies mondiales : dans les comparaisons de PIB au taux de change nominal, elle n’occupe plus que le 14ème rang et est dépassée par des pays tels que le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, l’Espagne et l’Australie. Les prévisions actuelles à échéance de cinq ans (2021) ne donnent pas un résultat très différent, même si la Russie pourrait regagner une ou deux places dans ce palmarès.
Certes, une analyse dite en parité de pouvoir d’achat conduirait à un résultat plus favorable à la Russie, mais l’analyse au taux de change nominal rend sans doute mieux compte de la puissance économique, car, si elle est inexacte pour mesurer la réalité des productions nationales et des pouvoirs d’achat comparés de leurs habitants, elle permet en revanche d’apprécier le « pouvoir d’achat international » des États : qu’il s’agisse d’importer ou d’exporter des biens divers, d’apporter des contributions internationales à des organisations ou à des alliés, d’accumuler des réserves de change, d’émettre ou d’acquérir des titres de dette sur les marchés internationaux, tout cela se fait en devises (et d’abord, toujours, en dollars) acquises au taux de change nominal…
Évolution des PIB totaux des quatorze premières économies mondiales, au taux de change nominal, selon le FMI
(en milliards de dollars américains)
Rangs (2016) |
2016 (prévision) |
2021 (prévision) | |
1 |
États-Unis |
18 558 |
22 766 |
2 |
Chine |
11 383 |
17 762 |
3 |
Japon |
4 413 |
4 895 |
4 |
Allemagne |
3 468 |
4 066 |
5 |
Royaume-Uni |
2 761 |
3 374 |
6 |
France |
2 465 |
2 895 |
7 |
Inde |
2 289 |
3 660 |
8 |
Italie |
1 849 |
2 092 |
9 |
Brésil |
1 535 |
1 829 |
10 |
Canada |
1 462 |
1 804 |
11 |
Corée du Sud |
1 321 |
1 629 |
12 |
Espagne |
1 242 |
1 476 |
13 |
Australie |
1 201 |
1 536 |
14 |
Russie |
1 133 |
1 608 |
Source : élaboré à partir d’extractions de la base de données du FMI, données d’avril 2016.
La présentation de ces données sous forme de graphique, ci-dessous, fait apparaître le poids écrasant des deux premières économies mondiales, États-Unis et Chine, derrière lesquelles se pressent en rangs serrés des économies de puissance plus moyenne.
Évolution des PIB totaux des quatorze premières économies mondiales, au taux de change nominal, selon le FMI
(en milliards de dollars américains)
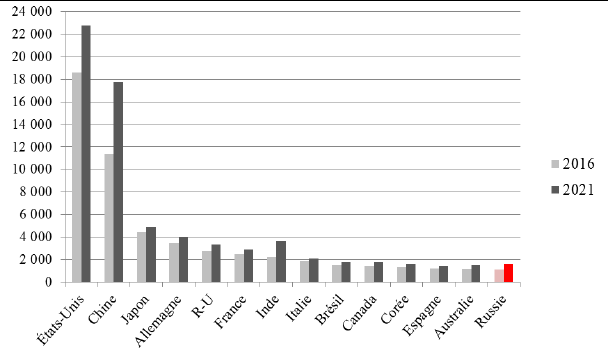
d. Un manque de confiance pour les années qui viennent
Les perspectives économiques de la Russie ne sont en général pas considérées comme brillantes à court/moyen terme. Selon les dernières prévisions du FMI, la croissance annuelle moyenne du pays sur la période 2016-2021 pourrait être de l’ordre de 0,7 %, ce qui le classerait en « queue de peloton » des principales économies mondiales, loin derrière non seulement les grands pays asiatiques émergents, mais aussi les pays industrialisés traditionnels, à l’exception du Japon, comme le graphique ci-après le montre.
Taux de croissance annuel moyen du PIB sur 2016-2021 : prévisions du FMI pour les quatorze premières économies mondiales
(en %)
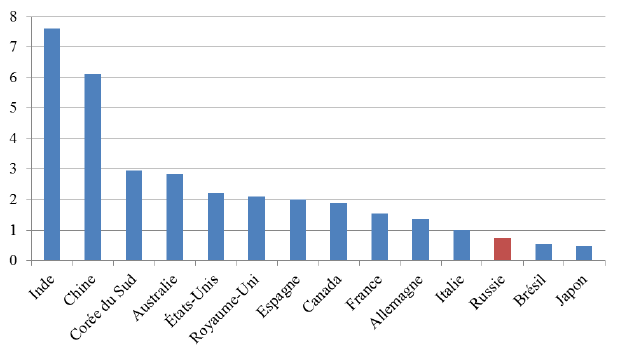
Source : élaboré à partir d’extractions de la base de données du FMI, données d’avril 2016.
Certes, ce genre de prévisions, fondées sur l’extrapolation des résultats du passé mêlée de quelques considérations démographiques, appelle de sérieuses réserves. Elles doivent pourtant être prises en compte, notamment parce qu’en influençant les investisseurs, elles deviennent en partie autoréalisatrices. Le fait est que l’économie russe apparaît aujourd’hui peu attrayante aux yeux de la majorité des observateurs. Tout se passe comme si, après avoir empoché dans les années 2000 les dividendes de la hausse du pétrole et de la remise en ordre de l’économie par le président Poutine, la Russie était maintenant confrontée au revers de la médaille : une dépendance excessive aux hydrocarbures, faute d’une modernisation et d’une diversification réussies ; un système économique à la fois étatiste, oligarchique et corrompu (tout cela allant ensemble, les grandes entreprises étant de plus en plus souvent dirigées par des proches du pouvoir) qui bloque cette modernisation ; le tout dans un contexte de déclin démographique.
C. L’ÉNERGIE : UN FACTEUR DE PUISSANCE REMIS EN CAUSE ?
1. La Russie reste une superpuissance énergétique
Bien que le développement de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, dits « de schiste », ait permis depuis quelques années aux États-Unis de relancer massivement leur production et de bouleverser les marchés mondiaux, la Russie reste une puissance incontournable en matière énergétique.
• Les réserves
S’agissant du gaz naturel, la Russie dispute traditionnellement à l’Iran la première place pour les réserves. D’après les derniers chiffres, fin 2015, l’Iran, avec 18,2 % du total des réserves mondiales prouvées, devançait légèrement la Russie, qui pouvait en revendiquer 17,3 % ; suivaient le Qatar (13,1 %), le Turkménistan (9,4 %) et les États-Unis (5,6 %).
S’agissant du pétrole, la Russie détiendrait les 6èmes réserves prouvées au monde, derrière le Venezuela, l’Arabie Saoudite, le Canada, l’Iran et l’Irak ; ces réserves représenteraient 6 % du total mondial.
• La production
Pour la production de gaz, la mise en exploitation du « gaz de schiste » a permis aux États-Unis de reprendre depuis 2009 le premier rang mondial à la Russie. La production de celle-ci, soit 573 milliards de m3 en 2015, conserve toutefois un poids prédominant, puisqu’elle représente pour cet exercice 16,1 % du total mondial, juste derrière celle des États-Unis (22 %) ; l’Iran, le Qatar et le Canada, respectivement 3ème, 4ème et 5ème producteurs mondiaux, arrivent bien après, avec chacun environ 5 % de la production mondiale.
La production mondiale de pétrole est dominée par trois acteurs qui représentent chacun 12 % à 13 % du total mondial ; en 2015 (comme les années précédentes depuis 2011), le premier producteur a été l’Arabie Saoudite (569 millions de tonnes), mais elle est suivie de très près les États-Unis (567 millions de tonnes), dont la production est en forte croissance grâce aux hydrocarbures non conventionnels, et par la Russie (541 millions de tonnes).
De ce fait, en additionnant les productions gazière et pétrolière, les États-Unis ont désormais repris le premier rang mondial pour l’extraction des hydrocarbures, mais restent talonnés par la Russie.
b. Les autres sources d’énergie
La Russie reste également un producteur significatif de charbon, avec une extraction de 185 millions de tonnes en 2015, qui la place au 6ème rang mondial (avec 4,8 % de la production mondiale). Surtout, elle détiendrait 17,6 % des réserves mondiales, juste derrière les États-Unis (26,6 %).
La Russie est enfin un producteur important d’énergie nucléaire, le troisième au monde (derrière les États-Unis et la France), et d’énergie hydro-électrique, avec le cinquième rang mondial (derrière, dans l’ordre, la Chine, le Canada, le Brésil et les États-Unis) – les autres énergies renouvelables restent en revanche extrêmement peu développées en Russie.
c. Les autres ressources naturelles
Il faut également rappeler plus généralement que la Russie a d’immenses ressources de minerais métalliques et autres matières premières. En 2012, elle était ainsi au 1er rang mondial pour l’extraction du palladium, au 2ème pour celles du platine, du tungstène et de l’aluminium, au 3ème pour le nickel, le vanadium et les « terres rares », au 4ème pour l’or, au 5ème pour le fer, l’argent et le chrome (32), etc.
Pour ce qui est des ressources de la terre, la Russie a la plus grande superficie forestière du monde et est le 5ème pays au monde pour la surface arable disponible par habitant (chiffre de 2009) (33).
2. Les hydrocarbures, facteur déterminant d’interdépendance avec l’Europe
Les exportations russes d’hydrocarbures – gaz, mais aussi pétrole – sont massivement orientées vers l’Europe. Cette situation a créé une interdépendance que, pour des raisons symétriques, les deux partenaires jugent excessive et cherchent à réduire, sans que les effets des actions menées à cette fin ne soient pour le moment très perceptibles.
a. La situation présente : une interdépendance écrasante
• Le gaz
Sur les 207 milliards de m3 de gaz exportés par la Russie en 2015, 64 % l’ont été à destination de l’Europe (hors Turquie), en premier lieu vers l’Allemagne, puis l’Italie, comme on le voit sur le graphique ci-après. La Turquie et la Biélorussie sont également des clients majeurs, mais ce n’est plus le cas de l’Ukraine, pour des raisons sur lesquelles il est inutile de revenir : sa part dans les exportations russes de gaz est tombée de 6,4 % à 3,4 % de 2014 à 2015.
Par ailleurs, les exportations vers l’Asie, effectuées sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL) en l’absence de gazoducs opérationnels depuis la Russie pour le moment, sont encore assez secondaires : les pays asiatiques n’ont absorbé que 7 % des exportations russes de gaz en 2015 (et la Chine quasiment rien).
Répartition des exportations russes de gaz en 2015
(en quantités de gaz)
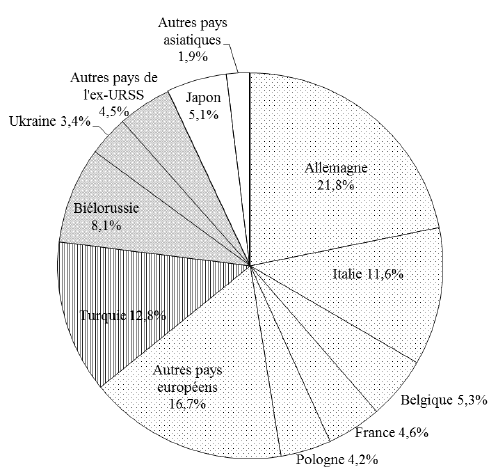
Source : élaboré à partir des données de « BP Statistical Review of World Energy », juin 2016.
Le flux annuel de gaz russe vers l’Europe, soit 133 milliards de m3 en 2015, représente près du tiers du total des importations de gaz des pays européens. S’agissant de l’Union européenne plus précisément, en 2013, selon Eurostat, 39 % de ses importations de gaz sont provenues de Russie, son deuxième fournisseur étant la Norvège, à 29,5 %.
La Russie ne fournit qu’une part relativement limitée (12 % en 2014 (34)) des importations françaises de gaz naturel : notre premier fournisseur reste de loin la Norvège et nous importons aussi des quantités significatives de gaz néerlandais et algérien. Mais l’apport du gaz russe est beaucoup plus essentiel pour nombre de nos partenaires : c’est bien sûr le cas pour certains pays d’Europe centrale/orientale qui restent totalement (ou presque) dépendants, techniquement, du gaz russe, mais aussi de pays situés plus à l’ouest, par exemple l’Allemagne et l’Italie, dont près de la moitié des approvisionnements en gaz proviennent de Russie.
Comme on l’observe sur la carte ci-après, ce flux de gaz russe vers l’Europe centrale et occidentale constitue de loin le plus important des flux interrégionaux de ce produit dans le monde.
Principaux flux commerciaux interrégionaux de gaz naturel en 2015
(en milliards de m3)
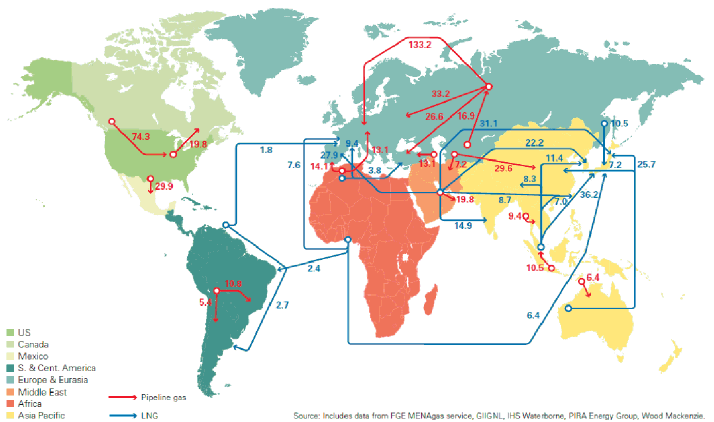
Source : « BP Statistical Review of World Energy », juin 2016.
• Le pétrole
La carte ci-après montre les flux de produits pétroliers entre les ensembles régionaux. Les exportations russes de produits pétroliers vers l’Europe, soit 247 millions de tonnes, ont représenté, en 2015, 61 % du total des exportations pétrolières russes (405 millions de tonnes) et assuré 37 % des importations pétrolières des pays européens (672 millions de tonnes).
Principaux flux commerciaux interrégionaux de produits pétroliers en 2015
(en millions de tonnes)
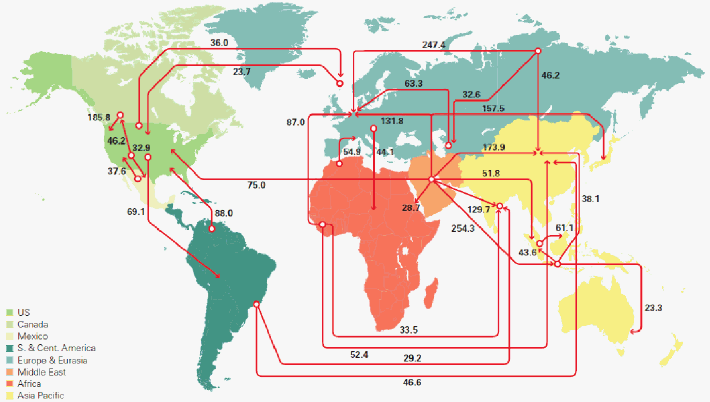
Source : « BP Statistical Review of World Energy », juin 2016.
S’agissant de l’Union européenne plus précisément, en 2013, selon Eurostat, 33,5 % de ses importations globales de pétrole sont provenues de Russie, son deuxième fournisseur, largement distancé à 11,7 %, étant la Norvège.
Pour le pétrole aussi, l’interdépendance est donc très grande, même si elle est nécessairement, pour des raisons techniques, moins importante que pour le gaz : ce dernier reste essentiellement transporté par gazoduc, ce qui implique des investissements considérables et des engagements à long terme entre pays producteurs et consommateurs.
• Les conséquences sur les flux commerciaux globaux
Le poids des ventes russes d’hydrocarbures aux pays européens se voit dans l’analyse globale du commerce extérieur russe :
– l’Union européenne demeure, malgré les difficultés politiques, le premier partenaire commercial de la Russie, en particulier à l’export (en 2014, plus de 41 % des importations russes provenaient de l’Union et surtout 52 % des exportations russes s’y dirigeaient). Les quatre principaux partenaires asiatiques de la Russie (Chine, Japon, Corée du Sud et Inde) ne viennent qu’après, pesant ensemble 20 % dans les échanges extérieurs russes ;
– si on raisonne par pays plutôt que par blocs, la Chine apparaissait certes en 2014 comme le premier partenaire commercial de la Russie (avec 11,3 % des échanges extérieurs russes), mais elle était suivie de près par trois pays européens, les Pays-Bas (9,5 % des échanges russes), l’Allemagne (8,8 %) et l’Italie (6,3 %) ;
– ce commerce Union européenne-Russie dégage un important excédent commercial pour la Russie : en 2015, on a relevé 136 milliards d’euros de flux de biens de la Russie vers l’Europe, contre 74 milliards dans l’autre sens, ce qui donne un solde favorable à la Russie de 62 milliards d’euros. Ces échanges sont donc essentiels pour le financement de l’économie russe.
Les principaux partenaires commerciaux de la Russie en 2014
(part des partenaires en % des montants totaux)
Importations : en % du total |
Exportations : en % du total |
Commerce total : en % du total | |||
Union européenne |
41,4 |
Union européenne |
52 |
Union européenne |
48,2 |
Chine |
17,8 |
Chine |
7,5 |
Chine |
11,3 |
États-Unis |
6,6 |
Turquie |
5 |
Turquie |
4 |
Biélorussie |
4,1 |
Japon |
4 |
Biélorussie |
4 |
Japon |
3,8 |
Biélorussie |
4 |
Japon |
3,9 |
Source : Commission européenne, DG Commerce, « Russia, Trade with world ».
Sans surprise, les importations de l’Union européenne depuis la Russie sont d’abord constituées de produits combustibles (pétrole, gaz et charbon…), qui en ont représenté 68 % en 2015. Viennent ensuite d’autres produits de base ou semi-transformés : métaux non ferreux (4,2 % du total en 2015), produits chimiques (4 %), fer et acier (2,9 %).
Les exportations européennes vers la Russie sont constituées essentiellement de produits manufacturés, notamment des machines et des équipements de transport (43,5 % du total de ces exportations en 2015) et des produits chimiques et pharmaceutiques (21,4 % de ce total).
b. La difficile réduction de l’interdépendance entre l’Union européenne et la Russie
Aussi bien l’Union européenne que la Russie souhaitent réduire leur dépendance mutuelle sur l’énergie.
i. L’Union européenne engagée dans la transition énergétique
L’Union européenne est confrontée à une difficulté majeure dans sa recherche traditionnelle d’indépendance énergétique : l’épuisement progressif des gisements de la mer du Nord.
De 2003 à 2013, d’après les données d’Eurostat, la production de pétrole brut des pays de l’Union européenne (en provenance essentiellement de la mer du Nord) a régressé de 142 à 66 millions de tonnes. La production norvégienne (issue du même bassin) a de même baissé fortement, passant de 149 à 75 millions de tonnes.
De même, sur cette période, la production primaire de gaz est passée dans l’Union de 202 à 132 millions en tonnes équivalent pétrole (TEP), baisse qui n’a pas été compensée intégralement par l’augmentation concomitante de la production norvégienne de 67 à 96 millions de TEP sur la période.
La réponse effective à cette situation a consisté, jusqu’à présent, à augmenter la dépendance de l’Union aux importations, comme le graphique ci-après le montre, importations dont le premier fournisseur est la Russie.
La part des importations de combustibles fossiles dans la consommation de l’Union européenne
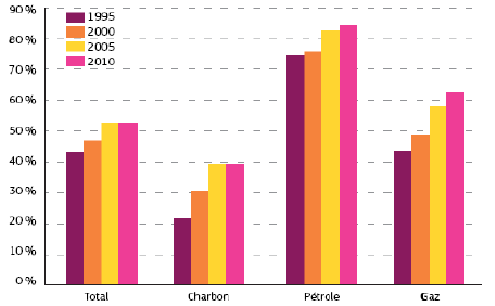
Source : Commission européenne, « Comprendre les politiques de l’Union européenne – Une énergie durable, sûre et abordable pour les Européens ».
Le développement de voies alternatives d’approvisionnement est le premier axe de réaction de la politique européenne.
Le lancement en mars 2015 du chantier du gazoduc transanatolien (TANAP) constitue à cet égard un succès du grand projet européen de « corridor sud » : à partir de 2019, le TANAP devrait permettre de transporter, à travers la Géorgie et la Turquie et jusqu’aux frontières grecque et bulgare, le gaz du gisement offshore de Shah Deniz en Azerbaïdjan. Sa capacité initiale de 16 milliards de m3 par an doit être portée à 23 milliards en 2023 puis 31 milliards en 2026. Il sera probablement prolongé vers l’Italie par le gazoduc transadriatique (TAP).
Cependant, l’axe principal de la politique européenne, qui aura aussi pour effet de réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes, est désormais la transition énergétique. Dans le cadre du « Paquet Énergie-Climat 2030 » adopté par les États membres en octobre 2014, l’Union s’est fixé un triple objectif d’ici 2030 :
– de réduction de 40 % de ses émissions de gaz à effet de serre ;
– de gains d’efficacité énergétique de 27 % (voire 30 % si cela est décidé lors du réexamen prévu en 2020) ;
– d’un taux d’énergies renouvelables de 27 % dans le mix énergétique.
ii. La Russie à la recherche de débouchés à l’est
Depuis deux ans, la Russie a beaucoup mis en valeur la signature – ou l’annonce de signature – de grands contrats pétroliers et gaziers avec des pays asiatiques, en particulier la Chine, pays vers lesquels, on l’a vu, les exportations russes d’hydrocarbures étaient jusqu’à présent très limitées.
Dans un article récent (35), un expert russe des questions énergétiques, M. Vladimir Milov (36), émet toutefois des doutes sérieux sur les réalisations de cette politique : « Même si [la période récente a été marquée] par d’intenses négociations, des sommets et des mémorandums d’accord entre la Russie et ces "nouveaux" partenaires, de nombreux problèmes sont toujours en suspens et ces relations demeurent d’une ampleur limitée. Un examen des relations sino-russes et turco-russes montre qu’aucun de ces nouveaux partenaires stratégiques n’est prêt à s’engager dans un "grand jeu" énergétique piloté par la Russie : Pékin comme Ankara préfèrent continuer de promouvoir pragmatiquement leurs propres intérêts dans ce domaine. Les tentatives russes visant à bouleverser la donne sur les marchés mondiaux de l’énergie n’ont pas abouti ».
● Avec la Chine, un accord a bien été signé en mai 2014 entre Gazprom et CNPC (China National Petroleum Corporation), prévoyant la livraison de gaz pendant trente ans, pour un montant cumulé sur cette période évalué à environ 400 milliards d’euros, ainsi que la construction du gazoduc « Force de Sibérie », long d’environ 4 000 kilomètres, pour acheminer ce gaz.
Mais d’autres accords commerciaux impliquant éventuellement la construction de nouveaux gazoducs et/ou prises de participation chinoises dans des champs pétroliers ou gaziers russes, qui avaient été annoncés, ne semblent finalement pas devoir être concrétisés. Selon l’auteur susmentionné, la partie chinoise a probablement jugé excessives les exigences financières russes, dans le contexte présent d’effondrement des cours du pétrole, et été déçue de ne se voir offrir en général que des prises de participation minoritaires dans des consortiums rassemblant des compagnies de divers pays : les entreprises chinoises escompteraient un traitement préférentiel.
Même l’enjeu du contrat « Force de Sibérie » susmentionné doit, selon M. Milov, être relativisé pour plusieurs raisons :
– les échanges gaziers sino-russes qu’il permettra resteront en-deçà de ceux entre le Turkménistan et la Chine, qui se sont fixé l’objectif d’atteindre un volume de livraisons du premier vers la seconde de 65 milliards de m3 dès 2020, quand « Force de Sibérie » vise la livraison annuelle de seulement 38 milliards de m3, et ce en 2031 (en 2020, on n’en serait encore qu’à 10 milliards de m3). Ces 38 milliards de m3 peuvent aussi être rapprochés du volume de gaz russe d’ores et déjà livré annuellement à l’Europe, soit, on l’a dit, plus de 120 milliards de m3 ;
– dans le contexte actuel de baisse du cours des hydrocarbures et de sanctions occidentales contre la Russie, le financement du projet ne serait pas complétement assuré, non plus que sa rentabilité ultérieure ;
– plus fondamentalement, ce projet présenté comme très important répondrait en fait à des préoccupations relativement secondaires des deux parties : pour la Russie, développer deux gisements gaziers très excentrés de Sibérie orientale ; pour la Chine, assurer l’approvisionnement de trois provinces périphériques de son nord-est qui ne sont pas connectées à son réseau interne de gazoducs.
Par ailleurs, les prévisions existantes sur l’évolution à moyen terme des besoins d’importations de gaz naturel par la Chine montreraient que ce pays n’a pas vraiment d’intérêt à chercher à ajouter à ses accords en vigueur avec le Turkménistan et à « Force de Sibérie » un (ou plusieurs) grand(s) contrat(s) supplémentaire(s) d’approvisionnement terrestre. La perspective de nouveaux contrats majeurs pour la Russie – en particulier celle de construire un gazoduc dit de l’Altaï pour livrer en Chine du gaz de Sibérie occidentale – serait donc faible.
La conclusion de l’article est donc sur ce point « qu’à court et moyen termes la coopération [sino-russe] restera limitée aux exportations de pétrole et de gaz provenant des gisements de Sibérie orientale, ce qui n’en fait qu’une coopération régionale d’une portée limitée. Malgré les nombreuses déclarations de Moscou, on est loin d’une exportation massive du pétrole et du gaz de Sibérie occidentale (qui sera la première région de production de la Russie au cours des prochaines décennies) vers la Chine plutôt que vers l’Europe ».
● S’agissant du projet Turkish Stream vers la Turquie, présenté en décembre 2014 comme une alternative à l’abandon du projet South Stream vers l’Europe du sud-est, il est à noter que l’article précité est antérieur à la destruction par la Turquie, à la frontière syrienne, d’un avion russe le 24 novembre 2015.
Dès avant cet événement, cet article estimait les perspectives brillantes annoncées par le gouvernement russe assez illusoires car :
– rien n’était prévu pour l’acheminement du gaz russe qui serait ainsi livré en Turquie vers l’Europe du sud et de l’est, et notamment les endroits précis où Gazprom est tenu de le livrer selon ses engagements contractuels avec les différents pays européens ;
– les pays d’Europe centrale et orientale sont plutôt en train de développer des infrastructures concurrentes destinées à réduire leur dépendance au gaz russe ;
– des pays tels que la Roumanie et la Bulgarie se sont eux-mêmes lancés dans la production gazière ou envisagent de le faire ;
– le projet serait concurrencé par le « corridor gazier sud » de l’Union européenne depuis l’Azerbaïdjan, bien plus avancé (le chantier du gazoduc TANAP traversant le territoire turc a été lancé en mars 2015).
L’auteur pensait donc que la capacité du futur gazoduc Turkish Stream serait probablement réduite par rapport aux annonces, de façon principalement à couvrir le marché turc.
On peut ajouter que la Turquie elle-même a des possibilités alternatives d’approvisionnement gazier (Azerbaïdjan et peut-être demain gaz des gisements off-shore de Méditerranée orientale – Chypre, Israël et Égypte).
Dans ces conditions, il n’est guère surprenant que le projet Turkish Stream ait été suspendu début décembre 2015, quelques jours seulement après la destruction de l’avion russe par l’armée turque : la crise politique n’a peut-être qu’accéléré une décision que les réalités économiques auraient en tout état de cause imposées.
c. Un rapport de forces qui penche en faveur de l’Europe ?
Les livraisons massives de pétrole et surtout de gaz depuis la Russie vers l’Union européenne créent donc une véritable interdépendance que les deux entités cherchent certes à réduire, mais n’envisagent pas de remettre en cause brutalement, car ce serait un désastre économique pour l’une et l’autre : l’interruption de ces livraisons énergétiques serait une sorte de « bombe nucléaire » que personne n’envisage malgré les tensions politiques (alors que, par exemple, l’Union européenne n’a pas hésité à décider d’un embargo sur le pétrole iranien pour imposer l’accord sur le nucléaire à l’Iran).
On peut cependant penser que le rapport de forces dans cette interdépendance, qui reste implicite puisqu’il n’est pas envisagé de chercher à le matérialiser, penche virtuellement de plus en plus en faveur de l’Union européenne, ce pour plusieurs raisons :
– comme le montrent le niveau historiquement bas des cours et les faibles perspectives de forte remontée à court terme selon la plupart des prévisions, les marchés des hydrocarbures sont aujourd’hui favorables aux acheteurs plutôt qu’aux producteurs ;
– même s’il est probable que les cours des hydrocarbures remonteront quelque peu à moyen terme, car leur niveau actuel ne permet pas d’assurer durablement une production suffisante rentable, la tendance générale à la décarbonation des économies (par l’amélioration de la performance énergétique et le développement des énergies renouvelables), imposée par la lutte contre l’effet de serre, ne jouera pas en faveur des exportateurs d’hydrocarbures ;
– d’un point de vue structurel, la différence de poids entre les économies européenne et russe – de l’ordre de un à douze – fait que les flux d’hydrocarbures de la Russie vers l’Union constituent forcément un enjeu moindre pour la seconde que pour la première. L’Union absorbe les trois cinquièmes des exportations russes d’hydrocarbures, mais celles-ci ne représentent qu’un gros tiers des approvisionnements de l’Union. Les ventes russes de « combustibles » divers à l’Union européenne, soit 92 milliards d’euros en 2015, représentaient moins de 0,7 % du PIB de l’Union, mais près de 8 % de celui de la Russie la même année : les enjeux économiques d’une éventuelle interruption de ces ventes – hypothèse d’école… – ne seraient donc pas du tout les mêmes pour l’un et l’autre partenaires, a fortiori dans un marché mondial pétrolier en surproduction où l’Union européenne pourrait trouver des fournisseurs de substitution.
D. LE SYSTÈME POLITIQUE : UN PRÉSIDENT QUI RESTE POPULAIRE
La stabilité de son système politique et son aptitude à susciter l’adhésion populaire sont aussi des facteurs déterminants de la capacité d’un pays à exercer un rôle international important.
La vie politique russe est dominée par la personnalité du président Vladimir Poutine, lequel, après deux premiers mandats en 2000-2008, puis un intermède en tant que premier ministre, a été élu pour un troisième mandat en 2012. La prochaine élection présidentielle, où il aura encore une fois le droit de se présenter, est prévue en 2018.
La situation présente se caractérise par le niveau exceptionnel de la popularité du président. Par ailleurs, le système politique semble parfaitement rôdé pour empêcher l’émergence à court terme d’une opposition susceptible de contester efficacement les dirigeants en place. Cependant, tout système trop bien contrôlé appelle des interrogations sur la manière plus ou moins prévisible, plus ou moins brutale, dont il pourrait être remis en cause.
1. Une approbation massive de la politique du président russe, sur fond d’exaltation patriotique
Toutes les études d’opinion montrent un niveau très élevé de soutien à la politique menée par le président Vladimir Poutine. Selon le Centre panrusse d’études de l’opinion publique (VTsIOM), ce taux s’établissait fin octobre 2015 à 89,9 %, soit un record absolu. Pour l’institut Levada, ce taux serait de 88 %.
L’évolution de ce taux de soutien, présentée sur le graphique ci-après, montre qu’il a grimpé en flèche en mars 2014, au moment de l’annexion de la Crimée et se maintient depuis lors. Le président russe a retrouvé le niveau de popularité qu’il avait atteint vers 2008, à la fin des années de forte croissance économique (avant la crise financière), alors qu’en 2012-2013, dans un climat économique moins florissant qu’avant et alors que sa nouvelle élection était contestée, ce taux variait entre 60 % et 70 %.
Évolution du soutien à la politique du président Vladimir Poutine
(réponse à la question : « dans l’ensemble, êtes-vous satisfait des actions de Vladimir Poutine ? », en %)
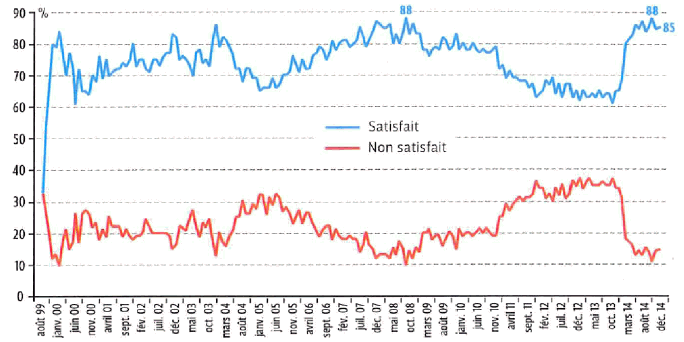
Source : Centre Levada, décembre 2014 ; repris dans Regards de l’observatoire franco-russe – Russie 2015.
Le soutien au président russe est manifestement lié à sa politique étrangère – et en particulier à l’annexion de la Crimée.
En effet, la population russe est évidemment consciente des graves difficultés économiques en cours, qu’elle subit, et pas forcément très satisfaite de l’action économique du gouvernement, même si, dans ce domaine aussi, le chef de l’exécutif échappe aux critiques : selon une enquête d’opinion publiée en juin 2015 (37), 73 % des sondés considéraient que la situation économique était mauvaise, mais ils estimaient pourtant que le président Vladimir Poutine avait un bilan positif dans tous les domaines (90 % pour sa politique étrangère envers la Chine, 85 % pour celle vis-à-vis des États-Unis, 83 % pour ses choix sur l’Ukraine, 82 % pour sa politique vis-à-vis de l’Union européenne), même en matière de politique économique (70 % d’approbation). Un autre sondage de la même source explique cette mansuétude des Russes pour leur président à propos des difficultés économiques : ils les imputent en grande majorité à des causes exogènes. Interrogés au printemps 2015 sur le facteur principal de crise économique, 33 % des sondés mettaient au premier plan les sanctions occidentales et le même nombre la chute des cours du pétrole (donc 66 % citaient d’abord des facteurs extérieurs), contre 25 % critiquant en premier lieu la politique économique de l’exécutif.
D’autres sondages publiés dans la même enquête montraient les ressorts « patriotiques », parfois inquiétants, du soutien à la politique de l’exécutif russe : selon ceux-ci, 61 % des Russes estimeraient que des territoires de pays voisins appartiennent en réalité à la Russie et 69 % que l’effondrement de l’URSS a été une mauvaise chose. S’agissant en particulier des régions séparatistes du Donbass, seuls 32 % des sondés déclaraient préférer qu’elles continuent à appartenir à l’Ukraine (même avec une autonomie accrue comme le prévoient les accords de Minsk), contre 35 % qui étaient en faveur de leur indépendance et 24 % en faveur d’un rattachement à la Russie.
Par ailleurs, selon la même source, l’image des pays occidentaux s’est considérablement dégradée en Russie dans la période la plus récente : entre 2013 et 2015, les opinions favorables envers l’Union européenne et les États-Unis ont été divisées respectivement par deux (de 63 % à 31 %) et par trois (de 51 % à 15 %).
Les jeunes sont désormais attirés par le prestige retrouvé de l’armée, qui n’a aucun mal à recruter (le chômage et l’amélioration des soldes étant aussi des explications de cette situation). Toutefois, l’opinion publique russe, gardant sans doute le souvenir des guerres d’Afghanistan ou de Tchétchénie, reste réticente à payer le prix du sang. L’annexion de la Crimée a été appréciée car réalisée sans la moindre effusion de sang. Mais un sondage du centre Levada en octobre 2015 montrait une forte opposition (aux deux tiers) contre un éventuel envoi de troupes au sol en Syrie.
Les sentiments patriotiques sont mêlés de préoccupations sécuritaires dans un contexte où le terrorisme menace toujours (cf. l’attentat contre l’avion russe au-dessus du Sinaï le 31 octobre 2015) et où, plus généralement, la Russie est souvent perçue comme assiégée par des forces hostiles. La prégnance de ces préoccupations facilite la confusion entre la sécurité de l’État, celle du régime et celle du président… Elle conduit aussi à faire placer au second plan les questions de démocratie et de droits de l’homme, et même dans une certaine mesure les questions économiques et sociales. L’augmentation des dépenses militaires et autres dépenses publiques sécuritaires se paie d’une baisse des dépenses sociales, éducatives ou liées à la modernisation économique.
Votre rapporteur ne se hasardera pas à qualifier le régime politique actuel de la Russie, qu’un célèbre acteur français avait cru bon de considérer comme une « grande démocratie » en 2013, quand d’autres commentateurs présentent le président russe comme un dictateur.
Il n’est en effet pas possible de faire rentrer le système politique russe dans des « cases » trop simples. La Russie est un pays où il y a de « vraies » élections, dont les résultats ne sont pas connus d’avance, mais le fait est que les surprises sont rares : les opposants ne gagnent que rarement. C’est aussi un pays où il n’y a pas de censure officielle des médias et des échanges sur internet, mais où les médias indépendants ainsi que les « corps intermédiaires » insoumis ont de plus en plus de mal à survivre face au harcèlement administratif, judiciaire et réglementaire et à un pouvoir économique concentré dans les mains de l’État et d’« oligarques » amis.
Après la nouvelle élection du président Vladimir Poutine en 2012, qui s’était déroulée sur fond de contestation et de manifestations populaires inédites, un ensemble de lois ont été adoptées qui sont présentées, par les opposants et les défenseurs des droits de l’homme, comme destinées essentiellement à conforter le pouvoir en place en limitant le débat public et en inhibant l’action des opposants. Ces lois rendent également compte de conceptions sociétales très conservatrices.
Ce sont notamment celles concernant la « trahison d’État », la « propagande homosexuelle », les ONG « agents de l’étranger », les « organisations étrangères indésirables », l’organisation de manifestations publiques, la lutte contre l’extrémisme, le respect des sentiments des croyants, etc.
Mme Françoise Daucé dresse un bilan assez redoutable de l’application de la loi sur les « agents de l’étranger » (38). Entrée en vigueur en novembre 2012, cette loi oblige (sous peine de sanctions pénales allant jusqu’à la prison pour les responsables associatifs) les associations bénéficiant de financements internationaux et exerçant une « activité politique » à se faire enregistrer auprès de l’administration comme « agents de l’étranger », à lui rendre compte de leurs activités « politiques » et à faire état de ce statut (infamant) dans toutes leurs publications. Les ONG visées ont refusé dans un premiers temps de se conformer à la nouvelle loi, ce qui leur a valu une vague de poursuites judiciaires et de contrôles administratifs et fiscaux divers, débouchant sur des sanctions variées. Une douzaine d’entre elles ont été sommées, suite à ces contrôles, de se déclarer « agents de l’étranger » conformément à la loi. Face au refus réitéré des ONG, des poursuites judiciaires ont été engagées et certaines associations ont préféré s’auto-dissoudre ou suspendre leurs activités que se soumettre. Pour venir à bout de cette résistance, la loi a été amendée pour permettre l’inscription d’office des récalcitrants sur le registre des « agents de l’étranger ». La lutte des ONG « contre les accusations qui les touchent absorbe désormais une grande partie de leur activité quotidienne. [La loi] a profondément transformé les conditions de fonctionnement des associations russes. La plupart d’entre elles ont renoncé à leurs financements internationaux afin d’éviter des poursuites. Pour remédier au déclin de leurs ressources, elles sont désormais incitées à se tourner vers les subventions russes [d’État ou de fondations privées] (...). De nombreuses organisations [ont été] contraintes de réduire leurs activités dans tous les domaines (depuis la lutte contre le sida jusqu’à la prévention des violences policières en passant par la défense des soldats ou l’aide aux réfugiés) ».
Au cours du déplacement à Moscou fin mars 2016 d’une délégation de la mission, des représentants d’ONG rencontrés sur place ont mis l’accent sur la probable cessation d’activité de nombre d’entre elles d’ici la fin de l’année en cours. Ils ont également dénoncé le flou de la définition de l’activité « politique » justifiant l’application de la loi : dans un cas qu’ils ont cité, la seule présence au siège de l’association en cause de livres de l’opposant Boris Nemtsov aurait suffi à qualifier celle-ci de « politique », car ces livres (politiques) étaient accessibles aux visiteurs…
Une nouvelle loi relative aux « organisations étrangères et internationales non gouvernementales indésirables » a été votée au printemps 2015. Elle permet, sur décision du procureur général de Russie prise en accord avec le ministère des affaires étrangères, de déclarer « indésirables » et d’interdire de fait d’activité les ONG étrangères qui représenteraient « une menace pour les fondements constitutionnels de la Fédération de Russie, la capacité de défense du pays ou la sécurité du gouvernement ». Une telle définition peut donner lieu à toutes sortes d’interprétations. Le flou des formulations est d’ailleurs un grief communément imputé à l’ensemble de la législation russe récente qui est contestée.
S’agissant de la liberté de manifestation, il a été mis fin aux manifestations qui avaient marqué la période électorale de 2011-2012 par une répression vigoureuse. Les simples citoyens arrêtés pour avoir commis des violences lors de la manifestation du 6 mai 2012 sur la place Bolotnaïa, accusations qu’ils ont niées et qui ne sont pas fondées selon les grandes ONG internationales de défense des droits de l’homme, ont été condamnés à de sévères peines de prison (deux à quatre ans) ; plusieurs sont encore emprisonnés. Puis, dès juin 2012, une nouvelle loi sur les rassemblements a durci la répression des manifestations non autorisées. Enfin, une loi adoptée en 2014 permet de frapper de peines allant jusqu’à cinq ans de prison toute personne ayant contrevenu plusieurs fois en six mois aux règles d’organisation des actions de rue ; M. Ildar Dadine a été condamné sur la base de cette loi à deux ans et demi de prison (le 31 mars 2016 en appel), alors même que certaines des « manifestations » prises en compte pour motiver cette condamnation avaient seulement pris la forme de « piquets » solitaires (où l’intéressé tenait des banderoles hostiles au président Vladimir Poutine).
Il apparaît aussi que des internautes sont de plus en plus souvent condamnés, parfois à des peines de plusieurs années de prison, pour « extrémisme » après qu’ils ont diffusé ou reposté des contenus déplaisant aux autorités : cela a par exemple été le cas, en mai 2016, de M. Andreï Boubeïev, condamné à deux ans et trois mois de prison pour avoir reposté un article de presse contestant l’annexion de la Crimée et un dessin humoristique.
Les médias indépendants du pouvoir ou des intérêts économiques qui le soutiennent sont de moins en moins nombreux en Russie. Une loi de 2014 limite à terme à 20 % l’actionnariat étranger dans la presse et les actionnaires étrangers de publications considérées jusqu’à présent comme de qualité et distanciées du pouvoir, telles que Vedomosti, Forbes Russia ou The Moscow Times, se sont retirés en 2015 ou vont le faire. Les nouveaux propriétaires russes semblent déjà avoir critiqué la ligne « trop politique » des organes de presse qu’ils ont rachetés… Dans le classement sur la liberté de la presse de l’ONG Reporters sans frontières, la Russie obtient en 2015 le 152ème rang sur 180 pays, perdant quatre places par rapport à 2014.
b. Une opposition divisée et plus ou moins crédible
Il existe en Russie une opposition parlementaire constituée par les partis qui parviennent à présenter des candidats aux élections (les opposants plus radicaux se plaignant d’en être empêchés : voir infra) et à y obtenir des résultats significatifs. Dans la Douma actuelle, élue en décembre 2011, le parti Russie unie fidèle au président Vladimir Poutine dispose d’une majorité absolue, mais pas écrasante (238 sièges sur 450), et trois autres partis sont représentés. Mais leur caractère d’« opposants » est parfois mis en doute.
● Avec 92 sièges à la Douma, le Parti communiste est la première force d’opposition parlementaire. Les autres élections confirment qu’il est actuellement la force d’opposition qui bénéficie de la meilleure assise électorale. Selon les résultats officiels, son candidat à l’élection présidentielle de 2012, M. Guennadi Ziouganov, y a recueilli 17 % des voix, certes très loin derrière M. Vladimir Poutine (près de 64 % de voix), mais également loin devant les autres candidats. Le Parti communiste est aussi la seule force dont les candidats l’emportent parfois contre des candidats du pouvoir pour des mandats certes locaux, mais importants : en avril 2014, M. Anatoly Lokot a ainsi été élu maire de Novossibirsk, troisième ville du pays (39) ; en septembre 2015, M. Sergueï Levtchenko a été élu gouverneur de la région d’Irkoutsk… Le Parti communiste prône l’économie mixte et la redistribution et ses députés votent en général contre l’exécutif sur les questions économiques et sociales. Mais il partage aussi le patriotisme et les valeurs sociétales conservatrices qui dominent en Russie ; il soutient la politique étrangère du président russe.
● Le parti Russie juste, doté de 64 députés, se veut social-démocrate, avec un programme économique en fait assez proche de celui du Parti communiste, mais aussi une insistance sur les valeurs démocratiques et le rôle de la société civile. En pratique, il apparaît comme une opposition plus que modérée.
● Le Parti libéral-démocrate, avec ses 56 élus, défend un programme que l’on peut qualifier d’extrême-droite nationaliste : union de la Russie avec la Biélorussie et l’Ukraine, rupture avec les États-Unis, promotion de la religion orthodoxe et des valeurs morales, interdiction de la prostitution et des revendications homosexuelles, rétablissement de la peine de mort (40) et durcissement de la législation pénale, droit au port d’armes généralisé pour les citoyens et renforcement de la police, protectionnisme et dirigisme économique, priorité nationale à l’emploi pour les Russes, etc. Sa pratique politique est plus modérée et n’en fait pas non plus une opposition redoutable.
L’opposition plus véhémente, qui dénonce ouvertement le régime comme autoritaire et surtout corrompu, n’a pas de représentation parlementaire. Elle est incarnée par quelques personnalités telles que le blogueur Alexeï Navalny, spécialisé dans la dénonciation de la corruption, ou encore M. Igor Nemtsov, victime le 27 février 2015 d’un assassinat dont les commanditaires n’ont toujours pas été identifiés.
Cette opposition est divisée en de nombreux petits partis, qui n’ont en commun que l’hostilité au régime et la revendication d’une vraie démocratie. En effet, les positions des uns et des autres sur d’autres questions sont extrêmement diverses : M. Navalny a ainsi tenu plusieurs fois des propos très nationalistes et xénophobes, alors qu’à l’inverse M. Nemtsov a été l’une des rares personnalités russes à ne pas partager le consensus national sur l’annexion de la Crimée et à dénoncer la guerre cachée menée par la Russie contre l’Ukraine dans le Donbass.
Les résultats électoraux de cette opposition « dure » restent faibles : l’un des plus anciens des partis d’opposition libérale, Iabloko, n’a obtenu que 3 % des suffrages aux élections législatives de 2011, ce qui l’a privé de représentation parlementaire. Le parti Parnas, dirigé par M. Nemtsov, puis M. Mikhaïl Kassianov, qui apparaît comme l’un des plus dynamiques dans l’opposition libérale actuelle, n’a pour sa part recueilli que 2 % des suffrages dans la région de Kostroma, où il avait pu présenter une liste, lors des élections locales de septembre 2015.
Les partisans de l’opposition « dure » se plaignent d’un harcèlement administratif et judiciaire qui les empêcherait de solliciter les suffrages populaires. Lors des élections locales de septembre 2015, plusieurs listes d’opposition n’ont en effet pas pu être enregistrées, leurs listes de parrainages citoyens ayant été jugées non conformes, voire frauduleuses. Les opposants en vue sont également ciblés à titre personnel : M. Alexeï Navalny est ainsi inéligible suite à des condamnations successives à de lourdes peines de prison (avec sursis ou exécutées très partiellement) pour une obscure affaire de détournement de fonds publics, puis pour une non moins incertaine escroquerie dont aurait été victime la filiale russe de l’entreprise Yves Rocher de la part d’une société de logistique appartenant à M. Navalny et à son frère. Ces procès ont été dénoncés par l’opposition russe, mais aussi par des organisations comme Amnesty International.
*
Dans ce contexte, une victoire ou même un bon score de l’opposition aux élections législatives qui auront lieu en septembre 2016 ne sont guère vraisemblables. D’après des témoignages recueillis par la délégation de la mission qui s’est rendue en Russie fin mars 2016, notamment auprès d’ONG, il est probable que le pouvoir russe actuel, sûr de lui, veillera à ce que ces élections se déroulent de manière plus honnête et transparente que dans le passé : la leçon de la contestation populaire de 2011-2012, portée par les accusations de fraude massive aux élections législatives de 2011, a été retenue. L’élection à la tête de la commission électorale de Mme Ella Pamfilova, ancienne présidente du Conseil des droits de l’homme de Russie, puis commissaire aux droits de l’homme du gouvernement russe, serait le signe de cette volonté d’élections « propres ». L’exécutif dispose par ailleurs de solides moyens administratifs pour contrôler le processus électoral, notamment la procédure de validation des candidats. En outre, il semble que les quatre partis actuellement représentés à la Douma (voir supra) aient passé un accord pour se répartir d’avance 40 circonscriptions à pourvoir au scrutin uninominal (le système est mixte proportionnel/uninominal), ce qui conforte les observations sceptiques que l’on peut faire sur l’existence d’une « opposition parlementaire ».
La population russe continue globalement à percevoir positivement ses gouvernants, même, semble-t-il, sur le plan des libertés publiques. Selon un autre sondage des enquêtes du Pew Research Center précitées, 63 % des Russes considéraient en 2015 que leur gouvernement respectait les libertés individuelles, contre 29 % d’avis contraire ; en 2008, les sondés n’étaient que 45 % à avoir une opinion positive de leur gouvernement sur ce point, contre 44 % d’opinions négatives.
La crise économique et sociale actuelle n’a pas débouché, pour le moment, sur de grands mouvements de contestation, que ce soit par crainte de la répression, par conviction que les difficultés sont dues à des causes extérieures auxquelles le pouvoir russe ne peut rien (cf. les enquêtes d’opinion précitées), ou du fait des expériences du passé récent, marqué par des crises encore plus graves (dans les années ayant suivi la chute de l’URSS), qui feraient redouter un effondrement du système. Mais cela durera-t-il ? Il faut signaler quelques mouvements, comme celui déclenché par les transporteurs routiers après l’annonce de l’instauration, le 15 novembre 2015, d’une taxe kilométrique à la tonne les frappant. Cela a suscité des manifestations dans environ 70 villes, avec des « opérations escargot » des camionneurs, qui ont contraint le gouvernement à transiger (abaissement du tarif de la taxe et de l’amende pour non-installation de l’enregistreur de bord permettant de la calculer, report de son application en province…).
Plus fondamentalement, le système politique russe apparaît assez largement bloqué. Les réformes nécessaires, notamment pour relancer l’économie, ont peu de chances d’être réalisées, faute de moyens budgétaires et aussi de volonté politique. La popularité du régime se concentre sur la personne du président Vladimir Poutine, ce qui renforce la centralisation du système autour de l’administration présidentielle, rendant les initiatives réformistes moins probables. Mais le ressentiment de la population restera-t-il éternellement canalisé sur les « ennemis » de l’intérieur et surtout de l’extérieur (Ukraine, États-Unis, Turquie…) désignés par les médias pro-gouvernementaux ? L’exaltation patriotique suffira-t-elle longtemps à masquer les difficultés ?
E. LE « SOFT POWER » RUSSE : UNE CAPACITÉ D’ATTRACTION QUI RESTE RELATIVE
La puissance d’un pays ne repose pas seulement sur ses moyens militaires, son économie et sa stabilité politique. Il y a aussi, évidemment, d’autres facteurs, plus divers, plus difficiles, renvoyant plus à l’influence, l’attraction, la capacité de persuasion, qu’à la coercition. En 1990, l’universitaire américain Joseph Nye, voulant montrer la permanence de certains facteurs de la puissance de son pays malgré le déclin relatif (par rapport aux autres) de sa puissance économique et militaire, a élaboré le concept de soft power pour désigner la capacité des États (ou autres entités politiques) à exercer une influence par des moyens non coercitifs : effets d’image et de réputation, attraction culturelle ou idéologique, rayonnement scientifique et technologique…
L’Union soviétique, de son temps, a beaucoup dû à son attraction idéologique : plus que sur une économie et une technologie qui n’ont jamais réussi à concurrencer vraiment celles des États-Unis et des autres pays « capitalistes », sous réserve des quelques succès dans le domaine spatial, le statut de superpuissance de l’URSS reposait certes sur son armement nucléaire et conventionnel et le contrôle des États vassalisés, mais aussi sur l’adhésion totale ou partielle de millions de Communistes ou « compagnons de route » dans le monde.
La Russie actuelle n’a pas renoncé à exercer une forme de soft power, mais avec des ambitions et des résultats bien moindres que du temps de l’URSS.
1. La volonté de développer une contre-propagande face à ce qui serait un usage délibéré et hostile des politiques d’influence par les pays occidentaux
La démarche russe contemporaine de soft power est délibérée. Encore récemment (1er mars 2016), le journal russe Kommersant faisait ainsi état de travaux menés par des théoriciens de la chose militaire pour répondre à la « guerre hybride » des nationalistes ukrainiens par des méthodes similaires intégrant le concept de soft power.
Cette démarche semble largement déterminée par l’analyse que font les dirigeants russes de l’attitude des pays occidentaux, ou du moins de certains d’entre eux, qui utiliseraient (ou auraient utilisé) leur influence pour nuire aux intérêts de la Russie, notamment en suscitant des révolutions contre les gouvernements qui lui étaient favorables dans son environnement régional.
Des diplomates allemands et français, dont les travaux sont repris dans une récente note du ministère des affaires étrangères (41), mettent ainsi en avant la « phobie russe des révolutions de couleur, [laquelle déterminerait] de plus en plus la politique étrangère et intérieure de la Russie ». Selon eux, depuis le tournant psychologique qu’aurait représenté la « révolution orange » ukrainienne en 2004, « la Russie a construit une interprétation unique de toutes ces révolutions » ; elle se sent « assiégée par des forces occidentales hostiles ». Cela conduirait les autorités russes à développer délibérément un « contre-modèle » fondé sur un discours anti-occidental et qui irait jusqu’à une réécriture de l’histoire : par exemple, « depuis l’annexion de la Crimée (…), les autorités russes ont de plus en plus tendance à réécrire l’histoire et à produire de nouveaux mythes historiques (par exemple : l’idée martelée par Vladimir Poutine selon laquelle la Crimée est le berceau de l’orthodoxie et la source de l’État russe) ».
Il semble aussi que les autorités russes aient mis en place un appareil de propagande et de désinformation efficace en réponse à ce qu’elles considèrent comme de la propagande des médias européens ou américains. L’Union européenne y a d’ailleurs réagi en créant à son tour une structure destinée à mettre en lumière la désinformation que, selon elle, les médias proches du pouvoir russe répandent délibérément : l’East Stratcom Task Force rattachée au Service européen d’action extérieure (SEAE), qui publie à cette fin sur internet des analyses en russe et en anglais (« Disinformation Rewiew » et « Disinformation Digest »). Dans ces publications (42), l’East Stratcom Task Force met en cause l’action d’agences de presse russes comme Sputniknews, de journalistes animateurs d’émissions populaires sur les télévisions publiques russes, tels que MM. Vladimir Soloviev et Dimitri Kiseliev, ou encore, pour propager les thèses les plus délirantes, d’obscurs sites internet localisés dans des pays d’Europe centrale. Parmi les thèses propagandistes qui auraient ainsi été mises en valeur en février-mars 2016 dans les médias russes ou pro-russes, l’East Stratcom Task Force signale par exemple l’idée selon laquelle la Turquie et l’Arabie Saoudite chercheraient à susciter une guerre des États-Unis contre la Russie, celle selon laquelle l’Allemagne et l’Union européenne enverraient délibérément des flots de réfugiés en Grèce pour détruire ce pays, ou encore des thèses récurrentes sur l’Ukraine (négation de la spécificité de ce pays, qui ne serait qu’une partie de la Russie ; accusations de fascisme et de complots belliqueux à l’encontre des dirigeants ukrainiens), des mises en cause de l’indépendance des médias européens et américains, voire des absurdités à propos de conspirations imputées au Vatican, lequel aurait organisé le « coup d’État » (nazi évidemment) contre le président Ianoukovytch en Ukraine et ferait du lobbysme pro-homosexualité !
2. Un concept à géométrie variable : le « monde russe »
L’un des outils conceptuels principaux développés pour accroître l’influence russe est celui de « monde russe ».
D’abord imaginé, à la fin des années 1990, par des intellectuels, ce concept a depuis lors reçu une onction officielle : une fondation « Monde russe » a été créée en 2007, par décret présidentiel et dans l’orbite des ministères des affaires étrangères et de l’éducation, avec pour objectif principal la promotion internationale de la langue russe.
La chercheuse Marlène Laruelle a mis en lumière, dans un article récent (43), le flou relatif du concept de « monde russe », dont elle observe qu’il peut renvoyer, sans que l’articulation soit très explicite, à plusieurs champs d’action : la politique de la Russie dans les pays de son voisinage (ex-républiques soviétiques) ; la politique vis-à-vis des diasporas russes dans le monde ; enfin, le développement d’une « marque » russe ou d’une politique d’image, avec là deux dimensions, l’une terre-à-terre de « marketing politique », l’autre à portée messianique, avec l’idée que la Russie a un message religieux ou plus généralement spirituel à faire passer pour le salut du monde.
Vu ce flou, les personnes ciblées par les actions menées au nom du « monde russe » sont elles-mêmes définies peu précisément : on aurait un noyau central constitué par les citoyens russes expatriés, et des cercles concentriques comprenant les personnes linguistiquement, spirituellement ou culturellement proches de la Russie, puis tous les peuples qui ont appartenu à l’URSS (ou à l’empire des tsars), enfin, tous ceux qui, par le monde, sont attirés par la langue ou la culture russes…
3. L’affirmation de « valeurs » différentes
La tradition intellectuelle russe est depuis longtemps marquée par la coexistence de courants très divers. Au XIXème siècle, des grands intellectuels russes ont adhéré sans réserve aux idées matérialistes venues de l’Europe occidentale, au point que la Russie, avec l’expérience soviétique, sera à partir de 1917 le premier pays à essayer de mettre en œuvre la promesse révolutionnaire du marxisme ; mais d’autres, parmi les plus grands, tels Dostoïevski ou Tolstoï, ont mis en exergue la dimension spirituelle et religieuse (avec des références chrétiennes fortes, même si les intéressés prenaient leurs distances avec le christianisme officiel). Certains ont prôné des conceptions universalistes, mais d’autres ont été nationalistes et/ou panslavistes, insistant sur les valeurs particulières qui seraient celles du peuple russe ou des peuples slaves.
Il existe donc en Russie un vieux fonds de conceptions selon lesquelles ce pays, soit serait radicalement étranger aux valeurs occidentales issues des Lumières, soit incarnerait les « vraies » valeurs européennes, avec leur dimension spirituelle et leurs racines chrétiennes.
Tout cela facilite le développement, parmi les dirigeants actuels de la Russie, d’un discours selon lequel le pays incarnerait d’autres valeurs que celles de l’Europe, ou bien les vraies valeurs de celles-ci, ancrées dans la tradition, lesquelles seraient dévoyées dans les pays d’Europe occidentale, qui seraient trop matérialistes, individualistes, capitalistes, oublieux de leurs racines chrétiennes…
Cela permet à la Russie d’exercer une réelle attraction sur un certain nombre de mouvements populistes (d’extrême droite, mais aussi de gauche eurosceptique) ou simplement conservateurs dans les pays européens. La presse a rendu compte des voyages à Moscou, sur l’invitation de personnalités éminentes, de divers leaders des mouvements en cause, y compris des personnalités aussi contestées que M. Gábor Vona, chef du parti Jobbik en Hongrie. Des personnalités politiques européennes telles que M. Aymeric Chauprade (44) ont également accepté de jouer un rôle d’observateur dans le referendum de mars 2014 qui a ratifié l’annexion de la Crimée par la Russie (45). La même personnalité aurait également pris part à Vienne en mai 2014, selon des articles de presse (46), à une rencontre associant des représentants de plusieurs partis d’extrême-droite européens (allemands, autrichiens, bulgares…) à des personnalités russes telles que M. Alexandre Douguine, théoricien de l’« eurasisme ».
L’attraction de la Russie est d’autant plus forte qu’il existe de sérieuses présomptions que les autorités russes soutiennent, notamment sur le plan financier, divers mouvements politiques européens. Cette politique d’influence répond aussi à des intérêts tactiques évidents : renforcer les mouvements extrémistes, populistes et/ou eurosceptiques contribue à affaiblir la cohésion de l’Union européenne.
4. L’église orthodoxe, vecteur d’influence ?
Les prises de position conservatrices, en particulier sur les valeurs sociétales, du pouvoir en place en Russie ne peuvent que donner satisfaction à l’Église orthodoxe russe, dirigée depuis 2009 par le patriarche de Moscou Kirill.
Par ailleurs, le patriarcat de Moscou et l’exécutif russe peuvent partager dans une certaine mesure certaines conceptions géopolitiques, par exemple autour de la notion de « monde russe ». Le chercheur russe Alexeï Miller, citant un discours prononcé par le patriarche Kirill à l’assemblée générale de 2009 de la fondation « Monde russe », relève que ce dernier « assimile, dans sa définition, la notion de Sainte-Russie, traditionnelle pour l’Église russe, à celle de Monde russe, plaçant ainsi l’Église orthodoxe au centre de cette idée et dévoluant au patriarche un rôle particulier dans sa réalisation » (47).
Il faut en effet rappeler que l’autorité du patriarche de Moscou est reconnue bien au-delà des frontières de la Russie, en particulier par les églises orthodoxes d’une grande partie de l’ex-URSS, bien que non sans quelques difficultés qui traduisent les conflits politiques en cours. C’est ainsi qu’en Ukraine, du fait des vicissitudes de l’histoire, coexistent plusieurs églises orthodoxes, dont l’une reconnaît l’autorité du patriarcat de Moscou, mais les deux principales autres sont autocéphales et nées, très significativement, de schismes avec Moscou à deux moments d’affirmation de l’indépendance politique de l’Ukraine, en 1920 puis 1992. De même, en Moldavie, deux églises orthodoxes se disputent les fidèles, l’une étant dans l’obédience du patriarcat de Moscou, l’autre dans celle du patriarcat de Roumanie, ce qui se comprend au regard des liens historiques et linguistiques d’une majorité de Moldaves avec la Roumanie. Hors de l’ex-URSS, la révolution de 1917 avait entraîné la création d’une Église orthodoxe russe à l’étranger qui s’était alors séparée du patriarcat de Moscou, considéré comme inféodé au pouvoir bolchevique. Dans le contexte nouveau créé par la chute de l’URSS, cette église a finalement rétabli son unité avec le patriarcat de Moscou en 2007, bien que certains dissidents aient refusé cette réunification.
L’influence du patriarcat de Moscou hors des frontières de la Russie, dans des pays tels que l’Ukraine et la Moldavie, ou encore dans les diasporas russes du monde entier, contribue donc, à sa manière, au soft power russe. L’article précité de M. Alexeï Miller signale les nombreuses visites pastorales du patriarche Kirill en Ukraine, Biélorussie et Moldavie, estimant qu’il y a aussi joué les « agents diplomatiques pour les projets d’intégration de Moscou ». Plus récemment, c’est à propos de la Syrie que l’Église orthodoxe russe a manifesté son adhésion la plus grande à la politique étrangère russe, son porte-parole Vsevolod Tchapline étant allé jusqu’à parler de « guerre sainte » s’agissant de l’intervention russe (le 30 septembre 2015), laquelle a été notamment motivée par la défense des minorités chrétiennes d’Orient.
Cependant, le patriarcat de Moscou se refuse à être inféodé. M. Alexeï Miller, évoquant le discours précité du patriarche Kirill à propos du « monde russe », y souligne aussi le refus de ce dernier de voir l’organisation de ce nom être un instrument d’influence politique de la Fédération de Russie.
Il faut par ailleurs mentionner l’action d’organisations liées à l’Église orthodoxe et dans lesquelles officient des personnalités proches de l’exécutif russe. M. Vladimir Iakounine, qui présidait jusqu’en 2015 l’entreprise RJD, homologue russe de notre SNCF, est ainsi vice-président de la fondation Saint-André-Premier-Appelé, créée en 1992 pour avoir une action orientée vers la sphère religieuse (organisation de pèlerinages, exposition de reliques, restauration de sanctuaires…). Dans son article susmentionné, M. Miller cite une déclaration de M. Iakounine, remontant à 2012, qui est caractéristique d’une conception du « monde russe » comme opposé aux autres civilisations (et notamment à la civilisation occidentale) : « la Russie est bien sûr un État-civilisation. Toute tentative de lui substituer des fondements empruntés à d’autres civilisations est contre-productive, inefficace pour l’essor du pays et, qui plus est, dangereuse ».
II. UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE TOURNÉE CONTRE LES ÉTATS-UNIS ET L’EUROPE ?
Le constat principal concernant l’évolution de la politique étrangère russe dans la période la plus récente est bien sûr celui de la confrontation croissante avec les États-Unis et l’Union européenne, qui s’est manifestée en Ukraine et en Syrie.
Ce climat général de confrontation ne touche certes pas tous les dossiers et concerne inégalement les pays – la France, notamment, a conservé des relations bilatérales satisfaisantes avec la Russie. Mais il implique de revenir sur les ressorts de la politique étrangère russe, et en particulier sur l’importance de la thématique du ressentiment quant aux injustices, voire aux agressions dissimulées, qui seraient le fait des pays occidentaux contre la Russie.
A. LE DÉBAT SUR LES RESSORTS DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ACTUELLE DE LA RUSSIE
Comme au temps de l’URSS, les ressorts de la politique étrangère du président Poutine sont l’objet de nombreux commentaires et débats. Quelques grandes thèses se dégagent.
1. Une réaction aux « agressions » des États-Unis et de l’Europe ?
Plusieurs auteurs considèrent qu’il y a eu, après la fin de l’URSS, un « grand malentendu » entre la Russie et ce que l’on peut appeler le « bloc occidental ».
Ce malentendu porte d’abord sur la perception des événements de l’époque. La chute du mur de Berlin, puis la fin de l’URSS, ont été vécues comme des événements miraculeux en Occident et dans les anciens pays du « bloc de l’est », mais la perception n’a pas été la même en Russie. Mme Marie Mendras, a ainsi pu écrire : « il est important de souligner le décalage entre le vécu russe et notre vision occidentale des années gorbatchéviennes et de la fin du communisme. Nous avons observé avec enthousiasme et bonne conscience cette période (…). Ce grand malentendu entre les Russes et nous sur l’épisode fondamental de leur histoire récente marquera pendant encore longtemps notre relation avec eux (…). La société russe a, dans l’ensemble, très mal vécu les années 1990 et en conçoit une hostilité au changement et à l’internationalisation, et un profond conservatisme » (48).
Il est clair que de nombreux Russes se reconnaissent dans deux formules, déjà anciennes, prêtées au président Vladimir Poutine : celle selon laquelle l’effondrement de l’URSS aurait été « la plus grande catastrophe géopolitique du XXème siècle » ; et l’affirmation mêlant nostalgie et réalisme selon laquelle celui qui ne regrette pas l’URSS n’a pas de cœur, mais celui qui souhaite son retour n’a pas de tête.
b. L’élargissement à l’est de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne, violation de promesses des dirigeants américains et européens ?
Après la fin du Pacte de Varsovie et de l’Union soviétique, il aurait été légitime, selon certains observateurs, de dissoudre symétriquement l’Alliance atlantique, ou du moins sa structure intégrée, l’OTAN.
Du moins, on aurait pu éviter l’élargissement à l’est de l’OTAN. D’après certains témoignages, les grands dirigeants occidentaux (notamment les présidents, premier ministre ou chancelier américain, français, anglais et allemand alors en exercice) auraient au moment de la réunification allemande, en 1990, pris des engagements oraux de cette nature, qui auraient été une contrepartie de l’acceptation par la Russie de cette réunification. Dans un rapport consacré en 2015 aux relations entre l’Union européenne et la Russie (49), la Chambre des lords fait état de témoignages ou déclarations en ce sens, notamment de Sir Rodric Braithwaite, ancien ambassadeur britannique en URSS puis en Russie, et de M. Robert Mc Namara, ancien secrétaire américain à la défense. Cependant, est-il relevé dans le même rapport, d’autres très hauts responsables, à commencer par les anciens présidents George Bush et Mikhaïl Gorbatchev, ont nié l’existence de tels engagements, lesquels, ajoute le rapport, s’ils ont existé, ne pouvaient qu’être oraux et informels, car leurs auteurs supposés n’avaient pas l’autorité juridique pour lier la politique future de l’Alliance atlantique.
Il n’est donc pas possible de conclure sur la réalité de ces engagements occidentaux, lesquels, s’ils ont existé, n’étaient de toute façon pas formalisés. La seule chose certaine est que l’argumentation sur la « trahison » de ces engagements, qu’elle soit ou non fondée à l’origine, pèse sur les relations entre la Russie et les pays occidentaux.
En effet, l’OTAN a été étendue à la plupart des anciens pays satellites de l’URSS et même à trois ex-républiques soviétiques, en plusieurs vagues d’adhésions : la Pologne, la Hongrie et la République tchèque en 1999 ; la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et les pays Baltes en 2004 ; l’Albanie et la Croatie en 2009 ; prochainement le Monténégro, suite à la décision de l’OTAN annoncée le 2 décembre 2015.
L’Union européenne a également poursuivi son élargissement à l’est. Celui-ci n’est bien sûr pas lié formellement à celui de l’OTAN et il n’est pas allégué qu’il aurait été l’objet d’engagements des pays occidentaux vis-à-vis de la Russie. Mais il a pu être perçu à Moscou comme un corollaire de l’extension de l’OTAN : le fait est que l’entrée dans l’OTAN a souvent été suivie, pour les pays concernés, par celle dans l’Union. Le fait est aussi que l’Union, faute d’avoir développé une réelle capacité militaire propre, se repose en pratique sur l’existence de l’OTAN. Les relations entre les deux organisations ont d’ailleurs été assumées de plus en plus explicitement au fil des ans (par exemple, la déclaration finale du sommet de l’OTAN à Lisbonne le 20 novembre 2010 insiste sur les « valeurs » et « intérêts stratégiques en commun » avec l’Union européenne, ainsi que sur le « partenariat stratégique » entre les deux organisations, qu’elle appelle à renforcer) et une coopération opérationnelle instituée.
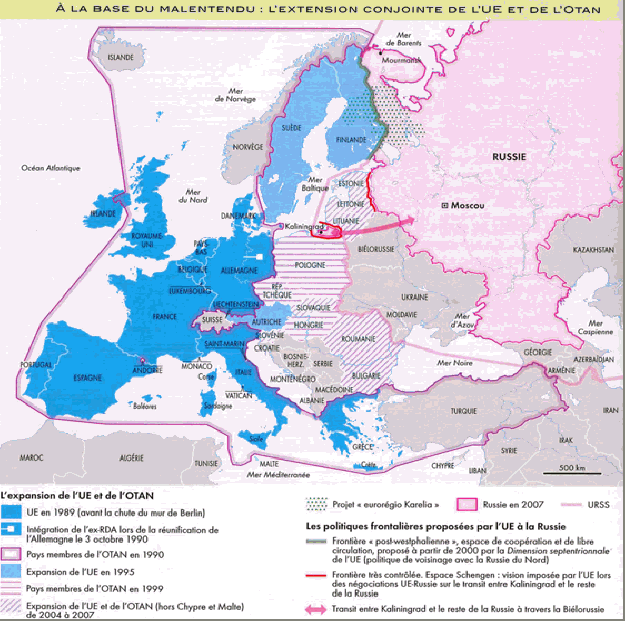
Source : carte extraite de l’Atlas géopolitique de la Russie, éditions Autrement, 2012, par Pascal Marchand.
Quand l’Autriche et la Finlande ont rejoint l’Union européenne en 1995, c’est bien parce que la fin de l’URSS les dispensait de l’obligation de neutralité qui les empêchait auparavant de faire ce choix. En 2004, la plupart des anciens satellites de l’URSS en Europe centrale, suivis en 2007 par la Bulgarie et la Roumanie, ont à leur tour adhéré. 2004 avait aussi vu l’adhésion de trois ex-républiques soviétiques, les pays Baltes.
Dans le même temps, n’étaient offerts à la Russie que des « partenariats » au contenu limité qui n’ont, dans le climat de tension croissante, pas débouché sur beaucoup de réalisations communes :
– en 1994, le « Partenariat pour la paix » de l’OTAN (auquel ont adhéré l’ensemble des pays européens et ex-républiques soviétiques non membres de l’organisation) ;
– la même année, l’accord de partenariat et de coopération avec l’Union européenne, entré en vigueur en décembre 1997 pour dix ans et toujours en attente de renouvellement.
c. Les « révolutions de couleur » et l’exportation de la démocratie, complot occidental contre la Russie, voire contre la paix du monde ?
Une note précitée du ministère des affaires étrangères (50) met en avant la « phobie russe des révolutions de couleur » développée depuis la « révolution orange » ukrainienne de 2004 et le sentiment obsidional qui en résulterait. En conséquence, selon les auteurs de cette note, la Russie aurait « développé une réponse structurée à la menace qu’elle perçoit de "l’exportation" par les pays occidentaux de la démocratie et des droits de l’Homme. Elle mène une politique d’endiguement de la démocratie, en particulier dans les Balkans et en Asie centrale (…) ». Le pouvoir russe développerait donc un « contre-modèle » fondé sur un discours anti-occidental susceptible d’exercer une réelle attraction dans le monde, notamment pour de nombreux pays émergents (voire européens) aux régimes plus ou moins autoritaires.
Les dirigeants russes actuels se posent volontiers en remparts de la légalité internationale – donc de la liberté et de la « démocratie réelle » – contre ce qui serait une nouvelle hégémonie mettant en cause les principes du droit international, en particulier celui de non-ingérence (au nom de l’exportation de la démocratie). Cette thématique est par exemple illustrée par le discours du président Vladimir Poutine à l’Assemblée générale des Nations-Unies le 28 septembre 2015, durant lequel, mettant en exergue les échecs évidents des interventions occidentales au Proche-et-Moyen-Orient, il s’est posé en défenseur du système onusien et plus généralement de la démocratie et de la liberté contre la « domination unique » de qui l’on sait : « nous savons tous qu’après la fin de la Guerre froide – tout le monde le sait – un centre de domination unique est apparu dans le monde. Ceux qui se trouvaient au sommet de cette pyramide ont cédé à la tentation de croire que s’ils étaient aussi forts et exceptionnels, cela signifiait qu’ils savaient tout mieux que tout le monde. Et, par conséquent, qu’ils n’avaient pas besoin de l’ONU (…). La Russie est prête, sur la base d’un consensus large, à œuvrer au développement futur de l’ONU avec tous ses partenaires, mais nous estimons que les tentatives visant à saper l’autorité et la légitimité de l’ONU sont extrêmement dangereuses. Elles pourraient conduire à l’effondrement de toute l’architecture des relations internationales. Auquel cas ne subsisterait plus aucune règle, si ce n’est la loi du plus fort. Ce serait un monde dans lequel l’égoïsme primerait sur le travail collectif, un monde dans lequel il y aurait de plus en plus de diktats et de moins en moins d’égalité, de démocratie réelle et de liberté, un monde dans lequel le nombre de protectorats dirigés de l’extérieur se multiplierait au détriment d’États véritablement indépendants (…) » (51).
2. L’influence des courants de pensée conservateurs, voire réactionnaires
Le philosophe Michel Eltchaninoff a mis en exergue, dans son ouvrage Dans la tête de Vladimir Poutine, l’influence que certains intellectuels auraient sur le président russe. Dans un article récent (52), il observe que, s’inscrivant dans une certaine tradition russe, « Vladimir Poutine, qui n’a pourtant rien d’un intellectuel, cite volontiers des philosophes dans ses discours ».
Il insiste particulièrement sur l’un d’entre eux : « plusieurs penseurs sont cités dans ses discours. Mais un seul peut prétendre au statut de penseur officiel du poutinisme. Il s’agit d’Ivan Ilyine » (1883-1954). Ce dernier, selon M. Eltchaninoff, était un « essayiste ultraréactionnaire » qui, après son expulsion d’URSS, a été proche du franquisme et du salazarisme. Solennellement réhabilité par la Russie postsoviétique, avec le rapatriement en grande pompe, en 2005, de sa dépouille et de ses archives, il serait devenu officiellement le « philosophe favori » du président russe, régulièrement cité dans ses discours.
L’auteur cite ensuite un certain nombre de thèmes récurrents des publications d’Ilyine, dans lesquels il voit une inspiration évidente pour le président Poutine : l’appel à l’unité du peuple ; le recours nécessaire à des hommes providentiels profondément patriotes, voire un « guide », pour sauver la Russie ; l’exaltation d’une « idée russe » nouvelle qui devrait se distinguer du socialisme et du totalitarisme, mais aussi de la démocratie, et serait « religieuse par ses sources et nationale par son sens spirituel » ; la liberté conçue avant tout comme « liberté pour la Russie elle-même » avant d’être liberté des Russes…
3. La constance des préoccupations sécuritaires
La chercheuse Tatiana Kastouéva-Jean a rappelé en audition aux membres de la mission que la Russie, depuis la chute de l’URSS, avait constamment connu des guerres ou des affrontements armés, d’intensité variable, dans son voisinage géographique (conflits ethniques et séparatistes du Caucase, de Transnistrie, du Donbass ; guerres civiles au Tadjikistan et au Kirghizstan…), voire sur son territoire, en Tchétchénie. Le pays a également été confronté plusieurs fois à un terrorisme sanglant causant des morts par centaines (on se souvient de la prise d’otages du théâtre de la Doubrovka à Moscou en 2002, ou encore des terribles événements de 2004 : attentats dans le métro de Moscou, explosion de deux avions des lignes intérieures, prise d’otages de l’école de Beslan). Dans la période la plus récente, l’explosion d’un avion de ligne russe de retour d’Égypte a fait 224 victimes le 31 octobre 2015, tandis que les attaques continuent (d’origines diverses et visant parfois les forces de sécurité, mais aussi, dans d’autres cas, des ONG et des journalistes) dans le nord-Caucase.
La sécurité nationale est donc une priorité du régime qui est globalement bien acceptée par la population. Et bien sûr ce genre de préoccupations peut aisément justifier – en Russie comme ailleurs… – une politique étrangère « musclée ».
4. Le poids des facteurs internes
Selon d’autres analyses enfin, le durcissement de la politique étrangère russe répondrait surtout à des facteurs internes.
De manière un peu triviale, on peut voir dans la politique de grandeur nationale actuelle une manière de ressouder le peuple russe autour de ses dirigeants dans une période de raidissement du régime et de difficultés économiques.
La chercheuse Tatiana Kastouéva-Jean a développé l’argumentation de manière beaucoup plus complète dans un article d’avril 2015 (53). Relevant le soutien populaire massif dont jouit la politique étrangère du président Poutine, elle considère que « ce niveau de soutien ne peut pas être attribué à la seule machine de propagande russe (…). La Russie instrumentalise le discours sur le comportement de l’Occident [qui aurait traité la Russie en "vaincue" de la Guerre froide] pour justifier le raidissement de sa politique étrangère. Si, à n’en pas douter, ce facteur joue, il cache trois mutations profondes de la Russie et de la nature de son régime politique qui ont porté au durcissement de cette politique : une concentration extrême du pouvoir à son sommet, l’échec de la diversification économique et de la modernisation de la Russie postsoviétique et la fragilisation de la société ».
Outre la concentration des pouvoirs entre les mains du président, Mme Kastouéva-Jean met en avant l’échec relatif du processus de modernisation et de diversification de l’économie russe, qui aurait selon elle trois conséquences conduisant à une politique étrangère plus renfermée et plus « dure » : la perspective de la réduction du poids de la Russie dans l’économie globale, génératrice de craintes sur la marginalisation ultérieure du pays ; l’incapacité à s’inscrire dans la mondialisation dans des conditions qui correspondraient à la vision que la Russie se fait de son rôle dans le monde ; la difficulté pour la Russie de s’ériger en modèle véritablement attractif pour les pays voisins (défaut de « soft power »). L’article insiste aussi sur la fragilisation de la société, marquée par la nostalgie de l’Union soviétique, le déclin démographique et la « fuite des cerveaux » (200 000 personnes auraient émigré de Russie au cours des huit premiers mois de 2014 contre 120 000 pour la même période en 2013).
Le consultant américain Robert D. Kaplan a exprimé de manière assez caricaturale le même type de considérations sur le poids des préoccupations internes dans un article récent (54) : pour lui, le régime russe, en semant délibérément le chaos à l’extérieur, viserait surtout à convaincre les Russes de l’intérêt d’un régime stable, même s’il est autocratique (du point de vue de l’auteur), et des risques de toute tentative de transition démocratique (55).
B. LE CONSTAT GÉNÉRAL : UNE DIPLOMATIE DE PUISSANCE ASSEZ CLASSIQUE
Quels qu’en soient les ressorts et les objectifs, l’action internationale de la Russie s’inscrit finalement dans des schémas assez classiques.
1. Une diplomatie souvent opportuniste et habile
Il faut d’abord relever que la Russie doit à son passé soviétique, qui valorisait fortement les diplomates (souvent « diplomates-espions »), de conserver un appareil diplomatique de qualité. De ce passé, elle a aussi hérité le statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies et le droit de veto afférent.
Cette situation conduit la Russie à apparaître souvent comme une force de blocage, invoquant son droit de veto faute d’avoir les moyens politiques, économiques et d’influence d’entraîner des « coalitions » dans son sillage.
Mais elle garde également la capacité de réussir de beaux « coups » diplomatiques. Un exemple caractéristique en est fourni par l’initiative qu’elle a prise suite aux bombardements chimiques du 21 août 2013 en Syrie, alors qu’une intervention des États-Unis et de pays ouest-européens contre le régime syrien paraissait inévitable :
– la diplomatie russe a su s’engouffrer instantanément dans la brèche ouverte par les hésitations américaines (et britanniques) quant aux frappes sur la Syrie. Il aura suffi que le secrétaire d’État John Kerry déclare le 9 septembre 2013 que le régime syrien pourrait échapper aux frappes en livrant l’intégralité de son arsenal chimique pour que quelques heures plus tard la Russie fasse une proposition en ce sens ;
– elle a ainsi épargné les frappes à son allié syrien, tout en évitant au monde, de manière générale, une guerre de plus ;
– cela a débouché sur le premier élément (certes très partiel) de règlement diplomatique de la crise syrienne, à savoir la neutralisation de l’armement chimique de l’armée syrienne :
– la négociation principale s’est faite en « tête-à-tête » avec les États-Unis (avec les conversations de MM. Sergueï Lavrov et John Kerry à Genève), au grand bénéfice du statut international de la Russie.
S’agissant toujours de la Syrie, la négociation du cessez-le-feu du 22 février 2016 apparaît aussi comme une réussite, obtenue là-encore en « tête-à-tête » avec les États-Unis, même si ce cessez-le-feu n’a tenu que deux mois. De même, l’annonce en mars 2016 du retrait russe de Syrie, après six mois de frappes aériennes, vise à faire ressortir l’intervention russe comme une action militaire maîtrisée, avec des objectifs limités et un enlisement évité, même si la réalité est peut-être différente, puisque ce retrait n’est que partiel, voire très partiel.
2. Finalement, une conception « traditionnelle » des relations internationales : souveraineté, puissance, prédominance régionale
Le poids relatif des différents facteurs évoqués supra – « phobie » des révolutions de couleur, ressentiment par rapport aux injustices qui auraient été subies, préoccupations sécuritaires, préoccupations de politique intérieure, influence de la pensée conservatrice… – peut être discuté.
Ce qui est certain, c’est qu’ils concourent à inscrire la politique étrangère russe dans des schémas très « traditionnels » :
– la valorisation des principes de souveraineté, de spécificité nationale, d’indépendance « véritable » (cf. le discours précité du président Vladimir Poutine à l’Assemblée générale des Nations-Unies) et donc de non-ingérence dans les affaires d’autrui et de respect des régimes en place ;
– la réaffirmation d’un « rang » de grande puissance qui a un rôle à jouer dans toutes les affaires du monde, constante qui est déterminante pour comprendre certains éléments de la politique étrangère russe, par exemple celle menée en Syrie ou encore la volonté continue de traiter des affaires du monde en tête-à-tête avec les États-Unis ;
– en corollaire de ce rang, la volonté de conserver, sinon une véritable sphère d’influence, du moins une certaine capacité de contrôle dans le voisinage géographique de la Russie ;
– tout cela conduisant à une combinaison de « légalisme » et de conservatisme dans les relations internationales avec ce que les critiques de la politique russe actuelle appellent du « révisionnisme ».
C. UNE CONFRONTATION CONTRÔLÉE AVEC LES ÉTATS-UNIS ET L’UNION EUROPÉENNE
La plupart des observateurs considèrent que la question des relations avec ce que l’on peut appeler le « bloc occidental » reste centrale dans la politique étrangère de la Russie, même si ces relations sont difficiles ; en particulier, les autorités russes sont particulièrement sensibles à la nature de leurs relations avec les États-Unis, relations parfois conflictuelles mais qu’elles veulent également partenariales, dans la continuité de ce qu’était le « condominium » américano-soviétique. C’est pourquoi votre rapporteur souhaite en traiter en premier, bien que les autres aspects de l’action extérieure de la Russie, tels que la politique de contrôle ou du moins d’influence dans son voisinage géographique ou la recherche d’alliances alternatives en Asie, ne soient pas à négliger.
Les relations entre la Russie et, d’une part les États-Unis, d’autre part l’Union européenne, sont clairement placées, depuis l’annexion illégale de la Crimée en mars 2014, sous le signe de la confrontation. Mais c’est une confrontation sous contrôle, que les différentes puissances ne veulent pas voir dégénérer et qui n’exclut pas des domaines de coopération.
La politique des sanctions, essentiellement économiques, est le symbole de cet affrontement mesuré et contrôlé, qui évite soigneusement le champ militaire, dans lequel l’on se contente de mesures et de confrontations symboliques (vols d’avions russes aux limites des espaces aériens des pays de l’OTAN ; déploiement de moyens aériens de l’OTAN dans les pays Baltes ; annonce récente du déploiement tournant, en 2017, d’une nouvelle brigade blindée américaine de 4 200 hommes en Europe orientale ; organisation, en ce mois de juin 2016, d’exercices militaires très importants de l’OTAN en Pologne, avec plus de 30 000 soldats venant de 24 pays, dont l’Ukraine…) – si l’on excepte le grave incident russo-turc de novembre 2015 (voir infra dans le présent rapport).
La politique des sanctions comporte elle aussi une dimension symbolique, mais permet également de vraies mesures qui font dommage à l’« adversaire », tout en ayant un coût pour ceux qui les appliquent. Cependant, l’on reste – heureusement – sur le terrain économique et, même dans ce domaine, l’on évite sagement les mesures trop radicales.
Mais les sanctions servent-elles à quelque chose ? Le débat sur leur efficacité est inévitable.
1. Les sanctions économiques, instrument à double tranchant
a. Des sanctions adoptées en coordination par un « bloc occidental »
Leur caractère aussi « universel » que possible est naturellement une condition de l’efficacité de sanctions économiques, afin de rendre plus difficiles les contournements.
Les sanctions contre la Russie ont été adoptées parallèlement par l’Union européenne et les États-Unis et sont très proches dans les deux entités, même s’il y a quelques différences, notamment dans les listes de personnes ou d’entreprises sous sanctions. D’autres « vieux » pays industrialisés très liés aux États-Unis ou à l’Union européenne ont également adopté des sanctions contre la Russie, qui restent toutefois généralement plus limitées que les sanctions européennes et américaines : le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l’Islande, la Norvège, la Suisse… Les sanctions font donc apparaître un « bloc occidental ».
b. Les sanctions européennes, un dispositif gradué
L’Union européenne a – de même que les États-Unis – gradué ses sanctions, adoptant successivement, à partir de mars 2014 (annexion de la Crimée), des sanctions dites de phase 1 de nature principalement diplomatique, puis des sanctions de phase 2 ciblant des personnalités ou des entreprises, enfin des sanctions de phase 3 touchant globalement des secteurs économiques, à partir de juillet 2014.
L’Union européenne, en accord avec les États-Unis le cas échéant, a rapidement décidé de remettre en cause un certain nombre de rencontres à haut niveau et de programmes de coopération :
– la Russie a été suspendue du « G8 ». Le sommet prévu à Sotchi a été remplacé en juin 2014 par une réunion du « G7 » à Bruxelles ;
– le sommet Union-Russie a été suspendu et les États membres de l’Union ont décidé de ne pas tenir les sommets bilatéraux que certains, comme la France, avaient habituellement avec la Russie (les réunions au niveau ministériel restant possibles) ;
– les négociations de l’espace Schengen avec la Russie sur les visas ont été suspendues, de même que celles (au point mort de toute façon…) sur un nouvel accord de partenariat Union-Russie ;
– la mise en œuvre des programmes de coopération bilatérale ou régionale avec la Russie a généralement été suspendue. Les projets portant exclusivement sur une coopération transfrontalière ou avec la société civile sont par contre maintenus.
ii. Les sanctions ciblées contre des personnes ou des entreprises
L’Union a imposé dès le 17 mars 2014 des sanctions individuelles : interdiction de voyager sur son territoire et gel des avoirs détenus dans l’Union.
Elles visent les personnes et entités qui sont responsables des « politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine », ou qui soutiennent ces politiques, ou encore apportent un soutien matériel à la politique russe dans le Donbass et en Crimée ou réalisent des transactions avec les séparatistes du Donbass. Sont également concernées des entreprises illégalement confisquées en Crimée.
La liste des personnes et entités sanctionnées, plusieurs fois complétée, comprend maintenant 149 personnes, dont 32 parlementaires russes, et 37 entités (entreprises).
Ces sanctions individuelles, de même que les sanctions économiques plus générales présentées infra, s’inscrivent dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) : conformément aux articles 24 et 31 du traité sur l’Union européenne, elles sont décidées à l’unanimité.
iii. Les sanctions générales prises en réaction à l’annexion illégale de la Crimée
Dans le cadre de sa politique de non-reconnaissance de l’annexion illégale de la Crimée par la Russie, l’Union européenne a imposé à partir du 23 juin 2014 des restrictions drastiques à ses échanges économiques avec la péninsule :
– interdiction des importations de biens en provenance de Crimée, sauf s’ils sont accompagnés d’un certificat d’origine ukrainien ;
– interdiction des investissements nouveaux en Crimée pour les entreprises européennes ;
– interdiction pour les opérateurs européens de proposer des services touristiques en Crimée et interdiction d’y faire escale pour les navires de croisière (battant pavillon d’un État membre ou appartenant à une entreprise européenne) ;
– interdiction d’exporter vers la Crimée des biens et technologies, ainsi que des services (assistance, ingénierie…) dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l’énergie et de l’exploration pétrolière, gazière et minérale.
iv. Les sanctions économiques générales
Adoptées le 31 juillet 2014 et reconduites et complétées périodiquement depuis (elles viennent d’être renouvelées jusqu’au 31 janvier 2017), les sanctions économiques générales de l’Union contre la Russie comprennent :
– la prohibition de tout apport de financement (achats d’actions, obligations et instruments similaires et prêts à plus de 30 jours d’échéance) par des opérateurs européens ou service lié à de telles opérations à : cinq grandes banques publiques russes (qui représentent ensemble près de 60 % du secteur bancaire russe en termes de crédits ou de dépôts) ; cinq grandes compagnies énergétiques russes ; trois grandes entreprises du complexe militaro-industriel (et les filiales de toutes ces entreprises) ;
– la prohibition des importations et exportations d’armes et de matériels connexes avec la Russie ;
– la prohibition des exportations de biens et technologies « à double usage » vers la Russie ;
– la prohibition des exportations vers la Russie de certains équipements, services et technologies du pétrole (le gaz n’est pas concerné) : ceux permettant l’exploration ou la production pétrolière en eaux profondes, dans l’Arctique ou « non conventionnelle » (huile de schiste).
Lors du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015, les dirigeants européens sont convenus, dans leurs conclusions, que la durée des sanctions économiques adoptées le 31 juillet 2014 « devrait être clairement liée à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk ».
Par ailleurs, le 16 juillet 2014, le Conseil européen avait demandé à la Banque européenne d’investissement (BEI) de suspendre toutes nouvelles opérations en Russie. Les États membres ont aussi décidé de coordonner leurs positions au sein du conseil d’administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) aux mêmes fins.
v. Les contre-sanctions russes
La Russie a réagi par des contre-sanctions qui comportent en particulier, depuis le 6 août 2014, un embargo sur une grande partie des importations agricoles (viandes, produits de la pêche, produits laitiers, fruits, légumes et certains types de produits préparés) en provenance de l’Union européenne, des États-Unis et d’autres pays tels que l’Australie, le Canada et la Norvège. Il a été reconduit en juin 2015 pour un an.
Cette mesure vient s’ajouter à l’embargo « sanitaire » en vigueur depuis février 2014 sur le porc et les produits à base de porc en provenance de l’ensemble du territoire de l’Union : cet embargo décidé juste avant la révolution de Maïdan a officiellement été motivé par quelques cas de peste porcine africaine détectés chez des sangliers en Lituanie et en Pologne, mais s’inscrivait déjà aussi dans le climat de confrontation politique Union européenne/Russie autour du Partenariat oriental et de la crise politique en Ukraine.
La Russie a également établi une liste de personnalités européennes interdites d’entrée sur son territoire.
c. Un coût économique nécessairement partagé entre « sanctionneurs » et « sanctionné »
Les sanctions économiques constituent un instrument diplomatique qui est déployé à des fins politiques. Elles ont nécessairement un coût économique partagé. L’enjeu est de maximiser ce coût pour le pays ciblé par rapport à celui supporté par les pays d’origine des sanctions ; pour ceux-ci, un autre enjeu est celui de la répartition « équitable » du coût des sanctions entre eux.
i. Les sanctions et contre-sanctions pèsent surtout sur la situation économique de la Russie
Lorsque des sanctions et contre-sanctions, qui constituent une sorte de « guerre économique », opposent des entités aux poids économique très différents, leur impact est généralement beaucoup plus fort sur l’entité dont le poids est le plus faible. En effet, l’impact de sanctions, comme de toutes autres mesures économiques, se ressent et se mesure donc en proportion (en %) du revenu, du PIB ou d’autres grandeurs économiques. Une politique d’embargo qui entraînera, par exemple, la diminution de 10 milliards des échanges commerciaux ne sera pas du tout ressentie de la même façon et n’aura pas les mêmes conséquences sur les grands équilibres économiques et le niveau de vie des populations selon que ces 10 milliards réduiront de 1 % ou de 10 % les échanges extérieurs des entités concernées. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est intéressant pour les « vieux » pays industrialisés de constituer des « blocs » pour sanctionner des pays tels que la Russie, car ils valorisent ainsi leur poids économique cumulé et accroissent la disproportion des effets des sanctions sur leur propre économie et sur l’économie du pays visé.
Dans ce contexte, vu la disproportion entre les poids économiques de la Russie et du « bloc » de pays qui ont pris des sanctions économiques contre elle, il n’est pas étonnant que les prévisions et analyses sur les conséquences des sanctions et contre-sanctions anticipent un impact bien plus fort sur l’économie russe que sur celle, notamment, de l’Union européenne : on l’a vu, le FMI ou la Commission européenne évoquent une perte de croissance, toutes choses égales par ailleurs, de 1 % à 1,5 % par an pour la Russie, contre au plus 0,2 % ou 0,3 % pour l’Union. Une analyse faite par l’administration américaine (56) arrive à des résultats comparables : selon celle-ci, l’impact négatif maximal des sanctions sur le montant des exportations mondiales des pays de l’Union serait de l’ordre de 0,2 % en 2015 (57).
Pour autant, le fait que l’immensité de l’économie européenne lui permette globalement d’absorber assez bien l’affrontement économique avec la Russie ne doit pas occulter, au plan micro-économique, les dommages qu’il cause, inévitablement, aux entreprises ou aux branches d’activité qui avaient l’habitude de travailler avec des partenaires russes et ne le peuvent plus.
Ce sont les pays tiers, non associés aux sanctions, qui profitent des mesures d’embargo en prenant la place, dans les échanges, des entreprises européennes qui ne peuvent plus commercer avec la Russie (et vice-versa des entreprises russes ne pouvant plus commercer avec l’Union ou s’y financer). Il est d’ailleurs assez vraisemblable que ces pays tiers, dans un certain nombre de cas, servent surtout de plateformes pour changer les étiquettes et contourner ainsi les restrictions commerciales des uns et des autres, en tirant au passage de substantiels profits de ces opérations de contournement. Il paraît que l’on trouve maintenant à Moscou des crevettes biélorusses, bien que la Biélorussie n’ait pas d’accès à la mer… Le graphique ci-après, relatif aux importations russes de produits alimentaires sous embargo (contre l’Union européenne, les États-Unis et d’autres pays) depuis août 2014, montre tout à la fois une forte baisse de ces importations en 2014 (due à l’embargo, mais aussi sans doute aux difficultés économiques de la Russie) et la montée en puissance de fournisseur alternatifs comme la Turquie et la Biélorussie.
Évolution des importations russes de produits alimentaires concernés par l’embargo
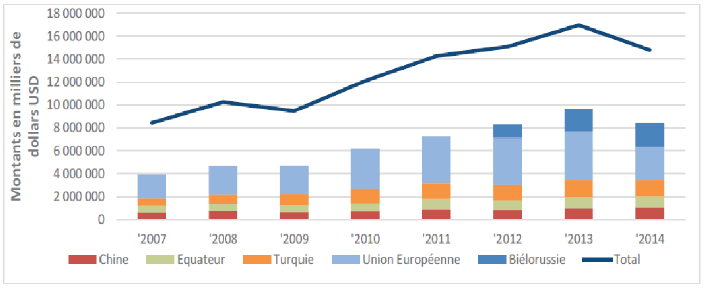
Source : douanes russes, note de la direction générale du Trésor, « Le commerce extérieur de la Russie en 2014 ».
Il faut toutefois rappeler que, depuis lors, la Russie a étendu son embargo aux produits turcs (suite à la destruction de son avion de combat en novembre 2015), tout en durcissant encore ses restrictions contre les produits ukrainiens : à force de multiplier les mesures de « guerre commerciale » de ce type, les autorités russes courent le risque de se mettre de plus en plus dans la main des quelques fournisseurs alternatifs restants.
ii. Un coût des sanctions partagé entre les pays occidentaux
Lors de la négociation préalable à l’établissement des sanctions économiques à l’encontre de la Russie, chaque pays européen a naturellement cherché à préserver ses intérêts.
Il est vraisemblable que l’impact des sanctions, contre-sanctions russes et plus généralement de la crise avec la Russie dépend pour les uns et les autres de l’intensité des relations économiques qu’ils avaient antérieurement avec la Russie.
Le poids de ce pays dans le commerce extérieur des États membres était très inégal avant la crise de 2014 : en 2013, selon le rapport de l’administration américaine précité, la Russie a absorbé en moyenne 3 % des exportations de marchandises des États membres, mais cette moyenne recouvrait des disparités considérables :
– entre 10 % et 20 % des exportations des pays Baltes allaient vers la Russie, de même que plus de 9 % des exportations finlandaises ;
– entre 3 % et 5 % des exportations allemandes, autrichiennes et de la plupart des pays d’Europe centrale étaient destinées à la Russie ;
– ce taux tombait à 2,75 % pour l’Italie, 1,75 % pour la France et 1,14 % pour le Royaume-Uni. S’agissant par ailleurs des États-Unis, il était encore plus faible : à peine 0,7 %.
Entre le premier trimestre 2014, juste avant la crise ukrainienne, et le premier trimestre 2015, le même rapport fait le constat d’une chute de presque 46 % des exportations moyennes des États membres de l’Union vers la Russie. Cette chute apparaît assez homogène selon les pays : pour chacun des dix principaux exportateurs européens vers la Russie, elle est comprise entre 42 % et 49 % (pour la France, elle est de 45 %, très proche de la moyenne européenne). Mais, comme la part des exportations globales de ces pays qui était destinée à la Russie était en revanche très disparate, l’impact estimé des sanctions sur leurs exportations globales, évalué à 20 % de la baisse de leurs ventes en Russie (le reste étant imputé à la crise économique due en Russie à la baisse des cours des hydrocarbures), est en revanche très inégal. Cet impact serait en moyenne de 0,22 % dans l’Union, mais avec de fortes disparités :
– plus de 1 % sur les exportations mondiales des pays Baltes et 0,71 % sur celles de la Finlande ;
– plus de 0,3 % sur celles de la Pologne et de la République tchèque ;
– 0,25 % sur celles de l’Allemagne, 0,2 % sur celles de l’Italie, 0,15 % sur celles de la France et 0,09 % sur celles du Royaume-Uni.
S’agissant des États-Unis, un fait curieux a toutefois été relevé en 2014 : alors que les exportations des différents pays européens vers la Russie baissaient – en moyenne de 12 % par rapport à 2013 –, celles des États-Unis vers la même Russie connaissaient une évolution beaucoup plus favorable : elles n’auraient baissé que de 3 % selon les chiffres américains et auraient même augmenté de 15 % selon les chiffres des douanes russes ! Selon le rapport – américain… – précité, ce phénomène serait temporaire et dû à des livraisons massives d’avions de ligne qui auraient eu lieu au premier semestre 2014 (avant l’imposition des sanctions économiques) et correspondraient à des commandes bien antérieures. En 2015, effectivement, la part du marché russe tenue par les importations américaines s’est légèrement tassée après sa forte progression de 2014.
Les contre-sanctions russes frappant l’agro-alimentaire ont été l’objet d’études plus spécifiques. D’après une analyse ex-ante (58) faite en France, notre pays ne devrait pas être celui qui en souffrira le plus, ce pour une raison simple déjà évoquée : notre commerce avec la Russie est bien moins important que celui d’autres États membres. Si l’on prend les exportations en 2013 vers la Russie de produits soumis depuis à embargo, ce qui est une manière d’évaluer les pertes potentielles, celles de provenance française atteignaient 220 millions d’euros, ce qui nous plaçait au 9ème rang dans l’Union, ainsi que derrière la Norvège, les États-Unis et le Canada, comme on le voit sur le graphique ci-après.
Montant en 2013, par pays, des exportations agricoles soumises en 2014 à l’embargo russe
(en millions d’euros)
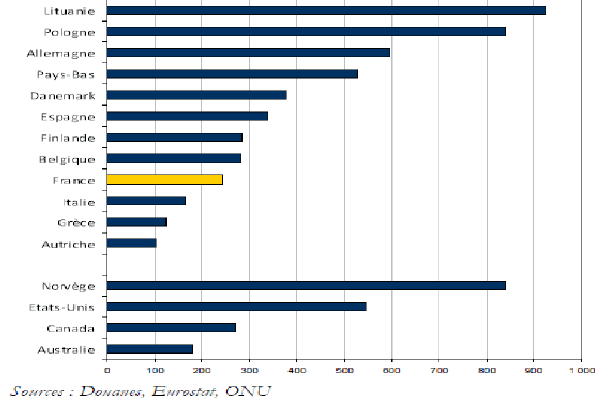
Les auteurs de l’étude précitée soulignaient toutefois la possibilité d’un « effet de second tour » : un déversement des produits sous embargo non vendus en Russie par nos partenaires vers les autres pays, dont la France, donc une augmentation des importations agro-alimentaires. En additionnant pour la France les deux effets de perte directe du marché russe et de report des exportations en provenance des autres pays sous embargo, on aurait une dégradation maximale de 590 millions d’euros de notre solde commercial agro-alimentaire, dégradation qui resterait toutefois plus faible que celle concernant plusieurs de nos partenaires : Allemagne, Pologne, Lituanie, Norvège, Pays-Bas et États-Unis (voir graphique ci-après). En pratique, il semble que l’absence d’exportations des produits sous embargo vers la Russie représente un manque à gagner annuel d’environ 280 millions d’euros. Mais l’impact réel est plus difficile à estimer car les produits en cause ont pu être exportés vers d’autres destinations (certainement à des prix inférieurs, mais il ne s’agit pas d’une perte sèche) ou transformés.
L’effet cumulé potentiel, sur la base des données de 2013, des pertes de marchés agricoles en Russie et du surcroît d’importations généré
(en millions d’euros)
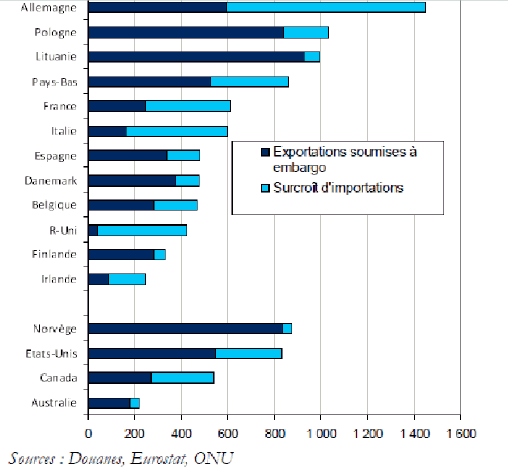
Il faut enfin signaler un effort particulier consenti, inévitablement, par notre pays en renonçant au contrat « Mistral » avec la Russie. Ce contrat de 2011 prévoyait la fourniture par l’entreprise publique DCNS de deux « bâtiments de projection et de commandement » Mistral pour 1,2 milliard d’euros. Il y a été mis fin le 5 août 2015 par un accord amiable avec le gouvernement russe, car, même si ce contrat ne tombait pas sous le coup de l’embargo sur les armes décidé par l’Union européenne à l’encontre de la Russie (compte tenu de son antériorité), il n’était pas envisageable de l’exécuter. Les conditions négociées avec la Russie sont raisonnables et les navires ont pu être revendus à l’Égypte, mais à un prix moindre. Cette affaire se soldera donc par une perte (ou un manque à gagner) limitée, mais réelle, correspondant au rabais consenti à l’Égypte, aux frais remboursés à la partie russe, enfin aux frais d’adaptation au nouveau client des navires et de gardiennage et maintenance pendant la période de latence.
Même s’il existait, avant 2014, des flux d’armements vers la Russie en provenance de plusieurs autres États membres de l’Union européenne, aucun contrat de l’ampleur du contrat Mistral n’avait été signé avec la Russie. En conséquence, si d’autres pays ont été amenés à annuler ou interrompre des contrats d’armement avec la Russie (par exemple, s’agissant de l’Allemagne, un contrat de 120 millions d’euros de l’entreprise Rheinmetall pour un centre d’entraînement, ou encore un contrat de fourniture de moteurs pour des corvettes de l’entreprise MTU Friedrichshafen qui était d’un montant d’environ 24 millions d’euros), les enjeux financiers étaient bien plus faibles.
De fait, notre pays a donc accepté, au titre de la solidarité européenne, un sacrifice financier réel.
d. Les enjeux politiques des sanctions
Les sanctions économiques constituent un instrument diplomatique : elles affectent l’économie à des fins politiques. Il est donc nécessaire de les analyser sous cet angle : sont-elles politiquement opportunes ? Atteignent-elles leur objectif politique ?
i. Les termes du débat sur l’opportunité de sanctionner la Russie
Sur le plan politique, l’adoption de sanctions contre un pays appelle d’abord un débat d’opportunité : la gravité des actes imputés aux dirigeants de ce pays, qui motivent ces sanctions, en justifie-t-elle les inconvénients non seulement économiques, mais aussi politiques – notamment, dans le cas de la Russie, la dégradation des relations avec un grand pays qui est un partenaire déterminant sur nombre de dossiers internationaux ?
Deux types de considérations ont conduit les dirigeants des grands pays européens, dont la France, à appuyer le principe de sanctions contre la Russie :
– d’une part, la Russie a commis, en annexant formellement et unilatéralement la Crimée, une violation caractérisée et très grave du droit international (voir sur ce point le développement sur la Crimée en première partie du présent rapport). Comme l’indiquait notre collègue Michel Vauzelle dans son rapport relatif à l’approbation du règlement amiable de l’affaire des navires Mistral (59), le nombre de précédents de ce type depuis 1945 est limité (60) et ils n’ont en règle générale pas été reconnus par la communauté internationale ;
– d’autre part, il était nécessaire de préserver la cohésion de l’Union européenne, car la crédibilité de la sa Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) était en jeu si elle ne parvenait pas à une position commune et ne réagissait pas fermement à une politique russe qui était perçue par certains États membres comme menaçant gravement leur sécurité nationale.
ii. Une efficacité difficile à mesurer
Le coût politique et économique de mesures de sanction doit par ailleurs être justifié par leurs résultats. Cependant, mesurer ces résultats est très difficile. En effet, cela suppose :
– d’une part, que des objectifs politiques précis aient été définis ;
– d’autre part, de pouvoir distinguer l’effet propre des sanctions de celui des autres facteurs qui déterminent la politique des pays.
• Des objectifs qui ne sont pas toujours explicités
Dans le cas des sanctions contre la Russie, l’Union a mis longtemps à en expliciter les objectifs.
En effet, lorsque l’on se reporte aux différentes décisions, prises en Conseil des ministres des affaires étrangères dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui ont institué en 2014 les différentes régimes de sanctions contre la Russie (sanctions individuelles ; sanctions liées à la Crimée ; sanctions économiques générales), on observe que les considérants qui en justifient le dispositif ne fixent pas à proprement parler d’objectifs aux sanctions : ils rappellent les actions reprochées à la Russie, les différentes demandes faites aux autorités de ce pays par les instances européennes de changer de politique, avant de conclure par des formules du type : « compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil estime qu'il est approprié de prendre des mesures restrictives en réaction aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine » (61). Les sanctions sont bien présentées comme des mesures prises « en réaction » à la politique russe, mais les résultats attendus de leur mise en œuvre ne sont pas explicités.
Les conclusions des Conseils européens (des chefs d’État et de gouvernement) sont longtemps restées aussi peu explicites. Toutefois, lors du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015, il a été acté dans les conclusions publiées que « la durée des mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie, adoptées le 31 juillet 2014 [ce sont donc les sanctions économiques générales], devrait être clairement liée à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk ». Un lien clair a donc été établi entre maintien des sanctions économiques générales et application des accords de Minsk.
• Est-ce une bonne chose de réduire les marges de manœuvre de l’exécutif russe ?
Au-delà de la question de la définition des objectifs politiques recherchés à travers les sanctions, se pose bien sûr celle de leur capacité à atteindre ces objectifs. Les sanctions économiques constituent un instrument de pression diplomatique qui apparaît comme une alternative à des moyens plus radicaux (comme une menace d’intervention ou de soutien militaire), avec un coût politique moindre, mais aussi une efficacité plus limitée.
Dans une note récente (62), la direction générale du Trésor s’est penchée sur les résultats de quelques 200 régimes de sanctions économiques qui ont été recensés au XXème siècle. Sans surprise, ce document arrive au constat que le taux de réussite des politiques de sanctions a été bon (65 %) lorsque leurs objectifs étaient « modestes » (règlement de litiges commerciaux ou de cas individuels – otages, extraditions), mais devient beaucoup plus faible dès que les objectifs étaient un peu plus ambitieux (par exemple, des améliorations de la situation des droits de l’homme ou la lutte contre la prolifération nucléaire), voire insignifiant (5 %) pour les objectifs « très ambitieux » comme le règlement d’un conflit militaire ou d’un litige territorial ou encore un changement de régime politique.
Taux de réussite des régimes de sanctions économiques recensés au XXème siècle en fonction de l’ambition des objectifs poursuivis
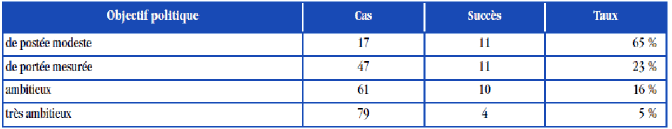
Source : Lettre Trésor-Éco, n° 150, juillet 2015, « Sanctions économiques : quelles leçons à la lumière des expériences passées et récentes ? »
On cite souvent le cas de l’accord sur le nucléaire iranien comme exemple de réussite d’une politique de pression par des sanctions économiques. Mais deux points doivent être soulignés dans l’analyse de ce cas de figure :
– les sanctions économiques adoptées contre l’Iran ont été efficaces car elles étaient particulièrement strictes, comprenant notamment un embargo européen contre sa principale source de devises à l’exportation, les hydrocarbures, et des mesures encore plus radicales de la part des États-Unis (interdiction de pratiquement tous les échanges commerciaux et transactions financières avec l’Iran, avec quelques exceptions « humanitaires » ou « culturelles » concernant par exemple les produits de santé, certains produits agricoles et les biens culturels). S’agissant de la Russie, les sanctions financières européennes et américaines n’interdisent pas les transactions courantes, mais seulement les opérations de prêt et de financement, et ce seulement à certaines banques publiques et secteurs économiques ; et il n’a jamais été question de stopper les flux de gaz et de pétrole russes vers l’Europe ;
– un accord pouvait être trouvé sur le programme nucléaire iranien sans que personne ne perde la face car, même si l’on sait bien quels étaient les enjeux réels (l’accès rapide ou non à la bombe atomique), ce programme a toujours été officiellement un programme « civil » et la communauté internationale ne remet pas en cause le droit de l’Iran à développer les usages civils de l’énergie nucléaire. Il était donc possible de passer un accord « technique » sur le renforcement du contrôle international de ce programme nucléaire « civil » et l’auto-limitation par l’Iran de certains de ses aspects tels que le degré d’enrichissement du combustible ou le nombre de centrifugeuses permettant cet enrichissement. A contrario, il serait sans doute naïf d’imaginer que des sanctions économiques puissent amener les dirigeants russes à perdre la face en renonçant à la Crimée…
En fait, les sanctions européennes et américaines ont probablement un double effet sur l’exécutif russe :
– d’un côté, en accentuant les difficultés économiques du pays, donc ses problèmes budgétaires et sociaux, elles réduisent à terme les marges de manœuvre du pouvoir pour mener des politiques coûteuses d’interventions extérieures ou d’armement. Elles montrent aussi l’unité et la détermination du « bloc occidental ». Les promoteurs des sanctions, notamment dans les milieux européens, considèrent que c’est leur existence qui a amené l’exécutif russe à se rallier à des positions modérées sur la crise du Donbass (adhésion au processus de Minsk et donc reconnaissance explicite de l’appartenance du Donbass à l’Ukraine ; distanciation par rapport à la thématique de la « Novorossiya » développée dans les milieux nationalistes russes, qui rappellent que le sud de l’Ukraine a d’abord été une région de colonisation russe au XVIII-XIXème siècles, d’où le vocable alors utilisé de « Nouvelle Russie ») ;
– de l’autre, elles amènent l’exécutif russe, avec un certain succès, à chercher à conforter sa légitimité en valorisant sa résistance à l’« impérialisme » occidental, ce qui lui interdit évidemment toute concession visible aux pressions américaines ou européennes. Le réflexe patriotique suite au « retour » de la Crimée à la mère-patrie sert pour le moment la popularité du président Vladimir Poutine : sa cote de popularité, qui était tombée à 60-65 % en 2013, se maintient depuis mars 2014 au-dessus de 85 %, ce qui, comme on l’a vu supra, l’a ramenée à ses meilleurs niveaux de 2007-2008, au temps des années de forte croissance économique. On peut donc se demander si la politique des sanctions, en permettant au pouvoir russe d’imputer en partie les difficultés économiques présentes du pays à une action « agressive » des pays occidentaux, ne le dédouane finalement pas trop facilement de ses propres responsabilités en la matière. On peut également craindre qu’un pouvoir dont la popularité repose trop largement sur l’exaltation patriotique ne soit enclin à aucune concession sur le plan international, voire ne soit tenté de jouer la carte de la continuation des tensions.
À court terme, on voit donc mal comment les pressions économiques pourraient amener l’exécutif russe à changer les grands axes de sa politique internationale, du moins visiblement. À plus long terme, elles peuvent contribuer à des inflexions vers des positions plus « constructives », par exemple concernant la Syrie ou le Donbass, mais on pourrait aussi imaginer, notamment en cas de grave crise sociale en Russie, des risques d’évolutions totalement contre-productives, comme un renforcement de la tentation des aventures militaires.
iii. Le lien établi avec l’application des accords de Minsk : les sanctions restent-elles équitables dans le contexte actuel ?
Enfin, s’agissant toujours des enjeux politiques des sanctions concernant la Russie, le lien établi, lors du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015, entre la poursuite des sanctions économiques générales et l’application des accords de Minsk ouvre le débat sur l’équité de sanctions concernant seulement la Russie quand les torts sont manifestement partagés dans les retards pris dans le processus de Minsk. En effet, la partie ukrainienne y a aussi sa part de responsabilité du fait, ainsi qu’on l’a vu, de l’absence de majorité parlementaire pour adopter dans les délais prévus la révision constitutionnelle destinée à « graver dans le marbre » le statut spécial des régions séparatistes du Donbass après leur réintégration à l’Ukraine.
2. Une politique russe plus constructive concernant le conflit du Donbass ?
La confrontation réelle, mais soigneusement contrôlée de part et d’autre, entre la Russie et les pays occidentaux se cristallise depuis 2014 sur deux conflits : l’Ukraine ; la Syrie.
Concernant l’Ukraine, l’annexion de la Crimée, qui a refait l’unité de la grande majorité des Russes autour de leur président, apparaît comme un fait vraiment difficile à remettre en cause – ce qui ne signifie pas pour autant qu’il faut la reconnaître…
L’attitude de la Russie dans le conflit séparatiste du Donbass est différente. Comme votre rapporteur l’a rappelé en première partie du rapport, les événements, dans le Donbass, sont d’abord partis d’un soulèvement local contre le changement du pouvoir central à Kiev survenu en février 2014. C’est ultérieurement que la Russie s’est mise à soutenir massivement les séparatistes dans leur affrontement avec l’armée ukrainienne.
Ensuite, la Russie s’est officiellement impliquée dans le processus de Minsk. Des déclarations successives le confirment. Par exemple, le président Vladimir Poutine a encore dit, dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations-Unies le 28 septembre 2015, sa conviction que « seul le respect complet et scrupuleux des accords de Minsk du 12 février 2015 permettra de mettre un terme à l’effusion de sang et de sortir de l’impasse. On ne garantira pas l’intégrité de l’Ukraine par les menaces et la force des armes » (63). La Russie reconnaît donc l’appartenance du Donbass à l’Ukraine, sous réserve cependant d’un « statut spécial » allant potentiellement très loin et tout en insistant sur la nécessité de dialoguer directement avec les séparatistes : toujours selon ce discours du président russe, « il faut réellement tenir compte des intérêts et des droits des populations du Donbass, respecter leur choix, s’entendre avec elles, comme le prévoient les accords de Minsk, sur les éléments clés de la structure politique de l’État ». Les officiels russes rencontrés par la délégation de la mission qui s’est rendue à Moscou fin mars 2016 ont généralement confirmé que leur pays n’avait pas d’autre politique que l’application pleine et entière de l’agenda de Minsk, mais réaffirmé la thèse selon laquelle la Russie n’aurait finalement guère de responsabilité dans toute cette affaire – selon cette thèse, elle n’aurait guère qu’un rôle de médiation, comme la France et l’Allemagne : il s’agirait avant tout, pour les autorités centrales ukrainiennes, de tenir leurs engagements politiques (révision constitutionnelle et loi sur le « statut spécial », loi d’amnistie…) après avoir directement négocié avec les « autorités » de fait séparatistes.
En pratique, l’exécutif russe joue-t-il le jeu ?
Il existe deux évolutions possibles dans le Donbass (si l’on écarte une reprise violente des combats heureusement peu probable) : soit un arrangement politique sera trouvé pour réintégrer effectivement le Donbass dans l’Ukraine (avec reprise du contrôle de la frontière avec la Russie par le gouvernement central), en contrepartie du fameux « statut spécial » ; soit on évoluera vers un « conflit gelé » à la manière de celui de Transnistrie en Moldavie, avec un probable apaisement des affrontements armés, mais le maintien de deux pseudo-États non reconnus, les « républiques populaires » de Donetsk et Louhansk.
Du point de vue de l’exécutif russe, les deux options présentent l’avantage de rendre très difficile toute perspective d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ou à l’Union européenne.
Selon certains observateurs, la Russie pourrait cependant avoir plus intérêt à une sortie de crise négociée s’inscrivant dans le processus de Minsk qu’à un « pourrissement » :
– cette option devrait permettre la levée d’une grande partie des sanctions européennes ;
– elle signifierait aussi que les coûts de reconstruction du Donbass, dévasté par la guerre, seraient largement pris en charge par la communauté internationale (en particulier l’Union européenne), alors que, dans l’hypothèse d’un « conflit gelé », la Russie, qui n’en a guère les moyens, devait « porter à bout de bras » des entités séparatistes (comme elle le fait déjà pour la Crimée, la Transnistrie, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud) sans avenir économique (car sous sanctions internationales), mais livrées aux trafics de tous genres ;
– la capacité de blocage d’évolutions diplomatiques de l’Ukraine vers l’OTAN ou l’Union européenne pourrait être mieux garantie par un compromis institutionnel interne donnant au Donbass un réel poids dans la politique ukrainienne que par le simple maintien du pays en situation de conflit larvé (64) ;
– cela permettrait de donner la priorité à la Syrie, autre dossier difficile.
Lors de son audition le 30 mars 2016 par la commission des affaires étrangères (65), notre ambassadeur à Moscou, S. E. Jean-Maurice Ripert, a estimé que les autorités russes souhaitaient réellement tourner la page du Donbass.
Également auditionné, le 27 avril 2016, par la commission (66), le diplomate Pierre Morel, chargé d’animer le groupe de travail « politique » dans le cadre du processus de Minsk, a souligné que, de son point de vue, ni la Russie, ni l’Ukraine n’avaient intérêt – contrairement à ce que leurs dirigeants respectifs croient peut-être – à un blocage de la situation : cela conduirait à la pérennisation, dans le Donbass, d’une vaste « zone de non-droit » dont l’existence finirait par contaminer les régions avoisinantes : « avec le temps qui passe, une zone de non-droit d’une ampleur sans précédent va se développer en Europe. On entend souvent dire que ce sera simplement un conflit gelé de plus, que le Donbass va devenir une sorte de grosse Transnistrie. [Mais] la Transnistrie, c’est 200 000 habitants, et cela fait plus de vingt ans que les petits trafics se perpétuent dans la région sans déranger grand monde ; ils affectent la vie locale, mais non l’ordre européen. Le Donbass, en revanche, c’est un ensemble de 4 à 5 millions d’habitants, voisin de très grandes zones industrielles. S’il devient, année après année, une zone où il n’y a plus de norme de référence, il concentrera automatiquement tous les trafics possibles et imaginables et contaminera non seulement le sud de l’Ukraine, mais aussi le sud de la Russie. Ce foyer de déstabilisation constituera une menace grave pour les deux pays et une source de tensions pour l’ensemble de l’Europe ».
Dans l’autre sens, on l’a dit, un pourrissement de la situation, accompagné d’un maintien des tensions, pourrait aussi servir les intérêts, notamment électoraux, d’un exécutif russe dont la popularité est principalement fondée sur sa politique étrangère de puissance.
Il pourrait y avoir aussi un pari attentiste sur un futur changement de pouvoir en Ukraine, suite à des élections, compte tenu de l’impopularité actuelle des dirigeants ukrainiens et de la crise qui a fait exploser la majorité parlementaire « pro-européenne » issue de la révolution de Maïdan : par retour de balancier, l’Ukraine pourrait alors se voir doter d’une représentation parlementaire moins « anti-russe », avec laquelle la Russie pourrait rechercher des arrangements plus favorables.
Sur le terrain, l’action de la Russie reste ambiguë. Lors de son audition précitée du 30 mars 2016, S. E. Jean-Maurice Ripert notait qu’« il est difficile de croire que [les Russes ne peuvent] pas imposer à MM. Alexandre Zakhartchenko et Igor Plotnitski, présidents autoproclamés respectivement à Donetsk et à Lougansk, ce qu’ils ont été capables, d’imposer en Syrie au président Bachar al-Assad [un cessez-le-feu effectif] ». Auditionnée le 2 février 2016 par la commission des affaires étrangères (67), Mme Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères et du développement international, a considéré également que les autorités russes pourraient notamment faire plus pour garantir le cessez-le-feu dans le Donbass, de manière à obtenir, en contrepartie, des avancées politiques de la partie ukrainienne (par exemple sur la révision constitutionnelle relative au statut du Donbass) : « M. Poutine et l’establishment russe disent à l’envi que la Russie fait sa part du travail alors que les Ukrainiens ne prennent pas les décisions qu’ils devraient prendre et sont donc responsables de la non-mise en œuvre des accords de Minsk. C’est en partie vrai, mais il faut faire pièce à cette rhétorique, car les premiers responsables de la situation sécuritaire sur le terrain sont les Russes. Selon la mission de l’OSCE, la majorité des violations du cessez-le-feu est le fait des séparatistes. Or les Russes contrôlent non pas la totalité des séparatistes, mais tout de même 80 % d’entre eux. Si le cessez-le-feu est devenu effectif le 1er septembre, c’est parce que les Russes ont signifié aux séparatistes qu’il fallait calmer le jeu. Il nous semble donc important (…) de faire en sorte que toutes les parties, notamment les Russes, s’engagent à stabiliser la situation sécuritaire ».
On peut également rappeler les mesures de « guerre économique » réciproques (embargos divers) adoptées depuis fin 2015 par la Russie et l’Ukraine, qui ne plaident pas pour la thèse d’un apaisement.
Il est donc vraiment difficile de présumer du degré de « bonne volonté » russe concernant le règlement du conflit dans le Donbass. Sommes-nous même sûrs que les dirigeants russes ont une vision claire de ce qu’ils veulent à moyen terme pour l’Ukraine et le Donbass ?
3. La Syrie : une coopération inévitable avec les États-Unis, malgré les divergences
Comme votre rapporteur le développe plus longuement infra dans la partie consacrée à la politique russe au Proche-et-Moyen-Orient, l’intervention militaire russe en Syrie, dont le désengagement vient de commencer, répondait à des justifications et des intérêts divers (mise en avant des valeurs de la diplomatie russe, telles que la fidélité aux alliés et l’attachement à la légalité internationale ; crainte de la contagion djihadiste en Russie et en Asie centrale ; intérêts stratégiques en Syrie…). Mais, parmi ces motivations, certaines allaient au-delà des considérations régionales ou sécuritaires : cette intervention visait aussi à réaffirmer le statut international de la Russie, sa capacité à mener des opérations militaires lointaines – qui n’est partagée que par une poignée de puissances, dont les États-Unis et la France – et son droit de regard sur une région, le Proche-et-Moyen-Orient, longtemps vue comme une « chasse-gardée » de l’influence américaine.
La politique syrienne de la Russie s’inscrit donc aussi, comme sa politique ukrainienne, dans le cadre de la confrontation contrôlée engagée avec les États-Unis et leurs alliés.
Mais le contexte est là bien différent de celui de l’Ukraine, pays engagé dans une évolution démocratique et pro-européenne qui ne peut que susciter des sympathies dans les pays occidentaux. La montée de Daesh et des autres groupes djihadistes en Syrie a conduit en effet la Russie d’une part, les États-Unis et leurs alliés européens d’autre part, à affirmer (au moins officiellement) la même priorité à la lutte contre le terrorisme, qui contrebalance leurs divergences sur le sort du régime de M. Bachar al-Assad et l’attitude vis-à-vis de l’opposition syrienne dite modérée.
La Russie et les États-Unis ont donc tout fait, par des mesures concrètes de « déconfliction », pour éviter que leurs interventions aériennes respectives dans le ciel syrien ne risquent de déboucher sur une confrontation armée entre eux. De plus, loin d’entraîner en pratique un nouveau refroidissement des relations entre dirigeants, l’intervention russe en Syrie a conduit à une multiplication des contacts au plus haut niveau. Elle a favorisé un rapprochement relatif sur les conditions de sortie politique de la crise syrienne, permettant (68) le vote le 18 décembre 2015 de la résolution 2254 du Conseil de sécurité, qui en avalise les grands principes : « respect de l’unité, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et du caractère non sectaire de la Syrie » et « nécessité d’assurer la continuité des institutions de l’État » ; mise en place d’une gouvernance de transition dans les six mois et élections dans un délai de dix-huit mois, le sort du président syrien n’étant en revanche pas évoqué ; lutte implacable contre les groupes terroristes, en vue notamment « d’éliminer le sanctuaire » territorial de Daesh. Les divergences sur l’avenir du régime syrien actuel ont donc été mises de côté, sans être résolues. Enfin, Russie et États-Unis ont été les deux promoteurs du cessez-le-feu du 22 février 2016 et de la reprise des négociations politiques inter-syriennes, quels qu’en soient les aléas.
Le choix d’une politique de force en Syrie, qui a pu apparaître comme un nouveau facteur de confrontation entre la Syrie et le « bloc occidental » du fait des frappes russes contre des groupes rebelles soutenus par ce dernier, conduit donc aussi, de manière paradoxale, à une forme de rapprochement. La réalité de ce rapprochement dépendra évidemment de la capacité qui en résultera ou non, pour les grandes puissances en cause, de promouvoir une véritable sortie politique de crise en Syrie, accompagnée d’une lutte efficace contre Daesh.
D. LA RECHERCHE DE NOUVELLES ALLIANCES ET SES LIMITES
Dans le contexte de la confrontation avec les États-Unis et leurs alliés européens, la Russie a accentué, depuis deux ans, sa politique de recherche de partenariats alternatifs, d’une part dans cet « étranger proche » qu’est l’ex-URSS, d’autre part en Asie.
1. Le voisinage : de la communauté postsoviétique à l’Union eurasiatique
Des responsables russes emploient parfois le terme d’« étranger proche » pour désigner les anciennes républiques soviétiques qui se sont séparées de la Russie lors de la chute de l’URSS en 1991. Les liens entre la Russie et celles-ci ont plusieurs fondements et les limites de cet « étranger proche » ne sont pas toujours évidentes, car on rejoint ici le concept ambigu de « monde russe » qui a été présenté supra. Pour aller vite, il y a :
– des liens historiques tissés pendant une histoire commune plus ou moins longue sous l’empire des tsars, puis l’URSS ;
– des liens humains du fait du brassage des populations, car, à la fin de l’URSS, plusieurs dizaines de millions de personnes se disant « russes » dans les recensements vivaient dans les républiques autres que la Russie, laquelle, de son côté, accueillait et continue à accueillir de nombreux ex-ressortissants de l’URSS (venant notamment d’Asie centrale et du Caucase) ;
– des liens linguistiques, car le russe, langue vernaculaire de l’URSS, est resté la langue maternelle ou la langue de communication courante de populations allant au-delà des « Russes ethniques ». Par exemple, dans tout le sud et l’est de l’Ukraine, mais aussi à Kiev, c’est au moins un quart de la population qui est ainsi russophone, et parfois beaucoup plus. De plus, l’ukrainien et le biélorusse sont de toute façon des langues apparentées au russe ;
– des liens culturels et religieux à travers le partage majoritaire de la foi orthodoxe (avec l’Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie et la Géorgie) et, plus récemment, l’empreinte commune à tous du système marxiste-léniniste ;
– des liens économiques qui ont perduré longtemps après la fin de l’URSS du fait du maintien de vieux circuits d’approvisionnement et de distribution.
La Russie revendique des relations privilégiées avec l’« étranger proche », d’une part en raison de ces liens, d’autre part au nom de sa sécurité et face à la politique d’empiétement qui serait selon elle celle des États-Unis et de l’Union européenne. Après la fin de l’URSS, plusieurs tentatives d’intégration régionale « entre égaux » ont été menées, pour tenter de perpétuer les liens existants dans la « communauté postsoviétique ». La dernière et celle qui va le plus loin dans l’intégration est l’Union économique eurasiatique. Cependant, en ne regroupant qu’une minorité des ex-républiques soviétiques, l’Union eurasiatique signe peut-être un échec de la Russie à reconstituer pacifiquement son aire d’influence régionale.
a. De la Communauté des États indépendants à l’Union eurasiatique
i. Les diverses tentatives d’intégration de l’espace postsoviétique
À l’exception des pays Baltes, qui ont très vite basculé vers l’ouest, les anciennes républiques soviétiques ont cherché après la fin de l’URSS à maintenir un minimum d’intégration, compte tenu des liens historiques, culturels, humains et économiques qui les unissaient.
Vu le peu de contenu de la Communauté des États indépendants (CEI), première organisation créée (dès 1991) à cette fin, d’autres tentatives de rapprochement concernant un plus petit nombre – celles qui restaient plus dans l’orbite de la Russie – des ex-républiques soviétiques ont rapidement eu lieu :
– la première tentative s’est effectuée entre la Russie et la Biélorussie, qui ont lancé en 1995 une union douanière et même signé en 1999 un traité prévoyant de constituer un « État commun », mais, même si les deux économies sont effectivement profondément intégrées, cet État commun n’a jamais vu le jour, car il aurait de fait abouti à une absorption de la Biélorussie par la Russie ;
– en 2001 était lancée la Communauté économique eurasiatique, à l’initiative du Kazakhstan, dont l’idée de base était qu’en se limitant à une intégration économique, les anciennes républiques soviétiques obtiendraient plus de résultats qu’avec une construction apparemment plus ambitieuse telle que la CEI. La Communauté, constituée initialement de la Russie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan, a été rejointe en 2005 par l’Ouzbékistan, qui s’en est toutefois retiré en 2008. Les réalisations ont cependant été assez maigres et notamment l’idée d’une union douanière, caressée à la fin des années 1990, n’a pu déboucher dans ce cadre large. L’organisation a été officiellement dissoute au 1er janvier 2015 (compte tenu de la création de l’Union économique eurasiatique : voir infra).
Parallèlement à cette recherche d’intégration économique, l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) a été constituée en 2002 pour être une sorte de pendant à l’OTAN. Outre les anciens membres de la Communauté eurasiatique, elle comprend l’Arménie. Cette organisation comporte un accord de défense, permet à ses membres d’acheter du matériel militaire russe à un tarif préférentiel et maintient une certaine intégration entre leurs industries de défense (héritées du complexe militaro-industriel soviétique).
ii. La marche vers l’Union eurasiatique
Un pas supplémentaire a été franchi, par rapport à la Communauté économique eurasiatique, avec la mise en place d’une Union douanière au champ plus limité, faute de succès de la tentative de la réaliser dans l’ensemble de la Communauté.
Cette Union douanière entre la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan a été décidée dans son principe en 2007 et mise en place progressivement à partir de 2009, suivie de l’instauration d’un Espace économique unique, en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
L’Union économique eurasiatique a officiellement succédé à l’Union douanière le 1er janvier 2015. Ce projet avait été proposé en octobre 2011 par M. Vladimir Poutine dans un article publié dans les Izvestia.
Outre les trois membres fondateurs de l’Union douanière, l’Union eurasiatique a intégré, début 2015, l’Arménie, après sa décision de ne pas signer d’accord d’association avec l’Union européenne. Le Kirghizstan est entré en août 2015. Le Tadjikistan est aussi un adhérent potentiel à terme.
iii. Une construction manifestement inspirée de la construction européenne
Cette construction en cours se distingue de la Communauté eurasiatique qui l’a précédée par la mise en place d’institutions communes et une assez large intégration des politiques économiques.
Sur ce dernier point, on observe que :
– dans le cadre de l’Union douanière, les trois pays fondateurs appliquent un tarif douanier commun depuis le 1er janvier 2010 et un code douanier commun depuis le 1er juillet 2010 ; les contrôles douaniers ont été abolis entre eux le 1er juillet 2011 ;
– l’entrée en vigueur de l’Espace économique unique en 2012 a été précédée de l’adoption de 17 accords portant sur des sujets tels que la coordination des politiques macro-économiques, le droit de la concurrence, celui de la propriété intellectuelle, la réglementation des subventions aux industries, le commerce des services et les investissements, le marché commun des produits pétroliers, etc. Les objectifs poursuivis étaient, d’une part de réaliser quatre libertés de circulation concernant respectivement les biens, les services, les capitaux et les travailleurs, d’autre part d’harmoniser ou unifier les réglementations dans un certain nombre de domaines économiques. Cette démarche est, on le voit, directement inspirée du modèle européen du « marché unique ».
Quant aux institutions, elles aussi inspirées de l’Union européenne, elles comportent :
– le Conseil économique eurasiatique suprême, formé des chefs d’État ou de gouvernement ;
– une Cour de justice ;
– la Commission économique eurasiatique, en place depuis février 2012 (elle avait été précédée par une Commission de l’union douanière), où chaque État membre nomme deux personnalités. Les membres du collège ont rang de ministre et bénéficient d’un statut de fonctionnaire international. Chaque « ministre » membre du collège a un portefeuille (commerce, coopération douanière, concurrence, etc.) et peut s’appuyer sur une administration qui emploie environ 1 000 personnes.
b. Les limites de l’Union eurasiatique
i. Une construction purement économique et technocratique
On le constate, le processus de construction de l’Union eurasiatique est clairement décalqué de celui de construction de l’Union européenne, mais il n’en reprend que certains éléments :
– s’agissant des institutions, il n’existe pas de parlement de l’Union, ni même d’assemblée parlementaire composée de délégations des parlements nationaux – et il n’est pas envisagé d’en instituer ;
– s’agissant des politiques, c’est uniquement le volet économique de la construction européenne qui est repris. Les autres volets sont absents – du moins pour le moment, car Vladimir Poutine, dans son article précité d’octobre 2011, mentionnait aussi la dimension politique de son projet.
Toujours est-il qu’en l’état actuel, l’Union eurasiatique en construction ne prétend pas développer de politique étrangère ou de sécurité commune (ce dernier rôle revenant à l’OTSC précitée). Elle ne se présente pas non plus, à la différence de l’Union européenne, comme un espace garantissant les droits et libertés de ses citoyens et où l’adhésion serait soumise à des conditionnalités politiques.
ii. Un périmètre insuffisant pour être très efficace du point de vue économique
L’efficacité économique d’une union commerciale (zone de libre-échange ou union douanière) est liée, selon la théorie économique libérale qui justifie le libre-échange, à sa taille.
En effet, selon celle-ci, l’intérêt du libre-échange est de diversifier le choix de leurs fournisseurs ou de leurs clients pour les agents économiques – de sorte d’obtenir de meilleurs rapports qualité-prix –, sans qu’ils soient bridés dans ce choix par des droits de douane ou des obstacles réglementaires aux échanges. Dans cette optique, une union commerciale apportera d’autant plus de gains économiques qu’elle sera vaste.
En outre, plus elle sera vaste, plus une union commerciale intégrée pèsera dans le commerce mondial et pourra donc imposer ses vues dans les négociations commerciales internationales. Selon la théorie dite du tarif optimal, la politique tarifaire (fixation des droits de douane) d’une union commerciale de grande taille lui permettra d’influer sur les cours internationaux – par exemple, si l’Union européenne, importateur majeur de pétrole, décidait d’une nouvelle taxe sur les importations pétrolières, cela réduirait sa consommation interne par renchérissement du carburant, mais la réduction consécutive de ses importations entraînerait aussi une baisse du prix mondial du pétrole, car le niveau de ces importations européennes est suffisamment élevé pour contribuer à « faire » ce prix. Les consommateurs européens « récupéreraient » donc une partie de la taxe par l’effet de baisse du prix mondial.
Il est donc très important pour une union commerciale d’être d’une grande taille économique. Or, ce n’est pas le cas de l’Union eurasiatique, dont le PIB représente moins du dixième de celui de l’Union européenne et est également beaucoup plus faible que celui de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, a fortiori que celui du Partenariat transpacifique étendu à plusieurs pays asiatiques. De fait, la part de leur commerce extérieur que les membres de l’Union eurasiatique font entre eux est bien moindre que dans le cas des autres grandes unions commerciales. On le voit sur le graphique ci-après (les choses n’ont pas fondamentalement changé, même s’il remonte à quelques années). On comprend aisément que moins le poids des partenaires d’une union douanière dans le commerce extérieur de chacun de ses membres est grand, moins cette union apporte d’opportunités nouvelles à leurs entreprises.
Part du commerce intra-régional dans le commerce extérieur des États membres des principales unions douanières (2011, en %)
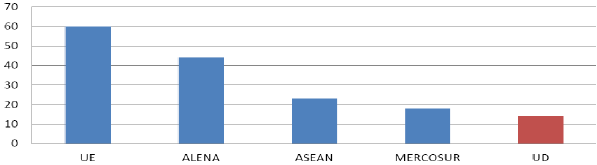
UD : Union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan.
Source : « De l’Union douanière à l’Union eurasiatique – État et perspectives d’intégration dans l’espace post-soviétique », par Emmanuel Dreyfus, sous la direction de Bertrand Slaski, CEIS, Les notes stratégiques.
Ce faible poids du commerce avec les autres membres de l’Union est surtout net pour la Russie : comme on l’a vu, les principaux partenaires commerciaux de celle-ci sont les pays européens, l’Union européenne représentant 48 % des échanges extérieurs russes de marchandises en 2014, et la Chine (11,3 % de ces échanges). Les partenaires de l’Union eurasiatique viennent bien après : en 2014, la Russie n’a réalisé que 4 % de son commerce extérieur avec la Biélorussie et 2,7 % avec le Kazakhstan.
Compte tenu des différences de poids économique, la Russie est en revanche un partenaire commercial déterminant, voire vital, pour les autres membres de l’Union : en 2014, la Biélorussie a réalisé 48,8 % de ses échanges extérieurs de marchandises avec la Russie, l’Arménie, 23,7 %, et le Kazakhstan, 21,5 %. Cette inévitable dissymétrie contribue aux interrogations sur l’avenir de l’Union, manifestement déséquilibrée.
iii. Les conséquences de la trop forte prédominance russe dans l’Union eurasiatique
En effet, lorsque l’on compare les poids démographiques et économiques respectifs des différents partenaires de l’Union eurasiatique, la prédominance absolue de la Russie est patente, sans même à avoir évoquer les autres facteurs de domination (puissance militaire, statut international…) : elle représente 80 % de la population et près de 85 % du PIB de l’Union (et l’éventuelle entrée du petit Tadjikistan ne changerait guère le constat).
Le poids prépondérant de la Russie dans l’Union eurasiatique (en 2015)
Population (en millions) |
Part dans la population de l’ensemble (en %) |
Part dans le PIB de l’ensemble (en %) | |
Russie |
146 ,3 |
80,2 |
84,4 |
Kazakhstan |
17,7 |
9,7 |
10,5 |
Biélorussie |
9,4 |
5,2 |
4,1 |
Kirghizstan |
6 |
3,3 |
0,5 |
Arménie |
3 |
1,6 |
0,6 |
TOTAL |
182,4 |
100 |
100 |
Source : élaboré à partir de la base de données du FMI, évaluations pour 2015 à partir des données d’octobre 2015, PIB évalués en parité de pouvoir d’achat.
Malgré l’égalité affichée des membres de l’Union eurasiatique dans les processus décisionnels – ils désignent chacun deux membres du collège de la Commission –, il est clair que, dans le seul champ commercial, sans même évoquer le champ politique, l’un est beaucoup plus « égal » que les autres, ne serait-ce que parce qu’il est, on l’a vu, beaucoup moins dépendant du commerce intra-Union que les autres. Pour la Russie, le commerce avec ses partenaires de l’Union n’est pas déterminant. En revanche, pour chacun de ces partenaires, le commerce avec la Russie l’est.
Cette prépondérance russe s’est d’ailleurs manifestée lors de la mise en place de l’Union douanière qui a précédé l’Union eurasiatique : le tarif douanier extérieur commun de l’Union a, sans surprise, repris pour l’essentiel le tarif douanier russe. Pour le Kazakhstan, cela a signifié un quasi-doublement des droits de douane à l’importation. Il en est de même pour les récents entrants que sont l’Arménie et le Kirghizstan, dont les droits de douane moyens s’élevaient, selon l’Organisation mondiale du commerce, respectivement à 3,7 % et 4,6 % en 2014 (avant leur entrée dans l’Union), contre 8,5 % pour l’Union. Ces différences de droits entre la Russie et les autres pays s’expliquaient par la volonté de la première de protéger ses diverses industries, alors que les pays plus petits n’avaient aucune raison de taxer à l’importation des catégories de marchandises quand ils ne les produisaient pas. L’alignement sur le tarif russe signifie pour les consommateurs de ces pays une augmentation des prix sans gain économique, puisqu’elle porte plutôt sur des produits non fabriqués localement et ne favorise donc pas les entreprises nationales.
Outre qu’elle contraint, sur le plan tarifaire, les membres de l’Union eurasiatique à s’aligner sur la Russie, ce qui n’est sans doute pas forcément avantageux pour eux, la trop forte prédominance russe explique sans doute largement leurs réticences à aller vers plus d’intégration économique et une forme d’intégration politique. C’est le président russe qui, dès 2011, suggérait cette dernière, qui a été le plus allant en matière de transferts de compétences et de passage au vote à la majorité qualifiée (plutôt qu’à l’unanimité) lors de la mise en place de l’Union eurasiatique fin 2014 et qui, en mars 2015, a proposé une union monétaire à ses partenaires, tandis que des pays tels que le Kazakhstan étaient sur la défensive.
iv. La crise ukrainienne, révélatrice des limites de l’Union eurasiatique
C’est sans doute la crise ukrainienne qui a le mieux mis au jour les tiraillements et les limites de l’Union eurasiatique.
Les dirigeants des deux partenaires historiques de la Russie dans l’Union eurasiatique, à savoir la Biélorussie et le Kazakhstan, sont apparemment partagés entre leur hostilité de principe aux mouvements révolutionnaires de type Maïdan et leur inquiétude face à une politique de force de la Russie qui s’est manifestée en Crimée et pourrait aussi les menacer. Il existe en effet une très importante population d’origine russe au Kazakhstan, tandis que des cercles nationalistes russes nient souvent l’existence d’une identité biélorusse séparée de la Russie.
Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s’est illustré en prenant des positions qui se voulaient médianes sur la crise ukrainienne : on lui prête des déclarations qui en renvoient la responsabilité à la fois aux Russes et aux occidentaux, présentent l’annexion russe de la Crimée comme une conséquence des erreurs du gouvernement ukrainien, mais récusent le projet (de certains nationalistes russes) de « Novorossiya » en Ukraine du sud et soutiennent l’unité et l’intégrité de l’Ukraine (69). En décembre 2014, son homologue du Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbaïev, et lui-même se sont rendu à Kiev pour apporter leur soutien formel au président Petro Porochenko et lui promettre des livraisons de charbon si la Russie interrompait les siennes à l’Ukraine. Ce n’est donc pas un hasard si, par ailleurs, c’est à Minsk, capitale de la Biélorussie, que se sont déroulées les négociations qui ont débouché sur les différents « accords de Minsk » destinés à ramener la paix dans le Donbass. Le président biélorusse a aussi profité de sa posture de médiateur pour renouer avec l’Union européenne et obtenir, en octobre 2015, suite à la libération de prisonniers politiques, la suspension de la plus grande part des sanctions européennes qui frappaient un certain nombre de personnalités et entreprises biélorusses en raison de la gestion autoritaire du pays.
Là où les divergences politiques entre les dirigeants des différents pays de l’Union eurasiatique en ont mis en cause le fonctionnement même, c’est dans la gestion des différents embargos et sanctions économiques. Le propre d’une union douanière est d’avoir une politique commerciale unique, même si certaines décisions relatives au commerce international – on pense évidemment aux sanctions et embargos – sont prises pour des raisons fondamentalement politiques sans rapport avec les enjeux commerciaux. L’Union européenne sait gérer cette ambivalence : les décisions de sanctions économiques sont prises à l’unanimité dans le cadre de la PESC (Politique étrangère et de sécurité commune), car tout un chacun connaît leur nature intrinsèquement politique, mais les États membres se gardent en général de prendre des mesures unilatérales qui remettraient en cause l’unicité de la politique commerciale de l’Union. S’agissant en revanche de l’Union eurasiatique, les différentes rétorsions commerciales de la Russie contre l’Union européenne, les États-Unis et d’autres pays en réponse aux sanctions, ainsi que contre l’Ukraine, puis la Turquie, ont été décidées unilatéralement et les autres membres de l’Union eurasiatique ne les appliquent évidemment pas.
Techniquement, l’Union eurasiatique n’existe donc plus vraiment, pour le moment, en tant qu’union douanière, puisque ses membres appliquent des règles différentes sur l’entrée ou la sortie des produits étrangers. Cette situation facilite d’ailleurs très probablement le contournement des embargos russes via le transit et le ré-étiquetage de produits européens, ukrainiens ou turcs par le territoire de pays tels que la Biélorussie.
v. Un processus qui marque l’abandon de toute idée de communauté « postsoviétique » ?
En fin de compte, l’Union eurasiatique apparaît donc comme une intégration plus avancée que les tentatives comparables qui l’ont précédée après la fin de l’URSS, mais avec un intérêt économique réduit par sa petite taille relative, ainsi que d’évidentes limites politiques.
Par ailleurs, elle n’intègre finalement que cinq, peut-être six à terme, des ex-républiques soviétiques, ce qui signifie que neuf de celles-ci, soit une majorité, restent en dehors : les trois pays Baltes, la Moldavie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, ainsi bien sûr que l’Ukraine, pour des raisons sur lesquelles il n’est pas utile de revenir à ce point du rapport.
● Les pays Baltes ont très rapidement fait le choix de l’alignement sur le modèle européen démocratique et libéral après la fin de l’URSS, ce qui leur a permis d’adhérer à l’Union européenne et l’OTAN dès 2004, avant que la nouvelle politique de puissance russe ne rende cette évolution plus conflictuelle.
● La Moldavie fait avec l’Ukraine et la Géorgie partie des pays ayant signé un accord d’association avec l’Union européenne en 2014.
Sa prise de distance avec la Russie est ancienne et liée au soutien apporté par Moscou à la sécession depuis 1991 de la région à majorité russophone de Transnistrie, où l’armée russe est toujours présente et qui constitue un « État de facto » non reconnu par la communauté internationale. De plus, la langue de la majorité des Moldaves est le roumain et les liens historiques et politiques avec la Roumanie sont forts. Enfin, une majorité parlementaire pro-européenne est en place depuis 2009.
Toutefois, la Moldavie n’a jamais rompu avec la Russie complétement. Elle conserve le principe de neutralité dans sa constitution, ce qui exclut une éventuelle adhésion à l’OTAN, et maintient des liens humains et économiques importants avec la Russie : plus de 500 000 Moldaves travailleraient en Russie (pour une population résidente sur le sol national moldave, hors Transnistrie, de moins de 3 millions de personnes) et leurs envois de fonds sont vitaux pour l’économie locale ; l’approvisionnement en gaz vient encore presque exclusivement de Russie.
De plus, la conjoncture politique moldave est aujourd’hui assez favorable à la Russie, car la majorité « pro-européenne » actuelle est engluée depuis deux ans dans un énorme scandale financier consécutif à la privatisation douteuse, puis au siphonage des fonds de plusieurs grandes banques, pour un préjudice qui pourrait représenter l’équivalent de 15 % du PIB moldave, voire plus. Quatre gouvernements se sont succédé depuis début 2015, un ancien premier ministre du clan « pro-européen » et « oligarque » éminent, M. Vlad Filat, a été arrêté, et les manifestations populaires se multiplient. Les partis d’opposition réputés « pro-russes » appellent à des élections anticipées, tandis que l’image de l’Union européenne pâtit du soutien qu’elle apporte à une classe politique manifestement corrompue et sous la coupe de puissants « oligarques ». Pour autant, anticiper un véritable changement d’orientation de la politique étrangère moldave qui romprait avec l’aspiration à une adhésion à l’Union européenne serait osé.
● La Géorgie, également signataire d’un accord d’association avec l’Union européenne en 2014, entretient des relations particulièrement difficiles avec la Russie du fait du soutien de cette dernière aux régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, qui ont rejeté l’autorité géorgienne dans les années consécutives à la fin de l’URSS. Les tensions dues au soutien russe à ces régions ont débouché, on s’en souvient, sur une brève guerre ouverte entre la Russie et la Géorgie en août 2008, rapidement apaisée par un cessez-le-feu négocié sous la médiation de l’Union européenne, mais sans que les négociations politiques ensuite engagées n’aient jamais abouti. La Russie a même reconnu comme « États » souverains les deux entités séparatistes, y maintient de nombreux soldats et a signé avec eux (le 24 novembre 2014 avec l’Abkhazie et le 18 mars 2015 avec l’Ossétie du Sud) des traités prévoyant une intégration de fait à l’espace russe (union douanière, levée des contrôles frontaliers, mise en commun de la défense et de la sécurité…). Enfin, le « président » de l’Ossétie du Sud, M. Leonid Tibilov, a annoncé récemment l’organisation avant le mois d’août 2016 d’un referendum sur le rattachement de son territoire à la Russie…
Dans ces conditions, l’alternance politique qui a conduit en 2012-2013 au remplacement du président géorgien Mikheïl Saakachvili et de ses partisans par des personnalités réputées moins hostiles à la Russie n’a pas débouché sur un rapprochement réel.
Certes, les contacts politiques de haut niveau ont repris et un canal de consultations informelles a été mis en place avec la désignation d’envoyés spéciaux par les deux pays, MM. Zourab Abachidze et Grigori Karassine ; les embargos imposés par la Russie depuis 2006, sous des prétextes sanitaires, sur divers produits agro-alimentaires géorgiens ont été levés ; la liaison aérienne Moscou-Tbilissi a été rétablie.
Mais l’absence d’avancée sur les contentieux politiques essentiels d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ne permet guère d’aller plus loin. L’adhésion à l’OTAN reste clairement le principal objectif de la politique étrangère et de sécurité de la Géorgie, qui espère à terme adhérer ensuite à l’Union européenne ; dans cette optique, la Géorgie est un « pays modèle » pour contribuer volontairement aux opérations militaires extérieures de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne.
● Sans être en situation conflictuelle avec la Russie, les trois républiques de tradition musulmane que sont l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan disposent de solides régimes présidentiels « postsoviétiques » à tendance plus ou moins autocratique qui estiment ne pas avoir besoin de la protection de Moscou. Pour les deux premiers, la volonté d’indépendance s’appuie aussi sur d’immenses ressources en hydrocarbures.
À ce titre, le Turkménistan a établi des liens privilégiés avec la Chine, qui a absorbé en 2014 presque 70 % du total de ses exportations, constituées essentiellement de gaz, et y a investi massivement.
Quant à l’Azerbaïdjan, sa priorité est manifestement le développement de ses canaux d’exportation des hydrocarbures vers l’ouest, notamment avec la construction en cours du gazoduc trans-anatolien TANAP (TransAnatolian Natural Gas Pipeline) à travers la Turquie.
La récente reprise, début avril 2016, de combats violents entre l’Azerbaïdjan et les forces arméniennes du Haut-Karabagh (réactivant ce conflit latent depuis un quart de siècle) constitue un test de la capacité de la Russie à exercer une influence prégnante sur la politique de l’Azerbaïdjan.
L’Arménie est pour la Russie une alliée fidèle, sur le sol duquel elle maintient des troupes qui servent en quelque sorte de garantie contre toute velléité d’agression turque ; les deux pays appartiennent à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), qui comprend un accord de défense. Certes, celui-ci ne s’applique pas dans le cas des affrontements au Haut-Karabagh, car ils n’ont pas lieu à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, mais à l’intérieur du territoire internationalement reconnu de l’Azerbaïdjan (dont le Haut-Karabagh prétend faire sécession) : ils ne concernent pas – formellement – l’Arménie. Une intervention militaire russe dans le conflit n’est donc pas vraisemblable. Mais, compte tenu des intérêts des deux pays, on voit mal comment leurs liens pourraient se relâcher.
Mais l’Azerbaïdjan est également un pays important pour la Russie : il achète massivement ses armements (pour un total qui serait de 4 milliards de dollars de 2010 à 2013) et est un partenaire nécessaire pour contrôler les flux de djihadistes entre le Caucase du nord et la Syrie ou l’Irak et plus généralement lutter contre le terrorisme dans la zone. De plus, une rupture entre Moscou et Bakou signifierait sans doute un renforcement massif de l’influence turque en Azerbaïdjan, ce que la Russie ne peut pas envisager dans le contexte actuel de crise avec Ankara.
C’est pourquoi la Russie ne peut que souhaiter un apaisement du conflit et s’est fortement impliquée dans l’imposition d’un cessez-le-feu. Le respect – ou non – de celui-ci montrera jusqu’à quel point le Russie garde une vraie capacité de coercition (diplomatique…) dans la zone.
*
On peut se demander si les événements qui se sont accélérés depuis 2014, avec tout à la fois la finalisation d’une Union eurasiatique au périmètre réduit et à l’unité politique fragile, l’annexion brutale de la Crimée au nom du nationalisme russe et, consécutivement, la brouille probablement durable entre la Russie et l’Ukraine ne signent pas l’abandon définitif de l’espoir d’une sorte de continuation pacifique de l’URSS à travers une « communauté postsoviétique ».
C’est du moins la thèse du politologue Fiodor Loukianov, qui voit dans l’annexion de la Crimée « le dernier acte de l’histoire soviétique » (70).
Cet auteur observe en effet que les deux décennies qui ont suivi l’éclatement de l’URSS ont été assez stables, car, après la prise d’indépendance en 1991 des différentes républiques soviétiques, déclenchée au centre par la Russie elle-même, la souveraineté et les frontières de ces républiques ont plutôt été respectées : les conflits qui ont éclaté ont débouché éventuellement sur la naissance de pseudo-États de fait (comme la Transnistrie, le Haut-Karabagh, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie), mais ceux-ci n’ont globalement pas été reconnus internationalement (étant toutefois noté que la Russie a reconnu officiellement l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie après la guerre de 2008 avec la Géorgie). Plus spécifiquement, la Russie et l’Ukraine nouvellement indépendantes des années 1990 avaient soigneusement évité d’ouvrir la boîte de Pandore du statut de la Crimée, alors même que la question était déjà posée localement (de 1992 à 1995 a existé une « république de Crimée » autonomiste et pro-russe dont les dirigeants ont été tentés de rompre avec l’Ukraine).
D’une certaine façon, pour M. Loukianov, l’année 2013 aurait été celle de l’apogée de la tentative de restauration politique de la Russie dans un cadre postsoviétique, avec l’espoir de fédérer autour d’elle la plus grande part de l’ex-URSS, quand il a semblé que le président ukrainien Viktor Ianoukovytch choisirait plutôt l’Union eurasiatique que l’association avec l’Union européenne. Mais ensuite, la chute de M. Ianoukovytvh, entraînant la décision d’annexer la Crimée, aurait signé la fin de cette vision : par cette décision qui marque une rupture durable avec l’Ukraine, la Russie aurait choisi définitivement de privilégier ses intérêts nationaux. Par ailleurs, en cessant de focaliser son attention sur l’Ukraine, donc sur l’ouest et l’Europe, la Russie aurait aussi, en 2014 seulement, enfin défini clairement son orientation « eurasiatique » (et non plus européenne).
Dans cette perspective, la construction de l’Union eurasiatique appelle un jugement partagé :
– c’est certes la réalisation la plus aboutie en matière d’intégration régionale dans l’espace postsoviétique depuis la fin de l’URSS ;
– mais son périmètre réduit et la très forte prédominance interne de la Russie qui en résulte limitent son intérêt économique pour ses membres et handicapent une éventuelle intégration politique, les « petits » pays de l’Union se méfiant d’une Russie qui y est trop prédominante ;
– de plus, ce périmètre réduit rend compte de l’échec de la Russie à entraîner dans son sillage la majorité des ex-républiques soviétiques.
2. L’Asie comme alternative à l’Europe et aux États-Unis ?
Face à la stratégie américaine de « pivot vers l’Asie », destinée à privilégier les intérêts américains en Asie orientale, cœur de la croissance mondiale, la Russie – en froid avec les États-Unis et les pays européens – a également mis de plus en plus l’accent ces dernières années sur l’alternative que représenteraient les relations avec les pays asiatiques, notamment la Chine. Cette stratégie s’appuie sur la dimension asiatique de la Russie, qui l’amène à se présenter comme « eurasiatique ».
a. L’Organisation de coopération de Shanghai, outil de coopération institutionnelle avec les pays asiatiques
La Russie a d’abord développé avec les autres pays de l’Asie continentale un cadre institutionnel multilatéral, celui de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Créée en 2001 (dans la continuité d’une structure plus informelle, le « groupe de Shanghai », qui remontait à 1996), cette organisation regroupe la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. En 2004-2005, la Mongolie, l’Inde, le Pakistan et l’Iran y ont acquis un statut d’observateur ; la Biélorussie a obtenu ce statut en 2015. L’Inde et le Pakistan devraient devenir membres à part entière en 2016 (une décision en ce sens a été prise au sommet de l’organisation à Oufa en juillet 2015).
L’OCS vise en principe à promouvoir la coopération dans divers domaines, mais son objet initial était d’ordre sécuritaire : il s’agissait en particulier de rassurer la Chine après l’indépendance des républiques d’Asie centrale, musulmanes et turcophones, par rapport aux mouvements séparatistes des Ouighours du Xinjiang, également musulmans et turcophones. L’OCS a mis en place une « structure antiterroriste régionale » à Tachkent (Ouzbékistan) et a permis divers accords de sécurité : réduction des forces armées aux frontières, mesures de confiance entre armées des États membres.
Même si les réalisations concrètes de l’OCS restent assez limitées, l’arrivée récente de nouveaux membres et observateurs montre qu’elle exerce une certaine attraction. Son dernier sommet en juillet 2015 a été couplé avec des sommets des BRICS (voir infra) et de l’Union eurasiatique.
b. L’organisation des BRICS, affirmation d’un monde multipolaire, mais aussi et surtout de la nouvelle puissance chinoise
La valorisation politique du concept des « BRICS » n’a pas seulement une dimension asiatique, puisque le Brésil et l’Afrique du Sud font partie de ce groupe, avec la Russie, l’Inde et la Chine. Cependant, cette dimension asiatique est prépondérante.
La volonté de donner un contenu politico-diplomatique aux BRICS en créant une organisation internationale ad hoc doit beaucoup à la diplomatie russe, mais on peut se demander aujourd’hui si ce n’est pas la Chine qui y a pris le premier rôle. Si l’affirmation des BRICS est progressive et reste encore relativement limitée, elle s’est accélérée en 2014-2015 et s’inscrit clairement (du moins du point de vue russe) dans une volonté de contrebalancer la « domination » occidentale et en particulier américaine.
Il faut rappeler que l’acronyme « BRIC » est d’abord apparu, en 2001, sous la plume d’un économiste de la banque Goldman-Sachs pour désigner les quatre plus grandes économies qualifiées d’émergentes (parce que n’appartenant pas à des pays industriels matures) : Brésil, Russie, Inde et Chine. L’Afrique du Sud a ensuite rejoint le groupe (bien qu’elle soit loin d’être la 5ème économie émergente, mais le continent africain devait être représenté…), complétant l’acronyme par un « S ».
Les BRICS regroupent près de 3,1 milliards d’êtres humains, soit environ 42 % de la population mondiale, et leur part dans le PIB mondial est passée, de 1995 à 2015, de moins de 18 % à 31 % (selon les statistiques du FMI en parité de pouvoir d’achat). Ils ont donc ensemble un poids considérable.
Mais il faut bien voir aussi que ces cinq pays sont très différents, que ce soit par leur situation géographique (ils sont répartis sur plusieurs continents), leur appartenance culturelle, leur niveau de population, leur puissance économique, leurs intérêts économiques (certains sont plutôt exportateurs de matières premières, d’autres importateurs de celles-ci et exportateurs de produits manufacturés ou de services), leur dynamisme économique (à côté d’économies très dynamiques comme celles de la Chine et de l’Inde, on trouve des pays qui ont un passé industriel ancien comme la Russie ou le Brésil et qui, dans l’histoire longue, se caractérisent plutôt par leur difficulté à atteindre le niveau de développement économique des pays les plus avancés), leurs régimes politiques…
La Russie a joué un rôle déterminant dans la création d’une entité politique nouvelle à partir d’un concept discutable qui réunissait des pays qui n’avaient a priori pas tant de points communs. Elle a été à l’origine de la création d’une institution commune aux BRICS en organisant en 2009 leur premier sommet, à Iekaterinbourg. Depuis lors, les dirigeants des BRICS tiennent un sommet annuel et ont créé une organisation commune (légère), le Forum des BRICS.
Pour atteindre ce résultat, la Russie a mis en valeur le seul véritable dénominateur communs aux cinq BRICS : leur volonté de s’affranchir de l’hégémonie américaine et de l’interventionnisme occidental. Elle a ainsi réussi à rapprocher des pays dont certains ont pourtant de fortes rivalités géopolitiques, en particulier la Chine et l’Inde.
D’abord assez virtuel, le rapprochement des BRICS a débouché sur un premier résultat concret avec la signature en juillet 2014, lors de leur sommet annuel tenu à Fortaleza (Brésil), d’un accord actant la création d’une banque de développement et d’une réserve de change communes. Cette décision s’inscrivait très clairement dans une volonté commune de réduire le rôle international trop prédominant du dollar. C’était aussi une réaction à l’immobilisme des institutions financières internationales traditionnelles, FMI et Banque mondiale, où les vieux pays industriels ont beaucoup de mal à laisser aux grands pays émergents la place qui devrait leur revenir du fait de leur montée en puissance économique.
La création d’institutions financières communes aux cinq BRICS a toutefois été rendue plus difficile par la grande disproportion de leurs poids économiques. Le compromis qu’ils ont trouvé reconnaît la prééminence de la Chine sans lui donner un poids proportionnel au rapport des PIB. Il a donc été décidé d’instituer une réserve commune (« Contingent Reserve Arrangement ») de 100 milliards de dollars, dont 41 milliards versés par la Chine, 18 milliards par l’Inde, le Brésil et la Russie, et 5 milliards par l’Afrique du Sud. Une banque de développement commune (« New Development Bank ») a aussi été mise en place : son capital de départ autorisé de 100 milliards de dollars a dans un premier temps été souscrit à moitié (50 milliards) par les cinq pays, ce à parts égales ; mais la Chine a obtenu que son siège soit à Shanghai ; elle a été inaugurée en juillet 2015.
Il faut rappeler que, dans le même temps, la Chine a également présidé au lancement d’une autre institution financière multilatérale nouvelle, la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), dont le siège est à Pékin. Dotée également d’un capital de 100 milliards de dollars, la BAII a été officiellement établie en juin 2015 avec cinquante-sept États fondateurs, mais une prédominance chinoise. La décision de la plupart des pays européens de participer à cette opération a suscité de l’agacement aux États-Unis et au Japon, qui n’y sont pas parties prenantes.
Même si la Russie est largement à l’origine de l’institutionnalisation des BRICS, on peut donc penser que le développement par eux d’outils financiers communs rend surtout compte de la nouvelle puissance chinoise, s’inscrivant dans une politique chinoise d’affirmation dans la sphère financière internationale.
Dans un article récent (71), le chercheur Bobo Lo résume ainsi les différences de perceptions russe et chinoise, qui ne peuvent que limiter l’affirmation des BRICS en tant que nouveau pôle international : « le président Poutine voit dans les BRICS le fondement d’un ordre multipolaire non occidental où la Russie jouerait un rôle central. Les Chinois, quant à eux, ne leur accordent qu’une importance marginale : à leurs yeux, les BRICS ne sont qu’un outil parmi d’autres pour promouvoir leurs intérêts (…) ». Il en conclut que « ces perceptions contrastées limitent sévèrement la capacité des BRICS à incarner un modèle alternatif de gouvernance mondiale, ou un levier efficace de développement ».
Il faut enfin signaler un autre projet commun aux BRICS, lancé en 2012 mais non abouti à ce jour, celui de mettre en place entre eux leur propre réseau de câbles sous-marins de communications. Le but explicite est de s’exonérer de la dépendance vis-à-vis des pays et entreprises occidentaux dans ce domaine, dans un contexte où le transit des données par des équipements appartenant à des opérateurs américains fait planer des présomptions d’espionnage de ces données.
c. Avec la Chine, un partenariat plus qu’une alliance
Historiquement, la Chine et la Russie ont longtemps été des rivales. Cette rivalité a commencé au temps où l’une et l’autre étaient des empires, quand les premiers trappeurs russes, au XVIIème siècle, ont pris possession de la Sibérie orientale et sont entrés en contact avec l’empire chinois. Au XIXème siècle, la Russie a pris part, avec les autres puissances européennes et le Japon, au dépeçage partiel de cet empire. Puis, l’URSS, ayant soutenu la conquête du pouvoir par Mao, a essayé de « satelliser » la Chine communiste, avant que celle-ci ne rompe brutalement les liens entre les deux pays. Cette rupture a même conduit en 1969 à des affrontements militaires sporadiques sur plusieurs mois, qui ont fait plusieurs centaines de morts, sur deux points contestés de la frontière commune.
Les deux pays ont en effet hérité de leur passé impérial une frontière commune de plus de 4 200 kilomètres (le deuxième frontière terrestre russe en longueur, après celle avec le Kazakhstan).
Toutefois, les relations bilatérales se sont grandement améliorées après la fin de l’Union soviétique. Les deux puissances ont en effet deux types de bonnes raisons de s’entendre, les unes économiques, les autres politiques.
• Des intérêts convergents
Sur le plan économique, il existe incontestablement des intérêts complémentaires :
– dans une optique de sécurité et de diversification, la Chine est en permanence à la recherche de nouveaux approvisionnements en matières premières et en particulier en hydrocarbures ;
– la Russie souhaite développer économiquement la Sibérie, notamment les gisements encore inexploités de sa partie orientale, et plus généralement diversifier la clientèle de ses hydrocarbures.
Sur le plan politique, les deux pays partagent quelques grandes conceptions :
– l’opposition à la vision jugée unipolaire des États-Unis ;
– l’affirmation du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le rejet des conceptions occidentales telles que la « responsabilité de protéger » ;
– la lutte contre le terrorisme mené au nom de l’Islam.
• Un rapprochement qui s’est accéléré depuis 2013
Dès 1996, la Russie et la Chine ont conclu un « partenariat stratégique pour le XXIème siècle », puis en 2001 un traité d’amitié et de coopération. Elles ont également réglé leurs vieux différends sur le tracé de leur frontière commune. La délimitation négociée de celle-ci, décidée en 1991, a fait l’objet de deux traités en 1994 et 2004 et est achevée depuis 2008.
Les relations russo-chinoises se sont intensifiées dans la période la plus récente sur fond de difficultés entre la Russie et ses partenaires occidentaux.
C’est en Russie que le nouveau président chinois Xi Jinping a effectué son premier déplacement à l’étranger en mars 2013. Puis les excellentes relations entre les deux pays ont été mises en valeur de manière spectaculaire avec la participation le 9 mai 2015 du président chinois à la commémoration à Moscou du 70ème anniversaire de la victoire de 1945 – boudée en revanche par les dirigeants occidentaux –, suivie en retour en septembre de la participation du président russe à la commémoration du même événement par la Chine à Pékin.
La Chine s’est gardée de condamner l’action de la Russie en Ukraine, alors même que celle-ci est contraire aux principes de non-ingérence et de respect de l’intégrité territoriale auxquels elle se réfère habituellement. La Chine s’est donc notamment abstenue (aux côtés des autres « BRICS ») lors du vote par l’Assemblée générale des Nations-Unies de la résolution du 27 mars 2014 condamnant l’annexion unilatérale de la Crimée.
Les deux pays ont également organisé en 2015 deux sessions de manœuvres navales communes de grande ampleur, dont l’une, en Méditerranée, a pu être considérée comme une provocation vis-à-vis des puissances occidentales. En avril 2015, la Russie a annoncé avoir vendu à la Chine des missiles S-400 Triumph (système antiaérien et antimissile dont la portée pourrait atteindre 400 kilomètres) ; le montant du contrat serait de l’ordre de 3 milliards de dollars. Les relations dans le domaine de l’armement sont solides, puisque, on l’a dit, la Russie aurait fourni plus de 60 % des importations chinoises en la matière entre 2010 et 2014.
Comme on l’a développé supra dans le présent rapport, Gazprom et CNPC (China National Petroleum Corporation) ont signé en mai 2014 le très gros contrat de livraison de gaz « Force de Sibérie » (400 milliards d’euros sur trente ans ; à terme, 38 milliards de m3 par an). Ce contrat a défrayé la chronique par son ampleur, mais aussi par la monnaie de libellé prévue pour les premiers paiements, à savoir le yuan et non plus le dollar, choix qui s’inscrit dans la politique très active de la Chine pour accroître le statut de sa monnaie, mais ne peut aussi que satisfaire la Russie compte tenu des sanctions occidentales.
• Mais la persistance d’une rivalité feutrée, accrue par la disproportion des poids économiques
Toute défiance n’a pourtant pas disparu entre les deux pays. La crainte d’une submersion démographique et économique de la Sibérie par les voisins chinois existe depuis longtemps en Russie et a été ravivée par les concessions faites par la Russie lors de la délimitation de la frontière commune dans les années 1990 et 2000 (les territoires disputés, c’est-à-dire principalement des îles du fleuve Amour, ont été partagés), ainsi que, plus récemment, par la décision de louer à long terme d’immenses parcelles de terres sibériennes à des entreprises chinoises (72). En face des 1,4 milliard de Chinois, l’Extrême-Orient russe ne compte que 6,2 millions d’habitants en 2015. De plus, cette population a diminué de 22 % depuis 1989, où elle approchait les 8 millions : le déséquilibre démographique ne cesse de se renforcer entre les deux rives du fleuve Amour et il semble bien que, jusqu’à présent, l’Extrême-Orient russe ait peu profité de sa proximité géographique avec la croissance chinoise. Cela relativise aussi les grandes déclarations sur la réorientation de la Russie vers l’est.
Plus globalement, la disproportion croissante des poids démographiques et économiques des deux partenaires – le rapport est de l’ordre de un à neuf tant pour la population que pour le PIB global – déséquilibre nécessairement les relations.
S’agissant du commerce, la Chine est essentielle pour la Russie : assurant 11,3 % des flux commerciaux extérieurs de la Russie (2014), elle est son premier partenaire (sauf à prendre l’Union européenne en bloc). S’agissant en particulier des importations russes, 17,8 % sont provenues de Chine en 2014, faisant de ce pays le premier fournisseur extérieur de la Russie, devant l’Allemagne (11,5 % des importations russes).
Mais réciproquement, pour la Chine, dont la masse du commerce extérieur est beaucoup plus grande, la Russie reste un partenaire commercial relativement secondaire : la Chine n’a réalisé en 2014 que 2,2 % de ses flux commerciaux extérieurs avec la Russie, ce qui place cette dernière, dans le commerce chinois, loin derrière l’Union européenne (14,3 % du total des flux extérieurs chinois), les États-Unis (12,8 %) et les grands voisins asiatiques (Japon, Corée du Sud, Taiwan…), malgré les différends historiques et politiques qui opposent souvent la Chine à ces pays.
De même, le commerce sino-russe, en dégageant en 2014 un excédent bilatéral pour la Chine équivalent à 9 milliards d’euros, ne contribue que modestement à l’excédent commercial global de la Chine, qu’elle obtient principalement avec les États-Unis (177 milliards d’euros en 2014) et l’Union européenne (93 milliards).
Enfin, il est à noter que le montant global des échanges bilatéraux, en croissance les années précédentes (89 milliards de dollars en 2013 ; 95 milliards en 2014), a diminué de 30 % en 2015 dans le contexte de baisse des cours des hydrocarbures et de difficultés économiques dans les deux pays. Le commerce russo-chinois n’a donc que partiellement « profité » des sanctions qui limitaient le commerce entre la Russie et les pays occidentaux.
Même le développement de nouveaux échanges bilatéraux d’hydrocarbures, concrétisé par le contrat « Force de Sibérie » de mai 2014, doit peut-être être relativisé, ainsi qu’il a été dit supra, notamment parce que les nouveaux flux gaziers prévus resteront en-deçà de ceux en provenance du Turkménistan, qui serait donc la priorité de la Chine.
Ce point illustre une autre réalité, celle de la rivalité géopolitique qui oppose inévitablement Russie et Chine en Asie centrale. Les deux puissances, soucieuses de leurs bonnes relations, veillent à éviter toute friction dans cette zone. Mais leur concurrence est inscrite dans l’histoire et la géographie.
En effet, les États d’Asie centrale sont d’ex-républiques soviétiques. À ce titre, ils ont adhéré à la Communauté des États indépendants (CEI) après la fin de l’URSS, puis certains d’entre eux, restés proches de la Russie, à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et à l’Union économique eurasiatique, ainsi qu’on l’a vu. Par ailleurs, plusieurs de ces pays abritent encore d’importantes communautés d’origine russes et/ou de langue vernaculaire russe, en particulier le Kazakhstan. Il y aurait en Asie centrale plus de 5 millions de « Russes » (il ne s’agit pas forcément de citoyens russes, mais de personnes revendiquant une appartenance russe) et plus de 9 millions de russophones (73).
Mais, dans le même temps, la Chine déploie une présence de plus en plus active en Asie centrale, surtout dans le cadre du projet des « Nouvelles routes de la soie » (également connu sous l’appellation « One Belt One Road » ou OBOR). Ce grand projet a été officiellement lancé en 2013 par le président Xi Jinping, dont il est l’une des priorités en politique étrangère. En septembre 2013, celui-ci a fait une tournée au Turkménistan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Kirghizstan durant laquelle de grands contrats ont été signés et 20 000 bourses pour étudier en Chine au bénéfice des étudiants de la région ont été annoncées. Le projet OBOR, même s’il reste assez nébuleux du point de vue de certains observateurs, draine des financements considérables, à la mesure des moyens de la Chine. Son objectif officiel central est le développement économique de l’Asie centrale : le projet n’est pas tourné contre la Russie, mais ne lui accorde pas une importance majeure. Le principal itinéraire terrestre qui doit être développé en priorité (le projet d’un premier tronçon de cet itinéraire, reliant le Xinjiang chinois et le Kirghizstan, a été finalisé) selon les vues chinoises ne passe en effet pas par le territoire russe : il traverse les pays d’Asie centrale pour atteindre l’Iran et, au-delà, le Moyen-Orient d’une part, l’Europe via la Turquie d’autre part. C’est bien la facilitation des échanges avec les pays du Golfe, source principale du pétrole consommé en Chine, et avec l’Union européenne, premier partenaire commercial de la Chine, qui, au-delà du développement de l’Asie centrale, est visée.
• Conclusion : un partenariat d’intérêt, mais destiné à durer ?
Nombre d’observateurs voient donc dans le rapprochement russo-chinois une convergence d’intérêts qui pourrait durer, les intérêts communs en cause étant durables, plus qu’une amitié profonde.
En tout état de cause, le fait est qu’il n’y a pas d’alliance formelle et que l’on voit mal comment il pourrait y en avoir une.
La presse chinoise proche du pouvoir est ainsi assez prudente. Un article du Huanqiu Shibao (74) présente la Russie et la Chine comme des « partenaires stratégiques » unis par des intérêts communs : le développement de leur coopération économique ; l’équilibre des forces (contre la supposée domination américaine). Mais le même article réfute toute idée d’alliance entre les deux pays, les conditions de base pour cela n’étant pas remplies selon lui : tradition historique de défiance mutuelle ; identité asiatique de la Chine et identité eurasienne de la Russie…
M. Dmitri Trenine, directeur du centre Carnegie à Moscou, voit dans le rapprochement des deux pays un « mouvement tectonique » (75), donc de fond et durable, mais préfère parler d’« entente » russo-chinoise, cette relation n’entrant pas « dans les définitions traditionnelles d’union, de bloc ou d’axe ». Il met aussi en exergue la « barrière des civilisations » qui devrait limiter la coopération culturelle et les échanges humains : de son point de vue, le développement de l’étude du chinois en Russie sera fondé sur des « considérations essentiellement pragmatiques » et « le rapprochement des peuples sera restreint ».
d. Le maintien de bonnes relations avec les rivaux asiatiques de la Chine
Il faut par ailleurs noter, ce qui est également susceptible de limiter le rapprochement sino-russe, que la Russie entretient d’excellentes relations avec d’autres grands pays asiatiques qui, souvent, ont eux-mêmes des rapports plus difficiles avec la Chine.
Du temps de l’Union soviétique, la brouille avec la Chine communiste dans les années 1960 avait amené à l’établissement de relations étroites entre Moscou et le régime également communiste du Vietnam (alors souvent présenté comme un des « satellites » de l’URSS). Il en était de même avec l’Inde, bien que celle-ci ne fût pas communiste, dans le cadre d’une véritable alliance stratégique tournée contre la Chine (et contre le Pakistan, allié des États-Unis et de la Chine et soutien des résistants afghans lors de l’intervention soviétique).
La fin de l’URSS et du monde des « blocs » a bien sûr détendu les choses, mais la Russie a conservé des liens étroits avec le Vietnam comme avec l’Inde, notamment dans le domaine des fournitures d’équipements militaires.
• L’Inde
Il existe une longue tradition d’acquisition d’armes soviétiques, puis russes, par l’Inde. De 2010 à 2014, 70 % des importations d’armements de l’Inde sont venues de Russie. En 2014, la Russie aurait vendu pour 4,7 milliards de dollars d’armements à l’Inde, son plus gros client en la matière.
Plusieurs contrats ont été discutés ou signés lors de la visite du premier ministre indien à Moscou en décembre 2015. Parmi les plus significatives des coopérations évoquées dans le domaine de l’armement, on peut relever l’éventuelle vente à l’Inde (comme à la Chine) de missiles anti-aériens S-400 (qui semble confirmée), la mise à disposition en leasing d’un deuxième sous-marin nucléaire d’attaque, ou encore un projet de co-production d’hélicoptères Kamov-226.
La coopération est également active dans le domaine nucléaire, où, à terme, douze réacteurs nucléaires de conception russe pourraient être construits.
• Le Vietnam
Avec le Vietnam, l’année 2015 a été marquée par la signature, en mai, après deux ans de négociations, d’un accord de libre-échange (passé dans le cadre de l’Union économique eurasiatique et impliquant donc aussi ses autres membres). Dans le cadre de cet accord, le Vietnam s’engage notamment à ouvrir son marché sur les produits d’élevage, les machines et équipements, ainsi que les véhicules. Il bénéficiera en contrepartie de tarifs préférentiels pour ses exportations (produits agricoles et de la mer, produits textiles et chaussures, mobilier en bois). Outre le commerce de biens et services, l’accord traite de la protection des investissements, des normes sanitaires et phytosanitaires, de la propriété intellectuelle, de la facilitation des procédures douanières et des échanges de main d’œuvre. Le gouvernement russe a indiqué espérer, grâce à cet accord, un volume d’échanges commerciaux entre la Russie et le Vietnam de 10 milliards de dollars à l’horizon 2020 (contre 2,7 milliards en 2013).
Il faut toutefois relativiser quelque peu la portée de cet accord économique : le Vietnam est également signataire fin 2015 du Partenariat transpacifique (TPP), autre grand accord commercial, mais celui-là initié par les États-Unis – et implicitement tourné contre la Chine, qui n’y a pas été invitée. La diplomatie vietnamienne semble donc surtout déterminée à rechercher des alliances variées, dès lors qu’elles font contrepoids à la Chine.
• Le Japon
Les relations entre la Russie et le Japon sont historiquement handicapées par le différend territorial sur les îles Kouriles, occupées en 1945 puis annexées unilatéralement par l’URSS, dont le Japon espère toujours récupérer une partie.
Dans la période la plus récente, toutefois, on a pu observer un rapprochement dans le contexte de ce que Mme Valérie Niquet, chercheuse de la Fondation pour la recherche stratégique, appelle une « convergence des intérêts stratégiques » entre les deux pays (76).
Le Japon est en effet de plus en plus obnubilé par ses relations difficiles avec la Chine : mécontentement chinois face au refus japonais de reconnaître pleinement les crimes commis pendant la Seconde guerre mondiale ; conflit sur les îles Senkaku-Diaoyu. Plus généralement, la montée en puissance de la Chine y est considérée comme une menace. Par ailleurs, selon l’auteur précité, les autorités japonaises sont également satisfaites des positions assez fermes de la Russie concernant les provocations nord-coréennes (essais nucléaires, tirs de missiles…), lesquelles contrastent avec l’ambiguïté de la Chine, qui continue à soutenir la Corée du Nord. Du point de vue japonais, la recherche de meilleures relations avec la Russie fait contrepoids à la puissance chinoise.
Les années 2012-2014 ont donc été marquées par une intensification des relations russo-nipponnes. Le président russe et le premier ministre Shinzõ Abe se sont rencontrés fréquemment, le second s’étant même rendu à Sotchi au moment des Jeux olympiques malgré le boycott de la plupart des dirigeants occidentaux. La vieille négociation d’un traité de paix soldant la Seconde guerre mondiale, toujours pas conclu, a été relancée en 2013, sans toutefois que les réunions tenues depuis n’aient débouché sur de réelles avancées (concernant le différend central sur les Kouriles).
La crise ukrainienne a cependant largement freiné ce rapprochement : le Japon a donné la priorité à sa relation de sécurité avec les États-Unis et a adopté des sanctions (plus limitées que celles des États-Unis ou de l’Union européenne) contre la Russie.
E. LE PROCHE-ET-MOYEN-ORIENT : LE GRAND RETOUR DE LA RUSSIE
L’intervention militaire russe en Syrie qui a été déclenchée le 30 septembre 2015 marque la fin d’une longue période où la Russie avait une position de retrait par rapport aux affaires du Proche-et-Moyen-Orient, un espace où, pourtant, l’URSS et les États-Unis s’étaient affrontés par alliés interposés (l’Égypte nassérienne et ses alliés arabes contre Israël) en leur temps.
Les auditions conduites par la mission, notamment celle du général Jean-Claude Allard et de M. Julien Nocetti (77), ont permis de mettre en lumière quelques grande réalités sous-jacentes que l’on doit garder à l’esprit lorsque l’on s’interroge sur la politique russe au Proche-et-Moyen-Orient :
– il y a tout d’abord la question de l’enclavement géographique russe, face auquel l’accès aux « mers chaudes » est une priorité constante depuis le temps des tsars ;
– il y a ensuite le statut de puissance pétrolière et gazière de la Russie. Pour les pays ouest-européens, le Proche-et-Moyen-Orient reste une source importante (et dans les esprits la source essentielle, même si ce n’est plus vraiment exact dans les faits) d’approvisionnements énergétiques vitaux. Pour la Russie, les pays de la zone sont au contraire des concurrents sur le marché des hydrocarbures. C’est pourquoi la fin de l’embargo pétrolier contre l’Iran consécutive à l’accord de juillet 2015 sur le nucléaire iranien n’est à cet égard pas une « bonne affaire » pour la Russie ;
– il y a enfin l’ancienneté et la continuité de la confrontation armée entre l’URSS, puis la Russie, et l’islamisme radical, qui a commencé dans les années 1980 en Afghanistan et s’est poursuivie dans le Caucase. Les autorités russes revendiquent et ont effectivement une expérience sans égal de cet affrontement. Avec plus ou moins 20 millions de citoyens musulmans ou d’origine musulmane en Russie, soit 13 % à 15 % de la population, ces autorités ne peuvent pas se permettre l’indifférence face à la propagation des idées djihadistes. De manière générale, les responsables russes ne croient guère dans la possibilité d’un islamisme « modéré » et légaliste qui arriverait au pouvoir grâce à la démocratisation du monde arabe et serait capable de stabiliser ensuite la démocratie. Cette position justifie leur hostilité aux politiques occidentales d’« exportation de la démocratie ». La différence de posture entre la Russie et les États-Unis apparaît bien, dans le cas de l’Égypte, avec la différence d’attitude des deux pays vis-à-vis du régime du président Abdel Fattah al-Sissi après le renversement de son prédécesseur démocratiquement élu Mohamed Morsi et la répression des Frères musulmans.
Malgré ces raisons manifestes d’intérêt pour la zone moyen-orientale, la Russie postsoviétique, concentrée sur d’autres priorités, a longtemps été peu active dans cette zone. Son retrait a été marqué dès les lendemains de la chute du mur de Berlin, quand ce qui était encore pour quelques mois l’URSS a laissé les États-Unis conduire la première « guerre du Golfe » contre l’Irak de Saddam Hussein au mépris des liens très forts qui existaient entre Moscou et Bagdad.
Encore aujourd’hui, la situation de retrait relatif de la Russie apparaît bien dans son positionnement modéré : à la différence des États-Unis, adversaires déclarés de l’Iran et du régime syrien, et des pays européens qui ont rompu leurs relations avec ce dernier, la diplomatie russe valorise le fait qu’elle entretient des relations correctes avec tous les pays de la zone, d’où par exemple ses offres de médiation dans la crise diplomatique irano-saoudienne de janvier 2016.
Autre conséquence de cette position en retrait : la question des rapports avec les États-Unis est toujours présente dans les relations entre la Russie et les pays du Proche-et-Moyen-Orient. En effet, ces derniers polarisent leur politique par rapport aux États-Unis, dont ils sont selon les cas les « amis » ou les « ennemis », et la Russie est surtout vue comme un partenaire de substitution pour les seconds et de complément pour les premiers quand l’alliance américaine semble devenir moins étroite (cas par exemple de l’Égypte du président Abdel Fattah al-Sissi, voire de l’Arabie Saoudite). Et du côté russe, la politique moyen-orientale intègre toujours les incidences attendues sur les relations avec les États-Unis (et dans une moindre mesure les pays européens).
1. L’intervention en Syrie, première intervention militaire extérieure de la Russie hors de l’ex-URSS
Déclenchée officiellement le 30 septembre 2015, en réponse à une demande d’aide du régime syrien et avec l’approbation des deux chambres du parlement russe, la campagne aérienne en Syrie a constitué la première intervention militaire de la Russie en dehors des anciennes frontières de l’URSS (sous réserve de quelques participations très limitées à des opérations de l’ONU).
La Russie y a déployé des moyens très significatifs, estimés au plus fort de l’intervention à 4 000 à 6 000 hommes, une quarantaine d’avions de chasse, une trentaine d’hélicoptères et un volume significatif de matériels terrestres servis par des soldats russes (78).
Les ressorts et les objectifs de cette opération apparaissent multiples : les personnalités et les experts intervenant sur la question en citent toujours plusieurs, qui se recoupent naturellement, mais en insistant plus ou moins sur tel ou tel.
a. L’insistance sur la fidélité aux alliances, la légitimité et la légalité internationale, par opposition à l’exportation aventureuse de la démocratie
La Russie justifie son soutien au régime du président Bachar al-Assad par sa fidélité à un allié ancien et par la légitimité de ce régime, seul à représenter la Syrie de son point de vue (puisqu’issu des processus constitutionnels syriens, quoi que l’on pense de ceux-ci, et universellement reconnu par la communauté internationale avant 2011, sans qu’aucun gouvernement alternatif réunissant l’opposition n’ait pu s’imposer depuis lors).
En justifiant son intervention non seulement par la lutte contre le terrorisme, mais aussi par la réponse à une demande d’aide du gouvernement « légitime » de la Syrie, la Russie a considéré qu’elle lui conférait une légalité internationale plus solide que celle d’autres interventions (dont l’extension de l’intervention française contre Daesh à la Syrie).
La fidélité au régime syrien est aussi légitimée, selon les autorités russes, par l’échec du « Printemps arabe » et de la politique de changement de régime et d’exportation de la démocratie promue par les pays occidentaux, politique qu’elles dénoncent systématiquement. Elles font valoir qu’en Irak, puis en Libye, les puissances occidentales, soit se sont passées d’un mandat international dans les formes (de l’ONU), soit l’ont outrepassé, avec des résultats dramatiques.
La thématique de la protection des Chrétiens d’Orient, effectivement gravement menacés par les groupes djihadistes, s’inscrit aussi dans celle, plus générale, de la fidélité aux vieilles alliances et aux traditions, puisque la Russie revendiquait déjà au XIXème siècle un tel rôle protecteur.
b. L’affirmation de la puissance russe et le retour dans le « grand jeu » international
Pour le général Didier Castres, auditionné par la commission des affaires étrangères le 8 décembre 2015, cette intervention a aussi été l’occasion de manifester le retour de la puissance militaire russe, en montrant la capacité restaurée de l’armée russe à conduire une opération moderne et efficace : « la Russie apporte en effet la preuve, déjà esquissée à travers l’annexion de la Crimée, qu’elle dispose d’une armée moderne. Ce n’est plus l’armée qui est intervenue en Tchétchénie : elle est capable de conduire des opérations complexes et de projeter des forces à l’extérieur de la Russie. L’outil militaire russe se révèle complet, comme le montrent les tirs de missiles de croisière, depuis les airs ou depuis un sous-marin. De même, les raids de bombardiers stratégiques effectués sur la Syrie en faisant le tour de l’Europe illustrent leur capacité en la matière. Cette démonstration de puissance constitue probablement un message destiné à l’OTAN » (79).
Sur le plan diplomatique, l’intervention visait à faire de la Russie un interlocuteur incontournable pour le règlement des crises au Moyen-Orient et à renouer le dialogue avec les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, sur un sujet où les positions des uns et des autres sont moins conflictuelles que sur l’Ukraine et où la volonté de coopérer est affichée par tous les acteurs extérieurs (à la Syrie). Même si, en pratique, les différences d’approches et d’objectifs ne permettent pas une véritable coopération militaire, le dossier syrien est clairement pour la Russie un moyen de reprendre contact avec les pays occidentaux qui lui sont le plus hostiles, à commencer par les États-Unis. Selon une formule sans doute un peu caricaturale mais qui exprime bien les espoirs russes, il ne s’agit pas d’« échanger » l’Ukraine contre la Syrie, mais plutôt de faire passer au second plan la première, et notamment l’annexion de la Crimée. Sur la question syrienne, les positions sont facilement moins antagoniques, car la Russie est bien obligée d’admettre que le régime du président Bachar el-Assad est très affaibli, tandis que les « amis de la Syrie », c’est-à-dire de l’opposition syrienne, sont forcés de constater le morcellement de celle-ci et le poids des extrémistes en son sein. Le soutien « sans nuances » à l’un ou l’autre camp n’est donc plus possible.
Enfin, l’intervention a renforcé le statut d’allié ou du moins de partenaire qu’a la Russie vis-à-vis de la plupart des pays de la zone. Elle a été précédée puis s’est accompagnée d’une intense activité diplomatique dans la zone : rien qu’entre juin et octobre 2015, le président Vladimir Poutine a reçu en Russie à deux occasions le vice-prince héritier Mohammed ben Salman, ministre saoudien de la défense, ainsi que le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane ; il a également reçu le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Tous ces interlocuteurs prestigieux ont donc été honorés de faire le voyage de Russie. Puis, à la réunion du G20 à Antalya les 15 et 16 novembre 2015, le président russe a eu des entretiens avec le roi d’Arabie Saoudite et le président américain. Enfin, il a reçu l’émir du Qatar à Moscou le 18 janvier 2016.
c. Des intérêts nationaux à préserver
En intervenant aux côtés du régime syrien, la Russie a défendu aussi des intérêts nationaux concrets.
i. Les bases dans les « mers chaudes »
On l’a beaucoup dit, la base navale de Tartous est la seule base militaire russe hors de l’ancienne URSS, que la Russie voudrait donc garder à tout prix. À cet égard, le soutien apporté au régime syrien, puis l’intervention à ses côtés ont doté la Russie d’installations à Lattaquié et Tartous dont il sera difficile de la déloger (sauf effondrement total du régime syrien).
La volonté de présence en Méditerranée orientale renvoie par ailleurs à une vieille constante de la politique étrangère russe, puis soviétique, depuis le XVIIIème siècle : le désenclavement par le sud, avec la conquête d’accès aux « mers chaudes », en particulier à la Méditerranée, malgré le « barrage » formé par la Turquie et l’Iran et l’opposition farouche à cette expansion des puissances occidentales (Grande-Bretagne et France au XIXème siècle, plus tard États-Unis…).
Toutefois, dans un monde contemporain où la possession de bases permanentes apparaît désormais moins déterminante que la capacité de projection des forces et celle de bâtir des « coalitions » qui permettent (au moins) de disposer de bases provisoire proches des objectifs visés, il faut peut-être relativiser l’enjeu du contrôle des bases de Tartous et Lattaquié.
ii. La crainte de la contagion djihadiste en Russie et en Asie centrale
Selon les estimations, on compterait dans les rangs de Daesh 4 000 à 5 000 combattants russophones, dont 2 000 à 3 000 citoyens russes (venus en majorité des minorités musulmanes du Caucase du nord). Cela ferait de la Russie l’un des principaux « contributeurs » involontaires au djihadisme international, à un niveau comparable avec des pays arabes tels que la Tunisie, l’Arabie Saoudite et la Jordanie et très loin devant, par exemple, la France (plus ou moins 600 de nos ressortissants se trouveraient en Syrie aux côtés de Daesh selon des chiffres du Gouvernement). L’anéantissement de ces combattants porteurs de passeports russes a certainement été l’un des objectifs tactiques des frappes russes en Syrie. Notre ambassadeur à Moscou, S. E. Jean-Maurice Ripert, l’a indiqué sans ambages lors de son audition le 30 mars 2016 par la commission des affaires étrangères : « ainsi que le président Poutine l’a expliqué très clairement, la politique russe consiste à empêcher les djihadistes russes non pas de partir, mais de revenir sur le territoire russe, de peur qu’ils n’y commettent des attentats » (80).
La crainte de la contagion djihadiste en Russie, notamment dans le nord-Caucase, ou en Asie centrale (dont les États comptent de nombreux Russes et entretiennent des échanges humains massifs avec la Russie, ce qui faciliterait d’éventuelles infiltrations ultérieures dans cette dernière) est un motif très communément cité de l’implication russe dans le conflit syrien.
De même que les pays riverains de la Méditerranée occidentale sont inquiets du développement de « succursales » de Daesh en Libye, les autorités russes sont préoccupées par l’implantation de groupes de talibans se revendiquant désormais de Daesh dans la région de Jalalabad en Afghanistan. Selon des sources russes, Daesh en Afghanistan aurait pour objectif de conquérir l’Asie centrale. Il y aurait des camps d’entraînement pour les russophones au sud du pays, lesquels seraient ensuite envoyés aux frontières nord, proches du Turkménistan et du Tadjikistan, ou plusieurs milliers seraient massés (peut-être 7 000). La situation serait d’autant plus préoccupante que certains des pays d’Asie centrale, qui ont longtemps vécu dans un environnement sécurisé (pas de vrais conflits frontaliers et pas d’opposition suffisamment structurée à leurs régimes autoritaires pour justifier un appareil militaire puissant), ne seraient absolument pas prêts à y faire face.
d. Quels objectifs tactiques ?
Les objectifs tactiques de l’intervention aérienne russe ont été l’objet de débats entre les experts. La justification globale qui en a généralement été donnée était la nécessité d’appuyer les forces du régime syrien (et les milices le soutenant), présentées comme seules à même de combattre Daesh et les groupes terroristes compte tenu de la faiblesses et des divisions de l’opposition syrienne « modérée », ainsi que de l’ambiguïté de ses positions par rapport à certains groupes terroristes.
Plusieurs déclarations officielles russes ont mis en avant le risque inacceptable d’une avancée rapide des terroristes, voire d’une chute de Damas, en l’absence d’intervention. Il se serait agi de sauver, non pas nécessairement le régime syrien, mais l’État syrien en tant que tel, ainsi que sa capitale. Le général Jean-Claude Allard, directeur de recherche à l’IRIS, a souligné devant la mission, ainsi que dans ses publications (81), les enjeux qui s’attachent à la capitale de la Syrie. La chute de Damas serait l’un des objectifs majeurs du prétendu « califat » mis en place par Daesh, car cette ville a été la première capitale (au VIIème siècle) du califat historique. Pour cette raison, une prise de Damas par Daesh aurait un retentissement allant bien au-delà des seuls enjeux stratégiques concrets en donnant une immense aura à l’organisation terroriste. Par ailleurs, la concentration des bombardements russes dans le nord-ouest de la Syrie répondrait à une volonté de protéger la région côtière alaouite, mais aussi de couper les voies d’import/export entre les territoires tenus par Daesh et la Turquie, dont l’attitude à l’endroit de l’organisation est longtemps apparue comme très ambivalente.
Selon le général Didier Castres, auditionné par la commission, l’objectif tactique de l’opération, à quelques mois d’échéance, était de remettre suffisamment en selle le régime syrien pour le rendre incontournable dans les négociations internationales sur la sortie de crise politique en Syrie.
D’autres analyses, plus sceptiques quant aux intentions du pouvoir russe, ont mis en cause la volonté même de la Russie de contribuer à un processus de transition politique en Syrie. Dans un article (82), Mme Natalie Nougayrède voyait ainsi dans l’offensive du régime syrien contre Alep en février 2016, soutenue par l’aviation russe, une volonté d’écarter tout solution négociée avec l’opposition syrienne « modérée », celle-ci étant écrasée, ce qui ne laisserait en place que les forces du régime et Daesh : ce serait « précisément l’objectif de la Russie et l’une des principales raisons de son intervention militaire ».
La question du degré d’attachement de l’exécutif russe au maintien durable au pouvoir du président Bachar al-Assad en tant que tel reste discutée. Mais la Russie est au moins clairement attachée au maintien d’un État syrien solide et laïc, ce qui implique selon elle que l’on conserve les cadres actuels du régime.
En fait, on peut penser que la Russie se reconnaît effectivement dans le « processus de Vienne » de l’automne dernier, dont les conclusions lui donnent satisfaction : réaffirmation de l’unité et du maintien des structures étatiques de la Syrie ; silence sur le sort de son président, qui passe ainsi au second plan ; primauté des négociations dans le cadre des Nations-Unies sur les initiatives des « amis de la Syrie » tels que l’Arabie Saoudite… Le cessez-le-feu obtenu fin février 2016, puis l’annonce du désengagement russe (en pratique partiel) le 14 mars 2016 confortent la thèse d’une intervention visant plus à promouvoir une solution politique négociée en Syrie qu’à permettre au régime syrien de se maintenir éternellement et sans aucune concession en reconquérant le terrain perdu.
Dans son article précité, Mme Natalie Nougayrède observe aussi que l’intervention russe a eu sur l’Europe des effets collatéraux qui pourraient être appréciés du pouvoir russe, d’une part en plaçant la Turquie dans une situation délicate, alors que c’est un membre de l’OTAN dont les autres pays occidentaux doivent, en principe, être solidaires, d’autre part en jetant sur les routes de nouvelles vagues de réfugiés syriens, avec les conséquences que l’on sait sur la solidarité entre pays européens.
e. Les résultats indéniables d’une intervention limitée
L’appui aérien russe a permis aux forces syriennes pro-gouvernementales de faire reculer l’opposition de façon significative au début de l’année 2016, en particulier au nord du pays (région d’Alep et Idlib), mais aussi au sud. Le régime syrien a repris le contrôle de voies de communication qui étaient sa priorité et a pu durcir le siège des localités tenues par l’opposition ; il a également remporté à Palmyre une victoire symboliquement très importante contre Daesh. Par ailleurs, la frontière entre la Syrie et la Turquie est désormais en grande partie contrôlée par les forces des Kurdes syriens proches du Parti de l’union démocratique (PYD) et fermée aux infiltrations de djihadistes passant par la Turquie et aux trafics divers au profit de Daesh, mais aussi aux flux logistiques soutenant l’opposition modérée…
Sur le plan diplomatique, l’intervention a mis en lumière la capacité militaire de la Russie (et l’efficacité de ses armements à destination d’éventuels acheteurs) et lui a permis de s’imposer comme un acteur incontournable pour le règlement de la crise syrienne. Le président russe et/ou son ministre des affaires étrangères ont été associés à tous les formats de discussion, même les plus restreints, sur la Syrie, avant de négocier directement avec les États-Unis le cessez-le-feu du 22 février 2016.
Avant cela, le retour de la Russie dans le débat international sur le dossier avait permis (83) le vote le 18 décembre 2015 de la résolution 2254 du Conseil de sécurité, qui avalisait les acquis du processus de Vienne sur la Syrie : « respect de l’unité, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et du caractère non sectaire de la Syrie » et « nécessité d’assurer la continuité des institutions de l’État » ; mise en place d’une gouvernance de transition dans les six mois et élections dans un délai de dix-huit mois, le sort du président syrien n’étant en revanche pas évoqué ; lutte implacable contre les groupes terroristes, en vue notamment « d’éliminer le sanctuaire » territorial de Daesh.
De même, on l’a dit, les visites de dirigeants arabes à Moscou et Sotchi ont continué en nombre même après le début de l’intervention russe, alors même qu’elle apparaît aux pays sunnites comme renforçant l’axe chiite Iran-Irak-régime syrien-Hezbollah.
Sur le terrain militaire, la crise avec la Turquie déclenchée par la destruction d’un avion russe ne doit pas occulter que la Russie a en revanche veillé à éviter les incidents avec les autres puissances intervenant en Syrie, passant à cette fin des accords de « déconfliction » avec Israël, la Jordanie et les États-Unis.
En annonçant enfin son retrait (partiel) le 14 mars 2016, alors que les négociations inter-syriennes reprenaient à Genève, la Russie a averti le régime syrien des limites de son soutien, s’est posée en promotrice de la paix et cherche à éviter les risques d’un enlisement qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques : risques de radicalisation encore plus forte du conflit, d’épuisement des forces syriennes gouvernementales, déjà bien affaiblies, de confrontation accrue de la Russie avec la Turquie et les pays arabes sunnites, de perte de popularité de l’intervention dans la population russe…
Ce retrait partiel a aussi l’avantage, pour une Russie plongée dans de grandes difficultés économiques, de limiter le coût de l’intervention, qui serait finalement de l’ordre de 400 à 450 millions d’euros selon différentes estimations avancées.
f. Mais aussi une intervention qui a mis en lumière un certain isolement russe
Si l’intervention en Syrie est donc assez largement un succès pour la Russie, il n’ne reste pas moins qu’elle confirme l’isolement relatif du pays sur le plan international : la Russie est intervenue à peu près seule et n’a pas réussi à constituer autour d’elle une coalition contre le terrorisme international.
Son seul allié dans la zone est l’Iran, mais même cette alliance est ambiguë, l’Iran étant aussi un concurrent, y compris en Syrie (voir infra).
La question de la participation de la Russie à une grande coalition intégrée contre Daesh reste posée. Cette participation est peut-être souhaitable, mais les conditions politiques nécessaires ne sont pas remplies.
2. L’Iran, allié mais aussi concurrent
En tant que soutien, comme la Russie, du régime du président Bachar al-Assad, l’Iran apparaît donc comme un allié.
Cependant, alors qu’il est difficile de connaître la réalité des rapports de force entre les différents soutiens du régime syrien sur le terrain, certaines analyses mettent en avant, parallèlement à cette alliance stratégique, une forme de concurrence entre la Russie et l’Iran en Syrie : on lit parfois que l’une des motivations (soit dans l’exécutif russe, soit du côté du régime syrien qui l’a sollicitée) de l’intervention russe en Syrie serait de contrebalancer l’influence iranienne croissante dans le « camp » pro-régime, du fait notamment du déploiement au sol non seulement de milices alliées de l’Iran (Hezbollah notamment), mais même de volontaires iraniens et de membres des Gardiens de la révolution.
D’autres analystes estiment au contraire que l’Iran pourrait tirer un grand bénéfice de l’intervention russe dans le cadre d’une sorte de partage des rôles : désirant éviter tout risque de confrontation avec la Turquie tout en préservant le régime syrien, les dirigeants iraniens seraient très satisfaits de laisser les Russes concentrer leurs frappes sur le nord de la Syrie (régions d’Alep et Idlib), donc près de la frontière turque et sur des groupes d’opposition syrienne souvent soutenus par la Turquie – ce qui a débouché sur les incidents que l’on sait, la destruction en novembre 2015 de l’avion russe par l’armée turque et la crise russo-turque consécutive.
Par ailleurs, les relations de l’Iran avec la Russie sont, comme celles de l’Iran avec les pays occidentaux, tributaires des questions concernant le programme nucléaire iranien. La Russie a « joué le jeu » dans la négociation avec l’Iran sur ce dernier, qui est donc l’un des dossiers où, malgré les crises ukrainienne et syrienne, sa diplomatie a continué à collaborer activement avec celles des États-Unis et des grands pays européens. La Russie doit jouer un rôle important dans l’application de l’accord du 14 juillet 2015, car c’est à elle que l’Iran doit transférer les stocks d’uranium enrichi dont il doit se séparer – un transfert a effectivement eu lieu en décembre 2015. Suite à l’accord, la Russie a également mis fin à la prohibition de vente de technologies nucléaires civiles à l’Iran qu’elle avait adoptée et ses dirigeants espèrent bien que l’industrie nucléaire russe en tirera profit.
Cela dit, le règlement du problème du programme nucléaire iranien pourrait bien s’avérer une moins bonne affaire pour la Russie sur un autre plan : l’Iran est en concurrence avec la Russie sur les marchés pétroliers et c’est d’ailleurs à la perspective de son retour sur ces marchés qu’est souvent imputée l’accentuation de la baisse des cours du pétrole fin 2015-début 2016, qui a été très préjudiciable à l’économie russe.
Les relations russo-iraniennes sont par ailleurs marquées par un vieux problème, celui posé par le contrat passé en 2007 prévoyant la livraison à l’Iran, pour 800 millions de dollars, de missiles anti-aériens russes S-300. L’exécution de ce contrat avait été suspendue par la Russie en 2010, dans le contexte des sanctions prises par la communauté internationale contre l’Iran en raison de son programme nucléaire et plus précisément suite à l’adoption de la résolution n° 1929 du 9 juin 2010 du Conseil de sécurité prohibant la fourniture à l’Iran de systèmes de missiles. L’Iran avait alors saisi la Cour internationale d’arbitrage pour réclamer un dédommagement. L’accord sur le nucléaire iranien de juillet 2015 étant ensuite survenu, des annonces ont été faites en novembre de la même année sur la signature d’un nouveau contrat relatif à la vente d’une version modernisée des missiles S-300, puis sur leur livraison imminente. Il semble cependant que cette livraison ait ensuite été suspendue en février-mars 2016 à cause de problèmes de paiement et/ou en raison de craintes exprimées par Israël quant à un éventuel transfert ultérieur de certains de ces armements au Hezbollah.
3. Des efforts intenses en direction des pays arabes sunnites
a. Un allié traditionnel, l’Égypte
L’Égypte constituait jusqu’à peu une destination privilégiée des touristes russes et les relations entre l’exécutif russe et le régime du président Abdel Fattah al-Sissi étaient au beau fixe. La Russie avait su à cet égard profiter de la prise de distance des États-Unis vis-à-vis de l’Égypte après le renversement du président Mohammed Morsi en juillet 2013 ; en effet, l’exécutif russe, de son côté, n’avait naturellement rien à redire à un changement de régime justifié par la lutte contre le danger islamiste puis acté par une élection présidentielle qui est apparue comme un plébiscite populaire en faveur du président al-Sissi aussi convaincant que, par exemple, le referendum de rattachement de la Crimée à la Russie en mars 2014.
Les excellentes relations bilatérales, qui avaient même conduit le pouvoir égyptien à approuver l’intervention russe en Syrie, ont cependant été un peu ternies suite à la destruction dans le Sinaï d’un avion de ligne russe de retour d’Égypte avec à son bord de nombreux touristes le 31 octobre 2015. En effet, l’exécutif russe a rapidement reconnu l’origine terroriste de cette destruction et, mettant en cause la sécurité des aéroports égyptiens, suspendu les liaisons aériennes entre les deux pays, ce qui portait naturellement un sévère préjudice à l’industrie touristique égyptienne.
La Russie et l’Égypte ont signé peu après, le 19 novembre 2015, un accord intergouvernemental de coopération pour la construction et l’exploitation de la première centrale nucléaire d’Égypte. Cet accord est certes l’aboutissement de longues négociations, mais sa signature juste après l’attentat du Sinaï marque sans doute la volonté des deux parties de ne pas laisser cette affaire mettre en cause leurs bonnes relations.
b. Des relations suivies avec les monarchies malgré les rivalités pétrolières et géopolitiques
Les monarchies conservatrices du monde arabe ont une vieille tradition de relations privilégiées avec les États-Unis et/ou certains pays européens. Les relations tissées entre les États-Unis et l’Arabie Saoudite sont à cet égard emblématiques. Dans l’autre sens, on se rappelle que l’URSS appuyait les pays arabes « progressistes » qui avaient adopté un régime formellement républicain, souvent après avoir renversé des monarchies : Égypte nassérienne, Irak et Syrie baasistes.
À ce vieil antagonisme, se sont ajoutés dans la période récente deux motifs de désaccords entre la Russie et les monarchies arabes conservatrices :
– des vues opposées sur l’avenir de la Syrie ;
– une rivalité sur les marchés pétroliers, rivalité dont il ne faut pas sous-estimer la portée. La très forte baisse des cours du pétrole depuis 2014 a certes été déclenchée par l’atonie de la croissance mondiale et l’explosion des hydrocarbures non-conventionnels, mais rend aussi compte du refus de l’Arabie Saoudite de réguler le marché en réduisant sa production. En agissant ainsi, ce pays espère probablement affaiblir ses concurrents exportateurs de pétrole, ce non seulement pour des raisons économiques (en rendant non rentables certains gisements de sorte que la production se régule et que les cours remontent), mais également pour des raisons d’adversité géopolitique.
Ces oppositions n’ont pas empêché un renforcement récent des relations entre la Russie et les monarchies arabes. La Russie a sans doute profité du désengagement relatif de l’administration américaine de sa « chasse gardée » moyenne-orientale. De plus, de manière paradoxale, la crise syrienne puis l’intervention militaire russe ont fait de la Russie une sorte d’adversaire pour les pays soutenant activement l’opposition au régime syrien, mais aussi une puissance qu’il devenait exclu de négliger. C’est ainsi que l’un des objectifs de la diplomatie saoudienne, centrée sur sa confrontation avec l’Iran, est désormais d’essayer de détacher dans une certaine mesure la Russie de ce pays.
Les contacts et les accords se sont donc multipliés. À titre d’exemple, en juin 2015, le président Vladimir Poutine et le ministre saoudien de la défense et vice-prince héritier Mohammed ben Salman ont signé six accords de coopération bilatérale, dont un nouveau programme dans le nucléaire civil.
De même, le gouvernement jordanien a annoncé en décembre 2014 avoir choisi l’entreprise Rosatom pour construire les premiers réacteurs nucléaires du pays et un accord-cadre de financement a été trouvé en mars 2015. Puis, en octobre, la Jordanie a accepté de « coordonner » ses opérations militaires dans le ciel syrien avec celles de la Russie.
4. La Turquie : d’un partenariat prometteur à la crise
Avant la destruction par l’aviation turque le 24 novembre 2015 d’un bombardier russe à la frontière turco-syrienne, la Russie et la Turquie avaient établi un partenariat qui s’était renforcé dans la période qui a juste précédé ce très grave incident et était fortement valorisé en Russie (par opposition aux mauvaises relations avec les États-Unis et l’Union européenne).
Ce partenariat était avant tout économique. En effet, les autorités turques n’avaient pas mis en œuvre les sanctions occidentales liées à la crise ukrainienne. Une partie du commerce russe et des projets russes s’était donc reportée vers la Turquie. Un exemple caractéristique de ce report était donné par le projet de gazoduc Turkish Stream à travers la mer Noire, mis en exergue après l’abandon du projet South Stream, dont le tracé était très voisin (la principale différence étant le lieu de débouché, situé dans un cas en Turquie, dans l’autre en Bulgarie).
Avant la crise, la Turquie était le 5ème partenaire commercial de la Russie. Les échanges bilatéraux étaient de l’ordre de 30 milliards de dollars, voire 44 milliards en incluant les services, avec une balance largement excédentaire pour la Russie en raison des hydrocarbures. La Turquie était en effet en 2014 le deuxième marché pour le gaz russe, absorbant environ 13 % des exportations russes dans ce domaine. C’était aussi une destination touristique particulièrement appréciée de la population russe : en 2014, près de 3,2 millions de touristes russes y ont dépensé environ 3,5 milliards de dollars.
Au-delà de cette dimension économique et malgré les divergences qui existaient déjà, notamment sur la Syrie, les deux pays entretenaient des relations politiques correctes, fondées sur une certaine ressemblance des modes de fonctionnement des régimes et sur la perception en Russie d’un rôle modérateur de l’Islam turc (« moderne » et bien contrôlé par l’État, y compris alors que l’AKP est au pouvoir en Turquie). Le président turc a ainsi pris part le 23 septembre 2015 à l’inauguration de la grande mosquée de Moscou, en partie financée par son pays, et des échanges denses existaient entre les institutions musulmanes des deux pays, concernant en particulier la formation des imams.
La crise violente engendrée par la confrontation du 24 novembre 2015 a évidemment changé la donne. Les deux pays se sont engagés dans une guerre de propagande, dénonçant mutuellement la prétendue collusion de leurs dirigeants respectifs dans des trafics avec Daesh. La Turquie est désormais présentée dans des médias russes comme un pays dangereusement islamisé, dont les dirigeants seraient plus ou moins complices du terrorisme et attiseraient les sentiments anti-russes pour préserver leur popularité en déclin… Les tensions se sont encore accrues quand la Turquie a entrepris de bombarder les forces des Kurdes syriens du PYD, dans le temps même où la Russie les soutenait (voir infra).
Le président russe a signé dès le 28 novembre 2015 un décret prévoyant des rétorsions essentiellement économiques applicables dès le 1er janvier 2016 :
– suspension du régime d’exemption de visa en place pour les citoyens turcs ;
– interdiction d’importer en Russie depuis la Turquie de la volaille et divers fruits et légumes (cet embargo toucherait les deux tiers des exportations agro-alimentaires turques vers la Russie ; il réduirait toutes choses égales par ailleurs ces exportations d’environ 1,06 milliard de dollars) ;
– interdiction ou limitation des activités des entreprises turques en Russie, notamment dans le secteur du bâtiment ;
– interdiction pour les entreprises russes d’employer des ressortissants turcs dans divers secteurs (60 000 à 100 000 personnes seraient concernées) ;
– « recommandation » aux voyagistes russes de ne pas commercialiser des séjours en Turquie et suppression des vols charters.
En revanche, le secteur énergétique, où les échanges et investissements croisés sont déterminants pour les deux pays, est resté à l’abri : le projet de gazoduc Turkish Stream est certes gelé, mais il était déjà très incertain avant la crise. Quant au très gros contrat (20 milliards de dollars) concernant la construction de quatre tranches nucléaires à Akkuyu par Rosatom, il apparaît trop avancé (selon Rosatom les travaux ont commencé en 2014) pour être remis en cause sans pertes considérables pour toutes les parties prenantes.
La crise entre les deux pays a des conséquences dommageables dans un autre domaine, celui de la coopération sécuritaire, devenue très difficile alors que de nombreux djihadistes de nationalité russe transitent par la Turquie.
Il est cependant à noter, en ce mois de juin 2016, que les deux parties semblent désireuses d’aller vers une normalisation et notamment une levée des sanctions russes.
5. Les Kurdes : des relations anciennes réactivées dans le contexte présent de crise avec la Turquie
La Russie a aussi réussi à établir de bonnes relations avec les représentants de plusieurs mouvements kurdes, comme en témoigne le chercheur Igor Delanoë (84).
L’Union soviétique, qui accueillait elle-même, dans le Caucase, une petite minorité kurde officiellement reconnue comme l’une de ses nombreuses « nationalités », a parfois apporté son soutien aux mouvements kurdes dans le cadre de sa politique de nuisance aux États de la région qui appartenaient au camp occidental et au nom de l’amitié avec les luttes « progressistes » de libération nationale : elle a ainsi soutenu en 1946 la tentative de créer une république kurde indépendante en Iran, à Mahabad, puis accueilli sur son territoire, après l’échec de cette action, les combattants kurdes conduits par Moustapha Barzani, père du leader kurde irakien Massoud Barzani. Cela crée des liens.
Dans les années 1990, la Russie a parfois utilisé la question kurde pour contrer l’influence de la Turquie.
Plus récemment, le développement des relations russo-kurdes est entré dans une nouvelle phase du fait d’intérêts convergents qui s’articulent principalement aujourd’hui autour de la lutte contre Daesh (priorité des Kurdes d’Irak comme de ceux de Syrie) et de la coopération dans le domaine énergétique : Gazprom opère depuis 2012 au Kurdistan irakien. Depuis quelques mois, enfin, la crise politique russo-turque n’a pu que pousser encore plus la Russie à miser sur la carte kurde. La Russie valorise ainsi sa position de défenseuse des minorités du Moyen-Orient.
La limite à ces relations privilégiées tient à la volonté russe de préserver l’intégrité territoriale des États de la région entre lesquels sont réparties les populations kurdes (Turquie, Syrie, Irak et Iran). C’est évidemment une condition pour conserver de bonnes (ou de pas trop mauvaises) relations avec ces États et cela correspond plus généralement à une position traditionnelle de la diplomatie russe (même si celle-ci s’en est pour le moins écartée en annexant la Crimée).
Ainsi, la Russie soutient-elle certaines factions des Kurdes syriens, malgré son alliance avec le régime de Damas, car ceux-ci évitent de combattre ce régime et ont adopté une posture politique prudente (officiellement l’autonomie locale qu’ils ont conquise est provisoire, dans l’attente d’une solution politique générale en Syrie). Dans le contexte d’affrontement indirect avec la Turquie, la Russie a autorisé en février 2016 l’ouverture à Moscou d’une représentation (sans statut diplomatique) du Parti de l’union démocratique (PYD), l’organisation la plus puissante des Kurdes syriens, au moment même où l’armée turque bombardait les milices de ce parti (car elles affrontaient dans la région d’Alep des rebelles syriens proches de la Turquie et sont considérées comme proches du Parti des travailleurs du Kurdistan-PKK, « bête noire » du gouvernement turc). Certaines sources évoquent même une forme de présence militaire de la Russie sur le territoire syrien sous contrôle kurde. De même, la Russie livre des armes aux peshmergas kurdes irakiens, qui luttent contre Daesh et dont la posture officielle est le maintien de leur situation de très large autonomie dans le cadre de l’Irak.
TROISIÈME PARTIE : PLUS QUE JAMAIS, LA FRANCE DOIT AIDER AU RÉTABLISSEMENT D’UN PARTENARIAT EUROPÉEN AVEC LA RUSSIE
On peut penser que l’établissement d’un partenariat solide et confiant entre l’Union européenne et la Russie (ainsi que l’Union eurasiatique) répondrait aux intérêts de long terme des deux parties. Mais le fait est que les relations entre l’Union européenne, en tant que telle, et la Russie apparaissent aujourd’hui particulièrement bloquées. La politique de la Russie, notamment vis-à-vis de l’Ukraine, en porte très largement la responsabilité, bien sûr, mais l’Union européenne a aussi sa part dans ce blocage.
Les relations bilatérales sont aujourd’hui meilleures entre la Russie et un certain nombre de pays de l’Union européenne, dont le nôtre. La France aurait donc sans doute un rôle à jouer pour aider au rétablissement de relations apaisées entre l’Union européenne et la Russie.
I. LE BLOCAGE DES RELATIONS RUSSO-EUROPÉENNES
La crise ukrainienne a parachevé un blocage des relations Union européenne-Russie qui était déjà engagé auparavant, en raison de différends plus anciens.
A. POURTANT, DES COMPLÉMENTARITÉS ET DES INTÉRÊTS COMMUNS INDÉNIABLES
Pourtant, il faut rappeler que l’Union européenne et la Russie ont certainement, à moyen-long terme, d’excellentes raisons de maintenir une relation partenariale complète.
À plus court terme, la priorité absolue du moment, la lutte contre le terrorisme, devrait les rapprocher.
1. Une communauté d’intérêts sur le long terme
Les facteurs d’identité partagée et de complémentarité entre l’Union européenne et la Russie sont nombreux.
S’agissant des identités, on relèvera l’appartenance à un espace géographique continu, que l’on peut qualifier d’eurasiatique, et la proximité culturelle au sein de la « culture européenne ».
S’agissant des complémentarités, on observe que :
– la Russie a l’espace – une superficie qui représente le quadruple de celle de l’Union européenne, 17 millions de km2 contre 4 millions –, ainsi que les ressources naturelles et énergétiques ;
– l’Union européenne a l’avantage par sa population (508 millions d’habitants, contre 146 millions en Russie), son niveau de développement et le niveau de performance de ses entreprises. Les entreprises européennes (et particulièrement françaises) ont donc des opportunités considérables pour la modernisation de l’économie russe et des infrastructures, la satisfaction des besoins de la nouvelle classe moyenne et, à terme, l’accompagnement de la mutation du pays vers un développement plus durable (cette mutation n’a guère commencé, mais elle est inéluctable en Russie comme ailleurs).
Sur le plan géopolitique, les deux entités partagent des caractéristiques structurelles qui pourraient justifier un rapprochement de leurs positions :
– l’une et l’autre devront se positionner par rapport à la montée de la superpuissance chinoise et au désengagement relatif des États-Unis ;
– l’Union et la Russie ont en commun d’être riveraines de la zone du monde qui risque de rester durablement la plus chargée de crises et de menaces, à savoir le Proche-et-Moyen-Orient. Cette proximité géographique partagée leur donne une responsabilité particulière et doit les inviter à coopérer dans la région.
2. Un facteur de rapprochement à court-moyen terme, la priorité à la lutte contre le terrorisme islamiste
À plus court terme, la Russie et l’Union européenne sont en première ligne face aux crises dramatiques qui secouent actuellement le Proche-et-Moyen-Orient, en particulier les situations de guerre civile en Syrie, Irak et Libye et leurs conséquences, explosion du terrorisme et flots de réfugiés.
Si les conséquences de ces phénomènes ne sont pas fatales à l’Union européenne, on peut penser qu’ils feront évoluer le rapport de force interne à l’Union entre ceux qui sont surtout inquiets des événements du « sud » (monde arabe et Sahel) et ceux dont la Russie est le principal sujet de préoccupation sécuritaire.
Il faut être conscient que, bien longtemps, la participation de pays tels que la France ou le Royaume-Uni à des opérations militaires dans le voisinage « sud » de l’Europe – Irak, Syrie, Libye, Mali… – a continué à être perçue par les opinions publiques de nombreux pays européens comme s’inscrivant dans une sorte d’impérialisme postcolonial. Les déboires éventuellement subis dans ces opérations ou postérieurement y étaient donc vus comme quelque peu « mérités » et il était hors de question de s’associer à de telles opérations.
Il y avait aussi le sentiment qu’une politique de prudente abstention épargnerait aux pays en cause les risques terroristes. Les événements récents, qu’il s’agisse de l’arrivée de foules de réfugiés ou de la multiplication d’actes terroristes épouvantables qui n’ont pas frappé que la France, mais aussi des pays comme le Danemark ou la Belgique qui sont peu impliqués dans les affaires moyen-orientales, démontrent la fausseté de ce genre de sentiment de sécurité.
Dans ce contexte, la lutte contre le terrorisme et l’apaisement des crises au Proche-et-Moyen-Orient, qui en est un préalable nécessaire, peuvent et doivent devenir les priorités centrales de l’Union européenne.
Or, sur ces dossiers, la Russie est évidemment un partenaire incontournable qui, de surcroît, partage sans doute assez largement les mêmes intérêts sécuritaires fondamentaux, quelles que soient les divergences sur le soutien à apporter à un moment donné à tel ou tel régime ou groupe d’opposition… En effet, la Russie et de nombreux pays de l’Union européenne ont en commun, outre la proximité géographique avec le Proche-et-Moyen-Orient, la présence sur le sol de communautés musulmanes importantes, ce qui facilite la diffusion de l’extrémisme chez une petite minorité.
Mais auparavant, il faudra dépasser les contentieux actuels.
B. LA CRISE UKRAINIENNE : L’UNION EUROPÉENNE PEUT-ELLE JOUER UN RÔLE POSITIF ?
Il était inévitable que des actions russes telles que l’annexion unilatérale de la Crimée, puis le soutien militaire, à peine dissimulé, aux séparatistes du Donbass suscitent de vives réactions de la plupart des membres de l’Union européenne, et donc de celle-ci en tant que telle, débouchant sur la politique des sanctions.
Mais on est en droit de regretter que le rôle propre de l’Union européenne dans cette crise avec la Russie apparaisse sous un jour particulièrement négatif : les politiques de l’Union ont une certaine responsabilité dans le déclenchement de la crise politique qui a débouché sur la situation présente en Ukraine, même si les causes profondes sont à rechercher dans les divisions et faiblesses intrinsèques de ce pays ; et ensuite, une fois la crise déclenchée, l’Union européenne n’a pas été en mesure de s’imposer dans un rôle positif de médiation, laissé à certains États membres, à commencer par la France et l’Allemagne. L’Union, quant à elle, apparaît cantonnée dans un rôle plus négatif, la mise en œuvre des sanctions.
1. Avant la crise : les maladresses du Partenariat oriental
a. L’échec global de la Politique européenne de voisinage
En 2003, l’Union européenne a formalisé une politique nouvelle, la « Politique de voisinage » (PEV). Elle visait à organiser les relations de l’Union avec seize partenaires de son « voisinage », dont dix situés au sud, autour de la Méditerranée, et six localisés à l’est. L’objectif qui lui a été donné à l’origine était de « créer un espace de prospérité et de bon voisinage – un "cercle d’amis" – caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération » (85).
Il n’est malheureusement pas besoin de longs développements pour expliquer que les voisinages sud et est de l’Union, treize ans plus tard, ne peuvent guère être qualifiés d’« espace de prospérité et de bon voisinage » formant un « cercle d’amis ». L’échec de la PEV est patent et, en 2015, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur sa réforme. À cette occasion, une résolution sur la Politique de voisinage a été votée par votre commission des affaires étrangères, assortie d’un rapport de notre collègue Pierre-Yves Le Borgn’ (86) et précédée d’un autre rapport de nos collègues Joaquim Pueyo et Marie-Louise Fort (87).
Ces documents font plusieurs constats sévères sur la PEV : « flou conceptuel, (…) tension perpétuelle entre valeurs politiques et intérêts économiques, (…) modestie des crédits au regard des enjeux, (…) lourdeurs bureaucratiques (…) » pour nos collègues Joaquim Pueyo et Marie-Louise Fort. Pour notre collègue Pierre-Yves Le Borgn’, la PEV a notamment pâti d’une « ambiguïté fondatrice sur les objectifs », dans la mesure où elle a été imaginée comme une sorte d’alternative à la poursuite de l’extension territoriale de l’Union, dans un moment où celle-ci se rendait compte des difficultés consécutives aux élargissements à l’est des années 2000, mais sans exclure formellement toute perspective d’adhésion des « voisins ». Elle a également été une politique bureaucratique, conduite « sans vision et sans direction politiques », et trop « euro-centrée », refusant de « prendre en compte les différences de valeurs et de sensibilités, de même d’ailleurs que les différences d’intérêts objectifs et de situations géopolitiques, entre l’Europe et ses partenaires et parmi ces derniers », de sorte que les mêmes offres ont été faites à tous (des accords d’associations plus ou moins similaires) et que les « voisins des voisins » (par exemple la Russie) n’ont pas été pris en considération.
La manière dont la Politique de voisinage a été gérée en Ukraine illustre assez bien ces observations. S’agissant des « voisins » de l’est, la PEV a été déclinée sous l’appellation de Partenariat oriental.
b. Le Partenariat oriental, déclinaison de la Politique de voisinage à l’est
Le Partenariat oriental a été lancé en 2009 en direction de l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, le Moldavie et l’Ukraine, bref tous les voisins de l’espace postsoviétique, à l’exception – qui n’est évidemment pas un hasard… – de la Russie. Issue d’une initiative polono-suédoise, sa création s’inscrivait dans un contexte marqué notamment par la guerre russo-géorgienne d’août 2008. Ses objectifs étaient « l’établissement d’une association politique et un approfondissement de l’intégration économique » avec l’Union européenne, pour reprendre les termes de la déclaration commune adoptée lors du sommet fondateur de Prague le 7 mai 2009, ceci passant par :
– le renforcement du dialogue politique via la conclusion d’accords d’association, destinés à remplacer les accords de partenariat et de coopération signés dans les années 1990 entre l’Union et les pays concernés ;
– la libéralisation des échanges commerciaux et la reprise d’une part considérable de l’« acquis communautaire » par le biais d’accords de libre-échange « complet et approfondi », intégrés aux accords d’association ;
– la libéralisation, à terme, du régime des visas de court séjour ;
– le développement de la coopération régionale au moyen de rencontres politiques et techniques et de projets concrets.
La principale offre du Partenariat oriental a donc été celle d’accords d’association comprenant surtout un volet économique très étoffé, conduisant de facto à l’intégration des pays qui accepteraient cette offre au « marché unique » européen (libre-échange quasi-intégral et alignement sur le droit économique et les réglementations techniques de l’Union). On le sait, trois des six pays ciblés – Géorgie, Moldavie et Ukraine – ont finalement signé un accord d’association en 2014.
c. L’offre faite à l’Ukraine d’un accord d’association trop rigide
Si la négociation de ces accords d’association a été assez aisée avec la Géorgie et la Moldavie, qui étaient clairement engagées depuis plusieurs années dans une démarche de rapprochement avec l’Union, les choses ont été beaucoup plus difficiles et chaotiques avec l’Ukraine. L’Union européenne, en proposant un projet d’accord d’association peut-être trop exigeant et rigide, a contribué aux événements à l’origine de la crise présente.
La négociation de l’accord d’association avec l’Ukraine avait débuté en 2007 et, lors du 15ème sommet Union européenne-Ukraine du 19 décembre 2011, un accord politique avait été annoncé concernant le texte de l’accord, ensuite paraphé en 2012. Cependant, entre-temps, les élections présidentielles de 2010 avaient vu la défaite des partis pro-européens issus de la « révolution orange » de 2004 et amené au pouvoir M. Viktor Ianoukovytch, représentant du Parti des régions et réputé « pro-russe ». La situation du président Ianoukovytch, tiraillé entre, d’une part, les intérêts économiques et la sensibilité de ses mandants, d’autre part, la détermination pro-européenne de l’autre partie de l’opinion ukrainienne, était difficile et il a peut-être cru qu’il pourrait louvoyer entre Bruxelles et Moscou pour tirer le meilleur parti de l’« hésitation » ukrainienne entre ces deux pôles d’influence. Toujours est-il qu’après de nombreux marchandages et atermoiements, on se rappelle que M. Ianoukovytch a finalement décidé, le 21 novembre 2013, de ne pas signer l’accord d’association qui lui était proposé, décision qui a déclenché les manifestations populaires qui finalement devaient en février 2014 entraîner sa chute, suivie de l’annexion de la Crimée par la Russie, puis des événements du Donbass.
La politique de l’Union européenne n’est certes pas responsable des manœuvres dilatoires du président Ianoukovytch, qui a trompé son peuple, a fortiori elle ne l’est pas de l’ensemble de sa mauvaise gouvernance, qui explique largement la révolution qui l’a finalement emporté. Quant aux événements de Crimée et du Donbass, ils renvoient d’abord aux choix politiques du président Vladimir Poutine.
Malgré tout, on est aussi en droit de regretter que les négociateurs de l’Union n’aient pas été en mesure de faire une offre alternative à un accord d’association qui, en intégrant en pratique l’Ukraine au « marché unique » européen, était incompatible avec l’offre économique concurrente de la Russie, l’Union économique eurasiatique, et plus généralement remettait en cause la profonde imbrication entre les économies russe et ukrainienne héritée de l’URSS. Pour les régions industrielles russophones du sud et de l’est de l’Ukraine, base électorale de M. Ianoukovytch, cette offre européenne était sans doute inacceptable, d’où son rejet final et la crise consécutive.
d. Une politique qui a irrité la Russie
De manière plus générale, il est clair que le Partenariat oriental, en tant qu’offre de quasi-intégration européenne faite à toutes les ex-républiques soviétiques situées sur le continent européen à l’exception notable de la Russie, ne pouvait qu’irriter cette dernière. Le Partenariat oriental a grandement contribué à renforcer le discours russe (qu’il relève de la conviction ou de la propagande) sur l’encerclement agressif de la Russie par l’Union européenne (et toujours, en arrière-plan, les États-Unis).
2. La gestion de la crise : une action propre de l’Union qui tend à se résumer à la politique de sanctions, à l’aide financière à l’Ukraine et aux « bons offices » sur les questions gazières
Dans son rapport précité sur la Politique européenne de voisinage, notre collègue Pierre-Yves Le Borgn’ se demandait si, pour le traitement politique des crises survenant sur son flanc est, l’Union européenne n’était pas « trop souvent aux "abonnés absents" ». Il constatait en effet « la modestie de la contribution de l’Union européenne en tant que telle et de ses politiques au traitement des différents conflits qui concernent les partenaires orientaux ».
S’agissant des « conflits gelés » du Caucase ou de Transnistrie, l’Union a certes déployé des missions de surveillance ou d’assistance (dans le Caucase, la Mission de surveillance de l’Union européenne ; sur la frontière ukraino-moldave, c’est-à-dire en grande partie en pratique entre l’Ukraine et la Transnistrie, la Mission d’assistance au contrôle de la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine), mais avec des moyens humains et juridiques limités, et donc des résultats également limités. Elle apporte par ailleurs un soutien financier très important, notamment à l’Ukraine.
Cependant, pour ce qui est de la crise ukrainienne, on doit bien constater que l’action proprement politique de l’Union est essentiellement constituée par l’adoption des diverses sanctions contre la Russie présentées supra.
En revanche, l’Union européenne a quelque difficulté à s’investir positivement dans le règlement des conflits. C’est en effet l’initiative de gouvernants des États membres qui a joué le rôle le plus déterminant dans ce domaine :
– c’est la médiation des ministres des affaires étrangères des trois pays du « triangle de Weimar » (France, Allemagne et Pologne) qui a facilité le 21 février 2014 la conclusion d’un accord qui fournissait une porte de sortie politique aux affrontements de plus en plus sanglants de la place Maïdan ;
– ce sont ensuite la France et l’Allemagne qui ont su établir, grâce à l’implication personnelle du Président de la République et de la Chancelière fédérale, un dialogue à quatre avec la Russie et l’Ukraine sur le Donbass, le « format Normandie » de juin 2014, qui s’est pérennisé ensuite avec le « processus de Minsk ».
Quant à l’organisation internationale choisie pour assurer la médiation entre les parties dans la mise en œuvre technique des accords de Minsk et pour l’observer sur le terrain, ce n’est pas l’Union européenne, mais l’OSCE (dont la Russie est membre, ce qui permet de mieux l’impliquer dans le processus).
Sur le plan économique, l’Union a cherché, en menant des négociations tripartites avec l’Ukraine et la Russie, à promouvoir une forme de conciliation entre l’entrée en vigueur du volet commercial (accord de libre-échange) de son accord d’association avec l’Ukraine et le maintien des relations économiques privilégiées antérieures de ce pays avec la Russie, mais elle a échoué (on l’a dit, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du volet commercial de l’accord d’association a entraîné des mesures de rétorsion russes contre le commerce ukrainien, puis des contre-mesures ukrainiennes).
L’action « positive » propre de l’Union se limite donc essentiellement, d’une part à l’offre à l’Ukraine d’aides financières substantielles, d’autre part à une mission de « bons offices » plus réussie (mais seulement partiellement là-aussi) pour apaiser les contentieux gaziers russo-ukrainiens, tout en améliorant l’approvisionnement de l’Ukraine depuis l’ouest, ce qui lui a permis de rompre sa dépendance gazière vis-à-vis de la Russie.
3. Une opinion européenne profondément divisée
La difficulté des États membres de l’Union européenne à élaborer une « politique ukrainienne et russe » commune rend compte d’une réalité : leurs intérêts fondamentaux, leur perception de la Russie et leur acceptation de l’hypothèse d’un éventuel affrontement armé avec celle-ci sont très différents et ces différences apparaissent non seulement dans les positions des gouvernements, mais aussi dans celles des opinions publiques (ce qui est normal en démocratie). L’enquête précitée du Pew Research Center publiée en juin 2015 (88) est à cet égard caractéristique. Elle porte sur les opinions publiques des grands pays européens, des États-Unis et du Canada.
● Globalement, selon cette enquête, la Russie est perçue comme une menace majeure par une majorité de sondés, sauf en Allemagne, mais les taux sont très variables selon les pays : on passe de 70 % de sondés polonais qui le pensent à seulement 38 % de sondés allemands, la France étant dans une position médiane (51 %).
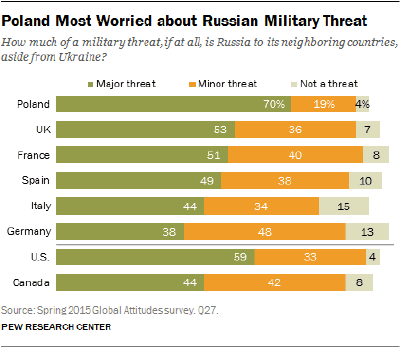
● Si les opinions occidentales sont très majoritairement en faveur d’un soutien économique à l’Ukraine, elles sont beaucoup plus divisées sur les autres formes de soutien politique ou militaire (fourniture d’armes à l’Ukraine, adhésion de celle-ci à l’Union européenne ou à l’OTAN). Sur ces différentes formes de soutien politico-militaire, on relève sans surprise une adhésion assez forte (bien que pas écrasante – les taux d’approbation ne dépassent pas les 50-60 %) en Pologne et, dans une moindre mesure, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. En France, l’opinion est assez partagée. Enfin, les Italiens et les Allemands sont les plus réticents (dans les deux pays, 35 % à 40 % des sondés seulement sont favorables à une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ou à l’Union européenne et un cinquième à l’envoi d’armes).
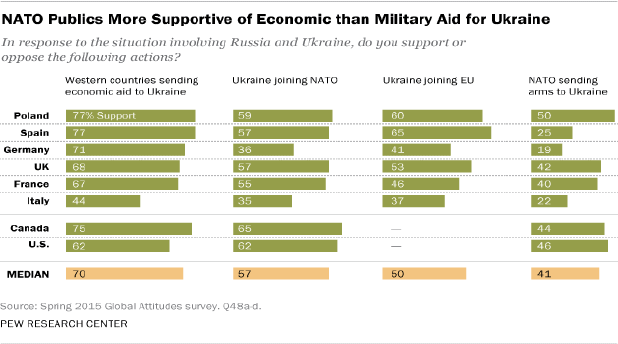
Les différences entre opinions publiques européennes pour ce qui est de l’engagement de soutien à l’Ukraine rendent compte d’une perception inégale de la « menace » russe, mais aussi d’une acceptation plus ou moins grande de l’hypothèse d’une guerre contre la Russie, ce qui renvoie aussi au degré plus ou moins grand de « pacifisme » et/ou de solidarité atlantique. Les opinions publiques sont en effet très divisées sur le principe du soutien militaire qu’il faudrait apporter à un membre de l’OTAN qui serait agressé par la Russie (ce qui est pourtant l’un des principes de l’OTAN) ; une majorité de sondés français et plus encore italiens et allemands n’y sont pas favorables.
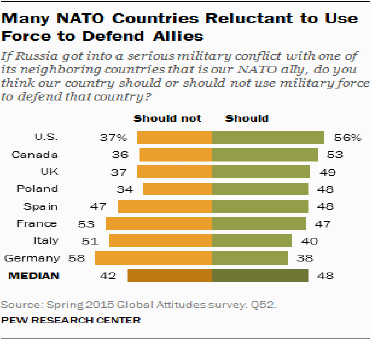
Les différends concernant l’Ukraine ne font que s’ajouter à ceux qui s’étaient déjà développés avant 2014 entre la Russie et l’Union européenne, différends qui n’ont naturellement guère évolué dans le contexte de gel des relations qui prévaut désormais.
● La question énergétique – pour être plus précis, celle du gaz – est celle par laquelle l’Union européenne a tout d’abord été impliquée, à son corps défendant au début, dans les difficiles relations russo-ukrainiennes. On se rappelle en effet qu’entre 2006 et 2009, plusieurs « guerres du gaz » ont opposé Russie et Ukraine, officiellement pour des raisons financières (non-paiement de livraisons, accusations de « vol » de gaz), mais sur un fond politique évident, le pouvoir en place en Ukraine étant celui issu de la « révolution orange », peu appréciée des autorités russes. Les coupures alors décidées du côté russe ont parfois impacté l’approvisionnement européen.
● Par ailleurs, l’Union européenne a adopté en 2009 un ensemble de textes communautaires, constituant le « troisième paquet énergie », qui appliquaient au secteur énergétique les principes du droit européen de la concurrence. Ces textes imposent notamment, dans le domaine du gaz et celui de l’électricité, la séparation effective entre la gestion des réseaux de transport, d’une part, et les activités de fourniture et de production, d’autre part ; à défaut, ils obligent les propriétaires de réseaux de transport, tels que les gazoducs, à réserver une part de leur capacité de transport à des tiers. En pratique, un fournisseur de gaz qui possède des gazoducs doit les vendre, les transférer sous le contrôle d’un opérateur indépendant ou garantir aux autres fournisseurs un accès à 50 % de ses capacités de transit. Ces règles, applicables naturellement aux entreprises de pays tiers qui sont actives dans l’Union, vont à l’encontre du modèle économique de Gazprom, qui est à la fois producteur de gaz et gestionnaire de gazoducs.
Les textes communautaires prévoient certes la possibilité d’exempter au cas par cas certaines infrastructures de ces règles, notamment dans le cas des gazoducs transfrontaliers, ce qui a bénéficié à plusieurs projets, mais toujours au cas par cas (alors que la Russie revendique depuis longtemps une exemption de portée plus générale).
Dans le contexte actuel, les projets d’infrastructures initiés par Gazprom suscitent des réticences encore plus grandes qu’il y a quelques années. Ce point est apparu de manière patente lors du débat organisé en séance plénière du Parlement européen le 7 octobre 2015 à propos du projet North Stream 2, destiné à doubler la capacité du gazoduc North Stream en service depuis 2012 de la Russie à l’Allemagne par la mer Baltique (89). Pratiquement tous les porte-paroles des groupes politiques ont fait part de grandes réserves, liées non seulement aux enjeux environnementaux, mais aussi à des préoccupations politiques telles que le poids de Gazprom dans le projet et la dépendance gazière vis-à-vis de la Russie.
● La signature en mars 2013 d’une « feuille de route » Union européenne-Russie de coopération énergétique jusqu’en 2050 n’apparaît pas vraiment de nature à améliorer effectivement les relations bilatérales dans ce domaine, car il s’agit d’un document essentiellement prospectif, qui formule de simples recommandations d’actions, de plus de portée très générale.
● Enfin, un contentieux de longue haleine (comme toujours dans ce domaine) oppose la Commission européenne à Gazprom quant au respect effectif du droit européen de la concurrence par l’entreprise. La Commission a ouvert une procédure formelle d’examen à l’encontre de Gazprom le 31 août 2012 et lui a adressé officiellement le 22 avril 2015 une « communication des griefs ». La Commission y reproche à Gazprom d’avoir des pratiques anti-concurrentielles dans huit États membres d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque et Slovaquie). La Commission conteste en particulier :
– les restrictions territoriales (interdictions de réexportation ou d’utilisation du gaz hors d’un territoire donné) pratiquées par Gazprom dans ses contrats avec des grossistes en gaz ;
– la politique de prix « déloyale » que mènerait Gazprom, grâce à ces restrictions territoriales, en Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne ;
– les abus de position dominante qui résulteraient de la subordination des livraisons de Gazprom à la Bulgarie et à la Pologne à l’obtention d’engagements distincts de la part des grossistes concernant les infrastructures de transport gazier (obligations de prendre une participation dans un gazoduc, ou au contraire de céder des parts à Gazprom…).
La Commission européenne peut en principe infliger des amendes allant jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires aux entreprises qui contreviennent au droit européen de la concurrence. En pratique, il y a toujours une longue négociation et le cas de Gazprom ne dérogera pas à cette règle. Il est donc possible que ce litige reste assez longtemps un autre facteur d’irritation dans les relations entre l’Union européenne et la Russie.
Il faut aussi être conscient que ce litige juridique et économique a d’évidentes implications géopolitiques : ainsi, c’est la contestation de la prétention de Gazprom à imposer des clauses contractuelles de non-réexportation du gaz livré à des pays de l’Union qui permet de mettre en place des « flux rebours » pour le rediriger vers l’Ukraine et affaiblit en conséquence le « pouvoir gazier » non seulement de l’entreprise, mais de la Russie en tant que telle.
2. La question des valeurs démocratiques
Après la fin de l’URSS, la Russie a clairement souhaité adopter les valeurs démocratiques de l’Europe. Elle en a accepté les contraintes en devenant en 1996 membre du Conseil de l’Europe, puis en ratifiant en 1998 la Convention européenne des droits de l’homme. Elle est donc soumise à la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dès la fin de l’URSS, la Russie postsoviétique a été inévitablement critiquée pour nombre de violations des droits fondamentaux. Mais il pouvait aussi y avoir une certaine compréhension pour les difficultés du pays et la nécessité pour lui de se débarrasser progressivement des mauvaises pratiques héritées du passé, tout en gérant des crises internes génératrices de terrorisme, en particulier dans le Caucase du nord (guerres de Tchétchénie et lutte contre les djihadistes dans les territoires voisins).
Toutefois, les positions se sont radicalisées compte tenu de l’évolution du régime russe depuis quelques années, avec, comme on l’a vu, l’adoption de législations contestables, le harcèlement administratif et judiciaire des opposants et des ONG ayant une activité politique, l’affirmation de valeurs différentes de celles des pays occidentaux et la critique de la « décadence » de ceux-ci, ainsi que la diffusion de ce discours par les médias sous contrôle de l’État ou amis.
Les questions concernant les valeurs démocratiques, la conception des droits de l’homme et leur application sont devenues très conflictuelles entre les instances européennes ad hoc et la Russie.
En janvier 2015, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, procédant à l’examen annuel des pouvoirs de ses membres, a décidé de suspendre la plupart des droits des représentants russes (participation aux instances dirigeantes de l’Assemblée ; droits de vote, d’être rapporteur, de participer à une mission d’observation électorale, etc.). En 2016, anticipant une reconduction de ces mesures, la délégation russe a décidé de ne pas participer à la session d’hiver.
S’agissant de la Cour européenne des droits de l’homme, on doit bien observer que la Russie y est très souvent condamnée. En 2015, selon le bilan annuel de la Cour, le pays vient au premier rang de tous les membres avec 109 condamnations sur un total de 694 arrêts constatant au moins une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette situation peut certes être plus ou moins corrélée avec le poids relatif de la population russe en Europe, la Russie y étant le pays le plus peuplé. Mais si l’on regarde plus précisément les condamnations fondés sur les motifs les plus graves, le prépondérance de la Russie apparaît encore plus forte et ne peut plus être corrélée à son poids démographique : 15 condamnations contre la Russie pour atteintes à la vie humaine (exécutions extra-judiciaires et « bavures » policières…) sur un total de 23 prononcées par la Cour en 2015 ; 4 pour torture sur un total de 10 ; 44 pour traitements inhumains ou dégradants sur un total de 157 ; 58 pour violation du droit à la liberté et la sûreté (arrestations et détentions arbitraires) sur un total de 182…
Le président russe a promulgué, en décembre 2015, une loi autorisant la Cour constitutionnelle russe à déclarer inexécutoires, sur requête de l’exécutif, les décisions de juridictions internationales telles que la Cour européenne des droits de l’homme.
3. La libéralisation des visas
La réglementation des visas de court séjour (jusqu’à trois mois) d’entrée dans l’espace Schengen, dits « visas Schengen », est une compétence communautaire. La « facilitation » (réduction du coût et accélération des procédures) de la délivrance de ces visas puis leur suppression si possible constituent des demandes fortes des populations des pays du voisinage de l’Union européenne ; elles sont donc un élément central de l’offre faite par l’Union à ces pays dans le cadre de la Politique européenne de voisinage.
La mise en œuvre des mesures européennes de libéralisation des visas s’inscrit dans un double processus. Il y a d’abord, en effet, un processus technique destiné à vérifier que les pays demandant l’exemption de visas Schengen répondent à un certain nombre de prescriptions : adoption de procédés tels que la biométrie rendant les documents plus difficiles à falsifier, garanties quant à la fiabilité des contrôles aux frontières et du fonctionnement des administrations compétentes… Il y a ensuite un processus politique, les avancées sur les visas étant toujours un point important des négociations menées : l’Union européenne les réserve aux pays qu’elle considère comme « méritants » ou les troque contre autre chose.
L’imbrication des exigences d’ordre technique, fondées sur des préoccupations de sécurité et de risque migratoire, et du marchandage politique apparaît constamment dans les annonces et décisions européennes :
– depuis avril 2014, les citoyens moldaves sont dispensés de visa Schengen. Seule pour le moment de tous les pays du Partenariat oriental, la Moldavie a obtenu cette mesure compte tenu de son engagement européen, mais aussi de son faible risque migratoire (c’est un petit pays en déclin démographique qu’un très grand nombre de jeunes adultes ont déjà quitté pour travailler en Russie ou dans l’Union européenne) ;
– dans la déclaration finale du sommet du Partenariat oriental à Riga des 21 et 22 mai 2015, les chefs d’État ou de gouvernement qui y avaient pris part ont fait état de leur hâte de voir l’Ukraine et la Géorgie parvenir au terme de leur processus de vérification de leur préparation à la suppression des visas Schengen. La Commission européenne a été sensible à cette hâte en publiant dès le 18 décembre 2015 le dernier rapport d’évaluation requis, concluant à l’opportunité de libéraliser rapidement les visas avec l’Ukraine, la Géorgie et le Kosovo ;
– tout récemment, la suppression prochaine des visas Schengen a été l’un des éléments de l’accord du 16 mars 2016 avec la Turquie sur la gestion des migrants. L’Union n’y renonce pas à ses exigences techniques habituelles, mais accepte une accélération du processus de vérification, en vue d’une libéralisation rapide, sous réserve, est-il précisé, que toutes les conditions techniques soient remplies.
S’agissant de la Russie, les négociations et les accords sur les visas sont anciens.
En 2006, l’Union européenne et la Russie ont conclu un accord de réadmission et un accord de « facilitation » de la délivrance des visas de court séjour aux ressortissants russes désireux de se rendre dans l’Union et vice-versa : cet accord précisait les documents (justificatifs de voyage) à produire pour obtenir un visa, fixait des délais de réponse, comprenait un régime tarifaire de faveur – 35 euros, au lieu de 60 euros, tarif de droit commun des visas Schengen, et la gratuité pour certaines catégories de personnes – et prévoyait la délivrance de visas à entrées multiples pour différentes catégories de demandeurs.
Par ailleurs, des arrangements ont été trouvés pour les courts déplacements dans certaines zones frontalières (en Finlande ou encore en Pologne pour les habitants de l’enclave russe de Kaliningrad : un accord frontalier russo-polonais de juillet 2012 permet notamment aux habitants de la zone frontalière de disposer d’une carte de circulation).
L’objectif suivant était la levée générale de l’obligation de visa pour les voyages de courte durée entre les deux partenaires. Lors du sommet Russie-Union européenne tenu à Bruxelles en décembre 2011, une liste d’« étapes communes » devant y conduire avait été arrêtée. Bien que difficiles, les négociations ont progressé durant les deux années suivantes. L’un des obstacles principaux résidait dans les « passeports de service », très nombreux en Russie : certains États membres, méfiants, voulaient exclure cette catégorie de passeports de l’exemption de visa. Finalement, en mars 2013, cette exigence a été abandonnée par les négociateurs européens.
Mais, sur ce point comme sur d’autres, la crise ukrainienne a ensuite tout bloqué, l’une des premières sanctions décidées par l’Union européenne étant le gel des négociations en cours. De plus, l’Union a pris la décision, conforme à ses positions mais inacceptable pour la partie russe, de refuser toute délivrance de visa sur le territoire russe à des habitants de Crimée (les intéressés doivent en principe solliciter les consulats en Ukraine des États membres).
Ce dossier, sur lequel un accord serait sans doute, techniquement, atteignable et servirait les échanges humains (tourisme, hommes d’affaires…) avec la Russie, est donc tributaire de l’évolution générale des relations avec la Russie.
D. L’INCAPACITÉ À RELANCER UN PARTENARIAT
1. Un accord de partenariat qui n’est toujours pas renouvelé
Dès avant la crise ukrainienne, la dégradation des relations entre l’Union européenne et la Russie avait empêché de développer le partenariat global imaginé entre les deux entités dans les années 1990.
a. Un accord de partenariat et de coopération arrivé à expiration
L’accord de partenariat et de coopération de 1994, arrivé à échéance en 2007, était reconduit tacitement chaque année depuis lors, faute de progrès des négociations ouvertes en 2008 sur le nouvel accord censé le remplacer.
b. Un instrument au champ moins global, le Partenariat pour la modernisation
Un arrangement partiel avait été trouvé, lors du sommet Russie-Union européenne de Rostov-sur-le-Don de juin 2010, avec la conclusion d’un « Partenariat pour la modernisation », qui entendait offrir « un cadre souple pour promouvoir les réformes, stimuler la croissance et améliorer la compétitivité », donnant une certaine priorité aux enjeux économiques ou à des enjeux politico-juridiques mais liés à l’économie (par exemple réforme de la justice et lutte contre la corruption placées dans l’optique de la protection des entreprises) – ce qui avait l’avantage de mettre de côté les divergences politiques.
Outre qu’il a justifié le maintien d’un dialogue à haut niveau (sommets Union européenne-Russie annuels), ce dispositif a pu donner quelques résultats concrets si l’on en croit les « rapports de progrès » publiés par les instances européennes (en mars 2013 et janvier 2014), qui citent notamment à cet égard (avec peut-être une certaine tendance à attribuer au dialogue Union européenne-Russie des avancées sans véritable rapport avec lui) :
– l’adoption de la « feuille de route » commune pour l’énergie précitée ;
– des accords de coopération ou de convergence sur certaines réglementations techniques, industrielles ou phytosanitaires ;
– l’instauration dans la justice russe de mécanismes d’appel ;
– le lancement d’une initiative de protection des entrepreneurs contre la corruption ;
– le développement de la coopération dans le domaine spatial avec le lancement des satellites Galileo depuis Kourou à l’aide de lanceurs Soyouz ;
– la poursuite d’une coopération active dans le domaine de la recherche (la Russie étant le premier partenaire extra-communautaire des programmes européens, ces programmes communs bénéficiant de 63 millions d’euros de fonds communautaires en 2012) ;
– la labellisation de financements de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour un total de 1,4 milliard d’euros fin 2012.
c. Des relations gelées dans le cadre des sanctions
L’annexion de la Crimée a conduit l’Union européenne à suspendre, à titre de sanctions, les sommets annuels avec la Russie (le dernier a eu lieu à Bruxelles le 28 janvier 2014), de même que la plupart des programmes de coopération avec la Russie, sauf ceux portant exclusivement sur une coopération transfrontalière ou avec la société civile.
Aujourd’hui, l’action de l’Union européenne en Russie est des plus réduites. Elle se concentre notamment sur la mobilité étudiante, dans le cadre du programme « Erasmus + », qui concerne 68 établissements d’enseignement supérieur russes et permet à quelques 3 500 jeunes Russes d’étudier dans l’Union et à quelques 1 200 jeunes Européens d’étudier en Russie. D’après les informations recueillies à Moscou auprès de la représentation de l’Union européenne par la délégation de la mission qui s’y est rendue, même ces échanges seraient parfois hypothéqués par le climat politique actuel (les autorités russes interdiraient ou décourageraient certains contacts).
2. La question récurrente de la reconnaissance de l’Union eurasiatique comme partenaire de négociation
Comme le signalent des documents européens (90), l’une des causes des retards pris à partir de 2008 pour renouveler l’accord de partenariat et de coopération global entre l’Union européenne et la Russie tenait aux problèmes de compétence pour discuter des questions commerciales, du fait de l’émergence de l’Union économique eurasiatique (d’abord en tant qu’Union douanière, puis Espace économique eurasiatique) : certaines questions ne pouvaient plus être négociées avec la seule Russie alors que les compétences correspondantes étaient transférées à la nouvelle Union en gestation.
Pourtant, l’Union européenne s’est jusqu’à présent toujours refusée à envisager l’Union eurasiatique comme partenaire de négociation, arguant à l’origine de la non-appartenance à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de la Biélorussie et du Kazakhstan, les deux autres membres fondateurs de l’Union eurasiatique (aux côtés de la Russie).
Sur ce point, il est à noter que le Kazakhstan est devenu membre de l’OMC le 30 novembre 2015, tandis que la Russie l’est depuis 2012 et l’Arménie depuis 2003. Trois des cinq membres actuels de l’Union eurasiatique sont donc désormais membres de l’OMC et ils représentent, du fait du poids de la Russie, plus de 90 % de la population de l’Union et plus de 95 % de son PIB. L’argument de la non-appartenance de membres de l’Union eurasiatique à l’OMC doit donc être relativisé.
Par ailleurs, même si l’intégration de sa politique commerciale extérieure est loin d’égaler celle de l’Union européenne, l’Union eurasiatique a commencé à s’imposer sur la scène internationale en négociant des accords de libre-échange. Le premier a été signé avec le Vietnam en mai 2015.
Dans ces conditions et quand, par ailleurs, les obstacles politiques majeurs liés à la crise ukrainienne auront été dépassés, on comprend mal pourquoi l’Union européenne, elle-même issue d’un processus progressif d’intégration économique, continuerait à refuser de voir dans l’Union eurasiatique un partenaire naturel sur les enjeux économiques.
E. CONCLUSION : UNE POSITION ACTUELLE DE L’UNION TRÈS RÉSERVÉE, L’« ENGAGEMENT SÉLECTIF » VIS-À-VIS DE LA RUSSIE
Réunis le 14 mars 2016 en Conseil de l’Union européenne, les ministres des affaires étrangères des États membres ont trouvé un consensus sur cinq principes directeurs de leur politique vis-à-vis de la Russie :
– la mise en œuvre des accords de Minsk comme condition clef pour tout changement substantiel dans la position de l’Union à l’égard de la Russie ;
– le renforcement des relations avec les partenaires orientaux de l’Union et autres voisins, en particulier en Asie centrale ;
– le renforcement de la résilience de l’Union, par exemple en matière de sécurité énergétique, de menaces hybrides ou de communication stratégique ;
– la nécessité d’avoir un « engagement sélectif » avec la Russie sur des questions comme l’Iran, le processus de paix au Proche-Orient, la Syrie, dès lors qu’il y a un « intérêt européen » ;
– enfin, la nécessité d’intensifier les contacts et de soutenir la société civile russe.
Le soutien apporté par l’Union à la mise en œuvre des accords de Minsk, élément central, doit être salué. Mais les autres principes directeurs mis en avant s’inscrivent clairement dans une démarche de défiance forte vis-à-vis de la Russie, notamment l’appel au renforcement des liens avec les partenaires orientaux de l’Union, en particulier en Asie centrale, qui risque d’être vu en Russie comme une volonté d’encerclement. Quant à la notion d’« engagement sélectif », il s’agit vraiment d’un ralliement minimal à une réalité internationale : sur certains dossiers, la Russie est un partenaire incontournable.
Or, il se trouve que certains de ces dossiers – on pense à la paix en Syrie et au tarissement du flot de réfugiés syriens qui devrait en résulter – apparaissent aujourd’hui vitaux pour l’Union européenne. Celle-ci a-t-elle vraiment les moyens d’une politique si peu allante concernant la Russie ?
La délégation de la misson qui s’est rendue à Moscou fin mars 2016 a pu recueillir l’opinion d’officiels russes sur ces cinq principes de l’Union européenne : l’un d’entre eux n’a pas caché sa déception, observant que quatre de ces principes étaient négatifs pour la Russie et un seul à moitié positif, celui de l’« engagement sélectif ». Encore, sur ce point, s’est-il demandé pourquoi la Russie devrait accepter de coopérer avec l’Union européenne sur les seuls dossiers internationaux intéressant celle-ci quand les autres dossiers resteraient bloqués : un bon dialogue ne peut être que global.
II. VALORISER LES BONNES RELATIONS DE LA FRANCE AVEC LES DEUX PAYS
La France entretient des relations politiques et économiques de bon niveau aussi bien avec la Russie que l’Ukraine. Si les difficultés économiques et, dans le cas de la Russie, les politiques de sanctions ont plutôt réduit les échanges économiques dans la période la plus récente, les contacts politiques se sont en revanche multipliés du fait du rôle de médiation adopté par la France dans le conflit du Donbass, dans le cadre du « processus de Minsk ».
Ces bonnes relations avec l’Ukraine comme avec la Russie donnent sans doute à la France des opportunités pour jour un rôle positif, non seulement dans le règlement de la crise du Donbass, mais aussi en vue d’un apaisement des tensions entre l’Union européenne et la Russie.
A. LA FRANCE ET L’UKRAINE : UNE RELATION RANIMÉE PAR L’ENGAGEMENT RÉSOLU DE NOTRE PAYS DANS LA RÉSOLUTION DU CONFLIT DU DONBASS
1. Des relations politiques devenues très étroites
Depuis l’établissement de relations diplomatiques en décembre 1991, la France et l’Ukraine ont conclu plus de quarante accords et traités notamment dans les domaines des investissements et du transport aérien (1994), de la coopération culturelle (1995), de la défense et de l’armement (1996). Les relations entre les deux pays sont encadrées, depuis 2005, par des feuilles de route bisannuelles. La France est également très présente dans les projets de jumelage financés par l’Union européenne (transport multimodal, développement des services sociaux, police, espace, sécurité routière, administration, gestion de l’eau, gestion de la dette).
Mais la relation bilatérale a surtout pris un nouveau rythme avec l’élaboration du « format Normandie » de négociation sur le conflit du Donbass : ce dispositif doit son nom au fait qu’il a été lancé à l’occasion des cérémonies du 70ème anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, auxquelles prenaient part, outre le Président de la République française et la Chancelière fédérale allemande, les présidents Porochenko et Poutine, ce qui a permis une rencontre au sommet au château de Bénouville.
Depuis lors, les présidents français et ukrainien se sont rencontrés fréquemment (sans compter de nombreux entretiens téléphoniques) : en marge du sommet de l’OTAN à Newport (Pays de Galles) le 4 septembre 2014 ; à l’occasion de la Marche républicaine organisée à Paris le 11 janvier 2015 après les attentats terroristes des 7-9 janvier ; pour la négociation des accords de « Minsk 2 » en février 2015 ; le 22 avril 2015 à l’occasion de la visite du président ukrainien à Paris ; à nouveau à Paris le 2 octobre 2015 lors d’un nouveau sommet en « format Normandie » ; le 17 mars 2016 à Bruxelles, lors d’une rencontre à laquelle a également pris part la chancelière fédérale allemande ; enfin, le 21 juin à nouveau à Paris.
S’y ajoutent naturellement des contacts multiples aux niveaux ministériel et administratif.
Enfin, les contacts sont également fréquents au niveau parlementaire. S’agissant en particulier de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, la présidente Élisabeth Guigou s’est rendue à Kiev en novembre 2015, puis avril 2016, tandis qu’une délégation de la présente mission y avait séjourné en mai 2015. Par ailleurs, la commission a reçu, depuis un an, plusieurs personnalités ukrainiennes : une délégation de la Rada en juin 2015, puis le ministre des affaires étrangères, M. Pavlo Klimkine, en mai 2016. Elle a aussi auditionné à plusieurs occasions nos diplomates compétents, tels que Mme Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères et du développement international, S. E. Isabelle Dumont, ambassadrice en Ukraine, S. E. Pierre Morel, animateur du groupe de travail sur les questions politiques dans le cadre des accords de Minsk.
2. Une coopération militaire limitée par la position politique de la France
Il faut toutefois noter que la coopération bilatérale reste limitée dans le domaine militaire, car la France a fait le choix d’écarter toute livraison de matériel létal (armes), alors que d’autres pays occidentaux sont beaucoup plus avancés dans la coopération militaire avec l’Ukraine.
Pour le moment, notre pays a livré en 2014 un millier de gilets pare-balles et des matériels sanitaires. Quelques contrats limités ont par ailleurs été signés par l’Ukraine avec des industriels français de l’armement (pour un total de quelques dizaines de millions d’euros).
3. Des échanges économiques assez modestes
Les échanges commerciaux franco-ukrainiens sont relativement limités : nos exportations vers ce pays ont atteint en 2014 un montant de 773 millions d’euros et nos importations depuis l’Ukraine 530 millions, dégageant donc un excédent bilatéral de 243 millions d’euros pour la France. Du fait de la crise actuelle, ces flux ont fortement baissé par rapport à 2013 : – 18 %.
En 2015, d’après les premiers chiffres disponibles, nos exportations vers l’Ukraine auraient fortement diminué, tombant à 584 millions d’euros, tandis que nos importations depuis ce pays s’élevaient à 556 millions d’euros. C’est donc à une nouvelle baisse de 24 % de nos ventes en Ukraine que l’on aurait assisté, dans le contexte de grave récession économique touchant ce pays.
Pour l’Ukraine, la France est un partenaire commercial significatif, mais pas dominant : notre part de marché dans les importations ukrainiennes totales était en 2014 de 2,3 %, ce qui faisait de la France le 9ème fournisseur de l’Ukraine et le 5ème parmi les membres de l’Union européenne après l’Allemagne (9,9 % de part du marché ukrainien), la Pologne, la Hongrie et l’Italie.
Du point de vue français, le commerce avec l’Ukraine est relativement marginal, puisqu’il représentait 0,13 % de nos exportations et 0,11 % de nos importations totales en 2015.
Les flux commerciaux franco-ukrainiens représentent un montant dix fois moins important que les flux franco-russes (1,1 milliard d’euros contre 11 milliards en 2015).
En 2014, les importations françaises depuis l’Ukraine ont été constituées à 68 % de produits agricoles ou agro-alimentaires. Les exportations françaises sont représentatives des points forts du commerce extérieur français : produits chimiques, cosmétiques et parfums (28 % du total de ces exportations en 2014), pharmacie (13 %), équipements mécaniques et électriques (18 %)…
La France est le 8ème investisseur étranger en Ukraine, avec 3,4 % du stock d’investissements directs étrangers (IDE) dans ce pays et plus de 160 entreprises françaises présentes. Cependant, avec un stock d’IDE français en Ukraine évalué à un peu plus de 700 millions d’euros, ce pays pèse moins de 0,1 % du total mondial des IDE français. Les IDE français en Russie pèsent quinze ou vingt fois plus lourd.
Au 31 décembre 2014, la communauté ukrainienne résidant régulièrement en France (détenteurs de titres de séjours valides) était proche de 11 000 personnes.
Le nombre des étudiants ukrainiens inscrits dans le système universitaire français était de 1 320 pour l’année scolaire 2013-2014. 450 visas pour études ont été délivrés à de jeunes Ukrainiens en 2014 et environ quarante bourses universitaires sont financées annuellement par l’ambassade.
L’Ukraine ne semble pas être un pays à risque migratoire élevé. Le taux de refus des demandes de visas par le service consulaire français est faible (1,5 % en 2014) et le nombre d’obligations de quitter le territoire national notifiées à des ressortissants ukrainiens est limité : entre 400 et 500 par an entre 2012 et 2014.
La communauté française enregistrée en Ukraine compte un peu plus de 900 personnes.
Le réseau culturel français est bien implanté en Ukraine :
– le lycée français Anne de Kiev scolarise 375 élèves de la maternelle à la terminale. Il existe également une école française privée labellisée à Kiev, qui scolarise essentiellement des enfants ukrainiens, et une autre à Odessa ;
– il existe un réseau de dix Alliances françaises (dont deux, celles de Donetsk et Louhansk, actuellement mises en sommeil à cause du conflit).
Le festival annuel Printemps français propose une programmation importante et attire un public nombreux : 30 000 personnes en 2015 au spectacle d’ouverture donnée sur la place Sainte-Sophie de Kiev.
B. LA FRANCE ET LA RUSSIE : UNE AMITIÉ CONSERVÉE MALGRÉ LES DIFFICULTÉS
L’amitié entre la France et la Russie est ancienne. Les échanges humains et culturels sont intenses depuis plus de deux siècles et deux guerres mondiales ont forgé une solidarité du sang versé. À partir des années 1960, la politique d’indépendance du général De Gaulle par rapport aux États-Unis a permis le développement d’une relation spécifique avec l’URSS, bien que les espoirs peut-être entretenus par celle-ci de détacher la France du « bloc occidental » aient été illusoires. Ensuite, au moment de la réunification allemande et de la fin de l’URSS, le président François Mitterrand a fait preuve d’une compréhension particulière pour les difficultés de la Russie et a défendu sur la « grande Europe » des idées assez proches de celles de M. Mikhaïl Gorbatchev (il évoquait une « confédération européenne » étendue à la Russie, proposition compatible avec le concept gorbatchévien de « maison commune européenne »).
La crise politique consécutive à l’annexion de la Crimée et aux événements du Donbass a eu sur les relations politiques bilatérales deux effets contradictoires : d’un côté, elle les a évidemment rendues plus difficiles, tandis que l’application des sanctions diplomatiques décidées par l’Union européenne conduisait à suspendre certaines formes d’échanges institutionnels ; mais la crise ukrainienne, avec l’implication française dans le « processus de Minsk », et, plus généralement, l’aggravation des crises internationales (Syrie, terrorisme…) ont aussi entraîné une multiplication des contacts au plus haut niveau.
Quant aux échanges économiques, ils sont tributaires de la situation économique des deux partenaires et de la politique des sanctions.
1. Le maintien des relations politiques
Les présidents François Hollande et Vladimir Poutine se sont rencontrés pour la première fois à Paris le 1er juin 2012, puis à nouveau à Moscou le 28 février 2013. La crise ukrainienne a ensuite multiplié leurs rencontres. La venue en France du président russe les 5 et 6 juin 2014 à l’occasion des commémorations du Débarquement a permis l’établissement du « format Normandie » pour la résolution de la crise ukrainienne. Les deux chefs d’État se sont ensuite entretenus le 6 décembre 2014 à Moscou, puis en février 2015 pour les accords de « Minsk 2 » et le 2 octobre 2015 lors du sommet de Paris en « format Normandie ». Enfin, le président français s’est rendu à Moscou le 26 novembre 2015 suite aux attentats du 13 novembre, tandis que le président russe prenait part le 30 novembre à la COP21. La lutte contre le terrorisme et celle contre le réchauffement climatique, intérêts communs majeurs, se sont ainsi ajoutées aux autres dossiers internationaux justifiant des échanges de haut niveau. Comme le relevait devant la commission des affaires étrangères notre ambassadeur à Moscou, « les présidents Poutine et Hollande se sont parlé en bilatéral vingt-quatre fois au cours de l’année 2015, directement ou par téléphone – je ne pense pas que beaucoup de chefs d’État se soient parlé aussi souvent en un an » (91).
Au niveau gouvernemental, la relation bilatérale est en principe structurée chaque année depuis dix-huit ans, au niveau des premiers ministres, par le Séminaire intergouvernemental franco-russe ; cependant, les sanctions diplomatiques appliquées par les États membres de l’Union européenne depuis début 2014 ont conduit à suspendre ces rendez-vous annuels. Pour autant, cela n’a pas empêché les premiers ministres des deux pays d’échanger à d’autres occasions ; MM. Manuel Valls et Dmitri Medvedev ont ainsi eu un entretien le 13 février 2016 en marge de la conférence sur la sécurité de Munich.
De même, le Conseil de coopération pour les questions de sécurité, qui réunit de part et d’autre les ministres des affaires étrangères et de la défense, ne s’est pas réuni depuis octobre 2012. Cependant, la coopération des diplomaties est restée régulière dans les enceintes internationales et les formats de discussion particuliers (membres permanents du Conseil de sécurité des Nations-Unies, format dit « E3 + 3 » ou « P5 + 1 » de négociation avec l’Iran sur son programme nucléaire…).
Dans le domaine économique, l’instance de dialogue intergouvernemental est le Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe (CEFIC). Alors que sa dernière session avait en lieu en septembre 2013 à Paris, le CEFIC s’est à nouveau réuni en janvier 2016, à Moscou, en présence notamment du ministre de l’économie Emmanuel Macron. Plus généralement, les derniers mois ont été marqués par une reprise des visites ministérielles bilatérales (en septembre 2015, celle du ministre russe du développement économique, M. Alexeï Oulioukaïev, à Paris ; en octobre, celles à Moscou de M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, puis de Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement ; en décembre, celle à Moscou du ministre de la défense Jean-Yves Le Drian, sans omettre la participation à la COP21 du ministre russe de l’environnement, M. Donskoy ; en mai 2016, celle à Moscou de M. Matthias Fekl, secrétaire d’État au commerce extérieur ; enfin, le même mois, la nouvelle visite de Mme Ségolène Royal dans le cadre des suites de l’accord de Paris sur le climat).
S’agissant des relations interparlementaires, la dernière Grande commission franco-russe s’est tenue à Paris en février 2013, mais les visites de parlementaires français en Russie sont ensuite restées nombreuses. Le président du Sénat, M. Gérard Larcher, s’est ainsi rendu à Moscou en avril 2016, quelques jours après une délégation de la présente mission.
Outre ce déplacement de membres de la mission, la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a également maintenu le contact avec la partie russe en recevant, durant ces derniers mois, M. Alexeï Pouchkov, président de la commission des affaires étrangères de la Douma, et l’ambassadeur de Russie S. E. Alexandre Orlov. Elle s’est également informée en auditionnant plusieurs de nos diplomates experts du pays : Mme Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères et du développement international, S. E. Jean-Maurice Ripert, ambassadeur à Moscou, ou encore S. E. Pierre Morel, animateur du groupe de travail sur les questions politiques dans le cadre des accords de Minsk.
Dans des domaines plus spécialisés, les échanges entre acteurs institutionnels, administratifs et universitaires restent intenses et de nombreuses rencontres ou colloques ont encore été organisés en 2014 et 2015 sur des thématiques aussi diverses que la santé, l’agriculture, les transports ferroviaires, le tourisme, le droit administratif, la recherche scientifique…
2. Des échanges commerciaux en baisse du fait des difficultés économiques de la Russie et des sanctions
Les échanges commerciaux bilatéraux sont importants, bien que les deux pays ne soient pas l’un pour l’autre des partenaires vitaux. Ces échanges ont toutefois été très fortement impactés par la baisse du cours des hydrocarbures, les sanctions et la récession russe.
a. France et Russie sont l’une pour l’autre des partenaires commerciaux moyennement importants
Que l’on se place du point de vue français ou du point de vue russe, les relations commerciales bilatérales sont significatives, mais sans doute pas essentielles.
● Du point de vue russe, on constate que la France n’a été, en 2015, que le 7ème pays fournisseur des importations du pays. Avec 3,2 % de part de marché, notre pays n’était que le 3ème fournisseur européen de la Russie derrière l’Allemagne (11,2 % de part de marché) et l’Italie (4,6 %). La part de marché française en Russie tend à se réduire depuis quelques années : elle a atteint son niveau maximal en 2009, à un peu plus de 5 %.
Évolution des parts de marché en Russie des principales puissances économiques
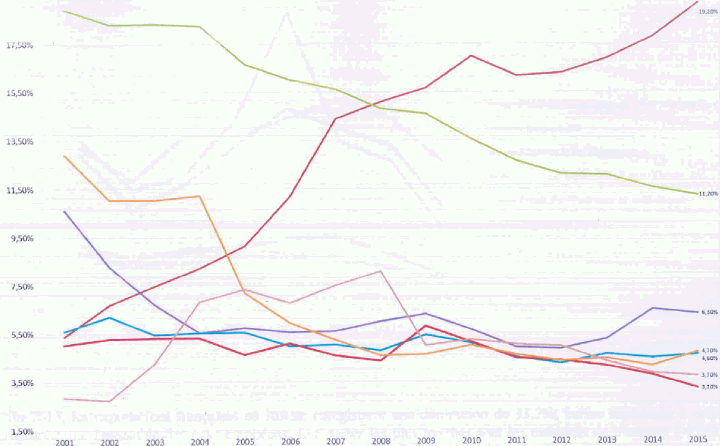
![]()
Source : service économique régional de Moscou, d’après les données des douanes russes.
Pour ce qui est, dans l’autre sens, des flux d’exportations de la Russie, la France apparaît comme un client relativement secondaire du pays : elle n’a en 2015 occupé que le 17ème rang parmi les destinations de ces exportations et n’en a absorbé que 1,7 %.
● Du point de vue français, la Russie est un partenaire commercial relativement important, mais dont l’importance décline. En effet, son poids relatif dans le commerce extérieur français est en fort recul actuellement, compte tenu de la baisse du commerce bilatéral (voir infra) :
– entre 2014 et 2015, le poids de la Russie dans les exportations françaises est tombé de 1,6 % à 1 % et elle a chuté du 12ème au 18ème rang de nos marchés à l’export. Alors que, traditionnellement, la Russie était le 3ème marché de la France à l’export hors Union européenne et Suisse, derrière les États-Unis et la Chine, elle a régressé en 2015 au 9ème rang à cet égard : outre les États-Unis et la Chine, la Turquie, le Japon, l’Algérie, Singapour, la Corée du Sud et le Brésil ont absorbé l’année dernière plus d’exportations françaises que la Russie ;
– le poids de la Russie a également diminué dans les importations françaises, passant de 2,1 % à 1,3 % de 2014 à 2015, de sorte qu’elle a été rétrogradée du 10ème au 13ème rang parmi nos fournisseurs.
b. Des exportations françaises diversifiées et souvent à fort contenu technologique
Les exportations françaises vers la Russie sont concentrées dans le segment des produits de haute et moyenne technologie, ceux-ci représentant un peu plus des deux tiers des exportations françaises à destination de ce pays. La France est l’un des pays dont la part de ces biens dans le total des exportations vers la Russie est la plus forte (71 %), après le Japon (87 %), d’après les données de 2014.
Ces exportations sont diversifiées, avec une prédominance des biens d’équipement : machines, matériel électrique, électronique et informatique, engins de transport. Les produits chimiques, parfums, cosmétiques et produits pharmaceutiques, autres points forts de l’offre française, sont également très présents.
La France occupe de solides positions dans le segment des produits de haute technologie tels que le matériel aéronautique et spatial (avec 45 % de part du marché russe à l’import) et les produits pharmaceutiques (avec 9,6 % de part du marché russe à l’import).
c. Des exportations russes dominées par les hydrocarbures
Les produits énergétiques sont très fortement prédominants dans les ventes russes à la France (83 % du total en 2014).
Cependant, du point de vue français, la dépendance par rapport aux produits énergétiques russes est limitée, car nous avons d’autres gros fournisseurs traditionnels :
– en 2014, la Russie a fourni 9,8 % de nos importations de pétrole brut (92), ce qui en faisait seulement notre 4ème fournisseur (derrière l’Arabie Saoudite, le Kazakhstan et le Nigeria) ;
– pour le gaz, d’après la même source, la Russie a été en 2014 notre second fournisseur, avec une part de marché de 12 %, loin derrière la Norvège (38,1 % de part de marché) ;
– la Russie a enfin été, toujours en 2014, le 3ème pays d’origine du charbon importé en France, derrière l’Australie et l’Afrique du Sud, avec 19,2 % de part de marché.
d. Des échanges commerciaux en forte diminution
i. Des échanges pratiquement divisés par deux en trois ans
Ainsi que le montre le tableau ci-après, les échanges commerciaux franco-russes ne cessent de reculer depuis 2012. En trois ans, de 2012 à 2015, leur montant total a été réduit de près de moitié, passant de 21 milliards d’euros à 11 milliards. La baisse a été particulièrement notoire entre 2014 et 2015 : ces échanges ont reculé de 6 milliards, soit 35 %.
Cet effondrement affecte aussi bien les exportations que les importations. De la sorte, notre commerce bilatéral avec la Russie reste déficitaire comme il l’est structurellement sur le moyen terme, comme on le voit sur le graphique ci-après. Toutefois, en 2015, le déficit bilatéral s’est fortement réduit pour atteindre, à 2 milliards d’euros, un niveau exceptionnellement faible.
Évolution des échanges commerciaux (biens) avec la Russie depuis 2012
(en milliards d’euros)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Exportations vers la Russie |
9,12 |
7,68 |
6,75 |
4,51 |
Évolution par rapport à l’année précédente |
- 15,7 % |
- 12,1 % |
- 33,2 % | |
Importations depuis la Russie |
11,95 |
10,58 |
10,25 |
6,51 |
Évolution par rapport à l’année précédente |
- 11,5 % |
- 3,1 % |
- 36,5 % | |
Total des échanges |
21,07 |
18,26 |
17 |
11,02 |
Évolution par rapport à l’année précédente |
- 13,3 % |
- 6,9 % |
- 35,2 % | |
Solde bilatéral |
- 2,83 |
- 2,9 |
- 3,5 |
- 2 |
Source : ministère des finances, « Le chiffre du commerce extérieur », http://lekiosque.finances.gouv.fr (chiffres des douanes françaises).
Évolution des échanges commerciaux (biens) avec la Russie sur le moyen terme
(en milliards d’euros)
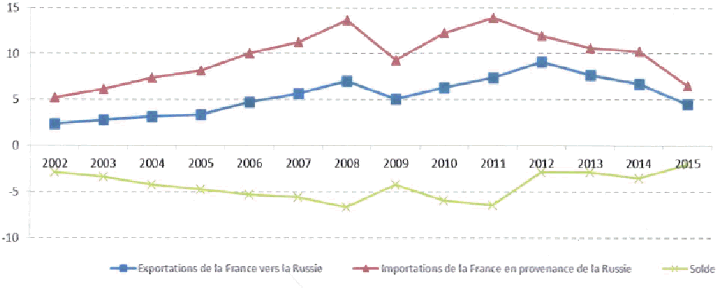
Source : service économique régional, Moscou.
ii. Quel impact de l’embargo agro-alimentaire russe ?
Jusqu’en 2013 les exportations françaises de produis agricoles et agro-alimentaires vers la Russie représentaient annuellement entre 750 millions d’euros (selon les douanes françaises) et 1,1 milliard d’euros (selon les douanes russes), écart dû à des différences méthodologiques, mais aussi au fait que de nombreux produits agro-alimentaires transitent par d’autres pays, de sorte que les douanes françaises ne connaissent pas leur destination finale.
Selon les douanes russes, la France était en 2013 le premier fournisseur de vins et spiritueux de la Russie, avec 21,7 % de part de marché à l’import.
D’après les chiffres des douanes françaises, les ventes françaises de produits agro-alimentaires en Russie ont diminué en 2014 de 23 % par rapport à 2013, alors que, dans leur globalité, les exportations françaises ne diminuaient que de 12 %. Il s’agit vraisemblablement d’un effet de l’embargo russe décidé en août 2014 sur un grand nombre de produits agro-alimentaires européens (viandes, produits de la pêche, produits laitiers, fruits, légumes et certains produits préparés). Des données américaines (93) confirment le constat : les exportations françaises de produits sous embargo russe auraient chuté de 42 % entre 2013 et 2014 (au niveau de l’Union européenne, on serait à 37 % de chute).
La diminution des flux de produits agro-alimentaires entre 2013 et 2014, de l’ordre de 170 millions d’euros, n’explique pourtant qu’une petite partie de la baisse des exportations globales de la France vers la Russie, qui a excédé un milliard d’euros sur la même période. L’embargo en lui-même n’est donc pas la cause principale du recul des ventes françaises en Russie, l’agro-alimentaire représentant moins de 9 % de celles-ci. En année pleine, les pertes de marché résultant directement de l’embargo russe devraient être de l’ordre de 300 millions d’euros, mais leur impact réel est plus difficile à estimer car les produits en cause ont pu être exportés vers d’autres destinations (certainement à des prix inférieurs, mais il ne s’agit pas d’une perte sèche) ou transformés (notamment en ce qui concerne les fruits et légumes, dont le surplus est recyclé en jus, conserves et confitures). De nouveaux marchés ont en effet permis de placer une partie de ce que nous vendions en Russie, par exemple en Chine pour le porc, au Danemark pour le bœuf, en Chine, Serbie et Géorgie pour la volaille, dans une quinzaine de pays pour les produits laitiers… Par ailleurs, dans l’autre sens, il faudrait mesurer effectivement les effets globaux sur les cours mondiaux et sur nos importations, car des produits provenant d’autres producteurs européens également coupés du marché russe sont désormais déversés sur notre marché ou concurrencent nos produits sur des marchés tiers.
iii. Quel impact des autres sanctions ?
La diminution en valeur des importations françaises depuis la Russie s’explique assez facilement par la baisse du prix des hydrocarbures qui en constituent la plus grande part.
Celle des exportations françaises vers la Russie ne tient qu’en relativement faible part, on l’a vu, aux effets directs de l’embargo agro-alimentaire russe. Pour le reste, elle est bien sûr corrélée aux grandes difficultés économiques que traverse la Russie.
Quelle est la part des sanctions décidées par l’Union européenne dans cette baisse des flux commerciaux ? Elle n’est pas mesurée et ne peut qu’être vaguement estimée par des calculs économétriques, mais elle est certainement significative, ce par plusieurs canaux :
– par effet direct, du fait de la prohibition de certaines exportations européennes vers la Russie (armements, biens à double usage, certains équipements pétroliers). Il n’est pas besoin de rappeler l’abandon du contrat sur les navires Mistral (bien que ce contrat antérieur aux sanctions européennes ne soit pas tombé formellement sous leur coup), évoqué supra, non plus que les positions de certains de nos grands industriels dans diverses technologies « duales ». Dans le domaine pétrolier, Total, qui avait créé en mai 2014 une co-entreprise avec Loukoil pour exploiter du « pétrole de schiste » (gisement de Bazhenov en Sibérie occidentale), s’en est retiré un an plus tard, ce secteur économique étant directement sous embargo ;
– du fait des problèmes de financement rencontrés par les entreprises russes suite à l’embargo financier partiel des pays occidentaux, voire rencontrés par les entreprises françaises confrontées à des banquiers « frileux » – la question a notamment été évoquée à propos du projet d’exploitation gazière et de liquéfaction de gaz de Yamal LNG, où Total a une participation de 20 % (il semble finalement que les capitaux manquants seraient principalement apportés par des banques chinoises), ou encore s’agissant de ventes d’Airbus ;
– plus indirectement, du fait de la perte de confiance générale dans l’économie russe et, dans l’autre sens, des réactions patriotiques en Russie contre les achats de biens européens et de la volonté de « russiser » l’économie, qui se manifeste notamment dans l’attribution des marchés publics ;
– enfin, du fait même de la contribution des sanctions à la récession en Russie, laquelle déprime les importations du pays.
On constate qu’entre 2014 et 2015, les importations russes ont un peu plus diminué, selon les chiffres des douanes russes, en provenance de l’Union européenne (– 40,8 %) et en particulier de la France (– 44,5 %) qu’en provenance des pays asiatiques (– 33,3 % pour les pays du Forum économique Asie-Pacifique, l’APEC) : il semble donc bien y avoir un certain effet global des sanctions (appliquées seulement sur cinq mois en 2014, contre une année pleine en 2015), mais il est certainement bien moins déterminant que celui de la crise économique russe, due d’abord à la baisse des cours des hydrocarbures.
3. Une forte implantation des entreprises françaises en Russie
a. La France, premier investisseur étranger en flux en Russie depuis 2014 ?
Fin 2013, d’après les estimations de la Banque de France, la Russie était en stock le 16ème pays de destination des investissements directs à l’étranger (IDE) des entreprises françaises et le 6ème pays hors Union européenne et Espace économique européen, après les États-Unis, le Brésil, le Japon, la Chine et le Canada. La valorisation des IDE français en Russie était alors estimée à 12,3 milliards d’euros : ce montant ne représente certes qu’une petite part – 1,2 % – du total des IDE français ; toutefois, il rend compte d’un certain tropisme des entreprises françaises pour la Russie si on compare leurs investissements dans ce pays avec ceux opérés dans d’autres économies émergentes, puisque les IDE français en Chine, évalués à la même date à 17,7 milliards d’euros, ne pesaient donc pas tellement plus lourd, bien que le PIB chinois soit neuf fois plus élevé que le PIB russe.
Les statistiques russes sur l’origine des IDE dans le pays sont assez concordantes avec les données de la Banque de France, puisqu’elles donnent un stock d’investissements français de l’ordre de 14 milliards de dollars début 2014. Toutefois, la valorisation de ces investissements a depuis lors été fortement revue à la baisse, dans un contexte général de sorties nettes d’IDE depuis la Russie et de baisse du rouble (qui réduit les valeurs exprimées en dollars). En octobre 2015, les IDE français en Russie ne représenteraient donc plus qu’une valeur de 10 milliards de dollars selon ces statistiques russes.
Il est à noter qu’en réalité la valorisation des investissements d’origine française est sans doute plus élevée, car ces statistiques ne recherchent pas l’origine finale véritable des investissements, d’où le poids des paradis fiscaux ou pays à fiscalité privilégiée qu’elles font apparaître (de Chypre, qui sert surtout à recycler en investissements « étrangers » des fonds russes, aux Bahamas et aux Bermudes en passant par les Pays-Bas ou le Luxembourg).
Parmi les grands pays développés, la France viendrait pour le niveau global de son stock d’IDE en Russie juste derrière l’Allemagne et devant le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, etc., cette hiérarchie étant toutefois à prendre avec prudence vu l’ampleur des IDE officiellement imputés à des paradis fiscaux.
Origine géographique et évolution récente des stocks d’IDE en Russie
(en milliards de dollars)
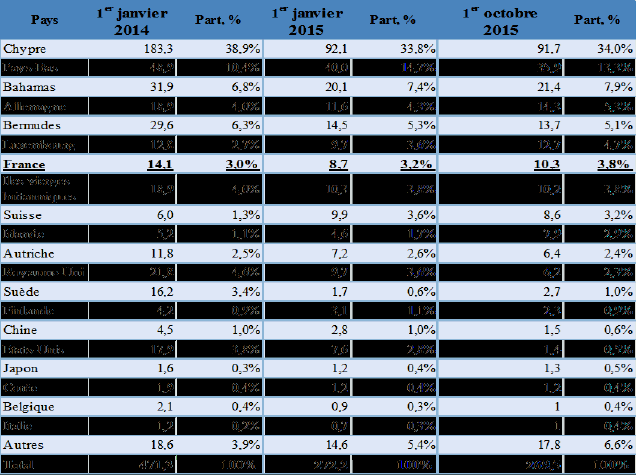
Source : service économique régional, Moscou, reprenant des données de la Banque centrale de Russie.
Ce qu’il est également intéressant de relever, c’est que la présence relative de nos investisseurs s’est renforcée depuis début 2014 : leur part relative en stock dans le total des IDE en Russie serait passée de 3 % à 3,8 % de janvier 2014 à octobre 2015. Effectivement, si l’on analyse non plus les stocks d’IDE, mais les flux, on voit que la France serait devenue en 2014 et 2015 (sur trois trimestres) le premier pays pourvoyeur (hors « paradis fiscaux ») d’IDE en Russie : les flux nets d’IDE français en Russie se sont maintenus à un niveau élevé (plus de 2 milliards de dollars en 2013, puis 2014 ; 1,2 milliard sur trois trimestres en 2015), quand ceux en provenance des autres grands pays s’effondraient, de sorte que la France est clairement devenue, en termes de flux, le premier investisseur en Russie.
Pour le moment et à la différence de celles d’autres pays, les entreprises françaises ne semblent donc globalement pas avoir considéré que les difficultés économiques de la Russie et celles liées aux sanctions économiques justifiaient de se retirer de ce pays.
b. Une présence française très diversifiée
On comptait en 2013 environ 550 filiales d’entreprises françaises en Russie, y employant quelques 166 000 salariés et y réalisant environ 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les entreprises françaises sont présentes dans de très nombreux secteurs de l’économie russe.
● Dans le secteur de l’énergie, les principaux groupes français possèdent d’importants intérêts industriels en Russie.
Total s’est partiellement désengagé du champ pétrolifère de Khariaga, mais y conserve une participation de 20 %. Le groupe détient aussi 17 % du producteur gazier Novatek, ainsi qu’une participation de 20 % dans le projet de liquéfaction gazière Yamal LNG, mené par Novatek. Enfin, Total détient 25 % du consortium créé pour le développement du champ gazier offshore de Shtokman, au côté de Gazprom, projet mis actuellement en sommeil.
GDF-Suez, devenu Engie, a pris une participation de 9 % dans le gazoduc North Stream, dont le consortium est mené par Gazprom (avec une participation de 51 %) et comprend d’autres entreprises européennes, notamment allemandes. En septembre 2015, Engie a également décidé de prendre part au projet North Stream 2 de doublement du premier gazoduc. Selon le pacte d’actionnaires qui a été signé, Engie y aurait une participation de 9 % également, aux côtés de Gazprom (51 %) et de BASF, E.ON, OMV et Shell (10 % chacun).
En matière d’énergie nucléaire, Alstom est implanté en Russie depuis 2007 par le biais d’une joint-venture avec Atomenergomash destinée à produire des turbines pour les centrales nucléaires russes.
● Dans le secteur automobile, Renault possède une usine à Moscou (Renault Russie) d’une capacité proche de 190 000 véhicules par an et est actionnaire depuis 2008 du constructeur automobile russe historique AvtoVAZ (qui possède la marque Lada), avec une participation de 50 % depuis mi-2014. PSA a construit une usine d’une capacité de 125 000 véhicules par an dans la région de Kalouga en partenariat avec Mitsubishi. Les grands équipementiers s’installent également.
● Dans le secteur des transports, le groupe Safran a investi près d’un milliard d’euros en Russie depuis 2001 dans différents projets dans l’aéronautique. En 2010, Alstom a acquis 25 % du groupe russe TransMashHolding, principal fabricant de matériel ferroviaire en Russie. Une filiale de Vinci est concessionnaire du premier tronçon de l’autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg.
● Dans le domaine des équipements électriques, les sociétés françaises telles que Schneider Electric et Nexans ont renforcé leur présence en Russie ces dernières années. En 2013, Schneider Electric a ainsi acheté le groupe russe SamaraElectroShield, principal fournisseur d’équipements électriques et de moyens d’automatisme pour de nombreux secteurs de l’industrie russe.
● Dans le secteur des matériaux de construction, on peut citer LafargeHolcim et Saint-Gobain, qui possèdent des sites industriels en Russie.
● Cinq groupes pharmaceutiques français sont implantés en Russie : Sanofi-Aventis, Servier, Boiron, Ipsen et Pierre Fabre. Parmi eux, les groupes Sanofi-Aventis et Servier possèdent des sites de production sur place.
● Dans l’agro-alimentaire, on peut notamment citer Danone, qui a pris en 2010 une participation majoritaire dans Unimilk, pour 1,3 milliard d’euros, et contrôlerait ainsi plus du cinquième du marché russe des produits laitiers et une vingtaine d’usines. Lactalis, directement ou par le biais de Parmalat, possède également plusieurs usines. Bonduelle, Sucden, Soufflet, DIANA, Castel, Louis Dreyfus, Lesaffre, Cooperl, Roquette, SNF Floerger sont d’autres exemples d’entreprises françaises ayant investi en Russie, dans des activités très variées (sucre, malterie, silos, nourriture pour animaux de compagnie, etc. – plusieurs de ces entreprises ont également acquis des grandes superficies de terres agricoles).
● Dans la distribution, les groupes français Auchan, Decathlon, Castorama et Leroy Merlin sont bien implantés. Auchan est la 3ème enseigne de grande distribution en Russie et la première de nationalité étrangère.
● Dans divers autres secteurs, on relève aussi l’implantation en Russie d’Air Liquide, d’Accor, de l’Oréal, de Plastic Omnium…
● Enfin, dans le secteur financier, la Société Générale est l’une des banques étrangères les mieux implantées du pays grâce à sa filiale Rosbank. Celle-ci est la 9ème banque russe en termes de portefeuille de crédits (mi-2015) et la 2ème parmi les banques étrangères implantées en Russie. BNP Paribas, Crédit Agricole, CIB et Natixis sont aussi présents, sur des créneaux plus modestes et spécialisés. Les filiales assurantielles de nos grandes banques sont également implantées et Axa a acquis en 2008 une participation de 36,7 % dans Reso-Garantia (4ème compagnie d’assurance de Russie) pour un montant de 0,8 milliard d’euros.
c. Des banques françaises assez engagées vis-à-vis de la Russie
Par ailleurs, depuis 2009, le pays dont les banques sont globalement le plus engagées en Russie est la France. La part de marché française fluctue depuis lors, sans que l’on puisse noter une véritable tendance à la hausse ou à la baisse : les banques françaises, comme les autres, ont réduit leur exposition à la Russie depuis 2014, dans le contexte de la crise économique de ce pays et des sanctions internationales. Cette exposition des banques françaises, qui représentait de l’ordre de 50 milliards de dollars en 2013, a depuis lors été ramenée à environ 30 milliards. Les engagements de nos banques en Russie représentent 20 % à 25 % des engagements des banques internationales dans ce pays, alors que ceux des banques allemandes ont été drastiquement réduits (de 2005 à 2015, ils sont passés de plus de 30 % à moins de 10 % du total des engagements internationaux sur la Russie).
Évolution des engagements bancaires internationaux en Russie
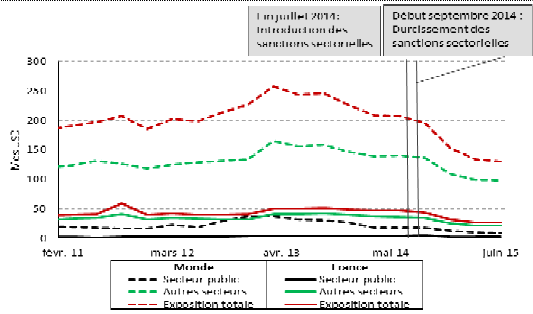
Source : service économique régional, Moscou.
d. Des investissements russes en France encore limités
Les investissements russes en France restent beaucoup plus limités. À la date du 31 décembre 2013, les IDE russes en France n’étaient évalués qu’à 1,5 milliard d’euros, soit 0,3 % seulement du stock d’IDE présents sur notre sol. Les 22 filiales d’entreprises russes implantées en France en 2012 y réalisaient environ 0,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’aide de 1 400 salariés. Le principal investissement russe réalisé depuis lors, qui continue à représenter au moins la moitié du stock d’investissements directs russes en France, est le rachat pour 800 millions d’euros, fin 2012, de 75 % des actions de l’entreprise de logistique GEFCO au groupe PSA par RJD (l’homologue russe de la SNCF).
Les investisseurs russes se plaignent parfois de ne pas être très bien accueillis en France et de s’y heurter notamment à de grandes réticences de la part des banques françaises (ce bien avant la crise ukrainienne et les sanctions financières consécutives).
Les échanges humains sont également considérables.
Le contexte de crise politique (assorti d’appels des autorités russes à privilégier le tourisme « national », notamment en Crimée) et sans doute surtout les difficultés économiques en Russie (baisse des revenus et chute du rouble) ont cependant entraîné une forte baisse des visites de Russes vers la France à partir de 2013.
Cette baisse est très visible dans les données relatives aux demandes de visa, même si l’évolution de celles-ci s’explique aussi par des facteurs techniques tels que l’exigence des données biométriques, le développement des visas de circulation permettant des entrées multiples (qui réduit le nombre de visas à délivrer à une même personne), ou encore la généralisation de l’externalisation de la gestion des visas chez nos partenaires Schengen (cette externalisation améliorant le service et les visas « Schengen » permettant d’entrer dans tout l’espace du même nom, les demandeurs privilégiaient les pays ayant les premiers introduit cette externalisation, dont à une époque la France).
Le nombre de demandes de visa déposées dans les consulats français en Russie a chuté de 26 % de 2013 à 2014, passant de 422 000 à 313 000. La Russie est ainsi passée du premier rang, dans le monde, pour la demande de visas français, au troisième (derrière la Chine et l’Algérie). En 2015, cette chute s’est encore accélérée, avec moins de 178 000 demandes de visa (soit une nouvelle baisse de 43 % par rapport à 2014) ; s’agissant des seuls visas touristiques, seuls 148 000 ont été délivrés en 2015, soit 45 % de moins que l’année précédente.
En 2015, un peu plus de 42 000 citoyens russes étaient régulièrement établis en France (titulaires d’un titre de séjour valide).
Durant l’année scolaire 2014-2015, les universités françaises accueillaient 3 867 étudiants russes, soit 1,8 % des étudiants étrangers présents dans leur sein, auxquels il faudrait ajouter plusieurs centaines de jeunes Russes présents dans d’autres formations supérieures non universitaires (IUT, « grandes écoles »…).
Les données sur la communauté d’origine russe en France sont beaucoup plus floues. L’immigration des « Russes blancs » après la Révolution d’octobre a concerné plusieurs centaines de milliers de personnes. L’influence sur leurs descendants est aujourd’hui un enjeu pour les autorités russes, comme le montrent les luttes d’influence qui se livrent pour le contrôle des lieux de culte. Celles-ci ont été illustrées par le procès fait et gagné par l’État russe (en appel en 2011 et en cassation en 2013) contre une association cultuelle locale pour récupérer la propriété et le contrôle de la cathédrale orthodoxe de Nice.
Dans l’autre sens, le nombre de Français installés en Russie n’est pas très élevé : fin 2015, ils étaient 5 755 à être inscrits sur les registres consulaires en Russie. Cette communauté est jeune (34 % de moins de 25 ans), majoritairement masculine (à 60 %) et active (55 % d’actifs) : les trois quarts de nos compatriotes sont des cadres expatriés, notamment pour des enseignes de la grande distribution.
On parle enfin d’au moins 12 000 couples mixtes franco-russes.
La francophonie est en déclin mais reste une réalité en Russie. Le nombre d’élèves apprenant le français a ainsi été divisé par trois de 1997 à 2013, tombant d’un million à 334 000, mais le français se maintient à la troisième place des langues étrangères enseignées derrière l’anglais et l’allemand (qui serait appris par environ quatre fois plus d’élèves que le français).
Il existe un réseau de 23 établissements bilingues, scolarisant 1 345 élèves, qui est, lui, en progression (11 établissements seulement en 2008). L’ambassade de France à Moscou a lancé en 2013 un travail d’harmonisation des sections bilingues, qui proposeront dès la rentrée 2016 un enseignement commun des disciplines non linguistiques (littérature, histoire, géographie et sciences économiques) intégrées dans les programmes scolaires russes en vigueur.
Deux établissements relèvent de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) :
– le lycée Alexandre-Dumas de Moscou connaît une expansion régulière et a vu ses effectifs tripler entre 2000 et 2015, passant de 415 à 1 303 élèves (dont moins de 60 % de Français et 26 % de Russes). Il a un potentiel de développement important auprès des élites russes, très demandeuses d’enseignement étranger, mais est limité dans ses projets d’expansion par son manque chronique d’espace. La partie russe a mis à disposition du lycée français un bâtiment scolaire pouvant accueillir plus de 400 élèves et a octroyé une parcelle de terrain supplémentaire juxtaposé au site principal sur laquelle pourront être lancés les travaux d’extension en 2016-2017 ;
– l’école primaire française André-Malraux de Saint-Pétersbourg, créée en 2002, est devenue une annexe du lycée français de Moscou en 2007. Entre 2009 et 2014, l’école a rencontré des problèmes immobiliers qui lui ont fait perdre une grande partie de ses effectifs (116 élèves en 2008, 55 en 2013). Une solution immobilière pérenne a été trouvée en 2014, mais le faible effectif met en danger la viabilité de l’établissement.
2016 sera l’année franco-russe du tourisme culturel, qui a été lancée à Moscou le 5 avril au cours d’un concert au Bolchoï de l’orchestre du Capitole de Toulouse. La veille s’était tenue la 4e session de la Commission culturelle franco-russe, qui ne s’était pas réunie depuis 2007. Cet automne, la fondation Louis Vuitton devrait présenter à Paris une prestigieuse exposition des pièces majeures de la « collection Chtchoukine » (Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Matisse...), actuellement partagée entre le musée Pouchkine à Moscou et celui de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
La question des relations avec la Russie est souvent traitée avec un excès de passion. La Russie contemporaine n’est pas un avatar de l’ancienne URSS qui serait tout aussi menaçant qu’elle l’était, comme certaines déclarations le laissent parfois penser, mais n’a pas non plus vocation, du moins à court terme, à devenir un allié privilégié qui pourrait se substituer à nos vieux alliés et partenaires traditionnels, comme certains partisans de l’actuel président russe semblent le souhaiter. La Russie est un grand pays, qui a gagné sa position internationale actuelle (la puissance nucléaire, le siège permanent au Conseil de sécurité…) suite aux sacrifices énormes consentis par son peuple durant la Seconde guerre mondiale ; c’est aussi un pays avec laquelle il existe en France une vieille tradition d’amitié. Mais la Russie n’est plus la superpuissance qu’elle a été et a peu de chance de le redevenir, quels que soient la volonté de ses dirigeants actuels et le retour au premier plan, notamment sur le plan militaire, que l’on constate suite à l’éclipse des années 1990 : son économie n’est pas assez puissante, ni surtout assez diversifiée et dynamique ; sa capacité d’influence et d’attraction, son soft power, restent relativement limités ; dans le système international, elle est un acteur incontournable, mais finalement assez isolé, dont les vrais alliés (anciens et fidèles) se comptent sur les doigts d’une main et ne sont ni puissants, ni toujours très « recommandables ».
Par ailleurs, la politique menée par la Russie à l’encontre de l’unité de l’Ukraine à partir de février 2014 n’est pas acceptable. L’annexion unilatérale de la Crimée constitue une violation très grave, sans précédent en Europe depuis 1945, des règles de base du droit international. Quant au conflit du Donbass, il n’a certes pas été déclenché par l’action des autorités russes, mais celles-ci lui ont permis de durer par leur soutien massif aux séparatistes et n’ont pas imposé, jusqu’à présent, un réel cessez-le-feu dont on peut pourtant penser qu’elles auraient les moyens.
La France et l’Union européenne ont l’obligation morale de soutenir le processus démocratique en Ukraine et l’unité de ce pays.
Mais la France et l’Union européenne ne peuvent pourtant pas ignorer la Russie.
Ce pour des raisons qui tiennent à la géographie et au temps long historique : la Russie est un pays européen, dont la partie européenne (la « Russie d’Europe » au sens géographique) est le plus vaste et le plus peuplé des pays du continent ; c’est aussi un pays extrêmement riche en sources d’énergie et en matières premières dont l’Union européenne est friande.
Ce aussi pour une raison plus « conjoncturelle », mais que l’on hésite à qualifier ainsi tant elle risque de structurer notre politique internationale pour des années, voire des décennies : la priorité à la lutte contre le djihadisme et le terrorisme à source islamiste, ainsi qu’à la stabilisation du Proche-et-Moyen-Orient et plus particulièrement des « États faillis » qui s’y trouvent (Syrie, Irak, Libye). Cette priorité s’impose aussi bien à la plupart des pays européens qu’à la Russie, dans les deux cas pour les mêmes raisons : la proximité géographique avec le Proche-et-Moyen-Orient et la présence de larges communautés d’origine musulmane dont le « contrôle » est un enjeu pour les extrémistes. Nous devons être conscients que d’autres puissances, à commencer par les États-Unis et la Chine, mais aussi le Japon ou la plupart des grands pays émergents asiatiques ou latino-américains, n’ont pas les mêmes raisons de donner une priorité absolue à ces questions. Le partenariat avec la Russie apparaît donc comme une nécessité dans ce domaine.
On ne peut donc pas se satisfaire de l’état de blocage des relations entre l’Union européenne et la Russie, dominées par la problématique des sanctions et la permanence de vieux litiges ou points d’irritation – la question des valeurs, l’application du droit européen de la concurrence à Gazprom, l’absence d’avancée sur la libéralisation des visas…
La Russie a conservé des relations plus cordiales avec un certain nombre d’États membres de l’Union européenne, dont la France, comme le démontre en particulier le règlement amiable obtenu assez aisément pour dénouer le contrat sur les navires Mistral. L’investissement de la France dans le processus de Minsk a, de plus, conduit à un resserrement des liens aussi bien avec la Russie qu’avec l’Ukraine. Notre pays pourrait donc agir pour sortir de la situation présente et faciliter la reprise de relations apaisées et partenariales avec la Russie, tout en continuant à œuvrer pour la résolution des conflits en cours.
Quelles sont les voies qui s’offrent ?
La pleine application des accords de Minsk est un premier point sur lequel votre rapporteur souhaite mettre l’accent.
On peut certes gloser sans fin sur les insuffisances du processus de Minsk et son blocage ; on peut juger « inacceptable », de part et d’autre, telle ou telle concession, alors même que la nature intrinsèque d’un compromis est d’en comporter. Mais il n’empêche que ce processus est certainement l’une des médiations extérieures les plus abouties dans un conflit de cette nature : rien de comparable n’a été mis en place dans les autres conflits « gelés » de l’ex-URSS (Transnistrie, régions séparatistes de Géorgie, Haut-Karabakh) ; dans l’ex-Yougoslavie, la paix est certes revenue, mais dans un contexte tout à fait différent où les États-Unis et leurs alliés européens s’étaient donné les moyens d’imposer leurs conditions, alors que, dans le processus de Minsk, la France, l’Allemagne et l’OSCE s’en tiennent à une mission de « bons offices ». Les résultats du processus de Minsk ont été obtenus grâce à une implication exceptionnelle, en France comme en Allemagne, des plus hauts responsables politiques et derrière eux des diplomates. Ils ont ensuite été en quelque sorte endossés par le reste de l’Union européenne, notamment lors du sommet des 19 et 20 mars 2015 où un lien explicite a été établi entre les sanctions européennes concernant la Russie et la mise en œuvre des engagements de Minsk.
Ce serait donc se déjuger que de renoncer à l’application des accords de Minsk. Et naturellement, s’agissant d’un compromis, les différentes parties doivent tenir tous leurs engagements : « tout Minsk, rien que Minsk ». Comme le rappelait lors de son audition par la commission des affaires étrangères le 30 mars 2016 notre ambassadeur à Moscou, S. E. Jean-Maurice Ripert, « les accords de Minsk sont non pas un "menu à options", mais un "menu à prix fixe", qui a été validé par toutes les parties au conflit, notamment par la Russie ».
Recommandation n° 1 : conserver la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk comme priorité de la politique française vis-à-vis de l’Ukraine et de la Russie.
La mise en œuvre des accords de Minsk nécessite des actes de bonne volonté de la part de la Russie comme de l’Ukraine.
La première ne peut pas continuer à prétendre qu’elle n’est en rien impliquée et aurait une position de médiatrice comparable à celle de la France et de l’Allemagne : la Russie a pris des engagements ; et il est évident qu’elle a une capacité d’influence « forte », pour ne pas dire plus, pour obtenir des dirigeants séparatistes du Donbass le respect effectif du cessez-le-feu – lequel, dans les accords de Minsk, est le préalable des développements politiques prévus. Ainsi que l’indiquait notre ambassadeur en Russie précité, « il est difficile de croire que [les Russes ne peuvent] pas imposer à MM. Alexandre Zakhartchenko et Igor Plotnitski, présidents auto-proclamés respectivement à Donetsk et à Lougansk, ce qu’ils ont été capables d’imposer en Syrie au président Bachar al-Assad [un cessez-le-feu effectif, du moins un certain temps] ». La diplomatie française peut légitimement plaider pour des initiatives, y compris unilatérales, de la Russie en matière sécuritaire dans le Donbass, car la Russie « a la main ».
Recommandation n° 2 : faire valoir, vis-à-vis de la partie russe, le geste positif que constituerait une initiative efficace, le cas échéant unilatérale, pour obtenir le respect effectif du cessez-le feu (et des autres engagements sécuritaires en matière de retrait des armes et de contrôle, donc d’accès de l’OSCE à toutes les zones).
Quant à l’Ukraine, elle doit évidemment tenir les engagements politiques qui ont été pris : définition d’un « statut spécial » du Donbass permanent et conforme aux textes signés, constitutionnalisation de ce statut, amnistie, organisation des élections locales après avoir débattu de la loi électorale aves les représentants des séparatistes…
Recommandation n° 3 : continuer à promouvoir, vis-à-vis de la partie ukrainienne, le respect de ses engagements politiques concernant le Donbass : constitutionnalisation du « statut spécial », amnistie, organisation des élections locales dans des conditions discutées avec les séparatistes.
Enfin, dans le contexte humanitaire désastreux créé par le conflit, il pourrait être opportun de pousser à une opération humanitaire internationale, dans un cadre à définir avec les différentes parties : ce serait aussi un moyen de plus impliquer la communauté internationale et ses organisations tout en restant dans un domaine, l’humanitaire, où cette implication est plus difficile à refuser par les parties au conflit que dans d’autres domaines.
Recommandation n° 4 : réfléchir aux voies et moyens d’une opération humanitaire dans le Donbass associant la communauté internationale, en accord avec les parties, et la promouvoir.
L’application intégrale des accords de Minsk peut impliquer l’exercice de pressions politiques sur l’Ukraine et sur la Russie.
S’agissant de la seconde, ces mécanismes incitatifs sont en place : il s’agit des sanctions de l’Union européenne et de ses partenaires. On y reviendra.
S’agissant de la première, plusieurs types de contreparties peuvent être envisagées selon la bonne volonté manifestée.
Il y a d’abord la question de la suppression réciproque des visas de court séjour Schengen, sur laquelle l’Union a pris vis-à-vis de l’Ukraine des engagements qui devraient être tenus prochainement.
Faut-il faire de la libéralisation des visas vis-à-vis des voisins de l’Union un instrument politique qui peut être intégré à un accord plus vaste – comme on le voit par exemple avec la Turquie ? Ou faut-il l’accepter dès lors que sont remplies les conditions « techniques » destinées à limiter les risques migratoires et sécuritaires (fiabilisation des procédures administratives, introduction de la biométrie…) ? Les deux thèses peuvent être soutenues : il est difficile pour l’Union européenne de ne pas faire de la libéralisation des visas un élément de compromis politiques plus larges, tant c’est une mesure dont ses partenaires sont « demandeurs » ; mais on peut aussi considérer que cette libéralisation, en facilitant la circulation des personnes vers l’Union, contribue intrinsèquement à la réalisation de l’idéal européen et au renforcement du soft power de l’Union, de sorte qu’elle doit être décidée sans contrepartie politique. En tout état de cause, il convient d’adopter des positions cohérentes pour les différents pays concernés.
Recommandation n° 5 : tenir, en matière de libéralisation des visas, les engagements pris vis-à-vis de l’Ukraine (et de la Géorgie), mais aussi relancer, dans la mesure du possible, les processus concernant les autres pays du voisinage oriental, notamment la Russie.
Les aides financières considérables qu’elle lui accorde constituent un autre outil d’influence de l’Union européenne sur l’Ukraine.
Le FMI, qui joue un rôle moteur en la matière, conditionne traditionnellement ses aides à des « réformes structurelles » et il le fait notamment en ce qui concerne l’Ukraine : la tranche d’aide qui devait être versée à l’automne 2015 a été longuement bloquée (elle pourrait être versée cet été) en raison de la crise politique du pays et de l’absence de progrès dans les réformes de gouvernance et dans la lutte contre la corruption, comme Mme Christine Lagarde, directrice générale du FMI, l’a explicitement déclaré.
L’Union européenne a souvent tendance à s’aligner sur les positions du FMI quand il s’agit de débloquer des soutiens financiers. Mais rien ne lui interdirait de subordonner ceux-ci à diverses conditions politiques, qu’il s’agisse de réformes internes ou de mise en œuvre des engagements de Minsk ; 1,2 milliard d’euros de l’aide macrofinancière décidée en mars 2015 restent à décaisser – c’est un montant qui permet tout de même de demander des contreparties… Le soutien accordé par l’Union à l’Ukraine vient en quelque sorte « récompenser » son engagement européen : il n’est pas illégitime que l’Union lie ce soutien à des avancées concrètes de l’Ukraine vers les standards européens et à une politique qui ne contredise pas l’action extérieure de l’Union, laquelle a endossé les accords de Minsk.
Recommandation n° 6 : agir dans le cadre de l’Union européenne pour que les aides européennes à l’Ukraine soient décidées et débloquées de manière autonome et en contrepartie d’avancées en matière de réformes internes et/ou d’adoption des mesures prévues par les accords de Minsk.
S’agissant des sanctions à l’encontre de la Russie, le vote majoritaire de l’Assemblée nationale, le 28 avril dernier, en faveur de la résolution « invitant le Gouvernement à demander la levée des mesures restrictives et des sanctions économiques imposées par l’Union Européenne à la Fédération de Russie » (94) de Thierry Mariani, président de la présente mission, et de ses collègues manifeste la montée des doutes quant à l’efficacité d’une politique qui entraîne des coûts économiques importants. La question des blocages politiques en Ukraine et donc de la responsabilité partagée entre Ukraine et Russie quant au blocage du processus de Minsk est également posée. Mais d’autres réponses, plus équilibrées, peuvent lui être données, comme l’a fait par exemple le Sénat dans le cadre de sa résolution « relative au régime de sanctions de l’Union européenne à l’encontre de la Fédération de Russie » adoptée le 8 juin à une très large majorité (95).
Du point de vue de votre rapporteur, les sanctions économiques générales ne peuvent pas être globalement levées tant que la paix ne sera pas revenue dans le Donbass : l’Union européenne se déjugerait (ses dirigeants ayant lié les deux points) et sa politique extérieure serait donc décrédibilisée. Une levée partielle de certaines sanctions, notamment les sanctions individuelles concernant des parlementaires russes, qui interdisent largement les contacts interparlementaires (outre les présidents des deux assemblées russes, un grand nombre des responsables parlementaires des groupes et des commissions sont concernés), est-elle envisageable ? La question mérite d’être posée.
Sa réponse peut aussi dépendre des gestes de bonne volonté que ferait de son côté la Russie, par exemple concernant son embargo contre la viande de porc européenne (étant rappelé que cet embargo, bien que décidé dans un contexte de forte tensions politiques juste avant la révolution de Maïdan, a officiellement un motif sanitaire, de sorte qu’il est politiquement plus aisé pour la partie russe de le réévaluer et d’envisager de l’atténuer en fonction de considérations sanitaires).
Des gestes d’ouverture de part et d’autre, s’agissant des sanctions et contre-sanctions, sont nécessaires notamment pour éviter que les entreprises françaises ne désinvestissent massivement de Russie : cela ne s’est pas produit jusqu’à présent, mais risque d’arriver si aucune perspective de sortie du blocage actuel n’est donnée.
En tout état de cause, votre rapporteur plaide pour le maintien d’une unité européenne sur cette question – il faudra convaincre tous nos partenaires –, mais aussi pour une démarche équilibrée tenant compte de l’attitude de toutes les parties.
Recommandation n° 7 : tout en veillant à maintenir l’unité européenne, réévaluer les sanctions à l’encontre de la Russie en tenant compte de l’action des différentes parties pour la mise en œuvre des accords de Minsk.
Dans un domaine connexe, car il s’agit aussi de « sanctions », même si elles ne s’inscrivent pas dans le corpus de celles décidées par l’Union européenne, votre rapporteur espère que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe évoluera vers une position plus équilibrée quant à la participation des représentants russes à ses travaux : on rappelle que, depuis janvier 2015, la plupart des prérogatives (participation aux instances dirigeantes de l’Assemblée ; droits de vote, d’être rapporteur, de participer à une mission d’observation électorale, etc.) de ceux-ci sont suspendues. L’intérêt d’une instance de cette nature est d’être un lieu de dialogue, ce qui n’est pas compatible avec ce type de décision. De plus, sans viser qui que ce soit nommément, le fait est que le respect des standards de la démocratie et de l’État de droit semble mis en cause dans d’autres pays européens que la Russie, de sorte que l’équité de mesures visant seulement les représentants de cette dernière peut être questionnée.
Recommandation n° 8 : inciter l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à jouer pleinement son rôle de dialogue, y compris avec les représentants russes.
Enfin, dans le contexte actuel de tension, certaines prises de position qui peuvent apparaître comme provocatrices vis-à-vis de la Russie devraient être évitées : il en est ainsi de celles qui donneraient à l’Ukraine des espoirs d’intégration dans l’OTAN.
Recommandation n° 9 : éviter toutes prises de position ou annonces nouvelles concernant les perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.
*
Au-delà des mesures liées directement à la situation de l’Ukraine et à la résolution de la crise du Donbass, plusieurs autres évolutions dans la politique de l’Union européenne seraient de nature à apaiser les relations avec la Russie, dans l’attente de la reconstruction d’un partenariat global qui sera longue.
Tout d’abord, l’Union européenne n’a aucun motif de continuer à refuser de reconnaître l’Union économique eurasiatique comme partenaire pour d’éventuelles négociations sur des sujets économiques et commerciaux.
L’argument selon lequel la non-appartenance à l’OMC de certains membres de l’Union eurasiatique serait rédhibitoire est peu convaincant alors même que, depuis l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC, plus de la moitié des membres de l’Union eurasiatique, représentant plus de 90 % de sa population et plus de 95 % de son PIB, sont également membres de l’OMC.
Par ailleurs, le rôle modérateur de pays tels que la Biélorussie et le Kazakhstan, qui ont adopté des positions prudentes et cherché à favoriser l’apaisement dans la crise russo-ukrainienne, doit être pris en compte : même si la Russie a évidemment un rôle prédominant dans l’Union eurasiatique, la présence de partenaires plus modérés dans celle-ci est susceptible d’en faire un acteur politique plus flexible que la Russie.
Mais encore faudrait-il, pour arriver à ce résultat, que les responsables de l’Union eurasiatique aient un véritable poids politique, ce qui n’est manifestement pas le cas actuellement – à ce égard, les « ministres » de l’Union eurasiatique n’ont de toute évidence pas le prestige et l’autonomie dont disposent leurs « homologues » les commissaires européens. De ce point de vue, une reconnaissance formelle, par l’Union européenne, de l’Union eurasiatique comme partenaire de négociation pourrait contribuer à rehausser l’autorité et l’autonomie de cette dernière, en tant qu’institution supranationale, par rapport au plus puissant de ses membres, la Russie.
De plus, sur le plan des principes, comment l’Union européenne pourrait-elle se refuser à reconnaître une autre tentative d’intégration régionale inspirée de son modèle, quelles que soient les limites intrinsèques de cette intégration ?
Recommandation n° 10 : inciter l’Union européenne à reconnaître l’Union eurasiatique comme partenaire légitime d’éventuelles négociations économiques et commerciales.
Ainsi qu’on l’a rappelé, les ministres des affaires étrangères des États membres de l’Union européenne se sont entendus, le 14 mars 2016, sur cinq principes directeurs de leur politique vis-à-vis de la Russie, dont certains peuvent apparaître comme inutilement provocateurs pour cette dernière – ainsi du renforcement des liens avec l’Asie centrale, dans lequel il est difficile de ne pas voir une sorte de volonté d’encerclement symbolique de la Russie, alors même qu’en réalité l’Union n’a ni l’envie ni les moyens de s’engager dans cette sorte de « grand jeu ».
Un autre principe de cette politique européenne n’est pas tenable à long terme, c’est celui de l’« engagement sélectif », qui prétend limiter la recherche de partenariats avec la Russie aux seuls domaines intéressant l’Union européenne (par exemple la Syrie, l’Iran…) : il devrait pourtant aller de soi qu’une politique extérieure ne peut pas ignorer les demandes et les priorités de l’autre protagoniste en refusant d’en discuter !
Pour autant, la possibilité de revenir vers une politique de partenariat global dépendra aussi de l’attitude de la Russie, qui doit s’impliquer plus positivement dans la résolution du conflit du Donbass et, elle-aussi, éviter les prises de position provocantes.
Recommandation n° 11 : faire évoluer les principes directeurs de la politique étrangère de l’Union européenne vis-à-vis de la Russie pour dépasser l’« engagement sélectif » et promouvoir à nouveau, à terme, un partenariat global, si l’évolution des positions de la Russie le permet.
Dernier point à souligner, la nécessité de disposer d’une Politique européenne de voisinage (PEV) plus pertinente.
Votre rapporteur a rappelé les critiques légitimes émises, notamment dans les rapports de nos collègues Pierre-Yves Le Borgn’ (96), Joaquim Pueyo et Marie-Louise Fort (97), contre cette politique de l’Union et en particulier son volet destiné à l’Europe orientale, le Partenariat oriental. Sans revenir longuement sur ces critiques, il est clair que c’est l’absence d’adaptation à leurs spécificités des offres faites aux « partenaires orientaux » et l’oubli total des intérêts des pays tiers qui a amené l’Union européenne à proposer à l’Ukraine un accord d’association dont le volet économique remettait en cause son imbrication économique avec la Russie. Et c’est cela qui a placé l’ex-président Ianoukovytch dans une situation intenable dont il n’a pu se sortir, ce qui a débouché sur sa chute, puis tous les événements que l’on sait.
La réforme de la PEV est l’objet depuis mars 2015 d’une consultation lancée par la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Le Parlement européen a adopté en juillet une résolution et une communication de la Commission et du SEAE (98) est venue en novembre synthétiser les premières conclusions, d’où il ressort des éléments de consensus autour de plusieurs principes de bon sens : la différenciation de la PEV selon les partenaires (« les aspirations de nos partenaires diffèrent ; nos relations devraient davantage en tenir compte »), son recentrage sur un moins grand nombre de priorités, au premier rang desquelles la sécurité et la stabilisation (« la consultation a révélé une volonté largement répandue de voir la sécurité occuper une place plus importante au sein de la PEV »), une plus grande implication des États membres eux-mêmes aux côtés des instances de l’Union…
La réforme de la PEV est une priorité afin d’éviter que les mêmes erreurs que celles commises en Ukraine ne se reproduisent.
Recommandation n° 12 : donner la priorité à une réforme de la Politique européenne de voisinage qui tienne mieux compte des intérêts propres des « voisins » ainsi que des pays tiers, tout en associant mieux les diplomaties des États-membres.
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa première séance du mercredi 29 juin 2016.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Nous examinons ce matin le rapport de la mission d’information sur la crise ukrainienne et l’avenir des relations entre la Russie et l’Union européenne et la France. C’est un rapport extrêmement important, fouillé, très précis et très informatif. C’est généralement le cas de nos rapports, mais cela témoigne du fait que nous travaillons beaucoup sur la question de l’Ukraine et de ses relations avec ses grands voisins depuis plusieurs années.
M. Jean-Pierre Dufau, rapporteur. Nous vous présentons aujourd’hui le résultat des travaux que nous avons menés depuis un an et qui nous ont notamment amenés à nous rendre en Ukraine et en Russie avec plusieurs autres membres de la mission. Je rappelle qu’outre Thierry Mariani et moi-même, ceux-ci étaient Jean-Luc Bleunven, Philippe Cochet, Jean-Claude Mignon, Marie-Line Reynaud et Odile Saugues.
Le rapport comprend trois parties consacrées respectivement à l’Ukraine, confrontée à une double crise nationale et économique, à la Russie, un partenaire difficile mais incontournable, enfin au rôle que peut jouer la France : plus que jamais, notre pays doit aider au rétablissement d’un partenariat européen avec la Russie. Ce rapport s’inscrit dans la continuité de celui que Chantal Guittet et Thierry Mariani avaient présenté début 2014. Il y a eu des événements majeurs depuis, la révolution de Maïdan en février 2014, puis l’annexion russe de la Crimée, puis le conflit du Donbass et tout ce qui s’en est suivi. Mais la question de nos relations avec la Russie n’en reste pas moins centrale, et c’est pourquoi, deux ans après, un nouveau rapport s’imposait.
En préalable, je souhaite souligner quelques points que nous devons garder à l’esprit. Les Ukrainiens ont fait, en février 2014, leur révolution en brandissant le drapeau européen et ont ensuite mis en place un nouveau pouvoir qui a commencé d’engager plus de réformes qu’aucun de ceux qui l’avaient précédé pour mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la corruption et aux abus des oligarques qui ont malheureusement caractérisé les vingt premières années de l’Ukraine indépendante. Les blocages et les lenteurs que nous regrettons aujourd’hui ne doivent pas le faire oublier.
Second point, la politique menée par la Russie à l’encontre de l’unité de l’Ukraine à partir de février 2014 n’est pas acceptable. L’annexion unilatérale de la Crimée constitue une violation très grave, sans précédent en Europe depuis 1945, des règles de base du droit international. Quant au conflit du Donbass, il n’a certes pas été déclenché directement par l’action des autorités russes, mais celles-ci lui ont permis de durer par leur soutien massif aux séparatistes et n’ont pas imposé, jusqu’à présent, un réel cessez-le-feu dont on peut pourtant penser qu’elles auraient les moyens. Il y a eu plus de 10 000 morts, 20 000 blessés, près de deux millions de déplacés.
Pourtant, le ministre Jean-Marc Ayrault l’a redit devant notre commission il y a quelques semaines, la Russie reste pour nous un partenaire, même si c’est un partenaire difficile. C’est un grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies, donc doté du droit de veto, et aussi d’une puissance militaire restaurée. Géographiquement, la Russie est le plus vaste et le plus peuplé des pays du continent européen, même en ne prenant en compte que sa partie européenne, sans la Sibérie. C’est aussi un pays avec lequel se maintient, malgré les difficultés et les crises, une large interdépendance énergétique. Les flux de gaz et de pétrole depuis la Russie vers l’Europe n’ont pas été affectés, à court terme, par la crise politique. C’est enfin un pays qui partage avec nous le défi d’avoir à affronter les dramatiques crises du Proche-et-Moyen-Orient et leurs sous-produits, terrorisme et flux de réfugiés. L’Europe et la Russie sont en première ligne sur ces crises, à la différence par exemple des États-Unis et des pays asiatiques, pour des raisons de voisinage géographique et de présence d’importantes communautés d’origine musulmane.
La Russie est donc un partenaire incontournable. Malheureusement, la question des relations avec elle est souvent traitée avec un excès de passion. Il ne faut ni surestimer, ni sous-estimer la Russie, mais la comprendre et mieux l’intégrer dans les relations internationales. Je ne crois pas que son régime actuel justifie ni l’engouement, ni le rejet. La popularité du président Poutine est incontestable et il n’est pas douteux qu’il bénéficie du soutien d’une grande majorité de son peuple. Mais il faut être conscient qu’il s’en donne les moyens, notamment à l’aide de législations de plus en plus rigoureuses à l’encontre de ceux qui ne pensent pas comme lui. Nous avons des différences d’appréciation sur les valeurs démocratiques. Ce printemps, par exemple, un opposant a été condamné à deux ans et demi de prison pour le seul fait d’avoir tenu plusieurs manifestations solitaires, des piquets silencieux en tenant des affiches hostiles au régime.
Mais je ne crois pas non plus que la Russie actuelle justifie les déclarations de ceux qui y voient une sorte de réincarnation de l’URSS et la plus grande menace à laquelle les démocraties européennes seraient confrontées. Ce tout simplement car la Russie actuelle, malgré ses ambitions, n’est plus et ne redeviendra probablement pas la superpuissance qu’elle était au temps du monde bipolaire.
Ce d’abord pour des raisons économiques. N’ayant pas su moderniser et diversifier ses activités, la Russie a créé une économie de rente pétrolière qui subit depuis 2014 la chute des cours du pétrole, à laquelle s’ajoute l’effet des sanctions occidentales et la chute consécutive du rouble. En termes de PIB global, le pays a été rétrogradé au 14ème rang mondial. Il est dépassé par des pays tels que l’Espagne, la Corée du Sud ou l’Australie.
Cela se voit aussi dans nos échanges bilatéraux. Traditionnellement, la Russie était le 3ème marché à l’export de la France hors Union européenne et Suisse, derrière les États-Unis et la Chine. En 2015, elle a régressé au 9ème rang à cet égard : outre les États-Unis et la Chine, la Turquie, le Japon, l’Algérie, Singapour, la Corée du Sud et le Brésil ont absorbé l’année dernière plus d’exportations françaises que la Russie. Cela traduit bien sûr l’effet des difficultés politiques et économiques et des sanctions, mais aussi la montée de tous ces nouveaux partenaires dans un monde de plus en plus multipolaire.
Même dans le domaine énergétique, la puissance de la Russie ne doit pas être surestimée, notamment s’agissant de l’interdépendance avec l’Union européenne. Les flux d’hydrocarbures de la Russie vers l’Union représentent certes un gros tiers des approvisionnements de l’Union, ce qui est considérable, mais aussi les trois cinquièmes des exportations russes d’hydrocarbures, ce qui les rend bien plus vitaux pour la Russie. Leur valeur représente 8 % du PIB russe en 2015, contre seulement 0,7 % du PIB de l’Union, bien plus élevé. Et dans le contexte énergétique actuel, marqué tout à la fois par la mise en exploitation des gaz et pétroles de schiste et par le mouvement de décarbonation acté par la COP21, nous savons bien qu’il est peu probable que les exportateurs traditionnels de pétrole retrouvent le pouvoir économique structurel qui était le leur durant les quarante dernières années, même si les cours remonteront peut-être.
Enfin, l’URSS s’appuyait sur un réseau de pays alliés ou vassalisés et exerçait une grande influence, ce que l’on appellerait un soft power, grâce au soutien inconditionnel de millions de Communistes dans le monde. La Russie contemporaine a au contraire peu d’alliés et est en fait assez isolée. Elle n’a réussi à rallier à son idée d’Union eurasiatique qu’une minorité des anciennes républiques soviétiques – cinq ou à terme six sur quinze – et le pivot vers l’Asie qu’elle a essayé de développer pour contrebalancer la crise avec l’Europe et les États-Unis conduit tout au plus à un partenariat d’intérêts avec la Chine, sans véritable confiance réciproque. Quant à l’attrait culturel et idéologique de la Russie, que le président Poutine cherche à renforcer en se présentant comme le héraut des valeurs conservatrices et autoritaires face à nous qui serions décadents, il reste malgré tout limité.
Le tableau général est donc celui-là. La Russie actuelle reste un grand pays, mais n’est ni un modèle, ni une sorte de nouvelle URSS surpuissante et maléfique. C’est simplement un partenaire nécessaire pour l’Union européenne, que nous devons traiter de manière plus juste et plus équilibrée. C’est dans ce sens, d’ailleurs, que va la voie de la diplomatie française, car nous avons su à tous les niveaux, jusqu’à celui des chefs d’État, garder depuis deux ans des relations bilatérales aussi bonnes que la situation générale le permettait.
Quels sont, dans ce contexte, les recommandations de la mission ?
La pleine application des accords de Minsk en est le premier point. La diplomatie française doit rester fidèle à une politique dont elle a été l’initiatrice, puisque c’est le Président de la République qui a organisé en juin 2014, lors de la commémoration du Débarquement, les premières rencontres à quatre qui ont donné ce que l’on appelle le « format Normandie ». Le principe de continuité des politiques que l’on engage est un premier motif évident de garder la priorité à la mise en œuvre des accords de Minsk.
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer les premiers résultats obtenus, même si les blocages actuels font douter certains. En effet, le processus de Minsk est certainement l’une des médiations extérieures les plus abouties dans un conflit de cette nature. Rien de comparable n’a été mis en place dans les autres conflits « gelés » de l’ex-URSS, en Transnistrie, Abkhazie, Ossétie du Sud, Haut-Karabakh. Dans l’ex-Yougoslavie, la paix est certes revenue, mais dans un contexte tout à fait différent. Dans le processus de Minsk, la France, l’Allemagne et l’OSCE s’en tiennent à une mission de « bons offices ». Les résultats de ce processus ont été obtenus grâce à une implication exceptionnelle, en France comme en Allemagne, des plus hauts responsables politiques et derrière eux des diplomates. Ils ont ensuite été en quelque sorte endossés par le reste de l’Union européenne, notamment lors du sommet des 19 et 20 mars 2015 où un lien explicite a été établi entre les sanctions européennes concernant la Russie et la mise en œuvre des engagements de Minsk. C’est pourquoi le rapport que je vous présente ne recommande pas une levée des sanctions avant que les accords ne soient pleinement appliqués.
La mise en œuvre des accords de Minsk nécessite des actes de bonne volonté de la part de la Russie comme de l’Ukraine. Le rapport est à cet égard équilibré.
La première ne peut pas continuer à prétendre qu’elle n’est en rien impliquée et aurait une position de médiatrice comparable à celle de la France et de l’Allemagne : la Russie a pris des engagements ; et il est évident qu’elle a une forte capacité d’influence pour obtenir des dirigeants séparatistes du Donbass le respect effectif du cessez-le-feu et le retrait des armes lourdes – qui, dans les accords de Minsk, sont le préalable des développements politiques prévus. Le rapport invite la Russie à s’investir davantage, y compris par des gestes unilatéraux, dans l’amélioration de la situation sécuritaire dans le Donbass.
Quant à l’Ukraine, elle doit évidemment tenir les engagements politiques qui ont été pris : définition d’un « statut spécial » du Donbass permanent et conforme aux textes signés, constitutionnalisation de ce statut, amnistie, organisation des élections locales après avoir débattu de la loi électorale aves les représentants des séparatistes.
L’application intégrale des accords de Minsk peut donc impliquer l’exercice de pressions politiques sur l’Ukraine et sur la Russie.
S’agissant de l’Ukraine, le rapport met en avant la possibilité de conditionner le versement des aides financières de l’Union européenne, qui sont considérables, à la poursuite des réformes, qu’il s’agisse des réformes de la gouvernance et de l’économie qui permettent au pays de se rapprocher de nos standards, ou même des réformes politiques prévues par les accords de Minsk. À partir du moment où l’Union européenne a endossé ceux-ci, il est légitime qu’elle subordonne ses aides au respect de son agenda politique.
S’agissant des sanctions contre la Russie, le rapport appelle à les réévaluer progressivement en tenant compte de l’action des différentes parties, puisqu’il y a des blocages chez les uns et les autres. De mon point de vue, les sanctions économiques générales ne peuvent pas être globalement levées tant que la paix ne sera pas revenue dans le Donbass, puisque l’Union européenne et plus spécifiquement la France et l’Allemagne se déjugeraient et donc se décrédibiliseraient. Il faut aussi conserver l’unité européenne. Mais une levée partielle de certaines sanctions, notamment les sanctions individuelles concernant des parlementaires russes, qui interdisent largement les contacts interparlementaires, pourrait être une piste à étudier.
Cela devrait aussi dépendre des gestes de bonne volonté que ferait de son côté la Russie, par exemple concernant son embargo contre la viande de porc européenne. Je rappelle que cet embargo, bien que décidé dans un contexte de fortes tensions politiques juste avant la révolution de Maïdan, a officiellement un motif sanitaire, de sorte qu’il est politiquement possible de le traiter en dehors du paquet des sanctions et contre-sanctions.
Dans des domaines connexes, le rapport suggère enfin plusieurs mesures pour rétablir le dialogue avec la Russie. D’abord au niveau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui a suspendu depuis janvier 2015 la plupart des prérogatives, comme le droit de vote ou celui d’être rapporteur, des délégués russes. Une assemblée est un lieu de dialogue qui ne peut pas fonctionner si l’on écarte certains de ses membres au motif que l’on est en désaccord, même si ce désaccord est fondamental.
Ensuite, dans le contexte présent du sommet de l’OTAN et dans la continuité des positions traditionnelles de notre diplomatie, il faut éviter les propos provocateurs sur une éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’organisation.
Enfin, le rapport propose plusieurs recommandations qui s’inscrivent dans une optique plus générale d’apaisement des relations de l’Union européenne avec la Russie.
L’une d’entre elles est de reconnaître officiellement l’Union économique eurasiatique comme partenaire d’éventuelles négociations économiques et commerciales. Je rappelle que l’Union économique eurasiatique est le fruit d’un processus d’intégration en cours entre la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie, le Kirghizstan et, potentiellement, le Tadjikistan. La reconnaître serait une position logique puisque cette Union bénéficie de transferts de souveraineté dans les domaines économiques, comme l’Union européenne. De plus, le rôle modérateur de pays tels que la Biélorussie et le Kazakhstan, qui ont adopté des positions prudentes et cherché à favoriser l’apaisement dans la crise russo-ukrainienne, doit être pris en compte : même si la Russie a évidemment un rôle prédominant dans l’Union eurasiatique, la présence de partenaires plus modérés dans celle-ci est susceptible d’en faire un acteur politique plus flexible.
Une autre recommandation concerne les grands principes de l’action de l’Union européenne vis-à-vis de la Russie. Les ministres des affaires étrangères des États membres se sont entendus, le 14 mars dernier, sur cinq principes directeurs dont certains peuvent apparaître comme inutilement provocateurs ou réducteurs. Il y a notamment le principe dit de l’« engagement sélectif », qui prétend limiter la recherche de partenariats avec la Russie aux seuls domaines intéressant l’Union européenne, par exemple la Syrie ou l’Iran. Il devrait pourtant aller de soi qu’une politique extérieure ne peut pas ignorer les demandes et les priorités de l’autre protagoniste en refusant d’en discuter. Bien sûr, la possibilité de revenir vers une politique de partenariat global dépendra aussi de l’attitude de la Russie, qui doit s’impliquer plus positivement dans la résolution du conflit du Donbass et, elle-aussi, éviter les prises de position provocantes. Mais il n’est pas possible de promouvoir durablement l’engagement dit « sélectif ».
Dernier point à souligner, la nécessité de disposer d’une Politique européenne de voisinage, ou PEV, plus pertinente. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses critiques émises dans nos commissions par nos collègues Pierre-Yves Le Borgn’, Joaquim Pueyo et Marie-Louise Fort, contre cette politique de l’Union et en particulier son volet destiné à l’Europe orientale, le Partenariat oriental. Sans revenir longuement sur ces critiques, il est clair que c’est l’absence d’adaptation à leurs spécificités des offres faites aux « partenaires orientaux » et l’oubli total des intérêts des pays tiers qui ont amené l’Union européenne à proposer à l’Ukraine un accord d’association dont le volet économique remettait en cause son imbrication économique avec la Russie. Et c’est cela qui a placé l’ex-président Ianoukovytch dans une situation intenable dont il n’a pu se sortir, ce qui a débouché sur sa chute, puis tous les événements que l’on sait. La PEV est en cours de réforme. Il faut qu’elle soit recentrée sur un moins grand nombre de priorités, au premier rang desquelles la sécurité et la stabilisation, soit plus différenciée pour mieux tenir compte des intérêts propres des « voisins » ainsi que des pays tiers, et associe mieux les diplomaties des États-membres. Nous devons promouvoir un véritable partenariat de paix adapté à un monde qui change.
M. Thierry Mariani, président de la mission d’information. Je salue le travail des membres de notre groupe, en premier lieu du rapporteur. Dans tout rapport, il y a des idées et on comprendra que je puisse être en désaccord avec un certain nombre de points pour des raisons qui n’ont rien de technique mais qui tiennent à des choix personnels. Vous comprendrez que j’aie pour cette raison demandé à pouvoir compléter le rapport d’une contribution afin d’être en cohérence avec mes engagements.
Je voudrais ici faire trois remarques qui devraient être consensuelles.
En premier lieu, nous faisons face en Europe, malheureusement, à une fracture durable et à un conflit gelé qui devrait durer. Je ne vois en effet pas d’issue à moyen terme et encore moins à court terme sur ce dossier. Ce conflit a fait pour l’instant 10 000 morts. Je rappelle que le conflit de Transnistrie, où j’étais il y a dix jours, a fait selon les estimations entre 200 et 1 000 morts. Par ailleurs, nous sommes dans une situation qui ne laisse entrevoir aucune porte de sortie. La seule solution est sans doute, comme on le répète, celle des accords de Minsk, mais on exige du côté ukrainien que le cessez-le-feu soit respecté à 100 % tandis que, du côté russe, on exige que soient rapidement votées des lois sur l’amnistie, les élections locales et l’autonomie.
L’entretien de ce matin avec l’ambassadeur de France en Ukraine confirme que, d’ici la fin de l’actuelle législature en Ukraine, la plupart de ces lois ne seront pas votées parce qu’il n’y a pas de majorité pour cela. S’il y a eu cet affrontement en août dernier devant la Rada, au cours duquel des policiers ont trouvé la mort, c’est justement parce que la majorité avait essayé d’avancer dans un de ces domaines. Les prochaines élections auront lieu en 2019. D’ici-là, nous continuerons donc à faire des rapports demandant que les accords de Minsk soient appliqués, les Russes se plaindront de ce que les Ukrainiens ne votent pas ces lois et les Ukrainiens se plaindront du non-respect du cessez-le-feu.
Je crains en outre que la situation actuelle n’arrange certains de nos partenaires occidentaux, comme les États-Unis et une partie des Européens, qui voient dans ce scénario un moyen d’affaiblir la Russie, de même qu’elle arrange une partie des Russes qui voient là le moyen d’avoir une sorte de zone grise, avec ce que cela signifie : on peut s’inquiéter non seulement à propos des droits de l’homme, mais également des conditions sanitaires qui règnent dans le Donbass. Malheureusement, les deux camps ont presque intérêt à ce que cette situation perdure. Je crains donc qu’au Haut Karabakh, à la Transnistrie et à l’Ossétie ne se soit ajoutée une nouvelle fracture durable.
Deuxième point, je pense comme les autres membres de la mission qu’on a besoin d’une politique plus indépendante. François Rochebloine, avec qui je siège au Conseil de l’Europe dans le même groupe politique, sera probablement d’accord pour estimer qu’il y a aujourd’hui en Europe deux sortes d’États : ceux qui ont souffert dans un passé proche du poids de l’Union soviétique et les autres, qui ont tourné la page de l’histoire depuis longtemps. Pour ceux qui siègent comme nous dans certaines institutions européennes, il est visible que les Baltes ou les Polonais, que je comprends, ont une revanche à prendre dès qu’on parle de la Russie, contrairement à nous. L’Europe est ainsi, malheureusement, poussée par les nouveaux entrants vers une politique qui ne peut pas nous amener à la conciliation, la règle du consensus nous poussant vers l’esprit de revanche plutôt que de partenariat.
Je le regrette parce que la France avait un rôle à jouer. Comme l’a dit Jean-Pierre Dufau, la Russie était notre troisième partenaire économique hors Europe et a reculé, notamment du fait des sanctions qui ont un certain poids et un certain impact.
Troisième et dernier point, je pense que la Russie est de retour. Un État, ce n’est pas uniquement un taux de croissance et un produit intérieur brut. Si les taux de croissance faisaient frémir les peuples, je connais des États qui seraient restés au sein de l’Europe. Même si le budget militaire russe est sans commune mesure avec celui des États-Unis ou de la Chine, ce budget est aujourd’hui un peu supérieur à celui de l’Arabie Saoudite. En outre, la Russie a commencé à comprendre les règles du Soft power. La « révolution orange » a été un choc, et la Russie a compris qu’aujourd’hui, il ne suffit plus de masser des forces militaires à la frontière ou des forces de police et qu’il y a des choses que l’on ne peut heureusement plus faire aujourd’hui. L’influence dans les médias a aujourd’hui une importance et il y a aujourd’hui de la part de la Russie, comme le souligne le rapport, une politique médiatique très offensive dans un certain nombre de pays.
Comme l’a dit le rapporteur, cette politique est soutenue par l’opinion publique. L’ambassadeur de France, lors d’un entretien, nous disait que l’opposition libérale progressait et pourrait atteindre 6 ou 8 %, ce qui donne une mesure du soutien populaire aux dirigeants actuels. Je rappelle que le président Poutine, dans l’échiquier politique russe, est un centriste. L’opposition, c’est d’abord le parti communiste de M. Ziouganov, puis l’extrême droite – ou la droite nationaliste, comme on voudra – de M. Jirinovski. Le président Poutine incarne le milieu et, de plus en plus, les classes moyennes, même si elles sont déçues.
On a malgré tout un pouvoir stable en Russie. La liberté n’y est pas aux standards européens mais internet est libre et la liberté existe à un degré supérieur à d’autres pays.
Enfin, qu’il n’y ait pas de malentendu concernant l’Ukraine : j’ai présidé le groupe d’amitié France-Ukraine pendant cinq ans et j’ai passé mon premier mandat, de 1993 à 1997, à faire des cours de formation en Ukraine avec Claude Goasguen pour des fondations européennes. Je suis cependant consterné par l’évolution de ce pays qui s’enfonce de plus en plus, peut-être parce qu’il n’a pas la classe politique qu’il mérite. La corruption n’y choque personne, la situation économique ne fait qu’empirer et le pays payera lourdement cette instabilité qu’on laisse s’installer. Les premiers mois de la « révolution de Maïdan » ont été très mal gérés, avec une partie du pays qui a fait sécession, tandis qu’une autre a été annexée ou a demandé à être rattachée à la Russie. Cette situation va durer et l’Ukraine sera durablement un pays tampon, mais surtout un pays malade. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas le soutenir, puisque nous n’avons aucun intérêt à avoir un pays malade au milieu de l’Europe, mais je ne vois pas non plus comment ce pays pourrait, à court terme, s’en sortir.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Vous venez d’exprimer vos opinions et celles-ci nous sont connues puisque vous les avez affirmées de manière répétée devant la commission. Nous avons eu des débats sur l’objet du rapport, et je ne partage pas tout ce que vous exprimez, mais c’est une question d’appréciation.
Je rappelle que le vote de la commission ne vise qu’à autoriser la publication du rapport, et qu’il ne vaut pas approbation ni de sa teneur, ni des opinions qui viennent d’être exprimées par M. Mariani.
M. Thierry Mariani. Je voterai pour la publication du rapport, qui est excellent, même si je ne partage pas toutes les opinions qui y sont exprimées.
Mme Marie-Line Reynaud. Je suis membre de la mission d’information et je tiens à saluer d’emblée le rapporteur de la qualité de son travail, dont je suis les conclusions. Je précise aussi que j’approuve en partie ce que vient de dire Thierry Mariani.
Lorsque l’on va en Ukraine, on est frappé par l’ampleur des problèmes, qu’il s’agisse notamment du poids des oligarques et de l’omniprésence de la corruption. Ce n’est pas un pays facile à stabiliser. Lorsque nous avons été dans le Donbass, et nous avons été les seuls parlementaires à le faire, nous avons pu constater l’état catastrophique du pays, qu’il s’agisse de ses installations industrielles ou de ses infrastructures routières. Sur place, la situation reste très tendue et les observateurs de l’OSCE nous ont indiqué que le cessez-le-feu n’était pas respecté des deux côtés. C’est un conflit qui s’enlise.
Il faut que l’accord de Minsk soit appliqué pour que la situation se débloque, mais il y a beaucoup à faire pour y parvenir. La grande incertitude est la durée du conflit. La conditionnalité des aides européennes est une bonne piste.
M. Philippe Cochet. Je suis également membre de la mission d’information et je tiens à remercier le rapporteur et le président. Le rapport est équilibré, mais il est difficile de parvenir à des conclusions qui fassent l’unanimité.
La situation de l’Ukraine est complexe, et il n’y a pas « les bons » d’un côté et « les méchants » de l’autre. L’accord de Minsk n’est respecté ni d’un côté ni de l’autre et le conflit peut ainsi durer.
L’Union européenne et la France, davantage que l’Europe d’ailleurs, peuvent jouer un rôle. Il est nécessaire de retisser les liens avec la Russie et indispensable de retrouver une existence propre et de ne pas suivre une voie qui n’est pas celle de nos intérêts.
Je retrouve mes positions dans l’équilibre du rapport et je comprends la position du président de la mission d’information, car c’est une analyse sur laquelle la France pourrait fonder son approche et sa politique.
M. Philippe Baumel. Les sanctions sont-elles utiles ? C’est la première question à se poser. Visiblement, ce n’est pas le cas. Elles n’atteignent pas leur objectif. Elles n’influencent pas la politique de la Russie vis-à-vis de l’Ukraine, qui n’a pas été modifiée. Elles ont même des incidences négatives pour l’Union européenne et elles sont de plus dommageables pour son image vis-à-vis du peuple russe, qui était assez favorable à l’Europe et très francophile. De même que pour le Proche-Orient ou pour les conséquences du Brexit, il y a matière à une initiative française pour desserrer l’étau d’une politique qui est selon une expression qui a été récemment employée, à « l’ouest de l’ouest », pour la repositionner vers l’Est, regardant vers nos voisins plutôt que de se préoccuper d’une politique d’outre-Atlantique qui préserve assez peu, voire rarement, nos intérêts.
M. Jacques Myard. Je voudrais reprendre une formule de Thierry Mariani qui a dit : « ça va être un conflit gelé ». C’est pire qu’un conflit gelé. C’est un conflit qui vient du fonds des âges et qui a une protohistoire. Et pour avoir lu l’ouvrage extraordinaire « Vie et Destin » de Vassili Grossman sur les relations entre l’Union soviétique et l’Ukraine, je peux rappeler que lorsque les armées soviétiques sont de nouveau entrées en Ukraine pendant la Seconde guerre mondiale, elles ont constaté l’horreur, à savoir que des Ukrainiens avaient massacré les Juifs, et cela pèse dans l’histoire et dans les relations entre les Russes et les Ukrainiens. Il y avait certes eu auparavant les déportations faites par Staline avant la guerre, mais le fait est que lorsque les troupes nazies sont entrées en Ukraine, elles ont été accueillies en libératrices. Tous ces éléments sont intégrés dans une psychologie très lourde à porter entre les deux peuples.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’absoudre les Russes : je ne suis ni pro-russe, ni pro-américain, mais pro-français. Il s’agit de voir où sont nos intérêts. Mais nous avons fait une série de fautes vis-à-vis de la Russie. Premièrement, il y a eu ces fameuses conclusions du sommet de Bucarest…
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Comme je partage votre opinion ! Ce n’est pas souvent le cas, mais là, oui.
M. Jacques Myard. ...lorsqu’il a été dit que l’Ukraine et la Géorgie pouvaient adhérer à l’OTAN, ce qui est une aberration monumentale sur le plan géostratégique. Deuxièmement, et là vous ne serez peut-être pas tout à fait d’accord, Mme la Présidente, le Président de la République s’est abstenu d’être présent le 9 mai 2015 aux commémorations de la victoire, alors que la Chancelière allemande y est allée, le 10. Je n’ai jamais compris pourquoi. S’il n’y avait pas eu l’armée soviétique à l’Est et les 27 millions de morts du pays, les Américains n’auraient pas eu la même situation sur les plages de Normandie. Il faut reconnaître la part de l’URSS, des Russes, dans la victoire sur le nazisme.
Enfin, une autre faute a été mentionnée par Philippe Baumel, c’est l’illusion des sanctions contre la Russie. Cela n’a pas de sens. C’est comme si l’on prenait des sanctions contre les États-Unis ou contre la Chine. Il faut une autre politique. Il faut sortir de ce suivisme des ultra-européens et de ce suivisme vis-à-vis de nos amis américains qui, en la matière, poursuivent des objectifs qui, à mon sens, sont dangereux. Au passage, je voudrais dire que Mme Hilary Clinton n’est pas la pacifiste que l’on nous présente. Il faut être très attentif. Elle a des positions extrêmement dures vis-à-vis de la Russie. Et nous sommes repartis pour une Guerre froide qui est véritablement contraire à nos intérêts. C’est la raison pour laquelle je prône une totale indépendance de notre politique étrangère et juge nécessaire que nous sortions de cette impasse dans laquelle nous nous sommes mis volontairement ou par faiblesse.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Il faut quand même souligner que les États membres de l’Union européenne ont refusé de livrer des armes à l’Ukraine.
M. Pierre Lellouche. Je suis tout à fait d’accord avec les positions exprimées par mes collègues Mariani, Baumel et Myard. Je trouve votre rapport très nourri, mais je n’y vois aucun examen rétrospectif de la politique de la France depuis le début de la crise ukrainienne. Il aurait fallu faire un travail d’introspection sur ce que nous n’avons pas fait. En réalité, au début, nous ne nous sommes préoccupés ni de la Russie, ni de l’Ukraine. Pendant la révolution de Maïdan, aucun ministre français ne s’est rendu en Ukraine, alors que les Européens l’ont fait. Le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius est arrivé tout à la fin, pour la signature de l’accord.
Je trouve aussi que ce rapport devrait être plus critique sur la Politique de voisinage de l’Union européenne. Il y a un véritable divorce entre la nouvelle Europe, très atlantiste, et l’ancienne. Et nous nous alignons sur les positions de cette nouvelle Europe en mettant en place des mesures de réassurance, une défense anti-missile et en prévoyant le retour de forces stationnées sur le territoire des États baltes et orientaux. Comme s’il n’y avait pas d’autres priorités que de rejouer la guerre froide en Europe !
Enfin, il est regrettable que les conclusions de ce rapport ressemblent à un communiqué de presse du Quai d’Orsay. Elles reprennent l‘éternelle incantation sur l’application des accords de Minsk. Vous esquissez parfois une position, par exemple sur l’octroi des visas aux Ukrainiens ou sur l’aide financière européenne, mais alors vous ne tranchez pas. Il faut être beaucoup plus incisif. Il faut appuyer l’idée que la France veut réévaluer les sanctions en fonction d’un calendrier de sortie de crise. La condition de l’application des accords de Minsk nous condamne à un renouvellement automatique des sanctions tous les six mois sans aucune porte de sortie. Nous devrions plutôt prévoir des mesures de confiance à mettre en œuvre de trois mois en trois mois en séquence avec une levée progressive des sanctions. Il est temps que la France se réinvestisse dans le règlement diplomatique de la crise ukrainienne et ce, au-delà du « format Normandie ». Nous ne devons pas nous contenter de suivre les Américains. Eux-mêmes ne s’embarrassent pas toujours de nous, comme l’avait crûment exprimé la diplomate américaine Victoria Nuland avec son inoubliable « Fuck the European union » !
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Vous avez raison de chercher les moyens d’une sortie de crise progressive en Ukraine. Mais à ce stade, heureusement que nous avons les accords de Minsk. C’est une voie de médiation extrêmement précieuse alors que la situation est très compliquée. Je pense que nous devons faire attention à préserver la position de médiation qui permet à notre pays de peser dans la résolution de certains conflits. Si nous quittons cette position, nous accentuerons la division entre Européens, et nous risquons d’abandonner la proie pour l’ombre.
M. Jacques Myard. Mais non, il faut casser la baraque !
M. Jean-Paul Bacquet. Je suis d’accord avec ce qu’ont dit mes collègues. C’est une évidence, nous devons lever cet embargo qui pénalise tout le monde. Je crois aussi, comme Jacques Myard, que nous devons accentuer notre ouverture vers l’est. Et je dois dire que je ne partage pas certaines de vos conclusions. Je pense que la Russie est en train de renaître. Vous dites que l’annexion de la Crimée est « une violation très grave, sans précédent en Europe depuis 1945, des règles de base du droit international », mais vous ne développez absolument pas. Vous dites que nous devons malgré tout maintenir de bonnes relations avec la Russie et vous argumentez sur le thème de la priorité à la lutte contre le terrorisme : cette forme de marchandage me semble un peu légère. Enfin, vous mentionnez le règlement à l’amiable sur la question des BPC Mistral : il me semble que ce n’était vraiment pas un grand moment de la politique extérieure de la France.
M. Pierre-Yves le Borgn’ : À rebours de mes collègues, je vais donner un satisfecit au rapporteur. Comme tout le monde, je souhaite la levée progressive des sanctions contre la Russie, mais elle doit évidemment être subordonnée à la mise en œuvre d’une solution pérenne dans le Donbass. Nous devons rappeler la Russie à ses devoirs.
Par ailleurs, vous ne faites pas explicitement mention de la Crimée dans vos recommandations, alors qu’il me semble que nous ne pouvons pas prendre acte de son annexion qui constitue une violation caractérisée du droit international. Autre point, avez-vous traité de la situation des minorités russes dans les États baltes ?
Enfin, le président de la mission a mis en exergue la liberté d’internet en Russie. Elle m’a valu d’être menacé de mort pour la position que je viens d’exprimer devant vous.
M. Jean-Paul Dupré. Mes félicitations au président et au rapporteur pour leurs conclusions et recommandations, notamment les n°11 et 12.
Néanmoins, je voudrais faire part de mon étonnement à la lecture du début des conclusions. La mission d’information me semble être sortie de son rôle en évoquant la représentativité de la Russie. Je ne pense pas que l’on aille ainsi dans la bonne direction en matière d’apaisement des relations. Permettez-moi de vous lire le passage en question : « la Russie n’est plus la superpuissance qu’elle a été et a peu de chance de le redevenir, quels que soient la volonté de ses dirigeants actuels (…) : son économie n’est pas assez puissante, ni surtout assez diversifiée et dynamique ; sa capacité d’influence et d’attraction (…) restent relativement limités ; dans le système international, elle est un acteur incontournable, mais finalement assez isolé, dont les vrais alliés (anciens et fidèles) se comptent sur les doigts d’une main et ne sont ni puissants, ni toujours très "recommandables" ». Je souhaiterais que l’on revoie ce paragraphe. Je me demande quelle serait la réaction de la France si une mission russe, après un séjour sur notre territoire, portait un tel jugement sur nous
J’ajoute que j’avais voté en faveur de la levée des sanctions.
M. Guy-Michel Chauveau. Notre ambassadrice en Ukraine, que nous avons reçue ce matin, nous disait que l’on parle finalement peu à Kiev de la guerre à l’est. L’opinion ne s’émeut guère du non-respect du cessez-le-feu, en particulier le retrait des armes lourdes, qui est pourtant un préalable. Par ailleurs, les observateurs de l’OSCE disent ne plus pouvoir faire leur travail et affirment que l’on ne peut pas dire qui tire le premier. Avec les moyens techniques qui existent de nos jours, cela paraît tout de même incroyable.
Au risque d’être un peu provocateur, je crois que cela arrange tout le monde. Le contexte est connu : le sommet de Varsovie dans quelques jours et bientôt le rapport de Mme Mogherini sur la stratégie européenne. Ce rapport est arrivé avant celui de Federica Mogherini, même s’il est déjà constitué, voire sorti. Il était d’abord prévu qu’il soit disponible à la fin du premier trimestre, mais ce sera peut-être pour le mois de juillet. Il faut dénoncer cette non-transparence.
S’agissant des relations avec la Russie, la Politique de voisinage a été évoquée. Si la Russie a plutôt fait l’objet d’un partenariat à part depuis 2003, on peut se demander pourquoi l’Allemagne et la France n’en ont pas fait davantage en 2008 à Bucarest. On peut toujours dire qu’on n’était pas là à Maïdan, mais en 2008 non plus. J’y vois une raison de la montée des pays Baltes et de l’est au sein de l’OTAN.
Pour ma part, je mettrais peut-être les recommandations 12 et 11 avant la 10ème, afin de bien montrer que l’Union européenne a manqué à ses obligations et surtout à ses orientations politiques.
M. Paul Giacobbi, président. Avec la Crimée, nous sommes au cœur d’une très vieille affaire. Cela fait très longtemps que la Russie veut aller vers les mers chaudes, la Méditerranée et l’Orient, pour des raisons qui tiennent à la religion et à l’histoire. Les tensions sur les lieux saints sont en grande partie entre les chrétiens d’Orient et les autres. Rappelons aussi qu’il y a eu une guerre de trois ans extrêmement sanglante à propos de la Crimée, entre la Russie d’une part, et toute une coalition, comprenant notamment la France, le Royaume-Uni et l’Empire ottoman, ce qui n’est pas neutre. Le Royaume de Piémont-Sardaigne en a très habilement profité pour se pousser sur la scène à très peu de frais. La Crimée, annexée au XVIIIème siècle, est très largement russe depuis cette époque, même s’il existe une population tatare minoritaire. Son intégration administrative à l’Ukraine en 1954 est tout à fait circonstancielle – passons sur le détail des soirées de beuverie de Nikita Khrouchtchev. Cette intégration s’est faite sur la base d’une double autonomie, administrative et linguistique, et même, à certains égards, militaire, avec un statut encore plus particulier pour Sébastopol. Il est donc très compliqué d’affirmer que la Crimée n’a rien de russe ou qu’elle a été brutalement annexée.
Un referendum a eu lieu. On peut tout contester, mais il ne fait de doute pour personne que, même s’il s’était déroulé dans des conditions absolument idéales et parfaites, il aurait donné à l’évidence une majorité en faveur du rattachement à la Russie. Sans revenir sur ce qui s’est passé pendant la guerre, car ce serait verser dans l’horreur, l’Ukraine elle-même n’est pas un modèle en général, et en particulier sur le statut de la langue russe par rapport à l’ukrainien.
Nous avons des intérêts nationaux et, jusqu’à la preuve du contraire, nous avons besoin de la Russie, notamment en Syrie. Je ne suis pas certain de savoir où nous en serions dans ce pays si nous n’y avions pas la Russie comme alliée sur le plan militaire. C’est une réalité incontestable.
Ensuite, je voudrais faire une comparaison avec la Chine. Il y a sûrement beaucoup de critiques à adresser à la Russie, en particulier sur le plan des droits de l’homme et de la moralité publique, mais on reste très loin de la réalité chinoise. Il n’y a pas la moindre trace de démocratie dans ce dernier pays, la corruption est largement plus développée et il y a aussi l’agressivité de la Chine, notamment en mer de Chine méridionale. Et ne parlons pas des guerres intérieures au Xinjiang et au Tibet, dont personne ne dit jamais rien.
Je voudrais donc demander à nos collègues pourquoi ils n’ont pas davantage nuancé ce qu’ils écrivent de la Crimée, dont plus personne ne parle car on a pris acte. Vous écrivez ceci : « l’annexion unilatérale de la Crimée constitue une violation très grave, sans précédent en Europe depuis 1945, des règles de base du droit international ». Mais il ne s’est quand même pas rien passé dans l’ex-Yougoslavie et je ne suis pas sûr que tout cela soit juridiquement exact. Les règles de base du droit international, qui permettent la sécession, exigent simplement que cela ne se fasse pas contre la volonté des peuples. Il faudrait a minima expliciter votre position – mais vous l’avez peut-être fait ailleurs dans le rapport.
M. Thierry Mariani. Il n’est pas surprenant qu’un des points de désaccord concerne la Crimée. Cette région est historiquement et culturellement russe. S’il y avait eu un referendum, organisé dans les formes, le résultat aurait été celui qu’il a été, c’est-à-dire massivement favorable.
Nous sommes allés en Crimée avec Jacques Myard et devrions y retourner dans quatre semaines. Un Français expatrié sur place m’a raconté comment la population de Sébastopol a accueilli avec des petits drapeaux russes la marine russe revenant de Géorgie en 2008. Je n’approuve pas l’intervention en Géorgie, mais en clair, la population était présente pour accueillir ses soldats, même si c’étaient ceux d’un pays dit étranger. Donc on a l’hypocrisie de ne plus parler de ce sujet, mais la messe est dite. Néanmoins, on ne reconnaîtra pas l’annexion, et cela peut durer encore très longtemps. D’autre part, quand on évoque les grands principes, il faut les respecter éternellement. Je n’ai pas l’impression que les grands principes d’intangibilité des frontières ont été respectés au Kosovo et en Serbie. Nous condamnons l’intervention russe en Syrie, mais, par exemple, le faisons nous aussi énergiquement pour l’intervention américaine en Irak, qui a été faite en se basant sur des preuves fausses ? Nous avons ainsi une politique de double standard. La Crimée est désormais à nouveau russe, et cela me semble un fait incontestable.
S’agissant des sanctions, personnellement, je trouve que c’est une aberration. C’est un peu comme l’état d’urgence, et je le dis sans aucune arrière-pensée politique. C’est bien quand on y rentre, mais après on ne sait plus comment en sortir. Je prends le pari que dans six mois, les sanctions seront reconduites. On nous expliquera que l’ancien président américain n’est pas encore parti et que le nouveau n’est pas encore installé, et qu’il est donc trop tôt. De plus, on ne voudra pas se désolidariser de nos amis européens. Cela durera donc encore des années. Dans le même temps, la France est en train de perdre des marchés notamment dans le domaine agricole, où elle avait une bonne position. Les Russes profitent d’une situation d’économie protégée pour développer une production de qualité équivalente.
La Russie n’est pas isolée. Lors du défilé du 9 mai 2015, étaient présentes l’Inde, la Chine et une trentaine d’autres pays. Il faut donc arrêter de faire de l’eurocentrisme.
L’Europe tolère pour les pays Baltes ce qu’on ne tolérerait jamais ailleurs, c’est-à-dire une politique de discrimination d’une partie de la population. 10 % des personnes qui vivent en Lettonie n’ont même pas le droit de vote, parce qu’ils sont nées en Russie ou ont eu des parents russes. L’Europe, qui fait des résolutions sur les droits des migrants, ferme totalement les yeux sur ces sous-citoyens dans ses propres pays. C’est cela que la Russie dénonce. Il ne faut pas s’étonner si la minorité russe dans les pays baltes se sent maltraitée et que la Russie veuille exercer une sorte de protection sur cette population menacée.
Comme me le disait un ancien diplomate, le seul intérêt pour le groupe de Minsk – celui concernant l’Arménie et l’Azerbaïdjan – est de se réunir, et cela est déjà un succès. J’ai l’impression qu’à terme, pour les accords de Minsk, ce sera la même chose, c’est-à-dire le fait d’exister et de donner un horizon lointain et inatteignable. Car, avec chaque jour qui passe, et qui rajoute des morts – maintenant 10 000 –, on arrivera plus à cicatriser les blessures.
S’agissant de l’opinion publique ukrainienne et de la guerre, il y a un paradoxe fréquent dans les pays en guerre, que j’ai constaté récemment à Damas : alors que j’y étais, la seule chose qui préoccupait la ville était la remise du prix du concours hippique. C’est une manière d’oublier la guerre. En Ukraine, c’est la même chose.
Enfin, nous critiquons souvent la liberté des médias en Russie et il est vrai que ce pays n’a pas les mêmes standards que nous avons en France. Mais en Ukraine, la situation n’est pas meilleure. Certains médias y ont été fermés manu militari.
M. Jean-Pierre Dufau. Si ce rapport ne comprend pas de recommandation sur la Crimée, c’est pour une raison simple : il n’est pas possible, sur le plan du droit international, de reconnaître l’annexion de la Crimée. Mais cela s’est dit ici et je peux le dire très tranquillement : chacun sait, compte-tenu de l’histoire et des rapports de force, du referendum auquel vous avez fait allusion et de la réalité des faits, que la Crimée restera russe, même si elle ne sera pas forcément reconnue comme telle par les États. C’est le cas d’un certain nombre de pays dans le monde : il y a là un état de fait avec lequel on est obligé de composer. C’est la raison pour laquelle cela ne figure pas dans le rapport. Les accords de Minsk et la feuille de route, par sagesse peut-être, ne font pas état de la Crimée et sont limités au Donbass.
La France continue d’avoir avec la Russie des rapports privilégiés. Elle entretient depuis 2014 des rapports politiques de haut niveau, et plus fréquents que jamais, avec la Russie comme l’Ukraine. À titre d’exemple, le président Hollande et le président Poutine se sont rencontrés ou parlés 24 fois en 2015. C’est aussi la France qui est à l’origine du « format Normandie » auquel s’est associée l’Allemagne. De même, il y a des rapports forts avec le président Porochenko, avec sept rencontres en deux ans.
C’est à titre d’exemple que j’ai choisi le cas des navires Mistral. La Russie aurait pu faire de cet épisode un conflit beaucoup plus dur, faire traîner l’affaire et imposer des arbitrages juridiques, ce qu’elle n’a pas fait. C’est donc plutôt en creux que l’on observe l’absence de volonté russe d’aggraver les choses.
L’impact des sanctions est regrettable pour tout le monde. D’après les études, c’est certainement la Russie qui a le plus perdu du fait des sanctions, peut-être de 1 % à 1,5 % de son PIB, tandis que pour la France, le manque à gagner serait de 300 à 600 millions d’euros d’exportations, soit entre 0,015 % et 0,03 % de notre PIB. Il faut relativiser les choses, sans pour autant se satisfaire de la situation : ce n’est pas la France qui en Europe subit le plus les conséquences de ces sanctions. Cela dit, on peut discuter l’efficacité politique des sanctions. Nous partageons indéniablement la volonté de trouver au plus vite les accords qui permettront de lever les sanctions européennes.
Je l’ai dit, je le répète et je ne l’oublie pas : la Russie – l’Union soviétique à l’époque – fait partie des vainqueurs de 1945. Nous n’avons pas, globalement, mesuré l’importance et les conséquences qu’entraînerait la chute du mur de Berlin lorsqu’elle s’est produite. Certains s’y sont engouffrés avec plus de précipitation que d’autres. Force est de constater qu’à l’époque, François Mitterrand étant Président de la République, la France faisait partie des nations les plus circonspectes, que ce soit à propos de l’ex-Yougoslavie ou des pays de l’est de l’Europe. Il est vrai les choses se sont peut-être emballées, que l’évolution a été trop rapide, mal préparée, et n’a pas permis d’appréhender les problèmes que cela pourrait entraîner.
Personne ne nie l’importance de la Russie. Ce pays ne correspond plus à la superpuissance qu’était l’URSS, mais la diplomatie russe est extrêmement active et présente, et est quelquefois très habile, dans la mesure où elle parvient à s’immiscer en creux lorsque les États-Unis se montrent absents de certains dossiers. Par exemple, la façon dont le dossier iranien a été traité témoigne d’une coopération internationale exemplaire à laquelle la Russie a été associée. Ainsi, lorsque des intérêts vitaux sont en jeu, il peut y avoir une conjonction internationale de très haut niveau. Il est toutefois regrettable que cela se produise de manière sélective, sans approche globale. C’est pour cette raison que je condamnais tout à l’heure la politique sélective que propose l’Union européenne.
Pour revenir à la question ukrainienne, personne ne tait ou ne cache les difficultés de l’Ukraine elle-même en termes économiques, d’inflation, d’endettement, sur ces dernières années. Il faut cependant reconnaître que cela n’est pas exclusivement lié à la crise ukrainienne et que cela renvoie aussi à une vingtaine d’années d’incurie.
La feuille de route de Minsk est vue comme un vœu pieu, mais jamais personne n’a proposé autre chose ; il n’y a pas de « plan B ». Les accords de Minsk ont le mérite d’exister, au moins a minima : l’objectif est de permettre un cessez-le-feu effectif, le retrait des armes lourdes – la Russie a là un rôle éminent à jouer ici – et le déploiement des observateurs de l’OSCE de part et d’autres de la ligne de cessez-le-feu, afin d’exercer un contrôle effectif et en retour d’exiger de l’Ukraine les élections locale, le statut spécial du Donbass et sa constitutionnalisation.
Quant à l’intérêt de la France au sein de l’Europe, comme la situation actuelle le démontre, la forme actuelle de l’Europe rend difficile de combiner identité européenne et intérêts nationaux. La volonté de mener une politique européenne de sécurité, sans en avoir les moyens, pour s’en remettre ensuite à des États pour proposer des solutions, créé un décrochage. Il y a là une véritable contradiction, soulignée par le rapport, qui en démontre à la fois la complexité et la difficulté, et qui explique les critiques que vous avez formulées.
Ce rapport aurait pu être plus audacieux sur un certain nombre de propositions, c’est tout à fait possible et j’en prends acte. Mais sur certains points, et notamment le fait de lier les aides européennes versées à l’Ukraine à l’application effective des accords de Minsk, il propose un élément nouveau et fort.
Nous n’avons pas tous la même analyse. On connaît la position du président Thierry Mariani sur la levée des sanctions. Sur cette question, je vous suggère de prendre connaissance du document élaboré par le Sénat, qui va dans le même sens que la résolution de l’Assemblée nationale, mais qui est plus développé.
Mon travail sur ce rapport m’a appris beaucoup de choses et permis de voir la complexité des problématiques rencontrées. Nous n’avons pas abordé dans le détail toutes les questions. Il y a beaucoup de sujets que l’on pourrait développer. Cela démontre que nous sommes dans un monde qui évolue très vite et que la situation internationale est beaucoup plus fluctuante qu’elle ne l’était il y a quelques années.
Quant à la Russie, nous continuons d’avoir avec elle des relations qui dépassent le seul cadre économique, car elles sont aussi culturelles. Le lycée français Alexandre Dumas de Moscou fonctionne bien, même si nous rencontrons quelques difficultés à Saint-Pétersbourg. De très belles expositions organisées par la fondation Vuitton et portant sur les impressionnistes vont avoir lieu à Saint-Pétersbourg et à Moscou.
M. Thierry Mariani. S’agissant du rapport, je ne souscris pas à tout ce qui est dedans. Nous faisons de la politique, nous avons le droit d’avoir des opinions divergentes. Néanmoins, je voterai la publication, car le travail est sérieux et complet.
Je souhaite juste revenir sur les origines de la situation en Ukraine, avec un peu d’ironie car cela le mérite. Tout a commencé le jour où le président de l’époque, M. Ianoukovytch, a déclaré du jour au lendemain qu’il ne pourrait pas appliquer l’accord d’association avec l’Union européenne. Et les gens se sont soulevés pour imposer l’accord d’association. L’Union européenne a soutenu cette révolution. Or, quelle a été ensuite l’une des premières décisions de la nouvelle majorité ? Repousser au 1er janvier 2016 l’application de l’accord d’association…
Il ne faut pas être naïf, l’implication de certains de nos amis européens et américains dans le début de cette affaire est flagrante. Les écoutes téléphoniques, dévoilées par les Russes, le montrent clairement : on se souvient de Mme Nuland expliquant qui devrait ou non être membre du nouveau gouvernement ukrainien. En réalité, je crains que pour réaliser la prédiction M. Brezinski, conseiller de plusieurs présidents américains, on n’ait réussi à créer une nouvelle fracture en Europe, qui nous affaiblit tous.
M. Paul Giacobbi, président. Je rappelle que ce qui est mis aux voix est simplement l’autorisation de publier ce rapport, complété de l’opinion dissidente du président. Il ressort du débat que nous avons eu et qui sera retranscrit que ce rapport est excellent. Tout le monde n’est pas d’accord sur tout, mais la qualité du travail des membres de la mission, de son président et de son rapporteur, doit être soulignée.
La commission autorise la publication du rapport d’information à l’unanimité.
CONTRIBUTION PRÉSENTÉE PAR M. THIERRY MARIANI, PRÉSIDENT DE LA MISSION
En préambule, Thierry Mariani, président de la mission d’information, tient à saluer le travail de qualité effectué par le rapporteur, Jean Pierre Dufau.
Dans un contexte de tensions entre la Russie et les pays occidentaux, il se félicite que la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale se soit saisie d’une question centrale : la crise ukrainienne et l’avenir de nos relations avec la Russie, partenaire historique et incontournable.
Comme l’introduction le souligne, « il y a donc des enjeux considérables et, sans doute, des opportunités pour notre pays pour faciliter la pacification des relations Union européenne-Russie et la recherche d’un nouveau partenariat ».
Aussi partage-t-il le constat dressé par le rapporteur concernant la nécessité de renforcer nos relations avec la Russie. Il souscrit également aux remarques du rapporteur concernant les « maladresses du Partenariat oriental » et l’échec évident de la « politique de voisinage » en Ukraine.
Par ailleurs, le président de la mission d’information préconise, comme l’a souligné le rapporteur, d’éviter les propos provocateurs qui pourraient donner à l’Ukraine une lueur d’espoir quant à une éventuelle adhésion à l’OTAN dans le contexte présent du sommet de cette organisation.
*
Néanmoins, Thierry Mariani, président de la mission d’information, ne peut s’associer à l’ensemble des orientations et des conclusions de ce rapport qui tend à faire peser sur la Russie uniquement la quasi-totalité des responsabilités du règlement de la crise ukrainienne. Par la présente contribution, il souhaite donc faire mention d’un certain nombre de remarques.
1. En ce qui concerne le conflit dans le Donbass et l’application des accords de Minsk, le président de la mission reconnaît qu’il s’agit d’une étape vers la paix. C’est tout à l’honneur de la France que d’avoir permis la conclusions de ces accords.
Les accords de Minsk imposent à la Russie et l’Ukraine de faire respecter un cessez-le-feu dans le Donbass, ce qui a permis une réduction notable des affrontements militaires entre les deux camps. Malheureusement, comme le souligne le Rapporteur, le « cessez-le-feu n’est pas toujours acquis ». De toute évidence, la Russie et l’Ukraine ont une part de responsabilité partagée.
Du reste, le président de la mission tient à rappeler que l’Ukraine est également soumise à un certain nombre d’obligations dans le cadre des accords de Minsk, à savoir le vote d’un certain nombre de réformes (vote d’une loi d’autonomie pour le Donbass, vote d’une loi d’amnistie pour la réconciliation et vote d’une loi électorale). Sur ce point, rien ne justifie qu’aucune réforme législative, telles qu’elles étaient prévues par les accords de Minsk, n’ait été adoptée par l’Ukraine.
En effet, le président de la mission souligne que rien n’est mis en œuvre concrètement par le gouvernement ukrainien aujourd’hui pour faire adopter les réformes attendues. Il tient à faire remarquer que ces obligations ne sont pas une priorité pour la Rada qui n’a visiblement aucune envie de les adopter. Il rappelle que le parlement ukrainien, bien loin de remplir ses obligations, préfère se trouver d’autres priorités comme par exemple voter le 16 juin 2016 une loi imposant aux radios des quotas de chansons à diffuser quotidiennement en langue ukrainienne… Les accords de Minsk peuvent attendre !
Aussi, le président de la mission d’information regrette-t-il que seule la responsabilité russe soit véritablement mise en cause à travers les sanctions européennes. Comme le souligne le rapport, « lors du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015, les dirigeants européens sont convenus, dans leurs conclusions, que la durée des sanctions économiques adoptées le 31 juillet 2014 "devrait être clairement liée à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk" ».
Or, la responsabilité de l’Ukraine dans la non-application des accords de Minsk doit également être clairement mise en lumière. Cette non-application bloque durablement tout le processus des accords de Minsk, transformant progressivement la situation dans l’est de l’Ukraine en conflit gelé.
Parallèlement, indépendamment des événements dramatiques survenus en Ukraine, les sanctions, contraires aux intérêts fondamentaux des relations franco-russes, décidées par l’Union européenne et fortement encouragées par les États-Unis, n’ont pour effet que de détériorer les relations économiques qui lient la France et la Russie.
La recommandation n° 1 du Rapporteur étant de « conserver la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk comme priorité de la politique française vis-à-vis de l’Ukraine et de la Russie », le président de la mission d’information estime que, dans un souci d’équité, il serait également nécessaire de prendre des sanctions contre l’Ukraine dans la mesure où ce pays ne fait pas de l’application des accords de Minsk une ardente obligation. Autre solution préconisée : si les sanctions ne s’appliquent pas aux deux protagonistes, il convient de lever les sanctions inutiles et dangereuses prises contre la Russie.
S’agissant des sanctions contre la Russie, il rappelle que l’Assemblée nationale a voté, le 28 avril 2016, en faveur de la résolution invitant le Gouvernement à ne pas renouveler les mesures restrictives et les sanctions économiques imposées par l'Union européenne à la Fédération de Russie. Une résolution a également été adoptée au Sénat le 8 juin dernier. En votant ce texte, les parlementaires français ont pu s’exprimer pour la première fois sur ce dossier. Il conviendrait de ne pas ignorer ce vote du Parlement.
2. En ce qui concerne la politique étrangère de la Russie et le développement de son « soft power », le président de la mission d’information regrette les termes du rapport qui laissent entendre que la Russie mène une politique étrangère « fondée sur un discours anti-occidental ».
En effet, le rapport précise que « la Russie s’est lancée à partir de 2014 dans une politique étrangère "décomplexée" de puissance parfois agressive. Cela a été, successivement, l’annexion de la Crimée le soutien aux séparatistes du Donbass, l’intervention militaire en Syrie ». Thierry Mariani précise que la politique menée par la Russie n’est qu’une faible réponse à l’élargissement à l’est de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne. Au regard de la très nette évolution, ces 30 dernières années, de la sphère d’influence américaine, il constate que la réponse russe est relativement mesurée. Il s’inquiète de la politique offensive de l’OTAN vis-à-vis de la Russie qui conduit à une escalade verbale pour le moins dangereuse.
Par ailleurs, qualifier d’agressive l’intervention russe en Syrie n’est pas du tout approprié. Il convient de rappeler que cette intervention a permis d’inverser le cours de la guerre contre l’État islamique dans ce pays.
En matière d’interventionnisme, les États-Unis sont, de toute évidence, plus actifs que les Russes. Il nous suffit de comptabiliser le nombre d’interventions extérieures. Faut-il rappeler le prétexte avancé par les Américains pour envahir l’Irak en 2003, qui a consisté à fabriquer de fausses preuves de présence d’armes de destruction massive ?
Concernant le « soft power » russe, la Russie en a en effet intégré les règles, notamment la nécessité de développer l’influence dans les médias. Ainsi, constate-t-on une politique offensive en matière de relations médiatiques de la Russie dans un certain nombre de pays, et cette politique est soutenue par l’opinion publique russe. Néanmoins, le « soft power » n’atteint pas l’importance de la propagande et des compagnes d’influence organisées par les États-Unis via le financement d’ONG pseudo-indépendantes, notamment dans les pays de l’Europe de l’est.
3. Enfin, en ce qui concerne la Crimée, tout au long du rapport, il est fait mention d’une « annexion illégale de la Crimée par la Russie ». Or, Thierry Mariani rappelle que le referendum du 16 mars 2014 a légitimé le rattachement de la péninsule de Crimée et a permis d'éviter des violences comme celles qui déchirent l’est de l'Ukraine.
Même si ce referendum a été organisé dans des conditions qui peuvent être discutables, notamment dans la précipitation, il n’en demeure pas moins que le résultat reflète la réalité historique et le sentiment largement partagé de la population en Crimée, majoritairement russe. Parler systématiquement d’« annexion de la Crimée » revient à passer sous silence cette réalité historique et culturelle.
Le président de la mission d’information note que les principes fondamentaux du droit international et l’inviolabilité des frontières sont trop souvent à géométrie variable. Il souligne en effet que dans le cadre du conflit yougoslave, ces principes n’ont pas entraîné les mêmes susceptibilités pour le Kosovo.
Sous réserve des remarques évoquées ci-dessus qu’il aurait souhaité voir formulées dans ce rapport, Thierry Mariani est bien sûr favorable à sa publication même s’il regrette qu’il manque d’équilibre concernant l’application des accords de Minsk, remettant ainsi en cause les engagements fondamentaux de la France dans cette région et vis-à-vis d’un partenaire incontournable, la Russie.
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES PAR LA MISSION
À Paris (par ordre chronologique) :
Ø MM. Guillaume Chabert, chef du service des affaires multilatérales et du développement à la direction générale du Trésor (ministère de l’économie), et Geoffroy Cailloux, adjoint au chef du bureau « endettement, financement international et secrétariat du Club de Paris », ainsi que Mme Carole Vachet, adjointe au chef du bureau « Turquie, Balkans, CEI et Moyen-Orient »,
Ø MM. Philippe de Suremain, ancien ambassadeur en Ukraine (2002-2005), président de l’Association française des études ukrainiennes, et Jacques Faure, ancien ambassadeur en Ukraine (2008-2011),
Ø M. Éric Fournier, directeur de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères et du développement international, et Mlle Joanna Bouyé, rédactrice chargée de la Russie,
Ø M. Denis Stoumen, auteur de travaux universitaires sur la question linguistique en Ukraine,
Ø Le contre-amiral Alain Christienne, sous-directeur de l’exploitation à la direction du renseignement militaire au ministère de la défense, et le capitaine de frégate Éric Fournaud,
Ø MM. Julien Nocetti, chercheur à l’IFRI, et Jean-Claude Allard, directeur de recherche à l’IRIS,
Ø M. Bernardo Sanchez Incera, co-président du conseil des affaires France-Russie, directeur général délégué de la Société générale,
Ø Mme Tatiana Kastouéva-Jean, chercheuse à l’IFRI,
Ø M. Julien Buissart, chef du bureau « Turquie, Balkans, CEI et Moyen-Orient » du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises de la direction générale du Trésor, et Mme Carole Vachet, son adjointe.
En Ukraine (du 20 au 23 mai 2015) :
À Kiev :
Ø Son Exc. Alain Rémy, ambassadeur, et ses collaborateurs, en particulier M. Christian Bec, deuxième conseiller,
Ø La communauté d’affaires française,
Ø Mme Hanna Hopko, présidente de la commission des affaires étrangères de la Rada, Mme Ivanna Klympush-Tsintsadze, première vice-présidente, et leurs collègues,
Ø M. Boris Kolesnikov, « Premier ministre » du « shadow cabinet » de l’opposition,
Ø Son Exc. Ertuğrul Apakan, chef de la Mission spéciale de surveillance en Ukraine de l’OSCE,
Ø Son Exc. Heidi Tagliavini, représentante de l’OSCE au Groupe de contact trilatéral,
Ø MM. Vadim Karassev, directeur de l’Institut des stratégies globales, Mykhaïlo Bassarab, expert politologue de First Rating System, Vadym Trioukhan, expert associé en politique internationale du Centre international des études politiques, et Dmytro Ostroouchko, directeur des programmes internationaux à l’Institut Gorshenin,
Ø M. Olexii Gontcharenko et Mme Aliona Shkroum, députés, co-présidents du groupe d’amitié avec la France à la Rada, et leurs collègues,
Ø M. Makeev, directeur politique au ministère des affaires étrangères,
Ø M. Olexandr Lytvynenko, secrétaire-adjoint du Conseil de sécurité et de défense nationale.
À Kramatorsk :
Ø M. Mykhaïlo Slivka, gouverneur-adjoint de la région de Donetsk.
À Sieverodonetsk :
Ø M. Klimenko, gouverneur-adjoint de la région de Louhansk,
Ø Mmes Guichard et de Vaulchier et M. Marquette, observateurs (de nationalité française) dans la Mission spéciale de surveillance en Ukraine de l’OSCE.
En Russie, à Moscou (les 31 mars et 1er avril 2016) :
Ø Son Exc. Jean-Maurice Ripert, ambassadeur, et ses collaborateurs, notamment MM. Frédéric Mondoloni, ministre conseiller, Nicolas de Lacoste, premier conseiller, et Anselme Imbert, adjoint au chef du service économique régional, ainsi que Mmes Mathilde de Germain, premier secrétaire, et Marie-Nil Chounet, stagiaire de l’École nationale d’administration,
Ø Son Exc. Vygaudas Usackas, chef de la délégation de l’Union européenne, et ses collaborateurs,
Ø M. Boris Gryzlov, plénipotentiaire du président russe pour la résolution du conflit dans la partie orientale de l’Ukraine, et ses collaborateurs,
Ø M. Andreï Kortounov, directeur général du Conseil russe pour les affaires internationales,
Ø M. Alexeï Pouchkov, président de la commission des affaires étrangères de la Douma, et ses collaborateurs
Ø MM. Sergueï Mironov, député, président du groupe parlementaire « Russie juste », et Alexandre Romanovitch, vice-président de la Douma,
Ø Mme Veronika Nikichina, membre de la Commission économique euro-asiatique, ministre du commerce,
Ø M. Grigori Karassine, vice-ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie,
Ø Les représentants de la société civile, MM. Lev Goudkov (du centre Levada), Kirill Koroteev (de l’ONG Memorial), Serguey Nikitine (d’Amnesty International) et Grigory Melkoniants (de l’ONG Golos).
*
Le président et le rapporteur remercient chaleureusement les ambassadeurs de France à Kiev et à Moscou et leurs équipes pour leur aide irremplaçable dans l’organisation de ces déplacements et leur accueil.
1 () Commission des affaires étrangères, XIVème législature, février 2014, rapport d’information n° 1793.
2 () Voir : http://www.diploweb.com/forum/ukraine06112.htm.
3 () Ces données proviennent d’un article de Denis Stoumen : « Les populations russophones d’Ukraine : une minorité linguistique ? », in « Gestion des minorités linguistiques dans l’Europe du XXIème siècle », aux éditions Lambert Lucas.
4 () Voir les études « NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis, but Reluctant to Provide Military Aid » et « Ukraine 2015: How We Approached Our Sample Design in Light of Insecurity in Eastern Ukraine », Pew Research Center, juin 2015.
5 () La France a rejoint le TNP en 1992.
6 () Voir « Crimée : une intégration problématique à l’espace russe », in Russie 2015 – Regards de l’observatoire franco-russe.
7 () Voir RBK, 20 octobre 2015.
8 () Le mandat de l’OSCE a été renouvelé une deuxième fois le 18 février 2016 pour 12 mois, avec la possibilité, le cas échéant, d’un renforcement des effectifs de sa mission d’observation à 1 000 observateurs (sachant qu’en réalité, en mars 2016, on décomptait 725 observateurs, dont 18 Français) ; de plus la France et l’Allemagne lui fournissent désormais des images satellitaires et elle utilise également des drones d’observation. Le budget annuel de cette mission s’élève à 99 millions d’euros.
9 () Voir l’audition de notre ambassadeur à Moscou, Jean-Maurice Ripert, par la commission des affaires étrangères le 30 mars 2016, compte-rendu n° 60.
10 () Voir l’audition de notre ambassadeur à Moscou, S. E. Jean-Maurice Ripert, par la commission des affaires étrangères le 30 mars 2016, session ordinaire 2015-2016, compte-rendu n° 60.
11 () Voir par exemple le rapport 2014/2015 d’Amnesty International.
12 () Session ordinaire 2015-2016, commission des affaires étrangères, compte-rendu n° 60.
13 () Session ordinaire 2015-2016, commission des affaires étrangères, compte rendu n° 44.
14 () Session ordinaire 2015-2016, commission des affaires étrangères, compte rendu n° 64.
15 () Sixth progress report on Ukraine’s implementation of the action plan on visa liberalization. 18 décembre 2015, COM(2015) 905 final.
16 () L’évaluation en parité de pouvoir d’achat utilise un taux de change fictif qui égalise les pouvoirs d’achat des monnaies, de sorte que l’on peut effectivement comparer les niveaux de vie réels dans les différents pays.
17 () « I am concerned about Ukraine’s slow progress in improving governance and fighting corruption, and reducing the influence of vested interests in policymaking. Without a substantial new effort to invigorate governance reforms and fight corruption, it is hard to see how the IMF-supported program can continue and be successful. Ukraine risks a return to the pattern of failed economic policies that has plagued its recent history. It is vital that Ukraine's leadership acts now to put the country back on a promising path of reform ».
18 () D’après un document du service agricole de l’ambassade américaine à Kiev.
19 () Données extraites de « BP Statistical Review of World Energy », juin 2014 et juin 2015.
20 () Les décisions d’arbitrage sont attendues pour 2016. Naftogaz aussi a présenté des demandes, qui s’élèvent à plus de 16 milliards de dollars, au motif que le gaz russe lui serait surfacturé, tandis que les droits de transit par l’Ukraine seraient insuffisamment valorisés.
21 () Bruxelles, 25/3/2015, SWD (2015) 74 final, « Implementation of the European Neighborhood Policy in Ukraine – Progress in 2014 and recommendations for action ».
22 () Elle porte formellement sur la condamnation des systèmes totalitaires communiste et nazi et la prohibition de la propagande de leurs symboles.
23 () Voir : http://www.osce.org/fom/158581.
24 () Voir : http://www.osce.org/fom/151321.
25 () Voir notamment sur ces réformes : « L’état actuel de l’armée russe », par Rouslan Pouchkov, in Russie 2015 – Regards de l’Observatoire franco-russe ; « Que vaut l’armée russe ? », par Isabelle Facon, in Politique étrangère, janvier 2016.
26 () Selon « BP Statistical Review of World Energy », juin 2015.
27 () Source : note de la direction générale du Trésor, « État du système bancaire russe à mi-2015 », août 2015.
28 () Voir infra dans le présent rapport pour la présentation plus détaillée de ces sanctions.
29 () FMI, août 2015, Country Report N° 15/211.
30 () Études économiques de l’OCDE – Fédération de Russie.
31 () Source : note de la direction générale du Trésor, « État du système bancaire russe à mi-2015 », août 2015.
32 () Selon « World-Mining-Data », par International Organizing Committee for the World Mining Congresses, Vienne 2014.
33 () Source : Annuaire 2013 de la FAO.
34 () Selon le « Bilan énergétique de la France pour 2014 », publié par le Commissariat général au développement durable en juillet 2015.
35 () Russie.Nei.Visions n° 86, « Les nouvelles alliances énergétiques russes : mythes et réalités », juillet 2015, IFRI.
36 () Ancien vice-ministre de l’énergie, chef de département à la commission fédérale pour l’énergie et président du think tank russe Institut de politique énergétique.
37 () Voir l’étude « NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis, but Reluctant to Provide Military Aid », Pew Research Center, juin 2015.
38 () « La mise en œuvre de la loi dite "sur les agents de l’étranger" », in Russie 2015-Regards de l’Observatoire franco-russe.
39 () Une autre personnalité a été élue récemment, en 2013, maire d’une grande ville russe en battant le candidat « officiel », M. Evgueni Roïzman à Iekaterinbourg, 4ème ville du pays, mais il semble d’agir plutôt d’une personnalité indépendante (et originale) que d’un véritable opposant.
40 () L’application de la peine de mort est suspendue en Russie depuis 1996, mais son rétablissement est régulièrement demandé par plusieurs partis politiques (le PLD, mais aussi le Parti communiste), notamment contre les terroristes.
41 () Centre d’Analyse, de prévision et de stratégie (CAPS), note 366 du 20 octobre 2015 : « Prendre au sérieux la phobie russe des révolutions de couleur ».
42 () Voir : http://eeas.europa.eu/euvsdisinfo/.
43 () « Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination », Center on Global Interests, mai 2015.
44 () Député européen élu sur une liste du Front national, récemment démissionnaire de ce parti.
45 () Voir : https://fr.sputniknews.com/analyse/201403161022770663-en-direct-de-la-crimee-a-chauprade-temoigne/.
46 () Voir par exemple : http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2014/06/04/moscou-paris-vienne-les-rencontres-daymeric-chaupradeconseiller-de-marine-le-pen/.
47 () « Le concept de "monde russe" », par Alexeï Miller, in Russie 2015–Regards de l’observatoire franco-russe.
48 () Source : « Vingt ans après – La Russie et la quête de puissance », par Marie Mendras, Commentaire n° 136, hiver 2011-2012.
49 () House of Lords, European Union Committee, 6th Report of Session 2014-2015, « The EU and Russia : before and beyond the crisis in Ukraine », février 2015, voir les paragraphes 107-109.
50 () Centre d’Analyse, de prévision et de stratégie (CAPS), note 366 du 20 octobre 2015 : « Prendre au sérieux la phobie russe des révolutions de couleur ».
51 () Traduit par Médiapart.
52 () « Ivan Ilyine, l’inspirateur secret du poutinisme », Revue des deux mondes, septembre 2015.
53 () « Les facteurs intérieurs de la politique étrangère russe », Russie.Nei.Visions n° 84, avril 2015.
54 () « Eurasias’s Coming Anarchy », in Foreign Affairs, mars-avril 2016.
55 () Le texte exact de la citation est le suivant: « For the more chaos he [le régime russe] can generate abroad, the more valuable the autocratic stability he provides at home will appear. Russians may know in the abstract that a freer society is preferable, but they fear the risks of such a transition ».
56 () Tirées de « Sanctions on Russia Cause Minimal Declines in EU and U.S. Exports Office of the Chief Economist, U.S. Department of State », 6 juillet 2015.
57 () On arrive à ce résultat en combinant les données suivantes : les exportations vers la Russie représentaient en moyenne 2,46 % des exportations des États membres (chiffre du premier trimestre 2014, juste avant les sanctions) ; au premier trimestre 2015, ces exportations européennes vers la Russie ont en moyenne baissé de près de 46 % par rapport au même trimestre en 2014 ; mais cette baisse est essentiellement le corollaire de la chute des prix du pétrole et serait due pour 20 % au plus à l’effet des sanctions. L’impact des sanctions est donc de 2,46 % * 46 % * 20 %, soit 0,22 % de baisse moyenne des exportations mondiales des États membres.
58 () Le chiffre du commerce extérieur, Études et éclairages, n° 55, mars 2015.
59 () Assemblée nationale, XIVème législature, rapport n° 3058, septembre 2015.
60 () Il citait les annexions de l’Érythrée en 1962 par l’Éthiopie, du Sahara occidental par le Maroc en 1975, du Sikkim par l’Inde et du Timor oriental par l’Indonésie la même année, du plateau du Golan et de Jérusalem-Est par Israël en 1981-1982, enfin du Koweït par l’Irak en 1990.
61 () Extrait de la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
62 () Lettre Trésor-Éco, n° 150, juillet 2015, « Sanctions économiques : quelles leçons à la lumière des expériences passées et récentes ? »
63 () Traduction par Mediapart.
64 () On peut faire à cet égard un parallèle avec le conflit chypriote : la division en deux de Chypre n’a pas empêché l’adhésion à l’Union européenne de la seule partie internationalement reconnue, la partie grecque ; il n’y a que si un compromis de réunification est trouvé entre Grecs et Turcs chypriotes que la partie turque, en bénéficiant de garanties institutionnelles dans un État chypriote réunifié, pourra peser sur sa politique étrangère et sur celle de l’Union européenne.
65 () Session ordinaire 2015-2016, commission des affaires étrangères, compte-rendu n° 60.
66 () Session ordinaire 2015-2016, commission des affaires étrangères, compte-rendu n° 64.
67 () Session ordinaire 2015-2016, commission des affaires étrangères, compte rendu n° 44.
68 () Compte tenu du droit de veto des membres permanents du Conseil.
69 () Voir Euronews, 3 octobre 2014, interview du président Loukachenko par Sergio Cantone.
70 () Voir l’article éponyme in Russie 2015 – Regards de l’observatoire franco-russe.
71 () Russie.Nei.Visions n° 92, « La Russie, la Chine et les BRICS : une illusion de convergence ? », mars 2016, IFRI.
72 () « La saison des soldes est ouverte ! Notre partenaire oriental vient de s’offrir 115 000 hectares de terres russes en location en Transbaïkalie ! », aurait lancé ironiquement le journal Novaya Gazeta rapporté par Courrier international du 26 juin 2015.
73 () In Russie 2015 – Regards de l’Observatoire franco-russe, « Russes et russophones en ex-URSS : un enjeu stratégique », par David Teurtrie.
74 () Traduit dans Courrier international n° 1296 du 3 au 9 septembre2015.
75 () In Russie 2015 – Regards de l’Observatoire franco-russe, article « Russie-Chine : des mouvements tectoniques ».
76 () Voir : « Japon et Russie : un rapprochement contrarié », Note de l’Observatoire franco-russe n° 13, avril 2016.
77 () Respectivement directeur de recherche à l’IRIS et chercheur à l’IFRI.
78 () Voir l’audition du général Didier Castres le 8 décembre 2015 par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, session ordinaire 2015-2016, compte-rendu n° 27.
79 () Session ordinaire 2015-2016, commission des affaires étrangères, compte-rendu n° 27.
80 () Session ordinaire 2015-2016, commission des affaires étrangères, compte-rendu n° 60.
81 () Voir notamment sa tribune du 21 octobre 2015.
82 () Publié dans The Guardian du 5 février 2016 et repris par Courrier international du 18-24 février 2016.
83 () Compte tenu du droit de veto des membres permanents du Conseil.
84 () Voir Russie.Nei.Visions n° 85, juin 2015 : « Les Kurdes : un relais d’influence russe au Moyen-Orient ».
85 () Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen COM(2003) 104 du 11 mars 2003 : « L’Europe élargie – Voisinage : vers un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l’Est et du Sud ».
86 () Assemblée nationale, juin 2015, rapport n° 2881, sur la proposition de résolution européenne sur la révision de la Politique européenne de voisinage, et texte de celle-ci, n° 2881-0.
87 () Assemblée nationale, mai 2015, rapport n° 2771 : « Pour une politique européenne de voisinage plus adaptée aux enjeux régionaux et nationaux ».
88 () Voir l’étude « NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis, but Reluctant to Provide Military Aid », Pew Research Center, juin 2015.
89 () Le 3 septembre 2015, Gazprom et plusieurs entreprises européennes, à savoir E.ON, BASF, Shell, OMV et Engie, ont signé un pacte d’actionnaires sur la construction de North Stream 2.
90 () Voir notamment « EU-Russia Common Spaces Progress Report 2012 », mars 2013.
91 () Audition de notre ambassadeur à Moscou, S. E. Jean-Maurice Ripert, par la commission des affaires étrangères le 30 mars 2016, compte-rendu n° 60.
92 () Selon le « Bilan énergétique de la France pour 2014 », publié par le Commissariat général au développement durable en juillet 2015.
93 () Tirées de « Sanctions on Russia Cause Minimal Declines in EU and U.S. Exports Office of the Chief Economist, U.S. Department of State, July 6, 2015 ».
94 () Assemblée nationale, XIVème législature, n° 3343.
95 () Sénat, session ordinaire de 2015-2016, n° 154.
96 () Assemblée nationale, juin 2015, rapport n° 2881, sur la proposition de résolution européenne sur la révision de la Politique européenne de voisinage, et texte de celle-ci, n° 2881-0.
97 () Assemblée nationale, mai 2015, rapport n° 2771 : « Pour une politique européenne de voisinage plus adaptée aux enjeux régionaux et nationaux ».
98 () Bruxelles, 18 novembre 2015, JOIN(2015) 50 final, communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Réexamen de la politique européenne de voisinage ».
© Assemblée nationale