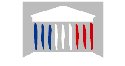
N° 4281
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 décembre 2016
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE,
sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence
et présenté par
MM. Dominique RAIMBOURG et Jean-Frédéric POISSON,
Députés.
____
___
Pages
INTRODUCTION 7
PREMIÈRE PARTIE : L’ÉTAT D’URGENCE : UNE PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE, UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE RENFORCÉ 11
I. L’INSTAURATION ET LES PROLONGATIONS SUCCESSIVES DE L’ÉTAT D’URGENCE 11
A. L’INSTAURATION ET LA PREMIÈRE PROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE : RÉAGIR VITE TOUT EN AMÉLIORANT UN OUTIL DATÉ 12
B. LES PROROGATIONS SUCCESSIVES : METTRE À JOUR ET AMÉLIORER LE DISPOSITIF INITIAL 17
C. UNE ÉVOLUTION PARALLÈLE DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 20
D. LA CONSTITUTIONNALISATION MANQUÉE DE L’ÉTAT D’URGENCE 21
II. L’INSTALLATION D’UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE INÉDIT ET TRANSPARENT 22
A. LES BASES JURIDIQUES DU CONTRÔLE 23
B. LES OUTILS DU CONTRÔLE 25
C. LES OBJECTIFS : UN CONTRÔLE « EN TEMPS RÉEL » ET TRANSPARENT 28
DEUXIÈME PARTIE : QUELLE APPLICATION DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 DEPUIS LE 14 NOVEMBRE 2015 ? 31
I. LES PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES : UNE UTILISATION MASSIVE ET DÉSORMAIS RÉDUITE 32
A. UN USAGE VARIABLE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE 33
1. Les perquisitions antérieures au 20 novembre 2015 33
2. Les perquisitions conduites entre le 20 novembre 2015 et le 25 mai 2016 35
3. Les perquisitions depuis le 21 juillet 2016 37
B. LE CADRE OPÉRATIONNEL ET LE RÉSULTAT DES PERQUISITIONS 39
1. Le ciblage des perquisitions 39
2. Le déroulement des perquisitions 41
a. Les acteurs de la perquisition 41
b. Les lieux perquisitionnés 42
c. Les horaires 43
d. Les mineurs 47
3. Les résultats 49
C. UN CADRE JURIDIQUE PROGRESSIVEMENT RENFORCÉ ET PRÉCISÉ 51
1. Les modifications législatives de novembre 2015 51
2. L’encadrement des perquisitions par le juge constitutionnel 52
3. Un contentieux rare 53
a. Le contentieux administratif 53
b. Le contentieux judiciaire 55
4. L’exploitation des données informatiques 56
a. Le cadre légal fixé par la loi du 21 juillet 2016 56
b. L’application par le juge 57
II. LES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE : UN USAGE IMPORTANT AFIN D’AFFAIBLIR LA MENACE TERRORISTE 61
A. LE RÉGIME JURIDIQUE DES ASSIGNATIONS 63
1. Un meilleur encadrement d’une mesure ancienne 63
2. La sanction des violations des mesures d’assignation 67
B. LA MISE EN œUVRE DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE 68
1. Le ciblage des personnes concernées 68
2. La mise en œuvre des assignations à résidence 69
a. La notification 69
b. Le débat contradictoire lors du prononcé de la mesure 70
c. Les facultés d’aménagement et de délivrance de sauf-conduits 71
d. Les abrogations 73
3. Un contrôle étendu du juge 74
a. Le contrôle des motivations des assignations 75
b. Le contrôle des modalités de mise en œuvre 77
C. LA DÉLICATE ARTICULATION DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS 78
1. L’articulation avec une autre mesure administrative 79
2. L’articulation avec des mesures judiciaires 79
a. L’assignation succède à une poursuite ou à une condamnation pénale. 79
b. L’assignation est concomitante d’une mesure judiciaire. 81
3. Le cas particulier des mineurs 82
III. UN USAGE VARIABLE DES AUTRES MESURES PRÉVUES PAR LA LOI DU 3 AVRIL 1955 84
A. DES OUTILS DE MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC ET DE SÉCURISATION DIVERSEMENT MOBILISÉS 84
1. Les mesures collectives 85
2. Les mesures individuelles 88
B. LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ ET LES FOUILLES DE VÉHICULES : UNE MESURE NOUVELLE UTILISÉE MASSIVEMENT PAR QUELQUES DÉPARTEMENTS 91
1. Une mesure introduite en juillet 2016 91
2. Une mise en œuvre concentrée dans quelques départements 92
C. LES AUTRES MESURES PRÉVENTIVES 94
1. Les remises d’armes 94
2. La fermeture provisoire de lieux de réunion 95
3. Les dissolutions d’association et les blocages de sites : des outils nouveaux mais guère utilisés 97
IV. LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L’ÉTAT D’URGENCE 99
A. L’AFFIRMATION RAPIDE DU CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF 99
B. LA SOLLICITATION DU JUGE CONSTITUTIONNEL 104
C. L’ÉCLAIRAGE DU JUGE EUROPÉEN 106
V. LA MOBILISATION DES SERVICES DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 108
A. LA CONFIRMATION DE L’EFFICACITÉ DES ÉTATS-MAJORS PRÉFECTORAUX 108
B. UN PILOTAGE CENTRAL « SOUS PRESSION » 111
TROISIÈME PARTIE : L’ÉTAT D’URGENCE À L’ÉPREUVE DU TEMPS 115
I. QUELLE EFFICACITÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ? 116
A. UNE RÉPONSE IMMÉDIATE NÉCESSAIRE 116
B. UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE DANS L’ARSENAL ANTI-TERRORISTE 117
1. La prééminence des outils de droit commun 117
2. Le renseignement recueilli au cours des perquisitions administratives 118
3. La déstabilisation de mouvances susceptibles d’apporter leur soutien aux terroristes 119
4. Un bilan modeste, en légère progression sur la dernière période de prorogation 120
II. LES CONSÉQUENCES DE LA PÉRENNISATION DE L’ÉTAT D’URGENCE 121
A. LIMITER LA DURÉE DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE 122
1. Les conditions de renouvellement des assignations à résidence 122
2. Vers des assignations « à durée indéterminée » ? 124
B. RECENTRER L’ÉTAT D’URGENCE 126
1. Une mise en œuvre de l’état d’urgence conforme à la rédaction très souple de la loi de 1955 126
2. Des utilisations assumées de l’état d’urgence pour maintenir l’ordre 127
3. Un recentrage souhaitable de l’état d’urgence pour en protéger le caractère exceptionnel 129
III. COMMENT « SORTIR » DE L’ÉTAT D’URGENCE ? 130
A. MAINTENIR UN MÉCANISME DE CADUCITÉ EN CAS DE DÉMISSION DU GOUVERNEMENT 130
B. LIMITER L’ÉTAT D’URGENCE DANS LE TEMPS 131
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 134
EXAMEN EN COMMISSION 137
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 151
LISTE DES DÉPLACEMENTS DES RAPPORTEURS 155
ANNEXE 1 : ASSIGNATION À RÉSIDENCE – MODALITÉS PRATIQUES 157
ANNEXE 2 : COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION DES LOIS SUR LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DE L’ÉTAT D’URGENCE 158
Vendredi 13 novembre 2015, la France a découvert, sidérée, les attaques terroristes dont elle était l’objet. Trois heures plus tard, le Président de la République prenait solennellement la parole pour annoncer plusieurs mesures, parmi lesquelles la déclaration de l’état d’urgence.
Il n’y a, depuis un an, pas été mis fin.
Depuis maintenant plus de douze mois, la France fait l’expérience de ce régime législatif d’exception, hérité de la IVe République et conçu pour faire face « aux événements » en Algérie. Aujourd’hui, l’état d’urgence est à la croisée des chemins : ce dispositif juridique d’exception s’inscrit désormais dans la durée, le Président de la République et le Premier ministre ayant annoncé qu’ils solliciteraient une nouvelle prorogation de l’état d’urgence en raison de la prégnance de la menace terroriste.
Appelée à se prononcer sur les prolongations de l’état d’urgence et l’adaptation de la loi qui l’organise, notre Commission s’est attachée à contrôler les mesures administratives prises par l’exécutif sur le fondement de l’état d’urgence. Ce dispositif original, car organisé dans le même temps que l’action gouvernementale, a été confié à vos deux Rapporteurs, l’un de la majorité, l’autre issu de l’opposition, respectivement président et vice-président de la Commission.
Le rapport qu’ils vous présentent aujourd’hui propose un bilan de cette année de contrôle. Il a été précédé de quatre communications d’étape et de la publication des comptes rendus des auditions auxquelles la commission des Lois avait procédé durant les six mois pendant lesquels elle a été dotée de prérogatives d’enquête spécifiques pour contrôler la mise en œuvre de l’état d’urgence (1).
Ce rapport a été conçu avec un souci constant de transparence. Certains n’y trouveront pas les réponses tranchées escomptées ; sur une matière aussi délicate – la juste conciliation de nos libertés et de notre sécurité dans un environnement marqué par la prégnance d’une menace élevée – vos Rapporteurs se sont toujours astreints à la mesure et à la prudence qu’implique un contrôle sans recul.
Parce qu’il n’est pas possible d’évaluer sans connaître, ce rapport a d’abord pour objet de dresser un panorama des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence depuis douze mois.
Sur ce point, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’est l’état d’urgence car des confusions existent parfois. Le public associe ainsi souvent ce terme à d’autres dispositifs, tels que le plan Vigipirate, les mesures de sécurité prises par des acteurs publics ou privés, l’opération Sentinelle ou encore l’arsenal pénal et administratif de droit commun, significativement renforcé au cours des dernières années pour contrer la menace terroriste à laquelle est exposé notre pays.
Pourtant, l’état d’urgence précisément défini par la loi du 3 avril 1955, consiste en douze mesures de police administrative (2), mises à la disposition du ministre de l’Intérieur et des préfets pour prévenir une menace à l’ordre et la sécurité publics. C’est au contrôle et au bilan de ces seules mesures que s’attache le présent rapport. Sur ce fondement, vos Rapporteurs se sont efforcés d’évaluer la plus-value de la loi du 3 avril 1955 dans la lutte contre le terrorisme.
Ce travail a pu être conduit grâce à l’introduction, en novembre 2015, d’un droit de contrôle parlementaire sur l’utilisation par l’exécutif de ces pouvoirs dérogatoires et grâce à la collaboration de tous les acteurs de l’état d’urgence dont vos Rapporteurs tiennent à souligner ici la disponibilité : les services centraux et déconcentrés du ministère de l’Intérieur, au premier chef, mais aussi les juridictions administratives, érigées par le législateur en gardiens de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prises pendant cette période d’exception, les services du ministère de la Justice, les procureurs de la République ou encore le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme et les associations.
Vos Rapporteurs ont été attentifs à la cohérence et à la fiabilité des données statistiques qu’ils présentent ; d’une part, en raison des modifications apportées aux différents dispositifs mis en œuvre et, d’autre part, au vu du changement de méthode de recueil des données intervenu en juillet dernier, il n’a cependant pas toujours été possible de collationner et d’exploiter les mêmes informations sur toute la durée de l’état d’urgence. Partant, il a été décidé de ne pas reconstituer – de façon potentiellement aléatoire – des ensembles mais d’asseoir le travail d’analyse, mesure par mesure, sur des séries statistiques robustes et certifiables. Les données exploitées ne visent pas l’exhaustivité mais proposent un éclairage suffisant sur les différentes mesures, propre à fonder une analyse à la fois en droit et en opportunité.
La connaissance acquise de la mise en œuvre des mesures prévues par la loi du 3 avril 1955 permet à vos Rapporteurs de formuler des préconisations sur certaines de ces dispositions.
Face à la durée exceptionnelle de l’état d’urgence, l’encadrement dans le temps des assignations à résidence leur paraît désormais s’imposer. De même, il paraît nécessaire à vos Rapporteurs d’engager une réflexion sur le recentrage de l’état d’urgence, par un meilleur fléchage des mesures prises sur son fondement, et sur les moyens de faciliter la « sortie » de cet état d’exception.
Cette sortie est rendue encore plus difficile par le fait que ce dispositif d’exception qu’aucun des acteurs ne connaissait lorsqu’il a été mis en œuvre, a désormais été « apprivoisé » par les services qui l’utilisent en complément de leurs prérogatives de droit commun et dans les limites que la justice administrative a rapidement posées.
Pour autant, on ne saurait se satisfaire d’une gestion routinière – à « bas bruit » – de cet état d’exception. Ce n’est que parce que l’état d’urgence a vocation à disparaître qu’il peut s’inscrire pleinement au sein de l’État de droit. Lors des débats parlementaires à l’occasion de l’examen du premier projet de loi de prorogation, le Premier Ministre, M. Manuel Valls indiquait que « la sécurité est la première des libertés. C’est pour cette raison que d’autres libertés ont été ou peuvent être temporairement limitées, dans une mesure strictement nécessaire » (3). Ce n’est pas qu’une formule : plusieurs milliers de nos concitoyens ont en effet eu à subir et certains subissent encore les conséquences concrètes de mesures prises en application de l’état d’urgence.
Ce rapport ne marque pas la fin du contrôle de la mise en œuvre de l’état d’urgence qu’assure notre Commission. En effet, vos Rapporteurs entendent poursuivre le suivi des mesures administratives prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955. Convaincus qu’on ne gagne pas à réformer le cadre juridique de l’état d’urgence « à chaud », sous le poids des circonstances dramatiques, ils s’attacheront également à poursuivre leur réflexion afin de donner corps aux préconisations de leur rapport qui ne peuvent toutes recevoir de traductions législatives immédiates.
PREMIÈRE PARTIE :
L’ÉTAT D’URGENCE : UNE PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE, UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE RENFORCÉ
En application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire, dans deux hypothèses : soit en cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », soit en cas d’« événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamités publiques ».
L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres, et non plus par la loi, depuis les modifications introduites par l’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960. Conformément à l’article 3 de la loi du 3 avril 1955, sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par une loi. Cette loi fixe « la durée définitive d’application de l’état d’urgence ».
Dès la déclaration de l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur et les préfets se voient dotés de pouvoirs de police étendus, c’est-à-dire qu’ils peuvent décider de mesures qui seraient déclarées illégales en temps ordinaires.
I. L’INSTAURATION ET LES PROLONGATIONS SUCCESSIVES DE L’ÉTAT D’URGENCE
À la suite des attentats meurtriers du 13 novembre 2015, le Président de la République a déclaré l’état d’urgence sur le territoire métropolitain à compter du 14 novembre, à zéro heure, par le décret n° 2015-1475 du même jour délibéré en Conseil des ministres. Un second décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015, pris dans les mêmes formes, a ensuite étendu le périmètre de ce régime d’exception aux cinq départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Initialement déclaré pour douze jours, soit jusqu’au 25 novembre 2015, à minuit, l’état d’urgence a été prorogé à quatre reprises :
– jusqu’au 25 février 2016, à minuit, par la loi du 20 novembre 2015 qui a également procédé à l’actualisation du régime des mesures de la loi du 3 avril 1955 (4) ;
– jusqu’au 25 mai 2016, à minuit (5), par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
– jusqu’au 25 juillet 2016, à minuit (6), par la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
– avec application immédiate à compter du 21 juillet, à zéro heure, et jusqu’au 20 janvier prochain, à minuit (7), par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.
D’ores et déjà, le Gouvernement a annoncé son intention de solliciter une cinquième prorogation de l’état d’urgence.
A. L’INSTAURATION ET LA PREMIÈRE PROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE : RÉAGIR VITE TOUT EN AMÉLIORANT UN OUTIL DATÉ
Adoptée au terme d’une lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat, la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 a autorisé une première prorogation de l’état d’urgence selon des modalités précises.
Comme l’a souligné le rapporteur public du Conseil d’État sur sept affaires concernant des contestations en référé d’assignations à résidence décidées par le ministre de l’Intérieur à l’occasion de la COP 21 (8), le projet de loi a parcouru « tambour battant les différentes étapes obligées » selon un calendrier « montrant les remarquables qualités d’adaptation des institutions de la République lorsque les circonstances l’exigent » : adopté en Conseil des ministres le 18 après un examen par le Conseil d’État la veille, le projet de loi a été débattu au sein de notre Commission quatre heures à peine après son dépôt, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 19 puis en première lecture au Sénat le 20, jour de sa promulgation (9).
Enserrés dans un temps aussi restreint, précédés de discussions informelles entre le Gouvernement et les rapporteurs de la commission des Lois de chaque assemblée (10),les débats ne furent pourtant pas bâclés : à l’Assemblée nationale, la commission des Lois se réunit durant quatre heures au cours desquelles elle adopta 18 des 40 amendements, suivies de près de cinq heures en séance publique, au cours de laquelle 67 amendements furent examinés et 15 adoptés.
L’examen de ce premier projet de loi de prorogation fut non seulement l’occasion de fixer la durée de l’état d’urgence mais aussi de moderniser l’outil qu’il constitue en le nettoyant de dispositions obsolètes, en y insérant à l’inverse de nouvelles et en adaptant certaines procédures.
L’article 1er de cette loi fixait à trois mois la durée de la prorogation, calculée à compter de la fin des douze premiers jours de l’état d’urgence. Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 avril 1955, la loi de prorogation de l’état d’urgence détermine la « durée définitive » de celui-ci. Elle doit donc fixer le temps de sa durée ; à l’expiration de ce temps, l’état d’urgence cesse de plein droit à moins, bien sûr, qu’une loi nouvelle n’en prolonge les effets.
Le point de départ de l’état d’urgence est, conformément au droit commun, soit le jour que le décret ou la loi de prorogation fixe, soit la date de la publication du décret ou de la promulgation de la loi – immédiates ou non. Cette durée se calcule de quantième à quantième (11). L’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 expirait ainsi le 26 novembre à zéro heure.
Les précédentes applications de l’état d’urgence IVe République 1955 L’état d’urgence a été déclaré en Algérie pour une période de six mois par la loi du 3 avril 1955, prorogé pour six mois par la loi n° 55-1080 du 7 août 1955 (1). Le décret n° 55-1147 du 30 août 1955 a ensuite étendu l’état d’urgence à tout le territoire algérien. La dissolution de l’Assemblée nationale le 1er décembre rendit immédiatement caduque la loi de prorogation, conformément à l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 alors applicable. 1958 À la suite du mouvement du 13 mai à Alger, l’état d’urgence a été déclaré en métropole pour trois mois par la loi n° 58-487 du 17 mai 1958 (2). Cette loi dérogeait aux dispositions de l’article 3 de la loi du 3 avril 1955 alors applicables pour prévoir une caducité immédiate de l’état d’urgence, et non au terme d’un délai de quinze jours, en cas de changement de Gouvernement. L’état d’urgence a pris fin le 1er juin, date du vote de la confiance au nouveau Gouvernement. Ve République 1961-1962 À la suite du « putsch des généraux », l’état d’urgence a été déclaré à compter du 23 avril 1961 par deux décrets nos 61-395 et 61-396 du 22 avril 1961. Le 24 avril, une décision du Président de la République, prise sur le fondement de l’article 16 de la Constitution prolonge l’état d’urgence jusqu’à nouvelle décision. Une seconde décision, prise sur le même fondement, du 29 septembre, eut pour effet de maintenir l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 1962. Enfin, une ordonnance n° 62-797 du 13 juillet 1962 (3) le prorogea jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mai 1963. La dissolution de l’Assemblée nationale le 9 octobre 1962 eut pour effet de mettre fin à l’état d’urgence « à l’issue d’un délai de quinze jours francs », soit le 25 octobre, conformément à la rédaction de l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 résultant de l’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960. 1985 L’état d’urgence a été déclaré en Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances par l’arrêté n° 85-35 du 12 janvier 1985 du haut-commissaire de la République, en application de l’article 119 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 (4) et de la loi du 3 avril 1955. Un délai supérieur à douze jours s’étant écoulé, cet état d’urgence a été rétabli (et non prorogé) à partir du 27 janvier et jusqu’au 30 juin 1985 par la loi du 25 janvier 1985 (5). 1986 L’état d’urgence a été déclaré le 29 octobre 1986 sur l’ensemble du territoire des îles de Wallis-et-Futuna par deux arrêtés de l’administrateur supérieur nos 117 et 118 pris à cette date, en application de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (6) et de la loi du 3 avril 1955. Il y a été mis fin, à compter du lendemain, par l’arrêté n° 120. 1987 L’état d’urgence a été déclaré le 24 octobre 1987 dans les communes de la subdivision des Îles du Vent en Polynésie française par deux arrêtés du haut-commissaire de la République nos 1214 CAB et 1215 CAB pris à cette date, en application de l’article 91 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 (7) et de la loi du 3 avril 1955. Il sera levé le 5 novembre, par l’arrêté n° 1285 CAB. 2005 L’état d’urgence a été déclaré, sur le territoire métropolitain, à compter du 9 novembre 2005 par deux décrets nos 2005-1386 et 2005-1387 pris le 8 novembre, et prorogé pour une durée de trois mois par la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 (8). Toutefois, un décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006 mit fin à l’application de l’état d’urgence à compter du 4 janvier, conformément à la faculté qui était offerte au pouvoir exécutif. (1) Loi n° 55-1080 du 7 août 1955 relative à la prolongation de l’état d’urgence en Algérie. (2) Loi n° 58-487 du 17 mai 1958 déclarant l’état d’urgence sur le territoire métropolitain. (3) Ordonnance n° 62-797 du 13 juillet 1962 prorogeant des décisions des 24 et 27 avril 1961 et modifiant l’ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958. (4) Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. (5) Loi n° 85-96 du 25 janvier 1985 relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances. (6) Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer. (7) Loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française. (8) Loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Sources : Rapport n° 2675 de M. Philippe Houillon (Assemblée nationale, XIIe législature) et rapport n° 3237 de M. Jean-Jacques Urvoas (Assemblée nationale, XIVe législature). |
Aucune disposition ne plafonne la durée pendant laquelle l’état d’urgence est prorogé : trois mois en 2005 et 2015, six mois en 1955 (12). Cette prorogation peut être renouvelée sans limitation. Il n’est alors pas besoin d’un nouveau décret présidentiel (13). Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis, « si les conditions de fond de l’état d’urgence sont toujours remplies, une nouvelle prorogation par la loi sera possible. Il reviendra au Parlement d’en décider au cas par cas ».
L’article 2 rendait expressément applicables les mesures de « l’état d’urgence aggravé », c’est-à-dire les perquisitions administratives prévues au I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955. Cet article 11 permet, en effet, « par une disposition expresse », de conférer aux autorités administratives deux prérogatives plus dérogatoires encore que les mesures exceptionnelles prévues par les autres articles : le préfet, ou plus rarement le ministre, peut ordonner des perquisitions domiciliaires, de jour comme de nuit. En outre, le ministre avait la faculté d’ordonner des mesures de contrôle de la presse écrite ou radiophonique. Cette mesure a été supprimée. En revanche, il lui est désormais possible de faire bloquer certains sites internet.
Le recours aux mesures complémentaires doit donc être prévu par le décret déclarant l’état d’urgence ou par la loi prorogeant celui-ci. Rien n’interdit toutefois au Parlement, tout en maintenant l’état d’urgence simple, de supprimer l’état d’urgence aggravé, comme on l’a vu, par la suite, avec la loi du 20 mai 2016.
L’article 3 permettait de mettre fin, de manière anticipée, à l’état d’urgence par décret en Conseil des ministres. Sans que la loi du 3 avril 1955 ne l’impose, les lois de prorogation comportent systématiquement, depuis 2005, une disposition expresse autorisant l’exécutif à mettre fin de la sorte à l’état d’urgence.
Au contraire, l’article 4 ne réglait pas, à proprement parler, les modalités de la prorogation mais procédait à l’actualisation du régime des mesures de la loi du 3 avril 1955. Il en a modifié substantiellement les articles 6, 9, 10, 11, 13, 14, a abrogé ses articles 7 et 12 et inséré trois nouveaux articles numérotés 4-1, 6-1 et 14-1.
On mentionnera plus particulièrement :
– le nouvel article 4-1 qui prévoit que le Gouvernement informe les deux assemblées des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, en temps réel ; la rédaction antérieure de la loi du 3 avril 1955 ne prévoyait, en effet, aucune information du Parlement sur la mise en œuvre des mesures de police administrative décidées en application de l’état d’urgence ;
– l’article 6 qui a été modifié afin de permettre au ministre de l’Intérieur d’assigner à résidence une personne à l’égard de laquelle « il existe de sérieuses raisons de croire que son comportement présente une menace », formule plus englobante que celle d’« activité s’avér[ant] dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics » ;
– l’article 7, prévoyant la possibilité pour les personnes visées par une interdiction de séjour ou une assignation à résidence d’introduire un recours administratif soumis à l’avis préalable d’une « commission consultative comprenant des délégués du conseil départemental désignés par ce dernier », et l’article 12, permettant de transférer à la juridiction militaire la compétence pour se saisir des crimes et des délits connexes relevant de la cour d’assises, qui ont été supprimés ;
– l’article 11 qui a été complété pour préciser la base légale – très lacunaire, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 septembre 2016 (14) – du régime juridique des perquisitions administratives et remplacer les dispositions sur le contrôle de la presse par un dispositif permettant au ministre de l’Intérieur d’ordonner l’interruption de tout site internet « provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie » ;
– l’article 13 qui a été modifié pour relever les quanta de peine en cas d’infraction à certaines mesures décidées dans le cadre de l’état d’urgence ;
– le nouvel article 14-1 qui a précisé que les mesures prises sur le fondement de l’état d’urgence sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, permettant notamment les recours en la forme de référé (15).
Enfin, les articles 5 et 6 de la loi du 20 novembre 2015 rendaient applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative les dispositions de la loi du 3 avril 1955 et en adaptaient les modalités.
B. LES PROROGATIONS SUCCESSIVES : METTRE À JOUR ET AMÉLIORER LE DISPOSITIF INITIAL
Trois autres lois de prorogation ont été votées par le Parlement depuis le mois de novembre 2015. Elles partagent, avec la loi du 20 novembre 2015, un point commun : toutes ont été débattues dans des délais extrêmement resserrés, compte tenu de la nécessité que la promulgation et l’entrée en vigueur interviennent avant le terme de l’état d’urgence. Elles n’ont pas toutes la même ampleur : seules les lois du 20 novembre 2015 et du 21 juillet 2016 comportent des dispositions de fond, tandis que les deux autres sont des prorogations « sèches ».
La loi du 19 février 2016 a prorogé, pour la deuxième fois, l’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 à zéro heure. Elle n’a modifié ni les territoires où ce régime d’exception est institué, ni le champ des mesures dérogatoires qui peuvent être prises et a procédé à une reconduction de trois mois.
La rédaction finale marque toutefois une différence formelle avec les précédents projets de loi de prorogation en 1985, 2005 ou 2015 : au lieu de deux ou trois articles fixant l’étendue de la prorogation (périmètre géographique et durée de la prorogation, mesures autorisées et, le cas échéant, modalités de cessation anticipée), la loi ne comporte qu’un article unique plus synthétique (16).
La loi du 20 mai 2016 a prorogé, une troisième fois, l’état d’urgence mais en s’inscrivant dans une logique de sortie. Il n’est en effet prolongé que pour une durée de deux mois supplémentaires et, conformément au souhait de l’un de vos Rapporteurs (17), il ne reconduit pas l’autorisation de procéder à des perquisitions administratives sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955. Deux raisons principales avaient alors convaincu le législateur. D’une part, cette mesure ne présentait plus le même intérêt opérationnel qu’au début de l’état d’urgence dès lors que, comme le précisait l’exposé des motifs du projet de loi correspondant, « la plupart des lieux identifiés ayant déjà fait l’objet des investigations nécessaires » et qu’il restait possible de recourir aux perquisitions judiciaires, dont les modalités ont été adaptées par la loi du 3 juin 2016 sur la procédure pénale (18). D’autre part, son efficacité avait été largement amoindrie par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 qui a censuré la copie des supports informatiques lors des perquisitions administratives.
Vos rapporteurs rappellent qu’il était alors envisagé de ne pas reconduire l’état d’urgence au-delà du 25 juillet 2016, compte tenu des nouvelles dispositions de droit commun votées par le Parlement dans le cadre de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Le Président de la République avait indiqué son souhait que l’état d’urgence ne soit pas renouvelé après son terme, sauf nouvel événement grave, lors de la traditionnelle allocution du 14 juillet.
L’attentat dramatique perpétré à Nice, le soir même, a conduit le Gouvernement à solliciter une nouvelle prorogation par le Parlement de l’état d’urgence, débattue au terme d’une navette de quelques jours (19) et votée dans la loi du 21 juillet 2016. La durée initiale de cette prorogation, fixée à trois mois dans le projet de loi, a été portée à six mois. L’article 1er autorise, à nouveau, les perquisitions administratives, dont le cadre est revu par l’article 5 qui crée un nouveau régime de saisie des données et des matériels informatiques, ouvre la faculté de faire des perquisitions « de rebond » et de maintenir la personne sur place le temps de la perquisition.
Les parlementaires ont entendu compléter les outils de l’état d’urgence. Élaboré en commission mixte paritaire, l’article 4 de cette loi a inséré un nouvel article 8-1 dans la loi du 3 avril 1955 ouvrant la possibilité aux préfets d’ordonner des contrôles d’identité et des fouilles de bagages et de véhicules sans réquisition préalable du procureur de la République.
Les garanties des justiciables ont également été renforcées. Inséré à l’initiative de nos collègues sénateurs, l’article 6 a légalisé la jurisprudence relative à la présomption d’urgence pour les recours en référé contre les mesures d’assignation à résidence. La délivrance d’une copie de l’ordre de perquisition à la personne concernée est désormais prévue par la loi.
Enfin, le contrôle parlementaire de l’état d’urgence a lui aussi franchi un pas supplémentaire, à l’initiative de l’un de vos Rapporteurs : l’article 2 de cette loi a complété l’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 pour prévoir que les autorités administratives transmettent au Parlement, sans délai, copie de tous les actes qu’elles prennent en application de l’état d’urgence.
Outre les dispositions modifiant la loi du 3 avril 1955, onze autres mesures intéressant la procédure pénale ou d’autres domaines forment un volet spécifique de la loi du 21 juillet 2016 :
– l’article 8 de cette loi a prévu des modalités d’aménagement de peine pour les personnes condamnées pour terrorisme, en interdisant aux personnes condamnées pour terrorisme le bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté, du régime de la semi-liberté et du placement à l’extérieur ainsi que des crédits automatiques de réduction de peine ;
– l’article 9 a complété la base légale de la vidéosurveillance des prisonniers placés en détention provisoire ;
– l’article 10 a augmenté la durée maximale d’assignation à résidence pour les personnes de retour d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes à l’étranger ;
– l’article 11 a supprimé la durée limite de l’interdiction de sortie du territoire ;
– l’article 12 a allongé les délais de détention provisoire pour les mineurs de plus de seize ans mis en cause dans des procédures terroristes ;
– l’article 13 a augmenté le quantum des peines applicables aux crimes terroristes, sans toutefois modifier la hiérarchie des peines ;
– l’article 14 a rendu obligatoire le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés pour terrorisme sauf décision expresse et motivée du juge ;
– les articles 15 et 17 ont corrigé des imperfections de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ;
– l’article 16 a adapté les conditions d’autorisation de l’armement des policiers municipaux ;
– les articles 18 et 19 concernaient la réserve : le premier étendait la réserve civile de la police nationale aux anciens adjoints de sécurité, tandis que le second augmentait les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale ;
– enfin, l’article 20, inséré par les sénateurs, a prévu que le Conseil supérieur de l’audiovisuel supervise l’élaboration d’un code de bonne conduite pour la couverture audiovisuelle des actes terroristes.
Vos Rapporteurs soulignent le nombre et la portée des mesures qui ont ainsi été adoptées, souvent à la demande des sénateurs, dans le cadre de l’examen d’une loi de prorogation. S’il est utile qu’une telle loi puisse, outre la prorogation stricto sensu, prévoir des aménagements indispensables de la loi du 3 avril 1955, ils n’estiment pas souhaitable qu’un véhicule législatif aussi particulier soit utilisé pour insérer des dispositions de droit commun, notamment lorsqu’elles intéressent des délits et des peines.
C. UNE ÉVOLUTION PARALLÈLE DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Plusieurs instruments juridiques, votés par le Parlement dans le cadre de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, doivent permettre aux services de sécurité et à la justice de faire face à la menace terroriste.
Le chapitre Ier du titre Ier du projet de loi a accru les prérogatives des magistrats spécialisés dans la lutte antiterroriste :
– les perquisitions de nuit dans les domiciles sont désormais autorisées en enquête préliminaire et en information judiciaire en matière terroriste (article 1er de cette loi) ;
– le parquet s’est vu reconnaître, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, des prérogatives quasiment équivalentes aux magistrats instructeurs, aussi bien en enquête de flagrance qu’en enquête préliminaire (article 4), leur permettant notamment d’avoir recours aux techniques de sonorisation et de captation d’images dans des lieux privés ou publics.
Les dispositions du projet de loi prévoyaient, par ailleurs, des mesures tendant à améliorer les conditions de la lutte contre le financement du terrorisme (chapitre IV du titre Ier).
Enfin, elles comportaient différentes mesures de police administrative, contenues dans le chapitre V du titre Ier, visant à renforcer les dispositifs de contrôle sur les personnes pour lesquelles existent des raisons sérieuses de penser que leur comportement est en lien avec des activités terroristes :
– le texte a modifié les articles 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale permettant la mise en œuvre de contrôles d’identité afin d’autoriser également dans ces cas l’inspection visuelle et la fouille des bagages ;
– il a créé une retenue administrative à l’article 78-3-1 du même code lorsqu’il existe, à l’égard d’une personne dont l’identité a été contrôlée ou vérifiée, des raisons de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste (article 48 de la loi) ;
– il a instauré un régime de contrôle administratif applicable aux personnes de retour sur le territoire national des théâtres d’opérations de groupements terroristes (article 52).
Vos Rapporteurs se félicitent des moyens supplémentaires ainsi octroyés aux services de police et à la justice. Les procédures judiciaires ouvertes, grâce aux dispositions de la loi du 3 juin 2016, permettront une lutte efficace contre la menace terroriste, en particulier lorsque l’état d’urgence aura pris fin.
D. LA CONSTITUTIONNALISATION MANQUÉE DE L’ÉTAT D’URGENCE
En dépit de son adoption en des termes voisins par les deux assemblées, la constitutionnalisation du régime juridique de l’état d’urgence, un temps envisagée dans le cadre du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, n’a pu aller à son terme.
L’article 1er du projet de loi constitutionnelle visait à introduire dans le titre V de la Constitution, consacré aux rapports entre le Parlement et le Gouvernement, un nouvel article 36-1 définissant les grandes lignes du régime juridique de l’état d’urgence.
Après l’examen par l’Assemblée nationale le 10 février 2016 et par le Sénat le 22 mars, cet article se composait de sept alinéas.
Le premier alinéa de l’article 36-1 reprenait les principaux éléments juridiques actuellement définis aux articles 1er et 2 de la loi du 3 avril 1955 : forme, périmètre territorial et motifs de la déclaration de l’état d’urgence.
Le deuxième alinéa a été modifié au Sénat par rapport à la version du projet de loi initial et complété par un septième alinéa. Ensemble, ils renvoyaient à la loi organique le soin de fixer « les mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles pour prévenir ce péril [imminent] » et imposaient que celles-ci soient « strictement adaptées, nécessaires et proportionnées ».
Cette rédaction n’aurait, toutefois, pas fait échec à l’interprétation, confirmée par le Conseil d’État dans ses décisions du 11 décembre 2015, en vertu de laquelle n’est pas requis un lien direct entre la nature du péril imminent ayant conduit à la déclaration d’état d’urgence et les justifications des mesures de police administrative prises en application de l’état d’urgence. Les débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale, au cours desquels ont été rejetés des amendements proposant l’instauration d’un lien direct entre, d’une part, les événements ou le péril imminent ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence et, d’autre part, la finalité des mesures de police prises en application de la loi du 3 avril 1955, ont en effet conduit à exclure une telle interprétation.
Sans guère apporter au droit positif, le troisième alinéa rappelait qu’il « ne peut être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l’article 66 ».
Le quatrième alinéa de l’article 36-1 traitait des conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en œuvre de l’état d’urgence. Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale de plusieurs amendements, il prévoyait la réunion de plein droit du Parlement pendant la durée de l’état d’urgence ; celle-ci devait permettre, au-delà de la mise en œuvre du contrôle parlementaire, la possibilité d’examiner et d’adopter une proposition de loi qui mettrait fin à l’état d’urgence ou qui modifierait un aspect du régime juridique de l’état d’urgence, voire celle, pour l’Assemblée nationale, d’engager la responsabilité du Gouvernement.
Pour lever toute incertitude liée à l’ordre du jour, la rédaction modifiée par le Sénat disposait en outre que, pendant la durée de l’état d’urgence, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l’état d’urgence étaient inscrits par priorité à l’ordre du jour à l’initiative de la Conférence des présidents de chaque assemblée pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement dont il prendrait l’initiative à cet effet.
Le cinquième alinéa de cet article reprenait les termes de l’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 et introduisait dans la Constitution des dispositions spécifiques relatives au contrôle parlementaire de l’état d’urgence.
Le pénultième alinéa de l’article 36-1 disposait que la prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne pouvait être autorisée que par la loi et que celle-ci en fixait la durée, « sans pouvoir excéder trois mois ». Sans exclure le renouvellement de cette prorogation, qui s’effectuerait alors dans les mêmes conditions, cette disposition garantissait au Parlement d’être consulté très régulièrement sur l’opportunité de prolonger l’état d’urgence.
Loin d’être inutile, ou purement symbolique, la constitutionnalisation de l’état d’urgence aurait consacré, on le voit, des garanties supplémentaires. Vos Rapporteurs considèrent que les questions soulevées par ce débat constitutionnel, et notamment celle de la limitation dans le temps de l’état d’urgence, doivent faire l’objet d’une réflexion de plus long terme, hors de la contrainte née des événements.
II. L’INSTALLATION D’UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE INÉDIT ET TRANSPARENT
En même temps que s’est imposée, dès le lendemain des attentats du 13 novembre 2015 la nécessité de prolonger l’état d’urgence au-delà des douze jours initiaux, s’est fait jour l’idée de l’assortir d’un contrôle parlementaire spécifique, propre à répondre au souci des députés de contrebalancer l’attribution de pouvoirs exceptionnels au pouvoir exécutif.
Si l’idée chemine pendant les quelques jours précédant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, à l’occasion des contacts informels entre l’exécutif et les commissions des Lois des deux assemblées, c’est un amendement du président de notre Commission, M. Jean-Jacques Urvoas, adopté à l’unanimité le 18 novembre 2015, qui donne corps au contrôle parlementaire de l’état d’urgence.
A. LES BASES JURIDIQUES DU CONTRÔLE
Cet amendement avait pour objet d’insérer dans la loi du 3 avril 1955 un nouvel article 4-1 ainsi rédigé : « L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ». Se trouve ainsi concrétisée une intention avancée lors des emplois précédents de la loi de 1955, en janvier 1985 puis en novembre 2005, mais jamais matérialisée (20).
Loin d’être superfétatoire par rapport aux textes qui organisent les prérogatives de contrôle et d’évaluation du Parlement, cette disposition ouvre la voie à un contrôle spécifique de l’action du Gouvernement, en mettant à la charge de ce dernier, tant que dure l’état d’urgence, une obligation explicite et constante d’information et de réponse aux interrogations des assemblées.
Très rapidement après l’entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2015, les commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, auxquelles avait été confié l’examen du projet de loi de prorogation, se sont mobilisées pour organiser ce contrôle : le 27 novembre 2015, la commission des Lois du Sénat créait un comité de suivi de l’état d’urgence et désignait M. Michel Mercier rapporteur spécial sur ce sujet ; le 2 décembre, notre commission, sous l’impulsion de son président Jean-Jacques Urvoas, arrêtait les grandes lignes de son contrôle.
Reprenant le binôme, habituel en matière de contrôle de l’application des lois, que forment le rapporteur et le rapporteur dit « d’application » désigné sur le fondement de l’article 145 de notre Règlement et issu des rangs de l’opposition, la Commission décida alors de confier cette mission permanente de suivi au président de la commission des Lois, qui avait été rapporteur sur le projet de loi de prorogation, et à son vice-président issu du groupe Les Républicains qui avait été désigné co-rapporteur sur la mise en application de cette loi (21). Afin de permettre l’information à tous les membres de la commission des Lois et dans un souci de transparence, le principe de restitutions régulières des rapporteurs lors de réunions ouvertes à la presse est alors arrêté.
Afin d’asseoir les nouvelles prérogatives de contrôle prévues par l’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955, la Commission décida également de mobiliser les pouvoirs d’enquête dont peuvent demander à être dotées les commissions permanentes en application de l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Introduite en 1996 mais jamais utilisée jusqu’alors, cette disposition autorise les commissions permanentes à « demander à l’assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n’excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête ». Par ce biais, la Commission se donnait ainsi la possibilité de procéder à des auditions sous serment et offrait toute latitude à ses rapporteurs pour faire des contrôles sur pièces et sur place et demander à disposer de tous documents de service.
Au terme de la procédure prévue par les articles 145-1 à 145-3 du Règlement de notre assemblée, la commission des Lois a donc été dotée à partir du 4 décembre 2015 et pour une durée de trois mois, permettant de couvrir toute la durée de prorogation de l’état d’urgence, des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour assurer sa mission de suivi, de contrôle et d’évaluation des mesures prises pendant l’état d’urgence. Par la suite, et compte tenu de la nouvelle prorogation de trois mois de l’état d’urgence, autorisée par la loi du 19 février 2016, la Commission demanda, lors de sa réunion du 11 février 2016, à être dotée de ces prérogatives spécifiques pour une nouvelle période de trois mois, du 4 mars au 3 juin 2016.
C’est sur ces bases juridiques – article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 et article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958 – que la Commission a d’abord bâti ses outils de contrôle.
La quatrième prorogation de l’état d’urgence en juillet dernier fut l’occasion de renforcer les dispositions relatives au contrôle parlementaire (22). Est modifié l’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 relatif au contrôle des assemblées pour préciser que « les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la présente loi », sans préjudice pour elles de pouvoir également « requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »
L’objectif de cette modification était triple.
Il s’agissait tout d’abord de combler les « blancs » persistants du contrôle parlementaire observés jusqu’alors. En effet, si le Gouvernement s’est mobilisé pour faire suite aux demandes de vos rapporteurs sur les principales mesures mises en œuvre sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, d’autres mesures ne faisaient pas l’objet d’un recensement exhaustif parce qu’elles étaient prises à l’échelon déconcentré, ou peu utilisées ou parce qu’elles empruntaient tout à la fois au droit commun et à la loi du 3 avril 1955. Alors que le souci de la commission des Lois était de disposer d’informations complètes sur l’intégralité des mesures susceptibles d’être prises en application de l’état d’urgence, la publication de données sur certaines mesures fondées sur les articles 5, 8, 9 et 10 (interdictions et limitations de circulation, interdictions de manifester, fermetures de lieux, remises d’armes, réquisitions des biens et des personnes), n’avait pu être assurée faute de consolidation exhaustive à l’échelon central. Par ailleurs, les données relatives à certaines perquisitions conduites entre le 26 février et le 25 mai 2016 n’avaient pas été transmises.
Cette modification législative avait également pour objectif de garantir un accès pérenne des assemblées aux données alors que leurs prérogatives spécifiques d’investigation fondées sur l’article 5 ter de la loi du 17 novembre 1958 ne pouvaient, conformément au droit commun des commissions d’enquête, trouver à s’exercer au-delà de six mois.
Enfin, il s’agissait de renforcer le contrôle parlementaire alors que, au même moment, le Parlement votait une prorogation de six mois de l’état d’urgence. Lors de la tenue de la commission mixte paritaire le 20 juillet sur le projet de loi de quatrième prorogation, le président de la commission des Lois du Sénat, M. Philippe Bas, a souligné son attachement à cette disposition et lié d’ailleurs explicitement durée de l’état d’urgence et contrôle parlementaire en indiquant que le choix fait en novembre 2015 de retenir une durée de trois mois avait notamment été fait, parce qu’elle « était plus favorable au contrôle parlementaire [et] obligeait le Gouvernement à revenir devant le Parlement » (23). Dès lors que l’état d’urgence se trouvait prolongé pour une durée particulièrement longue, il était légitime que le contrôle parlementaire fût simultanément renforcé.
Dès le 25 juillet 2016, les commissions des Lois des deux assemblées se sont vues transmettre copie des mesures prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, permettant ainsi à vos rapporteurs de disposer d’une connaissance plus fine et exhaustive de la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Les outils témoignent du souci de pouvoir procéder à un contrôle approfondi fondé sur plusieurs sources d’information.
La première initiative, lancée dès le 27 novembre 2015 et poursuivie ensuite avec intensité pendant plusieurs semaines, a consisté à saisir le Gouvernement afin d’obtenir des précisions sur certaines mesures individuelles ou générales (perquisitions, assignations à résidence, interdictions de manifester, couvre-feu,…) sur lesquelles l’attention de vos Rapporteurs avait été appelée. Il s’est souvent agi de cas dont la presse, légitimement vigilante sur le périmètre et les modalités d’action des services de police, s’était fait l’écho. Au total, soixante-huit courriers auxquels le ministre de l’Intérieur a tous répondu ont ainsi été envoyés, certains ayant fait l’objet de demandes de précisions complémentaires. Signe de la vigilance du Parlement, cette démarche a contribué à structurer le contrôle en permettant de mieux saisir l’usage par le Gouvernement des pouvoirs qui lui ont été conférés et d’ouvrir des pistes de travail à vos Rapporteurs.
Nécessairement partiels, ces cas individuels n’étaient toutefois pas suffisants pour parvenir à des conclusions et obtenir une connaissance fine et détaillée de l’application de l’état d’urgence. Aussi la Commission s’est-elle attachée à disposer de données statistiques exhaustives auprès du Gouvernement, seul moyen de certifier les constats et de tirer des conclusions sur des bases étayées.
Ces données étaient de deux ordres :
– les données chiffrées dites de « synthèse » qui récapitulent le nombre de mesures prises en application de la loi du 3 avril 1955 et les suites judiciaires auxquelles elles donnent lieu, fournies par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice ;
– les informations détaillées sur chacune des mesures administratives mises en œuvre depuis le 14 novembre dernier. Ces données détaillées n’étaient initialement pas disponibles à l’échelon central mais ont été fournies pour les perquisitions et les assignations à résidence décidées depuis le 14 novembre. En près de trois semaines, au prix d’une mobilisation intense des services du ministère de l’Intérieur, la Commission a reçu des données relatives à plusieurs milliers de mesures déjà décidées.
Depuis le 21 juillet, vos rapporteurs se voient transmettre copie des actes pris par les autorités administratives sur le fondement de la loi du 3 avril 1955.
Publié sur le site internet de l’Assemblée nationale, le recensement statistique des mesures administratives et des suites judiciaires auxquelles elles donnent lieu est encore aujourd’hui le seul pôle de diffusion régulière de données accessible au public. Par ailleurs, le recueil de données détaillées a permis à notre Commission de diffuser, dès le 13 janvier dernier, un aperçu objectif de la mise en œuvre des perquisitions et des assignations à résidence dans le temps et l’espace puis de montrer de façon détaillée l’usage des perquisitions et des assignations à résidence (évolution dans le temps des mesures prises, part des perquisitions nocturnes dans la totalité des opérations, répartition entre les services de renseignement, mobilisation des forces intervenantes,...).
Dès la déclaration de l’état d’urgence, le Gouvernement a veillé à tenir informé l’ensemble des élus.
Dans le week-end qui a suivi les attentats du 13 novembre dernier, le Président de la République reçut les présidents des assemblées, les présidents de tous les groupes parlementaires et les présidents des commissions concernées, avant de s’exprimer le 16 novembre devant le Parlement réuni en Congrès.
Comme l’a rappelé le Premier ministre devant notre Commission le 27 janvier 2016 lors de la discussion en première lecture du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, « le Président de la République avait pris l’engagement que le Parlement serait informé très étroitement des conditions de mise en œuvre de l’état d’urgence, et que tout serait fait pour faciliter le contrôle parlementaire ». Dès l’installation du contrôle, le ministre de l’Intérieur et la ministre de la Justice assuraient la commission des Lois de la collaboration de leurs services au bon déroulement de son contrôle.
Parlementaires de la majorité et de l’opposition ont ainsi été conviés à des réunions permettant de faire le point sur la mise en œuvre de l’état d’urgence et sur les suites des attentats, alternativement sous l’autorité du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur. Calées selon un rythme hebdomadaire après le 14 novembre 2015, ces réunions continuent d’être tenues. À l’Assemblée nationale, une séance de questions a été organisée sur la mise en œuvre de l’état d’urgence et la politique pénale le 13 janvier 2016 à laquelle ont participé la garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur.
Enfin, à l’échelon local, et comme les rapporteurs ont pu le constater lors de leurs déplacements, les préfets ont veillé à tenir informés les élus locaux qui étaient légitimement fortement demandeurs, d’autant que l’état d’urgence avait été déclenché à proximité des fêtes de fin d’année et que la question du maintien de certains événements – marchés de Noël, braderies,…– se posait (24). D’une façon générale, une politique de communication renforcée a été mise en place dans les préfectures (25).
Plusieurs instances ont également été sollicitées par vos Rapporteurs, afin de croiser les sources d’information. Des éléments ont été recueillis auprès du Conseil d’État, afin de disposer de données sur le contentieux administratif lié à la mise en œuvre de l’état d’urgence. Vos Rapporteurs se sont également procuré de très nombreuses décisions rendues par les tribunaux administratifs, notamment sur les autorisations d’exploitation de données informatiques et sur les assignations à résidence.
Le Défenseur des droits, qui a mis en alerte ses 397 délégués territoriaux, nous a signalé plusieurs cas puis est venu le 22 mars 2016 présenter ses propres conclusions sur l’état d’urgence.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme a également été sollicitée le 9 décembre puis est venue présenter ses observations le 16 mars 2016 devant la commission des Lois.
Enfin, des avocats, des collectifs et des associations ont également saisi vos Rapporteurs de différents cas ainsi que des députés, auxquels a été adressé un courrier le 8 décembre 2015 afin de les informer de la démarche de contrôle entreprise par la Commission et leur indiquer la disponibilité des Rapporteurs pour recevoir tous les éléments d’information qu’ils jugeraient pertinent de leur transmettre.
Soucieux de voir comment était concrètement appliqué l’état d’urgence, vos Rapporteurs ont procédé à des déplacements dans plusieurs départements (26) pour y rencontrer, sous l’autorité du préfet, les acteurs de la mise en œuvre de l’état d’urgence sur le terrain. Ces échanges nous ont permis de tirer des enseignements précieux sur les méthodes de travail et l’organisation déployée à l’échelon préfectoral.
Enfin, notre Commission, dans son entier, a procédé à plusieurs auditions dont l’essentiel furent conduites dans les premiers temps de l’état d’urgence et dans le format propre aux auditions des commissions d’enquête, c’est-à-dire sous serment (27). L’état d’urgence s’inscrivant dans la durée, vos Rapporteurs ont ensuite d’ailleurs repris contact avec certaines des personnalités entendues par la commission des Lois en janvier dernier afin d’actualiser ces échanges (28).
C. LES OBJECTIFS : UN CONTRÔLE « EN TEMPS RÉEL » ET TRANSPARENT
Comme l’a indiqué le président Jean-Jacques Urvoas le 16 décembre 2015 à la Commission, « nous sommes partis de rien, dans un environnement en constante évolution » mais avec la conviction qu’il fallait bâtir un contrôle innovant, permettant de suivre « en temps réel » autant que possible l’action des autorités administratives.
Le choix d’une « veille parlementaire » se justifiait à plus d’un titre. Dès le 14 novembre 2015, l’état d’urgence avait été déployé et mis en œuvre à grande échelle. Rappelons en effet que, par décrets successifs (voir supra), il a couvert tout le territoire de la République, et que dans sa première semaine de mise en œuvre, il a donné lieu à 890 perquisitions et à près de 160 assignations à résidence. Lorsque la Commission définit les grandes lignes de son contrôle le 2 décembre 2015, près de 100 perquisitions sont conduites chaque jour, 281 personnes sont déjà assignées à résidence et l’ensemble des mesures donnent – légitimement – lieu à une large couverture médiatique, comme en témoignent les très nombreuses relations dans la presse, notamment quotidienne régionale, ou des initiatives sur internet (blogs, page de la Quadrature du Net recensant les articles sur la mise en œuvre de l’état d’urgence,…).
Il n’était donc pas question d’attendre, mais au contraire de contrôler dans le temps même de l’action, afin d’imposer au Gouvernement et aux services d’agir en transparence, sous le regard du contrôle parlementaire. Il s’agissait aussi de mettre à la disposition de chacun des données complètes permettant de saisir l’état d’urgence et de substituer une connaissance aussi complète que possible aux angoisses et aux fantasmes.
Ce souci de transparence et de diffusion des informations explique le choix qui est fait dès décembre 2015 de diffuser des données au « fil de l’eau », sous deux formes distinctes :
– les données chiffrées synthétiques recueillies auprès des services du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice : elles sont publiées chaque semaine et, depuis juillet 2016, tous les quinze jours – cette périodicité semblant plus significative compte tenu de l’utilisation désormais faite de la loi du 3 avril 1955 – sur la page que notre Commission a dédiée au suivi de l’état d’urgence sur le site internet de l’Assemblée nationale (29) ;
– les différentes communications d’étape présentées par vos Rapporteurs à la Commission le 16 décembre 2015, le 13 janvier 2016, le 30 mars 2016 et le 17 mai 2016 (30).
Ainsi conçu, le contrôle parlementaire s’est vite imposé comme un élément de la légitimité de cette période d’exception comme le montrent les débats engagés à l’occasion de l’examen en première lecture du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation et les amendements qui furent déposés afin de constitutionnaliser l’existence et la nature de ce contrôle parlementaire, en l’inscrivant dans le nouvel article 36-1 de la Constitution relatif à l’état d’urgence.
Vos Rapporteurs se sont efforcés de rendre compte avec exactitude et précision des conditions de mise en œuvre de ces mesures particulières. À titre d’exemple, la communication du mois de janvier a permis d’infirmer l’idée qui s’était répandue que les perquisitions étaient presque exclusivement réalisées en pleine nuit (31).
Pour exigeant que notre contrôle soit, il ne saurait à lui seul suffire à prendre la mesure de toutes les conséquences de la mise en œuvre de l’état d’urgence. Très tôt dans leur contrôle, vos Rapporteurs avaient indiqué qu’ils n’étaient pas en mesure de se prononcer par exemple sur les conditions matérielles de mise en œuvre des perquisitions.
Par ailleurs, ils ont été sensibles aux observations de M. Jacques Toubon, Défenseur des droits qui, lors de son audition par la commission des Lois le 22 mars 2016, soulignait que « les mesures qui ont été prises – perquisitions, assignations à résidence, etc. – peuvent créer un climat de suspicion, de délation ou une atmosphère délétère, au détriment des personnes qui en ont fait l’objet, dans la plupart des cas à tort, ou qui en ont subi des dommages tels que la perte de leur emploi » (32).
Concentrés sur certaines mesures, les recours engagés ne sont pas en soi un indicateur suffisant. Pour les 19 personnes dont l’assignation à résidence de façon continue depuis la première semaine de l’état d’urgence, on compte par exemple 49 contentieux. Il convient également de noter que ces contentieux ne cessent pas avec le temps. Enfin, il n’est pas facile pour les personnes visées par une mesure prise sur le fondement de l’état d’urgence de connaître le circuit de contestation et d’introduire effectivement un recours. S’adressant au tribunal de grande instance, un requérant se voit réorienté vers le tribunal administratif avant de se voir opposer le principe d’un préalable administratif, étant entendu qu’il convient de distinguer les mesures prises par le préfet de celles qui relèvent de la compétence du ministre de l’Intérieur…
Une mobilisation des sciences sociales permettrait, selon vos Rapporteurs, de mieux connaître la façon dont l’état d’urgence a été ressenti et d’en mesurer les effets sur la population.
Proposition : Solliciter la recherche en sciences sociales afin d’évaluer l’impact du recours à l’état d’urgence sur la population.
DEUXIÈME PARTIE :
QUELLE APPLICATION DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 DEPUIS LE 14 NOVEMBRE 2015 ?
Véritable « boîte à outils » pouvant être utilisée aussi bien en cas d’attentat que de crise sanitaire majeure, de catastrophe naturelle ou industrielle, la loi du 3 avril 1955 offre aux autorités administratives la faculté de recourir à douze mesures, présentées dans le tableau figurant ci-après.
LES MESURES ADMINISTRATIVES PERMISES PAR LA LOI DU 3 AVRIL 1955
Article de la loi |
Mesure |
Acte juridique de mise en œuvre de la mesure |
Article 5 (1°) |
Interdiction de la circulation des personnes ou des véhicules |
Arrêté préfectoral |
Article 5 (2°) |
Institution de zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé |
Arrêté préfectoral |
Article 5 (3°) |
Interdiction de séjour |
Arrêté préfectoral |
Article 6 |
Assignation à résidence, complétée le cas échéant par : |
Arrêté ministériel (Intérieur) |
- assignation à domicile à temps partiel | ||
- pointage au commissariat | ||
- interdiction d’entrer en relation | ||
Article 6-1 |
Dissolution d’associations ou de groupements |
Décret en Conseil des ministres |
Article 8 (premier alinéa) |
Fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion |
Arrêté ministériel (Intérieur) ou préfectoral sur l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence |
Article 8 (second alinéa) |
Interdiction de manifestation |
Arrêté ministériel (Intérieur) ou préfectoral sur l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence |
Article 8-1 |
Contrôle d’identité, inspection visuelle et fouilles des bagages, visite des véhicules |
Arrêté préfectoral |
Article 9 |
Remise des armes des catégories A à C et de celles de catégorie D soumises à enregistrement |
Arrêté ministériel (Intérieur) ou préfectoral |
Article 10 |
Réquisition de personnes ou de biens |
Ordre de réquisition préfectoral |
Article 11 (I) |
Perquisition au domicile de jour et de nuit |
Ordre de perquisition du ministre de l’Intérieur ou du préfet |
Article 11 (II) |
Blocage de sites Internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie |
Arrêté ministériel (Intérieur) |
Source : commission des Lois.
Contrairement à la situation qui avait prévalu en 2005 où l’état d’urgence avait essentiellement donné lieu à l’établissement de couvre-feux (33), l’état d’urgence actuellement en vigueur a conduit les autorités administratives à mobiliser presque tous ces outils, en particulier les perquisitions et les assignations à résidence, amenant ainsi le développement d’un contrôle contentieux nouveau. C’est un panorama des mesures prises pendant l’année écoulée sur le fondement de cette loi que présentent vos Rapporteurs dans cette deuxième partie.
I. LES PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES : UNE UTILISATION MASSIVE ET DÉSORMAIS RÉDUITE
Les perquisitions administratives ont été massivement utilisées au début de l’état d’urgence, comme le montre le graphique suivant. Le faible nombre d’opérations engagées au premier trimestre 2016 et leur très faible plus-value opérationnelle dès lors que le Conseil constitutionnel a interdit les copies des données numériques, conduisit le législateur à écarter cette faculté lors de la prorogation du mois de mai 2016 (34).
![]()
NOMBRE DE PERQUISITIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE
![]()
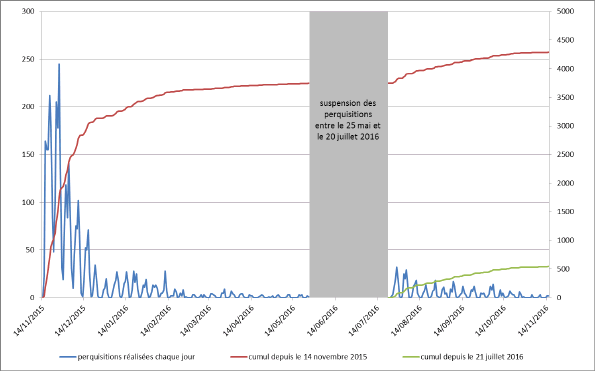
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
Entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016 ce sont quelque 3 750 perquisitions qui ont été réalisées avec une répartition inégale dans le temps : le 30 novembre, plus de 2 000 perquisitions avaient eu lieu, c’est-à-dire 54 % du total. Les perquisitions ont été de nouveau autorisées à partir du 21 juillet 2016 mais leur usage apparaît plus modéré et équivaut aux volumes quotidiens de la fin de l’année 2015 et du début de l’année 2016. Le constat d’une forte baisse du rythme des perquisitions, dressé dès le 13 janvier 2016 par les Rapporteurs en charge du suivi de l’état d’urgence, n’a donc pas été démenti.
L’usage des perquisitions semble s’inscrire dans un contexte propre à chaque période de l’état d’urgence : au-delà des questions de volume, le ciblage et l’organisation des perquisitions ont évolué parallèlement aux modifications apportées au cadre juridique. Le régime d’exploitation des données a été traité de façon particulière lors de la prorogation du mois de juillet 2016.
A. UN USAGE VARIABLE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE
Il convient de distinguer les perquisitions selon le régime juridique applicable :
- jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2015, elles ont été faites sous le régime de la loi de 1955 non modifiée ;
- entre le 21 novembre 2015 et le 25 mai 2016, elles ont relevé du cadre fixé par la loi du 20 novembre ;
- la loi du 21 juillet 2016 a enfin fait évoluer les dispositions de novembre, notamment en ce qui concerne les saisies de données informatiques.
1. Les perquisitions antérieures au 20 novembre 2015
Le graphique ci-après détaille répartition par jour des 890 perquisitions réalisées entre le 14 et le 20 novembre 2015 (35).
PERQUISITIONS RÉALISÉES ENTRE LE 14 ET LE 20 NOVEMBRE 2015
![]()
![]()
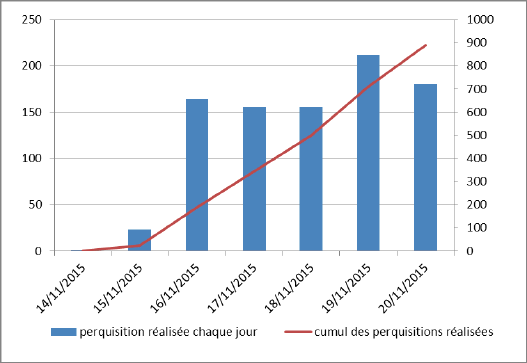
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
La répartition géographique, représentée dans la carte ci-après, est relativement inégale : plus de 41 % des perquisitions se sont déroulées en Île-de-France (26 % du total) ou dans un des quatre départements suivants : les Bouches-du-Rhône, le Rhône, la Haute-Garonne et le Bas-Rhin.
RÉPARTITION TERRITORIALE DES PERQUISITIONS RÉALISÉES
ENTRE LE 14 ET LE 20 NOVEMBRE 2015
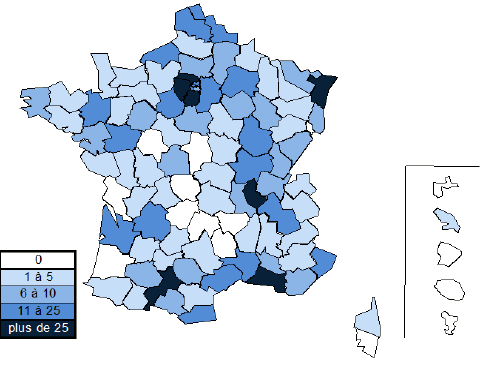
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
En termes de procédure, faute de disposer d’un cadre légal spécifique, les pratiques des perquisitions judiciaires ont été largement reprises. Dès le 14 novembre, un officier de police judiciaire a ainsi assisté, voire conduit chaque perquisition, sa présence permettant de basculer dans une procédure judiciaire dès lors qu’apparaissaient les éléments constitutifs d’une infraction.
2. Les perquisitions conduites entre le 20 novembre 2015 et le 25 mai 2016
Le rythme des perquisitions réalisées après le 20 novembre s’est significativement ralenti durant cette période comme le montre le graphique suivant : environ un mois après le déclenchement de l’état d’urgence, soit le 20 décembre 2015, le nombre de perquisitions était tombé à moins de 30 par jour et ce seuil n’a jamais été atteint de nouveau par la suite.
PERQUISITIONS RÉALISÉES ENTRE LE 21 NOVEMBRE 2015 ET LE 25 MAI 2106
![]()
![]()
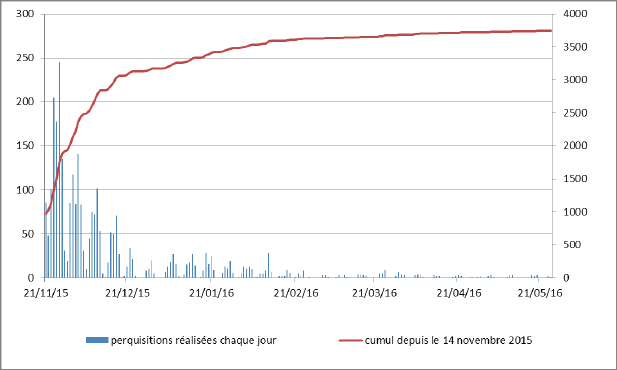
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
La répartition géographique des perquisitions s’inscrit dans la même tendance que celle constatée lors de la première semaine : quatre départements (par ordre décroissant le Nord, les Alpes maritimes, l’Essonne et les Bouches-du-Rhône) concentrent 21 % de l’ensemble des perquisitions réalisées durant la période considérée. L’Île-de-France ne concentre plus que 16 % des perquisitions.
RÉPARTITION TERRITORIALE DES PERQUISITIONS RÉALISÉES
ENTRE LE 21 NOVEMBRE 2015 ET LE 25 MAI 2016
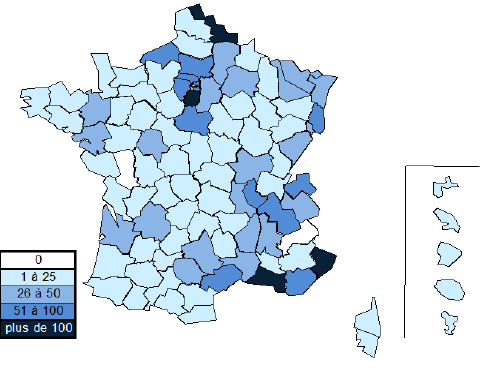
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
3. Les perquisitions depuis le 21 juillet 2016
Durant les quinze jours suivant le 21 juillet 2016, le rythme des perquisitions a retrouvé un niveau proche de celui de la fin de l’année 2015 avec une vingtaine de perquisitions par jour. Comme le montre le graphique ci-après, ce rythme s’est nettement ralenti au début du mois de septembre, montrant de nouveau une moindre utilisation attrition de la mesure.
PERQUISITIONS RÉALISÉES DEPUIS LE 21 JUILLET 2016
![]()
![]()
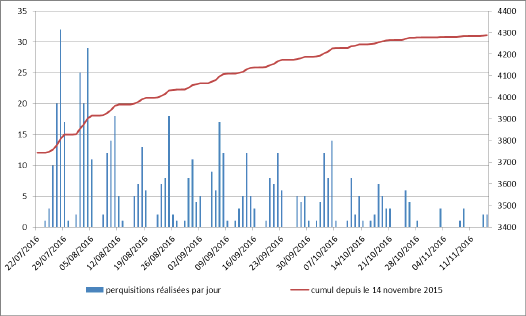
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
Sur le plan territorial, la répartition est conforme à celles des périodes précédentes : l’Île-de-France, le Nord et les Alpes-Maritimes concentrent plus d’un tiers des perquisitions réalisées depuis le 21 juillet.
RÉPARTITION TERRITORIALE DES PERQUISITIONS RÉALISÉES
ENTRE LE 21 JUILLET ET LE 15 NOVEMBRE 2016
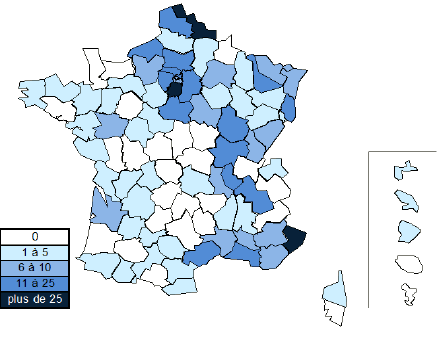
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
B. LE CADRE OPÉRATIONNEL ET LE RÉSULTAT DES PERQUISITIONS
1. Le ciblage des perquisitions
Du 14 novembre 2015 au 25 mai 2016, un peu moins de la moitié des perquisitions ont été ordonnées à partir d’éléments venant, au moins en partie, des services de renseignement, qu’il s’agisse des services centraux ou des services locaux. Ce sont souvent ces objectifs qui ont été traités au cours des deux premières semaines de l’état d’urgence et avec l’appui des forces spécialisées d’intervention. Selon nos interlocuteurs, ces perquisitions avaient pour but de déstabiliser le microcosme radicalisé, d’éviter des répliques d’attentats tirant profit de l’effet de sidération immédiatement consécutif au 13 novembre et de s’assurer que les individus concernés n’avaient pas échappé à des procédures judiciaires antiterroristes. Comme le montre le graphique suivant, ce phénomène est limité dans le temps et concentré sur les premiers temps de l’état d’urgence.
PERQUISITIONS RÉALISÉES SUR LA BASE D’INFORMATIONS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ET CONCERNANT DES PERSONNES AYANT DES ANTÉCÉDENTS EN LIEN AVEC L’ISLAM RADICAL
(du 14 novembre 2015 au 24 mai 2016 – en nombre de perquisitions)
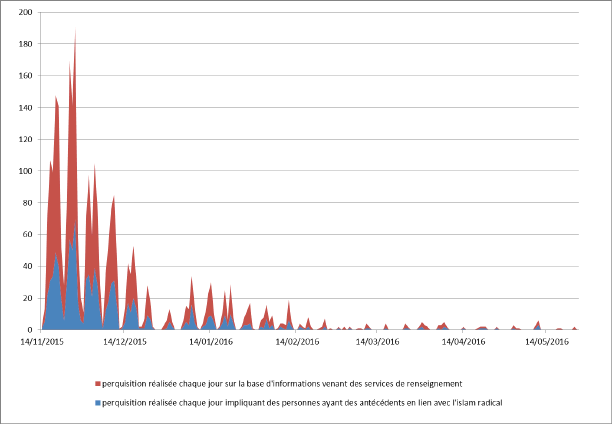
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
Comme le relevaient vos Rapporteurs dans leur communication du 13 janvier 2016, pour l’autre moitié des perquisitions, presque toutes réalisées à l’initiative des services de sécurité publique, les objectifs sont nettement moins prioritaires pour les services de renseignement. Dans certains cas, le rattachement à l’islam radical passe par une inscription au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), administré par l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) et qui comprend des personnes d’inégale dangerosité. Pour d’autres perquisitions, les objectifs poursuivis concernaient très explicitement des infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, soit du droit commun. Leur justification tient alors à la porosité, souvent évoquée, entre radicalisation, terrorisme et économie souterraine.
Lors de nos déplacements et entretiens, plusieurs de nos interlocuteurs nous ont confirmé que les perquisitions s’étaient recentrées à compter du début de l’année 2016 avec une attention marquée aux processus de radicalisation, tendance qui s’est confirmée durant l’été.
Ce recentrage ressort d’ailleurs du télégramme du 23 juillet 2016 adressé par le ministre de l’Intérieur aux préfets. Il y souligne qu’à « la différence de la première vague de mesures qui avait suivi le déclenchement de l’état d’urgence à la mi-novembre 2015 et dont le large spectre poursuivait notamment le but de vérification par les services de renseignement des viviers d’objectifs qu’ils avaient en compte, cette nouvelle prorogation doit donner lieu à des opérations ciblées dirigées vers le terrorisme et la radicalisation violente ».
En pratique, l’analyse des motivations des ordres de perquisition montre que depuis le 21 juillet 2016, la menace terroriste – directe ou indirecte – est presque toujours évoquée. Demeurent des cas de délinquance ordinaire qui n’ont, au mieux, qu’un lien très indirect avec la menace terroriste. De même, le comportement présumé violent ou les troubles psychiatriques, s’ils constituent une menace potentielle, apparaissent pour le moins très éloignés du djihadisme au sens strict et devraient être pris en compte par des dispositifs de droit commun. Par exemple, une perquisition a été ordonnée en juillet 2016 à l’encontre d’un individu signalé pour « escroquerie à la vente d’or susceptible de lui avoir rapporté une importante somme d’argent ». Il apparaîtrait « sur son profil Facebook en position de tir avec une arme de type kalachnikov » après avoir été impliqué dans une affaire de détention d’armes en 2014. Il souffrirait en outre de schizophrénie et aurait été hospitalisé en hôpital psychiatrique. En octobre dernier, une autre perquisition a visé un individu appartenant à la mouvance néo-nazie, ayant des « projets violents à l’encontre de la communauté musulmane » et susceptible de détenir des armes sans autorisation et manifestant son intérêt pour les explosifs.
2. Le déroulement des perquisitions
Dès le 14 novembre 2015 et alors que ces opérations se déroulent dans le cadre légal daté de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 tel qu’il résulte de l’ordonnance du 15 avril 1960 (cf. infra), le ministre de l’Intérieur a adressé à l’ensemble des préfets une circulaire relative aux modalités de mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Concernant les perquisitions, il rappelait que « compte tenu de l’atteinte que ces mesures portent à la liberté personnelle des individus qu’elles visent, il est nécessaire de les encadrer très précisément », notamment en ce qui concerne leur « objet, les lieux et le moment » de leur réalisation. Le Procureur de la République doit être informé sans délai de la décision et du lieu de la perquisition. En pratique, la perquisition doit avoir lieu « en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent » et « en présence de l’occupant ou, à défaut de son représentant ou de deux témoins ». La perquisition fait l’objet d’un compte rendu dont copie est adressée sans délai au Procureur de la République. Ces règles ont été reprises et consacrées par la loi du 20 novembre 2015.
a. Les acteurs de la perquisition
Si la circulaire puis la loi prévoient que les perquisitions sont conduites en présence d’un officier de police judiciaire, elles ne précisent nullement que ledit officier est opérationnellement en charge de la perquisition. La présence de l’officier de police judiciaire n’est en effet requise que pour des actes judiciaires. Comme le relève le ministre dans sa circulaire, leur présence « offre la garantie que puissent être effectuées des saisies auxquelles ceux-ci sont seuls habilités à procéder et permet la constatation d’éventuelles infractions ». En raison de leur expérience dans des procédures judiciaires, ces missions ont toujours échu à des officiers de police judiciaire.
Le choix de l’unité appartient au préfet et l’importance des moyens mobilisés pour procéder aux perquisitions dépend de la dangerosité de l’individu visé ou de la nature du lieu perquisitionné. Les effectifs mobilisés pour procéder aux perquisitions administratives varient de 2 à 108 personnels au plus avec une moyenne de l’ordre de 15 personnels par perquisition. Les rares perquisitions mobilisant plus de 100 personnes concernent exclusivement des espaces collectifs, qu’il s’agisse d’un hôtel susceptible d’abriter plusieurs individus radicalisés et détenant potentiellement des armes ou une salle de prière accueillant de nombreux individus radicalisés. Les effectifs peuvent également être importants lorsque plusieurs perquisitions sont conduites de façon coordonnée dans une même zone, les moyens mobilisés sont alors mutualisés même si chaque lieu est perquisitionné par une équipe distincte.
Entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016, un peu plus de 150 perquisitions ont été conduites par ou avec l’appui de forces d’intervention spécialisées (RAID, BRI, GIGN ou PI2G). Ces opérations se concentrent dans les premiers temps de l’état d’urgence : ces unités sont ainsi intervenues 54 fois entre le 14 et le 20 novembre 2015, 54 fois entre le 21 et le 30 novembre 2015, 30 fois durant le mois de décembre 2015 et 13 fois entre le 1er janvier et le 25 mai 2016. Sur cette même période, il a été fait usage une dizaine de fois à des unités mobiles (CRS ou gendarmerie mobile) pour sécuriser la zone dans laquelle se déroulait la perquisition. Depuis le 21 juillet, 25 perquisitions ont été réalisées avec l’appui de ces unités ; aucune n’a été réalisée directement par ces forces spécialisées.
La perquisition est autorisée « en tout lieu, y compris un domicile », à l’exception des lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes. Il s’agit des lieux au sujet desquels « il existe des raisons de penser » qu’ils sont « fréquenté[s] par une personne dont le comportement constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics ». Si l’identification d’un domicile ou d’un local professionnel individuel ne posent pas de difficulté, il en est différemment pour les espaces partagés. Plusieurs ordres de perquisition étendent par exemple la mesure aux vestiaires ou aux parties communes d’un immeuble. Depuis le 21 juillet 2016, les perquisitions concernent pour l’essentiel des habitations ; on relève néanmoins la perquisition de deux chambres d’hôtel, de sept locaux commerciaux, de deux locaux associatifs ou sociaux, de deux salles de prière situées dans un foyer Adoma et de trois lieux de culte.
Si les juges constitutionnel et administratif exigent que le lieu soit précisément identifié, depuis le 21 juillet 2016, la loi a prévu une facilité opérationnelle de l’ordre de perquisition dit « de rebond ». Les informations à l’origine de la perquisition peuvent en effet être inexactes ou incomplètes et ne peuvent être corrigées qu’une fois la perquisition commencée. Les préfets peuvent autoriser l’extension de la perquisition au véhicule par exemple ou modifier l’adresse en cas d’erreur matérielle. De même, la perquisition peut montrer que l’individu visé dispose de plusieurs adresses et, pour en préserver l’efficacité, devoir se prolonger dans un autre lieu. Ces ajustements de dernière minute sont autorisés de façon parfois orale par le préfet compétent qui ensuite prend un arrêté de régularisation de la mesure ; en pratique, comme tenu du caractère oral de cette procédure, les préfets veillent à informer et sans délai les procureurs de ce changement avant de leur transmettre formellement l’arrêté de régularisation.
En termes d’horaires, la loi de 1955 ne fixait aucune borne. Comme le montre le graphique ci-après, les forces de l’ordre ont procédé assez largement à des opérations de nuit, c’est-à-dire en-dehors des horaires ordinaires (de 6 heures à 21 heures) de perquisition tels que définis par l’article 59 du code de procédure pénale.
HEURE DE DÉBUT DES PERQUISITIONS RÉALISÉES DU 14 NOVEMBRE 2015 AU 15 NOVEMBRE 2016
(en nombre de perquisitions)
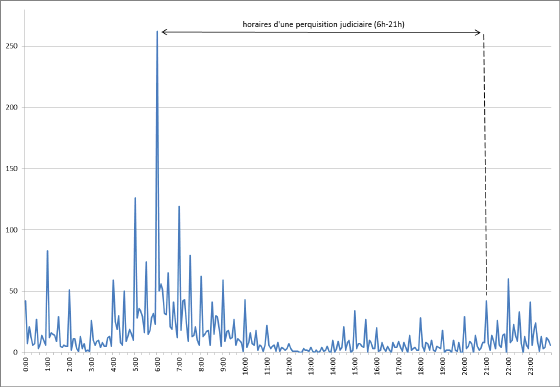
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
Pour autant, l’analyse des données période par période fait apparaître des différences très significatives. Comme le montre le graphique suivant, durant la première semaine de l’état d’urgence, 68 % des perquisitions ont commencé entre 21 heures et 6 heures, c’est-à-dire par dérogation au régime applicable aux perquisitions judiciaires.
HEURE DE DÉBUT DES PERQUISITIONS RÉALISÉES
ENTRE LE 14 ET LE 20 NOVEMBRE 2015
(en nombre de perquisitions)
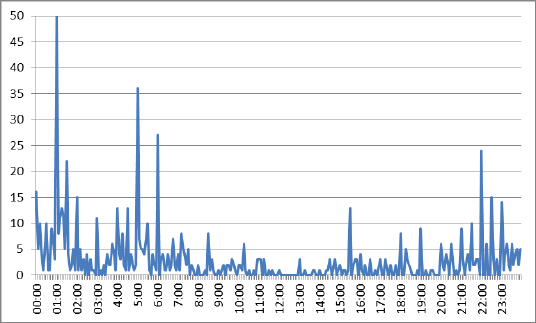
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
En revanche, les horaires des perquisitions conduites après le 20 novembre 2015 et jusqu’au 25 mai 2016 se rapprochent des horaires judiciaires comme le montre le graphique ci-après.
HEURE DE DÉBUT DES PERQUISITIONS RÉALISÉES
ENTRE LE 21 NOVEMBRE 2015 ET LE 25 MAI 2016
(en nombre de perquisitions)
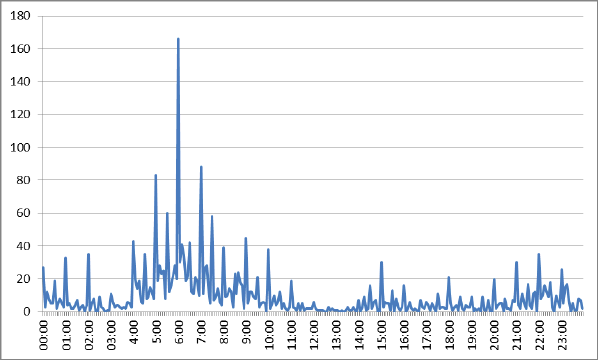
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
Sur la période considérée, 44 % des perquisitions ont commencé entre 21 heures et 6 heures, étant entendu que le recours à des opérations de nuit diminue dans le temps. Contrairement à la première semaine, les horaires auxquels débutent les perquisitions correspondent de plus en plus aux pratiques judiciaires ordinaires.
Le graphique ci-après montre bien que le recours aux perquisitions de nuit correspond bien aux circonstances exceptionnelles de la première semaine de l’état d’urgence, notamment pour conserver un effet de surprise. Il répond aussi au souci des forces de l’ordre de procéder à la perquisition lorsque la personne est présente à son domicile, de s’assurer d’un environnement plus calme ou de procéder plus discrètement.
Ce mode opératoire est nettement moins utilisé depuis le début de l’année 2016 comme le confirme la courbe de tendance ci-après et l’analyse des perquisitions conduites ces derniers mois.
HEURE DE DÉBUT DES PERQUISITIONS RÉALISÉES
ENTRE LE 21 JUILLET ET LE 24 NOVEMBRE 2016
(en nombre de perquisitions)
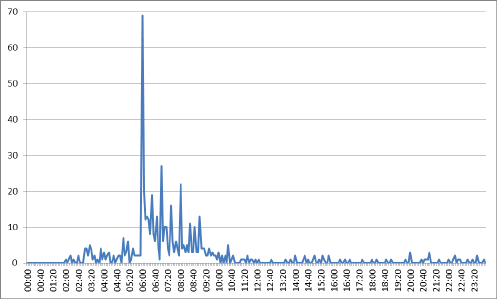
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
Sur la période considérée, moins de 18 % des perquisitions administratives se sont déroulées entre 21 heures et 6 heures, soit 2,5 fois moins souvent que lors de la précédente période.
TAUX DE PERQUISITIONS DE NUIT PARMI LES PERQUISITIONS RÉALISÉES CHAQUE JOUR
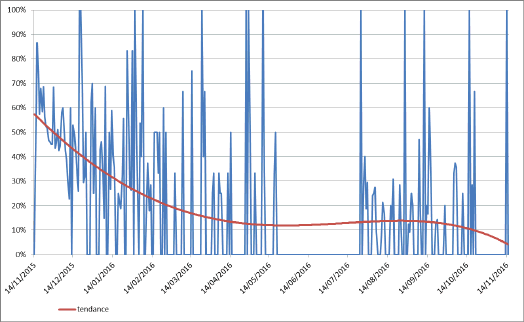
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
Il paraît pour autant souhaitable à vos Rapporteurs que le recours aux perquisitions administratives nocturnes ne puisse être laissé à la libre appréciation des services. Dans un avis contentieux rendu le 6 juillet 2016 en réponse à des questions soulevées par les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun, le Conseil d’État a précisé le régime de ces perquisitions sur plusieurs points et notamment sur les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État. Il y indique en particulier que « la perquisition de nuit doit être justifiée par l’urgence ou l’impossibilité de l’effectuer de jour ». Pour vos Rapporteurs, préciser le régime des perquisitions nocturnes dans la loi constituerait une garantie pour les personnes qui en font l’objet.
Proposition : Préciser le régime des perquisitions de nuit en indiquant que les perquisitions ne peuvent être conduites entre 21 heures et 6 heures qu’en cas d’urgence absolue ou lorsqu’il est impossible de l’effectuer de jour.
Les perquisitions visent des individus qui peuvent être mineurs. Par ailleurs, les perquisitions peuvent être conduites en présence de tiers et notamment d’enfants en bas âge.
Entre le 14 novembre 2015 et le 24 mai 2016, près de 60 mineurs ont été visés par une perquisition administrative. Depuis le 21 juillet 2016, 20 perquisitions ont visé des mineurs, auxquelles s’ajoutent 4 perquisitions concernant des personnes dans leur dix-huitième année. Deux perquisitions ont visé des mineurs de moins de 15 ans. Le plus jeune avait 14 ans, en voie de radicalisation ayant des projets de départ en Syrie et faisant par ailleurs l’objet d’une interdiction de sortie du territoire. La plupart des dossiers concernent des mineurs en voie de radicalisation, en contact régulier avec des djihadistes et ayant fait état de tentatives pour rejoindre les zones de combat ou ayant tenu des propos publics ou sur les réseaux sociaux faisant ouvertement l’apologie du djihadisme et/ou du terrorisme. À deux exceptions près, ces perquisitions n’ont abouti à aucune poursuite judiciaire.
L’attention de vos Rapporteurs et du Défenseur des droits a par ailleurs été appelée sur les conditions de déroulement des perquisitions en présence de jeunes enfants.
Dans son avis n° 16-03 du 25 janvier 2016, le Défenseur des droits rappelait qu’il « est essentiel d’éviter que les interventions soient traumatisantes pour les enfants afin qu’eux-mêmes ne soient pas durablement perturbés et que la représentation qu’ils auront des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie ne soit pas négative, ce qui pourrait contribuer plus tard à des attitudes agressives à l’encontre de ces derniers ». Rappelant ses recommandations de 2012 (36), il préconisait que toute intervention soit précédée de la collecte des informations sur la présence, le nombre et l’âge du ou des enfants présents. Dans la mesure du possible, l’équipe d’intervention doit comprendre un intervenant social ou un psychologue, ou un fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie de la brigade de protection des familles. À tout le moins, une personne, au sein de l’équipage intervenant, doit se charger plus spécifiquement de la protection du mineur. Et le Défenseur de préciser que durant l’intervention, « policiers et gendarmes se doivent de « ne pas mettre les menottes aux parents devant l’enfant » et de prendre ce dernier « à part », sur le palier de l’appartement par exemple, afin qu’« il n’assiste pas à l’intervention ». Lorsque les membres des forces de sécurité arborent des cagoules, il est recommandé de les enlever pour parler à un enfant » (37).
Au-delà de ses propres préconisations, le Défenseur des droits rappelait alors la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et notamment son arrêt du 15 octobre 2013. En l’espèce, la Cour examinait le déroulement d’une perquisition en Bulgarie. Les autorités ont été sanctionnées car « la présence éventuelle des enfants mineurs et de l’épouse du requérant n’a jamais été prise en compte dans la planification et l’exécution de l’opération policière », la Cour relevant que « ses deux filles étaient psychologiquement vulnérables en raison de leur jeune âge – cinq et sept ans respectivement ». L’arrêt s’interroge également sur le choix de l’horaire d’intervention, estimant que « l’heure matinale de l’intervention policière et la participation d’agents spéciaux cagoulés, qui ont été vus par [l’épouse] et ses deux filles, ont contribué à amplifier les sentiments de peur et d’angoisse éprouvés par ces trois requérantes à tel point que le traitement infligé a dépassé le seuil de gravité exigé pour l’application de l’article 3 de la Convention » (38).
En réponse à un courrier de vos Rapporteurs, le ministère de l’Intérieur a indiqué que le directeur général de la police a adressé, le 16 mars 2016, aux directeurs des services actifs de la police nationale une note relative à la prise en compte de la présence des jeunes enfants au cours des interventions à domicile. Il rappelle que « les instructions [établies en 2013] demeurent d’actualité, y compris dans le cadre de l’état d’urgence ».
Note du 16 mars 2016 du directeur général de la police nationale relative à la prise en compte de la présence des jeunes enfants au cours des interventions à domicile
Avant toute intervention, il convient de s’assurer de l’éventuelle présence de jeunes enfants et d’adapter le schéma d’intervention en conséquence. Lors de l’intervention, les jeunes mineurs doivent être « confiés très rapidement aux agents chargés de cette mission qui, dans toute la mesure du possible, les préservent de la vue de la suite des opérations et s’attachent à dédramatiser la situation en leur tenant des propos rassurants ». À l’issue de l’intervention, si l’adulte est interpellé ou placé en garde à vue, le mineur ne peut en aucun cas être laissé seul. Les services de police doivent alors rendre compte de la situation à l’autorité judiciaire et « dans l’attente des directives […], l’enfant peut, le cas échéant, être confié à un proche, dans la mesure du possible, membre de la famille ou, à titre exceptionnel et uniquement en dernier recours, être ramené au commissariat où il sera accueilli dans des conditions adaptées ».
Entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016, selon le ministère de la Justice, 605 perquisitions ont abouti à une procédure judiciaire, dont 36 pour des faits en lien avec le terrorisme.
Entre le 21 juillet 2016 et le 2 décembre 2016, 65 perquisitions administratives ont abouti à l’ouverture d’une procédure judiciaire dont 25 ont révélé des faits de nature terroriste.
Depuis le début de l’état d’urgence, les perquisitions administratives ont donc conduit à 61 procédures pour des faits en lien avec le terrorisme.
Depuis le 1er décembre 2015, le parquet de Paris a ouvert 20 enquêtes pour association de malfaiteurs en matière terroriste à la suite de perquisitions administratives dont 11 depuis le 21 juillet 2016. Sur cette même période, s’y ajoutent 41 procédures pour des faits d’apologie du terrorisme ou, depuis juin 2016, pour des faits liés à l’extraction, la reproduction ou la transmission de données faisant l’apologie du terrorisme et la consultation de site invitant au terrorisme ou faisant son apologie (39).
Lorsqu’elles ont été fructueuses, et comme le montre le tableau suivant, les perquisitions administratives ont plus souvent permis la découverte de stupéfiants, d’armes ou d’infractions au droit du travail ou au droit des étrangers (étrangers en situation irrégulière) ou d’argent liquide (numéraire).
Le graphique montre que les découvertes se concentrent dans les premiers temps de l’état d’urgence avec une relative reprise statistique durant l’été 2016.
DÉCOUVERTES FAITES DANS LE CADRE D’UNE PERQUISITION ADMINISTRATIVE
(du 14 novembre 2015 au 15 novembre 2016 – en nombre de découvertes)
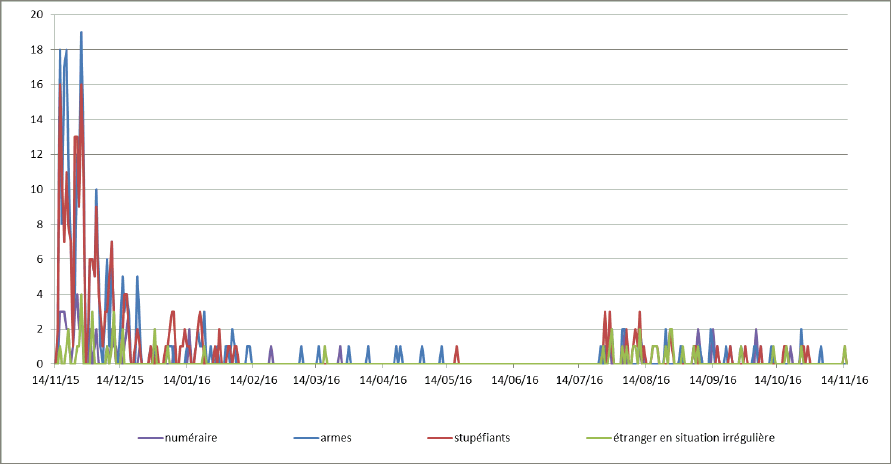
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
N.B. : Ces données ont été élaborées sur la base des éléments transmis par les services ayant procédé aux différentes perquisitions. Elles ne correspondent pas nécessairement aux informations transmises par le ministère de la Justice en matière de procédures judiciaires, la découverte de ces différents éléments ne conduisant pas nécessairement à l’ouverture d’une procédure.
C. UN CADRE JURIDIQUE PROGRESSIVEMENT RENFORCÉ ET PRÉCISÉ
1. Les modifications législatives de novembre 2015
Dans son ordonnance du 14 novembre 2005, le président de la section du contentieux du Conseil d’État relevait que « les perquisitions autorisées par le 1° de l’article 11 de la loi [du 3 avril 1955] devaient à l’origine être effectuées suivant les modalités définies par les dispositions alors en vigueur de l’article 10 du code d’instruction criminelle conférant au préfet des pouvoirs de police judiciaire, auquel a succédé l’article 30 du code de procédure pénale [et] que l’abrogation de cet article par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 n’a pas eu pour conséquence de soustraire au contrôle de l’autorité judiciaire l’exercice par le ministre de l’Intérieur ou le préfet de missions relevant de la police judiciaire ». Faute d’une modification législative, ce sont les dispositions de 1955 qui ont trouvé à s’appliquer dans la première semaine de mise en œuvre de l’état d’urgence, avant que la loi ne modifie assez significativement le dispositif.
Dans sa décision du 23 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a censuré le régime des perquisitions administratives antérieur à la loi du 20 novembre 2015. Il a estimé qu’en « ne soumettant le recours aux perquisitions à aucune condition et en n’encadrant leur mise en œuvre d’aucune garantie, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée » (40).
Le I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 consacré aux perquisitions administratives est sans doute la disposition qui aura été la plus retouchée à l’occasion des prorogations successives de l’état d’urgence, tout à la fois pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des difficultés opérationnelles concrètes que suscitent ces perquisitions qui sont très dérogatoires par rapport aux procédures voisines de droit commun, judiciaires, fiscales ou douanières.
Le projet de loi de prorogation de novembre 2015 avait identifié les limites du dispositif initial et la loi adoptée a significativement modernisé le cadre légal applicable. La loi du 21 juillet 2016 s’est également attachée à résoudre des difficultés pratiques dont vos Rapporteurs avaient d’ailleurs eu connaissance au fil de leur contrôle : la possibilité de maintenir la personne sur les lieux durant la perquisition ; la possibilité pour les autorités administratives de prononcer une « perquisition de rebond » ; la délivrance obligatoire d’une copie de l’ordre de perquisition.
2. L’encadrement des perquisitions par le juge constitutionnel
Les lois de prorogation n’ayant pas été déférées au Conseil constitutionnel, ce dernier ne s’est prononcé sur le cadre légal de l’état d’urgence que par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité dont deux ont porté sur les perquisitions telles qu’elles sont organisées depuis le 20 novembre 2015.
Dans sa décision du 19 février 2016 (41), le Conseil a partiellement validé le dispositif fixé par la loi du 20 novembre 2015.
Il a tout d’abord jugé que les perquisitions relèvent de la seule police administrative et qu’elles n’affectent pas la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Partant, elles n’ont donc pas à être placées sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que les perquisitions ne peuvent être ordonnées que pour la durée et dans la zone couverte par l’état d’urgence. Sur le plan formel, l’ordre de perquisition doit en préciser le lieu et le moment ; le procureur de la République est informé sans délai de cette décision ; la perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire et ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins ; enfin elle donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.
La perquisition et ses modalités de mise en œuvre doivent être justifiées et proportionnées, le juge administratif devant veiller au respect de ces principes. À ce titre, une perquisition de nuit doit être justifiée par l’urgence ou l’impossibilité de l’effectuer de nuit.
Si les voies de recours prévues à l’encontre d’une décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions contestées ne peuvent être mises en œuvre que postérieurement à l’intervention de la mesure, elles doivent permettre à l’intéressé d’engager la responsabilité de l’État.
En revanche, le Conseil constitutionnel a considéré que la copie des données informatiques auxquelles il aura été possible d’accéder au cours de la perquisition est assimilable à une saisie, ladite saisie n’étant pas autorisée par un juge. De surcroît, les données copiées peuvent être dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le Conseil a estimé que la loi n’opérait pas une juste conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. Il a donc censuré les dispositions permettant de procéder à la copie de données informatiques.
Dans une décision du 2 décembre 2016 (cf. infra), le Conseil constitutionnel a été amené à se pencher sur les saisies de données informatiques telles que la loi du 21 juillet 2016 les a autorisées.
a. Le contentieux administratif
S’il est adapté au contentieux des assignations à résidence, le référé ne peut être utilisé en matière de perquisition : le juge ne peut en effet être saisi qu’après l’achèvement de l’opération – il n’y a donc pas urgence – et ne saurait donc prononcer une quelconque suspension de la mesure. Le contrôle ne peut se faire qu’au travers d’un contentieux de fond.
Au-delà des recours contre la mesure elle-même, la responsabilité de l’État peut être engagée en raison des modalités de mise en œuvre de la perquisition. Interrogé sur l’indemnisation des personnes perquisitionnées, M. Thomas Andrieu, alors directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur, indiquait devant notre Commission en janvier 2016 que les contentieux sont adressés aux préfets « puisque ce sont ces derniers qui décident des perquisitions ». Il ajoutait qu’il « y aura assurément des indemnisations », ne doutant pas « que des problèmes d’exécution se soient posés lors de certaines perquisitions ». Il rappelait toutefois que la question de l’indemnisation doit bien être distinguée du débat sur la légalité de la mesure. Il s’interrogeait alors en ces termes : « peut-on casser la porte ? Oui, si personne n’est là pour ouvrir, ou si l’on estime qu’un effet de surprise est nécessaire compte tenu de la dangerosité des personnes concernées. Que se passe-t-il ensuite dans l’appartement ? Là encore, c’est une affaire de fait, touchant l’usage le plus strictement proportionné de moyens coercitifs » (42).
Saisi de deux demandes d’avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’office du juge administratif en la matière. L’avis contentieux, commun aux deux affaires, rendu en assemblée le 6 juillet 2016 (43) tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016. Ils éclairent utilement la pratique et traitent d’une part de la légalité des ordres de perquisition et, d’autre part, des conditions d’engagement de la responsabilité de l’État à la suite de perquisitions.
L’avis du Conseil d’État du 6 juillet 2016 sur les perquisitions administratives
Une perquisition administrative ne peut être décidée que s’il y a des raisons sérieuses de penser que le lieu visé par la perquisition est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Il appartient au juge administratif saisi de contrôler les éléments matériels et de vérifier que la mesure est nécessaire et proportionnée au regard des éléments dont dispose l’administration au moment où elle a pris sa décision.
L’ordre de perquisition doit être motivé, en faisant apparaître les raisons qui ont conduit l’autorité administrative à décider de la perquisition. Il doit indiquer le lieu et le moment à partir duquel la perquisition peut être exécutée.
Le Conseil d’État estime que lorsque la perquisition est illégale, notamment s’il n’existe pas d’éléments crédibles faisant soupçonner une menace pour l’ordre public ou si la mesure est disproportionnée au regard du risque, il y a une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État pour les préjudices qu’elle aura causés. Il souligne par ailleurs que, même si la perquisition est légale, il peut y avoir des fautes commises dans son exécution (ouverture par la force de la porte sans justification, usage de la contrainte ou atteinte aux biens disproportionnés, traitement des enfants mineurs sans égard pour leur vulnérabilité particulière…). Ces fautes engagent alors la responsabilité de l’État qui doit indemniser leurs conséquences.
En revanche, en l’absence de faute, les personnes concernées par une perquisition ne sont pas susceptibles d’être indemnisées des conséquences de cette perquisition. Il n’en va pas de même pour les tiers qui seront indemnisés même s’il n’y a aucune faute, en application du principe selon lequel les charges publiques doivent être réparties également entre les citoyens. Par exemple, l’éventuel propriétaire du lieu visé par la perquisition, qui n’a pas d’autre lien avec les personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique que le contrat de location, sera indemnisé des dégradations du local même si la perquisition était légale et si les services de police n’ont commis aucune faute.
Le régime de responsabilité ainsi établi reprend la solution dégagée par le ministre de l’Intérieur dans une circulaire portant sur ce sujet et datée du 25 novembre 2015. Il y rappelait que « dans la mesure où il n’est pas matériellement possible d’apprécier en amont si la perquisition administrative ordonnée impliquera ou non des tiers, les modalités de sa mise en œuvre doivent être graduées ».
Les tribunaux ont peu eu l’occasion de mettre en œuvre l’avis du Conseil d’État, seuls 16 recours ayant été jugés à la fin du mois d’octobre 2016. Le Conseil d’État a indiqué que 31 dossiers restent à juger et qu’un appel a été enregistré devant une cour administrative d’appel mais que cette dernière n’a pas encore statué. À la fin du mois d’octobre, moins de 50 contentieux relatifs aux perquisitions ont donc été engagés, c’est-à-dire que les recours portent sur à peine plus d’1 % du volume total.
Au début du mois de mai 2016, 22 contentieux indemnitaires étaient engagés, le montant total des sommes demandées atteignant un peu plus de 224 000 euros.
La procédure a pu apparaître longue et complexe, notamment pour des tiers. Dans sa décision du 26 mai 2016, le Défenseur des droits recommandait à ce titre « de faciliter l’accès au droit à l’indemnisation en prévoyant des mécanismes exceptionnels de réparation des dommages causés par des mesures de police administrative prises en application de l’état d’urgence à l’origine d’un trouble anormal et d’en informer les personnes intéressées » (44).
Au 30 août 2016, le ministère de l’Intérieur indiquait que les perquisitions administratives ont fait l’objet de plus de 200 requêtes indemnitaires préalables, de 32 recours de plein contentieux et d’un référé. Six décisions ont été rendues, une seule condamnant l’État au versement de 1 500 euros. Les demandes indemnitaires préalables ont abouti à 18 transactions pour la réparation de dommages matériels et à quatre transactions pour la réparation du préjudice moral, les sommes accordées s’élevant respectivement à 23 186 euros et à 1 065 euros.
L’instruction de plusieurs dossiers a été suspendue au début de l’été, dans l’attente de l’avis contentieux du Conseil d’État rendu le 6 juillet 2016.
Au-delà de ces données chiffrées, vos Rapporteurs ont conscience du traumatisme que peut causer à ses occupants l’ouverture brutale d’une maison ou d’un appartement et dont la presse, particulièrement dans les premiers temps de l’état d’urgence, s’était fait l’écho. Très rapidement après la déclaration de l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur a d’ailleurs pris une circulaire en date du 25 novembre 2015 qui rappelle les règles de déroulement opérationnel des perquisitions. Aussi vos Rapporteurs préconisent-ils que l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 soit modifié sur ce point afin de préciser les conditions d’usage de la force par les unités intervenantes.
Proposition : Préciser les conditions de recours à la force pour pénétrer dans les lieux lors d’une perquisition administrative.
Bien que les ordres de perquisition constituent une mesure administrative et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire est amené à se prononcer sur la légalité de la perquisition administrative lorsqu’elle a permis la découverte d’éléments constitutifs d’une infraction. Certains requérants ont en effet introduit une requête en exception d’illégalité, estimant notamment que l’ordre de perquisition n’était pas suffisamment motivé ou ne permettait pas d’identifier avec assez de précision les lieux ou les personnes visés.
Les tribunaux correctionnels n’hésitent pas à annuler les saisies opérées lors d’une perquisition administrative ou à constater l’irrégularité de l’ordre de perquisition lorsqu’ils considèrent que ledit ordre n’est pas suffisamment motivé. La chambre d’instruction de la cour d’appel de Grenoble relève par exemple, dans deux arrêts du 31 mai 2016 que la simple mention de « l’existence de raisons sérieuses de penser que se trouvent dans les lieux ciblés des personnes, armes ou objets susceptibles d’être liés à des activités à caractère terroriste », ne permet pas de s’assurer que l’ordre est adapté, nécessaire et proportionné à sa finalité. Le 28 avril 2016, la cour d’appel de Riom a constaté l’illégalité de l’acte administratif ordonnant la perquisition, pour défaut de motivation. L’ordre préfectoral contesté s’appuyait sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire et la « nécessité d’employer les moyens juridiques rendus possibles par la déclaration d’état d’urgence pour prévenir cette menace ». Selon la cour, ces considérants constituent des « clauses de style » ne pouvant en aucune mesure s’apparenter à une motivation en droit et en fait du cas d’espèce concerné.
Les tribunaux veillent également à ce que le lieu de perquisition et la personne visée soient identifiables sans doute possible. Le tribunal correctionnel de Grenoble a ainsi relaxé deux prévenus le 18 février 2016 dans deux affaires distinctes de détention d’armes et de stupéfiants. Les perquisitions administratives qui avaient conduit aux découvertes fondant les procédures n’ont pas été jugées suffisamment précises : le lieu visé était constitué d’un hameau constitué de plusieurs habitations comportant plusieurs logements et aucune personne n’était nommément visée par l’ordre de perquisition.
Le 29 juin 2016, la cour d’appel de Grenoble confirmait les décisions du tribunal correctionnel de Grenoble, considérant cependant qu’au regard des éléments apportés par le ministère public, il ne pouvait y avoir de confusion sur les lieux désignés par l’ordre de perquisition et sur l’identité de la personne visée. En revanche, la Cour retenait que les arrêtés étaient insuffisamment précis pour justifier la contrainte exercée, puisqu’il n’était fait référence à aucun élément factuel, fût-il sommaire, propre à établir leur bien fondé au regard des nécessités de la sécurité et de l’ordre publics, ainsi qu’à justifier l’urgence attachée à la réalisation des perquisitions.
Ces décisions du juge judiciaire montrent la nécessite de la parfaite légalité des ordres de perquisition pour ne pas fragiliser les procédures judiciaires susceptibles d’être ouvertes à la suite de la découverte d’une infraction. Par ailleurs, il faudrait se garder qu’à l’occasion de l’examen de la légalité des perquisitions administratives soit réouvert le débat sur la coexistence de deux ordres juridictions.
4. L’exploitation des données informatiques
a. Le cadre légal fixé par la loi du 21 juillet 2016
Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 (45), l’article 11 de la loi de 1955 définit un nouveau cadre juridique pour la saisie de données informatiques intervenant lors d’une perquisition administrative. Cette procédure est applicable aux « données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal » et aux supports matériels de ces données, c’est-à-dire aux téléphones, tablettes, ordinateurs, périphériques de stockage, mais aussi à d’autres équipements comme des manettes de jeux vidéo dès lors que celles-ci permettent d’échanger des messages.
Sont exclus « les éléments dépourvus de tout lien avec la menace » que représenterait la personne visée par la perquisition afin d’assurer le respect de la vie privée que le Conseil constitutionnel avait expressément visé en février 2016.
La saisie peut se faire soit par la copie des données soit, lorsque la copie allongerait « le temps de la perquisition », par la confiscation des matériels. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal spécifique dont copie est remise à la personne perquisitionnée. Si la copie ou la confiscation sont de la compétence de l’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition, elles doivent intervenir « en présence de l’officier de police judiciaire ».
La loi instaure ensuite un dispositif original consistant à soumettre l’exploitation des données saisies à l’autorisation du juge administratif. Dans l’attente de sa décision, les « données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition » et « nul n’y a accès avant l’autorisation du juge ».
Le juge des référés du tribunal administratif du lieu de la perquisition est saisi par le préfet qui a ordonné la perquisition. Au vu « des éléments révélés par la perquisition », c’est-à-dire des procès-verbaux rédigés par les policiers et les gendarmes ayant réalisé la perquisition, et, s’il l’estime utile, des premières analyses effectuées durant la perquisition, il autorise leur exploitation. La procédure est contradictoire et passe par une audience publique. L’appel suspensif est également possible devant le juge des référés du Conseil d’État.
La durée de conservation des données et des matériels informatiques est limitée au « temps strictement nécessaire à leur exploitation ». En tout état de cause, les matériels seront restitués au bout de quinze jours au maximum, le cas échéant après qu’une copie des données ait été réalisée, tandis que les données seront détruites après trois mois. Ces délais peuvent être prorogés par décision du juge des référés saisis dans les mêmes conditions. Cette possibilité vise notamment les cas où l’exploitation soulève des difficultés techniques particulières.
Le juge administratif, saisi par le préfet, statue en référé pour autoriser – ou non – l’exploitation des données. Selon le Conseil d’État, au 26 octobre 2016, 80 demandes d’exploitation ont été soumises aux tribunaux administratifs. 70 demandes ont été totalement accordées, une partiellement, une demande a été retirée et huit ont été rejetées. Le Conseil d’État n’a été saisi que de cinq appels, un seul dossier ayant conduit au maintien du refus prononcé en première instance.
Des ordonnances des juges des référés, il ressort que les tribunaux veillent effectivement à ce que des éléments probants viennent caractériser la menace que pourrait représenter l’individu pour l’ordre et la sécurité publics. La radicalisation des personnes, si elle est souvent évoquée, ne suffit pas en elle-même. Le tribunal administratif de Dijon autorise par exemple l’exploitation de données détenues par un individu qui diffuse de la propagande, possède des drapeaux de l’État islamique et des ouvrages salafistes et dont l’administration a pu démontrer qu’il entretient une correspondance électronique avec des personnes en zone de combat syro-irakienne. De même, le Conseil d’État confirme que l’entretien de communications avec des personnes parties dans ces zones de combat constitue un élément suffisant pour autoriser l’exploitation de données informatiques, « alors même qu’aucun objet permettant l’ouverture d’une procédure judiciaire n’a été découvert au cours de la perquisition et qu’une première consultation des données informatiques […] n’a pas fait ressortir d’éléments en rapport avec la menace pour la sécurité et l’ordre publics ayant motivé la perquisition ».
Dans son analyse, le juge administratif opère un contrôle de proportionnalité et veille au respect des droits fondamentaux des personnes perquisitionnées.
Les décisions de rejet sont fondées sur l’insuffisance des éléments relatifs à la menace que constitue la personne pour la sécurité et l’ordre publics. Les éléments apportés par l’administration doivent bien être en lien avec la perquisition, le tribunal administratif de Rennes refusant par exemple que la demande d’exploitation des données saisies soit justifiée par les motifs fondant l’assignation à résidence de l’intéressé. De même, le tribunal administratif de Nancy relève que les éléments qui « étaient de nature à fonder la mesure de perquisition […] ne sauraient en revanche être utilement invoqués au soutien de la demande d’exploitation du contenu du matériel saisi ». En l’espèce, la personne avait fait « l’objet de procédures pour apologie d’actes de terrorisme et […] aurait formulé des propos publics exprimant une attirance pour l’idéologie djihadiste » mais la perquisition n’avait pas révélé d’éléments « caractérisant une menace pour l’ordre et la sécurité public », la possession de deux livres relatifs à l’islam ne suffisant pas à caractériser un comportement menaçant.
Le 5 septembre 2016, le Conseil d’État relève que « la seule circonstance […] que [des] fichiers comportent des éléments en langue arabe qui n’ont pas pu être exploités immédiatement ne suffit pas à les faire regarder comme relatifs à la menace que constituerait pour la sécurité et l’ordre publics le comportement des personnes concernées ». En première instance, le tribunal administratif de Strasbourg avait déjà considéré que « la présence d’un dossier intitulé « Islam » contenant des fichiers en langue arabe » n’est pas un élément suffisant même si la perquisition a été « motivée par la circonstance que [l’individu] présenterait des signes de radicalisation » car « ces éléments ne sont […] corroborés par aucun commencement de preuve ».
Le juge fonde souvent son autorisation sur les premières analyses conduites durant la perquisition. Ainsi le tribunal administratif de Lyon autorise-t-il l’exploitation des données stockées sur le disque dur d’un ordinateur car l’examen du téléphone portable de la personne perquisitionnée a fait apparaître « des sites privés accessibles par cooptation et des photographies à caractère djihadiste appelant à commettre des attentats ou faisant l’apologie du terrorisme ».
Dans la plupart des cas, les tribunaux administratifs soulignent que l’autorisation d’exploitation des données et supports saisis est limitée aux données en lien avec la menace à l’ordre public. Le juge a ainsi pu autoriser le propriétaire de données à y accéder dès lors qu’il avait démontré en avoir besoin dans le cadre de sa scolarité. Devant le tribunal administratif d’Amiens, le requérant a pu démontrer que sur « les supports informatiques saisis […], se trouvaient quelques fichiers dont il a impérativement besoin dans le cadre de [son] stage » ; le juge a alors ordonné au chef de service conservant les matériels saisis d’inviter, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’intéressé à « se rendre dans les locaux où sont conservés lesdits matériels afin [qu’il] désigne les fichiers dont il a impérativement besoin dans le cadre de son stage [et] qu’après vérification du caractère inoffensif de leur contenu, une copie de ces fichiers [lui soit délivrée] dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Les juges rappellent également que cette autorisation est contrainte dans le temps. Le tribunal administratif de Besançon va jusqu’à fixer précisément la date à laquelle les équipements et matériels saisis doivent être restitués à leur propriétaire.
Saisi par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif dans sa décision du 2 décembre 2016. Il rappelle que la copie des données ne « peut être effectuée que si la perquisition révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne justifiant cette perquisition ». Lorsque le juge autorise l’exploitation de données, cette dernière ne peut « porter que sur des éléments présentant un lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne justifiant la perquisition ». Avec ce dispositif de saisie et d’autorisation du juge après la copie ou la saisie mais avant l’exploitation, le législateur a opéré, selon le Conseil constitutionnel, « une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il n’a pas non plus méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif ».
Le Conseil a censuré en revanche une partie des dispositions relatives à la durée de conservation des données. Il relève que « lorsque les données copiées caractérisent une menace sans conduire à la constatation d’une infraction, le législateur n’a prévu aucun délai, après la fin de l’état d’urgence, à l’issue duquel ces données sont détruites » et, partant, ne prévoit pas les garanties légales propres à « assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public » (46) . Pour permettre de corriger ce point, l’inconstitutionnalité de cette disposition ne court qu’à compter du 1er mars 2017.
Le dispositif actuellement mis en œuvre est bien conforme aux intentions du législateur qui avait souhaité, à travers l’adoption de ce dispositif d’autorisation original opérer une juste conciliation entre les impératifs opérationnels et le respect du droit de la vie privée. En pratique, il évite de systématiser la copie de données et permet de concentrer les analyses – souvent très chronophages – sur les données les plus sensibles. Il appartiendra au Parlement de procéder aux ajustements identifiés par le Conseil constitutionnel en matière de conservation des données.
II. LES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE : UN USAGE IMPORTANT AFIN D’AFFAIBLIR LA MENACE TERRORISTE
L’article 6 de la loi du 3 avril 1955 donne au ministre de l’Intérieur la possibilité d’assigner à résidence toute personne à « l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Cette faculté a été ouverte dès le 14 novembre 2015 (47) pour les communes d’Île-de-France et le lendemain (48) pour l’ensemble du territoire métropolitain. Le 18 novembre 2015, la mesure a été étendue à plusieurs territoires d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) (49). Cette disposition originelle de la loi de 1955 a été pérennisée mais sensiblement ajustée par la première loi autorisant la prolongation de l’état d’urgence (50).
L’assignation à résidence (AAR) a été utilisée de façon importante, surtout au début de l’état d’urgence, comme le montre le graphique ci-après.
ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE MISES EN œUVRE DEPUIS LE 14 NOVEMBRE 2015
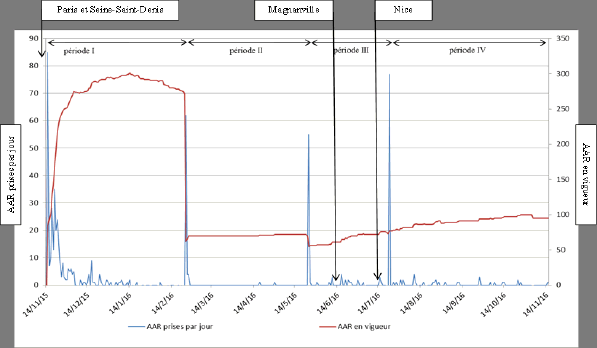
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
Les mesures d’assignation ne pouvant excéder la durée de l’état d’urgence telle que fixée par la loi de prorogation, le ministère a dû reprendre des arrêtés pour prolonger les assignations qu’il convenait de maintenir. Ce mécanisme explique les pics apparaissant le 25 février, le 25 mai et le 21 juillet 2016 dans le graphique précédent.
Le caractère inégal de la répartition dans le temps des assignations à résidence se retrouve au plan géographique. Comme le montre la carte suivante, l’Île-de-France concentre près de 30 % des assignations. Avec le Nord et l’Hérault, ce taux dépasse les 40 %.
CARTE DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE NOTIFIÉES PAR DÉPARTEMENT
(DU 14 NOVEMBRE 2015 AU 15 NOVEMBRE 2016)
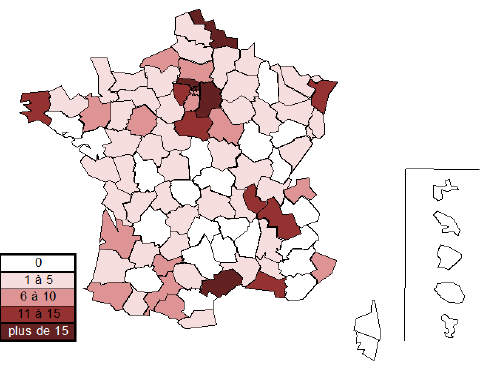
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
Dans 29 départements, aucune assignation à résidence n’a été prononcée. Comme le détaille la carte suivante, les assignations à résidence en vigueur au 15 novembre 2016 se sont encore concentrées, l’Île-de-France, le Nord et le Rhône représentant près de 43 % du total des assignations.
CARTE DES ASSIGNATIONS PAR DÉPARTEMENT EN VIGUEUR AU 15 NOVEMBRE 2016
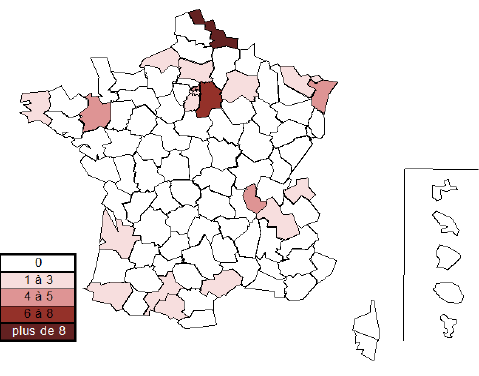
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
A. LE RÉGIME JURIDIQUE DES ASSIGNATIONS
1. Un meilleur encadrement d’une mesure ancienne
En 1955, le dispositif légal relatif aux assignations à résidence était assez bref. Les personnes dont « l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics » pouvaient être obligées de résider dans ou à proximité d’une agglomération, étant entendu que ce dispositif ne pouvait avoir « pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes » susvisées. La loi prévoyait en outre qu’il appartient à l’État de prendre toutes les dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes ainsi que celle de leur famille.
Adapté aux circonstances particulières de la guerre d’Algérie, ce mécanisme a été significativement modifié en 2015, empruntant, comme le relève le rapporteur public du Conseil d’État dans ses conclusions en décembre 2015, au dispositif d’assignation prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (51). Si elle reste dans la logique de 1955, la loi de novembre 2015 fonde la mesure non plus sur une activité dangereuse mais sur des « raisons sérieuses [de penser] que le comportement [de l’individu] constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public ». La nouvelle formulation accorde au ministre plus de latitude dans la motivation de sa décision, cette souplesse étant apparue nécessaire suite aux tragiques attentats de novembre 2015 (52). Il convient de rappeler que l’expression de « raisons sérieuses » suppose que le ministre – ou ses services – soit en mesure d’apporter, notamment dans le cadre d’un contentieux, des éléments de preuve suffisants pour justifier la mesure, le juge ayant développé sur ce point un contrôle entier de proportionnalité (cf. infra).
Le mécanisme initial a été par ailleurs complété sur cinq points. Il lui adjoint en outre un dispositif spécifique concernant les personnes précédemment condamnées pour des actes liés au terrorisme.
Désormais le ministre de l’Intérieur décide du lieu d’assignation et peut faire conduire l’intéressé sur son lieu d’assignation par les forces de police ou de gendarmerie. Cette faculté peut représenter une contrainte forte, le lieu d’assignation pouvant être éloigné du lieu de domicile ou d’exercice d’une activité professionnelle. Selon les informations portées à la connaissance de vos Rapporteurs, cette faculté n’a été utilisée que de façon très ciblée (53). Afin d’éviter toute dérive, ils jugeraient toutefois utile de l’encadrer par une disposition législative spécifique.
Proposition : Encadrer le périmètre géographique dans lequel la personne est assignée pour rendre la mesure conciliable avec sa vie familiale et professionnelle.
Le choix du lieu peut également s’avérer être difficile lorsque l’assignation concerne des personnes sans domicile fixe, ce qui a été le cas au moins à deux reprises dans la période récente. Le lieu d’assignation a été conjointement choisi par la préfecture et les services de renseignements. La mesure leur impose de demeurer sur le territoire d’une commune mais ne les oblige pas à demeurer la nuit dans un local donné.
L’assignation à séjourner dans un territoire circonscrit peut se doubler d’une obligation de demeurer dans un lieu d’habitation pendant la moitié de la journée. En d’autres termes, le ministre de l’Intérieur peut limiter les déplacements de jour et les interdire la nuit. Cette possibilité assortit quasiment systématiquement les assignations à résidence prononcées : depuis le 21 juillet, seuls cinq arrêtés d’assignation sur 96 renoncent à cette possibilité.
Le 1° de l’article 6 de la loi de 1955 prévoit que le ministre de l’Intérieur peut obliger les personnes assignées à « se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ». Le système de pointage mis en place s’inspire assez largement de dispositifs existant avant l’actualisation de la loi de 1955, notamment ceux prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’introduction d’une limitation à trois pointages par jour dans la loi du 20 novembre 2015 a d’ailleurs conduit le ministère à modifier tous les arrêtés d’assignation précédemment pris car ils avaient été établis sur la base de quatre pointages quotidiens sur le modèle des dispositions applicables aux étrangers terroristes astreints à résidence dans l’attente de leur éloignement. Toutes les assignations en vigueur au 15 novembre sont assorties d’obligations de pointage quotidien : 6 % d’entre elles prévoient un pointage unique, 25 % deux pointages et 69 % trois pointages. Une seule assignation, concernant une personne mineure, comporte des obligations de pointage plus allégées à raison de trois fois par semaine.
La remise du passeport ou de toute pièce justificative de son identité doit se comprendre comme complémentaire des dispositifs de prévention de départ à l’étranger, souvent pour rejoindre, directement ou non, une zone de combat. À la différence du dispositif d’interdiction de sortie du territoire (IST) prévu par l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure (54), le passeport n’est pas temporairement « invalidé » ; en revanche le dispositif de l’état d’urgence prévoit, comme dans le cadre de l’IST, la remise du passeport ou de tout document justificatif de son identité. Dans tous les cas, un récépissé est remis à l’intéressé.
Lorsque la remise de passeport est ordonnée, les arrêtés d’assignation font généralement état de tentatives antérieures pour rejoindre une zone de combat ou mentionnent des « velléités de départ ». Entre le 21 juillet et le 15 novembre 2016, 24 assignés à résidence ont dû remettre leurs passeports ou pièces d’identité.
Les mesures d’assignation peuvent se compléter d’une interdiction d’entrer en relation avec une ou plusieurs personnes dont le comportement constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité publics. Cet ajout est apparu particulièrement nécessaire dans le cadre de démantèlement de réseaux ou de filières, les assignations à résidence devant permettre de « fixer » les intéressés et de réduire les potentielles collusions terroristes. Il reprend les termes du dispositif introduit en 2014 dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers (55). En application de son article L. 563-1, peut en effet être prononcée « une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste ».
La mise en œuvre pratique de l’interdiction d’entrer en relation a pu, dans un premier temps, ne pas s’articuler de façon optimale avec d’autres mesures de l’état d’urgence : plusieurs personnes assignées à résidence pouvaient en effet se rencontrer au commissariat pour souscrire à leurs obligations de pointage alors même qu’il leur était interdit d’entrer en relation. Au-delà l’interdiction d’entrer en contact, ainsi que l’a observé M. Jean-François Illy, directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin lors de la table ronde des responsables opérationnels de la police nationale organisée le 11 janvier 2016 (56), le fait de convoquer à la même heure les personnes assignées leur permet de faire connaissance alors même qu’ils ne se connaissaient pas auparavant et, partant, de constituer d’éventuels réseaux. Cette limite a été rapidement identifiée et les horaires de pointage ont été aménagés en conséquence.
Au 15 novembre 2016, sur les 95 assignations à résidence en vigueur, seules cinq d’entre elles comportaient une interdiction complémentaire d’entrer en relation, une assignation comportant cette interdiction ayant été abrogée le 19 septembre 2016.
L’article 6 prévoit enfin un dispositif spécifique de contrôle du respect de l’assignation à résidence par certaines personnes dont le passé pénal atteste d’une dangerosité particulière. Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l’Intérieur peut ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La loi précise que ce dispositif permet à tout moment de déterminer à distance la localisation de la personne faisant l’objet de la mesure. Cette mesure ne peut pas être cumulée avec une obligation de pointage ni avec une obligation de demeurer à son domicile la nuit.
Comme le relevait le Premier ministre lors de l’examen du premier projet de loi de prolongation de l’état d’urgence, cette mesure vise les « individus qui ont été condamnés à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification, puni de dix ans d’emprisonnement, et qui ont fini l’exécution de leur peine depuis moins de huit ans » (57). Elle ne peut s’appliquer qu’après « accord de la personne concernée, recueilli par écrit ».
À ce jour, ce dispositif n’a pas été mis en œuvre, le ministère de l’Intérieur indiquant que ses modalités opérationnelles de fonctionnement doivent être préalablement définies, ce qui implique :
- de disposer du matériel adéquat (bracelet, émetteur et récepteur, traitement automatisé de gestion du dispositif) ;
- de réaliser une enquête préalable de faisabilité technique in situ, visant notamment à vérifier la bonne couverture réseau des zones envisagées et à tester le bon fonctionnement du dispositif ;
- de déterminer les modalités de pose et de dépose des émetteurs sur les personnes faisant l’objet de cette mesure et des récepteurs dans les domiciles concernés ;
- de déterminer comment les services de police et de gendarmerie sont informés de ce dispositif et comment ils reçoivent les éventuelles alarmes ;
- de définir les modalités d’interventions des forces de l’ordre en cas de déclenchement d’alarme.
Un mécanisme équivalent existe pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en raison d’un comportement lié à des activités à caractère terroriste, assignés à résidence dans l’attente de leur éloignement en application de l’article L. 571-3 du CESEDA. Compte tenu du faible nombre d’individus pouvant faire l’objet de la mesure au titre de l’état d’urgence, le ministère de l’Intérieur a choisi de rattacher la gestion du dispositif propre à l’état d’urgence à celle du système mis en place par le ministère de la Justice. Une convention de délégation de gestion, à laquelle sera annexé un guide de procédures, est en cours de passation avec la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice.
Le ministère de l’Intérieur a indiqué à vos Rapporteurs qu’un projet de décret en Conseil d’État précisant les missions assumées respectivement par les services de l’administration pénitentiaire, l’autorité administrative et les services de police ou de gendarmerie, et modifiant les dispositions du code de procédure pénale relatives au traitement automatisé de gestion du placement sous surveillance électronique, a été élaboré en concertation avec le ministère de la justice et sera très prochainement soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés puis au Conseil d’État.
2. La sanction des violations des mesures d’assignation
Depuis la loi du 20 novembre 2015, la violation d’une mesure d’assignation est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le non-respect d’une obligation complémentaire (pointage, interdiction d’entrer en relation…) est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le durcissement significatif du quantum des peines s’inscrit dans un objectif dissuasif clair.
Selon les informations transmises à vos Rapporteurs, les cas de violation restent rares : entre le 14 novembre 2015 et le 21 juillet 2016, le ministère de la Justice a recensé 58 affaires de non-respect des mesures de l’état d’urgence. Depuis le 21 juillet 2016, 11 violations d’assignation ont été recensées ; huit d’entre elles ont conduit à une garde à vue et parmi elles, quatre ont abouti au prononcé d’une peine d’emprisonnement. Le juge pénal fait preuve d’une réelle sévérité dans la répression des violations des mesures d’assignation, n’hésitant pas à prononcer des peines d’emprisonnement ferme.
Lorsque la personne est incarcérée, l’assignation est abrogée, la personne visée ne pouvant plus satisfaire à ses obligations ; elle peut en revanche être reprise dès sa sortie de prison.
B. LA MISE EN œUVRE DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
La mise en œuvre de l’assignation a fait l’objet d’adaptations de procédure sous le contrôle attentif des juges constitutionnel et administratif. Si des solutions ont été trouvées, la potentielle concurrence de l’assignation avec d’autres mesures administratives ou judiciaires doit encore faire l’objet d’un meilleur encadrement juridique.
1. Le ciblage des personnes concernées
Les déplacements faits par vos Rapporteurs comme les auditions conduites par la Commission ont permis de constater des impulsions croisées entre l’échelon central des services de renseignement – qui sont presque exclusivement à l’origine du ciblage des assignations – et leurs échelons déconcentrés.
Le circuit d’un arrêté d’assignation est globalement le suivant.
Les services de renseignements saisissent en général l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) qui, avant de saisir la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), sollicite les autres services pour s’assurer de la compatibilité de l’assignation avec d’autres mesures ou investigations en cours. M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, a décrit à la Commission le travail qui s’opère alors : « les propositions remontent par la voie hiérarchique – soit la direction générale de la police nationale (DGPN), soit la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), soit la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) –, après quoi il est indispensable que le nom de la personne soit mis au « pot commun » pour vérifier que tous les services sont d’accord pour l’assigner. D’où le rôle de l’UCLAT. Lorsqu’une personne est suivie par un service, elle ne l’est normalement plus par un autre, et un effort de coordination du travail des services de renseignement a été fait cette année ; il faut toutefois s’assurer que la personne n’est pas une source pour un autre service, que les services étrangers n’expriment pas d’opposition, etc. C’est alors une procédure de silence qui s’applique : pour qu’une mesure de police administrative soit validée, il faut que les autres services ne s’y opposent pas. C’est à ce stade que s’opère la coordination » (58).
L’UCLAT saisit ensuite la DLPAJ via une « note blanche » préservant la confidentialité des sources. Une préfecture peut également saisir directement la DLPAJ qui sollicite alors l’UCLAT afin de disposer d’une note blanche. Au sein de la DLPAJ, les dossiers sont instruits par une cellule « état d’urgence » qui peut, autant que de besoin, recueillir des informations complémentaires. La décision finale sur l’opportunité de l’assignation à résidence intervient lors de la signature de l’arrêté par le DLPAJ qui dispose d’une délégation permanente du ministre pour ce faire. L’arrêté signé est envoyé à la préfecture concernée pour notification à la personne assignée.
Vos Rapporteurs observent que, aux termes de la loi, et contrairement aux dispositions qui prévalent en matière de perquisitions, aucune information préalable du parquet n’est prévue. Dans les faits, elle existe toutefois avec le parquet territorialement compétent qu’une circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 décembre 2015 recommande d’informer, mais aussi, depuis juillet 2016 avec le parquet parisien qui détient une compétence spécifique en matière d’anti-terrorisme. Vos Rapporteurs jugent souhaitable d’introduire dans la loi une disposition prévoyant l’information systématique du parquet pour chaque mesure d’assignation compte tenu de la concurrence qui peut parfois exister avec les procédures judiciaires.
Proposition : Prévoir l’information du parquet de chaque assignation à résidence, de son aménagement et de son abrogation.
2. La mise en œuvre des assignations à résidence
Bien qu’utilisées dès la promulgation de l’état d’urgence, les mesures d’assignation disposaient d’un cadre juridique ancien et assez flou qui a été précisé par le législateur et le juge et qui a bénéficié d’une normalisation des pratiques.
Pour entrer en vigueur, l’assignation à résidence doit être notifiée à l’intéressé. Si ce préalable semble aller de soi en droit, il peut être plus difficile à mettre en œuvre, notamment lorsque les individus ne disposent pas d’un domicile déterminé ou que, anticipant une potentielle mesure d’assignation, ils n’occupent pas leur domicile habituel.
Dans leur communication du 30 mars 2016, vos Rapporteurs relevaient par exemple que, dans le cadre de la COP 21, 15 des 27 assignations à résidence n’avaient pu être notifiées aux intéressés. Au 25 février 2016, sur les 271 assignations en vigueur, 5 n’avaient pu être notifiées.
Les notifications ne semblent aujourd’hui pas soulever de difficulté. Vos Rapporteurs relèvent néanmoins le cas particulier des personnes sans domicile fixe. Sur la période, deux arrêtés d’assignation ont été prononcés contre des personnes sans domicile fixe, le premier en date du 16 septembre 2016, le second en date du 17 octobre 2016. La notification est intervenue par convocation au commissariat de police pour l’un, l’autre arrêté n’ayant pas été notifié puisque l’intéressé a finalement été placé en centre de rétention administrative puis éloigné.
Outre les enjeux pratiques, un assigné ne pouvant se conformer aux obligations qui en découlent que s’il en est dûment informé, la notification permet d’informer l’intéressé de ses droits et de ses voies de recours et des possibilités d’aménagement de la mesure. Le ministère de l’Intérieur précise remettre désormais systématiquement aux intéressés un guide pratique (figurant en annexe au présent rapport) précisant les possibilités de demande d’aménagements, en particulier en raison de leurs obligations professionnelles. Dans leurs décisions, aussi bien en référé que lorsqu’ils statuent au fond, les tribunaux administratifs relèvent souvent que les requérants omettent de se saisir de cette possibilité d’aménagement, préférant demander la suspension voire l’annulation de toutes les obligations de pointage.
b. Le débat contradictoire lors du prononcé de la mesure
Des requérants ont contesté les modalités de mise en œuvre des mesures d’assignation, considérant qu’elles violaient les droits de la défense et le principe du débat contradictoire préalable.
N’étant pas une mesure judiciaire mais une mesure de police administrative, l’assignation n’est pas soumise aux mêmes impératifs procéduraux. Et si le code des relations entre le public et l’administration dispose, dans son article L. 121-1 que les décisions administratives qui sont « prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », il prévoit une dérogation « en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » (article L. 121-2). Le ministère de l’Intérieur a fait usage de cette dérogation et son approche a été validée par les tribunaux administratifs.
Exemples de jurisprudence sur l’obligation d’un débat contradictoire
Dans son ordonnance du 5 février 2016, le tribunal administratif de Melun, saisi par un assigné à résidence de l’absence de contradictoire avant que ne soit pris l’arrêté d’assignation, a considéré qu’une contestation fondée sur « le respect du principe du contradictoire est [inopérante] » dans le cadre de la procédure d’urgence que constitue le référé. Le tribunal administratif de Rennes, dans son ordonnance du 15 avril 2016, précise quant à lui que « la mise en œuvre d’une procédure contradictoire priverait de tout effet utile une mesure d’assignation à résidence et serait ainsi de nature à compromettre l’ordre public ».
Dans un autre cas, un assigné a attaqué le dernier arrêté d’assignation qui le vise devant le tribunal administratif de Lyon, considérant notamment que cette mesure viole le principe de présomption d’innocence. L’arrêté d’assignation se fondait en effet sur une condamnation pénale qui n’était pas encore définitive, l’intéressé ayant interjeté appel, et que par ailleurs le juge pénal l’avait relaxé pour d’autres faits. Il relève en outre qu’il n’a pas été « en mesure de présenter ses observations avant la prolongation de la mesure d’assignation à résidence ; aucun élément ne peut permettre de justifier une dérogation à ces dispositions, en l’absence de toute urgence et dès lors qu’il était déjà assigné depuis plusieurs mois ». Dans son mémoire en défense, le ministère de l’Intérieur soutient que l’administration « n’a pas l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque cette mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Il estime également que le respect du principe de présomption d’innocence « n’est pas invocable à l’encontre d’une simple mesure de police administrative ». Le tribunal administratif de Lyon valide cette argumentation, relevant que les éléments invoqués par le requérant ne sont « pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte » et, sur ce fondement, rejette sa demande.
Pour leur part, vos Rapporteurs considèrent qu’il s’agit d’une formalité substantielle. En effet, ce débat contradictoire permettrait à l’intéressé de faire valoir ses arguments, de comprendre la mesure et de décider, en connaissance de cause, s’il choisit d’engager un contentieux. Il convient d’ailleurs de noter que ce dispositif existe dans d’autres procédures voisines, telles que le contrôle administratif des personnes s’étant rendues sur des zones de djihad (art. L. 225-4 du code de sécurité intérieure). Afin de ne pas engorger l’échelon central, la conduite de ces procédures pourrait utilement être confiée aux préfets.
Proposition : Préciser que les personnes assignées peuvent faire valoir leurs observations dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’assignation.
c. Les facultés d’aménagement et de délivrance de sauf-conduits
C’est sans doute ici que le ministère est passé, sous l’impulsion très claire du juge administratif (cf. infra), d’assignations « standardisées », ne serait-ce qu’en raison de leur signature en très grand nombre dans les tout premiers jours de l’état d’urgence, à des dispositifs plus individualisés. Lors de son audition par la Commission le 11 janvier 2016, M. Thomas Andrieu, alors directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur, indiquait ainsi qu’« à mesure que [la DLPAJ recevait] des demandes de rectification des services ou des plaintes des intéressés, [elle a] ajusté les modalités pour tenir compte de la vie privée et familiale des assignés. C’est en ce moment […] l’essentiel du travail de la cellule dédiée à l’assignation à résidence au sein de [la] direction. Et c’est un travail permanent, car les situations individuelles évoluent » (59).
De fait, les modifications ont été particulièrement nombreuses durant la première période de l’état d’urgence, 215 arrêtés ayant été modifiés, sans qu’il soit possible d’isoler les changements intervenus à la demande des intéressés. Durant la deuxième période, 11 arrêtés ont été modifiés, et 15 l’ont été durant la troisième période. Entre le 21 juillet et le 15 novembre 2016, 32 modifications ont été accordées par le ministre de l’Intérieur. Outre les modifications du fait du ministère, essentiellement pour ajouter une interdiction d’entrer en contact, elles concernent surtout des changements de domicile ou des demandes liées à une activité scolaire ou professionnelle.
Le circuit administratif de modification d’une assignation à résidence est le suivant : la DLPAJ peut être saisie d’une demande de modification d’une assignation à résidence par l’UCLAT, par une préfecture ou par l’individu assigné lui-même via une adresse mél dédiée.
La demande de modification est examinée par la cellule « état d’urgence » de la DLPAJ, qui peut demander des justificatifs et des informations complémentaires à l’UCLAT ou à l’individu assigné. L’avis favorable de l’UCLAT est nécessaire à toute modification d’un arrêté d’assignation. La cellule « état d’urgence » rédige le projet d’arrêté modificatif. La décision finale de la modification intervient lors de la signature de l’arrêté modificatif par l’équipe de direction de la DLPAJ. L’arrêté modificatif signé est envoyé à la préfecture concernée pour notification à la personne concernée.
Il convient de noter que les changements de domicile restent soumis à l’autorisation préalable du ministre de l’Intérieur et ce même si la personne assignée ne change pas de commune de résidence dès lors qu’elle est également astreinte à demeurer à son domicile la nuit. Les aménagements liés à la scolarité ou à l’activité professionnelle sont appréciés de façon rigoureuse : l’assignation initiale est par exemple rétablie en cas de renoncement à la formation. Un aménagement obtenu pour suivre une formation a été annulé parce que l’intéressé n’avait finalement pu s’inscrire dans les délais à cette formation. De même, une personne assignée avait obtenu un aménagement pour pouvoir rejoindre un centre de prévention de la radicalisation. Étant revenue sur sa décision, l’aménagement a été aussitôt supprimé. Plus généralement, le ministère a fait droit à des demandes liées aux contraintes d’organisation de la vie privée et familiale.
Sur la dernière période, deux aménagements ont été accordés pour se conformer à des décisions judiciaires, dans un cas pour permettre à la personne d’exercer son droit de visite et d’hébergement et dans l’autre cas pour rendre compatibles les obligations liées à l’assignation et celles du contrôle judiciaire dont la personne fait l’objet. Sur la dernière période, les aménagements apparaissent être examinés avec bienveillance et dans un délai rapide.
Afin d’éviter une surcharge de travail à l’échelon central et d’assurer le traitement de ces demandes d’aménagement au plus près du terrain, vos Rapporteurs proposent que ces aménagements puissent être examinés et décidés par le préfet dès lors qu’ils portent sur les modalités de pointage et les plages horaires d’aménagements de l’assignation à domicile.
Proposition : Confier aux préfets le soin de prendre certaines mesures d’aménagement des assignations.
Les sauf-conduits constituent une autre forme d’aménagement très ponctuel des assignations relevant de la compétence des préfets. Ils permettent aux assignés à résidence de quitter la circonscription dans laquelle ils sont assignés. Cette mesure étant décentralisée, il est difficile de disposer de données consolidées à l’échelle nationale. Vos Rapporteurs ont pris connaissance d’exemples qui démontrent que le dispositif est effectivement utilisé par les intéressés. Cette mesure a par exemple permis à un assigné d’accomplir les démarches administratives d’inscription dans un établissement d’enseignement. Par la suite, fort de cette inscription, il a demandé – et obtenu – un aménagement des conditions de son assignation pour pouvoir suivre sa scolarité.
Les sauf-conduits sont également délivrés pour permettre aux intéressés de rencontrer leurs avocats ou de se rendre à une audience les concernant. Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé que refuser de délivrer un sauf-conduit permettant d’assister à une audience porte « atteinte aux droits de la défense entachant d’irrégularité l’ordonnance attaquée », sauf à ce que l’intéressé soit dûment représenté par son avocat et sous réserve que ce dernier ait eu accès « à l’ensemble des éléments du dossier ». Le Conseil d’État conclut, en l’espèce, en considérant que « la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que [l’assigné] n’ait pas été autorisé à assister en personne à l’audience des référés n’a pas entaché d’irrégularité l’ordonnance attaquée, la personne ayant été représentée» (60).
Le ministre de l’Intérieur dispose toujours de la faculté d’abroger des assignations à résidence.
Dans un premier temps, ces abrogations ont été prises en assez grand nombre, souvent après qu’un réexamen des dossiers à la faveur d’un contentieux en a montré la fragilité. Lors de son audition, M. Thomas Andrieu indiquait ainsi à notre Commission : « Au cours du premier week-end, les notes étaient plus courtes, la pression extrême. Les faits expliqués n’en étaient pas moins graves, mais ils étaient moins étayés. Nous avons donc pris les mesures demandées, puis, au fil du temps, nous avons demandé des compléments et réexaminé les mesures sur le fondement des notes complémentaires rédigées par les services de renseignement, notamment lorsque des personnes se plaignaient et saisissaient le ministre ou un préfet ou lorsque des recours étaient formés. C’est ce qui nous a conduits à abroger 23 assignations ». « Ensuite, même si, devant le juge, on se bat, il faut parfois reconnaître que l’on s’est trompé. J’assume totalement la politique qui consiste, dans ce cas, à retirer la mesure aussitôt, sans attendre de se faire taper sur les doigts. […] Il nous arrive donc d’abroger une décision alors même que le contentieux est pendant devant le Conseil d’État. Mais je pense – ce serait au Conseil d’État de le dire – que cela donne davantage de crédibilité aux mesures que nous continuons à défendre. L’abrogation peut être justifiée par le fait que, même si la personne n’est vraiment pas recommandable, tient des propos inadmissibles ou fraude massivement, on ne peut pas, pour autant, établir qu’elle est liée au terrorisme, et donc qu’elle représente une menace grave pour l’ordre public. Dans un tel cas, la mesure a été retirée » (61).
Désormais, les abrogations dont vos Rapporteurs ont eu connaissance tiennent au fait que les personnes assignées ont été prises en charge par d’autres dispositifs : mesures de police administrative de droit commun, procédure judiciaire entraînant l’incarcération, ou prise en charge psychiatrique.
Dans sa décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rappelé que « le juge administratif est chargé de s’assurer que [la mesure d’assignation à résidence] est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit » (62). Le contrôle juridictionnel a porté sur les éléments de motivation afin d’en apprécier la pertinence et le caractère proportionné ; il s’est également interrogé sur le régime de la charge de la preuve entre le ministère de l’Intérieur et la personne assignée à résidence.
La mesure d’assignation doit veiller à la « conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République » (63). Cet équilibre concerne aussi bien la liberté d’aller et venir que les conséquences de la mesure sur la vie professionnelle ou familiale. Le juge vérifie donc qu’aucune atteinte grave n’a été portée à une liberté fondamentale, « que ce soit dans [l’appréciation] de la menace […] ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence » (64).
a. Le contrôle des motivations des assignations
Sur les motivations de la décision, la jurisprudence a été amenée à préciser, d’une part, les conditions de recevabilité des éléments transmis par le ministère, avec le cas particulier des « notes blanches », et, d’autre part, le régime de la charge de la preuve.
L’utilisation des « notes blanches », c’est-à-dire des informations transmises par les services de renseignement, est presque systématiquement contestée par les requérants. Ils relèvent que ces documents ne sont pas datés et que rien ne permet d’identifier leur provenance ni les moyens par lesquels les informations ont été obtenues. De façon générale, le juge administratif admet ces preuves, sous réserve que les éléments soient suffisamment détaillés et circonstanciés et que ces éléments soient soumis au débat contradictoire. Le tribunal administratif de Toulouse rappelle ainsi qu’aucune « disposition législative ni aucun principe ne s’oppose » à ce que des éléments tirés de notes blanches « soient pris en compte […] dès lors que, versés au dossier, ils ont été […] soumis au débat contradictoire » (65). Le contrôle du juge est attentif, le tribunal administratif de Grenoble soulignant par exemple que les éléments figurant dans la note blanche, « dépourvus d’autres précisions, ne peuvent être regardés comme caractérisant une activité de l’intéressé s’avérant dangereuse pour la sécurité et l’ordre public » (66). Dans le cas d’espèce, le tribunal administratif de Grenoble a considéré les éléments comme insuffisants et a annulé l’arrêté d’assignation.
En exigeant que les éléments soient soumis au débat contradictoire, le juge administratif donne la possibilité au requérant de contester la matérialité des faits comme leur analyse. Il apprécie la matérialité de façon assez détaillée, n’hésitant pas à annuler une mesure d’assignation lorsque l’intéressé réussit à contester, point par point, les éléments avancés par le ministère de l’Intérieur. Dans un cas, le ministère relevait que la personne visée par la mesure d’assignation aurait pris des photographies du dispositif policier de protection d’une personnalité. Le requérant a pu démontrer que « sa position a pu être confondue avec celle d’une personne prenant des photographies alors qu’il utilisait son téléphone portable en mode “haut-parleur” tenu face au visage pour pouvoir conserver son casque sur la tête ». Le Conseil d’État reçoit cet argument et note qu’aucun « élément suffisamment circonstancié produit par le ministère de l’Intérieur ne permet de justifier que [l’intéressé] appartiendrait à la mouvance islamiste » (67). Dès lors, faute d’éléments, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu la mesure d’assignation.
La contestation reste toutefois difficile. Le tribunal administratif de Melun, comme d’autres tribunaux administratifs, note par exemple que le « requérant ne dément pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés » et n’apporte « aucun élément nouveau ou circonstancié qui n’aurait pas déjà été examiné par le juge des référés […] lors de l’examen des précédents recours » (68). En l’espèce le requérant avait en effet introduit sept recours, tous rejetés par le tribunal. Au-delà du cas d’espèce, les décisions de certains tribunaux administratifs semblent faire peser la charge de la preuve sur la personne assignée : à elle d’infirmer les éléments transmis par le ministère de l’Intérieur.
Dans son ordonnance du 17 mars 2016, Le Conseil d’État se montre plus mesuré, estimant qu’il ne peut « raisonnablement être attendu que [l’assigné] apporte la preuve, difficile à établir, du caractère inexact de certains des faits qui lui sont imputés ». Il considère cependant que l’assigné peut apporter des « documents relatifs à sa situation personnelle, témoignages ou attestations, susceptibles, notamment à travers un éclairage crédible sur ses convictions et sa personnalité, de remettre en cause utilement les éléments auxquels se réfère le ministre » (69).
Lorsque le juge estime ne pas disposer d’éléments suffisants, il lui est loisible de prolonger l’instruction de façon à laisser aux parties le temps nécessaire à la collecte de données complémentaires. Dans un cas, le requérant contestait la réalité des voyages que le ministère de l’Intérieur estimait qu’il avait effectués ; le ministère a pu établir, au cours de la seconde audience, « la réalité de l’un en tout cas de ces voyages » et démontrer que « contrairement à ce que le requérant avait initialement indiqué », il n’avait pas rencontré fortuitement la personne avec qui il voyageait mais qu’ils « avaient pris au préalable la décision de voyager ensemble » (70).
Le juge administratif est également attentif à la temporalité des motivations d’une mesure d’assignation. En février 2016, le Conseil d’État relève par exemple que « si, à la date de l’assignation [en l’espèce le 9 décembre 2015], il pouvait exister des raisons sérieuses de penser que le comportement de [l’intéressé] était, eu égard notamment à l’adhésion sans réserve au courant salafiste [qu’il revendique] et à la vulnérabilité de son profil psychologique, de nature à justifier une mesure d’assignation à résidence », l’arrêté porte, à la date de l’ordonnance du Conseil, « en l’absence de tout élément avéré sur les contacts et sur le prosélytisme de l’intéressé, une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir » (71).
Dans certains contentieux, le ministère de l’Intérieur a retiré de lui-même certaines mesures, estimant par exemple que depuis l’introduction du recours, il disposait « de nouveaux éléments de nature à infirmer les motifs de l’assignation à résidence » ou soit parce que « l’administration se trouvait dans l’impossibilité de produire des éléments complémentaires » (72).
b. Le contrôle des modalités de mise en œuvre
Le juge administratif reconnaît clairement que l’assignation nuit à l’exercice des droits individuels, le Conseil d’État notant qu’une assignation « porte atteinte à la liberté d’aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale » (73). De même, le tribunal administratif de Toulouse, dans son ordonnance du 15 septembre 2016, relève que les obligations de pointage constituent bien une « gêne […] dans [la] vie de famille et [les] activités de loisir ». Les juges n’écartent donc pas le grief mais ne l’examinent, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, que sous l’angle de la proportionnalité. Comme l’indique le Conseil d’État notamment dans son ordonnance du 7 octobre 2016, il ne faut pas que la mesure porte « une atteinte grave et manifestement illégale à [la] liberté d’aller et venir et à [la] liberté personnelle [de l’assigné] » (74). En d’autres termes, le juge administratif s’assure que les restrictions découlant de l’assignation ne sont pas « excessives » (75).
Le Conseil d’État a également considéré qu’il lui revenait de s’assurer de la matérialité des mesures prises pour assurer, conformément au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi de 1955, « la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille ». Dans un cas d’espèce en janvier 2016, le Conseil d’État a ainsi écarté le moyen du requérant considérant qu’il n’apparaissait pas « dépourvu de moyens de subsistance » (76).
Enfin, le juge administratif, là encore sous l’impulsion du Conseil d’État, a examiné les modalités de pointage afin de s’assurer de leur compatibilité avec la vie familiale et professionnelle des personnes assignées, comme le montre cet exemple de personne assignée, évoquée par le président de la section du contentieux du Conseil d’État lors de son audition le 7 janvier 2016 et qu’il semble à vos Rapporteurs intéressant de restituer ci-après pour montrer l’office du juge sur ces mesures administratives.
Un exemple d’assignation à résidence maintenue mais aménagée
Lors de son audition du jeudi 7 janvier 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a insisté sur la situation d’une « mère de famille d’origine tchétchène résidant à Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne, et dont le comportement a alerté à juste titre les services de renseignement : elle n’a pas expliqué de manière satisfaisante ses voyages très fréquents en Turquie, notamment au cours de l’audience où elle s’est montrée confuse, voire contradictoire. Son compagnon – qui a quitté la France – a quant à lui un comportement incontestablement dangereux ; on a d’ailleurs pu avoir l’impression qu’elle était sous son emprise et qu’il lui faisait accomplir des missions pour le compte de réseaux terroristes, de sorte que, d’une certaine manière, l’assignation à résidence la protège des pressions de cet homme, dont elle est aujourd’hui séparée. […] Cette dame est mère de trois jeunes enfants respectivement âgés d’un an, de quatre ans et de sept ans. Le cadet reste avec elle et les deux autres sont scolarisés l’un le matin, l’autre toute la journée. Or l’arrêté initial d’assignation à résidence exigeait trois pointages par jour – soit le nombre maximal – qui, de manière quelque peu surprenante, devaient avoir lieu au commissariat d’Arpajon, distant de Brétigny de dix kilomètres, alors même qu’il existe à Brétigny un poste de police ouvert, du moins en semaine. Dès lors, la dame était dans une situation préoccupante : elle devait se rendre trois fois par jour à Arpajon en bus puis en train – elle n’a pas de voiture – avec son plus jeune enfant et avait de grandes difficultés pour récupérer les deux autres à l’école. Après d’abondantes discussions au cours de l’audience de référé, cette situation a conduit le ministère de l’intérieur à modifier in extremis, [la veille], les modalités d’assignation à résidence en ramenant à deux le nombre de pointages quotidiens et en décidant qu’ils auraient lieu à Brétigny en semaine – mais toujours à Arpajon le week-end ». Le président Bernard Stirn relevait que « l’ordonnance rendue par le juge des référés prend acte de ces modifications – que le juge aurait sans doute ordonnées si le ministère de l’intérieur n’en avait pas pris l’initiative –, mais enjoint de trouver d’autres modalités pour le week-end. En effet, les deux pointages prévus à Arpajon le samedi et le dimanche font peser sur l’intéressée des contraintes excessives, d’autant qu’il n’y a pas de bus le week-end, ce qui l’oblige à marcher pendant trois quarts d’heure avec son bébé d’un an. Il est certainement possible de faire en sorte qu’un fonctionnaire de police passe dans la journée à Brétigny pour assurer le pointage » (77).
C. LA DÉLICATE ARTICULATION DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS
La mesure d’assignation à résidence, pour spécifique qu’elle soit, peut compléter ou, de façon plus problématique, entrer en concurrence avec d’autres mesures, qu’elles aient été prises dans un cadre administratif ou judiciaire. La loi de 1955 ne détermine pas les modalités d’articulation entre ces différents dispositifs. La prééminence des décisions judiciaires semble aller de soi, les personnes auditionnées par vos Rapporteurs retenant toutes cette solution in abstracto. Néanmoins, cette hiérarchie ne semble pas toujours adéquate sur un plan pratique et n’est d’ailleurs pas toujours retenue. En outre elle ne permet pas d’établir une articulation pertinente entre plusieurs mesures administratives. Même si elles restent rares, les assignations des mineurs doivent enfin faire l’objet d’une attention particulière.
1. L’articulation avec une autre mesure administrative
La mesure d’assignation doit parfois être articulée avec des mesures administratives d’expulsion. Dans ce cas, il n’y a pas de concurrence directe entre les deux mesures administratives sauf lorsque la personne assignée à résidence est placée dans un centre de rétention administrative et que la mesure d’assignation n’est plus nécessaire. Dans d’autres cas, la mesure d’assignation à résidence va venir compléter le dispositif de surveillance d’un individu représentant un risque pour l’ordre et la sécurité publics.
Les mesures d’assignation à résidence apparaissent également comme un complément utile, voire un substitut, à des mesures d’internement d’office. Un assigné à résidence à Paris a par exemple fait l’objet de deux mesures d’internement d’office avant d’être assigné à résidence. Une personne assignée a fait l’objet alternativement de mesures d’hospitalisation d’office et d’assignations à résidence. Dans de nombreux cas, les arrêtés d’assignation soulignent la fragilité psychiatrique des individus. La mesure d’assignation semble alors être un palliatif à un dispositif de droit commun qui, pour pertinent qu’il soit sur le plan médical, ne permet pas de prévenir de façon complète et pérenne les risques pour l’ordre et la sécurité publics. Une réflexion pourrait s’engager sur les mesures de surveillance de moyen et long terme qui pourraient être déployées pour des personnes qui relèvent d’un suivi psychiatrique et qui, à ce titre peuvent représenter une menace pour l’ordre et la sécurité publics.
Proposition : Examiner la possibilité de renforcer les liens entre les états-majors locaux de sécurité et les entités en charge de l’accompagnement psychiatrique des personnes possiblement concernées par les mesures administratives d’assignation à résidence.
2. L’articulation avec des mesures judiciaires
Pour administrative qu’elle soit, la mesure d’assignation intervient souvent en parallèle d’une mesure prise dans le cadre d’une procédure judiciaire.
a. L’assignation succède à une poursuite ou à une condamnation pénale.
Plusieurs personnes assignées à résidence ont fait ou font l’objet de poursuites ou de condamnations pénales par exemple pour « apologie directe et publique d’un acte de terrorisme et menaces de crime ou de délit à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ». La mesure d’assignation constitue alors une précaution conservatoire le temps que le tribunal compétent soit saisi ou que la peine éventuelle soit exécutée.
L’assignation peut parfois être prise faute d’une décision judiciaire. Certaines personnes ont ainsi pu être placées en garde en vue ou interpellées mais la procédure judiciaire n’est pas allée plus loin. Un individu a par exemple été expulsé par les autorités turques alors qu’il cherchait, selon ses déclarations lors d’un entretien administratif à son arrivée à Paris, à rejoindre la ville de Raqqa afin d’y intégrer les rangs de Daech. Interpellé et placé en garde à vue, il a été laissé libre « faute d’éléments permettant sa mise en examen ». Compte tenu de sa dangerosité, le ministre de l’Intérieur a décidé de l’assigner à résidence.
La mesure administrative peut également s’inscrire dans la continuité de la sanction pénale. Comme le relève le Conseil d’État, le fait d’avoir purgé sa peine n’épuise pas la dangerosité potentielle d’un individu pour l’ordre et la sécurité publics. Dans son ordonnance du 7 octobre 2016, le juge des référés relève par exemple que « la personne assignée à résidence a été condamnée le 4 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq années d’emprisonnement, dont une année avec sursis, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, en raison de sa participation à la planification d’attentats sur le sol français pour le compte de l’organisation terroriste Al Qaïda au Maghreb Islamique. Les faits établis par ce jugement pénal s’imposent au juge administratif. Les faits en cause, qui datent de 2008 et 2009, sont particulièrement graves : seule l’arrestation de l’intéressé avait permis de faire obstacle à la réalisation de ses projets d’attentats. À partir de juin 2013, cette personne a résidé au Brésil, où elle a exercé des fonctions d’enseignant-chercheur à l’université fédérale de Rio de Janeiro. Si elle soutient qu’elle a depuis « tourné la page » et qu’aucun acte similaire ne peut plus lui être reproché, le juge des référés du Conseil d’État a constaté que son retour en France, contre son gré, résultait d’une mesure d’expulsion prise par les autorités brésiliennes le 15 juillet 2016, le Brésil ayant estimé que l’intéressé présentait un risque pour sa sécurité. Si les autorités françaises n’ont pas obtenu, à ce jour, davantage d’informations sur les raisons de cette expulsion, le juge a également constaté que les recours formés au Brésil contre cette mesure n’ont pour l’instant pas conduit à remettre en cause l’expulsion. Enfin, si la personne assignée à résidence, qui a la double nationalité algérienne et française, souhaite la levée de l’assignation à résidence pour quitter la France et s’installer en Algérie, le juge des référés a relevé que, du fait de sa nationalité française, l’intéressé pourrait ensuite à tout moment retourner en France depuis l’Algérie, pays où résidaient des membres d’Al Qaïda au Maghreb islamique avec lesquels il avait été en relation, sans que les autorités françaises ne puissent s’y opposer ni même en être nécessairement informées » (78). Cette position du Conseil d’État a pu être critiquée assez vivement par la doctrine. Dans la continuité de son opposition à l’état d’urgence en général (79), le professeur Paul Cassia considère ainsi qu’en l’espèce le Conseil d’État a « validé un mécanisme de double peine, une rétention de sûreté administrative après une condamnation pénale ». De cette décision, il retient « qu’un “comportement” datant de 2008 peut conduire à une assignation à résidence sept ans plus tard » et résume cette situation par la formule « condamné un jour, suspect pour toujours » (80). Indépendamment du cas d’espèce où est intervenu un élément nouveau lié à l’expulsion, il semble difficile de fonder un arrêté d’assignation seulement sur une condamnation antérieure dès lors que la personne condamnée a purgé sa peine.
Plus globalement, se pose la question de la succession d’une mesure administrative et d’une mesure judiciaire, question qui renvoie au caractère libératoire de l’exécution de la peine. Plusieurs cas illustrent cette difficulté. Une personne a par exemple été condamnée pour apologie du terrorisme à six mois d’emprisonnement dont deux mois fermes suite à des propos tenus en novembre 2015. Son assignation à résidence a été prononcée et renouvelée depuis le 22 novembre 2015, c’est-à-dire aussi bien pendant qu’après la procédure judiciaire. En l’espèce, la condamnation n’étant pas encore exécutée, on peut se demander si le juge de l’exécution des peines prendra en compte, d’une manière ou d’une autre, les effets de l’assignation.
b. L’assignation est concomitante d’une mesure judiciaire.
Plusieurs assignés à résidence dans le cadre de l’état d’urgence ont fait ou font l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une mise à l’épreuve. Un cas illustre bien la difficile conciliation des différents dispositifs. Condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs dans le but de commettre des actes terroristes en 2012, l’intéressé a été libéré en 2014 et s’est investi dans les activités d’une association notoirement connue pour le soutien logistique « aux détenus pratiquant un islam radical et écroués pour des faits de terrorisme et à leurs familles ». À sa sortie de prison, il a été placé sous surveillance électronique par le juge de l’application des peines. En parallèle, le ministre de l’Intérieur l’a assigné à résidence à compter du 15 novembre 2015. Le tribunal administratif de Melun relève que les conditions de l’assignation à résidence ont « pour effet de modifier les conditions de la mesure d’exécution de la peine pénale » mais que cette conséquence est « sans influence sur la légalité » de l’assignation à résidence. En l’espèce, la mesure de police administrative semble primer et pouvoir remettre en cause les conditions d’exécution d’une décision pénale.
De même, le Conseil d’État, dans une ordonnance du 12 septembre 2016, se prononce sur l’assignation à résidence d’un individu qui « fait l’objet d’un contrôle judiciaire l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police ». Il estime qu’il résulte « de l’instruction que cette dernière obligation, qui n’a pour seul objet que de s’assurer que l’intéressé reste à la disposition de la justice pendant la durée de l’instruction dont il fait l’objet, ne peut à elle seule suffire à remplir l’objectif que vise l’obligation quotidienne posée par l’arrêté d’assignation à résidence ; que, au demeurant, il résulte des échanges lors de l’audience publique que les obligations résultant de son assignation à résidence permettent de remplir également celles résultant de son contrôle judiciaire ». Le juge valide dès lors le dispositif d’assignation à résidence qui vient donc s’ajouter aux obligations de pointage prises dans le cadre du contrôle judiciaire. Outre la validation de l’addition des procédures, le juge administratif s’est fait l’interprète de la décision du juge d’application des peines et met en regard les objectifs poursuivis par le juge pénal – à savoir s’assurer que l’individu reste à la disposition de la justice – et ceux de l’assignation – prévenir une menace à l’ordre et à la sécurité publics – et estime que les deux peuvent être poursuivis sans qu’il soit porté atteinte aux libertés fondamentales de l’intéressé.
L’analyse de cet exemple doit se faire à la lumière d’un autre cas : une personne a été condamnée en 2015 à une peine de 12 mois de prison, dont 8 mois avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de trois ans avec l’obligation de fixer sa résidence, d’obtenir l’autorisation du juge d’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et de suivre un stage de citoyenneté ainsi qu’une formation. Le ministre de l’Intérieur l’a assignée à résidence dès sa sortie de prison, les mesures complémentaires prévues par le tribunal ne suffisant sans doute pas à prévenir efficacement la menace qu’elle représente pour l’ordre et la sécurité publics.
Dans les deux cas précités, le ministère de l’Intérieur met donc en place un dispositif complémentaire lorsqu’il estime que le dispositif judiciaire n’est pas suffisant. En d’autres termes, le ministère de l’Intérieur apparaît seul habilité à apprécier, sous le contrôle du juge administratif, le risque que représente le comportement d’un individu, même si un juge pénal s’est déjà prononcé.
Conscients des possibles frottements entre les différentes procédures, le 5 novembre 2016, les ministres de la Justice et de l’Intérieur ont adressé aux procureurs, aux directeurs pénitentiaires et aux préfets une circulaire appelant leur attention sur ce risque. L’articulation des mesures poursuit un triple objectif d’échange d’informations, de suivi continu des personnes radicalisées et de conciliation de l’exécution des mesures de police administrative et des mesures judiciaires.
3. Le cas particulier des mineurs
Entre le 14 novembre 2015 et le 15 novembre 2016, 11 mineurs ont été assignés à résidence, étant précisé que 8 autres personnes ont été assignées dans le courant de leur dix-huitième année. Durant la dernière prolongation, cinq mineurs, dont deux de moins de 16 ans, ont fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Deux autres personnes ont été assignées à résidence alors qu’elles étaient mineures mais ont atteint l’âge de la majorité depuis.
La loi de 1955 n’imposant aucun dispositif spécifique pour les mineurs, le ministre de l’Intérieur était fondé à procéder de la même manière que pour les adultes. Il convient de rappeler que ces actes de police administrative ne font en aucune manière obstacle à l’application des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. En outre, l’analyse des motivations des arrêtés fait apparaître une grande disparité de situations. Si leur dangerosité ne doit pas être minorée, les mineurs délinquants peuvent également être en situation de grande détresse et avoir besoin de mesures d’assistance ; l’assignation à résidence peut alors servir utilement de mesure d’urgence dans l’attente de la mise en œuvre d’un dispositif plus pérenne.
Dans deux cas, les arrêtés d’assignation ont d’ailleurs été abrogés après que les intéressés ont été l’un placé dans un centre éducatif fermé, et l’autre incarcéré dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à des faits de terrorisme. Dans les deux cas précités, l’assignation ne s’accompagne pas d’une obligation de demeurer à son domicile la nuit. Dans le cas d’un mineur de 15 ans, les obligations de pointage ont été adaptées et apparaissent moins contraignantes que pour la plupart des majeurs.
Indépendamment des cas particuliers évoqués, il convient de s’interroger sur la spécificité des assignations concernant des mineurs et sur la possibilité d’introduire un mécanisme particulier à leur endroit, par exemple en prévoyant une information systématique du juge des enfants territorialement compétent, lui ouvrant ainsi ensuite la possibilité de prendre une mesure d’assistance éducative.
Proposition : Préciser que, lorsqu’une assignation à résidence concerne un mineur, le juge des enfants territorialement compétent est informé.
III. UN USAGE VARIABLE DES AUTRES MESURES PRÉVUES PAR LA LOI DU 3 AVRIL 1955
Outre les perquisitions et les assignations à résidence, l’état d’urgence autorise les autorités publiques à prendre de nombreuses mesures à caractère collectif ou individuel. Les restrictions de circulation ont été les plus utilisées afin de maintenir l’ordre et de sécuriser de grands événements.
Les contrôles d’identité, fouilles de bagages et visites de véhicules, introduits en juillet 2016, ont été massivement utilisés. S’ils ont permis de sécuriser les grands événements de l’été 2016, ils s’inscrivent désormais le plus souvent dans une réponse banalisée à des risques et non dans un cadre exceptionnel de riposte à une menace imminente.
Les autres mesures ont été utilisées de façon plus marginale voire pas du tout, interrogeant ainsi sur la plus-value de leur maintien.
A. DES OUTILS DE MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC ET DE SÉCURISATION DIVERSEMENT MOBILISÉS
L’article 5 de la loi de 1955, non modifié, autorise le préfet à prendre des mesures restreignant la circulation et le séjour soit de façon collective soit de façon individuelle. Dans les deux cas, la mesure est circonscrite dans le temps et l’espace. Si la loi ne prévoit pas de motivation spécifique pour les mesures collectives, le recours aux mesures individuelles est limité aux personnes « cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Ces dispositions ont été utilisées de façon hétérogène selon les périodes et les zones considérées.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 8 autorisent quant à eux les préfets à interdire, d’une part, « à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre », et, d’autre part, « les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique […] dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose », cette dernière disposition résultant d’un ajout fait en juillet 2016 à l’occasion de la dernière prorogation.
Si le cadre juridique fixé par la loi de 1955 distingue bien les situations, sa mise en œuvre apparaît plus confuse, poursuivant d’abord un objectif de maintien de l’ordre ou répondant à des considérations d’opportunité, parfois sans lien aucun avec la menace terroriste.
Dans ce domaine, le renforcement du contrôle parlementaire opéré en juillet dernier a été profitable : là où vos Rapporteurs n’avaient que des données partielles (81), ils disposent désormais d’un panorama complet de l’utilisation de ces mesures.
Ces mesures sont utilisées avec une intensité variable mais continûment par les préfectures. Elles prennent deux formes : la création de zones de protection et de sécurité (ZPS) et les interdictions de manifester ou de se réunir (IMR).
Dès le début de l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur a rappelé aux préfets qu’il leur revient d’établir que « les mesures [qu’ils prennent sont] nécessaires et proportionnées à l’importance des troubles ou de la menace qu’il s’agit de prévenir. Un arrêté qui, par exemple, interdirait la circulation des personnes, à certaines heures, sur l’ensemble du territoire d’une commune devra être particulièrement étayé. Il [leur] appartiendra de justifier cet arrêté par l’existence d’une menace grave pesant soit directement, soit par propagation, sur tous les quartiers de cette commune » (82).
a. Les zones de protection et de sécurité
Du 21 juillet au 15 novembre 2016, 15 zones de protection et de sécurité ont été instituées. Pour la période précédente, vos Rapporteurs ne peuvent fournir de chiffres exhaustifs mais ont eu connaissance de plusieurs exemples de recours à ces dispositifs.
Ces mesures peuvent se répartir en deux grandes catégories.
Il peut tout d’abord s’agir de mesures prises pour toute la durée de l’état d’urgence et visant à renforcer la protection de sites particulièrement exposés. Il peut s’agir, par exemple, de casernes militaires abritant des unités dont les personnels sont déployés en opérations extérieures ou dévolues à la maintenance d’équipements sensibles, de sites SEVESO (83) ou de diverses autres catégories de sites : centre pénitentiaire, synagogue, zone portuaire, ... Dans certains départements, les préfets ont même pu établir une ZPS autour des sièges des institutions publiques, qu’il s’agisse de la préfecture ou du conseil départemental.
Certaines de ces zones avaient été instituées dès le mois de décembre 2015 et ont été reconduites à chaque prorogation de l’état d’urgence. Vos Rapporteurs s’étonnent du cadre juridique retenu, parfois pour répondre à des enjeux sécuritaires locaux de basse intensité.
Ces zones permettent également d’assurer la sécurité d’un événement spécifique, tel que la COP 21 (84),l’Euro 2016 pour couvrir les fans zones implantées dans les grandes villes, ou encore le démantèlement de la lande de Calais. Depuis l’été 2016, ces ZPS ont également été utilisées pour assurer la sécurité de grands rassemblements qu’il s’agisse de salons, de braderies ou d’événements festifs comme les feux d’artifice tirés dans les stations balnéaires au mois d’août, ou désormais de marchés de Noël.
La ZPS a démontré son utilité durant l’été 2016, surtout que les préfets ont fait un usage mesuré et adapté du dispositif, n’hésitant pas à le combiner utilement à d’autres mesures de l’état d’urgence.
La réglementation de l’accès et du séjour dans la zone peut être stricte (personne n’entre ni ne s’y trouve) ou au contraire subordonnée aux contrôles d’identité et de véhicules.
La création des ZPS peut également s’accompagner de mesures complémentaires autorisant par exemple des agents de sécurité privée à procéder à des contrôles visuels des bagages et à des palpations de sécurité, les personnes refusant de s’y soumettre pouvant se voir interdire l’accès à la zone.
L’intérêt de cette mesure est de réunir dans un instrument juridique unique pour un espace donné différentes interdictions et réglementations mais surtout de faire des manquements à ces dispositifs des délits et non plus des contraventions, du seul fait de l’application de la loi du 3 avril 1955. La préfecture de police de Paris a ainsi indiqué que les réglementations suivantes figurent généralement dans les zones de protection et de sécurité :
– l’interdiction, sauf dans les parties occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaires, d’introduire, de détenir et de transporter des objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les bouteilles en verre, des boissons alcooliques, ainsi que leur consommation ;
– l’interdiction d’introduire, de détenir, de transporter et d’utiliser les artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et des produits pétroliers dans tout récipient transportable, des armes à feu, y compris factices, et des munitions ;
– l’interdiction d’introduire, de porter ou d’exhiber des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe ;
– la restriction de la circulation et du stationnement des véhicules.
b. Les interdictions de manifester ou de se réunir
Là aussi, les exemples sont nombreux et concernent toute la période de l’état d’urgence. Ces interdictions doivent néanmoins être rapprochées des milliers d’interdictions de manifester de droit commun prises chaque année.
Compte tenu de la très forte mobilisation des forces de l’ordre pour sécuriser la COP 21 et du caractère prioritaire de cette mission, le ministre de l’Intérieur a adressé un télégramme à l’ensemble des préfectures le 23 novembre 2015 leur demandant d’interdire, dans leur zone de compétences, les manifestations sur voie publique, « quel qu’en soit le motif et à l’exception des hommages aux victimes », du 28 novembre 2015 à 0 heure jusqu’au 30 novembre 2015 à minuit. Le 27 novembre, il invitait toutefois les préfets à « faire preuve de discernement dès lors que le risque de trouble à l’ordre public exigeant la mobilisation d’effectifs de la police ou de la gendarmerie nationale est écarté ». Ce télégramme visait en l’espèce, à titre d’exemple, les événements liés à l’organisation du Téléthon qui pouvaient être autorisés « si les circonstances locales le permettent et s’ils ne détournent pas de leurs missions prioritaires les forces de sécurité intérieure ». Dans les considérants des arrêtés pris en conséquence, les préfets soulignent ne pas être en mesure d’encadrer les manifestations et de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public en raison de l’insuffisance d’effectifs, prioritairement mobilisés pour la COP 21.
Sur le fondement de l’état d’urgence et en raison des risques de trouble à l’ordre public, le préfet de Mayotte a quant à lui interdit deux manifestations en novembre 2015 : une « marche pacifique » contre l’insécurité à Koungou et une « marche citoyenne » contre les étrangers en situation irrégulière. Dix arrêtés préfectoraux ont notamment interdit des rencontres de football, y compris des rencontres amateurs dépourvues de visibilité nationale, mais également deux spectacles à Paris, un forum philosophique au Mans et un Salon Studyrama à Toulon. Cet outil a également permis au préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 25 novembre 2015, de prononcer la fermeture du sous-sol du foyer d’accueil d’immigrés ADEF de Pontoise pour une durée indéterminée, au motif qu’il accueillait une salle de prière clandestine où étaient tenus des prêches radicaux.
Il arrive que ces mesures collectives se combinent entre elles. La création de certaines ZPS s’accompagne parfois d’une interdiction de manifester ou de se réunir (IMR) dans la zone et pendant la durée de création de la ZPS. Vos Rapporteurs ont d’ailleurs relevé quelques restrictions de circulation ou d’accès qui s’apparentent à des IMR sans pour autant avoir une dimension aussi contraignante.
Le fondement juridique des arrêtés est très variable, entretenant une certaine confusion, comme si tous les dispositifs de l’état d’urgence se recoupaient et qu’ils étaient, finalement, assez interchangeables. Les 21 interdictions de manifester prises entre le 21 juillet 2016 et le 10 novembre 2106 l’ont été sur le fondement de l’article 5 ou de l’article 8 de la loi de 1955, les arrêtés visant la loi de 1955 en général (14 occurrences), ou l’un ou l’autre des articles (deux visent l’article 5 et quatre visent l’article 8). Un seul arrêté vise les deux articles. La préfecture de police de Paris a, par exemple, fondé les interdictions relatives au mouvement « Nuit Debout » sur la loi en général ; en revanche pour des décisions plus spécifiques, l’arrêté vise spécifiquement l’article 8.
De façon générale, les IMR répondent à des situations spécifiques et ne s’inscrivent pas dans la durée. Quelques arrêtés inscrivent à l’inverse la mesure dans le temps : un arrêté limite par exemple l’accès à l’aéroport de Bâle pour la durée de l’état d’urgence, considérant que le site représente une cible potentielle notamment en raison de son positionnement transfrontalier.
Dans une ordonnance du 22 janvier 2016, le Conseil d’État a rappelé qu’il appartient ainsi au juge « d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières ». Dans cette affaire, le Conseil d’État considère qu’il ne ressort pas de l’instruction que « des mesures moins contraignantes que celles édictées par l’arrêté litigieux seraient de nature à éviter la survenance des troubles graves à l’ordre public qu’elles ont pour but de prévenir ». Dans la plupart des arrêtés d’IMR ou de restriction de circulation, les préfets font état de la très forte mobilisation des forces de l’ordre et de la nécessité pour l’autorité d’emploi de concentrer les moyens disponibles sur les événements les plus sensibles.
Entre le 14 novembre 2015 et le 20 juillet 2016, quelque 540 mesures individuelles d’interdiction de séjour ont été prononcées. Toutefois, leur répartition temporelle est très inégale avec un usage massif de l’interdiction de séjour au moment des manifestations contre la loi de réforme du code du travail à partir du mois de juin 2016.
Dès le 14 novembre 2015, le ministère de l’Intérieur rappelait aux préfets que « compte tenu de sa gravité », l’interdiction individuelle de séjour « ne trouve à s’appliquer que dans des circonstances d’appréciation particulière » (85). La loi de 1955 renvoyant au seul critère de menace pour l’ordre et la sécurité publics, il n’est pas nécessaire que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence soient liées à la prévention d’une menace terroriste. En pratique, ces mesures, bien que prises sur le fondement de l’état d’urgence, apparaissent en effet souvent sans lien direct avec la menace terroriste. Le ministère de l’Intérieur met l’accent moins sur le risque terroriste que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, sur le fait que ces mesures se justifient par la mobilisation prioritaire des forces de l’ordre « pour prévenir la menace résultant du péril imminent ayant justifié la déclaration ou la prorogation de l’état d’urgence ».
Cette dissociation des interdictions de séjour et de la menace terroriste que représentent les personnes visées par la mesure apparaît dès le début de l’état d’urgence avec par exemple 21 mesures « à l’encontre de militants anarcho-autonomes français durant la COP21 ». En décembre 2015, plusieurs arrêtés individuels ont été également pris par le préfet de Corse du Sud à l’encontre de personnes faisant état de leurs « velléités de passer outre un arrêté ministériel d’interdiction de déplacement » et en raison de risques avérés de troubles graves à l’ordre public dans le cadre d’un match de football.
Les manifestations du printemps 2016 contre la loi de réforme du code du travail ont également été l’occasion de prendre plusieurs centaines d’interdictions de séjour. Ainsi devant notre Commission, le ministre de l’Intérieur précisait-il le 17 mai 2016, qu’à cette date, 53 arrêtés d’interdiction de séjour avaient été pris à l’encontre de personnes soupçonnées de pouvoir troubler l’ordre public par leur participation à divers rassemblements. Ces mesures se répartissaient géographiquement de la façon suivante : 41 à Paris, 8 en Loire-Atlantique, 3 en Haute-Garonne et une en Ille-et-Vilaine. Sur ces 53 arrêtés, 5 n’ont pas été notifiés.
Ces 53 arrêtés sont tous construits selon la même architecture :
– constat de débordements violents lors des dernières manifestations ;
– rappel de la prégnance de la menace terroriste, attestée par le fait que le Parlement envisage de proroger une troisième fois l’état d’urgence ;
– présentation des faits reprochés à la personne visée par l’interdiction de séjour.
Le 3 juin 2016, 136 interdictions avaient été signées mais plus aucune n’était en vigueur. Le 10 juin 2016, 41 étaient en vigueur, dont 22 ont été notifiées ; le 14 juin 2016, 164 étaient en cours mais seulement 51 d’entre elles avaient été notifiées. Le 16 juillet 2016, 438 interdictions avaient été signées.
Vos Rapporteurs ont noté un décalage toujours croissant entre les mesures signées et les mesures notifiées. Au 14 juin 2106, 164 interdictions étaient par exemple applicables mais seules 51 d’entre elles avaient été notifiées, soit moins d’un tiers. Faute d’être notifiée, la mesure n’est pas opposable à la personne et perd de son intérêt pratique.
En ce qui concerne les faits reprochés aux personnes visées par ces arrêtés, la précision des informations données est très inégale. Les arrêtés de Loire-Atlantique, d’Ille-et-Vilaine et de Haute-Garonne imputent aux personnes visées par ces mesures de police administrative des faits précis en rapport avec les désordres dont les préfets craignent la réitération : interpellations récentes lors de manifestations, gardes à vue, condamnations à des peines d’emprisonnement avec sursis ou des travaux d’intérêt général.
Le contrôle du juge sur 11 interdictions individuelles en mai 2016
Le 14 mai 2016, le préfet de police de Paris a prononcé 11 interdictions de séjour dans le cadre des mesures d’encadrement des manifestations contre le projet de loi de réforme du code du travail. Le ministère indique que « les personnes faisant l’objet de ces arrêtés d’interdiction de séjour étant connues pour leur participation à des actions violentes lors de précédentes manifestations ayant dégénéré, il y avait tout lieu de considérer que leur présence [dans les manifestations] visait à réitérer de telles actions violentes et devait donc être interdite ». Il note également que les débordements constatés lors des manifestations étaient le fait d’individus « déterminés, organisés, masqués et sur lesquels les organisateurs n’avaient aucune prise » et qui « cherchaient avant tout à en découdre avec les forces de l’ordre ». Se mêlant aux « manifestants pacifiques », ils rendaient « très compliqué le maintien de l’ordre et les interpellations ».
Les 11 arrêtés parisiens du 14 mai 2016 ont été attaqués devant le juge administratif qui n’a eu à se prononcer que sur dix d’entre eux, le préfet de police ayant abrogé une mesure concernant un journaliste indépendant qui avait pu expliquer sa présence lors des précédents affrontements. Le tribunal administratif de Paris a suspendu neuf des dix arrêtés, relevant que le « préfet de police ne produit aucun élément permettant de retenir que [les intéressés ont] personnellement participé [aux] dégradations et violences ». Le juge a considéré que faute de ces éléments, la mesure portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de manifestation. Le tribunal n’a confirmé la mesure que pour la personne qui avait été « identifiée » comme ayant participé aux dégradations et violences.
La durée des mesures varie ; si dans la majorité des cas elle ne correspond qu’à quelques heures (Paris et Toulouse) ou jours, elle est parfois beaucoup plus longue.
Le périmètre des interdictions de séjour, défini par des rues ou des arrondissements, peut être plus ou moins vaste. Pour les mesures du mois de mai, à Paris, l’interdiction peut par exemple correspondre aux arrondissements traversés par le cortège, y compris celui dans lequel la personne réside. Les préfets de Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine justifient le choix de retenir un périmètre assez large d’interdiction par « la forte mobilité des groupes violents » et l’absence de parcours déterminé à l’avance.
Entre le 21 juillet 2016 et le 15 novembre 2016, 30 interdictions individuelles d’accès ou de séjour ont été prononcées. La plupart des mesures déclinent des décisions collectives liées à la tenue d’un événement particulier. Le préfet du Haut-Rhin a par exemple prononcé huit mesures individuelles en complément des mesures générales destinées à sécuriser la tenue de la foire kermesse de Mulhouse à la fin du mois de juillet 2016. De même, pour sécuriser les fêtes de Bayonne, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a restreint assez fortement la circulation et a assorti son dispositif de mesures individuelles ciblées sur quelques individus identifiés comme représentant une menace manifeste pour l’ordre et la sécurité publics. Le préfet de police de Paris a prononcé également des interdictions de séjour visant à empêcher certaines personnes de participer ou même d’être à proximité de la manifestation contre la loi de réforme du code du travail le 15 septembre 2016. Dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais, la préfète du Pas-de-Calais a prononcé quatre interdictions de séjour couvrant l’ensemble du territoire de l’arrondissement de Calais (cf. infra).
Les préfectures ont donc fréquemment eu recours à des interdictions individuelles de séjour prévues par la loi du 3 avril 1955 qui n’existent pas en droit commun. Leur démarche fait écho à la préconisation, faite en mai 2015 par la commission d’enquête sur le maintien de l’ordre (86), d’instituer une mesure de police administrative portant interdiction individuelle de participer à une manifestation à l’encontre d’individus condamnés ou connus en tant que casseurs violents.
B. LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ ET LES FOUILLES DE VÉHICULES : UNE MESURE NOUVELLE UTILISÉE MASSIVEMENT PAR QUELQUES DÉPARTEMENTS
1. Une mesure introduite en juillet 2016
En juillet 2016, les députés ont souhaité modifier le cadre juridique permettant aux forces de police de procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules. Le code de procédure pénale encadre strictement ces actes qui, sauf pour les contrôles d’identité auxquels les officiers de police judiciaire procèdent en cas de suspicion criminelle ou délictuelle, n’interviennent que sur réquisitions écrites du Procureur de la République aux fins de recherche de poursuite d’infractions. Ces mesures ne s’appliquent que pour une zone et une période données.
S’inspirant de ce régime, les parlementaires ont créé un mécanisme propre à l’état d’urgence. Le nouveau dispositif introduit à l’article 8-1 de la loi de 1955 reprend les principales caractéristiques du régime de droit commun mais en en confiant l’autorisation au préfet, à savoir :
- le principe d’une autorisation écrite préalable du préfet qui doit motiver sa décision ;
- un pouvoir confié aux officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints ;
- la limitation dans l’espace et le temps, la loi disposant que cette autorisation ne saurait excéder 24 heures ;
- seuls les véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public peuvent être visités.
Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a encadré le recours à des contrôles d’identité à caractère préventif. Dans sa décision du 5 août 1993 (87), il considère que « la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle » et que « s’il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d’identité d’une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle ». En d’autres termes, le préfet doit dûment motiver son arrêté et indiquer pourquoi il a été amené à retenir cette solution.
2. Une mise en œuvre concentrée dans quelques départements
L’analyse des quelque 1 650 arrêtés pris depuis le 21 juillet 2016 fait apparaître une grande hétérogénéité des motifs invoqués pour recourir à ce dispositif, les préfets s’en étant emparés très vite avec un objectif principal de sécurisation des personnes. Utilisés à l’occasion de grands rassemblements estivaux comme les fêtes de Bayonne, des festivals ou des grands feux d’artifice, ils ont été aussi mis en place au moment des chassés-croisés routiers ou pour sécuriser des sites touristiques nationaux. À l’occasion des célébrations religieuses du 15 août, plusieurs préfets ont également autorisé les forces de l’ordre à procéder à des contrôles.
Si cette utilisation de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 s’inscrit dans une logique d’ensemble de sécurisation et de prévention de troubles à l’ordre public dans un contexte sécuritaire spécifique, force est de constater néanmoins qu’une très grande majorité d’arrêtés ne vise pas de circonstances particulières. Dans certains départements, le caractère répétitif des arrêtés montre bien qu’ils ne relèvent plus d’une logique d’urgence et d’exception mais, en fait, se substituent aux mesures de droit commun. Dans la zone de la gare de Mâcon-Loché en Saône-et-Loire, les forces de l’ordre sont ainsi autorisées à procéder à des contrôles d’identité, fouilles de bagages et visites de véhicules, tous les jours entre le 28 juillet et le 8 septembre 2016, le préfet reprenant chaque jour un nouvel arrêté, voire élargissant de façon plus ponctuelle les plages horaires de cette autorisation. De même, entre le 21 juillet et le 11 octobre 2016, le préfet du Loiret a prononcé pas moins de 53 arrêtés autorisant les forces de l’ordre à procéder à ces contrôles, en raison de « flux importants de circulation ». En Seine-et-Marne, quelque 111 arrêtés ont été pris pendant la même période pour des zones situées autour des gares SNCF ou RER, sans qu’un événement particulier ne soit organisé. Le préfet de l’Yonne a quant à lui justifié le recours à de tels contrôles par les nombreuses « atteintes à l’ordre public constatées » dans les secteurs visés et le préfet d’énumérer les « 28 vols à la roulotte, 13 vols d’accessoires, 8 cambriolages, 8 vols d’automobile et 19 infractions à la législation sur les stupéfiants ». La préfecture de Seine-et-Marne motive également un de ses arrêtés par la « recrudescence des vols avec effraction ».
La durée des arrêtés varie assez nettement, avec une moyenne située entre 9 et 10 heures. Certaines préfectures ont interprété de façon souple le texte de la loi sur ce point : en raison du marché de Noël de Bourges, la préfecture du Cher a ainsi autorisé les forces de l’ordre à procéder à des contrôles d’identité tous les jours de 17h à 20h du 10 au 24 décembre 2016. La loi prévoyant une durée maximale de 24 heures, il eût été plus conforme à la lettre et à l’esprit de la loi de prononcer plusieurs arrêtés distincts, donnant ainsi la possibilité au préfet de réévaluer son dispositif au quotidien en fonction de l’évolution de la menace.
Au-delà des motivations, la carte ci-après montre la très forte disparité territoriale d’usage de cette mesure. Jusqu’au 15 novembre 2016, trois départements (la Seine-et-Marne, la Saône-et-Loire et le Loiret) concentrent 68 % des arrêtés prononcés. En ajoutant le département du Nord, on dépasse les 75 % du total.
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DES CONTRÔLES D’IDENTITÉ, FOUILLES DE BAGAGES ET VISITES DE VÉHICULES
du 21 juillet au 15 novembre 2016
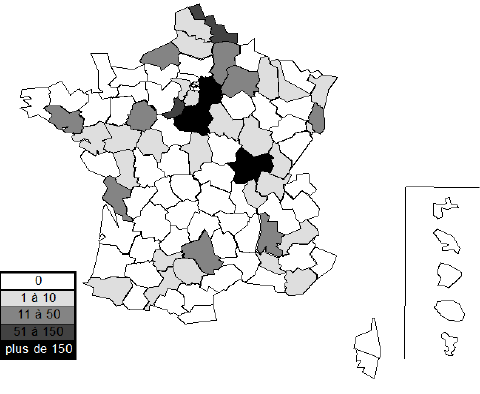
Source des données : ministère de l’Intérieur.
Ces mesures étant déconcentrées dans chaque préfecture, il est impossible de disposer de statistiques consolidées sur leurs effets réels et sur les découvertes auxquelles ces contrôles ont abouti. De façon générale, les services de police et de gendarmerie ont indiqué avoir contrôlé quelque 123 000 individus et 81 360 véhicules entre le 21 juillet et le 15 novembre 2016.
Par ailleurs, il est difficile de s’assurer que chaque arrêté a été, d’une part, bien transmis aux unités opérationnelles et, d’autre part, effectivement mis en œuvre.
C. LES AUTRES MESURES PRÉVENTIVES
L’article 9 de la loi de 1955 autorise le préfet à prononcer une mesure générale de remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C ainsi que celles soumises à un enregistrement relevant de la catégorie D. Il peut également prendre, pour des motifs d’ordre public, des décisions individuelles de remise d’armes.
Les catégories d’armes Les armes sont classées en quatre catégories en fonction de leur dangerosité. La dangerosité d’une arme à feu s’apprécie en fonction des modalités de répétition du tir et du nombre de coups tirés. À chaque catégorie correspond un régime administratif d’acquisition et de détention : - catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sauf exception ; - catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention (tir sportif ou défense) ; - catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention, notamment pour le tir sportif ou la chasse ; - catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres comme par exemple les armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon, les lanceurs de paintball, certains générateurs d’aérosols lacrymogènes, les armes blanches, les matraques… |
Cette mesure n’a été utilisée que de façon extrêmement marginale : durant la dernière période, seuls quatre arrêtés individuels de remise d’arme ont été prononcés, reconduisant d’ailleurs des mesures prises durant la période antérieure.
Outre les autres mesures ciblées, vos Rapporteurs ont eu communication d’actes administratifs originaux, pris sur le fondement de l’état d’urgence mais sans nécessairement renvoyer expressément à l’une des dispositions de la loi du 3 avril 1955. Visant l’état d’urgence, le préfet de l’Ardèche a par exemple interdit durant le festival country « Equiblues » le port, la vente ou l’exposition d’armes. Cette mesure ne constitue pas une remise d’arme au sens de l’article 9 ; elle est toutefois justifiée par « le niveau élevé de la menace terroriste ».
2. La fermeture provisoire de lieux de réunion
L’article 8 de la loi de 1955 autorise le ministre de l’Intérieur, ou le préfet dans son département, à ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux et réunion de toute nature. La loi du 21 juillet 2016 a précisé l’article en visant spécifiquement les « lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ». Le ministre ou le préfet peuvent par ailleurs interdire, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Entre le 14 novembre 2015 et le 21 juillet 2016, le ministère de l’Intérieur a porté à la connaissance de vos Rapporteurs quatre cas de fermeture de lieu de réunion. Depuis le 21 juillet, 13 arrêtés ont été pris pour 11 lieux, essentiellement des lieux de culte clandestins. Le caractère provisoire de la mesure a été effectivement mis en œuvre : une fois l’élément constituant une menace ou un trouble à l’ordre public écarté, le lieu concerné peut être autorisé à rouvrir. Un préfet a par exemple ordonné la fermeture d’une salle de prière clandestine qui était fréquentée « par une ou des personnes dont le comportement constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publique ». Il relevait par ailleurs « qu’aucune personne dirigeant la prière ni aucune association n’est identifiée comme représentant de ce lieu de culte » et qu’enfin « ce local présente une non-conformité à la réglementation des établissements recevant du public ». Six jours après, le préfet constate que le « propriétaire du lieu a repris possession de son local », que « les lieux ont été sécurisés par un huissier » et qu’ils ne constituent plus « un espace de rassemblement de personnes dont le comportement constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics ». Partant, il a abrogé l’arrêté antérieur, « la fermeture de la salle de prière clandestine [n’étant] plus justifiée ».
Plusieurs autres cas concernent des espaces au sein d’un plus vaste ensemble, l’autorité préfectorale constatant un détournement de leur usage premier. Ont ainsi été fermées provisoirement des salles communes de foyers dans la mesure où elles étaient fréquentées par des personnes extérieures au foyer et « connues par les services de l’État en raison de leur appartenance au mouvement salafiste ». La direction du foyer faisait d’ailleurs état de son incapacité à contrôler l’afflux d’invités et que la salle, prévue pour 19 personnes, en accueillait jusque 150.
Le 2 novembre 2016, le ministre de l’Intérieur a indiqué avoir fait procéder à la fermeture de quatre lieux de culte « au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ». Il souligne que « sous couvert de but cultuel, ces lieux abritaient des réunions visant en réalité à promouvoir une idéologie radicale, contraire aux valeurs de la République et susceptible de constituer un risque grave d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics » (88). Un préfet ayant pris l’un de ces arrêtés fait ainsi valoir parmi les considérants que « l’une des anciennes fidèles de la mosquée a ouvertement donné une interview dans le numéro de Dar Al Islam (89) d’août 2016 en indiquant que les épouses doivent pousser leurs maris à mourir comme le sien dans un attentat suicide » et qu’un « autre ancien fidèle de la mosquée apparaît sur une vidéo de Daech appelant à tuer les Français ». Dans les quatre cas, les arrêtés soulignent que ces mosquées sont fréquentées par des djihadistes avérés, certains ayant même été condamnés pour des actes liés au terrorisme et que les fidèles sont encouragés, a minima, à adopter à une attitude agressive et discriminatoire.
3. Les dissolutions d’association et les blocages de sites : des outils nouveaux mais guère utilisés
Certaines mesures, pourtant introduites dans la loi du 3 avril 1955 lors de son adaptation en novembre 2015 n’ont jusqu’ici guère trouvé à s’appliquer. Il est vrai qu’elles doublonnent avec des dispositifs de droit commun auxquels les services du ministère de l’Intérieur ont préféré recourir.
Outre la faculté de soumettre une personne assignée à résidence au port du bracelet électronique (cf. supra), les dispositions relatives à la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait n’ont jamais été utilisées jusqu’ici.
Le nouvel article 6-1 de la loi du 3 avril 1955 permet au ministre de l’Intérieur de prononcer la dissolution des associations ou groupements de fait « qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités la facilitent ou y incitent ». Par rapport à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui, reprenant l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, permet la dissolution, par décret en Conseil des ministres, de certaines associations ou groupements de fait, ces nouvelles dispositions introduisaient un critère plus large, supposé faciliter ces dissolutions et faciliter ainsi la fermeture « plus rapide, c’est-à-dire en quelques jours, des mosquées salafistes radicales » (90).
Toutefois, si quatre associations cultuelles ont effectivement été dissoutes depuis le début de l’état d’urgence en 2015, toutes l’ont été sur la base des 6° et 7° de l’article L. 212-1 précité (91). Interrogé sur ce choix de base légale lors de son audition par la Commission le 19 janvier 2016, M. Thomas Andrieu, alors directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur, avait indiqué que le recours au droit commun avait paru préférable afin de « consolider » les arrêtés de dissolution – en l’occurrence à l’encontre de trois associations cultuelles intervenant à Lagny-sur-Marne – le ministère prouvant, « en satisfaisant aux standards du code de la sécurité intérieure [… ] , que la mesure est étayée » (92).
De même, la procédure de blocage de services de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, figurant au II de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, est restée lettre morte.
Cette disposition permet au ministre de l’Intérieur de s’adresser indifféremment et sans délai à l’éditeur, à l’hébergeur ou au fournisseur d’accès à internet, pour demander la fermeture d’un compte facebook dont le mur est ouvert au public, d’un compte Twitter ou d’un blog s’il contient des éléments incitant à la provocation et à l’apologie du terrorisme.
Dans son rapport d’activité présenté le 15 avril 2016, M. Alexandre Linden, désigné personnalité qualifiée par la CNIL (93) pour contrôler la mise en œuvre des mesures administratives de blocage des sites, a noté que « les modalités de mise en œuvre de ce dispositif [n’avaient] pas été précisées ». D’après les informations fournies à vos Rapporteurs, le ministère de l’Intérieur n’y a pas recouru à ce jour.
Il est vrai que, comme l’indiquait Mme Mireille Ballestrazzi, directrice centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur lors de son audition le 8 janvier dernier, le droit commun modifié sur ce point par l’article 12 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, comporte déjà une mesure administrative voisine de droit commun (94). C’est donc sur ce fondement qu’ont été prises les mesures de blocage administratif de sites internet faisant l’apologie du terrorisme. Lors de son intervention devant les préfets et les procureurs réunis à l’École militaire le 7 novembre dernier, le ministre de l’Intérieur a indiqué que 54 sites internet avaient fait l’objet d’une mesure de blocage pour de tels motifs et que 319 adresses électroniques avaient été déréférencées par les moteurs de recherche.
Pour vos Rapporteurs, le recours systématique depuis un an au droit commun plutôt qu’à ces deux dispositifs récemment introduits dans la loi relative à l’état d’urgence conduit à s’interroger sur la plus-value de ces derniers.
IV. LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L’ÉTAT D’URGENCE
S’agissant d’un dispositif de police administrative, il relève de façon prééminente du juge administratif. La justice pénale n’est toutefois pas exclue du dispositif : elle réprime, comme on l’a vu, tous les manquements aux mesures prises dans ce cadre, qui constituent autant d’infractions pénales et peut être amenée à examiner la légalité des ordres de perquisitions administratives (cf. supra).
A. L’AFFIRMATION RAPIDE DU CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
La loi du 20 novembre 2015, en introduisant un nouvel article 14-1 dans la loi du 3 avril 1955, a reconnu la pleine compétence du juge administratif pour connaître des mesures de police administrative prévues par l’état d’urgence. La loi du 20 juillet 2016 a ensuite modifié l’office du juge administratif en lui octroyant un pouvoir nouveau d’autorisation d’exploitation des données informatiques découvertes lors des perquisitions administratives.
En choisissant de remplacer les commissions départementales ad hoc prévues par l’ancien article 7 de la loi du 3 avril 1955 par des voies de recours de droit commun, le législateur a manifesté sa confiance aux juridictions administratives, et singulièrement à l’office du juge des référés chargé de statuer en urgence. L’affirmation d’un contrôle exigeant du juge administratif était un enjeu essentiel de la réorganisation de l’état d’urgence souhaité par le législateur. Il l’était aussi certainement pour les juridictions administratives qui ont dû, sur un sujet nouveau très sensible, faire la preuve de leur capacité à garantir la nécessité et la proportionnalité de ces mesures.
Le contentieux dévolu au juge administratif était entièrement nouveau, ainsi que l’a souligné le Vice-président du Conseil d’État, M. Jean-Marc Sauvé lors de son audition par notre Commission le 8 janvier 2016, « la juridiction administrative était-elle préparée à traiter du contentieux relatif aux mesures prises en application de l’état d’urgence ? Nous avons tout fait pour que les juges des référés soient en mesure de se prononcer. Dès le 14 novembre, nous avons appelé l’attention des tribunaux administratifs d’Île-de-France et des grandes métropoles sur la nécessité d’une montée en puissance à la fois quantitative et qualitative de leurs permanences. Nous nous attendions en effet à une vague de requêtes, et il nous semblait souhaitable qu’elles soient examinées par des juges expérimentés et en nombre suffisant. Nous avons toutefois été confrontés à des difficultés que nous n’avions pas anticipées. Si, depuis l’entrée de vigueur de la loi du 10 janvier 1990 modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, qui ouvre une voie de recours à caractère suspensif contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, la juridiction administrative a acquis une véritable culture de l’urgence, si nous savons désormais nous prononcer en première instance comme en appel dans des délais extrêmement brefs, nous n’avions pas l’expérience de l’état d’urgence qui peut conduire à prendre des mesures de caractère tout à fait exceptionnel, comme en 2015 de nombreuses mesures d’assignation à résidence » (95).
Pourtant, le juge administratif a rapidement construit son contrôle sur cette matière inédite et précisé son office.
Il est vrai que, dans un premier temps, l’état d’urgence a pu dérouter les juridictions de première instance. En effet, se fondant sur une interprétation trop littérale du code de justice administrative, des juges des référés de première instance ont prononcé, dans plusieurs affaires relatives à des assignations à résidence décidées durant les premières semaines de l’état d’urgence, des rejets pour défaut d’urgence (« ordonnances de tri ») qui aboutissaient à ne pas même convoquer d’audience pour entendre les parties. Le Conseil d’État s’est rapidement prononcé afin de mettre un terme à ces solutions.
Plusieurs décisions scandent la construction de l’édifice jurisprudentiel.
Le 11 décembre 2015, les décisions rendues en section sur sept affaires d’assignations à résidence décidées à l’encontre de militants radicaux pendant la COP 21 permettent au Conseil d’État d’ajuster, redresser et préciser les contours de l’office du juge des référés et de mettre un terme à la pratique contestable mentionnée plus haut des « ordonnances de tri » en prévoyant une « présomption d’urgence » garantissant ainsi l’examen en référé d’une mesure prise en application de la loi du 3 avril 1955.
Étayées par les conclusions solides du rapporteur public, ces ordonnances précisent le régime des assignations à résidence et définissent l’étendue du contrôle du juge administratif qui exercera désormais un entier contrôle de proportionnalité, solution rapidement confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 22 décembre 2015. Il s’agit ici d’une évolution importante car, jusqu’alors, en ce qui concerne les assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence, le juge administratif s’en tenait, en l’état de sa jurisprudence classique, à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (96), ainsi que le rappelait d’ailleurs le ministère de l’Intérieur dans de nombreux contentieux de première instance, comme devant le Conseil d’État.
Depuis cette décision, les tribunaux administratifs ont décliné cette jurisprudence, même si l’étendue du contrôle opéré n’apparaît pas uniforme selon les dossiers et les tribunaux considérés.
Le 6 juillet 2016, le Conseil d’État, réuni en assemblée, rend son avis contentieux sur le régime des perquisitions. Il fait suite à deux demandes d’avis présentées, en application de l’article L. 113-1 du code de la justice administrative par les tribunaux de Melun et de Cergy-Pontoise et lui permet de préciser les conditions auxquelles une perquisition peut être considérée comme légale et de fixer les règles devant présider à son indemnisation.
Enfin, trois semaines après l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2016, le Conseil d’État a précisé, dans une ordonnance du 8 août 2016, les contours de l’office du juge administratif, totalement nouveau, lorsqu’il doit autoriser l’exploitation des données numériques saisies lors d’une perquisition administrative.
Les données figurant ci-dessous permettent d’appréhender la réalité du contentieux administratif né de l’application de la loi du 3 avril 1955.
BILAN STATISTIQUE DU CONTENTIEUX DES MESURES PRISES SUR LE FONDEMENT DE L’ÉTAT D’URGENCE 1. ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE Procédures d’urgence Dans les tribunaux administratifs (chiffres au 26 octobre 2016) : 233 référés ont été formés, ils ont donné lieu à : – 3 désistements ; – 23 non-lieux ; – 169 rejets (dont 48 sans audience, sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative) ; – 12 satisfactions partielles (suspension partielle de l’assignation ou aménagement de ses modalités) ; – 16 satisfactions totales (suspension totale de l’assignation). Au Conseil d’État (chiffres au 26 octobre 2016) : 55 procédures d’urgence ont été portées devant le Conseil d’État en appel ou en cassation. Les décisions rendues se répartissent ainsi : – 1 a donné acte d’un désistement ; – 5 ont prononcé ou confirmé la suspension totale de l’assignation ; – 4 ont prononcé ou confirmé la suspension partielle de l’assignation ; – 17 se sont soldées par un non-lieu (dans la plupart des cas, parce que le ministre avait abrogé la mesure en cours d’instance) dans 28 cas, le Conseil d’État a rejeté ou confirmé le rejet du référé formé par le requérant. Recours au fond Dans les tribunaux administratifs (chiffres au 26 octobre 2016) : 133 recours au fond ont été jugés 11 ont été traités par ordonnance (sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative) et 122 par une formation de jugement collégiale. Ces affaires ont donné lieu, au total, à : – 10 désistements ; – 6 non-lieux ; – 82 rejets ; – 3 satisfactions partielles (annulation partielle de l’assignation) ; – 22 satisfactions totales (annulation totale de 1’assignation). Il reste un stock de 62 dossiers à juger. Dans les cours administratives d’appel (chiffres au 26 octobre 2016) : Les cours administratives d’appel ont jugé 13 appels : elles ont confirmé le tribunal administratif dans 10 cas et inversé la solution dans 3 cas. Il leur reste un stock de 9 dossiers à juger. Aucun dossier de fond n’a été jugé par le Conseil d’État à ce jour. 2. PERQUISITIONS Il n’y a, par construction, pas eu de référés contre des mesures de perquisitions. Les chiffres ne portent donc que sur les recours au fond. Dans les tribunaux administratifs (chiffres au 26 octobre 2016) : 16 recours ont été jugés : – 8 rejets (dont 1 par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative) ; – 8 satisfactions partielles ou totales (annulation de la mesure de perquisition et/ou indemnisation du requérant). Il reste un stock de 31 dossiers à juger. À ce jour, un appel a été enregistré devant une cour administrative d’appel qui n’a pas encore statué. 3. AUTORISATIONS POUR EXPLOITATION DES DONNÉES SAISIES LORS D’UNE PERQUISITION Dans les tribunaux administratifs (chiffres au 26 octobre 2016) : 80 décisions qui se répartissent comme suit : – 70 autorisations totales ; – 1 autorisation partielle ; – 1 désistement ; – 8 rejets. Au Conseil d’État (chiffres au 26 octobre 2016) : 5 appels ont été formés devant le Conseil d’État. Les décisions rendues en appel se répartissent comme suit : – 4 autorisations d’exploiter ou confirmations de l’autorisation accordée en première instance ; – 1 confirmation du refus opposé en première instance. 4. AUTRES MESURES (fermeture d’un restaurant, interdiction de manifester, interdiction de fréquenter un lieu de culte, etc.) Procédures d’urgence Dans les tribunaux administratifs (chiffres au 26 octobre 2016) : 38 référés ont été formés, ils ont donné lieu à : – 1 désistement ; – 1 non-lieu ; – 26 rejets (dont 6 sans audience, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative) ; – 3 satisfactions partielles ; – 7 satisfactions totales. Au Conseil d’État (chiffres au 26 octobre 2016) : 5 procédures d’urgence ont été portées devant le Conseil d’État en appel ou en cassation. Les décisions rendues se répartissent ainsi : - 1 a prononcé ou confirmé la suspension totale de la mesure ; - dans 4 cas, le Conseil d’État a rejeté ou confirmé le rejet du référé formé par le requérant. Recours au fond Dans les tribunaux administratifs (chiffres au 30 septembre 2016) : 39 recours au fond ont été jugés, tous par une formation de jugement collégiale. Ces affaires ont donné lieu, au total, à : – 16 rejets ; – 6 satisfactions partielles (annulation partielle de la mesure) ; – 17 satisfactions totales (annulation totale de la mesure). Il reste un stock de 49 dossiers à juger. À ce jour, les cours administratives d’appel ont été saisies de 3 appels (aucun n’a été jugé pour l’instant). |
Source : Conseil d’État.
De cette activité juridictionnelle, on peut tirer les enseignements suivants :
– les volumes contentieux ne sont pas considérables – de l’ordre de quelques centaines de décisions à comparer aux 229 000 affaires jugées par l’ensemble des juridictions administratives. Pourtant, outre les questions juridiques importantes qu’il a soulevées, le contentieux de l’état d’urgence 2015-2016 a également entraîné un aménagement du fonctionnement des juridictions qui se sont réorganisées pour traiter ce contentieux urgent (notamment durant l’été afin de pouvoir délivrer les autorisations d’exploitation de données numériques) et tenir compte des impératifs de sécurité (recours à des audiences à huis clos, anonymisation des décisions, sécurisation de certains tribunaux,..) ;
– le cœur du contentieux est jugé en référé dans lequel les débats oraux contradictoires prennent toute leur part (cf. supra pour le contrôle juridictionnel des assignations à résidence) ;
– le « taux de satisfaction » globale ou partielle, notamment sur les assignations à résidence, est notable mais le nombre de suspensions a fortement décru par rapport aux premiers temps de l’état d’urgence ;
– les mesures administratives ne font pas toutes l’objet d’un contentieux : si les assignations à résidence ont été à l’origine d’un nombre important de demandes, tel n’est pas le cas des perquisitions, alors qu’elles ont pourtant été menées en nombre et qu’il s’agit d’une procédure intrusive ; de même, certaines mesures n’ont donné lieu à aucun contentieux.
B. LA SOLLICITATION DU JUGE CONSTITUTIONNEL
Ni la loi du 20 novembre 2015 ni les lois de prorogations qui ont suivi n’ont été déférées au Conseil constitutionnel. Celui-ci a pourtant été amené à se prononcer à cinq reprises, par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité – dont quatre ont été transmises par le Conseil d’État – sur la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la loi du 3 avril 1955.
À ce jour, le Conseil a été saisi : du régime des assignations à résidence ; du cadre applicable aux perquisitions administratives avant et après les modifications législatives de novembre 2015 ; de la question particulière posée par l’exploitation des données numériques découvertes lors des perquisitions ; des mesures de police des réunions et des lieux publics.
La première décision rendue le 22 décembre 2015 concerne les assignations à résidence (97) ; elle a été l’occasion pour le Conseil constitutionnel de préciser l’appréhension juridique de l’état d’urgence. Il relève que « la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence [et] qu’il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République » (98). Ce principe de proportionnalité et d’équilibre est central dans la jurisprudence constitutionnelle et il appartient au juge administratif de s’en assurer en pratique au travers d’un triple contrôle – le « triple test de proportionnalité » – sur le caractère « adapté, nécessaire et proportionné à la finalité » que la mesure poursuit (99).
En l’espèce, le juge constitutionnel a considéré que l’assignation à résidence est « une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions » et que, compte tenu du cadre établi, ne méconnaît « ni le droit au respect de la vie privée ni le droit de mener une vie familiale normale » (100).
Deux autres QPC, rendues le 19 février 2016, sont l’occasion de valider les dispositions relatives à la police des réunions et des lieux publics, et d’examiner le régime des perquisitions administratives. Saisi du régime applicable aux perquisitions, le Conseil constitutionnel a censuré partiellement le dispositif par sa décision du 19 février 2016 (101). Outre la validation du dispositif créé par la loi du 20 novembre, à l’exception du mécanisme de saisie des données numériques (cf. supra), le juge a repris l’argumentation développée en décembre en insistant de nouveau sur la nécessité de vérifier que l’administration exerce une juste conciliation entre les principes. Cet examen suppose de veiller au caractère proportionné et adapté des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.
La décision du 23 septembre dernier (102) s’inscrit dans la même logique et reprend la même argumentation, le Conseil censurant le dispositif de perquisition administrative antérieur à la loi du 20 novembre 2015 (cf. supra) car il n’opère une juste conciliation entre les différents principes à valeur constitutionnelle.
Enfin, la dernière QPC en date, transmise le 16 septembre dernier et sur laquelle le Conseil s’est prononcée le 2 décembre dernier, porte sur le nouveau régime de saisie et d’exploitation de ces données, adopté par le législateur en juillet dernier. Comme précédemment indiqué, elle valide le dispositif dans son organisation globale, ne censurant que les dispositions relatives à la durée de conservation des données saisies lorsqu’elles ne conduisent pas à la constatation d’une infraction.
C. L’ÉCLAIRAGE DU JUGE EUROPÉEN
L’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme stipule qu’en « cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute [partie] contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international ». Depuis le 3 mai 1974, la France a émis des réserves sur cet article, considérant que les circonstances énumérées pour la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution et pour les lois sur l’état de siège et l’état d’urgence « doivent être comprises comme correspondant à l’objet de l’article 15 de la Convention ».
Dans une décision d’assemblée, le Conseil d’État avait jugé que les dispositions de la loi du 3 avril 1955 « ne sont incompatibles avec aucune des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » (103), confirmant la préservation des droits fondamentaux de toutes les personnes susceptibles d’être visées par un acte pris sur le fondement de l’état d’urgence.
S’il incombe, en principe, à chaque État contractant de déterminer si la vie de la nation est menacée par un danger public, la Cour vérifie in concreto l’existence d’une situation de crise, de danger exceptionnel et imminent justifiant la prise de mesures dérogatoires à la Convention. La Cour a ainsi souligné que « dans le contexte général de l’article 15 de la Convention, le sens normal et habituel des mots « en cas de guerre ou en cas d’autres dangers publics menaçant la nation » est suffisamment clair ». Elle estime « qu’ils désignent […] une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’État » (104).
La Cour vérifie ensuite que les mesures litigieuses étaient strictement exigées par la situation et proportionnées à la menace. L’article 15 n’autorise en effet les États à prendre des mesures dérogeant à leurs obligations au titre de la Convention que « dans la stricte mesure où la situation l’exige ». La Cour se considère compétente « pour décider, notamment, s’ils ont excédé la “stricte mesure” des exigences de la crise. La marge nationale d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle européen » (105). La Cour effectue un contrôle de proportionnalité en examinant notamment la nature des droits touchés par la dérogation, la durée de l’état d’urgence et les circonstances qui l’ont créé. L’application de ces règles est toutefois variable selon les affaires que la Cour a jugées. Elle s’est par exemple montrée très compréhensive à l’égard des détentions extrajudiciaires décidées par les autorités britanniques dans les années 1970. En 1978, elle a ainsi estimé que dans le contexte « d’une vague massive de violence et d’intimidation, le gouvernement d’Irlande du Nord puis, une fois instaurée l’administration directe (30 mars 1972), le gouvernement britannique ont pu raisonnablement estimer que les ressources de la législation ordinaire ne suffisaient pas à la lutte contre le terrorisme et qu’ils devaient recourir à des moyens exorbitants du droit commun sous la forme de privations “extrajudiciaires” de liberté » (106).
Outre l’examen de fond, la Cour exige que les mesures prises par les États sur le fondement de l’état d’urgence puissent faire l’objet d’un recours devant le juge national. En 1993 (107), elle a ainsi jugé que le gouvernement britannique n’avait pas excédé sa marge d’appréciation en dérogeant aux obligations découlant de l’article 5 de la Convention par des dispositions autorisant la détention sans contrôle judiciaire pendant une période maximale de sept jours de personnes soupçonnées d’infractions terroristes. En l’espèce, elle a estimé que des garanties effectives assuraient une protection appréciable contre les comportements arbitraires et les détentions au secret : l’habeas corpus permettait un contrôle de la légalité de l’arrestation et de la détention initiales et les détenus avaient le droit absolu, qu’ils pouvaient revendiquer en justice, de consulter un solicitor quarante-huit heures après leur arrestation, de même que celui d’informer un parent ou ami de leur détention et de se faire examiner par un médecin.
En 1996, la Cour a infléchi sa jurisprudence, refusant qu’un suspect puisse être détenu pendant quatorze jours sans intervention judiciaire. En l’espèce, elle a relevé que le requérant n’a pas bénéficié de garanties suffisantes, ayant été privé de l’accès à un avocat, à un médecin, à un parent ou à un ami. Elle note l’absence de toute possibilité réaliste d’être traduit devant un tribunal aux fins de contrôle de la légalité de sa détention conduit à ce que le détenu soit complètement à la merci de ses gardiens (108) .
En 2009, la Cour a confirmé sa position antérieure, à savoir qu’il « incombe à la juridiction saisie – qu’elle soit interne ou internationale – d’examiner les mesures adoptées en dérogation aux droits conventionnels en jeu et de les mettre en balance avec la nature de la menace pesant sur la nation » (109) et précisé que « la question de la proportionnalité relève en dernière instance du domaine judiciaire, particulièrement lorsque, comme en l’espèce, des justiciables ont subi une longue privation de leur droit fondamental à la liberté » (110).
Au-delà de son examen sur des cas d’espèce, la Cour a rappelé l’existence de droits indérogeables ou intangibles qui ne peuvent faire l’objet d’aucun aménagement. Dans son arrêt du 27 septembre 1995, la Cour rappelle ainsi que l’article 2 de la Convention « garantit non seulement le droit à la vie mais expose les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier ; il se place à ce titre parmi les articles primordiaux de la Convention auquel aucune dérogation ne saurait être autorisé, en temps de paix » (111). De même, l’article 3 prohibant la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants « ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la Nation » (112), pas plus que l’article 4 qui interdit l’esclavage et la servitude (113). L’article 7 consacre enfin le principe de la légalité des délits et des peines, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir de peine sans loi (114).
Depuis la déclaration de l’état d’urgence, le dispositif français n’a pas fait l’objet de contestations devant la Cour. Le cadre applicable n’apparaît pas contraire à la jurisprudence de la Cour et ne viole aucun droit intangible ni indérogeable. L’ensemble des personnes faisant l’objet de mesures prises sur le fondement de l’état d’urgence ont accès à des conseils et sont en mesure d’introduire des recours devant les juridictions nationales qui veillent à la juste conciliation de principes de valeur juridique équivalente.
V. LA MOBILISATION DES SERVICES DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Parce qu’il s’est traduit par le déploiement massif de mesures administratives puissantes sur tout notre territoire, l’état d’urgence a fortement mobilisé les services centraux et déconcentrés du ministère de l’Intérieur.
A. LA CONFIRMATION DE L’EFFICACITÉ DES ÉTATS-MAJORS PRÉFECTORAUX
Aux termes de la loi du 3 avril 1955, les préfets sont les chevilles ouvrières de l’état d’urgence. En effet, si l’on excepte les dissolutions d’associations qui font l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres, les assignations à résidence et les blocages des sites internet qui sont arrêtés par le ministre de l’Intérieur, toutes les autres dispositions relèvent de la compétence du préfet de département qui les exerce de façon exclusive ou partagée avec le ministre de l’Intérieur (115).
En s’en tenant aux mesures les plus nombreuses prises depuis la déclaration de l’état d’urgence (perquisitions, assignations, contrôles d’identité), il apparaît qu’aucun département métropolitain ou ultra-marin n’a été tenu à l’écart de la mise en œuvre de l’état d’urgence, même si l’on observe naturellement des disparités entre les territoires. En effet, 19 départements comptabilisent moins de 10 actes relatifs à des perquisitions ou des assignations alors que, à l’inverse, dans quatre départements (Nord, Essonne, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes), on en dénombre plus de 200 entre le 14 novembre 2015 et le 15 novembre 2016.
Or, dans la conduite de cet exercice inédit qu’est l’état d’urgence, et même si des actes isolés pris par certains préfets ont pu susciter des interrogations chez vos Rapporteurs, ils considèrent, au vu des déplacements qu’ils ont faits sur le terrain (116) et des auditions des responsables opérationnels de la gendarmerie et de la police nationales (117), que les préfectures ont fait preuve de réactivité et de sang-froid dans l’urgence.
Les préfets et leurs équipes se sont vite organisés pour piloter le ciblage, signer les ordres et contrôler l’action des services placés sous leur autorité, dégageant des modes de fonctionnement opérationnel adaptés à leurs besoins. Les services du département d’Ille-et-Vilaine ont fait le choix de confier à la direction départementale de la sécurité publique la coordination du déroulement des perquisitions.
L’enjeu était de taille puisque pour certains départements, les perquisitions ont débuté dès le 14 novembre 2015 dans la soirée et il leur a donc fallu en quelques heures, définir des objectifs d’actions et arrêter les modalités d’intervention des unités chargées de leur exécution.
De fait, le ciblage des perquisitions a donné lieu à une organisation déconcentrée très spécifique, réunissant systématiquement la sécurité intérieure, le renseignement territorial, la direction de la sécurité publique et la gendarmerie nationale, mais aussi les services de police judiciaire et le parquet. Grâce à la coordination entre les services départementaux de renseignement, des perquisitions visant le même individu ont pu être ordonnées dans plusieurs départements de façon coordonnée.
L’association des procureurs de la République à la mise en œuvre de l’état d’urgence est l’une des autres particularités de l’organisation observée localement, même si elle n’a pas toujours concerné toutes les mesures.
Aux termes de la loi, les procureurs sont informés sans délai du déclenchement d’une perquisition administrative qui est obligatoirement conduite en présence d’un officier de police judiciaire, seul habilité à constater les infractions éventuellement découvertes et à procéder aux saisies en vue de poursuites judiciaires. En pratique, les rencontres effectuées sur le terrain témoignent d’une grande association des procureurs et de la mobilisation de ces derniers (118) : même s’il s’agissait d’opérations de police administrative, la primauté du judiciaire a toujours été recherchée car il était hors de question que l’état d’urgence menace les dossiers judiciaires menés de longue haleine et chaque cas a donné lieu à une réflexion pour savoir si l’option devait être judiciaire ou administrative. Le plus souvent, c’est une information très en amont des procureurs qui a été recherchée.
En ce qui concerne les assignations, il convient de noter que la loi du 3 avril 1955 ne prévoit pas l’information des procureurs de la République territorialement compétents. Une dépêche du ministère de la Justice et une circulaire du ministère de l’Intérieur du 11 décembre 2015 relative aux arrêtés d’assignation à résidence ont remédié à cette lacune en précisant que les préfets devaient informer le parquet territorialement compétent de toute décision d’assignation à résidence.
« On n’a pas été pris au dépourvu » a indiqué un responsable du renseignement territorial à vos Rapporteurs lors de l’un de leurs déplacements. Il est vrai que des outils et des structures de collaboration et de partage d’information existaient déjà et qu’ils ont pu être davantage sollicités.
Ainsi est-ce le cas des états-majors de sécurité qui ont accéléré le rythme de leurs réunions (de une à trois réunions par semaine dans les premiers temps d’après les interlocuteurs rencontrés) ; se retrouvaient ainsi autour d’une même table et du préfet tous les services de police, de gendarmerie et de renseignement. De même, l’organisation des groupes d’évaluation départementaux de la radicalisation (GED) (119) a permis aux responsables locaux des services de sécurité qui alimentent le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) de gagner beaucoup de temps et d’efficacité au début de l’état d’urgence, en particulier dans le ciblage des individus.
Les acteurs de l’état d’urgence rencontrés par vos Rapporteurs lors de leurs déplacements ont également mentionné la préparation déontologique et le travail d’encadrement des équipes d’intervention lors des perquisitions : afin de veiller à leur bon déroulement, la présence d’un commissaire de police ou, pour la gendarmerie, au moins d’un commandant de compagnie ou d’un de leurs adjoints a ainsi été assurée et des préfets ou des directeurs de cabinet ont parfois été présents (Haute-Garonne notamment). Les préfets ont insisté sur la nécessité de respecter les procédures et de veiller à la proportionnalité des mesures, le préfet d’Ille-et-Vilaine ayant indiqué avoir toujours inclus dans ses ordres de perquisition un article spécifique demandant la réquisition d’un serrurier afin d’éviter les bris de porte. Et, lorsque des erreurs furent constatées, les équipes furent rappelées explicitement à la vigilance, comme l’ont indiqué le préfet de Haute-Garonne, des Alpes-Maritimes ou encore le préfet de police de Paris.
Parallèlement à ce travail de ciblage et de pilotage des perquisitions et des assignations, il a aussi fallu que l’administration préfectorale assure des tâches nombreuses et pour certaines totalement nouvelles, telles que la défense lors d’audiences contentieuses orales et contradictoires de mesures prises sur le fondement de l’état d’urgence, la mise en place d’une communication renforcée à destination des élus, de la population ou des sites sensibles dans les heures qui ont suivi les attentats, ou encore le collationnement de données pour permettre les remontées statistiques attendues par le ministère ou demandées par le contrôle parlementaire de l’état d’urgence….
Plus généralement, vos Rapporteurs ont perçu l’extrême mobilisation de forces de sécurité, dont tous leurs responsables se sont fait l’écho lors des échanges qu’ils ont pu avoir avec eux et ce, au prix de congés suspendus et de formations différées. D’après les données qu’ils ont réunies sur les perquisitions administratives, les effectifs moyens mobilisés lors d’une perquisition sont de l’ordre d’une quinzaine de personnes ; de même les contrôles d’identité déployés à grande échelle dans certains départements ou les notifications d’interdictions de séjour mobilisent fortement les effectifs. Sur ce point, il paraîtrait souhaitable que le ministère de l’Intérieur examine le coût budgétaire de la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Proposition : Examiner le coût budgétaire de la mise en œuvre de l’état d’urgence.
B. UN PILOTAGE CENTRAL « SOUS PRESSION »
Il faut mesurer la réactivité des services centraux du ministère de l’Intérieur et la sollicitation intense dont ils ont été l’objet face à la « déferlante » de l’état d’urgence déployé en quelques heures sur tout le territoire alors que, parallèlement se poursuivait la préparation de la COP 21, événement international de grande ampleur, préparé de longue date et dont le maintien avait été décidé par le Président de la République.
Les attaques terroristes qui avaient frappé la France entre les 7 et 9 janvier 2015 avaient conduit les services du ministère de l’Intérieur à se pencher sur la loi du 3 avril 1955 et à envisager son utilisation pour répondre à une crise de ce type (120).
Toutefois, durant le premier week-end qui suit la déclaration de l’état d’urgence, les services centraux du ministère de l’Intérieur « produisent » abondamment : outre les textes réglementaires relatifs à la déclaration de l’état d’urgence, les premières circulaires du ministre sur les mesures susceptibles d’être prises en application du 3 avril 1955 – indispensables compte tenu de l’obsolescence de ce texte dans sa rédaction de 1960 – sont diffusées ; le projet de loi de prorogation est préparé, 104 assignations à résidence sont prononcées sur la base de notes dont les premières sont parvenues à la DLPAJ à minuit dans la nuit du samedi 14 novembre au dimanche 15 novembre 2015 ; le service central du Renseignement territorial précise les méthodes de travail et de ciblage des perquisitions et des assignations, en s’appuyant sur les coordinateurs zonaux de sécurité publique et des responsables locaux du renseignement territorial.
Compte tenu de la complémentarité existant entre les mesures administratives et les procédures judiciaires, le ministère de la Justice a également été sollicité. Comme l’a précisé M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces, devant notre Commission le 8 janvier 2016, « notre premier souci a été d’informer les parquets et de les mobiliser sur les problématiques posées et les nouveaux dispositifs mis en place. Depuis le 13 novembre et jusqu’à la pause de Noël, nous leur avons ainsi adressé deux circulaires et sept dépêches, ce qui est beaucoup en un peu plus d’un mois. La première circulaire a été celle signée par la garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur dans la nuit du 13 au 14 novembre et adressée aux parquets dès dix heures le samedi matin. Nous avons adressé une dépêche aux parquets le même jour, dans l’après-midi, afin de mettre en place un dispositif de remontée d’information. Nous avons ensuite envoyé différentes dépêches pour préciser le cadre juridique de la loi prorogeant l’état d’urgence » (121). La loi du 3 avril 1955 sanctionnant pénalement la violation des mesures prises sur son fondement, la Chancellerie a également établi les références de tous les codes NATINF (122) pour engager les poursuites en cas de violation d’une mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence, et produit des tableaux comparatifs entre les différents régimes.
Il s’agissait également de diffuser des informations vers les responsables de la mise en œuvre sur le terrain. Au ministère de l’Intérieur, la DLPAJ a mis en place une boîte mél fonctionnelle dédiée (rendue destinataire de 6 500 messages depuis le début de l’état d’urgence dont 2 500 au cours de la première période) et diffusé des modèles d’arrêtés dont peuvent s’inspirer les préfets et alimenté des « foires aux questions ». Ces informations ont d’ailleurs dépassé la seule sphère préfectorale et ont été reprises et diffusées auprès des services du renseignement territorial, comme l’a indiqué M. Jérôme Léonnet, chef du service central du Renseignement territorial au ministère de l’Intérieur (123). La diffusion d’informations via la « foire aux questions » de la DACG est également organisée à la Chancellerie afin que les parquets disposent de tous les outils possibles.
La communication de l’échelon central a aussi porté sur les modalités de déroulement des perquisitions dont, très vite, la presse se fait l’écho : à la circulaire du ministre du 25 novembre précitée (124), se sont ajoutés des télégrammes des responsables à l’échelon central (125) qui ont rappelé les règles déontologiques applicables en la matière.
De même, des instructions sont régulièrement diffusées aux services déconcentrés sur différents points de mise en œuvre de l’état d’urgence : destruction des copies de données informatiques faites lors des perquisitions à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 ; conditions du maintien de l’ordre au printemps dernier à l’occasion des manifestations revendicatives et des rassemblements « Nuit debout » ; articulation des mesures administratives et des mesures judiciaires en matière de lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation.
Vos Rapporteurs ont eu l’occasion de rencontrer les équipes de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques chargées de la mise en œuvre de l’état d’urgence. Ils ont pu constater l’importance de leurs missions, la charge de travail qui a été la leur et soulignent ici l’opportunité d’un renforcement des moyens qui leur sont alloués.
Proposition : Renforcer les moyens de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur.
De même, il leur paraît nécessaire que le pilotage central des mesures prises en application de l’état d’urgence soit précisé.
En effet, au fil de leur contrôle, vos Rapporteurs ont pu constater que le Gouvernement, alors même qu’il met en œuvre l’état d’urgence dans des proportions inédites, ne s’est pas doté d’outils lui permettant de disposer d’une connaissance centralisée et exhaustive des mesures prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955.
Si le ministère de la Justice a organisé une remontée des données via les parquets généraux au premier jour de l’état d’urgence (126), tel n’est pas le cas du ministère de l’Intérieur en ce qui concerne les procédures déconcentrées. La DLPAJ dispose d’une connaissance complète des mesures relevant de la compétence du ministre mais tel n’est pas le cas des perquisitions administratives dont le traitement centralisé a été assuré au cabinet du ministre, notamment pour répondre aux demandes des parlementaires chargés du contrôle parlementaire, avant d’être récemment attribué aux services du haut fonctionnaire de défense du ministère de l’Intérieur.
À la question adressée au responsable de l’état-major opérationnel de la prévention du terrorisme (EMOPT) sur le point de savoir si, depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, il était informé des mesures administratives prises dans l’ensemble du territoire, M. Olivier de Mazières a ainsi répondu : « Oui, via les préfets de zone. Il est facile d’avoir connaissance du bilan quantitatif, mais nous n’avons eu accès aux données qualitatives — comment se déroulaient les perquisitions ? constatait-on un phénomène d’assèchement ? Comment le compenser dans les perquisitions administratives ? Comment les élus, les médias et la population percevaient-ils l’état d’urgence ? — qu’après un certain temps et par le biais du cabinet du ministre. Le développement des indicateurs demandés par la commission des Lois nous a également permis d’avoir accès à des informations fiables et complètes » (127).
La fiabilité des informations disponibles dans les tout premiers temps de l’état d’urgence sur les procédures centralisées aurait sans doute gagné à être renforcée. Afin de garantir un pilotage centralisé et exigeant, particulièrement nécessaire lorsque des prérogatives dérogatoires du droit commun sont laissées aux autorités administratives, vos Rapporteurs jugeraient ainsi pertinent de prévoir une instance de coordination qui, à l’échelon interministériel, permettrait de consolider les données recueillies par les ministères, de faire un suivi qualitatif des mesures prises, d’assurer des échanges fluides entre les différents ministères susceptibles d’être concernés par l’état d’urgence et garantirait au Gouvernement la maîtrise d’un pilotage en toute connaissance de cause.
Proposition : Prévoir une instance assurant une coordination interministérielle des mesures prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955.
TROISIÈME PARTIE :
L’ÉTAT D’URGENCE À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Contrairement aux prévisions initiales, l’état d’urgence s’est installé dans la durée. S’il devait être prolongé afin de couvrir la période électorale à venir comme l’ont récemment annoncé le Président de la République et le Premier ministre, notre pays aura alors fait l’expérience de l’un des états d’urgence les plus longs de notre histoire – vingt mois – depuis sa création en 1955 (128), avec des prolongations d’une durée croissante et couvrant à chaque fois l’intégralité du territoire.
La répartition dans le temps des mesures prises sur le fondement de l’état d’urgence présentée dans le graphique suivant montre toutefois, outre les pics d’activité liés aux prorogations successives de l’état d’urgence (129), que les mesures ont été principalement prises en réaction aux attentats du 13 novembre 2015 et du 14 juillet 2016. Passé le temps d’une nécessaire réaction à l’attaque, les mesures prises sur le fondement de l’état d’urgence semblent plus rares et s’inscrire dans une forme d’activité « à bas bruit », sorte de gestion routinière des mesures d’exception.
RÉPARTITION DANS LE TEMPS DES MESURES DE L’ÉTAT D’URGENCE
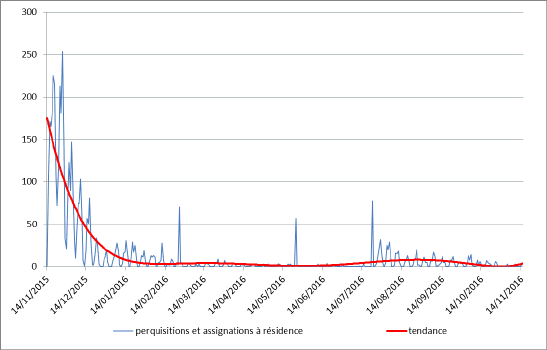
Source des données : ministère de l’Intérieur – traitement : Assemblée nationale.
L’application durant douze mois continus de ce régime d’exception prévu par la loi du 3 avril 1955 conduit nécessairement à s’interroger sur la pertinence de ce dispositif juridique au regard de son objectif de lutte contre le terrorisme, sur les conséquences de sa pérennisation et sur son encadrement dans le temps.
I. QUELLE EFFICACITÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ?
La loi du 3 avril 1955 n’était pas une loi conçue pour lutter contre le terrorisme. C’est néanmoins dans ce but qu’elle a été utilisée à partir du 14 novembre 2015.
Après un an de mise en application, quel est son bilan ? Sur ce point, il faut refuser les raisonnements qui argueraient de la seule survenance des attaques de Magnanville, de Nice et Saint-Etienne du Rouvray pour nier toute utilité à l’état d’urgence comme ceux qui font de l’addition des découvertes faites lors des perquisitions la justification de l’application de ce régime d’exception afin de lutter contre le terrorisme.
A. UNE RÉPONSE IMMÉDIATE NÉCESSAIRE
Comme le soulignait le Premier ministre devant l’Assemblée nationale lors de l’examen de la première loi de prorogation de l’état d’urgence le 18 novembre 2015, « il fallait une réponse à la hauteur, immédiate et puissante. Ce dispositif, prévu par la loi du 3 avril 1955, et instauré en moins de deux heures par décret signé du chef de l’État, a permis aux pouvoirs publics de mettre en œuvre, sans attendre, des moyens et des procédures exceptionnels pour protéger nos concitoyens et assurer leur sécurité » (130).
Effectivement, le contexte dramatique ne pouvait laisser la place à aucun attentisme. Comme le soulignait notre collègue Sébastien Pietrasanta dans le rapport qu’il a remis au nom de la commission d’enquête constituée après les attentats du 13 novembre 2015 : « alors que la crainte de répliques d’attentats existait, que les auteurs de ces attaques meurtrières n’étaient pas tous neutralisés, un temps de mobilisation et de sécurisation exceptionnelles s’imposait. L’état d’urgence, au soir du 13 novembre, se justifiait pleinement » (131).
Il s’agissait aussi d’envoyer un message fort à la population, comme l’ont rappelé les responsables de deux organes de coordination chargés au sein du ministère de l’Intérieur de la lutte contre le terrorisme. M. Loïc Garnier, chef de l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) indiquait ainsi le 8 janvier dernier devant notre Commission que la mise en œuvre de l’état d’urgence constituait « un signe rassurant à l’égard de la population française », sentiment partagé par M. Olivier de Mazières, responsable de l’EMOPT, lors de son audition le même jour, qui relevait que « le millier d’opérations effectuées la première semaine suivant les attentats a permis à l’État d’envoyer un message de fermeté pour rassurer la population et de jeter les fondements de l’action de demain contre le terrorisme » (132).
B. UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE DANS L’ARSENAL ANTI-TERRORISTE
Il est difficile de mesurer l’efficacité de l’état d’urgence dans la lutte contre le terrorisme. En effet, par leur nature même, les mesures de police administrative prévues par la loi du 3 avril 1955 n’obéissent pas à la même logique que les mesures de police judiciaire. Comme l’indiquait M. Jérôme Léonnet, chef du service central du renseignement territorial lors de son audition par la Commission le 8 janvier 2016, « les perquisitions administratives, dans le domaine de compétence du renseignement territorial, n’avaient pas, selon nous, pour effet attendu la découverte d’armes, d’explosifs, de stupéfiants ou de numéraires en liquide » (133). Il n’est donc en soi pas anormal que les perquisitions administratives aient donné lieu à un nombre relativement faible de découvertes et donc d’ouverture de procédures judiciaires incidentes (cf. supra).
1. La prééminence des outils de droit commun
Vos Rapporteurs partagent avec la commission d’enquête sur les moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 la conviction que la voie judiciaire est l’outil prééminent de la lutte antiterroriste.
Dans son rapport, M. Sébastien Pietrasanta notait qu’alors « que toutes les auditions de notre commission se sont tenues pendant l’état d’urgence, force est de constater que les mesures prises pendant l’état d’urgence n’ont pas été évoquées par les spécialistes de la lutte contre le terrorisme comme jouant un rôle particulier dans celle-ci » (134).
Dans leur communication du 30 mars 2016, vos Rapporteurs ont eu l’occasion de rappeler que les affaires les plus médiatisées menées contre les réseaux terroristes, à Saint-Denis le 18 novembre 2015 ou encore à Boulogne et Argenteuil en mars 2016, étaient exclusivement le fruit d’enquêtes et de procédures judiciaires et il en va de même de l’arrestation de plusieurs personnes à Marseille et Strasbourg dans le cadre d’une opération conduite par la DGSI les 19 et 20 novembre 2016. Le traitement judiciaire semble d’autant plus à privilégier que le législateur s’est attaché à en renforcer l’efficacité, notamment à travers l’adoption de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale qui a notamment permis de faciliter le déroulement des investigations judiciaires.
Lors de son audition le 8 janvier 2016, le directeur général de la Sécurité intérieure, M. Patrick Calvar, indiquait ainsi : « Nous avons visé des individus que nous ne pouvions pas, sur la base des informations dont nous disposions, intégrer dans le cadre des procédures judiciaires. Il s’agit par exemple des personnes rentrées de la zone syro-irakienne sans que nous ayons la preuve qu’elles avaient pénétré en Syrie et rejoint des groupes terroristes ; en l’absence de cette preuve, elles ne pouvaient pas faire l’objet de ces procédures. Nous savions avec exactitude qu’elles s’étaient rendues en Turquie, mais il nous manquait les informations sur leur itinéraire ultérieur. Nous avions également rangé parmi les cibles des individus sur lesquels nous possédions des informations indiquant un possible engagement djihadiste, mais sans actes matériels qui nous auraient permis d’entrer dans une phase judiciaire. De façon générale, la DGSI mène une action préventive de démantèlement des réseaux pour empêcher la commission d’actes ; c’est dans cette perspective que nous avons opéré, cherchant – notamment au travers des perquisitions administratives – des éléments susceptibles de déboucher sur des actions de neutralisation judiciaire » (135).
Les autres voies administratives que peuvent emprunter les services de renseignement ne doivent pas non plus être oubliées, loin s’en faut, et le choix a parfois été fait de ne pas recourir aux mesures de l’état d’urgence à l’encontre de personnes surveillées afin de ne pas éveiller leur attention. Le directeur général de la Sécurité intérieure indiquait ainsi : « Pour ne pas attirer l’attention, nous n’avons pas perquisitionné les personnes en cours de surveillance ; nous n’avons agi que lorsqu’il s’agissait de lever le doute, et l’état d’urgence représentait pour nous un outil extraordinaire nous permettant de le faire en temps réel » (136).
2. Le renseignement recueilli au cours des perquisitions administratives
Même s’il n’est pas quantifiable, le renseignement recueilli à l’occasion de la réalisation de ces opérations de police administrative constitue sans doute l’un des principaux apports de l’état d’urgence, comme l’ont mis en exergue plusieurs personnes entendues par la Commission.
Lors de la table ronde réunissant des directeurs départementaux de la sécurité publique, M. Pierre-Marie Bourniquel, alors directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, dressait le constat suivant : « Il fallait faire ces perquisitions administratives […]. Elles nous permettent de mieux connaître des individus, de lever des doutes et de mieux comprendre le phénomène de la radicalisation. Les services de renseignement y gagnent beaucoup de temps. C’est peut-être là leur principal intérêt » (137). Et c’est à une observation très voisine que se livrait M. Olivier de Mazières, responsable de l’EMOPT, indiquant pour sa part que l’état d’urgence permettait de « jeter les fondements de l’action de demain contre le terrorisme. Les mesures prises au titre de l’état d’urgence nous apportent une connaissance beaucoup plus fine de la réalité de la radicalisation ; nous avons ainsi réévalué la dangerosité de certaines personnes et relativisé la menace présentée par d’autres » (138).
Lors de la table ronde réunissant des responsables opérationnels de la gendarmerie nationale le 11 janvier 2016, le colonel Frédéric Boudier, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône notait ainsi que les perquisitions étaient menées à charge et à décharge : « dans un certain nombre de cas, nous avons constaté qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la surveillance […] Cela permet, sur l’ensemble des cibles potentielles, de nous recentrer sur les objectifs les plus pertinents » (139).
Compte tenu du point essentiel que constitue l’accès aux données de connexion, il était donc pleinement légitime que le Parlement réintroduise, selon une procédure à même de garantir les droits des personnes concernées, des facultés de saisir les données informatiques.
3. La déstabilisation de mouvances susceptibles d’apporter leur soutien aux terroristes
L’état d’urgence, et notamment les perquisitions, ont eu un effet « déstabilisateur » sur les personnes ciblées en les soumettant, comme le notait M. Patrick Calvar « à une pression qu’ils ne ressentaient pas nécessairement avant » (140) et, au-delà de ce premier cercle, sur toute une mouvance susceptible d’apporter son soutien logistique à des terroristes. M. Olivier de Mazières notait ainsi : « nous avons en effet porté de rudes coups à des réseaux de trafiquants d’armes et de stupéfiants, qui alimentent les personnes radicalisées en moyens logistiques […] Cette action de déstabilisation de la criminalité et de ses liens avec la radicalisation se révèle fort utile » (141).
Cet effet déstabilisateur n’a toutefois qu’un temps, de l’ordre de quelques heures à plusieurs jours. Dès le 11 janvier, les directeurs départementaux de la sécurité publique entendus par notre Commission ont indiqué que l’effet de surprise s’était dissipé très vite. De même, le directeur général de la sécurité intérieure notait : « Pour nous, l’état d’urgence est un moyen direct de se faire une idée. Ensuite, chez certaines personnes, nous n’avons pas trouvé ce que nous aurions pu espérer car ils s’attendaient à notre venue » (142).
Les assignations à résidence n’ont pas la même logique. Prévenue de la surveillance dont il fait l’objet, la personne se trouve entravée, ses prises de contact et ses possibilités de déplacement sont rendues plus complexes. Comme le notait le directeur général de la sécurité intérieure, « beaucoup d’entre eux ne travaillent pas régulièrement, se déplacent facilement et entrent en contact avec d’autres ; l’assignation à résidence permet de les fixer. Deuxièmement, nous cherchons à déstabiliser la mouvance. Enfin, assigner à résidence les individus faisant partie d’un groupe les empêche de tenir les réunions conspiratives » (143).
4. Un bilan modeste, en légère progression sur la dernière période de prorogation
Si le faible volume d’infractions découvertes à l’occasion de ces perquisitions n’est pas en soi un indicateur pertinent de l’efficacité de l’état d’urgence, le nombre de procédures judiciaires ouvertes pour des infractions davantage en lien avec le terrorisme l’est. Avec le recul d’une année, il permet sans doute davantage de mesurer la part prise dans la lutte contre le terrorisme par les perquisitions.
D’après les données fournies par la Chancellerie, sur la durée totale de l’état d’urgence, 61 procédures judiciaires résultent de perquisitions visant des faits en lien avec le terrorisme et 20 procédures ont été ouvertes par la section C1 anti-terroriste du parquet de Paris. L’ouverture de ces procédures se répartit très inégalement compte tenu du volume global des perquisitions réalisées sur les deux périodes au cours desquelles elles ont été autorisées (144) :
- Du 14 novembre 2015 au 25 mai 2016 : 605 perquisitions ont abouti à une procédure judiciaire dont 36 ont entraîné l’ouverture d’une procédure judiciaire pour des faits en lien avec le terrorisme. Sur ces 36 procédures, 27 ont visé des faits d’apologie de terrorisme et 9 ont été initiées par la section anti-terroriste du parquet de Paris du chef d’association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste (AMT) ;
- Entre le 21 juillet 2016 et le 2 décembre 2016, 65 perquisitions ont abouti à l’ouverture d’une procédure judiciaire parmi lesquelles 25 ont révélé des faits de nature terroriste, dont 23 avec une saisie informatique. Parmi ces 25 procédures, 11 ont été initiées par la section anti-terroriste du parquet de Paris du chef d’AMT (145).
Ces données montrent que les perquisitions administratives, bien que nettement moins nombreuses au cours de la deuxième période, sont plus fructueuses sur le front de la lutte anti-terroriste, accréditant ici l’idée d’un meilleur ciblage.
Elles montrent aussi l’utilité potentielle des mesures de saisies de données informatiques à l’occasion des perquisitions puisque 92 % des procédures ouvertes pour des faits de terrorisme avaient donné lieu à saisie informatique.
Ces perquisitions restent toutefois une contribution modeste à l’activité générale du parquet anti-terroriste. Depuis 2012, 462 procédures judiciaires en lien avec la zone irako-syrienne ont été ouvertes au pôle anti-terroriste de Paris. Durant l’état d’urgence renforcé (c’est-à-dire avec possibilité de procéder à des perquisitions administratives), 169 procédures ont été ouvertes pour ce chef, 95 procédures entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016 et 74 autres depuis le 21 juillet 2016.
D’une façon générale, les mesures administratives prévues par la loi du 3 avril 1955 sont utilisées dans une logique complémentaire – voire « interstitielle » - par rapport au droit commun qui, rappelons-le, a été significativement renforcé et est massivement mobilisé.
II. LES CONSÉQUENCES DE LA PÉRENNISATION DE L’ÉTAT D’URGENCE
En théorie, l’état d’urgence ne s’entend par essence que comme exceptionnel et temporaire. Lors de l’examen du premier projet de loi de prorogation le 18 novembre 2015, M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur du texte, exprimait ainsi sa conviction : « Les mesures que nous allons décider ne dureront qu’un temps limité. Elles ne se comprennent d’ailleurs que par leur obsolescence programmée. » De même, le Conseil d’État rappelait dans son avis rendu le 6 février 2016 sur le projet de loi relatif à la deuxième prorogation que « l’état d’urgence reste un “état de crise” qui est par nature temporaire. Ses renouvellements ne sauraient par conséquent se succéder indéfiniment », conviction partagée par le Conseil constitutionnel lorsqu’il indique que les effets d’un régime de pouvoirs exceptionnels doivent « être limités dans le temps et l’espace » (146) et que la durée de l’état d’urgence « ne saurait être excessive au regard du péril imminent […] ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence » (147).
Pourtant, l’état d’urgence décrété le 14 novembre 2015 s’inscrit désormais dans la durée (quatorze mois, voire vingt si le Parlement vote la prorogation annoncée par l’exécutif afin de couvrir la période électorale à venir).
Dans ces conditions, faut-il continuer de fonder l’état d’urgence sur le postulat qu’il ne peut se concevoir que temporaire et donc rester sur l’idée que ce caractère exceptionnel justifie tout à la fois la vigueur des mesures administratives qu’il autorise et le déséquilibre qu’il opère entre sécurité et ordre publics et protection des libertés individuelles ?
Au contraire, faut-il, face au constat que le « provisoire » dure, en tirer les conséquences, prévoir de nouveaux aménagements sans obérer toutefois l’efficacité et la réactivité d’un dispositif dont l’essence est d’offrir aux pouvoirs publics une capacité d’action exceptionnelle en cas de péril imminent ?
Pour vos Rapporteurs, la prolongation de l’état d’urgence justifie d’encadrer dans le temps les assignations à résidence et de s’interroger sur l’opportunité de recentrer l’état d’urgence dans son objet.
A. LIMITER LA DURÉE DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
Dans sa décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a validé le mécanisme des assignations à résidence et jugé qu’elles ne « comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution ». Il a également indiqué que « tant la mesure d’assignation à résidence que sa durée, ses conditions d’application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence ».
Les prorogations de l’état d’urgence successives ont entraîné le maintien en assignation à résidence de plusieurs personnes. Ce constat comme la possibilité d’une nouvelle prorogation au début de l’année 2017 invitent à encadrer dans le temps les facultés d’assignation.
1. Les conditions de renouvellement des assignations à résidence
Les assignations à résidence sont des mesures provisoires, qui cessent en même temps que l’état d’urgence. Dans la décision précitée du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel l’a bien précisé : « en vertu de l’article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d’assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l’état d’urgence » et « si le législateur prolonge l’état d’urgence par une nouvelle loi, les mesures d’assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées ».
Chaque prorogation de l’état d’urgence (148) – le 26 février 2016, le 25 mai 2016 puis le 21 juillet 2016 – a donc entraîné un réexamen des dossiers des personnes précédemment assignées à résidence. Le travail commence d’ailleurs assez largement en amont, à l’échelon déconcentré tout d’abord avant de faire l’objet d’un examen coordonné par l’UCLAT entre les services centraux.
Sur la durée globale de l’état d’urgence, le nombre de personnes assignées à résidence a décru fortement à l’issue de la première période de prorogation (soit au 26 février). Il s’est ensuite relativement stabilisé.
La première période, entre le 14 novembre 2015 et le 25 février 2016, est celle où le nombre de personnes assignées est à la fois le plus important et le plus instable, avec deux types d’assignations distinctes : celles liées à l’organisation de la COP 21 qui sont arrivées à échéance le 12 décembre 2015, dès cet événement fini, et celles pour radicalisation violente qui couraient jusqu’à la fin de l’état d’urgence.
Dans ces premiers mois, 563 personnes ont fait l’objet d’une proposition d’assignation adressée à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégataire du ministre de l’Intérieur sur ce sujet. La DLPAJ en a rejeté 76 dans le cadre de la COP21 pour n’en garder finalement que 27, dont 15 n’ont pu être notifiées par les services. Ces assignations particulières sont arrivées à échéance le 12 décembre 2015. Quant aux assignations pour radicalisation violente, la DLPAJ a rejeté 86 demandes, pour en garder au total 374 sur l’ensemble de la période. Au soir du 25 février 2016, cependant, seules 271 d’entre elles étaient en vigueur. Cette différence s’explique par le fait que 16 assignations ont été suspendues ou annulées par le juge administratif, 57 ont été retirées ou abrogées en cours de période, 24 bloquées avant même leur notification ; six, enfin, n’ont pas été notifiées aux intéressés.
À la date du 25 février 2016, l’état d’urgence ayant été prorogé, la DLPAJ a engagé une procédure de réexamen individuel des dossiers. Sur ce fondement, 70 assignations ont été renouvelées. La majeure partie des assignations décidées avant le 26 février n’ont donc pas fait l’objet d’un renouvellement et une minorité d’entre elles ont ensuite fait l’objet d’une mesure administrative de droit commun.
Durant la seconde période, entre le 26 février 2016 et le 25 mai 2016, deux autres mesures ont été prises, soit un total de 72 assignations.
Entre le 25 mai 2016 et le 20 juillet 2016, 79 mesures d’assignation ont été prononcées au total mais deux d’entre elles n’ont pas été notifiées, soit un total de 77 assignations.
Entre le 21 juillet 2016 et le 15 novembre 2016, 111 mesures d’assignation ont été prononcées. Au 15 novembre, 15 ont été abrogées, une a été suspendue par le juge et 95 sont toujours en vigueur. Parmi les personnes concernées, une part non négligeable vise des personnes qui sont assignées depuis le début de l’état d’urgence.
2. Vers des assignations « à durée indéterminée » ?
Le graphique ci-après détaille la date de prise du premier arrêté d’assignation pour les mesures toujours en vigueur. Il montre que 47 personnes ont été assignées durant la première période de l’état d’urgence (c’est-à-dire avant le 25 février 2016).
DATE DE LA PREMIÈRE MESURE D’ASSIGNATION POUR LES ASSIGNATIONS EN VIGUEUR AU 15 NOVEMBRE 2016
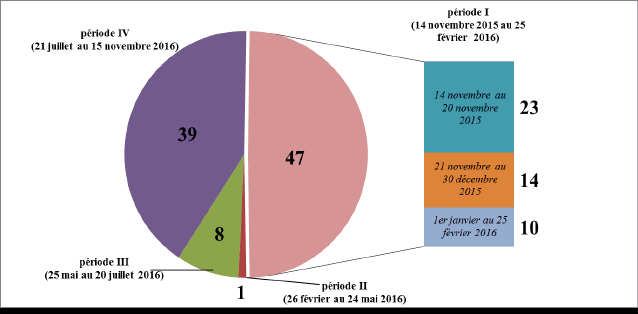
Source des données : ministère de l’Intérieur – Traitement : Assemblée nationale
Sans se prononcer sur la menace que le comportement de ces assignés représente pour l’ordre et la sécurité publics, vos Rapporteurs s’interrogent de l’absence de procédure judiciaire engagée à leur encontre. Dans plusieurs arrêtés d’assignation, il est fait mention d’une procédure judiciaire mais sans qu’il soit possible de savoir si elle est toujours en cours ou si elle s’est arrêtée faute d’éléments. Sur ces 47 cas, au moins 6 d’entre eux concernent des personnes ayant séjourné ou tenté de rejoindre un théâtre d’opération de groupements terroristes sans que les arrêtés ne fassent état d’une procédure judiciaire sur ce fondement. De même, plusieurs cas semblent entrer dans le champ d’application des articles 421-2-5-1 (extraction, reproduction ou transmission de données faisant l’apologie du terrorisme) et 421-2-5-2 (consultation de site invitant au terroriste ou faisant son apologie) du code pénal. Les arrêtés d’assignation mentionnent explicitement des éléments constitutifs de ces infractions, sans que la date de constatation de ces éléments ne soit précisée. Gageons que l’entrée en vigueur récente de ces nouvelles infractions explique que les poursuites n’aient pu être engagées.
Par ailleurs, dans d’autres cas, les personnes concernées « cumulent » une mesure d’assignation à résidence et une mesure administrative de droit commun (interdictions de sortie du territoire, gel des avoirs,...).
Ces situations, pour complexes qu’elles sont, doivent trouver une résolution judiciaire rapide, comme l’ont indiqué de nombreuses personnes entendues par vos Rapporteurs.
Car, ainsi que l’a déjà souligné M. Michel Mercier, sénateur et rapporteur du suivi de l’état d’urgence et des projets de loi de prorogations, les assignations à résidence « ne peuvent se prolonger indéfiniment » (149).
En effet, si l’assignation à résidence ne peut pas être assimilée à une privation de liberté, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, et si elle obéit à une logique distincte des sanctions pénales, comme le relèvent les juridictions de première instance (150), elle restreint considérablement la liberté d’aller et venir des personnes concernées, qui se voient, dans l’immense majorité des cas, soumises à un régime très lourd de pointage et de maintien à domicile, en l’absence même d’éléments de nature à constituer une infraction pénale.
Pour vos Rapporteurs, il ne semble guère concevable que des personnes puissent être maintenues durablement dans un dispositif d’assignation à résidence sans élément de nature à constituer une infraction pénale, sauf à méconnaître les principes fondateurs de l’État de droit.
La mesure d’assignation à résidence prévue par la loi du 3 avril 1955 a une utilité aujourd’hui avérée - dans plusieurs cas, elle a permis d’éviter la survenance d’événements dramatiques – mais elle ne peut que répondre au besoin urgent de garantir la sécurité de nos concitoyens ni se substituer durablement à des procédures de droit commun.
De même, il convient de mobiliser les outils administratifs de droit commun qui permettent de surveiller la personne ou d’entraver, le cas échéant, la commission d’une infraction (interdictions de sortie du territoire, gel des avoirs,…).
Par ailleurs, s’il permet d’entraver la circulation de la personne concernée, le dispositif d’assignation à résidence ne semble pas une panacée. On peut donc s’interroger sur l’intérêt opérationnel de maintenir une telle mesure alors que le droit commun offre des possibilités de surveillance plus nombreuses et potentiellement plus adaptées. Par ailleurs, la mesure d’assignation peut parfois être une source d’économie de moyens pour les services de renseignement fortement sollicités ; mais cette question de ressources ne peut justifier seule le maintien de ce dispositif.
À l’issue de la première période de l’état d’urgence, quelque 210 personnes n’avaient pas vu leurs assignations être renouvelées ; les services de l’État n’ont pas nécessairement renoncé à surveiller les individus qui représentent un danger potentiel, mais ils ont privilégié les voies de droit commun.
Vos Rapporteurs considèrent donc qu’il est nécessaire de limiter la durée des assignations à résidence dont une personne peut faire l’objet, avec un juste équilibre entre une mesure potentiellement à durée indéterminée – ce qui soulèverait des difficultés au regard de la jurisprudence constitutionnelle – et un encadrement trop restreint qui ferait perdre tout son intérêt à ce dispositif d’exception.
Proposition : Préciser qu’une même personne ne peut pas être assignée plus de huit mois au cours d’une période totale de douze mois. Préciser que, exceptionnellement, il ne peut être passé outre cette interdiction que si des éléments nouveaux sont apparus depuis la dernière assignation. Prévoir un réexamen, sur ces bases, des personnes assignées depuis le début de l’état d’urgence.
L’examen de l’année écoulée montre, dans certains cas, que l’état d’urgence a permis de prendre des mesures tendant moins à lutter directement contre la menace terroriste qu’à atteindre un objectif général de maintien de l’ordre, amenant à s’interroger sur une possible « finalisation » des mesures prises durant cette période d’exception.
1. Une mise en œuvre de l’état d’urgence conforme à la rédaction très souple de la loi de 1955
Très rapidement après la déclaration de l’état d’urgence, le Conseil d’État s’est prononcé sur la question du lien entre les mesures prises et les motifs de déclenchement de l’état d’urgence lorsqu’il a été saisi des arrêtés d’assignation pris durant la COP 21 à l’encontre de personnes présentées par le ministère de l’Intérieur comme des militants contestataires radicaux.
Dans ses conclusions, le rapporteur public s’interrogeait en effet sur un possible « effet d’aubaine » permettant au pouvoir exécutif de « tirer argument [de l’état d’urgence] pour éviter tout risque de débordement qui lui serait désagréable ». Il se demandait si ce ne serait pas « le début ou la manifestation d’une dérive de l’usage par le pouvoir exécutif des pouvoirs exorbitants du droit commun que lui a accordé le législateur ». Il écartait ces critiques, estimant que « la loi fait clairement une différence entre les motifs justifiant que soit déclaré l’état d’urgence et les motifs pouvant justifier que soient prononcées, une fois l’état d’urgence déclaré, des assignations à résidence » (151).
Dans ses décisions du 11 décembre 2015, le Conseil d’État estime que les dispositions de la loi de 1955, « de par leur lettre même, n’établissent pas de lien entre la nature du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à ce que soit déclaré l’état d’urgence et la nature de la menace pour la sécurité et l’ordre publics susceptible de justifier une mesure d’assignation à résidence ; que, par suite, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre de l’Intérieur, tant que l’état d’urgence demeure en vigueur, puisse décider de l’assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, une menace pour la sécurité et l’ordre publics » (152).
Quelques jours plus tard, le Conseil constitutionnel corroborait cette lecture de la loi du 3 avril 1955 dans sa décision du 22 décembre 2015.
Ainsi, si la menace terroriste constitue bien une priorité et fonde le déclenchement de l’état d’urgence, le cadre légal qu’offre ce dernier permet de répondre aussi à d’autres menaces et de procéder à un arbitrage optimisé dans l’utilisation des forces de l’ordre.
2. Des utilisations assumées de l’état d’urgence pour maintenir l’ordre
Les douze derniers mois ont fourni des exemples de mesures fondées sur l’état d’urgence avec un objectif clair de maintien ou de rétablissement de l’ordre.
Ce fut d’abord la COP 21 qui donna lieu à l’assignation de 27 personnes (en réalité 12 puisque toutes les décisions d’assignation ne purent être notifiées) et à l’édiction d’une interdiction générale de manifester. Il convient toutefois de rappeler les circonstances particulières dont le Conseil d’État était saisi : les assignations contestées avaient été prises 10 jours après les attentats du mois de novembre et au moment où la région parisienne se préparait à accueillir un sommet international de très grande ampleur. Le Conseil n’a pas manqué de souligner ces éléments de contexte qui expliquent que « les forces de l’ordre demeurent particulièrement mobilisées pour lutter contre la menace terroriste et parer au péril imminent […] ainsi que pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la conférence des Nations-Unies se tenant à Paris et au Bourget ».
Ce fut également le cas de plusieurs mesures individuelles ou collectives prises pour limiter, dans certaines circonstances, la circulation des personnes comme durant le printemps dernier à l’occasion des manifestations contre la loi de réforme du code du travail (cf. supra) ou encore récemment à l’occasion du démantèlement de la lande de Calais.
Le recours à l’état d’urgence pour sécuriser le démantèlement du camp de la lande de Calais en octobre 2016
Dans le cadre de l’opération d’évacuation des migrants de la zone nord du camp de la Lande de Calais, communément dénommé la « jungle » de Calais, la préfecture a fait un usage combiné de plusieurs mesures sur le fondement de l’état d’urgence. Dans les considérants, la préfecture rappelait les actions antérieures « d’activistes d’ultra-gauche « No Border » en provenance de toute l’Europe », soulignant en particulier qu’ils avaient « fait usage récemment de violence ». Relevant que ces personnes « s’opposent avec violence » à l’opération d’évacuation et qu’il « existe un risque élevé que ces activistes pénètrent dans le camp lors de l’évacuation pour influencer les migrants afin qu’ils rejoignent [des] squats », la préfecture établit le 23 octobre une zone de protection dont l’accès est interdit sauf à résider dans l’espace, à être un agent public ou un chauffeur routier traversant la zone. Toutes les autres personnes doivent obtenir une accréditation préfectorale parmi les cinq catégories suivantes : association ; prestataire ; entreprise ; presse ; invité. La ZPS est en vigueur du 24 octobre à 7 heures au 6 novembre à 18 heures.
Dans le même temps, la préfecture a prononcé quatre interdictions individuelles d’interdiction de séjour. Elle relève que la mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre ne « saurait être détournée pour répondre aux risques d’ordre public » liés à la « présence de groupes d’ultra-gauche No Border ayant l’intention de perturber les opérations ». Si les arrêtés n’indiquent pas que les quatre personnes visées appartiennent à ces groupes, ils relèvent qu’elles ont pénétré dans la ZPS précédemment instaurée et qu’il « y a tout lieu de penser » qu’elles envisagent de « prendre part à des actions revendicatives violentes de nature à constituer un trouble grave pour l’ordre public et à entraver l’action des pouvoirs publics ».
Si ces mesures visent effectivement à maintenir l’ordre et la sécurité publics, elles n’entretiennent pas de lien direct avec les éléments ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence. S’il s’agit de l’ordre public en général, pourquoi fonder de telles décisions sur la loi relative à l’état d’urgence ? Ne serait-il pas préférable de réserver ce dispositif exceptionnel aux cas qui présentent un lien indéniable avec la menace ou le risque ayant conduit à sa déclaration ?
3. Un recentrage souhaitable de l’état d’urgence pour en protéger le caractère exceptionnel
Lors de son audition par notre Commission le 8 janvier 2016, le Vice-président du Conseil d’État a réfuté toute « malfaçon » dans la loi du 3 avril 1955. Il précisait ainsi, s’agissant des assignations à résidence (mais le raisonnement vaut pour toutes les mesures susceptibles d’être prises sur le fondement de l’état d’urgence) : « S’il est tout à fait possible de rédiger la loi afin de donner au ministre de l’Intérieur et aux préfets la possibilité de prononcer des assignations à résidence pour les seuls motifs ayant conduit à la proclamation de l’état d’urgence, en l’absence de restrictions en ce sens, l’article 6 de la loi de 1955 tel que modifié par la loi du 20 novembre dernier s’applique : il prévoit que toute personne dont le « comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics » peut être assignée à résidence, quelle que soit la nature de cette menace » (153) .
Pour légale qu’elle soit, l’utilisation de l’état d’urgence pour assurer le maintien de l’ordre peut parfois surprendre et donner l’impression d’une démesure des outils mobilisés.
L’aspect dissuasif des dispositifs de l’état d’urgence a souvent été mis en avant. Toutefois, sur ce point, vos Rapporteurs ne disposent d’aucune donnée permettant de confirmer ou d’infirmer cette analyse. Ils relèvent également que les mesures de maintien de l’ordre prévues par la loi de 1955 sont très proches du droit commun, à l’exception des mesures individuelles d’interdiction de séjour pour se rendre à une manifestation.
Ils mesurent la difficulté très concrète d’évaluer la pertinence de l’arbitrage optimisé dans l’utilisation des forces de l’ordre qui sous-tend les mesures de maintien de l’ordre public prises sur le fondement de la loi de 1955.
Toutefois, pour vos Rapporteurs, l’état d’urgence, en raison de la gravité des atteintes qu’il porte aux libertés individuelles et à la vie privée, ne doit pouvoir être utilisé pour prévenir toutes les atteintes les plus banales à l’ordre ou à la sécurité. Afin d’éviter toute confusion dans les finalités de l’état d’urgence, ils jugeraient souhaitable que le Parlement puisse, dans une interprétation restrictive du mandat donné au Gouvernement, réserver l’utilisation de ce dispositif d’exception à la lutte contre les menaces qui ont conduit à sa déclaration.
Proposition : Engager une réflexion sur les moyens de limiter les mesures administratives susceptibles d’être prises en application de la loi du 3 avril 1955 afin qu’elles ne puissent être prononcées que pour les motifs ayant justifié la déclaration de l’état d’urgence.
III. COMMENT « SORTIR » DE L’ÉTAT D’URGENCE ?
Il n’est guère facile de sortir de l’état d’urgence. C’est ce constat qui amène vos Rapporteurs à formuler plusieurs propositions sur la limitation dans le temps de l’état d’urgence, propositions dont ils ont bien conscience qu’elles ne peuvent toutes trouver de traduction législative immédiate mais qu’il paraît cependant utile de présenter à l’appui de leur travail de contrôle.
Ils estiment par ailleurs nécessaire d’engager une réflexion d’ensemble sur le dispositif d’état d’urgence, ce qui passe par une réécriture de la loi de 1955 et son insertion dans un ensemble constitutionnel et organique plus abouti.
A. MAINTENIR UN MÉCANISME DE CADUCITÉ EN CAS DE DÉMISSION DU GOUVERNEMENT
Le seul verrou procédural prévoyant une caducité automatique de l’état d’urgence figure à l’article 4 de la loi du 3 avril 1955. Il prévoit en effet que « la loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale ».
Appliquées au premier semestre 2017, ces dispositions sont mal adaptées puisqu’elles pourraient contraindre le Gouvernement nommé à la suite de l’élection présidentielle à soumettre un projet de loi de prorogation de l’état d’urgence à une assemblée dont le renouvellement général est imminent.
Au demeurant, ces dispositions « cadrent mal avec les équilibres institutionnels de la Ve République : il est désormais plus aisé aux députés de mettre fin à l’état d’urgence, par l’adoption d’un texte ad hoc à la majorité simple, que de voter la censure du Gouvernement. Quant à la dissolution, elle devrait être envisagée moins comme une cause de caducité, que comme une limite posée à la mise en œuvre de l’état d’urgence » (154).
Toutefois, dès lors qu’il s’agit du seul verrou procédural disponible, vos Rapporteurs souhaitent que, dans l’hypothèse de l’examen d’une prochaine loi de prorogation, ces dispositions ne soient pas supprimées de la loi du 3 avril 1955 mais que leur application soit seulement écartée le temps du prochain semestre afin d’ « enjamber » la période électorale.
Proposition : Maintenir le mécanisme automatique de caducité de l’état d’urgence en cas de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale prévue par l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 ; n’en écarter l’application que pour éviter la caducité lorsque la démission du Gouvernement est présentée après un renouvellement général de l’Assemblée nationale.
B. LIMITER L’ÉTAT D’URGENCE DANS LE TEMPS
Certaines voies d’encadrement de l’état d’urgence ont été explorées lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation dont l’article 1er avait pour objet de donner un fondement constitutionnel à l’état d’urgence. Comme l’indiquait le Premier ministre lorsqu’il est venu présenter le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation mercredi 27 janvier 2016 devant notre Commission, « il s’agit d’empêcher la banalisation de l’état d’urgence ou tout recours excessif » à cet instrument.
Aujourd’hui, plusieurs dispositions existent pour encadrer l’état d’urgence :
- l’état d’urgence lorsqu’il est déclaré par décret en Conseil des ministres ne peut avoir une durée de plus de douze jours ;
- si une loi intervient pour proroger l’état d’urgence, elle est caduque à l’issue des quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale ;
- même si la loi du 3 avril 1955 ne l’impose pas, les lois de prorogation comportent toujours une disposition expresse autorisant l’exécutif à mettre fin à l’état d’urgence, de manière anticipée, par décret en Conseil des ministres.
Toutefois, aucune disposition ne plafonne la durée pendant laquelle l’état d’urgence est prorogé et cette prorogation peut être renouvelée sans limitation et sans qu’il soit besoin d’un nouveau décret. L’Assemblée nationale avait alors introduit, sur proposition de notre collègue Jean-Christophe Lagarde, une disposition ayant pour effet de limiter à quatre mois la durée maximale d’une prorogation législative de l’état d’urgence, durée ramenée à trois mois par le Sénat sur proposition de son rapporteur M. Michel Mercier.
Un tel encadrement offre plusieurs avantages. En effet, outre le fait qu’il garantit au Parlement d’être consulté à intervalles rapprochés sur l’opportunité de prolonger l’état d’urgence et potentiellement au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l’opportunité d’une prorogation de l’état d’urgence s’il devait considérer qu’elle ne répond plus aux conditions posées à leur déclenchement, il permet aux personnes à l’encontre desquelles sont prononcées des mesures administratives sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 de voir leur situation être réexaminée par l’autorité compétente pour édicter la mesure.
Vos Rapporteurs rejoignent l’objectif qui était poursuivi par ces propositions, mais, compte tenu des durées de prorogation de l’actuel état d’urgence (deux périodes de trois mois, une période de deux mois puis une période actuelle de six mois), ils jugent pragmatique de fixer cette durée maximale à six mois.
Proposition : limiter à six mois la durée maximale de prorogation législative de l’état d’urgence.
Toutefois, une telle limitation, si elle n’est fixée que dans la loi ordinaire, peut néanmoins être infirmée par un autre dispositif légal.
Revenant sur les conditions d’adoption des lois des 3 avril et 7 août 1955 sur l’état d’urgence, Roland Drago indiquait à juste titre que « les textes d’exception sont rarement votés, en France, dans le calme d’une période de stabilité politique, en prévision d’un temps de crise. C’est fréquemment sous la pression des circonstances que les législateurs délibèrent et leurs actes portent ainsi la marque de leur époque et des besoins auxquels ils répondaient » (155). Force est de reconnaître que l’année écoulée donne raison à cette analyse. C’est la raison pour laquelle vos Rapporteurs jugeraient opportun de mettre l’état d’urgence à l’abri des « emballements » causés par les circonstances.
Une fois encore, la discussion engagée dans les deux assemblées du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation ouvrait une piste intéressante en proposant de conférer un caractère organique à la loi d’application sur l’état d’urgence. Introduite par le Sénat sur proposition de son rapporteur M. Michel Mercier, cette proposition s’inscrit dans le droit fil des propositions faites par le comité Balladur chargé en 2007 de présenter les grands axes d’une réforme constitutionnelle. Les contraintes procédurales propres aux dispositions organiques – examen dans des délais spécifiques prévus par le troisième alinéa de l’article 42 de la Constitution, majorité renforcée pour l’adoption en lecture définitive à l’Assemblée nationale, contrôle préalable de sa conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel plutôt que des décisions successives de ce dernier au gré de questions prioritaires de constitutionnalité – paraissent autant de garanties de nature à éviter des modifications législatives improvisées dans l’urgence des débats sur une prorogation car, comme cela était relevé dans le rapport sur le projet de loi constitutionnelle : « rien n’empêche en effet une loi de prorogation de revenir sur la loi ordinaire d’application […] afin de modifier, « à chaud », les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre » (156).
Proposition : Conférer un caractère organique à la loi précisant le régime juridique de l’état d’urgence.
De même pourrait être examinée la possibilité de prévoir des règles dérogatoires de majorité pour l’adoption des lois de prorogation.
Mais, en toute hypothèse, ces aménagements exigent une révision constitutionnelle puisque seul le Constituant peut déterminer le champ des matières organiques, les règles de majorité d’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi.
***
Encadrer dans le temps l’état d’urgence |
Maintenir le mécanisme automatique de caducité de l’état d’urgence en cas de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale prévu par l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 actuellement en vigueur ; n’en écarter l’application que pour éviter la caducité lorsque la démission du Gouvernement est présentée après un renouvellement général de l’Assemblée nationale. |
Limiter à six mois la durée maximale de chaque prorogation législative de l’état d’urgence. |
Conférer un caractère organique à la loi précisant le régime juridique de l’état d’urgence. |
Recentrer l’utilisation de l’état d’urgence |
Engager une réflexion sur les moyens de limiter les mesures administratives susceptibles d’être prises en application de la loi du 3 avril 1955 afin qu’elles ne puissent être prononcées que pour les motifs ayant justifié la déclaration de l’état d’urgence. |
Consolider le pilotage de l’état d’urgence |
Prévoir une instance assurant une coordination interministérielle des mesures prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955. |
Solliciter la recherche en sciences sociales afin d’évaluer l’impact du recours à l’état d’urgence sur la population. |
Examiner le coût budgétaire de la mise en œuvre de l’état d’urgence. |
Renforcer les moyens de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur. |
Préciser le régime des assignations à résidence |
Prévoir l’information du parquet de chaque assignation à résidence, de son aménagement et de son abrogation. |
Préciser que, lorsqu’une assignation à résidence concerne un mineur, le juge des enfants territorialement compétent est informé. |
Préciser que les personnes assignées peuvent faire valoir leurs observations dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’assignation. |
Encadrer le périmètre géographique dans lequel la personne est assignée pour rendre la mesure conciliable avec sa vie familiale et professionnelle. |
Confier aux préfets le soin de prendre certaines mesures d’aménagement des assignations. |
Préciser qu’une même personne ne peut pas être assignée plus de huit mois au cours d’une période totale de douze mois. Préciser que, exceptionnellement, il ne peut être passé outre cette interdiction que si des éléments nouveaux sont apparus depuis la dernière assignation. Prévoir un réexamen, sur ces bases, des personnes assignées depuis le début de l’état d’urgence. |
Examiner la possibilité de renforcer les liens entre les états-majors locaux de sécurité et les entités en charge de l’accompagnement psychiatrique des personnes possiblement concernées par les mesures administratives d’assignation à résidence. |
Encadrer les perquisitions administratives |
Préciser le régime des perquisitions de nuit en indiquant que les perquisitions ne peuvent être conduites entre 21 heures et 6 heures qu’en cas d’urgence absolue ou lorsqu’il est impossible de l’effectuer de jour. |
Préciser les conditions de recours à la force pour pénétrer dans les lieux lors d’une perquisition administrative. |
Lors de sa réunion du mardi 6 décembre 2016, la Commission procède à l’examen du rapport d’information sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence (MM. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson, rapporteurs).
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. Chers collègues, nous vous soumettons aujourd’hui un rapport sur le contrôle de l’application de l’état d’urgence. Comme vous le savez, plusieurs lois sont successivement intervenues. La loi du 20 novembre 2015 a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 25 février 2016, puis celle du 19 février 2016 l’a prolongé jusqu’au 25 mai 2016, celle du 20 mai 2016 l’a maintenu en vigueur jusqu’au 25 juillet, et celle du 21 juillet 2016 l’a prolongé jusqu’au 20 janvier 2017, mais l’application de cette dernière sera affectée par la démission, ce matin, du Gouvernement, de sorte que nous devrons sans nul doute envisager sa nouvelle prorogation un peu plus tôt que nous ne l’avions prévu.
La prolongation de l’état d’urgence par la loi du 21 juillet 2016 est assortie de douze mesures qui se sont ajoutées à celles du 3 juin 2016. En outre, l’état d’urgence a fait l’objet d’un essai de constitutionnalisation qui a échoué, notamment du fait du débat sur la déchéance de nationalité.
Notre commission a décidé de se doter d’un moyen de contrôle inédit et transparent. Le Sénat a fait de même, quoique selon des modalités différentes : il a constitué un comité de suivi présidé par l’ancien Garde des sceaux Michel Mercier, tandis que nous avons mis en place une mission de suivi, dont un des deux rapporteurs est le président de la commission des Lois – Jean-Jacques Urvoas dans un premier temps, moi-même par la suite – et dont l’autre, M. Jean-Frédéric Poisson, qui accomplit cette tâche depuis le début, appartient à l’opposition.
Nous nous sommes d’abord dotés des pouvoirs d’une commission d’enquête, c’est-à-dire le pouvoir d’investigation le plus étendu dont puisse jouir une instance parlementaire. Depuis la loi du 21 juillet 2016, les autorités administratives nous transmettent directement les diverses mesures prises en application de l’état d’urgence. Nous avons pris le parti de recenser, au fil de l’eau, toutes ces mesures, en nous documentant auprès de sources diverses : essentiellement le ministère de l’intérieur, mais aussi les préfectures – je me loue de la parfaite coopération de toutes ces autorités – ainsi que le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), divers collectifs d’avocats ou citoyens. Nous avons également effectué des déplacements, des entretiens – neuf en ce qui concerne Jean-Jacques Urvoas et Jean-Frédéric Poisson, dix pour ma part – et diverses investigations. Ainsi avons-nous pu prendre toute la mesure de la mobilisation de l’appareil d’État pour répondre à la vague d’attentats terroristes.
Nous avons mis en place un système qui nous permet de disposer d’informations extrêmement détaillées tout en garantissant qu’aucune donnée personnelle, nominative, ne circule. Le fait que l’Assemblée nationale soit à même de fournir, en retour, des informations aux autorités administratives atteste la réussite de notre travail…
J’en viens aux chiffres. L’état d’urgence a entraîné 4 292 perquisitions, qui ont débouché sur 670 procédures judiciaires, dont 61 concernaient des faits en lien avec le terrorisme, parmi lesquelles 20 portaient spécifiquement sur des faits d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Parallèlement, 612 assignations à résidence ont été décidées. Celles-ci ont été rendues possibles par la reprise, lors de l’instauration de l’état d’urgence, d’une disposition de la loi du 3 avril 1955. Elles consistent à obliger une personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics » à résider soit dans une commune, soit dans une communauté de communes, soit éventuellement dans un département. L’autorité administrative peut alors l’obliger à pointer une, deux ou, au maximum, trois fois par jour au commissariat ou à la gendarmerie. Ces 612 assignations ont concerné 434 personnes, une même personne pouvant faire l’objet de plusieurs assignations successives. Aujourd’hui, 95 personnes restent assignées à résidence, dont 62 l’étaient déjà la dernière fois que nous avons prolongé l’état d’urgence, au mois de juillet dernier. En effet, toutes les assignations à résidence sont frappées de caducité à l’expiration de la loi qui les a permises. Chaque fois que nous prorogeons l’état d’urgence, les assignations doivent donc être renouvelées et réexaminées. Au total, 47 des 95 personnes actuellement assignées à résidence l’ont été pour la première fois durant la première période de l’état d’urgence, c'est-à-dire avant le 25 février 2016.
Depuis la loi du 21 juillet dernier, les préfets de police et les préfets de département ont en outre la possibilité d’ordonner des contrôles d’identité et des fouilles de véhicules.1 657 mesures de ce type ont été ordonnées, avec des variations géographiques qui s’expliquent sans doute par les relations existant entre le procureur et le préfet. Selon le droit commun, en effet c’est le procureur qui autorise ou ordonne ces contrôles. Dans les départements où ce dernier y recourt déjà largement, le préfet n’en ordonne lui-même que peu. Dans d’autres départements, il en va différemment. Cela ne traduit pas forcément des dissensions ; simplement, certains départements comptent deux ou trois procureurs, dont les politiques respectives peuvent, en la matière, différer légèrement.
Il est également possible, à la suite de cette même loi du 21 juillet dernier, de procéder à des saisies de données informatiques dans le cadre d’une perquisition administrative. Dans une décision du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel avait estimé que c’était porter une atteinte excessive aux libertés que de permettre de telles opérations à l’occasion de perquisitions. Ces dernières se sont donc faites sensiblement moins nombreuses à la suite de cette décision, mais, en réaction ou en réponse à celle-ci, la loi du 21 juillet 2016 a mis en place un système garantissant mieux les libertés et prévenant les atteintes excessives à la vie privée : il est ainsi prévu que l’exploitation des données par les services de police est soumise à l’autorisation du juge administratif. Depuis, 104 demandes d’exploitation ont été formulées – je parle bien de demandes, car la demande ne préjuge pas de la décision du juge.
Le juge administratif étant compétent pour connaître des mesures de police prévues dans l’état d’urgence, 233 recours ont été formés en référé, et 133 recours au fond ont été jugés. Finalement, les annulations ont été assez peu nombreuses, et les perquisitions ont suscité très peu de contentieux : dès l’instant où une perquisition est réalisée, l’intérêt de la contester devient assez faible. Par ailleurs, 177 demandes d’indemnisation ont été adressées à l’État pour des préjudices subis à l’occasion de l’application de ces mesures, principalement pour des bris de portes lors des perquisitions.
Par ailleurs, la violation par les personnes assignées à résidence de leurs obligations est sanctionnée pénalement. Il y a eu 69 violations qui ont fait l’objet de poursuites.
Toutes ces mesures sont-elles efficaces et utiles ? Il est naturellement difficile de mesurer scientifiquement le recul des menées terroristes sur notre territoire.
Première observation : de façon générale, les mesures les plus efficaces sont celles du droit commun, c’est-à-dire les mesures d’enquête et les mesures judiciaires. Deuxième observation : le nombre élevé des gardes à vue et des procédures affaiblit forcément les milieux délinquants, susceptibles de servir de soutien logistique aux activités terroristes. Les perquisitions permettent particulièrement de découvrir deux types d’activité : le trafic d’armes et le trafic de stupéfiants, qui peut procurer des fonds.
Depuis le 21 juillet dernier, nous assistons à un recentrage, à un ciblage plus net des mesures sur la prévention des actes terroristes. Du 14 novembre 2015 au 25 mai 2016, il y avait eu 3 750 perquisitions, qui avaient débouché sur 605 procédures, dont 36 pour des faits en lien avec le terrorisme ; ce sont donc 16,13 % des perquisitions qui ont, au cours de cette période, donné lieu à des procédures, et 0,96 % à des procédures pour des faits en lien avec le terrorisme. Depuis le 21 juillet dernier, 542 perquisitions ont eu lieu, qui ont débouché sur 65 procédures, dont 25 pour des faits en lien avec le terrorisme ; ce sont donc 12 % des perquisitions qui ont donné lieu à des procédures, et 4,61 % à des procédures pour des faits en lien avec le terrorisme. Il faut certes manier ces chiffres avec prudence, mais, visiblement, les mesures sont plus ciblées et débouchent sur plus de procédures visant à lutter contre le terrorisme.
Voilà pour les chiffres.
L’état d’urgence ne peut être éternel. Par définition, c’est un état exceptionnel. S’il dure, forcément, il faudra un certain encadrement, et nous nous sommes mis d’accord, Jean-Frédéric Poisson et moi, pour proposer un certain nombre de mesures.
Première proposition : il faut limiter la durée des assignations à résidence. Il ne devrait pas être possible d’assigner quelqu’un à résidence pendant plus de huit mois, au total, en une ou plusieurs fois, cette interdiction ne pouvant être levée qu’en raison de l’existence d’éléments nouveaux.
Deuxième proposition : il faut conserver la disposition selon laquelle l’état d’urgence est frappé de caducité en cas de démission ou de chute du Gouvernement. Certes, s’il nous faudra bientôt voter une nouvelle prolongation de l’état d’urgence, nous devons permettre que l’état d’urgence puisse perdurer au-delà de la démission du Gouvernement qui interviendra au lendemain de l’élection présidentielle, au mois de mai prochain, mais ce sera à titre exceptionnel. La disposition de la loi du 3 avril 1955 qui prévoit la fin de l’état d’urgence en cas de démission du Gouvernement nous paraît effectivement protectrice.
Troisième proposition : il faudrait constitutionnaliser l’état d’urgence et lui donner un cadre offrant des garanties qui s’appliquent quelle que soit la majorité issue des urnes, et quelque emballement politique que puisse provoquer une catastrophe – car même une catastrophe naturelle ou une épidémie de grande ampleur pourraient aboutir à des comportements excessifs. La loi d’application serait une loi organique, ce qui permettrait d’encadrer et de limiter l’état d’urgence.
Par ailleurs, si nous devions limiter de façon générale l’état d’urgence, il faudrait prévoir une durée maximale, qui ne devrait pas excéder six mois. Précisons encore une fois que nous ne respecterons pas cette préconisation si nous prolongeons l’état d’urgence au mois de décembre de cette année, à moins de renoncer à couvrir la période des élections législatives.
Nous formulons ensuite une série de préconisations visant à améliorer le « fonctionnement » de l’état d’urgence qui certes correspondent souvent à des pratiques observées mais nous considérons que cela va mieux en le disant.
Il faut, tout d’abord, encadrer les perquisitions de nuit qui doivent obligatoirement être motivées. Elles le sont déjà souvent, mais il vaut mieux formaliser la pratique.
Il faut aussi préciser les conditions de recours à la force. C’est souvent le cas dans les arrêtés, mais une fois encore cette précision semble bienvenue.
Le périmètre géographique des assignations à résidence doit permettre la vie familiale et professionnelle la plus normale possible, et les parquets doivent être informés des assignations à résidence. Ils le sont déjà souvent, mais, une fois de plus, cela ira mieux en le disant. Il faut aussi permettre aux assignés à résidence de formuler, dans un délai de huit jours à compter de la notification, leurs observations sur la mesure dans le but de la faire retirer ou modifier, car l’assignation est une mesure faisant grief. Et il faut confier au préfet l’aménagement de certaines modalités de l’assignation, notamment les horaires de pointage.
Il faut ensuite travailler sur les liens entre, d’une part, les états-majors de sécurité départementaux, et, d’autre part, les hôpitaux psychiatriques ou les autorités sanitaires. Notre rencontre avec l’état-major opérationnel de la prévention du terrorisme (EMOPT) nous a appris que 15 % des personnes inscrites sur le fichier des personnes radicalisées avaient fait l’objet de mesures d’internement psychiatrique, à la demande du préfet ou à la demande de tiers. Encore ce chiffre ne rend-il compte que de la partie émergée de l’iceberg, car ne figurent sur les fiches que les mesures de contrainte, non les mesures de soin consenties ni les soins en ambulatoire. Cela signifie qu’un nombre non négligeable de personnes présentent des troubles de nature à les entraîner à des comportements criminels, et justifiant une coordination entre les autorités préfectorales et les autorités sanitaires. Il est d’ailleurs un certain nombre de personnes assignées à résidence dont on lève l’assignation à résidence le temps de leur hospitalisation, parfois d’office ; l’assignation reprend à la sortie, car les soins dispensés au cours de l’hospitalisation et les soins en ambulatoire qui suivent ne permettent parfois pas d’assurer une sécurité suffisante. Il existe donc une articulation entre les problèmes de santé mentale et les problèmes de sécurité.
Nous préconisons aussi l’information du juge des enfants lorsque des mineurs sont assignés à résidence.
Nous préconisons aussi une coordination interministérielle, ne serait-ce que pour évoquer la question de la santé mentale.
Qu’en est-il de la finalité des mesures prises ? Faut-il qu’elles ne concernent que le risque terroriste ? Comment faire en sorte que les mesures prises au titre de l’état d’urgence n’aillent pas trop au-delà de la lutte contre le risque terroriste ? Nous en avions débattu en abordant la question de la constitutionnalisation, mais c’est extrêmement délicat, d’autant que les policiers doivent gérer en même temps des troubles à l’ordre public et la lutte antiterroriste.
Nous nous posons également la question d’une évaluation budgétaire de l’état d’urgence. En moyenne, chaque perquisition a nécessité l’intervention de 15 personnes, policiers ou autres, certaines nécessitant des forces très importantes, d’autres se passant plus simplement. Le coût est donc relativement important.
L’état d’urgence a été une réponse nécessaire. Si nous pouvons ne pas être tous d’accord sur la nécessité de le proroger encore, il me semble, dans l’ensemble, avoir apporté quelque chose.
Saluons encore la réactivité des services de l’État, centraux ou départementaux, et leur dévouement. Ces services travaillent parfois dans des conditions difficiles, avec des moyens limités. Je me rappelle très précisément certains locaux visités ; on s’étonne de voir des gens travailler dans des conditions aussi difficiles, jusque dans les murs mêmes du ministère de l’intérieur !
J’ai également été étonné du souci constant de ne pas prendre des mesures inutilement attentatoires aux libertés dont témoignent les autorités préfectorales. Il faut le répéter : nous disposons d’un État qui sait faire la part des choses. La meilleure preuve en est qu’au-delà de critiques plutôt techniques émanant de juristes, l’état d’urgence ne suscite guère de critiques majeures de la part de nos concitoyens, les mesures prises étant somme toute, d’un simple point de vue statistique, limitées.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. Le président Raimbourg a dit l’essentiel, et je m’associe à l’ensemble des remerciements adressés aux services de l’État. Saluons le fait que notre institution soit capable de rendre des rapports de qualité, ce qui tend à justifier la jurisprudence constante de cette commission, plutôt défavorable aux amendements dont l’objet est de demander un rapport au Gouvernement… Nous démontrons que le pouvoir législatif sait, lui aussi, travailler au fond, de manière parfaitement efficace.
Nous touchons selon moi, avec cette nouvelle prolongation, les limites de l’exercice de l’état d’urgence. Ce n’est un mystère pour personne : j’ai acquiescé bien volontiers, sans réserve, à son instauration par décret du Président de la République à la suite des attentats du 13 novembre 2015, et j’ai voté sans hésitation la première prolongation de trois mois, mais j’ai voté contre toutes ses prolongations ultérieures, considérant que l’efficacité et l’utilité du dispositif n’étaient pas démontrées et que nous étions en train de prolonger, d’installer ce qui est, sur le plan juridique, un état d’exception.
La réflexion que nous avons conduite montre bien la nécessité d’encadrer par des mesures de droit commun certaines incertitudes du régime de l’état d’urgence, et je suis solidaire des dix-sept propositions par lesquelles nous concluons ce rapport. De mon point de vue, il s’agit de s’interroger sur la façon dont la durée elle-même de l’état d’urgence est susceptible de modifier sa nature. Telle est, à mon avis, la question qui nous est posée.
En ce qui concerne les perquisitions et leur « finalisation », j’avoue ne pas savoir comment garantir a priori qu’une perquisition est justifiée, avant d’avoir trouvé au domicile que l’on perquisitionne ce qu’on y cherchait – ou ce qu’on n’y cherchait pas –, tout en lui conservant son caractère soudain et inopiné : il y a, entre la protection des droits du citoyen et l’efficacité de la perquisition, une forme de contradiction pratique que je ne sais pas résoudre, d’autant que, dès lors que l’on cherche à mieux encadrer juridiquement un tel dispositif, on lui ôte ce qui, par définition, caractérise et résume l’état d’urgence, à savoir la possibilité donnée aux pouvoirs publics d’agir très rapidement, voire très brutalement.
Cela m’amène à la question de la durée même de l’état d’urgence et à sa prorogation sur une période qui, au bout du compte, approchera les vingt mois, ce qui n’était certainement pas dans les intentions du législateur à l’origine – en tout cas pas dans les nôtres. Cette durée a un impact sur la nature de l’état d’urgence, notamment parce qu’elle aboutit à ce que certaines autorités administratives utilisent les dispositifs qu’il autorise dans des procédures qui relèvent du maintien de l’ordre public, donc du droit commun.
Si la principale vertu de l’état d’urgence est son efficacité, notre commission ne peut pas ne pas s’interroger sur ses détournements éventuels et sur ses conséquences en termes de normes de droit et de hiérarchie de ces normes : que produit, à terme, cette superposition, qui se prolonge dans le temps, des pouvoirs administratif et judiciaire, et comment en sort-on ?
Nous faisons, dans le rapport, dix-sept propositions, afin de mieux encadrer l’application de l’état d’urgence et de mieux garantir les droits des citoyens, sans perdre de vue que, même si je suis le premier à souhaiter que jamais plus on ne doive recourir dans notre pays à l’état d’urgence, il faut, quitte à le maintenir, lui conserver toute son efficacité.
On touche notamment ici à la question, déjà soulevée dans le premier rapport que Jean-Jacques Urvoas et moi avions rendu en janvier 2016, de la porosité entre le terrorisme et d’autres modes de délinquance, qui nous a conduits à remplacer dans la loi la notion d’« activité » suspecte par celle de « comportement » suspect.
À cet égard, et compte tenu des liens avérés entre certains trafics et les réseaux terroristes, je ne saurais reprocher à des préfets ou à des policiers de vouloir perquisitionner des lieux susceptibles d’abriter des armes et de la drogue ; je ne saurais davantage leur reprocher ensuite de ne pas avoir trouvé de lien entre ces trafics et le terrorisme. Même si la frontière est ténue entre une perquisition motivée par la lutte contre le terrorisme et une perquisition d’opportunité, vouloir encadrer le dispositif revient à annuler l’état d’urgence ; ne pas l’encadrer nous oblige à faire confiance aux autorités de l’État et aux magistrats qui auront à en juger par la suite.
Je suis, quoi qu’il en soit, favorable à ce que les préfets puissent aménager certaines modalités des assignations à résidence sans autorisation de la place Beauvau.
Enfin, je m’interroge comme vous sur le coût de toutes ces mesures car, si la sécurité n’a pas de prix, elle a un coût, et il est bon que le Parlement le connaisse.
M. Pierre Morel-à-l’Huissier. Monsieur le président, en ce qui concerne les demandes d’indemnisation, vous avez parlé de 69 violations : pourriez-vous nous apporter quelques éclaircissements sur ce point ?
En ce qui concerne les mesures d’urgence et les référés, peut-on distinguer entre référés administratifs et référés judiciaires ?
Enfin, vous ne faites aucune préconisation particulière touchant à la coordination des forces de sécurité en matière de surveillance et de renseignement. Est-ce à dire que cette coordination n’offre guère de difficulté et que la coordination entre police et gendarmerie est adaptée à l’état d’urgence ?
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. Je vais clarifier mon propos, pour éviter toute confusion. Il y a actuellement 177 requêtes indemnitaires en cours, faisant suite à des préjudices allégués – un préjudice matériel dans 140 cas, correspondant pour l’essentiel à des bris de portes. Ce sujet est sans rapport avec celui de la violation des obligations qui incombent à une personne assignée à résidence, violation qui est une infraction pénale : 69 de ces infractions ont ainsi été constatées et font actuellement l’objet de poursuites.
À ma connaissance, il n’y a pas eu de référé judiciaire, puisque nous parlons de mesures administratives, qui ont donc toutes été portées devant les magistrats administratifs.
Quant à l’organisation des forces de sécurité, je distinguerai deux niveaux : d’une part, l’organisation autour des préfets, qui nous a paru de grande qualité, la coordination avec le procureur, l’administration pénitentiaire, le renseignement territorial et la sécurité intérieure fonctionnant de manière tout à fait satisfaisante. Au plan national, en revanche, nous avons affaire à un organigramme plus complexe et plus difficile à déchiffrer, ce qui s’explique par le fait que, le ministère de l’Intérieur n’étant pas habitué à gérer l’état d’urgence, le dispositif s’est élaboré à partir des directions et des organigrammes déjà existants, difficiles à coordonner – au point que, pendant toute une période, les chiffes qui remontaient au ministre étaient ceux transmis par la cellule parlementaire. C’est pour pallier ce dysfonctionnement que le ministère réfléchit actuellement à un dispositif central de collecte des données.
M. Pierre Morel-à-l’Huissier. Les référés administratifs sont-ils pour l’essentiel des référés-suspension ou y a t-il eu quelques référés-liberté ?
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. Les deux types de référés ont été formés, avec les conséquences que détaille le rapport, pour les assignations à résidence. Le contrôle juridictionnel est en revanche beaucoup plus faible sur les perquisitions – seulement 47 contentieux pour 4 292 perquisitions –, ce qui s’explique par le fait qu’il est peu utile, a posteriori, de contester une perquisition.
Mme Cécile Untermaier. Je souhaiterais quelques éclaircissements sur les assignations à résidence. Vous nous avez indiqué que 612 arrêtés d’assignation à résidence avaient été pris, concernant 434 personnes, parmi lesquelles 95 qui sont toujours sous le coup de cette mesure, dont 62 depuis juillet 2016.
J’imagine que ces assignations ont fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, notamment du fait de leur durée qui, évidemment, est problématique. Si je suis par ailleurs favorable à toutes les propositions que vous faites dans votre rapport, les remontées de terrain me donnent à penser que ces mesures représentent une charge très lourde pour les services de police et de gendarmerie, en particulier lorsque les assignations sont assorties de l’obligation de pointer trois fois par jour.
Je m’interroge par ailleurs sur leur efficacité, car une assignation à résidence n’empêche pas quelqu’un de disparaître. Le jeu en vaut-il donc la chandelle, sachant qu’il s’agit d’une mesure très attentatoire à la liberté d’aller et de venir ?
Enfin, l’assignation à résidence peut avoir pour conséquence, pour l’assigné, la perte de son emploi. Or, quel meilleur mode d’assignation à résidence que le fait de devoir se rendre chaque jour au travail ? Ne pourrait-on envisager des mesures d’aménagement qui permettraient à la surveillance de s’effectuer sur le lieu de travail, à charge pour l’employeur, par exemple, de signaler que la personne ne s’est pas présentée à son poste ?
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. Les services considèrent l’assignation à résidence comme assez efficace, dans la mesure où elle oblige une personne à rester chez elle tout en mobilisant très peu de moyens de surveillance, puisque c’est la personne qui se déplace pour pointer au commissariat ou à la gendarmerie. Par ailleurs, non seulement le fait de disparaître est constitutif d’un délit, mais l’assignation peut également être assortie d’une obligation de remettre son passeport aux autorités. Le procureur de la République de Paris, M. François Molins, a d’ailleurs indiqué que les interdictions de sortie du territoire – qui relèvent du droit commun et non de l’état d’urgence – avaient considérablement fait chuter le nombre de départs constatés pour la Syrie.
En ce qui concerne la protection des droits, le ministère de l’intérieur nous dit être très attentif à ne pas trop perturber le cadre familial ou la vie professionnelle. Il a même mis en place une adresse électronique permettant de solliciter des aménagements afin, par exemple, de se rendre à son travail. Mais ces aménagements ne sont pas toujours accordés, ce qui, dans certains cas, a pu nous laisser perplexes. Le Monde a ainsi publié une enquête, qui mettait en exergue trois cas problématiques. Ils concernaient certes des personnes dont le profil pouvait être inquiétant, mais cela ne justifie pas la multiplication des tracasseries.
Nous avons alerté la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur, indiquant qu’il fallait procéder à des aménagements lorsque cela était possible. Nous avons également dit qu’il était souhaitable de poursuivre judiciairement toutes ceux qui pouvaient l’être, sans qu’il soit nécessairement question d’une incarcération mais plutôt de la mise en place d’un contrôle judiciaire, assorti des garanties traditionnelles qui accompagnent la procédure pénale.
Nous nous sommes par ailleurs préoccupés des 47 assignations à résidence qui durent depuis la première période de l’état d’urgence ; il s’agit, pour certaines d’entre elles, de cas très difficiles à gérer.
Mme Cécile Untermaier. J’imagine que, si ces 47 assignations à résidence devaient être prolongées, elles seraient transformées en mesure de contrôle judiciaire ?
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. Cela suppose de disposer d’indices suffisants, au-delà des simples soupçons qui ont justifié l’assignation.
Mme Cécile Untermaier. Mais ne proposez-vous pas, dans votre rapport, de limiter la période d’assignation à résidence à huit mois ?
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. En effet, mais elle pourrait être prolongée en cas d’apparition d’éléments nouveaux.
M. Sergio Coronado. La possibilité pour le Parlement de contrôler l’application de l’état d’urgence démontre, à travers votre rapport, tout son intérêt, puisque le travail que vous avez accompli avec M. Poisson fait apparaître l’impasse dans laquelle nous nous trouvons.
Lors de la première évaluation, Jean-Jacques Urvoas, alors président de notre commission, avait déclaré qu’il avait été facile d’entrer dans l’état d’urgence mais qu’il serait beaucoup plus difficile d’en sortir. Je crains, malheureusement, qu’il n’ait eu raison.
La gravité de l’attaque que nous avons subie et l’horreur qu’elle a suscitée nous ont conduits à légiférer sous l’empire de l’émotion – et les législations d’exception sont souvent adoptées dans de tels contextes –, mais nous nous trouvons aujourd’hui face à un casse-tête politique et juridique.
Nul ne conteste l’efficacité réelle de l’état d’urgence dans les jours qui ont suivi sa proclamation, l’effet de surprise et la brutalité de sa mise en œuvre ayant été pour beaucoup dans cette efficacité. Mais nous nous éloignons aujourd’hui, alors que plus d’une année est révolue, de la volonté originelle du législateur, celui de 1955, qui s’est prononcé en faveur d’un état d’exception limité dans le temps.
Dans ces conditions, les propositions que vous faites témoignent sans doute de votre bonne volonté, mais elles ressemblent à un vœu pieux. D’abord parce que la plupart des dispositions mises en œuvre ont déjà été intégrées au droit commun ; ensuite parce que vos efforts pour limiter la portée de cet état d’exception montrent que vous le jugez à la fois dangereux et non pertinent – et l’on peut en effet s’interroger sur la pertinence, contre la nouvelle forme de menace à laquelle nous sommes confrontés, d’un dispositif pensé au moment de la guerre d’Algérie.
Vous proposez enfin de conférer un caractère organique à la loi d’application de l’état d’urgence, ce qui exige une révision constitutionnelle. Or vous connaissez comme moi les conditions de cette révision, à savoir une majorité qualifiée. Il me paraît donc hautement improbable que ces propositions, pourtant sages, soient adoptées avant la fin de la législature.
On ne peut que saluer la lucidité de celles et ceux qui, depuis l’origine, nous ont présenté des rapports d’une grande qualité. Je ne peux m’empêcher de constater qu’émerge un sentiment d’impuissance face à un dispositif qui nous échappe et dont ne savons aujourd’hui ni empêcher la dérive ni limiter les abus.
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. S’agissant de la sortie de l’état d’urgence, le rapport est susceptible de vous éclairer puisqu’il récapitule les précédentes applications de l’état d’urgence. Il en ressort que, dans les cas où celui-ci a été prolongé, il n’y a pas été mis fin par une décision, mais du fait de la démission du Gouvernement ou de la dissolution de l’Assemblée nationale. Il en a été différemment lorsque l’état d’urgence a été très court, comme ce fut le cas à la suite des émeutes de 2005 ou des événements de Nouvelle-Calédonie en 1985.
La difficulté de penser la fin d’un dispositif de coercition a été soulignée. Cela me rappelle le mot de ce psychiatre pour qui « toute hospitalisation d’office est abusive et toute levée de celle-ci anormale »… Ces mesures de contrainte ne peuvent prendre fin si l’on n’est pas en mesure de garantir la sécurité des citoyens.
Je tempérerai votre appréciation très critique, monsieur Coronado, en soulignant que l’état d’urgence semble connaître, depuis juillet 2016, un regain d’efficacité du fait d’un meilleur ciblage des mesures : le pourcentage de procédures auxquelles elles donnent lieu a augmenté.
Je mesure la difficulté d’aboutir à une constitutionnalisation de l’état d’urgence. Vous aurez noté que les recommandations du rapport se divisent en deux parties : ce qui est possible et souhaitable aujourd’hui et ce qui l’est dans un avenir plus lointain, dans lequel il sera sans doute nécessaire de concevoir, à côté du régime découlant de l’article 16 de la Constitution, un dispositif bien encadré, efficace et protecteur, afin de répondre à des situations extraordinaires.
M. Guillaume Larrivé. Lors du précédent débat sur l’état d’urgence, nous nous étions prononcés non seulement sur sa prorogation, mais aussi sur des dispositions de droit et de procédure pénale pérennes, notamment la limitation des mécanismes d’aménagement des peines pour les détenus condamnés pour faits de terrorisme.
Dans quelques jours, nous serons saisis d’un nouveau projet de loi visant à proroger l’état d’urgence et le Gouvernement, alors que nous sommes à la fin de la législature, ne nous a toujours pas soumis les propositions qu’il avait annoncées sur certains sujets liés à la sécurité publique. Je veux parler de la traduction législative, souhaitable du point de vue du groupe Les Républicains, des revendications légitimes de certains policiers et gendarmes quant à leur protection dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit de la légitime défense et de l’usage des armes, sujets que notre commission connaît bien pour les avoir évoqués, vainement à ce jour, six ou sept fois depuis 2012, à l’initiative de notre groupe.
Pouvez-vous m’indiquer si ces questions seront traitées dans le projet de loi relatif à l’état d’urgence, soit à l’initiative du Gouvernement, soit par amendements ?
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. À ma connaissance, la réponse est non, car un texte distinct est prévu. La mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité a remis récemment ses conclusions. Le projet de loi qui devrait comporter des dispositions sur le délit d’outrage aux policiers et sur l’anonymisation de certaines procédures pénales n’est pas encore prêt. Il sera présenté en Conseil des ministres le 21 décembre et vraisemblablement examiné par le Parlement en janvier.
Quant au vote sur la prorogation de l’état d’urgence, il devrait intervenir dans un délai qui s’est encore réduit du fait de la démission du Gouvernement ce matin.
M. Guillaume Larrivé. Il serait utile que la commission auditionne le nouveau ministre de l’Intérieur pour obtenir des précisions sur le calendrier.
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. Notre réactivité est grande mais le ministre a été nommé il y a quelques heures seulement…
M. Georges Fenech. Je souhaite rappeler les conclusions de la commission d’enquête que j’ai présidée sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, conclusions qui ont été approuvées par 28 des 30 membres qui la composaient – les deux autres s’abstenant.
Notre conviction, forgée par l’audition d’acteurs de terrain, est que l’état d’urgence produit, s’agissant de la lutte contre le terrorisme, un effet très limité dans le temps. Combien de perquisitions administratives ont un lien effectif, même ténu, avec les affaires de terrorisme ?
Il faut avoir le courage politique de sortir d’un état d’urgence qui est contraire à nos traditions juridiques, sans attendre un quelconque événement institutionnel. Il faut avoir le courage de reconnaître son effet limité et de privilégier le renforcement des moyens de la justice, qui, elle, travaille efficacement en profondeur sur les filières en vue de démantèlement. C’est sur ce point que l’effort doit porter.
M. Jean-Michel Clément. Je souhaite prolonger la réflexion de M. Fenech, qui me surprend mais que j’apprécie.
Je m’interroge. Ne sommes-nous pas dans une nasse, ou dans une impasse dont nous ne savons comment sortir ? L’état d’urgence est justifié par une situation et par des règles que chacun a acceptées. Si nous considérons que la menace que nous connaissons aujourd’hui est appelée à perdurer, alors il nous faut définir un nouvel état du droit, sans quoi nous resterions dans un état d’exception.
Quel peut être ce nouvel état ? Il nous faut revoir un certain nombre de règles que certains jugent – non sans raison – attentatoires aux libertés, et dont le caractère exceptionnel ne fait pas de doute. Lorsque l’état d’exception vient à durer, il faut revisiter le droit positif.
Aller de prorogation en prorogation ne peut être la solution. À la lecture du rapport, on peut se demander si les moyens de droit commun dont nous disposions avant l’état d’urgence n’auraient pas permis d’aboutir aux mêmes résultats.
La prorogation ad vitam aeternam interpelle le démocrate que je suis.
M. Yves Goasdoué. J’observe que le constat et les interrogations sont à peu près les mêmes sur tous les bancs.
L’état d’urgence est-il vraiment efficace ? Chacun en convient, il ne peut pas être pérenne : par le passé, il a généralement pris fin tout seul, du simple fait de sa non-reconduction – à l’exception de sa levée par le président Chirac en janvier 2006.
L’état d’urgence, ce sont d’abord des perquisitions, qui perdent de leur efficacité à mesure que leur caractère impromptu disparaît.
Ce sont aussi des assignations à résidence, qui peuvent être très longues, comme l’a justement souligné Mme Untermaier. Je ne veux pas croire qu’elles soient longues parce que l’autorité administrative s’amuse à les faire durer. Il peut être justifié d’« avoir à l’œil » des individus dont on peut penser qu’ils pourraient participer à des actions terroristes ou faire partie de filières. Peut-être faudrait-il envisager dans notre droit des assignations à résidence qui seraient soustraites à la décision du juge judiciaire ?
Enfin, l’état d’urgence offre la possibilité, dans des situations dangereuses, par exemple lors de grands rassemblements, de procéder à des fouilles ou à des contrôles d’identité dans des conditions qui ne sont pas prévues par le droit commun actuel. C’est cela, la réalité de l’état d’urgence.
La menace ne disparaît pas. C’est la raison pour laquelle nous devons être très prudents. Nous pourrions tous admettre – il faudrait avoir le courage de le dire – que, si les mesures prises en application de l’état d’urgence ne sont pas la panacée, si elles ne règlent pas tout, elles peuvent permettre, dans certaines circonstances, de surveiller de près des individus non susceptibles de faire l’objet de procédures judiciaires, et de procéder, à l’occasion de grands événements, à des contrôles d’identité, à des fouilles de véhicules, qui peuvent être nécessaires pour prévenir un attentat. Nous devons bien peser les choses.
Je terminerai par une question : avez-vous eu connaissance, monsieur le président, de cas dans lesquels l’assignation à résidence a été levée alors même que la judiciarisation intervenue n’a pas donné lieu à la mise en place d’un contrôle renforcé de l’individu concerné ?
M. le président Dominique Raimbourg, rapporteur. Parmi les cas de judiciarisation, on relève des procédures avec incarcération, d’autres avec contrôle judiciaire… Pour les personnes faisant l’objet d’un contrôle judiciaire, l’assignation à résidence a parfois été maintenue et parfois levée. Il y a même des cas dans lesquels l’incarcération a été suivie d’une remise en liberté, assortie éventuellement d’un contrôle judiciaire conjugué avec une assignation à résidence. Les cas de figure sont assez divers. Il est relativement rare que des assignations à résidence perdurent sans que d’autres mesures aient été prises. J’admets néanmoins que certains cas peuvent susciter la perplexité.
Votre réflexion conduit à envisager l’entrée dans notre droit de l’assignation à résidence et de la perquisition sans autorisation judiciaire, ainsi que de mesures d’interdiction de paraître – expression que je préfère à celle d’interdiction de séjour –, destinées à éviter que certaines personnes s’approchent d’un lieu considéré comme dangereux ou participent à de manifestations violentes. Cela nécessite aussi de repenser la question du contrôle d’identité.
Ce sont quatre sujets très délicats, qui demanderaient des débats très précis et sans doute complexes.
Le rapport de la commission d’enquête sur les missions et les modalités de maintien de l’ordre républicain préconise d’introduire dans notre arsenal juridique l’interdiction individuelle de manifester, sur le modèle de l’interdiction de stade qui peut être prononcée à l’encontre des supporters violents. Ce n’est pas le sujet le plus difficile, pas plus que celui du contrôle d’identité.
Mais les deux mesures, autrement plus coercitives, que sont l’assignation à résidence et la perquisition sans autorisation préalable du juge soulèvent un débat très compliqué, car elles sortent du cadre habituel du droit pénal. Des garanties devraient être instituées afin d’éviter que leur champ d’application ne s’étende au détriment de la mesure judiciaire qui nécessite l’intervention d’un juge et la constatation qu’une infraction a été commise ou est en train de se commettre. Sur cette question extrêmement difficile, j’ai bien conscience que ma réponse clôt de façon insatisfaisante le débat…
Pour conclure, je vous propose d’autoriser la publication du rapport, étant précisé que le vote ne vaut pas approbation de son contenu.
La Commission autorise, à l’unanimité, la publication du rapport d’information sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence.
——fpfp——
Les auditions sont présentées par ordre chronologique. Les auditions suivies de la mention (*) ont fait l’objet de comptes rendus publiés dans le rapport n° 3784 fait par MM. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson, au nom de la Commission des Lois (157).
• Jeudi 7 janvier 2016
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État et M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux (*)
M. Serge Gouès, président du Syndicat de la juridiction administrative (SJA) et Mme Hélène Bronnenkant, secrétaire générale du SJA (*)
• Vendredi 8 janvier 2016
M. Loïc Garnier, chef de l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) au ministère de l’Intérieur (*)
M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure (DGSI) au ministère de l’Intérieur, M. Jean-Yves Guillard, sous-directeur de la sécurité intérieure, et Mme Marie Deniau, chef de cabinet (*)
M. Jérôme Léonnet, directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du Service central du renseignement territorial au ministère de l’Intérieur (*)
Mme Mireille Ballestrazzi, directrice centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur (*)
M. Olivier de Mazières, préfet, chargé de l’état-major opérationnel de la prévention du terrorisme (EMOPT) au ministère de l’Intérieur (*)
M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice (*)
• Lundi 11 janvier 2016
Table ronde réunissant des responsables opérationnels de la gendarmerie nationale (*)
Colonel Marc Boget, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise
Colonel Frédéric Boudier, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône
Colonel Marc Payrar, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée
Général Michel Pidoux, commandant la région de gendarmerie du Centre – Val de Loire et le groupement de gendarmerie départementale du Loiret
Colonel David Rey, commandant le groupement de gendarmerie départementale de Saône-et-Loire
Colonel Charles-Antoine Thomas, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Val d’Oise
Table ronde réunissant des responsables opérationnels de la police nationale (*)
Le commissaire divisionnaire M. Paul Agostini, directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne
Le commissaire divisionnaire M. Pascal Belin, directeur départemental de la sécurité publique du Loiret
L’inspecteur général M. Pierre-Marie Bourniquel, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône
Le commissaire divisionnaire M. Jean-François Illy, directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin
Le contrôleur général M. Patrick Mairesse, directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère
Mme Sophie Tissot, présidente de l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), et M. Olivier Di Candia, secrétaire général de l’USMA
• Mardi 19 janvier 2016
M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur (*)
• Mardi 15 mars 2016
Mme Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Mme Gwénaëlle Calvès, membre de la CNCDH, et M. Hervé Henrion-Stoffel, conseiller juridique (*)
M. Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme (*)
• Mardi 22 mars 2016
M. Jacques Toubon, Défenseur des droits (*)
• Jeudi 7 avril 2016
M. Jérôme Léonnet, directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du Service central du renseignement territorial au ministère de l’Intérieur
• Vendredi 28 octobre 2016
M. François Molins, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris
• Mercredi 2 novembre 2016
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État et M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux.
LISTE DES DÉPLACEMENTS DES RAPPORTEURS
• Mercredi 9 décembre 2015
Préfecture du Val-de-Marne
• Jeudi 17 décembre 2015
Préfecture du Rhône
• Mardi 22 décembre 2015
Préfecture de l’Yonne
• Mardi 29 décembre 2015
Préfecture du Nord
• Lundi 4 janvier 2016
Préfecture d’Ille-et-Vilaine
• Mardi 5 janvier 2016
Préfecture de l’Hérault
• Mercredi 6 janvier 2016
Préfecture de la Haute-Garonne
• Mardi 12 janvier 2016
Préfecture de police de Paris
• Mardi 26 janvier 2016
Préfecture de Haute-Savoie.
• Mardi 23 février 2016
Préfecture du Bas-Rhin.
• Mercredi 24 février 2016
Préfecture des Alpes-Maritimes
Préfecture déléguée pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy et du Bourget
• Vendredi 25 mars 2016
Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) – ministère de l’Intérieur
• Vendredi 22 avril 2016
État-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) – ministère de l’Intérieur
• Jeudi 23 juin 2016 :
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) – ministère de l’Intérieur
• Jeudi 20 octobre 2016 :
Préfecture de police de Paris.
ANNEXE 1 : ASSIGNATION À RÉSIDENCE – MODALITÉS PRATIQUES
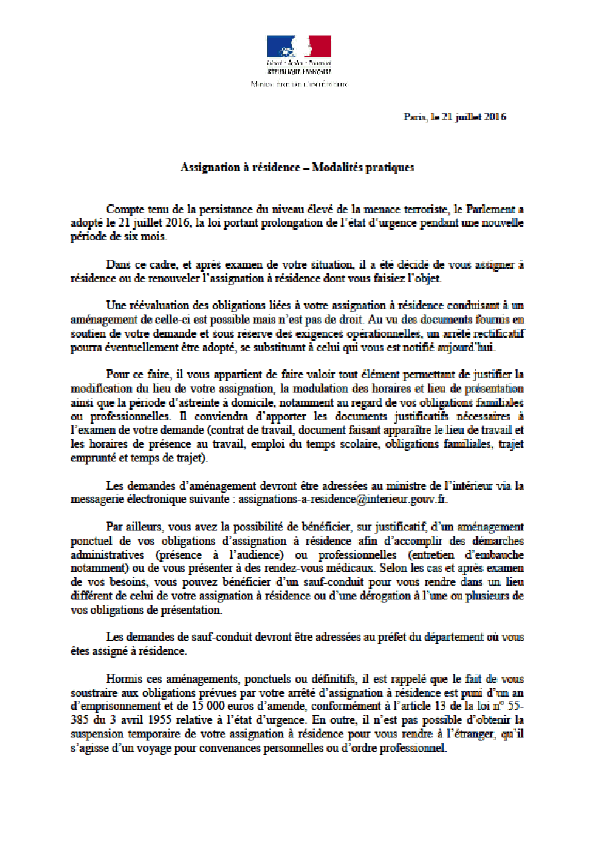
ANNEXE 2 :
COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION DES LOIS SUR LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DE L’ÉTAT D’URGENCE
– Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mercredi 2 décembre 2015. 159
– Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mercredi 16 décembre 2015. 177
– Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mercredi 13 janvier 2016 191
– Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mercredi 30 mars 2016. 208
– Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mardi 17 mai 2016. 218
Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mercredi 2 décembre 2015.
(Extrait du compte rendu n° 20)
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mes chers collègues, je souhaite tout d’abord vous rappeler le contexte. Sur la base d’un amendement voté à l’unanimité par la Commission, conforté par les débats en séance publique tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, un nouvel article 4-1 a été inscrit dans la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Cet article prévoit ceci : « L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ».
Cet article confère au Parlement un pouvoir de contrôle précis et constant des mesures adoptées et appliquées par l’exécutif durant trois mois. C’est la marque de nos débats, concrétisant une intention avancée lors des emplois précédents de la loi de 1955, à savoir en janvier 1985 puis en novembre 2005, mais jamais matérialisée.
Le vote unanime du Parlement renforce notre détermination collective à démontrer que l’état d’urgence est partie intégrante de l’état de droit puisqu’il ne suspend pas l’application des autres lois.
Il nous faut maintenant organiser les modalités d’exercice de ce pouvoir afin qu’il soit effectif, permanent et efficace. À cet égard, permettez-moi de citer Guy Carcassonne qui écrivait dans la préface d’un ouvrage d’un de nos collègues présents dans cette salle : « Il ne suffit pas de donner des pouvoirs à l’Assemblée, encore faut-il que les députés les exercent ». Nous allons exercer ces pouvoirs.
Quels objectifs allons-nous poursuivre ? Sans préjudice du travail classique a posteriori de l’action du Gouvernement qui nous conduira, le moment venu, à en dresser le bilan, il nous faut mettre en place une veille parlementaire continue tout au long de la durée de l’état d’urgence.
Quoique concomitante de l’action des pouvoirs publics, il s’agira donc de favoriser, en temps réel, le regard de l’Assemblée nationale sur les services auxquels ont été consentis temporairement des pouvoirs particuliers, d’évaluer la pertinence des moyens mobilisés et ainsi signaler, le cas échéant, tout risque d’abus.
Ce mode opératoire permettra ainsi à la commission des Lois d’évaluer l’application de l’état d’urgence en délivrant une analyse technique et statistique complète ainsi qu’objective des procédures mises en œuvre. Notre but étant qualitatif et pas seulement quantitatif, nous allons tenter d’évaluer les bénéfices retirés de ces mesures exceptionnelles en termes de sécurité publique, de procédures judiciaires et de collecte de renseignements. Cela nous amènera, le cas échéant, à adresser au Gouvernement des préconisations dans le but, soit de conforter l’efficacité du dispositif, soit de mieux garantir les libertés individuelles et collectives.
Le contrôle conjuguera un suivi de données relatives à la mise en œuvre de l’état d’urgence et une réflexion plus approfondie sur certaines thématiques et certains faits. Ainsi, dès l’entrée en vigueur du dispositif, vendredi prochain, différents tableaux de bord seront institués et actualisés chaque semaine, grâce à une remontée quotidienne d’informations. Ils intégreront le suivi des procédures exceptionnelles de l’état d’urgence. Nous aurons ainsi des indicateurs détaillés sur les différentes mesures possibles : bien sûr, les assignations à domicile ou les perquisitions à domicile de jour et de nuit, ou encore les remises des armes de catégorie A à D dont le ministre évoque régulièrement les résultats, mais aussi toutes les autres mesures possibles dans le cadre de l’état d’urgence, c’est-à-dire les interdictions de la circulation des personnes ou des véhicules, la dissolution d’associations ou de groupements, les interruptions de sites internet, les fermetures provisoires des salles de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion. Il existe sept articles dans la loi de 1955 qui prévoient treize mesures possibles. Nous nous intéresserons à la totalité de ces treize mesures. Ensuite, nous procéderons à un recensement des éventuelles suites judiciaires ou administratives, les recours intentés contre elles ou contre leurs suites.
En complément de ce suivi hebdomadaire et grâce aux données ainsi collectées, le contrôle sera complété par un travail d’enquête et d’information portant sur plusieurs thématiques déterminées en fonction des premières analyses des données fournies. Tous les outils de travail habituels seront alors mobilisés : auditions, demandes de pièces, contrôles sur place, déplacements sur certaines zones, envois de questionnaires.
Quels outils allons-nous mobiliser pour concrétiser ces intentions ? La semaine dernière, j’ai appelé le défenseur des droits, Jacques Toubon. Je lui ai fait part de mon souhait de mobiliser les 397 délégués territoriaux afin de transmettre à la Commission les informations qu’il jugera utiles. Une circulaire du défenseur des droits a déjà été envoyée. Ces délégués recevront les éventuelles réclamations des citoyens concernés par une mesure et communiqueront les éléments indispensables à une exploitation. Parallèlement, j’ai appelé Christine Lazerges, la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme afin de conduire un travail de sensibilisation auprès des associations représentées en son sein pour, là encore, faire parvenir aux Rapporteurs tous les éléments qu’elles pourraient juger utiles.
De plus, les parlementaires – et pas uniquement ceux de la commission des lois – qui, comme l’a décidé le ministre de l’intérieur, seront régulièrement informés par les préfets de ce qui se passe dans les départements, auront la faculté, et même le devoir de faire remonter des observations.
Mais surtout, je vous propose d’utiliser pour la première fois sous la Vème République l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Cet article permet à une commission permanente de se doter, en plus de ses pouvoirs traditionnels, des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête. Ainsi, elle disposera de moyens d’action non négligeables, et d’abord de pouvoirs de contraintes. Toute personne dont nous jugerons l’audition utile sera tenue de déférer à notre convocation. En cas de faux témoignage, les articles du code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement et d’amende seront applicables. La Commission disposera aussi de pouvoirs d’enquête. Je vais vous proposer de me désigner rapporteur de ce travail et de nommer Jean-Frédéric Poisson co-rapporteur d’application, afin de mener des investigations sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter notre mission devront nous être fournis. Nous serons ainsi habilités à nous faire communiquer tous les documents de service. À cette fin, trois administrateurs de la Commission des lois se consacreront à ces tâches pendant les trois mois à venir.
Enfin, j’ai naturellement informé le Gouvernement de ces intentions. Je me suis assuré de la disposition d’esprit du ministre de l’intérieur. Il a adressé hier un courrier à la Commission dans lequel il indique son intention de contribuer très activement à l’effectivité de ce contrôle et que nous pouvons compter sur sa diligence et celle de ses services à qui il a transmis des consignes de coopération d’une grande clarté pour que nous élaborions ensemble un dispositif de contrôle inédit sous la Vème République.
M. Jean-Frédéric Poisson. L’exposé que vous venez de faire et la note d’information sur laquelle il s’appuie retracent la méthode que nous allons adopter afin de contrôler les pouvoirs exceptionnels que le Parlement a confiés au Gouvernement pendant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence. Pour y avoir été associé, j’approuve pleinement cette manière de procéder au contrôle du détail des opérations, mais aussi de leur quantité et de leur qualité. Plusieurs interrogations sont apparues depuis que le Parlement a décidé de prolonger l’état d’urgence. La méthode que nous propose le président permettra à la Commission d’exercer ces nouveaux pouvoirs de contrôle s’apparentant à ceux d’une commission d’enquête, et au Gouvernement de se rendre pleinement disponible à ces fins – condition sine qua non du bon déroulement de nos travaux de contrôle.
J’ai participé avec M. le président, M. Larrivé et d’autres à la réunion qui s’est tenue jeudi dernier au ministère de l’intérieur : nous y avons constaté la bonne volonté du Gouvernement de communiquer ces informations. Je suppose que leur traitement administratif et leur aiguillage vers notre Commission présentent un certain nombre de difficultés matérielles ; il nous appartient de déployer l’énergie nécessaire pour que les délais de traitement habituels soient réduits, de sorte que le Parlement puisse exercer pleinement sa mission de contrôle.
Au terme des trois mois d’état d’urgence – et qu’il soit prolongé ou non, puisque le Premier ministre ne l’a pas exclu, sachant que la réforme de la Constitution ne pourra de toute façon pas avoir lieu avant cette date –, je propose que la Commission use par anticipation des facultés du rapporteur d’application pour qu’il dresse un bilan global de la situation et qu’il le communique à la Commission.
Je demeure attentif à la question de l’information des élus locaux – à laquelle le ministre a répondu avec quelque réserve. Il a en effet donné instruction aux préfets de réunir une fois par mois les maires et les parlementaires de chaque département pour leur présenter l’état précis des opérations menées sur leur territoire. Il me semble toutefois qu’il reste à trouver une formule permettant d’éviter que les maires découvrent par la presse locale, voire par des rumeurs dans le voisinage, que tel ou tel de leurs administrés a été assigné à résidence dans leur commune, même si je suis parfaitement conscient qu’une assignation à résidence ou une perquisition administrative sont susceptibles d’entraîner d’autres opérations incompatibles avec le degré habituel de discrétion des maires. Il faut informer les maires, mais il peut s’avérer délicat de le faire alors que des procédures sont en cours. Quoi qu’il en soit, il faut trouver un équilibre en matière d’information des élus locaux.
Certains s’inquiètent – et la presse s’en fait parfois l’écho – que les pouvoirs publics soient tentés d’effectuer des perquisitions fondées sur d’autres faits présumés que des actes terroristes et, ainsi, déclencher des procédures de droit commun en profitant de la facilité que leur offre l’état d’urgence. À titre personnel, je crois que le recours à des pouvoirs spéciaux peut en effet donner lieu à d’occasionnels débordements, mais je constate que les liens qui existent entre la délinquance de droit commun – y compris la grande délinquance – et les actes terroristes empêchent d’interdire, à supposer que cela soit possible, que l’on profite de l’état d’urgence pour conduire des perquisitions dont le lien avec des faits de terrorisme est plus ou moins lointain. Je comprends les inquiétudes exprimées au nom de la protection des libertés fondamentales et, le cas échéant, la Commission interrogera le ministre de l’intérieur a posteriori pour vérifier qu’aucune atteinte ne leur a été portée. À ce stade, néanmoins, aucun élément ne peut selon moi nous prémunir contre cette éventualité. En l’espèce, je fais confiance à l’appareil policier pour effectuer le tri nécessaire.
Pour conclure, je réaffirme mon accord total avec la méthode que vous avez exposée, monsieur le président, et à laquelle vous avez bien voulu m’associer.
M. Alain Tourret. Le contrôle s’impose d’autant plus que les libertés sont restreintes. Je vous félicite, monsieur le président, d’avoir incité l’Assemblée à adopter un amendement qui, outre le contrôle du juge, instaure le contrôle politique et parlementaire de la procédure.
Il va de soi que je fais toute confiance au président Urvoas et à M. Poisson, mais je note que les groupes politiques minoritaires sont éliminés du processus. Je vous demande d’y être attentifs : nos travaux de contrôle devront se fonder sur l’unanimité des parlementaires, et non pas sur un simple consensus entre les deux principaux groupes politiques. En particulier, on commettrait une erreur en refusant d’emblée d’associer les députés écologistes, dont certains se sont saisis de ce dossier.
Deuxième question : le Gouvernement assistera-t-il à nos travaux en dépêchant un ministre ou l’un de ses représentants ?
Enfin, la garde à vue n’est pas une procédure conçue spécialement pour l’état d’urgence mais, lorsqu’il est en vigueur, elle ne s’applique pas de la même manière. Il me semble donc indispensable de prendre connaissance du nombre de gardes à vue prononcées et de leurs motivations. Il en va de même des référés-liberté liés aux affaires de terrorisme : nous devons exiger de l’autorité administrative qu’elle nous fasse connaître non seulement leur nombre, mais surtout leur véritable motivation. La stratégie du Conseil d’État consiste à rendre sa décision de manière lapidaire, en quelques mots ; de mon point de vue, il est beaucoup plus important de savoir pourquoi tel référé-liberté a été admis ou rejeté – et, pour ce faire, d’avoir accès au texte lui-même desdits référés.
M. Dominique Raimbourg. En cette période très difficile, il est essentiel de préserver l’unité du pays autour des mesures visant à lutter contre le fléau terroriste et à rétablir l’ordre normal des choses. Dès lors, il est indispensable que les mesures exceptionnelles liées à l’état d’urgence soient soumises à un contrôle, de sorte qu’une fois passée l’émotion, cette restriction des libertés ne suscite pas une levée de boucliers.
Nous avons pris la précaution de prévoir dans la loi un contrôle par le juge administratif – une nouveauté par rapport à la loi de 1955. D’autre part, toutes les mesures prises doivent avoir une traduction judiciaire : le procureur de la République, qui est avisé des perquisitions, exerce lui aussi un contrôle. Nous disposons donc déjà d’outils qui permettent de contrôler les mesures exceptionnelles de restriction des libertés.
Avec M. Poisson, vous avez, monsieur le président, pris l’initiative d’instaurer un mécanisme de contrôle parlementaire. Il est non seulement très utile, mais aussi nécessaire, et il va de soi que le groupe SRC en approuve la création car il permettra de rassurer nos concitoyens et de donner sa pleine efficacité aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, qui n'ont de sens que si elles recueillent l’assentiment de tout notre peuple dans sa lutte contre le terrorisme.
M. Georges Fenech. L’une des modalités du contrôle que vous instaurez consiste à établir un réseau de sept correspondants. Je m’interroge sur le cinquième d’entre eux : le parquet de Paris. Comment un procureur pourrait-il ainsi être tenu de répondre à une commission parlementaire sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs – a fortiori lorsqu’il a lui-même été désigné par le Gouvernement ? Ne serait-il pas plus conforme au fonctionnement de nos institutions que le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice soit notre correspondant, et non un magistrat en exercice ?
D’autre part, envisagez-vous de rendre nos travaux publics ?
M. Pascal Popelin. Mieux vaut exercer pleinement les pouvoirs que la Commission s’est accordée que de se contenter de leur existence théorique. Votre proposition, monsieur le président, a le mérite de prévoir un contrôle exhaustif des mesures liées à l’état d’urgence. Il me semble opportun de mobiliser les autorités administratives et les commissions consultatives concernées afin que nous puissions nous appuyer sur différentes sources d’information. De même, l’emploi original des dispositions permettant d’attribuer à notre Commission les pouvoirs d’une commission d’enquête me semble utile. Les moyens humains et administratifs que vous nous avez indiqués sont en rapport avec l’ambition inédite et loin d’être modeste que vous nous proposez. Cette ambition a d’emblée recueilli le soutien du Premier ministre et du Gouvernement, comme l’a illustré la manière dont nous avons travaillé à l’élaboration de ce texte et les échanges qui ont eu lieu depuis.
Nous allons analyser des informations nationales. J’insiste néanmoins sur l’importance des informations recueillies à l’échelle des territoires. Il est prévu que nous y ayons accès, même si je suis conscient du caractère délicat de cette question compte tenu de l’impératif de confidentialité qui est parfois la condition de l’efficacité des procédures engagées. À ce jour, pourtant, ce n’est jamais le cas dans mon département, la Seine-Saint-Denis. Je comprends que l’on hésite à fournir des données relatives à certains dossiers ; d’autres, en revanche, ne devraient donner lieu à aucune hésitation. Je vous le dis en toute franchise : qu’un parlementaire qui a personnellement contribué à accorder des pouvoirs exceptionnels à l’autorité administrative apprenne par la presse qu’une perquisition administrative a été conduite – par erreur – dans la circonscription dont il est l’élu et qu’il ne dispose à ce jour encore d’aucune information officielle à ce propos relève d’une forme de désinvolture tout à fait inacceptable. La chaîne de commandement – ministère et préfecture – doit être alertée afin que de telles situations – heureusement fort rares – ne se reproduisent pas et que les parlementaires puissent en prendre connaissance.
M. Guillaume Larrivé. Nous débattons aujourd’hui des modalités du contrôle de l’application de la loi de 1955 modifiée en 2015, mais la question de l’application d’autres lois se pose également : je pense à la loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement et à la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Dans l’un et l’autre cas, nous aurions tout intérêt à envisager la rédaction d’un rapport d’application. Il n’est pas question d’empiler inutilement les rapports mais, au-delà de l’état d’urgence, il ne faut pas négliger l’application des autres mesures qui sont aussi au cœur du sujet.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Les deux assemblées, en accord avec le Gouvernement, ont élaboré un dispositif très original qui s’inscrit dans le cadre de la mesure législative modifiée à votre initiative, monsieur le président, pour instaurer le contrôle parlementaire de l’état d’urgence. Hier, j’ai eu l’honneur de vous remplacer à la réunion qui s’est tenue à Matignon en présence des présidents des deux Chambres, des présidents de tous les groupes parlementaires et de ceux de toutes les commissions parlementaires régaliennes, ainsi que des ministres concernés, afin que la représentation parlementaire soit informée de l’ensemble des dispositions qui ont été prises. Les informations qui nous ont été fournies étaient d’une très grande précision, et chacun a convenu que le Gouvernement les livrait en toute sincérité.
Les deux dispositifs de contrôle parlementaire ont été évoqués : le Sénat a opté pour la désignation d’un rapporteur, et l’Assemblée a présenté les informations qui figurent dans la note que vous nous avez communiquée, monsieur le président. Ce dispositif très original est tout à fait pertinent pour répondre aux interrogations qu’ont suscitées l’entrée en vigueur puis la prolongation de l’état d’urgence concernant les droits fondamentaux sur lesquels reposent notre République et notre État de droit, en particulier.
Le dispositif législatif ne prévoit pas que les actions administratives se cantonnent aux seuls actes présumés de terrorisme. Si c’était le cas, nous n’aurions pas avancé d’un iota par rapport à la loi de 1955, dont l’obsolescence est pourtant avérée. Au contraire, le processus actuel ne s’enferme pas dans le seul soupçon d’acte terroriste.
Ensuite, nous avons, encore une fois à votre initiative, monsieur le président, imposé la présence d’un officier de police judiciaire dans les opérations domiciliaires. En conséquence, le processus judiciaire s’inscrit désormais dans le cadre de la procédure administrative. On ne parle guère de cette excellente proposition qui, pourtant, est loin d’être anodine ! En effet, l’officier de police judiciaire est tenu par une obligation permanente de communication. En outre, toutes les assignations à résidence et toutes les perquisitions administratives se traduisent par une procédure judiciaire, y compris une garde à vue. Ce dispositif très large et innovant doit satisfaire tout le monde, en particulier les commissaires aux lois de l’Assemblée et du Sénat.
Enfin, lors de la réunion d’hier que j’évoquais, les ministres compétents ont fourni des statistiques très précises sur le nombre de gardes à vue, d’assignations à résidence et d’autres procédures. Ces chiffres constitueront la matière du travail qui nous est proposé. De surcroît, le ministre de l’intérieur nous a indiqué – sans que la question lui soit même posée – qu’il avait donné des instructions très claires concernant la traçabilité de chaque acte, chaque décision, chaque procédure, afin de produire un ensemble d’éléments « susceptibles de rendre possible le contrôle parlementaire », a-t-il ajouté.
En clair, nous disposons d’un mécanisme cohérent, efficace et original dont je souhaite qu’il soit mis en œuvre aussi bien que possible sous l’autorité conjointe de notre président et du collègue désigné par le Sénat, en vue notamment de la prochaine réunion bimensuelle qui se tiendra, comme hier, à l’hôtel Matignon.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. J’approuve totalement l’amendement que vous avez fait adopter en séance, monsieur le président, ainsi que le processus que vous nous proposez aujourd’hui afin de doter la commission des Lois des pouvoirs d’une commission d’enquête.
Est-ce à dire que les acteurs qui seront associés aux travaux de notre Commission – fonctionnaires, préfets, inspecteurs généraux, agents des autorités de sécurité, magistrats ou encore délégués du défenseur des droits – seront libérés du secret professionnel lors de leurs échanges avec vous ?
Ensuite, la divulgation des informations recueillies ne gênera-t-elle pas les enquêtes policières en cours ?
Enfin, sur quels moyens humains la commission des Lois pourra-t-elle s’appuyer afin d’accomplir sa mission de commission d’enquête ?
M. Marc Dolez. Le groupe GDR a approuvé la création d’un nouvel article 4-1 dans la loi de 1955 instaurant le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence. De même, il porte aujourd’hui une appréciation positive sur le dispositif que vous proposez, monsieur le président, afin que ce contrôle parlementaire s’exerce pleinement. Comme M. Tourret, toutefois, je m’interroge sur l’association à ces travaux de l’ensemble des groupes politiques de notre Commission. En effet, il n’est prévu de présenter une communication de synthèse à la Commission dans son ensemble que toutes les trois semaines. Autrement dit, les quatre groupes politiques qui n’ont pas désigné de rapporteur risquent d’être laissés à l’écart du contrôle effectif qui sera pratiqué.
M. Jean-Christophe Lagarde. Vous avez, monsieur le président, proposé ce dispositif lors du débat sur l’état d’urgence, et nous avions alors exposé plusieurs difficultés. Tout d’abord, il ne correspond pas à la culture parlementaire française depuis 1958 et, de ce point de vue, le fait de donner au Parlement les capacités réelles de contrôler les pouvoirs qu’il a confiés au pouvoir exécutif représente une évolution très favorable et nécessaire, qu’il s’agisse de l’état d’urgence ou d’autres questions. En outre, c’est une excellente manière de protéger l’exécutif contre ses propres services, qui peuvent parfois prendre des initiatives malheureuses susceptibles de mettre tel ou tel ministre en difficulté. Par nature, le contrôle accentue la vigilance des autorités à l’égard de la pertinence des mesures qu’elles prennent.
Le dispositif que vous nous proposez peut sembler efficace mais présente quelques difficultés. Tout d’abord, il est valable pendant la période d’état d’urgence, mais certaines mesures – d’assignation à résidence, par exemple – pourraient être prolongées au-delà ; il faudrait alors que le contrôle parlementaire se poursuive en conséquence.
La deuxième difficulté a trait à la confiance et à la solidité du consensus national qui a été recherché et qui s’est illustré par le vote quasi unanime de l’Assemblée nationale et du Sénat en faveur de la prolongation de l’état d’urgence. Or, pour que le pouvoir législatif confie des pouvoirs exceptionnels au pouvoir exécutif, chacun doit être associé au contrôle. Pourtant, le dispositif prévu exclut de fait quatre groupes parlementaires du contrôle effectif – et non pas du seul contrôle statistique, qui n’a qu’un intérêt très relatif et dont les conclusions ne peuvent éventuellement servir qu’à envisager des suites législatives. Ainsi, les éléments d’informations qui seront demandés aux autorités pour chaque perquisition administrative et chaque assignation à résidence doivent pouvoir être vérifiés par l’ensemble des groupes. On ne saurait en effet demander aux groupes politiques de soutenir les mesures d’état d’urgence tout en privant certains d’entre eux de la capacité de contrôle. À l’inverse, je serais très réticent à ce que tous les parlementaires puissent vérifier ces éléments dans leurs circonscriptions : se poseraient alors des problèmes de secret des informations.
Précisément, qu’en sera-t-il de l’habilitation ou de l’obligation au secret des parlementaires concernés ? M. Popelin évoquait la Seine-Saint-Denis : il existe en effet quelques départements dans lesquels les difficultés et les personnes surveillées se concentrent et, par conséquent, dans lesquels les perquisitions et assignations sont plus nombreuses. Faute de garantir un niveau de secret suffisant, les services pourraient finir par renoncer à certaines opérations de crainte que les liens entre telle et telle personne soient trop diffusés.
Il nous faudra donc trouver un équilibre – c’est déjà en partie le cas – qui doit notamment s’appuyer sur un partage de la mission de contrôle entre l’ensemble des forces politiques, faute de quoi les groupes qui n’auront pas été associés au contrôle effectif de l’action des services ne pourront pas accepter une nouvelle prolongation de l’état d’urgence. D’autre part, il faut que les informations qui seront demandées aux services – dont la liste que vous nous présentez est très complète – soient assorties d’un degré suffisant de confidentialité pour qu’elles nous soient effectivement fournies.
M. Olivier Marleix. Comme M. Fenech, j’estime qu’il faut ajouter la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice à la liste des interlocuteurs de la Commission. Les perquisitions effectuées peuvent se solder par trois sortes de résultats. Premièrement, l’infraction est assez grave pour être constitutive d’un fait de terrorisme, et c’est alors la section antiterroriste du parquet de Paris qui est saisie par le parquet territorial compétent. Deuxième possibilité : l’infraction est plus légère – détention d’armes, par exemple – et ne constitue pas un fait terroriste et, dans ce cas, c’est au procureur compétent sur le territoire concerné qu’il appartient d’engager des poursuites. Le troisième cas s’apparente à une zone grise dans laquelle les services ont l’assurance que les perquisitions ont permis d’effectuer un « nettoyage » – lequel peut donner lieu à quelques suspicions – et une enquête préliminaire pourra être lancée. Il est essentiel que nous sachions ce qu’il adviendra des procédures engagées dans ces deux derniers cas. Pour ce faire, nous devons avoir une vue plus large que le seul tableau dressé par le parquet de Paris. Nous pourrons ainsi répondre à cette question primordiale : à quoi servent les pouvoirs exceptionnels que nous avons octroyés au Gouvernement en remaniant la loi de 1955, et la justice en tire-t-elle le meilleur parti ?
M. Jacques Bompard. Dans notre République, la notion de défense des droits et des libertés est parfois portée à un degré pathologique, voire liberticide. Nous luttons contre des terroristes sans foi ni loi, mais nos combattants sont ligotés par un extraordinaire arsenal de lois. Je reconnais la difficulté de la situation. Je note toutefois qu’il existe environ huit cents défenseurs des libertés. Je veux dire mon admiration à MM. Urvoas et Poisson, car ils vont devoir livrer un combat contre le terrorisme qui risque fort de les dépasser, quels que soient leurs talents respectifs – telle est mon inquiétude.
M. Daniel Goldberg. Je me félicite de la démarche qu’adopte votre Commission, monsieur le président. Permettez-moi, ayant entendu plusieurs collègues de mon département, de proposer que dans certains départements, le contrôle parlementaire puisse s’exercer sur une zone plus restreinte que l’ensemble du territoire national. En effet, le dispositif prévu vous donnera une vision synoptique de la situation. Il faudrait dans certains départements – la Seine-Saint-Denis et d’autres – collaborer de manière plus étroite avec les services concernés pour vérifier les conditions dans lesquelles les opérations sont conduites et pour cerner les problèmes qui justifient qu’elles aient lieu. Je propose non pas de réunir l’ensemble des maires et des parlementaires concernés pour leur livrer les informations prévues dans votre dispositif, mais de constituer un panel représentatif assez restreint pour respecter la confidentialité des informations, auquel le préfet communiquerait des informations par nature confidentielles mais qui pourraient donner lieu à une discussion ; un tel mécanisme serait très utile et contribuerait aux travaux de votre Commission.
Mme Cécile Untermaier. J’ai noté avec satisfaction que vous aviez prévu, dans le cadre de ce contrôle parlementaire, que les préfets rencontrent les députés. Dans mon département, où nous avons déjà organisé ce type de rencontres, nous sommes convenus d’un rendez-vous mensuel. Quel niveau d’informations pourrons-nous requérir ? Si nous avons eu connaissance d’assignations à résidence, ce n’est qu’une fois le climat de confiance instauré que nous avons pu, selon les cas, disposer d’informations plus fournies. Le ministère de l’intérieur et vous-mêmes ne pourriez-vous pas encadrer de façon plus précise les conditions dans lesquelles se dérouleront ces séances d’information ? Je trouve par ailleurs fort utile que nous soit donnée la possibilité de faire remonter l’information. J’ai d’ores et déjà pu, en effet, mesurer la richesse de ces réunions, constater quelques difficultés, et envisager certaines évolutions procédurales.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je voudrais à mon tour, Monsieur le président, saluer ce travail complet, solide et original, d’autant qu’il a été réalisé en un temps très court – l’urgence appelant l’urgence, y compris des procédures. La note qui nous a été distribuée sera à l’évidence d’une grande utilité lors de la future révision constitutionnelle – même si la boîte à outils qu’offre ce document est extrêmement complète, et si une loi organique peut ensuite décliner certaines mesures ici prévues. Sans faire de la loi-fiction, il me semble que nous sommes déjà dans cette perspective – et je remercie les auteurs de cette note de l’avoir ainsi tracée.
La commission des Lois – transformée en commission d’enquête si j’ai bien compris – procèdera-t-elle dans certains cas à des auditions publiques ? L’essentiel du travail ne s’effectuera pas dans une grande publicité pour des raisons évidentes mais il me paraîtrait utile de prévoir, dans le cadre de l’évaluation – qui, certes, constitue l’une des missions du Parlement mais que vous avez spécifiquement définie dans cette note –, une sorte de séance publique de bilan. Cela nous permettrait de faire taire nombre de rumeurs tenaces et de mettre un terme aux ressentiments et dissensions qui ne sont pas toujours empreints de la plus grande maturité.
Enfin, si la question du rapport entre les préfets et les parlementaires a été soulevée ici à trois reprises, ce n’est pas le sujet du jour. Je comprends qu’il puisse y avoir des problèmes ici ou là. Mais cette relation doit être facilitée par le ministre de l’intérieur qui donne des instructions à ses préfets. Il convient que chaque parlementaire ait avec eux des rapports constructifs et apaisés, suffisamment en amont – sachant que certains territoires sont, plus que d’autres, des nids à difficultés.
M. Philippe Gosselin. Je m’associe à tous les propos qui ont été tenus : cette note est parfaite. Je ne suis d’ailleurs pas certain que son contenu plaide en faveur d’une révision constitutionnelle, madame Bechtel.
Puisque l’on se plaint souvent du nombre excessif de communes en France, j’insisterai au contraire sur le caractère extraordinaire de notre réseau de collectivités locales : nos communes sont autant de points de contact et chaque maire étant aussi officier de police judiciaire, il est déjà doté de par la loi de missions et de responsabilités. Nous devons donc faire fructifier ce réseau et formaliser les relations entre les forces de l’ordre – police et gendarmerie –, d’une part, et, d’autre part, les associations de maires ou les élus locaux directement.
Quant aux relations entre préfets et parlementaires, elles se nouent assez naturellement. Il faut bien sûr qu’elles soient particulièrement suivies et efficaces dans cette période mais c’est globalement plutôt déjà le cas.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je remercie l’ensemble des députés qui viennent d’intervenir pour la qualité et la densité de leurs observations. Depuis le vote de la prolongation de l’état d’urgence, Jean-Frédéric Poisson et moi-même avons cherché à inventer un dispositif, le Parlement n’ayant strictement aucune expérience en la matière. Si c’est la septième fois que notre pays connaît l’état d’urgence, jamais en effet aucune chambre ne s’était lancée dans un travail d’investigation. Au regard de l’ampleur des mesures prises – l’état d’urgence ayant été proclamé sur la totalité du territoire, ce qui n’était le cas ni en 2005 ni en 1985 –, il était indispensable que le Parlement se hisse à la hauteur des responsabilités qui lui sont conférées par l’article 24 de la Constitution : celles de l’évaluation et du contrôle de l’action gouvernementale. C’est pourquoi nous avons cherché à bâtir un dispositif exemplaire, fondé sur la recherche d’une efficacité durable. Cela explique que nous ayons pris le temps d’y réfléchir : le temps de la Commission n’est pas celui de la fébrilité. Nous ne sommes pas dans la réactivité à l’immédiat.
Le dispositif que nous vous proposons s’appuie sur quatre convictions.
Tout d’abord, pour contrôler, il faut savoir. Il est donc nécessaire de bénéficier du plus grand nombre possible d’informations. Qu’il y ait eu cette nuit 106 perquisitions, qu’au total, depuis le début de l’état d’urgence, celles-ci s’élèvent à 2 235, est un fait. Mais cela n’est pas suffisant. Nous avons besoin de savoir où elles se sont produites, dans quels locaux, à quelle heure, qui étaient les personnes présentes, s’il y avait notamment un officier de police judiciaire, si des biens ont été détruits, si des infractions ont été constatées et si des saisies informatiques ont été effectuées.
Nous avons donc bâti un dispositif tenant compte des treize mesures – et j’insiste sur ce point – que permet potentiellement de prendre l’état d’urgence. Toutes n’auront certes pas la même ampleur quantitative. Les dissolutions d’associations ou de groupements ne pouvant résulter que d’une décision prise en Conseil des ministres, je ne pense pas qu’on y ait beaucoup recours. J’ignore si la disposition votée à l’initiative du président Schwartzenberg concernant le blocage des sites internet sera utilisée mais il me semble nécessaire que le Parlement sache sur quelles bases juridiques elle le sera : celles de la loi de 1955, comme nous en avons ouvert la possibilité, ou celles de la loi de novembre 2014 – je rappelle que quatre-vingt-dix sites ont été bloqués depuis lors.
Je souhaite que les informations qui nous seront communiquées – nous étions, ce matin encore, Michel Mercier et moi-même, en réunion de travail avec le ministre de l’intérieur –, et que je veux mettre à la disposition du Parlement, soient quotidiennes. Si vous validez le dispositif proposé, nous donnerons, cet après-midi à quinze heures dans le cadre d’une réunion prévue avec des représentants de l’Intérieur, la totalité des exigences statistiques de notre Commission.
D’abord savoir. Ensuite, connaître. C’est la raison pour laquelle le contrôle ne se fait pas seulement à l’Assemblée nationale : la capacité des parlementaires à écouter les élus locaux apportera des informations. Nous ne pourrons exercer un contrôle que si celles-ci n’émanent pas toujours de la même source. Les faits que je lis comme vous dans les coupures de presse viennent d’une parole qui n’est pas nécessairement la plus objective et qui, en tout état de cause, a besoin d’être confrontée à d’autres points de vue. Je suis d’accord avec Olivier Marleix : une perquisition administrative n’aboutit pas nécessairement au constat d’une infraction. La saisine d’un ordinateur nécessite le temps d’examiner le contenu de celui-ci. Si la perquisition est de nature administrative, c’est précisément parce que la procédure n’est pas « judiciarisable ».
Savoir, connaître, puis interroger. C’est pourquoi – je le précise car cela n’était sans doute pas clair dans mon propos liminaire – la commission des Lois ne devient pas une commission d’enquête : elle s’en donne les pouvoirs, ce qui est fort différent. Cette faculté n’a encore jamais été utilisée ; je m’en suis évidemment entretenu avec le Président Bartolone et la garde des sceaux qui, selon les formes, doit nous confirmer qu’aucune poursuite judiciaire en cours ne s’y oppose.
Savoir, connaître, interroger pour évaluer. Ne nous trompons pas : le Parlement a une responsabilité particulière. Nous ne sommes pas une autorité judiciaire donc nous ne jugerons pas. Nous ne sommes pas une voie de recours dans des procédures juridictionnelles. Nous sommes uniquement ici pour contrôler l’application des mesures prévues – raison pour laquelle je suggère que nous ne nous dispersions pas. Nous ne devons avoir qu’un seul interlocuteur : le ministre de l’intérieur, seul responsable de son administration comme le prévoit la Constitution. Sinon, si l’on s’adresse à tel corps, à tel groupement, à telle direction départementale de la sécurité publique, à telle section de recherche, à tel service central du renseignement territorial, à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), nous risquons d’être submergés.
Il est évident que tout cela sera public. J’aurais dû commencer par là – pardon pour cet oubli ! Nous allons donc ouvrir, dès cet après-midi, sur le site de l’Assemblée nationale une page dédiée au contrôle parlementaire qui fera état des données statistiques que nous publierons, des remontées obtenues et des manques constatés – si nous n’obtenons pas les renseignements que nous avons demandés. Cette page sera actualisée autant que nécessaire – et au moins de façon hebdomadaire. Toutes les trois semaines, je suggère que la Commission ait un débat sur ce sujet de façon à répondre aux interrogations évoquées par Alain Tourret, Marc Dolez et Jean-Christophe Lagarde. Il ne s’agit en aucun cas – bien au contraire ! – d’écarter quiconque du contrôle exercé dans le cadre de la commission des Lois. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas pris le chemin choisi par nos collègues du Sénat, qui ont simplement désigné un rapporteur spécial. Pour moi, toute la Commission est engagée dans ce travail : l’information qui parviendra au rapporteur sera destinée à tous ses membres. La tenue d’un débat toutes les trois semaines permettra du reste de combler le manque d’information des uns et des autres.
De même, il est évident qu’à l’issue de l’état d’urgence, à la fin du mois de février, un rapport sera publié. Celui-ci n’aura pas seulement vocation à être adopté par la commission des Lois mais devra faire l’objet, selon moi, d’une séance publique de contrôle dans l’hémicycle. Là encore, en effet, il ne s’agit pas d’informer la seule commission des Lois – même si celle-ci est le bras armé de notre assemblée : tous les parlementaires sont concernés par l’état d’urgence puisque tous l’ont voté. Et dans cette affaire, je ne crois pas que nous puissions agir par délégation. Ce bilan, présenté lors d’une séance de contrôle, nous permettra de disposer des éléments que vous imaginez.
S’agissant des correspondants, nous devons faire évoluer la position prise au moment où cette note a été rédigée. Ce qu’a dit Georges Fenech est frappé au coin du bon sens : comme nous avons besoin d’informations, il faut viser celui qui, à la Chancellerie, les donne – probablement un correspondant à la direction des affaires criminelles et des grâces. En citant le parquet de Paris dans ma note, c’est à cela que je pensais. Il ne s’agit nullement de bafouer le principe de séparation des pouvoirs, alors que nous en sommes tous les défenseurs, en allant nous immiscer dans la procédure judiciaire.
Naturellement, si la Commission le décide, le Gouvernement assistera à nos travaux. Le ministre de l’intérieur, la garde des sceaux et le Premier ministre ont d’ailleurs dit depuis le début qu’ils souhaitaient que nous soyons pleinement associés à la procédure. Effectivement, monsieur Le Bouillonnec, nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter que le Gouvernement nous informe. Dès le dimanche 15 novembre, le Président de la République a réuni quelques-uns d’entre nous à l’Élysée. Peu de temps après, le ministre de l’intérieur a fait de même, puis le Premier ministre cette semaine. Le Gouvernement informe : c’est à son honneur et c’est sa responsabilité. Le Parlement, lui, doit contrôler. Il ne s’agit donc pas ici de marcher sur des platebandes qui ne nous sont pas communes.
Qu’allons-nous contrôler ? Là est la difficulté. Il n’y a pas de solution toute prête. Comment mesurer l’efficacité des mesures prises par le Gouvernement ? C’est dans le travail collectif que nous parviendrons à le déterminer. Comment évalue-t-on l’efficacité d’un renseignement obtenu ? Chacun d’entre nous aura une culture nourrie de l’expertise que nous pourrons forger au fur et à mesure
Monsieur Goldberg, si nous nous dotons des pouvoirs d’une commission d’enquête, c’est justement pour permettre à Jean-Frédéric Poisson et à moi-même de nous rendre dans les départements – non seulement de jour mais aussi de nuit afin de vérifier sur pièces et sur place la manière dont les mesures autorisées par le Parlement sont appliquées.
Quant à savoir si le secret sera opposé, je considère que les débats de la Commission doivent être publics : ils l’ont toujours été et le sont toujours. Nous n’avons demandé qu’une fois le huis clos pour une audition du directeur général de la sécurité intérieure. Je ne crois pas que quiconque ait à gagner à ce que nos débats deviennent secrets en période d’état d’urgence – bien au contraire. Comme vous le savez, je suis un adepte du philosophe libéral Jeremy Bentham qui considère que l’œil du public rend l’homme d’État vertueux. Je pense donc que nos débats doivent rester publics. Cela étant, certaines règles s’appliquent : je vous renvoie à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui prévoit dans quels cas le secret est levé ou opposable. Ainsi, le secret défense est opposable dans le cadre d’une commission d’enquête. Naturellement, nous respecterons le cadre légal, personne n’ayant proposé à ce stade de le faire évoluer.
Un dernier mot pour vous dire que le contrôle a commencé depuis vendredi : j’ai adressé quotidiennement, sur la base d’informations qui m’ont été transmises, vingt-quatre courriers au ministre de l’intérieur, concernant des cas précis. Treize d’entre eux me sont revenus pour le moment. Nous publierons sur le site de l’Assemblée nationale le taux de réponses obtenu. Il ne s’agit pas de publier ces courriers – chacun le comprendra. Mais à partir d’informations entendues, relevées et lues, il est de notre responsabilité d’interroger le Gouvernement et de la sienne de nous répondre. Le public, quant à lui, doit savoir si nous avons obtenu réponses ou pas. Ce que nous en ferons figurera dans le rapport que nous publierons. Je crois ainsi que nous n’aurons pas été en deçà de ce qu’il était légitime d’attendre de notre part en termes de capacité à inventer un dispositif exigeant et robuste.
M. Jean-Christophe Lagarde. Vous dites que l’ensemble de la Commission sera associé à ce travail. Mais la partie la plus pertinente et la plus précise du contrôle des services de l’État sera réservée aux deux rapporteurs et – désormais – aux deux groupes auxquels ils appartiennent, à l’exclusion des quatre autres.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si c’est aux indications statistiques que vous faites référence, elles n’ont pas seulement vocation à être lues par les rapporteurs. L’anonymisation des données sera évidente mais l’information transmise me paraît devoir être discutée par la Commission.
M. Jean-Christophe Lagarde. Je fais référence à la dernière page de la note que vous nous avez transmise où sont mentionnés les date et heure de début de perquisition administrative, la nature des locaux concernés, les autorités décisionnaires et les services originaires du ciblage. Vous précisez notamment qu’il s’agira « de déterminer l’élément déclencheur de la perquisition » : cette information me semble devoir être accessible à un représentant par groupe politique et non seulement aux rapporteurs.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. On peut en discuter. Mais dans mon esprit, dès lors que ces données sont rendues anonymes, il n’y a pas de raison d’être restrictif dans l’usage qui est fait de l’information. Ce ne sont pas les noms des individus qui m’intéressent mais les conditions dans lesquelles les mesures sont appliquées.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Vous n’avez pas abordé la question de la divulgation de certains éléments au sein de la commission des Lois. Où est la limite ? Ce contrôle ne va-t-il pas gêner les enquêtes en cours ? D’autre part, quels moyens humains seront-ils mis à disposition de la Commission ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Notre vigilance sera nécessairement constante – raison pour laquelle j’ai rappelé que nous n’étions pas autorité judiciaire ni voie de recours dans une procédure juridictionnelle. Il relève de notre déontologie d’y réfléchir. C’est pourquoi nous y travaillons avec les trois administrateurs que la division du contrôle du service des affaires juridiques de notre assemblée a mobilisés à cette fin. Depuis le début, y compris lorsque Jean-Frédéric Poisson et moi avons imaginé ce dispositif, nous avons à l’esprit la nécessité de ne pas outrepasser la compétence de l’Assemblée nationale pour ne pas fragiliser les procédures parfaitement fondées qui pourraient être engagées.
La Commission en vient au vote de la demande d’attribution des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et à la désignation du rapporteur et du co-rapporteur chargés d’assurer un travail de veille, de suivi et de contrôle parlementaire des mesures prises pendant l'état d'urgence.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous propose de demander que la commission des Lois soit dotée, pour une durée de trois mois, des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, ainsi que le permet l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
À l’issue de cette séance, j’adresserai une lettre en ce sens au Président de l’Assemblée nationale. Lui-même saisira immédiatement la garde des sceaux aux fins de savoir si des poursuites judiciaires en cours s’y opposent. Mais je puis d’ores et déjà vous assurer que ce ne sera pas le cas puisqu’il n'est pas question de nous substituer à la justice et que nous agirons dans le respect de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
En application des articles 145-2 et 145-3 du règlement de l’Assemblée nationale, la demande sera alors affichée et notifiée aux présidents de groupes. Si avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission ou le président d’un groupe, la demande sera considérée comme adoptée. Concrètement, nous considérons qu’il devrait en être décidé vendredi matin. Y a-t-il des oppositions à cette intention ?
M. Jean-Christophe Lagarde. Il n’est pas d’usage de formuler des explications de vote en commission mais j’ai entendu votre réponse concernant l’association de l’ensemble des groupes à ce contrôle : vous nous avez indiqués que nous pouvions en discuter. En l’absence de réponse précise, il m’est compliqué d’émettre un vote, raison pour laquelle je m’abstiendrai. Je vais en discuter avec mon groupe qui, évidemment, souhaite être associé à ce travail dans les mêmes conditions que les autres.
Je rappellerai notre philosophie pour éviter tout malentendu. Le contrôle – et c’est pourquoi je faisais référence aux exemples anglo-saxons – doit être exercé par un nombre restreint de parlementaires parce que cette activité, qui consiste notamment à interpeller quotidiennement le ministre de l’intérieur, ne peut être partagée. Que chacun ait le droit d’interpeller les personnes concernées pour se renseigner, est une autre chose. En l’état, et en l’absence de réponse plus précise de votre part, je m’abstiendrai donc.
M. Alain Tourret. Je suis très gêné, Monsieur le président. Il faut que nous trouvions une solution. Historiquement, du reste, c’est toujours avec les petits groupes que se posent les problèmes – les grands trouvant toujours un consensus. Il faut procéder à une association en amont, éventuellement dans le cadre d’une structure intermédiaire, de sorte que vous ayez tous deux, rapporteur et co-rapporteur, la possibilité d’être à chaque fois accompagné d’un représentant de l’un des groupes de l’Assemblée nationale. Il nous faut trouver une solution médiane entre le contrôle quotidien des deux rapporteurs et la réunion de la Commission. Sans quoi nous serons obligés de ne pas participer au vote – et j’en serai très malheureux. C’est pour nous une question de principe.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’entends bien et je suis très attentif à vos observations. La Commission ne change pas son fonctionnement : le bureau de la Commission – qui, depuis trois ans, associe tous les groupes, même ceux qui n’en sont pas membres – continue à exister. Si donc instance réduite il doit y avoir, ce sera le bureau de la Commission.
Nous pouvons bien sûr tout inventer. Mais je veux quand même rappeler le temps que cette affaire exige. Je sais que tout le monde est volontaire lors de nos discussions collectives. Mais qu’en sera-t-il lorsqu’il va falloir mettre l’ouvrage quotidiennement sur le métier ? Les statistiques que nous recevons depuis quatre jours nous parviennent à minuit trente-trois toutes les nuits. Je réunis à ce moment-là la structure – car nous travaillons vraiment en temps réel – et nos interrogations sont adressées au Gouvernement dans la foulée. Je le répète, je suis prêt à tout mais je veux un dispositif robuste, efficace et constant, jusqu’à la fin du mois de février, y compris pendant la période de Noël.
M. Marc Dolez. Je ferai la même remarque que mes deux collègues. Le dispositif proposé est très poussé et particulièrement intéressant. Il serait dommage de ne pas trouver la solution concrète qui permette d’associer tous les groupes.
M. Jean-Frédéric Poisson. Notre groupe votera bien sûr en faveur de cette demande. Je partage l’avis selon lequel le bureau est la structure idoine pour répondre à l’interrogation de nos collègues. Enfin, je rappelle que si la Commission des lois se dote effectivement des attributions d’une commission d’enquête aux termes de l’ordonnance de 1958, cette même ordonnance ne prévoit pas un élargissement spectaculaire de nos capacités quotidiennes d’enquête. Il nous faut donc trouver un équilibre qui permette à la fois à chacun d’être satisfait des informations qu’il récupère et à la Commission de travailler comme elle le doit, dans le respect des règles qui la régissent.
M. Philippe Gosselin. Ne créons pas un comité Théodule. Le bureau existe, il se réunira sans doute plus souvent. C’est vraiment l’instance paritaire idoine qui répondra très bien aux interrogations légitimes de nos collègues.
M. Paul Molac. Je tiens à exprimer ma satisfaction à l’égard de votre proposition : elle était attendue par les Français et permettra de conjuger sécurité et liberté. Je connais votre capacité de travail et votre volonté. Je crois que vous serez – avec, je l’espère, tous nos collègues ici – à la hauteur de la tâche qui nous incombe. Je soutiens évidemment votre idée de recourir au bureau, auquel tous les groupes sont associés.
La Commission adopte la demande tendant à ce que lui soient attribuées les prérogatives d’une commission d’enquête.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous propose à présent de me confier le soin d’assurer, avec les compétences d’un rapporteur, le travail de veille quotidienne, de suivi et de contrôle que je viens d’évoquer. Je vous propose également d’y associer Jean-Frédéric Poisson, qui a été d’ores et déjà désigné avec moi co-rapporteur d’application de la loi du 20 novembre 2015.
Il en est ainsi décidé.
Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mercredi 16 décembre 2015.
(Extrait du compte rendu n° 26)
M. le président Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. Jean-Frédéric Poisson et moi souhaitions faire un point sur l’état d’urgence, un mois après son instauration, et formuler un certain nombre d’observations sur le travail de contrôle que nous effectuons au nom de l’Assemblée nationale et, plus particulièrement, de sa commission des Lois.
Cette première communication, dont nous étions convenus du principe lorsque vous nous avez confié, chers collègues, ces pouvoirs de contrôle, vise à vous présenter de manière assez exhaustive les outils que nous avons mis en place et, surtout, à tirer des premiers enseignements. Je ne reviens pas sur le cadre juridique de notre intervention ; vous le connaissez pour l’avoir adopté.
Commençons par les outils. L’Assemblée ne s’étant jamais livrée à cet exercice, et le contexte évoluant constamment, nous sommes évidemment partis de rien. À mes yeux, les chiffres ne sont pas l’essentiel, mais, en moyenne, chaque jour depuis la proclamation de l’état d’urgence, le Gouvernement a procédé à quatre-vingt-sept perquisitions et prononcé douze assignations à résidence.
Nos outils ne sauraient être solides qu’à deux conditions. D’une part, il faut obtenir régulièrement le plus grand nombre d’informations des ministères de l’intérieur et de la justice. À cette fin, l’article 4-1 de la loi 3 avril 1955 dispose que le Parlement est informé « sans délai des mesures prises pendant l’état d’urgence ». D’autre part, il faut évidemment multiplier les sources afin de croiser les informations, les recouper et les analyser. Voilà qui est plus facile à dire qu’à faire, et de nombreux échanges avec les cabinets du ministre de l’intérieur et de la garde des sceaux ont été nécessaires. Je veux d’ailleurs en souligner la qualité. Si nous avons cru percevoir ici ou là des tentatives de comportements dilatoires, les ministres se sont chargés de rappeler la disponibilité du Gouvernement vis-à-vis du pouvoir législatif. Nous disposons d’ailleurs de deux lettres, l’une du ministre de l’intérieur, datée du 1er décembre, l’autre de la garde des sceaux, datée du 9, qui expriment de manière formelle et sans ambiguïté cette disponibilité de leurs services.
Quels sont nos moyens d’investigation ? Le premier, ce sont des saisines quotidiennes – j’insiste sur le qualificatif – du ministre de l’intérieur. Commencées dès avant notre réunion du 2 décembre dernier, elles se poursuivent. Elles concernent les mesures administratives, générales ou individuelles prises, pour l’essentiel, par les préfets et par le ministre lui-même, car c’est bien celui-ci qui peut décider les perquisitions administratives et les assignations à résidence.
Ces saisines portent sur des faits relevés dans les différents médias, dont nous avons instauré une veille aussi attentive que possible, ou signalés par courrier, notamment par les parlementaires. Jean-Frédéric Poisson et moi-même vous avions écrit le 8 décembre pour vous dire notre disponibilité. À ce jour, quatre collègues nous ont répondu, en appelant notre attention sur des faits survenus depuis l’instauration de l’état d’urgence dans leur département ou dans leur circonscription. Nous recevons également des communications du Défenseur des droits, que nous avions sollicité, pour qu’il mette en alerte ses délégués territoriaux. Le Défenseur a désigné un interlocuteur unique ; depuis l’établissement de ce lien, onze sujets de vigilance ont été portés à notre connaissance. Nous recevons aussi du courrier d’avocats – le Conseil national des barreaux nous avait indiqué le 1er décembre qu’il était mobilisé sur ce sujet. Enfin, nous sommes sollicités par des collectifs associatifs.
Lorsque des informations sont données, nous ne répondons pas à ceux qui nous les envoient – nous n’en avions pas pris l’engagement —, mais nous nous servons des éléments qui nous paraissent les plus intéressants pour interroger le ministre. Ainsi, entre le 27 novembre et le 15 décembre, nous avons écrit cinquante-huit lettres, qui concernent trente-sept départements. Quarante-deux visent des perquisitions, dix des assignations à résidence, six des mesures générales de police administrative, comme des interdictions de manifester ou des couvre-feux décidés dans telle ou telle commune. Le ministre a répondu à quarante et une de ces lettres, soit un taux de réponse de 77 %, mais il a promis hier qu’il répondrait à toutes, sans aucun délai. Nous n’avons donc pas de raison de nous inquiéter, et nous lui laissons un peu de temps, car nous souhaitons que ses réponses soient extrêmement précises. Lorsqu’elles ne le sont pas suffisamment, nous lui envoyons un courrier complémentaire.
Ce sont ces informations qui nourrissent la page du site internet de l’Assemblée dédiée au contrôle. Nous veillons cependant à respecter la confidentialité qui s’attache, par essence, à ces courriers. Nous sommes également constamment attentifs au fait que notre contrôle porte sur l’usage par le Gouvernement des mesures prévues par la loi de 1955. Il ne saurait être question, pour nous, de porter atteinte à la séparation des pouvoirs.
Notre deuxième outil, ce sont les alertes des associations. Dès le 9 décembre, nous avons sollicité la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) afin que les trente associations, syndicats et ONG qui y siègent puissent nourrir notre réflexion. J’ai confirmé notre disponibilité lors de l’assemblée plénière de la CNCDH qui se tenait dans nos murs, le 10 décembre dernier. La CNCDH m’a indiqué à cette occasion qu’elle rendrait le 15 février prochain un avis sur l’état d’urgence. Nous verrons quelles suites les associations donnent à cet échange. Certaines, comme l’Observatoire international des prisons, ont indiqué leur intention de nous transmettre des éléments.
Les déplacements sur le terrain sont notre troisième outil, en vertu du pouvoir de contrôle sur place et sur pièces dont vous nous avez investis. Le premier déplacement a eu lieu dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 décembre, à la préfecture du Val-de-Marne. Nous avions annoncé notre arrivée, effectivement imminente, au préfet de ce département où ont eu lieu soixante-quatorze perquisitions et où dix personnes sont assignées à résidence. En présence de toutes les autorités de police, y compris, pour Orly, la police de l’air et des frontières et la gendarmerie des transports aériens, et de la procureure de Créteil, nous avons examiné le détail des mesures prises et les conditions de leur préparation, ainsi que les modalités de coordination entre les différents services de l’État, notamment l’éventuelle articulation entre autorités administratives et parquet. D’autres déplacements auront lieu, demain, mais aussi mardi prochain, et peut-être tous les jours au cours de ces vacances parlementaires qui libèrent quelque peu notre agenda. Il y a des perquisitions et des assignations pendant les vacances, il y aura donc aussi des contrôles !
Notre quatrième outil, le recueil de données statistiques auprès du Gouvernement, est évidemment la source d’information la plus massive en volume.
Il y a tout d’abord les données chiffrées dites « de synthèse », dont le Gouvernement dispose depuis le premier jour de l’état d’urgence. Formant la base de l’information qu’il diffuse régulièrement et récapitulant le nombre des mesures et le contentieux administratif auquel elles donnent lieu, elles sont intégralement publiées sur la page internet de l’Assemblée nationale et font l’objet d’une actualisation hebdomadaire, en général le vendredi soir. Ces seules indications n’étaient cependant pas suffisantes. Nous avons donc demandé au ministère de la justice de construire des données relatives au suivi judiciaire de l’état d’urgence, en se fondant sur les informations transmises par les parquets généraux. La Chancellerie a publié ce matin un communiqué dont les informations que nous lui avions demandé de collecter forment la matière. Je me félicite que nous ayons ainsi pu pousser le Gouvernement à améliorer l’information délivrée aux citoyens. Nous examinons actuellement le détail de ces informations, notamment les suites pénales des perquisitions ainsi que les sanctions prononcées en cas de non-respect des mesures administratives.
Il y a ensuite les informations détaillées relatives à chacune des mesures administratives, qui n’étaient pas disponibles au cabinet du ministre de l’intérieur, mais toutes nos exigences en termes d’information sur chacune des mesures prises depuis le 14 novembre dernier ont été satisfaites. Avec plus de 2 700 perquisitions menées depuis un mois, le stock est considérable et le flux constant. Nous sommes convenus, avec le ministre, d’apurer le flux quotidien. Ainsi, nous recevons quotidiennement les informations demandées sur les perquisitions, assignations et autres mesures administratives — pour une seule perquisition, les informations comportent une vingtaine d’items. Quant au stock, le ministre a pris l’engagement qu’il serait repris avant le 20 décembre. Pour l’instant, l’Assemblée nationale dispose d’informations sur 500 perquisitions, sur 2 700, mais toutes ne sont pas aussi documentées que nous le souhaitons. Nous demanderons donc des compléments d’informations.
Nous attendons beaucoup de ces indicateurs que nous avons construits. Ce sont eux qui nous donneront une connaissance fine et détaillée de l’application de l’état d’urgence. Ce sont aussi eux qui nous permettront d’organiser nos déplacements dans les départements. Ce sont eux, enfin, qui permettront une analyse quantitative et qualitative des pouvoirs momentanément accordés aux services de sécurité intérieure.
Le contrôle parlementaire a d’ores et déjà montré son utilité, puisqu’il a poussé le Gouvernement – autant le ministère de l’intérieur que celui de la justice – à structurer sa remontée d’informations, notamment sur certaines mesures insuffisamment observées, comme les restrictions de circulation et les interdictions de manifester. Nos échanges avec le Gouvernement se sont très bien passés et nous ont permis de mesurer les potentialités que nous avions devant nous.
J’en viens aux premiers enseignements.
Je veux d’abord souligner une dynamique vertueuse entre les préfets et les parquets, constatée dans nos contacts. Les mesures administratives étant susceptibles de donner lieu à la découverte d’éléments pouvant caractériser des infractions pénales, leur articulation avec les procédures judiciaires doit être parfaitement assurée. Il est ainsi prévu qu’un officier de police judiciaire territorialement compétent soit présent au cours des perquisitions. Le lien entre les préfets et les procureurs n’est pas seulement réel, mais essentiel, et, à l’évidence, la collaboration née à l’occasion de certaines politiques publiques, dans les zones de sécurité prioritaire, a été un solide point d’appui.
Deuxième enseignement, il ne faut pas se focaliser sur les faits publics. Le recensement des perquisitions évoquées par la presse est une source précieuse d’informations, mais se limiter à ces cas, qui ne peuvent à eux seuls permettre d’appréhender globalement les mesures prises, conduirait à une vision très partielle de l’efficacité de l’état d’urgence. Aussi spectaculaires soient-elles, les perquisitions ne constituent que l’une des treize mesures que le Gouvernement peut prendre en vertu des sept articles que comporte la loi sur l’état d’urgence. Et la comparaison des réponses du ministre aux récits que nous pouvons lire, dans notre courrier ou dans la presse, fait ressortir des différences significatives dans la moitié des cas. Ainsi, les faits souvent spectaculaires relayés publiquement – le non-respect des règles relatives aux sommations, l’investissement brutal de locaux, la prise à partie d’occupants, parfois mineurs – n’apparaissent pas dans les réponses ministérielles, dont les plus précises indiquent seulement qu’aucune indemnisation n’a été demandée, qu’aucun recours n’a été formé.
Qu’en conclure ? Devons-nous aller plus loin dans nos investigations ? Est-ce notre mission ? Le cas échéant, comment faire ?
Cela nous amène à un troisième constat : nous devons définir avec précision le périmètre de notre action. Si les cas individuels sur lesquels nous avons travaillé ne répondent pas à toutes les questions, ils nous ont permis d’aller plus loin dans l’organisation de notre contrôle. Pour éviter toute ambiguïté, il faut circonscrire avec précision le champ de notre action. L’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 mentionne à la fois « le contrôle et l’évaluation » par le Parlement des mesures prises.
Primo, l’un des buts du contrôle parlementaire est bien de chercher à mesurer l’intérêt de ces mesures exceptionnelles. Le contrôle doit ainsi chercher à mesurer quelle plus-value apporte l’état d’urgence, en termes d’efficacité de la lutte contre le terrorisme, par rapport au droit commun. Secundo, conduire une évaluation, c’est démontrer que l’encadrement démocratique de l’exception fait partie intégrante du processus de protection de l’État et de ses citoyens. Loin d’être une concession à la marge, l’innovation que représente ce contrôle parlementaire est au contraire la source de la légitimité de ce moment d’exception que nous vivons, et les observations formulées doivent permettre d’éviter la routinisation de certaines mesures dérogatoires au droit commun, qui pourrait conduire à une entreprise de rationalisation de l’exception et de ses usages. C’est à cette fin que l’étude de cas particuliers peut se révéler utile, selon la méthode du « carottage » –un cas particulier servant à approfondir tel ou tel point.
Nous avons ainsi étudié, entre autres, les mesures préventives prises en lien avec la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dite « COP21 », puisque le Gouvernement a utilisé les prérogatives de l’état d’urgence pour maintenir l’ordre durant ces deux semaines. L’application de ces mesures fut limitée dans le temps et dans l’espace. Ainsi furent décidées par le ministre des interdictions de manifester, des interdictions de séjour et vingt-sept assignations à résidence. Le Conseil d’État a jugé, le 11 décembre, que celles des assignations dont il était saisi « n’étaient manifestement pas illégales », leur conformité à la Constitution faisant l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité dont il a accepté qu’elle soit transmise au Conseil constitutionnel.
L’état d’urgence, c’est, de notre point de vue, l’alliance de la force et du droit, c’est l’articulation entre les principes de nécessité et de proportionnalité qui limitent toute action de police administrative. De ce point de vue, des interrogations manifestes existent sur la justification de certaines mesures individuelles – perquisitions, assignations à résidence — ou générales — interdictions de manifester. Il est en effet encore trop tôt pour mesurer la tension qui pèse sur les forces de l’ordre et qui pouvait justifier ces mesures – ce serait donc la nécessité dont le ministre peut légitimement se réclamer. Cependant, dans le département de la Dordogne, par exemple, les mesures apparaissent manifestement disproportionnées.
Plus généralement, ces mesures préventives interrogent sur la finalité et le périmètre de l’état d’urgence. Celui-ci doit-il viser au maintien de l’ordre public dans son ensemble ou être concentré sur la seule lutte contre le terrorisme ? Elles nécessitent donc de notre part des approfondissements sur la caractérisation d’un certain nombre de faits, voire sur la notion de « comportement » dangereux, dont nous avons débattu lors de l’examen de la loi sur l’état d’urgence. Je rappelle que la loi de 1955 visait les personnes « dont l’activité s’avère dangereuse » ; elle s’applique désormais à toute personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace ». Alain Tourret avait soulevé cette question, nous devrons l’approfondir.
Enfin, nous souhaitons rappeler les mesures d’accompagnement. L’état d’urgence ne suspend pas l’application des autres lois et ne dispense pas d’un devoir de transparence. Le Gouvernement contribue à celle-ci en informant régulièrement le Parlement – hier encore, les présidents des commissions concernées du Sénat et de l’Assemblée nationale et les présidents de tous les groupes parlementaires étaient réunis autour du Premier ministre –, mais nombre d’entre vous ont souligné, à raison, l’importance de l’information du public. De même, l’information des élus paraît incontournable, mais la situation est très différente d’un département à l’autre : des préfets sont extrêmement proactifs, d’autres beaucoup plus mesurés dans le partage de l’information.
Nous devons veiller aussi à une juste et rapide indemnisation des dommages causés à mauvais escient. De ce point de vue, nos premiers constats laissent apparaître des marges manifestes de progression. Nous allons donc inciter le Gouvernement à réaliser les progrès indispensables.
Telles sont les premières observations que nous voulions porter à votre connaissance. Nous avons également veillé à ce que vous disposiez d’un écrit qui résume nos propos, pour éviter toute mésinterprétation.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. Je souscris sans réserve aux propos du président Urvoas. Cette opération de contrôle et d’évaluation est parfaitement novatrice. Évidemment, nous essuyons les plâtres, et nous devons en quelque sorte apprendre en marchant, ce qui peut susciter quelques interrogations et hésitations. Nous n’en avons pas moins réussi à obtenir du Gouvernement des informations précises en mettant en place des indicateurs appropriés et fiables. Cela restera.
Je suis régulièrement sollicité, comme sans doute nombre d’entre vous, chers collègues, par des journalistes qui craignent d’éventuelles dérives ou s’interrogent sur des cas particuliers. Le premier intérêt de ce contrôle parlementaire est de signaler les problèmes, de lever les doutes et de donner les assurances nécessaires. Lorsque les droits fondamentaux des personnes sont en jeu, le fonctionnement de la démocratie ne saurait laisser place à quelque hésitation. Bien sûr, nul système n’est parfait, mais je veux souligner, moi qui ne suis guère soupçonnable de flagornerie à l’égard du Gouvernement, que les ministres et leurs services nous répondent avec soin.
J’insiste aussi sur la nécessité de qualifier précisément les faits qui nous sont rapportés – cela vaut tant pour le Gouvernement que pour les sources évoquées tout à l’heure. Nous devrons peut-être compléter ou modifier la loi. Pour le faire avec la plus grande justesse, nous devrons bien comprendre quels manquements, failles ou exagérations peuvent, en la circonstance, affecter l’action des pouvoirs publics. Nous cherchons ainsi à comprendre comment et pourquoi telle ou telle décision est prise – c’était l’objet de cette visite de deux heures à la préfecture du Val-de-Marne, la semaine dernière. Pourquoi intervient-on ? Pourquoi telle personne est-elle perquisitionnée plutôt que telle autre, que l’on pourrait croire plus radicalisée ? Les services sont soumis à certains impératifs et agissent avec professionnalisme, il ne s’agit pas d’user bêtement des prérogatives de l’état d’urgence. Le travail peut se poursuivre normalement, dans le respect des procédures habituelles, mais, comme nous avons pu le constater dans l’immense majorité des cas portés à notre connaissance, l’état d’urgence présente l’intérêt de permettre des opérations qui ne seraient pas possibles autrement.
Voilà qui pose la question de son éventuelle prolongation. Nos interlocuteurs ont été à peu près d’accord avec nous : passé le premier mois et demi, la courbe d’utilité va probablement décroissant, et, au terme des trois mois, tous ceux qu’on voulait perquisitionner ou assigner à résidence risquent de s’être organisés autrement, et d’être sortis des écrans radars. C’est une question opérationnelle qu’il faudra considérer. Plus généralement, l’évaluation de cette période est essentielle pour vous permettre, le cas échéant, de vous prononcer sur une éventuelle prolongation de l’état d’urgence. J’ai cru comprendre qu’il ne fallait pas exclure que le Parlement soit saisi en ce sens.
J’évoquerai, pour terminer, trois problèmes opérationnels qui ressortent de nos entretiens et des documents que nous recevons.
Le premier, c’est la question de l’information des élus – le président Urvoas en a dit un mot. Le ministre de l’intérieur avait donné aux préfets instruction de réunir les parlementaires et élus de leurs départements respectifs. Diversement suivie jusqu’à présent, la consigne est réitérée, nous a indiqué hier M. le ministre de l’intérieur – j’imagine que toutes les préfectures de France et de Navarre vont recevoir un mot doux invitant à la tenue de cette réunion. Cela concerne l’information institutionnelle, structurée, mensuelle, pour laquelle il est difficile de procéder autrement, mais il y a aussi l’information au jour le jour des élus locaux, sur laquelle nous insistons toujours.
Bien évidemment, si des dispositions sont prises dans leur commune au titre de l’état d’urgence, un tri doit être fait. Tout le monde comprend que le maire ne puisse être prévenu la veille d’une perquisition dans sa commune. Peut-être même ne peut-il pas être prévenu non plus le lendemain, puisqu’une perquisition peut en appeler d’autres. En revanche, les assignations à résidence sur le territoire dont il a la charge sont un autre cas de figure. Il serait tout à fait baroque que les maires, acteurs de la vie publique et qui détiennent de nombreux renseignements, apprennent « par la bande », par la presse ou par leurs conseillers de quartier que des personnes sont assignées à résidence dans leur commune. Un équilibre doit être trouvé, dont les modalités précises ne sont pas définies, mais nous insistons sur cette question – je l’ai encore fait hier à Matignon.
Le deuxième problème est celui de l’utilité des gardes statiques, sur lesquelles nous recueillons aussi quelques impressions. Nos sources nous invitent à préserver leur anonymat, je ne les révélerai donc pas, mais cette interrogation paraît assez largement partagée. Certes, la question n’entre pas dans le champ de la loi, mais la doctrine d’emploi des forces de l’ordre doit être interrogée. On finit par se rendre compte que, dans certains cas, les gardes statiques présentent plus d’inconvénients que d’avantages, à tel point que le ministre de l’intérieur a décidé d’octroyer une semaine de congé, par roulement, entre le 18 décembre et Noël, pour que tout le monde se repose.
Le troisième problème est celui de l’information des citoyens sur les préjudices subis. Le ministre de l’intérieur, comme le préfet du Val-de-Marne à son niveau, font preuve de transparence sur les erreurs commises dans le cadre d’interventions, principalement des perquisitions. Par exemple, deux erreurs d’adresse ont été commises. Nous avons demandé si les forces de l’ordre ou le commissionnaire divisionnaire étaient retournés s’excuser auprès des habitants, qui ont dû être surpris, et prendre des nouvelles ; visiblement, cela a été fait. En revanche, aucune procédure n’est prévue quand l’État est fautif, et il l’est en l’espèce – il le reconnaît lui-même. Un formulaire type, une adresse, un numéro de téléphone ou un quelconque moyen devraient permettre de demander une indemnisation. Lorsqu’un bailleur social est concerné, c’est plus facile : un intermédiaire organisé discute avec la puissance publique. Dans le cas de particuliers dont la résidence ne se situe pas dans un groupement quelconque, il faudrait accélérer ce genre de procédure.
Je confirme donc l’utilité de ce contrôle parlementaire de l’état d’urgence. Certes, de temps en temps, nous pouvons avoir l’impression de bousculer quelques habitudes au sein des cabinets ministériels, mais, après tout, nous ne faisons que notre travail : le rôle de contrôle du Parlement est inscrit dans la Constitution. En l’occurrence, l’utilité du suivi mis en place par la Commission n’est pas à démontrer.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Vous nous avez écrit, monsieur le président, que le Parlement n’était ni une autorité judiciaire ni une voie de recours supplémentaire. Dont acte. Pour ma part, je vous ai écrit, avec Georges Fenech, une lettre assez détaillée, le 9 décembre dernier.
Je me pose plusieurs questions.
Vous voulez évaluer l’efficacité des mesures prises, mais, franchement, de quels moyens disposez-vous pour vérifier que les informations fournies par une administration centrale sont pertinentes ?
Par ailleurs, ces derniers temps, je n’ai nullement entendu parler des GIR, les groupes d’intervention régionaux, qui regroupent les services des douanes et du ministère de l’économie et des finances, la gendarmerie et la police. Sont-ils sollicités dans le contexte actuel ? Sont-ils utiles ?
En ce qui concerne le zèle des préfets, je crains que la presse ne publie un jour quelque carte de l’efficacité des différents préfets. La question a-t-elle été abordée ?
Tout repose, aujourd’hui, sur la qualité du renseignement, mais, si j’en crois leurs propos, certains gendarmes n’ont pas beaucoup apprécié qu’aient été supprimés les FAR, ces fichiers alphabétiques de renseignements dont ils disposaient dans leurs unités territorialisées et qu’ils alimentaient eux-mêmes, pour un usage interne. Ils regrettent également de ne guère accéder à beaucoup d’informations sur les individus qu’ils peuvent côtoyer ou arrêter. La commission se penchera-t-elle sur la question de la qualité du renseignement ? Il n’y a pas de malice dans ma question.
Les perquisitions s’accélèrent depuis le 13 novembre dernier, mais pourquoi n’ont-elles pas eu lieu auparavant ? Je sais bien qu’il s’agit de perquisitions administratives et pas judiciaires, mais tout de même… 2 700 perquisitions, c’est curieux ! Notre système d’information n’était-il pas suffisamment développé ? Et peut-être le rythme des perquisitions ralentira-t-il bientôt, si, comme l’a suggéré Jean-Frédéric Poisson, les circuits se réorganisent.
Je suis très heureux de ce que vous faites, monsieur le président, mais je m’interroge quelque peu sur la nature et l’efficacité de votre action de contrôle.
M. Alain Tourret. Le contrôle auquel vous vous livrez actuellement avec notre collègue Jean-Frédéric Poisson est essentiel, monsieur le président, et renforce l’état de droit. Le mérite vous en revient principalement, je tiens à vous le dire.
Cela dit, peut-on connaître le nombre des gardes à vue et la durée de chacune ? La question se pose de savoir si la durée de la garde à vue peut ou doit être allongée en matière de terrorisme. Actuellement, elle est de six jours au plus.
Dans quelles mesures les perquisitions ont-elles été suivies de saisies ? Le cas échéant, étaient-ce des saisies habituelles ou des saisies informatiques ? Avec Roger-Gérard Schwartzenberg, nous avions beaucoup insisté sur le problème des saisies informatiques. Au regard du code de procédure pénale, c’est totalement nouveau.
Quant aux référés-liberté, qui sont l’autre aspect du contrôle de l’état d’urgence, le contrôle judiciaire, qui s’ajoute à notre contrôle politique, j’ai cru lire dans la presse que tous avaient été rejetés, mais pourriez-vous me renseigner ? Et a-t-on le texte des arrêts rendus par le juge administratif ? Leur motivation devrait nous permettre de déterminer sur quoi doit porter notre propre contrôle.
En ce qui concerne l’exploitation du renseignement, évoquée par notre collègue Pierre Morel-A-L’Huissier, deux types de dossiers peuvent être distingués : les nouveaux dossiers et ceux déjà détenus, soit par la police, soit par la magistrature. Or les informations dont nous disposons à propos de l’attentat du Bataclan me laissent extrêmement songeur – je n’en dirai pas plus, mais nous pourrons peut-être en parler ensemble, monsieur le président. Manifestement, il existe des mines de renseignements qui ne sont pas utilisées ; c’est très grave. En ce qui concerne les dossiers en cours, que peut faire l’autorité judiciaire dans le respect du secret de l’instruction ? Quels documents peuvent être produits ? La principale mine de renseignements, ce ne sont pas les actions menées actuellement, c’est le travail entamé depuis des mois, sinon des années. Quant aux dossiers qui viennent d’être ouverts, le renseignement doit, si possible, être exploité en temps réel. Il faut, monsieur le président, que vous sachiez ce qui a été tiré des renseignements obtenus ; c’est indispensable, et c’est toute la chaîne qu’il faudra étudier. Sinon, ce contrôle sera purement formel.
Le but est d’obtenir des résultats. Les mesures d’exception prises doivent permettre de prévenir, ou, éventuellement, de sanctionner.
M. Dominique Raimbourg. Il faut progresser sur la question de l’indemnisation des dégâts de perquisitions qui se révèlent vaines. Cette indemnisation doit être rapide. Il ne faut pas que la personne perquisitionnée doive avancer trop longtemps le montant de la réparation de sa porte fracturée.
Nous devons d’autre part nous interroger sur la question de la sortie de l’état d’urgence, et, pour cela, pouvoir mesurer son efficacité. Les perquisitions débouchent-elles sur des gardes à vue, puis sur des suites judiciaires ? La question de la prolongation de cette situation va se poser. Nous devons donc pouvoir évaluer dans quelle mesure les dispositions prises permettent d’engager des poursuites. Et, ensuite, il faudra revenir au droit commun, aux règles ordinaires de l’État de droit.
Le Parlement peut se féliciter de ce travail de contrôle auquel vous vous livrez. C’est une initiative nouvelle, originale. Vous innovez, nous innovons tous, collectivement. Il n’en faut pas moins que cela nous permette de déterminer dans quelle mesure prolonger l’état d’urgence serait nécessaire.
M. Erwann Binet. Vous l’avez rappelé, monsieur le président : le périmètre de l’état d’urgence est, par essence, très circonscrit, c’est une évidence, et l’usage par le Gouvernement des outils mis à sa disposition par la loi de 1955 vise un objectif précis : la lutte contre le terrorisme. Cependant, sur le terrain, les perquisitions ont des effets collatéraux. Elles peuvent en effet permettre la découverte d’infractions à d’autres législations qui ne relèvent pas de la lutte contre le terrorisme. Je ne parle pas de la détention d’armes, qui peut, directement ou indirectement, y être liée, mais des infractions à la législation sur le droit au séjour des étrangers ou encore aux règles sanitaires. C’est l’objet d’un article que je vous ai fait parvenir, monsieur le président : en Savoie, des restaurants ont été fermés pour cette raison. Il s’agit donc d’examiner les suites données aux perquisitions à la lumière des motifs pour lesquelles elles ont été menées. De quels moyens disposez-vous pour ce faire ?
Par ailleurs, j’ai cherché à obtenir des informations d’associations qui, sur le terrain, notamment dans la région lyonnaise et le nord de l’Isère, ont entamé assez rapidement un travail de veille et d’accompagnement des familles qui ont fait l’objet de perquisitions. Ce qui me frappe, c’est qu’il est très difficile d’obtenir des éléments objectifs. Sont évoqués le comportement des forces de l’ordre, les interrogations des habitants sur les motifs pour lesquels ils ont été perquisitionnés et les effets des perquisitions sur l’environnement immédiat et le voisinage. Les personnes perquisitionnées ont la terrible impression d’avoir subi une humiliation. Ainsi, dans ma circonscription, une famille a été perquisitionnée pour des raisons auxquelles elle avait très peu à voir. Certes, la perquisition s’est déroulée dans des conditions assez respectueuses, mais, en province, dans un petit quartier, ce n’est évidemment pas discret, et cela laisse des traces, notamment cette impression d’humiliation. Dominique Raimbourg a fort justement parlé des dégâts matériels, notamment ceux infligés aux portes, mais il serait important d’examiner également la question des réparations symboliques.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Les services peuvent-ils déterminer dans quelle mesure les assignations à résidence et perquisitions ont plutôt concerné les zones de sécurité prioritaires ? Leurs habitants craignent d’être plus particulièrement visés, au motif qu’ils seraient potentiellement inquiétants ou dangereux, tandis que les autres seraient forcément de bons citoyens. Je ne demande pas que nous disposions d’une cartographie : préservons le déroulement des enquêtes et reconnaissons le professionnalisme des services placés sous l’autorité des préfets et des services judiciaires. Avons-nous, cependant, connaissance de tels phénomènes ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. Madame Le Dain, vous avez raison, il faut sans doute commencer par se demander qui est concerné, comment sont identifiés ceux qui font l’objet d’une perquisition ou d’une assignation à résidence. Jean-Frédéric Poisson et moi nous posons ces questions, et c’est pour cela que notre contrôle n’est pas en chambre : nous nous rendons dans les préfectures, nous y voyons les chefs des services – de tous les services, police judiciaire, renseignement territorial, sécurité intérieure, sécurité publique, gendarmerie… Nous examinons alors des cas précis, sur lesquels nous avons pu être amenés à nous interroger : nous demandons qui est à l’origine de la mesure prise, ce qui s’est concrètement passé.
À l’échelle nationale, le ministre de l’intérieur a créé un état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), qui siège place Beauvau. Présidé par le ministre lui-même, il se réunit de façon extrêmement régulière. C’est là que sont passés au crible les objectifs des perquisitions et des assignations à résidence, sur la base sans doute des informations qui reviennent des départements. À votre question, je réponds donc par l’affirmative. Ce n’est pas tel ou tel préfet qui prend telle ou telle initiative : la réflexion se tient bien dans un cadre national.
Une grande partie des mesures administratives sont d’ailleurs signées, non pas par le préfet, mais par le ministre de l’intérieur lui-même.
Toutes les questions qui viennent d’être soulevées touchent au cœur du problème : nous sommes là pour préparer le jour d’après, c’est-à-dire le 26 février. Si le Gouvernement devait nous demander la prorogation de l’état d’urgence au-delà de cette date, notre devoir serait, à notre sens, de fournir à l’Assemblée nationale une grille de lecture de ce qui s’est passé pendant ces trois mois d’état d’urgence. Quelle est la plus-value de l’état d’urgence par rapport au droit commun, en matière de lutte contre le terrorisme ? Voilà la question que nous nous posons. Une grande partie des questions que vous m’avez adressées, monsieur Morel-A-L’Huissier, avec M. Fenech, touchent d’ailleurs précisément au droit commun – je pense notamment à celles qui portent sur le RAID, la BRI, le GIGN, les GIR... Ce n’est pas aujourd’hui notre sujet.
Vous nous avez interrogés sur les fichiers alphabétiques de renseignements (FAR) de la gendarmerie. À ma connaissance, ils existent toujours. Ils ont été intégrés à la base de données de sécurité publique (BDSP), qui est l’outil de la gendarmerie – et d’ailleurs à mon sens l’un des meilleurs outils de collecte de l’information au plan national. La police ne dispose pas d’équivalent de la BDSP, dont je précise que l’accès est restreint. Le renseignement, qu’évoquait Alain Tourret, est aussi un outil de droit commun, qui fonctionne.
Il y a une plus-value de l’état d’urgence, c’est évident. Mais quelle est son efficacité ? Quel doit être le périmètre de l’état d’urgence ?
Quels moyens avons-nous de vérifier la véracité des informations qui nous sont fournies par le ministre ? Tout d’abord, vous nous avez accordé les pouvoirs d’une commission d’enquête. Nous mentir est une infraction pénale. Nous organiserons donc ici même des auditions soutenues, après prestation de serment, afin de croiser les informations avec celles qui nous auront été délivrées lors de nos visites sur le terrain.
Erwann Binet a raison : dans les éléments matériels dont nous disposons, le sentiment d’humiliation, comme le non-respect de sommations, n’apparaît pas. Un dialogue avec les individus est donc nécessaire. Sur le terrain, nous voyons évidemment les chefs de service, mais nous n’écartons pas l’idée de rencontrer également les commissaires ou les commandants de brigade qui ont procédé aux investigations. Cela implique que nous disposions d’éléments suffisants pour poser des questions précises : nous ne faisons pas cela pour le plaisir de la conversation... C’est pourquoi nous procédons à un carottage : nous n’allons pas étudier les 2 721 perquisitions qui ont eu lieu jusqu’à présent.
Monsieur Tourret, les chiffres qui m’ont été fournis hier soir indiquent qu’il y a eu 273 gardes à vue, à la suite des 2 721 perquisitions, des 419 infractions constatées et de la découverte de 434 armes. Nous n’interrogeons pas le ministère sur la durée de ces gardes à vue, et vous faites bien de nous signaler ce point : nous allons nous y intéresser de plus près.
Les saisies informatiques font partie des vingt-quatre items de notre liste. Nous avons d’ailleurs débattu de cette question avec des chefs opérationnels : pendant le débat parlementaire, la question de savoir s’il fallait prévoir une saisie du matériel informatique, ou si une simple copie était suffisante, s’est posée ; le Parlement a décidé que la copie suffisait, les éléments dont je disposais comme rapporteur me semblant aller dans ce sens. Nous vérifions sur le terrain si c’est bien le cas.
Monsieur Raimbourg, la proportion des perquisitions administratives débouchant sur une procédure judiciaire est aujourd’hui limitée, puisqu’elle est de 20 %. Mais faut-il en conclure à l’inefficacité de la perquisition ? Il faut en effet du temps pour analyser la copie des données informatiques. De plus, une perquisition peut permettre de dissiper une suspicion née de faisceaux d’indices qui paraissaient converger. Si quelqu’un peut nous dire précisément, statistiquement, ce qu’est l’efficacité, nous en serons très heureux ! Pour le moment, nous tâtonnons.
Les informations de la Chancellerie n’ont commencé à nous arriver qu’hier : le processus est naturellement plus long. Dans beaucoup de cas, nous n’en sommes qu’au stade de l’information préliminaire, et les parquets ne sont pas encore saisis. Nous aurons rapidement le détail des détentions provisoires, que nous avons évidemment demandé, ainsi que le détail des incarcérations en exécution de peine. Nous pourrons ainsi mieux lire le chiffre brut des incarcérations.
Le territoire n’est pas concerné de manière uniforme : c’est la raison pour laquelle nous allons diversifier nos déplacements, en nous rendant dans différents départements, y compris certains qui ne viennent pas spontanément à l’esprit quand on pense à ces sujets.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. Monsieur Binet, nous interrogeons bien sûr les autorités sur la proportion d’infractions liées au terrorisme par rapport aux infractions de droit commun. Mais il faut bien constater que l’imbrication entre les unes et les autres est étroite. C’est une difficulté.
Madame Le Dain, vous nous interrogez sur la concentration des actions sur certains territoires. J’ai en tête l’exemple du Val-de-Marne : c’est un département à forte concentration urbaine, où vit l’une des plus grandes communautés juives de France – à Créteil et à Saint-Maur –, où se trouvent deux stations d’alimentation en eau potable de la Ville de Paris, mais aussi Rungis et Orly, notamment. On y trouve encore l’un des foyers de radicalisme les plus importants de l’Île-de-France, à Champigny-sur-Marne. On nous y explique comment traiter la question des personnes dangereuses, fichées, qui travaillent pour des sous-traitants d’Aéroports de Paris. Il est donc probable que la concentration des mesures prises dans ce département est forte ! De mémoire, la semaine dernière, il y avait déjà eu quatre-vingts perquisitions, c’est-à-dire un trentième de l’ensemble des perquisitions. C’est sans doute plus que presque partout ailleurs.
Il est probable que nous constaterons mécaniquement une concentration des mesures liées à l’état d’urgence dans ou autour des ZSP, et cela sans avoir besoin de soupçonner un « délit de faciès ». Pour autant, cela ne signifie pas que les services ne sont pas actifs ailleurs. Le fait est que nous sommes régulièrement saisis, par voie de presse ou par des collègues, de faits qui se déroulent dans la France entière.
Dans la question de M. Raimbourg, enfin, il y a deux façons d’entendre la sortie de l’état d’urgence : pense-t-il à sa cessation simple, ou bien à ses suites après le 26 février, notamment à la continuation des poursuites engagées dans le cadre de l’état d’urgence ? Tout cela est réglé par le droit, avec l’hypothèque, peut-être, d’éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité.
En ce qui nous concerne, il me semble que notre rôle s’arrêtera — à part peut-être pour réaliser des compléments d’information ultérieurs, plus détaillés — au 26 février. Mais c’est une situation nouvelle pour tous : nous verrons bien. Il me semble qu’un rapport de qualité doit permettre à la commission des Lois, et à l’ensemble de l’Assemblée nationale, de statuer sur une éventuelle prorogation de l’état d’urgence, ce qui suppose qu’il soit rendu avant la fin de l’état d’urgence. Nous serons certainement amenés – mais cette décision appartient au président de la Commission – à vous rendre ce rapport assez tôt pour qu’il puisse être examiné à tête reposée, mais aussi assez tard pour englober une période aussi large que possible.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je vous fais confiance à tous deux pour analyser la plus-value réelle de l’état d’urgence. Les perquisitions judiciaires sont-elles aujourd’hui asséchées par rapport aux perquisitions administratives ?
Vous prévoyez d’interroger des autorités locales tant de police que de gendarmerie : je ne peux que vous y encourager fortement. La « grande muette » n’est pas un mythe : il n’est pas du tout certain que les autorités centrales aient la même vision que les autorités territoriales.
M. le président Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. Je ne peux pas répondre à votre première question : les informations sont encore en cours de traitement.
Sur le second point, nous essaierons de créer les conditions pour que notre information soit aussi complète que possible. Vous pouvez nous faire confiance.
Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mercredi 3 janvier 2016.
(Extrait du compte rendu n° 33)
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cette communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence est la deuxième que Jean-Frédéric Poisson et moi-même vous présentons.
Cette tâche de contrôle nous paraît – comme à vous tous, je crois – indispensable, mais elle est délicate à accomplir dans le bruit de l’immédiat. Nous avons pu le constater au cours de nos six semaines de travail.
Ce travail, mené à partir des outils que nous avions élaborés, a pris différentes formes. D’abord, un effort très important, dont je tiens à remercier les administrateurs présents, de recueil et de collecte des données que les ministères de l’Intérieur et de la justice nous adressent régulièrement et que nous publions de manière hebdomadaire. Les chiffres que vous pouvez trouver sur le site internet de l’Assemblée ne sont pas ceux, publiés tels quels, que nous recevons du Gouvernement : les services les retravaillent et les croisent avec d’autres pour s’assurer de leur fiabilité.
Ensuite, nous avons continué d’interroger le Gouvernement sur les mesures prises : 66 courriers ont été adressés, portant sur 41 départements différents. Le taux de réponse du ministre de l’Intérieur, de 92 %, est tout à fait remarquable, et je l’en remercie.
Jean-Frédéric Poisson et moi-même avons également effectué huit déplacements. Outre le Val-de-Marne, nous nous sommes ainsi rendus, durant la suspension des travaux parlementaires, dans le Rhône, l’Yonne, le Nord, l’Ille-et-Vilaine, l’Hérault, la Haute-Garonne ; et, cette nuit, nous étions à la préfecture de police de Paris.
Parallèlement, nous avons commencé d’organiser des auditions, et nous allons continuer de le faire.
Compte tenu du rôle confié par la loi aux juridictions administratives, il nous a d’abord paru nécessaire de recueillir l’analyse du vice-président du Conseil d’État et du président de sa section du contentieux, ainsi que celles des représentants syndicaux des magistrats administratifs.
Naturellement, nous avons aussi entendu, pour le ministère de l’Intérieur, les responsables des services du renseignement Intérieur, la direction centrale de la police judiciaire, ainsi que les responsables des instances de coordination de la lutte antiterroriste – l’unité de coordination de la lutte antiterrorisme (UCLAT), et l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT). La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a également été auditionnée.
Enfin, lundi dernier, nous avons organisé deux tables rondes avec les responsables départementaux des forces de police, d’une part, et de gendarmerie, d’autre part, pour neuf départements au total.
Toutes ces auditions se sont tenues à huis clos, vu la sensibilité des sujets abordés, mais donneront lieu à des comptes rendus qui seront publiés, en tout ou en partie, à l’issue de nos travaux. En revanche, ainsi que je l’ai indiqué le 2 décembre, les débats en commission, comme celui d’aujourd’hui, sont bien sûr publics.
Voici les observations que nous pouvons formuler sur le fondement de nos constatations.
Premièrement, l’usage des mesures administratives est contrasté.
Parmi les treize mesures qui sont à la disposition du Gouvernement, dont cinq issues des modifications apportées en 2015, certaines n’ont pas du tout été utilisées. C’est notamment le cas du blocage des sites internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, et du placement sous surveillance électronique mobile des personnes assignées à résidence. En ce qui concerne la première de ces deux mesures, cela s’explique probablement par sa proximité avec le dispositif introduit par la loi du 13 novembre 2014 dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Toutefois, nous continuons de chercher pourquoi cette mesure, comme celle relative au placement sous surveillance électronique, n’a pas été mise en œuvre. L’administration n’aurait-elle pas anticipé la faisabilité réelle de ces dispositifs issus d’amendements parlementaires ? Sont-ils tout simplement inapplicables ? Inutiles ? Nous aurons besoin d’étudier ces questions de plus près.
D’autres mesures prévues par la loi du 3 avril 1955 ont été ponctuellement mises en œuvre par les préfectures. D’abord, la faculté de créer des zones de protection, dont nous avons identifié cinq utilisations : à Dunkerque, dans la gare de Lille, et dans trois départements d’Ile-de-France pendant la COP21. Ensuite, la remise d’armes des catégories A à D détenues légalement. Troisièmement, la fermeture provisoire de salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion, qui a par exemple concerné le Zénith de Paris – à la demande des organisateurs d’ailleurs. Enfin, le couvre-feu a été instauré une fois à ma connaissance, dans le quartier des Champs-Plaisants, à Sens, dans l’Yonne. Nous sommes toujours en attente d’informations nous permettant de dresser un inventaire complet du recours à ces mesures.
Par ailleurs, nous avons relevé que l’état d’urgence était mentionné dans les visas de plusieurs décisions préfectorales et ministérielles concernant des mesures qui pouvaient être prises sur d’autres fondements juridiques que la loi de 1955. Ainsi de l’interdiction de la vente d’alcool décidée par le préfet du Nord, mais aussi par le préfet de police de Paris ; de l’arrêté ministériel limitant les déplacements de supporters de clubs de football pour la dix-neuvième journée de championnat de ligue 1 et de ligue 2, le 11 décembre 2015 ; enfin, de l’interdiction préfectorale frappant la vente d’articles pyrotechniques dans le Bas-Rhin entre le 29 et le 31 décembre. Il conviendra d’en préciser les raisons.
Enfin, trois mesures ont été massivement utilisées : les perquisitions administratives – 3 021 ont été organisées, selon le décompte provisoire qui nous a été fourni hier soir par le cabinet du ministre de l’Intérieur –, les assignations à résidence – 381 ont été signées, selon la même source – et les interdictions de manifester.
Comme le ministre de l’Intérieur l’a précisé le 2 décembre, ces dernières ne doivent viser « en aucun cas à empêcher les mobilisations citoyennes ou sociales, dont les attentes et revendications doivent bien évidemment pouvoir s’exprimer ». Nous ne pouvons pour l’instant vous faire état d’un recensement exact de ces mesures. Le ministre nous a indiqué, dans une réponse datée du 26 décembre, qu’il avait demandé à tous les préfets de prendre des arrêtés d’interdiction de manifestation pour les trois premiers jours de la COP21, soit les 28, 29 et 30 novembre et que, au regard du travail que cela imposerait à ses services, il ne ferait pas procéder à un recensement des manifestations ayant effectivement eu lieu mais qu’il nous garantirait une réponse au cas par cas.
C’est donc un point sur lequel nous allons poursuivre nos investigations, d’autant que, comme nos déplacements et nos courriers nous ont permis de le constater, les préfets savent exactement quelles manifestations se déroulent dans leur département ; or celles qui nous intéressent sont peu nombreuses. En outre, les cas déjà étudiés le montrent, la connaissance de l’usage de cette mesure est très utile pour nourrir la réflexion globale sur l’état d’urgence.
La mesure principale est la perquisition administrative. Rappelons qu’au cours des 57 jours qu’a duré l’état d’urgence en 2005, il n’y en avait eu qu’une dans les 26 départements concernés. C’est la mesure plus commentée par la presse, qui, faisant son travail, relate des interventions parfois spectaculaires, souvent nocturnes, ainsi que par les associations et les avocats, qui en contestent des modalités qu’ils estiment abusives, pointant également des « erreurs manifestes dans le choix des cibles ».
Notre contrôle a donc porté sur la méthodologie utilisée.
Je soulignerai en premier lieu l’efficacité de la coordination préfectorale. De tous les acteurs concernés par la mise en œuvre de l’état d’urgence, les préfectures se sont révélées les mieux préparées à l’état d’urgence. Les préfets et leurs équipes se sont organisés pour piloter le ciblage, signer les ordres de perquisition et contrôler l’action des services placés sous leur autorité.
Il est vrai que, en ce qui concerne la coordination des services, beaucoup d’outils existaient déjà ; ils ont été davantage sollicités pendant l’état d’urgence – donnant ainsi raison à Pasteur, pour qui « le hasard ne profite qu’aux esprits préparés »... C’est le cas des états-majors de sécurité qui, partout, ont accéléré le rythme de leurs réunions, mais aussi des groupes d’évaluation départementaux de la radicalisation (GED), qui ont fait gagner beaucoup de temps aux responsables locaux des services de sécurité, en particulier dans le ciblage des individus.
Deuxième observation, illustrée par les graphiques qui vous ont été communiqués : le recours aux perquisitions administratives s’est concentré dans les premières semaines de l’état d’urgence. Ainsi, selon les données les plus récentes et les plus complètes dont nous disposons, au cours des sept jours qui ont suivi les attentats, 907 perquisitions ont été organisées, soit près du tiers des 2 975 dont nous connaissons la date d’exécution ; et, au cours des deux premières semaines, ce sont 58,7 % des perquisitions qui ont été conduites.
Ces perquisitions se sont déroulées pour moitié – 50,4 % exactement – de nuit, une possibilité qui les distingue notablement des perquisitions judiciaires. Selon nos interlocuteurs, le choix d’une intervention nocturne résulte essentiellement d’une précaution tactique pour les forces de sécurité permettant de jouer pleinement de l’effet de surprise lorsque la cible est réputée dangereuse, ou d’opérer plus discrètement lorsque la zone est connue pour ses désordres. Mais il a aussi pu être justifié par la disponibilité plus grande des unités ou des techniciens, notamment les techniciens informatiques chargés de procéder aux copies d’ordinateurs. Nous constatons que la proportion de perquisitions nocturnes reste stable alors même que l’effet de surprise s’est estompé, que les cibles prioritaires se raréfient et que les unités spécialisées interviennent moins fréquemment : depuis le 30 novembre, la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), l’unité Recherche, assistance, intervention, dissuasion (RAID) et le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ne sont presque plus engagés. En outre, nous avons relevé que, dans quelques départements, les préfets ont choisi de ne pas ordonner d’interventions la nuit ; les volumes de perquisitions y sont pourtant quantitativement comparables.
J’en viens au ciblage des perquisitions.
Contrairement aux assignations à résidence, les perquisitions administratives sont décidées par les préfets. Une organisation déconcentrée très spécifique a donc été mise en œuvre, qui réunit systématiquement la sécurité Intérieure, le renseignement territorial, la direction de la sécurité publique du département et la gendarmerie nationale, mais aussi la police judiciaire et le parquet. Je répète aujourd’hui ce que je disais le 16 décembre : nous avons constaté partout une très bonne coopération opérationnelle entre les parquets et les préfectures, quelle que soit la taille du département. Partout, on nous a fait l’éloge de la « synergie » ou de la « dynamique de concertation » entre les deux institutions. Le parquet de Lille a même installé une permanence dédiée à l’état d’urgence pour être encore plus réactif.
Globalement, selon nos calculs, la moitié des perquisitions a été conduite à partir d’éléments venant des services de renseignement – renseignement territorial et sécurité intérieure. Ce sont souvent ces objectifs qui ont été traités au cours des deux premières semaines et avec l’appui des forces spécialisées d’intervention. Selon nos interlocuteurs, ces perquisitions avaient pour but de déstabiliser le microcosme radicalisé, d’éviter des répliques d’attentats tirant profit de l’effet de sidération immédiatement consécutif au 13 novembre et de s’assurer que les individus concernés n’avaient pas échappé à des procédures judiciaires antiterroristes. Depuis la période de fin d’année, nous n’observons pas de demandes nouvelles de ce type.
En ce qui concerne l’autre moitié des perquisitions, presque toutes réalisées à l’initiative des services de sécurité publique, les objectifs sont nettement moins prioritaires. Dans certains cas, le rattachement à l’islam radical passe par une inscription au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), administré par l’UCLAT et qui comprend des personnes d’inégale dangerosité. Pour d’autres perquisitions, les objectifs poursuivis concernaient très explicitement des infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, soit du droit commun. Leur justification tient alors à la porosité, souvent évoquée, entre radicalisation, terrorisme et économie souterraine.
En ce qui concerne le déroulement de ces perquisitions, s’il est concevable, et même logique, que le Parlement cherche à connaître les conditions matérielles de leur mise en œuvre, il nous a été concrètement impossible de nous livrer à leur étude. Au demeurant, un tel exercice aurait nécessairement été partiel. Nous avons de surcroît estimé qu’il relevait de la mission constitutionnelle du Défenseur des droits, dont la compétence est totale en matière de déontologie des forces de sécurité. Nous comptons tout de même faire état dans notre rapport final des circulaires et messages rédigés par les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales et établissant les modalités concrètes de déroulement des perquisitions. Tous font état de la rigueur déontologique à respecter et précisent les responsabilités hiérarchiques engagées.
En ce qui concerne les assignations à résidence, dont le pilotage était local, elles avaient pour vocation, selon nos interlocuteurs, à restreindre la liberté de circulation des personnes visées et à limiter leur capacité à se mettre en relation avec d’autres personnes considérées comme dangereuses, dans un contexte où les forces de l’ordre sont très mobilisées. Le Conseil d’État a validé cette approche extensive, puisqu’il a admis une distinction entre le fondement de la déclaration de l’état d’urgence et les motifs des assignations à résidence. De facto, il a estimé que, si le législateur n’avait pas voulu qu’il en soit ainsi, il aurait dû préciser qu’il doit toujours y avoir un rapport entre la situation à laquelle on applique le droit et, sinon l’objet, au moins sa finalité.
On notera cependant avec étonnement que certaines assignations ont été abrogées à la dernière minute, avant la décision du juge administratif saisi. Au total, dix-sept assignations ont été abrogées. On peine à interpréter cet empressement qui oblige le juge à prononcer un non-lieu sur le contentieux présenté devant lui.
J’en viens justement au contentieux.
La loi du 20 novembre 2015 a fait du juge administratif le garant de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prises en application de l’état d’urgence, à la place des commissions départementales ad hoc, inadaptées, que prévoyait initialement la loi de 1955. Le nombre de contentieux est significatif, mais limité : 62 affaires ont été jugées par les tribunaux administratifs ; 53 d’entre elles concernent des assignations à résidence. Le juge a prononcé six suspensions, une suspension partielle et une annulation. À la suite de ces jugements, quinze affaires ont été portées devant le Conseil d’État ; vous en trouverez l’issue dans les éléments que nous vous présentons sur table.
Il convient d’abord de relever que les premières ordonnances rendues par les juges de première instance sont très disparates, au point de donner un sentiment d’improvisation. Mais il faut surtout souligner la prise de position, aussi bienvenue qu’indispensable à l’effectivité de l’office du juge, qu’ont représenté les décisions du Conseil d’État du 11 décembre, instituant un régime de présomption d’urgence – ce que la jurisprudence passée du Conseil d’État n’annonçait pas.
Le juge constitutionnel a par la suite validé le régime des assignations à résidence que nous avons voté. Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a en effet jugé conformes à la Constitution les neuf premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, relatifs au régime des assignations à résidence et modifiés en novembre. Le dixième alinéa, dont la conformité n’a pas été contrôlée, concerne le placement sous surveillance électronique. Le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé une nouvelle fois qu’il appartient au juge administratif, chargé de se prononcer sur la légalité des mesures individuelles, de procéder au contrôle de proportionnalité.
Quant à la justice judiciaire, la loi du 3 avril 1955 a qualifié d’infractions tous les manquements aux mesures prises au titre de l’état d’urgence. Cela concerne le non-respect d’une assignation à résidence ou encore la violation d’une interdiction de circuler ou de séjour. Les infractions constatées sont peu nombreuses : 41 affaires ont donné lieu à 40 gardes à vue et des poursuites judiciaires ont été engagées dans 21 cas.
Rappelons aussi que les procureurs sont informés sans délai du déclenchement d’une perquisition administrative, laquelle est obligatoirement conduite en présence d’un officier de police judiciaire, seul habilité à constater les infractions éventuellement découvertes et à procéder aux saisies en vue de poursuites judiciaires. Un cinquième des perquisitions a permis de constater des infractions, qui n’ont débouché sur des suites judiciaires que dans 201 cas.
Tous nos interlocuteurs ont souligné, d’une part, la grande continuité entre les opérations de police administrative et le déclenchement des poursuites judiciaires lorsque le cas se présentait, et, d’autre part, la très grande différence d’objectifs entre perquisitions administratives et perquisitions judiciaires. La perquisition administrative a pour objet principal de permettre à l’autorité administrative de réunir des éléments qui, croisés avec d’autres, sont de nature à prévenir un trouble à l’ordre public. Elle n’a donc pas vocation à conduire systématiquement à une procédure judiciaire. La perquisition judiciaire a, elle, pour unique objet de permettre à la police et à la gendarmerie, sous l’autorité d’un magistrat, de rechercher les preuves d’une infraction. Bref, pour parodier les propos de Mauriac sur l’Allemagne, j’aime tellement les libertés publiques que je préfère qu’il y ait plusieurs juges pour les protéger …
Mais, pour parvenir à un fonctionnement optimal, il faut que les prérogatives des deux polices soient scrupuleusement respectées et que leurs frontières ne soient pas mouvantes : à la police administrative la seule prévention, à la police judiciaire la répression.
Pour conclure – provisoirement –, à ce stade du contrôle et de notre réflexion, trois évidences s’imposent.
La première est la nécessité de ces mesures. La proclamation de l’état d’urgence était justifiée : le Président de la République et le Gouvernement se devaient d’adopter des mesures à la fois fermes et efficaces face à la menace terroriste.
Mais accorder à une législation d’exception une fonction préventive, c’est faire de la norme et de l’exception les deux branches d’une alternative. Or la législation d’exception est une véritable dérogation, qui ne peut être justifiée que par l’évidence. Comme le disait notre prédécesseur le vicomte de Martignac à la Chambre des députés, le 8 juin 1824 : « Les nécessités réelles se sentent et ne se controversent pas ». Le grand dérangement qu’entraînent les législations d’exception ne peut donc être que bref et sans séquelles.
La seconde évidence est la lecture nécessairement restrictive qu’il convient de faire de cette législation, en raison de son caractère exceptionnel. C’est là un principe constant de notre droit qui donne toujours une interprétation étroite à une législation d’exception, principe qu’exprime la règle exceptio est strictissimae interpretationis. Adoptée pour faire face à une menace imminente, une législation d’exception doit être limitée au strict nécessaire, ciblée avec suffisamment de précision et seulement temporaire. En conséquence, il faudra veiller à ce que les procédures gloutonnes permises par l’état d’urgence ne viennent pas dévorer le droit commun des libertés.
La troisième et dernière évidence concerne la fin de l’état d’urgence. Y entrer était une décision consensuelle ; en sortir sera un acte délicat à prendre – rappelons que le plan Vigipirate est activé, sous des formes diverses, depuis les attentats commis dans la station de RER Saint-Michel en juillet 1995. J’espère donc que, dans ce domaine aussi, nous ferons preuve de responsabilité le moment venu. L’arrêt de l’état d’urgence ne sera pas synonyme d’une moindre protection des Français.
L’essentiel de l’intérêt que l’on pouvait attendre des mesures dérogatoires me semble à présent derrière nous. Partout où nous nous sommes déplacés, nous avons entendu que les principales cibles et les principaux objectifs avaient été traités, qu’en tout état de cause l’effet de surprise était largement estompé et que les personnes concernées étaient désormais pleinement préparées à une éventuelle perquisition. Cette extinction progressive de l’intérêt des mesures de police administrative se lit d’ailleurs dans les chiffres mêmes, qui montrent bien plus qu’un essoufflement. Le doyen Hauriou l’écrivait en 1929, les mesures administratives constituent un « droit de seconde qualité » et devront donc disparaître à l’expiration de l’état d’urgence.
Réagir efficacement à un attentat terroriste en donnant à l’État des moyens proportionnés à l’ampleur de la menace imminente était une chose ; cela a été fait, et bien fait. Combattre le terrorisme en profondeur en sera une autre. (Applaudissements.)
M. Jean-Frédéric Poisson. Je partage bien sûr entièrement le point de vue que vient d’exposer notre président. J’aimerais l’appuyer ou le compléter par les remarques suivantes.
Premièrement, je confirme la diligence avec laquelle les services ministériels et ceux du Défenseur des droits fournissent à ceux de notre commission – que je remercie au passage – les éléments demandés, malgré les délais de traitement administratif des courriers. Globalement, nous constatons partout la même bonne volonté. C’est elle qui nous permet de vous tenir informés le plus précisément possible, ce matin comme tout au long de la période d’état d’urgence.
Deuxièmement, j’aimerais signaler ce qui est apparu comme une évidence au cours de nos entretiens : d’une part, la très étroite coopération entre les services ; d’autre part, l’attention accordée par les préfets aux modalités des interventions, en particulier lors des perquisitions. Quelques inquiétudes se sont exprimées à propos de la manière quelque peu sèche, quelque peu énergique, dont sont opérées les perquisitions. Or, chaque fois que nous avons posé des questions sur les modalités d’intervention, leur surveillance, la présence ou non de hauts gradés lors des opérations, on nous a confirmé que les choses ne se faisaient pas n’importe comment et que les préfets avaient donné des consignes strictes encadrant précisément la manière d’entrer dans les domiciles perquisitionnés. Je crois pouvoir dire qu’il y a là un motif de satisfaction : la pratique a rendu infondées les craintes légitimement exprimées au début de l’état d’urgence.
Troisièmement, et plus généralement, plusieurs d’entre nous ont été questionnés à diverses reprises sur le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques pendant l’état d’urgence. Cette demande concernait notamment les mesures d’assignation à résidence. Dans les situations dont nous avons eu à connaître ou à propos desquelles nous avons interrogé nos interlocuteurs, il ne m’a pas semblé que des dérives pouvant constituer des atteintes aux libertés publiques aient été constatées.
Lors de l’épisode, qui a fait couler un peu d’encre, de l’assignation à résidence de « militants » écologistes pendant la durée de la COP21, certains ont critiqué la manière dont on aurait utilisé le dispositif de l’état d’urgence pour prendre des mesures sans rapport avec le terrorisme. Nous aurons certainement ce débat, monsieur le président, lorsqu’il s’agira de sortir de l’état d’urgence le moment venu. Cela dit, la formulation de la loi est large et permet ce genre d’interventions même lorsqu’elles ne sont pas directement liées au terrorisme. En outre, nous avons pu prendre connaissance du profil des personnes visées par ces mesures : dans certains cas, il s’agit très clairement d’agitateurs et de casseurs, voire de délinquants récidivistes, bien plus que de simples militants. Le risque de perturbation de l’ordre public était donc réel. Je me tourne vers ma collègue Nathalie Appéré, dont la région est concernée : il n’y a eu là aucun abus de la part des services de la police et de l’administration, mais simplement des mesures préventives. Certes, du point de vue des principes du droit, la question de l’utilisation de l’état d’urgence à titre de prévention reste posée.
Cette absence d’atteinte aux libertés fondamentales depuis le début de l’état d’urgence est d’ailleurs confirmée par les décisions des juridictions, qui, dans l’immense majorité des cas, ont validé les mesures prises par l’administration.
S’agissant en quatrième lieu des milieux pénitentiaires – à propos desquels le président Urvoas utilise souvent, au cours des entretiens, le qualificatif d’« incubateur » du terrorisme, emprunté à Gilles Kepel –, nos interlocuteurs signalent presque systématiquement deux aspects. D’abord, la bonne relation de travail entre les services de renseignement et l’administration pénitentiaire. Ensuite, la porosité des prisons vis-à-vis des technologies de communication, en particulier de l’internet, qui pose un véritable problème. Celui-ci existe en dehors de l’état d’urgence, mais prend une acuité particulière dans la période actuelle, et doit être réglé. On nous a même raconté qu’un détenu dangereux placé à l’isolement était parvenu à donner une interview à un journal étranger !
Un mot de la sortie de l’état d’urgence, sur laquelle nous avons conclu hier soir notre rencontre avec le préfet de police de Paris. L’enjeu est le passage de relais entre la justice administrative et le juge judiciaire. Cette transition pose deux questions. La première, culturelle, a été soulevée plusieurs fois dans le cadre des entretiens, et rappelée à l’instant par Jean-Jacques Urvoas : l’articulation est-elle possible alors qu’il ne s’agit pas du même métier ? En second lieu, comment, malgré ces différences, faire en sorte que les procédures entamées sous le régime administratif se poursuivent dans le cadre habituel sans fragiliser la sécurité des Français ?
J’en terminerai par l’information des élus, qui a suscité des questions dès nos premiers échanges. En règle générale, les préfets ont réuni dans les départements les maires et les parlementaires pour les informer des mesures prises pendant l’état d’urgence. Mais nous constatons que cette information est d’une densité extrêmement variable d’un département à l’autre. Des parlementaires de Seine-Saint-Denis, en particulier, ont fait part de leur grande insatisfaction : ils ne s’estiment ni tenus au courant de la mise en œuvre de l’état d’urgence ni associés alors même que ce département peut à bon droit être considéré comme particulièrement sensible dans le domaine qui nous occupe.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je vous félicite, monsieur le président, de ce document d’un très grand intérêt et d’une excellente tenue, en particulier dans sa conclusion, à propos de laquelle j’aimerais faire deux observations.
La seule – légère – critique que je formulerai à l’endroit de cette belle conclusion, dont j’approuve le principe, résulte de son caractère quelque peu prématuré : que se passerait-il si – ce qu’à Dieu ne plaise – d’autres attentats avaient lieu dans notre pays d’ici au 26 février ? Personne, évidemment, ne songe à se placer dans cette perspective sinistre, mais nous devons être conscients du fait que les cartes pourraient alors être rebattues. On ne saurait donc conclure trop hâtivement à propos de la coupure entre l’état d’urgence, état d’exception, et l’état normal de nos institutions.
La qualité du contrôle exercé, la largeur du champ balayé, la précision des observations formulées, le niveau des réponses obtenues du Gouvernement militent pour que le principe du contrôle parlementaire soit inscrit dans le futur projet de loi constitutionnelle sur l’état d’urgence. Les membres de notre commission des Lois devraient s’accorder sans grande difficulté sur un texte permettant d’enrichir en ce sens le projet gouvernemental.
Enfin, vous-même, monsieur le président, et M. Poisson vous donnerez-vous un peu de temps après le 26 février, afin de dresser le bilan final de l’état d’urgence avec suffisamment de recul ? Nous sommes conscients du fait que cela requiert de votre part un grand investissement et beaucoup de travail. Mais ce décalage temporel aurait l’intérêt de nous permettre d’honorer concrètement, après être intervenus sur une question majeure de principe, le devoir parlementaire d’évaluation des politiques publiques, tenant ainsi les deux bouts de la chaîne.
Merci encore pour ce très beau rapport.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous ne devrions pas avoir trop de mal à inscrire le contrôle parlementaire dans le texte constitutionnel, en effet.
M. Guillaume Larrivé. La note de synthèse que vous nous avez présentée, monsieur le président, soulève trois questions. La première porte sur le nombre et les modalités des assignations à résidence : seules 381 mesures de ce type ont été prises, alors que les déclarations du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur indiquent que plusieurs milliers d’individus sont dans le champ des « radars », si j’ose dire, des services de renseignement, en particulier ceux d’entre eux qui sont inscrits au fichier des personnes recherchées pour atteinte à la sûreté de l’État ou pour faits de radicalisation. Pourquoi si peu ? Quels critères de criblage ont été utilisés pour aboutir à n’assigner que ces personnes-là ?
Deuxième préoccupation : le placement sous surveillance électronique des personnes assignées, introduit en novembre 2015 dans la loi de 1955, est tout à fait inopérant. Nous l’avions, à l’époque, déjà dit en commission puis dans l’hémicycle lors de l’examen de l’amendement, adopté à l’initiative du Gouvernement, qui conditionne ce placement à l’accord des individus qui, de surcroît, doivent déjà avoir été condamnés pour acte de terrorisme. Manifestement, ce dispositif ne fonctionne pas puisqu’il n’a pas été appliqué une seule fois depuis son entrée en vigueur. Sans doute faut-il envisager une évolution législative pour l’améliorer. Si le recours au bracelet électronique constitue dans certains cas une modalité pratique utile du renforcement de l’assignation à résidence, comme nous le pensons puisque nous avons voté en faveur de cette mesure, il faut néanmoins qu’il soit applicable.
Enfin, vous nous apprenez, monsieur le président, que quarante-trois adresses de sites internet ont fait en 2015 l’objet de blocages en application de la loi antiterroriste que nous avons adoptée en 2014. À l’échelle de l’internet et face à l’ampleur de la diffusion de la propagande, ce nombre semble faible. Surtout, il semble que le dispositif spécial adopté dans la loi de 2015 sur l’état d’urgence soit complètement inopérant, puisqu’il n’a donné lieu à aucun blocage de site internet djihadiste. Là encore, une évolution juridique est sans doute souhaitable pour rendre cette mesure plus efficace.
M. Georges Fenech. Je m’associe aux félicitations qui sont faites aux deux auteurs de cette précieuse note d’information.
Vous avez distingué, monsieur le président, entre le juge judiciaire et le juge administratif, le premier étant selon vous répressif tandis que le second est préventif. Je ne partage pas ce point de vue : le juge judiciaire ne se réduit pas à son rôle répressif. Aux termes de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle ».
Mon inquiétude, qu’il faudra vérifier lors de la sortie de l’état d’urgence, est celle-ci : la presse se fait l’écho d’un projet de loi de réforme de la procédure pénale qui, dit-on, devrait être défendu par Mme Taubira – mais à cet égard, rien n’est sûr ces temps-ci… Même si nous n’en sommes pas officiellement informés, ce projet de loi, qui serait en cours d’examen par le Conseil d’État, prévoirait, semble-t-il, de transférer aux préfets un certain nombre de pouvoirs judiciaires qui sont loin d’être anodins, notamment le pouvoir d’ordonner des fouilles de véhicules et de bagages et de procéder à des assignations à résidence – toutes mesures directement attentatoires aux libertés individuelles alors même que l’état d’urgence aurait été levé. La magistrature, de la base au sommet de sa hiérarchie, s’inquiète comme elle ne l’a jamais fait de cette forme de dépossession de l’autorité judiciaire – qui, répétons-le, demeure le garant de la liberté individuelle.
Souhaitons que le virage sécuritaire de la gauche ne se transforme pas en sortie de route ! J’entends bien votre souci – qui est aussi le nôtre – de protéger la sécurité des Français, mais il ne faut pas pour autant piétiner les fondements de notre démocratie, en particulier le pouvoir judiciaire.
M. Sébastien Pietrasanta. Je salue à mon tour ce remarquable travail de contrôle parlementaire. Comme vous l’avez indiqué, monsieur le président, un tiers des perquisitions administratives ont eu lieu pendant la première semaine d’état d’urgence, et 58% au cours des deux premières semaines. Les personnes que nous avons auditionnées ces derniers jours ont convenu que, dans leur grande majorité, les perquisitions effectuées aux premiers jours de l’état d’urgence ont été efficaces, en particulier grâce à l’effet de surprise. En revanche, certains individus perquisitionnés au-delà de cette période initiale attendaient la police et avaient anticipé la perquisition de leur domicile en nettoyant leurs ordinateurs ou en faisant disparaître leurs téléphones – sans doute des armes et des matériels de propagande ont-ils également été déplacés. L’un de ces individus avait même effacé toutes les données de son ordinateur, ne laissant par provocation que les mots « état d’urgence » dans son moteur de recherche. Une telle préparation ne risque-t-elle pas de mettre en difficulté nos services de renseignement et n’a-t-elle pas déjà limité l’efficacité de certaines perquisitions ?
M. Éric Ciotti. Je vous remercie, monsieur le président, pour la qualité du travail que vous avez accompli avec M. Poisson, dont la synthèse pourrait tenir en un constat, que vous avez fait : il n’y a pas de dérive de l’état d’urgence.
S’agissant de l’assignation à résidence de certains professionnels de l’agitation à la veille de la COP21, je pense à titre personnel que ce fut une erreur. Ne mélangeons pas ce sujet avec l’objectif de l’état d’urgence, qui vise à lutter contre le terrorisme et à protéger les Français – même si l’on peut comprendre que le recours à la procédure d’assignation à résidence se soit en l’espèce justifié pour ne pas disperser les moyens des forces de l’ordre, déjà engagées contre le terrorisme. Je persiste néanmoins à croire que la lutte contre le terrorisme est un sujet tout à fait distinct de la lutte contre des agitateurs professionnels, dont le caractère nuisible n’est plus à démontrer par ailleurs.
Une fois le constat dressé comme vous venez de le faire, se pose la question de la nécessité de prolonger l’état d’urgence. Si j’ai bien compris votre conclusion, monsieur le président, vous appelez aujourd’hui à son interruption. Je ne partage pas ce point de vue. Lors de l’examen du projet de prorogation de l’état d’urgence, j’avais défendu un amendement portant sa durée à six mois. Compte tenu de la menace, ce délai me semble nécessaire. Les faits qui se sont produits avant-hier à Marseille et la semaine dernière à Paris démontrent que nous assistons à une série de répliques du séisme du 13 novembre qui activent des esprits à très forte dangerosité. Il ne faut donc pas baisser la garde, bien au contraire, car la menace est là. Les procédures de l’état d’urgence ont été utiles et demeures indispensables ; je souhaite qu’il demeure possible d’y recourir au moins pendant cette période de six mois.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je vous remercie à mon tour, monsieur le président, ainsi que M. Poisson, pour votre implication sur cette question fondamentale. J’ai également pris note de la diligence avec laquelle les services ont collaboré à vos travaux.
À la fin décembre, j’ai eu l’occasion d’appeler votre attention sur les observatoires que certains organes de presse comme Mediapart, L’Obs et Le Monde ont créés pour dénoncer d’éventuelles dérives. Avez-vous été directement informé de telle ou telle dérive par voie de presse ? D’autre part, le nouveau bâtonnier de Paris, que nous avons rencontré récemment, nous a alertés non pas sur des dérives concernant des individus en particulier, mais sur des mesures administratives prises hors du champ de la lutte contre le terrorisme. En avez-vous été informés ?
M. Alain Tourret. La qualité évidente des travaux de notre président et de M. Poisson démontre que le contrôle politique est inséparable de la protection des libertés. À bien y réfléchir, il constituait l’un des éléments de la révision de 2008, à l’occasion de laquelle a été introduit un contrôle de l’usage des dispositions de l’article 16 de la Constitution. Il devrait dès lors être l’une des priorités de la prochaine inscription de l’état d’urgence dans la Constitution.
De ce point de vue, je préfère parler d’état de nécessité plutôt que d’état d’urgence. Le premier n’est pas encadré dans le temps ; le second, si. Je vous renvoie à la thèse très convaincante de Geneviève Camus, L’État de nécessité en démocratie, qui permet de pérenniser telle ou telle mesure.
Qui est le garant de la liberté individuelle ? Aujourd’hui, la magistrature judiciaire est meurtrie. Ce qui se dit de réunion en réunion dans les assemblées générales des cours d’appel doit au moins être entendu, à défaut d’être pris en compte. S’il fallait distinguer entre prévention d’un côté et répression de l’autre, ne faudrait-il pas alors procéder à une réforme d’ensemble du statut de la magistrature et de celui du parquet ? Avant-hier encore, la procureure générale près la cour d’appel de Caen ne disait pas autre chose : dans ces conditions, il faut repenser de fond en comble les missions de la magistrature administrative et celle de la magistrature judiciaire. J’ai toujours été convaincu que la magistrature administrative est l’une des garantes des libertés, mais une scission sans doute trop simpliste est en train de s’opérer. En tout état de cause, s’il fallait confier l’ensemble des mesures de prévention à la magistrature administrative, il faudrait sans doute réviser la Constitution, et non pas seulement la loi. Il s’agit d’une rupture profonde avec nos traditions. Je n’y suis pas opposé, mais tout doit être mis sur la table. La magistrature judiciaire s’est toujours considérée comme la protectrice des libertés, ce que ne revendique pas la magistrature administrative.
M. Patrick Mennucci. Je vous félicite, monsieur le président, pour vos travaux, d’une qualité telle qu’ils ont été reçus par des applaudissements, pourtant rares dans notre commission. Sur l’utilisation des mesures prévues par l’état d’urgence dans des cas ne relevant pas directement de la lutte contre le terrorisme, M. Ciotti ne semble pas avoir compris que nos forces de sécurité étaient dispersées lors de la COP21. Il est pourtant contradictoire de rappeler, à longueur de déclarations, que les forces mobiles de police et de gendarmerie sont trop sollicitées, par exemple pour des gardes statiques, sans comprendre que l’état d’urgence nécessitait alors d’éviter tout affrontement avec les black blocks qui, eux, le recherchaient. Bien au contraire, les mesures prises pendant la COP21 étaient absolument indispensables, même si elles n’entraient pas dans le cadre de la lutte contre DAECH, car elles ont permis de ne pas perturber l’organisation de la police de surveillance et d’appliquer correctement les mesures de l’état d’urgence. On se trompe donc en isolant les mesures prises à l’encontre des manifestants contre la COP21.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Je vous remercie, monsieur le président, pour le nécessaire et utile travail de contrôle parlementaire que vous avez accompli avec M. Poisson.
Il s’est produit dans le département où je suis élue des manquements concernant la porosité des frontières, même si les Mosellans se rendant au Luxembourg ont bien compris les quelques ralentissements qui se sont produits à la frontière. Après la fin de l’état d’urgence, cependant, comment les services des douanes effectueront-ils leurs contrôles et ces contrôles, qui sont utiles, se poursuivront-ils ? J’ajoute qu’il n’a pas toujours été procédé à ces contrôles avec la rigueur nécessaire, ce que j’avais signalé à l’époque au préfet de région.
Ma deuxième question est plus préoccupante encore : vous venez, monsieur le président, de nous alerter – comme nous le sommes régulièrement – sur la porosité du milieu carcéral. Chacun est conscient de cette situation qui ne date ni de l’état d’urgence, ni du début de cette législature, mais qui est plus ancienne encore. Dans les circonstances de l’état d’urgence, il est indispensable sinon de légiférer, en tous cas de prendre des mesures rigoureuses dans le milieu carcéral. Je suis surprise, en effet, d’entendre parler çà et là de porosité alors que rien n’est fait !
M. Dominique Raimbourg. Je m’associe, monsieur le président, aux félicitations qui vous sont adressées ainsi qu’à M. Poisson pour votre travail qui montre combien ce contrôle parlementaire s’est révélé pertinent et fructueux. Il prouve en effet l’efficacité de l’état d’urgence, qui a produit des résultats – même si nous ne sommes évidemment pas à l’abri de tout. Nous avons néanmoins apporté une réponse importante. Par ailleurs, vos travaux démontrent que l’état d’urgence n’est pas liberticide. Certes, des mesures exceptionnelles ont été prises mais, rappelons-le, elles n’ont pas donné lieu à des atteintes disproportionnées aux libertés. Nous avons conservé le contrôle parlementaire et juridictionnel des choses, et notre réaction à l’attaque que nous avons subie a été particulièrement adaptée non seulement sur le plan des principes, mais aussi en termes d’efficacité.
Enfin, évitons de nous écharper sur la question de la sortie de l’état d’urgence, qui est difficile, à l’évidence. Gardons-nous de penser que tous les individus inscrits sur un fichier sont particulièrement dangereux ; des nuances sont à faire. Il s’agit d’y inscrire les personnes que l’on souhaite surveiller, sans forcément devoir prendre des mesures à leur encontre. Quant à l’idée de prolonger l’état d’urgence, elle ne me semble pas acceptable, car nous n’arriverons alors jamais à en sortir. La menace terroriste perdurera. Nous pouvons, le cas échéant, envisager de renforcer l’arsenal des mesures préventives dans le cadre du droit commun, mais déclencher une polémique sur la prolongation de l’état d’urgence contribuerait à rompre l’unité nationale que nous recherchons suite à ces attaques terroristes.
M. Sébastien Huyghe. Je m’associe, monsieur le président, aux abondants remerciements qui vous ont été adressés. Lors de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, les préfets ont reçu les députés et les maires de chaque département pour leur expliquer l’application des mesures. Ces réunions se sont poursuivies de manière contrastée selon les départements : régulières ici, épisodiques ou inexistantes là. Il me semble nécessaire d’harmoniser cette pratique, et souhaitable que les préfets de chaque département rassemblent les élus, qui dialoguent constamment avec nos concitoyens, pour faire un point d’étape avant même la sortie de l’état d’urgence sur les mesures qui ont été prises.
L’évolution des mesures dans le temps révèle comme l’indique votre rapport, monsieur le président, que l’effet de surprise s’est estompé. Cela étant, il s’est estompé très rapidement : au terme de la première semaine ou des quelques premières semaines de l’état d’urgence, toutes les personnes susceptibles d’être concernées avaient pris des dispositions pour dissimuler ce qui devait l’être. Or, après la sortie de l’état d’urgence, elles pourront ressortir ce qu’elles voulaient cacher aux autorités – les armes, en particulier. Même si les mesures d’urgence sont désormais moins nombreuses qu’au début de la période, il est peut-être utile de maintenir l’état d’urgence dans la durée pour conduire des investigations plus approfondies qui permettront de trouver ce qui a été caché.
M. Sergio Coronado. Comme tous nos collègues, je vous adresse, monsieur le président, mes remerciements les plus vifs pour le travail que vous avez accompli en faveur du contrôle parlementaire de l’état d’urgence.
Vous avez indiqué que l’intérêt des mesures d’urgence était pour l’essentiel derrière nous, l’effet de surprise s’étant considérablement estompé. Faut-il y voir une manière de plaider en faveur de la levée de l’état d’urgence, ou est-ce une fausse impression ? Sur cette question, en effet, la parole du président de la commission des Lois est primordiale.
La question de l’assignation à résidence de militants écologistes n’est pas anecdotique. Le débat préalable à la réforme constitutionnelle devra établir si la prorogation de l’état d’urgence que nous avons adoptée visait uniquement à lutter contre le terrorisme ou également à maintenir l’ordre public. De ce point de vue, l’éviction du juge judiciaire est très problématique.
Enfin, le rapport que vous nous présentez évalue les opérations de police administrative. Or les effets de l’état d’urgence ne se limitent pas à cela. Plusieurs parlementaires ont été saisis pour savoir si des fonctionnaires dont la dangerosité n’a pas été jugée probante et qu’il n’a pas été décidé de poursuivre, d’interroger ou de surveiller davantage bien qu’ils fassent l’objet d’une « fiche S », auraient néanmoins fait l’objet de mesures purement administratives de mutation, voire de « placardisation ». Compte tenu du nombre très élevé de mesures prises, ce point doit donner lieu à une évaluation afin que nous soyons pleinement informés.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les raisons juridiques qui compliquent l’utilisation du bracelet électronique, Monsieur Larrivé, sont notamment liées à une décision du Conseil constitutionnel de juillet 2015 qui prévoit l’obligation de consentement de l’intéressé et de sa condamnation antérieure à une peine privative de liberté. Dans ces conditions, cette mesure n’a jamais été utilisée pendant l’état d’urgence. Cela étant, le Conseil d’État étudie aujourd’hui même une question prioritaire de constitutionnalité sur ce sujet. D’autre part, monsieur le député, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la pertinence de telle ou telle assignation à résidence, mais nous avons examiné les raisons pour lesquelles la mesure avait été prise ici ou là. Plusieurs interlocuteurs nous ont expliqué que l’assignation n’était pas adaptée à tous les cas : certains individus, en effet, sont sous surveillance, et les assigner à résidence reviendrait à le leur révéler. On déstabiliserait ainsi la surveillance même du réseau autour duquel est susceptible de graviter l’intéressé. En clair, il a été fait un usage assez fin de cette capacité d’entrave, puisque tel nous a semblé être l’objet principal des mesures d’assignation, qui visaient surtout à nuire aux capacités de communication des personnes – lesquelles pouvant souvent privilégier un déplacement, les écoutes s’étant au fil du temps révélées peu fructueuses.
L’information que je vous ai donnée concernant le blocage des sites internet m’a été transmise hier soir : nous constatons que le dispositif utilisé n’est pas celui de la loi de 2015, mais celui de la loi de 2014. Il faudra en élucider les raisons.
Je n’ai pas fait la distinction entre juge administratif et juge judiciaire, Monsieur Fenech, mais entre police administrative et police judiciaire, ce qui, dans mon esprit, n’est pas la même chose.
Concernant les contrôles frontaliers, madame Zimmermann, le code des douanes donne aux douaniers des pouvoirs autrement plus intrusifs que ceux qui sont prévus dans le cadre de l’état d’urgence. Une fois celui-ci levé, ils pourront donc poursuivre leur travail avec la même efficacité.
J’en viens à la sortie de l’état d’urgence. Tout d’abord, les mesures n’ont pas épuisé tous leurs effets potentiels, même s’il semble que l’essentiel de ce que l’on pouvait prendre l’a été. Je ne plaide aucunement pour la levée de l’état d’urgence dès aujourd’hui ; il se prolongera jusqu’à la fin du mois de février. Il me paraissait néanmoins relever de notre responsabilité de poser la question de la manière dont nous en sortirons. À ce stade, les différentes mesures mises à la disposition des autorités administratives ont été utilisées de manière pertinente et modulée. La question se posera néanmoins le 26 février. Or, chacun sait que la « guerre » contre le terrorisme n’est pas un blitzkrieg, mais une guerre longue qu’il faudra mener avec les armes du droit commun. La législation d’exception était utile car nous faisions face à un péril imminent. Le péril est toujours là, constant, et le dire n’est pas chercher à gouverner par la peur mais seulement prendre conscience de notre responsabilité, y compris celle de réfléchir aux outils qu’il nous faudra utiliser demain. Il faudra alors tirer les leçons de l’usage qui a été fait des mesures de l’état d’urgence, mais je prends la législation de 1955 et de 2015 pour ce qu’elle est : temporaire. Elle a été efficace pendant un temps et continuera sans doute à produire des effets jusqu’en février, à mesure que les informations déjà recueillies seront traitées pour, le cas échéant, donner lieu à d’autres mesures administratives. Qu’il n’y ait pas d’ambigüité sur ce point : il serait stupide de suspendre l’état d’urgence à ce stade.
La totalité des 66 démarches que nous avons effectuées par courrier, monsieur Morel-A-L’Huissier, portait sur des cas dont nous avons parfois pris connaissance par la presse, qui en fait – et ne prétend d’ailleurs pas faire autrement – une narration nécessairement partielle puisque très souvent univoque. M. Poisson et moi-même avons dès lors cherché à rassembler des éléments plus approfondis auprès des organes de l’État, et nous avons constaté que ce qui se publie dans la presse ne donne pas un tableau complet de la situation. De ce point de vue, chacun est dans son rôle et seul le juge est apte à constater ou non les abus.
Enfin, monsieur Coronado, les mesures administratives individuelles que vous évoquez ont été prises en dehors du cadre de l’état d’urgence.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. S’agissant de l’efficacité des perquisitions, monsieur Pietrasanta, la courbe représentant l’évolution de leur nombre dans le temps révèle une diminution globale. Les creux apparaissant à intervalles réguliers correspondent tout simplement aux fins de semaine : les perquisitions sont en effet moins nombreuses les samedis et les dimanches en raison de l’organisation normale des services.
Nous avons eu de nombreux échanges sur ce que signifie une perquisition efficace : au fond, lorsqu’une perquisition ne permet pas aux forces de l’ordre de trouver quoi que ce soit, elle est tout de même efficace puisqu’elle accroît leur capacité de renseignement. Il est vrai, d’autre part, que l’opportunité de perquisitionner des cibles qui ne l’ont pas encore été diminue avec le temps. Se pose alors la question de l’utilité d’une prorogation supplémentaire de l’état d’urgence ; à titre personnel, j’en doute.
Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mercredi 30 mars 2016.
(Extrait du compte rendu n° 66)
M. le président Dominique Raimbourg. Nous en venons à présent à la communication d’étape sur le contrôle de l’état d’urgence.
Les attentats commis le 13 novembre 2015 sur de multiples sites à Paris et à Saint-Denis ont entraîné la mort de 130 personnes et fait plus de 350 blessés. Déclaré à la suite de ces attaques, l’état d’urgence a été, depuis, prorogé deux fois, et le contrôle parlementaire des mesures prises par le pouvoir exécutif, fondé sur une veille continue, des auditions et des déplacements, a mécaniquement suivi cette prolongation, afin de vous tenir autant informés que possible des conséquences de cet état d’exception au quotidien.
Jean-Frédéric Poisson, qui ne peut être parmi nous ce matin et vous prie d’excuser son absence, et moi-même, vous proposons ainsi de vous livrer pour la troisième fois un bilan intermédiaire de notre contrôle, articulé autour de trois points : le bilan de l’état d’urgence avant le 26 février 2016 ; la prorogation de l’état d’urgence après le 26 février ; les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016.
Sur le premier point, les données brutes sont les suivantes : au 26 février dernier, le Gouvernement avait procédé à 3 397 perquisitions administratives et 400 assignations à résidence. Au 1er janvier 2016, toutes les personnes assignées durant l’état d’urgence l’avaient été et 98 % des perquisitions avaient déjà été conduites, ce qui signifie que ces mesures ont principalement été concentrées dans la première prorogation de l’état d’urgence.
Le contrôle parlementaire des perquisitions administratives est assez difficile, car nous ne disposons que de peu d’éléments sur ces opérations, qui obéissent à un régime dérogatoire par rapport aux perquisitions judiciaires. Le rapporteur Jean-Frédéric Poisson et moi-même souhaitons, dans ces conditions, que les recommandations faites, entre autres, par le Défenseur des droits soient suivies d’effet, c’est-à-dire : qu’un récépissé de perquisition soit systématiquement remis aux intéressés ; que les formalités d’indemnisation des bris de portes ou de fenêtres occasionnés lors de perquisitions soient allégées, de façon à ce que l’indemnisation puisse être rapide en cas de perquisition infructueuse ; que lors de ces perquisitions, enfin, les mineurs présents soient rapidement mis à l’écart par des fonctionnaires non cagoulés, de façon à éviter qu’ils ne soient trop impressionnés.
En ce qui concerne le ciblage des perquisitions, nous avons constaté, lors de nos déplacements en préfectures, la coordination de grande qualité entre les services de renseignement et de sécurité sous l’autorité des préfets.
Schématiquement, la moitié des perquisitions ont été conduites à l’initiative des services de renseignement : 18 % pour la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et 32 % pour le service central du renseignement territorial (SCRT). La seconde moitié a été initiée à la demande des autres services de la sécurité publique ou de la gendarmerie nationale.
Le 27 février 2016, 583 perquisitions, soit 17 %, avaient débouché sur une action judiciaire, principalement pour des infractions à la législation sur les armes ou à celle sur les stupéfiants.
Les perquisitions demandées par les services de renseignement sont les seules à avoir nécessité la mobilisation des forces spéciales d’intervention. Ces perquisitions n’ont que très marginalement abouti à la découverte d’infractions de droit commun – 12 % d’entre elles seulement ont conduit à découvrir des armes ou des stupéfiants, contre 15 % en moyenne –, ce qui conforte l’idée que les services de renseignement ont bien ciblé les personnes soupçonnées de radicalisation. Il faut également souligner que les découvertes d’infractions lors des perquisitions ont été encore davantage concentrées dans le temps que les perquisitions elles-mêmes.
L’incidence des perquisitions sur le nombre de poursuites est assez faible ; on peut en revanche penser qu’elles ont constitué un choc, particulièrement vigoureux dans les premières semaines, pour une mouvance difficile à caractériser comme strictement délinquante ou strictement radicalisée mais qui peut apparaître comme un terreau favorable à l’accueil et au soutien éventuel de réseaux terroristes. À ce titre, on peut espérer que ces perquisitions auront permis d’affiner la connaissance de cette mouvance, tout en luttant contre la criminalité de droit commun.
Pour autant, préfets et procureurs ont veillé, depuis le début de l’état d’urgence, à ne pas nuire à une procédure judiciaire par des mesures de police administrative. Cette précaution générale de bon sens est particulièrement justifiée en matière de lutte contre le terrorisme. Sur ce point, vos rapporteurs estiment utile de prévenir les risques de confusion : les affaires les plus médiatisées concernant des réseaux terroristes, à Saint-Denis le 18 novembre ou à Boulogne-Billancourt et Argenteuil la semaine passée, sont exclusivement le fruit d’enquêtes et de procédures judiciaires.
Entre le 14 novembre 2015 et le 25 février 2016, 563 personnes ont fait l’objet d’une proposition d’assignation adressée à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), délégataire du ministre de l’Intérieur sur ce sujet.
La DLPAJ en a rejeté 76 dans le cadre de la COP21 pour n’en garder finalement que 27, dont 15 n’ont pu être notifiées par les services. Ces assignations particulières sont arrivées à échéance le 12 décembre.
Quant aux assignations pour radicalisation violente, la DLPAJ a rejeté 86 demandes, pour en garder au total 374 sur l’ensemble de la période. Au soir du 25 février, cependant, seules 268 d’entre elles étaient en vigueur. Cette différence s’explique par le fait que 13 assignations ont été suspendues en référé, deux annulées par les juges administratifs, 61 abrogées en cours de période, 25 bloquées avant même leur notification ; cinq, enfin, n’ont pas être notifiées aux intéressés, l’un d’entre eux se trouvant d’ailleurs déjà incarcéré.
La prorogation de l’état d’urgence a eu un effet important sur les assignations à résidence. À la date du 25 février 2016, correspondant à la fin de la première prorogation, 268 mesures d’assignation à résidence étaient en vigueur sur le territoire national. Au terme de la procédure de réexamen individuel des dossiers, 69 assignations ont été renouvelées ; une nouvelle assignation a été décidée ; 199 assignations n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement.
Sur les 199 assignations non renouvelées, 32 individus ont fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire (IST) tandis que 13 dossiers d’IST sont en cours d’instruction ; deux individus ont été expulsés et trois dossiers d’expulsion sont en cours d’instruction. À notre connaissance, 149 dossiers ne font l’objet d’aucune mesure à ce jour : nous nous efforcerons de savoir ce qu’il en est lorsque nous rédigerons le rapport final.
J’en viens à la question de la censure, par le Conseil constitutionnel, des dispositions relatives à l’enregistrement de données informatiques lors des perquisitions administratives. Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 18 janvier 2016 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Ligue des droits de l’homme sur la conformité à la Constitution du régime de la perquisition administrative prévu par l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, et en particulier de la possibilité, dans ce cadre, de copier des données stockées dans un système informatique.
Par sa décision du 19 février, le Conseil constitutionnel a validé trois aspects de la perquisition administrative : d’abord, le principe même d’une perquisition administrative ; ensuite, le fait que la perquisition puisse être réalisée en dehors de la direction et du contrôle de l’autorité judiciaire ; enfin, le régime contentieux de la perquisition administrative. En revanche, le Conseil a jugé que les copies de données informatiques portaient atteinte de manière excessive à la vie privée, estimant que « le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée ».
Le ministère de l’Intérieur a tiré les conséquences de cette décision en ordonnant aux services de police et de gendarmerie concernés – selon des modalités et des délais différents – la destruction des données déjà collectées. Il conviendra que nous nous penchions sur la question de la validation des saisies informatiques, une procédure pouvant nécessiter l’intervention d’un juge.
J’insiste sur l’importance du contrôle parlementaire exercé sur l’état d’urgence, et je salue la collaboration du ministère de l’Intérieur, qui a fourni aux administrateurs chargés de ce dossier les renseignements qui leur étaient nécessaires.
Comme nous l’avions déjà relevé lors de la présentation du rapport rédigé par mon prédécesseur Jean-Jacques Urvoas, l’état d’urgence perd de sa pertinence au fur et à mesure que le temps passe : les mesures de perquisition et d’assignation à résidence sont de moins en moins nombreuses, comme le montrent les graphiques joints au dossier qui vous a été remis.
La décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 a pour conséquence d’affaiblir l’intérêt qu’il y a à proroger l’état d’urgence, puisque cette décision oblige en pratique à retourner au dispositif de droit commun, qui soumet à l’autorisation du juge judiciaire la possibilité de procéder aux perquisitions administratives.
Tels sont les éléments d’information que nous souhaitions vous communiquer dans le cadre de ce rapport d’étape sur le contrôle de l’état d’urgence.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Puisque vous considérez, alors même que l’on entend dire que le niveau de risque reste élevé, que l’état d’urgence a vocation à être suspendu ou levé, êtes-vous en mesure de nous confirmer que tous les quartiers sensibles, les quartiers dits de non-droit, ont été traités comme il se doit, que l’on a fouillé tout ce qu’il y avait à fouiller, et interpellé toutes les personnes qui devaient l’être ?
M. Guy Geoffroy. Nous avons tous conscience – et les chiffres relatifs aux assignations à résidence et aux perquisitions le confirment – qu’au fil du temps l’efficacité de l’état d’urgence s’est estompée, ce qui est normal. Vous avez conclu, monsieur le président, en soulignant que, depuis le renouvellement de l’état d’urgence et la décision du Conseil constitutionnel de février dernier, l’état d’urgence avait perdu de sa substance, c’est-à-dire de sa capacité à permettre de recourir à des dispositifs exorbitants du droit commun, porteurs de résultats garantissant la sécurité de nos concitoyens.
Les Français s’interrogent sur ce que va devenir l’État de droit si l’état d’urgence est levé, en particulier à l’approche de ce grand rendez-vous populaire qu’est l’Euro 2016, que les pouvoirs publics ont eu raison de maintenir. Savez-vous quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière ? Va-t-il maintenir l’état d’urgence pour rassurer la population, ou tirer les conséquences du fait que cette mesure ne produira plus aucun effet tangible et prendre, en y mettant fin, le risque d’être mal compris par une partie de nos concitoyens ? C’est là une question sensible, sur laquelle j’avoue ne pas avoir de certitude ; c’est pourquoi je souhaite connaître les éléments d’information que vous êtes certainement en mesure de nous communiquer.
M. Philippe Gosselin. Monsieur le président, je vous remercie pour le travail que vous avez effectué avec Jean-Frédéric Poisson, dans la continuité de ce qu’avait entrepris le président Urvoas.
D’un point de vue quantitatif, le nombre de perquisitions et d’assignations à résidence est effectivement en décrue, ce qui s’explique par la durée de l’état d’urgence et par le fait que le « stock » initial de personnes et d’affaires à traiter diminue régulièrement. Cela dit, sommes-nous sûrs que toutes les personnes susceptibles d’être assignées à résidence l’ont été ?
La décision du Conseil constitutionnel du 19 février dernier met à mal une partie du dispositif mis en place fin 2015. Certes, la vie privée et les données personnelles doivent être protégées, mais nous sommes dans un contexte très particulier qui ne saurait durer : il appartient au Gouvernement de prendre des mesures fortes, éventuellement sous la forme d’un projet de loi – l’initiative peut également venir du Parlement –, car nous ne pouvons rester au milieu du gué, avec un dispositif inopérant en pratique.
M. Pascal Popelin. Je salue votre travail, celui de Jean-Frédéric Poisson et de l’ensemble des administrateurs qui y concourent. Le contrôle de l’état d’urgence, décidé sous l’impulsion de Jean-Jacques Urvoas, a donné lieu à un travail inédit du Parlement, qui contribue à la préservation de l’État de droit dans des circonstances tout à fait particulières.
Ayant été le rapporteur du texte proposant la prorogation de l’état d’urgence pour trois mois, je suis de ceux qui considèrent que, même si les mesures prises dans ce cadre diminuent quantitativement, le travail qui continue d’être mené par les différents services de police et de gendarmerie contribue efficacement à assurer la sécurité de nos compatriotes.
La sortie de l’état d’urgence, évoquée par Guy Geoffroy, est une vraie question, déjà abordée au moment de voter la prorogation. Nous devons considérer que l’état d’urgence n’a pas vocation à durer indéfiniment, et nous avons œuvré pour donner à l’autorité judiciaire et à nos services de sécurité, en dehors de l’état d’urgence, des moyens particuliers qui se trouvaient jusqu’alors dans les angles morts de notre droit. Je pense au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, dont Colette Capdevielle et moi-même sommes les rapporteurs : adopté en première lecture à une large majorité, ce texte vient d’être voté par le Sénat avec certaines modifications, et une commission mixte paritaire (CMP) va prochainement se réunir. Je forme le vœu que cette CMP soit l’occasion de trouver tous les points d’équilibre nécessaires – le travail de rapprochement avec les positions de nos collègues sénateurs ne me paraît pas insurmontable –, afin que le texte puisse être promulgué avant le 26 mai prochain. Nous disposerions ainsi dans le droit commun, non pas de dispositions analogues à celles de l’état d’urgence, mais de mesures conférant à nos services de sécurité et à l’autorité judiciaire une force nouvelle permettant à notre pays de faire face aux menaces auxquelles il est confronté.
Mme Colette Capdevielle. Je me joins aux félicitations de mes collègues pour le travail que vous avez accompli avec M. Poisson, monsieur le président, et qui nous permet de suivre quotidiennement l’évolution de l’état d’urgence.
La banalisation de l’état d’urgence, résultant de son inscription sur une longue période, est un problème en ce qu’elle diminue son efficacité. Dès lors, il faut se demander comment en sortir. Il y aura toujours un événement justifiant que l’on s’interroge sur la nécessité de maintenir ce dispositif : après l’Euro de football, ce sera le Tour de France cycliste, puis les manifestations du 14 juillet, et ainsi de suite. Comme l’a dit M. Popelin, nous avons déjà intégré au droit commun des dispositions donnant plus d’efficacité aux services de sécurité et à l’autorité judiciaire. Le plus important, ce sont les personnes assignées à résidence. De ce point de vue, le texte que nous avons voté et qui est en cours d’examen au Sénat sera de nature, une fois devenu définitif, à permettre de mettre fin dans des conditions raisonnables à un état d’urgence dont la poursuite sur une trop longue durée compromettrait gravement l’efficacité.
Je suis très attentive au sort des trois observations formulées par le Défenseur des droits, à savoir qu’un récépissé de perquisition administrative doit être systématiquement remis à l’intéressé afin de lui permettre de faire valoir ses droits ; que les formalités d’indemnisation des bris de portes ou de fenêtres occasionnés lors de perquisitions s’étant révélées juridiquement non fondées soient facilitées et rendues plus rapides ; enfin, que des mesures particulières doivent être prises dans le cas de la présence de mineurs sur les lieux d’une perquisition administrative. Je souhaite, monsieur le président, que vous interrogiez le Gouvernement sur ces trois points.
Nos concitoyens peuvent être rassurés, car les récentes affaires très médiatisées relèvent en fait du droit pénal commun. Nous avons voté des mesures constituant un véritable arsenal législatif, et je pense que l’aggravation des sanctions prévues par le code pénal, ainsi que la multiplication des possibilités offertes par le code de procédure pénale, assurent à nos concitoyens une grande sécurité juridique, les affaires les plus graves relevant du droit commun.
M. François Vannson. Je vous félicite également, monsieur le président, pour la qualité de ce rapport, en soulignant l’étroitesse de votre marge de manœuvre eu égard à la spécificité de l’état d’urgence, qui ne facilite pas l’action de contrôle.
Le Président de la République a annoncé lors du Congrès de Versailles qu’il allait créer des postes de gendarmes et de policiers – mais former des personnels des forces de sécurité prend du temps. Il a également fait part de sa volonté de voir mobiliser les réservistes, ce qui me paraît une très bonne idée compte tenu de la nécessité de faire intervenir rapidement des forces sur le terrain : pouvez-vous nous faire part de votre avis et des éléments d’information dont vous disposez sur ce point ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Monsieur le président, je vous félicite également pour le travail accompli, dont on ne soulignera jamais assez l’aspect novateur.
Je voudrais d’abord souligner fermement que l’État de droit s’est bien tenu durant l’état d’urgence, grâce à l’activité de contrôle du Parlement, à l’intervention d’un juge administratif très protecteur, absent dans de nombreux pays, ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, même si, comme cela a été dit, celle-ci peut avoir pour effet de gêner l’action entreprise dans le cadre de l’état d’urgence – ce qui risque de conduire à ce que le renseignement prenne éventuellement le relais pour mener à bien certaines actions qui ont dû être abandonnées.
Vous avez souligné que le nombre de perquisitions et d’assignations à résidence avait décru au fil du temps, ce qui montre bien que l’état d’urgence n’est pas si nocif. Au demeurant, il me semble que l’état d’urgence n’empêche pas nos concitoyens de manifester dans les rues comme ils l’ont toujours fait. Je me trouvais à la gare du Nord deux jours après les horribles attentats de Bruxelles, lorsque j’ai vu passer durant une demi-heure, le long d’un train Thalys retardé en raison d’un incident mécanique, une manifestation d’étudiants et de lycéens contre la réforme du droit du travail. Loin de moi l’idée de blâmer cette manifestation, mais force est de constater qu’elle se déroulait librement au milieu de l’une des gares les plus exposées, donc les plus surveillées de France, sans que cela semble choquer qui que ce soit – surtout pas les Britanniques, très habitués aux manifestations, qui attendaient pour prendre leur train. Si je souligne cela, c’est que je suis parfois choquée des prises de position de certaines associations.
J’ai été un peu étonnée par la question de M. Morel-A-L’Huissier, qui se demandait si l’on avait bien fouillé tous les quartiers sensibles. Mais qu’est-ce qu’un quartier sensible, cher collègue ? En êtes-vous encore à croire que le radicalisme djihadiste ne se rencontre que dans ce que l’on appelait autrefois les banlieues, alors que chacun sait que le terrorisme trouve aussi bien sa source en Bretagne ou en Ariège, y compris dans des zones rurales ou dans des quartiers aisés ? Votre question est d’autant plus étonnante que nous n’en serions pas là aujourd’hui si votre majorité n’avait pas, en son temps, supprimé la police de proximité dans ce que vous appelez les quartiers sensibles : la maintenir aurait permis de continuer à surveiller la montée du radicalisme – et il en est de même du renseignement territorial, réduit à zéro durant le quinquennat précédent, alors que 32 % des perquisitions effectuées dans le cadre de l’état d’urgence ont été conduites à l’initiative de ses services.
J’approuve l’idée de remettre un récépissé de perquisition administrative aux intéressés, évoquée par Colette Capdevielle ; j’ajoute que, pour moi, ce document devrait comporter les observations de l’intéressé.
Enfin, je ne partage pas les inquiétudes qui ont été exprimées au sujet de la durée de l’état d’urgence, l’État de droit me paraissant protégé de manière satisfaisante. À mes yeux, il n’y a pas de banalisation de l’état d’urgence : nous nous trouvons plutôt dans un état sociologiquement intermédiaire que je qualifierai d’état de vigilance.
Mme Sandrine Mazetier. Monsieur le président, je vous félicite pour le travail mené par vous-même, ainsi que par Jean-Frédéric Poisson et les administrateurs de la commission.
Il ressortait du premier point d’étape sur l’état d’urgence que les assignations à résidence étaient effectuées selon des modalités standards. J’aimerais savoir si les choses ont évolué du fait des observations que nous avions formulées à l’époque, ou si les personnes assignées à résidence sont toujours soumises au même rythme et aux mêmes modalités d’assignation.
Je souscris pleinement aux trois questions que vous formulez au sujet des assignations à résidence, mais je me demande tout de même si nous ne pourrions pas obtenir davantage d’informations sur la judiciarisation éventuelle des situations et des personnes concernées.
Pourrez-vous nous préciser aussi ce qu’il advient des assignations à résidence qui ne sont pas notifiées à leur destinataire, faute de pouvoir localiser cette personne ? Cela déclenche-t-il une alarme et la mise en place d’une procédure particulière, ou prend-on simplement acte du fait que la personne est introuvable ? Cette question revêt une certaine importance, compte tenu du nombre d’assignations à résidence non notifiées.
Pour ce qui est des perquisitions, nous devons prendre acte de la censure du Conseil constitutionnel relative à la copie de données informatiques, qui rend impossible un examen approfondi des données saisies. Certes, on peut difficilement conserver en masse les données saisies dans le cadre de l’état d’urgence, ce qui montre que l’outil juridique dont nous nous étions dotés n’était manifestement pas adapté : nous devons donc engager une réflexion en consultant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et l’ensemble des acteurs concernés, afin de trouver une solution équilibrée permettant à la fois de fournir des garanties quant à la protection de la vie privée et d’exploiter les données obtenues grâce aux perquisitions, qui constituent sans nul doute une source d’informations utiles à la lutte contre le terrorisme.
Mme Cécile Untermaier. Je souligne, moi aussi, la qualité du travail effectué et l’importance du contrôle parlementaire de l’état d’urgence.
J’aimerais savoir s’il est prévu d’analyser précisément, a posteriori, le fait déclencheur des perquisitions, surtout dans les cas où celles-ci n’ont pas abouti au résultat attendu. Le bilan que nous pourrions établir permettrait sans doute d’affiner le dispositif pour le rendre plus efficace.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Puisque Mme Bechtel a cru bon de m’interpeller au sujet de la question que j’avais posée – j’apprécie à sa juste valeur cette marque de sympathie à mon endroit –, je précise que, lorsque les perquisitions administratives ont été autorisées, les préfets ont utilisé tous les moyens de renseignement dont ils disposaient, notamment dans les quartiers sensibles. On a ainsi traité le « stock » dans les zones de non-droit où les gendarmes et les policiers n’osaient plus mettre les pieds. Le sens de ma question est le suivant : à l’heure actuelle, tous les quartiers sensibles ont-ils été traités, ou existe-t-il des poches de résistance ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Il ne fallait pas supprimer l’îlotage !
M. le président Dominique Raimbourg. Je commencerai par souligner, en leur rendant hommage, l’implication des services de police et de gendarmerie ainsi que la qualité du travail fourni à l’initiative des préfectures, des états-majors de sécurité et des services centraux.
Comme l’ont dit Colette Capdevielle et Pascal Popelin, il est important que nous votions le texte sur la procédure pénale, qui pourra ainsi prendre le relais des dispositifs sur lesquels nous nous appuyons dans le cadre de l’état d’urgence.
Le droit commun ne nous laisse toutefois pas totalement démunis, puisque nous avons adopté un certain nombre de textes : après les lois antiterroristes du 21 décembre 2012 et du 13 novembre 2014 et la loi sur le renseignement du 24 juillet 2015, nous sommes en train d’examiner une loi renforçant la lutte contre le crime organisé.
Je n’ai pas d’informations particulières au sujet des réservistes, mais je vais me renseigner.
En réponse à Mme Mazetier, je veux dire que la personnalisation des assignations à résidence s’est affinée, notamment en ce qui concerne les horaires de pointage.
Pour ce qui est de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, il paraît difficile de mettre en œuvre dans les deux mois qui restent une procédure particulière au sein de l’état d’urgence, permettant de procéder aux saisies informatiques – c’est d’autant moins pertinent que le nombre de perquisitions et d’assignations à résidence a beaucoup diminué.
J’ai le sentiment que tout ce qui était « en stock », pour reprendre l’expression de M. Morel-A-L’Huissier, a été traité, et que les perquisitions ont eu lieu partout où elles devaient être effectuées, sans que cela occasionne de grandes difficultés si l’on se réfère au nombre assez limité d’interventions des unités spéciales d’intervention dans ce cadre – ce qui est plutôt rassurant.
Si l’état d’urgence prend fin, nous ne serons pas pour autant démunis, le droit commun permettant de lutter contre la délinquance, la radicalisation et le terrorisme. Ainsi, 140 perquisitions administratives ont eu lieu dans le Val-d’Oise, dont 23 à Argenteuil, mais la découverte de la cache de Reda Kriket, arrêté à Boulogne-Billancourt, s’est faite dans le cadre d’une perquisition judiciaire classique. Je ne suis ni policier, ni sociologue, mais j’émets l’hypothèse selon laquelle l’état d’urgence aurait servi à intervenir dans un « bas de spectre », tandis que les dispositifs judiciaires de droit commun intervenaient dans un « haut de spectre ».
Telles sont les réponses que je peux apporter à l’heure actuelle aux questions que vous m’avez posées.
M. Jean-Luc Warsmann. Je vous félicite pour votre travail, monsieur le président, et suis tout à fait d’accord avec ce que vous venez de dire. Quand les services ont disposé du nouvel outil que constituait le droit d’effectuer des perquisitions, ils l’ont immédiatement utilisé en des lieux où des indices laissaient penser qu’ils étaient en lien avec des infractions, alors qu’en temps normal le même travail aurait pris plusieurs mois : nous avons pêché en eaux troubles, et fait quelques prises intéressantes ayant donné lieu à des suites judiciaires. Les critiques relatives à un taux de suites judiciaires jugé insuffisant me paraissent injustifiées, car l’objectif consistant à pouvoir agir dans les lieux où nous n’avions que des soupçons a été atteint.
M. le président Dominique Raimbourg. Mes chers collègues, je vous remercie pour votre présence et vos interventions.
Communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence lors de la réunion de la commission des Lois du mardi 17 mai 2016.
(Extrait du compte rendu n° 79)
M. le président Dominique Raimbourg. Nous accueillons aujourd’hui M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, pour une séance consacrée à l’état d’urgence. L’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, prorogeant une troisième fois l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est l’occasion, pour Jean-Frédéric Poisson et moi-même, de présenter la quatrième communication d’étape relative au contrôle parlementaire de l’état d’urgence, après celles du 16 décembre 2015, du 13 janvier et du 30 mars 2016.
Sur le fondement des chiffres transmis par le Gouvernement, 3 579 perquisitions administratives ont été conduites entre le 14 novembre 2015 et le 13 mai 2016 dans le cadre de l’état d’urgence. Elles ont permis la découverte de 756 armes, la constatation de 557 infractions, la réalisation de 420 interpellations et le placement de 364 personnes en garde à vue. Seules 152 perquisitions ont été effectuées pendant la période couvrant la deuxième prorogation de l’état d’urgence. On constate donc à nouveau une baisse des perquisitions, mais nous ne disposons de données détaillées que pour 88 des 152 perquisitions annoncées.
Parmi les armes saisies, 558 sont des armes à feu, dont 75 armes de guerre, 226 armes de poing et 257 armes longues – ces dernières étant pour partie des fusils de chasse. Ces chiffres représentent environ 10 % du total des armes saisies au cours d’une année ordinaire par les services des douanes, de la police et de la gendarmerie. Les 191 autres armes sont des armes blanches, des matraques, des pistolets d’alarme et des poings américains. La détention de certaines de ces armes est libre ou soumise à une simple déclaration, si bien qu’elle ne constitue pas forcément une infraction.
La chancellerie nous a indiqué que les perquisitions administratives ont conduit les tribunaux à prononcer 67 peines, dont 56 incarcérations. On a constaté, à l’occasion des perquisitions administratives, 31 infractions susceptibles de se rattacher au terrorisme, dont beaucoup constituent des apologies du terrorisme. Six procédures, résultant totalement ou partiellement d’une perquisition administrative, ont été initiées sur le fondement de chef d’association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste et ont conduit à la saisine de la section antiterroriste du parquet de Paris. Cette dernière a ouvert 96 procédures exclusivement judiciaires, sur le même chef, depuis le 14 novembre 2015.
Le risque d’annulation par les tribunaux judiciaires des procédures ouvertes sur le fondement d’une perquisition administrative est bien réel, puisque la procédure pénale s’avère plus exigeante à l’encontre des actes d’enquête que le contrôle a posteriori effectué par la juridiction administrative. La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la Justice a recensé à ce jour huit procédures dans lesquelles la régularité des perquisitions administratives a été contestée à l’audience. Dans cinq cas, l’insuffisante motivation des ordres de perquisition constituait le moyen avancé ; nous ignorons l’issue de l’une de ces affaires, mais le tribunal a fait droit à cette exception d’illégalité dans deux cas. Dans les trois autres procédures, l’exception d’illégalité tenait à l’insuffisante précision des ordres de motivation concernant les personnes et les lieux visés.
Dans une décision du 19 février dernier, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution une partie des dispositions du I de l’article 11 de la loi qui lui était soumise, privant ainsi de fondement juridique les copies de données informatiques et d’une partie de leur intérêt les perquisitions administratives. En outre, le total de cibles à perquisitionner ayant diminué, le nombre de ces opérations a baissé.
Entre le 14 novembre 2015 et le 29 avril 2016, 404 personnes ont fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Parmi ces mesures, 27 ont été prononcées dans le cadre des dispositions prises par le Gouvernement pour assurer la sécurité de la 21e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). Parmi les 374 assignations visant des individus au titre de leur implication dans la mouvance islamiste radicale, 268 étaient encore en vigueur en février dernier, à la fin de la première période de prorogation de l’état d’urgence. Depuis le 26 février, 69 assignations ont été renouvelées, trois nouvelles ont été mises en œuvre et 199 n’ont pas été renouvelées.
La loi du 3 avril 1955 permet de prendre des dispositions particulières pour préserver l’ordre public, leur régime juridique allégeant les contraintes et les exigences de proportionnalité requises normalement par la juridiction administrative. Nous avons examiné 135 arrêtés préfectoraux d’encadrement de la circulation des personnes pris entre le 14 novembre et le 14 janvier. Ces arrêtés concernent entre autres des interdictions de réunion prises rapidement après les attentats, comme des rencontres de football, deux spectacles à Paris, un forum philosophique au Mans, le salon Studyrama à Toulon, ou encore la fermeture par le préfet du Val-d’Oise du sous-sol d’un foyer d’immigrés à Pontoise pour une durée indéterminée, au motif qu’on y entendait des prêches radicaux.
Le second alinéa de l’article 8 étend le pouvoir des préfets d’interdire des manifestations sur la voie publique. Les préfets ont utilisé cette disposition à 19 reprises, même si neuf de ces rassemblements avaient été déclarés en préfecture. À notre connaissance, 82 arrêtés préfectoraux d’interdiction générale de manifestation ont concerné, dans la même période, des territoires coïncidant le plus souvent avec le département entier et des rassemblements liés principalement à la COP21.
Enfin, le régime de l’état d’urgence permet de réglementer plus strictement la circulation et l’accès à certains périmètres. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit la circulation dans des sites industriels sensibles, son homologue de Mayenne a procédé à des interdictions temporelles afin de favoriser la conduite de perquisitions et celui de l’Yonne a mis en place un couvre-feu pendant trois nuits dans un quartier de Sens. Des interdictions d’accès à certains périmètres ont été prononcées pour la COP21 ou pour la sécurisation d’un site « Seveso ».
Malgré la diminution du nombre de perquisitions, le contrôle parlementaire reste justifié car l’état d’urgence, centré jusqu’à maintenant sur le terrorisme, va se déplacer sur le terrain du maintien de l’ordre public, à l’occasion de l’Euro de football et du Tour de France. Cet élargissement important légitime le maintien d’un contrôle parlementaire, non pour en contester la nécessité, mais pour assurer à la représentation nationale un regard sur les mesures prises. Monsieur le ministre, nous vous demandons donc de nous communiquer toutes les décisions générales ou individuelles arrêtées par les préfets ; en effet, nous devons veiller à garantir le difficile équilibre entre le respect de l’ordre et celui des libertés dans cette période qui reste exceptionnelle.
Mes chers collègues, conformément aux règles et aux usages applicables aux commissions d’enquête, vous vous prononcerez la semaine prochaine sur la publication des comptes rendus des auditions auxquelles nous avons procédé dans les formes applicables aux commissions d’enquête, depuis l’instauration du contrôle parlementaire de l’état d’urgence. Nous souhaitons rendre publics ces documents avant le 3 juin prochain, l’ensemble des membres de notre Commission pouvant les consulter avant le vote qui, en cas d’issue positive, précédera de cinq jours la publication.
Je tiens à remercier M. Jean-Frédéric Poisson de participer à ce contrôle parlementaire, ainsi que les services de la commission des Lois, qui ont effectué un travail précis et minutieux d’examen de toutes les décisions.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je remercie également les services de la Commission de leur travail et notamment de la rédaction du rapport, celui-ci s’avérant exhaustif et ferme sur les points d’accord entre le président Raimbourg et moi-même, tout en laissant la place aux différentes opinions de chacun sur l’opportunité de proroger l’état d’urgence.
Je suis défavorable au principe même d’une nouvelle prolongation de l’état d’urgence, pour des raisons que j’ai exposées ici en janvier et en mars, et que je maintiens aujourd’hui. En effet, ce bilan reprend totalement les conclusions auxquelles M. Jean-Jacques Urvoas et moi étions parvenus en janvier dernier. Le nombre de mesures prises au titre de l'état d’urgence décline, ce qui ne constitue pas une surprise, et l’on s’interroge sur l’efficacité des dispositifs et sur la capacité des forces de l’ordre à les appliquer de manière cohérente et homogène dans le temps. Il ne faut pas oublier en effet le degré de mobilisation demandé aux services de sécurité et à ceux de l’État en général, non plus que la tension que ces services connaissent du fait de l’état d’urgence et d’autres facteurs ; tout cela doit nous conduire à nous interroger sur la pérennité de ce régime juridique.
Comme en janvier dernier, je constate que la mise en œuvre de l’état d’urgence ne constitue pas une entorse à l’état de droit. Certaines institutions célèbres et prestigieuses cherchent à faire accroire le contraire dans le débat public, mais elles ont tort. Au nom de la représentation nationale, notre Commission doit affirmer que, même si certaines mesures peuvent être annulées ou modifiées, l’état d’urgence ne dégrade pas notre État de droit. N’ayons pas peur de marteler ce fait !
Ce dispositif a besoin, pour être efficace, de nombreuses perquisitions et assignations à résidence. Or la prolongation qui nous est présentée entérine la fin des perquisitions administratives, et le nombre des assignations à résidence recule nettement – grâce au travail des forces de sécurité. Le contrôle parlementaire dresse un tableau quantitatif des opérations menées et met en lumière les raisons qui ont conduit à leur déploiement ; il doit donc continuer, l’extinction des pouvoirs de commission d’enquête n’empêchant pas la poursuite de ce travail, qui fournit à la représentation nationale et aux Français des éléments d’appréciation complets.
M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur. En raison de la persistance de menaces graves à caractère terroriste susceptibles de se concrétiser à tout moment sur le territoire national, le Gouvernement soumet à votre examen une troisième loi de prorogation de l’état d’urgence, pour une durée supplémentaire limitée à deux mois.
Avant d’en détailler la présentation, je tiens à remercier le président Raimbourg, qui a repris le flambeau du président Urvoas au côté du co-rapporteur Jean-Frédéric Poisson, et qui vient de dresser avec ce dernier le bilan de la mise en œuvre de l’état d’urgence depuis sa prorogation en date du 26 février.
À cet égard, nous nous sommes efforcés, comme nous le faisons depuis de nombreuses semaines, de répondre à toutes les demandes qui nous ont été adressées. Afin de permettre aux parlementaires de disposer des dernières informations, mon directeur de cabinet envoie, sous mon autorité, un ensemble d’éléments au Parlement lorsque c’est nécessaire.
Il ne m’appartient pas de commenter ceux qui viennent d’être portés à votre connaissance par Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson. Je constate simplement que, globalement, ils vont dans le même sens que l’analyse du Gouvernement quant à la nécessité de proroger l’état d’urgence – même si j’ai bien perçu, depuis de nombreuses semaines, la position de Jean-Frédéric Poisson.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés du contexte actuel. Ils sont d’abord juridiques, avec l’évolution jurisprudentielle du juge administratif, à laquelle nous avons dû nous adapter. Ainsi, il a été tenu compte de cette évolution pour la reconduite des assignations à résidence après le 26 février, et ce sera évidemment fait aussi après le 26 mai. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les perquisitions administratives en a ensuite considérablement réduit la portée, rendant nécessaire un renforcement de notre droit commun auquel nous avons œuvré dans le projet de loi porté par mon collègue Jean-Jacques Urvoas.
Enfin, l’analyse des mesures prises au cours des derniers mois tranche un débat juridique et politique, mais aussi, en quelque sorte, philosophique. Il a opposé ceux qui, au nom d’intérêts parfois contradictoires, voient dans l’état d’urgence un mode de gouvernance dérogatoire à tout principe démocratique et ceux, dont je suis, qui considèrent que l’état d’urgence est au service non seulement de la préservation des libertés, mais également de leur expression, dans le cadre d’une menace terroriste imminente.
Ce dernier point correspond d’ailleurs exactement à ce qu’a révélé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 février dernier. Les mesures de police administrative que nous prenons en application de l’état d’urgence présentent un caractère exceptionnel. Elles doivent être strictement proportionnées à la nature de la menace et au contexte d’ordre public qui en découle. Elles doivent concilier la prévention des atteintes à l’ordre public avec le respect des droits et des libertés, parmi lesquels le droit et la liberté d’expression collective des idées et des opinions.
J’ai été saisi par votre rapporteur Jean-Frédéric Poisson d’une demande d’interdiction préventive de tout rassemblement sur l’ensemble du territoire. Il le sait, une telle demande générale et générique ne saurait trouver de fondement légal dans notre droit. La liberté de manifester est une liberté constitutionnelle, comme le rappelle la décision du Conseil constitutionnel du 19 février dernier ; constitutionnellement garantie, elle doit être protégée. Je lui ai indiqué les éléments qui président à ce positionnement de l’État dans un courrier dont j’ai apporté la copie et que je tiens à votre disposition. De fait, si les autorités chargées des mesures de police administrative prenaient de telles décisions générales et absolues, non seulement elles se mettraient hors du droit, mais ces décisions seraient assurément censurées par le juge, ce qui affaiblirait considérablement le crédit dont jouit l’État. Vous avez d’ailleurs pu constater aujourd’hui même que le juge administratif adopte au sujet des interdictions de paraître une position qui doit nous inciter à la plus grande méticulosité lorsque nous prenons des mesures de police administrative destinées à éviter des troubles à l’ordre public.
Il est toutefois naturellement possible, dans le cadre de l’état d’urgence comme dans celui du droit commun, d’interdire des manifestations de manière préventive et ponctuelle. Cela a été fait samedi dernier à Rennes, mais dans des conditions particulières : l’existence d’une menace à l’ordre public spécifique et étayée, et l’impossibilité de prévenir les risques que représentent les troubles à l’ordre public par un moyen au moins aussi coercitif que l’interdiction de manifestation. Car le droit de manifester n’est pas le droit de s’affranchir de toutes les règles de droit, de déverser sa haine et sa violence dans l’espace public, de s’en prendre aux personnes et aux biens.
De même, à Paris, le préfet de police a pris 41 mesures d’interdiction dites de séjour, qui sont en réalité des interdictions de paraître en un lieu et en une période donnés. Il l’a fait parce que, face à la menace terroriste, nos forces de sécurité sont mobilisées sur l’ensemble du territoire et que, en recourant à une mesure circonstanciée plutôt qu’à une interdiction générale, nous nous sommes efforcés de concilier le droit de manifester avec la protection des Français contre le péril que représenterait un acte violent.
Huit arrêtés ont en outre été pris par le préfet de Loire-Atlantique, un par le préfet d’Ille-et-Vilaine et trois par celui de Haute-Garonne. Au niveau national, ce sont donc 53 arrêtés préfectoraux qui ont été signés, dont 48 notifiés. Un arrêté a été levé ce matin et certains ont fait l’objet de suspensions. Il faudra d’ailleurs regarder de très près les considérants du juge administratif concernant les interdictions de paraître, car ils permettront de circonscrire le domaine d’intervention ouvert à l’État en matière de mesures de police administrative, sachant que le juge administratif précise sa doctrine à chaque jugement. En ce qui concerne les assignations à résidence comme les perquisitions administratives, les choses se sont considérablement durcies.
Enfin, lorsque des débordements ou des exactions ont lieu en marge des cortèges, nous intervenons, et ce, comme auparavant, sur le fondement du droit commun. C’est ainsi que, depuis le début des manifestations contre la loi « travail », plus de 1 300 individus ont été interpellés pour des faits de violence commis lors de ces manifestations, parmi lesquels 819 ont été placés en garde à vue, et 51 ont d’ores et déjà été condamnés par la justice dans le cadre de comparutions immédiates.
Toutefois, je le répète, l’état d’urgence n’est pas un état de convenance politique. De même, je veux rappeler le principe essentiel selon lequel l’état d’urgence n’a pas vocation à durer plus longtemps que nécessaire. Certes, aujourd’hui, nous en demandons à nouveau la prorogation, mais c’est en raison de la persistance du péril terroriste dans un contexte particulier, marqué par l’organisation d’événements de dimension internationale qui contribuent au rayonnement de la France. Je songe notamment à l’Euro 2016.
Quant à l’intensité de la menace, le 22 mars dernier, Bruxelles a été victime, après Paris, d’un attentat multi-sites d’une extrême violence qui a provoqué la mort d’une trentaine de personnes. Le 24 mars, à Argenteuil, l’action de nos services de renseignement nous a permis de mettre en échec un nouveau projet d’attentat – voire plusieurs, au vu de ce que nous avons trouvé chez Reda Kriket. Si les investigations menées à l’échelle européenne ont permis d’arrêter, au cours de ces dernières semaines, la plupart des membres identifiés du réseau terroriste ayant fomenté et exécuté les attentats de Paris et de Bruxelles, nous savons que la menace demeure très élevée. Nous savons aussi que les attentats de Bruxelles ont été commis dans cette ville parce que leurs auteurs n’ont pas eu le temps de frapper à nouveau la France – car tel était bien leur projet. Songez par ailleurs que, depuis le début de l’année, les services de police spécialisés ont procédé à 101 interpellations en lien direct avec le terrorisme djihadiste, ayant donné lieu à 45 mises en examen et 33 mises sous écrou.
Ces chiffres témoignent à eux seuls du niveau de la menace. L’organisation, cet été, de l’Euro 2016 et du Tour de France nous impose une vigilance redoublée, car ces événements populaires et d’ampleur internationale constituent des cibles potentielles pour les terroristes.
Le rapport de Dominique Raimbourg dressant le bilan opérationnel des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence, je ne reviendrai pas sur les détails, préférant insister sur la stratégie déployée.
Comme vous le savez, au cours des premiers jours de l’état d’urgence, en novembre dernier, les forces de sécurité ont conduit plusieurs centaines de perquisitions administratives dans le but de déstabiliser les filières terroristes. Le risque d’une réplique immédiate des attentats qui venaient de frapper notre pays était en effet très élevé, comme l’a démontré la neutralisation d’Abdelhamid Abaaoud, le 18 novembre, au cours d’une opération à Saint-Denis, alors qu’il projetait de commettre un nouvel attentat.
Une fois ce travail considérable accompli par les forces de sécurité, le nombre de perquisitions a logiquement diminué, pour s’établir à 145 entre le 27 février et le 9 mai. En dépit de cette baisse, 162 armes ont encore été saisies au cours de cette deuxième phase, ce qui montre que les personnes ciblées étaient particulièrement dangereuses. Au total, depuis le déclenchement de l’état d’urgence, 750 armes ont été neutralisées, dont 75 armes de guerre.
En outre, ces perquisitions ont permis d’effectuer un important travail de renseignement, de levée de doutes et de mise à jour des fichiers, qui s’est poursuivi durant la deuxième phase de l’état d’urgence.
En ce qui concerne les suites judiciaires des mesures que nous avons prises, 594 perquisitions administratives ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire, dont 223 du chef d’infraction à la législation sur les armes et 206 du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Vingt-huit informations judiciaires ont été ouvertes et 67 peines prononcées à l’issue de ces procédures, et 56 personnes ont été placées en détention, ce qui représente là encore des résultats particulièrement significatifs.
En ce qui concerne les assignations à résidence, sur les 268 procédures en vigueur au 26 février dernier, 69 ont été renouvelées. Trois nouvelles assignations ont été décidées au cours de cette deuxième phase, ce qui porte à 72 le nombre de décisions d’assignation. Par la suite, deux suspensions ont été prononcées par le juge administratif. Enfin, une assignation a été abrogée à l’initiative de l’administration car, concomitamment à l’abrogation, la personne concernée a été expulsée du territoire national.
À ce jour, et depuis 2013, pas moins de douze attentats ont été déjoués, dont sept depuis janvier 2015. Je veux par conséquent saluer le travail des services de renseignement, notamment de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dont je rappelle qu’elle est saisie, en propre ou avec la police judiciaire, du suivi de 261 dossiers judiciaires concernant 1 157 individus, en raison de leur implication dans des activités liées au terrorisme djihadiste. Parmi eux, 353 ont d’ores et déjà été interpellés et 13 font l’objet d’un mandat d’arrêt international ; 223 ont été mis en examen, 171 ont été écroués et 52 sont soumis à un contrôle judiciaire. Ces chiffres montrent à quel point l’action quotidienne des services, sous l’autorité de la justice, porte ses fruits en empêchant la commission d’actions violentes et d’attentats sur le sol national.
J’en viens à la prorogation de l’état d’urgence et aux raisons pour lesquelles nous la croyons à nouveau absolument nécessaire.
Au cours de ces derniers mois, plusieurs attentats, d’ampleur comparable ou inférieure à celle des attentats du 13 novembre, ont été commis à l’étranger, qui visaient nos intérêts et nos ressortissants. Les groupes djihadistes ont également visé des alliés directs de la France.
Grâce aux investigations menées, nous savons que les terroristes impliqués dans les attentats de Bruxelles appartenaient à la cellule qui a planifié et exécuté les attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. En outre, le parquet fédéral belge a confirmé que les attentats du 22 mars, qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés, devaient initialement avoir lieu en France, avant que les terroristes, pris de cours par les investigations judiciaires menées en Belgique par les équipes d’enquête franco-belges, ne soient contraints de précipiter leur action en s’attaquant à Bruxelles.
À l’heure actuelle, la menace terroriste demeure donc, je le répète, très élevée. La France représente clairement une cible prioritaire, en raison du combat résolu qu’elle mène contre les djihadistes au Sahel, en Irak et en Syrie, mais aussi, plus profondément, des principes universels de liberté, de laïcité et d’émancipation qui sont les nôtres depuis plus de deux siècles et qui font horreur aux terroristes djihadistes.
Pour toutes ces raisons, et quelles que soient les précautions que nous prenons, il ne nous est pas permis de nous croire à l’abri, ni de considérer que le « péril imminent » qui a justifié, en novembre dernier, la proclamation de l’état d’urgence a disparu.
En outre, au cours des mois qui viennent, les enjeux de sécurité seront d’autant plus complexes à traiter que nous nous apprêtons à accueillir un très grand nombre de visiteurs étrangers à l’occasion de l’Euro 2016, du 10 juin au 10 juillet prochains. Je l’ai dit, ce grand événement festif d’ampleur internationale intéresse les groupes terroristes, et nous devons, comme je l’ai fait pour le festival de Cannes – bien que les moyens mobilisés ne soient pas les mêmes –, prendre toutes les mesures nécessaires afin que la manifestation se déroule dans de bonnes conditions.
Nous bénéficierons du maintien du contrôle aux frontières. Depuis six mois, 33 millions de personnes ont été contrôlées sur l’ensemble de nos frontières, dans les deux sens, et 17 500 individus n’ont pas été admis sur le sol français. Le déploiement sur le territoire national de 110 000 policiers, gendarmes et militaires de nos armées dans le cadre de l’opération Sentinelle se poursuivra bien entendu également. S’y ajoutent le vote de la loi Savary et l’examen bientôt achevé du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
J’aimerais enfin apporter certaines précisions concernant les mesures que nous proposons de maintenir dans le cadre de l’état d’urgence.
Il sera possible de maintenir les dispositifs d’assignation à résidence, en procédant au renouvellement des assignations après un examen très attentif de ce que la jurisprudence nous dicte, au vu du nombre de décisions déjà prises par le juge administratif.
En revanche, nous ne procéderons pas à de nouvelles perquisitions administratives, notamment en raison de ce que le Conseil constitutionnel a indiqué concernant la modalité d’utilisation des éléments numériques saisis à cette occasion, et qui rend la mesure moins intéressante qu’au moment où nous avons déclenché certaines perquisitions il y a quelques semaines.
Enfin, s’agissant des rassemblements et de leurs conditions d’organisation, nous prendrons, dans le strict respect du principe de proportionnalité, les mesures d’ordre public qui peuvent permettre aux forces de l’ordre de faire face aux manifestations, dans le but de préserver l’ordre public mais sans jamais oublier que notre priorité est de mobiliser ces forces contre le terrorisme.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Pour la troisième fois, après nos débats de novembre puis de février dernier, notre commission est saisie par le Gouvernement d’une demande de prorogation de l’état d’urgence.
Beaucoup, presque tout a déjà été dit sur l’état d’urgence, son objet et ses modalités. Les appréciations diverses que suscite ce temps d’exception ont été maintes fois exprimées, parfois avec la nuance qui garantit davantage une belle exposition médiatique qu’elle ne témoigne d’un souci de vérité… Ainsi quelques-uns n’ont-ils eu de cesse de dénoncer un recours gouvernemental à l’état d’urgence qui, à leurs yeux, ne visait qu’à limiter la liberté d’expression. On voit que ces oracles ont nourri un procès d’intention contredit par les faits. D’autres, à l’inverse, rêvaient de l’état d’urgence pour légitimer juridiquement la suspension des libertés publiques, au premier rang desquelles le droit de manifester. Tant que la majorité et le Gouvernement seront ce qu’ils sont, il n’en sera naturellement jamais question.
L’état d’urgence, tel que nous le concevions, c’est un choix de responsabilité, de fermeté, d’efficacité. C’est un choix difficile, mais assumé, dans le strict respect du cadre légal que nous avons adapté à son temps en novembre 2015, sous un étroit contrôle juridictionnel et parlementaire.
Ce contrôle parlementaire inédit, notre président Dominique Raimbourg et notre collègue Jean-Frédéric Poisson viennent d’en dresser un bilan précis auquel je n’ai rien à ajouter. Je me contenterai de saluer leur travail, où l’on retrouve intacte la vigilance des débuts.
Pour nous prononcer sur la demande du Gouvernement, la première question qu’il nous revient de trancher est la permanence de la menace.
Le souvenir des attentats meurtriers de novembre en Seine-Saint-Denis et à Paris, après ceux de janvier 2015, est naturellement encore vif dans toutes les mémoires. Beaucoup d’autres ont malheureusement été perpétrés depuis, partout dans le monde : au Proche et au Moyen-Orient ; en Afrique de l’Ouest, en particulier en Côte-d’Ivoire, où des ressortissants et des intérêts français ont été frappés le 13 mars dernier.
Mais ce sont les attentats de Bruxelles, survenus le 22 mars, qui illustrent le mieux la persistance de la menace, par leur proximité géographique, ainsi que par le lien direct – pour ne pas dire davantage – qui apparaît établi entre leurs auteurs et ceux des opérations terroristes dont la France a été victime.
Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis du 28 avril 2016, le fait que perdure un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » est caractérisé par la coïncidence entre l’intensité de cette menace terroriste et l’organisation en France de deux manifestations sportives d’ampleur exceptionnelle : le Tour de France et le championnat d’Europe de football.
Ces éléments répondent à mes yeux sans le moindre doute à la question de la permanence de la menace.
La deuxième question sur laquelle nous devons nous déterminer est celle de la durée de la prorogation de l’état d’urgence qu’il est opportun de consentir.
Dans son avis du 2 février 2016, portant sur le projet de loi autorisant la deuxième prorogation, le Conseil d’État avait souligné que « les renouvellements de l’état d’urgence ne sauraient se succéder indéfiniment » et que « l’état d’urgence devait demeurer temporaire ».
Je crois pouvoir affirmer que personne, au sein de notre commission, n’accepterait que l’état d’urgence soit prolongé au-delà du strict nécessaire. Si chacun peut avoir sa propre appréciation de ce strict nécessaire, nous sommes collectivement désireux de revenir à la légalité ordinaire, dès lors que la sécurité de nos concitoyens pourrait être pleinement assurée par les moyens du droit commun.
De ce point de vue, j’observe que la durée proposée pour cette troisième prorogation permet d’englober exactement les deux grands événements sportifs internationaux que je viens d’évoquer. Elle doit permettre de recourir durant leur déroulement à des moyens renforcés, en particulier sur le fondement de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955, pour encadrer et sécuriser les grands mouvements de foule inhérents à ce type de manifestation. Je le rappelle, nous parlons, s’agissant de l’Euro 2016, de 51 matchs programmés dans dix villes dont Paris, de 2,5 millions de spectateurs attendus, dont un million d’étrangers, auxquels s’ajouteront plusieurs millions d’autres personnes qui participeront aux rassemblements populaires organisés en marge de cette compétition. Pour le Tour de France, ce seront des dizaines de milliers de spectateurs qui affluent chaque jour le long du parcours et dans les dix-sept sites et villes d’étape.
En outre, du point de vue du calendrier, notre Assemblée débattra après-demain du texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, dont j’ai l’honneur d’être le co-rapporteur avec notre collègue Colette Capdevielle. Cette loi devrait donc être promulguée très prochainement et entrer en vigueur dans les semaines à venir. Sans transposer, bien évidemment, dans le droit commun les dispositions d’exception de l’état d’urgence, elle permettra de doter l’autorité judiciaire et l’administration d’outils mieux adaptés à la prévention et à la répression du terrorisme.
Au regard de ces éléments, le délai de prorogation de deux mois me semble donc convenablement calibré.
La dernière question que je souhaite aborder est celle des conséquences en droit de la prorogation dont nous devons décider.
Le Gouvernement nous propose de revenir de l’état d’urgence « aggravé », comme on le qualifiait en 1955, à un état d’urgence « simple », c’est-à-dire sans perquisitions administratives.
Durant les premières semaines qui ont suivi le 13 novembre, les perquisitions administratives ont été nombreuses. Elles ont permis de chercher et de trouver les renseignements nécessaires pour désorganiser les réseaux terroristes. Elles ont aussi été l’occasion de lever des doutes. Au cours de la deuxième période, à compter du 26 février, elles ont été bien moins nombreuses, mais davantage ciblées et, par voie de conséquence, proportionnellement plus fructueuses. Désormais, elles ne bénéficient plus, ni de l’effet de surprise, ni de l’utilité spécifique qui les justifiait au cours des six derniers mois.
La décision d’abandonner cet outil exceptionnel me semble donc appropriée à l’évolution de la situation, la norme de droit commun que constituent les perquisitions judiciaires étant suffisante pour faire face aux nécessités.
C’est en dressant des constats similaires que le Sénat a fait le choix d’adopter sans modification le texte présenté par le Gouvernement, par 309 voix contre 30. Il me semble que l’Assemblée nationale ne peut faire moins.
Voilà pourquoi je vous propose d’adopter conforme le projet de loi prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, pour une durée de deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 25 juillet 2016 à minuit.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Personne n’approuve de gaieté de cœur l’état d’urgence, d’autant que les circonstances qui le justifient ne sont pas des plus plaisantes. Personne non plus ne confond cet état d’urgence avec un état d’exception grave et aigu qui serait prolongé des années durant, comme nous en avons l’exemple outre-Atlantique. Par deux fois en dix ans, le Congrès a passé outre des décisions du juge judiciaire sur l’habeas corpus de manière à prolonger un état d’exception, qui dure donc depuis bientôt quinze ans dans ce grand État démocratique. Personne, me semble-t-il, ne fait cette confusion.
Je dois dire au président mon scepticisme quant à la distinction qu’il a établie entre l’état d’urgence contre le terrorisme et un état d’urgence lié à l’ordre public et dicté par les grands événements sportifs à venir. Tout montre, et le rapporteur vient de le faire excellemment à l’instant, que c’est bien le lien entre le risque terroriste permanent et la survenance en France de deux très grands événements ayant vocation à attirer l’attention sur notre pays et à rassembler des foules qui justifie la troisième prorogation de l’état d’urgence. Il faut dissiper toute équivoque sur ce point. C’est seulement ce lien entre ces événements d’une durée limitée, qui correspond à celle pendant laquelle nous prorogeons l’état d’urgence, et la persistance de la menace terroriste, qui peut nous conduire à autoriser l’état d’urgence, qui permet de prendre des mesures qui vont au-delà des mesures habituelles en matière d’ordre public, par exemple les interdictions de paraître ou les interdictions de se trouver en certains lieux à certains moments, ou encore l’interdiction plus large de certains rassemblements. L’existence des deux compétitions sportives ne fait de doute pour personne. Reste donc à apprécier la réalité de la menace terroriste.
De ce point de vue, l’exécutif gère les affaires de sécurité intérieure et bénéficie pour ce faire du concours des services de renseignement. Ce n’est évidemment pas le cas du pouvoir législatif. Lorsque l’exécutif nous indique, sans agitation, avec fermeté et sang-froid, que la menace terroriste demeure aujourd’hui très grave, et qu’il s’appuie sur un certain nombre d’événements survenus récemment, comme les attentats déjoués, il me semble difficile de mettre en doute son constat. Au fur et à mesure que le temps passe, le terrorisme prend de plus en plus la forme d’un arbre : on coupe des branches, mais le tronc demeure et certains bourgeons repoussent peut-être plus vite que nous ne l’aurions souhaité.
De mon point de vue, vous l’aurez compris, nous pouvons, nous devons même, d’autant plus voter cette prorogation, encore une fois limitée dans le temps, que les choses ont beaucoup changé depuis 1955 : le contrôle par le juge, qu’il soit administratif ou judiciaire, des mesures prises par l’autorité publique chargée de la mise en œuvre de l’état d’urgence, ainsi que le contrôle parlementaire sur lequel nous avons beaucoup innové depuis la dernière loi créent un contexte tout à fait différent. Les chiffres et le bilan de l’efficacité sont sur la place publique, et le seront encore plus si nous suivons la proposition du président de communiquer davantage encore les données dont disposent les contrôleurs de l’état d’urgence.
Ce contrôle ne doit pas être confondu avec l’évaluation des politiques publiques, même si le mot « évaluation » figure, malheureusement selon moi, dans la loi du 20 novembre 2015 – il était également inscrit dans le projet de loi constitutionnelle. L’évaluation des politiques publiques fait partie des pouvoirs reconnus au Parlement par la Constitution. Mais il s’agit là de tout autre chose, d’un contrôle spécifique au fil de l’eau qui doit être garant de cet équilibre que nous recherchons tous entre les mesures prises par le Gouvernement, lui-même parfois surpris par certains événements, et le regard que le Parlement peut porter sur leur mise en œuvre au jour le jour. Ce n’est pas exactement de l’évaluation des politiques publiques. C’est autre chose.
Pour finir, je crois comprendre à la lecture du projet de loi que nous prorogeons l’application de la loi de 1955 dans l’ensemble des articles de cette dernière. Je ne trouve pas trace d’une disposition mettant fin à l’utilisation des perquisitions administratives. Faut-il comprendre que le Gouvernement s’engage à ne pas utiliser cet outil ? J’avoue n’avoir pas trouvé l’explication dans le texte.
M. Jean-Frédéric Poisson. Il y a une réponse !
Mme Marie-Françoise Bechtel. Mon cher collègue, puisque vous m’interpellez, il y a un certain paradoxe à demander l’interdiction de tout rassemblement public pendant une période déterminée, ce qui est pour le moins difficilement acceptable sur le plan constitutionnel, et, dans le même temps, à considérer que l’état d’urgence est inutile. Entre ces deux tentations extrêmes, la prorogation, pour les raisons que j’ai essayé de résumer rapidement, me semble correspondre à l’équilibre le plus raisonnable, puisque, malheureusement, notre pays reste une cible, ce que personne ne saurait contester.
M. Guillaume Larrivé. Le groupe Les Républicains avait voté en novembre et en février les lois relatives à l’état d’urgence. Nous avions considéré qu’il était indispensable de renforcer ainsi les pouvoirs de police administrative dont dispose l’exécutif.
Cet esprit de responsabilité guide notre expression sur chacun des textes qui sont présentés par le ministre de l’Intérieur ou le garde des Sceaux. Notre seule exigence est l’efficacité de l’État. Dans cet esprit, je souhaite vous faire part de deux interrogations et d’une demande.
La première interrogation porte sur le volume des assignations à résidence. Vous nous avez indiqué, monsieur le président, monsieur le rapporteur, que 69 personnes font aujourd’hui l’objet de cette mesure. Est-on absolument certain, monsieur le ministre, que d’autres ne devraient pas être assignés à résidence parmi les milliers d’individus d’ores et déjà fichés comme susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État ou faisant l’objet d’une radicalisation islamiste ? Nous sommes sortis du débat binaire qui opposait les tenants de l’assignation à résidence pour tout le monde et ceux qui défendaient une position diamétralement inverse. Entre tout et rien, n’est-il pas opportun pour le ministre de l’Intérieur de s’interroger sur un élargissement des mesures d’assignation à résidence ?
La deuxième interrogation porte sur l’absence d’utilisation des dispositions de la loi sur l’état d’urgence censées accélérer, d’une part, le blocage de contenus internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et, d’autre part, la fermeture de mosquées salafistes – les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent –, dispositions prévues respectivement par le II de l’article 11 et par l’article 6-1 de la loi de 1955. L’application des textes de droit commun reste possible, mais elle n’est guère satisfaisante. C’est en vertu des dispositions du code de la sécurité intérieure que la dissolution de trois associations cultuelles a été décidée par le conseil des ministres du 13 janvier. Or, l’une de ces trois décisions a été suspendue par le juge des référés. Nous vous demandons, monsieur le ministre, de préciser les raisons pour lesquelles vous n’avez pas jugé nécessaire ou opportun de vous fonder sur les dispositions particulières de la loi relative à l’état d’urgence pour procéder à des dissolutions ou au blocage de contenus internet. Nous vous appelons à amplifier cet effort en utilisant pleinement les instruments juridiques nouveaux que nous vous avons donnés pour fermer ces lieux de haine.
Enfin, nous vous demandons de maintenir la possibilité de recourir à des perquisitions administratives sous l’empire de l’état d’urgence. Notre groupe présentera un amendement à cette fin. Je précise à Mme Betchtel que l’article 11 de la loi de 1955 dispose qu’une disposition expresse de la loi de prorogation doit prévoir la possibilité de perquisitions administratives. C’est précisément l’objet de notre amendement que de le faire.
Selon nous, rien ne justifie, monsieur le ministre, que l’État soit demain privé de la possibilité d’effectuer une perquisition administrative, même dans le cadre contraint défini par le Conseil constitutionnel le 19 février, par exemple avant un match de l’Euro 2016 pour lequel un renseignement nécessiterait une vérification, une « levée de doute » comme vous le disiez, en urgence absolue. Je ne comprends pas les motifs qui ont poussé le Gouvernement à renoncer à cette faculté, non sans avoir hésité d’ailleurs, puisque l’avant-projet de loi dont vous aviez saisi le Conseil d’État incluait cette possibilité – la section de l’intérieur n’y avait du reste pas vu de difficultés – avant qu’une saisine rectificative ne la retire. Je précise que l’argument du rapporteur selon lequel le nombre de perquisitions administratives était moins important en avril qu’en décembre me paraît assez inopérant. Ce n’est pas le volume des perquisitions passées qui importe, mais la possibilité d’éviter tout nouvel attentat avant des événements qui présentent la particularité – c’est en cela que la question est nouvelle – d’être à date fixe. Avant de tels événements, il est possible, naturellement pas souhaitable, qu’un renseignement précis apparaisse « dans le radar » des services nécessitant une « levée de doute » en urgence absolue. Même si une seule perquisition administrative était nécessaire demain, pourquoi s’interdire d’utiliser cette faculté alors que cela pourrait peut-être sauver des vies ? Je le dis avec une certaine gravité, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement y renonce. L’argument avancé en commission au Sénat, selon lequel la loi relative à la procédure pénale facilite le régime des perquisitions judiciaires, est lui aussi relativement inopérant puisque cette loi n’est pas encore en vigueur.
Vous l’aurez compris, le groupe Les Républicains est favorable au principe de la prorogation de l’état d’urgence naturellement. Mais une interrogation persiste sur la nature de cet état d’urgence, en particulier sur la faculté dont vous vous privez de recourir aux perquisitions administratives extrêmement ciblées qui peuvent hélas être encore utiles.
M. Georges Fenech. Comme vient de l’indiquer Guillaume Larrivé, nous voterons cette prorogation de l’état d’urgence. Nous aurions préféré éviter ce nouveau débat, ce qu’aurait permis l’adoption des amendements de M. Ciotti, prévoyant une durée de prorogation couvrant les manifestations internationales.
Le constat est clair : nos forces de l’ordre sont à bout, et ce six mois après l’attaque du Bataclan. Après les actes terroristes effroyables dont notre pays a été la cible, nos forces de l’ordre avaient le soutien entier et total ainsi que la reconnaissance des Français. Nous partageons vos préoccupations et vos objectifs mais nous sommes dubitatifs sur les moyens qui nous paraissent sous-dimensionnés pour lutter contre les menaces. Aujourd’hui, les forces de l’ordre sont malmenées, épuisées et désormais prises pour cible. Les débordements et affrontements, lors des manifestations contre la loi « travail », continuent – il y a encore quelques heures à proximité de la gare Montparnasse ; le rassemblement « Nuit debout », place de la République, se poursuit, en dépit de l’état d’urgence ; la fan zone a été acceptée par la maire de Paris, Mme Hidalgo, avec votre approbation, pour l’Euro 2016.
La lassitude des forces de l’ordre est palpable : demain, elles manifesteront contre la haine « anti-flic » place de la République. Vous avez rappelé à juste titre que la menace terroriste était très élevée et imminente. Qu’allez-vous faire pour enfin soutenir vraiment nos forces de l’ordre, et ce à tous les échelons ? Quand allez-vous rétablir l’ordre en faisant cesser « Nuit debout » ? Quel signal allez-vous envoyer pour monter aux Français votre soutien total aux forces de l’ordre ?
J’entends bien vos explications sur l’impossibilité d’interdire de manière générale et absolue toute manifestation, mais n’y a-t-il pas un moyen juridique pour empêcher ces rassemblements ? Je vous pose la question. Je ne suis pas publiciste, mais n’est-ce pas là une occupation permanente illicite du domaine public, avec tous les dangers et les désagréments que cela comporte ?
L’État serait-il désarmé face à ce genre de manifestation alors que nous sommes en état de guerre, nous dit-on, et en état d’urgence ?
En ce qui concerne les fan zones, vous dites que la vigilance est redoublée, mais comment accepter de prendre le risque d’autoriser à Paris une fan zone où se rassembleront quelque 120 000 personnes ? N’aurait-il pas été plus prudent de les interdire à Paris ?
M. Yves Goasdoué. Il n’est pas dans l’« ADN » du groupe socialiste de considérer la prolongation de l’état d’urgence comme quelque chose de naturel ou de normal, mais nul ne peut prétendre que la menace serait surestimée. En raison de la coïncidence de cette menace et de l’Euro 2016 – plusieurs millions de personnes seront alors massées dans des stades – puis du Tour de France – qui offre à un ennemi la capacité de faire filmer son attaque en direct par la télévision –, le Conseil d’État a considéré qu’était caractérisé un péril imminent au sens de la loi du 3 avril 1955. Dans son avis, il a estimé nécessaire, adaptée, proportionnée, et par suite justifiée, l’application de mesures propres à l’état d’urgence dès lors que celui-ci était limité à deux mois et que n’y figuraient plus les mesures afférentes aux perquisitions administratives prévues par l’article 11 de la loi de 1955. Nous en prenons acte.
Nous prenons acte également du bilan d’étape parlementaire et du fait que, selon M. Poisson, la mise en œuvre de l’état d’urgence ne comporte aucune entorse à notre État de droit. S’il fallait en apporter une preuve supplémentaire, nous regarderions de près les attendus des tribunaux ayant censuré des interdictions de paraître.
Selon le Conseil d’État, la prolongation « opère une conciliation non déséquilibrée entre la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis, d’une part, et la protection de l’ordre et de la sécurité publics, d’autre part ». Il ne nous semble pas possible, en responsabilité, d’exposer la France, les Français et les étrangers qui vont nous rejoindre à un danger grave sans recourir à l’état d’urgence.
M. Patrice Verchère. Je suis, comme beaucoup, favorable à la prolongation de l’état d’urgence, même si, comme l’indique le rapport d’étape, les mesures qu’il permet ont été très utiles après les attentats du 13 novembre mais ne présentent plus le même intérêt aujourd’hui. J’y suis favorable, en raison de l’Euro 2 016 qui débutera le 10 juin et de la nécessité absolue de prévoir des moyens d’exception pour la sécurité des matchs.
Je suis toutefois inquiet au sujet de la sécurité des fan zones. Cette grande fête du football va accueillir près de dix millions de supporters. Il faudra sécuriser dix stades ainsi que les vingt-quatre équipes nationales engagées dans la compétition, mais aussi les sept à huit millions de personnes attendues aux quatre coins de notre pays. Selon certains spécialistes, les fan zones sont le maillon faible du dispositif sécuritaire. Y aura-t-il suffisamment de forces de l’ordre, déjà très sollicitées depuis plusieurs mois ? Y aura-t-il suffisamment d’agents de sécurité formés pour assurer les contrôles d’entrée des fins de zone ? Vu le nombre d’agents en cours de recrutement, sommes-nous assurés que certains ne font pas l’objet d’un fichage par nos services de renseignement ? Enfin, quelle sera la responsabilité des organisateurs de ces fan zones, notamment les mairies ?
M. Jacques Bompard. Je suis favorable à la prolongation de l’état d’urgence sur notre territoire. La menace islamiste, les explosions sociales, l’accélération des flux migratoires ajoutent au risque accru d’attentats contre la France. Quelques remarques sont cependant nécessaires concernant l’équilibre de cette politique.
La première concerne la difficulté légale, dans un État de droit, de lutter contre le terrorisme, un terrorisme formé par l’État islamique, ou par la télévision puisque tout se dit à la télévision. Un chef terroriste n’aura chez lui aucune arme, pas d’ordinateur, et sera donc à l’abri de toute enquête. Par ailleurs, le nombre de terroristes potentiels rend la surveillance très difficile car il faut beaucoup de monde pour surveiller ne serait-ce qu’une personne. Il ne serait pas non plus sage de mélanger lutte contre le terrorisme et lutte contre les manifestations.
Quelle est la portée de l’assignation à résidence dans la lutte contre le terrorisme ? Un terroriste assigné à résidence peut continuer d’agir. Mais il est vrai que, dans un État de droit, nous n’avons pas beaucoup d’autres moyens.
Qu’a-t-on fait dans la lutte contre l’islamisme radical, qui est le fond du problème ? À l’exception de quelques clips, critiqués par les spécialistes, et d’arrestations notables au départ, les mesures concrètes d’endiguement de la radicalisation de certains territoires se font attendre. Dans mon département, face à la perpétuation de milices de la charia en Avignon ou aux conflits entre salafistes à Bollène, le Gouvernement reste sans rien faire.
Où en est l’exemplarité ? Comment l’exécutif peut-il banaliser le terme « kouffar » dans la période actuelle ? Les symboles agissent, monsieur le ministre, et chacun sait que le mot « kouffar » est une banalisation de l’appel à la persécution des mécréants au cœur de l’idéologie takfiriste qui agite beaucoup d’islamistes.
Vous avez fait le lien avec la politique internationale. Comment croire à l’efficacité de l’état d’urgence tant que la France poursuivra une politique caricaturale sur le dossier syrien ? Faites-vous pression sur le Quai d’Orsay pour sortir d’une posture qui ne fait qu’aggraver le risque pesant sur notre pays ?
Les Français ont relativement bien subi les premiers attentats, en raison de la surprise, mais il n’est pas certain qu’ils supportent de nouveaux actes terroristes. Chacun d’entre nous doit réfléchir à cette situation extrêmement inconfortable pour tout le monde.
Mme Colette Capdevielle. La prolongation de l’état d’urgence permettra de couvrir les deux grands événements que sont l’Euro 2016 et le Tour de France, et c’est principalement pour cette raison que nous la voterons. Mais il y aura d’autres événements sportifs et festifs après le 26 juillet. Le 27 juillet, le lendemain même de la fin de l’état d’urgence, commenceront les célèbres fêtes de Bayonne. Depuis une dizaine d’années, ces fêtes rassemblent plus d’un million de personnes durant cinq jours, ce qui place cet événement parmi les plus importantes fêtes au monde en termes d’affluence, après le carnaval de Rio, la fête de la bière à Munich et la féria de Pampelune.
Pour relever le défi de la sécurité, un dispositif spécifique et innovant a été mis en place, permettant de faire travailler en commun les services de la mairie, de la préfecture, de l’État et de la justice. Accueillir plus d’un million de personnes sur un espace aussi réduit que le centre-ville historique d’une ville de moins de 50 000 habitants comporte son lot de risques. Chaque année, pourtant, le miracle a lieu, sans incidents majeurs, notamment grâce à des actions de prévention et à une forte conscience citoyenne, en particulier quant aux violences faites aux femmes.
Néanmoins, la présence des forces de l’ordre est indispensable au bon déroulement de la fête. L’an dernier, le dispositif mobilisait 500 policiers et CRS, 40 gendarmes, 500 sapeurs-pompiers, 380 agents hospitaliers, 150 volontaires associatifs, sans compter les centaines de bénévoles de la Croix-Rouge et de la protection civile. Pouvez-vous garantir la reconduction de ce dispositif de sécurité exceptionnel, malgré la proximité immédiate de la fin de l’état d’urgence ?
M. Guy Geoffroy. Je souhaite également vous interroger, monsieur le ministre, sur l’après-26 juillet, mais de façon générale. Nos concitoyens associent les dispositions que nous prenons à la réalité qu’ils ressentent d’un risque terroriste persistant, peut-être imminent. Ils comprendront, compte tenu du risque aggravé que constituent les deux événements dont nous avons parlé, que nous prolongions aujourd’hui l’état d’urgence, mais ils ne manqueront pas de s’interroger sur la période qui suivra. Ils risquent de se demander si leur sécurité pourra être assurée sans l’état d’urgence, et vous aurez donc à expliquer que l’absence des capacités supplémentaires permises par celui-ci n’empêchera pas l’État de continuer à protéger les Français. Avez-vous déjà à l’esprit le message par lequel le Gouvernement expliquera que la prolongation indéfinie de l’état d’urgence n’est pas possible, mais que sa fin ne signifie pas pour autant l’abandon par l’État de ses responsabilités à l’égard du risque terroriste, qui ne disparaîtra pas le 27 juillet au matin ?
M. Sergio Coronado. Comme le disait le 13 janvier, dans une communication solennelle, notre ancien président, devenu entretemps garde des Sceaux : « La législation d’exception n’est pas une simple alternative à celle des temps normaux. C’est une véritable dérogation seulement justifiée par l’évidence. Le grand dérangement qu’elle entraîne ne peut donc être que d’une brève durée et sans séquelles. »
D’aucuns considèrent que l’état d’urgence est quasiment devenu un état ordinaire. Je ne le pense pas, et l’ai dit au moment de la première prolongation, car cette législation d’exception met en suspens nos libertés fondamentales, même si je ne suis pas de ceux qui considèrent que la manière de l’appliquer justifie de comparer la France à une dictature.
Comme M. Geoffroy vient de le rappeler, il ne sera pas facile de sortir de l’état d’urgence. Il appartiendra au Gouvernement d’expliquer aux Français que la fin de l’état d’urgence n’est pas synonyme de moindre protection, mais que l’essentiel de l’apport de ses mesures est à présent derrière nous : l’effet de surprise s’est largement estompé, les chiffres montrent un essoufflement.
Au moment de la première prorogation, mon groupe s’est divisé sur le vote. Je pense qu’il votera majoritairement contre cette nouvelle prorogation.
Je souhaite, monsieur le ministre, vous interroger sur le passage d’un état d’urgence visant à s’attaquer au projet terroriste à un état d’urgence désormais utilisé au maintien de l’ordre public. Il sera très utile de regarder le fondement des décisions prises par les tribunaux administratifs pour mettre fin aux interdictions de paraître notifiées par le préfet de police de Paris à une dizaine de personnes. Nous avions fait savoir que nous pensions qu’il s’agissait d’une mesure exagérée et disproportionnée quand elle concernait les militants écologistes au moment de la COP21. La justice administrative semble nous donner raison. Votre réflexion tiendra-t-elle compte des fondements évoqués par le juge administratif ?
Enfin, quel intérêt y a-t-il à proroger l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire ? M. le rapporteur a utilisé l’argument de la proximité en faisant référence aux atroces attentats de Bruxelles : est-il nécessaire, pertinent et proportionné de maintenir l’état d’urgence partout en France, y compris dans les territoires d’outre-mer ?
M. Philippe Gosselin. Sans doute, monsieur Coronado, l’efficacité des dispositions de l’état d’urgence diminue-t-elle, comme en atteste le rapport, et cette tendance se confirmera-t-elle dans les mois qui viennent ; c’est la preuve que l’état d’urgence ne saurait être l’alpha et l’oméga de notre politique de lutte contre le terrorisme.
Cela étant dit, nous sommes en l’espèce sur la même longueur d’ondes que le Gouvernement – et n’avons aucun problème d’ADN, monsieur Goasdoué, même si, sans prétendre à un clivage caricatural entre l’ordre qui serait à droite et le désordre à gauche, nous n'avons pas les mêmes préventions en matière de sécurité. La prorogation, en effet, est nécessaire, car l’Euro de football et le Tour de France sont deux événements majeurs – même si d’autres pourraient s’ajouter à la liste comme, au hasard, la foire de Lessay, monsieur le ministre… (Sourires.) Sans doute aurions-nous pu anticiper davantage ces deux grands rassemblements populaires, comme l’avaient proposé certains de nos collègues, ce qui nous aurait évité non pas une séance de débat et de contrôle, l’un et l’autre étant parfaitement sains dans une démocratie, mais la répétition de grandes déclarations.
Même en période d’état d’urgence, le sentiment existe que le traitement des manifestants n’est guère différent de celui que prévoit le droit commun. Je pense à « Nuit Debout », aux manifestations de Rennes et de Nantes, à celles qui ont lieu aujourd’hui même : on pourrait s’attendre que l’approche adoptée soit différente en période d’état d’urgence, mais cela ne semble pas toujours être le cas.
Qu’en est-il de la fatigue de nos forces de l’ordre, auxquelles nous rendons tous hommage ? Le risque de surchauffe existe : comment préserver le moral des troupes et gérer l’organisation des services face à la pression à laquelle ils seront soumis dans les prochaines semaines ?
Enfin, quid de la sortie de l’état d’urgence, qui ne pourra pas connaître d’extinction progressive comme d’autres mesures ? D’autres dispositions sont-elles prévues pour que nous soyons prêts le moment venu ?
M. Jean-Frédéric Poisson. Permettez-moi tout d’abord de revenir sur l’utilisation que font le ministre et certains collègues de la permanence de la menace terroriste. Plus on dira que la menace terroriste se renforce, ce qui est vrai, et moins il sera aisé de justifier la levée de l’état d’urgence. Or, on a tant convaincu les Français qu’il n'existe pas d’autre moyen que l’état d’urgence pour lutter contre le terrorisme que, le jour où il faudra y mettre un terme, il sera très difficile d’expliquer à l’opinion publique que les services de police continuent néanmoins de travailler et que notre pays est en sécurité. Certes, la menace persiste, incontestablement, mais il me semble délicat d’en faire un argument, car elle ne s’éteindra pas le 27 juillet au matin.
D’autre part, à l’Euro et au Tour de France succéderont d’autres événements symboliques qui rassemblent des foules, qu’il s’agisse des fêtes de Bayonne, de la rentrée des classes, du 11 novembre ou que sais-je encore. Dès lors, la prorogation de l’état d’urgence ne saurait se justifier par le calendrier. De ce point de vue, monsieur le ministre, la cohérence de votre argumentation ne me semble pas si solide.
Troisièmement, je ne comprends pas pourquoi vous renoncez aux perquisitions administratives. De deux choses l’une : soit celles effectuées après la décision que le Conseil constitutionnel a prise de censurer la possibilité d’effectuer des saisies de données informatiques étaient inutiles, auquel cas il ne fallait pas les faire, soit elles étaient utiles, auquel cas il faut les poursuivre. Contrairement à M. Larrivé, j’estime que, lorsqu’une information concernant un projet d’attentat apparaît, rien n’empêche de saisir un juge pour qu’il ouvre une information judiciaire spécifique et ordonne une perquisition judiciaire chez la personne visée. Cependant, le Gouvernement, puisqu’il souhaite proroger l’état d’urgence – ce à quoi je ne suis pas favorable –, devrait maintenir, par cohérence, la possibilité d’effectuer des perquisitions administratives. Pourquoi abandonner cette disposition, même s’il n’est plus possible de saisir toutes les données informatiques ? Comme vous l’avez-vous-même indiqué, monsieur le ministre, les perquisitions servent notamment à lever des doutes et à saisir des armes.
J’en viens aux manifestations. Sous la Ve République, le droit de manifester n’est pas un droit constitutionnel. C’est la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit la liberté de manifester ses opinions et impose aux pouvoirs publics le devoir d’organiser cette liberté si elle s’exprime dans le cadre de manifestations sur la voie publique. Néanmoins, la jurisprudence française et européenne prévoit clairement que ce droit de manifester peut être suspendu en cas de menace grave à l’ordre public ou si aucun dispositif policier n’est susceptible de contenir la manifestation en question. Autrement dit, monsieur le ministre, il y a là un problème non pas de principe, mais d’appréciation des circonstances.
De ce point de vue, je reconnais volontiers que le ministre de l’Intérieur est mieux placé que le vice-président de la commission des Lois pour apprécier la gravité du risque que présente pour l’ordre public telle ou telle manifestation et pour constater que des dispositifs policiers sont ou non capables de la contenir. Je constate simplement que les manifestations qui se déroulent depuis quelques jours donnent systématiquement lieu à des débordements, que les forces de l’ordre sont toujours mises en difficulté et que des policiers sont à chaque fois blessés. Sans méconnaître les garanties des droits fondamentaux qui existent dans notre pays, c’est en me fondant sur ce constat que je vous ai demandé d’ordonner aux préfets d’interdire ces rassemblements qui menacent la sécurité de nos concitoyens et placent les forces de l’ordre dans une situation extrêmement difficile, comme en attestent les incidents sur lesquels Mme Appéré vous a interrogé lors des questions d’actualité et les débordements qui ont lieu en ce moment même à Paris. En effet, je ne crois pas que les dispositifs ordinaires permettent d’y faire face.
Enfin, l’utilité opérationnelle des gardes statiques effectuées dans le cadre de l’opération Sentinelle a souvent été mise en cause : avez-vous décidé d’y mettre fin ? Que pouvez-vous nous dire de cette opération Sentinelle, dont la première conséquence est un affaiblissement sans précédent du moral des troupes qui y participent ?
M. le ministre. M. le président Raimbourg a exposé la théorie selon laquelle l’état d’urgence aurait muté : initialement conçu pour protéger la France contre le terrorisme, il se serait transformé en dispositif d’ordre public. Une fois n’est pas coutume, je ne partage pas du tout l’analyse du président et rejoins plus volontiers celle de Mme Bechtel. En effet, la menace terroriste nous oblige à mobiliser en abondance les moyens publics et les forces de sécurité intérieure pour protéger les Français contre ceux qui veulent nous frapper. Or, en cas de troubles à l’ordre public qui ne relèvent pas de cette menace terroriste, nous ne pouvons plus assurer cette mobilisation. L’état d’urgence permet alors de recourir aux moyens de police administrative nécessaires pour déployer le volume de forces requis par le devoir de protection des Français contre le risque terroriste. Faute de raisonner ainsi, on ne comprendra pas les raisons pour lesquelles nous devons prendre certaines mesures administratives autorisées par l’état d’urgence pour contingenter des rassemblements susceptibles de provoquer de graves troubles à l’ordre public, qui divertiraient ici ou là les forces de sécurité de leur mission de protection contre la menace terroriste. Autrement dit, il est erroné de prétendre que le Gouvernement a souhaité changer d’objectif. La motivation du Gouvernement est la suivante : il faut protéger les Français contre le risque terroriste et, dans le contexte particulier d’une menace imminente, préserver un volume de forces de sécurité permettant d’y parvenir. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre des mesures de police administrative pour éviter d’affecter ces forces à des missions secondaires.
M. Larrivé s’étonne que seules 69 assignations à résidence soient en cours, alors que plusieurs milliers de personnes sont radicalisées. Le fichier des personnes signalées pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), coordonné par l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), et qui évolue quotidiennement, comprend environ 13 000 noms. Il n’est évidemment pas nécessaire d’assigner toutes ces personnes à résidence : la très grande majorité d’entre elles n’émettent que des signaux très faibles, et leur assignation à résidence ne respecterait pas le principe de proportionnalité qui conduit le juge à l’accepter ; d’autres, au contraire, émettent des signaux très forts, au point qu’ils sont incarcérés ou sous le coup d’un contrôle judiciaire, et la question de leur assignation ne se pose donc pas. J’ajoute qu’il y a eu jusqu’à 400 assignations à résidence, et nous avons renoncé à certaines d’entre elles pour nous conformer à la jurisprudence du juge administratif. Le raisonnement consistant à juger insuffisant le nombre actuel d’assignations face au volume de personnes radicalisées n’est donc pas juste.
D’autre part, le juge administratif et le Conseil d’État ont considérablement durci les critères en vertu desquels ils acceptent de proroger les assignations à résidence. Récemment, le juge administratif a par exemple demandé la transmission au ministère de l’Intérieur de dossiers judiciaires afin d’accepter la prorogation ou l’entrée en vigueur d’assignations administratives, demandes auquel le procureur de la République a parfois fait droit, et parfois non. Il va de soi que nous devons tenir compte de la jurisprudence du juge administratif avant de décider d’une assignation à résidence.
M. Larrivé m’a également interrogé sur les blocages administratifs de sites internet et la fermeture de mosquées salafistes. Pourtant, il a activement participé au débat sur la loi du 13 novembre 2014, en faveur de laquelle il a voté. Il sait donc parfaitement que cette loi contient toutes les mesures de police administrative nécessaires pour bloquer lesdits sites et déréférencer leurs adresses, et que tous les décrets d’application correspondants ont été pris. C’est d’ailleurs au titre de cette loi que j’ai continué de proposer depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence des mesures de police administrative de blocage de sites appelant au terrorisme.
Quant aux mosquées salafistes, le délai du contradictoire n’est pas dirimant lorsqu’il y a urgence. Même lorsqu’un défaut de procédure m’a obligé à présenter une nouvelle décision en conseil des ministres afin de relancer le contradictoire dans une affaire concernant une association établie à Lagny, nous ne nous sommes aucunement trouvés dans des délais excessifs qui nous auraient empêchés d’agir vite. Nous agissons donc comme nous le devons.
Pouvez-vous m’indiquer, monsieur Larrivé, combien de mosquées salafistes ont été fermées entre 2002 et 2012 ? Aucune. Le phénomène de salafisation, de radicalisation et de communautarisme était pourtant tel qu’il aurait pu justifier de telles décisions. Combien de prêcheurs de haine a-t-on expulsés au cours de cette période ? Combien en a-t-on expulsé depuis ? J’invite la commission des Lois à se pencher sur ces chiffres. Cessons donc les déclarations ; concentrons-nous sur l’action.
Si nous renonçons aux perquisitions administratives, c’est parce qu’elles ont été effectuées d’emblée et d’un coup, pour éviter que les personnes concernées s’y adaptent afin d’y échapper. De plus, en l’absence de réforme constitutionnelle, la saisie et l’utilisation des données numériques, qui constituent le volet le plus utile de la perquisition administrative, ne sont plus possibles. Le maintien de cette mesure n’a donc plus guère de raison d’être.
M. Fenech me demande si les moyens consacrés à la lutte antiterroriste ne sont pas sous-dimensionnés. Il est vrai qu’ils sont plus sous-dimensionnés qu’ils ne le seraient si 13 000 emplois n’avaient pas été supprimés dans les forces de sécurité intérieure, et si leur budget n’avait pas subi une réduction de 17 %, à une époque qui n’est pas si lointaine. Au contraire, au cours de ce quinquennat, nous aurons créé 9 000 emplois supplémentaires dans la police et la gendarmerie. La ritournelle politique, ressassée pour des raisons partisanes, selon laquelle il ne se serait rien passé après le mois de janvier 2015, est tout à fait erronée. Deux lois antiterroristes avaient déjà été adoptées avant cette date, 432 emplois supplémentaires avaient été créés à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et ses crédits hors titre 2 avaient été augmentés de 12 millions d’euros par an. Après le mois de janvier, de nombreuses autres mesures ont été prises. Le plan de lutte antiterroriste, tout d’abord, a prévu la création de 1 500 emplois ainsi répartis : 500 emplois supplémentaires – en plus des 432 emplois précités – à la DGSI ; 500 emplois au sein du renseignement territorial qui en avait bien besoin, tant la réforme des renseignements généraux avait affaibli nos capteurs dans les territoires ; 126 emplois supplémentaires à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ; 32 emplois supplémentaires à la direction des moyens informatiques du ministère de l’intérieur pour moderniser certaines applications comme CHEOPS, qui fédère l’ensemble des fichiers constitués en matière de terrorisme et de criminalité. Outre les crédits inscrits en loi de finances, le budget du ministère de l’Intérieur a été augmenté de 233 millions d’euros consacrés aux forces de sécurité intérieure. S’y ajoutent, monsieur Fenech, les 900 emplois destinés à faire face à l’immigration irrégulière, dont vous avez voté la création par un amendement parlementaire à l’automne 2015 et qui sont fort utiles dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ainsi que pour aider Frontex, qui monte en puissance, à contrôler les frontières extérieures de l’Union européenne. Enfin, le Président de la République a annoncé devant le Congrès la création de 5 000 emplois supplémentaires, dont les deux tiers seront pourvus en 2016.
Voilà l’inventaire des efforts budgétaires exceptionnels consentis en faveur du ministère de l’Intérieur. J’ajoute, monsieur Fenech, que nous venons de signer avec les organisations syndicales un protocole portant sur des mesures catégorielles, pour un montant de 800 millions d’euros, et incluant une augmentation de 30 % de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) versée aux unités de forces mobiles – indemnité qui n’avait pas été augmentée depuis quinze ans –, ainsi qu’une augmentation de l’indemnité de sujétion spéciale police (ISSP) et de la prime d’officier de police judiciaire (OPJ), et la possibilité pour un certain nombre de policiers de bénéficier d’un avancement beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Je pense que les policiers, qui ont signé ce protocole à une immense majorité, se rendent compte des efforts que nous faisons pour soutenir nos forces.
Faut-il organiser des fan zones en cas de risque terroriste ? Dois-je rappeler que le président de l’organisation politique à laquelle vous appartenez avait proposé que l’on annule la COP21 ? Notre raisonnement est un peu différent. Nous estimons en effet que ce n’est pas parce qu’un attentat vient de se produire que la France ne doit plus être la France, et que, en annulant ces événements, nous enverrions aux terroristes le message que nous avons peur et qu’ils ont gagné, ce qui n’est pas une bonne manière de mener la guerre. Certes, dès lors que nous avons décidé de maintenir ces manifestations, nous devons être capables d’assurer la protection de nos concitoyens, ce qui implique que nous y consacrions des moyens. Mais il faut avoir la franchise de reconnaître que, ce faisant, nous ne garantissons pas pour autant le « risque zéro », car celui-ci n’existe pas, y compris dans l’hypothèse où l’Euro 2016 ne serait pas maintenu.
C’est ce raisonnement qui a conduit Alain Juppé, dont je n’ai pas le sentiment qu’il soit totalement irresponsable, à demander que l’Euro 2016 soit maintenu et que le Gouvernement signe avec les villes hôtes de la compétition et l’Union des associations européennes de football (UEFA) une convention définissant les compétences de chacun. Il n’a absolument pas réclamé la suppression des fan zones, et j’ai tenu avec lui deux conférences de presse pour exposer les conditions dans lesquelles nous allons les maintenir.
Monsieur Verchère, les moyens mobilisés dans le cadre de l’Euro 2016 sont très précisément définis par la convention que je viens d’évoquer. J’ai ainsi adressé ce matin à l’ensemble des préfets une note dans laquelle je précise les unités de forces mobiles que nous mobiliserons dans le cadre de cette manifestation. En outre, j’ai indiqué, au terme d’un travail qui a duré de nombreux mois, la manière dont les forces spécialisées – Recherche, assistance, intervention, dissuasion (RAID), Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), Brigade de recherche et d’intervention (BRI) – seront réparties sur l’ensemble du territoire national, de manière à garantir leur intervention rapide en cas d’événement ou de tuerie de masse hors événement. Contrairement à ce que j’ai lu sous la plume d’un certain nombre d’experts, cette répartition n’est pas de nature à créer une concurrence entre ces forces, puisque chacune d’entre elles a un territoire d’intervention particulier. En revanche, il est possible que le GIGN intervienne en zone de police à la place du RAID, et inversement. Mais tout cela se fera dans une grande cohérence.
Par ailleurs, le criblage est assuré par les services du renseignement intérieur. Aux termes de la convention que nous avons signée, l’UEFA est en charge de la sécurité dans les stades, les communes de la sécurité dans les fan zones et les forces de sécurité intérieure de la sécurité dans les villes où sont implantés les stades et les fan zones. Elles seront ainsi présentes à proximité de ces lieux pour assurer le filtrage des entrées et les palpations de sécurité.
La répartition des forces a donc été effectuée, les agents de sécurité privée ont été recrutés par les collectivités – la direction de la formation du ministère du travail a été mobilisée à cette fin – et le criblage aura lieu. Un comité de pilotage national a été mis sur pied, et nous travaillons avec les maires et avec l’UEFA. Tout cela est évalué quotidiennement, et la responsabilité de chacun est définie de manière extrêmement précise.
En tout état de cause, si je supprimais les fan zones, un très grand nombre de Français iraient regarder les matches dans des bars, sans bénéficier d’une protection aussi importante que celle qui sera assurée à proximité des fan zones dès lors que je ne peux pas mettre des gardes statiques devant chacun des bistrots où nos concitoyens se rassembleront. La sécurité est-elle mieux assurée – même si, je le dis très clairement, il existe toujours un risque – dans des espaces organisés de manière à permettre une intervention rapide le cas échéant, ou si les spectateurs se dispersent dans l’ensemble de la ville sans que l’on puisse être certain de pouvoir intervenir de manière aussi efficace ? Je vous invite à y réfléchir.
J’en viens aux manifestations des forces de l’ordre. Celles-ci ne manifesteront pas, demain, parce que nous avons supprimé des emplois – nous en avons créé 9 000 – ou parce qu’elles sont insatisfaites des mesures catégorielles que nous leur avons proposées : elles viennent de signer, dans leur immense majorité, un protocole de 800 millions d’euros. Elles manifesteront, demain, parce qu’elles estiment que, compte tenu de leurs efforts, elles ont droit au respect et à la considération des Français, et elles ont raison.
Lorsque les forces de l’ordre – qui sont mobilisées depuis des mois pour assurer la protection de nos concitoyens contre un risque terroriste imminent et de graves difficultés, mais aussi la protection des frontières et des lieux de culte, tout en luttant contre la délinquance – sont confrontées à des casseurs qui, au nom de l’existence de violences policières, estiment pouvoir s’en prendre à elles, alors qu’elles incarnent l’État de droit, cela pose un problème. Elles ont donc envie de dire qu’elles sont de plain-pied dans la République et la démocratie, qu’elles accomplissent une tâche difficile, qu’elles s’efforcent de remplir correctement, et qu’elles ont droit, en contrepartie, à un minimum de respect.
Il faut interdire les manifestations, dites-vous. La décision du Conseil constitutionnel du 19 février est extrêmement claire à cet égard : l’interdiction d’une manifestation n’est possible que si l’État ne peut pas mobiliser les forces qui permettent de maintenir l’ordre public. Vous estimez que l’action des casseurs démontre l’incapacité de l’État de maintenir l’ordre public. Mais des casseurs, il y en a eu dans toutes les manifestations contre le contrat première embauche (CPE) – je dispose même d’un bilan extrêmement précis de leurs trophées. Or, à l’époque, je n’ai entendu aucun député de la majorité dénoncer la « chienlit », déplorer que l’autorité de l’État soit remise en cause et préconiser l’interdiction des manifestations.
J’ajoute que, selon le Conseil constitutionnel, lorsque l’état d’urgence a été décrété, les principes de proportionnalité doivent continuer de s’appliquer. Je peux interdire, sans prendre le risque d’être censuré par le juge, une manifestation organisée, à Rennes, pour casser, car il s’agit, non pas du droit de manifester, mais d’un délit. Et il est beaucoup plus délicat de maintenir l’ordre public dans une manifestation de casseurs que dans une manifestation de personnes sincères, qui doivent au contraire être protégées contre les agissements de ces derniers. Voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés.
Je vais prendre un autre exemple, monsieur Fenech. Aujourd’hui, nous avons pris la décision d’interdire à certaines personnes de paraître à des manifestations. Qu’a dit le juge administratif ? Dans sa décision – dont je vais prendre connaissance dans le détail et à laquelle nous nous conformerons, bien entendu –, il indique que nous ne pouvons pas prononcer une telle interdiction si nous ne disposons pas d’éléments suffisants prouvant absolument que ces individus ont déjà participé à des manifestations violentes. Mais si nous disposons de tels éléments, nous n’avons pas besoin de leur interdire de paraître à des manifestations : nous les judiciarisons. Le juge administratif rend ainsi fragile la séparation entre ce qui relève de la judiciarisation et ce qui relève de la prévention et de la police administrative.
Sur ce sujet, vous adoptez une position politique. Pour ma part, je pense que, dans le cadre de l’état d’urgence, il faut avoir une position juridique, légaliste. Je ne peux donc pas vous suivre sur ce point.
M. Bompard est parti. Je lui enverrai donc ma réponse par écrit, même si sa déclaration n’en appelait pas.
Mme Capdevielle m’a interrogé sur les prochaines fêtes de Bayonne, qui se déroulent durant cinq jours et pour lesquelles de nombreux participants sont attendus. Chaque année, un dispositif de sécurité et de secours important s’appuie sur des renforts de forces mobiles, des brigades anti-criminalité (BAC) et des services d’appui judiciaire. Ce dispositif sera maintenu et affiné par le préfet avec les organisateurs et le renseignement, et orienté vers une stratégie d’anticipation. La possibilité de prépositionner un élément de forces d’intervention rapide est d’ores et déjà envisagée.
Après l’état d’urgence, la loi du 13 novembre, la loi sur le renseignement et la loi Urvoas nous permettront de prendre un ensemble de mesures administratives préventives.
En ce qui concerne les interdictions de paraître, monsieur Coronado, je le répète, ma philosophie est la suivante : lorsque le juge a dit le droit, on applique sa décision. On peut dire : « Voilà ce que pense le juge », mais on ne peut pas dire : « Ce que le juge pense est bien ou mal ». Telle est ma conception du droit et de l’exercice de mes responsabilités.
Par ailleurs, les menaces sont réelles outre-mer. J’apprécie l’état d’urgence en fonction, non de la distance qui sépare un territoire de la métropole, mais de la menace qui pèse sur celui-ci. C’est pourquoi je ne suis pas favorable à ce qu’on le remette en cause outre-mer.
Monsieur Gosselin, concernant l’interdiction des manifestations dans le cadre de l’état d’urgence, j’ajouterai un argument à ceux que j’ai exposés à l’instant. Ce n’est pas parce que vous interdisez une manifestation que les gens ne manifesteront pas. Et si vous pensez qu’il n’en serait pas ainsi sous un autre gouvernement qui incarnerait, lui, l’autorité de l’État, vous vous trompez. L’idée selon laquelle les forces de l’ordre pourraient, si l’on interdisait les manifestations, se reposer dans la perspective de leur mobilisation pleine et entière dans le cadre de l’état d’urgence et de la crise terroriste est une pure illusion.
M. Philippe Gosselin. Ce n’est pas ce qui a été dit, monsieur le ministre.
M. le ministre. J’ai interdit une manifestation à Rennes. Les gens sont tout de même venus ; ils étaient 700. Pour que cette interdiction soit respectée, il a donc fallu mobiliser des forces de l’ordre.
Monsieur Poisson, en ce qui concerne les gardes statiques et l’opération Sentinelle, ainsi que je l’ai déjà dit devant la commission des lois et la commission de la défense, je crois qu’il faut passer des gardes statiques à des gardes dynamiques. C’est en effet le caractère aléatoire de la garde qui dissuade le terroriste de se rendre sur tel ou tel territoire, car il sait qu’il peut y rencontrer des forces de l’ordre à tout moment. Nous avons mis en place ce type de garde de façon expérimentale dans trois arrondissements à Paris en ce qui concerne la protection des lieux de culte de confession juive, qui mobilisaient de nombreuses gardes statiques. Nous travaillons en très étroite collaboration avec la communauté juive et, si l’expérience est concluante, nous généraliserons progressivement ce dispositif.
M. le président Dominique Raimbourg. Monsieur le ministre, nous vous remercions.
——fpfp——
1 () Rapport d’information n° 3784 présenté par MM. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson Contrôle parlementaire de l’état d’urgence : auditions de la Commission, 25 mai 2016. http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3784.pdf. [URL consultée le 15 novembre 2016].
2 () Les mesures de police administrative ont pour objet de prévenir un trouble à l’ordre public. Elles se distinguent des actes de police judiciaire qui tendent à détecter une infraction ou empêcher sa commission. Les mesures susceptibles d’être prises au titre de l’état d’urgence sont les suivantes : restrictions à la liberté d’aller et venir, perquisitions administratives, assignations à résidence, remises d’armes, réquisitions de personnes et de biens, fermetures de lieux de réunions ; interdictions de cortèges ; contrôles d’identité et fouilles de bagages et de véhicules ; blocages de sites internet ; dissolutions d’associations.
3 () Compte rendu des débats de l’Assemblée nationale, première séance du jeudi 19 novembre 2015.
4 () Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions. Voir le rapport n° 3237 de M. Jean-Jacques Urvoas (Assemblée nationale, XIVe législature). http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3237.asp [URL consultée le 15 novembre 2016].
5 () Voir le rapport n° 3495 de M. Pascal Popelin (Assemblée nationale, XIVe législature). http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3495.asp [URL consultée le 15 novembre 2016].
6 () Voir le rapport n° 3753 de M. Pascal Popelin (Assemblée nationale, XIVe législature). http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3753.asp [URL consultée le 15 novembre 2016].
7 () Voir les rapports nos 3978 et 3993 de M. Pascal Popelin (Assemblée nationale, XIVe législature). http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3978.asp et http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3993.asp [URL consultée le 15 novembre 2016].
8 () Conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, sur CE., Sect., 11 décembre 2015, M. J. D… et autres, in RFDA, mars 2016, p. 105.
9 () Si l’article 42 de la Constitution fixe des délais précis d’examen des textes, il précise qu’ils ne s’appliquent pas aux projets relatifs aux états de crise, ce qu’était précisément le projet de loi examiné.
10 () Lors de l’examen du projet de loi le 18 novembre 2015, M. Jean-Jacques Urvoas indiquait ainsi à la Commission : « Avec le Gouvernement, que je remercie, ainsi qu’avec Philippe Bas, président de la commission des Lois du Sénat, nous avons travaillé depuis deux jours. Évidemment, notre capacité collective d’amendement est restreinte : le texte que l’Assemblée doit adopter demain doit pouvoir être accepté dans les mêmes termes par le Sénat. Il fallait donc que les rapporteurs des deux assemblées anticipent nos débats et que des rapprochements soient réalisés avec le Gouvernement, afin que nous puissions dessiner une ébauche permettant des ajustements ».
11 () Le quantième désigne le numéro du jour du mois courant. Par exemple, une décision d’un mois (durée calculée de quantième à quantième) prise le 12 du mois s’arrêtera le 12 du mois suivant.
12 () Prises toutes deux sur le fondement de l’article 16 de la Constitution, une première décision du 24 avril 1961 avait même prorogé l’état d’urgence sine die en renvoyant à une seconde décision le soin d’en déterminer le terme, celle-ci opérant une nouvelle prorogation pour neuf mois et demi.
13 () Le législateur a même eu l’occasion de voter, en 1985, l’état d’urgence alors que le délai de douze jours au-delà duquel son intervention était nécessaire avait expiré, attestant ainsi que le décret présidentiel ne pouvait être considéré comme une base juridique indispensable à la régularité d’une éventuelle loi.
14 () Dans sa décision n° 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le régime des perquisitions administratives tel qu’il résultait de l’ordonnance du 15 avril 1960 et sur la base duquel ont été pratiquées les perquisitions du 14 novembre au 20 novembre 2015, méconnaissait l’article 2 de la Déclaration de 1789 et devait être déclaré contraire à la Constitution. Il a toutefois précisé que cette inconstitutionnalité ne pouvait permettre de contester les procédures pénales ouvertes à la suite de ces perquisitions, « la remise en cause des actes de procédure pénale consécutifs à une mesure prise sur le fondement des dispositions déclarées contraire à la Constitution [méconnaissant] l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et [ayant] des conséquences manifestement excessives ».
15 () Dans le contentieux de l’état d’urgence, le référé administratif prend principalement deux formes : le référé liberté ou le référé suspension. Le référé liberté est une procédure d’urgence introduite devant le juge administratif par toute personne qui considère qu’une décision administrative prise à son encontre porte une atteinte grave et « manifestement » illégale à l’une de ses libertés fondamentales. Le juge des référés statue en 48 heures à l’issue d’un débat contradictoire faisant une large place à l’oralité. L’appel est porté directement devant le Conseil d’État.
Le justiciable peut recourir au référé suspension si l’administration a pris à son encontre une décision exécutoire dont il souhaite obtenir la suspension en attendant que le juge se prononce au fond sur la mesure. Pour être recevable, trois conditions sont requises : il doit y avoir urgence à suspendre l’exécution de la décision (par exemple une décision d’expulsion), il doit y avoir de sérieuses raisons de penser que la décision est illégale et le demandeur doit avoir déposé une requête en annulation ou modification de la décision dont il réclame la suspension. Au terme d’une procédure contradictoire, le juge des référés se prononce en général dans un délai de 15 jours. L’appel n’est pas possible ; seul un recours en cassation peut être introduit devant le Conseil d’État.
16 () La rédaction adoptée en Conseil des ministres, puis déposée sur le bureau de la Haute Assemblée, était encore différente. Le projet comportait un article unique procédant, par renvoi à la loi du 20 novembre 2015, à une reconduction de la précédente prolongation pour trois mois supplémentaires. Cette rédaction avait été suggérée par le Conseil d’État à l’occasion de l’examen de l’avant-projet de loi. Nos collègues sénateurs ont, à l’initiative du rapporteur, M. Michel Mercier, procédé à une réécriture complète de l’article, revenant à la rédaction traditionnelle des lois de prorogation de l’état d’urgence, en trois points (prorogation à proprement parler, autorisation expresse des perquisitions administratives, modalités d’une cessation anticipée) mais les rassemblant dans un article unique.
17 () http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/prolongation-de-letat-durgence-raimbourg-ps-souhaite-la-fin-des-perquisitions [URL consultée le 15 novembre 2016].
18 () Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
19 () Déposé le 19 juillet 2016, le projet de loi a été examiné, en première lecture, par l’Assemblée nationale le jour même, puis par le Sénat le lendemain. Réunie le soir même, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord, définitivement voté le 21 juillet 2016 avant une promulgation et une entrée en vigueur immédiates.
20 () Lors de l’examen en première lecture du premier projet de loi de prorogation de l’état d’urgence, M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur, indiquait ainsi : « La place des assemblées fut un sujet évoqué dans cet hémicycle lorsque fut également instauré l’état d’urgence en 1985 puis en 2005. Les parlementaires avaient réclamé en 1985 de jouer un plus grand rôle et avaient réitéré leur vœu vingt ans plus tard. À chaque fois, le Gouvernement s’y était montré favorable, mais les textes adoptés le 25 janvier 1985 et le 18 novembre 2005 n’en portaient que très marginalement la trace. Tel ne sera pas le cas du présent texte » (1ère séance du jeudi 19 novembre 2015).
21 () Réunion de la Commission des Lois du 17 novembre 2015.
22 () Cette disposition a été introduite par un amendement de l’un de vos Rapporteurs. http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3978/AN/84.asp [URL consultée le 15 novembre 2016].
23 () Rapport fait au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, MM. Pascal Popelin et Michel Mercier, rapporteurs (n°3993 et n°808- 2015-2016), 20 juillet 2016. http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3993.pdf [URL consultée le 15 novembre 2016].
24 () Lors du déplacement de la mission en Haute-Garonne, M. Pascal Mailhos, préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, a ainsi indiqué avoir fait une première réunion dès le 14 novembre 2015 puis de nouveau le 20 novembre à laquelle se sont rendus de très nombreux maires du département (environ 300 sur les 589 que comptent le département).
25 () Lors du déplacement à Rennes le 4 janvier 2016, M. Patrick Strzoda, alors préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, a indiqué avoir tenu, très rapidement après le déclenchement de l’état d’urgence, une réunion du CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance), des réunions avec les instances professionnelles et religieuses, avec les avocats, les responsables des communautés musulmanes, les médias. Il a précisé que le numéro vert mis en place avait reçu 500 appels d’élus qui ont pu être renseignés sur la protection des populations et le maintien des activités de la vie quotidienne.
26 () Cf. liste des déplacements figurant en annexe du présent rapport d’information.
27 () Rapport n° 3784, op. cit.
28 () Cf. liste des personnes entendues figurant en annexe du présent rapport d’information.
29 () http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence
30 () Cf. en annexe les comptes rendus des réunions auxquelles ces communications ont été présentées.
31 () En réalité, 50,4 % d’entre elles étaient réalisées entre 21 heures et 6 heures.
32 () Compte rendu n° 62 du mardi 22 mars 2016, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale.
33 () En 2005, l’état d’urgence a donné lieu à une perquisition administrative et à aucune assignation à résidence.
34 () Les éléments utilisés dans le présent rapport reposent sur des séries statistiques qui ne présentent pas la même exhaustivité selon la nature de l’information collectée. Les périmètres retenus peuvent varier d’un graphique à l’autre ; ne sont donc comparables que les graphiques traitant du même type d’informations.
35 () L’article 6 de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, publiée au Journal officiel de la République française le 21 novembre 2015, prévoit une entrée en vigueur immédiate. Le cadre juridique des perquisitions administratives modifié par cette même loi est donc entré en vigueur à compter du 21 novembre.
36 () Décision n° 2012-61 (MDE/MDS) du 26 mars 2012 relative à des recommandations à l’usage des forces de police et de gendarmerie lorsqu’elles sont amenées à intervenir dans un domicile où sont présents des enfants.
37 () Avis n° 16-03 du 25 janvier 2016, http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20160125_16-03.pdf, [URL consultée le 15 novembre 2016].
38 () CEDH, 15 octobre 2013, n° 34529/10, Gutsanovi c/ Bulgarie.
39 () Ces infractions ont été créées par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée.
40 () Cons. Const., décision n° 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016, op. cit.
41 () Cons. Const., décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l’Homme.
42 () Audition de Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur le 19 janvier 2016, in Rapport n° 3784, op. cit., p. 156.
43 () CE, Ass., 6 juillet 2016, M. E et autres ; M. H et autres.
44 () Décision du Défenseur des droits MSP-MDS 2016-153 du 26 mai 2016.
45 () Cons. Const., décision n° 2016-536 QPC, op. cit.
46 () Cons. Const., décision n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016, M. Raïme A.
47 () Décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
48 () Décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
49 () Décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
50 () Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, op. cit.
51 () On consultera avec profit les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, sur CE., Sect., 11 décembre 2015, M. J. D… et autres, in RFDA, mars 2016, p. 105.
52 () Lors de son audition, M. Thomas Andrieu, alors directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur, considérait que « la notion de comportement a inquiété, à [son] avis à tort. Elle existe déjà dans notre droit en matière de police administrative, précisément s’agissant des étrangers que l’on expulse pour des motifs liés au terrorisme : l’article L 521 3 du CESEDA parle de « comportements […] liés à des activités à caractère terroriste ». Elle est donc maniée tous les jours devant le juge administratif, notamment devant le tribunal administratif de Paris, qui juge de ces mesures, et devant le Conseil d’État », in Rapport n° 3784, op. cit., p. 153.
53 () Un individu assigné à Toulouse a par exemple vu son lieu d’assignation déplacé à Brienne-le-Château dans l’Aube entre le 15 juin et le 8 août 2016. Le ministère de l’Intérieur a en effet considéré qu’au vu « de la dangerosité avérée de l’individu » et de la « prégnance de ses relations au sein de la mouvance djhadiste », il convenait de l’éloigner, pour la durée de l’Euro 2016, de l’agglomération toulousaine où plusieurs matchs devaient être disputés. Le choix du lieu d’assignation a porté sur une zone n’accueillant aucune compétition durant l’Euro 2016 ni aucune étape du Tour de France. Conformément au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi de 1955, l’État a pris à sa charge son hébergement durant cette période. Les déplacements de Toulouse vers Brienne-le-Château et de Brienne-le-Château vers Toulouse ont été assurés par les forces de l’ordre.
54 () Article créé par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
55 () Ibid.
56 () Audition de M. Jean-François Illy, in Rapport n° 3784, op. cit.
57 () Assemblée nationale, séance du jeudi 19 novembre 2015.
58 () Audition de M. Thomas Andrieu, in Rapport n° 3784, op. cit.
59 () Ibid.
60 () CE, ordonnance du 7 octobre 2016, M. B...
61 () Audition de M. Thomas Andrieu, in Rapport n° 3784, op. cit.
62 () Cons. Const., décision 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, considérant 12.
63 () Ibid, considérant 8.
64 () CE, sect, 11 décembre 2015, M. D…
65 () Tribunal administratif de Toulouse, ordonnance du 17 février 2016.
66 () Tribunal administratif de Grenoble, ordonnance du 2 juin 2016.
67 () CE, ordonnance du 22 janvier 2016, M. A…
68 () Tribunal administratif de Melun, ordonnance 18 janvier 2016.
69 () CE, ordonnance du 17 mars 2016, M. Z…
70 () CE, ordonnance du 23 décembre 2015, M. R…
71 () CE, ordonnance du 23 février 2016, M. F…
72 () CE, ordonnance du 12 février 2016, M. K…
73 () CE, sect, 11 décembre 2015, M. D…, op. cit.
74 () CE, ordonnance du 7 octobre 2016, M. B...
75 () Terme employé par le tribunal administratif de Toulouse.
76 () CE, ordonnance du 29 janvier 2016, M. D…
77 () Audition de M. Bernard Stirn, in Rapport n° 3784 op.cit., p. 22 et suivantes.
78 () Communiqué de presse du Conseil d’État sur l’ordonnance du 7 octobre 2016, M. B…
79 () P. Cassia, Contre l’état d’urgence, Dalloz, 2016.
80 () P. Cassia, « Le Conseil d’État laisse l’état d’urgence dériver », https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/091016/le-conseil-d-etat-laisse-l-etat-d-urgence-deriver, [URL consultée le 9 novembre 2016].
81 () Comme ils le rappelaient dans leur communication du 17 mai 2016, vos Rapporteurs ont notamment obtenu communication de 135 arrêtés pris entre le 14 novembre 2015 et le 14 janvier 2016. Ils ont ensuite reçu une soixantaine d’arrêtés préfectoraux portant interdiction individuelle de séjour.
82 () Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets du 14 novembre 2015 relative à la mise en œuvre du décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d’urgence et du décret n° 2015-1476 du 14 décembre 2015 relatif à l’application de la même loi.
83 () Par exemple, le préfet des landes a ainsi pris sept arrêtés le 19 novembre 2015 ayant chacun pour objet d’instituer une zone de protection ou de sécurité autour d’un site SEVESO en raison de l’attaque commise en 2015 contre un établissement Seveso à Saint-Quentin-Fallavier. À noter également une ZPS instaurée pour protégerr un site pétrochimique à Berre-l’Étang.
84 () Deux arrêtés préfectoraux instituant trois zones du 24 novembre 2015 au 14 décembre 2015 avaient été pris en Île-de-France par les préfets de l’Essonne et des Yvelines afin de prévenir des troubles à l’ordre public susceptibles d’accompagner l’organisation de la manifestation.
85 () Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets du 14 novembre 2015 relative à la mise en œuvre du décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d’urgence et du décret n° 2015-1476 du 14 décembre 2015 relatif à l’application de la même loi.
86 () Rapport n° 2794 de la commission d’enquête chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, M. Pascal Popelin, rapporteur et M. Noël Mamère, président, 21 mai 2015. http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2794.asp [URL consultée le 15 novembre 2016].
87 () Cons. Const., décision 93-323 DC du 5 août 1993 sur la loi relative aux contrôles et vérifications d’identité.
88 () Communiqué de presse du ministre de l’Intérieur du 2 novembre 2016 : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Fermeture-administrative-de-quatre-mosquees-au-titre-de-l-etat-d-urgence, [URL consultée le 15 novembre 2016].
89 () Dar Al Islam est la déclinaison française de la revue de propagande de Daech.
90 () Manuel Valls, Premier ministre ; discussion en 1ère lecture du projet de loi de prorogation de l’état d’urgence, Assemblée nationale, 19 novembre 2015.
91 () Ont ainsi été dissoutes : l’« Association des musulmans de Lagny-sur-Marne » (le décret du 14 janvier 2016 prononçant la dissolution ayant été suspendu le 30 mars 2016 en raison du caractère non contradictoire de la procédure suivie, la dissolution a été de nouveau prononcée le 6 mai 2016), les associations « Retour aux sources » et « Le retour aux sources musulmanes » (dissolution prononcée le 14 janvier 2016) ; l’association « Fraternité musulmane Sanâbil (Les Épis) » (dissolution prononcée le 24 novembre 2016).
92 () Audition de M. Thomas Andrieu, in rapport n° 378, op.cit.
93 () Personnalité désignée au titre de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Son rapport porte sur la période allant de mars 2015 à février 2016.
94 () Le dispositif introduit dans l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique permet le blocage de certains contenus d’un service de communication en ligne et prévoit une obligation de respecter un principe de subsidiarité et des délais (demande aux hébergeurs ou aux éditeurs de retirer un contenu ; en l’absence de retrait dans un délai de 24 heures, notification de la liste des adresses électroniques des services de communication contrevenants aux fournisseurs d’accès qui doivent « empêcher sans délai l’accès à ces adresses ».
95 () Audition de M. Jean-Marc Sauvé, in Rapport n° 3784, op. cit.
96 () CE, 25 juillet 1985, Mme Dagostini.
97 () Cons. Const., décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. Cédric D…
98 () Ibid., considérant 8.
99 () Ibid., considérant 12.
100 () Ibid., considérant 16.
101 () Cons. Const., décision n° 2016-536, op. cit.
102 () Cons. Const., décision n° 2016-567/568, op. cit.
103 () CE, Ass., 24 mars 2006, Rolin et Boisvert.
104 () CEDH, 1er juillet 1961, Lawless c. Irlande.
105 () CEDH, 26 mai 1993, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni.
106 () CEDH, plénière, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni.
107 () CEDH, 26 juin 1993, Brannigan et McBride c. Royaume Uni.
108 () CEDH, 18 décembre 1996, Aksoy c. Turquie.
109 () CEDH, 26 juin 1993, Brannigan et McBride c. Royaume Uni.
110 () CEDH, 19 février 2009, Affaire a et autres c. Royaume-Uni.
111 () CEDH, 27 septembre 1995, Mc Cann et autres c. Royaume-Uni.
112 () CEDH, 18 décembre 1996, Aksoy c. Turquie.
113 () CEDH, 7 janvier 2010, Rantsev c. Chypre et Russie.
114 () CEDH, 21 octobre 2013, Del Rio Prada c. Espagne.
115 () Voir sur ce point le tableau présentant les douze mesures susceptibles d’être prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 figurant dans le présent rapport.
116 () Voir liste des déplacements en annexe du présent rapport.
117 () Cf. Rapport n° 3784, op. cit.
118 () Par exemple, le parquet du tribunal de grande instance de Lille a décidé de mettre en place une permanence continue spécifique.
119 () Ces instances réunissent sous l’autorité du préfet de département les services de police et de renseignement pour passer en revue les différents individus radicalisés, proposer une inscription au fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et désigner un service « chef de file » pour chaque nouvel individu inscrit.
120 () On se reportera à ce sujet à l’audition de M. Thomas Andrieu, in Rapport n° 3784, op. cit.
121 () Audition de M. Jérôme Léonnet, in Rapport n° 3784, op.cit., p. 94.
122 () La nomenclature par nature d’infraction ou « code NATINF » permet de rassembler au sein d’un même système d’indexation l’ensemble des infractions présentes dans le code pénal, mais également au sein d’autres codes (code rural, code de la route, code de la consommation, etc.).
123 () Audition de M. Jérôme Léonnet, in Rapport n° 3784, op.cit., p. 67.
124 () Cf. supra deuxième partie.
125 () Lors de son audition le 8 janvier 2016, M. Jérôme Léonnet, chef du SCRT précise ainsi, au sujet d’une instruction adressée le 8 décembre 2015 : « j’en ai profité pour leur rappeler la rigueur et la déontologie dont on ne doit pas se départir au moment où l’on procède à une perquisition administrative. Ce n’est pas là un aspect « RT » en tant que tel : je l’ai indiqué sous ma casquette de directeur central adjoint après en avoir parlé avec Pascal Lalle [directeur central de la sécurité publique] qui avait lui-même donné des instructions en ce sens à plusieurs reprises », in Rapport n° 3784, op.cit.,
126 () M. Robert Gelli, directeur des Affaires criminelles et des Grâces, a ainsi indiqué que : « Concernant plus particulièrement votre mission, nous avons également mis en place dès le premier jour un tableau de bord de remontée d’informations sur les perquisitions administratives, de façon à suivre le devenir de ces perquisitions au plan judiciaire. Les éléments vous ont été transmis. Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité, car il s’agit de dispositifs manuels : chaque jour les parquets alimentent un tableau, qui passe par le parquet général, lequel l’adresse à son tour à la DACG. Il peut donc exister, à l’unité ou à la dizaine près, des décalages. Nous constatons d’ailleurs déjà des décalages avec le ministère de l’Intérieur sur le nombre de perquisitions administratives. En revanche, je pense que nos chiffres sur les suites judiciaires sont bons, car ce sont là des chiffres par définition maîtrisés par la justice. Au 5 janvier 2016, 530 perquisitions ont abouti à une procédure judiciaire », in Rapport n° 3784, op. cit.
127 () Audition de M. Olivier de Mazières, in Rapport n° 3784, op. cit., p. 91
128 () Il s’agira même de l’état d’urgence le plus long car l’état d’urgence déclaré en avril 1961 avait été validé jusqu’à la fin mai 1963 (soit 25 mois) mais la dissolution de l’Assemblée nationale en octobre 1962 y a mis incidemment fin.
129 () Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une assignation à résidence ne peut être prise que pour la durée de l’état d’urgence telle qu’elle résulte de la loi de prorogation ; si le ministère souhaite la prolonger, elle doit être formellement renouvelée lors de chaque prorogation.
130 () Assemblée nationale, 18 novembre 2015.
131 () « Mieux anticiper la menace et combattre le terrorisme : les leçons des attentats de 2015 » : Rapport n° 3922, op. cit.
132 () Auditions de M. Loïc Garnier et de M. Olivier de Mazières, in Rapport n° 3784, op. cit.
133 () Audition de M. Jérôme Léonnet, in Rapport n° 3784, op. cit.
134 () « Mieux anticiper la menace et combattre le terrorisme : les leçons des attentats de 2015 » : Rapport n° 3922, op. cit., p. 362.
135 () Audition de M. Patrick Calvar, in Rapport n° 3784, op. cit.
136 () Ibid.
137 () Audition de M. Pierre-Marie Bourniquel, in Rapport n° 3784, op. cit.
138 () Audition de M. Olivier de Maizières, in Rapport n° 3784, op. cit.
139 () Audition du colonel Frédéric Boudier, in Rapport n° 3784, op. cit.
140 () Audition de M. Patrick Calvar, in Rapport n° 3784, op. cit.
141 () Audition de M. Olivier de Maizières, in Rapport n° 3784, op. cit.
142 () Audition de M. Patrick Calvar, in Rapport n° 3784, op. cit.
143 () Ibid.
144 () Les données ici mentionnées sont celles des poursuites judiciaires effectivement engagées ; elles ne correspondent pas forcément aux découvertes faites lors des perquisitions ni au nombre de procédures engagées à l’issue de ces mêmes perquisitions, la constatation d’éléments infractionnels ne suffisant pas nécessairement à l’ouverture d’une procédure judiciaire par le magistrat saisi.
145 () Les 14 autres procédures concernent donc des infractions de nature terroriste hors AMT, soit apologie ou consultation régulière de sites djihadistes, ce délit ayant été créé par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.
146 () Cons. Const., décision n° 2016-536, op. cit.
147 () Cons. Const., décision n° 2015-527, op. cit.
148 () La première prorogation opérée par la loi du 20 novembre 2015 ne figure pas dans cette liste dans la mesure où elle n’a pas donné lieu à un réexamen des assignations à résidence qui avaient été décidées durant les 12 jours précédents.
149 () Rapport n° 368 (2015-2016) de M. Michel Mercier au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. http://www.senat.fr/rap/l15-368/l15-3681.pdf [URL consultée le 15 novembre 2016].
150 () Le tribunal administratif de Rennes rappelle ainsi que « l’assignation à résidence [est une] mesure de police administrative qui n’a pas pour objet de tirer les conséquences d’un comportement répréhensible ou délictuel mais de prévenir des risques ».
151 () Xavier Domino, conclusions sur CE., sect., 11 décembre 2015, op. cit.
152 () CE, sect, 11 décembre 2015, M. D…, op. cit.
153 () Audition de M. Jean-Marc Sauvé, in Rapport n° 3784, op. cit.
154 () Rapport n°3451 fait au nom de la commission des Lois par M. Dominique Raimbourg sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, 28 janvier 2016, p. 89. http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3451.pdf [URL consultée le 15 novembre 2016].
155 () R. Drago, « L’état d’urgence et les libertés publiques », in Revue du droit public, 1955, pp. 670 et s.
156 () Rapport n° 3451 de M. Dominique Raimbourg, op. cit., p. 90.
157 () Rapport n° 3784 sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, 25 mai 2016.
© Assemblée nationale