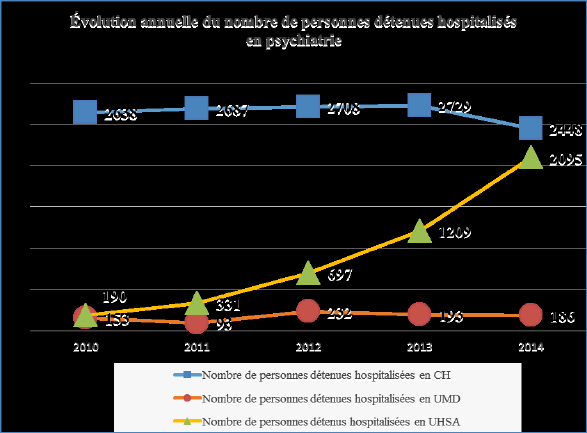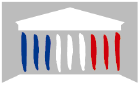
N° 4486
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2017.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145-7 alinéa 3 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
en conclusion des travaux de la mission d’évaluation de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Denys ROBILIARD et Denis JACQUAT,
Députés.
——
SOMMAIRE
___
Pages
SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS DE LA MISSION 7
LISTE DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 13
INTRODUCTION 15
I. LE RECOURS AUX SOINS SANS CONSENTEMENT SOUS LE SCEAU DE L’URGENCE ? 20
A. ÉTAT DES LIEUX DE L’ADMISSION EN SOINS SANS CONSENTEMENT 21
1. Une procédure majoritairement utilisée par les chefs d’établissements 21
a. Une progression sensible des décisions émanant des chefs d’établissements 21
b. Un relatif tassement des admissions décidées par les préfets 24
c. Les autres admissions 25
2. Un profil type inchangé 26
3. Une réelle disparité territoriale 27
a. L’organisation des soins, facteur déterminant de l’organisation des soins sans consentement ? 27
b. L’isolement social : un paramètre à prendre en compte 29
c. Des différences liées à la prévalence des pathologies : une hypothèse à creuser 29
d. Une hétérogénéité résultant de pratiques distinctes ? 30
4. Des statistiques à consolider 31
B. UNE AUGMENTATION SENSIBLE DES PATIENTS SOUS CONTRAINTE 34
1. Les soins sans consentement couvrent un large panel de prise en charge 35
a. Une variété de prises en charge 35
b. Un dispositif dont le principe est encore contesté 36
2. Une augmentation du nombre de patients suivis due à un « effet stock » 39
a. Une part relativement significative des patients suivis dans le cadre ambulatoire 39
b. Une prise en charge intensive des patients présentant des troubles sévères 40
c. Une efficacité qui reste à établir 42
d. Une incidence à relativiser 43
3. Le cas des unités pour malades difficiles 46
a. Des dispositions légales censurées par le Conseil constitutionnel 46
b. Le retour à un encadrement réglementaire 47
c. Un nouveau texte déjà contesté 48
C. LES SOINS SANS CONSENTEMENT CONFRONTÉS À UNE BANALISATION DE L’URGENCE 50
1. Le cadre dérogatoire et exceptionnel de l’urgence 50
a. Les procédures d’urgence dans le cadre de l’admission sur décision du représentant de l’État 50
b. Les procédures allégées dans le cadre de l’admission à la demande du tiers 54
c. L’urgence, une pratique bien ancrée 59
2. La nécessaire revitalisation des commissions départementales des soins psychiatriques 63
a. Les missions dévolues aux commissions départementales des soins psychiatriques 63
b. Un fonctionnement globalement satisfaisant mais empreint de fragilité 63
c. L’exploitation insuffisante des données des commissions 66
II. L’EFFECTIVITÉ ENCORE PERFECTIBLE DE L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES ADMISES EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT. 68
A. DES MARGES DE PROGRÈS EN MATIÈRE D’ACCÈS AU DROIT DES PATIENTS AVANT L’AUDIENCE 70
1. L’information des patients sur leurs droits 71
2. Les relations des patients avec leur avocat 76
a. La représentation obligatoire par avocat 76
b. Les conditions de prise de connaissance des dossiers des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement 78
3. La question de l’aide juridictionnelle 82
B. DES MARGES DE PROGRÈS DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE L’OFFICE DU JUGE À L’AUDIENCE 86
1. Les magistrats dans le contentieux des soins psychiatriques sans consentement 87
a. L’augmentation du nombre de saisines du juge des libertés et de la détention (JLD) 87
b. La recherche de l’office du juge 95
c. Un parquet très discret 99
2. Les audiences du juge des libertés et de la détention (JLD) 100
a. La date de l’audience 100
b. Le lieu de l’audience 104
c. Les conditions de déroulement de l’audience 107
3. Les pièces produites à l’audience 110
a. La réduction du nombre de certificats médicaux 110
b. Le bulletin n° 1 du casier judiciaire 114
C. AU-DELÀ DE L’AUDIENCE, L’APPEL À UN CONTRÔLE JUDICIAIRE DES CONDITIONS D’HOSPITALISATION, ET NOTAMMENT DES MESURES D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION. 117
1. La contestation croissante, par les patients, des modalités des mesures de soins sans consentement plutôt que de leur principe même. 117
2. Le rappel, par la Cour de cassation, de la compétence résiduelle du juge administratif 128
3. L’émergence, en jurisprudence, d’un contrôle judiciaire de la proportionnalité des décisions (notamment d’isolement) prises dans le cadre de mesures de soins sans consentement 129
TRAVAUX DE LA COMMISSION 133
ANNEXES 153
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES CO-RAPPORTEURS 153
ANNEXE 2 : DÉPLACEMENTS DE LA MISSION ET LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 157
ANNEXE 3 : EXEMPLE DE REGISTRE DE LA LOI 159
ANNEXE 4 : EXEMPLE D’ARRÊTÉ PORTANT ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DÉCISION DU PRÉFET 163
ANNEXE 5 : STATISTIQUES RELATIVES À L’ADMISSION EN SOINS SANS CONSENTEMENT 165
ANNEXE 6 : STATISTIQUES FOURNIES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE 167
ANNEXE 7 : LE CADRE JURIDIQUE DES SOINS SANS CONSENTEMENT 179
SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS DE LA MISSION
La mission d’évaluation s’est concentrée sur l’apport de loi de septembre 2013 au regard des droits du patient. Mais elle a souhaité situer ses travaux dans la perspective initiée par la loi du 5 juillet 2011 et des modifications consécutives à la loi de modernisation de notre système de santé.
Ø Les rapporteurs ont ainsi saisi l’occasion de l’imminence de la publication des travaux de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) pour dresser tout d’abord un état des lieux des tendances significatives des soins sans consentement. Plusieurs caractéristiques peuvent être mises en lumière tenant à la population prise en charge, à l’augmentation de la file active des patients suivis en soins sans consentement et à la banalisation du recours aux procédures d’urgence.
● S’agissant des caractéristiques générales, on observe une stabilité de la répartition des modes d’admission depuis l’application de réforme de 2011. Environ 8 patients sur 10 sont admis sur décision d’un directeur d’établissement à la demande d’un tiers. 18 % des patients relèvent d’une admission sur décision du préfet.
La mission relève que le profil type des patients n’a pas été modifié avec l’entrée en vigueur de la réforme de 2011. Il s’agit d’une population essentiellement masculine (60 %), âgée en moyenne d’une quarantaine d’années et souffrant de troubles psychiatriques sévères. On note en effet une surreprésentation des troubles psychotiques (50 % des patients) au regard de la file active de patients suivis en psychiatrie au sein des établissements de santé (11 % des patients).
L’admission en soins sans consentement se caractérise aussi par une hétérogénéité d’application selon les territoires dont les raisons mériteraient d’être creusées.
Les données statistiques se caractérisent toutefois par une certaine incomplétude. Les travaux de la mission se sont ainsi heurtés à l’absence de statistiques nationales portant sur la répartition territoriale des modes légaux d’admission. Faute de lisibilité, la mission formule une série de recommandations portant sur l’exhaustivité et la qualité des données statistiques. La variabilité territoriale du recours aux soins sans consentement mériterait par ailleurs une enquête plus poussée sur ses déterminants. Ces derniers conditionnent en effet l’adaptation de la prise en charge des patients à travers l’organisation des soins.
● S’agissant des évolutions observées depuis 2011, la mission s’est interrogée sur la progression significative du nombre de patients suivis en soins sans consentement (92 000 en 2015) au regard de la file active des patients de plus de 16 ans suivis en psychiatrie (1,7 million en 2015) : respectivement + 15,9 % et + 4,9 % entre 2012 et 2015. Cette augmentation serait principalement due à un « effet stock » des patients dont la prise en charge au titre des programmes de soins excède une année. En 2015, on estime à près de 37 000 le nombre personnes ayant fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre ambulatoire, soit 40 % du nombre total de personnes en soins sans consentement.
Cette augmentation significative met en lumière l’accès élargi des patients à une gamme de soins plus variée que la seule hospitalisation complète ne peut à elle seule offrir. Elle autorise une désinstitutionnalisation de la psychiatrie en accordant une prise en charge des patients hors les murs de l’hôpital, y compris pour les troubles sévères. Ainsi, plus de 60 % des personnes suivant un programme de soins souffrent de troubles psychotiques.
Parallèlement, la mission relève une augmentation de la durée du programme de soins ainsi que de la durée moyenne d’hospitalisation. Dans ce dernier cas, le constat infirme les premières conclusions issues des premiers résultats d’application de la loi du 5 juillet 2011.
S’il est encore tôt pour douter de l’efficacité des programmes de soins sur l’amélioration de l’état de santé des patients, il importe de davantage documenter le recours à ces formes de prise en charge. Pour la mission, il apparaît nécessaire de faire évoluer les systèmes d’information hospitaliers pour déterminer si la durée moyenne d’hospitalisation résulte plus d’une stratégie de soins (hospitalisation séquentielle) que d’un arrêt du programme de soins commandé par une rechute du patient (« ré-hospitalisations »). Au demeurant, la mission préconise une enquête exhaustive portant sur le recours aux programmes de soins et l’efficacité de cette prise en charge.
● Enfin, la mission émet le constat d’une certaine banalisation du recours aux procédures d’urgence. Cette tendance, déjà observable avant 2011, s’est durablement installée dans le paysage des soins sans consentement. Par définition moins protecteur, le recours aux procédures d’urgence ou allégées mériterait d’être davantage documenté. Là encore, les rapporteurs déplorent l’absence de données nationales exhaustives permettant d’éclairer ce phénomène et d’encadrer des pratiques territoriales très hétérogènes et parfois contra legem. L’admission en soins pour péril imminent, nouveauté introduite en juillet 2011 pour la prise en charge des personnes isolées, concerne ainsi un patient en soins sans consentement sur cinq et apparaît davantage comme un expédient pour désengorger les services d’urgence : deux tiers des patients relevant de cette procédure sont ainsi passés par les services d’urgence.
La mission propose de prendre à bras-le-corps cette dérive en s’appuyant davantage sur les commissions départementales de suivi psychiatriques. Elle propose d’encourager les dispositifs alternatifs de prise en charge des patients en amont et en aval des services d’urgences dans les territoires caractérisés par un fort taux de recours aux procédures d’urgence. Elle sensibilise enfin les personnels médicaux à une amélioration de leur pratique médicale, conformément à l’éthique médicale et au cadre fixé par le législateur, à travers des recommandations émises par la Haute Autorité de santé (HAS).
Ø S’agissant des droits des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, la mission a constaté que l’effectivité de leur exercice était encore perfectible. En effet, il y a un important hiatus entre les progrès opérés par la loi de 2013 en matière de garantie des libertés individuelles et leur traduction concrète dans le quotidien des usagers, notamment en raison d’une insuffisance de moyens humains et financiers, mais aussi en raison du degré d’implication des acteurs sur le terrain et de la qualité des relations entre préfets, juges des libertés et de la détention (JLD), médecins (psychiatres) et directeurs d’établissements de santé.
La mission s’étonne en particulier d’une diversité de pratiques (aussi bien en matière d’information des patients sur leurs droits, d’établissement des certificats médicaux, d’isolement et de contention que de conduite de la procédure, de déroulement de l’audience et de taux de mainlevées judiciaires) qui peuvent varier de façon considérable d’un territoire à l’autre, d’un établissement à l’autre, d’un service à l’autre au sein d’un même établissement et d’une juridiction à l’autre.
● Pour remédier au déficit d’information des justiciables sur leurs droits et contrer les logiques de renonciation auxquels certains d’entre eux se résignent, les rapporteurs encouragent la généralisation, au niveau national, de points d’accès au droit dans l’ensemble des établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Pour faciliter et favoriser l’efficacité des avocats dans la procédure de contrôle judiciaire de ces mesures de soins, les rapporteurs estiment utile que se développent davantage encore les formations communes aux avocats, magistrats et soignants sur ce contentieux très spécifique et très technique et que les établissements d’accueil des patients et les juridictions adoptent de bonnes pratiques pour que les délais de communication des dossiers aux avocats avant l’audience soient moins courts qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Par ailleurs, en instaurant un principe d’assistance et de représentation obligatoire par avocat des patients lors des contrôles judiciaires de leur hospitalisation sous contrainte, la loi du 27 septembre 2013 a ouvert la voie à l’octroi, de plein droit, de l’aide juridictionnelle à l’ensemble des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement – mesure que les rapporteurs appellent de leurs vœux.
● S’agissant du contrôle juridictionnel des admissions en soins psychiatriques sans consentement, la mission a constaté qu’il pouvait encore s’améliorer, aussi bien pour ce qui concerne l’investissement des magistrats dans ce contentieux que pour ce qui est des conditions de déroulement de la procédure, plus précisément de l’audience tenue par le JLD avant l’expiration du délai de douze jours d’hospitalisation complète des patients.
En partie du fait du raccourcissement de ce délai du contrôle obligatoire du JLD qui a été opéré par la loi du 27 septembre 2013, le juge judiciaire s’est trouvé confronté à une augmentation du nombre de saisines (+ 27 % entre 2012 et 2015) et du nombre de recours contre ses décisions (+ 40 % d’appels entre 2012 et 2015) alors même qu’il ne parvient pas toujours à cerner avec précision et certitude les contours de son office (contrôle de la régularité formelle de la procédure ? et/ou de la proportionnalité de la mesure privative de liberté ? et/ou de la nécessité médicale de l’hospitalisation complète ?). D’après certaines des personnes entendues par la mission, certains JLD ne seraient pas loin d’intervenir dans la définition du contenu des programmes de soins (qui est en principe de la seule compétence des médecins), tout comme certains préfets, du reste… ce qui conduit les rapporteurs à demander à la HAS d’élaborer des recommandations afin de clarifier le dispositif des programmes de soins et d’harmoniser les pratiques en la matière sur l’ensemble du territoire.
Si, au niveau national, seule une saisine du JLD sur dix (en moyenne) aboutit à une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, la mission a pu constater, grâce aux études de l’IRDES, mais aussi lors de ses déplacements, que les taux de mainlevée variaient de façon significative entre les départements, ce qui peut s’expliquer aussi bien par la qualité des certificats médicaux établis par les professionnels de santé que par les pratiques des JLD. L’investissement de ces derniers serait en effet très variable, peut-être parce qu’ils peinent à percevoir les enjeux et l’intérêt d’un contentieux où leur rôle leur apparaît très limité et très formel. Ce défaut d’investissement est particulièrement patent chez les magistrats du parquet qui sont largement absents aux audiences du JLD, tout au moins en première instance.
Pour ce qui concerne la date et le lieu de ces audiences, les apports de la loi du 27 septembre (à savoir la tenue de l’audience au plus tard le douzième jour suivant l’admission en hospitalisation complète et, à titre de principe, dans une salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil) font l’objet d’un large consensus. Les rapporteurs ont pu constater avec satisfaction l’absence de toute stratégie médicale de contournement de la loi par des levées d’hospitalisation massives destinées à éviter le contrôle judiciaire.
Si certaines des personnes entendues militent pour un contrôle judiciaire avancé dès l’admission en soins psychiatriques sans consentement et étendu aux programmes de soins, si d’autres encore font valoir les difficultés logistiques qui résultent, pour les établissements de santé, pour les juridictions et pour les avocats, de l’organisation d’audiences dans des salles mutualisées, et si la question du port de la robe à l’audience fait toujours débat, toutes ou presque approuvent la suppression de la visioconférence pour la tenue de l’audience et la possibilité ouverte aux justiciables d’obtenir, de droit, la tenue des débats à huis clos.
En revanche, la réduction, opérée par la loi du 27 septembre 2013, du nombre de certificats ou avis médicaux produits à l’audience est, elle, plus discutée. Plébiscitée par les psychiatres, elle est critiquée par certaines associations d’usagers des services psychiatriques. S’agissant de ces certificats et avis, avocats et magistrats déplorent leur qualité variable et s’inquiètent de ce que les avis médicaux attestant du caractère « non-auditionnable » et « non-transportable » de patients sont souvent établis pour des motifs plus logistiques que médicaux. Certains se sont aussi émus de ce que certains greffes continuaient d’exiger le bulletin n° 1 du casier judiciaire dans le cadre du contrôle renforcé qu’opère le JLD sur les demandes de mainlevée concernant des patients ayant des antécédents judiciaires, alors que la loi du 27 septembre 2013 a supprimé la recherche de ces antécédents pour ces patients. Il semblerait que cette pratique s’appuie sur une circulaire du 21 juillet 2011 dont certaines dispositions ont été rendues obsolètes par la loi de 2013 sans que la Chancellerie ait pour autant pris la peine de les modifier : les rapporteurs invitent donc le garde des Sceaux à procéder à cette modification.
● Plusieurs représentants d’associations d’usagers de la psychiatrie ayant estimé que le principal défaut de la loi du 27 septembre 2013 tenait à ce qu’elle n’avait pas étendu le contrôle judiciaire aux conditions d’hospitalisation des patients (notamment aux mesures d’isolement et de contention), la mission a choisi de s’intéresser à cette question, d’autant que de récentes évolutions jurisprudentielles sont intervenues sur ce sujet.
Beaucoup d’avocats et de magistrats ont fait valoir que, bien souvent, les patients contestaient moins le principe même de leur hospitalisation que ses conditions, particulièrement au regard des pratiques en matière d’isolement et de contention, qui peuvent être des facilités pour des établissements sous-dotés en moyens humains et matériels et qui peuvent prendre des formes très préoccupantes dans certains établissements, comme l’exemple du centre psychothérapique de l’Ain l’a encore montré l’an dernier.
Les rapporteurs espèrent donc que seront publiées dans les meilleurs délais tant la circulaire du ministère des affaires sociales et de la santé relative à la contention et à l’isolement que les recommandations de bonnes pratiques de la HAS en la matière – étant précisé que l’on ne saurait se satisfaire de la durée maximale de 14 heures que la version provisoire de ces recommandations prévoit pour les mesures d’isolement continues.
En tout état de cause, il semblerait qu’émerge en jurisprudence un contrôle judiciaire de la proportionnalité des décisions de contention et de placement à l’isolement, pour la plus grande satisfaction d’associations d’usagers des services psychiatriques mais aussi de magistrats qui estiment que leur degré de gravité au regard des droits des patients justifie que le juge les examine, y compris lorsqu’elles sont prises dans le cadre d’hospitalisations libres.
LISTE DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
Ø Améliorer le pilotage de la politique des soins sans consentement
Recommandation n° 1 : engager une recherche permettant d’identifier les variables territoriales de recours aux soins sans consentement.
Recommandation n° 2 : transmettre sans délai le rapport prévu par l’article 9 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013.
Ø Évaluer l’efficacité des programmes de soins
Recommandation n° 3 : identifier dans le cadre du RIM-P le début et la fin d’un programme de soins.
Recommandation n° 4 : mettre en place une étude portant sur le recours aux programmes de soins et l’efficacité de cette prise en charge.
Recommandation n° 5 : redynamiser les commissions départementales de suivi psychiatrique par :
– le contrôle de la situation des personnes faisant l’objet de programmes de soins d’une durée supérieure à un an ;
– l’exploitation des données statistiques portant sur les programmes de soins.
Ø Encadrer le recours aux procédures d’urgence
Recommandation n° 6 : disposer des statistiques relatives aux mesures provisoires afin, le cas échéant, de définir une doctrine de leur emploi.
Recommandation n° 7 : enquêter sur les conditions du recours à la procédure d’urgence à la demande du tiers.
Recommandation n° 8 : saisir la Haute Autorité de santé en vue d’édicter des recommandations de bonne pratique relatives aux admissions en soins psychiatriques par des procédures d’urgence.
Recommandation n° 9 : instaurer un indicateur d’évaluation du respect des recommandations de bonne pratique relatives aux admissions en procédures d’urgence dans le cadre de la certification des établissements de santé.
Recommandation n° 10 : soutenir le recours aux dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence (équipes mobiles, coordination avec le centre 15) dans les territoires pour lesquels le taux de recours aux procédures d’urgence est important par :
– la définition des dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence ;
– l’élaboration d’indicateurs de suivi ;
– une éventuelle incitation financière inversement proportionnelle au taux de recours aux procédures d’urgence.
Ø Redynamiser les commissions départementales des soins psychiatriques
Recommandation n° 11 : prévoir la nomination de membres suppléants dans les commissions départementales de soins psychiatriques.
Recommandation n°12 : redynamiser les commissions départementales des soins psychiatriques, en redéfinissant leur rôle en articulation avec celui des juges des libertés et de la détention, en exploitant et en diffusant leurs comptes rendus et rapports d’activité par une structure nationale identifiée.
Ø Rendre les droits du patient plus effectifs
Recommandation n° 13 : reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle de plein droit aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement.
Recommandation n° 14 : demander à la Haute Autorité de santé (HAS) d’élaborer des recommandations relatives aux conditions de mise en place, de modification et de levée des programmes de soins.
Recommandation n° 15 : modifier la circulaire du ministre de la justice du 21 juillet 2011 relative à la présentation de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011, afin d’en supprimer les dispositions exigeant que le greffe demande systématiquement copie du bulletin n° 1 du casier judiciaire du patient, pour vérifier si ce dernier a fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité suivie d’une mesure d’hospitalisation d’office.
Le fondement juridique des soins contraints en psychiatrie trouve sa source dans la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Loi d’assistance aux malades mentaux autant que loi de sûreté, le texte, qui a prospéré près d’un siècle et demi sans modification, prévoit l’intervention de l’autorité administrative en cas de danger public ou simplement pour protéger une personne malade contre elle-même.
Après avoir reconnu le droit du patient à être pleinement partie au procès en contestation de son hospitalisation contraire avec la loi « Sécurité et liberté » du 2 février 1981, par ailleurs décriée, le législateur a opéré une évolution fondamentale en 1990 en affirmant les droits des malades hospitalisés en raison de troubles mentaux, et en s’efforçant de conjuguer nécessité liée à la sécurité publique et nécessité des soins (1). Par ailleurs, à côté de l’hospitalisation libre, le nouveau texte prévoyait deux régimes d’hospitalisation sous contrainte, l’hospitalisation d’office, à la main du préfet, et l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Vingt ans plus tard, sous la contrainte du Conseil constitutionnel (2), lui-même placé sous l’œil attentif de la Cour européenne des droits de l’Homme, et dans le prolongement du discours prononcé à Antony en décembre 2008 par le Président de la République, Nicolas Sarkozy, le législateur a amplement modifié le régime de l’hospitalisation d’office en adoptant la loi du 5 juillet 2011 (3) qui a fait l’objet d’une évaluation six mois après son entrée en vigueur (4).
Ce texte introduisait dans la prise en charge des patients deux changements importants et étrangers à la logique du discours d’Antony. Avec la substitution de la notion de « soins sans consentement » à celle d’« hospitalisation », la loi a étendu la prise en charge à l’ambulatoire, afin de répondre à la nécessaire continuité des soins, cheval de bataille de l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM). À côté de l’hospitalisation complète, le patient peut désormais être légalement obligé à des soins selon diverses modalités dans le cadre d’un programme de soins établi par le psychiatre. Cette loi a par ailleurs consacré le rôle du juge judiciaire, et plus précisément du juge des libertés et de la détention (JLD), dans le contrôle de toutes les hospitalisations psychiatriques complètes sous contrainte, ouvrant ainsi la voie à une procédure civile atypique et à un contentieux hybride dans lequel un accord judiciaire est requis pour la poursuite d’une mesure administrative, et dans lequel le juge judiciaire se trouve ainsi en position de « juge administrateur », un peu comme le juge des tutelles ou comme le juge des enfants en matière d’assistance éducative.
À nouveau sous la contrainte du Conseil constitutionnel, le législateur a ensuite adopté une nouvelle loi, publiée en septembre 2013 (5). Elle avait notamment vocation à satisfaire une décision du Conseil constitutionnel qui avait jugé contraires à la Constitution, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), certaines dispositions de la loi de juillet 2011. Le législateur s’était saisi de cette circonstance pour améliorer le contrôle judiciaire dans le sens recommandé par un rapport intermédiaire de la mission « santé mentale et avenir de la psychiatrie », dont les travaux étaient en cours.
En effet, dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraires à la Constitution deux dispositions de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Le Conseil avait donné au législateur jusqu’au 1er octobre 2013 pour réformer la procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement des personnes ayant séjourné en unités pour malades difficiles (UMD) ou hospitalisées à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Le 7 novembre 2012, la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale avait parallèlement créé une mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie. Après avoir procédé à une trentaine d’heures d’auditions et effectué deux déplacements, cette mission avait remis, le 29 mai 2013, un rapport d’étape (6) dont s’est inspirée la proposition de loi n° 1223 relative aux soins sans consentement en psychiatrie (7).
Examinée selon la procédure d’urgence eu égard aux délais impartis par le Conseil constitutionnel, cette proposition de loi est devenue la loi du 27 septembre 2013 (8) dont certaines des dispositions sont entrées en vigueur de façon échelonnée.
Outre les dispositions répondant à la censure du Conseil constitutionnel, l’allégement de la procédure par la suppression d’un certain nombre de certificats, les précisions apportées sur le programme de soins et les mesures relatives aux sorties d’essai sont entrés en vigueur immédiatement, le 30 septembre 2013. En revanche, la réforme de la procédure judiciaire (délai de saisine du juge, délai ouvert au juge pour statuer, lieu de l’audience, suppression de la visioconférence et représentation obligatoire par avocat) est entrée en vigueur le 1er septembre 2014 – sauf pour ce qui concerne le délai de 15 jours pour saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre du contrôle semestriel des hospitalisations sans consentement : ce délai est entré en vigueur le 15 mars 2014.
Un peu plus de trois ans après son adoption, il était nécessaire d’évaluer l’application de ces différentes mesures. C’est la raison pour laquelle une mission d’évaluation a été instituée dans le cadre prévu par l’article 145-7, alinéa 3, du Règlement de l’Assemblée nationale.
Au cours du mois dont elle disposait pour mener ses travaux, la mission a réalisé plus d’une quinzaine d’auditions et de tables rondes ainsi que deux déplacements : l’un à l’hôpital Sainte-Anne et à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, l’autre à l’hôpital de Meaux.
Les rapporteurs regrettent toutefois que le ministère de l’intérieur, à l’exception notable de la préfecture de police de Paris et de l’association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur (ACPHFMI), n’ait ni répondu au questionnaire qui lui a été adressé en décembre dernier ni permis l’organisation d’une audition de ses services.
Si l’évaluation de l’apport de loi du 27 septembre 2013 sur l’amélioration des droits du patient a constitué un axe important des travaux effectués par la mission, les rapporteurs ont aussi souhaité se situer dans la perspective initiée par la loi du 5 juillet 2011 ainsi que dans les ajustements opérés par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Les modifications de la loi du 27 septembre 2013 relatives à l’allégement du nombre de certificats médicaux ou les précisions portant sur la variété des prises en charge par les programmes de soins ne peuvent en effet être appréhendées sans un état des lieux clair des modes légaux d’admission refondés par la loi du 5 juillet 2011.
Aussi, les rapporteurs ont-ils entendu profiter de l’imminence de la publication des travaux de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) pour examiner avec attention les tendances significatives qui se dégagent.
La mission s’est ainsi interrogée sur la progression significative du nombre de patients suivis en soins sans consentement depuis 2012. L’allongement de la durée de la contrainte, matérialisé par le recours aux programmes de soins, en semble la cause principale. Elle pose d’emblée la question de l’efficacité de ce dispositif introduit par la loi du 5 juillet 2011. Les rapporteurs conviennent qu’il est encore tôt pour l’apprécier et sont plutôt partisans de le maintenir pour en évaluer complètement les effets. En revanche, ils recommandent de se doter sans tarder d’outils d’expertise plus appropriés.
Les rapporteurs ont ensuite constaté que le recours aux procédures d’urgence ou dérogatoires constitue désormais une pratique désormais bien et trop ancrée dans le paysage des soins sans consentement. Cette tendance lourde, observable avant la réforme engagée il y six ans, n’a été enrayée ni par la loi du 5 juillet 2011 ni par celle du 27 septembre 2013. On assiste en effet à une véritable banalisation de l’urgence au risque d’un dévoiement de l’esprit de la loi. Il en est ainsi des admissions sur le fondement du péril imminent, pourtant circonscrites aux seules personnes isolées. Le recours immodéré à ce mode d’admission contribue à élever l’allégement de la procédure au rang d’une pratique médicale et/ou administrative normale dans certains territoires. Il n’est évidemment pas question de remettre en cause la nécessite de protéger la santé du patient. Mais il n’est pas non plus anormal de s’interroger sur les modalités selon lesquelles cette protection s’opère. La banalisation de l’admission en péril imminent contrevient aux droits du patient et de son entourage – les fameux tiers. Elle implique par ailleurs une remise en question d’habitudes des praticiens bien ancrées sur le fondement de l’éthique médicale.
S’agissant des droits du patient, la présence obligatoire de l’avocat dans la procédure ne fait sens qu’au regard du contrôle exercé par le juge. Il fallait donc envisager l’évaluation de la totalité de l’édifice législatif construit sur l’équilibre entre, d’une part, le respect des droits du patient, au premier chef desquels la liberté d’aller et venir, et, d’autre part, la protection de sa santé. Au terme de leurs travaux, les rapporteurs déplorent un décalage considérable entre les droits reconnus aux patients par la loi et l’effectivité de l’exercice de ces droits au quotidien.
Pour reprendre la formule du Dr Isabelle Montet, secrétaire générale du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), « les logiques médicale, judiciaire et sécuritaire se superposent plus qu’elles ne se complètent », ce qui n’est pas sans susciter certaines frictions entre les différents acteurs de la procédure d’admission en soins sans consentement (praticiens des établissements de santé, avocats, magistrats, préfets).
Or, comme l’a justement souligné M. Jean-François Carenco, préfet de la région Île-de-France, président de l’association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur, la mise en œuvre de la loi dépend largement de la bonne intelligence des acteurs sur le terrain, notamment de la qualité des relations entre préfets, juges des libertés et de la détention (JLD), médecins (psychiatres) et directeurs d’établissements de santé.
Selon Mme Marie-Christine Leprince, présidente du TGI de Caen et membre du bureau de la conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance (TGI), ces différents acteurs auraient manqué d’un accompagnement au niveau national pour la mise en œuvre des réformes de 2011 et de 2013, par exemple en matière d’aménagement des salles d’audience sur l’emprise des établissements d’accueil.
Il est également apparu nécessaire aux rapporteurs de ne pas écarter de leurs travaux les évolutions portées par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, s’agissant de l’encadrement de la pratique de contention et d’isolement. Dans ce domaine, l’atteinte aux droits du patient est susceptible d’emporter un effet sur sa liberté et partant, sur l’appréciation judiciaire de la légalité de la mesure.
I. LE RECOURS AUX SOINS SANS CONSENTEMENT SOUS LE SCEAU DE L’URGENCE ?
Dans un article publié en janvier 2015, Magali Coldefy, Tonya Darfou et Clément Nestrigues observaient que « si le nombre de patients concernés par des soins sans consentement a augmenté en valeur absolue entre 2010 et 2012, il représente toujours une part relative de près de 5 % de la file active suivie en psychiatrie en établissement de santé » (9).
Un an plus tard, à l’appui de séries statistiques plus complètes, Mme Magali Coldefy, maître de recherche à l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), souligne que l’augmentation du nombre de patients admis en soins sans consentement est plus importante que la file active des patients. Sur la période 2012-2015, on note une évolution de respectivement 16 % et 5 %. Cette augmentation a bien entendu retenu l’attention des rapporteurs qui ont souhaité, au travers de leurs auditions, en comprendre les raisons.
Faute de transmissions de séries statistiques portant sur l’admission aux soins sans consentement et sa répartition territoriale, les rapporteurs ont conduit leurs travaux en tenant principalement compte des études menées par les personnes auditionnées, praticiens, professionnels du droit ou statisticiens. Ces éclairages ont également été croisés avec les publications de revues spécialisées, d’actes de colloques disponibles sur internet ou directement remis par leurs auteurs.
S’il est établi que le profil des personnes admises n’a guère varié, il n’en demeure pas moins que le recours aux soins sans consentement varie d’un territoire à l’autre. Les rapporteurs ont bien entendu souhaité identifier ces déterminants mais les hypothèses qu’ils avancent mériteraient d’être davantage creusées avec l’aide de statistiques fiables et centralisées.
Deux constats peuvent être faits. Tout d’abord, l’augmentation de la file de patients serait imputable à la mise en application des programmes de soins, les patients étant suivis plus d’une année. Surtout, la progression des modes d’admission d’urgence, telle celle des soins sans consentement en péril imminent, traduit l’installation durable de procédures allégées dont la pratique jure avec l’esprit de la loi.
A. ÉTAT DES LIEUX DE L’ADMISSION EN SOINS SANS CONSENTEMENT
L’admission en soins sans consentement se caractérise par une certaine permanence tant dans les modes légaux d’admission, que du profil type des patients ou des différences territoriales. Sur ce dernier point, faute de données statistiques satisfaisantes, les rapporteurs ne peuvent qu’émettre des hypothèses qui ne demandent qu’à être évaluées à l’aune d’études plus complètes.
1. Une procédure majoritairement utilisée par les chefs d’établissements
Rappelons qu’il existe plusieurs possibilités d’admettre une personne en soins sans consentement. Schématiquement, on distingue l’admission sur la décision du directeur d’un établissement autorisé en psychiatrie chargé d’assurer les soins psychiatriques sans consentement et l’admission sur décision du représentant de l’État. Il faut toutefois y ajouter le cas particulier des personnes placées en détention ainsi que des personnes déclarées pénalement irresponsables.
La répartition entre modes d’admission en soins sans consentement se caractérise par une certaine constance depuis 2010. Le mode principal d’admission reste la décision des directeurs d’établissements autorisés en psychiatrie (aux alentours de 80 %). Viennent ensuite les soins sur demande du représentant de l’État. Cette répartition se caractérise par une relative stabilité depuis l’application de la loi du 5 juillet 2011 (10).
a. Une progression sensible des décisions émanant des chefs d’établissements
8 patients sur 10 sont admis sur décision d’un directeur d’établissement. Ce taux ne surprend guère puisque la mesure est prise majoritairement à la demande d’un tiers.
L’admission en soins sans consentement repose sur le constat que le patient ne dispose pas des facultés nécessaires pour consentir librement à une prise en charge. Deux conditions sont ainsi formulées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. D’une part, les troubles mentaux rendent impossible son consentement ; d’autre part, l’état mental de la personne concernée « impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante […] soit d’une surveillance médicale régulière […] ».
Cette demande, manuscrite, est présentée par un tiers, en l’occurrence un membre de la famille du malade ou par « une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ». Dans les mêmes conditions, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut également faire une demande de soins pour le patient. Enfin, la loi exclut explicitement « les personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ».
Le législateur a entendu garantir que le tiers soit un proche du malade car une hospitalisation contrainte porte une atteinte directe à la liberté de la personne. On rappellera à cet effet, que le juge administratif avait conclu que la proximité du lien entre le tiers demandeur et l’intéressé constitue une garantie, un membre de la famille pouvant être présumé agir dans l’intérêt du malade (11).
S’agissant du tiers non-membre de la famille, la demande ne peut être recevable que s’il justifie de l’existence de relations constantes antérieures à la demande et lui donnant qualité pour agir. À cet égard, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique constitue une catégorie qui justifie à l’avance de ce lien personnel avec le malade, d’autant qu’il est prévu un texte écrit désignant expressément la personne.
Par ailleurs, si la loi écarte explicitement toute demande émanant du personnel soignant, on rappellera que la jurisprudence s’est aussi attachée à exclure les membres du personnel administratif exerçant dans l’établissement d’accueil dans la mesure où aucun lien familial ou personnel ne peut être retenu pour les regarder comme agissant dans l’intérêt du malade (12).
Enfin, pour éviter toute demande manifestement contraire à l’intérêt du patient, l’article L. 3212-1 précité dispose que les certificats médicaux rédigés à l’appui de la demande d’admission ne doivent être établis que par des médecins qui ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Le taux de patients suivis, en légère augmentation, masque une réalité nuancée, la procédure d’admission à la demande du chef d’établissement couvrant très schématiquement les deux cas de figure mentionnés à l’article L. 3212-1 : la procédure de droit commun d’une part, la procédure pour péril imminent d’autre part. L’augmentation du nombre d’admissions sur décision du chef d’établissement résulte principalement d’un accroissement sans précédent du recours à la procédure de soins pour péril imminent.
L’admission à raison du péril imminent vise spécifiquement le cas des personnes isolées. Procédure dérogatoire, ce dispositif a vocation à s’appliquer en l’absence de tiers. Elle est doublement justifiée par « l’impossibilité d’obtenir une demande » dans les conditions précitées et par l’existence, à la date d’admission, d’un « péril imminent pour la santé de la personne » (13), c’est-à-dire « l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient » (14). L’hypothèse la plus répandue correspond au malade présentant un risque important de passage à l’acte suicidaire mais ce n’est pas la seule : il peut aussi s’agir d’une personne en état de profonde désorientation pouvant l’exposer à un risque d’accident.
Ce dispositif allégé n’exclut cependant pas l’obligation d’informer, dans les vingt-quatre heures, la famille ou la personne qui en assure la protection juridique, de même que celle qui a des relations avec le malade.
Aux termes des statistiques portées à la connaissance des auteurs, la procédure de soins pour péril imminent (SPI) concernerait à ce jour 21 % des patients, soit un quart du nombre total de personnes faisant l’objet de soins sur décision du directeur d’établissement. Ce chiffre apparaît par ailleurs en nette augmentation au regard des dernières données publiques. Une publication scientifique datée du mois de janvier avançait le taux de 11 % pour l’année 2012 (15). Cette poussée significative fait aujourd’hui question et semble participer d’une pratique administrative centrée sur l’efficacité de l’admission, et partant une certaine célérité (cf. C).
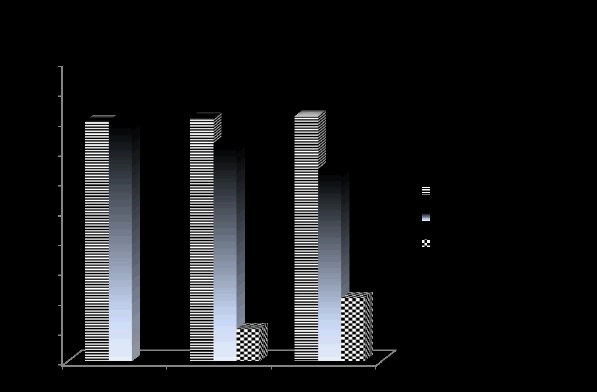
(*) Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
(**) Donnée présentée en audition.
N.B. : Un patient peut être vu dans la même année une fois en SPI, une autre fois en procédure de droit commun, les pourcentages présentés ne sont pas cumulables.
b. Un relatif tassement des admissions décidées par les préfets
Sans remettre en cause le principe d’un dispositif prenant en compte l’atteinte à l’ordre public, l’un des co-rapporteurs s’était interrogé par le passé sur la « persistance du rôle confié au préfet » (16). Véritable exception française au regard des autres pays de l’Union européenne, le rôle dévolu au représentant de l’État reste encore important même s’il apparaît comme second aujourd’hui.
Rappelons en effet que la motivation de l’intervention du préfet trouve sa source notamment dans le trouble à l’ordre public. Cette admission est prononcée sur la base d’un certificat médical « circonstancié » établi par un psychiatre qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Elle est doublement motivée par l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et par les risques d’atteinte qui à « la sûreté des personnes » qui, « de façon grave, à l’ordre public » (17).
Selon les dernières données portées à la connaissance des rapporteurs, le nombre de patients suivis sur décision préfectorale représente près d’un cinquième de la file de personnes en soins sans consentement. Les services préfectoraux, dont la place au sein du dispositif d’intervention d’urgence reste encore prépondérante, sont encore significativement sollicités pour initier une procédure de soins sans consentement. Depuis 2010, on observe néanmoins une proportion d’admissions en très légère diminution.
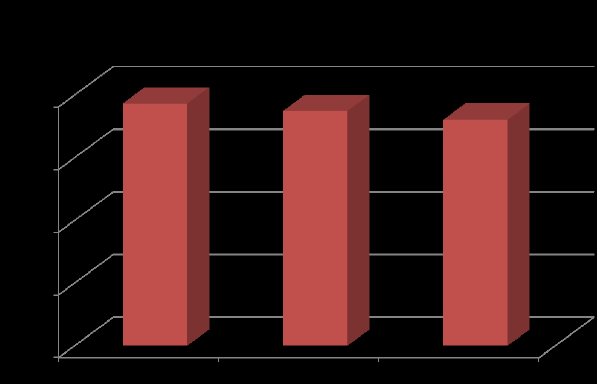
(*) IRDES, Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
(**) Donnée présentée en audition.
Plus anecdotiques, en raison de leur part relativement faible, les autres admissions n’en sont pas moins importantes.
L’article D. 398 du code de procédure pénale dispose que les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire et font l’objet d’une hospitalisation complète, sur décision préfectorale, au vu d’un certificat médical circonstancié. Ces personnes sont admises sur le fondement du chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique. L’article L. 3214-1 du code de la santé publique prévoit ainsi la possibilité d’admettre en soins psychiatriques les personnes détenues sous la seule forme de l’hospitalisation complète lorsque les troubles mentaux rendent impossible leur consentement. Les données portées à la connaissance des rapporteurs font état d’une stabilité des effectifs concernés entre 2010 et 2015, à l’exception d’une légère augmentation en 2012.
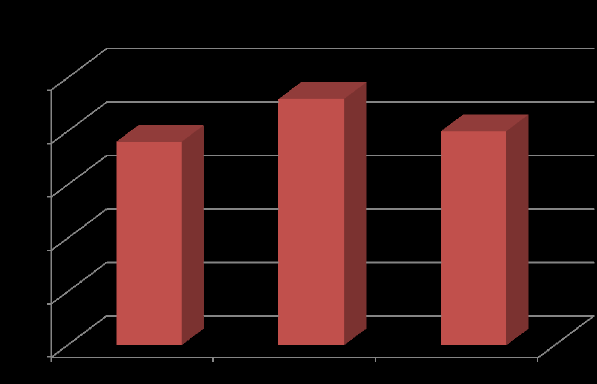
(*) IRDES, Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
(**) Donnée présentée en audition.
Viennent ensuite les prises en charge résultant de décisions judiciaires. On distingue alors deux situations :
– aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, peut être ordonnée par une décision de justice prononçant une déclaration d’irresponsabilité pénale (chambre d’instruction ou juridiction de jugement). Le régime d’admission est ensuite celui prévu par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique (admission sur décision du représentant de l’État) (18).
– selon l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, le représentant de l’État peut prononcer une admission en soins psychiatriques lorsqu’il a été avisé par les autorités judiciaires. Dans ce cas de figure, « les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public ».
Ces modes d’admissions ne concernent qu’un faible nombre de personnes. Par ailleurs, leur part reste relativement stable au regard du nombre de personnes faisant l’objet de soins sans consentement.
La modification du régime d’admission en soins psychiatriques engagée en 2011 n’a pas fondamentalement eu d’influence sur le profil type des patients concernés. On note en effet une relative stabilité des caractéristiques de la population.
Il s’agit d’une population majoritairement masculine (60 %), âgée en moyenne d’une quarantaine d’années et souffrant de troubles psychiatriques sévères. On relève en effet une surreprésentation des troubles psychotiques au regard de la file active de patients suivis en psychiatrie au sein des établissements de santé. Près de 50 % des personnes prises en charge sans consentement relèvent de ce cas de figure contre 11 % pour la file active.
Ces caractéristiques restent prédominantes quel que soit le mode légal d’admission, même si l’on peut souligner quelques différences. On notera que le profil des personnes admises en soins sans consentement à la demande du représentant de l’État, détenues ou jugées pénalement irresponsables, se caractérise par une part accrue de patients masculins, jeunes et souffrant de troubles au degré de sévérité particulièrement élevé.
De l’avis des experts auditionnés, ces caractéristiques générales étaient déjà observables avant l’application de la loi de 2011. À l’appui de cette assertion, les rapporteurs rappellent les conclusions d’un état des lieux mené avant la réforme de juillet 2011 (19).
Avant cette date, la part des hommes dans les patients hospitalisés sans consentement représentait déjà 60 %, taux dont il était souligné qu’il ne différait guère des résultats observés dans la littérature internationale. La prédominance masculine était par ailleurs aussi constatée, quel que soit le mode légal auquel il était recouru. Les hommes étaient déjà très largement majoritaires qu’ils fassent l’objet d’une hospitalisation d’office (80 %), qu’ils soient jugés irresponsables pénalement (91 %) ou qu’ils soient détenus (93 %).
L’âge moyen des patients hospitalisés alors constaté s’élevait à 43 ans, s’échelonnant de 33 ans pour les détenus à 44 ans pour l’hospitalisation à la demande d’un tiers, en passant par l’âge de 40 ans pour ceux relevant de l’hospitalisation d’office.
Enfin, si l’on s’attache aux troubles justifiant une hospitalisation sans consentement, on constate que les troubles psychotiques représentaient déjà plus de la moitié des diagnostics.
Il semble donc que le nouveau régime de soins sans consentement n’ait pas eu d’incidence notable sur les caractéristiques populationnelles.
3. Une réelle disparité territoriale
La disparité territoriale dans l’organisation des soins constitue un enjeu majeur. Ce constat vaut également pour l’admission en soins sans consentement, régime pour lequel les chiffres portés à la connaissance des rapporteurs témoignent d’une réelle hétérogénéité.
Mme Magali Coldefy a ainsi indiqué aux rapporteurs que le taux moyen de prise en charge sans consentement constaté pour l’année 2015 est de 171 pour 100 000 habitants. Il ne s’agit toutefois que d’une moyenne nationale, les écarts s’échelonnant de 1 à 10 selon les départements. Parmi les taux les plus élevés figurent des départements tels que l’Yonne, le Vaucluse ou le Val-de-Marne.
Ces différences territoriales suscitent des interrogations. Plusieurs explications sont convoquées combinant des déterminants sociologiques, économiques ou d’organisation des soins.
a. L’organisation des soins, facteur déterminant de l’organisation des soins sans consentement ?
Selon certaines études, les différences observées peuvent ainsi tenir à la présence d’unités spécialisées dans la prise en charge de patients difficiles – les unités pour les malades difficiles (20) –, commec’est le cas dans le département du Vaucluse. Les écarts s’expliquent aussi par la sectorisation psychiatrique, le découpage visant à soigner les personnes au plus près de leur lieu de résidence. Au cours de son audition, Mme Magali Coldefy a ainsi souligné que la patientèle de la ville de Paris dépend plus largement de l’offre de soins localisées dans les départements de la petite couronne (Essonne, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis).
Deux travaux mériteraient à cet égard d’être mis en lumière. L’ancienneté des données ne remet pas en cause les conclusions (21). Toutefois, convaincus par leur intérêt, les rapporteurs plaident en faveur de leur actualisation au regard des dernières statistiques pour confirmer le bien-fondé des constats opérés.
Dans une étude publiée récemment dans la Revue française des affaires sociales et à laquelle a participé Mme Magali Coldefy (22), il est souligné que la typologie des territoires de santé en matière de prise en charge de la maladie mentale exerce une influence sur le taux de recours à l’hospitalisation sous consentement. Il est notamment corrélé avec la dotation plus ou moins élevée en équipements et en personnels. La quantité de l’offre de soins ou encore sa qualité – le caractère spécialisé des établissements – induirait un plus fort recours à l’hospitalisation sans consentement.
Une autre étude, certes menée sur les seules admissions sur décision du préfet, tend à confirmer cette approche par l’organisation des soins. Le docteur Jean-Luc Roelandt a ainsi présenté aux rapporteurs les premières conclusions de travaux portant sur 45 établissements situés sur 125 secteurs psychiatriques de 4 régions (Nord-Pas-de-Calais, Aquitaine, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Il a été constaté que les secteurs pour lesquels le taux de recours aux soins sous contrainte était important se distinguaient notamment par une « offre de soins conséquente en termes de ressources humaines et capacités d’hospitalisation » et des « durées moyennes de séjour supérieures ». Plus significatif est le « faible taux de recours ambulatoire ». À l’opposé, les secteurs à bas taux de recours aux soins sans consentement sont caractérisés par un « taux de recours ambulatoire élevé », des « durées d’hospitalisation réduites » et un « nombre de lits peu élevé ».
D’autres explications sont également avancées pour expliquer ces écarts. Des hypothèses portant sur les caractéristiques sociales spécifiques des résidents sur certains territoires ont ainsi été émises.
b. L’isolement social : un paramètre à prendre en compte
Menée par une équipe du centre hospitalier Le Vinatier (23), une étude avait pour principal objet de vérifier si « les patients résidant en zone urbaine sensible (ZUS) sont plus souvent hospitalisés en soins à la demande d’un représentant de l’État que les patients ne résidant pas en ZUS » (24). Cette hypothèse a été infirmée par des travaux portant sur les patients adultes hospitalisés dans l’établissement durant les années 2012 et 2013. Le fait d’habiter en ZUS ne prédispose pas à un taux de recours à l’admission à la demande du représentant de l’État plus important que celui constaté sur d’autres territoires. En effet, il apparaît que, de manière générale, les personnes habitant dans les ZUS sont plus souvent hospitalisées que les personnes n’y demeurant pas et ce, quel que soit le régime d’hospitalisation. Cette situation pourrait s’expliquer par la concentration de personnes fragiles psychiquement, disposant de faibles revenus et habitant des logements sociaux. Cette hypothèse n’a toutefois pas été scientifiquement vérifiée.
L’étude précitée à laquelle a participé Mme Magali Coldefy a aussi permis d’affiner l’hypothèse portant sur les caractéristiques sociales. Il a ainsi été démontré que la situation d’isolement social, mesuré à partir d’un nouvel indicateur récemment utilisé par les chercheurs français – l’indicateur de fragmentation sociale – apparaît fortement corrélée au taux de recours (25). Cet indicateur, qui prend en compte le statut marital, l’isolement du ménage et le type d’habitat, serait même plus déterminant que « l’indicateur de désavantage social, qui qualifie davantage la situation matérielle et économique du contexte de vie de l’individu ».
L’étude du docteur Jean-Luc Roelandt confirme aussi la corrélation entre l’isolement et le recours aux soins contraints. Il est ainsi constaté un taux élevé de personnes isolées et l’existence de structures telles que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale dans les territoires recourant aux soins sans consentement.
c. Des différences liées à la prévalence des pathologies : une hypothèse à creuser
La variabilité du recours aux soins sans consentement serait aussi liée à la différence de prévalence des pathologies sur le territoire. Il ressort des études scientifiques que la densité de personnes suivies pour des troubles schizophréniques en établissement de santé est corrélée aux taux d’hospitalisation sans consentement. C’est aussi l’une des conclusions de la première analyse nationale de la variabilité territoriale du recours aux hospitalisations publiée par la Revue française des affaires sociales déjà citée par les rapporteurs.
d. Une hétérogénéité résultant de pratiques distinctes ?
Sans qu’ils puissent en tirer de conclusions générales, les rapporteurs ont été sensibilisés aux différences de pratiques administratives d’un territoire à l’autre. Celles-ci appellent une réponse faisant appel à la sensibilisation des acteurs sur la portée et la philosophie des dispositifs.
Dans le cas particulier des admissions à la demande des représentants de l’État, il a été indiqué que certaines procédures ont pu être davantage motivées par les antécédents des personnes concernées que par leur état de santé mentale. Les rapporteurs ont ainsi appris que le risque de « radicalisation » pouvait justifier à lui seul une admission en soins sans consentement. Cette pratique, bien qu’isolée, ne constitue pas une réponse idoine à ce phénomène. Elle interpelle les professions médicales pour lesquelles l’éthique médicale commande de prendre en charge des patients à raison de leur trouble de santé.
La mission a également été informée par les représentants de la direction générale de la santé que les agences régionales de santé recevaient des « demandes insistantes » des préfectures pour un accès direct à l’outil de gestion médico-administrative des soins sans consentement Hopsy.
Ce fichier automatisé a été institué par un arrêté du 19 avril 1994 sur délibération conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (26). Les préfectures ne disposent pas d’un accès direct à ce fichier qui comprend diverses informations relatives à la situation administrative et médicale du patient suivi en soins sans consentement (saisies des données nécessaires à l’admission, échéancier de certificats médicaux, gestion des sorites d’essai et des sorties définitives,…). Ce fichier sert notamment d’outil de gestion délégué des admissions en soins psychiatriques sans consentement à la demande des représentants de l’État en permettant la production automatique des arrêtés préfectoraux.
L’arrêté précité prévoit par ailleurs que les préfets peuvent être destinataires des informations d’Hopsy « à raison de leurs attributions ». L’article R. 312-8 du code de la sécurité intérieure dispose ainsi que le préfet peut solliciter de l’ARS l’interrogation des données contenues dans Hopsy, dans le respect des règles du secret médical, avant de statuer sur une demande de port d’armes. Il est ainsi fondé à faire vérifier auprès de l’ARS si l’intéressé est ou a été admis en soins sans consentement.
Une autorisation d’accès direct des préfectures au logiciel, motivé par la « simplification du travail de contrôle des demandes de ports d’armes », peut susciter quelques doutes quant à l’utilisation d’un outil dont la finalité consiste à suivre exclusivement les seuls patients en soins sans consentement. La mission aurait souhaité pouvoir interroger le ministère de l’intérieur sur cette question mais n’a pas été en mesure de le faire faute de réponse à ses nombreuses sollicitations.
Les pratiques témoignent aussi du désarroi dans lequel se trouvent plongés certains acteurs confrontés à des situations répétitives de violence, particulièrement dans l’univers carcéral. Pour des établissements pénitentiaires de taille comparable, on observe ainsi des grandes variations de personnes suivies en soins sans consentement des détenus. Selon M. Jean-Pierre Staebler, président de la Conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH), il semble qu’il faille attribuer ces écarts aux différentes compétences des équipes pénitentiaires. L’admission est décidée en l’absence de l’équipe psychiatrique en s’appuyant sur le concours des services médicaux d’urgence appelés pour l’occasion et sous la pression de l’administration pénitentiaire. Cet expédient permet d’apporter une réponse à une situation de crise mais ne constitue pas nécessairement la solution de prise en charge la plus appropriée.
4. Des statistiques à consolider
Les rapporteurs se félicitent des recherches qui ont permis d’affiner la connaissance du recours à l’hospitalisation d’office et, depuis la réforme de 2011, aux soins sans consentement. Ces travaux sont d’autant plus nécessaires qu’ils permettront de déterminer l’organisation de soins la plus appropriée aux personnes souffrant de troubles mentaux. Il existerait ainsi une corrélation entre le taux de recours à l’admission en soins sous contrainte et la situation d’isolement social. On observerait aussi une corrélation entre l’admission et la présence d’équipements hospitaliers. Dans les deux cas, c’est la question du format de l’organisation des soins qui peut se poser. Les rapporteurs n’ont cependant pas de réponse à apporter à ce stade. Les travaux qui ont été menés mériteraient d’être complétés afin de prendre en compte les effets des réformes intervenus en 2011 et 2013.
Recommandation n° 1 : engager une recherche permettant d’identifier les variables territoriales de recours aux soins sans consentement.
En tout état de cause, les rapporteurs constatent avec regret qu’aucune statistique « brute » portant sur la répartition des admissions en soins sans consentement ne leur a été transmise. Ces données existent mais leur exploitation exige un retraitement difficilement compatible avec le temps imparti pour les travaux des rapporteurs.
Dès lors, il est permis de s’interroger sur la qualité des remontées d’informations. Lors de son audition, le docteur Jean-Luc Roelandt a déploré les difficultés rencontrées dans l’exploitation des données statistiques portant sur l’admission sur décision du représentant de l’État. Les rapporteurs ont été stupéfaits d’apprendre que, faute de fiabilité des données permettant d’assurer le suivi de leur étude, les chercheurs avaient entrepris de collecter les informations auprès de chaque registre prévu par l’article L. 3212-11 du code de la santé publique.
Lors de leur visite au centre hospitalier Sainte-Anne, un exemplaire des registres de la loi a été présenté aux rapporteurs. Outre le caractère volumineux de l’ouvrage rendant difficiles sa manipulation et son stockage, le renseignement du registre, par l’apposition successive des différentes étapes de la prise en charge, mobilise un temps précieux (cf. Annexe 1). Le passage à un registre dématérialisé fait d’autant plus sens lorsque l’on sait que toutes les informations sont déjà consultables par la voie dématérialisée. À l’hôpital Sainte-Anne, les pièces du dossier font ainsi l’objet d’une transmission cryptée au juge des libertés et de la détention, du moins s’agissant des cas d’hospitalisation complète.
À cet égard, les rapporteurs ne peuvent que regretter l’absence de transmission du rapport prévu par l’article 9 de la loi de septembre 2013. Ce document, aujourd’hui en cours d’élaboration, leur aurait permis d’évaluer de manière totalement éclairée les conditions de la tenue des registres ainsi que le cadre de la remontée d’informations, au besoin par la voie dématérialisée . Il y a là à la fois un gisement de productivité, une source d’économies et une possibilité d’améliorer l’accès aux informations relatives aux soins sans consentement. On ne comprend donc pas les raisons pour lesquelles ce rapport qui devrait être déposé depuis deux ans ne l’est toujours pas (27).
Article 9 de la loi ° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre prévu à l’article L. 3212-11 du code de la santé publique, examinant sa faisabilité technique et détaillant les modalités de consultation et de recueil des observations des autorités chargées du contrôle des établissements de santé accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement susceptibles d’être mises en œuvre ainsi que les adaptations législatives ou réglementaires qu’elle rendrait nécessaires ».
Recommandation n° 2 : transmettre sans délai le rapport prévu par l’article 9 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013
Enfin, les rapporteurs ont été sensibilisés à plusieurs reprises sur le manque de fiabilité des informations portées dans les systèmes d’information hospitaliers. Deux problèmes ont été soulevés.
Plusieurs systèmes d’information coexistent et les données ne sont pas souvent concordantes. Un temps de retraitement est ainsi nécessaire pour parvenir à l’information la plus pertinente possible.
Cette première difficulté découle aussi de la saisie des informations. Par manque de temps, par désintérêt ou par facilité, les données ne sont pas suffisamment précises pour qu’une information pertinente soit dégagée. Dans le cas particulier du recueil d’information spécialisé en psychiatrie (RIM-P), il est apparu que tous les modes légaux de soins sont renseignés comme « soins libres ». Parfois, les séquences de prise en charge pour un même patient font apparaître des incohérences. Bref, il nécessite pour l’analyse un fastidieux travail de reprise. Pour son étude portant sur le devenir des personnes admises à la demande du représentant de l’État, le Dr Jean-Luc Roelandt a indiqué que 80 % des lignes de données avaient dû être corrigées tandis que 7,6 % des données n’étaient pas exploitables.
Les recueils de données dans le cadre des soins sans consentement
Le recueil d’information spécialisé en psychiatrie (RIM-P) : équivalent du programme de médicalisation des systèmes d’information en médecine, chirurgie, obstétrique (PMSI MCO), le RIM-P est une base de données médico-administratives appliquée aux activités de psychiatrie. Elle est produite annuellement par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) à partir des informations remontées par chaque établissement de santé.
La statistique annuelle des établissements (SAE) est une enquête administrative obligatoire auprès des établissements de santé. Les données sont collectées par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
Au niveau régional, un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé Hopsy a été institué. Il a pour objet le suivi des personnes faisant l’objet des soins sans consentement. Il répertorie les certificats et décisions relatifs à la demande d’un tiers ou pour péril imminent. Les données ne sont toutefois conservées que pour une période d’un an, ce qui complique la mise en place de séries statistiques pluriannuelles.
Les établissements tiennent enfin des registres sur lesquels sont transcrites les informations relatives aux patients (identité, dates d’admission, avis et certificats médicaux).
Les rapporteurs restent conscients du caractère parfois chronophage de saisie des données. Cela étant, ces informations n’en restent pas moins importantes pour l’organisation des soins. Ils attachent une attention particulière à ce que des efforts soient engagés sur cet aspect qui relève des bonnes pratiques. Le levier de la certification pourrait être davantage mobilisé. Certains ont fait l’hypothèse que les statistiques ne seraient correctement établies que quand elles seraient utilisées pour le financement des services et établissements psychiatriques. Lors de son audition, la direction générale de l’offre de soins a indiqué aux rapporteurs que la question de la modulation du financement des activités de psychiatrie en fonction de la qualité des données saisies est aujourd’hui à l’étude. Ces informations sont cependant d’ores et déjà nécessaires à la bonne définition et conduite des politiques publiques en matière de santé mentale.
La certification des établissements de santé et la qualité des données de santé
L’ensemble des visites de certification des établissements de santé, a fortiori de santé mentale, inclut un audit de processus du dossier patient. L’investigation des experts-visiteurs vise à évaluer l’organisation mise en place par l’établissement pour permettre la traçabilité des actions menées dans le cadre de la prise en charge.
Par ailleurs, durant les visites, les experts-visiteurs peuvent mobiliser la méthode du patient-traceur qui permet de suivre l’intégralité du parcours du patient au sein de l’établissement. Cette méthode utilise le dossier du patient choisi comme patient-traceur. Elle permet de s’assurer que les données sont tracées et fiables.
Enfin, les experts-visiteurs peuvent également mobiliser la valeur de l’indicateur national « Tenue du dossier patient », qui évalue la saisie et la fiabilité des données.
Source : Haute Autorité de santé.
B. UNE AUGMENTATION SENSIBLE DES PATIENTS SOUS CONTRAINTE
Les données transmises aux rapporteurs, corroborées par les auditions, témoignent d’une augmentation significative du nombre de personnes faisant l’objet de soins sans consentement. Le ministère des affaires sociales et de la santé a ainsi indiqué aux rapporteurs qu’entre 2012 et 2015, « le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement a augmenté plus que la file active totale des personnes suivies en psychiatrie ». Les dernières études statistiques, publiées en janvier 2015, et portant sur les premiers résultats de la mise en œuvre de la réforme de juillet 2011, n’ont pas permis d’évaluer ce décrochage qui semble résulter des effets du développement des programmes de soins.
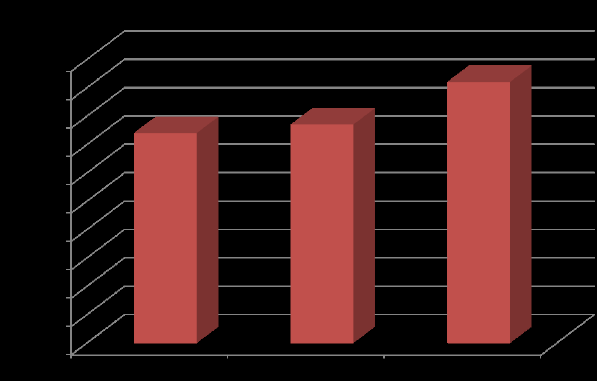
(*) Ces chiffres n’incluent pas deux départements non répondant.
(**) Donnée présentée en audition. Le chiffre concerne tous les departements. À périmètre comparable, le nombre de patients suivis est de 91 151.
1. Les soins sans consentement couvrent un large panel de prise en charge
a. Une variété de prises en charge
La loi du 5 juillet 2011 a considérablement remanié le régime des soins psychiatriques sous contrainte. Auparavant appréhendés sous la seule forme de l’hospitalisation complète – la fameuse hospitalisation d’office –, les soins sans consentement couvrent aujourd’hui une variété de modes de prise en charge.
Rappelons que l’admission débute par la mise en place d’une période initiale d’observation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète d’une durée maximale de soixante-douze heures. Durant cette période, l’avis et le consentement du patient doivent être recherchés afin de l’associer aux soins qui lui sont prodigués. Du reste, les professionnels de santé, psychiatres au premier chef, réaffirment continuer à susciter ce consentement lorsque l’état de santé de leur patient le permet.
La levée de la mesure de contrainte peut intervenir au cours de la période d’observation ou à la fin de celle-ci. La loi exige la production de deux certificats médicaux respectivement dans les vingt-quatre heures suivant l’admission et dans les soixante-douze heures, soit à l’issue de la période d’observation. Si l’un ou l’autre de ces documents infirme la nécessité d’une contrainte de soins, la levée de la mesure est décidée.
Lorsque les deux certificats médicaux concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le certificat établi à l’issue de la période d’observation indique la forme de la prise en charge : l’hospitalisation complète en établissement psychiatrique (surveillance constante) ou toute autre forme de prise en charge assortie à un programme de soins (surveillance régulière).
S’agissant d’une admission à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil a compétence liée pour prononcer le maintien des soins et pour retenir la forme de prise en charge proposée par le psychiatre ainsi que le protocole de soins établi par lui. S’agissant d’une procédure d’admission sur décision du représentant de l’État, le préfet décide de la forme de prise en charge de la personne « en tenant compte » non seulement de la proposition établie par le psychiatre, mais aussi « des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public ».
L’hospitalisation complète, comme le rappelle l’étude d’impact jointe à la loi de juillet 2011, a vocation à « dispenser des soins intensifs adaptés aux situations aiguës nécessitant une prise en charge continue ».
Les formes de prise en charge autres que l’hospitalisation complète ont été précisées par l’article 1er de la loi du 27 septembre 2013. La liste reste inchangée par rapport au dispositif de 2011 mais il est précisé que la prise en charge peut être effectuée dans le cadre d’une « hospitalisation à domicile (HAD), des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet ». Dans ce cadre, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Il « définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation ».
La loi de septembre 2013 ayant procédé à quelques modifications, il était nécessaire de réviser la partie réglementaire du code de la santé publique. Le décret du 1er février 2016 (28) procède à ces actualisations.
b. Un dispositif dont le principe est encore contesté
La mise en place de soins sans consentement en lieu et place de l’hospitalisation complète constitue une évolution majeure dans la prise en charge psychiatrique. Cette réforme est globalement acceptée par les différentes parties prenantes (patients, professionnels médicaux, professionnels de la justice), même si des « poches de résistance » subsistent.
● Pour certains des représentants des usagers, la privation de la liberté doit constituer le critère majeur du contrôle des mesures opérées sur les patients qu’il s’agisse de l’hospitalisation complète ou de la prise en charge en ambulatoire sous la forme des programmes de soins.
Advocacy France s’insurge ainsi contre la confusion existante entre la décision de privation de liberté et la décision de soins psychiatriques.
Opposée à la privation de liberté décidée en raison de l’état de santé d’une personne, l’association estime que le régime des soins sans consentement est discriminatoire. La contrainte et la privation de liberté ne devraient, selon elle, exister qu’en réponse à une situation d’urgence. De façon générale, la privation de liberté, justifiée par la situation d’urgence, doit faire l’objet d’un contrôle systématique du juge.
Cette position de principe emporte deux conséquences.
Comme pour tout patient, les personnes souffrant de troubles mentaux ne devraient pas faire l’objet de contraintes mais être accompagnées dans la réappropriation de leur capacité. Ni la contrainte ni la privation de liberté ne peuvent permettre d’arriver à cet objectif.
De façon plus spécifique, la prise en charge en ambulatoire, ne répond pas à cette situation d’urgence pour Advocacy France. Elle doit être abrogée en ce qu’elle procède d’une logique sécuritaire plus que de soins.
Pour les rapporteurs, la contrainte dans le cadre de l’hospitalisation complète comme le programme de soins, dans le cadre ambulatoire, découlent du principe de la protection de la santé, d’essence constitutionnelle.
Il est certain que la règle du consentement tend à s’étendre dans le champ de la santé comme aussi dans la sphère médico-sociale. Ce principe ne peut cependant s’appliquer aux soins sans consentement quand les troubles psychiatriques empêchent les personnes concernées d’avoir pleinement conscience de leur état de santé. La loi permet alors de porter une atteinte nécessaire et proportionnée à la liberté individuelle sur avis médical puis psychiatrique. En tout état de cause, le caractère contraignant de soins ne fait pas perdre de vue l’objectif d’alliance thérapeutique. « Le plancher de Jeannot », exposé à proximité de l’hôpital Sainte Anne et de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, témoigne de la nécessité de protéger le patient, y compris contre lui-même.
Le plancher de Jeannot
Le plancher de Jeannot Grand est un morceau de parquet d’environ 15 m2, récupéré par le Dr Guy Roux dans une ferme d’un paysan béarnais en 1993. Il a été gravé par un jeune paysan, Jeannot, qui « ne fut jamais soigné et [qui] sombra dans la déchéance et l’isolement avant de mourir à 33 ans ».
Ce plancher est gravé et rend compte de propos désorganisés, traduisant « un vécu de persécution et d’intrusion ». Son exposition à la vue de tous, rue Cabanis dans le 14ème arrondissement de Paris, rappelle à tous que les maladies mentales ne sont pas honteuses et doivent faire l’objet d’une attention bienveillante et protectrice.
Source : Dr Nathalie Giloux, « Le plancher de Jeannot », École nationale de la magistrature, février 2016
D’autres associations, qu’elles acceptent ou pas le principe des soins sans consentement, travaillent à l’extension de leur contrôle judiciaire. Tel est le cas du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), dont les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont conduit à l’instauration d’un contrôle judiciaire systématique.
S’agissant des programmes de soins, le législateur n’a prévu aucun contrôle systématique du juge en tant qu’ils ne constituent pas, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une mesure privative de liberté individuelle, au sens de l’article 66 de la Constitution, à la différence de l’hospitalisation complète (cf. II).
Dans le cadre d’un recours contentieux porté devant le Conseil d’État, le CRPA a ainsi soulevé la question de l’absence de contrôle systématique judiciaire en cas de « possibilité de séjours forcés dans un établissement psychiatrique dans le cadre de l’obligation de soins ambulatoires » (29). Cette question a été renvoyée au Conseil constitutionnel qui s’est prononcé sur les différences de garantie entre l’hospitalisation complète et les autres formes de prise en charge (30).
Le Conseil constitutionnel a conclu au caractère constitutionnel des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique portant définition du programme de soins. Si l’obligation de soins constitue une restriction apportée à la liberté personnelle, elle ne constitue pas une privation de la liberté individuelle. Le législateur était ainsi fondé à prévoir des garanties distinctes. Le Conseil juge que si le régime des soins psychiatriques ambulatoires permet une obligation de soins, il n’autorise en aucune manière l’administration forcée de soins. Du reste, s’il est constaté que la personne refuse de suivre le traitement, de se rendre ou de demeurer dans l’établissement, un passage en hospitalisation complète est toujours possible, permettant l’administration de soins contraints. Aux termes de l’article R. 3211-1 du même code, l’hospitalisation complète peut intervenir « notamment en cas d’une inobservance de ce programme susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé ». Dans ce dernier cas, la protection du juge trouve à nouveau à s’exercer. La Cour de cassation a rappelé ce cadre légal dans un arrêt en date du 10 février 2016 (31).
Le Conseil constitutionnel a également rappelé à cette occasion que l’avis du patient est préalablement requis à la définition et à la modification du programme à l’occasion d’un entretien. Si le programme de soins comporte des séjours en établissement, cette obligation ne s’effectue pas sous la contrainte, pas plus que l’administration des soins ambulatoires n’est menée de manière coercitive.
Enfin, il n’a pas jugé l’atteinte à la liberté individuelle particulièrement déséquilibrée. Pour le Conseil constitutionnel, le législateur a opéré une conciliation entre la protection de la santé et la protection de l’ordre public, d’une part et la liberté personnelle, d’autre part.
● La contestation du nouveau régime de soins est aussi portée par des psychiatres.
Elle fait notamment suite au refus de principe du virage sécuritaire, inauguré par le discours d’Antony de décembre 2008, et transcrit par la loi de juillet 2011 dont la logique n’aurait pas été fondamentalement modifiée par la loi de septembre 2013.
Pour les psychiatres concernés, les programmes de soins se révèlent aussi contreproductifs soit parce qu’ils n’emportent aucun effet quand les patients en refusent le principe, soit parce qu’il est proprement inutile d’entraver davantage le patient lorsque son état de santé est stabilisé. Il apparaît plus efficace d’accompagner le patient à l’occasion de soins libres.
Cela étant, la loi du 5 juillet 2011 n’est pas réductible à la traduction législative du discours d’Antony. Elle a modifié le régime des soins sans consentement en étendant l’éventail des prises en charge des patients, qui n’est plus circonscrit à la seule hospitalisation complète. Le législateur, sous contrainte du juge constitutionnel, a par ailleurs modéré la logique sécuritaire en introduisant un contrôle du juge judiciaire propre à empêcher toute atteinte à la liberté individuelle autre que strictement nécessaire.
Il semble ainsi à vos rapporteurs que le nouveau régime est trop récent pour être définitivement jugé et qu’il faut lui laisser subir l’épreuve du temps.
2. Une augmentation du nombre de patients suivis due à un « effet stock »
Les premières remontées d’information font état d’une augmentation significative des patients faisant l’objet de soins sans consentement. Celle-ci est principalement due à un « effet stock » des patients dont la prise en charge au titre des programmes de soins excède une année.
a. Une part relativement significative des patients suivis dans le cadre ambulatoire
En 2015, on estime à près de 37 000 le nombre personnes ayant fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre ambulatoire, soit 40 % du nombre total de personnes en soins sans consentement. Ce chiffre a été établi après un considérable travail de retraitement des informations, les données saisies dans le RIM-P ne permettant pas d’identifier les programmes de soins. Le recours aux programmes de soins est déduit d’après le repérage d’au moins « deux actes ambulatoires ou une séquence d’hospitalisation partielle non libre dans l’année […] » (32).
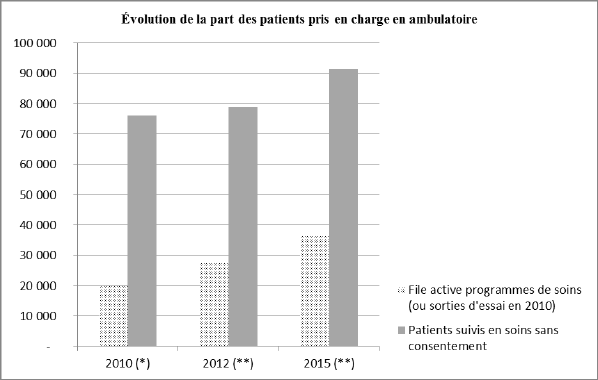
(*) Avant 2011, il s’agit des sorties d’essai de longue durée (IRDES, Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015)
(**) Donnée présentée en audition.
b. Une prise en charge intensive des patients présentant des troubles sévères
Cette augmentation significative met en lumière l’accès élargi des patients à une gamme de soins plus variée que l’hospitalisation complète ne peut à elle seule offrir. Le profil des patients pris en charge en ambulatoire présente à cet égard plusieurs caractéristiques notables.
Selon les informations délivrées aux rapporteurs, le profil des personnes ayant accès aux programmes de soins se caractérise par la prévalence de troubles psychiatriques sévères. Ainsi, plus de 60 % des personnes suivant un programme de soins souffrent de troubles psychotiques. Selon Mme Magali Coldefy, cette donnée confirme par ailleurs les conclusions de la littérature scientifique internationale. Les soins en ambulatoire permettent d’adapter l’éventail de soins à l’évolution des pathologies tout en autorisant la « désinstitutionnalisation […] des soins psychiatriques » (33). Les programmes de soins procèdent aussi d’une volonté d’apporter un cadre légal à des pratiques en marge du régime d’hospitalisation complète. À certains égards, le programme de soins est le nouvel avatar des sorties d’essai de longue durée (34). Aujourd’hui les programmes de soins s’inscrivent dans cette intention en offrant une large palette de modalités de soins, telles que des consultations médicales, des suivis de situation sociale ou des suivis à domicile.
Les sorties d’essai
Les sorties d’essai visent avant tout à aménager la prise en charge des patients hospitalisés et à favoriser leur réintégration progressive hors les murs de l’établissement de santé. Cet objectif n’est d’ailleurs pas incompatible avec l’institutionnalisation des programmes de soins. C’est la raison pour laquelle le législateur a souhaité réintroduire en 2013 les sorties d’essai de courte durée.
La loi du 27 septembre 2013 a en effet réintroduit le principe des sorties d’essai, en rétablissant des sorties de courte durée non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures afin de favoriser notamment la guérison des patients, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale.
Ces sorties sont accordées, selon les cas, par le directeur ou par le représentant de l’État, étant précisé qu’en cas de soins sur demande d’un tiers, le directeur doit informer le tiers de l’autorisation de sortie qu’il a accordée au patient et de la durée de celle-ci. S’agissant des patients admis sur demande du représentant de l’État, ce dernier peut expressément s’opposer à la sortie dont le projet lui a été soumis au moins quarante-huit heures à l’avance. Il faut relever que l’information du patient et a fortiori la notification de la décision préfectorale ne sont, en l’état pas prévues, de sorte que la personne n’est pas mise à même d’exercer un recours, quelle que soit sa nature.
Parallèlement, les dernières données mesurables confirment le caractère très intensif du suivi des patients dans le cadre ambulatoire déjà observés au moment de la remontée des premiers résultats de la mise en place de la loi du 5 juillet 2011.
S’agissant du nombre d’actes moyens par patient, il était constaté un passage de 10 à 12 actes entre 2010 et 2012. Cette intensité se vérifie dans les années suivantes qu’il s’agisse du nombre d’actes ou de journées de prises en charge dans l’année.
Paradoxalement, l’intensité de la prise en charge est aussi mesurée par l’augmentation importante des épisodes d’hospitalisation à rebours des hypothèses initialement formulées. La prise en charge dans le cadre ambulatoire aurait dû correspondre à une diminution des épisodes d’hospitalisation. Or, on constate au contraire une augmentation de la durée moyenne d’hospitalisation pour les patients faisant l’objet d’un suivi ambulatoire dans le cadre des soins sans consentement : en 2012, celle-ci s’élevait à 64 jours contre 42 jours pour les autres patients en soins sans consentement et 53 jours pour la file active totale (35). En 2015, selon les résultats de l’étude présentée par Mme Magali Coldefy, les durées moyennes, en léger retrait, confirment ces observations : respectivement 61, 45 et 50 jours.
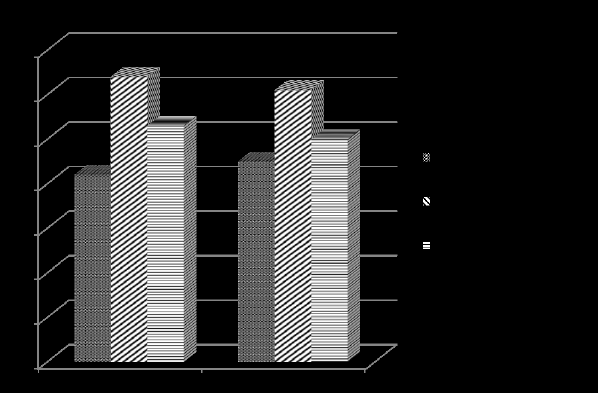
Sources : Enquête de l’IRDES et données présentées en audition.
Ces derniers chiffres nécessitent cependant d’être appréhendés avec une certaine précaution. En effet, la durée moyenne d’hospitalisation pour les patients en programmes de soins recouvre une réalité plurielle. Ces derniers connaissent des épisodes d’hospitalisation répétés au cours de l’année contrairement au « groupe majoritaire uniquement hospitalisés à taux plein, souvent hospitalisés une seule fois dans l’année » (36). Or, le logiciel de saisie de données (RIM-P) ne permet pas de distinguer entre les formes d’hospitalisation. En effet, ces épisodes peuvent faire partie d’une stratégie de soins – on parlera d’hospitalisation séquentielle – mais peuvent aussi inclure des « ré-hospitalisations » dues à une rechute ou une non-observance du programme de soins. Le recueil de données mériterait ainsi d’être affiné, impliquant de facto une évolution du RIM-P : il importe en effet de déterminer si la ré-hospitalisation résulte d’une stratégie délibérée de parcours de soins ou bien d’un échec du programme de soins.
Enfin, les programmes de soins sont plus fréquemment utilisés dans le cadre du régime d’admission à la demande du représentant de l’État que dans le mode légal d’admission à la demande d’un tiers (53 % contre 40 % en 2015) (37). Cette différence mériterait d’être creusée plus avant puisque le cadre juridique des programmes de soins ne diffère aucunement entre les deux régimes d’admission.
c. Une efficacité qui reste à établir
À la lumière de ces éléments, il apparaît que le recours aux programmes de soins, s’il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée n’est pas pour autant dépourvu de contrainte en serait-ce que celle que constitue la menace d’une hospitalisation complète sous contrainte. Cette situation revêt un évident enjeu éthique pour le législateur comme pour le personnel soignant dès lors qu’est formulé le constat de l’augmentation tant de la durée du programme de soins que de la durée moyenne d’hospitalisation.
Assiste-t-on à un allongement de la durée d’une certaine forme de contrainte ? Cette interrogation ne saurait être écartée et mériterait d’être davantage analysée. En effet, c’est toute la question de l’efficacité du programme de soins qui est posée. La littérature internationale existante est plutôt contradictoire en la matière. Un récent programme d’études dirigé par M. Tom Burns au nom de l’Oxford Mental Health Coercion (OCTET) a ainsi conclu à l’absence de preuves d’efficacité des suivis en dehors de l’hôpital tant en termes de coûts que d’amélioration de la prise en charge des patients (38). À l’inverse, d’autres études mettent notamment en lumière la possibilité, via les programmes de soins, de davantage susciter l’adhésion des patients (39) ou le fait qu’il s’agit de mesures moins restrictives que l’hospitalisation (40).
Au vu de ces éléments, les rapporteurs demeurent convaincus qu’il faut davantage documenter la mise en œuvre des programmes de soins en France. Cette initiative est toutefois subordonnée à l’identification de ces programmes dans les logiciels hospitaliers, particulièrement le RIM-P. Elle pourrait aussi s’appuyer sur le concours des commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP) qui sont plus particulièrement chargées de suivre la situation des personnes pour lesquelles les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an (cf. 2 du C du présent I). Ces structures pourraient plus particulièrement faire porter leur effort sur le suivi des programmes de soins dont la durée excède une année.
d. Une incidence à relativiser
L’incidence du recours aux programmes de soins dans l’augmentation de la file active des patients suivis en soins sans consentement mériterait d’être nuancée. De fait, plusieurs données doivent inciter à une certaine prudence.
En effet, après une phase de progression rapide, qui témoigne de la généralisation du nouveau dispositif, il semble que l’on assiste à une stabilisation du nombre de personnes nouvellement prises en charge dans ce cadre. Si la file active des patients en programme de soins progresse, l’augmentation est, en valeur absolue, plus modérée que celle constatée pour l’ensemble des personnes suivies en soins sans consentement.
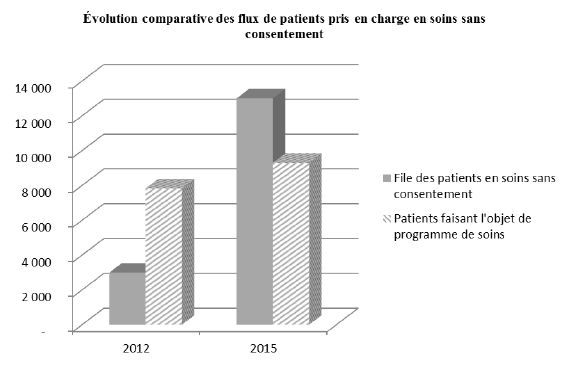
Sources : Enquête de l’IRDES et données présentées en audition.
Ce constat est corroboré aussi bien par le ministère des affaires sociales et de la santé que par l’étude menée par l’IRDES. Dans sa réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs, le ministère des affaires sociales et de la santé souligne ainsi que « la mise en place des programmes de soins et leur développement ne sauraient expliquer à eux-seuls l’augmentation du nombre de personnes en soins sans consentement, même si la prolongation de la prise en charge après la période d’hospitalisation y contribue ». Lors de son audition par les rapporteurs, Mme Magali Coldefy a également insisté sur l’augmentation plus conséquente du nombre de patients admis en hospitalisation complète que de la patientèle suivie dans le cadre ambulatoire. Elle a notamment fait état d’une hausse de 13 % par rapport à 2012.
Des études plus poussées doivent sans conteste être engagées tant les résultats contrastent avec les premières données publiées en janvier 2015. Il était alors observé un recul des prises en charges non consenties pour les patients ayant à un moment de leur parcours eu besoin d’être suivis sans leur consentement au bénéfice d’une progression des suivis dans le cadre ambulatoire (41). En définitive, ces constats plaident encore en faveur d’une meilleure traçabilité des programmes de soins dans les systèmes d’information hospitalière.
La progression limitée du recours aux programmes de soins doit aussi être appréhendée à la lumière des variations territoriales observées. Déjà en 2015, les premiers résultats témoignaient d’une certaine diversité. « Dans les départements de l’Aude, de la Haute-Corse, de l’Eure, des Landes, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire, moins de 10 % des patients pris en charge sans leur consentement ont été intégrés dans un programme de soins. À l’inverse, dans l’Ain, la Manche, la Mayenne, la Meuse, l’Oise et les Hautes-Pyrénées, plus de 60 % des patients ont eu accès à ce type de programme » (42).
La décision du Conseil constitutionnel, au terme de laquelle les soins sans consentement dans le cadre ambulatoire ne sauraient être prodigués de force, a peut-être rendu plus difficile la mise en œuvre des programmes de soins.
Pour le moment, les rapporteurs en sont réduits à émettre des hypothèses sur la base de remontées d’informations isolées à partir desquelles il serait hasardeux de déduire des conclusions générales (influence des consignes adressées par le psychiatre chef de service ou explication selon le profil des pathologies constatées dans le territoire).
Une étude portant sur les 148 secteurs psychiatriques de la région Île-de-France rend compte de cette variation territoriale à un niveau infra-départemental. Globalement, la proportion des soins délivrés dans le cadre des programmes de soins est très modeste au regard de la file active des personnes suivies dans le cadre des soins sans consentement (0,63 %). Cela étant, on y retrouve la confirmation des constats dégagés par Mme Magali Coldefy dans le cadre de son étude pour l’IRDES. Le recours aux soins ambulatoires se caractérise par une « très grande variabilité du nombre de [programmes de soins] avec 5 secteurs qui en ont fait en 2012 plus de 47 […] par secteur, un tiers en ayant fait moins que 5, un tiers plus de 15 par an ». Il est également constaté que les programmes de soins sont utilisés en proportion plus importante dans le cadre des soins à la demande du représentant de l’État (20 %) qu’en SDT (7 %). L’étude relève en outre qu’« aucun des facteurs « organisationnels » de chacun des secteurs n’est lié à la proportion des [programmes de soins] au regard des soins sans consentement ». Le recours aux programmes de soins ne semble donc pas lié à la richesse en équipement ou en personnels mais dépendrait plutôt de « l’engagement des secteurs dans ce type de pratique ». Cette conclusion accrédite ainsi l’idée d’une politique de soins strictement dépendante de l’attitude des professionnels de santé (43).
Au vu de ces éléments, les rapporteurs souhaiteraient faire plusieurs recommandations.
Les programmes de soins « sont mal décrits et mesurés car mal repérés dans les systèmes d’informations » (44). Or, cette information est essentielle pour identifier le recours aux programmes de soins, leur durée ainsi que pour évaluer leur efficacité. Il importerait donc de faire évoluer le RIM-P en ce sens.
Les rapporteurs recommandent ainsi de faire évoluer le RIM-P en vue d’une meilleure traçabilité des programmes de soins en identifiant a minima le début et la fin du programme de soins.
Recommandation n° 3 : identifier dans le cadre du RIM-P le début et la fin d’un programme de soins.
Ce pré-requis permettrait de davantage documenter le recours aux soins ambulatoires en mesurant son efficacité.
Recommandation n° 4 : mettre en place une étude portant sur le recours aux programmes de soins et l’efficacité de cette prise en charge.
Par ailleurs, il serait plus qu’opportun de mener une étude nationale portant sur les facteurs explicatifs des variations territoriales observées dans le recours aux programmes de soins sur un échantillon représentatif des personnes admises en soins sans consentement. Les informations collectées par les commissions départementales de suivi psychiatrique pourraient être mises à profit (cf. 2 du C du présent I) et permettraient de revitaliser des structures dont les travaux sont insuffisamment exploités et mis en valeur.
Recommandation n° 5 : redynamiser les commissions départementales de suivi psychiatrique par :
– le contrôle de la situation des personnes faisant l’objet de programmes de soins d’une durée supérieure à un an ;
– l’exploitation des données statistiques portant sur les programmes de soins.
3. Le cas des unités pour malades difficiles
Les unités pour malades difficiles (UMD) sont des services psychiatriques spécialisés, admettant uniquement des personnes en hospitalisation sans consentement « sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières » (45). Le territoire français abrite dix de ces unités qui accueillaient un peu moins de 1 000 personnes en 2014 (46).
a. Des dispositions légales censurées par le Conseil constitutionnel
En 2011, le législateur avait adopté un régime particulièrement sévère de levée des soins des personnes admises en UMD.
Hospitalisés sur demande du représentant de l’État, les patients concernés ne pouvaient faire l’objet d’une mesure de levée de soins qu’après avis d’un collège de professionnels de santé et deux avis concordants sur l’état mental du patient. Au surplus, l’ordonnance de mainlevée du juge des libertés et de la détention était également soumise à une exigence similaire de recueil de l’avis du collège ainsi que de deux experts.
Saisi après l’adoption de la loi, le Conseil constitutionnel avait estimé que le législateur n’avait pas suffisamment défini les conditions d’entrée dans ce régime alors même que les règles prévues étaient « plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée des soins » (47). Il avait donc censuré les dispositions contestées en laissant au législateur jusqu’au 1er octobre 2013 pour remédier à cette inconstitutionnalité.
b. Le retour à un encadrement réglementaire
La loi de septembre 2013 avait pris acte de cette décision en procédant à l’abrogation du statut légal des UMD. En somme, le législateur est revenu à la situation antérieure à 2011, à savoir un encadrement par la voie réglementaire. Il considérait que les UMD étant un dispositif thérapeutique, aucune conséquence juridique n’avait à être tirée de la durée d’un séjour dans une telle unité.
En application de la loi de septembre 2013, le ministère des affaires sociales et de la santé a procédé à la rédaction d’un texte de mise à jour des dispositions réglementaires rendues obsolètes par la suppression du statut légal ou par l’application de la jurisprudence. Toutefois sa publication a été retardée en raison d’un contentieux porté devant le Conseil d’État relatif aux dispositions réglementaires encadrant les UMD déjà existantes. Ce contentieux était lui-même suspendu à une décision du Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC transmise par la Cour de Cassation (48).
Les auteurs de la QPC considéraient que la prise en charge dans une UMD entraînait « un degré plus rigoureux de privation de la liberté individuelle et des autres libertés constitutionnellement protégées ». Ils en déduisaient la nécessité de prévoir des voies de recours appropriées. Ils prenaient appui d’une part sur un avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relevant que le passage en UMD aggravait sensiblement la contrainte (49), d’autre part sur la décision du Conseil constitutionnel précitée déclarant non constitutionnelles les dispositions législatives relatives aux UMD.
Le Conseil constitutionnel (50) a jugé que le raisonnement tenu dans sa décision antérieure ne pouvait être transposé. Il n’a pas conclu que « le placement en UMD en lui-même était dépourvu de garanties légales qui auraient été nécessaires ». Le Conseil précise qu’il n’avait alors retenu l’insuffisant encadrement des conditions de l’admission « que pour dénier au législateur la capacité de retenir cette admission comme un critère objectif de dangerosité à l’appui d’un régime de rigueur pour la levée des soins ». Le régime de rigueur ayant été supprimé, il convient de regarder le placement en UMD comme « une mesure d’organisation hospitalière affectant un malade dans un service spécialisé » et de conclure que ce placement est soumis aux mêmes garanties que les hospitalisations de droit commun (notamment les droits reconnus par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique et la faculté de saisir le juge des libertés et de la détention).
Sur le fondement de cette décision, le Conseil d’État a rejeté la requête présentée par le CRPA et formulé dans ses considérants des éléments importants pour la rédaction des futures dispositions réglementaires (51) : ineffectivité de l’application du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la procédure d’admission en UMD, information du patient sur son admission et possibilité de faire valoir ses observations, statut de la commission du suivi médical statuant sur le maintien ou non du patient en UMD.
c. Un nouveau texte déjà contesté
En suite de la décision de la juridiction administrative, le Gouvernement a procédé à la publication d’un nouveau décret en février 2016 (52).
Il précise les conditions dans lesquelles les patients peuvent être hospitalisés en UMD et rappelle notamment la nécessité d’une proposition médicale justifiant l’admission afin que les UMD ne soient pas utilisées à d’autres fins que thérapeutiques. Les patients en UMD sont admis en hospitalisation complète sans consentement soit sur décision du représentant de l’État, soit en application de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique pour les personnes détenues soit en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale (irresponsables pénaux). En revanche, il a été indiqué aux rapporteurs que le texte « n’énumère pas de critères d’indication médicale, ces derniers ne relevant pas d’un texte réglementaire mais des bonnes pratiques professionnelles et ne faisant pas consensus entre professionnels ».
Le décret simplifie par ailleurs les modalités d’admission en UMD : insertion de l’accord du psychiatre de l’UMD dans le dossier administratif et médical présenté au préfet et suppression de l’accord du préfet pour la visite préalable du psychiatre de l’UMD dans l’établissement demandant l’admission. Le texte précise que l’arrêté d’admission est pris par le préfet du département où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Le texte prévoit aussi les modalités de sortie de l’UMD. Elle peut être décidée sous forme d’une levée de la mesure de soins sans consentement ou de la poursuite des soins sans consentement, soit dans l’établissement de santé où le patient se trouvait lors de la décision d’admission en UMD, soit dans un autre établissement. L’établissement de santé qui a demandé l’admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité : l’établissement dispose d’un délai de vingt jours pour accueillir le patient. Pour les personnes détenues, ce retour s’effectue en détention ou en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA).
Ce décret fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir formé par le CRPA.
Pour cette association, « les unités pour malades difficiles sont des unités particulières où peuvent s’exercer des protocoles sécuritaires renforcés ». Il n’est, d’après elle, pas de la compétence du pouvoir réglementaire de définir de telles unités ou d’encadrer les droits fondamentaux des personnes aux termes de l’article 34 de la Constitution. Dans sa requête, l’association relève que le transfert dans une unité pour malades difficiles entraîne une restriction des libertés plus importante que dans les services hospitaliers psychiatriques classiques. Selon elle, le nombre limité d’unités ne peut qu’entraîner un « éloignement important de la personne hospitalisée de sa famille, restreignant ainsi son droit d’exercer une vie familiale et privée conformément à l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ».
Le décret violerait par ailleurs les dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, relatif au contrôle effectué par le juge judiciaire. Pour l’association requérante, une personne transférée en UMD sur décision préfectorale devrait pouvoir en contester le bien-fondé dans le cadre d’un contrôle juridictionnel à titre obligatoire ou facultatif. Or, le texte ne mentionne aucune disposition particulière à cet effet, pas plus qu’il ne prévoit de garantie procédurale ni de représentation du patient par un avocat lorsque le dossier du patient est examiné par la commission du suivi médical.
Sans préjuger de la décision qui sera arrêtée, il ne semble pas que les dispositions réglementaires contreviennent à la position du Conseil constitutionnel ou au cadre fixé par le Conseil d’État. S’agissant plus particulièrement de la commission du suivi médical, le décret ne s’écarte pas de la position de principe formulée par la juridiction administrative : elle n’opère qu’un contrôle de la situation du patient en UMD et ne fait que saisir le préfet si les conditions de maintien en UMD ne sont pas remplies. La levée totale de la mesure appartient ensuite au représentant de l’État dans les conditions fixées par la partie législative du code de la santé publique.
La commission du suivi médical
Dans chaque département d’implantation d’une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé pour un mandat de trois ans renouvelable (un médecin représentant l’agence régionale de santé, trois psychiatres hospitaliers n’exerçant pas leur activité dans l’unité pour malades difficiles).
La commission peut s’autosaisir à tout moment de la situation d’un patient hospitalisé dans une UMD, ou être saisie par diverses personnes dont le patient, le psychiatre responsable de l’UMD ou le psychiatre de l’établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge. Enfin, elle examine tous les six mois, le dossier de chaque patient hospitalisé en UMD.
Informée par le psychiatre responsable de l’UMD, la commission, lorsqu’elle estime que le patient ne présente plus un danger, saisit le préfet qui prononce la sortie du patient. Cette sortie peut consister en une levée de la mesure de soins sans consentement ou en une poursuite des soins sans consentement dans un établissement de santé. Ce dernier dispose d’un délai de vingt jours pour organiser l’accueil du patient.
C. LES SOINS SANS CONSENTEMENT CONFRONTÉS À UNE BANALISATION DE L’URGENCE
Le nombre de patients pris en charge en ambulatoire constitue un premier facteur explicatif de la progression des personnes admises en soins sans consentement. Un second facteur a également été mis en lumière avec l’étonnante progression des admissions selon la procédure de soins pour péril imminent (SPI). Ce constat, déjà formulé par l’IRDES à l’occasion des premiers résultats de la mise en place de la loi de juillet 2011, est confirmé par l’exploitation des données du RIM-P concernant les années 2012 et suivantes. Pour les rapporteurs, cette situation mérite un examen approfondi. La célérité, à travers l’allégement des procédures, n’est pas une nouveauté mais semble s’être durablement installée dans le paysage de l’admission en soins sans consentement alors que la nature des procédures d’urgence est par construction exceptionnelle et dérogatoire.
1. Le cadre dérogatoire et exceptionnel de l’urgence
Plusieurs procédures d’admission allégées coexistent. Elles partagent toutes le même point commun : le caractère exceptionnel ou dérogatoire. Dans les résultats qui ont été présentés aux rapporteurs, l’augmentation du recours aux soins pour péril imminent est déterminante. L’utilisation des autres procédures d’urgence est également importante mais pas dans les proportions constatées pour la procédure de péril imminent.
a. Les procédures d’urgence dans le cadre de l’admission sur décision du représentant de l’État
Dans le cadre de l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, l’article L. 3213-2 dispose que le maire ou le commissaire de police à Paris (cf. encadré infra) peut prendre, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, toute mesure provisoire nécessaire à la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète « à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes » et « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes ».
Cette procédure accorde au maire la possibilité d’intervenir en amont de l’admission d’une personne en soins sans consentement. Cette initiative doit par ailleurs être attestée par un avis médical et non par un certificat médical. L’utilisation du terme « avis médical » requiert bien que la personne soit examinée par un médecin. Mais l’avis permet aussi au maire d’agir, alors même que le médecin n’aura pas été en mesure d’examiner la personne souffrant de troubles mentaux. Dans une réponse à une question parlementaire (53), le ministère des affaires sociales et de la santé précise qu’il « s’agit par exemple des cas dans lesquels l’individu se sera retranché dans un lieu inaccessible » ou encore « de cas dans lesquels le médecin aura vu la personne et constaté ses troubles, sans avoir pu l’examiner, en raison de l’agitation de cette dernière ». Dans ces circonstances, les conditions ne sont pas réunies pour rédiger un certificat en bonne et due forme mais l’avis permet d’attester au maire que les conditions sont réunies pour agir. En tout état de cause, la réglementation impose que l’avis, comme le certificat d’ailleurs, doit être précis et motivé (article R. 3213-3 du code de la santé publique). Enfin, si les mesures provisoires doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l’urgence est de nature à exonérer l’administration du respect de cette procédure (54).
Le Conseil constitutionnel a aussi eu l’occasion de se prononcer sur la conformité de cette procédure à la Constitution. Deux garanties entourent le dispositif (danger imminent pour la sûreté des personnes et comportement révélant des troubles mentaux manifestes). Selon le Conseil, « ces hypothèses correspondent à des cas d’urgence particulière et manifeste dans lesquels la décision du maire ou du commissaire peut permettre d’éviter des drames » (55). En conséquence, la possibilité de recourir, dans ces circonstances, à un avis médical ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles qui entourent la protection de la liberté individuelle.
Enfin, notons qu’il ne s’agit que d’une mesure provisoire puisque l’arrêté du maire est pris dans l’attente de la décision du représentant de l’État dans les conditions de droit commun (certificats médicaux). Sa validité est limitée à une durée de 48 heures, à charge pour le maire d’en informer dans les 24 heures le préfet qui peut décider d’admettre la personne concernée en soins sans consentement.
Dans le cas particulier de la Ville de Paris (56), les mesures provisoires échoient au commissaire de police qui peut décider d’envoyer la personne interpellée à l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police (IPPP) pour un examen de santé sur la base d’un avis médical assorti d’une demande d’observation prolongée généralement établis par les services d’urgence de l’Hôtel-Dieu (urgences médico-chirurgicales ou urgences médico-judiciaires). À son arrivée à l’IPPP, le patient est pris en charge par l’équipe médicale pour un examen médical et une observation d’une durée de vingt-quatre heures (57). Durant ce laps de temps, il est examiné par un médecin de garde et fait l’objet d’un nouvel entretien. À l’issue de l’entretien, le patient peut, selon son état de santé, sortir (45 % des cas). Dans les trois quarts de ces situations, il est réentendu par un officier de police judiciaire, la sortie libre ne concernant que le quart restant. Le patient peut aussi faire l’objet d’une admission sur décision du représentant de l’État. En 2016, 491 admissions ont été prononcées, ce chiffre étant en constante diminution depuis 2011 (690) (58). Cette procédure d’admission est facilitée par le faire que les locaux de l’IPPP se trouvent dans le même immeuble que le bureau des actions de santé mentale de la préfecture de police (59) chargé d’établir le projet d’arrêté dont les rapporteurs ont constaté le degré de précision et de motivation (cf. Annexe 2).
ARRÊTÉS D’ADMISSIONS À LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT PRIS PAR LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |
Nombre d’arrêtés pris à la suite d’une conduite à l’IPPP |
690 |
556 |
573 |
581 |
599 |
491 |
Nombre d’arrêtés pris hors conduite à l’IPPP |
93 |
69 |
81 |
68 |
48 |
58 |
Total |
783 |
625 |
654 |
649 |
647 |
549 |
Source : Infirmerie psychiatrique près la préfecture de police de Paris, Bureau des actions de santé mentale de la préfecture de police de Paris
L’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police de Paris
En application de l’article 73 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le Gouvernement était tenu de présenter au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, un rapport sur l’évolution de l’organisation de l’IPPP pour sa mise en conformité avec le régime de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins psychiatriques sans consentement.
L’Assemblée nationale n’ayant pas eu communication de ce rapport dans les délais impartis par la loi, la mission l’a demandé au Gouvernement qui, à défaut de transmettre à l’Assemblée ledit rapport en bonne et due forme, a néanmoins fourni aux rapporteurs un document, transmis au ministère de l’intérieur par la Préfecture de police en juin 2016, intitulé « Éléments pour le rapport au Parlement relatif à l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police de Paris ». L’IPPP n’est pas un établissement autorisé en psychiatrie au sens du code de la santé publique (60).
Ce service fonctionne auprès de la préfecture de police suivant l’arrêté du 12 Messidor An VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris. Ce texte dispose que le préfet de police est chargé d’empêcher « qu’on laisse vaguer des furieux, des insensés, […] ».
L’IPPP est une structure d’observation, d’orientation, accueillant temporairement les personnes qui y sont conduites sur le fondement des mesures de police municipale provisoires pour une évaluation psychiatrique d’urgence. L’unité fonctionne en permanence et peut accueillir jusqu’à seize personnes simultanément. Sa direction médicale est assurée par un médecin-chef, assisté d’un médecin-chef adjoint, tous les deux psychiatres. L’équipe médicale est par ailleurs composée de quatre internes (trois spécialisés en psychiatrie et un interne spécialisé en médecine légale), d’une équipe de médecins de garde et de cinq médecins seniors titulaires, tous vacataires (61). Une permanence est assurée en continu par un médecin certificateur afin de s’entretenir avec les patients reçus. Le personnel de l’IPPP est par ailleurs composé de cadres de santé, d’infirmiers, de personnels surveillants chargés d’assurer la sécurité ainsi que d’un régisseur.
L’IPPP a reçu 1 800 personnes en 2016, parmi lesquelles un tiers de personnes en état de grande précarité. Les patients lui sont adressés par un commissaire de police qui s’appuie soit sur un avis médical d’un service d’urgence hospitalier (SAU), soit sur un certificat médical des urgences médico-judiciaires (UMJ) établi à l’occasion des cas de gardes à vues.
À leur arrivée, les personnes font l’objet d’un examen somatique, prennent une douche et sont placées en chambre de sûreté dépourvue de sanitaires. Ils sont accompagnés par deux personnes pendant la totalité de leurs déplacements dans l’infirmerie. Après leur admission, l’état de santé mentale des personnes accueillies à l’infirmerie psychiatrique est évaluée par l’équipe médicale. Le cas échéant, il peut être proposé de prononcer une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SPDRE) (62). En 2016, 491 arrêtés d’admission en SPDRE ont été prononcés à la sortie de l’infirmerie psychiatrique.
Enfin, l’IPPP a formalisé sa coopération avec le centre psychiatrique d’orientation et d’accueil (CPOA) du centre hospitalier Sainte-Anne dans le cadre d’une convention signée le 17 juillet 2015 avec l’AP-HP.
En dépit de leurs demandes, les rapporteurs n’ont obtenu aucune statistique nationale portant sur le recours aux mesures provisoires, leur répartition territoriale ou leur sort après intervention préfectorale (63). Quelques données leur ont néanmoins été présentées, témoignant d’une très grande variation territoriale du recours aux mesures provisoires. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), le recours aux soins à la demande du représentant de l’État (SDRE) ayant pour origine une mesure provisoire varie ainsi de 7 % à 57 % selon les départements.
Cette insuffisance statistique interroge plus généralement sur le circuit de remontée des informations. Elle interdit de tirer des conclusions sur les mesures provisoires. Ces éléments sont pourtant importants puisqu’ils conditionnent la réponse qu’il convient d’apporter aux patients, à leurs familles et aux édiles, qui se trouvent être bien souvent les premiers décisionnaires en raison de leur mandat de proximité.
Recommandation n° 6 : disposer des statistiques relatives aux mesures provisoires afin, le cas échéant, de définir une doctrine de leur emploi.
b. Les procédures allégées dans le cadre de l’admission à la demande du tiers
Deux procédures allégées sont prévues par le code de la santé publique dans le cadre de l’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers : la procédure d’urgence et la procédure dite de « soins pour péril imminent » (SPI).
● Le droit commun d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers impose la production de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant d’une part, de l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement, d’autre part, de la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale prenant la forme d’une hospitalisation complète ou d’une prise en charge ambulatoire. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Le second certificat est établi par un autre médecin qui, lui, peut exercer dans l’établissement d’accueil. Dans les deux cas, les médecins ne doivent avoir aucun lien de parenté ni entre eux, ni avec le directeur de l’établissement, ni avec le tiers demandeur et ni avec le patient. Enfin, les deux certificats médicaux établis par la suite durant la période d’observation sont, quant à eux, établis par un troisième médecin, psychiatre de l’établissement d’accueil. Dans cette procédure, quatre certificats médicaux sont donc établis par au moins trois certificateurs distincts.
ADMISSION SUR DEMANDE D’UN TIERS : PROCÉDURE DE DROIT COMMUN
Certificat médical 1 Docteur en médecine « A » extérieur à l’établissement d’accueil |
Décision d’admission |
Certificat médical 24 h Psychiatre « C » de l’établissement d’accueil |
Certificat médical 72 h Psychiatre « C » de l’établissement d’accueil |
Certificat médical 2 Docteur en médecine « B » qui peut appartenir à l’établissement d’accueil |
→ Au moins 3 certificateurs différents
Source : « Psychiatrie : Guide des soins sans consentement », Centre hospitalier Sainte Anne, ADESM, SHAM, décembre 2013
Dans le cas de la procédure d’urgence, prévue par l’article L. 3213-3 du code de la santé publique, un seul certificat médical est exigé à l’admission. Cette procédure « exceptionnelle » est motivée par le « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ». Enfin, le certificat médical peut être produit par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. Si tel est le cas, il importe que les deux certificats médicaux ultérieurement exigés pendant la période d’observation soient établis par deux psychiatres distincts alors que le droit commun permet de ne recourir qu’à un seul certificateur. En résumé, la procédure d’urgence se traduit par la production de trois certificats médicaux distincts émis par trois médecins distincts. Au surplus, cette procédure fait toujours intervenir un tiers qui agit dans l’intérêt du malade.
ADMISSION SUR DEMANDE D’UN TIERS : PROCÉDURE D’URGENCE
Certificat médical –urgence Docteur en médecine « A » de l’établissement d’accueil |
Décision d’admission |
Certificat médical 24 h Psychiatre « B » de l’établissement d’accueil |
Certificat médical 72 h Psychiatre « C » de l’établissement d’accueil |
→ 3 certificateurs différents
Source : « Psychiatrie : Guide des soins sans consentement », Centre hospitalier Sainte Anne, ADESM, SHAM, décembre 2013
Malheureusement, et malgré leurs demandes, les rapporteurs regrettent de n’avoir reçu aucune statistique relative à l’emploi de cette procédure. Les seuls éléments portés à la connaissance des rapporteurs témoignent d’une variation du recours à cette procédure d’urgence. Lors de son audition par la mission, Mme Nathalie Borgne, représentant la Conférence des directeurs généraux de CHU, a indiqué l’importance du taux de recours aux admissions sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, cette situation tenant à l’absence de possibilité de solliciter un deuxième certificateur faute de médecin disponible en établissement ou en ambulatoire. Mme Magali Coldefy a, quant à elle, souligné qu’en région PACA le taux de recours concerne de 56 % à 99 % des admissions à la demande des tiers selon les départements. Ces quelques résultats, bien que significatifs, ne permettent pas de tirer des enseignements généraux en l’absence de données comparatives et, surtout, faute de recul sur la durée de la mesure de soins sans consentement.
Recommandation n° 7 : enquêter sur les conditions du recours à la procédure d’urgence à la demande du tiers.
● Dans le cadre de l’admission en SPI, les modalités sont encore plus allégées. Un seul certificat est émis par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et qui ne peut être parent ou allié ni du médecin ni du directeur d’établissement. Si l’on inclut les deux certificats émis par des médecins distincts durant la période d’observation, ce dispositif fait aussi intervenir trois médecins différents pour trois certificats.
ADMISSION EN PÉRIL IMMINENT
Certificat médical péril imminent Docteur en médecine « A » extérieur à l’établissement d’accueil |
Décision d’admission |
Certificat médical 24 h Psychiatre « B » de l’établissement d’accueil |
Certificat médical 72 h Psychiatre « C » de l’établissement d’accueil |
→ 3 certificateurs différents
Source : « Psychiatrie : Guide des soins sans consentement », Centre hospitalier Sainte Anne, ADESM, SHAM, décembre 2013
Surtout, la procédure ne peut être mise en œuvre qu’après avoir vainement recherché un tiers demandeur, ce qui vaut à cette procédure d’être présentée comme une « demande de tiers sans tiers ». Cela étant, le texte prévoit que le directeur d’établissement informe dans un délai de vingt-quatre heures la famille du patient ou toute personne justifiant de relations avec la personne antérieures à l’admission.
Dans l’esprit du législateur, cette procédure reste dérogatoire et n’a été prévue pour que pour permettre la prise en charge des personnes socialement isolées. En outre, il doit être rappelé que « les conditions d’admission des patients ont ensuite des répercussions non négligeables sur la mise en œuvre des soins. Le tiers joue en effet pour les psychiatres un rôle important tout au long du processus de soins et n’est pas seulement à l’initiative de celui-ci » (64).
Or, tout laisse à croire que la pratique observée s’écarte significativement de l’esprit de la loi. Environ 20 % des patients suivis en soins sans consentement relèvent de la procédure des soins pour péril imminent, soit une personne sur cinq.
Les raisons sont multiples mais peuvent être regroupées en deux catégories principales.
Comme cela avait déjà été souligné, cette procédure peut être déclenchée afin de pallier la réticence des tiers potentiels à demander l’admission. Les rapporteurs ont ainsi constaté qu’une ARS présente cette procédure comme utile notamment en cas de « refus des membres de l’entourage du patient de participer à une telle décision d’admission en soins psychiatriques », tout en ajoutant qu’il « ne convient pas de recourir de manière trop fréquente à cette procédure » (65). La procédure de soins pour péril imminent est ainsi appréhendée comme une mesure susceptible d’être déclenchée lorsqu’il est impossible d’obtenir une demande parce que les proches du patient ne souhaitent pas déclencher les soins, par désintérêt ou peur de compromettre leurs relations avec lui, alors qu’une contestation est susceptible d’être portée devant le juge. Du reste, ni les associations de patients, ni les représentants des professionnels médicaux n’ont infirmé cette hypothèse.
Pour autant, le désengagement du tiers devrait se traduire par une diminution équivalente du nombre d’admissions de droit commun à la demande d’un tiers. Ce transfert ne semble pas confirmé par les données existantes. Il a en effet été indiqué aux rapporteurs que la relative stabilité des admissions à la demande d’un tiers ne suffisait pas à expliquer la véritable poussée des procédures de soins pour péril imminent (plus de 200 % d’augmentation).
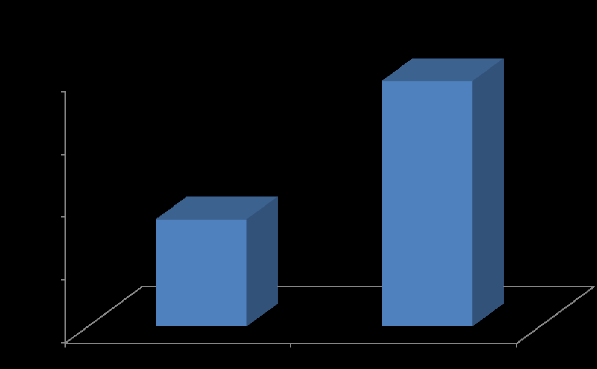 (*) IRDES, Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
(*) IRDES, Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
(**) Donnée présentée en audition.
Il semble dès lors acquis, que cette procédure allégée soit privilégiée dans un contexte d’urgence, accréditant l’idée d’une véritable banalisation. Environ les deux tiers des admissions en SPI seraient ainsi émises à l’occasion d’un passage aux services d’urgence.
Le flux des patients transitant par les services d’urgence ne permet pas aux personnels soignants de connaître le patient qui se présente, son passé médical et son environnement familial et social. En proie à un état de crise, le patient n’est pas non plus en mesure d’apporter toute information utile au personnel du service d’urgence. Le choix le plus rationnel, dicté aussi bien par l’état du patient
– circonscrire la crise – que par celui du service – traiter la file d’attente –, consiste à proposer une admission en soins sans consentement en péril imminent.
Dans la région lyonnaise, une étude a ainsi montré que 90 % des patients admis en SPI ont été orientés par un service d’urgence, majoritairement un service d’urgence général avec « la volonté sous-jacente de désengorger rapidement les services » (66). Or, le recours à cette pratique comporte des risques qui ont été mis en lumière par cette même étude.
Le recours à cette procédure n’est pas un gage de qualité de la prise en charge. Dans 78 % des cas, les certificats médicaux initiaux étudiés « n’étaient absolument pas circonstanciés en ce qui concerne l’absence de tiers », la pratique constatée consistant à reprendre un modèle pré-imprimé. L’étude a parallèlement montré qu’en reprenant l’ensemble des dossiers pour lesquels une admission en SPI semblait justifiée, il est finalement apparu qu’un tiers « s’avérait disponible dans deux tiers de ces admissions » et que dans 44 % de ces cas ce tiers disponible « n’avait pas été sollicité quant à [la] position et son avis » (67).
Par ailleurs, le recours au SPI comporte des risques pour la pratique soignante. L’absence de rencontre avec la famille prive le clinicien des informations utiles pour évaluer l’état du patient autant qu’elle prive la famille du caractère pédagogique de l’entretien. Au surplus, elle modifie la relation entre le patient et son médecin placé « en position de toute puissance, étant seul à ordonner et prescrire l’admission, sans contradicteur possible dans sa décision médicale ».
Les constats qui ont été faits ne laissent pas d’interroger les rapporteurs qui souhaitent tout de même rappeler que la pratique consistant à considérer comme normale l’admission en SPI ne résulte pas de l’intention du législateur.
c. L’urgence, une pratique bien ancrée
L’augmentation des admissions en soins psychiatriques au titre des SPI s’inscrit dans le cadre déjà ancien d’un recours aux procédures d’urgence. La banalisation des procédures allégées d’admission n’a pas débuté avec l’application de la loi de 2011 comme cela a été rappelé aux rapporteurs en audition. Cela étant, le nouvel outil d’admission en cas d’impossibilité de contacter un tiers constitue un facteur facilitant le recours aux procédures d’urgence.
Cette tendance à la banalisation de l’urgence persiste alors qu’avec la loi de septembre 2013, le législateur a contribué à l’allégement des tâches imposées aux psychiatres en rationalisant le nombre de certificats médicaux à produire dans le cadre des admissions sans consentement à la demande d’un tiers (68). Il s’agissait aussi de faire en sorte que les certificats médicaux produits soient davantage circonstanciés et revêtent une réelle utilité pour le juge.
Pour les rapporteurs, il importe de comprendre les raisons de cette généralisation et de s’interroger aussi bien sur les pratiques médicales que sur l’organisation des soins, particulièrement dans les territoires pour lesquels il est constaté un taux de recours important : les auditions ont en effet mis en lumière une certaine hétérogénéité du recours aux SPI. Lors de son audition, Mme Magali Coldefy a ainsi souligné que sur 260 établissements autorisés en soins sans consentement, une quarantaine accueille 16 % des patients en psychiatrie, 19 % des patients admis en soins sans consentement mais concentre 36 % des SPI.
Les professionnels de santé, particulièrement les psychiatres, doivent s’interroger sur leur propre pratique et les raisons qui l’ont fait évoluer.
Lors de leur audition, les représentants des directeurs d’établissements de santé mentale aussi bien le président de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d’établissement ont déploré l’absence de « séniorisation » des médecins établissant les certificats médicaux d’admission en SPI. Bien souvent opérée par des médecins généralistes ou des médecins urgentistes non spécialisés en psychiatrie, l’évaluation de l’état du patient résulte parfois plus d’une formalité à accomplir dans l’urgence (la production du sésame d’entrée en admission) que de l’appréciation de l’état mental du patient.
S’agissant de la pratique médicale, il importe notamment de déterminer les conditions d’appréciation du « péril imminent », tout autant que l’impossibilité de recherche d’un tiers. Dans des recommandations antérieures à la réforme des soins sans consentement, la Haute Autorité de santé (HAS) avait défini le cadre du péril imminent, alors qu’à l’époque la notion de péril imminent permettait de justifier non des soins sans tiers demandeur mais une procédure de demande de soins par un tiers en urgence (69).
Les rapporteurs estiment que l’édiction de recommandations de bonne pratique à l’usage des professionnels de santé permettrait de concourir à un moindre recours aux SPI, davantage conforme à l’intention du législateur. Ils suggèrent également d’établir un indicateur permettant d’évaluer le respect de ces bonnes pratiques dans le cadre de la certification des établissements de santé.
Recommandation n° 8 : saisir la Haute Autorité de santé en vue d’édicter des recommandations de bonne pratique relatives aux admissions en soins psychiatriques par des procédures d’urgence.
Recommandation n° 9 : instaurer un indicateur d’évaluation du respect des recommandations de bonne pratique relatives aux admissions en procédures d’urgence dans le cadre de la certification des établissements de santé.
Le recours aux procédures d’urgence apparaît principalement déterminé par le passage dans les services d’urgence alors que le patient est en état de crise. Il conviendrait de reconsidérer le parcours des patients en amont et en aval des services d’urgences. L’engorgement est un fait indéniable et la situation est aussi éprouvante pour les patients que pour les professionnels hospitaliers.
Les réponses susceptibles d’être apportées touchent à la coordination renforcée entre la médecine de ville et la médecine hospitalière mais renvoient aussi à l’organisation des établissements de santé.
L’implication des médecins de ville et des associations de permanence des soins doit être encouragée à travers les outils apportés par la loi de modernisation de notre système de santé. Le recours à l’admission en cas de péril imminent résulte de la tension pesant sur l’offre médicale. Bien souvent, l’envoi du patient aux urgences apparaît comme la seule solution possible dans un contexte de pénurie de médecins de ville. Au CHU de Saint-Étienne, il est constaté que l’admission en urgence tient en partie à l’absence d’articulation avec les médecins de ville. Dans les établissements abritant un service d’urgence, solliciter un second médecin certificateur se révèle aussi être une tâche ardue faute de personnel disponible alors que la procédure d’admission exige deux certificateurs différents. La possibilité de réunir les conditions exigées par la loi se heurte aussi aux difficultés d’organisation. C’est une réelle préoccupation pour les chefs de services et les responsables d’établissements confrontés aux exigences de la permanence des soins.
Dès lors, il est permis de s’interroger sur les modes complémentaires de prise en charge permettant d’éviter le passage aux urgences ou l’admission dans un établissement autorisé en psychiatrie.
Plusieurs initiatives d’équipes mobiles d’urgence en psychiatrie ont été mises en place. Elles ont permis d’accroître l’efficacité de la prise en charge en raccompagnant les patients à domicile au sortir des urgences et en opérant une surveillance régulière dans les jours suivants sans avoir à initier une période d’observation en hospitalisation complète.
Ces modes opératoires mériteraient d’être davantage soutenus dans les zones caractérisées par un encombrement des services d’urgence et/ou un important recours aux procédures d’urgence. En outre, il pourrait être également opportun d’encourager l’application de l’article 75 de la loi de modernisation de notre système de santé, au terme duquel doit s’opérer la coordination de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence. Au CHU de Saint-Étienne a été ainsi instituée une Hotline psychiatrique coordonnée avec la plateforme téléphonique du centre SAMU. Tout patient manifestant des troubles de santé mentale est ainsi orienté du centre 15 vers la plateforme d’urgences psychiatriques pour un entretien, une évaluation spécialisée et une réponse appropriée.
Aujourd’hui, le déploiement de cette coordination n’est pas mesurable. Dans sa réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs, le ministère des affaires sociales et de la santé précise, que pour être évaluée, cette articulation implique de « préciser la définition de ce que sont les dispositifs de psychiatrie d’intervention d’urgence » puis de la prévoir explicitement dans le cahier des charges régionaux de la PDSA.
Pour permettre le recours à des dispositifs d’urgence alternatifs, deux pistes pourraient être envisagées : l’insertion d’un indicateur spécifique dans le cahier des charges régional de la PSDA associé à une incitation financière inversement proportionnelle au taux de recours aux procédures d’urgence.
Recommandation n° 10 : soutenir le recours aux dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence (équipes mobiles, coordination avec le centre 15) dans les territoires pour lesquels le taux de recours aux procédures d’urgence est important par :
– la définition des dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence ;
– l’élaboration d’indicateurs de suivi ;
– une éventuelle incitation financière inversement proportionnelle au taux de recours aux procédures d’urgence.
Les dispositifs hospitaliers permettant d’éviter le recours aux procédures d’urgence sont nécessaires mais ne peuvent, à eux seuls, résoudre ce problème. Il convient aussi de prendre en compte la qualité de la prise en charge à travers le parcours du patient entre les établissements de santé particulièrement lorsque l’admission suit un passage aux urgences. Ce parcours est aujourd’hui évalué dans le cadre de la certification conjointe lorsque les deux établissements de santé appartiennent au même groupement hospitalier de territoire (GHT). Or, pour les centres hospitaliers spécialisés (CHS), cette évaluation varie selon la situation rencontrée. Trois configurations sont ainsi possibles :
– le CHS n’appartient à aucun GHT (12 établissements à ce jour) : il n’existe aucune évaluation externe de la qualité du parcours patient, sauf à ce qu’il s’associe avec d’autres établissements qui décident conjointement de répliquer la méthode HAS du patient traceur ;
– le CHS est dans un GHT spécialisé en santé mentale (cas de 13 établissements) : la HAS applique, lors de la certification conjointe, la démarche du patient traceur au sein du GHT mais n’analyse que son parcours entre les différents établissements psychiatriques. Rien n’empêche toutefois la possibilité de s’associer avec d’autres établissements abritant les structures d’urgence pour appliquer la méthode HAS du patient traceur ;
– le CHS est dans un GHT polyvalent : la HAS applique, lors de la certification conjointe, la démarche du patient traceur au sein du GHT.
Pour contribuer à l’amélioration de la pratique médicale ou de l’organisation des soins, il importe de disposer au préalable des données relatives aux pratiques médicales dans les territoires. Les rapporteurs déplorent l’absence d’exploitation nationale des informations existantes. Elles sont en effet collectées par des structures départementales dont la mission consiste précisément à contrôler et à améliorer la prise en charge des patients admis en soins sans consentement.
2. La nécessaire revitalisation des commissions départementales des soins psychiatriques
Si le contentieux de l’admission en soins psychiatriques sans consentement échoit au juge judiciaire, le législateur a également prévu l’examen des situations des personnes, au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, par le biais des commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP).
a. Les missions dévolues aux commissions départementales des soins psychiatriques
Prévues par les articles L. 3223-1 à L. 3223-3, les CDSP sont composées de 6 personnes – pour moitié des médecins – et se réunissent au moins une fois par trimestre. Elles sont chargées de plusieurs missions.
Elles sont tout d’abord informées de toutes les décisions d’admission en soins psychiatriques, de tous les renouvellements et de toutes les décisions mettant fin aux soins dans le ressort du département.
Elles reçoivent par ailleurs les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement, quel que soit le régime d’admission (à la demande d’un tiers, sur décision du représentant de l’État, détenu, personne pénalement irresponsable).
Elles examinent aussi la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et obligatoirement de celles admises en cas de péril imminent ou celle des patients dont le séjour se prolonge au-delà d’une année.
Elles visitent les établissements autorisés en psychiatrie au moins deux fois par an et à vérifier les informations figurant sur les registres de la loi.
Enfin, elles adressent chaque année un rapport d’activité au juge des libertés et de la détention (JLD), au représentant de l’État dans le département, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
b. Un fonctionnement globalement satisfaisant mais empreint de fragilité
De l’état des lieux réalisé par l’UNAFAM, association auditionnée par les rapporteurs, il ressort que l’activité des CDSP est globalement satisfaisante pour trois-quarts d’entre elles, même si des différences territoriales subsistent :
– pour un quart des départements, la situation est considérée comme défaillante, le nombre de réunions enregistrées n’atteignant pas le seuil minimal exigé par la réglementation (au moins une fois par trimestre) ;
– 28 départements ont connu une activité correspondant au seuil réglementaire ;
– pour 40 départements, la fréquence des réunions est mensuelle.
Le fonctionnement des CDSP a aussi été évalué à partir de leur composition. Là également, la vitalité des CDSP est globalement satisfaisante eu égard aux données fournies par 86 départements :
– 34 départements abritent une commission composée de 6 membres ;
– 30 départements voient la commission compter 5 membres ;
– 15 départements ont une commission comportant deux sièges vacants ;
– 7 départements comptent au moins 3 sièges vacants.
Le constat plutôt positif de la vitalité des commissions mériterait d’être tempéré tant au regard de la vitalité des commissions que de l’exploitation de leurs travaux.
Par comparaison avec la dernière enquête menée par la direction générale de la santé (DGS), une sensible érosion de la participation aux commissions doit être soulignée. Lors des Journées des commissions départementales d’hospitalisation psychiatrique (70) organisées en décembre 2011, la DGS avait présenté un bilan de leur fonctionnement portant sur l’année 2009. Sur 95 départements ayant répondu à l’enquête, 70 commissions indiquaient fonctionner avec six membres, 15 avec cinq membres et 10 avec quatre membres.
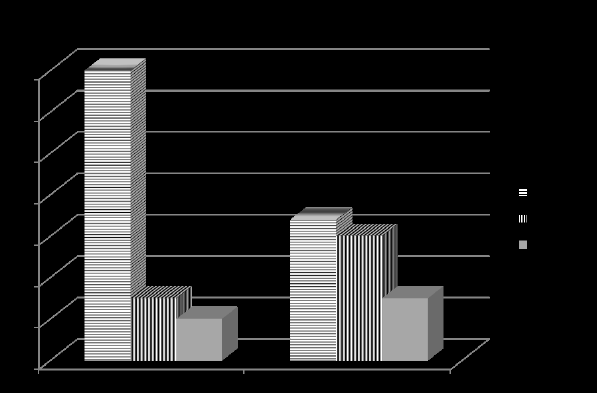
Il en résulte globalement une fragilité du fonctionnement des commissions. Leur réunion dépend de l’investissement de leurs membres et le manque de disponibilité peut d’autant plus affecter leur travail quand le nombre de sièges vacants est important.
Si l’on s’en tient aux exigences réglementaires, le quorum pour la tenue des réunions est fixé à 3 membres dont au moins un médecin (71). Il est plus difficile de l’atteindre lorsque la commission compte 4 ou 5 sièges. Or, depuis 2009, on compte une plus grande proportion de CDSP pour lesquelles 4 ou 5 sièges sont pourvus que de CDSP à effectif complet.
En outre, le constat d’une certaine fragilité s’avère si l’on croise le nombre de sièges vacants avec la nature de leur titulaire.
Dans son enquête, l’UNAFAM souligne que les « proportions de vacances de psychiatres (20 %) ou de généralistes (16 %) illustrent la difficulté de recrutement de ces professionnels ». Cette érosion concerne aussi la représentation des patients : « un siège sur trois du représentant des patients n’a pas de titulaire », à comparer aux 15 commissions dans lesquelles il manquait un représentant des usagers en 2009.
Composition des commissions départementales de soins psychiatriques
(Article L. 3223-2 du code de la santé publique)
La commission se compose :
– de deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le représentant de l’État dans le département ;
– d’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ;
– de deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l’État dans le département ;
– d’un médecin généraliste désigné par le représentant de l’État dans le département.
La vitalité du travail des CDSP mériterait aussi d’être appréhendée au travers du nombre d’avis rendus ou du suivi réservé à leurs observations. Malheureusement, les seules données datent de la dernière enquête menée par la DGS – 2011 – et ne sont plus significatives.
Il faut enfin souligner le rôle déterminant des agences régionales de santé (ARS) pour le travail des commissions puisque, au terme de l’article R. 3223-7 du code de la santé publique, le secrétariat de la commission est assuré par elles. Auditionnées par les rapporteurs, l’UNAFAM et la FNAPSY convergent sur le diagnostic. Le dynamisme des CDSP dépend bien souvent de l’implication de la personne désignée pour en assurer le secrétariat. Ainsi, dans le département de Loir-et-Cher, la CDSP ne s’est-elle pas réunie depuis plus d’un an ! Il faut y ajouter aussi les difficultés liées aux réorganisations territoriales qui peuvent avoir raison tant de la disponibilité de leurs membres que de leur bonne volonté. En Auvergne, il faut ainsi faire preuve d’une grande motivation pour se rendre aux réunions des commissions départementales qui ont été fixées… au siège de la région !
Afin de permettre une stabilité, de leur fonctionnement, les rapporteurs font leur la proposition de l’UNAFAM visant à généraliser la nomination de membres suppléants. Cette possibilité permettrait d’atteindre plus efficacement le quorum exigé.
Recommandation n° 11 : prévoir la nomination de membres suppléants dans les commissions départementales de soins psychiatriques.
S’agissant de l’impulsion donnée par les ARS, il appartient aux services centraux du ministère des affaires sociales et de la santé de davantage sensibiliser les ARS concernées à la portée des travaux de ces commissions.
c. L’exploitation insuffisante des données des commissions
Un arrêté du 26 juin 2012 (72) fixe le modèle des statistiques faisant l’objet du rapport d’activité des commissions prévu par l’article L. 3223-1 du code de la santé publique.
Ces données sont essentielles en ce qu’elles permettent de dresser une situation exhaustive de l’admission en soins sans consentement dans chacun des départements.
Les informations demandées ont évidemment trait aux travaux de la commission : citons ainsi la fréquence des réunions, le nombre de dossiers de réclamation examinés ou encore le suivi des demandes émises par les CDSP au représentant de l’État, au directeur d’établissement ou au juge judiciaire.
Le législateur leur a par ailleurs confié la responsabilité du suivi des mesures d’urgence ou des mesures de soins d’une durée supérieure à un an, celles qui restreignent le plus les libertés. Ce suivi est primordial puisque, comme les rapporteurs l’ont constaté, les mesures d’admission comme les procédures utilisées varient d’un territoire à l’autre. L’exploitation des documents confiés aux CDSP permettrait de davantage éclairer les pratiques territoriales. En cas de visite d’un établissement, les membres de la commission ont ainsi accès au dossier administratif de chaque malade et peuvent se voir communiquer les données médicales nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Surtout, les acteurs pourraient agir de manière plus mesurée et plus adaptée à l’esprit de la loi s’ils savaient que les informations collectées permettent des actions correctrices !
À l’heure actuelle, les rapports d’activité élaborés par les CDSP, s’ils constituent une source d’informations utiles, ne sont pas exploités nationalement. On se prive ainsi de la possibilité peu coûteuse d’exercer un meilleur pilotage de la politique publique de santé mentale en offrant à tous les acteurs un cadre de référence partagé.
Force est aussi de constater que ce défaut d’exploitation a laissé l’initiative à la Commission des citoyens pour les droits de l’Homme, émanation de l’Église de scientologie (73), qui a publié les rapports d’activité dans la plupart des départements pour l’année 2012 non sans avoir auparavant saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) aux fins de communication (74).
À l’heure de la numérisation des informations, il semble pour le moins étonnant que l’administration ne puisse pas rassembler elle-même ces informations dans un document de synthèse, les exploiter et les rendre accessibles au public ! Il s’agit de documents d’intérêt public dont la publicité doit être accompagnée d’éléments d’interprétation. Il s’agit avant tout d’évaluer l’efficacité de la politique de santé mentale et de présenter aux citoyens ses résultats et les actions entreprises pour remédier, le cas échéant, aux entorses à la loi.
Les rapporteurs appellent en conséquence le ministère des affaires sociales et de la santé à faciliter l’exploitation et la publicité des informations déjà disponibles dans les CDSP. La question du cadre d’exploitation des données reste posée (structure identifiée au sein de l’administration centrale ou création d’un observatoire national indépendant) mais n’apparaît pas à ce stade déterminante puisque l’enjeu consiste d’abord à redynamiser les commissions départementales.
Plus fondamentalement, le rôle des CDSP pourrait être allégé compte-tenu de la mise en place d’un contrôle judiciaire systématique par la loi du 5 juillet 2011. Le Président de la conférence des Présidents de TGI s’est même interrogé sur la nécessité de leur maintien. Si l’on ne saurait réduire le regard extérieur, particulièrement celui des usagers et de leur famille, dans les hôpitaux psychiatriques, le rôle des CDSP est à repenser compte-tenu de celui des juges des libertés et de la détention.
Recommandation n° 12 : redynamiser les commissions départementales de soins psychiatriques, en redéfinissant leur rôle en articulation avec celui des juges des libertés et de la détention, en exploitant et en diffusant leurs comptes rendus et rapports d’activité par une structure nationale identifiée.
*
* *
La pratique des admissions en soins sans consentement, le traitement des situations d’urgence ou des modes de prises en charge par les différents acteurs des soins psychiatriques varient d’un territoire à l’autre. En l’absence de séries statistiques suffisantes, cette situation ne peut être complètement décrite et expliquée par les rapporteurs. Cela étant, les publications scientifiques qu’ils ont pu consulter, corroborées par les auditions permettent de conclure à une réelle inégalité des patients devant les soins sans consentement. Les déterminants sont encore mal connus (organisation des soins, prévalence de pathologies, pratiques des chefs de service, facilités administratives, restes d’opposition à la réforme…) mais mériteraient d’être davantage cernés afin de proposer des mesures correctrices adaptées. La réflexion sur les bonnes pratiques médicales ainsi que l’adaptation du système de santé à la prise en charge en urgence constituent a minima les pistes à creuser très rapidement. Cela ne dispense pas de s’interroger sur l’effet du contrôle du juge sur la prise en charge des patients ni sur la qualité des pièces mises à sa disposition.
*
* *
I. L’EFFECTIVITÉ ENCORE PERFECTIBLE DE L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES ADMISES EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT.
Des auditions et déplacements effectués par la mission, il ressort que les nombreuses avancées apportées par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 à la garantie des droits des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement ne se traduisent pas toujours avec une effectivité optimale dans le quotidien des patients.
Il y aurait donc un hiatus entre les progrès opérés par la loi en matière de garantie des libertés individuelles et les pratiques observées. Pour reprendre l’élégante formule de Mme Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (FNAPSY), « le non-droit n’est plus mais le non-dit subsiste » (75).
C’est aussi le constat dressé par le Dr Jean-Luc Roelandt qui, dans la contribution écrite qu’il a fournie à la mission, présente la loi du 27 septembre 2013 comme « une bonne évolution législative qui n’a cependant pas suffi à empêcher l’augmentation de la contrainte » et qui met en exergue la « nécessité de droits effectifs et non pas uniquement formels ».
C’est également l’analyse de plusieurs des représentants des syndicats de magistrats, parmi lesquels ceux de l’Union syndicale des magistrats (USM) et du Syndicat de la magistrature, qui, lors de leur audition, ont salué les progrès que la loi du 27 septembre 2013 a marqués en matière de garantie des droits des usagers, tout en soulignant que, faute de moyens humains et financiers, ces progrès ne se concrétisent pas effectivement dans le quotidien des usagers.
Ils ont en particulier noté le décalage entre, d’une part, les besoins en magistrats et en personnel de greffe identifiés dans l’étude d’impact jointe au texte devenu la loi du 5 juillet 2011, et, d’autre part, le nombre de postes effectivement créés. D’après M. Michel Dutrus, conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, délégué général de FO-Magistrats, les décrets pris en application de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, ne devraient conduire qu’à la création, sur l’ensemble du territoire, de 22 postes supplémentaires – étant précisé que le nombre actuel de juges des libertés et de la détention (JLD) serait de 254, selon la même source. Dans sa contribution écrite, le même Michel Dutrus s’interroge, en outre, sur « les raisons pour lesquelles le temps consacré aux trajets par le magistrat n’a pas été pris en compte » et pour lesquelles « l’attribution de véhicules supplémentaires n’a pas même été envisagée » (76).
Selon Mme Joëlle Munier, présidente du tribunal de grande instance (TGI) d’Albi et vice-présidente de la conférence nationale des présidents de TGI, les juridictions n’ont reçu aucune dotation informatique… alors même que les modifications procédurales introduites en 2011 et 2013 nécessitent la dématérialisation et l’accélération des échanges avec les établissements de santé et qu’une circulaire du ministère de la Santé du 29 juillet 2011 prévoyait que « l’équipement informatique sera[it] fourni par le ministère de la justice et des libertés » (77).
Mme Marie-Christine Leprince, présidente du TGI de Caen et membre du bureau de cette même conférence, a déploré que les juridictions n’aient par ailleurs bénéficié d’aucun renfort de leurs greffes, alors même que le contentieux des soins psychiatriques sans consentement est très chronophage pour ces derniers (78).
En somme, pour reprendre la formule employée par M. Michel Dutrus lors de son audition, « l’indigence de moyens est à des années-lumière des ambitions du législateur ».
Les rapporteurs ont en effet constaté que des marges de progrès subsistaient à la fois avant l’audience du JLD (en matière d’accès au droit pour les patients), pendant cette audience (notamment au regard de l’office du juge) et après celle-ci (en matière de contrôle des conditions d’hospitalisation, et en particulier des mesures de contention et d’isolement).
A. DES MARGES DE PROGRÈS EN MATIÈRE D’ACCÈS AU DROIT DES PATIENTS AVANT L’AUDIENCE
Dans la contribution écrite qu’il a fournie à la mission, M. André Bitton, président du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), estime qu’« on ne peut pas dire que les personnes sous mesure de soins psychiatriques sous contrainte peuvent aisément accéder à leurs droits et voies de recours ».
D’après Mme Pauline Rhenter, chercheure pour l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), les principaux obstacles à l’exercice effectif des droits des patients tiendraient :
– au dispositif d’admission en soins sans consentement dont certains éléments seraient contraires aux droits reconnus à l’ensemble des usagers en matière de santé ;
– à l’organisation du système de soins ;
– aux ressources des personnes admises en soins sans consentement (environnement, capital social et culturel, etc.) ;
– aux représentations des pathologies psychiatriques tant chez le personnel soignant que chez les agents des forces de l’ordre et les magistrats.
La mission a pu constater que les difficultés d’accès au droit que peuvent rencontrer les patients tiennent tant au déficit d’information quant à leurs droits qu’aux conditions de leur défense, qui pâtit notamment du caractère tardif de leur rencontre avec leur avocat.
1. L’information des patients sur leurs droits
D’après M. Claude Deutsch, secrétaire général de l’association Advocacy France, le principal obstacle que rencontre l’application de la loi du 27 septembre 2013 est sa méconnaissance, particulièrement chez les usagers des services de psychiatrie qui, pour la plupart, ignoreraient leurs droits ainsi que les décisions prises à leur sujet.
Les rapporteurs notent cependant avec satisfaction que l’information des patients sur leurs droits a connu une amélioration à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP).
L’information des patients sur leurs droits à l’IPPP
Le document « Éléments pour le rapport au Parlement relatif à l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police de Paris », que le Gouvernement a remis à la mission, souligne que « le cadre de l’action de l’infirmerie psychiatrique a été validé par la jurisprudence administrative et conventionnelle. En effet, le tribunal administratif de Paris, dans une décision du 30 octobre 2002, a réaffirmé la compétence du préfet de police pour se doter d’un service d’observation médicale (requête n° 006413), tandis que la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt “R.L. et M-J.D contre France” du 19 mai 2004, n’a pas non plus remis en cause l’existence et le bien-fondé de l’IPPP (affaire n° 44568/98). En outre, les personnes conduites à l’IPPP y bénéficient des mêmes droits et garanties que dans les établissements de santé spécialisés en psychiatrie, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 20 novembre 2009 (requête n° 313598), confirmé par un arrêt du 13 mars 2013 (requête n° 354976).
Dès leur arrivée à l’infirmerie psychiatrique, les personnes qui y sont conduites sont informées de leurs droits. Une “Charte d’accueil et de prise en charge des personnes conduites à l’infirmerie psychiatrique” leur est systématiquement distribuée à cet effet. Elle existe en six langues, et également en version audio. Ainsi, l’information concernant les droits des personnes est assurée rapidement et automatiquement. Par ailleurs, l’information des patients admis à l’IPPP s’agissant de leur état de santé est toujours effectuée de manière appropriée à cet état, et leurs observations sur les modalités de soins sont systématiquement sollicitées et prises en considération dans la mesure du possible […] S’agissant de l’exercice des droits, à l’infirmerie psychiatrique, comme dans les établissements de santé autorisés en psychiatrie, les personnes admises disposent du droit de communiquer avec le préfet, le directeur général de l’Agence régionale de santé, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le maire de la commune. Également, les personnes admises à l’infirmerie psychiatrique peuvent saisir la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), le juge des libertés et de la détention (JLD) ou encore de porter à la connaissance du Contrôleur Général des lieux de privation de liberté (CGLPL) des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence. La personne est informée de ces droits procéduraux dès son admission à l’IPPP, grâce à la charte d’accueil qui lui est distribuée et son commentaire.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose également que les personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte ont le droit de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent. À l’infirmerie psychiatrique, le règlement intérieur est mentionné dans la Charte d’accueil ; les personnes admises à l’IPPP sont donc systématiquement informées de l’existence de ce règlement intérieur, et de leur droit à le consulter et à recevoir des explications.
En outre, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte ont le droit de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de leur choix.
La famille des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne peuvent également avoir une place centrale dans l’exercice de ces droits, puisqu’ils peuvent être exercés à leur demande. […] Globalement, très peu de demandes sont exercées en ce sens. À titre d’exemple, sur 1 945 personnes conduites à l’infirmerie psychiatrique en 2015, 15 personnes ont demandé à prendre conseil auprès d’un avocat.
L’infirmerie psychiatrique a évolué ces dernières années pour venir faciliter l’exercice des droits des personnes admises, en améliorant la qualité d’accueil et les conditions matérielles de prise en charge des personnes, de leur famille, et de leurs avocats ou médecins. Ainsi, la Charte d’accueil a été révisée pour prendre en compte notamment la jurisprudence du Conseil d’État s’agissant de la visite d’un avocat, d’un médecin ou d’un proche ; elle précise désormais : “ Toute personne accueillie à l’infirmerie psychiatrique est informée, dès son admission, de son droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix. Elles peuvent également rencontrer un membre de leur famille. L’infirmerie s’attachera à respecter la confidentialité des visites. Les contacts avec les familles pourront être différés dans le temps en raison de contre-indications médicales prononcées par le médecin, dans l’intérêt du présumé malade. Le médecin l’informera des raisons de cette mesure qui seront consignées, et signées par le médecin, dans son dossier médical ”.
Par ailleurs, un bureau dédié aux entretiens avec la famille, le médecin ou l’avocat du patient a été créé, des sonnettes individuelles ont été installées dans chacune des chambres pour permettre au patient d’appeler les personnels de l’Infirmerie, et des menus de substitution peuvent être servis pour respecter les particularités alimentaires des personnes admises à l’IPPP. Des registres sont tenus au sein de l’IPPP pour permettre de contrôler les conditions dans lesquelles est garanti l’exercice des droits et libertés des personnes qui y sont conduites. Ainsi, un registre mentionnant les droits que les présumés malades ont demandé à exercer permet d’établir la traçabilité de ces demandes. Un deuxième registre permet aux présumés malades ou à leurs proches de noter leurs réclamations et leurs observations. Enfin, un registre des contentions précise les motifs, la durée et les modalités de toute mise en contention prescrite pas un médecin. »
Le document fourni par le Gouvernement ajoute que « l’infirmerie psychiatrique est soumise à de nombreux contrôles externes et visites. Ainsi, elle a pu être successivement visitée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en 1996 ; la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) en 2002, 2005, 2008, 2012, et le 15 juin 2016 ; le Médiateur de la République en septembre et novembre 2007 ; les magistrats représentant le président du TGI de Paris et le Procureur de la République en septembre 2008 ; la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) de Paris en décembre 2008 ; le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) en juillet 2009 ; des délégations d’élus du Conseil de Paris en 2010 et 2011 et des parlementaires. Enfin, en novembre 2011, la Ville de Paris a mis en place une commission relative à l’IPPP, présidée par Mme Wieviorka, conseillère de Paris, adjointe au maire du IIe arrondissement déléguée à la prévention et à la sécurité, qui a constitué un groupe de travail chargé d’étudier les évolutions à apporter à cette structure. Trois visites de l’IPPP par les membres de ce groupe ont eu lieu en mars 2012 et six audits ont été réalisés du 13 février au 22 juin 2012. À l’issue des conclusions de ce groupe de travail en août 2012, le maire de Paris a écrit le 30 mai 2013 une lettre au préfet de police saluant les améliorations mises en œuvre depuis la visite du CGLPL et l’informant de son souhait de voir maintenir la structure, au regard de sa grande efficacité et de son utilité au sein de la capitale ».
Au-delà du cas particulier de l’IPPP, les associations d’usagers de la psychiatrie ont majoritairement relevé un déficit d’information des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sur leurs droits mentionnés à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
C’est aussi l’analyse de Mme Adeline Hazan, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), qui, lors de son audition, a expliqué que la date et les modalités de notification de leurs droits aux patients passaient souvent au second plan : ces droits sont parfois non-notifiés, rarement expliqués et décrits dans les livrets d’accueil qui se contentent souvent de présenter l’organisation de l’établissement. Après avoir souligné qu’il est difficile pour les contrôleurs d’avoir une preuve de la notification des droits, Mme Adeline Hazan a suggéré, en citant l’exemple d’un hôpital où, toutes les semaines, les patients de l’unité sont rassemblés dans une salle où le personnel soignant et des assistantes sociales leur expliquent leurs droits, qu’un imprimé présentant ces droits soit au moins remis au patient à son admission (même s’il n’est pas en état de le comprendre) et que son contenu lui soit expliqué plus tard par le responsable des notifications désigné au sein de l’établissement.
Dans la contribution écrite qu’ils ont fournie à la mission, les représentants de l’association Advocacy France décrivent « un univers kafkaïen [dans lequel] il n’est pas exceptionnel que des personnes soient placées en chambre d’isolement dès leur admission ou mises sous camisole chimique sans visite extérieure, parfois pendant dix jours. Elles sont alors déclarées non capables d’être présentées au juge, elles ne disposent pas d’un avocat, ne savent rien de ce qui a été dit à leur sujet. […] La personne de confiance n’est pas prévenue de l’audience, et, de ce fait, pas entendue par le juge. Les familles sont généralement tenues à l’écart. […] La majorité des [avocats] commis d’office ne rencontrent l’usager que trois à cinq minutes avant l’audience. Les usagers rencontrent des difficultés pour saisir un avocat. Ils se voient interdits de téléphoner et leur courrier est filtré ».
D’après les réponses apportées par le ministère des affaires sociales et de la santé au questionnaire que la mission lui a adressé, lors d’une journée sur le thème de la réforme des soins sans consentement de 2011, organisée le 12 décembre dernier par l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Ville-Evrard, une psychiatre de cet établissement « a estimé la notification de leurs droits aux patients, à seulement 30 à 40 % des cas » (79).
Il semblerait que l’information du patient se limite souvent à un formulaire proposant une réponse par « oui » ou par « non » à la question « voulez-vous un avocat ? ».
Certains patients seraient tentés de cocher « non » en pensant que cela signifie qu’ils n’ont pas besoin d’un avocat parce qu’ils ne sont pas coupables.
Me Aurore Bonduel, avocate au barreau de Lille, a indiqué qu’il n’était pas rare qu’après avoir été informés de leurs droits par un avocat (et non par un psychiatre), des patients ayant déclaré renoncer à l’assistance d’un avocat revenaient sur leur choix initial. Elle juge donc nécessaire que les avocats puissent s’entretenir avec les patients hors la présence du personnel soignant, dans un local dédié qui permette de garantir la confidentialité des échanges mais aussi la sécurité des avocats (par exemple, grâce à un bouton d’alerte (80)).
Selon M. André Bitton, président du CRPA, on n’explique pas assez aux patients que la procédure encadrant leur admission en soins sans consentement est civile, et non pénale. Selon Mme Yaël Frydman, secrétaire générale de la même association, « bien qu’ils aient l’obligation de le faire, les hôpitaux omettent trop souvent d’informer les personnes prises en charge sans leur consentement de leurs droits et de leurs voies de recours » (81).
Dans certains cas, les personnes admises en soins sans consentement peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à leur dossier. Les frais de copies des dossiers sont en effet à leur charge et peuvent parfois s’élever, d’après ce qui a été rapporté à la mission, à plusieurs centaines d’euros (82).
Ces personnes auraient également, selon Mme Pauline Rhenter, des difficultés à faire valoir leurs droits parentaux (autorité parentale, garde des enfants, droit de visite). Il serait également difficile de faire valoir les droits des enfants mineurs hospitalisés (parfois en psychiatrie adulte), d’autant que, si leurs représentants légaux ont consenti à leur hospitalisation complète, celle-ci est regardée juridiquement comme une hospitalisation libre qui échappe donc au contrôle de plein droit du JLD – ce qu’a déploré Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, président de la commission « hospitalisation d’office et personnes vulnérables » du Syndicat des avocats de France (SAF). Tant les représentants des syndicats de psychiatres que ceux du Syndicat de la magistrature ont appelé l’attention des rapporteurs sur cette question du contrôle judiciaire de l’hospitalisation sous contrainte des mineurs. Pour autant, l’internement abusif d’un mineur supposerait la collusion d’un au moins des parents avec un psychiatre… et dans un tel cas, le mineur serait en danger et le juge des enfants pourrait être saisi. La nécessité d’une extension du contrôle judiciaire systématique aux mineurs n’a ainsi pas paru établie à vos rapporteurs.
Certaines personnes renonceraient à revendiquer le respect de leurs droits et développeraient, selon Mme Pauline Rhenter, des stratégies de contournement, s’abstenant par exemple de contester le non-respect de leurs droits dans l’espoir de conserver leur liberté de circulation dans l’hôpital, voire d’obtenir une sortie d’essai. Des patients se soumettraient à un traitement neuroleptique pour ne pas être mis en chambre d’isolement ou à des injections tous les mois dans un centre médico-psychologique pour ne pas retourner à l’hôpital. D’autres renonceraient à porter plainte au sujet de manquements ponctuels pour éviter de briser le lien avec l’équipe médicale qui en a la charge. Bref, comme l’explique Mme Pauline Rhenter dans la contribution écrite qu’elle a fournie à la mission, « faire valoir ses droits est bien souvent considéré comme une stratégie perdante à court terme ». Et de ce que « l’expression de leurs revendications est précisément interprétée par le corps médical ou paramédical comme l’expression d’un symptôme ou d’une agitation à caractère pathologique », il résulte, pour de nombreuses personnes hospitalisées, une impossibilité de faire respecter leurs droits.
Les rapporteurs n’entendent pas encourager cette logique de renonciation. Comme M. André Bitton, ils estiment que « la généralisation, dans les enceintes hospitalières psychiatriques, de guichets d’accès au droit, avec des juristes indépendants […] serait susceptible d’améliorer l’état de fait actuel ».
C’est du reste ce qui se fait à Lille. M. Stéphane Dhonte, bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille, a indiqué, lors de son audition, que des points d’accès au droit avaient été ouverts dans les établissements situés dans le ressort du TGI de Lille. Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille a appelé de ses vœux la généralisation, au niveau national, de tels points d’accès au droit dans l’ensemble des établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Au-delà de cette initiative lilloise, il a suggéré qu’un numéro vert soit créé ou qu’une page du livret d’accueil des patients soit consacrée à l’information des patients sur leurs droits et leurs relations avec leur avocat.
À cet égard, les rapporteurs rappellent que, parmi les recommandations formulées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), dans le rapport d’activité pour l’année 2015, figurait celle de « prévoir une protocolisation des modalités d’information du patient et de la notification des mesures de soins sans consentement », – Mme Adeline Hazan recommandant « que le ministère de la Santé établisse un document type expliquant en termes simples les différents types d’hospitalisation sous contrainte et les voies de recours » (83).
2. Les relations des patients avec leur avocat
Du point de vue de Me Françoise Mathe, présidente de la commission Libertés et droits de l’homme du Conseil national des barreaux (CNB), le hiatus constaté entre le contenu théorique des droits reconnus par la loi du 27 septembre 2013 aux patients et leur effectivité en pratique s’explique par un « problème d’exercice des droits de la défense ».
Tout en reconnaissant, comme Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, que la loi du 27 septembre 2013 avait, comme celle du 5 juillet 2011, marqué des progrès considérables en termes de garantie des libertés fondamentales des patients, Me Françoise Mathe a expliqué que le législateur ne pouvait utilement « créer de nouveaux droits en se fondant sur la tradition de désintéressement du barreau ».
Un certain nombre de barreaux ne seraient pas en mesure d’exécuter les missions confiées aux avocats par la loi du 27 septembre 2013, à commencer par la représentation obligatoire des patients admis en soins psychiatriques sans consentement.
a. La représentation obligatoire par avocat
La loi du 27 septembre 2013 a consacré le principe d’une représentation obligatoire des patients par avocat lors des contrôles judiciaires des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Le second alinéa du I de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit en effet que lorsque le juge est saisi en application des articles L. 3211-12 (contrôle judiciaire facultatif) ou L. 3211-12-1 (contrôle judiciaire de plein droit), « à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ».
Dans la contribution écrite qu’il a remise à la mission, M. André Bitton estime qu’il s’agit là d’« une très bonne mesure ». Lors de son audition, il a expliqué que cela avait amené les avocats à s’investir dans un contentieux complexe pour lequel ils manifestaient jusqu’ici un intérêt modéré, selon lui. Il a ainsi salué les initiatives prises par certains barreaux, comme celui de Versailles dont est membre Me Raphaël Mayet, qui a également estimé que la représentation obligatoire par avocat constituait « un progrès pour la défense des personnes hospitalisées » (84).
Les rapporteurs ont pu constater que certains barreaux, comme celui de Lille, avaient mis en place une formation initiale adaptée aux spécificités du contentieux des admissions en soins psychiatriques sans consentement. M. Stéphane Dhonte, bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille, a expliqué que cette formation comprenait 9 heures d’enseignements relatifs à la psychiatrie, 3 heures d’enseignements juridiques et 2 heures d’enseignements relatifs à la déontologie.
À Paris, nous a rapporté Me Letizia Monnet-Placidi, avocate au barreau de Paris, l’ordre des avocats a mis en place des formations, dès 2010-211, afin que les avocats volontaires les ayant suivies puissent s’inscrire sur une liste de « permanenciers » (85). Le service de l’accès au droit du barreau de Paris organise ainsi une formation « initiale » à destination de ces avocats : cette formation comprend quatre modules de trois heures (trois modules de théorie illustrée par la jurisprudence et un module pratique d’étude de dossiers).
Par ailleurs, plusieurs avocats parisiens ont créé en 2013 une association « Avocats, droits et psychiatrie », qui, ayant une vocation nationale, rassemble des avocats brestois, strasbourgeois ou encore nîmois, et qui tend à développer les échanges autour des décisions de justice rendues, afin de constituer un recueil de jurisprudence.
Au barreau de Meaux, la formation des 30 avocats qui, parmi les quelque 190 avocats inscrits à ce barreau, assurent une permanence à l’audience tous les deux mois et défendent en moyenne 4 à 5 clients par audience, se limite à un « tutorat » qui consiste à accompagner un « permanencier » chevronné à au moins une audience du JLD avant d’assurer soi-même des permanences.
Le Dr Natalie Giloux, psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Le Vinatier (Bron), estime que la participation des avocats à ce type de formations contribue à éviter l’écueil qui consiste, pour l’avocat, à aborder le contentieux des soins psychiatriques sans consentement dans une optique pénale et à penser qu’il faut à tout prix plaider et obtenir la mainlevée de la mesure dont son client fait l’objet (86). Cet écueil semble être récurrent, si l’on en croit M. Benjamin Blanchet, magistrat, chargé de mission de l’Union syndicale des magistrats (USM), qui a déclaré avoir vu des avocats plaider la mainlevée de la mesure d’hospitalisation alors même que leur client souhaitait son maintien. À l’inverse, certains avocats ont confié à la mission que, quand bien même ils repéreraient une nullité procédurale, ils choisiraient de ne pas la soulever s’ils estiment que l’intérêt de leur patient est de rester hospitalisé pour bénéficier de soins.
Cet investissement des avocats serait encore insuffisant, selon M. André Bitton, qui a étayé son propos par des statistiques fournies à la mission par le ministère de la justice. Celles-ci révèlent que, depuis 2013, près de 50 % des mainlevées de mesures d’hospitalisation complète sont acquises sans débat – étant précisé que ce peut être le cas soit parce que le JLD ne rend pas de décision dans les délais, soit parce qu’il n’est pas saisi dans les délais. En effet, le codage actuel ne permet pas d’identifier les motifs d’une mainlevée sans débat : interrogés sur ce point, les services du ministère de la justice ont indiqué que, dans le prolongement du questionnaire que la mission leur a adressé, ils réfléchissaient à une évolution du codage de façon à créer deux codes distincts afin de savoir si le retard est imputable aux établissements d’accueil ou aux préfectures ou s’il est le fait du JLD. En toute hypothèse, selon ces services, seules 4 % des décisions de cour d’appel confirmant des mainlevées acquises sans débat sont motivées par le non-respect des délais par le JLD.
PART DES MAINLEVÉES DE MESURES D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ACQUISES SANS DÉBAT DEPUIS 2012
2012 * |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p ** | |
Ensemble des mainlevées de la mesure d’hospitalisation (1) |
3 820 |
5 028 |
5 144 |
6 262 |
4 971 |
– dont mainlevées acquises sans débat (2) |
1 591 |
2 477 |
2 631 |
3 108 |
2 534 |
Part des mainlevées acquises sans débat sur l’ensemble des mainlevées (2 janvier)*100 |
41,6 |
49,3 |
51,1 |
49,6 |
51,0 |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | ||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes, attention certaines demandes de contrôle semblent avoir été codées sous l’ancien code 14C ** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016 *** en 2012 et 2013, les décisions rendues par les TGI de Fort de France, de Béziers et Metz ne sont pas prises en compte en raison d’un problème de codage. | |||||
Les rapporteurs estiment pour leur part que l’efficacité des avocats dans la procédure de contrôle judiciaire des mesures de soins sans consentement pourrait être meilleure si les conditions de leur intervention – et notamment les délais dont ils disposent pour prendre connaissance des dossiers – étaient améliorées.
b. Les conditions de prise de connaissance des dossiers des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement
Dans la contribution écrite qu’il a fournie à la mission par l’intermédiaire du CRPA, Me Raphaël Mayet, avocat au barreau de Versailles, explique qu’en réduisant de 15 à 12 jours le délai dans lequel le JLD doit, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, impérativement se prononcer sur une mesure d’hospitalisation complète sans consentement, la loi du 27 septembre 2013 a posé des « problèmes d’ordre pratique », en particulier dans les départements comptant plusieurs lieux d’audience. D’après lui, « les dossiers sont transmis au juge très peu de temps avant l’audience, très souvent même la veille de celle-ci », et « l’avocat, s’il n’est pas choisi par le patient, n’aura pas le temps nécessaire pour entrer en contact avec son client, préparer sa défense dans un délai raisonnable et communiquer au juge ses conclusions avant l’audience ».
Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, président de la commission « hospitalisation d’office et personnes vulnérables » du Syndicat des avocats de France (SAF), a confirmé ces propos. Dans la contribution écrite qu’il a fournie à la mission, il note que « la réduction du délai de saisine du JLD peut entraîner des délais si courts, entre cette saisine et la mise à disposition du dossier, que l’avocat en arrive à ne pas disposer du temps nécessaire pour assurer une défense de qualité : autant il est opportun que ce délai de saisine ait été réduit, autant il est dommageable qu’il n’y ait pas un délai obligatoire incompressible, préalable à l’audience, pour la mise à disposition du dossier auprès de l’avocat ».
Et lors de son audition, M. André Bitton, président du CRPA, a corroboré ce constat, expliquant que certains avocats (notamment « de permanence ») ne prennent connaissance des dossiers de leurs clients que quelques minutes (ou une heure, tout au plus) avant l’audience du JLD (87). D’après Me Letizia Monnet-Placidi, avocate au barreau de Paris, le parcours de l’avocat pour prendre un contact (notamment téléphonique) avec son client serait « semé d’embûches ». Si l’ordre des avocats dispose d’une liste des personnes référentes dans les établissements d’accueil, il semblerait que « les documents remis à l’avocat ne portent que rarement la ligne directe du service où se trouve son client », de sorte que « l’avocat doit consacrer un temps très important à le joindre, sans certitude d’y parvenir », dans la mesure où il « se heurte parfois à un refus du personnel soignant de lui passer son client, certaines personnes hospitalisées n’ayant pas accès au téléphone sur prescription médicale, d’autres [étant] placées à l’isolement » (88).
Afin d’améliorer les conditions dans lesquelles s’exerce la défense des personnes admises en soins sans consentement, Me Raphaël Mayet a donc proposé d’« imposer un délai minimal d’un jour franc entre la saisine et l’audience pour permettre de préparer utilement la défense des personnes hospitalisées ».
Cette proposition rejoint, dans une certaine mesure, la pratique adoptée par le barreau de Lille qui, après avoir obtenu l’engagement que les dossiers des patients admis en soins sans consentement seraient transmis aux avocats au moins 48 heures avant l’audience du JLD, a mis fin, le 14 novembre dernier, à la « grève » de la désignation d’avocats commis d’office qu’il conduisait depuis 2011, estimant qu’il n’était pas en capacité d’accomplir correctement ses missions au vu de la faiblesse du montant de l’aide juridictionnelle.
Les représentants du barreau de Lille ont expliqué, devant la mission, que ce délai minimal de 48 heures était nécessaire pour assurer une défense de qualité conforme au « vade-mecum relatif à la déontologie de l’hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers », que ce barreau a publié en 2011. Selon Me Aurore Bonduel, une telle défense suppose, outre une formation initiale, au moins trois déplacements de l’avocat dans l’établissement d’accueil : le premier pour recueillir son mandat et interroger le patient sur son souhait de demander la mainlevée ou le maintien de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet ; le deuxième pour assister ou représenter le patient à l’audience ; et le troisième pour informer le patient sur le sens de la décision du JLD et sur ses voies de recours possibles (89), dont certains avocats souhaiteraient, s’agissant de l’appel, qu’il n’ait plus à être obligatoirement motivé (90).
Les représentants de ce barreau ont proposé que ce délai soit inscrit dans la loi – ce qui leur paraît d’autant plus faisable que la dématérialisation des procédures facilite la communication du dossier du patient au greffe. À cet égard, la mission a pu constater que cette dématérialisation n’était pas acquise sur l’ensemble du territoire.
Au TGI de Paris, les dossiers sont transmis au greffe, puis, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), à l’ordre des avocats (à charge pour ce dernier de le transmettre aux avocats « permanenciers »), le tout sous forme numérisée et cryptée (91). Me Letizia Monnet-Placidi, avocate au barreau de Paris, a précisé que, malgré cette dématérialisation, les avocats n’avaient communication du dossier que tardivement, moins de 24 heures avant l’audience. D’après le greffe du TGI, cela tiendrait au caractère tardif non seulement de la saisine du JLD (au septième ou huitième jour suivant l’admission du patient), mais aussi de la saisie informatique des dossiers par les établissements d’accueil : selon Me Letizia Monnet-Placidi, le dernier avis médical n’est en effet adressé au greffe que la veille de l’audience (en soirée), voire le jour même de l’audience, de sorte que c’est « au dernier moment que l’avocat découvre que son client, déclaré non-auditionnable, ne sera pas présent à l’audience » (92).
Au TGI de Meaux, les dossiers sont consultables au format papier au greffe le matin du jour de l’audience du JLD. Et, d’après Me Laetitia Joffrin, membre du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Meaux en charge de la commission pénale, les avocats ne disposent le plus souvent que de cinq à dix minutes pour s’entretenir avec leur client avant l’audience.
Interrogés sur l’opportunité de consacrer dans les textes un délai d’un jour franc ou de 48 heures entre la communication du dossier à l’avocat et la tenue de l’audience, aussi bien Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, et les services du ministère de la justice que l’association des directeurs d’établissements participant au service public de santé mentale (ADESM) (93) s’y sont déclarés hostiles, soulignant :
– l’inutilité d’une telle modification des textes, dans la mesure où tant l’avocat que le JLD n’ont que rarement le temps de prendre connaissance du dossier avant l’audience ;
– les inconvénients qui pourraient en résulter, en faisant peser des contraintes excessives sur les établissements d’accueil et en ouvrant la voie à une nouvelle nullité procédurale susceptible de provoquer des mainlevées en masse, si le délai de communication du dossier n’était pas respecté.
C’est aussi le sentiment de M. Michel Dutrus, conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, délégué général de FO Magistrats, qui a prévenu que, si un tel délai devait être introduit dans les textes, la responsabilité de la complétude du dossier ne devrait en aucun cas reposer sur les greffes dont il a néanmoins été indiqué à la mission que certains d’entre eux n’hésitaient pas à faciliter le travail des parties à la procédure que sont les établissements d’accueil en leur rappelant les pièces à fournir et les délais pour les transmettre, ni à organiser eux-mêmes la répartition des dossiers aux audiences des JLD.
De son côté, M. Benjamin Blanchet, magistrat, chargé de mission de l’Union syndicale des magistrats (USM), a lui aussi estimé que, si un tel délai était souhaitable en théorie, il pourrait difficilement être respecté en pratique, les dossiers étant très souvent encore incomplets à la date de l’audience.
Selon ce dernier, plutôt que d’inscrire dans les textes un délai minimal entre la communication du dossier à l’avocat et la tenue de l’audience, il serait préférable de mobiliser les établissements d’accueil pour qu’ils adoptent des chartes de bonnes pratiques en la matière. C’est aussi le point de vue exprimé par M. Guillaume Meunier, sous-directeur du droit civil à la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) du ministère de la justice, qui a jugé plus opportun d’améliorer les pratiques locales en matière de dématérialisation et d’accélération des procédures.
3. La question de l’aide juridictionnelle
D’après les données fournies à la mission par le ministère de la justice, en 2015, parmi 56 770 affaires terminées dans lesquelles au moins une partie aurait été représentée par un avocat, il n’y en aurait que 724 pour lesquelles il serait fait mention de l’attribution d’au moins une aide juridictionnelle (soit 1,3 %).
AFFAIRES TERMINÉES RELATIVES AUX SOINS SANS CONSENTEMENT POUR LESQUELLES IL EST MENTIONNÉ LA REPRÉSENTATION D’AU MOINS UNE DES PARTIES PAR AVOCAT ET SITUATION AU REGARD DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | ||||
Ensemble des affaires terminées avec représentation d’au moins une partie par un avocat (1) |
15 050 |
20 653 |
31 781 |
56 770 |
47 747 | |||
dont affaires pour lesquelles il est fait mention de l’attribution d’au moins une aide juridictionnelle (2) |
621 |
583 |
129 |
724 |
932 | |||
Part des affaires avec représentation d’une des parties par un avocat pour lesquelles il est fait mention de l’aide juridictionnelle (3/1)*100 |
4,1 |
2,8 |
0,4 |
1,3 |
2,0 | |||
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | |||||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes. ** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016. | ||||||||
Toujours selon le ministère de la justice, le budget de l’aide juridictionnelle dévolu à l’assistance et à la représentation par avocat des malades admis en soins psychiatriques sans consentement, en première instance et en appel, serait, en 2015, de 5 663 397 euros (toutes taxes comprises) – ce qui signifierait qu’en moyenne, 7 822 euros auraient été versés dans chacune des 724 affaires terminées la même année pour lesquelles il est fait mention de l’attribution d’au moins une aide juridictionnelle.
Les personnes entendues ont fait état de leur incompréhension face à ces données. M. André Bitton a déclaré que les personnes admises en soins sans consentement bénéficiaient aussi souvent que possible de l’aide juridictionnelle.
Ce constat est corroboré par les statistiques fournies à la mission par Me Yves Tamet, président de la commission Accès au droit et à la justice du Conseil national des barreaux (CNB). D’après ce dernier, les chiffres établis par l’Union nationale des caisses de règlement pécuniaire des avocats (UNCA) indiquent que, sur 69 800 décisions rendues en 2014 par les JLD et les Cours d’appel en matière de soins psychiatriques sans consentement, 31 781 l’ont été dans des affaires où au moins un avocat était intervenu. Et sur ces 31 781 affaires, au moins une aide juridictionnelle avait été versée dans 27 225 affaires (soit 86 % des affaires ayant donné lieu cette année-là à l’intervention d’un avocat). Pour l’année 2015, où 77 386 décisions ont été rendues par les JLD et les cours d’appel, au moins un avocat est intervenu dans 56 770 affaires dont 50 336 (soit près de 89 %) ont donné lieu au versement d’au moins une aide juridictionnelle.
D’après Me Yves Tamet, le taux de diffusion de l’aide juridictionnelle dans le contentieux des soins sans consentement est donc de 90 % (94).
Interrogés sur l’écart considérable entre les chiffres fournis par l’UNCA et ceux qu’ils ont transmis à la mission, les services du ministère de la justice ont admis que le taux de diffusion de l’aide juridictionnelle établi par l’UNCA était certainement plus proche de la réalité que celui résultant des statistiques du ministère, pour la bonne et simple raison qu’un problème de sous-enregistrement massif des informations relatives à l’attribution de l’aide juridictionnelle a été identifié au sein des juridictions.
Toujours est-il qu’en instituant un principe de représentation obligatoire par avocat des patients lors des contrôles judiciaires des mesures de soins psychiatriques sans consentement, la loi du 27 septembre 2013 pourrait avoir modifié la nature du mandat de l’avocat, qui pourrait être considéré comme légal.
Du point de vue des rapporteurs, il serait souhaitable qu’en cohérence, le bénéfice de l’aide juridictionnelle soit alloué de plein droit aux personnes vulnérables faisant l’objet de mesures d’admission en soins psychiatriques sans consentement, de la même façon que les mineurs entendus par le juge aux affaires familiales ou par le juge des enfants dans une procédure les concernant bénéficient de plein droit de cette aide, sans condition de revenus (95). Dans la mesure où, dans cette dernière hypothèse, c’est la loi qui prévoit l’octroi de plein droit de l’aide juridictionnelle aux mineurs concernés, il semblerait, d’après les services du ministère de la justice, la mesure prévoyant l’allocation d’office de cette aide aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement relève du niveau législatif.
Aussi bien Me Yves Tamet que M. Stéphane Dhonte, bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille, se sont prononcés en ce sens, soulignant que l’octroi d’une aide juridictionnelle d’office ne prive nullement le justiciable du choix de son avocat.
Cette mesure a également recueilli l’adhésion des représentantes du Syndicat de la magistrature.
Recommandation n° 13 : reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle de plein droit aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement.
Une telle mesure constituerait tout d’abord une simplification administrative. En effet, comme l’a expliqué Me Yves Tamet lors de son audition, les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement rencontrent très souvent des difficultés à remplir le dossier de demande d’une aide juridictionnelle. En outre, l’urgence dans laquelle se déroule la procédure de contrôle judiciaire des mesures d’hospitalisation permet rarement, sinon jamais, au bureau d’aide juridictionnelle de traiter les demandes d’aide avant la tenue de l’audience (96).
À cet égard, les rapporteurs forment le vœu que la situation s’améliore à la faveur de l’extension récente (97), aux procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques mentionnées au IV.8 de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 (98), des protocoles relatifs aux rétributions allouées pour les missions d’aide juridictionnelle en matière pénale qui sont passés entre les TGI et les barreaux sur le fondement de l’article 91 du même décret (99).
Par ailleurs, l’impact d’une telle mesure sur les finances publiques serait négligeable quand on sait que, d’après les représentants du CNB, près de 90 % des personnes admises en soins sans consentement et assistées ou représentées par un avocat bénéficient d’ores et déjà de l’aide juridictionnelle (100). À cet égard, l’ensemble des représentants de la Conférence nationale des présidents de TGI que la mission a entendus (à savoir M. Gilles Accomando, président du TGI d’Avignon, Mme Joëlle Munier, présidente du TGI d’Albi, et Mme Marie-Christine Leprince, présidente du TGI de Caen) ont déclaré qu’au sein de leur juridiction, l’octroi de l’aide juridictionnelle était systématique et qu’il n’était pas même demandé aux patients de fournir des pièces justificatives. Il semblerait que ce soit également le cas au TGI de Meaux, d’après Me Laetitia Joffrin, membre du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Meaux en charge de la commission pénale.
Interrogé sur la faisabilité de la réforme proposée, M. Guillaume Meunier, sous-directeur du droit civil à la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) du ministère de la justice, a répondu que, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, elle pourrait être envisagée dans l’avenir, mais pas à court terme.
À défaut d’une telle mesure, on pourrait concevoir, comme le suggère Me Raphaël Mayet dans la contribution écrite qu’il a fournie à la mission, que, « pour les personnes ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle, la question d’une tarification de l’intervention de l’avocat pourrait être envisagée utilement avec une mission qui pourrait être confiée aux ordres des avocats de définir un barème indicatif ».
S’agissant d’une assistance ou représentation imposée par la loi, le droit de la concurrence devrait s’effacer. On voit d’ailleurs mal comment la concurrence pourrait concrètement être organisée en la matière.
Le même Raphaël Mayet a également proposé que, compte tenu du transfert en milieu hospitalier des audiences opéré par la loi du 27 septembre 2013, et compte tenu de l’éloignement géographique des lieux d’hospitalisation, « une prise en charge d’un forfait de déplacement par audience au titre de l’aide juridictionnelle pourrait utilement être mise en place », afin d’éviter que les avocats n’interviennent à perte.
Si la réforme de 2013 a fait évoluer la nature du mandat et de la défense de l’avocat, au point qu’on peut envisager l’octroi systématique de l’aide juridictionnelle aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, elle a aussi fait évoluer le contrôle exercé par le juge, qui, selon M. Gilles Accomando, président du TGI d’Avignon et président de la conférence nationale des présidents de TGI, semble désormais être un sujet d’interrogations moins pour le corps médical que pour le juge lui-même, tant les contours de son office sont délicats à tracer.
B. DES MARGES DE PROGRÈS DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE L’OFFICE DU JUGE À L’AUDIENCE
Comme le rappellent le Dr Natalie Giloux, psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier de Bron, et Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, dans leur article sur « Le psychiatre et le juge face à la protection de la personne dans les soins contraints », « l’entrée en vigueur de la loi [du 5 juillet 2011] a constitué un bouleversement. Elle a obligé les psychiatres à soumettre au regard du juge l’ensemble de leurs décisions concernant les hospitalisations sans consentement qui perdurent au-delà d’un certain délai […] : c’était en même temps leur demander de rendre compte, dans un langage accessible, des raisons pour lesquelles ils estiment qu’une hospitalisation complète contrainte est nécessaire. […] En imposant le contrôle judiciaire prévu par la Constitution pour toute privation de la liberté individuelle, la loi de 2011 a démontré à de nombreux endroits l’intégration constructive par les psychiatres de l’esprit des lois, comme leur volonté de réflexion et d’interrogation des pratiques, qu’elles soient médicales ou juridictionnelles. Elle a également obligé les juges à se plonger de manière régulière et systématique dans un domaine qu’ils n’abordaient jusqu’ici que ponctuellement. […] Parce qu’il y a atteinte à cette liberté individuelle qu’est la liberté d’aller et de venir et à ce droit fondamental qu’est le libre consentement aux soins, le juge judiciaire est l’autorité compétente pour exercer son contrôle. […]. Le juge qui confondrait le contrôle du bien-fondé de l’hospitalisation qu’il doit mener au vu des certificats, avec sa propre évaluation d’un trouble psychique chez la personne qu’il entend à l’audience, ferait fausse route. En effet, l’office du juge en cette matière est de vérifier que les conditions légales sont remplies : ainsi, essentiellement, de contrôler que l’existence de troubles psychiatriques nécessitant des soins en hospitalisation complète est rapportée par les certificats et avis médicaux et qu’il est également établi par ces mêmes certificats et avis que le consentement de cette personne ne peut être recueilli eu égard aux troubles qui sont les siens. À aucun moment, la loi ne demande au juge d’apprécier lui-même l’existence de troubles psychiatriques, et pour cause, il n’a aucune formation pour ce faire et n’est donc en rien compétent pour cela. De la même manière, à aucun moment le juge n’a à apprécier lui-même la capacité du patient de consentir aux soins, cette capacité relevant d’une appréciation médicale complexe, définie par la Haute Autorité de Santé, que seul le psychiatre peut mener puis rapporter dans les certificats. […] La place du juge dans la garantie de la liberté d’aller et de venir et du droit au libre consentement aux soins ne peut donc être assurée que si le juge maintient sa position de juge, et ne s’en départ pas » (101).
Or la mission a pu constater qu’il restait encore des marges de progrès, dans l’accomplissement de l’office du juge, tant pour ce qui concerne son investissement dans ce contentieux que pour qui est des conditions de tenue de l’audience.
1. Les magistrats dans le contentieux des soins psychiatriques sans consentement
a. L’augmentation du nombre de saisines du juge des libertés et de la détention (JLD)
Lors de son audition, Mme Magali Coldefy, maître de recherche à l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), a expliqué qu’en cohérence avec la hausse du nombre de personnes soignées sans leur consentement, le nombre total de saisines du JLD a connu une hausse continue depuis la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (+ 27 % entre 2012 et 2015).
Cette hausse est encore plus significative depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 qui a raccourci le délai d’intervention du JLD dans le cadre du contrôle judiciaire de plein droit des mesures d’hospitalisation complète. Le JLD doit en effet statuer sur la régularité de ces mesures dans les 12 jours suivant l’admission de la personne en soins psychiatriques sans consentement (et non plus dans un délai de 15 jours comme le prévoyait la loi du 5 juillet 2011) (102).
ÉVOLUTION 2011-2016 DU NOMBRE DES SAISINES DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
|
2011 |
2012** |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p* |
Ensemble des saisines JLD |
24 657 |
60 526 |
65 862 |
70 810 |
77 931 |
64 200 |
Demande relative à l’internement d’une personne |
24 657 |
4 761 |
||||
Demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt |
2 916 |
2 840 |
3 073 |
1 998 |
1 489 | |
Demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt |
403 |
570 |
523 |
408 |
387 | |
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète |
52 403 |
62 371 |
67 123 |
75 451 |
62 252 | |
Demande de contrôle de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet |
43 |
81 |
91 |
74 |
72 | |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-SDSE | |||||
* 2016p : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016. ** Les nouveaux codes ont pris effet à compter de 2012. | ||||||
La hausse globale du nombre des saisines du JLD provient très majoritairement des saisines dans le cadre de ce contrôle obligatoire : ces saisines représentaient 96,8 % de l’ensemble des saisines du JLD en 2015, contre 94,4 % en 2013.
On constate parallèlement une diminution des saisines du JLD dans le cadre de son contrôle facultatif : la part de ces saisines rapportée au nombre total des saisines du JLD était de 3,1 % en 2015, contre 5,2 % en 2013.
Selon Mme Magali Coldefy, cette baisse des saisines dites « facultatives » pourrait s’expliquer en partie soit par une meilleure information des patients, soit, au contraire, par une information insuffisante ou inadaptée sur les droits et recours de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement.
S’agissant de ces recours, les rapporteurs notent que leur nombre tend à augmenter : d’après les chiffres fournis par le ministère de la justice, le nombre d’appels interjetés contre les décisions des JLD en matière de soins psychiatriques sans consentement, sur l’ensemble du territoire, est ainsi passé de 2 049 en 2012 à 2 150 en 2013, 2 428 en 2014 et 2 882 en 2015 – soit une progression de plus 40 % entre 2012 et 2015, qui est supérieure à celle du nombre de saisines du JLD sur la même période (+ 27 %). Pour l’année 2016, on en dénombrait 2 403 au 15 décembre dernier.
Enfin, les saisines du JLD en cas de désaccord entre les psychiatres et le représentant de l’État dans le département sont rares, les établissements d’accueil renonçant le plus souvent à engager avec le préfet un « bras de fer » (pour reprendre la formule employée par les personnes entendues à l’IPPP). On n’en dénombre que 74 en 2015 (103). Le JLD suit d’ailleurs l’avis du préfet dans plus de 70 % des cas, comme le montre le tableau ci-dessous, fourni par le ministère de la justice.
DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE LA NÉCESSITÉ D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE EN CAS DE DÉSACCORD
ENTRE PSYCHIATRES ET PRÉFET
Nombre de demandes introduites au cours de l’année |
Nombre de décisions rendues au cours de l’année | |||
Total des décisions * |
Dont décisions de maintien de l’hospitalisation complète (2) |
Taux de maintien de l’hospitalisation complète **** (en %) (2/1)*100 | ||
2012 ** |
43 |
39 |
26 |
66,7 |
2013 |
81 |
79 |
59 |
74,7 |
2014 |
91 |
89 |
64 |
71,9 |
2015 |
74 |
69 |
50 |
72,5 |
2016p *** |
72 |
62 |
37 |
59,7 |
Source : SDSE-RGC Exploitation DACS-PEJC * hors jonction et interprétation. ** 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes. *** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016. **** le taux de maintien de l’hospitalisation correspond au taux de confirmation de la décision du représentant de l’État. | ||||
La procédure de saisine du JLD en cas de désaccord
entre les psychiatres et le représentant de l’État
L’article L. 3213-3 du code de la santé publique prévoit que « dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée [par le représentant de l’État] ou résultant [d’un jugement ou d’un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental] et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade […] demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. […] Après réception des certificats ou avis médicaux […] et, le cas échéant, de l’avis du collège [comprenant un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient] et de l’expertise psychiatrique [susceptible d’avoir été ordonnée] et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du collège [précité] recommandant la prise en charge [d’un patient médico-légal] sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise. […] Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’État décide d’une prise en charge [sous une forme autre que l’hospitalisation complète : soins ambulatoires, soins à domicile, hospitalisation à domicile, séjours à temps partiel ou séjours de courte durée à temps complet dans un établissement autorisé en psychiatrie et chargé d’assurer les soins psychiatriques sans consentement]. Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’État maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure ». Cette saisine n’a toutefois pas lieu d’être lorsque la décision du représentant de l’État est intervenue dans le délai de 12 jours dans lequel le JLD doit se prononcer sur une mesure d’hospitalisation complète.
L’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique prévoit que « si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement [décidée par le représentant de l’État] peut être levée ou que le patient peut être pris en charge [sous une forme autre que l’hospitalisation complète], le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’État, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre […] confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge [sous une forme autre que l’hospitalisation complète].
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre […] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’État maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure » – étant précisé que cette saisine n’a pas lieu d’être lorsque la décision du représentant de l’État est intervenue dans le délai de 12 jours dans lequel le JLD doit se prononcer sur une mesure d’hospitalisation complète.
Après avoir indiqué que les préfets avaient mal vécu les réformes de 2011 et de 2013, qu’ils ont perçues comme faisant peser sur eux le soupçon d’attenter aux libertés publiques et comme une forme de « mise sous tutelle » du JLD, M. Jean-François Carenco, préfet de la région Île-de-France, président de l’association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur, a expliqué que les préfets pouvaient être enclins à demander l’avis d’un second psychiatre pour s’exonérer de toute responsabilité en cas d’infraction ou de dommage causé par le patient après la levée de son hospitalisation. Le préfet étant lié par l’avis du second psychiatre s’il concorde avec celui du premier, il n’est en effet plus responsable.
C’est la raison pour laquelle le recueil de l’avis d’un second psychiatre tendrait à devenir systématique, comme l’ont fait remarquer aussi bien les représentants des directeurs d’établissements de santé mentale que ceux de syndicats de psychiatres. Ces derniers ont ajouté que les préfets opposeraient par ailleurs des refus trop systématiques aux demandes d’aménagement des soins ou de sorties (104). D’après le Dr Christian Muller, président de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers spécialisés (CME-CHS), ces refus seraient en outre fondés sur des considérations plus sécuritaires que sanitaires, notamment au regard de situations de radicalisation. Il a toutefois été signalé à la mission, lors de ses déplacements, tant à Paris qu’à Meaux, que les patients présentant des signes de radicalisation étaient très rares : aussi bien le pôle du bureau des actions de santé mentale (BASM) de la préfecture de police de Paris chargé des signalements que M. Jean-Paul Novella, vice-président du TGI de Meaux, estiment que les propos qui peuvent laisser suspecter une radicalisation chez certains patients relèvent plus du délire mystique qu’autre chose.
Qui plus est, face à des demandes de levées d’hospitalisation complète, les préfets subordonneraient parfois leur décision à l’indication, dans les certificats médicaux, de l’administration au patient d’un traitement neuroleptique « retard » (105). C’est du moins ce qui a été rapporté à la mission par le Dr Philippe Gasser, président de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP).
M. Jean-François Carenco a vigoureusement nié l’assertion selon laquelle certains préfets ne seraient pas loin d’intervenir dans la définition du programme de soins, qui est en principe de la seule compétence des médecins. Tout au plus s’assurent-ils de la progressivité des sorties, qu’ils souhaiteraient courtes et accompagnées dans un premier temps, puis non-accompagnées dans un second temps. Lors de sa visite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), il a été indiqué à la mission que le préfet de police de Paris appréciait l’opportunité de la mise en place ou de l’abrogation d’un programme de soins au regard des faits générateurs d’une mesure d’admission en soins sans consentement à la demande du représentant de l’État (106), mais qu’en aucun cas le préfet n’appréciait le contenu du programme de soins.
Cette analyse a été confortée par celle de Mme Geneviève Castaing, cheffe du bureau de la santé mentale à la Direction générale de la santé (DGS), qui a déclaré, lors de son audition, n’avoir jamais eu connaissance de pratiques d’intervention des préfets dans la conception du programme de soins.
Pourtant, aussi bien M. Jean-Pierre Staebler, directeur du centre hospitalier de Montfavet, représentant de la conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH), que le Dr Christian Muller ont confirmé que, face à une proposition de sortie d’un patient, les préfets étaient souvent « très attentifs » au contenu du programme de soins dont ils seraient parfois amenés à négocier le contenu ou à refuser la levée.
La mission a été frappée des interprétations aussi diverses que discutables dont le dispositif de programme de soins fait l’objet, tant du côté des préfectures que du côté des établissements d’accueil et des psychiatres : il semblerait par exemple que les motifs permettant de décider la réhospitalisation d’un patient suivant un programme de soins ne soient pas clairs et que des hésitations existent quant à la question de savoir si celle-ci peut être motivée soit par un constat de non-respect du programme, soit par un simple risque de rechute médicalement constaté.
Sans doute le dispositif encadrant la mise en œuvre des programmes de soins gagnerait-il à être clarifié par des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) qui permettraient en outre d’harmoniser les pratiques en la matière sur l’ensemble du territoire.
Recommandation n° 14 : demander à la Haute Autorité de santé (HAS) d’élaborer des recommandations relatives aux conditions de mise en place, de modification et de levée des programmes de soins.
Ces recommandations seraient d’autant plus souhaitables que, d’après le Dr Jean Ferrandi, secrétaire général du Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP), certains JLD, notamment en Île-de-France, seraient également « très attentifs » au contenu des programmes de soins (107). Tout en suggérant que, s’il est ainsi conçu, le programme de soins devrait être rebaptisé « programme de surveillance », le Dr Michel Triantafyllou, président du SPEP, a ainsi rapporté que certains JLD subordonnaient leur décision de mainlevée à l’accomplissement, par le patient, de consultations dans des centres médico-psychologiques.
D’après les données fournies à la mission par le ministère de la justice, moins d’une saisine du JLD sur dix aboutit à une mainlevée de la mesure (108). Ce faible taux de mainlevée contribuerait, selon les JLD du TGI de Paris entendus par la mission, à décontenancer voire à décourager les magistrats, dont beaucoup considéreraient que la procédure de contrôle des admissions en soins psychiatriques sans consentement demande beaucoup de travail pour de maigres résultats.
SORT DES DEMANDES DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
PAR LE PATIENT OU PAR TOUTE PERSONNE AGISSANT DANS SON INTÉRÊT
|
2012 * |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p ** |
Ensemble des décisions prononcées *** (hors jonction et interprétation) (1)=(2+3) |
2 060 |
2 172 |
2 831 |
1 895 |
1 398 |
Décisions ne statuant pas sur la demande (2) |
282 |
357 |
301 |
178 |
125 |
dont désistement |
111 |
126 |
117 |
57 |
45 |
dont caducité |
16 |
38 |
26 |
15 |
9 |
dont dessaisissement au titre de l’article 384 du CPC |
42 |
58 |
40 |
34 |
27 |
Décisions statuant sur la demande (3) |
1 778 |
1 815 |
2 530 |
1 717 |
1 273 |
maintien de la mesure d’hospitalisation (4) |
1 359 |
1 460 |
2 078 |
1 480 |
1 082 |
mainlevée de la mesure d’hospitalisation |
419 |
355 |
452 |
237 |
191 |
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions (4/1)*100 |
66,0 |
67,2 |
73,4 |
78,1 |
77,4 |
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions statuant sur la demande (4/3)*100 |
76,4 |
80,4 |
82,1 |
86,2 |
85,0 |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | ||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes. ** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016. *** en 2012 et 2013, les décisions rendues par les TGI de Fort de France, de Béziers et Metz ne sont pas prises en compte en raison d’un problème de codage. | |||||
SORT DES DEMANDES DE CONTRÔLE OBLIGATOIRE PÉRIODIQUE DE LA NÉCESSITÉ D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | ||||
Nombre de demandes formées devant le JLD au cours de l’année |
52 403 |
62 366 |
67 120 |
75 450 |
62 251 | |||
Nombre de décisions prononcées (hors jonction et interprétation) (1)=(2+3) |
49 661 |
61 060 |
65 986 |
74 834 |
60 729 | |||
Décisions ne statuant pas sur la demande (2) |
5 247 |
5 501 |
4 772 |
4 008 |
2 953 | |||
dont désistement |
2 025 |
1 861 |
1 653 |
1 462 |
1 107 | |||
dont caducité |
952 |
1 150 |
968 |
806 |
544 | |||
dont dessaisissement au titre de l’article 384 du CPC |
1 023 |
1 125 |
1 030 |
1 084 |
787 | |||
Décisions statuant sur la demande (3) |
44 414 |
55 559 |
61 214 |
70 826 |
57 776 | |||
maintien de la mesure d’hospitalisation (4) |
40 594 |
50 531 |
56 070 |
64 564 |
52 805 | |||
mainlevée de la mesure d’hospitalisation**** |
3 820 |
5 028 |
5 144 |
6 262 |
4 971 | |||
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions (4/1)*100 |
81,7 |
82,8 |
85,0 |
86,3 |
87,0 | |||
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions statuant sur la demande (4/3)*100 |
91,4 |
91,0 |
91,6 |
91,2 |
91,4 | |||
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | |||||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes, attention certaines demandes de contrôle semblent avoir été codées sous l’ancien code 14C (4 761 demandes). | ||||||||
Toutefois, d’après Mme Magali Coldefy, on constate des variations importantes entre les départements : de 0 à 38 % en 2015 pour les décisions prises dans le cadre du contrôle obligatoire du JLD. Par exemple, comparant la jurisprudence des juridictions parisiennes et versaillaises, Mme Corinne Vaillant, avocate et présidente de l’association « Avocats, droit et psychiatrie », a jugé « curieux de voir comment des juridictions aussi proches [géographiquement] peuvent rendre des décisions aussi différentes » : tantôt le défaut de notification de ses droits au patient serait regardé comme ne portant pas une atteinte telle à ses droits qu’elle justifie la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, tantôt ce serait le contraire.
La mission a elle-même pu constater qu’alors qu’au TGI de Paris, le taux de mainlevée avoisinerait 2 % à 3 % des saisines du JLD, les JLD du TGI de Meaux n’ont ordonné, en 2016, aucune mainlevée dans le cadre de leur contrôle obligatoire au douzième jour suivant l’admission (soit un taux de mainlevée de 0 %). Par ailleurs, lors de sa visite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), la mission a appris que, si les taux de mainlevée étaient globalement homogènes entre les quatre TGI (Paris, Bobigny, Créteil et Évry) qui connaissent des mesures d’admissions en soins psychiatriques sans consentement décidées par le préfet de police de Paris, ces taux pouvaient varier significativement d’un JLD à l’autre, au sein d’un même TGI.
Selon Mme Magali Coldefy, la proportion de mainlevées est plus élevée, mais reste limitée dans le cas des saisines facultatives effectuées par les patients ou leurs proches (13,5 % en 2015).
Cette proportion de mainlevées est encore plus élevée en cas de saisine du JLD à la suite d’un désaccord entre les psychiatres et le représentant de l’État puisque 25,4 % des saisines ont abouti à une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en 2015.
PART DES SAISINES DU JLD ABOUTISSANT À UNE MAINLEVÉE DE LA MESURE EN 2015
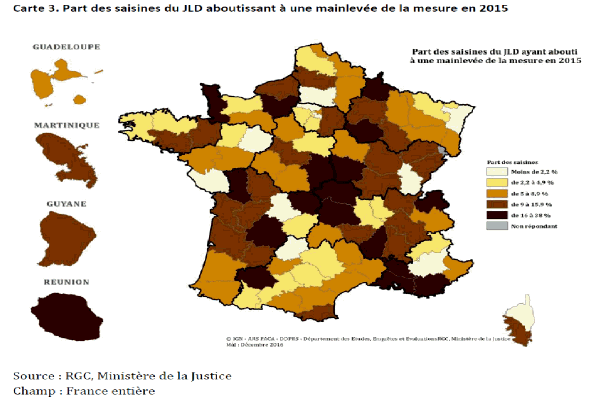
Source : RGC, Ministère de la justice.
Champ : France entière.
Mme Magali Coldefy a indiqué à la mission que la forte variabilité de la proportion des mainlevées dans le cadre du contrôle obligatoire du JLD pouvait s’expliquer aussi bien par la qualité des certificats médicaux établis par les professionnels de santé que par les pratiques des JLD.
b. La recherche de l’office du juge
Me Françoise Mathe, présidente de la commission Libertés et droits de l’homme du Conseil national des barreaux (CNB), a suggéré que les fortes disparités territoriales en matière de taux des mainlevées pouvaient être liées à l’attitude plus ou moins libérale des établissements de santé – qui recourraient plus ou moins aux mesures d’hospitalisation complète – qu’à celle des JLD – dont il faut rappeler qu’ils sont amenés à contrôler la régularité des mesures d’hospitalisation complète sur la base de documents limités (décision d’admission du directeur d’établissement et certificats médicaux circonstanciés) et dans des délais contraints.
Selon M. André Bitton, président du CRPA, certains JLD montreraient un intérêt tout relatif pour la procédure de contrôle judiciaire des mesures de soins sans consentement (109).
Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, a elle aussi convenu que les JLD pouvaient s’investir à des degrés divers dans le contentieux des soins psychiatriques sans consentement, signalant cependant que cela pourrait changer à la faveur de la réforme qui rend la fonction statutaire à compter du 1er septembre 2017 (110). Cette réforme du statut du JLD peut conduire à interdire la délégation d’un juge d’instance pour tenir les audiences dans un établissement de santé plus proche du tribunal d’instance que du TGI. Elle pourrait néanmoins aussi remédier au déficit de spécialisation, de connaissance du territoire et du personnel soignant qui a été identifié par les représentantes du Syndicat de la magistrature lors de leur audition – à condition qu’il y ait suffisamment de candidats aux postes de JLD. Ce ne semble pas être le cas à ce jour. Les JLD du TGI de Paris ont indiqué à la mission que, pour l’heure, le nombre de candidats représentait les deux tiers du nombre de postes à pourvoir sur l’ensemble du territoire (7 candidatures pour 11 postes à Paris) (111).
Au-delà des effets attendus de cette réforme statutaire, les JLD bénéficient de formations en matière de contentieux des soins psychiatriques sans consentement qui peuvent les aider à mieux en comprendre les enjeux. Dans le cadre de la formation initiale à l’École nationale de la magistrature (ENM), le nombre de stages extérieurs en centres hospitaliers spécialisés effectués par les auditeurs de justice est passé de 1 en 2011 (promotion 2009) à 10 en 2014 (promotion 2012) et 23 en 2017 (promotion 2015) (112).
Dans le cadre de la formation continue, le ministère de la justice a assuré à la mission que « la formation en matière psychiatrique est très largement traitée par l’École nationale de la magistrature au-delà même de propositions de stage. […] Deux sessions de formation continue sont proposées aux magistrats sur cette thématique spécifique dont l’une est complétée par la mise en place d’un e-learning accessible aux magistrats et greffiers. Par ailleurs, trois formations plus globales comprennent une partie consacrée à la formation en matière psychiatrique et notamment celle consacrée à la pratique des fonctions de juge des libertés et de la détention » (113).
Une première action de formation spécifique sur la psychiatrie et la justice pénale aborde, pendant 5 jours, les principales questions thérapeutiques, expertales, criminologiques, pénitentiaires, victimologiques de la matière. Elle est ouverte à un large public incluant des médecins psychiatres.
Une deuxième action de formation spécifique en matière psychiatrique se présente sous forme de composante dans le cadre de formations plus larges sur les majeurs protégés (114), sur les fonctions de juge de l’application des peines (JAP) et sur les fonctions de JLD (115).
Enfin, une troisième action de formation spécifique s’est traduite par la création, en 2010, d’une session annuelle de formation de 3 jours à l’ENM sur les soins psychiatriques sans consentement. Cette session est ouverte aux magistrats, psychiatres, avocats, gendarmes, policiers, contrôleurs des lieux de privation de liberté et aux cadres de la fonction publique dans le cadre du réseau des écoles de service public (116).
Cette session de formation est animée par Mme Marion Primevert et par le Dr Natalie Giloux, psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Le Vinatier (Bron), et a permis de prodiguer des enseignements sur les soins sans consentement, et notamment sur l’exercice de la contrainte en chambre d’isolement, à plus de 500 magistrats depuis 2010 (117).
Selon le Dr Natalie Giloux, certains magistrats sont très demandeurs de formations sur les pathologies mentales. Ces formations permettent en effet de faciliter la compréhension de la procédure encadrant l’admission en soins psychiatriques sans consentement en clarifiant la délimitation des rôles des médecins et des magistrats. Il faut, il est vrai, prendre garde à ce que des magistrats ne se fourvoient en se prenant pour des médecins lorsqu’ils statuent. À cet égard, le Dr Vincent Mahé, chef du pôle de psychiatrie adulte du Groupe Hospitalier de l’Est Francilien (GHEF), a regretté que le fait qu’à la faveur des réformes de 2011 et de 2013, le psychiatre soit devenu un objet d’attention « médicale » pour le magistrat (de la même manière que le patient est devenu un objet d’attention juridique pour le psychiatre) ait conduit à ce que certains magistrats substituent leur évaluation personnelle de l’état mental des patients à celle des médecins, sans prendre suffisamment en compte leur pronostic psychique et la protection de leur avenir psychique.
La lecture de certificats médicaux ne s’improvisant pas, les rapporteurs estiment nécessaire de développer les formations au contentieux des soins psychiatriques sans consentement, à l’attention tant des magistrats que des avocats.
La faible appétence des JLD pour le contentieux des soins psychiatriques sans consentement peut s’expliquer par le rôle limité qui leur est reconnu, d’après Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, président de la commission « hospitalisation d’office et personnes vulnérables » du Syndicat des avocats de France (SAF). Les JLD ne peuvent en effet se prononcer sur le bien-fondé médical de la mesure – qui relève de l’appréciation des médecins – mais seulement sur sa régularité formelle (établissement des certificats médicaux dans les conditions requises, notification des droits au patient, etc.) et sur sa proportionnalité (nécessité de la privation de liberté au regard des exigences de protection du patient lui-même et de l’ordre public). Pour reprendre la formule de Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, « certains JLD se considèrent comme des boutons “on-off” » chargés de répondre par « oui » ou par « non » à des demandes de mainlevées, au vu de critères essentiellement formels –, ce qu’a d’ailleurs déploré le Dr Isabelle Montet, secrétaire générale du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), qui a déclaré que, trop souvent, des mainlevées sont décidées pour des questions de pure forme, sans considération pour les impératifs de soins. Selon la représentante de la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires (CHU), Mme Nathalie Borgne, directrice adjointe chargée notamment du pôle psychiatrie au CHU de St Étienne, cet excès de procédure finirait par « tuer la procédure ».
Qui plus est, le caractère formel de l’office du juge peut tenir à ce que, lors de l’audience que le JLD tient dans le cadre de son contrôle de plein droit, les nullités susceptibles de vicier la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont censées être purgées. La Cour de cassation, statuant en sa première chambre civile, a en effet décidé le 19 octobre 2016, qu’« à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge » (118).
Cette règle doit être rapprochée des statistiques fournies à la mission par le ministère des affaires sociales et de la santé, d’après lesquelles les principaux moyens de contestations de la mesure portent :
– dans 59 % des cas sur des vices de procédure (non-respect de notification des droits de la personne, auteur du certificat psychiatrique, qualité du tiers, non-respect des délais prévus par la loi, etc.) ;
– dans 24 % des cas sur des vices de forme pour insuffisance de la motivation de la nécessité de l’admission en soins ;
– dans 17 % des cas sur la compétence de l’auteur de l’acte administratif (119).
Alors que la circulaire du garde des Sceaux du 21 juillet 2011 (120) précise, en son paragraphe 1.3.1, qu’il est « souhaité que le ministère public soit étroitement associé au contrôle de la nécessité des mesures de soins psychiatriques et soit en mesure de donner son avis dans chaque affaire », il a été indiqué avec constance à la mission que le parquet est largement absent aux audiences du JLD (121). Parfois, il n’y aurait même pas de place identifiée pour les représentants du ministère public dans la salle d’audience (mutualisée ou non) spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. La mission l’a d’ailleurs constaté lors de deux audiences auxquelles elle a assisté, à l’hôpital parisien de Sainte-Anne et à l’hôpital de Meaux.
D’après les représentants de l’ordre des avocats au barreau de Lille, les magistrats du parquet près leur juridiction ne s’investiraient guère dans le contentieux des soins psychiatriques sans consentement, limitant essentiellement leurs interventions aux appels fondés sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (122).
Les représentantes du Syndicat de la magistrature ont, lors de leur audition, convenu de ce que, quand bien même il produirait des réquisitoires écrits, l’absence du parquet aux audiences pouvait être préjudiciable au caractère contradictoire des débats.
Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille a regretté ce désintérêt – selon lui plus marqué en première instance qu’en appel – et souligné qu’une présence plus assidue du parquet aux audiences des JLD aurait un double intérêt :
– tout d’abord, celui de fournir plus d’informations sur le justiciable dont l’avocat ignore parfois l’état matrimonial, les conditions de logement, les éventuelles mesures incapacitantes dont le patient fait l’objet (tutelle, curatelle, etc.) ;
– ensuite, celui d’inciter les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) à assister plus souvent aux audiences.
2. Les audiences du juge des libertés et de la détention (JLD)
Le principe même de l’audience du JLD n’a guère été discuté par les personnes entendues par la mission, si ce n’est par certains JLD du TGI de Paris qui, s’appuyant sur le modèle néerlandais du contrôle sur dossier, se sont interrogés sur l’opportunité de la présence du patient à une audience qui intervient parfois trop tôt au regard de l’évolution de sa pathologie et de l’administration de ses traitements (notamment sédatifs) (123), au point qu’elle nuise à son état physique et psychique. Ils ont toutefois convenu de la nécessité de la tenue de l’audience au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles (respect du principe du contradictoire, publicité de l’audience qui est une garantie des libertés, etc.), ainsi que de son utilité dans le cadre du travail médical entrepris par l’équipe soignante du patient.
La date et le lieu de l’audience ont en revanche fait l’objet de nombreuses observations tout au long des travaux de la mission.
La loi du 27 septembre 2013 a ramené le délai de contrôle obligatoire des mesures d’hospitalisation complète de 15 à 12 jours, ce qui a pu contribuer à augmenter le nombre des audiences tenues par le JLD : selon le président de la conférence nationale des présidents de TGI, M. Gilles Accomando, président du TGI d’Avignon, certains JLD tiendraient désormais deux audiences hebdomadaires, au lieu d’une auparavant. Au TGI de Paris, les audiences ont lieu chaque jour de la semaine, les matins et après-midis, du lundi au vendredi : chaque semaine, les JLD se relaient et ils statuent chaque jour sur une quinzaine ou une vingtaine de dossiers – ce qui les occupe à plein temps la semaine où ils se consacrent au contentieux des soins psychiatriques sans consentement. Au TGI de Meaux, le nombre des audiences a augmenté significativement en 2015 (+ 25 % par rapport à 2014) avant de retrouver un « rythme de croisière » en 2016 (+ 3 % par rapport à 2015) et les audiences, qui ont lieu deux fois par semaine (le lundi dans la salle d’audience mutualisée du centre hospitalier de Marne-la-Vallée et le jeudi dans celle de l’hôpital de Meaux), occupent là aussi les JLD à temps plein le jour où elles se déroulent.
Si cette réduction du délai du contrôle obligatoire du JLD fait l’objet d’une approbation quant au principe, elle est aussi considérée insuffisante ou, au contraire, pouvant être préjudiciable aux personnes.
Le débat subsiste sur l’opportunité de fixer le contrôle judiciaire dès l’admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le modèle des pays anglo-saxons où le juge exerce un contrôle limité aux conditions d’entrée dans les soins.
Lors de son audition, le psychiatre Jean-Luc Roelandt s’est ainsi exprimé en faveur d’une judiciarisation de la mesure de l’admission du patient jusqu’à la fin des soins ambulatoires, le JLD étant amené à statuer sur l’hospitalisation complète dès le premier jour de celle-ci. Cette revendication est partagée par les représentants de certains syndicats de psychiatres, notamment par le Dr Philippe Gasser, président de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP), qui considère qu’on ne pouvait pas préjuger de l’état du patient et de sa capacité à être auditionné ou non pour retarder le contrôle judiciaire.
Les représentants de certains syndicats de magistrats aussi appellent à un contrôle judiciaire dès le début de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. C’est le cas de ceux du Syndicat de la magistrature.
Les représentants de certaines associations de directeurs d’établissements de santé abondent en ce sens. C’est notamment le cas du représentant de la conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH), M. Jean-Pierre Staebler.
À l’inverse, d’autres personnes entendues ont exprimé leur scepticisme, voire leur inquiétude à l’égard d’une telle proposition, doutant de l’intérêt d’une audience lorsque les troubles de la personne risquent de rendre son audition impossible, lorsque les délais contraints peuvent nuire à la qualité de sa défense, voire à la présence même d’un avocat, et lorsque le juge peut donc se retrouver dans l’incapacité d’échanger avec le patient et son avocat.
Ainsi, Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, estime que si le contrôle judiciaire s’effectuait ab initio, sa nature pourrait s’en trouver modifiée, au détriment des patients dont la plupart pourraient être regardés comme n’étant pas en état d’être auditionnés (124).
Les rapporteurs notent par ailleurs que, dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel, tout en estimant que le maintien de l’hospitalisation d’une personne sans son consentement devait être soumis à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution, a expressément énoncé que si « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible, […] les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai » (125).
***
Dans sa contribution écrite, Mme Yaël Frydman, secrétaire générale du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), relève quelques cas où le personnel soignant aurait tenté d’éviter de présenter des patients devant le JLD, par exemple en transformant une mesure d’hospitalisation complète en programme de soins avant l’expiration du délai de 12 jours au terme duquel le JLD doit se prononcer.
Cependant, d’après les données fournies à la mission par le Dr Jean-Luc Roelandt, on ne constate pas de stratégie médicale globale de contournement de la loi pour éviter le contrôle judiciaire, ce dont les rapporteurs se félicitent.
En effet, si une étude plus complète au niveau national est particulièrement souhaitable, on constate tout au moins, d’après les données issues du registre prévu par l’article L. 3212-11 du code de la santé publique dans 32 secteurs des départements du Nord et du Pas-de-Calais, que les levées, par les directeurs des établissements d’accueil, des mesures d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État sont progressives. Et on ne constate pas de levées massives la veille ou l’avant-veille de l’échéance du délai de 12 jours au terme duquel le JLD doit se prononcer sur l’hospitalisation complète des patients.
RÉPARTITION DES DURÉES DE MESURES DE SPDRE INFÉRIEURES À 13 JOURS
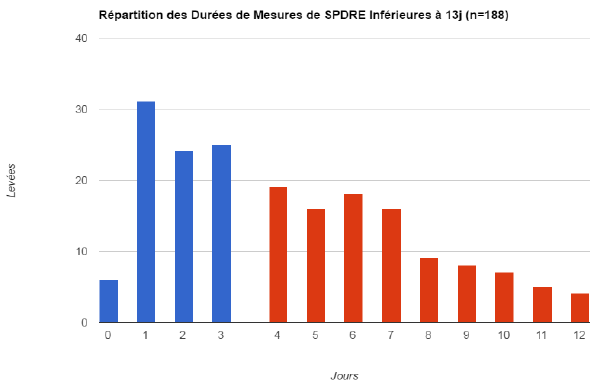
Source : Dr Jean-Luc Roelandt, Établissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole, Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la recherche et la formation en santé mentale.
Il a en revanche été signalé à la mission que certains médecins développeraient une stratégie de contournement de la décision du JLD une fois celle-ci intervenue, en décidant par exemple de renouveler la mesure d’hospitalisation complète immédiatement après que le juge en a donné mainlevée (126).
Certains analysent ces réadmissions immédiates après mainlevée comme une forme de détournement de procédure et de remise en cause de l’autorité de la chose jugée.
Ce n’est pas le point de vue de Mme Marion Primevert, qui a expliqué qu’en renouvelant une mesure d’hospitalisation complète dont la mainlevée a été donnée pour des motifs liés à des vices de forme ou de fond, les établissements d’accueil respectent l’esprit de la loi dès lors qu’ils agissent dans l’unique souci de protéger la santé du patient concerné. Et d’après les représentants des syndicats de psychiatres entendus par la mission, c’est bien ce souci qui, seul, motive les réadmissions immédiates après mainlevée.
Il faut par ailleurs souligner qu’en cas d’infraction ou de dommage causé par un patient ayant bénéficié d’une mainlevée d’hospitalisation complète, la responsabilité civile de l’établissement d’accueil voire la responsabilité pénale du médecin concerné sont susceptibles d’être recherchées.
À cet égard, le Dr Maurice Bensoussan, président du Syndicat des psychiatres français (SPF), a formé le vœu que la situation évolue, notamment à la faveur du décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
La loi du 27 septembre 2013 a prévu qu’à titre de principe, « le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ou, en cas de nécessité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande instance et l’agence régionale de santé [ARS] » (127). À titre d’exception, « lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance » (128).
D’après les données transmises à la mission par le ministère de la justice, au 1er janvier 2014, sur les 290 établissements accueillant des patients en soins psychiatriques sans consentement sur l’ensemble du territoire (y compris ultra-marin), 104 (soit environ un tiers) étaient dotés d’une salle spécialement aménagée pour l’audience (129).
D’après les chiffres fournis tant par les représentantes du Syndicat de la magistrature que par la direction des services judiciaires du ministère de la justice, qui, il y a deux ans, a effectué une enquête sur la mise en œuvre de la réforme du 27 septembre 2013, près de 70 % des audiences du JLD se tenaient, en juillet 2015, dans une salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil (130). Dans 10 % des juridictions, les audiences du JLD se tenaient tantôt au TGI tantôt dans une salle située dans l’enceinte d’un établissement d’accueil. Et dans 20 % des juridictions, les audiences se tenaient exclusivement au TGI. Au sein de ces dernières juridictions, les obstacles à la tenue d’audiences foraines relevaient, pour 55 % d’entre elles, de considérations matérielles (salle d’audience non conforme aux prescriptions infra-réglementaires, absence d’équipement) et, pour 29 % d’entre elles, de considérations géographiques (éloignement de l’établissement d’accueil).
Au mois de juillet 2015, la mutualisation des salles d’audiences était pratiquée par 75 % des juridictions comptant plus d’un établissement de soins dans leur ressort (131).
Les personnes entendues ont largement approuvé le principe de la tenue des audiences sur l’emprise des établissements d’accueil. Ainsi, tant M. Alain Monnier, référent des commissions départementales de soins psychiatriques à l’Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM), que Mme Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (FNAPSY), ou encore les JLD du TGI de Paris entendus par la mission (dont Mme Marion Primevert) ont jugé « positif pour tout le monde que l’audience puisse avoir lieu à l’hôpital ». M. Thierry Fusina, vice-président du TGI de Paris, voit dans les audiences foraines un net progrès par rapport à la situation antérieure, où le JLD connaissait, lors de la même audience, aussi bien d’affaires de droit pénal ou de droit des étrangers que de dossiers d’admissions en soins psychiatriques sans consentement. Selon Mme Mme Corinne Vaillant, avocate et présidente de l’association « Avocats, droits et psychiatrie », les délais d’attente des patients à l’audience s’en sont trouvés réduits, ainsi que, par voie de conséquence, les désagréments liés aux éventuels effets secondaires de leur traitement.
Avouant son scepticisme initial quant au principe de la tenue des audiences sur l’emprise des établissements d’accueil, Me Aurore Bonduel, avocate au barreau de Lille, a jugé que l’aménagement des salles d’audience dans le ressort du TGI de Lille était plutôt satisfaisant, dans la mesure où il permettait non seulement d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public, mais aussi de marquer une différenciation entre le « monde médical » et le « monde juridique » - les salles d’audiences étant relativement isolées des établissements d’accueil, bien qu’édifiées dans leur enceinte.
Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille a lui aussi exprimé sa satisfaction quant à la tenue des audiences dans des salles annexées aux établissements d’accueil, d’autant que les patients sont habillés pour assister à l’audience – ce qui ne semble toutefois pas être le cas à l’hôpital de Meaux où la mission a pu constater que certains patients étaient présentés à l’audience en pyjama et que presque tous portaient des chaussons.
Toutefois, certaines des personnes entendues ont estimé que ce principe pouvait entraîner une dégradation des conditions de prise en charge des personnes admises en soins sans consentement, notamment dans le cadre de leur transport vers un autre établissement de santé, si l’audience se tient dans une salle mutualisée. Mme Marie-Jane Ody, vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats (USM), a ajouté que ce principe pouvait entraîner une désorganisation des juridictions, tout en reconnaissant qu’il était favorable aux patients – encore que cela est discuté par Mme Corinne Vaillant, avocate et présidente de l’association « Avocats, droit et psychiatrie », qui a expliqué que, par souci d’éviter ou de faciliter le transport des patients, ces derniers étaient, selon le cas, soit déclarés non-auditionnables (132), soit tellement sédatés que leur présentation à l’audience dans la salle mutualisée perdait une grande partie de son intérêt.
Par ailleurs, certaines salles d’audience seraient aménagées de façon conviviale, d’autres moins. On peut douter de cette convivialité lorsqu’on lit les prescriptions de la circulaire du ministère de la Santé du 29 juillet 2011 relative aux caractéristiques de la salle d’audience aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil (133). Cette circulaire prescrit notamment « un espace entre la table de justice et les premiers rangs de bancs réservés aux avocats permettant l’installation de la barre (comprenant une tablette pour les dossiers) ».
Cette circulaire fixe des conditions tellement draconiennes pour l’aménagement de salles d’audience sur l’emprise des établissements d’accueil (134) que certains présidents de TGI et certaines ARS ont en l’état renoncé à tout projet d’aménagement ou se sont affranchis de ses exigences pour mener à bien leur projet. Le Syndicat de la magistrature considère que les exigences sur la qualité des salles d’audience à l’hôpital servent parfois de prétexte pour que le juge continue de siéger au palais de justice, particulièrement quand les établissements d’accueil sont éloignés des TGI. Il a cependant été rapporté à la mission que certaines salles d’audience dans un établissement hospitalier n’avaient rien à envier à des salles d’enceintes judiciaires, des magistrats précisant même qu’ils ne perdraient pas au change.
Qui plus est, certaines des personnes entendues ont indiqué que le principe de la tenue des audiences sur l’emprise des établissements d’accueil pouvait nuire à la qualité de la défense des patients, en particulier dans les zones où les lieux d’hospitalisation sont dispersés. Me Françoise Mathe, présidente de la commission Libertés et droits de l’homme du CNB, a ainsi cité les établissements de santé situés sur le plateau de Langres, où il peut être long et difficile de se rendre pour les avocats au barreau de Dijon, en particulier lorsque les routes sont impraticables en hiver.
Mme Marie-Jane Ody a même indiqué à la mission que certains bâtonniers – parmi lesquels ceux des barreaux de Coutances et de Cahors (135) – écrivaient aux chefs de juridiction que, compte tenu de la distance séparant le TGI de l’établissement d’accueil et de la faiblesse de l’indemnisation des avocats au titre de l’aide juridictionnelle, ils ne désigneraient aucun avocat commis d’office pour assister et représenter les patients aux audiences du JLD (136).
Cependant, M. Stéphane Dhonte, bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille, a souligné que la possibilité ouverte par la loi du 27 septembre 2013 d’aménager des salles d’audience mutualisées pouvait faciliter la tâche des avocats – et rendre par ailleurs leur intervention financièrement plus viable en leur permettant de plaider plusieurs dossiers dans un même lieu et de réaliser ainsi des économies sur les frais de transport. Sans doute faut-il encourager les juridictions, les avocats et les établissements d’accueil des patients à s’organiser pour s’efforcer de concentrer les audiences de façon à limiter les déplacements des uns et des autres. Enfin, les protocoles « article 91 » qui permettent d’indemniser les avocats pour une permanence d’audience pourraient intégrer le temps et les frais du déplacement comme élément de fixation d’une indemnité forfaitaire.
c. Les conditions de déroulement de l’audience
Le désintérêt relatif pour le contrôle judiciaire des admissions en soins sans consentement que certaines des personnes entendues prêtent à certains JLD retentirait, selon ces mêmes personnes, sur les conditions de déroulement de l’audience (137), et se traduirait notamment par le fait que certains JLD ne portent pas la robe. S’il lui a été rapporté qu’à Lyon, magistrats et avocats auraient renoncé au port de la robe, la mission a en revanche pu constater par elle-même qu’à Paris, le port de la robe, tant par les magistrats que par les avocats, est quasi-systématique et qu’il en va de même à Meaux, où le greffier porte également la robe.
Mais il a été expliqué par d’autres personnes entendues, et notamment par Me Stéphane Dhonte, que l’abandon de la robe témoignerait de la volonté de JLD de ne pas intimider voire « effrayer » les patients et d’éviter ainsi de les renvoyer à un imaginaire pénal.
Cette analyse a été confirmée par Mme Anaïs Vrain, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature et par M. Benjamin Blanchet, magistrat, chargé de mission de l’Union syndicale des magistrats (USM). De leur point de vue, l’absence de port de la robe permet de faciliter le contact avec les patients et ce serait une erreur que d’imposer le port de la robe au JLD.
À l’inverse, d’autres magistrats estiment, à l’instar de Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, que le port de la robe contribuait à bien placer le juge dans le rôle qui est le sien, en rappelant à tous les acteurs de l’audience, à commencer par le juge, qu’il est « une robe noire et pas une blouse blanche ».
Il semble que les représentants des associations d’usagers de la psychiatrie aient des avis partagés sur la question. Bon nombre souhaitent que les magistrats statuent en robe dans les salles d’audience aménagées sur l’emprise des établissements d’accueil. Ainsi, Mme Claude Finkelstein a expliqué, lors de son audition, que le « decorum » judiciaire, auquel participe le port de la robe, pouvait contribuer à « retrouver la limite dont les patients psychiatriques ont la pathologie ».
En revanche, les avis des associations d’usagers de la psychiatrie approuvent unanimement la suppression de la visioconférence pour la tenue des audiences du JLD (138) ainsi que la possibilité ouverte aux patients d’obtenir, de droit, la tenue des débats en chambre du conseil (139). Sur ce dernier point, l’association Advocacy France, sans plaider pour la tenue systématique des débats à huis clos, estime qu’il faut en la matière « respecter les désirs de l’usager » (140).
Mme Marie-Jane Ody a toutefois précisé que, même lorsque la tenue des débats en chambre du conseil n’est pas décidée, la publicité des audiences du JLD était très relative, dans la mesure où les proches des patients (141), les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), les représentants des établissements d’accueil (142) et, le cas échéant, de la préfecture, sont rarement présents (143). Le même constat a été dressé au cours des déplacements de la mission, tant à Paris qu’à Meaux – les magistrats parisiens estimant que la présence de représentants des établissements d’accueil et des préfectures n’est toutefois pas nécessaire, ce qui, en dépit du caractère hybride de la procédure, est contesté par Me Letizia Monnet-Placidi, avocate au barreau de Paris, qui invoque le principe d’irrecevabilité d’une demande non soutenue en procédure civile orale.
Il n’en demeure pas moins que les entailles au secret médical qui résultent de la publicité des audiences justifieraient, selon le Dr Christian Muller, président de la conférence nationale des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers spécialisés (CME-CHS), que d’autres que le patient ou son avocat devraient pouvoir demander la tenue de l’audience en chambre du conseil, notamment les proches, tuteurs ou curateurs des patients, lorsqu’ils sont présents. Rappelons que la mission « santé mentale et avenir de la psychiatrie » avait envisagé que les audiences se tiennent par principe en chambre du conseil. La publicité avait cependant été maintenue après que la Chancellerie ait utilement souligné que la publicité était une garantie pour le justiciable, particulièrement en matière de liberté individuelle. L’équilibre trouvé par la loi du 27 septembre 2013 n’apparaît pour cette raison pas devoir être remis en cause.
Toujours est-il que, pour reprendre la formule de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, « les conditions de déroulement de l’audience du juge des libertés et de la détention demeurent marquées par une hétérogénéité qu’il n’est pas souhaitable de laisser perdurer. Si l’on ne doit pas s’arrêter à un formalisme trop strict quant à la configuration des locaux pour écarter le principe d’une audience foraine, il semble nécessaire qu’une action conjointe des juridictions et des tutelles des établissements hospitaliers identifie les bonnes pratiques et les fasse connaître par des directives nationales ainsi que, localement, par des actions de formation, de sensibilisation ou d’échange entre soignants, magistrats et avocats » (144).
3. Les pièces produites à l’audience
a. La réduction du nombre de certificats médicaux
En application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’État, elle fait l’objet d’une période initiale d’observation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat dit « des 72 heures » la forme de la prise en charge (hospitalisation complète, soins ambulatoires, soins ou hospitalisation à domicile, séjours à temps partiel ou séjours de courte durée à temps complet dans un établissement de santé, etc.) et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Me Aurore Bonduel, avocate au barreau de Lille, a signalé lors de son audition que, de son point de vue, le certificat médical « des 72 heures » était souvent établi trop tôt après l’admission, bien avant l’échéance du délai de 72 heures, parfois même avant l’expiration d’un délai de 48 heures après l’admission.
De leur côté, les représentants du Syndicat des greffiers de France (SDGF-FO) ont déploré que les certificats médicaux soient fournis trop tardivement, souvent le jour même de l’audience – ces lenteurs pouvant entre autres s’expliquer par les difficultés résultant, pour les établissements d’accueil, de l’interdiction faite à leur personnel administratif d’accéder aux éléments médicaux du dossier du patient.
Pour leur part, Mme Marie-Jane Ody, vice-présidente de l’USM, et Mme Joëlle Munier, vice-présidente de la conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance (TGI), ont regretté l’insuffisante motivation des certificats médicaux. Mme Marie-Jeanne Ody a relevé que, parfois, tout au long du processus d’hospitalisation, des motivations identiques étaient reproduites dans des certificats successifs émanant pourtant de médecins différents. Il pourrait selon elle y être remédié en exigeant des certificats qu’ils soient mieux formalisés et qu’ils soient remis contre reçu au patient.
Le Dr Isabelle Montet, secrétaire générale du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), a reconnu qu’aujourd’hui, bon nombre de certificats étaient rédigés de façon à éviter le plus possible toute contestation par un avocat, d’autant que, d’après le Dr Michel David, vice-président du SPH, on recense plus d’une centaine de vices de procédure possibles dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Par ailleurs, aussi bien le président de la conférence nationale des présidents de TGI, M. Gilles Accomando, que le représentant de la conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH), M. Jean Pierre Staebler, ont expliqué que, tant par souci de respect pointilleux de la procédure que pour des questions d’organisation à la fois des établissements d’accueil et des greffes des juridictions, les certificats médicaux étaient parfois établis bien en amont des délais prévus par la loi, de sorte qu’à la date à laquelle il statue, le JLD se trouve parfois face à un patient dont l’état ne correspond plus du tout à celui décrit dans le dossier qui lui est soumis. À cet égard, les JLD du TGI de Paris entendus par la mission ont regretté qu’il n’ait pas été prévu en première instance un avis médical actualisé comparable à celui exigé en cause d’appel par l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Toutefois, le Dr Maurice Bensoussan, président du Syndicat des psychiatres français (SPF), a, à l’inverse, reproché à certains tribunaux de ne pas suffisamment exploiter les informations fournies par les psychiatres dans les certificats et avis médicaux.
D’après les réponses fournies par le ministère des affaires sociales et de la santé au questionnaire que la mission lui a adressé, « la Haute Autorité de santé (HAS) élabore actuellement un protocole pour la rédaction des certificats dans le cadre des soins sans consentement. Il s’agit notamment de définir les contenus et motivation des certificats ou avis médicaux à produire en fonction des situations. Les situations envisagées sont celles qui découlent chronologiquement de la période d’observation de 72 heures consécutive à l’admission en soins sans consentement, pour lesquelles la loi prévoit que des certificats ou avis médicaux soient produits ». D’après les indications fournies à la mission par Mme Geneviève Castaing, cheffe du bureau de la santé mentale à la Direction générale de la santé (DGS), ce protocole devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2017. Mais les représentants de la HAS ont indiqué, lors de leur audition, que le groupe de travail chargé de l’élaborer mériterait d’être redynamisé – ce à quoi les rapporteurs ne peuvent qu’inviter.
La loi du 27 septembre 2013 a réduit le nombre de certificats ou avis médicaux devant être produits à l’audience que le JLD tient avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission d’une personne en soins sans consentement.
Elle a notamment supprimé le certificat (dit « de huitaine ») qui devait être établi entre le sixième et le huitième jour suivant la décision d’admission – de sorte que, pour les admissions sur décision du directeur d’établissement, la mesure de maintien des soins retenue par ce dernier pour une durée d’un mois ne s’appuie plus sur le certificat de huitaine mais sur celui des 72 heures. Cette modification était intervenue sur l’information que le certificat de huit jours était très souvent proche de celui des 72 heures, quand il n’était pas identique.
Par ailleurs, l’avis conjoint de deux praticiens de l’établissement d’accueil (dont l’un ne devait pas être chargé du suivi du patient) qui devait être adressé auparavant au JLD pour l’exercice de son contrôle, a été remplacé par un avis simple – ce que Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, a approuvé, « les avis conjoints antérieurs présentant une lourdeur formelle excessive au regard de leur apport sur le fond » (145).
D’après les réponses apportées par le ministère des affaires sociales et de la santé au questionnaire que la mission lui a adressé, « ces mesures n’ont pas engendré de difficultés particulières. Il semble que ces dispositions, visant à réduire le nombre de certificats médicaux, ont plutôt satisfait les professionnels de santé ».
C’est en effet le point de vue des représentants des syndicats de psychiatres que la mission a entendus. Le Dr Isabelle Montet a même jugé qu’un seul certificat médical circonstancié serait suffisant.
Cet avis ne semble pas être partagé par certaines associations d’usagers des services psychiatriques. Pour M. André Bitton, président du CRPA, la qualité du débat judiciaire en a pâti.
Le CRPA réclame en conséquence la production de l’ensemble du dossier médical du patient dans la procédure de contrôle judiciaire des admissions en soins sans consentement.
Sans aller jusque-là, Me Aurore Bonduel a déploré l’absence de production, au dossier qui est soumis au JLD, des pièces justifiant la réalisation, en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, d’un examen somatique dans les 24 heures de l’admission en soins psychiatriques. Souvent les établissements d’accueil refusent la transmission d’informations sur l’accomplissement de cet examen en invoquant le secret médical.
Le Dr Christian Muller, président de la conférence nationale des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers spécialisés (CME-CHS), a cependant signalé que la jurisprudence des juges du fond tendrait désormais à exiger la production du justificatif de la réalisation d’un examen somatique dans les 24 heures suivant l’admission en soins psychiatriques – examen qui lui paraît inutilement lourd lorsqu’il a déjà été réalisé aux urgences avant l’admission. La « lourdeur » de cet examen a en revanche paru justifiée au Dr Éric Mairesse, médecin-chef de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), qui a expliqué qu’un certain nombre de pathologies (comme le diabète insulino-dépendant) pouvaient passer inaperçues lors d’un premier examen somatique aux urgences ou à l’IPPP.
S’agissant des avis médicaux attestant que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, il semble, d’après les réponses apportées par le ministère des affaires sociales et de la santé au questionnaire que la mission lui a adressé, que certains « s’interrogent sur un éventuel recours [à ces avis médicaux] pour des motivations plus liées au fonctionnement de l’établissement » d’accueil qu’à l’état du patient.
C’est notamment le cas du Dr Isabelle Montet qui a reconnu que certains avis médicaux étaient établis pour des questions liées aux difficultés de transport des patients.
D’après le Dr Philippe Gasser, président de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP), ces « certificats logistiques » seraient de plus en plus fréquents dans les départements (comme le Gard, par exemple) où les TGI sont éloignés des établissements de santé accueillant les patients en soins psychiatriques sans consentement.
Selon les JLD du TGI de Paris entendus par la mission, ces certificats seraient moins fréquents qu’avant au sein de leur juridiction, d’autant que, selon eux, les magistrats se montrent très sourcilleux sur leur motivation en exigeant non seulement la preuve du caractère « non transportable » du patient, mais aussi et surtout celle de son caractère « non auditionnable » - étant précisé que l’impossibilité de faire liée aux moyens de transport, qui n’est pas un cas de force majeure, n’est pas favorablement accueillie par les juges.
Selon Mme Marion Primevert, si un juge constate qu’un même établissement fournit un nombre conséquent d’avis médicaux attestant de ce que les patients ne sont pas en état d’être auditionnés, et/ou que ces avis sont peu ou pas motivés, il appartient au JLD de se rendre sur place et de visiter l’établissement (notamment ses chambres d’isolement).
Mme Marion Primevert a toutefois signalé que les faux certificats ou avis médicaux étaient rarissimes (elle-même n’en a « rencontré » qu’un seul dans l’exercice de ses fonctions) et que les « copier-coller » étaient tout aussi rarissimes (et qui plus est très mal perçus par les JLD).
b. Le bulletin n° 1 du casier judiciaire
En application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le JLD dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut, à tout moment, se saisir d’office ou être saisi aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques (et notamment d’une hospitalisation complète) prononcée en cas de péril imminent, à la demande d’un tiers ou sur décision du représentant de l’État dans le département, ou sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale (146).
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure, la personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle, son conjoint, son partenaire ou son concubin, la personne qui a formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, ou le procureur de la République.
La loi du 5 juillet 2011 prévoyait que, dans le cadre de son contrôle facultatif ou de plein droit, le JLD ne pouvait statuer sur une demande de mainlevée qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège comprenant un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient :
– lorsque la personne faisait l’objet d’une mesure de soins ordonnée à l’initiative des autorités judiciaires en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique – qui dispose que « lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal (147), d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission [départementale des soins psychiatriques] ainsi que le représentant de l’État dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade et au vu duquel, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques » ;
– ou lorsque la personne faisait l’objet de soins sur décision du représentant de l’État (articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique) et qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des articles 706-135 du code de procédure pénale ou L. 3213-7 du code de la santé publique au cours des dix années précédentes ;
– ou lorsque la personne faisait l’objet de soins sur décision du représentant de l’État et qu’elle faisait ou avait déjà fait l’objet, au cours des dix années précédentes, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles pendant au moins un an.
En cohérence avec la loi du 5 juillet 2011 ainsi qu’avec les décrets du 18 juillet 2011 (148), une circulaire du garde des Sceaux du 21 juillet 2011 a prévu qu’« en raison des conséquences sur la procédure du régime renforcé dont relèvent certains patients [dits « médico-légaux »], le juge devra disposer des éléments lui permettant d’apprécier si le patient relève bien de cette procédure de suivi renforcé. À cet égard, le greffe devra systématiquement demander copie du bulletin n° 1 du casier judiciaire du patient, pour vérifier si ce dernier a fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité suivie d’une mesure d’hospitalisation d’office » et qu’« il est expressément laissé au directeur d’établissement la possibilité de produire d’autres éléments qu’il estimerait utiles (tels que les antécédents de saisine d’un juge des libertés et de la détention) ».
Toutefois, la loi du 27 septembre 2013 a supprimé la référence aux antécédents judiciaires et/ou psychiatriques des patients médico-légaux dans le cadre du contrôle judiciaire renforcé des procédures de mainlevée.
Désormais, les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoient que le JLD ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège comprenant un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient que lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens (149).
Plusieurs des personnes entendues se sont félicitées de la suppression de la recherche des antécédents judiciaires et/ou psychiatriques des patients pour lesquels la procédure de mainlevée fait l’objet d’un contrôle renforcé. Dans la contribution écrite qu’il a fournie à la mission, M. André Bitton, président du CRPA, y voit « une très bonne chose ».
Cependant, malgré la modification législative intervenue en 2013, la circulaire du garde des Sceaux précitée est restée en vigueur, dans sa rédaction en date du 21 juillet 2011, de sorte qu’alors même que la loi a mis fin à toute recherche d’antécédents dans le cadre de la procédure de mainlevée faisant l’objet d’un contrôle judiciaire renforcé, certains greffiers en chef continuent systématiquement de demander copie du bulletin n° 1 du casier judiciaire du patient (150), conformément à la circulaire en cause.
Comme le souligne justement M. André Bitton dans sa contribution écrite, « cette production du casier judiciaire n’était opérante que pour autant qu’il fallait, en application de la loi du 5 juillet 2011, pouvoir faire une recherche d’antécédent médico-légal sur 10 ans en arrière. Cette recherche d’antécédent ayant été abrogée par la loi du 27 septembre 2013, ce point précis de cette circulaire n’a plus d’objet ». M. André Bitton a donc appelé lors de son audition à la modification de la circulaire du 21 juillet 2011, considérant que sa rédaction actuelle contribuait à inscrire la procédure de mainlevée faisant l’objet d’un contrôle renforcé dans un « arrière-plan quasi-pénal ».
Lors de son audition, Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, a indiqué avoir attiré l’attention de la Chancellerie sur le caractère illégal du paragraphe litigieux (n° 1.3.1) de la circulaire du 21 juillet 2011.
Interrogés à ce sujet, les services du ministère de la justice ont fait valoir que, de leur point de vue, le point n° 1.3.1 de la circulaire du 21 juillet 2011 était ipso facto devenu caduc à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 27 septembre 2013, sans qu’il soit nécessaire de l’abroger formellement – et ce d’autant plus qu’une circulaire du garde des Sceaux du 22 mai 2014 (151) précise expressément que « eu égard à l’absence de fichiers d’antécédents psychiatriques fiables, la loi supprime également l’application du régime plus strict de mainlevée aux patients qui avaient, depuis moins de dix ans, été soumis à des soins psychiatriques sous contrainte à la suite d’une déclaration judiciaire d’irresponsabilité pénale ».
Dans un souci de clarté, les rapporteurs appellent néanmoins le garde des Sceaux, ministre de la justice, à modifier la rédaction de la circulaire du 21 juillet 2011 afin de la rendre conforme aux dispositions de la loi du 27 septembre 2013.
Recommandation n° 15 : modifier la circulaire du ministre de la justice du 21 juillet 2011 relative à la présentation de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011, afin d’en supprimer les dispositions exigeant que le greffe demande systématiquement copie du bulletin n° 1 du casier judiciaire du patient, pour vérifier si ce dernier a fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité suivie d’une mesure d’hospitalisation d’office.
C. AU-DELÀ DE L’AUDIENCE, L’APPEL À UN CONTRÔLE JUDICIAIRE DES CONDITIONS D’HOSPITALISATION, ET NOTAMMENT DES MESURES D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION.
Plusieurs représentants d’associations d’usagers de la psychiatrie ont estimé que le principal reproche qui pouvait être fait à la loi du 27 septembre 2013 tenait à ce qu’elle n’avait pas étendu le contrôle judiciaire au-delà de la régularité formelle et de la proportionnalité de la mesure d’hospitalisation complète. Comme le note M. André Bitton, président du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), dans la contribution écrite qu’il a remise à la mission, « sont laissées en zones grises les problématiques de l’atteinte à la vie privée, des traitements, des droits de visite également ».
Toutefois, le contrôle judiciaire pourrait évoluer à l’aune d’une décision récente du Premier président de la cour d’appel de Versailles.
1. La contestation croissante, par les patients, des modalités des mesures de soins sans consentement plutôt que de leur principe même.
Lors de son audition, Me Aurore Bonduel, avocate au barreau de Lille, a expliqué que, bien souvent, les patients sollicitent leur avocat pour contester non pas tant le principe même de l’hospitalisation que ses conditions : ils voudraient que le JLD se prononce sur le choix des traitements appliqués, sur leur mode d’administration, sur leurs effets secondaires, sur la sectorisation, ou encore sur le choix du psychiatre qui les suit (152).
Ce constat est partagé par les représentants du Syndicat de la magistrature et de l’Union syndicale des magistrats (USM), qui ont indiqué que le JLD est souvent saisi de demandes ayant trait au contenu de la prise en charge thérapeutique (port du pyjama(153), interdiction de fumer, de téléphoner, de sortir, etc.) sur lequel il ne lui revient pourtant pas de se prononcer – ce qu’a déploré M. Michel Dutrus, conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, délégué général de FO-Magistrats.
Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, a fait remarquer que, souvent, la mesure d’hospitalisation complète est mieux acceptée lorsque ses conditions sont améliorées et que la présence d’un représentant de l’établissement d’accueil aux audiences est souhaitable, dans la mesure où ce dernier pourrait recueillir les motifs d’insatisfaction du patient afin d’y remédier, au moins en partie.
Tous ces constats rejoignent celui établi par Mme Pauline Rhenter, chercheure pour l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), dans la contribution écrite qu’elle a fournie à la mission. Elle y rapporte qu’au cours des nombreux entretiens qu’elle a menés, au cours des treize dernières années, avec une centaine de personnes usagères des services de psychiatrie, c’était souvent les conditions de mise en œuvre des mesures de soins sans consentement plutôt que leur principe même qui étaient dénoncées : « il est alors question a maxima de restrictions franches à la liberté de circulation, de contention, de traitements médicamenteux imposés jugés trop lourds ou inadaptés, et, a minima, de pressions, de chantage, d’infantilisation, de sentiments de discrédit et d’humiliation ». Est également pointée « la limitation des choix quant à l’accompagnement et sa continuité : choix de son médecin, de son équipe, de la méthode d’accompagnement et des médicaments, contraintes de la sectorisation telle qu’elle est opposée au patient », etc.
Lors de son audition, M. Claude Deutsch, secrétaire général de l’association Advocacy France, a lui aussi fait état du développement, chez les patients, d’un « sentiment croissant d’arbitraire », particulièrement au regard des pratiques en matière d’isolement et de contention qui, d’après la représentante de la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires (CHU), Mme Nathalie Borgne, posent des questions de formation du personnel infirmier.
S’agissant de ces mesures, l’article 72 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit dans le code de la santé publique un article L. 3 222-5-1 prévoyant que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours », qu’« il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée », et que « leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin ».
En application de ce texte, « un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement [et] pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires ».
Par ailleurs, « l’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, de la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa mise en œuvre ». Ce rapport est transmis à la commission des usagers de l’établissement concerné ainsi qu’à son conseil de surveillance.
Dans les réponses qu’il a apportées au questionnaire de la mission, le ministère des affaires sociales et de la santé a indiqué « ne pas dispose[r] à ce stade d’un état des lieux de la mise en œuvre des registres dans les établissements(154) mais envisage[r] de réaliser cet état des lieux à l’issue de la publication d’une instruction […] visant à préciser les modalités de mise en œuvre du registre et l’utilisation des données recueillies aux niveaux des établissements, des régions et de l’État afin de suivre l’évolution du recours à ces pratiques. Cette instruction sera complétée par les recommandations de bonne pratique en cours d’élaboration par la Haute Autorité de santé (HAS) sur la contention et sur l’isolement. Ces textes préciseront les modalités détaillées de mise en œuvre : qualité du médecin auteur de la décision, indications et contre-indications, fréquence de la surveillance infirmière, fréquence des examens somatiques et psychiatriques, information du patient, durée maximum, post-entretien, etc. ».
D’après les indications fournies à la mission, les recommandations de la HAS en matière d’isolement et de contention devraient être finalisées au cours du mois de février 2017, et la circulaire du ministère des affaires sociales et de la santé d’ici la fin du mois de mars 2017. Rappelant que les travaux du Conseil national de la santé mentale installé en octobre 2016 par Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, allaient porter en partie sur le recours à la contention et à l’isolement, les agents de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) entendus par la mission ont précisé que l’élaboration de la circulaire relative à la contention et à l’isolement prenait du temps en raison du choix fait d’opérer une large concertation, qui a d’ailleurs été lancée par le comité de pilotage sur la psychiatrie le 13 janvier dernier. Ces agents ont en outre assuré à la mission qu’ils travaillaient étroitement avec la HAS de façon à s’assurer que les termes de la circulaire convergent avec ceux des recommandations de la HAS et qu’il n’y ait ainsi aucune ambiguïté sur ces sujets sensibles.
Les rapporteurs ont pu obtenir de la HAS ces projets de recommandations. Ils constatent avec satisfaction qu’ils traitent la question de savoir si un interne peut, par délégation de compétence, décider d’un isolement ou d’une contention. En effet, la HAS envisage de recommander « que le médecin [appelé à décider de l’isolement et de la contention] soit préférentiellement le psychiatre traitant du patient dans l’unité de soins », et qu’« en cas de décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre, et durant les périodes de garde, cette décision doi[ve] être confirmée par un psychiatre dans l’heure qui suit ». En effet, comme l’a rappelé Mme Anne Lecourbe, contrôleure auprès de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), un interne n’a pas la capacité juridique de prendre une décision de placement à l’isolement. Seul un psychiatre peut le faire.
En revanche, les rapporteurs s’étonnent – non sans inquiétude – que le projet de recommandations de bonnes pratiques de la HAS en matière d’isolement et de contention prévoie, fût-ce « à titre dérogatoire et uniquement en cas d’urgence », qu’« il peut être possible d’isoler, pour des raisons tenant à sa sécurité un patient en soins libres pour une durée maximale de 14 heures, temps maximum nécessaire soit à la résolution de la situation d’urgence, soit à l’initiation de la transformation de son régime de soins ».
Comme la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Mme Adeline Hazan, les rapporteurs jugent beaucoup trop longue cette durée de 14 heures dont des esprits chagrins ont relevé qu’elle était celle d’une garde d’interne.
S’il est positif que le projet de recommandations rappelle que « seuls les patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peuvent être isolés », il n’en demeure pas moins que, quand bien même elle interviendrait dans le cadre d’une hospitalisation contrainte, une mesure d’isolement continue pendant 14 heures ne serait pas conforme à l’article 72 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Par ailleurs, lors de leur audition, les représentants de la HAS ont indiqué que, si les pratiques adoptées en matière de contention et d’isolement ne constituaient pas en tant que telles un élément de la certification des établissements autorisés en psychiatrie et chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement, elles étaient néanmoins examinées dans le cadre de cette certification, à l’occasion du contrôle des pratiques relatives au parcours des patients, au respect de leurs droits et à l’administration des traitements médicamenteux.
À cet égard, ces mêmes représentants ont signalé que les commissions réunies pour se prononcer sur la certification des établissements de santé ne font pas l’objet d’une configuration spéciale lorsqu’il s’agit des établissements de santé mentale, de sorte que les représentants des associations d’usagers qui siègent dans les commissions statuant sur la certification de ces derniers établissements ne sont pas nécessairement ceux d’associations d’usagers des services psychiatriques. Estimant la situation regrettable, ils ont donc suggéré :
– soit que les commissions soient réunies sur la base d’un ordre du jour thématique de façon à permettre aux représentants des associations d’usagers des services psychiatriques d’assister aux réunions statuant sur la certification des établissements de santé mentale ;
– soit que la question de la certification des établissements de santé mentale fasse l’objet de réunions de commissions distinctes associant les représentants des associations d’usagers des services psychiatriques.
Les rapporteurs appellent de leurs vœux la publication, dans les meilleurs délais, de la circulaire relative à la contention et l’isolement ainsi que des recommandations de bonnes pratiques de la HAS en la matière.
La publication de ces textes est d’autant plus pressante que, dans son attente, certains établissements (en particulier ceux qui n’étaient pas dotés de registres sur l’isolement et la contention avant la loi du 26 janvier 2016) n’appliquent pas cette loi en vigueur depuis plus d’un an et que certaines pratiques préoccupantes subsistent. Ainsi, dans le Journal officiel du 16 mars 2016, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a formulé, en urgence, des recommandations relatives au centre psychothérapique de l’Ain, à Bourg-en-Bresse, en conclusion d’un rapport qui explique que, lors de la visite de cet établissement, les contrôleurs ont fait le constat de situations individuelles et de conditions de prise en charge portant des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées.
La Contrôleure générale a estimé que « les conditions dans lesquelles les patients sont placés à l’isolement, enfermés, sous contention pour des durées particulièrement longues, pouvant atteindre des mois, voire des années, constituent, à l’évidence, un traitement inhumain et dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (155). Le rapport relève notamment un recours à l’isolement et à la contention non conforme aux règles communément appliquées et utilisé dans des proportions jamais observées jusqu’à présent – alors même que la résolution n° 46/119 de l’Assemblée générale des Nations unies du 17 décembre 1991 prévoit expressément que « la contrainte physique ou l’isolement d’office du patient ne doivent être utilisés que conformément aux méthodes officiellement approuvées du service de santé mentale, et uniquement si ce sont les seuls moyens de prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui » (156).
À l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), le recours à l’isolement est systématique, l’infirmerie ne disposant que de chambres fermées, afin d’éviter toute fugue. Après avoir été conduits à l’infirmerie par les forces de l’ordre, les patients y sont pris en charge immédiatement par le personnel soignant qui, se relayant par tour de garde de 24 heures (de 13 heures le jour J à 13 heures le jour J + 1) assure une permanence nuit et jour, sept jours sur sept. Les patients sont ensuite placés dans une chambre d’isolement dotée d’un bouton d’appel et pouvant comporter un ou deux lits – étant précisé que les mineurs sont toujours seuls dans leur chambre. Les patients sont toujours accompagnés par au moins deux personnes pour se rendre aux sanitaires.
D’après ce qui a été indiqué à la mission, la contention est presque systématiquement pratiquée à l’IPPP, pendant une quinzaine de minutes à l’arrivée des patients en raison de leur agitation. Si leur état médical le justifie, de nouvelles mesures de contention peuvent être décidées, pour une durée maximale de six heures, conformément au projet de recommandations de la HAS en la matière – étant précisé qu’elles sont évaluées toutes les deux ou trois heures.
L’état de délabrement des chambres d’isolement de certains établissements de santé a été dénoncé, notamment par M. Alain Monnier, référent des commissions départementales de soins psychiatriques, entendu en tant que représentant de l’Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM).
Lors de son déplacement, la mission a pu constater par elle-même l’état particulièrement dégradé d’une chambre d’isolement de l’hôpital de Meaux, qui était pourtant, nous a-t-on dit, la moins dégradée… Cet hôpital fait partie, avec les centres hospitaliers de Marne-la-Vallée et de Coulommiers, du Groupe Hospitalier de l’Est Francilien (GHEF). Couvrant neuf secteurs, comptant 300 lits d’hospitalisation et suivant une file active de près de 15 000 patients, le pôle de psychiatrie adulte de ce groupe hospitalier est, après celui de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), le plus important de France. Cela peut entre autres s’expliquer par le fait que la Seine-et-Marne est le seul département du pays à n’avoir jamais été doté d’un hôpital spécialisé en psychiatrie et que l’ensemble des soins psychiatriques sont pris en charge par l’hôpital général (ce qui peut avoir des incidences en termes de moyens).
Rappelant que l’agglomération de Meaux ne compte que 4 psychiatres libéraux pour 100 000 habitants et que la Seine-et-Marne ne dispose d’aucun lit pour mineurs dans les services de psychiatrie, le chef du pôle de psychiatrie adulte du GHEF, le Dr Vincent Mahé, a lui-même convenu du caractère vétuste voire « indigne » des locaux abritant les services qu’il dirige. Depuis les constats sévères qu’avait émis le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) à la suite de sa visite du centre hospitalier de Meaux en décembre 2009 (157), les conditions d’hébergement des malades en psychiatrie ne se sont guère améliorées, faute de moyens : les chambres d’isolement sont toujours dépourvues de sanitaires, les détenus hospitalisés sont toujours systématiquement placés à l’isolement et le pôle de psychiatrie ne dispose toujours pas d’espace extérieur ouvert, de sorte que les patients se voient interdire de fumer (sauf dans leur chambre, pour certains d’entre eux). Notant que, grâce aux travaux réalisés, le taux de fugue des patients avait diminué au centre hospitalier de Marne-la-Vallée, le Dr Vincent Mahé espère que les conditions d’hébergement des patients dans les services psychiatriques de l’hôpital de Meaux s’amélioreront à la faveur de la construction annoncée d’un nouvel hôpital. Si la mission se réjouit de ce projet ambitieux, elle considère néanmoins que les travaux nécessaires à la remise en état de décence des locaux accueillant des malades ne sauraient attendre sa réalisation.
Aujourd’hui, si certains progrès ont pu être enregistrés grâce à la constitution d’un réseau avec les centres médico-psychologiques et les psychologues, qui permet une orientation plus rapide et plus pertinente des patients vers la prise en charge la plus appropriée au regard de leur pathologie (médecine de ville pour les pathologies les plus légères ; hospitalisation pour les plus lourdes), il n’en demeure pas moins que les services psychiatriques de l’hôpital sont embolisés par de longs séjours de patients qui, faute de structures d’accueil en aval, sont parfois contraints de se rendre en Belgique pour trouver un établissement qui les accueillera aux frais des organismes de sécurités sociales français. Selon le Dr Vincent Mahé, le problème n’est donc pas le placement abusif en hospitalisation contrainte (et, le cas échéant, à l’isolement) que des non-admissions ou des sorties abusives en ce sens qu’elles sont motivées par le manque de places au sein des services psychiatriques.
Le CRPA a attiré l’attention des rapporteurs sur des situations alarmantes. Dans la contribution écrite qu’elle a fournie à la mission, Mme Yaël Frydman, secrétaire générale du CRPA, après avoir donné l’exemple de l’isolement et d’une contention de cinq jours dès l’hospitalisation d’une personne calme, considère que « vu le manque de personnel, l’isolement et la contention sont indéniablement un confort pour le service ».
Les mesures d’isolement et de contention pourraient donc être des facilités pour les établissements d’accueil en sous-effectif, alors même que, dès 1993, la circulaire dite « Veil » portant sur le rappel des principes relatifs à l’accueil et aux modalités de séjours des malades hospitalisés pour troubles mentaux (158), précisait que « l’hébergement d’un malade dans une unité fermée doit répondre à une indication posée par un médecin et non pas relever d’une simple commodité du service ».
Cette analyse est notamment celle de Mme Pauline Rhenter qui, dans la contribution écrite qu’elle a fournie à la mission, note que « de nombreuses études menées à l’étranger ont montré que la mise en chambre d’isolement était plus corrélée à des facteurs liés à l’équipe et au service qu’à des facteurs liés à l’agitation ou à la violence des patients hospitalisés ».
Ces études sont corroborées par l’expérience du Dr Natalie Giloux qui, dans un article publié en 2014, écrit : « mon expérience de psychiatrie aux urgences m’a amenée à constater qu’à un certain seuil de saturation du dispositif de soin, à cause de la présence dans le service d’un trop grand nombre de patients, par défaut de lits entraînant une trop grande promiscuité, par manque de personnel, nous ne soignons plus, nous faisons taire. Faire taire, c’est endormir, enfermer, attacher parfois… Enfermer, ce n’est pas soigner » (159).
Le Dr Isabelle Montet, secrétaire générale du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), a confirmé qu’il peut être recouru aux mesures d’isolement et de contention pour des problèmes liés à l’aménagement architectural et matériel de l’établissement d’accueil. Cela risque d’être d’autant plus le cas, selon le Dr Maurice Bensoussan, président du Syndicat des psychiatres français (SPF), qu’il est désormais interdit aux établissements de santé privés de compter des chambres comportant plus de trois lits.
Pour sa part, le Dr Michel Triantafyllou, président du syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP), a signalé que le recours aux mesures d’isolement peut aussi s’expliquer par le positionnement de certains magistrats du parquet qui, dans l’attente du complet déploiement des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) sur l’ensemble du territoire, exigeraient systématiquement que les détenus soient placés en chambres d’isolement lorsque les établissements de santé sont dépourvus de portiques de contrôle électronique (160). La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan, s’en est inquiétée dans son rapport d’activité pour l’année 2015, où elle note que « des considérations de sécurité conduisent parfois, sans fondement légal, à des mesures excessives de privation de liberté : dans certains services, les détenus hospitalisés sont placés systématiquement en chambre d’isolement », alors que « ces placements ne devraient pas être systématiques mais faire l’objet d’une décision médicale individualisée correspondant à une nécessité thérapeutique » (161).
État du déploiement des UHSA Depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, les personnes détenues bénéficient de soins délivrés par des professionnels hospitaliers et ne sont plus prises en charge, en matière de soins, par l’administration pénitentiaire. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a prévu la création d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) chargées d’accueillir les personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques nécessitant une hospitalisation à temps complet, avec ou sans consentement. Le programme de construction portait sur 705 lits et comportait deux tranches de construction. La première tranche, d’une capacité de 440 places, couvrait la période de 2010 à 2014. Toutefois, des arbitrages financiers ainsi que des mises en chantier ont prolongé le calendrier d’ouverture jusqu’à 2017 (pour l’UHSA de Marseille). Un bilan quantitatif de la mise en œuvre de la première tranche a été finalisé en décembre 2015. La détermination des emplacements des UHSA de la deuxième tranche de construction est actuellement à l’étude par les administrations des ministères de la justice ainsi que des Affaires sociales et de la santé. Les dates et lieux d’implantation prévus sont les suivants : DISP Localisation Commune Capacité Mise en service CH Le Vinatier BRON 60 21 mai 2010 TOULOUSE CH Gérard Marchand TOULOUSE 40 6 janvier 2012 Centre Psycho-thérapeutique de Nancy Laxou LAXOU 40 5 mars 2012 DIJON CH Georges Daumezon FLEURY LES AUBRAY 40 04/03/2013 PARIS Paul Guiraud Villejuif VILLEJUIF 60 25/04/2013 LILLE CH Seclin SECLIN 60 Juillet 2013 RENNES CH Guillaume Régnier RENNES 40 23 sept 2013 BORDEAUX Centre Hospitalier spécialisé Cadillac CADILLAC SUR GARONNE 40 Juin 2016 MARSEILLE CH Edouard Toulouse MARSEILLE 60 Juillet 2017 Le nombre d’UHSA est passé de 1 en 2011 à 3 en 2012, avant de se stabiliser à 7 de 2013 à 2015 pour progresser enfin à 8 en 2016. De son côté, le nombre de personnes détenues prises en charge en soins libres en UHSA est passé de 371 en 2012 à 583 en 2013, avant de doubler pour atteindre 1 098 en 2014 et 1129 en 2015. Il serait de 920 à la fin du troisième trimestre de 2016, d’après la direction de l’administration pénitentiaire. Il faut préciser qu’au niveau national, sur le nombre annuel total d’hospitalisations en UHSA, la part des hospitalisations consenties a pu varier entre 55 % en 2011 et 68 % en 2012. Pour l’année 2015, d’après les chiffres fournis par huit directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP), 61 % des hospitalisations en UHSA étaient consenties et 39 % s’effectuaient sous contrainte. Le nombre de personnes détenues hospitalisées en UHSA ayant progressivement augmenté au fur et à mesure de l’ouverture des UHSA, ces unités n’ont pas permis d’absorber l’ensemble des hospitalisations en établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins psychiatriques.
Nota : les chiffres 2015 et 2016 ne sont pas consolidés. Source : Ministère de la justice. |
Par ailleurs, Mme Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (FNAPSY), a signalé que, dans certains établissements, les chambres d’isolement seraient rebaptisées « chambres d’apaisement » ou encore « chambre de soins psychiatriques intensifs », afin de faire échapper les mesures d’enfermement dans ces chambres à l’obligation légale de tenue du registre – tenue dont la qualité serait par ailleurs variable et difficile à vérifier, notamment dans certains établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC).
Cette analyse a toutefois été réfutée par le Dr Natalie Giloux, psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Le Vinatier (Bron), et par les différents syndicats de psychiatres entendus par la mission.
Comme les représentants de ces syndicats, le Dr Natalie Giloux a expliqué que l’application de la dénomination « chambres d’apaisement » à des chambres fermées résulte non pas de la volonté des médecins de contourner l’obligation légale de renseignement du registre par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, mais de leur souci d’adopter une terminologie qui rompe avec la logique carcérale et qui reste sans impact sur la tenue du registre, ce dernier étant renseigné dès lors qu’un patient est placé dans une chambre fermée, quel que soit le nom donné à cette chambre (« d’isolement » ou « d’apaisement »).
Ainsi, le Centre Hospitalier Le Vinatier, à Bron, s’est doté :
– d’un « espace psychiatrique de soins intensifs » qui est une chambre fermée très sécurisée et dont l’aménagement est conçu pour éviter toute mise en danger du patient ou d’autrui ;
– de « chambres d’apaisement » qui sont des chambres fermées d’aménagement classique et pouvant comporter du mobilier ;
– de « salons d’apaisement » qui sont des espaces où le patient peut s’enfermer lui-même pour une heure ou deux.
Le Dr Natalie Giloux a assuré la mission que tout placement d’un patient dans l’un de ces espaces fermés donnait lieu au renseignement du registre précité, à une visite du personnel soignant au moins une fois par heure et à un compte-rendu écrit de chacune de ces visites.
Les représentants de la HAS ont, lors de leur audition, confirmé que tout placement d’un patient dans une pièce fermée devait donner lieu au renseignement du registre.
Plusieurs personnes entendues ont revendiqué l’interdiction pure et simple des mesures d’isolement et de contention. C’est notamment le cas des représentants d’Advocacy France. Tout en plaidant pour l’interdiction du recours à la contention, les représentants du Cercle de réflexion et de propositions d’actions sur la psychiatrie (CRPA) demandent qu’à défaut d’être interdites, les mesures d’isolement soient mieux formalisées, notifiées aux patients concernés et soumises au contrôle du JLD. Selon le CRPA, les patients placés à l’isolement devraient, avec l’assistance d’un avocat, pouvoir contester la mesure et celle-ci devrait faire l’objet d’un contrôle de plein droit du JLD au-delà d’une certaine durée (de cinq jours, par exemple).
C’est aussi le point de vue des représentantes du Syndicat de la magistrature que la mission a entendues : selon elles, les mesures d’isolement et de contention présentent un degré de gravité supplémentaire tel, au regard de l’atteinte aux droits des patients qui résulte de l’hospitalisation complète, qu’elles devraient faire l’objet d’un contrôle systématique par le JLD.
On peut toutefois se demander si, en l’état de notre législation et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la notion de liberté individuelle, ce contrôle ne relève pas davantage du juge administratif.
2. Le rappel, par la Cour de cassation, de la compétence résiduelle du juge administratif
Si la loi du 5 juillet 2011 a confié le contentieux de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement au juge judiciaire, conformément à la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel, elle n’a pas créé de bloc de compétence, ainsi que l’a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2016 (162).
En l’espèce, il s’agissait d’un patient qui avait fait l’objet de plusieurs mesures de soins sans consentement, notamment en hospitalisation complète, avant d’être pris en charge sous la forme d’un programme de soins. Saisi d’une demande de mainlevée de cette mesure, le premier président de la cour d’appel de Paris a annulé la décision administrative d’admission en soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
Cette décision a été logiquement cassée par la Cour de cassation qui a rappelé que « si le juge judiciaire connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, il ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure, s’il est résulté, de l’irrégularité qu’il constate, une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet », mais que, pour autant, « le juge judiciaire ne peut annuler une décision administrative », sauf à commettre un excès de pouvoir.
Comme l’explique Mme Patricia Hennion-Jacquet, maître de conférences à l’Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, dans sa note sous l’arrêt du 11 mai 2016, « si, outre le bien-fondé de la décision administrative qui relève de ses compétences depuis 1946, le juge des libertés et de la détention (JLD) contrôle désormais la régularité de la décision administrative de soins forcés, l’article L. 3216-1 du code de la santé publique (CSP) (163)ne lui a pas pour autant conféré explicitement le pouvoir, pour le cas où il retiendrait l’illégalité externe de l’acte administratif, d’annuler ce dernier. […] Le JLD peut donc paralyser les effets d’une décision administrative, mais il ne peut l’annuler. » (164)
Jugeant le maintien d’une compétence résiduelle au profit du juge administratif inutilement complexe, dans la mesure où ce partage de compétences « ne simplifie nullement la procédure et conduit le justiciable à demander à un juge (administratif) d’annuler un acte dont l’irrégularité a été constatée par un autre juge (judiciaire) » (165), Mme Patricia Hennion-Jacquet suggère d’unifier l’ensemble du contentieux des soins psychiatriques sans consentement au profit du juge judiciaire.
Il semble qu’une récente décision des juges du fond aille en ce sens.
3. L’émergence, en jurisprudence, d’un contrôle judiciaire de la proportionnalité des décisions (notamment d’isolement) prises dans le cadre de mesures de soins sans consentement
Dans un ordonnance du 24 octobre 2016, le Premier président de la Cour d’appel de Versailles a donné mainlevée d’une mesure d’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’État au motif que l’établissement d’accueil de la personne internée ne justifiait pas la mesure d’isolement dont elle avait fait l’objet pendant une longue période.
Il s’agissait dans cette affaire d’un patient qui, en décembre 2012, avait été admis en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’État dans le département. En juillet 2016, ce patient a bénéficié d’un programme de soins auquel il a été mis fin un mois plus tard, en raison de la persistance d’un état paranoïde chronique avec manifestations périodiquement difficiles au domicile des parents. Le patient a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète le 17 août 2016 – date à laquelle il a aussitôt été placé à l’isolement, avant d’être transféré dans une unité pour malades difficiles (UMD) par arrêté préfectoral du 29 septembre dernier.
Au début du mois d’octobre, les parents du patient ont saisi le JLD du TGI de Nanterre d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Ce dernier a rejeté leur demande.
Ils interjetèrent appel, en soutenant que leur enfant avait été placé à l’isolement de façon continue depuis le 17 août 2016 en raison du manque de place et que cette mise à l’isolement, qui avait provoqué une altercation entre ce dernier et son équipe soignante, n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Qui plus est, leur fils n’avait, selon eux, pas fait l’objet d’un examen somatique complet dans les 24 heures suivant sa réintégration en hospitalisation complète et l’arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques était à leurs yeux insuffisamment motivé dans la mesure où le certificat médical sur lequel il était fondé n’avait pas été joint à la décision.
Considérant que « les mesures d’isolement et de contention sont, par leur nature même, gravement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et venir dont le juge judiciaire est le garant par application de l’article 66 de la Constitution », que la charge de la preuve du respect des dispositions de l’article L. 3222-5-1 précité pesait non pas sur les demandeurs, mais sur l’établissement hospitalier défendeur, que c’était donc à cet établissement de « fournir au juge les éléments lui permettant d’opérer le contrôle qui lui incombe sur les atteintes à la liberté du patient » et qu’en l’espèce, « aucun élément n’est produit permettant de déterminer si la mise à l’isolement [du patient] résulte bien d’une décision d’un psychiatre et si elle était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui », le Premier président de la Cour d’appel de Versailles a constaté une atteinte aux droits du patient qui justifiait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, dans un délai maximal de 24 heures susceptible de permettre l’établissement d’un programme de soins (166).
Outre qu’elle place le fardeau de la preuve du respect des conditions légales du recours aux mesures d’isolement sur l’établissement d’accueil des patients, cette décision est particulièrement remarquable en ce qu’elle reconnaît au juge judiciaire la compétence pour contrôler les mesures d’isolement et de contention – au motif qu’elles portent atteinte à une liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution érige ce juge en gardien – et en ce qu’elle tire des conditions d’hospitalisation des conséquences sur son principe même.
Cela n’avait rien d’évident :
– d’une part, parce que, comme l’a rappelé M. Guillaume Meunier, sous-directeur du droit civil à la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) du ministère de la justice, l’esprit de la réforme de 2011 était que le JLD se prononce moins sur les conditions d’hospitalisation des patients que sur la régularité formelle de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement ;
– et d’autre part, parce que les mesures de contention et d’isolement sont des décisions dont on pourrait soutenir qu’elles relèvent du contrôle du juge administratif, saisi par exemple dans le cadre d’un référé-liberté.
Toutefois, cela se comprendrait, selon Mme Marion Primevert, dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, a tendu à reconnaître implicitement au juge judiciaire le pouvoir de contrôler la proportionnalité des mesures dont les personnes admises en soins sans consentement peuvent faire l’objet au cours de leur hospitalisation.
En effet, le considérant n° 16 de cette décision énonce que « l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre de celles-ci figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire [et] que les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ».
Plusieurs avocats entendus par la mission, et notamment Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, président de la commission « hospitalisation d’office et personnes vulnérables » du Syndicat des avocats de France (SAF), ainsi que Me Aurore Bonduel, avocate au barreau de Lille, ont salué la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 24 octobre dernier, estimant qu’il était légitime de tirer des conséquences des conditions d’hospitalisation sur le principe même de celle-ci.
Selon M. André Bitton, président du CRPA, cette décision pourrait ouvrir la voie à un contrôle, par le juge judiciaire, non seulement des conditions d’hospitalisation sans consentement (et pas seulement de leur principe), mais aussi des mesures contraignantes assortissant des hospitalisations libres, telles des mises à l’isolement séquentielles de quelques heures par jour.
« Impensables » si elles durent plus de six heures, selon le Dr Michel Triantafyllou, président du syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP), ces mises à l’isolement séquentielles dans le cadre d’hospitalisations libres suscitent la préoccupation de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Mme Adeline Hazan, qui a expliqué à la mission que, faute de places dans les unités d’hospitalisation libre, elles s’effectuaient parfois dans des unités fermées (sans que l’autorisation du patient soit pour autant requise) et qu’elles pouvaient donner lieu à une transformation de l’hospitalisation libre en hospitalisation contrainte.
Ces pratiques sont d’autant plus inquiétantes que les mises à l’isolement séquentielles sont affranchies de tout contrôle judiciaire, comme l’est du reste le recours à la contention dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Leur contrôle relève de l’ARS et du conseil départemental, et échappe à celui du CGLPL (167). La loi d’adaptation de la société au vieillissement (168) a également donné compétence au Défenseur des droits.
Plusieurs des personnes entendues, parmi lesquelles les représentantes du Syndicat de la magistrature, ont appelé l’attention des rapporteurs sur la nécessité de se pencher sur les mesures restrictives de liberté dont peuvent faire l’objet les personnes vivant dans les EHPAD, en particulier celles atteintes de maladies neurodégénératives.
La commission des affaires sociales procède à l’examen du rapport d’information de la mission d’évaluation de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (MM. Denys Robiliard et Denis Jacquat, rapporteurs).
M. Denis Jacquat, rapporteur de la mission d’évaluation. Madame la présidente, monsieur le co-rapporteur, mes chers collègues, comme vous le savez, le bureau de notre commission a décidé, en décembre dernier, sur le fondement de l’article 145-7, alinéa 3, du Règlement, de créer une mission d’évaluation de la loi du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Un peu plus de trois ans après leur adoption, il était en effet nécessaire d’évaluer l’application des différentes mesures que comportait la loi du 27 septembre 2013.
Je vous rappelle que, en réponse à une censure du Conseil constitutionnel en date du 20 avril 2012, cette loi a réformé la procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD) ou hospitalisées à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Cette loi a, par ailleurs, allégé la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement en supprimant un certain nombre de certificats médicaux, et en précisant le dispositif de programme de soins ainsi que celui relatif aux sorties d’essai. Ces mesures sont entrées en vigueur immédiatement, le 30 septembre 2013.
La loi a, en outre, réformé la procédure judiciaire encadrant l’admission en soins psychiatriques sans consentement. Elle a ramené de quinze à douze jours le délai dont dispose le juge des libertés et de la détention (JLD) pour statuer sur une hospitalisation complète sous contrainte. Elle a institué le principe d’une salle d’audience aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, lieu où l’audience du JLD doit se tenir – celle-ci ne pouvant avoir lieu au tribunal de grande instance qu’à titre d’exception. Elle a supprimé la visioconférence. Enfin, elle a instauré un principe de représentation obligatoire par avocat au bénéfice des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement. Toutes ces mesures sont entrées en vigueur le 1er septembre 2014 – sauf celle ayant fixé à quinze jours le délai pour saisir le JLD dans le cadre du contrôle semestriel des hospitalisations sous contrainte : ce délai est entré en vigueur le 15 mars 2014.
Notre assemblée suspendant ses travaux fin février, nous ne disposions que d’un mois environ pour mener à bien notre mission d’évaluation.
Malgré ces délais contraints, nous sommes parvenus, grâce à nos administrateurs, à réaliser plus d’une quinzaine d’auditions et de tables rondes qui ont duré au total une vingtaine d’heures et au cours desquelles nous avons rencontré la quasi-totalité des acteurs concernés, qu’il s’agisse des représentants des associations des usagers des services psychiatriques, des avocats, des magistrats, des psychiatres, des directeurs d’établissements de santé, des chercheurs et experts – je pense notamment à Mme Magali Coldefy –, des services des ministères de la justice ainsi que des affaires sociales et de la santé, ou encore d’autorités indépendantes comme la Haute Autorité de santé (HAS) ou la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL).
La mission a également effectué deux déplacements : l’un à l’hôpital Sainte-Anne et à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, l’autre à l’hôpital de Meaux.
Si le ministère de la justice, ainsi que celui des affaires sociales et de la santé, se sont montrés disponibles pour répondre à nos questions, aussi bien par écrit qu’à l’occasion d’auditions, on ne peut pas en dire autant du ministère de l’intérieur. La préfecture de police de Paris (PPP) et l’association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur (ACPHFMI) mises à part, le ministère de l’intérieur s’est en effet montré sourd à nos nombreuses sollicitations : il n’a ni répondu au questionnaire qui lui a été adressé en décembre dernier, ni permis l’organisation d’une audition de ses services. Nous ne pouvons que vivement le regretter.
Je veux néanmoins achever mon propos introductif sur une note positive en me félicitant de la bonne intelligence dans laquelle vos deux co-rapporteurs, issus de la majorité et de l’opposition, ont collaboré dans le cadre de cette mission, et en soulignant que cette qualité des relations de travail a favorisé le consensus : en effet, je souscris à l’ensemble des recommandations que nous formulons à l’issue de nos investigations et que mon collègue Denys Robiliard, qui a suivi ce dossier durant toute la législature, va vous présenter sans plus tarder.
M. Denys Robiliard, rapporteur de la mission d’évaluation. Madame la présidente, monsieur le co-rapporteur, mes chers collègues, notre mission a effectivement mené ses travaux très rapidement, compte tenu des délais qui lui étaient impartis – avec le concours de nos administrateurs, que je remercie –, et dans une excellente ambiance, ce qui lui a permis de trouver un accord sur la totalité des recommandations proposées.
Je regrette également que le ministère de l’intérieur n’ait pas répondu à nos sollicitations, car j’estime qu’il a, comme les autres ministères, le devoir de rendre compte à l’Assemblée nationale – d’autant qu’en l’occurrence, nous traitions d’un sujet important, touchant aux libertés, qui méritait que cette administration, ayant certes une importante charge de travail à assumer, dégage le temps nécessaire pour nous répondre.
Pour en revenir à ce qui nous réunit aujourd’hui, un bref historique me semble s’imposer. Les deux premières lois à avoir modifié celle du 30 juin 1838 sur les aliénés sont la loi du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes et la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. Le dispositif s’appliquant à la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques est resté constant dans sa tension entre la recherche des soins et le souci d’assurer l’ordre public.
La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge était perçue par les psychiatres comme une loi liberticide et procédant du discours prononcé en 2008 à Antony par le président Sarkozy.
Or, si elle s’inscrivait bien dans la filiation de ce discours, la loi avait deux autres « parents » – le mariage pour tous n’était pourtant pas entré en vigueur… (Sourires.). Premièrement, une décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 affirmait que le système d’hospitalisation d’office à la demande d’un tiers, résultant de la loi de 1990 et reprenant les grandes lignes de la loi de 1838, n’était pas constitutionnel dès lors qu’il n’y avait pas, comme l’exige l’article 66 de la Constitution, un juge pour contrôler, dans un délai de quinze jours, la validité de l’hospitalisation décidée contre le gré du patient. Deuxièmement, le souci de la continuité des soins était porté à la fois par l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) et par la direction générale de l’organisation des soins (DGOS) du ministère de la santé – qui exprimait cette préoccupation dans un rapport de 2004 de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Ce souci a conduit à une évolution assez considérable du paradigme des soins sans consentement. Avant la loi du 5 juillet 2011, les soins sans consentement étaient des hospitalisations sans consentement – la commission chargée de leur contrôle était d’ailleurs la commission départementale de l’hospitalisation psychiatrique. En 2011, on est passé à la notion de soins sans consentement, c’est-à-dire que les soins susceptibles de faire l’objet d’une obligation légale pouvaient consister en une hospitalisation complète, mais aussi en une hospitalisation de jour, c’est-à-dire à temps partiel, ou encore en des soins ambulatoires. Cela a constitué une modification extrêmement importante du périmètre des soins sans consentement.
Dans sa décision du 20 avril 2012, le Conseil constitutionnel a invalidé deux dispositions de la loi du 5 juillet 2011, mais également fait une lecture particulière de cette loi, en considérant que le législateur n’avait pas entendu assortir les soins sans consentement hors hospitalisation complète d’une possibilité de coercition. Autrement dit, il a jugé que l’on ne pouvait pas, pour l’exécution de soins certes obligatoires – puisque faisant l’objet d’un programme de soins à valeur obligatoire – recourir à la force pour contraindre le patient à recevoir ces soins. Si le psychiatre considère que les soins doivent absolument être administrés, il n’a donc pas d’autre option que de lancer un nouveau programme d’hospitalisation complète qui, lui, fera l’objet d’un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention.
Le premier motif d’invalidation de la décision du 20 avril 2012 portait sur le statut des unités pour malades difficiles (UMD), ou plus exactement sur le fait que le séjour en UMD supérieur à un an entraînait l’application d’un dispositif renforcé conditionnant la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement.
Les UMD étaient à la fois des lieux de soin et des lieux à forte dimension carcérale, à des fins sécuritaires. Ce qui prédominait dans ce dispositif était l’importance de l’encadrement médical, trois à quatre fois supérieur à celui mis en œuvre dans un service classique. Ce système avait son efficacité : il aboutissait dans la plupart des cas – pas tous, certes – à ce que le patient ressorte au bout de quelques mois, une fois que le traitement reçu avait permis de réduire suffisamment les troubles ayant conduit à l’hospitalisation. Estimant qu’il n’y avait pas de raisons de tirer des conséquences juridiques du passage dans une structure thérapeutique, le législateur de 2013 avait choisi de supprimer le statut légal des UMD.
Le deuxième motif d’invalidation de la décision du 20 avril 2012 avait trait au statut des irresponsables pénaux. Sans nier la nécessité de maintenir un statut particulier, le Conseil constitutionnel considérait que les garanties dont ce statut devait être assorti n’étaient pas précisées par la loi, alors qu’elles relevaient nécessairement d’elle seule, et que, dès lors, le régime juridique des irresponsables pénaux n’était pas conforme à la Constitution. Je rappelle que, sur ce point n’ayant fait l’objet d’aucune observation des personnes que nous avons entendues, nous avons décidé de cantonner l’application du dispositif aux faits les plus graves – alors qu’il s’appliquait précédemment à toute déclaration d’irresponsabilité, y compris les actes les plus véniels.
Si nous avons souhaité maintenir le dispositif, ce n’était pas par défiance à l’égard des psychiatres, mais pour assurer la société que, lorsqu’une personne passait à l’acte en commettant une infraction, toutes les précautions étaient prises avant qu’elle ne retrouve la liberté – ce qui, à l’inverse, justifiait que la personne concernée retrouve pleinement sa place au sein de la société en même temps que sa liberté.
J’ajoute, en ce qui concerne les UMD, que la position du législateur de 2013 a été validée par le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), un acteur judiciaire extrêmement actif qui estimait que l’UMD restreignait les droits du patient davantage que la simple hospitalisation sous contrainte, et atteignait plus profondément sa liberté, ce qui nécessitait un contrôle spécialisé. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que l’UMD était un lieu thérapeutique, et qu’il n’y avait pas de différence juridique – sur le plan matériel, les conditions de sécurité sont très renforcées en UMD – entre un patient en UMD et un patient en hôpital psychiatrique.
Notre mission s’est concentrée essentiellement sur trois points. Premièrement, nous avons voulu déterminer comment fonctionnait le système reposant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et sur celles de la loi du 27 septembre 2013, qui font corps au sein du code de la santé publique. Deuxièmement, nous avons cherché à déterminer si le contrôle judiciaire que nous avions modifié en 2013 fonctionnait de manière satisfaisante. Troisièmement, enfin, un an après l’entrée en vigueur de l’article 72 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui organise un régime juridique s’appliquant à l’isolement et à la contention, nous avons voulu vérifier les conditions de sa mise en œuvre dans les hôpitaux. Si nous avions initialement prévu un décret d’application, la deuxième lecture du projet de loi avait été l’occasion de supprimer le renvoi au décret, car nous avions considéré que le régime était défini de manière suffisamment précise pour entrer en vigueur sans l’application de dispositions réglementaires – ce qui fait qu’il a pu entrer en vigueur dès la publication de la loi et a, depuis lors, vocation à s’appliquer dans les hôpitaux.
Pour ce qui est des hospitalisations sous contrainte, nous sommes passés de l’hospitalisation sous contrainte aux soins sous contrainte, comme je vous l’ai expliqué tout à l’heure. Nous constatons en la matière une augmentation assez nette du recours aux soins sous contrainte. Au cours de la période 2011-2015, la file active en psychiatrie – c’est-à-dire l’ensemble des personnes ayant consulté au moins une fois durant l’année – a augmenté de 4,9 % pour atteindre 1,7 million de personnes. Quant aux soins sans consentement, ils ont augmenté de 15,9 %.
Nous nous sommes beaucoup appuyés sur un rapport de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), rédigé par la chercheuse Magali Coldefy, qui met en évidence sur, sur les 92 000 personnes ayant fait l’objet en 2015 d’une prise en charge sans leur consentement, 80 000 ont été hospitalisées à plein-temps au moins une fois dans l’année, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport à 2012. On constate en réalité deux phénomènes : d’une part, une augmentation de l’hospitalisation à temps complet – évaluée à 13 % –, d’autre part, une très forte montée des programmes de soins sans consentement hors hospitalisation complète, en augmentation de 40 % entre 2012 et 2015, pour atteindre le chiffre de 37 000. On a conclu peut-être un peu rapidement que l’augmentation s’expliquait principalement par les soins sans consentement, alors qu’une lecture attentive du rapport de Mme Coldefy montre que le recours à l’hospitalisation complète a également augmenté.
Je précise, pour conclure sur ce point, que les préfets recourent davantage que les hospitaliers – dans un cas sur deux, pour être précis – aux programmes de soins. Il semble que les agences régionales de santé (ARS), qui ont repris les attributions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et assistent à ce titre les préfets dans la gestion des personnes hospitalisées sans consentement, conditionnent leur accord à la levée d’une hospitalisation au bénéfice d’un programme de soins au contenu même de ce programme, notamment avec des exigences quant à la prescription de certains médicaments à effet retard.
Or, un programme de soins reste d’essence thérapeutique, et si la décision de mettre en œuvre un programme de soins peut revenir au préfet, le contenu de ces soins, lui, ne saurait relever de son autorité. Quand nous avons entendu le préfet d’Île-de-France au titre de l’Association des préfets, il nous a clairement indiqué que les préfets n’avaient pas à intervenir dans ce domaine, et n’intervenaient donc pas. Force est de constater que certains préfets le font pourtant, via les ARS. Sur ce point, nous devons faire notre mea culpa : n’ayant pas identifié les ARS comme un acteur important de la question qui nous intéressait, nous ne les avons pas auditionnées, alors que nous aurions dû le faire.
Le fait que les programmes de soins puissent être obligatoires a constitué une innovation. Certes, la mise en œuvre de ces programmes ne peut donner lieu à des mesures de coercition, mais le psychiatre peut menacer de demander une hospitalisation complète, ce qui constitue une forme indirecte de coercition. Constatant le manque d’éléments d’information sur ce qui constitue un nouveau paradigme, nous préconisons pour notre part que soit menée une réflexion à un double niveau. D’une part, au plan local, les commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP) doivent être repensées, car les anciennes commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (CDHP) n’ont pas été modifiées dans leurs attributions alors qu’elles reprenaient une partie des fonctions revenant précédemment à un juge. Il faut également donner davantage de temps aux CDSP afin de leur permettre d’intervenir à la fois sur les formes d’hospitalisation, sur les programmes de soins, sur l’isolement et la contention. Enfin, certaines CDSP sont confrontées à des problèmes matériels nuisant à leur fonctionnement. Dans mon département, la CDSP ne s’est pas réunie depuis plus d’un an, tout simplement parce que l’ARS ne la convoque pas, en dépit des demandes de l’UNAFAM et du tribunal : une telle situation est tout à fait anormale, et il doit y être remédié au plus tôt.
La deuxième chose que nous avons constatée, c’est l’augmentation des procédures d’admission d’urgence. La loi du 5 juillet 2011 en prévoit plusieurs types : sur décision du préfet ; à la demande d’un tiers ; sans tiers, dans le cadre de la procédure dite de « soins pour péril imminent » (SPI), laquelle a connu une progression très importante en l’espace de cinq ans au point de représenter aujourd’hui 20 % des décisions.
Comment expliquer cette évolution ?
D’abord, le recours à cette procédure répond à des situations très concrètes vécues dans les services d’urgences, psychiatriques comme générales. Quand le patient en crise décompense, sa prise en charge doit être quasi immédiate. Or la procédure de soins pour péril imminent ne suppose qu’un seul certificat médical contre deux dans le cas de la procédure de droit commun à la demande d’un tiers et elle peut être mise en œuvre sans tiers.
Ensuite, la procédure d’admission à la demande d’un tiers n’est pas toujours assumée par ceux qui la déclenchent, car ils ne tiennent pas forcément à ce que la personne qui fait l’objet de l’hospitalisation sache que ce sont eux qui ont pris cette décision. Il n’est pas si simple pour des parents de demander l’hospitalisation de leur enfant, qui peut être âgé de trente ans, quarante ans ou cinquante ans, et qui reviendra vivre chez eux, car ils savent que la loi de 2011 permet au patient de connaître l’identité des personnes qui ont demandé son hospitalisation. Ces parents, je les comprends. Je ne leur jette pas la pierre.
Enfin, il y a une troisième raison : la facilité. Pourquoi s’embêter à rechercher un tiers quand la procédure de soins pour péril imminent permet de s’en passer ? Cette raison-là n’est pas acceptable, car on ne saurait faire l’économie du tiers, qui joue un rôle important. C’est la personne sur laquelle continuera de s’appuyer le malade après sa sortie de l’hôpital. Et une sortie se prépare dès l’entrée.
Nous avons appelé l’attention de l’ensemble des instances compétentes en matière de santé mentale sur la forte augmentation du recours aux procédures d’urgence, qui ne se justifie qu’en partie. La facilité que constitue la procédure de soins pour péril imminent sera à terme coûteuse pour le patient et même pour l’hôpital.
Nous avons renvoyé à la HAS et aux CDSP le soin de formuler des recommandations à ce sujet.
J’en viens au contrôle judiciaire et à la question de l’isolement et de la contention.
La première modification que nous avons apportée par la loi du 27 septembre 2013 est la réduction du délai de contrôle du juge des libertés et de la détention : après une longue négociation avec le ministère de la justice, nous avons pu le faire passer à douze jours suivant l’admission au lieu des quinze jours qui figuraient dans la loi de 2011, laquelle s’était calée sur le délai indiqué par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010. Nous considérons qu’en matière de libertés, plus le contrôle intervient tôt, mieux c’est.
La réduction du délai de contrôle et le recours accru à l’hospitalisation complète ont conduit à une forte augmentation des décisions : celles-ci ont progressé de 27 % entre 2012 et 2015. En 2013, année où la loi du 5 juillet 2011 a atteint ses pleins effets, il y a eu 65 682 décisions ; en 2015, année où la loi du 27 septembre 2013 a, à son tour, atteint ses pleins effets, il y en a eu 77 791, soit une progression de 18,64 %. Aujourd’hui, ces décisions représentent ainsi près d’un cinquième de l’activité des juges des libertés et de la détention.
Par ailleurs, le taux des mainlevées est bas, ce dont nous pouvons nous féliciter car cela signifie que les procédures sont bien conduites. Il est inférieur à 10 % et se rapproche progressivement des 5 %. Cela n’est pas pour autant négligeable, puisque cela représente 4 000 décisions. Les problèmes ne concernent pas les abus, ou très peu, mais avant tout le respect des délais, la rédaction des certificats et la proportionnalité des mesures, l’hospitalisation complète sans consentement étant attentatoire à la liberté de la personne.
La deuxième modification concerne le déroulement des audiences : la loi de 2011 avait permis qu’elles se tiennent à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique ; la loi de 2013 pose le principe selon lequel les audiences à l’intérieur de l’hôpital sont la règle et celles au palais de justice, l’exception. La place du malade mental n’est pas au tribunal, lieu qui peut lui donner l’impression qu’il a quelque chose à se reprocher alors que ce n’est évidemment pas le cas. Le juge apparaît en effet dans l’imaginaire collectif davantage comme une figure répressive que comme une figure bienveillante à l’instar des juges aux affaires familiales ou des juges pour enfants. Tout le monde s’accorde pour dire que les audiences à l’hôpital sont beaucoup mieux vécues par les patients.
Où en sommes-nous ?
Nous déplorons le manque de fiabilité et d’exhaustivité des données, qui caractérise de manière plus générale l’ensemble de l’appareil statistique, défauts appelés à être corrigés. Grâce aux informations que nous avons recueillies, nous avons établi que 60 % des audiences se tenaient à l’hôpital, que 20 % se déroulaient, pour un même tribunal, soit à l’hôpital, soit au palais de justice, et que 20 % n’avaient lieu qu’au palais de justice.
On ne peut pas dire que le cahier de charges pour l’aménagement des salles d’audience brille par sa légèreté. Est-il vraiment besoin de placer une barre devant le juge des libertés et de la détention qui statue sur une hospitalisation contrainte ? À l’évidence, non. Pourtant, l’installation d’une barre est requise. Nous avons pu constater que, dans la salle d’audience dépendant du tribunal de Meaux, une barre était placée devant la table de l’avocat de la défense au côté duquel se tenait le justiciable : curieuse configuration car, habituellement, la barre est placée devant le juge. La salle d’audience devrait ressembler non à une salle de tribunal correctionnel, mais plutôt aux vastes bureaux dans lesquels les juges aux affaires familiales et les juges pour enfants reçoivent les justiciables. Je ne suis pas sûr non plus qu’il soit nécessaire de fixer par écrit la hauteur de l’estrade sur laquelle doit être juché le bureau du président de l’audience…
J’ai ici à vous livrer une petite anecdote. Dans la salle d’audience, sont présents, bien évidemment, le président, qui est le juge des libertés et de la détention, un greffier, un représentant de la défense et dans la plupart des cas le justiciable. Le représentant du parquet, lui, est absent : dans une salle d’audience dont je ne citerai pas le nom, son fauteuil n’a même pas été déballé ! La question de l’assistance fournie par les mandataires à la protection des majeurs est également posée car les gérants de tutelle ou de curatelle, dûment convoqués, sont eux aussi absents.
Ajoutons que les salles d’audience, dans l’immense majorité des cas, sont mutualisées. Quand un tribunal comprend dans son ressort plusieurs hôpitaux psychiatriques, le plus souvent, un seul d’entre eux dédie une pièce à la salle d’audience afin d’accueillir les audiences de patients venant des autres hôpitaux. Il est mieux, pour un patient, de se déplacer dans un autre hôpital plutôt qu’au palais de justice. Le mélange des publics n’est en effet pas favorable aux malades.
Un problème se pose à terme. La réforme du statut du juge des libertés et de la détention, qui prendra effet en septembre prochain, rend cette fonction statutaire. Or il manquera, semble-t-il, des candidats et on ne peut pas nommer sans candidatures. Les chiffres qui nous ont été donnés font apparaître que la pénurie touche un tiers des effectifs. C’est un point auquel nous devrons veiller.
La loi prévoit que les débats peuvent se tenir en chambre du conseil comme devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge pour enfants, dans sa fonction civile comme répressive. Or il est très peu recouru au huis clos : les audiences se tenant à l’hôpital, il n’y a pas de public.
Il faut se pencher également sur la façon dont le contrôle s’exerce.
Quel est l’office du juge ? Les magistrats se posent, à juste titre, beaucoup de questions à ce propos. Le contrôle est avant tout formel et porte sur le nombre de certificats requis ou le respect des délais. Si le délai de douze jours est passé, le juge ne peut plus statuer : le patient doit faire l’objet d’une mainlevée et quitter l’hôpital.
Le juge doit néanmoins aborder également le fond. Pour vérifier que les conditions matérielles de l’hospitalisation contraintes sont réunies, il doit apprécier la qualité des certificats. Cela suppose que la langue des certificats soit suffisamment compréhensible et que le magistrat se forme à la psychiatrie. Des formations conjointes réunissant psychiatres, magistrats et avocats sont souhaitables et souhaitées ; l’École nationale de la magistrature (ENM) a d’ailleurs déjà prévu des outils de formation performants dans ce domaine.
S’agissant des avocats, il faut souligner que certains sont allés à ces audiences à reculons. Au barreau de Coutances, le bâtonnier avait même décidé de ne pas désigner d’avocats au motif qu’il leur fallait parcourir quatre-vingts kilomètres pour se rendre à l’audience et que les frais de transport n’étaient pas pris en charge dans l’indemnisation. Les patients de certains hôpitaux n’étaient donc pas défendus, jusqu’à ce que le problème soit résolu par la création de salles mutualisées. Et ce n’est pas le seul exemple qui nous ait été cité.
Il faut être très attentif au vocabulaire employé et aux glissements qui peuvent se produire. Pour un médecin, la personne hospitalisée est un patient, pour le juge elle est un justiciable, pour l’avocat elle est un client. Si un avocat ou un juge la désigne comme un patient, c’est qu’il y a un problème. Chacun doit être attentif à son rôle. Le juge ne doit pas se transformer en psychiatre, il doit appliquer la loi. L’avocat doit rechercher l’intérêt de son client d’un point de vue déontologique et juridique mais il n’est certainement pas en mesure de décider de la façon dont il doit être soigné.
Dernier point à propos du contentieux : ce que les personnes hospitalisées remettent en cause, c’est moins leur hospitalisation elle-même – elles reconnaissent la nécessité pour elles d’être soignées et surtout en soins libres – que les conditions dans lesquelles elle se déroule. Elles se plaignent de l’administration de médicaments aux effets secondaires extrêmement lourds mais aussi de l’isolement et de la contention.
S’agissant des programmes de soins, y a-t-il une possibilité de contrôle ? Si oui, quel est le juge compétent pour les contrôler ? Le recours au programme de soins résulte d’une décision administrative mais nous n’avons pas créé de bloc de compétence dans les lois de 2011 et de 2013, ce qui implique a priori – même si ce n’est pas au législateur d’interpréter la loi – qu’il y a plusieurs juges compétents en ce domaine.
La question du contrôle se pose également pour les sorties d’essai, qui peuvent être de courte durée, accompagnées ou non. Le préfet peut s’y opposer si l’hospitalisation sous contrainte a été faite à sa demande. En ce cas, la décision n’est pas notifiée au patient, qui ignore alors qu’il aurait pu bénéficier d’une telle procédure. Dans ces conditions, quels sont les recours possibles ? Des progrès restent à faire.
Plusieurs personnes ont appelé notre attention sur l’effectivité des droits. Pour la renforcer, peut-être est-il nécessaire de prévoir la mise en place systématique d’un point d’accès au droit (PAD), les avocats n’étant présents qu’au moment des audiences présidées par les juges des libertés et de la détention.
La judiciarisation éventuelle de l’isolement et de la contention constitue un autre enjeu important.
La circulaire n’est pas parue et certaines administrations considèrent qu’en l’absence d’un tel texte la loi n’a pas à s’appliquer. Les législateurs que nous sommes estiment que la loi s’applique dès qu’elle est publiée, à moins qu’un décret soit nécessaire ou que son application soit différée, ce qui n’est pas le cas pour la loi de modernisation de notre système de santé. Certains établissements n’ont pas mis en place les registres prévus par cette loi et ne se conforment pas au régime juridique de l’isolement et la contention. Nous ne sommes pas capables de savoir dans quelle proportion car il n’y pas de traçabilité de ces pratiques.
Nous avons demandé à la HAS de faire du respect de la législation un critère de certification des établissements. La tâche de vérifier la façon dont les établissements se conforment à la législation devrait revenir aux commissions départementales de soins psychiatriques, structures légères et peu coûteuses. La loi a expressément prévu qu’elles puissent avoir accès aux registres.
Je terminerai par une information surprenante. Savez-vous qui publie les rapports annuels des CDSP ? Une association dépendant de l’Église de Scientologie ! Est-il opportun qu’elle continue à le faire ? Je ne le crois pas. Ces rapports sont utiles et nous devons confier à une structure identifiée la charge de les publier et de les exploiter. De manière générale, il convient de revitaliser ces commissions, dont certaines fonctionnent très bien, d’autres pas. Composées de professionnels, d’un magistrat et de représentants d’associations d’usagers, elles posent un nécessaire regard extérieur sur le fonctionnement des établissements psychiatriques qu’elles sont autorisées à visiter alors que les juges ne font que se rendre dans la salle d’audience, sans entrer dans les lieux où vivent les patients ou pénétrer dans les chambres d’isolement. Elles constituent un formidable outil, au même titre que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lequel n’est pas en mesure de se rendre dans chaque établissement. Il nous appartient de mieux articuler leurs tâches avec celles des juges des libertés et de la détention. Grâce au travail qu’elles effectuent, de nouveaux progrès pourront être accomplis dans les hôpitaux psychiatriques.
Mme Martine Carrillon-Couvreur, présidente. Tout d’abord, j’aimerais remercier nos deux rapporteurs pour ce rapport très utile qui a permis de faire le point sur des questions extrêmement importantes dans un court délai.
Ce rapport fait suite à plusieurs lois qui ont constitué des étapes significatives, qu’il s’agisse du renforcement de l’encadrement des soins sans consentement ou de leur extension à l’ambulatoire, mesure qui répondait à l’exigence de continuité des soins qui est une préoccupation constante de l’UNAFAM.
Nous avons tous autour de nous des exemples qui montrent que la question de l’accès au droit se pose. L’effectivité des droits est encore perfectible. Cela renvoie à la prise de conscience des acteurs sur le terrain et à leur implication.
Par ailleurs, vous soulignez qu’il existe de grandes variations d’un territoire à l’autre. Comment pouvons-nous améliorer concrètement sur chaque territoire le respect de la continuité des soins ? Vous évoquez les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé et le rôle des CDSP.
J’aimerais vous poser une question sur les tiers. Nous savons qu’il est extrêmement difficile pour les membres de la famille d’un malade de demander son admission sans son consentement, alors qu’ils ont ensuite à l’accompagner dans son retour à la vie sociale. Ne faudrait-il pas envisager que d’autres personnes jouent le rôle de tiers ? Les commissions départementales de soins psychiatriques n’auraient-elles pas leur place ? Dans d’autres domaines a émergé la notion de personne de confiance. Qui pourrait-on désigner pour ce qui est des soins psychiatriques ? Comment cette personne pourrait elle-même être accompagnée ?
Enfin, pour les mandataires à la protection des majeurs, quelle formation envisager ? Comment procéder à une clarification des rôles ?
Voilà autant de questions que nous devons approfondir pour progresser encore dans l’accompagnement des malades.
M. Michel Liebgott. Le sujet qui nous occupe, abordé par les rapporteurs avec beaucoup d’humilité, nous amène à nous interroger sur la liberté et sur les atteintes qu’elle peut subir.
L’intervention du juge permet un véritable contrôle de la régularité de la contrainte, de la proportionnalité des mesures et de la nécessité médicale d’agir. C’est un progrès. L’important rôle joué par le préfet dans les décisions d’hospitalisation sans consentement était une exception française et nous pouvons nous réjouir qu’il ait moins à intervenir. À cet égard, on peut s’étonner du mutisme du ministère de l’intérieur, même si le véritable scoop est plutôt le rôle joué par l’Église de Scientologie dans la publication des rapports annuels des CDSP.
Nous voyons bien que, depuis la loi de 1838, nous n’avons pas forcément su adapter les textes législatifs aux réalités médicales du temps présent. Nous sommes toutefois très éloignés de l’époque où l’enfermement psychiatrique était appliqué à toute personne marginale.
Les questionnements restent nombreux. Vous les avez pointés, soulignant notamment la nécessité de saisir la HAS pour édicter des recommandations de bonnes pratiques.
Les phénomènes que vous décrivez renvoient à des réalités plus larges, que nous connaissons bien. S’il y avait plus de médecins généralistes, les urgences seraient moins engorgées. De la même manière, s’il y avait davantage de psychiatres libéraux, le recours à l’hospitalisation serait moindre. Nous nous heurtons toujours aux mêmes problèmes, ceux des moyens et de l’inégale répartition des professionnels de médecine sur l’ensemble du territoire.
Nous savons en outre que les personnes malades sont souvent des personnes fragiles. Rappelons que 70 % des personnes incarcérées souffrent de problèmes psychiques.
Bref, nous sommes au cœur d’un drame de société mais nous pouvons considérer que la France ne le prend si mal en compte que cela. Je considère que les lois de 2011 et de 2013 ont permis une progression des libertés : amélioration du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention, réduction de son délai d’intervention, audiences tenues au sein des établissements et non plus au sein des tribunaux, obligation de la représentation par un avocat.
Étant maire, je sais à quel point ces questions sont parfois délicates à gérer : il faut trouver un médecin, envoyer la police ou la gendarmerie pour chercher le malade. Il n’est pas étonnant que d’autres difficultés se posent lorsque la personne entre à l’hôpital ainsi que lorsqu’elle en sort. Elle peut se retourner vers le tiers qui a demandé son hospitalisation ou se retrouver dans un environnement peu favorable à la poursuite des soins.
Au nom du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), je vous remercie, chers collègues, pour ce travail de spécialistes. Nous savons que vous ne pourrez que parfaire la législation en ce domaine.
M. Jean-Louis Costes. Au nom du groupe Les Républicains, je tiens à féliciter nos deux rapporteurs qui ont su, dans le temps réduit dont ils disposaient, effectuer un travail utile sur un sujet très complexe.
La loi de 2011 relative aux droits et à la protection des patients faisant l’objet de soins psychiatriques a apporté un réel progrès dans la réponse au difficile et douloureux problème de la prise en charge des maladies psychiatriques. Elle a fait évoluer les pratiques en matière de soins sans consentement et a apporté des améliorations très importantes en accroissant l’efficacité des soins pour les patients en soulageant leurs souffrances et en facilitant une meilleure réinsertion sociale et même professionnelle.
L’ampleur des avancées avait conduit le législateur de 2011 à prévoir l’évaluation de la mise en œuvre de la loi. La censure d’une partie du texte par le Conseil constitutionnel a ensuite obligé la nouvelle majorité à agir dans l’urgence en 2013.
Nous avions soutenu une grande partie du texte mais exprimé le regret que la réforme de l’encadrement juridique des unités pour malades difficiles, rendue indispensable par la censure du Conseil constitutionnel, ait été mal pensée.
À la lecture de votre rapport, je constate que nous avions raison : le nouveau texte réglementaire n’est pas encore appliqué qu’il est déjà contesté. La question est particulièrement compliquée et il faudra y revenir dans les mois qui viennent. Quand on touche à l’encadrement légal de sujets aussi essentiels que les libertés individuelles, la protection des personnes ou la sécurité publique, il faut le faire en prenant le temps de la réflexion et en s’entourant de précautions.
La plupart des autres observations que vous nous livrez nous poussent à nous interroger sur le déroulement et la durée des hospitalisations, sur l’efficacité de certains programmes, sur le manque d’effectivité de certains droits nouveaux, autant de problèmes qui renvoient sans doute en grande partie au manque de moyens de la médecine psychiatrique en France.
Nous considérons que votre travail contribuera à améliorer la mise en œuvre des dispositions des lois les plus récentes et donc la prise en charge de nos concitoyens atteints d’une maladie mentale. Nous autoriserons bien sûr la publication du rapport.
Si vous me le permettez, madame la présidente, je compléterai mon intervention de porte-parole du groupe Les Républicains par une remarque que je formule à titre personnel.
Je tiens à souligner toute la pertinence de la recommandation n° 10. Le retour à domicile après une hospitalisation d’urgence pose très souvent problème. Le seul accompagnement est bien souvent une prescription médicamenteuse, que les patients ne suivent pas forcément. Ils sont un peu laissés à l’abandon. Dans ces conditions, le renforcement des équipes mobiles dédiées à l’hospitalisation à domicile que vous préconisez me paraît essentiel.
Mme Dominique Orliac. Tout d’abord, au nom du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP), j’aimerais féliciter nos deux rapporteurs pour leur travail très complet et détaillé. Je regrette simplement que l’ordre du jour très chargé ne nous ait pas permis de suivre toutes les auditions de la commission des affaires sociales.
Ce rapport de la mission d’évaluation permet de dresser un large bilan de la loi du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Le chapitre consacré à la problématique de l’augmentation des admissions en soins psychiatriques sans consentement est particulièrement intéressant et instructif. Je retiens que l’augmentation, entre 2012 et 2015, du nombre de patients admis en soins sans consentement est plus importante que celle de la file active des patients : 16 % contre 5 %.
Le temps imparti aux groupes ne me permettant pas d’aborder l’ensemble des quinze préconisations contenues dans le rapport, je reviendrai sur l’article 73 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, introduit dans le texte initial par un amendement que j’avais proposé avec le soutien de mon groupe.
Il vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP) dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Force est de constater que les délais n’ont pas été tenus.
Vous indiquez dans votre rapport, chers collègues, que le Gouvernement vous a fourni un document transmis au ministre de l’intérieur par la préfecture de police de Paris en juin 2016. Nous serait-il possible de le consulter ? En outre, pouvez-vous nous préciser qui l’a rédigé ? Je crains que l’optique adoptée ne soit plutôt partiale. S’il est l’œuvre de l’équipe dirigeante de l’IPPP, par exemple de son médecin-chef, on peut sincèrement se demander s’il ne s’agit pas d’un plaidoyer pro domo.
Rappelons qu’en 2011 le Contrôleur général des lieux de privation de liberté Jean-Marie Delarue dénonçait le fait que les droits formels des patients hospitalisés sous contrainte n’étaient pas respectés à l’IPPP. Dans tous les cas, cet article visait à obtenir un document provenant du Gouvernement et non de l’IPPP elle-même.
Pour terminer, permettez-moi de faire un aparté qui reste contenu dans la thématique qui nous occupe aujourd’hui. Je vous invite à visionner le documentaire de la réalisatrice Sonia Médina intitulé Looking for Mary Barnes. Réalisé à la suite de l’Appel des Trente-Neuf de 2008, il porte un regard intéressant sur les soins psychiatriques, les équipes soignantes et les patients dans des lieux de soins dits de « psychiatrie ouverte ». Il est très instructif pour les personnes intéressées par ce sujet mais également pour les autres.
Je précise que nous voterons en faveur de la publication de ce rapport pour lequel je vous remercie très chaleureusement, messieurs les rapporteurs.
Mme Jacqueline Fraysse. Au nom du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), je remercie nos rapporteurs pour ce travail très intéressant conduit dans un délai court, qui impliquait beaucoup de contraintes.
Les lois de 2011 et de 2013 visaient à placer la personne humaine au centre de la réflexion, avant même de les considérer comme des cas psychiatriques sans négliger bien sûr la sécurité publique. Il s’agissait – tâche ardue – de construire un équilibre entre les droits des patients, la protection de leur santé et la sécurité publique.
Vous soulignez certains points positifs comme l’amélioration de la protection des libertés, processus qui réclamera encore du temps pour que les professionnels s’imprègnent de ces enjeux, pour que les locaux soient dûment aménagés et que tous les fauteuils soient déballés…
Vous dressez aussi des constats préoccupants : banalisation du recours aux procédures d’urgence et aux procédures dérogatoires ; banalisation de l’admission en soins psychiatriques pour péril imminent, qui constitue un véritable dévoiement de l’esprit de la loi ; « décalage considérable entre les droits reconnus aux patients par la loi et l’effectivité de ces droits au quotidien ».
La loi de 2011 n’a pas modifié la répartition des modes d’admission et des profils des patients. Vous notez même une augmentation significative du nombre de patients admis en soins pour péril imminent. Comme deux tiers d’entre eux proviennent des urgences, on peut légitimement soupçonner que cette procédure est utilisée pour désengorger les services hospitaliers d’urgences, ce qui pose problème.
Je m’interroge sur les raisons de la grande diversité des pratiques d’un territoire à l’autre. Ces dernières doivent en tout cas être mieux encadrées.
Je souscris totalement aux recommandations formulées dans le rapport d’information. J’ai relevé, en particulier, celle qui préconise d’« enquêter sur les conditions du recours à la procédure d’urgence à la demande du tiers », celle relatives aux commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP) et à leurs fonctions, celle visant à permettre à la Haute Autorité de santé (HAS) d’« édicter des recommandations de bonne pratique relatives aux admissions en soins psychiatriques par des procédures d’urgence », et celle qui tend à « instaurer un indicateur d’évaluation du respect des recommandations de bonne pratique relatives aux admissions en procédures d’urgence dans le cadre de la certification des établissements de santé ».
Nous souhaitons évidemment la publication de ce rapport.
M. Bernard Perrut. Les maires et leurs adjoints sont confrontés toutes les semaines aux problèmes que posent les procédures d’urgence.
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes », le code de la santé publique permet au maire de prendre, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, toute mesure provisoire nécessaire à la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète « à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes ». Ces dispositions sont exprimées en termes suffisamment larges pour laisser une marge d’appréciation. Qu’entend-on par « trouble mentaux manifestes » ou par « danger imminent » ? Un médecin doit évidemment donner un avis, mais sans avoir nécessairement examiné la personne concernée.
Dans ce domaine, les décisions des élus ne sont pas faciles à prendre. Nous savons parfaitement que l’hospitalisation crée une véritable rupture pour la personne concernée alors que nous ne connaissons ni le contexte ni les antécédents au moment où nous nous prononçons.
Nous manquons aussi d’informations sur la suite de la procédure. Le représentant de l’État, qui est le seul à pouvoir donner une suite à la mesure provisoire prise par le maire, informe-t-il ce dernier ? Je ne crois pas que ce soit le cas. Cela permettrait pourtant que les communes assurent un meilleur suivi.
Disposez-vous pour de chiffres département par département concernant les procédures d’urgence mises en œuvre par les communes ?
Que pensez-vous, enfin, des services de médecine psychiatrique des hôpitaux ? Au-delà des grandes structures hospitalières, certains besoins restent-ils encore aujourd’hui insatisfaits ? Il faut pouvoir accueillir les personnes concernées en restant le plus proche possible du terrain.
M. Denis Jacquat, rapporteur. MM. Liebgott, Costes et Perrut sont maires. Leurs questions m’ont fait penser aux remarques que nous avons entendues en audition sur le caractère parfois très succinct des certificats médicaux. En tant que médecin, je sais qu’il est extrêmement difficile de rédiger un certificat s’agissant de patients et de situations que l’on peut ne pas bien connaître. La judiciarisation à l’œuvre explique que les certificats médicaux soient de plus en plus concis ; avec le temps, ils tendront sans doute à l’être encore davantage.
M. Denys Robiliard, rapporteur. Monsieur Costes, le fait que le décret relatif aux UMD ait été attaqué dès sa parution semble prouver, selon vous, que vous aviez raison de contester la disposition de la loi qui les concerne. Je vous rassure, si je puis dire : le reste de la loi, que vous souteniez, a également été mis en cause. Pour notre part, nous considérons que le passage par un dispositif thérapeutique n’a pas à produire d’effets juridiques ; les deux champs ne se recouvrent pas. Je ne crois pas que notre analyse soit erronée.
Je me félicite qu’un large consensus se dégage ce matin. Lorsque nous nous opposons sur les questions psychiatriques, cela fait d’abord souffrir les malades – bien plus que les psychiatres eux-mêmes. Il est de notre responsabilité qu’il n’en soit pas ainsi. Je constate avec satisfaction la quasi-unanimité de notre commission sur un sujet difficile.
Certaines de vos remarques concernent moins les soins sans consentement que la psychiatrie en général. Nous retrouvons, dans cette spécialité, les problèmes généraux du monde médical.
La question des déserts médicaux, par exemple, se pose parfois davantage en psychiatrie : certains hôpitaux ne disposent pas du nombre de psychiatres nécessaire à leur fonctionnement. En 2013, lorsque j’étais rapporteur de la mission d’information de notre commission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, on m’avait cité le cas d’un hôpital psychiatrique sans psychiatre : les spécialistes d’autres hôpitaux s’y relayaient. Lorsque l’on sait l’importance de la personnalisation et de la continuité médicale afin de rétablir la relation humaine, on s’interroge. Je continue de penser qu’une partie de la solution se trouve chez les médecins généralistes qui doivent être davantage formés : il leur appartient d’identifier la maladie, et de savoir passer la main à un spécialiste plus tôt qu’ils ne le font généralement. Il faut également que ce dernier assure un retour vers le généraliste, ce qu’il ne fait pas toujours, tant s’en faut.
Mme Orliac a évoqué l’IPPP et, de son côté, M. Perrut a parlé des mesures urgentes. Il s’agit en fait du même sujet. L’IPPP intervient en matière de mesures urgentes prises par les commissaires de police lorsqu’ils exercent, par délégation du préfet de police, une prérogative qui est habituellement celle des maires.
Je rappelle que, pour prolonger une hospitalisation d’urgence, le préfet doit prendre une décision dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrêté du maire. Ce dernier lui est transmis dans les vingt-quatre heures de sa signature. À défaut de décision du préfet, la personne est remise en liberté.
Si nous disposons de nombreuses informations sur les mesures d’urgences prises à Paris grâce aux comptes rendus transmis par l’IPPP, nous n’en avons en revanche aucune sur la situation en province. Paradoxalement, nous n’avons donc aucune statistique sur les pratiques de ceux qui sont les moins préparés pour agir – le maire est parfois seul, sans aucun service communal.
Le préfet doit certes informer le maire dans les vingt-quatre heures de la décision qu’il prend, mais il n’y a pas de dispositions spécifiques pour assurer le suivi des décisions. Sachant qu’à Paris deux mille personnes passent tous les ans par l’IPPP, on peut penser que les cas sont nombreux hors de la capitale, même si nous avons bien conscience que le cas de Paris est un peu particulier en raison de sa nombreuse population et de l’attrait particulier exercé par la ville sur les malades. Je rappelle aussi que, par délégation du préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet de police de Paris gère les problèmes de l’aéroport de Roissy.
Madame Orliac, vous avez raison, il y a bien un problème : le rapport prévu à l’article 73 de la loi du 26 janvier 2016 devait être remis au Parlement dans les six mois de la promulgation de la loi. De son côté, la préfecture de police a fait la partie du travail qui lui incombait, et nous avons eu connaissance des « Éléments pour le rapport au Parlement relatif à l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police de Paris ». Le préfet de police assume la responsabilité de ce document, et nous ne sommes pas certains qu’il ait été rédigé par le médecin-chef de l’IPPP. Nous ne lui avons pas posé la question, même si nous avons passé trois heures à l’IPPP où nous l’avons rencontré, ainsi que les professionnels qui travaillent dans cette structure. L’infirmerie psychiatrique fonctionne en coordination avec le bureau des actions de santé mentale de la préfecture de police (BASM) qui émet tous les arrêtés suite aux décisions du préfet relatives à l’admission en soins psychiatriques de personnes non consentantes.
Nous ne nous sommes pas prononcés sur l’IPPP. Nous avons seulement constaté que l’établissement fonctionnait bien. Il compte cinq psychiatres : un médecin-chef, un médecin-chef adjoint, trois psychiatres à temps partiel. Ces derniers se relaient, et la présence psychiatrique est continue. Conformément aux objectifs poursuivis par la loi, 93 % des personnes hospitalisées y font un passage de moins de vingt-quatre heures. Un véritable dispositif d’observation est en place. Malgré la durée généralement limitée passée à l’IPPP, le placement systémique en isolement peut être discuté, d’autant que les lieux dédiés ne sont pas équipés de sanitaires – un infirmier et un surveillant doivent assurer les déplacements dans l’infirmerie. Le dispositif médical est cependant très bien encadré. Le personnel est en nombre suffisant. Les certificats sont rédigés de façon très précise, et le taux de confirmation est très élevé – les ordonnances de mainlevée des JLD parisiens sont peu fréquentes. Dans ces conditions, je vous avoue que la réforme de l’IPPP ne constitue pas, à mes yeux, la priorité du moment. En matière de psychiatrie, il me semble que nous devons mener des travaux autrement urgents.
À mon sens, l’IPPP est victime de son rattachement à la préfecture de police car, assez spontanément, on imagine que la psychiatrie ne devrait pas relever de cette institution. N’oublions pas que l’IPPP prend en charge des personnes qui font l’objet de mesures urgentes d’hospitalisation à Paris alors que, partout ailleurs en France, ces mesures sont prises par les maires sans que l’on n’en sache jamais rien ! Comment sont-elles exécutées ? Combien en compte-t-on ? Même si je n’ai pas connaissance d’abus particuliers sur les territoires, je pense qu’il faudrait commencer par répondre à ces questions, et par savoir comment les choses se passent dans les communes avant de chercher à réformer l’IPPP.
Vous êtes nombreux à vous être interrogés sur l’effectivité des droits. Notre rapport d’information traite ce sujet en abordant trois questions importantes.
Les rapporteurs encouragent « la généralisation, au niveau national, de points d’accès au droit dans l’ensemble des établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement ». Cela vaut aussi à mon sens dans les hôpitaux généralistes. La question se pose cependant avec davantage d’acuité à l’hôpital psychiatrique où il faut répondre non seulement aux problèmes relatifs à l’hospitalisation sans consentement, mais aussi à ceux concernant les régimes de protection des majeurs. Les commissions départementales d’accès au droit (CDAD), instituées auprès de chaque tribunal de grande instance, sont compétentes pour agir, mais des financements sont nécessaires.
J’en viens à la question des notifications. Qui notifie ? Est-ce le médecin ou le directeur d’établissement ? Comment les notifications sont-elles faites ? Vérifie-t-on que la personne hospitalisée dispose bien d’une copie du document sans lequel elle ne pourra pas attaquer la décision qui la concerne ? Pour exercer ses droits, il faut être informé. L’IPPP a pris des dispositions afin d’informer de ses droits toute personne maintenue dans ses locaux, dès son arrivée sur place. Je crois, madame Orliac, que ces mesures permettent de répondre aux observations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que vous citiez. La notification de la décision énonce nécessairement les conditions de recours car, sans cette précision, le délai de recours ne court pas.
Il ne faut pas oublier le sujet un peu urticant de l’aide juridictionnelle. La loi du 27 septembre 2013 impose la présence de l’avocat, car le législateur a estimé que, si l’état de santé d’une personne l’empêche de consentir aux soins qui lui sont nécessaires, on ne peut présumer qu’il lui permet de discerner si elle a besoin d’être assistée par un conseil. La loi impose donc la présence de l’avocat, mais sans prévoir une prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. La pratique des bureaux d’aide juridictionnelle est cependant assez souple pour que cette prise en charge soit accordée dans environ 90 % des cas, sans que l’avocat ait à justifier des revenus de son client. La situation de l’avocat est particulièrement difficile : il intervient en urgence dans des délais si brefs que le bureau d’aide juridictionnel n’a pas le temps de prendre une décision. De plus, il a affaire à une personne hospitalisée qui n’a plus accès aux documents qui justifieraient de ses revenus et de ses charges.
Une question plus fondamentale se pose. Il serait en effet un peu saumâtre de demander à une personne qui fait l’objet d’un examen judiciaire qu’elle n’a pas demandé mais auquel la loi le soumet, et qui sera assistée d’un avocat parce que le législateur le lui impose, de régler les honoraires de ce dernier au motif qu’elle en a les moyens. Nous recommandons en conséquence que soit reconnu le bénéfice de l’aide juridictionnelle de plein droit aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement. Cette prise en charge devrait être systématique lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle – chacun conservant la liberté de choisir son avocat par ailleurs.
J’ajoute que ce dispositif n’est pas coûteux, tout étant relatif. Actuellement, la dépense qui permet de couvrir 90 % des cas s’élève à 5,6 millions d’euros. En extrapolant, il faudrait donc mettre sur la table environ 600 000 euros supplémentaires ; j’ai déjà soutenu des amendements plus onéreux… J’en appelle donc au Gouvernement, car l’initiative parlementaire en matière de dépense est contrainte par l’article 40 de la Constitution.
Vous avez évoqué le tiers de confiance. Ce dernier n’est pas défini par la loi. La jurisprudence montre qu’il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un proche qui peut prouver qu’il est soucieux des intérêts de la personne concernée, ou encore des mandataires aux tutelles. Je sais aussi les hôpitaux un peu réticents à l’égard des personnes de confiance de peur que certaines aient développé des stratégies pour être désignées à des fins qui ne seraient pas désintéressées. La crainte concerne aussi les sectes qui pourraient chercher à approcher des personnes fragiles. Toutefois, dès lors que la loi n’opère pas de distinction, il n’y a pas lieu de le faire. De plus, si je ne prétends pas qu’il n’y a jamais eu d’affaires, les inquiétudes dont on nous fait part ne sont pas documentées. L’institution de la personne de confiance permet d’instaurer un véritable dialogue avec le médecin. Nous protestons contre le développement peut-être trop important des procédures d’urgence, parce qu’elles placent le médecin, selon les mots mêmes de l’un d’entre eux, « en position de toute puissance, étant seul à ordonner et prescrire l’admission, sans contradicteur possible dans sa décision médicale ». Il faut donc porter une attention particulière à la présence du tiers qui est utile à la fois à l’hôpital et au patient.
Mme Martine Carrillon-Couvreur, présidente. Je remercie vivement nos deux rapporteurs.
*
* *
La Commission autorise à l’unanimité la publication du rapport d’information.
ANNEXE 1 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES CO-RAPPORTEURS
(par ordre chronologique)
Ø Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA) – M. André Bitton, président, Mme Yaël Frydman, secrétaire générale, et Mme Pauline Rhenter, chercheure pour l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), élève avocate
Ø Audition commune :
– Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (FNAPSY) – Mme Claude Finkelstein, présidente
– Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) – M. Alain Monnier, référent des commissions départementales des soins psychiatriques
Ø Association Advocacy France – M. Philippe Guerard, président, M. Bernard Meile, vice-président et M. Claude Deutsch, conseiller scientifique et technique
Ø Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) – Mme Magali Coldefy, maître de recherche
Ø Table ronde :
– Barreau de Lille – Me Stéphane Dhonte, Bâtonnier de l’Ordre, et Me Aurore Bonduel, avocat au Barreau de Lille
– Conseil national des barreaux (CNB) (*) – Me Françoise Mathe, présidente de la commission Libertés et droits de l’homme, Mme Géraldine Cavaillé, directrice du service juridique, et Me Yves Tamet, président de la commission Accès au droit et à la justice
– Syndicat des avocats de France (SAF) – Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, président de la commission « hospitalisation d’office et personnes vulnérables »
Ø Audition commune :
– Mme Natalie Giloux, psychiatre, praticien hospitalier au Centre Hospitalier Le Vinatier
– Mme Marion Primevert, magistrate, vice-présidente au Tribunal de grande instance (TGI) de Paris
Ø Dr Jean-Luc Roelandt, psychiatre
Ø Table ronde :
– Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP) – Dr Michel Triantafyllou, président, et Dr Jean Ferrandi, secrétaire général
– Syndicat des psychiatres français (SPF) – Dr Maurice Bensoussan, président
– Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) – Dr Michel David, vice-président, et Dr Isabelle Montet, secrétaire générale
– Union syndicale de la psychiatrie (USP) – Dr Philippe Gasser, président
Ø Table ronde :
– FO Magistrats – M. Michel Dutrus, délégué général, conseiller à la cour d’appel de Bordeaux
– Syndicat de la magistrature – Mme Anaïs Vrain et Mme Juliane Pinsard, secrétaires nationales
– Syndicat des greffiers de France (SDGF-FO) – Mme Isabelle Besnier-Houben, secrétaire générale, greffière au conseil de prud’hommes de Caen, et Mme Sophie Grimault, secrétaire générale adjointe, greffière au TGI de Limoges
– Union syndicale des magistrats (USM) – Mme Marie-Jane Ody, vice-présidente, et M. Benjamin Blanchet, chargé de mission
Ø Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur (ACPHFMI) – M. Jean-François Carenco, président, préfet de la région Île-de-France, et M. Bruno André, directeur du cabinet du préfet
Ø Table ronde :
– Association des directeurs d’établissements participant au service public de santé mentale (ADESM) – M. Pascal Mariotti, président et directeur du centre hospitalier Alpes Isère, Mme Luce Legendre, vice-présidente et directrice du groupe public de santé Perray Vaucluse
– Conférence des directeurs généraux de CHU – Mme Nathalie Borgne, directrice de la qualité et des projets au CHU de Saint-Etienne
– Conférence nationale des présidents de Commissions médicales d’établissement des Centres hospitaliers spécialisés (CME-CHS) – Dr Christian Muller, président
– Conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH) – M. Jean-Pierre Staebler, directeur du centre hospitalier de Montfavet
Ø Conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance (TGI) – M. Gilles Accomando, président, président du TGI d’Avignon, Mme Joëlle Munier, vice-présidente de la conférence, présidente du TGI d’Albi, et Mme Marie-Christine Leprince, membre du bureau de la conférence, présidente du TGI de Caen
Ø Audition commune :
– Direction générale de la santé (DGS) – M. Patrick Ambroise, adjoint à la sous directrice « Santé des populations et prévention des maladies chroniques », Mme Geneviève Castaing, cheffe du bureau de la santé mentale, et Dr Philippe Leborgne, adjoint à la cheffe du bureau de la santé mentale
– Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – M. Thierry Kurth, chef du bureau prise en charge post-aiguës, pathologies chroniques et santé mentale par intérim, et Mme Odile Maurice, chargée de mission psychiatrie et santé mentale
Ø Contrôleur général des lieux de privation de liberté – Mme Adeline Hazan, contrôleure générale, et Mme Anne Lecourbe, contrôleure
Ø Table ronde :
– Direction des affaires civiles et du Sceau – M. Guillaume Meunier, sous-directeur du droit civil, Mme Virginie Brot, cheffe du bureau du droit des personnes et de la famille, Mme Sophie Parat, adjointe au chef du bureau du droit processuel et du droit social, et Mme Maud Guillonneau, cheffe du Pôle d’évaluation de la justice civile
– Direction des services judiciaires – Mme Caroline Coustillas, cheffe du bureau des méthodes et des expertises
– Mme Tania Jewczuk, rédactrice au bureau du droit des personnes
– Mme Lise Duquet, cheffe du bureau de l’aide juridictionnelle
Ø Avocats droits et psychiatrie – Mme Corinne Vaillant, avocate et présidente de l’association
(*) Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE 2 :
DÉPLACEMENTS DE LA MISSION
ET LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
À Paris, le mercredi 1er février 2017
● Infirmerie psychiatrique près la préfecture de police de Paris
Pour la Préfecture de police de Paris :
- M. Jean Benet, directeur des transports et de la protection du public
- Mme Nadia Seghier, sous-directrice de la protection sanitaire et de l’environnement
- Mme Célia Rouby, chargée de mission pour les affaires sanitaires auprès de la sous-directrice de la protection sanitaire et de l’environnement
- M. Jean-Paul Berlan, chef du bureau des actions de santé mentale
- M. Stéphane Velin, adjoint au chef de bureau des actions de santé mentale
Pour l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de Paris :
- Dr Eric Mairesse, médecin en chef
- Dr Pascal Forissier, médecin chef adjoint
- Mme Guenaëlle Jegu, cadre supérieur de santé
- Mme Douay, cadre de santé
● Centre hospitalier Sainte-Anne
Pour le Centre hospitalier :
- M. Jean-Luc Chassaniol, directeur
- Mme Nathalie Alamowitch, directrice en charge des affaires juridiques et des usagers
- Dr Alain Mercuel, chef de service, président de la commission médicale d’établissement
Pour le Tribunal de grande instance de Paris :
- M. Thierry Fusina, magistrat, vice-président du TGI de Paris
- Mme Roïa Palti, magistrate, vice-présidente du TGI de Paris
Pour l’Ordre des avocats de Paris :
- Me Christophe Grignard, avocat, responsable du bureau pénal
- Me Mathieu Petit, membre du bureau pénal
- Me Letizia Monnet-Placidi, avocate, déléguée par la vice-bâtonnière
À Meaux, le jeudi 2 février 2017
● Centre hospitalier de Meaux
- Dr Vincent Mahé, chef du pôle de psychiatrie adulte du Groupe Hospitalier de l’Est Francilien (GHEF)
● Ordre des avocats au barreau de Meaux
- Me Laetitia Joffrin, membre du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Meaux, en charge de la commission pénale
- Me Marylin Brejou, avocate au barreau de Meaux
● Tribunal de grande instance de Meaux
- M. Jean-Paul Novella, vice-président
ANNEXE 3 :
EXEMPLE DE REGISTRE DE LA LOI
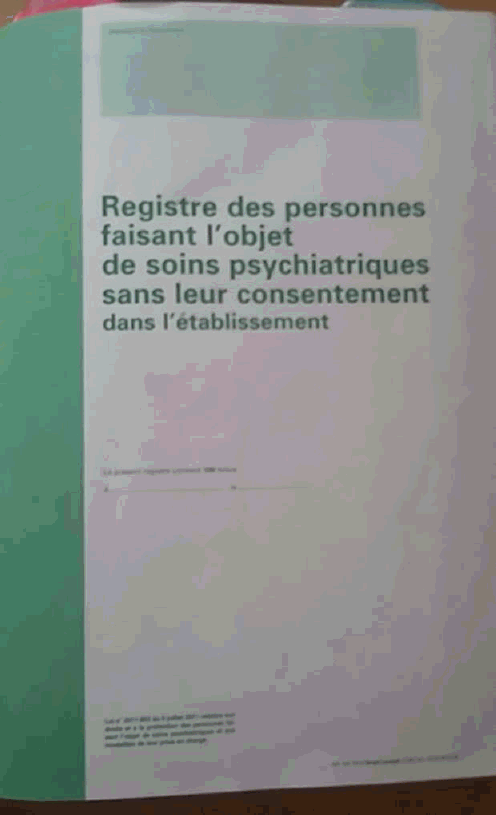
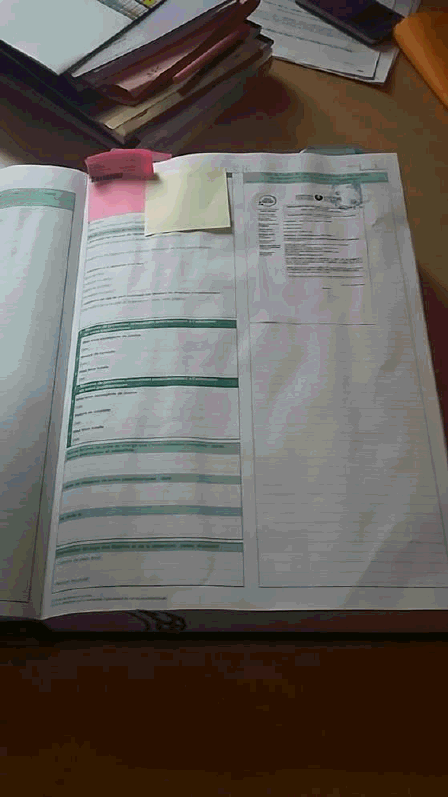
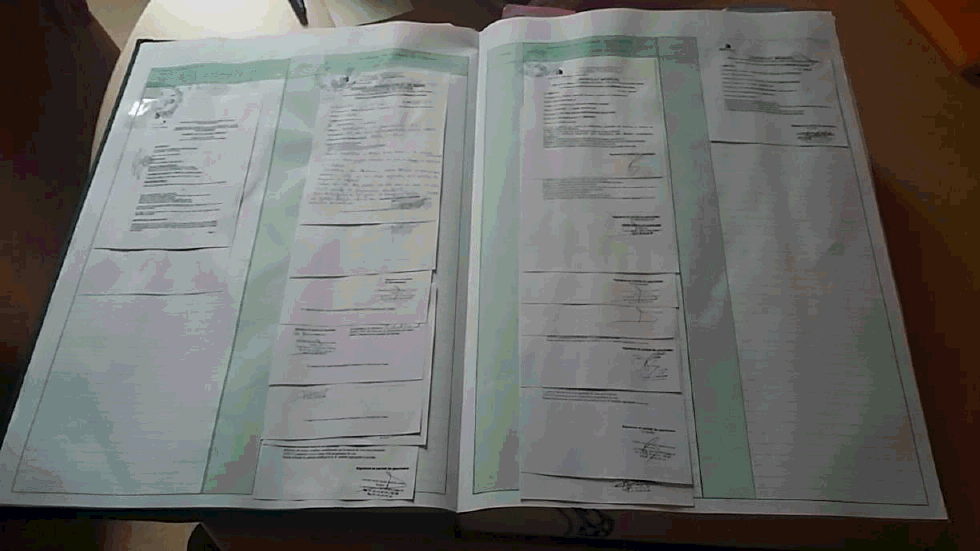
ANNEXE 4 :
EXEMPLE D’ARRÊTÉ PORTANT ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DÉCISION DU PRÉFET
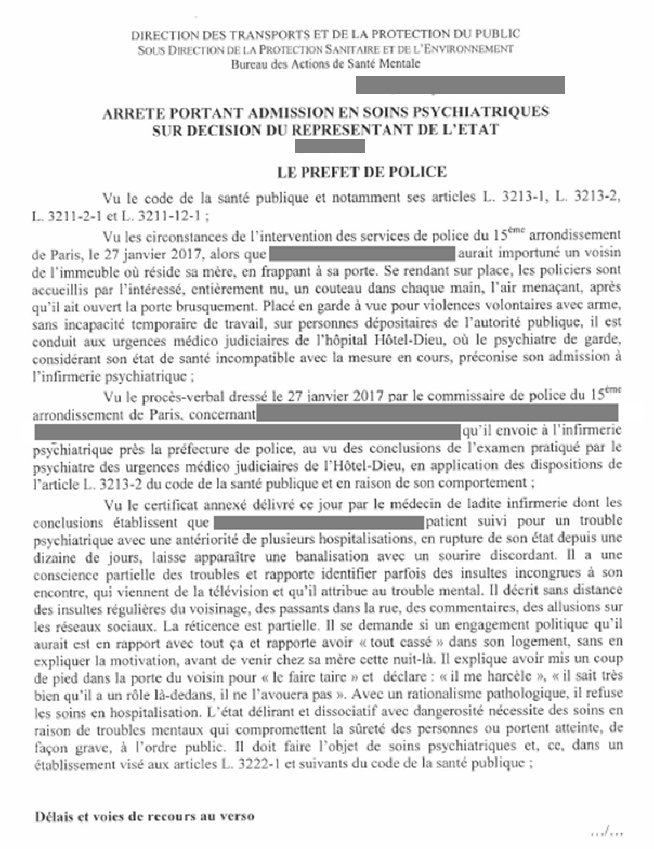
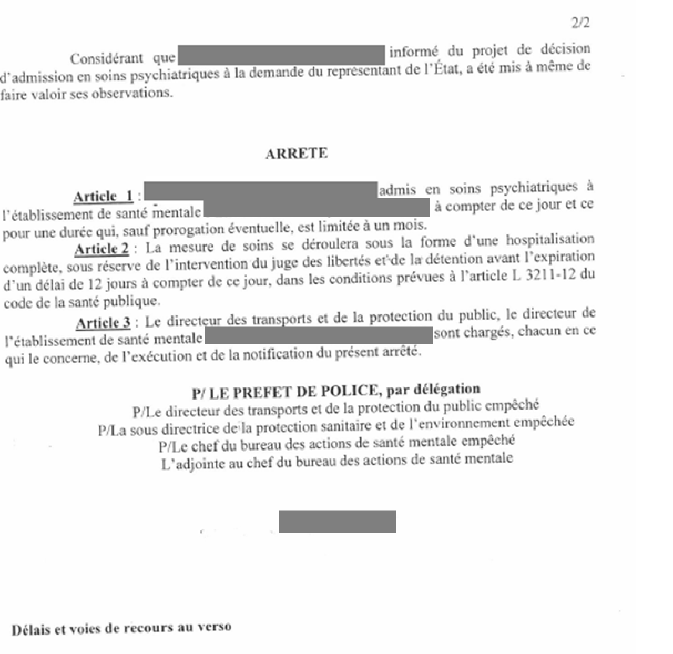
ANNEXE 5 :
STATISTIQUES RELATIVES À L’ADMISSION EN SOINS SANS CONSENTEMENT
RÉPARTITION DU NOMBRE DE PATIENTS FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES À LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
Année |
Part des patients faisant l’objet d’une admission à la demande d’un tiers |
Part des patients faisant l’objet d’une admission selon la procédure de droit commun |
Part des patients faisant l’objet d’une admission selon la procédure de péril imminent |
2010 |
80,30 % |
80,30 % |
|
2012 |
81,20 % |
72,80 % |
11 % |
2015 |
81,80 % |
64 % |
21 % |
(1) Ces chiffres sont relatifs au nombre de patients faisant l’objet de soins sans consentement et non pas du nombre d’admissions ou de mesures : un patient ayant été admis à plusieurs reprises n’est compté qu’une fois. (2) Un même patient peut faire l’objet, au cours de la même année, d’une admission selon la procédure de péril imminent et d’une admission selon la procédure de droit commun. Les chiffres de la présente colonne ont été retraités et ne constituent pas un cumul des pourcentages présentés dans les deux dernières colonnes. | |||
Sources : Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015 et données présentées en audition. | |||
PART DES PATIENTS FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES
À LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
Année |
Proportion (en %) |
2010 (*) |
19,30 % |
2012 (*) |
18,70 % |
2015 (**) |
18 % |
(*) Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015. (**) Données présentées en audition. | |
PART DES DÉTENUS FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES
SANS CONSENTEMENT (ARTICLE D. 398 DU CODE PÉNAL)
Année |
Proportion (en %) |
2010 (*) |
1,9 % |
2012 (*) |
2,3 % |
2015 (**) |
2 % |
(*) Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015. (**) Données présentées en audition. | |
NOMBRE DE PATIENTS FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Année |
Patients suivis en soins sans consentement faisant l’objet de programmes de soins |
Patients suivis en soins sans consentement |
File active des patients de plus de 16 ans suivis en psychiatrie |
2010 (1) |
19 827 |
76 000 |
1 516 151 |
2012 (1) |
27 658 |
79 000 |
1 630 084 |
2015 |
36 948 |
92 000 |
1 727 081 |
2015 (2) |
36 943 |
91 551 |
1 709 399 |
(1) Ces nombres incluent les départements d’outre-mer mais ne comprennent pas les départements de la Nièvre des Deux-Sèvres alors non répondant à l’enquête en 2010 et 2012. (2) Données retraitées selon le périmètre des départements non répondants en 2010 et 2012 (exclusion des départements de la Nièvre des Deux-Sèvres). | |||
Sources : Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015 et données présentées en audition. | |||
ANNEXE 6 :
STATISTIQUES FOURNIES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
NOMBRE TOTAL DE DEMANDES REÇUES PAR LE JLD AU TITRE DES SOINS SANS CONSENTEMENT, RÉPARTITION SELON L’ACTE (ADMISSION, MODIFICATION DE PRISE EN CHARGE, MAINTIEN OU FIN DE MESURE)
2011 |
2012** |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p* | |
Ensemble des saisines JLD |
24 657 |
60 526 |
65 862 |
70 810 |
77 931 |
64 200 |
14C-Demande relative à l’internement d’une personne |
24 657 |
4 761 |
||||
14I-Demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt |
2 916 |
2 840 |
3 073 |
1 998 |
1 489 | |
14J-Demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt |
403 |
570 |
523 |
408 |
387 | |
14K-Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète |
52 403 |
62 371 |
67 123 |
75 451 |
62 252 | |
14L-Demande de contrôle de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet |
43 |
81 |
91 |
74 |
72 | |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-SDSE | |||||
* 2016p : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
** Les nouveaux codes ont pris effet à compter de 2012
CONTRÔLE DE LA NÉCESSITÉ D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE PSYCHIATRES ET PRÉFET : NOMBRE DE DEMANDES FORMÉES, NOMBRE DE DÉCISIONS PRONONCÉES ET TAUX DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE (2012-2016P)
Nombre de demandes introduites au cours de l’année |
Nombre de décisions rendues au cours de l’année | |||
Total des décisions* (1) |
Dont décisions de maintien de l’hospitalisation complète (2) |
Taux de maintien de l’hospitalisation complète**** (en %) (2/1)*100 | ||
2012** |
43 |
39 |
26 |
66,7 |
2013 |
81 |
79 |
59 |
74,7 |
2014 |
91 |
89 |
64 |
71,9 |
2015 |
74 |
69 |
50 |
72,5 |
2016p*** |
72 |
62 |
37 |
59,7 |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation DACS-PEJC | |||
* Hors jonction et interprétation
** 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes
*** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
**** Le taux de maintien de l’hospitalisation correspond au taux de confirmation de la décision du représentant de l’état.
SAISINE AU TITRE DU I : NOMBRE DE DEMANDES (2012-2016P)
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | |
Ensemble des saisines JLD (y compris saisine d’office) |
3 319 |
3 410 |
3 596 |
2 406 |
1 876 |
14I-Demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt |
2 916 |
2 840 |
3 073 |
1 998 |
1 489 |
14 J-Demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt |
403 |
570 |
523 |
408 |
387 |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | ||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
Champ : France entière
SAISINE D’OFFICE AU TITRE DU DERNIER ALINÉA DU I :
NOMBRE DE DEMANDES (2012-2016P)
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | ||
Ensemble des saisines d’office du JLD |
28 |
3 |
8 |
10 |
9 | |
14I-Demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt |
28 |
2 |
6 |
8 |
9 | |
14 J-Demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 | |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | |||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
Champ : France entière
SORT DES DEMANDES DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE PAR LE PATIENT OU TOUTE PERSONNE AGISSANT DANS SON INTÉRÊT (14I)
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | |
Ensemble des décisions prononcées *** (hors jonction et interprétation) (1)=(2+3) |
2 060 |
2 172 |
2 831 |
1 895 |
1 398 |
Décisions ne statuant pas sur la demande (2) |
282 |
357 |
301 |
178 |
125 |
dont désistement |
111 |
126 |
117 |
57 |
45 |
dont caducité |
16 |
38 |
26 |
15 |
9 |
dont dessaisissement au titre de l’article 384 du CPC |
42 |
58 |
40 |
34 |
27 |
Décisions statuant sur la demande (3) |
1 778 |
1 815 |
2 530 |
1 717 |
1 273 |
maintien de la mesure d’hospitalisation (4) |
1 359 |
1 460 |
2 078 |
1 480 |
1 082 |
mainlevée de la mesure d’hospitalisation |
419 |
355 |
452 |
237 |
191 |
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions (4 janvier)*100 |
66,0 |
67,2 |
73,4 |
78,1 |
77,4 |
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions statuant sur la demande (4 mars)*100 |
76,4 |
80,4 |
82,1 |
86,2 |
85,0 |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | ||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
*** En 2012 et 2013, les décisions rendues par les TGI de Fort de France, de Béziers et Metz ne sont pas prises en compte en raison d’un problème de codage
SORT DES DEMANDES DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION AUTRE QUE COMPLÈTE PAR LE PATIENT OU TOUTE PERSONNE AGISSANT DANS SON INTÉRÊT (14 J)
2012 |
2013* |
2014 |
2015 |
2016p** | |
Ensemble des décisions prononcées*** (hors jonction et interprétation) (1)=(2+3) |
369 |
539 |
502 |
405 |
363 |
Décisions ne statuant pas sur la demande (2) |
56 |
87 |
48 |
57 |
44 |
dont désistement |
11 |
19 |
12 |
19 |
12 |
dont caducité |
5 |
8 |
2 |
3 |
4 |
dont dessaisissement au titre de l’article 384 du CPC |
15 |
14 |
14 |
9 |
7 |
Décisions statuant sur la demande (3) |
313 |
452 |
454 |
348 |
319 |
maintien de la mesure d’hospitalisation (4) |
254 |
378 |
374 |
291 |
265 |
mainlevée de la mesure d’hospitalisation |
59 |
74 |
80 |
57 |
54 |
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions (4 janvier)*100 |
68,8 |
70,1 |
74,5 |
71,9 |
73,0 |
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions statuant sur la demande (4 mars)*100 |
81,2 |
83,6 |
82,4 |
83,6 |
83,1 |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | ||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
***En 2012 et 2013, les décisions rendues par les TGI de Fort de France, de Béziers et Metz ne sont pas prises en compte en raison d’un problème de codage
DEMANDE DE CONTRÔLE OBLIGATOIRE PÉRIODIQUE DE LA NÉCESSITÉ D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE (14K) : DEMANDE ET DÉCISIONS SUR 2012-2016P
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | |||
Nombre de demandes formées devant le JLD au cours de l’année |
52 403 |
62 366 |
67 120 |
75 450 |
62 251 | ||
Nombre de décisions prononcées (hors jonction et interprétation) (1)=(2+3) |
49 661 |
61 060 |
65 986 |
74 834 |
60 729 | ||
Décisions ne statuant pas sur la demande (2) |
5 247 |
5 501 |
4 772 |
4 008 |
2 953 | ||
dont désistement |
2 025 |
1 861 |
1 653 |
1 462 |
1 107 | ||
dont caducité |
952 |
1 150 |
968 |
806 |
544 | ||
dont dessaisissement au titre de l’article 384 du CPC |
1 023 |
1 125 |
1 030 |
1 084 |
787 | ||
Décisions statuant sur la demande (3) |
44 414 |
55 559 |
61 214 |
70 826 |
57 776 | ||
maintien de la mesure d’hospitalisation (4) |
40 594 |
50 531 |
56 070 |
64 564 |
52 805 | ||
mainlevée de la mesure d’hospitalisation**** |
3 820 |
5 028 |
5 144 |
6 262 |
4 971 | ||
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions (4 janvier)*100 |
81,7 |
82,8 |
85,0 |
86,3 |
87,0 | ||
Taux de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur l’ensemble des décisions statuant sur la demande (4 mars)*100 |
91,4 |
91,0 |
91,6 |
91,2 |
91,4 | ||
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | ||||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes, attention certaines demandes de contrôle semblent avoir été codées sous l’ancien code 14C (4 761 demandes)
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
*** En 2012 et 2013, les décisions rendues par les TGI de Fort de France, de Béziers et Metz ne sont pas prises en compte en raison d’un problème de codage.
**** Y compris les mainlevées acquises à raison de l’absence de décision du JLD dans les délais
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAINLEVÉES PRONONCÉES À L’ISSUE D’UNE DEMANDE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE LA NÉCESSITÉ D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE ET MAINLEVÉES CONSTATÉES SANS DÉBAT À RAISON DE L’ABSENCE DE DÉCISION DU JLD DANS LES DÉLAIS
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | ||||
Ensemble des mainlevées de la mesure d’hospitalisation (1) |
3 820 |
5 028 |
5 144 |
6 262 |
4 971 | |||
– dont mainlevées acquises sans débat (2) |
1 591 |
2 477 |
2 631 |
3 108 |
2 534 | |||
Part des mainlevées acquises sans débat sur l’ensemble des mainlevées (2/1)*100 |
41,6 |
49,3 |
51,1 |
49,6 |
51,0 | |||
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | |||||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes, attention certaines demandes de contrôle semblent avoir été codées sous l’ancien code 14C
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
*** En 2012 et 2013, les décisions rendues par les TGI de Fort de France, de Béziers et Metz ne sont pas prises en compte en raison d’un problème de codage
AFFAIRES TERMINÉES RELATIVES AUX SOINS SANS CONSENTEMENT SELON LA REPRÉSENTATION OU NON D’UNE DES PARTIES PAR UN AVOCAT
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | |||
Ensemble des affaires relatives aux soins sans consentement traitées au cours de l’année (1=2+3) |
59 335 |
64 874 |
69 832 |
77 386 |
62 658 | ||
Affaires avec représentation d’au moins une partie par un avocat (2) |
15 050 |
20 653 |
31 781 |
56 770 |
47 747 | ||
Affaires sans représentation par un avocat d’une des parties (3) |
44 285 |
44 221 |
38 051 |
20 616 |
14 911 | ||
Part des affaires sans représentation par un avocat d’une des parties (3/1)*100 |
74,6 |
68,2 |
54,5 |
26,6 |
23,8 | ||
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | ||||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes,
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
AFFAIRES TERMINÉES RELATIVES AUX SOINS SANS CONSENTEMENT POUR LESQUELLES IL EST MENTIONNÉ LA REPRÉSENTATION D’AU MOINS UNE DES PARTIES ET SITUATION AU REGARD DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | ||||
Ensemble des affaires terminées avec représentation d’au moins une partie par un avocat (1) |
15 050 |
20 653 |
31 781 |
56 770 |
47 747 | |||
Dont affaires pour lesquelles il est fait mention de l’attribution d’au moins une aide juridictionnelle (2) |
621 |
583 |
129 |
724 |
932 | |||
Part des affaires avec représentation d’une des parties par un avocat pour lesquelles il est fait mention de l’aide juridictionnelle (3/1)*100 |
4,1 |
2,8 |
0,4 |
1,3 |
2,0 | |||
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | |||||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016
NOMBRE D’AFFAIRES TRAITÉES ET DÉLAIS MOYENS DE TRAITEMENT (EN JOURS) PAR LES JLD DU RESSORT DES COURS D’APPEL
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | ||||||||||
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne (en jours) |
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne (en jours) |
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne (en jours) |
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne (en jours) |
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne (en jours) | |||||
Ensemble du territoire |
59 335 |
5,4 |
64 874 |
5,3 |
69 832 |
5,5 |
77 386 |
4,6 |
62 658 |
4,6 | ||||
AGEN |
779 |
5,9 |
656 |
5,0 |
830 |
5,3 |
902 |
4,8 |
735 |
4,6 | ||||
AIX EN PROVENCE |
4 081 |
5,4 |
4 019 |
5,6 |
4 559 |
5,3 |
4 761 |
4,8 |
3 745 |
5,1 | ||||
AMIENS |
2 372 |
4,6 |
2 652 |
4,8 |
2 610 |
5,0 |
2 748 |
5,8 |
2 312 |
5,5 | ||||
ANGERS |
751 |
4,3 |
823 |
4,2 |
775 |
3,7 |
1 366 |
4,0 |
1 117 |
5,0 | ||||
BASSE TERRE |
378 |
5,8 |
789 |
6,8 |
696 |
7,1 |
843 |
5,4 |
652 |
4,4 | ||||
BASTIA |
325 |
4,5 |
301 |
3,7 |
326 |
3,2 |
351 |
3,0 |
293 |
3,7 | ||||
BESANÇON |
1 328 |
5,2 |
1 371 |
5,3 |
1 354 |
5,2 |
1 481 |
4,2 |
1 211 |
4,1 | ||||
BORDEAUX |
2 392 |
6,9 |
2 710 |
6,4 |
2 959 |
6,4 |
3 209 |
5,6 |
2 757 |
5,5 | ||||
BOURGES |
621 |
5,3 |
613 |
5,4 |
636 |
5,4 |
724 |
4,9 |
499 |
4,6 | ||||
CAYENNE |
153 |
7,4 |
143 |
4,5 |
78 |
4,2 |
261 |
2,6 |
215 |
4,3 | ||||
CAEN |
1 067 |
4,0 |
1 116 |
4,5 |
1 209 |
5,3 |
1 373 |
4,6 |
1 111 |
5,5 | ||||
CHAMBÉRY |
1 037 |
6,2 |
1 166 |
6,4 |
1 194 |
6,5 |
1 149 |
5,9 |
1 007 |
6,0 | ||||
COLMAR |
1 751 |
4,2 |
1 785 |
5,0 |
1 775 |
5,2 |
1 943 |
5,0 |
1 691 |
4,2 | ||||
DIJON |
954 |
5,6 |
1 092 |
5,5 |
1 273 |
5,7 |
1 487 |
5,2 |
1 301 |
5,2 | ||||
DOUAI |
2 908 |
5,5 |
3 028 |
5,3 |
3 336 |
10,1 |
3 555 |
5,1 |
2 696 |
5,1 | ||||
FORT DE FRANCE |
644 |
1,2 |
432 |
0,1 |
658 |
1,5 |
728 |
2,5 |
584 |
1,7 | ||||
GRENOBLE |
1 669 |
4,9 |
1 902 |
4,1 |
2 066 |
3,4 |
2 211 |
3,1 |
1 617 |
3,1 | ||||
LIMOGES |
861 |
5,4 |
915 |
5,5 |
1 115 |
5,4 |
1 247 |
4,5 |
907 |
4,7 | ||||
LYON 5ÈME |
4 055 |
5,0 |
4 154 |
4,7 |
4 265 |
4,7 |
4 690 |
4,6 |
3 584 |
4,7 | ||||
METZ |
1 235 |
6,5 |
1 150 |
5,3 |
1 308 |
5,8 |
1 444 |
8,4 |
1 108 |
7,0 | ||||
MONTPEL-LIER |
2 168 |
5,7 |
2 529 |
4,7 |
2 589 |
5,7 |
2 880 |
3,8 |
2 432 |
3,7 | ||||
NANCY |
1 206 |
10,0 |
1 237 |
5,4 |
1 337 |
16,2 |
1 504 |
3,9 |
1 196 |
3,7 | ||||
NÎMES |
918 |
6,1 |
1 953 |
4,9 |
2 218 |
4,3 |
2 349 |
3,8 |
2 002 |
4,6 | ||||
ORLÉANS |
942 |
4,3 |
1 054 |
3,9 |
1 062 |
3,4 |
1 232 |
3,6 |
1 028 |
3,0 | ||||
PARIS 1er |
8 882 |
5,6 |
9 423 |
6,5 |
10 355 |
5,2 |
11 373 |
4,3 |
9 104 |
4,3 | ||||
PAU |
1 421 |
5,5 |
1 526 |
5,7 |
1 534 |
5,7 |
1 664 |
4,5 |
1 516 |
4,3 | ||||
POITIERS |
2 342 |
5,6 |
2 373 |
5,6 |
2 380 |
4,5 |
2 639 |
4,2 |
2 017 |
4,2 | ||||
REIMS |
762 |
6,0 |
1 065 |
5,9 |
1 263 |
6,0 |
1 430 |
6,2 |
1 182 |
6,2 | ||||
RENNES |
3 914 |
5,2 |
4 044 |
4,6 |
4 477 |
4,7 |
5 188 |
4,5 |
4 120 |
4,9 | ||||
RIOM |
978 |
5,7 |
873 |
4,9 |
1 288 |
4,5 |
1 581 |
4,3 |
1 131 |
5,9 | ||||
ROUEN |
1 374 |
5,8 |
1 566 |
5,6 |
1 921 |
5,8 |
2 302 |
4,8 |
1 794 |
5,0 | ||||
ST DENIS |
612 |
4,4 |
730 |
5,2 |
771 |
3,8 |
878 |
2,9 |
980 |
3,8 | ||||
TOULOUSE |
1 005 |
4,6 |
1 845 |
4,4 |
1 932 |
4,9 |
2 117 |
3,6 |
1 771 |
3,4 | ||||
VERSAILLES |
3 450 |
5,2 |
3 839 |
4,8 |
3 683 |
5,0 |
3 776 |
4,5 |
3 243 |
4,4 | ||||
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | |||||||||||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes.
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016.
NOMBRE D’AFFAIRES TRAITÉES ET DÉLAIS MOYENS DE TRAITEMENT (EN JOURS) PAR LES PREMIERS PRÉSIDENTS DE LA COUR D’APPEL EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** |
||||||||||||
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne |
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne (en jours) |
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne (en jours) |
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne (en jours) |
Nbre d’affaires terminées |
Durée moyenne (en jours) | |||||||
Ensemble du territoire |
2 018 |
7,8 |
2 118 |
8,0 |
2 405 |
7,6 |
2 870 |
7,8 |
2 383 |
7,7 | ||||||
AGEN |
24 |
4,8 |
31 |
5,9 |
27 |
6,7 |
34 |
6,7 |
24 |
5,1 | ||||||
AIX EN PROVENCE |
153 |
10,0 |
127 |
9,9 |
160 |
9,3 |
158 |
9,8 |
120 |
6,6 | ||||||
AMIENS |
78 |
6,9 |
65 |
7,8 |
53 |
6,9 |
61 |
9,9 |
78 |
9,0 | ||||||
ANGERS |
45 |
8,9 |
45 |
7,5 |
43 |
6,7 |
43 |
7,4 |
44 |
6,7 | ||||||
BASSE TERRE |
11 |
6,0 |
7 |
12,3 |
12 |
5,5 |
16 |
7,1 |
12 |
5,3 | ||||||
BASTIA |
3 |
14,0 |
7 |
8,9 |
10 |
8,2 |
11 |
5,0 |
13 |
8,3 | ||||||
BESANÇON |
43 |
9,6 |
41 |
8,9 |
55 |
7,7 |
78 |
6,5 |
54 |
7,9 | ||||||
BORDEAUX |
149 |
7,5 |
130 |
7,8 |
141 |
7,9 |
155 |
8,2 |
113 |
7,9 | ||||||
BOURGES |
27 |
7,0 |
24 |
5,6 |
37 |
5,1 |
35 |
5,5 |
25 |
7,3 | ||||||
CAYENNE |
||||||||||||||||
CAEN |
41 |
5,9 |
38 |
6,1 |
54 |
7,9 |
50 |
8,2 |
50 |
8,2 | ||||||
CHAMBÉRY |
32 |
6,4 |
57 |
7,7 |
50 |
7,0 |
52 |
8,1 |
34 |
6,5 | ||||||
COLMAR |
65 |
6,8 |
56 |
6,7 |
59 |
8,6 |
86 |
6,8 |
77 |
7,0 | ||||||
DIJON |
47 |
7,9 |
43 |
11,1 |
42 |
7,0 |
52 |
7,8 |
40 |
7,3 | ||||||
DOUAI |
56 |
6,4 |
68 |
17,6 |
75 |
7,0 |
78 |
8,1 |
83 |
7,9 | ||||||
FORT DE FRANCE |
5 |
8,0 |
7 |
6,3 |
7 |
4,0 |
5 |
5,4 |
5 |
8,0 | ||||||
GRENOBLE |
50 |
7,1 |
51 |
7,6 |
59 |
6,6 |
74 |
5,7 |
59 |
5,7 | ||||||
LIMOGES |
33 |
5,3 |
48 |
6,5 |
50 |
6,0 |
62 |
7,0 |
47 |
7,1 | ||||||
LYON 5e |
190 |
8,1 |
190 |
7,2 |
157 |
6,7 |
164 |
8,4 |
181 |
8,0 | ||||||
METZ |
32 |
6,8 |
32 |
6,7 |
12 |
9,7 |
37 |
5,8 |
24 |
5,4 | ||||||
MONTPELLIER |
51 |
7,8 |
44 |
9,5 |
56 |
8,9 |
107 |
8,0 |
80 |
8,0 | ||||||
NANCY |
52 |
7,3 |
26 |
7,3 |
29 |
6,9 |
42 |
6,2 |
31 |
8,3 | ||||||
NÎMES |
32 |
6,1 |
45 |
5,4 |
64 |
7,3 |
49 |
6,8 |
45 |
6,8 | ||||||
ORLÉANS |
35 |
7,2 |
24 |
6,8 |
46 |
7,9 |
64 |
6,5 |
43 |
7,0 | ||||||
PARIS 1er |
250 |
8,6 |
373 |
9,0 |
472 |
8,3 |
561 |
7,0 |
405 |
7,7 | ||||||
PAU |
33 |
6,8 |
48 |
5,9 |
45 |
7,2 |
31 |
7,0 |
41 |
6,7 | ||||||
POITIERS |
39 |
16,9 |
39 |
10,6 |
47 |
9,6 |
58 |
7,9 |
50 |
8,2 | ||||||
REIMS |
45 |
8,8 |
44 |
7,3 |
45 |
6,6 |
58 |
6,8 |
40 |
7,0 | ||||||
RENNES |
147 |
6,8 |
130 |
6,5 |
218 |
7,6 |
242 |
7,8 |
181 |
6,9 | ||||||
RIOM |
28 |
7,7 |
28 |
7,5 |
25 |
8,2 |
46 |
6,7 |
42 |
6,2 | ||||||
ROUEN |
34 |
7,4 |
30 |
7,3 |
52 |
7,0 |
58 |
12,4 |
44 |
21,3 | ||||||
ST DENIS |
9 |
5,3 |
11 |
5,9 |
12 |
4,0 |
8 |
3,9 |
10 |
7,7 | ||||||
TOULOUSE |
44 |
6,6 |
53 |
6,0 |
49 |
5,8 |
53 |
6,7 |
55 |
6,6 | ||||||
VERSAILLES |
135 |
7,0 |
156 |
6,4 |
142 |
6,8 |
242 |
10,2 |
233 |
8,5 | ||||||
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | |||||||||||||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes.
** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016.
RECOURS FORMÉS DEVANT LES COURS D’APPEL
2012* |
2013 |
2014 |
2015 |
2016p** | ||
Ensemble du territoire |
2 049 |
2 150 |
2 428 |
2 882 |
2 403 | |
AGEN |
26 |
29 |
27 |
34 |
24 | |
AIX EN PROVENCE |
151 |
129 |
159 |
156 |
121 | |
AMIENS |
82 |
69 |
58 |
65 |
78 | |
ANGERS |
45 |
45 |
46 |
46 |
45 | |
BASSE TERRE |
11 |
7 |
14 |
18 |
12 | |
BASTIA |
3 |
7 |
10 |
11 |
13 | |
BESANÇON |
42 |
41 |
55 |
78 |
55 | |
BORDEAUX |
146 |
131 |
139 |
157 |
113 | |
BOURGES |
25 |
25 |
36 |
35 |
25 | |
CAEN |
45 |
38 |
54 |
53 |
54 | |
CAYENNE |
||||||
CHAMBÉRY |
33 |
57 |
50 |
51 |
34 | |
COLMAR |
65 |
58 |
58 |
85 |
78 | |
DIJON |
48 |
45 |
39 |
54 |
40 | |
DOUAI |
57 |
68 |
72 |
82 |
81 | |
FORT DE FRANCE |
5 |
7 |
7 |
6 |
6 | |
GRENOBLE |
54 |
53 |
60 |
72 |
59 | |
LIMOGES |
35 |
50 |
54 |
59 |
47 | |
LYON 5ÈME |
192 |
190 |
155 |
165 |
188 | |
METZ |
32 |
31 |
11 |
37 |
24 | |
MONTPELLIER |
60 |
58 |
66 |
109 |
84 | |
NANCY |
50 |
26 |
29 |
42 |
31 | |
NÎMES |
32 |
46 |
62 |
49 |
45 | |
ORLÉANS |
36 |
25 |
44 |
64 |
47 | |
PARIS 1ER |
257 |
377 |
478 |
555 |
401 | |
PAU |
31 |
49 |
47 |
30 |
40 | |
POITIERS |
43 |
37 |
49 |
56 |
49 | |
REIMS |
46 |
44 |
45 |
58 |
42 | |
RENNES |
143 |
131 |
222 |
242 |
179 | |
RIOM |
28 |
28 |
26 |
46 |
43 | |
ROUEN |
34 |
32 |
52 |
60 |
41 | |
ST DENIS |
9 |
11 |
12 |
8 |
11 | |
TOULOUSE |
44 |
55 |
48 |
53 |
54 | |
VERSAILLES |
139 |
151 |
144 |
246 |
239 | |
Source : SDSE-RGC |
Exploitation : DACS-PEJC | |||||
* 2012 : date de prise en compte des nouveaux codes. ** 2016 : données provisoires et incomplètes en raison des délais d’enregistrement dans les applications : extraction au 15 décembre 2016. | ||||||
ANNEXE 7 :
LE CADRE JURIDIQUE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
Le code de la santé publique définit les modalités de soins en psychiatrie, réformées en juillet 2011 puis en septembre 2013. Il pose le principe du consentement aux soins « des personnes atteintes de troubles mentaux », énonce l’exception des soins sans consentement et définit ses modalités d’application. Les dispositions tendant à concilier la nécessaire protection de la santé du patient, y compris contre lui-même, et la protection des libertés individuelles en raison des restrictions qu’impose l’absence de consentement.
1. Le régime issu de la loi du 5 juillet 2011
La loi du 5 juillet 2011 a procédé à un changement majeur, guidée en cela par la position du Conseil constitutionnel. Elle étend les formes de prise en charge en ne la réduisant plus seulement à une mesure d’hospitalisation et prévoit parallèlement un contrôle par le juge judiciaire constitutionnellement garant des libertés individuelles.
a. Les modes légaux d’admission en soins sans consentement
L’admission en soins sans consentement repose sur le constat que le patient ne dispose pas des facultés nécessaires pour consentir librement à une prise en charge. Deux conditions sont ainsi formulées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. D’une part, les troubles mentaux rendent impossible son consentement ; d’autre part, l’état mental de la personne concernée « impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante […] soit d’une surveillance médicale régulière […] ».
Il existe ensuite plusieurs modalités d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement.
La décision du directeur d’un établissement, qui constitue le principal mode d’admission, repose sur une demande formulée par un tiers assortie de deux certificats médicaux établis par deux médecins distincts (1° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique).
Cette procédure de droit commun coexiste avec deux procédures exceptionnelles et allégées. On distingue ainsi la procédure d’admission sur le fondement du péril imminent (2° du II du même article L. 3212-1), dont le législateur avait entendu la réserver aux personnes socialement isolées : ce régime ne requiert qu’un seul certificat médical, toujours établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, et n’intervient qu’après avoir vainement recherché un tiers, ce qui lui vaut d’être qualifiée de « procédure d’admission à la demande d’un tiers sans tiers ».
On distingue en outre l’admission à la demande d’un tiers en procédure d’urgence (article L. 3212-3 du même code) motivée par le « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ». Celle-ci n’exige que la production d’un seul certificat qui peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.
Véritable exception française au regard des autres pays de l’Union européenne, le rôle dévolu au représentant de l’État reste encore important même s’il apparaît comme secondaire aujourd’hui. Cette admission est prononcée sur la base d’un certificat médical « circonstancié » établi par un psychiatre qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Elle est doublement motivée par l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et par les risques d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public (article L. 3213-1). Comme pour les admissions sur décision du directeur d’établissement, des mesures d’urgences peuvent être diligentées par le maire (ou par le commissaire de police pour la ville de Paris) « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical », non sans en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État.
Il faut enfin y ajouter le cas particulier des personnes placées en détention ainsi que des personnes déclarées pénalement irresponsables dont la procédure d’admission nécessite une décision préfectorale établie dans les conditions précitées.
b. La prise en charge
La prise en charge du patient débute par une période d’observation (d’une durée maximale de 72 heures) sous la forme d’une hospitalisation complète. Durant ce laps de temps, le patient fait l’objet d’un suivi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. La loi exige la production de deux certificats médicaux respectivement dans les vingt-quatre heures suivant l’admission et dans les soixante-douze heures. Si l’un ou l’autre de ces documents infirme la nécessité d’une contrainte de soins, la levée de la mesure peut être décidée.
Lorsque les deux certificats médicaux concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le certificat établi à l’issue de la période d’observation indique la forme de la prise en charge : l’hospitalisation complète en établissement psychiatrique (surveillance constante) ou toute autre forme de prise en charge en ambulatoire assortie d’un programme de soins (surveillance régulière).
c. Le juge judiciaire, garant des libertés individuelles
La loi du 5 juillet 2011 a consacré le rôle du juge judiciaire dans le contrôle des soins psychiatriques sans consentement. Il est le juge de l’hospitalisation complète. En effet, son contrôle porte obligatoirement sur les décisions d’admission en hospitalisation complète appelée à se prolonger pour une durée supérieure à douze jours.
Lorsque le juge des libertés et de la détention (JLD) décide de maintenir une hospitalisation complète requise par le représentant de l’État dans le département ou ordonnée par un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, il est de nouveau amené à se prononcer sur cette hospitalisation dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques (et ensuite au moins tous les mois) si le préfet décide de ne pas suivre l’avis du collège de psychiatres recommandant la prise en charge de la personne en ambulatoire, et s’il maintient l’hospitalisation complète au vu d’une expertise en ce sens.
Ce contrôle obligatoire mensuel ne doit pas être confondu avec le contrôle obligatoire semestriel que le juge exerce sur les autres hospitalisations complètes de longue durée. En effet, si le JLD a maintenu une hospitalisation complète dans le cadre de son contrôle du douzième jour suivant l’admission et si le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision, alors il doit de nouveau être saisi pour contrôler la nécessité du maintien de cette mesure à l’expiration d’un délai de six mois suivant la décision prononcée dans les douze jours suivant l’admission (et ensuite tous les six mois).
Outre ces contrôles obligatoires, le juge judiciaire exerce un contrôle facultatif sur la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement. Il peut en effet se saisir d’office ou être saisi à tout moment (par le procureur de la République ou par le patient, ses parents, tuteur, curateur, conjoint, concubin, partenaire ou tout autre proche susceptible d’agir dans son intérêt) aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate d’une telle mesure.
Par ailleurs, le JLD ne se prononce sur la prise en charge dans le cadre des programmes de soins que sur saisine des intéressés. Le suivi des programmes de soins ne requiert en effet aucun contrôle judiciaire obligatoire en l’absence de contrainte légale.
2. Les apports de la loi de septembre 2013
À nouveau sous la contrainte du Conseil constitutionnel, le législateur a ensuite adopté un nouveau texte en septembre 2013. Ce texte avait notamment vocation à satisfaire une décision du Conseil constitutionnel qui s’était prononcé, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), sur certaines dispositions de la loi de juillet 2011 relatives aux unités pour malades difficiles.
Le législateur s’était parallèlement saisi de ce vecteur législatif pour intégrer diverses conclusions intermédiaires formulées par une mission d’information alors en cours. Outre des modifications relatives au régime des soins psychiatriques sans consentement (suppression d’un certain nombre de certificats, précisions relatives au programme de soins, réintroduction des sorties d’essai), le texte s’attache à modifier la procédure de contrôle juridictionnel :
– délai de contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD) réduit de quinze à douze jours suivant l’admission ;
– tenue de l’audience du JLD sur l’emprise des établissements de santé à titre de principe, et au tribunal de grande instance à titre d’exception ;
– obligation d’assistance et de représentation par un avocat.
1 () Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation.
2 () Conseil constitutionnel, décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010.
3 () Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
4 () Rapport d’information n° 4402 sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, déposé en application de l’article 145-7, alinéa 1, du Règlement par la commission des Affaires sociales, et présenté par les députés Serge Blisko et Guy Lefrand.
5 () Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
6 () Rapport d’étape n° 1085 déposé le 29 mai 2013 par M. Denys Robiliard.
7 () Proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Denys Robiliard, Mme Catherine Lemorton, MM. Christian Paul et Gérard Bapt et plusieurs de leurs collègues relative aux soins sans consentement en psychiatrie, n° 1223, déposée le 3 juillet 2013.
8 () Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
9 () Magali Coldefy, Tonya Tartour, Clément Nestrigue, « De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la mise en place de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
10 () Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
11 () CE, 31 juillet 1996, requête n° 120736.
12 () CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 97NT01930, Centre hospitalier spécialisé de Pontorson.
13 () La notion de péril imminent existait déjà avant la loi de 2011 mais se rattachait à une procédure de demande de soins par un tiers en urgence. Les deux procédures ne doivent pas être confondues.
14 () Haute Autorité de santé, « Recommandations pour la pratique clinique : Modalités de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant des troubles mentaux », avril 2005.
15 () Magali Coldefy, Tonya Tartour, Clément Nestrigue, « De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la mise en place de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
16 () Denys Robiliard, rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie, n° 1284, 17 juillet 2013, session extraordinaire de juillet 2013, XIVè législature.
17 () Article L. 3213-1 du code de la santé publique.
18 () La décision initiale d’admission en soins émanant d’un juge judiciaire, le premier contrôle obligatoire du juge des libertés et de la détention sera effectué à l’issue d’une période de 6 mois.
19 () Magali Coldefy, Clément Nestrigue, « L’hospitalisation sans consentement en psychiatrie en 2010 : première exploitation du RIM-P et état des lieux avant la réforme du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 193, décembre 2013.
20 () Magali Coldefy, Charlène Le Neindre, « Les disparités territoriales d’offre et d’organisation des soins en psychiatrie en France : d’une vision segmentée à une approche systémique », Les Rapports de l’IRDES, n° 558, décembre 2014.
21 () Les travaux ont davantage porté sur la situation antérieure à l’application de la loi de juillet 2011.
22 () Magali Coldefy, Clément Nestrigue, Louis-Marie Paget, Nadia Younès, « L’hospitalisation sans consentement en psychiatrie en 2010 : analyse et déterminants de la variabilité territoriale », Revue française des affaires sociales, La Documentation française, 2016/2 n° 6, pp. 253 à 273.
23 () Joubert Fabien, Hechinger Morgane, Chevallier Violette, Marescaux Claude, « Hospitalisations sans consentement en psychiatrie : analyse comparative chez les personnes résidant ou non en zones urbaines sensibles », Santé Publique, 1/2016 (Vol. 28), p. 61-69.
24 () Dr Claude Marescaux, « Epidémiologie des soins sans consentement », in « Les soins psychiatriques sans consentement », Actes de la formation sous la direction du Dr Natalie Giloux et de Marion Primevert, École nationale de la magistrature, mars 2015.
25 () Magali Coldefy, Clément Nestrigue, Louis-Marie Paget, Nadia Younès, « L’hospitalisation sans consentement en psychiatrie en 2010 : analyse et déterminants de la variabilité territoriale », Revue française des affaires sociales, La Documentation française, 2016/2 n° 6 pages 253 à 273.
26 () Délibération n° 94-024 du 29 mars 1994.
27 () Lors d’échanges avec les représentants du ministère de la santé et des affaires sociales, il a été indiqué aux rapporteurs que le rapport serait transmis au Parlement à la mi-février 2017, soit concomitamment à la présentation des conclusions de la mission devant la commission des affaires sociales. Les rapporteurs auraient néanmoins souhaité disposer de ce document qui leur aurait permis de davantage irriguer leurs travaux.
28 () Décret n° 2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
29 () Commentaire de la décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012.
30 () Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012.
31 () Cass., 1ère civ., 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521.
32 () Magali Coldefy, Tonya Tartour, Clément Nestrigue, « De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la mise en place de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
33 () Magali Coldefy, Tonya Tartour, Clément Nestrigue, « De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la mise en place de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
34 () L’institution des programmes de soins visait à encadrer les sorties d’essai, dont certaines se poursuivaient sur plusieurs années, alors même que le patient était toujours considéré comme hospitalisé.
35 () Magali Coldefy, Tonya Tartour, Clément Nestrigue, « De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la mise en place de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
36 () Magali Coldefy, Tonya Tartour, Clément Nestrigue, « De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la mise en place de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
37 () Données présentées en audition.
38 () Burns T, Rugkåsa J, Yeeles K, Catty J., “Coercion in mental health: a trial of the effectiveness of community treatment orders and an investigation of informal coercion in community mental health care”, Programme Grants Appl Res 2016 ; 4 (21).
39 () O’Reilly RL. Does involuntary out-patient treatment work? Psychiatr Bull 2001; 25: 371-4.
40 () Swartz MS, Wilder CM, Swanson JW, Van Dorn RA, Robbins PC, Steadman HJ, et al. Assessing Outcomes for Consumers in New York’s Assisted Outpatient Treatment Program. Psychiatric Services. 2010;61(10):976–81.
41 () Magali Coldefy, Tonya Tartour, Clément Nestrigue, « De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la mise en place de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
42 () Magali Coldefy, Tonya Tartour, Clément Nestrigue, « De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la mise en place de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, IRDES, n° 205, janvier 2015.
43 () Gilles Vidon, Marie-Christine Hady-Baylé, Nadia Younès, « Quelle place pour les soins sans consentement en ambulatoire ? À propos de l’enquête IDF sur les programmes de soins », L’information psychiatrique vol. 91, n° 7, septembre 2015, pp. 602 à 607.
44 () Dr Claude Marescaux, « Épidémiologie des soins sans consentement », in « Les soins psychiatriques sans consentement », Actes de la formation sous la direction du Dr Natalie Giloux et de Marion Primevert, École nationale de la magistrature, mars 2015
45 () Article R. 3222-1 du code de la santé publique.
46 () Ces éléments chiffrés ne portent toutefois que sur huit établissements, deux d’entre eux ne saisissant pas correctement leurs données selon les indications formulées par le ministère des affaires sociales et de la santé.
47 () Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012.
48 () Cass. 1ère civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 13-17.984.
49 () Avis du 17 janvier 2013 relatif aux séjours injustifiés en unités pour malades difficiles.
50 () Décision n° 2013-367 QPC du 14 février 2014.
51 () Conseil d’État, 30 juin 2014, requête n° 352668.
52 () Décret n° 2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
53 () Sénat, question écrite n° 195.
54 () Conseil d’État, 13 mars 2013, requête n° 354976.
55 () Commentaire de la décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011.
56 () La compétence du préfet de police s’étend à l’aéroport de Roissy par délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis.
57 () 93 % des séjours ont une durée qui n’excède pas vingt-quatre heures.
58 () Cette diminution s’observe aussi pour les admissions sur décision du représentant de l’État sans passage par l’IPPP : 58 en 2016 contre 93 en 2011.
59 () Ce bureau est chargé du suivi de toutes les personnes relevant de la compétence de la préfecture de police de Paris, y compris de celles qui ne seraient pas présentées pour observation à l’IPPP.
60 () Article L. 3222-1 du code de la santé publique : « I. Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement, en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale (...) ».
61 () Ces médecins sont spécialisés en psychiatrie.
62 () Des admissions sur la demande d’un tiers peuvent être proposées mais en proportion moindre.
63 () À l’exception notable des informations transmises par la préfecture de police de Paris.
64 () Denys Robiliard, rapport n° 1284 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie, Assemblée nationale, XIVè législature, session extraordinaire de juillet 2013.
65 () Agence régionale de Santé Pays de la Loire, Guide de procédures, les soins psychiatriques sans consentement, p. 13.
(http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_actualites/2015/2015-06-soins_sans_consentement/procedures_soins_sans_consentement_ars_pdl_.pdf)
66 () Dr Hervé Claudel, « À propos de l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPPI) ; une expérience lyonnaise », in « Les soins psychiatriques sans consentement », Actes de la formation sous la direction du Dr Natalie Giloux et de Marion Primevert, École nationale de la magistrature, mars 2015.
67 () Dr Hervé Claudel, « À propos de l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPPI) ; une expérience lyonnaise », in « Les soins psychiatriques sans consentement », Actes de la formation sous la direction du Dr Natalie Giloux et de Marion Primevert, École nationale de la magistrature, mars 2015.
68 () Article 8 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
69 () Haute Autorité de santé, « Modalités de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant des troubles mentaux », Avril 2005.
70 () Ancienne appellation des CDSP.
71 () Article R. 3224-3 du code de la santé publique.
72 () Arrêté du 26 juin 2012 fixant le modèle du tableau des statistiques d’activité des commissions départementales des soins psychiatriques prévu à l’article R. 3223-11 du code de la santé publique.
73 () Rapport d’activité 2015 de la MILIVUDES.
74 () Avis 20135083, Séance du 16/01/2014.
75 () Dans son rapport d’activité pour l’année 2015, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan juge que, « dans un contexte de grande diversité des pratiques, les réformes de 2011 et 2013 sur la notification des mesures d’hospitalisation sous contrainte, l’information des patients et le contrôle du juge des libertés et de la détention se mettent péniblement en place » (p. 7).
76 () Interrogée sur les moyens déployés pour la mise en œuvre des réformes de 2011 et 2013, la direction des services judiciaires (DSJ) du ministère de la justice a expliqué n’avoir pas d’élément précis à fournir sur les équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT) de magistrats consacrés au contentieux des soins psychiatriques sans consentement, dans la mesure où les données collectées par cette direction concernent les ETPT relatifs à l’ensemble de l’activité civile du JLD, sans distinction entre la part consacrée au contentieux des soins sans consentement et celle consacrée au contentieux du droit des étrangers. La DSJ ne dispose pas non plus du niveau de détail requis dans « Outilgreffe » pour distinguer les moyens de greffe affectés au contentieux des soins psychiatriques sans consentement.
S’agissant des moyens matériels dévolus à ce contentieux (et notamment des véhicules mis à la disposition des JLD pour se transporter au sein des établissements d’accueil), il s’agit d’une information qui ne fait pas l’objet d’une centralisation par la DSJ.
77 () Circulaire DGOS/R4 n° 2011-312 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
78 () Sur les 22 000 actes qu’a dressés le greffe des JLD du TGI de Paris en 2016, 3769 concernaient le contentieux des soins psychiatriques sans consentement.
79 () Le rapport d’activité pour l’année 2015 de la CGLPL, Mme Adeline Hazan, relève que « de nombreuses visites ont mis en lumière des procédures de notification et d’information insatisfaisantes. Ainsi, lorsque les cadres de santé maîtrisent bien la procédure et la pédagogie qui doit l’accompagner, il arrive que, faute de disponibilité, la notification intervienne dans des délais trop longs, de 48 heures, voire de 72 heures. Dans d’autres cas, dans des hôpitaux généraux, l’information donnée aux patients et à leurs familles est insuffisante avec un livret d’accueil quasiment muet sur la psychiatrie et peu d’affichage dans les unités » (p. 10).
80 () La mission a pu constater lors de son déplacement à Meaux que le local dédié à l’entretien des avocats avec leur client n’était pas sécurisé (et qu’en outre les infirmiers refusaient d’accompagner les patients dans la salle d’audience aménagée dans les locaux de l’hôpital). En revanche, elle a relevé la présence d’un vigile provenant d’une société privée à l’hôpital parisien de Sainte-Anne.
81 () Contribution écrite fournie à la mission.
82 () S’agissant du montant des frais de copie des dossiers médicaux, l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, prévoit, en son annexe, que, s’agissant du coût de l’accès au dossier, « il est recommandé que la personne puisse connaître le coût de la communication des copies du dossier qu’elle souhaite détenir, afin de l’aider à prendre une décision sur sa demande de reproduction de tout ou partie de son dossier. La loi précise que la consultation du dossier sur place est gratuite. En cas de demande de copies, quel qu’en soit le support, seuls les coûts de reproduction et d’envoi sont facturables au demandeur. Il convient de se limiter au coût du consommable et de l’amortissement du matériel. Il est recommandé de prendre en considération la situation personnelle des demandeurs démunis afin de leur permettre de faire valoir leur droit d’accès aux informations concernant leur santé. »
83 () CGLPL, Rapport d’activité 2015, p. 11.
84 () Contribution écrite fournie par l’intermédiaire du CRPA.
85 () Ceux-ci seraient aujourd’hui une centaine, commis en moyenne une fois toutes les six semaines (soit neuf fois par an), par le service de l’accès au droit de l’ordre, pour assurer une permanence à l’audience du JLD au cours de laquelle ils défendent en moyenne 4,5 clients.
86 () Comme le Dr Natalie Giloux l’explique dans l’article sur « Le psychiatre et le juge face à la protection de la personne dans les soins contraints », qu’elle a cosigné avec Mme Marion Primevert, vice-présidente du TGI de Paris, dans ce contentieux, « l’atteinte à la liberté d’aller et de venir mérite une attention particulière, car elle recouvre ici un sens et une portée bien différents d’ailleurs. […] Elle ne constitue pas une “rétention administrative” comme c’est le cas pour les étrangers sans titre de séjour. […] L’hospitalisation sans consentement ne constitue pas plus une peine, ce que l’enfermement carcéral est : être malade n’a jamais été une infraction. […] Ni la rétention administrative, ni les peines d’emprisonnement, ni les détentions provisoires, n’ont pour premier et unique objet le bien de la personne concernée. C’est toute la différence avec l’hospitalisation sans consentement : l’atteinte à la liberté d’aller et de venir est dans ce cas décidée dans l’intérêt du patient. […] Le positionnement pénaliste de l’avocat n’a donc pas de sens dans ces audiences » (Revue de droit sanitaire et social, 2015, p. 973).
87 () D’après M. André Bitton, le délai de prise de connaissance des dossiers pourrait varier selon que l’avocat a été choisi par le patient ou commis d’office – la qualité de la défense étant, toujours selon lui, meilleure dans le premier cas.
88 () Contribution écrite fournie à la mission.
89 () Une avocate au barreau de Meaux que la mission a pu rencontrer a indiqué n’avoir jamais revu ses clients après la notification de la décision du JLD, ni informé ces derniers de leurs voies de recours (qui sont toutefois mentionnées sur la décision), ni interjeté appel d’une décision du JLD dans le cadre du contentieux des soins psychiatriques sans consentement.
90 () C’est notamment le vœu de Mme Corinne Vaillant, avocate et présidente de l’association « Avocats, droits et psychiatrie ».
91 () D’après Mme Corinne Vaillant, avocate et présidente de l’association « Avocats, droit et psychiatrie », l’envoi, aux établissements d’accueil, des convocations adressées par le greffe à l’attention des patients s’effectuerait par fax, sans récépissé, de sorte que certains patients n’apprendraient leur présentation à l’audience du JLD que tardivement, de la bouche de leur avocat, la veille de cette audience.
92 () Contribution écrite fournie à la mission.
93 () Contribution écrite fournie à la mission, après concertation des membres du bureau national, dont le président, M. Pascal Mariotti, précise que, si un tel délai devait être introduit, « l’ADESM demanderait, dans l’intérêt du patient, que l’avis médical motivé soit dissocié du dossier et qu’il puisse être présenté le jour de l’audience […afin] de bénéficier d’un avis médical plus conforme à l’état de santé réel du patient le jour de l’audience ».
94 () Lors de son audition, Mme Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (FNAPSY), a toutefois regretté que des personnes dont les ressources ne sont que très légèrement supérieures aux minima sociaux ne bénéficient pas de cette aide.
95 () L’article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388-1 du code civil, s’il choisit d’être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat, bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle ». Pour mémoire, l’article 388-1 précité prévoit que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
96 () Dans son rapport d’activité pour l’année 2015, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan, observe même que « la décision du bureau d’aide juridictionnelle intervenant généralement deux mois après l’audience, plusieurs patients dont le niveau de ressources était supérieur au plafond se sont vus refuser l’aide juridictionnelle et adresser des notes d’honoraires alors même qu’ils ne souhaitaient pas être assistés à l’audience mais que la loi le leur impose »( p. 14).
97 () Article 14 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique.
98 () Décret n° 91-1266 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
99 () À Paris, un protocole de défense d’urgence homologué par la Chancellerie pour les années 2016-2018 prévoit une rémunération forfaitaire des avocats d’un montant de 370 euros HT par audience.
100 () Depuis le 1er janvier 2017, les missions civiles des avocats dans les procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sont rétribuées, au titre de l’aide juridictionnelle, à hauteur de six unités de valeur (dont le montant unitaire – désormais unique – est, au niveau national, de 32 euros) – soit à hauteur de 192 euros hors taxes par dossier (frais de transport inclus). Dans la contribution écrite qu’il a fournie à la mission, Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, président de la commission « hospitalisation d’office et personnes vulnérables » du Syndicat des avocats de France (SAF), juge cette indemnisation dérisoire.
101 () N. Giloux et M. Primevert, « Le psychiatre et le juge face à la protection de la personne dans les soins contraints », Revue de droit sanitaire et social, 2015, p. 973. Délicate est la définition du consentement, en matière de contentieux des soins psychiatriques sans consentement, car si un patient est jugé comme n’étant pas en capacité de consentir aux soins, il est néanmoins regardé comme capable de signer le récépissé de la copie de la décision prise par le JLD à son sujet… C’est pour cette raison même que le législateur de 2013 a choisi de rendre obligatoire la présence de l’avocat, le patient ne pouvant être présumé en capacité de déterminer s’il a, ou non, besoin d’être assisté ou représenté.
102 () Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
103 () Ce chiffre ne prend toutefois pas en compte les désaccords antérieurs au douzième jour suivant l’admission, désaccords dont le JLD connaît dans le cadre de son contrôle obligatoire.
104 () Dans son rapport d’activité pour l’année 2015, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan, note que « les sorties de patients admis en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État (SDRE) en dehors de l’établissement sont parfois soumises par l’autorité administrative à des conditions qui vont au-delà des prescriptions médicales (conditions de progressivité : d’abord accompagnement par deux soignants, puis par un soignant, avant d’autoriser l’accompagnement par un membre de la famille) » (p. 8). Lors de son audition par la mission, Mme Adeline Hazan a ajouté que les refus de sorties opposés par les préfets n’étaient pas toujours notifiés aux patients et que, lorsqu’ils l’étaient, les modalités de recours n’étaient pas précisées sur la décision.
105 () Les « neuroleptiques retard » sont des antipsychotiques à action prolongée, administrés de façon soit hebdomadaire, soit bimensuelle, soit mensuelle, généralement par voie intramusculaire, et favorisant le suivi de patients psychotiques chroniques en cure ambulatoire.
106 () À cet effet, le préfet s’appuie sur les avis soit de médecins-conseils (psychiatres) qui se prononcent à la lecture du dossier, sans voir le patient, soit de médecins-inspecteurs qui se prononcent après avoir vu le patient soit à son domicile, soit en centre médico-psychologique (CMP).
107 () M. Jean-Paul Novella, vice-président du TGI de Meaux, a indiqué n’être qu’exceptionnellement saisi de demandes de mainlevée d’un programme de soins : une fois par an en moyenne.
108 () À Paris, d’après les informations fournies à la mission par le bureau des actions de santé mentale (BASM) de la préfecture de police, le taux de confirmation de la décision du préfet par le JLD avoisinerait 95 % sur la période 2011-2016, passant de 87,5 % en 2011 à 98 % en 2015 – soit un taux de mainlevée de 5 % en moyenne, oscillant entre 12,5 % en 2011 et 2 % en 2015. On dénombrait 17 mainlevées de mesures d’admission à la demande du préfet de police de Paris en 2015, et 25 en 2016. D’après les personnes entendues par la mission lors de sa visite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), ce faible taux de mainlevée pourrait s’expliquer, notamment, par la qualité des arrêtés pris par le préfet de police de Paris sur la base des certificats médicaux circonstanciés établis à l’IPPP.
109 () Ce constat rejoint, dans une certaine mesure, celui établi par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan, qui écrit, dans son rapport d’activité pour l’année 2015, que « la professionnalisation des acteurs demeure insuffisante », que « des difficultés surviennent surtout lorsque l’établissement [d’accueil] est très éloigné du siège du tribunal », que « la tenue des audiences est alors considérée comme “très chronophage” par les magistrats », que « de nombreux magistrats assurent alors à tour de rôle la tenue des audiences, ce qui présente parfois des difficultés car l’acquisition de compétence en matière de psychiatrie est complexe et supposerait un investissement régulier, incompatible avec une forte rotation » (pp. 11-12).
110 () Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016 portant dispositions statutaires relatives à la magistrature pris en application de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016.
111 () Interrogés à ce sujet, les services du ministère de la justice ont souligné que les contraintes résultant des missions toujours plus nombreuses qui sont confiées aux JLD (notamment en matière de droit des étrangers) rendent leurs postes moins attractifs que d’autres. Si, au 1er septembre prochain, le nombre de candidats était inférieur au nombre de postes de JLD à pourvoir, d’autres magistrats assureraient « par intérim » les fonctions dévolues au JLD.
112 () Ces données ont été fournies à la mission par la Chancellerie.
113 () Réponses au questionnaire adressé à la Chancellerie.
114 () Cette session est ouverte à des médecins de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) afin de favoriser les échanges avec les médecins psychiatres, notamment à l’occasion d’une matinée entière consacrée à une typologie des maladies mentales et au rôle du médecin.
115 () Une journée est consacrée aux hospitalisations sous contrainte, dont une demi-journée de table-ronde réunissant un JLD, un psychiatre et un avocat.
116 () En soutien à cette formation, l’ENM a mis en ligne, sur son site intranet un e-learning accessible en permanence aux magistrats et greffiers. Cet outil a été transmis aux médecins, directeurs d’hôpitaux et cadres de santé en lien avec l’ENM ainsi qu’à l’AP-HP.
117 () D’après les données fournies par la Chancellerie, au-delà de la formation continue au niveau national, la formation continue déconcentrée a permis la formation de 13 magistrats au sein de la cour d’appel de Bordeaux, de 19 magistrats au sein de la cour d’appel de Rennes et de 14 magistrats au sein de la cour d’appel de Versailles.
118 () Cass. 1ère civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849.
119 () Lors de son audition, M. André Bitton s’est étonné de ces statistiques, car, selon lui, des mainlevées sont ordonnées dans au moins un quart des cas pour des motifs tenant au fond, et plus précisément à l’absence de nécessité de la mesure d’hospitalisation complète.
120 () Circulaire du 21 juillet 2011 relative à la présentation des principales dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
121 () Dans le rapport d’activité pour l’année 2015 de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan, note que « dans tous les établissements visités, le parquet s’abstient de venir à l’audience et se contente de réquisitions écrites » (p. 15). Ce semble être le cas à Paris, d’après la contribution écrite de Me Letizia Monnet-Placidi.
122 () Cet article prévoit notamment que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État ».
123 () Me Laetitia Joffrin, membre du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Meaux en charge de la commission pénale, a indiqué qu’à l’hôpital de Meaux 75 % à 80 % des patients étaient trop sédatés pour pouvoir assister à l’audience que le JLD tient au douzième jour suivant leur admission, dans le cadre de son contrôle obligatoire. Cette proportion serait en revanche bien inférieure si l’on en croit M. Jean-Paul Novella, vice-président du TGI de Meaux, qui a estimé à 20 % le nombre de patients non-présentés à l’audience.
124 () M. Primevert, « Les soins psychiatriques sans consentement : nouvelle réforme », JCP G n° 42, 14 octobre 2013, 1065 : « le délai retenu pour que le juge statue ne doit dépendre d’aucune autre considération que l’intérêt de la personne malade ; le délai de 12 jours est en tous cas la durée minimale nécessaire à la stabilisation de l’état du malade, et permettant par conséquent au juge d’exercer un tel contrôle sur la poursuite de la mesure ».
125 () Considérant n° 25.
126 () Lors de sa visite à l’IPPP, il a été expliqué à la mission que de telles mesures de réadmission ne pouvaient être prises à l’initiative des préfets puisqu’en l’absence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, ces derniers ne peuvent pas s’auto-saisir pour demander une nouvelle admission des patients. En cas de mainlevée, la préfecture de police de Paris :
– soit s’assure de la mise en place d’un programme de soins si le JLD a décidé que la mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un tel programme puisse être établi ;
– soit interjette un appel (suspensif ou non, selon que l’établissement d’accueil estime que l’hospitalisation complète est, ou non, impérativement nécessaire) ;
– soit attend un événement justifiant une nouvelle mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État (nouveau trouble à l’ordre public, rupture de traitement signalée par un médecin suivant la personne concernée, etc.).
127 () Article L. 3211-12-2, I, alinéa 3, du code de la santé publique.
128 () Idem.
129 () La direction des services judiciaires (DSJ) du ministère de la justice ne dispose pas du nombre exact de conventions signées entre TGI et ARS mais compte engager un travail de recensement de ces conventions.
130 () Selon Mme Marie-Christine Leprince, présidente du TGI de Caen et membre du bureau de la conférence nationale des présidents de TGI, la création de ce type de salles serait plus aisée dans les établissements de grande taille que dans ceux dont les dimensions sont plus modestes.
131 () À Paris, les audiences ont lieu, depuis le 21 septembre 2015, dans la salle mutualisée aménagée sur l’emprise de l’hôpital Sainte-Anne, pour les patients accueillis dans cet établissement ainsi que dans les établissements de Maison Blanche et du Perray Vaucluse.
132 () D’après Mme Corinne Vaillant, avocate et présidente de l’association « Avocats, droits et psychiatrie », dans certains établissements, les patients déclarés « non-auditionnables » ne recevraient même pas de convocation à l’audience du JLD. En outre, toujours selon la même source, certains patients « refuseraient de venir » à l’audience sans que leur avocat ait les moyens de contrôler la réalité et les motifs de ce refus autrement que par le biais d’un manuscrit ni daté ni signé ou d’un certificat établi par un psychiatre.
133 () Circulaire DGOS/R4 n° 2011-312 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
134 () D’après les indications fournies à la mission, le cahier des charges immobilier relatif aux salles d’audience aménagées sur l’emprise des établissements d’accueil prévoit notamment que ces salles devront comporter « une salle des délibérés de 12 m² », « un box avocat/client de 6 m² », une barre et une estrade (« table de justice ») de 17,4 centimètres de haut.
135 () S’agissant de Coutances, il semblerait que les difficultés soient en voie de résolution. Concernant la situation de Cahors, au sujet de laquelle la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan, a interpellé le garde des Sceaux à l’automne dernier, il semblerait, d’après les services du ministère de la justice, qu’il n’y ait, pour l’heure, pas de remontée d’information sur la persistance de difficultés.
136 () Constatant elle aussi que la présence des avocats n’est pas toujours effective, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan, note, dans son rapport d’activité pour l’année 2015, que « le bâtonnier estime quelquefois, dans un établissement éloigné du tribunal, qu’il “ne peut pas imposer à un confrère de consacrer une demi-journée à un tel déplacement avec de telles conditions de rémunération” » (p. 13).
137 () Les services du ministère de la justice ont précisé qu’un guide sur les conditions de tenue de l’audience avait été élaboré et diffusé. Voir également la circulaire du 18 août 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n° 2014-897du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
138 () Il a toutefois été signalé aux rapporteurs qu’à Tarascon, les audiences en visioconférence étaient encore pratiquées il y a quelques mois, au mépris de la loi. Par ailleurs, la mission a pu constater lors de son déplacement à Meaux qu’un certain nombre d’acteurs (psychiatres et magistrats) regrettaient la suppression de la visio-conférence qui, de leur point de vue, évitait des déplacements à tout le monde, à commencer par les patients, et favorisait par conséquent la présentation de ces derniers à l’audience.
Pour leur part, les rapporteurs estiment que l’audience en présence physique du patient, du JLD et de l’avocat permet un contact humain absolument essentiel à la bonne exécution de l’office du juge. C’est aussi le point de vue de Me Laetitia Joffrin, avocate au barreau de Meaux, qui a expliqué que la visioconférence avait le double inconvénient de priver l’avocat :
– de la certitude que son entretien avec son client était bien confidentiel ;
– de l’occasion de rencontrer les proches de son client afin de mieux connaître son environnement.
139 () Article L. 3211-12-2, I, du code de la santé publique : « le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ».
140 () Contribution écrite fournie à la mission.
141 () S’agissant des proches des patients, leur absence à l’audience, alors même qu’ils sont parfois à l’origine de la demande d’admission, peut en partie s’expliquer par l’extrême brièveté des délais dont dispose le greffe pour convoquer les tiers à l’audience du JLD, selon Mme Joëlle Munier, présidente du TGI d’Albi et vice-présidente de la conférence nationale des présidents de TGI. Quoi qu’il en soit, leur absence prive le juge d’informations familiales et sociales qui pourraient être très utiles à sa décision.
142 () Au vu de son expérience, M. Benjamin Blanchet, magistrat, chargé de mission de l’Union syndicale des magistrats (USM), a ajouté qu’il était très rare de voir un directeur d’établissement de santé ou un psychiatre assister aux audiences du JLD et qu’il arrivait même parfois que l’audience ait lieu en l’absence de tout personnel soignant pour encadrer les patients. Selon lui, la mise en œuvre de la loi du 27 septembre 2013 ne peut être de bonne qualité que dans les établissements où existe une bonne adhésion du corps médical.
143 () S’agissant des représentants des préfectures, c’est aussi le sentiment du représentant de la conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH), M. Jean Pierre Staebler, qui a déclaré qu’il arrivait parfois que le JLD enjoigne au préfet de désigner un agent de l’ARS pour défendre une mesure d’admission en soins psychiatriques prise sur sa décision.
S’agissant plus précisément de la préfecture de police de Paris, il a été indiqué à la mission, lors de son déplacement à l’IPPP, que celle-ci se faisait presque systématiquement représenter, par trois cabinets d’avocats avec lesquels elle a conclu des marchés, en cas de contrôle facultatif à la demande du patient et en cas d’appel de la décision rendue par le JLD dans le cadre du contrôle obligatoire.
144 () CGLPL, Rapport d’activité 2015, p. 16.
145 () M. Primevert, « Les soins psychiatriques sans consentement : nouvelle réforme », JCP G n° 42, 14 octobre 2013, 1065.
146 () Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement autorisé en psychiatrie chargé d’assurer les soins psychiatriques sans consentement, s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées sur décision du représentant de l’État.
147 () Cet article dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ».
148 () Décrets n° 2011-846 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et n° 2011-847 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
149 () Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’ARS de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.
150 () Après avoir été le cas au TGI de Paris, il semblerait que, d’après M. Thierry Fusina, vice-président de ce TGI, que ce ne le soit plus : compte tenu des débats sur la légalité de la circulaire du 21 juillet 2011, il aurait été demandé au greffe de ne plus transmettre le bulletin n° 1 du casier judiciaire, d’autant que, dans le cadre du contrôle renforcé des demandes de mainlevée, la préfecture de police de Paris fournit au JLD des dossiers volumineux.
151 () Circulaire du 22 mai 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables.
152 () À cet égard, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan, a relevé, dans son rapport d’activité pour l’année 2015, que « des questions telles que le maintien des liens familiaux, le port obligatoire du pyjama, la définition des espaces ouverts et fermés, la sexualité, l’accès au téléphone ou l’informatique ou la gestion des dépenses personnelles, semblent faire l’objet de disparités qui ne sont pas toujours liées aux exigences des traitements médicaux », que « cette diversité peut être observée d’un établissement à l’autre, d’un service à l’autre, voire parfois d’un étage à l’autre », et que « ces différences portent sur l’exercice des libertés individuelles, [de sorte que] l’hétérogénéité observée pose une véritable question d’égalité de traitement » (pp. 7-8). Ces différences de traitement seraient telles que, d’après Mme Adeline Hazan, certains patients donneraient une fausse adresse (voire déménageraient) pour être suivis dans tel établissement plutôt que dans tel autre, par tel médecin plutôt que par tel autre.
Mme Adeline Hazan s’est par ailleurs déclarée frappée par le caractère systématique de certaines mesures qui, comme le port du pyjama, devraient rester des exceptions : dans certaines unités, le port du pyjama est imposé à tous les patients, sans distinction, pour des motifs divers et pas toujours pertinents (facilité de localisation dans les espaces ouverts, etc.).
153 () Lors de sa visite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), il a été expliqué à la mission que, dans cette infirmerie, les patients revêtaient systématiquement un pyjama à leur arrivée, à la fois par souci de sécurité (pour vérifier s’ils ne détiennent pas d’objet dangereux) et par souci de santé (leur mise à nu pouvant permettre de diagnostiquer des lésions, ecchymoses ou dermatoses).
154 () Lors de son déplacement à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), la mission a pu constater qu’un registre des mesures d’isolement et de contention y avait été mis en place, même si cette infirmerie n’est pas un établissement de santé autorisé en psychiatrie au sens de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique. Ce registre précise le nom du médecin prescripteur, les motifs et les modalités de la mesure (durée, évaluation régulière de l’état du patient, traitement associé – étant précisé que, d’après le Dr. Éric Mairesse, médecin-chef de l’IPPP, seuls 10 % des traitements administrés dans cette infirmerie sont parentéraux).
La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Mme Adeline Hazan, a précisé qu’à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris, le registre des mesures d’isolement et de contention n’était pas tenu lors du dernier contrôle qu’elle y a effectué : hormis le service chargé de la sécurité en cas d’incendie, aucun service n’était en mesure d’indiquer combien de personnes faisaient l’objet de telles mesures le jour du contrôle.
Mme Adeline Hazan a déploré en conséquence qu’aucune instance d’évaluation nationale du recours aux mesures d’isolement et de contention n’ait été mise en place pour identifier la diversité des pratiques d’un secteur géographique à l’autre.
155 () Cet article prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
156 () Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale, principe n° 11, § 10.
157 () Ce rapport est consultable au lien suivant : http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2012/11/Rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-Meaux-Seine-et-Marne.pdf
158 () Circulaire n° 48 DGS/SP3 du 19 juillet 1993.
159 () N. Giloux, « Du quartier de sécurité à la chambre d’apaisement… » in Consentement et contrainte dans les soins en psychiatrie, dir. J.-C. Pascal et C. Hanon, éd. Doin, 2014.
160 () Les rapporteurs précisent à cet égard que, d’après le Dr Christian Muller, président de la conférence nationale des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers spécialisés (CME-CHS), les recommandations de bonnes pratiques en cours d’élaboration par la HAS préconiseraient expressément qu’aucune différence de traitement ne doit être établie entre les patients au regard des mesures d’isolement et de contention, qu’ils soient, ou non, des détenus.
161 () CGLPL, Rapport d’activité 2015, pp. 3 et 15. Mme Adeline Hazan ajoute « que, trop souvent, l’enfermement entraîne une infantilisation et une déresponsabilisation des patients, que les préoccupations de sécurité infiltrent les pratiques psychiatriques, que la crainte des fugues ou le sous-effectif des soignants conduisent à priver les patients de l’attention ou des marges de liberté qui devraient leur être accordées ».
162 () Cass. 1re civ. 11 mai 2016, pourvoi n° 15.16-233.
163 () Cet article prévoit que « la régularité des décisions administratives prises [en matière d’admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en cas de péril imminent, sur décision du représentant de l’État ou lorsque les atteintes de troubles mentaux sont détenues] ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ».
164 () P. Hennion-Jacquet, « L’unification du contentieux en matière de soins non consentis face à la tradition de la dualité juridictionnelle : le JLD commet un excès de pouvoir en annulant une décision administrative relative aux soins forcés », Revue de droit sanitaire et social, 2016, p. 738.
165 () Idem.
166 () Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi du seul hôpital psychiatrique exécutant de la mesure d’hospitalisation décidée par le représentant de l’État, et non d’un pourvoi de ce dernier, qui est pourtant le « donneur d’ordre » de la mesure.
167 () CGLPL, Rapport d’activités 2014, p. 38 : « la question de l’opportunité de l’élargissement de la compétence du CGLPL au contrôle des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n’a pas fait l’objet d’une suite positive ».
168 () Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
© Assemblée nationale