N° 2738
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 avril 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE relative à la dette souveraine des États de la zone euro (n° 2723),
PAR M. Nicolas SANSU,
Député.
——
Voir les numéros : 2689 et 2723.
___
Pages
A. LA DETTE : UN SYSTÈME DE DOMINATION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE 7
1. La dette : une question morale et politique 7
2. Les origines de la dette contemporaine en France 9
a. Le résultat d’une politique fiscale inefficace en faveur des plus aisés 10
b. Après l’inflation, l’effet « boule de neige » 15
c. La socialisation d’une crise de la dette privée 17
3. Un outil de pression sur les choix politiques et sociaux 18
a. Une justification facile pour toutes les réformes antisociales 18
b. Mais de quelles générations futures parle-t-on ? 18
c. Dette brute, dette nette, actifs nets 19
B. L’URGENCE : EXTRAIRE PROGRESSIVEMENT LA FRANCE DE LA TUTELLE DES MARCHÉS FINANCIERS 20
1. Les raisons du recours aux marchés financiers 20
a. Un recours aux marchés financiers pour lutter contre l’inflation 20
b. Des conditions de financement aujourd’hui très favorables 21
c. Bientôt une nouvelle crise financière ? 23
2. Une gestion opaque de la dette 24
a. Les créanciers de la France protégés par un secret légal 24
b. Une part importante de non-résidents parmi les créanciers qui singularise la France 24
c. Vers un cadastre de la dette ? 25
3. Imaginer enfin des alternatives 25
a. Se séparer du stock de dette publique : un moratoire ou une taxe exceptionnelle 25
b. Financer les déficits autrement 26
c. Construire un pôle public bancaire de grande ampleur 26
d. La création d’un circuit du Trésor européen 28
II. LIBÉRER LES PEUPLES EUROPÉENS DU JOUG DE LA DETTE 28
A. SORTIR DU DIKTAT DE LA DETTE POUR PRÉSERVER LES DROITS FONDAMENTAUX 28
1. Cesser de faire de la dette un instrument de chantage et d’asservissement des peuples européens 29
a. Les règles européennes relatives à la maîtrise de la dette et du déficit publics sont dénuées de fondement économique 29
b. Elles conduisent à mener des politiques d’austérité au bilan économique, social et politique dramatique 31
2. Organiser une « opération vérité » sur la dette afin de permettre aux peuples européens d’exercer un véritable contrôle sur la dette et de se réapproprier le débat économique 36
a. Soutenir la Commission grecque de vérité sur la dette publique 36
b. Instaurer une conférence européenne sur la dette 38
B. DONNER UN NOUVEL ÉLAN À L’ÉCONOMIE ET À LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNES 40
1. Définir une autre politique budgétaire, au service de la croissance et de la réduction des inégalités 41
a. De nouvelles ressources fiscales 43
b. Lutter de manière efficace contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux 44
c. Un Fonds d’investissement européen solidaire, social et écologique 45
2. Mettre la politique monétaire au service de l’économie réelle 46
a. La politique d’assouplissement quantitatif, un outil efficace ? 46
b. Dans quelle mesure l’action de la BCE est-elle légitime ? 48
C. LIBÉRER LES ÉTATS EUROPÉENS DE LA TUTELLE DES MARCHÉS FINANCIERS 49
1. Le secteur bancaire 49
a. La réforme inachevée du secteur bancaire classique 49
b. L’inquiétante absence de régulation du système bancaire parallèle 54
2. Instaurer une taxe européenne ambitieuse sur les transactions financières 57
EXAMEN EN COMMISSION 61
TABLEAU COMPARATIF 73
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 77
ANNEXE 2 : DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE DU PARLEMENT GREC, ZOÉ KONSTANTOPOULOU, À LA SESSION INAUGURALE DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ DE LA DETTE PUBLIQUE, 5 AVRIL 2015 79
S’il y avait une expression qui exprime le sentiment de fatalité dans la mise en œuvre de politiques publiques récessives depuis trop d’années, ce serait « au nom de la dette ».
Au nom de la dette, trop de promesses de campagne de 2012 ont été abandonnées.
Au nom de la dette, les collectivités locales, les hôpitaux, l’État sont appelés à faire des efforts de diminution de dépenses qui, à terme, sont inefficaces et injustes tant en matière d’activité que de créations d’emplois.
Au nom de la dette, on étrangle des peuples en Europe, à commencer par nos amis grecs qui ont le courage d’ouvrir un chemin différent de celui qui a échoué.
En fait, la dette et le fameux chiffre fétiche des 2 000 milliards d’euros (atteint en septembre 2014 pour notre pays) sont de formidables justificatifs des politiques orthodoxes mises en œuvre – les dernières pour la France s’appuyant sur la politique exclusive de l’offre avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et les baisses de prélèvements sur les entreprises sans ciblage, ni conditionnalité.
Pour des pays où la crise a été plus violente, avec des droits humains bafoués – comme en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Irlande – ce sont des ajustements dramatiques qui ont été imposés par la « troïka », représentants d’une oligarchie financière garante des dogmes libéraux.
À bien y regarder, sur la période contemporaine de l’après-guerre, le triomphe idéologique du néo-libéralisme (le fameux TINA – « There Is No Alternative » – de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan) a coïncidé avec un double phénomène : l’accroissement considérable des dettes privées et publiques et un accroissement tout aussi considérable des inégalités. Les trente dernières années, ce sont les Trente Glorieuses des 1 % les plus riches !
S’interroger sur la dette, c’est donc remettre en cause les fondements et les remèdes à cette dette, c’est remettre en cause l’acception selon laquelle la seule origine de la dette viendrait d’un surcroît de dépenses, c’est refuser la culpabilisation permanente orchestrée par une petite caste qui, elle, profite de la crise. Faut-il rappeler les travaux de M. Thomas Piketty ou tout simplement les chiffres des 500 plus grosses fortunes françaises qui ont progressé de près de 20 % en 2014 ?
Devant une telle chape de plomb imposée par la dette – une chape de plomb entretenue et relayée – devant une telle dramatisation, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine, dont font partie les députés du Front de Gauche, ont souhaité déposer une proposition de résolution européenne pour qu’un débat contradictoire puisse se tenir et que des solutions alternatives soient étudiées.
Cette proposition de résolution décline six grands axes :
– la tenue d’une grande conférence européenne sur la dette, qui s’appuie également sur la volonté exprimée par la Grèce et son Parlement ;
– la transparence sur les détenteurs finaux des titres de dette ;
– la nécessité de mettre en place des outils de financement de la dette en dehors des marchés financiers ;
– la nécessité d’une véritable séparation bancaire et d’une véritable taxe sur les transactions financières pour « désintoxiquer » notre économie d’une spéculation dangereuse et se doter d’outils de régulation du secteur financier opérants ;
– l’urgence d’un débat sur les conséquences de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), dans le cadre de la modification de sa doctrine et son nécessaire contrôle politique ;
– l’exigence de l’arrêt des politiques récessives et d’austérité qui ont conduit à un double échec : inégalités en hausse et dette explosive.
La conviction du Rapporteur est que la question de la dette ne saurait être comprise et abordée uniquement par le prisme économique, c’est une question éminemment politique et s’il est légitime de s’astreindre à une gestion rigoureuse des finances publiques, il est illégitime de laisser accroire qu’il n’y aurait qu’une seule politique possible.
Sortir du piège de la dette, par des propositions innovantes, par une architecture fiscale plus juste et efficace, par une politique monétaire et une politique budgétaire au service de l’économie réelle, telles sont les propositions que le Rapporteur souhaite aborder et esquisser.
Depuis l’été 2011, l’appel national « Pour un audit citoyen de la dette publique », rassemblant vingt-neuf associations, organisations non gouvernementales (ONG) et syndicats, et bénéficiant du soutien de diverses formations politiques, a été signé par près de soixante mille personnes. Plus de cent vingt comités d’audit citoyen (CAC) se proposant de « remplacer les agences de notation » ont été créés depuis l’automne 2011. L’un des animateurs de cette campagne, le philosophe Patrick Viveret, propose de se « désidérer » de la dette publique : « La sidération a ceci de caractéristique que même les victimes pensent qu’il n’est pas possible de faire autrement. La sidération, c’est, sur le plan économique, ce qu’on pourrait appeler la pensée TINA [“There is no alternative”] de Margaret Thatcher : un état où l’on dit juste “Oui, c’est catastrophique” et “Non, on ne peut pas faire autrement” » (1). La sidération, selon Patrick Viveret, est un blocage de l’imagination. La débloquer permet d’agir.
Interroger les origines et la nature de la dette permet de comprendre qu’elle forme un système : un système de domination politique et économique aujourd’hui mobilisé pour faire pression sur les choix politiques et sociaux des nations.
La dette a toujours existé. Elle est même à l’origine des sociétés. Si l’échange égal et le troc sont à l’origine du commerce – qui suppose l’égalité et l’indépendance des parties –, c’est l’emprunt qui est à l’origine des relations sociales.
Le sociologue français Marcel Mauss, le premier, a su montrer à travers l’exemple de plusieurs sociétés d’Amérique du Nord ou du Pacifique que les sociétés archaïques avaient une économie sociale basée sur le don et le contre-don, tout don devant être rendu par un don de valeur supérieure et ainsi de suite. C’est le phénomène du potlatch sur la côte ouest de l’Amérique du Nord ou de la kula dans les îles Trobriand de l’océan Pacifique (2). On ne s’échange pas que des biens matériels, on s’échange aussi « des politesses, des festins, des rites, des services militaires, des femmes, des enfants, des danses, des fêtes ». Ce faisant, Marcel Mauss déconstruit les fondements de l’idéologie libérale présentant l’échange (le commerce, la monnaie) comme les fondements des sociétés.
L’anthropologue David Graeber, auteur d’un best-seller intitulé Dette : 5 000 ans d’histoire évoque aussi les Tiv d’Afrique de l’Ouest qui s’offrent de petits présents en prenant garde à ne jamais répondre à un don par un objet de valeur équivalente, ce qui reviendrait à rompre le lien. Ces dettes, selon David Graeber, sont les seules formes de rapports humains suivis : « Si nous tenons à définir toute interaction humaine comme l’échange d’une chose contre une autre, les rapports humains suivis ne peuvent prendre qu’une seule forme : les dettes. Sans elles, nul ne devrait rien à personne. Un monde sans dettes retomberait dans le chaos primordial, dans la guerre de tous contre tous [...]. Chacun de nous deviendrait une planète isolée. » (3)
Être redevable envers quelqu’un (du fait d’un prêt ou d’une invitation) est donc une forme de relation sociale pérenne. Elle vous oblige, ainsi que vos proches, créant des liens entre les individus dans le temps. Elle est la mémoire de la solidarité passée et l’origine de la solidarité future. Elle suppose la confiance.
David Graeber montre ensuite combien la perversion de la notion de dette est intrinsèquement liée à la guerre et la violence. L’Empire romain aurait eu besoin de matérialiser les salaires des soldats en campagne et d’imposer la monnaie ainsi créée aux populations conquises pour le bon fonctionnement de l’armée. « Qu’est-ce qu’une dette, en fin de compte ? Une dette est la perversion d’une promesse. C’est une promesse doublement corrompue par les mathématiques et la violence. » (4) Et de rappeler que les pays conquis devaient verser un « tribut » à la puissance impérialiste. Historiquement, les marchés et la monnaie sont donc nés de la guerre et de la violence, non de l’échange paisible entre voisins.
Pourquoi l’idée qu’une dette doit être intégralement remboursée est-elle si profondément ancrée dans notre esprit aujourd’hui ? Dans nos sociétés contemporaines, la force morale de la dette repose à la fois sur la liberté et l’égalité postulée des individus ou des États. Dans la philosophie libérale, la dette doit être remboursée parce qu’elle a été librement consentie par des débiteurs égaux en droit à leurs créanciers. C’est oublier que beaucoup de dettes sont en réalité contraintes et que les débiteurs sont loin d’avoir la même information et de supporter les mêmes risques que leurs créanciers, qui ne sont pas dans le besoin.
L’effacement des dettes a existé dès l’Antiquité pour des raisons politiques et sociales. Il compense des processus d’appauvrissement et d’aliénation récurrents : il suffisait de malchance, de maladies, de mauvaises récoltes, pour que facilement un petit propriétaire rural doive se transformer en fermier, pour qu’il aliène un champ pour payer ses dettes, pour qu’il en vienne même à aliéner dans l’esclavage ses enfants ou sa propre personne, pour éteindre ses dettes. Dans la Mésopotamie antique, les rois babyloniens effaçaient l’ardoise des créditeurs. Des siècles plus tard, la loi biblique du Jubilé disposait que toutes les dettes seraient automatiquement annulées tous les sept ans.
Il existe donc une dette injuste : celle qui est exigée au prix de la liberté ou de la vie humaine, celle qui prive des moyens de subsistance, celle qui repose sur une égalité théorique ignorante de la réalité sociale. C’est pourquoi elle est le ferment des révolutions.
Notre pays n’a pas été exempté de ces soubresauts ou de changements politiques d’ampleur qui ont entraîné des restructurations, annulations de dette, volontaires ou subies. L’existence de ces moments d’Histoire permet de dédramatiser la réalité de la dette et de s’extraire d’une vision court-termiste (5).
Depuis 1980, la dette publique française est passée d’un peu moins de 20 % du PIB à 64,2 % en 2007.
ÉVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE DEPUIS 1980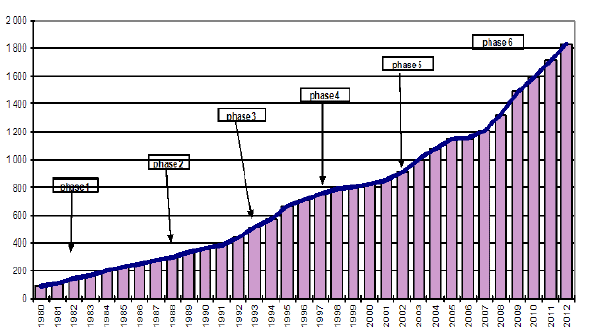
Source : Insee, comptes nationaux, base 2005, dette publique brute au sens de Maastricht in Rapport spécial n° 251 annexe 25 relatif aux engagements financiers de l’État présenté par M. Dominique Lefebvre, 10 octobre 2012
Comme le montre le graphique ci-dessus, on peut distinguer six grandes phases d’évolution de la dette publique depuis trente ans en France :
– de 1981 à 1987, la dette a progressé à un rythme de 1,8 point de PIB par an en moyenne, sous l’effet d’une augmentation sensible des dépenses publiques dans le cadre des plans de relance keynésiens conduits par la gauche ;
– de 1987 à 1991, la progression de l’endettement public a ralenti (+ 0,9 point de PIB par an en moyenne), à la faveur notamment d’une croissance économique soutenue ;
– entre 1992 et 1996, la troisième phase d’augmentation de la dette a été particulièrement marquée (+ 4,4 points de PIB par an en moyenne) : après deux années de ralentissement de la croissance, la récession de 1993 a porté le déficit public à 6,4 % du PIB ;
– de 1997 à 2001, grâce aux efforts d’assainissement budgétaire et à une forte croissance économique, le taux d’endettement public s’est stabilisé en deçà de la limite « maastrichtienne » de 60 % du PIB et s’est même infléchi en fin de période (– 0,2 point de PIB en moyenne par an). Les années 1999 à 2001 connaissent ainsi une diminution de l’endettement, passé de 59,5 % en 1997 à 57,1 % en 2001 ;
– entre 2002 et 2007, la cinquième phase d’évolution voit la dette publique repartir à la hausse de 1,2 point de PIB en moyenne chaque année sous l’effet d’une politique d’allégement des impôts non justifiée en raison du ralentissement de la croissance. Au demeurant, cette progression moyenne de la dette publique apparemment modérée est trompeuse. Elle intègre en effet la spectaculaire baisse de l’endettement public obtenue en 2006 (– 2,7 points de PIB) par des moyens en grande partie étrangers à l’amélioration de la situation des finances publiques ;
– depuis 2007, la sixième phase d’évolution est celle d’une augmentation sans précédent de la dette publique, pour atteindre 95 % en 2015. Entre 2007 et 2012, la dette a progressé de 25,7 points de PIB et de 600 milliards d’euros en valeur, passant de 64,2 % du PIB à 89,9 % du PIB.
La dette publique française ne résulte donc pas uniquement, loin s’en faut, de la crise financière de 2008. Elle est aussi le résultat de l’emballement de la charge de la dette du fait d’un financement de l’État à des taux supérieurs à ceux de la croissance et d’une politique de « cadeaux » fiscaux menée en continu depuis les années 2000.
Le 30 juin 2010, le Rapporteur général de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, aujourd’hui président de la Commission, présentait un rapport à l’occasion du débat d’orientation des finances publiques. La première partie de ce rapport était consacrée aux politiques fiscales conduites en France, depuis 2000, à l’appui d’une politique dite « de l’offre ». Il s’agissait, en effet, de réduire les prélèvements obligatoires portant sur les détenteurs de capital en espérant ainsi dynamiser l’activité.
Entre 100 et 120 milliards d’euros de recettes fiscales ont ainsi été perdues pour le budget général de l’État entre 2000 et 2010. Cette politique de « cadeaux » fiscaux s’est révélée être un échec à deux titres : d’une part, les pertes de recettes n’ont pas été compensées par des baisses de dépenses, entraînant des déficits croissants ; d’autre part, les baisses d’impôts consenties ont bénéficié aux ménages les plus aisés avec une efficacité plus que douteuse sur la croissance.
DIX ANS DE RECETTES FISCALES NETTES
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Recettes fiscales nettes |
243,5 |
248,3 |
243,8 |
269,9 |
276,9 |
272,9 |
272,3 |
265,1 |
230,7 | |
Évolution annuelle en % |
|
2,0 |
1,8 |
– 0,1 |
10,8 |
2,6 |
– 1,5 |
– 0,2 |
– 2,6 |
– 13 |
Évolution spontanée en % |
|
7,5 |
– 0,2 |
0,1 |
6,7 |
4,4 |
8,8 |
6,0 |
2,8 |
– 9,6 |
Coût cumulé des mesures nouvelles depuis 2000 | ||||||||||
Fourchette haute |
– 7,9 |
– 20,4 |
– 25,9 |
– 31,8 |
– 36,2 |
– 40,0 |
– 50,5 |
– 65,6 |
– 77,8 |
– 77,7 |
Fourchette basse |
– 7,9 |
– 19,8 |
– 25,2 |
– 30,2 |
– 32,5 |
– 33,9 |
– 41,6 |
– 53,5 |
– 61,7 |
– 68,3 |
Coût cumulé des mesures de périmètre depuis 2000 | ||||||||||
Fourchette haute |
– 1,7 |
– 7,8 |
– 12,7 |
– 15,8 |
– 17,9 |
– 22,0 |
– 25,6 |
– 34,6 |
– 38,2 |
– 41,6 |
Fourchette basse |
– 1,7 |
– 7,6 |
– 12,4 |
– 14,1 |
– 15,9 |
– 18,2 |
– 20,4 |
– 27,8 |
– 29,3 |
– 32,9 |
Source : rapport d’information préalable au débat d’orientation sur les finances publiques n° 2689, 30 juin 2010.
IMPACT DES BAISSES D’IMPÔTS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL DE L’ÉTAT
(en pourcentage de PIB)
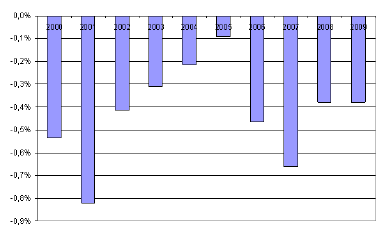
Source : rapport d’information préalable au débat d’orientation sur les finances publiques n° 2689, 30 juin 2010.
D’après le rapport de M. Gilles Carrez, les baisses d’impôts sur le revenu représentaient environ la moitié des diminutions d’impôts d’État entre 2000 et 2009 et leur impact sur le budget général de l’État en 2009 serait compris entre 33 et 41,5 milliards d’euros – entre 1,7 et 2,2 % de PIB.
DIX ANS D’IMPÔT SUR LE REVENU
(en milliards d’euros)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Impôt net sur le revenu |
50,6 |
49,8 |
46,3 |
50,0 |
49,9 |
52,5 |
53,8 |
50,0 |
51,7 |
47,7 |
Évolution annuelle en % |
|
-1,6 |
-7,0 |
8,1 |
-0,2 |
5,3 |
2,3 |
-6,9 |
3,4 |
-7,7 |
Coût cumulé des mesures nouvelles depuis 2000 | ||||||||||
Fourchette haute |
-1,7 |
-7,8 |
-12,7 |
-15,8 |
-17,9 |
-22,0 |
-25,6 |
-34,6 |
-38,2 |
-41,6 |
Fourchette basse |
-1,7 |
-7,6 |
-12,4 |
-14,1 |
-15,9 |
-18,2 |
-20,4 |
-27,8 |
-29,3 |
-32,9 |
Source : rapport d’information préalable au débat d’orientation sur les finances publiques n° 2689, 30 juin 2010.
Comment qualifier ces baisses d’impôts ? Pour l’essentiel, il s’agit de diminuer l’imposition des plus hauts revenus pour les inciter à investir dans la pierre, dans des éoliennes outre-mer, ou à consommer davantage de services.
PRINCIPALES MESURES NOUVELLES PORTANT SUR L’IMPÔT SUR LE REVENU
(en milliards d’euros)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
TOTAL |
-1,7 |
-6 |
-4,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-2,4 |
-2,2 |
-7,4 |
-1,4 |
-3,7 |
dont Réforme du barème |
-1,7 |
-3,2 |
-2 |
-3,6 |
-1,8 |
|
|
-4,4 |
|
|
LFR 2000 |
-1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LFI 2001 |
|
-3,2 |
-2 |
|
|
|
|
|
|
|
LFI 2003 |
|
|
|
-3,6 |
|
|
|
|
|
|
LFI 2004 |
|
|
|
|
-1,8 |
|
|
|
|
|
LFI 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
-4,4 |
|
|
dont Dépenses fiscales |
|
|
|
|
-0,2 |
-0,2 |
-1,3 |
-1,5 |
-0,9 |
-2,3 |
Aide à l’investissement outre-mer |
|
|
|
|
-0,2 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Robien |
|
|
|
|
-0,1 |
-0,1 |
|
|
-0,2 |
0,1 |
CI salariés à domicile |
|
|
|
|
|
|
-0,1 |
|
|
|
CI développement durable |
|
|
|
|
|
|
-1 |
-0,9 |
-0,2 |
-0,6 |
CI frais de garde |
|
|
|
|
|
|
-0,1 |
-0,5 |
|
|
CI intérêts d’emprunt |
|
|
|
|
|
|
|
|
-0,3 |
-0,8 |
Exo. heures supplémentaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
-0,2 |
-1 |
dont Prime pour l’emploi |
|
-2,4 |
|
-0,2 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,1 |
|
Source : rapport d’information préalable au débat d’orientation sur les finances publiques n° 2689, 30 juin 2010.
Ces « niches » fiscales se sont multipliées depuis 2000 avec une efficacité toute relative. Par exemple, les services à la personne (incluant le jardinage, les cours à domicile, les soins et promenade d’animaux à domicile, le soutien scolaire etc.) sont soutenus par une quinzaine de dispositifs pour un montant total de 6 milliards d’euros, selon la Cour des comptes. (6) Leurs effets sur l’emploi sont sans commune mesure avec le coût de cette politique d’exonération massive d’impôts et de cotisations sociales, comme le montre le graphique suivant.
ÉVOLUTION COMPARÉE DES AIDES PUBLIQUES ET DE L’EMPLOI
DANS LE SECTEUR DES SERVICES À LA PERSONNE
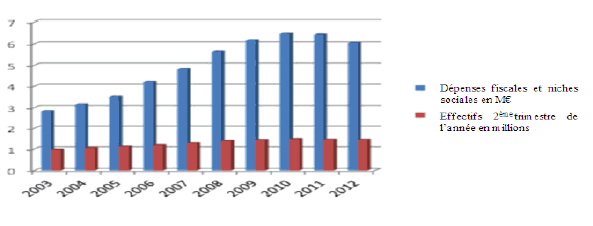 Source : Cour des comptes.
Source : Cour des comptes.
Comme le montre le graphique ci-après, ces dispositifs bénéficient au premier chef aux ménages aisés, du fait des relèvements successifs des plafonds de dépenses éligibles consentis en 1995, 2003 et 2005, qui n’auraient eu qu’un effet mineur sur l’emploi tout en ayant des effets fortement anti-redistributifs.
CONSOMMATION MOYENNE DES SERVICES À DOMICILE ET AVANTAGE FISCAL MOYEN À CE TITRE, POUR LES FOYERS CONSOMMATEURS SELON LE REVENU
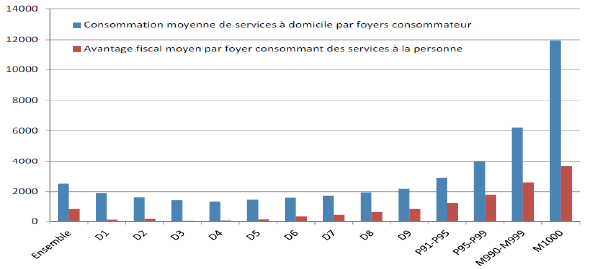 Source : Cour des comptes. Échantillon de 500 000 déclarations de revenu 2011 pour l’impôt 2012, calculs DG Trésor. Champ : Ensemble des foyers fiscaux, par unité de consommation.
Source : Cour des comptes. Échantillon de 500 000 déclarations de revenu 2011 pour l’impôt 2012, calculs DG Trésor. Champ : Ensemble des foyers fiscaux, par unité de consommation.
Une partie de la dette est donc le fruit de « cadeaux » fiscaux consentis aux plus riches et n’ayant jamais démontré leur efficacité.
Bien que des modifications de l’architecture fiscale aient eu lieu depuis juillet 2012, en accroissant la progressivité de l’impôt sur le revenu et en modérant l’effet des niches fiscales, la décennie 2000 pèse lourdement sur le stock de dette.
DÉPENSES ET RECETTES PUBLIQUES ENTRE 1993 ET 2013
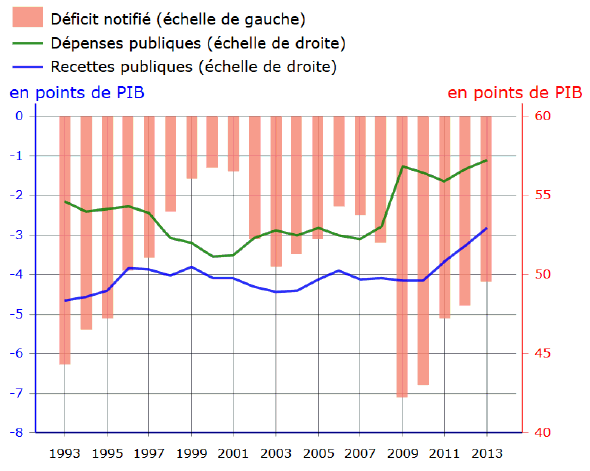
![]()
![]()
![]()
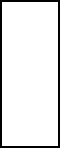
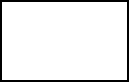 Source : Insee, comptes nationaux, base 2010.
Source : Insee, comptes nationaux, base 2010.
Une autre origine de la dette doit être recherchée dans une révolution silencieuse intervenue il y a quarante ans. Si la nécessité, pour un État, d’emprunter lorsque ses dépenses excèdent le niveau des prélèvements obligatoires est une évidence, le recours à des titres de dette négociables et soumis aux prix consentis à la puissance publique par les acteurs et organisations des marchés ne l’a pas toujours été.
Jusqu’à la fin des années 1970, l’État disposait de plusieurs moyens de financement. Lorsqu’il s’endettait, il le faisait principalement en collectant les ressources de son réseau d’épargnants (particuliers et établissements bancaires). Ces dépôts, dont l’État fixait lui-même les intérêts, assuraient à l’époque des ressources spontanées au Trésor. Ce circuit du Trésor a permis de financer la reconstruction du pays et de l’économie. À l’époque, la dette était « non négociable » et « administrée ».
À partir des années 1970, l’État a progressivement cessé de faire appel aux épargnants et aux dépôts du réseau bancaire pour se financer (cf. infra B). Il a émis des titres financiers négociés sur les marchés internationaux. Servi par un argumentaire aux ressorts techniques, en apparence, l’abandon d’une dette administrée pour une dette négociable sur les marchés a été justifié par la nécessité de lutter contre l’inflation, causée, selon les réformateurs libéraux, par un excès de création monétaire de la part de l’État. En devenant négociables, les bons du Trésor se sont trouvés soumis aux lois de l’offre et de la demande, avec des conséquences immédiates sur lesquelles n’ont pas manqué d’alerter les services de la direction du Trésor. Les notes et documents d’archives de l’époque, analysés par M. Benjamin Lemoine (7), révèlent qu’une nouvelle doctrine s’est imposée à cette époque, une doctrine selon laquelle il est sain que l’État apprenne à être un emprunteur comme un autre. Sans doute imaginait-on décourager l’endettement public…
En réalité, le coût de cet endettement sur les marchés s’est révélé particulièrement élevé entre 1980 et 1991. Ainsi, en 1992, la France s’endettait à 10,4 % pour un taux de croissance de 3,5 %. Cet effet s’est atténué par la suite. Il est néanmoins responsable de 15 points de PIB de hausse du ratio dette/PIB de 1992 à 2002. (8)
Aujourd’hui encore, l’État est en déficit de 31,4 milliards d’euros avant même de payer les intérêts de sa dette : ceux-ci sont donc financés par emprunt. Cela conduit à une progression autoentretenue de la dette de l’État, alimentée chaque année par la charge des intérêts. Dans la mesure où la croissance reste atone, il se produit un phénomène que le prix Nobel d’économie Trygve Haavelmo a appelé « l’effet boule de neige ».
LA CHARGE DE LA DETTE FRANÇAISE DEPUIS 2008
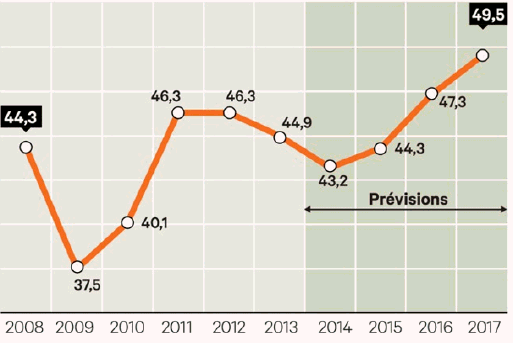
Source : Les Échos, 12 décembre 2014.
Au total, entre l’effet boule de neige et la politique fiscale favorable aux plus aisés, le rapporteur estime que 600 milliards d’euros de dette peuvent être définis comme une dette illégitime, soit 30 % du PIB !
Depuis 2007, la dette publique française a connu une augmentation sans précédent : de 64,2 % du PIB en 2007, elle a atteint 95 % du PIB en 2014.
ÉVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE AU SENS DE MAASTRICHT
ET DE LA DETTE PUBLIQUE NETTE
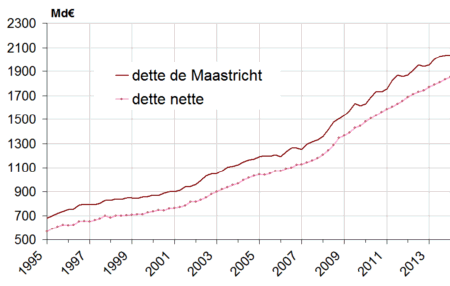
Source : Insee.
En 2007 et 2008, à la suite de l’explosion de plusieurs bulles, dont la bulle des prix de l’immobilier encouragée aux États-Unis par des taux d’intérêt très bas facilitant l’accès au crédit, et de la crise des « subprimes », les cours de bourse se sont effondrés, provoquant une réaction en chaîne dans plusieurs grands établissements bancaires. Pour éviter la propagation d’une crise systémique, les États sont intervenus massivement, s’endettant à leur tour.
Si les prêts consentis par l’État aux banques commerciales ont été, depuis, remboursés (9), la crise financière puis bancaire a entraîné une profonde récession et une hausse des taux d’intérêt sur les marchés, à l’origine d’une troisième crise : la crise des dettes souveraines. La panique des acteurs de marché a renforcé l’influence des agences de notation. Les titres publics des États les plus avancés faisaient jusqu’alors figure d’actifs non risqués. La perte de ce statut a, certes, pénalisé les États concernés mais aussi, incidemment, l’ensemble des établissements bancaires et les autres États qui détenaient des titres de dette souveraine ainsi décrédibilisés. C’est la quatrième crise : celle qui grève le bilan des banques et pénalise durablement l’économie réelle.
Ainsi, en criant haro sur la Grèce à l’instar des spéculateurs, les Européens se sont trouvés pris au piège de leur propre défiance, leurs banques et leurs Trésors étant largement exposés à la dette grecque.
Nul ne peut dire si cette liste est terminée. Pour sa part, le Rapporteur estime qu’elle pourrait bien être suivie d’une nouvelle crise (cf. infra).
Pour ne pas porter atteinte au « crédit » de l’État, dans tous les sens du terme, les décideurs publics veillent à rassurer les investisseurs soucieux d’éviter un « défaut souverain ». Ils subissent une pression des marchés financiers que les réformateurs libéraux accueillent avec satisfaction. M. François Chesnais citait ainsi un document du Fonds monétaire international de novembre 2010 qui estimait que « les pressions des marchés pourraient réussir là où les autres approches ont échoué (10) ».
La dette est en effet devenue un épouvantail idéologique agité par des réformateurs libéraux afin de réduire les dépenses publiques et le poids de l’État dans l’économie. En 2005, l’habileté du ministre des Finances, Thierry Breton, et de Michel Pébereau, président de la commission éponyme, a résidé dans leur capacité à produire une pédagogie dramatisante, et en apparence non partisane, de la dette. En juillet, un chiffrage alarmant fut communiqué mystérieusement aux médias laissant entendre que la dette pourrait être incommensurablement plus élevée qu’en apparence. La commission a en effet additionné à la dette financière contractée par l’État une dette « implicite » composée des engagements de l’État quant au paiement des retraites des fonctionnaires. Cette opération, qui outrepassait les conventions comptables de l’époque, a depuis été adoptée dans le système comptable européen (SEC10), accroissant encore le ratio de dette sur PIB.
En septembre 2014, l’Insee a fait état du franchissement du cap symbolique des 2 000 milliards de dette publique. Cet événement a donné lieu à de nombreux commentaires, où ont très souvent été convoquées les générations futures, victimes universelles de la dette.
En réalité, ces générations futures correspondent à un public pour le moins hétérogène. Les enfants des plus privilégiés n’hériteront pas, en effet, du fardeau du passif de l’État mais au contraire des rentes privées placées par leurs aïeux dans des obligations du Trésor. Les plus démunis pourront difficilement compter sur les dépenses sociales amputées par les politiques d’austérité.
Les plus aisés ont tout intérêt à ce que perdure la dette des États, qui offre un placement sûr à leur capital accumulé, en tout cas plus sûr que d’autres valeurs boursières, dès lors qu’elle est bien notée. On ne saurait rappeler sans ironie qu’une partie de cette dette s’est formée au profit de ces mêmes ménages les plus aisés.
La dette est donc bien un instrument de production et de reproduction des inégalités.
Quand nous sont livrés les chiffres de la dette, il n’est question que de dette brute, avec ce message culpabilisant de « la dette laissée à nos enfants ». Plus encore, il est parfois écrit que chaque enfant qui naîtrait serait tributaire de 30 800 euros de dettes dès sa naissance ! Ce raisonnement est pourtant d’une rare stupidité.
D’abord, parce que cette dette n’est nullement remboursable en une génération et que ce raisonnement fait abstraction de l’existence d’actifs qui se transmettent de génération en génération.
Si l’on considère que la dette brute s’établit à 2 000 milliards d’euros, mais que les actifs financiers de l’État s’élèvent à environ 900 milliards, la dette nette est de 1 100 milliards. Or, en 2009, une estimation des actifs non financiers (écoles, hôpitaux, routes…) s’élevait à 1 450 milliards d’euros, donc les actifs nets sont positifs !
En 2014, si chaque habitant se voit lesté d’une dette publique de 30 800 euros, il est allégé par les 37 000 euros d’actifs publics en moyenne qui lui sont attachés. Il convient de relativiser le poids de la dette et de se libérer de cette culpabilité que d’aucuns souhaiteraient faire peser pour imposer des politiques récessives.
Dans le même ordre d’idée, comment ne pas souligner que le ratio dette publique surproduit intérieur brut contrevient à toutes les règles de comptabilité en associant stock et flux…
Auteur d’une thèse intitulée Les valeurs de la dette. L’État à l’épreuve de la dette, M. Benjamin Lemoine rappelle qu’à l’époque de l’après-guerre, l’État avait recours à un « circuit du Trésor », système de financement permettant de reconstruire le pays en évitant le recours aux marchés (11). Jusqu’à la fin des années 1970, l’État s’appuyait sur les ressources de son réseau d’épargnants (particuliers et établissements bancaires). Ces dépôts, dont l’État fixait lui-même les intérêts, assuraient à l’époque des ressources spontanées au Trésor. Le taux élevé de faillites bancaires, expérimenté pendant l’entre-deux-guerres, et les conditions économiques d’après-guerre avaient en effet conduit les autorités à réglementer cette industrie. Les banques étaient alors spécialisées et classées en trois catégories : les banques de dépôts, les banques d’affaires et les banques de crédit à moyen et long terme. Cette spécialisation permettait aux autorités de contrôler les activités des établissements et de limiter les risques systémiques, c’est-à-dire les risques de défaillance en cascade des banques, reliées entre elles par des opérations interbancaires. Pour renforcer la tutelle de l’État, les pouvoirs publics ont nationalisé la Banque de France et les quatre grandes banques de dépôt en 1945. Leur objectif était d’orienter les financements de ces établissements conformément aux objectifs de la politique économique.
Peu à peu, l’objectif de croissance et de stabilité systémique s’effaça derrière la question de l’orthodoxie monétaire des financements du Trésor. À partir des années 1970, en effet, la lutte contre l’inflation est devenue l’objectif central des pouvoirs publics, notamment avec les premiers plans de stabilisation. Les instruments de trésorerie administrés ont alors été identifiés par la Banque de France, le Conseil national du crédit et les réformateurs libéraux du Trésor comme une des causes de l’inflation conçue, conformément à une version pratique de la théorie quantitative de la monnaie, comme s’expliquant par l’excès de création monétaire par l’État dans l’économie.
Les pouvoirs publics ont décidé d’assouplir le cadre réglementaire, d’une part, pour favoriser l’expansion des banques en réponse à la demande croissante de crédits des agents et d’autre part, influencer les stratégies bancaires au gré des orientations de la politique monétaire.
À partir de 1974, face aux déficits publics systématiques, l’administration des finances investit dans la conquête d’outils d’emprunt sur les marchés financiers sophistiqués, en privilégiant la dette à moyen et long terme (dette consolidée) par rapport à la dette contractée à l’égard du système bancaire (« dette flottante »). Le fait d’aller toujours plus loin dans la « mise en marché » de la dette publique était alors présenté comme une nécessité technique, d’après les notes et documents d’archives analysés par M. Lemoine.
Pour faire face à des besoins de financement croissants, liés pour partie à des politiques fiscales qui amenuisent les recettes (cf. supra), le bureau A1
– devenu l’Agence France Trésor – devint une petite salle de marché qui commercialisa les titres de dette français sur les marchés internationaux.
En dépit de la baisse de la note française par plusieurs agences de notation, à la suite des crises de 2007, 2008 et 2011, les conditions de financement de la dette française sur les marchés restent tout à fait favorables. Rien ne semble devoir mettre fin à cette situation remarquable dont tout le monde admet pourtant qu’elle ne peut pas durer.
Les taux français bénéficient d’abord de la politique de quantitative easing de la Banque centrale européenne (BCE) qui, après bien des atermoiements, s’est rangée à l’idée de racheter des titres de dettes souveraines. Sa crainte, qu’on pourrait dire constitutive, d’une inflation galopante se heurtant pour l’instant à la réalité de la zone euro qui connaîtra une inflation légèrement négative en 2015.
ÉVOLUTION DU TAUX À DIX ANS POUR LA FRANCE CES 24 DERNIERS MOIS
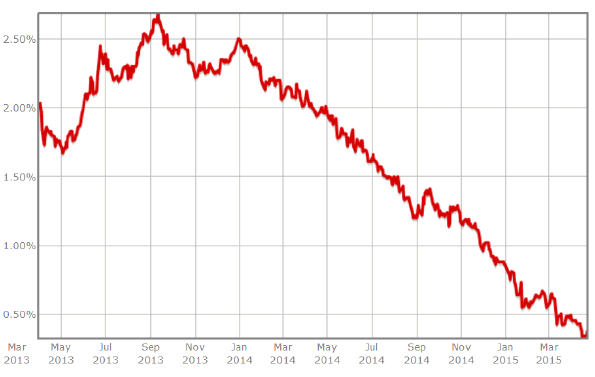
Source : Agence France Trésor.
L’attention portée par les gouvernements successifs à l’enjeu de la dette et la qualité de la gestion de l’Agence France Trésor peuvent être d’autres facteurs explicatifs. Après la dégradation à « AA+ » de la note de la France par l’agence Standard & Poor’s, le ministère des Finances a ainsi pu affirmer de façon crédible début novembre 2013 que « la dette française est et demeure parmi les plus sûres et les plus liquides au sein de la zone euro. Elle bénéficie de taux historiquement bas, preuve de la confiance réaffirmée des investisseurs. »
On pourrait ajouter que les investisseurs désireux de se positionner en euros n’ont pas beaucoup d’alternatives, les volumes d’émission de dette allemande étant moins significatifs.
Cette situation est néanmoins extrêmement précaire, comme l’a d’ailleurs rappelé le ministre des Finances et des comptes publics, Michel Sapin, lors de la présentation du programme de stabilité devant la commission des finances, le 15 avril 2015. Un choc de 1 % sur l’ensemble des taux à compter de 2014 se traduirait par une augmentation de la charge « maastrichtienne » de la dette d’environ 2,2 milliards d’euros en 2014 (soit 0,1 point de PIB). Concentrée au départ sur les bons du Trésor à taux fixe, elle se diffuserait progressivement à la dette à moyen et long terme, au fur et à mesure du renouvellement du stock, pour atteindre près de 15 milliards d’euros à un horizon de dix ans comme le montre le graphique suivant.
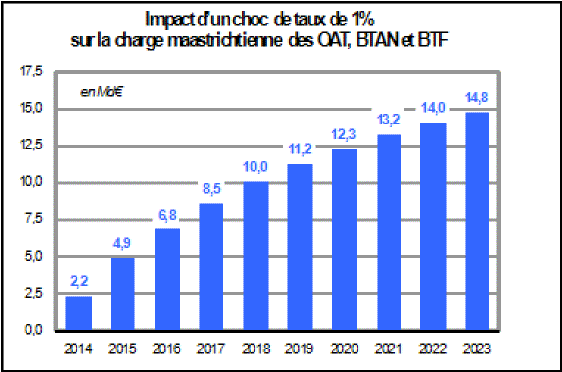
Source : projet annuel de performance du programme 117 « Charge de la dette et trésorerie de l’État » de la mission « Engagements financiers de l’État », annexé au projet de loi de finances pour 2014.
De nombreux acteurs s’inquiètent aujourd’hui de voir poindre les signes avant-coureurs d’une nouvelle crise financière. La faiblesse historique des taux d’intérêt en zone euro réduit la rentabilité des actifs. Dans leur recherche de meilleurs rendements, les gestionnaires d’actifs, que sont les compagnies d’assurances, les banques, ou encore les fonds de pension, pourraient réinvestir massivement hors zone euro, aux États-Unis, par exemple, en cas d’un resserrement monétaire faisant remonter les taux d’intérêt outre-Atlantique, ou dans des actifs plus risqués.
Le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis du 13 avril 2015, signale un accroissement des fragilités financières depuis 2014 : « La hausse des marchés boursiers a été rapide et massive aux États-Unis puis en Europe. Plusieurs indicateurs suggèrent que les marchés financiers peuvent désormais être à nouveau confrontés à des risques de caractère systémique. » (12)
Parmi ces indicateurs, le Haut Conseil observe que le ratio qui rapporte l’indice boursier américain SP500 (13) aux profits enregistrés par ces entreprises, corrigé des variations du cycle économique, pourrait avoir atteint un pic. (14)
ÉVOLUTION SUR LONGUE PÉRIODE DE L’INDICATEUR CAPE SP500
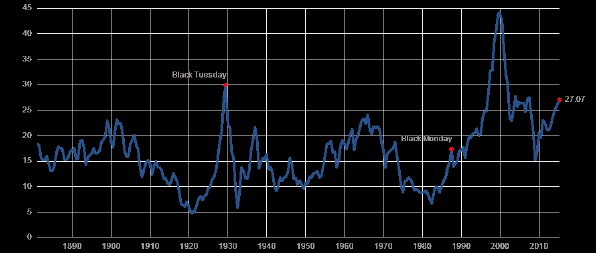
Source : site multpl.com.
Qui détient la dette française ? Voilà une question à laquelle il est bien difficile de répondre. Mme Laure de la Raudière en a fait l’expérience lorsqu’elle a attiré l’attention du ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, le 6 juin 2010, sur la transparence de la gestion de la dette.
Selon le ministère, en effet, « les textes actuellement en vigueur (notamment art. L. 228-2 du code de commerce, décret d’application n° 2002-803 du 3 mai 2002 publié au Journal officiel du 5 mai 2002, art. L. 212-4 du code monétaire et financier relatif à la nominativité obligatoire) n’autorisent les conservateurs d’instruments financiers (Euroclear France pour les titres d’État français) à communiquer aux émetteurs la liste de leurs détenteurs finaux qu’aux seuls émetteurs d’actions, de bons de souscription d’actions ou d’instruments de taux donnant immédiatement ou à terme accès au capital. Par conséquent, l’agence France Trésor (AFT) ne peut pas identifier précisément les détenteurs des obligations assimilables du Trésor (OAT), des bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) et des bons du trésor à taux fixe (BTF). »
En d’autres termes, la loi protège le secret sur l’identité des créanciers.
Tout au plus, les statistiques de la balance des paiements fournies par la Banque de France permettent-elles de connaître la part des résidents et des non-résidents. Ainsi, au quatrième trimestre 2014, la dette négociable de l’État était détenue à 65 % par des non-résidents. C’est plus que l’Allemagne (57 %), l’Australie (11,4 %), le Canada (20,4 %), les États-Unis (41,8 %) ou encore le Japon (9 %). Or, ces non-résidents peuvent être de « faux » non-résidents. Des Français détenteurs d’un portefeuille d’obligations via un paradis fiscal, comme le suggère Michel Husson, de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires). Un investisseur saoudien, qui détient de la dette française car il a investi dans un fonds d’investissement à Londres, est comptabilisé comme un investisseur britannique.
Les enquêtes réalisées par l’Agence France Trésor auprès de ses vingt banques partenaires révèlent que les premiers acheteurs sont des banques centrales, des fonds souverains, des assureurs, des banques commerciales et des fonds de pension. Nous y retrouvons des assureurs (Axa, Allianz…), des mutuelles (MMA, MAAF, Groupama…), des banques (BNP-Paribas, La Banque postale, ING…) et une multitude de fonds d’investissement, principalement européens. Seules les banques partenaires et la société Euroclear France, le dépositaire central des titres français, connaissent ces investisseurs en dette souveraine. Mais la loi leur interdit de rendre publiques ces informations.
Le Rapporteur estime que cette situation d’opacité n’est pas tenable. Avec un peu de perfidie, il a posé la question à l’Agence France Trésor de savoir si ce sont les princes qataris ou le parti communiste chinois qui détiennent une grande part de la dette de la France. La réponse : c’est les deux !
Cela pose un problème démocratique de ne pas savoir quels sont les détenteurs finaux de la dette publique. M. Pascal Franchet, vice-président France du Comité pour l’annulation de la dette des pays du tiers-monde(CADTM) a évoqué la création d’un cadastre de la dette lors de son audition. Le Rapporteur estime que cette proposition est susceptible de répondre à l’exigence de transparence.
Le problème de la dette publique est volontiers présenté comme insoluble. Il est tellement commode de justifier n’importe quelle réforme antisociale par le niveau d’endettement public qu’on la regretterait presque si elle disparaissait ! Pourtant des solutions tout à fait concrètes existent.
Une première solution serait d’instaurer une taxe exceptionnelle non renouvelable sur le capital. Bien qu’assortie d’un solide point d’interrogation, cette solution a été envisagée par le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport sur la soutenabilité des dettes publiques de 2013. Mais le FMI envisageait une taxe de 10 % sur l’ensemble de l’épargne des ménages de la zone euro, sans distinction de revenu. Le FMI cite une autre étude d’un économiste allemand, Stefan Bach qui, avec deux confrères, a étudié en 2012 un projet similaire au nom de l’institut de conjoncture DIW. Là encore, avec un point d’interrogation : « une taxe sur le patrimoine pour amener les riches à réduire la dette publique ? ». S’intéressant exclusivement au cas allemand, ils parviennent à la conclusion que la richesse des foyers possédant chacun plus de 250 000 euros représente au total une assiette imposable de 2 950 milliards d’euros ; une taxe exceptionnelle de 3,4 % permettrait alors d’engranger 100 milliards d’euros, soit 4 % du PIB, pour alléger la dette publique.
En France, le patrimoine des 1 % les plus riches est estimé à 2 000 milliards d’euros, soit le montant de la dette et presque l’équivalent du PIB. Selon M. Thomas Coutrot, économiste, coprésident de l’association Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne), une telle mesure, ciblée sur les grandes fortunes, pourrait rapporter jusqu’à 500 milliards d’euros.
Une deuxième solution est évidemment de recourir à un moratoire sur tout ou partie de la dette, en identifiant les créanciers et en distinguant les petits épargnants des fonds spéculatifs.
La toute première manière de résoudre le problème des déficits, c’est de ne pas y avoir recours. Une autre politique fiscale, plus progressive, qui encadrerait strictement les « niches » et préserverait le niveau des recettes publiques doit être mise en œuvre. En dépit des évaluations et des rapports qui s’accumulent pour démontrer l’inefficacité de ces « niches », elles ne sont que très rarement supprimées. Leur nombre s’accroît continûment pour des motifs tous plus louables les uns que les autres (créer des emplois, initier la transition énergétique, inciter à consommer moins de boissons sucrées etc.). Elles sont une source de complexité et donc d’inégalité devant la loi fiscale. Tandis que les ménages les plus aisés organisent leur évasion fiscale avec une kyrielle de professionnels de « l’optimisation », les ménages modestes appréhendent la déclaration d’impôt sur le revenu et les nombreuses opportunités d’erreurs qu’elle présente désormais.
Bien qu’il faille lutter contre les déficits récurrents que la France a connus jusqu’à présent, il est indispensable que l’État préserve une capacité d’emprunt pour financer l’investissement, l’innovation et des politiques d’aménagement de long terme. Il est souhaitable de s’émanciper progressivement de la tutelle des marchés financiers en recourant de nouveau à l’emprunt direct aux ménages. Dans cette optique, il est nécessaire de créer des produits d’épargne attractifs pour les contribuables français.
La crise financière, bancaire, puis économique qui a débuté en 2007 a largement démontré que les banques ne pouvaient être laissées à la seule main d’acteurs privés. C’est la faillite de l’idéologie néolibérale qui postule que le libre jeu des intérêts privés aboutit à l’intérêt général et que le libre fonctionnement des marchés produit un optimum économique pour tous. Cette idéologie a servi de couverture pour justifier l’enrichissement des plus riches, l’explosion des inégalités, le développement de la précarité et de la pauvreté. Il ne s’agit pas de socialiser les pertes d’aujourd’hui pour privatiser de nouveau les profits demain. Le crédit relève du service public, il faut le mettre au service de la satisfaction des besoins sociaux.
ÉVOLUTION DES TAUX D’ÉPARGNE EN EUROPE (2007-2013)
(en pourcentage du revenu disponible brut)
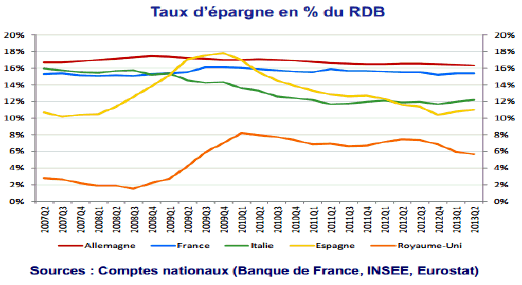
Source : comptes nationaux (Banque de France, Insee, Eurostat)
En décembre 2013, selon les comptes nationaux, le total des placements des ménages atteignait près de 4 500 milliards d’euros, dont plus de 1 250 milliards de dépôts, 1 277 milliards d’actions et 1 530 milliards d’euros comptabilisés au titre de l’assurance-vie (15).
Il y a bien un enjeu d’orientation de cette épargne afin de la dégager autant que possible des marchés financiers. Ce pourrait être une des fonctions du pôle financier public : ses composantes pourraient tirer une partie de leurs ressources de l’émission de titres d’un type nouveau (par exemple des bons à moyen terme négociables assortis d’un engagement contractuel du souscripteur de les conserver jusqu’à l’échéance) émis à un taux déconnecté de celui du marché. De tels titres pourraient être souscrits par les organismes de retraite qui ont des liquidités à gérer et qui souhaitent les placer dans des emplois qui maximisent l’assiette de leurs cotisations, c’est-à-dire les salaires, donc la valeur ajoutée et l’emploi. Ils pourraient également servir à La Banque postale pour placer les fonds des chèques postaux, et à la Caisse des dépôts.
Le pôle financier public devrait assurer la réorientation du crédit vers des investissements qui servent réellement l’intérêt général. Il s’agirait d’augmenter considérablement le flux des crédits permettant la réalisation de projets favorables à l’emploi, à la formation, à l’élévation du potentiel de création de richesses des territoires dans le respect de l’environnement – tout en réduisant le flux des crédits qui viennent contribuer au gonflement des prix des actifs financiers (et immobiliers).
La BCE devrait refinancer à des conditions privilégiées ces crédits, dans le cadre de la nouvelle sélectivité de la politique monétaire que préconise le Rapporteur. Même si elle ne le fait pas pour tous les crédits ainsi « labellisés », l’existence du label serait une incitation réelle, pour les banques, à sélectionner de préférence les projets qui en bénéficieraient.
Par ailleurs, l’état actuel des traités ouvre la possibilité pour des établissements de crédit publics, qu’ils appartiennent aux États ou aux institutions européennes, d’emprunter à la BCE au titre du paragraphe 2 de l’article 123 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Ces établissements publics pourraient par la suite prêter aux États. Ces derniers verseraient éventuellement des intérêts, mais qui reviendraient, au final, dans le budget de l’État au titre de son bénéfice, allégeant la part du fardeau de la dette découlant des intérêts versés aux marchés financiers privés.
Comme l’a souligné M. Benjamin Lemoine, lors de son audition par le Rapporteur, rien n’interdit la création d’un circuit du Trésor européen ou la mise en œuvre d’un emprunt européen pour financer une partie de l’investissement public, et dans le même temps « refaire de la banque un métier ennuyeux », chargé de financer l’économie réelle.
Au vu du bilan économique, social et démocratique désastreux auquel ont conduit les politiques d’austérité menées sous la pression des marchés financiers, il faut impérativement libérer les peuples européens du joug de la dette. À défaut, l’avenir commun des Européens est menacé.
Afin de remettre l’Europe, et en particulier la zone euro, sur les rails de la démocratie, la France doit être à l’initiative d’une grande conférence européenne sur la dette pour dresser le bilan des politiques économiques menées et définir un autre modèle économique. Il s’agit d’abandonner des objectifs chiffrés de court terme et sans fondement économique avéré au profit d’un développement durable et équilibré des États de la zone euro, en particulier des plus fragiles.
a. Les règles européennes relatives à la maîtrise de la dette et du déficit publics sont dénuées de fondement économique
Le « gouvernement par les règles » mis en place au sein de l’Union, et plus particulièrement de la zone euro, n’a pas de fondement économique avéré. Il apparaît plutôt comme un palliatif inefficace – et même contreproductif – aux défauts d’origine de la monnaie unique.
La zone euro, caractérisée par la faible mobilité géographique de sa main-d’œuvre, la flexibilité réduite des rémunérations en son sein et l’absence d’un véritable budget centralisé rendant possible une action conjoncturelle, ne constituait en effet – et ne constitue d’ailleurs toujours – pas une zone monétaire optimale telle que définie par Robert Mundell et Marcus Fleming en 1961. (16)
Aussi, à défaut de pouvoir disposer de modes d’ajustement automatique face aux chocs asymétriques, les États membres de la zone euro ont fait le choix d’adopter des règles strictes en matière de solde et de dette publics, assorties de l’interdiction faite à la Banque centrale européenne de renflouer un État membre, qui a pour conséquence que la dette publique des pays de la zone euro ne peut être financée par émission monétaire.
L’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit ainsi que « les États membres évitent les déficits publics excessifs » et « la Commission européenne surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée », sur la base d’un critère relatif au déficit public, qui doit être inférieur à 3 % du PIB, et d’un critère relatif à l’endettement public, qui ne doit pas dépasser le seuil de 60 % du PIB. (17)
Ces critères, initialement posés par le traité de Maastricht comme préalables à l’entrée dans la zone euro, ne correspondent à aucun fondement économique et sont, en réalité, purement arbitraires. Le seuil de 60 % était simplement conforme à la moyenne constatée de l’endettement public au cours des années précédentes et le critère de 3 % correspondait au déficit qui stabilisait le poids de la dette à 60 % du PIB pour une croissance nominale du PIB de 5 % ainsi qu’aux pics qui avaient pu être observés en Allemagne.
La mise en œuvre des règles posées par le traité en matière de surveillance et de coordination des politiques budgétaires a fait l’objet d’une complexification et d’une sophistication continues depuis l’adoption du pacte de stabilité et de croissance en 1997 (18), avec comme objectif affiché de mieux en assurer le respect.
Il en résulte que les États membres dont le niveau d’endettement dépasse 60 % du PIB doivent améliorer leur solde budgétaire structurel d’au moins 0,5 point de PIB par an et réduire d’un vingtième par an (sur une moyenne de trois ans) l’écart entre leur taux d’endettement et la valeur de référence de 60 %.
La mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance se conclut aujourd’hui par un constat d’échec, confirmant qu’il s’agit bien, comme l’avait qualifié le président de la Commission européenne Romani Prodi en 2005, d’un « pacte de stupidité ». Absence totale de cohérence entre les politiques budgétaires et réponses inadaptées à la crise : voilà le résultat de l’application de ces règles qui conduisent, dans les faits, à l’austérité. Nous mesurons à l’aune de l’intransigeance de la « troïka », dont font partie la BCE et la Commission européenne, l’occasion manquée par le président de la République François Hollande, qui n’a pas engagé la nécessaire renégociation du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG), contrairement à ses engagements de campagne.
L’expérience montre en outre qu’un taux d’endettement public élevé ne constitue un frein ni à la prospérité économique, ni à la capacité à attirer des investisseurs. Ainsi, en 2013, le taux d’endettement public aux États-Unis s’établit à 109,2 % du PIB en termes bruts et à 85,1 % du PIB en termes nets contre respectivement 107,2 % et 66 % en zone euro et 110,4 % et 67,2 % en France. Le Japon, où l’endettement public s’élève à 224,2 % en termes bruts et à 137,2 % en termes nets, n’est pas confronté à la défiance de ses créanciers (19).
b. Elles conduisent à mener des politiques d’austérité au bilan économique, social et politique dramatique
Alors que les États membres de l’Union ont dû faire face à partir de 2008 à une crise financière et économique d’une ampleur inégalée depuis les années 1930, les politiques économiques menées au sein de la zone euro, axées sur la rigueur budgétaire, ont prolongé et accentué la crise et obéré les capacités de production, en particulier dans les pays placés sous programme d’ajustement économique.
C’est vrai au niveau de la zone euro, dont le taux de croissance accuse un net décrochage avec les autres pays. Il s’établit ainsi à – 0,7 % et à – 0,5 % en 2012 et 2013, contre, respectivement, 0,7 % et 1,7 % au Royaume-Uni, 1,8 % et 1,7 % en Pologne et 2,3 % et 2,2 % aux États-Unis. Pour sa part, la France a connu un taux de croissance de 0,3 % ces deux années.
Mais c’est au sein des États placés sous programme d’ajustement (Irlande et Grèce en 2010, Portugal en 2011 et Chypre en 2013) en contrepartie du soutien financier de l’Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI) ainsi qu’en Espagne et en Italie, que les effets récessionnistes des politiques prescrites par les autorités européennes ont été les plus forts, ainsi que le montre le tableau ci-dessous.
ÉVOLUTION DU TAUX DE CROISSANCE ENTRE 2011 ET 2013
(en pourcentage)
2011 |
2012 |
2013 | |
Grèce |
– 8,9 |
– 6,6 |
– 3,9 |
Chypre |
0,3 |
– 2,4 |
– 5,4 |
Irlande |
2,8 |
– 0,3 |
0,2 |
Portugal |
– 1,8 |
– 3,3 |
– 1,4 |
Espagne |
– 0,6 |
– 2,1 |
– 1,2 |
Italie |
0,6 |
– 2,3 |
– 1,9 |
Source : Commission européenne, Prévisions économiques d’hiver, 5 février 2015.
La réduction inconsidérée des dépenses publiques, répondant à une logique comptable et de court terme, s’est traduite inéluctablement par une contraction de l’activité, alimentant ainsi les risques de déflation qui pèsent aujourd’hui sur la zone euro dans son ensemble et faisant craindre un scénario à la japonaise.
Loin de prendre en compte les intérêts à long terme de l’Europe, les plans de baisse des dépenses publiques ont plus particulièrement conduit les pays du Sud de l’Europe dans la dépression. Les richesses nationales y sont exsangues. Le tissu économique est détruit. Ainsi, en Italie, l’investissement est revenu à son niveau d’après-guerre.
Ces politiques d’austérité ont en outre engendré une paupérisation et une précarisation inédites de la société, sous le prétexte de « rassurer les marchés financiers » !
Ainsi, selon l’OCDE (20), le taux de chômage de la zone euro s’établit en 2014 à 11,5 %, soit un niveau bien plus élevé que celui des États-Unis (6,2 %), du Royaume-Uni (6,1 %), de la Russie (5,2 %) ou encore du Japon (3,6 %). La moyenne de la zone euro cache en outre des écarts prononcés entre les États, les pays d’Europe du Sud connaissant des taux « records » : 12,7 % en Italie, 24,4 % en Espagne et 26,5 % en Grèce. La France enregistre, pour sa part, un taux de 9,9 %.
Le taux de chômage de longue durée est également très élevé : 49,7 % des chômeurs en Espagne, 56,9 % en Italie et même 67,5 % en Grèce, tandis qu’il s’établit à 25,9 % aux États-Unis en 2013. En France, il est de 40,4 % (21).
Le taux de chômage des jeunes atteint aussi des niveaux inquiétants : 29,6 % de la population active jeune en Irlande, 38,9 % à Chypre, 40 % en Italie, 55,5 % en Espagne et 58,3 % en Grèce, contre 6,9 % au Japon et 7,9 % en Allemagne. En France, il s’établit à 23,9 % (22).
La précarisation de la société en Europe se traduit également par une diminution des revenus, une augmentation du taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale et un creusement des inégalités.
Ainsi, dans son rapport sur l’emploi conjoint à l’examen annuel de croissance présenté le 28 novembre 2014, la Commission européenne souligne que l’évolution du revenu disponible des ménages a baissé au sein de la zone euro en 2011 et 2012, et plus particulièrement dans les pays d’Europe du Sud : Grèce, Chypre, Italie et Portugal, comme le montre le graphique ci-dessous.
ÉVOLUTION RÉELLE DU REVENU DISPONIBLE BRUT DES MÉNAGES
EN 2011 ET 2012
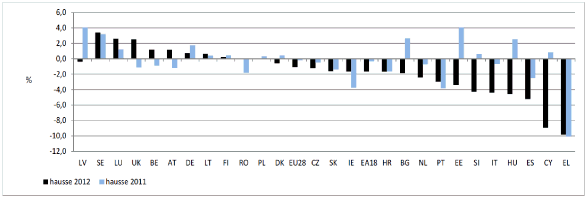
Source : Commission européenne, rapport sur l’emploi, novembre 2014.
Il ressort de ce même rapport que le taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale a connu une forte progression, qui s’est accompagnée d’un creusement des écarts entre les États membres. Entre le début de la crise en 2008 et 2012, le nombre d’Européens exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale a progressé de 8,7 millions, pour atteindre plus de 25 % de la population de l’Union en 2012. Au sein de la zone euro, ce sont les pays sous programme d’ajustement (Grèce, Irlande, Chypre) et d’Europe du Sud (Italie et Espagne) qui enregistrent les résultats les plus inquiétants, comme le montre le graphique ci-dessous.
ÉVOLUTION DES TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ OU D’EXCLUSION SOCIALE
ENTRE 2008 ET 2012
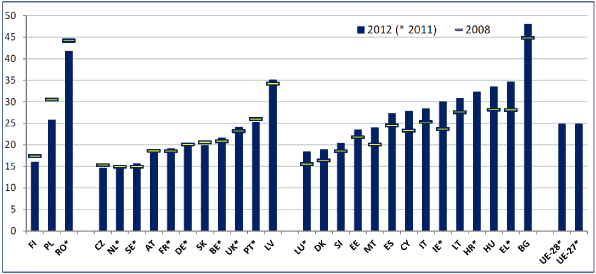
Source : Commission européenne, rapport sur l’emploi, novembre 2014.
Si l’on considère plus particulièrement le taux de risque de pauvreté de la population en âge de travailler, qui est celui qui a le plus progressé, il apparaît que ce sont à nouveau les pays d’Europe du Sud qui enregistrent les taux de risque de pauvreté les plus élevés : 18,4 % au Portugal, 18,8 % en Italie, 20,4 % en Espagne et 23,8 % pour la Grèce.
TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ DE LA POPULATION EN ÂGE DE TRAVAILLER
(niveau en 2013 et évolutions entre 2011 et 2012 et entre 2012 et 2013)
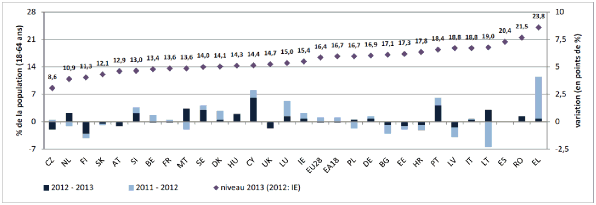
Source : Commission européenne, rapport sur l’emploi, novembre 2014.
Si le ratio retenu par la Commission européenne pour mesurer le niveau des inégalités montre que celui-ci est resté stable entre 2008 et 2013 au sein de l’Union, les disparités entre les États se sont accusées. Les inégalités ont en particulier fortement augmenté dans les États du Sud de l’Europe. Ainsi au Portugal, en Grèce et en Espagne, le revenu global des 20 % d’habitants aux revenus les plus élevés est au moins six fois supérieur à celui des 20 % aux revenus les plus faibles.
INÉGALITÉS
(niveau en 2013 et variations entre 2011 et 2012 et entre 2012 et 2013)
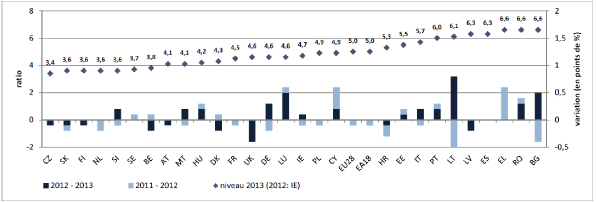
Source : Commission européenne, rapport sur l’emploi, novembre 2014.
Hausse du chômage et de la pauvreté, exil de la population, progression insupportable des inégalités, abandon des hôpitaux et services publics… : le bilan social des politiques d’austérité est lourd. Un récent article de M. Pierre Rimbert dans Le Monde Diplomatique d’avril 2015 titré « Docteur Folamour à Athènes » est éclairant, en mettant en exergue que le taux de suicide a bondi en Grèce depuis les mesures d’austérité de 2011 (+ 35 %). C’est la vie même que l’austérité met en péril.
Ce désastre économique et social s’accompagne de la mise en danger de ce qui constitue l’essence même de l’Europe : la démocratie.
Tout d’abord, les politiques d’austérité conduisent à remettre en cause de nombreux droits fondamentaux affirmés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans la Charte sociale européenne.
L’accès à l’éducation, aux soins et à la justice est ainsi extrêmement fragilisé dans les pays où les politiques d’austérité ont été menées, comme le montre une étude commandée cette année par la commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen qui a pour objet de comparer les conséquences de la crise sur les droits fondamentaux dans sept États membres de l’Union. (23)
Les droits fondamentaux des travailleurs sont également remis en question, ainsi que l’a souligné M. Stéphane de la Rosa, professeur à l’Université de Valenciennes, au cours de son audition. La Cour de justice de l’Union européenne est de plus en plus souvent saisie à ce titre mais s’estime incompétente en la matière. En effet, les décisions prises sur le fondement des injonctions de la « troïka » et des recommandations adoptées par le Conseil ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union ; dès lors elles ne peuvent être contestées au motif qu’elles violent la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. C’est en ce sens que la Cour a conclu dans sa décision du 7 mars 2013, dans laquelle elle s’est estimée incompétente pour connaître d’une question préjudicielle relative à la conformité d’une loi établissant des réductions salariales pour certains travailleurs du secteur public (bancaire en l’espèce) à la Charte des droits fondamentaux, en particulier à son article 31 qui affirme le droit à des conditions de travail qui respectent la dignité du travailleur (24).
Se pose ainsi la question du statut juridique des programmes d’ajustement économique qui ne reposent pas sur le droit primaire de l’Union et peuvent, en conséquence, s’exonérer des principes posés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union, la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte sociale européenne, alors qu’ils contiennent des prescriptions précises en matière de systèmes de soins de santé et de retraite.
La question de leur légitimité est également soulevée. Les membres de la « troïka » sont des agents de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international qui ne rendent, en réalité, de compte à personne. Ainsi que l’a mis en évidence le rapport d’enquête sur le rôle et les activités de la « troïka » dans les pays sous programme de la zone euro, présenté par MM. Othmar Karas et Liem Hoang Ngoc au nom de la commission des Affaires économiques du Parlement européen en 2014, « la réunion au sein de la troïka de trois institutions indépendantes entre lesquelles les responsabilités sont inégalement partagées, dont les mandats, les méthodes de négociation et la structure décisionnelle sont différents, et qui présentent divers niveaux de responsabilité, a conduit à un manque de contrôle et de responsabilité démocratique adéquats de la troïka dans son ensemble ».
En particulier, la participation de la BCE à la « troïka » apparaît incongrue. Source de conflit d’intérêts, elle doit cesser, ainsi que le demande le Parlement européen (25) et comme l’a mis en évidence l’avocat général de la Cour de justice de l’Union, M. Cruz Villalón, dans ses conclusions relatives à la compatibilité du programme des opérations monétaires sur titres de la BCE avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (26).
Conséquence de ces errements, les institutions européennes font l’objet d’une défiance croissante de la part des citoyens et le projet européen semble avoir perdu tout sens. Le repli national et communautariste se renforce. Les partis xénophobes et anti-européens connaissent un succès aussi grandissant qu’inquiétant pour l’avenir des générations futures. Le risque d’une scission de l’Europe entre pays du Nord et pays du Sud, qui scellerait la fin du projet de paix et de prospérité porté à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ne semble plus devoir être exclu. (27)
Les taux d’abstention record lors des dernières élections européennes traduisent également la déconnexion du projet européen avec les peuples du continent. Comment ne pas rappeler que les institutions européennes, comme les gouvernements, ont affiché leur plus grand mépris devant les résultats de consultations du peuple ? Le vote du 29 mai 2005 sur le traité établissant une constitution pour l’Europe (TCE) et la victoire du « non » dans notre pays ont été méprisés et balayés par un vote au Parlement qui montre également le hiatus qui peut exister entre représentation nationale et pays réel… Le Rapporteur estime que la situation actuelle doit beaucoup à l’absence de prise en compte des messages exprimés lors des consultations référendaires sur le projet européen.
L’Europe de Maastricht porte en elle l’accroissement des inégalités. Ce sont les Trente Glorieuses des 1 % les plus riches et les Trente Oublieuses des 99 autres.
2. Organiser une « opération vérité » sur la dette afin de permettre aux peuples européens d’exercer un véritable contrôle sur la dette et de se réapproprier le débat économique
Face à ce bilan économique, social et démocratique désastreux et au désespoir des citoyens européens, une réaction vive s’impose, afin de permettre aux peuples d’exercer leur droit de contrôle sur la dette publique et ainsi de se libérer du diktat des marchés financiers.
Alors que la Grèce doit faire face à une situation économique et sociale d’une gravité inédite et subit le diktat de l’Eurogroupe, du FMI et de la BCE, la présidente du Parlement grec, Mme Zoé Konstantopoulou, a décidé de créer, le 4 avril 2015, une « Commission Spéciale du Parlement des Grecs pour la recherche de la vérité concernant la création et le gonflement de la dette publique, l’audit de la dette et la promotion de la collaboration internationale du Parlement avec le Parlement européen, les Parlements d’autres pays et des organismes internationaux en matière de dette, ayant comme objectif de sensibiliser et activer la société, la communauté internationale et l’opinion publique internationale ».
Cette Commission de vérité sur la dette publique est ainsi conçue comme « un instrument de vérité. Un instrument de réparation de l’injustice. Un instrument de dignité, de défense sociale et démocratique, de contestation et de résistance contre des choix qui tuent la société. Un instrument de réveil des peuples, des sociétés et des directions européennes. Un instrument de solidarité » selon ses propres termes employés lors de la session inaugurale de la Commission qui s’est tenue le 5 avril 2015(cf. texte intégral du discours de la présidente en annexe 2).
Composée d’experts grecs et étrangers – dont M. Michel Husson, économiste, et M. Éric Toussaint, président du Comité pour l’annulation de la dette du Tiers-monde (CADTM) –, cette Commission se distingue de la Commission parlementaire sur les conditions du mémorandum de 2010 mise en place le 7 avril 2015.
Elle a pour objectif de déterminer comment la dette grecque s’est constituée et d’en identifier la part illégale, illégitime, odieuse et insoutenable.
Dette illégale, illégitime, odieuse et insoutenable selon la classification du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM)
Dette publique illégitime : dette contractée par les pouvoirs publics sans respecter l’intérêt général ou d’une manière qui lui est préjudiciable.
Dette publique illégale : dette contractée par les pouvoirs publics en violation flagrante de l’ordre juridique en vigueur.
Dette publique odieuse : prêts octroyés à des régimes autoritaires ou qui imposent des conditions, pour leur remboursement, qui violent les droits sociaux fondamentaux.
Dette publique insoutenable : dette qui condamne la population à un appauvrissement et à une dégradation de la santé et de l’éducation publiques, à une augmentation du chômage ou à des problèmes de malnutrition. Il s’agit d’une dette qui empêche les pouvoirs publics de garantir les droits humains fondamentaux.
En particulier, cette Commission va s’interroger sur les conditions dans lesquelles on est passé d’une dette publique grecque détenue en 2007 à 80 % par des créanciers privés, en particulier des banques de la zone euro et du Royaume-Uni, à une dette désormais possédée à plus de 70 % par des créanciers publics ou parapublics. Elle a également pour mission d’examiner la légalité du traitement réservé à la BCE – qui n’a pas été concernée par le programme de restructuration de la dette grecque en mars 2012 – et la légitimité de la demande de cette dernière d’un remboursement intégral.
La Commission de vérité sur la dette publique n’a pas vocation à formuler des recommandations, mais ses travaux éclaireront les décisions du Parlement et du gouvernement grecs ainsi que l’opinion de l’ensemble des citoyens grecs et européens.
Elle devrait présenter un premier rapport d’étape en juin 2015, soit avant la fin, le 30 juin 2015, de l’accord-cadre d’assistance financière relatif à la Grèce, et un rapport définitif d’ici à la fin de l’année.
Le Rapporteur considère cette « opération vérité » comme salutaire pour la Grèce et la zone euro dans son ensemble.
Il rappelle à cet égard les résultats positifs des audits menés dans d’autres pays, comme l’Équateur, où la décision du gouvernement de réaliser un audit intégral de sa dette publique en 2007 et 2008 a conduit à l’allégement de 70 % de la dette externe envers les banques privées et à la réduction de la dette publique de 7,5 milliards de dollars, somme qui a ainsi pu être consacrée à l’éducation et à la santé. Comme l’a souligné M. Pascal Franchet, vice-président du CADTM-France, lors de son audition : « la décision de l’Équateur de réaliser un audit intégral de sa dette publique a adressé une leçon de souveraineté au monde, en montrant qu’il est possible d’affronter le pouvoir financier mondial ».
Dans la lignée des initiatives équatorienne et grecque, le Rapporteur soutient l’idée d’organiser une grande conférence européenne sur la dette, réunissant les gouvernements nationaux, les institutions européennes, le Fonds monétaire international, les parlements nationaux ainsi que les associations et organisations intergouvernementales.
Cette conférence doit avoir pour objectifs une prise de conscience des enjeux liés à la dette, une réappropriation démocratique du contrôle de la dette publique et du débat économique et une réduction significative et durable de l’endettement des États membres de la zone euro, en particulier les plus fragiles d’entre eux, et notamment la Grèce.
Il s’agit ainsi tout d’abord d’identifier les causes qui ont conduit à l’endettement massif des États de la zone euro. Cela suppose que des audits soient conduits au sein de chaque État membre. De telles initiatives ont d’ailleurs déjà été engagées dans nombre d’entre eux : en France, où ont été créés le Collectif pour un audit citoyen de la dette publique – à l’initiative de plusieurs organisations (comme Attac et le CADTM) et syndicats (CGT, Solidaires, Sud BPCE et FSU) et avec l’appui de partis politiques (NPA, Parti communiste, Parti de gauche et Europe Écologie les Verts) – ainsi que 140 collectifs locaux ; en Espagne avec la Plateforme d’audit citoyen de la dette (Plataforma de la Auditoria Ciudadana de la Deuda) ; au Portugal avec le mouvement pour l’audit citoyen de la dette ou encore en Irlande où un audit de la dette mené par plusieurs groupes dont Action from Ireland et Debt and Development Coalition Ireland a conduit à la création d’un nouveau groupe d’action dénommé Debt Justice Action.
Il s’agit ensuite, sur le fondement d’un constat citoyen, de formuler des propositions pour que la situation d’étranglement financier que connaissent certains États, en particulier les plus fragiles, cesse.
Plusieurs options sont possibles, allant de la mutualisation de tout ou partie des dettes publiques au sein de la zone euro dans la logique d’un affermissement de la monnaie unique, à une annulation totale ou partielle d’une dette nationale en passant par toutes les formes de restructuration de la dette.
S’agissant de l’option la plus ambitieuse, à savoir l’annulation de la dette, le Rapporteur tient à en minimiser les effets. Ainsi, l’expérience montre qu’un défaut de paiement n’entraîne pas, sur le long terme, d’impossibilité d’accès aux marchés financiers. Par exemple, la Russie a pu emprunter à nouveau sur les marchés financiers deux ans après son défaut de paiement qui avait été décrété unilatéralement. Il ajoute qu’il existe des arguments forts en faveur d’une suspension du remboursement des dettes publiques, qui peut générer un cercle vertueux. M. Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, souligne ainsi que lorsqu’un pays utilise les fonds économisés à la suite d’une réduction de dette pour mener une politique économique expansionniste, « le nombre d’entreprises locales qui tombent en faillite diminue à la fois parce que les taux d’intérêt locaux sont plus bas que si le pays avait continué à rembourser sa dette et parce que la situation économique générale du pays s’améliore. Puisque l’économie se renforce, les recettes d’impôts augmentent, ce qui améliore encore la marge budgétaire du gouvernement. (…) Tout cela signifie que la position financière du gouvernement se renforce, rendant plus probable le fait que les prêteurs voudront à nouveau octroyer des prêts. » (28)
Pour ce qui concerne la Grèce, la conférence pourrait permettre de sortir du dialogue de sourds qu’elle a actuellement avec ses créanciers grâce à une restructuration significative de sa dette publique (réduction de la valeur de la dette, allongement des maturités), la résolution de la question des intérêts de la dette perçus par les créanciers de la Grèce (en particulier la BCE, qui n’a toujours pas versé à la Grèce les intérêts, soit 1,8 milliard d’euros, qu’elle doit lui rétrocéder sur les titres de dette acquis dans le cadre du « programme SMP » (« Securities Markets Program »), lancé en 2010, qui a consisté en l’achat d’obligations souveraines sur le marché secondaire, l’arrêt des conditions mortifères imposées à la Grèce, l’instauration d’une « clause de développement » pour le pays (pour que le remboursement de la dette ne tue pas le redressement de l’économie) et l’apport d’un soutien réel à la Grèce pour l’aider à mettre en place un véritable système fiscal.
N’oublions pas que, dans l’Histoire, en France comme dans nombre de pays, la restructuration, l’annulation partielle ou totale de la dette ont été largement utilisées. L’une des plus emblématiques restructurations de dette a d’ailleurs concerné l’Allemagne, conformément aux conclusions de la Conférence de Londres de 1953.
UN EXEMPLE HISTORIQUE : LA CONFÉRENCE DE LONDRES DE 1953
En 1953, une conférence, réunissant vingt-deux États, dont la Grèce, s’est tenue à Londres pour traiter le cas de la dette allemande.
L’Allemagne, mal en point économiquement et socialement, était dans l’incapacité de financer sa reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le pays demandait à pouvoir bénéficier d’une annulation d’une partie de sa dette, afin de relancer son économie.
Ayant retenu les leçons du désastreux traité de Versailles, les parties prenantes à la conférence décidèrent de renoncer à plus de la moitié de leurs créances à l’égard de l’Allemagne. Cette annulation partielle ne fut pas été assortie d’une austérité budgétaire extrême.
Par ailleurs, l’Allemagne se vit accorder un moratoire de 5 ans, de 1953 à 1958, et ses remboursements furent échelonnés sur une période de 30 ans.
Enfin, l’Allemagne bénéficia d’une « clause de développement », prévoyant qu’elle pouvait interrompre le remboursement de ses dettes en cas de déficit commercial. Les créanciers s’obligeaient, d’une certaine manière, à acheter plus de produits allemands pour permettre à l’Allemagne de rembourser ses dettes grâce à des excédents commerciaux.
Pour ce qui concerne plus largement la zone euro, la conférence pourrait contribuer à la définition d’une stratégie européenne de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la corruption, étudier les possibilités de créer des outils de financement de l’action publique autres que le recours aux marchés financiers et, enfin, participer à la mise en place d’une véritable gouvernance économique européenne fondée sur des critères démocratiques.
La grande conférence européenne sur la dette doit permettre de définir un autre modèle économique, reposant sur une politique budgétaire au service de la croissance et de la réduction des inégalités et une politique monétaire au service de l’économie réelle.
1. Définir une autre politique budgétaire, au service de la croissance et de la réduction des inégalités
Le recul de l’activité et l’accroissement des inégalités générés par les politiques d’austérité menées au nom de la réduction de la dette publique (cf. supra II.A.1.b) marquent l’échec de ces politiques. Il faut en conséquence définir un autre modèle de progrès économique et social, ce qui suppose, en premier lieu, de revoir les politiques budgétaires menées au sein de la zone euro.
À cet égard, il est permis de douter de la volonté réelle de la Commission européenne de donner à l’économie européenne un « nouvel élan », selon les termes employés par son président Jean-Claude Juncker.
Conformément aux orientations définies par son président le 15 juillet 2014 (29), la Commission européenne affirme en effet vouloir donner un nouvel élan à l’emploi, à la croissance et à l’investissement sur l’ensemble de sa mandature.
Pour 2015, la Commission européenne, soulignant, dans son examen annuel de croissance présenté le 28 novembre 2014, l’urgence de « revitaliser la croissance dans toute l’UE et de susciter un nouvel élan placé sous le signe du changement », propose de définir trois grandes orientations de politique économique :
– accroître les investissements ;
– poursuivre les réformes structurelles ;
– mener des politiques budgétaires « responsables et propices à la croissance ».
La Commission européenne affirme ainsi vouloir se démarquer de la précédente. Toutefois, une lecture attentive de l’examen annuel de croissance conduit à s’interroger sur la volonté réelle de « changement » de la Commission. En effet, on retrouve dans l’examen annuel de croissance pour 2015 les mêmes recommandations que celles de la précédente Commission européenne, qui retenait cinq orientations de politique économique : assurer un assainissement budgétaire différencié selon les États et favorable à la croissance ; rétablir l’activité de prêt à l’économie ; promouvoir la croissance et la compétitivité ; lutter contre le chômage et prendre des mesures pour faire face aux retombées sociales de la crise ; moderniser l’administration publique.
Par ailleurs, alors que la Commission européenne estime à 1 000 milliards d’euros le besoin d’investissement en infrastructures en Europe, le plan présenté par le président Jean-Claude Juncker le 28 novembre dernier apparaît largement insuffisant au regard des besoins.
Principales caractéristiques du plan d’investissement pour l’Europe
Se fondant sur l’analyse de la Banque européenne d’investissement selon laquelle, en dépit d’une abondance de liquidités en Europe, de nombreux projets ne trouvent pas de financements en raison des risques micro et macroéconomiques, la Commission européenne a présenté, le 26 novembre 2014, un plan d’investissement pour l’Europe. Son objectif affiché est de remédier à l’insuffisance de l’investissement, qui serait inférieur de 230 à 370 milliards d’euros à sa tendance soutenable de long terme.
Ce plan repose sur trois volets :
– la mobilisation de 315 milliards d’euros sur 3 ans, reposant sur la création, sous l’égide du groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), d’un Fonds européen d’investissement stratégique (FEIS) destiné à assumer les risques liés aux investissements à long terme et à garantir aux PME un meilleur accès au financement des risques. Abondé à hauteur de 5 milliards d’euros par la BEI (sur ressources propres) et assis sur 16 milliards d’euros de garanties à partir du budget de l’Union (8 milliards adossés à 3,3 milliards du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 2,7 milliards du programme Horizon 2020 et 2 milliards de marges budgétaires), ce Fonds devrait permettre à la BEI d’intervenir à hauteur de 60 milliards d’euros, ce qui devrait générer des co-investissements permettant d’atteindre le montant de 315 milliards d’euros. Un effet multiplicateur d’au moins 15 est donc attendu.
Les États membres peuvent en outre, sur une base volontaire, contribuer au Fonds.
L’objectif affiché est que le Fonds puisse être créé le 1er juin 2015, à la suite de l’adoption d’un règlement selon la procédure législative accélérée. Toutefois, la BEI devrait commencer l’instruction des projets auparavant, sur la base de ses ressources propres :
– l’instruction des projets : selon les principes posés par la Commission européenne, les concours financiers seraient destinés à des secteurs prioritaires (infrastructures de transport, réseaux à haut débit et d’énergie, éducation, recherche, innovation, transition énergétique) et le FEIS devrait soutenir à hauteur des trois quarts du plan (soit 240 milliards d’euros) des projets d’investissement à long terme et pour un quart (soit 75 milliards) des PME. Pour le reste, le choix des projets devrait être indépendant de considérations politiques et de contraintes géographiques et sectorielles. Une plateforme de conseil en investissements associant la Commission européenne et la BEI devrait par ailleurs être mise en place afin d’aider les porteurs de projet dans leurs démarches ;
– l’amélioration du cadre réglementaire, grâce à la levée des obstacles à l’investissement et à l’approfondissement du marché unique.
Nettement insuffisant, ce plan se caractérise également par la faiblesse des moyens publics mobilisés (21 milliards d’euros dont en réalité seuls 13 milliards correspondent à des crédits – 5 milliards mobilisés par la BEI et 8 milliards obtenus par redéploiement au sein du budget de l’Union) et l’absence de mobilisation financière nouvelle puisque les ressources publiques ainsi dégagées le sont par redéploiement. L’appel massif aux instruments financiers instaure en outre à nouveau une dépendance. Par ailleurs, au vu de la gouvernance qui devrait se mettre en place, on ne peut que douter de l’efficacité de ce plan. Enfin, le troisième volet du plan, à savoir la levée des obstacles à l’investissement et l’approfondissement du marché unique, suscite des inquiétudes, dès lors qu’il reflète la volonté libérale constante de la Commission européenne. Cette annonce pâtit également de la fiabilité du montant de levier attendu. Un effet multiplicateur de 15 est tout simplement une hérésie.
Par conséquent, il convient de revoir les politiques budgétaires au sein de la zone euro, avec comme objectifs de redémarrer l’économie, de créer des emplois durables et de qualité et d’aller de l’avant sur la transition énergétique.
Ainsi que l’a souligné M. Thomas Coutrot lors de son audition par le Rapporteur, il faut sortir de l’austérité imposée par la dépendance des États de la zone euro vis-à-vis des marchés financiers, pour mener une politique alternative fondée sur la fin du paradigme de la croissance économique et de la consommation individuelle à tout prix et un investissement massif dans le développement durable.
La réorientation des politiques budgétaires dans un sens plus favorable au développement économique et social et à la réduction des inégalités suppose notamment d’instaurer de nouvelles ressources fiscales, de lutter de manière efficace contre l’évasion et l’optimisation fiscales et de mettre en place un Fonds européen solidaire, social et écologique.
Les propositions formulées précédemment pour réduire le montant de la dette publique en France (cf. supra I.) peuvent aussi inspirer une réflexion sur de nouvelles ressources fiscales au niveau européen. Là encore, une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des 1 % des ménages les plus aisés en Europe serait une solution de crise adéquate, à laquelle seront de toute façon conduits les États européens si une nouvelle crise financière majeure intervenait dans les prochains mois, comme le craint le Rapporteur. Les États n’auront plus les moyens de remettre à flot les marchés financiers, compte tenu de leur niveau d’endettement. Ils devront aller puiser là où l’argent et le patrimoine se trouvent, à savoir chez les plus aisés.
Une nouvelle architecture fiscale s’impose, privilégiant l’impôt direct plutôt que l’impôt indirect, et l’équilibre entre ménages et entreprises doit être revisité. Depuis 2012, avec la création du crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi (CICE) et la baisse des cotisations sociales employeurs, une distorsion a été créée. Si personne ne peut nier l’exigence de compétitivité du secteur industriel, l’idée d’une modulation des prélèvements fiscaux et sociaux des entreprises favorisant l’emploi, l’investissement, la formation et la transition écologique doit être posée.
En outre, la création d’un impôt européen sur les dividendes doit être une priorité pour l’Europe fiscale. Dans le contexte actuel de concurrence exacerbée, chaque État européen est en quelque sorte le paradis fiscal de son voisin, pour un certain type de population ou d’entreprise. Cette concurrence fiscale à outrance a profondément dégradé les déséquilibres budgétaires, en réduisant fortement les recettes publiques mais aussi en incitant à privilégier les impôts indirects, plus injustes, qui frappent des bases taxables captives. En cela, elle a profondément aggravé les inégalités, favorisées par les baisses de l’impôt progressif sur le revenu et celles sur le stock et les revenus du patrimoine.
Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a adopté un plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il comprend une trentaine d’actions pouvant être menées à court terme et moyen terme. Il porte sur la bonne gouvernance fiscale (par exemple un numéro d’identification fiscale de l’UE pour identifier les personnes physiques ou morales engagées dans des opérations transfrontières) et la transparence fiscale, la lutte contre les pratiques dommageables, la mise à jour de la réglementation relative à la TVA et la coordination des accords fiscaux internationaux au niveau de l’UE.
Une enquête a été lancée par la Commission en juin 2013 sur les pratiques de sept États membres en matière de « rescrits fiscaux » (tax rulings en anglais), des accords entre l’entreprise et l’administration fiscale qui peuvent conduire à minorer fortement l’impôt dû par l’entreprise, soit du fait d’un accord exorbitant du droit commun conclu avec l’administration, soit par la mise en œuvre de mesures d’optimisation fiscale permises par cet échange d’informations avec l’administration. Bien que légales, ces pratiques sont constitutives d’une politique fiscale agressive de la part des États concernés et pourraient même être qualifiées d’aides d’État par la Commission.
Le contenu du plan d’action de la Commission et son rythme de mise en œuvre se sont révélés très insuffisants lorsqu’un consortium international de journalistes d’investigation a révélé, le 5 novembre 2014, le scandale du « Luxembourg leaks » ou « Lux - Leaks ». Ce sont 28 000 pages d’accords fiscaux issues du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) que la fuite (leak en anglais) a mises au jour. Ces 548 accords fiscaux montrent l’organisation de l’exil fiscal de 343 entreprises avec l’approbation de l’administration luxembourgeoise des impôts. Les révélations sont fondées sur des documents datant de 2002 à 2010. À partir du début des années 1990, le Luxembourg a commencé à accueillir des filiales de sociétés étrangères en grand nombre. Cet essor s’est inscrit dans la volonté de développer l’économie du Luxembourg vers la finance, en s’appuyant sur une législation visant à attirer les capitaux étrangers et sur le développement d’activités bancaires et de domiciliation de sociétés.
M. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne nouvellement élu, est directement touché par le scandale LuxLeaks, en tant qu’ancien Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg de 1995 à 2013. Reconnaissant être « politiquement responsable », le président de la Commission a néanmoins fait valoir que ce mécanisme d’accords fiscaux était parfaitement légal.
Le 28 novembre 2014, les ministres des Finances français, italien et allemand ont adressé au commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, M. Pierre Moscovici, une lettre demandant un renforcement significatif de la lutte contre les paradis fiscaux par le développement de l’échange de renseignements, l’adoption d’une directive « anti-BEPS » pour lutter l’optimisation fiscale agressive et une meilleure prise en compte de la nécessité de protéger l’Europe contre les paradis fiscaux hors de l’Union. Le 9 décembre 2014, le Conseil Ecofin a donné son accord politique pour l’échange obligatoire d’informations entre les administrations fiscales de l’Union européenne.
Il est primordial de renforcer les moyens de lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux au sein de l’Union. Un pacte européen contre le dumping fiscal et social devrait permettre de définir une stratégie ambitieuse et cohérente, visant à stopper la concurrence entre États qui conduit inévitablement à l’appauvrissement de tous.
Sans nier les avancées en ce qui concerne la fraude des particuliers, l’enjeu majeur demeure sur les pratiques d’évasion et de fraude des groupes transnationaux. Les travaux de la mission d’information de la commission des Finances de l’Assemblée nationale sur l’érosion des bases fiscales (30) et le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales (31) ont ouvert de nombreuses pistes qu’il s’agit désormais d’emprunter.
Afin de permettre aux États européens d’investir massivement dans la réalisation de grands projets d’investissement porteurs de croissance et d’espoir dans l’Union, sans subir le diktat des marchés financiers, il convient d’instaurer un Fonds européen solidaire, social et écologique, ainsi que cela avait été proposé par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine en 2011. (32)
Ce Fonds aurait pour objectif d’allouer des financements à des taux d’intérêt bas voire nuls aux États membres de la zone euro en fonction de leurs besoins propres et expressément pour le développement de services publics nationaux et de leur coopération européenne. Il financerait également des projets publics de création et de sécurisation des emplois, de développement de la formation et de la recherche et de protection de l’environnement. À cet effet, le Fonds, qui aurait le statut de banque, se financerait, d’une part, auprès de la BCE et, d’autre part, auprès des organismes nationaux qui collectent l’épargne populaire, comme par exemple la Banque postale en France. Le Fonds devrait ainsi notamment s’appuyer sur une mobilisation de l’épargne populaire à l’échelle européenne. Bien plus ambitieux que le plan d’investissement présenté par la Commission européenne, ce Fonds permettrait de canaliser des financements massifs au service de grands projets d’intérêt général.
Alors que la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Paris de décembre 2015 doit ouvrir des perspectives concrètes, mettre un tel fonds en œuvre, doté de plusieurs centaines de milliards d’euros, permettrait un saut qualitatif en matière de transition écologique par la réalisation de grandes infrastructures de transport propres, par un plan d’amélioration du bâti et de ses performances énergétiques, par l’engagement vers les énergies renouvelables. Ce fonds d’investissement, riche en emplois, serait un signe très fort de la volonté commune des Européens.
La recherche d’une plus grande efficacité des politiques budgétaires suppose enfin d’assurer une réelle coordination entre les politiques budgétaires nationales, d’une part, et avec les actions menées à l’échelon européen, d’autre part. Cette meilleure articulation entre les politiques budgétaires doit s’accompagner d’une politique monétaire au service de l’économie réelle.
Devant le constat d’une part d’une atonie de la croissance assortie d’une inflation très faible laissant craindre des risques déflationnistes et d’autre part de difficultés persistantes dans la transmission à l’économie réelle de la politique monétaire – les PME se heurtant à un accès très limité voire inexistant aux prêts bancaires dans les États du Sud de la zone euro –, la Banque centrale européenne a annoncé le 22 janvier 2015 la mise en place d’un programme d’assouplissement quantitatif (ou « quantitative easing »).
Soulignant sa volonté de soutenir le niveau des prix dans la zone euro, en agissant à la fois sur les liquidités bancaires (pour relancer le crédit bancaire) et sur les anticipations d’inflation, le programme d’assouplissement quantitatif devrait ainsi conduire la BCE à racheter des titres publics et privés au rythme de 60 milliards d’euros par mois entre mars 2015 et septembre 2016, soit un total de 1 100 milliards d’euros en 16 mois.
L’initiative de la Banque centrale, par son ampleur, sa durée – l’objectif est de poursuivre ce programme jusqu’à ce que le taux d’inflation se rapproche de 2 % – et sa nature confirme l’urgence de la situation et entérine un changement de doctrine. En effet, les rachats d’actifs couvrent cette fois explicitement des titres de dette publique contrairement aux programmes antérieurs qui concernaient en priorité des titres privés et ne visaient des titres publics que de manière limitée. Ainsi, selon les estimations, la BCE pourrait racheter jusqu’à 900 milliards d’euros d’obligations d’États et d’organismes financiers européens et 240 milliards d’euros de titres privés. Au 10 avril 2015, soit un mois après le début du programme, la BCE a racheté des titres publics à hauteur de 61,7 milliards d’euros ainsi que des titres privés et des obligations structurées selon le rythme annoncé.
Cependant, ce programme d’assouplissement quantitatif, dont la mise en œuvre est déléguée aux banques centrales nationales sous coordination de la BCE, trouve rapidement ses limites.
Il est en effet assorti de conditions très strictes. Tout d’abord, seuls 20 % des nouveaux rachats d’actifs devraient bénéficier d’une mutualisation des risques. Cela signifie que les banques centrales nationales porteront l’essentiel du risque lié aux pertes en cas de défaut ou de restructuration de leur dette nationale. Cette condition s’explique par la nécessité de trouver un compromis au sein du conseil des gouverneurs (sous la pression de la banque centrale allemande qui veut limiter l’exposition commune au risque souverain) et par le caractère pendant de la question préjudicielle adressée par la Cour de Karlsruhe à la CJUE au sujet du programme des opérations monétaires sur titres (malgré l’orientation encourageante des conclusions de l’avocat général de la CJUE (33)). Ensuite, la BCE ne devrait pas racheter plus d’un tiers de la dette par émetteur et 25 % par émission. Enfin, seuls les titres de dette qui ont une notation financière comprise entre AAA et BBB- pourront bénéficier du programme de rachats, sauf si l’État concerné est engagé dans un programme d’assistance financière. Ainsi, la Grèce, dont la notation est inférieure à la fourchette mentionnée, ne pourra bénéficier dans les mois à venir du programme de la BCE qu’à la condition que son programme d’assistance financière soit reconduit.
L’initiative de la BCE peut également être considérée comme tardive, puisqu’elle intervient alors que l’activité stagne depuis plusieurs mois et que le risque de déflation est évoqué depuis plus d’un an. D’autres banques centrales (la Réserve fédérale américaine, la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon), dont les mandats sont toutefois plus clairement définis, ont ainsi lancé des programmes d’assouplissement quantitatif beaucoup plus tôt. La FED réduit d’ailleurs le sien depuis un an.
Il convient enfin d’être vigilant pour que cette injection massive de liquidités n’entraîne pas la constitution de bulles financières, comme peut le laisser craindre l’euphorie des bourses européennes depuis le mois de janvier.
Au total, ce nouveau programme a pour objectifs affichés de maintenir la stabilité des prix en zone euro et de rétablir des conditions normales d’accès au crédit, mais également de favoriser, indirectement, l’ajustement en zone euro.
Toutefois, ses effets sur l’économie réelle risquent d’être limités – compte tenu des conditions qui encadrent sa mise en œuvre – voire contreproductifs – compte tenu des risques de formation de bulles financières.
En outre, ainsi que l’a souligné M. Clément Fontan, chercheur à l’université de Montréal, lors de son audition par le Rapporteur, si l’on ne connaît pas précisément les effets de l’assouplissement quantitatif sur l’économie réelle, les premières études tendraient à montrer qu’il contribuerait surtout à consolider le système bancaire et à renforcer le prix des actifs, bénéficiant ainsi aux plus riches. Le « quantitative easing » aurait ainsi pour conséquence de renforcer les inégalités.
Cette analyse est confortée par la Banque d’Angleterre qui estime, dans une étude de juillet 2012 consacrée aux effets redistributifs du « quantitative easing » que, si cette politique permet de soutenir la croissance et l’emploi, elle peut engendrer des bulles spéculatives sur certains actifs financiers ou immobiliers et bénéficie avant tout aux classes les plus favorisées de la population, qui détiennent les actifs dont la valeur s’apprécie sous l’effet du « quantitative easing » (34).
Par conséquent, le Rapporteur considère qu’il faut davantage veiller à la dimension redistributive de la politique monétaire menée par la BCE. À cet effet, il convient de suivre plusieurs indicateurs relatifs aux effets de la politique monétaire de la BCE sur l’économie réelle et sur l’évolution des inégalités. En effet, des inégalités importantes ont un impact négatif sur la croissance économique.
Depuis le début de la crise en 2008, la Banque centrale européenne s’est affirmée comme un acteur institutionnel majeur au niveau de la zone euro, d’autant plus facilement que les États membres éprouvaient des difficultés à définir des positions communes.
Sans revenir sur sa présence plus que contestable au sein de la « troïka » (cf. supra II.A.1.b), force est de constater que la Banque centrale européenne exerce, de fait, un rôle politique de premier plan, qui n’est pas prévu dans les traités, alors que le principe même de son indépendance totale y demeure gravé.
Ainsi, le président de la Banque centrale européenne formule régulièrement des recommandations aux États membres. Lors de la présentation du programme d’assouplissement quantitatif le 22 janvier 2015, le président de la BCE a rappelé que la politique monétaire ne suffisait pas pour relancer la croissance et que d’autres mesures étaient nécessaires. Il a explicitement mentionné les réformes structurelles de nature à améliorer l’investissement et la création d’emploi et à augmenter la productivité. Il a également indiqué que les politiques budgétaires devaient être mises au service de la relance économique tout en assurant la soutenabilité de la dette, en accord avec les règles du pacte de stabilité, semblant ainsi outrepasser le mandat de son institution.
Dans le cas des pays sous programme d’ajustement, la BCE va encore plus loin, puisqu’elle dicte ses conditions – ses partenaires de la « troïka » étant moins puissants et la validation de l’Eurogroupe paraissant une simple formalité. À cet égard, il convient de souligner qu’avec la BCE, il y a deux poids, deux mesures. Pour la Grèce et les autres pays européens ayant « bénéficié » de l’aide de la zone euro, l’assistance a été accordée en contrepartie de la mise en place de mesures de flexibilisation et de réduction aveugle des dépenses publiques, tandis que le soutien plus général apporté par la BCE aux autres États n’est pas soumis à conditions.
Comme l’a souligné M. Clément Fontan lors de son audition, « la BCE est un acteur politique avec un agenda précis. Elle n’est pas neutre et a le pouvoir d’imposer sa vision du monde. »
Cette évolution du rôle de la BCE appelle nécessairement un contrepoids politique fort. Plusieurs options sont possibles. Le contrôle de l’action de la BCE par le Parlement européen pourrait être sensiblement renforcé ; une réelle gouvernance de la BCE par le Conseil européen pourrait être mise en place. L’indépendance affichée actuellement traduit, en fait, de l’avis du Rapporteur, une dépendance aux exigences des marchés financiers.
S’affranchir de la tutelle des marchés financiers passe notamment par l’instauration d’une véritable régulation du secteur bancaire et la mise en œuvre d’une taxe européenne sur les transactions financières digne de ce nom.
Depuis le déclenchement de la crise financière en 2008, chaque pays européen a dû faire face aux difficultés rencontrées par au moins un de ses établissements bancaires.
Il en va notamment ainsi du Royaume-Uni, où la défaillance de Northern Rock a entraîné une ruée des déposants aux guichets à l’automne 2007 et où la Royal Bank of Scotland et Barclays ont également été touchées, de l’Espagne, avec le sauvetage de Bankia et des caisses d’épargne, de l’Italie, où la Banca Monte dei Paschi di Siena a fait l’objet d’un renflouement par la banque centrale d’Italie, de l’Irlande, qui a dû mettre en place un plan de sauvetage de son système bancaire, de Chypre confrontée aux difficultés de la Laiki Bank et de la Bank of Cyprus, de l’Allemagne, où l’État a dû renflouer la Deutsche Bank et la Commerzbank et où la situation des Landesbank s’est révélée préoccupante, mais également de la France et de la Belgique, avec la défaillance de Dexia et, dans le cas français, les difficultés rencontrées par Natixis et le Crédit immobilier de France.
Si aucun modèle de banque – grande ou petite, spécialisée ou universelle, d’investissement ou de dépôt – n’a été épargné par la crise, leurs défaillances présentent toutefois des origines communes : une régulation prudentielle insuffisante, un défaut manifeste de supervision, l’existence d’un risque systémique et la prédominance d’un aléa moral favorisé par la garantie implicite de l’État qui a conduit le système financier à une prise de risque excessive et, in fine, à la mobilisation massive de concours publics.
Les faiblesses de la régulation bancaire et financière ainsi mises au jour ont conduit la Commission européenne à formuler plusieurs propositions législatives destinées à davantage encadrer le secteur bancaire selon cinq axes :
– renforcer les exigences prudentielles ;
– améliorer les mécanismes de supervision et de contrôle interne ;
– revoir la gouvernance et la responsabilité des dirigeants et des preneurs de risques ;
– mettre en place des dispositifs de prévention et de résolution des défaillances ;
– et, enfin, modifier la structure même des banques.
Au niveau de l’Union européenne, plusieurs textes ont donc été adoptés sous la précédente législature européenne, afin notamment de renforcer en termes quantitatifs et qualitatifs les exigences relatives aux fonds propres des banques et d’encadrer les bonus des banquiers (35), de moderniser le système de garantie des dépôts en prévoyant un élargissement du champ de la couverture et un relèvement à 100 000 euros du montant des dépôts garantis (36) et d’harmoniser les règles nationales en matière de prévention et de résolution des faillites bancaires (37).
Compte tenu des spécificités de la zone euro, les États qui en sont membres (38) ont en outre mis en place une union bancaire reposant, d’une part, sur un mécanisme unique de supervision, qui fait de la Banque centrale européenne le superviseur central des établissements bancaires de la zone euro en lien avec les autorités nationales de supervision (39) et, d’autre part, sur un mécanisme de résolution unique (40), assis sur un Conseil de résolution et un fonds de résolution européens, destinés à assurer un traitement plus efficace et juste des défaillances bancaires. Ce fonds reste néanmoins modeste au regard des risques encourus.
Toutefois, les leçons de la crise financière n’ont pas toutes été tirées. En particulier, aucun texte européen n’a pu, jusqu’à présent, être adopté au sujet de l’interdiction et du cantonnement des activités bancaires les plus risquées, condition pourtant essentielle à l’assainissement du secteur bancaire.
Alors que la précédente Commission européenne avait présenté, le 29 janvier 2014, une proposition de réforme structurelle du secteur bancaire européen qui allait dans le bons sens (41), plusieurs États membres, au premier rang desquels la France, ont tenté d’en atténuer la portée.
S’appuyant sur les conclusions présentées en octobre 2012 par le groupe d’experts de haut niveau présidé par M. Erkki Liikanen et chargé d’évaluer la nécessité de mener une réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union (42), la Commission européenne suggérait en effet de mener une réforme des banques jugées comme étant « trop importantes pour faire faillite » (« too big to fail »), c’est-à-dire les banques considérées comme trop grandes ou trop complexes, soit une trentaine de banques européennes. La Commission européenne privilégiait ainsi une approche automatique : dès lors qu’une banque dépassait une certaine taille, elle entrait dans le champ de la réglementation.
La proposition de réforme du secteur bancaire
présentée par la Commission européenne
Visant d’une part les banques considérées comme présentant un risque systémique (c’est-à-dire celles susceptibles de mettre en danger le système financier) au niveau mondial et d’autre part les banques qui, pendant trois années consécutives, dépassent certains seuils d’activité (valeur totale des actifs de la banque supérieure à 30 milliards d’euros et valeur totale des actifs et passifs de son portefeuille de négociation supérieure à 70 milliards d’euros ou à 10 % de la valeur totale de ses actifs), la réforme proposée par la Commission européenne repose sur trois principes :
– l’interdiction de la négociation pour compte propre, c’est-à-dire les activités de négociation menées par la banque sur les instruments financiers et les matières premières pour son propre compte et à la seule fin de réaliser des profits ;
– l’attribution aux autorités de surveillance du pouvoir, voire dans certains cas de l’obligation, d’imposer le transfert d’autres activités de négociation à haut risque (telles que la tenue de marché, les produits dérivés complexes et les opérations de titrisation complexes) pour séparer, au sein du groupe, les entités juridiques qui pratiquent les activités de négociation ;
– l’adoption de règles relatives aux liens économiques, juridiques, opérationnels et de gouvernance entre l’entité de négociation et le reste du groupe bancaire.
Il s’agit ainsi d’interdire l’activité de négociation pour compte propre, qui comporte de nombreux risques sans apporter d’avantages aux clients des banques ni à l’économie dans son ensemble, mais également d’éviter que les banques ne puissent contourner l’interdiction de certaines activités de négociation en se livrant à des activités de négociation pour compte propre masquées.
Cette réforme, qui vise à séparer les activités de négociation (c’est-à-dire les activités de banque d’investissement) des activités traditionnelles de dépôt (dépôts, prêts et systèmes de paiement) selon une approche systématisée en fonction du risque, est la seule opérante pour confiner le risque et éviter sa contagion à l’économie réelle.
Néanmoins, plusieurs États membres, dont la France, qui souhaite préserver son système bancaire national et ses quatre plus grandes banques qui se trouvent expressément visées par la réforme, tentent d’en atténuer la portée.
On ne peut pourtant se contenter d’une réforme a minima – d’ailleurs peut-on vraiment parler de réforme ? – comme celle conduite par le Gouvernement en 2013 (43), qui aboutit à ce qu’une part minime (moins de 5 %) des activités les plus risquées soit cantonnée dans une filiale, ainsi qu’il ressortait des propos du président-directeur général de la Société générale lors de son audition par la commission des Finances en 2013. (44) Cette séparation bancaire « à la française » n’est en réalité qu’une séparation de façade.
Les discussions actuellement en cours au Conseil, qui devraient aboutir à la définition d’une approche générale en juin prochain, s’orientent vers une position intermédiaire entre la proposition initiale de la Commission européenne et la loi française, avec la définition de deux groupes d’établissements bancaires :
– un premier groupe, qualifié de « tier-one », ferait l’objet d’une séparation des activités de négociation pour compte propre (« activités spéculatives »), dans la même logique que celle figurant dans la loi française ;
– un second groupe, qualifié de « tier-two », ferait l’objet d’une évaluation des risques de l’ensemble des activités de marché, et non seulement des activités spéculatives. Ainsi, la décision de séparation de certaines activités ne serait pas automatique ou quasi-automatique, comme cela était suggéré dans la proposition de la Commission européenne, mais fondée sur une analyse des risques conduite activité par activité.
Les critères permettant de distinguer les banques relevant de la première ou de la deuxième catégorie ne sont pas encore définitivement arrêtés : la taille des groupes bancaires ou bien leur inscription sur la liste des institutions présentant un risque systémique (45) pourrait être retenu. En tout état de cause, BNP-Paribas, la Société générale et le Crédit agricole devraient relever du second groupe, qui devrait comprendre une douzaine d’établissements, tandis que BPCE pourrait, selon le critère retenu, figurer dans le second groupe ou le premier groupe, qui devrait recouvrer une quinzaine d’établissements.
Pour sa part, le Parlement européen n’a pas encore défini sa position.
Le Rapporteur considère que la position défendue par la France, qui vise à préserver les seuls intérêts de ses grandes banques nationales, est dangereuse pour l’économie française et européenne.
Aussi, alors que l’hypertrophie du secteur financier – le seul secteur bancaire représente 43 000 milliards d’euros, soit près de 350 % du PIB de l’Union – constitue une menace pour l’économie réelle et que les conditions (surabondance de liquidités, faiblesse des taux d’intérêt, sophistication croissante des outils financiers) semblent réunies pour la survenue d’une nouvelle crise financière, encore plus dévastatrice, il est impératif de mener une action résolue, afin de séparer les banques de détail et les banques d’investissement. Ainsi que l’a souligné M. Henri Sterdyniak, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), lors de son audition par le Rapporteur : « l’idéal serait d’avoir d’une part des banques de dépôts, où les particuliers déposeraient leur argent qui serait ensuite prêté aux PME et qui bénéficieraient de la garantie de la Banque centrale européenne et d’autre part des banques d’affaires, destinées aux plus riches, qui, elles, ne profiteraient pas de cette garantie ».
La régulation du secteur bancaire classique est vaine si elle ne concerne pas également le système bancaire parallèle ou « shadow banking », qui désigne les intermédiaires financiers non bancaires qui fournissent des services proches de ceux offerts par les banques commerciales, comme les fonds monétaires, les produits structurés ou encore les fonds spéculatifs (ou « hedge funds »).
Le système bancaire parallèle ou shadow banking system
Le Conseil de stabilité financière définit le système bancaire parallèle comme le système d’intermédiation de crédit auquel concourent des entités et activités qui ne font pas partie du système bancaire traditionnel. Peuvent être considérées comme des entités et des activités bancaires parallèles :
– les fonds monétaires (MMF, Money Market Funds) et autres types de fonds ou produits d’investissement qui présentent des caractéristiques de dépôt ;
– les fonds d’investissement qui procurent des crédits ou utilisent les mécanismes de levier, y compris les ETF (Exchange Traded Funds) et les hedge funds ;
– les sociétés de financement et entités spécialisées dans les titres qui fournissent des crédits ou des garanties de crédit, ou réalisent des opérations de transformation de liquidité ou d’échéance, sans être réglementées comme les banques ;
– les entreprises d’assurance et de réassurance qui émettent ou garantissent des produits de crédit ;
– la titrisation, les prêts de titres et les accords de pension livrée.
Le système bancaire parallèle assure en effet un quart de l’intermédiation financière et les actifs transitant par lui représentent la moitié des actifs du système bancaire traditionnel. Il connaît en outre une croissance quasi continue depuis 2002 pour représenter 53 000 milliards d’euros d’actifs en 2012, dont 23 000 milliards d’euros au sein de la zone euro, soit davantage qu’aux États-Unis (19 300 milliards d’euros).
Or, sept ans après la crise des « subprimes », les activités des institutions financières non bancaires demeurent mal voire pas régulées. Cette situation est d’autant plus inquiétante que les canaux de financement non bancaires peuvent devenir source de risque systémique, en particulier lorsqu’ils assument des fonctions traditionnellement réservées aux banques (comme la transformation ou l’effet de levier) ou lorsque les interconnexions avec le système bancaire sont fortes.
Le système bancaire parallèle doit donc être soumis à une surveillance et à une régulation appropriées pour faire face aux risques financiers qui émergent en dehors du système bancaire classique et assurer des conditions de concurrence loyale.
Dans cet objectif, la Commission européenne a présenté, en complément de son projet de réforme du secteur bancaire, une proposition de règlement destinée à renforcer la transparence de certaines opérations extérieures au secteur bancaire régulé. (46) Afin d’assurer un meilleur contrôle, elle propose plusieurs mesures pour améliorer la lisibilité des opérations de financement sur titres pour les autorités de réglementation et les investisseurs. Lors de la crise financière, ces opérations ont en effet été source de contagion et d’effets pro-cycliques.
La proposition de règlement sur les opérations de financement sur titres présentée par la Commission européenne
La proposition de règlement de la Commission européenne prévoit plusieurs mesures destinées à améliorer la transparence dans trois domaines :
– le suivi de l’accumulation des risques systémiques liés aux opérations de financement sur titres dans le système financier ;
– la communication d’informations aux investisseurs dont les actifs sont utilisés dans ce type de transactions ou dans des transactions équivalentes ;
– la transparence des contrats relatifs aux activités de réaffectation de sûretés reçues en garantie.
Cette proposition a fait l’objet d’un accord au Conseil en décembre 2014 et au sein de la commission chargée des affaires économiques au Parlement européen en mars 2015. Les échanges entre les institutions devraient commencer avec un premier trilogue, le 28 avril 2015, l’objectif d’un accord politique étant fixé pour le mois de juin au plus tard.
Par ailleurs, la Commission européenne a présenté, le 4 septembre 2013, une proposition de règlement destinée à fixer un cadre juridique européen pour les fonds monétaires (47), qui sont une source importante de financement à court terme pour les institutions financières, les entreprises et les gouvernements (48). Alors que le montant des créances gérées par ces fonds est de l’ordre de 1 000 milliards d’euros, les fonds monétaires ne sont pas couverts par une garantie des dépôts bancaires et sont soumis aux risques de marché inhérents à tout fonds.
La proposition de règlement sur les fonds monétaires présentée par la Commission européenne
Afin de renforcer leur liquidité et leur stabilité, les fonds monétaires seraient soumis aux obligations suivantes :
– accroître leur liquidité, afin de pouvoir satisfaire les demandes de remboursement des investisseurs ;
– analyser le profil des clients, afin de mieux anticiper les demandes de remboursement massives ;
– distinguer clairement les types de fonds monétaires, de telle sorte que les investisseurs sachent à quoi ils s’engagent auprès de ces fonds ;
– constituer une réserve de capital de 3 %, afin d’assurer la stabilité de la valeur des parts et de réduire les conséquences des demandes de remboursement ;
– évaluer les risques de crédit en interne, afin d’éliminer la dépendance systématique à l’égard des notations externes.
Alors qu’il apparaît nécessaire de mieux encadrer les fonds monétaires, le Parlement européen doit adopter sa position sur la proposition de la Commission européenne en séance plénière le 28 avril 2015, tandis que les discussions au Conseil semblent bloquées.
Ces propositions ne constituent toutefois qu’un embryon de régulation et doivent être rapidement complétées afin de mettre en place une véritable régulation du système bancaire parallèle.
Mieux encadrer le système financier européen suppose également de mettre en place une taxe européenne sur les transactions financières large et ambitieuse, à même de réguler la finance et de générer des recettes fiscales importantes.
Toutefois, alors que la Commission européenne a formulé deux propositions destinées à créer une taxe sur les transactions financières au niveau européen – une première en 2011 concernant les 27 États membres de l’Union (49), qui a dû être abandonnée en juin 2012 devant le constat de l’impossibilité d’obtenir l’unanimité requise dans le domaine de la fiscalité au sein du Conseil, l’autre en 2013 dans le cadre d’une coopération renforcée réunissant onze États membres (50) désireux de trouver un accord en la matière (51) –, ces États ne sont toujours pas parvenus à un accord. Tandis que la proposition de la Commission européenne présentait l’intérêt d’une taxation large, les États butent sur la définition des champs matériel et territorial de la taxe.
Les principales caractéristiques de la taxe sur les transactions financières proposée par la Commission européenne
– Une assiette large, qui vise l’ensemble du marché secondaire des actions et des obligations ainsi que l’intégralité des produits dérivés. Seraient toutefois exclues les transactions réalisées avec la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales afin d’éviter toute incidence négative sur les possibilités de refinancement des établissements financiers ou sur les politiques monétaires en général.
– Des taux faibles et différenciés : si chaque État membre fixe le taux de la taxe, celui-ci ne peut être inférieur à 0,1 % pour les actions et les obligations et à 0,01 % pour les autres transactions financières.
– L’application du principe de résidence : pour qu’une transaction financière soit imposable dans l’Union, l’une des parties à la transaction doit être établie sur le territoire d’un État membre. Il s’agirait ainsi de réduire les risques de fraude, d’évasion et d’abus.
Alors qu’en mai 2014 les ministres des finances des onze États participant à la coopération renforcée avaient annoncé un calendrier ambitieux avec la définition de « solutions techniques viables » d’ici à la fin de l’année 2014, le Conseil Ecofin du 9 décembre 2014 s’est ainsi conclu sur un constat d’échec.
À cet égard, la position défendue par la France, pourtant instigatrice d’une taxe nationale sur les transactions financières, s’est avérée pour le moins ambiguë.
Soucieux de préserver les intérêts des grandes banques françaises très actives sur les marchés de produits dérivés, le ministre des Finances et des comptes publics, M. Michel Sapin, a ainsi pendant longtemps défendu une taxation des actions et, parmi les produits dérivés, des seuls CDS (credit default swaps (52)). Ainsi qu’il l’avait indiqué lors de son audition par la commission des Affaires européennes le 3 décembre 2014 : « Nous ne devons pas perdre de vue qu’à l’origine, la taxe sur les transactions financières n’avait pas pour objet de rapporter de l’argent mais, en renchérissant le coût de certaines opérations, d’introduire un grain de sable dans des mécanismes financiers à caractère dangereux, afin d’en dissuader le recours. […] Cependant, il ne faut pas trop renchérir le coût des transactions, certains produits dérivés garantis étant absolument indispensables : ainsi, le fait de se garantir contre l’évolution de la valeur de la monnaie dans laquelle s’effectue une transaction est-il une bonne chose, de même que le fait pour un agriculteur de se garantir contre l’évolution erratique des prix agricoles. Ce n’est que lorsque ce produit dérivé est mis en œuvre à des fins de spéculation, perdant ainsi sa fonction première de sécurisation des marchés et des acteurs économiques, que son utilisation doit faire l’objet d’une régulation. » (53) Le ministre a également prôné l’application du principe d’émission pour déterminer l’assiette de la taxe et du principe de résidence pour définir l’État bénéficiaire de l’impôt levé.
C’est donc le principe d’une taxe sur les transactions financières au rabais qui était défendu par la France, jusqu’à ce que le Président de la République se prononce, le 5 janvier 2015, en faveur d’une taxe portant sur « tous les produits de la finance ».
Depuis, le ministre chargé des finances Michel Sapin et son homologue autrichien M. Hans-Jörg Schelling ont adressé, à la fin du mois de janvier 2015, un courrier à leurs homologues des neuf autres États parties à la coopération renforcée, afin de reprendre les travaux en partant du principe que « la taxe sur les transactions financières devra reposer sur une assiette la plus large possible, associée à des taux faibles ». Ils ajoutent toutefois que « nous devrons être attentifs à la définition précise des éléments techniques de la taxe, afin de limiter les risques de délocalisation de l’activité qui ne feraient que déplacer les transactions financières hors des pays ayant mis en œuvre la taxe, sans réduire pour autant les activités spéculatives, et tout en abaissant les recettes attendues de la taxe. »
Sur le fondement des propositions franco-autrichiennes, les onze États de la coopération renforcée ont alors réaffirmé leur engagement à créer les conditions d’une entrée en vigueur de la future taxe financière le 1er janvier 2016 et revu leur méthode de travail. Les travaux sont désormais dirigés par l’Autriche au niveau politique, le Portugal étant chargé d’animer le groupe technique, auquel la Commission européenne est davantage associée. Toutefois, aucune avancée décisive n’est, jusqu’à présent intervenue, et l’on ne peut exclure le risque d’un nouvel enlisement.
Il convient pourtant de parvenir au plus vite à un accord, d’autant plus que, selon les estimations, le produit de la taxe sur les transactions financières, tel que calculé sur la base de la proposition de la Commission européenne, s’élèverait à environ 35 milliards d’euros pour les onze États selon la Commission européenne, d’autres instituts se montrant plus optimistes et prévoyant une fourchette comprise entre 14 et 36 milliards d’euros pour la seule France (selon l’institut de recherche économique allemand DIW).
Au total, le Rapporteur considère que les propositions de la Commission européenne en matière de régulation financière doivent être mises en œuvre rapidement. Pour autant, elles ne constituent qu’une première esquisse : il convient d’aller jusqu’au bout de la logique de régulation financière, notamment en limitant au maximum les comportements spéculatifs grâce à un encadrement plus rigoureux des revenus excessifs des traders et à l’interdiction des produits financiers toxiques et inutiles pour l’économie réelle.
La Commission, au cours de sa séance du 22 avril 2015 à 10 heures 30, examine la proposition de résolution européenne relative à la dette souveraine des États de la zone euro (n° 2723.)
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Si la commission des Finances veut gagner du temps, je lui suggère d’adopter la proposition de résolution européenne que je présente : elle n’aura plus besoin d’entendre les membres du Gouvernement qui doivent s’exprimer devant elle tout à l’heure car les problèmes traités par le programme de stabilité et le programme national de réforme seront réglés autrement. Vous conviendrez que l’argument vaut son pesant d’or !
Plus sérieusement, cette proposition de résolution européenne a été adoptée par la commission des Affaires européennes avec le plus petit des scores – le même aurait tout de même fait le bonheur du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Quel que soit son sort au sein de notre Commission – je souhaite évidemment qu’il soit au moins aussi favorable que la semaine dernière, mais je n’en suis pas sûr –, elle sera examinée au cours de la première séance publique du jeudi 7 mai puisque le groupe GDR a demandé son inscription dans une séance dont il a fixé l’ordre du jour.
Plutôt que vous lire l’exposé des motifs de la proposition de résolution, je souhaite vous expliquer, le moins mal possible, ce qui a motivé le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, et d’abord les députés du Front de gauche, pour inscrire ce texte dans leur « niche » parlementaire.
Pour nous, la dette est un formidable moyen de pression et de domination qui sert les intérêts d’une politique précise : celle qui consiste à favoriser les politiques publiques récessives, austéritaires parfois, en s’inscrivant en tout cas dans la tradition du libéralisme triomphant de ces dernières décennies. À ce sujet, je ne résiste pas à l’envie de vous citer la fameuse note rédigée en 2010 par le FMI : « Les pressions des marchés pourraient réussir là où les autres approches ont échoué. Lorsqu’elles font face à des conditions insoutenables, les autorités nationales saisissent souvent l’occasion pour mettre en œuvre des réformes considérées comme difficiles, comme le montrent les exemples de la Grèce et de l’Espagne. »
Ce que ne disait pas encore le FMI, c’est que les réformes « considérées comme difficiles » provoquent des dégâts humains, sociaux et économiques considérables. Je ne reviens pas sur les plans d’ajustement imposés aux peuples espagnol, grec et portugais ni sur la remise en cause de droits humains comme le droit à la santé – le nombre de personnes mal soignées a augmenté en Grèce ainsi que le nombre de suicides – ou le droit au logement bafoué pour de nombreuses familles espagnoles. Notre pays lui-même, à un degré moindre, a également subi des ajustements qui ont touché notre peuple : ainsi la « réforme Fillon » des retraites de 2010. Alors que le président Sarkozy avait annoncé qu’il ne toucherait pas aux retraites, cette réforme a été mise en œuvre pour maintenir la crédibilité financière de la France, comme François Fillon le disait lui-même. Je pense aussi au revirement de François Hollande et à son choix exclusif, en novembre 2012, confirmé en 2014, d’un allégement massif des prélèvements sur les entreprises, ce qui s’est répercuté de facto sur la consistance du service public et sur le soutien à la demande.
Cette dette, et c’est encore plus vrai avec ce chiffre magique de 2 000 milliards d’euros, est donc une justification très forte des politiques publiques néolibérales qui ont triomphé depuis trente ans. Je consacrerai un important passage de mon rapport à ce sujet. Cette approche est d’autant plus contestable que l’on pourrait parler de dette illégitime, du moins pour une partie de son montant.
D’abord en raison de ce que l’on nomme l’effet « boule de neige ». Les taux d’intérêt bien supérieurs à la croissance dans les années 1980-1990 ont contribué à gonfler la dette au bénéfice de ses détenteurs. Un rapport de la commission des Finances du Sénat soulignait, en 1998, que s’ils avaient été « financés par des emprunts dont la rémunération est égale au taux de croissance courant, les déficits primaires structurels enregistrés depuis 1980 n’auraient contribué qu’à hauteur de 17,1 points de PIB à l’augmentation du ratio d’endettement, contre 29,3 actuellement. L’écart atteint alors 12,2 points de PIB, les déficits primaires structurels ayant été quasi continuellement financés à des taux d’intérêt supérieurs au taux de croissance. »
Ensuite, en raison d’une baisse des prélèvements sur les classes les plus aisées comme l’ont montré, en 2010, un fameux rapport du rapporteur général de notre Commission, notre actuel président, puis le rapport sur la situation des finances publiques de MM. Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis.
Au total, nous aurions pu et dû éviter trente points de dette ! Le contexte de concurrence fiscale permise par l’Europe et l’évasion fiscale n’ont fait qu’aggraver les choses.
Cette évolution n’a été possible que parce que l’on a démantelé le circuit du Trésor sans mettre en œuvre un équivalent européen. En 2008, quand survient la crise économique et financière, le pays et la zone euro sont déjà fortement endettés du fait d’un choix clair en faveur des plus aisés. Le transfert des dettes privées vers la dette publique, le sauvetage des banques et le soutien à l’activité par l’accroissement des déficits vont faire exploser encore davantage les dettes souveraines des États de la zone euro. Ce n’est pas une première dans l’histoire ; ce n’est pas non plus propre à la seule zone euro. Vous comprendrez dès lors que les remèdes proposés ne sont, à notre sens, opérants ni pour résoudre la crise ni pour trouver un chemin alternatif.
En commission des Affaires européennes, j’ai été interrogé sur la situation de la France, qui emprunte aujourd’hui à des taux très bas – le ministre a évoqué un taux de 0,43 %. Il faut bien voir que la mise sur le marché de liquidités de façon massive par la BCE recèle un danger car cela risque de créer une bulle financière pouvant exploser à tout moment. Aujourd’hui, les États ne seraient sans doute pas en mesure de réagir comme ils l’ont fait en 2007 ou 2008. Cette bulle semble bien voir le jour comme le montre, depuis trois mois, l’envolée du CAC 40 sous l’effet des rachats d’actions en masse.
Il y a donc urgence à proposer un autre chemin. Il s’articule autour des six points de la résolution.
Premier point : une grande conférence sur la dette devrait rassembler les gouvernements mais aussi les citoyens. La présidente du Parlement grec a lancé il y a un mois le Comité pour la vérité sur la dette qui s’appuie sur des experts ainsi que sur des associations grecques et internationales, comme cela s’est déjà produit en Équateur. Dans le cas grec, se pose la question d’une solution qui ne passe pas par les exigences de la « troïka » : il existe un réel besoin de moratoire, le temps de définir la part de dette qu’il faudrait restructurer, voire annuler.
Le deuxième point a trait à la transparence. J’ai enfin eu un contact avec l’Agence France Trésor. Si le circuit d’émission de la dette et la connaissance des titres émis ne posent pas de problème, en revanche, l’opacité règne une fois que l’on passe par la chambre de compensation, que ce soit Euroclear ou SWIFT. Il serait tout de même bien de savoir si ce sont les princes qataris ou le parti communiste chinois qui détiennent la dette de la France.
M. Dominique Baert. Les deux !
M. le rapporteur. Si c’est le parti communiste chinois, je suis d’accord... Je vous rassure, je plaisante.
Troisièmement, nous souhaitons également désintoxiquer pour partie la dette du circuit des marchés financiers. Cela peut se faire au niveau européen : j’évoquais d’un circuit du Trésor européen qui pourrait passer par un système de réserves obligatoires comme cela se pratiquait dans les années cinquante, soixante et soixante-dix, avec un plancher du Trésor.
Quatrièmement, pour éviter l’emballement des circuits financiers, créateurs d’insécurité, nous proposons une véritable séparation bancaire – nous pensons que la loi bancaire a raté son objectif –, et la mise en place d’une taxe sur les transactions bancaires qui soit digne de ce nom, c’est-à-dire assise sur une assiette large.
Le cinquième point concerne les objectifs de la Banque centrale européenne – BCE. La BCE va au-delà des traités ou tout au moins les interprète de manière très large. L’encadrement budgétaire des États se fonde par exemple sur une interprétation extensive de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le rôle de la BCE et de la politique monétaire dans le cadre d’un soutien à l’activité et à la réduction des inégalités doit être repensé. Ce n’est ni plus ni moins que le débat sur l’indépendance de la BCE que nous souhaitons relancer.
Le sixième point, enfin, appelle à la mise en œuvre d’un réel pacte de croissance ainsi que d’une harmonisation fiscale et sociale dans un contexte où la concurrence prévaut et met à mal l’Union économique et monétaire – avec la bénédiction de tous : nos établissements bancaires et nos multinationales font, comme les autres, leur miel de ces distorsions, et parfois même des paradis fiscaux.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec moi sur ce texte, ainsi que les personnes que j’ai entendues afin de préparer mon rapport : MM. Pascal Franchet, vice-président France du Comité d’annulation pour la dette du Tiers-Monde, Clément Fontan, chercheur à l’université de Montréal, auteur d’une thèse sur l’évolution du rôle de la BCE, Henri Sterdyniak, directeur du département économie de l’Observatoire français de conjoncture économique – OFCE –, Benjamin Lemoine, chercheur à Sciences Po, auteur des travaux sur la mise en marché de la dette publique française, Michel Husson, membre du Comité pour la vérité de la dette grecque et membre du conseil scientifique d’ATTAC, Thomas Coutrot, économiste et membre des Économistes atterrés à l’initiative de l’audit citoyen de la dette, et Stéphane de la Rosa, professeur à l’université de Valenciennes, spécialiste de la gouvernance économique européenne.
Cette proposition de résolution, je l’ai dit, a été adoptée avec le plus petit score par la commission des Affaires européennes. Je ne doute pas que mes collègues de la commission des Finances auront à cœur de montrer leur solidarité et leur talent en la faisant gagner plus largement.
M. le président Gilles Carrez. La dette est un sujet majeur. Je suis d’accord avec Nicolas Sansu sur un point : nos problèmes à venir viendront de la dette et de la remontée des taux d’intérêt. Ce sera l’heure de vérité. Il reste que les marchés financiers cloués au pilori par la proposition de résolution permettent aujourd’hui à la France de se financer à coût nul, y compris en raisonnant en taux d’intérêt réels.
M. Olivier Carré. Parfois même à taux négatifs !
M. le président Gilles Carrez. Cela relativise un peu le diagnostic. Il est vrai, comme l’a rappelé Nicolas Sansu, que, par le passé, des taux réels extrêmement élevés ont permis aux créanciers de se constituer des réserves financières colossales. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, même si j’ai la conviction que la situation actuelle ne peut pas durer – nous le répétons depuis des années, même si les taux ne font que baisser. Quand on compare l’exécution 2013 et 2014 de l’ensemble des comptes publics, on constate que les frais financiers, c’est-à-dire les intérêts de la dette, diminuent légèrement en valeur courante alors qu’il a fallu financer plus de 80 milliards d’euros supplémentaires pour couvrir le déficit de quatre points de 2014. Autrement dit, la dette a augmenté, mais les frais financiers ont diminué parce que l’économie liée au refinancement par des prêts à 1 % de la fraction en capital de nos 2 000 milliards d’euros tombés en 2014 – constituée pour partie par des emprunts contractés lors de la crise financière à 3 ou 4 % – est plus importante que le surcoût lié à l’accroissement de l’endettement. À l’évidence, il s’agit d’une situation...
M. Charles de Courson. Précaire !
M. le président Gilles Carrez. ... disons temporaire.
Je remercie enfin Nicolas Sansu d’avoir cité mon rapport de 2010 : c’est une analyse qui, rétrospectivement, donne à réfléchir.
M. Christophe Caresche. Cette proposition de résolution veut affirmer un certain nombre de positions et engager un débat sur la dette. Cela semble tout à fait légitime, et il paraît tout à fait positif que l’Assemblée nationale s’exprime sur ce sujet aussi bien au sein des commissions qu’en séance publique.
La logique qui sous-tend le texte est assez différente de celle qui prévaut aujourd’hui, notamment concernant le financement par une banque centrale placée sous l’étroite autorité de la souveraineté politique. Nous voyons bien quelle logique est à l’œuvre et à quel point elle est loin des pratiques actuelles.
Le président Carrez a raison de souligner que les marchés, desquels il nous est proposé de sortir, nous permettent aujourd’hui d’emprunter pratiquement à des taux négatifs, ce qui est plutôt une bonne chose même si cela n’a pas vocation à durer. Notons que lorsque la Grèce est sortie des marchés, son financement a été assuré par les États, par le Fonds européen de stabilité financière – FESF –, puis par le mécanisme européen de stabilité
– MES. D’un certain point de vue, la situation de la Grèce aujourd’hui est liée à une problématique non de marchés, mais bien de financement par les États.
Les propositions de la résolution concernant la Banque centrale européenne me paraissent un peu contradictoires. Nous pouvons saluer le fait que la BCE ait décidé d’une politique d’expansion monétaire dans un contexte de quasi-déflation. Je veux bien que l’on parle de risque de bulle spéculative, mais l’urgence commandait de faire redémarrer la croissance en Europe. Et malgré un statut d’autonomie critiqué, force est de reconnaître que la BCE a réussi à prendre ces dernières années des décisions que l’on n’aurait pas pu imaginer de sa part au moment de sa constitution.
Le groupe socialiste considère qu’il faut essayer d’emprunter une trajectoire de mutualisation de la dette au niveau européen, ce qui signifie aussi qu’il faut plus d’intégration économique et politique. Dans une zone monétaire unique, l’idée est de disposer d’instruments d’émission de dette communs avec, par exemple, un Trésor européen. Les propositions faites en ce sens par M. Michel Aglietta nous semblent intéressantes. Si on laisse en revanche chaque État responsable de sa dette, cela ne marche pas. Il faut donc aller dans cette direction, même si les réticences et les résistances peuvent être fortes.
M. Dominique Lefebvre. Le débat sur la dette est non seulement légitime, mais également utile et nécessaire.
Nous partageons une partie des analyses développées dans l’exposé des motifs de la proposition de résolution de notre collègue Nicolas Sansu mais, au final, pas complètement sa logique, et certainement pas ses propositions.
La question de la dette française doit être replacée dans une perspective longue. Il ne faut pas mentir aux Français sur l’origine de la dette : le principal des 2 000 milliards d’euros de dette publique ne résulte pas de la crise financière. Le doublement de la dette entre 2002 et 2012 est d’abord lié à l’accumulation sur une longue période de déficits publics et sociaux sans qu’il n’ait jamais été démontré que cette politique constante ait donné des résultats en termes de croissance ou de compétitivité.
En entamant un débat sur la dette, il faut être clair sur la façon dont on entend faire évoluer la trajectoire des comptes publics. Une partie des réponses aux questions posées par Nicolas Sansu se trouve dans l’orientation choisie par le Gouvernement, soutenue par le groupe socialiste : une politique de soutien à la croissance dans le cadre d’une réduction progressive des déficits publics qui ne mette pas en cause le retour de l’activité. Historiquement, la croissance constitue bien, avec l’inflation, l’un des deux moteurs à même de faire se dégonfler la dette.
La question de la transparence nous revient chaque année, notamment à l’occasion du rapport spécial consacré à ces sujets, qu’il m’a un temps été donné de rédiger. Certains éléments de transparence sont à l’évidence nécessaires. Il est vrai que nous ne sommes pas en mesure de savoir en permanence qui détient la dette française. Nous savons cependant qu’elle est détenue pour près des deux tiers par des étrangers. Ce mouvement d’internationalisation est rendu nécessaire à partir du moment où l’on empile les déficits publics : il faut bien se financer. Si l’on veut réduire la dépendance par rapport à l’étranger, commençons par réduire les déficits publics plutôt que de chercher à faire défaut sur la dette ou à trouver d’autres modes de financement.
Sur plusieurs points enfin, les termes de résolution sont plutôt durs. Contrairement à ce que dit Nicolas Sansu, nous ne menons pas de politique d’austérité en France ; nous ne voterons pas une résolution qui tendrait à le laisser croire. La proposition de résolution appelle aussi à avancer en matière de régulation ; or, la régulation des marchés financiers existe déjà. Des dispositions ont été prises à l’échelon national, mais aussi à l’échelon européen sur la régulation bancaire et la régulation des marchés financiers. Il faut continuer dans cette voie.
Quoi qu’il en soit, le débat a le mérite d’exister et je salue l’initiative de notre collègue qui l’a lancé.
M. le président Gilles Carrez. Nicolas Sansu a cité mon rapport de 2010. À cette époque, nous commencions à observer une érosion des recettes fiscales en raison de la crise. Je me suis interrogé sur la dette, dont nous savions qu’elle était le résultat de déficits accumulés depuis quarante ans en raison d’un écart persistant entre les dépenses et les recettes. N’avions-nous pas pris depuis une douzaine d’années des mesures aboutissant à altérer...
M. Henri Emmanuelli. Creuser !
M. le président Gilles Carrez. ... les recettes ? Indépendamment des effets de la crise, cette situation ne tenait-elle pas à une accumulation de mesures dont nous n’avions pas pris conscience en termes de pression fiscale ?
Mon étude a porté sur dix ans. En 2000 était mis en œuvre le plan Fabius. M. Fabius, le ministre de l’Économie et des finances de l’époque, considérait que la majorité courrait les plus grands dangers si elle n’était pas capable de baisser les impôts. Des baisses considérables ont été décidées, qui ont porté sur plusieurs dizaines de milliards : baisse d’un point de la TVA, baisse de l’impôt sur le revenu, suppression de plusieurs impôts locaux comme la vignette automobile... Ce mouvement s’est poursuivi en 2002. Si aujourd’hui, on se demande quelle majorité a le plus augmenté les impôts, avant ou après 2012 – comme toujours, dans ce genre de débat, ce sont les deux –, en 2010, je montrais déjà qu’en termes de baisse d’impôts nous avions fait montre d’une continuité extraordinaire ! J’avais chiffré à 100 milliards d’euros le total des baisses d’impôts cumulées en dix ans, avec un tiers sous la majorité menée par M. Jospin et deux tiers sous la majorité suivante.
M. Henri Emmanuelli. On a diminué les recettes sans en faire autant avec les dépenses !
M. le président Gilles Carrez. Par rapport à des dépenses qui restaient structurellement à peu près constantes, je me demandais en 2010 s’il avait été bien raisonnable de diminuer ainsi les recettes. Cette diminution de recettes n’avait-elle pas été financée par la dette ?
À partir de 2010, le mouvement s’est inversé et les recettes ont augmenté pour un montant atteignant quasiment 100 milliards d’euros, ce qui amène à se poser une autre question, celle de la stabilité fiscale. La bonne fiscalité ne devrait-elle pas être pas d’abord dédiée à couvrir des dépenses, avant de chercher à modifier les comportements des agents économiques dans tel ou tel sens, et adaptée à un niveau de dépenses reflétant le consensus politique de la société ?
Lorsque l’on se pose la question dans ces termes, force est de constater une grande continuité de fait, quelles qu’aient été les majorités.
M. Christophe Caresche. Mais pas dans la rigueur !
M. le rapporteur. Je pensais qu’on avait encore la possibilité d’influer sur le cours des choses ! Il semblerait, à entendre Gilles Carrez, que les mêmes politiques semblent s’imposer à toutes les majorités ; je ne vous cache pas mes inquiétudes quant aux conclusions que l’on pourrait tirer d’un tel constat.
Mme Véronique Louwagie. Depuis le début de la crise financière, certains pays européens ont connu une très forte progression de leur dette publique, liée notamment à l’augmentation de leurs dépenses destinées à soutenir leur économie et leur système bancaire. L’article unique du texte examiné contient six propositions, au premier abord alléchantes. Ainsi, nous pouvons tous tomber d’accord sur la nécessité d’organiser un débat : la crise de la dette souveraine a conduit l’Union européenne à mettre en place un dispositif pour protéger la zone euro, mais malgré les premiers signes de reprise, le poids de la dette reste relativement important. Nous pouvons également vous rejoindre sur l’exigence de transparence et de régularité de l’information. Nous avons enfin tous réfléchi à la mise en place d’outils de financement de l’action publique autres que le recours aux marchés financiers.
En revanche, les deux points suivants – la proposition de séparation des activités bancaires et la mise en place d’une taxation européenne large des transactions financières – m’interpellent davantage. Le chantier de la régulation du secteur financier a déjà été lancé par l’ancienne majorité, le président Sarkozy étant le premier chef d’État à avoir mis cette taxe à l’ordre du jour du G20. Aujourd’hui, son assiette reste à déterminer, alors que les éléments chiffrés à la fois sur ses recettes et sur son impact font défaut. Mais la crise de la politique monétaire de la BCE doit être relativisée : le récent programme de rachat de la dette publique par la banque centrale a ainsi permis de redonner confiance aux marchés, et il faut s’y inscrire pour faire repartir la croissance et éviter que la zone euro ne tombe en déflation.
Enfin, nous ne saurions approuver l’idée de stopper les politiques d’austérité. La fin du sérieux budgétaire que vous préconisez, monsieur Sansu, apparaît déconnectée des réalités économiques et européennes. Notre pays doit respecter ses obligations vis-à-vis de Bruxelles ; or, depuis quelques mois, aucun message fort n’a été envoyé en ce sens, alors que les échecs et les promesses non tenues décrédibilisent la parole de la France. La maîtrise durable de la dette ne peut passer que par une réduction des déficits et par un rétablissement contrôlé des comptes publics ; cela implique des réformes structurelles courageuses que ce Gouvernement ne semble pas prêt à engager.
M. Éric Alauzet. Merci, monsieur Sansu, d’avoir été à l’initiative de ce débat essentiel ! Le groupe écologiste est d’accord avec la plupart de vos six propositions, mais regrette que la dernière d’entre elles désigne l’austérité budgétaire comme seule origine de la dette, sans mentionner la problématique de l’illégitimité de celle-ci, même si c’est porteur d’un risque d’irresponsabilité. Je m’explique : s’agissant du capital, chacun doit être responsable des décisions qu’il a prises à un moment donné. Mais l’histoire montre que le niveau des taux d’intérêt a épuisé les pays qui recouraient à l’emprunt alors que des bénéfices importants étaient réalisés par les créanciers. L’Europe pourrait donc aujourd’hui demander à ces derniers de consentir quelques efforts.
Le problème se présente différemment pour ce qui est du capital – on pourrait notamment s’interroger sur la répartition des richesses.
Gilles Carrez a évoqué la question des recettes de l’État en décrivant les politiques fiscales menées par différentes majorités ; je compléterai sa remarque en soulignant le poids de l’évasion fiscale. Certes, les déficits résultent pour partie des décisions volontaires de renoncer à une collecte fiscale, mais également des conséquences involontaires de la fuite des capitaux et de l’évasion fiscale.
La mutualisation suppose que les différents pays européens acceptent de mettre davantage au pot commun. Dans ce contexte, au-delà d’une hypothétique annulation de la dette – solution qu’on ne saurait prôner aujourd’hui, même si elle a été fréquemment expérimentée par le passé, dès le Moyen Âge, et plus récemment en Grèce où l’on a annulé une partie de la dette privée –, deux pistes m’apparaissent légitimes à explorer : interpeller les créanciers de la dette sur leurs responsabilités et travailler à l’extinction de l’évasion fiscale. Si l’on veut rendre la courbe de réduction des déficits crédible, on ne peut pas compter uniquement sur la baisse de la dépense publique. L’austérité joue un rôle, mais celui-ci n’est pas prépondérant. Ne déresponsabilisons pas les uns et les autres sur leur choix d’emprunter !
M. Olivier Carré. Monsieur le président, votre remarque en matière de recettes fiscales aurait été juste si les taux de prélèvements obligatoires avaient baissé sur la période. Or, ils n’ont pas cessé de monter, pour atteindre aujourd’hui un niveau sensiblement différent de celui des autres pays européens. On s’interroge souvent sur l’intérêt de distinguer déficits structurels et conjoncturels ; mais l’accumulation croissante et régulière du montant de la dette d’un pays montre bien l’existence de déficits structurels liés à des dépenses elles-mêmes structurelles, les taux augmentant par rapport au PIB nominal. Au-delà du cas français, cette même cause explique la situation d’autres pays.
En matière de gestion de la dette, les critiques de l’indépendance de la BCE ont un relent de planche à billets ; mais le changement drastique de sa doctrine conduit aujourd’hui la BCE, en rachetant les dettes des États, à agir à la manière des banques centrales d’autrefois.
M. Henri Emmanuelli. À cette époque, on était en croissance !
M. Olivier Carré. En effet, la croissance réelle et nominale de l’économie absorbait alors une bonne part des charges liées à l’endettement, permettant de ne pas accroître le poids de la dette. De fait, seule la croissance nominale du PIB – liée en partie à l’inflation et en partie à la croissance réelle – peut réellement réduire la dette. Pourtant, il arrive un point – c’est toute la raison des ratios de Maastricht – où le poids des charges de la dette en vient à contraindre la croissance, enclenchant un cercle vicieux. En France, mais aussi ailleurs, on se trouve probablement dans cette configuration, et c’est à cela qu’il nous faut réfléchir en priorité.
M. Charles de Courson. Deux des six propositions de notre collègue ne peuvent que recueillir l’assentiment général : la deuxième, qui en appelle à la transparence – mais pour avoir auditionné la direction générale du Trésor, nous savons déjà globalement qui détient quoi en matière de dette publique – et la cinquième, qui invite à organiser un large débat sur les effets du quantitative easing de la BCE. Je reste pour ma part sceptique quant à l’efficacité de cette politique : il faut être plein d’illusions pour croire que l’émission de monnaie fait la croissance.
Les quatre autres points soulèvent des problèmes de fond. Ainsi, pour commencer, notre collègue s’interroge encore sur les facteurs qui ont conduit à ce niveau d’endettement, alors que tout le monde sait qu’il s’agit d’une conséquence du laxisme budgétaire, voire d’une illusion politique selon laquelle l’impopularité des économies serait supérieure à l’impopularité de la hausse des impôts. Or, tout cela a changé : désormais, le peuple en a marre.
M. Henri Emmanuelli. Le peuple ? Quel peuple ?
M. Charles de Courson. Oui, le peuple : il le fait clairement sentir au travers des résultats électoraux !
Avant de baisser les impôts, il faut commencer par réduire les dépenses, le seul débat devant porter sur les domaines à privilégier de façon à réaliser des économies justes. Voici vingt-deux ans que je dénonce l’illusion portée par tous les démagogues – nombreux dans la classe politique, à gauche, à droite et au centre –, qui invitent à commencer par baisser les recettes ; on a vu le résultat de cette politique !
Je suis fondamentalement en désaccord avec le troisième point : mon cher collègue, pour libérer la puissance publique de la tutelle des marchés financiers, il suffit de faire des économies ! Une fois nos comptes à l’équilibre, nous ne dépendrons plus des marchés.
Quant à appeler le Gouvernement à ne plus être un frein à une régulation ambitieuse du secteur financier, aucun gouvernement national n’a plus les moyens d’encadrer ce processus : seule une action dans le cadre européen reste possible. Convertissez-vous, mon cher collègue !
Enfin, le dernier point invite les instances européennes à abandonner les politiques d’austérité ; mais loin de mener une politique d’austérité, on ne réalise pas assez d’économies réelles et structurelles !
En conséquence, le groupe UDI votera massivement contre cette proposition de résolution.
M. Laurent Wauquiez. La situation européenne est si mauvaise qu’il ne faut interdire aucun débat ! Celui que vous proposez, portant sur la mutualisation de la dette, apparaît pleinement honorable et a tout droit d’être mené, sans jugement de valeur ou d’orthodoxie a priori. Contrairement aux promesses d’il y a trois ans, la France n’arrive plus à être moteur de proposition sur la scène européenne ; nous avons perdu notre socle de crédibilité, et pour que la France arrive à retrouver un rôle moteur, il nous faut d’abord le reconstruire.
Le débat sur la dette souveraine des États de la zone euro, déjà ancien, renvoie à une question majeure en matière de solidarité européenne : comment éviter que les États non vertueux trouvent dans la mutualisation de la dette une soupape au détriment de leurs homologues vertueux ? Au-delà du regard que l’on peut porter sur les différentes propositions du texte, il y manque un point important : la question des European bonds. La scène européenne étant marquée par le sous-investissement, cet instrument – qui ferait porter l’endettement par l’Europe – permettrait de financer des projets d’infrastructures tels que le Lyon-Turin, les grandes liaisons ferroviaires en direction de l’Espagne ou encore les infrastructures numériques. Je regrette qu’on en reste à une approche de dette nationale et à une réflexion européenne sur la question, alors que le dossier des European bonds, qui peut permettre d’avancer, est freiné. Il est dommage que la proposition de résolution n’aborde pas ce sujet.
M. Pascal Cherki. Je voudrais moi aussi remercier Nicolas Sansu, dont le texte nous offre l’occasion d’engager ce débat politique fondamental pour notre pays et notre continent. Sans partager tous les termes de la proposition de résolution, j’estime qu’elle pose des questions fondamentales : pourquoi ce continent aussi riche – le plus grand PIB agrégé du monde – s’avère-t-il incapable d’atteindre les taux de croissance nécessaires pour réduire la dette publique ? Pourquoi voit-il les écarts de richesse se creuser de façon substantielle et les peuples se détourner de plus en plus de l’idée européenne ? Devant la progression de l’extrême droite dans les pays de l’Union, l’européen convaincu que je suis s’interroge sur le décalage entre la doxa des politiques pratiquées par l’UE et le ressenti des peuples. L’histoire tragique de notre continent montre que cette situation représente un véritable danger. Nous devons mener en permanence ce débat, car nous portons une lourde responsabilité pour les années à venir.
Avant d’être une question économique, la dette constitue d’abord un enjeu politique, et c’est ainsi qu’il convient de l’aborder. Dans le passé, nous avons déjà été confrontés au problème de dettes publiques importantes. Dans un récent article paru dans Libération, M. Thomas Piketty montre ainsi que lorsque l’Allemagne a connu, après la Seconde Guerre mondiale, un taux d’endettement de 200 % – résultat de la dette de Weimar et des prêts consentis par les vainqueurs de 1945 –, la réaction de ses collègues européens et de son protecteur américain n’a pas été de lui faire la morale, comme on l’a fait aux Grecs, ni de mettre le peuple allemand à genoux en exigeant qu’il rembourse ses dettes.
M. Charles de Courson. C’étaient des dettes de guerre...
M. Pascal Cherki. En 1953, les créanciers institutionnels réunis à Londres ont décidé d’effacer une partie de la dette ; selon les économistes, c’est de ce moment-là que date le décollage économique de l’Allemagne. Ce fut une décision de nature politique et non économique : on avait pris conscience de l’importance que revêtait la stabilité démocratique de l’Allemagne pour celle de l’Europe. Il est dommage que dans le débat européen actuel, beaucoup de responsables se comportent comme des conseillers en patrimoine – parfois médiocres – et non comme des dirigeants politiques à la hauteur de l’Histoire.
Certains points de la proposition de résolution mériteraient le débat tant ils renvoient au devenir de l’économie capitaliste financiarisée et au rôle prépondérant qu’y joue le capital fictif. Il en va ainsi de la contradiction qui caractérise la politique de la BCE, obligée de pratiquer le quantitative easing à court terme en injectant des liquidités sous peine de faire tarir les investissements, au risque, il est vrai, de reconstituer une nouvelle bulle spéculative. Cette contradiction majeure ne pouvant être réglée dans l’immédiat, je soutiens le choix de la banque centrale.
Au niveau institutionnel, la mutualisation des dettes pose la question de l’évolution de l’Europe vers un modèle plus fédéraliste. En effet, dans ce type de constructions
– notamment aux États-Unis –, la dette est mutualisée au niveau de l’État fédéral, mais les États fédérés sont tenus à une forme de discipline budgétaire qui les conduit à l’équilibre. Paradoxe de la situation, nos collègues allemands – dont je condamne par ailleurs la vision ordo-libérale – tiennent sur cette question une position beaucoup plus claire et cohérente que nous, Français, que notre histoire a conduits à rester à mi-chemin, avec le concept nébuleux de fédération d’États-nations.
Enfin, le contenu politique de l’Union européenne – lié à la question du libre-échange et du partage des richesses – doit également faire l’objet de débat. Globalement, on produit de la richesse en Europe, mais la répartition de la plus-value et la pression de l’actionnaire pèsent sur notre capacité à dégager une croissance soutenable et durable. C’est en creux l’idée que porte cette proposition de résolution ; je n’en partage pas tous les termes – notamment la critique de la BCE –, mais j’inviterai nos collègues à la voter parce que son adoption marquerait la volonté des parlementaires que nous sommes de promouvoir ce débat indispensable.
Mme Karine Berger. L’alinéa 24 de la proposition de résolution soulève un débat que Pascal Cherki a rapidement évoqué. On ne peut pas expliquer dans la même phrase que la BCE pratique une politique expansionniste – ou « audacieuse » – et que cette politique est de nature à créer des bulles. Ou plutôt, si on le fait, on admet qu’il y a bel et bien un arbitrage à trouver à tout moment entre la création monétaire – toujours accompagnée du risque inflationniste – et la lutte contre le chômage qui fait également partie des missions d’une banque centrale. Si vous reconnaissez qu’avec M. Draghi, la BCE a changé son mandat pour se mettre à lutter contre le chômage, il faudrait l’expliciter davantage – d’autant que vous êtes un député de gauche – car ce fait reste peu reconnu. Pourquoi pointez-vous dans la même phrase les risques de bulle, et à quelle bulle exactement faites-vous référence : immobilière, d’actions, d’obligations, d’assurance-vie ? Il y a quelque temps, j’ai fait valoir dans un rapport que si nous ne faisions pas rapidement une vraie réforme de l’assurance-vie, nous risquions à terme de faire face à un véritable problème ; le terme, malheureusement, semble aujourd’hui arrivé.
M. le rapporteur. Nous reconnaissons évidemment que la BCE a changé de doctrine ; cette évolution me semble d’ailleurs délicate du point de vue juridique, la BCE étant réduite à s’appuyer sur des articles quelque peu bancals du traité. Comme le ministre l’a reconnu la semaine dernière, l’injection de liquidités risque toujours de produire des bulles spéculatives, et le rachat massif d’actions par la BCE pose problème. Quitte à le faire, la banque centrale aurait pu éviter de passer uniquement par les marchés bancaires et financiers en créant notamment un fonds d’investissement pour la transition écologique.
Je ne suis pas étonné que Charles de Courson soit un adepte de l’austérité...
M. Charles de Courson. De la rigueur ! Du sérieux budgétaire !
M. le rapporteur. Vous avez bien fait référence à l’austérité. Or, comme l’a notamment souligné Éric Alauzet, mettre en cause la manière dont se construit la dette ne signifie pas que l’on souhaite creuser les déficits. Leur réduction peut très bien passer par une réforme fiscale et une lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, sans forcément exiger de baisser les dépenses publiques en matière sociale.
Le débat sur la dette existe actuellement dans l’espace public, où il est notamment porté par des collectifs d’économistes. Nous souhaitons que ce texte le fasse entrer à l’Assemblée nationale. Le 7 mai, la proposition de résolution sera examinée en séance publique ; je doute qu’elle y soit adoptée, mais nous réfléchirons ensuite aux manières de faire évoluer ce débat que j’estime essentiel pour l’avenir.
M. le président Gilles Carrez. Merci, cher collègue, de nous avoir offert l’occasion d’aborder ce sujet et d’engager un débat très intéressant. Quel que soit le résultat de notre vote, la proposition de résolution sera examinée en séance.
La Commission rejette la proposition de résolution.
*
* *
___
Texte de la proposition de résolution ___ |
Texte rejeté par la Commission ___ |
Proposition de résolution européenne relative à la dette souveraine des États de la zone euro |
|
Article unique |
|
L’Assemblée nationale, |
|
Vu l’article 88-4 de la Constitution, |
|
Vu l’article 151-5 du Règlement, |
|
Vu les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail, |
|
Vu la Convention européenne des droits de l’Homme, |
|
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment l’article 123, |
|
Vu le Traité sur l’Union européenne, |
|
Vu le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire, |
|
Vu la Charte des droits fondamentaux, et plus spécifiquement son titre IV, |
|
Vu la Charte sociale européenne, |
|
Vu le règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière, |
|
Vu le Traité instituant le Mécanisme européen de stabilité, |
|
Vu la résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rapport d’enquête sur le rôle et les activités de la Troïka (BCE, Commission européenne et FMI) dans les pays sous programme de la zone euro, |
|
Vu la décision de la Banque Centrale Européenne du 22 janvier 2015 annonçant la mise en place d’un programme d’assouplissement quantitatif, |
|
Vu les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 14 janvier 2015 relatives à la demande préjudicielle présentée par le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) le 10 février 2014 (affaire C-62/14), |
|
Vu la proposition de directive du Conseil du 14 février 2013 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM(2013) 71), |
|
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 janvier 2014 relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne (COM(2014) 43), |
|
Considérant que le niveau de l’endettement public des États de la zone euro découle, à la fois, de l’obligation faite aux États d’emprunter sur les marchés financiers à des taux parfois excessifs, et de la baisse continue des recettes fiscales aggravée par l’application des politiques néolibérales ; |
|
Considérant qu’il est aussi le fruit de la socialisation d’une crise financière privée dont l’origine réside dans les comportements irresponsables et inconsidérés pris, pendant des années par des institutions financières, dont la rentabilité des activités, alimentée par la spéculation, s’est finalement effondrée ; |
|
Considérant que le bilan des politiques d’austérité menées, au nom de la réduction de cette dette publique, à travers l’Union européenne depuis cinq ans est dramatique tant elles sont inefficaces économiquement, injustes socialement, néfastes budgétairement, et menacent un avenir commun pacifique et démocratique entre les peuples européens ; |
|
Considérant que le poids actuel de la dette publique conduit les États à répondre de moins en moins aux attentes et aux besoins de leurs citoyens afin de contenter les exigences des créanciers et des marchés financiers, mettant à mal la démocratie et bafouant la souveraineté populaire ; |
|
Considérant l’exigence de disposer d’une information claire et transparente sur la dette souveraine des États membres de l’Union européenne, et sur les enjeux d’une restructuration de la dette publique, en particulier pour les pays les plus fragiles ; |
|
Considérant qu’il en va de l’intérêt des États, et notamment de la France, de favoriser des modes de financement de l’action publique autres que le recours aux marchés financiers privés afin de s’extraire progressivement, mais durablement de la tutelle que ces marchés exercent aujourd’hui sur la zone euro ; |
|
Considérant que l’audacieuse politique monétaire actuellement menée par la Banque Centrale Européenne risque de favoriser le développement de bulles financières spéculatives et générer un nouvel accroissement des inégalités ; |
|
Considérant que les leçons de la crise financière de 2008 n’ont pas été retenues et que le cadre réglementaire actuel ne permettra pas d’éviter une nouvelle crise financière majeure ; |
|
Considérant qu’il existe un projet européen alternatif portant un modèle économique, social et écologique progressiste au service du plus grand nombre ; |
|
1° Invite le Gouvernement à prendre l’initiative d’une grande conférence européenne sur la dette, réunissant les décideurs politiques et la société civile, et dont les objectifs seraient de définir les facteurs ayant conduit au niveau d’endettement actuel des États européens, les bénéficiaires du système d’endettement, les lacunes réglementaires, ainsi que les enjeux d’une restructuration de la dette publique, en particulier pour les pays les plus fragiles ; |
|
2° Demande au Gouvernement de favoriser la transparence en informant, à échéance régulière, le Parlement français sur le niveau de la dette publique ainsi que sur la dénomination sociale, le siège social, l’appartenance éventuelle à un groupe capitalistique ainsi que les montants détenus par l’ensemble des créanciers ; |
|
3° Alerte le Gouvernement sur la nécessité de libérer la puissance publique de la tutelle des marchés financiers et l’invite à étudier la possibilité de mettre en place des outils de financement de l’action publique autres que le recours aux marchés financiers, notamment le recours à l’épargne interne ou le développement de projets européens financés par le biais de la Banque Centrale Européenne ; |
|
4° Appelle le Gouvernement à ne plus être le frein, mais le moteur d’une régulation ambitieuse du secteur financier, notamment en matière de séparation des activités bancaires et de mise en place rapide d’une taxe européenne sur les transactions financières reposant sur une assiette large qui comprend en particulier les produits dérivés ; |
|
5° Demande qu’un large débat soit engagé entre la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen, ainsi que les Parlements nationaux sur les effets de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, en particulier son efficacité sur l’économie réelle et sur l’évolution des inégalités en Europe ; |
|
6° Invite le Gouvernement à agir au sein des instances européennes pour mettre fin le plus rapidement possible aux politiques d’austérité budgétaire et lui demande de mettre enfin en œuvre le « Pacte de croissance », promis par le Président de la République, ainsi qu’une stratégie européenne de lutte contre le dumping social et fiscal. |
ANNEXE 1 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR
– M. Pascal Franchet, vice-Président France du Comité d’annulation pour la Dette du Tiers-Monde (CADTM) ;
– M. Clément Fontan, chercheur à l’université de Montréal, auteur d’une thèse sur l’évolution du rôle de la Banque centrale européenne ;
– M. Henri Sterdyniak, directeur du Département économie de l’Observatoire français de conjoncture économique (OFCE) ;
– M. Benjamin Lemoine, chercheur à l’Institut d’études politiques de Paris, auteur d’une thèse sur la « mise en marché » de la dette publique française intitulée Les valeurs de la dette. L’État à l’épreuve de la dette publique ;
– M. Michel Husson, membre du Comité pour la vérité de la dette grecque et membre du conseil scientifique d’ATTAC ;
– M Thomas Coutrot, économiste, membre des Économistes atterrés à l’initiative de l’audit citoyen de la dette ;
– M. Stéphane de la Rosa, Professeur à l’Université de Valenciennes, spécialiste de la gouvernance économique européenne.
ANNEXE 2 :
DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE DU PARLEMENT GREC, ZOÉ KONSTANTOPOULOU, À LA SESSION INAUGURALE DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ DE LA DETTE PUBLIQUE, 5 AVRIL 2015
Messieurs et Mesdames, nous vous remercions de votre présence à l’événement d’aujourd’hui qui est d’importance historique et marque le début du remboursement d’une vraie dette : celle de dire la vérité et de rendre des comptes au peuple et à la société grecque sur comment a-t-elle été créée et gonflée, la dette qui est suspendue au-dessus des têtes des citoyens et des jeunes générations. La dette publique qui est utilisée comme instrument de chantage et d’asservissement, comme moyen de soumission, dans des conditions qui n’ont rien à voir avec l’objectif statutaire européen de prospérité des peuples et des sociétés, des conditions qui, au lieu de garantir, de servir les principes œcuméniques de démocratie, d’égalité, d’équité, de respect des droits de l’homme et des libertés ainsi que de progrès social, produisent le rétrécissement des espaces démocratiques, des discriminations, des exclusions, de la misère et la crise humanitaire.
La dette ne constitue pas un signe des temps. Elle est le résultat d’actes et d’omissions, de contrats d’emprunt aux conditions léonines et aux effarants taux d’intérêt, d’actes et de gestions financières, mais aussi de contrats marqués par la corruption, qui ont catapulté la dette et dont témoigne foule de dossiers se trouvant au Parlement et à la Justice.
La dette n’est pas incontestable. Tant qu’elle n’est pas contrôlée et de-codifiée, tant qu’elle n’est pas analysée, demeure suspendue la question : quel pourcentage et quelle part est éventuellement légitime et laquelle est illégitime, illégale ou odieuse ? Cette question impitoyable hante, ces dernières années, la conscience collective et s’est cristallisée dans la revendication qui reflète le droit démocratique de ceux qui sont appelés à payer la dette, de connaître comment celle-ci a été créée, en quoi consiste leur dette, mais aussi de pouvoir se défendre et résister contre l’obligation de la rembourser et revendiquer son effacement.
Le contrôle de la dette n’est pas seulement un droit démocratique des citoyens, il est aussi un droit souverain des peuples.
Il est en même temps un devoir institutionnel de l’État même selon le Droit de l’Europe Unie. C’est-à-dire, il constitue une obligation internationale du pays, selon l’expression chère à ceux qui font mention des obligations internationales du pays, seulement quand il s’agit des obligations financières et oublient que les obligations internationales supérieures du pays sont celles qui concernent la démocratie, la transparence, les droits et les libertés de l’homme ainsi que tout ce qui fait la vie digne d’être vécue.
La dette ne se résume pas en profits et pertes, mais concerne des vies humaines.
Des milliers de vies humaines qui ont été perdues afin de payer la dette, des millions des vies humaines qui ont été meurtries et broyées, je veux rappeler aujourd’hui cinq êtres humains appartenant à différentes générations.
La petite fille, fille d’immigrée, élève à l’école primaire, qui en décembre 2013 a perdu sa vie à cause des gaz toxiques d’un brasier improvisé dans une maison sans électricité où elle vivait depuis des mois avec sa mère.
Le garçon de 19 ans qui, l’été de 2013, a perdu sa vie en essayant d’éviter le contrôle des billets dans un bus.
Les deux jeunes, de 20 et 21 ans, étudiants à Larissa, qui en mars 2013, sont eux aussi morts des gaz d’un brasier.
Enfin, Dimitris Hristoulas, le pharmacien retraité qui, il y a trois ans jour pour jour, a mis fin à sa vie devant le monument au Soldat Inconnu juste devant le Parlement, refusant que son existence soit avilie à tel point qu’il soit obligé de chercher sa nourriture dans les ordures.
La Commission de vérité de la dette publique constitue une dette envers ces hommes aussi.
Un instrument de vérité. Un instrument de réparation de l’injustice.
La Commission de vérité de la dette publique, créée par le Parlement grec, est un instrument précieux, que le Parlement met au service de la société et de la démocratie. Un instrument de vérité. Un instrument de réparation de l’injustice. Un instrument de dignité, de défense sociale et démocratique, de contestation et de résistance contre des choix qui tuent la société. Un instrument de réveil des peuples, des sociétés et des directions européennes. Un instrument de solidarité.
La présence aujourd’hui de toute la direction de l’État, du Président de la République, du Premier ministre du pays, des ministres, des vice-présidents du Parlement, des représentants du pouvoir judiciaire et des autorités indépendantes, reflète la volonté que l’audit commence et aille jusqu’au bout.
La préparation scientifique, l’expérience et le désintéressement des hommes et femmes qui se sont empressé-e-s de répondre à l’invitation, de contribuer avec leurs connaissances et leur travail à cet effort, constitue une garantie de succès.
Je veux remercier tout spécialement ceux et celles qui ont répondu à cet appel et les scientifiques et les experts qui sont venus tout de suite de l’étranger, mais aussi ceux qui sont venus de Grèce. Je voudrais aussi mettre en exergue le soutien spontané des scientifiques, des gens d’esprit et des mouvements sociaux de tout le monde, ce qui nous oblige à garder ce processus initié aujourd’hui ouvert et vivant.
Messieurs et Mesdames, je vous annonce la Décision numéro 1448 de la Présidente du Parlement, du 4 avril 2015, par laquelle est constituée la Commission Spéciale du Parlement des Grecs pour la recherche de la vérité concernant la création et le gonflement de la dette publique, l’audit de la dette et la promotion de la collaboration internationale du Parlement avec le Parlement européen, les Parlements d’autres pays et des organismes internationaux en matière de dette, ayant comme objectif de sensibiliser et activer la société, la communauté internationale et l’opinion publique internationale. Cette Commission on l’appellera Commission de vérité de la dette publique. Je veux remercier spécialement Sofia Sakorafa qui a accepté d’être responsable des relations de cette Commission avec le Parlement européen et les Parlements nationaux. Je veux aussi remercier spécialement Éric Toussaint qui a accepté tout de suite de coordonner le travail scientifique de l’équipe internationale. Je veux remercier beaucoup les services du Parlement et spécialement le Service scientifique et le Bureau de budget du Parlement, qui vont assister la Commission, en constituant des équipes de travail. Par cette introduction, j’appelle à la tribune afin qu’il adresse son salut à cette session inaugurale de la Commission de vérité de la dette publique, le Président de la République M. Prokopis Pavlopoulos.
© Assemblée nationale