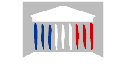______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (n° 3381)
de protection de la Nation
PAR M. Dominique RAIMBOURG
Député
——
SOMMAIRE
___
Pages
A. INSCRIRE L’ÉTAT D’URGENCE DANS LA CONSTITUTION 7
1. La légalité d’exception 7
a. L’état de siège 7
b. Les circonstances exceptionnelles 9
c. L’état d’urgence 9
d. L’article 16 10
2. Une révision qui ne se limite pas à une inscription symbolique de l’état d’urgence dans la Constitution 11
B. PERMETTRE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE DES CRIMINELS CONDAMNÉS POUR ATTEINTE GRAVE À LA VIE DE LA NATION 12
1. La déchéance de la nationalité : un outil classique de sanction des comportements indignes ou déloyaux à l’égard de l’État 12
2. Les possibilités existantes de déchéance de la nationalité 15
3. L’extension proposée par le projet de loi constitutionnelle 16
II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS 18
A. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES EN MATIÈRE D’ÉTAT D’URGENCE 18
B. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES EN MATIÈRE DE DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ 19
CONTRIBUTION DU GROUPE UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS (en application de l’article 86, alinéa 7, du Règlement) 21
AUDITION DE MM. MANUEL VALLS, PREMIER MINISTRE, ET JEAN-MARIE LE GUEN, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX RELATIONS AVEC LE PARLEMENT, ET DISCUSSION GÉNÉRALE 23
EXAMEN DES ARTICLES 61
Article premier (art. 36-1 [nouveau] de la Constitution) : Régime constitutionnel de l’état d’urgence 61
Après l’article 1er 113
Avant l’article 2 115
Article 2 (art. 34 de la Constitution) : Compétence du législateur pour prévoir la déchéance de la nationalité des Français binationaux 116
Après l’article 2 164
Le vendredi 13 novembre 2015, la France a subi les attentats terroristes les plus meurtriers que notre pays ait connus : 130 personnes sont mortes, plus de 350 ont été blessées. Cette abomination fut le point culminant d’une série d’attaques, ou de tentatives d’attaques heureusement déjouées, qui ont marqué l’année 2015.
Les pouvoirs publics ont immédiatement réagi. Lors d’un Conseil des ministres réuni dans la nuit du 13 au 14 novembre, le Président de la République a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national. Le Gouvernement a décidé d’une mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité, soutenues par les effectifs de nos armées.
Le Parlement a tenu son rôle. Par une loi du 20 novembre 2015, il a renforcé le cadre juridique de l’état d’urgence et autorisé sa prolongation pour trois mois, à compter du 26 novembre (1). Il a également assuré sa fonction de contrôle : votre commission des Lois a chargé son Président, alors M. Jean-Jacques Urvoas, ainsi que M. Jean-Frédéric Poisson, d’une mission permanente de suivi des mesures prises au titre de l’état d’urgence ; le Sénat a créé un Comité de suivi de l’état d’urgence, dont le rapporteur spécial est M. Michel Mercier. Les deux commissions des Lois se sont dotées des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête (2).
Dès le 16 novembre 2015, trois jours après les attentats, le Président de la République a déclaré devant le Parlement, réuni en Congrès en application de l’article 18 de la Constitution, qu’il convenait de « faire évoluer notre Constitution pour permettre aux pouvoirs publics d’agir, conformément à l’État de droit, contre le terrorisme de guerre ».
Tel est l’objet du présent projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation (n° 3381), déposé à l’Assemblée nationale le 23 décembre dernier.
Conformément aux engagements pris par le chef de l’État devant le Congrès, ce texte comporte deux mesures.
Parce que « tout État libre où les grandes crises n’ont pas été prévues est à chaque orage en danger de périr » (Jean-Jacques Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne), l’article 1er consacre l’état d’urgence dans la Constitution. L’objectif est d’encadrer les conditions du recours à ce régime d’exception, mais aussi de renforcer les moyens d’action des forces de l’ordre et la sécurité juridique des mesures prises pendant cette période.
Parce que la nationalité est, non pas seulement un rattachement formel à un État, mais aussi un lien d’appartenance à une culture et à un ensemble de valeurs, l’article 2 tend à permettre la déchéance de la nationalité française de ceux qui, par la gravité particulière de leurs crimes, ont eux-mêmes détruit ce lien.
Lutter contre le terrorisme, protéger la Nation : l’ambition de ce projet de loi constitutionnelle appelle, au-delà des clivages politiques habituels, un vaste rassemblement de tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République.
L’article 1erdu projet de loi donne un fondement constitutionnel à l’état d’urgence. Il fixe, dans un nouvel article 36-1 inséré au titre V de la Constitution, le régime de cet « état de crise », selon la formule introduite par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (3).
Afin de faire face à des situations exceptionnelles – quelle que soit la nature de celles-ci : guerre, agression, coup d’État, émeute, insurrection, actes de terrorisme, catastrophe naturelle de grande ampleur –, il peut être nécessaire de renforcer temporairement les prérogatives reconnues au pouvoir exécutif.
L’histoire française est riche en expériences de ce type – on peut penser à la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, au décret-loi de 1939 sur les publications étrangères ou à la loi de 1963 sur la Cour de sûreté de l’État. D’autres pays ont aussi adopté des textes sur l’urgence ou la nécessité. Comme le remarquait Guy Braibant, « autrefois, on se contentait de l’état de siège et des réquisitions militaires, pour le temps de guerre (…). Depuis, les textes sont devenus à la fois plus nombreux et plus solennels » (4).
L’État de droit suppose, en effet, d’organiser, à l’avance, les conditions de mises en œuvre de ces légalités d’exception. Plusieurs constructions, héritées des XIXème et XXème siècles, cohabitent dans notre système juridique, que l’on peut présenter dans l’ordre chronologique de leur apparition : l’état de siège, aujourd’hui prévu par l’article 36 de la Constitution ; la théorie des circonstances exceptionnelles, développée par le juge administratif ; l’état d’urgence bien sûr, fondé sur la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; les pouvoirs exceptionnels susceptibles d’être dévolus au Président de la République conformément à l’article 16 de la Constitution.
L’état de siège remonte à l’Ancien Régime. Il tire son nom du statut des places fortes assiégées dont le gouverneur militaire assurait tous les pouvoirs. Il fut aussi utilisé à Paris, sous la Seconde République, lors des journées de juin 1848 : la ville est alors « mise en état de siège » par un « décret de l’Assemblée nationale » du 24 juin déléguant « tous les pouvoirs exécutifs » au général Cavaignac ; il ne sera levé que le 19 octobre.
De 1849 à 1955, la France ne connaît comme régime d’exception législatif que l’état de siège. La loi du 9 août 1849 sur l’état de siège encadre indifféremment l’état de siège effectif ou l’état de siège fictif déclaré en temps de guerre hors des places investies et en temps de paix dans le cas de troubles intérieurs. Elle fut appliquée dans les villes de l’Est de la France et à Paris pendant la guerre franco-prussienne de 1870, mais aussi en Algérie lors de l’insurrection kabyle de 1871.
Son régime définitif fut arrêté par la loi du 3 avril 1878 relative à l’état de siège. Aux termes de l’article 1er de cette loi, l’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de « péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée ». Ce régime prévoyait, à l’origine, qu’« une loi peut seule déclarer l’état de siège » ; en cas d’ajournement des chambres, le Président de la République pouvait déclarer l’état de siège, suivant l’avis du conseil des ministres, mais les chambres se réunissaient alors de plein droit au plus tard dans les deux jours. C’est sur ce fondement que, le 2 août 1914, par décret pris en conseil des ministres, Raymond Poincaré plaça en état de siège les départements de la France et de l’Algérie, avant que la loi du 5 août 1914 relative à l’état de siège ne proroge celui-ci pour la durée de la guerre. Il ne fut finalement levé – et avec lui la censure – que le 12 octobre 1919, soit près d’un an après la fin des combats. Vingt ans plus tard, le décret-loi du 1er septembre 1939 portant déclaration de l’état de siège fit à nouveau application de cette légalité d’exception, dont la levée intervint le 12 octobre 1945.
Aussitôt l’état de siège décrété, les pouvoirs dont l’autorité civile était investie pour le maintien de l’ordre public et la police générale « passent tout entiers à l’autorité militaire ». Ce transfert n’est cependant pas absolu ; ainsi, l’article 7 de la loi de 1849 prévoyait que « l’autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire ne l’a pas dessaisie ». Cette substitution de l’autorité militaire à l’autorité civile se traduit également par des restrictions aux libertés publiques allant au-delà de ce qu’autorise le droit commun. Il en est ainsi du droit de perquisition de jour et de nuit, du droit d’éloigner les repris de justice et les personnes non domiciliées dans le ressort du territoire mis en état de siège, du droit de réquisition des armes et munitions, et du droit d’interdire les réunions de nature à entraîner des risques de désordre. Le déclenchement de l’état de siège permet, enfin, de confier à des tribunaux militaires le soin de juger des crimes et délits – par exemple, espionnage, provocation à la désobéissance des militaires. Ce transfert n’est toutefois pas automatique : d’une part, les juridictions militaires ont été supprimées depuis 1982 en temps de paix et, d’autre part, le transfert n’a lieu que si l’autorité militaire revendique la poursuite auprès des juridictions de droit commun.
En dépit des évolutions politiques et des changements institutionnels, le régime de l’état de siège est demeuré presque intangible. Son principe fut inscrit à l’article 7 de la Constitution du 27 octobre 1946 par la loi constitutionnelle du 7 décembre 1954. Il fut repris – dans une formule qui continue à renvoyer à la loi pour en fixer le régime mais prévoit sa déclaration par le pouvoir exécutif sous la forme d’un décret en conseil des ministres – à l’article 36 de la Constitution du 4 octobre 1958. Aucune loi ne fut votée pour préciser l’état de siège. Abrogés en 2004 seulement, les textes de 1849 et 1878 ont été presque intégralement repris aux articles L. 2121-1 à L. 2121-8 du code de la défense.
Affirmée pendant la Grande guerre, mais déjà esquissée au cours de la décennie précédente, la théorie des circonstances exceptionnelles a été consacrée par un arrêt Heyriès du Conseil d’État du 28 juin 1918. Cette jurisprudence admet que, dans certaines conditions de très grave urgence, politique ou sociale, le pouvoir exécutif puisse s’affranchir du respect intégral de la loi afin de préserver les services publics et les intérêts de la Nation.
Les circonstances exceptionnelles sont une condition mais aussi une justification pour appliquer un régime de légalité d’exception des actes administratifs. Ainsi, les actes administratifs illégaux en temps normal sont tenus pour légaux en raison des circonstances exceptionnelles.
Aux termes de la loi du 3 avril 1955 – élaborée pour faire face aux « évènements d’Algérie » –, l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des départements d’outre-mer, dans deux hypothèses : soit en cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », soit en cas d’« événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamités publiques ». L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres, et non plus par la loi, depuis les modifications introduites par l’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 (5). Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut, en revanche, être autorisée que par une loi. Cette loi fixe la durée définitive d’application de l’état d’urgence.
Dès la déclaration de l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur et les préfets se voient dotés de pouvoirs de police étendus, qui ont été précisés par la loi précitée du 20 novembre 2015. Onze mesures dérogatoires, individuelles ou de portée générale, sont prévues par la loi du 3 avril 1955 :
– l’interdiction de la circulation des personnes ou des véhicules (1° de l’article 5 de la loi) ;
– l’institution de zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé (2° de l’article 5) ;
– l’interdiction de séjour (3° de l’article 5) ;
– l’assignation à résidence, complétée le cas échéant par une assignation à domicile à temps partiel, pouvant comporter jusqu’à trois pointages au commissariat ou à la brigade de gendarmerie et une interdiction d’entrer en relation, et qui peut être aménagée sous la forme d’un placement sous surveillance électronique (article 6) ;
– la dissolution d’associations ou de groupements (article 6-1) ;
– la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion (premier alinéa de l’article 8) ;
– l’interdiction de manifestation (second alinéa de l’article 8) ;
– la remise des armes des catégories A à C et de celles de catégorie D soumises à enregistrement (article 9) ;
– la réquisition de personnes ou de biens (article 10) ;
– la perquisition au domicile de jour et de nuit (I de l’article 11) ;
– le blocage de sites Internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie (II de l’article 11).
Marqué par le souvenir de la défaite de juin 1940 et l’impuissance de la IIIème République à résister à l’invasion allemande, le constituant de 1958 a, enfin, ménagé des pouvoirs exceptionnels, parfois qualifiés de « pleins pouvoirs », au chef de l’État en cas de crise de grave. Le Président de la République prend alors les mesures exigées par les circonstances, y compris sous la forme d’actes législatifs.
Cette compétence étendue est, toutefois, soumise à des conditions de forme et de fond.
S’agissant des conditions de forme, le Président de la République doit d’abord consulter officiellement le Premier ministre, le président de chacune des deux assemblées et le Conseil constitutionnel. Ensuite, il doit informer le pays de la mise en œuvre de l’article 16. Le Conseil constitutionnel doit être consulté au sujet de chacune des mesures prises dans ce cadre par le Président de la République. Le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute durant la période de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels. L’article 89 de la Constitution précise, quant à lui, qu’« aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ».
S’agissant des conditions de fond, il faut, tout d’abord, que les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux de la France soient menacées de manière grave et immédiate. Il faut, ensuite, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Une troisième condition de fond s’ajoute aux deux autres : les mesures prises doivent avoir pour objectif d’assurer aux pouvoirs publics, dans les plus brefs délais, les moyens d’accomplir leur mission.
Ces pouvoirs exceptionnels n’ont été utilisés qu’une seule fois, du 23 avril au 29 septembre 1961, à la suite du putsch de quatre généraux en Algérie.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a davantage encadré le régime des pouvoirs exceptionnels, en instaurant un mécanisme de contrôle portant sur la durée de l’application de l’article 16. Désormais, après trente jours, le Conseil constitutionnel, saisi par le président d’une des deux assemblées ou par soixante députés ou sénateurs, doit se prononcer par un avis public pour examiner si les conditions d’application des pouvoirs de crise sont toujours réunies. Le Conseil se prononce de plein droit au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà.
2. Une révision qui ne se limite pas à une inscription symbolique de l'état d'urgence dans la Constitution
Le nouvel article 36-1, dont l’article premier du présent projet de loi permet l’insertion dans la Constitution, fixe, d’abord, les conditions de mise en œuvre de l’état d’urgence, en reprenant au mot près celles imaginées par le législateur de 1955. Il arrête également, entérinant les modifications de la loi du 3 avril 1955 intervenues en 1960, la procédure de son déclenchement : il désigne les autorités constitutionnelles chargées de le déclarer – le Président de la République, qui préside le conseil des ministres – et, le cas échéant, de le proroger – le Parlement, qui vote la loi. Ce faisant, le présent projet de loi constitutionnelle met le régime de l’état d’urgence à l’abri des « emballements » causés par les circonstances, ou des combinaisons d’une majorité de rencontre.
Le régime constitutionnel de l’état d’urgence ne se limite pas à ces aspects procéduraux. Il pose, au deuxième alinéa du nouvel article 36-1, des principes relatifs aux mesures pouvant être décidées sous son emprise : « La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements. »
Alors que la loi du 20 novembre 2015 n’avait pu procéder qu’à leur actualisation, sauf à risquer une éventuelle censure du juge constitutionnel, cette constitutionnalisation autorisera une vaste révision des mesures dérogatoires prévues par la loi du 3 avril 1955.
L’intention du Gouvernement, dont témoigne l’exposé des motifs du présent texte, paraît être de renforcer singulièrement la variété et l’efficacité de ces mesures – sont notamment évoqués les contrôles d’identité sans nécessité de justifier de circonstances particulières, les visites des véhicules avec ouverture des coffres, la retenue administrative sans autorisation préalable dans le cadre de perquisitions, ou la saisie administrative d’objets et d’ordinateurs durant les perquisitions. Un projet de loi séparé devrait être soumis au Parlement dans ce but, au cours des prochaines semaines. En tout état de cause, le calendrier de discussion de ce projet de loi d’application ne retardera pas l’entrée en vigueur du nouvel article 36-1 de la Constitution, puisque celui-ci n’emporte pas l’abrogation de la loi du 3 avril 1955 dont les dispositions continueront à s’appliquer.
En se plaçant délibérément dans le champ de la police administrative, le présent projet de loi constitutionnelle écarte la compétence que les juridictions judiciaires tiennent de l’article 66 de la Constitution, pour confier à l’office du juge administratif – et singulièrement à celui de son juge des référés – le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des mesures ordonnées. Le débat à venir sur le renforcement des mesures administratives dans le cadre de l’état d’urgence devra donc porter non seulement sur l’efficacité des mesures existantes et de celles qui seront introduites, mais également sur les procédures et les moyens du contrôle juridictionnel.
B. PERMETTRE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE DES CRIMINELS CONDAMNÉS POUR ATTEINTE GRAVE À LA VIE DE LA NATION
L’article 2 du présent projet de loi constitutionnelle tend à compléter l’article 34 de la Constitution, qui définit le champ de compétence du législateur, afin d’y ajouter la possibilité de déchoir de leur nationalité les personnes nées françaises, ayant une autre nationalité et condamnées pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation.
1. La déchéance de la nationalité : un outil classique de sanction des comportements indignes ou déloyaux à l’égard de l’État
Historiquement, la déchéance de la nationalité s’analyse comme une sanction pouvant être prononcée contre un individu coupable d’un comportement indigne ou manifestant un défaut de loyalisme à l’égard de l’État.
Si elle se distingue aujourd’hui de la perte de la nationalité (6), qui représente moins une sanction qu’une libération d’allégeance, les deux notions ont, pendant longtemps, été entremêlées.
L’article 6 du titre II de la Constitution de 1791 en fournit une première illustration, en disposant que « la qualité de citoyen français se perd :
« 1° par la naturalisation en pays étranger ;
« 2° par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité ;
« 3° par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ;
« 4° par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit les preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux ».
En 1793, l’article 4 de la Constitution de la Première République prévoit la perte, non de la nationalité, mais de « l’exercice des droits de citoyen » : « par la naturalisation en pays étranger ; par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non populaire ; par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu’à réhabilitation ».
Sous la IIe République, l’article 8 du décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et possessions françaises « interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions, entraînera la perte de la qualité de citoyen français » – peu importe qu’il soit Français de naissance ou Français par acquisition.
La déchéance de nationalité proprement dite apparaît avec les « dénaturalisations » auxquelles donne lieu la Première guerre mondiale :
– la loi du 7 avril 1915 autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d’anciens sujets de puissances en guerre avec la France prévoit la déchéance, par décret, de certains étrangers naturalisés. Tel est notamment le cas de celui qui a « soit porté les armes contre la France, soit quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d’ordre militaire » et de celui qui a « prêté ou tenté de prêter contre la France, en vue ou à l’occasion de la guerre, une aide quelconque à une puissance ennemie » ;
– la loi du 18 juin 1917, modifiant celle de 1915, précise les cas de déchéance et confie aux tribunaux judiciaires le soin de la prononcer.
Pérennisant ces dispositions (7), la loi du 10 août 1927 sur la nationalité définit trois motifs de déchéance, applicables aux seuls Français par acquisition :
– « pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l’État français » ;
– « pour s’être livré, au profit d’un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France » ;
– pour s’être soustrait aux obligations militaires.
Le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers ajoute à ces motifs la condamnation pour crimes et délits punis par une peine d’au moins un an d’emprisonnement et rétablit le caractère administratif de la déchéance, prononcée par décret sur avis conforme du Conseil d’État.
Le décret-loi du 9 septembre 1939 modifiant les dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française élargit cette procédure – pour une période temporaire dont le terme devait être fixé par décret – à « tout Français qui se sera comporté comme le ressortissant d’une puissance étrangère », y compris s’il s’agit d’un Français de naissance.
La procédure de déchéance de la nationalité fut dévoyée sous le régime de Vichy. Après avoir pérennisé certaines des dispositions qui précèdent (8), le régime lance, à partir de juillet 1940, un vaste processus de dénaturalisations – qui frappent plus de 15 000 Français, dont 7 000 juifs. La déchéance est également utilisée pour sanctionner ceux qui, tel le général de Gaulle, ont rejoint la France libre.
Après-guerre, l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française donne à la déchéance de la nationalité ses principaux traits actuels. Elle réserve cette mesure aux Français par acquisition, en redéfinit les motifs (article 98) (9) et reconduit son prononcé par décret sur avis conforme du Conseil d’État (article 122).
En 1973 est supprimé l’ « effet collectif » de la déchéance, qui ne peut désormais plus être étendue au conjoint ou aux enfants mineurs de la personne concernée (10).
Les dispositions du code de la nationalité sont ensuite intégrées dans le code civil, sans modification de leur contenu, par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité.
Prévue aux articles 25 et 25-1 du code civil, la déchéance de la nationalité française ne peut aujourd’hui concerner :
– qu’un individu « qui a acquis la qualité de Français », ce qui exclut les Français de naissance ;
– à condition de ne pas avoir pour résultat de le « rendre apatride », ce qui suppose qu’il dispose d’une autre nationalité. Cette restriction, visant à éviter l’apatridie, a été introduite par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
Quatre motifs peuvent justifier la déchéance :
– avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant soit une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (11), soit, depuis 1996 (12), un acte de terrorisme ;
– avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte à l’administration publique commise par une personne exerçant une fonction publique ;
– avoir été condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
– s’être « livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ».
Un cinquième cas de déchéance, applicable à un individu « condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement », a été supprimé par la loi du 16 mars 1998 précitée.
La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits :
– soit dans un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la nationalité française, délai porté à quinze ans lorsque l’individu a été condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un acte de terrorisme ;
– soit avant l’acquisition de la nationalité française. Cet ajout résulte de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
Dans les deux cas, la déchéance ne peut être prononcée que dans un délai de dix ans à compter des faits qui la justifient. Ce second délai est, lui aussi, porté à quinze ans en cas d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de terrorisme (13).
La déchéance de la nationalité est prononcée par décret du Premier ministre, pris après avis conforme du Conseil d’État.
À la connaissance de votre rapporteur, depuis 1973, treize déchéances pour acte de terrorisme ou atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ont été prononcées : une en 2002, une en 2003, cinq en 2006, une en 2014 et cinq en 2015.
L’article 2 du présent projet de loi constitutionnelle tend à mettre en œuvre l’engagement pris par le Président de la République devant le Congrès le 16 novembre 2015 : « nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, je dis bien "même s’il est né français" dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité ».
Comme l’a souligné le Conseil d’État, dans son avis du 11 décembre 2015 sur le présent projet, « si devait être instituée la déchéance de la nationalité française pour des binationaux condamnés pour des faits de terrorisme, le principe de cette mesure devrait être inscrit dans la Constitution, eu égard au risque d’inconstitutionnalité qui pèserait sur une loi ordinaire » (14).
En conséquence, l’article 2 du présent projet modifie l’article 34 de la Constitution, qui définit le champ de compétence du législateur (15), afin de l’habiliter à étendre la procédure de déchéance de la nationalité aux Français de naissance disposant d’une autre nationalité, en cas de condamnation pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation (16). Une loi ordinaire pourra ensuite définir la liste des crimes visés et la procédure applicable.
L’article 2 s’applique à « une personne née française qui détient une autre nationalité ».
Sont donc principalement concernées les personnes binationales ou plurinationales :
– nées françaises par filiation, parce qu’au moins l’un de leurs parents est français, en application du « droit du sang » (quel que soit le lieu de la naissance). Relèvent également de ce cas de figure les personnes réputées avoir été françaises depuis leur naissance, par exemple à la suite d’une adoption plénière ;
– nées françaises parce qu’elles sont nées en France et que l’un de leurs parents est lui-même né en France, en application du « double droit du sol ».
À l’inverse, sont exclus du champ de l’article 2 :
– les personnes ayant acquis la nationalité française postérieurement à leur naissance (par le « droit du sol simple », par mariage, par transmission d’un parent devenu français, par naturalisation, etc.). Celles-ci peuvent déjà être déchues de leur nationalité, dans les conditions déjà évoquées, définies aux articles 25 et 25-1 du code civil ;
– les Français de naissance qui ne disposent pas d’une autre nationalité au moment où la déchéance serait susceptible d’être prononcée. Il s’agit d’éviter de rendre des individus apatrides, à l’instar de ce que prévoient, depuis 1998, les dispositions législatives applicables aux Français par acquisition.
La déchéance de la nationalité pourrait être prononcée contre une personne « condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ».
La notion d’atteinte grave à la vie de la Nation et la liste des crimes justifiant une possible déchéance de la nationalité seraient fixées par une loi ordinaire. Selon l’exposé des motifs du présent projet, qui reprend les termes de l’avis du Conseil d’État précité, « il ne pourrait s’agir que de crimes en matière de terrorisme et, éventuellement, des crimes les plus graves en matière d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ».
Les infractions en cause seraient donc plus restreintes que celles retenues aujourd’hui à l’encontre des Français par acquisition, tant du point de vue :
– de leur champ, qui serait spécifique aux Français de naissance (les atteintes graves à la vie de la Nation) ;
– que de leur gravité, dès lors qu’une condamnation pour un délit, même terroriste, ne suffirait pas à autoriser la déchéance de la nationalité d’une personne née française.
L’article 2 du projet de loi constitutionnelle permet au législateur de définir « les conditions dans lesquelles » pourront être déchus de leur nationalité les individus concernés.
Il lui appartiendra de définir si la déchéance est prononcée :
– par un juge, qui pourrait être soit le juge répressif, à l’occasion de la condamnation pénale pour le crime justifiant la déchéance, soit un autre juge (par exemple un tribunal civil) au cours d’une instance spécifique ;
– ou par le pouvoir exécutif, à l’instar de la procédure en vigueur pour les Français par acquisition (décret pris après avis conforme du Conseil d’État). Telle est l’intention initiale des auteurs du projet, puisqu’il s’agit, selon l’exposé des motifs, de « rapprocher les règles ainsi applicables » aux différents Français concernés.
Saisie de l’article 1er relatif au régime constitutionnel de l’état d’urgence, la commission des Lois a souhaité compléter le nouvel article 36-1 de la Constitution, en organisant le contrôle parlementaire des mesures prises durant son application :
– à l’initiative de votre rapporteur, elle a prévu que le Parlement siègerait de plein droit ;
– sur proposition de Mme Marie-Françoise Bechtel, contre l’avis du rapporteur, elle a confié à la loi le soin de déterminer les modalités de ce contrôle.
La commission des Lois a également adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteur, un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs de ses collègues interdisant la dissolution de l’Assemblée nationale pendant la mise en œuvre de cette légalité d’exception.
Sur proposition de votre rapporteur, elle a clarifié le dispositif prévu par le présent projet de loi en explicitant les modalités de déclaration de l’état d’urgence et en soumettant expressément au contrôle du juge administratif les mesures prises dans ce cadre par les autorités civiles.
Par ailleurs, la commission des Lois a adopté deux amendements portant article additionnel :
– le premier, proposé par MM. Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret avec l’avis favorable de votre rapporteur, inscrit dans la Constitution les hypothèses dans lesquelles l’état de siège, dont le régime est fixé à l’article 36, peut être déclaré ;
– le second, d’ordre technique, initié par votre rapporteur, définit la notion d’« états de crise » insérée à l’occasion de la révision de 2008, en opérant par renvoi aux articles 36 et 36-1.
Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à modifier l’article 2 du présent projet. L’article 34 de la Constitution habiliterait la loi à fixer « les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ».
Cette nouvelle rédaction modifie le présent projet sur plusieurs points :
– il ne serait plus fait mention d’une personne « née française », le régime juridique de déchéance de la nationalité ayant vocation à être identique pour les Français de naissance et les Français par acquisition ;
– aucune référence à la binationalité ne serait introduite dans la Constitution ;
– les infractions pouvant justifier la procédure de déchéance pourraient être des crimes, mais aussi les délits les plus graves, dont la liste devra être fixée par le législateur ;
– la déchéance pourrait parfois ne porter que sur les « droits attachés » à la nationalité, plutôt que sur la nationalité elle-même.
Il reviendra au législateur ordinaire de préciser si la déchéance de la nationalité doit être prononcée par le pouvoir exécutif ou par un juge. Cette seconde solution a la préférence de votre rapporteur, dans la mesure où elle permettrait une meilleure individualisation de la sanction.
CONTRIBUTION DU GROUPE
UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS
(en application de l’article 86, alinéa 7, du Règlement)
Le 16 novembre dernier, le Président de la République a annoncé, devant le Parlement réuni en Congrès, sa volonté de réviser la Constitution, afin d’inscrire l’état d’urgence dans notre loi fondamentale et de sanctionner de déchéance de nationalité ceux qui rejettent ouvertement les valeurs de notre pays.
La première mesure de ce projet de loi, l’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution, semble nécessaire. Elle permettrait de renforcer la sécurité juridique de l’état d’urgence et de donner un fondement incontestable aux mesures de police mises en œuvre dans ce cadre. Notre devoir de constituant est d’encadrer, au nom de la défense des libertés publiques, en l’intégrant dans la Constitution, cette mesure exceptionnelle qui n’avait pas été envisagée en 1958. L’article premier du projet de loi doit ainsi être considéré comme un rempart de protection pour les Français.
En revanche, une telle réforme doit s’accompagner d’un renforcement des contre-pouvoirs.
Ainsi, nous souhaitons, en premier lieu, qu’un contrôle parlementaire de l’état d’urgence soit inscrit dans la Constitution. Même si un contrôle parlementaire renforcé figure, depuis l’adoption de la loi du 20 novembre 2015, dans la loi du 3 avril 1955, sa mise en œuvre dépend de la majorité en place et de l’exécutif. Dès lors, une constitutionnalisation du contrôle du Parlement permettrait que la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels confiés à l’exécutif durant l’état d’urgence fasse l’objet d’un contrôle permanent, afin qu’il ne soit pas dévoyé et utilisé à mauvais escient par un pouvoir autoritaire.
En second lieu, la prorogation de l’état d’urgence, qui est soumise à la loi, ne doit pas atteindre une durée excessive. Nous proposons sa limitation dans le temps, sur le modèle de l’article 35 de la Constitution qui impose au Gouvernement, lorsque la durée d’intervention des forces armées à l’étranger excède quatre mois, de soumettre sa prolongation au Parlement. Ainsi, la prolongation de l’état d’urgence serait soumise à une approbation régulière du Parlement.
Enfin, l’article 16 de la Constitution dispose que l’Assemblée nationale ne peut être dissoute dans le cadre de la mise en œuvre de pouvoirs exceptionnels du Président de la République. La Constitution devrait également empêcher toute dissolution du Parlement au cours de la période de l’état d’urgence dont on soulignera qu’elle permet au pouvoir exécutif de restreindre un certain nombre de libertés. Une campagne électorale qui se tiendrait dans une période où le pouvoir exécutif à toute liberté pour restreindre le droit de réunion, de manifestations ou encore de communication publique, pourrait ouvrir la voie à une dérive autoritaire.
S’agissant de la déchéance de nationalité, le groupe UDI est attaché au principe selon lequel il ne peut être fait aucune différence entre les Français. Faire référence, au sein même de la Constitution, à la binationalité, ce serait reconnaître dans notre loi fondamentale l’existence de deux catégories de français. Accorder un privilège à un criminel en fonction de son ascendance serait contraire à l’individualisation des peines et aux principes fondamentaux de notre République. Une personne doit être punie en fonction de ses actes et non pas en fonction de ses origines. La déchéance de nationalité devrait ainsi s’appliquer à tous les Français, condamnés pour crimes terroristes.
Si nous inscrivons la déchéance de nationalité dans la Constitution, nous devrons nous engager dans un processus global et cohérent, consistant notamment à ratifier la Convention des Nations Unies de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, tout en prévoyant que la France se réserve le droit de faire application de l’article 8, paragraphe 3 a) ii, qui permet de priver de nationalité un individu dès lors qu’il « a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ».
La déchéance de nationalité devrait être réservée aux individus condamnés pour « crime contre la nation ». Il nous appartiendrait ensuite de définir ce type de crime, puni de sanctions exceptionnelles. Conséquence d’une sanction pénale préalable, elle devrait relever du pouvoir exécutif et prendre la forme d’un décret.
Enfin, notre arsenal ne doit pas se limiter à des mesures exclusivement symboliques.
Ainsi, une peine d’indignité nationale, réservée aux délits, devrait être créée. Cette mesure s’appliquerait notamment aux individus qui ont séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. Cette peine d’indignité nationale permettrait de restreindre les droits civiques et civils, et de poser des conditions à l’éventuel retour de ces personnes sur le territoire national.
AUDITION DE MM. MANUEL VALLS, PREMIER MINISTRE,
ET JEAN-MARIE LE GUEN, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX RELATIONS AVEC LE PARLEMENT, ET DISCUSSION GÉNÉRALE
Lors de sa réunion du mercredi 27 janvier 2016, la commission des Lois procède à l’audition de MM. Manuel Valls, Premier ministre, et Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État aux relations avec le Parlement, et entame l’examen, sur le rapport de M. Dominique Raimbourg, du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation (n° 3381).
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. J’ai l’honneur de souhaiter la bienvenue à M. le Premier ministre, venu nous présenter, au nom du Gouvernement, le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, accompagné de M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.
Je remercie M. Dominique Raimbourg d’avoir accepté ce matin de remplacer M. Jean-Jacques Urvoas, en tant que rapporteur de ce projet de loi constitutionnelle. J’exprime à M. Jean-Jacques Urvoas, nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice, notre gratitude pour le travail accompli et la façon dont il a porté les travaux de notre commission. Nous avons formé des vœux chaleureux et fervents pour l’accomplissement de sa mission. J’exprime également l’estime, la gratitude et l’admiration que nous a inspirées Mme Christiane Taubira dans l’exercice des fonctions qu’elle vient de quitter.
La Commission examinera les articles du projet de loi constitutionnelle demain, à partir de neuf heures trente. Conformément à l’article 117-1 de notre Règlement, le Gouvernement n’assistera pas à cette discussion. Le texte est inscrit à l’ordre du jour de la séance publique des vendredi 5, lundi 8 et mardi 9 février. Je rappelle que, pour un projet de loi constitutionnelle, en application de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance publique « porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement ».
Après que M. le Premier ministre nous aura présenté le projet de loi constitutionnelle, je donnerai la parole à notre rapporteur, puis à un orateur par groupe politique ainsi qu’au co-rapporteur chargé du suivi de l’application de la loi, qui a été désigné hier, avant que ne s’expriment les intervenants qui le souhaitent.
M. Manuel Valls, Premier ministre. Monsieur le Président, monsieur le secrétaire d’État, mesdames, messieurs les députés, je suis heureux de revenir dans cette salle de la commission des Lois où j’ai siégé durant cinq ans en tant que député – je retrouve des visages familiers – et où je suis aussi intervenu en tant que ministre de l’Intérieur.
Je salue l’action de M. Jean-Jacques Urvoas à la tête de votre Commission. Chacun connaît sa rigueur intellectuelle mais aussi son indépendance et sa cohérence. À mon tour, comme l’a fait ce matin le Président de la République, je veux également saluer l’action de Christiane Taubira.
En janvier et en novembre 2015, notre pays a été frappé par le terrorisme islamiste, par des actes de guerre. Onze autres tentatives ont été évitées l’an dernier, dont deux au mois de décembre.
La France est visée ; elle l’est au plus haut point. Elle n’est pas la seule. Si le bilan pour 2015 n’est pas encore connu, une étude internationale de référence établit qu’en 2014, le terrorisme a causé plus de 32 600 victimes dans quatre-vingt-treize pays, soit une augmentation de 81 % en un an. Onze pays ont enregistré plus de 500 morts. La moitié des victimes de ces actes terroristes dans le monde est le fait de Daech ou de Boko Haram.
Depuis le début du phénomène, chiffre sans précédent, les filières terroristes syro-irakiennes ont impliqué, ou impliquent encore, près de 2 000 personnes. Plus de 1 000 individus ont fait le voyage : 600 sont encore sur place, 154 y ont été tués, et plus de 250 en sont repartis.
Nous sommes entrés dans un nouveau monde, dans une réalité particulièrement dure qui vient faire basculer une forme d’insouciance dans des pays qui vivaient en paix. La France, parce qu’elle est la France et qu’elle porte en elle une vision du monde et des valeurs universelles, se situe en première ligne. Les terroristes contestent notre engagement diplomatique et militaire. Mais ce qu’ils contestent avant tout, c’est notre modèle démocratique, nos libertés, notre idéal de laïcité, notre art de vivre. Les terroristes cherchent à nous déstabiliser, et à s’engouffrer dans les failles qui traversent notre société.
La gravité du moment nous oblige. Les Français attendent de nous que nous soyons, collectivement, quelles que soient nos sensibilités, à la hauteur des défis et de leur exigence. Une éthique de responsabilité collective s’impose.
Être à la hauteur, c’est donner davantage de moyens à nos forces de l’ordre, à nos services de renseignement, à nos armées ; c’est ce qu’a décidé le Président de la République, et ce que le Parlement a souvent approuvé de manière très large, ce que je salue.
Être à la hauteur, c’est poursuivre et intensifier notre action militaire pour frapper Daech et les groupes terroristes à la racine. La France assume son rôle de grande puissance.
Être à la hauteur, enfin, c’est adapter notre loi fondamentale à cette guerre nouvelle. Cet engagement, le Président de la République l’a pris devant vous. Il l’a pris devant la représentation nationale réunie en Congrès à Versailles. Il l’a donc pris devant la France. Il a réuni ainsi, d’une certaine manière, les conditions du rassemblement de la Nation.
Depuis le 13 novembre, le Parlement est étroitement associé aux réponses que nous apportons. Le 15 novembre, les groupes parlementaires et les formations politiques étaient reçus à l’Élysée. Le 16 novembre, vous étiez réunis en Congrès pour entendre le Président de la République. Le 19 novembre, vous votiez, à l’Assemblée nationale, l’état d’urgence, adopté le lendemain dans les mêmes termes par le Sénat et promulgué dès le 20. Le 25 novembre, vous autorisiez la prolongation de l’engagement des forces aériennes en Syrie. À chacune de ces dates, j’ai tenu à être devant vous. Il est donc naturel que je le sois à nouveau aujourd’hui pour ce projet de révision constitutionnelle, projet qui s’inscrit, je veux insister sur ce point, dans le fil de notre stratégie antiterroriste ; dans le fil du plan de lutte contre les filières terroristes, adopté par le Conseil national du renseignement en avril 2014 ; dans le fil, enfin, de la réforme du renseignement intérieur et territorial, des renforcements successifs des effectifs et des moyens, techniques et budgétaires accordés aux services de renseignement, d’investigation, et plus généralement de sécurité.
Ce projet s’inscrit également dans le contexte d’une refonte globale du cadre juridique applicable aux services de renseignement. Elle a permis de conforter les moyens d’investigation dont ils disposent au service de la détection des terroristes et de leurs projets, avec une saisie aussi fréquente que possible de l’autorité judiciaire.
J’en viens au premier élément du projet de loi constitutionnelle : l’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution.
Vous connaissez la succession des événements : dans les trois heures qui ont suivi les attentats, dès le 13 novembre au soir, le Conseil des ministres décidait le déclenchement de l’état d’urgence. Et, dès l’examen parlementaire du projet de loi de prorogation, le Gouvernement proposait au Parlement de moderniser la loi de 1955.
Il était nécessaire d’aller plus loin en donnant un fondement constitutionnel incontestable au régime de l’état d’urgence. Les juristes que le Gouvernement avait consultés informellement le recommandaient, et le Conseil d’État l’a officiellement confirmé dans son avis du 11 décembre.
Je veux exposer brièvement les trois motifs qui justifient d’inscrire l’état d’urgence dans la Constitution.
Premièrement, le régime de l’état d’urgence est d’abord le régime de circonstances exceptionnelles le plus fréquemment utilisé sous la Ve République ; mais aussi le seul qui ne soit pas inscrit dans la norme juridique la plus haute. Cela pose un vrai problème au regard de la hiérarchie des normes. Le bloc de constitutionnalité s’est considérablement enrichi depuis les débuts de la Ve République. Il faut donc pouvoir justifier, au regard de la jurisprudence constitutionnelle, l’ensemble des pouvoirs temporaires et dérogatoires conférés aux autorités civiles dans le cadre de l’état d’urgence. Conférer une base constitutionnelle à l’état d’urgence, c’est consolider les mesures de police administrative définies par la loi de 1955.
Deuxièmement, il convient de parachever la révision de la loi de 1955. Certaines mesures n’ont pu être inscrites dans la loi du 20 novembre en raison de contraintes jurisprudentielles. Un projet de loi ordinaire permettra de préciser les conditions de déroulement des perquisitions administratives et d’assignation à résidence. II créera une mesure de retenue de brève durée, permettant de garder sur place la personne visée pendant les opérations de perquisition, pour une durée maximale de quatre heures, durée maximale habituellement applicable à la vérification d’identité. Si la personne visée le demande, l’autorité judiciaire sera immédiatement prévenue et aura la possibilité de mettre fin à la mesure si elle l’estime non justifiée. En outre, lorsque des documents liés à l’objet de la perquisition ne peuvent être matériellement exploités pendant les opérations – s’ils sont, par exemple rédigés dans une langue étrangère –, un régime de saisie temporaire à durée limitée, de quinze jours, sera prévu. Il en ira de même lorsque l’exploitation ou la copie sur place des matériels informatiques ne sera pas techniquement possible. Enfin, si la perquisition permet de révéler un autre lieu fréquenté par la personne visée, un droit de suite permettra de réaliser une perquisition en urgence dans cet autre lieu.
Troisièmement, il s’agit d’empêcher la banalisation de l’état d’urgence ou tout recours excessif. C’est le rôle de la norme la plus haute d’en encadrer les principes essentiels, c’est-à-dire la caractérisation des motifs de déclenchement, le fait de subordonner ce déclenchement à une décision prise en conseil des ministres, et le fait de confier au Parlement la prérogative de pouvoir, seul, le proroger au-delà de douze jours.
L’état d’urgence s’inscrit pleinement au sein de l’État de droit. En 2016, il est grand temps d’en tirer les conséquences en l’inscrivant dans la Constitution, c’est-à-dire aussi d’en protéger les critères essentiels – toute modification étant en effet conditionnée à une majorité de trois cinquièmes des parlementaires.
Le Président de la République avait pris l’engagement que le Parlement serait informé très étroitement des conditions de mise en œuvre de l’état d’urgence, et que tout serait fait pour faciliter le contrôle parlementaire. Cet engagement a été tenu. Et je veux remercier tout particulièrement la commission des Lois et M. Jean-Jacques Urvoas, qui fut son président jusqu’à il y a quelques heures à peine, pour leur engagement remarqué dans ce domaine. Certains amendements proposent de constitutionnaliser l’existence et la nature de ce contrôle parlementaire au rang des principes essentiels. Le Gouvernement est très ouvert sur ce sujet et pourra se rallier à une formulation de cette nature.
D’autres amendements proposent de constitutionnaliser un plafond temporel, par exemple, de quatre mois, à la prolongation de l’état d’urgence par les parlementaires. Cette limitation des prérogatives du Parlement ne présente pas que des avantages. Elle pourrait ne pas s’adapter à certaines crises civiles. Mais le Gouvernement souhaite écouter tous les arguments présentés à ce sujet pendant la discussion et poursuivre le dialogue, sans a priori.
La constitutionnalisation du principe d’incompatibilité entre la procédure de dissolution parlementaire et la mise en œuvre de l’état d’urgence est plus délicate. Si l’état d’urgence avait été déclaré en mai et juin 1968, le Général de Gaulle aurait-il pu dissoudre l’Assemblée nationale ? Je ne doute pas que nous débattrons de ces questions en séance publique.
Je ne reviens pas aujourd’hui en détail sur les conditions de mise en œuvre de l’état d’urgence. Nous en discuterons également très prochainement à l’occasion de l’examen du projet de loi portant nouvelle prorogation, qui sera délibéré mercredi prochain en conseil des ministres. Il a été inscrit à l’ordre du jour du Sénat du 9 février prochain. Je dirai simplement qu’il y a eu, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et des préfets, une application maîtrisée, contrôlée et encadrée. Elle s’est efforcée de tenir compte des observations faites au cours du contrôle parlementaire et de l’examen des recours juridictionnels.
À ce jour, 3 234 mesures de perquisitions administratives ont été décidées. Mais cela reste ciblé sur des personnes particulièrement signalées au regard des milliers de personnes concernées par la radicalisation violente. Le nombre des mesures d’assignation à résidence, par nature restrictives de liberté, est resté beaucoup plus réduit. Il concerne ou a concerné 406 personnes.
En outre, il faut souligner l’usage décroissant dans le temps depuis le début de l’état d’urgence du recours à ces mesures, et c’est normal. Ces dispositions demeurent toutefois très utiles, soit lorsqu’il faut traiter de nouveaux dossiers, soit lorsque des éléments inquiétants supplémentaires sont relevés à l’égard de personnes n’ayant pas justifié jusque-là une telle mesure.
Cette mise en œuvre s’est accomplie dans l’entier respect des prérogatives de l’autorité judiciaire s’agissant des affaires sur lesquelles elle avait ouvert des enquêtes. Par ailleurs, toute nouvelle infraction constatée a été immédiatement portée à sa connaissance, entraînant un dessaisissement de l’autorité administrative.
Ces mesures ont permis, et permettent encore, d’accélérer le travail de renseignement sur la mouvance islamiste radicale.
Chacun, y compris les observateurs qui jouent leur rôle de contre-pouvoir, doit bien mesurer l’intérêt de ces mesures pour déstabiliser ceux qui soutiennent, encouragent ou participent aux filières du terrorisme, que ce soit directement ou indirectement.
À l’inverse, tout ce qui est fait en matière d’antiterrorisme depuis le 13 novembre ne relève pas de l’état d’urgence. Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, préparé par le ministère de la Justice, comprendra ainsi de nouvelles mesures, indépendantes de l’état d’urgence. J’ai eu l’occasion de dire, en répondant, hier, au président Roger-Gérard Schwartzenberg, lors des questions au Gouvernement, que nous examinerons aussi avec la plus grande attention les solutions avancées par le Sénat au travers de la « proposition de loi Bas-Mercier ».
Personne ne peut préjuger des événements à venir. Avec la diffusion toute récente de la vidéo de Daech, nous voyons bien quel est l’état de la menace. Mais le régime d’état d’urgence est un régime d’exception nécessairement borné dans le temps. Le constitutionnaliser ne revient bien sûr en rien à instaurer un état d’urgence permanent.
L’autre élément de cette révision constitutionnelle, le second article du texte, porte sur l’extension de la déchéance de la nationalité française à l’encontre de coupables condamnés pour des faits constitutifs d’atteintes graves à la vie de la Nation. Par cette expression, le projet du Gouvernement englobe des crimes de terrorisme, de trahison, d’espionnage, ou de gravité comparable pour la vie collective nationale.
Le Gouvernement mesure l’intensité du débat sur ce sujet. Il respecte tous les points de vue qui se sont exprimés, et je me présente devant vous avec l’intention d’être fidèle aux engagements pris par le Président de la République devant le Congrès le 16 novembre dernier, et avec la volonté de répondre aux interrogations politiques, morales et juridiques qui ont pu s’exprimer.
Je souhaite réaffirmer de manière très solennelle les valeurs et les objectifs poursuivis par le Gouvernement, et formuler certaines propositions permettant, je l’espère, le rassemblement le plus large possible.
Rappelons que la déchéance de la nationalité a une histoire juridique et politique, étroitement liée à celle de la République.
Cette mesure, originellement introduite pour combattre l’esclavagisme en 1848, a été élargie au XXe siècle comme moyen de sanction à l’encontre des citoyens ayant choisi de servir des puissances ennemies. Prévue initialement à titre temporaire par les lois de 1915 et 1917 à l’encontre des Français naturalisés, cette sanction a été consolidée par la loi du 10 août 1927. Notons d’ailleurs, que ce texte, voté sous le gouvernement d’Union nationale de Raymond Poincaré, attribue à l’autorité judiciaire la compétence pour prononcer cette sanction.
Avec la montée des tensions en Europe à la fin des années 1930 et la perspective d’un nouveau conflit, la décision fut prise en 1938 par décret-loi de confier le prononcé de cette sanction à l’autorité administrative. Toutefois, ce texte subordonnait la déchéance à une condamnation pénale préalable, marquant à nouveau l’importance attachée à l’intervention de l’autorité judiciaire.
Depuis, la déchéance de nationalité a toujours fait partie du droit républicain, pour sanctionner l’acte délibéré portant trahison des intérêts fondamentaux de notre pays avec la volonté de fragiliser ses institutions ou d’attenter à sa stabilité. La loi du 22 juillet 1996, qui la prévoit pour les actes terroristes, s’est inscrite dans cette filiation républicaine.
Bien sûr, chacun ici éprouve la plus grande répulsion face aux déchéances collectives ordonnées par le régime de Vichy. En ce domaine comme dans bien d’autres, ce régime a subverti le droit républicain au service d’une politique inique, raciste et discriminatoire. Mais, gardons-nous des raccourcis et ne confondons pas des décisions prises après condamnation par des tribunaux libres et indépendants avec ce pan sombre de notre histoire ! Le souvenir de Vichy ne doit jamais effacer la longue histoire de la République. Au lendemain de ces heures terribles, le général de Gaulle a également pris des décisions pour rappeler cette histoire.
Enfin, ayons à l’esprit une autre étape importante qu’a constituée la loi du 16 mars 1998, adoptée par le Parlement sur proposition du gouvernement de Lionel Jospin. Elle transcrit dans notre droit positif les accords internationaux humanitaires adoptés après-guerre, qui interdisent la création d’apatrides.
Tout dans l’histoire républicaine rappelle donc que la déchéance de nationalité est un acte exceptionnel, rare, qui sanctionne des comportements graves de rupture avec la communauté nationale. De nombreuses déchéances ont été prononcées depuis plusieurs années. Depuis 2012, le ministre de l’Intérieur a engagé des déchéances de nationalité. Cette histoire républicaine, c’est bien celle dans laquelle a voulu s’inscrire le Président de la République après les attentats commis au cours de l’année 2015. La rupture et la déchirure avec la communauté nationale appellent une réponse de l’État.
Dans son avis du 11 décembre 2015, le Conseil d’État, saisi par le Gouvernement, établit que l’extension du régime de la déchéance devait passer par une mention dans la Constitution, d’où ce projet d’article 2. Néanmoins, dans le souci d’avancer, et, je le répète, d’aboutir à un rassemblement le plus large possible, ou de lever des ambiguïtés, le Gouvernement a décidé, en accord avec le Président de la République, de proposer une nouvelle rédaction. Elle repose sur les principes qui suivent.
Premièrement, aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel, ni a priori dans la loi ordinaire. Seuls les principes prévus par la Convention internationale de 1954 et par la loi du 16 mars 1998, qui proscrivent la création de nouveaux apatrides, devront continuer à figurer dans notre droit positif. La France s’engagera d’ailleurs dans la ratification de cet accord qu’elle a signé dès 1955.
Deuxièmement, le principe d’égalité commande, aussi bien sur le plan moral que juridique, d’unifier les régimes applicables aux personnes condamnées encourant la déchéance, qu’elles soient naturalisées ou nées françaises. J’ai beaucoup entendu parler d’égalité devant la loi, mais je constate que personne n’a souligné qu’en l’état du droit, seuls peuvent être déchus de leur nationalité les Français naturalisés. Je n’ai pas entendu de nombreuses voix protester lorsque moi-même ou Bernard Cazeneuve avons engagé des déchéances de nationalité
– ce qui s’était déjà fait précédemment, notamment sous la présidence de Jacques Chirac marquée également par des actes terroristes en 1995.
Troisièmement, seules des infractions d’un niveau de gravité très élevé pourront justifier la procédure de déchéance. Les crimes certes, mais sans doute aussi les délits les plus graves – dans le texte transmis au Conseil d’État, les délits et les crimes étaient concernés – tels que l’association de malfaiteurs à caractère terroriste, le financement direct du terrorisme ou l’entreprise terroriste individuelle, tous punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement.
Quatrièmement, le champ sera strictement limité au terrorisme et aux autres formes graves d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, parmi lesquelles l’espionnage et la trahison. Depuis l’été 2015, le Conseil constitutionnel a clairement délimité cette notion.
Cinquièmement, la loi ordinaire comprendra un article instaurant un régime global couvrant à la fois la déchéance de nationalité et la déchéance de tout ou partie des droits attachés à la nationalité, actuellement prévues par le code pénal. Ainsi, cet article aura une portée universelle puisqu’il concernera l’ensemble des personnes condamnées pour les atteintes graves aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Je confirme que l’engagement de l’exécutif sera tenu, qui prévoit que votre assemblée dispose le plus rapidement possible des deux avant-projets de loi d’application des articles 1er et 2 du projet de loi constitutionnelle – soit bien avant la séance publique du 5 février prochain. Une communication sur ces sujets est prévue en conseil des ministres mercredi prochain. Les avant-projets pourront bien évidemment faire l’objet d’un débat avec les parlementaires.
Un dernier débat mérite d’être conduit, puis tranché : il concerne, au regard de l’histoire juridique républicaine de la déchéance que je viens de rappeler, le régime juridique de cette sanction. Doit-il s’agir d’une décision administrative, subordonnée à l’avis conforme du Conseil d’État, qui lie les mains de l’exécutif, ou bien doit-on en revenir à un régime de peine complémentaire prononcée par le juge pénal, en l’occurrence la juridiction nationale spécialisée dans la lutte contre le terrorisme ? À ce stade, je me contente d’une remarque pour nourrir ce débat : le droit actuel, c’est-à-dire la déchéance de nationalité par l’autorité administrative sous contrôle du Conseil d’État, ne prévoit aucune automaticité de cette sanction. Qu’elle soit administrative ou judiciaire, une sanction d’une telle gravité gagne toujours à être individualisée.
Ainsi, tout en laissant ouvert le sujet que je viens d’évoquer relatif au régime juridique de la sanction, le Gouvernement est conduit à proposer la rédaction suivante : « La loi fixe les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation. »
Je ne doute pas que vos débats nourriront la réflexion sur le sujet. Le Gouvernement, qui souhaite installer un dialogue permanent avec l’ensemble des groupes à l’Assemblée et au Sénat, sera extrêmement ouvert à l’ensemble des amendements.
Voilà, mesdames et messieurs, l’état de la réflexion du Gouvernement, après écoute et prise en compte du débat déjà très riche sur ce sujet qui est loin d’être terminé.
M. Dominique Raimbourg, rapporteur. Je partage évidemment totalement les propos élogieux tenus précédemment tant à l’égard de M. Jean-Jacques Urvoas que de Mme Christiane Taubira.
Si mon nom est associé tardivement au rapport que je vous présente aujourd’hui, j’ai collaboré au travail de M. Jean-Jacques Urvoas, et je ne découvre pas le dossier ce matin.
En réunissant le Congrès à Versailles, le 16 novembre dernier, le Président de la République a voulu avant tout favoriser l’unité du pays après les attentats dont nous avons été victimes – mais vous avez rappelé à juste titre, monsieur le Premier ministre, que le terrorisme frappait dans le monde entier. Sans perdre de vue cette nécessité d’unité, doit venir ensuite le temps parlementaire, qui permet d’améliorer les mesures à mettre en place. Mon travail s’inscrira dans cet esprit, de même que les quelques observations, plus ou moins importantes, que je vous livre.
À l’occasion de cette révision, nous pourrions nous interroger sur la possibilité de « toiletter » les états d’exception inscrits dans la Constitution, comme l’article 16 ou l’article 36, et sur la nécessité de les regrouper dans un titre spécifique.
Plutôt que de prévoir que l’état d’urgence est « déclaré » en conseil des ministres, il me semble préférable d’écrire qu’il est « décrété », terme qui semble favoriser une délibération collective au sein de cet organe.
Pour ce qui est de la durée de l’état d’urgence, le projet de loi constitutionnelle reprend le dispositif de la loi de 1955 qui ne prévoit pas de limitation dans le temps : le Parlement fixe lui-même ce délai. Je pense que c’est une bonne décision car l’état d’urgence doit être adapté aux circonstances précises auxquelles il répond. L’encadrement de la prolongation pose aussi question : il appartiendra au Parlement de se prononcer sans que la Constitution ne fixe par avance une date butoir.
J’entends à la fois dire que la constitutionnalisation de l’état d’urgence permettait son encadrement, mais aussi qu’elle constituerait une banalisation. J’observe que le Conseil constitutionnel a déjà validé l’existence de l’état d’urgence dans sa décision du 25 janvier 1985 relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie. La constitutionnalisation n’est donc pas un recul mais, bien au contraire, un encadrement qui permet de rappeler que la loi fixe les modalités et la durée de l’état d’urgence, et qu’elle organise sa prorogation. Il serait ensuite très difficile, à moins d’adopter une révision constitutionnelle, de revenir sur ce privilège légitime accordé au Parlement.
Nous avons prévu, je le rappelle, un contrôle par le juge administratif ; il faudra peut-être reprendre ce point, au cas où il ne figurerait pas dans le projet du Gouvernement.
Peut-être pourrions-nous nous inspirer de l’article 16 de la Constitution pour prévoir un contrôle régulier par le Conseil constitutionnel, sans doute pas de l’opportunité, mais plutôt de la proportionnalité de l’état d’urgence vis-à-vis des circonstances.
Nous pouvons également nous demander si la loi qui fixe les modalités de l’état d’urgence doit être une loi simple ou une loi organique. Dans ce second cas, elle serait en effet soumise au contrôle préalable du Conseil constitutionnel.
Vous vous êtes dit, Monsieur le Premier ministre, favorable à un contrôle parlementaire. L’action de M. Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des Lois, a été exemplaire ; la collaboration avec le Gouvernement, et plus généralement avec l’autorité administrative responsable, a été tout à fait bonne. Le contrôle parlementaire a été satisfaisant, et n’a pas révélé de dérives pouvant constituer des atteintes aux libertés publiques – même si chacun est conscient que l’état d’urgence est un moment particulier.
Quant à l’article 2, je veux rappeler notre objectif : ne pas briser l’unité nationale, rester unis face au terrorisme, faire face. C’est ainsi que notre pays sera efficace. Nous devons également réfléchir avec modération aux questions qui se posent.
Sanctionner, c’est dire les choses ; c’est donc rappeler que l’action terroriste est un crime. Dès lors, la judiciarisation de la sanction est une bonne mesure : elle permet de rappeler que ces actes sont des crimes. Il est alors logique de judiciariser également l’autre sanction prévue par l’article 2, c’est-à-dire la déchéance de nationalité. Toute mesure de déchéance, quelle qu’elle soit, doit à mon sens être une peine complémentaire, imposée par le juge judiciaire.
Il serait également bon, je crois, d’utiliser les termes d’« atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation » : cette notion, qui englobe le terrorisme, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel dans une décision du 23 juillet 2015, fait déjà l’objet du titre Ier du livre IV du code pénal.
Nous pourrions également proposer d’aggraver la répression. Ainsi, nous pourrions calquer la période de sûreté sur ce qui est prévu au dernier alinéa de l’article 221-4 du code pénal, c’est-à-dire une durée de trente ans. Nous pourrions également penser à d’autres privations de droits, plus symboliques : déchéance d’autorité parentale, par exemple, sans préjudice du droit de visite et d’hébergement. Cela signifierait que celui qui s’est laissé aller à commettre des crimes de sang contre son pays n’est plus qualifié pour élever un enfant, à venir ou déjà né. Nous devons aussi réfléchir à ces points.
Sur l’égalité, monsieur le Premier ministre, je vous rejoins : il ne faut pas inscrire dans la Constitution de différence entre les citoyens en fonction de la façon dont ils ont acquis la nationalité française. L’article 1er de notre Constitution dispose en effet que la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine ».
Sur ces bases, nous pourrions peut-être travailler tous ensemble. Notre unité, je le redis, sera notre meilleure réponse au terrorisme.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Nous entendons maintenant les représentants des groupes.
M. Christian Jacob. Merci, monsieur le Président, de m’accueillir dans cette commission, dont je ne suis pas membre.
Monsieur le Premier ministre, je réagirai rapidement à vos propos, tout en soulignant la difficulté que nous éprouvons à travailler sur un texte dont nous ne disposons pas, puisque j’ai compris que le texte déposé le 23 décembre allait être modifié.
L’opposition a toujours, quand il s’est agi d’armer la France contre le terrorisme, su répondre présente. Sur la poursuite des frappes aériennes en Syrie, sur la loi relative au renseignement, sur la loi prorogeant l’état d’urgence, l’opposition a pris ses responsabilités. Aujourd’hui et demain, elle saura le faire à nouveau.
Le Parlement a modifié les dispositions relatives à l’état d’urgence, et cette loi a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, la nécessité de constitutionnaliser ces mesures apparaît moins clairement.
J’entends vos arguments sur la nécessité de parachever cette mise à jour de la loi de 1955, par exemple sur les perquisitions. C’est un point qu’il faut travailler, mais les experts sont suffisamment nombreux au sein de la commission des Lois pour que je ne m’y arrête pas.
S’agissant de la déchéance de nationalité, nous avons présenté à deux reprises une proposition de loi sur ce sujet. Dès lors que des individus binationaux prennent les armes contre la France, contre nos militaires, contre nos gendarmes, contre nos policiers, contre tous nos concitoyens, ils ne sont pas dignes d’être Français : cette position a toujours été la nôtre, et nous l’avons rappelée à plusieurs reprises. Vous souhaitez l’inscrire dans la Constitution. Vous vous rappelez que, lors de mon intervention au Congrès, je m’étais interrogé sur la nécessité d’emprunter cette voie.
La nouvelle rédaction que vous nous proposez ne fait plus référence, je crois, à la binationalité, ce qui était le cas de la première mouture de votre projet de loi. Je comprends votre argument : ne va-t-on pas alors demander à la loi d’encadrer la Constitution ? (Exclamations.) Ce point demeure flou.
Je laisse la place au débat, et aux juristes présents, qui sont encore une fois suffisamment nombreux ici pour le nourrir. Mais comprenez qu’entre le texte déposé le 23 décembre et celui que vous nous annoncez, le changement est grand.
Nous serons toujours au rendez-vous de l’efficacité. Mais j’attends que l’on me démontre que c’est en révisant la Constitution que notre efficacité sera la plus grande.
Voilà où en est aujourd’hui notre réflexion.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Je rappelle, mes chers collègues, que c’est le texte initialement déposé par le Gouvernement qui sera débattu en séance. Les amendements que nous adopterons éventuellement demain ne modifieront pas immédiatement ce texte, mais seront défendus en séance par le rapporteur, au nom de la commission des Lois.
Cette règle vaut évidemment pour les amendements du Gouvernement.
M. Patrick Mennucci. J’ai la difficile tâche de prendre la parole au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen, en lieu et place de notre collègue Dominique Raimbourg.
Ce projet de loi constitutionnelle concrétise l’engagement pris par le Président de la République devant le Congrès, le 16 novembre dernier. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen considère que ce projet traduit la volonté du Gouvernement de mobiliser tous les ressorts de l’État pour faire face au terrorisme qui a ensanglanté notre pays.
Les deux articles du projet de loi ont, pour des raisons très différentes, suscité des débats nourris et des interrogations légitimes.
S’agissant de l’article 1er, qui inscrit le régime de l’état d’urgence dans la Constitution, sa portée juridique tient principalement à son deuxième alinéa, qui précise que « la loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements ».
Après avoir entendu le Premier ministre, ainsi que notre rapporteur, je souligne que notre travail devra s’articuler autour de quelques questions essentielles.
Faut-il réfléchir à une articulation des différents états de crise qui figurent dans notre Constitution ? Le Gouvernement ne propose pas à ce jour de rapprocher l’état d’urgence de l’état de siège, comme l’avaient proposé le comité Vedel en 1993 et le comité Balladur en 2007, ni de remplacer l’état de siège par l’état d’urgence, même si ceux-ci entretiennent une certaine proximité.
L’article 36, consacré à l’état de siège, et le futur article 36-1, sur l’état d’urgence, figurent tous deux au titre V, qui a trait aux rapports entre le Parlement et le Gouvernement. On pourrait imaginer qu’un titre spécifique soit consacré aux « états de crise », formule qui figure depuis 2008 dans la Constitution : il regrouperait ces deux dispositifs, ainsi peut-être que les dispositions prévues à l’article 16, relatives aux pleins pouvoirs.
Sur la procédure de déclenchement de l’état d’urgence, je souscris entièrement aux propos du rapporteur : il serait préférable que l’état d’urgence soit « décrété » ; ce terme suppose en effet une délibération en conseil des ministres, ce qui me semble un élément supplémentaire de protection des libertés.
Nous devons également nous interroger sur la durée de l’état d’urgence lors de son déclenchement initial, ainsi que sur celle d’éventuelles prorogations. Comme la loi du 3 avril 1955 récemment modifiée, le projet de loi constitutionnelle ne prévoit aucune limite globale à l’application dans le temps de l’état d’urgence, et ne fixe pas non plus un nombre maximal de prorogations. Il reviendra au Parlement, seul compétent pour proroger l’état d’urgence, de déterminer au cas par cas l’opportunité et la durée de ces prorogations.
Constitutionnaliser le régime de l’état d’urgence, c’est encadrer cet état d’exception : à ce titre, c’est un progrès pour les libertés publiques, et notre groupe ne peut que s’en féliciter. La banalisation de cette mesure est ainsi écartée.
Afin de contrôler si les conditions nécessitant l’état d’urgence sont toujours réunies, il pourra être envisagé de prévoir, comme l’a dit notre rapporteur, un avis du Conseil constitutionnel, sur le modèle des dispositions de l’article 16. Il appartiendra ensuite aux parlementaires de se saisir de cet avis pour accorder, ou pas, une prorogation supplémentaire.
Nous proposerons donc d’intégrer le Conseil constitutionnel au processus de contrôle de l’état d’urgence.
Notre rapporteur a aussi souligné que le Gouvernement pouvait choisir de recourir à une loi organique plutôt qu’à une loi ordinaire, ce qui garantirait un contrôle préalable par le Conseil constitutionnel de l’ensemble des dispositions, et nous éviterait ainsi d’attendre les décisions successives qui seraient prises au gré des questions prioritaires de constitutionnalité. Une loi organique doit, en outre, être approuvée en lecture définitive par une majorité absolue des députés.
Le nouvel article 36-1 ne reprend pas les dispositions récemment votées qui organisent un contrôle parlementaire de l’état d’urgence. Ce n’est pas indispensable, puisque l’article 24 de la Constitution confère au Parlement le pouvoir de contrôler l’action du Gouvernement, en temps ordinaire comme en temps de crise. Le travail effectué ces derniers mois par notre Commission l’a d’ailleurs prouvé.
S’agissant de l’article 2, qui porte sur la déchéance de nationalité, les différents arguments sont connus. Merci, monsieur le Premier ministre, d’avoir indiqué que vous avez entendu le Parlement, et la société tout entière, sur ce sujet. Ce débat ne fut pas exempt de confusion ; il fut parfois lourd de malentendus ; beaucoup ont éprouvé de l’inquiétude mais aussi, je l’avoue, une certaine lassitude.
Quand la politique s’emballe, il peut arriver que le droit soit emporté par la tourmente. C’est pourtant le droit qui pourra nous aider à mettre de l’ordre dans nos débats, à calmer les passions et à aller au fond des choses. C’est ce que nous proposent le Premier ministre et le rapporteur.
Comment sanctionner ceux qui se vautrent dans l’ignominie et foulent aux pieds les valeurs humanistes consubstantielles à notre pacte démocratique ? Par quels moyens la République peut-elle se défendre contre ses agresseurs ?
Nous ne cherchons pas ici les symboles : nous voulons combattre le terrorisme. À cet égard, nous avons beaucoup entendu que la déchéance de la nationalité n’avait rien à voir avec ce combat. Ce n’est pas, je crois, la réalité.
L’acte terroriste n’est rien d’autre qu’un acte criminel, et il est identifié comme tel par notre code pénal. Il est essentiel de nier toute singularité politique à la violence terroriste ; nous devons refuser toute spécificité à sa répression. Le terrorisme n’est qu’un crime.
Le projet initial du Gouvernement évoquait le terrorisme ; le Conseil d’État a ensuite suggéré la notion de « crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation ». Pour éviter toute ambiguïté, le groupe Socialiste, républicain et citoyen propose d’en revenir à la notion plus intelligible d’« atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », déjà présente dans notre code pénal. C’est une catégorie bien connue de notre droit positif, que la décision constitutionnelle du 23 juillet 2015 a encore complétée en indiquant explicitement qu’elle englobait le terrorisme.
Toute mesure de déchéance de nationalité constituera une peine complémentaire, liée à une condamnation pour acte de terrorisme.
Une loi sera nécessaire pour compléter la nouvelle rédaction de l’article 34 de la Constitution. Là encore, nous souhaitons nous placer dans le champ du code pénal plutôt que du code de la nationalité. Nous suggérons de prévoir la possibilité d’aggraver le châtiment pénal par l’élargissement de la privation, pour les condamnés, de droits et garanties qui sont propres aux citoyens français.
Le groupe Socialiste, républicain et citoyen propose également que la période de sûreté prévue à l’article 132–23 du code pénal soit portée à trente ans pour les crimes terroristes, interdisant ainsi toute réduction ou aménagement de peine. On pourrait aussi imaginer d’étendre aux actes de terrorisme les dispositions relatives à la peine de perpétuité incompressible. Cette perpétuité dite réelle est au sommet de notre hiérarchie répressive ; elle s’applique aujourd’hui uniquement aux personnes reconnues coupables soit de meurtre avec viol, tortures ou acte de barbarie d’un mineur de quinze ans, soit de meurtre en bande organisée ou assassinat d’une personne dépositaire de l’autorité publique à l’occasion ou en raison de ses fonctions.
L’individualisation de la peine est un principe fondamental de notre droit. La loi d’application de la Constitution permettra au juge de l’appliquer.
Nous avons beaucoup entendu que la déchéance de nationalité serait inefficace pour lutter contre le terrorisme, et donc inutile. Monsieur le Premier ministre, j’entends au contraire que vous proposez la déchéance de nationalité pour les terroristes dans le cadre des lois françaises et des conventions internationales. Cette proposition nous convient, et nous semble propre à dissiper la confusion. La déchéance est un principe, et non un symbole : dès lors, peu importe le mode d’acquisition de la nationalité. L’article 1er de la Constitution dispose de plus que la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine » ; il ne saurait donc être question d’inscrire, quelques articles plus loin, une distinction entre les citoyens en fonction de la façon dont ils ont acquis la nationalité française ou de faire référence à une éventuelle double nationalité.
La nouvelle rédaction que vous proposez nous paraît donc conforme à l’esprit de la convention internationale de 1954 et de la loi du 16 mars 1998. Elle permettra au juge d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble de ces textes, l’opportunité de prononcer cette peine supplémentaire que pourrait être la déchéance de nationalité.
Voilà, au moment où nous parlons, et même s’il est difficile de réagir dans l’instant, la position du groupe Socialiste, républicain et citoyen.
M. Jean-Christophe Lagarde. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Président, mes chers collègues, la guerre que livrent à la France des groupes barbares, comme les attentats qui ont à plusieurs reprises frappé notre pays l’an dernier, ont conduit le Président de la République à réunir le Congrès le 16 novembre dernier. Il y a annoncé sa volonté de réviser la Constitution afin d’inscrire l’état d’urgence dans notre loi fondamentale, mais aussi afin de pouvoir sanctionner par la déchéance de la nationalité française des gens qui manifestement ne partagent plus rien avec la France et n’ont plus pour notre pays que de la haine.
Le projet de loi constitutionnelle que vous nous proposez comporte deux articles.
Le premier paraît nécessaire au groupe Union des démocrates et indépendants : il semble en effet indispensable de renforcer la sécurité juridique de l’état d’urgence, ce que permettra sa constitutionnalisation. Nous souhaiterions que le contrôle parlementaire soit également inscrit dans la Constitution : pour la première fois, à l’initiative des deux commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, un contrôle parlementaire renforcé a en effet été mis en œuvre. Mais celui-ci dépend aujourd’hui du bon vouloir de la majorité en place, comme de l’exécutif. Il nous semble donc indispensable de le constitutionnaliser : les parlementaires doivent pouvoir contrôler les pouvoirs exceptionnels confiés à l’exécutif.
Notre groupe estime également nécessaire de prévoir une limite de l’état d’urgence dans le temps. Nous pourrions la calquer sur les dispositions qui régissent aujourd’hui les interventions militaires extérieures : cela n’empêcherait en rien la prorogation de l’état d’urgence, mais imposerait une approbation régulière du Parlement. J’avoue m’interroger sur la place du Conseil constitutionnel dans un tel dispositif ; c’est un débat que nous devrons mener. L’état d’urgence ne doit pas devenir permanent ; il ne doit pas durer trop longtemps sans que le Parlement approuve sa prorogation.
Nous souhaitons que la dissolution ne soit pas possible au cours de cette période particulière qui permet au pouvoir exécutif de restreindre certaines libertés, notamment celles de manifester, de communiquer, de se déplacer ou de tenir des réunions : le pouvoir exécutif qui aurait le pouvoir de dissoudre aurait en effet aussi celui de fausser le résultat des élections, et c’est un point qu’il faut garder à l’esprit. Il ne s’agit nullement ici d’un procès d’intention que je ferais au Président de la République actuel ou au Gouvernement actuel ; mais on ne sait pas qui, demain, pourrait avoir la possibilité d’abuser de ses pouvoirs.
Je souligne, monsieur le Premier ministre, que lorsque vous avez reçu les groupes parlementaires, nous avions indiqué que si cette menace s’avérait d’une intensité et d’une ampleur exceptionnelle, sa durée n’était pas limitée : dès lors, il nous semble nécessaire d’adapter aussi notre droit commun, pour ne pas être amenés à vivre de façon permanente sous l’état d’urgence.
Je salue enfin l’engagement du Gouvernement de nous permettre de disposer des projets de textes d’application dès que possible.
Quant à l’article 2 et à la déchéance de nationalité, qui a fait couler beaucoup d’encre, souvent d’ailleurs dans la méconnaissance des textes existants, je veux dire notre attachement au principe selon lequel il n’est fait aucune différence entre les Français. La nouvelle rédaction que propose le Gouvernement, que j’ai écoutée attentivement, nous paraît mieux correspondre à ce que nous souhaitons.
Aujourd’hui, des différences entre citoyens français existent ; elles étaient souvent ignorées, et n’étaient pas dénoncées. Elles ne nous conviennent pas. Nous sommes naturellement favorables à l’individualisation de la peine – il faut punir quelqu’un pour ses actes, et non en fonction de ses origines. Nous sommes surtout opposés à l’attribution de privilèges à tel ou tel criminel selon qu’il possède, ou pas, une autre nationalité.
Nous souhaitons que la déchéance de nationalité soit limitée aux crimes, et n’aille pas au-delà. Nous créerions en quelque sorte un crime contre la nation, comme il existe des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Ce sont des actes qui méritent des sanctions exceptionnelles, certes symboliques, bien sûr complémentaires, mais indispensables.
Nous souhaitons enfin que la déchéance de nationalité, qui serait naturellement la conséquence d’une sanction pénale préalable, relève du pouvoir exécutif. Elle doit à notre sens prendre la forme d’un décret. Il revient au Président de la République et au Gouvernement, représentants légitimes de la nation française, de prendre une telle décision.
Je terminerai en abordant deux points qui ne figurent pas dans ce projet de loi constitutionnelle, mais dans les autres textes que vous nous annoncez.
Tout d’abord, il nous semble nécessaire de nous donner les moyens de prévenir des attentats, même lorsque l’état d’urgence sera levé. L’un de nos amendements au projet de loi constitutionnelle abordera cette question. L’état d’urgence permet en effet de prendre des mesures de police individuelles, temporaires, sous le contrôle du juge administratif, afin d’intervenir en amont pour éviter des attentats. La question se pose de nos possibilités d’action hors de l’état d’urgence : ainsi, l’assignation à résidence ou le placement sous bracelet électronique d’un individu n’est pas possible aujourd’hui. De même, la restriction de la liberté de communiquer d’un individu dont on pense qu’il pourrait s’avérer dangereux pour la nation pourrait également être nécessaire. Or notre Constitution ne nous permet sans doute pas aujourd’hui d’envisager de telles mesures.
Nous souhaitons également la création d’une peine d’indignité nationale, réservée aux délits. Elle concernerait par exemple ceux qui partent rejoindre des groupes terroristes, puisque nous avons voté une loi qui a créé ce délit. Cette peine d’indignité nationale permettrait de restreindre les droits civiques et civils, et de poser des conditions à l’éventuel retour de ces personnes sur le territoire national. Nous y reviendrons.
Le groupe Union des démocrates et indépendants a la volonté de participer à un rassemblement national qui nous semble nécessaire. J’indique ici que l’évolution du texte semble permettre d’aller dans ce sens.
M. Sergio Coronado. Le Président de la République a annoncé une réforme de la Constitution devant le Parlement réuni en Congrès, afin de constitutionnaliser l’état d’urgence et d’introduire la déchéance de nationalité pour des citoyens nés français et disposant d’une autre nationalité. Le débat, qui nous occupe depuis lors, a souvent pris une tournure polémique et vos déclarations, monsieur le Premier ministre, n’ont pas toujours permis d’apaiser les tensions avivées par les propositions présidentielles.
La déchéance de nationalité pour des citoyens nés Français disposant d’une autre nationalité a cristallisé le débat public, tant il est vrai que cette proposition « n’est pas de gauche », pour reprendre l’appréciation du Premier secrétaire du parti socialiste, M. Jean-Christophe Cambadélis, et qu’elle trouble les parlementaires de la majorité. Il s’agit en effet d’une proposition de l’extrême-droite, recyclée par une partie de la droite, qui figurait en bonne place dans le discours de Grenoble prononcé par M. Nicolas Sarkozy, alors Président de la République. Elle avait, en 2010, suscité un tollé dans les rangs de la gauche et même parmi certains membres de la majorité précédente. M. François Hollande l’avait qualifiée d’attentatoire à la tradition républicaine et de non protectrice des citoyens. Je fais mienne ces oppositions : cette mesure améliorera-t-elle en quoi que ce soit la protection et la sécurité de nos concitoyens ?
Le premier article de ce projet de loi propose de constitutionnaliser l’état d’urgence. L’instauration d’un dispositif d’exception privant les citoyens de garanties parmi les plus essentielles que procure un État de droit et que protège la Constitution est un problème. L’est également le fait de procéder à une réforme sous état d’exception, car des libertés fondamentales se trouvent aujourd’hui mises entre parenthèses. La Constitution n’a pas pour fonction première de conférer des compétences ou de donner une assise juridique au pouvoir politique, mais d’encadrer et de fixer des bornes à ceux qui l’exercent.
Vous avez évoqué dans votre intervention le renvoi à un projet de loi ordinaire des conditions d’application des prérogatives qui permettent de mener à bien des perquisitions ou des contrôles d’identité, mais à aucun moment vous n’avez proposé de mesures assurant un meilleur encadrement de ces pratiques. Monsieur Patrick Mennucci, vous souhaitez la mise en place d’un contrôle constitutionnel de l’état d’urgence, mais le groupe Socialiste, républicain et citoyen aurait pu le prévoir pour le texte voté et pour celui qui nous sera soumis dans le but de reconduire l’état d’urgence.
Il n’est nul besoin de modifier la Constitution, car la loi suffit ; le Conseil constitutionnel a reconnu dès 1985 que le silence de la Constitution n’interdisait pas au législateur ordinaire d’instaurer l’état d’urgence. Il a estimé qu’en inscrivant l’état de siège, régi jusque-là par la seule loi du 9 août 1849, à l’article 36 de la Constitution, le constituant de 1958 n’avait pas souhaité pour autant exclure la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence susceptible de concilier les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public. La Constitution de 1958 n’a ni abrogé la loi du 3 avril 1955, ni ne l’a constitutionnalisée. On a d’ailleurs modifié cette loi à plusieurs reprises pour l’adapter aux circonstances. En décembre 2005, le juge des référés du Conseil d’État a affirmé que la consécration du régime de l’état de siège sur le plan constitutionnel ne faisait pas obstacle à ce que le législateur institue un régime de pouvoirs exceptionnels distinct du précédent car ne reposant pas, comme c’est le cas pour l’état de siège, sur un accroissement des pouvoirs de l’autorité militaire. Dans une récente décision, portant sur la loi du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence et considère qu’il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Il peut apparaître étonnant que le principe de hiérarchie des normes n’ait pas imposé à la Constitution d’organiser ce régime d’exception, mais le constituant de 1958 ne l’a pas souhaité, et la jurisprudence se révèle constante en la matière.
Monsieur le Premier ministre, vous avez fait naître une question fondamentale dans le débat public, celle de l’adéquation de l’état d’urgence, un état d’exception limité aux frontières du territoire national et dans le temps, à l’existence d’une menace globale, diffuse et pérenne. Est-ce le meilleur état pour affronter la menace terroriste ? Vous n’avez pas apporté de réponse à cette interrogation.
Tout a été dit sur la déchéance de nationalité qui ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme – vous l’avez vous-même reconnu. En effet, en quoi l’article 2 qui consacrait la déchéance de nationalité pour des citoyens nés Français et disposant d’une autre nationalité protégeait-elle l’unité de la Nation, puisque tout le monde reconnaît son caractère exclusivement symbolique et sans portée opérationnelle ?
Quel État acceptera d’accueillir un citoyen français déchu de sa nationalité au prétexte que nous souhaitons nous en débarrasser et qu’il possède la nationalité du pays en question ? Les États étrangers n’acceptent de recevoir des naturalisés déchus de la nationalité française qu’à la condition qu’ils soient poursuivis sur place. Même déchus de leur nationalité, ces individus ne sont d’ailleurs pas expulsables, bien souvent en raison des traités qui nous obligent ; en effet, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) les protège en cas de peine de mort, de traitements inhumains et dégradants.
Cette idée charrie un imaginaire pour le moins inquiétant, car ces personnes, nées en France, élevées en France, éduquées en France, ayant manqué des projets et étant souvent passées par nos prisons et possédant la nationalité française ne seraient pas de vrais Français, mais des corps étrangers au corps national. Je ne partage pas cette conception.
Le texte constitutionnel comme le projet de loi ordinaire ne font plus référence à la binationalité. Monsieur le Premier ministre, sous couvert de compromis, vous durcissez le texte, notamment en élargissant la liste des sanctions ; je me réjouis que le président du groupe Union des démocrates et indépendants, M. Jean-Christophe Lagarde, ait souhaité limiter l’article 2 du projet de loi constitutionnelle aux crimes en excluant les délits.
Certes, le texte que vous avez présenté ne fait plus référence aux binationaux, mais les peines de déchéance cibleront uniquement cette population, puisque les conventions internationales protègent les autres citoyens.
Notre opposition à cette disposition, fondamentale, est connue. Le groupe Écologiste porte des points de vue divers, mais la majorité d’entre nous s’opposent à cette mesure. Une formule, empruntée à votre successeur place Beauvau, M. Bernard Cazeneuve, résume parfaitement ma pensée : « Lorsque M. Éric Ciotti a déposé un amendement sur la déchéance de nationalité, j’ai refusé car la lutte contre le terrorisme ne se fait pas contre la Constitution ».
M. Roger-Gérard Schwarztenberg. Le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste estime nécessaire la constitutionnalisation de l’état d’urgence, que consacre l’article 1er du projet de loi ; d’ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous y incite, puisque tout justiciable peut actuellement demander au Conseil d’État ou à la Cour de cassation de poser une question préalable de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel portant sur la conformité à la Constitution de la loi prorogeant l’état d’urgence. Certes, en 1985, le Conseil constitutionnel a reconnu que la législation sur l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie était conforme à la Constitution, mais il a précisé qu’une modification de la loi du 3 avril 1955 entraînait la réouverture du contrôle de constitutionnalité. Tel est le cas du texte du 20 novembre dernier dont le titre précise qu’il renforce les dispositions de la loi du 3 avril 1955. Le Conseil constitutionnel peut également intervenir si les circonstances de droit ou de fait changent, et réévaluer la conformité du texte à la Constitution. Ce cas s’est présenté à l’occasion de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », sur la garde à vue : le Conseil constitutionnel l’avait déclarée conforme à la Constitution dans un premier temps avant que l’ampleur de l’extension de la garde à vue ne le conduise à réexaminer la loi.
Comme M. Jean-Christophe Lagarde l’a dit, les futurs gouvernements pourraient être de sensibilité politique différente de celle de l’actuel, et s’ils ne pouvaient pas utiliser l’état d’urgence, ils pourraient être tentés de mobiliser les dispositifs plus rigoureux de l’article 36 de la Constitution sur l’état de siège, qui prévoit le transfert des pouvoirs à l’autorité militaire, et de l’excessif article 16. Un état d’urgence constitutionnalisé apportera une meilleure protection des libertés publiques.
Je partage également le point de vue de M. Jean-Christophe Lagarde sur l’inopportunité de procéder à une dissolution de l’Assemblée nationale pendant l’état d’urgence. Celui-ci visant à assurer la stabilité du fonctionnement des pouvoirs publics, une dissolution de l’Assemblée nationale apparaîtrait pour le moins paradoxale et pourrait constituer une manœuvre juridique pour résoudre un problème politique. Les comités Vedel et Balladur avaient préconisé l’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution.
Comme pour l’article 1er, je me retrouve en large accord avec le Premier ministre pour l’article 2. La rédaction présentée marque un progrès par rapport à la précédente, mais risque d’entraîner une conséquence non souhaitée : en effet, l’article 34 de la Constitution énumère les matières législatives, dont fait partie la nationalité, et la rédaction de l’article pourrait circonscrire l’objet de la loi en matière de nationalité à la déchéance.
Il ne me paraît pas opportun, mais le choix relève avant tout du Premier ministre, de confier le soin de prononcer les déchéances de nationalité à l’autorité judiciaire. Il est préférable d’en rester à un décret pris après avis conforme du Conseil d’État, cette procédure ne fermant pas la possibilité de former un recours contre cet acte réglementaire devant le Conseil d’État. Ce dernier s’avère aussi protecteur des libertés que les magistrats de l’ordre judiciaire et se révèle mieux informé de ces questions de nationalité. Les magistrats de la Cour de cassation interviennent de manière sonore ces temps-ci, l’intensité de ce bruit n’étant pas proportionnelle à la justesse de leur analyse.
L’article 131-26 du code pénal porte sur l’interdiction des droits civiques sous le titre, inscrit depuis le code de 1791 et de 1810, de « dégradation civique » ; cette interdiction présente l’intérêt de priver de nombreux droits liés à la citoyenneté et de pouvoir être prononcée à l’encontre de délinquants mono ou binationaux sans aucune distinction. Il s’agit d’une peine complémentaire qui, en matière de terrorisme, est d’une durée maximale de 15 ans, comme le précise l’article 422-3 du code pénal. Il conviendrait d’augmenter le quantum de cette peine et de rétablir la dénomination antérieure de dégradation civique qui n’a pas été retenue par le code pénal de 1992 de manière à supprimer les appellations infamantes. Comme nous recherchons un phénomène de réprobation publique, il serait utile de reprendre cet intitulé. En outre, cette peine complémentaire pourrait posséder un caractère obligatoire, même si je sais qu’une telle proposition ne fait pas l’unanimité.
Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de ne plus faire référence à la binationalité dans l’article 2 du texte. Nous pouvons donc admettre cette proposition, surtout si la déchéance ou la dégradation civique l’accompagne. La France a déjà ratifié la convention initiale de 1954 relative au statut d’apatride en 1955, ce qui nous oblige, fort heureusement, à mettre en œuvre des mesures de protection des apatrides. La seconde convention intervenue dans ce domaine, toujours dans le cadre de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), date du 30 août 1961 et vise à réduire les cas d’apatridie ; elle comporte des dispositions protectrices appréciables, mais le paragraphe 3 de son article 8 dispose que l’État contractant conserve sa capacité, dans une série de cas limités, de priver un individu de sa nationalité s’il établit une déclaration à cet effet au moment de sa signature ou de sa ratification de la convention. Les actes terroristes entrent dans les cas pour lesquels la privation est possible, si bien que nous pourrions résoudre le problème de manière rationnelle et équitable en faisant en sorte que les apatrides soient mieux protégés tout en faisant cette déclaration. Cette possibilité nous est ouverte, car la France n’a pas encore ratifié cette convention et qu’en signant ce traité en 1962, elle a précisé que son instrument de ratification intégrerait la faculté offerte par le paragraphe 3 de l’article 8. Une loi doit autoriser la ratification, et le Parlement interviendrait dans un esprit largement consensuel, me semble-t-il.
M. Marc Dolez. Après l’adoption du projet de loi de révision constitutionnelle par le conseil des ministres du 23 décembre dernier, le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, par la voix de son président, M. André Chassaigne, avait exprimé son opposition à l’ensemble du texte. À cette heure, et sous réserve de l’issue du débat parlementaire, il n’apparaît pas que les précisions que vous venez d’apporter, monsieur le Premier ministre, soient de nature à infléchir l’appréciation du groupe.
M. Philippe Houillon. En tant que membre de la commission des Lois, je m’associe aux félicitations adressées au président Jean-Jacques Urvoas pour sa nomination et lui adresse tous mes vœux de réussite. En revanche, je ne félicite pas le Gouvernement, monsieur le Premier ministre, pour les conditions chaotiques, confuses et laborieuses dans lesquelles intervient cette réforme constitutionnelle.
Vous l’avez rappelé dans votre propos, une telle réforme suppose une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres du Parlement, parce qu’elle doit être consensuelle et presque du domaine de l’évidence. Aujourd’hui, vous nous présentez un texte différent de celui proposé par le Président de la République devant le Congrès le 16 novembre dernier. Nous ne sommes donc plus vraiment dans l’esprit d’une réforme constitutionnelle. En outre, lorsque l’on porte une réforme consensuelle, on est assuré de l’adhésion de sa majorité et on tente de convaincre l’opposition pour atteindre la barre des trois cinquièmes. Or, nous nous trouvons dans un scénario inverse, puisque vous comptez sur les voix de l’opposition tout en tentant d’amadouer la partie récalcitrante de votre majorité. Enfin, le comble est atteint lorsque la ministre signataire du texte n’en approuve pas les dispositions.
Vous dites, monsieur le Premier ministre, que le Conseil d’État juge nécessaire la constitutionnalisation de l’état d’urgence. En vérité, deux décisions du Conseil constitutionnel consacrent déjà le caractère constitutionnel de l’état d’urgence, la dernière d’entre elles, rendue le 22 décembre 2015, consacrant même la constitutionnalité de l’une des mesures qu’il permet, l’assignation à résidence. Dans son avis du 17 novembre 2015 sur l’avant-projet de loi de prorogation, le Conseil d’État a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de constitutionnaliser le dispositif de l’état d’urgence. Vous avez rappelé que l’avis du Conseil d’État portant sur ce projet de loi constitutionnelle estimait nécessaire la constitutionnalisation, mais il avait défendu l’idée inverse en novembre. Qu’est-ce que la constitutionnalisation de l’état d’urgence apporte ? Cette question se pose car la constitutionnalisation ne concerne que le principe de l’état d’urgence. Une loi dressera la liste des mesures qui pourront être appliquées – je vous rappelle que, malgré votre ton très affirmatif, c’est au Parlement d’en décider. Quand le Parlement aura-t-il connaissance de ce projet de loi ordinaire ? La loi pourra être soumise au Conseil constitutionnel. La constitutionnalisation du principe vous paraît-elle en mesure de contraindre davantage l’arbitrage du Conseil constitutionnel ? Si tel était le cas et contrairement à ce que disait M. Patrick Mennucci, il n’y a là aucun progrès pour les libertés.
Vous allez modifier la disposition concernant la déchéance de nationalité ; la Constitution fixe les règles touchant à la nationalité, et votre projet de loi propose de préciser que ces normes comprennent la déchéance et la perte des droits attachés à la nationalité. Une loi développera ces éléments – et nous devons avoir rapidement connaissance de votre projet pour vérifier si la parole du Président de la République est respectée –, mais elle n’évoquera pas les binationaux. Pourtant, comme vous dites que l’on ne pourra pas créer d’apatrides, cela ne touchera que les binationaux. M. Jean d’Ormesson avait raison, lorsque vous avez dialogué sur le plateau de l’émission On n’est pas couché, de se demander si cette démarche ne relevait pas de l’enfumage.
Les articles 130 et suivants du code pénal fixent le cadre de la déchéance des droits attachés à la nationalité. La rédaction du projet de loi constitutionnelle ne doit pas suggérer que l’on ne peut appliquer certaines déchéances que dans le cas de « crimes ou délits constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ». Cela pourrait signifier qu’aucun autre cas ne peut entraîner des déchéances des droits attachés à la nationalité. La rapidité avec laquelle ce projet a été élaboré a empêché de conduire des expertises précises, et il faudra étudier attentivement ce point. Enfin, s’il s’agit d’une peine complémentaire, on s’éloigne également de la parole du Président de la République.
M. le Premier ministre. Je serai bref. Demain, vous examinerez les amendements et nous nous retrouverons en séance publique à partir du vendredi 5 février. Le Président de la République avait indiqué dans sa déclaration au Congrès qu’il me confiait la mission de défendre la réforme constitutionnelle devant vous – ce n’est d’ailleurs pas la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un Premier ministre le fait. Mais, bien sûr, Jean-Jacques Urvoas sera utilement présent à mes côtés tout au long de ces discussions et de ces débats.
Je ne veux pas entrer dans le fond de l’ensemble des éléments. Il y a deux grands thèmes. Il y a d’abord tout ce qui est lié à l’état d’urgence, à sa durée, à son contenu, au contrôle parlementaire qui s’exerce sur lui, mais aussi à celui qu’exerce le Conseil constitutionnel – dans certaines limites, monsieur Lagarde, j’ai bien entendu vos remarques sur ce point.
S’agissant de la dissolution de l’Assemblée nationale en régime d’état d’urgence, monsieur Houillon, le Gouvernement est ouvert ; c’est le Parlement qui décide. J’évoquais le précédent de 1968, alors que l’état d’urgence n’était pas en vigueur. Je rappellerai simplement que, sous l’état d’urgence, des élections ont bien eu lieu au début du mois de décembre, même si je reconnais qu’il ne s’agissait pas d’élections législatives faisant suite à une dissolution. Quoique les élections régionales aient été marquées par les faits terribles que notre pays a subis, elles se sont déroulées normalement, en termes de réunions publiques ou de possibilité d’aller voter. Il n’y eu aucune entrave à l’exercice du droit fondamental qu’est le droit de vote. Mais vous mènerez une discussion sur ce point. Nous restons ouverts.
Ensuite, un autre débat se noue sur la différence qui ne doit pas s’opérer entre Français sur la base de la déchéance. C’est un des éléments que le Président de la République a voulu intégrer dans notre réflexion, depuis sa déclaration du 16 novembre. Nous avons donc préféré venir ici tirer les conclusions des divers débats, plutôt que d’attendre la séance publique. Sur la question de l’égalité, ne pas intégrer la problématique de la binationalité dans la Constitution me semble être une avancée.
Monsieur Houillon, comme votre président de groupe Christian Jacob en avait fait la demande, vous disposerez des avant-projets de loi d’ici à la fin de la semaine, avec les imperfections inhérentes à des textes encore à ce stade d’élaboration. Je souhaite maintenir un lien permanent avec les responsables des groupes et la Commission, dans le respect bien sûr du rôle du Parlement. Je veux être le plus transparent possible. Je ne veux piéger personne : la proposition que nous venons de vous distribuer n’est ni enfumage, ni solution miracle pour sortir de je ne sais quelle difficulté.
Je suis en désaccord avec vous, Monsieur Houillon, sur la réforme constitutionnelle. En effet, en général, une telle réforme se prépare. Celle de 2008 a été préparée par le comité présidé par l’ancien Premier ministre Édouard Balladur. Ses travaux ont donné lieu à beaucoup de débats et de discussions. Pourtant, même si le texte a recueilli au Congrès la majorité des trois cinquièmes, la révision n’a pas conduit à un rassemblement de la majorité et de l’opposition. On peut le regretter. Avec Jean-Marie Le Guen, nous avions, comme députés de l’opposition, défendu à l’époque certaines positions ; d’autres étaient favorables à la révision. En tout état de cause, même avec une longue préparation et avec un long travail, on ne réussit pas forcément le rassemblement auquel on aspire.
Je comprends le débat sur l’opportunité d’une réforme constitutionnelle. Mais celle-ci comporte une différence avec les autres : elle intervient après un choc. Je crois profondément que nous avons changé d’époque depuis les attentats de l’année 2015 et dans le contexte géopolitique que je n’ai pas besoin de décrire. Mon objectif et ma volonté sont donc de rassembler et d’avancer. Nous devons tenir compte des sensibilités et des déclarations des uns et des autres. C’est ce que nous faisons depuis le 16 novembre, pour aboutir à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, au texte le plus solide possible, sur le plan des principes comme sur le plan juridique, en étant accompagné des lois que vous évoquiez.
Il y a bien sûr des différences entre nous, monsieur Coronado, et il faut complètement les assumer. Vous êtes opposé à la fois à l’état d’urgence et à la déchéance de la nationalité. Voilà qui est clair. Cela n’empêche pas que vous ayez initialement voté en faveur de l’état d’urgence, pour des raisons que votre collègue Cécile Duflot et d’autres orateurs de votre groupe ont bien expliquées devant le Congrès et dans la discussion, dans les circonstances particulières du moment. Mais vous vous opposez à sa prolongation ou à sa constitutionnalisation.
En tenant compte tant des travaux du « comité Balladur » que des avis rendus par le Conseil constitutionnel, la constitutionnalisation de l’état d’urgence assoit pourtant davantage cette règle exceptionnelle, qui était la seule à n’être pas dans la Constitution. Aussi proposons-nous de la conforter dans notre droit en l’inscrivant dans le texte fondamental, avec tout le contrôle qui s’impose.
Quant à la déchéance, je ne puis être d’accord avec vous quand vous dites que ce n’est pas une idée de gauche, car, à mes yeux, ce n’est pas le problème. Comme je l’ai rappelé il y a un instant, la déchéance de la nationalité s’inscrit dans notre histoire républicaine, qui a vu se succéder entre autres, depuis la Première Guerre mondiale, Raymond Poincaré, Édouard Daladier, le général de Gaulle et les autres présidents de la Ve République.
Je n’oublie pas les débats qu’il peut y avoir sur la déchéance et sur ceux qu’elle doit frapper – je ne veux entrer dans aucune polémique à ce stade. Doit-elle s’appliquer à des crimes contre des gendarmes ou des policiers, comme il a pu en être question à une époque, ou bien à ceux qui sont dirigés contre les intérêts fondamentaux de la nation ? Même si tout crime est terrible, horrible et insupportable, nous pensons que ce n’est pas la même chose de s’en prendre aux intérêts fondamentaux de la nation. Quand on déchire le pacte national, ce qui fonde le fait d’être Français, prendre une mesure de déchéance peut à ce moment-là s’expliquer parfaitement. Nous avons donc sur ce point un désaccord de fond.
Je ne veux certes pas faire de différence entre les Français binationaux et les autres. Mais il en existe déjà quelques-unes. Il y a déjà eu des déchéances de nationalité de binationaux ayant acquis la binationalité française. Ils étaient aussi Français que les autres. Comme je l’ai déclaré dans l’émission qui a conduit M. Houillon a veiller bien tard – et je l’en remercie –, je ne me considère pas comme différent parce que je suis un Français naturalisé ; je considère avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Au-delà des sentiments des uns et des autres, ce débat ne me semble cependant pas être le bon. Je ne veux pas de différence entre les Français binationaux et les autres. Ce n’est pas l’objet de cet article de loi. Je veux faire la différence entre les terroristes et les autres. C’est celle que nous devons pleinement établir. Telle est la clarification que nous proposons : la vraie différence sépare ceux qui rompent avec le pacte national, avec ce que nous sommes et avec la France et ses valeurs, et l’immense majorité de nos compatriotes, sinon leur quasi-totalité, quelle que soit la manière dont ils ont acquis leur nationalité, par le droit du sol ou par le droit du sang, ou par naturalisation postérieure. Ce qui importe, c’est la manière dont ils font vivre ces valeurs qui les définissent comme profondément Français.
C’est pourquoi cet article 2 est utile. Il n’est pas une arme contre le terrorisme, au sens où nous l’entendons quand nous donnons plus de moyens aux forces de l’ordre ou aux forces de sécurité. Mais je crois à la force concrète des symboles, inscrits dans la Constitution. Elle a incontestablement sa portée.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre, et monsieur le secrétaire d’État, pour votre présence.
Nous poursuivrons demain matin, en salle Lamartine, l’examen de ce projet de loi constitutionnelle, en commençant par la suite de la discussion générale. Puis nous passerons à l’examen des articles et des amendements. Une réunion dans le cadre prévu par l’article 88 du Règlement de l’Assemblée nationale sera aussi nécessairement organisée.
*
* *
Lors de sa réunion du jeudi 28 janvier 2016, la commission des Lois poursuit l’examen, sur le rapport de M. Dominique Raimbourg, du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation (n° 3381).
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le projet de loi constitutionnelle sera examiné en séance publique les vendredi 5, lundi 8 et mardi 9 février et que, conformément à l’article 42 de la Constitution, la discussion portera, non pas sur le texte adopté par notre Commission, mais sur le projet de loi présenté par le Gouvernement. Les amendements que celle-ci adoptera aujourd’hui ne seront donc pas intégrés dans le texte qui sera examiné. Je vous invite à en tenir compte lorsque vous prendrez la parole car, dans le cadre d’une telle procédure, l’essentiel du débat a lieu en séance publique, en présence du Gouvernement. Je précise à ce propos que celui-ci, soucieux que le travail parlementaire puisse se faire, a déposé dès aujourd’hui, comme il s’y était engagé, l’amendement que le Premier ministre a évoqué hier et que nous examinerons tout à l’heure. Vous aurez ainsi la possibilité de préparer des sous-amendements en vue de la discussion en séance publique.
Nous allons maintenant achever la discussion générale avant d’aborder l’examen des articles.
Mme Marie-Françoise Bechtel. J’interviens ici en tant que députée apparentée au groupe socialiste, républicain et citoyen et au nom du Mouvement républicain et citoyen fondé par Jean-Pierre Chevènement, dont on s’accorde à reconnaître qu’il est une voix singulière.
Tout d’abord, nous sommes très conscients du contexte sécuritaire dans lequel ce projet de loi constitutionnelle nous est soumis. Il nous paraît donc normal de prendre des mesures de court terme ou d’ordre constitutionnel, mais nous estimons également nécessaire de mener, un jour, une réflexion sur de grands projets d’intégration qui nous éloignerait de la simple question de la déchéance de nationalité, laquelle est inessentielle dans l’esprit des Français.
S’agissant de l’état d’urgence, je crois avoir été la première à souligner la nécessité de réviser la Constitution afin de l’y intégrer, car il faudra bien, avais-je ajouté, introduire dans le texte fondamental le principe du contrôle du Parlement. J’ai d’ailleurs déposé un amendement en ce sens, qui a été approuvé par certains de nos collègues. À cet égard, je précise que, le texte de la Constitution devant être concis, cet amendement doit être bref.
Quant à la déchéance de nationalité, elle a fait l’objet, au Parlement, dans la presse et dans le pays, d’un débat que je n’ai pas trouvé indigne. Il m’a beaucoup appris, m’a fait longuement réfléchir et, je n’hésite pas à le dire, m’a conduite à changer plus ou moins de point de vue sur la question. En résumé, il me paraît nécessaire que l’on prête la plus grande attention au principe d’égalité. Les Français ne comprennent pas – c’est culturel – que l’on traite les uns et les autres d’une manière différente. Ils ont la passion de l’égalité, et elle les entraîne parfois très loin. Or, cette égalité a une traduction juridique, car nous sommes un peuple de juristes. En tant que constituant, nous ne sommes soumis à aucun contrôle, et cela nous oblige : nous devons légiférer avec tact et mesure et nous en tenir à un texte clair et précis.
Le texte du Gouvernement pourrait nous convenir, à certaines conditions que le débat pourrait utilement éclaircir. C’est pourquoi il est bon, monsieur le Président, que nous discutions aujourd’hui de sa dernière mouture, c’est-à-dire de l’amendement du Gouvernement auquel vous avez fait allusion. Supprimer du texte toute référence aux binationaux est une bonne initiative car, encore une fois, les Français ne comprennent pas qu’il y ait deux poids et deux mesures. En revanche, le principe selon lequel tout Français, y compris un Français de naissance, peut être privé, dans des conditions drastiques, de sa nationalité est un principe républicain, comme le Premier ministre l’a rappelé hier en précisant que cette mesure avait été créée pour sanctionner ceux qui n’auraient pas respecté la prohibition de l’esclavage. Il importe néanmoins que le texte soit clair sur ce point. La déchéance de nationalité est, certes, une mesure symbolique, mais le débat qu’elle a suscité a eu le mérite de remettre la question de la nationalité sur le devant de la scène. C’est la raison pour laquelle je crois utile que nous l’adoptions.
J’approuve le fait que cette disposition soit intégrée dans l’article 34, qui dispose que la loi fixe les règles relatives à la nationalité. Mais je précise qu’elle n’a de sens constitutionnel que si elle permet l’application de la déchéance de nationalité à tous et non aux seuls binationaux, autrement dit si elle rend possible l’apatridie. Se pose, dès lors, la question de savoir quel sera le contenu de la loi. Je me félicite, à cet égard, que le Premier ministre ait accepté la proposition de ratifier la Convention de New York du 30 août 1961. Je rappelle que celle-ci limite les cas d’apatridie, ce qui signifie a contrario qu’elle ne les prohibe pas totalement au nom du droit international, lequel est largement fondé, pour ce qui est des Conventions des Nations-Unies, sur le droit naturel – c’est un point important. La Convention de 1961 acceptant des cas d’apatridie plus larges que ceux prévus dans le texte du Gouvernement, je ne vois pas pourquoi notre Constitution n’autoriserait pas l’application de la déchéance de nationalité aux nationaux nés Français. Dès lors que nous ratifierions cette Convention – dont la valeur, je le rappelle, est inférieure à celle de la Constitution mais supérieure à celle de la loi –, une loi pourrait permettre une apatridie limitée. Tel est le dispositif qui pourrait être retenu. Celui-ci pourrait cependant avoir des répercussions sur l’écriture de l’article 2 car, en précisant que la déchéance de nationalité n’est possible qu’en cas de condamnation pénale, il est plus restrictif que la Convention.
Sous cette réserve, je crois qu’en étant ainsi attentifs à adopter une mesure – certes symbolique, mais les symboles ont leur rôle – qui ne violerait ni le droit naturel ni les conventions internationales tout en prévoyant une apatridie restrictive, nous pourrions aboutir à une solution constructive et, j’insiste sur ce point, claire. Nous avons en effet le devoir, en tant que constituant, d’écrire un texte qui ne laisse aucune place à l’équivoque.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Avant de donner la parole à M. Valax, je vous propose d’organiser, le moment venu, une discussion spécifique sur l’article 2 et l’amendement du Gouvernement.
M. Jacques Valax. Le Premier ministre a eu raison de rappeler que la période actuelle est particulière, marquée par des événements d’une gravité exceptionnelle qui mettent en péril les fondements mêmes de notre République, qu’il faut donc adapter la loi à cette situation nouvelle et exceptionnelle et que le projet de loi constitutionnelle doit être adopté de façon consensuelle. Il nous appartient en effet de légiférer face à l’atteinte portée aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Mais, avant que nous n’abordions l’examen des articles, je veux rappeler un certain nombre de principes. Une République qui oublierait ses origines ne tarderait pas à les renier. Dans ces moments difficiles, notre République doit se ressourcer, se ressaisir pour ne pas s’abîmer, voire sombrer dans l’excès. Notre héritage républicain ne doit en aucun cas être menacé. Ce que nous appelons, avec fierté, nos grands principes républicains ne sont pas et ne seront jamais des acquis ineffaçables et irréversibles. Notre Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sont au fondement de ce qui nous rassemble, ce qui nous permet de vivre ensemble. Ne modifions donc pas la Constitution sous le coup de l’émotion ! Travaillons dans le calme, avec objectivité, en étant soucieux de faire aboutir une volonté commune. Ne renonçons pas à ce qui fait la force de notre République : l’unité et l’indivisibilité de notre corps social républicain. Ne laissons pas penser que notre Constitution pourrait devenir un outil de marketing politique ; nous l’avons suffisamment reproché à la majorité précédente. Ne mettons jamais au même niveau juridique la déchéance de nationalité, la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité.
Les événements nous obligent, certes, à légiférer, mais il nous faut garder une certaine distance, source de sagesse, afin de parvenir au consensus que nous recherchons tous.
En ce qui concerne l’état d’urgence, je partage pleinement l’analyse du Premier ministre. Lui donner un fondement constitutionnel, c’est conforter les mesures de police actuelles et éviter les conséquences fâcheuses ou désastreuses qu’entraînerait la recevabilité éventuelle d’une question prioritaire de constitutionnalité. Par ailleurs, et c’est rassurant du point de vue des libertés individuelles, le Premier ministre a précisé qu’un contrôle parlementaire, dont l’efficacité serait garantie, serait instauré et qu’une loi ordinaire définirait certaines mesures : saisie du matériel informatique, droit de suite, droit de maintien à disposition d’une personne pendant quatre heures. Enfin, le tout serait assorti, et c’est essentiel du point de vue de la garantie des libertés publiques, d’un contrôle judiciaire et non plus administratif.
Sur la déchéance de nationalité, je reste réservé ; j’espère que nos débats apporteront une réponse à mes interrogations. L’homme de la rue a besoin qu’on lui parle de manière claire et précise. Certes, le texte ne fait plus de distinguo entre les citoyens, mais le doute demeure puisque la rédaction de l’article 2 du projet laisse supposer que le binational pourrait être déchu de la nationalité française tandis que le Français ne possédant pas d’autre nationalité ne pourrait être déchu que de ses droits civils ou civiques. Il va donc falloir que l’on m’explique les choses de manière pragmatique, que l’on me dise quel juge fera ce distinguo et à quel stade de la procédure.
Par ailleurs, pourquoi est-il désormais prévu que la déchéance de nationalité puisse s’appliquer à des personnes ayant commis des délits alors que seuls les crimes étaient mentionnés dans le texte initial ? Que l’on fasse référence aux crimes, on le comprend puisque les faits reprochés à ceux qui seront jugés en tant que terroristes seront des crimes affreux. En revanche, on ignore sur quel fondement matériel et juridique seront définis les délits visés. Je n’accepte pas cette extension soudaine du champ d’application de la mesure. J’attends donc des explications sur ce point ; je les écouterai, et peut-être me convaincront-elles. Je reste circonspect. J’attends des garanties supplémentaires, et je demeurerai intransigeant sur la sauvegarde de nos principes républicains.
En conclusion, les Françaises et les Français attendent de nous, au-delà de nos discussions savantes, voire byzantines, que nous nous attaquions aux racines du mal – l’injustice, l’exclusion, le rejet, la pauvreté, la précarité – et que nous agissions fortement dans nos quartiers, nos écoles, pour restaurer le pacte républicain, redistribuer les richesses, rétablir partout la sécurité, qui est un bien essentiel. Ils attendent de nous une action forte, pragmatique, réaliste et adaptée aux besoins qui sont les leurs.
M. Alain Tourret. Qu’est-ce que la Constitution ? C’est un texte qui définit les principes républicains et organise les pouvoirs. Dans celle de 1958, seuls deux articles, les articles 16 et 36, visent à organiser les pouvoirs dans les périodes pendant lesquelles la République doit répondre à des attaques, extérieures ou intérieures. Mais ces articles ne concernent pas les mesures relatives à l’état d’urgence, qui relèvent actuellement de la loi du 3 avril 1955. Or il me semble que, dans un souci d’équilibre évident, la notion d’état d’urgence – ou de nécessité, j’y viendrai dans un instant – doit figurer dans la Constitution.
Mais, précisément, doit-on parler d’état d’urgence ou d’état de nécessité ? L’urgence, les juristes le savent, permet aux organes judiciaires de prendre des décisions par référé, pour désigner un expert ; elle est strictement limitée dans le temps. Il me semble préférable de retenir la notion de nécessité. L’état de nécessité désigne en effet très exactement une organisation des pouvoirs de nature à permettre à la Nation de répondre à la menace dont elle est victime. Qu’en est-il de l’état de siège ? Doit-on le maintenir dans la Constitution ? À l’évidence, non. L’état de siège, qui permet de confier tous les pouvoirs à celui qui commande une ville assiégée, n’a en effet plus rien à voir avec la situation actuelle. Du reste, la Constitution du 27 octobre 1946 ne comportait pas de dispositions à ce sujet. Dans le cadre de l’état de siège, ces pouvoirs exceptionnels sont confiés, non pas aux autorités civiles, mais aux autorités militaires et toutes les affaires judiciaires sont transférées aux juridictions militaires lorsque celles-ci demandent à en être saisies. Outre qu’il faudrait reconstituer toutes les juridictions militaires, depuis les tribunaux militaires de plein droit jusqu’à la Cour de sûreté de l’État, on peut se demander s’il est bien sage que la Constitution prévoie la possibilité de confier des pouvoirs exceptionnels aux autorités militaires. Or, ne pas la modifier sur ce point alors que l’on va compléter son article 36, c’est conforter la notion d’état de siège, qui est très dangereuse pour la démocratie elle-même.
Par ailleurs, je crois que nous allons parvenir à cette forme de consensus que j’appelle une majorité d’idées républicaine. Celle-ci constitue la réponse adéquate aux attaques que nous subissons actuellement. Du reste, lors des dizaines de réunions auxquelles j’ai participé récemment, je n’ai pas rencontré une seule personne qui conteste la nécessité de répondre, notamment par la déchéance de nationalité, à ces attaques. Je ne peux qu’avoir confiance dans l’opinion des électeurs de ma circonscription, surtout lorsqu’elle s’exprime de manière aussi massive. En revanche, il ne faut pas aller trop loin. Ainsi, la déchéance de nationalité est une mesure si importante qu’elle ne peut sanctionner que des personnes ayant commis des crimes, et des crimes graves, faute de quoi elle pourrait s’appliquer de plein droit, massivement. Or, nous avons tous en mémoire les pratiques du régime de Vichy dans ce domaine. Ce serait donc extrêmement dangereux. C’est pourquoi il est nécessaire de répondre aux attentes de nos concitoyens en instaurant la déchéance de nationalité, mais en en limitant le champ d’application et en en confiant l’organisation au pouvoir judiciaire plutôt qu’aux structures administratives.
Mme Cécile Duflot. La situation commande que l’on parle clair. C’est pourquoi je veux dire avec netteté, au risque de choquer certains, que je suis opposée à la révision de la Constitution dont nous débattons.
La première raison de mon opposition est de nature historique. Je ne crois pas, en effet, que lorsque notre pays est confronté à un péril, la meilleure réponse soit de réviser notre Constitution et de modifier à la hâte les fondements de notre démocratie. La Constitution fixe le cadre commun dans lequel nous vivons ; elle est une forme de capital immatériel de la démocratie. Or, entamer ce capital est une erreur. Chacun sait d’où naît une telle précipitation, mais il n’est pas interdit de revenir à la sagesse, laquelle commande d’agir avec prudence et modération. La réforme de la Constitution ne saurait être justifiée par des coups de menton ou par la volonté de créer un embrouillamini tactique. Le bruit des talons qui claquent, l’affichage de l’autorité, ne peuvent constituer en soi un objectif. Ce n’est pas l’esprit de discipline qui doit nous guider. Je mesure la pression qui s’exerce sur les parlementaires, mais il nous faut agir avec pondération. Nous devons appliquer un principe de précaution démocratique en prenant garde de ne pas céder à l’emportement pour des raisons de circonstance.
La deuxième raison de mon opposition tient à ma conception de la lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons pas offrir à nos ennemis la victoire symbolique que serait pour eux la révision de notre pacte commun. Notre démocratie est leur cible ; elle doit demeurer à chaque instant notre arme. Aussi devons-nous rester extrêmement prudents face au piège qui nous est tendu. Leur rêve est de nous voir restreindre le champ de notre démocratie, qu’ils détestent ou tiennent pour un régime malsain. Or, cette révision constitutionnelle est la première, dans l’histoire, à restreindre les libertés. Il nous faut, au contraire, tenir bon sur les libertés publiques, sur l’usage de la démocratie, sur notre conception des rapports entre justice et police et sur la nécessité de contre-pouvoirs forts et avisés.
À ceux qui diront que j’exagère et que je devrais être plus modérée car rien de tout cela n’est menacé, je réponds que la démocratie ne souffre pas de faux plis. Je refuse que nous empruntions le chemin de l’état d’urgence permanent, qui représente désormais un véritable risque. Il mène à l’état d’exception, dans lequel l’arbitraire deviendrait la nouvelle norme démocratique. En tant que parlementaires, en tant que constituant, nous ne pouvons l’accepter.
Enfin, mais j’y reviendrai, je veux dire un mot du débat sur la déchéance de nationalité. La plus grande confusion règne à ce sujet. Ce débat est né du discours prononcé par le Président de la République à Versailles, dans lequel il a indiqué que la déchéance de nationalité « ne doit pas avoir pour conséquence de rendre quelqu’un apatride » mais qu’il fallait « pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu […] même s’il est né Français […] dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité. » Or, ce matin, M. Patrick Mennucci a indiqué qu’un binational né Français ne pourra pas être déchu de sa nationalité. On voit donc bien que l’objectif du texte n’est plus de traduire la volonté exprimée par le Président de la République. Et pour cause : ce débat a suscité un réveil des consciences. Des intellectuels de toutes obédiences se sont exprimés et une ministre – et non des moindres – a démissionné pour marquer son opposition à une mesure qu’elle juge dangereuse et attentatoire à nos valeurs. Je tiens d’ailleurs à la saluer et à rendre hommage à son action, à son courage, à sa clairvoyance et aux propos qu’elle a tenus hier. Les attentats et la lutte contre le terrorisme ne sauraient nous conduire à pointer du doigt une catégorie de personnes résidant sur notre territoire.
Je ne manifeste là aucune faiblesse ; je pense que les terroristes doivent être combattus, traqués, jugés et lourdement punis. Le combat que nous menons contre ces fanatiques requiert la plus grande fermeté, mais être ferme, c’est aussi mener et gagner la bataille des symboles. Ils rêvent de nous désunir, de nous opposer, de nous faire entrer dans leur spirale de haine. Ils rêvent que ce débat tourne à la caricature et – je le dis avec gravité – que l’on accuse ceux qui s’opposent à la réforme de la Constitution d’être faibles et de manquer de fermeté. C’est faux. Nous devons refuser d’emprunter le toboggan glissant de la déchéance de nationalité et mener la véritable bataille, celle qui empêche d’enrégimenter les esprits faibles, celle qui, comme le disait si bien Germaine Tillion, consiste à répondre au terrorisme, non pas uniquement par des opérations de police, mais aussi en asséchant ce qui l’engendre.
Enfin, l’article 89 de notre Constitution dispose qu’« aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». Cette notion fait l’objet d’un débat parmi les constitutionnalistes. On sait que le constituant de 1958 pensait à l’Occupation, mais on peut tout de même considérer que, dans son esprit, cet article proscrit toute révision constitutionnelle en période troublée car cela aboutit à créer un malaise et une situation tactique. Je suis l’élue d’une circonscription qui a été durement éprouvée par les attentats du 13 novembre, mais je suis aussi, comme nombre d’entre vous, une femme politique engagée dans des débats internes à un parti politique. À ce titre, je sais mieux que quiconque, en tant que membre du parti écologiste, ce que sont les congrès, les commissions de résolution, les accords et les petits compromis. Ce n’est pas indigne : aboutir à des compromis est le sens de la politique. On peut rédiger un texte de manière à ce que chacun puisse y lire ce qu’il veut lorsqu’il s’agit d’une motion de synthèse, mais non lorsqu’il s’agit de la Constitution.
Telles sont les raisons pour lesquelles je m’oppose, ainsi qu’une majorité des écologistes, à ce texte. Je souhaiterais surtout que mon intervention soit une invitation à la réflexion. Il y a une forme de grandeur à ne pas s’obstiner dans l’erreur quand le seul bénéfice de la joute tactique est d’affaiblir l’esprit même de notre pacte fondamental.
Mme Marietta Karamanli. Je ne partage pas complètement les appréciations précédentes. Ce projet de loi constitutionnelle a beaucoup fait parler de lui. Cette intense médiatisation ferait presque perdre de vue plusieurs éléments que je tiens à rappeler.
En premier lieu, il s’inscrit dans un contexte nouveau, symbolisé par les vies enlevées et meurtries à tout jamais. Le projet de loi constitue un élément de réponse à la menace diffuse et permanente que représente le terrorisme.
Ensuite, cette réforme constitutionnelle comporte deux volets : d’une part, la constitutionnalisation du dispositif de l’état d’urgence et son encadrement, point positif, me semble-t-il ; d’autre part, l’inscription dans la Constitution d’une mesure juridique de rupture avec des criminels qui commettent des actes terroristes ou qui y participent.
Quant à la déchéance de nationalité, elle ne constitue pas une novation. Elle existe dans notre droit et, dans des formes analogues, à l’étranger : quinze États de l’Union européenne disposent d’une législation sur le retrait de la nationalité en cas de trahison ou de déloyauté. Douze d’entre eux prévoient la déchéance de nationalité pour des citoyens qui s’engageraient dans une armée étrangère.
La France a signé la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Nous sommes plusieurs à plaider pour sa ratification, ce qui serait une manière de répondre à Mme Duflot.
Restent la question du périmètre et celle du contrôle du dispositif. Je remercie le Premier ministre d’avoir entendu les interrogations et les craintes exprimées par les députés sur l’insuffisant calibrage de la mesure. Il y a répondu en annonçant que le texte n’établirait pas de distinction entre Français, qu’ils aient ou non une double nationalité, afin de ne pas créer deux catégories de sujets de droit. Il a également fait part de la volonté du Gouvernement de poursuivre la ratification des conventions relatives à l’apatridie. Enfin, il a apporté des garanties juridictionnelles nouvelles qui répondent également à nos préoccupations.
Nous avons à répondre non pas tant à des questions de principe – puisque la mesure existe et est appliquée – mais à des interrogations sur une délimitation stricte et sous contrôle de l’utilisation de celle-ci. Je compte sur notre rapporteur et notre Commission pour avancer dans cette voie.
Faut-il encadrer cette mesure en l’inscrivant dans la Constitution pour éviter toute surenchère ? Quelle sera l’articulation entre le volet constitutionnel et la loi ?
Il faut redonner sa place à la délibération politique. Il ne faut pas avoir peur de dire, sur ce sujet comme sur bien d’autres, qu’il n’existe pas de réponse évidente, simple ou facile et que seule la discussion permet d’avancer.
En conclusion, je veux saluer les efforts de l’exécutif pour écouter le législatif et le remercier pour les discussions en cours.
M. Patrick Devedjian. Il est tout de même paradoxal de discuter d’un texte cosigné par Mme Taubira alors qu’elle a démissionné en exprimant son désaccord majeur avec ce dernier. Il est pour le moins singulier de nous faire délibérer sur un texte désavoué publiquement et totalement par l’ancienne garde des sceaux.
La contradiction ne s’arrête pas là. On la retrouve en rapprochant l’exposé des motifs des déclarations de notre collègue Patrick Mennucci. L’exposé des motifs indique en effet que l’article 2 « insère, à l’article 34 de la Constitution, une disposition permettant de déchoir de la nationalité française une personne qui, née française et ayant également une autre nationalité, aura été condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ». Or, aujourd’hui, on nous annonce le contraire : aux dires de M. Mennucci, une personne née française ne pourra pas être déchue de la nationalité. Un minimum de cohérence entre le projet de loi déposé et le discours de la majorité serait bienvenu : plus que d’un amendement, il s’agit d’un reniement du projet de loi initial. L’amendement proposé par le Gouvernement en dit long sur l’improvisation qui a présidé à l’élaboration du texte modifiant rien moins que la loi fondamentale. Nous ne débattons pas d’une petite loi à la sauvette mais de la Constitution !
Ce projet de loi est à ce point improvisé que son signataire l’a renié et qu’à peine déposé, il est modifié. Il serait plus conforme aux convenances que le Gouvernement retire le texte pour en présenter un nouveau au Conseil des ministres.
Je souligne à mon tour l’hypocrisie que tout le monde a relevée. La modification annoncée par le Premier ministre ne change rien au fond : les binationaux continueront à être les seuls citoyens à pouvoir être déchus de la nationalité française ; la discrimination demeure ; on ne le dit pas mais la règle demeure.
Vous vous apprêtez donc à inscrire dans notre Constitution une inégalité fondamentale, contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux termes de laquelle « les hommes naissent libres et égaux en droit ». Ce n’est plus vrai : ceux qui naissent binationaux pourront être déchus de la nationalité, ceux qui naissent « mononationaux » ne pourront pas l’être. Il s’agit d’écrire dans notre Constitution que les hommes ne naissent plus libres et égaux en droit. Ce n’est pas rien comme symbole !
Ce symbole aurait pour objet de répondre au terrorisme. Il m’apparaît plutôt comme une grande victoire pour les terroristes. Ces derniers nous obligent non seulement à modifier la loi fondamentale, mais aussi à réduire nos libertés alors même que ceux-ci nous reprochent d’abord d’être une société de liberté, ce qui leur est insupportable. Nous allons leur donner raison. Nous accédons, en partie, à leur demande en commençant à réduire les libertés.
Ce n’est décidément pas un bon texte.
Mme Isabelle Attard. Aucun parlementaire ne s’est opposé à la déclaration de l’état d’urgence dès le 13 novembre pour répondre au chaos dans lequel notre pays était plongé. Ensuite, nous avons été quelques-uns à refuser la première prolongation. Nous restons opposés à une deuxième prolongation, comme nous le sommes à l’inscription dans la Constitution de l’état d’urgence et de la déchéance de nationalité.
Contrairement à M. Valls, il me semble utile de comprendre avant d’agir. Je considère que vouloir expliquer n’est pas un début d’excuse. Je ne suis pas seule à le penser. Nous avons reçu récemment M. Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté. Son analyse nous oblige à nous interroger sur notre inaction. Il considère qu’au lieu de nous focaliser sur l’état d’urgence – je suis d’accord avec les propos tenus par M. Devedjian à l’instant –, nous gagnerions à nous intéresser à quelques points importants : une politique d’aide aux victimes, avec une véritable prise en charge sanitaire et financière ; une réflexion sur le fonctionnement des dispositifs de protection des personnes – avec ces questions en toile de fond : que ferons-nous lors des prochains attentats ? Devrons-nous modifier une nouvelle fois la Constitution ? – une tentative de comprendre et de se mettre à la place des terroristes pour mieux agir contre eux et faire de la prévention. Je n’ai entendu aucune de ces réflexions dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Enfin, nous devrions examiner notre attitude à l’égard des autres pays ; je ne note aucun débat sur la coopération entre les services de justice et de renseignement au niveau européen et international. Ces sujets sont pourtant prioritaires par rapport au débat aujourd’hui.
Les mesures proposées sont symboliques. Mais le symbole ne facilite pas la compréhension, pas plus qu’il ne garantit que l’action va dans la bonne direction.
Autre question qui se pose : comment sortir de l’état d’urgence, alors qu’on nous annonce qu’il durera jusqu’en 2017, voire jusqu’à la disparition de l’État islamique ? L’état d’urgence n’est pas borné, contrairement à ce qu’affirmait le Premier ministre hier.
Pour toutes ces raisons, je suis opposée à ce projet de loi. Avec ma collègue sénatrice Esther Benbassa, nous avons mis ce projet de loi en discussion sur la plateforme Parlement et citoyens. À rebours des sondages à la va-vite dont les médias sont friands, il est nécessaire de solliciter l’avis éclairé des citoyens et de comprendre ensemble ce qui se passe. Vous pouvez tous participer en soumettant à la discussion des amendements et en échangeant avec les citoyens qui participent en grand nombre à cette consultation. Je vous invite à débattre et à ne pas vous en tenir à une opinion exprimée « à chaud ». Nous sommes d’ailleurs nombreux à déplorer que cette discussion ait lieu dans une période d’état d’urgence. Je rappelle que l’article 89 de la Constitution interdit la révision de celle-ci lorsque les intérêts de la Nation sont en danger.
M. Georges Fenech. L’opposition assiste ébahie et impuissante au spectacle d’une majorité en voie d’éclatement – la plupart des intervenants ce matin se sont prononcés contre le texte constitutionnel. Nous verrons quelles nouvelles surprises nous réserve ce texte qui n’en manque pas…
La première surprise est venue de l’annonce par le Président de la République, à Versailles, d’une réforme constitutionnelle. Personne n’était dans le secret de cette volonté présidentielle.
À la différence de la majorité, la position de notre groupe n’est pas sinueuse. Elle est cohérente depuis le début. Nous avions annoncé que nous étions prêts, dans un esprit de responsabilité, à adopter toutes les mesures susceptibles de renforcer la sécurité des Français. Nous l’avons fait. Nous avons voté sans difficulté la modification de la loi de 1955 sur l’état d’urgence.
Nous sommes disposés à apporter nos voix à la nécessaire majorité des trois cinquièmes en faveur de la constitutionnalisation de l’état d’urgence, encore que la révision de la Constitution sur ce point ne nous paraisse pas absolument nécessaire. Preuve en est l’intervention du Premier ministre, hier encore, qui justifiait cette constitutionnalisation par la nécessité de compléter les moyens d’action des forces de sécurité, tout en ajoutant que, dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier 1985, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y a pas d’incompatibilité de principe entre la loi de 1955 et la Constitution. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion d’affirmer la conformité de cette loi à la Constitution, ce qu’ont confirmé les dernières décisions sur les recours déposés. On ne peut toutefois pas refuser la consolidation juridique de la loi de 1955. On se souvient que le comité Balladur l’avait envisagé – à l’occasion, il est vrai, d’un toilettage de la Constitution. Dont acte.
S’agissant de l’article 2, nous considérons que la révision constitutionnelle n’était pas une nécessité. La nationalité relève de la loi, non de la Constitution. La volonté d’inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité a sans doute été confortée par l’avis du Conseil d’État pointant un risque constitutionnel en raison de la distinction entre binationaux et nationaux. Quant au principe même de la déchéance de nationalité, nous ne pouvons qu’y être favorables puisque nous avions déposé une proposition de loi en ce sens, bien avant le discours de Versailles. Nous attendons avec beaucoup de curiosité de voir si, sur ce sujet, nous assisterons à un deuxième reniement.
Le premier reniement, en effet, c’est celui de la parole présidentielle : la déchéance de nationalité pour les binationaux nés Français devait être inscrite dans la Constitution, elle ne l’est plus. Le sera-t-elle dans la loi ? Nous attendons de voir ce qu’il adviendra des amendements sur ce sujet.
J’ai aujourd’hui des doutes sérieux sur l’aboutissement de ce texte, non pas de notre fait mais de celui de votre majorité, qu’il faudra rassembler alors qu’elle est aujourd’hui divisée. Le spectacle que vous nous offrez a connu son apothéose hier avec la démission très théâtrale de la garde des Sceaux, quittant tout sourire et à vélo la place Vendôme, alors qu’il y a moins de trois mois, 130 de nos concitoyens mouraient sous les balles des terroristes.
Plusieurs députés du groupe Socialiste, républicain et citoyen. Cela n’a rien à voir !
Mme Cécile Untermaier. S’agissant de l’article 1er, l’état d’urgence a été décrété et prorogé par le Parlement dans le respect du cadre constitutionnel. La Constitution, en ses articles 16 et 36, prévoit deux régimes particuliers qui ne correspondent pas à la situation que nous devons affronter. Je ne souhaite pas, contrairement à certains, la suppression de l’article 16. En revanche, je suis favorable à ce que la Constitution intègre ce troisième régime d’exception de l’État de droit qu’est l’état d’urgence.
La constitutionnalisation permet d’écrire la réalité de notre société et donne les outils pour répondre aux problèmes majeurs que nous rencontrons. Elle permet d’encadrer l’état d’urgence, en citant limitativement les cas d’ouverture.
Enfin, j’ajoute que la réactivité n’est pas la précipitation. Dans le cas présent, nous sommes des parlementaires réactifs à une situation. La Constitution est là pour prendre acte de cette réactivité.
Le travail parlementaire va enrichir cet article 1er, en y ajoutant le contrôle parlementaire ainsi que, je l’espère, le contrôle constitutionnel, comme pour l’article 16. Ce contrôle permet de s’assurer que la loi de prorogation est bien conforme aux conditions posées pour déclarer l’état d’urgence. Celui-ci ne doit pas être prolongé à des fins détournées par une majorité. Seul le juge constitutionnel est suffisamment extérieur à l’exercice politique pour apprécier si le maintien de l’état d’urgence est justifié au regard du contexte.
Il est important que l’état d’urgence soit inscrit dans la Constitution. Elle est là pour ça. Ce n’est pas un texte sacré.
La Commission en vient à l’examen des articles.
Article premier
(art. 36-1 [nouveau] de la Constitution)
Régime constitutionnel de l’état d’urgence
Le présent article introduit dans la Constitution le régime de l’état d’urgence et en précise les conditions de mise en œuvre. Ce faisant, il reprend les dispositions des trois premiers articles de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (17).
À la suite des attentats meurtriers du 13 novembre dernier, les pouvoirs publics ont décidé de recourir à cet état d’exception – ce n’était que la huitième fois, en soixante ans. Le Président de la République a ainsi décrété, en Conseil des ministres, l’état d’urgence à compter du 14 novembre, à zéro heure (18), avant que l’Assemblée nationale et le Sénat n’autorisent sa prorogation jusqu’au 25 février 2016, à minuit, par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (19).
Lors de son allocution devant le Parlement réuni en Congrès, le 16 novembre, le chef de l’État a souhaité aller au-delà et faire évoluer la loi constitutionnelle, en déclarant : « cette guerre d’un autre type face à un adversaire nouveau appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l’état de crise ». Plus qu’une simple inscription de la notion d’état d’urgence, cette constitutionnalisation autoriserait, comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi , à compléter les moyens d’action des forces de sécurité et à accroître l’efficacité des mesures administratives susceptibles d’être prises.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Notre droit public prévoit la possibilité d’attribuer au pouvoir exécutif des pouvoirs renforcés pour faire face à des situations exceptionnelles. Il faut distinguer, à cet égard, quatre constructions juridiques, sans hiérarchie certaine entre elles :
– la jurisprudence des circonstances exceptionnelles, développée par le juge administratif, qui ne s’applique que dans le silence de la loi ;
– deux « états de crise » (20) : l’état d’urgence, d’une part, aujourd’hui défini par une loi ordinaire, qui accroît les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre, et l’état de siège, d’autre part, inscrit à l’article 36 de la Constitution, qui se distingue du précédent par le transfert des pouvoirs de police aux autorités militaires qu’il organise ;
– les pouvoirs exceptionnels susceptibles d’être conférés au Président de la République sur le fondement de l’article 16 de la Constitution, dans les cas les plus graves et au terme d’une procédure minutieusement encadrée par le constituant.
A. L’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉTAT D’URGENCE
La loi du 3 avril 1955 fixe le régime juridique de l’état d’urgence. L’application de cette législation d’exception rend légales des décisions administratives qui ne le seraient pas en temps ordinaires. Elle pose également des limites temporelles ou géographiques à l’exercice de ces pouvoirs ; elle soumet ceux-ci aux principes de nécessité et de proportionnalité.
1. Dans quels cas l’état d’urgence peut-il être déclaré ?
Aux termes de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et du territoire de la Nouvelle-Calédonie, dans deux hypothèses :
– en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ;
– en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamités publiques.
La rédaction retenue par le législateur de 1955, reprenant sur ce point le premier des deux projets de loi gouvernementaux qui avaient été déposés, à l’époque, sur le Bureau de l’Assemblée nationale (21), conditionne l’établissement de l’état d’urgence à des situations définies en des termes assez généraux. Il en résulte un pouvoir très étendu laissé aux pouvoirs publics constitutionnels – hier, exclusivement le législatif et, depuis 1960, l’exécutif seul pendant les douze premiers jours – pour apprécier les motifs justifiant cet établissement.
a. La situation de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public »
La première hypothèse a une visée préventive : l’état d’urgence est déclaré dans l’intention de prévenir les conséquences d’un danger immédiat, sur le point de se concrétiser.
Les termes choisis font écho à ceux de l’article premier de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège, dont la rédaction originale visait le « cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure ». Cette formulation n’est pas totalement inconnue, non plus, du juge administratif, qui l’employait pour définir « le cas d’extrême urgence, entendu dans le sens du péril imminent pour la sécurité, la salubrité, le bon ordre » (22) afin de justifier des mesures de police aggravée ou l’exécution forcée d’actes administratifs. Dans cette logique, il faut sous-entendre que le danger, dont l’état d’urgence vise à contrecarrer les conséquences, concerne l’ordre public dans sa conception la plus traditionnelle et fondamentale.
Plus explicite est la circonstance que ce « péril imminent » doive naître d’« atteintes graves à l’ordre public ». Là encore, la comparaison avec le régime de l’état de siège est éclairante : la loi du 3 avril 1878 relative à l’état de siège a, dans un second temps, limité celui-ci au cas de « péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée » (23). Si l’on suit la restriction opérée par cette réécriture, la loi du 3 avril 1955 doit s’interpréter comme conditionnant la déclaration d’urgence, dans cette première hypothèse, à la survenue de troubles graves à l’ordre public.
Ayant admis de contrôler, en référé comme au fond, la légalité du décret instituant l’état d’urgence, le juge administratif a été conduit à examiner les motifs justifiant de recourir à ce régime d’exception. Ainsi, justifie la mise en œuvre de l’état d’urgence l’existence de violences urbaines sur une partie importante du territoire et portant des atteintes graves à la sécurité publique (24). Les attentats du 13 novembre dernier, parce qu’ils emportaient un danger immédiat de récidive, ont également pu justifier l’état d’urgence et ce « péril imminent » n’a pas disparu deux mois plus tard : en l’espèce, le Conseil d’État n’a pas statué sur la légalité du décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 déclarant l’état d’urgence mais sur la décision implicite du Président de la République de ne pas mettre fin à l’état d’urgence avant l’expiration du délai prévu par loi (25).
b. Les « calamités publiques »
Cette seconde hypothèse est curative : il s’agit, en quelque sorte, d’une « législation de détresse » (26) permettant d’organiser un secours urgent face à une catastrophe de grande ampleur. Le projet gouvernemental de mars 1955 mentionnait ainsi les incendies de forêt, les inondations ou les tremblements de terre.
Si l’on en saisit plus aisément la signification, l’expression « calamités publiques » ne renvoie pas, pour autant, à une notion juridique précise. Le douzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 utilise une terminologie voisine en proclamant « la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ». Le code des assurances définit la catastrophe naturelle (27) et crée un dispositif d’indemnisation des victimes, pour le fonctionnement duquel les calamités publiques correspondent aux catastrophes naturelles d’une ampleur exceptionnelle. Le législateur a même récemment créé (28) un « fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques » ayant pour objet de réparer les « dommages causés (…) par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée ». Du fait de cette absence de définition légale, la question de l’extension des « calamités publiques » au-delà des seuls évènements naturels demeure sans réponse et, avec elle, celle de l’inclusion des catastrophes technologiques (nucléaire ou chimique) et sanitaires, dont le législateur de 1955 ignorait la gravité mais dont l’actualité récente a démontré la prégnance.
L’état d’urgence n’a toutefois jamais été déclaré sur ce fondement. Deux raisons peuvent l’expliquer : d’une part, aucune mesure spécifique aux « calamités publiques » n’a été prévue dans la loi du 3 avril 1955 et, d’autre part, des procédures d’urgence alternatives, sans doute plus adaptées à la gestion de telles crises, existent aujourd’hui (plans ORSEC (29), par exemple).
2. Comment l’état d’urgence est-il déclaré ?
Conçue sous la IVème République, la loi du 3 avril 1955 prévoyait, dans la rédaction initiale de son article 2, que « l’état d’urgence ne [pouvait] être déclaré que par la loi ». Les débats parlementaires avaient même conduit à écarter la possibilité de déclarer l’état d’urgence, en dehors des sessions du Parlement, par décret pris en Conseil des ministres, pourtant prévue par le projet gouvernemental sur le modèle de la loi du 3 avril 1878.
L’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 (30) a donné à ces dispositions leur forme actuelle, en prévoyant notamment que l’état d’urgence soit toujours déclaré par décret en Conseil des ministres. Il s’agit donc d’un acte précisément identifié en droit, qui est un décret présidentiel soumis au contreseing du Premier ministre. L’article 13 de la Constitution dispose que le Président de la République « signe les décrets et les ordonnances délibérés en Conseil des ministres ». Même si la circonstance ne s’est jamais présentée, le chef de l’État ne pourrait donc pas, en période de cohabitation, imposer l’état d’urgence à un Gouvernement qui y serait hostile.
Ce décret détermine, à tout le moins, la date et l’heure de début de l’état d’urgence et les territoires sur lesquels celui-ci est institué ; il peut également autoriser la mise en œuvre de certaines mesures prévues à l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 (cf. infra), qui restreignent les libertés individuelles.
Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi de 1955, réaménagé en 1960, limite cependant à douze jours cette première phase. Seule une loi peut proroger l’état d’urgence au-delà de cette période initiale, selon une procédure strictement parallèle à celle prévue, en 1958, à l’article 36 de la Constitution pour l’état de siège.
Il résulte de ce qui précède que le pouvoir exécutif a la possibilité de mettre en œuvre l’état d’urgence sans intervention du législateur dès lors qu’il y met un terme avant le délai de douze jours : c’est le choix qui a été fait à deux reprises, en 1986 dans les îles Wallis-et-Futuna, pendant 36 heures, et, en 1987, dans plusieurs communes polynésiennes, pendant exactement douze jours – dans le cas un peu particulier, il est vrai, des prérogatives reconnues au représentant de l’État par les statuts alors applicables à ces territoires.
3. Quelle est la durée de l’état d’urgence ?
Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 avril 1955, la loi de prorogation de l’état d’urgence détermine la « durée définitive » de celui-ci. Elle fixe donc le temps de sa durée ; à l’expiration de ce temps, l’état d’urgence cesse de plein droit à moins qu’une loi nouvelle n’en prolonge les effets. Cette rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 1960 est moins précise que celle qu’elle a remplacée qui prévoyait à l’origine : « La loi fixe la durée de l’état d’urgence qui ne peut être prolongé que par une loi nouvelle ».
Le point de départ de l’état d’urgence est, conformément au droit commun, soit le jour que le décret ou la loi de prorogation fixe, soit la date de la publication du décret ou de la promulgation de la loi. Cette durée se calcule de quantième à quantième. L’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 expirait ainsi le 26 novembre à zéro heure. Prolongé pour trois mois par la loi du 20 novembre 2015, il expirera le 26 février 2016 à zéro heure.
Aucune disposition ne plafonne la durée pendant laquelle l’état d’urgence est prorogé : trois mois en 2005 et 2015, six mois en 1955. Prises toutes deux sur le fondement de l’article 16 de la Constitution, une première décision du 24 avril 1961 avait même prorogé l’état d’urgence sine die en renvoyant à une seconde décision le soin d’en déterminer le terme, celle-ci opérant une nouvelle prorogation pour neuf mois et demi.
Cette prorogation peut être renouvelée sans limitation. Il n’est alors pas besoin d’un nouveau décret. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis, rendu public, sur le présent projet de loi, « si les conditions de fond de l’état d’urgence sont toujours remplies, une nouvelle prorogation par la loi sera possible. Il reviendra au Parlement d’en décider au cas par cas. » Le législateur a même eu l’occasion de voter, en 1985, l’état d’urgence alors que le délai de douze jours au-delà duquel son intervention était nécessaire avait expiré, attestant ainsi que le décret présidentiel ne pouvait être considéré comme une base juridique indispensable à la régularité d’une éventuelle loi.
En outre, sans que la loi du 3 avril 1955 ne l’impose, les lois de prorogation comportent toujours une disposition expresse autorisant l’exécutif à mettre fin à l’état d’urgence, de manière anticipée, par décret en Conseil des ministres. Tel était le cas, par exemple, en 2005 comme en 2015.
En dépit du terme fixé par la loi de prorogation, l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 précise que celle-ci est caduque à l’issue des quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale. Dans le premier cas, il revient au nouveau Gouvernement de solliciter la confirmation de l’état d’urgence, en faisant adopter une loi avant l’expiration de ce délai. En revanche, le législateur de 1955 n’a pas expressément prévu que l’état d’urgence serait caduc avec la fin de la législature.
La date d’expiration de l’état d’urgence est, en tout cas, importante puisque l’article 14 de la loi du 3 avril 1955 prévoit que « les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même temps que prend fin [celui-ci] ». La loi n’aménage donc pas les conditions de sortie de l’état d’urgence.
4. Les limites territoriales de l’état d’urgence
La détermination des effets juridiques de l’état d’urgence impose de distinguer entre les territoires où celui-ci entre en vigueur et ceux où il reçoit application. Elle s’effectue en deux temps :
1° L’état d’urgence est déclaré par un décret en Conseil des ministres, conformément au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 3 avril 1955, qui détermine les « circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur ». Cette déclaration entraîne l’extension de la compétence du ministre de l’Intérieur ou des préfets qui peuvent recourir aux mesures prévues aux articles 5 (interdiction de circulation, zones de protection et interdiction de séjour), 6-1 (dissolution des associations), 9 (remise des armes) et 10 (réquisitions) de la loi.
Ces mesures avaient concerné, en 2005, les circonscriptions territoriales déterminées par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 déclarant l’état d’urgence, qui visait l’ensemble du territoire métropolitain mais excluait les départements d’outre-mer.
Le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 a d’abord retenu un périmètre identique à celui choisi dix ans plus tôt. Toutefois, un second décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 a été adopté en Conseil des ministres afin d’étendre l’état d’urgence aux cinq départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
2° Ensuite, à l’intérieur de ces circonscriptions, un décret simple fixe les « zones où l’état d’urgence recevra application », en vertu du deuxième alinéa de l’article 2. Les mesures qui ne peuvent être mises en œuvre que dans ces zones sont celles prévues aux articles 8 (fermeture des lieux de réunion, interdiction de manifester), 6 (assignations) et 11 (perquisitions administratives).
En 2005, pour faire face aux émeutes urbaines dans un certain nombre de quartiers, le Gouvernement avait choisi d’énumérer les communes concernées –soit la quasi-totalité des zones urbaines importantes – dans un tableau annexé au décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 qui concernait 25 départements.
Dix ans plus tard, le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 a, dans un premier temps, limité ces zones à l’ensemble des communes d’Île-de-France, avant que le décret n° 2015-1478 du même jour procède à une extension afin d’englober l’ensemble du territoire métropolitain et de la Corse. Un décret n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 a finalement étendu ces zones d’application aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Cette distinction ne figurait pas, en 1955, dans le projet de loi gouvernemental. La sophistication ainsi introduite – sans doute inspirée par le souci de cantonner les mesures les plus attentatoires aux libertés à des zones circonscrites – laisse, en réalité, une compétence discrétionnaire au pouvoir exécutif pour « appliquer » l’état d’urgence. Les décrets pris au mois de novembre dernier l’illustrent assez bien, puisque l’on observe in fine une coïncidence totale entre les circonscriptions où l’état d’urgence est déclaré et les zones où il est appliqué.
5. Le régime de base et les mesures complémentaires
On peut opérer une distinction entre l’état d’urgence simple et « l’état d’urgence aggravé », comme il est parfois qualifié (31). L’article 11 de la loi du 3 avril 1955 peut, en effet, « par une disposition expresse », conférer aux autorités administratives deux prérogatives plus dérogatoires encore que les mesures exceptionnelles prévues par les autres articles : d’une part, le préfet, ou plus rarement le ministre, peut ordonner des perquisitions domiciliaires, de jour comme de nuit ; d’autre part, le ministre a la faculté, depuis la loi du 20 novembre 2015, de faire bloquer certains sites Internet (et non plus d’ordonner des mesures de contrôle de la presse écrite ou radiophonique comme c’était le cas auparavant).
Aux termes de cet article, le recours aux mesures complémentaires doit être prévu par le décret déclarant l’état d’urgence ou par la loi prorogeant celui-ci. Cela suppose que la décision soit prise au début de l’état d’urgence ; rien n’interdirait toutefois au Parlement, tout en maintenant l’état d’urgence simple, de supprimer l’état d’urgence aggravé.
Les applications de l’état d’urgence
IVème République
1955
L’état d’urgence a été déclaré en Algérie pour une période de six mois par la loi du 3 avril 1955, puis prorogé pour six mois par la loi n° 55-1080 du 7 août 1955 (32). Le décret n° 55-1147 du 30 août 1955 a ensuite étendu l’état d’urgence à tout le territoire algérien. La dissolution de l’Assemblée nationale le 1er décembre rendit cependant caduque la loi de prorogation.
1958
À la suite du mouvement du 13 mai à Alger, l’état d’urgence a été déclaré en métropole par la loi n° 58-487 du 17 mai 1958 (33) jusqu’au 1er juin, date de la démission du Gouvernement.
Vème République
1961-1962
À la suite du « putsch des généraux », l’état d’urgence a été déclaré à compter du 23 avril 1961 par deux décrets nos 61-395 et 61-396 du 22 avril 1961.
Le 24 avril 1961, une décision du Président de la République, prise sur le fondement de l’article 16 de la Constitution, a prolongé l’état d’urgence jusqu’à nouvelle décision. Une seconde décision, prise sur le même fondement, du 29 septembre, eut pour effet de maintenir l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 1962. Enfin, une ordonnance n° 62-797 du 13 juillet 1962 (34) le prorogea jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mai 1963. La dissolution de l’Assemblée nationale le 9 octobre 1962 eut pour effet de mettre fin à l’état d’urgence.
1985
L’état d’urgence a été déclaré en Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances par l’arrêté n° 85-35 du 12 janvier 1985 du haut-commissaire de la République, en application de l’article 119 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 (35) et de la loi du 3 avril 1955. Un délai supérieur à douze jours s’étant écoulé, cet état d’urgence a été rétabli (et non prorogé) à partir du 27 janvier et jusqu’au 30 juin 1985 par la loi du 25 janvier 1985 (36).
1986
L’état d’urgence a été déclaré le 29 octobre 1986 sur l’ensemble du territoire des îles de Wallis et Futuna par deux arrêtés de l’administrateur supérieur nos 117 et 118 pris à cette date, en application de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (37) et de la loi du 3 avril 1955. Il y a été mis fin, à compter du lendemain, par l’arrêté n° 120.
1987
L’état d’urgence a été déclaré le 24 octobre 1987 dans les communes de la subdivision des Îles du Vent en Polynésie française par deux arrêtés du haut-commissaire de la République nos 1214 CAB et 1215 CAB pris à cette date, en application de l’article 91 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 (38) et de la loi du 3 avril 1955. Il fut levé le 5 novembre, par l’arrêté n° 1285 CAB.
2005
L’état d’urgence a été déclaré, sur le territoire métropolitain, à compter du 9 novembre 2005 par deux décrets nos 2005-1386 et 2005-1387 pris le 8 novembre, et prorogé pour une durée de trois mois par la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 (39). Toutefois, un décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006 mit fin à son application à compter du 4 janvier, conformément à la faculté qui était offerte au pouvoir exécutif.
2015
L’état d’urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, « sur le territoire métropolitain et en Corse », à compter de cette même date, à zéro heure. Il a ensuite été étendu, par un second décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015, aux cinq départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 a prorogé cet état d’urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015. Un nouveau projet de loi de prorogation, non encore déposé, a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du 16 février 2016.
Sources : Rapports n° 2675 de M. Philippe Houillon (Assemblée nationale, XIIème législature) et n° 3237 de M. Jean-Jacques Urvoas (Assemblée nationale, XIVème législature).
B. LES EFFETS DE L’ÉTAT D’URGENCE
Dès la déclaration de l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur et le préfet se voient dotés de pouvoirs de police étendus. Les mesures permises pendant son application constituent autant d’outils à la disposition de l’autorité administrative qui peut s’en saisir pour prévenir n’importe quelle menace à l’ordre et la sécurité publics. Le Conseil d’État a constaté, en effet, que la loi du 3 avril 1955 n’établissait pas de lien direct entre la nature du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à ce que soit déclaré l’état d’urgence et la nature de la menace pour la sécurité et l’ordre publics susceptible de justifier une mesure d’assignation à résidence (40).
1. Les restrictions à la liberté d’aller et de venir
Dans les circonscriptions où l’état d’urgence s’applique, les préfets peuvent, par arrêté, prendre des mesures générales ou individuelles pour :
– interdire ou règlementer la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures déterminés, en vertu du 1° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 ;
– instituer des zones de protection ou de sécurité dans lesquelles le séjour des personnes est réglementé, conformément au 2° du même article ;
– interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics (3°).
Même si l’autorité de police – le maire ou le préfet, selon les cas – a toujours la possibilité de réglementer la circulation, y compris de l’interdire temporairement en cas d’atteintes graves à la sécurité, le juge administratif considère comme illégale une interdiction générale et permanente. Les mesures autorisées par le 1° de l’article 5 ont donc bien un caractère exceptionnel.
Ces différentes mesures ont été utilisées en 2005 et 2015 ; l’examen des arrêtés préfectoraux pris en vertu de l’article 5 montre la conception extensive donnée par les autorités administratives à cette disposition. En novembre et décembre 2005, l’état d’urgence a servi, principalement, à prononcer des couvre-feux, sur le fondement du 1° de cet article, dans les agglomérations touchées par des émeutes urbaines. Cette mesure a été mise en œuvre par les préfets dans environ quarante communes, sous la forme d’interdictions plus ou moins ciblées (41). Au cours des dernières semaines, en revanche, un seul couvre-feu a été ordonné (42) mais plusieurs interdictions de séjour (3°) et des restrictions de la circulation automobile ont été prononcées ; des zones de protection ont également été créées, en Île-de-France, pendant la durée de la Conférence de Paris sur le climat (COP 21) et dans le Nord.
La mise en œuvre de la loi du 3 avril 1955 a parfois servi aussi d’élément de circonstance, expressément visé dans l’acte administratif, pouvant justifier des arrêtés ministériels ou préfectoraux pris sur des fondements ordinaires : c’est le cas de plusieurs arrêtés du ministre de l’Intérieur interdisant le déplacement de supporters lors de rencontres de football, en application de l’article L. 332-16-1 du code du sport (43).
2. Les perquisitions administratives
Dans le cadre de « l’état d’urgence aggravé » évoqué plus haut, le I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 prévoit la possibilité pour le ministre de l’Intérieur, sur l’ensemble des zones où est appliqué l’état d’urgence, ou pour un préfet, sur tout ou partie de son département sous réserve que l’état d’urgence s’y applique, d’ordonner des perquisitions, de jour comme de nuit.
S’il existe, à côté des perquisitions strictement judiciaires (44), d’autres types de perquisitions – les perquisitions fiscales prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les perquisitions douanières à l’article 64 du code des douanes – pouvant être demandées par l’autorité administrative, cette mesure d’exception a la particularité de ne pas requérir une autorisation du juge des libertés et de la détention.
L’article 4 de la loi du 20 novembre 2015 a complété le régime juridique de ces perquisitions administratives, imaginé en 1955, dans le souci d’écarter tout risque d’inconstitutionnalité pour cause d’incompétence négative du législateur.
Le premier alinéa du I de l’article 11 précise désormais que ces perquisitions ne peuvent être effectuées que « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », selon une expression identique à celle introduite à l’article 6 pour les assignations à résidence. Les modifications ont aussi eu pour but d’élargir à tous les types de lieux, et pas seulement aux locaux à usage d’habitation, la faculté d’ordonner des perquisitions, tout en excluant les locaux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, magistrats ou journalistes.
Reprenant le cadre de deux circulaires prises respectivement par le ministre de l’Intérieur (45) et le ministre de la Justice (46), le deuxième alinéa de ce I impose que la décision du préfet précise le lieu et le moment de la perquisition et que le procureur de la République territorialement compétent en soit informé sans délai. La perquisition ne peut, de surcroît, être conduite qu’en présence d’un officier de police judiciaire ; elle doit se dérouler en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. Bien que la loi ne le prévoit pas expressément, la logique impose aussi la remise de l’ordre de perquisition aux occupants du local visé.
S’inscrivant dans le strict cadre de la police administrative, le troisième alinéa de ce I n’ouvre la faculté d’opérer des saisies à l’occasion d’une perquisition administrative qu’au seul officier de police judiciaire agissant en flagrance. Faute de prévoir des saisies administratives, comme pourtant le Conseil d’État y avait encouragé le Gouvernement (47), la loi du 20 novembre 2015 a retenu la possibilité d’accéder, « par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial » et de procéder à la copie de ces données, sur le modèle des perquisitions judiciaires de données informatiques prévues à l’article 57-1 du code de procédure pénale.
Alors qu’une seule perquisition administrative avait eu lieu en 2005 pendant toute la durée de l’état d’urgence, cette mesure a été largement utilisée depuis le 14 novembre 2015 : selon les données recueillies par la commission des Lois, dans le cadre du contrôle de l’état d’urgence qu’elle a mis en place, 3 239 perquisitions avaient été ordonnées, exclusivement par les préfets, au 12 janvier 2016, dont plus de la moitié au cours des douze premiers jours de l’état d’urgence.
3. Les assignations à résidence
Conformément à l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l’Intérieur dispose, pendant la durée de l’état d’urgence, d’un pouvoir de police spéciale lui permettant de prononcer l’assignation à résidence dans une localité qu’il détermine de certaines personnes résidant dans les zones où s’applique l’état d’urgence. Cette assignation prend la forme d’un arrêté, signé par le ministre ou par un fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation, notifié individuellement à l’intéressé ; comme toute décision administrative individuelle défavorable, l’assignation n’entre en vigueur qu’à compter de sa notification.
Le Parlement a posé, en 1955, plusieurs garde-fous à cette mesure, peut-être la plus coercitive de la loi, qui ne fait pourtant pas partie des prérogatives devant être expressément autorisées par le décret déclarant l’état d’urgence ou la loi le prorogeant :
– en aucun cas, cette prérogative exceptionnelle ne peut avoir pour effet de créer des camps où seraient détenues ces personnes ;
– l’autorité administrative doit veiller à prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ;
– enfin, précaution supplémentaire ajoutée par la loi du 7 août 1955, l’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité d’une agglomération.
L’article 4 de la loi du 20 novembre 2015 a élargi et adapté ce régime afin d’assurer une meilleure surveillance des personnes assignées à domicile. Alors que la rédaction antérieure prévoyait que le ministre pouvait assigner à résidence les individus « dont l’activité s’avère dangereuse », le premier alinéa de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 repose désormais sur un critère plus large qui vise toute personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace ». Il prévoit également la faculté d’escorter la personne jusqu’au lieu d’assignation à résidence, lorsque celui-ci est éloigné de son domicile.
Le deuxième alinéa de cet article 6 organise une nouvelle possibilité d’assignation à temps partiel dans un lieu d’habitation précis (par exemple, au domicile), dans la limite de douze heures sur vingt-quatre, conçue comme un complément à la mesure principale d’assignation à résidence.
Au 12 janvier 2016, sur la base des chiffres communiqués par le ministre de l’Intérieur, 381 personnes avaient fait l’objet, depuis le début de l’état d’urgence mis en œuvre le 14 novembre 2015, d’un arrêté d’assignation à résidence, systématiquement assorti d’une assignation à domicile.
Le septième alinéa (1°) permet d’obliger la personne assignée à résidence à se présenter périodiquement au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, dans la limite de trois pointages par jour (48), tandis que le huitième alinéa (2°) ouvre la faculté d’ordonner, en outre, à la personne concernée d’y déposer ses documents d’identité. Le neuvième alinéa prévoit la possibilité d’interdire à l’intéressé d’entrer en contact avec des individus nommément désignés.
Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, le dernier alinéa de l’article 6 permet de placer sous surveillance électronique mobile, avec leur accord, des personnes assignées à résidence déjà condamnées pour des crimes ou délits qualifiés d’actes terroristes. En dépit des précautions prises pour que cette mesure ne déborde pas le champ des mesures de police administrative, ou peut-être à cause de ces contraintes fortes, cette possibilité n’a jamais été utilisée depuis le 14 novembre 2015.
4. Les autres mesures pouvant être prononcées
L’article 4 de la loi du 20 novembre 2015 a créé, dans un nouvel article 6-1 de la loi du 3 avril 1955, une mesure dérogatoire du droit commun, permettant au ministre de l’Intérieur de prononcer la dissolution des associations ou groupements de fait « qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités la facilitent ou y incitent ».
Il faut rappeler que l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, reprenant l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, permet déjà la dissolution, par décret en Conseil des ministres, de certaines associations ou groupements de fait.
Ces nouvelles dispositions introduisaient un critère plus large, ce qui était supposé faciliter ces dissolutions. Toutefois, si trois associations cultuelles ont effectivement été dissoutes depuis le début de l’état d’urgence en 2015, toutes l’ont été sur la base de l’article L. 212-1 précité, ce qui conduit à s’interroger sur l’intérêt de la mesure ainsi ajoutée.
Dans les zones où l’état d’urgence est appliqué, conformément à l’article 8 de la loi du 3 avril 1955, le préfet peut ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion de toutes natures ; quatre salles de prière ont été fermées sur ce fondement depuis le mois de novembre dernier.
Il peut également y interdire, à titre général ou particulier, « les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre » : des manifestations sur la voie publique ont, plus particulièrement, été interdites dans de nombreux départements durant les premières semaines de l’état d’urgence. Il s’agit là de l’extension d’un pouvoir normal de police, qui appelle les mêmes remarques qu’en matière de police de la circulation.
L’article 9 de la loi du 3 avril 1955 prévoit que le ministre ou le préfet peut ordonner la remise des armes détenues ou acquises légalement, ainsi que de leurs munitions. La confiscation est temporaire ; les armes et munitions sont restituées au plus tard à la fin de l’état d’urgence. Dans le silence du dispositif, il ressort des travaux préparatoires que cette faculté est accordée à l’administration pour tout le territoire où l’état d’urgence est institué. Une compétence analogue est accordée à l’autorité militaire, pendant l’état de siège, par l’article L. 2121-7 du code de la défense.
La loi du 20 novembre 2015 a procédé à une réécriture afin que ce dispositif se réfère à la classification des armes en vigueur et permette de prononcer indifféremment une mesure générale ou individuelle. Les travaux de contrôle de la commission des Lois ont mis en évidence que plusieurs préfets avaient eu recours, depuis le 14 novembre 2015, à ce dispositif pour ordonner la remise des armes et munitions de certains licenciés dans des clubs de tir.
Sur tout le territoire où l’état d’urgence est appliqué, des réquisitions de personnes ou de biens peuvent être ordonnées par les préfets, conformément à l’article 10 de la loi du 3 avril 1955. Les modalités de ces réquisitions sont identiques à celles prévues en temps de guerre, au livre II de la deuxième partie du code de la défense.
Les préfets disposent déjà, en temps normal, d’un pouvoir de réquisition en cas d’urgence, prévu au 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, visant à préserver « le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publique ». Toutefois, dans le cadre de l’état d’urgence, ces réquisitions peuvent être exécutées d’office, sans avoir à saisir le juge, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 3 avril 1955.
LES MESURES ADMINISTRATIVES PERMISES PAR LA LOI DU 3 AVRIL 1955
Article de la loi |
Mesure |
Acte juridique de mise en œuvre de la mesure |
Condition supplémentaire pour l’adoption de l’acte de mise en œuvre |
Article 5 (1°) |
Interdiction de la circulation des personnes ou des véhicules |
Arrêté préfectoral |
- |
Article 5 (2°) |
Institution de zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé |
Arrêté préfectoral |
- |
Article 5 (3°) |
Interdiction de séjour |
Arrêté préfectoral |
- |
Article 6 |
Assignation à résidence, complétée le cas échéant par : |
Arrêté ministériel (Intérieur) |
Décret fixant les zones d’application de l’état d’urgence |
- assignation à domicile à temps partiel | |||
- pointage au commissariat | |||
- interdiction d’entrer en relation | |||
Article 6-1 |
Dissolution d’associations ou de groupements |
Décret en Conseil des ministres |
- |
Article 8 (premier alinéa) |
Fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion |
Arrêté ministériel (Intérieur) ou préfectoral sur l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence |
Décret fixant les zones d’application de l’état d’urgence |
Article 8 (second alinéa) |
Interdiction de manifestation |
Arrêté ministériel (Intérieur) ou préfectoral sur l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence |
Décret fixant les zones d’application de l’état d’urgence |
Article 9 |
Remise des armes des catégories A à C et de celles de catégorie D soumises à enregistrement |
Arrêté ministériel (Intérieur) ou préfectoral |
- |
Article 10 |
Réquisitions de personnes ou de biens |
Ordre de réquisition préfectoral |
- |
Article 11 (I) |
Perquisitions au domicile de jour et de nuit |
Ordre de perquisition du ministre de l’Intérieur ou du préfet |
Mention expresse dans le décret déclarant ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence Décret fixant les zones d’application de l’état d’urgence |
Article 11 (II) |
Blocage de sites Internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie |
Arrêté ministériel (Intérieur) |
Mention expresse dans le décret déclarant ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence |
Source : commission des Lois.
5. Les sanctions en cas de violation de ces mesures
L’article 13 de la loi du 3 avril 1955 fixe le quantum maximal des peines encourues en cas de violation des mesures prises par le ministre de l’Intérieur, ou les préfets, dans le cadre de l’état d’urgence.
Afin de les rendre plus dissuasives, l’article 4 de la loi du 20 novembre 2015 a porté ces peines à :
– six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende pour les infractions aux dispositions des articles 5 (circulation et séjour des personnes), 8 (fermeture des lieux de réunion) et 9 (remise des armes) ;
– trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende s’agissant des infractions au premier alinéa de l’article 6 relatif à l’assignation à résidence ;
– un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende s’agissant des infractions au deuxième (assignation à temps partiel) et aux deux derniers alinéas (pointage et interdiction d’entrer en relation) de l’article 6.
Ce faisant, le législateur a hissé ces infractions au niveau délictuel, ce qui permet aux forces de l’ordre de procéder à des interpellations en flagrance. Toutes ces infractions sont susceptibles de poursuites judiciaires : ainsi, entre le 14 novembre 2015 et le 19 janvier 2016, la Chancellerie a recensé 47 infractions à des mesures de l’état d’urgence concernant principalement des cas de violation d’assignations à résidence, d’interdictions de manifester et d’interdiction de séjour.
6. Les garanties accordées aux personnes
La loi du 20 novembre 2015, en introduisant un nouvel article 14-1 dans la loi du 3 avril 1955, a reconnu la pleine compétence du juge administratif pour connaître des mesures de police administrative prévues par l’état d’urgence. Cela revenait à faire de lui le garant de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures.
Le Conseil constitutionnel n’a pas dit autre chose dans sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 (49). Il s’est assuré, en premier lieu, de ce que le législateur avait suffisamment encadré les pouvoirs conférés à l’autorité administrative. Il a vérifié, en second lieu, que le juge administratif, chargé de se prononcer sur la légalité des mesures individuelles, procédait à un contrôle de proportionnalité.
S’agissant de la mise en œuvre des dispositions contestées, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer du caractère adapté, nécessaire et proportionné à la finalité poursuivie des mesures d’assignation à résidence. Le Conseil constitutionnel a ainsi indiqué « que tant la mesure d’assignation à résidence que sa durée, ses conditions d’application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence » (50).
a. L’ « entier contrôle » du juge administratif
En choisissant de remplacer les commissions départementales ad hoc prévues par l’ancien article 7 de la loi du 3 avril 1955 par des voies de recours de droit commun, le législateur a manifesté sa confiance aux juridictions administratives, et singulièrement à l’office du juge des référés.
Les mesures prises au titre de l’état d’urgence ont suscité un contentieux significatif, mais limité en nombre (51). Ces décisions – en particulier celles du 11 décembre (52) éclairées par les conclusions du rapporteur public – ont permis au Conseil d’État de faire évoluer sa jurisprudence et de l’adapter aux enjeux du contrôle pendant l’état d’urgence tel que l’avait réorganisé le législateur.
Se fondant sur une interprétation trop littérale du code de justice administrative, les juges des référés de première instance ont prononcé, dans plusieurs affaires relatives à des assignations à résidence décidées durant les premières semaines de l’état d’urgence mis en œuvre à compter du 14 novembre 2015, des rejets pour défaut d’urgence (« ordonnances de tri ») qui aboutissaient à ne pas même convoquer d’audience pour entendre les parties. Le Conseil d’État a entendu mettre un terme à cette pratique contestable, s’agissant de mesures restrictives de la liberté d’aller et venir des intéressés, en faisant bénéficier celles-ci d’une présomption d’urgence.
En ce qui concerne les assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence, le juge administratif s’en tenait, en l’état de sa jurisprudence classique, à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (53). Dans de nombreux contentieux de première instance, comme devant le Conseil d’État, le ministère de l’Intérieur avait soutenu que « le contrôle juridictionnel [était] limité à un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation en cas d’état d’urgence afin de laisser une marge de manœuvre à l’autorité de police pour faire face à la menace urgente et extrêmement grave résultant d’actes terroristes commis sur le territoire français ».
Une évolution importante est donc intervenue, au terme de laquelle le juge administratif exerce désormais sur ces mesures un contrôle de proportionnalité qualifié d’ « entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir ».
b. L’appréciation par le juge judiciaire de la légalité des mesures administratives prononcées
La compétence affirmée du juge administratif ne signifie pas que la justice pénale n’ait pas à connaître de l’état d’urgence. Elle réprime, comme on l’a vu, tous les manquements aux mesures prises dans ce cadre, qui constituent autant d’infractions pénales. Elle était, par ailleurs, concernée par l’ancien article 12 de la loi du 3 avril 1955 puisque celui-ci prévoyait la possibilité de transférer à la juridiction militaire la compétence pour se saisir des crimes et des délits connexes relevant de la cour d’assise ; cette disposition a finalement été abrogée par l’article 4 de la loi du 20 novembre 2015.
La juridiction répressive peut également être amenée, comme le prévoit l’article 111-5 du code pénal, à apprécier directement de la légalité des actes administratifs et réglementaires lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis. Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école : les nombreuses perquisitions administratives mises en œuvre depuis le 14 novembre 2015 ont conduit à constater des infractions pénales et à saisir des éléments de preuve dont la recevabilité sera conditionnée à l’appréciation portée sur la légalité des ordres de perquisitions préfectoraux par le juge pénal, qui pourrait différer de celle du juge administratif.
II. LE DROIT PROPOSÉ
La constitutionnalisation de l’état d’urgence est parfois jugée inutile, ou purement symbolique. Dans sa décision n° 85-187 du 25 janvier 1985, le Conseil constitutionnel s’est, en effet, déjà prononcé sur ce régime d’exception. Il avait alors jugé que la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 3 avril 1955, qui, d’ailleurs, a été modifiée sous son empire. Ce point a été confirmé par la décision précitée n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015.
Le Conseil constitutionnel n’a toutefois jamais contrôlé in extenso la constitutionnalité de la loi du 3 avril 1955, même s’il s’est prononcé – et s’apprête encore à se prononcer – ponctuellement sur certaines de ses dispositions (54). En outre, les circonstances pourraient requérir la mise en œuvre de nouvelles mesures.
A. LA NOTION D’ÉTAT D’URGENCE
Pour examiner l’opportunité de cette constitutionnalisation, il n’est pas inutile de rechercher si des situations juridiques analogues peuvent se rencontrer en droit comparé ou dans l’histoire constitutionnelle de notre pays.
Le droit international encadre aussi très étroitement les régimes d’exception. Le texte de la loi du 3 avril 1955, avant sa dernière modification en novembre 2015, avait ainsi été jugé compatible par le juge administratif avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (55). Même constitutionnalisé, le régime de l’état d’urgence demeurera soumis à l’examen des juridictions internationales.
1. Un « état de crise »
a. L’héritage de l’histoire constitutionnelle française
La France a connu plusieurs régimes d’exception analogues, au moins dans leurs effets, à l’état d’urgence tel que l’a organisé la loi du 3 avril 1955.
Le décret de l’Assemblée nationale du 21 octobre 1789 créait, à cet égard, « un état d’urgence avant l’heure » (56) avec la « loi martiale » qui confiait des pouvoirs exorbitants aux autorités exécutives et leur permettait d’utiliser sans condition les forces armées ainsi placées sous leurs ordres.
Sous le Directoire, la loi du 10 fructidor an V, déterminant la manière dont les communes de l’intérieur de la République pourront être mises en état de guerre ou de siège, est parfois considérée comme la première loi sur l’état de siège politique, dans la mesure où elle ne s’applique pas qu’aux seules places assiégées.
La loi du 24 messidor an VII sur « l’état de troubles civils » n’est pas, non plus, sans rappeler les caractéristiques de la loi du 3 avril 1955, dans sa forme originelle : seule la loi peut l’instituer, les pouvoirs des autorités administratives sont renforcés, des conseils de guerre spéciaux peuvent connaître de certains crimes et délits commis sur les territoires déclarés en état de trouble.
À l’époque du Consulat, des mesures du même ordre ont été inscrites à l’article 92 de la Constitution de l’an VIII : en particulier, la suspension des garanties constitutionnelles pouvait résulter d’un arrêté du Gouvernement lorsque le Corps législatif n’était pas en session.
Sous l’Empire, un décret du 24 décembre 1811 organisait le régime de l’état de siège sous une forme qui annonce celle de la loi du 9 août 1849 tandis qu’avec la Restauration, celui-ci est systématiquement utilisé en cas de troubles.
À partir de 1849, et jusqu’en 1955, notre pays ne connaît plus comme régime d’exception que l’état de siège, qu’il s’agisse de se défendre face à un siège militaire effectif ou, en temps de paix et en temps de guerre hors des places investies, de réprimer des troubles intérieurs – autrement dit, l’état de siège politique. Ce régime fut en particulier appliqué pendant les journées de juin 1849, pendant la Commune de 1871, y compris en Algérie, et durant les deux guerres mondiales.
D’autres mesures d’exception ont pu être appliquées, sans toutefois former un cadre aussi élaboré : la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre, qui comporte des dispositions restreignant les libertés publiques, ou les ordonnances des 10 janvier et 3 juin 1944 conférant aux commissaires régionaux de la République des pouvoirs exceptionnels.
b. État d’urgence et état de siège
Classiquement, l’état d’urgence est considéré comme une situation intermédiaire entre le droit commun et la législation de l’état de siège. Le discours du Président de la République devant le Congrès, le 16 novembre dernier, s’inscrivait dans cette perspective : « Premier régime, c’est le recours à l’article 16 de la Constitution. Il implique que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. (…) Et puis il y a l’article 36 de la Constitution qui porte sur l’état de siège. Il n’est pas non plus approprié. (…) Dans ce cas, différentes compétences sont transférées de l’autorité civile à l’autorité militaire. Chacun voit ici qu’aucun de ces deux régimes n’est adapté à la situation que nous rencontrons. »
Il est vrai que les deux régimes partagent beaucoup de points communs : l’état d’urgence, comme l’état de siège, sont déclarés par décret en Conseil des ministres ; ils visent tous les deux à prévenir un « péril imminent » résultant de troubles particulièrement graves pour la sécurité publique ; ils permettent de mettre en œuvre des mesures de police administrative qui seraient illégales en temps ordinaire ; enfin, jusqu’à la loi du 20 novembre 2015 réformant l’état d’urgence, ils organisaient la compétence des juridictions militaires.
L’état de siège a une spécificité : aussitôt décrété, les pouvoirs dont l’autorité civile était investie pour le maintien de l’ordre et la police sont transférés à l’autorité militaire. Sans doute la rigueur supposée de ce régime a-t-elle justifié sa constitutionnalisation dès 1954, alors que celle de l’état d’urgence n’a pas été envisagée pendant soixante ans.
À rebours de cette conception, Roland Drago estimait, dès 1955 (57), que l’état d’urgence était infiniment plus rigoureux que l’état de siège. La comparaison des deux régimes montre, en effet, que la proclamation de l’état d’urgence autorise les autorités administratives à prendre des mesures qui sont interdites en période d’état de siège.
Lorsque l’état de siège est décrété, l’autorité militaire peut :
– faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;
– éloigner toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ;
– ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
– interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à menacer l’ordre public.
En revanche, les autres mesures prévues par l’état d’urgence, en particulier l’interdiction de séjour et les assignations à résidence, ne font pas partie de celles pouvant être mises en œuvre dans le cadre de l’état de siège. Les nouvelles dispositions introduites par la loi du 20 novembre 2015 n’ont fait que creuser un peu plus cet écart (58).
c. État d’urgence et état de nécessité
Outre l’état de siège, deux autres régimes juridiques se caractérisent par une augmentation des prérogatives du pouvoir exécutif qui peut, dans certaines circonstances, restreindre les libertés publiques garanties par la Constitution et les lois ordinaires. Il convient d’examiner comment situer l’état d’urgence par rapport à la théorie des circonstances exceptionnelles, inaugurée par l’arrêt du Conseil d’État Heyriès de 1918, et par rapport aux pleins pouvoirs de l’article 16 de la Constitution que celle-ci a inspiré.
Ces deux régimes se rapprochent de l’état d’urgence par la situation qu’ils entendent prévenir et par certains des moyens qu’ils prévoient. Ils s’en séparent sur un point au moins : les pleins pouvoirs comme la théorie des circonstances exceptionnelles permettent au pouvoir exécutif de déroger à toute la législation établie, alors que dans l’état d’urgence les autorités administratives se voient seulement reconnaître des prérogatives exorbitantes.
À la différence de l’état d’urgence, la décision de recourir à l’article 16 et les actes législatifs pris par le Président de la République pendant sa mise en œuvre ne font l’objet d’aucun contrôle juridictionnel. Dans un arrêt Rubin de Servens de 1962, le Conseil d’État a admis que la décision présidentielle de mettre en œuvre l’article 16 était un acte de gouvernement – c’est-à-dire un acte insusceptible de recours juridictionnel. Il a également souligné qu’il ne pouvait être saisi que de recours contre des mesures relevant du domaine réglementaire. Dès lors, une mesure prise dans le cadre de l’article 16, relevant du domaine législatif, et violant les libertés fondamentales, ne peut être déférée au juge administratif.
Au surplus, l’état d’urgence procède de la loi, qui en organise le régime et en proroge l’application, alors que la théorie des circonstances exceptionnelles est jurisprudentielle.
2. Les exemples étrangers
La plupart des constitutions modernes prévoient, ou tentent de prévoir, les situations pouvant représenter un péril national justifiant un régime juridique d’exception.
Plusieurs pays ont inscrit dans leur Constitution l’état de siège au moins, parfois l’état d’urgence, ou des mécanismes similaires. Les articles 115a à 115l de la loi fondamentale allemande définissent l’ « état de défense », qui permet une dérogation au droit commun en cas d’agression armée en cours ou imminente. Ils autorisent l’élargissement des compétences législatives du Bund (Fédération) et organisent une procédure législative d’urgence. L’article 91 prévoit également la faculté de recourir à l’ « état de crise intérieure », pour écarter un danger menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d’un Land ; ce régime est tenu pour applicable aux cas d’insurrection, de révolution ou de guerre civile (59). L’article 19 de la Constitution du Portugal régit à la fois l’état de siège et l’état d’urgence qui « ne peuvent être déclarés (…) que dans le cas d’agression effective ou imminente par des forces étrangères, de grave menace ou de perturbation de l’ordre constitutionnel démocratique ou de calamité publique » (60). Une gradation est également opérée : l’état d’urgence est réservé aux situations d’une moindre gravité.
Le pouvoir constituant peut organiser le régime d’exception, mais il peut également donner compétence au législateur pour en préciser les modalités d’application. L’article 23 de la Constitution finlandaise dispose ainsi que, « en cas d’agression armée (…) ou en cas de situation exceptionnelle d’une gravité comparable, la loi peut imposer aux droits fondamentaux des restrictions provisoires ». L’article 116, §1, de la Constitution espagnole, dont on sait qu’elle emprunte certains de ses traits au système français, énonce qu’ « une loi organique réglemente les états d’alerte, d’urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes ».
Au Royaume-Uni, en l’absence de Constitution formelle, une loi du 10 décembre 2004 sur les événements civils imprévus (Civil Contingencies Act) permet à l’exécutif de prendre toute mesure adaptée aux circonstances en situation de crise, définie comme une menace sérieuse pour la sécurité du royaume, pour l’environnement ou pour le bien-être public, le cas échéant seulement dans une partie du pays. Ces mesures deviennent caduques si elles ne sont pas approuvées par le Parlement dans les sept jours. Cette loi a abrogé une législation de 1920 sur les pouvoirs exceptionnels, qui ne pouvait être mise en œuvre que dans des circonstances très particulières, ainsi que la loi de 1926 sur les pouvoirs exceptionnels, uniquement appliquée en Irlande du Nord.
D’autres systèmes organisent un cadre souple, en se gardant de trop préciser les situations – forcément imprévisibles – justifiant des mesures exceptionnelles. L’article 77 de la Constitution italienne prévoit ainsi que « dans des cas extraordinaires de nécessité et d’urgence », le Gouvernement puisse recourir sans autorisation aux décrets-lois, équivalents des ordonnances françaises.
Enfin, plutôt que d’organiser le renforcement des pouvoirs des autorités administratives, certaines Constitutions s’attachent, au contraire, à poser des limites irréductibles à l’action des pouvoirs publics : ainsi, l’article 1er de la Section IX de la Constitution américaine prévoit-il que « le privilège de l’habeas corpus ne pourra jamais être suspendu, à moins que le salut public ne l’exige, dans le cas de rébellion ou d’invasion ».
3. Le cadre conventionnel
Le droit international fait sien le principe selon lequel on ne peut gouverner selon les voies ordinaires dans des circonstances exceptionnelles. Trois textes majeurs comprennent des stipulations relatives à l’état d’exception :
– la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, élaborée par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, prévoit, dans son article 15, une « dérogation en cas d’état d’urgence, (…) en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation ». Il est alors possible d’apporter des restrictions aux libertés fondamentales à l’exclusion du droit à la vie, de l’interdiction de la torture et de l’esclavage, et du principe de légalité des peines ;
– le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations-Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, prévoit, dans son article 4, que « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte » sous la stricte condition de ne pas attenter au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et de l’esclavage, à la liberté de pensée et au principe de légalité des peines ;
– la Convention américaine relative aux droits de l’homme, aussi appelée Pacte de San José, adoptée le 22 novembre 1969, comprend un article 27 stipulant la « suspension des garanties (…) en cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l’indépendance ou la sécurité d’un État partie ». Les circonstances exceptionnelles n’autorisent toutefois pas la levée des garanties relatives à la reconnaissance de la personnalité juridique, au droit à la vie et à l’intégrité de la personne, à l’interdiction de l’esclavage, aux principes de légalité et de non-rétroactivité des peines, à la liberté de conscience et de religion, à la protection de la famille, aux droits au nom et à une nationalité, aux droits de l’enfant et aux droits politiques.
Ces trois conventions internationales précisent que les États qui souhaitent mettre en œuvre la stipulation dérogatoire le signalent aux autres parties et au secrétariat général de l’organisation internationale responsable de leur bonne application. La Représentation permanente de la France a ainsi informé le secrétaire général du Conseil de l’Europe, le 26 novembre, de la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Les modalités de proclamation des circonstances exceptionnelles ont été précisées par le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies ainsi que par les cours de Strasbourg et de San José chargées de veiller au respect des conventions continentales européenne et américaine. On peut en déduire quatre principes auxquels doivent se conformer les États qui entendent proclamer l’état d’urgence :
– le principe de légalité impose aux États de prévoir à l’avance le régime juridique des pouvoirs de crise, qui doit être connu au moment de sa proclamation à la population et de sa notification aux organisations internationales ;
– le principe de nécessité limite le recours aux pouvoirs de crise aux situations dans lesquelles les moyens habituels dont disposent les pouvoirs publics sont insuffisants pour la protection de l’ordre public. Le déclenchement de l’état d’urgence suppose donc une menace exceptionnelle dont la disparition provoque au plus tôt la levée ;
– le principe de proportionnalité impose l’adoption de mesures proportionnées aux faits pour restaurer l’ordre public constitutionnel en portant une atteinte minimale aux droits et libertés. Le Gouvernement s’y est conformé, le 14 novembre, en choisissant de proclamer l’état d’urgence au lieu de recourir à l’état de siège ou aux pouvoirs spéciaux de l’article 16 de la Constitution. Par ailleurs, il ne peut être porté atteinte à certains droits fondamentaux – à la vie, à l’intégrité physique, au principe de légalité des peines notamment ;
– le principe de compatibilité avec les autres règles internationales vaut obligation de faire prévaloir la norme de protection des droits et libertés la plus favorable en cas de conflit de normes.
Le régime juridique de l’état d’urgence posé par la loi du 3 avril 1955 se conforme à ce cadre international. Toutefois, les mesures restrictives des libertés qui en découlent ne manqueront pas d’être attentivement examinées par la Cour européenne des droits de l’homme, comme elles le sont par les juridictions nationales saisies au fond.
B. L’INCIDENCE DE LA CONSTITUTIONNALISATION SUR LES LIBERTÉS PUBLIQUES
L’article 1er du projet de loi constitutionnelle ne comporte pas qu’une révision symbolique de la Constitution, qui y inscrirait presque à l’identique des dispositions aujourd’hui prévues par la loi du 3 avril 1955.
La portée juridique du nouvel article 36-1, qu’il est proposé d’insérer, tient principalement dans son deuxième alinéa : « La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements ».
1. La nécessité d’un état d’exception est communément admise
La fréquence des législations du même ordre que la loi du 3 avril 1955 dans les régimes démocratiques conduisait Maurice Hauriou à soutenir « la légitimité des lois de salut public » (61), qu’il fondait sur la notion de légitime défense. Pour incontestable et partagée qu’elle soit, cette conception doit être nuancée car elle comporte des risques d’arbitraire et d’atteintes aux libertés individuelles.
Toute législation de salut public constitue « du droit de seconde qualité », auquel il faut préférer la légalité qui représente un « droit supérieur ». À l’heure d’inscrire le régime de l’état d’urgence dans la Constitution, ces considérations, devenues des notions classiques de philosophie du droit, invitent à limiter dans le temps l’état d’exception et à toujours privilégier une interprétation stricte, selon la maxime « exceptio est strictissimae interpretationis ».
2. Son inscription dans la Constitution n’est pas qu’une condition symbolique
a. La mise en œuvre de l’état d’urgence
i. Les régimes de l’état d’urgence, de l’état de siège et celui des pleins pouvoirs de l’article 16 demeurent distincts
Le présent article insère le nouvel article 36-1 relatif à l’état d’urgence après l’article 36 de la Constitution qui régit l’état de siège. Si ces deux régimes s’apparentent aux « états de crise » mentionnés aux articles 42 et 48 de la Constitution (cf. supra), à aucun moment cette terminologie n’est employée par le projet de loi constitutionnelle. Ainsi, la notion d’ « état de crise » demeure générique.
La commission des Lois a d’ailleurs adopté un amendement de son rapporteur, après l’article premier, afin de remédier à cette imprécision, en prévoyant, aux articles 42 et 48 de la Constitution, un renvoi à ses articles 36 et 36-1.
Il n’est donc envisagé ni de rapprocher ces deux régimes en insérant l’état d’urgence dans l’article 36, comme l’avaient proposé le comité Vedel en 1993 et le comité Balladur en 2007 (62), ni de remplacer l’état de siège par l’état d’urgence. Ils entretiennent une certaine proximité mais leurs fondements constitutionnels sont clairement distingués : l’alinéa 3 de l’article 1er du projet de loi vise expressément les autorités « civiles » pour prendre les mesures de police administrative requises par l’état d’urgence.
Les dispositions insérées prennent place dans le titre V de la Constitution, consacré aux rapports entre le Parlement et le Gouvernement – le même choix a été fait pour l’article 35, dans la mesure où celui-ci requiert également pour la déclaration de guerre une autorisation parlementaire.
Nettement séparé, l’article 16 de la Constitution, qui figure dans le titre Ier relatif au Président de la République, permet au chef de l’État d’exercer des pouvoirs exceptionnels. Cette autre légalité d’exception, conçue pour faire face aux crises les plus graves, n’est d’ailleurs pas exclusive d’un recours à l’état d’urgence, comme le précédent de 1961 l’atteste. Le présent projet ne revient pas sur ce régime, qui a été doté lors de la dernière révision en 2008 (63) d’un garde-fou utile en prévoyant, au bout de trente jours, l’avis du Conseil constitutionnel pour constater si les conditions de mise en œuvre sont toujours réunies.
ii. La procédure de déclaration de l’état d’urgence reprend celle prévue par la loi du 3 avril 1955
L’alinéa 2 du présent article s’inspire de l’article 1er et de la première phrase de l’article 2 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 1960. Entérinant la prééminence de l’exécutif sous la Vème République, cet alinéa prévoit que l’ « état d’urgence est déclaré en conseil des ministres », alors que le législateur de 1955 s’était réservé cette prérogative.
La formulation retenue ne mentionne pas que cette déclaration prend la forme d’un décret, au sens de l’article 13 de la Constitution, c’est-à-dire un décret délibéré en Conseil des ministres, signé par le Président de la République et soumis au contreseing du Premier ministre. Cette imprécision introduit un risque d’a contrario : si la rédaction de l’article 36 prévoit expressément que « l’état de siège est décrété en Conseil des ministres », la procédure de l’état d’urgence pourrait être interprétée comme excluant le recours au décret.
La pratique pourrait également être, s’agissant d’une décision aussi importante que la proclamation de l’état d’urgence, plus respectueuse de la lettre de l’article 13 et mieux garantir le caractère collégial de cette décision, dont le Gouvernement assume ensuite la responsabilité devant l’Assemblée nationale.
La commission des Lois a donc adopté un amendement de son rapporteur visant à remplacer le terme « déclaré » par le terme « décrété ».
iii. Les hypothèses pouvant justifier de recourir à l’état d’urgence sont exprimées en des termes d’acception large
Ce même alinéa 2 reprend, au mot près, les deux hypothèses permettant la mise en œuvre de l’état d’urgence formulées par l’article 1er de la loi du 3 avril 1955. Selon les circonstances dans lesquelles l’état d’urgence est déclaré, le Gouvernement pourra justifier sa décision par l’une ou l’autre.
Les critiques visant l’imprécision de l’expression « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » utilisée en 1955, et jamais modifiée depuis, valent aussi pour le présent projet de loi. Cela confère incontestablement une marge d’appréciation importante au Gouvernement pour engager le régime de l’état d’urgence. Cette formulation a l’avantage, toutefois, d’une certaine plasticité, caractéristique que l’on retrouve dans plusieurs constitutions ou lois étrangères, permettant d’anticiper n’importe quelle situation future.
Quant aux termes de « calamités publiques », on rappellera que figurait dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à valeur constitutionnelle, la notion très voisine de « calamités nationales ».
Le fait d’inscrire ces conditions dans la Constitution aura pour conséquence d’interdire au législateur de les modifier ou d’en étendre la liste. Il faut, à cet égard, observer que les hypothèses dans lesquelles l’état de siège peut être mis en œuvre ne sont pas, elles, déterminées par l’article 36 de la Constitution, mais par une simple disposition législative (64).
Par souci de parallélisme entre le régime de l’état d’urgence et celui de l’état de siège, la commission des Lois a adopté un amendement de MM. Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret, après l’article premier du projet de loi, inscrivant à l’article 36 de la Constitution les hypothèses de mise en œuvre du second de ces états de crise, à savoir « un péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée ».
b. La durée de l’état d’urgence
i. La durée totale de l’état d’urgence n’est pas limitée
Conformément à la pratique de la loi du 3 avril 1955, le nouvel article 36-1 ne prévoit aucune limite de durée globale de l’état d’urgence. La rédaction quelque peu ambiguë de l’article 3 de cette loi, qui prévoyait que la loi de prorogation de l’état d’urgence « fixe sa durée définitive », est d’ailleurs abandonnée par l’alinéa 4 de l’article 1er du projet de loi constitutionnelle.
Le nombre de prorogations n’est pas plafonné, pas plus que la durée de chacune d’entre elles. Il reviendrait donc au Parlement, seul compétent pour proroger l’état d’urgence, d’en déterminer au cas par cas l’opportunité et la durée. Il y aurait, sur ce point, une totale continuité entre le droit existant et le droit proposé.
Les dispositions figurant à l’article 4 de la loi du 3 avril 1955, qui prévoient la caducité de l’état d’urgence à la suite de la démission du Gouvernement ou de la dissolution de l’Assemblée nationale, ne sont pas reprises dans le projet de loi constitutionnelle, où elles auraient a priori leur place. Ces limites cadrent mal avec les équilibres institutionnels de la Vème République : il est désormais plus aisé aux députés de mettre fin à l’état d’urgence, par l’adoption d’un texte ad hoc à la majorité simple, que de voter la censure du Gouvernement. Quant à la dissolution, elle devrait être envisagée moins comme une cause de caducité, que comme une limite posée à la mise en œuvre de l’état d’urgence.
La commission des Lois a adopté un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs de ses collègues interdisant de dissoudre l’Assemblée nationale tant qu’est mis en œuvre l’état d’urgence.
ii. Le Parlement autorise la prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours
L’alinéa 4 du présent article reprend la limite des douze jours durant lesquels l’état d’urgence déclenché par décret en Conseil des ministres échappe à l’autorisation parlementaire. C’est également cette limite qui s’applique à l’état de siège, conformément à l’article 36 de la Constitution.
Sauf à transformer la logique du régime de l’état d’urgence, du moins tel qu’il est organisé depuis 1960, et à confier au Parlement la compétence pour le déclencher, il paraît difficile de réduire significativement ce délai. La prorogation effective suppose, en effet, de franchir toutes les étapes de la procédure législative – examen de l’avant-projet de loi par le Conseil d’État, adoption du texte en Conseil des ministres, une lecture au moins dans chaque assemblée, éventuellement examen de sa constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, puis promulgation, publication et entrée en vigueur.
À l’inverse, certains suggèrent d’augmenter ce délai, afin de donner plus de temps au Parlement pour apprécier l’opportunité de proroger l’état d’urgence.
Il pourrait également être envisagé de distinguer la loi de prorogation proprement dite, débattue sans retard, et les modifications de celle qui fixe le régime de l’état d’urgence, qui seraient alors assujetties à des formes particulières ou des délais minimums.
iii. Le projet ne prévoit pas de modalités particulières de sortie de l’état d’urgence
L’avant-projet de loi constitutionnelle prévoyait un dispositif de sortie progressive de l’état d’urgence, reconnaissant un stade intermédiaire entre l’état d’urgence à proprement parler et la légalité normale. Celui-ci devait permettre de prolonger certaines mesures (les assignations à résidence, notamment) jusqu’à six mois après la fin de l’état d’urgence. Le Gouvernement s’est finalement rangé à l’avis du Conseil d’État qui a disjoint ces dispositions, les jugeant inutilement complexes.
Dans ces conditions, comme le prévoit expressément l’article 14 de la loi du 3 avril 1955, les mesures administratives décidées au titre de l’état d’urgence s’interrompront toutes en même temps que lui.
c. Les mesures pouvant être prises pendant l’état d’urgence
i. Les modalités d’application seront déterminées par une loi ordinaire
L’alinéa 3 du présent article renvoie à une loi ordinaire la fixation des mesures de police que l’autorité administrative peut prendre dans le cadre de l’état d’urgence. Il organise, sur ce point, un strict parallélisme avec l’état de siège, de facto régi par des dispositions législatives ordinaires (65), mais se montre plus précis que l’article 36 de la Constitution qui ne dit rien des modalités de son application.
Le choix de recourir à une loi organique, plutôt qu’à une loi ordinaire, pourrait être motivé par le souci de garantir un contrôle préalable par le Conseil constitutionnel de l’ensemble des dispositions d’application de l’état d’urgence, plutôt que des décisions successives au gré de questions prioritaires de constitutionnalité. Il mettrait également le régime de l’état d’urgence à l’abri de modifications improvisées, dans l’urgence des débats sur une prorogation. Rien n’empêche, en effet, une loi de prorogation de revenir sur la loi ordinaire d’application de l’article 36-1 afin de modifier, « à chaud », les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre.
ii. La déclaration et la prorogation de l’état d’urgence ne sont pas finalisées
La question du lien qui doit exister entre une mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence et les motifs qui ont conduit à déclarer ce dernier a été soulevée à l’occasion de la décision du Conseil d’État du 11 décembre 2015 comme de celle du Conseil constitutionnel du 22 décembre.
La première décision a mis en évidence que la lettre de la loi du 3 avril 1955, y compris après les modifications opérées par la loi du 20 novembre 2015, autorisait l’administration à prendre une mesure sans lien direct avec la raison pour laquelle l’état d’urgence a été déclaré (par exemple une assignation à résidence pendant la durée de la COP 21), c’est-à-dire la prévention de nouveaux attentats terroristes après ceux du 13 novembre : compte tenu du « péril imminent » ou de la « calamité publique », une « menace pour la sécurité et l’ordre publics » est un motif suffisant.
La seconde décision constate également que le législateur n’a pas imposé au pouvoir de police de ne prendre que des mesures en lien direct avec les motifs de l’état d’urgence et juge que, ce faisant, il n’a pas violé la Constitution.
L’alinéa 3 de l’article 1er du projet de loi renvoie à une loi d’application le soin de fixer les mesures que les autorités administratives peuvent prendre « pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements ». Si l’on souhaite que les mesures de police soient en lien direct avec les motifs précis pour lesquels l’état d’urgence a été décrété, il conviendrait de le prévoir dans la Constitution.
iii. Le contrôle parlementaire de l’état d’urgence n’est pas organisé par le nouvel article 36-1
Le présent article ne reprend pas les dispositions récemment insérées à l’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955, qui organisent un contrôle et une évaluation parlementaire de l’état d’urgence. Ces dispositions traduisaient celles de l’article 24 de la Constitution : « Le Parlement (…) contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. »
L’enjeu consiste moins à contraindre l’Assemblée nationale et le Sénat à mettre en place un suivi de l’état d’urgence qu’à leur assurer les moyens de conduire ce contrôle.
Dans cette logique, la commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que le Parlement se réunisse de plein droit pendant la durée de l’état d’urgence.
Elle a également adopté un amendement de Mme Marie-Françoise Bechtel renvoyant à la loi le soin de préciser les modalités du contrôle parlementaire de la mise en œuvre de l’état d’urgence.
3. La loi d’application du nouvel article 36-1 devra opérer une conciliation délicate entre les impératifs de la préservation de l’ordre public et les libertés publiques
L’alinéa 3 du présent article renvoie à une loi le soin de déterminer « les mesures de police administrative », par conséquent à visée préventive, que les autorités pourront prendre dans le cadre de l’état d’urgence.
a. En dépit de plusieurs modernisations, la loi du 3 avril 1955 est devenue inadaptée
Les mesures prévues par l’actuelle loi du 3 avril 1955 sont « limitées par l’absence de fondement constitutionnel de l’état d’urgence », comme le souligne l’exposé des motifs du présent projet de loi. Même si le Conseil constitutionnel a validé les principales dispositions relatives aux assignations à résidence, des interrogations perdurent s’agissant du régime de la surveillance électronique des personnes assignées à résidence ou des perquisitions administratives (notion de lieux, délai de conservation des données enregistrées, communication des ordres de perquisition…).
Faute d’ancrage constitutionnel adéquat, il est surtout impossible de « compléter les moyens d’action des forces de sécurité » pendant l’état d’urgence. Plusieurs nouvelles mesures pourraient ainsi être proposées dans le cadre d’un projet de loi d’application de l’article 36-1 :
– le contrôle d’identité, la fouille de bagages sans nécessité de justifier de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public (66), et la visite des véhicules ;
– la retenue administrative, sans autorisation préalable du juge de la liberté et de la détention, des personnes présentes dans les locaux faisant l’objet d’une perquisition administrative ;
– la saisie administrative d’objets, et notamment d’ordinateurs ou de téléphones, durant les perquisitions administratives, puisque la loi du 3 avril 1955 n’a prévu, outre la remise des armes, que l’accès aux données informatiques et leur copie ;
– ou l’escorte jusqu’au lieu d’assignation à résidence.
b. L’efficacité pratique des mesures ordonnées dans ce cadre a été débattue
La commission des Lois de l’Assemblée nationale poursuit encore les travaux de contrôle qu’elle a entamés le 2 décembre dernier, sur le double fondement de l’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 et de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (67).
Au 12 janvier, le Gouvernement avait procédé à 3 239 perquisitions administratives et 381 assignations à résidence (68). Ces mesures, les plus nombreuses, ont suscité à la fois beaucoup d’attente et d’émotions :
– d’un côté, ces pouvoirs exceptionnels conférés aux forces de sécurité de pénétrer dans des lieux privés sur le seul fondement de soupçons d’un comportement dangereux pour l’ordre et la sécurité publics constituent un outil majeur face à la menace terroriste ;
– d’un autre côté, beaucoup de nos concitoyens et d’associations se sont émus de ces interventions parfois spectaculaires, souvent nocturnes, suscitant des questions sur les personnes concernées ou sur l’attitude et l’objectif des services de sécurité.
L’efficacité de ces perquisitions administratives a également été questionnée, au regard du nombre modeste d’armes de guerre saisies et de la faible proportion de poursuites judiciaires engagées. Quant au recueil de renseignements permis par ces opérations, il est par nature difficilement quantifiable.
Enfin, des difficultés opérationnelles ont pu être relevées : durée excessive des perquisitions (jusqu’à douze heures) induite par la lenteur du processus d’enregistrement des données informatiques, défaillances de l’indemnisation des éventuels dégâts causés par les opérations, abrogations d’assignations injustifiées…
c. Cette loi d’application devra également consolider l’office du juge administratif des référés
Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis sur l’avant-projet de loi constitutionnelle, les mesures prises sur le fondement du nouvel article 36-1 de la Constitution seraient contrôlées exclusivement par les juridictions administratives. Il n’a donc pas jugé nécessaire de mentionner ce contrôle du juge administratif dans le texte de l’article 36-1.
L’article 66 de la Constitution dispose que le juge judiciaire est le garant de la liberté individuelle. C’est pourquoi, il a pu être imaginé de préserver la compétence du juge judiciaire pour éviter les risques d’atteintes aux droits et libertés fondamentaux inhérents à l’état d’urgence : par exemple, en lui confiant le contrôle des mesures restrictives de la liberté d’aller et venir excédant 12 heures par jour (c’est-à-dire les interdictions de circulation, de séjour, mais pas les assignations à résidence) et le contentieux des perquisitions administratives.
Toutefois, depuis qu’il dispose de pouvoirs importants en matière de référé, encore renforcés par la décision du 11 décembre dernier, le juge administratif est en mesure d’assurer un contrôle réel de ces mesures alors que ce n’était pas le cas autrefois. La présomption d’urgence théorisée par le Conseil d’État, en matière d’assignation à résidence, pourrait être étendue par la loi à l’ensemble du contentieux sur des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.
Afin d’expliciter les modalités de ce contrôle, la commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur précisant que les mesures de police administrative prises par les autorités pendant l’état d’urgence étaient placées « sous le contrôle du juge administratif ».
*
* *
La Commission examine l’amendement CL5 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er. Je ne reviens pas sur les considérations générales, mais sur la nécessité ou non de constitutionnaliser l’état d’urgence alors même que celui-ci s’applique toujours. Je tiens à souligner cette contradiction.
J’ai été membre d’un groupe de travail sur l’avenir des institutions, qui a travaillé dans cette même salle pendant huit mois et débattu de tous les sujets, y compris les plus anecdotiques. En dépit des nombreuses réformes institutionnelles que nous avons envisagées, jamais cette question de la constitutionnalisation de l’état d’urgence n’a été soulevée par l’un quelconque des participants. À Mme Untermaier qui siégeait avec moi dans ce groupe de travail, je tiens à dire qu’il s’agit sans doute moins de réactivité que d’opportunité. Il fallait relayer par une révision constitutionnelle un effet d’annonce et donner corps à la volonté d’apporter une réponse à une situation de grand drame.
Dans sa décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel estime – c’est le considérant n° 8 – que « la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence ». Les termes sont pesés. Il en ressort qu’il est tout à fait possible que les dispositions existent sous forme législative. C’est le sens de la loi de 1955 que nous avons révisée. Je ne reviens pas sur le manque de garanties, qui a motivé certains amendements dont j’ai pris note.
Je suis attachée à une précision très importante : les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence doivent avoir un lien direct avec les événements ou le péril imminent invoqué. Le bilan de la mise en œuvre de l’état d’urgence révèle en effet de nombreux abus, en particulier des assignations à résidence justifiées par la COP21, ou des interdictions de déplacements de supporters de football.
Il est absolument nécessaire d’encadrer le dispositif pour exclure les mesures extrêmement dérogatoires – contrôles d’identité, visites de véhicule avec ouverture de coffre ou saisies administratives – sans lien direct avec les événements qui motivent la déclaration d’état d’urgence. À cet égard, la constitutionnalisation ne me semble pas être une garantie mais, au contraire, la porte ouverte à des mesures qui seraient en rupture, durablement, avec l’État de droit.
En outre, il est indispensable de maintenir la compétence du juge judiciaire. La loi de 1955 a été modifiée en novembre 2015 dans la précipitation que chacun connaît. Son vote conforme a été obtenu, dans une logique politique de surenchère, au prix d’une extension des modalités d’assignation à résidence – douze heures de présence à domicile, trois pointages quotidiens dans des commissariats parfois très éloignés – qui les rendent impossibles à vivre par les personnes concernées, à tel point que certaines assignations ont été levées par le ministre de l’Intérieur à la veille des audiences où leur validité devait être examinée !
Pour toutes ces raisons et à cause de l’inutilité de cette inscription dans la Constitution, je défends cet amendement de suppression de l’article 1er.
M. Dominique Raimbourg, rapporteur. Mon avis est défavorable.
La constitutionnalisation de l’état d’urgence a été envisagée par deux comités de réflexion sur la réforme de la Constitution : le comité Vedel en 1993, le comité Balladur en 2008. Les juristes comme les hommes et les femmes politiques qui les composaient s’étaient inquiétés du défaut d’encadrement constitutionnel de cet état qui sort du commun.
Le juge judiciaire exerce incidemment un contrôle. Les mesures prises ayant pour but de poursuivre ceux qui sont convaincus de participer à une entreprise terroriste, la judiciarisation intervient nécessairement à un moment donné. En outre, les mesures de police administrative sont soumises au contrôle du juge administratif.
Votre présentation, madame la députée, démontre d’une certaine façon l’efficacité du dispositif : certaines assignations ont été levées, la veille de l’audience, par crainte du juge. C’est donc que le contrôle fonctionne. On peut regretter que les mesures d’assignation aient été mises en place, mais le contrôle du juge administratif est bel et bien effectif. Il ne me semble pas opportun de modifier la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif.
M. Patrick Mennucci. Nous ne pourrons pas voter cet amendement, qui est contraire à ce que nous souhaitons faire. La constitutionnalisation améliore la protection des libertés. Comme les amendements du rapporteur le préciseront, elle permet le contrôle du juge et le contrôle du Parlement – qui doit nous mobiliser particulièrement, et qui ne serait pas possible si l’article devait être supprimé.
M. Patrick Devedjian. Je suis d’accord, et ce pour quatre raisons, avec l’amendement que M. Poisson n’a pu venir défendre ici, et qui vise, tout comme celui de Mme Duflot, à supprimer l’article.
Première raison : le régime de l’état d’urgence permet de prendre des mesures sans lien avec les événements qui l’ont motivé. Les exemples récents l’ont montré.
Deuxième raison : l’état d’urgence peut être instauré pendant douze jours par le seul Conseil des ministres, sans intervention du Parlement. En douze jours, on peut faire beaucoup de choses pour attenter aux libertés – je ne soupçonne pas ce gouvernement, ni les précédents, d’être animé de telles intentions, mais un autre gouvernement pourrait parfaitement le faire.
Troisième raison : le juge judiciaire a été écarté, alors qu’il est le gardien naturel des libertés, ce qui est assez grave au regard du fonctionnement même de la Constitution.
Quatrième raison, enfin : le Président de la République a considéré que nous étions en « état de guerre » ; or, l’article 89 de la Constitution ne permet pas de la modifier dans une telle situation.
M. Jean-Christophe Lagarde. D’aucuns nous disent qu’il ne serait pas nécessaire d’intégrer les dispositions relatives à l’état d’urgence dans la Constitution ; je pense au contraire que c’est nécessaire. Si l’état d’urgence existe aujourd’hui dans notre droit, s’il y a été recouru à plusieurs reprises, il n’est pas certain, étant donné la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a introduit la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), que la mise en œuvre de cette disposition, antérieure à la Constitution de 1958, soit acceptée par le Conseil constitutionnel dans tous les domaines possibles de son application.
Notre devoir de constituant est d’encadrer, au nom de la défense des libertés publiques, en l’intégrant dans la Constitution, cette mesure exceptionnelle qui, on me pardonnera de le dire, n’a pas été envisagée par le constituant de 1958, ni par aucun autre depuis. C’est ce que fait le présent article, celui-là même qui justifie la révision constitutionnelle – ce dont je ne suis pas certain pour l’autre article du projet, même si je comprends sa portée symbolique, voulue par l’exécutif. L’article 1er doit être un rempart de protection pour les Français, en ce qu’il permettra de réagir à toutes les situations, tout en évitant que l’état d’urgence puisse être dévoyé.
Ne légiférons pas en fonction de la majorité du moment : nous ignorons qui les Français porteront demain à la tête de l’État. S’ils devaient choisir une dérive autoritaire, démagogique – ou pire encore –, la seule protection qui demeurerait serait la Constitution. C’est particulièrement vrai dans le cas où l’état d’urgence serait déclaré, car, comme vient de le dire Patrick Devedjian, en douze jours on peut déjà faire beaucoup de mal à la démocratie, et on pourrait, en le prolongeant, mettre à mal toute opposition qui voudrait s’exprimer. Nous avons la responsabilité de l’empêcher.
M. Philippe Houillon. Nous abordons une question assez générale, et il serait bon que le rapporteur ou le ministre de la Justice nous apporte une réponse claire, puisque le Président de la République et le Premier ministre ont considéré publiquement, à plusieurs reprises, que la France était en « état de guerre ».
La première phrase de l’exposé des motifs du projet de loi fait, à juste titre, référence aux lâches attentats que nous avons connus. Or, l’article 89 de la Constitution interdit l’engagement ou la poursuite d’une révision constitutionnelle « lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire », et l’article 412-1 du code pénal définit l’attentat comme un acte portant atteinte à l’intégrité du territoire. Nous sommes donc, en termes de calendrier, confrontés à un problème de recevabilité : si nous sommes en état de guerre, l’article 89 de la Constitution s’applique, ce qui n’est manifestement pas l’avis du Gouvernement, car dans le cas contraire il n’aurait pas engagé une révision constitutionnelle. L’exécutif doit donc lever l’ambiguïté résultant de la combinaison des dispositions des articles 89 de la Constitution et 412-1 du code pénal alors même que sont commis des attentats portant atteinte à l’intégrité du territoire.
Mme Sandrine Mazetier. Je souscris aux propos de Jean-Christophe Lagarde quant à la nécessité d’encadrer les conditions de déclenchement du régime exceptionnel que constitue l’état d’urgence. Jusqu’à présent, chaque fois que l’état d’urgence a été déclaré, c’était sous le régime d’une loi antérieure à la Constitution de 1958, laquelle ne l’a pas abrogée. Je pose donc la question au rapporteur : faudra-t-il considérer, au terme de la présente révision constitutionnelle, que la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui prévoit notamment que les tribunaux militaires se substituent aux juges judiciaire et administratif – je le rappelle à l’intention de nos collègues qui, légitimement, soutiennent l’intervention du juge des libertés et de la détention – se trouve abrogée ipso facto et que ses dispositions ne sont plus applicables en situation d’état d’urgence, ou faudra-t-il l’abroger explicitement ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Il convient d’évacuer le faux débat portant sur l’article 89 de la Constitution : nous ne sommes pas dans ce contexte, il suffit pour s’en rendre compte de se référer aux travaux préparatoires de la Constitution de 1958 et à ceux du comité Vedel – dans lesquels je me suis plongée. La notion d’atteinte à l’intégrité du territoire vise l’invasion de celui-ci, pour des raisons historiques que chacun peut deviner. Sur le plan juridique, l’argument voulant que la situation actuelle interdise la révision de la Constitution est donc de peu de portée.
M. le rapporteur. Je partage l’argumentation de Mme Bechtel au sujet de l’article 89 de la Constitution, et je répondrai à Mme Mazetier que, le cas échéant, il conviendra d’abroger la loi du 3 avril 1955.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL38 de M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. La notion d’état de nécessité est bien connue du droit public général. On entend par là des circonstances urgentes et imprévues qui rendent indispensable, pour la sauvegarde de l’État, la concentration des pouvoirs, laissée à la seule décision de l’organe appelé à en bénéficier. J’invite les uns et les autres à relire la thèse de Mme Geneviève Camus, L’état de nécessité en démocratie, qui précise cette notion, bien supérieure à mon avis, sémantiquement parlant, à celle d’état d’urgence, car elle correspond parfaitement à la période exceptionnelle qui frappe la Nation.
M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable. Plusieurs constitutions étrangères emploient le terme de nécessité, mais celui-ci, en droit international, renvoie plutôt à une situation de danger pour l’existence de l’État, sa survie politique ou économique, ce qui est tout autre chose. Par ailleurs, la nécessité est invoquée, en droit pénal, comme excuse ou justification de la commission d’un délit.
La Commission rejette l’amendement.
Elle étudie ensuite l’amendement CL68 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit également d’une question de vocabulaire : je propose de substituer au mot « déclaré » le mot « décrété ».
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Toutes les lois successives qui ont remanié la loi du 3 avril 1955 ont utilisé le terme « déclaré », précisant au besoin « déclaré par décret ». La déclaration est un acte, le décret en est le véhicule. Je ne vois donc pas pourquoi nous changerions cette dénomination constamment retenue par le Législateur.
M. le rapporteur. La loi du 3 avril 1955 comporte effectivement les mots « déclaré par décret », mais il n’y a pas ici de renvoi au décret.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Dans sa version originelle, la loi de 1955 dispose que l’état d’urgence est « déclaré », puis un autre article précise que cette déclaration est le fait d’un décret. Je pense que vous disposez de la version du texte consolidé, mais le terme « déclaré » figure bien dans toutes les versions successives.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. J’observe que, aux termes de l’article 36 de la Constitution, l’état de siège est « décrété ».
M. Patrick Mennucci. Nous considérons que la position du rapporteur est la bonne.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement CL47 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Le danger auquel nous sommes exposés aujourd’hui est latent plutôt qu’« imminent » – terme retenu par le présent projet, à l’instar de la loi du 3 avril 1955, et qui désigne ce qui va se produire dans très peu de temps. C’est pourquoi je préfère écrire « péril majeur », afin de mieux correspondre à un péril qui se prolonge dans le temps – même s’il n’y a pas lieu d’apporter cette précision dans la Constitution. L’adjectif « imminent » risquerait de nous enfermer dans des limites excessives au regard des nécessités de la sécurité publique.
M. le rapporteur. La rédaction proposée par le Gouvernement fait état d’un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ». Les deux éléments sont donc présents : des attentats, mais aussi l’éventualité de leur réitération. Je suis donc défavorable à l’amendement.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Cette rédaction est « à côté de la plaque », car elle signifie que les troubles se sont déjà produits, puisque le péril en résulte. Or, dans la situation actuelle, il n’y a pas eu de troubles à proprement parler depuis le 13 novembre.
M. Alain Tourret. Viser un péril « imminent » signifie que celui-ci n’est qu’une éventualité. Faut-il déclencher l’état d’urgence pour une éventualité ?
Mme Cécile Duflot. Je remercie le président Schwartzenberg, car il vient de démontrer indirectement la nécessité de mettre un terme à l’état d’urgence tel qu’il est appliqué aujourd’hui ! L’expression « péril majeur » peut conduire à prolonger indéfiniment l’état d’urgence, et nous ne pouvons envisager de rester sous le coup d’un état d’exception permanent ; c’est pourquoi nous préférons, à tout prendre, le terme « imminent ».
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je ne partage pas la façon dont M. Schwartzenberg lit le texte : si le péril est caractérisé comme « résultant d’atteintes graves à l’ordre public », cela signifie que ces atteintes sont potentiellement graves même si elles ne sont pas produites à ce stade.
M. Guillaume Larrivé. Hier, le juge des référés du Conseil d’État a rendu une décision dans laquelle il considère que le péril imminent justifiant l’état d’urgence n’a pas aujourd’hui disparu, compte tenu du maintien de la menace terroriste et du risque d’attentats. Cette conception assez large du péril imminent dans la situation actuelle me semble infirmer le raisonnement de notre collègue Schwartzenberg.
M. Jean-Christophe Lagarde. Le débat ouvert par l’amendement de M. Schwartzenberg montre que nous courons un risque de sanction de la part du Conseil constitutionnel si nous conservons la qualification de péril imminent. Le Conseil est théoriquement constitué de neuf sages, mais j’observe qu’il est de plus en plus constitué d’anciens responsables politiques plutôt que de juristes, ce que je déplore, ainsi que d’anciens chefs de l’État, ce qui ne devrait plus être. Il faut – et je ne fais pas allusion, en disant cela, à des nominations à venir – que le peuple français puisse avoir confiance dans les décisions rendues par cet organe, et je proposerai, dans un autre contexte, un amendement à ce sujet.
La question n’est pas neutre, car le Conseil constitutionnel, qui a parfois tendance, de par sa composition, à juger en opportunité politique, pourrait estimer que l’imminence d’un péril est insuffisamment établie. Je pense que le terme « majeur » permettrait d’éviter cet écueil. Le Conseil constitutionnel pourrait statuer soit ab initio, sur recours contre la loi prolongeant l’état d’urgence, soit à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas, redouté par Mme Duflot, d’une prorogation intempestive. C’est pourquoi il me paraît nécessaire de prévoir que le Parlement se prononce à intervalles réguliers sur cette prorogation.
M. Patrick Mennucci. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen défend le terme « imminent », car il renvoie directement à la notion d’urgence.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL24 de M. Alain Tourret et CL69 du rapporteur.
M. Alain Tourret. L’expression de « calamité publique », qui ne figure dans aucun texte juridique, s’applique pour l’essentiel à des événements naturels exceptionnels, tels qu’un tremblement de terre, une chute de météorite, un tsunami ou un réchauffement incontrôlé de la planète. Je propose de lui substituer celle d’« évènement dommageable d’une exceptionnelle gravité », qui permettrait de mieux appréhender les conditions de recours à l’état d’urgence.
M. le rapporteur. Je suis sensible à votre argumentation, et c’est pourquoi je vous propose de vous rallier à mon amendement CL69, qui tend à remplacer l’expression « calamité publique » par l’expression « calamité nationale ». Cela permettrait de ne pas centrer la définition sur les événements climatiques…
M. Alain Tourret. Je ne suis pas de cet avis : publique ou nationale, une « calamité » s’entend comme un phénomène naturel. La notion d’exceptionnelle gravité me semble couvrir davantage de situations.
M. François de Rugy. Nous sommes plusieurs députés écologistes à soutenir cet article : pour le cadre constitutionnel qu’il confère à l’état d’urgence, mais aussi pour la référence faite à des « événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique », formule assez générale qui permet d’englober des situations très diverses. Celles-ci peuvent résulter de catastrophes – naturelles ou non – ou d’évènements climatiques exceptionnels pouvant toucher des installations industrielles, chimiques, voire nucléaires. N’oublions pas que la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde, a failli être inondée lors de la tempête du mois de décembre 1999 !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. J’en déduis que vous êtes défavorable à l’amendement CL24…
M. Jean-Christophe Lagarde. J’inviterai nos collègues à ne pas voter les amendements proposés. Je conçois que la « calamité publique » soit insuffisamment définie, mais la « calamité nationale » risque d’être entendue comme concernant obligatoirement l’ensemble du territoire. Or, l’exemple que vient de donner M. de Rugy montre bien qu’un évènement exceptionnel très localisé peut justifier la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Le constituant que nous sommes doit avoir pleine conscience que le Conseil constitutionnel exerce son office à un double niveau depuis qu’a été instituée la question prioritaire de constitutionnalité, par laquelle le citoyen peut contester une loi en vigueur. C’est une nouveauté à laquelle nous ne sommes pas encore habitués, et retenir la notion de « calamité nationale » sans définir suffisamment les événements susceptibles de la provoquer comporte un risque.
M. le rapporteur. J’entends l’argumentation de M. Lagarde, et je suis prêt à retirer mon amendement si M. Tourret fait de même, afin de préparer une nouvelle rédaction pour la séance publique.
Les amendements sont retirés.
La Commission examine l’amendement CL17 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. Cet amendement prévoit que les mesures susceptibles d’être prises dans le cadre de l’état d’urgence font l’objet d’une loi organique, qu’elles doivent avoir un lien direct avec les événements ayant provoqué le recours à l’état d’urgence, et que la compétence du juge judiciaire est maintenue.
Si je juge inutile l’introduction de l’état d’urgence dans la Constitution, je ne me suis pas opposée, en novembre, à sa prolongation. Les mesures prises dans ce cadre peuvent être utiles, mais doivent être très limitées dans le temps et entourées d’un certain nombre de garanties. Les recours formés devant le Conseil d’État ont fait l’objet de certaines décisions contre lesquelles le texte soumis à notre examen ne permet pas d’aller. En tout état de cause, il est inenvisageable de recourir à l’état d’urgence à titre préventif.
La justification de certaines assignations à résidence, celles de militants écologistes en particulier, se fondait sur l’hypothèse que, si les intéressés déclenchaient des actions ou des manifestations, ils mobiliseraient des forces de l’ordre qui seraient alors détournées de leurs missions initiales. Cette pratique ouvre un champ immense au recours à l’assignation à résidence, susceptible par exemple de concerner d’anciens malfaiteurs risquant de commettre de nouveaux délits alors que la force publique serait concentrée ailleurs. Dans ces conditions, limiter strictement une telle mesure aux motifs ayant justifié le recours à l’état d’urgence me semble indispensable.
M. le rapporteur. J’invite Mme Duflot à retirer cet amendement au profit de son amendement CL11 qui suit, et qui se limite à conférer le caractère de loi organique à la loi détaillant les mesures susceptibles d’être autorisées dans le cadre de l’état d’urgence. L’intérêt est qu’elle sera automatiquement examinée par le Conseil constitutionnel ; l’inconvénient éventuel est que, si nous ne prenons pas la précaution de l’actualiser régulièrement, nous risquons de voir notre tâche compliquée en cas de situation grave et urgente. Ainsi, au mois de novembre dernier, nous avons dû ajouter les saisies de matériel informatique aux dispositions de la loi du 3 avril 1955 ; cela nous a été facile, car il s’agissait d’une loi simple, mais cela l’aurait moins été s’il avait fallu prendre le temps d’attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. La défense des libertés me paraît toutefois justifier cette précaution.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Madame Duflot, compte tenu de la suggestion du rapporteur, dois-je considérer que votre amendement CL11 est défendu ?
Mme Cécile Duflot. Oui, ainsi que l’amendement CL18, qui est également de repli et prévoit que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence devront avoir un lien direct avec les événements ou le péril imminent. Je souhaite d’ailleurs entendre la réponse du rapporteur sur ce point, ainsi que sur le rôle dévolu à l’autorité judiciaire – je déduis cependant de son amendement CL70 que sa position est différente de la mienne. Je suis heureuse, en revanche, de constater qu’il partage mon analyse quant à la nécessité d’une loi organique.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je comprends très bien qu’il y ait un désir de passer par une loi organique ; j’appelle simplement l’attention de chacun sur le fait que cela revient, une fois de plus, à mettre le Parlement sous contrôle. Il n’est pas normal que les parlementaires s’autocritiquent, s’autosacrifient, s’autocensurent en pensant que le Conseil constitutionnel, autorité vénérable et appréciée, a une appréciation plus saine qu’eux de la situation. Je pense que c’est le contraire : neuf membres nommés et quelques anciens Présidents de la République n’ont pas nécessairement une vision très complète de ce qui peut se passer sur le terrain ; le ministre de l’Intérieur oui, le Parlement peut-être.
Deuxième point : la loi organique, comme vous le savez, monsieur le rapporteur, monsieur le Président, suppose une condition spéciale de majorité s’il y a désaccord entre les deux assemblées.
Comme il n’est pas absolument indispensable de ligoter le Parlement ou le Gouvernement, nous pourrions sans doute renoncer à l’amendement CL17, généreux dans son esprit mais contraignant sur le fond.
M. Jean-Christophe Lagarde. Je suis pour ma part favorable à l’amendement CL11 : il me paraît intéressant de prévoir le recours à une loi organique. Par définition, l’état d’urgence a un caractère exceptionnel. Par définition, il répond à une situation exceptionnelle. La loi organique offre à cet égard un double avantage.
D’une part, elle apporte une protection supplémentaire : elle requiert pour être adoptée, en cas de désaccord entre les deux chambres, la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale ; si celle-ci ne peut être réunie pour proroger l’état d’urgence, c’est que celui-ci est discutable.
D’autre part, les mesures privatives de liberté méritent d’être placées sous le contrôle des parlementaires que nous sommes, mais aussi sous celui du Conseil constitutionnel, qui veille à leur constitutionnalité.
En revanche, les autres précisions introduites par les amendements CL17 et CL18 me semblent inutiles.
M. Guillaume Larrivé. Je ne suis pas favorable à ce que le constituant que nous sommes aujourd’hui lie définitivement les mains du législateur de demain en prévoyant qu’une loi organique s’impose pour régir l’état d’urgence.
Rappelons que le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, dans sa rédaction issue de l’excellente révision constitutionnelle résultant de l’initiative prise par le président Giscard d’Estaing en 1974, donne au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu’à soixante députés et à soixante sénateurs la faculté de saisir le Conseil constitutionnel de toute loi avant sa promulgation.
Sortant du théâtre d’ombres, nous pourrions rappeler que le président Hollande, le président Bartolone, le président Larcher ou nous-mêmes, parlementaires, aurions pu saisir le Conseil constitutionnel en novembre dernier de la loi relative à la prorogation de l’état d’urgence. Certains d’entre nous l’avaient alors souligné, notamment Philippe Bas au Sénat.
Nous sommes en train de légiférer pour l’avenir et non pas seulement pour sortir aujourd’hui de ce débat. Il est de notre responsabilité de constituant de permettre une adaptation de la loi aux troubles futurs. Restons souples. Laissons au législateur la possibilité de faire ce qu’il a à faire et laissons ceux qui en ont la faculté décider de saisir le Conseil constitutionnel s’ils le jugent nécessaire.
Je ne voterai donc aucun des amendements de Mme Duflot.
M. Denis Baupin. J’irai dans le même sens que M. le Rapporteur. La loi organique offre des protections supplémentaires. La modification constitutionnelle à laquelle nous procédons doit être durable et valoir dans une configuration politique qui serait très différente de celle d’aujourd’hui. Il faut pouvoir éviter que des mesures privatives de liberté contraires à l’intérêt national ne soient adoptées. En posant une condition de majorité absolue, la loi organique tend à éviter semblable situation.
M. Patrick Mennucci. Le débat fait son chemin. Après réflexion, nous ne sommes pas favorables à l’introduction d’une loi organique. Beaucoup de députés auront été sensibles, me semble-t-il, aux arguments de M. Schwartzenberg. Certes, des protections sont nécessaires, chacun le comprend, mais il ne faut pas brider l’agilité de gouvernements futurs dans des situations dont nous ne pouvons pas, par définition, connaître la gravité.
M. François de Rugy. Je ne suis pas favorable non plus à une loi organique. Elle implique non seulement un contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel, mais des délais supplémentaires entre les lectures à l’Assemblée et au Sénat alors que l’urgence règne.
Par ailleurs, elle exige une majorité absolue en cas de désaccord avec le Sénat, ce qui constitue une contrainte lourde. Dans l’Assemblée nationale élue à la proportionnelle que j’appelle de mes vœux – ce qui ne passe pas forcément par une révision constitutionnelle, le changement de mode de scrutin pouvant s’effectuer à travers une loi simple –, il serait difficile de répondre à cette condition. Nous voyons bien aujourd’hui comme il est difficile au groupe majoritaire dans une assemblée élue au scrutin majoritaire de dégager une majorité nette.
Certaines personnes qui militent en faveur de la loi organique ont dans l’idée, me semble-t-il, de rendre très difficile le recours à l’état d’urgence et veulent introduire toutes sortes de contraintes pour que cette disposition ne puisse être activée. Ceux qui pensent, au contraire, que l’état d’urgence, à condition qu’il soit utile et nécessaire, doit pouvoir être appliqué facilement et rapidement ne sauraient accepter l’introduction de cette lourdeur supplémentaire.
M. le rapporteur. Je reste favorable à la solution de la loi organique. Nous avons trois niveaux : le niveau constitutionnel, le niveau de la loi-cadre, le niveau de la loi ordinaire pour la prorogation. L’amendement de Mme Duflot vise à prendre la précaution de soumettre au Conseil constitutionnel la loi organique qui détaillera le catalogue des mesures pouvant être prises lorsque l’état d’urgence, après un délai de douze jours, est prorogé par une loi – qui, elle, reste une loi ordinaire adoptée à la majorité simple
Il est toujours difficile pour un Parlement de s’en remettre au juge constitutionnel pour valider la loi qu’il a élaborée, mais il me semble bon de faire en sorte que la conformité à la Constitution de mesures privatives de liberté soit examinée. Cette précaution sera de nature à écarter tout soupçon de volonté liberticide.
La lourdeur procédurale liée à la loi organique s’imposerait, je le répète, non au stade de la prorogation de l’état d’urgence, mais à celui de la fixation des mesures administratives pouvant être prises dans ce cadre.
Mme Cécile Duflot. Je retire mon amendement CL17 au profit des amendements CL11 et CL18, et remercie le rapporteur d’avoir dissipé la confusion qui s’était instaurée : la loi organique ne serait pas celle qui proroge l’état d’urgence, mais celle qui énumère les mesures de police administrative que les autorités peuvent prendre. Je ne vois pas d’objection, au contraire, à ce que ces mesures, potentiellement très restrictives des libertés publiques, fassent l’objet d’un contrôle de constitutionnalité et, le cas échéant, d’un vote à la majorité absolue des députés, qui ne me paraît constituer une condition exorbitante.
L’amendement CL17 est retiré.
La Commission rejette, contre l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL11 de Mme Cécile Duflot.
Elle en vient à l’amendement CL70 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les mesures de police administratives sont prises « sous le contrôle du juge administratif ». Certains me diront que cela va de soi, mais il vaut mieux, me semble-t-il, l’indiquer explicitement
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL18 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. Il s’agit, je le répète, de préciser que les mesures de police administratives doivent avoir un lien direct avec le péril ou les événements qui ont motivé la déclaration de l’état d’urgence.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à cette rédaction, mais nous pourrons peut-être y revenir en séance. Vous avez bâti votre argumentation à partir des assignations à résidence qui ont été décidées à l’occasion de la COP21. Certes, elles n’avaient pas de lien direct avec l’état d’urgence, mais elles étaient justifiées par la nécessité de préserver la disponibilité des forces de police en essayant de prévenir des troubles potentiels à l’ordre public lors de manifestations. Ces mesures, qui ont été contestées, ont d’ailleurs été confirmées par le juge administratif, ce qui laisse penser qu’elles avaient un fondement.
Naturellement, il ne faudrait pas que les mesures de police administrative n’aient aucun lien avec l’état d’urgence. Cependant, préciser que ce lien doit être direct serait restrictif : cela limiterait trop fortement les pouvoirs de police dans une situation qui, par définition, est exceptionnelle.
Mme Isabelle Attard. Lorsque des gendarmes ont procédé à des perquisitions chez des maraîchers bio en Dordogne, aucun appel à manifestation n’était susceptible de mobiliser les forces de l’ordre et de les détourner de leurs tâches de lutte contre le terrorisme. Je me suis rendue sur place et j’ai pu constater qu’il n’y avait aucun rapport avec les attentats.
Il me semble donc très important d’ajouter le mot « directement ». Cela éviterait sans doute que des recours comme ceux qui se multiplient actuellement ne soient déposés.
M. Georges Fenech. M. le rapporteur a raison de souligner qu’une telle mention serait trop restrictive. Le véritable contrôle, c’est le juge administratif qui l’exerce en examinant la proportionnalité de la mesure et le lien avec l’état d’urgence.
M. Jean-Christophe Lagarde. Si nous sommes trop précis, nous risquons d’empêcher le Parlement et le Gouvernement de mettre en œuvre des mesures d’une nécessité impérieuse. Je vais dans votre sens, monsieur le rapporteur.
La Commission rejette l’amendement CL18.
Puis elle examine l’amendement CL12 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 3 par les mots : « dans le respect des droits et libertés que la Constitution garantit ». Cela va sans doute de soi, mais cela va mieux en le disant.
M. le rapporteur. Cet amendement est purement déclaratif : par définition, nous légiférons dans le respect des droits et des libertés. Par ailleurs, il est peu opérationnel : l’état d’urgence peut impliquer dans certains cas des restrictions temporaires à certaines libertés. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL35 de M. Jean-Christophe Lagarde.
M. Jean-Christophe Lagarde. Dans le cas où une loi organique ne viendrait pas encadrer les mesures résultant de l’état d’urgence, cet amendement vise à préciser qu’elles sont soumises au contrôle du juge administratif, à l’exception de celles relevant de l’article 66 de la Constitution, donc de l’autorité judiciaire.
M. le rapporteur. Cet amendement opère un partage entre le juge administratif et le juge judiciaire. Or le contrôle de certaines mesures est susceptible d’être transféré, dans le cadre de l’état d’urgence, du juge judiciaire au juge administratif : c’est le cas, par exemple, pour les perquisitions administratives ou les visites de véhicule avec ouverture du coffre. La réintroduction de la mention à l’article 66 apporterait de la confusion. Avis défavorable.
M. Georges Fenech. Je crois savoir que la réforme pénale à venir risque de pérenniser ce transfert en dehors de l’état d’urgence. Je tenais à le dire, même si cela renvoie à un autre débat.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL71 rect. du rapporteur.
M. le rapporteur. L’article 24 de la Constitution donne au Parlement le pouvoir de contrôler l’action du Gouvernement. Cet amendement vise à permettre le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, en prévoyant que l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit pendant la durée de celui-ci. Cet amendement, qui procède par parallélisme avec l’article 16 de la Constitution, constitutionnalise le contrôle parlementaire pendant l’état d’urgence.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Avec ma collègue Sandrine Mazetier, nous nous sommes demandé si cet amendement, auquel nous sommes favorables, ne comportait pas un risque. L’absence d’une telle mention pour d’autres dispositions n’impliquera-t-elle pas, a contrario, que le Parlement ne peut exercer son pouvoir de contrôle ?
Mme Marietta Karamanli. J’ai une autre question, monsieur le rapporteur : le contrôle parlementaire figurera-t-il dans la Constitution faute d’être garanti dans une loi organique ?
M. Jean-Christophe Lagarde. Je n’ai rien contre cet amendement : que le Parlement se réunisse de plein de droit, pourquoi pas ? Toutefois, cela n’implique nullement que le Parlement puisse contrôler de manière effective la mise en œuvre de l’état d’urgence. Je souhaite que ce contrôle soit inscrit dans la Constitution au lieu de relever d’une simple loi, car il serait laissé alors à l’appréciation de la majorité du moment. La Constitution présente des garanties qui transcendent les clivages entre majorité et opposition : c’est la raison de la règle des trois cinquièmes.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Lorsque le constituant a prévu que le Parlement se réunissait de plein droit, la session unique n’existait pas. Dans l’organisation actuelle du Parlement, cette disposition a une moindre portée. Reste la session extraordinaire, ce qui suppose que le Parlement soit convoqué sur décision du Président de la République.
Nous anticipons ici sur le débat relatif au contrôle, qui aura lieu plus loin, notamment à propos d’un amendement que j’ai signé avec plusieurs de mes collègues.
M. Guillaume Larrivé. Si le constituant a estimé nécessaire, à l’article 16, de prévoir que le Parlement se réunit de plein droit, c’est précisément parce que le champ de cet article est celui de l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics avec le déclenchement de la possibilité donnée au Président de la République de se faire législateur.
L’état d’urgence se situe dans un tout autre cadre : le fonctionnement des pouvoirs publics n’est pas interrompu, le Parlement continue à remplir son office. L’amendement de notre rapporteur me paraît dès lors superfétatoire. La règle selon laquelle la loi ne doit pas être bavarde vaut a fortiori pour la Constitution. Une économie de mots serait bienvenue.
M. le rapporteur. Cet amendement vise, madame Bechtel, les périodes qui se situent en dehors de la session ordinaire du Parlement. Il n’est donc pas complétement superfétatoire. Par ailleurs, monsieur Larrivé, je reconnais bien volontiers qu’il s’applique dans un autre cadre que celui de l’article 16.
Mon idée était, une fois ce principe posé dans la Constitution, de prévoir les modalités du contrôle dans une loi, sujet que nous aborderons plus loin.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL32 et CL36 de M. Jean-Christophe Lagarde, CL53 de M. François de Rugy et CL54 de Mme Marie-Françoise Bechtel.
M. Jean-Christophe Lagarde. L’amendement CL32 et l’amendement de repli CL36 prévoient le déclenchement automatique d’une procédure de contrôle de l’état d’urgence par le Parlement.
L’état d’urgence attribue des pouvoirs exceptionnels, parfois attentatoires aux libertés publiques, à l’exécutif, qui peut être tenté de convaincre sa majorité, laquelle procède de l’élection présidentielle puisque désormais mandat présidentiel et législature suivent le même calendrier, de ne pas exercer un contrôle réel et effectif, ce qui priverait l’opposition de tout moyen de contrôle. Et ce n’est pas, je le répète, à la majorité actuelle ou à celle d’hier que je pense en disant en cela, mais à une autre qui pourrait sortir des urnes dans des circonstances qui n’échappent à personne. Ce scénario était impossible il y a quelque temps, il n’est désormais plus improbable. C’est notre devoir de constituant que d’apporter des garanties par un mécanisme automatique inscrit dans la Constitution. Je tiens à souligner que l’insertion d’une telle disposition déterminera le vote de l’Union des démocrates et indépendants au Sénat et à l’Assemblée nationale. Nous ne voulons pas prendre le risque que l’état d’urgence puisse être un jour utilisé par un pouvoir autoritaire sans qu’il y ait possibilité de débat.
Imaginons que l’état d’urgence soit déclenché en août ou en septembre, mois où le Parlement ne siège pas. Avec l’amendement précédent que nous venons d’adopter, il pourra se réunir et débattre. Avec mes amendements, il pourra en outre exercer un contrôle en s’assurant que celui-ci n’est pas le fait d’une majorité de circonstance ou d’une majorité sous pression soit de l’événement soit de l’exécutif.
Rappelons tout de même que si M. Jean-Jacques Urvoas, en tant que président de la commission des Lois, n’était pas allé contre la culture de notre Parlement, qui a pour habitude de parler de contrôle sans chercher à l’exercer de manière effective, nous n’aurions peut-être pas pu contrôler politiquement les mesures prises par le Gouvernement.
Il y a deux types de contrôle dans le cadre de l’état d’urgence : un contrôle politique, qui doit être automatiquement déclenché par la Constitution ; un contrôle exercé par le juge, qui assure une protection individuelle visant à éviter que les pouvoirs exceptionnels soient utilisés à d’autres fins que celles justifiées par l’état d’urgence. Dans la société d’information qui est la nôtre, il faut bien voir que de telles dérives ne peuvent perdurer très longtemps quand on a la faculté d’exercer un contrôle politique et de les dénoncer. C’est tout l’objet de mon amendement CL36.
M. François de Rugy. Mon amendement repose sur la même idée que ceux de M. Lagarde.
À propos de l’amendement précédent du rapporteur, je tiens à dire que le parallélisme avec l’article 16 n’est guère adapté à l’état d’urgence. Je me référerai plutôt à l’article 35 de la Constitution : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. ». Je proposerai donc de préciser, de la même façon, que « l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation » des mesures prévues par la loi de 1955 modifiée par la loi du 20 novembre dernier.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Mon amendement CL54, que certains de mes collègues n’ont pu signer compte tenu du très court délai dont nous avons disposé, va dans le même sens que les précédents, mais il est plus bref car je considère que le texte constitutionnel doit comporter le strict nécessaire. Je propose la rédaction suivante : « La loi prévoit les conditions dans lesquelles le Parlement exerce un contrôle sur la mise en œuvre des mesures résultant de l’état d’urgence. »
L’équilibre des droits et libertés concerne au premier chef le Parlement, et même exclusivement le Parlement, si l’on met à part le contrôle du juge sur les mesures de police administrative. Ce contrôle ne saurait être partagé avec le Conseil constitutionnel. Le représentant de la souveraineté populaire doit prendre toute sa place s’agissant de ces questions : il appartient au Parlement de contrôler.
Enfin, toute Constitution est un texte répartiteur des pouvoirs. C’est la raison pour laquelle il me paraît intelligent de donner une forme constitutionnelle à l’état d’urgence. Dans cet amendement, nous nous bornons à pointer la prérogative du Parlement ; il reviendra ensuite à la loi de déterminer les modalités de la mise en œuvre du contrôle.
M. le rapporteur. Ces amendements vont tous dans le même sens. Nous pourrions retenir l’amendement CL36 de M. Lagarde : « L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ». Il se réfère, en effet, à la rédaction que nous avons adoptée dans la loi du 20 novembre 2015, qui a constitué un précédent : c’est sur son fondement qu’a été mis en place le contrôle exercé par le précédent président de la commission des Lois. Mais si l’on préfère une version plus courte, c’est la rédaction de Mme Bechtel qui s’impose.
M. Patrick Devedjian. Au train où vont les choses, notre Constitution sera bientôt comme notre code du travail !
M. Guillaume Larrivé. Nous sommes tous profondément attachés à ce que le contrôle parlementaire soit pleinement effectif, mais ces quatre amendements sont déjà satisfaits par l’article 24 de la Constitution, aux termes duquel le Parlement contrôle l’action du Gouvernement, les modalités de ce contrôle étant définies soit par la loi organique prévue à l’article 25, soit par les règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat.
La preuve en est que nous n’avons eu nul besoin d’une modification constitutionnelle pour contrôler, comme nous le faisons actuellement, les mesures prises pendant l’état d’urgence en vigueur. Ne réinventons pas la roue tous les jours : nous vivons dans un régime parlementaire depuis 1958, et la Constitution actuelle permet pleinement au Parlement de remplir son office de contrôle de l’action du Gouvernement.
M. Jean-Christophe Lagarde. L’article 24 est en effet censé permettre au Parlement de contrôler l’action du Gouvernement, mais, en toute sincérité, considérez-vous réellement que ce contrôle s’effectue pleinement ? Il ne me semble pas pour ma part que ce soit la pratique de la Ve République, encore moins depuis l’instauration du quinquennat et la tenue quasi simultanée des élections présidentielle et législatives.
De surcroît, cela ne concerne guère le cas exceptionnel que constitue l’état d’urgence, situation dans laquelle le contrôle du Parlement – d’ordinaire plutôt aléatoire et plus ou moins efficace – sur l’action gouvernementale est a fortiori indispensable. La nécessité de ce contrôle peut certes être inscrite dans la loi, mais il me paraît plus protecteur de l’inscrire dans la Constitution. J’admets que celle-ci ne doit pas être bavarde, mais elle doit surtout nous garantir contre tout excès du pouvoir exécutif.
M. Pascal Popelin. J’accorde à Guillaume Larrivé que nous sommes dans un régime parlementaire et que l’une des prérogatives du Parlement est le contrôle du pouvoir exécutif. Néanmoins, notre Constitution comporte des dispositions créant des situations spécifiques dans lesquelles il est nécessaire de réaffirmer l’exercice de ce contrôle. L’état d’urgence est une de ces situations, et il n’y a que des avantages à constitutionnaliser le contrôle parlementaire.
En revanche, je plaide pour que nous options pour la concision. À cet égard l’amendement CL54 a l’avantage d’être bref, puisqu’il renvoie à la loi les modalités du contrôle. D’ailleurs, afin de souligner qu’il s’agit bien d’une prérogative naturelle du Parlement, sans doute pourrions-nous écrire que le Parlement exerce « son » contrôle.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je m’étonne de l’argumentation de M. Larrivé qui nous avait habitués à des approches plus exigeantes des principes et textes constitutionnels. Son interprétation de l’article 24 de la Constitution n’est pas défendable, car l’article 24 instaure le droit du Parlement à contrôler – c’est-à-dire évaluer – les politiques publiques, a posteriori. Cela n’a rien à voir avec le contrôle au fil de l’eau que nous exerçons aujourd’hui sur les mesures liées à l’état d’urgence, qui est une forme de contrôle tout à fait spécifique.
Quant à l’argument consistant à dire que l’exercice de ce contrôle ne nécessite guère de réforme constitutionnelle, il vaut tout autant pour l’état d’urgence lui-même, que nous constitutionnalisons pourtant, précisément pour qu’il soit soumis au contrôle du Parlement.
M. Denis Baupin. Nous soutenons l’esprit dans lequel sont défendus ces quatre amendements, avec une préférence pour les amendements CL36 et CL53. En effet, nous souhaitons garantir le contrôle du Parlement sur l’application de l’état d’urgence mais sans, comme le suggère Mme Bechtel, renvoyer les modalités de ce contrôle à une loi, laquelle pourrait fort bien être modifiée à la majorité simple. Une loi organique serait plus difficilement modifiable.
M. Patrick Devedjian. Je peux soutenir l’amendement CL54 s’il y est inscrit que le Parlement exerce « le » contrôle sur les mesures liées à l’état d’urgence, ce qui donne plus de force à ce contrôle que l’article indéfini.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Pourquoi ne pas écrire, dans ce cas, « le Parlement contrôle la mise en œuvre » ?
M. le rapporteur. Je me rallie à cette dernière proposition.
La Commission rejette successivement les amendements CL32, CL36 et CL53.
Elle adopte l’amendement CL54 (2ème rectification).
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL25 de M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. Il s’agit de porter de douze à vingt-et-un jours le délai au-delà duquel l’état d’urgence doit être prorogé par la loi. Le délai de douze jours apparaît en effet comme trop contraignant, sachant qu’à l’intérieur de ce délai, un avant-projet de loi doit être rédigé et soumis au Conseil d’État, le projet de loi doit être adopté en conseil des ministres, puis voté dans les mêmes termes par les deux chambres, la loi devant enfin être promulguée par le Président de la République.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Vingt et un jours constituent un délai trop long. Nous avons réussi à conduire le processus en douze jours. Cela pose certes quelques contraintes, mais la circonstance est exceptionnelle.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL52 de M. François de Rugy et CL33 de M. Jean-Christophe Lagarde.
M. François de Rugy. Notre amendement fixe à trois mois la durée maximale de prolongation de l’état d’urgence, afin que, par parallélisme des formes avec l’article 35, le Parlement ait son mot à dire sur cette prolongation.
M. Jean-Christophe Lagarde. Il nous semble nécessaire que la prorogation de l’état d’urgence, qui est soumise à la loi, ne puisse atteindre une durée excessive. La Constitution doit imposer qu’un débat ait lieu et qu’une nouvelle loi soit votée tous les quatre mois, délai qui correspond au délai imposé au Gouvernement dans le cas d’interventions militaires extérieures. Les deux situations étant à peu près comparables, c’est un délai raisonnable.
M. le rapporteur. Je partage vos intentions, mais préconise de nous aligner sur la procédure figurant à l’article 16, qui requiert l’avis du Conseil constitutionnel.
Je mesure la difficulté à mettre fin à l’état d’urgence, le Gouvernement pouvant indéfiniment invoquer la permanence du péril. Aussi l’intervention d’une instance comme le Conseil constitutionnel me paraît-elle une manière de faciliter le retour à la normale. C’est l’objet de l’amendement CL72 que nous allons examiner.
M. Jean-Christophe Lagarde. Je suis totalement opposé à ce que le Conseil constitutionnel exerce un contrôle d’opportunité sur l’état d’urgence !
M. Guillaume Larrivé. Je suis parfaitement d’accord avec Jean-Christophe Lagarde. Ce n’est pas au Conseil constitutionnel de se substituer au législateur, qui a le monopole de l’opportunité politique.
La Commission rejette successivement les amendements CL52 et CL33.
Puis elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CL44 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg et CL15 de Mme Cécile Duflot.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Il s’agit de la reprise d’une disposition courante, qui vise à préciser qu’il peut être mis fin de façon anticipée à l’état d’urgence, quand les circonstances qui ont justifié sa mise en œuvre ont évolué. Cela figure dans la loi du 20 novembre 2015, comme cela figurait dans la loi du 18 novembre 2005.
M. le rapporteur. C’est une disposition qui me paraît aller de soi. Lors des douze premiers jours, le décret instaurant l’état d’urgence, peut être abrogé par un autre décret ; ensuite, la loi peut parfaitement prévoir qu’il sera mis fin à l’état d’urgence par anticipation si les circonstances le demandent. Avis défavorable.
La Commission rejette successivement les amendements CL44 et CL15.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL34 de M. Jean-Christophe Lagarde, CL 45 et CL46 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Jean-Christophe Lagarde. L’article 16 de la Constitution dispose que l’Assemblée nationale ne peut être dissoute dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels du Président de la République. Nous proposons d’établir la même garantie pour l’état d’urgence. Il n’est pas envisageable, en effet, qu’une campagne électorale puisse se tenir dans une période où le pouvoir exécutif a toute liberté pour restreindre le droit de réunion, de manifestation et de communication publiques. Ce serait ouvrir la voie à une dérive autoritaire.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Il est souhaitable, puisque l’état d’urgence vise à renforcer les pouvoirs publics, que l’Assemblée nationale ne puisse être dissoute tant qu’il est en vigueur. On ne sait ce que l’avenir peut nous réserver, et nous devons poser des garde-fous. Je reprends donc dans l’amendement CL45 les termes mêmes de l’article 4 de la loi de 1955.
L’amendement CL46 est un amendement de repli, qui reprend une disposition de l’ordonnance prise le 15 avril 1960 par le général de Gaulle et précise que la loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale. Il n’est pas non plus souhaitable pour la stabilité des pouvoirs publics que le Gouvernement soit remplacé par un autre gouvernement en période d’état d’urgence.
M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CL34, donc défavorable aux deux autres.
Mme Cécile Duflot. Je suis très favorable à l’amendement de M. Lagarde, d’autant que ce que nous faisons, à savoir une réforme constitutionnelle en période d’état d’urgence – ce qui est une première –, nous amène à nous interroger sur ce qu’il convient de faire ou non sous un régime d’exception. C’est une lourde responsabilité car chacun imagine aisément quel usage pourrait faire certaine formation politique de notre Constitution. Nous devons donc faire preuve de la plus grande prudence, sachant, je le répète, que je m’interroge sur la possibilité de réviser la Constitution sous le régime de l’état d’urgence, c’est-à-dire en des temps par essence troublés.
Les amendements CL45 et CL46 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement CL34.
L’amendement CL72 du rapporteur est retiré.
La Commission adopte l’article 1ermodifié.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL23 de M. Alain Tourret et CL43 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Alain Tourret. Il s’agit d’abroger l’article 36 de la Constitution, qui n’a jamais trouvé à s’appliquer sous la Ve République.
L’état de siège trouve son origine dans une loi du 9 août 1849. Il se définit comme la suspension de l’exercice de certaines libertés et se traduit, à la différence de l’état d’urgence, par le transfert temporaire du maintien de l’ordre aux forces armées. Il est organisé par le code de la défense et permet le transfert des pouvoirs de police civile à l’autorité militaire, la création de juridictions militaires et l’extension des pouvoirs de police.
L’état de siège est très ancien. Il remonte au XVIIIe siècle et a été mis en œuvre en 1848, tous les pouvoirs étant confiés au général Cavaignac, de triste mémoire. Une codification de l’état de siège est alors décidée le 9 août 1849, puis modifiée par la loi du 3 avril 1878. Il est précisé que l’état de siège n’a pas vocation à s’appliquer sur tout le territoire.
Cependant, en 1914, l’état de siège s’applique à toute la France, mais dans l’esprit d’une collaboration entre les pouvoirs civil et militaire. L’état de siège est en effet instauré par le président Poincaré deux jours avant la déclaration de guerre du 2 août 1914. Il est levé le 12 octobre 1919, près d’un an après l’armistice.
En période d’état de siège, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l’autorité militaire ne réclame pas les poursuites sur tous les délits et crimes prévus par la loi du 27 avril 1916.
La Constitution de 1946 ne comporte pas de dispositions relatives à l’état de siège, mais son article 7 est ainsi complété le 7 décembre 1954 : « l’état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi ». Néanmoins, aucune loi n’a jamais été votée pour préciser ces conditions.
Selon la Constitution de la Ve République, l’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent résultant soit d’une guerre étrangère soit d’une insurrection. Le transfert des pouvoirs à l’autorité militaire concerne pour l’essentiel les attributions des juridictions militaires. Or les juridictions militaires ont été supprimées. L’article 36 de la Constitution sur l’état de siège est donc vide de sens.
Quant aux éventuels pouvoirs d’exception, ils sont exercés par les autorités civiles sous le contrôle du Parlement et de la Justice, l’article 16 de la Constitution venant compléter les mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises dans des circonstances répondant à l’état de siège.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Au cas – peu probable – où l’amendement d’Alain Tourret ne serait pas adopté, je propose un amendement de repli précisant, par souci d’équilibre entre le régime d’état de siège et le régime d’état d’urgence, que l’état de siège est déclenché « en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée », critère repris de l’article L. 2121-1 du code de la défense.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CL23, mais favorable à l’amendement CL43, qui constitutionnalise l’article L. 2121-1 du code de la défense et précise les conditions de mise en œuvre de l’état de siège.
L’amendement CL23 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL43 rectifié.
Puis elle adopte l’amendement de précision CL73 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL16 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. Il s’agit des conditions dans lesquelles peut s’appliquer l’article 89. Il me paraît important de préciser que l’on ne peut réviser la Constitution lorsque le pays est sous le régime de l’article 16, de l’article 36 ou de l’article 36-1.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
La Commission examine l’amendement CL49 de M. François de Rugy.
M. François de Rugy. Jusqu’à présent, la question de la nationalité n’était évoquée dans la Constitution qu’à propos des rapports entre le Parlement et le Gouvernement, l’article 34 précisant que les règles concernant la nationalité relevaient de la loi.
L’article 2 de ce projet de loi, qui vient modifier l’article 34, aborde la question de la déchéance de nationalité. Quoi qu’on en pense – et, contrairement à d’autres, je n’y suis pas opposé par principe –, nos compatriotes binationaux ou plurinationaux ont pu avoir le sentiment qu’en proposant d’inscrire dans la Constitution le principe de la déchéance de nationalité on remettait du même coup en cause le principe de la plurinationalité. Je propose donc d’inscrire à l’article 1er de la Constitution, qui mentionne que la France est une République qui assure l’égalité des citoyens devant la loi, le droit de détenir une ou plusieurs autres nationalités que la nationalité française.
M. le rapporteur. Avis défavorable, pour deux raisons. D’abord parce que la plurinationalité est aujourd’hui possible en France et que très peu de pays dans le même cas l’ont inscrite dans leur constitution. Ensuite, la déchéance de nationalité visée à l’article 2 ne concerne plus, dans la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement, les citoyens binationaux. La question ne se pose donc plus.
La Commission rejette l’amendement.
Article 2
(art. 34 de la Constitution)
Compétence du législateur pour prévoir la déchéance de la nationalité des Français binationaux
Cet article tend à compléter l’article 34 de la Constitution, qui définit le champ de compétence du législateur, afin d’y ajouter la possibilité de déchoir de leur nationalité française les personnes nées françaises, ayant une autre nationalité et condamnées pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation.
Cette possibilité n’est aujourd’hui ouverte, dans le code civil, qu’à l’encontre des personnes nées avec la nationalité d’un autre État et devenues françaises postérieurement.
I. LA PERTE ET LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ DANS LE DROIT EN VIGUEUR
Le chapitre IV du titre Ierbis du code civil distingue la « perte » et la « déchéance » de la nationalité : si la seconde est toujours une sanction, la première ne l’est que dans de rares hypothèses.
A. LA PERTE DE LA NATIONALITÉ
Le plus souvent, la perte de nationalité n’est pas une sanction, mais le résultat de l’exercice d’un droit, conduisant une personne à renoncer à la nationalité française.
Sous certaines conditions, un Français ayant une autre nationalité – un binational – peut ainsi demander à perdre la nationalité française (articles 23 à 23-2 et 23-4 du code civil) ou la « répudier », qu’il en dispose depuis sa naissance ou qu’il l’ait acquise postérieurement, par exemple par mariage (articles 23-3 et 23-5 du même code).
Toutefois, à ces cas de perte volontaire s’ajoutent trois hypothèses – rares en pratique – de perte subie. Aucune des trois dispositions législatives correspondantes n’a, à ce jour, été contrôlée par le Conseil constitutionnel.
1. La perte de la nationalité en l’absence de possession d’état
L’article 23-6 du code civil prévoit la perte de la nationalité française, prononcée par jugement du tribunal de grande instance, lorsque « l’intéressé, français d’origine par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle ».
Cette disposition ne concerne que les Français de naissance. Elle vise à éviter que l’attribution de la nationalité française par filiation (69) aboutisse à une transmission infinie de cette nationalité à des personnes dépourvues, depuis longtemps, de tout lien réel avec la France.
La perte de la nationalité peut théoriquement concerner un Français « mono-national », dès lors que l’article 23-6 ne fixe aucune condition tenant à une nationalité étrangère. Toutefois, au regard de la situation visée – l’absence de toute attache effective avec la France (70) –, il est très probable, en pratique, que la personne concernée détiendra une autre nationalité.
Quoique subie, la perte de la nationalité française est ici moins une sanction que la constatation d’un état de fait. L’article 23-6 dispose d’ailleurs que la perte de nationalité peut être « constatée » par jugement.
L’un de ses corollaires figure à l’article 30-3 du code civil, selon lequel « lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6 ».
2. La perte de la nationalité en cas de comportement comme le national d’un pays étranger
L’article 23-7 du code civil dispose que « le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français ».
Cet article ne concerne que les binationaux (« s’il a la nationalité de ce pays ») (71), qu’ils soient français de naissance ou par acquisition. Il est interprété par le Conseil d’État « dans le sens d’un comportement manifestant un défaut de loyalisme de l’intéressé à l’égard de la France » (72) – ce qui donne à la procédure une dimension punitive (73).
L’article 23-7 n’apparaît cependant guère applicable aux formes de terrorisme auxquelles notre pays est aujourd’hui confronté – sauf, par une interprétation aussi constructive qu’inopportune, à reconnaître la qualité étatique (« un pays étranger ») à des groupes terroristes.
Selon le ministère de l’Intérieur (74), les trois derniers cas d’application de cette disposition (75) ont concerné :
– en 1958, un Franco-Norvégien ayant donné des conférences et publié des articles dirigés contre la France et sa politique ;
– en 1960, un Franco-Guinéen qui, nommé trésorier payeur de la République de Guinée un mois après l’indépendance de ce pays, militait dans des partis politiques guinéens et écrivait des articles extrêmement violents contre le Gouvernement français ;
– en 1970, un Franco-Allemand qui, résidant en Allemagne depuis la Libération, se comportait, dès avant 1939, comme un ressortissant allemand et manifestait ouvertement son hostilité à l’égard de la France.
La procédure à suivre est précisée à l’article 59 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Le Gouvernement notifie à l’intéressé « les motifs de droit et de fait justifiant qu’il ait perdu la qualité de français ». À défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel. L’intéressé dispose d’un délai d’un mois pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations (aujourd’hui : le ministre de l’Intérieur) « ses observations en défense ». Après quoi, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’État, que « l’intéressé a perdu la qualité de français ».
3. La perte de la nationalité en cas de concours apporté à une armée ou un service public étranger ou une organisation internationale dont la France ne fait pas partie
L’article 23-8 du code civil permet de prononcer la perte de nationalité d’un Français qui, « occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement ». L’intéressé est déclaré avoir perdu la nationalité française, par décret en Conseil d’État, s’il n’a pas mis fin à son activité dans le délai fixé par l’injonction (entre quinze jours et deux mois). En cas d’avis défavorable du Conseil d’État, la mesure doit être prise par décret en Conseil des ministres.
Cette disposition est théoriquement applicable à tout Français, d’origine ou par acquisition, qu’il soit binational ou non : elle peut donc aboutir à rendre une personne apatride.
Rarement utilisée (76), elle trouve ses origines dans les Constitutions de 1793 et 1795, ainsi que dans le code civil de 1804 (77). Son texte actuel résulte de l’article 97 de l’ordonnance n° 45-2447 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française (78), successivement modifié par :
– l’ordonnance n° 61-120 du 2 février 1961 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité française. Celle-ci visait principalement à assouplir la procédure (en remplaçant l’avis conforme du Conseil d’État par un avis simple) et à l’élargir à celui qui « apporterait son concours à un État ou à un service public étranger sans occuper un emploi proprement dit » (79) (insertion des mots : « ou plus généralement leur apportant son concours »), ainsi qu’à celui qui sert « une organisation internationale dont la France ne fait pas partie » ;
– la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, qui s’est bornée à supprimer la disposition selon laquelle « l’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date du décret » ;
– la loi du 22 juillet 1993 précitée, qui, sans en modifier le texte, l’a introduit dans le code civil, à l’article 23-8.
La procédure applicable est proche de celle régissant la perte de la nationalité prévue à l’article 23-7 du code civil : le Gouvernement adresse à l’intéressé une injonction de cesser l’activité en cause, « en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », en précisant les « motifs de droit et de fait qui la justifient ». À l’expiration du délai prévu par l’injonction, la perte de la nationalité française peut être déclarée, par décret motivé, dans les formes déjà évoquées.
L’article 23-8 du code civil n’est pas adapté au cas d’un Français apportant son concours à un groupe terroriste. D’une part, comme l’avait relevé notre collègue M. Philippe Meunier (80), les termes : « une armée ou un service public étranger » visent manifestement l’armée régulière ou un service public d’un autre État. D’autre part, la notion d’ « organisation internationale dont la France ne fait pas partie » doit être interprétée comme ne renvoyant qu’à « un organisme international interétatique » (81). Au demeurant, à supposer qu’une lecture constructive soit faite de l’article 23-8 du code civil, il y aurait quelque incongruité à voir le Gouvernement français enjoindre à un terroriste de cesser son activité criminelle, puis attendre l’écoulement du délai légal, avant, le cas échéant, de prononcer la perte de sa nationalité française.
B. LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ
Prévue aux articles 25 et 25-1 du code civil (82), la déchéance de la nationalité ne peut concerner qu’un individu « qui a acquis la qualité de Français » – ce qui exclut les Français de naissance – et à condition de ne pas avoir pour résultat de le « rendre apatride », ce qui suppose qu’il dispose d’une autre nationalité. Elle est donc inapplicable, par exemple, aux personnes naturalisées originaires de pays qui ne reconnaissent pas la double nationalité.
Cette restriction visant à éviter l’apatridie résulte de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. Elle a été introduite à l’Assemblée nationale le 28 novembre 1997 par un amendement du Gouvernement, présenté par Mme Élisabeth Guigou, Garde des Sceaux, qui avait déclaré : « Actuellement, ces déchéances peuvent être prononcées même si elles ont pour résultat de rendre l’intéressé apatride. Une telle conséquence n’est pas acceptable. D’ailleurs, tant la convention des Nations-Unies de 1961 que la convention du Conseil de l’Europe sur la nationalité [alors non encore signée par la France] tendent à éviter l’apatridie. La France a l’intention de signer et ratifier ces deux conventions. Aussi s’agit-il de mettre notre droit en conformité avec celles-ci » (83).
La déchéance de la nationalité est prononcée par décret du Premier ministre, pris après avis conforme du Conseil d’État.
1. Les motifs de la déchéance
L’article 25 du code civil distingue quatre hypothèses dans lesquelles un individu peut être déchu de la nationalité française. D’une façon générale, comme le relève le professeur Paul Lagarde, il s’agit de sanctionner « un comportement jugé indigne ou déloyal », qui apparaît « comme une rupture d’allégeance, une provocation » à l’égard de l’État (84).
a. Lorsque l’individu est « condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme »
Prévu au 1° de l’article 25 du code civil, ce cas se subdivise en deux, en fonction des infractions pénales commises.
● D’une part, sont concernés les crimes et délits prévus au titre Ier, consacré aux « atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation », du livre IV (« Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique ») du code pénal, parmi lesquels figurent :
– la trahison (85) : livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère, intelligence avec une puissance étrangère, livraison d’informations à une puissance étrangère, sabotage, fourniture de fausses informations (articles 411-1 à 411-11 du code pénal) ;
– l’attentat, défini à l’article 412-1 du code pénal comme « le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ». Contrairement à l’usage courant de ce terme, il ne s’agit pas d’un acte de terrorisme au sens du code pénal ;
– le complot (article 412-2 du même code) ;
– le mouvement insurrectionnel (articles 412-3 à 412-6) ;
– l’usurpation de commandement (1° de l’article 412-7) ;
– la levée de forces armées (2° de l’article 412-7) ;
– la provocation à s’armer illégalement (article 412-8) ;
– les autres atteintes à la défense nationale (articles 413-1 à 413-13).
● D’autre part, depuis la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, les crimes et délits « constituant un acte de terrorisme » peuvent également justifier la déchéance de la nationalité.
Ceux-ci sont définis au chapitre Ier du titre II (« Du terrorisme ») du livre IV du code pénal. Constituent des actes de terrorisme :
– les infractions de droit commun prévues à l’article 421-1 du code pénal, « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » : atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, enlèvement et séquestration, détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, vol, extorsion, destruction, dégradation, détérioration, infractions en matière informatique, infraction en matière de groupes de combat et de mouvements dissous, entrave à la saisine de la justice, faux, infraction en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires, recel du produit de l’une des infractions qui précèdent, blanchiment et délit d’initié (86) ;
– le terrorisme écologique, à savoir l’introduction « dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, [d’]une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel », lorsque cette introduction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (article 421-2 du même code) ;
– l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, c’est-à-dire le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme qui précèdent (article 421-2-1) ;
– le financement d’une entreprise terroriste, en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un des actes de terrorisme qui précèdent, « indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte » (article 421-2-2) ;
– la non-justification de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes mentionnés ci-avant (article 421-2-3) ;
– le fait, « même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet », d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 (article 421-2-4) ;
– le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes (article 421-2-5) ;
– la préparation individuelle d’un acte de terrorisme, au sens du II de l’article 421-2-6, dès lors que cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par « le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui » et par l’un des autres faits matériels suivants : « a) recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes » ; « b) s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires » ; « c) consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie » ; « d) avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ».
b. Lorsque l’individu est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte à l’administration publique commise par une personne exerçant une fonction publique
Le 2° de l’article 25 du code civil s’applique à l’individu « condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ».
Les crimes et délits en question sont les atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique : abus d’autorité dirigé contre l’administration, atteintes à la liberté individuelle, discrimination, atteinte à l’inviolabilité du domicile, atteinte au secret des correspondances, concussion, corruption passive, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, soustraction et détournement de biens (articles 432-1 à 432-17 du code pénal).
c. Lorsque l’individu est « condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national »
Prévu au 3° de l’article 25 du code civil, ce cas est devenu virtuel depuis que la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a suspendu l’application des dispositions relatives au service national pour les personnes nées après le 31 décembre 1978.
d. Lorsque l’individu « s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France »
À la différence des cas précédents, il n’est pas ici fait référence à une condamnation judiciaire, mais à la simple constatation d’un état de fait (4° de l’article 25 du code civil).
Jusqu’en 1998 existait un cinquième cas de déchéance, applicable à un individu « condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement ». Cette déchéance pour crime de droit commun a été supprimée par la loi du 16 mars 1998 précitée.
2. Les délais à respecter
En application de l’article 25-1 du code civil, dans les trois dernières hypothèses (atteinte à l’administration publique commise par une personne exerçant une fonction publique, soustraction au service national, actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France), la déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits :
– soit dans un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la nationalité française. Passé ce délai, la personne n’est, à l’instar d’un Français de naissance, plus susceptible d’être déchue de sa nationalité (87) ;
– soit antérieurement à l’acquisition de la nationalité française. Cette disposition a été ajoutée, à l’initiative de M. Christian Estrosi, par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
En outre, la déchéance ne peut être prononcée que dans un délai de dix ans à compter de la perpétration des faits la justifiant.
Par dérogation, dans la première hypothèse de déchéance – atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ou actes de terrorisme –, les deux délais qui précèdent sont portés à quinze ans.
Cet allongement résulte de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. L’exposé des motifs du projet de loi, présenté par M. Nicolas Sarkozy, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, le justifiait ainsi : « compte tenu (…) de l’avantage qu’ils prêtent à l’obtention de la nationalité française, les réseaux terroristes développent des stratégies d’implantation territoriale : une fois la nationalité française acquise, l’activiste ne peut plus faire l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une mesure administrative d’éloignement et se voit, en outre, dispensé de l’obligation d’obtenir un visa pour se déplacer vers de nombreux pays. Il s’agit de faire échec à ces stratégies. La mesure proposée tient compte des délais des procédures judiciaires et administratives et de la nécessité pour l’administration de s’assurer que les condamnations prononcées par le juge judiciaire ont acquis un caractère définitif » (88).
Du fait du cumul des deux délais, la déchéance peut, dans un cas de terrorisme, être prononcée au plus tard trente ans après l’acquisition de la nationalité (vingt ans dans les autres cas).
3. La mise en œuvre et les effets de la déchéance
Depuis le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers (89), la déchéance de la nationalité est une procédure purement administrative. Elle prend la forme d’un décret, publié au Journal officiel (90), pris sur avis conforme du Conseil d’État, après que l’intéressé a été « entendu ou appelé à produire ses observations » (articles 25 et 27-3 du code civil). S’agissant d’une mesure individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce décret doit être motivé (91).
L’article 61 du décret du 30 décembre 1993 précité dispose :
– que le ministre chargé des naturalisations « notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française » ;
– qu’à compter de la notification ou de la publication, la personne concernée dispose d’un délai d’un mois pour faire parvenir au ministre « ses observations en défense ». À l’expiration de ce délai, le Gouvernement « peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’État, que l’intéressé est déchu de la nationalité française ».
Ce décret est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, dans les conditions de droit commun.
Depuis la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, les effets de la déchéance de la nationalité sont strictement individuels : elle ne s’étend ni au conjoint, ni aux enfants (92).
La déchéance de la nationalité est dépourvue d’effet rétroactif, en application de l’article 27-1 du code civil et de l’article 63 du décret du 30 décembre 1993 précité.
En théorie, la déchéance n’est pas nécessairement définitive. Toutefois, l’article 21-27 du code civil dispose que « nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet (…) d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ». Si un tel motif a motivé la déchéance, celle-ci aura alors un caractère définitif.
La déchéance de la nationalité française est une prérogative rarement mise en œuvre par les gouvernements successifs. À la connaissance de votre rapporteur, depuis 1973, treize déchéances pour acte de terrorisme ou atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ont été prononcées : une en 2002, une en 2003, cinq en 2006, une en 2014 et cinq en 2015 (93).
Le tableau ci-après récapitule les différents cas de perte ou de déchéance de la nationalité aujourd’hui applicables.
CAS DE PERTE OU DE DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ (DROIT EN VIGUEUR)
Français de naissance |
Français par acquisition | |
Mono-national |
Perte de nationalité par jugement en l’absence de possession d’état et de résidence en France |
– |
Perte de nationalité par décret en cas d’emploi dans une armée ou un service public étranger | ||
Binational |
Perte de nationalité par jugement en l’absence de possession d’état et de résidence en France |
– |
Perte de nationalité par décret en cas de comportement comme national d’un pays étranger | ||
Perte de nationalité par décret en cas d’emploi dans une armée ou un service public étranger | ||
– |
Déchéance de nationalité par décret à raison de certains crimes ou délits commis avant l’acquisition de la nationalité ou dans un délai de 10 ou 15 ans après cette acquisition | |
N.B. : Ne sont pas mentionnés les cas de perte volontaire de la nationalité (à la demande de l’intéressé), prévus aux articles 23 à 23-5 du code civil.
4. La constitutionnalité et la conventionnalité des dispositions en vigueur
a. La conformité à la Constitution
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à deux reprises sur la constitutionnalité des dispositions législatives organisant la déchéance de la nationalité française.
En 1996, saisi de la loi ajoutant les condamnations pour crime ou délit terroriste parmi les possibles motifs de déchéance, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (94).
D’une part, celles-ci ne sont pas contraires au principe d’égalité :
– certes, « au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ». Sans doute faut-il y voir une conséquence de l’article 1er de la Constitution, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens « sans distinction d’origine » ;
– toutefois, « le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité ».
Autrement dit, c’est non pas une différence de situation, mais un motif d’intérêt général – la lutte contre le terrorisme – qui justifie la différence de traitement entre les Français d’origine (soustraits à toute possibilité de déchéance de leur nationalité) et les Français par acquisition (susceptibles d’une telle déchéance).
D’autre part, « eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme », le Conseil constitutionnel juge que la « sanction » que représente la déchéance de la nationalité ne méconnaît pas les exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789 (95).
En 2015, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l’occasion de la contestation devant le Conseil d’État d’un décret portant déchéance de la nationalité, le Conseil constitutionnel a confirmé cette jurisprudence, dans la décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S.
Le Conseil rappelle la position qu’il avait prise en 1996 (96) et relève les deux évolutions législatives intervenues depuis lors :
– la faculté de prononcer la déchéance de la nationalité a été étendue en 2003 aux faits antérieurs à l’acquisition de la nationalité, ce qui « ne conduit pas à un allongement du délai au cours duquel la nationalité française peut être remise en cause » ;
– pour les crimes et délits constituant un acte de terrorisme, la loi du 23 janvier 2006 précitée a porté de dix à quinze ans le délai entre l’acquisition de la nationalité française et la perpétration des faits, ainsi que le délai entre cette dernière et le prononcé de la déchéance (97).
Après avoir relevé la « gravité toute particulière » des faits en question, le Conseil constitutionnel conclut à l’absence de violation du principe d’égalité. Il ajoute néanmoins, en forme d’obiter dictum, que le premier délai, séparant l’acquisition de la nationalité de la commission des actes de terrorisme, « ne saurait être allongé sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité entre les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance ». Est ainsi tracée une limite à ne pas franchir pour le législateur. Soulignons toutefois que si la présente révision constitutionnelle conduisait à étendre aux Français de naissance la procédure de déchéance, cet argument tiré de l’atteinte au principe d’égalité ne serait plus opérant.
Enfin, dans la même décision, le Conseil constitutionnel juge :
– qu’ « eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d’une punition qui n’est pas manifestement disproportionnée », au regard des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ;
– que la déchéance de la nationalité étant dépourvue d’effet rétroactif, elle ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise ;
– que la déchéance de la nationalité d’une personne « ne met pas en cause son droit au respect de la vie privée ».
En conséquence, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les mots : « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1° de l’article 25 du code civil, ainsi que, dans sa totalité, l’article 25-1 du même code.
Le juge constitutionnel ne s’est, en revanche, jamais prononcé sur la constitutionnalité des autres motifs de déchéance de la nationalité figurant à l’article 25 du code civil : ni en cas de condamnation pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour une atteinte à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, ni en cas d’actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France accomplis au profit d’un État étranger.
b. La compatibilité avec nos engagements internationaux
Le juge administratif a eu plusieurs fois à connaître de la compatibilité entre la déchéance de la nationalité prévue à l’article 25 du code civil et nos engagements internationaux.
En 2003, le Conseil d’État a jugé :
– le dispositif de déchéance compatible avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), relatif à l’interdiction des discriminations, au motif que « le droit pour un étranger d’acquérir la nationalité d’un État signataire de cette convention et de la conserver n’est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci » ;
– « inopérant » le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (98).
Ce dernier point a été confirmé en 2007, le Conseil d’État jugeant qu’ « un décret portant déchéance de la nationalité française est dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur les liens de ce dernier avec les membres de sa famille ». En conséquence, les stipulations de l’article 8 de la CEDH « ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre ce décret » (99).
Cette jurisprudence est antérieure à certaines décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) intéressant les questions de nationalité.
Dans un arrêt du 13 juillet 2010, Kurić c. Slovénie (n° 26828/06), après avoir rappelé que « le droit d’acquérir ou de conserver une nationalité particulière n’est garanti, comme tel, ni par la Convention ni par ses Protocoles », la Cour de Strasbourg « n’exclut pas qu’un refus arbitraire d’octroyer la nationalité puisse, dans certaines conditions, poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention en raison de l’impact d’un tel refus sur la vie privée de l’individu ». En l’espèce, elle condamne la Slovénie pour avoir, lors de son accession à la souveraineté, privé de leur nationalité certains ressortissants de l’ancienne Fédération de Yougoslavie, ainsi devenus apatrides (100).
De même, dans un arrêt du 11 octobre 2011, Genovese c. Malte (n° 53124/09), la CEDH conclut à une violation combinée des articles 8 et 14 de la Convention, à propos d’un ressortissant britannique n’ayant pu obtenir la nationalité maltaise au motif qu’il était issu de l’union hors mariage d’une Britannique et d’un Maltais. La Cour réaffirme qu’il n’est pas exclu qu’un refus arbitraire d’octroyer la nationalité d’un État puisse, dans certaines conditions, poser problème au regard de son impact sur la vie privée de l’individu.
En conséquence, le principal enjeu d’un éventuel contrôle juridictionnel d’une mesure de déchéance de la nationalité résiderait dans l’appréciation de son caractère « nécessaire », « dans une société démocratique », au sens de l’article 8 de la CEDH (101).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est également prononcée sur la question de la perte de la nationalité d’un ressortissant d’un État membre de l’Union. En effet, celle-ci entraîne de plein droit la perte de la citoyenneté européenne, au sens du titre V de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (102), dès lors que l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose qu’ « est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre ».
Dans l’arrêt Janko Rottman c. Freistaat Bayern du 2 mars 2010 (C-135/08), la CJUE avait été saisie par une juridiction allemande d’une question préjudicielle concernant un ressortissant autrichien de naissance, devenu allemand, mais dont la naturalisation avait été retirée par l’Allemagne car obtenue frauduleusement. L’intéressé, ayant perdu la nationalité autrichienne lors de l’acquisition de la nationalité allemande, était susceptible de devenir apatride. La Cour de Luxembourg considère qu’il appartient à la juridiction nationale « de vérifier si la décision de retrait en cause au principal respecte le principe de proportionnalité en ce qui concerne les conséquences qu’elle comporte sur la situation de la personne concernée au regard du droit de l’Union, outre, le cas échéant, l’examen de la proportionnalité de cette décision au regard du droit national ». En conséquence, « il convient, lors de l’examen d’une décision de retrait de la naturalisation, de tenir compte des conséquences éventuelles que cette décision emporte pour l’intéressé et, le cas échéant, pour les membres de sa famille en ce qui concerne la perte des droits dont jouit tout citoyen de l’Union. Il importe à cet égard de vérifier, notamment, si cette perte est justifiée par rapport à la gravité de l’infraction commise par celui-ci, au temps écoulé entre la décision de naturalisation et la décision de retrait ainsi qu’à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer sa nationalité d’origine ».
En d’autres termes, le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un État membre retire sa nationalité à un citoyen de l’Union, à condition que cette décision respecte le principe de proportionnalité.
Après ces décisions de la CEDH et de la CJUE, le juge administratif a eu de nouveau à statuer sur la question de la déchéance de la nationalité. Le 11 mai 2015, dans l’affaire Ahmed S. précitée, le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir contre le décret prononçant une telle déchéance (103). Il réaffirme la compatibilité de la mesure avec l’article 14 de la CEDH (104). Surtout, le Conseil d’État juge les dispositions sur la déchéance compatibles avec le droit de l’Union européenne :
– le fait que la déchéance ne concerne que les Français par acquisition ayant une autre nationalité n’est pas contraire aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatifs au principe d’égalité et à l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, dès lors que ces articles ne « font pas obstacle à ce que la perte de nationalité puisse dépendre du mode ou des conditions d’acquisition de la nationalité » ;
– rappelant l’exigence de proportionnalité posée dans l’arrêt Rottman précité de la CJUE, le Conseil d’État juge qu’en l’espèce, « eu égard à la gravité toute particulière des actes de terrorisme et aux conditions fixées par les articles 25 et 25-1 du code civil, les dispositions de ces articles ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union ».
II. LA RÉFORME PROPOSÉE : L’EXTENSION DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ AUX BINATIONAUX NÉS FRANÇAIS
Le 16 novembre 2015, trois jours après les attentats ayant endeuillé notre pays, le Président de la République a déclaré devant le Parlement réuni en Congrès en application de l’article 18 de la Constitution : « nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, je dis bien "même s’il est né français" dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité ».
Afin de mettre en œuvre cet engagement, le présent article vise à habiliter le législateur à étendre la procédure de déchéance de la nationalité aux Français de naissance disposant d’une autre nationalité, en cas de condamnation pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation. Une loi ordinaire pourra ensuite définir la liste des crimes concernés et la procédure applicable.
Suivant l’avis du Conseil d’État du 11 décembre 2015 sur le présent projet de loi constitutionnelle (105), il est proposé de modifier l’article 34 de la Constitution, qui définit le champ de compétence du législateur :
– alors que son troisième alinéa prévoit aujourd’hui que la loi fixe les règles concernant « la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités », le 1° du présent article tend à le remplacer par des dispositions selon lesquelles la loi fixe les règles concernant « la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation » ;
– en conséquence, le 2° du présent article tend à déplacer, dans un nouvel alinéa de l’article 34, les dispositions relatives à la compétence législative en matière d’état et de capacité des personnes, de régimes matrimoniaux, de successions et de libéralités.
A. LA NÉCESSITÉ DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
La nécessité d’une révision constitutionnelle a parfois été contestée, au motif qu’il serait possible de prévoir la déchéance de la nationalité de Français de naissance par une simple loi ordinaire – qui, par exemple, se bornerait à élargir le champ d’application des articles 25 et 25-1 du code civil déjà évoqués.
Cette analyse n’est partagée ni par le Gouvernement, ni par le Conseil d’État.
À plusieurs reprises, le Gouvernement a considéré que la déchéance de la nationalité de Français d’origine se heurterait à une probable censure du Conseil constitutionnel.
En 2014, lors de la discussion à l’Assemblée nationale de la proposition de loi présentée par M. Philippe Meunier visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police, Mme Pascale Boistard, Secrétaire d’État chargée des droits des femmes, avait déclaré qu’une « déchéance prononcée à l’encontre d’une personne née française serait immanquablement jugée disproportionnée par le Conseil constitutionnel » (106). En 2015, au cours des débats sur la proposition de loi du même auteur visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité, Mme Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du numérique, avait estimé : « Une perte de nationalité prononcée à l’encontre d’une personne née française risque fort d’être jugée disproportionnée par le Conseil constitutionnel » (107).
Rien ne garantit effectivement qu’une sanction jugée non manifestement disproportionnée pour un Français par acquisition (108) serait appréciée de la même façon pour un Français de naissance. Dans ce second cas, aucune condition de délai – semblable aux dix ou quinze ans pendant lesquels l’État peut revenir sur la nationalité acquise – ne peut être fixée : un Français de naissance pourrait être déchu de sa nationalité à tout moment de sa vie. D’une manière plus générale, les mesures relatives à la nationalité sont contrôlées avec une particulière vigilance : en 1993, le Conseil constitutionnel a jugé que la perte du droit à l’acquisition de la nationalité française qui résulterait soit d’un arrêté de reconduite à la frontière, soit d’un arrêté d’assignation, « apparaît comme une sanction manifestement disproportionnée par rapport aux faits susceptibles de motiver de telles mesures en méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 » (109).
Confirmant l’analyse du Gouvernement, le Conseil d’État, dans son avis du 11 décembre 2015 précité, « considère que si devait être instituée la déchéance de la nationalité française pour des binationaux condamnés pour des faits de terrorisme, le principe de cette mesure devrait être inscrit dans la Constitution, eu égard au risque d’inconstitutionnalité qui pèserait sur une loi ordinaire ».
D’une part, une telle mesure pourrait se heurter à « un éventuel principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant de priver les Français de naissance de leur nationalité ».
Quoique cette question ne soit pas davantage développée dans l’avis du Conseil d’État – seul le Conseil constitutionnel étant en mesure de la trancher (110) –, on peut constater que la législation républicaine a généralement exclu les Français de naissance d’une possible déchéance de leur nationalité. La loi du 7 avril 1915 autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d’anciens sujets de puissances en guerre avec la France, puis la loi du 18 juin 1917 la modifiant, permettaient la déchéance des seuls Français naturalisés. Quoique le champ des personnes visées ait été élargi par la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, cette dernière ne concernait que les Français par acquisition. Il en va de même du décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.
En sens inverse, le décret-loi du 9 septembre 1939 modifiant les dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française a élargi – pour une période temporaire, mais dont le terme n’était pas fixé – cette procédure à tous les Français, y compris ceux de naissance et ne disposant pas d’une autre nationalité : était concerné « tout Français qui se sera comporté comme le ressortissant d’une puissance étrangère ». C’est en application de ce texte qu’ont, par exemple, été déchus de leur nationalité française les deux députés communistes André Marty et Maurice Thorez, par décrets du 27 janvier et du 17 février 1940.
L’incertitude sur l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République s’accroît davantage si l’on prend en compte, non seulement les cas de déchéance stricto sensu, mais aussi les cas de perte de la nationalité française, lesquels ont toujours pu concerner des personnes nées françaises (111).
Enfin, il convient de signaler que le Conseil constitutionnel a déjà refusé de consacrer un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit de la nationalité : alors que les requérants entendaient voir ainsi qualifié le principe selon lequel « la naissance en France assortie le cas échéant de conditions d’âge et de résidence doit ouvrir droit de manière automatique à cette nationalité », le Conseil constitutionnel a jugé qu’un tel principe – pourtant affirmé en 1851, puis confirmé en 1874, 1889 et 1927 – n’avait pas de valeur constitutionnelle (112).
D’autre part, le second argument invoqué par le Conseil d’État, à l’appui de la nécessité de la présente révision constitutionnelle, rejoint celui avancé par le Gouvernement, à savoir le risque d’une disproportion excessive entre la gravité des faits en cause et la sévérité de la sanction : « la nationalité française représente dès la naissance un élément constitutif de la personne. Elle confère à son titulaire des droits fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait être regardée comme une atteinte excessive et disproportionnée à ces droits, qui, par suite, serait inconstitutionnelle. La mesure envisagée par le Gouvernement poserait, en particulier, la question de sa conformité au principe de la garantie des droits proclamé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ».
Personne n’est aujourd’hui en mesure de trancher ce débat juridique – pour la simple raison que le Conseil constitutionnel n’a jamais eu à en connaître (113). Il est impossible d’affirmer de façon indubitable qu’une loi permettant la déchéance de la nationalité d’une personne née française ne pose aucune question de constitutionnalité, comme il est impossible de certifier qu’une telle loi serait nécessairement censurée par le Conseil constitutionnel. Compte tenu de ce niveau d’incertitude, le chef de l’État et le Premier ministre ont pris leurs responsabilités, en proposant la voie procédurale la plus sûre, celle qui prémunit la réforme contre tout risque juridique : l’appel au pouvoir constituant.
B. LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ
Le présent article s’applique à « toute personne née française qui détient une autre nationalité ».
1. Une personne née française
L’objet du présent article est de pouvoir déchoir de leur nationalité des Français de naissance, en raison de la particulière gravité des crimes qu’ils ont commis, alors que cette possibilité n’existe aujourd’hui, aux articles 25 et 25-1 du code civil, que pour les Français par acquisition (114).
Classique en droit de la nationalité, cette distinction entre Français de naissance – ou Français d’origine – et Français par acquisition figure au titre Ierbis du code civil, dont le chapitre II est consacré à « la nationalité française d’origine » et le chapitre III à « l’acquisition de la nationalité française ».
Une personne « née française », au sens du présent article, est une personne disposant de la nationalité française dès sa naissance, quelle qu’en soit la cause.
Il s’agit principalement :
– des personnes nées françaises par filiation, parce qu’au moins l’un de leurs parents est français, en application du « droit du sang » consacré à l’article 18 du code civil (quel que soit le lieu de la naissance). Relèvent également de ce cas de figure les personnes réputées avoir été françaises depuis leur naissance, par exemple à la suite d’une adoption plénière (article 20 du code civil) ;
– des personnes nées françaises parce qu’elles sont nées en France et que l’un de leurs parents est lui-même né en France, en application du « double droit du sol », consacré à l’article 19-3 du code civil ;
– des personnes nées en France de parents apatrides ou de parents étrangers qui ne leur transmettent pas leur nationalité en raison de lois étrangères (article 19-1 du code civil). Il est toutefois peu probable, dans ce cas, que l’intéressé satisfasse à la seconde condition posée au présent article, à savoir disposer d’une autre nationalité – sauf à l’avoir acquise ultérieurement, par exemple par mariage avec un étranger.
À l’inverse, le présent article n’est pas applicable aux Français par acquisition, c’est-à-dire à ceux qui ont obtenu la nationalité française postérieurement à leur naissance. Sont concernés tous les modes d’acquisition :
– de plein droit, par exemple en application du « droit du sol simple » pour les enfants nés en France de parents étrangers (article 21-7 du code civil) (115) ou par le jeu de l’ « effet collectif » dont bénéficient les enfants mineurs d’un étranger qui acquiert la nationalité française (article 22-1) (116) ;
– par déclaration, notamment à la suite d’un mariage avec un Français (article 21-2) ou d’une adoption simple (article 21-12) ;
– par décision de l’autorité publique, en particulier par un décret de naturalisation (article 21-15).
Initialement, le projet de loi constitutionnelle soumis pour avis au Conseil d’État devait s’appliquer à tout Français ayant une autre nationalité, ce qui aurait englobé à la fois les Français de naissance et les Français par acquisition. Le Conseil d’État, suivi par le Gouvernement lors du dépôt du présent projet, a restreint la rédaction à la seule mention d’une « personne née française », considérant probablement que la situation des Français par acquisition n’appelait pas de disposition constitutionnelle, la déchéance de leur nationalité étant déjà possible en application de l’article 25 du code civil (117). Le présent article ne leur est donc pas applicable et n’a pas pour objet de revenir sur les règles en vigueur.
2. Une personne qui détient une autre nationalité
L’extension de la déchéance de la nationalité prévue au présent article concerne une personne née française « qui détient une autre nationalité » – peu importe qu’elle en dispose depuis sa naissance (118) ou qu’elle l’ait acquise postérieurement (par exemple par mariage avec un étranger).
Cette condition a été posée par le chef de l’État dès le 16 novembre 2015 : « la déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu’un apatride ». La nouvelle procédure ne pourra ainsi s’appliquer qu’à une personne binationale ou plurinationale.
Certes, juridiquement, aucun engagement international n’empêche la France de rendre un individu apatride (voir l’encadré ci-après). Pour autant, la limitation des cas d’apatridie est un objectif poursuivi par plusieurs conventions signées par la France, même si elle ne les a pas toutes ratifiées. Cet objectif a d’ailleurs justifié la modification de l’article 25 du code civil par la loi du 16 mars 1998 précitée, afin d’exclure que la déchéance de la nationalité d’un Français par acquisition puisse le rendre apatride (119).
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE EN MATIÈRE D’APATRIDIE
• La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 stipule en son article 15 : « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». Elle n’a cependant aucune valeur juridique : il s’agit d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies, qui n’a pas la dimension contraignante d’un traité international (Conseil d’État, 23 novembre 1984, Roujansky).
• La Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, entrée en vigueur le 6 juin 1960, signée par la France le 12 janvier 1955 puis ratifiée le 8 mars 1960, n’interdit pas aux États de créer des cas d’apatridie : elle vise à donner un statut aux apatrides n’ayant pas la qualité de réfugié – qui ne peuvent donc pas bénéficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (signée et ratifiée par la France). La Convention de 1954 n’interdit pas non plus l’expulsion d’apatrides. D’une part, son bénéfice peut être refusé « aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (…) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies » (article 1er). D’autre part, son article 31 stipule que « les États contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ».
• La Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961 a été signée par la France le 31 mai 1962, mais n’a pas été ratifiée. En tout état de cause, elle ne proscrit pas toute possibilité de déchéance de la nationalité, puisque le 3 de son article 8 stipule qu’ « un État contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité, s’il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs prévus à sa législation nationale à cette date et entrant dans les catégories suivantes :
« a) Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l’État contractant :
« i) a, au mépris d’une interdiction expresse de cet État, apporté ou continué d’apporter son concours à un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d’un autre État des émoluments, ou
« ii) a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ;
« b) Si un individu a prêté serment d’allégeance, ou a fait une déclaration formelle d’allégeance à un autre État, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l’État contractant ».
Au moment de la signature de cette Convention, le Gouvernement français a déclaré « qu’il se réserve d’user, lorsqu’il déposera l’instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte par l’article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition ».
• La Convention européenne sur la nationalité (n° 166) du Conseil de l’Europe du 6 novembre 1997 a été signée par la France le 4 juillet 2000, mais non ratifiée. Son article 7 permet à un État de « prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit » dans certaines hypothèses, notamment :
– en cas d’« acquisition de la nationalité de l’État partie à la suite d’une conduite frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d’un fait pertinent de la part du requérant » ;
– en cas de « comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État partie », hypothèse dans laquelle on peut probablement ranger les actes de terrorisme ;
– en l’« absence de tout lien effectif entre l’État partie et un ressortissant qui réside habituellement à l’étranger ».
Toutefois, ce même article interdit à l’État de prendre de telles mesures « si la personne concernée devient ainsi apatride », sauf dans le premier cas ci-dessus (retrait de naturalisation).
La jurisprudence constitutionnelle relative à l’apatridie, quant à elle, est d’une portée incertaine. En 1996, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’extension aux condamnations pour terrorisme de la procédure de déchéance de la nationalité, alors qu’elle n’excluait pas encore la création d’apatrides (120). En 2015, en revanche, le juge constitutionnel a relevé – sans que l’on sache si cette condition était nécessaire ou non – que l’article 25 du code civil ne permettait pas de rendre l’individu apatride, avant de conclure à l’absence de caractère disproportionné de cette mesure, au regard de l’article 8 de la Déclaration de 1789 (121).
Quoi qu’il en soit, le présent article conditionne le prononcé de la déchéance au fait que la personne visée dispose d’une autre nationalité, évitant ainsi la création d’apatrides.
En cas de contestation sur ce point, la jurisprudence du Conseil d’État considère aujourd’hui que c’est à l’intéressé qu’il appartient, à l’appui d’un recours contre le décret portant déchéance, de prouver qu’il a perdu sa nationalité antérieure à l’acquisition de la nationalité française (122).
C. LES MOTIFS DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ
Le présent article autorise la déchéance de la nationalité lorsque la personne concernée est « condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ».
Sans être directement reconnue au niveau constitutionnel, la notion d’ « atteinte grave à la vie de la Nation » peut être rapprochée :
– de l’ancien article 92 de la Constitution, abrogé en 1995, qui autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance, pendant les quatre premiers mois de la Ve République, les « mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la Nation » ;
– de l’exigence constitutionnelle de « continuité de la vie nationale » (123) ou de « continuité de la vie de la Nation » (124) dégagée par le Conseil constitutionnel ;
– des « exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation », consacrées en 2015 par le Conseil constitutionnel lors de l’examen de la loi relative au renseignement (125).
L’article 15 de la CEDH, par ailleurs, permet à un État de déroger à certaines des obligations de la Convention, « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation » – stipulations dont la France est susceptible d’invoquer le bénéfice à la suite des mesures prises après les attentats du 13 novembre 2015 (126).
Le code pénal, quant à lui, comporte un livre IV intitulé « Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique », qui inclut :
– les « atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » (titre Ier) ;
– le « terrorisme » (titre II) ;
– les « atteintes à l’autorité de l’État » (titre III) ;
– les « atteintes à la confiance publique » (titre IV).
Il reviendra au législateur ordinaire de préciser, sur le fondement de l’article 34 de la Constitution révisée, la liste des crimes constituant une « atteinte grave à la vie de la Nation ». Selon l’exposé des motifs du présent projet, qui reprend les termes de l’avis du Conseil d’État du 11 décembre 2015, « il ne pourrait s’agir que de crimes en matière de terrorisme et, éventuellement, des crimes les plus graves en matière d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » (127).
Le présent article aboutirait ainsi à créer une double différence entre le nouveau régime de déchéance de la nationalité propre aux Français de naissance et celui déjà applicable aux Français par acquisition, prévu aux articles 25 et 25-1 du code civil (128).
D’une part, la gravité des infractions justifiant la déchéance serait plus élevée s’agissant des Français de naissance : seule une condamnation pour crime serait de nature à motiver la déchéance, alors que l’article 25 du code civil prend aujourd’hui en compte les crimes comme les délits (129).
Ainsi, en application du présent article, la déchéance de la nationalité ne serait pas encourue, par exemple, à la suite de délits de financement d’une entreprise terroriste, de non-justification de ressources, de recrutement terroriste, de provocation au terrorisme, d’apologie du terrorisme ou d’entreprise terroriste individuelle (articles 421-2-2 à 421-6 du code pénal). En matière d’association de malfaiteurs, la qualification délictuelle ou criminelle est variable : le fait de diriger ou d’organiser le groupement est un crime, tandis que la simple participation est un délit – sauf s’il s’agit de préparer certaines infractions, notamment des crimes d’atteinte aux personnes (articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal).
D’autre part, le champ des infractions concernées serait plus réduit pour les Français de naissance, celui-ci ne couvrant ni nécessairement toutes les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, ni les atteintes à l’administration publique commise par une personne exerçant une fonction publique (130).
Cette double différence est la conséquence de la rédaction proposée par le Conseil d’État dans son avis précité, que le Gouvernement a reprise à son compte. Le texte initial ouvrait la possibilité de sanctionner toute personne ayant commis un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ou une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, reprenant ainsi les termes du 1° de l’article 25 du code civil. Le Conseil d’État a néanmoins considéré que « la plupart de ces infractions, notamment celles qui ne sont pas de nature criminelle, ne sauraient justifier une sanction aussi grave que la déchéance, laquelle pourrait être regardée comme étant disproportionnée. En conséquence, le Conseil d’État estime que la mesure envisagée ne devrait concerner que les seuls auteurs d’actes criminels les plus graves et non les auteurs de délits. Il estime par ailleurs, qu’il ne serait pas opportun d’introduire le terme "terrorisme" dans la Constitution et qu’il est par conséquent préférable de prévoir que la déchéance pourrait être infligée aux seules personnes "condamnées pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation" ».
Les deux tableaux ci-après, établis par votre rapporteur, rendent compte de la distinction entre crimes et délits en matière de terrorisme. Le premier porte sur les infractions de droit commun qui, par renvoi de l’article 421-1 du code pénal, sont qualifiées d’actes de terrorisme « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » et dont les peines sont alors aggravées dans les conditions prévues à l’article 421-3 du même code. Le second tableau porte sur les infractions terroristes autonomes, définies aux articles 421-2 à 421-2-6 et 421-4 à 421-6 du même code.
ACTES DE TERRORISME : CRIMES ET DÉLITS DÉRIVÉS DU DROIT COMMUN
Renvoi de l’article 421-1 du code pénal |
Infraction |
Qualification en matière de terrorisme |
Article du code pénal |
atteintes volontaires à la vie (1° de l’art. 421-1) |
meurtre et assassinat |
crime |
221-1 et s. |
empoisonnement |
crime |
221-5-1 | |
provocation non suivie d’effet à un assassinat ou à un empoisonnement |
crime |
221-5-1 | |
atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (1° de l’art. 421-1) |
torture et acte de barbarie |
crime |
222-1 et s. |
violences ou administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort |
crime |
222-7 et 222-15 | |
violences ou administration de substances nuisibles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente |
crime |
222-9 et 222-15 | |
violences ou administration de substances nuisibles ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours |
délit |
222-11 et 222-15 | |
violences ou administration de substances nuisibles ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou aucune incapacité de travail |
délit |
222-13 et 222-15 | |
violences habituelles sur personne vulnérable ou administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente |
crime |
222-14 et 222-15 | |
violences habituelles sur personne vulnérable ou administration de substances nuisibles ayant entraîné une ITT de plus de huit jours |
crime |
222-14 et 222-15 | |
violences habituelles sur personne vulnérable ou administration de substances nuisibles n’ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours |
délit |
222-14 et 222-15 | |
violences avec usage ou menace d’une arme commises en bande organisée ou avec guet-apens sur une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné la mort, une mutilation, une infirmité permanente ou une ITT pendant plus de huit jours |
crime |
222-14-1 et 222-15 | |
violences avec arme commises en bande organisée ou avec guet-apens ou administration de substances nuisibles sur une personne dépositaire de l’autorité publique n’ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours |
crime |
222-14-1 et 222-15 | |
participation à un groupement préparant des violences volontaires contre les personnes, des destructions ou dégradations de biens |
délit |
222-14-2 | |
manœuvres dolosives en vue de contraindre à un mariage ou à une union à l’étranger en vue de déterminer une personne à quitter le territoire |
délit |
222-14-4 | |
embuscade |
délit |
222-15-1 | |
appels téléphoniques, messages malveillants et agressions sonores |
délit |
222-16 | |
menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes |
délit |
222-17 et s. | |
enlèvement et séquestration (1° de l’art. 421-1) |
enlèvement et séquestration |
crime |
224-1 |
enlèvement et séquestration avec libération volontaire avant sept jours |
délit |
224-1 | |
enlèvement et séquestration avec mutilation, infirmité permanente, tortures ou actes de barbarie |
crime |
224-2 | |
enlèvement et séquestration de plusieurs personnes |
crime |
224-3 | |
enlèvement et séquestration de plusieurs personnes avec libération volontaire avant sept jours |
crime |
224-3 | |
enlèvement et séquestration comme otage |
crime |
224-4 | |
enlèvement et séquestration comme otage avec libération volontaire avant sept jours |
crime |
224-3 | |
détournement d’un moyen de transport (1° de l’art. 421-1) |
détournement d’un aéronef, d’un navire ou de tout autre moyen de transport |
crime |
224-6 et s. |
compromission de la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire |
délit |
224-8 | |
vols (2° de l’art. 421-1) |
vol et vols aggravés |
délit |
311-3 et s. |
autres vols aggravés |
crime |
311-4, 311-4-1, 311-4-2 | |
vol avec violences sur autrui ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours |
crime |
311-6 | |
vol avec violences sur autrui ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente |
crime |
311-7 | |
vol avec arme |
crime |
311-8 | |
vol en bande organisée |
crime |
311-9 | |
vol avec violences ayant entraîné la mort ou avec tortures et actes de barbarie |
crime |
311-10 | |
extorsions (2° de l’art. 421-1) |
extorsion simple |
délit |
312-1 |
extorsion aggravée |
crime |
312-2 | |
extorsion avec violence sur autrui, arme ou en bande organisée |
crime |
312-4 à 312-6 | |
destructions, dégradations et détériorations (2° de l’art. 421-1) |
destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes |
délit |
322-1 et s. |
destruction, dégradation et détérioration de certains biens culturels commises par plusieurs personnes |
crime |
322-3-1 | |
destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes |
délit |
322-5 et 322-6-1 | |
destruction, dégradation et détérioration en violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ayant entraîné la mort |
crime |
322-5 | |
destruction, dégradation et détérioration par substance explosive, incendie ou autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes |
crime |
322-6 | |
destruction, dégradation et détérioration par incendie de bois ou forêt |
crime |
322-6 | |
destruction, dégradation et détérioration par substance explosive, incendie ou autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, avec circonstances aggravantes |
crime |
322-7 à 322-10 | |
détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de certaines infractions |
délit |
322-11-1 | |
détention et transport, en bande organisée, de substances ou produits incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de certaines infractions |
crime |
322-11-1 | |
menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes |
délit |
322-12 et s. | |
infractions en matière informatique (2° de l’art. 421-1) |
atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données |
délit |
323-1 et s. |
atteinte en bande organisée et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État |
crime |
323-4-1 | |
groupes de combat et mouvements dissous (3° de l’art. 421-1) |
organisation et participation à un groupe de combat ou à un mouvement dissous |
délit |
431-13 et s. |
autres infractions (3° de l’art. 421-1) |
fourniture à un terroriste d’un logement, de subsides ou de tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation |
délit |
434-6 |
faux |
délit |
441-2, 441-3 et 441-5 | |
faux et usage de faux en écriture publique |
crime |
441-4 | |
faux et usage de faux en écriture publique par une personne dépositaire de l’autorité publique |
crime |
441-4 | |
autres infractions (4° de l’art. 421-1) |
infractions en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires |
crime |
L. 1333-9 (I), L. 1333-11 et L. 1333-13-2 c. défense |
provocation non suivie d’effet à une infraction en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires |
délit |
L. 1333-13-2 c. défense | |
infractions en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires en bande organisée |
crime |
L. 1333-13-3 (II) c. défense | |
infractions visant à se doter d’une arme nucléaire |
crime |
L. 1333-13-4 (II) c. défense | |
provocation non suivie d’effet à certaines infractions en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires |
délit |
L. 1333-13-6 c. défense | |
fabrication et commerce de matériels de guerre, armes et munitions |
délit |
L. 2339-2 c. défense | |
fabrication et commerce de matériels de guerre, armes et munitions en bande organisée |
crime |
L. 2339-2 c. défense | |
fabrication et commerce de vecteurs d’armes de destruction massive |
crime |
L. 2339-14 c. défense | |
délivrance indue d’agréments en matière de vecteurs d’armes de destruction massive |
délit |
L. 2339-16 c. défense | |
infractions en matière d’armes biologiques ou à base de toxines |
crime |
L. 2341-1, L. 2341-4 et L. 2341-5 c. défense | |
provocation non suivie d’effet à une infraction en matière d’armes biologiques ou à base de toxines |
délit |
L. 2341-5 c. défense | |
infractions en matière d’armes chimiques |
crime |
L. 2342-57 à L. 2342-61 c. défense | |
provocation non suivie d’effet à une infraction en matière d’armes chimiques |
délit |
L. 2342-61 c. défense | |
infractions en matière d’armes chimiques anciennes ou abandonnées |
délit |
L. 2342-62 c. défense | |
fabrication d’explosifs |
délit |
L. 2353-4 c. défense | |
fabrication d’explosifs en bande organisée |
crime |
L. 2353-4 c. défense | |
commerce d’explosifs |
délit |
L. 2353-5 (1°) c. défense | |
acquisition, détention, transport et port illégal de produits ou d’engins explosifs |
délit |
L. 2353-13 c. défense | |
infractions en matière d’armes et de munitions |
délit |
L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 c. sécurité intérieure | |
infractions en matière d’armes et de munitions en bande organisée ou avec circonstances aggravantes |
crime |
L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 c. sécurité intérieure | |
autres infractions (5° de l’art. 421-1) |
recel du produit d’une des infractions qui précèdent |
délit |
321-1 |
recel du produit d’une des infractions qui précèdent, commis de façon habituelle, en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou en bande organisée |
crime |
321-2 | |
autres infractions (6° de l’art. 421-1) |
blanchiment |
délit |
324-1 |
blanchiment commis de façon habituelle, en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou en bande organisée |
crime |
324-3 | |
autres infractions (7° de l’art. 421-1) |
délit d’initié |
délit |
L. 465-1 c. monétaire et financier |
N.B. : dans la troisième colonne, le mot : « crime » est signalé en gras lorsque cette qualification est la conséquence de l’aggravation des peines en matière de terrorisme, en application de l’article 421-3 du code pénal (l’infraction en cause n’étant qu’un délit en droit commun).
ACTES DE TERRORISME : CRIMES ET DÉLITS AUTONOMES
Infraction |
Type |
Fondement dans le code pénal |
Terrorisme écologique |
crime |
art. 421-2 et 421-4 |
Association de malfaiteurs (cas général) |
délit |
art. 421-2-1 et 421-5 |
Direction ou organisation d’une association de malfaiteurs |
crime |
art. 421-2-1 et 421-5 |
Association de malfaiteurs préparant certaines infractions |
crime |
art. 421-2-1 et 421-6 |
Non-justification de ressources |
délit |
art. 421-2-3 |
Recrutement terroriste |
délit |
art. 421-2-4 |
Provocation et apologie du terrorisme |
délit |
art. 421-2-5 |
Entreprise terroriste individuelle |
délit |
art. 421-2-6 et 421-5 |
D. LA MISE EN œUVRE DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ
1. La procédure
Le présent article se borne à habiliter le législateur à définir « les conditions dans lesquelles » pourront être déchus de leur nationalité les individus concernés. La déchéance pourrait donc tout aussi bien être prononcée par un juge que par le pouvoir exécutif.
Toutefois, la référence, dans l’exposé des motifs, à « l’élargissement des cas de déchéance de nationalité » déjà prévus dans le code civil, suggère que la volonté gouvernementale est de voir la déchéance décidée, comme aujourd’hui, par l’autorité administrative – probablement par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, au terme de la procédure déjà décrite, définie à l’article 61 du décret du 30 décembre 1993 précité.
De plus, l’exposé des motifs indique que la déchéance de la nationalité française ne serait possible qu’en cas de condamnation « définitive », c’est-à-dire une fois les voies de recours épuisées. Si cette condition – qui ne se conçoit que pour un prononcé par décret – ne figure pas explicitement au présent article (131), elle n’est pas davantage mentionnée aujourd’hui aux articles 25 et 25-1 du code civil, sans empêcher son respect en pratique. D’une part, l’exigence du caractère définitif de la condamnation est la raison d’être de la longueur du délai maximal
– dix ans en général, quinze en matière de terrorisme ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation – pendant lequel la déchéance peut, à compter de la perpétration des faits, être prononcée. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un projet de décret portant déchéance de la nationalité (ou d’un recours contre un tel décret), le Conseil d’État vérifie que la condamnation pénale a bien acquis un caractère définitif.
Précisons enfin que, comme aujourd’hui pour les Français par acquisition, la déchéance serait possible même au cas où la condamnation pénale aurait été prononcée avec sursis.
2. L’application dans le temps
Le dispositif de déchéance que le législateur est autorisé à mettre en place par le présent article ne vaudrait que pour l’avenir : ne pourront être visés que les auteurs condamnés pour des crimes commis après l’entrée en vigueur de la future loi ordinaire.
En effet, quoique les lois nouvelles relatives à l’acquisition ou à la perte de la nationalité soient en principe d’application immédiate, conformément à l’article 17-2 du code civil (132), tel ne saurait être le cas en l’espèce, la déchéance de la nationalité apparaissant comme une sanction, soumise comme telle au principe constitutionnel de non-rétroactivité.
Dans sa décision précitée du 23 janvier 2015, Ahmed S., le Conseil constitutionnel a ainsi clairement placé l’actuel dispositif de déchéance de la nationalité dans le champ des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789, selon lequel « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le juge constitutionnel précise que « les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition », y compris donc à la déchéance de la nationalité – fût-elle décidée par décret (133).
3. Les effets
À l’instar du dispositif applicable aux Français par acquisition (134), la déchéance de la nationalité d’un Français de naissance aurait un effet strictement individuel (sans s’étendre au conjoint et aux enfants) et limité à l’avenir (sans remise en cause de la validité des actes accomplis en tant que Français avant son prononcé).
Devenu étranger, l’intéressé perdrait tous les droits réservés aux Français, en particulier les droits de vote et d’éligibilité, ainsi que le droit d’accéder à certains emplois publics ou réglementés. Il en irait de même pour un individu qui disposerait de la nationalité d’un autre État membre de l’Union européenne : un Franco-Italien déchu de la nationalité française ne pourrait se prévaloir de sa qualité de citoyen de l’Union européenne (tenant à sa nationalité italienne) pour voter en France aux élections municipales et européennes ou pour intégrer la fonction publique française.
La personne déchue de la nationalité française perdrait également le droit de ne pas pouvoir être extradée, expulsée ou interdite du territoire français. En particulier, elle ne pourrait plus se prévaloir de l’article 3 du Protocole n° 4 à la CEDH (135), qui dispose que « nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant » et que « nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant » (136).
À cet égard, l’exposé des motifs du présent projet indique que la déchéance permettra « de procéder à l’éloignement durable du territoire de la République, par la voie de l’expulsion, des personnes dont le caractère dangereux est avéré par la condamnation définitive dont elles ont fait l’objet et à interdire leur retour sur le territoire ». Lors de la présentation de la présente réforme, le Premier ministre a précisé que « c’est seulement à l’expiration de leur peine » que les auteurs d’un crime terroriste feraient l’objet de mesures d’éloignement (137).
Certaines de ces mesures seront parfois susceptibles de se heurter aux limites habituelles en matière d’éloignement, telle que l’impossibilité d’expulser un étranger – fût-il un terroriste – dans un État où il pourrait être exposé à des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 3 de la CEDH, ou pour lequel l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale serait jugée excessive. En témoigne l’arrêt de la CEDH du 3 décembre 2009, Daoudi c. France (n° 19576/08), rendu à propos d’un ressortissant franco-algérien, déchu de la nationalité française après avoir été condamné pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme : la Cour juge que « dans les circonstances particulières de l’espèce, des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir le requérant subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Algérie » et que « la décision de renvoyer l’intéressé vers l’Algérie emporterait violation de l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution ».
Dans des cas de ce type, des mesures de sûreté pourraient cependant être prises, par exemple une assignation à résidence (138), éventuellement assortie d’une surveillance électronique (sous réserve de l’accord de l’intéressé) (139) ou d’une interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes entretenant des liens avec le terrorisme (140).
III. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS
Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement présenté par le Gouvernement modifiant le présent article, aux termes duquel l’article 34 de la Constitution habiliterait la loi à fixer « les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ».
Cette nouvelle rédaction diffère en plusieurs points du texte figurant dans le projet de loi.
En premier lieu, il ne serait plus fait mention d’une personne « née française ». Le législateur ordinaire pourra ainsi définir un régime juridique de déchéance de la nationalité commun aux Français de naissance et aux Français par acquisition.
En deuxième lieu, aucune référence à la binationalité ne serait introduite dans la Constitution, les mots « qui détient une autre nationalité » étant supprimés.
En troisième lieu, les infractions pouvant justifier la procédure de déchéance pourraient être des crimes, mais aussi certains délits. Aujourd’hui, comme on l’a vu, les délits constituant un acte de terrorisme ou une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation peuvent déjà motiver la déchéance de la nationalité d’un Français par acquisition (1° de l’article 25 du code civil) (141). Si le législateur ordinaire en décidait ainsi, pourraient par exemple être concernés les délits d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1 du code pénal) (142), de non-justification de ressources (article 421-2-3 du même code), de recrutement terroriste (article 421-2-4), de provocation et d’apologie du terrorisme (article 421-2-5), d’entreprise terroriste individuelle (article 421-2-6). Il en irait de même des délits de droit commun considérés comme des actes de terrorisme, car commis dans un but terroriste (au sens de l’article 421-1), ainsi que des délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (au sens des articles 410-1 et suivants).
En dernier lieu, l’amendement du Gouvernement adopté par votre Commission introduit la possibilité d’une déchéance « des droits attachés » à la nationalité. Une telle sanction, alternative à la déchéance de la nationalité elle-même, pourrait être appliquée à tout citoyen, sans risque de créer des cas d’apatridie. Les droits en question sont ceux dont les titulaires ne peuvent être que des citoyens français, en particulier les droits de vote et d’éligibilité, ainsi que le droit d’accéder à certains emplois publics ou réglementés.
Votre rapporteur souligne, par ailleurs, que le texte adopté par la Commission ne tranche pas la question de l’autorité compétente pour prononcer la déchéance. Il reviendrait à la loi ordinaire de déterminer s’il doit s’agir d’une décision administrative (par exemple un décret après avis conforme du Conseil d’État) ou d’une peine complémentaire prononcée par le juge pénal. Cette seconde solution a la préférence de votre rapporteur, dans la mesure où elle permettrait une meilleure individualisation de la sanction.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques CL1 de Mme Cécile Duflot et CL65 de M. Jean-Marc Germain, tendant à supprimer l’article.
Mme Cécile Duflot. Je ne reprendrai pas tout le débat ouvert sur la déchéance de nationalité. On peut évidemment dire et redire que seuls sont visés par cet article les terroristes ou ceux qui envisageraient de commettre un acte terroriste. Mais on peut aussi rappeler qu’une telle disposition ne les empêcherait absolument pas de commettre un tel acte. On pourrait même penser que la création de fait d’une forme de brevet ou de reconnaissance d’actes terroristes présenterait un attrait pour ceux qui s’inscrivent dans cette logique folle, meurtrière et symbolique. Nous n’avons pas encore débattu de la notion d’indignité nationale mais celle-ci pourrait également, dans cette logique inversée, constituer une forme d’encouragement morbide. Je veux donc dire à quel point nous sommes opposés à une telle mesure.
Je m’interroge aussi fortement quant à la nouvelle rédaction de l’article 2 qui nous a été proposée hier lorsque le Premier ministre a présenté le projet de loi. Le Gouvernement fait preuve d’habileté tactique en proposant de retirer la référence à la binationalité qui figurait dans la rédaction initiale de l’article 2 et en annonçant son intention de ratifier la Convention de New York du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Je rappelle que l’article 7.3 de la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 stipule qu’un État partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité si la personne concernée devient ainsi apatride. La France est signataire de cette Convention, mais certains objectent qu’elle ne l’a pas ratifiée.
Soit dit en passant, la non-ratification de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie nous renvoie à un moment difficile de l’histoire de France, et il n’est pas anecdotique que nous ayons ce débat en ce moment. En revanche, l’article 27 de la Convention européenne sur la nationalité prévoit précisément que la signature de celle-ci vaut consentement si aucune réserve n’est émise par l’État signataire. La France n’ayant émis aucune réserve à sa signature, l’application de cette dernière est obligatoire.
Par ailleurs, l’annonce de la ratification de la Convention de 1961, signal positif en faveur de la lutte contre l’apatridie, signifie a contrario que la déchéance de nationalité ne sera applicable qu’aux binationaux. La nouvelle rédaction de l’article 2 proposée par le Gouvernement permet donc deux lectures : la lecture « large » faite par le Gouvernement, selon laquelle la déchéance serait permise dans la Constitution mais réservée aux seuls binationaux du fait de la ratification de la Convention de 1961 – de sorte que l’amendement gouvernemental ne changerait rien au projet de loi initial si ce n’est que la notion de binationalité serait retirée du texte ; une lecture plus restrictive, selon laquelle cette réforme n’aurait aucun effet utile dans cette nouvelle rédaction puisque l’article 1er de la Constitution dispose que « les Français naissent et demeurent libres et égaux en droits » – ce qui protégerait tous les Français, binationaux ou non, leur déchéance demeurant impossible.
Je comprends que l’on essaie de trouver des compromis, voire des habiletés d’habillage, pour respecter les sensibilités des uns et des autres. Mais ce n’est guère responsable lorsqu’il s’agit de réviser la Constitution.
Sur un plan plus secondaire, l’élargissement de la déchéance de nationalité aux délits me semble considérable d’autant que la qualification des délits n’est pas précisée. Elle le serait certes dans la loi ordinaire, mais vous savez à quel point il est facile de modifier des textes législatifs. On ouvre donc la voie à la surenchère. On se souvient des débats ayant eu lieu dans des moments d’émotion concernant les condamnations pour apologie du terrorisme : certains ont proposé des condamnations à des peines invraisemblables au regard des faits constatés. Cet élargissement pourrait nous mener à une situation extrêmement préjudiciable. Soit ce qui apparaît comme un compromis n’en est pas un, auquel cas ce n’est pas honnête, soit ce compromis nous fait revenir au droit actuel, auquel cas il n’y a pas besoin de réviser la Constitution.
M. Jean-Marc Germain. Je voudrais, sur cette question essentielle, m’adresser à mes collègues de l’opposition. À gauche, nous sommes tous d’accord, je le crois, pour dire que le juste symbole à adresser aux terroristes ne concerne en rien la nationalité – que l’on acquiert par le sang de ses parents ou par le sol sur lequel on naît, et que, par conséquent, l’on ne choisit pas. Le symbole que l’on doit viser est celui auquel les terroristes se sont attaqués en janvier puis en décembre : celui de la liberté de la presse, de l’égalité, garantie par les forces de l’ordre par le biais des policiers, et de la fraternité – puisque des Juifs ont été spécifiquement ciblés. C’est aux valeurs de la République française que les terroristes se sont attaqués, valeurs auxquelles on adhère en étant citoyen français. C’est pourquoi nous pourrions tous à gauche nous rassembler autour de la notion de déchéance de citoyenneté.
Si nous en sommes arrivés à faire cette proposition, c’est que nous voulons l’unité nationale, parce que nous pensons que, face au terrorisme, cette unité est essentielle. L’unité nationale ne consiste pas pour nous à reprendre des idées qui sont celles de certains d’entre vous depuis longtemps – certains mais pas tous, d’ailleurs, et je salue les positions courageuses de notre collègue Patrick Devedjian –, mais à ce que chacun fasse un pas vers l’autre. C’est ce que je propose avec cet amendement de suppression et mes deux sous-amendements à l’amendement du Gouvernement. Je suis prêt à accepter que nous étendions aux délits ce qui, aujourd’hui, est prévu dans le texte pour les crimes. Mais je vous demande de faire le pas – qui correspond à ce que beaucoup d’entre vous souhaitent – de considérer que le bon symbole n’est pas la déchéance de nationalité mais la déchéance de citoyenneté. Si vous le faites, il y aura unité nationale et je suis convaincu que le Gouvernement comme le Président de la République pourront reprendre cette position.
M. François de Rugy. S’il était question de savoir si chacun d’entre nous, aurait pris, à titre individuel, l’initiative de réviser la Constitution sur ce point, je puis vous dire que ce n’est pas mon cas. Mais le Président de la République en a décidé ainsi le 16 novembre devant le Parlement réuni en Congrès, dans un souci d’union nationale.
Dès lors, quels sont le contenu et la portée réels de cette révision de la Constitution ? De mon point de vue, cette portée est très limitée même si, dès que l’on touche à la question de la nationalité, cela suscite des débats – plus intellectuels que populaires d’ailleurs. Je ne suis pas contre l’article 2 – a fortiori dans la nouvelle rédaction présentée hier par le Premier ministre, qui ne fait plus spécifiquement référence aux binationaux. J’ai dit tout à l’heure qu’il me semblait en effet regrettable d’aborder pour la première fois dans notre Constitution la question de la plurinationalité sous le seul angle de son éventuelle déchéance.
La France, dans ces circonstances, se défend, et c’est normal. Si les Français sont, avec beaucoup de bon sens, très majoritairement favorables à cette mesure, c’est parce qu’ils en voient la portée symbolique. Tout le monde s’accordait pour dire après le 13 novembre, sans doute encore davantage qu’après les attentats de janvier 2015, que le terrorisme visait la destruction de nos valeurs démocratiques – non seulement le terrorisme que nous avons à subir depuis plus d’un an mais aussi des formes de terrorisme s’appuyant sur d’autres idéologies.
D’aucuns objectent que la mesure n’aura pas d’effet dissuasif sur le terrorisme. Mais, à ce compte-là, nous ne prévoirions pas de peines de prison ! La plupart des sanctions en vigueur s’appliquent a posteriori, une fois les crimes commis – et c’est heureux. Ayant essayé, dans la loi relative à l’état d’urgence, d’introduire des mesures visant à prévenir la commission de certains actes, nous avons bien vu à quel point c’était compliqué. La peur d’écoper d’une peine de prison n’a pas d’effet dissuasif mais nous prenons une telle sanction parce que c’est, pour la société, une façon de se défendre et de montrer qu’elle sanctionne certains comportements. Il ne s’agit pas d’une mesure générale : sont très clairement ciblées ici les atteintes graves à la vie de la nation, dont le terrorisme.
Le droit du sol n’est nullement remis en cause par cet article. Ceux qui entretiennent cette idée propagent une contre-vérité. Le droit du sol est l’acquisition de la nationalité par la naissance, ou le séjour pendant un certain nombre d’années, sur le sol français. Le texte ne remet nullement en cause la binationalité ni la plurinationalité. La Constitution ne les a d’ailleurs jamais prévues ni interdites. On ne sait même pas combien il y a de plurinationaux dans notre pays, les chiffres variant de 1,5 à 3,5 millions. J’étais pour que l’on inscrive la notion de plurinationalité de manière positive dans la Constitution. Mais si on ne le fait pas, on ne peut pas dire a contrario que la plurinationalité soit remise en cause, a fortiori dans la nouvelle rédaction que le Premier ministre a présentée hier.
Pour conclure, je trouve insupportable que certains entretiennent ces idées fausses et fassent sans cesse des analogies historiques avec le régime du maréchal Pétain – qui n’ont d’autre but que d’empêcher le débat.
M. Sébastien Pietrasanta. L’amendement qui a été présenté par le Gouvernement – dont je salue d’ailleurs ici le sens de l’écoute et la volonté de rassembler le plus largement possible – est un pas en avant significatif. Il supprime toute référence à la binationalité et précise le périmètre des infractions pouvant entraîner la déchéance. Il couvre à la fois la déchéance de nationalité et celle des droits qui lui sont attachés.
Néanmoins, la loi devra préciser les modalités d’application de cette disposition. Comme Patrick Mennucci, je souscris à l’exigence d’encadrer précisément ces modalités. Aujourd’hui, l’article 25 du code civil prévoit qu’un individu peut être déchu de sa nationalité en raison d’un acte terroriste s’il a été naturalisé il y a moins de quinze ans avant sa condamnation définitive : il existe bel et bien dans cet article une distinction entre les binationaux nés français et les binationaux naturalisés depuis moins de quinze ans.
Il ne serait pas acceptable de modifier cet état d’esprit en permettant de déchoir de sa nationalité un binational né Français, sans quoi l’on créerait une rupture d’égalité entre ceux qui sont uniquement Français et ceux qui possèdent une autre nationalité. Ce serait remettre en cause l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Enfin, dans une société tourmentée, où certains cherchent à trier les fils et filles de France en fonction de l’origine de leurs parents, il ne faudrait pas alimenter ce discours prétendant qu’il y aurait de « vrais Français » et des « Français de papier ». Je serai donc particulièrement vigilant sur ce sujet.
M. Guillaume Larrivé. À ce stade de nos débats, je voterai contre les amendements de suppression de l’article 2 et ne prendrai pas part au vote de l’amendement du Gouvernement, pour les raisons suivantes.
Je voterai contre les amendements de suppression de l’article 2, car je suis favorable au principe de déchéance de la nationalité française pour les personnes condamnées pour crime ou délit portant gravement atteinte à la vie de la Nation.
Quant à l’amendement du Gouvernement, il suscite plusieurs interrogations qui doivent être levées avant le débat dans l’hémicycle. Peut-être certaines le seront-elles d’ailleurs par la communication qui nous sera faite, et que nous demandons, de l’avant-projet de loi d’application de cet article. Mais j’aurais une deuxième demande à l’endroit du rapporteur et du nouveau garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas : comment le Gouvernement interprète-t-il la suppression par amendement des mots « qui détient une autre nationalité » figurant dans le projet de loi constitutionnelle ? Nous sommes très nombreux ici à considérer que la création d’apatrides doit être totalement prohibée. L’amendement du Gouvernement n’interdit pas explicitement le retrait de la nationalité française à des personnes qui n’ont que celle-ci – à la différence du projet de loi initial. Dès lors, sans doute le permet-il. Bref, le texte constitutionnel nouveau, si l’amendement du Gouvernement était adopté, interdit-il ou non la création d’apatrides ?
Parallèlement, le Premier ministre nous a annoncé hier qu’il entendait présenter un projet de loi de ratification des Conventions de 1961 et de 1997 prohibant la création d’apatrides. La question qui nous est posée, à nous constituant potentiel, est celle de l’articulation entre la Constitution révisée et les conventions internationales qui seraient ratifiées en droit interne. L’article 54 de la Constitution dispose que si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. Je ne voudrais pas que l’adoption de l’amendement du Gouvernement nous mette dans une impasse où la Constitution, révisée conformément à l’amendement du Gouvernement, n’interdirait pas la création d’apatrides alors même qu’une loi de ratification serait votée pour l’interdire, car cette loi de ratification ne pourrait être adoptée sans révision de la Constitution alors que celle-ci viendrait tout juste d’être modifiée. Il y a là une vraie interrogation technique et juridique qui doit être levée par le rapporteur et par le ministre de la Justice.
J’ajoute que cet amendement, par construction, n’a fait l’objet d’aucune saisine du Conseil d’État et que les conditions dans lesquelles il a été préparé ne dissipent pas les interrogations qui subsistent. D’ici à la séance publique du 5 février, il est absolument nécessaire que le Gouvernement clarifie pleinement cette articulation.
M. Denis Baupin. Nous avons bien compris que l’objectif de l’article 2 était l’adoption d’une mesure emblématique plutôt qu’efficacement dissuasive, et bien noté aussi les évolutions du texte présenté hier par le Premier ministre en Commission, visant à prendre en compte les débats ayant eu lieu lors de la présentation du texte précédent.
Malgré tout, nous continuons de penser qu’aborder la question de la nationalité dans la Constitution ouvre une voie extrêmement dangereuse. Les différentes interventions que nous avons entendues ce matin montrent bien que nous ne maîtrisons pas complètement les conséquences que pourraient avoir cette révision constitutionnelle, sa loi d’application et l’éventuelle ratification de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Qui plus est, la proposition de déchéance de nationalité a animé le débat public de façon très significative au cours des dernières semaines.
Nous avons donc déposé l’amendement CL51 rectifié, qui a pour objet de remplacer la notion de déchéance de nationalité par celle de déchéance de citoyenneté. Cela permettrait de ne plus distinguer entre les personnes ayant une seule nationalité et celles qui en ont plusieurs. Dans notre amendement, nous n’avons pas précisé les conséquences qu’aurait la déchéance de citoyenneté sur les droits civiques, la possibilité d’accéder à la fonction publique ou celle d’obtenir un passeport : nous renvoyons cela à la loi ordinaire. Notre proposition pourrait réunir l’ensemble de ceux qui souhaitent l’adoption d’un symbole fort sans faire peser de risque sur la cohésion nationale.
M. René Dosière. La nouvelle rédaction de l’article 2 reçoit mon adhésion pour deux motifs. D’une part, parce qu’elle ne fait plus de distinction entre les personnes mais insiste davantage sur la sanction, applicable en cas d’atteinte à la vie de la Nation, qu’est la déchéance de nationalité. D’autre part, parce qu’en inscrivant dans la Constitution la possibilité de déchoir un Français de sa nationalité, nous retrouvons l’esprit et la pratique de nos anciens collègues de la Révolution française. Entre 1789 et 1799, période pendant laquelle la notion moderne de Nation s’est mise en place, ceux-ci ont en effet prévu – dans chacune des constitutions rédigées en 1791, 1793, 1795 et 1799 – que tout individu ayant porté atteinte à la nation pouvait, à l’issue d’un procès individuel, être exclu de la communauté nationale. Par conséquent, il n’y a rien de choquant à prévoir la déchéance de nationalité pour des gens qui veulent s’exclure d’eux-mêmes de la Nation. Cette tradition de la Révolution française est bien plus ancienne que les traditions républicaines dont on a pu faire état ici ou là, et qui remontent sans doute à la IIIe et à la IVe Républiques – dont les Constitutions ne disent mot de la déchéance de nationalité. La valeur de ces dispositions est beaucoup plus forte quand on fait plutôt référence à nos ancêtres.
M. Jean-Christophe Lagarde. Souvenons-nous d’abord que le principe de déchéance de nationalité a beaucoup évolué au cours de notre histoire pour répondre à des circonstances et à des volontés politiques différentes. Je mets évidemment de côté les déchéances collectives du régime de Vichy.
Rappelons-nous ensuite que nous sommes en train de rédiger la Constitution et que la loi ordinaire pourra évoluer par la suite au gré des majorités successives. Si je le dis, c’est qu’il est pour nous extrêmement important que la Constitution ne fasse pas de distinction entre Français – que ce soit entre mononationaux et binationaux ou autres. Une telle distinction figure déjà dans certaines lois, puisque l’on peut aujourd’hui être déchu de la nationalité française si l’on est Français par naturalisation depuis moins de quinze ans, mais, de grâce, n’en faisons pas autant dans la Constitution !
La nouvelle proposition présentée hier par le Premier ministre me semble correspondre à notre impérieuse exigence en la matière. Je pourrais d’autant moins voter un texte qui établirait une différence entre Français selon leur origine que nous nous accordons tous sur le fait que la déchéance de nationalité doit découler d’une décision judiciaire. Or, on ne saurait accorder un privilège judiciaire à un criminel en fonction de son ascendance : ce serait contraire à l’individualisation des peines et aux principes fondamentaux qui président à la justice telle que nous la concevons dans la République.
De ce fait, je ne comprends pas l’idée selon laquelle les conventions internationales seraient un point de blocage nous obligeant à faire une distinction entre Français. Les principes précités me paraissent bien plus essentiels que le problème de l’apatridie – apatridie dont je veux dire qu’elle doit naturellement être évitée, mais qu’elle existe et qu’elle n’est pas privative de tout droit. Il existe fort heureusement un statut international et un statut national des apatrides, ainsi qu’un Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il me paraît plus important de faire en sorte qu’il n’y ait aucune distinction entre les Français, que l’individualisation de la peine soit maintenue dans notre système judiciaire et que nous puissions respecter la hiérarchie des valeurs.
On a beaucoup parlé de la Convention de 1961. Je veux donc préciser que, si nous en décidons ainsi – et c’est mon souhait –, nous pouvons parfaitement traiter les Français de façon égale dans la Constitution et ratifier cette Convention tout en prévoyant, au moment de la ratification, que la France se réserve le droit de faire application de son article 8, paragraphe 3 a) ii, qui permet en effet de priver de nationalité un individu dès lors qu’il « a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ». Rien ne nous empêche de ratifier cette Convention, à condition que le Gouvernement s’engage à procéder à la réserve précitée.
Nous ne devons donc pas supprimer l’article 2, mais nous engager, puisque nous parlons d’unité nationale, dans un processus global et cohérent, allant jusqu’à la ratification de la Convention de 1961, sans quoi l’on pourrait penser qu’il y a derrière tout cela une manœuvre politique visant à gêner le déroulement de ce processus.
Enfin, l’amendement présenté hier par le Gouvernement, qui semble avoir été écrit un peu précipitamment, prévoit que l’on peut déchoir un individu de sa nationalité « ou des droits qui lui sont attachés ». Une telle formulation laisse planer l’idée qu’il pourrait y avoir une déchéance à deux vitesses en fonction de l’origine des Français. Une partie de nos concitoyens ont une seconde nationalité, parfois d’ailleurs contre leur souhait, par la seule volonté de l’État d’origine de leurs ascendants. Nous ne pouvons donc pas conserver cette formulation, qui fait peser le risque que l’interprétation de la loi ordinaire aboutisse à établir des différences entre Français.
M. Yves Goasdoué. Je me retrouve largement dans les interventions de nos collègues Rugy, Dosière et Lagarde. La question qui nous agite peut se résumer simplement : que souhaitent et que comprennent nos concitoyens ? Ils se disent que ceux qui ont déchiré eux-mêmes le lien national doivent être sanctionnés, y compris de façon infamante, et donc qu’on doit leur retirer une nationalité qu’ils vomissent et leur retirer les droits attachés à cette nationalité.
D’autre part, nos concitoyens estiment que nous devons prévoir ce dispositif pour tout le monde, indépendamment de la manière dont la personne concernée a acquis sa nationalité. Aussi je remercie le Gouvernement d’avoir retiré du texte initial la notion de binationalité ou de plurinationalité, au demeurant compliquée à définir. On a en effet souligné à juste titre que certains États sont prompts à réclamer des nationaux, les intéressés étant les premiers surpris de cette réclamation lorsqu’ils entrent, à l’occasion d’un voyage, sur le territoire dudit État.
Nous pouvons faire exactement ce que préconise Jean-Christophe Lagarde : dans le cadre de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, signée à New York en 1961, nous pouvons traiter l’ensemble de nos nationaux de la même manière parce que des réserves ont été déjà formulées,…
Mme Marie-Françoise Bechtel. Absolument !
M. Yves Goasdoué. …et parce que nous pouvons, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 3, de cette Convention, régler la difficulté à laquelle nous sommes confrontés.
Ensuite, pour ce qui est du périmètre des crimes et délits concernés, la formule « atteinte grave à la vie de la Nation » n’est pas très familière de notre droit. La jurisprudence, y compris celle du Conseil constitutionnel, se réfère plus à l’expression d’« atteinte aux intérêts supérieurs de la Nation ». L’utiliser ici préciserait l’atteinte que nous visons et qui est susceptible de déclencher des cas de déchéance de nationalité.
M. Philippe Houillon. Partons du principe que c’est l’amendement déposé ce matin par le Gouvernement qui a vocation à devenir l’article 2 du projet de loi constitutionnelle. Il concerne la déchéance de la nationalité et la déchéance des droits qui lui sont attachés.
L’exposé sommaire de l’amendement visant à récrire l’article m’inquiète quelque peu, puisqu’il restreint la déchéance « aux seuls actes de terrorisme et aux autres atteintes graves à la vie de la Nation, telle la trahison et des infractions de gravité équivalente ». Et d’ajouter : « La disposition couvre à la fois la déchéance de nationalité et celle des droits attachés à celle-ci. » Cela signifie que les dispositions en vigueur, figurant notamment dans le code civil et dans le code pénal, prévoyant la perte de nationalité, la déchéance de nationalité, la déchéance de droits attachés à la nationalité, si elles sont appliquées à l’occasion d’une infraction autre que celle visée par le texte tel qu’il est rédigé par le Gouvernement, se trouveront contraires à la Constitution. Aussi le texte gouvernemental conduit-il à réduire le périmètre de la protection : c’est donc une moins-value. Je dis cela sous réserve des dispositions du projet de loi d’application dont la communication nous a été promise par le Premier ministre d’ici à demain. J’y insiste : si l’on s’en tient à l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental, tout ce qui sortira du périmètre qu’il définit sera mécaniquement contraire à la Constitution.
Ensuite, il ne vous a pas échappé qu’une décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 2015 admet du bout des lèvres que l’on peut traiter différemment les binationaux. Le Conseil ne va toutefois pas jusqu’à admettre un traitement différencié entre binationaux. Nous ne pouvons donc prendre position tant que nous n’aurons pas le projet de loi d’application sous les yeux. En attendant, l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental laisse penser qu’on réduit le périmètre de la protection, ce qui serait inacceptable.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je constate avec satisfaction que le Gouvernement a accepté de retirer du texte de l’article 2 le critère de binationalité qui heurtait nombre d’entre nous. J’ai, depuis un certain temps, préconisé que l’on se borne à l’application de l’article 131-26 du code pénal prévoyant l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, qu’on pourrait rebaptiser « dégradation civique », pour reprendre une expression de l’ancien code pénal, et qui paraîtrait régler le problème de façon suffisante, sans que l’on se fonde sur un critère de nationalité ou sur une sanction la visant.
Cela dit, quelle que soit la satisfaction que l’on peut éprouver, cet article, dans sa nouvelle rédaction, n’est pas nécessaire puisqu’il revient à s’en remettre au droit positif en vigueur. Le fait que la Constitution ne prévoie rien en matière de déchéance de la nationalité n’a pas empêché le législateur, notamment en 1998, sous l’égide de Lionel Jospin et d’Élisabeth Guigou, de légiférer sur la question
– et très légitimement d’ailleurs. Il suffirait donc, à la place de cette phrase qui fait penser à ce qu’on appellerait un « encombrant » dans le vocabulaire des gestionnaires de la voirie urbaine (Sourires), de rédiger ainsi le 3e alinéa de l’article 34 de la Constitution : « la nationalité, ses conditions d’acquisition, de perte et de déchéance ». Encore une fois, le texte de l’amendement gouvernemental n’ajoute rien, sauf une ambiguïté. Sortons-en, fût-ce à notre détriment…
On peut certes considérer que cette disposition est juridiquement inutile mais politiquement nécessaire. Si cet affichage qui ne sert à rien est indispensable, alors pourquoi ne pas dire oui… Bonaparte estimait qu’une constitution devait être « courte et obscure ». Les constituants de 1958 ont suivi à moitié le précepte : si elle n’est pas courte, la Constitution actuelle est bien obscure. Est-il nécessaire d’ajouter à son obscurité…
M. Paul Giacobbi. Et à sa longueur !
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. …par des dispositions opaques telles que celle que nous allons voter ? Je ne le pense pas.
Je terminerai en citant un certain Montesquieu, selon qui « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Il n’avait pas complètement tort… Aussi en revenir à une plus grande concision ne changerait rien, serait plus rationnel et éviterait d’éveiller un soupçon relatif à une éventuelle distinction postérieure entre telle ou telle catégorie de Français.
M. Pascal Popelin. Comme d’autres intervenants, je me réjouis de la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement, et en particulier de la disparition de la distinction entre les Français qui disposent d’une autre nationalité et ceux qui n’ont que celle-là.
Je fais mienne – et c’est assez peu courant pour mériter d’être souligné – l’intervention de Jean-Christophe Lagarde sur la philosophie de la déchéance de la nationalité, conçue comme outil non de dissuasion vis-à-vis de ceux qui veulent s’exclure de la communauté nationale, mais de réaction contre ceux qui portent atteinte aux Français et à tous ceux qui résident en France.
J’ai un point de divergence avec notre collègue Schwartzenberg : le principe selon lequel une constitution doit être « courte et obscure » me paraît daté, en ce qu’il correspond à l’idée que Bonaparte se faisait du fonctionnement des pouvoirs publics et qui n’est pas tout à fait la nôtre. Certes, la Constitution doit être la plus concise possible, mais elle doit également être la plus claire possible.
Inscrire dans la Constitution les conditions dans lesquelles la déchéance de la nationalité peut être prononcée, y préciser qu’on sanctionne « un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation » – nous verrons bien si nous modifions l’expression ou non –, est pour nos compatriotes une garantie que le législateur, en d’autres temps et en d’autres circonstances, ne galvaudera pas cette notion de déchéance. En effet, si la Constitution l’encadre strictement, on ne pourra pas en avoir, demain, une conception extensive. L’article 2, dans la nouvelle rédaction souhaitée, constitue donc une protection des libertés et une protection de nos compatriotes contre l’éventuelle tentation de prévoir la déchéance de la nationalité pour tout et n’importe quoi.
M. Hugues Fourage. Je salue la profondeur des réflexions que je viens d’entendre. Le débat est complexe et renvoie, pour certains, à la sphère intime – il ne faut pas oublier que, derrière le symbole, se trouvent des hommes et des femmes.
La distorsion que nous avons évoquée entre binationaux, les uns pouvant être déchus et les autres non, et la distorsion entre les binationaux et ceux qui ne le sont pas, nous renvoie au principe d’égalité. Doit-on aller jusqu’au symbole fort de la déchéance de la nationalité ou, comme le propose Roger-Gérard Schwarztenberg, en rester à la déchéance des droits civiques ? Quand on s’est délibérément exclu de la communauté nationale, la force symbolique de la déchéance des droits civiques est-elle suffisante ? Je ne le crois pas. Il faut aller jusqu’à la déchéance de la nationalité, qui est une réponse ferme à des gens qui, je le répète, se sont placés d’eux-mêmes en dehors de la communauté nationale.
Le Premier ministre s’est engagé à ce que nous ratifiions la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Nous devons savoir dans quelles conditions afin que toute ambiguïté soit levée. La Convention prévoit en effet qu’un « État contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité, s’il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, à une déclaration à cet effet ». Je reste persuadé que si nous voulons respecter le principe d’égalité entre les Français quelle que soit la manière dont ils ont acquis la nationalité, nous devons répondre précisément à l’article 8, alinéa 3 b ii, de ladite Convention – c’est une exigence intellectuelle autant que juridique.
Je partage l’avis de M. Popelin sur la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité. L’article 2 dans la nouvelle version proposée par le Gouvernement renforce à la fois la notion de nation et celle de protection.
Pour terminer, afin de consolider la base juridique de cette disposition, nous devons privilégier non pas l’idée, suggérée par M. Goasdoué, d’atteinte grave aux intérêts « supérieurs » de la Nation, mais l’idée d’atteinte aux intérêts « fondamentaux » de la Nation, reprise par le Conseil d’État et qui figure dans plusieurs jurisprudences.
La Commission rejette les amendements identiques tendant à supprimer l’article.
Elle examine, en discussion commune, l’amendement CL74 du Gouvernement, qui fait l’objet des sous-amendements CL81 et CL82 de M. Jean-Marc Germain, et l’amendement CL51 rectifié de M. Denis Baupin.
M. le rapporteur. Comme l’a souligné M. de Rugy, notre pays se défend face à une agression dont la brutalité est difficilement exprimable : les mots rendent mal compte de l’horreur que représente le fait de mitrailler des gens simplement assis, pacifiquement, à la terrasse d’un café. Cette agression a été commise au nom d’un groupe qui prétend régner sur un territoire qui n’est pas une nation. Face à cela, le Président de la République a essayé de renforcer l’unité nationale et c’est bien en ce sens que nous devons aller.
Les avantages de l’amendement CL74 du Gouvernement sont importants.
Le premier est de lever la difficulté posée par la différence de traitement entre les Français binationaux et ceux qui ne le sont pas. La dimension symbolique de la disposition s’en trouve renforcée. J’entends toutefois parfaitement que des difficultés subsistent et que le renvoi à la loi d’application est délicat puisque nous n’en connaissons pas la teneur. Il nous reviendra donc de vérifier dans quelles conditions le dispositif se mettra en place. Suivrons-nous les observations de M. Lagarde en ratifiant la Convention avec des réserves ? Comment définirons-nous ensuite les binationaux ? Ici encore, l’objection soulevée par M. Lagarde est intéressante : traiterons-nous différemment les criminels qui ont une autre nationalité à leur corps défendant, et ceux qui jouiraient d’une sorte de privilège judiciaire lié à l’appartenance à une seule nation ? Nous devrons trancher.
De même, nous devrons trancher la question très difficile de la nature des délits visés par l’article tel que le Gouvernement souhaite le rédiger. En effet, la qualification d’un délit ne correspond pas toujours à la gravité du fait constaté. La qualification d’association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste est grave et implique des peines encourues très élevées, alors même que, parfois, le délit constaté ne correspond pas à des faits d’une particulière gravité.
Nous devrons également désigner l’autorité compétente pour prononcer la déchéance de la nationalité et la déchéance des droits attachés à la nationalité. Il me paraîtrait souhaitable que ce soit le juge judiciaire qui prononce la sanction sous forme de peine complémentaire. Je ne vois pas que l’on prononce, après que le jugement sera rendu, une déchéance de la nationalité ou des droits attachés à celle-ci : une telle procédure passerait inévitablement pour une double peine. Aussi curieux que cela paraisse et malgré les immenses qualités du juge administratif, c’est, dans l’esprit du public, le juge judiciaire qui est le garant des libertés. En effet, une bonne partie de nos concitoyens ont du mal à se représenter la justice administrative et, pour eux, la justice se rend dans les palais de justice par des hommes et des femmes qui respectent un rituel particulier, revêtent des robes particulières, par exemple dans un tribunal de grande instance plutôt proche de leur domicile. C’est injuste vis-à-vis du juge administratif mais c’est ainsi que nos concitoyens perçoivent la réalité.
En attendant de régler ces problèmes, l’amendement du Gouvernement, parce qu’il lève une partie des difficultés, doit être adopté.
M. Jean-Marc Germain. Le sous-amendement CL81 vise à remplacer la déchéance de la nationalité française par la déchéance de la citoyenneté française et des droits qui y sont attachés. Il ne s’agit donc pas seulement d’une déchéance civique : elle peut être étendue à tous les droits du citoyen tels que définis par le droit français.
J’en profite pour demander au rapporteur plusieurs clarifications. Nous sommes nombreux, si j’ai bien compris, à ne pas souhaiter créer d’apatrides. Or le présent débat montre que nous allons bel et bien créer des apatrides et que nous l’assumons, notre collègue Lagarde nous rappelant les stipulations de la Convention de 1961 aux termes desquelles les cas d’apatridie prévus « collent » quasiment, au mot près, à ceux du texte que nous sommes en train d’examiner.
Je partage l’inquiétude de nos collègues Lagarde et Houillon : dès lors que l’amendement du Gouvernement évoque « la déchéance de nationalité française ou des droits attachés à celle-ci », la porte reste ouverte à une déchéance de nationalité pour les binationaux et à une déchéance des droits rattachés à la nationalité pour ceux qui n’ont que la nationalité française, ce qui revient bien à maintenir la discrimination refusée par M. Lagarde et par nombre d’entre nous. Nous devons par conséquent vraiment savoir si le texte va conduire ou non à une discrimination entre les binationaux, notamment ceux nés en France, et les autres. Notre collègue Mennucci a rappelé que les binationaux nés en France, en vertu de plusieurs articles de la Constitution, ne pourront être déchus de la nationalité française. Je souhaite donc avoir une réponse très claire sur ce point : le texte d’un futur gouvernement – car je n’imagine pas cela du nôtre – pourrait-il prévoir une telle déchéance ?
Notre collègue Denis Baupin l’a très bien dit : plus nous travaillons sur la question, plus nous en arrivons à la conclusion que c’est sur la citoyenneté et les droits qui lui sont rattachés qu’il faut se concentrer si nous ne voulons pas créer d’apatrides, si nous ne voulons pas créer de discrimination entre Français.
Nous sommes presque les seuls, avec les Américains, à intervenir en Syrie pour assurer la paix dans le monde, et nous voudrions « exporter » nos terroristes parce que nous ne serions pas capables de nous en occuper nous-mêmes, y compris après une peine de prison, y compris après les avoir privés d’un certain nombre d’attributs de la citoyenneté ? Nous devons assumer nos responsabilités politiques : ce sont des Français qui commettent des actes terroristes en France, aussi devons-nous les condamner en France et doivent-ils exécuter leur peine en France. S’il reste des conclusions à tirer après cela, tirons-les, mais sur notre sol !
Quant au sous-amendement CL82, il s’agit d’un sous-amendement de repli qui vise, à l’alinéa 4, à supprimer les mots : « ou un délit ».
M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable aux deux sous-amendements. Malheureusement, je n’ai pas les réponses aux questions légitimes posées par M. Germain, puisque c’est la loi d’application qui le permettra. Nous devrons nous montrer vigilants.
M. Philippe Houillon. En aurons-nous connaissance avant la fin de la semaine ?
La Commission rejette successivement les sous-amendements CL81et CL82.
Elle adopte l’amendement CL74.
En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé et l’amendement CL51 rectifié de M. Denis Baupin tombe, ainsi que tous les autres amendements à cet article.
La Commission examine l’amendement CL48 de M. Paul Giacobbi.
M. Paul Giacobbi. On me dira que la Corse n’est pas le sujet, mais comme il n’y aura pas de « train constitutionnel » relatif à la Corse, on ne pourra proposer le dispositif prévu ici par l’amendement CL48 qu’à l’occasion d’une révision constitutionnelle, et encore ces occasions seront-elles sans doute très rares !
Cet amendement est le fruit d’une nécessité juridique. La Corse se trouve en effet dans une situation schizophrénique : d’un côté, on lui reconnaît un statut particulier et, de l’autre, la Constitution ne la reconnaît pas, ou ne reconnaît qu’à demi-mot l’existence de ce statut particulier, si bien que nous devons faire face à des difficultés considérables : ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il récemment censuré, par deux fois, des dispositions fiscales adoptées assez largement par l’Assemblée comme par le Sénat.
Depuis longtemps, les représentants de la Corse ont travaillé sur le sujet, notamment dans le cadre d’un comité de professeurs de droit dirigée par le regretté Guy Carcassonne dont je vous rappelle humblement qu’il était selon lui « indécent, illogique et insultant que la Corse ne [fût] pas mentionnée dans le texte suprême ». Je relève, au passage, qu’il n’existe pas d’île française, à part les îles côtières, qui ne soit mentionnée dans la Constitution de la République française, laquelle consacre tout de même deux lignes à l’îlot de Clipperton qui n’est pas occupé, à ma connaissance, par l’homo sapiens sapiens sauf quand, une fois tous les deux ans, un bateau de la Marine nationale y accoste.
C’est également une question de cohérence, puisqu’il s’agit de mettre la Constitution en accord avec la loi et de permettre, dans un cadre qui est celui de la République, non de s’écarter de la loi générale, mais, parfois, de l’adapter, comme nous l’admettons dans toute une série de cas.
Ce que nous demandons ici l’est depuis de nombreuses années par une très large majorité des représentants à l’assemblée de Corse, a été discuté à de multiples reprises par le Gouvernement – et, au fond, jamais personne n’a considéré que c’était déraisonnable. Nous n’en sommes pas moins liés à un moment politique car il est tout de même contradictoire que, dans le même temps, le Gouvernement ouvre une discussion sur les sujets fondamentaux concernant la Corse, préparant, d’une certaine manière, les voies et moyens d’un prélude à l’indépendance, et que l’on n’admette pas des dispositions qui consistent à ancrer la Corse dans la Constitution de la République française.
M. le rapporteur. Le sujet est très intéressant mais, comme vous l’avez relevé vous-même, mon cher collègue, il n’a pas grand-chose à voir avec la discussion en cours. Je comprends que vous éprouviez quelque difficulté à trouver un vecteur constitutionnel, mais nous ne pourrons trancher la question que vous soulevez sans mener au préalable un débat approfondi. Je ne peux donc que donner un avis défavorable à votre amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL57 de Mme Cécile Duflot.
Mme Cécile Duflot. En l’absence d’autre possibilité, nous aurions pu, à l’instar de M. Giacobbi, présenter de nombreux amendements portant sur des sujets tels que le droit de vote des résidents étrangers, la composition du Conseil constitutionnel, la démocratie sociale, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et, évidemment, la modification du mode de scrutin, cela afin d’instaurer une forme moderne de démocratie, une VIe République.
Si nous n’avons déposé aucun amendement dans ce sens, celui-ci, auquel je tiens, vise à soumettre le projet de révision de la Constitution au Conseil constitutionnel. Guy Carcassonne avait formulé sur le sujet de nombreuses propositions.
Vous aurez noté mon obsession de la question de la révision constitutionnelle en période troublée. En 2003, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour statuer sur une révision constitutionnelle. Il s’agit donc de lui permettre de contrôler la régularité de la révision par rapport à la procédure prévue par l’article 89, sur le fait que la procédure de révision n’ait pas été engagée ou poursuivie lorsqu’il était porté atteinte à l’intégrité du territoire ou sur le fait que la révision ne porte pas atteinte à la forme républicaine du Gouvernement.
Il s’agit bien de distinguer la procédure de révision de la capacité constituante elle-même, qui laisse au constituant une totale liberté.
Ce débat essentiel mériterait d’être poursuivi, d’autant que l’adoption de la présente réforme, que je ne souhaite pas, créerait un précédent : en réponse à des situations d’extrême gravité, on estimera devoir de nouveau modifier la Constitution. Nous savons bien que quand nous sommes l’objet de menaces prévaut la jurisprudence Vigipirate : il est très difficile de redescendre du niveau « écarlate » au niveau « rouge »… Une nouvelle menace nous a même conduits à l’adoption du dispositif « Sentinelle ». Aucun responsable politique ne sait plus ensuite faire machine arrière parce qu’il ne veut pas se voir reprocher de n’avoir pas fait le maximum. Ainsi allons-nous convoquer le Congrès pour réviser la Constitution… Mais que ferions-nous si devait survenir un événement difficile ?
Nous devons donc nous doter de protections et, à cette fin, pourvoir le Conseil constitutionnel de sa pleine compétence – la vérification de l’intégralité de l’application du texte constitutionnel en fait partie.
M. le rapporteur. Je partage vos préoccupations et comprends également votre envie dévorante d’ajouter quelques modifications constitutionnelles. Reste que je vois mal qu’on soumette une révision constitutionnelle au Conseil constitutionnel : on ne peut pas demander au juge de la constitutionnalité des lois de vérifier la conformité de la révision à ses propres attentes, de même qu’on ne soumet pas au verdict du juge la loi qu’il est chargé d’appliquer. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable.
Mme Cécile Duflot. Ma proposition fait l’objet d’un numéro entier des Cahiers du Conseil constitutionnel, où sont cités des exemples étrangers. Il y a un grand débat de constitutionnalistes sur le sujet, que l’on ne peut pas évacuer d’un revers de la main.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Nous connaissons tous la Cour constitutionnelle de Karlsruhe.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi constitutionnelle modifié.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation (n° 3381), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions ___ |
Projet de loi constitutionnelle |
Projet de loi constitutionnelle | |
Article 1er |
Article 1er | |
Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 36-1. – L’état d’urgence est |
« Art. 36-1. – L’état d’urgence est décrété en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. amendement 41 (CL 68) | |
« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements. |
« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre, sous le contrôle du juge administratif, pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements. amendement 42 (CL 70) | |
« Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l’état d’urgence. amendement 43 (CL 71) | ||
« La loi prévoit les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en œuvre des mesures de l’état d’urgence. amendement 44 (CL 54) | ||
« La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée. » |
(Alinéa sans modification) | |
« L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l’état d’urgence. » amendement 45 (CL 34) | ||
Constitution du 4 octobre 1958 |
Article additionnel après l’article 1er | |
Art. 36. – L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. |
Après le premier alinéa de l’article 36 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. |
||
« L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. » amendement 46 (CL 43) | ||
Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie. |
||
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée. |
||
La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. |
Article additionnel après l’article 1er | |
L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. |
À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 42 et au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, après le mot : « crise », sont insérés les mots : « prévus aux articles 36 et 36-1 ». amendement 47 (CL 73) | |
Art. 48. – Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée. |
||
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour. |
||
En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité. |
||
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. |
||
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires. |
||
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. |
||
Article 2 |
Article 2 | |
Art. 34. – La loi fixe les règles concernant : |
L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; |
||
1° Le troisième alinéa est |
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | |
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; |
« – la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne |
« – la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ; » amendement 48 (CL74) |
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) | |
« – l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ». |
||
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; |
||
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie. |
||
La loi fixe également les règles concernant : |
||
– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; |
||
– la création de catégories d’établissements publics ; |
||
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; |
||
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé. |
||
La loi détermine les principes fondamentaux : |
||
– de l’organisation générale de la Défense nationale ; |
||
– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; |
||
– de l’enseignement ; |
||
– de la préservation de l’environnement ; |
||
– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; |
||
– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. |
||
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. |
||
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. |
||
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. |
||
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. |
||
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. |
ANNEXE : LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ
EN DROIT COMPARÉ (143)
Allemagne
La déchéance de nationalité peut être infligée à un citoyen allemand, disposant d’une autre nationalité, dans des cas limitativement énumérés. L’article 16 de la Loi fondamentale indique, en effet, que « La nationalité allemande ne peut pas être retirée. La perte de la nationalité ne peut intervenir qu’en vertu d’une loi et lorsqu’elle intervient contre le gré de l’intéressé, seulement si celui-ci ne devient pas de ce fait apatride ».
Longtemps cette question a été sans objet pour au moins deux raisons : d’une part elle rappelait la politique de la « dénaturalisation » (Ausbürgerung) qui avait été tragiquement pratiquée de 1933 à 1945 ; d’autre part, l’Allemagne a longtemps interdit la double nationalité du fait d’un attachement strict au droit du sang.
Depuis la modification en aout 2007 de la loi sur la nationalité de janvier 2000 (la Staatsangehörigkeitsgesetz ou StAG) la double nationalité est autorisée pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse. Depuis juillet 2014, elle est également possible pour les ressortissants d’autres nationalités mais nés en Allemagne et y ayant vécu au moins 8 ans avant l’âge de 21 ans. Cette réforme intéresse l’importante communauté turque.
À l’heure actuelle la loi allemande prévoit cette possibilité de déchéance dans deux situations :
1 – un acte juridique incompatible avec le maintien de la nationalité allemande. La StAG prévoit l’hypothèse du ressortissant allemand qui répudie sa nationalité ou exprime sa volonté d’acquérir la nationalité d’un État autre que ceux cités ci-dessus. Dans ce dernier cas, en application de l’article 25 de la StAG, il perd sa nationalité allemande s’il n’obtient pas la permission de la conserver (Beibehaltungsgenehmigung).
2 – l’engagement dans une armée étrangère. La StAG en son article 28 vise le cas d’un engagement volontaire et non le service militaire que le ressortissant allemand décide d’effectuer dans l’État dont il a également la nationalité. Cependant, le ministère fédéral de la défense a indiqué, dans un arrêté en date du 6 juillet 2011, que le service dans une armée étrangère n’était plus un motif de perte de la nationalité allemande s’il était effectué dans un État membre de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange, de l’OTAN ou de tout autre État visé dans le règlement relatif au séjour des étrangers (Aufenthaltsverordnung).
Actuellement la question de la déchéance de nationalité fait l’objet de nombreux débats. Ainsi la CDU lors de son congrès en décembre 2015 a adopté, à la quasi-unanimité, une motion prévoyant la possibilité de retirer sa nationalité allemande « à une personne combattant pour une milice terroriste à l’étranger et détenant la double nationalité », afin de l’empêcher de revenir en Allemagne.
1. Les ressortissants de votre pays peuvent-ils posséder, concomitamment, une autre nationalité?
L’idée de base de la loi allemande sur la nationalité (StAG) est d’éviter la nationalité multiple (dite « pluralité de nationalités »). Cependant, à la suite de réformes dont la dernière en décembre 2014, la pluralité de nationalités est autorisée dans de nombreux cas :
a) Si la nationalité allemande est acquise à raison du principe de la filiation (acquisition à la naissance, parce qu’un parent possède la nationalité allemande, § 4 al. 1 StAG) et si l’enfant acquiert à la naissance également la nationalité d’un autre État, la pluralité de nationalités est alors traditionnellement autorisée par le droit allemand.
b) Si la nationalité allemande est acquise à raison du principe du lieu de naissance (acquisition à la naissance en Allemagne, lorsque les deux parents sont d’origine étrangère et qu’un parent a sa résidence légale habituelle en Allemagne depuis huit ans et qu’il possède un droit de séjour permanent au moment de la naissance § 4 al. 3 StAG), la pluralité de nationalités peut être permanente, si :
• les parents de l’enfant sont des ressortissants d’un État membre de l’UE ou des ressortissants suisses ou
• l’enfant a habituellement résidé en Allemagne pendant huit ans ou a été scolarisé pendant six ans en Allemagne ou dispose d’un diplôme de fin d’études ou d’un diplôme professionnel allemand.
Si ce n’est pas le cas, dans un premier temps, l’enfant acquiert à la naissance les deux nationalités, mais est amené à devoir choisir entre la nationalité allemande et la nationalité étrangère avant l’âge de 21 ans (voir dispositif option, § 29 al. 1 StAG).
c) Si la nationalité allemande est acquise par naturalisation (§§ 8, 10 StAG), il est en principe nécessaire de renoncer à son ancienne nationalité (§ 10 al. 1 n°. 4 StAG). Mais ce principe présente également aujourd’hui de nombreuses exceptions, notamment pour les ressortissants d’un État membre de l’UE et les ressortissants suisses, les personnes âgées, personnes bénéficiant du droit d’asile, les personnes ayant le statut de réfugié. En outre, la pluralité de nationalités est tolérée lors d’une naturalisation, lorsque la législation de l’État étranger ne prévoit pas l’abandon de nationalité, que la législation de l’État étranger refuse systématiquement le renoncement à sa nationalité ou le subordonne à des conditions irréalisables, ou enfin inacceptables ou si la perte de la nationalité étrangère s’accompagnerait d’inconvénients substantiels (§ 12 StAG).
2. Ces ressortissants peuvent-ils perdre leur nationalité ou en être déchus ? Dans quels cas ?
3. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité s’appliquent-ils indifféremment selon que le ressortissant de votre pays a la nationalité de votre pays depuis sa naissance ou uniquement s’il l’a acquise ultérieurement ?
4. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité peuvent-ils concerner des personnes qui ne possèdent que la nationalité de votre pays ?
Selon l’art. 16 al. 1 point 2 de la Loi fondamentale (GG), la perte de la nationalité ne peut être appliquée « qu’en vertu d’une loi et lorsqu’elle intervient contre la volonté de la personne concernée, seulement si celle-ci ne devient pas apatride de ce fait ».
Une personne qui, concomitamment à la nationalité allemande, possède une autre nationalité, peut donc perdre la nationalité allemande, si :
dans le cadre de l’option à prendre (cf. 1 b), elle choisit la nationalité étrangère (§§ 17 al. 1 n°. 6, 29 al. 2 StAG) ;
elle fait une déclaration écrite de renoncement à la nationalité allemande auprès de l’autorité compétente (§§ 17 Abs. 1 Nr. 3, 26 StAG) ;
elle intègre, de son propre gré et sans y être autorisée par le ministère allemand de la Défense, les forces armées de l’État étranger dont elle possède la nationalité (§§ 17 al. 1 n°. 5, 28 StAG).
Un ressortissant allemand qui n’a pas de double nationalité ne peut perdre la nationalité allemande que si :
suite à la demande d’acquisition d’une nationalité étrangère et la promesse d’attribution de cette nationalité, il fait la demande de renoncement à la nationalité allemande (§§ 17 al. 1 n°. 1, 18 StAG). Cependant, ce renoncement est considéré comme nul et non avenu si la personne concernée, en dépit de cette promesse, n’obtient pas la nationalité étrangère dans un délai d’un an (§ 24 StAG) ;
il obtient la nationalité d’un pays hors de l’UE, dont il a fait lui-même la demande (§§ 17 al. 1 n°. 2, 25 StAG) ;
durant sa minorité, il est adopté par un étranger et, par conséquent, obtient la nationalité de l’adoptant (§§ 17 Abs. 1 Nr. 4, 27 StAG).
Dans ces cas de figure, aucune distinction n’est faite entre la nationalité acquise par la naissance et la nationalité acquise par naturalisation.
Si la nationalité allemande a été acquise par naturalisation (cf. 1.c) et non par filiation ou par lieu de naissance, une personne peut perdre la nationalité allemande si sa naturalisation est annulée ultérieurement (§§ 17 al. 1 n°. 7, 35 StAG). Cette annulation n’est possible que si la naturalisation était non conforme à la loi et qu’elle a été obtenue soit de manière frauduleuse, soit par la menace, soit par la corruption ou en fournissant délibérément des informations incorrectes et incomplètes qui sont essentielles pour l’attribution de la nationalité (§ 35 al. 1 StAG). Cette annulation ne peut intervenir que dans les cinq années suivant la notification de la naturalisation (§ 35 al. 3 StAG). Contrairement à la nationalité par la naissance, la nationalité par naturalisation peut être annulée, même si la personne concernée devient apatride à la suite de cette mesure (§ 35 al.2 StAG). D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, cette disposition n’entre pas en contradiction avec l’art. 16 al. 1 GG.
5. La législation de votre pays permet-elle d’expulser de son territoire des individus apatrides? Dans quelles conditions ?
Lorsqu’un étranger apatride n’a pas de titre de séjour pour l’Allemagne, il est comme tout autre étranger sans titre de séjour obligé de quitter l’Allemagne (§ 50 al. 1 de la loi sur le séjour des étrangers/Aufenthaltsgesetz – AufenthG). S’il ne respecte pas cette obligation de quitter le territoire, son expulsion peut être ordonnée (expulsion, § 58 AfenthG). Dans les faits, l’expulsion d’un étranger apatride peut s’avérer impossible, puisqu’il n’existe aucun État pour l’accueillir. Dans ce cas, il faut suspendre l’expulsion de l’étranger en question (voir tolérance, § 60a al. 2 AufenthG).
6. Votre pays a-t-il signé et/ou ratifié la convention des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatride ? Dans ce cas, a-t-il effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une déclaration sur le fondement de son article 8, paragraphe 3 ?
L’Allemagne a ratifié la convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatride par la loi du 29 juin 1977. L’Allemagne ne s’est pas réservé la possibilité de retirer la nationalité à une personne sur le fondement des raisons énumérées dans l’art. 8 al. 3 de la convention.
7. Le pays interrogé a-t-il signé et/ou ratifié la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ? Dans ce cas, a-t-il effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une réserve relative à son article 7 (« Perte de la nationalité de plein droit ou à l’initiative d’un État Partie ») ?
L’Allemagne a signé le traité le 4 février 2002, l’a ratifié le 11 mai 2005. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005.
8. La législation de votre pays prévoit-elle des mesures qui, sans toucher à la nationalité, privent un de ses ressortissants de la qualité de citoyen ou limitent les attributs attachés à cette qualité (indignité nationale, dégradation civique, déchéance des droits civils et politiques, etc.) ?
Oui. Selon l’art. 18 de la Loi fondamentale (GG), il peut y avoir privation de certains droits fondamentaux - la liberté de la presse, la liberté d’enseignement, la liberté de réunion, la liberté d’association, le secret des postes et des télécommunications, le droit de propriété et d’asile - si la personne abuse de ces droits pour combattre l’ordre démocratique et libéral. Seule la Cour constitutionnelle fédérale est compétente pour statuer sur la privation et son ampleur. Dans l’histoire de la République fédérale, aucune décision de ce genre n’a été prononcée.
Le Code pénal (StGB) prévoit une peine complémentaire en cas de condamnation, à savoir la perte de la capacité d’exercer une fonction publique (perte de la fonction) et/ou la perte du droit de vote actif et passif. Une condamnation à une peine privative de liberté de plus d’un an entraîne automatiquement la perte de la capacité d’exercice d’une fonction publique et du droit de vote passif pour une durée de cinq ans (§ 45 al. 1 StGB).
En outre, il est possible, par décision judiciaire, de prononcer la perte de la capacité de l’exercice d’une fonction publique et la privation du droit de vote actif et passif, si cela est prévu par la loi (§ 45 Abs. 2, 5 StGB). Ainsi le tribunal peut en plus d’une peine privative de liberté d’au moins six mois pour crimes contre la paix publique, haute trahison ou mise en danger de l’État de droit démocratique retirer les droits énumérés pour une durée de deux à cinq ans (§§ 92a, 45 al. 2, 5 StGB). Il en est de même en cas de condamnation à une peine privative de liberté d’au moins six mois pour trahison intentionnelle et mise en danger de la sécurité extérieure ou pour attaque contre des institutions et représentants d’États étrangers (§§ 101, 102, 45 al. 2, 5 StGB).
De même, en cas de condamnation à une peine privative de liberté d’au moins six mois pour la création d’un groupe terroriste, il est possible de retirer le droit d’exercer une fonction publique et le droit de vote passif pour une durée de deux à cinq ans (§§ 129a al. 8, 45 al. 2 StGB). Par ailleurs, le droit de vote actif et passif peut être retiré pour une durée de deux à cinq ans pour toutes les infractions liées à la fraude électorale (§§ 108c, 107, 107a, 108, 108b StGB).
9. Dans quelle mesure votre Parlement est-il partie prenante ou associé à la prise et au contrôle des décisions prononçant la perte ou la déchéance de la nationalité ?
Le Bundestag n’est pas partie prenante dans la prise des décisions relatives à la perte de la nationalité allemande. Il n’a pas non plus de droit de contrôle. La perte de la nationalité allemande et l’annulation de la naturalisation sont prononcées au terme d’une procédure administrative engagée par l’autorité administrative compétente. Le recours contre cette décision est possible auprès des tribunaux administratifs.
Autriche
1. Les ressortissants autrichiens peuvent-ils posséder, concomitamment, une autre nationalité ?
Conformément à la loi fédérale sur la citoyenneté autrichienne (Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft, StbG) de 1985 amendée, la double nationalité ou la pluralité de nationalité n’est pas autorisée en Autriche sauf exceptions liées par exemple à l’éminence d’une personne dans un domaine - sportifs, chanteurs d’opéra, etc. (§28 abs 1) - ou tenant à des raisons spécifiques relatives à la vie privée et familiale (§28 abs 2). Les Autrichiens qui souhaitent acquérir une nationalité supplémentaire doivent en faire la demande expresse (§28 abs 3).
Les étrangers qui souhaitent obtenir la nationalité autrichienne tout en conservant leur propre nationalité doivent justifier de l’intérêt qu’il y a pour l’Autriche à accepter cette bi ou pluri-nationalité.
2. Ces ressortissants peuvent-ils perdre leur nationalité ou en être déchus ? Dans quels cas ?
Conformément à la loi fédérale sur la citoyenneté autrichienne, la perte de nationalité est automatique en cas d’acquisition d’une autre nationalité (§27) ou lorsque l’individu prend volontairement une part active dans des opérations de combat au profit d’un autre pays ou au profit d’un groupe organisé armé (§32). La nationalité autrichienne peut être perdue lorsqu’un individu travaille pour un autre État et se conduit dans un sens contraire aux intérêts et à la réputation de l’Autriche. Il peut également y avoir déchéance de nationalité si son titulaire refuse de renoncer à son ancienne nationalité alors qu’il n’obtient pas la permission d’être binational.
3. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité s’appliquent-ils indifféremment selon que le ressortissant du pays interrogé a la nationalité de ce pays depuis sa naissance ou uniquement s’il l’a acquise ultérieurement ?
Il n’y a pas de différence selon que la nationalité est de naissance ou acquise.
4. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité peuvent-ils concerner des personnes qui ne possèdent que la nationalité autrichienne ?
La déchéance de la nationalité autrichienne lorsque l’individu prend volontairement une part active dans des opérations de combat au profit d’un autre pays ou au profit d’un groupe organisé armé n’est possible que si elle ne le rend pas apatride.
5. La législation autrichienne permet-elle d’expulser de son territoire des individus apatrides ? Dans quelles conditions ?
L’Autriche a ratifié la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954 dont l’article 31 indique :
1. Les États contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
2. L’expulsion de cet apatride n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément la procédure prévue par la loi. L’apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.
3. Les États contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.
6. L’Autriche a-t-elle signé et/ou ratifié la convention des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatride ? Dans ce cas, a-t-elle effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une déclaration sur le fondement de son article 8, paragraphe 3 ?
L’Autriche a adhéré à la Convention des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatride le 22 septembre 1972 avec la réserve suivante relative à l’article 8 § 3 (i) et (ii) :
« L’Autriche déclare se réserver le droit de priver de sa nationalité toute personne qui, de son plein gré, effectue son service militaire auprès d’un État étranger.
L’Autriche déclare se réserver le droit de priver une personne de sa nationalité, si cette personne, au service d’un État étranger, se conduit d’une manière qui porte gravement atteinte aux intérêts ou au prestige de la République d’Autriche. »
7. L’Autriche a-t-elle signé et/ou ratifié la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ? Dans ce cas, a-t-elle effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une réserve relative à son article 7 (« Perte de la nationalité de plein droit ou à l’initiative d’un État Partie ») ?
Oui. L'Autriche a déclaré se réserver le droit de priver de la nationalité un ressortissant autrichien s'engageant volontairement dans les forces armées d’un État étranger ou s’il est établi, à quelque moment que ce soit, que les conditions déterminées par le droit interne ayant entraîné l'acquisition de plein droit de la nationalité autrichienne ne sont plus remplies.
8. La législation autrichienne prévoit-elle des mesures qui, sans toucher à la nationalité, privent un de ses ressortissants de la qualité de citoyen ou limitent les attributs attachés à cette qualité (indignité nationale, dégradation civique, déchéance des droits civils et politiques, etc.) ? Dans quels cas ?
Les citoyens autrichiens peuvent perdre leur droit de vote s’ils commettent un crime. Le § 22 de la Loi fédérale sur les élections du Conseil national précise que les personnes qui ont été condamnées en dernière instance par une cour autrichienne pour certains crimes relevant :
1. des Sections 14, 15, 16, 17, 18, 24 or 25 de la Partie Spéciale du Code pénal, qui portent sur les insultes (Beleidigung), les atteintes à la sphère privée (Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs), les atteintes à la personne (Straftaten gegen das Leben) comme le meurtre, délits contre l’intégrité physique (Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit), les atteintes à la liberté individuelle (Straftaten gegen die persönliche Freiheit), voire les délits passibles d’une sanction comme les jeux d’argent ;
2. des § 278a à § 278e du Code pénal relatifs aux organisations criminelles ;
3. de la loi sur la prohibition du national-socialisme de 1947 ;
4. en rapport avec une élection, un referendum ou une initiative populaire conformément à la Section 22 de la Partie spéciale du Code pénal en matière de fraude.
Sous réserve que la peine soit d’un an d’emprisonnement minimum et ne fasse pas l’objet d’une suspension conditionnelle, les individus peuvent être privés de leur droit de vote par le tribunal (§ 446a du Code de procédure pénale).
9. Dans quelle mesure le Parlement autrichien est-il partie prenante ou associé à la prise et au contrôle des décisions prononçant la perte ou la déchéance de la nationalité ?
Le Parlement autrichien n’est pas concerné par les décisions de perte ou de déchéance de nationalité. Il n’exerce pas de contrôle en la matière.
Belgique
1. Les ressortissants de votre pays peuvent-ils posséder, concomitamment, une autre nationalité ?
Le Code belge de la nationalité admet la double nationalité et même la plurinationalité.
On distingue trois hypothèses :
Les Belges qui se sont vu attribuer une nationalité étrangère de plein droit. A cette catégorie appartiennent par exemple les enfants issus de mariages mixtes qui possèdent à la naissance tant la nationalité de leur auteur belge que la nationalité étrangère de leur autre auteur.
Les Belges majeurs qui, depuis l’instauration de la possibilité de la double nationalité en 2006, ne perdent plus la nationalité belge à la suite de l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère.
Les étrangers qui ont acquis volontairement la nationalité belge et qui conservent leur nationalité d’origine.
2. Ces ressortissants peuvent-ils perdre leur nationalité ou en être déchus ? Dans quels cas ?
Un ressortissant belge perd sa nationalité dans les hypothèses suivantes (article 22 du Code de la nationalité belge) :
Par une déclaration de renonciation : une personne majeure peut déclarer qu’elle renonce à la nationalité belge à condition que le déclarant prouve qu’il possède une nationalité étrangère ou qu’il l’acquiert ou la recouvre par l’effet de la déclaration. Par effet induit, l’enfant mineur non émancipé du déclarant perd également la nationalité belge à la condition que cet enfant acquière la nationalité d’un de ses auteurs ou adoptants ou qu’il la possède déjà. Il ne perd cependant pas la nationalité belge tant que l’un de ses auteurs ou adoptants la possède encore.
L’enfant mineur non émancipé, adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l’adoptant ou de l’un d’eux lui soit acquise par l’effet de l’adoption ou qu’il possède déjà cette nationalité perd sa nationalité belge. Cependant, il ne la perd pas si l’un des adoptants est Belge ou si l’auteur conjoint de l’adoptant étranger est Belge ;
Le Belge né à l’étranger perd sa nationalité belge lorsqu’il a eu sa résidence principale et continue à l’étranger de dix-huit à vingt-huit ans, qu’il n’exerce à l’étranger aucune fonction conférée par le Gouvernement belge et qu’il ne déclare pas, avant d’atteindre l’âge de vingt-huit ans, vouloir conserver sa nationalité belge. Par effet induit, l’enfant mineur non émancipé dont le seul auteur ou adoptant ou les deux auteurs ou adoptants perdent la nationalité belge en raison de leur résidence principale à l’étranger perd également la nationalité belge.
Lorsqu’il est déchu de la nationalité belge.
La déchéance de la nationalité belge est réglée aux articles 23 à 23/2 du Code de la nationalité belge.
La déchéance ne peut être prononcée à l’égard d’un belge « de souche » (personne qui possède sa nationalité d’un auteur ou adoptant belge au jour de sa naissance) ou d’un étranger de la troisième génération (personne qui est Belge car elle est née en Belgique et dont au moins un des auteurs est né en Belgique et a eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance de l’enfant / personne née en Belgique et adoptée par un étranger, pour autant que l’adoptant soit né lui-même en Belgique et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant l’adoption).
La déchéance peut être prononcée dans les hypothèses suivantes :
si la personne a acquis la nationalité belge de manière frauduleuse ;
si la personne manque gravement à ses devoirs de citoyen belge.
La loi du 4 décembre 2012 a inséré un article 23/1 dans le Code de la nationalité belge qui prévoit d’autres cas de déchéance :
si la personne a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis pour une infraction (attentat ou complot contre le Roi, crime contre la sureté intérieure et extérieure de l’état, crime de droit international humanitaire, traite des êtres humains) pour autant que les faits reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d’obtention de la nationalité belge;
si la personne a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d’emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l’infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d’obtention de la nationalité belge ;
si la personne a acquis la nationalité belge par mariage et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance.
La loi du 20 juillet 2015 a inséré un article 23/2 dans le Code de la nationalité belge qui élargit les cas de déchéance de la nationalité en visant les personnes qui ont été condamnées, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal, à savoir une infraction terroriste.
3. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité s’appliquent-ils indifféremment selon que le ressortissant de votre pays a la nationalité de votre pays depuis sa naissance ou uniquement s’il l’a acquise ultérieurement ?
La déchéance de nationalité n’est pas possible pour les « Belges de souche » ni pour ceux que l’on qualifie « d’étrangers de la troisième génération » (voir ci-dessus, réponse à la question 2).
4. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité peuvent-ils concerner des personnes qui ne possèdent que la nationalité de votre pays ?
La perte de la nationalité belge par déclaration peut concerner une personne qui ne possède que la nationalité belge. Le déclarant doit cependant prouver qu’il acquiert ou recouvre une nationalité étrangère par l’effet de la déclaration. Si cette acquisition ou ce recouvrement ne suit pas immédiatement la déclaration de renonciation et a pour résultat de rendre l’intéressé apatride, la déclaration ne produira des effets juridiques qu’au moment de l’acquisition ou du recouvrement effectifs de la nationalité étrangère.
La déchéance de nationalité n’est pas prononcée lorsqu’elle a pour effet de rendre l’intéressé apatride, à moins que la nationalité n’ait été acquise à la suite d’une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d’un fait pertinent. Dans ce cas, même si l’intéressé n’a pas réussi à recouvrer sa nationalité d’origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu’à l’expiration d’un délai raisonnable afin de permettre à l’intéressé d’essayer de recouvrer sa nationalité d’origine
5. La législation de votre pays permet-elle d’expulser de son territoire des individus apatrides ? Dans quelles conditions ?
La reconnaissance du statut d’apatride ne donne pas automatiquement droit à un séjour de longue durée en Belgique, à moins que l’apatride reconnu se voie octroyer un droit de séjour en Belgique sur la base d’une autre procédure. L’apatride reconnu qui séjourne légalement en Belgique, bénéficie cependant d’une « interdiction d’expulsion ». La jurisprudence estime en effet qu’un apatride doit se voir accorder un séjour temporaire s’il est établi qu’il ne constitue pas un danger pour la sécurité nationale ou pour l’ordre public. Le contraire reviendrait à le priver des droits qui lui sont reconnus par la Convention de New York.
Si l’apatride reconnu souhaite un droit de séjour plus long, il doit introduire une demande d’autorisation de séjour exceptionnel pour motifs autres que médicaux (article 9 bis de la Loi sur les étrangers).
6. Votre pays a-t-il signé et/ou ratifié la convention des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ? Dans ce cas, a-t-il effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une déclaration sur le fondement de son article 8, paragraphe 3 ?
La Belgique a signé la convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
La Belgique a formulé la réserve suivante par rapport à l’article 8, § 3, de la Convention sur la réduction des apatrides :
« La Belgique se réserve le droit de déchoir de sa nationalité une personne qui ne tient pas sa nationalité d’un auteur belge au jour de sa naissance ou qui ne s’est pas vu accorder sa nationalité en vertu du Code de la nationalité belge dans les cas actuellement prévus dans la législation belge, à savoir :
o si cette personne a acquis la nationalité belge à la suite d’une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l’identité ou par fraude à l’obtention du droit de séjour ;
o si elle manque gravement à ses devoirs de citoyen belge ;
o si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis pour une des infractions suivantes :
- attentats et complots contre le Roi, contre la famille royale et contre le Gouvernement ;
- crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État ;
- crimes et délits contre la sûreté intérieure de l’État ;
- violations graves du droit international humanitaire ;
- infractions terroristes ;
- menace d’attentat contre les personnes ou contre les propriétés, et fausses informations relatives à des attentats graves ;
- vols et extorsions en matières nucléaires ;
- infractions relatives à la protection physique des matières nucléaires ;
- traite des êtres humains ;
- trafic des êtres humains ;
o si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l’infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d’obtention de la nationalité belge. »
L’assentiment parlementaire a été donné par la loi du 10 juin 2014.
7. La Belgique a-t-elle signé et/ou ratifié la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ? Dans ce cas, a-t-elle effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une réserve relative à son article 7 (« Perte de la nationalité de plein droit ou à l’initiative d’un État Partie ») ?
Non.
8. La législation de votre pays prévoit-elle des mesures qui, sans toucher à la nationalité, privent un de ses ressortissants de la qualité de citoyen ou limitent les attributs attachés à cette qualité (indignité nationale, dégradation civique, déchéance des droits civils et politiques, etc.) ? Dans quels cas ?
L’article 7 du Code pénal prévoit l’interdiction de certains droits politiques et civils comme peine accessoire en matière criminelle et correctionnelle. L’article 31 du Code pénal énumère différents droits dont l’interdiction doit ou peut être prononcée. On citera par exemple, le droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, l’éligibilité, le droit de porter une décoration ou un titre de noblesse, etc. L’interdiction de tous ces droits est obligatoire et à perpétuité pour la personne condamnée à une peine de réclusion de plus de dix ans. Pour les peines de réclusion de cinq à dix ans, l’interdiction est facultative et elle peut porter sur tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 de façon perpétuelle ou pour dix ans à vingt ans. En matière correctionnelle, l’interdiction ne peut être prononcée que dans les cas où la loi le prévoit (par exemple viol, attentat à la pudeur, outrage public aux mœurs, etc.). Il existe également des dispositions spécifiques qui prévoient des déchéances et interdictions automatiques, qui résultent d’office de la condamnation du chef de certaines infractions.
On signalera par ailleurs une nouvelle mesure décidée par le gouvernement, début 2015, dans le cadre de son plan de lutte contre le terrorisme.
Le ministre de l’Intérieur a, depuis le 5 janvier 2016, la possibilité de temporairement refuser, retirer ou invalider la carte d’identité d’un Belge s’il existe des indices fondés et très sérieux que celui-ci souhaite se rendre sur un territoire où des groupes terroristes sont actifs. L’identité des personnes soupçonnées est communiquée au ministre par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace. Le refus ou retrait temporaire de la carte d’identité entraîne automatiquement la décision de refus de délivrance, de retrait ou d’invalidation du passeport ou du titre de voyage belge de la personne concernée par le ministre des Affaires étrangères.
La durée maximale du refus de délivrance, de retrait ou d’invalidation de la carte d’identité est de trois mois. Ce délai ne peut être prolongé qu’une seule fois par le ministre pour une durée identique, après avis motivé de l’Organe de coordination de la menace.
9. Dans quelle mesure votre Parlement est-il partie prenante ou associé à la prise et au contrôle des décisions prononçant la perte ou la déchéance de la nationalité ?
Le Parlement n’est pas associé aux décisions prononçant la déchéance de la nationalité. Ce sont les autorités judiciaires qui sont compétentes en la matière.
Espagne
1. La binationalité est possible en Espagne mais elle est limitée.
- Dans le cas d’une personne qui demande sa naturalisation, l’article 23.b du Code civil stipule qu’elle doit renoncer à sa nationalité antérieure sauf « les cas cités à l’article 24.1 et les Séfarades originaires d’Espagne » (ce dernier élément a été ajouté par la loi 12/2015 du 24 juin 2015 portant sur l’acquisition de la nationalité espagnole par les juifs séfarades originaires d’Espagne). Les pays d’origine concernés par l’article 24.1 sont tous les pays d’Amérique latine, Andorre, Portugal, les Philippines et la Guinée équatoriale.
- Dans le cas d’une personne espagnole souhaitant acquérir une autre nationalité (par exemple parce qu’elle habite dans un autre pays), elle ne peut conserver sa nationalité espagnole en plus de la nouvelle que s’il s’agit des pays cités dans l’article 24.1 ou si la personne fait une déclaration enregistrée à l’état civil (au Consulat par exemple) affirmant qu’elle souhaite garder sa nationalité espagnole. Si cette démarche volontaire n’est pas faite, la perte de la nationalité espagnole (sauf pour les pays de l’article 24.1) est automatique au bout de 3 ans.
2. Conformément à l’article 11 de la Constitution espagnole, les Espagnols d’origine (de origen) ne peuvent être déchus de leur nationalité, quels que soient les actes qu’ils commettent. Cette mention dans la Constitution espagnole a des raisons historiques, de nombreux membres de l’armée républicaine et leurs familles ayant été déchus de leur nationalité durant la période franquiste.
À côté des cas de renonciation volontaire à la nationalité et en relation avec les règles inhérentes à la binationalité en Espagne, les Espagnols d’origine peuvent perdre leur nationalité dans les cas suivants (article 24 du Code civil) sauf si l’Espagne est en guerre :
- s’ils sont émancipés, qu’ils résident à l’étranger et acquièrent volontairement une autre nationalité. La perte peut être évitée si dans un délai de trois ans ils manifestent leur volonté de conserver leur nationalité. L’acquisition de la nationalité d’un pays ibéro-américain, d’Andorre, des Philippines, de Guinée équatoriale ou du Portugal n’est pas un motif suffisant pour entraîner la perte de la nationalité espagnole ;
- s’ils sont émancipés, qu’ils résident à l’étranger et que pendant une durée de trois ans, ils utilisent exclusivement la nationalité qu’ils possédaient avant leur émancipation. La perte peut être évitée si dans un délai de trois ans ils manifestent leur volonté de conserver leur nationalité ;
- s’ils sont émancipés, qu’ils possèdent une autre nationalité et résident habituellement à l’étranger et qu’ils y renoncent volontairement ;
- les Espagnols, nés à l’étranger et qui sont espagnols parce qu’ils sont nés d’un père espagnol ou d’une mère espagnole né(e) également à l’étranger, perdront leur nationalité si dans un délai de trois ans à compter de leur émancipation ou de leur majorité ils ne déclarent pas leur volonté de conserver la nationalité espagnole.
La déchéance de nationalité, uniquement applicable aux personnes naturalisées, n’est possible que dans les trois cas prévus par l’article 25 du Code civil espagnol :
- Lorsque pendant une durée de trois ans, la personne naturalisée « utilise » uniquement sa nationalité d’origine (article 25.1.a).
- Lorsque la personne naturalisée « entre volontairement au service armé ou exerce une charge politique dans un État étranger en dépit de l’interdiction expresse du Gouvernement espagnol » (article 25.1.b).
- Lorsqu’il est établi par une décision de justice que la personne naturalisée a fraudé ou menti pour obtenir sa nationalité espagnole (article 25.2).
3. Voir ci-dessus
4. Étant donné les règles applicables en matière de binationalité, les cas de pertes ou de déchéance de la nationalité espagnole peuvent concerner des personnes ne possédant que la nationalité espagnole. Cependant il convient de préciser que la grande majorité des demandes de naturalisation en Espagne est faite par des citoyens de pays latino-américains, à l’exception des Marocains. Bien entendu, les Espagnols d’origine, conformément à la Constitution, ne peuvent devenir apatrides de ce fait.
5. L’Espagne a ratifié en 1997 la convention de 1954 sur les apatrides. En conséquent, les apatrides peuvent être expulsés du territoire espagnol dans les conditions prévues par l’article 31 de la convention de 1954 et selon la procédure établie pour les étrangers dans la loi sur les droits et libertés des étrangers (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social révisée en juillet 2015). Dans tous les cas, il sera appliqué aux apatrides un délai leur permettant de rechercher un pays d’accueil où il sera admis légalement ainsi que demandé dans l’article 31 de la Convention.
6. L’Espagne n’est pas partie à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie
7. L’histoire espagnole a été jalonnée d’épisodes de dégradation civiques, en particulier pendant l’époque franquiste où de nombreux opposants ont été interdits de séjour ou soumis à la dégradation civique. Aujourd’hui il existe uniquement des mesures sur la limitation d’obtention du passeport.
8. Le décret royal 896/2003 du 11 juillet 2003 portant sur la délivrance des passeports stipule qu’une personne peut se voir retirer son passeport si une décision judiciaire a été prise contre elle sur des délits ou des mesures de sécurité impliquant la privation ou la limitation de sa liberté de circulation ; si une autorité judiciaire a interdit la délivrance du passeport ; si le ministère de l’intérieur le demande dans l’application de l’état d’urgence ou l’état de siège.
9. L’article 11.2 de la Constitution espagnole interdit indirectement au Parlement d’établir des critères imposant la perte de nationalité à des Espagnols d’origine.
Italie
1. Les ressortissants italiens peuvent-ils posséder, concomitamment, une autre nationalité ?
Conformément à l’article 11 de la loi n° 91 du 5 février 1992, la double nationalité est possible. Cependant, la loi reconnaît la validité des diverses dispositions prévues par les accords internationaux en vigueur entre l’Italie et les autres pays (art. 26.3) en matière de nationalité, et notamment la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalité. Sur la base de cette convention, le citoyen d’un État qui acquiert la nationalité d’un autre État à la suite d’une manifestation expresse de volonté (naturalisation, option ou réintégration) perd la nationalité antérieure (voir la perte de nationalité). Conformément à la loi n° 876 du 4 octobre 1966 de ratification de la Convention de Strasbourg sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité et à l’article 1 de cette convention, l’acquisition volontaire par un ressortissant italien de la nationalité d’un des États parties à cette convention (les Pays-Bas par exemple) entraîne donc de plein droit la perte de la nationalité italienne. L’Italie a cependant ratifié le Second Protocole à la Convention de 1963, selon lequel si un citoyen d’un État partie à la Convention acquiert la citoyenneté d’un autre État partie sur le territoire duquel il est né et réside, ou est domicilié depuis une date antérieure à ses dix-huit ans, chaque État peut décider que la nationalité d’origine soit conservée.
2. Ces ressortissants peuvent-ils perdre leur nationalité ou en être déchus ? Dans quels cas ?
3. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité s’appliquent-ils indifféremment selon que le ressortissant du pays interrogé a la nationalité de ce pays depuis sa naissance ou uniquement s’il l’a acquise ultérieurement ?
4. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité peuvent-ils concerner des personnes qui ne possèdent que la nationalité italienne ?
Conformément à l’article 22 de la Constitution italienne, « personne ne peut être privé, pour des motifs d’ordre politique, de la capacité juridique, de la nationalité (cittadinanza), du nom. »
A côté des cas de renonciation volontaire à la nationalité, prévus par la loi, la loi italienne n° 91/1992 du 5 février 1992 prévoit deux cas de déchéance automatique de nationalité :
• Lorsque le citoyen italien refuse d’accéder à la demande, émise par l’État italien, de renoncer à l’emploi ou à la charge publics qu’il exercerait dans un autre pays étranger, ou à la fonction qu’il aurait dans une organisation internationale à laquelle l’Italie n’est pas partie, ou de ne pas réaliser son service militaire dans un autre état ;
• Lorsque la charge publique, le service militaire effectué au profit d’un État étranger ou l’acquisition de la nationalité de cet État ont lieu durant une situation d’état de guerre entre l’Italie et cet État (article 12, alinéa 2).
En matière de perte de nationalité automatique, la loi ne précise pas selon que le citoyen a la nationalité de naissance ou pas, ni s’il possède ou non une autre nationalité.
On notera qu’après la perte de la nationalité, la loi italienne ménage la possibilité de sa réacquisition. Ainsi l’article 13 de la loi précitée souligne que hors des cas de perte de nationalité due à la perte d’effet de l’adoption du fait de l’adopté, visé à l’article 3 alinéa 2, et la déchéance automatique visée par l’article 12 alinéa 2, il est possible de recouvrer la nationalité sous réserve que le Ministère de l’Intérieur ne s’y oppose pas par décret pour raisons graves et motivées (article 13 alinéa 3).
5. La législation du pays interrogé permet-elle d’expulser de son territoire des individus apatrides ? Dans quelles conditions ?
L’Italie a signé et ratifié respectivement les 20 octobre 1954 et 3 décembre 1962 la Convention de 1954 relative au statut d’apatride, dont l’article 31 indique :
1. Les États contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
2. L’expulsion de cet apatride n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément la procédure prévue par la loi. L’apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.
3. Les États contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.
6. L’Italie a-t-elle signé et/ou ratifié la convention des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatride ? Dans ce cas, a-t-elle effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une déclaration sur le fondement de son article 8, paragraphe 3 ?
L’Italie n’a adhéré à la Convention des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatride que le 1er décembre 2015. Plus précisément, la loi italienne n° 162/2015 du 29 septembre 2015, entrée en vigueur le 13 octobre après sa publication au Journal officiel la veille (Gazzetta ufficiale n° 237 du 12 octobre) en a autorisé la ratification. Le rapport publié à l’occasion du projet de loi soulignait le paradoxe qu’il y avait pour l’Italie à n’avoir pas ratifié cette convention alors qu’elle l’avait fait pour la Convention de 1954 relative au statut d’apatride (loi italienne n° 306 du 1er février 1962) et que son droit interne avec la loi n° 11/1992 du 5 février 1992 en avait introduit les principaux éléments. L’article 8 de la convention est ainsi visé par l’article 12 de la loi italienne précitée.
7. L’Italie a-t-elle signé et/ou ratifié la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ? Dans ce cas, a-t-elle effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une réserve relative à son article 7 (« Perte de la nationalité de plein droit ou à l’initiative d’un État Partie ») ?
L’Italie a signé la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 mais ne l’a pas ratifiée.
8. La législation italienne prévoit-elle des mesures qui, sans toucher à la nationalité, privent un de ses ressortissants de la qualité de citoyen ou limitent les attributs attachés à cette qualité (indignité nationale, dégradation civique, déchéance des droits civils et politiques, etc.) ? Dans quels cas ?
Sans objet.
9. Dans quelle mesure le Parlement italien est-il partie prenante ou associé à la prise et au contrôle des décisions prononçant la perte ou la déchéance de la nationalité ?
La déchéance de nationalité relève du Ministère de l’Intérieur.
Compléments
1. La législation du pays interrogé permet-elle d’expulser de son territoire des individus apatrides ? Dans quelles conditions ?
En vertu du décret n° 286/98, la législation italienne sur l’immigration qui énonce les cas d’expulsion comprend des dispositions à l’égard des étrangers, c’est-à-dire des citoyens de pays hors de l’Union européenne ou des apatrides. L’article 19 établit le principe du non refoulement : « en aucun cas ne peut avoir lieu l’expulsion ou le rapatriement vers un État dans lequel l’étranger est susceptible de faire l’objet de persécutions en raison de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses vues politiques, de ses conditions personnelles et sociales, ou serait susceptible d’être renvoyé dans un État dans lequel il ne serait pas protégé contre la persécution. »
De même, l’expulsion n’est pas possible pour un étranger de moins de 18 ans ou qui détient un permis de résidence permanent dans un pays de l’Union européenne (sauf pour raisons tenant à la sécurité nationale) ou qui vit avec des personnes titulaires de la citoyenneté italienne ou enfin qui attend un enfant.
L’article 20 du décret législatif n° 251/07 affirme cependant que pour le réfugié ou l’étranger admis à recevoir la protection subsidiaire l’expulsion est possible dans les cas suivants :
• Lorsqu’il existe des raisons substantielles tenant à la sécurité nationale de la République italienne ;
• Lorsqu’il est condamné pour une infraction passible d’une peine d’au moins 4 ans de prison et au maximum de 10 ans.
En pratique, pour une personne apatride ou dont il est impossible de vérifier la nationalité, il est « techniquement » impossible de procéder à une expulsion.
2. La législation italienne prévoit-elle des mesures qui, sans toucher à la nationalité, privent un de ses ressortissants de la qualité de citoyen ou limitent les attributs attachés à cette qualité (indignité nationale, dégradation civique, déchéance des droits civils et politiques, etc.) ? Dans quels cas ?
L’article 28 du Code pénal italien permet d’interdire l’exercice de charges publiques (à titre définitif ou temporaire) lorsque la personne est condamnée à certaines infractions et, plus récemment, en vertu du décret législatif n° 235/2012, la condamnation à certaines infractions empêche la candidature aux élections législative et sénatoriale.
Pologne
La Constitution polonaise du 2 avril 1997, dans le second alinéa de son article 34 indique que : « Le citoyen polonais ne peut perdre la nationalité polonaise, à moins qu’il renonce à celle-ci ».
Elle assortit cette demande à un mécanisme de renonciation assez solennel. Son article 137 précise ainsi que : « Le président de la République attribue la nationalité polonaise et autorise la renonciation à celle-ci ».
La question de la nationalité est historiquement sensible en Pologne :
- nombre de dirigeants, durant les premiers temps de l’occupation soviétique, avaient la double nationalité (russe, ukrainienne, biélorusse) ;
- plusieurs opposants (notamment de confession juive) ont été déchus de leur nationalité à la fin des années soixante.
Royaume-Uni
La déchéance de nationalité existe en droit britannique depuis longtemps - on trouve par exemple un texte législatif en la matière en 1914 - mais la base juridique principale qui la régit est la loi sur la nationalité britannique de 1981 (British Nationality Act 1981 ou BNA 1981), et plus particulièrement sa section 40 amendée.
Avec les dispositions de la section 66 de la loi sur l’Immigration de 2014 (Immigration Act 2014), entrée en vigueur le 28 juillet 2014, le Ministre de l’Intérieur peut désormais également priver de leur nationalité les citoyens britanniques sur la base d’une conduite considérée comme « sérieusement préjudiciable » à l’égard des intérêts vitaux du Royaume-Uni, au nombre desquels les atteintes à la sécurité nationale.
Outre le cas de nullité de la nationalité, on peut donc dégager trois principaux cas de figure de déchéance de nationalité :
• Lorsque la nationalité a été obtenue au moyen de fraude, représentation erronée ou de dissimulation de faits matériels (« fraud, false representation or the concealment of any material fact ») ;
• Lorsque la mesure de déchéance paraît propice à garantir l’ordre public (« conducive to the public good ») : le Ministre de l’Intérieur peut priver la personne de sa nationalité britannique dès lors qu’elle ne rend pas la personne apatride (section 40 (2) et 40 (4) de la loi de 1981 modifiée) ;
• En cas de citoyenneté obtenue par naturalisation, pour des raisons d’ordre public dès lors que la personne s’est conduite d’une manière sérieusement préjudiciable aux intérêts vitaux du Royaume-Uni, de ses Iles ou de tout territoire britannique ultramarin, dès lors que le Ministre de l’Intérieur a des motifs raisonnables de penser que la personne serait éligible à une autre nationalité (« reasonable grounds to believe that the person is able to become a national of another country »).
Les deux derniers cas de figure font appel à la notion de « conducive to the public good » que les documents de travail d’instruction des dossiers en matière de visas et d’immigration (UKVI Instructions de la nationalité, volume 1, chapitre 55) explicitent comme la prise en compte de l’intérêt public ou de l’intérêt général, évaluée sur le fondement « d’une participation au terrorisme, à l’espionnage, au crime organisé, aux crimes de guerre et aux comportements inacceptables ».
Il ressort également du BNA 1981 que les premier et troisième scenarios – dans lesquels la citoyenneté a été acquise par « naturalisation » ou « enregistrement » - peuvent être mis en œuvre sans tenir compte du fait que la personne puisse devenir apatride. De fait, le troisième cas de figure résulte de la loi sur l’Immigration de 2014 dont l’affaire Al-Jedda a été l’un des arrière-plans avec l’arrêt controversé de la Cour suprême en 2013. En 2007, un citoyen d’origine irakienne, naturalisé britannique, s’étant vu privé de la nationalité britannique à l’issue de sa peine de prison (après son arrestation en Irak) pour raison d’ordre public, avait fait appel de la décision au motif que celle-ci le rendait apatride. La Cour suprême, saisie par le Ministère de l’Intérieur débouté, considérait en 2013 que la rédaction initiale de la section 40 du BNA 1981 amendé nécessitait que la déchéance de nationalité ne rende pas l’individu apatride au moment de sa décision.
L’objectif recherché par le gouvernement pour modifier la législation antérieure à 2014 consistait donc à permettre au Ministre de l’Intérieur de déchoir de la nationalité britannique un individu sans tenir compte du risque d’apatridie. Or une telle prérogative qui existait jusqu’en 2003 avait été supprimée en anticipation de la signature de la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, que le Royaume-Uni n’a en définitive jamais signée.
Outre les conditions de motivation et d’information de la procédure à l’intéressé, la section 40 du BNA 1981 amendé indique que la décision de déchéance de nationalité est susceptible d’appel soit auprès de la Chambre d’immigration et d’asile du Tribunal de Premier niveau (First-Tier Tribunal) soit, si la confidentialité l’exige en raison de motifs de sécurité nationale, auprès de la Commission spéciale des appels en matière d’immigration. La procédure d’appel est non suspensive.
En mai 2014 (avant l’adoption de la loi sur l’immigration de 2014), le Ministre de l’Immigration et de la sécurité, James Brockenshire, produisit des chiffres sur la procédure de déchéance de nationalité qui lui faisaient dire qu’elle était relativement peu mise en œuvre : depuis 2006 en effet, il avait été procédé à 26 déchéances de nationalité au titre de la condition de fraude, fausse représentation ou de dissimulation de fait important, et 27 au titre de la condition relative à l’ordre public (conducive to the public good grounds). Au vu d’autres sources, le Bureau du Journalisme d’investigation invoque cependant dans son rapport sur la « révocation de la citoyenneté » une augmentation significative du nombre de déchéances dans les années récentes, principalement depuis 2013 dans le contexte des combattants partis faire le jihad en Syrie. A l’encontre de l’exigence de notification à l’intéressé d’un « ordre » de déchéance de nationalité, la plupart de ces déchéances prononcées l’auraient été alors que les intéressés se trouvaient à l’extérieur du Royaume-Uni.
On notera qu’à l’heure actuelle, la législation entrée en vigueur fin juillet 2014 n’a pas été appliquée à des situations d’espèce.
Suède
1. Les ressortissants suédois peuvent-ils posséder, concomitamment, une autre nationalité ?
La loi sur la nationalité (le Sweden citizenship act) autorise la double nationalité depuis juillet 2001.
2. Ces ressortissants peuvent-ils perdre leur nationalité ou en être déchus ? Dans quels cas ?
La personne ayant acquis la nationalité suédoise par naturalisation ne peut la perdre.
3. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité s’appliquent-ils indifféremment selon que le ressortissant suédois a la nationalité de ce pays depuis sa naissance ou uniquement s’il l’a acquise ultérieurement ?
Le seul cas de déchéance concerne le ressortissant suédois par filiation et qui réside à l’étranger. La section 14 du Sweden citizenship act dispose que : « Perd sa nationalité suédoise à l’âge de 22 ans le citoyen suédois né à l’étranger, qui n’a jamais été domicilié sur le territoire suédois et qui n’y a jamais séjourné dans des circonstances qui indiqueraient un lien avec la Suède ». Concrètement, s’il ne confirme pas sa volonté de demeurer suédois entre 18 et 22 ans il perd sa nationalité automatiquement à 22 ans.
4. Ces cas de perte ou de déchéance de la nationalité peuvent-ils concerner des personnes qui ne possèdent que la nationalité suédoise ?
La loi suédoise sur la nationalité ne prévoit l’hypothèse de la déchéance que pour son ressortissant qui dispose d’une autre nationalité.
5. La législation suédoise permet-elle d’expulser de son territoire des individus apatrides ? Dans quelles conditions ?
La loi suédoise sur l’entrée et le séjour aligne la situation de l’apatride sur celle des autres ressortissants étrangers. Ainsi, en cas d’absence de titre de séjour ou de commission d’infractions pénales il peut se faire refuser l’entrée sur le territoire suédois ou faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
6. La Suède a-t-elle signé et/ou ratifié la convention des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatride ? Dans ce cas, a-t-elle effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une déclaration sur le fondement de son article 8, paragraphe 3 ?
La Suède a ratifié le 19 février 1969 sans réserves la convention de 1961.
7. La Suède a-t-elle signé et/ou ratifié la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ? Dans ce cas, a-t-elle effectué, lors de cette signature ou de cette ratification, une réserve relative à son article 7 (« Perte de la nationalité de plein droit ou à l’initiative d’un État Partie ») ?
La Suède a signé la Convention de 1997 le 6 novembre 1997. Ce texte a été ratifié le 28 juin 2001 et est en vigueur depuis le 1er octobre 2001.
8. La législation suédoise prévoit-elle des mesures qui, sans toucher à la nationalité, privent un de ses ressortissants de la qualité de citoyen ou limitent les attributs attachés à cette qualité (indignité nationale, dégradation civique, déchéance des droits civils et politiques, etc.) ? Dans quels cas ?
La loi suédoise sur la nationalité ne prévoit pas ce type de situations.
9. Dans quelle mesure le Parlement suédois est-il partie prenante ou associé à la prise et au contrôle des décisions prononçant la perte ou la déchéance de la nationalité ?
Les questions de nationalité sont gérées par la Swedish migration agency, qui agit dans le cadre d’instructions émanant du Gouvernement et du Parlement (Riksdag)