N° 1510 N° 254
____ ___
ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2008 - 2009
____________________________________ ___________________________
Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale Annexe au procès-verbal
le 10 mars 2009 de la séance du 10 mars 2009
________________________
OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
________________________
sur l’évaluation de l’application de l’article 19
de la loi de programme pour la recherche
(compte rendu de l’audition publique du 16 décembre 2008)
Par
M. Claude Birraux, député
M. Jean-Claude Étienne, sénateur
Mme Geneviève Fioraso, députée
__________ __________
Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale Déposé sur le Bureau du Sénat
par M. Claude BIRRAUX, par M. Jean-Claude ÉTIENNE,
Président de l'Office Premier Vice-Président de l'Office
_________________________________________________________________________
COMPOSITION
de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques
Président
M. Claude BIRRAUX
Premier Vice-Président
M. Jean-Claude ÉTIENNE
Vice-Présidents
M. Claude GATIGNOL, député Mme Brigitte BOUT, sénatrice
M. Pierre LASBORDES, député M. Christian GAUDIN, sénateur
M. Jean-Yves LE DÉAUT, député M. Daniel RAOUL, sénateur
|
SÉnateurs | |
M. Christian BATAILLE M. Claude BIRRAUX M. Jean-Pierre BRARD M. Alain CLAEYS M. Pierre COHEN M. Jean-Pierre DOOR Mme Geneviève FIORASO M. Claude GATIGNOL M. Alain GEST M. François GOULARD M. Christian KERT M. Pierre LASBORDES M. Jean-Yves LE DÉAUT M. Michel LEJEUNE M. Claude LETEURTRE Mme Bérengère POLETTI M. Jean-Louis TOURAINE M. Jean-Sébastien VIALATTE |
M. Gilbert BARBIER M. Paul BLANC Mme Marie-Christine BLANDIN Mme Brigitte BOUT M. Marcel-Pierre CLÉACH M. Roland COURTEAU M. Marc DAUNIS M. Marcel DENEUX M. Jean-Claude ÉTIENNE M. Christian GAUDIN M. Serge LAGAUCHE M. Jean-Marc PASTOR M. Xavier PINTAT Mme Catherine PROCACCIA M. Daniel RAOUL M. Ivan RENAR M. Bruno SIDO M. Alain VASSELLE |
Sommaire
M. CLAUDE BIRRAUX, PRÉSIDENT DE L’OPECST, DÉPUTÉ DE HAUTE-SAVOIE 13
MME VALÉRIE PÉCRESSE, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE. 15
MME GENEVIÈVE FIORASO, MEMBRE DE L’OPECST, DÉPUTÉE DE L’ISÈRE. 19
M. JEAN-CLAUDE ÉTIENNE, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE L’OPECST, SÉNATEUR DE LA MARNE 22
M. MARC LE GAL, DIRECTEUR DE LYON SCIENCE TRANSFERT 29
M. MARC LEDOUX, DIRECTEUR DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE DU CNRS 33
M. BRUNO SPORTISSE, DIRECTEUR DU TRANSFERT ET DE L’INNOVATION À L’INRIA 36
M. PASCAL IRIS, DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION ARMINES 40
M. GÉRARD JACQUIN, PRÉSIDENT DE INRA TRANSFERT 42
MME CÉCILE THARAUD, PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE D’INSERM-TRANSFERT 45
M. JEAN THERME, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE DU COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE 48
M. THIERRY SUEUR, PRÉSIDENT DU COMITÉ PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU MEDEF. 55
M. DENIS RANDET, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ANRT (ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE TECHNIQUE) 58
M. LE PRÉSIDENT CLAUDE BIRRAUX 59
M. JEAN-YVES LE DÉAUT, DÉPUTÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE, VICE-PRÉSIDENT DE L’OPECST. 59
M. GILLES AVENARD, VICE-PRÉSIDENT DE FRANCE BIOTECH 60
MME ÉDITH HENRION D’AUBERT, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE CROISSANCEPLUS 63
M. CHRISTOPHE FORNES, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION « RECHERCHE ET INNOVATION » DE CROISSANCEPLUS 64
Comment organiser les liens entre la recherche et l’innovation? Quels sont les leviers d’une politique de valorisation? Quels en sont les freins?
La présente audition publique, organisée par l’OPECST, a recueilli le témoignage d’acteurs publics et privés sur ce thème.
Divers outils ont en effet été mis en place. La loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche a ainsi offert la possibilité aux établissements, pôles et réseaux de recherche, de confier à des entités de droit privé la gestion d’activités de valorisation et a chargé l’OPECST d’évaluer les initiatives prises dans ce cadre.
L’évaluation de l’application de cette disposition a été l’occasion de dresser un bilan des politiques de valorisation mises en oeuvre en France et de dégager des perspectives d’évolution.
I - Le paradoxe français : une recherche reconnue pour son excellence qui peine en matière de valorisation
Si la qualité de la recherche française est reconnue, l’innovation accuse un véritable retard : cinq ans par rapport à l’Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, et dix ans par rapport aux États-Unis et à Israël, selon certains indicateurs.
Il est urgent que la France rejoigne le peloton de tête des pays innovants. Dans ce contexte, la valorisation de la recherche (recherche partenariale, valorisation de la propriété intellectuelle, création d’entreprises issues de laboratoires publics, mobilité des chercheurs entre les secteurs public et privé) est stratégique dans une économie mondialisée.
L’extrême concentration des contrats de recherche sur certains établissements
La volonté du législateur, à travers la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, était de favoriser la conclusion de partenariats entre les établissements de recherche et les entreprises privées. En effet, le système actuel souffre d’une très grande concentration des contrats de recherche sur certains établissements. En rapportant les montants des contrats à la dépense de recherche des établissements, un écart apparaît nettement entre le CEA, qui obtient les résultats les plus élevés dans presque toutes les disciplines scientifiques où il est présent, et les universités et le CNRS, qui ne couvrent que 3 % en moyenne de leurs dépenses de recherche par des contrats avec les entreprises.
Sur les 20 premiers instituts Carnot, le CEA devance largement les autres établissements.
La dispersion des structures en charge de la valorisation et la coupure persistante entre le monde de l’entreprise et le monde de la recherche
L’enchevêtrement des structures chargées de la valorisation de la recherche engendre confusion, perte d’information et saupoudrage des crédits. De ce fait, on déplore également une faible professionnalisation des équipes. Chaque laboratoire a tendance à tout faire alors que la valorisation est un métier. Ainsi, il a fallu du temps pour convaincre les chercheurs que l’inventeur n’est pas le propriétaire, que celui-ci n’est pas le mandataire négociateur et que ce dernier n’est pas l’unique récipiendaire d’un revenu financier éventuel.
Par ailleurs, la plupart des partenariats sont conclus avec de grandes entreprises. En revanche, les petites entreprises y ont plus difficilement accès. Elles restent demandeuses d’un guichet unique qui les dirigerait vers les plates-formes, les technopoles, les pépinières susceptibles de les aider.
Du côté des laboratoires, l’entreprise est encore trop souvent perçue comme un financeur possible des travaux de recherche ou des équipes, sans réelle collaboration sur le long terme, ni véritable adaptation des programmes de recherche aux besoins de l’économie.
Des organismes de recherche en première ligne
Les organismes de recherche ont exploré toutes les solutions juridiques pour développer la valorisation : structures internes dotées d’équipes spécialisées ou filiales de valorisation. Et les résultats sont prometteurs.
Ainsi, entre 2000 et 2007, le nombre d’inventeurs issus du CNRS a progressé de 1000 à 3 200 ; 12% de l’ensemble des personnels susceptibles de déposer un brevet en ont déposé un en 2007. 41% des brevets sont exploités par un industriel au bout d’un an. Mais les chiffres ne sont intéressants que par comparaison. Le nombre de déclarations d’invention du CNRS se situe au niveau des grandes universités américaines : 484 pour le CNRS, contre 518 pour l’Université de Stanford et 523 pour le MIT de Boston. Le nombre de demandes de brevet est proche de celui du MIT – 316 contre 321 – mais inférieur à celui de Stanford : 541. En revanche, le nombre de brevets délivrés est nettement supérieur à celui des grandes universités américaines : 284, contre 118 pour Stanford et 121 pour le MIT. Pour ce qui est des licences, le CNRS est à peu près à égalité avec Stanford et Boston – 104 contre respectivement 109 et 121 – mais le nombre de start-up est largement au-dessus. La Max-Planck-Gesellschaft ne compte que deux start-up, 30 licences, 79 brevets délivrés.
L’INSERM, pour sa part, a opté en 2008 pour une filiale de droit privé à l’instar de ce qui existe à l’université Louvain, au Massachusetts Institute of Technology, au DKFZ allemand (centre de recherche contre le cancer). La priorité de la filiale est de créer une culture de l’innovation, et d’assurer de façon proactive la rencontre entre une offre de technologies de rupture et une demande croissante du monde industriel. Le principal client d’INSERM-Transfert, l'industrie pharmaceutique, sous-traite 50 % de son budget de recherche d’innovations de rupture au milieu académique.
En matière de filiales privées de transfert de technologies, deux grands modèles d’organisation coexistent. Dans les pays anglo-saxons, des chefs de projet gèrent la détection de l’invention, la stratégie de propriété industrielle, sa négociation, sa contractualisation, puis son suivi et son développement auprès de l’industrie. Les ingénieurs et techniciens français maîtrisent peu la gestion de projet et le transfert de technologies manque encore de professionnalisme.
Aussi, INSERM-Transfert a-t-il fait le choix d’une organisation en départements techniques, qui devront dans un premier temps développer leur expertise et leur professionnalisme pour les porter à des niveaux d’excellence internationale.
Les performances de l’INSERM sont celles d’une université américaine moyenne, soit cinq millions d’euros de revenus de licence. Pour un budget équivalent, le Medical Research Council génère cent millions d’euros de redevances annuelles. Le Medical Research Council, les Instituts de Stanford, de Harvard, l’université de Louvain sont parvenus progressivement à créer un cercle vertueux d’innovation fondé sur un réinvestissement dans la recherche.
La direction de la recherche du CEA gère plus de deux cent millions d’euros de contrats industriels, qui assurent 75% de son financement, bien qu’il s’agisse d’une entité publique. Le CEA dépose 400 brevets par an, soit un brevet par million de dollars de chiffre d’affaires, ce qui le classe au meilleur niveau mondial. Le CEA compte plus de 400 partenaires industriels.
Des catalyseurs d’innovation ont été créés au sein de centres d’excellence rassemblant enseignement supérieur, recherche appliquée, acteurs de l’entreprise et du monde économique, tels que le MINATEC de Grenoble, l’INES de Chambéry ou le DIGITEO Labs de Saclay.
Le CEA fonctionne selon un business model original : la propriété industrielle est le capital, dont est concédée la jouissance à des industriels sous forme de licences. Cela suppose une recherche de clients, avec 115 commerciaux, qui sont des chercheurs formés à la négociation commerciale
L’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) a une politique de valorisation très dynamique. En effet, le transfert technologique fait partie des missions de cet établissement public au même titre que la recherche, l’institut dépendant de deux ministères de tutelle, celui de la recherche et celui de l’industrie. Le transfert peut s’opérer par la création d’une entreprise, la licence, la participation à une action de standardisation, la mise à disposition d’une communauté industrielle de logiciels libres – open source –, ou par le montage d’un consortium avec des industriels pour valoriser une technologie.
La recherche partenariale s’adresse essentiellement aux départements de R&D des grands groupes et peut prendre la forme de laboratoires communs avec mise en commun des personnels et définition d’actions stratégiques.
L’INRIA essaie de renforcer le transfert technologique vers les PME, les « spin-off » de l’INRIA bien sûr – une centaine ont été créées depuis 25 ans – mais aussi les PME innovantes.
La politique de transfert technologique de l’INRA reflète sa position, très dominante en matière de productions végétales et animales, alors que dans le domaine de la transformation des produits et de la nutrition, ses compétences recouvrent en partie celles d’autres établissements. La valorisation « bipolaire » constitue une autre spécificité de l’INRA, dont les premiers « clients » sont les 400 000 exploitations agricoles françaises.
Deux sociétés de transfert, filiales à 100 % de l’INRA, ont été créées, INRA-Transfert SA, dont le chiffre d’affaires s’élève à 7,5 millions d’euros et qui compte dans son portefeuille 350 licences actives, et Agri-Obtentions SA, qui détient 500 titres de protection d’une très haute spécialisation.
Une veille internationale partenariale est assurée sur une centaine de groupes industriels, au niveau mondial.
50 à 80 déclarations d’invention sont examinées chaque année et l’intéressement des chercheurs représente 1 million d’euros, pour 300 ayants droit, soit un peu plus que la moyenne des établissements similaires. Depuis huit ans, l’INRA a assuré l’incubation de 45 start-up.
II - Des perspectives prometteuses
Les inflexions récentes de la politique de valorisation de la recherche
La loi de 1999 sur l’innovation et la recherche, au-delà des dispositions qu’elle a pu introduire sur les incubateurs ou sur la création d’entreprises par les personnels de la recherche publique, a été un véritable « déclencheur » dans l’esprit des chercheurs français.
Le Bayh-Dole Act américain a joué le même rôle de déclencheur dans la société américaine. Or le transfert technologique a connu aux États-Unis le plus fort taux de croissance au milieu des années 90, soit une quinzaine d’années après le Bayh-Dole Act. La loi sur l’innovation et la recherche ayant été votée il y a seulement neuf ans, cela laisse beaucoup d’espoirs pour les prochaines années.
De nouveaux outils ont été créés, tels que le statut de la jeune entreprise innovante, les pôles de compétitivité, les fonds d’amorçage, les instituts Carnot et la loi de programme de 2006 pour la recherche a créé les PRES, pôles de recherche et d’enseignement supérieur.
L’âge de la maturité commence enfin à arriver avec la loi de 2007 sur les universités, qui place la valorisation au même niveau que la recherche dans la liste des missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche. La valorisation intervenait après un certain nombre d’autres missions ; désormais « la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats » sont mises au même niveau.
Les efforts considérables des universités pour combler leur retard
Depuis une dizaine d’années, les freins au développement d’une recherche partenariale en France commencent à être levés et particulièrement depuis la loi de 2006 qui a instauré les PRES. Ces pôles ont vocation à coordonner sur un territoire des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et à leur donner une visibilité internationale, en lien avec les entreprises. Le plan Campus vise dans les trois prochaines années à faire de ces pôles universitaires des champions internationaux de la recherche, de la formation et de l’innovation. Ainsi, le ministère a sélectionné 15 sites qui seront autant de clusters d’excellence. à Lyon et en Bretagne ont déjà été créés des services de valorisation des PRES qui sont des services mutualisés et uniques, facilement reconnaissables par les industriels et disposant d’une masse critique.
Ces services accompagnent les chercheurs à toutes les étapes du processus de valorisation.
Cette fonction mobilise des ressources importantes, pour un retour sur investissement aléatoire et, quand il existe, assez éloigné dans le temps : il faut compter cinq à six ans entre le dépôt d’une demande prioritaire et une valori-sation financière effective, quand elle a lieu. Les universités doivent donc pouvoir bénéficier de services de valorisation performants et la constitution de ceux-ci au niveau d’un PRES permet de répondre à cette exigence.
Aller à l’encontre des idées reçues : en France, la recherche publique compense-t-elle la faiblesse de la recherche privée ?
Il faut cesser de propager des idées ou même des chiffres faux sur la valorisation de la recherche publique en France. Le diagnostic habituel rend-il compte de la réalité ? La cause du retard français ne réside pas forcément dans la recherche, ni dans les systèmes de valorisation, mais peut-être se situe-t-elle au niveau de l’innovation industrielle elle-même.
En effet, la recherche est souvent plus une vitrine qu’un véritable moyen d’alimenter la croissance de l’entreprise ; ce phénomène s’explique en partie par l’insuffisante formation des dirigeants d’entreprise à l’innovation et par leur méconnaissance du monde de la recherche.
Ont été mis en place des dispositifs de promotion du doctorat dans les entreprises qui vont dans le bon sens à cet égard : le dispositif CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche) qui accompagne les entreprises recrutant des doctorants, et les doctorants-conseils qui assurent, pour le compte de l’université, des missions de conseil en entreprise.
La simplification des règles de gestion de la propriété intellectuelle
Ces règles seront prochainement allégées pour les opérateurs publics.
L’hébergeur du laboratoire à l’origine de la découverte, c’est-à-dire le plus souvent l’université, deviendra ainsi le gestionnaire unique du brevet. Ce gestionnaire assurera la valorisation, tout en partageant les bénéfices de ce brevet avec les autres financeurs du laboratoire.
Des évolutions sont également souhaitables au niveau européen ; le brevet communautaire devrait ainsi offrir de meilleures opportunités que le brevet européen.
M. Claude Birraux, Président de l’OPECST, député de Haute-Savoie. L'Office que j'ai l'honneur de présider doit établir un rapport d'évaluation sur le dispositif de l'article 19 de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006. Un des objectifs de cette loi porte sur l'intensification de la dynamique de valorisation de la recherche et le développement de liens plus étroits entre recherche publique et recherche privée.
L'article 19 permet aux établissements, pôles et réseaux de recherche de confier à des entités de droit privé diverses activités de gestion de la recherche et de ses résultats, comme la gestion de prestations de services, la gestion de contrats de recherche, l'exploitation des brevets et des licences, la commercialisation des produits. Les structures privées apportent, à n'en pas douter, des solutions innovantes, alternatives ou complémentaires aux dispositifs existants, grâce à leur réactivité et à leur souplesse de gestion.
Cette mesure essentielle faisait partie du plan de valorisation de la recherche, voulu par la loi. La valorisation de la recherche doit être entendue dans son acception la plus large, c'est-à-dire : recherche partenariale, valorisation de la propriété intellectuelle, création d'entreprises issues de laboratoires publics, mobilité des chercheurs entre les secteurs public et privé. La présente audition a pour objet de mener à bien l’évaluation de l'article 19 et de voir si la volonté du législateur a été respectée. Vous le voyez, Madame la Ministre : nous sommes précurseurs par rapport aux dispositions qui vont refondre le règlement de l’Assemblée nationale et du Sénat pour leur permettre d’être plus performants dans leur travail d’évaluation.
La volonté du législateur dans la loi de 2006 était de permettre le plus possible à tous les organismes de recherche et aux universités de conclure des partenariats avec les entreprises privées. En effet, le système actuel souffre d'une extrême concentration des contrats de recherche sur certains établissements. En rapportant les montants des contrats à la dépense de recherche des établissements, un écart apparaît clairement entre le CEA, qui obtient les résultats les plus élevés dans presque toutes les disciplines scientifiques où il est présent, et les universités et le CNRS, qui ne couvrent que 2 % en moyenne de leurs dépenses de recherche par des contrats avec les entreprises. Deux ans après la promulgation de la loi, nous sommes réunis aujourd'hui pour savoir si les choses ont bougé.
On constate, au niveau de l'application de la loi, une certaine lenteur, voire un peu de lourdeur dans les procédures administratives. La circulaire d'application de ces nouvelles dispositions sur la coopération en matière de recherche entre les établissements publics et des structures privées n'a été publiée que le 12 juillet 2007, soit plus d'un an après la promulgation de la loi de programme.
J’ajoute un petit commentaire. En 1999, nous avions voté la loi sur l’innovation et la recherche, permettant à des chercheurs de créer leur propre entreprise. Trois mois plus tard, Bercy publiait une circulaire selon laquelle, en cas d’augmentation de capital – c’est-à-dire quand l’entreprise commençait à produire –, la part du chercheur devait être limitée à 15 % du capital initial ! C’est dire si l’on encourageait l’essaimage …
Les modalités d'approbation des conventions prévues par la circulaire du 29 juin 2007 comportent, afin d’harmoniser les conditions d'approbation par capitalisation des expertises, la création d'une commission consultative chargée de donner un avis sur ces conventions. Cette commission comprend de très nombreux membres : autorité de tutelle de l'établissement public contractant, qui n'est pas toujours le ministère de la recherche – cela dépend de l'établissement –, et c’est sûrement dommage, Madame la Ministre !...
Mme Valérie Pécresse, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Je le trouve aussi, monsieur le Président !
M. le Président Claude Birraux. …ministère du budget, et bien d’autres... Aussi cette commission n'a-t-elle été créée que par le décret du 28 mai 2008.
Cette commission a donc mis du temps à se mettre en place : deux ans après la promulgation de la loi! Mais elle est là, et les dossiers ont commencé à être traités en cette fin d'année. Cette commission est cependant essentielle car elle garantit la sécurité juridique des conventions et la préservation des intérêts des établissements publics.
Mais au-delà de l'article 19 et de son évaluation, j'ai souhaité élargir le sujet et aborder la valorisation de la recherche au cours d'une audition publique rassemblant tous les intervenants de la valorisation et de l'innovation en France : les acteurs de la recherche publique, avec une place particulière pour les universités et les grandes écoles qui sont à l'origine de l'excellence de nos chercheurs, sans oublier les grands organismes de recherche ; et les entreprises privées qui doivent transformer notre formidable potentiel de recherche en atout concurrentiel dans ce que l'on appelle maintenant la société de la connaissance. Car la valorisation de la recherche est stratégique dans une économie mondialisée où les avancées scientifiques et technologiques sont les ressorts de la compétitivité et de la croissance.
Madame la Ministre, si chargé que soit l’emploi du temps d’un Ministre, je vous assure qu’une journée consacrée à visiter l’Université de Louvain, en Belgique, vous serait des plus profitables, car notre pays aurait largement intérêt à s’inspirer des méthodes qui y ont été mises en place. Un parc est associé à l’université – le Parc scientifique de Louvain-la-Neuve –, et l’accord du conseil d’administration de celle-ci est nécessaire pour pouvoir s’y implanter. Comme c’est une université catholique, vous en reviendriez même bénie par l’évêque qui préside le conseil d’administration ! (Sourires.)
Mme Valérie Pécresse, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, je suis allée non à Louvain, mais à l’Université hébraïque de Jérusalem et au Technion : partis d’un système très proche du nôtre, administratif et fonctionnarisé, ils sont arrivés à simplifier et à rendre très efficaces leur valorisation et leur transfert de technologies. Après avoir reçu la bénédiction israélienne, j’irai donc recevoir à Louvain-la-Neuve celle de l’évêque, ce qui montrera le profond œcuménisme de la laïcité à la française ! (Sourires.)
Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette audition publique sur la valorisation de la recherche. En effet, comme l’a si bien dit le Président Birraux, la valorisation est le résultat ultime d'un travail de recherche, l'acte qui lie le chercheur à l'ensemble de la société, et qui convertit la recherche en croissance.
Car si l'excellence est une fin en soi pour la recherche, celle-ci ne doit pas perdre de vue qu'elle a aussi vocation à améliorer la vie de nos concitoyens. C'est la recherche qui fournira les remèdes aux maladies qui frappent nos familles, et permettra de développer des technologies moins polluantes et plus adaptées aux changements globaux que connaît la planète.
La recherche doit aussi être un appui à notre économie – particulièrement en ces temps de crise. Si nous voulons maintenir la France et l'Europe dans leurs positions internationales en matière industrielle et économique, c'est sur la connaissance que nous devons miser. C'est tout l'esprit de la stratégie de Lisbonne que de renforcer l'Europe dans la compétition mondiale de l'intelligence. C'est tout l'esprit de la politique que je mène au nom du Président de la République pour rapprocher recherche publique et entreprises.
Ce rapprochement, il est d'abord physique, vous l’avez dit, avec la création de véritables clusters d'excellence, ces sites qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'Opération Campus. Cinq milliards d'euros y seront consacrés, et le plan de relance annoncé par le Président de la République nous permettra d'accélérer cette dynamique. A partir de 85 universités et 200 écoles, nous espérons aboutir, d’ici à la fin de 2009, à l’instauration d’une quinzaine de pôles de recherche et d’enseignement supérieur. Créés par la loi de 2006, qui est la traduction législative du Pacte pour la recherche, ces PRES ont vocation à coordonner sur un territoire des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et à leur donner une visibilité internationale, en lien avec les entreprises.
Nous voulons en effet faire de ces pôles universitaires des champions internationaux de la recherche, de la formation et de l'innovation. Il faut pour cela assurer la convergence entre tous nos dispositifs : pôles de compétitivité, réseaux thématiques de recherche avancée – les 13 réseaux d’excellence – et pôles de recherche et d'enseignement supérieur.
Car nos champions industriels doivent pouvoir s'appuyer sur l'excellence scientifique de nos laboratoires et sur une formation supérieure de qualité. De la même manière, nos universités et nos organismes de recherche doivent pouvoir s'enrichir des problématiques industrielles et de l'expérience commerciale des entreprises. C'est déjà le cas à Grenoble, autour de la micro et de la nanoélectronique – Jean Therme, Directeur du centre CEA de Grenoble, pourra nous en parler –, à Toulouse, avec l'aérospatiale, et bientôt à Saclay, en particulier autour des sciences et technologies de l'information – un représentant de l’INRIA est également présent aujourd’hui.
Pour doper la création d'entreprises sur les campus, nous donnerons dès le début de 2009 le statut de jeune entreprise universitaire à toute entreprise qui aura été créée par un jeune diplômé depuis moins de cinq ans, ou par un chercheur qui se lance dans la valorisation d'un résultat de ses recherches. Ce statut, en donnant de multiples avantages d'ordre fiscal, permettra à ces jeunes pousses de se développer au plus vite pour acquérir des parts de marché et de créer des emplois au cœur même des campus universitaires. Ce statut évite en outre d’avoir à poser la question de la nature de l’innovation mise en œuvre : toute sorte d’innovation peut être concernée, y compris dans le domaine des services, donc pas nécessairement au sens de la loi sur les jeunes entreprises innovantes.
La création d'entreprise est en effet un mode important de valorisation des recherches. Mon ministère soutient de nombreux incubateurs d'entreprises sur tout le territoire, et vient de lancer l’édition 2009 du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Avec ce concours, les lauréats de la catégorie « en émergence » peuvent recevoir jusqu'à 45 000 euros pour financer la maturation de leur projet. Les entreprises créées par les lauréats « création-développement » peuvent, quant à elles, obtenir jusqu'à 450 000 euros. C'est donc un véritable tremplin offert aux entrepreneurs. Les financeurs de projet l'ont d'ailleurs bien compris. Avec la notoriété du concours, les lauréats sont largement privilégiés par les capitaux-risqueurs et lèvent plus facilement des fonds.
Car une des difficultés majeures de la création d'entreprise est, vous le savez tous, le manque de business angels sur notre territoire. Déjà, de nombreux dispositifs fiscaux existent, comme la société unipersonnelle d'investissement à risque ou SUIR, défiscalisée sur dix ans, ou les fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, dont les souscripteurs sont exonérés de 25% de l'impôt sur le revenu – sans compter les nouvelles dispositions que nous avons prises pour défiscaliser une partie des fonds de l’impôt sur la fortune.
Mais la clé nous viendra probablement de l'exemple de Sophia Antipolis, où la réalité de l'interpénétration des entreprises et des laboratoires publics a fait émerger de véritables capitaux-risqueurs de site. C'est sur tous les campus universitaires que je veux mettre en place cette équation gagnante.
C'est en effet dans les universités que la recherche doit être placée aujourd'hui, au cœur du triangle de la connaissance qui lie recherche, formation et innovation. Dans ce cadre, les organismes de recherche doivent être de véritables agences de moyens, répartissant personnels et efforts financiers dans les différents laboratoires universitaires, au terme d’une stratégie définie par eux en fonction de l'excellence scientifique, de priorités stratégiques, et d'une prospective scientifique partagée entre tous les acteurs.
Ce dont nous manquons aujourd'hui encore, c’est d’une vision stratégique globale, qui offrirait un cadre clair, de long terme, à tous les acteurs de la recherche. Certes, les gouvernements successifs ont su faire de tel sujet d'actualité, ou de telle urgence sociétale, une priorité de la recherche, comme ce fut le cas pour le sida ou l'environnement. Et les résultats sont là, avec notre prix Nobel de médecine 2008 par exemple. Mais ces priorités ont toujours été des focus successifs, sans vraie continuité et sans vraie coordination.
Voilà pourquoi, avec le secrétaire d’État à l’industrie, Luc Chatel, j'ai proposé au Président de la République qu'une réelle stratégie nationale de recherche et d'innovation soit définie. Cette stratégie doit être le fruit d'une véritable discussion et de nombreux débats entre tous les acteurs intéressés: les chercheurs eux-mêmes, bien sûr, mais aussi les industriels, les milieux associatifs et tous les citoyens. Car notre avenir, à tous, dépendra des résultats de la recherche.
C'est donc à partir des regards croisés des différents acteurs de notre société, dirigeants d'entreprise, chercheurs et représentants des citoyens – et l'OPECST aura un rôle particulier à jouer dans cette réflexion –, que nous pourrons définir ensemble les grandes thématiques de recherche que nous devrons renforcer, pour consolider l'excellence là où nos communautés scientifiques sont déjà reconnues au niveau international, mais aussi pour assurer un appui sans faille de la recherche publique aux attentes de nos concitoyens et de nos entreprises.
Cette stratégie a vocation à être un document-cadre de référence pour les quatre ou cinq prochaines années – à l’image de ce qui s’est fait en Allemagne et de ce qui se fait au Japon – et permettra aux chercheurs de se projeter dans l’avenir en leur assurant la continuité des crédits publics.
Les liens entre la recherche publique et les entreprises sont encore insuffisamment développés. Déjà certains laboratoires travaillent en étroite collaboration avec le tissu industriel qui les entoure, à l'image de la recherche technologique du CEA ou de l'IFP, ou du pôle de Satory. Mais trop souvent, l'entreprise est perçue comme un financeur possible des travaux de recherche des équipes, sans réelle collaboration sur le long terme, ni réelle adaptation des programmes de recherche aux besoins de l'économie.
Pour y remédier, je mène une politique forte de promotion du doctorat dans les entreprises. En effet, quand un dirigeant a lui-même une expérience de recherche, il est plus enclin à confier ses travaux à un laboratoire public. Il y est déjà encouragé grâce au doublement du crédit d’impôt recherche pour ces partenariats, mais il faut aller plus loin.
C'est pourquoi j'ai renforcé l'attractivité du dispositif CIFRE – convention industrielle de formation par la recherche – qui accompagne les entreprises qui recrutent des doctorants, en augmentant l'année dernière de 16% le salaire minimum. J'ai aussi mis en place les doctorants-conseil qui assurent, pour le compte de l'université, des missions de conseil en entreprise. Ainsi, 85 entreprises ont bénéficié de ces missions l'année dernière, dont 56% de PME. Et toutes se disent particulièrement satisfaites de leurs rapports avec les jeunes doctorants.
Le système de recherche français est aussi particulièrement complexe, ce qui fait qu'une entreprise qui cherche une compétence spécifique en France ne la trouve pas toujours, ou seulement si, par chance, le hasard a fait se rencontrer les personnes voulues. C’est pourquoi nous devons faire des services de valorisation des pôles de recherche et d'enseignement supérieur de véritables carrefours entre les entreprises de la région et les laboratoires publics. A l'image de ce qui se fait déjà dans la région lyonnaise ou en Bretagne – dont certains représentants sont ici –, je veux qu'un service unique soit offert aux industriels, pour leur proposer des programmes de recherche partenariale, leur proposer l'expertise des laboratoires que fédèrent les pôles, ou encore les inviter à développer de nouvelles technologies à partir des résultats de la recherche publique.
En effet, la valorisation des travaux de nos laboratoires est encore insuffisante. La politique de dépôt de brevets est encore sans cohérence entre nos organismes et nos universités, et les procédures administratives nous font perdre une réactivité pourtant indispensable. Aujourd'hui, dans nos 400 plus grosses unités de recherche, ce sont plus de quatre acteurs publics qui détiennent la copropriété d’un seul et unique brevet, sans politique commune de valorisation, sans stratégie commune de commercialisation, sans possibilité réelle de transfert à l'industrie, en quelque sorte.
Il est donc temps de simplifier les règles de gestion de la propriété intellectuelle au sein des opérateurs de l'État. Ce sera le cas dès demain : l'hébergeur du laboratoire à l'origine de la découverte, c'est-à-dire la plupart du temps l'université, deviendra le gestionnaire unique du brevet. A lui, ensuite, d'en assurer la valorisation, seul ou avec l'aide d'un service de site ou d'un service national, tout en partageant les bénéfices de ce brevet avec les autres financeurs du laboratoire.
Mais en matière de brevets, nous devons aussi aller plus loin dans l'intégration européenne. Car si le brevet européen existe aujourd'hui, il n'est encore qu'une réalité technique, non une réalité juridique. Chaque État garde en effet sa réglementation et sa juridiction propres. Demain nous créerons un cadre réglementaire unique en Europe. Le brevet communautaire offrira un cadre juridique clair, sûr et sécurisant pour une meilleure circulation des idées et de l'innovation en Europe. Mais il est difficile de travailler sur le brevet communautaire, le Ministre en charge de ce dossier en France étant celui des finances, celui de la justice en Allemagne, et celui de la recherche dans d’autres pays ! Ce qui aide beaucoup à trouver des consensus dans les réunions du Conseil « compétitivité »…
Vous l'aurez compris, je suis pleinement engagée pour la valorisation de la recherche. Non seulement dans la promotion et la simplification des dispositifs et services existants pour assurer une fluidité administrative et juridique maximale, mais aussi en promouvant la recherche partenariale. Cette recherche qui compte double dans le crédit d’impôt recherche – elle compte pour 60 % de la dépense – permet aux chercheurs publics de transformer leurs résultats en véritable avancée pour la société et assure aux entreprises des atouts considérables en termes de compétitivité.
Cette recherche partenariale naît de la cohésion entre recherche publique et entreprises, de la cohabitation, c'est-à-dire de la vie quotidienne commune des étudiants, des chercheurs et des industriels sur nos futurs campus universitaires, au centre du triangle de la connaissance. C'est l’ambition du Gouvernement, partagée avec le Parlement, et c'est ce que nous souhaitons mettre en place avec l'Opération campus.
M. le Président Claude Birraux. Merci, Madame la Ministre. En vous écoutant, je m’imaginais à l’université de Twente aux Pays-Bas, créée sur les friches industrielles du textile et où, en vingt ans, 600 start-up sont nées et ont créé 6 000 emplois. Dans ce triangle que vous avez parfaitement défini, il y a des portes à double battant : entre la recherche et les entreprises naissantes, on peut aller et venir. Pourquoi ne pourrions-nous pas en faire autant ? C’est par l’exemple que nous arriverons à changer les habitudes, à acquérir les réflexes nécessaires. C’est la raison de notre rencontre aujourd’hui, et j’espère que ces auditions nous permettront, à partir de l’évaluation de l’application de l’article 19 de la loi sur la recherche, de savoir comment nous pouvons aller plus vite, plus fort, plus loin.
Je passe la parole à Mme Geneviève Fioraso, députée de l’Isère, qui est entrée de plain-pied dans le travail de l’OPECST dont elle est un nouveau membre.
Mme Geneviève Fioraso, membre de l’OPECST, députée de l’Isère. Je remercie le Président et le Premier Vice-Président de l’Office de me faire confiance pour aborder, dans le cadre de cette audition, la valorisation de la recherche. Ce sujet me tient à cœur comme députée de Grenoble et Présidente de la SEM Minatec Entreprises qui héberge des projets partenariaux entre la recherche publique et les entreprises privées dans un pôle d'innovation dédié aux micro et nanotechnologies, mais surtout parce que je vois dans la valorisation de la recherche un moteur de dynamisme et de relance pour notre économie et notre progrès social et sociétal. En effet, l’innovation ne doit pas être réduite à sa dimension technologique et scientifique, si importante soit-elle : elle doit rencontrer un marché et, pour cela, il importe d’appréhender tout ce qui relève du social et du sociétal.
Dans la crise sévère que nous traversons, l'innovation est plus que jamais indispensable pour assurer à nos produits et à nos services la valeur ajoutée qui les rendra compétitifs. Et la valorisation de la recherche est l'un des éléments essentiels de cette création d'innovation.
La France accuse un retard certain, et nous avons une grande marge de progression. Pourtant, nos atouts sont nombreux.
Notre pays est reconnu pour la qualité de sa recherche et possède les expertises nécessaires pour relever les défis de la société de la connaissance. Il ne s'agit pas d'opposer, comme on le fait trop souvent, et à tort, recherche fondamentale et recherche appliquée. Une culture trop binaire prévaut en France où l’on aime opposer les grandes entreprises aux PMI-PME, ou la recherche fondamentale à la recherche appliquée, alors qu’elles doivent être liées et que l’innovation est au cœur de ces liens et de ces rencontres. Ce qu'il faut favoriser, c'est l'excellence, l'attraction des talents et la valorisation des résultats. Nous savons aussi que souvent des recherches menées très en amont ne trouvent leur application qu’après des années et pas toujours dans les domaines initialement pressentis. Il en est de nombreux exemples : qu’on songe par exemple à l’invention d’Internet.
Quelques chiffres montrent le retard de notre pays pour la valorisation de sa recherche. Le retard est d'environ cinq ans par rapport à nos voisins européens, comme l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, et de quelque dix ans par rapport aux États-Unis et à Israël. Dans certains domaines, nous sommes même distancés par la Chine et l'Inde.
Tout d'abord, si la France dépense autant que les pays développés en termes de financement de la recherche fondamentale – 0,5% du PIB –, les liens entre le secteur public et le secteur privé sont bien moins développés que dans les pays précités.
Selon un rapport de janvier 2007 de l’Inspection Générale des Finances sur la valorisation de la recherche, la part de la recherche publique financée par des contrats avec les entreprises est de 2,7% en France contre 5% aux États-Unis, 8,7% au Canada, 12,6% en Allemagne et 12,7% en Belgique. Trop peu de laboratoires mènent une coopération avec le secteur privé. En effet, les trois quarts de l'activité de recherche contractuelle sont le fait de 3% seulement des laboratoires. Les témoignages des responsables d’organismes de recherche ici présents, comme celui de Jean Therme, Directeur de la recherche technologique au CEA et ex-Directeur d'un laboratoire, le LETI, à Grenoble, qui réalise plus de 70% de son activité en partenariat avec le secteur privé – ce qui est assez exemplaire –, nous permettront peut-être de mieux comprendre les mécanismes qui permettent d'atteindre un tel résultat.
Cette difficulté à valoriser notre recherche nous prive d'un élément concurrentiel indispensable. La production de connaissances ne peut engendrer un développement de l'innovation, de la croissance économique et de donc l'emploi que si les entreprises, quelle que soit leur taille – grands groupes, jeunes pousses innovantes, petites entreprises – sont capables d'exploiter les résultats de la recherche publique.
La législation a évolué en ce sens depuis dix ans : loi sur l'innovation en 1999, avec la possibilité pour les chercheurs de créer leur entreprise avec un statut adapté – même s’il a été immédiatement limité par Bercy… –, clarification des règles de retour sur investissement des brevets ou licences pour les laboratoires publics, mise en place d'incubateurs académiques pour la maturation des start-up.
Un certain nombre d'initiatives ont suivi pour favoriser ce partenariat public-privé : le statut des jeunes entreprises innovantes, l'accès au financement facilité pour les start-up (avec la mise en place de fonds d’amorçage, thématiques ou généralistes, nationaux ou régionaux), la mise en place des Instituts Carnot, des réseaux technologiques, des pôles de compétitivité, le renforcement du crédit d’impôt recherche, la loi sur l'autonomie des universités, le renforcement des structures de valorisation dans les organismes de recherche publique et les universités, avec une implantation décentralisée dans les pôles stratégiques en région pour favoriser les initiatives locales, et le plan Campus. Le tout au profit d’une stratégie nationale qui reste à développer et d’une vision européenne également à construire. Enfin, la loi de programme de 2006 pour la recherche a permis aux établissements, pôles et réseaux de recherche de confier à des entités de droit privé la gestion d'activités de valorisation, et l'Office a été chargé d'étudier les initiatives prises dans ce cadre. C’est tout un «écosystème » qui peut être mis en place et développé si on fédère toutes les initiatives, si on leur donne une vision.
Il y a trois jours, j’étais à Bruxelles pour un congrès européen organisé par les industries des semi-conducteurs. La microélectronique étant le socle de tout, la base des systèmes miniaturisés intelligents, ce secteur est très diffusant et nous donne un avantage compétitif dans de nombreux domaines d’application vis-à-vis des pays asiatiques et des États-Unis, mais à condition de continuer à en maîtriser la technologie en Europe. Or, je le dis en tant que parlementaire active à Grenoble où est implanté un gros pôle de microélectronique, quand nous allons à Bruxelles, c’est pour demander à l’Europe l’autorisation d’aider, à sa place, une industrie qui est quand même fondamentale en termes d’innovation, parce que nous osons, nous, collectivités territoriales et État français, aider directement une entreprise qui a des partenariats avec un organisme de recherche ! La direction générale de la concurrence de l’UE croit que la concurrence est à l’intérieur de l’Europe. La concurrence est aux États-Unis, dans les pays asiatiques et dans les pays émergents. Cette politique qui vise à ne jamais aider sa propre industrie traduit une méconnaissance totale du sujet ; elle est choquante et même suicidaire ! Promouvoir la valorisation de la recherche sera impossible si l’on continue à avoir cette politique en Europe. On ne le dit pas assez, et je pense que nous devons tous – parlementaires, presse, responsables d’organismes – relayer ce message, car ce qui est valable pour la microélectronique l’est aussi pour d’autres industries stratégiques.
En conclusion, nous avons des atouts, un cadre juridique, des initiatives sur le terrain qui vont dans le bon sens, des expériences reconnues, mais la valorisation de notre recherche reste insuffisante face aux enjeux de la compétition mondiale. Je compte donc sur vous pour que notre rencontre et vos témoignages nous permettent d'identifier les freins qu'il nous faut encore lever, qu'ils soient législatifs, réglementaires, financiers ou même culturels.
Je remercie à l'avance les différents participants. Sur ce sujet passionnant, nous sommes à l’Office dans un climat qui transcende les clivages politiques – c’est ainsi que je le ressens en tant que nouvelle membre –, et animés par la volonté d’aider la recherche et le développement de l’économie et de la connaissance, parce que nous y croyons. C’est dans cet état d’esprit que nous vous demandons de contribuer à nous faire progresser afin de nous aider à être plus efficaces en termes législatifs.
M. le Président Claude Birraux. Merci pour cette présentation magnifique à laquelle je souscris totalement.
Les États européens se sont mis d’accord sur la Stratégie de Lisbonne en fixant des objectifs, mais n’ont jamais dit quels moyens permettaient de les atteindre. Evidemment, l’objectif en matière d’innovation ne sera pas atteint, et, avec les procédures qu’a évoquées Mme Fioraso, cela devient difficile. Nous sommes, je pense, tous les trois des Européens convaincus et n’avons jamais pensé que la construction de l’Europe passait d’abord par l’organisation des paris en ligne ou du PMU sur Internet : il y a sûrement autre chose à mettre dans le concept européen.
M. Jean-Claude Étienne, Premier Vice-Président de l’OPECST, sénateur de la Marne. Le relevé de terrain que vient de nous présenter Geneviève Fioraso doit être, pour nous tous, une référence constante. Il y a un retard français. Comment en sortir ?
Le frein culturel est évident. Certes sa seule analyse ne résout pas le problème, mais on doit tenter de mieux le cerner pour l’atténuer.
L’histoire de la science, à laquelle s’adosse la conscience des hommes, remonte loin. Mais ce qui est nouveau, dans les sociétés contemporaines, est que la science nourrit le lien socioéconomique qui fabrique le tissu des collectivités humaines. Cette seconde dimension ne retire rien à la première : il reste vrai que la science et la connaissance sont la base de la conscience ; mais il s’y ajoute une exigence pratique, sociétale, que la Ministre et Geneviève Fioraso ont soulignée.
Comment s’attaquer au problème ? On a commencé de le faire, au cours de ces dix dernières années, et la Ministre l’a rappelé. A cet égard, la loi de 1999, permettant aux organismes publics de créer des filiales, traduisait un changement culturel important : voilà que, dans les universités, on parlait de filiales, comme dans les sociétés. Mais, depuis 1999, les filiales qui se sont développées ne se comptent même pas sur les doigts des deux mains…
Cela montre qu’il ne suffit pas d’énoncer des objectifs, ni de les traduire en termes réglementaires, mais qu’il faut coordonner les volontés dans une sorte de révolution culturelle. Cette révolution, il nous faut la concrétiser. Merci de nous avoir réunis pour cela.
PRÉSENTATION DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE DU 18 AVRIL 2006 ET DE LA POLITIQUE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
M. Bernard Froment, chef du bureau de la valorisation, de la propriété intellectuelle et du partenariat à la Direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il n’existe pas aujourd’hui de définition admise du terme « valorisation », la meilleure preuve en étant qu’il n’a pas d’équivalent international. Comme l’ont rappelé les orateurs, la valorisation désigne la contribution de la recherche au développement économique, mais aussi au développement sociétal. En ce sens, la définition de la valorisation que j’ai l’habitude de poser est tout simplement : le retour vers la société des résultats de la recherche qu’elle a financée.
La diversité de ce retour rend extrêmement difficile la mesure de la valorisation. On a parlé du retard de la France sur certains autres pays. Certes, les indicateurs dont nous disposons révèlent un retard ; néanmoins, je souhaite nuancer cette approche. Par exemple, s’agissant d’un résultat de chimie qui permet de mettre au point une nouvelle molécule pour un médicament ou un vaccin,
va-t-on mesurer le flux financier qui revient à l’établissement public, le chiffre d’affaires généré par ce médicament, le nombre d’emplois créés ou l’impact sur la santé de nos concitoyens ? On comprend toute la difficulté de faire cette mesure.
Autre exemple : comment qualifier dans les indicateurs internationaux le nombre de vies d’écureuils sauvées ou la préservation de la biodiversité par un tracé autoroutier ou ferroviaire intelligent ? On sait que parmi les applications de la recherche publique, certaines ont un impact direct sur l’économie, mais d’autres ont un impact sur notre environnement qui ne passe pas nécessairement par un résultat mesurable en nombre d’emplois, en chiffre d’affaires ou en profits monétaires.
C’est pourquoi je ne parlerai pas de chiffres, voulant plutôt revenir sur le processus de valorisation et sur la stratégie développée par le ministère, pour éclairer, par des applications pratiques, les propos de Mme la Ministre.
Quels sont les champs couverts par la valorisation ? M. le Président a cité quatre grands champs couramment reconnus : le partenariat de recherche, le transfert de technologies, la création de nouvelles entreprises, la mobilité public-privé. Sur ce dernier point, je préfère parler de transfert de compétences, car il faut ajouter à la mobilité le flux de jeunes diplômés passant de leur cursus initial vers l’entreprise, flux qui n’est pas habituellement classé dans la « mobilité », et qui comporte, surtout lorsqu’il s’agit de jeunes docteurs, un potentiel de transfert de savoir-faire très intéressant. On pourrait ajouter un cinquième champ, généralement non reconnu, qui comprend les prestations, notamment les savoir-faire propres à la recherche, l’expertise, la formation continue, etc., bref un ensemble d’activités qui contribuent aussi assez fortement à la valorisation.
La loi de 1999 sur l’innovation et la recherche a été citée par chacun des premiers orateurs. Au-delà des dispositions qu’elle a pu introduire sur les incubateurs, sur la possibilité de création d’entreprise pour les personnels de la recherche publique, etc., l’important pour moi est qu’elle a été un véritable déclencheur dans l’esprit de nos chercheurs.
Une comparaison est possible en termes de déclencheur avec le Bayh-Dole Act américain : même si son contenu n’est pas celui de notre loi sur l’innovation, il a joué le même rôle de déclencheur dans la société. Or la période durant laquelle le transfert a connu aux États-Unis le plus fort taux de croissance est le milieu des années 90, soit une quinzaine d’années après le Bayh-Dole Act. Notre loi sur l’innovation et la recherche ayant été votée il y a seulement neuf ans, cela nous laisse beaucoup d’espoir pour les prochaines années.
Ensuite est intervenue la loi de programme de 2006 pour la recherche, dont font partie les articles 19 et 21 sur lesquelles je reviendrai, mais aussi d’autres dispositifs, notamment les pôles de recherche et d’enseignement supérieur. Madame la Ministre a également parlé des réseaux thématiques de recherche avancée ; mais en termes de valorisation, c’est surtout vers les PRES que notre regard va se tourner.
L’âge de la maturité commence enfin à arriver avec la loi de 2007 sur les universités, qui place la valorisation au même niveau que la recherche dans la liste des missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche. La valorisation intervenait après un certain nombre d’autres missions ; désormais « la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats » sont mises au même niveau.
Les mécanismes que met en jeu la valorisation concernent aussi bien la gestion des contrats que la création d’entreprises, la prospection auprès des entreprises, la détection des savoirs, celle des inventions potentielles au niveau de la recherche publique, la mise en relation. Certaines difficultés naissent de la persistance d’un modèle linéaire de la valorisation selon laquelle, pour résumer, « on détecte, on protège – notamment par un brevet –, on mature et on transfère ». Malheureusement, ce modèle est faux, et constamment démenti sur le terrain. Combien de fois une maturation, qui paraissait pouvoir déboucher directement sur un transfert, débouche en fait sur une recherche partenariale pour approfondir certains points, de façon à pouvoir ensuite transférer éventuellement via une nouvelle protection ! Combien de fois les résultats de propriété sont eux-mêmes issus de recherches partenariales conduites en amont ! Combien de fois, après un premier brevet déposé à la suite d’une première phase de maturation, une deuxième phase de maturation est conduite, amenant parfois à déposer d’autres brevets !
Par conséquent, la politique que nous conduisons, et qu’a rappelée Mme la Ministre, consiste à associer le plus possible le chercheur dans les phases où il peut apporter un concours. Certes, dans de nombreux cas, la valorisation n’est pas directement le résultat de l’action du chercheur, mais si ce dernier n’y est pas associé, la valorisation a toutes les chances d’échouer.
Notre stratégie est donc basée sur cette proximité par rapport aux chercheurs, mais aussi sur la professionnalisation des équipes d’appui, car les missions conduites nécessitent un grand nombre de professionnels de très bon niveau pour accompagner le transfert vers la sphère économique ou la sphère sociétale, suivant les cas. Et nous cherchons à associer le plus intimement possible les différentes phases pour que les divers cheminements possibles dans le processus de valorisation, dont j’ai dit qu’il était loin d’être linéaire, puissent se dérouler avec la plus grande facilité.
Le dernier axe de notre stratégie est de lier le plus étroitement possible la politique de valorisation à la politique de recherche. Pour cela, nous cherchons à construire de véritables services de sites articulés autour d’actions structurantes en termes de recherche, notamment les pôles de recherche et d’enseignement supérieur, les opérations campus et, dans certains cas, des opérations plus ciblées lorsque le potentiel le permet.
Cette logique de sites dans l’organisation progressive de la valorisation est conduite en lien avec l’évolution qui concerne la propriété intellectuelle et sa gestion. L’idée est donc bien d’avoir des services de sites consolidés qui gèrent une grande majorité des activités. Toutefois, sur certains sujets, il n’est pas toujours possible d’agir au niveau du site. Le premier exemple est le contentieux ou l’action en contrefaçon, qui implique une dynamique en termes de puissance de travail et une dynamique économique qui ne sont pas à la portée d’un site. Le nombre d’organismes publics français qui ont agi avec succès dans ce domaine est extrêmement limité.
D’autres types d’actions ne sauraient raisonnablement être répartis entre les différents sites ; par exemple, la protection par certains types de propriété, comme le certificat d’obtention végétal, dont on sait qu’il a des caractéristiques propres. Le nombre de dépôts qui pourraient être faits en dehors de l’établissement national qui en est spécialiste est trop faible pour qu’il soit intéressant de développer cette compétence.
Un autre point à prendre en compte est l’articulation des différentes phases. Il est souvent allégué qu’en dessous d’un certain potentiel, on ne sait pas constituer des grappes de brevets intelligentes et donc procéder à une valorisation efficace. C’est vrai dans un certain nombre de domaines mais le phénomène n’est pas systématique, et reste assez ciblé.
Pour y remédier, il est important que des opérateurs puissent avoir une vision sur l’ensemble du potentiel. Ce qui n’implique pas de gérer celui-ci de manière centralisée mais plutôt de mettre en place une structure en réseau car, dans un réseau correctement organisé, chaque membre a accès à l’information disponible chez chacun des autres.
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE
EN PREMIÈRE LIGNE
M. Marc Le Gal, Directeur de Lyon Science Transfert. Je vais tenter de vous retracer le chemin parcouru depuis deux ans et demi en fait de valorisation de la recherche dans un dispositif « mutualisé » en tant que responsable d’un service au sein du PRES Université de Lyon.
Quelle était la situation au printemps 2006 ? Sur le site de Lyon, les gros établissements, notamment l’INSERM lyonnais et l’Université Claude Bernard, s’étaient équipés, après la loi de 1999, de filiales, qui se sont principalement développées selon un modèle de gestion de contrats, en vue d’une recherche partenariale, et de prestations. Elles ont fait faire un chemin important aux établissements et ont permis de fluidifier la relation des laboratoires avec les partenaires industriels.
Dans ce contexte, l’accompagnement du chercheur – qui consiste à identifier ce qui, dans les résultats de sa recherche, peut être valorisé sous forme de brevet puis communiqué au monde socio-économique – s’est opéré un peu différemment. Épauler le chercheur dans de telles circonstances suppose, en effet, premièrement, de pouvoir échanger avec lui sur le terrain de la science ; deuxièmement, de savoir manipuler les dispositifs de protection, principalement le brevet – en étant conscient que les sciences du vivant et le domaine des procédés et, plus encore, celui du logiciel sont, au regard du brevet, des mondes différents qui demandent des compétences spécifiques – ; troisièmement, d’avoir une vision des applications attendues par les partenaires industriels – or, on l’a rappelé, le chemin entre la technologie initiale et son application n’est pas toujours
linéaire – ; enfin, de pouvoir manipuler les outils du marketing – études de marché, outils promotionnels – pour conduire à des actions de négociation.
Cela fait beaucoup de ressources à mobiliser et cela représente un coût important pour un retour sur investissement aléatoire et, quand il existe, assez éloigné dans le temps : il faut compter cinq à six ans entre le dépôt d’une demande prioritaire et une valorisation financière effective – quand elle a lieu. Les retours sont également difficiles à quantifier en termes de visibilité pour le laboratoire, c’est-à-dire de génération de contrats, les créations d’entreprises étant plus visibles.
Il en résulte une moindre mobilisation des établissements sur ce segment de la valorisation : il est difficile, même dans des établissements de grande taille, de demander à une personne d’aborder l’ensemble de ces problématiques. Initialement spécialisé dans le domaine des matériaux, je me suis retrouvé à devoir traiter de brevetabilité sur le vivant, de logiciel libre, de polymères composites nanorenforcés et de semi-conducteurs, tout en intégrant la problématique de la propriété intellectuelle, le marketing, la communication et la dynamique du réseau industriel. La tâche n’est pas aisée.
L’élément déclencheur de cette nouvelle approche a été l’appel à projets lancé par l’ANR sous la tutelle du ministère, qui a invité les acteurs de la valorisation à se regrouper pour faire les choses autrement. Les universités et groupes universitaires qui ont répondu à l’appel l’ont interprété comme une invitation à globaliser les énergies, les compétences et les projets pour bâtir des pôles de compétences par domaines de technologie. Cela a abouti au sein de Lyon Science Transfert à une organisation par pôles thématiques : biologie-santé, chimie, matériaux-mécanique, physico-chimie-dispositifs de mesure, et un pôle logiciel en cours de création (même si le logiciel est plutôt un vecteur qu’une technologie en soi), sans oublier qu’on nous demande de nous intéresser aussi aux sciences humaines et sociales. L’équipe regroupe des chercheurs qui ont fait de la recherche dans le milieu industriel, et dont certains se sont risqués à la création d’entreprise ou ont été business developers dans des biothèques.
Compte tenu du volume de projets que nous pouvons maintenant traiter, nous pouvons nous permettre d’embaucher des juristes ayant une expérience dans le domaine et mobiliser plus facilement des ressources sur le terrain de la propriété intellectuelle : conseil externe, intégration dans l’organisation de bases de données payantes, recours à des sociétés de conseil capables de défricher certains segments de marché que nous n’avons pas les moyens d’explorer.
La relation avec le chercheur en est immédiatement améliorée : meilleure capacité de dialogue, mise en relation en direct, meilleure approche des questions de brevetabilité.
L’autre impact de cette démarche mutualisante est une meilleure capacité à regrouper des compétences et des brevets sur un ensemble d’établissements. La tâche nous est parfois facilitée quand un grand nombre de laboratoires sont appuyés sur plusieurs établissements.
Nous n’avons plus de complexes à aller à BIO à San Diego, à Eurobio, ou encore à Copenhague sur des opérations telles que Copenmind qui a eu lieu au début du mois de septembre sur les cleantech, car nous nous y rendons avec un portefeuille conséquent, ce qui laisse poindre la notion de masse critique.
La seconde caractéristique des dispositifs qui ont émergé de l’appel à projets de l’ANR, et qui fait leur force, est de pouvoir conjuguer cette notion de masse critique – et par voie de conséquence de compétence – avec celle de proximité avec les chercheurs.
Cette logique de proximité consiste à être aux côtés des chercheurs lorsqu’ils prennent conscience, avant de faire une intervention dans un congrès, que leurs découvertes doivent être protégées. Il faut alors se pencher rapidement sur les questions de brevetabilité et engager la phase de dépôt. Nous devons aussi pouvoir les assister dans des échanges avec des industriels en ayant préalablement veillé à la mise en place d’accords de confidentialité, voire leur suggérer des pistes de collaboration. Cette notion de proximité recouvre également la possibilité de faire interagir entre eux des chercheurs sur un même site universitaire. Par exemple, nous comptons développer sur Lyon une relation entre biologistes, chimistes et praticiens hospitaliers afin de mettre en place des démarches convergeant sur des approches thérapeutiques.
Pour épauler également les chercheurs ou les équipes dans leur stratégie de valorisation, il faut les aider à faire les choix qu’appelle le niveau de maturité de leurs technologies : pour certaines, il faudra favoriser la collaboration, pour d’autres la prestation. On peut parfois envisager également le rattachement des projets à des dossiers du PCRD – programme cadre de recherche et développement technologique – ou de l’ANR. Une maturation de ceux-ci, permise par l’appel à projets, est tout à fait opportune parce qu’elle permet de faire la démonstration du caractère opérationnel de la technologie et de pouvoir entrer en contact avec des industriels sur une base étayée d’exemples.
Je dois reconnaître que le modèle de Bretagne Valorisation que représente ici Mme Élisabeth Lagente est plus abouti que le nôtre dans ce domaine. Au sein du dispositif lyonnais, nous nous sommes efforcés de mutualiser le processus d’accompagnement du chercheur vers le marché. Nous interagissons donc avec les filières de valorisation des établissements sur la partie contrat, qui est une interface capitale. On ne peut pas faire du push sans faire du pull.
La maturation apparaît aujourd’hui très structurante, même si elle constitue un placement à risque et à long terme. Selon les technologies, les processus de maturation n’ont pas du tout les mêmes horizons temporels.
La force de notre modèle est d’allier les notions de proximité et de masse critique. Cette dernière prête bien sûr à discussion. Où commence-t-elle ? À 3 000 brevets ? À 5 000 chercheurs ?
M. le Président Claude Birraux. Combien êtes-vous dans votre équipe ?
M. Marc Le Gal. Sur la partie accompagnement, dite techno-push, nous sommes aujourd’hui une dizaine de personnes, pour 6 000 ou 7 000 enseignants chercheurs ou, plus exactement, comme une partie est en sciences de l’homme et de la société, 4 000 enseignants chercheurs dans le domaine des sciences dures.
Compte tenu de ce ratio, mobiliser les chargés de valorisation sur des actions de promotion et de prospection est un combat de tous les jours quand on connaît la charge administrative liée à la gestion des brevets dans le contexte français. C’est un vrai problème aujourd’hui, qui nous entrave dans la compétition avec nos partenaires européens et américains.
A l’université de Louvain, une même filiale intègre l’incubation, la gestion des contrats et la valorisation par le brevet. Il y a là des exemples fort intéressants à prendre. Nous pouvons également nous inspirer de certains modes de fonctionnement autour de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Au-delà des notions de masse critique et de proximité, ces exemples mettent en jeu deux éléments qui font, malheureusement, défaut dans le système français : la notion de responsabilisation des acteurs, c’est-à-dire des chercheurs et des responsables de laboratoire – les circuits de décision sont souvent constitués en France par de multiples comités qui distendent le lien entre le chercheur et l’objet de la valorisation – et la simplicité des procédures. Dans ces deux domaines, nous avons une grande marge de progrès.
Sur les deux ans et demi de fonctionnement de notre équipe, nous avons doublé chaque année le nombre de projets analysés et soutenus – même si notre effectif ne permettra pas de maintenir un tel taux de croissance.
La dynamique impulsée par l’appel à projets de l’ANR est présente aujourd’hui dans quatorze régions ou villes françaises. Elle s’inscrit dans des contextes très variés, comme on peut s’en rendre compte avec Bretagne Valorisation.
En conclusion, j’insiste sur la nécessité d’une simplification des procédures et d’une responsabilisation des acteurs.
M. le Président Claude Birraux. Je précise que Lyon Science Transfert a été un précurseur dans la mise en place de ces dispositifs. Il serait intéressant aujourd’hui de faire des comparaisons d’une part, entre les quatorze sites français, afin de mettre en évidence les freins réglementaires ou institutionnels qui les empêchent d’être plus performants et, d’autre part, avec ce qui se fait dans d’autres pays. Jérusalem est plus « exotique » que Louvain-La-Neuve mais cette dernière offre de bons exemples puisque vingt-deux personnes y gèrent non seulement la valorisation de la recherche mais également les programmes européens, après avoir résolu tous les problèmes réglementaires et institutionnels qui les freinaient et qui nous freinent encore en France. La réunion de comités divers et variés pour mettre tout le monde d’accord entraîne une perte de temps et d’énergie.
M. Marc Le Gal. L’exercice de comparaison, ou benchmarking, est tout à fait éclairant. Nous tâchons de nous y livrer, que ce soit dans le cadre du réseau C.U.R.I.E ou en marge, et cela devrait nous conduire à présenter des recommandations, notamment en matière de copropriété.
M. Marc Ledoux, Directeur de la politique industrielle du CNRS. Le CNRS comprend une soixantaine d’unités propres, presque un millier d’unités mixtes et une vingtaine d’unités associées, soit avec le CEA, soit avec Pasteur.
Sa politique s’appuie sur trois piliers : la légitimité, le service public et la création de richesse.
Le CNRS se situe à l’interface entre le laboratoire, les départements scientifiques et le monde de l’économie, c’est-à-dire entre ceux qui font de la recherche et le monde des entreprises. Si nous voulons à la fois des chercheurs qui soient d’efficaces créateurs de connaissances et un monde économique également efficace, il faut arriver à les faire discuter ensemble. Or n’importe qui ne peut pas aller dire à un chercheur de modifier ses procédures ou de faire telle ou telle chose pour renforcer son brevet. Il est important que ce soient des chercheurs qui fassent ce travail de médiation entre les deux.
Entre 2000 et 2007, le nombre d’inventeurs, qu’ils soient au CNRS, enseignants-chercheurs dans les universités de nos unités, thésards ou post-doc payés par le CNRS, a progressé de 1 000 à 3 200. Par rapport à l’ensemble des personnels susceptibles de déposer des brevets, ceux qui l’ont fait représentent à peu près 12,1 % en 2007, taux très élevé.
Le second aspect de la légitimité est l’impact de la structure de valorisation sur le travail du laboratoire en amont et en aval du brevet : aide à la maturation, construction d’un portefeuille de brevets de défense autour d’une invention originale et porteuse. Lorsqu’une nouvelle connaissance est en train de naître dans un laboratoire, nous devons nous hâter de l’aider et de monter autour de lui une structure de protection : dépôt de brevets, conseil sur la manière de présenter, proposition de nouvelle manipulation par rapport à la manipulation primaire. Il est très difficile à des non-scientifiques de le faire car les laboratoires et les chercheurs n’acceptent pas que quelqu’un vienne leur dire ce qu’ils doivent faire. La question de la légitimité est donc très importante et est même un des secrets du succès car des services dépourvus de cette légitimité ne peuvent pas faire ce travail de médiation.
Le deuxième pilier du CNRS est le service public.
J’entends par là, tout d’abord, le fait de prendre des brevets amont et la protection de la connaissance. Un exemple : le prix Nobel Albert Fert était dans un laboratoire du CNRS dont la propriété intellectuelle était gérée par un industriel. Ce dernier n’a pas pris le brevet parce que les découvertes d’Albert Fret n’entraient pas dans le courant principal de son industrie. Dans le même temps, le service public dans lequel travaillait son co-prix Nobel, Peter Grünberg, a pris le brevet. À qui profite l’affaire aujourd’hui ? Au service public, qui a su maintenir le brevet suffisamment longtemps.
La notion de service public recouvre, ensuite, l’implémentation économique de problèmes sociétaux : maladies rares, voitures propres, développement durable. Rares sont les industriels de la pharmacie qui prennent des brevets dans le domaine des maladies rares parce qu’ils ne gagnent pas d’argent. Si nous n’étions pas là pour donner une valeur à ces connaissances et leur permettre un jour de déboucher, personne ne le ferait.
Autre exemple : depuis plus de vingt ans, nous maintenons au CNRS des brevets, dont certains sont maintenant tombés dans le domaine public, sur les batteries légères pour les automobiles. Aucun industriel ne voulait les prendre en charge à l’époque. Or, on est bien content aujourd’hui que la France possède cette technologie.
Le troisième pilier du CNRS est la création de richesse.
Cela signifie, premièrement, soutenir le réseau de production de la connaissance sans se substituer aux nœuds du réseau, unités locales et universités – bref, ne pas laisser une connaissance échapper à la protection. Le CNRS doit toujours être en veille. Mais, comme cela a été souligné, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas au niveau central parisien et qui se font soit avec nos délégations, soit avec nos correspondants des autres organisations. Nous ne devons pas laisser passer entre les mailles du filet des inventions qui peuvent être brevetées ou protégées.
Le deuxième aspect de la création de richesse en est le B-A-BA : il s’agit de valoriser la connaissance par le biais des brevets, des licences et des créations d’entreprises.
Le troisième aspect consiste à se défendre contre les contrefacteurs ou les « pirates » en menant une politique judiciaire agressive et en assurant une protection renforcée. Nous avons intenté trois gros procès au cours des trois dernières années qui nous ont coûté cher, en France et aux États-Unis, mais que nous avons gagnés. Nous avons à peu près dix affaires en cours. Quant à la protection renforcée, elle présente deux aspects. Elle consiste à renforcer un brevet en prenant d’autres brevets autour et, d’autre part, à travailler avec des sociétés d’assurance des brevets.
Je citerai quelques chiffres illustrant les fruits de cette politique.
Le stock de brevets du CNRS a été en 2007 de 3 200 et le flux de brevets de 217. Ce dernier devrait être de 300 cette année et probablement 400 l’année prochaine. Le stock de licences – qui regroupe les licences de brevets, les licences de logiciels et les licences de savoir-faire – a été de 1 200 en 2007 : 104 licences ont été signées, 243 nous ont rapporté un revenu d’environ 57 millions d’euros, 184 inventeurs ont été rémunérés.
Les chiffres ne sont intéressants que par comparaison. Nous avons donc fait un benchmarking entre l’Université de Stanford, qui est réputée comme la meilleure valorisatrice, le MIT à Boston, la Max-Planck-Gesellschaft en Allemagne et l’Imperial College à Londres, les chiffres étant établis, pour ces quatre établissements, sur 2006, et le CNRS, à partir de chiffres évalués entre juillet 2007 et juillet 2008 car nous avons fait une étude très précise sur cette période. Le nombre de déclarations d’invention du CNRS se situe au niveau des grandes universités américaines : 484 pour le CNRS contre 518 pour l’Université de Stanford et 523 pour le MIT de Boston. Le nombre de demandes de brevet est proche de celui du MIT – 316 contre 321 – mais inférieur à celui de Stanford : 541. En revanche, le nombre de brevets délivrés est nettement supérieur à celui des grandes universités américaines : 284 contre 118 pour Stanford et 121 pour le MIT. Cela signifie que nous sommes très sélectifs sur les déclarations d’invention et les demandes de brevet. Pour ce qui est des licences, le CNRS est à peu près à égalité avec Stanford et Boston – 104 contre respectivement 109 et 121 – mais le nombre de start-up est largement au-dessus : 41 dont 21 directement créées par nous et 20 adossées à nos laboratoires ou à nos licences, contre 7 pour Stanford et 23 pour le MIT.
La Max-Planck-Gesellschaft, qui est un peu notre équivalent en Allemagne, ne compte que deux start-up, 30 licences, 79 brevets délivrés. Nous faisons donc bonne figure dans ce tableau.
Le service de communication du CNRS a fait parvenir à tous les membres de l’OPECST un épais document reprenant l’analyse réalisée entre juillet 2007 et juillet 2008. Il en ressort que, sur les 284 brevets publiés durant cette période, 116 sont déjà exploités, soit 41 % – ce qui est considérable. J’entends par « brevet exploité », un brevet qui est déjà dans les mains d’un industriel, soit sous forme d’une licence, soit sous forme d’une cession – ce qui ne veut pas dire qu’il nous rapporte de l’argent ; c’est une autre question. Mais il ne dépend plus de nous.
Je ne suis pas d’accord avec mes collègues qui considèrent la copropriété comme un handicap. Pour nous, il n’y a aucune différence avec la propriété unique. Tout dépend avec qui nous gérons.
Le CNRS peut discuter directement avec un industriel. C’est le cas pour 225 brevets sur les 284 publiés, dont 116 sont exploités, ce qui représente un résultat de 47 %.
Quand le gestionnaire est une université, c’est elle qui gère avec l’industriel et non le CNRS. Il y 32 brevets publiés dans ce cas, dont 3 exploités, soit un résultat de 9 %.
Les gestionnaires peuvent être d’autres organismes : soit des universités étrangères, soit le CEA ou l’INSERM. C’est le cas pour 50 brevets publiés, dont 8 sont exploités, soit un résultat de 16 %.
Ma première conclusion sera un peu dure : il faut cesser de propager des idées ou même des chiffres faux sur la valorisation de la recherche publique en France. Le diagnostic habituel cache la vérité : la recherche publique comme la recherche privée et leur processus de valorisation sont au niveau international. Le benchmarking le montre. Le gros problème en France n’est ni la recherche, ni les systèmes de valorisation, c’est le relais qui vient ensuite, c’est-à-dire l’innovation industrielle, malade ou absente. La recherche française est classée parmi les trois ou quatre premières mondiales. Notre système de valorisation fonctionne bien comme le montre le benchmarking que je vous ai présenté – même s’il y manquait l’Institut Weizmann d’Israël qui est indiscutablement le champion du monde en la matière, mais je n’avais pas les chiffres exacts. Cela étant, quand, au bout d’un an ou d’un an et demi, 41 % des brevets sont déjà dans les mains d’industriels, c’est un résultat exceptionnel.
Ensuite, il serait intéressant que chaque organisme de recherche publie chaque année, en toute transparence, des tableaux comme ceux que je viens de vous présenter. La représentation nationale serait ainsi informée chaque année et cela ferait, de plus, un benchmarking interne de nature à nous stimuler entre nous et à nous faire avancer.
Troisièmement, il conviendrait de généraliser le mandat unique, pour gérer la valorisation d’un brevet, au propriétaire le plus apte à remplir les trois conditions que j’ai données, c’est-à-dire à la fois la légitimité, le service public et la création.
Quatrièmement, il faut absolument accroître l’incitation locale, faire de la « propagande » dans les laboratoires. Il faut, pour cela, faire venir des chercheurs de très grande qualité qui soient aussi de très grands inventeurs. Les laboratoires les plus productifs en termes de brevets et d’innovations sont également les plus productifs en termes de publications de grande qualité. La grande et la bonne recherche génère la grande et la bonne technologie. Il ne faut pas hésiter à faire participer des gens qui ont réussi scientifiquement afin qu’ils convainquent nos collègues chercheurs de penser à protéger leurs découvertes avant de les publier.
Cinquièmement, il est important de s’ouvrir sur des collaborations européennes pour renforcer notre position par rapport aux deux continents concurrents : l’Asie et l’Amérique du Nord. Mme la Ministre a bien souligné dans son propos une faiblesse invraisemblable en Europe : le fait qu’il soit très compliqué de travailler entre collègues européens. Cela fait près de deux ans que j’essaie, sans succès, de monter un « service commun » avec la Max-Planck-Gesellschaft.
M. Bruno Sportisse, Directeur du transfert et de l’innovation à l’INRIA. L’INRIA, l’Institut national de recherche en informatique et en automatique est un établissement public à caractère scientifique et technologique, focalisé sur les sciences et les technologies de l’information et de la communication. L’INRIA présente la particularité d’avoir un fort ancrage régional avec huit centres de recherche, dont un à Grenoble, un à Paris Rocquencourt et un à Sophia Antipolis. Il a un modèle original d’organisation, reposant sur la notion de petites équipes-projets de quinze à vingt personnes regroupées autour d’un leader scientifique et d’un objet de recherche et de transfert très clair.
L’INRIA s’est doté d’un plan stratégique 2008-2012 centré sur quatre thèmes – modéliser, programmer, communiquer, interagir – et trois enjeux applicatifs : ingénierie numérique, sciences numériques, médecine numérique.
Le transfert – mot employé à l’INRIA à la place de celui de valorisation – a une place très importante. Il fait partie de ses missions au même titre que la recherche, l’institut dépendant de deux ministères de tutelle : celui de la recherche et celui de l’industrie. Le transfert passe par trois voies : le transfert des idées, le transfert de la technologie, enfin le transfert des hommes et des compétences.
Le transfert des idées passe par la recherche partenariale, c’est-à-dire par le biais de projets de recherche appliquée avec des industriels, qu’il s’agisse de projets bilatéraux ou de projets collaboratifs, c’est-à-dire financés dans le cadre d’appels à propositions financés par le public en Europe ou en France.
Le transfert technologique est lié, à l’INRIA, à la problématique logicielle beaucoup plus qu’à de celle du brevet, ce qui est une différence notable avec le CNRS – même si le logiciel est à mes yeux une technologie, pas simplement un vecteur.
Le transfert des compétences se fait via la mobilité ou via l’expertise et le conseil des chercheurs auprès d’industriels.
Le transfert à l’INRIA est organisé autour d’un siège, de réseaux nationaux et d’officiers de transfert dans les huit centres. Une filiale – INRIA-Transfert – joue un rôle important. Elle réfléchit actuellement sur l’évolution de son modèle. Elle est en charge, depuis une dizaine d’années, de l’accompagnement et de la création d’entreprises.
Le transfert dans le domaine des sciences et technologies de l’information et de la communication – STIC – a ses spécificités, du fait notamment que les STIC sont partout : ils sont très diffusifs sur tous les secteurs industriels. Il n’y a donc pas de modèle unique de transfert, les marchés étant très différents. Il est donc nécessaire d’expérimenter de manière un peu « darwinienne » et de faire de la preuve de concept. La maturation de la technologie avant transfert est essentielle. La création d’entreprises est, selon notre retour d’expérience, un outil puissant de maturation.
Dans le cadre de la recherche partenariale, les projets de R&D sont appliqués en général avec des départements de R&D des grands groupes. L’INRIA s’intéresse moins à la relation que peuvent avoir ses 160 équipes-projets avec des industriels qu’à la structuration de ses relations avec quelques grands groupes. Sa priorité est d’avoir des partenariats « stratégiques » pour la recherche, c’est-à-dire de chercher, par sa relation structurelle avec un grand groupe, à avoir accès aux bons problèmes de recherche. Nous prenons acte du fait que, sur un certain nombre de sujets, et spécialement dans les STIC, seuls les industriels sont à même de construire avec nous des bons sujets susceptibles de mobiliser une bonne part de notre recherche.
Les vecteurs de cette stratégie sont des laboratoires communs, avec mise en commun de personnels, et des actions stratégiques, c’est-à-dire la structuration d’une partie de nos activités de recherche réunissant plusieurs équipes-projets sur un sujet construit avec un industriel. Un exemple récent des premiers est la signature, l’année dernière d’un laboratoire commun avec la partie française des Bell Labs dans le cadre d’un partenariat avec Alcatel Lucent autour de la problématique d’Internet du futur. Un exemple des seconds vecteurs est l’action concertée avec ST Microelectronics avec une focalisation sur la problématique des systèmes embarqués.
Pour le transfert technologique, qui, à l’INRIA, concerne en général un logiciel ou un quasi-logiciel, il est très important d’avoir une vision consolidée des voies possibles de transfert vers le monde économique. Le transfert peut s’opérer par la création d’entreprise, par la licence, par la participation à une action de standardisation, par la mise à disposition d’une communauté industrielle de logiciels libres – open source –, ou par le montage d’un consortium avec des industriels pour valoriser notre technologie. Les structures de transfert doivent impérativement être capables de passer d’une culture d’accompagnement à une culture stratégique. Notre objectif est de maximiser l’impact sur le monde économique de notre technologie, quelle que soit la voie retenue. Encore faut-il qu’on soit capable d’instruire toutes ces voies en parallèles, sachant que la démarche n’est pas balistique au départ.
L’institut a pour cible prioritaire de transfert technologique les PME. Les petites et moyennes entreprises avec lesquelles il est le plus facile de travailler sont celles que l’on crée. Un premier cercle à consolider est donc l’ensemble des spin-off de l’INRIA. Une centaine ont été créées en vingt-cinq ans, soixante-dix en dix ans et neuf l’année dernière.
L’un des enjeux est d’aller au-delà de ce premier cercle. Nous nous heurtons pour cela à plusieurs écueils. La façon dont on y répond renvoie à l’écosystème de l’innovation en France, qui est en train d’évoluer fortement.
La première difficulté est d’avoir accès aux réseaux de PME innovantes. Il est beaucoup plus facile pour nous d’avoir accès à des départements de R&D de grands groupes. Qu’est-ce qu’une PME innovante susceptible de vouloir travailler avec l’INRIA ? J’avoue ne pas vraiment pouvoir en donner une définition. L’INRIA estime que les pôles de compétitivité qui viennent de subir leur évaluation après trois années d’existence et d’être pérennisés seront à même de jouer un rôle d’animation auprès de PME. Nous devrions pouvoir, en leur sein, identifier et faire vivre de petits réseaux de PME à même de travailler avec nous. L’enjeu pour l’INRIA, qui est présent dans vingt pôles de compétitivité, est d’être capable de travailler en réseau pour pouvoir irriguer au niveau national l’ensemble de ses contacts au sein des pôles. Un rêve de l’institut national serait de pouvoir opérer le transfert technologique d’une équipe de Saclay, par exemple, vers une PME de Grenoble identifiée grâce à notre participation à un pôle de compétitivité de Grenoble : MINALOGIC, par exemple.
Le deuxième écueil est l’adaptation de l’offre de l’INRIA à ces PME. Pour les STIC, le courtage en technologies n’est pas le mode de transfert le plus efficace parce qu’il faut tâtonner. Il vaut mieux être capable de faire remonter des besoins d’une PME pour pouvoir faire « maturer » notre technologie en fonction d’eux.
Une fois qu’on a connecté des PME et qu’on a adapté notre offre, il est important d’avoir les bons vecteurs. Nous devons adapter nos pratiques contractuelles à destination des PME et être un peu innovants. La notion de plate-forme logicielle est, de ce point de vue, intéressante à creuser. L’INRIA a signé hier avec OSEO et le Comité Richelieu une extension du Pacte PME à la problématique du transfert des résultats de recherche des établissements publics de recherche à destination des PME pour pouvoir définir les bons cadres de relations, en faisant notamment du benchmarking.
En conclusion, je situerai la politique de transfert de l’INRIA dans l’écosystème de l’innovation en France, qui bouge beaucoup en ce moment.
J’évoquerai d’abord le contexte de la mutualisation du transfert de la recherche publique, avec l’émergence de logiques de sites et, notamment, le programme des 14 opérations soutenues par l’Agence nationale de la recherche. Au niveau régional, l’INRIA est partie prenante dans deux de ces opérations, assez emblématiques : DIGITEO sur le plateau de Saclay et GRAVIT au sein du bassin grenoblois.
Mais, au-delà de la logique de site, il est important que l’INRIA soit capable de connecter des territoires. Il existe, en effet, un risque non négligeable de création de bulles territoriales. L’INRIA, institut national, a un rôle à jouer en matière de transfert technologique interterritorial. L’offre de valeur que fait l’INRIA à ses partenaires régionaux est d’être un courtier en opportunités de maturation. Il est très important, dans notre domaine, de faire remonter les besoins du marché pour pouvoir faire du transfert. Cela suppose d’être proche des équipes pour identifier leur travail et être à même de gérer leurs contrats. Mais ce n’est pas le travail d’un institut national.
M. Pascal Iris, Directeur de l’Association ARMINES. Je représente sans doute la seule des structures réunies aujourd’hui qui soit directement concernée par l’article 19 de la loi de programmation du 18 avril 2006. Depuis sa création par Pierre Laffitte il y a quarante ans, ARMINES a vécu dans une espèce de no man’s land juridique. Nous nous sommes battus pour être encore présents aujourd’hui. C’est dire avec quelle joie nous avons accueilli cet article 19 qui clarifie enfin notre statut juridique. Les législateurs ont bien fait car nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Parmi les instituts Carnot, qui sont très engagés dans la recherche partenariale, figurent bon nombre de structures comme la nôtre.
ARMINES gère une activité d’environ 50 millions d’euros par an et a un effectif salarié de droit privé, dans les laboratoires publics qu’elle accompagne, de près de 600 personnes. Il est intéressant de voir des gens de statut privé faire de la recherche dans des laboratoires publics. Cela marche à condition de les accompagner, ce qui est un véritable métier.
Premièrement, je lance un cri d’alarme nous concernant. La loi nous permet maintenant d’exister. Mais nous ne pouvons pas faire bénéficier nos partenaires industriels du doublement du crédit impôt recherche comme les autres laboratoires publics, au motif que nous sommes les titulaires de contrats de statut privé. C’est une aberration qui a des effets catastrophiques pour nous. Il faut savoir que les laboratoires de grandes écoles universitaires que nous accompagnons sont, via ARMINES, engagés à 50 % sur ressources propres. Gérer des contrats consiste avant tout à dépenser ceux-ci de manière intelligente. D’où les 600 personnes employées dans les laboratoires. Or, les industriels menacent d’aller voir ailleurs si nous ne pouvons pas leur permettre ce doublement. Comme en ce moment ils ne font pas de cadeaux, je me permets d’être un peu véhément sur ce sujet : l’administration doit agir très rapidement.
Mon deuxième point concerne le financement de nos activités. Je suis personnellement un ardent défenseur de ce que l’on appelle les coûts complets. Lorsqu’on présente à un industriel une étude ou un projet de recherche, on doit être capable, quelle que soit la nature des moyens qui seront mis en œuvre, de chiffrer le coût réel de l’étude ou du projet. Ces coûts complets sont des critères internationalement reconnus et privilégiés par l’Europe. Intégrant tous les salaires et les charges liés au projet, ils montrent à l’industriel que, si la recherche vaut 100, il ne participe qu’à hauteur de 30 ou 40. Il est dès lors possible de négocier la propriété intellectuelle dans des conditions claires.
Nous sommes les garants du temps long de la recherche. Quand un industriel a l’impression de financer un projet à 100 % alors qu’il ne paie que les coûts marginaux, comment voulez-vous vous battre sur la propriété intellectuelle ? Le résultat est que les laboratoires perçoivent peu d’argent et que l’industriel capture en totalité la propriété intellectuelle. En général, il n’en fait pas grand-chose ; de surcroît, les laboratoires risquent d’être bloqués. Si on finance sur la base des coûts complets, il est demandé plus à l’industriel mais, comme il se rend compte qu’il ne finance pas la totalité, il est possible de négocier avec lui un marché gagnant-gagnant. Le laboratoire conserve la propriété industrielle de son propre patrimoine intellectuel qu’il peut faire évoluer et concède des licences intelligentes à l’industriel dans son domaine de compétence. On fait là de l’innovation ouverte.
Or, du fait des modifications du financement de la recherche publique, réparti entre l’ANR, l’ADEME, les régions et la direction générale des entreprises, nous nous retrouvons face à un maquis invraisemblable de modalités de financement qui nous fait perdre de l’argent, les financements dépendant de la personnalité juridique plus ou moins bien comprise de l’intervenant à financer. C’est contraire aux règles européennes. Je plaide, avec véhémence, pour que la France s’inspire de celles-ci : si la comptabilité de l’intervenant ne lui permet pas de payer le coût complet, il est financé en coûts additionnels ; s’il a fait l’effort, comme nous, de mettre en place des coûts complets, il est financé sur la base de ceux-ci. Cette procédure ne plaît pas forcément à Bercy mais ce dernier a un paramètre de réglage : le taux de financement, qui peut être établi en fonction des ressources propres des laboratoires et des établissements. Il est anormal, par exemple, que l’ANR finance la recherche partenariale sur la base des coûts complets uniquement pour les EPIC. Dans les instituts Carnot, certains EPST sont plus engagés sur leurs ressources propres que des EPIC.
Troisièmement, dans la France jacobine, il n’est pas facile à un institut de droit privé comme ARMINES d’exister. Nous souhaiterions avoir une reconnaissance institutionnelle un peu plus forte et ne pas être oubliés quand l’État doublera le crédit impôt recherche.
Quelques mots, pour terminer, sur les instituts Carnot. Ils sont remarquables mais les résultats ne seront pas immédiats. Il se constitue néanmoins un club très intéressant, dans des dimensions d’ailleurs surprenantes. Je donne un seul exemple. Grâce aux Carnot, nos relations se sont renforcées avec le CETIM – centre technique des industries mécaniques –, qui est proche des PME de la mécanique. Il en résulte une « mayonnaise » très intéressante, à laquelle il faut donner un peu de temps pour monter.
Enfin, il faut veiller à ce que les critères d’évaluation de l’AERES, l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur – qui a, par nature, un biais académique – prennent bien en compte les objectifs des établissements et leurs missions.
M. Gérard Jacquin, Président de INRA Transfert. INRA Transfert essaie depuis quelques années de développer un modèle dual : rassembler au niveau national tous les organismes (écoles, EPST, EPIC…) qui participent à nos thématiques tout en nous ancrant au niveau local dans les structures mutualisées universitaires.
Les compétences de l’INRA sont extrêmement spécialisées, et la politique de transfert technologique de l’institut reflète sa position : celle-ci est hégémonique, ou du moins très dominante, en matière de productions végétales et animales, alors que dans le domaine de la transformation des produits et de la nutrition, ses compétences recouvrent en partie celles d’autres établissements, comme en matière de biotechnologies vertes et blanches et dans les sciences humaines et sociales liées à ces champs.
Nous partageons avec M. Bernard Froment une conception élargie de la valorisation de la recherche : la recherche finalisée doit intégrer toute la chaîne de valeur, de l’amont, à travers le « partenariat d’orientation », jusqu’à l’aval de la recherche, via le « partenariat de transfert », en passant par le partenariat de recherche.
La valorisation bipolaire est une autre spécificité de l’INRA, dont les premiers clients sont les 400 000 exploitations agricoles françaises, même si ce fait est peu connu. Les chiffres que je donnerai dans la suite de mon exposé ne décrivent pas cette valorisation diffuse, et pourtant la société attend beaucoup de l’INRA dans les dix ans qui viennent, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement.
Par ailleurs, notre stratégie de valorisation se décline selon trois portefeuilles, qui doivent assurer notre présence à l’international : nous voulons gérer nos conventions de recherche, qui déterminent la propriété intellectuelle, nos grappes de brevets thématiques, et notre portefeuille de licences, car nous pensons connaître les meilleurs interlocuteurs industriels dans nos domaines de compétence.
La politique de valorisation de l’INRA traduit ses convictions et ses valeurs. Au partenariat linéaire de transfert descendant, qui, à notre avis, ne fonctionne pas, nous préférons le dialogue et la concertation avec les porteurs d’enjeux à tous les stades de la chaîne de la valeur. Nous associons ainsi depuis trente ans le plus grand nombre de partenaires, jusqu’à des PME, aux recherches précompétitives de l’INRA. Par ailleurs, conformément à notre vocation de service public, la lutte contre la captation et l’appropriation des ressources génétiques et de la biodiversité reste un enjeu majeur de notre stratégie de valorisation. Ces valeurs sont inscrites dans notre charte de la propriété intellectuelle, qui vise également à défendre les intérêts des jeunes entreprises innovantes, dont nous accompagnons le développement.
Les options de l’INRA sont les suivantes : associer gestion publique et privée, afin de pouvoir retenir la solution la plus adaptée à chacun de nos métiers ; « penser national » pour exister à l’international, et « agir local » : c’est la logique de notre projet « Agrovalo », qui traduit notre volonté de mutualisation à travers la constitution de plates-formes de transfert spécialisées au sein des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, les PRES, avec un adossement à notre expertise nationale.
En amont de la recherche, le partenariat d’orientation, dévolu à notre direction scientifique et à nos présidents de centre et intégrant notamment nos participations aux pôles de compétitivité, a pour fonction de capter des besoins de long terme. Le partenariat de recherche relève, lui, des quatorze chefs de département scientifique. Quant à la direction de la valorisation, que j’anime, elle assure la cohérence du portefeuille contractuel, la gestion du portefeuille de brevets, la communication interne, les systèmes d’information et les indicateurs de performance. INRA-Transfert SA et Agri Obtentions SA sont deux sociétés de transfert, filiales à 100 % de l’INRA, dont le pilotage direct est assuré par la direction de la valorisation de l’INRA, afin d’assurer l’intégration complète du système. Enfin, nous déclinons depuis deux ans des plates-formes spécialisées « Agrovalo », qui contractualisent avec les PRES.
Nos effectifs sont constitués de quinze chargés de partenariat dans les départements de l’INRA, quinze juristes, huit cadres chargés de la communication et de la relation avec les pôles, et une mission dédiée au développement agricole.
Le chiffre d’affaires de INRA-Transfert SA est de 7,5 millions d’euros ; elle a signé une convention de sept ans et son portefeuille compte 350 licences actives. Agri Obtentions SA, filiale dédiée aux certificats d’obtention végétale, compte 500 titres de protection d’une très haute spécialisation. L’INRA a créé deux autres filiales : la dernière, Agro Biotech Accélérateur SA, créée en novembre en partenariat avec le capital-risqueur Seventure, est une filiale de pré-amorçage avant essaimage, destinée à accélérer la maturation des projets les plus innovants.
Nous fournissons enfin une expertise juridique adossée au réseau « Agrovalo ».
Nous travaillons avec les opérateurs internationaux les plus importants. Nous assurons ainsi une veille partenariale sur une centaine de groupes industriels. Nous passons également avec ces opérateurs des accords cadres, destinés souvent à accélérer des conventions de recherche, ainsi que des partenariats stratégiques, en nombre beaucoup plus limité : le dernier a été passé avec Nestlé, auquel nous lient une vision commune de recherche sur l’alimentation et un agenda de recherche sur une vingtaine d’années.
Nos relations avec les PME ne sont certes pas exemptes de difficultés, comme c’est le cas de tous les établissements publics. Notre intervention passe souvent par la médiation de centres techniques ou de plates-formes de transfert fournissant aux PME des services et des études, dont elles sont plus friandes que de conventions de recherche. Enfin nous expérimentons depuis trois ans l’usage des lettres électroniques et autres outils d’innovation ouverte.
Notre partenariat avec le monde agricole est une de nos spécificités. Exemple de son impact social, les travaux que nous menons depuis huit ans avec la filière ovine ont permis l’éradication totale de la tremblante du mouton du cheptel français. Voilà un résultat non chiffrable, mais dont nous sommes aussi fiers que de nos transferts ou de nos brevets.
En ce qui concerne notre mission de protection des résultats, nous examinons 50 à 80 déclarations d’invention par an. Nous avons en outre pris l’initiative originale, en accord avec un partenaire anglais, de rassembler dans un portefeuille sectoriel tous nos brevets européens de biotechnologie agronomique. Nous menons une politique d’extension internationale systématique des brevets les plus porteurs, avec un rythme de trente brevets par an qui est appelé à s’accélérer. L’intéressement des chercheurs représente un million d’euros pour 300 ayants droit, soit un peu plus que la moyenne des établissements similaires.
La mission de l’INRA-Transfert relève d’une logique européenne et internationale. Cette filiale récolte cinq millions d’euros de redevances pour 350 licences actives et connaît une croissance très vertueuse.
L’incubation de jeunes entreprises innovantes est une de nos missions relevant d’une logique locale. Depuis huit ans, nous avons incubé 45 start-up, auxquelles nous apportons une assistance scientifique et technique, dans le cadre d’une charte nationale qui leur accorde des conditions préférentielles. La société Agro Biotech Accélérateur, que nous venons de créer, est en outre dédiée à accélérer le développement des meilleures créations d’entreprises innovantes. Si nous avons pu convaincre ainsi les « capital-risqueurs », c’est grâce à une politique très active de prévalorisation, qui nous permet de détecter trente à quarante projets par an.
En résumé, l’INRA est satisfait de ses relations avec ses deux filiales de transfert de droit privé : un pilotage stratégique très strict nous permet de leur imposer des missions de service public ; un bon dispositif juridique, notamment la rémunérations sur résultats et performances autorisée par la structure de droit privé, assure le dynamisme et le professionnalisme des acteurs. Nous veillons enfin à ne pas concurrencer les bureaux d’étude privés sur nos segments d’intervention. C’est un outil performant, que nous proposons aux futurs membres du consortium agronomique en cours de création. Il s’ajoute au dispositif Agrovalo en cours de développement, puisque nous allons sans doute signer pour quatre à cinq plates-formes avec les PRES en 2009.
Mme Cécile Tharaud, Présidente du directoire d’INSERM-Transfert. La création d’INSERM-Transfert est très récente, l’INSERM ne s’occupant de transfert de technologies que depuis 2006.
Si la valorisation de la recherche fait partie des missions de l’INSERM depuis la loi de programmation de 1982, sa filiale INSERM-Transfert n’existe comme structure juridique que depuis 2001, en application des lois Allègre. Destinée à favoriser la création d’entreprises innovantes en biotechnologie, elle a rapidement développé d’autres activités connexes, comme le montage et la gestion de projets européens dans le cadre des programmes cadres de recherche et développement, et la recherche de synergies avec le privé en matière d’innovation. Ce n’est qu’en 2005 que Christian Bréchot m’a demandé de restructurer l’activité de transfert de technologies de l’INSERM, jusque-là gérée par le département de valorisation et de transfert de technologie de l’institut, afin que les industriels trouvent en face d’eux un interlocuteur qui partage leur culture.
Mais pouvait-on confier à une structure de droit privé la gestion de la propriété intellectuelle d’une institution de recherche publique, et ses contrats de partenariat avec l’industrie, outils de plus en plus stratégiques de financement de la recherche ? La comparaison avec des institutions étrangères homologues telles que l’université de Louvain, l’institut flamand des biotechnologies, le DKFZ allemand, le Massachusetts Institute of Technology, entre autres, m’ont convaincue de la pertinence de transférer intégralement cette activité dans une filiale de droit privé. C’est pourquoi, depuis le 1er janvier, l’INSERM-Transfert gère l’intégralité des activités qui vous ont été décrites.
Les effectifs d’INSERM-Transfert sont d’environ soixante-dix personnes, dont vingt-cinq gèrent son activité européenne. Le transfert de technologies en lui-même n’occupe qu’une quarantaine de personnes, le reste des effectifs se consacrant à la gestion de la société.
En matière de création de filiales privées de transfert de technologies, il y a deux grands choix d’organisation. Dans les pays anglo-saxons, des chefs de projet gèrent la détection de l’invention en proximité avec les scientifiques, la stratégie de propriété industrielle, sa négociation, sa contractualisation, puis son suivi et son développement auprès de l’industrie. Si je n’ai pas fait le choix de cette organisation, c’est principalement parce que les ingénieurs et techniciens français maîtrisent peu la gestion de projet et que le transfert de technologies manque encore de professionnalisme.
Voilà pourquoi nous avons fait le choix d’une organisation en départements techniques, qui devront dans un premier temps développer leur expertise et leur professionnalisme pour les porter à des niveaux d’excellence internationale. INSERM- Transfert compte ainsi des départements dédiés à la propriété intellectuelle, à la création d’entreprises, aux affaires européennes.
Le benchmark international ne s’est pas limité à la définition de l’organisation de l’entreprise, puisque nous rencontrons régulièrement nos homologues européens dans le domaine du transfert de technologies. Ces rencontres doivent nous permettre, d’une part d’améliorer nos pratiques professionnelles et d’autre part de lancer des partenariats opérationnels, à travers le partage de plates-formes technologiques ou l’enrichissement de portefeuilles de brevets, afin de nous ancrer dans un réseau international d’opérateurs.
Une des priorités d’INSERM-Transfert est de créer une culture de l’innovation à l’interface entre ces deux mondes, et d’assurer de façon proactive la rencontre entre une offre de technologies de rupture et une demande croissante du monde industriel. Ainsi, l’industrie pharmaceutique, qui est notre client principal, sous-traite aujourd’hui jusqu’à 50 % de son budget de recherche d’innovations de rupture aux milieux académiques.
L’autre priorité est celle de l’intégration de la chaîne complète menant à la création de valeur à travers différents types d’outils, depuis le plus concret jusqu’aux dispositifs de plus long terme.
Parmi les obstacles que nous rencontrons aujourd’hui, le partenariat institutionnel arrive au premier rang. La science du vivant étant de plus en plus multidisciplinaire, nous entretenons des partenariats avec de nombreux instituts de recherche, tels que l’INRA ou l’INRIA, l’université ou l’hôpital. Ce dernier partenariat, spécifique à la recherche en science du vivant et qui se traduit par une tutelle supplémentaire, aggrave encore la complexité de ces relations institutionnelles et la difficulté de faire parvenir au patient l’innovation en santé.
Pour parler sans langue de bois, je dirais que l’état dans lequel nous avons trouvé les relations institutionnelles de l’INSERM se rapprochait du champ de bataille, et l’impasse à laquelle la négociation de nombreux accords-cadres avait abouti pesait sur les négociations avec l’industrie.
Ces tensions ont des origines multiples. Il y a tout d’abord un problème de compréhension, qui tend à se résoudre avec la montée en puissance du concept de valorisation. Mais il a fallu du temps pour convaincre nos interlocuteurs que l’inventeur n’est pas le propriétaire, que celui-ci n’est pas le mandataire négociateur, et que ce dernier n’est pas l’unique récipiendaire d’un revenu financier éventuel. La distinction de ces quatre notions permet d’appréhender la notion d’inventeur conformément au droit national et international de la propriété intellectuelle.
La propriété est une notion contractuelle, et je souligne la nécessité de réduire la dispersion de la propriété intellectuelle si nous voulons être efficaces en matière de transfert de technologie. Je me réjouis qu’un consensus se dégage aujourd’hui parmi les organismes de recherche en faveur de la solution consistant, au cas où plusieurs institutions mènent une recherche commune, à en mandater une seule pour sa valorisation. Vous me permettrez cependant de douter de l’efficacité de ce dispositif quand ce malheureux mandataire dissimule cinq, six, voire sept copropriétaires s’inquiétant de la répartition de leurs droits au brevet. Si le mandat unique est incontournable, il est tout aussi nécessaire de réserver le statut de propriétaire au plus petit nombre de tutelles possible. Point besoin pour cela de complexifier le droit de la propriété intellectuelle, ce qui aurait en outre le désavantage de créer inutilement des exceptions françaises : il suffit d’accompagner les tutelles vers une contractualisation à l’anglo-saxonne, par laquelle elles répartiraient les droits entre elles, réduisant ainsi le nombre de propriétaires à un, deux au maximum.
C’est possible à partir du moment où ces organismes se professionnalisent suffisamment pour gérer leurs relations dans une très grande transparence. Cela suppose la capacité de s’informer des actions de valorisation en cours et de discuter très en amont de stratégies de recherche. Ces tutelles pourront alors conduire la véritable politique d’innovation que la Ministre appelle de ses vœux. Elles pourront en effet entretenir entre elles des relations de confiance et se répartir en toute transparence les retombées financières éventuelles de leur recherche, selon des clés de répartition simples, et non dossier par dossier et inventeur par inventeur, comme c’est le cas actuellement. Des organismes qui font preuve par ailleurs du plus grand professionnalisme, passent parfois des années à définir des règlements de copropriété absolument inutiles. Croyez-vous que les industriels attendent que ces règlements soient régularisés ? Non ! Ils vont chercher ailleurs une technologie similaire, et étant donné le caractère concurrentiel des domaines en cause, ils la trouvent.
En ce qui concerne les critères d’évaluation du transfert de technologies, je souscris entièrement, en tant que membre du conseil d’administration de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, aux propos de M. Iris. Les critères d’évaluation des organismes de recherche, qu’il s’agisse des critères internes ou de ceux de la LOLF, sont d’un maniement difficile. On a en outre tendance à se focaliser excessivement sur le premier d’entre eux, à savoir le nombre de brevets déposés. Or, si le brevet est incontournable en matière d’évaluation, la détention du titre n’est pas en elle-même un critère pertinent. On ne pourra pas fluidifier le transfert de technologies sans améliorer ces critères d’évaluation.
Les performances de l’INSERM sont celles d’une université américaine moyenne : nous générons cinq millions de revenus de licence, alors que pour un budget équivalent, le Medical Research Council génère cent millions d’euros de redevances annuelles. Le Medical Research Council, les instituts de Stanford, de Harvard ou l’université de Louvain ont mis longtemps à mettre en place un système générateur de revenus grâce à un cercle vertueux d’innovation qui suppose un réinvestissement dans la recherche. Un des mérites de l’université de Louvain a ainsi été d’assurer à ses patrons de recherche la liberté de construire des partenariats stratégiques avec l’industrie.
Si notre marge de progression est importante en matière de revenus de licences, nous maintenons un chiffre d’affaires d’environ seize millions d’euros en matière de collaboration de recherche. La licence reste donc le véritable enjeu en matière de transfert de technologies.
En matière de création d’entreprises, l’INSERM a essaimé 65 entreprises innovantes. Nous gérons également INSERM-Transfert Initiatives, un petit fonds d’amorçage de 4 millions d’euros financé en partenariat avec trois « capitaux-risqueurs », et qui a contribué en 2008 au financement de trois petites entreprises issues de l’INSERM ou d’autres institutions de recherche publique (Muséum, Institut Curie), avec des business angels.
En ce qui concerne la preuve de concept, l’INSERM a peu d’argent à consacrer à cette activité, en comparaison avec le système israélien, qui fait aujourd’hui référence. Ce système a le mérite de consacrer des moyens considérables à la recherche « préindustrielle », à la différence de notre recherche académique en sciences de la vie. Même si l’INSERM a débloqué cette année deux millions d’euros pour compléter le financement de cette activité par l’Agence nationale de la recherche, ce budget reste insuffisant : le recul de trois ou quatre ans dont nous disposons désormais sur ce travail de consolidation de la preuve de concept visant à assurer la maturation des projets des laboratoires académiques destinés à l’industrie nous permet d’affirmer que nous n’avons pas aujourd’hui les moyens de ce travail ; or tous nos partenaires européens ont mis en place des dispositifs d’une ampleur bien supérieure, comparables à ce qui se fait en Israël.
M. le Président Claude Birraux. Merci pour la clarté de votre message sur ces sujets complexes, qui pourraient constituer autant de chantiers nouveaux pour l’application des lois sur la recherche et sur les universités.
M. Jean Therme, Directeur de la recherche technologique du Commissariat à l’énergie atomique. Je vous parlerai d’activités où la valorisation ne suit pas la recherche, mais l’accompagne dès son premier jour.
Le CEA a une longue histoire en la matière : la valorisation de la recherche dans le domaine du nucléaire, avec la création de la COGEMA, devenue ensuite AREVA, ou le laboratoire d’électronique et de technologie de l’information, le LETI, sont ses activités les plus connues dans ce domaine. La direction de la recherche technologique, que j’anime, est chargée de la valorisation, hors du champ nucléaire, des technologies issues de ce champ. Regroupant 3 500 personnes pour un budget de 400 millions d’euros, elle gère plus de deux cent millions d’euros de contrats industriels, qui assurent 75 % de son financement, bien qu’il s’agisse d’une entité publique. Nous déposons 400 brevets par an, soit un brevet par million de dollars de chiffre d’affaire, ce qui nous classe au meilleur niveau mondial, et nous avons plus de 400 partenaires industriels.
Nous avons porté notre démarche de valorisation à un haut degré de professionnalisation, puisqu’une direction du CEA lui est totalement dédiée. Ses domaines de compétence sont au nombre de quatre : le benchmark international ; les brevets, notamment la gestion de portefeuille et le contentieux en la matière ; la contractualisation des partenariats ; l’investissement en capital. Surtout, le CEA a créé, à mon initiative, des catalyseurs d’innovation au sein de centres d’excellence rassemblant enseignement supérieur, recherche appliquée, acteurs de l’entreprise et du monde économique, tels que le MINATEC de Grenoble, l’INES de Chambéry ou le DIGITEO Labs de Saclay.
L’opposition entre recherche fondamentale et recherche appliquée est à mon sens un faux débat. Aux États-Unis, la recherche est totalement intégrée ; en Europe, des instituts de recherche technologique à caractère intermédiaire servent de passerelles entre la recherche fondamentale et le monde de l’entreprise. J’ai coutume de résumer le processus d’innovation par la formule « 4 P », comme Publications, qui est le travail de la recherche fondamentale, « Patents », relevant plutôt de la recherche appliquée, Prototypes issus du développement industriel, et enfin Produits de la production de masse.
Au cours de la dernière décennie, nous sommes passés insensiblement de l’ère des « agriculteurs de l’innovation » à celle des « chasseurs-cueilleurs de l’innovation ». À l'ère des « agriculteurs », peu de pays avaient investi dans l’innovation, et les mêmes pays regroupaient recherche fondamentale, technologie et industrialisation. Désormais, dans un monde où les acteurs sont nombreux, les plus compétitifs sont ceux qui savent « piquer » les innovations chez ceux qui créent la connaissance : le Japon des années quatre-vingt, la Corée ou Taiwan dans les années quatre-vingt-dix, beaucoup d’autres pays aujourd’hui. On assiste à un découplage géographique entre la production des connaissances et leur exploitation industrielle. C’est ce qui rend nécessaire une recherche partenariale liant la recherche fondamentale et l’application l’industrielle.
La DRT fonctionne selon un business model assez original : la propriété industrielle est notre capital, dont nous concédons la jouissance à des industriels sous forme de licences. Nous la concédons selon des marchés, des timings et des pays différents, ce qui permet de réutiliser n fois la même propriété intellectuelle. Cela suppose une recherche de clients : elle emploie 115 commerciaux, qui sont des chercheurs formés à la négociation commerciale. Nous cherchons également à nouer des partenariats avec les industriels selon des méthodologies compétitives sur le marché international, car nos concurrents se trouvent aux États-Unis ou en Asie, et non en France, ni même parfois en Europe.
La DRT consacre enfin 25 % de son activité à son ressourcement, qui consiste à chercher auprès de la recherche fondamentale les idées créatrices qui nous permettront de déposer des brevets et de faire de l’innovation. À ce propos, je veux insister, après Pascal Iris, sur l’importance du soutien par le ministère du réseau des instituts Carnot, sans lequel les relations entre recherche fondamentale et instituts de technologie s’étioleraient.
Un partenariat industriel se crée sur la durée : celle-ci est nécessaire pour faire naître la confiance et le respect, et produire des résultats. Le schéma suivant vous indique la montée en puissance de nos partenariats, du plus libre, la recherche autofinancée, au partenariat stratégique.
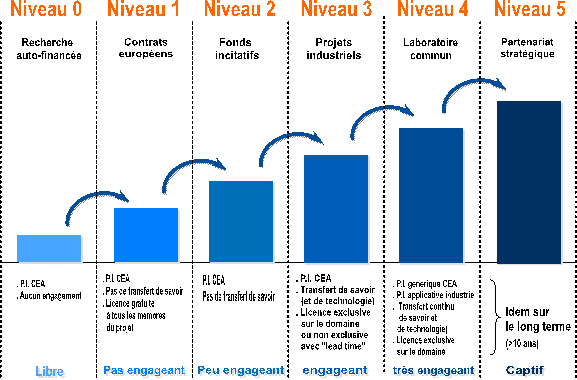
Si les contrats européens ne sont que des premiers contacts afin de mieux se connaître, le stade du projet industriel permet à l’industriel de tester nos performances et de nous mettre en concurrence. Nous établissons ensuite ce que nous appelons un laboratoire commun, piloté par l’industriel, qui nous permet de travailler ensemble pendant trois à quatre ans avec un budget suffisant pour garder les meilleurs. Le partenariat stratégique n’intervient que dix ans après les premiers contacts. À ce stade, l’industriel s’appuie principalement sur la DRT pour sa recherche externalisée : il nous indique ses besoins en termes de marchés et de produits ; nous mettons à sa disposition les technologies qui lui seront utiles. Il s’agit donc d’une relation extrêmement privilégiée.
Nous comptons actuellement une trentaine de laboratoires communs, qui représentent 75 % de nos recettes industrielles. Nous signons 80 à 85 % de nos partenariats de l’année dès le début d’année, et nous avons deux ans et demi de commandes en portefeuille. Ce backlog nous permet de négocier dans de bonnes conditions avec les industriels, notre objectif n’étant pas de gagner de l’argent, mais de réussir des valorisations industrielles.
Nos premiers partenaires sont les leaders nationaux, le groupe des entreprises du CAC 40 et un peu au-delà. Les start-up sont nos clients historiques : nous en avons créé beaucoup à l’origine, et aujourd’hui ce sont des start-up extérieures qui viennent chercher de la technologie auprès de la DRT. Il nous arrive même de donner à des activités que nous avons rachetées la forme de start-up. Les majors internationaux constituent le troisième groupe de nos partenaires. C’est à la demande de nos partenaires industriels que nous sommes allés à l’international pour tester nos performances. Nous ne sommes malheureusement pas à égalité de ressources avec nos concurrents, le financement public nous étant interdit dans ce cas.
Enfin, le dernier groupe de nos partenaires, arrivé tardivement mais en pleine expansion, est constitué par les entreprises traditionnelles qui subissent la concurrence internationale des pays à bas coût de main-d’œuvre. Ceux-ci nous demandent d’apporter de l’intelligence à leurs produits, qu’il s’agisse d’automobiles, de pneus, de lunettes, de volets roulants, de papier, de textile, que sais-je encore. Ce groupe compte un nombre très important de PME-PMI.
Vous trouverez ci-après le classement de nos vingt premiers clients.
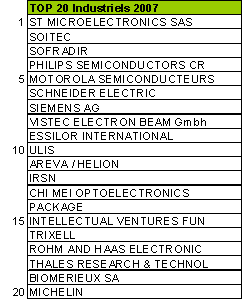
Alors que l’ensemble de ces partenariats pesait plus de 21 millions d’euros et 92 % de nos recettes industrielles, il représente aujourd’hui presque 70 millions d’euros et 75 % de nos recettes industrielles, et représentera plus de 80 millions d’euros l’année prochaine. Nos partenariats industriels se densifient et se diversifient.
Autre évolution positive, trois start-up issues du CEA font aujourd’hui partie de nos dix meilleurs clients.
La croissance de nos dépôts de brevets est très importante : 250 brevets par an sont déposés par le LETI, 400 par la DRT, 500 par le CEA, ce qui suppose une ingénierie puissante. Les accords de licence – qui mesurent l’utilité réelle des brevets – ont connu également une croissance significative, passant d’un taux de 10 % à près de 50 %, au point que nous préférons désormais ne pas dépasser ce taux et attendre que les brevets rencontrent de vrais marchés. Il faut savoir en effet que nos meilleurs brevets n’ont pas généré de retombées financières avant une vingtaine d’années.
Notre objectif n’est pas de faire du licensing à tout va pour gagner de l’argent, mais d’apporter des brevets au patrimoine de nos laboratoires communs. Nous construisons ensuite d’autres brevets dans le cadre de ces partenariats et nous les réutilisons sur différents marchés. Nos brevets constituent donc un apport permettant d’amorcer le financement des industriels, qui va à son tour permettre de déposer de nouveaux brevets. Cette politique nous coûte dix millions d’euros par an, et nous rapporte un peu plus de vingt millions d’euros de redevances.
En ce qui concerne les start-up, le CEA en a créé une centaine, dont 50 % à Grenoble et 25 % à Saclay. Entre trois et huit projets par an entrent en incubation, après un long travail en amont. Chaque année, trois projets en moyenne parviennent à maturation et environ 15 % sont abandonnés avant création de la start-up. Certaines meurent ; d’autres sont intégrées dans d’autres groupes, mais la plupart sont encore en activité, dans des domaines aussi divers que la biophysique, le design, les composants, les micro-écrans, etc.
La valorisation industrielle passe aussi par les centres d’excellence coopératifs, tels que MINATEC. Ce pôle grenoblois rassemble tous les acteurs du monde de la recherche, de l’enseignement supérieur, de l’économie et de l’industrie afin de constituer une plate-forme de rang mondial en micro et nanotechnologies. Le passage du LETI des années quatre-vingt-dix à MINATEC a nécessité un investissement de 1,3 milliard d’euros, ce qui est conforme au coût moyen d’un centre d’excellence de stature internationale dans un domaine donné. Ce coût a été assumé à hauteur de 50 % par un financement public. Dans une étude réalisée pour le compte de l’Europe, le Karlsruhe Institut of Technology place MINATEC en tête des centres de nanotechnologies européens. Lux Research, cabinet américain spécialisé en nanotechnologies, nous place également au nombre des grands centres mondiaux, MINATEC étant caractérisé comme le centre qui connaît le meilleur retour sur investissement industriel dans le domaine des nanotechnologies.
Le rapport « Guillaume » de l’Inspection Générale des Finances de 2007 sur la valorisation de la recherche reconnaît le caractère tout à fait particulier de la politique de valorisation du CEA, notamment à travers sa politique des brevets et sa capacité à nouer des partenariats industriels importants, ainsi que la professionnalisation de sa démarche de valorisation. Selon lui, le CEA obtient les meilleurs résultats dans ses domaines de compétence, et les start-up créées par lui – ainsi que par l’INRIA – connaissent une croissance plus rapide que les autres et une probabilité de succès beaucoup plus élevée.
En conclusion, la DRT se sent un peu seule en France ! Ceci n’est pas une attaque contre mes collègues ici présents, mais une simple constatation : sur les vingt premiers instituts Carnot, la DRT pèse cinq fois plus en matière de recettes de recherche partenariale que le premier de ses concurrents et dix fois plus que les autres ! C’est là une situation anormale. Il faut absolument renforcer la recherche partenariale française. Cela suppose d’abandonner notre politique de « French Doctors » qui veulent s’occuper de tout le monde, pour adopter une stratégie offensive d’investissement massif au bénéfice de quelques acteurs choisis pour en faire des « Top Performers ». Puisqu’il y a peu de chances que la France produise 300 champions du monde, il vaut mieux sélectionner dix organismes et les porter le plus haut possible. Je veux bien qu’on qualifie une telle stratégie d’élitiste, si cela signifie « anti-démagogique » et non « antisocial ».
Ce sera ma recommandation finale : qu’on ait enfin dans ce pays le courage de choisir !
LES ENTREPRISES PRIVÉES COMME PARTENAIRES
M. le Président Claude Birraux. J’ai participé à l’université d’été du MEDEF, à qui j’ai délivré deux messages : embauchez des docteurs – et, si vous voulez avancer sur les problèmes de la société, embauchez des philosophes !
M. Thierry Sueur, Président du Comité Propriété intellectuelle du MEDEF. Monsieur le Président, sur les docteurs, vous serez entendu. Sur les philosophes, je demande un joker ; on verra…
Je voudrais rapidement évoquer les objectifs que poursuivent les entreprises lorsqu’elles coopèrent avec la recherche publique, puis les questions de propriété intellectuelle et de copropriété, et terminer sur la valorisation, vue du côté de l’entreprise.
Dans la période actuelle les entreprises se sont recentrées sur leur métier. Elles ont des compétences limitées : grâce à la coopération avec la recherche publique – CNRS, université, INSERM ou autres – nous avons accès à des compétences dont nous ne disposons pas dans l’entreprise. Cela nous permet de résoudre les problèmes nés de la complexité croissante des technologies. Nous avons accès à une recherche de pointe, à des idées nouvelles, à un réseau de chercheurs, à des instrumentations dont nous ne disposions pas. Nous espérons aussi, par ce biais, exercer une certaine influence sur les programmes de la recherche, et je souscris aux propos qui ont été tenus sur le continuum de la recherche. C’est enfin pour nous la possibilité de trouver des chercheurs à recruter, des thésards, des consultants, ce qui est extrêmement important. Grosso modo, nous sommes satisfaits de notre coopération avec la recherche publique.
La qualité des relations que nous sommes à même de développer est essentielle. Elle est d’autant meilleure que nous avons des coopérations récurrentes avec les différents laboratoires. Cette qualité des relations ne se décrète pas et se construit au fur et à mesure des projets. Nous souhaiterions que les relations contractuelles et les projets tiennent compte de ce développement de bonnes pratiques et de cette expérience pour construire des relations à long terme, pour accentuer ce qui est coopératif, trouver le moyen de traiter qui peut être conflictuel et échanger sur toutes les opportunités possibles.
Les choses se gâtent un peu quand on aborde les questions de propriété intellectuelle. Elles sont difficiles à traiter, y compris lorsque l’on coopère avec des concurrents et avec des clients. Nous avons connu, notamment avec la recherche publique, l’université et le CNRS, une phase où les industriels déposaient le titre à leur nom. À la suite d’un groupe de travail formé sous l’égide de Francis Mer, au titre de l’ANRT, auquel j’ai participé, et de travaux menés avec le CNRS, dès l’époque de Mme Bréchignac, nous nous sommes orientés vers les copropriétés.
La copropriété ne fait pas l’unanimité. Certaines entreprises vivent avec – c’est mon cas, au titre d’Air Liquide. D’autres rencontrent plus de problèmes. Elles soulignent que, dans ce cadre, les discussions mobilisent une énergie énorme, que les contrats tardent à être signés, et le sont parfois même après que la recherche a été terminée. C’est très pénalisant et il faudrait peut-être que nous soyons plus intelligents, plus pragmatiques et moins dogmatiques. Les industriels considèrent qu’ils se battent beaucoup, parfois pour pas grand-chose. Il conviendrait d’introduire un peu de souplesse, de sortir de dogmes préétablis, et de travailler davantage sur une reconnaissance mutuelle des contraintes et des besoins. Que ce soit du côté de la recherche publique ou du côté des entreprises, il y a des cas où la copropriété peut parfaitement se comprendre. Mais on pourrait imaginer des copropriétés différentes : dans un domaine d’activité pour l’un, dans un autre pour l’autre. On pourrait faciliter les cessions de brevets, qui parfois, pour créer une activité, ont plus de sens, ne serait-ce que pour lever du capital ; c’est particulièrement vrai pour les petites entreprises.
Je reviens sur ce qu’a dit Pascal Iris à propos du coût de la recherche. De temps en temps, nous avons besoin d’être propriétaires des résultats et nous sommes prêts à payer pour cela. Certains laboratoires nous disent qu’ils ne sont pas là pour faire de la sous-traitance de recherche. Certes, mais il arrive que l’industriel, pour diverses raisons – parce qu’il veut créer une entreprise, par exemple – ne souhaite pas avoir de multiples partenaires. Il conviendrait donc d’assouplir le système.
Nous parlons de « valorisation ». Aux États-Unis, on utilise le terme licensing, qui signifie : concéder de la licence, créer des entreprises, des alliances stratégiques, en fait extraire de la valeur, une valeur supplémentaire d’une technologie, d’une idée, d’une innovation au sens large.
Quand les entreprises collaborent avec la recherche, elles ont d’abord en tête leurs objectifs propres : créer une activité, améliorer une compétitivité, perfectionner les produits. Elles attendent d’abord que les résultats leur profitent. Pour cela, il faut que l’exclusivité soit prise en considération. Cela soulève plusieurs problèmes, liés à l’exploitation, car on ne peut pas concevoir une exclusivité sans exploitation ; à un certain temps de latence, qu’il faut accepter ; enfin à la notion de développement, qui n’est pas toujours comprise. Ce n’est pas parce qu’une recherche a abouti que le produit peut aller déjà sur le marché – le développement peut représenter des efforts considérables en matière de coût et de temps ; le marché peut ne pas être prêt. Les activités de valorisation doivent s’appuyer sur une meilleure connaissance du marché. Il ne s’agit pas de scléroser une invention, mais de reconnaître des faits. En ce domaine, il faut trouver un équilibre.
La valorisation est un partage de valeur. Encore faut-il avoir quelque chose à partager. J’ai été extrêmement impressionné par les chiffres qui ont été donnés sur le taux d’exploitation des brevets. De par mes différentes fonctions, je dispose de quelques statistiques établies au plan international et concernant certaines entreprises industrielles ; le taux habituel d’utilisation des brevets est de 10 % et Air Liquide est très fière de ses 20 %. Comme quoi, nous avons beaucoup à apprendre de part et d’autre.
Ce que l’on attend de ce partage, ce sont des solutions simples, des systèmes simples en fait de paiement, en évitant les « usines à gaz ». En matière de licensing, sur le plan général, beaucoup de problèmes se résolvent, y compris entre industriels, par des forfaits. Il n’est pas obligatoire de passer par des redevances, dont l’assiette est toujours source de discussions. La formule du forfait a le mérite de la simplicité.
Pour gérer la propriété industrielle, il s’agira de trouver celui qui sera le plus apte à le faire. Dans de nombreux cas, ce sera l’industriel, soit parce qu’il a un service, soit parce qu’il est près du marché et que l’orientation d’un brevet est très liée à ce que l’on veut en faire sur le marché.
Pour moi, l’activité de licensing est beaucoup plus proche de la vente que du domaine juridique : il faut avoir une approche « clients », une approche pragmatique, il faut savoir ce qu’est un marché, ce qui permet une certaine souplesse d’exécution.
Il convient de privilégier le long terme, le partenariat, d’identifier les meilleures pratiques, et d’être réaliste. Je suis très content des chiffres qui nous ont été fournis mais il ne faut pas rêver : lorsque les chiffres sont importants, c’est qu’il y a une activité de licence qui rapporte 80 à 90 % du lot, et le reste relève de petits contrats. Il faut savoir aussi que le licensing n’est pas adaptable à tous les domaines. Je viens de chez Thomson, où j’ai créé une activité de licensing assez rémunératrice – nous avons dépassé depuis longtemps le milliard d’euros sur la lecture optique. Je suis maintenant chez Air Liquide, où l’activité de licensing est très peu importante, parce que son domaine ne s’y prête pas. Cela dit, nous venons de faire l’acquisition, en Allemagne, d’une société qui est un des leaders dans les biocarburants et l’hydrogène et qui fait du licensing ; nous en ferons donc dans ces domaines.
Chaque domaine a sa spécificité. Le consumer électronique, les télécoms et la pharmacie se prêtent idéalement au licensing. D’autres ne s’y prêtent pas. Ayons donc une approche pragmatique et raisonnable.
Je me réjouis de ce qui a été dit sur les brevets. Pour ma part, je reçois à peu près 550 déclarations d’inventions par an. Si vous voulez que je dépose 550 demandes de brevet par an, ce n’est pas un problème, mais donnez-moi l’argent pour le faire. Nous en déposons à peu près 250. Ce qui est difficile, c’est de choisir ce qui a un sens ; il faut parfois élaguer parce que l’on a pris des options ; et puis, on peut se tromper.
Pour terminer, je reviendrai sur les aides d’État. Ce que vous avez dit, Madame la Députée, était vraiment majeur. J’ai vécu cela dernièrement à l’occasion d’un programme sur l’hydrogène et la pile à combustible, pour lequel nous avons eu du mal à arracher l’autorisation de la Direction générale de la concurrence. Celle-ci m’a dit que nous lui compliquions la vie et que si nous faisions comme les Allemands en saucissonnant les programmes, on serait en dessous des seuils et on ne nous poserait pas de question ; on me suggérait en somme de tricher un peu avec les règles, ce que je trouve surréaliste ! À côté de cela, lorsque j’ai parlé des centaines de millions de dollars mis à la disposition d’un de nos concurrents par les États-Unis, on n’a pas voulu le savoir … On se trompe de combat ! La concurrence est ailleurs. Certes, il faut empêcher les distorsions de concurrence et ne pas perturber le jeu du marché européen. Mais il serait bon de regarder à l’extérieur.
M. Denis Randet, délégué général de l’ANRT (Association nationale de la recherche technique). Le débat budgétaire est clos, mais la question se pose de la coexistence des différents outils qui ont été mis en place. Le crédit d’impôt recherche est un système ouvert par définition. Bercy a déjà fait des hypothèses, qui l’amènent assez loin. Sans attendre les résultats, il en a tiré la conclusion qu’il fallait serrer les robinets dans certains compartiments qui fonctionnent déjà ou, pire, qui viennent à peine d’être lancés : je pense aux instituts Carnot. En plafonnant l’abondement de ces instituts à 60 millions d’euros, on empêche la création de nouveaux instituts Carnot ; de plus on bloque un système dans lequel, plus on développait les relations avec les entreprises, plus on obtenait d’abondement, car il était d’autant plus nécessaire pour faire son ressourcement. Il faudrait avoir le sens des proportions et de l’efficacité des outils que l’on met en place. Je préfère plaider pour les instituts Carnot que de plaider directement pour les CIFRE, dont on dit pourtant du bien, à juste titre. Malgré toutes les qualités que l’on reconnaît au dispositif, on parle tout de même d’en limiter le nombre, pour la première fois depuis vingt-cinq ans. Je ne prétends pas refaire la discussion budgétaire, mais il y a tout de même des choses à surveiller.
Enfin, je tiens à reprendre le message de Pascal Iris. Cette question de financement ne relève peut-être pas de la représentation nationale, mais cette dernière a tout de même un devoir de vigilance. Continuer à financer une partie de la recherche publique en payant 0 % des titulaires et 100 % des intérimaires et supplétifs aboutit à une inflation des supplétifs et à l’immobilité des titulaires. Or, comme l’on souhaite reconfigurer la recherche française pour faire en sorte que les gens aillent dans les bonnes équipes, il faut éviter de leur donner le signal suivant : restez où vous êtes, ce n’est pas grave…
M. Jean Therme. Je voudrais évoquer les instituts Carnot. François d’Aubert m’avait demandé d’en imaginer le concept, avec Jean-Jacques Gagnepain. J’avais fait un rapport, en soulignant que les instituts Carnot n’étaient pas faits pour faire gagner tout de suite de l’argent aux industriels, et qu’il ne convenait pas de réduire le coût que paieraient les industriels en donnant un peu d’argent public : plus on irait avec les industriels, plus on permettrait à ces fameux laboratoires de se ressourcer en amont et donc de travailler en profondeur pour préparer les « coups d’après » pour les industriels. Ce fut contesté par tous les industriels qui nous ont dit : donnez-nous l’argent, nous serons bien meilleurs et plus efficaces que la fonction publique. Je suis sûr que si nous l’avions fait, ils auraient fait du court terme et nous n’aurions jamais rien vu sur le long terme.
Mais deux erreurs ont été commises. La première idée était de monter une association des instituts Carnot qui soit capable de sortir du système français de recherche pour aller vers des instituts Fraunhofer à l’allemande. Or, le ministère ne l’a pas voulu. Il a coupé toute autonomie à l’association des instituts Carnot en la mettant sous tutelle interne, dans l’ANR, et il a demandé à des gens qui ne connaissaient pas la recherche partenariale de gérer la recherche partenariale des instituts Carnot. Résultat : le système vertueux selon lequel plus on travaille avec des industriels, plus on obtient de l’argent en amont, s’est cassé. Tous ceux qui sont performants seront tirés vers le bas en raison d’une limitation globale alors que, par ailleurs, on a largement augmenté les financements de la recherche fondamentale. Cela signifie que, dans ce pays, on n’a pas vraiment envie de soutenir sur le long terme la recherche partenariale. Il faut se le dire ! Je n’attaque pas le ministère ; je pense qu’il n’y a pas eu prise de conscience de l’aspect stratégique de ce type de recherche partenariale. Il faudrait que davantage de gens défendent ce moteur indispensable de l’innovation qui permet, comme on l’a fait à MINATEC, et comme on le fait aujourd’hui à Saclay, d’entraîner, dans la mouvance des spécialistes de la recherche partenariale, l’ensemble local de la recherche fondamentale, pour l’aider à progresser. Nous avons besoin d’instituts puissants qui catalysent l’innovation au cœur des sites locaux. Je ne comprends pas pourquoi cette bonne idée s’est transformée en une sorte de demi-mesure, qui va mal finir.
M. le Président Claude Birraux. Je vais vous l’expliquer très simplement. Bercy n’a pas digéré que le contrôle a priori soit supprimé. Et il aime dire à la fin de l’année au Ministre : on vous l’avait bien dit ; vous avez cédé à la démagogie ; nous avions mis 2 milliards au budget, il n’y en a eu que 100 millions de dépensés, cela ne servait donc à rien… Mais c’est évident, quand on met des bâtons dans toutes les roues ! Voilà pourquoi il faudra vraiment soutenir tous les Ministres de la recherche. Ceux de tous les gouvernements se sont heurtés aux mêmes difficultés.
M. Jean-Yves Le Déaut, député de Meurthe-et-Moselle, Vice-Président de l’OPECST. La discussion budgétaire a lieu au Parlement, mais beaucoup de choses sont déjà bloquées. Vous avez pu le constater, nous avons voté un budget mais, dans la loi rectificative, environ 400 millions de crédits de la recherche ont été supprimés par Bercy avant tout début de mise en oeuvre. Par ailleurs, sur le crédit impôt recherche et sur son utilisation, il convient de se poser les vraies questions. Au moment de la discussion budgétaire, un amendement a été voté à l’unanimité sur l’évaluation du crédit impôt recherche, pour le 30 juin 2008. Il serait important que, sur ces dispositifs, l’Office fasse un travail de préparation, puisque l’on nous a remis cette évaluation du CIR.
M. Gilles Avenard, Vice-Président de France Biotech. Je suis très heureux de pouvoir m’exprimer, au titre de France Biotech et à titre personnel, en tant que cofondateur d’une société, BioAlliance Pharma. Je voudrais vous donner tout d’abord un panorama des sociétés de biotechnologie dans les sciences du vivant en France. Je me centrerai ensuite sur la valorisation et notamment sur un groupe de travail que France Biotech a animé avec beaucoup des personnes présentes et qui a rendu en 2007, lors d’assises de la valorisation, un Livre blanc que nous tenons à votre disposition.
France Biotech réalise tous les ans un panorama des sociétés de biotechnologie. Je précise que sous le terme de sociétés de technologie et de sciences du vivant, nous réunissons des entreprises françaises qui exercent des activités dans le domaine des sciences du vivant, qui consacrent plus de 15 % de leurs dépenses à la recherche développement, et qui ne sont pas filiales d’un groupe pharmaceutique ou d’une société étrangère. Pour la plupart, il s’agit de sociétés créées par des entrepreneurs.
Ces sociétés sont aujourd’hui regroupées autour de grands centres universitaires ou hospitalo-universitaires et autour de pôles de compétitivité. Il existe aujourd’hui environ 500 sociétés de biotechnologie en France et 14 sont cotées.
Une comparaison entre l’Europe et les États-Unis permet de tordre le cou à certaines idées reçues. Le nombre des sociétés européennes a pratiquement rejoint celui des sociétés américaines. Mais la grande différence entre l’Europe et les États-Unis tient au financement : les sociétés américaines investissent beaucoup plus que les sociétés européennes ; elles ont par définition un plus grand nombre d’employés et, parce qu’elles sont souvent plus anciennes, un chiffre d’affaires beaucoup plus important.
Il y a aujourd’hui en France 14 sociétés dites de biotechnologie cotées sur le marché. Nous avons assisté, à partir de 2005, à une brutale augmentation du nombre de cotations. La capitalisation boursière a diminué à partir de 2007. Je pense que, pour 2008, le chiffre a encore baissé, mais c’est un élément conjoncturel qui ne rentre pas dans la présente discussion. Ce qui est en revanche très positif, c’est la maturité qui se profile, avec l’apparition de sociétés ayant des produits en phase avancée de développement clinique. Ces sociétés avancent depuis 2005 et aujourd’hui, 13 médicaments ou produits issus de ces sociétés sont sur le marché, ce qui est loin d’être négligeable.
Les 130 sociétés incluses dans ce panorama regroupent environ 5 400 salariés. La filière, qui est donc très vivante, est issue de la valorisation, avec des centres académiques.
Le triptyque classique de la création de ces entreprises repose sur un projet. Qui dit projet dit propriété intellectuelle. Il est impossible de créer une entreprise dans ce secteur sans une innovation et une recherche fortes, qui viennent la plupart du temps de la recherche académique, et sans une protection importante qui se traduit par la prise de brevets. Les hommes sont également importants. Dans ces sociétés, ils sont issus de la recherche académique, et souvent du monde des entrepreneurs. Le couple projet/produit et mode de financement/création de valeur est évidemment important.
Pour 2007, près de la moitié des sociétés de biotechnologie ont un partenariat public/privé, ce qui traduit l’importance de la valorisation et du transfert de technologie. Je n’insisterai pas sur les brevets. Plus les sociétés sont âgées, plus elles ont un portefeuille de brevets important. Le dépôt de ces brevets se fait aujourd’hui non seulement en France, mais aussi dans l’Union européenne et, pour la plupart, aux États-Unis. La France est au cinquième rang pour le nombre de brevets déposés. On note une augmentation d’environ 4 % entre 2006 et 2007. Nous sommes dans la moyenne des pays qui déposent le plus de brevets.
En 2006, France Biotech a animé un groupe de travail qui réunissait non seulement des entreprises, mais aussi un certain nombre d’acteurs de la valorisation : Pasteur, le réseau CURIE, l’AP-HP, l’INRA, des universités, INSERM Transfert, un certain nombre d’incubateurs comme Eurasanté et Génopole. Nous avons réfléchi sur plusieurs points qui nous intéressent aujourd’hui.
Tout à l’heure, Bernard Froment a indiqué qu’il n’y avait pas de définition claire de la valorisation. Ce groupe de travail a cherché à en donner une, peut-être imparfaite, mais consensuelle, au moins dans notre groupe. Selon nous, la mission de la valorisation est de « permettre que les découvertes issues d’une recherche académique d’excellence soient développées et commercialisées via leur transfert à des structures industrielles, au bénéfice de la société, dans les délais impartis et dans le respect des règles éthiques ».
Lors de ces assises, le groupe a fait un certain nombre de recommandations. Sur le plan législatif et réglementaire, il préconise la révision des critères d’évaluation des structures de recherche. On ne peut pas les évaluer uniquement sur le nombre de brevets. Dans le Livre blanc qu’a édité France Biotech, d’autres critères, comme la création d’entreprises et la qualité du travail scientifique de l’établissement de recherche, sont mentionnés. Ces critères doivent faire l’objet d’un travail important pour mieux apprécier les performances des structures de valorisation.
Le groupe a également recommandé la clarification des modalités de partage des revenus à l’intérieur des structures, que ce soit vis-à-vis des chercheurs ou des structures de valorisation elles-mêmes et la création de lignes budgétaires importantes pour financer la maturation des projets à potentiel au sein même des centres académiques.
Le groupe a fait six propositions plus précises :
- premièrement, la professionnalisation des structures de valorisation. Les industriels doivent avoir en face d’eux des personnes capables de discuter sur le même plan. Les structures doivent pouvoir embaucher des personnels qui ne soient pas uniquement issus de l’université ;
- deuxièmement, la mise en place de mandats de représentation clairs dans le cadre des copropriétés. Vis-à-vis des industriels, il est très important qu’un seul représentant soit en mesure de négocier en cas de copropriété. Dans la société que je dirige, pour certains brevets, il y a cinq copropriétaires ! C’est un véritable problème pour les industriels ;
- troisièmement, l’établissement d’éléments structurants standard, de façon que, lorsque les industriels s’adressent à l’une ou l’autre structure de valorisation, ils retrouvent des éléments classiques et non des clauses particulières inventées par chaque structure ;
- quatrièmement, le renforcement des activités de business development ou de marketing, de façon que les structures de valorisation puissent présenter l’ensemble des innovations à l’intention de l’industrie, afin de mieux les valoriser ;
- cinquièmement, des points de mutualisation, au plan national ou régional, de certaines expertises et de certains outils ;
- sixièmement, le renforcement de la formation à la valorisation, qu’il s’agisse des chercheurs ou des étudiants dans leur cursus scientifique.
Les messages généraux de la filière tournent essentiellement autour de la professionnalisation. Le groupe suggérait que les structures de valorisation aient les moyens de recruter des personnels venant de l’industrie, ce qui implique d’améliorer les grilles de rémunération dans la fonction publique pour pouvoir accueillir ce type de personnels.
Aujourd’hui, les industriels constatent, notamment dans ces sociétés de biotechnologie, que les relations avec les structures sont souvent compliquées, pour des raisons de délais, mais aussi de vision commune : le bien est à valoriser dans l’intérêt des deux parties, ce qui n’est pas toujours bien compris. Les organismes de recherche ont fréquemment l’impression que leur innovation a beaucoup de valeur. Il est important de s’entendre sur l’utilité du bien ou du service. Mais les délais de négociation sont le point le plus important. Le temps est un élément fondamental pour les petites entreprises et un délai de négociation de plusieurs mois est souvent incompatible avec leur agenda ; certains accords ne se font pas pour cette seule raison.
En conclusion, le groupe a préconisé le recrutement dans les structures de valorisation de personnes ayant une expérience professionnelle et industrielle. Il a recommandé ensuite que ces professionnels aient véritablement la capacité de s’engager, c’est-à-dire qu’ils aient une réelle capacité à négocier, surtout lorsque les innovations viennent de plusieurs organismes de recherche. Il a recommandé enfin une mobilité réciproque entre les structures de valorisation et l’industrie, la mutualisation de certaines fonctions afin d’augmenter l’expertise, la mise en place de filières pour améliorer la formation et l’expérience, surtout dans ses aspects de négociation, et enfin l’adaptation des grilles de rémunération.
M. le Président Claude Birraux. Nous allons maintenant écouter CroissancePlus.
Mme Édith Henrion d’Aubert, Directrice Générale de CroissancePlus. CroissancePlus est avant tout un groupement professionnel d’entrepreneurs. Nous fédérons des PME et des PMI dans tous les secteurs d’activité créateurs de valeur, d’emploi et de croissance ; il s’agit en grande partie de secteurs liés à l’innovation, à la recherche, à la technologie, au high tech, mais aussi de secteurs liés à l’industrie ou à des produits plus traditionnels.
Nous avons dix ans d’existence. Au moment de la bulle internet, nous avons connu un fort reflux, puisque nos entrepreneurs ont énormément souffert. Mais nous avons repris vigueur depuis cinq ans, en intervenant sur des problématiques essentiellement juridiques, fiscales et sociales. Petit à petit, nous nous sommes intéressés à des domaines plus proches du vôtre : recherche, innovation, croissance responsable et même internationale. Notre vocation est en effet, en fédérant ces entrepreneurs de croissance, d’amener des start up à ce middle management qui n’existe pas en France. Nous leur permettons de crever le plafond de verre, en leur donnant des financements, des structurations innovantes. On peut être à la fois innovant dans sa production et ses services, mais aussi dans son modèle de développement et son mode de management. Notre objet est d’amener le plus possible de petites entreprises vers de grosses PME pour créer un tissu industriel solide en France et à l’exportation.
Nous avons depuis deux ans une commission qui s’occupe de création et de recherche. Elle est présidée depuis un an par Christophe Fornes, fondateur de la société Memobox, qui produit des logiciels et des services dans la gestion financière des télécoms ; il est à la tête d’une entreprise de 25 salariés, avec un chiffres d’affaires de 2 millions d’euros. Il va vous exposer les quelques pistes que nous avons creusées.
M. Christophe Fornes, Président de la commission « Recherche et innovation » de CroissancePlus. Je représente en effet de petites entreprises. Au sein de notre commission, nous avons fait le même constat depuis deux ans : les petites entreprises de dix ou vingt personnes ne connaissent pas du tout la recherche-développement qui se fait au niveau des institutions de la recherche publique. Or cela pourrait être très intéressant pour elles, d’autant qu’elles n’ont pas les moyens d’avoir, dès le départ, dans leurs structures, des gens qui se consacrent à la vraie recherche, qui pourraient préparer leur avenir. C’est sans doute pourquoi ces entreprises restent petites. Leurs dirigeants se débrouillent avec les moyens du bord, parce qu’ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Ils ont leur idée de produit et font en sorte de le développer et de le commercialiser, ce qui occupe déjà leur temps.
Notre idée était que beaucoup de choses existent, qui ne sont pas connues des petites entreprises. Ne serait-il pas possible de faire en sorte qu’une structure déjà existante leur serve de premier guichet, connu d’elles et capable de les aiguiller vers les bonnes plates-formes, les technopoles, les pépinières ? La chronologie a son importance : si un entrepreneur n’intègre pas tout de suite un tel schéma, lorsque l’entreprise aura quelques années d’existence, il lui sera très difficile de revenir en arrière. Résultat : certaines entreprises se limitent à dix ou quinze personnes et, même si elles sont innovantes, elles restent dans leur coin et ne deviennent jamais des midcaps capables de rivaliser avec des entreprises internationales.
Parmi les petites entreprises, en matière de recherche et d’innovation, on connaît OSEO. C’est l’exemple de ce que pourrait être un guichet, qui permettrait à une petite entreprise de savoir où s’adresser et de nouer les liaisons nécessaires avec les réseaux existants, qui sont très performants. Mais j’insiste sur la taille de ces entreprises : nous avons beaucoup entendu parler d’industries ; nous en sommes bien loin ici. Cela m’amène à revenir en passant sur l’évaluation du CIR : je souhaite vivement que, dans cette évaluation, on fasse une distinction entre le CIR dans les grandes entreprises et dans les industries, et le CIR dans les PME.
Notre objectif principal est que la recherche publique acquière une certaine visibilité parmi les PME, ce qui n’est pas aujourd’hui le cas. Tout le monde pourra en bénéficier.
L’entrepreneur d’une petite entreprise et le chercheur appartiennent à deux mondes complètement différents, qui ne se connaissent pas. Il serait intéressant de les faire communiquer, par le biais de séminaires, de formations : des chercheurs pourraient participer à des séminaires dans des écoles de commerce ; des patrons de PME pourraient leur expliquer ce qu’est une PME – et inversement. On ne parle pas des mêmes choses, on n’utilise pas le même vocabulaire, et personne ne se connaît très bien.
Dans le cadre de l’enseignement, il faudrait un peu mélanger les uns et les autres, comme cela se fait à l’étranger, notamment aux États-Unis. Ce qui a été dit à propos de Grenoble m’a semblé très intéressant : en un seul endroit, on pourra retrouver des gens capables de manager une entreprise, des chercheurs capables d’apporter l’innovation, des étudiants qui sont les futurs chercheurs ou les futurs managers. Cela permettra de créer dès le départ un réseau qui, sinon, n’existerait pas.
Voilà ce qui se passe au niveau des PME, qui sont encore bien loin des négociations sur la propriété intellectuelle…
M. le Président Claude Birraux. Les pôles de compétitivité auxquels vous avez pu participer ont-ils modifié cet état de fait et permis une ouverture sur le monde de l’université, de la formation, de la recherche ? Dans mon département, existe un petit pôle sur la mécatronique. L’université s’y est totalement impliquée et elle est partenaire d’un laboratoire dédié au pôle de compétitivité. Pourtant, certains chefs d’entreprise ne savaient même pas que l’université existait et pouvait s’occuper de leurs questions. Avez-vous la même perception des choses ?
M. Christophe Fornes. Des structures intéressantes pour les PME existent, notamment les pôles de compétitivité. Mais le plus souvent, les entrepreneurs ne le savent pas. Il faut que l’information circule plus. C’est à l’entrepreneur d’utiliser l’outil minimum que constitue internet pour aller chercher ce qui se passe. Mais, dans une petite structure qui ne comprend au départ que cinq ou six personnes, il ne peut pas consacrer beaucoup de temps à s’informer. Un relais unique, susceptible de lui indiquer qu’il existe une technopole à tel endroit, qu’OSEO peut l’aider pour la partie innovation, qu’il peut aller voir le responsable de l’école qui, à proximité, forme dans sa spécialité, lui apporterait une aide concrète et l’aiderait à passer d’une petite structure à une structure de 20, 50 ou cent personnes.
M. le Président Claude Birraux. En tout domaine, que ce soit dans la mécanique, dans les relations sociales ou même dans la politique, il faut organiser les interfaces, pour éviter que le système se grippe. En l’occurrence, des pôles de compétitivité ou des pôles technologiques ont un rôle à jouer, en allant vers les entreprises pour recenser leurs besoins et leur proposer des réponses.
M. Marc Ledoux. S’agissant des PME, je ne dépeindrais pas la situation de manière aussi noire. Des interfaces existent, et le système commence à fonctionner assez bien. Chaque année, nous signons entre 460 et 500 contrats de recherche coopérative avec les PME, avec un renouvellement annuel d’à peu près 200 par an. Par ailleurs, on assiste à une extraordinaire montée en puissance des contrats avec les pôles de compétitivité, contrats qui, pour la plupart, concernent de petites entreprises ; en 2007 on a signé un peu plus de 65 millions d’euros de contrats, à travers les pôles de compétitivité. Bien sûr, certaines entreprises ne saisissent pas ces possibilités. Malgré tout, il y a eu un sacré changement depuis quelque temps et je pense que les pôles de compétitivité y ont particulièrement contribué. Je suis donc moins pessimiste que vous. Nous menons aussi d’autres opérations. À travers l’ANRT, nous essayons de mettre en place des systèmes avec les PME. Enfin, nous avons nous-mêmes, en interne, des systèmes régionaux.
Mme Édith Henrion d’Aubert. Je ne pense pas que Christophe Fornes se voulait pessimiste. Les pôles de compétitivité, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur ont complètement transformé les relations entre les entreprises, la recherche et l’université. C’est vraiment la voie à suivre, mais nous nous demandons si l’on ne pourrait pas aller un peu plus loin et créer des pépinières d’entreprises, des « pépinières franches », sur des zones très limitées géographiquement et pas forcément en perdition, avec des régimes fiscaux et sociaux avantageux. On a créé récemment à Montréal, dans le domaine des jeux vidéo, une petite pépinière d’entreprises, qui a permis de faire exploser le développement de ces produits. Il ne s’agirait pas de le faire pour toutes les entreprises, mais pour des secteurs très innovants, très pointus, qui ont besoin d’un écosystème temporaire et limité. Cela pourrait constituer un complément aux pôles de compétitivité.
M. Jean Therme. Je voudrais abonder dans le sens de M. Fornes. Nous travaillons beaucoup avec les PME. Nous avons constaté que celles-ci avaient du mal à consacrer des ressources à des programmes de recherche et développement, tant elles sont absorbées par leurs problèmes quotidiens. Il ne suffit pas d’aller les voir. Il faut les aider dans leurs démarches, qu’il s’agisse d’ingénierie financière de projets, de montage de projets ou d’accompagnement dans les laboratoires. Ce sont elles qui ont besoin d’aide et c’est à nous de nous déplacer.
À MINATEC, nous organisons des visites. Nous avons eu 17 000 visiteurs, entreprises et chercheurs en 2007, et nous en aurons plus de 20 000 en 2008. Vous voyez combien de personnes un centre d’excellence peut attirer. Nous avons par ailleurs décidé de mettre en place avec l’INPG et l’UJF à Grenoble, un bâtiment qui s’appelle le BII, ou bâtiment pour les industries intégratrices. Il est dédié aux entreprises, PME ou PMI, dans lesquelles on injectera les nanotechnologies pour rendre leurs produits plus performants. Cela va du tuyau de PVC aux chemises ou aux volets roulants... Pour ramener la barrière des coûts à un niveau accessible aux PME, nous créons avec l’INPG un centre de transfert, où trois étudiants travaillent pour une PME pendant quatre mois de leur temps, y compris pendant l’été qui suit leur stage, voire la deuxième année de stage, et qui sont encadrés par des gens du LETI. Le but est d’utiliser nos moyens technologiques à coût marginal, avec des étudiants qui travaillent sur leur projet, pour abaisser le niveau de coût, souvent inaccessible à une PME. Le coût d’une personne au CEA est de 150 000 à 200 000 euros, et une PME ne peut pas l’assumer.
Il faut donc des lieux, dans lesquels on crée des conditions telles que la PME pourra passer cette barrière potentielle trop difficile pour elle en termes de ressources, de capacité de financement et d’environnement. Il faut que les centres de recherche soient moteurs et qu’on n’attende pas que la PME vienne frapper à la porte pour demander ce qu’on peut lui fournir.
Une autre initiative prise avec le conseil général de l’Isère a consisté, avec l’agence économique locale, à aller au contact des entreprises qui, situées hors de la zone irriguée par notre dispositif, n’étaient pas impliquées dans celui-ci, afin d’élaborer ensemble des projets de recherche – le CIR se révèle à cet égard un outil merveilleux. Ce que l’on fournit ainsi à ces PME, c’est en fait un package complet de mise en œuvre d’une R&D avec un laboratoire, en leur ouvrant un accès plus lisible à notre savoir-faire, en imaginant avec elles ce que nos produits peuvent leur offrir – y compris pour ce qui est de la propriété industrielle – et en leur apportant l’ingénierie financière du projet, notamment en matière de rescrit fiscal, bref, tout ce qu’une entreprise de six personnes ne peut envisager de faire seule.
M. Marc Le Gal. Les dispositifs mutualisés élaborés autour des PRES avaient également le souci de faciliter pour les industriels, petits ou grands, l’accessibilité des compétences grâce à des initiatives peut-être moins abouties que celles qu’a décrites Jean Therme, mais qui permettent d’améliorer l’affichage à la fois de l’offre et du dispositif d’accompagnement. Il ne suffit pas en effet de mettre une PME face à une offre d’un laboratoire. Encore faut-il qu’un médiateur lance une passerelle entre les deux puis facilite leur rapprochement.
Sans que l’université doive rassurer à tout prix le MEDEF, je tiens tout de même à revenir sur les chiffres évoqués par Marc Ledoux concernant le taux d’exploitation des brevets de la recherche publique. En effet, si 84 % sont détenus en copropriété avec les universités, le licensing out, c'est-à-dire les brevets monnayés, est de 10 % : le taux de 41 % de brevets exploités qui a été indiqué, comprend en fait les brevets qui sont en co-exploitation parce qu’issus d’un travail en collaboration avec un industriel, et non pas seulement ceux qui font l’objet de licences auprès de partenaires n’ayant pas participé aux travaux de recherche.
Mme Geneviève Fioraso. Je soulignerai pour ma part le rôle des collectivités locales en matière de maillage. En prenant la présidence de la SEM MINATEC Entreprises, je sortais quelque peu, certes, de mon cœur de métier d’élue puisque cette société, chargée d'assurer la commercialisation du bâtiment de haute technologie de MINATEC, était confrontée au marché. Finalement, les locaux ont été remplis au bout de deux ans, mais démarcher des prospects, héberger des start-up n’est pas franchement le métier d’un élu.
En tout cas, ce qui fait la force des pôles c’est le fait que tous les acteurs travaillent ensemble, que ce soit les start-up, les PMI-PME, les grands groupes, les universités – où les PRES aident à surmonter le défaut de structure pyramidale des centres décisionnels – et les organismes de recherche.
Aussi faut-il toujours conserver l’esprit de risque et l’esprit de projet en évitant tout excès de juridisme : MINATEC a réussi sans aucune structure juridique, le comité de pilotage prenant toutes les décisions à l’unanimité. Si l’on avait commencé l’aventure en faisant appel à des juristes, comme certains nous y incitaient, je suis convaincue que MINATEC n’existerait pas.
De même, on s’est aperçu que les start-up réunies dans le bâtiment de MINATEC faisaient affaire entre elles, s’échangeaient des compétences, même quand elles utilisaient des technologies très différentes. L’idée de zone franche de Mme Henrion d’Aubert vaut à cet égard moins en termes de défiscalisation ou d’aides qu’en termes de dynamique créée. Des partenariats sont nés qu’on n’aurait jamais imaginés. C’est ainsi que, hors de la thématique Minalogic, tout un étage est aujourd'hui dédié à des entreprises de sciences du vivant et de biotechnologies qui travaillent avec des sociétés relevant, elles, des technologies de l’information et de la communication.
Toujours au sein du pôle, Schneider Electric, l’entreprise leader, a pris l’initiative, plutôt que d’attendre le small business act que l’Europe doit élaborer, de conclure un contrat de partenariat avec les PMI-PME sous-traitantes et partenaires dans Minalogic, non pas seulement pour approfondir les contrats liés à la recherche et à l’innovation, mais aussi pour les faire bénéficier de tout son réseau à l’exportation. Pour une petite structure, s’épargner les recherches d’agents ou de réseaux à l’export est en effet au moins aussi important que bénéficier d’un crédit impôt recherche, lequel d’ailleurs conduit souvent à un contrôle fiscal qui mobilisera deux personnes... Une telle initiative permet de former un cluster – une grappe – de petites entreprises autour d’une grande, ce qui est bénéfique à toutes. L’effet dynamisant d’un rapprochement du MEDEF, de la CGPME, des grands groupes, des PMI-PME au bénéfice d’un projet, est incontestable sur le terrain.
Je m’interroge à cet égard sur le récent élargissement, sans contrepartie, du crédit impôt recherche en faveur des grands groupes. Ne court-on pas ainsi le risque de décourager ces derniers de travailler avec des PMI-PME au sein des pôles de compétitivité, sachant le travail que cela représente pour eux ? Le crédit impôt recherche aurait dû être accompagné de conditions de partenariat avec les PMI-PME, isolées ou organisées en réseau. J’avais proposé un amendement répondant à cette préoccupation. Il n’a pas été accepté, mais l’idée devrait être creusée.
M. Thierry Sueur. Le premier facteur en matière de recherche consiste à savoir où sont les bons partenaires. À cet égard, l’entreprise dont je fais partie a signé, comme d’autres, le pacte PME avec OSEO. Cela permet, pour nous, en rencontrant plusieurs centaines de PME, de leur faire part des problèmes que nous avons à traiter, voire de découvrir que certaines ont des solutions à nous proposer ou qu’elles sont prêtes à y travailler, et, pour les PME, de s’associer avec nous pour vendre leur technologie dans le monde entier – je pense, par exemple, à la découpe par jets d’azote liquide sous 3 000 bars. Les partenariats existent donc de toute façon.
M. Christophe Fornes. Le pacte PME est un très bon exemple de coopération possible entre les PME et les grands groupes – il en a encore été fait état tout à l’heure à propos du partenariat signé hier par l’INRIA. Mais tout le problème pour la petite entreprise tient à la connaissance de toutes les possibilités existantes. C’est pourquoi je parlais de guichet unique.
À cet égard, être issu, comme l’est M. Jean Therme, de l’industrie et faire de la recherche constitue un profil particulièrement intéressant, propre à permettre d’orienter les PME vers le bon pôle. En effet, si les pôles de compétitivité, les technopoles, présentent de l’intérêt, encore faut-il savoir qu’ils existent. Nous avons ainsi rencontré, au sein de notre commission Recherche et innovation, une entreprise de mécanique du Val-d’Oise qui ne connaissait pas une société, pourtant située à trois kilomètres d’elle, qui lui était complémentaire. Le guichet permettrait de disposer, si ce n’est de solutions, du moins des informations nécessaires.
Cette double compétence entreprise-recherche permet en tout cas de faire le lien entre le monde des chercheurs et celui de l’entreprise, mondes qui sont très différents au moins pour une petite entreprise.
M. Jean Therme. Parmi les nombreux visiteurs que reçoit MINATEC, certains, venus pour le laboratoire, découvrent une petite start-up, tandis que d’autres, venus pour une start-up, en rencontrent finalement plusieurs. C’est un lieu magique pour former des réseaux, et des relations d’affaires s’y nouent souvent entre des gens qui ne se connaissaient pas avant la visite. C’est pourquoi l’on organise des visites très ciblées, par exemple d’industriels, que l’on présente un peu à tous.
M. Bernard Froment. Je ne voudrais pas que l’on se quitte sans avoir abordé la question de la valorisation des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales.
M. Fornes soulignait l’importance de réunir sur un campus des gens aux profils différents. C’est l’une des richesses de certains établissements dans le monde, mais aussi de certaines de nos universités, de permettre des complémentarités entre des spécialistes en sciences humaines et sociales et en sciences « dures », notamment dans la phase de valorisation. Tel est le cas des fameux quatorze projets labellisés voilà trois ans par l’Agence nationale de la recherche – ANR – et qui arrivent aujourd'hui à maturité : dans certains sites, comme en Bretagne ou en Lorraine, la valorisation tient compte également des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales.
Je prendrai également comme illustration de transferts de résultats l’exemple déjà cité des Québécois qui ont développé ce qu’ils appellent des « trousses d’intervention », issues de la recherche en sciences humaines et sociales. Il s’agit en fait d’outils qui sont mis à disposition des intervenants – acteurs sociaux, policiers, etc. – notamment pour tout ce qui a trait à la problématique des femmes battues ou des enfants maltraités. Il ne s’agit pas là d’une valorisation des résultats de la recherche par une entreprise, mais d’une valorisation sociétale. Cet aspect me semble essentiel et je n’aurais pas voulu qu’on l’oublie cet après-midi.
M. le Président Claude Birraux. Cela ne peut qu’inciter M. Sueur à engager des philosophes en entreprise !
M. Pascal Iris. Les gens qui travaillent dans le domaine de la valorisation ou de l’accompagnement sont souvent d’accord entre eux, et je suis à peu près certain qu’en matière de propriété intellectuelle, par exemple, on pourrait trouver des accords méthodologiques généraux. À cet égard, je me demande s’il ne conviendrait pas de réunir en France un corpus d’idées qui pourrait servir de référence en matière de propriété intellectuelle ou encore de modalités de financement. D’autre part, le savoir-faire qui consiste à accompagner les chercheurs et à comprendre le langage de l’entreprise devient en même temps un véritable métier. Aussi, je me demande s’il ne faudrait pas créer une formation à ce métier, avec un master spécialisé. Nombre de réseaux d’échanges existent, tel le Réseau CURIE, mais aucun ne centralise ce corpus d’idées, qui pourrait s’accompagner d’une formation spécialisée. Il existe maintenant un capital de savoir-faire et d’expériences très important qui ne serait pas si difficile à structurer en termes de formation et d’information.
M. le Président Claude Birraux. L’école nationale de santé de Rennes forme tous les dirigeants d’hôpitaux de France. On pourrait imaginer une école formant également à la valorisation et à la gestion de projets universitaires et de recherche
M. Michel Safar, CroissancePlus. Vous avez eu raison de souligner, ainsi que Jean Therme, combien la double culture recherche-industrie est fondamentale. Pour autant cette double culture qui fait la richesse du CEA ou de l’INRIA doit pouvoir être acquise.
M. Jean-Claude Étienne, Premier Vice-Président de l’OPECST. Ce caractère de deux mondes étrangers l’un à l’autre que vous avez tous souligné me fait penser à l’exemple récent du bassin d’emploi du Bassigny dans la Haute-Marne profonde où des PME fabriquaient depuis des lustres des ciseaux et des bistouris qu’ils n’arrivaient plus à vendre, sans rien imaginer d’autre. C’est après leur avoir simplement donné l’idée de produire des prothèses de hanche que l’emploi est reparti et qu’ils vendent aujourd'hui, quatre ans plus tard, leurs prothèses au Japon et partout dans le monde. Comme toujours, il s’agissait d’un problème d’interface, de méconnaissance. Les entrepreneurs ne savent pas vers qui se tourner. Ils n’ont même pas idée de l’accompagnement que l’on peut leur apporter.
M. Claude Allègre, ancien Ministre, membre de l’académie des sciences, chargé de l’organisation des Assises européennes de l’innovation. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, je suis très heureux de me retrouver devant un organisme à la création duquel j’ai contribué en 1981 et dont le rôle est devenu important pour l’Assemblée nationale.
Si j’ai été chargé d’organiser les premières Assises européennes de l’innovation, il m’a surtout été demandé de présenter des propositions afin de réviser l’agenda de Lisbonne qui n’a pas donné les résultats espérés. Celles qui ont été retenues par le Président de la République ont été annoncées de manière claire, à l’exception de l’une d’entre elles.
La première a trait directement à la révision de l’agenda de Lisbonne, qui devait initialement avoir lieu en 2011. Le Président de la République a fait accepter par l’ensemble de ses collègues, lors du sommet européen qui s’est tenu deux jours après les Assises – ce qui n’était pas un hasard –, l’avancement du calendrier en 2010, l’idée étant de faire de 2009 l’Année européenne de l’innovation et de la créativité.
Cette action européenne ne doit pas être réservée à quelques experts. Il doit s’agir d’une opération bottom-up conduisant, à partir de débats organisés dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque organisme s’intéressant à l’innovation, à l’élaboration de propositions concrètes pour un nouvel agenda de Lisbonne, dont plus personne aujourd’hui ne défend le programme-cadre tel qu’il est.
La présidence tchèque poursuivra cet objectif puisque, le 7 janvier, se tiendra à Prague une réunion pour lancer cette Année européenne de l’innovation et de la créativité, et je vous invite, pour ce qui concerne la France, à organiser des forums de discussions afin d’aboutir à des propositions concrètes en la matière.
La deuxième proposition tient au constat selon lequel l’effort de recherche fourni par l’Europe représente à peu près 6 % des dépenses effectuées à cet effet dans l’Union européenne, 94 % d’entre elles étant réalisées par les États. Nous avons par conséquent proposé de coordonner davantage les politiques de ces derniers, sur la base du volontariat naturellement. Une telle coordination des politiques publiques de recherche et d’innovation à l’échelle de l’Europe pourra faire l’objet de plusieurs volets.
Nous proposons d’abord de lancer tout de suite un plan de remise à niveau des pays nouveaux entrants, financé par des fonds structurels.
Pour les pays plus avancés, ensuite, le Président de la République a proposé un pacte de l’innovation. Ce pacte, qui sera discuté dans les premières semaines de janvier, consiste en des mesures très contraignantes, notamment sur le plan budgétaire. L’objectif de l’agenda de Lisbonne de consacrer 3 % du PIB de chaque pays à la recherche étant loin d’être atteint, il convient de définir quelque chose de plus modeste mais qui soit réalisable sur le plan budgétaire.
D’autres mesures très contraignantes porteront, par exemple, pour les pays qui signeront le pacte sur l’innovation, sur l’engagement de trouver un accord en un an sur un brevet commun à cet espace européen, sachant que le brevet coûte en Europe huit fois plus cher qu’aux États-Unis.
Il conviendra par ailleurs de conclure la discussion déjà engagée sur l’innovative small business act.
Enfin, pour favoriser la coopération européenne dans la recherche et de l’innovation, un programme, appelé COPERNIC, engagera notamment ses signataires à coordonner les programmes de recherche sur des points ciblés, impliquant les gros équipements. L’idée générale est de prendre exemple sur le programme Eurêka en retrouvant les moyens que ce dernier a perdus en ne disposant plus aujourd'hui pour les projets innovants que de 300 millions d’euros contre 1 300 en 1985. Dans le même ordre d’idée, il s’agira de redonner aux petites et moyennes entreprises les moyens de participer aux programmes européens de recherche, sachant qu’avec le temps la participation des grandes entreprises y est devenue écrasante.
La troisième proposition porte sur l’évaluation, laquelle n’existe pas aujourd'hui au niveau européen. Aussi proposons-nous la création d’une Académie européenne des sciences et des techniques impliquant non seulement les sciences dites dures, mais également les sciences humaines et d’autres disciplines telles que l’ingénierie ; elle sera chargée d’évaluer à la fois les universités, les organismes de recherche et les programmes européens.
La quatrième proposition, enfin, annoncée mezzo voce, mais qui figure dans la déclaration du sommet européen, tend à l’intervention de la Banque européenne d’investissement par l’intermédiaire d’un emprunt européen pour l’innovation, les fonds devant être remboursés non par les États, mais par les projets eux-mêmes. Il s’agit, autrement dit, de créer un fonds pour permettre – c’est la priorité numéro un – aux 3 000 petites et moyennes entreprises innovantes en Europe de passer à la taille supérieure, ce que les banquiers ne savent pas aider à faire.
La deuxième priorité dans ce cadre est de créer des laboratoires mixtes privés-publics non plus pour le décor, comme c’est parfois le cas, mais avec pour objectif l’aboutissement concret d’un projet puisqu’il faudra rembourser l’emprunt à la fin.
Enfin, la troisième priorité est d’orienter des fonds vers quelques programmes de recherche européens débouchant sur des applications économiques. J’en donnerai trois exemples.
Le premier a trait à la recherche sur les moteurs propres non pas des voitures, mais des bateaux. On l’oublie trop souvent en effet, ils représentent aujourd’hui 40 % des dépenses de carburant et une pollution considérable.
Le deuxième exemple concerne les forages géothermiques. L’idée est de lancer un programme européen en la matière, non pour produire de l’électricité, sauf dans les territoires d’outre-mer, mais pour le chauffage : on pourrait rendre les maisons quasiment autonomes en chauffage avec un petit apport en photovoltaïque.
Le dernier exemple porte sur ce que l’on appelle la santé à la maison, c'est-à-dire la télémédecine. Dans tous les hôpitaux d’Europe, 30 % des consultations aux urgences non seulement n’ont pas de raison d’être, mais font perdre du temps en paperasserie. L’idée est de développer le réseau RENATER, que nous avons nous-même créé et qui est devenu la base du réseau européen en la matière, en facilitant son passage au très haut débit. Il existe en France nombre d’entreprises extraordinairement innovantes de trente à quarante personnes dans ce domaine, mais qui, étant bloquées dans leur croissance, sont condamnées à être absorbées tôt ou tard par une multinationale américaine.
Le Président de la République a fait acter par le sommet européen l’instauration d’une séance annuelle réservée à l’innovation, ce qui permettra une discussion sur ce sujet au niveau des chefs d’État.
La philosophie générale en matière d’innovation est la suivante : les politiques fixent les grandes priorités, mais le reste relève du bottom-up. Ce n’est pas en effet à une administration de décider la répartition des financements européens de la recherche, mais aux concours, à la compétition.
Après le lancement, au mois de janvier à Prague, de l’Année européenne de l’innovation et de la créativité, 2009 verra donc la mise en place du groupe de travail sur la création de l’Académie européenne des sciences et des techniques, du programme COPERNIC et du pacte de l’innovation. Compte tenu des sommes dépensées dans chaque pays, ce dernier comprendra probablement la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les pays scandinaves, l’Espagne, la Belgique, la Hollande, l’Italie et sans doute le Portugal, mais il restera naturellement ouvert à tous ceux qui voudront le signer.
Qu’il me soit permis, avant de conclure, de formuler quelques remarques.
La première vous étonnera peut-être : à l’exception de l’Allemagne, j’ai noté en moyenne une extraordinaire faiblesse de la recherche privée. Tout le monde « tape » sur la recherche publique, mais la recherche privée, particulièrement en France, où les montants de la recherche sont en retard d’un point de PIB, n’est pas, d’une manière générale, le moteur des entreprises, même si certains secteurs sont en pointe comme la recherche privée chez L’Oréal ou sur le médicament.
La deuxième remarque est que les grandes entreprises européennes, sauf en Allemagne encore une fois, étouffent les start-up innovantes – c’est aussi vrai en Finlande avec Nokia – qui non seulement souffrent de piratage de brevets, mais peuvent être absorbées pour qu’elles arrêtent leurs recherches.
La troisième remarque a trait à l’aide à la recherche privée dont la France détient le record du monde avec un taux de 23 % contre 0 % en Allemagne et même moins 10 % au Japon où la recherche privée finance la recherche publique. Or, ces aides données à la recherche privée, en particulier des grands groupes, ne font pas l’objet d’évaluation. Pourtant une évaluation de la recherche privée est indispensable en France, comme l’a d’ailleurs souligné le Président de la République en annonçant au secteur automobile que l’État était prêt à lui consentir des avances de fonds, mais à condition de savoir ce qu’il faisait de cet argent. Ainsi que je l’ai constaté en maints endroits, la recherche est souvent en effet plus une vitrine qu’un véritable moyen d’alimenter la croissance de l’entreprise. Ce phénomène s’explique par l’insuffisante formation de nos dirigeants d’entreprise à l’innovation. Je suis persuadé que si dans les plus grandes écoles on obligeait les étudiants à faire de la recherche plutôt que de bachoter et d’écrire des thèses, l’état d’esprit serait différent.
Lors du conseil des Ministres franco-allemand du mois de novembre dernier, où j’avais été chargé de présenter des propositions sur l'innovation et la recherche, la chancelière Angela Merkel a donné son accord pour que l’innovation soit un pilier de l’axe franco-allemand par l’intermédiaire de projets communs. Il est vrai, à parler franchement, que je lorgne terriblement sur leurs instituts qui pourraient nous aider à « booster » le réseau des instituts Carnot que nous avons créé. Le budget de l’Allemagne fédérale en matière de recherche a en effet été de 55 milliards d’euros l’année dernière, les deux tiers provenant de la recherche privée, les quatre grands instituts – Max-Planck, Helmholtz, Leibniz et Fraunhofer – comptant pour un sixième, de même que la Deutsche Forschungsgemeinschaft pour le financement universitaire. Et parmi les quatre grands instituts, Fraunhofer tire les deux tiers de ses revenus des brevets, ce qui lui donne une liberté extraordinaire. Mon sentiment est que tout le retard de la France par rapport à l’Allemagne dans le domaine du commerce extérieur est lié à ce contexte.
Notre pays dispose, tous secteurs confondus, de quatre fois moins d’entreprises de haute technologie de plus de 800 salariés que son voisin. C'est dire, pour rester optimiste, que nous avons une énorme richesse à mettre en valeur ! De fait, nombre d’initiatives formidables sont prises en France car, contrairement à ce que l’on dit parfois, l’esprit d’entreprise existe dans notre pays, comme le montre le nombre de créations de petites entreprises. Le problème est que, une fois créées, leurs dirigeants ne savent pas comment passer à la vitesse supérieure. Aussi un fonds d’investissement est-il nécessaire pour les aider car les banquiers ne le feront pas. Faudra-t-il créer à cet effet, en plus du fonds européen, un fonds français ? C’est une question que je vous pose après l’avoir posée au Président de la République. Nous avons en tout cas absolument besoin d’une aide car la compétitivité de la France dans ce domaine en dépend.
CLÔTURE PAR M. CLAUDE BIRRAUX, PRÉSIDENT DE L’OPECST
Je tiens à remercier, au moment de clôturer nos travaux, tous les intervenants de la valorisation de la recherche, qu’ils soient acteurs de la recherche publique ou acteurs privés, en particulier Mme Valérie Pecresse, qui nous a honorés de sa présence pour ouvrir la présente audition publique et qui connaît bien l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi que M. Claude Allègre qui a brossé les perspectives européennes résultant du travail qu’il a mené en amont des premières Assises européennes de l’innovation.
Il est bon de réviser la stratégie de Lisbonne. Mais l’Europe, en définissant un objectif, aurait dû préciser ce qu’il fallait faire pour l’atteindre plutôt que de laisser chacun au bord d’un chemin semé de clous empêchant tout le monde d’avancer. À l’exemple du programme qui a été cité tout à l’heure et pour lequel il a fallu justifier auprès de l’Europe qu’il n’y avait pas là distorsion de concurrence, il faut que les instances communautaires cessent de voir partout des distorsions de concurrence en Europe et comprennent que la concurrence est en Asie et aux États-Unis, qu’elle est mondiale et non pas en Europe.
Le vétéran des conférences interparlementaires Eurêka que je suis, a pu voir ce dernier programme s’étioler du fait même, curieusement d’ailleurs, de l’intervention de plus en plus grande des représentants de la Commission européenne venant affirmer tantôt que cette dernière ne voulait pas de telle mesure, tantôt que les règles de la concurrence interdisaient telle autre. C’est au point, pour forcer un peu le trait, que tout le monde est à la recherche d’un système de financement européen de la recherche et de l’innovation qui échapperait au contrôle de la Commission !
Le Président de la République, lors des premières assises européennes de l'innovation, a, me semble-t-il, résumé les défis auxquels les Français et les Européens sont confrontés, en déclarant : « Nous les Européens, nous devons placer au cœur de nos économies les passerelles qui nous manquent entre la connaissance, la recherche et la société. ».
« Ces passerelles s'appellent innovation technologique et innovation industrielle », poursuivait le Président de la République, rappelant à juste titre que l'Europe a l'obligation de rester un grand continent d'innovation et de rattraper le retard qu'elle a pris. L'érosion de la position technologique et scientifique de l'Europe par rapport aux États-Unis et aux pays émergents asiatiques est en effet manifeste depuis le milieu des années 1990.
Je citerai à cet égard une anecdote. Lors de la création de la Fondation franco-suisse pour la recherche et la technologie, l’un des représentants suisses, M. Charles Kleiber, secrétaire d’État à l’éducation et à la recherche, a en effet souligné que, face à la mondialisation, trois attitudes étaient possibles : le protectionnisme, que d’aucuns appellent le patriotisme économique ; la fuite en avant, c'est-à-dire la délocalisation dans des pays à bas coût – encore que des fabricants de jouets en bois du Jura viennent de rappeler d’anciens salariés suite aux déconvenues rencontrées avec différents produits en provenance de pays exotiques ; enfin, l’innovation qui permet d’avoir un coup d’avance et de faire travailler la matière grise.
La France a des atouts majeurs dans la mise en place européenne du pacte de l'innovation que le Président de la République appelle de ses vœux. Ces atouts, nous les connaissons, ils ont été explicités tout au long de cet après-midi qui, personnellement, m'a beaucoup appris – il est vrai que l’Office parlementaire est peut-être le seul lieu où l’on puisse débattre sereinement de sujets relativement compliqués et parfois même conflictuels. Je commence ainsi, après avoir mieux compris les points de blocage à la valorisation, à anticiper quelque peu les améliorations que Claude Allègre a parfois esquissées dans son intervention et qui recoupent les préoccupations de cet après-midi.
Ce que je retiens surtout c’est que s’il faut être professionnel, performant, encore faut-il que les esprits soient ouverts. Notre débat, à cet égard, n’aurait pu avoir lieu voilà encore cinq ou six ans, le sujet étant encore tabou. Aujourd'hui, avec la crise qui arrive et les esprits qui s’ouvrent, tous les ingrédients me semblent réunis pour engager une meilleure valorisation de la recherche.
Dans cet espace de liberté que constitue l’Office parlementaire, permettez-moi, en conclusion, de citer Pierre Joliot : « Toute certitude est par essence contradictoire avec la philosophie de la recherche », phrase qui fait écho à celle du dalaï-lama que je cite souvent : « Doutez, parce que le doute incite à la recherche, et la recherche est la voie qui conduit à la connaissance. »
© Assemblée nationale