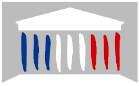N° 1429
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2013.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI de finances pour 2014,
TOME IX
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET VIE ÉTUDIANTE
Par M. Emeric BRÉHIER,
Député.
___
Voir les numéros : 1395, 1428 (annexe n° 38).
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. LES CRÉDITS DEMANDÉS POUR 2014 : UNE VOLONTÉ DE « SÉCURISATION » ET DE JUSTICE 6
II. LE THÈME CHOISI PAR LE RAPPORTEUR : LA FRANCE ET SES DOCTORANTS 10
A. L’ÉTAT DU DOCTORAT 10
1. Le « stock » de docteurs et les « flux » de doctorants 10
2. Un « statut » qui reste marqué par la précarité 14
a. D’importants éléments de régulation 14
b. Une situation financière et sociale trop souvent fragile 15
3. Un diplôme culturellement déconsidéré 18
B. ASSURER UN FINANCEMENT POUR TOUS LES DOCTORANTS ET UNE INSERTION PROFESSIONNELLE POUR TOUS LES DOCTEURS 23
1. La nécessaire protection juridique et sociale de l’expérience professionnelle qu’est la préparation d’un doctorat 24
2. Un financement « universel » des thèses qui suppose des arbitrages 24
3. L’enjeu de la professionnalisation des doctorants 27
4. Les carrières publiques et privées 30
a. Ne plus considérer le statut d’enseignant-chercheur comme le débouché exclusif et naturel du doctorat 30
b. Élargir l’accès à la haute fonction publique en particulier territoriale 32
c. Valoriser les recrutements de docteurs par le secteur privé 35
TRAVAUX DE LA COMMISSION 39
ANNEXES 61
Le présent rapport pour avis porte sur deux des douze programmes de la mission budgétaire interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». Intitulés « Formations supérieures et recherche universitaire » et « Vie étudiante », ils devraient mobiliser, l’année prochaine, respectivement, 12,803 milliards et 3,160 milliards d’euros.
Ces crédits étant examinés, de manière détaillée, par le rapporteur spécial de la Commission des finances, M. Thierry Mandon, le rapporteur pour avis a centré ses travaux sur un thème – la France et ses doctorants – lié au vote, il y a quelques mois, de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Ce texte comporte en effet des dispositions tendant à la reconnaissance du doctorat par les concours de recrutement de catégorie A, à commencer par celui de l’École nationale d’administration (ÉNA). L’adoption de ces mesures, à la portée variable, a pourtant suscité un vif débat au sein et autour du parlement, dont les a priori étaient fort instructifs pour le thésard qu’a été le rapporteur pour avis.
Le doctorat constitue, par ailleurs, « l’étage » le plus élevé de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, qui, à la suite de la Conférence ministérielle réunie à Bologne en juin 1999, s’est structuré autour des trois diplômes de la licence (bac + 3), du master (bac + 5) et du doctorat (bac + 8, théoriquement du moins) – ce qu’on appelle communément le « LMD ».
Or, force est de constater que la France s’est affranchie du D. En effet, son système de formation « dual » et ses cadres des secteurs public et privé n’accordent pas une réelle considération au grade universitaire qui, dans le reste du monde, est indiqué sur la carte de visite de son titulaire. Cette anomalie « culturelle » est d’autant plus étonnante que notre pays, comme tous ceux qui doivent produire de la valeur ajoutée pour être suffisamment compétitifs, doit impérativement s’interroger sur son « stock » et ses « flux » de docteurs.
Le rapporteur a donc souhaité enquêter sur la situation de ce diplôme, dans le temps et le cadre nécessairement contraints que constitue la rédaction d’un avis budgétaire. Pour ce faire et pouvoir ensuite formuler quelques pistes d’évolution, il a pu recueillir l’avis de cinquante-huit personnes. Qu’elles en soient remerciées ici.
L’article 49 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances fixe au 10 octobre la date butoir pour le retour des réponses aux questionnaires budgétaires.
À cette date, 83 % des réponses étaient parvenues.
L’enseignement supérieur bénéficie d’une progression globale de ses moyens. À structure constante, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit de doter les programmes 150 (« Formations supérieures et recherche universitaire ») et 231 (« Vie étudiante ») de 15,273 milliards d’euros de crédits de paiement. L’évolution par rapport à la loi de finances initiale pour 2013 est donc de + 194 millions d’euros, soit + 1,3 %.
Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit, après transferts, 9 377 équivalents temps plein travaillé (ETPT) rémunérés sur le titre du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, soit une baisse de – 1 876 ETPT par rapport à 2013.
Cette variation s’explique par divers transferts entre programmes et, pour l’essentiel, par un ajustement intra-programme lié au transfert d’emplois de l’État vers ses opérateurs de l’enseignement supérieur. Celui-ci résulte de l’accession des établissements aux responsabilités et compétences élargies (RCE) définies par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (loi « LRU »), qui a fait basculer 1 945 ETPT du titre 2 vers le titre 3.
Le nombre d’emplois sous plafond des opérateurs sur le programme 150 pour 2014 devrait s’établir à 160 141 équivalents temps plein (ETP), soit une évolution positive de 2 844 emplois par rapport à 2013. Cette variation s’explique, outre par les transferts liés à l’accession aux RCE au titre de l’année 2013, par la création de 1 000 emplois supplémentaires dans l’enseignement supérieur, dédiés à la réussite en licence, pour un montant estimé de 60,52 millions d’euros dont 22,13 millions au titre du compte d’affectation spéciale (CAS) pensions.
Le nombre d’emplois sous plafond des opérateurs du programme 231 devrait augmenter de 11 ETP par rapport à 2013 sous l’effet de deux transferts en provenance du programme 150, soit dix assistantes sociales vers le réseau des œuvres universitaires et scolaires et un ingénieur d’études vers l’Observatoire de la vie étudiante (OVE). Il devrait s’élever, après transferts, à 12 716 ETP.
On rappellera, au préalable, que 95 établissements (100 au départ, avant les fusions des établissements de Marseille et de Nancy) exercent les RCE et qu’à à ce titre, depuis le 1er janvier 2012, ils gèrent la masse salariale de tous leurs personnels, y compris ceux dont la rémunération relevait antérieurement du titre 2 du budget de l’État.
Des crédits leur ont donc été notifiés à cet effet, soit 10,616 milliards d’euros, dont plus de 99 % en février 2012. Cependant, depuis le changement de majorité, trois autres notifications ont été émises afin d’actualiser cette dotation initiale : en juin, en novembre et en décembre 2012, pour un complément cumulé de 145,2 millions d’euros, les notifications définitives des « établissements RCE » s’élevant, au final, à 10,761 milliards d’euros au titre de l’exercice 2012.
60 % de ces moyens complémentaires visaient à financer des actions spécifiques, tandis qu’un tiers de ces moyens ont couvert des ajustements de masse salariale, notamment pour les nouvelles accessions aux RCE de 2011 et la prise en charge du glissement vieillesse technicité pour les établissements passés aux RCE en 2009, 2010 et 2011.
La situation financière des universités
L’obligation pour les recteurs, contrôleurs budgétaires, d’établir le budget des établissements RCE dans le cas d’un double déficit (cf. l’article 56 du décret n° 2008-618), a conduit le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à porter une attention particulière à certaines situations particulièrement dégradées.
En effet, en 2012, 6 établissements étaient en double déficit. Aussi à la rentrée 2012, la ministre de l’enseignement supérieur et la recherche, Mme Geneviève Fioraso, prenant acte d’un manque de préparation et d’accompagnement à l’autonomie, a-t-elle mis en place un « dispositif national de suivi, d’alerte et d’accompagnement des établissements », reposant sur des diagnostics flash et des audits approfondis. Cependant, selon les prévisions transmises par le ministère, 17 établissements dont le résultat était positif en 2012 devraient connaître un déficit en 2013.
De plus, s’agissant des fonds de roulement des universités, une étude du ministère indique que le nombre d’établissements ayant un résultat déficitaire n’a pas évolué entre 2011 et 2012, soit 17 au total. En revanche, le nombre d’établissements ayant un fonds de roulement sous le seuil prudentiel des 30 jours de fonctionnement est passé de 26 à 29 entre 2011 et 2012. Or cette érosion va bien au-delà des régularisations d’écritures, parfois massives, liées aux opérations de certifications des comptes. Les établissements ont en effet mobilisé leurs fonds de roulement afin de financer de l’investissement, notamment destiné à la mise en sécurité des bâtiments, les besoins en la matière étant immenses avec 40 % du parc immobilier dégradé ou très dégradé (dont 12 % à reconstruire).
Pour 2014, les moyens des établissements (somme des crédits de titre 2 et de titre 3) augmenteront de + 106 millions d’euros en crédits de paiement pour atteindre 12,128 milliards d’euros. Ceux-ci incluent les crédits qui couvrent les 1 000 créations d’emplois dédiées à la réussite en licence, ainsi que 39 millions d’euros destinés à couvrir le surcroît de cotisation au CAS pensions lié à la titularisation d’agents contractuels au titre de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique (« loi Sauvadet »). 2 200 titularisations sont d’ailleurs prévues en 2014.
Parallèlement, des corrections ont été apportées au système de répartition des moyens aux universités, appelé « SYMPA » (1), lequel continue de donner un trop grand poids aux dotations historiques versées aux établissements et laisse persister, entre eux, des disparités importantes.
À cet égard, selon un rapport sénatorial de Mme Dominique Gillot et M. Philippe Adnot, en 2012, 46 établissements étaient en situation de sous-dotation en emplois, tandis que 26 étaient sous-dotés en crédits (2).
C’est pourquoi, pour l’exercice 2013, la répartition des 1 000 emplois ciblés sur la réussite en licence a tenu compte du sous-encadrement dans SYMPA, cette mesure traduisant une politique volontariste de réduction des inégalités. Ainsi, une première répartition de 791 emplois a eu lieu dès novembre 2012 selon les critères suivants :
– afin de prendre en compte l’objectif de rééquilibrage des moyens, 70 % des emplois (soit 686) ont d’abord été répartis en fonction de la sous-dotation en emplois calculée par SYMPA en 2012, avec une accentuation pour les universités dont les effectifs sont en augmentation en premier cycle sur trois ans. Ces dernières universités, 23 au total, ont donc bénéficié de 60 % de l’enveloppe d’emplois au lieu des 50 % résultant de l’application stricte du modèle SYMPA ;
– à la demande de la Conférence des présidents d’université, et afin de pondérer les résultats de SYMPA par un autre critère, il a été décidé de répartir 30 % des emplois (soit 294 emplois) en fonction du « taux d’encadrement enseignant brut » en premier cycle, c’est-à-dire du nombre d’étudiants en licence sur le nombre total d’enseignants titulaires. Cette mesure permet ainsi d’anticiper la refonte du modèle d’allocation des moyens, prévue pour le 1er janvier 2015 ;
– l’application d’un écrêtement a permis de dégager 189 emplois constituant un « fonds d’intervention » afin de soutenir, entre autres, la politique de site de la vague C des contrats État-établissements (2009-2012).
Le programme 231 « Vie étudiante » bénéficie, à périmètre constant, d’un abondement significatif de + 140,4 millions d’euros en crédits de paiement (+ 6 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2013, ce qui établit son montant à 2,465 milliards d’euros.
Cette hausse sans équivalent au niveau des autres budgets ministériels intervient après les 140 millions dégagés en fin de gestion 2012 pour honorer le paiement du dixième mois de bourse et revaloriser les aides aux étudiants de 2,1 % et après un effort de près de 160 millions supplémentaires au titre du budget 2013.
Les moyens consacrés aux bourses et aux autres aides directes seront augmentés de 157,8 millions d’euros en crédits de paiement et cette majoration se traduira notamment la mise en place de deux nouveaux échelons de bourses (échelons 0 bis et 7) à la rentrée 2013, ainsi que l’inscription d’un contingent supplémentaire de 1 000 aides d’urgence au fonds national d’aide d’urgence (FNAU).
Selon une estimation provisoire, 52 600 boursiers devraient percevoir, à cette rentrée universitaire, une bourse de 1 000 euros au titre du nouvel échelon 0 bis et 31 900 boursiers devraient voir, grâce à la création de l’échelon 7, leur bourse augmenter de 765 euros pour atteindre la somme de 5 500 euros.
Cet abondement tient compte aussi du fait qu’il est prévu de poursuivre la réforme du dispositif des aides aux étudiants à la rentrée universitaire 2014. Par conséquent, il s’ajoutera à l’augmentation enregistrée l’an dernier et, de ce fait, la majoration correspondante de + 153,4 millions d’euros accordée en 2013 pour les seules bourses sur critères sociaux sera conservée en 2014, notamment au titre du financement du 10ème mois de bourses.
Il y a lieu de noter que le programme 231 intègre une économie évaluée à – 6,6 millions d’euros, liée à une rationalisation du modèle de la restauration universitaire, ainsi qu’une autre de – 10,6 millions d’euros, résultant de l’achèvement du volet immobilier du contrat de plan État-région de 2007-2013.
Toutefois, l’effort du gouvernement en faveur du logement étudiant se poursuivra, avec le maintien de l’enveloppe supplémentaire de 20 millions d’euros en crédits de paiement consacrée à cet objectif qui avait été ouverte par la loi de finances initiale pour 2013.
Sur ce dernier point, qui a été traité l’an dernier par l’avis budgétaire de notre collègue Mme Isabelle Attard (3), on rappellera l’annonce, par le Président de la République, de la création de 40 000 logements étudiants sur cinq ans, qui devrait permettre d’accroître l’offre en la matière. Ces nouveaux logements seront cofinancés par le biais de la relance des opérations Campus, pour 13 000 d’entre eux, et par le budget du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), le financement par l’État des crédits du réseau des œuvres consacrés au logement restant constant. Des projets de 30 000 nouveaux logements ont d’ores et déjà été identifiés, dont 13 000 en Île-de-France.
Quelle est la situation des doctorants et du diplôme du doctorat en France ? Elle n’est guère brillante. Quantitativement, le « stock » de docteurs et les « flux » de doctorants dessinent un tableau contrasté, mais qui, au regard de la « production » des principales puissances économiques, est plutôt problématique. Qualitativement, ce grade universitaire, qui couronne un troisième cycle d’études supérieures, défini comme une « formation à la recherche et par la recherche » (article L. 612-7 du code de l’éducation), ne constitue pas, en particulier par rapport aux diplômes de management ou d’ingénieur, un passeport efficace vers l’emploi pérenne. Il est vrai aussi que le statut hybride du doctorant, aujourd’hui trop souvent synonyme de précarité, tend à accréditer l’image, aussi fausse que nocive, « d’éternel étudiant » du thésard, qui hésite à se lancer dans la vie professionnelle. En outre, le doctorat est le moins « réglementé » de nos diplômes d’enseignement supérieur, un indice de la faible considération accordée à ce titre universitaire qui s’ajoute à d’autres.
L’ « état » du doctorat est donc préoccupant, et ce d’autant plus que nos choix collectifs à l’égard du positionnement de ce diplôme sont susceptibles de freiner notre effort de recherche, ainsi que la modernisation et la diversification de nos fonctions publiques. Ce constat a donc conduit le rapporteur pour avis à formuler, à partir des éléments qu’il a pu recueillir au cours des auditions et tables rondes qu’il a organisées, des propositions pour assurer une meilleure reconnaissance de ce diplôme ainsi qu’une insertion professionnelle aux détenteurs de ce titre. Au total, ces pistes d’évolution se veulent une contribution modeste au débat public sur le doctorat, qui a été avivé par le vote de l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, lequel tend à faire « entrer » ce titre universitaire dans l’École nationale d’administration, une mesure qui symbolise l’écart qui doit être résorbé entre celui-ci, la société française et ses élites.
Dans les développements qui suivront, le rapporteur pour avis se penchera, d’abord, sur la statistique de la « production » française de docteurs et, ensuite, sur la situation sociale et financière des doctorants.
Le nombre étant toujours un facteur décisif, sommes-nous en « déficit » en ce qui concerne celui de nos doctorants et docteurs ? Cette question appelle, en réalité, des réponses nuancées.
En ce qui concerne les effectifs, dans les universités et établissements assimilés, en 2012, il y avait 63 560 étudiants inscrits en doctorat. Il y en avait 62 420 en 2002, soit une évolution de + 1,8 % en dix ans, même si le nombre de doctorants diminue régulièrement depuis sept ans. Parallèlement le nombre de doctorats délivrés a augmenté de manière significative : 12 100 ont été délivrés en 2011, contre environ 8 400 en 2003 (4).
Ces chiffres traduisent-ils un retard français par rapport à nos principaux concurrents ? Une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) parue en 2011 montre que le « différentiel » par rapport à l’Allemagne provient des matières lettres-droit-sciences humaines et sociales, ce qui renverse les idées reçues. En effet, en 2009, ce pays décernait, dans ces disciplines, trois fois plus (et le Royaume-Uni deux fois plus) de doctorats que la France, alors que dans les matières scientifiques l’écart français avec l’Allemagne, qui a une population supérieure, n’est « que » de 25 % (5). En outre, si l’on tient compte du facteur démographique, le nombre de doctorats en sciences et ingénierie par million d’habitants est de 107 en France et de 116 en Allemagne, soit une différence de 7 %. Seules la Suisse et la Suède forment, dans leurs nouvelles générations, une proportion très élevée de nouveaux docteurs scientifiques, soit, respectivement, 195 et 189 par million d’habitants (6).
Il reste que pour augmenter sa compétitivité, notre pays devrait, comme l’a souligné le président de la Conférence des présidents d’université, M. Jean-Loup Salzmann, former davantage de « professionnels de la recherche », surtout au regard d’une concurrence internationale qui s’exerce – aussi – dans le domaine de la formation doctorale. Cet aspect a été mis en avant par M. Mohamed Harfi, chargé de mission au Commissariat général à la stratégie et à la prospective. Dans la grande majorité des pays membres de l’OCDE, entre 1998 et 2011, le nombre de docteurs y a augmenté de plus de 2 % en moyenne, tandis qu’en France, celui-ci n’a progressé que de 1,4 %. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont ainsi connu une forte croissance, avec respectivement 3,6 % et 4,7 %, au moment où, par ailleurs, les pays émergents ont développé massivement leur capacité de formation doctorale. La Chine a en effet multiplié le nombre de doctorats délivrés par quatre entre 2000 et 2008 et les quatre BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) décernent désormais un diplôme de doctorat sur quatre dans le monde (26 % du total), soit l’équivalent de l’Union européenne (7).
En outre, par rapport à cet environnement mondial à forte croissance, la France devrait connaître, à moyen terme, une baisse du nombre des doctorats délivrés. C’est en tout cas l’analyse de la sous-direction des études statistiques du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui a estimé, en 2012, que si les effectifs de l’enseignement supérieur pourraient augmenter de 8,7 % entre 2012 et 2021, ceux en doctorat diminueraient de 2,1 % (8).
Ce contexte quantitatif plutôt défavorable est, de surcroît, aggravé par le constat qualitatif établi par la directrice de l’école doctorale Économie Panthéon Sorbonne, Mme Dominique Guégan, pour qui les « meilleurs éléments » de notre système d’enseignement ne préparent pas un doctorat et connaissent, de ce fait, un « déficit de formation » dans la mesure où ils s’arrêtent au niveau master ou équivalent. Cette situation, qui résulte de notre système dual de formation faisant « cohabiter » l’université et les grandes écoles, a été implicitement reconnue par le président de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieur (CEDEFI), M. Christian Lerminiaux, puisqu’il a fait part au rapporteur pour avis de sa volonté de porter, d’ici quatre ans, le taux de poursuite en doctorat des élèves-ingénieurs de 7,5 % à 10 % (9).
La répartition par filière des doctorants inscrits se caractérise, depuis l’année 2000-2001, par une grande stabilité. Selon l’édition 2013 de L’état de l’emploi scientifique en France, pour les doctorants, les effectifs en sciences sont les plus importants (44,5 %) tandis que les lettres, langues, sciences humaines représentent plus d’un tiers des inscrits (34,5 %).
Cependant, cette répartition disciplinaire connaît un double décalage :
– par rapport à la répartition des doctorats délivrés annuellement, qui est quelque peu différente : 60 % des diplômés le sont en sciences et sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et 24 % seulement en lettres, langues, sciences humaines. Ce décalage prouve, à lui seul, que ces dernières disciplines souffrent de problèmes aigus d’encadrement et d’orientation. En particulier, celles-ci connaissent des « fausses vocations », pour reprendre les termes employés par le délégué général de l’Association nationale pour la recherche et la technologie (ANRT), M. Denis Randet ;
– par rapport aux possibilités de recrutement, que celui-ci soit pérenne ou contractuel. La Conférence des présidents d’université a ainsi observé que l’on compte, chaque année, un peu moins de 3 000 postes d’enseignants chercheurs et de chercheurs titulaires (10) et un peu moins de 4 000 contrats doctoraux, auxquels il convient d’ajouter environ 1 300 conventions industrielles de formation par la recherche subventionnées par l’ANRT. En outre, dans les entreprises, la majorité des chercheurs proviennent du réseau d’écoles d’ingénieurs : 55 % ont un diplôme d’ingénieur, 16 % ont un master (ou un diplôme d’études approfondies ou un diplôme d’études supérieures spécialisées) et 12 % – seulement – un doctorat, toutes disciplines confondues (11).
Pour l’année universitaire 2012-2013, les étudiants de nationalité étrangère représentaient 42 % des inscrits en doctorat, contre 30 % en 2002. En outre, entre les rentrées 2001 et 2011, si le nombre de doctorants a augmenté de 6 % (+ 3 600), cette hausse a surtout été le fait des doctorants étrangers (+ 9 900) car le nombre de doctorants français a baissé sur la période (– 6 300). De même, la hausse du nombre de doctorats délivrés – plus de 4 200 depuis 2000-2001, soit + 53 % –vient surtout du nombre de doctorats décernés à des étrangers (+ 3 100) (12).
La France est donc une destination attractive pour les doctorants étrangers, ce qui constitue un atout pour notre rayonnement tant scientifique que culturel. Dans le même temps, les financements pour les doctorats étrangers ne représentent que 16 % des doctorats financés. Par conséquent, ainsi que l’a souligné la représentante de la Fédération CFDT-cadres, Mme Patricia Blancard, cette proportion de 40 % constitue peut-être un point d’équilibre à ne pas dépasser, car tout accroissement significatif de celle-ci se traduirait, à conditions budgétaires inchangées, par une diminution de la part des thèses financées, ce phénomène revêtant d’ores et déjà, comme on le verra plus loin, une ampleur trop importante.
En revanche, les conditions d’accueil et de travail de ces doctorants devraient être améliorées, sous peine de voir de grands pays, comme les États-Unis et la Russie, « capter » des chercheurs étrangers qui seraient rebutés par des mesures ou des demandes vexatoires, concernant par exemple le niveau de ressources exigé d’un jeune docteur pour demeurer dans notre pays.
Le rapporteur souligne, à cet égard, l’adoption récente de mesures visant à faciliter l’entrée et le séjour des chercheurs étrangers :
– extension aux scientifiques du visa de long séjour valant titre de séjour par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (13) ;
– circulaire du 10 juin 2013 invitant les préfectures à faire un principe de la délivrance de titres pluriannuels aux doctorants étrangers accueillis en France
– la délivrance de titres annuels devient ainsi « l’exception » ;
– modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suite à l’adoption de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et la recherche et circulaire du 30 juillet 2013 permettant à l’étudiant ou au doctorant étranger d’obtenir une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 12 mois (autrefois de 6 mois) s’il a achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master et souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Il convient de préciser, en outre, qu’à l’issue des douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi est autorisé à séjourner en France sans que lui soit opposable le critère de la situation de l’emploi.
Le dépôt prochain d’un projet de loi sur l’immigration devrait permettre d’améliorer encore le dispositif, notamment en dématérialisant les procédures d’inscription universitaire et de délivrance de visas et en généralisant la mise en place de guichets uniques, à l’instar des initiatives des universités de Nantes, de Lorraine et de Grenoble.
Il n’existe pas de statut du doctorant. Ou plutôt celui-ci, malgré certaines avancées relativement récentes, est, selon l’analyse de la Confédération des jeunes chercheurs, « hybride et opaque », le doctorant étant à la fois un professionnel de la recherche et un étudiant. Or, le flou entourant son positionnement n’est pas de nature à faciliter son insertion professionnelle.
Plusieurs dispositifs ont été adoptés pour améliorer la situation et l’encadrement des doctorants et leur donner – mais pour une partie d’entre eux seulement – un véritable statut.
Chronologiquement, il convient de commencer par les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE), qui ont été créées en 1981 et sont développées par l’Association nationale pour la recherche et la technologie (ANRT). Dans ce cadre, l’entreprise recrute en contrat à durée indéterminée ou déterminée de trois ans un jeune diplômé de master avec un salaire brut mensuel de 1 957 euros et lui confie des travaux de recherche, objet de sa thèse. Elle reçoit, à ce titre, une subvention annuelle de l’ANRT de 14 000 euros par mois pendant trois ans. Les CIFRE ont donc connu un succès croissant (14), d’autant qu’elles constituent une garantie d’employabilité : deux tiers des doctorants ayant terminé leur convention s’insèrent rapidement dans le secteur privé, un tiers restant dans l’entreprise partenaire (15). Au total, les docteurs CIFRE accèdent rapidement à l’emploi – 96 % en un an et plus de 70 % en moins de trois mois – et un an après la soutenance de thèse, plus de 60 % des docteurs sont en emploi à durée indéterminée (16).
Les écoles doctorales – au nombre de 285 à la rentrée 2012 – viennent ensuite. Créées en 1991 pour les premières d’entre elles, elles ont été généralisées en 2000 et leur cadre réglementaire a été redéfini par un arrêté en date du 7 août 2006. Avec ce texte, pris sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, qui dispose que les « formations doctorales sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales », celles-ci sont devenues le pivot de l’organisation de cette formation, un établissement d’enseignement supérieur ne pouvant délivrer le doctorat dans un domaine où il ne dispose pas d’une telle école. En outre, ces structures ont pour mission majeure d’apporter aux doctorants une culture pluridisciplinaire et de leur offrir, durant la préparation de la thèse, des services d’accompagnement, en particulier des actions complémentaires de formation et un « dispositif d’appui à l’insertion professionnelle des docteurs, tant dans les établissements publics que dans le secteur privé » (article 4 de l’arrêté précité).
L’arrêté du 3 septembre 1998, qui a édicté une « charte type » des thèses et instauré, pour chaque établissement public d’enseignement supérieur habilité à délivrer le doctorat, une charte des thèses, peut être rattaché à cette volonté de « normer » la formation doctorale. Ce référentiel, qui concerne aussi bien la limitation du nombre de doctorants encadrés par un même directeur de thèse que la durée de référence du doctorat, égale à trois ans, n’a pas eu, semble-t-il, les effets escomptés. En effet, une évaluation de la conformité des chartes des thèses effectuée en 2009 par la Confédération des jeunes chercheurs indiquait que 86 % d’entre elles obtenaient une note globale négative ou nulle et que 67 % des universités disposaient d’une charte avec une note négative (17).
Le « dernier venu » est le contrat doctoral, qui a été créé par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 et qui a remplacé, à la rentrée universitaire 2009, les contrats d’allocataire de recherche et de moniteur de l’enseignement supérieur. Conditionné par l’inscription en doctorat, ce dispositif est un contrat de droit public conclu pour trois ans et applicable dans les universités comme les organismes de recherche. Il fixe une rémunération minimale qui s’élève, depuis le 1er juillet 2010, à 1 684,93 euros bruts mensuels pour une activité de recherche et à 2 024,70 euros en cas d’activités complémentaires (18). Le contrat doctoral garantit donc, pour reprendre l’expression employée par Mme Dominique Jeuffrault de la Confédération générale des cadres, un « socle social » à son bénéficiaire, avec les droits à cotisation afférents, ainsi qu’une rémunération très légèrement inférieure à celle d’un maître de conférences placé au premier échelon.
Malgré ces éléments de régulation, la situation des doctorants et des docteurs reste marquée par une très grande fragilité. Au final, celle-ci se traduit trop souvent par un véritable gâchis humain, les éléments les plus brillants d’une génération pouvant être, pour reprendre l’expression du Syndicat général de l’éducation nationale-CFDT, « condamnés à être aigris ».
● Une politique de recherche qui jusqu’en 2012 alimentait la précarité
La politique menée par la précédente majorité a conduit à ce que les universités souffrent d’un « manque total de visibilité sur l’évolution pluriannuelle de leurs moyens », le système d’allocation des moyens restant très obscur, ainsi qu’à une « prolifération » des moyens extrabudgétaires selon le constat établi, l’an dernier, par notre collègue M. Thierry Mandon (19). En outre, la place prise par l’Agence nationale de la recherche (ANR), le principal instrument de financement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, a engendré de la précarité, en réduisant les moyens attribués par les universités aux laboratoires et, via ces derniers, aux doctorants.
Cet « effet de précarité » trouve sa traduction dans l’évolution des « allocations doctorales » – allocations de recherche, puis contrats doctoraux – dont le stock décroît d’année en année. Ainsi, entre 2002 et 2008, le nombre d’allocations de recherche par année a été caractérisé par une grande stabilité, « tournant » autour de 4 000. Entre 2009 et 2012, en revanche, le nombre de contrats doctoraux a baissé de 4,77 %, en passant de 3 981 à 3 791.
● Le poids des thèses non financées et ses effets pervers
Le monde des doctorants est « fracturé » entre ceux dont la thèse est financée et ceux qui ne bénéficient pas d’un tel financement, ces derniers représentant aujourd’hui près du tiers du total.
À la rentrée 2012, près de 68 % des doctorants inscrits en première année de doctorat ont bénéficié d’un financement pour leur thèse. Cette proportion a baissé de 0,7 point en trois ans, la part des thèses non financées se situant donc à 32 %.
La majorité des doctorats financés le sont par des financements publics, provenant soit de contrats doctoraux (31 % des doctorats financés), d’un organisme de recherche (11 %) ou de collectivités territoriales (8 %). Toutefois, le nombre de doctorats financés par des financements publics est en baisse sur les trois dernières années, étant précisé que les CIFRE représentent 10 % des doctorats financés, en hausse de 1,8 % sur la même période (20).
En outre, pour les thèses en sciences humaines et sociales (SHS), la situation est différente de la situation moyenne, c’est-à-dire qu’elle est médiocre. En effet, selon le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 35 % ont un financement, 35 % des thésards sont salariés et 30 % n’ont pas de financement identifié. Autrement dit, la part des « thèses non financées » est de 65 % pour les SHS et la part des salariés est élevée (21).
Or, le non-financement d’une thèse a deux effets pervers.
D’une part, celui-ci s’accompagne souvent de l’absence d’un contrat de travail, synonyme de précarité et d’aides par des proches ou de travail alimentaire. Ainsi, selon une enquête effectuée par la Confédération des jeunes chercheurs, les doctorants sans contrat pour effectuer leur recherche réalisent cette dernière dans des conditions déplorables : 73 % déclarent ne pas avoir droit au remboursement de la moitié des frais de transport ; seuls 44 % déclarent que leurs frais de voyage pour des missions ou congrès sont pris en charge alors que ce pourcentage dépasse 80 % pour les doctorants sous contrat ; 28 % déclarent ne pas avoir accès au matériel de base (ordinateur, imprimante, etc.). De plus, sur les 959 doctorants sans contrat ayant indiqué leur revenu, 604 gagnent moins de 1 000 euros par mois et, parmi ceux-ci, 312 moins de 500 euros (22).
D’autre part, ainsi que le souligne l’édition 2013 de L’État de l’emploi scientifique en France, l’obtention d’un financement de thèse a « un rôle prédominant sur l’accès à l’emploi, mais aussi sur l’accès à des fonctions de recherche » : en effet, les thèses sans financement « s’accompagnent généralement de difficultés plus élevées dans les années qui suivent l’obtention du doctorat ». C’est pourquoi on peut considérer que le doctorant en SHS subit une forme de « double peine », puisqu’il est moins financé et, de ce fait, moins assuré d’occuper, par la suite, un emploi stable.
● Des diplômés exposés au chômage ou à l’emploi non permanent
Plus le diplôme est élevé, moins son titulaire est exposé au chômage. Ce théorème est étayé par d’innombrables rapports de l’OCDE, mais la France l’a fait mentir en ce qui concerne le doctorat.
Selon les observations de M. Mohamed Harfi, chargé de mission au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, depuis le début des années 2000, une « césure » s’est opérée pour le diplôme le plus élevé de la formation universitaire : alors qu’en 2007, les jeunes diplômés de niveau master avaient un taux de chômage de 7 %, celui des titulaires d’un doctorat culminait à 10 %.
Ce constat est corroboré par l’enquête Génération du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) qui montre, depuis plusieurs années, que, trois années après le doctorat, le taux de chômage et la part des docteurs employés en contrat à durée déterminée sont supérieurs à ceux des diplômés de grandes écoles ou de master universitaire. La dernière édition, celle de la Génération 2007, interrogée en 2010, confirme une insertion difficile pour les docteurs, avec un taux de chômage stable et élevé – toujours égal à 10 % –, mais qui est, fait rare depuis 2001, inférieur à celui des diplômés d’un master professionnel (23).
En outre, les représentants du CEREQ entendus par le rapporteur pour avis ont relevé un « effet disciplinaire » : en effet, trois disciplines sont « à la traîne » en ce qui concerne le taux d’emploi et le taux élevé de contrat à durée déterminée : la chimie, les lettres et sciences humaines (LSH) et les sciences de la vie et de la terre (SVT). Ainsi, trois années après la soutenance de thèse, si en 2010, 30 % des docteurs n’ont toujours pas accédé à l’emploi permanent, les docteurs en SVT (45 %) et en LSH (32 %) étaient le plus souvent dans ce cas (24).
Il est vrai aussi que le premier emploi des docteurs est, dans la majorité des cas, un emploi précaire. En effet, au premier emploi, 67 % des docteurs de la Génération 2007 interrogés en 2010 étaient en contrat à durée déterminée (63 % pour l’enquête Génération 2004), car ils occupaient le plus souvent des positions leur permettant de préparer leur futur emploi dans la recherche (25). Il s’agit, en l’occurrence, de contrats d’ATER (attaché temporaire d’enseignement et de recherche), ceux-ci impliquant un service d’enseignement lourd et contraignant, égal, sauf en cas de temps partiel, à 128 heures de cours ou 288 heures de travaux pratiques par an, ou de post-doctorats, qui permettent d’être engagé en contrat à durée déterminée dans un laboratoire de recherche.
Ce n’est que cinq ans après l’obtention du doctorat que les titulaires de ce diplôme atteignent le « sésame » de l’emploi permanent. En effet, selon le CEREQ, la ré-interrogation en 2012 des docteurs diplômés en 2007 montre une « nette amélioration de leur situation sur le marché du travail au bout de cinq années de vie active ». Ainsi, sur 74 mois observés, les docteurs « ont passé en moyenne 58 mois en emploi et un peu plus de 5 mois au chômage et, entre septembre 2010 et décembre 2012, le taux d’emploi est passé de 88 % à 94 % » (26).
Alors que nos partenaires placent le doctorat ou le PhD au sommet de l’échelle des qualifications et peuvent l’exiger pour occuper les postes les plus élevés des grandes administrations et entreprises, la France se singularise par le fait qu’elle ne valorise pas ce diplôme. De fait, elle agit comme si, pour reprendre les propos de M. Jean-Luc Antonucci, le secrétaire général de la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture Sup CGT, elle avait « évacué le D du LMD ».
Ce choix, qui obéit à des facteurs culturels, nous isole dans le concert des élites mondiales au point que la directrice de l’École nationale d’administration (ÉNA), Mme Nathalie Loiseau, envisage d’encourager les élèves de cette école à commencer une thèse au cours de leur scolarité pour la finir par le biais de la validation des acquis de l’expérience. En effet, comme l’a fait remarquer à juste titre cette interlocutrice, le titre d’ancien élève, certes prestigieux, ne « pèse rien à l’international ».
● Le secteur privé
On peut certes se rassurer sur le « rayonnement » du doctorat dans le secteur privé en regardant le pourcentage de titulaires de ce diplôme dans les comités exécutifs des entreprises, comme le montre l’encadré ci-après.
Le doctorat et les comités exécutifs des entreprises
Selon le représentant du MEDEF au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, M. Amaury de Buchet, 20 % des membres des comités exécutifs des grandes entreprises françaises sont docteurs, contre 10 % aux États-Unis. Ce pourcentage, assez élevé, montre que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, le doctorat n’est pas méconnu de ces groupes cotés au CAC 40.
De son côté, l’Association nationale pour la recherche et la technologie (ANRT), a calculé, parmi les 100 entreprises recensées par le classement R&D Scoreboard, qu’il y a une proportion moyenne de 13,7 % de docteurs par comité. La France, avec 20,5 %, se situe donc au-dessus de celle-ci. Cependant, deux pays se situent très largement au-dessus, à savoir l’Allemagne et la Suisse, avec respectivement 57,3 % et 31,4 % (27).
Il n’en reste pas moins que le doctorat est la victime collatérale du « dualisme » de notre système d’enseignement supérieur, qui fait coexister des universités et des grandes écoles, celles-ci détenant un prestige et une influence incomparables.
Comme l’a fait remarquer M. Jean-Georges Gasser, secrétaire national du Sup’Recherche UNSA, cette « révérence », particulièrement marquée à l’égard des écoles d’ingénieurs, peut constituer un sujet d’interrogation dans la mesure où la part de l’industrie dans la valeur ajoutée totale en France est passée de 18 % en 2000 à 12,5 % environ en 2011, ce qui nous situe à la quinzième place sur les dix-sept pays de la zone euro, avec une Allemagne, dont les ingénieurs sont formés à l’université, à 26,2 % (28). Mais sans aller jusqu’à attribuer à nos filières sélectives une part de responsabilité dans notre déclin industriel, lequel est multifactoriel, on peut néanmoins constater, aux côtés du président de la Conférence des directeurs d’écoles françaises d’ingénieurs, M. Christian Lerminiaux, que notre pays est en matière d’enseignement supérieur « à contre-courant » : dans les pays anglo-saxons en effet les formations tendent de plus en plus à se structurer autour de la licence et du doctorat, tandis que le master « est en train de disparaître ».
Le facteur « grande école » ne peut être nié, dès lors que l’emploi des docteurs en entreprise croît dans une proportion plus faible que celle de l’effort de recherche du secteur privé. En effet, comme le relève le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, « même lorsqu’il s’agit de recrutements pour la fonction recherche, les entreprises privilégient les profils d’ingénieurs par rapport aux titulaires de doctorat ». Rappelons à cet égard que ces derniers ne représentaient, en 2011, que 12 % des chercheurs en entreprises, contre 55 % pour les ingénieurs et 9 % pour les diplômes de niveau bac + 2 comme les diplômes universitaires de technologie (DUT). Il existe donc bien, selon le Commissariat général, « une réticence de nombreuses entreprises à recruter un docteur, même pour des postes de recherche » (29).
Selon le délégué général de la Conférence des grandes écoles, M. Pierre Aliphat, ce « tropisme » à l’égard des grandes écoles conduit certains milieux économiques à considérer la préparation d’une thèse comme une « absence de prise de risque » de la part de l’étudiant, ce qu’ils perçoivent d’un mauvais œil. Et comme, de plus, les directeurs de ressources humaines recrutent plutôt des diplômés au cursus proche du leur, ce sont ceux des écoles de management ou d’ingénieurs qui l’emportent, haut la main, dans les processus de recrutement.
À cela s’ajoute un « effet sujet » : l’initiative, la forte implication personnelle, les qualités de rédaction et de synthèse et la capacité à travailler en équipe – le doctorant travaille au sein d’un laboratoire – qu’impliquent un doctorat ne comptent guère aux yeux de l’employeur qui, en France, ne regarde que le sujet de thèse et, dans le cas des lettres et sciences humaines, son caractère plus ou moins exotique (30). Pour reprendre l’analyse du directeur général délégué à la science du CNRS, M. Joël Bertrand, alors que ce diplôme est un « label » aux États-Unis et en Allemagne, en France, son titulaire est souvent regardé comme un « étudiant marqué par son sujet ».
À la source de ces représentations biaisées on trouve des « préventions » selon le président d’honneur de BNP-Paribas, M. Michel Pébereau et qui, d’après lui, s’alimentent les unes aux autres : prévention d’une partie de l’université à l’égard du monde de l’entreprise et… inversement. En outre, les entreprises n’ont pas de vision claire de ce qu’est un doctorat, car ce dernier n’est pas, d’après cet interlocuteur, un diplôme assez « normé », qui correspondrait à un contenu défini en termes de compétences. Les grandes écoles, en revanche, se situent dans la situation exactement inverse, car elles forment leurs élèves en un temps déterminé et leur font acquérir des compétences identifiées, notamment la capacité à fournir un résultat dans un délai précis. De fait, elles sont en mesure, pour reprendre l’expression ironique de la directrice l’école doctorale Économie Paris Sorbonne de Paris I, Mme Dominique Guégan, de « livrer un produit fini ».
Nous avons donc, d’un côté, un diplôme qui, selon M. Pébereau, « n’a pas de contenu clair » pour les entreprises et de l’autre, avec les diplômes d’ingénieurs et de management, des « produits finis » qui rassurent.
Le premier constat a d’ailleurs été confirmé par Mme Simone Bonnafous, la directrice générale pour l’enseignement supérieur : le doctorat est le « moins réglementé de nos diplômes d’enseignement supérieur », « le plus libéral, pour le meilleur et le pire ». Aussi la France n’a-t-elle pas « cadré » strictement la durée de la thèse, autrement que par une charte-type. De même, elle n’a pas attribué au doctorat de crédits transférables d’un État-membre de l’Union européenne à l’autre (dans le cadre de l’European Credits Transfer System ou ECTS) (31). Inversement, chez certains partenaires, ce diplôme peut valoir 60 ECTS, ces derniers permettant ainsi de reconnaître les compétences, linguistiques ou méthodologiques par exemple, acquises lors de la formation doctorale.
Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux n’ont pas entamé les négociations qui permettraient, au niveau des branches professionnelles, d’assurer la reconnaissance du titre de docteur. Le principe en était pourtant prévu par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, mais les dispositions concernées n’ont jamais été mises en œuvre. La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche les a donc justement rendues obligatoires, en assortissant d’une date butoir, fixée au 1er janvier 2016, la convocation d’une commission formée des délégués parties signataires à la convention de branche ou à l’accord professionnel par les ministres chargés de la recherche, de l’industrie et du travail.
Le résultat des récentes négociations relatives à la convention collective de l’enseignement privé hors contrat montre tout l’intérêt d’une politique affirmée de reconnaissance du doctorat. En effet, l’avenant n° 21 du 19 juin 2013 qui modifie cette convention classe les doctorants, qui sont, de toute évidence, titulaires d’un master, en dessous des titulaires d’une licence (32), ce qui, parmi d’autres raisons, a conduit le SNEPL-CFTC à ne pas signer ce document. C’est là un signe évident, parmi d’autres, de la méconnaissance du doctorat.
● La haute fonction publique
Pour se rénover, la haute fonction publique, dont de nombreux rapports ont déploré le « formatage » tant sociologique qu’intellectuel, devra renouveler ses compétences et diversifier son recrutement, deux domaines où les docteurs disposent de solides atouts. En effet, ceux-ci se caractérisent par leur capacité permanente d’apprentissage et d’adaptabilité, leur travail de recherche les amenant à remettre en question leurs hypothèses. En outre, cette formation est « à la fois très féminisée, avec une proportion de femmes qui approche les 50 % et sociologiquement très diversifiée avec 22 % de ses effectifs issus des catégories socioprofessionnelles des ouvriers, employés et professions intermédiaires » (33).
Cependant, pour prendre l’exemple emblématique de l’École nationale d’administration (ÉNA), le nombre d’élèves titulaires du doctorat y est très faible : selon les éléments recueillis par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2012, pour des effectifs (tous concours confondus) de 80 élèves, dans les quatre dernières promotions le nombre d’élèves titulaires du doctorat a varié de 1 à 6, soit 14 pour 320 élèves environ sur 4 ans. Toutefois, aucun élève issu du concours externe, soit la moitié du total, n’était, dans ces quatre promotions, titulaire du doctorat, les 14 docteurs étant tous issus du concours interne et du troisième concours (1).
En outre, les recrutements de docteurs dans les grands corps techniques n’excèdent pas une dizaine par an, même si certains d’entre eux ont créé, ces dernières années, des concours ouverts spécifiquement aux détenteurs du doctorat. Ainsi, les statuts du corps des ingénieurs des mines (34) et celui du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (35) ont été modifiés pour prévoir un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires « d’un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps » ou justifiant de « qualifications au moins équivalentes ».
Il est vrai que l’organisation de notre fonction publique et ses modalités de recrutement expliquent en grande partie cette place marginale du doctorat. Alors que nos partenaires peuvent recruter sur la base d’appels à candidatures profilés ou ignorer les procédures nationales de concours, notre fonction publique de carrière repose sur des statuts et des concours spécifiques qui produisent des « effets d’éviction » (1). Sur ce dernier point, si les limites d’âge ont été supprimées pour l’ensemble des concours d’accès aux fonctions publiques, excepté pour certains recrutements, les conditions liées à l’ancienneté de service pour les concours internes et les troisièmes concours peuvent être dissuasives.
En outre, d’une manière générale, le système de recrutement sur concours avec épreuves sur programmes est peu adapté au parcours de diplômés à bac + 8. Notre collègue M. Vincent Feltesse observait à ce sujet et de manière fort juste que « psychologiquement, ce retour à une situation d’étudiant est perçu comme un déclassement » alors que les docteurs ont souvent été en pointe de la recherche dans leur discipline pendant plusieurs années (36).
Enfin, les grilles indiciaires de la fonction publique ne prévoient pas de donner un bonus au titulaire d’un doctorat – à une exception près, qui concerne une petite administration (37). En effet, la nomination à un grade signifie que ses titulaires bénéficient d’une égalité de traitement. Le doctorat pourrait être en revanche valorisé dans le cadre du déroulement de la carrière, mais tel n’est pas le cas aujourd’hui selon M. Pierre Coural, chef de service à la direction générale de l’administration et de la fonction publique : les compétences acquises par le biais de ce diplôme ne sont absolument pas prises en compte à cette occasion, notamment en début de parcours.
Comme on le verra plus loin, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche devrait changer la donne.
Le poids du doctorat dans la fonction publique
Selon le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’enquête « emploi » de l’INSEE indique que le pourcentage de la population active titulaire du doctorat est de 4 % dans la fonction publique. Mais, sur ce total, 52 % exercent des fonctions scientifiques ou d’enseignement, et seul 1,8 % des cadres de la fonction publique, hors enseignement supérieur et recherche, sont docteurs.
À titre de comparaison, une enquête sur la place des docteurs dans l’emploi menée au sein des pays de l’OCDE indique qu’une proportion considérable des docteurs est employée dans le secteur public administratif (« government »). Selon les pays, cette proportion descend rarement en dessous du seuil de 20 % des docteurs : elle est par exemple de 20 % en Autriche, 24 % en Belgique, et atteint même 35 % en Espagne. Seuls les États-Unis se distinguent par un taux très bas, qui n’est que de 8,5 %.
Les docteurs bénéficient cependant d’une « surreprésentation invisible » au sein de l’administration française pour reprendre l’analyse de M. Pierre Coural, chef de service à la direction générale de l’administration et de la fonction publique : d’après l’enquête « Emploi 2012 » de l’INSEE, on comptabilise au total, au sein des trois fonctions publiques, 201 000 agents titulaires d’un doctorat et 40 000 d’entre eux, dont la moitié dans la fonction publique de l’État, ne sont ni enseignants et/ou chercheurs, ni praticiens hospitaliers. « Les docteurs sont bien là », mais leurs compétences ne sont pas exploitées et ils occupent parfois des postes pour lesquels ils sont surqualifiés.
B. ASSURER UN FINANCEMENT POUR TOUS LES DOCTORANTS ET UNE INSERTION PROFESSIONNELLE POUR TOUS LES DOCTEURS
Si nous ne faisons rien pour corriger ce contexte globalement défavorable, notre pays verra, peu à peu, le doctorat « s’effilocher ». Cet enjeu, déterminant pour la compétitivité de notre recherche et de notre économie, est devenu une « urgence sociale » pour reprendre l’expression employée par le Syndicat national de l’enseignement supérieur-FSU.
Ce constat devrait conduire chaque défenseur de l’Université française à considérer que les deux bouts de la chaîne des formations supérieures – la licence et le doctorat – connaissent chacun, pour des raisons différentes, une situation de crise qu’il convient de traiter. Le « plan de redressement de la licence » engagé par le gouvernement devrait trouver un équivalent au niveau bac + 8, impliquant l’adoption de mesures, tant financières que juridiques, et nécessitant, de la part des universités, des entreprises et de l’administration, de profonds changements culturels.
1. La nécessaire protection juridique et sociale de l’expérience professionnelle qu’est la préparation d’un doctorat
Puisqu’il effectue un travail de recherche de haut niveau, le doctorant devrait bénéficier d’une protection sociale et financière adéquate, le corollaire obligé de son statut de « professionnel ».
Il convient de rappeler que la Commission européenne a adopté en la matière des recommandations qui ne souffrent d’aucune ambiguïté : « Tous les chercheurs engagés dans une carrière de recherche devraient être reconnus comme professionnels et être traités en conséquence. Cette reconnaissance devrait commencer au début de leur carrière, c’est-à-dire au niveau du troisième cycle, et devrait englober tous les niveaux, indépendamment de leur classification au niveau national (par exemple employé, étudiant du troisième cycle, doctorant, boursier titulaire d’un doctorat, fonctionnaire) ». Cette charte européenne du chercheur précise en outre que « les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les chercheurs jouissent de conditions équitables et attrayantes sur le plan du financement et/ou des salaires, assorties de dispositions adéquates et équitables en matière de sécurité sociale (y compris l’assurance maladie et les allocations parentales, les droits à la retraite et les indemnités de chômage) conformément à la législation nationale en vigueur et aux conventions collectives nationales ou sectorielles. Ces mesures doivent inclure les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, y compris les chercheurs en début de carrière » (38).
Le doctorat devrait donc être reconnu comme une première expérience professionnelle ouvrant un « triptyque » de droits, à savoir un salaire, des droits sociaux et la prise en compte des années de thèse dans le calcul de la retraite.
Tout doctorant devant bénéficier d’un salaire, cela signifie que toute thèse devrait être financée. Le financement de la thèse devrait être en effet « universel », ce qui devrait inciter les acteurs publics, dans un contexte budgétaire contraint, à mieux réguler les « flux » de doctorants.
● Du côté des opérateurs
Au sein des universités et des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), le système de répartition des allocations de recherche, quelles qu’elles soient (contrats doctoraux, allocations des organismes de recherche, etc.), devrait remis à plat. Cette demande n’a cessé d’être formulée par les interlocuteurs du rapporteur pour avis – notamment par l’UNEF qui a dénoncé, à ce sujet, le caractère totalement opaque des critères de financement des doctorants.
Au niveau des unités de formation et de recherche ou des laboratoires, cette refonte devrait conduite à « responsabiliser » les directeurs de thèse selon les propos tenus par la directrice de l’école doctorale Économie Paris Sorbonne, Mme Dominique Guégan. Ces derniers peuvent en effet « embarquer » des étudiants qui ne bénéficient d’aucun financement, alors que les grandes écoles, de leur côté, n’acceptent pas les doctorants non financés. Il arrive aussi qu’un étudiant s’inscrive dans deux écoles doctorales afin de multiplier – par deux – ses chances d’obtenir une allocation.
Des abus caractérisés ont également été signalés au rapporteur pour avis. Le Syndicat national des chercheurs scientifiques a notamment cité le cas d’un directeur de laboratoire qui souhaitait garder dans ses murs un doctorant qui pourtant ne semblait pas prêt à finir sa thèse au seul motif qu’il fallait « malgré tout » conserver son allocation pour ne pas chuter dans les classements établis par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. De même, selon la Confédération étudiante, il arrive qu’un directeur de thèse conseille à un doctorant de percevoir des allocations chômage pendant un certain moment, avant que celui-ci ne puisse bénéficier, à nouveau, d’un financement. Pendant ce temps, l’université fera pression sur ce dernier pour qu’il corrige « gracieusement » des copies, en lui faisant miroiter la perspective d’un poste d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche.
Ces dérives, parmi beaucoup d’autres, ont amené M. Jean-Georges Gasser, secrétaire national du Sup’Recherche UNSA, à considérer qu’elles sont le propre d’un « système mafieux ».
Ces comportements devraient être sanctionnés, au besoin en « coupant les vivres » des écoles doctorales qui laissent prospérer de telles pratiques. Faut-il aller jusqu’à rétablir un fléchage national des crédits, laboratoire par laboratoire comme l’a préconisé l’UNEF ? Le rapporteur pour avis ne le pense pas, car un tel cadrage serait antinomique avec l’autonomie des établissements. En revanche, il faudrait recourir aux contrats État-établissements, qui seront, conformément à la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, remplacés par des contrats de site conclus avec les communautés d’universités et établissements, pour s’assurer de l’adéquation de la répartition des financements par discipline avec les perspectives d’insertion professionnelle des diplômés. Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective estime qu’à cet égard, une première piste pourrait consister à « fixer aux universités, dans le cadre de la contractualisation avec l’État, des objectifs d’amélioration du taux de thèses financées. Cela inciterait les universités soit à déployer différemment les moyens financiers dont elles disposent, soit à démarcher davantage les entreprises » (39).
Parallèlement, les crédits des investissements d’excellence (IDEX), aujourd’hui destinés à faire émerger des grands pôles pluridisciplinaires, pourraient, dans le cadre des contrats de site, être partiellement « fléchés » par les établissements sur des contrats doctoraux, afin de valoriser ces derniers, comme l’a suggéré Mme Simone Bonnafous, la directrice générale pour l’enseignement supérieur.
● Du côté de l’État
De son côté, l’État devrait élargir la palette des instruments de financement du doctorat, tout en développant les outils existants :
– Ainsi que l’a suggéré la Confédération des jeunes chercheurs, des dotations supplémentaires de contrats doctoraux devraient être attribuées aux établissements engagés dans une politique d’amélioration de la formation doctorale. Cette politique devrait d’ailleurs être mise en œuvre dans le cadre des contrats d’établissement ou de site conclus avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
– Le nombre de contrats doctoraux et donc de doctorants financés pourrait être progressivement augmenté, en tenant compte des moyens budgétaires.
– Le nombre de conventions CIFRE devrait être augmenté, notamment au regard du fait que 88 % des doctorants concernés sont satisfaits de leur emploi et que ce dispositif bénéficie souvent à de petites structures (40). Il y a lieu de noter, à ce sujet, que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche étudie, avec l’Association nationale pour la recherche et la technologie (ANRT), la possibilité de financer quelques CIFRE supplémentaires en 2014 afin d’atteindre 1 400 conventions, contre 1 375 prévues cette année. Il faudrait aller plus loin et accroître cet effort, d’année en année, en veillant à ce que les conventions de recherche pour l’action publique et sociétale (CRAPS), également gérées par l’ANRT, puissent être plus nombreuses et mieux connues du public. En effet, ces dernières permettent l’embauche de doctorant par des collectivités territoriales et des associations d’action sociale, mais ces structures ne représentent que 4 % des conventions acceptées en 2012 – en outre, il semble que les grandes villes comme Paris ou Lyon soient les plus « consommatrices ». Le développement des CIFRE devrait toutefois s’accompagner d’un contrôle sur la pertinence du travail scientifique accompli dans ce cadre pour éviter que celui-ci ne soit subordonné à des considérations de court terme.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, les formations doctorales « constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur ». Le volet « professionnel » ne devrait donc pas être « à côté » du doctorat, mais au cœur de cette formation. Dans ce but, il conviendrait de le renforcer, tant au niveau des écoles doctorales que du diplôme lui-même.
Les écoles doctorales n’ont cessé, depuis leur généralisation, de monter « en gamme », mais si l’on note, de leur part, une « réelle adhésion » à la règle commune que constitue l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, on constate aussi, d’après M. Denis Randet, le président de l’Association nationale pour la recherche et la technologie, une « diversité d’appropriation ».
Aussi ces écoles ne parviennent-elles pas toujours à garantir, à chaque étudiant, un encadrement et une politique d’aide à l’insertion professionnelle de qualité. À titre d’illustration, lors de l’évaluation de 69 écoles doctorales effectuée en 2009-2010, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) a noté B (constat de « points faibles importants qui devront être impérativement corrigés ») 46 % des écoles du secteur sciences de la vie et de la terre, aucune d’entre elles n’ayant su pleinement convaincre sur la politique de suivi et d’insertion des doctorants. Dans le secteur sciences sociales, humanités, droit économie et gestion, 29 % des écoles ont été notées B. Ce pourcentage plus satisfaisant ne doit pas faire oublier qu’en ce qui concerne la mission de suivi et d’insertion et la qualité de leur encadrement, respectivement 57 % et 50 % des écoles de ce secteur ont obtenu la note B (41). Les 22 écoles doctorales évaluées en 2011-2012 ont conduit l’AERES à souligner que si le taux d’encadrement maximal était globalement maîtrisé, il restait « encore quelques cas isolés excessifs (avec parfois entre 15 et 20 doctorants sous la responsabilité d’un seul directeur de thèse) ». En outre, « en relation directe avec la qualité de l’encadrement », elle a pointé du doigt un taux d’abandon parfois trop élevé (de l’ordre de 50 % et plus), ainsi qu’une durée moyenne de thèse supérieure ou égale à 5 ans. En matière d’insertion, de surcroît, une seule école affichait un bilan optimal (42).
D’une manière générale, la mission d’appui à l’insertion professionnelle, en particulier hors secteur « enseignement supérieur et recherche », apparaît « trop souvent à la fin du parcours du doctorant » pour prendre le constat de la directrice générale pour l’enseignement supérieur, Mme Simone Bonnafous. D’ailleurs, un des attendus implicites de cette mission, selon le directeur général délégué à la science du CNRS, M. Joël Bertrand, était que les écoles doctorales développent, à l’instar des grandes écoles, une culture de la « promotion », de manière à créer des réseaux au profit de leurs doctorants, ce qui n’a pas été le cas.
Les écoles doctorales devraient donc disposer d’indicateurs de suivi, ceux-ci étant, selon Mme Simone Bonnafous, trop souvent négligés. Parallèlement, conformément à une recommandation de la Confédération des jeunes chercheurs, ces entités devraient mettre en place des formations complémentaires « cohérentes avec les possibilités de carrière des docteurs », que celles-ci soient académiques ou non. L’employabilité des docteurs pourrait ainsi être accrue, notamment dans le secteur privé, si ces actions de formation portaient, entre autres, sur le management ou l’audit.
En ce qui concerne l’encadrement des doctorants, celui-ci devrait être amélioré. Des « bonnes pratiques » existent en la matière et gagneraient à être généralisées. On peut citer, à titre d’exemple, voire de modèle, celles mises en œuvre dans le cadre du « parcours doctoral » de l’école doctorale Économie Paris Sorbonne : durée de principe de la thèse limitée à trois ans ; nombre maximal de doctorants par directeur de thèse limité à huit (contre quinze pour l’université Paris I à laquelle est rattachée l’école) ; organisation systématique, depuis 2011, d’un « bilan 12-18 » au cours de la deuxième année de thèse afin de faire état de son avancement devant un comité, sa validation conditionnant l’inscription en troisième année ; procédure de pré-soutenance six mois avant la soutenance. Ces dernières mesures ont permis de réduire la durée moyenne des thèses. Ainsi, en 2012, 68 % des doctorants l’ont soutenu en quatre ans et 25 % en trois ans (43).
La limitation du nombre de thèses encadrées par une seule personne constitue, à cet égard, un enjeu essentiel. On rappellera que le rapporteur général des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, M. Vincent Berger, avait estimé, pour sa part, que ce « plafond » devrait « dépendre naturellement de la discipline » et faire l’objet de propositions précises, expertisées par le Conseil national des universités et le CNRS (44).
Les docteurs possèdent des compétences générales évidentes, à commencer par une très grande force de travail et des qualités attestées de questionnement, de rédaction et de synthèse. Cependant, celles-ci ne sont pas perçues par le secteur privé. Elles devraient donc être rendues plus visibles, en « normant » davantage le doctorat, ainsi que l’a préconisé M. Michel Pébereau.
Pour ce dernier, ce travail devrait être effectué au niveau de chaque université, à charge pour elle de définir et de donner une large publicité aux caractéristiques de tel ou tel doctorat afin que les entreprises puissent être rassurées sur les compétences des titulaires du diplôme qu’elles envisageraient de recruter.
Aux yeux du rapporteur pour avis, cette politique de « normalisation » devrait être conduite au niveau national et agir sur quatre leviers :
– La qualité de la thèse devrait être garantie, ce qui implique de garantir celle des sujets et des jurys de thèse et d’accroître la sélectivité à l’entrée du parcours doctoral, un point qui a été évoqué tant par la chef du service CIFRE de l’Association nationale pour la recherche et la technologie, Mme Clarisse Angelier, que par les représentants du Centre d’études et de recherches sur les qualifications. Ce résultat devrait être obtenu par la « responsabilisation » des écoles doctorales et des directeurs de thèse, sujet déjà évoqué.
– Le recours au nouveau chapitre de la thèse, une initiative portée depuis 2000 par l’Association Bernard Grégory, devrait être systématique. On rappellera que ce chapitre a pour but d’aider le doctorant à présenter les compétences et les savoir-faire professionnels acquis au cours des années de préparation du doctorat.
– La norme « LMD » en matière de durée des études de troisième cycle, à savoir trois ans, devrait, à terme, être celle de la thèse. Nous en sommes loin puisqu’en 2012, selon la dernière édition de L’état de l’emploi scientifique en France, près de 40 % des nouveaux docteurs, seulement, ont soutenu leur thèse en moins de 40 mois. Pour près d’un tiers, une année supplémentaire a été nécessaire et 11 % des doctorats délivrés ont nécessité plus de 6 années de préparation. En outre, la « règle » des trois ans est loin d’être consensuelle, plusieurs interlocuteurs du rapporteur pour avis ayant plaidé pour une durée souple (cas de l’Union nationale des étudiants de France par exemple) ou de quatre ans au motif que le contrat doctoral, qui est de trois ans, peut être toutefois prolongé d’un an (cas de la Confédération étudiante) (45). Le rapporteur pour avis, pour sa part, considère que notre engagement européen et le réalisme budgétaire – la situation actuelle ne permettra pas, de toute évidence, de multiplier les contrats doctoraux de longue durée – devraient inciter la communauté universitaire et de recherche à respecter les règles de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Cet objectif devrait être partagé par tous, car il est socialement fondé, la « thèse au long cours » rimant trop souvent avec « précarité ».
– Enfin, les compétences professionnelles acquises dans le cadre de la formation doctorale devraient être valorisées par des référentiels ou des certifications. Plusieurs initiatives vont dans ce sens, en particulier dans le secteur aéronautique, avec l’Association Bernard Grégory et le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), et au niveau national où cette association a constitué, avec le MEDEF et la Conférence des présidents d’universités, un groupe de travail qui a pour objectif de définir un référentiel commun des compétences génériques des docteurs, le référentiel DocPro. De même, la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs a conçu le projet d’un parcours « compétences pour l’entreprise » pour les doctorants, qui repose aussi sur un référentiel, neuf établissements participant à son expérimentation. L’État devrait s’associer à ces démarches pour déterminer ensuite, après une concertation approfondie, à quelles conditions il serait possible d’adjoindre des certifications génériques ou spécifiques au doctorat.
La France ne pourra pas assurer une insertion professionnelle de qualité à ses doctorants si la majorité d’entre eux n’envisagent pas d’autres débouchés que les postes statutaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce changement de perspective devrait être encouragé en faisant valoir l’intérêt des carrières dans le secteur privé et le secteur public hors recherche. Les gisements d’emploi peuvent y être en effet considérables.
a. Ne plus considérer le statut d’enseignant-chercheur comme le débouché exclusif et naturel du doctorat
Selon le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), cité par L’état de l’emploi scientifique en France, en ce qui concerne le secteur d’insertion, les préférences des doctorants au moment de la soutenance des thèses « restent stables d’une enquête à l’autre : malgré les difficultés rencontrées pour s’insérer dans la recherche publique, et l’augmentation des emplois à durée déterminée dans ce secteur, une grande majorité des docteurs (70 %) souhaite travailler à l’université ou dans la recherche publique, ce chiffre culminant à 87 % pour les lettres et sciences humaines » (46).
Dans le même temps, l’insertion hors « recherche académique » tend à devenir majoritaire, même s’il s’agit d’une insertion par défaut. Ainsi, en 2010, trois ans après la soutenance de thèse, un peu moins de la moitié des docteurs en emploi travaillaient dans la recherche académique, 20 % dans la recherche privée, 19 % dans le secteur privé en dehors de la recherche et 13 % dans le public hors recherche. Il existe cependant des différences disciplinaires en termes de débouchés, puisque les diplômés de lettres et sciences humaines s’inséraient majoritairement dans le secteur public (49 % dans la recherche académique et 25 % dans le public hors recherche), tandis que ceux de sciences de l’ingénieur rejoignaient surtout la recherche et développement (40 %) et ceux de sciences économiques et gestion plutôt le secteur privé hors recherche (32 %) (47).
En outre, le débouché « recherche publique ou académique » est celui où les jeunes docteurs sont le moins stabilisés trois années après leur sortie du système éducatif, comme le relève la dernière édition de L’état de l’emploi scientifique en France : en 2010, « près de 40 % des jeunes docteurs occupant un emploi dans la recherche publique ou académique sont encore en emploi à durée déterminée au moment de l’interrogation, ce qui est supérieur à la génération précédente. Dans le secteur privé, que ce soit dans la R&D ou non, les jeunes docteurs ont nettement plus accès souvent aux emplois stables ». Au total, la comparaison des résultats entre les différentes générations montre que « le recours à l’emploi à durée déterminée s’est accru seulement dans la sphère publique » (48).
En outre, les perspectives de carrière hors « recherche académique » sont les plus intéressantes, comme le montrent les enquêtes Génération du CEREQ. Ainsi, entre 2007 et 2010, « la majorité des docteurs accèdent aux positions les plus élevées sur le marché du travail et ce dès le premier emploi (79 %) » et trois années après la soutenance de thèse, « c’est plus de 90 % des docteurs en emploi qui occupent la profession de cadre ». De plus, ces positions les plus privilégiées sur le marché du travail « leur assurent avec les diplômés d’écoles d’ingénieurs et les docteurs en santé les salaires les plus élevés en 2010. À ce moment, le salaire net médian mensuel des docteurs s’élève à 2 000 euros contre 2 210 pour les docteurs en santé et 2 270 pour les diplômés d’écoles d’ingénieurs ». Enfin, la ré-interrogation en 2012 des diplômés de 2007 montre que cinq années après la soutenance de thèse, « les docteurs en emploi accèdent toujours aussi souvent à la profession de cadre et leurs salaires nets médians ont augmenté en moyenne de 10 % en euros constants depuis 2010 atteignant un peu moins de 2 500 euros » (1).
Par ailleurs, à moyen terme, les perspectives de recrutement par le secteur privé ne devraient pas se tarir, notamment en raison, selon l’Association Bernard Grégory, de la présence croissante de fonctions « tranverses » dans les offres d’emploi et l’émergence de métiers avec une dominante « conseil, expertise, étude », « production, ingénierie », « communication » ou « veille technologique, brevet ». Ces métiers « sont présents depuis longtemps dans les entreprises, mais ces dernières formalisent mieux leurs besoins et les compétences attendues chez les candidats » (49). De plus, selon une étude de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques, les métiers d’ingénierie informatique, d’études et de recherche et de cadre technique de l’industrie devraient « bénéficier de nombreuses créations d’emploi, portées par le développement des nouvelles technologiques (technologie de l’information et de la communication, nanotechnologies…), des efforts en matière de recherche-développement et de la bonne tenue de secteurs à fort contenu technologique comme la pharmacie ou la construction aéronautique. Sur les dix prochaines années, ces trois familles professionnelles pourraient offrir au total près de 200 000 emplois supplémentaires, soit un taux de création nette proche de 2 % par an » (50).
Enfin, il convient de ne pas oublier les besoins de la fonction publique territoriale qui devrait, dans les prochaines années, renouveler massivement ces cadres de catégorie A. Selon une étude du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), un tiers des agents de catégorie A devrait atteindre l’âge moyen de départ à la retraite en 2014, la moitié en 2018 et près de 57 % en 2020, soit dix points de plus que la moyenne nationale (51). Il y a là un vivier peu connu du monde universitaire, mais qui permettrait aux docteurs, notamment ceux en lettres, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion, d’occuper, au sein des collectivités territoriales, des postes à haute responsabilité, mobilisant des budgets et des personnels conséquents.
Les dispositions de l’article L. 412-1 du code de la recherche, dans leur rédaction issue de l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, visent à assurer la reconnaissance du « temps doctoral » par les concours de la fonction publique. Certaines d’entre elles, relatives à l’École nationale d’administration (ENA), ont une portée pratique limitée mais fortement symbolique. Les autres devraient inciter les fonctions publiques à réformer, avec discernement, leurs procédures de recrutement et à mieux prendre en compte le titre de docteur dans le déroulement de la carrière.
● Les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 concernant l’ÉNA
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 78 assimilent la période de préparation du doctorat à une période d’activité professionnelle, dans la limite de trois ans, pour se présenter au troisième concours de l’ÉNA et autorisent la prise en compte des services sous contrat doctoral comme des services effectifs pour se présenter au concours interne.
Elles sont de portée limitée à un double titre. D’une part, juridiquement, elles n’ont pas supprimé les conditions liées à l’ancienneté de service qui, comme on l’a vu, peuvent être bloquantes – soit, dans le cas précis du concours interne de l’ÉNA, au moins quatre années de service public effectif au 31 décembre de l’année du concours dans un emploi d’agent public et, pour le troisième concours, huit années d’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles. Ainsi, les doctorants qui n’ont pas signé de contrat doctoral ne pourront pas s’inscrire au concours interne, tandis que ceux qui ont bénéficié de ce dispositif pourront compter leur année d’ATER (attaché temporaire d’enseignement et de recherche) pour atteindre les quatre années de service requises pour s’y présenter. D’autre part, sur un plan pratique, il convient de rappeler que, sur une promotion qui comprend, en moyenne, quatre-vingts élèves, on compte en général huit élèves recrutés au titre du troisième concours et une trentaine au titre du concours interne. C’est dire si ces voies d’accès ne pourront être massivement empruntées par les docteurs.
Ces dispositions ont donc une vertu essentiellement symbolique et pédagogique, tant à l’égard des doctorants que des élites administratives pour qui le monde universitaire se résume à une célèbre institution sise rue Saint-Guillaume, à Paris. Techniquement, elles ne seront pas difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles sont d’application directe et pourront donc concerner la session 2014 des concours de l’ENA. En outre, dans la mesure où les conditions nécessaires pour s’inscrire aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours sont strictement identiques aux conditions exigées pour s’inscrire aux concours eux-mêmes, aucune modification réglementaire ne devrait être requise pour permettre l’application directe de l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013 à l’examen d’entrée dans ces cycles (52).
● Les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 à caractère général
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 78 prévoient l’adaptation des concours et procédures de recrutement des corps et cadres d’emploi de catégorie A à la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant d’une formation sanctionnée par un doctorat et la prise en compte des années de formation et de recherche des docteurs lors de leur classement dans un corps ou cadre d’emploi de la fonction publique.
Elles nécessitent des mesures d’application et doivent faire l’objet d’une analyse approfondie de l’ensemble des statuts particuliers des 128 corps de catégorie A, dont 47 corps d’enseignants et enseignants-chercheurs (53). Le chantier réglementaire ouvert par la loi du 22 juillet 2013 est donc immense – et fragile, puisque, selon la directrice générale de l’administration et la fonction publique, Mme Marie-Anne Lévêque, le secrétariat général du gouvernement a estimé que le caractère « systématique » des dispositions concernées pourrait être contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle les règles de recrutement doivent être adaptées aux besoins du service public.
Cependant, aux yeux du rapporteur pour avis, tout devrait être entrepris pour concrétiser rapidement les dispositions précitées, car celles-ci permettront de diversifier et de démocratiser le recrutement de la haute fonction publique. En outre, la reconnaissance du « temps doctoral » devrait appuyer la politique de « désacadémisation » des concours envisagée par le gouvernement, ceux-ci n’étant pas assez professionnalisés et donnant trop souvent une prime au « bachotage ». Mme Lévêque a souligné l’intérêt d’une telle approche pour les concours internes, mais celle-ci pourrait, sans doute, trouver à s’appliquer aux concours externes. À cet égard, l’ÉNA a engagé une réflexion visant à mettre en place un nouveau « format » pour ses concours, qui comprendrait, selon sa directrice Mme Nathalie Loiseau, « un peu moins d’épreuves écrites et un peu plus d’épreuves orales », afin de mieux prendre en compte les aptitudes et les parcours des candidats.
● Des concours spécifiques pour les titulaires du doctorat ?
Faut-il aller plus loin et envisager de mettre en place, dans chaque corps de catégorie A, une voie spécifique de recrutement pour les docteurs ? Pour certains interlocuteurs, cette solution serait parfaitement envisageable. Ainsi, le directeur de l’Institut national des études territoriales, M. Jean-Marc Legrand, a considéré qu’une « deuxième voie » pourrait être ouverte au sein des concours externes pour les titulaires du doctorat, la première restant accessible aux titulaires d’une licence, voire d’un master, ce deuxième diplôme étant devenu, dans les faits, celui du recrutement des fonctionnaires de catégorie A.
Il semble, en outre, selon certaines analyses, qu’une telle solution soit recevable sur le plan constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel a estimé que l’exigence de capacité des candidats peut dépendre de l’intérêt général et de besoins spécifiques du service : « les règles de recrutement destinées à permettre l’appréciation des talents et des qualités des candidats à l’entrée d’une école de formation ou dans un corps de fonctionnaire [peuvent être] différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins du service public » (54). Le Conseil d’État a également précisé que des régimes d’accès distincts à des corps pouvaient légalement coexister « pour tenir compte de la diversité de la formation et des expériences des candidats » (55).
Pour sa part, la direction générale de l’administration et de la fonction publique s’est montrée plus réservée, en estimant que « la création d’une quatrième voie d’accès réservé aux docteurs serait probablement jugée contraire au principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics » (56), postulé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Le Conseil d’État a d’ailleurs annulé la création d’un régime d’accès privilégié à l’ÉNA réservé aux élèves des écoles normales supérieures (ENS) en ce qu’elle méconnaissait ce principe. Il a, en effet, estimé que ce concours d’entrée réservé n’était « justifié ni par la situation particulière dans laquelle se trouveraient lesdits élèves au regard du recrutement dans les corps auxquels ouvre accès l’école nationale d’administration, ni par les besoins du service public » (57).
Outre qu’une telle mesure pourrait être inconstitutionnelle, elle présente un autre risque, celui de « décrédibiliser », à terme, le doctorat. En effet, comme l’a fait remarquer M. Michel Pébereau, un concours spécifique qui générerait, chez ses candidats, un taux d’échec important ne manquerait pas d’être rapidement contesté dans son principe ni, surtout, de conforter les « préjugés » de tous ceux qui n’ont pas une très haute opinion de ce diplôme. De plus, la création d’un quatrième concours conduirait à réduire le nombre de places prévues pour les concours internes, ce qui, d’un point de vue « social », serait très mal perçu.
En revanche, deux autres pistes pourraient être explorées avec profit pour mettre en place des procédures de recrutement adaptées.
– La première consisterait à développer les recrutements sur titre, ainsi que l’a préconisé la directrice générale de l’administration et la fonction publique, Mme Marie-Anne Lévêque. D’ailleurs, pour la fonction publique d’État, le 8ème alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit sans restriction particulière que les concours externes peuvent « être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par un jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves ». La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale n’autorisant pas de plein droit ces concours sur titre, une modification législative devrait donc être envisagée sur ce point (58).
– La seconde mesure consisterait à dispenser les docteurs de tout ou partie des épreuves d’admissibilité, qui sont des épreuves écrites, en considérant que la préparation et la rédaction de la thèse ont déjà permis d’apprécier la culture générale et les capacités rédactionnelles des candidats (59). Une mesure pourrait être prise à cet effet, sous forme d’un décret transversal applicable à tous les corps de catégorie A de la fonction publique d’État, étant précisé que des décrets miroirs devraient être envisagés pour les deux autres fonctions publiques (1). Il convient toutefois de souligner qu’une telle disposition pourrait ne pas avantager de manière automatique les docteurs, puisque la note qui leur serait attribuée au titre de cette admissibilité serait la note moyenne des candidats admissibles et que, par conséquent, celle-ci pourrait pénaliser leur classement au moment du concours, puis à l’issue de leur période de stage.
● La question de la valorisation financière du doctorat
Quant à l’enjeu de la reconnaissance « financière » du doctorat, outre que celle-ci pourrait entrer en contradiction avec le principe de gestion des cadres de la fonction publique, la spécificité de ce diplôme pourrait a contrario être mieux établie dans le déroulement de la carrière.
● Maintenir l’avantage fiscal lié au recrutement d’un docteur
Depuis la loi de finances initiale pour 2006, le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) permet de doubler des dépenses prises en compte au titre des jeunes docteurs. En effet, durant deux ans, les dépenses de personnel liées à la première embauche sur un contrat à durée indéterminée de titulaires d’un doctorat sont prises en compte pour le double de leur montant, avec des frais de fonctionnement équivalents à 200 % des dépenses, à condition que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
Or, comme les frais de fonctionnement rattachés à ces emplois sont par ailleurs fixés forfaitairement à 200 % des dépenses de personnel, la combinaison de ces deux modalités de calcul dérogatoires aboutit à un crédit d’impôt correspondant à 120 % de la dépense de personnel engagée par l’entreprise. La Cour des comptes a donc considéré qu’un taux de soutien public supérieur à la dépense engagée, n’apparaissait pas justifié et préconisé, en conséquence, de conserver le doublement d’assiette pour les dépenses des jeunes docteurs, avec un forfait de dépenses de fonctionnement de droit commun, soit de 50 % seulement de la dépense de personnel (60).
À ce sujet, le rapporteur pour avis pense se faire l’écho fidèle des propos tenus par la plupart de ses interlocuteurs en affirmant qu’il ne faut « surtout pas » toucher à l’avantage fiscal lié à l’embauche des jeunes docteurs. En revanche, son maintien, comme l’ont suggéré conjointement la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture CGT et la Confédération générale des cadres, devrait être lié à l’obligation, pour l’entreprise, de recruter les post-doctorats en contrat à durée indéterminée.
● Entrer dans la négociation de conventions collectives reconnaissant le doctorat
Conformément aux dispositions, déjà mentionnés, de l’article L. 411-4 du code de la recherche, des négociations devraient s’ouvrir au niveau des branches professionnelles pour assurer la reconnaissance du doctorat. Certes, le sujet est loin d’être consensuel et les organisations entendues par le rapporteur pour avis ont, de surcroît, souligné que de telles discussions demandent du temps – quand certaines d’entre elles ont avoué avoir pris connaissance des obligations fixées par le législateur lors de la préparation de l’audition.
Cependant, il existe un précédent, celui de l’accord du 10 août 1978 modifiant la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952. Celle-ci a en effet créé un barème distinct de coefficients applicables aux ingénieurs et cadres débutants ayant soutenu leur thèse de doctorat. Le MEDEF en a toutefois souligné la portée toute relative (61), tandis que M. Michel Pébereau a considéré qu’un docteur est recruté par les entreprises au niveau où elles recrutent un diplômé de grande école trois ou quatre ans après sa sortie, c’est-à-dire à celui d’un cadre supérieur dont le statut ne saurait relever des conventions collectives. Ainsi, selon lui, tout accord professionnel ou de branche qui imposerait une norme de rémunération des docteurs s’avérerait, au final, inadapté, car il conduirait à fixer une rémunération moyenne, qui dévaloriserait le diplôme.
Ces arguments ont leur cohérence intellectuelle. Il reste que notre pays ne sera jamais en mesure d’orienter correctement ses flux des doctorants tant que le secteur privé n’aura pas envoyé, à leur égard, les signaux d’une reconnaissance pleine et entière du doctorat. Les partenaires sociaux devraient donc se mettre en ordre de marche, à une double condition toutefois : que l’État joue un rôle moteur en matière de reconnaissance du doctorat en réformant rapidement ses procédures de recrutement et que les universités, en lien avec ce dernier, définissent clairement, dans le cadre de ce que M. Mohamed Harfi, chargé de mission au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, a appelé une « démarche qualité », les compétences acquises lors de la préparation d’un doctorat.
Une fois ces « prérequis » remplis, les partenaires sociaux devraient aborder la question, délicate mais incontournable, de la définition du salaire minimum que devrait percevoir un jeune docteur. Plusieurs pistes ont été évoquées, à ce sujet, devant le rapporteur pour avis, comme le fait de se référer au salaire « charnière » annuel de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (40 958 euros bruts) ou de situer à mi-chemin entre ce plafond et le salaire minimum annuel des CIFRE (23 484 euros).
● Faire du doctorat un investissement rentable pour les employeurs et les salariés
– Du côté des entreprises, les missions d’expertise devraient être développées. On rappellera qu’elles permettent à des doctorants, déjà recrutés sur un contrat à durée déterminée de droit public, d’effectuer une ou des missions en entreprise (ou dans une collectivité territoriale), d’une durée annuelle totale de trente-deux jours, la durée minimale étant fixé à quinze jours pour les entreprises. Les entreprises auraient ainsi l’occasion de faire plus souvent appel aux compétences des doctorants sur une période plus courte et de découvrir les atouts et les compétences que présente ce diplôme. Par ailleurs, ainsi que l’a préconisé le président de la Conférence des présidents d’université, M. Jean-Loup Salzmann, il faudrait réfléchir à la mise en place, à partir des bourses CIFRE, d’un dispositif de pré-recrutement en entreprise dès la deuxième année de master pour sécuriser au plus tôt le parcours du futur doctorant. Une autre piste consisterait à créer un « dispositif de financement de thèse par une entreprise en contrepartie d’un engagement du doctorant à demeurer dans l’entreprise pendant quelques années à compter de son embauche », destiné notamment aux PME innovantes à la recherche de chercheurs à haut potentiel (62). De même, la création, au sein des universités, de chaires industrielles permettrait d’appuyer nos recherches dans ce domaine et d’offrir aux doctorants y participant la garantie d’être recrutés par les groupes ayant financé le dispositif.
– Du côté des salariés, il faudrait encourager les reprises d’études conduisant au doctorat. Pour la directrice générale pour l’enseignement supérieur, Mme Simonne Bonnafous, les secteurs de la gestion, de l’urbanisme, de la communication, de l’architecture, etc. ont des besoins importants en matière de recrutement de consultants hautement qualifiés. C’est pourquoi, selon cette interlocutrice, de nouvelles formes de doctorat devraient être inventées pour les salariés qui souhaitent accroître leur qualification et faire évoluer leurs perspectives de carrière (63). En particulier, la durée de la thèse devrait être adaptée à la situation spécifique de ces « étudiants ». Parallèlement, comme l’a suggéré le directeur de l’École nationale des ponts et chaussées, M. Armel de La Bourdonnaye, le travail de recherche-développement en entreprise pourrait être reconnu comme un parcours conduisant au doctorat par le biais de la validation des acquis de l’expérience. Le chercheur concerné pourrait, dans le cadre de ce dispositif, soumettre un document qui présente ses travaux à des rapporteurs nommés par l’université et si celui-ci recevait deux avis favorables, il pourrait être alors présenté à un jury formé dans les mêmes conditions que celles des jurys de thèse classiques. Ces doctorats d’un type nouveau pourraient ainsi aider notre pays à occuper ou récupérer des postes de prestige au sein des structures internationales, publiques ou privées, pour lesquels ce diplôme et une longue expérience professionnelle sont exigés.
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation procède, le jeudi 24 octobre 2013, en commission élargie à l’ensemble des députés, dans les conditions fixées à l’article 120 du Règlement, à l’audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les crédits pour 2014 de la mission « Recherche et enseignement supérieur » (64).
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine pour avis, au cours de sa première séance du mercredi 30 octobre 2013, les crédits pour 2014 de la mission « Recherche et enseignement supérieur » sur les rapports de M. Patrick Hetzel (Recherche) et de M. Emeric Bréhier (Enseignement supérieur et vie étudiante).
M. le président Patrick Bloche. Je vous rappelle que les crédits pour 2014 de la mission « Recherche et enseignement supérieur » ont fait l’objet, le 24 octobre dernier, d’une procédure d’examen en commission élargie. À cette occasion, Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a répondu de manière particulièrement détaillée aux questions qui lui ont été posées, ce qui a permis d’aborder de nombreux domaines relevant de l’action de son ministère.
Nous allons aujourd’hui entendre nos collègues Patrick Hetzel et Emeric Bréhier, rapporteurs pour avis. Au-delà de l’étude des crédits prévus pour 2014, chacun d’entre eux s’est attaché à approfondir plus spécifiquement une thématique particulière.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour avis pour la recherche, s’est plus particulièrement intéressé à la recherche sur projet et aux retombées économiques de la recherche, en appelant de ses vœux la mise en place d’un véritable continuum entre la recherche fondamentale et l’innovation.
M. Patrick Hetzel, rapporteur pour avis pour la recherche. Le budget de la recherche a été examiné, avec celui de l’enseignement supérieur, lors du débat en commission élargie jeudi dernier. Il est cependant nécessaire d’en rappeler brièvement les grandes orientations, afin d’éclairer la Commission sur l’avis de son rapporteur.
Le budget proposé pour 2014 est, en effet, très illustratif de la contradiction entre une volonté politique fortement affichée en faveur de la recherche et de l’innovation, et la réalité des moyens proposés. On retrouve là le décalage permanent entre le discours et les actes de l’actuel gouvernement.
Les crédits qui sont globalement attribués à la recherche publique baissent d’un peu plus de 1 %. Cette diminution touche principalement l’Agence nationale de la recherche, et les organismes de recherche.
Rappelons que ces dotations en baisse ont à couvrir non seulement les charges pour pensions qui progressent, elles, nettement, chaque année, mais aussi le glissement vieillesse- technicité des fonctionnaires des EPST (établissements publics à caractère scientifique et technologique) ou les mesures salariales des personnels des EPIC (établissements publics industriels et commerciaux). Les moyens réellement disponibles pour les laboratoires et les équipes de recherche sont donc réduits d’autant, alors même que la chute des crédits de l’ANR (Agence nationale de la recherche) diminue parallèlement les financements sur contrat de recherche de ces organismes.
Les emplois des organismes de recherche en 2014 sont présentés comme stables en équivalents temps plein, mais il convient de s’interroger sur la réalité que recouvre cette stabilité : les emplois inscrits, qui sont un plafond, seront-ils réellement pourvus ? Les auditions des responsables des instituts permettent, pour le moins, d’en douter.
Ce budget très médiocre conduit également à s’interroger sur les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche, dont la loi relative à la recherche et à l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013 prévoit une présentation quinquennale, sous forme de livre blanc, avec la stratégie nationale de l’enseignement supérieur qui lui est liée. Cette nouvelle stratégie va-t-elle se traduire par la remise en cause de dix ans de progression des financements de la recherche ?
Il est nécessaire, au minimum, de « sanctuariser » les crédits de la recherche, à défaut d’en prévoir une programmation croissante, comme l’avait disposé et l’a effectivement réalisé la loi de programme pour la recherche de 2006. Ce n’est véritablement pas ce que fait cette loi de finances. Je suggère donc à la Commission de donner un avis défavorable à l’adoption des crédits « Recherche » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
Mais venons-en à la partie thématique de mon intervention, sur la recherche sur projet et sur les retombées économiques de la recherche.
Le financement de la recherche par des appels à projets et la mise en concurrence n’a trouvé sa forme actuelle que tardivement en France, même si la recherche sur projet existait, en pratique, à l’intérieur des organismes de recherche ou à l’initiative de fondations, ou encore dans le cadre des programmes cadres européens pour la recherche et le développement technologique. Par ailleurs, deux fonds, le Fonds national de la science – FNS – et le Fonds de la recherche technologique – FRT –, finançaient des actions concertées incitatives depuis la fin des années 90 et avaient pour objectif de permettre l’émergence de disciplines nouvelles, d’accompagner des politiques publiques et d’encourager les partenariats publics-privés en matière de recherche. Mais le véritable lancement en France d’une politique nationale de la recherche sur projet ne date que de 2005, avec la création de l’Agence nationale de la recherche – ANR –, dans le cadre du Pacte pour la recherche.
Le budget de la recherche pour 2013 s’était déjà traduit par ce qui était présenté comme un « rééquilibrage » des financements entre recherche sur projet et crédits récurrents, au profit des organismes de recherche.
Si, dans le projet de loi de finances pour 2014, les organismes de recherche sont cette fois-ci également touchés par les baisses de crédits, les moyens de l’ANR n’en continuent pas moins de diminuer. Les autorisations d’engagement de l’Agence sont inférieures à ce qu’elles étaient à la création de celle-ci, en 2005, et se rapprochent donc, en euros constants, des budgets dont disposaient les anciens fonds incitatifs au début des années 2000…
La Cour des comptes constatait, dans son rapport de juin 2013 sur le financement public de la recherche, que l’Agence était à la croisée des chemins. Le Gouvernement semble avoir dépassé cette étape, mettant en cause son existence même comme agence de financement de la recherche sur projet.
Lors des auditions, la question s’est posée d’une nouvelle approche du financement de la recherche, suivant la doctrine, en vogue dans le monde anglo-saxon : « Fund the people, not the project » – subventionner la personne, pas le projet. Il s’agit là de la volonté légitime de permettre à des chercheurs innovants d’accéder directement aux financements et de leur faire confiance pour développer leurs propres voies de recherche, cette dernière s’accommodant mal du carcan trop systématique des thématiques du moment.
Or c’est précisément à cet objectif que répondent les programmes « blancs » de l’ANR, qui représentaient encore 47,9 % des engagements totaux pris sur appels à projet en 2012. Il serait dommage, de ce point de vue également, que l’attrition des crédits de la recherche sur projet tarisse une indispensable respiration de notre système de recherche, si nécessaire aux jeunes chercheurs notamment, et que nous retournions à des pratiques que la création de l’Agence avait pour objet de dépasser.
Faut-il voir dans cette évolution rapide l’abandon des financements sur projet dans notre pays, ce qui serait une rupture avec la pratique générale, au niveau tant européen qu’international ? Ce serait d’autant plus paradoxal que le programme des investissements d’avenir, de financement extrabudgétaire, repose sur la même logique des appels à projets, d’ailleurs confiés très majoritairement à l’ANR – dont l’expertise se voit ainsi confirmée. Je précise également que Louis Gallois – qu’on ne peut pas accuser d’avoir été impliqué dans l’ANR du temps de la précédente majorité – insiste beaucoup sur la nécessité de développer ces financements de recherche sur projet.
Les crédits annoncés par le Premier ministre au mois de juillet pour financer le deuxième programme des investissements d’avenir sont inscrits dans le projet de loi de finances pour 2014, mais avec une répartition interne et des montants inférieurs aux annonces gouvernementales de l’été dernier.
Le premier programme, lancé à l’initiative du précédent gouvernement, est un succès dont il convient d’apprécier le caractère structurant pour l’ensemble de notre dispositif de recherche et d’enseignement supérieur, en soulignant en particulier qu’il contribue à remédier à une faiblesse française majeure : l’insuffisante valorisation de la recherche. Tout le monde en convient, les retombées économiques de notre recherche sont insuffisantes. Cette absence de corrélation entre une recherche scientifique française, qui reste performante, et la valorisation en entreprises est un problème culturel propre à notre pays.
Si la France a le cinquième PIB mondial, elle occupe le septième rang pour les activités de R&D, mais seulement la seizième place pour l’innovation. Le décrochage est sans appel et illustre parfaitement l’une des raisons de notre moindre compétitivité économique. Nous devons absolument corriger cette situation si nous voulons rester durablement dans le peloton de tête des pays créateurs de richesse.
Les indices français, en matière de publications scientifiques, évoluent de façon intéressante : si leur part relative diminue au niveau mondial, comme pour tous les pays de tradition scientifique ancienne confrontés aux nouveaux pays industriels, notamment les BRICS, leur indice d’impact, c’est-à-dire leur rayonnement, progresse significativement depuis cinq ans. Pour autant, un véritable continuum entre recherche et innovation, caractéristique des économies dynamiques d’un monde globalisé, reste à établir. Les résultats décevants de la France dans la captation des financements des programmes européens de recherche le confirment.
Les études portant sur le système français de recherche et d’innovation convergent toutes vers le même constat : l’accroissement de la performance et de la visibilité de la recherche française passe par la clarification du rôle de ses acteurs, le renforcement de leur autonomie et l’amélioration de la coordination nationale et européenne. Pour ce faire, notre pays a développé un certain nombre d’outils de soutien à l’innovation, sous tous ses aspects, la plupart créés durant la dernière décennie, en particulier dans le cadre du Pacte pour la recherche de 2006 et des investissements d’avenir décidés en 2009. Il convient sans doute de mieux les coordonner.
Renforcer l’innovation, c’est à la fois développer l’interface entre la recherche publique et l’entreprise, et favoriser la recherche directement effectuée en entreprise. C’est à faciliter les partenariats et renforcer les liens entre recherche publique et entreprises que concourt, hors programme des investissements d’avenir, la mise en place des alliances, des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, des pôles de compétitivité, des instituts Carnot ou des conventions CIFRE (conventions industrielles de formation par la recherche), conventions tripartites passées entre un laboratoire de recherche, une entreprise et un doctorant.
Dans le cadre du programme des investissements d’avenir ont été fondés, dans le même but, huit instituts de recherche technologique, moteurs des campus d’innovation technologique, ainsi que des sociétés d’accélération du transfert technologique, qui ont vocation à regrouper l’ensemble des équipes de valorisation des sites universitaires et à mettre fin au morcellement des structures existantes. Leur présentation détaillée et leurs éventuels financements figurent dans le rapport.
Enfin, le soutien principal à la recherche directement effectuée en entreprise relève aujourd’hui du crédit d’impôt recherche. C’est un instrument dont l’efficacité est soulignée par les tous les acteurs du secteur, qu’il convient donc de maintenir et de renforcer. Il est, du fait de la faiblesse actuelle des partenariats public privé de la recherche sur projet, le seul levier véritablement efficace pour développer l’innovation en entreprise. C’est ce que rappelait M. Louis Gallois lors des premières rencontres parlementaires pour l’innovation que Mme Anne-Yvonne Le Dain et moi-même avons coprésidées le 9 octobre dernier : « L’innovation, pour éclore, a besoin de trouver un écosystème favorable. Cet écosystème est d’abord fiscal. […] Ceux qui critiquent le crédit impôt recherche ne se rendent pas compte de la férocité de la concurrence pour l’implantation des sites de recherche. Le CIR représente un puissant élément pour retenir la recherche en France. »
Plus que jamais notre pays doit se préoccuper des insuffisantes retombées économiques de sa recherche. Tandis qu’en Allemagne, la recherche technologique représente 20 % de l’ensemble des recherches, elle n’en représente en France que 7 %. Nous devons donc davantage coordonner recherche, innovation et formation. Le préalable à tout choc de compétitivité est un choc d’innovation. Notre appareil de recherche, quoique excellent, n’est pas suffisamment orienté vers la création de valeur économique, orientation pourtant essentielle si nous voulons maintenir la France au rang des nations qui comptent.
Mme Sandrine Doucet. Merci, monsieur le rapporteur pour avis, pour votre travail, dont on peut néanmoins regretter qu’il ne remette pas suffisamment en perspective ce projet de budget de 7,7 milliards d’euros dans la chronologie et la cohérence qui sont les siennes. En effet, lorsque le candidat François Hollande a abordé la question de la recherche en mars 2012, il a fait le constat d’un recul de la place de la France parmi les pays de l’OCDE, notre pays étant passé en dix ans de la quatrième à la quinzième place. Cela l’a conduit à prôner une simplification du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec l’idée que les chercheurs devaient se consacrer à leurs recherches plutôt qu’à la recherche de financements.
Lors de la discussion de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, la ministre Geneviève Fioraso a également souligné le recul de notre pays au plan européen : alors qu’elle était le deuxième contributeur au financement du plan cadre de recherche et développement technologique européen pour la période 2007-2013, la France a vu sa participation aux programmes européens baisser de 18 à 11,9 %.
Nous voici donc dotés d’un budget stabilisé dont l’un des marqueurs est le maintien des 68 441 emplois, qui ne se voient pas appliquer l’objectif de réduction de l’emploi public.
Sur ce budget de 7,7 milliards d’euros, je me permets de souligner que, comme le prévoit la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, et selon l’agenda stratégique de la France, la participation du pays aux grands programmes scientifiques internationaux bénéficie pour la deuxième année de moyens en hausse : ils augmentent de 4 millions par rapport à 2013 et de 34 millions par rapport à 2012, soit une hausse de 14 % en deux ans. À ce budget s’adjoint celui des investissements d’avenir qui débloquent et accélèrent les actions et conventions du premier programme des investissements d’avenir (PIA) pour un montant de plus de 5 milliards.
Monsieur le rapporteur pour avis, nous ne trouvons dans votre rapport nulle trace de la situation initiale assez désastreuse qui explique les objectifs poursuivis et les choix faits en lien avec la loi de juillet 2013. En lieu et place d’un commentaire dynamique tourné vers les défis de la période 2014-2020, vous vous livrez à un exercice nostalgique, qui n’est pas exempt de quelques petits arrangements avec la chronologie.
Vous parlez d’une baisse du budget de la MIRES : elle était déjà significative dans le budget pour 2012, que vous avez voté, sans parler de l’évolution en yo-yo des crédits au cours des années précédentes – oscillation entre 4,2 % et 4,9 % –, ce qui nuisait à la visibilité pour les chercheurs.
Vous évoquez la nécessité d’un redressement économique qui s’appuie sur des ambitions plus affirmées. Mais n’est-ce pas admettre que l’on a hérité d’une situation dégradée ? On apprend que le glissement vieillesse-technicité était financé jusqu’en 2009. Mais que s’est-il passé entre 2009 et 2012 ?
Vous déplorez le manque de transferts, mais comment s’adosser à un secteur productif qui a perdu des milliers d’entreprises et 750 000 emplois en dix ans ?
Vous affirmez que le financement de l’ANR a atteint son maximum en 2008. Que s’est-il passé après ? A-t-il baissé ?
Vous déplorez le manque d’implication des parlementaires dans les choix budgétaires. C’est oublier les articles 11, 49 et 53 de la loi ESR, qui donnent toute leur place à ces parlementaires dans les choix stratégiques de notre pays.
Monsieur le rapporteur pour avis, la nostalgie n’étant plus ce qu’elle était, ne faut-il pas considérer ce budget comme un budget d’avenir, qui regarde vers l’Europe ? Le nouveau programme-cadre de recherche de l’Union européenne augmente de 40 % pour la période 2014-2020, et nous entendons bien nous adosser à ce budget.
M. Michel Herbillon. Je voudrais, au nom du groupe UMP, féliciter Patrick Hetzel pour son analyse, livrée en des termes exempts de toute polémique. Il a rappelé l’obsession qu’a la majorité, bien au-delà du seul secteur de la recherche, de défaire tout ce qui existait auparavant, y compris ce qui fonctionnait, seul le crédit d’impôt recherche échappant pour l’instant à cette obsession de la table rase.
Patrick Hetzel livre dans son rapport la feuille de route qu’il conviendrait d’adopter pour mieux établir le lien entre recherche et innovation, puis pour en étendre les effets au monde de l’entreprise, afin d’en tirer des bénéfices économiques.
Il a raison de pointer le décalage entre les discours, qui insistent sur la priorité donnée à la recherche, et la réalité de crédits en baisse. Cette baisse touche non seulement les organismes de recherche, mais aussi l’ANR et, quand le rapporteur évoque le retour au financement par projet du temps de Claude Allègre, ce n’est pas par nostalgie ; c’est pour dénoncer une situation préjudiciable.
Il a raison de dire que notre système de recherche doit trouver une nouvelle respiration, qu’il ne faut pas hésiter à renoncer à nos habitudes en matière de financement afin de favoriser les jeunes chercheurs particulièrement innovants, pour qui la recherche de fonds s’apparente souvent à un parcours d’obstacles.
Il a également raison de parler de logiques d’excellence et d’insister sur le développement de la recherche sur projet. Il convient de mieux valoriser l’implication de la recherche dans le monde économique et de développer un véritable continuum entre la recherche, l’innovation et ses implications dans l’entreprise. La faiblesse du lien entre recherche, innovation et formation, la difficulté à traduire les retombées de la recherche en termes de croissance et donc de compétitivité sont bien un mal français.
Les propositions du rapporteur devraient donc inciter la majorité à développer la recherche. Quant au groupe UMP, il votera contre les crédits de la MIRES.
M. Rudy Salles. Je félicite à mon tour Patrick Hetzel pour l’excellent travail qu’il a réalisé. Sandrine Doucet devrait s’inspirer de son objectivité, elle dont les propos semblent avoir été directement dictés par le cabinet de Mme Fioraso.
Si l’école est la colonne vertébrale de notre société, l’enseignement supérieur et la recherche s’inscrivent dans son prolongement. C’est sur l’excellence de ses formations que la France s’est toujours appuyée pour rayonner dans le monde, et il n’est guère surprenant que nos jeunes diplômés soient si prisés à l’étranger. La formation à la française et la recherche sont des symboles de notre culture.
Nous sommes unanimes à nous réjouir lorsque notre pays se voit accorder un prix Nobel. Ces récompenses ne sont pas dues au hasard ; elles sont le fruit des moyens octroyés à la recherche par les majorités successives, qui ont permis à notre pays de briller sur la scène internationale. C’est l’engagement de l’État, aux côtés de ses chercheurs, qui a donné naissance à des merveilles de technologie comme le Concorde, le TGV, ou d’autres réussites moins médiatiques.
Néanmoins, j’ai l’impression à la lecture de ce budget que l’État abandonne petit à petit ses ambitions. Alors que se succèdent les enquêtes nous alertant sur l’état de nos universités, vous en abaissez le budget de 100 millions d’euros tout en voulant revenir sur l’autonomie pourtant indispensable à leur épanouissement. Certes, cette mission, l’une des plus importante de l’État, est en augmentation, mais cela n’est dû qu’à deux programmes nouveaux, aux contours d’ailleurs assez peu clairs.
Au moment où notre pays est en crise et où nous nous enfonçons lentement dans les classements internationaux, vous aviez ici l’occasion d’envoyer un signal en direction de l’avenir. Le groupe UDI attendait un geste fort en faveur de l’innovation, de la recherche et des nouvelles technologies, dont nos voisins savent si bien tirer parti, pour retrouver le chemin de la croissance et créer de l’emploi.
Ce budget de l’enseignement supérieur et de la recherche, nous le voyons comme un investissement sur l’avenir par et pour la jeunesse, cette jeunesse que vous affirmiez avoir placée au cœur de l’action de ce quinquennat.
Ne vous méprenez pas : nous ne vous demandons pas de prendre des risques inconsidérés avec les deniers de l’État, mais nous aurions souhaité l’affichage d’un cap clair et d’objectifs chiffrés.
Cette année la France n’a pas reçu de prix Nobel. Davantage de nos jeunes diplômés envisagent chaque jour de s’exiler à l’étranger, car ils n’ont plus confiance en l’avenir de leur pays. Or le budget de cette mission n’est malheureusement pas en mesure d’inverser la tendance. Et c’est parce que le groupe UDI considère qu’il est en contradiction avec la trajectoire nécessaire au redressement de notre pays qu’il s’y opposera.
M. Thierry Braillard. Patrick Hetzel a souhaité insister sur le fait que note pays souffrait culturellement d’un retard en matière d’innovation. Le travail qu’il accomplit avec les rencontres parlementaires pour l’innovation mérite à ce titre d’être souligné.
Si la recherche fondamentale se porte bien dans notre pays, il n’en est pas de même pour la recherche appliquée et l’innovation, ou ce que l’on appelle le développement expérimental. La compétitivité de l’industrie française a régressé depuis dix ans, et le rapport Gallois a mis en évidence la mauvaise articulation entre la recherche et l’industrie. Le faible succès de la France dans les appels à projet des programmes européens de recherche et développement n’est donc pas surprenant. Si le rapporteur pour avis rappelle que des outils d’interface entre recherche et innovation ont été mis en place ces dernières années, nous estimons que le crédit d’impôt recherche mérite d’être refondé pour éviter les effets d’aubaine fiscaux.
Le rapporteur pour avis relève également l’importance des structures régionales et le succès des pôles de compétitivité. M. Herbillon notera que nous ne les avons pas remis en cause, ce qui prouve que nous ne touchons pas aux dispositifs qui fonctionnent.
Évoquant le programme des investissements d’avenir, M. Hetzel oublie de relever l’accélération et le déblocage des actions de la première génération par la ministre Geneviève Fioraso. Cela explique la très forte progression des versements effectifs aux porteurs de projets entre 2012 et 2013, puisque ceux-ci ont augmenté de plus de 30 %. Dans le projet de budget pour 2014, les versements annuels se stabilisent à hauteur d’un milliard d’euros, montant bien supérieur aux budgets de la majorité précédente.
J’aimerais rappeler pour conclure que la commission Innovation 2030 de Mme Lauvergeon a identifié sept ambitions pour l’hexagone en matière d’innovation : le stockage de l’énergie, le recyclage des matières premières dont les métaux rares, la valorisation des richesses marines, la chimie du végétal, la médecine individualisée, la « silver » économie et le « Big data ». Je souhaiterais avoir le sentiment du rapporteur sur ces choix.
Mme Isabelle Attard. Je salue à mon tour la qualité du travail de notre rapporteur pour avis. Si nous sommes d’accord avec lui sur quelques chiffres, nous divergeons sur les conclusions à en tirer.
Mon intervention s’articulera autour de trois sigles : CEA, CIR et ANR.
Le CEA – commissariat à l’énergie atomique– d’abord. Si nous constatons une légère amélioration cette année du budget de la recherche, elle masque mal des décisions qui ne peuvent satisfaire ni les écologistes ni ceux qui se soucient de transition écologique.
Les crédits du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durable » sont certes en légère augmentation, mais ceux du programme 187 « Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources » diminuent. Par ailleurs, les lignes qui progressent dans le programme 190 sont celles consacrées aux charges nucléaires de long terme des installations du CEA.
Ce dernier, qui a déjà vu son budget augmenter de 7 % l’an dernier, bénéficie cette année d’une nouvelle hausse de 7,4 %, les crédits étant affectés non pas au démantèlement et à la prévention des risques mais au développement de la technologie. Les choix sont donc clairs ; j’en veux pour preuve le réacteur thermonucléaire expérimental international ITER, financé dans le programme 172 à hauteur de 96 millions d’euros.
Cet investissement massif dans le CEA est en contradiction avec la volonté affirmée de sortir progressivement du nucléaire, même à très long terme. Il cache mal, par ailleurs, la misère des autres organismes de recherche, sachant que le budget du CEA représente 58 % de celui du CNRS. Je m’interroge donc sur la volonté réelle de notre ministre en matière de soutien aux organismes de recherche.
Créé en 1983, le CIR – crédit d’impôt recherche – a été profondément remanié en 2007, ce qui n’a pas empêché la Cour des comptes de se montrer récemment très critique sur ce dispositif qui constitue l’aide fiscale la plus importante de tous les pays de l’OCDE. Un pays comme la Suède n’a pas fait le choix du crédit d’impôt pour soutenir la recherche et le développement, ce qui ne l’empêche pas de figurer à la première place du classement Innovation Union Scoreboard de la Commission européenne pour son climat en faveur de l’innovation. Il y a donc d’autres façons de soutenir la recherche en France.
Les conclusions de la Cour des comptes sont précises : d’une part, l’État doit se donner les moyens de connaître mieux et plus rapidement le droit à crédit d’impôt constitué par les entreprises au titre du CIR, ainsi que la dépense fiscale associée ; d’autre part, les services de l’État doivent se donner les moyens de lutter plus efficacement contre la fraude en matière de CIR.
Tandis que, cette année encore et malgré les critiques, le CIR est intouchable au nom du pacte de compétitivité, il est urgent d’avoir sur le financement public de la recherche un véritable débat public.
Enfin, pour ce qui concerne le budget de l’ANR – Agence nationale de la recherche–, vous évoquez, monsieur le rapporteur pour avis, une diminution de 11,9 %, mais il ne faut pas oublier que les écosystèmes d’excellence transiteront pour une bonne partie par l’ANR dont le budget passera donc de 605 millions à 4,5 milliards d’euros. J’ai du mal à comprendre que vous critiquiez ce budget où dominent les appels à projet. Pour leur part, les écologistes souhaitent voir se développer les fonds pérennes des organismes de recherche, notamment ceux du CNRS, pour redonner confiance à ces organismes et leur assurer les moyens de travailler. Dans la mesure où cette politique qui favorise les appels à projet nous semble dans la droite ligne de ce qui se pratiquait sous la majorité précédente, nous nous abstiendrons sur le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Mme Claudine Schmid. Après m’être associée aux félicitations qu’a reçues le rapporteur pour avis, j’aborderai la question des partenariats avec les universités et les instituts de recherche à l’étranger. Lors du forum de l’innovation qui s’est tenu en juin à Lausanne, la ministre Geneviève Fioraso a souligné la volonté de la France de renforcer la coopération avec la Suisse en matière de recherche et d’innovation. Monsieur le rapporteur pour avis, les auditions que vous avez menées vous permettent-elles de confirmer que cette politique de coopération avec des organismes étrangers est mise en œuvre par le ministère ?
M. Hervé Féron. Je félicite à mon tour Patrick Hetzel pour son travail. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur le financement public de la recherche révèle qu’en 2010 plus de 45 % de nos publications dans le domaine de la recherche ont été réalisées en partenariat avec un laboratoire étranger. Cela fait de la France le premier pays en matière de taux de collaboration, rang qu’elle occupait déjà en 2000. Néanmoins, les capacités de recrutement des organismes publics sont bien inférieures au nombre de jeunes scientifiques formés chaque année. L’inadéquation entre la formation de chercheurs et ces capacités d’accueil n’est-elle pas une incitation à l’exil, à la fuite des cerveaux ? Peut-on quantifier ce phénomène ?
Mme Annie Genevard. Le crédit d’impôt recherche a permis de nombreuses créations d’emploi ainsi que des créations d’entreprise. Mais les entreprises qui en ont bénéficié constatent une très forte accélération du nombre de contrôles et de redressements depuis le début de l’année. Le fisc a trouvé une proie facile, mais ce phénomène est délétère. On ne peut encourager les entreprises à recourir au CIR, tout en faisant planer sur elles la menace d’un contrôle fiscal. Il est normal de contrôler quel usage est fait de l’argent public, mais sans doute faudrait-il fixer un cadre a priori pour assurer les entreprises qu’elles sont bien éligibles au crédit d’impôt.
Je tiens également à attirer votre attention sur les plateformes technologiques situées dans les établissements d’enseignement professionnel ou de technologie, qui dépendent de l’ANR. Bien que ce dispositif, qui consiste à mettre à disposition des entreprises les équipements et les compétences qui existent dans l’enseignement scolaire, secondaire ou supérieur, ait fait ses preuves il est aujourd’hui budgétairement très fragilisé.
M. Frédéric Reiss. Je remercie à mon tour Patrick Hetzel pour son rapport et sa démonstration implacable du détricotage auquel se livre la majorité.
Je souhaite revenir sur le manque de corrélation entre le niveau de notre recherche, nos publications scientifiques et leurs retombées économiques. La part mondiale de la France dans la production mondiale de publications scientifiques est en repli ; elle ne représente que 3,7 %, ce qui nous place au troisième rang de l’Union européenne, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. Certes nous n’avons pas eu de prix Nobel cette année, mais nous avons pour la troisième fois consécutive obtenue la médaille Fields. Les mathématiques étant une discipline dont les caractéristiques bibliométriques sont structurellement faibles, le fort engagement de la France dans cette discipline ne la désavantage-t-elle pas ?
M. le rapporteur pour avis. Pour comprendre que mon analyse n’est pas nostalgique mais fondamentalement stratégique, j’invite Sandrine Doucet à se reporter au plaidoyer de Christophe Borgel en faveur d’une recherche qui prenne davantage en compte les aspects économiques. Certes, Christophe Borgel est membre de la commission des affaires économiques, mais je ne saurais trop inciter les membres des commissions parlementaires à travailler ensemble sur ces questions.
Le budget de l’ANR est aujourd’hui en diminution, proche du niveau qui était le sien à l’époque de Claude Allègre. La baisse a en effet commencé sous la précédente législature, mais cela était déjà problématique. Rapporteur pour avis l’an dernier, j’avais déjà souligné qu’on était « à l’os » et qu’aller plus loin équivaudrait à remettre en cause le financement par projet. C’est le cas aujourd’hui.
Tous ceux qui répondent actuellement aux appels à projet de l’ANR vous diront que les taux de sélection sont devenus tellement drastiques que les très bons projets ne sont pas tous retenus. Cela veut dire qu’en matière de recherche nous avons des potentialités que nous ne parvenons pas à financer. La seule réponse du ministère à ce paradoxe consiste à renvoyer vers les fonds européens, ce qui est en contradiction avec le discours de François Hollande qui souhaitait que les chercheurs se consacrent à la recherche plutôt qu’à la recherche de financements.
Les sept orientations préconisées par Anne Lauvergeon sont très pertinentes. Je ne considère pas qu’elles soient en contradiction avec les trente-cinq domaines définis par Arnaud Montebourg : tandis que ce dernier a défini des potentialités économiques immédiates, Anne Lauvergeon évoque, elle, des potentialités pour les quinze ou vingt ans à venir. Il faut articuler les deux.
Thierry Braillard a expliqué qu’avec 1 milliard d’euros les investissements d’avenir n’avaient jamais été aussi hauts. Mais, comme en témoignent les documents budgétaires, ce montant était celui prévu dès l’origine, et il ne reflète que la montée en puissance du dispositif.
Les questions d’Isabelle Attard sur les programmes 190 et 187 sont parfaitement justifiées mais, sur ce sujet, c’est à la majorité d’arbitrer. Mme Attard devrait néanmoins se réjouir de l’augmentation du budget du CEA : sans les crédits affectés au démantèlement d’installations nucléaires, celui-ci serait en diminution.
Quant au crédit d’impôt recherche, la Cour des comptes n’en met pas en cause le principe. Elle juge que c’est un bon dispositif mais qu’il faut l’améliorer. Il conviendrait notamment de renforcer le rescrit fiscal, afin de donner davantage de sécurité aux entreprises. Celles-ci doivent pouvoir consulter en amont l’administration fiscale qui leur fournira un avis, évidemment opposable.
Pour en revenir au budget de l’ANR, il comporte deux volets : le budget initial et le volet extrabudgétaire lié aux investissements d’avenir. Je ne m’exprime que sur le seul volet budgétaire, lequel est en baisse, ce qui contribue à fragiliser le cœur de métier de l’ANR y compris, comme le soulignait Annie Genevard, les plateformes technologiques.
Il est vrai, madame Schmid, qu’il reste une marge de progression importante en matière de coopération avec les organismes étrangers. Cette politique n’est guère détaillée par le bleu budgétaire et ne semble pas faire partie des priorités de la ministre.
Le fonctionnement particulier de la recherche en mathématiques explique le petit nombre de publications dans ce domaine, monsieur Reiss. Je pense comme vous que notre pays, qui compte aujourd’hui trois titulaires vivants de la médaille Fields, ne peut que se féliciter de son excellence dans cette discipline. Mais pour qu’il conserve sa précellence, il faut préserver les programmes « blancs » de l’ANR, aujourd’hui mis en péril par la politique gouvernementale.
M. le président Patrick Bloche. Je donne maintenant la parole à Emeric Bréhier, rapporteur pour avis sur les crédits de l’enseignement supérieur. Comme vos collègues rapporteurs, de très nombreuses auditions vous ont permis de dresser un constat tout à fait intéressant, mais également plutôt inquiétant, sur la situation de nos doctorants.
M. Emeric Bréhier, rapporteur pour avis pour l’enseignement supérieur et la vie étudiante. Chacun reconnaît que l’augmentation du taux de réussite en licence est un défi essentiel pour notre pays. À cet égard, les priorités ont été réaffirmées avec force par Mme la ministre. Il est plus rare, en revanche, de se pencher sur la situation et le devenir de nos doctorants.
Les débats, parfois âpres, auxquels l’article 78 de la loi du 22 juillet 2018 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui encadre la reconnaissance du doctorat par l’ENA, a donné lieu ont eu le grand mérite de mettre en lumière le traitement que la France réservait à ses doctorants. Il m’a semblé utile d’aller plus loin dans l’examen de la situation et de proposer quelques pistes d’évolution.
Un tableau exhaustif de la situation suppose qu’on distingue entre les « stocks » de docteurs et les « flux » de doctorants. Notre pays décerne trois fois moins de doctorats que l’Allemagne en sciences « molles » – et deux fois moins que le Royaume Uni – et 25 % de moins pour les sciences « dures ». Du fait de la faible attractivité de ce diplôme, nombre d’étudiants brillants préfèrent préparer les grandes écoles ou arrêter leur cursus après l’obtention du master.
La question des flux est également préoccupante, 44,5 % des doctorants menant une recherche en sciences et 34,5 % en lettres, langues et sciences humaines. Ce décalage se retrouve doublement aggravé : au niveau de la répartition des doctorats délivrés annuellement, puisque 60 % des diplômés le sont en sciences « dures » et en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, quand seulement 24 % le sont en sciences « molles », ce qui prouve l’existence de graves problèmes d’encadrement et d’orientation ; au niveau des possibilités de recrutement puisque l’on crée moins de 3 000 postes d’enseignants chercheurs et de chercheurs titulaires par an, un peu moins de 4 000 contrats doctoraux et un peu plus de 1 300 conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE). Concernant les entreprises, 55 % des chercheurs ont un diplôme d’ingénieur, 16 % un master ou équivalent et seulement 12 % sont titulaires d’un doctorat.
Reste la question des doctorants étrangers. S’ils sont très attirés par notre pays – ils représentent 42 % des inscrits en doctorat en 2012, alors que le nombre de doctorants français a baissé de 30 % en cinq ans – les conditions d’accueil et de travail qui leur sont offertes ne sont guère propres à préserver cette attractivité. La nouvelle majorité a déjà pris différentes mesures pour remédier à cette situation et il conviendra de poursuivre le travail engagé.
Au-delà de ces éléments quantitatifs et qualitatifs, c’est la question même du statut qui est posée : simultanément professionnel de la recherche et étudiant, le doctorant doit à la fois être encadré et bénéficier d’un statut qui lui évite la précarisation. Grâce aux nombreuses auditions que nous avons menées, nous pouvons affirmer l’efficacité des CIFRE, des écoles doctorales ou encore des contrats doctoraux. Malheureusement, ces outils ne permettent pas de remédier à la fragilité de la situation de nombreux doctorants, fragilité qui a été amplifiée par plusieurs facteurs, notamment par la politique de recherche menée entre 2008 et 2012. Le manque de visibilité et de moyens des universités notamment a provoqué une baisse de près de 5 % du nombre de contrats doctoraux entre 2009 et 2012. Il convient en outre de distinguer entre les thèses financées et celles qui ne le sont pas, 32 % des doctorants devant se débrouiller seuls pour financer leurs travaux. Pour ces étudiants c’est la double peine, l’absence de financement de la thèse s’accompagnant d’une plus grande difficulté à occuper un emploi stable une fois la thèse achevée.
À cela s’ajoute l’exposition accrue des docteurs au chômage : 10 % des docteurs étaient au chômage en 2007 contre 7 % des titulaires d’un master 2. Enfin, un docteur doit attendre en moyenne cinq ans avant d’occuper un emploi permanent.
Pour parfaire le tableau, j’ajouterai un dernier élément, qui est peut-être le cœur du sujet : notre pays, contrairement à ses partenaires, ne valorise pas ce diplôme. Alors qu’à l’étranger un docteur indiquera son diplôme sur sa carte de visite, en France, il ne viendra jamais à l’esprit d’un docteur de faire de même, sous peine de subir sarcasmes et quolibets. Cette anecdote révèle une réalité qui existe dans le secteur privé comme dans la haute fonction publique, territoriale ou d’État.
Dans le secteur privé, la dualité entre les universités et les grandes écoles aboutit à une préférence significative pour les diplômes d’ingénieur. Le sentiment, chez les employeurs, que les doctorants s’abstiennent de prendre des risques ou que le sujet de la thèse est plus important que les compétences requises pour préparer un doctorat, parfois même la méfiance entre mondes universitaire et entrepreneurial, ou encore la difficulté à « normer » le diplôme du doctorat ont amené les partenaires sociaux à ne même pas engager les négociations de branche permettant la reconnaissance du titre de docteur. C’est la raison pour laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a souhaité inscrire dans la loi l’obligation de négocier la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives à partir du 1er janvier 2016.
Dans la haute fonction publique, la situation n’est pas moins complexe. Sur les quatre dernières promotions de l’ENA, seuls quatorze élèves sont docteurs et aucun d’eux n’est passé par le concours externe. Les grands corps techniques ne recrutent qu’environ dix docteurs par an. D’une manière générale, les modalités de recrutement de la fonction publique – par voie de concours comportant des épreuves sur programmes – sont peu adaptées aux docteurs.
On voit que le tableau est relativement sombre. Il est pourtant possible d’assurer un financement pour tous les doctorants et une insertion professionnelle à tous les docteurs, à condition qu’on ose s’attaquer aux causes de la situation actuelle. Je vous propose quelques pistes, glanées au cours des auditions.
Cette évolution positive suppose d’abord une protection juridique et sociale de l’expérience professionnelle qu’est la préparation d’un doctorat. Cette expérience devrait être reconnue via un « triptyque » de droits : un salaire, des droits sociaux et la prise en compte des années de thèse dans le calcul de la retraite.
Du côté des opérateurs, le financement universel des thèses ne serait pas neutre car il impliquerait un certain nombre d’arbitrages. Il faudrait tout d’abord remettre à plat le système de répartition des allocations de recherche. En effet, les auditionnés ont abondamment pointé le caractère opaque des critères de financements des doctorants. Une réforme du financement devrait également permettre de responsabiliser les directeurs de thèses qui n’ont pour objectif que de maintenir le nombre de contrats doctoraux qui leur est alloué.
L’État devrait élargir la palette des instruments de financement du doctorat tout en développant les outils existants : augmentation du nombre de contrats doctoraux ou encore de CIFRE, accompagnée d’un contrôle de la qualité scientifique de la recherche et de la réalité de l’intégration professionnelle au sein des entreprises ou des collectivités territoriales bénéficiant de ces conventions.
La professionnalisation des doctorants est le deuxième enjeu. Pour y parvenir, deux actions semblent indispensables. Il faut tout d’abord transformer l’essai des écoles doctorales en leur permettant de disposer d’indicateurs de suivi des doctorants, en généralisant les bonnes pratiques ou encore en limitant le nombre de thèses encadrées par un même directeur de recherche. Parallèlement, il importerait de « normer » davantage le diplôme afin de permettre, au secteur privé notamment, de mieux percevoir les compétences et qualités requises pour la réussite d’un doctorat. Cette « normalisation » passerait par la garantie de la qualité de la thèse, le recours systématique au nouveau chapitre de la thèse présentant les compétences et savoir-faire acquis, la limitation à trois ans de la durée de rédaction de la thèse et la valorisation des compétences professionnelles par une certification ou des référentiels. Il s’agit, en un mot, de mettre enfin en place le troisième étage du LMD, alors que nous nous sommes arrêtés à l’étape du master.
Le dernier point capital est celui de la carrière des docteurs. Les auditions nous ont permis de dégager trois éléments incontournables pour que ce diplôme puisse enfin être reconnu à sa juste valeur.
Le statut d’enseignant-chercheur ne doit plus être considéré comme le débouché exclusif et naturel du doctorat, ce qui serait une révolution copernicienne pour certains directeurs de thèse.
Il faut élargir l’accès à la haute fonction publique, en particulier territoriale. Si les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 concernant l’ENA ont une vertu essentiellement symbolique et pédagogique, l’instauration de concours spécifiques pour les titulaires du doctorat semble d’une mise en œuvre difficile. En revanche, le développement de recrutements sur titre et la dispense de tout ou partie des épreuves d’admissibilité des concours de catégorie A pour les docteurs pourraient être des pistes à explorer. La spécificité de ce diplôme pourrait également être mieux établie dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires concernés.
Il faut enfin valoriser les recrutements de docteurs par le secteur privé : cette valorisation passerait par le maintien de l’avantage fiscal lié au recrutement d’un docteur, la négociation de conventions collectives reconnaissant le doctorat et l’engagement d’une évolution culturelle faisant du doctorat un investissement rentable pour les employeurs et les salariés.
Je souhaiterais, en conclusion, remercier l’ensemble des personnes que j’ai eu le plaisir d’auditionner pour la préparation de ce rapport. L’angle adopté n’était pas toujours facile à évoquer pour certains mais tous ont accepté de se poser sérieusement la question de la situation et des perspectives des doctorants et des docteurs. Les propositions présentées dans ce rapport s’inspirent pour beaucoup de leur réflexion.
Je pense que notre pays aurait tout à gagner à faire évoluer sa perception du diplôme de docteur. À l’heure où le niveau de conceptualisation, la capacité de travail et d’analyse sont des éléments essentiels pour affronter sereinement les défis posés par les échanges internationaux, la question de la reconnaissance du doctorat revêt un caractère stratégique pour regagner de la compétitivité et créer de la valeur ajoutée. Mme la ministre nous a donné l’occasion de nous saisir de ce sujet ; j’espère que ce rapport nous aidera à avancer collectivement en ce sens.
M. Yves Daniel. Nous sommes réunis ce matin pour examiner les crédits de la mission « Recherche et Enseignement supérieur ». Avant de revenir plus en détail sur les programmes « Formations supérieures et recherche universitaire » et « Vie étudiante », je voudrais insister sur l’ambition globale portée par ce budget, le troisième de l’État après l’enseignement scolaire et la défense. En dépit de la période de délicatesse budgétaire que nous connaissons, la majorité gouvernementale tient le cap des priorités qu’elle a fixées, notamment celle de doter notre jeunesse des moyens de croire en son avenir.
Je tiens également à saluer les travaux de mes collègues, Thierry Mandon et Emeric Bréhier, respectivement rapporteur spécial et rapporteur pour avis des crédits de ces deux programmes. Leurs analyses et leurs réflexions donnent sens à la technicité budgétaire, en la mettant en perspective avec les politiques menées par le ministère et les objectifs que nous souhaitons assigner à notre enseignement supérieur.
Sur les crédits en eux-mêmes, beaucoup a déjà été dit, je me contenterai donc de reprendre les quelques points qui ont retenu mon attention.
La réussite étudiante est un levier de croissance, comme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’affirmait dans une tribune publiée il y a quelques mois par le journal Le Monde. Or, le taux de réussite en premier cycle a chuté de cinq points entre 2006 et 2011. À l’heure actuelle, 32 % des étudiants ne se réinscrivent pas à l’université à l’issue de leur année de licence. Dans le meilleur des cas ils se réorientent, mais bien souvent cette absence de réinscription s’accompagne d’un abandon des études.
Le programme 150 traduit la volonté du gouvernement et de la majorité de renverser la tendance grâce à une meilleure prise en compte du passage du lycée à l’enseignement supérieur. Ainsi, 1 000 nouveaux postes seront créés en 2014 – ce qui représente un effort de 60,5 millions d’euros – pour offrir aux étudiants de premier cycle un accompagnement digne de ce nom. Ces emplois seront destinés à améliorer l’encadrement dans certaines filières, à orienter individuellement les étudiants à leur arrivée à l’université, et à soutenir ceux qui seraient le plus en difficulté. C’est un premier pas indispensable pour atteindre d’ici à la fin du quinquennat l’objectif de conduire 50 % d’une classe d’âge à un diplôme d’enseignement supérieur, alors que nous stagnons à 40 % depuis quinze ans.
Deuxièmement, l’essentiel de la progression de 6 % des crédits du programme 231, qui concerne la vie étudiante, est consacré à la réforme des bourses. Créant un échelon 0 bis et un échelon 7, cette réforme profitera aussi bien aux étudiants issus de la classe moyenne qu’aux plus modestes. Je veux aussi citer les 1 000 allocations supplémentaires qui seront attribuées à des jeunes en situation d’autonomie et non éligibles aux bourses de droit commun. Rappelons que l’assurance de bénéficier de conditions matérielles décentes est un préalable indispensable à la réussite et qu’aujourd’hui près d’un étudiant sur deux est contraint de travailler pendant son cursus universitaire.
Je finirai par quelques mots sur le logement étudiant. Nous nous sommes engagés à en construire 40 000 d’ici à cinq ans pour combler le déficit hérité des années précédentes. Le budget présenté ce matin confirme cette ambition via la relance des opérations Campus pour 13 000 d’entre eux, et le maintien à un niveau constant de la partie de la dotation du réseau du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) dédiée au logement.
Si ce budget ne résout pas toutes les difficultés qui pèsent sur le financement à long terme des universités, il marque le début d’une nouvelle ère : il est le premier que nous élaborons depuis le vote, en juillet dernier, de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, mais surtout il témoigne de la place nouvelle donnée par la majorité gouvernementale à notre enseignement supérieur et à nos étudiants. Ces derniers portent l’avenir de notre économie, de notre société, du pays tout entier. Ces crédits nous permettront de les accompagner sur les chemins de la réussite. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à les voter.
M. Patrick Hetzel. Avant d’en venir à la thématique du doctorat retenu par le rapporteur pour avis, qui mérite une attention toute particulière, je voudrais commenter quelques éléments de ce budget.
Je trouve très surprenant qu’il ne propose aucune solution de financement du glissement vieillesse-technicité des universités, alors que nous avons entendu la semaine dernière Mme la ministre accuser l’ancienne majorité de ne pas l’avoir pas financé. Si cela est vrai, il aurait été de bonne gestion de régler ce problème en priorité. Or on préfère nous proposer la création de 1 000 postes supplémentaires, qui ne sauraient être que des créations en trompe-l’œil si le GVT n’est pas financé. Il y a là un double discours.
Je voudrais répéter par ailleurs que l’obtention d’un diplôme, un des trois chantiers prioritaires de ce budget, ne saurait être une fin en soi : il faut aussi que ce diplôme permette aux jeunes d’entrer dans le monde du travail. Pour cela il est nécessaire de renforcer le rôle de l’enseignement supérieur en matière d’insertion professionnelle, notamment en incitant les établissements à entretenir des coopérations très étroites avec les milieux professionnels.
Le choix du rapporteur pour avis de développer la thématique du doctorat est très pertinent, tant ce titre est déconsidéré dans notre pays. Sans nier l’intérêt de ses propositions de revalorisation, je regrette qu’il n’ait pas évoqué le rôle que peuvent jouer les grandes écoles en la matière. Le gouvernement précédent avait ainsi intégré dans les contrats passés avec ces établissements des objectifs de progression du nombre d’élèves titulaires du doctorat. En effet, le rôle des docteurs ingénieurs est essentiel dans le renforcement du lien entre la recherche et l’innovation et partant dans la compétitivité de notre économie.
Mme Isabelle Attard. Mme la ministre a tenu ses engagements en matière de réévaluation des bourses, mais je déplore que cela soit au détriment des crédits destinés au logement et à la restauration étudiants, éléments pourtant indispensables à la santé et au bien-être des étudiants et qui contribuent à lutter contre le fort taux d’abandon de ceux-ci.
Je remercie le rapporteur pour avis d’avoir remis en première ligne la situation des doctorants. Il est vrai que la France ne valorise pas suffisamment le doctorat, notamment dans le cadre de la haute fonction publique d’État ou territoriale. La nécessité pour les docteurs de se soumettre à la procédure de qualification pour pouvoir exercer le métier d’enseignant-chercheur prouve que le doctorat n’a pas en France la valeur qu’il a à l’étranger. Il est temps de s’attaquer à ce problème. La revalorisation du doctorat suppose aussi d’homogénéiser les chartes de thèses et de redéfinir les critères d’encadrement des doctorants.
M. Thierry Braillard. Pour le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, ce budget est bon puisqu’il prévoit notamment la création de 1 000 postes supplémentaires et la titularisation de 2 200 contractuels. Nous notons également avec satisfaction les propositions d’amélioration des conditions de vie des étudiants, notamment des plus modestes, via une augmentation significative du montant des bourses.
Nous vous remercions, monsieur le rapporteur pour avis, d’avoir mis l’accent sur la question des doctorants, qui sont souvent dans une situation financière et sociale difficile. Je rappelle que c’est à l’initiative de notre groupe RRDP que les parlementaires ont introduit dans la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche une mesure visant à valoriser le titre de docteur et son usage. La loi du 22 juillet 2013, notamment par son article 78, constitue un progrès incontestable vers la reconnaissance du doctorat, même si la mise en œuvre des procédures de recrutement reste problématique.
Nous pensons, comme le rapporteur, qu’il faut maintenir les outils favorisant le recrutement de doctorants par le secteur privé et élargir l’accès des docteurs à la haute fonction publique, notamment territoriale.
J’aimerais savoir, monsieur le rapporteur, s’il vous semble, à l’issue des auditions, que la loi du 22 juillet 2013 a déjà eu une incidence sur la situation des doctorants ?
M. Hervé Féron. La durée de rédaction des thèses, souvent jugée excessive, ne constitue-t-elle pas un handicap pour le recrutement par le privé ? Ce problème n’est-il pas dû à l’absence d’équipes structurées assurant un véritable encadrement des doctorants ?
M. Mathieu Hanotin. Non seulement le doctorat n’est pas reconnu à sa valeur, mais il est même bien souvent déqualifiant à l’embauche. Or la politique de recrutement est déterminante pour assurer l’attractivité du doctorat, et je suis convaincu qu’en la matière le secteur public doit donner l’exemple. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation absurde : l’investissement de notre pays dans la formation des docteurs profite aux pays étrangers, où ceux-ci sont trop souvent contraints de travailler. Il faut aujourd’hui réformer notre politique de recrutement et privilégier une dynamique de projets avec des cycles de cinq ans et des financements adaptés. Cela suppose que l’on donne plus d’autonomie aux laboratoires et aux écoles doctorales.
M. le rapporteur pour avis. La durée de la thèse est un point essentiel de la « normalisation » que j’appelle de mes vœux. Si nous voulons nous conformer au standard européen du LMD, il faudra aller progressivement vers une limitation à trois ans de la durée de rédaction de la thèse. C’est ainsi qu’on achèvera la mise en place de l’étage « D » du LMD, essentiel pour permettre à nos jeunes chercheurs de poursuivre leur cursus à l’étranger, notamment en Europe.
Pour moi, monsieur Hanotin, que des docteurs ou des doctorants poursuivent leur recherche à l’étranger n’est pas un problème ; qu’ils enrichissent ainsi leur expérience est une chance pour notre pays. La science ne peut pas s’enfermer dans les frontières hexagonales ou européennes et beaucoup de ces scientifiques reviennent en France. La difficulté est de trouver un accord avec les communautés universitaires quant à la définition du « D », notamment dans le domaine des sciences humaines, encore dominées par le modèle de la thèse d’État de dix ans.
Je vous rappelle, monsieur Hetzel, que l’objectif de conduire 50 % d’une classe d’âge à la licence est un objectif européen de la stratégie de Lisbonne, et que Mme Pécresse avait présenté son Plan pour la réussite en licence comme une concrétisation de cette stratégie.
S’agissant du devenir professionnel des docteurs dans la haute fonction publique, je voudrais insister sur le vivier d’emplois que constituera dans l’avenir la fonction publique territoriale, puisque 60 % de ses cadres seront à la retraite dans six ans. C’est la raison pour laquelle mon rapport insiste sur la nécessité d’inciter les collectivités territoriales à signer des CIFRE, qu’à l’exception des villes de Paris et Lyon, elles utilisent encore trop peu. Voilà une des pistes concrètes que l’on peut explorer avant d’envisager d’engager une nouvelle réforme – je vous rappelle, mes chers collègues, que la dernière réforme que nous avons votée n’est vieille que de quatre mois ! Nous devons désormais nous appuyer sur ce socle législatif pour apporter des solutions pratiques.
Les grandes écoles ont d’ores et déjà pris conscience de la nécessité d’inciter leurs élèves à passer un doctorat, monsieur Hetzel. C’est la raison pour laquelle les écoles d’ingénieurs ont pour objectif de porter le taux de poursuite en doctorat des élèves-ingénieurs de 7,5 % à 10 %. Les grandes écoles d’application de la fonction publique d’État se sont également engagées sur cette voie, notamment l’École nationale d’administration : il est vrai qu’être un ancien élève de l’ÉNA n’a aucune valeur en dehors de l’hexagone.
Nous accuser comme vous le faites, monsieur Hetzel, de ne pas financer le GVT revient à se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous n’ignorez pas que cette question du financement du GVT pour les prochaines années fait partie des points actuellement en discussion entre la ministre et la Conférence des présidents d’université. La discussion sur ce point est assez avancée, et je pense que des mesures pourront bientôt être prises pour résoudre cet épineux problème.
Pour moi, c’est l’immobilier qui constitue la véritable bombe à retardement pour le budget des universités françaises qui devront, dans quelques années, faire face à une explosion de leurs charges dans ce domaine. C’est là un véritable sujet, dont nous devons nous saisir dès maintenant.
Imposer à ceux qui ont déjà soutenu une thèse une procédure de qualification illustre bien la schizophrénie française, madame Attard. Cette procédure est en outre inégalitaire, la qualification étant quasiment automatique dans certaines disciplines et extrêmement sélective dans d’autres. Le problème fondamental est celui du défaut de reconnaissance de ce diplôme.
Pour finir, je voudrais souligner que la France a privilégié l’étape du master dans la mise en place du LMD, alors que tous les autres pays européens ont privilégié la licence et le doctorat.
La Commission examine l’amendement AC1 de M. Thierry Braillard, portant article additionnel après l’article 71.
M. Thierry Braillard. Cet amendement part du constat que les moyens alloués à la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) profitent presque exclusivement à l’Institut d’études politiques de Paris, au détriment des IEP de province. Cependant, au bénéfice de l’engagement de Mme la ministre de me transmettre de nouveaux éléments d’information, je le retire. Je le proposerai en séance, une fois que j’aurais reçu les informations que j’attends.
M. le rapporteur pour avis. Tout en prenant acte du retrait de cet amendement, je reconnais que la répartition de la subvention accordée à la FNSP pose un véritable problème d’égalité de traitement entre Sciences Po Paris et les IEP de province.
L’amendement AC1 est retiré.
La Commission émet un avis favorable à l’adoption des crédits pour 2014 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
(par ordre chronologique)
Ø Conférence des présidents d’université (CPU) – M. Jean-Loup Salzmann, président, et M. Florent Olivier, attaché parlementaire
Ø Conférence des grandes écoles (CGE) – M. Pierre Aliphat, délégué général
Ø Association Sauvons la recherche – M. Emmanuel Saint-James, président
Ø Coordination nationale des précaires de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNPESR) – M. Joan Cortinas, porte-parole
Ø Association nationale des docteurs (ANDES) – M. Pascal Crépey, président du conseil d’administration, et M. Alexandre Bérard, secrétaire général
Ø Confédération des jeunes chercheurs (CJC) – Mme Hélène Duffuler-Vialle, présidente, Mme Shirine Benhenda, M. Rafaël Cos, et, M. Julien O’Miel
Ø Sciences-Po – M. Michel Pébereau, membre du conseil d’administration, président d’honneur de BNP-Paribas, accompagné de M. Patrick Schmitt, directeur de recherche au MEDEF et de M. Mathieu Pineda, chargé de mission à la direction des affaires publiques du MEDEF
Ø Table ronde réunissant les partenaires sociaux :
– Mouvement des entreprises de France (MEDEF) – M. Amaury de Buchet, représentant du MEDEF au CNESER, M. Patrick Schmitt, directeur de la Recherche et de l’Innovation et M. Matthieu Pineda, chargé de mission à la Direction des Affaires Publiques
– Confédération générale du Travail – M. Jean-Luc Antonucci, secrétaire général de la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture (FERC) SUP CGT, et M. Vincent Martin, enseignant-chercheur, membre du bureau de la FERC SUP CGT
– Confédération française des travailleurs CFDT – Mme Patricia Blancard, secrétaire générale adjointe à la Fédération CFDT Cadres
– Confédération générale des cadres (CGC) – Mme Dominique Jeuffrault, déléguée nationale au secteur Emploi et Formation, et M. Samir Bouzbouz, membre du bureau du Syndicat national indépendant de la recherche scientifique-CGC
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – Mme Sophie Larivet, enseignant-chercheur
Ø Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – M. Joël Bertrand, directeur général délégué à la science, M. Christophe Coudroy, directeur des ressources humaines, et Mme Hélène Lebas, responsable du service développement personnel des chercheurs
Ø Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – Mme Simone Bonnafous, directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle
Ø Association nationale pour la recherche et la technologie (ANRT) – M. Denis Randet, délégué général, et Mme Clarisse Angelier, chef du service CIFRE
Ø Association Bernard Gregory (ABG-Intelli’agence) – Mme Mélanie Ribas, directrice générale adjointe, et M. Vincent Mignotte, directeur
Ø Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) – M. Christian Lerminiaux, président, et M. Armel de La Bourdonnaye, président de la commission recherche, directeur de l’École nationale des ponts et chaussées
Ø École doctorale Économie Panthéon Sorbonne (EPS) – Mme Dominique Guégan, directrice
Ø Table ronde réunissant les syndicats de l’enseignement supérieur :
– Syndicat général de l’éducation nationale-CFDT (SGEN-CFDT) – M. Yannick Bourlès, secrétaire général du Sgen-CFDT Recherche EPST, et M. Thierry Côme, élu au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
– Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture-Sup CGT – M. Jean-Luc Antonucci, secrétaire général, M. Michel Pierre (Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique-CGT) et M. Pascal Regnier (Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés-CGT)
– Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU) –Mme Heidi Charvin, M. Bruno Truchet, responsables du secteur Recherche
– Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU) – M. Jacques Fossey, membre du bureau national, et M. Christophe Blondel, trésorier national
– Sup’recherche UNSA – M. Stéphane Leymarie, secrétaire général adjoint et M. Jean-Georges Gasser, secrétaire national et membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
– SUPAUTONOME-Confédération syndicale de l’éducation nationale – M. Laurent Reverso, secrétaire général de SupAutonome-Droit, et M. Dominique Barjot, secrétaire général de SupAutonome-LSH
Ø Institut national des études territoriales de Strasbourg – M. Jean-Marc Legrand, directeur
Ø Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) – Mme Marie-Anne Lévêque, directrice générale, et M. Pierre Coural, chef de service
Ø Table ronde réunissant les associations étudiantes :
– Union nationale des étudiants de France (UNEF) – Mme Marthe Corpet, élue au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
– Confédération étudiante – M. Thibaut Sellier, directeur et trésorier
– Mouvement des étudiants (MET)-UNI – M. Jean-Rémi Costa, délégué national adjoint
– Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) – M. Julien Blanchet, président, et M. Charles Bozonnet, vice-président en charge des affaires académiques
Ø Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ) – Mme Isabelle Recotillet, chef du département « Entrées et évolutions dans la vie active », et M. Julien Calmand
Ø Commissariat général à la stratégie et à la prospective – M. Mohamed Harfi, chargé de mission
Ø École nationale d’administration – Mme Nathalie Loiseau, directrice
EFFECTIFS D’ÉTUDIANTS INSCRITS EN DOCTORAT
EN INSCRIPTION PRINCIPALE (TOUT NIVEAU)
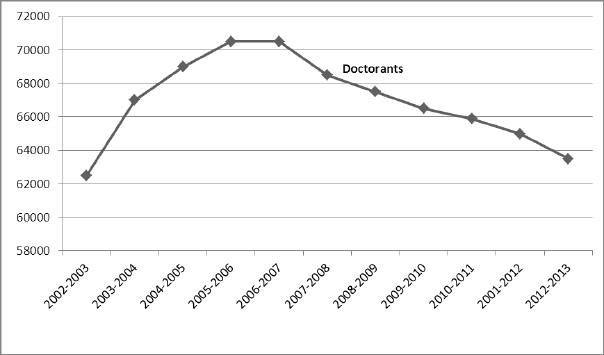
NOMBRE DE DOCTORATS DÉLIVRÉS
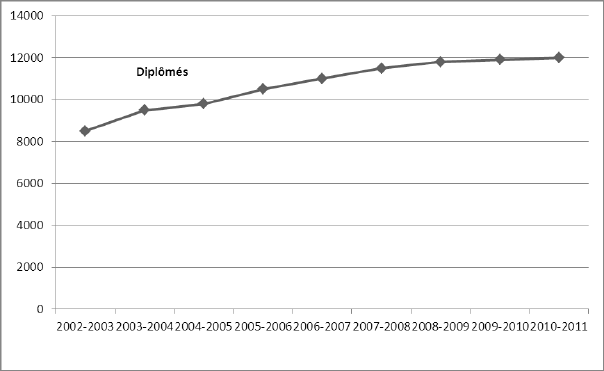
Source : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, septembre 2013.
NOMBRE DE DIPLÔMES DE DOCTORAT DÉLIVRÉS DANS LE MONDE EN 2000-2008
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
France |
9 903 |
10 404 |
10 404 |
8 420 |
8 420 |
9 578 |
9 818 |
10 650 |
11 309 |
Allemagne |
25 780 |
24 796 |
23 838 |
23 043 |
23 138 |
25 952 |
24 946 |
24 439 |
25 604 |
Chine |
11 383 |
12 465 |
14 638 |
18 806 |
23 446 |
27 677 |
36 247 |
41 464 |
43 759 |
Corée |
6 143 |
6 208 |
6 690 |
7 172 |
7 946 |
8 449 |
8 657 |
9 082 |
9 369 |
États-Unis |
44 947 |
45 068 |
44 311 |
46 177 |
48 560 |
52 855 |
56 309 |
60 887 |
61 716 |
Inde |
11 296 |
11 544 |
11 974 |
13 733 |
17 853 |
17 898 |
18 730 |
– |
– |
Japon |
15 357 |
16 078 |
16 183 |
16 314 |
16 909 |
16 851 |
17 396 |
17 291 |
– |
Royaume-Uni |
11 550 |
14 120 |
14 210 |
14 870 |
15 260 |
15 780 |
16 516 |
17 545 |
16 610 |
Russie |
27 667 |
22 638 |
26 387 |
28 361 |
29 850 |
34 300 |
34 613 |
34 494 |
27 719 |
Taïwan |
1 455 |
1 463 |
1 501 |
1 759 |
1 964 |
2 165 |
2 614 |
2 850 |
3 140 |
Source : Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 3 octobre 2012.
LE « DIFFÉRENTIEL » FRANCE-AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS
EN TERMES DE NOMBRE DE DOCTEURS
Nouveaux doctorats en sciences et ingénierie décernés en 2009 |
Nouveaux doctorats en lettres, droit, économie et sciences humaines décernés en 2009 | |
Source : OCDE sauf pour la Chine et l’Inde. Pour ces deux pays, l’OCDE fournit le rapport entre les nombres de doctorats des deux types. Pour tous les pays, ces chiffres incluent les doctorats obtenus par des étudiants étrangers | ||
Chine |
30 000 |
24 200 |
États-Unis |
23 400 |
44 500* |
Inde |
10 000 |
18 000 |
Allemagne |
9 400 |
16 200 |
Royaume-Uni |
7 800 |
9 900 |
France |
7 000 |
4 900 |
Japon |
6 400 |
10 200 |
Italie (2007) |
4 700 |
5 600 |
Corée |
3 400 |
6 600 |
Espagne |
3 200 |
4 800 |
Canada |
3 000 |
2 500 |
Australie |
2 300 |
3 500 |
(*) Ce chiffre varie dans les statistiques américaines selon que l’on inclut ou non des doctorats qui ne sont pas des « Phd » – par exemple les « Education Doctorates ».
Source : « Doctorats scientifiques : y a-t-il un retard français ? », M. François-Xavier Martin, Le Monde.fr du 14 septembre 2012.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE (CIFRE) ALLOUÉES PAR AN
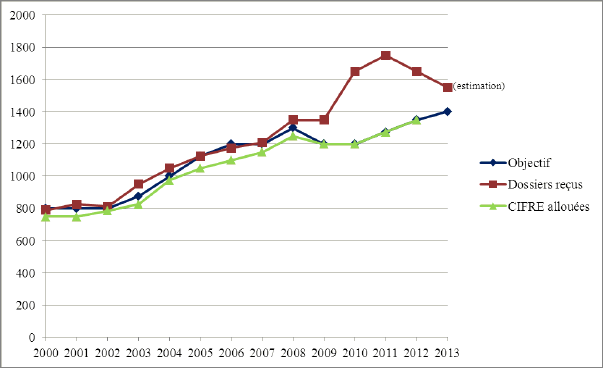
Source : Association nationale pour la recherche et la technologie, 19 septembre 2013.
RÉPARTITION DES DOCTORANTS PRIMO-ENTRANTS FINANCÉS PAR TYPE DE FINANCEMENT
2009-2010 |
2012-2013 |
Évolution 2009/2012 |
Répartition des diplômes en 2012-2013 | |
Contrats doctoraux MESR |
4 027 |
3 837 |
– 4,7 |
30,9 |
Conventions CIFRE |
1 203 |
1 225 |
1,8 |
9,9 |
Par organismes de recherche |
1 432 |
1 412 |
– 1,4 |
11,4 |
Par écoles |
353 |
307 |
– 13,0 |
2,5 |
Par autres ministères |
308 |
169 |
– 45,1 |
1,4 |
Par collectivités locales ou territoriales |
1 004 |
1 000 |
– 0,4 |
8,1 |
Par associations ou fondations |
315 |
350 |
11,1 |
2,8 |
Par entreprises (hors CIFRE) |
275 |
251 |
– 8,7 |
2,0 |
Par crédits ANR |
– |
342 |
– |
2,8 |
Par contrat de recherche |
1 198 |
840 |
– 29,9 |
6,8 |
Pour étrangers |
2 067 |
2 031 |
– 1,7 |
16,4 |
Autres financements |
579 |
641 |
10,7 |
5,2 |
Sous-total financés |
12 761 |
12 405 |
– 2,8 |
100 |
Source : ministère de l’enseignement et de la recherche, 19 septembre 2013.
L’ÉVOLUTION DE L’INSERTION DES DOCTEURS
(en euros)
Taux de chômage |
Emploi à durée limitée |
Salaire net mensuel médian |
||||||||||||||||
Trois ans plus tard |
2001 |
2004 |
2007 |
2010 |
2001 |
2004 |
2007 |
2010 |
2001 |
2004 |
2007 |
2010 | ||||||
Ensemble des docteurs |
7 % |
11 % |
10 % |
10 % |
19 % |
24 % |
27 % |
30 % |
1 960 |
1 980 |
2 000 |
2 020 | ||||||
– dont allocataires de recherche |
9 % |
6 % |
7 % |
23 % |
22 % |
32 % |
1 980 |
2 100 |
2 200 | |||||||||
– dont signataires convention CIFRE |
7 % |
7 % |
12 % |
14 % |
2 300 |
2 300 |
||||||||||||
Diplômes d’école d’ingénieurs |
2 % |
6 % |
4 % |
5 % |
6 % |
8 % |
8 % |
7 % |
2 110 |
2 100 |
2 150 |
2 270 | ||||||
Titulaire d’un master pro |
5 % |
11 % |
7 % |
12 % |
18 % |
23 % |
21 % |
24 % |
1 740 |
1 730 |
1 820 |
1 950 | ||||||
Source : Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), « Génération 98 » enquête menée en 2001 auprès de la génération sortie de formation initiale en 1998 ; « Génération 2001 » enquête de 2004 auprès de la génération 2001 ; « Génération 2004 » enquête de 2007 auprès de la génération 2004 ; « Génération 2007 » enquête de 2010 auprès de la génération 2007 (rapport provisoire de mai 2013 transmis par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche le 19 septembre 2013). Nota : convention CIFRE = convention industrielle de formation par la recherche.
INDICATEURS D’INSERTION DES DOCTEURS SELON LEUR DISCIPLINE
(en pourcentages)
Taux de chômage |
Emplois à durée déterminée |
Emploi dans le secteur public | |||||||||||||
1999 |
2001 |
2004 |
2007 |
2010 |
1999 |
2001 |
2004 |
2007 |
2010 |
1999 |
2001 |
2004 |
2007 |
2010 | |
Maths, physique |
5 |
5 |
7 |
8 |
3 |
21 |
14 |
21 |
22 |
25 |
58 |
43 |
69 |
61 |
72 |
Sciences de l’ingénieur |
2 |
2 |
6 |
6 |
8 |
12 |
7 |
13 |
13 |
16 |
50 |
36 |
49 |
42 |
45 |
Chimie |
14 |
10 |
14 |
16 |
13 |
28 |
26 |
30 |
40 |
30 |
40 |
51 |
52 |
56 |
57 |
SVT |
8 |
7 |
11 |
10 |
12 |
45 |
32 |
32 |
45 |
45 |
62 |
60 |
60 |
52 |
59 |
Droit, sciences économiques, gestion |
7 |
5 |
11 |
8 |
5 |
15 |
8 |
24 |
19 |
23 |
63 |
73 |
69 |
56 |
56 |
Lettres et sciences humaines |
6 |
20 |
17 |
11 |
13 |
24 |
29 |
22 |
30 |
32 |
84 |
68 |
74 |
75 |
84 |
Source : CEREQ, enquête «Enseignement supérieur 1997 et 1999 » ; « Génération 98 » enquête menée en 2001 auprès de la génération sortie de formation initiale en 1998 ; « Génération 2001 » enquête de 2004 auprès de la génération 2001 ; « Génération 2004 » enquête de 2007 auprès de la génération 2004 ; « Génération 2007 » enquête de 2010 auprès de la génération 2007 (rapport provisoire de mai 2013, transmis par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche le 19 septembre 2013).