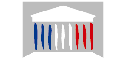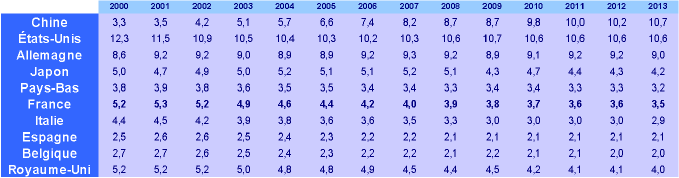______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2014
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2015 (n° 2234),
TOME VI
ÉCONOMIE
Commerce extÉrieur
PAR Mme SEYBAH DAGOMA
Députée
——
Voir le numéro 2260 (annexe n° 32).
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. UN COMMERCE EXTÉRIEUR EN REDRESSEMENT PROGRESSIF 9
A. UN SOLDE DE LA BALANCE DES BIENS EN AMÉLIORATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DÉPRIMÉ 9
B. UN EXCÉDENT DURABLE SUR LES ÉCHANGES DE SERVICES 11
C. UN COMMERCE EXTÉRIEUR QUI CONTINUE À CONTRIBUER À LA CROISSANCE 12
II. MAIS DES FAIBLESSES STRUCTURELLES QUI DEMEURENT 13
1. La compétitivité prix, un enjeu déterminant, mais qui ne doit pas être surestimé 16
a. Une compétitivité prix qui se redresse depuis la crise financière de 2008 17
b. Les termes du débat sur l’impact des mesures générales de compétitivité coût pour nos exportateurs 18
2. L’enjeu central de la compétitivité hors prix 21
3. L’enjeu de l’insertion dans les chaînes de valeur mondiales 24
4. Trop peu d’entreprises exportatrices ? 28
C. UNE ORIENTATION GÉOGRAPHIQUE ENCORE « EUROCENTRÉE » 30
III. LA POURSUITE DE L’ADAPTATION DU DISPOSITIF PUBLIC DE SOUTIEN 35
A. UNE NOUVELLE ARCHITECTURE GOUVERNEMENTALE ET ADMINISTRATIVE 35
1. Les nouvelles compétences rattachées au ministère des affaires étrangères et du développement international 35
2. Des conséquences limitées sur l’organisation administrative 36
a. Les dispositions du décret d’attribution 36
b. Une modification limitée de la nomenclature budgétaire 36
c. Une volonté de clarifier les missions des services 36
3. L’affirmation de la « diplomatie économique » 37
a. La création de la direction des entreprises et de l’économie internationale 38
b. L’affirmation de la mission « économique » des ambassades 38
c. Le recours à des personnalités pour des missions spécifiquement économiques 40
B. LA RÉVISION DES PRIORITÉS DE LA POLITIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 40
1. La priorité au tourisme 42
2. Les industries culturelles et créatives, une priorité pour demain ? 44
a. Des activités au poids économique très significatif 44
b. Un potentiel remarquable à l’exportation 45
c. Mais des exportations souvent encore concentrées sur quelques marchés traditionnels 46
d. Un secteur déjà organisé collectivement 47
e. Mais un écosystème encore insuffisamment tourné vers l’international 48
f. Les enjeux pour demain : la présence sur tous les supports et la capacité à communiquer sur notre « modèle » 48
C. LES RÉSEAUX À L’ÉTRANGER : UNE MISE EN COHÉRENCE QUI SE POURSUIT 49
1. Vers le nouvel opérateur Ubifrance-AFII 49
a. Les enjeux de la mise en œuvre de la fusion 50
b. La question de la concurrence avec les opérateurs privés 52
c. La poursuite du redéploiement géographique du réseau 53
d. L’action ciblée sur les entreprises de taille intermédiaire de croissance 54
2. La recherche de complémentarités entre les différents opérateurs 54
a. Le rôle des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international 54
b. La convention entre Ubifrance et ERAI 57
c. Les « maisons de l’international » 58
3. Les conseillers du commerce extérieur de la France : vers un réseau rajeuni, féminisé et mieux coordonné avec l’action publique 59
4. Une réussite du programme VIE ? 60
D. LA COORDINATION DANS LES TERRITOIRES 60
1. Le rôle des régions 60
2. Le réseau des chambres de commerce et d’industrie 61
3. Le label « Bpifrance Export » 62
4. La mobilisation des pôles de compétitivité 63
E. LA POURSUITE DE L’ADAPTATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 63
1. Les nouveaux outils de la Banque publique d’investissement 63
2. L’évolution des garanties publiques gérées par la Coface 64
a. L’extension de plusieurs garanties, notamment pour favoriser les grands contrats dans l’aéronautique et la construction navale 65
b. Le recentrage de l’assurance prospection 66
3. Les réformes envisagées à court terme 66
IV. L’EFFORT DE COHÉRENCE ET DE LISIBILITÉ DOIT ÊTRE POURSUIVI 69
A. SE DOTER ENFIN D’UNE POLITIQUE D’IMAGE DE LA FRANCE 69
1. L’insuffisance de la communication institutionnelle internationale française 69
2. Les leçons des expériences étrangères 70
B. PRENDRE EN COMPTE LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE EN LIGNE 74
C. ACCENTUER LE REDÉPLOIEMENT GÉOGRAPHIQUE DE NOS RÉSEAUX DE SOUTIEN 74
1. Une politique volontariste depuis deux ans 75
2. Des réseaux dont la reconfiguration ne fait que commencer 76
D. INSTITUER UNE PRIORITÉ BUDGÉTAIRE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR ? 79
1. Le choix fait au Royaume-Uni 79
2. La dépense publique pour le commerce extérieur, un investissement public qui s’autofinance ? 81
E. TIRER TOUTES LES CONSÉQUENCES DE LA NOUVELLE ARCHITECTURE GOUVERNEMENTALE 85
1. Donner enfin une visibilité budgétaire au commerce extérieur 85
2. Rendre l’organisation administrative plus cohérente avec l’architecture gouvernementale 88
3. Poursuivre la mise en cohérence des opérateurs 88
a. La question des opérateurs spécialisés 89
b. L’équilibre entre la nouvelle agence et le réseau consulaire 89
c. L’équilibre entre la nouvelle agence et les opérateurs privés 90
d. Le rôle des régions 90
4. Clarifier la présentation de la balance commerciale 90
Mesdames, Messieurs,
Depuis trois ans, le solde extérieur de la France s’améliore régulièrement : après un déficit record en 2011, à 74 milliards d’euros pour la balance des biens, ce déficit est revenu à 67 milliards d’euros en 2012, puis 61 milliards d’euros en 2013. L’année 2014 devrait encore voir une évolution favorable, quoique plus limitée, du solde commercial et, en 2015, il pourrait revenir en deçà de 50 milliards d’euros. C’est du moins la prévision faite très récemment, en octobre 2014, par l’entreprise d’assurance crédit Euler-Hermes. Cette prévision conforte celles du projet de loi de finances : le commerce extérieur devrait en 2015 contribuer positivement à la croissance française.
Ces résultats sont à saluer. Mais le retour à l’équilibre demandera encore de sérieux efforts, après une décennie de dégradation continue de notre commerce extérieur jusqu’en 2011, une décennie où les parts de marché françaises à l’export ont considérablement reculé, non seulement face aux économies émergentes comme la Chine, ce qui était inéluctable, mais aussi face à de grandes économies matures comme l’Allemagne et les États-Unis.
Le Gouvernement a engagé depuis 2012 une politique vigoureuse pour rétablir la compétitivité de la France. Les mesures d’allégement des charges des entreprises, comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, contribuent au rétablissement de notre solde extérieur, même si le débat sur leur ciblage insuffisant sur les entreprises les plus exposées à la concurrence internationale, et plus globalement le débat sur les impacts respectifs de la compétitivité par les coûts et les prix et de la compétitivité hors prix ne doivent pas être éludés.
Le Gouvernement œuvre aussi pour que notre dispositif de soutien à l’internationalisation des entreprises soit plus professionnel et plus cohérent. Deux décisions très importantes ont été prises dans les derniers mois : le rattachement des politiques du commerce extérieur et du tourisme au ministère des affaires étrangères, devenu ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI) ; la fusion des opérateurs Ubifrance et Agence française pour les investissements internationaux (AFII). Une nouvelle priorité sectorielle a également été dégagée pour notre politique de développement économique : le tourisme.
Mais ce mouvement de réforme ne peut pas être considéré comme achevé.
En premier lieu, votre rapporteure considère que toutes les conséquences de la nouvelle architecture gouvernementale n’ont pas été tirées. Ainsi que le montre le rattachement du présent avis « Commerce extérieur » à la mission « Économie », la nomenclature budgétaire n’a pas encore été mise en adéquation avec les nouvelles compétences ministérielles. S’agissant des administrations centrales, l’essentiel des compétences en matière de commerce extérieur, d’attractivité et de tourisme restent concentrées au ministère de l’économie, mais un service chargé de la diplomatie économique a aussi été constitué au Quai d’Orsay ; l’équilibre entre ces administrations est appelé à évoluer. Au niveau des opérateurs, la fusion entre Ubifrance et l’AFII est un premier pas, mais l’effort de fédération des énergies, à défaut peut-être de fusion, pourrait aussi concerner d’autres acteurs, tels que les opérateurs spécialisés qui soutiennent nos exportations agricoles et culturelles. Le débat sur l’équilibre entre la politique nationale et les initiatives des conseils régionaux n’est pas non plus clos.
De même, la mission de préfiguration de la « Marque France » menée en 2013 n’a pour le moment pas reçu de débouché concret. Or, une politique de construction et de valorisation à l’international de l’image de notre pays est plus que jamais nécessaire. L’expérience de pays tels que la Suède et le Royaume-Uni, qui ont pris de l’avance dans ce domaine, permet de dégager quelques conditions essentielles de la réussite d’une telle action : l’octroi d’un budget significatif, se comptant en dizaines de millions d’euros ; une impulsion politique forte et une gestion interministérielle, afin d’associer toutes les administrations à une politique qui ne concerne pas que le champ économique ; la mobilisation d’autres acteurs, notamment des artistes et des entreprises ; le recours à une communication multilingue et multisupports.
Par ailleurs, les différents réseaux qui concourent au rayonnement économique de la France (ceux d’Ubifrance-AFII, d’Atout France, des services économiques des ambassades, des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international et des conseillers du commerce extérieur de la France) restent insuffisamment déployés là où sont les opportunités de demain : entre le quart et la moitié de leurs effectifs à l’étranger restent à ce jour localisés en Europe ou en Amérique du Nord, alors même que dans les prochaines années, la croissance – donc les nouveaux marchés – sera concentrée aux deux tiers dans les économies émergentes et en développement.
Enfin, même si le contexte général ne s’y prête guère, votre rapporteure s’interroge sur l’opportunité qu’il y aurait à donner une véritable priorité budgétaire aux actions de rayonnement économique international. Malgré un déficit public nettement plus élevé que le nôtre, nos voisins britanniques ont fait ce choix en augmentant massivement les moyens de leur opérateur public UKTI, qui sont supérieurs de moitié à ceux de la future agence issue de la fusion Ubifrance-AFII, pour un périmètre de missions identique. Des études économétriques sur le surplus d’exportations généré par les soutiens publics existants montrent qu’un euro d’argent public peut engendrer cinq à douze euros d’exportations supplémentaires, donc par effet induit des ressources fiscales et sociales qui couvrent largement la dépense initiale. De plus, on constate que, d’ores et déjà, les coûts budgétaires des politiques de soutien étatique à nos exportateurs sont en fait équilibrés par les bénéfices que produit un créneau particulier de cette politique, qui est le régime public d’assurance crédit géré par la Coface pour le compte de l’État. Actuellement, en net, la politique du commerce extérieur ne coûte rien à l’État. Ces observations peuvent justifier une réflexion sur le calibrage de ces moyens.
L’année 2013 a vu la poursuite du redressement de notre solde commercial qui est engagé depuis deux ans.
S’agissant de la balance des biens, après le déficit record de 2011, qui atteignait 74 milliards d’euros, on est revenu à 67 milliards d’euros en 2012, puis à 61 milliards en 2013. Hors énergie et matériel militaire, le déficit a sur la même période été réduit de plus de 53 %, passant de 29 milliards d’euros à 13,5 milliards.
Évolution des flux et soldes commerciaux globaux et hors-énergie
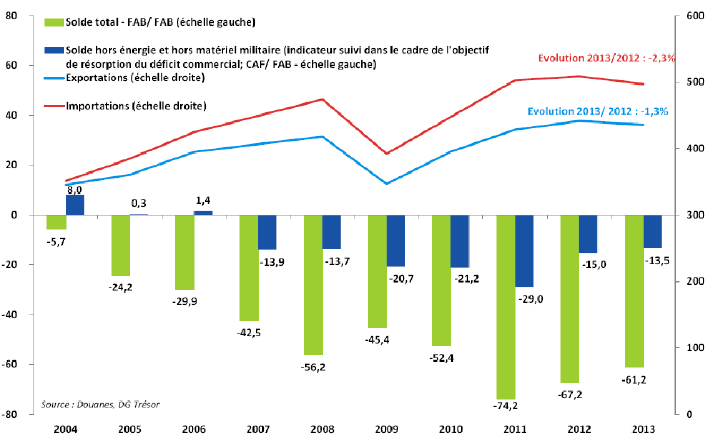
Source : « Résultats du commerce extérieur en 2013 », ministère du commerce extérieur, 7 février 2014.
Les données les plus récentes, couvrant la période allant de juillet 2013 à juin 2014, montrent une poursuite de l’amélioration du solde commercial : sur ces douze mois, le déficit se réduit encore de 1,5 milliard d’euros par rapport au chiffre de l’année civile 2013.
Il faut toutefois admettre que l’amélioration de notre solde commercial recouvre des évolutions parfois inquiétantes, car elles confirment l’atonie générale, voire les risques de déflation :
● Cette amélioration résulte principalement d’une réduction de la facture énergétique, passée de 69 milliards d’euros à 65,6 milliards dans un contexte de baisse des cours internationaux du pétrole – qui sont exprimés en dollars – dont l’effet est renforcé par l’appréciation de l’euro, comme on le voit sur le graphique ci-après.
Évolution de la facture énergétique
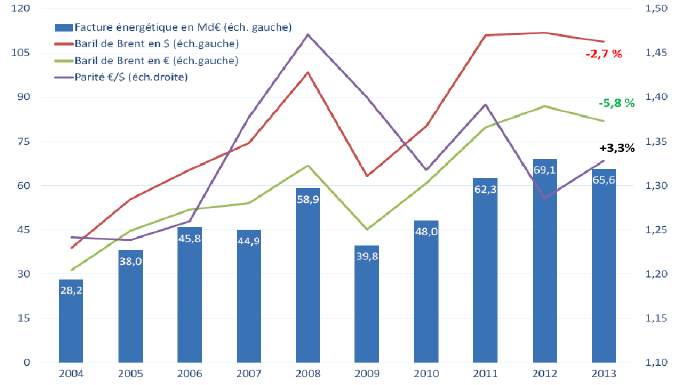
Source : « Résultats du commerce extérieur en 2013 », ministère du commerce extérieur, 7 février 2014.
● Plus généralement, l’amélioration constatée est la résultante tout à la fois d’une baisse, en valeur, de nos importations et de nos exportations : en 2013, par rapport à l’année précédente, les premières ont diminué de 2,3 % et les secondes de 1,3 % ; la baisse en valeur étant plus forte pour les importations que pour les exportations, le solde s’améliore. Cette baisse particulièrement notable sur la valeur de nos importations s’explique principalement par la baisse des prix du pétrole. Cela dit, même en volume, donc hors variation des prix, l’évolution de nos flux commerciaux a été médiocre, ce qui rend compte du climat économique général déprimé de l’Europe.
Les données disponibles pour le premier semestre 2014 ne marquent pas de véritable changement : les exportations ont continué de se replier pour le 3ème semestre consécutif, avec notamment un recul très prononcé pour les ventes de produits pharmaceutiques et de produits agricoles, partiellement compensé par une progression des livraisons aéronautiques et spatiales et une reprise des ventes d’automobiles. Les importations restent également en baisse, en particulier du fait de l’évolution des achats d’hydrocarbures.
Il faut également prendre en compte les échanges de services, dont l’excédent est en constante augmentation depuis 2006.
Cependant, selon les données de la Banque de France (1), l’année dernière s’est caractérisée par un repli de cet excédent, passé de 24,7 milliards d’euros en 2012 à 18,3 milliards en 2013, soit un niveau proche de celui de 2010. La dégradation, observe la Banque de France, est due pour l’essentiel aux commissions pour usage de propriété intellectuelle (recettes en baisse de 2,1 milliards d’euros), aux services de télécommunication, d’informatique et d’information (– 1,6 milliard) et aux services de transport (solde se dégradant de 1,4 milliard). S’agissant des commissions pour usage de la propriété intellectuelle, l’origine de la dégradation provient pour partie de l’expiration de redevances et licences du secteur pharmaceutique, sans que des innovations aient pris le relais. Ce point nous rappelle le lien direct qui existe entre l’intensité de l’effort de recherche et d’innovation et le solde extérieur, à travers la question des flux de rémunération des brevets (s’y ajoutant bien sûr les effets indirects de compétitivité).
Plus généralement, les échanges de biens et de services constituent des éléments de la balance des transactions courantes. Le solde des transactions courantes de la France a été déficitaire de 30,3 milliards d’euros en 2013, après 31,8 milliards en 2012. Cette légère amélioration est la résultante de celle de la balance des biens, malgré la dégradation d’autres soldes dont celui des services.
Il convient enfin de signaler deux autres soldes significatifs de la balance courante, car ils montrent l’incidence directe sur notre équilibre extérieur de certaines caractéristiques de notre économie :
– le solde des revenus d’investissements directs est resté en 2013 très positif, à 34,2 milliards d’euros. Cet excédent découle pour l’essentiel du fait que les capitaux français investis à l’étranger sont (en stock) deux fois plus importants que les capitaux étrangers investis en France : la politique massive d’investissement à l’étranger de nos grandes entreprises, souvent critiquée par ailleurs, a au moins le mérite de contribuer à notre équilibre courant ;
– le déficit sur les revenus d’investissements de portefeuille a représenté 17,2 milliards s’euros : ce déficit est notamment lié au niveau de la dette publique détenue par des étrangers.
La croissance économique globale, mesurée par l’évolution du produit intérieur brut (PIB), peut être décomposée en plusieurs facteurs : la consommation ; l’investissement ; la variation des stocks ; enfin, l’évolution des échanges extérieurs. En effet, si par exemple la consommation est atone, un surcroît d’exportations pourra représenter un débouché pour une production nationale qui, de ce fait, restera bien orientée ; a contrario, si c’est l’augmentation des importations qui couvre les surplus de consommation ou d’investissement, la croissance sera nulle. L’évolution en volume des flux commerciaux, importations et exportations, permet donc de déterminer une contribution globale des échanges extérieurs à la croissance du PIB.
Comme on le voit sur le tableau ci-après, cette contribution, très positive en 2012 – c’est le solde extérieur qui nous a évité la récession –, est beaucoup plus faible en 2013 et, selon les prévisions, en 2014 et 2015. Elle reste toutefois positive grâce à l’optimisme raisonnable que l’on peut avoir sur l’évolution du commerce international. On peut parier sur une accélération de la demande mondiale (+ 5,1 % en 2015, après + 3,8 % 2014) qui soutiendrait la croissance de nos exportations (+ 4,6 % en 2015, après + 2,8 % en 2014). Ces exportations étant plus dynamiques que les importations, les échanges internationaux devraient contribuer positivement à notre PIB.
Contribution du commerce extérieur à l'évolution du produit intérieur brut en volume aux prix de l’année précédente
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Solde extérieur des biens et services (contribution à la croissance du PIB en points) |
- 0,3 |
- 0,3 |
- 0,1 |
0,0 |
0,7 |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
Dont : |
|
|||||||
– Exportations (contribution) |
0,1 |
-3,1 |
2,2 |
1,8 |
0,3 |
0,6 |
0,8 |
1,3 |
– Importations (contribution) |
- 0,4 |
2,7 |
- 2,3 |
- 1,8 |
0,4 |
-0,5 |
-0,8 |
- 1,1 |
Produit intérieur brut (taux de croissance) |
0,2 |
- 2,9 |
2,0 |
2,1 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
1,0 |
Source : INSEE et, pour les prévisions 2014 et 2015, documents budgétaires (Rapport économique, social et financier 2015).
Il faut d’ailleurs observer que d’autres sources confirment les prévisions du Gouvernement : selon le « Baromètre Export » d’Euler-Hermes publié en octobre 2014 (2), l’année 2015 pourrait voir nos exportations augmenter de 30 milliards d’euros ; le déficit commercial continuerait à se réduire pour revenir, sur la balance des biens, à un peu moins de 50 milliards d’euros.
Depuis deux ans, notre solde commercial se redresse, mais, on l’a vu, ce redressement est progressif. C’est que notre pays a connu précédemment une décennie de dégradation de ses échanges extérieurs, qui est en quelque sorte une décennie perdue pour notre bonne insertion dans les chaînes de valeur mondiales et pour notre compétitivité. Cette dégradation sur le moyen terme met en lumière des faiblesses structurelles de notre appareil exportateur et plus généralement de notre économie. L’action de redressement devra donc s’inscrire dans la durée.
De 2003, dernière année d’équilibre, à 2011, année de déficit record, le solde commercial de la France s’est enfoncé dans le rouge avec régularité, si l’on excepte une brève rémission en 2009, année où la crise mondiale a entraîné une forte restriction des échanges dans laquelle la contraction de nos importations a été plus forte que celle de nos exportations, ceci amenant une amélioration temporaire du solde. Le graphique ci-dessous montre bien cette évolution, stoppée depuis deux ans seulement.
Évolution du solde des biens
(FAB/FAB, y compris matériel militaire)
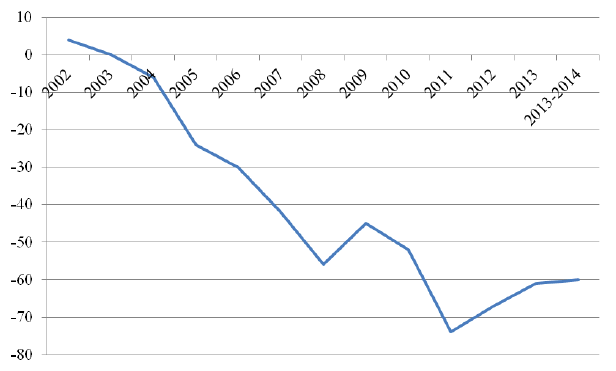
Source : Gouvernement (questionnaire budgétaire).
NB : l’étiquette « 2013-2014 » correspond à la période juillet2013-juin 2014.
Le graphique ci-après permet d’observer visuellement, dans nos importations, comme nos exportations :
– d’une part la dérive des années 2003-2008, avec une croissance des importations constamment plus rapide que celle des exportations ;
– le « creux » dû en 2009 à la crise financière, suivi en 2010-2011 d’un rattrapage ;
– les conditions du redressement du solde commercial depuis deux ans, lié à un fort ralentissement, voire en 2013 une diminution des flux.
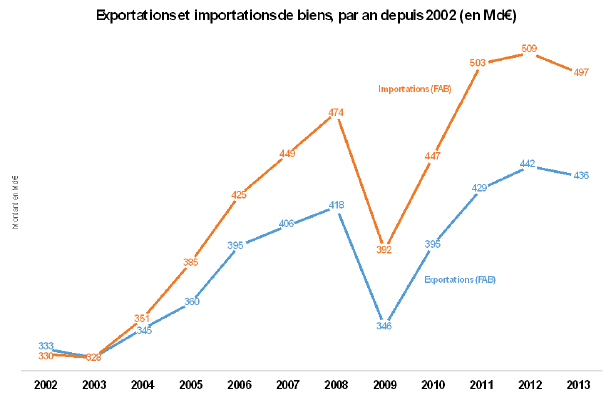
Source : douanes.
Le suivi des parts de marché de nos exportateurs au niveau mondial constitue un autre indicateur pertinent de notre capacité à rester compétitifs sur le moyen terme. Le tableau ci-après montre le déclin relatif de la part de marché mondiale de la France dans la décennie 2000 : en volume (ce qui neutralise les effets de prix et de taux de change), cette part a baissé de 5,3 % en 2001 à 3,5 % en 2013. On observe que ce recul a été rapide dans les années 2000 et que depuis 2011, il s’est ralenti ; on irait donc vers une stabilisation.
Dans la même période, parmi les grands pays exportateurs, c’est évidemment la Chine qui a fortement progressé (avec une part de marché mondiale qui a triplé depuis 2000 et dépasse désormais 10 %), aux dépens d’à peu près tous les grands pays occidentaux. On note cependant la capacité de résistance de l’Allemagne, qui parvient à conserver une part de marché voisine de 9 % sur toute la période, mais aussi des États-Unis, dont la part de marché fluctue entre 10 % et 11 % depuis 2002. Des pays européens tels que le Royaume-Uni, l’Espagne et les Pays-Bas ont également connu des reculs relatifs de leur part de marché, mais moindres que celui de la France. Parmi les grands exportateurs, seule l’Italie a connu un recul comparable à celui de la France.
Parts de marché mondiales en volume (exportations en volume de biens et services du pays rapportées aux exportations mondiales) |
|
Sources : OCDE, Perspectives économiques 95, calculs DG-Trésor. |
La montée en puissance des émergents, en particulier de la Chine, est un phénomène de fond qui a pour effet que, de toute façon, la part que représentent les pays développés « traditionnels », les économies matures, dans le commerce mondial et plus généralement l’économie mondiale est nécessairement en recul. Nos vrais concurrents sur le marché mondial, ce sont ces autres économies matures. Le tableau qui suit permet une comparaison des parts de marché centrée sur les pays de l’OCDE : il s’agit de voir comment évoluent les parts des uns et des autres non pas dans le total des exportations mondiales, mais dans le total de celles faites par les pays de l’OCDE.
Parts de marché relatives en volume vis-à-vis des partenaires OCDE
Exportations de biens et services du pays rapportées à celles d’un groupe de 24 pays de l’OCDE, calculées en volume (en déflatant la valeur des exportations par un indice de prix d’exportation, se rapportant à une année de base)

Sources : OCDE, calculs DG Trésor.
On voit clairement, sur ce tableau :
– le renforcement progressif de la position de l’Allemagne, passée de 2000 à 2013 de moins de 14 % à près de 17 % de part dans le total des exportations des pays de l’OCDE ;
– la stabilité relative, à moyen terme, des positions des États-Unis, du Japon et de l’Espagne ;
– le recul modéré du Royaume-Uni ;
– le recul plus net de la France et de l’Italie.
Il est à noter que le recul de la part de marché de la France dans le total OCDE a été particulièrement rapide de 2002 à 2008 (part passée de 8,1 % à 6,6 %), avant une relative stabilisation.
On a donc bien assisté depuis le début des années 2000 et, en particulier, entre 2002 et 2008, à une dégradation très nette des positions françaises dans le commerce international.
Inscrite dans le moyen terme, la dégradation du commerce extérieur français dans la décennie qui a précédé 2012 rend compte d’un problème structurel, donc un problème de compétitivité.
Ce constat conduit à s’interroger sur la nature de ce problème de compétitivité, au regard notamment du débat sur l’impact des mesures d’allégement des coûts des entreprises sur nos échanges extérieurs.
On distingue traditionnellement la compétitivité prix et la compétitivité hors prix, laquelle renvoie à des déterminants difficiles à quantifier : qualité des produits, innovation, adaptation de l’appareil productif à la demande internationale…
Certains faits conduisent à porter une appréciation nuancée sur les enjeux qui s’attachent à la compétitivité prix.
À court terme, elle peut sans doute apporter des gains substantiels : selon l’analyse du « Baromètre Export » précité d’Euler-Hermes publié en octobre 2014, les 30 milliards d’euros d’exportations supplémentaires potentielles anticipées en 2015 reposent notamment sur l’hypothèse du maintien d’un euro « faible » face au dollar (comme il l’est actuellement) : sur ce montant d’exportations additionnelles, plus de 10 milliards seraient permis par ce facteur de compétitivité prix. Le même document met également en avant l’impact positif sur les coûts des entreprises des mesures d’allégement de leurs charges, comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
D’autres éléments, plutôt sur le moyen terme, montrent cependant les limites des politiques centrées sur la seule compétitivité prix pour redresser notre commerce extérieur.
L’évolution de la compétitivité prix est déterminée par plusieurs facteurs : les coûts des entreprises, dont celui du travail (mais pas seulement) ; l’effort de marge des entreprises (c’est-dire-la compression ou non de leurs marges qu’elles acceptent pour exporter) ; l’évolution des taux de change ; le différentiel d’inflation entre les pays (la composition des taux de change nominaux avec l’inflation permettant de déterminer des « taux de change effectifs réels »).
Effectivement, au début des années 2000, la forte appréciation de l’euro dans la période qui a précédé la crise de 2008 a fortement dégradé la compétitivité prix française.
Mais, depuis 2008, comme on le voit sur le tableau ci-après, la compétitivité prix de la France s’est plutôt améliorée (+ 3,2 % au 1er semestre 2014 par rapport à 2008) et cette amélioration est très voisine de celle connue par notre principal partenaire et concurrent, l’Allemagne (+ 3,4 %). Dans le même temps, l’évolution a été moins favorable dans les pays d’Europe du sud, tandis que les États-Unis et dans une certaine mesure le Royaume-Uni ont perdu en compétitivité prix.
Évolution de la compétitivité prix
(base 100 en 2008)
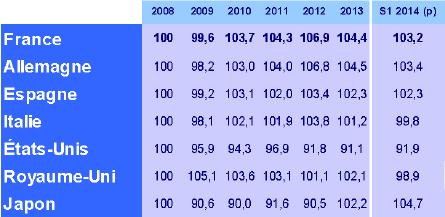
Sources : OCDE, calculs DG Trésor.
Ces mouvements sont dus principalement aux fluctuations monétaires : au 1er semestre 2014, le taux de change effectif réel de la France s’était déprécié de 4,1 % par rapport à son niveau moyen de 2008. Cette baisse en termes réels reflète avant tout les mouvements à la baisse de l’euro par rapport à son plus haut avec le dollar, mais également une moindre progression relative des prix à la consommation en France que chez la moyenne de ses concurrents : les évolutions moins favorables de la compétitivité prix en Espagne et en Italie, pourtant également membres de la zone euro, s’expliquent notamment par une inflation plus élevée.
L’amélioration de la compétitivité prix française depuis 2008 est supérieure à celle de la compétitivité coût, comme on le voit sur le tableau ci-dessous, ce qui rend aussi compte d’un effort de marge relativement plus important de la part des entreprises exportatrices françaises.
On observe sur le même tableau qu’un pays tel que l’Espagne a pu connaître une très forte augmentation de sa compétitivité coût (presque + 20 % sur 2008-2014), du fait de la réduction drastique des salaires moyens consécutive à la crise financière, sans que cela ne se retrouve au final dans l’évolution de sa compétitivité prix : les autres facteurs que sont l’effort de marge et le différentiel d’inflation apparaissent tout aussi déterminants que les coûts.
Évolution de la compétitivité coût
(base 100 en 2008)

Sources : OCDE, calculs DG Trésor.
En fin de compte, ces données éclairent le débat sur le rôle de la compétitivité prix en le relativisant : après une période de dégradation, la compétitivité prix de la France a connu depuis la crise financière une évolution plus favorable que celle de la plupart de ses concurrents. Pour autant, le rétablissement de son commerce extérieur n’est qu’à peine engagé depuis deux ans.
b. Les termes du débat sur l’impact des mesures générales de compétitivité coût pour nos exportateurs
Le débat sur l’importance de la compétitivité prix est lié à celui sur les mesures d’allégement des coûts des entreprises, en particulier des coûts salariaux : quel est l’impact de telles mesures sur notre compétitivité globale et, plus spécifiquement, sur la compétitivité prix de nos exportateurs ? Cette question se pose aussi bien pour les allégements généraux de charges sociales sur les bas salaires progressivement mis en place depuis deux décennies que pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), ou encore les décisions du Pacte de responsabilité et de solidarité qui vont s’appliquer en 2015 (nouvel allégement de cotisations sociales sur les bas salaires, allégement de cotisations des indépendants, suppression graduelle de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dite C3S…).
S’agissant du CICE, la controverse a été nourrie par les données d’évaluation présentées dans le premier rapport (présenté en 2013) du comité de suivi du dispositif (3). Celui-ci fait en effet un constat simple : statistiquement, les entreprises exportatrices bénéficient moins du CICE que les autres : « pour l’ensemble des entreprises exportatrices, la part de la masse salariale entrant dans le champ du CICE est moindre (58 %) que pour les entreprises non exportatrices (79 %) ».
Part de la masse salariale couverte par le CICE selon le statut des entreprises par rapport à l’exportation
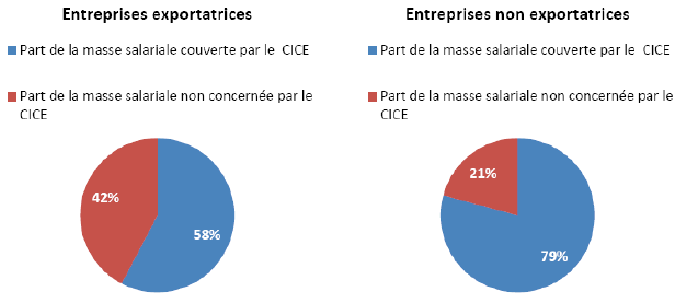
Source : Commissariat général à la stratégie et à la prospective – Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, Rapport 2013, octobre 2013.
On peut ajouter que plus les entreprises exportent, moins elles bénéficient du CICE : comme on le voit sur le graphique ci-après, la part de la masse salariale qui est hors CICE passe de 42 % à 48 % si on prend en compte non pas tous les exportateurs, mais seulement ceux dont l’export représente plus de 5 % du chiffre d’affaires, et même à 54 % pour ceux dont l’export représente plus de 35 % du chiffre d’affaires.
Part de la masse salariale couverte par le CICE selon le statut des entreprises par rapport à l’exportation
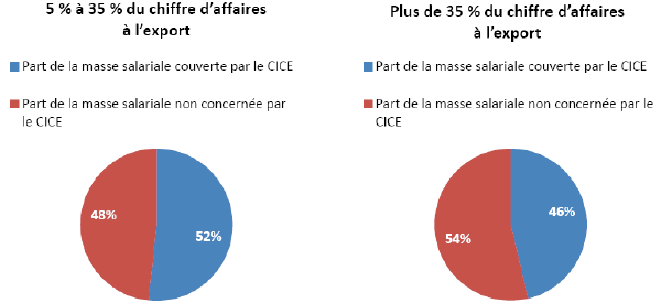
Source : Commissariat général à la stratégie et à la prospective – Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, Rapport 2013, octobre 2013.
Globalement, il apparaît que l’ensemble des entreprises exportatrices devraient recevoir 62 % de la dépense de CICE, mais celles réalisant au moins 5 % de leur chiffre d’affaires à l’export seulement 27 %.
Répartition des gains du CICE entre entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires à l’export
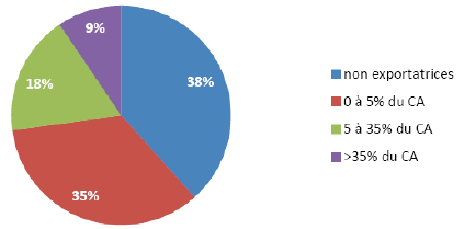
Source : Commissariat général à la stratégie et à la prospective – Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, Rapport 2013, octobre 2013.
Cette situation rend compte d’une réalité simple : plus grosses, plus productives, plus technologiques que la moyenne, les entreprises exportatrices versent des salaires généralement plus élevés, de sorte que les dispositifs ciblés sur les salaires modestes, CICE ou allégements de charges, leur profitent moins. On observe effectivement que l’écart de salaire moyen est de plus de 62 % entre les entreprises exportant plus de 35 % de leur chiffre d’affaires et les entreprises non exportatrices.
Le ciblage des aides sur les salaires modestes est justifié par l’analyse selon laquelle c’est surtout au niveau des rémunérations des moins qualifiés que la France aurait un problème de compétitivité et que se trouveraient des gisements d’emplois susceptibles d’être créés ou préservés par une politique d’allégement des coûts. Ce raisonnement est toutefois contesté par des chefs d’entreprise qui soulignent qu’il peut aussi y avoir un problème de compétitivité internationale sur le coût salarial de cadres. En tout état de cause, le constat est là : les dispositifs d’allégement des charges ciblés sur les salaires modestes profitent peu aux entreprises exportatrices.
On peut répondre à ces observations statistiques que la compétitivité coût de nos exportateurs ne tient pas seulement à leurs coûts propres : elle dépend aussi des prix pratiqués par leurs fournisseurs, donc des coûts de ceux-ci. Or, il existe un certain nombre d’entreprises qui, sans être elles-mêmes exportatrices, sont susceptibles de bénéficier à plein du CICE et dont les services sont orientés vers d’autres entreprises, lesquelles sont, quant à elles, éventuellement exportatrices. On peut penser en particulier aux activités de nettoyage, gardiennage, restauration collective, etc., qui sont maintenant presque systématiquement externalisées dans les entreprises industrielles. Ces activités emploient une main d’œuvre en général peu qualifiée et sont donc dans le cœur de cible du CICE. Or, les prix qu’elles peuvent pratiquer en fonction de leurs coûts, et donc des allégements tels que le CICE, influent sur la compétitivité prix de leurs clients.
Ce raisonnement peut difficilement être transposé à d’autres secteurs qui, eux aussi, bénéficient du CICE et sont majoritairement ou exclusivement tournés vers une clientèle particulière et non d’entreprise : grande distribution, banque de détail… Mais dans ce cas encore, des effets indirects de compétitivité prix à l’export sont envisageables. Par exemple, si l’application du CICE dans la grande distribution se traduit, toutes choses égales par ailleurs, par une modération des prix à la consommation (ce qui est vraisemblable car le secteur est très concurrentiel), cela concourt à la modération salariale dans l’ensemble de l’économie, entreprises exportatrices comprises. Cet effet, s’il existe, est en tout état de cause très indirect et incertain…
L’analyse de la seule compétitivité prix ne suffit donc pas à expliquer les difficultés du commerce extérieur français. Tout autant, voire plus que la compétitivité prix, c’est probablement la compétitivité hors prix qui s’est révélée insuffisante durant la décennie 2000.
Une analyse de la direction générale du Trésor (4) parvient à cette conclusion par une voie détournée : elle tend à montrer que c’est parce que la compétitivité prix reste assez importante pour la France que son commerce extérieur est en difficulté, tandis que des pays dont le commerce extérieur repose essentiellement sur des éléments de compétitivité hors prix sont moins menacés par les inévitables évolutions des coûts et des changes. Pour ce faite, l’étude s’efforce de quantifier le positionnement « hors prix » des économies avancées, en construisant un indicateur classant les pays selon le degré de sensibilité au prix de leurs exportations. Les résultats apparaissent sur le tableau ci-après.
Indice de sensibilité prix / positionnement hors prix des exportations
(moyenne 1998-2011)
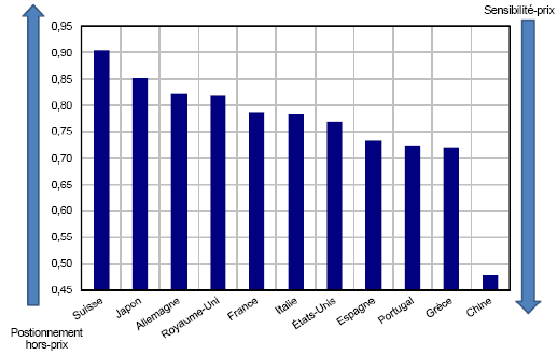
On le voit, le positionnement de la France est médian, tandis que les pays dont les performances à l’export sont les moins sensibles au prix sont les habituels « champions de l’export », Suisse, Japon et Allemagne. A contrario, l’autre champion de l’export qu’est la Chine a des exportations très sensibles au prix qu’elle peut offrir : ce pays a fondé son expansion commerciale sur ses faibles coûts et la sous-évaluation de sa monnaie. Dans l’entre-deux, plusieurs économies d’Europe du sud dont les exportations dépendent largement des prix qu’elles peuvent offrir sont celles qui ont connu de graves difficultés ces dernières années…
La conclusion est claire : il faut agir à la fois sur la composante coût et sur la composante hors prix, pour acquérir dans les créneaux où cette dernière est déterminante un avantage comparatif qui permet d’y avoir une position forte.
La Commission européenne met encore plus clairement en avant la question de la compétitivité hors prix, s’agissant de la France, dans les bilans par pays qu’elle produit au titre de la procédure de correction des déséquilibres macro-économiques (dans le cadre du « semestre européen ») : « la compétitivité hors prix est le principal facteur expliquant les mauvais résultats de la France en matière d’exportation ces dix dernières années (…). La perte de compétitivité hors prix de l’économie constitue la principale cause des mauvais résultats des exportations depuis 1999. Cette évolution s’expliquerait par la qualité des produits et par la capacité de certaines entreprises, et plus particulièrement des PME, à mener des activités d’exportation et à investir, notamment dans la recherche et le développement (…). La compétitivité hors prix (y compris des aspects tels que le climat pour les entreprises, la propension des entreprises françaises à exporter et innover) semble être le premier élément responsable des piètres résultats à l’exportation » (5).
Cela dit, observe aussi la Commission, il existe un lien entre compétitivité coûts et compétitivité hors coûts dans la mesure où l’insuffisance de la première, conduisant les entreprises à réduire leurs marges, aurait un impact négatif sur l’investissement et l’innovation, facteurs essentiels de la compétitivité hors coûts.
Des économistes tels que M. Philippe Askenazy vont encore plus loin en contestant même cet effet indirect des coûts. Cet auteur relève effectivement certains faits troublants : l’un concerne les dépenses de recherche et développement (R&D). On observe dans ce domaine une réduction de longue durée de l’effort des entreprises françaises, alors même que dans la plupart des autres pays de l’OCDE l’évolution a été inverse, comme on le voit sur le tableau ci-après.
Poids en % du PIB des dépenses intérieures en R&D des entreprises

Source : CEPREMAP, Document de travail (Docweb) n° 12.08, Un choc de compétitivité en baissant le coût du travail ? – Un scénario bancal qui évince des pistes alternatives, par Philippe Askenazy, octobre 2012.
Or, « le raisonnement selon lequel les entreprises ne disposent pas de marges de manœuvre financières suffisantes pour la R&D [a été] à la base d’une réforme du crédit d’impôt recherche (CIR) en 2008. Le dispositif fiscal français est désormais le plus généreux de l’ensemble des pays de l’OCDE (…). Or, les dépenses de R&D des entreprises privées en part du PIB n’ont que légèrement progressé de 2007 à 2010 et moins vite qu’en Allemagne et à peine dans la moyenne de la zone euro » (6).
M. Askenazy en conclut que l’on peut légitimement s’interroger sur l’impact des mesures de réduction des coûts (qu’il s’agisse de celui de la R&D dans ce cas ou du coût du travail avec par exemple le CICE) sur le comportement des entreprises, notamment sur leurs dépenses tournées vers l’avenir et donc la compétitivité hors prix. Il relève de même que la compression des marges des entreprises n’a pas empêché, même dans le contexte de l’après crise financière de 2008, une augmentation quasi-constante de leurs distributions de dividendes… L’impact des coûts, et donc des mesures d’aides qui les atténuent, sur le comportement des entreprises devrait donc être relativisé.
*
Une fois que l’on est parvenu à la conclusion selon laquelle la compétitivité hors prix est déterminante, il reste bien sûr à en analyser les composantes. Nombre de ces composantes sont celles qui font la compétitivité et l’attractivité générales d’un pays : qualité des infrastructures, qualité du système de formation, qualification de la main d’œuvre, système de recherche, capacité d’innovation des entreprises, simplicité et stabilité du cadre réglementaire, etc. Ce que sont à cet égard les points forts et les points faibles de la France apparaît bien dans toutes les enquêtes d’attractivité et il n’y a pas lieu d’y insister dans un rapport sur le commerce extérieur.
D’autres éléments concernent plus spécifiquement l’appareil productif et exportateur.
S’agissant de nos entreprises, une première interrogation porte sur leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.
On constate qu’au fil des années, la santé de notre commerce extérieur dépend de plus en plus de quelques secteurs d’excellence.
L’année 2013 ne dément pas cette tendance. D’un côté, l’excédent aéronautique continue à s’accroître et atteint un nouveau record, à 22 milliards d’euros. De même, nos positions dans la chimie, les cosmétiques et la pharmacie se renforcent encore. Enfin, l’excédent agroalimentaire reste élevé, étant rappelé que cet excédent repose sur quelques productions, en premier lieu les vins et spiritueux (10,3 milliards d’euros d’excédent en 2013 – la France contrôlant près de 22 % du marché mondial !), suivis des céréales, des produits laitiers (3,3 milliards d’euros d’excédent), des huiles et farines et des aliments pour animaux. Vins et spiritueux, céréales et produits laitiers représentent 45 % de nos exportations agroalimentaires.
De l’autre, certains soldes industriels continuent à se dégrader, notamment sur l’automobile et les biens d’équipement, où les déficits se creusent.
Les soldes par produit et leur évolution
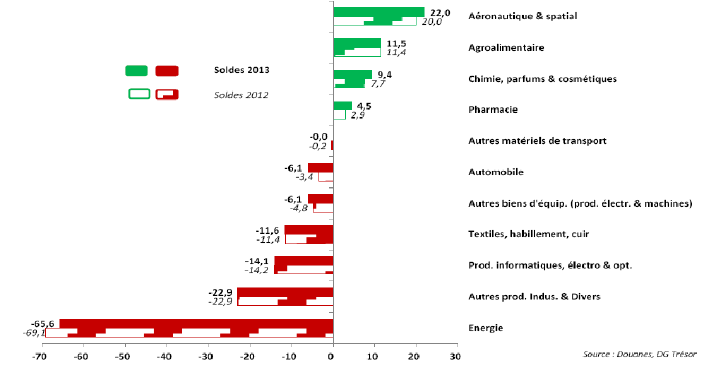
Source : « Résultats du commerce extérieur en 2013 », ministère du commerce extérieur, 7 février 2014.
Comme on peut le voir sur le graphique qui suit, qui montre l’évolution sur une décennie du poids relatif des différents secteurs dans nos exportations, les quatre « points forts » sur lesquels la France dégage un excédent croissant ont vu leur poids se renforcer sur le moyen terme :
– celui de l’aéronautique dans nos exportations est passé de 7,2 % à 11,9 % en neuf ans ;
– celui de l’agroalimentaire de 11,7 % à 14,1 % ;
– celui de la chimie et des cosmétiques de 11,4 % à 12,1 % ;
– enfin, celui de la pharmacie de 5,3 % à 6,9 %.
La plupart des autres secteurs ont vu leur poids dans l’export baisser, en particulier l’automobile, tombée de 15,7 % à 9 % – dans le même temps, le solde sectoriel passait d’un fort excédent à un fort déficit. Cette coïncidence entre spécialisation des exportations et concentration des soldes sectoriels montre que l’évolution sectorielle des importations a été moindre.
Répartition des exportations françaises par grand secteur – comparaison 2004-2013
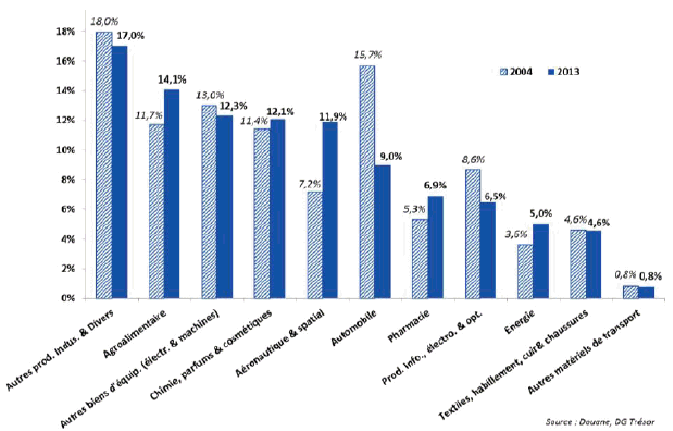
Source : « Résultats du commerce extérieur en 2013 », ministère du commerce extérieur, 7 février 2014.
Le jugement que l’on peut porter sur cette spécialisation accrue à l’export est naturellement ambivalent : elle est certes un facteur de fragilité. Mais est-elle évitable ? Elle rend sans doute compte d’une insertion accrue de notre pays dans les chaînes de valeur mondiales, insertion qu’il faut accepter, car elle est vraisemblablement la clé d’une amélioration qualitative de notre compétitivité.
Beaucoup d’observateurs considèrent que la réussite commerciale de l’Allemagne repose largement sur sa capacité à utiliser au mieux les potentialités de l’« Hinterland » constitué pour elle par les pays d’Europe centrale depuis la chute du mur de Berlin. Ces pays sont géographiquement voisins de l’Allemagne, culturellement proches et dotés d’une main d’œuvre qualifiée et de traditions industrielles, mais aussi de coûts salariaux attrayants. Le succès de l’industrie allemande reposerait en grande partie sur sa capacité à sous-traiter une large part de ses processus de production à ces pays, par exemple pour l’industrie automobile à y faire fabriquer de nombreuses pièces d’équipement.
Le fait est que si l’Allemagne a un taux d’exportations, rapporté à son PIB, bien supérieur à la France, son taux d’importations est également plus élevé.
Une étude récente des services du ministère de l’économie donne quelques éléments sur cette problématique (7). Elle relève d’abord l’augmentation constante du commerce international des biens intermédiaires, qui rend compte de la dissociation internationale des chaînes de production. Les biens intermédiaires représentent désormais 56 % de nos importations et 48 % de nos exportations.
L’étude s’intéresse aussi à un indicateur significatif : le contenu des exportations en importations, c’est-à-dire ce qu’un pays importe pour produire les biens qu’il exporte. Pour la France, le contenu en importations des exportations s’est régulièrement accru, passant de 33 % à 39 % de 1995 à 2009. Cependant, comme on le voit sur le graphique ci-après, la France reste pour cet indicateur en dessous de l’Allemagne et même de la Chine (ce qui peut surprendre, car, généralement, plus un pays est grand, moins il est ouvert et a besoin d’importer, y compris pour ses industries d’exportation – à cet égard, il n’est pas surprenant que sur le graphique les dernières lignes soient occupées par de petits pays comme Singapour et le Luxembourg).
Contenu en importations des exportations de biens en 2009
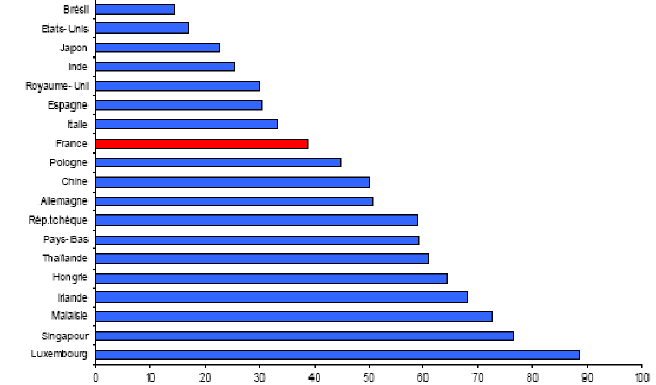
Source : OCDE.
Cette corrélation ne prouve certes rien en soi, mais il semble donc bien que les pays qui accumulent les excédents soient souvent ceux dont les exportations intègrent un niveau élevé d’importations. Cela peut paraître contradictoire, mais le fait est qu’il faut savoir importer pour exporter encore plus et donc, au final, améliorer son solde commercial.
Sans être très conclusive sur la question, l’étude précitée arrive bien à cette conclusion : « l’existence d’une corrélation entre fragmentation des processus productifs et performances à l’exportation fait l’objet de peu d’études. À partir des bases de données douanières détaillées par entreprise, il est toutefois possible d’en avoir une idée. On peut en effet mettre en évidence que les entreprises important le plus de biens intermédiaires sont aussi celles qui affichent les meilleures performances à l’exportation. Ainsi une augmentation de 10 % du montant des importations de biens intermédiaires s’accompagne d’une hausse de 3 % des exportations en valeur ». L’étude ajoute que « l’impact sur les exportations des achats de biens intermédiaires venant en totalité des pays de l’OCDE, à fort contenu technologique, l’emporte sur celui des achats venant en totalité des pays hors OCDE à bas salaires. Toutefois, il est encore plus important quand les inputs sont combinés et proviennent des deux zones à la fois (autrement dit en exploitant leurs avantages comparatifs respectifs) ».
Une autre interrogation classique concerne le nombre d’entreprises exportatrices : elles sont traditionnellement trois fois moins nombreuses en France qu’en Allemagne et deux fois moins nombreuses qu’en Italie.
Corrélativement, notre commerce extérieur est très concentré sur un petit nombre d’exportateurs (les 1 000 plus gros exportateurs font plus de 70 % des ventes à l’international).
Après une longue période de déclin, on observe cependant depuis 2011 un relèvement du nombre d’entreprises exportatrices dans l’année : on est passé de 2011 à 2013 de 116 100 à 120 700. Ce nombre revient ainsi au niveau constaté juste avant la crise de 2008.
Ainsi que le graphique qui suit le montre, la corrélation n’est toutefois que relative entre le nombre d’exportateurs et le niveau des exportations. À court terme, cette corrélation est faible ; on l’a vu, la remontée du nombre d’exportateurs en 2013 n’a pas empêché une contraction globale des exportations. À moyen terme, cette corrélation est un peu plus marquée : par exemple, le nombre d’exportateurs aussi bien que le montant global des exportations ont fortement augmenté à la fin des années 1990, avant un recul parallèle au début des années 2000 ; plus récemment, la corrélation demande encore à être vérifiée.
Évolutions comparées sur le moyen terme des exportations et du nombre d’exportateurs
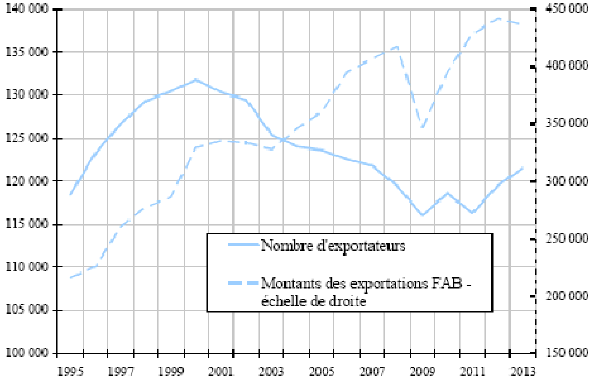
Source : Le chiffre du commerce extérieur – Les opérateurs du commerce extérieur – 2013, « Poursuite de la hausse du nombre d’exportateurs », http://lekiosque.finances.gouv.fr.
Dans son bilan précité consacré à la France (8), la Commission européenne évoque ainsi l’insuffisance du nombre d’entreprises exportatrices, liée à la plus faible taille moyenne des entreprises françaises : « le nombre limité d’entreprises exportatrices explique en partie les mauvais résultats de la France en matière d’exportation. Si l’on compare la structure des secteurs industriels français et allemand, il apparaît que les entreprises françaises sont généralement beaucoup plus petites que leurs concurrentes allemandes. D’après les données recueillies par les offices statistiques nationaux en France (en 2006) et en Allemagne (en 2005), la proportion de micro-entreprises industrielles est plus élevée en France (82 %) qu’en Allemagne (77 %). En revanche, la proportion de grandes PME industrielles (au moins 10 employés) est plus élevée en Allemagne (21 %) qu’en France (17 %). Compte tenu de l’importance des coûts fixes inhérents à toute activité d’exportation, les entreprises industrielles françaises qui exportent sont susceptibles, du fait de leur taille relativement petite, d’être désavantagées par rapport aux entreprises allemandes ».
La Commission observe néanmoins que « la taille n’est pas l’unique facteur à peser sur la compétitivité des entreprises françaises. Leur moindre propension à exporter joue également un rôle en la matière. Pour une taille donnée, la propension à exporter (c’est-à-dire la part des exportations dans le chiffre d’affaires total) des entreprises françaises est inférieure à celle des entreprises allemandes (…). Seuls 12 % du chiffre d’affaires des petites entreprises industrielles françaises [moins de 20 salariés] sont réalisés à l’étranger, contre 47 % pour leurs concurrentes allemandes ». Cet écart du simple au quadruple est effectivement impressionnant.
Une autre analyse critique du comportement des entreprises françaises met en avant le manque de continuité de leur engagement à l’international. Lorsque l’on regarde les quelques 120 000 entreprises exportatrices d’une année donnée, on constate régulièrement – cette donnée fluctuant assez peu – qu’environ 30 000, soit le quart, sont des exportateurs « entrants » qui n’avaient pas exporté l’année précédente, tandis que sensiblement le même nombre d’entreprises arrêtent d’exporter d’une année à la suivante. Tous les ans, environ 20 000 entreprises, soit un exportateur sur six, sont même des primo-exportateurs n’ayant jamais exporté dans le passé. Le taux de continuité dans l’export de ces novices est faible : environ 40 % seulement persévèrent au-delà d’un an.
Si ce renouvellement des entreprises participe à la compétitivité économique, il reflète aussi la vulnérabilité des exportateurs occasionnels, qui s’essayent à l’international sans toujours transformer cet essai, soit qu’ils se contentent d’un « coup », soit qu’ils se révèlent incapables de gérer le développement à moyen terme d’une activité à l’international.
D’une manière plus qualitative, un reproche souvent fait à l’étranger aux entreprises françaises porte sur leur capacité à développer une relation commerciale de long terme, à assurer le suivi des clients, à gérer l’après-vente, à faire évoluer leurs produits pour les adapter à la demande internationale... Il y a sans doute des équilibres à faire évoluer entre le rôle des « ingénieurs » et celui des « commerciaux », et entre l’innovation de rupture et l’innovation incrémentale.
Enfin, le commerce extérieur français reste insuffisamment orienté, même si cela évolue graduellement, vers les zones géographiques économiquement les plus dynamiques.
Comme on le constate sur le graphique ci-après, la France continue à réaliser près de 60 % de son chiffre d’affaires à l’export dans l’Union européenne, et près de 47 % dans la seule zone euro. Plus généralement, plus des trois quarts de ses exportations vont vers les pays développés traditionnels.
Répartition des exportations françaises de biens en 2013
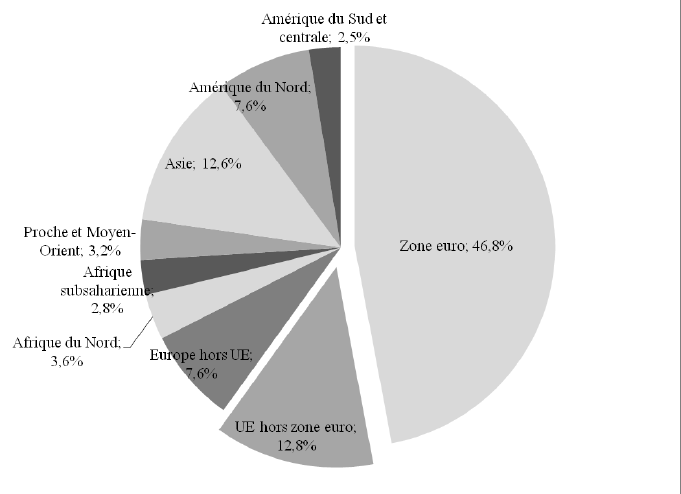
Source : graphique élaboré à partir des données du rapport « Résultats du commerce extérieur en 2013 », ministère du commerce extérieur, 7 février 2014.
Bien sûr, les flux commerciaux sont fortement influencés par la proximité géographique, du fait des coûts et temps de transport, et s’inscrivent dans des traditions. Que l’Europe reste le marché principal des exportateurs français n’a donc rien d’étonnant. Quant à la zone euro, elle apporte la facilité et la sécurité d’une monnaie commune ; le développement du commerce interne était d’ailleurs l’une des justifications de sa création.
D’ores et déjà, pourtant, et contrairement à une « idée reçue » très répandue sur la concurrence « déloyale » des pays du sud à bas coûts salariaux, les pays émergents ou encore en développement sont des partenaires économiques très intéressants pour la France. Il est significatif d’observer, comme le démontre le graphique ci-après, qu’une majorité de nos excédents commerciaux bilatéraux sont obtenus avec de tels pays (Émirats-Arabes-Unis, Singapour, Algérie, Philippines, Corée du Sud, Brésil, etc.), même si le plus important est en Europe (Royaume-Uni) ; dans l’autre sens, le fait que notre plus gros déficit bilatéral soit avec la Chine ne doit pas occulter les déficits que nous avons avec les grandes économies matures, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, les États-Unis, etc.
Les principaux déficits et excédents bilatéraux de la France (août 2013-juillet 2014)
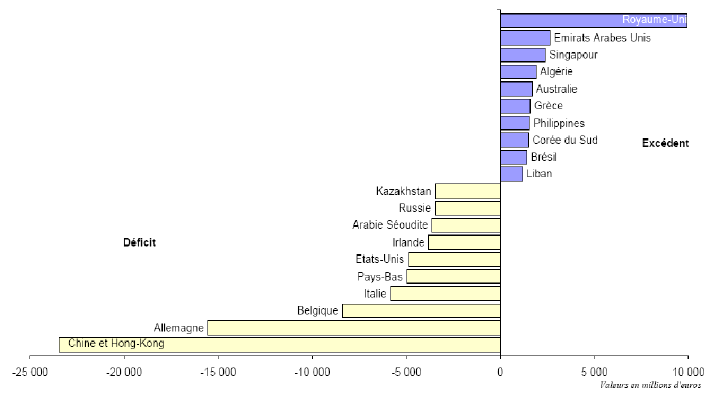 Source : « Aperçu du commerce extérieur de la France (données de référence : juillet 2014) », Douanes.
Source : « Aperçu du commerce extérieur de la France (données de référence : juillet 2014) », Douanes.
Il faut surtout être conscient que, si les pays développés traditionnels continuent encore à dominer l’économie mondiale, cette prépondérance est en train d’être remise en cause très rapidement. La croissance future, donc les opportunités commerciales, se situent dans les économies émergentes. Le graphique ci-après montre où, selon le Fonds monétaire international (FMI), seront localisés les gains de PIB (le différentiel entre la richesse actuelle et celle prévue pour 2019) durant les cinq prochaines années : les économies avancées ne devraient générer que le tiers de cette richesse supplémentaire, dont 12 % dans l’Union européenne, tandis que les deux tiers seraient localisés dans les pays émergents et en développement, en particulier en Asie (42 % du total).
De plus, il faut bien voir que le développement économique s’accompagne classiquement d’un accroissement de l’ouverture des pays, donc d’une augmentation de leur taux d’importations et d’exportations dans le PIB, alors que cette ouverture évolue moins dans les économies matures. Cela signifie que si les économies du sud représenteront les deux tiers de la croissance dans les prochaines années, elles représenteront une part encore plus importante des flux commerciaux qui seront générés.
La distribution géographique des gains prévisionnels de PIB nominal de 2014 à 2019 (en parité de pouvoir d’achat)
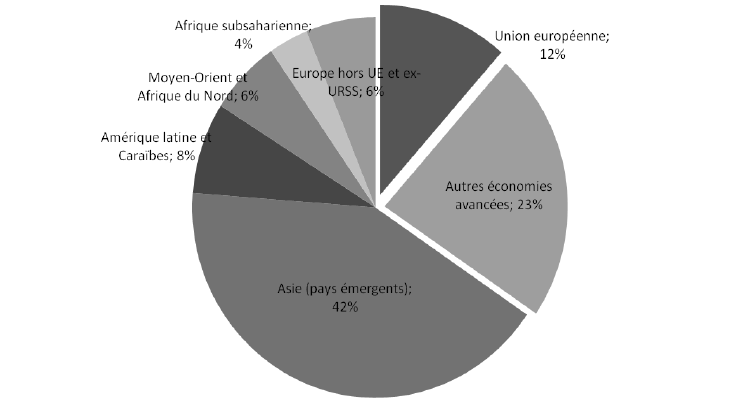
Source : graphique élaboré à partir d’extractions de la World Economic Outlook Database du FMI, données d’avril 2014.
Ces dernières années, la France n’a manifestement pas su saisir toutes les opportunités offertes par les économies émergentes.
S’agissant des célèbres « BRIC » (Brésil, Russie, Inde et Chine), notre pays n’était plus en 2013 que leur 16ème fournisseur (globalement), alors qu’il occupait la 9ème position en 2008. Sur la même période, la part de marché française dans les importations de ces États (pris ensemble) a reculé, tombant de 1,9 % à 1,4 %. La croissance des exportations françaises vers ces marchés a donc été moins importante que la hausse des importations totales des quatre pays. Le recul de notre part de marché s’est accentué dans le contexte de la crise économique et financière mondiale : en 2005, elle était encore de 2 %.
Dans le monde émergent, les opportunités ne concernent d’ailleurs pas que les BRIC, traditionnellement mis en avant. De nombreuses autres économies sont en émergence.
Dans une analyse récente des services du ministère de l’économie (9), l’accent est mis sur les « pays émergents de taille intermédiaire » (PETI). Le plan d’action gouvernemental pour le commerce extérieur de la France présenté en décembre 2012 a en effet identifié 22 pays émergents de taille intermédiaire qui sont prioritaires pour la France.
Leur poids global dans le commerce mondial est aujourd’hui comparable à celui des BRIC, puisque leurs importations représentent 15 % du total mondial (17 % pour les BRIC) et leurs exportations mondiales dépassent 17 % (19 % pour les BRIC). Ces pays sont localisés sur tous les continents : monde arabo-musulman (Algérie, Arabie Saoudite, Égypte, Émirats-Arabes-Unis, Maroc, Tunisie et Turquie), ex-URSS (Kazakhstan et Ukraine), Asie orientale (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Vietnam), Afrique (Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Nigeria et Kenya) et Amérique latine (Argentine, Chili, Colombie et Mexique).
En 2013, les échanges entre la France et ces « PETI » ont représenté environ 10 % de l’ensemble de nos échanges commerciaux, soit, pour être plus précis, 9,8 % de nos importations et 11,4 % de nos exportations de biens. Notre commerce avec ces pays est aujourd’hui proche de l’équilibre et nos exportations vers eux sont dominées par les produits de haute technologie. Avec ce taux de 10 %, les PETI continuent à peser moins dans le commerce de la France qu’ils ne pèsent globalement dans le commerce mondial (16 %). Il y a donc des marges de progression pour ces échanges qui sont intéressants : il s’agit de pays solvables et souvent en forte croissance, avec de gros besoins en équipements et, avec l’émergence d’une classe moyenne, en biens de consommation plus « haut de gamme » que la France peut fournir.
Il faut également insister sur les opportunités nouvelles qu’offre l’Afrique, un continent qui est pour nous géographiquement plus proche que l’Asie et avec lequel la France maintient des liens historiques, culturels, politico-militaires exceptionnels.
Or, l’Afrique est aujourd’hui la deuxième zone de croissance au monde derrière l’Asie, avec des taux d’environ 5 % par an en moyenne. Cette croissance n’est plus uniquement tirée par le commerce des matières premières : on assiste au développement d’une croissance endogène, plus inclusive, portée par les progrès technologiques (notamment dans les télécommunications) et soutenue par une classe moyenne grandissante, qui représentera bientôt entre 300 et 500 millions de consommateurs.
De plus, l’insertion de l’Afrique dans le commerce mondial se fait à un rythme plus élevé que sa croissance économique, la progression des échanges dépassant celle des richesses : entre 2000 et 2012, les importations totales de l’Afrique subsaharienne ont cru de 16 % en moyenne annuelle, dépassant largement le rythme du commerce mondial (+ 10 % par an).
Les opportunités sont donc considérables et le redéploiement géographique de notre commerce extérieur n’est pas encore suffisant.
Le dispositif public de soutien à l’internationalisation des entreprises est depuis deux ans l’objet d’une réorganisation en profondeur. Celle-ci a connu un nouveau développement au printemps 2014 avec l’instauration d’un « ministère des affaires étrangères et du développement international » (MAEDI), auquel le commerce extérieur est dévolu (de même que la promotion du tourisme). Un secrétariat d’État au commerce extérieur est rattaché au MAEDI. Le commerce extérieur perd donc son rattachement traditionnel au pôle « économie-finances ».
Cette évolution, destinée à unifier au sommet l’action extérieure de l’État, y compris dans le champ économique, ne remet pas en cause mais conforte plutôt celles engagées précédemment, qui visent à une plus grande cohérence ou du moins coordination des acteurs publics chargés d’aider nos entreprises à l’international. Avec la fusion des opérateurs Ubifrance et AFII (l’Agence française pour les investissements internationaux), cette mise en cohérence va se poursuivre.
1. Les nouvelles compétences rattachées au ministère des affaires étrangères et du développement international
Aux termes du décret n° 2014-400 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères et du développement international (MAEDI), ce dernier « est compétent pour définir et mettre en œuvre la politique du développement international de la France, notamment au titre du commerce extérieur et du tourisme ». En outre, « en liaison avec le ministre de l’économie (…) et les autres ministres intéressés, il prépare et conduit les négociations commerciales internationales, qu’elles soient multilatérales, européennes ou bilatérales. Il coordonne l’action des services qui concourent à promouvoir les intérêts économiques de la France à l’étranger. Pour l’exercice de ses attributions au titre du commerce extérieur, il est associé à la politique de financement des exportations ».
Le MAEDI est donc tête de file pour les négociations commerciales ; il a une mission de coordination, donc une autorité fonctionnelle sur tous les services à vocation économique à l’étranger ; il n’est en revanche qu’« associé » à la politique du financement de l’exportation. Les instruments financiers gérés par la Banque publique d’investissement (BPI) et la Coface restent donc principalement du ressort du ministère des finances.
Selon les termes du décret d’attribution précité, « pour l’exercice de ses attributions en matière de commerce extérieur, le ministre des affaires étrangères et du développement international dispose de la direction générale du Trésor.
Il a autorité, conjointement avec le ministre des finances et des comptes publics et avec le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, sur les services économiques à l’étranger (…). Pour l’exercice de ses attributions en matière de tourisme, [il] dispose de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services [devenue la direction générale des entreprises en septembre 2014] ».
La nouvelle architecture gouvernementale n’a donc pas entraîné la profonde réorganisation des structures administratives qu’aurait constitué le transfert à l’administration du ministère des affaires étrangères d’une partie des services de la direction générale du Trésor et, s’agissant du tourisme, de celle des entreprises. Selon une formule classique, il a simplement été décidé que le ministre des affaires étrangères et du développement international pourrait « disposer » de ces administrations du ministère de l’économie et des finances dans le cadre de ses attributions. Sur les services économiques extérieurs de la direction générale du Trésor, ses prérogatives sont toutefois plus importantes : il s’agit d’une autorité conjointe des deux ministres des affaires étrangères et de l’économie.
Parallèlement, la structure de présentation des crédits budgétaires n’a pour le moment été modifiée qu’à la marge ; n’ont été transférées de la mission « Économie » à la mission « Action extérieure de l’État » que deux lignes de crédits :
– des crédits de fonctionnement dits d’« État-major » (ministres ou secrétaires d’État et leur entourage) pour 0,52 million d’euros (montant des crédits hors rémunérations) ;
– la dotation principale à l’agence Atout France, pour 30,4 millions d’euros.
En revanche, le financement de la nouvelle agence qui va remplacer Ubifrance et l’AFII, de même qu’a fortiori celui des services économiques extérieurs restent sur la mission « Économie ».
Une convention a été signée en juillet 2014 entre le ministère des affaires étrangères et du développement international et le directeur général du Trésor (représentant les ministères des finances et de l’économie) afin de mieux faire travailler ensemble les différents services dans le cadre de la nouvelle architecture gouvernementale.
Au niveau des administrations centrales, le changement de structure ministérielle devrait surtout se traduire par un rôle accru des directions géographiques du MAEDI pour coordonner les dossiers économiques concernant leur ressort. Ces directions assureront la préparation des dossiers d’entretiens et des visites ministérielles sur la base des contributions demandées aux autres services.
Un partage des tâches est également prévu pour répondre aux demandes des entreprises :
– aux directions géographiques du MAEDI, les questions politiques ou ayant trait principalement à un pays ou à une zone géographique ;
– à la direction des entreprises et de l’économie internationale (voir infra) du MAEDI, les demandes d’accompagnement à l’export des secteurs stratégiques et des familles prioritaires à l’export ;
– à la direction générale du Trésor, tout ce qui a trait aux négociations commerciales internationales ou aux outils d’appui financier (BPI, Coface, etc…).
Pour autant, la sorte de dyarchie qui s’installe dans l’animation administrative de notre politique d’internationalisation des entreprises met en lumière des enjeux de coordination. Des acteurs extérieurs perçoivent sur certains sujets des divergences de positions.
S’agissant du tourisme, aux termes de l’article L. 141-2 du code du tourisme, Atout France est placé « sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ». La compétence « tourisme » relevant de deux ministres, il est logique que la tutelle soit partagée. Le ministre des affaires étrangères l’a confirmé dans son discours devant les ambassadeurs fin août, évoquant une « co-tutelle d’Atout France ». Les deux ministères des affaires étrangères et de l’économie devraient être présents au conseil d’administration de l’agence (le premier en tant que ministère « chargé du tourisme », le second en tant que commissaire du Gouvernement). Le MAEDI devrait aussi assurer la représentation française à l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).
La nouvelle architecture ministérielle doit permettre à la « diplomatie économique », qui est depuis deux ans une priorité majeure du MAEDI, de se déployer pleinement : ce ministère disposera désormais d’une plus grande autorité sur des services traditionnellement rattachés au ministère de l’économie tels que la direction générale du Trésor.
Au niveau de l’administration centrale du MAEDI, la volonté de développer une action extérieure plus forte dans le domaine économique a conduit à la création d’une direction des entreprises et de l’économie internationale (DEEI).
Cette direction a été créée en mars 2013 et remaniée au printemps 2014 dans le cadre de la direction générale de la mondialisation. Elle reste une petite administration, avec environ 70 collaborateurs et aucun moyen propre d’intervention.
Elle est constituée de trois sous-directions ou missions :
– celle des affaires économiques internationales est chargée de la coordination des positions françaises sur les grands sujets économiques (mission qui est aussi celle de la direction générale du Trésor au ministère de l’économie) ;
– celle de soutien aux secteurs stratégiques suit la négociation de certains « grands contrats » dans des domaines régaliens qui nécessitent une implication gouvernementale ; elle intervient aussi dans la détermination des priorités stratégiques de la politique du commerce extérieur ;
– un dernier pôle se consacre à la tutelle des opérateurs et aux relations avec les acteurs ; il suit aussi le dossier de l’attractivité, sur lequel le MAEDI a à la fois un rôle de proposition et de coordination.
Comme on l’a vu, afin d’éviter des doublons et compte tenu des compétences préexistantes, la DEEI a renoncé à être présente sur certaines thématiques, comme celle des négociations commerciales, laissée à la direction générale du Trésor.
La « diplomatie économique » consiste d’abord à mieux mobiliser l’ensemble des services des ambassades, et en particuliers les ambassadeurs, sur les thématiques économiques et le soutien à nos entreprises à l’international.
L’évaluation des ambassadeurs tient désormais compte de leur implication à cet égard. Les critères initialement retenus étant trop nombreux, la DEEI envidage de les resserrer en en retenant cinq :
– la capacité à animer la communauté économique française locale ;
– celle à « vendre la France » ;
– l’ouverture aux entreprises et le soutien qui peut leur être apporté ;
– l’accompagnement de la structuration de l’offre française dans les « familles » de produits prioritaires ;
– la capacité à coordonner au service de nos entreprises l’ensemble des moyens de notre diplomatie : services consulaires, scientifiques, culturels…
La mission d’animation économique des ambassadeurs doit s’appuyer sur des « conseils économiques » : la création de ceux-ci a été demandée en février 2013, par l’administration centrale, dans tous les postes correspondant à des pays significatifs pour notre commerce extérieur – ceux où les exportations françaises dépassent 50 millions d’euros.
Les premiers éléments de bilan sont plutôt positifs selon le MAEDI. Les postes se sont largement mobilisés pour mettre en place les conseils économiques : 109 postes sur les 120 concernés l’ont fait. Cependant, dans certains pays, on relève des réticences, soit que les conseils économiques soient perçus comme redondants des réunions des conseillers du commerce extérieur, soient même qu’ils apparaissent comme redondants des réunions de service internes à l’ambassade. Certains postes considèrent que leur pays de résidence ne se prête pas à l’exercice pour diverses raisons : petite taille de l’ambassade, modestie de la communauté d’affaires française, gravité de la situation sécuritaire, absence de service économique...
L’objectif de composition mixte publique-privée a bien été intégré. La quasi-totalité des conseils économiques comprennent des représentants d’entreprises.
La fréquence de réunion retenue est hétérogène : plusieurs postes importants réunissent le conseil économique quasi-mensuellement, tandis que les réunions sont plus espacées dans les autres postes, avec une périodicité généralement trimestrielle, et parfois semestrielle. De nombreux postes mettent en place un système de rotation des réunions du conseil économique dans les centres économiques du pays ou tiennent des réunions « délocalisées » à l’occasion de déplacements de l’ambassadeur. Certains postes ont mis en place, en complément des conseils économiques pléniers, des conseils économiques sectoriels.
Les missions assignées aux conseils économiques restent cependant hétérogènes. La plupart des postes utilisent le conseil économique comme instance d’échange d’informations sur les perspectives économiques et l’environnement des affaires, et pour faire un point sur les principales difficultés rencontrées par les entreprises françaises dans le pays. Mais la fonction de coordination entre les acteurs est intégrée de manière inégale. Enfin, seuls certains postes y voient l’occasion de définir une véritable stratégie de marché pour les produits français.
La fonction de coordination de l’ensemble des acteurs de la diplomatie économique devrait donc sans doute être renforcée. En particulier, les conseils économiques sont encore insuffisamment utilisés pour l’articulation entre les moyens mis en œuvre dans le domaine économique stricto sensu et les moyens relevant de notre politique d’influence. L’articulation entre les actions des conseils économiques et des conseils d’influence reste souvent à améliorer.
Au-delà des instances tels que les conseils économiques, on doit enfin signaler le déploiement dans les ambassades de nouveaux personnels à vocation économique. Il en est ainsi par exemple des experts techniques internationaux (ETI) sur l’innovation. En 2014, des ETI ont été installés en Allemagne et Israël. Des discussions avancées avec les autorités des pays partenaires sont engagées afin d’installer des ETI au Canada et aux États-Unis.
La diplomatie économique repose enfin sur le concours de personnalités qui ont accepté une mission spécifiquement économique et ont l’avantage d’avoir un solide « carnet d’adresses » et/ou un prestige personnel, du fait de leurs fonctions passées (ou présentes) dans le monde économique ou politique, ce qui leur ouvre des portes habituellement fermées.
Dix « représentants spéciaux » sont maintenant en poste pour dynamiser les relations économiques avec des pays clés : Mmes Martine Aubry pour la Chine et Anne-Marie Idrac pour les Émirats-Arabes-Unis, et MM. Jean-Pierre Chevènement pour la Russie, Philippe Faure pour le Mexique, Paul Hermelin pour l’Inde, Louis Schweitzer pour le Japon, Jean-Pierre Raffarin pour l’Algérie, Alain Richard pour les Balkans, Jean-Charles Naouri pour le Brésil et Philippe Varin pour l’ASEAN.
Par ailleurs, six ambassadeurs en région couvrent onze régions (celles qui ont souhaité recourir à ce dispositif) : Lorraine, Champagne-Ardenne, Limousin, Poitou-Charentes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Centre, Haute-Normandie, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Ils participent à l’accueil des délégations d’investisseurs internationaux dans les régions. Par ailleurs, l’information qu’ils rassemblent alimente la connaissance des offres économiques des territoires et permet d’enrichir la composition des délégations d’entreprises accompagnant les visites ministérielles et présidentielles à vocation économique.
Depuis deux ans, il a été décidé de donner des priorités géographiques et sectorielles croisées à notre appareil de promotion des exportations. Lancée en décembre 2012 suite à une étude de la direction générale du Trésor, cette démarche repose sur le constat qu’il ne suffit pas d’avoir une offre commerciale compétitive, mais qu’il faut aussi qu’elle corresponde à une demande. Il s’agit donc de croiser des domaines où la France a une offre solide avec une liste de pays-cibles où la demande est forte dans les secteurs en cause et où notre pays pourrait être plus présent.
Les secteurs prioritaires ont été déclinés en quatre « familles » de produits, baptisées « Mieux se nourrir », « Mieux se soigner », « Mieux vivre en ville » et « Mieux communiquer ». La matrice « familles »/pays proposée en 2012 était la suivante (la liste des pays a été complétée depuis lors pour compter finalement 49 pays) :
Mieux se nourrir |
Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Corée du Sud, Pologne, Canada, Émirats-Arabes-Unis, Russie, Tunisie, Maroc, Algérie, Brésil, Singapour, Arabie-Saoudite, Kazakhstan, Ukraine, Mexique, Afrique du Sud, Nigeria |
Mieux se soigner |
Chine, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Pologne, Russie, Turquie, Algérie, Brésil, Inde |
Mieux vivre en ville |
Chine, Inde, États-Unis, Indonésie, Vietnam, Brésil, Russie, Allemagne, Pologne, Algérie, Arabie-Saoudite, Maroc, Turquie, Émirats-Arabes-Unis, Kenya |
Mieux communiquer |
Chine, États-Unis, Corée du Sud, Allemagne, Royaume-Uni, Mexique, Brésil, Japon, Russie, Inde, Qatar |
Des « fédérateurs », choisis en général dans les milieux professionnels concernés, ont été nommés pour chaque « famille ». Si les résultats sont divers selon les familles, le choix de cette politique est clairement justifié au regard de plusieurs constats classiques sur l’appareil exportateur français :
– la difficulté de nos entreprises à se fédérer pour « chasser en meute » (voir supra) ;
– le manque de visibilité internationale de l’offre française, y compris au niveau sectoriel, faute notamment d’un effort de communication spécifique.
Les résultats obtenus en peu de temps et avec peu de moyens par certaines des familles doivent être soulignés. La famille « Mieux vivre en ville » a ainsi mis en place en septembre 2013 une marque, dénommée Vivapolis, qui vise à exporter le concept de « ville durable à la française » et associe de nombreux acteurs publics et privés : six ministères, diverses agences publiques (Ubifrance, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie-ADEME, l’Agence française de développement-AFD…), des fédérations professionnelles, le pôle de compétitivité Advancity, une centaine d’entreprises de tailles diverses, etc. Vivapolis conduit des actions de communication en gérant un site internet et en participant à des salons internationaux dans son secteur, mais s’efforce aussi de lancer des projets concrets, avec par exemple deux projets de quartiers durables « sino-français » dans des villes chinoises.
Certains observateurs relèvent cependant certaines limites et risques de la politique des « familles » :
– la visibilité de celles-ci apparaît inégale ;
– des enjeux de cohérence de l’action publique sont signalés. Par exemple, fallait-il créer la marque Vivapolis avant la « marque France » ?
*
La nouvelle équipe gouvernementale met en avant une nouvelle priorité sectorielle, le tourisme, tout en resserrant la liste des pays-cibles.
Les industries culturelles et créatives pourraient aussi bénéficier d’une priorité politique. Il a été décidé, comme pour le tourisme, de s’efforcer de mieux les fédérer à l’international en établissant une « famille » sectorielle. Deux nouvelles familles sectorielles sont donc en cours de constitution : « Mieux se divertir » et « Mieux voyager ».
Un point très intéressant est à noter : ces deux familles nouvelles ne produisent pas des biens, ou secondairement, mais plutôt des services. En faire des priorités de notre politique du commerce extérieur rend compte de deux réalités insuffisamment prises en compte jusqu’à présent :
– les services sont déjà et seront de plus en plus l’objet d’échanges internationaux intenses ;
– pour des économies avancées et très tertiarisées comme la nôtre, ils représentent sans doute les meilleures opportunités. Au demeurant, comme on l’a vu supra, les échanges de services apportent déjà un excédent substantiel et croissant à notre pays, excédent qui compense partiellement le déficit sur les biens dans la balance des transactions courantes. Encore faudrait-il y ajouter les effets induits des échanges de services sur le commerce des biens : pour un étranger, voir un film français ou bien faire du tourisme en France induit très souvent l’achat de produits français. Il faut donc se féliciter de cet élargissement du champ de la politique du commerce extérieur aux services.
Le potentiel économique du tourisme est considérable. Comme le relevait M. Laurent Fabius dans son discours de clôture des Assises du tourisme le 19 juin 2014, « en 1950, 25 millions voyageaient à travers la planète. Aujourd’hui, un milliard. En 2030, deux milliards ». Et la France a des atouts évidents : « une nature diverse et magnifique (…), des villes parmi les plus belles, 38 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, une gastronomie classée au patrimoine immatériel de l’humanité, 8 000 musées, 45 000 monuments historiques classés ou inscrits, des événements de toute nature de portée mondiale et un art de vivre recherché ».
La France a accueilli 84,7 millions de touristes étrangers en 2013 et l’objectif est d’atteindre un chiffre de 100 millions d’ici 2020.
Pour ce faire, le ministre a annoncé lors des Assises des mesures qui forment une politique complète et volontariste, notamment :
– la constitution de cinq pôles d’excellence (gastronomie et œnotourisme, sport et montagne, écotourisme, savoir-faire et tourisme urbain) financés par le Programme d’investissement d’avenir à hauteur – dans un premier temps – de 15 millions d’euros ;
– l’élaboration d’une politique de marque pour promouvoir les différentes destinations sur notre territoire ;
– un effort particulier sur l’accueil des touristes arrivant à l’aéroport de Paris-Charles-De-Gaulle (amélioration de l’accueil à l’aéroport puis en gare du Nord, accroissement de la fréquences des RER directs puis construction du Charles de Gaulle Express avec un début effectif de travaux en 2017, voie réservée pour les taxis sur l’autoroute A1 entre Roissy et Paris et mise en place d’un forfait taxi pour ce trajet, etc.) ;
– l’extension à plusieurs pays du Golfe, à l’Afrique du Sud et à l’Inde de la délivrance des visas de tourisme en 48 heures, expérimentée depuis début 2014 en Chine, avec des effets remarquables (après une croissance de plus de 20 % en 2013, par rapport à 2012, du nombre de visas français délivrés en Chine, le rythme de croissance annuel de ce nombre était au 1er semestre 2014 supérieur à 50 % !) ;
– un effort sur la pratique des langues étrangères dans l’hôtellerie-restauration, avec une bonification du classement hôtelier pour les établissements dont le personnel sera formé et la création d’un bac technologique hôtellerie-restauration avec des compétences renforcées pour le « savoir-être » et la pratique des langues étrangères.
Votre rapporteure approuve cette politique volontariste, mais souligne qu’elle demande aussi des moyens. À cet égard, il faut certainement s’interroger sur l’évolution de ceux dévolus à l’opérateur public Atout France, qui ont fortement diminué en quelques années :
– la subvention globale pour charges de service public attribuée à cet opérateur est passée de 33,49 millions d’euros en 2011 à 29,49 millions prévus pour 2014, soit une baisse de 12 % en trois ans ;
– de plus, dans le même temps, les autres financements étatiques, soit liés à des opérations particulières, soit dédiés à la rémunération de personnels issus du ministère de l’économie et affectés à l’agence, ont reculé encore plus ;
– en conséquence, les recettes totales d’Atout France sont en baisse depuis plusieurs années, car les recettes de partenariat ne peuvent être mobilisées que dans la mesure où un minimum de financement public est présent ; ces recettes totales sont passées de 77,7 millions d’euros en 2010 à 70 millions en 2013 ;
– de 2010 à 2013, les effectifs sont tombés, en équivalents temps plein (ETP), de 410 à 370.
La poursuite du mouvement de réduction constante du financement public d’Atout France menacerait son équilibre économique et sa capacité à assurer ses missions.
Deux études récentes mettent en lumière l’atout que sont les industries culturelles et créatives (ICC) : celle de novembre 2013 du cabinet EY (10) et celle élaborée conjointement par les Inspections générales des finances et des affaires culturelles de décembre 2013 (11). Adoptant des périmètres différents pour qualifier les ICC, ces études arrivent à des résultats différents, mais significatifs, sur ce qu’elles pèsent :
– les ICC représentent ainsi entre 2,8 % et 3,2 % du PIB national ;
– elles génèrent de 670 000 à 1,2 million d’emplois, soit entre 2,5 % et 5 % de l’emploi total.
L’étude d’EY comprend également une comparaison du poids économique de différents secteurs économiques qui est assez significative.
Comparaison des impacts directs des ICC avec d’autres filières économiques
(en milliards d’euros)
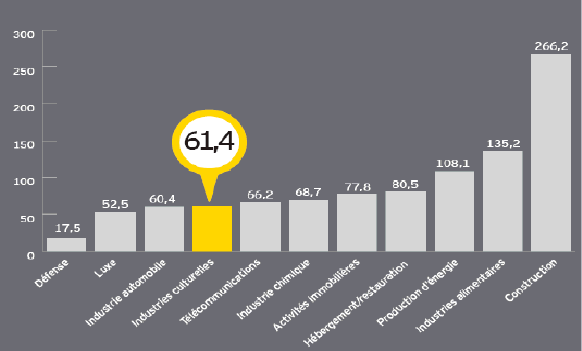
Source : « 1er panorama des industries culturelles et créatives – Au cœur du rayonnement et de la compétitivité de la France, novembre 2013 », Ernst&Young.
Ce n’est certainement pas sans une certaine malice que les auteurs du rapport ont choisi les filières économiques présentées dans leur graphique, faisant apparaître que les ICC pèsent plus dans la richesse nationale que des secteurs emblématiques – communément jugés essentiels pour le commerce extérieur et le rayonnement de la France – tels que l’automobile, le luxe ou l’armement.
La balance commerciale des ICC est excédentaire de plus de 300 millions d’euros (12), avec 2,7 milliards d’euros d’exportations pour 2,4 milliards d’euros d’importations.
De plus il faudrait prendre en compte les effets indirects. Les ICC sont les vecteurs, à l’étranger, d’une image positive de notre pays. Elles sont prescriptrices d’un mode de vie et de consommation. L’exportation des biens culturels contribue à notre rayonnement culturel et linguistique au niveau mondial, avec un impact certain dans les pays émergents auprès de publics jeunes et issus de la classe moyenne. Selon l’une des personnalités auditionnées par votre rapporteure, le visionnage d’un film français par un étranger lui donnerait huit fois sur dix envie de venir en France ou d’acheter un produit français – c’est l’« effet Amélie Poulain ».
La dimension internationale est une priorité pour certaines filières des ICC. Les données qui suivent ont été recueillies auprès des organismes spécialisés des différentes filières (Bureau Export de la musique, Unifrance, TV France International et le Bureau international de l’édition française), étant spécifié que ceux-ci soulignent en général qu’elles présentent des incertitudes.
Pour le secteur de la musique, les revenus tirés de l’activité internationale sont estimés à 439 millions d’euros pour 2012, ce montant incluant l’exportation d’instruments de musique et de supports pour enregistrement, les revenus tirés par le spectacle vivant de ses cachets à l’étranger, la commercialisation de droits de diffusion et de droits de synchronisation, etc.
Le cinéma français occupe traditionnellement la deuxième place dans le commerce international des films. Certes le poids du premier pays exportateur, les États-Unis, est écrasant, puisqu’ils contrôlent 90 % du marché international, mais la position du cinéma français est également enviée par beaucoup, car son chiffre d’affaires à l’export est également sans commune mesure avec ceux des pays qui viennent ensuite aux troisième, quatrième, cinquième places… Le succès international, parfois inattendu si l’on pense à un film comme « The Artist », de plusieurs productions françaises en 2012 a entraîné un doublement des recettes à l’export du cinéma français pour cet exercice par rapport aux années précédentes, avant malheureusement une année 2013 décevante à cet égard ! Désormais, le nombre de spectateurs des films français à l’étranger est voisin de celui de leurs spectateurs dans l’Hexagone (70 à 80 millions en moyenne dans les deux cas, avec de fortes fluctuations : les films français ont attiré 144 millions de spectateurs à l’étranger en 2012, mais à peine 47 millions en 2013…) et les recettes à l’international l’emportent sur les recettes domestiques.
En 2013, les ventes à l’étranger de programmes audiovisuels français ont représenté 137 millions d’euros, montant qui est même porté à près de 180 millions si l’on inclut les préventes. Ce montant est encore en dessous de la réalité dans la mesure où il n’inclut pas les droits pour les produits dérivés (constat qui vaut d’ailleurs aussi pour les autres filières des ICC). Les deux types de programmes les plus exportés sont les dessins animés (73 millions d’euros en 2013) et les documentaires (40 millions d’euros).
L’édition française réalise le quart de son chiffre d’affaires à l’export. Les exportations françaises de livres ont représenté 640 millions d’euros en 2013. Il faut y ajouter 12 000 contrats de vente de droits d’édition pour traduction qui ont été signés par des éditeurs français, plaçant la France au second rang mondial des exportateurs de ce type de droits. Ce nombre a doublé en dix ans.
Selon l’étude d’EY précitée, la France exporte pour environ 1,5 milliard d’euros par an de jeux vidéo, pour un chiffre d’affaires domestique du secteur de 2,2 milliards d’euros.
Cependant, ces exportations de biens et services culturels français restent souvent concentrées sur quelques pays. Leurs destinations prioritaires sont nos voisins européens et les États-Unis.
Pour prendre l’exemple de l’édition, les exportations françaises de livres restent concentrées sur les trois grands marchés francophones et matures que sont la Belgique, le Canada et la Suisse : ces trois pays en ont absorbé 57 % en 2013, plus de la moitié de ce montant allant d’ailleurs vers la seule Belgique. En revanche, toujours sur la même période, l’Afrique francophone et le Maghreb n’ont absorbé au total que 12 % de nos exportations de livres. Globalement, pour des raisons faciles à comprendre, les zones francophones ont été la destination de 71 % des exportations de livres français sur la période. Ces statistiques sont cependant biaisées par le fait qu’elles portent sur le commerce des seuls livres, sans inclure les droits de traduction, qui naturellement visent des marchés beaucoup plus divers : le chinois, avec 1 500 contrats de vente de droits de traduction en 2013, est la première langue de destination de ces exportations, devant l’italien, l’espagnol et l’allemand. Même sur les marchés francophones d’ailleurs, notamment ceux d’Afrique, le développement de la vente de droits d’édition est sans doute le bon moyen de développer le lectorat des livres français : elle permet d’y commercialiser des livres imprimés sur place qui sont nettement moins cher qu’en France, alors que ceux importés sont vendus plus cher qu’en France (coûts de transports, taxes…).
S’agissant du cinéma, plus de la moitié des spectateurs et des recettes des films français à l’étranger durant la très bonne année 2012 ont été localisés dans six pays (dans l’ordre du nombre de spectateurs) : États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Russie et Espagne. Il est toutefois à noter que viennent juste après dans ce palmarès des marchés, avec des scores significatifs, plusieurs grands pays émergents : dans l’ordre, Mexique, Corée du Sud, Chine et Brésil.
Pour ce qui est des programmes audiovisuels, 57 % des exportations ont été destinées à l’Europe de l’Ouest en 2013 et 12 % à l’Amérique du Nord.
Enfin, dans la filière musicale, l’Europe aurait absorbé, en 2012, 60 % des exportations de musique enregistrée et fourni 70 % du chiffre d’affaires à l’export des producteurs de spectacles musicaux.
Les ICC, même si les différentes filières ont bien sûr des fonctionnements très divers, présentent quelques points communs :
– la création est généralement assurée par une multitude de petites entités, les processus créatifs n’étant pas « industrialisables ». Dès lors, le financement de la création repose essentiellement sur le secteur aval, qui exerce un contrôle plus ou moins important sur la création (en particulier pour l’audiovisuel, le jeu vidéo, le cinéma et la mode) ;
– l’intervention de l’État dans l’économie de la culture connaît une intensité et des modalités variées selon les filières. Pour certaines, elle est déterminante ;
– le secteur est donc, pour la plupart des filières professionnelles, organisé collectivement et a l’habitude de travailler avec la puissance publique.
Plusieurs organismes de promotion de la création française et de soutien à l’export se sont mis en place, parfois depuis très longtemps, dans les filières et jouent un rôle essentiel : Unifrance pour le cinéma, TV France international pour la télévision, le Bureau export pour la musique, le Bureau international de l’édition française et le syndicat professionnel « le GAME » pour le jeu vidéo. À l’international, ils peuvent souvent s’appuyer sur de petites équipes propres de salariés expatriés (Unifrance a ainsi quatre salariés expatriés, dont trois en Asie et un aux États-Unis ; les éditeurs français ont créé un bureau aux États-Unis, avec trois salariés ; le Bureau export de la musique a des antennes à Berlin, Londres, New York, Sao Paulo et Tokyo). Les moyens de chacun de ces organismes, dont le financement est souvent très majoritairement public, sont cependant assez limités, ce qui rendrait certainement intéressante une mutualisation de ces moyens.
Par ailleurs, le réseau diplomatique apporte son soutien à travers les instituts français, les services culturels et, plus spécifiquement, 60 à 70 attachés audiovisuels, ainsi que parfois par la mise à disposition de personnels aux antennes à l’étranger d’opérateurs spécialisés. Il semble qu’en revanche les attachés « musique » soient beaucoup moins nombreux que les attachés audiovisuels, ce qui suscite un certain mécontentement dans la filière en cause.
Le secteur des ICC comprend quelques groupes qui sont parfois des « champions mondiaux » (par exemple, Universal Music, Deezer, Ubisoft, Hachette…), mais aussi beaucoup de petites entreprises.
Surtout, même parmi les entreprises de taille significative, le développement international n’est pas toujours prioritaire. Ces entreprises restent souvent tournées principalement vers le marché domestique, en particulier quant existent des dispositifs « franco-français » de financement qui sont bien rôdés. Pour le cinéma, notamment, la rentabilisation des productions continue à être recherchée essentiellement sur le marché domestique, l’éventuel succès international d’un film étant alors une sorte de bonus.
D’autres filières sont d’ores et déjà, heureusement, beaucoup plus tournées vers l’export, comme celle des jeux vidéo, dont les entreprises travaillent d’emblée pour un marché mondial, ou celle de l’animation (dessins animés), où des financements internationaux sont souvent recherchés dès le montage de la production.
f. Les enjeux pour demain : la présence sur tous les supports et la capacité à communiquer sur notre « modèle »
Les technologies numériques ont bouleversé de manière transversale les modes de création, de production, de diffusion et de consommation des biens et services culturels. Pour prendre l’exemple de la musique, 50 % des ventes à l’international se font désormais en ligne. Cette évolution influence le format des œuvres (programmes courts, séries…) et même leur nature (avec par exemple le développement des social games au détriment des jeux sur consoles). Les opérateurs français prennent d’ailleurs d’ores et déjà en compte cette nouvelle donne. Unifrance a ainsi compris que, pour toucher le public jeune des nouvelles classes moyennes des pays émergents, il fallait miser sur internet : l’association organise annuellement un festival en ligne de films français, sous-titrés en 13 langues, qui permet 4 millions de visionnages.
La multiplication des supports et des moyens de diffusion, par ailleurs de plus en plus polyvalents, constitue l’une des principales justifications de la volonté actuelle de fédérer une « famille » des ICC, car les approches deviennent nécessairement transversales.
La promotion de notre conception de la diversité culturelle, avec tout le « modèle » d’organisation qui va avec (modes de financement, réglementations…), est également un impératif qui justifie cet effort de fédération. Ce modèle est souvent envié, mais aussi dénigré et incompris. Or, il faut bien voir que « vendre » le modèle français de régulation de la diversité culturelle est aussi un moyen de préserver les débouchés de nos productions. Par exemple, il existe en France des règles simples interdisant à un cinéma « multiplex » de consacrer plus d’une certaine fraction de ses salles à un même film : cela garantit que les « petits » films – ce que sont souvent les films français à l’étranger par rapport aux superproductions américaines – trouvent des écrans pour être diffusés. Car, en l’absence de règle de cette nature, il y a des pays où parfois toutes les salles, même dans un même complexe, diffusent le même film…
Plus généralement, les ICC constituent de toute évidence un secteur où une politique de promotion de l’image de marque nationale a un sens. Des démarches de label se mettent d’ailleurs déjà en place, comme la « French Touch » dans la musique. C’est donc aussi un domaine où une action de fédération aurait un sens.
Il existe donc des motifs de s’efforcer de mieux fédérer la « famille » des industries culturelles et créatives, afin de faciliter la réalisation de leur potentiel international. Préalablement, le secteur mérite certainement une étude spécifique, afin de mieux évaluer ce potentiel, qui est encore trop mal connu, comme le montre notamment l’absence de statistiques fiables et normalisées sur les exportations des ICC.
L’année 2015 devrait voir la mise en œuvre d’une décision très importante annoncée lors de la réunion du 17 février 2014 du Conseil stratégique de l’attractivité : la fusion d’Ubifrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII). Cette décision s’inscrit dans un ensemble de dispositions prises pour parvenir à une meilleure cohérence des réseaux de soutien à l’internationalisation des entreprises françaises.
Le rapprochement de l’opérateur chargé d’accompagner les entreprises françaises à l’export, Ubifrance, et de celui chargé de rechercher et accompagner les investisseurs étrangers en France, l’AFII, est justifié par plusieurs considérations :
– les métiers de leurs personnels respectifs présentent des proximités, même s’ils sont différents. Ils partagent certains savoir-faire, notamment la capacité à vendre l’excellence française, à identifier les besoins des entreprises, à entretenir une relation suivie avec elles. Qu’il s’agisse d’aider au placement d’un produit français à l’étranger ou de convaincre un investisseur potentiel, il s’agit toujours de « vendre » les atouts de la France ;
– une entreprise étrangère que l’on va démarcher peut être à la fois (ou successivement) à la recherche de fournisseurs français et un potentiel investisseur en France ;
– on peut imaginer grâce à ce rapprochement des synergies telles que le développement d’une offre d’accompagnement des entreprises étrangères qui s’implantent en France, y compris pour le développement export de leurs filiales françaises – le lien entre investissement étranger et commerce extérieur est évident quand l’on voit que les filiales d’entreprises étrangères assurent 30 % des exportations françaises – ou la facilitation de partenariats technologiques ou industriels (Ubifrance apportant sa connaissance des entreprises françaises et l’AFII sa connaissance des étrangères) ;
– la mutualisation des moyens permettra de disposer d’un plus vaste réseau sur le plan géographique, d’améliorer la connaissance des entreprises et des tissus économiques des pays (intelligence économique) et d’obtenir des économies d’échelle sur des fonctions support ou sur la communication institutionnelle.
La fusion entre les deux agences doit être autorisée par le Parlement. Elle est l’objet de l’article 29 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, voté en juillet 2014 par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat. Cet article prévoit une habilitation au Gouvernement à régler les détails de la fusion par voie d’ordonnance.
Il est prévu que la fusion entre les deux agences soit effective, juridiquement, au 1er janvier 2015. Elle prendrait la forme d’une absorption de l’AFII par Ubifrance, solution plus simple et moins coûteuse que la création sui generis d’un nouvel organisme. En conséquence, le statut des personnels issus d’Ubifrance ne changera pas, tandis que ceux issus de l’AFII leur seront assimilés, tout en conservant leurs droits acquis conformément au droit du travail.
Cette unification des conventions collectives, qui exigera un accord collectif d’adaptation, entraînera certains coûts. D’autres coûts résulteront inévitablement de la fusion, au moins dans deux domaines :
– l’informatique (unification des systèmes) ;
– la communication (élaboration de la communication « corporate » de la nouvelle agence et remplacement des supports de communication des deux agences actuelles). À cet égard, des personnes auditionnées par votre rapporteure ont cependant souligné la nécessité de conserver la marque « Ubifrance » : quoi que l’on pense de cette appellation, elle a le mérite d’avoir acquis une notoriété qu’il serait dommage de perdre.
Comme toute fusion, celle d’Ubifrance et de l’AFII commencera donc par entraîner des coûts, avant de générer d’éventuelles économies. Ces coûts sont évalués à 5 millions d’euros en 2015.
Or, il faut bien voir que dans le cadre de l’effort de maîtrise des dépenses publiques, les ressources de subventions des deux établissements sont sous contrainte depuis plusieurs années, comme le graphique ci-après le montre bien.
Subventions reçues, ressources propres et plafond global d’emploi de l’ensemble Ubifrance + AFII
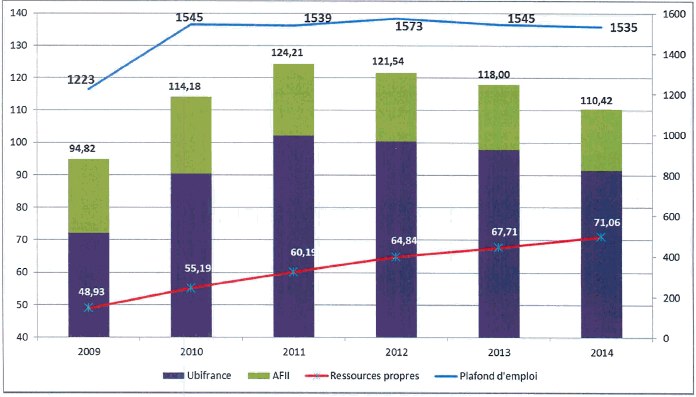
Source : Ubifrance-AFII.
En 2015, la subvention inscrite dans le projet de loi de finances s’élève, pour le nouvel établissement issu de la fusion, à 108,77 millions d’euros (13), donc en recul sur la dotation cumulée des deux agences en 2014, supérieure à 110 millions ; encore cette dotation de loi de finances initiale risque-t-elle de subir les habituelles mesures de gel et d’annulation. Les coûts de la fusion n’apparaissent donc pas pris en compte.
Il est vrai qu’Ubifrance dispose aussi de ressources commerciales, qui proviennent des prestations d’accompagnement qu’acceptent de payer les exportateurs et qui seront apportées à la nouvelle agence. Ces ressources propres, on l’observe sur le graphique, ont beaucoup augmenté en quelques années, passant de 49 millions d’euros en 2009 à 71 millions d’euros en 2014. Serait-il possible d’y trouver le financement des coûts de la fusion ? Les responsables de la future agence y font deux objections :
– d’une part, à force de développer des prestations commerciales, l’agence risque de perdre sa qualité d’organisme de service public au service d’une politique publique ;
– d’autre part, le développement des ressources propres est également bridé par le fait que l’ensemble Ubifrance-AFII est soumis, comme tous les opérateurs de l’État, à un plafond d’emplois. Ce plafond n’augmente pas et devrait même être ramené à 1 500 en 2017. Or, il s’applique à toutes les activités, y compris celles qui sont financées sur ressources propres, qu’il limite ipso facto.
Votre rapporteure est attachée à ce que la nouvelle agence puisse être lancée dans des conditions satisfaisantes, ce qui implique que les inévitables coûts de fusion soient couverts par l’État.
Sur la question des ressources propres d’Ubifrance, il faut aussi signaler que l’Autorité de la concurrence a récemment rendu un avis (14), sur saisine de l’Union professionnelle des opérateurs spécialisés du commerce international (OSCI), laquelle réunit des entreprises commerciales spécialisées dans l’accompagnement à l’international, au nombre d’environ 70 en France. L’OSCI a interrogé l’Autorité sur la concurrence faite à ses membres par Ubifrance et d’autres structures publiques comme l’association ERAI (voir infra le développement qui lui est dédié), lesquelles proposent des prestations payantes à l’international tout en bénéficiant de fonds publics.
Dans son avis, l’Autorité de la concurrence se refuse à se prononcer sur le principe du développement d’activités marchandes par Ubifrance, ce développement pouvant être justifié dès lors qu’un intérêt public est en cause. Elle considère également comme fondé dans son principe le subventionnement public d’Ubifrance ou d’ERAI, « dès lors que les ressources correspondantes ont pour objet de compenser des charges particulières résultant pour les opérateurs concernés de l’exercice d’une mission de service public », notamment en finançant des prestations qui par nature ne peuvent pas être commercialement rentables. Mais elle estime aussi que « des distorsions de concurrence seraient caractérisées s’il apparaissait que les acteurs publics du soutien à l’export, tels qu’Ubifrance ou ERAI, proposaient des services d’accompagnement relevant du champ concurrentiel à des prix sans rapport avec le coût réel des prestations correspondantes et que cette sous-couverture des coûts était compensée par les subventions publiques qu’ils perçoivent au titre des missions de service public qu’ils exercent par ailleurs ». Pour éviter cela, l’avis appelle à la mise en place d’une séparation comptable des activités subventionnées car relevant de missions de service public et des activités concurrentielles d’Ubifrance.
L’Autorité de la concurrence remet en cause les pratiques des opérateurs publics sur un autre point : la capacité qu’ils auraient, par leur positionnement dans certaines procédures développées à la demande de la puissance publique, d’en profiter pour « capter » des clients pour leurs prestations commerciales. Elle critique à ce titre la procédure de « labellisation » gérée par Ubifrance. par laquelle cette agence accorde le « label France » (ainsi qu’une subvention) à des actions collectives de promotion à l’international des entreprises françaises (salons, rencontres d’affaires, etc.) : Ubifrance, dans ce cas d’espèce, a le pouvoir d’attribuer ou non un label et une subvention à des opérations qui peuvent être montées par divers opérateurs publics ou privés avec lesquels l’agence est en concurrence par ailleurs ; « une telle situation est potentiellement attentatoire au libre jeu de la concurrence ». L’Autorité de la concurrence attaque pour les mêmes raisons la présence des chargés d’affaires d’Ubifrance dans les bureaux de la Banque publique d’investissement dans le cadre du label « Bpifrance Export » (voir infra), ce positionnement en amont étant susceptible de donner à Ubifrance un avantage anticoncurrentiel pour la commercialisation de prestations d’accompagnement en aval.
Sans remettre en cause les fondements de l’action d’Ubifrance et donc de la nouvelle agence issue de su fusion avec l’AFII, ces enjeux de concurrence sont donc susceptibles de l’amener à revoir ses méthodes comptables ainsi que certaines procédures.
Ubifrance compte 85 bureaux avec une présence ou une représentation (dans le cas de chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international titulaires d’une délégation de service public – voir infra) dans 70 pays. Quant aux bureaux de l’AFII, ils se trouvent dans des pays où Ubifrance est déjà présent.
En 2013, 25 personnels Ubifrance-AFII ont été redéployés de l’Europe vers les autres continents. Durant cette année, des bureaux nouveaux ont été ouverts au Myanmar et au Kenya, mais aussi en Espagne (à Barcelone). Dans certains pays, faute de moyens, Ubifrance se contente de créer des antennes confiées généralement à un volontaire international en entreprise ou administration (VIE-VIA), ce qui est tout de même léger. En 2014, des antennes de cette nature ont ainsi été établies au Sénégal, au Ghana et au Congo Brazzaville.
Cependant, la rapidité avec laquelle ce redéploiement peut être mené est limitée par la nécessité, dans un contexte de réduction des effectifs globaux du futur opérateur et de ses ressources publiques, de préserver ses ressources propres, c’est-à-dire les prestations de services payées volontairement par les entreprises ; en effet, ces prestations payantes sont principalement demandées sur les marchés traditionnels des entreprises, notamment en Europe ; il est donc nécessaire de maintenir sur place des personnels pour rendre ces services. Par ailleurs, il faut bien voir que l’internationalisation des primo-exportateurs passe d’abord par les marchés proches : si l’objectif est d’accroître le nombre des exportateurs, il faut y maintenir une offre publique d’accompagnement.
L’action en direction des 1 000 ETI (entreprises de taille intermédiaire) de croissance correspond à la décision n° 14 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012. Elle s’inscrit dans une approche nouvelle de l’accompagnement des entreprises, à savoir :
– une approche qui n’est pas centrée sur les PME, mais sur des entreprises plus grosses et choisies pour leur potentiel à l’export, mais qui pour le moment n’exportent pas, ou pas assez au regard de ce potentiel ;
– une approche dans la durée, de façon à consolider l’internationalisation des entreprises concernées.
L’objectif était d’inclure dans le dispositif 250 entreprises en 2013 et 600 en 2014 pour arriver à 1 000 en 2015. En 2013, 260 entreprises ont accepté l’accompagnement personnalisé. L’objectif de 600 entreprises ayant accepté d’entrer dans le dispositif d’ici fin 2014 est d’ores et déjà atteint fin septembre 2014 ; et, parmi elles, plus de 300 ont déjà commencé à travailler sur l’élaboration d’un plan d’action.
La fusion envisagée entre Ubifrance et l’AFII laisse de côté de nombreux autres opérateurs publics ou parapublics de l’internationalisation des entreprises. La question de la coordination de tous ces opérateurs, qui progresse lentement, reste donc entière.
On décompte 112 chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international (CCIFI), dans 82 pays (voir carte ci-après) :
– elles regroupent 32 000 entreprises membres ;
– elles emploient près de 900 collaborateurs à l’étranger ;
– leur chiffre d’affaires global a dépassé 56 millions d’euros en 2013, leur budget étant autofinancé à 97 % ;
– elles revendiquent pour l’année 2013 l’organisation de 3 400 « événements » à l’étranger, l’accueil de près de 2 000 entreprises dans des missions de prospection, la domiciliation de près de 900 entreprises…
Les pays d’implantation des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international
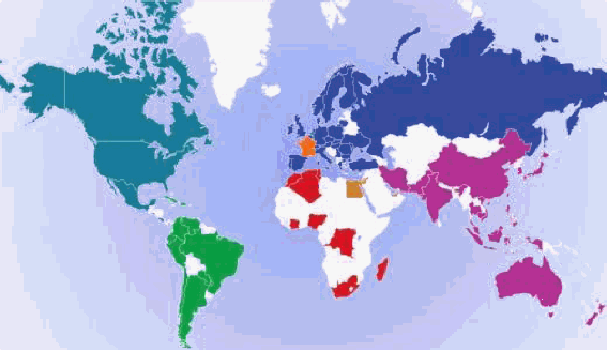
Source : CCI France international, « Cartographie du réseau des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international », juillet 2014.
Les CCIFI proposent aux entreprises une gamme de prestations diverses, variables d’ailleurs selon les chambres : informations sur les marchés et les pratiques d’affaires des pays, mise en relation avec des partenaires potentiels, études de marché, domiciliation postale ou fiscale, hébergement (bureaux provisoires dans l’attente d’une implantation), fourniture de commerciaux à temps partagé, aide au recrutement, gestion de paie et de formalités, etc. 38 % du chiffre d’affaires des CCIFI, soit 21,4 millions d’euros, est provenu en 2013 de la vente de prestations d’appui aux entreprises.
Les CCIFI sont donc souvent de fait en concurrence avec Ubifrance. Les tentatives d’établir un modus vivendi entre les deux réseaux, notamment à travers la Charte nationale de l’export signée en 2011, n’ont pas donné jusqu’à présent de résultats très probants. Il semble que l’on se dirige progressivement, dans les pays où les deux acteurs sont présents, vers un partage des rôles qui laisserait plutôt à Ubifrance l’amont de l’accompagnement des entreprises souhaitant s’implanter sur un nouveau marché (informations générales, organisation des premiers contacts...) et aux CCIFI l’aval du processus (hébergement provisoire de personnels envoyés et domiciliation de l’entreprise en cours d’implantation, aide au recrutement de personnel, à l’ouverture d’un bureau commercial…).
S’étant déplacée à Londres dans le cadre de la préparation du présent avis, votre rapporteure a pu visiter la chambre de commerce et d’industrie française au Royaume-Uni, qui est une institution dynamique animée par une équipe de direction jeune et très féminisée.
La chambre française en Grande Bretagne
La chambre française en Grande Bretagne a été créée en 1883. Elle regroupe 580 membres, qui sont tous des entreprises, avec une très forte prépondérance des activités de services. Leurs représentants désignés à la chambre sont à 60 % de nationalité française et à 33 % de nationalité britannique.
Elle emploie 22 collaborateurs.
La chambre propose aux entreprises des services divers : accompagnement, notamment à l’export, outsourcing de tâches de gestion (comptabilité, paie, domiciliation, etc.), aide au recrutement, location de bureaux provisoires dans ses locaux…
Elle a également une activité importante de publication, avec par exemple, avec l’AFII, celle d’un guide en anglais sur comment travailler et faire des affaires en France, ou encore d’un petit livre traitant de manière pragmatique des différences de comportement au travail entre Français et Anglais…
Le chiffre d’affaires annuel est d’environ 2 millions de livres (plus de 2,5 millions d’euros), alimenté à 40 % par les cotisations des membres, à 40 % par les services d’appui aux entreprises, à 14 % par l’organisation d’événements et à 6 % par la vente des publications. Il n’y a pas de financement public.
La chambre française se présente comme la plus grosse chambre de commerce étrangère au Royaume-Uni.
Il faut enfin rappeler que, dans sept pays dont Ubifrance est absent, la CCIFI locale a obtenu une délégation de service public (DSP) pour l’ensemble des prestations d’accompagnement à l’internationalisation. Ce choix a été fait au Maroc, pour des raisons historiques, la communauté d’affaires française et la chambre de commerce et d’industrie y étant anciennes et très actives, mais aussi dans plusieurs pays en développement dont certains beaucoup plus « difficiles » pour nos entreprises – soit que le développement économique y reste embryonnaire, soit pour des raisons politiques ou sécuritaires : Madagascar, Nigeria, Venezuela…
Les résultats obtenus dans le cadre de ces DSP apparaissent donc très inégaux. Les documents relatifs à l’activité des chambres transmis par leur « tête de réseau » CCI France international sont éloquents, comme on le voit sur le tableau ci-dessous : si la chambre du Maroc peut revendiquer, en 2013, l’accompagnement de 337 entreprises françaises, on tombe à zéro au Venezuela et en Jordanie sans compter le non-renseignement de certaines rubriques dans d’autres chambres… Il est vrai aussi que les moyens sont de même très disparates : 105 collaborateurs au Maroc ; entre 4 et 9 dans les autres chambres bénéficiant d’une DSP…
Moyens humains et activité des CCIFI bénéficiant d’une DSP
(en 2013, d’après le rapport d’activité des CCIFI par CCI France International)
Rép. dém. du Congo |
Jordanie |
Madagascar |
Maroc |
Nigéria |
Pérou |
Venezuela | |
Personnels |
4 |
4 |
9 |
105 |
7 |
6 |
6 |
Entreprises ayant bénéficié d’un service d’appui |
10 |
4 |
98 |
200 |
N.C. |
95 |
89 |
Entreprises accompagnées |
N.C. |
0 |
108 |
337 |
20 |
22 |
0 |
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les responsables du réseau des CCIFI soient moins enthousiastes pour l’ouverture de nouvelles DSP qu’ils ont pu l’être il y a quelques années.
La nécessaire coordination entre Ubifrance et les autres opérateurs progresse mieux, semble-t-il, s’agissant de la structure Entreprise Rhône-Alpes international (ERAI).
Cette structure, créée en 1987 avec un statut associatif, est emblématique des ambitions de certaines régions françaises à l’international. Elle s’est en effet considérablement développée : elle compte aujourd’hui 150 salariés et dispose de 27 implantations à l’étranger, réparties dans 21 pays, avec un budget (en 2012) de 14 millions d’euros, provenant pour moitié de subventions publiques. D’autres régions françaises ont aussi cherché à s’implanter à l’étranger pour aider leurs entreprises, mais le développement d’ERAI, pour le compte de la région Rhône-Alpes, reste sans égal.
L’essor d’ERAI l’a amenée à proposer aux entreprises la plupart des services d’accompagnement disponibles sur le marché : études de faisabilité, participation à des foires et salons, conseil en financement, recherche de partenaires commerciaux, recrutement d’agents, hébergement/domiciliation, suivi commercial, etc. ERAI a de plus développé une offre globale d’aide à l’implantation, dite « Implantis », dans le cadre d’incubateurs d’entreprises. Cet essor, disproportionné avec les besoins des seules entreprises rhônalpines, l’a enfin conduite à élargir son offre à des entreprises d’autres régions et même à rechercher des partenariats hors de France : un accord a été passé avec la province du Québec pour ouvrir les incubateurs d’ERAI à ses entreprises.
Il s’est donc créé une concurrence de fait entre Ubifrance et ERAI sur plusieurs sites où les deux agences sont implantées. Pour sortir de cette situation, une première convention de partenariat opérationnel a été conclue le 13 juin 2012, pour mieux articuler les réseaux et les compétences de l’une et l’autre, suivie le 27 mai 2013 d’une convention cadre pour développer la complémentarité entre les deux agences. L’intérêt de ce texte est surtout de prévoir des déclinaisons locales : sur les 13 implantations communes aux deux agences, 10 ont vu la signature de conventions locales.
Les « maisons de l’international » représentent potentiellement un modèle de rapprochement beaucoup plus abouti entre les opérateurs.
L’initiative en a été annoncée par le Président de la République à l’issue des Assises de l’entreprenariat en avril 2013. L’objectif est de faciliter l’implantation des entreprises françaises sur des marchés stratégiques – l’ambition étant qu’elles gagnent ainsi un an sur leur période d’installation.
La première « maison » a été inaugurée par le Président de la République le 12 février 2014 à San Francisco. Baptisée « French Tech Hub », elle est née de la transformation de l’incubateur de l’agence régionale de développement (ARD) d’Île-de-France « Hubtech21 », qui était localisé à San Francisco et Boston : il a été ouvert aux entreprises de toute la France. Les secteurs visés sont principalement les technologies de l’information et de la communication (à San Francisco) et la santé (à Boston). Il s’agirait d’ici trois ans d’accompagner 75 entreprises par an, avec le soutien de tous les opérateurs français de soutien à l’internationalisation et en lien avec les pôles de compétitivité concernés.
Ubifrance met à disposition deux conseillers seniors spécialistes du numérique (à San Francisco) et des sciences du vivant (à Boston) et le MAEDI un expert technique international. Il est prévu que le Programme des investissements d’avenir (PIA) apporte une dotation d’amorçage d’un million d’euros pour la structure et de deux millions d’euros en avances remboursables aux entreprises.
Une autre maison de l’international est en cours de constitution en Chine en s’appuyant sur le partenariat établi avec l’opérateur ERAI (voir supra), qui y apportera son « Espace Rhône-Alpes » situé à Shanghai.
D’autres projets de « maisons de l’international » sont à l’étude au Japon et en Russie notamment. La vocation de ces maisons – généraliste sur un territoire ou spécialisée sur des créneaux comme c’est le cas aux États-Unis – est toutefois l’objet d’interrogations chez certains opérateurs.
3. Les conseillers du commerce extérieur de la France : vers un réseau rajeuni, féminisé et mieux coordonné avec l’action publique
L’histoire des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) remonte à 1898. C’est une institution originale, qui semble assez propre à notre pays même si certains de nos voisins ont des dispositifs qui s’en rapprochent ou souhaitent s’en inspirer.
Les CCEF sont des entrepreneurs ou des cadres d’entreprises privées qui acceptent de donner bénévolement une part de leur temps pour « concourir au développement des échanges internationaux de la France » (15). Ils ont à ce titre plusieurs missions :
– mener une action de veille et de conseil pour les pouvoirs publics ;
– transmettre leur expertise aux entreprises françaises qui souhaitent s’internationaliser ;
– sensibiliser les jeunes aux métiers de l’international, en promouvant en particulier le volontariat international en entreprise (VIE) ;
– promouvoir l’attractivité de la France. Cette dernière mission leur a été donnée par le décret n° 2013-1189 du 18 décembre 2013 qui a réformé l’institution en demandant également à ses membres de prendre un engagement écrit de remplir leurs fonctions.
Les CCEF sont nommés par décret pour trois ans. Ils sont présents dans 146 pays où ils forment 110 sections. Il y a au total 4 300 CCEF, dont 2 800 à l’étranger (des CCEF sont également nommés sur le sol français parmi les personnes ayant une grande expérience de l’international).
Ce réseau est l’objet depuis plusieurs années d’une politique active de rajeunissement et de féminisation qui était bien nécessaire, même si l’application très stricte et administrative de quotas exigeants quant au sexe des nouveaux conseillers conduit parfois à des difficultés de gestion.
De manière générale, le déploiement de la « diplomatie économique » dans les ambassades semble permettre une meilleure association des CCEF à l’action des services et des opérateurs publics comme Ubifrance, notamment grâce à la mise en place des conseils économiques.
M. Alain Bentéjac, nouveau président du Comité national des Conseillers du commerce extérieur de la France, désire renforcer les synergies entre les CCEF et les opérateurs publics en posant le principe du parrainage systématique par un conseiller des entreprises accompagnées à l’international par Ubifrance ou la chambre de commerce et d’industrie française du pays. Au niveau national, il souhaite aussi renforcer les échanges entre les CCEF et les administrations centrales et ministres compétents, afin que la mission de conseil aux pouvoirs publics soit mieux remplie.
Le programme des volontaires internationaux en entreprise (VIE) continue à se développer. Fin septembre 2014, plus de 8 200 VIE étaient en poste, soit une augmentation de 8 % depuis un an. Ce dispositif apparaît tout à fait bénéfique aussi bien pour les jeunes qui en bénéficient que pour les entreprises et plus généralement pour l’attractivité de la France :
– six mois après la fin de leur contrat, 97 % des jeunes ont un emploi ; 80 % sont embauchés par l’entreprise où ils ont réalisé leur VIE ;
– 30 % des cadres expatriés des entreprises françaises sont d’anciens volontaires (VIE ou autres statuts qui ont précédé celui-ci).
Néanmoins, il y a certainement un point sur lequel le programme VIE doit être amélioré : il n’est pas assez ouvert sur les compétences « techniques ». Les entreprises n’ont pas seulement besoin de jeunes issus des écoles de commerce. Une évolution se dessine heureusement : un programme « VIE-pro », permettant d’ouvrir le volontariat aux jeunes suivant des études supérieures professionnalisantes courtes, comme les licences professionnelles, sera expérimenté à partir du printemps 2015.
L’enjeu de coordination ne concerne pas que les opérateurs présents en aval, dans les pays étrangers, pour accueillir et accompagner les entreprises françaises. Le dispositif d’amont, chargé de détecter, motiver et conseiller les entreprises pour qu’elles se mettent à exporter ou exportent plus est tout aussi important. S’agissant de l’attraction des investissements étrangers, l’enjeu est similaire, bien que les phases soient inversées : il faut démarcher les investisseurs potentiels à l’étranger et détecter les projets d’investissement (rôle de l’AFII), mais aussi faire en sorte qu’ils soient ensuite bien accueillis dans les territoires.
Dans leur rapport de 2013 sur les dispositifs de soutien à l’internationalisation des entreprises (16), MM. Alain Bentéjac et Jacques Desponts soulignaient tout à la fois le degré élevé d’implication des régions françaises dans le soutien à leurs entreprises à l’international et la diversité des modes d’organisation de ce soutien : « chaque région a son propre schéma d’organisation et de répartition des missions de soutien à l’export, d’attractivité (…) et d’innovation, entre le conseil régional, la CCI régionale et des agences spécialisées, qui peuvent exercer une ou plusieurs de ces missions à la fois. On ne peut donc pas dégager de modèle général. En outre, les entités infrarégionales (départements, métropoles) ont aussi souvent leurs propres agences de développement ».
Les chiffres recueillis dans le cadre de ce rapport montraient un effort budgétaire très variable mais parfois très important des conseils régionaux : par exemple, pour 2012, un budget de plus de 3 millions d’euros pour l’Alsace et des implantations au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Chine et en Italie ; pour le Languedoc-Roussillon, un budget de près de 2 millions d’euros et une présence aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Maroc et en Chine ; pour Rhône-Alpes, avec l’agence régionale ERAI, une présence dans 21 pays… Le rapport décomptait au total 94 implantations directes à l’étranger, employant un peu moins de 200 personnes.
Que ce soit au regard de leur implication effective ou en raison de leur compétence de développement économique, les régions ont une réelle légitimité à l’international.
C’est dans cette optique que le choix a été fait, en 2012, de confier aux régions une mission de coordination en la matière, dans le cadre de la déclaration commune État-régions pour la croissance et l’emploi du 12 septembre 2012, dite « déclaration de l’Élysée ».
Les régions ont donc été chargées d’élaborer des plans régionaux pour l’internationalisation des entreprises (PRIE). 19 régions sont maintenant dotées d’un PRIE. De plus, dans un cas, celui de la Bourgogne, le plan d’action régional export antérieur (2011-2014) fait office de PRIE. Dans quelques régions, les négociations se poursuivent pour une signature prévue pour la fin de l’année, notamment en Alsace, en Martinique et en Guadeloupe.
Il reste à voir dans quelle mesure les PRIE joueront un rôle utile de coordination. Il convient également de veiller à ce que le développement de 22 politiques régionales à l’export, qui est une réalité, ne remette pas en cause l’unité de la politique nationale dans ce domaine.
Le réseau des chambres de commerce et d’industrie évalue à 400 le nombre des conseillers export qu’il déploie sur le sol français. Il déclare avoir appuyé, en 2013, 24 000 entreprises à l’international, dont plus de 5 000 primo-exportateurs. Il joue donc un rôle considérable.
La coordination entre ce réseau et les autres acteurs ou opérateurs, notamment les régions et Ubifrance, a été l’objet ces dernières années de plusieurs tentatives aux résultats incertains : une convention pentapartite en 2008, puis la « charte nationale de l’export » en 2011. Celle-ci prévoyait la création, dans chaque région, d’un guichet unique dont l’animation serait principalement confiée aux chambres de commerce et d’industrie régionales. Elle comprenait un engagement du réseau consulaire à orienter les entreprises vers Ubifrance pour leur accompagnement à l’export, plutôt qu’à privilégier systématiquement un renvoi vers les CCIFI. Cet engagement était même chiffré. Cependant, il ne semble toujours pas possible de quantifier précisément sa réalisation. Cette situation est due à l’absence de système d’information coordonné dans le réseau consulaire et peut-être à la réticence de ce dernier à s’engager sur des objectifs traçables.
S’agissant de l’articulation avec les régions, la plupart des PRIE qui viennent d’être adoptés désignent la chambre de commerce et d’industrie comme point d’entrée pour les entreprises désirant se développer à l’international. Cependant, la coordination reste plus ou moins assurée selon les régions. Il en est de même pour l’évitement des « doublons ».
Le label « Bpifrance Export » a été créé en mai 2013. Il repose sur un partenariat entre la Banque publique d’investissement, la Coface et Ubifrance. L’objectif est de favoriser l’accès des PME et des ETI aux dispositifs des différents acteurs en rendant plus lisible l’offre globale de soutien aux exportateurs.
Cette offre rationalisée doit permettre de coupler le volet d’accompagnement des entreprises à l’export par Ubifrance avec le volet de financement assuré par la BPI et la Coface, ce tout au long de leur internationalisation :
– la phase de prospection sur les marchés internationaux peut être couverte par un accompagnement d’Ubifrance, en vue d’explorer l’ouverture de nouveaux marchés, et par l’assurance prospection de la Coface, qui préfinance la prospection des marchés ;
– le financement du développement international peut être pris en charge par le « prêt export » de Bpifrance et par les garanties de la Coface sur les cautions et les préfinancements accordés par des banques sur des contrats exports ;
– la phase de déroulement du projet export peut être sécurisée par la Coface (assurance crédit et assurance de change) ;
– la phase de consolidation du projet export peut être accompagnée par Ubifrance, par la Coface, qui propose une protection contre les risques politiques (assurance investissement), et par Bpifrance, qui propose une garantie des apports en fonds propres aux filiales étrangères.
Sur le terrain, ce rapprochement des offres des opérateurs est obtenu grâce au déploiement dans les directions régionales de la BPI de « développeurs » de la Coface et de chargés d’affaires venus d’Ubifrance. 37 de ces chargés d’affaires Ubifrance sont en poste en septembre 2014, l’objectif de 40 initialement fixé devant être atteint en 2015.
La réussite de l’opération « Bpifrance Export » semble cependant laisser un peu de côté certains acteurs, notamment le réseau consulaire.
La nouvelle phase (2013-2018) de la politique des pôles de compétitivité met en particulier la priorité sur leur développement à l’international : il s’agit non seulement de renforcer ainsi notre capacité d’exportation, mais aussi de favoriser les partenariats internationaux pour les PME et ETI innovantes. Il est donc désormais demandé aux pôles de compétitivité de se fixer des objectifs et des indicateurs de résultat en matière d’internationalisation. Le dernier rapport d’évaluation de la politique des pôles de compétitivité (17) montre que le nombre de collaborations formalisées avec les clusters étrangers a connu une forte croissance sur la période 2008-2011 : chaque pôle a cité en moyenne 4,8 collaborations en 2011 contre 1,9 en 2008, soit un total de 340 collaborations.
Une convention conclue en janvier 2009 entre Ubifrance et l’État constitue le cadre principal du soutien à l’internationalisation des pôles de compétitivité. Entre 2009 et 2012, environ 100 opérations ont été menées dans ce cadre, pour un coût budgétaire de 1,8 million d’euros, lesquelles ont permis de soutenir 1 160 acteurs économiques des pôles de compétitivité, dont 660 PME/ETI. Plus de 200 accords de partenariats technologiques et commerciaux ont été signés suite aux missions mises en œuvre au cours de cette période. Le renouvellement de cette convention pour la période 2014-2017 est en cours de discussion.
Les outils de financement et de garantie à l’export constituent des instruments techniques très utiles. Les deux opérateurs qui interviennent pour le compte de l’État en la matière sont, d’une part, traditionnellement, la Coface, d’autre part, plus récemment, la Banque publique d’investissement (BPI), qui ont, comme on l’a dit, coordonné leurs offres aux entreprises dans le cadre du label « Bpifrance Export ».
La BPI a lancé récemment plusieurs nouveaux produits.
Le « prêt export », lequel a remplacé le « prêt pour l’export » qui était plafonné à 150 000 euros, rencontre un réel succès : fin septembre 2014, 469 dossiers avaient déjà été validés pour un montent de 268 millions d’euros – contre seulement 647 prêts pour l’export durant tout l’exercice 2013, pour un montant de 102 millions d’euros. Ce prêt export est désormais le produit unique de financement à l’exportation pour les PME et les ETI ; pouvant atteindre jusqu’à 5 millions d’euros, il est remboursable en 7 ans dont 2 ans de différé, sans caution personnelle ni garantie.
La « garantie de projet à l’international », destinée à garantir les fonds propres des filiales créées hors Europe par des entreprises françaises, connaît des débuts plus modestes, avec seulement 55 dossiers recensés jusqu’en septembre 2014.
La BPI souhaite aussi favoriser le renforcement des fonds propres des exportateurs. Lancé en février 2013, l’appel à projet « label Export » vise à accélérer l’émergence et le développement de fonds d’investissement accompagnant l’internationalisation des PME. Les fonds de capital-investissement doivent, pour pouvoir être sélectionnés, soit avoir une stratégie centrée sur l’internationalisation des entreprises, soit s’engager à investir dans des PME exportatrices. Ces fonds sont alors éligibles à une enveloppe de 150 millions d’euros de Bpifrance Investissement, dans le cadre de son activité de fonds de fonds. Cet objectif est déjà dépassé : au 1er septembre 2014, sept fonds avaient déjà été labellisés pour un total de souscriptions de Bpifrance de 254,5 millions d’euros.
La Coface gère pour le compte de l’État cinq dispositifs d’assurance pour les exportateurs :
– l’assurance crédit consiste à couvrir, à moyen ou à long terme, les exportateurs contre le risque d’interruption de leur contrat et les banques contre le risque de non remboursement des crédits à l’exportation octroyés à un acheteur étranger. C’est traditionnellement le dispositif qui correspond aux plus gros dossiers et donc au plus gros encours garantis. En 2013, les encours à ce titre représentaient plus de 61 milliards d’euros, soit plus de 95 % du total des encours des garanties publiques (64 milliards d’euros). Le bénéfice de ce dispositif est très concentré sur les secteurs économiques qui passent des « grands contrats » : défense, aéronautique, espace, construction navale… La défense et l’aéronautique réunies ont ainsi représenté 81 % des contrats d’assurance crédit en 2012, 59 % en 2013 et 79 % au 1er semestre 2014 ;
– l’assurance prospection a pour objet d’accompagner les actions de prospection commerciale dans les pays étrangers, en avançant les dépenses liées à ces actions, le degré de remboursement étant lié aux résultats obtenus ensuite. Ce dispositif structurellement déficitaire est réservé aux PME. Le montant moyen des dossiers est faible : l’encours par dossier a été en moyenne de 57 000 euros en 2013, soit exactement le millième de l’encours moyen en assurance crédit (57 millions d’euros). En revanche, le nombre de bénéficiaires est élevé : près de 4 000 dossiers en 2013, soit 78 % du total des dossiers au titre des différentes garanties publiques ;
– la garantie de change assure les exportateurs contre la baisse éventuelle du cours des devises de facturation d’un contrat dont la signature et l’entrée en vigueur sont incertaines ;
– la garantie du risque exportateur assure les cautions et les préfinancements octroyés par les banques dans le cadre de contrats à l’export ;
– il faut enfin signaler pour mémoire la garantie du risque économique qui protégeait les exportateurs français, pendant l’exécution de leurs contrats, contre le risque d’accroissement de leurs coûts en période d’inflation élevée. Cette procédure n’est plus utilisée et est aujourd’hui en extinction.
Ces dispositifs ont été significativement réformés depuis deux ans.
a. L’extension de plusieurs garanties, notamment pour favoriser les grands contrats dans l’aéronautique et la construction navale
La première réforme des garanties publique, inscrite dans la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, avait pour objectif d’élargir les sources de financement des exportations françaises à travers trois mesures :
– la création d’une garantie de refinancement offrant un nouvel accès à la liquidité aux banques qui accordent des crédits à l’export ;
– la création d’une garantie de change sur la valeur résiduelle des aéronefs, afin de développer les financements en euros de ce type d’actifs ;
– l’extension du bénéfice de la garantie dite « pure et inconditionnelle » (à 100 %), auparavant réservée aux seuls avions gros porteurs, à la plupart des avions et hélicoptères civils.
La loi de finances rectificative du 29 décembre 2013 comprend une nouvelle série de modifications des dispositifs :
– le relèvement de 900 millions d’euros à 2 milliards du plafond des garanties octroyées dans le cadre de la construction de navires de croisière, pour s’adapter à l’accroissement de la taille et donc du prix de ce type de navires ;
– la création d’un mécanisme d’intervention rapide de l’État sur le marché de l’assurance crédit de court terme (durée de crédit inférieure à deux ans), destiné à être utilisé sur des zones géographiques délaissées par le marché privé. Ainsi en cas de besoin, un dispositif public pourra prendre sans délai le relais des assureurs crédit privés ;
– l’élargissement du champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement, rendu nécessaire par le fait que certains refinanceurs potentiels importants n’étaient pas éligibles au mécanisme mis en place fin 2012. Les principales institutions auxquelles ce dispositif a été étendu sont la Caisse des dépôts et consignations, les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne, les fonds souverains, les organismes de retraite et fonds de pension français ou étrangers.
L’assurance prospection est un dispositif ancien, puisqu’il remonte à 1951. Étant tourné vers les PME, il a été poussé par depuis quelques années par les pouvoirs publics. En 2008, il a notamment été décidé de créer un nouveau produit, l’« assurance prospection premiers pas » (A3P), simplifié et destiné aux entreprises primo-exportatrices, lequel a connu un réel succès.
De 2008 à 2013, le flux annuel de bénéficiaires a donc plus que doublé (passant de 1 645 à 3 960, y compris l’A3P précitée) et le total de l’encours garanti a connu une évolution presque aussi rapide (il est passé de 148 millions d’euros à 281 millions d’euros). Ceci s’est accompagné d’une forte croissance du déficit de la procédure, à la charge de l’État : ce déficit est passé de 36 millions d’euros en 2008 à 95 millions en 2013 et devrait être de l’ordre de 106 millions d’euros en 2014 ; il aura donc triplé en six ans.
En conséquence, des mesures de recentrage ont été adoptées le 30 mars 2014. Elles concernent à la fois l’assurance prospection et l’A3P. Elles visent, pour l’essentiel, à limiter ou plafonner certaines prises en charge (montant des frais de séjour des salariés ou des représentants légaux de l’entreprise, frais de conseil, frais liés aux sites internet) et à limiter à deux le nombre de contrats d’A3P qu’une entreprise peut solliciter.
De nouvelles évolutions des outils de financement de l’export devraient voir le jour prochainement :
– Bpifrance pourrait développer en 2015 une activité d’octroi de crédits à l’export de faibles montants et de rachat de crédits fournisseur, conformément à l’annonce faite le 14 février 2014 par le Gouvernement. Ces prêts directs auraient vocation à pallier une défaillance de marché identifiée (sur un pays par exemple) et serait centrés sur les PME et ETI ;
– il est également envisagé de mettre en place un dispositif de refinancement avec cession de créances. Ce schéma, actuellement à l’étude, présenterait l’avantage de déconsolider les crédits export du bilan des banques commerciales, répondant ainsi aux nouvelles contraintes bilancielles créées par l’entrée en vigueur des règles prudentielles issues des accords dits « Bâle III » ;
– enfin, le dispositif de prêts concessionnels de l’État aux acheteurs souverains (Réserve pays émergents) pourrait être élargi à des prêts non concessionnels consentis aux États étrangers dans lesquels la politique d’assurance crédit autorise l’intervention publique. Cette évolution permettra de proposer, en complément des deux dispositifs précédents, une offre de prêt dans des cas où les exportateurs français sont confrontés à des conditions de concurrence particulièrement sévères (exportateurs étrangers bénéficiant de dispositifs de prêt public direct ou de refinancement public notamment).
Beaucoup a déjà été fait, depuis deux ans, pour rendre plus cohérents et plus lisibles nos dispositifs d’appui à l’international. La nouvelle architecture gouvernementale en place depuis le printemps 2014 contribue à la visibilité de l’impératif de développement international.
Votre rapporteure considère que le mouvement engagé doit être poursuivi et amplifié. Il reste beaucoup à faire pour unifier et valoriser l’image internationale « économique » de la France, donner toute sa portée à la priorité au développement international et positionner notre pays sur les marchés de demain, c’est-à-dire le monde émergent.
Durant ses déplacements à l’étranger, votre rapporteure fait trop souvent le constat de la faiblesse de la communication institutionnelle française.
Les documents adressés à nos ambassades et opérateurs économiques à l’étranger pour présenter et valoriser la France, son économie, les réformes engagées par son Gouvernement, sont souvent inutilisables : touffus, peu compréhensibles par des personnes étrangères aux débats internes français, trop rarement traduits dans au moins une langue étrangère, parfois tardifs et décalés par rapport à l’actualité…
Des campagnes publicitaires ont certes été menées pour promouvoir à l’international l’image économique de la France, notamment la campagne « Say oui to France, say oui to innovation » confiée à l’AFII et à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) en 2012-2013, mais avec des moyens limités. Cette campagne n’a couvert qu’un nombre limité de pays (États-Unis, Canada, Chine, Inde et Brésil).
De même, les moyens confiés à l’opérateur Atout France pour la promotion touristique de la France sont en recul constant. En 2015, ils atteindraient seulement 2,9 millions d’euros pour la part étatique du financement des campagnes de promotion. Cette situation oblige Atout France à recourir très massivement à des partenariats (avec les régions ou des entreprises en sponsoring) pour financer la promotion de la destination France dans les différents pays. Cela a pour conséquence que l’opérateur national n’a qu’une influence réduite sur le contenu de ces campagnes : il n’est plus possible d’avoir une ligne directrice.
En 2013, le Gouvernement avait confié une mission sur les enjeux et les moyens de mise en œuvre d’une « marque France » à un groupe présidé par M. Philippe Lentschener. L’objectif était d’identifier le « récit économique » de la France – en partant du constat que notre récit national est pour l’heure politique, culturel, social, mais guère économique – et de définir les meilleurs moyens de le partager. Ce travail a débouché sur un document qui identifiait trois valeurs qualifiées de typiquement françaises : l’amour des gestes et des savoir-faire ; la capacité à penser, imaginer et initier, de sorte qu’en France on ne se contente pas de créer des produits, mais on leur donne du sens et on imagine le monde qui va avec ; l’art de la surprise, la liste des inventions françaises étant impressionnante. Un concept fédérateur était dégagé : « la France est un multiplicateur de valeur ».
Mais cette démarche n’a pour le moment été suivie d’aucune mise en œuvre concrète.
S’agissant de l’ambition, plus restreinte, d’au moins fédérer sur internet les différents opérateurs publics français intervenant dans le champ international « économique », le Comité interministériel de la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013 avait pris plusieurs décisions : création d’une marque commune « France international », d’un portail internet unique proposant la palette des prestations et des financements et donnant accès à un annuaire interactif des partenaires de l’export, d’un réseau social dédié à la « communauté française de l’export », d’une plate-forme de mise en relation entre PME et sociétés de négoce international, etc. Le portail « France international » a effectivement été mis en place, avec des liens vers certains opérateurs selon la nature des informations ou prestations recherchées. Mais cet instrument reste en deçà des ambitions affichées.
Votre rapporteure s’est rendue en 2013 en Suède et en 2014 au Royaume-Uni, deux pays qui, eux, ont déjà investi dans la promotion d’une forme de « marque » nationale, ou plus exactement dans la promotion organisée, par la puissance publique, de leur image nationale, ce qui amène de fait à développer une politique de marque (« nation branding »).
Les encadrés qui suivent présentent synthétiquement ces expériences.
L’exemple britannique
La « GREAT Campaign », dont le slogan est « Britain is great », est une campagne de communication que le gouvernement britannique a lancée en 2012 en prévision des cérémonies du Jubilee et des Jeux Olympiques qui avaient lieu durant cette année, afin de capitaliser sur ces deux événements.
La campagne s’appuie sur plusieurs organismes, parmi lesquels UK Trade & Investment (UKTI, équivalent à la fois d’Ubifrance et de l’AFII), Visit Britain (équivalent d’Atout France), le British Council (équivalent de l’Alliance française), ainsi que sur les ministères des affaires étrangères, de la culture, des medias et des sports et des entreprises, de l’innovation et des compétences.
Une équipe a été constituée auprès du Premier ministre pour élaborer la stratégie de la campagne et assurer son organisation. C’est à ce niveau que la marque « Britain is great » est gérée : les déclinaisons de la campagne par les différents opérateurs doivent y être autorisées. Cette structuration interministérielle est présentée en Grande-Bretagne comme ayant le double avantage d’assurer la cohérence de l’action et d’impliquer l’ensemble des administrations.
Par ailleurs, plus de 90 célébrités britanniques et 60 entreprises ont soutenu bénévolement la campagne.
Le coût total sur quatre ans de la campagne est évalué à 100 millions de livres, soit environ 126 millions d’euros au taux de change actuel – plus de 30 millions d’euros par an. Ce coût annuel est pris en charge sur le budget de l’État. Les entreprises volontaires peuvent apporter un soutien sous la forme d’aide au marketing, de mise à disposition d’espaces publicitaires et de participation au lancement et à l’organisation des événements.
La campagne a lieu au Royaume-Uni, ainsi que dans 14 villes de 9 pays avec une cible de 90 millions de personnes touchées. UKTI a également organisé des « Great weeks » dans 10 pays : conférences, sessions de « speed dating » pour les entreprises britanniques avec des clients potentiels, campagne marketing auprès des medias locaux et réceptions organisés dans les résidences des ambassadeurs.
Le site internet de la campagne, « Britain is great », se donne pour vocation, selon son message d’accueil, de mettre en valeur ce que la Grande-Bretagne a de mieux à offrir. Sa page d’accueil met en avant trois items :
– le business, avec un lien vers le site de UKTI ;
– le tourisme ;
– les études en Grande-Bretagne. Cette valorisation des études comme élément central des échanges internationaux est significative. En 2012, selon l’UNESCO, le Royaume-Uni était le deuxième pays au monde pour l’accueil des étudiants étrangers : en accueillant 11 % du total mondial de ceux-ci, il arrivait derrière les États-Unis (19 %), mais devant la France (7 %), l’Australie (6 %) et l’Allemagne (5 %).
Selon le rapport annuel de UKTI, la « GREAT Campaign » a soutenu 2 500 entreprises britanniques à l’export et a contribué à la signature de 6 000 contrats d’exportation de services.
L’exemple suédois
La promotion de l’image de la Suède est présentée par les officiels suédois comme centrale dans l’action extérieure du pays : en découlent la valorisation de la culture du pays et, en troisième position, la recherche de gains économiques grâce aux investissements étrangers et au commerce international. Les ambassades suédoises à l’étranger ont des plans de promotion qui doivent décliner les trois volets : image de la Suède ; valorisation de la culture suédoise ; relations économiques.
La stratégie suédoise d’image nationale a pris forme en 1995 avec la création du « Conseil pour la promotion de la Suède à l’étranger », qui regroupe des représentants des ministères des affaires étrangères, des entreprises, de l’énergie, des communications et de la culture, ainsi que les agences nationales concernées, essentiellement l’agence de promotion des exportations et des investissements internationaux en Suède (Business Sweden), l’Institut suédois (Svenska institutet) et l’office du tourisme suédois (Visit Sweden).
L’Institut suédois est l’organisme en charge de la mise en œuvre de cette politique d’image, auquel il consacre l’équivalent d’une dizaine de millions d’euros par an (pour un pays de 9 millions d’habitants, donc sept fois moins peuplé que la France).
Une plate-forme de communication sur le label « Suède » a été élaborée entre 2005 et 2007. Cette communication est centrée sur les valeurs, le mode de vie et les façons de penser des Suédois, le postulat étant que des valeurs uniques contribuent à créer un positionnement unique. Elle se décline sur plusieurs axes : innovation, créativité, durabilité (« sustainability ») et société. L’objectif central est d’associer à la Suède le qualificatif de « progressive » en anglais, qui signifie à la fois « progressif » et « progressiste » : il s’agit de dire que la Suède est attachée au progrès, mais un progrès inclusif, graduel, respectueux des personnes et de l’environnement.
La Suède mise enfin sur son portail internet officiel, « sweden.se » : il est partiellement accessible (à des degrés divers) dans une trentaine de langues et serait le 3ème portail national le plus visité au monde (plus de 14 millions de visites uniques par an).
On peut tirer plusieurs leçons des expériences suédoise et britannique :
– toutes les dimensions sont prises en compte par ces politiques de marque nationale. Les dimensions économique et touristique ne sont même pas nécessairement présentées comme prioritaires. La promotion de la culture nationale, des valeurs sociétales ou de la qualité du système éducatif des pays peuvent être (au moins dans la présentation) aussi, voire plus importantes ;
– comme les politiques de marque nationale intéressent nécessairement plusieurs ministères et divers opérateurs publics – notamment ceux chargés du soutien aux exportateurs, de l’attractivité et de la promotion touristique, mais aussi tous ceux liés à la culture –, leur animation est nécessairement collective et interministérielle. La volonté est d’impliquer autant que possible le plus grand nombre de ministères ;
– des moyens financiers importants sont dégagés sur le budget de l’État ;
– les acteurs privés, entreprises et célébrités, sont associés à ces politiques ;
– si, pour des raisons de domination linguistique, le Royaume-Uni ne se soucie guère de communiquer sur son image dans de multiples langues, c’est en revanche le cas de la Suède, dont le site internet est accessible, outre le suédois, en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.
On peut donc dégager quelques préconisations générales sur ce que pourrait être une politique d’image de la France :
– elle demandera un effort budgétaire significatif, se comptant en dizaines de millions d’euros ;
– les acteurs privés, entreprises et personnalités du monde artistique et culturel, devront également y prendre part ;
– elle devra présenter un caractère interministériel, le plus grand nombre possible de départements ministériels ayant vocation à y être associés et à la décliner ;
– cela peut ou non impliquer un pilotage au niveau du Premier ministre. En tout état de cause, cette action devra recevoir une forte impulsion politique. En effet, il n’est pas seulement nécessaire de se doter d’outils de communication, mais aussi de savoir quels messages on veut faire passer, ce qui est du ressort du « politique ». Une impulsion politique au plus haut niveau permet aussi de mobiliser plus facilement (et bénévolement) les artistes et les entreprises pour qu’ils contribuent à la politique d’image nationale ;
– la communication qui sera mise en place devra utiliser tous les supports possibles et être systématiquement traduite, autant que possible dans plusieurs langues, à défaut au moins en anglais.
Sur ce point, votre rapporteure observe que la législation française, à trop vouloir bien faire, a parfois des effets inverses de ceux recherchés. Il apparaît ainsi que les sites internet publics français sont rarement traduits en anglais, car la loi, dans un souci de promotion de la diversité linguistique face à la domination de cette langue, impose une traduction en deux langues au moins, ce qui accroît les coûts et décourage les velléités de traduction. La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite « loi Toubon », dispose en effet que « toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public (…) et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française (…). Lorsque [ces] inscriptions ou annonces (…), apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public, font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux » ; cette formulation est considérée comme s’appliquant aux sites internet.
Enfin, la question de la structure qui aura à mettre en œuvre cette politique reste ouverte. Il semble que cela doive faire partie des missions confiées à la nouvelle agence issue de la fusion entre Ubifrance et l’AFII. C’est une option. Quoi qu’il en soit, il est important que soient mobilisées l’ensemble des compétences qui existent déjà dans l’administration et les opérateurs publics en matière de communication. On peut citer à cet égard les personnels d’Atout France et les services de communication des ambassades et du ministère des affaires étrangères ; le site internet de ce dernier est aujourd’hui parmi les sites publics les plus visités et il serait regrettable de ne pas utiliser cette notoriété.
Le commerce en ligne est en développement rapide et c’est sans doute un outil très efficace de développement de l’export, qui de surcroît ne coûte aucun argent public. Les entreprises qui proposent leurs produits en ligne reçoivent en effet des commandes de l’étranger sans avoir à les solliciter et souvent sans les chercher particulièrement. Cela pose d’ailleurs, semble-t-il, des problèmes particuliers, pour le moment non pris en charge, quand ces exportateurs « malgré eux » sont des petites voire de très petites entreprises : elles n’ont souvent aucune connaissance des moyens pratiques d’expédier des produits à l’international à un coût raisonnable, ni des formalités douanières.
À cet égard, il serait opportun que soit mis en place un dispositif d’information basique et d’aide sur les questions de fret et de formalités douanières.
Par ailleurs, puisque le fait de proposer ses produits sur internet génère des achats étrangers, accroître le nombre d’entreprises vendant sur internet pourrait faire partie des objectifs de la politique du commerce extérieur, avec des actions de communication adaptées. Le taux d’entreprises françaises qui vendent en ligne, soit 14 % en 2012, reste inférieur à la moyenne européenne (16 %) et à ceux de pays tels que l’Allemagne (24 %) ou le Royaume-Uni (21 %).
Votre rapporteure l’a rappelé en première partie du présent avis, le commerce extérieur français reste concentré à près de 60 % sur l’Union européenne, alors même que les neuf dixièmes de la croissance des marchés se feront ailleurs dans les prochaines années.
C’est un fait que notre « diplomatie économique » se positionne clairement sur les économies émergentes depuis deux ans, votre rapporteure s’en félicite. Mais le mouvement est encore insuffisant. Il faut que les administrations, les réseaux des opérateurs suivent. Ils ont commencé, mais il reste beaucoup à faire.
Une politique volontariste de diplomatie économique a effectivement été engagée depuis deux ans en direction des économies émergentes. Des initiatives ont été prises dans de nombreux pays ou régions du monde, telles que :
– la nomination des « représentants spéciaux ». Sur les dix qui ont été nommés, un seul a pour champ d’action une économie mature (le Japon) ; les autres voient leur action orientée vers des économies émergentes, dont les quatre « BRIC » ;
– la signature d’un plan de coopération à moyen et long terme des relations franco-chinoises, durant la visite d’État du Président Xi Jinping en mars 2014, qui permettra de poursuivre plusieurs objectifs économiques : l’approfondissement des partenariats historiques dans les domaines de l’aéronautique, du nucléaire et de l’automobile ; la promotion de nouveaux secteurs porteurs pour notre coopération (urbanisme durable, santé, agroalimentaire, numérique), afin de favoriser une diversification et un rééquilibrage des relations économiques et commerciales bilatérales ; l’ouverture plus grande du marché chinois…
– en Inde, après la visite du Président de la République en février 2013, des actions concentrées sur les secteurs des transports, des énergies renouvelables et du développement urbain (cinq missions conduites par le représentant spécial, M. Paul Hermelin ; l’organisation prochaine d’un séminaire « rail »), ainsi que sur l’agroalimentaire ;
– la mise en place du 2ème Forum économique franco-brésilien en mai 2014, qui a réuni les entreprises et les administrations des deux pays ;
– en Colombie, un déplacement de la ministre Nicole Bricq, en décembre 2012, pour promouvoir l’offre française dans le secteur du « mieux vivre en ville », puis, en février 2013, une visite du ministre des affaires étrangères. Une nouvelle séquence de visites de haut niveau est prévue en 2014-2015. Le ministère de l’économie et des finances a financé plusieurs études de faisabilité, réalisées par des ingénieries françaises, pour des projets d’infrastructures ;
– pour le continent africain, la création en juillet 2014, suite au sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique de décembre 2013, de la Fondation franco-africaine pour la croissance, qui rassemblera intérêts publics et privés français et africains, et dont la préfiguration a été confiée à M. Lionel Zinsou.
Par ailleurs, s’agissant de l’Afrique du Sud, la visite du Président de la République François Hollande, en octobre 2013, puis la rencontre du Vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa avec le ministre des affaires étrangères et du développement international Laurent Fabius, en juin 2014, ont permis de manifester le soutien de la France au renforcement du rôle de l’Afrique du Sud dans la gouvernance économique mondiale et de relancer les relations économiques bilatérales.
Un redéploiement significatif de l’instrument d’aide liée qu’est la Réserve pays émergent (RPE) a également été effectué. Alors même qu’une seule RPE avait été historiquement accordée en Afrique subsaharienne, deux le seront en 2014 dans la zone : une en Côte d’Ivoire (pour le réseau d’adduction d’eau de la région centre-ouest), signée lors de la visite du Président de la République en juillet 2014, l’autre au Kenya (également pour l’adduction d’eau, à Nairobi).
En trois ans, la présence, directe ou indirecte, d’Ubifrance en Afrique subsaharienne a connu un renforcement conséquent avec :
– la création de quatre nouveaux bureaux (Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire et Kenya) qui s’ajoutent à celui d’Afrique du Sud, de sorte que les cinq bureaux de l’organisme lui permettront de couvrir 13 pays africains ;
– la création d’antennes légères (un VIA-VIE) au Sénégal, au Ghana et au Congo Brazzaville ;
– le recours à des VIA en poste dans les ambassades pour « vendre » le catalogue Ubifrance au Mozambique et en Éthiopie ;
– la conclusion en 2012-2013 de trois accords de partenariat exclusif (délégation de service public) avec les CCIFI de Madagascar, du Nigeria et de la République démocratique du Congo.
Le renforcement de la présence africaine d’Ubifrance doit certes être salué, mais on voit bien aussi que, faute de moyens suffisants, il repose en partie sur des solutions qui ne sont pas pleinement satisfaisantes : le recours aux délégations de service public à des chambres de commerce et d’industrie dans des pays « difficiles » où, la présence française préexistante étant limitée, ces chambres ont forcément des moyens limités ; l’envoi de VIE, donc de jeunes dépourvus d’expérience, qui se retrouvent de plus assez isolés, même s’ils peuvent s’appuyer sur les ambassades de France.
Dans le contexte budgétaire présent, les moyens doivent se trouver principalement par redéploiement interne. Quand on examine la répartition géographique des personnels d’Ubifrance et des autres grands réseaux internationaux publics ou parapublics à vocation économique, qui est détaillée dans les graphiques qui suivent, on constate qu’ils sont encore assez « eurocentriques » : selon les cas, l’Europe accueille encore de 20 % à 40 % de tous leurs personnels localisés hors de France.
Certes l’Europe pèse encore, à ce jour, plus lourd dans le commerce extérieur français (60 %). Et ceux de ces réseaux dont les ressources reposent pour tout ou partie sur les paiements ou les cotisations des entreprises françaises implantées (chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international et Ubifrance) doivent évidemment aussi tenir compte des implantations et des marchés de celles-ci.
Mais, votre rapporteure en est convaincue, le redéploiement des réseaux vers les marchés émergents reste très insuffisant et doit être amplifié.
La répartition des effectifs à l’étranger d’Ubifrance en 2013 (18)
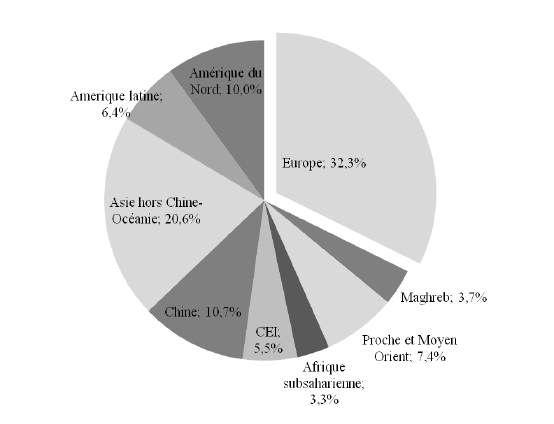
La répartition des personnels à l’étranger de l’AFII en 2013 (19)
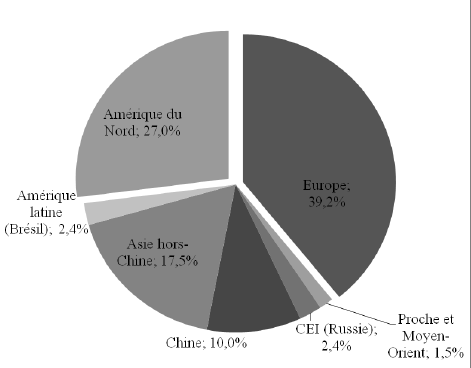
La répartition des personnels des services économiques extérieurs au 31/12/2013 (20)
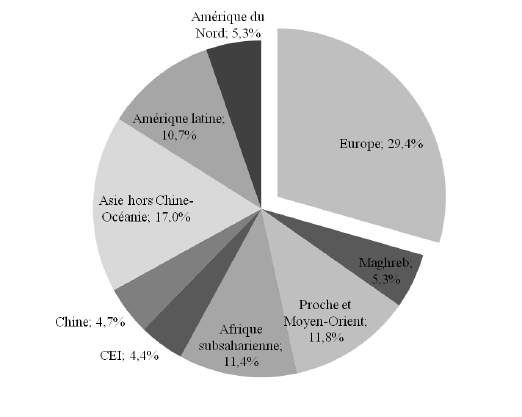
La répartition des collaborateurs des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger (21)
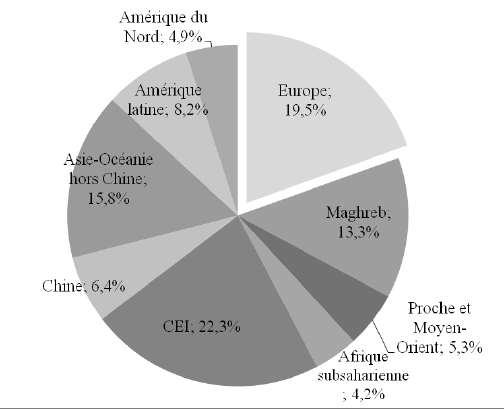
Source des graphiques : données du questionnaire budgétaire et des CCIFI.
Ce redéploiement des réseaux doit sans doute s’accompagner de mesures d’organisation, par exemple :
– une réflexion sur les missions des différents réseaux, avec notamment un partage géographique plus clair entre Ubifrance (ou plutôt la nouvelle agence issue de sa fusion avec l’AFII) et le réseau consulaire. Bénéficiant d’argent public, l’agence a peut-être plus vocation à défricher les pays nouveaux et « difficiles » pour les entreprises françaises ;
– une meilleure mobilisation des diasporas françaises et, dans leur pays d’origine, des Français d’origine étrangère, comme les États-Unis, notamment, savent le faire ;
– le déploiement le plus grand possible du réseau des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), qui exercent leur mission bénévolement. À cet égard, le fait que l’accès au statut de CCEF reste réservé aux citoyens français et communautaires paraît parfois inadapté dans une économie mondialisée où, de plus en plus souvent, les filiales des entreprises françaises implantées à l’étranger ont des dirigeants qui ne sont pas de nationalité française.
Dans le contexte actuel de nécessaire réduction des dépenses publiques, il peut paraître difficile de soutenir que le soutien à l’export et plus généralement à l’internationalisation de nos entreprises devrait bénéficier d’une priorité budgétaire.
Mais votre rapporteure, s’étant rendue à Londres pour la préparation du présent avis, a constaté que le Royaume-Uni avait décidé de renforcer considérablement les moyens de son opérateur dédié à l’internationalisation des entreprises, UK Trade & Investment (UKTI), alors même que la situation globale des finances publiques est plus dégradée qu’en France. Un déficit public s’élevant à 6,6 % du PIB pour l’exercice budgétaire 2013-2014 n’a pas empêché le Gouvernement britannique de décider d’accroître de 70 % les moyens de l’agence UKTI !
UKTI constitue un exemple intéressant, car le périmètre de ses missions correspond sensiblement à celui de la nouvelle agence qui sera issue de la fusion entre Ubifrance et l’AFII : ce regroupement a été effectué depuis longtemps au Royaume-Uni. Par ailleurs, ce qui facilite la comparaison, les tailles économique et démographique de la France et de la Grande-Bretagne sont quasiment identiques (66 millions d’habitants en France pour 64 millions outre-Manche ; des PIB globaux très voisins puisque l’écart entre les deux pays – selon les statistiques du FMI pour 2014 – est de 2 %).
UK Trade & Investment
UK Trade & Investment est une agence d’État placée sous la tutelle conjointe du ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences et du ministère des affaires étrangères ; elle dépend du secrétaire d’État au commerce et à l’investissement. Il faut noter que la double tutelle ministérielle exercée sur UKTI est perçue comme un élément de complexité – c’est du moins ce qui ressort de l’entretien de votre rapporteure avec l’un des dirigeants d’UKTI.
Les moyens alloués à UKTI ont considérablement augmenté en 2013-14, avec un budget de 157,2 millions de livres, soit environ 200 millions d’euros, contre 92,5 millions de livres en 2012-13 (+ 70 %). Le volet de ce budget qui est consacré à l’export a quasiment doublé par rapport à 2012-2013 et s’élève pour l’exercice 2013-2014 à 111,6 millions de livres. Ce budget est mis au service d’un objectif extrêmement ambitieux : doubler les exportations britanniques par rapport à leur niveau de 2012 pour atteindre mille milliards de livres d’exportations d’ici 2020.
UKTI est organisé autour de 5 pôles, chargés respectivement :
– du soutien aux entreprises britanniques à l’international. Il s’agit du pôle le plus important, qui comprend des bureaux sectoriels et géographiques ;
– de la promotion du Royaume-Uni auprès des investisseurs étrangers ;
– du soutien spécifique aux entreprises des secteurs de la défense et de la sécurité ;
– de la communication (notamment campagne « GREAT ») ;
– des fonctions support.
UKTI a 109 implantations à l’étranger et employait 1 911 agents en 2013, dont 1 352 à l’étranger. Ces effectifs ont globalement augmenté d’une trentaine de personnes de 2012 à 2013, avec de plus un fort redéploiement vers l’étranger, où les effectifs en poste ont augmenté de 70. Dans des pays majeurs comme les États-Unis, la Chine et l’Inde, UKTI a une centaine d’agents au moins.
Outre ses personnels, les limites imposées à l’emploi public en Grande-Bretagne conduisent UKTI à recourir aux services de consultants extérieurs. UKTI a également décidé de financer les chambres de commerce britanniques à l’étranger, afin qu’elles fournissent de meilleurs services aux entreprises. Le budget pour ce recours aux consultants et le financement des chambres de commerce représente 16 millions de livres pour l’exercice 2013-2014, soit 20 millions d’euros.
16 millions de livres sont également prévues pour subventionner la participation des entreprises britanniques à des événements (salons, foires…) à l’étranger.
Il faut enfin signaler un programme spécifique de UKTI qui rend compte du pragmatisme revendiqué par l’institution : le programme « High Value Opportunities » assure une veille sur les grands projets d’infrastructures dans le monde, liés par exemple aux grands événements sportifs, afin d’identifier des opportunités de marchés pour les grandes entreprises britanniques et leurs sous-traitants potentiels. Cette démarche pragmatique est préférée au ciblage de pays prioritaires, qui présente un risque si des difficultés économiques ou politiques viennent ensuite rendre ces pays moins attractifs (l’exemple cité étant celui de la Russie).
Il apparaît que les moyens dévolus à UKTI sont très supérieurs à ceux dont disposera la nouvelle agence Ubifrance-AFII :
– UKTI dispose d’un budget d’environ 200 millions d’euros pour l’exercice budgétaire 2013-2014, quand le projet de loi de finances pour 2015, on l’a vu, attribue à la nouvelle agence Ubifrance-AFII une subvention de 108,77 millions d’euros, qui pourrait être complétée, il est vrai, par environ 70 millions d’euros de ressources propres ;
– ce budget de UKTI a très fortement augmenté, alors que les subventions à l’ensemble Ubifrance-AFII baissent depuis plusieurs années, cette baisse se poursuivant dans le projet de loi de finances pour 2015 ;
– UKTI emploie plus de 1 900 agents, dont 1 350 à l’étranger, contre un peu plus de 1 500 pour l’ensemble Ubifrance-AFII, dont 930 à l’étranger ;
– UKTI a augmenté son effectif global de 30 personnes en 2013-2014, permettant grâce à des redéploiements un gain de 70 sur son effectif à l’étranger, alors que le plafond d’emploi dans l’ensemble Ubifrance-AFII est réduit de quelques unités tous les ans.
Il semble clair que le dispositif britannique d’accompagnement des entreprises à l’export et d’attraction des investisseurs étrangers, du moins si l’on s’en tient à l’examen des opérateurs publics nationaux, est nettement mieux doté que son homologue français (alors même que le poids global des deux économies est quasiment identique). De plus, son renforcement est privilégié par les pouvoirs publics. Ce choix britannique d’investir dans le soutien budgétaire à l’internationalisation des entreprises – ce malgré une situation difficile des finances publiques – amène nécessairement à s’interroger sur l’opportunité qu’il y aurait à faire de même en France.
Votre rapporteure considère que ce débat est légitime, car certains éléments permettent de soutenir que la dépense publique pour le commerce extérieur est jusqu’à un certain point un investissement public qui s’autofinance.
Le CEPII a produit récemment, à la demande du ministère de l’économie, une étude économétrique des effets des principaux dispositifs français d’aide aux exportateurs (22). Cette analyse, rétrospective, porte sur les quatre principales mesures en place sur les années 2007-2009, à savoir le dispositif SIDEX aujourd’hui disparu, l’assurance-prospection de la COFACE, l’accompagnement collectif et l’accompagnement individuel d’Ubifrance.
Les auteurs soulignent les difficultés méthodologiques qu’ils ont rencontrées dans la mesure où il s’agissait de comparer ex-post la « population » des entreprises ayant bénéficié de ces dispositifs avec une « population témoin » comparable d’entreprises n’en ayant pas bénéficié, qu’il fallait reconstituer – tâche délicate car les entreprises aidées étaient en moyenne, avant même de bénéficier d’un soutien, plus grosses, plus productives et plus internationalisées que les autres.
Sous ces réserves, l’étude arrive à des conclusions intéressantes :
– les dispositifs étudiés auraient, en cumulé (mais essentiellement du fait de l’accompagnement collectif d’Ubifrance, apparemment particulièrement efficace), généré 700 à 800 millions d’euros d’exportations annuelles supplémentaires ;
– leur « rendement » serait donc bon, puisque ce supplément d’export serait le fruit de 45 à 70 millions d’euros de dépenses publiques annuelles.
Cela dit, ces exportations supplémentaires dues aux soutiens publics étudiés n’ont représenté, relèvent les auteurs, que 0,2 % du total des exportations françaises, donc une part minime. Il est vrai que les dispositifs pris en compte n’ont concerné annuellement que 5 000 entreprises environ sur la période, soit 5 % des entreprises exportatrices seulement et moins de 1 % du total des entreprises françaises.
De plus, les entreprises qui ont accru leur internationalisation à l’aide des dispositifs publics ont sans doute aussi, en même temps qu’elles exportaient plus, augmenté leurs importations (énergie, matières premières…) pour produire ces biens exportés, réduisant ainsi le gain de solde commercial que l’on peut associer à cette production supplémentaire.
L’étude conclut donc logiquement : « 1) les dispositifs servent les entreprises qui les demandent à court terme et a fortiori à long terme ; 2) toutefois il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils puissent contribuer à eux-seuls à l’amélioration de la compétitivité globale de la France, et au-delà à l’ajustement du déficit de la balance commerciale ».
On pourrait aussi faire une observation complémentaire : si effectivement plusieurs centaines de millions d’euros d’exportations supplémentaires ont ainsi été obtenues, et donc une amélioration relative de notre commerce extérieur, même si les importations ont aussi augmenté consécutivement, c’est autant de PIB en plus qui a été créé, donc de l’emploi, des revenus et de l’assiette pour tous les prélèvements obligatoires. Dans cette optique, il est donc vraisemblable que les soutiens publics au commerce extérieur s’autofinancent largement par les ressources fiscales et sociales supplémentaires qu’ils génèrent indirectement.
D’autres travaux menés en interne par l’administration sur le « retour » de dispositifs tels que le FASEP ou la Réserve pays émergents, à partir d’analyses a posteriori, font état de taux de retour d’au moins cinq euros de contrats obtenus par des entreprises françaises pour un euro d’argent public (correspondant non pas à la totalité du prêt, mais au coût de sa bonification), et ce en ne prenant en compte que la part exécutée en France de ces contrats.
Si effectivement, on obtient avec un euro d’argent public cinq, voire dix euros d’exportations supplémentaires, cela représente autant de PIB supplémentaire (sous réserve de la déduction des importations supplémentaires faites pour produire les biens et services exportés en plus), donc de revenus et d’emplois. Compte tenu aussi de ce qu’est le taux global de prélèvement obligatoires en France, cela signifie aussi des ressources nouvelles pour les caisses publiques qui dépassent la dépense initiale.
Il est probable que le même genre de raisonnement est applicable aux dépenses de promotion touristique, vu la faiblesse actuelle des dépenses publiques dans ce domaine au regard des revenus potentiels pour la France si elle arrive à capter une petite part supplémentaire du flux mondial de touristes.
Votre rapporteure est consciente de la fragilité de ce genre de raisonnements économiques. Il faut aussi prendre en compte une réalité commune à toutes les interventions publiques, qui est leur rendement décroissant : il en découle que ce n’est pas parce qu’une politique donnée produit un résultat que le doublement des moyens de cette politique doublerait le résultat obtenu ; loin de là s’en faut en général…
Pour autant, la question mérite sans soute d’être creusée, d’autant qu’il existe une autre argumentation qui relativise le coût de la politique d’appui à l’internationalisation des entreprises.
Dans leur rapport précité (23), MM. Alain Bentéjac et Jacques Desponts relevaient que, dans le cadre du budget de l’État, cette politique est autofinancée du fait des bénéfices retirés par l’État de la gestion des régimes de garanties publiques qu’il confie à la Coface, ainsi que d’autres garanties étatiques. En effet, ces régimes étant des dispositifs d’assurance pour lesquels les entreprises versent des primes, ils peuvent être bénéficiaires et, de fait, l’assurance crédit, qui est le principal d’entre eux, l’est traditionnellement. Le rapport présentait le graphique suivant, où l’on voit que le financement d’Ubifrance, des dispositifs ciblés comme la RPE et le FASEP et de l’assurance prospection (structurellement déficitaire) est couvert par les bénéfices retirés des autres garanties publiques.
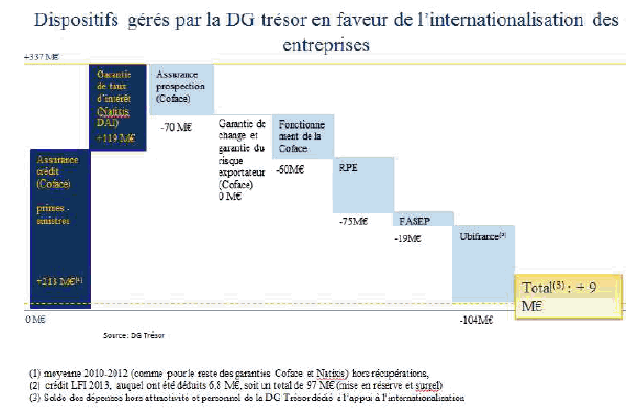
Source : extrait des annexes du rapport de la mission d’évaluation sur l’efficacité du dispositif d’appui à l’internationalisation de l’économie française, juin 2013.
Il faut cependant ajouter que ce raisonnement, vrai en général, l’est peut-être moins en temps de difficultés économiques : des éléments transmis à votre rapporteure tendent à montrer que, globalement, le résultat des activités réalisées par la Coface pour le compte de l’État, généralement très positif, s’est fortement dégradé en 2013, come le montre le tableau ci-après.
Résultat des procédures de garanties publiques gérées par le Coface
(résultat par procédure et résultat global)
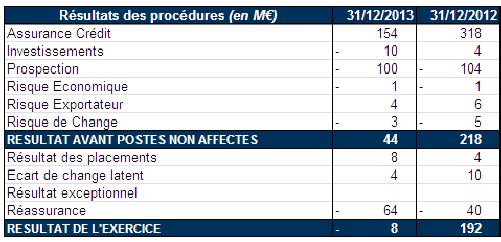
Source : MAEDI (questionnaire budgétaire).
Quoi qu’il en soit, votre rapporteure estime que la piste de la priorité budgétaire à l’internationalisation des entreprises et plus généralement au rayonnement économique de la France mérite d’être creusée et soigneusement évaluée.
A contrario, la politique actuelle de restriction constante des moyens a des effets contre-productifs par rapport aux objectifs poursuivis.
Ubifrance, par exemple, a été amené à supprimer des subventions qu’il versait à des petits opérateurs de soutien à l’export dans les industries culturelles et créatives ou à renoncer à des opérations conjointes avec eux, ou avec les chambres de commerce et d’industrie à l’international délégataires de service public dans certains pays : ce type de choix, qui s’inscrit dans une logique de recentrage de l’agence sur son cœur de mission dans un contexte de difficultés budgétaires, va clairement à l’encontre de la nécessité de développer des synergies entre les opérateurs.
Quant à l’opérateur touristique Atout France, ses moyens en forte réduction (voir le développement consacré dans le III-B supra à la priorité au tourisme) ne lui permettent pas de financer les multiples priorités gouvernementales annoncées lors des Assises du tourisme en juin 2014.
Les politiques publiques doivent être lisibles et visibles. C’est pourquoi votre rapporteure attend que toutes les conséquences de la nouvelle architecture gouvernementale soient tirées, notamment dans la présentation budgétaire et l’organisation administrative.
Votre rapporteure reprend ici des éléments qu’elle avait déjà présentés dans son avis sur le commerce extérieur de l’année passée, mais qui restent d’actualité.
En effet, le commerce extérieur, ou plus généralement la mission de rayonnement économique international, ne conservent dans le projet de loi de finances pour 2015 qu’une visibilité très faible. De plus, la modification de l’architecture gouvernementale n’a pas, pour le moment, eu de traduction satisfaisante dans la maquette budgétaire.
La nomenclature actuelle continue à ne comporter aucune mention du commerce extérieur ou du rayonnement économique, ni en tant que « mission » du budget de l’État, ni en tant que « programme ». Tout au plus peut-on repérer la mention du « Développement international des entreprises et attractivité du territoire » au niveau le plus bas de la nomenclature, celui des « actions ».
Par ailleurs, cette action, qui correspond à la subvention qui sera versée à l’agence issue de la fusion entre Ubifrance et l’AFII, soit 108,77 millions d’euros, est insérée dans le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme », lui-même intégré à la mission « Économie ».
Un autre programme de la mission « Économie », le programme 305 « Stratégie économique et fiscale », comprend à son tour une action « Développement international de l’économie française », qui correspond au financement du réseau international de la direction générale du Trésor (services économiques des ambassades). Cette action, constituée principalement de crédits de rémunérations, sera dotée de 84,27 millions d’euros en 2015.
D’autres moyens budgétaires qui concourent à l’appui à nos entreprises se trouvent sur d’autres « missions » :
● L’aide au renforcement des capacités des pays en développement passe notamment par des dons pour l’aide à la réalisation de projets d’investissement. Le FASEP (Fonds d’études et d’aide au secteur privé) permet de financer des études de faisabilité en amont de projets d'investissement. Il est inscrit sur le programme « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement » et doté pour 2015 de 20,9 millions d’euros en crédits de paiement.
● La Réserve pays émergents émarge sur le programme « Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure » de la mission « Prêts à des États étrangers ». Les autorisations d’engagement proposées pour 2015 s’élèvent à 330 millions d’euros.
● Quant à la participation de l’État au financement des mécanismes gérés par la Coface (couverture des déficits sur certaines garanties publiques, principalement l’assurance prospection), elle apparaît dans les crédits évaluatifs du programme « Appels en garantie de l’État » de la mission « Engagements financiers de l’État », action « Développement international de l’économie française ».
Il faut enfin rappeler que le principal – en termes d’encours – régime d’assurance que gère la Coface pour le compte de l’État, l’assurance crédit, génère en fait un excédent structurel : en 2013, ce résultat positif a atteint 758 millions d’euros, ce qui faisait bien plus que couvrir le déficit de l’assurance prospection (95 millions d’euros) et les faibles pertes des autres régimes de garanties publiques (moins de 12 millions d’euros au total). Pour 2014 et 2015, les prévisions sont du même ordre : le résultat positif de l’assurance crédit, évalué à 800 millions d’euros pour chacun des deux exercices, devrait couvrir très largement les pertes de l’assurance prospection (estimées à 106 millions d’euros en 2014 et 112 millions en 2015) et des autres garanties. Régulièrement, la Coface opère donc des reversements à l’État, lesquels, pour 2015, sont évalués à 500 millions d’euros (après 700 millions en 2014). C’est au fin fond du fascicule budgétaire dit des « Voies et moyens », qui comporte l’évaluation des recettes budgétaires, que l’on doit chercher la ligne « Reversements de la Coface » parmi les recettes « diverses »… Cette évaluation n’est par nature l’objet d’aucun débat ni vote parlementaire.
Le changement d’architecture gouvernementale n’a donc amené jusqu’à présent qu’une clarification très relative de l’architecture budgétaire. Certes, il a été décidé de rattacher au budget du MAEDI la plus grande part des crédits finançant Atout France, ce qui constitue un premier pas. Mais, par ailleurs, le maintien du rattachement des crédits « Ubifrance-AFII » à la mission « Économie » est désormais en discordance claire avec la structure gouvernementale, puisque cette mission « Économie » a pour vocation de regrouper les crédits du ministère du même nom, auquel le commerce extérieur n’est plus rattaché.
Or, les choix de nomenclature budgétaire ne sont pas dépourvus d’incidence. Ceux concernant le rayonnement économique international ont pour double conséquence :
– de rendre très difficile l’identification et la sommation de ces flux, qui permettraient d’évaluer globalement le degré de priorité attaché à cette politique ;
– de limiter le contrôle parlementaire exercé dans le cadre budgétaire sur cette politique. En effet, il faut rappeler que c’est l’existence d’une « mission » budgétaire qui détermine la publication de documents la présentant (tels que les projets annuels de performances, ou « bleus », et les rapports annuels de performances qui rendent compte de l’exécution budgétaire) et l’organisation de débats parlementaires spécifiques (en commission puis en séance dans les deux assemblées). Matériellement, à l’Assemblée nationale, cette situation a notamment pour conséquence que le débat sur le commerce extérieur est noyé, en commission élargie puis en séance publique, dans celui sur la mission « Économie », qui est l’occasion d’évoquer de trop nombreux autres sujets (industrie, commerce, artisanat, entreprises publiques, gestion des administrations financières, etc.), et ce alors même que le commerce extérieur n’est plus de la compétence du ministère de l’économie !
Même si les changements de rattachement des crédits entre « missions » peuvent entraîner des conséquences complexes à gérer, notamment sur le statut des personnels concernés par ces transferts, votre rapporteure considère qu’il est nécessaire de revoir la nomenclature budgétaire, de sorte que :
– la politique relative au rayonnement économique international y ait une plus grande visibilité ;
– cette nomenclature soit plus conforme à l’architecture gouvernementale.
C’est dans le même esprit de clarté et de lisibilité que votre rapporteure appelle à rendre l’organisation administrative plus cohérente avec l’architecture gouvernementale.
Au niveau des administrations centrales, on a, comme on l’a vu, une coexistence de plusieurs directions responsables – la direction générale du Trésor et la direction des entreprises et de l’économie internationale (DEEI) au MAEDI s’agissant du commerce extérieur ; la direction générale des entreprises et la DEEI, avec une toute petite équipe, s’agissant du tourisme. Cela entraîne des coûts de coordination (ne serait-ce que ceux de déplacement des agents entre les sites de ces services) et fait craindre l’apparition de « doublons », quelle que soit la volonté de les éviter (par des arrangements conventionnels : voir supra).
Par ailleurs, la prise du MAEDI reste faible sur un des opérateurs importants dans l’appui aux entreprises à l’international, le réseau des chambres de commerce et d’industrie : la tutelle de ce réseau est exercée par la direction générale des entreprises du ministère de l’économie.
L’équilibre à trouver entre les départements ministériels chargés de l’économie et des affaires étrangères s’agissant du commerce extérieur n’est pas un problème propre à la France. Au Royaume-Uni, l’opérateur public UKTI est de même soumis à une double tutelle de ces ministères, laquelle entraîne des complications. Il est donc peu probable qu’une solution parfaite et définitive puisse être trouvée. Mais votre rapporteure considère que le choix d’architecture gouvernementale qui é été fait au printemps 2014, avec l’institution du MAEDI, n’a pas encore eu toutes les conséquences qu’il implique sur l’organisation des administrations.
Parallèlement, des chantiers doivent sans doute aussi être engagés quant aux compétences respectives des ministères et des administrations dans les secteurs économiques où existent des opérateurs spécialisés de soutien à l’export, comme la SOPEXA pour l’agroalimentaire, ou les opérateurs des industries culturelles et créatives (Unifrance, TV France international, Bureau export de la musique française, Bureau international de l’édition française…). Les représentants de certains de ces opérateurs des ICC, qui sont de petits organismes, ont indiqué à votre rapporteure avoir très peu de contacts avec le secrétariat d’État au commerce extérieur. Leur ministère « de référence » est plus souvent celui de la culture et de la communication, dans les services duquel, cependant, la préoccupation de l’export ne paraît pas toujours très développée…
La poursuite de l’effort de mise en cohérence concerne enfin les opérateurs publics d’appui à l’internationalisation des entreprises.
La fusion Ubifrance-AFII est un premier pas structurant. Mais ensuite il faudra reposer la question des autres opérateurs, tels que les opérateurs sectoriels.
S’agissant de la SOPEXA, pour la promotion du secteur agroalimentaire, l’opportunité d’un rapprochement avec la nouvelle agence issue de la fusion Ubifrance-AFII est actuellement à l’étude. Des conclusions devraient être présentées aux ministres compétents d’ici la fin de l’année 2014.
Pour ce qui concerne les opérateurs du secteur culturel, la création d’une « famille » qui les fédérera constitue une première avancée. L’intérêt d’un plus grand rapprochement entre eux, voire avec la nouvelle agence généraliste, devra aussi être étudié, car il paraît clair que plusieurs facteurs poussent à cette évolution :
– l’intérêt de mutualiser des moyens actuellement faibles et dispersés ;
– le brouillage, du fait de la multiplication des supports des medias, des frontières techniques traditionnelles (qui distinguaient clairement, dans le passé, le cinéma de la télévision, l’audiovisuel du livre, etc.) ;
– les enjeux d’une politique plus unifiée de construction d’une image nationale de la France, politique dont les industries culturelles seraient à la fois des relais efficaces et des bénéficiaires avérés.
À court terme, il est au minimum nécessaire que ces opérateurs sectoriels soient présents sur le portail unifié « France international » : actuellement celui-ci ne comporte de liens que vers les opérateurs « généralistes » (Ubifrance, réseau consulaire, BPI, Coface…).
Le point d’équilibre entre la nouvelle agence issue de la fusion Ubifrance-AFII et le réseau consulaire n’est sans doute pas encore atteint. Le partage des tâches à l’international n’est toujours pas très clair. La démarche consistant à octroyer des délégations de service public à des chambres consulaires dans des pays africains ou sud-américains en pré-émergence, difficiles, où les entreprises françaises sont encore peu présentes, a montré ses limites. Elle permet certes à Ubifrance de concentrer ses moyens sur les marchés plus porteurs, mais elle se heurte à une contradiction : une chambre de commerce et d’industrie ne peut fonctionner que si elle a des membres et des clients, donc un tissu d’entreprises françaises implantées et d’entreprises désireuses de s’implanter – ce qui n’est justement pas le cas dans plusieurs des pays concernés.
Une démarche inverse, proposée par certains observateurs, consisterait à implanter prioritairement l’opérateur étatique sur les marchés les plus difficiles, puisque leur pénétration ne peut sans doute commencer que sur fonds publics, faute d’entreprises françaises désireuses d’y aller et prêtes pour ce faire à acheter des prestations d’appui.
L’avis rendu durant l’été 2014 par l’Autorité de la concurrence à la demande des opérateurs privés d’accompagnement à l’export aura certainement des conséquences. La nouvelle agence issue de la fusion Ubifrance-AFII aura probablement à clarifier sa comptabilité et à trouver avec ces opérateurs un nouvel équilibre.
Certaines régions ont, dans le passé, développé des politiques propres d’appui à l’internationalisation de leurs entreprises qui étaient parfois très ambitieuses. Le développement excessif d’une structure comme ERAI, dont le modèle économique implique qu’elle recherche des « clients » hors des entreprises de son terroir d’origine, en est une manifestation.
C’est pour concilier deux exigences quelque peu contradictoires – l’une de coordination des acteurs, l’autre de reconnaissance de leur compétence de développement économique – qu’il a été décidé de confier aux régions une mission de tête de file. Elles ont donc élaboré les plans régionaux pour l’internationalisation des entreprises (PRIE).
Il est trop tôt pour mesurer l’efficacité de ces instruments de coordination. Le bilan devra en être fait avant d’éventuels ajustements.
Les dernières observations de votre rapporteure porteront sur la présentation de notre balance commerciale.
Jusqu’à présent, le focus a toujours été mis sur la balance commerciale des seuls biens. Cela tient largement à des raisons historiques : longtemps, les échanges internationaux ont été constitués presqu’exclusivement de produits. Et très tôt, des administrations des douanes ont été mises en place pour taxer ces échanges, administrations qui ont commencé à produire des statistiques sur les flux qu’elles dédouanaient. Encore aujourd’hui, nos statistiques du commerce extérieur sont essentiellement des statistiques douanières, qui ne portent donc que sur les biens (et encore laissent de côté certains d’entre eux qui ont un régime spécial, comme les armes).
Mais les échanges internationaux sont devenus plus complexes et intègrent en particulier une part croissante de flux de services, voire de revenus liés aux activités économiques, tels que les rémunérations de la propriété intellectuelle (redevances pour l’utilisation des brevets, droits d’auteur, etc.), les revenus des investissements à l’étranger, les sommes transférées par les travailleurs expatriés…
Des économies fortement tertiarisées telles que la France et plus encore le Royaume-Uni parviennent à compenser partiellement le déficit de leurs échanges de biens par l’excédent de leurs échanges de services. Car c’est finalement le solde des transactions courantes, après prise en compte des flux de services et de revenus, qui compte : c’est lui qui indique si un pays vit ou non « au dessus de ses moyens », s’il s’endette à l’extérieur ou au contraire accroît ses créances sur le monde extérieur…
Par ailleurs, on l’a vu aussi, les échanges de services ont sans doute des effets induits considérables et très positifs sur les exportations françaises de biens matériels. Lorsqu’un pays dispose d’une image de marque très forte dans le monde entier – ce qui est évidemment le cas de la France, même si cette image est insuffisamment construite –, cette image lui permet d’exporter massivement des services culturels et/ou touristiques, exportations de services qui à leur tour entretiennent cette image et favorisent le placement des produits matériels.
Quand on s’efforce de mesurer la contribution à nos échanges extérieurs de secteurs comme celui des industries culturelles et créatives (ICC), on s’aperçoit que les flux d’échanges générés sont très composites et de natures diverses : on y trouve toujours des biens matériels (des livres par exemple), mais aussi et de plus en plus des revenus liés à la propriété intellectuelle (ventes de droits de reproduction, de diffusion, de traduction, de remake, de « formats », c’est-à-dire de concepts d’émissions télévisées, de droits dérivés, etc.), sans oublier les revenus touchés par les producteurs et artistes du spectacle vivant qui se produisent à l’étranger, lesquels s’assimilent aussi à une « exportation ». Les opérateurs spécialisés dans le soutien à l’export des filières des ICC, qui s’efforcent de produire des statistiques sur leur contribution au commerce extérieur de la France, ne cachent pas les difficultés qu’ils rencontrent et l’incertitude des chiffres qu’ils présentent.
Il faut se féliciter de ce que la notion de « développement international », dans la nouvelle architecture gouvernementale, comprenne à la fois le commerce extérieur, mais aussi l’attractivité et le tourisme. Mais il serait logique d’en profiter pour promouvoir une conception rénovée, plus conforme à la réalité de notre insertion dans la mondialisation, de notre balance commerciale.
À l’issue de l’audition, le 30 octobre 2014, en commission élargie, de MM. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, et Christian Eckert, secrétaire d’État au budget, et de Mmes Carole Delga, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, et Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique (24), la commission des affaires étrangères examine, pour avis, les crédits pour 2015 du commerce extérieur figurant dans la mission « Économie », sur le rapport de Mme Seybah Dagoma.
Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission émet un avis favorable à l’adoption des crédits de la mission « Économie », tels qu’ils figurent à l’état B annexé à l’article 32 du projet de loi de finances pour 2015.
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE
À Londres (le 16 octobre 2014) :
- Ambassade de France : Son Exc. Sylvie Bermann, ambassadeur de France, et ses collaborateurs, notamment MM. Alain de Cointet, chef du service économique régional, et Emmanuel Bétry
- Conseillers du commerce extérieur de la France : Mmes Élisabeth Maxwell, trésorière de la section britannique des CCEF, associée chez Mazars LLP, et Dorothée Lacroix, responsable de la filiale britannique de 1000mercis
- Ubifrance : M. Hervé Ochsenbein, directeur pour le Royaume-Uni et l’Irlande
- Agence française pour les investissements internationaux (AFII) : Mme Caroline Laporte, directrice pour le Royaume-Uni et l’Irlande
- Atout France : MmeAgnès Angrand, directrice adjointe
- UK Trade and Investment (UKTI) : M. Nick Archer, Managing Director, Policy and Network Development
- French Chamber in Great Britain : Mme Florence Gomez, directrice générale, et ses collaborateurs
À Paris (par ordre chronologique) :
– Cabinet du secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger : MM. Cyrille Pierre, directeur, et Vincent Aussilloux, conseiller pour la stratégie, les partenaires et les instruments du commerce extérieur
– Ubifrance-AFII : Mme Muriel Pénicaud, ambassadrice déléguée aux investissements internationaux, chargée de conduire la fusion des deux opérateurs, et MM. Jean-Paul Bacquet, député, président du conseil d’administration d’Ubifrance, Laurent Jacquet-Saillard, directeur financier, Bertrand Buffon, chef de cabinet (AFII), et Julien Ravalais-Casanova, chef de cabinet (Ubifrance)
– Bpifrance : MM. Alain Renck, directeur international, et Jean-Baptiste Marin-Lamellet, directeur des relations institutionnelles
– Ministère des affaires étrangères et du développement international – direction des entreprises et de l’économie internationale : Mme Agnès Romatet-Espagne, directrice
– Unifrance : Mme Isabelle Giordano, directrice générale, et M. Xavier Lardoux, directeur général adjoint
– Famille « mieux vivre en ville » : Mme Michèle Pappalardo, fédératrice
– Bureau international de l’édition française : M. Jean-Guy Boin, directeur général
– Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – direction générale du Trésor – service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises : Mme Sandrine Gaudin, chef de service, et M. Eric David, sous-directeur pour le financement
– CCI International : MM. Jean-François Gendron, président, et Dominique Brunin, délégué général
– Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France : M. Alain Bentéjac, président
– TV France International : M. Mathieu Béjot, délégué général
– Bureau Export : MM. Olivier Nusse, président, et Fabrice Rebois, directeur général
– Atout France : MM. Christian Mantei, directeur général, et Gérard Bornier, secrétaire général, et Mme Sophie Lacressonnière, directrice du marketing
*
Votre rapporteure remercie les personnes qu’elle a auditionnées pour les éclairages qu’elles lui ont apportés pour la rédaction du présent avis.