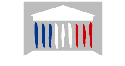______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2015.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2016 (n° 3096)
TOME VII
ÉCONOMIE
COMMERCE EXTÉRIEUR
PAR Mme Jeanine DUBIÉ
Députée
——
Voir les numéros : 3096, 3110 (annexe 21).
SOMMAIRE
___
PAGES
INTRODUCTION 5
I. LES CRÉDITS BUDGÉTAIRES POUR 2016 7
A. L’ACTION N° 7 DU PROGRAMME 134 FINANCE LE NOUVEL OPÉRATEUR BUSINESS FRANCE 7
B. LES CRÉDITS DU PLF 2016 EN SOUTIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR AUGMENTENT. 7
II. LE PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS 9
A. LE PTCI LAISSE ESPÉRER DES GAINS ÉCONOMIQUES RÉELS, MAIS LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION SUSCITE DE LÉGITIMES INTERROGATIONS. 9
1. Le PTCI est un traité commercial structurant pour les relations économiques entre les deux grandes puissances occidentales. 9
2. Marqué par des garanties de transparence insuffisantes, le processus de négociations cristallise un ensemble de critiques en France et dans l’Union européenne. 10
a. L’état des négociations : un processus long et marqué par l’imprévisibilité du contenu du texte consolidé 10
b. La divergence marquée des intérêts américains et européens a conduit à un durcissement de la position française. 12
c. De nombreux points d’inquiétudes relayés dans la société civile 14
d. L’effort de transparence effectué vers les Parlements nationaux devrait être poursuivi. 15
B. LA QUESTION DE L’ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS ENTRE INVESTISSEURS ET ÉTATS DEMEURE LA PRINCIPALE PRÉOCCUPATION. 16
1. Le système de règlement des différends investisseurs-États (ISDS) est susceptible de restreindre la souveraineté et le droit à réguler des États. 16
2. Une proposition de réforme française largement suivie par la Commission européenne 17
III. LES DÉTERMINANTS INTERNATIONAUX DE LA CRISE AGRICOLE FRANÇAISE 21
A. LA FILIÈRE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE FRANÇAISE SUBIT UNE DÉGRADATION DE SA COMPÉTITIVITÉ 21
1. Les moindres performances à l’exportation de certains secteurs agricoles et agro-alimentaires contrastent avec les résultats passés 21
2. La structuration de la filière française est une source de fragilités économiques 23
B. L’EXPOSITION À LA CONCURRENCE INTERNATIONALE APPORTE UN ÉCLAIRAGE NOUVEAU SUR LA CRISE AGRICOLE DE L’ÉTÉ 2015 24
1. L’agriculture française connaît une crise aux déterminants multiples 24
2. L’internationalisation des échanges agricoles et le renforcement de la concurrence expliquent en grande partie les tensions que traversent les entreprises françaises 24
3. Des solutions existent pour soutenir les exploitations françaises à l’international tout en préservant leur modèle de production 27
La France s’engage depuis début 2015 dans une trajectoire de croissance favorable qui laisse entrevoir une sortie de crise. La croissance devrait progresser cette année de 1 %, favorisée par plusieurs facteurs comme les mesures de soutien à la compétitivité des entreprises, la baisse du prix de l’énergie, la dépréciation de l’euro par rapport au dollar et la reprise de l’activité chez nos partenaires européens.
Dans ce contexte, le commerce extérieur joue un rôle essentiel de contribution à la croissance. L’économie française est particulièrement internationalisée : si son exposition aux fluctuations du commerce international est moins prononcée que l’Allemagne, le dynamisme des exportations est le signe d’une meilleure santé économique. Précisément, malgré la stabilisation de la croissance de la demande mondiale adressée à la France (+ 3,1 % les deux années), les exportations françaises ont connu une légère accélération en 2014 (+ 2,4 % après + 1,7 % en 2013), notamment en raison d’exportations aéronautiques et de matériel militaire dynamiques en fin d’année. Selon le gouvernement, en 2015, les exportations de biens et services connaîtraient un réel dynamisme (+ 6,0 %) grâce à l’accélération graduelle de la demande mondiale (+ 3,7 % en 2015), en lien avec la hausse de l’activité en zone euro et dans les autres économies avancées.
Les crédits budgétaires du projet de loi de finances pour 2016 qui seront votés en soutien du commerce extérieur doivent donc faire l’objet d’une attention particulière : il s’agit de faire en sorte que les entreprises exportatrices françaises tirent profit de cette conjoncture internationale favorable.
Toutefois, l’optimisme qui accompagne ces perspectives de reprise ne doit pas masquer de légitimes sujets d’inquiétude. Votre rapporteure a ainsi souhaité engager une réflexion sur, d’une part, l’état et les perspectives des négociations du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI, « TTIP » en anglais) entre l’Union européenne et les États-Unis et, d’autre part, les déterminants internationaux de la crise de l’élevage qui touche les agriculteurs français depuis plusieurs mois.
Le PTCI, initialement présenté par la France et par la Commission européenne comme une opportunité à saisir pour les économies européennes, fait en effet l’objet d’une contestation grandissante dans la société civile, tandis que le Gouvernement a récemment dû durcir le ton sur les conditions de la négociation. Il convient de s’interroger tant sur la transparence de ce processus de négociation - l’information des parlementaires, par exemple, est encore balbutiante – que sur les effets économiques à attendre de la ratification du traité : la France y sera-t-elle vraiment gagnante ?
La crise de l’élevage, qui a connu un pic de tension à l’été 2015, est souvent présentée comme l’effet d’un problème de répartition de la valeur ajoutée entre les exploitants agricoles et les autres acteurs de la chaîne de production et de distribution, les premiers vendant leurs produits à un prix sans commune mesure avec les prix finaux en grande surface. Toutefois, votre rapporteure a souhaité mettre le doigt sur les déterminants internationaux de la formation de ces prix. La pression concurrentielle mondiale, la volatilité des cours mondiaux, l’exposition aux variations de la demande mondiale, la nécessité d’une compétitivité prix toujours plus grande, sont autant de facteurs qui soumettent les exploitants agricoles à une obligation de performance parfois incompatible avec la préservation du modèle français de production agricole. Mais si l’ouverture à l’international est l’une des causes de la crise, elle peut également représenter une porte de sortie.
ÉVOLUTION DU SOLDE DE LA BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE DEPUIS 2010
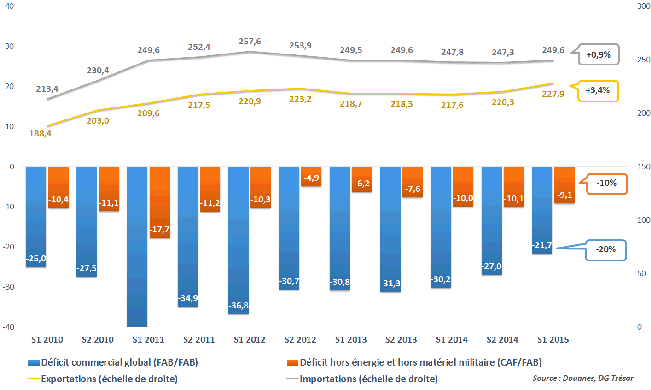
(en milliards d’euros)
Au sein de la mission « Économie » du projet de loi de finances pour 2016, les crédits du soutien au commerce extérieur figurent dans le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme », qui coordonne les instruments de soutien aux entreprises, notamment envers les petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des services et du tourisme.
La maquette du projet de loi de finances pour 2016 évolue encore par rapport à la loi de finances pour 2015, afin d’intégrer l’apparition du nouvel opérateur de soutien aux entreprises à l’international, Business France. Il résulte de la fusion, effective au 1er janvier 2015, d’Ubifrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII).
L’ensemble des crédits de l’action n° 7, « Développement international des entreprises et attractivité du territoire », est dévolu à l’action de cet opérateur, soit 103,9 millions d’euros, sous forme de subvention pour charges de service public.
Cette action a « pour objectifs l’information et le soutien des entreprises françaises, notamment les PME et ETI, afin de favoriser leur internationalisation et leur développement sur les marchés extérieurs, la prospection d’investissements étrangers et la promotion du territoire français auprès des investisseurs internationaux susceptibles de s’y implanter et la mise en œuvre d’une stratégie de communication pour améliorer l’image de la France à l’international », selon le projet annuel de performance annexé au projet de loi de finances pour 2016.
Business France remplit donc une mission d’information, de promotion individuelle et collective de l’offre française, et déploie une stratégie de communication et d’influence pour développer l’image de la France à l’international. Les services – payants – de Business France proposent également un accompagnement commercial, une prospection des marchés étrangers et un soutien aux investissements internationaux. Opérationnellement, Business France s’appuie sur un réseau de 85 bureaux dans 70 pays différents.
En apparence, par rapport à la loi de finances pour 2015, les crédits de l’action n° 7 du programme 134 dévolus au soutien du commerce extérieur semblent en diminution de 5 %.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS PAR ACTION
(en euros)
Crédits de paiement (M€) |
Réalisé 2014 |
LFI 2015 |
Variation 2014/2015 |
PLF 2016 |
Variation 2015/2016 |
N° 7 Développement international des entreprises et attractivité du territoire |
104 098 |
108 770 |
+ 4 % |
103 848 |
– 5 % |
Source : Ministère des finances et des comptes publics.
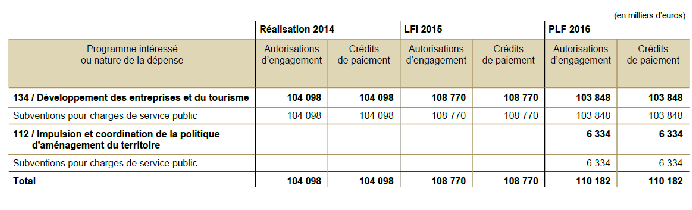
Toutefois, Business France hérite également d’une subvention de 6,3 M€ de crédits issus du programme 112 (« Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ») de la mission « Politique des territoires ». Cette subvention était auparavant destinée à l’AFII.
Pris dans leur globalité, les crédits dévolus à Business France augmentent donc de 1,3 % entre 2015 et 2016, et de 5,5 % depuis 2014. Ce soutien affiché au commerce extérieur en période de rigueur budgétaire est une bonne nouvelle : les crédits du commerce extérieur jouent un rôle important d’effet de levier sur les résultats économiques des entreprises, et le retour attendu en matière de croissance et d’emplois supplémentaires justifie cet effort.
Business France dispose d’un plafond d’emplois de 1 532 équivalent temps plein travaillé (ETPT), en hausse de 8 ETPT par rapport à 2015. Le schéma d’emplois de Business France a imposé une baisse de 9 ETPT dans cette période, compensée par le transfert de 17 ETPT lié à l’attribution d’une nouvelle mission de promotion de l’agroalimentaire français à l’international – auparavant réalisée par la société Sopexa sous forme de délégation de service public.
II. LE PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS
A. LE PTCI LAISSE ESPÉRER DES GAINS ÉCONOMIQUES RÉELS, MAIS LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION SUSCITE DE LÉGITIMES INTERROGATIONS.
1. Le PTCI est un traité commercial structurant pour les relations économiques entre les deux grandes puissances occidentales.
Le fort développement des échanges commerciaux internationaux a justifié une régulation internationale marquée, jusqu’aux années 2000, par le multilatéralisme au sein de l’Organisation mondiale du commerce. L’ensemble des États membres s’entendaient sur des règles communes afin d’organiser les flux commerciaux de manière efficace. Mais l’économie mondiale connaît, depuis dix ans, la conjonction d’une crise du multilatéralisme et de l’essor rapide de pays émergents dont le poids dans les échanges internationaux n’est plus négligeable. Les cartes de la régulation commerciale mondiale sont donc rebattues : l’OMC échoue de façon regrettable, depuis le début du cycle de Doha en 2001, à dégager un consensus entre tous les acteurs, tandis que les pays émergents organisent leurs flux commerciaux dans le cadre d’accords régionaux « sud-sud ».
Dans ce contexte, l’Union européenne et les États-Unis ont rapidement conclu à la pertinence d’un vaste accord bilatéral, bénéfique pour leurs économies, mais, étant donné leur poids combiné dans le marché mondial, structurant pour l’ensemble des relations commerciales mondiales. L’enjeu est tant économique que géopolitique : en s’entendant sur la définition des standards commerciaux, ces deux puissances économiques seront en mesure de les imposer comme référentiels des échanges mondiaux, en particulier face à la Chine. D’aucuns voient ainsi dans le PTCI un « OTAN économique », en mesure de préserver l’« occidentalisation » des règles commerciales.
Ce projet n’est en réalité pas nouveau. Dans les années 1990, des négociations ont pris cours entre Union européenne et États-Unis pour un Nouveau marché transatlantique (« NTM » en anglais). Les divergences de normes entre les deux puissances étaient déjà considérées comme un frein au développement des échanges commerciaux. Ces négociations ont cependant échoué sur la question des marchés publics, tandis que le multilatéralisme au sein de l’OMC était encore prometteur.
D’un point de vue strictement économique, le PTCI concerne un marché de 800 millions de consommateurs. L’Union européenne est le plus gros investisseur aux États-Unis, la deuxième destination la plus importante des exportations américaines de biens et le plus gros marché pour les exportations américaines de services.
L’enjeu est aussi d’importance pour la France, dès lors que les États-Unis sont son premier partenaire commercial en dehors de l’Union européenne. 22 000 entreprises françaises exportent vers les États-Unis, et 80 % d’entre elles sont des PME. Le matériel de transport, les biens d’équipement et les produits chimiques, agroalimentaires et pharmaceutiques représentent les trois quarts des exportations françaises vers les États-Unis. Le dynamisme du secteur des matériels de transport demeure le principal moteur de la croissance de nos exportations vers les États-Unis en 2013.
Toutefois, les évaluations économétriques des gains à espérer de la conclusion du PTCI sont peu nombreuses, et leur méthodologie sujette à caution, dans la mesure où il est difficile d’anticiper sur la portée concrète de l’accord (cf. infra). Au niveau microéconomique, le PTCI se traduirait par la réduction de droits de douane et par un meilleur accès aux marchés publics américains pour les entreprises européennes (en particulier pour les exportations de textiles, de fruits et légumes, de viande bovine, de matériel de transport, de services d’assurance). Au niveau macroéconomique, le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (1) (CEPII) estime que la France pourrait bénéficier d’un surcroît de PIB estimé à 0,5 % à horizon 2025 (dans un scénario de libéralisation tarifaire à 100 % et d’une baisse de 20 % des barrières non tarifaires). Selon le CEPR (2), centre de recherche européen auprès duquel la Commission européenne a commandé une étude (3), l’Union européenne pourrait retirer du PTCI, à terme, un bénéfice de 119 milliards d’euros par an.
2. Marqué par des garanties de transparence insuffisantes, le processus de négociations cristallise un ensemble de critiques en France et dans l’Union européenne.
a. L’état des négociations : un processus long et marqué par l’imprévisibilité du contenu du texte consolidé
Les négociations du PTCI ont débuté il y a presque trente mois. Onze sessions se sont tenues, la dernière s’étant déroulée fin octobre à Miami. Les sujets de négociations, regroupés en « chapitres », touchent à tous les champs du commerce extérieur régulés par les précédents accords multilatéraux : l’accès aux marchés étrangers ; les services et les marchés publics ; la protection des investisseurs ; la protection de la propriété intellectuelle ; l’énergie et les matières premières ; le développement durable, etc.
Au cours de chaque session de négociation, tous les sujets en discussion peuvent potentiellement être abordés, et aucun n’est considéré comme « clos » avant que l’ensemble des chapitres ne fasse l’objet d’un accord. Les négociateurs peuvent ainsi proposer de nouvelles concessions sur un chapitre déjà traité afin d’améliorer leur position sur un autre chapitre. Ainsi, aucun texte consolidé et fiable du traité ne sera disponible avant que l’ensemble de la négociation n’aboutisse.
Ceci explique que la Commission européenne émette de fortes réserves à communiquer sur les avancées des discussions. C’est un principe de base des négociations internationales : les négociateurs européens n’ont pas intérêt à exposer leur satisfaction sur un sujet sur lequel ils ont obtenu un accord favorable, dans la mesure où cela les exposerait à une position américaine plus offensive sur d’autres sujets. Mais cette prudence est porteuse d’effets pervers : le secret des négociations nourrit les fantasmes sur les concessions que la Commission européenne serait prête à accorder, et le manque de transparence entraîne une frustration légitime des autres acteurs publics – en premier lieu, les Parlements nationaux –, qui ont le sentiment qu’ils n’ont aucune prise sur l’orientation et la conclusion de ces discussions.
Sur le fond, si une partie des négociations concerne la diminution des barrières tarifaires (droits de douane), notamment les « pics tarifaires » sectoriels (chaussures, machines-outils, chimie), l’intérêt principal du Partenariat réside dans la réduction des barrières non tarifaires, en particulier des réglementations. Les principaux gains attendus du PTCI portent sur la « convergence réglementaire » entre les États-Unis et l’Union européenne : si les normes élaborées pour réguler les marchés sont partagées entre ces deux puissances économiques, elles auront plus de chances de s’imposer à l’ensemble des acteurs internationaux. Cette dimension de « rule maker » plutôt que de « rule taker » placerait les entreprises européennes et américaines en position de force pour la conquête de parts de marchés de pays tiers, notamment de la Chine.
La convergence normative entre l’Union européenne et les États-Unis
L’Union européenne et les États-Unis possèdent un grand nombre de normes et de réglementations portant sur des biens et des services échangeables. Les divergences normatives peuvent imposer des coûts supplémentaires aux producteurs, notamment lorsqu’ils doivent prévoir des chaînes de production distinctes. Cependant, l’harmonisation des normes n’est pas le but recherché : la convergence des normes n’est pas la convergence des législations, notamment en matière d’OGM ou de procédures sanitaires et phytosanitaires.
Afin de développer les transactions entre ces deux ensembles, ainsi que de mettre en place des standards de normalisation qui pourront faire référence au niveau mondial, une partie des négociations du PTCI porte donc sur la convergence des normes. Les véhicules, les appareils médicaux et les produits pharmaceutiques sont trois domaines dans lesquels une plus grande convergence réglementaire pourrait notamment être envisagée.
Les parties ont échangé une première offre tarifaire en février 2014 suivie d’une offre portant sur les services en juin et juillet 2014, révisée en juillet 2015. Les offres tarifaires échangées se sont caractérisées par un décalage marqué entre le niveau de l’offre européenne – libéralisation de 96 % des lignes tarifaires – et celui de l’offre américaine – libéralisation de 75 % des lignes seulement –. Ce décalage a conduit la Commission européenne à suspendre les discussions tarifaires (« gel » des négociations) en attendant que les États-Unis proposent une offre non tarifaire intéressante pour l’Union européenne : sur les marchés publics (en particulier des États fédérés), sur les normes, sur la protection des indications géographiques. En ce qui concerne les offres en matière de services, le niveau est plus équilibré.
Peu d’avancées ont eu lieu depuis plus d’un an, et la 10e session de négociation, du 13 au 17 juillet 2015, n’a guère produit de progrès substantiels. Les négociateurs américains étaient davantage mobilisés par la conclusion imminente du Partenariat transpacifique (« TPP » en anglais), dont les négociations ont débuté il y a cinq ans. Le onzième cycle de négociations a eu lieu à Miami du 19 au 23 octobre 2015, et s’est concentré sur les sujets non tarifaires. Par exemple, ont été abordées les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS), pour lesquelles l’Union européenne a des intérêts offensifs, comme la promotion du principe de régionalisation en matière de santé animale, et défensifs, au nom des préférences collectives : réglementation de la production de viande sans hormones, législation sur les organismes génétiquement modifiés, etc.
Les points d’achoppement politiques rencontrés à ce stade laissent de côté certains thèmes de crispation prévisibles dans la suite du processus, éventuellement dans le domaine du numérique (commerce électronique et télécommunications) et sur les questions agricoles. Ce dernier point suscite l’inquiétude des exploitants agricoles français, dans un contexte de crise de l’élevage (cf. troisième partie).
b. La divergence marquée des intérêts américains et européens a conduit à un durcissement de la position française.
Selon la commissaire européenne au commerce, Mme Cecilia Malmström, il est nécessaire qu’un changement d’état d’esprit de la négociation ait lieu. La Commission a d’ores et déjà effectué plusieurs offres concrètes dans le cadre des discussions du PTCI, sans que les engagements américains en réponse à ces propositions soient suffisants pour respecter un nécessaire principe de réciprocité. Dans ces conditions, plusieurs sujets sont considérés comme « gelés » par les négociateurs européens : sans avancée concrète sur les sujets comme les lignes tarifaires ou les marchés publics, aucune négociation ne portera, par exemple, sur le mécanisme de règlement des différends État-investisseurs (« ISDS » en anglais, cf. infra).
Dans ce contexte, la France, par la voix de son secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, M. Matthias Fekl, a été pionnière sur le durcissement du ton dans le jeu des négociations, allant jusqu’à envisager un arrêt des négociations si les États-Unis ne marquaient pas un investissement plus fort dans ces dernières. La France est pour le moment la seule à affirmer une telle position exigeante, mais suscite des coalitions ad hoc au sein de l’Union européenne pour influencer la Commission (groupes de travail, rédaction de papiers communs…). En effet, l’Union européenne à 28 a le désavantage d’apparaître en ordre dispersé pour défendre ses intérêts face aux États-Unis. Ainsi, plusieurs lignes de partage peuvent être cernées en son sein : l’Europe du nord (pays scandinaves en tête) affiche son libéralisme économique mais également ses positions pro-transparence ; l’Europe du sud est plus protectrice de ses producteurs, notamment en matière de protection des indications géographiques (Portugal, France, Grèce, Espagne). Une deuxième ligne est apparue à l’Est, avec des États-membres qui sont marqués par un atlantisme pragmatique en raison de leur proximité avec la Russie, tandis que le pays traditionnellement le plus proche des États-Unis, le Royaume-Uni, est traversé par une tension entre la potentielle sortie de l’Union européenne et la crainte d’être écarté, le cas échéant, du champ d’application du PTCI. Les « lignes rouges » que chaque État défend dans les négociations du PTCI sont donc à géométrie variable. La Commission européenne s’efforce de faire la synthèse de tous ces éléments, et doit intégrer le rôle du Parlement européen, partagé entre lignes politiques et nationalités.
Les États-Unis, quant à eux, sont sur une ligne géopolitique qui accorde plus d’importance à l’ouverture vers le Pacifique que vers l’Europe. Pourtant, le PTCI serait de nature à achever leur politique d’isolement commercial de la Chine. Sur le fond, les négociateurs américains ont mis en avant des intérêts qui divergent fondamentalement des positions européennes :
– sur l’accès aux marchés publics américains : les États-Unis refusent le principe du traitement national en matière de marchés publics, qui remettrait partiellement en cause les mesures issues du « Buy American Act », et se retranchent derrière la compétence des États fédérés (non incluse dans le mandat de négociation) pour exclure tout engagement en matière d’accès aux marchés publics de niveau subfédéral ;
– sur l’accès au marché des biens : la première offre américaine, remise en février 2014 (11 % des lignes tarifaires exclues), s’écartait trop nettement du niveau de l’offre européenne (4 % des lignes exclues) pour qu’une discussion soit possible ;
– sur les services : malgré un deuxième échange d’offres en juillet 2015, les États-Unis refusent de lister les mesures des États fédérés qui sont non conformes aux principes de l’accord. Cela signifie que les États-Unis refusent de reconnaître ces mesures de protection, préalable nécessaire à leur suppression. Sur les services financiers et les mutuelles, sur lesquels l’Union européenne a une position offensive, la coopération réglementaire semble dans l’impasse ;
– sur les indications géographiques protégées : les États-Unis écartent les pistes de travail proposées par la Commission, préférant une protection de la marque commerciale ; ils excluent également toute évolution et intégration dans le cadre du PTCI de l’accord « vins » de 2006 qui permettrait de mettre fin à l’usage des semi-génériques (comme le champagne californien).
Les indications géographiques protégées (IGP)
Les IGP permettent de référencer des produits dont les qualités, la réputation ou le savoir-faire de confection sont liées à une zone géographique d’origine. Cette indication est une garantie d’authenticité pour le consommateur et de protection pour les producteurs, qui se soumettent en échange à un cahier des charges précis.
Lors des négociations internationales, la reconnaissance des IGP par les pays anglo-saxons ne va pas de soi. Ainsi, les États-Unis, pays d’immigration, détiennent une approche historique des savoir-faire et des techniques protégés. Un produit n’a pas à être issu d’un territoire en particulier, puisqu’un artisan ou un agriculteur détenteur d’un savoir-faire qui fait le choix d’émigrer doit pouvoir rester maître de l’appellation de son produit. Pour les États-Unis, il faut donc privilégier la protection de la marque au système de l’IGP.
Cependant, la protection classique des marques n’intègre pas suffisamment les contraintes des IGP, qui garantissent la qualité des produits (approvisionnement, manières de faire encadrés par un cahier des charges, territorialité). En outre, la protection est limitée dans le temps (et fait l’objet d’un renouvellement coûteux tous les dix ans) et l’usurpation de marque doit être recherchée par le détenteur (compliqué à l’échelle mondiale pour des petits producteurs artisanaux). Enfin, si une IGP n’est pas reconnue sur le sol américain, rien n’empêche un producteur de fabriquer du champagne, du camembert ou du jambon de Parme sans être inquiété, même si le produit fini ne respecte pas les canons traditionnels de production européenne.
Dans ce contexte, la reconnaissance dans le partenariat commercial entre l’Union européenne et le Canada (dit « CETA » en anglais) de 175 IGP (hors vin), dont 42 françaises, est un véritable succès pour les producteurs français. Les négociateurs européens tâchent de s’appuyer sur cette avancée pour faire reconnaître les IGP dans le PTCI.
Mi-octobre 2015, une mobilisation sans précédent a réuni 150 000 personnes à Berlin pour s’opposer à la conclusion du PTCI. Une pétition européenne signée par plus de trois millions de citoyens réclame l’arrêt des négociations. Parmi les sujets d’inquiétude relayés par les manifestants ou les pétitionnaires, qui trouvent un écho au sein d’associations et d’organisations non gouvernementales françaises comme ATTAC ou le collectif « stop TAFTA », figurent la crainte de voir les marchés européens inondés de produits fabriqués à partir d’OGM, de volaille traitée au chlore ou encore la déréglementation de la fracturation hydraulique pour extraire des gaz de schiste. Une grande partie de ces inquiétudes n’est pas justifiée, dans la mesure où le mandat de négociation donné à la Commission européenne ordonne de ne pas transiger sur les préférences collectives des États européens, exclues a priori des négociations.
Pourtant, cette mobilisation citoyenne doit interroger sur les raisons pour lesquelles un tel accord ne suscite pas une plus grande adhésion de la population. Plusieurs « erreurs de méthode » peuvent être relevées : il n’était pas possible, pour la Commission, à la fois de communiquer sur le caractère global et structurant du PTCI, tout en imposant à l’opinion publique et aux États le secret des négociations. Le manque de transparence des négociations a ainsi largement alimenté les fantasmes sur le contenu potentiel du PTCI, le secret étant souvent associé à la nécessité de cacher l’inavouable.
En outre, le manque de transparence démocratique envers les États membres et leur représentation nationale, pour lesquels la Commission négocie in fine, a suscité des critiques. En effet, dans la perspective probable où le PTCI serait qualifié d’accord mixte, c’est-à-dire touchant en partie à des compétences partagées entre l’Union européenne et les États membres, ces derniers devront tous le ratifier : les représentations nationales auront donc un droit de regard sur son entrée en vigueur. Il est donc dans l’intérêt de la Commission européenne de s’assurer du soutien en amont des États membres, ce qui passe par une transparence renforcée.
Ce manque de transparence se double d’une asymétrie problématique des négociations. Par crainte des fuites, les négociateurs américains ont imposé que la publicité des comptes rendus des cycles de discussion ne puisse se faire qu’à destination de personnes autorisées (comme des représentants élus des parlements nationaux ou du Parlement européen), au sein des ambassades américaines et sous haute surveillance. Ces conditions, qualifiées d’« humiliantes » par le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur M. Matthias Fekl, ont jeté un trouble sur le bien-fondé même des négociations.
Néanmoins, des avancées ont eu lieu : des réunions de restitution ont lieu à l’issue de chaque session de négociations à destination de la société civile ; des consultations publiques sont menées sur des sujets sensibles comme l’arbitrage des différends États-investisseurs ; un comité consultatif rassemblant des représentants des entreprises, des syndicats, des consommateurs et des ONG a été mis en place ; plusieurs documents de position européens ont été mis en ligne. La France a également mis en place un comité de suivi stratégique pour informer à étapes régulières les parlementaires et les représentants de la société civile.
L’information du Parlement a certes progressé, mais dans des proportions qui apparaissent insuffisantes aux yeux de votre rapporteure. La commission des affaires économiques et la commission des affaires européennes ont pris l’initiative de mener des auditions régulières de M. Matthias Fekl, et le Gouvernement s’est engagé à fournir davantage de documents d’information à destination des députés.
Cependant, il serait utile que les comptes rendus intégraux des sessions de négociations soient disponibles dans des conditions acceptables pour la représentation nationale. Cette information de première main garantit un suivi efficace et lucide des positions prises par les négociateurs européens. Il permettrait à la fois aux parlementaires de maîtriser le fond des sujets abordés, de vérifier que le mandat donné aux négociateurs est respecté, et également d’être en mesure de fournir une opinion avisée lorsque les citoyens les confrontent en circonscription.
L’enjeu n’est pas qu’éthique et démocratique, il est aussi celui de parlements nationaux mobilisés en soutien à l’Union européenne dans les territoires, et davantage disposés à accepter la ratification du PTCI si les négociations aboutissaient.
B. LA QUESTION DE L’ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS ENTRE INVESTISSEURS ET ÉTATS DEMEURE LA PRINCIPALE PRÉOCCUPATION.
1. Le système de règlement des différends investisseurs-États (ISDS) est susceptible de restreindre la souveraineté et le droit à réguler des États.
Un des principaux débats qui entourent les négociations du PTCI concerne le chapitre instaurant un système de règlement des différends investisseurs-États par des tribunaux privés (appelé « ISDS » en anglais). Il s’agit de tribunaux d’arbitrage auxquels les entreprises peuvent recourir pour engager des contentieux contre les États dont les mesures auraient pour conséquence de léser leurs intérêts économiques. Beaucoup d’observateurs craignent que ces tribunaux ne menacent la souveraineté des États, découragés de faire évoluer leur réglementation par peur des procès intentés par les multinationales et des compensations financières prohibitives qu’ils seraient condamnés à verser.
En effet, l’expérience a montré ces dernières années que les arbitrages internationaux appelés à statuer dans ce genre de cas avaient une interprétation extensive du terme « expropriation » et que l’impartialité des arbitres internationaux pouvait être sujette à caution en raison du risque de conflit d’intérêts. Récemment, l’entreprise cigarettière américaine Philip Morris a poursuivi l’Australie qui avait fait le choix d’imposer la vente du paquet neutre. De même, l’entreprise suédoise Vattenfall, qui fournit de l’énergie, a attaqué l’Allemagne lorsque cette dernière a décidé de supprimer le nucléaire de son mix énergétique. Enfin, la compagnie gazière Long Pine Resources a engagé une procédure contre le Canada pour être indemnisée du fait du préjudice du moratoire mis en place par le gouvernement québécois contre la fracturation hydraulique sous des eaux fluviales. Le dévoiement du mécanisme d’arbitrage a conduit ces entreprises à plaider contre une « expropriation indirecte » du fait de ces législations souveraines et à réclamer des millions de dollars de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, la France et l’Union européenne ont émis des réserves importantes sur le fonctionnement du futur mécanisme ISDS, et ont initialement proposé, à défaut de le supprimer, de l’encadrer soigneusement. L’Assemblée nationale était allée plus loin, dans sa résolution du 15 juin 2013, appelant « à ce que soit exclu du mandat le recours à un mécanisme spécifique de règlement des différends entre les investisseurs et les États pour préserver le droit souverain des États ».
En outre, le 13 janvier dernier, la Commission européenne a présenté son rapport sur la consultation publique concernant le mécanisme ISDS dans le PTCI, qui repose sur un arbitrage privé. 150 000 réponses ont été analysées qui, pour 97 % d’entre elles, étaient négatives. Toutefois, la Commission a estimé que ces réponses, envoyées via des plateformes en ligne de groupes d’intérêt, avaient un contenu prédéfini et les a écartées. La commissaire européenne au Commerce, Mme Cecilia Malmström, estimant que cette consultation n’avait pas valeur de référendum, a toutefois admis que « la consultation publique montre bien que les Européens sont très sceptiques quant à l’instrument de règlement des différends entre investisseurs et États ».
Le sujet du mécanisme d’arbitrage ISDS est toujours gelé par les négociateurs européens. Toutefois, la Commission a publié le 16 septembre 2015 une proposition de compromis en vue de réviser le mécanisme de règlement des différends investisseur-État. Cette proposition résulte du travail constructif mené par la France pour dégager des modalités de protection juridique alternatives.
La France estime en effet que la rédaction du projet de texte devrait mettre en lumière quatre priorités principales :
– la nécessité de reconnaître explicitement dans le texte le droit pour chaque État de réglementer : la France défend des dispositions visant à préserver ce droit afin que la protection des investissements ne puisse se faire au détriment d’aides d’État ou de toutes autres politiques publiques légitimes. Les propositions françaises suggèrent en ce sens une clarification de la définition des concepts-clés sur lesquels s’appuieraient les stipulations du PTCI. Il conviendrait dès lors de définir de manière plus précise l’étendue des protections accordées aux investisseurs étrangers de telle sorte qu’elles ne puissent être dévoyées contre le droit des États à réguler ;
– la France soutient la création d’un nouveau cadre institutionnel, sous forme de Cour permanente, qui serait responsable du réexamen des sentences arbitrales ainsi que de la nomination des arbitres. L’objectif français est de créer, à terme, une nouvelle organisation juridictionnelle, remplaçant les tribunaux ad hoc actuels, qui serait chargée de régler directement les différends entre États et investisseurs, à la fois en première instance et en appel ;
– l’attention française s’est également arrêtée sur les moyens visant à renforcer la transparence des tribunaux arbitraux et les exigences éthiques imposées aux arbitres. Plusieurs propositions sont défendues : la mise en place pour les arbitres d’un code de déontologie obligatoire, l’introduction de dispositions visant à dissuader par des sanctions toute plainte abusive ou tentative de « treaty shopping » (4), ou encore le renforcement des mesures autour de l’encadrement des tiers financeurs (transparence, confidentialité, clarification de leurs obligations…) ;
– la France tient enfin à faire rappeler l’importance du rôle des instances internes dans le règlement des différends États-investisseurs, et souligne que l’arbitrage ne peut en aucun cas se placer en « cour suprême » au-dessus des juges nationaux.
Ces quatre approches marquent ainsi la volonté française de mieux prendre en compte les spécificités des litiges impliquant les États, et proposent ainsi des pistes de réformes nouvelles en faveur d’une meilleure protection du principe de souveraineté.
Suite à ces contributions, la proposition de la Commission s’appuie sur deux sections. La première consacre le principe de souveraineté des États en leur reconnaissant le droit de réglementer.
Dans une seconde section, la Commission propose la création d’un système juridictionnel public des investissements, composé de juges qualifiés – dont la qualification demandée est analogue à celle exigée par les juridictions internationales permanentes (Cour internationale de justice, OMC) –, soumis à des règles d’éthiques strictes et nommés conjointement par les gouvernements de l’UE et des États-Unis. Cette nouvelle institution, organisée autour d’un tribunal de première instance (quinze juges dont cinq ressortissants de l’UE, cinq des États-Unis et cinq de pays tiers) et d’une cour d’appel (six membres dont deux ressortissants de l’UE, deux des États-Unis, et deux de pays tiers), répond aux critiques françaises à l’encontre des tribunaux d’arbitrage ad hoc, et propose une évolution concrète vers davantage de transparence. Un tel système juridictionnel ouvre ainsi la voie à une « institutionnalisation » progressive du règlement des différends États-investisseurs.
De manière générale, les principaux engagements de la Commission portent sur un encadrement renforcé des procédures de saisine des juridictions par les investisseurs étrangers : elles seraient dès lors limitées à des situations bien précises, en cas notamment de discrimination (fondée sur le sexe, la race, la nationalité…), d’expropriation sans indemnisation ou de déni de justice. Par le biais de ces garanties, la Commission européenne espère donc écarter plus rapidement les recours inutiles ou abusifs.
Parallèlement aux négociations sur le PTCI, la Commission a, en outre, affirmé sa volonté de travailler à la création d’une « juridiction internationale permanente des investissements » qui viserait, à terme, à changer le paradigme de l’arbitrage en créant un nouveau standard juridique qui pourrait s’appliquer à l’ensemble des mécanismes de règlement des différends internationaux.
Si les propositions de la Commission vont dans le sens des attentes françaises, elles restent encore à être acceptées par les autorités américaines. À cet égard, des réticences importantes sont à prévoir : les États-Unis sont très attachés à l’arbitrage, que ce soit philosophiquement, dans leur conception du droit international, ou d’un point de vue plus pragmatique, dès lors que cet État a remporté la quasi-totalité des procédures qu’il a intentées contre des entreprises étrangères. Sans position officielle à cette date, il est toutefois possible de relever la forte opposition prononcée par la chambre de commerce américaine (AmCham) contre la proposition de réforme européenne.
1. Les moindres performances à l’exportation de certains secteurs agricoles et agro-alimentaires contrastent avec les résultats passés
Le premier constat qui s’impose dans l’analyse de la filière agro-alimentaire est celle de sa plus-value dans la balance commerciale française : l’agroalimentaire reste l’une des forces de la France à l’exportation, en particulier dans les vins, les céréales et les produits laitiers. En 2014, le secteur agricole et agroalimentaire est le troisième excédent commercial sectoriel de la France (9,1 milliards d’euros) derrière le secteur aéronautique et spatial (20,5 milliards) et celui de la chimie, des parfums et cosmétiques (10,9 milliards). Au total, l’agroalimentaire français représente 58 milliards d’euros d’exportations en 2014, soit 14 % du total.
Évolution depuis 2004 du solde commercial des principaux sous-secteurs agroalimentaires, en milliards d’euros
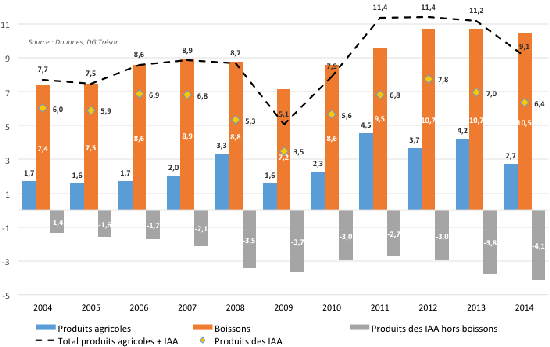
Toutefois, deux réserves peuvent être émises : d’une part, les produits transformés constituent les trois-quarts de ces exportations, les produits agricoles représentant le quart restant (14,7 Md€). D’autre part, la part française dans les exportations agroalimentaires mondiales est en baisse tendancielle, passant de 8,3 % en 2000 à 5,2 % en 2014. Au début des années 2000, la France était le troisième exportateur mondial de produits agroalimentaires, mais a cédé sa place à l’Allemagne en 2006 puis au Brésil en 2011. Quelques secteurs résistent, comme celui des boissons ou des fromages.

ÉVOLUTION DU SOLDE COMMERCIAL PAR PRODUIT ENTRE 2013 ET 2014, EN MILLIONS D’EUROS
Ce constat d’ordre général se reflète dans l’analyse d’un secteur actuellement en difficulté, la production de lait. La France est en 2014 le 5e exportateur mondial de lait derrière la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis, avec 10 % des exportations de lait sous forme liquide et 5,8 % des ventes de lait en poudre. Les exportations françaises ont doublé depuis 2004, mais leur croissance a été moins rapide que celle des exportations mondiales. Par conséquent, la part de marché de la France a eu tendance à reculer au cours des dernières années (de 11 % en 2000 à 6,9 % en 2014).
Le secteur est particulièrement exposé à la conjoncture internationale : 35 % de la collecte de lait est exportée. Avec 1,8 Md€ d’exportations en 2014, le secteur est en excédent, mais au premier semestre 2015, les ventes ont diminué de 20 % en valeur, ce qui est lié à une forte baisse des prix. En effet, en volume, ces ventes ont progressé de 8 %. Après deux années de cours élevés, cette chute s’explique par des facteurs de demande (le repli de la demande chinoise et l’embargo russe) et par des facteurs d’offre : la fin des quotas laitiers dans l’Union européenne a tiré la production à la hausse, ce qui pèse sur les prix.
Cependant, cette dimension conjoncturelle se double d’une dimension plus structurelle : on observe une perte latente de compétitivité de la filière agro-alimentaire, particulièrement manifeste pour les produits agricoles. C’est sur cette dimension qu’il s’agit de cibler l’analyse.
La position internationale de la France en matière d’exportations s’évalue à l’aide d’indicateurs de compétitivité prix (coûts de production, dont les coûts salariaux, coûts de l’énergie, coût des matières premières, taux de change) et de compétitivité hors prix (qualité de confection, réputation, marketing, innovation). Si le modèle agricole français permet un excellent positionnement sur le hors prix, les exploitants agricoles peinent à maintenir des coûts compétitifs à l’international, face à l’émergence de modèles de production plus dynamiques à l’étranger.
Ainsi, en matière de production de lait par exemple, deux modèles existent : en Europe du Nord, la production de lait est très intensive, concentrée dans de grandes unités (Danemark, Pays-Bas) ; dans certains pays émergents, il s’agit plutôt de petites exploitations vivrières (notamment en Inde, premier producteur de lait au monde). La France se situe entre ces deux modèles, avec une production essentiellement familiale, de proximité, atomisée sur l’ensemble du territoire et très diverse selon les régions, le climat et l’histoire.
Cette organisation a des avantages indéniables, et participe en particulier à un meilleur aménagement du territoire, tout en permettant un prix du foncier qui reste raisonnable – en particulier au regard de l’expérience allemande, où le fort développement de la méthanisation a tiré le prix des terrains à un niveau prohibitif. Mais cette dispersion empêche des gains de productivité liés à la taille des exploitations : une activité très intensive peut dégager des économies d’échelle substantielles qui lui permette de mobiliser des capitaux en plus grande quantité et de financer des équipements plus modernes.
La concentration des activités sur certains territoires ne suffit pas toujours à dégager de telles économies d’échelle : la production porcine, essentiellement présente dans l’Ouest de la France, n’est pas synonyme d’exploitations de plus grande taille. Ce mode de production est aussi une richesse : il permet la diversité des produits, une culture de terroir qui valorise les biens sur les marchés et permet de respecter un haut standard environnemental et de bien-être animal. Cependant, des rapprochements pourraient être envisagés pour gagner en performance, notamment au travers des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) ou des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). Mais la structuration de la filière porcine est marquée par un fort individualisme des producteurs, qui peinent à s’entendre pour faire valoir leurs intérêts en commun. Ceci est problématique lorsque l’ouverture à l’international oblige les producteurs à mobiliser la taille critique suffisante pour répondre aux besoins des marchés étrangers (en termes de volumes ou de prix) ou tout simplement pour assumer les coûts de prospection d’un marché émergent.
S’il ne faut pas souhaiter l’industrialisation de la production agricole française, force est de constater que son mode d’organisation est une source de fragilité en période de crise et de renforcement des acteurs internationaux.
B. L’EXPOSITION À LA CONCURRENCE INTERNATIONALE APPORTE UN ÉCLAIRAGE NOUVEAU SUR LA CRISE AGRICOLE DE L’ÉTÉ 2015
La baisse des cours mondiaux de la viande et du lait a entraîné une crise majeure de l’élevage de porc et de bovin. L’essentiel de la crise se joue au sein de la filière de l’élevage, où la fixation des prix français s’effectue en partie par un accord entre éleveurs, transformateurs et grande distribution. La table ronde organisée par la commission des affaires économiques du 22 juillet 2015, sur la crise des filières d’élevage, résume les tensions qui parcourent les relations entre ces acteurs. Tandis que les éleveurs, souvent très endettés, doivent subir des prix de vente en forte baisse et peinant à couvrir leurs coûts de production, les transformateurs et la grande distribution ont dénoncé un accord de prix décorrélé des cours européens.
Mais la crise actuelle est le prolongement de facteurs de difficultés plus structurels. De taille souvent modeste, les exploitations françaises doivent engager des investissements importants pour dégager des marges de production et pour respecter les normes environnementales, tandis que les coûts d’exploitation – notamment les charges sociales – pèsent sur leur rentabilité. Ainsi, dans le cas de l’élevage bovin, 285 000 exploitations ont disparu entre 2000 et 2010.
Enfin, l’évolution des instruments de la politique agricole commune (PAC) a pu engendrer une fragilisation du tissu agricole français. La programmation PAC 2015-2020 confirme la marginalisation des outils de régulation traditionnels des marchés, avec notamment le maintien au niveau nul des aides aux exportations et la fin des deux régimes de quotas de production (dès 2015 pour le lait). La pratique des prix d’intervention a progressivement cessé depuis les années 2000, dans le cadre de la libéralisation des marchés agricoles européens.
2. L’internationalisation des échanges agricoles et le renforcement de la concurrence expliquent en grande partie les tensions que traversent les entreprises françaises
L’aspect international de la crise est omniprésent : l’ouverture des échanges commerciaux au niveau mondial, le développement d’une offre compétitive dans les pays émergents et dans les pays européens concurrents de la France, l’internationalisation des prix agricoles, sont autant de facteurs qui doivent être pris en compte par les agriculteurs français. L’exposition internationale des secteurs agroalimentaires est en effet très prononcée : à titre d’exemple, 38 % de la production française de lait est exporté. Plus l’exposition internationale d’une filière est importante, plus elle est sensible aux déterminants internationaux des prix et des échanges. Ceci peut être une chance : la croissance des marchés asiatiques est un débouché important pour le secteur laitier français, alors que la fin des quotas laitiers en Union européenne tire la production européenne vers le haut, et que la demande européenne est déjà saturée.
Cependant, l’internationalisation des échanges agricoles est le plus souvent un défi pour les exploitations françaises, qui doivent augmenter leurs performances pour résister à une pression concurrentielle accrue. Ainsi, en matière de fixation des prix au sein des filières bovines, porcines et laitières, les entreprises en aval de la filière peuvent facilement acheter leurs produits agricoles à l’étranger si les prix sont plus favorables, ce qui requiert des éleveurs français un effort de compétitivité difficile à assumer face aux conditions dans lesquelles les concurrents mondiaux proposent leurs produits. La forte volatilité des marchés agricoles internationaux qui fixent le prix de référence est également un facteur de fragilité qui trouble les perspectives d’investissement des exploitants. De façon plus problématique, tandis que les cours de l’élevage sont presqu’aussi volatiles que ceux des céréales (notamment en termes de volumes échangés), les producteurs font face à un problème de stockage des excédents, dont la péremption – et donc la perte nette en cas d’invendu – est rapide.
En outre, des facteurs exogènes pèsent sur la conjoncture internationale : l’embargo russe – mis en place en 2014 en rétorsion des sanctions économiques de l’Union européenne infligées à la Russie – coûte, pour la seule exportation de gras de porc, 45 millions d’euros à la France. Certains produits polonais ou baltes, qui trouvaient leur destination de prédilection en Russie et qui y sont désormais interdits, sont reversés sur le marché européen et pèsent sur les prix. D’autres embargos plus durables sont régulièrement dénoncés par la France, notamment ceux portant sur le risque prétexté de contamination de la viande française exportée avec l’ESB (c’est notamment le cas du marché chinois).
Dans le même temps, la concurrence étrangère s’est renforcée. Le développement d’une offre très compétitive en provenance de pays émergents s’explique par la faiblesse de leurs coûts de production, même si la qualité de la viande ou du lait demeure un avantage comparatif de la production française. En outre, certains pays européens comme les Pays-Bas ou le Danemark ont fortement intensifié leur production agricole, au détriment d’exploitations françaises peu modernisées et atomisées. Enfin, les États-Unis tirent leur compétitivité d’un prix de l’énergie plus faible – grâce à l’exploitation des gaz et pétroles de schiste – , de contraintes environnementales plus modestes et de pratiques sanitaires qui ne correspondent pas aux standards de protection du consommateur européen (comme l’utilisation de chlore dans la désinfection de la volaille). Si, pour prendre ce dernier exemple, ces produits ne peuvent être importés en Union européenne, ils ont une influence à la baisse sur les prix fixés au niveau mondial.
Cette concurrence « légitime », qui oblige les agriculteurs français à augmenter leur degré de performance, se double cependant d’une forme de concurrence qu’on peut qualifier de déloyale : des pays comme l’Allemagne ont su dégager d’importants gains de compétitivité en recourant à une main-d’œuvre étrangère à bas coût – les travailleurs détachés – au détriment de conditions de travail et de couverture sociale acceptables. La faiblesse du coût du travail dans les pays limitrophes de l’Allemagne induit une divergence marquée de compétitivité prix pour des produits assez homogènes, comme les biens agricoles non transformés. Ainsi, l’institut du porc (IFIP) vient de publier une étude (5) qui relève une différence sensible de coût du travail entre abattoirs français et allemands, comme le montre le tableau ci-dessous.
COÛT DE LA MAIN D’œUVRE SALARIÉE DANS LE SECTEUR DE L’ABATTAGE-DÉCOUPE | ||||||
|
France |
Allemagne |
Espagne |
Danemark |
Pays-Bas |
Belgique |
Coût du travail/ETP (€/an) |
42 393 |
32 895 |
27 462 |
58 776 |
47 807 |
47 824 |
Coût du travail/heure (€/heure) |
nd |
19,9 |
15,0 |
nd |
28,4 |
30,5 |
Source : IFIP, d’après SSE/Eurostat. |
||||||
Néanmoins, affaiblis sur le segment « prix » de leur compétitivité internationale, les exploitants agricoles français disposent d’une réputation favorable à l’étranger, lié à la qualité de leur production et à la confiance qui y est associée. La poudre de lait française a ainsi trouvé un solide débouché en Chine face aux produits locaux moins fiables, avant que la demande chinoise ne se rétracte depuis début 2015.
La question des travailleurs détachés
Le recours aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de service ou par le biais d’une agence d’intérim est encadré par le droit européen. Les travailleurs détachés étrangers bénéficient des règles du pays d’accueil concernant le droit du travail (notamment la rémunération minimale) mais restent affiliés au régime social de leur pays d’origine (notamment la sécurité sociale).
Selon l’IFIP, l’origine de la concurrence déloyale des travailleurs détachés en Allemagne dans l’industrie de la viande provient du fait que ce secteur n’était, jusqu’à peu, pas concerné par la transposition nationale des règles européennes précisées ci-dessus. Les abattoirs allemands pouvaient ainsi délibérément rémunérer les travailleurs en provenance d’Europe de l’Est au salaire minimum en vigueur dans leur pays d’origine, ce qui leur permettaient de réduire drastiquement leurs coûts de production.
La mise en place d’un salaire minimum interprofessionnel en Allemagne et la signature en 2014 d’une convention collective entre les principaux abatteurs allemands et les salariés devrait résoudre en partie cette distorsion de concurrence, à moins que les « fraudes au détachement » (heures supplémentaires non payées, absence de protection sociale, contrats à la tâche, retenues sur salaire) ne se multiplient.
3. Des solutions existent pour soutenir les exploitations françaises à l’international tout en préservant leur modèle de production
La crise actuelle a d’ores et déjà fait l’objet de mesures ponctuelles de soutien aux éleveurs : en France, ces derniers ont obtenu un moratoire d’un an pour le remboursement de leurs dettes bancaires, une suspension d’application des nouvelles normes environnementales et un plan public d’investissements s’élevant à 3 milliards d’euros sur trois ans. En outre, la Commission européenne a annoncé le déblocage de 500 millions d’euros d’aides, notamment pour les producteurs laitiers, grâce à une clause de sauvegarde de la PAC : pour répondre à des perturbations graves de marché, une « réserve de crise » peut être spontanément utilisée.
Cependant, face à des déterminants de crise d’origine internationale, des solutions tournées vers l’international peuvent également être explorées :
– des actions ont déjà été mises en place pour favoriser l’achat de viande française, notamment un label qualité, destiné à orienter la demande française sur ces produits plutôt que sur les concurrents internationaux. Mais en ce qui concerne les produits transformés, une meilleure traçabilité de l’origine des produits pourrait être mise en place pour la bonne information du consommateur. La production française est plus chère, mais au prix de préférences assumées collectivement : le choix du bien-être animal, le respect de normes environnementales qui marquent la soutenabilité du modèle agricole français, la qualité des produits. Les consommateurs doivent pouvoir être informés de l’origine française des produits pour prendre leur décision d’achat en connaissance de cause ;
– de façon corrélée, il est sans doute illusoire de vouloir gagner la bataille de la compétitivité prix face aux concurrents internationaux qui produisent à bas coût. En revanche, l’agriculture française dispose d’atouts hors prix qu’il faut valoriser à l’international, avec l’appui de Business France – qui a récupéré les missions de Sopexa pour valoriser l’offre agroalimentaire française à l’étranger. Ainsi, la réputation des produits français n’est pas à faire, mais leur marketing pourrait être amélioré pour mettre en valeur leur dimension de bien supérieur : dans ce cas-là, le facteur prix joue moins que la qualité intrinsèque des produits consommés. Ainsi, la reconnaissance de la qualité de certaines petites productions comme le porc noir de Bigorre permet des prix de vente bien supérieurs à ceux du marché, sans qu’une exploitation de masse ne soit nécessaire pour faire face à la pression concurrentielle ;
– encore faut-il que les agriculteurs puissent être suffisamment présents à l’international. Trop petits, insuffisamment organisés, ils peinent à s’attaquer aux marchés dans lesquels des débouchés naturels existent. Dans cette perspective, la plateforme « France Viande Export » vient d’être mise en place pour la filière bovine : des groupements de producteurs sont prévus pour « chasser en meute » à l’étranger, avec des prix de vente communs, une mutualisation des coûts d’exportation et des volumes importants pour répondre aux appels d’offres internationaux. Cet esprit de filière, qui répond à une logique de patriotisme économique, doit être généralisé dans les autres secteurs, encore trop marqués par des logiques individualistes ;
– plus généralement, les petites exploitations doivent mieux mutualiser leurs moyens de production et regrouper leurs efforts pour survivre. Il ne s’agit pas d’appeler à une remise en cause du modèle français, qui permet un vrai ancrage dans les territoires et une authenticité de la production plébiscitée par les producteurs comme par les consommateurs. Cependant, des outils existent pour faciliter l’entente entre agriculteurs, comme les CUMA, les GAEC ou, plus récemment, les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE). Les exploitants doivent se les approprier pour préserver leur modèle face aux tentatives d’industrialisation qu’ils perçoivent comme de nouvelles menaces – l’exemple le plus relevé dans les auditions portant sur « la ferme des 1 000 vaches » ;
– au niveau des territoires, une prédilection pour les circuits courts pourrait être mieux mise en avant, même si cette option n’est pas la solution miracle à la crise agricole. Pour mettre en place un circuit court, il faut structurer des plateformes de transformation et de vente de proximité, avec, par exemple, des abattoirs situés à distance raisonnable des exploitations, ou encore des magasins d’éleveurs dans lesquels les producteurs pourraient fixer leurs prix à partir de leurs coûts de production et non des prix du marché. Lorsque ces magasins existent, le consommateur peut d’ailleurs constater que les prix de vente ne sont pas plus élevés qu’en grande surface ;
– enfin, ce sont sans doute les comportements de consommation qu’il faut pointer du doigt : le recul de l’attrait pour la viande noble, au profit de produits transformés peu chers mais de moindre qualité comme les steaks hachés, traduit une uniformisation des habitudes alimentaires décourageante pour les exploitants. Votre rapporteure regrette ainsi qu’une meilleure éducation alimentaire n’ait pas lieu dès l’école pour que le goût pour les produits de qualité français ne soit pas irrémédiablement perdu.
Dans le cadre de la commission élargie, la commission des affaires économiques a examiné pour avis, sur les rapports de M. Lionel Tardy (Entreprises), Mme Jeanine Dubié (Commerce extérieur), Mme Corinne Erhel (Communications électroniques et économie numérique), M. Jean-Luc Laurent (Industrie) et Mme Michèle Bonneton (Postes), les crédits de la mission « Économie » (voir le compte rendu officiel de la commission élargie du 29 octobre 2015, sur le site internet de l’Assemblée nationale (6).
*
* *
À l’issue de la commission élargie, la commission des affaires économiques a délibéré sur les crédits de la mission « Économie ».
*
La commission examine les amendements II-CE 19 et II-CE 20.
Mme la présidente Frédérique Massat. Je demande à Mme Michèle Bonneton de bien vouloir présenter ses amendements.
Mme Michèle Bonneton, rapporteure pour avis. Le premier amendement II-CE 19 propose une augmentation du budget de l’ARCEP, à hauteur d’un million d’euros, afin de permettre au régulateur des télécommunications et des postes de renforcer son département « études et prospectives ». Depuis plusieurs années, le budget de l’ARCEP ne cesse en effet d’être réduit, alors que ses missions augmentent, ce qui a été à nouveau dit aujourd’hui. À titre d’exemple, l’ARCEP est chargée de piloter le processus de libération de la bande 700 MHz, de contrôler le processus de déploiement du très haut débit fixe et de suivre l’évolution de la couverture des zones blanches. La loi dite « Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a confié de nouvelles missions au régulateur, et son budget continue de se dégrader.
Cette année, son plafond d’emplois est stabilisé, et c’est une bonne nouvelle. Toutefois, l’ARCEP a été contrainte ces dernières années de sacrifier certaines de ses activités pour remplir les missions qui lui sont confiées avec un budget en diminution. Parmi ces activités sacrifiées figurent particulièrement les études et la prospective. En matière postale par exemple, la dernière étude du régulateur date d’il y a plus de cinq ans. Ceci est anormal alors que les enjeux sont colossaux et que ce secteur postal évolue très rapidement, avec la baisse du courrier, l’augmentation des colis et les nouvelles missions. La concurrence avec Amazon devient ainsi cruciale : c’est le premier client et premier concurrent de La Poste. Cette problématique nécessiterait une étude à elle seule. En matière de télécommunications, on pourrait légitimement penser que le régulateur devrait s’intéresser davantage à la question des objets connectés. Là aussi, une étude serait nécessaire.
De plus, on reproche souvent aux parlementaires, au cours des débats sur des projets de loi, de solliciter par amendement la réalisation d’un rapport qui viendrait encore surcharger certaines autorités de l’État tel que l’ARCEP. Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation, en donnant les moyens au régulateur de renforcer ses compétences et sa capacité d’anticipation par la réalisation d’études prospectives.
Quant à l’amendement II-CE 20, il s’agit de la compensation de l’État pour la mission de transport de la presse, évoquée précédemment dans mon intervention relative au rapport sur les postes. Cet amendement a pour objet de rehausser à 130 millions d’euros, contre 119 millions en PLF, le montant de la compensation versée par l’État à La Poste au titre de la mission de transport et d’acheminement de la presse.
Pour rappel, le montant de cette compensation a fortement chuté au cours des dernières années. Il était de 217 millions d’euros en 2013, contre 250 millions d’euros en 2012. Ceci correspond à l’engagement de l’État dans sa mission de préservation du pluralisme des médias. Ces deux dernières années, le Gouvernement justifiait la baisse du montant de la compensation par le bénéfice que tirait La Poste du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Je comprends cette justification. Toutefois, pour cette année, la situation est tout autre. Le Gouvernement met en avant la réforme à venir des modalités d’exercice de la mission de transport et d’acheminement de la presse confiée à La Poste pour justifier cette baisse de 11 millions d’euros. Lui retirer cette mission contribuerait à la baisse du volume de la sacoche du facteur, dans un contexte où la presse connaît elle-même de grandes difficultés.
Mme la présidente Frédérique Massat. Nous allons passer au vote des amendements. Je rappelle que le ministre, dans son expression en réponse à Mme Bonneton, a donné sa position.
L’amendement II-CE 19 n’est pas accepté.
L’amendement II-CE 20 n’est pas accepté.
Conformément aux avis favorables de Mme Jeanine Dubié, rapporteure pour avis sur les crédits du Commerce extérieur, Mme Corinne Erhel, rapporteure pour avis sur les crédits Communications électroniques et économie numérique, M. Jean-Luc Laurent, rapporteur pour avis sur les crédits de l’Industrie, Mme Michèle Bonneton, rapporteure pour avis sur les crédits des Postes et contrairement à l’avis défavorable de M. Lionel Tardy, rapporteur pour avis sur les crédits des Entreprises, la commission a donné un avis favorable à l’adoption des crédits de la mission « Économie ».
La commission examine ensuite les amendements II-CE 24 et II-CE 25.
Mme la présidente Frédérique Massat. Je demande à M. Jean-Luc Laurent de bien vouloir présenter ses amendements à l’article 53.
M. Jean-Luc Laurent, rapporteur pour avis. Ces amendements ont déjà été largement présentés et débattus précédemment. Ils concernent les centres techniques industriels (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE), visent à clarifier les dispositifs et s’inscrivent dans les propositions également faites par M. Jean-Louis Gagnaire dans son rapport.
Les amendements II-CE 24 et II-CE 25 sont acceptés.
La Commission, conformément à l’avis favorable de M. Jean-Luc Laurent, donne un avis favorable à l’adoption de l’article 53, ainsi modifié.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l’étranger
M. Cyrille Pierre, directeur de cabinet
M. Pierre Hausswalt, conseiller affaires commerciales multilatérales et européennes
M. Pierre-Louis Autin, conseiller spécial
Mme Camille Perez, conseillère parlementaire
Représentation française à l’Union Europénne
M. François Riegert, ministre-conseiller, chef du service économique, en charge de la politique commerciale
Commission des affaires étrangères
Mme Seybah Dagoma, rapporteure sur la PPRE sur le mandat de négociation de l’accord de libre-échange entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne
Attac France (stop-TAFTA)
Mme Amélie Canonne, présidente de l’Aitec, association membre d’Attac menant un travail d’expertise sur les accords de libre-échange
M. Frédéric Viale, juriste, membre de la commission Europe d’Attac France
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) (*)
M. Arnold Puech d’Allissac, membre du bureau
Mme Chloé Bordet, chargée d’études économiques
Mme Nadine Normand, chargée des relations avec le Parlement
Coordination rurale
M. François Lucas, 1er vice-président
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Mme Marie-Hélène Le Henaff, sous-directrice International, service Europe et international
Mme Andrée Sontot, cheffe du bureau des négociations commerciales
Fédération nationale porcine (FNP)
M. Guillaume Roué, membre du Bureau
Association nationale des industries alimentaires (ANIA) (*)
M. Michel Nallet, administrateur, président de la Commission Export
M. Alexis Degouy, directeur des affaires publiques
Jeunes agriculteurs (*)
M. Julien Bigand, vice-président de Jeunes Agriculteurs
M. Yann Nédélec, chef du service économique de Jeunes agriculteurs
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
© Assemblée nationale