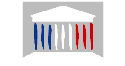______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1)
sur l’évaluation des accords de libre-échange de l’Union européenne
ET PRÉSENTÉ
PAR MM. Joaquim PUEYO et Hervé GAYMARD
Députés
——
(1) La composition de la commission figure au verso de la présente page.
La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; M. Christophe CARESCHE, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; M. Philip CORDERY, Mme Sandrine DOUCET, MM. Arnaud LEROY, André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Kader ARIF, Philippe BIES, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, M. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Rémi PAUVROS, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY.
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. L’ÉVALUATION EX-ANTE DES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE (ALE) 11
A. UNE ÉVALUATION QUI, MALGRÉ L’INFLUENCE CROISSANTE DU PARLEMENT EUROPÉEN, EST LARGEMENT DANS LA MAIN DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 12
1. Le rôle primordial de la Commission européenne dans l’évaluation ex-ante des ALE s’appuie sur l’expertise de consultants indépendants 12
a. Une triple évaluation obéissant à une méthodologie précise 12
i. L’étude d’impact initiale (IA) 12
ii. L’étude d’impact sur le développement durable (SIA) 14
iii. L’étude d’impact post-négociation 16
b. Des évaluations qui s’appuient sur l’expertise de consultants indépendants et dont les résultats sont rendus publics 17
i. Le recours par la Commission à des consultants indépendants dont l’action est toutefois encadrée 17
ii. Une large consultation de l’ensemble des parties prenantes 19
iii. La Commission s’appuie largement sur les constats des consultants mais n’en tire pas forcément les mêmes conclusions 20
2. Si le Conseil s’appuie sur les seules études d’impact de la Commission, le rôle du Parlement européen s’est accru avec le développement d’une capacité autonome d’évaluation 23
a. Contrairement aux États membres, le Conseil, en tant qu’institution, fait sienne l’évaluation de la Commission européenne 23
i. Le Conseil ne fait pas de contre-expertise des études d’impact produites par la Commission européenne 23
ii. Les États membres réalisent des études d’impact mais limitent généralement leur analyse aux seuls effets des ALE pour leur pays 24
b. Le contrôle accru du Parlement européen sur la politique commerciale 25
i. La volonté nouvelle du Parlement européen de peser sur la conduite des négociations commerciales 26
ii. Le développement, par le Parlement européen, de sa propre capacité d’évaluation des accords de libre-échange 28
3. L’influence des études d’impact sur la politique commerciale 30
a. La Commission s’appuie sur les études d’impact pour prendre ses décisions et influencer le Parlement et le Conseil 30
b. Les études d’impact sont une arme de communication vis-à-vis de l’opinion publique 32
B. LA FIABILITÉ DE L’ÉVALUATION EX-ANTE DES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE SE HEURTE AUX LIMITES DES MÉTHODES UTILISÉES ET À LA MAUVAISE VOLONTÉ DE LA COMMISSION 33
1. La modélisation économique, bien qu’au cœur de l’analyse des impacts économique, social et environnemental, présente de nombreuses limites susceptibles de remettre en cause ses résultats 34
a. Les différentes méthodes utilisées par les consultants pour évaluer l’impact économique, social et environnemental d’un ALE 34
b. Des modèles et méthodes critiquables en eux-mêmes comme dans l’utilisation qui en est faite 38
i. La structure du modèle et les hypothèses utilisées reposent sur des choix subjectifs des consultants 38
ii. Les données ne sont pas forcément complètes ni adéquates 42
2. Les faiblesses de l’évaluation de l’impact sur les droits humains 44
a. Après avoir longtemps été ignoré, l’impact des ALE sur les droits humains fait désormais l’objet d’une étude de la Commission 44
b. Malgré les progrès, la prise en compte des droits humains dans les études d’impact n’est pas jugée satisfaisante 46
C. ILLUSTRATION DE LA DIFFICULTÉ D’ÉVALUER EX-ANTE UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE : LE CAS DE L’AECG ET DU PTCI 49
1. L’AECG : un accord aux gains économiques modestes qui repose sur une évaluation ex-ante qui n’a pas été réactualisée 49
a. Le travail d’analyse préalable très approfondi d’un accord présenté comme favorable aux intérêts de l’Union 49
i. Un travail d’analyse préalable très approfondi 49
ii. L’accord est présenté comme favorable aux intérêts de l’Union 51
b. Malgré sa qualité, un travail d’évaluation clairement insuffisant alors qu’approche la signature de cet accord 54
i. D’insurmontables problèmes méthodologiques 54
ii. Une évaluation datée qui n’a pas été réactualisée 56
2. Le PTCI : les conclusions de l’étude d’impact de la Commission nuancées par de nombreuses analyses indépendantes 57
a. L’étude d’impact met en évidence les avantages économiques du PTCI 57
b. Des avantages nuancés par d’autres études 60
i. Les critiques du Parlement européen 60
ii. Les résultats parfois contradictoires des autres études 63
II. SI L’ÉVALUATION EX-POST S’EST RÉCEMMENT DÉVELOPPÉE À L’INITIATIVE DE LA COMMISSION, SA PORTÉE SUR LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EST ENCORE TRÈS LIMITÉE 66
A. L’ÉVALUATION EX-POST DES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE, PRINCIPALEMENT FAITE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE, A UNE ORIGINE RÉCENTE ET PORTÉE LIMITÉE 67
1. La montée en puissance de l’évaluation ex-post des accords de libre-échange par la Commission 67
a. Une évaluation qui n’était pas systématique mais parfois obligatoire 67
i. Les règlements européens mettant en œuvre les clauses de sauvegarde imposent à la Commission d’évaluer certains effets des ALE 67
ii. Les rapports annuels réalisés en application de ces règlements évaluent de manière très succincte les effets des ALE 68
b. L’apparition récente d’évaluations ex-post des ALE inspirée des études d’impact ex-ante 69
i. La nouvelle stratégie de la Commission en matière d’évaluation ex-post 69
ii. L’évaluation des ALE avec le Mexique et le Chili, très approfondie, s’inspire des études d’impact sur le développement durable 70
2. Le rôle croissant du Parlement européen contraste avec le désintérêt actuel du Conseil et des États membres pour l’évaluation des ALE une fois ceux-ci entrés en vigueur 72
a. Le désintérêt du Conseil et, dans une moindre mesure, des États membres pour l’évaluation ex-post des accords de libre-échange 72
b. Le Parlement européen suit de manière relativement distante les ALE une fois ceux-ci en vigueur 73
3. La portée de l’évaluation ex-post est difficile à cerner compte tenu de son caractère récent et du peu d’ALE concernés 75
a. Le suivi de la mise en œuvre des accords existants 75
i. Un suivi nécessaire à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde 75
ii. Un suivi qui pourrait, à terme, avoir des conséquences sur l’application elle-même des accords de libre-échange 77
b. L’évaluation ex-post prépare la modernisation des ALE existants 79
B. L’ÉVALUATION EX-POST DES ALE SE HEURTE AUX MÊMES DIFFICULTÉS QUE L’ÉVALUATION EX-ANTE TOUT EN ILLUSTRANT LES LIMITES DE CELLE-CI 80
1. Parce qu’elle utilise aussi la modélisation, l’évaluation ex-post se heurte aux mêmes limites que l’évaluation ex-ante : le cas de l’accord UE-Chili 80
a. L’analyse des seuls flux commerciaux est insuffisante pour évaluer correctement l’impact d’un accord de libre-échange 80
b. La modélisation permet, malgré ses limites, d’éclairer l’impact économique de l’ALE UE-Chili 85
i. L’indispensable recours à la modélisation pour l’évaluation de l’impact économique 85
ii. Les impacts sociaux et environnementaux 87
2. Dans le cas de l’ALE UE-Corée du sud, la Commission a mis en avant ses bénéfices sans recourir à la modélisation 88
a. Les bénéfices de l’ALE UE-Corée du sud ont été mis en évidence par le dernier rapport annuel de la Commission 88
i. L’ALE UE-Corée du sud : premier ALE de nouvelle génération 88
ii. Les bénéfices pour l’Union de l’accord ont été largement mis en avant par la Commission européenne 91
b. Les bénéfices économiques de l’accord n’avaient pas été forcément anticipés par les études d’impact ex-ante 92
i. Des bénéfices qui doivent être relativisés 92
ii. L’étude d’impact sur le développement durable n’avait pas saisi toutes les implications de l’ALE 94
C. L’ALE UE-COLOMBIE/PÉROU : PREMIÈRE ÉVALUATION D’UN ACCORD DE NOUVELLE GÉNÉRATION 96
1. L’ALE UE-Colombie/Pérou, un ALE de nouvelle génération complété par des « feuilles de route » 96
a. Un accord initialement ambitieux dont la ratification a été compliquée 96
i. Un accord initialement ambitieux 96
ii. Une approbation difficile, acquise après la présentation, par la Colombie et le Pérou, de « feuilles de route » complétant l’accord 98
b. Le contenu de l’accord 99
i. Les dispositions relatives au commerce 100
ii. Les dispositions relatives au développement durable 101
iii. Les dispositions institutionnelles 102
2. Bien que globalement satisfaisante, la mise en œuvre de l’ALE pose la question de la portée des dispositions relatives aux droits humains, sociaux et environnementaux 103
a. Des premiers résultats satisfaisant sur le plan économique, malgré quelques difficultés de mise en œuvre 103
i. Des premiers résultats satisfaisants 103
ii. Quelques difficultés de mise en œuvre sur des points précis 107
b. La question de la portée des dispositions relatives aux droits humains, sociaux et environnementaux dans les ALE 109
i. Les initiatives prises par la Colombie et le Pérou, tout en allant dans le bon sens, apparaissent encore insuffisantes 109
ii. L’ALE ne peut, à lui seul, améliorer la situation des droits humains, sociaux et environnementaux qui découlent de facteurs structurels dépassant largement le commerce 112
Mesdames, Messieurs,
Même si la part qu’elle représente dans le commerce international décline régulièrement, l’Union européenne est toujours la première puissance commerciale du monde. Si l'on exclut le commerce intra-européen, elle représente un peu plus de 15 % des exportations mondiales de marchandises (2 307 milliards d'euros) et 25 % des exportations mondiales de services (890 milliards d'euros), soit bien plus que la Chine (11,7 % des exportations mondiales de marchandises et 4,4 % des exportations mondiales de services) et les États-Unis (respectivement 8,4 % et 14,3 %).
Le commerce extérieur constitue donc un enjeu essentiel qui justifie que la politique commerciale soit une compétence exclusive de l’Union européenne. L’objectif de cette dernière, tel que fixé par l’article 21 du Traité sur l’Union européenne, est « d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international ». La signature d’accords de libre-échange (ALE) est le moyen privilégié d’atteindre cet objectif.
Historiquement, cette politique a pris deux formes très différentes :
– l’abaissement des droits de douane et la suppression des barrières non-tarifaires via les négociations multilatérales du GATT puis de l’OMC menées par la Commission européenne au nom de l’ensemble des États membres ;
– le soutien au développement économique des pays les moins avancés via la convention de Lomé (et ses succédanés), l’ouverture de l’Union aux exportations de ces pays devant contribuer à leur insertion dans l’économie mondiale et à leur développement économique.
Toutefois, depuis les années 2000 et plus encore depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (2009), la politique commerciale de l’Union européenne a subi une triple évolution. En effet, confrontée à l’enlisement des négociations multilatérales à l’OMC depuis 2001 (cycle de Doha), l’Union, comme d’ailleurs ses principaux partenaires économiques, a fait le choix de multiplier les accords bilatéraux ou interrégionaux de libre-échange. Après la signature d’accords de libre-échange, incluant ou non l’investissement, avec la Corée du sud (2010), l’Amérique centrale (2012) et la Colombie et le Pérou (2012) et la conclusion des négociations avec Singapour (2014), le Canada (2014) et le Vietnam (2015), sont aujourd’hui en cours des négociations avec notamment les États-Unis, le Japon, le Mercosur ou la Chine.
Désormais principalement bilatérale, la politique commerciale de l’Union européenne a en outre élargi ces objectifs en donnant aux accords de libre-échange une portée bien plus importante, au point qu’ils ont pu être présentés comme des ALE de « nouvelle génération ».
En effet, les ALE dits « d’ancienne génération » contenaient, comme les accords du GATT puis de l’OMC, pour l'essentiel des dispositions sur la circulation des marchandises (plus particulièrement la suppression des droits de douane) et, le cas échéant, des services. Or, avec la transformation du commerce mondial et la place toujours plus importante des services et des droits de propriété intellectuelle, les nouveaux accords vont bien au-delà des seuls échanges de marchandises. Non seulement ils intègrent les services et les droits de propriété intellectuelle mais ils traitent également des investissements, des normes, ou encore des marchés publics. Le changement de portée est d’ailleurs visible dans le titre même des accords : par exemple, le traité en voie d’être signé avec le Canada s’intitule « Accord Économique et Commercial Global (AECG) ».
De plus, ces ALE de « nouvelle génération » ne contiennent pas seulement des dispositions d’ordre économique et commercial mais également des dispositions relatives aux droits humains, sociaux et environnementaux. Naturellement de telles dispositions sont, pour l’essentiel, réservées aux accords avec des pays du Sud ; elles sont toutefois la preuve que la politique commerciale, désormais, intègre d’autres dimensions que le seul commerce. C’est ainsi que la signature, par l’Union européenne, des ALE avec la Colombie et Pérou ainsi qu’avec les pays d’Amérique centrale (et, demain, avec le Vietnam) a été subordonnée à des engagements précis de leur part dans le domaine, notamment, du droit de l’environnement et du droit du travail.
Enfin, dernière évolution, cette politique commerciale fait désormais l’objet de nombreuses évaluations afin de mesurer aussi précisément que possible les effets des accords de libre-échange signés par l’Union européenne.
En effet, comme l’indique la Commission européenne dans sa récente communication : « Le commerce pour tous » (2015), « toute initiative importante en matière de politique commerciale fera l’objet d’une analyse d’impact. Durant le processus de négociation d’accords commerciaux majeurs, la Commission procède à des évaluations d’impact sur le développement durable, ce qui permet d’effectuer une analyse plus approfondie des effets économiques, sociaux et environnementaux potentiels des accords commerciaux, y compris sur les PME, les consommateurs, les différents secteurs économiques, les droits de l’homme ainsi que sur les pays en développement. La Commission analyse aussi l’incidence économique des accords après leur conclusion ».
Par conséquent, avant même d’ouvrir des négociations avec un pays, une étude d’impact du futur accord de libre-échange est réalisée, complétée en cours de négociation par une analyse de ses effets potentiels sur le développement durable, allant donc au-delà du seul impact économique.
En outre, une fois les ALE entrés en vigueur, la Commission réalise des évaluations de leur mise en œuvre prenant la forme, le cas échéant, d’un rapport annuel à destination du Conseil et du Parlement européen.
Par conséquent, il est possible de distinguer deux types d’évaluation qui constitueront la summa divisio du présent rapport : les évaluations ex-ante, effectuées avant l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange, et les évaluations ex-post, réalisées une fois celui-ci en vigueur.
Toutefois, si ce travail d’évaluation est, en lui-même, une bonne chose compte tenu de la portée qu’ont désormais les ALE de « nouvelle génération », à la fois pour les pays concernés et l’Union européenne elle-même, il soulève de nombreuses questions auxquelles le présent rapport se donne l’ambition de répondre. Celles-ci sont au nombre de quatre :
– qui réalise ces évaluations et dans quelles conditions ? Les études d’impact ex-ante s’appuient, contrairement aux études ex-post, sur des analyses commandées par la Commission européenne à des consultants indépendants recrutés sur appel d’offres. Toutefois, celle-ci contrôle étroitement leur action, au point qu’on peut se demander quelle est réellement leur marge de manœuvre. Par ailleurs, le Conseil et le Parlement, qui sont les premiers destinataires de ces études, n’ont pas toujours accordé à celles-ci toute l’attention nécessaire, même s’ils s’impliquent désormais plus dans la définition et le contrôle de la politique commerciale de l’Union, en particulier le Parlement européen ;
– comment sont-elles réalisées ? Ces études reposent toutes, s’agissant en particulier de celles réalisées avant l’entrée en vigueur de l’ALE, sur la modélisation économique et, notamment, sur l’utilisation de modèles d’équilibre général calculable (EGC). Or, ces modèles, malgré leur utilité, présentent de nombreuses faiblesses théoriques et pratiques qui rendent incertains les résultats auxquels ils parviennent ;
– quels sont les résultats de ces évaluations ? Incertains donc s’agissant des évaluations ex-ante, ils sont par ailleurs toujours positifs pour l’économie européenne ; quant aux évaluations ex-post, elles montrent également toutes les bénéfices que cette dernière retire des ALE. Une telle unanimité interpelle et doit conduire, en lien avec l’analyse des modèles utilisés, à évaluer dans quelle mesure ces résultats sont pertinents ;
– quelle est l’influence de ces évaluations sur la politique commerciale de l’Union européenne ? Les études ex-ante sont utilisées par le Conseil pour déterminer si des négociations doivent être ouvertes et par le Parlement européen si l’ALE en résultant doit être approuvé. Toutefois, il est possible que d’autres éléments soient pris en compte que les seuls résultats des études. De même, on doit s’interroger sur les suites données à l’évaluation ex-post des ALE, en particulier s’agissant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits humains, sociaux et environnementaux.
Répondre à ces quatre questions a nécessité d’analyser de manière approfondie les accords de libre-échange de l’Union européenne, toutes les études, ex-ante et ex-post auxquels ils ont donné lieu et se déplacer afin de constater, sur place, l’impact de ces ALE, en particulier dans les domaines sociaux et environnementaux. Le nombre considérable de ceux-ci a amené vos rapporteurs à faire le choix de se concentrer sur les seuls ALE de « nouvelle génération », qu’ils soient d’ores et déjà en vigueur, seulement conclus ou en cours de négociation. Outre l’ALE avec la Corée du sud (2010), l’Amérique centrale (2013) et la Colombie et le Pérou (2012), feront également l’objet d’une analyse approfondie les négociations conclues avec le Canada et celle en cours avec les États-Unis. Toutefois, l’exemple d’autres ALE que ceux précités pourra être utilisé en cas de besoin, en particulier l’ALE UE-Chili (2002).
Le premier axe d’analyse du présent rapport porte sur l’évaluation ex-ante des accords de libre-échange de l’Union européenne. Dans sa communication précitée, la Commission européenne a indiqué que, désormais, avant leur entrée en vigueur, les accords de libre-échange feront tous l’objet de deux évaluations successives, lesquelles s’ajoutent à l’évaluation ex-post qui sera l’objet de la deuxième partie du présent rapport :
– une étude d’impact initiale (en anglais : « impact assessment » – IA), préalable à l’ouverture des négociations qui, comme son nom l’indique, a pour objet d’analyser la pertinence d’ouvrir des négociations commerciales avec le pays concerné ;
– une étude d’impact sur le développement durable (en anglais : « sustainability impact analysis » – SIA) de l’accord commercial envisagé, réalisée après l’ouverture des négociations mais avant la conclusion de celles-ci ;
À ces deux études successives, il est possible d’ajouter, même si elle n’est pas systématique, une étude d’impact post-négociations, une fois les négociations achevées. Toutes ces études sont publiques et transmises au Conseil et au Parlement européen.
Toutefois, la Commission n’est pas seule à évaluer les accords de libre-échange. Non seulement elle s’appuie sur l’expertise de consultants indépendants pour sa propre évaluation mais le Conseil et le Parlement européen participent également à cette entreprise d’évaluation, à des degrés divers. Toutefois, si le premier se repose largement sur la Commission et les États membres, le deuxième a développé depuis quelques années une capacité autonome d’évaluation qu’il met au service d’un contrôle accru de la politique commerciale commune (A).
Cependant, quel que soit l’auteur des évaluations, il n’en reste pas moins qu’elles reposent toutes sur une méthodologie faisant appel à la modélisation économique qui, en tant que telle et pour utile qu’elle soit, pose de nombreux problèmes à la fois dans l’obtention des résultats que dans l’utilisation qui en est faite, conduisant à certaines contradictions entre les études préalables, celles-ci étant sensibles aux hypothèses choisies (B).
Enfin, vos rapporteurs s’intéresseront spécialement à l’AECG, dont la signature est imminente, et au Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI). Toujours en cours de négociation, ce dernier a fait l’objet d’études d’impact de la Commission, du Parlement, de nombreux États membres et de plus encore d’études universitaires, en Europe et aux États-Unis. Plus qu’un autre, il montre la difficulté de parvenir à des résultats homogènes sur l’impact potentiel d’un ALE (C).
A. UNE ÉVALUATION QUI, MALGRÉ L’INFLUENCE CROISSANTE DU PARLEMENT EUROPÉEN, EST LARGEMENT DANS LA MAIN DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Les articles 207 et 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) répartissent strictement les compétences entre les trois institutions européennes. Le Conseil autorise, sur la base de recommandations de la Commission, l’ouverture de négociations commerciales que celle-ci mène seule dans le cadre défini par le mandat du Conseil tout en informant ce dernier via un comité spécial. Le Parlement européen est quant à lui informé des négociations mais n’intervient qu’à la fin, pour approuver l’accord une fois les négociations conclues. Avant cette approbation, le Conseil autorise la signature et la conclusion de l’accord.
Toutefois, en matière d’évaluation, les choses ne sont pas si simples. En effet, la Commission s’appuie largement, pour réaliser ses évaluations, y compris l’étude d’impact initiale, sur des consultants indépendants dont elle encadre strictement la méthodologie (1). Destinataire de ces évaluations, le Conseil n’en fait pas de réelles contre-expertises, ni avant l’ouverture des négociations, ni avant la signature et la conclusion de l’accord concerné, renvoyant le travail d’évaluation aux États membres qui, logiquement, n’évaluent l’impact de ce dernier que pour leur seul pays. En revanche, le Parlement européen, loin d’être un simple spectateur des négociations, veut désormais peser sur celles-ci et, à cette fin, a récemment développé sa propre capacité d’évaluation des ALE (2). Par conséquent, sous réserve des évolutions en cours au Parlement européen dont l’avenir dira leur portée, les seules évaluations qui, aujourd’hui, ont une réelle influence sur la politique commerciale commune sont celles de la Commission européenne (3).
1. Le rôle primordial de la Commission européenne dans l’évaluation ex-ante des ALE s’appuie sur l’expertise de consultants indépendants
À partir des années 2000 et compte tenu du nombre croissant d’initiatives européennes importantes dans des domaines toujours plus variés, le besoin s’est fait sentir que la présentation de celles-ci s’accompagne d’une étude d’impact. Comme l’indique la Commission européenne dans sa communication du
5 juin 2002, ces études d’impact sont « un instrument pour améliorer la qualité et la cohérence du processus d’élaboration des politiques publiques. Elles contribuent à rendre l’environnement réglementaire plus efficace et, au-delà, à une mise en œuvre plus cohérente de la stratégie pour le développement durable ». Toutefois, « une étude d’impact n’est pas un substitut à la décision politique. [En] identifiant les impacts positifs et négatifs des différentes options, elle apporte une contribution aux décideurs publics sur les conséquences des choix qui s’offrent à eux ».
Depuis cette Communication, complétée en 2005 par un accord interinstitutionnel sur l’approche commune en matière d’étude d’impact, la Commission européenne a structuré sa capacité d’évaluation en créant en son sein, en 2007, un Comité d’évaluation (« impact assessment board » – IAB) dont les membres sont nommés par le Secrétaire général de la Commission après approbation du Président de cette dernière. Les règles en matière d’étude d’impact ont été fixées par des lignes directrices dont les dernières (en cours de réactualisation), datent de 2009.
En pratique, la procédure aboutissant à la publication de l’étude d’impact peut être schématisée comme suit :
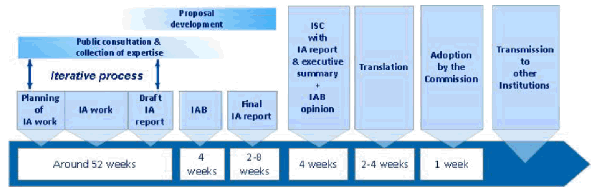
Plus précisément, une fois la décision prise en interne, de préparer une initiative, un comité de pilotage de l’étude d’impact ad hoc (« Impact assessment steering group » - IASG) est créé associant la Direction générale leader et l’ensemble des services concernés de la Commission (1). Ce comité consulte les parties prenantes, rassemble les données pertinentes et les analyse en vue de produire un projet d’étude d’impact qui est transmis à l’IAB.
Ce projet, comme les études d’impact elles-mêmes une fois publiées, s’inscrit dans un cadre normalisé comprenant sept sections :
– section 1 : les rappels de procédure et les résultats de la consultation des parties prenantes ;
– section 2 : le contexte politique, la définition du problème et la prise en compte de la subsidiarité ;
– section 3 : les objectifs ;
– section 4 : les différentes options possibles ;
– section 5 : l’analyse des différents impacts ;
– section 6 : la comparaison des différentes options ;
– section 7 : le contrôle et l’évaluation.
Le Comité d’évaluation contrôle la qualité de ce projet. Il donne un avis qui peut être positif ou négatif. Dans ce dernier cas, le projet est renvoyé au Comité de pilotage qui devra l’améliorer avant de le soumettre à nouveau. Une fois celui-ci validé par l’IAB, le projet est soumis à une consultation interservices parallèlement à l’initiative sur laquelle porte l’étude d’impact, à supposer naturellement que le Commissaire compétent, s’appuyant sur le projet d’IA, estime toujours qu’une action de l’UE est nécessaire. Après avoir intégré les remarques de l’ensemble des services, le projet d’IA est transmis au Collège des commissaires accompagné de l’avis de l’IAB et de l’initiative.
Ces règles, fixées par les lignes directrices, sont applicables à l’ensemble des études d’impact produites par la Commission. Elles diffèrent légèrement s’agissant des accords de libre-échange compte tenu de la nature particulière de ceux-ci. En effet, l’IA d’un ALE ne porte pas sur un texte, comme c’est le cas pour un projet de règlement ou de directive, mais sur un accord international dont le contenu n’est, par définition, pas connu. L’analyse des « impacts probables en termes économique, social et environnemental » de ce dernier repose donc sur des instruments, parmi lesquels la modélisation économique, qui sont spécifiques à la politique commerciale commune. N’ayant pas forcément de compétence dans ce domaine hautement technique, la Commission s’appuie donc sur des études économiques qu’elle commande à des consultants spécialisés. Enfin, la décision prise par la Commission sur la base de cette IA est une recommandation au Conseil d’ouvrir les négociations commerciales avec le pays concerné, accompagné d’un projet de mandat de négociation, et rien de plus.
Une fois cette étude d’impact réalisée et publiée, et dans les six mois suivant la décision du Conseil d’ouvrir des négociations (à supposer qu’elle ait été prise), une deuxième étude d’impact est lancée, réalisée cette fois-ci par des consultants indépendants, appelée « étude d’impact sur le développement durable » (« sustainability impact assessment « – SIA). Cette étude est spécifique aux accords de libre-échange qui, par leurs multiples dimensions et leur sensibilité dans l’opinion, exigent à la fois une évaluation approfondie, « participative » et, surtout, en plusieurs étapes afin de tenir compte de l’avancée des négociations.
Les SIA sont encadrées par un document spécifique établi par la Commission : un manuel (ou « handbook ») publiée en 2006 et révisé en 2016 qui fixe avec une très grande précision l’ensemble des règles que les consultants doivent suivre dans la réalisation de leur étude. Cette étude n’est toutefois pas sans lien avec l’étude d’impact. En effet, aux termes du « handbook », l’IA doit « mettre en lumière les aspects sur lesquels les consultants indépendants devront concentrer leurs recherches », sachant qu’ils devront, en outre, « tenir compte des résultats de l’étude d’impact et élargir la consultation des experts et des parties prenantes ». Contrairement à la première étude, qui vise à répondre à la question de savoir si un ALE est pertinent, cette nouvelle évaluation pose la question du comment.
Pour répondre à cette question, la SIA exige généralement un an (voire plus) de travail divisé en trois étapes successives :
– la première est un rapport initial (« inception report »). Il décrit l’approche méthodologique retenue par le consultant et identifie les éléments en cours de négociation susceptibles d’avoir un impact ainsi que les secteurs économiques devant faire l’objet d’une analyse détaillée ;
– le deuxième est un rapport préliminaire (« preliminary report »). Il met en œuvre la méthodologie décrite dans le rapport initial et présente une analyse approfondie de l’impact économique, social et environnemental, ainsi qu’en termes de droits humains, de l’accord en cours de négociation ;
– enfin, dans le rapport final, le consultant affine l’analyse générale et sectorielle de l’impact de l’accord de libre-échange envisagé en tenant compte des contributions auxquelles le rapport préliminaire a donné lieu.
Le « handbook » détaille très précisément la méthodologie que doit suivre le consultant. Celui-ci doit commencer son travail par une vérification préliminaire (« screening ») et une délimitation du champ (« scoping »). Le premier a pour objectif d’identifier quelles sont les mesures en discussion qui sont susceptibles d’avoir un impact, positif ou négatif, pour l’Union européenne et le ou les pays concernés et, ainsi, de sélectionner les questions clés en matière de développement durable qui devront être évaluées plus en détails. Quant au deuxième, il vise à identifier quels composants des mesures commerciales, identifié et ciblées pendant le « screening », sont susceptibles d’être les principaux moteurs de l’impact prévu. Les deux doivent permettre d’identifier les secteurs qui feront ultérieurement l’objet d’une analyse détaillée.
Une fois ce travail effectué, une analyse approfondie est réalisée pour produire une estimation des impacts les plus significatifs de l’accord sur le développement durable. La SIA analyse d’abord les impacts économiques probables de l’accord en cours de négociation sur l’Union européenne et le ou les pays concernés, à la fois de manière agrégée et désagrégée par secteur ainsi que sur les pays tiers, notamment les pays en voie de développement. Cette analyse repose sur la modélisation économique de l’impact de l’ALE envisagé sur la production, les flux commerciaux, les prix, les ressources fiscales, les revenus et le bien-être. Une attention particulière est portée aux impacts qui pourraient être disproportionnés, ou ceux qui affectent particulièrement certains groupes, à commencer par les PME. Toutefois, comme le contenu est encore en discussion, le consultant utilise plusieurs scénarios de l’issue des négociations afin d’en modéliser l’impact.
L’analyse économique est complétée par une analyse des impacts sociaux et environnementaux de l’ALE en discussion. Elle identifie ainsi les groupes d’individus ou d’acteurs économiques susceptibles d’être affectés. Une attention particulière doit être portée à l’impact sur l’emploi (création globale ou perte d’emploi, création ou perte dans un secteur, profession ou niveau de qualification), sur les conditions de travail (salaire, santé et sécurité, dialogue social) et sur la répartition des revenus, l’égalité et la pauvreté, sans oublier l’impact sur certains groupes sociaux (femme, enfant, minorités, travailleurs non qualifiés…). S’agissant de l’impact environnemental, la SIA analyse plus particulièrement l’impact sur le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l’eau et les déchets. Le consultant doit également identifier comment l’accord pourrait contribuer à « verdir » l’économie, améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir une consommation et une production durable.
Enfin, la principale nouveauté du « handbook » révisé en 2016 est l’élargissement de la SIA aux droits humains. Certes, ainsi qu’il sera indiqué infra, c’était déjà le cas dans le fait, au moins depuis 2012, mais désormais, le consultant dispose de lignes directrices claires sur la méthodologie précise pour mener à bien cette évaluation.
Du point de vue procédural, si le consultant est indépendant, recruté par appel d’offres de la Commission (voir infra), il n’en reste pas moins que cette dernière, selon les termes du « handbook », établit un « processus interne de consultation afin de guider le consultant dans sa tâche. Un comité de pilotage impliquant les représentants des différents services de la Commission et les négociateurs permet d’assurer la pertinence de la procédure d’évaluation ». En outre, la SIA ne représente pas la position officielle de la Commission européenne quant à l’impact de l’ALE envisagé et ne l’engage pas. C’est ainsi, par exemple, que la SIA réalisée pour l’ALE avec la Communauté andine indique expressément que « les opinions exprimées sont ceux du consultant et ne représente pas la position officielle de la Commission ». Celle-ci, qui prend la forme d’un exposé de position (« position paper ») peut parfaitement s’en écarter sur un ou plusieurs points.
Ainsi qu’il a été dit, la caractéristique des ALE par rapport aux autres initiatives de la Commission est que leur processus d’élaboration s’inscrit dans une durée longue atteignant systématiquement plusieurs années. Par exemple, les négociations de l’AECG avec le Canada se sont ouvertes en mai 2009 et se sont poursuivies jusqu’en septembre 2014. Mais elles peuvent être bien plus longues : les négociations pour la conclusion d’un accord avec le MERCOSUR ont ainsi été initialement lancées en 1999, relancées en 2010 et elles sont toujours en cours. Dans ces conditions, non seulement le contexte politique, économique, social peut évoluer mais le contenu même de l’ALE n’est connu qu’une fois les négociations conclues. Tant que celles-ci sont en cours, l’étude d’impact repose sur une modélisation qui, elle-même, s’appuie sur des scénarios qui peuvent toujours être infirmés.
Pour l’ensemble de ces raisons, une dernière étude d’impact est parfois réalisée une fois les négociations terminées afin d’évaluer, cette fois-ci, l’impact dispositions réelles de l’accord de libre-échange.
Comme le dit l’étude post-négociation de l’accord de libre-échange avec la Corée du sud (2010), « cette étude présente une évaluation quantitative actualisée et élargie pour les biens, les services et les investissements. Elle complète également l’étude d’impact sur le développement durable lancée en octobre 2007 et achevée en octobre 2008 ». Cette étude est généralement plus courte que la SIA et sert principalement à éclairer le Conseil et le Parlement européen dans leurs décisions concernant l’approbation de l’accord.
Au terme de cette présentation de l’évaluation ex-ante, par la Commission, des accords de libre-échange, force est de constater que, avec deux voire trois études d’impact successives, celle-ci va très au-delà de ce qu’imposent les lignes directrices en la matière. Elle peut même, parfois être complétée par une quatrième étude d’impact. Ce fut le cas, par exemple, pour l’ALE avec la Corée du sud. L’étude d’impact initiale a en effet été complétée par une nouvelle étude, réalisée en 2007 par un consultant sur demande de la Commission, afin, selon ses propres termes, de « servir de base aux négociations ». Toutefois, n’ayant pas été endossée par la Commission, elle s’analyse plus comme un document de travail que comme une véritable étude d’impact.
b. Des évaluations qui s’appuient sur l’expertise de consultants indépendants et dont les résultats sont rendus publics
L’évaluation des ALE présente, comme on l’a dit, cette particularité que l’objet de l’évaluation n’est pas encore connu lorsque celle-ci est réalisée. Par conséquent, pour mesurer les impacts, notamment économiques, d’un ALE en cours de négociation, il est nécessaire de recourir à la modélisation à partir d’hypothèses plus ou moins certaines. Or, la Commission européenne n’a pas forcément les ressources nécessaires pour réaliser en interne une telle modélisation. Certes, c’est bien elle qui réalise et endosse les études d’impact mais elle s’appuie, pour ce faire, sur l’expertise technique de consultants indépendants. Outre cette nécessité technique, le recours à des consultants indépendants présente un autre avantage pour la Commission. Considérant le caractère parfois sensible des ALE – par exemple le PTCI – et la suspicion qui peut normalement peser sur l’impartialité de son évaluation, un tel recours permet à la Commission de légitimer ses études d’impact en les appuyant sur les constatations d’un tiers extérieur aux institutions européennes.
Vos rapporteurs ont toutefois noté une seule exception à cette pratique. En effet, l’étude d’impact initiale de l’AECG avec le Canada, dont les négociations ont été lancées en mai 2009, repose sur une étude réalisée conjointement par la Commission européenne et le gouvernement du Canada. En revanche, la SIA a bien été réalisée, comme il est d’usage, par un consultant indépendant. Interrogée sur cette particularité, la DG Trade n’a pas fourni d’explication à cette particularité de la procédure d’évaluation ex-ante de l’ALE avec le Canada.
Hors cette exception, la Commission recourt à des consultants indépendants qu’elle sélectionne aux termes d’un appel d’offres. Vos rapporteurs ont consulté, à titre d’exemple, l’appel d’offres publié en 2012 par la Commission pour la réalisation de la SIA pour l’accord de libre-échange euro-méditerranéen. Outre la définition d’un budget maximal (600 000 € en l’espèce), l’appel d’offres précise les catégories de critères qui seront utilisées ainsi que leur pondération. Celles-ci sont au nombre de deux : des critères techniques et de capacité professionnelle et une capacité financière et économique. Par ce dernier critère, la Commission veut s’assurer de la solidité financière du consultant et de sa capacité à mener à bien sa mission. Cette procédure de sélection est, selon la Commission, de nature à la faire bénéficier de la meilleure expertise disponible sur le marché au meilleur prix.
Il convient de souligner que l’appel d’offres ne vaut que pour une seule étude et qu’il est organisé autant d’appel d’offres qu’il y a d’études à réaliser, bien qu’il est fréquent que les différentes études d’impact soient effectuées par un consultant différent selon des méthodes différentes, en particulier s’agissant de la modélisation. C’est le cas pour deux accords de libre-échange de « nouvelle génération » actuellement en vigueur, avec la Colombie et le Pérou, d’une part, et la Corée du sud, d’autre part. Cette situation, inévitable, n’est pas sans conséquence sur la pertinence des études d’impact elles-mêmes, ainsi qu’il sera analysé infra.
Le recours à des experts extérieurs pour évaluer l’opportunité d’ouvrir des négociations commerciales se justifie, ainsi qu’il a été dit, par l’impartialité supposée que comporte leur analyse, laquelle est de nature à renforcer la légitimité de l’étude d’impact de la Commission. Toutefois, sans forcément remettre en cause la déontologie des cabinets concernés, l’indépendance de l’analyse comporte nécessairement des limites. Vos rapporteurs en distinguent deux qu’ils vont successivement présenter.
Le monde de l’évaluation des accords de libre-échange est petit et entretient des liens étroits avec les institutions européennes. Le recours à un appel d’offres semble signifier que la compétition est donc ouverte. Pourtant, l’analyse de l’ensemble des études d’impact préalables révèle qu’un petit nombre de cabinets se partagent le « marché » de l’évaluation des accords de libre-échange de l’Union européenne. Or, comme l’indique le consultant ECORYS sur son site Internet, « le marché des institutions européennes est d’une importance majeure et croissante pour Ecorys compte tenu du fait que les marchés privés et nationaux rencontrent des difficultés ». Par ailleurs, « depuis 20 ans, Ecorys a travaillé intensément pour les institutions européennes et en particulier, la Commission ». Dans ces conditions, sachant qu’ECORYS est très fréquemment utilisé par la Commission pour les études d’impact mais également pour d’autres missions pour d’autres directions générales et agences que la DG Trade, on peut s’interroger sur la dépendance qui pourrait se créer entre ce cabinet et ce qui apparaît être l’un de ses meilleurs – sinon son meilleur client.
La deuxième limite porte sur la marge de manœuvre des consultants par rapport à la Commission européenne. En effet, bien qu’ils soient tenus de mener leurs travaux de manière indépendante, celle-ci non seulement les encadre mais les suit de très près. En effet, les lignes directrices s’imposent au consultant pour l’étude qu’il réalise pour l’étude d’impact initiale, de même que celles du « handbook » pour la SIA. S’agissant de cette dernière, « même si l’étude d’impact sur le développement durable est une étude indépendante, les services de la Commission doivent néanmoins être régulièrement informés des progrès de l’étude et fournir l’ensemble des informations et des règles nécessaires à la conduite de l’étude », notamment via le comité de pilotage. L’information se fait donc à double sens : d’un côté, les consultants doivent transmettre régulièrement leurs analyses aux négociateurs, lesquels ne peuvent attendre la publication des rapports et de l’autre, ils reçoivent de leur part des informations confidentielles sur les négociations leur permettant d’orienter leur travail.
Il n’est ni surprenant ni scandaleux que la Commission entretienne des contacts réguliers avec les consultants, ni qu’elle encadre leur action. Ces faits ne prouvent rien d’autre que l’intérêt qu’elle porte à leurs travaux ainsi que son souci de les voir réaliser de manière cohérente et pertinente. Toutefois, vos rapporteurs s’interrogent sur certaines dispositions figurant, par exemple, dans l’appel d’offres précité. Il est ainsi fait obligation au consultant de construire son analyse sur « un scénario ambitieux impliquant une libéralisation totale du commerce des biens, une progressive et réciproque libéralisation du commerce des services, la réduction du coût des barrières non tarifaires et des hypothèses ambitieuses de libéralisation dans les autres domaines de négociation ». Or, il va de soi qu’un tel scénario ne peut que maximiser le gain que l’Union européenne retirerait de la conclusion d’un accord de libre-échange avec le ou les pays concernés.
Renforcer la légitimité des négociations commerciales exige, outre une analyse indépendante de leurs impacts potentiels, une large consultation de l’ensemble des parties prenantes. C’est l’une des caractéristiques de l’évaluation préalable des accords de libre-échange d’être « participative », en particulier s’agissant de la SIA.
En effet, selon le « handbook », la SIA est « hautement participative : un processus de consultation ouvert, transparent et large est essentiel à l’analyse » dont il assure « la transparence, la qualité, la crédibilité et la légitimité ». L’ensemble des parties prenantes doit ainsi pouvoir s’exprimer le plus rapidement possible. C’est pourquoi, dès le rapport initial, le consultant établit un projet de consultations incluant, après les avoir identifiées, toutes les parties prenantes concernées, c’est-à-dire les ONG, les entreprises, partenaires sociaux, les universitaires ou encore les administrations. Ce projet de consultations est présenté et discuté lors des réunions avec l’Unité « dialogue avec la société civile » de la DG Trade ainsi qu’avec le comité de pilotage (voir supra).
Les parties prenantes sont associées à l’étude d’impact sur le développement durable via des questionnaires mais également des réunions. Surtout, elles peuvent réagir à chaque étape de l’étude puisque les rapports initial, préliminaire et final sont publiés sur un site web dédié, créé au plus tard à la date de la publication du projet de rapport initial et actif jusqu’à deux ans après l’approbation du rapport final. S’agissant du rapport initial, les parties prenantes ont ainsi la possibilité de critiquer la méthode retenue par le consultant et mettre l’accent sur certains impacts ou secteurs qui auraient été oubliés. De même peuvent-elles laisser des contributions pour le rapport préliminaire et le rapport final. Ce dernier doit mettre en évidence toutes les contributions pertinentes des parties prenantes.
De même, l’étude d’impact initiale, même si elle est faite en interne par la Commission européenne, inclut la consultation des parties prenantes, comme le rappellent les lignes directrices. À titre d’exemple, l’étude d’impact initiale de l’ALE avec le Japon (2012) rappelle qu’une consultation publique en ligne a été organisée en septembre 2010 pour laquelle 87 contributions ont été reçues de la part d’ONG, de syndicats, d’universités, d’instituts de recherche, d’entreprises privées, de fédérations professionnelles et de ministères nationaux. En parallèle de cette consultation publique, la DG Trade a organisé deux réunions à Bruxelles avec la société civile afin de lui présenter son point de vue et de recueillir le sien. Enfin, elle a également envoyé des représentants à de nombreux séminaires et conférences.
En revanche, lorsqu’elle est réalisée, l’étude post-négociation, qui n’a pour but que d’actualiser les études d’impact antérieures compte tenu du résultat des négociations, n’inclut pas une telle participation des parties prenantes.
iii. La Commission s’appuie largement sur les constats des consultants mais n’en tire pas forcément les mêmes conclusions
Vos rapporteurs ont analysé les études d’impact des principaux ALE négociés ou en cours de négociation par l’Union européenne depuis 2009 et l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne : Corée du sud, Amérique centrale, Colombie/Pérou, Canada, Vietnam, Japon et États-Unis. Ils ont notamment recherché si et dans quelle mesure la Commission européenne, dans l’étude d’impact qu’elle publie, s’écarte des constats faits par les consultants.
Ce dernier point est relativement aisé à vérifier, en particulier pour les SIA, puisque la Commission, une fois celles-ci rendues publiques, publie un exposé de position (« position paper ») présentant sa position officielle sur la SIA et endossant – ou non – ses constats, conclusions et recommandations. Or, cet exposé intègre un résumé des impacts économiques, sociaux et environnementaux identifiés par le consultant, lesquels sont présentés de manière objective par la Commission, sans que soient passés sous silence les risques et dommages possibles de l’ALE envisagé.
C’est le cas en particulier dans l’exposé de position sur la SIA de l’ALE avec la Colombie et le Pérou. Le consultant insiste longuement sur l’impact social et environnemental défavorable de la hausse de la production agricole comme de la hausse des investissements dans le secteur minier. Or, ces analyses sont présentées telles quelles dans l’ « exposé de position ». La Commission note ainsi que, « dans le secteur de l’éthanol et de l’huile de palme, la SIA estime que l’augmentation de la production pourrait avoir un impact social négatif compte tenu du risque de déplacement de population ». De plus et d’une manière générale, « la croissance anticipée du secteur agricole pourrait accroître la pression sur les ressources en eau et en terre [tandis que] l’extraction minière comporte un risque d’entraîner une importance source de pollution. Dans les deux cas, il en résulterait « des impacts en terme de réduction de la biodiversité et de déforestation ».
Toutefois, la Commission peut, dans ce même « exposé de position », apporter des bémols à l’analyse du consultant sur certains points précis, voire les contredire. Par exemple, alors que le consultant point les risques de l’augmentation de la production d’éthanol et d’huile de palme pour la destination des sols et la biodiversité, la Commission rappelle que les importations de ces deux produits bénéficient d’ores et déjà d’une exemption de droits de douane en application du système des préférences généralisées (SPG). Par conséquent, « l’impact environnemental de l’accord de libre-échange dans ce domaine ne sera probablement pas significatif ».
De même, la SIA estime que l’accord privera, par principe, la Colombie
et le Pérou de l’essentiel des ressources qu’ils tirent des droits de douane, entraînant une potentielle baisse de leurs dépenses sociales. Sans nier cet effet, la Commission estime en revanche que « cet effet de court terme de baisse des revenus devrait être compensé par l’impact positif sur les finances publiques de l’augmentation de la production locale, du commerce et de la meilleure allocation des ressources ».
Par conséquent, la Commission s’appuie réellement sur les constats de la SIA pour établir son étude d’impact, même lorsque ceux-ci ne sont pas forcément positifs mais sans s’interdire, lorsqu’elle l’estime justifié, de nuancer voire contredire certains de ses constats.
Toutefois, même si elle fait une présentation objective des constats des consultants et ne les conteste pas sur d’autres points que des points de détail, la Commission en tire des conclusions qui ne sont pas forcément évidentes à la lecture de ces études. En effet, toutes les études d’impact de la Commission
se concluent par un soutien à la signature d’un accord de libre-échange avec le
ou les pays concernés. Pourtant, dans l’étude d’impact initiale sur le PTCI (2013), la Commission, s’appuyant sur l’étude économique du consultant CEPR, estime à 0,48 % l’accroissement du PIB de l’Union découlant de la négociation d’un accord de libre-échange ambitieux avec les États. Modestes, ces gains sont cependant très supérieurs à ceux attendus de deux ALE aujourd’hui en vigueur :
– dans la SIA de l’ALE avec la Communauté andine, le consultant relève qu’ « il n’y a aucune modification pour le PIB de l’UE27 et l’impact sur les flux commerciaux est négligeable » ;
– de même, dans la SIA de l’ALE avec la Corée du sud, le consultant estime à 0,01 % l’accroissement du PIB de l’UE25 en cas de signature d’un ALE ambitieux, soulignant, avec un certain sens de la litote, que ces résultats « montrent clairement que l’impact d’un accord de libre-échange ambitieux est limité s’agissant du PIB » ;
– enfin, dans la SIA de l’ALE avec l’ASEAN, l’impact sur le PIB de l’UE d’un tel accord est limité à 0,23 % à long terme dans le cas du scénario le plus ambitieux.
L’impact économique modeste, voire nul, de ces trois ALE par les consultants, de même que les impacts sociaux et environnementaux potentiellement négatifs, n’ont donc pas empêché la Commission européenne de soutenir la conclusion d’un accord avec le ou les pays concernés. Il est vrai que la Commission, comme le Conseil ou le Parlement, peuvent poursuivre des objectifs stratégiques et/ou politiques qui ne sont pas forcément évalués par le consultant. Vos rapporteurs reviendront sur ce point lorsqu’ils analyseront plus précisément la portée de ces études d’impact et les déterminants de la décision en matière de politique commerciale (voir infra).
Le consultant n’hésite enfin pas à prendre position, comme le lui demande d’ailleurs le « Handbook ». Ainsi, dans la SIA de l’ALE UE Corée du sud, on peut lire : « le statu quo ou un accord de libre-échange limité n’est pas une option pour l’Union européenne. […] Un accord de libre-échange ambitieux visant à éliminer non seulement les barrières tarifaires mais également les barrières non tarifaires, portant également sur l’investissement et la libéralisation des services, est la seule option susceptible de maximiser les bénéfices économiques pour l’Union européenne ». Plus précisément, le consultant donne des conseils aux négociateurs : « les négociateurs devraient insister pour que la Corée du sud reconnaisse les normes et les règlements techniques internationaux ou européens » Il va encore plus loin dans les termes suivants : « pour que l’accord de libre-échange ait un plein effet sur le commerce bilatéral, il fait se focaliser sur les barrières non-tarifaires ». S’agissant de l’investissement, « l’ALE devrait accorder à chaque partie le traitement national avec une définition précise de ce qu’est un investisseur », tout en insistant sur les aspects des droits propriété intellectuelle, lesquels impactent fortement l’investissement. C’est pourquoi le consultant recommande que « l’accord couvre la propriété intellectuelle, les marques, les indications géographiques, les brevets et les dessins et modèles ».
En conclusion, force est de constater que le travail d’évaluation ex-ante des accords de libre-échange par la Commission européenne, s’appuyant sur de consultants indépendants, malgré certaines réserves et limites qui seront détaillées infra, est à la fois transparent et très approfondi.
2. Si le Conseil s’appuie sur les seules études d’impact de la Commission, le rôle du Parlement européen s’est accru avec le développement d’une capacité autonome d’évaluation
Le rôle du Conseil et du Parlement européen en matière de politique commerciale est substantiellement différent de celui de la Commission. Il appartient en effet au premier d’autoriser l’ouverture des négociations, sur la base de recommandations de la Commission accompagnées de l’étude d’impact initiale, puis la conclusion et la signature de l’accord, éclairée le cas échéant par l’étude d’impact post-négociation. En d’autres termes, le Conseil s’appuie, pour les décisions qu’il a à prendre, sur les études d’impact de la Commission. En revanche, le Parlement européen, qui approuve l’ALE une fois celui-ci négocié, a développé une réelle capacité d’évaluation.
a. Contrairement aux États membres, le Conseil, en tant qu’institution, fait sienne l’évaluation de la Commission européenne
i. Le Conseil ne fait pas de contre-expertise des études d’impact produites par la Commission européenne
Ainsi qu’il a été rappelé supra, l’article 207 du TFUE se borne à stipuler que la Commission propose au Conseil d’ouvrir des négociations mais ne dit rien de plus. Toutefois, le « handbook » apporte des précisions sur les rapports entre ces deux institutions et sur la prise de décision en matière d’ouverture des négociations commerciales : « la Commission réalise une étude d’impact et propose un mandat de négociation au Conseil. Ce dernier prend sa décision sur la base de ces deux documents ».
Par conséquent, le Conseil se base sur l’étude d’impact initiale de la Commission pour décider ou non d’ouvrir des négociations. Toute la question est de savoir s’il se contente de cette étude d’impact, s’il en fait une contre-expertise ou s’il en réalise d’autres afin d’avoir des points de vue différents pour éclairer sa décision. La même question se pose, dans les mêmes termes, s’agissant de l’étude d’impact sur le développement durable et, surtout, de l’étude post-négociation, préalable à sa décision d’autoriser ou non la signature et la conclusion de l’accord.
Les auditions qu’ils ont menées, tant à Paris qu’à Bruxelles, ont confirmé à vos rapporteurs que la réponse à ces questions est négative. Bien plus, comme l’a noté le Parlement européen dans une étude très récente (2), « les pressions d’au moins un tiers des États membres pour que le secrétariat du Conseil crée une petite unité d’évaluation préalable s’est heurtée à des oppositions ». En effet, certains États membres ne considèrent pas comme opportun de multiplier les organes d’évaluation et préfèrent responsabiliser la Commission. Toutefois, on peut se demander comment cette préférence – qui est louable – peut être mise en œuvre si le Conseil n’est pas en mesure d’évaluer la qualité de ce qu’elle produit.
En outre, aux termes de l’article 207 du TFUE, si les négociations sont exclusivement conduites par la Commission, celle-ci le fait « en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser ». Ce point suscite une autre interrogation : dans quelle mesure le Conseil peut-il adresser des directives pertinentes s’il ne dispose pas d’évaluation de leurs impacts autre que celle de la Commission. Vos rapporteurs s’interrogent donc sur le suivi, par le Conseil, de ces négociations et la capacité des États à bien en appréhender les conséquences.
ii. Les États membres réalisent des études d’impact mais limitent généralement leur analyse aux seuls effets des ALE pour leur pays
Si le Conseil ne produit pas, en tant qu’institution, ses propres études d’impact des accords de libre-échange envisagés ou négociés par la Commission européenne, se basant pour ouvrir, encadrer et clore les négociations sur les seules études fournies par cette dernière, il n’en va pas de même des États membres. L’activisme de ceux-ci individuellement explique peut-être d’ailleurs leur passivité collective au Conseil ce qui, montrerait, s’il en était besoin, le primat des intérêts nationaux sur l’intérêt européen.
En effet, si les études d’impact de la Commission mesurent les effets agrégés d’un ALE au niveau de l’Union européenne, en pratique, ces effets se feront sentir dans les États membres avec une intensité, voire un sens différent. Certes, dans les lignes directrices, il est clairement indiqué qu’un « problème peut avoir une pertinence particulière pour certains États membres, groupes d’États membres (comme les petits États membres, les États membres du sud ou du Nord…) ou région ». En outre, « les options développées pour résoudre le problème peuvent aussi affecter différentes parties de l’Union de manière différente. Il peut donc être utile de présenter les données par catégories d’États membres dans les termes de nouveaux ou anciens, petit ou grand, nord et sud ». Enfin, « les différentes options politiques doivent être évaluées en fonction de leur impact, positif ou négatif, qui est peut-être inégal. Quand un seul État membre ou région est affectée de manière disproportionnée, cela doit être mentionné. Quand de telles disparités apparaissent significatives, elles doivent être analysées dans le sens de justifier une raison d’adapter l’initiative, par exemple pour offrir des atténuations ou des mesures de transition ».
Par conséquent, c’est seulement lorsqu’un problème se pose pour un État membre en particulier ou une région que l’étude d’impact adopte un autre niveau d’analyse que le niveau européen. Pour le reste, elle s’en tient à une évaluation de l’accord du point de vue européen. Ce fait n’est d’ailleurs pas critiquable en lui-même. C’est la Commission européenne, en charge de l’intérêt général européen, qui conduit les négociations et, à ce titre, elle ne doit prendre en compte que l’intérêt européen, pas les différents intérêts nationaux. C’est ainsi que l’étude d’impact initiale du PTCI ne relève aucun problème particulier de cet accord et se borne à mentionner les effets positifs, pour certains États membres, mais sans les évaluer précisément.
Le fait que la Commission n’évalue pas l’impact d’un ALE pour les différents États membres justifie que ceux-ci le fassent, du moins pour les accords les plus importants. Toutefois, par définition, ils n’évaluent pas l’impact de l’ALE sur l’Union européenne ni sur le pays tiers concerné mais uniquement sur leur propre économie. Or, même si ces analyses nationales peuvent être agrégées au sein du Comité de politique commerciale, il n’en reste pas moins qu’en matière économique, la somme des parties n’est pas forcément égale au tout et que l’impact sur l’Union européenne ne se déduit pas de la somme des impacts sur chacun des États membres, sans parler des méthodologies inévitablement différentes qu’ils ont utilisées.
Le PTCI, autant par son ampleur que par la mobilisation médiatique qu’il suscite, a fait l’objet de très nombreuses évaluations au niveau national, réalisées à la demande ou non des gouvernements. C’est ainsi qu’au Royaume-Uni, le Department for Business, Innovation and Skills (BIS) a commandité une étude auprès du même cabinet que la Commission européenne, CEPR, qui a été rendue publique en mars 2013 ; de même le gouvernement du Portugal a-t-il conduit une étude, mais en faisant appel à la chambre de commerce et la fondation latino-américaine pour le développement. En France, c’est le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), qui a été choisi par la Direction générale du Trésor pour conduire l’étude d’impact. De même, afin d’éclairer les choix du gouvernement au Conseil, celle-ci réalise sa propre analyse des études de la Commission européenne en portant un regard critique sur celle-ci, le cas échéant en s’aidant du CEPII dont les rapports avec l’administration du Trésor sont étroits. Ce n’est pas le cas simplement pour le PTCI mais également pour l’ensemble des autres accords.
En conclusion, il apparaît que le Conseil ne réalise pas de contre-expertise des études d’impact de la Commission européenne, pas plus que les États membres. Si ces derniers analysent bien l’impact d’un ALE, cette évaluation se limite aux seuls impacts pour leur pays. Par conséquent, les États membres réunis au sein du Conseil ne disposent, pour se prononcer sur l’ouverture des négociations comme sur leur conclusion, que de la seule étude d’impact de la Commission et, le cas échéant, de leurs évaluations nationales, souvent réalisées par les mêmes consultants que ceux recrutés par la Commission européenne.
Institutionnellement, le rôle du Parlement européen en matière de politique commerciale est relativement limité, comme d’ailleurs pour l’ensemble de la politique extérieure de l’Union. Toutefois, depuis quelques années, il ne se borne plus aux seuls pouvoirs que lui accordent les traités mais cherche à étendre son influence, en particulier dans la conduite des négociations, au point que ses résolutions peuvent apparaître comme des mandats de négociation « bis ». Cette volonté d’influence est allée de pair autant qu’elle s’est appuyée sur le développement d’une capacité autonome d’évaluation des accords de libre-échange de l’Union européenne.
Même si le traité de Lisbonne a renforcé les pouvoirs du Parlement européen en matière de politique extérieure, incluant la politique commerciale (3), celui-ci n’a, institutionnellement, aucune influence sur la décision d’ouverture des négociations, pas plus que sur la conduite de celles-ci. Ainsi qu’il a été dit, il appartient au seul Conseil d’autoriser la Commission, sur la base d’un mandat de négociation qu’il adopte, à les ouvrir avec le pays concerné. Les négociations sont conduites exclusivement par la Commission européenne, « en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser » (article 207 §3). Toutefois, aux termes de ce même article, « la Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen sur l'état d'avancement des négociations », c’est-à-dire, en principe, sous la forme d’audition du Commissaire chargé du commerce. En d’autres termes, le seul droit que le Parlement européen tire du Traité, lorsque les négociations sont en cours, est d’être informé de celles-ci. Il ne peut ni influencer leur contenu, pas plus qu’il n’autorise leur ouverture ou ne peut les arrêter.
En revanche, une fois les négociations conclues, le Parlement européen retrouve la plénitude de son pouvoir en approuvant – ou non – l’accord de libre-échange. Ce pouvoir n’est pas resté lettre morte. En effet, le 4 juillet 2012, le Parlement européen n’a pas hésité à rejeter l’accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) (4), entraînant son abandon définitif par l’ensemble des autres États signataires.
Le rôle du Parlement européen suit donc une chronologie inverse de celle de la Commission. Alors que celle-ci, une fois les négociations terminées, n’a plus aucune influence (autre qu’officieuse), c’est à ce moment que le Conseil et, surtout, le Parlement européen (ainsi que, le cas échéant, les Parlements nationaux pour les accords mixtes) retrouvent le premier rôle.
Pour autant, même si le TFUE est clair, en particulier s’agissant de la conduite des négociations, le Parlement ne se borne pas à être simplement informé et cherche de plus en plus à peser sur celles-ci. Cette volonté d’influencer la politique commerciale au-delà des dispositions du Traité a été formalisée dans l’accord-cadre interinstitutionnel du 20 novembre 2010. Aux termes de celui-ci, la Commission doit informer le Parlement à tous les stades de la négociation, y compris pour la « définition de directives de négociation » et doit tenir « dûment compte des commentaires du Parlement tout au long des négociations commerciales » (annexe 3, point 3). Il prévoit également que la Commission peut accorder à des députés européens le statut d'observateurs lors des négociations sur les accords internationaux et faciliter leur accès « en tant qu'observateurs faisant partie des délégations de l'Union » lors des « réunions des instances instituées par des accords multilatéraux internationaux et impliquant l'Union » (articles 25 et 26). En échange, le Parlement s'engage à respecter le statut d'information restreinte et classifiée.
Après cet accord-cadre, le Parlement a utilisé l’arme de la résolution pour peser, avec succès, sur les négociations commerciales en cours ou envisagées. Trois exemples sont particulièrement frappants. Le 25 octobre 2012, le Parlement a adopté une résolution sur les négociations commerciales de l’Union européenne avec le Japon. S’il se félicitait de l'ouverture imminente des négociations, il insistait également pour que le Japon prenne des engagements importants en ce qui concerne la suppression des barrières non tarifaires au commerce avant le début des négociations. Par ailleurs, il demandait que le mandat de négociation comporte la révision obligatoire, dans le délai d'un an, des négociations afin de permettre d'évaluer si le Japon avait fait des propositions raisonnables en matière l'élimination desdites barrières. Le mandat de négociation, dont l’adoption avait été retardée le temps du vote du Parlement européen, a tenu compte des exigences présentées dans la résolution.
Un autre exemple de l’influence nouvelle du Parlement européen a été donné par le PTCI dont les négociations ont débuté en juillet 2013. Deux ans après, par sa résolution du 8 juillet 2015, le Parlement européen a adopté ce qu’il faut bien appeler un « mandat bis de négociation » en fixant à la fois des objectifs et des lignes rouges. Parmi ces dernières, la plus médiatique porte le mécanisme de règlement des différends entre les États et les investisseurs (RDIE). Le Parlement européen a ainsi exigé « un nouveau système de règlement des différends entre investisseurs et États conforme aux principes démocratiques, dans lequel les différends seraient réglés de manière transparente par des juges professionnels indépendants, au cours d’audiences publiques, qui inclura un mécanisme d’appel, où la cohérence des décisions serait assurée, la compétence des juridictions européennes et nationales préservée, et où les intérêts privés ne pourraient pas prévaloir sur les choix de politique publique ». La proposition de la Commission européenne en matière de RDIE, publiée le 16 septembre 2015, a repris chacun des points mentionnés ci-dessus.
Enfin, alors que l’approbation du Parlement européen n’est pas nécessaire pour qu’un accord de libre-échange entre provisoirement en vigueur, ni la Commission ni le Conseil n'ont souhaité courir le risque de voir l'accord avec la Corée du sud mis en œuvre immédiatement au risque, suite à un mouvement de mauvaise humeur du Parlement, d’être rejeté par ce dernier. La subordination de l’entrée en vigueur provisoire de cet accord à l’approbation du Parlement européen a établi un précédent clair confirmant, si besoin en étant, le rééquilibrage des pouvoirs existant entre les institutions européennes.
Si la Commission et, le cas échéant, le Conseil, ont accepté de se plier aux exigences du Parlement européen, c’est évidemment parce qu’il possède « l’arme atomique » qu’est la possibilité de rejeter le traité, signant ainsi son arrêt de mort. Les deux autres institutions ne voulant pas prendre ce risque, surtout après des années de négociations parfois laborieuses, sont dès lors obligées, en dehors de toute obligation découlant des traités, de faire une place au Parlement européen à la table des négociations.
ii. Le développement, par le Parlement européen, de sa propre capacité d’évaluation des accords de libre-échange
Tant que le Parlement se contentait de suivre les négociations et de ratifier les traités, ils pouvaient s’en tenir aux seules informations transmises par la Commission. Le Parlement dispose, en effet, des études d’impact produites par cette dernière et, en particulier, de l’étude post-négociation spécialement réalisée afin de l’éclairer sur la portée de l’ALE une fois les négociations achevées. En effet, il lui était totalement inutile de faire des évaluations préalables d’un ALE en cours de négociation dès lors puisqu’il n’avait pas d’influence sur celles-ci.
En revanche, s’il veut jouer un rôle plus important sur la conduite des négociations et, d’une manière générale, en matière de politique commerciale, il doit s’en donner les moyens et se doter lui aussi d’une capacité d’évaluation, autonome de celle de la Commission. Le 8 juin 2011, le Parlement européen a ainsi adopté une résolution sur la garantie de l’indépendance des études d’impact, qui soutient le développement d’une capacité d’évaluation indépendante. À la suite de cette résolution a été créée, en 2012, une Direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne comportant une Unité « études d’impact préalables » dont le rôle est « d’évaluer les forces et faiblesses des études d’impact de la Commission [et de] fournir, à la demande des commissions concernées, une analyse plus approfondie ». Le Parlement européen a également établi ses propres lignes directrices afin de guider les commissions dans l’utilisation des études d’impact.
Ce rôle nouveau en matière d’évaluation des accords de libre-échange, le Parlement peut le jouer à trois moments : avant l’ouverture des négociations, une fois celle-ci en cours et, enfin, lorsqu’elles sont conclues, avant l’approbation. Jusqu’à présent, le Parlement n’a pas fait d’étude d’impact préalable à l’ouverture des négociations et, selon les informations transmises à vos rapporteurs, ne l’envisage pas. Il préfère en effet évaluer les études d’impact initiales de la Commission européenne et l’a d’ailleurs fait pour trois des plus importants accords en cours de négociation : le PTCI, l’accord de libre-échange avec le Japon et le traité d’investissement avec Chine. Le Parlement semble en effet vouloir rester en retrait s’agissant de l’opportunité d’ouvrir des négociations et n’intervenir qu’une fois la décision prise, afin de peser tant sur le contenu du mandat de négociation (voir supra) que, par des études préalables, sur la conduite des négociations elle-même.
Une fois de plus, c’est avec le PTCI que le Parlement européen a donné la pleine mesure de ses nouveaux moyens. Le débat autour de ces négociations avec les États-Unis porte en effet beaucoup sur les effets de ce traité et l’étude de la Commission européenne a fait l’objet d’une large contestation dont les termes seront rappelés infra. S’il veut participer à ce débat et l’influencer, le Parlement européen doit lui aussi pouvoir s’appuyer sur sa propre évaluation et non s’en remettre à celle des autres et encore moins à celle de la Commission européenne. Conscient qu’il y avait là une carte à jouer, le Président Martin Schulz a institué un groupe de suivi des négociations dont le Président de la Commission du commerce international est le rapporteur permanent. Par ailleurs, non seulement l’étude d’impact initiale de la Commission européenne a été expertisée mais le Parlement a également fait réaliser une série d’études portant sur l’agriculture et l’alimentation (décembre 2014), les marchés publics (février 2015), la protection des investissements (mars 2015), les implications géostratégiques du PTCI (avril 2015), l’impact sur les services (mai 2015), la coopération réglementaire (juin 2015), les télécommunications (juillet 2015), les enjeux énergétiques (juillet 2015), les produits chimiques (juillet 2015), la protection des consommateurs (juillet 2015), les barrières non-tarifaires et les barrières techniques (août 2015).
En d’autres termes, le Parlement est la seule institution qui ait fait une contre-expertise de l’étude d’impact initiale de la Commission européenne sur le PTCI, doublée d’une évaluation de l’impact du PTCI pour l’Union européenne. À noter que, comme la Commission, le Parlement européen a recruté un consultant extérieur pour réaliser ces études, n’ayant pas lui-même l’expertise économétrique nécessaire.
Enfin, une fois les négociations conclues, alors que la prochaine étape l’implique directement, à savoir l’approbation, le Parlement européen ne se repose pas, comme le Conseil, exclusivement sur les évaluations de la Commission. C’est ainsi qu’avant d’examiner l’accord avec la Colombie et le Pérou, le Parlement européen a demandé à sa direction générale des affaires internationales de réaliser une étude afin de « l’assister dans ses délibérations ». Celle-ci a été faite par des consultants indépendants et a été rendue publique le 20 mars 2012.
En conclusion, si l’évaluation préalable des accords de libre-échange est principalement faite par la Commission, assistée des consultants indépendants, le Parlement européen réalise quant à lui un véritable travail de contradiction de l’évaluation de la Commission, cohérent avec le rôle important qu’il veut désormais jouer en matière de politique commerciale de l’Union européenne. Face à ces deux institutions, le Conseil apparaît largement inexistant, suivant les négociations mais se reposant sur les études d’impact de la Commission sans réaliser les siennes propres ; les États membres, individuellement, évaluent l’impact de l’accord mais leurs évaluations sont limitées aux seuls effets sur leur pays et n’apportent donc qu’un éclairage limité au Conseil en tant qu’institution européenne.
Après avoir examiné longuement les études d’impact produites par la Commission européenne, les procédures qu’elles suivent, leur forme et leur réception par le Parlement européen et le Conseil, vos rapporteurs se sont interrogés sur leur portée. En effet, elles seraient vaines si elles n’avaient aucune influence sur la politique commerciale de l’Union européenne. Mesurer cette influence oblige à analyser à la fois la prise en compte de ces études par la Commission européenne elle-même, par les deux autres institutions européennes que sont le Conseil et le Parlement européen et, enfin, l’usage qui en est fait vis-à-vis de l’opinion publique.
Les développements à suivre ne concerneront toutefois que les études de la Commission et non celles du Parlement européen. En effet, c’est seulement depuis 2012 et, plus encore, avec le PTCI, à partir de 2014, que ce dernier a développé une capacité propre d’évaluation, si bien qu’il est encore trop tôt pour mesurer l’influence de celle-ci sur la politique commerciale commune au-delà de ce qui a été dit supra.
a. La Commission s’appuie sur les études d’impact pour prendre ses décisions et influencer le Parlement et le Conseil
Si la Commission européenne réalise des études d’impact, c’est avant tout pour guider sa propre action. Comme l’indiquent les lignes directrices, lorsque plusieurs options s’offrent à elle, la Commission doit pouvoir s’appuyer sur « une analyse solide basée sur les données disponibles les plus fiables » tout en prenant en considération « les contributions de l’ensemble des parties prenantes ». Dès lors, « la réalisation d’une étude d’impact est un élément clé dans l’élaboration de propositions par la Commission, et le Collège des commissaires tiendra compte du rapport d’impact lorsqu'il prendra ses décisions. L’étude d’impact aide la décision, mais ne la remplace pas : l’adoption d’une proposition politique reste toujours une décision politique prise uniquement par le Collège ».
Vos rapporteurs ont donc analysé dans quelle mesure les conclusions des études d’impact se retrouvent dans les décisions de la Commission en matière de politique commerciale, en commençant par l’étude d’impact initiale.
Cette étude d’impact initiale, on le rappelle, est annexée aux recommandations de la Commission au Conseil pour une décision autorisant l’ouverture de négociations. Il n’est donc pas surprenant que la Commission aille dans le même sens que l’étude d’impact initiale : si ce n’était pas le cas, il est peu probable qu’elle prenne le risque de présenter un projet de décision qui n’aurait pas été appuyé par une étude d’impact favorable. Toutefois, on peut tirer une conclusion inverse : si l’étude d’impact n’est pas favorable, la Commission n’aurait pas pris cette décision. Dans les deux cas, on ne peut que souligner que la décision de la Commission de recommander au Conseil l’ouverture de négociations commerciales s’appuie incontestablement – et très logiquement –sur l’étude d’impact initiale.
Cette étude d’impact initiale influence d’ailleurs très largement la décision du Conseil d’ouvrir des négociations puisque, comme il a été précisé supra, celui-ci ne fait pas de contre-expertise de l’étude. Cependant, il serait faux de croire que l’impact économique justifie à lui seul l’ouverture de négociations commerciales et leur conclusion. En effet, celui-ci est le plus souvent limité, voire même nul dans certains cas. En pratique, les enjeux commerciaux sont très souvent liés à des enjeux politiques et géopolitiques plus larges.
Le communiqué de presse publié à l’occasion de l’ouverture des négociations avec l’Ukraine le 18 février 2008 est de ce point de vue éloquent : « un accord de libre-échange UE-Ukraine s’inscrit dans la politique plus large de l’Union consistant à créer un voisinage européen stable et prospère en resserrant les liens économiques. L’Union n’est pas seulement le premier partenaire commercial de l’Ukraine, elle est aussi l’un des marchés les plus vastes et les plus riches du monde. Le resserrement des liens économiques avec l’Union offre des avantages importants pour l’Ukraine. L’accord de libre-échange représentera un élément essentiel du nouvel accord renforcé entre l’Union et l’Ukraine, dont les négociations sont en cours et qui couvrira tous les aspects de leurs relations ». Ce sont ces enjeux qui expliquent que, malgré les gains économiques limités, l’Union européenne souhaite conclure des accords de libre-échange, utilisant l’instrument du commerce à des fins politiques.
L’influence des études d’impact de la Commission ne se limite pas à la seule ouverture des négociations. Elle est également visible, pour ce qui concerne la SIA, dans la conduite de celles-ci. Comme l’indique le « handbook », « la crédibilité de l’Union européenne en matière de développement durable dépend de comment l’étude d’impact est utilisée pour influencer l’élaboration de la politique commerciale et les négociations commerciales ». Or, les exemples abondent qui montrent que les conclusions et recommandations de la SIA ont clairement influencé la position de négociation de la Commission européenne, ce que cette dernière reconnaît d’ailleurs explicitement.
C’est le cas notamment dans le « position paper » sur l’ALE UE-Corée du sud. Alors que le consultant recommandait une libéralisation progressive et différenciée des secteurs encore protégés par des droits de douane, « la Commission a pris ces recommandations en compte dans les négociations et s’est assurée que le calendrier des libéralisations tarifaires au niveau de sensibilité des différents secteurs ». De même, s’agissant des mesures sanitaires et phytosanitaires, « les services de la Commission soutiennent les recommandations faites par le consultant et ont essayé, autant que possible, qu’elles se reflètent dans les résultats de la négociation ». C’est le cas également pour les recommandations en matière d’investissement. Enfin, le soutien de la Commission ne s’est pas limité à des mots puisque ces recommandations se retrouvent effectivement dans le texte final de l’accord. La même analyse, faite par vos rapporteurs pour l’ALE avec la Colombie et le Pérou, montre les mêmes résultats d’une claire influence de l’étude d’impact sur les positions de négociation de la Commission.
Enfin, la SIA, complétée le cas échéant par une étude post-négociation,
est l’un des principaux arguments de la Commission européenne pour obtenir du Conseil et du Parlement qu’ils approuvent l’accord, en plus d’éventuelles justifications politiques (voir supra). L’approfondissement et la multiplication
des études d’impact sont d’ailleurs peut-être liés au renforcement, par le
Traité de Lisbonne, des pouvoirs du Parlement en matière de politique commerciale.
Les négociations commerciales, qu’elles soient multi, pluri ou bilatérales, se sont longtemps déroulées dans le secret. Très techniques et progressant toujours avec lenteur, elles ne suscitaient pas l’attention des peuples qui, par conséquent, n’étaient pas en mesure d’en percevoir tous les enjeux. Toutefois, cette indifférence est aujourd’hui révolue et, depuis les années quatre-vingt-dix, nombreuses sont les négociations commerciales qui ont été au cœur de l’actualité. Les manifestations lors des sommets de l’OMC sont dans toutes les mémoires, comme les débats qu’a suscités l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) ou, plus récemment, l’Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA). Avec le développement d’Internet, une société civile mondiale a émergé qui demande, en matière de politique commerciale comme dans les autres domaines, une plus grande transparence dans l’élaboration des politiques publiques.
La Commission européenne n’a pas immédiatement pris la mesure
de ce changement de paradigme et, une fois de plus, c’est le PTCI qui l’a
contrainte à modifier ses pratiques. En effet, alors que les négociations avaient commencé en juillet 2013 avec les États-Unis, comme à l’habitude dans le
secret le plus total, la mobilisation croissante de la société civile comme
des Parlements nationaux et du Parlement européen a obligé la Commission
à faire preuve de transparence sur ces négociations, en publiant pour la première fois le mandat de négociation ainsi que de nombreux documents de négociation.
C’est dans ce nouveau contexte que s’insèrent désormais les études d’impact qui, de fait, ont acquis une nouvelle utilité. Si leur principale fonction est naturellement toujours d’éclairer les décisions de la Commission et des autres institutions européennes, elles ont aussi acquis une fonction de légitimation des choix politiques adoptés. En effet, maintenant que les décisions de la Commission sont débattues publiquement, voire contestées, celle-ci doit pouvoir opposer autre chose que le silence ou ses propres certitudes. Il est donc dans son intérêt de consulter l’ensemble des parties prenantes dans le cadre d’études d’impact elles-mêmes basées sur les constats et les recommandations de consultants indépendants dont l’impartialité est systématiquement mise en avant. Les études d’impact légitiment donc à la fois le processus d’élaboration de la décision et la décision elle-même.
Cette utilité des études d’impact en termes de communication, si elle est récente, n’avait pas échappé à la Commission lorsqu’elle a instauré ses procédures d’évaluation. C’est ainsi que, dès sa communication du 5 juin 2002 précitée, parmi les plus-values apportées par les études d’impact, elle souligne que « l’étude d’impact est aussi un efficace et utile instrument de communication ». Vos rapporteurs observent d’ailleurs que dans les débats sur les deux traités qui, aujourd’hui, focalisent l’attention – l’AECG et le PTCI – la Commission fait un large usage des effets économiques positifs mis en évidence dans les études d’impact, sans jamais oublier de citer le fait que celles-ci s’appuient sur l’analyse de consultants indépendants (5).
Toutefois, vos rapporteurs ont pu noter, notamment dans la communication de la Commission sur le PTCI, une présentation des faits sous un jour favorable qui n’est pas forcément celui de l’étude d’impact et encore moins celui du consultant indépendant. C’est ainsi que l’étude d’impact et, avant elle, le consultant, ont évalué deux scénarios – conservateur et ambitieux – pour le PTCI, lesquels aboutissent à des résultats très différents. Les gains pour l’Union européenne d’un accord ambitieux avec les États-Unis sont presque deux fois plus importants que ceux qui résulteraient d’un accord conservateur. Il est intéressant d’observer que c’est le scénario ambitieux qui est systématiquement mis en avant par la Commission, lequel se traduit par une augmentation de la taille de l’économie européenne de 119 milliards d’euros, soit 0,48 % du PIB. Ces deux chiffres sont très régulièrement repris par la Commission dans sa communication sans que les incertitudes entourant leur fiabilité le soient également (voir infra).
B. LA FIABILITÉ DE L’ÉVALUATION EX-ANTE DES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE SE HEURTE AUX LIMITES DES MÉTHODES UTILISÉES ET À LA MAUVAISE VOLONTÉ DE LA COMMISSION
Les études d’impact de la Commission européenne obéissent à une procédure et une méthodologie précises qui ont été longuement présentées supra. Celles-ci sont censées garantir la fiabilité des études d’impact dans leur évaluation des effets économiques, sociaux et environnementaux des accords de libre-échange. Les effets économiques sont ainsi analysés au moyen d’une modélisation économique, laquelle est inévitable puisque l’exercice d’évaluation consiste à anticiper les effets sur l’économie européenne de mesures qui n’existent pas encore. Or, ces modèles économiques, pour utiles qu’ils soient, sont critiquables en eux-mêmes notamment parce qu’ils laissent une large part à la subjectivité des consultants (1). De même, les méthodes d’évaluation des impacts sociaux et environnementaux des accords de libre-échange ont elles aussi été contestées, sans oublier le fait que, pendant de longues années, l’impact sur les droits humains n’a pas fait l’objet d’une évaluation (2).
1. La modélisation économique, bien qu’au cœur de l’analyse des impacts économique, social et environnemental, présente de nombreuses limites susceptibles de remettre en cause ses résultats
La modélisation économique occupe aujourd’hui une place fondamentale dans l’évaluation des accords de libre-échange. Par leur prétention à prévoir le futur et à estimer les gains résultant d’un accord de libre-échange, les modèles économiques constituent l’outil de prédilection des consultants recrutés par la Commission européenne dans le cadre des études d’impact. Toutefois, pour utile qu’elle soit, la modélisation présente des limites intrinsèques qui sont de nature à remettre en cause ses résultats.
a. Les différentes méthodes utilisées par les consultants pour évaluer l’impact économique, social et environnemental d’un ALE
Deux catégories de modèles sont aujourd’hui utilisées pour l’évaluation ex-ante des accords de libre-échange. Il convient toutefois de préciser que ce sont principalement les modèles d’équilibre général calculable (EGC) qui ont la faveur des économistes, les modèles de gravité n’étant plus utilisés que pour
des aspects précis de l’analyse de l’impact économique. Toutes les études d’impact de la Commission, sans exception, reposent aujourd’hui sur des modèles d’EGC.
Les modèles de gravité, qui s’inspirent des lois de l’attraction de Newton (d’où leur dénomination), visent à déterminer le niveau potentiel des échanges entre deux (ou plusieurs) pays. Ils expliquent ce dernier par des variables dites gravitaires (notamment le PIB, la distance…) et de variables d’intérêt. Dans sa forme la plus simple, un modèle de gravité montre que le commerce international entre deux pays est proportionnel à leur PIB et inversement proportionnel à la distance qui les sépare (qui est représentative des coûts de transport). Des formes plus élaborées, qui sont les seules utilisées en pratique, intègrent de nombreuses autres variables favorisant ou freinant le commerce bilatéral, comme la langue, l’appartenance à une zone de libre-échange, une frontière commune, une ancienne relation coloniale, etc.
Dans le cas des accords de libre-échange, les modèles de gravité sont utiles pour comparer le volume réel des échanges entre deux pays avec les résultats du modèle, comparaison contrôlée le cas échéant par une comparaison avec d’autres pays. S’il apparaît, par exemple, que le commerce de l’Union européenne avec un pays tiers est inférieur à ce qu’il devrait être compte tenu des variables utilisées, il faut en déduire que des barrières, tarifaires et/ou non-tarifaires nuisent aux échanges bilatéraux ; dans ces conditions, un accord de libre-échange est probablement pertinent pour accroître le commerce bilatéral. Toutefois, les modèles de gravité ainsi utilisés ne fournissent qu’une simple indication et ne renseignent pas des faits aussi importants que l’accroissement ou non du PIB ou du bien-être ainsi que les effets structurels possibles de l’ALE.
Les modèles d’équilibre général calculable (EGC) sont souvent opposés aux modèles de gravité alors qu’ils ne répondent pas au même besoin. En effet, ces modèles traitent de l’effet du commerce sur d’autres variables (par exemple le PIB, le bien-être, le revenu…), alors que les modèles de gravité ne s’intéressent, comme on l’a vu, qu’aux variables qui influencent le commerce. Ils ne peuvent donc simuler que les effets d’une modification de ces variables sur le commerce. Or, l’augmentation du commerce entre deux pays n’est pas forcément, par elle-même, favorable compte tenu de ses effets sur certains marchés et, par conséquent, sur les agrégats précités.
Les modèles d'EGC s'inscrivent dans la tradition néoclassique, pour laquelle l'économie se décompose en un ensemble de marchés sur lesquels l’équilibre de l’offre et de la demande se réalise par le prix, étant précisé que ces marchés interagissent entre eux. Un éventuel déséquilibre sur un marché ne peut donc être que temporaire. Toutefois, les modèles d’EGC ne fonctionnent pas nécessairement dans le cadre des hypothèses néoclassiques de base que sont la concurrence pure et parfaite, le plein emploi et la flexibilité des prix, incluant celle des salaires. Ils posent ainsi couramment une hypothèse de concurrence imparfaite dans l’échange international, se basant sur « l’hypothèse d’Armington » selon laquelle les biens sont différenciés selon leur origine géographique.
Concrètement, la construction d’un modèle d’équilibre général calculable s’opère en trois étapes :
– la première est la construction d’une base de données représentative de l’économie concernée pour une période donnée : la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS). Outre l’ensemble des données publiques disponibles, s’agissant de l’évaluation des accords de libre-échange, les économistes peuvent s’appuyer sur la base de données internationale du commerce international GTAP (Global Trade Analysis Projet) gérée par l’Université Américaine de Purdue qui mutualise depuis 1993 le travail de constitution d’une matrice de comptabilité sociale mondiale pour une année de référence ;
– une fois les données rassemblées, il faut construire le modèle proprement dit qui doit être capable de représenter et de comptabiliser l’ensemble des transactions entre tous les secteurs et marchés de cette économie. Ce modèle repose sur des variables endogènes ou libres, dont le niveau est susceptible de changer après un choc (par exemple la consommation des ménages, l’investissement, l’épargne…) et des variables exogènes ou fixes à partir desquels est simulé un choc de politique économique (par exemple le taux d’impôt sur le revenu, les droits de douane et autres barrières non-tarifaires…). Ils modélisent également le comportement des agents (État, ménages, entreprises) tel que résultant des théories microéconomiques, incluant des comportements d’optimisation. Enfin, les modèles intègrent de nombreux paramètres et hypothèses générales, à la fois pour l’économie concernée que pour les économies tierces ou l’économie mondiale (par exemple, signature d’autres ALE, prix du pétrole, inflation, taux d’intérêt, coût du transport…) ;
– enfin, une fois les variables et paramètres définis, les concepteurs du modèle leur donnent une valeur. Ce point, particulièrement problématique, fera l’objet de développements infra.
Le modèle ainsi construit a l’ambition de modéliser l’ensemble d’une économie, si bien qu’en jouant sur les variables exogènes, il est possible de simuler l’effet sur l’équilibre initial d’un choc de politique publique comme la signature d’un accord de libre-échange, lequel se répercute sur l’ensemble des marchés selon des interactions directes et indirectes entraînant le cas échéant des rétroactions. On compare alors le nouvel état d’équilibre à l’état initial pour évaluer si ce choc a un effet positif ou négatif sur l’économie concernée.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, de tels modèles ne se bornent pas à évaluer l’impact économique d’un ALE mais sont aussi utiles pour évaluer l’impact environnemental et social. Les études d’impact sur le développement durable s’appuient en effet largement sur les modèles d’équilibre général calculable pour estimer l’augmentation des émissions de CO2 ou l’évolution de l’emploi qui découlent des changements de structures économiques.
C’est notamment le cas de la SIA de l’ALE avec la Colombie et le Pérou. Comme l’expliquent les consultants, « une hypothèse nécessaire du modèle est le caractère constant de la force de travail du pays. Cependant, en s’appuyant sur la moyenne pondérée ou absolue des changements dans l’emploi sectoriel, il est possible de calculer les transferts d’emplois entre les secteurs découlant des changements dans la production résultant de la libération des échanges », tout en distinguant entre les travailleurs qualifiés et non-qualifiés.
Le modèle permet également d’évaluer l’impact sur les salaires pour ces deux catégories de travailleurs. En outre, comme l’explique le consultant dans la SIA sur l’ALE avec l’Amérique centrale, « l’impact sur la pauvreté ne peut pas être calculé avec un modèle d’EGC mais les résultats de ce dernier peuvent être utilisés pour l’analyse ». En effet le modèle fournit des estimations des changements dans le revenu moyen et les prix à la consommation. En supposant que la distribution des revenus ne changera pas, les changements de revenu moyen auront nécessairement un effet sur le ratio de pauvreté.
S’agissant de l’impact environnemental, les modèles d’EGC sont également utiles, en particulier pour mesurer l’effet de l’ALE sur les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation des ressources naturelles. La même SIA de l’accord avec la Colombie et le Pérou considère en effet que « le changement dans les émissions reflète le niveau et la composition de l’activité économique. Les changements dans l’utilisation des ressources naturelles sont estimés directement à partir du modèle, qui retrace l’intensité de l’utilisation de celles-ci comme une composante de la structure de base du modèle (similaire à l’utilisation du capital et du travail ». Par conséquent, des changements sectoriels d’une économie découlant d’un ALE, il est possible de déduire l’impact de ceux-ci sur les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation des ressources naturelles.
La modélisation n’est pas le seul outil à disposition des consultants pour évaluer l’impact économique d’un accord de libre-échange. Compte tenu de ses limites (voir infra), ils doivent recourir à d’autres instruments afin d’analyser aussi finement que possible lesdits impacts. Comme l’explique le consultant CEPS dans l’étude d’impact qu’il a réalisé de l’accord avec la Corée du sud (2007), « si les modèles théoriques peuvent nous aider à appréhender les effets économiques d’un accord de libre-échange, la théorie seule ne peut fournir des réponses claires sur les effets économiques probables d’un accord spécifique. La raison en est, au moins en partie, que les différents effets d’un tel accord n’ont pas tous la même portée. Certains sont bénéfiques, d’autres néfastes. Pour cette raison, une combinaison d’analyse empirique et de modélisation est nécessaire ».
La principale difficulté que rencontrent généralement les études d’impact est l’estimation des barrières non tarifaires, en particulier dans les services. En effet, il n’y a généralement pas de données sur celles-ci qui, par ailleurs, prennent des formes tellement nombreuses qu’elles ne peuvent en tant que telles être aussi facilement modélisées que les barrières tarifaires.
Dans l’étude qu’il a réalisée pour l’étude d’impact initiale du PTCI, le consultant CEPR s’est appuyé sur une autre étude, plus ancienne, du consultant ECORYS centrée sur les barrières non-tarifaires entre les États-Unis et l’Union européenne (6) pour calculer les équivalents-ad valorem des barrières non tarifaires. Ce consultant avait interrogé directement 5 500 entreprises des deux côtés de l’Atlantique et dans les pays tiers (Chine, Japon, Inde, Mexique, Canada, Brésil et Afrique du sud), actives dans 23 secteurs, leur envoyant un questionnaire détaillé incluant la question suivante : « si 0 représente un marché entièrement ouvert et 100 un marché entièrement fermé en raison des barrières non tarifaires, quel chiffre vous semble décrire le mieux le niveau global de protection aux États-Unis (dans l’Union européenne) pour votre produit (service) ? » Les réponses ont ensuite été comparées avec les indicateurs de protection de l’OCDE afin de définir un niveau global de protection par secteur.
Toutefois, il faut être conscient que ce niveau repose sur la perception de celui-ci par les entreprises interrogées et qu’il est donc parfaitement arbitraire. En outre ces données ne sont pas directement utilisables dans le modèle car elles ne traduisent pas un impact actuel en termes de prix et de coût. Pour ce faire, les données doivent être intégrées dans des modèles de gravité afin d’estimer l’équivalent ad valorem d’impact sur le prix des variations des barrières non tarifaires.
D’une manière générale, vos rapporteurs ont pu constater que les modèles de gravité sont très souvent utilisés, seuls ou en complément de l’analyse empirique, pour évaluer les barrières non-tarifaires et, d’une manière générale, les obstacles aux échanges dans un secteur particulier.
C’est toutefois dans le domaine de l’impact social et environnemental que le recours aux méthodes alternatives à la modélisation est le plus fréquent. En effet, pour utile qu’ils soient, les modèles restent à un niveau d’abstraction qui ignore la réalité du terrain. Pour avoir une vision claire des conséquences concrètes de l’ALE, il est nécessaire d’aller sur le terrain et de rencontrer les personnes et/ou organisations directement concernées par l’ALE. D’où l’importance de la phase de consultation car certains effets ne peuvent être connus ni même estimés par la modélisation. Les syndicats peuvent informer les consultants – et la Commission – des tensions sociales, des pratiques des employeurs et de l’effectivité des droits sociaux, par exemple dans le secteur minier ou agricole en Colombie et au Pérou. C’est fort de ces informations que le consultant a pu estimer que « les restrictions aux droits des mineurs limiteraient l’augmentation des revenus et l’amélioration des conditions de travail » qui, normalement, aurait dû découler de l’augmentation de la production. De même les ONG peuvent-elles attirer l’attention sur les conditions particulières de minorités ou de communautés locales dans une région donnée. Sans ces consultations, une multitude d’informations ne seraient pas disponibles.
Comme l’explique une étude de l’OMC (7), les résultats d’un modèle « sont nécessairement sujets aux erreurs et leur qualité variera avec l’adéquation du modèle au problème, la qualité et l’actualité des données utilisées et les paramètres choisis ». Vos rapporteurs vont examiner la double limite des modèles tenant à la fois à leur structure et aux hypothèses utilisées, d’une part, et à la qualité des données, d’autre part.
i. La structure du modèle et les hypothèses utilisées reposent sur des choix subjectifs des consultants
C’est un fait qui apparaît immédiatement à quiconque lit les études des consultants recrutés par la Commission pour évaluer l’impact économique d’un accord de libre-échange. Non seulement ils recourent tous à la modélisation sur la base d’un modèle d’équilibre général calculable mais ils utilisent tous des modèles différents. S’ils sont nombreux à utiliser le modèle GTAP, certains consultants ont développé leur propre modèle.
Or, comme l’explique la SIA de l’ALE UE-Corée du sud à propos des modèles d’équilibre général calculable et, en particulier, du modèle GTAP, « la qualité de ces modèles dépend avant tout de celle des équations et des paramètres. Ainsi, par exemple, l’élasticité des échanges n’est pas toujours précisément mesurée. De manière générale, toute erreur ou modification du paramètre dans la période d’évaluation peut avoir un impact important sur les résultats ». Par conséquent, le choix des paramètres par les consultants impacte directement les résultats de la modélisation.
Vos rapporteurs se sont ainsi penchés sur l’un des paramètres clés
des modèles d’EGC : les paramètres comportementaux ou élasticités. Ainsi qu’il a été dit supra, dans la construction d’un modèle d’EGC, après avoir renseigné toutes les informations dans la matrice sociale, le consultant doit fournir une valeur aux paramètres qui définissent le comportement des agents économiques. Ces paramètres mesurent leur réaction aux changements de prix et de
revenu relatifs et, par conséquent, ont un effet important sur le résultat de la simulation.
Parmi ces paramètres comportementaux, l’un est essentiel en matière de commerce international : les élasticités d’Armington qui déterminent la substituabilité entre les produits importés et les produits nationaux. Or, comme l’indique l’étude de l’OMC précitée, l’estimation de ces élasticités est, au mieux, « controversée ». En effet, « dans certains cas, les modélisateurs n’évaluent pas eux-mêmes statistiquement ces paramètres mais les prennent, tels quels, d’autres sources » avec le problème que « si les bases de données sont régulièrement actualisées, les estimations de paramètres ne le sont pas, si bien que certains paramètres comportementaux sont basés sur des estimations datant parfois de quinze ans ». Selon les sources choisies par les consultants, qui ne sont pas toujours renseignées (comme bien d’autres paramètres), les élasticités auront donc une valeur différente.
L’autre exemple de la subjectivité des modèles est la détermination du niveau des barrières non-tarifaire, en particulier dans les services. Comme le rappelle la SIA de l’ALE avec la Colombie et le Pérou, « nombreuses sont les barrières au commerce des services qui sont difficiles à mesurer, ce qui augmente le degré d’incertitude de l’estimation des effets de la libéralisation des échanges. […] La modélisation n’est pas adaptée pour prendre en compte des services très différents par nature et leur lien avec la politique de réglementation nationale. La nature de la libéralisation dans les services est fondamentalement différente de la libéralisation des biens. Dans ce dernier cas, les discussions portent sur des changements dans le niveau de barrières effectives au commerce exprimées en termes mesurables, dans le cas des services, la libéralisation porte avant tout sur des mesures qualitatives, qui doivent être converties en des équivalents quantitatifs pour être modélisés ». Vos rapporteurs ont présenté supra comment les barrières non tarifaires avaient été évaluées dans le PTCI. Le consultant Ecorys avait recouru à des questionnaires dont les réponses ont reçu un équivalent ad valorem par l’intermédiaire d’un modèle de gravité. La subjectivité du modèle du consultant s’ajoute donc à la subjectivité des réponses des entreprises.
La Commission est autant consciente que les consultants des incertitudes entourant la modélisation de l’impact économique d’une libéralisation des services. Dans son « position paper » sur la SIA de l’Accord avec la Colombie et le Pérou, elle note ainsi que « dans le secteur des services, les techniques de modélisation font face à des difficultés considérables et les résultats doivent être maniés avec précaution ».
Enfin, le dernier exemple de l’importance des choix du consultant dans les résultats de la modélisation est fourni, une fois de plus, par l’étude CEPR sur le PTCI. Ce consultant appuie en effet ses résultats sur un effet d’entraînement direct fondé sur l’hypothèse que la convergence réglementaire entre les États-Unis et l’Europe se traduira par une baisse du coût des échanges avec les pays tiers. C’est ainsi que CEPR estime que l’accès aux marchés européen et américain sera facilité à hauteur de 20 % de la baisse bilatérale des coûts liés au BNT. En d’autres termes, une baisse de 5 % des coûts liés aux BNT entre les États-Unis et l’Union européenne aura pour conséquence une baisse de 1 % des coûts pour les pays tiers exportant vers les États-Unis et l’UE. La logique à la base de cette hypothèse est que les entreprises des pays tiers exporteront plus facilement dans ces deux marchés si les réglementations sont identiques ou proches.
Le CEPR pose également l’hypothèse d’un effet d’entraînement indirect. En effet, si les États-Unis s’accordent sur une réglementation commune avec l’Union européenne, vu leur poids économique, il est fort possible que celle-ci soit adoptée, au moins partiellement, aussi par les pays tiers, en dehors du tout ALE entre ceux-ci et les États-Unis ou l’UE. Par conséquent, les entreprises américaines et européennes pourront plus facilement exporter vers ces pays tiers. Cet effet est évalué à la moitié de l’effet d’entraînement direct, soit, pour reprendre l’exemple ci-dessous, 0,5 %. Vos rapporteurs ont clairement l’impression que cet effet d’entraînement indirect, comme d’ailleurs l’effet d’entraînement direct, a été évalué « au doigt mouillé ».
Ces trois exemples, parmi d’autres, de paramètres importants des modèles d’EGC utilisés par les consultants, montrent que les choix de ses derniers ont une influence importante sur les résultats. En effet, selon la valeur donnée aux élasticités, la substitution entre les importations et la production nationale sera plus ou moins forte ; de même, selon le niveau estimé des barrières non-tarifaires, l’accroissement des exportations sera plus ou moins important ; enfin, selon l’importance de l’effet d’entraînement indirect, les gains seront aussi plus ou moins élevés. L’effet est d’autant plus important que, dans les accords de « nouvelle génération » entre pays où les droits de douanes sont, globalement, faibles, l’essentiel du gain est attendu de la baisse des barrières non tarifaires, celle-là même dont la modélisation fait défaut.
Enfin, un dernier exemple des limites de l’évaluation ex-ante des accords de libre-échange est, naturellement, le fait qu’elle repose, inévitablement, sur un ou des scenarios de libéralisation. Le consultant discute avec la DG Trade des différentes orientations possibles de la négociation et plusieurs scénarios, plus ou moins ambitieux, sont retenus. Mais il n’est absolument pas certain que ces scénarios se retrouvent in fine dans les résultats de la négociation, c’est-à-dire dans l’ALE lui-même. En outre, ces évaluations ex-ante peuvent être affectées par les aléas politiques de la négociation. Par exemple, alors que l’étude d’impact prenait en compte les quatre pays de la Communauté andine, au final, l’UE n’a signé d’ALE qu’avec la Colombie et le Pérou, la Bolivie et l’Équateur s’étant entre-temps retirés des négociations. Les résultats en sont nécessairement faussés.
D’une manière générale, au-delà des choix subjectifs des consultants, vos rapporteurs attirent l’attention sur deux des hypothèses de base qui, certes, sont des postulats nécessaires à la modélisation mais sont très éloignées de la réalité que, pourtant, ils ont pour ambition de décrire et de prédire :
– les modèles d’équilibre général calculable postulent le plein emploi et la pleine utilisation des facteurs de production. Dans ces conditions, ils ne sont pas capables de mesurer l’impact d’un ALE sur le niveau de chômage mais juste de prédire un changement dans la demande de travail résultant d’une offre de travail supérieur (en raison de l’augmentation de la production découlant de la hausse des exportations). Or, en plein emploi, toute hausse de la demande entraine une augmentation du prix et donc des salaires. Comme l’explique l’ONG South Centre (8), qui a réalisé une analyse critique de l’ALE UE-Amérique centrale, « le modèle transforme une augmentation de la demande de travail en une hausse du niveau de salaire, laquelle est considérée comme un impact positif. Cependant, il y a plusieurs mécanismes à l’œuvre qui ne sont pas pris en compte, rendant l’augmentation des salaires moins probable que ne l’indique le modèle », à commencer par le chômage ;
– la plupart des modèles d’EGC supposent que les agents économiques, y compris, par exemple, les PME, sont en mesure de répondre à de nouvelles incitations par les prix (résultant d’une hausse de la demande pour leurs biens) en augmentant sensiblement leur offre. Ils ne tiennent pas compte des autres contraintes telles que le besoin de liquidité, de crédit, la disponibilité des intrants, l’aversion au risque et à l'incertitude…
En outre, parce que ces modèles sont des modèles d’équilibre, ils supposent tous qu’existe une situation d’équilibre, au départ comme à la suite de la mise en œuvre des accords et, par conséquent, que les ajustements au sein des activités et entre les activités se font sans frictions ni coûts. En pratique, comme les barrières sont réduites et que certains secteurs jusqu’alors protégés sont exposés à la concurrence internationale, ces modèles présupposent que les secteurs les plus compétitifs d’une économie absorberont toutes les ressources, y compris l’emploi, libéré par les secteurs affaiblis. Cependant, pour que cela arrive, encore faut-il que les secteurs compétitifs croissent suffisamment pour avoir besoin de toutes ces ressources. De plus, ces ressources sont supposées ne pas être spécifiques aux secteurs et donc pouvoir être réemployées ailleurs. Comme l’explique l’Université américaine de Tufts, « un employé sur une chaîne de production automobile pourrait instantanément prendre un nouveau travail dans une compagnie de logiciels pour autant que son salaire est suffisamment bas ». En réalité, cependant, ce mécanisme ne fonctionne pas. Dans la plupart des cas, les secteurs les moins compétitifs se contractent plus vite que les secteurs compétitifs croissent, laissant de nombreux employés sur le carreau, au moins temporairement. Le plein emploi ne se fait pas de lui-même même si les travailleurs acceptaient des baisses de salaires, ce qui n’est pas toujours le cas.
Enfin, ces modèles ne tiennent pas compte des « coûts d’opportunité » induits par la libéralisation des échanges. Le désarmement douanier se traduit par une baisse des revenus de l’État concerné. Même si, en fin de période, on peut supposer que le revenu national a augmenté, et avec lui les recettes de l’État, ce dernier n’en est pas moins confronté à la baisse immédiate de celles-ci. Or ces recettes financent des dépenses publiques qui devront être réduites le temps que la hausse du revenu national se produise (si elle doit se produire…). C’est d’autant plus problématique que les dépenses publiques, particulièrement dans le domaine de l’éducation, de la recherche, de la santé et des infrastructures, ont un effet important sur la croissance de l’économie. Il faudrait donc logiquement calculer le coût d’opportunité de la perte de recettes fiscales induite par la libéralisation du commerce en estimant ce que ces sommes auraient pu induire en croissance potentielle. D’une manière plus générale, c’est l’absence de prise en compte des coûts de la libéralisation des échanges qui rend les résultats de modèles d’EGC suspects aux yeux de certains économistes.
Outre la limite tenant aux choix faits par les consultants dans la construction du modèle, les modèles d’équilibre général calculable peuvent souffrir des données incomplètes et pas forcément adéquates qui sont utilisées pour les faire fonctionner.
Les consultants recrutés par la Commission européenne s’appuient sur l’ensemble des données disponibles et, en particulier, sur la base de données du Global Trade Analysis Project (GTAP). Ce projet, coordonné par une équipe du Center for Global Trade Analysis (CGTA) basée au département d'économie de l'Université de Purdue (États-Unis), rassemble un réseau mondial de chercheurs spécialisés en politique commerciale internationale qui coopèrent pour produire une base de données couvrant de nombreux secteurs et toutes les régions du monde. La base de données GTAP décrit ainsi les flux commerciaux bilatéraux, la production, la consommation, et l'utilisation intermédiaire de biens et services. La même équipe maintient un modèle mondial d'équilibre général calculable, qui utilise la base de données GTAP. Certes, il existe plusieurs modèles d’EGC, notamment le modèle MIRAGE du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) et de nombreuses autres bases de données mais vos rapporteurs ont pu constater que les études d’impact de la Commission utilisent souvent le modèle GTAP et, même lorsque ce n’est pas le cas, la base de données du même nom.
Or, cette base de données pose plusieurs problèmes dont ses utilisateurs comme ses concepteurs sont parfaitement conscients. Elle n’est pas actualisée tous les ans, si bien que les simulations peuvent reposer sur des données parfois très anciennes. La version actuelle de GTAP – GTAP 9 – s’arrête à l’année 2011. Par conséquent, l’ensemble des évaluations faites à partir de cette base, y compris pour les ALE les plus récents, utilisent des données remontant à plusieurs années.
En outre, les données de GTAP s’appuient sur la production des offices statistiques nationaux. Or, celle-ci peut être imparfaite, à la fois en qualité mais également en raison de conventions différentes. En effet, malgré les efforts de standardisation, il existe des différences de conventions statistiques entre les pays que les chercheurs de GTAP doivent réconcilier avant d’intégrer ces données dans la base.
Enfin, certaines données très importantes sont parfois tout simplement inexistantes. C’est le cas, notamment, pour la protection des services qui est, on le rappelle, le gros point noir de la modélisation des impacts économiques, obligeant les consultants à les évaluer autrement, comme on l’a vu pour le PTCI. C’est le cas également pour la SIA de l’ALE avec la Corée du sud. En effet, comme le relève le consultant, « la base de données GTAP sur les services montre que toutes les lignes de tarifs sont égales à zéro ». Par conséquent, le consultant ayant établi l’étude d’impact initiale – Copenhagen Economics – a calculé les tarifs via un modèle de gravité simplifié reposant sur un échantillon de pays et d’importations. Pour ce consultant, toute différence dans les importations de services qui n’est pas expliquée directement par une variable du modèle
est la conséquence d’une barrière tarifaire. Il en résulte que les barrières tarifaires sur les services en Corée sont, selon ce consultant, très hautes (46 %) et
bien supérieures à celles en vigueur dans l’UE25 (17 %). Un tel niveau de protection a été ouvertement critiqué par le consultant auteur de la SIA. Il est donc possible que le modèle repose sur des données elles-mêmes issues d’un autre modèle.
De même, c’est très logiquement que les données relatives à l’économie informelle manquent et ne peuvent être qu’estimées, souvent grossièrement. Or, dans certains pays, l’économie informelle peut représenter une part importante, voire prépondérante, de leur PIB. Vos rapporteurs ont ainsi appris lors de leur déplacement qu’au Pérou, on pouvait évaluer la part du travail non déclaré à 70 % et à 50 % en Colombie.
Enfin, ainsi qu’il a été dit supra, les consultants complètent les données manquantes par d’autres moyens comme la consultation des parties prenantes. Toutefois, la qualité de ces consultations est fondamentale. Comme le dit le « handbook », elles doivent être conduites « à chaque étape de la SIA » avec « le champ le plus large possible de parties prenantes » tout « en maintenant une approche équilibrée entre elles » ; or, celle-ci n’est jamais évaluée, comme l’avoue ECORYS dans la SIA de l’ALE avec l’ASEAN. En outre, ces consultations prennent souvent la forme d’un seul et unique atelier sur un ou deux jours, avec l’ensemble des parties prenantes, c’est-à-dire qu’elle s’apparente plus une réunion d’information qu’un réel échange sur l’impact de l’ALE. Les défenseurs des droits humains ne sont pas forcément présents. Les documents ne sont pas traduits dans les langages accessibles et les peuples les plus vulnérables, en particulier, indigènes, ne peuvent donc être consultés directement. Malgré sa meilleure volonté, le consultant n’est pas forcément en mesure, dans le délai qui lui est imparti, de pallier à l’absence d’informations publiques.
En conclusion, malgré la sophistication des modèles et les avancées de la science économique en matière de compréhension du fonctionnement du commerce international, vos rapporteurs rappellent, comme l’étude précitée de l’OMC, que les résultats des modèles sont « des simulations et non pas des prévisions » et regrettent que ce fait évident ne soit pas plus souvent rappelé. Sans vouloir, comme l’une des personnes auditionnées, qualifier les études d’impact de « fantaisistes », vos rapporteurs soulignent que, pour utiles qu’elle soit, la modélisation et ses résultats, bien que fortement mis en avant dans la communication de la Commission, est très loin d’une vérité scientifique. C’est d’autant moins le cas aujourd’hui que l’impact des nouveaux accords de libre-échange, portant essentiellement sur les barrières non tarifaires, est bien plus difficilement modélisable que ne l’étaient les anciens.
Ainsi qu’il a été dit, les études d’impact de la Commission européenne sont multidimensionnelles et visent à évaluer l’ensemble des effets d’un accord de libre-échange, et pas seulement les effets économiques. Elles analysent donc également les impacts sociaux et environnementaux ainsi que l’impact sur les droits humains. Toutefois, si l’analyse des impacts économiques se heurte à des critiques, ce n’est pas le cas de l’évaluation des impacts sociaux et environnementaux dont vos rapporteurs ont pu constater qu’ils étaient d’une manière générale convenablement détaillés, en particulier dans les SIA. En revanche, l’impact sur les droits humains a pendant longtemps été le « parent pauvre » de l’évaluation, victime d’une certaine mauvaise volonté de la Commission.
a. Après avoir longtemps été ignoré, l’impact des ALE sur les droits humains fait désormais l’objet d’une étude de la Commission
Si les études d’impact successives de la Commission européenne font une large part à l’impact économique de l’ALE envisagé, il convient de souligner que les autres impacts ne sont pas ignorés, en particulier dans la SIA mais également dans l’IA. En revanche, l’étude d’impact post-négociations ne traite généralement que de l’impact économique. En effet, celle-ci consiste principalement en l’actualisation des résultats économiques des études précédentes, une fois connues les principales dispositions de l’ALE. Les impacts sociaux et environnementaux de l’ALE, d’ores et déjà identifiés et analysés dans l’IA et, surtout, dans la SIA, n’ont pas à l’être une nouvelle fois.
Si les impacts économiques, sociaux et environnementaux des ALE sont bien évalués dans les études d’impact, l’impact de ces derniers sur les droits humains n’a, pendant longtemps, fait l’objet d’aucune évaluation de la Commission, pas plus d’ailleurs que des consultants qu’elle recrutait. C’est ainsi que les anciennes lignes directrices pour les études d’impact, publiées en 2005, comme le « handbook » de 2006, n’intègrent pas les droits humains et la démocratie dans le champ des études d’impact.
Or, il est évident qu’au-delà de seuls impacts économiques, sociaux et environnementaux, un accord de libre-échange peut aussi avoir un impact, positif ou négatif, sur les droits humains dans le pays concerné, en particulier s’il s’agit d’un pays en voie de développement. En outre, aux termes de l’article 21 du Traité sur l’Union européenne, « l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement. Elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international ». Dans ces conditions, l’absence de prise en compte des droits humains dans l’évaluation préalable des ALE était difficilement compréhensible, si ce n’est comme preuve de la volonté de la Commission de ne pas mélanger commerce et droits humains.
Parce qu’une telle absence des droits humains était insoutenable à terme, les nouvelles lignes directrices, publiées en 2009, imposent une analyse de l’impact sur les droits fondamentaux de toute initiative : « la Commission a décidé que les analyses d’impact devaient prendre en considération les retombées des initiatives sur les droits fondamentaux exposés dans la Charte ». Cette déclaration d’intention n’était pas suffisante pour le Parlement européen qui, dans une résolution du 25 novembre 2010, a demandé à la Commission « d'améliorer son modèle d'évaluation de l'impact sur le développement durable, de façon à prendre dûment en compte les implications des négociations commerciales en matière de droits humains, dans les domaines économique, environnemental et social, y compris les objectifs d'atténuation du changement climatique ».
C’est ainsi que ces lignes directrices ont été complétées par un guide opérationnel pour la prise en compte des droits fondamentaux dans les études d’impact (2011), lequel insiste sur « l’attention qu’il est nécessaire de porter aux possibles impacts sur les droits fondamentaux des accords de l’Union, par exemple dans les études d’impacts accompagnant le mandat de négociation d’un accord de libre-échange ou d’un accord d’investissement ». De plus, même si le « handbook » n’avait pas encore été révisé, le cadre de référence des SIA, qui s’impose aux consultants recrutés par la Commission, les obligeait à établir une évaluation de l’impact sur les droits humains de l’ALE envisagé (9).
Cependant, pour intéressants qu’ils soient, ces progrès en matière d’évaluation de l’impact des ALE sur les droits humains ne pouvaient remplacer l’établissement d’une véritable méthodologie. C’est pourquoi, le 25 juin 2012, le Conseil a adopté un « cadre stratégique pour les droits humains et la démocratie » accompagné d’un plan d’action qui appelait la Commission européenne à incorporer les droits humains dans toutes les études d’impact et à développer une méthodologie pour prendre en compte la situation des droits humains dans les pays concernés par le lancement ou la conclusion d’accord de libre-échange ou d’accord sur les investissements. En d’autres termes, la Commission ne pouvait pas se contenter de règles générales mais devait élaborer une méthodologie précise et spécifique pour l’évaluation de l’impact sur les droits humains des ALE. Cette méthodologie a pris la forme de lignes directrices publiées par la DG Trade le 2 juillet 2015.
Par conséquent, alors que la Commission européenne a établi ses premières lignes directrices en 2005, c’est seulement dix ans plus tard qu’est applicable une méthodologie pour la prise en compte des droits humains dans l’analyse de l’impact des ALE.
En pratique, comme dans le cas de la SIA (voir supra), l’analyse de l’impact sur les droits humains commence par un « screening » des mesures envisagées afin d’identifier celles qui sont susceptibles d’avoir un tel impact. Une fois celles-ci identifiés, le « scoping » vise à les analyser en détail et à expliquer dans quelle mesure et selon quelle(s) modalité(s) elles impacteront les droits humains dans le ou les pays concernés. Il est nécessaire, à cette fin, de tenir compte des conditions préexistantes d’insécurité ou de vulnérabilité, générales ou limitées à certains groupes (femmes, enfants, minorités…). Enfin, sur la base des informations recueillies, notamment auprès de l’ensemble des parties prenantes, l’évaluation doit présenter dans quelle mesure les dispositions envisagées dans l’accord peuvent renforcer ou, au contraire, compromettre la jouissance des droits humains. Toutefois, la Commission précise que « l’analyse doit prendre en compte le fait que les impacts négatifs sur les droits humains puissent être justifiés en termes de nécessité et de proportionnalité ». De même, « elle doit prendre en compte les effets dynamiques et attirer l’attention sur le fait que l’impact à court terme sur les droits humains peut différer de l’impact à long terme ». Par conséquent, il est admis qu’un ALE puisse avoir un impact négatif sur les droits humains pour autant qu’il soit nécessaire et proportionné, voire temporaire.
b. Malgré les progrès, la prise en compte des droits humains dans les études d’impact n’est pas jugée satisfaisante
Si vos rapporteurs tiennent à saluer les progrès enregistrés, les ONG sont loin de les juger suffisants. Dans une étude récente, la Fédération internationale des droits de l’homme dresse un constat sévère de la mise en œuvre des documents précités. Elle note ainsi que, « depuis 2012, la Commission a réalisé trois études d’impact (Japon, Chine, États-Unis) qui manquent toutes d’une dimension sérieuse sur les droits humains ». L’ONG dénonce ainsi le fait que l’étude d’impact de l’ALE avec le Japon contienne seulement cinq paragraphes sur les droits humains ; de même, vos rapporteurs ont constaté que les droits humains font l’objet de quatre paragraphes dans l’étude d’impact sur le PTCI : dans les deux cas la Commission affirme que compte tenu du haut niveau de protection de ces droits, un accord de libre-échange, centré sur le commerce et l’investissement, n’aura pas en tant que tel, d’impact sur les droits humains.
La FIDH considère une telle affirmation comme « hautement critiquable ». Toutefois, il faut reconnaître que le Japon et les États-Unis sont, de longue date, des démocraties garantissant l’État de droit. Certes, tout n’est pas parfait et certaines questions se posent, par exemple la discrimination raciale aux États-Unis ou la peine de mort dans ce pays et au Japon, mais on a du mal à voir quel impact négatif ou positif pourrait avoir un ALE en la matière. La FIDH essaie de lier deux sujets – les droits humains et le commerce qui, dans le cas de ces deux pays, n’ont pas vraiment de lien.
En revanche, la FIDH a touché un point sensible en pointant l’absence de prise en compte des droits humains dans l’étude d’impact de l’ALE UE-Vietnam. En effet, depuis 2012 et l’adoption par le Conseil du « Cadre stratégique pour les droits humains et la démocratie » et du Plan d’action précités (voir supra), la Commission européenne est censée analyser l’impact en termes de droits humains. S’agissant de l’ASEAN, une SIA a été réalisée en 2009 qui ne comporte pas une telle analyse. A priori, rien de plus normal puisque les négociations ont été ouvertes bien avant 2012. En réalité, le processus de négociation a été scindé par pays et relancé le 26 juin 2012 avec le Vietnam. La FIDH estime dès lors que l’absence d’étude d’impact sur les droits humains est « incohérente avec la pratique de la Commission de systématiquement réaliser une étude d’impact dans les cas similaires ». Elle a donc saisi l’Ombudsman européen pour ce qu’elle considère comme un dysfonctionnement.
L’analyse des arguments de la Commission dans cette procédure est intéressante et montre pour le moins une certaine mauvaise volonté de sa part en matière d’étude d’impact sur les droits humains d’un ALE avec un pays qui, pourtant, n’est pas exemplaire sur ce plan. En effet, la Commission considère en substance que :
– l’obligation de réaliser des études d’impact sur les droits humains découle d’un Programme d’action adopté le 25 juin 2012. Elle ne considère pas celle-ci rétroactive et n’a donc pas vocation à s’appliquer aux négociations d’ores et déjà ouvertes, ce qui est le cas du Vietnam qui, malgré la scission et la reprise des négociations le 26 juin 2012 (soit le lendemain dudit Programme d’action), s’insère dans le cadre de la SIA réalisée en 2009. La Commission ajoute qu’une telle rétroactivité aurait des effets « disproportionnés et onéreux » sans préciser lesquels ;
– que la Commission, via le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), est très attentive à la situation des droits humains au Vietnam (et ailleurs). D’ailleurs, elle rappelle avoir organisé de nombreuses consultations avec la société civile et mené un dialogue avec les autorités vietnamiennes sur ces questions, incluant des programmes pour supporter les droits humains au Vietnam, notamment l’accès des groupes vulnérables à la justice ;
– qu’une fois l’ALE en vigueur, une évaluation sera faite de son impact sur la situation des droits humains au Vietnam.
L’Ombudsman a rejeté ces trois arguments avec force dans sa décision du 26 février 2016. En effet, il considère que l’argument de la rétroactivité n’en est pas un et dénonce la mesquinerie de la Commission, rappelant que « le respect des droits humains ne saurait être subordonné à des considérations de simple coût ». Vos rapporteurs partagent cette critique et s’étonnent que la Commission puisse trouver légitime l’argument du coût – d’ailleurs très limité compte tenu des enjeux – d’une étude d’impact pour refuser de la réaliser. En outre, toutes les initiatives qu’a pu prendre la Commission au Vietnam en matière de droits humains, aussi louables soient-elles, ne remplacent en rien une étude d’impact dont l’objet est « d’être un instrument analytique pour démontrer que tous les facteurs nécessaires et circonstances ont été pris en compte dans la définition de la politique commerciale ». Par définition, l’étude d’impact ne peut être postérieure. Elle doit être préalable à l’ALE « car si des impacts négatifs sont identifiés, les mesures envisagées devront être modifiées ou des mesures d’atténuation devront être décidées avant que l’accord entre en vigueur ».
Par conséquent, il a considéré qu’en l’espèce, le refus de la Commission de réaliser une étude d’impact ex-ante de l’ALE sur les droits humains constituait une mauvaise administration.
Cette décision est intervenue à la suite de la recommandation du
26 mars 2015 dans laquelle l’Ombudsman recommandait à la Commission de réaliser une telle étude d’impact. Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet, pas plus que la résolution du Parlement européen du 17 avril 2014 relative à la situation de l’accord de libre-échange UE-Vietnam, qui appelait elle aussi la Commission à réaliser une telle étude. Les négociations de l’ALE UE-Vietnam ont finalement été conclues le 2 décembre 2015, sans que l’impact sur les droits humains ait été évalué.
D’une manière générale, au-delà du cas particulier de l’ALE UE- Vietnam, la FIDH pointe, avec des arguments forts, des faiblesses dans la méthodologie d’analyse de l’impact sur les droits humains mais également la mauvaise qualité des consultations de la SIA, laquelle est pourtant le principal moyen de cette analyse.
Vos rapporteurs rappellent toutefois que les critiques faites par la FIDH portent sur des faits passés et concernent des ALE dont les négociations ont été ouvertes bien avant l’adoption des nouvelles lignes directrices le 2 juillet 2015. Ils espèrent donc que la mise en œuvre de ces dernières conduira à une amélioration substantielle de la qualité des études d’impact sur les droits humains. Il devrait d’ailleurs être très prochainement possible d’en juger puisque des négociations commerciales vont s’ouvrir avec des pays qui sont loin d’être exemplaires en matière de droits humains, en particulier le Mexique et les Philippines (10), sans oublier celles, déjà ouvertes, avec la Birmanie.
C. ILLUSTRATION DE LA DIFFICULTÉ D’ÉVALUER EX-ANTE UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE : LE CAS DE L’AECG ET DU PTCI
Si la politique commerciale de l’Union européenne, longtemps nimbée de mystères, est désormais sous le feu de l’actualité, c’est en raison des forts enjeux qui entourent les négociations du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) avec les États-Unis. Celles-ci, en cours depuis juillet 2013, ont également mis en lumière un autre accord : l’Accord économique et commercial global avec le Canada, dont les négociations sont closes depuis le 26 septembre 2014. Ces deux accords ont vocation – sous toutes réserves s’agissant du PTCI – à être des accords globaux, traitant à la fois du commerce des biens et des services mais également des droits de propriété intellectuelle et de l’investissement ; ils visent enfin à supprimer les barrières non tarifaires à la fois pour le présent mais également pour l’avenir en institutionnalisant une coopération transatlantique en matière de réglementation et ce, dans de très nombreux secteurs importants.
Il n’est donc pas surprenant qu’ils suscitent aujourd’hui l’inquiétude à la fois de l’opinion publique mais également de nombreux Parlements nationaux et du Parlement européen. Or, c’est aussi pour pallier à de telles craintes que des études d’impact sont réalisées ; elles sont en effet sensées, par les bénéfices qu’elles mettent en évidence, rassurer l’opinion publique comme les institutions susmentionnées sur les bienfaits de ces accords. Seulement, ces études, bien que très approfondies, n’en souffrent pas moins des défauts intrinsèques soulignés supra auxquels s’ajoutent leur caractère daté (pour l’AECG) et l’existence de résultats contradictoires (pour le PTCI).
1. L’AECG : un accord aux gains économiques modestes qui repose sur une évaluation ex-ante qui n’a pas été réactualisée
a. Le travail d’analyse préalable très approfondi d’un accord présenté comme favorable aux intérêts de l’Union
L’Accord économique et commercial global est l’un des premiers accords négociés par la Commission européenne après la publication en 2006 de sa Communication « Commerce, croissance et affaires mondiales », laquelle avait tiré les conséquences de l’enlisement du cycle de Doha en relançant les négociations commerciales bilatérales.
Comme l’ensemble des ALE, l’AECG a fait l’objet, préalablement à l’ouverture des négociations, d’une étude d’impact initiale très approfondie, réalisée conjointement par la Commission et le gouvernement canadien, avec toutefois l’appui de deux économistes spécialisées dans la modélisation. Seuls les impacts économiques ont toutefois été évalués, contrairement à la pratique actuelle qui veut que les impacts sociaux, environnementaux et en termes de droits humains soient également analysés, quoique plus succinctement que dans la SIA.
Cette étude d’impact initiale, rendue publique en octobre 2008, débute par une présentation des relations économiques bilatérales mais également des relations du Canada et de l’Union européenne avec les pays tiers. Purement factuelle, cette partie n’appelle pas de commentaire particulier.
Plus intéressante est la deuxième partie, qui constitue le cœur de l’étude d’impact initiale. Cette dernière analyse en effet les barrières qui affectent l’investissement et le commerce de biens et de services entre l’Union et le Canada, avec un focus particulier sur certains secteurs comme les télécommunications, les marchés publics ou les droits de propriété intellectuelle. Elle modélise également l’impact qu’aurait la réduction, voire la suppression de celles-ci, sur la base d’un modèle d’équilibre général calculable dont le fonctionnement est, pour une fois, précisément détaillé, de même que les données utilisées.
S’agissant des échanges de biens, l’étude note que le niveau des droits de douane est relativement bas, à 2,2 % pour les produits canadiens entrant dans l’Union et à 3,5 % pour les produits européens entrant au Canada. En revanche, de très nombreux pics tarifaires subsistent, en particulier dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, les pêcheries, le textile, la construction navale et l’automobile. Les barrières non-tarifaires sont en outre très importantes et peuvent avoir un effet considérable sur les échanges de biens. Toutefois, « il est impossible de présenter en détail toutes les barrières non-tarifaires » et l’étude se contente de deux exemples, l’un sur les règles canadiennes relatives à la composition du fromage, l’autre sur les règles européennes relatives aux produits chimiques.
Les services représentent une part considérable du commerce bilatéral mais ils sont difficiles à quantifier, notamment parce qu’ils sont de plus en plus intégrés dans la production de biens complexes. En outre, les barrières au commerce des services sont très rarement situées à la frontière et sont, pour l’essentiel, non-tarifaires, avec toutes les difficultés d’évaluation en résultant. Si l’étude reconnaît qu’il est « impossible d’analyser tous les facteurs affectant le commerce des services », elle donne deux exemples : les services financiers au Canada et les services d’architecture et d’ingénierie dans l’Union.
Enfin, l’étude montre que, selon l’OCDE, le Canada figure parmi les pays développés les moins accueillants pour l’investissement direct étranger, avec un niveau de protection supérieur à celui de l’Union européenne (mais parfois inférieur à celui de certains États membres). Les services financiers, les télécommunications, le transport et l’électricité figurent parmi les secteurs les plus protégés, tant d’ailleurs au Canada que dans l’UE. Toutefois, cette étude est contestée par d’autres études et le consultant se garde de prendre parti, tout en attirant l’attention sur la difficulté à quantifier le niveau de protection comme l’impact économique de la libéralisation des investissements.
Dans une troisième partie, les plus longs développements de l’étude visent à identifier, au-delà des secteurs précités, ceux qui pourraient faire l’objet d’une coopération bilatérale approfondie (environnement, énergie, pêche…).
Cette étude d’impact initiale a été complétée, en juin 2011, par une étude d’impact sur le développement durable (SIA) détaillant, sur plus de quatre cents pages, les impacts potentiels de l’accord envisagé en termes économiques, sociaux et environnementaux. La méthodologie de la SIA suit les règles du « Handbook » précité et repose sur trois outils :
– la modélisation économique, sur la base d’un modèle d’équilibre général calculable s’appuyant sur la base de données GTAP et quatre scénarios de libéralisation, du plus limité au plus ambitieux. La modélisation a également été utilisée pour évaluer les effets de l’accord sur les émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur les flux d’investissements (via, pour ces derniers, un modèle de gravité dont les limites sont toutefois soulignées) ;
– la recherche documentaire. Ont ainsi été utilisées l’ensemble des sources pertinentes, à savoir la littérature économique, les statistiques et les études de cas ;
– enfin, la consultation des parties prenantes. Comme l’explique le consultant, celle-ci « est une importante source d’informations et de conseils pour l’évaluation ex-ante des impacts. Elle contribue également à la bonne gouvernance, en renforçant la responsabilité et la transparence de l’évaluation ». Cette consultation a pris la forme, classique, de rencontres avec la société civile, d’un atelier de travail à Ottawa et de la création d’un site web dédié permettant la mise à disposition d’informations autant que le recueil de commentaires et d’analyses.
Contrairement à l’étude d’impact initiale, la SIA se concentre sur les effets potentiels de l’accord et ne revient pas sur l’analyse des relations commerciales bilatérales ou l’estimation des barrières au commerce et à l’investissement.
Tant l’étude d’impact initiale que la SIA présentent les impacts potentiels de l’AECG comme favorables aux intérêts de l’Union européenne, sans toutefois ignorer certains aspects négatifs de cet accord. L’étude d’impact initiale, contrairement à la SIA, n’analyse pas les effets potentiels autres qu’économiques.
Les résultats de la modélisation, telle que réalisée dans le cadre de l’étude d’impact initiale, montrent une augmentation de l’activité économique de l’Union européenne, mesurée par le PIB à terme 2014 par rapport à un scénario de référence sans libéralisation, de 11,6 milliards d’euros annuellement, contre 8,2 milliards d’euros pour le Canada. En termes de pourcentage toutefois, le gain est plus important pour le Canada (0,77 %) que pour l’Union (0,08 %), tout en restant particulièrement modeste. Il convient de souligner que la moitié du gain économique pour l’Union provient de la libéralisation des services, un quart de la libéralisation des tarifs sur les biens et un dernier quart de la réduction des coûts associés aux barrières non tarifaires.
S’agissant du commerce bilatéral, le modèle montre une augmentation de 22,9 %, soit 25,7 milliards d’euros dont les deux tiers (18,6 milliards d’euros) concernent le commerce des biens. Le gain pour l’UE s’agissant du seul commerce des biens s’élèverait à 12,2 milliards d’euros, soit une augmentation de 36,6 %, substantiellement plus importante que celle du Canada (+ 24,3 %, soit 6,4 milliards d’euros). Dans les services, l’augmentation du commerce bilatéral est évaluée à 7 milliards d’euros, dont 4,8 milliards pour l’Union (+13,1 %) et 2,2 milliards d’euros pour le Canada (+ 14,2 %).
Du point de vue sectoriel, il est frappant de constater que, selon l’étude d’impact initiale, les exportations de l’Union européenne vers le Canada et du Canada vers l’Union européenne augmenteraient dans les mêmes secteurs : les produits alimentaires transformés, les textiles, le pétrole et la construction, quoique dans des proportions différentes, l’augmentation des exportations européennes étant plus importante. Seules baisseraient les exportations européennes de produits de pêcheries.
La SIA est, tant sur l’évaluation des impacts économiques de l’AECG que sur les autres, bien plus complète que l’étude d’impact initiale, ne serait-ce que parce qu’elle intègre les dimensions environnementales et sociales de l’accord.
S’agissant de l’impact macroéconomique, la SIA estime également que l’AECG aura un impact positif, à long terme, sur le niveau d’activité économique (PIB), tant dans l’Union européenne qu’au Canada. Toutefois, pour l’ensemble des quatre scénarios pris en compte, cet impact est bien plus faible que celui mesuré par l’étude d’impact initiale :
Scénario A |
Scénario B |
Scénario C |
Scénario D |
Étude d’impact initiale | |
UE27 |
+ 0,02% |
+ 0,02% |
+ 0,02% |
+ 0,03% |
+ 0,08% |
Canada |
+ 0,18% |
+ 0,25% |
+ 0,29% |
+ 0,36% |
+ 0,77% |
Il apparaît donc clairement que, bien qu’allant dans le même sens que l’étude d’impact initiale, la SIA est moins optimiste que cette dernière s’agissant l’impact macroéconomique de l’AECG. Même dans le scénario D, qui est le plus ambitieux, la modélisation aboutit à une augmentation de l’activité économique très inférieure, tant pour l’Union européenne que pour le Canada.
Il n’apparaît pas nécessaire, dans le cadre du présent rapport, de rentrer dans le détail d’une étude développée sur plus de quatre cent pages, touchant à la totalité des secteurs économiques européens et canadiens et analysant, pour chacun d’entre eux, l’ensemble des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l’AECG. Vos rapporteurs souhaitent toutefois insister sur le sérieux qui se dégage de cette étude qui, tout en présentant les impacts potentiels positifs de l’AECG, tant pour l’UE que pour le Canada, ne cache rien des éventuels impacts négatifs. Là est en effet l’apport essentiel de la SIA qui met bien en évidence que l’AECG, malgré ses impacts économiques positifs, pourrait avoir de nombreux impacts négatifs, notamment environnementaux.
Par ailleurs, la lecture de la SIA de l’AECG a interpellé vos rapporteurs sur un point précis qui, à partir de 2014, a connu une fortune exceptionnelle dans le débat sur la politique commerciale européenne : le mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États, plus connu sous l’acronyme ISDS (Investors-States Dispute Settlement). L’ISDS est un mécanisme juridique, prévu par un traité, permettant à un investisseur étranger et à lui seul, en cas de différend sur le respect, par un État partie, d’une disposition dudit traité, de voir celui-ci réglé par une instance internationale de préférence aux tribunaux de l’État partie concerné. Un tel mécanisme de protection des investisseurs étrangers existe dans les traités bilatéraux d’investissements depuis 1959 ainsi que dans certains traités plurilatéraux comme l’ALENA ou le Traité sur la Charte de l’énergie.
L’AECG devait comporter un ISDS sous la forme, classique, de tribunaux arbitraux privés et, au cours des négociations, il n’a jamais été question de s’en passer, pas plus que de réformer ce mécanisme. La SIA analyse donc cette disposition en présentant les deux points de vue. Pour ses défenseurs, « l’ISDS apporte une garantie supplémentaire aux investisseurs qui, in fine, apportera des bénéfices économiques à la société », en maximisant l’impact des dispositions de l’AECG relatives à l’investissement. Inversement, ses opposants mettent en avant le fait que l’impact de l’ISDS sur les flux d’investissement n’a jamais été prouvé, que « son utilité entre des pays développés est sujette à caution, en particulier pour l’UE et le Canada compte tenu de la robustesse de leur cadre juridique respectif » et, enfin, que « les investisseurs pourraient abuser de l’ISDS pour chercher à remettre en cause les réglementations nationales », voire les « geler ». Entre ces deux positions, la SIA ne tranche pas, concluant qu’ « il est incertain que l’ISDS créera un bénéfice économique net, de même qu’il est douteux qu’il maximisera ces bénéfices dans une proportion supérieure à ce que ferait un mécanisme interétatique de règlement des différends ».
Vos rapporteurs observent que les mêmes arguments, quasiment au mot près, seront développés à partir de 2014 dans le débat sur la présence de l’ISDS dans le PTCI et l’AECG, aboutissant, on le rappelle, à une profonde réforme de ce mécanisme (11). Ce fait les amène à partager deux réflexions :
– le sérieux avec lequel la SIA de l’AECG, comme d’ailleurs les SIA des autres accords de libre-échange, a été réalisée doit être souligné. Pas un seul aspect de l’évaluation de l’AECG n’a été oublié, y compris les plus politiques et/ou techniques comme l’ISDS ;
– bien que rendue publique, l’analyse de l’ISDS par la SIA en juin 2011 n’a suscité quasiment aucune réaction de la société civile, ce qui doit pour le moins amener à nuancer la critique régulièrement entendue de l’opacité des négociations. Si celles-ci, contrairement à celle du PTCI, ont été menées dans le secret, les enjeux en étaient largement connus, notamment à travers les études d’impact dont le contenu était directement alimenté par les négociateurs.
b. Malgré sa qualité, un travail d’évaluation clairement insuffisant alors qu’approche la signature de cet accord
C’est un fait que vos rapporteurs tiennent à souligner une fois de plus. La Commission européenne ne prend pas l’évaluation ex-ante des accords de libre-échange à la légère. Celle-ci fait l’objet d’analyses très complètes et aussi approfondies qu’il est possible. La SIA sur l’AECG en est un excellent exemple. Toutefois, aussi sérieuse que soient ces évaluations, elles se heurtent à des limites méthodologiques intrinsèques à l’utilisation de la modélisation et, de fait, insurmontables.
L’étude d’impact initiale est par ailleurs bien plus explicite que la SIA sur lesdites limites. Celle-ci est peut-être également explicite mais les explications relatives à la modélisation sont renvoyées à des annexes qui, malheureusement, ne sont pas intégrées au seul document accessible sur le site de la DG Trade.
Ces limites ont été longuement présentées supra et tant l’étude d’impact initiale que la SIA de l’AECG en constituent de parfaites illustrations sur au moins trois points. Le premier est le caractère très incertain des hypothèses retenues dans le modèle qui, pour certaines, se sont tout simplement révélées fausses. C’est ainsi que l’étude d’impact initiale postule que le prix du pétrole augmenterait de 82 % entre 2004 et 2014. Avec le recul, il est facile de constater que ce prix a été multiplié par quatre de 2004 à 2008 avant d’être divisé par cinq à la suite d’une crise financière majeure qui, évidemment, n’avait pas été prévue. Des variations aussi brutales du prix du pétrole mais aussi du gaz et de l’ensemble des matières premières, ajoutées à la « révolution des gaz et pétrole de schiste » qu’a connue le Canada, remettent en cause la fiabilité de l’évaluation dans des secteurs aussi importants que les mines, l’énergie ou la chimie. La crise financière de 2008 explique également que l’hypothèse de croissance moyenne annuelle retenue pour l’Union européenne sur la période, à savoir 2,55 %, s’est révélée totalement irréaliste. Elle s’est effet établie, selon Eurostat, à 0,9 % (UE28). Enfin, la SIA note que ses conclusions « s’appuient très largement sur la modélisation et les hypothèses utilisées s’agissant du niveau de libéralisation qui pourrait être atteint dans l’AECG. Pour l’agriculture, une hypothèse majeure est celle du succès du cycle de Doha », hypothèse retenue « en accord avec la demande de la DG Trade ». Or, ce succès lui-même a fait l’objet d’hypothèses en matière de réduction des droits de douane sur les produits agricoles, des subventions internes et des aides à l’exportation qui ne se sont pas réalisées.
Le deuxième point est le défi que représente l’évaluation en matière de barrières non-tarifaires. L’étude d’impact initiale note ainsi qu’« il y a très peu d’informations sur la mesure dans laquelle ces différentes mesures [réglementaires] constituent des barrières, d’une part, et si elles peuvent être réduites par le biais d’une libéralisation ou d’une facilitation du commerce, d’autre part ».
Ce point est d’autant plus problématique que l’essentiel du gain de l’AECG doit découler de la réduction des barrières non-tarifaires, en particulier dans le secteur des services. Comme l’explique l’auteur de l’étude d’impact initiale, « évaluer l’impact d’une libéralisation pour les services est bien plus compliqué que dans le cas des biens. Alors qu’une base de données complète est disponible pour les barrières tarifaires en matière de biens, l’équivalent pour les services n’existe pas. De plus, considérant le fait que les barrières dans le commerce des services sont généralement une partie d’un cadre réglementaire plus large gouvernant les prestations de services dans une juridiction donnée, la mesure par laquelle les mesures de libéralisation peuvent réduire les aspects néfastes de ces régulations pour le commerce est aujourd’hui impossible à mesurer directement ». Dans ces conditions, « tant le niveau de ces barrières que la mesure dans laquelle la réduction est faisable doit être déduite à travers l’analyse économétrique », c’est-à-dire en pratique en recourant à un modèle de gravité.
Les limites de l’évaluation ne concernent pas seulement la modélisation mais également l’autre méthode que constitue la recherche documentaire. Les études académiques sont parfois contradictoires entre elles, notamment sur l’investissement. Pour l’OCDE, ainsi qu’il a été indiqué supra, le Canada est un pays fermé aux investissements étrangers. Or, les auteurs de l’étude d’impact initiale notent que « la méthodologie de l’OCDE a ses limites. En effet, ses propres auteurs reconnaissent qu’elle ne présente qu’une vision partielle de l’environnement d’investissement. Une autre étude (12), pointe le fait que l’indicateur OCDE ne prend pas en compte les barrières imposées par les entreprises publiques et les sociétés mixtes ainsi que celles détentrices de droits spéciaux. Alors que ce fait tend à aggraver les restrictions, l’étude montre également que d’autres études estiment au contraire que les restrictions sont surestimées. Le Canadian Competition Panel a ainsi critiqué, dans une étude (13), la vision selon laquelle le Canada serait fermé aux investissements étrangers ». Il en veut pour preuve que la part des investissements directs étrangers dans le PIB représente, au Canada, le double des États-Unis.
Non seulement les études s’opposent quant au degré de fermeture du Canada aux investissements étrangers – ce qui complique logiquement l’évaluation de l’impact de l’ALE en matière d’IDE – mais l’étude d’impact initiale indique que « la quantification de l’impact de la libéralisation des IDE n’en est qu’à ses balbutiements. Actuellement, il y a des difficultés insurmontables à évaluer le niveau des barrières résultant de la réglementation nationale et à déterminer dans quelle mesure de telles barrières peuvent être réduites avec la libéralisation. Dès lors, une quantification explicite de l’impact de la libéralisation des investissements n’est pas tentée dans la présente étude ». Quant à la SIA, elle ne tente pas plus de quantifier l’effet de l’AECG sur l’investissement, disant simplement qu’il serait « moins que significatif ».
Enfin, les consultants sont parfaitement conscients des limites de la modélisation elle-même. L’étude d’impact initiale souligne ainsi que « la plupart des effets en réponse à un changement de politique en matière de commerce et d’investissement se situe au niveau des entreprises, ce qui met les modèles d’EGC dans une position défavorable car ils ne prennent en compte les effets au niveau des entreprises qu’à un niveau très abstrait ». De même, « les modèles d’EGC ne peuvent pas anticiper les futurs changements du paysage industriel international résultant des tendances macroéconomiques, des changements de parité monétaire, des évolutions technologiques et de l’évolution des avantages de pays individuellement en réponse aux changements de politique concomitamment faits dans l’ensemble des pays ».
Ainsi qu’il a été dit supra, l’étude d’impact initiale date d’octobre 2008 et la SIA de juin 2011. Or, c’est peu dire que bien des événements se sont produits depuis qui les ont directement remis en cause, à commencer par la crise financière bien sûr, mais surtout la conclusion des négociations de l’AECG le 26 septembre 2014. Cette date a ouvert une période de « toilettage juridique » qui s’est achevée le 29 février 2016 par la publication du texte définitif de l’accord. Par conséquent, quasiment deux ans se sont écoulés depuis la conclusion des négociations et on aurait pu s’attendre à ce que ce délai soit mis à profit pour la réalisation d’une nouvelle étude d’impact qui prenne en compte le nouveau contexte économique mais également le texte définitif de l’AECG puisque, on le rappelle, tant l’étude d’impact initiale que la SIA reposait sur de simples scénarios, d’ailleurs différents selon les deux études. Une telle étude d’impact, post-négociation, avait d’ailleurs été réalisée pour l’ALE UE-Corée du Sud.
Lorsqu’ils ont rencontré la DG Trade à Bruxelles le 5 avril dernier, vos rapporteurs l’ont interrogée sur la réalisation d’une nouvelle étude d’impact d’ici à l’approbation de l’AECG par le Conseil et le Parlement européen. Ils n’ont pas obtenu de réponse claire. Maintenant que ces deux institutions doivent examiner l’accord très prochainement, force est de constater que ce ne sera pas le cas alors même que le Brexit est entre-temps devenu une perspective certaine. Par conséquent, ils se prononceront sur l’AECG sur la base d’évaluations remontant à plusieurs années et, de ce fait, en partie dépassées.
Une telle absence de d’actualisation de l’impact, au moins économique, de l’AECG laisse songeur car la Commission disposait du temps nécessaire pour la mener comme des quelques dizaines de milliers d’euros qu’une nouvelle étude aurait coûtés. Il faut donc considérer qu’elle n’a pas la volonté de la réaliser, n’en voyant peut-être pas l’intérêt après le travail considérable réalisé par la SIA. Toutefois, vos rapporteurs considèrent cette absence d’une étude d’impact post-négociations comme une erreur aussi majeure que le refus, jusqu’au PTCI, de publier les mandats de négociation. Cette décision affaiblit la position de la Commission dans sa défense de l’AECG et nuit à la crédibilité du processus d’évaluation dans son ensemble.
2. Le PTCI : les conclusions de l’étude d’impact de la Commission nuancées par de nombreuses analyses indépendantes
Contrairement à l’AECG, en voie d’être signé et approuvé, les négociations du PTCI sont toujours en cours – le 14ème round de négociation s’est tenu à Bruxelles en juillet 2016 – et, malgré certaines déclarations optimistes, sont encore très loin d’être achevées. Si une étude d’impact initiale a bien été produite, appuyée sur une étude économique du Center for Economic Policy Research (CEPR), et publiée en mars 2013, la SIA n’a pas encore été réalisée. Seul a été publié, par ECORYS, le rapport initial (« inception report »). Par conséquent, vos rapporteurs présenteront, dans les développements à suivre, les conclusions de l’étude d’impact initiale et les analyseront à la lumière des critiques qui lui ont été faites, notamment par le Parlement européen.
Les conclusions de l’étude d’impact de la Commission sont bien connues puisqu’ils sont régulièrement mis en avant dans le débat sur le PTCI depuis 2013. Celle-ci se contente, pour une très large part, de synthétiser les résultats de l’étude du consultant CEPR publiée à la même date.
En préalable, il convient de souligner que cette étude s’appuie sur l’étude du consultant ECORYS, publiée en 2009 et consacrée à l’évaluation des barrières non-tarifaires aux échanges et à l’investissement entre les États-Unis et l’Union européenne. La méthodologie utilisée pour l’évaluation a été présentée supra et repose, pour l’essentiel, sur l’appréciation que les entreprises américaines et européennes ont de ces barrières et de leur niveau. La transformation de cette appréciation en équivalent ad valorem (c’est-à-dire leur impact sur le prix) est réalisée par un modèle de gravité. Le consultant estime ainsi ces barrières, s’agissant des seuls flux commerciaux (à l’exclusion des flux d’investissement) :
– frappant les exportations américaines vers l’Union européenne, à 21,5 % en moyenne pour les biens et à 8,5 % en moyenne pour les services, avec des pics à 76,8 % pour les produits alimentaires et les boissons et à 25,5 % pour les véhicules automobiles ;
– frappant les exportations européennes vers les États-Unis, à 25,4 % en moyenne pour les biens et à 8,9 % en moyenne pour les services, avec des pics à 73,3 % pour les produits alimentaires et les boissons et à 26,8 % pour les véhicules automobiles.
Par conséquent, l’étude CEPR met en évidence plusieurs points intéressants s’agissant des barrières non tarifa ires : que celles-ci sont plus élevées aux États-Unis qu’en Europe, qu’elles sont plus élevées pour les biens que pour les services et qu’elles concernent exactement les mêmes secteurs des deux côtés de l’Atlantique, notamment les produits alimentaires et les boissons ainsi que les véhicules automobiles.
L’étude de CEPR repose exclusivement sur la modélisation via le modèle d’équilibre général calculable GTAP. Cinq scénarios ont été modélisés, du plus modeste au plus ambitieux :
– un scénario A « barrières tarifaires uniquement », avec une élimination de 98 % des barrières tarifaires ;
– un scénario B « services uniquement », avec une réduction de 10 % des barrières non tarifaires ;
– un scénario C « marchés publics uniquement », avec une réduction de 25 % des barrières non-tarifaires dans ce secteur ;
– un scénario D « complet mais limité », incluant une élimination de 98 % des barrières tarifaires, une suppression de 10 % des barrières non-tarifaires pour les biens et les services et de 25 % s’agissant des marchés publics ;
– un scénario E « complet et ambitieux », incluant une élimination de 98 % des barrières tarifaires, une suppression de 25 % des barrières non-tarifaires pour les biens et les services et de 50 % s’agissant des marchés publics.
Par ailleurs, l’ensemble des scénarios incluent un « spill-over effect » ou effet d’entraînement, direct et indirect, qui a été présenté supra lorsqu’ont été analysées les méthodes de modélisation.
L’impact économique des trois scénarios limités – A, B et C – est, comme on pouvait l’attendre, limité, tant pour les États-Unis que pour l’Union européenne, bien moindre que l’impact des deux scénarios complets – D et E. Cependant, quel que soit le scénario, l’impact est positif sur le PIB.
Indicateur |
Zones |
Scénario A |
Scénario B |
Scénario C |
Scénario D |
Scénario E |
PIB (en %) |
UE27 |
+ 0,1% |
+ 0,02% |
+ 0,02% |
+ 0,27% |
+ 0,48% |
États-Unis |
+ 0,04% |
+ 0,03% |
+ 0,01% |
+ 0,21% |
+ 0,39% | |
PIB (en M€) |
UE27 |
+ 23 753 |
+ 5 298 |
+ 6 367 |
+ 68 274 |
+ 119 212 |
États-Unis |
+ 9 447 |
+ 7 356 |
+ 1 875 |
+ 49 543 |
+ 94 904 |
L’étude a décomposé cet impact selon sa cause, du moins pour les scénarios D et E. Il apparaît ainsi très clairement que c’est la réduction des barrières non tarifaires aux échanges de biens qui contribue le plus à l’augmentation du PIB, tant pour l’Europe que pour les États-Unis. Plus précisément, la moitié du gain peut lui être attribué.
Le tableau suivant synthétise l’impact des différends scénarios s’agissant de la valeur des exportations bilatérales. On retrouve les mêmes différences que dans l’évaluation de l’impact sur le PIB : le scénario E est de très loin celui qui présente le plus d’avantages pour l’Union européenne (et les États-Unis).
Indicateur |
Zones |
Scénario A |
Scénario B |
Scénario C |
Scénario D |
Scénario E |
Exportations |
UE27 |
+ 44,0 |
+ 4,6 |
+ 3,0 |
+ 108,0 |
+ 187,0 |
États-Unis |
+ 54,0 |
+ 2,9 |
+ 3,4 |
+ 101,0 |
+ 159,0 |
L’étude du CEPR, comme l’étude d’impact elle-même de la Commission, détaille également, secteur par secteur, l’impact des cinq scénarios précités, tant pour les États-Unis que pour l’Union européenne. Il mesure également les effets de ceux-ci sur le montant des droits de douane, le détournement des flux intra-européens et internationaux ainsi que les changements structurels dans la production et les exportations en Europe et aux États-Unis. S’appuyant sur l’étude CEPR mais également sur ses propres consultations, la Commission examine plus précisément les effets des scénarios D et E sur les PME ainsi que sur trois secteurs : les équipements électriques et électroniques, l’assurance et les véhicules automobiles (y compris les pièces détachées). Il apparaît qu’un accord avec les États-Unis serait défavorable à l’Union s’agissant du premier de ces secteurs et favorable s’agissant des deux derniers. Les éventuels impacts économiques négatifs de l’accord ne sont donc pas passés sous silence.
D’une manière générale, on observe que l’analyse du CEPR, comme l’étude d’impact de la Commission elle-même, est bien plus approfondie pour les deux scénarios d’accords complets que pour les autres. C’est le cas s’agissant de l’impact économique mais également des impacts sociaux et environnementaux. En effet, ces derniers ne sont pas évalués pour les scénarios
A, B et C.
S’agissant de l’impact environnemental, l’étude de la Commission s’appuyant sur des consultations comme sur les résultats de la modélisation économique s’agissant du niveau et de la structure de la production et des échanges de l’UE et des États-Unis, estiment que l’effet de l’accord le plus ambitieux (scénario E) sera limité. En effet, « la production supplémentaire de ces économies devra respecter les plafonds existants d’émission de CO2 à travers une combinaison d’amélioration de l’efficacité (notamment énergétique) et une réallocation de la production vers des secteurs plus propres. Les changements dans la composition de ces économies résultant de l’accord de libre-échange pourraient aussi conduire à une réallocation de la production dans les pays tiers » et notamment en Chine. De même, le scénario E mais également les autres auront, par principe, un impact négatif sur les ressources naturelles, les déchets et la biodiversité, en raison de l’augmentation de la production qu’ils prédisent. Toutefois, cet impact sera minimal. L’augmentation de la pression sur les ressources naturelles est ainsi évaluée à 0,01 % dans le cas d’un accord complet et ambitieux. En outre, ces effets négatifs sont susceptibles d’être contrebalancés par les bénéfices résultant de l’augmentation du commerce des biens environnementaux comme des progrès technologiques en matière de réduction des émissions résultant d’une meilleure coopération transatlantique.
L’impact social du PTCI est également évalué, en particulier pour les scénarios D et E. Il est clairement affirmé que cet accord « créera de nouvelles opportunités économiques pour un montant de plusieurs centaines de milliards d’euros, lesquelles se traduiront par des centaines de milliers de nouveaux emplois des deux côtés de l’atlantique ». De même, les salaires des travailleurs qualifiés et non qualifiés sont susceptibles d’augmenter, quoique faiblement.
Les potentiels impacts négatifs de l’accord ne sont pas pour autant oubliés, même s’ils sont minimisés. C’est ainsi que « les aires urbaines sont mieux outillées pour répondre aux défis du commerce international alors que les régions rurales sont plus vulnérables ». De plus, le modèle capture la réallocation des travailleurs entre les secteurs qui résulterait du changement de politique commerciale. C’est ainsi que, selon les scénarios, certains secteurs gagneront des emplois alors que d’autres en perdront. Dans le scénario E, l’étude d’impact relève que le secteur primaire sera sous pression, notamment certains secteurs agricoles. Cependant, « la potentielle réduction de l’emploi dans certains secteurs pourrait être contrebalancée par plus d’emplois et de plus hauts salaires dans les secteurs qui auront bénéficié de la libéralisation des échanges ».
Au final, l’étude d’impact de la Commission se conclut par la recommandation d’un accord complet et ambitieux avec les États-Unis.
Depuis qu’elles ont été lancées en 2013, les négociations du PTCI ont suscité de très nombreuses études, plus qu’aucune autre avant elles. Un tel foisonnement d’analyses tient naturellement à l’ampleur de l’accord envisagé : non seulement il lierait les deux premières puissances économiques mondiales mais il vise à créer un véritable marché transatlantique en faisant converger les réglementations américaines et européennes. Ces riches matériaux permettent, pour la première fois, de faire une véritable contre-expertise de l’étude d’impact initiale de la Commission.
À la demande du Parlement européen, le Centre for European Policy Studies (CEPS) a produit « une évaluation de l’étude d’impact de la Commission européenne, en particulier du modèle économique » (14), en pointant les forces et les faiblesses tout en les relativisant. Il est possible de la résumer en trois points, en précisant d’ores et déjà que les critiques portent autant voire plus sur la modélisation elle-même que sur son utilisation dans ce cas particulier par la Commission et le CEPR.
Le premier point a déjà été longuement étudié dans le cadre du présent rapport et sera rapidement évoqué. Le CEPR souligne, comme l’ont fait vos rapporteurs, que le PTCI est un accord de nouvelle génération et, qu’à ce titre, « sa nature est plus celle d’un vaste accord sur la réglementation, avec quelques éléments d’un accord de libre-échange classique ». Cette nature « rend extrêmement difficile l’analyse de l’impact économique du résultat des négociations. Les barrières non-tarifaires et les différences réglementaires entre les États-Unis et l’Union européenne créent des coûts d’accès au marché qui sont difficiles à évaluer précisément, de même que leurs conséquences sur les biens et les services ».
Cette difficulté de l’évaluation rappelée, le CEPS décerne une sorte de satisfecit à la Commission et à son consultant. En effet, le modèle d’équilibre général calculable utilisé représente « l’état de l’art de la science économique ». Les économistes du CEPS « ne connaissent pas de meilleurs instruments pour évaluer les effets à long terme d’un tel accord ». Non seulement les modèles EGC permettent seuls de modéliser le comportement des différents acteurs sur l’ensemble des marchés mais la base de données GTAP 8 utilisée « représente une source de données complètes et fiables collectées dans le monde entier afin d’assurer un tableau robuste des flux commerciaux ». En outre, la base de référence utilisée dans le modèle – c’est-à-dire l’état actuel du commerce et des investissements bilatéraux – est « correctement analysée » et les perspectives de l’économie mondiale n’ont pas été présentées « de manière déraisonnable ».
C’est un point qu’il est important à souligner. La modélisation économique via les modèles d’équilibre général calculable est incontournable dans l’évaluation des accords de libre-échange. Même si elle a des limites, il n’y a pas d’outils meilleurs à disposition.
Enfin, malgré ce satisfecit, le CEPS adresse plusieurs critiques à la Commission s’agissant de la méthodologie retenue. Trois apparaissent particulièrement significatives et de nature à nuancer les bénéfices que l’étude d’impact voit dans le PTCI.
Les deux premières sont inhérentes aux modèles d’équilibre général calculable. C’est un fait bien connu – et déjà rappelé par vos rapporteurs – que ces modèles sont inadaptés à saisir pleinement les changements en matière d’emplois induits par un ALE. Tout au plus sont-ils capables de mesurer la réallocation des emplois entre les secteurs économiques et les évolutions du salaire des travailleurs qualifiés et non-qualifiés. C’est ce qu’a fait le CEPR. En revanche, il ne dit rien sur le niveau de chômage ou la création d’emplois, tout simplement parce que, sur le long terme, ces modèles postulent un équilibre parfait entre l’offre et la demande de travail. C’est donc la Commission, dans son étude d’impact, qui a pris sur elle d’affirmer que le PTCI créera des centaines de milliers d’emplois des deux côtés de l’Atlantique.
L’autre critique porte, très logiquement et à nouveau, sur la modélisation des barrières non tarifaires et de l’impact de leur réduction. Comme l’explique le CEPS, « il est extrêmement difficile de prendre en compte les barrières non tarifaires dans un modèle […]. Le coût des barrières réglementaires (c’est-à-dire des équivalents ad valorem des barrières non tarifaires) est un problème majeur et la Commission a fait le choix de la sécurité en s’appuyant sur l’étude ECORYS ». Toutefois, cette dernière n’est pas exempte de failles méthodologiques. C’est ainsi que les barrières tarifaires sont calculées par secteurs et, par conséquent, présumées identiques pour l’ensemble des activités qu’ils recouvrent. Le secteur de la chimie, par exemple, malgré toute la variété des activités concernées, est ainsi considéré comme confronté à un seul niveau de barrières non tarifaires, ce qui est absurde mais nécessaire pour la modélisation.
Une autre faille, dûment identifiée par le CEPS, est le choix fait par ECORYS de regrouper deux barrières en une : les mesures non tarifaires stricto sensu, c’est-à-dire les barrières spécifiques à un produit ou un service, et ce qui relève de la divergence réglementaire. Cette dernière recouvre naturellement les premières mais sans que l’on sache exactement dans quelle proportion. Or, « cette distinction a des implications immédiates dans la manière dont les mesures non tarifaires (au sens large) sont modélisées en termes de coûts ».
Enfin, le CEPS relève que, d’une manière générale, les modèles d’EGC ne modélisent pas les marchés publics, pas plus qu’ils incluent un scénario spécifique de libéralisation de ceux-ci. « L’étude du CEPR semble ainsi être l’exception, sachant que les détails de la modélisation de l’ouverture des marchés publics ne sont pas bien expliqués ». En principe, il est possible de réaliser une telle modélisation puisque la base de données GTAP contient un secteur « Government ». Toutefois, ce secteur peut être interprété de manière étroite – incluant l’administration publique stricto sensu, l’éducation, la santé et la défense – ou large, en incluant le sport, la culture ou encore les utilities. Rien n’est dit, dans l’étude du CEPR, sur l’interprétation qu’il a retenue. En outre, le véritable problème est que la difficulté à quantifier la discrimination vis-à-vis des étrangers. Le CEPR a fait le choix d’associer une réduction des barrières non tarifaires à une ouverture des marchés publics. Cependant, comme l’effet d’une telle réduction est aussi modélisé dans les autres scénarios plus larges, ils incluent nécessairement la libéralisation des marchés publics dont l’impact ne peut donc être isolé. Le CEPS conclut en indiquant qu’à sa connaissance, « il n’y a aucune tentative réussie de modélisation de l’ouverture des marchés publics aux firmes étrangères dans les modèles d’ECG ».
Enfin, la dernière critique du CEPR porte sur un point particulier de l’étude d’impact : l’effet d’entraînement ou « spill-over effect ». Pour mémoire, le CEPR, repris par la Commission, estime que la réduction des barrières non tarifaires dans les deux économies les plus importantes du monde et leur coopération en matière réglementaire auront des effets positifs pour les pays tiers mais également, indirectement, pour les exportateurs américains et européens puisque ces mêmes pays tiers pourraient être amenés, par un effet d’entraînement, à adopter les standards définis en commun. L’effet d’entraînement direct est ainsi évalué à 20 % du gain découlant de la réduction des barrières non-tarifaires et, s’agissant de l’effet d’entraînement indirect, à 10 % de celui-ci. Le CEPS considère que ces pourcentages sont « arbitraires » et que l’effet d’entraînement ne doit pas être tenu pour acquis. En d’autres termes, l’incertitude à peu près totale sur l’existence et l’ampleur de cet effet d’entraînement est de nature à réduire les bénéfices attendus du PTCI, à la fois pour l’Union européenne, les États-Unis et les pays tiers.
En définitive, le Parlement européen, à travers l’étude du CEPS, reconnaît le sérieux de l’évaluation faite par la Commission mais attire l’attention sur les inévitables limites de la modélisation économique en général et les problèmes méthodologiques du modèle utilisé en l’espèce pour le PTCI.
Le PTCI a suscité de nombreuses autres études, à la fois en Europe et aux États-Unis, mais deux ont particulièrement retenu l’attention de vos rapporteurs : celle de la fondation allemande Bertelsmann (2013) et celle de l’université américaine de Tufts (2014).
Ces deux études ont en effet en commun – et a priori, elles sont les seules dans ce cas – de ne pas utiliser un modèle d’EGC pour l’analyse de l’impact du PTCI. L’étude Bertelsmann, pour commencer, repose sur une méthodologie tout à fait originale. Sa base de référence est l’ensemble des flux commerciaux bilatéraux entre 126 pays (soit 15 750 paires) ainsi que le PIB de chacun d’entre eux pour l’année 2007. Sur cette base et en s’appuyant sur les élasticités, les obstacles au commerce (ou coûts commerciaux) ont été estimés par une équation de gravité, permettant d’évaluer ce que devrait être le niveau des échanges commerciaux. La comparaison entre cette estimation et le niveau actuel des échanges commerciaux permet non seulement d’évaluer les barrières au commerce mais également l’impact d’une réduction de celles-ci, à la fois sur le commerce et sur le PIB. En outre, contrairement aux modèles d’ECG, qui sont multirégionaux, ce modèle permet une désagrégation au niveau national de l’impact du PCTI. Enfin, il a été complété par une analyse néokeynésienne du marché de l’emploi, permettant d’évaluer son impact sur les créations d’emplois.
L’étude de l’université de Tufts propose quant à elle une évaluation alternative sur la base du modèle des politiques mondiales des Nations-Unies (modèle GPM). Comme l’explique l’étude, le GPM est un modèle économétrique mondial axé sur la demande qui, selon ses auteurs, présente trois avantages :
– l’hypothèse de plein emploi des modèles d’EGC étant remplacée par le principe keynésien de demande effective, le niveau de l’activité économique est stimulé par la demande globale plus que par l’efficacité productive. Par conséquent, « une modification de la politique commerciale via la réduction des coûts pourrait avoir des effets défavorables pour l’économie si les coûts qu’elle réduit portent sur les revenus du travail qui soutiennent la demande globale ». Contrairement aux modèles d’EGC, les changements dans la distribution des revenus contribuent donc à déterminer le niveau de l’activité économique ;
– le modèle fournit des informations précises sur les interactions économiques entre les régions, si bien qu’il permet d’évaluer si une stratégie politique donnée est durable à l’échelle mondiale. Par exemple, le GPM prouve que, lorsqu’elle est mise en œuvre par tous les pays, une politique de croissance fondée sur la hausse des exportations pourrait avoir des conséquences négatives ;
– enfin, le GPM a la capacité d’évaluer l’emploi, en démontrant comment les variations de croissance du PIB affectent la croissance de l’emploi et réciproquement. Le modèle « peut ainsi expliquer la mystérieuse occurrence d’évènements récents comme la croissance sans emploi ».
La mise en œuvre du modèle GPM par l’université de Tufts repose sur plusieurs paramètres : c’est ainsi que l’augmentation du volume des échanges résultant du PTCI n’est pas calculée par le modèle mais reprises des autres études. Cependant, ses conséquences sur le PIB, la distribution des revenus ou l’emploi sont bien évaluées à travers le modèle GPM. En outre, le modèle prend en compte deux mécanismes originaux :
– la concurrence internationale accrue résultant du PTCI aurait des effets sur la demande ; en effet, les entreprises, cherchant à rester concurrentielles à l’échelle internationale, pourraient s’efforcer de réduire davantage les coûts salariaux, affaiblissant d’autant la demande globale ;
– la possibilité, pour les gouvernements et les institutions financières, confrontés à une baisse de la demande intérieure, de faciliter l’endettement privé. Par conséquent, le prix des actifs pourrait augmenter et, avec lui, l’instabilité des économies concernées.
Les résultats de ses deux études apparaissent très différents de ceux des autres études basées sur un modèle d’EGC, même si, comme ces dernières, l’étude Bertelsmann considère que le PTCI aurait un impact économique positif sur l’Union européenne. Cette étude pronostique en effet, dans le cas d’un accord de libre-échange complet et approfondi, une augmentation du revenu réel par habitant, même si elle met en évidence, grâce au modèle de gravité, de fortes disparités entre les États membres. C’est ainsi que le revenu réel par habitant augmenterait de 2,64 % en France mais de 9,7 % au Royaume-Uni. La France est ainsi le pays qui profiterait le moins du PTCI, après le Luxembourg. En revanche, le PTCI aurait un impact très négatif sur le reste du monde en raison des forts effets de détournement des flux commerciaux qu’il entraînerait, en particulier vis-à-vis des partenaires traditionnels de l’UE et des États-Unis. Le revenu réel par habitant baisserait ainsi de 9,5 % au Canada, de 5,9 % au Japon ou encore de 3,5 % en Algérie. L’étude reconnaît cependant que ces chiffres, s’ils indiquent une tendance, sont probablement très exagérés.
S’agissant de l’impact du PTCI sur l’emploi, il est également positif, en particulier pour les États-Unis qui devraient enregistrer, dans le cas d’un ALE complet et approfondi, la création de plus d’un million d’emplois. L’Union européenne, dans son ensemble, verra également le niveau d’emploi s’accroître de 1,3 million, l’ensemble des États membres en bénéficiant. La France, par exemple, devrait connaître 121 566 créations d’emplois et le Royaume-Uni plus de 400 000. En revanche, l’impact sera négatif pour les partenaires commerciaux de l’Europe et des États-Unis, en particulier pour le Canada
(-101 854), le Japon (-71 833) et le Turquie (-94 831).
En d’autres termes, comme les autres études, l’étude Bertelsmann conclut à un impact favorable du PTCI, parfois même plus favorable que ces dernières, tout en pointant les effets négatifs du détournement de flux comme les disparités entre les États membres, mis en évidence par le modèle de gravité.
Très différentes sont en revanche les conclusions de l’étude de l’université de Tufts, parfois même totalement contradictoires avec celles de l’étude Bertelsmann. En effet, même si l’étude postule, en s’appuyant sur les autres études, une augmentation des flux commerciaux entre l’UE et les États-Unis, le modèle GPM montre que celle-ci entraînera des pertes nettes pour l’ensemble des principales variables de l’Union européenne, incluant les exportations européennes nettes vers le reste du monde. Cet apparent paradoxe s’explique de la manière suivante : « alors que l’économie de l’UE stagne, la demande intérieure pour des produits manufacturés à faible valeur ajoutée – secteur dans lequel l’Europe est peu concurrentielle – surpassera celle pour les produits à forte valeur ajoutée. En effet, nos chiffres indiquent une augmentation des exportations nettes dans presque toutes les autres régions du monde excepté l’Europe, ce qui implique qu’une plus forte demande de produits à faible valeur ajoutée entraînera une hausse des importations nettes en provenance des économies africaines et asiatiques ainsi que des États-Unis ».
Or, « les exportations nettes sont une composante clé du PIB. Ainsi, la perte nette dans les échanges commerciaux réduira directement le revenu national des pays de l’Union européenne ». C’est ainsi que le PIB allemand devrait diminuer de 0,29 % et le PIB français de 0,48 %. En termes d’emploi, les résultats ne sont pas meilleurs puisque l’Europe devrait perdre 600 000 emplois, dont 130 000 en France et 134 000 en Allemagne. À l’inverse, le PIB des États-Unis devrait croître de 0,36 % et l’emploi augmenter de 734 000.
Par conséquent, le cas du PTCI illustre très clairement le fait – dont on pouvait se douter – que le choix d’un modèle impacte très fortement les résultats de l’évaluation, au point de les inverser totalement. Toutefois, il convient de souligner que l’utilisation du modèle GPM pour l’évaluation de l’impact d’un accord de libre-échange est inédite et très controversée.
À l’issue de cette première partie sur l’évaluation ex-ante des accords de libre-échange, il est possible de tirer de l’ensemble de ses développements plusieurs conclusions importantes. La première, c’est que cette évaluation est réalisée de manière sérieuse par la Commission européenne qui utilise l’ensemble des instruments à sa disposition pour parvenir à une vision aussi claire que possible de l’impact d’un ALE, sous le contrôle, désormais, du Parlement européen. Toutefois – et c’est la deuxième conclusion, ces instruments ont leurs limites et, en particulier, la modélisation qui, tout au plus, permet de dégager des tendances. Il faut admettre que l’extraordinaire complexité des ALE de « nouvelle génération » et, en particulier, la place qu’ils donnent à la réduction des barrières non-tarifaires rendent impossible une évaluation précise de leurs impacts potentiels. Enfin, la troisième conclusion porte sur l’utilisation qui est faite de ces évaluations dans le débat démocratique. Souvent présentées comme des faits, il est rarement fait mention de leurs limites, notamment par la Commission, probablement parce qu’elles sont essentielles à la justification de l’ouverture de négociations commerciales qu’elles légitiment.
II. SI L’ÉVALUATION EX-POST S’EST RÉCEMMENT DÉVELOPPÉE À L’INITIATIVE DE LA COMMISSION, SA PORTÉE SUR LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EST ENCORE TRÈS LIMITÉE
La première partie du présent rapport a mis en évidence que les accords de libre-échange de l’Union européenne font l’objet, depuis le début des années 2000, d’une évaluation préalable systématique et très approfondie – malgré ses faiblesses – de la Commission, dont la portée est grande puisqu’elle conditionne largement l’ouverture des négociations comme l’approbation de l’accord par le Conseil et le Parlement européen. Des négociations à forts enjeux comme celles du PTCI ont, par ailleurs, incité le Parlement européen à développer une capacité autonome d’évaluation.
En revanche, il n’en va pas de même pour l’évaluation ex-post. En effet, celle-ci est très récente puisqu’elle n’est évoquée par la Commission qu’en 2010 dans sa Communication « Commerce, croissance et affaires mondiales ». C’est pourquoi, aujourd’hui, seules deux évaluations ex-post ont été publiées, inspirées des SIA et confiées, comme elles, à des consultants indépendants : l’une sur l’accord de libre-échange avec le Mexique (2000), l’autre sur l’ALE avec le Chili 2003). Ces études ex-post s’ajoutent toutefois aux rapports annuels que la Commission transmet au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de l’ALE UE-Corée du sud et UE-Colombie/Pérou, en application de règlements sur les clauses de sauvegarde.
Après avoir présenté les modalités de l’évaluation ex-post des ALE en vigueur par les trois institutions européennes et, en particulier, par la Commission (A), vos rapporteurs analyseront précisément l’impact économique des ALE UE- Corée du sud et UE-Chili en comparant celui-ci aux études d’impact préalables (B) et, enfin, analysera la mise en œuvre de l’ALE UE-Colombie/Pérou (C).
Vos rapporteurs ont en effet fait le choix de se concentrer sur ces quatre accords et d’écarter les autres ALE en vigueur. En effet, l’ALE avec l’Amérique centrale, qui est également un ALE de « nouvelle génération », n’a fait l’objet que d’un seul rapport annuel concluant à l’impossibilité de tirer une conclusion claire sur les effets de l’accord, à la fois par manque de recul et de données mais aussi en raison du faible niveau des échanges. Quant aux ALE d’ancienne génération que sont les ALE avec la Tunisie, le Maroc, l’Afrique du sud ou la Jordanie, négociés dans les années quatre-vingt-dix, ils sont trop anciens pour avoir fait l’objet d’une étude d’impact préalable. Par ailleurs, si l’ALE avec le Mexique a bien, quant à lui, fait l’objet d’une évaluation ex-post avec la publication, en juillet 2015, d’une analyse du consultant ECORYS dans la perspective d’une modernisation de l’ALE, il n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact préalable, ayant été lui aussi négocié dans les années quatre-vingt-dix. Par conséquent, il n’était pas possible, pour ces ALE, de comparer leurs effets réels avec les estimations desdites études d’impact, qui sera au cœur de l’analyse de cette deuxième partie.
A. L’ÉVALUATION EX-POST DES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE, PRINCIPALEMENT FAITE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE, A UNE ORIGINE RÉCENTE ET PORTÉE LIMITÉE
Comme pour l’évaluation ex-ante, c’est la Commission qui tient le premier rôle en matière d’évaluation ex-post des ALE. Cette dernière est parfois obligatoire lorsqu’un règlement européen portant clause de sauvegarde a été adopté mais l’évaluation ex-post systématique des ALE est encore en devenir puisqu’elle n’a été actée qu’en 2010. Par conséquent, outre des suivis statistiques, à ce jour, seules deux évaluations ont été réalisées, fortement inspirées, dans leur méthodologie, par les SIA (1). En revanche, le Conseil se désintéresse de la mise en œuvre des ALE, n’ayant plus de rôle à jouer en la matière une fois ceux-ci en vigueur. Le Parlement européen, parce qu’il lui appartient de contrôler l’activité de l’exécutif européen, s’est parfois intéressé à l’application de certains ALE, mais dans des proportions bien moindres que, par exemple, le PTCI (2). Dans tous les cas, quelle que soit l’institution, la portée de ces évaluations ex-post reste très limitée (3).
i. Les règlements européens mettant en œuvre les clauses de sauvegarde imposent à la Commission d’évaluer certains effets des ALE
Pendant longtemps, les seules évaluations ex-post des ALE ont été celles découlant des obligations pesant sur la Commission en matière de mise en œuvre des clauses de sauvegarde. C’est notamment le cas de l’ALE avec la Colombie et le Pérou, l’Amérique centrale et la Corée du sud. Dans les deux premiers cas, sont concernées les exportations de bananes, qui sont de nature à déstabiliser les productions de certaines régions ultrapériphériques comme les Antilles françaises et dans le dernier cas, les exportations coréennes d’automobiles.
Ces trois ALE ouvrent donc la possibilité d’adopter des mesures de sauvegarde. C’est ainsi que l’article 3.1 de l’ALE avec la Corée du sud stipule que « si, à la suite de la réduction ou de l'élimination de droits de douane en vertu du présent accord, des marchandises originaires d’une partie sont importées sur le territoire de l’autre partie en telles quantités, en valeur absolue ou relative à la production domestique, et dans de telles conditions qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à une industrie intérieure produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées ». Ces dernières consistent en une mesure de sauvegarde bilatérale visant à « suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu du présent accord [ou] augmenter le taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée ». Une clause identique est prévue à l’article 48 de l’ALE avec la Colombie et le Pérou et à l’article 104 de l’ALE avec l’Amérique centrale.
Sur la base de ces trois articles ont été adoptés trois règlements mettant en œuvre ces clauses de sauvegarde : n° 511/2011 du 11 mai 2011 pour l’ALE avec la Corée du sud, n° 19/2013 du 15 janvier 2013 pour l’ALE avec la Colombie et Pérou) et, enfin, n° 20/2013 du 15 janvier 2013 pour l’ALE avec l’Amérique centrale.
Ces trois règlements, très similaires dans leur rédaction, imposent à la Commission européenne de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l'application, la mise en œuvre et le respect des obligations découlant de l'accord, incluant notamment une synthèse des statistiques et de l’évolution du commerce et des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord, y compris sur le respect des obligations relatives au développement durable et sur celles des comités consultatifs de la société civile. L’objet de ces rapports annuels n’est donc pas simplement d’informer le Parlement et le Conseil en évaluant la mise en œuvre de l’accord. Ils sont aussi nécessaires à l’application de la clause de sauvegarde.
ii. Les rapports annuels réalisés en application de ces règlements évaluent de manière très succincte les effets des ALE
Ainsi qu’ils l’ont annoncé supra, vos rapporteurs ont écarté de leur analyse le rapport annuel sur l’ALE avec l’Amérique centrale. Dans le rapport publié en mars 2015 – le premier à l’être sur cet accord pourtant en vigueur depuis 2013 – il constate que « trop limitées, les données disponibles ne permettent pas de tirer des conclusions claires de cet accord ».
Ce rapport, comme les autres rapports annuels sur l’ALE avec la Colombie et le Pérou et sur l’ALE avec la Corée du sud, sont réalisés en interne par la Commission européenne avec ses seules ressources et sans recourir, comme pour les études d’impact préalables, à l’expertise d’un consultant indépendant. C’est une différence majeure qui explique que ces rapports, en pratique, se bornent à apporter trois types d’informations.
Les rapports annuels présentent en premier lieu des données statistiques de l’évolution des échanges bilatéraux entre l’Union européenne et le ou les pays concernés, par catégories de produits ou de services, étant précisé que les données pour ces derniers sont généralement disponibles avec retard. Les rapports publiés en 2016 pour l’année 2015 s’appuient ainsi sur les données de l’année 2013 qui sont les derniers disponibles. Par conséquent, le rapport sur la mise en œuvre de l’accord commercial avec la Colombie et le Pérou, publié le 10 février 2016, ne disposent que de données remontant à trois ans, limitant les possibilités de l’évaluation pour un accord entré en vigueur justement en 2013 (15). Par ailleurs, le recours aux contingentements tarifaires, lorsque ceux-ci sont prévus, par exemple dans l’accord avec la Colombie et le Pérou (pour le sucre de canne), est également renseigné.
Ces données statistiques mises à part, les rapports annuels ne comportent aucune évaluation de l’impact économique global de cet accord, ni pour l’Union européenne, ni pour les pays concernés. L’évolution des échanges, qu’elle soit positive ou négative selon les points de vue, n’est donc pas analysée en termes de bien-être, de revenu ou d’emplois.
En deuxième lieu, les rapports annuels analysent l’activité des organes d’exécution de l’accord de libre-échange. En effet, tant l’ALE avec la Colombie et le Pérou que l’ALE avec la Corée du sud ont institué un comité « Commerce » et des organes spécialisés, comités, sous-comités et autres groupes de travail pour superviser son exécution et faire avancer les projets d’intérêt commun. La lecture des rapports annuels renseigne ainsi sur le fait qu’au sein du sous-comité chargé de l’accès au marché, qui s’est réuni le 19 juin 2015 à Bogota, « l’UE a fait part de ses préoccupations concernant la politique colombienne en matière de mise au rebut des camions ». De même le comité « Douanes », qui s’est réuni les 18 et
19 juin à Séoul, « a abordé l’interprétation de “l’ingrédient principal” du surimi transformé ». Quant au groupe de travail « Indications géographiques », réuni également à Séoul le 10 octobre 2014, « des avancées considérables ont été réalisées sur le projet de règlement intérieur, qui pourra ainsi être adopté dès que les parties auront achevé leurs procédures internes ».
Enfin, en dernier lieu, les rapports annuels mettent en évidence les avancées (ou non) dans la mise en œuvre des dispositions relatives au développement durable, c’est-à-dire celles relatives au travail, en particulier s’agissant de la ratification des conventions de l’OIT, et à l’environnement, notamment les différents programmes d’action.
Au final, ces rapports annuels établis par la Commission en application des règlements sur la mise en œuvre des clauses de sauvegarde tiennent plus de la compilation statistique et du rapport d’activité que d’une véritable analyse ex-post des effets économiques, sociaux et environnementaux des ALE. Il faut toutefois souligner que tel n’a jamais été leur objectif qui est principalement d’éclairer le Parlement et le Conseil dans la mise en œuvre éventuelle des mesures de sauvegarde.
Pendant longtemps, au-delà des rapports annuels précités, la mise en œuvre des accords de libre-échange n’a fait l’objet d’aucune évaluation ex-post autre qu’un suivi statistique de l’évolution des échanges. En réalité, cette absence d’évaluation n’emportait pas de réelle conséquence puisque très rares étaient les accords de libre-échange bilatéraux de l’Union européenne qui, en plus, n’étaient pas signés avec ses principaux partenaires commerciaux : Mexique, Chili, Afrique du sud, Jordanie, Maroc et Tunisie.
Toutefois, deux facteurs ont récemment contribué à ce que l’évaluation ex-post des ALE prenne une nouvelle dimension et s’approche de plus en plus de l’évaluation ex-ante :
– le premier est l’ouverture, à partir de 2006, de négociations avec des partenaires commerciaux de premier ordre : Corée du sud, Canada, Japon, États-Unis, Chine…
– le deuxième est l’importance sans cesse croissante, tout au long des années 2000, donnée à l’évaluation, d’une manière générale, dans l’élaboration des politiques de l’Union. Certes, les procédures d’évaluation ont été instituées avant tout pour éclairer la décision de la Commission européenne et des autres institutions, et donc préalables à celle-ci. Toutefois, il est évident que l’évaluation ex-ante devait un jour être complétée par une évaluation ex-post, ne serait-ce que pour s’assurer de la pertinence de la première.
La conjugaison de ces deux facteurs rendait intenable une évaluation des ALE limitée aux études d’impact ex-ante. C’est ainsi que dans sa Communication « Croissance, commerce et affaires mondiales » publiée en 2010, la Commission « passe à la vitesse supérieure en incorporant des analyses d’impact et
des évaluations dans notre processus d’élaboration de politiques commerciales », lesquelles incluront « une évaluation ex post sur une base plus systématique ».
ii. L’évaluation des ALE avec le Mexique et le Chili, très approfondie, s’inspire des études d’impact sur le développement durable
Cette nouvelle stratégie en matière d’évaluation ex-post a mis deux ans à être mise en œuvre et une première étude d’impact ex-post a été publiée en
mars 2012, portant sur le pilier « commerce » de l’accord d’association de l’Union européenne avec le Chili (2002). Une étude similaire a également été publiée en mai 2015 sur l’accord de libre-échange avec le Mexique (1997).
Ces deux études et, comme l’a confirmé la DG Trade à vos rapporteurs, l’ensemble des études ex-post à venir, s’inspirent très largement des études d’impact sur le développement durable et ce, sur plusieurs points fondamentaux. Quelques différences doivent toutefois être soulignées.
Comme les SIA, elles ont été réalisées par des consultants indépendants recrutés sur appel d’offres de la DG Trade. L’étude sur l’accord d’association avec le Chili a ainsi été réalisée par un cabinet français – ITAQA – et l’étude sur l’ALE avec le Mexique par ECORYS. La procédure applicable est en tout point identique à celle des SIA puisqu’elle comporte trois rapports successifs : à savoir un rapport initial (« inception report »), un rapport préliminaire (« interim technical report ») et un rapport final (« final report »), lesquels sont précisément définis dans le cadre de référence de l’appel de l’offre. Par ailleurs, un comité directeur (« steering committee ») est également institué afin de superviser le travail du consultant.
Les études ex-post doivent, comme les SIA, « éclairer et évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et potentiels de l’accord pour les deux parties ». Outre l’impact économique proprement dit de l’accord, le consultant analyse son impact sur l’emploi, les salaires et le revenu des ménages ainsi que sur la mise en œuvre des normes de l’OIT et, en particulier, son « agenda pour le travail décent ». L’impact environnemental est quant à lui évalué à travers la prise en compte des différents types d’externalités de l’accord, notamment sur le climat, la biodiversité et les ressources naturelles. L’analyse est donc multidimensionnelle mais également sectorielle puisqu’elle doit identifier les secteurs, les activités et les groupes qui ont été impactés par l’accord, positivement et négativement, tout en mettant en évidente les effets non-voulus. Enfin, l’impact sur les droits humains n’est pas oublié puisque le consultant « devra prendre en compte la problématique des droits humains tels qu’ils sont fixés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans les traités des Nations-Unies ». Elles vont donc très au-delà des rapports annuels publiés par la Commission et font autour de deux cents pages.
Cette analyse repose, comme pour les SIA, sur plusieurs outils et, en particulier, sur la modélisation économique. En effet, une analyse ex-post complète ne peut se contenter de retracer l’évolution des échanges entre l’Union européenne sur la seule base des flux commerciaux. Comme l’explique le consultant ITAQA, prenant l’exemple des importations européennes du Chili, « au lieu de considérer [celles-ci] à proprement parler, les estimations économétriques sont basées sur l’évolution de ces importations au-delà de ce qui aurait pu être attendu compte tenu des tendances des exportations chiliennes sur d’autres marchés et des tendances des importations européennes d’autres fournisseurs ». Un modèle de gravité est donc utilisé pour mesurer l’impact des réductions tarifaires sur les flux commerciaux, complété par un modèle d’équilibre général calculable afin de prendre en compte les interactions de ceux-ci avec d’autres variables comme les revenus ou les prix. Par conséquent, contrairement à ce
que l’on aurait pu penser, même dans une étude d’impact ex-post d’un
accord de libre-échange, qui dispose par définition de l’ensemble des données relatives aux flux commerciaux réels, il n’est pas possible de faire
l’impasse sur la modélisation économique, avec toutes les limites que celle-ci implique.
À noter que, comme dans les études d’impact ex-ante, les résultats de ces modèles sont également utilisés pour l’analyse de l’impact social et environnemental des accords.
Enfin, ces études d’impact ex-post reposent sur une large consultation
de l’ensemble des parties prenantes, notamment les administrations, les entreprises et la société civile, incluant les partenaires sociaux. Un site web dédié, créé par le consultant, ainsi que des ateliers animés dans les pays concernés, sont les principaux vecteurs de cette consultation. Les différents rapports sont en outre publiés afin que ces parties soient en mesure de fournir leurs observations.
2. Le rôle croissant du Parlement européen contraste avec le désintérêt actuel du Conseil et des États membres pour l’évaluation des ALE une fois ceux-ci entrés en vigueur
Comme en matière d’évaluation ex-ante, le Parlement européen porte une attention croissante à la mise en œuvre des accords de libre-échange ; en revanche, le Conseil s’en désintéresse à peu près, n’ayant plus de rôle réel une fois ceux-ci signés et approuvés.
a. Le désintérêt du Conseil et, dans une moindre mesure, des États membres pour l’évaluation ex-post des accords de libre-échange
Vos rapporteurs ont mis à profit leurs auditions pour éclairer le rôle du Conseil dans l’évaluation ex-post des accords de libre-échange de l’Union européenne, en interrogeant sur ce point à la fois la Direction générale du Trésor du ministère de l’Économie – qui suit la politique commerciale européenne à Paris – et la Représentation permanente française à Bruxelles. Leurs conclusions sont unanimes : le Conseil en tant qu’institution européenne se désintéresse largement de la mise en œuvre des ALE16. Dans les cas où il est saisi de celle-ci, par exemple à l’occasion de la transmission des rapports d’application des ALE avec la Corée du sud, l’Amérique centrale ainsi qu’avec la Colombie et le Pérou, il ne donne pas suite et n’organise pas de débat sur cette question de l’impact de ces accords, tant pour l’Union européenne que pour le ou les pays concernés.
Les raisons d’un tel désintérêt du Conseil sont à chercher dans les compétences de celui-ci, quasi-nulles une fois l’ALE en vigueur. Contrairement au Parlement européen, il n’a pas vocation, en principe, à contrôler a posteriori l’action de la Commission européenne. Par conséquent, autant il est actif – et encore, moins que le Parlement européen – avant la conclusion des accords, parce qu’il lui revient d’autoriser l’ouverture des négociations puis la signature et l’approbation de l’accord, autant il est inactif une fois ceux-ci en vigueur car il n’a pas de réel pouvoir sur ces accords.
Ce désintérêt du Conseil pour l’évaluation ex-post des accords de libre-échange reflète largement celui des États membres eux-mêmes. En effet, pour prendre l’exemple de la France, le gouvernement français n’a jamais réalisé de réelles études sur l’impact d’un quelconque ALE en vigueur, pas plus d’ailleurs un ALE de l’Union européenne qu’un ALE national. En revanche, parce que les ALE de l’Union européenne avec la Corée du sud, l’Amérique centrale et ainsi que l’ALE avec la Colombie et le Pérou sont des accords « mixtes », les Parlements nationaux doivent autoriser leur ratification en droit interne et, par conséquent, produire un rapport sur leur mise en œuvre avec un recul de quelques années puisque le Conseil les avait tous les trois rendus applicables provisoirement. C’est ainsi que le Parlement français a adopté les projets de loi autorisant la ratification :
– de l’ALE UE-Corée du sud, en vigueur depuis le 1er juillet 2011, le 31 octobre 2013 ;
– de l’Accord d’association UE-Amérique centrale, en vigueur depuis le 1er août 2013, le 18 décembre 2014 ;
– de l’ALE UE-Colombie/Pérou, en vigueur depuis le 1er mars 2013, le 17 décembre 2015.
Ces accords ont donné lieu, comme il se doit, à un rapport de la Commission des affaires étrangères. Si ces rapports détaillent l’évolution des échanges bilatéraux depuis l’entrée en vigueur de l’accord, ils ne peuvent être considérés comme une véritable évaluation ex-post comme la Commission a pu en faire des deux accords précités avec le Chili et le Mexique. En outre, en séance publique, ces deux projets de loi ont été adoptés, comme la quasi-totalité des projets de loi identiques, selon la procédure simplifiée, c’est-à-dire sans débat.
Compte tenu de la barrière de la langue, il n’a pas été possible à vos rapporteurs de vérifier la portée des travaux parlementaires des autres chambres de l’Union européenne sur ces trois accords. Toutefois, il est possible qu’ils se soient, eux aussi, d’une manière générale et au-delà de leurs attributions strictement législatives, intéressés à la mise en œuvre de ces ALE. C’est ainsi que la Chambre des Lords a organisé, le 26 novembre 2015, un séminaire consacré à l’ALE avec la Colombie et le Pérou, centré sur les dispositions relatives aux droits humains, sociaux et environnementaux.
Pour expliquer ce relatif désintérêt des États membres pour l’évaluation ex-post des accords de libre-échange de l’Union européenne actuellement en vigueur, vos rapporteurs attirent l’attention sur le fait que ces accords, en eux-mêmes, ne sont pas susceptibles d’avoir un impact significatif sur leurs économies, en dehors de certains secteurs économiques sensibles par ailleurs suivis en tant que tels par la Commission européenne (voir supra). Toutefois, les choses pourraient, une fois encore, changer avec le PTCI. Si cet accord, souvent qualifié de « gigantesque », avec la première puissance économique mondiale, est un jour signé, nul doute que les États membres réaliseront des évaluations ex-post de son impact, comme ils ont réalisé des évaluations ex-ante.
Comme pour la Commission européenne, l’évaluation ex-post des ALE en vigueur est une pratique récente au Parlement européen. De même qu’il a développé, à partir de 2012, ses capacités d’évaluation pour réaliser des études d’impact ex-ante des ALE, il a également utilisé celles-ci pour évaluer leurs effets une fois entrés en vigueur. Toutefois, ce travail d’évaluation ex-post n’est pas aussi approfondi que celui réalisé, par exemple, pour le PTCI et, surtout, il ne semble pas avoir de portée politique, n’étant examiné ni en commission, ni en séance plénière.
Ainsi qu’il a été dit supra, c’est à partir de 2012 que le Parlement européen s’est doté d’une capacité d’évaluation autonome mise au service de son ambition de peser plus fortement sur la politique commerciale. Toutefois, c’est la direction générale des politiques extérieures qui, s’agissant de l’évaluation ex-post, tient le premier rôle, alors que l’évaluation ex-ante est, comme on l’a vu, dirigée par une direction ad hoc. Dans les deux cas, cependant, les évaluations ne sont pas réalisées en interne mais par des consultants extérieurs.
Comme l’ont confirmé à vos rapporteurs les représentants du Parlement européens rencontrés le 5 avril dernier, une seule vraie étude d’impact ex-post d’un ALE a, à ce jour, été réalisée à la demande de la commission du commerce international. Elle a porté sur l’ALE UE-Colombie/Pérou (17). On peut rapprocher de celle-ci le « Worshop » organisé en 2013 sur l’ALE UE-Corée du Sud (18). Cependant, compte tenu du peu de recul vis-à-vis de cet accord et du peu de données disponibles, il n’a avancé que des constatations très vagues mais qui déjà pointe le fait – qui sera développé infra – que les études d’impact sont en partie passées à côté des résultats réels de l’accord.
Dans les deux cas, des études ont été réalisées par des consultants indépendants sous l’égide de la Direction générale des politiques extérieures. En d’autres termes, ce travail d’évaluation est purement administratif et les documents produits ne sont pas des documents parlementaires, signés et endossés par des eurodéputés. En revanche, une délégation d’eurodéputés membres de la commission du commerce international s’est bien rendue à Bogota et à Lima en mars 2014 et lui a fait communication, le 28 avril 2014, de ses constatations quant à la mise en œuvre de l’accord UE-Colombie/Pérou.
D’une manière générale, le Parlement européen suit la mise en œuvre principalement à travers des auditions et, notamment, celles du commissaire chargé du commerce et des ambassadeurs des pays concernés. Ces auditions ont lieu au sein de la commission du commerce international mais également des différentes délégations géographiques, qui sont les équivalents des groupes d’amitié. Celles-ci ont de nombreuses activités qui vont bien au-delà des relations commerciales, même si elles ont pu, parfois, s’en préoccuper. Cependant, ce travail d’audition est somme toute limité. La délégation pour les relations avec la Communauté andine a ainsi tenu une seule réunion consacrée à la mise en œuvre de l’ALE avec la Colombie et le Pérou, le 26 février 2015. Le procès-verbal de la réunion « insiste sur les tendances favorables que l'on observe en matière de diversification des produits exportés. Il met l'accent sur le degré élevé d'institutionnalisation atteint à ce jour, tout en mentionnant certains thèmes qui doivent être renforcés, en particulier en ce qui concerne certains aspects sanitaires et phytosanitaires ». À noter que de nombreuses réunions ont été tenues sur l’accession de l’Équateur à l’accord (voir infra), preuve que l’évaluation ex-ante passionne plus que l’évaluation ex post.
En revanche, la délégation pour la péninsule coréenne, compétente, comme son nom l’indique, à la fois pour la Corée du sud et la Corée du nord, s’est bien plus préoccupée du nucléaire nord-coréen que des échanges commerciaux avec la Corée du sud, auxquels elle n’a consacré aucune réunion ni audition depuis la mise en œuvre de l’ALE. Le même constat peut être fait pour les délégations couvrant d’autres pays liés à l’Union par des accords de libre-échange (Afrique du sud, Chili, Amérique centrale…).
Enfin, la portée proprement politique de ce travail d’évaluation est limitée. Non seulement il est principalement fait par les services administratifs (aidés de consultants extérieurs) mais il n’a, à ce jour, jamais débouché sur l’adoption d’une résolution, même si la perspective d’une résolution sur l’ALE UE-Corée du sud a été évoquée.
3. La portée de l’évaluation ex-post est difficile à cerner compte tenu de son caractère récent et du peu d’ALE concernés
Comme vos rapporteurs l’ont rappelé supra, les études d’impact ex-ante s’intègrent dans le processus d’élaboration des politiques européennes afin d’éclairer les décisions prises par la Commission et les autres institutions européennes. Elles ont donc une portée opérationnelle puisqu’elles participent, au moins en partie, à la prise de décision au niveau européen. En matière de politique commerciale, les évaluations ex-ante des accords de libre-échange guident ainsi la Commission, le Conseil et le Parlement dans l’exercice de leurs compétences respectives s’agissant des accords de libre-échange.
Compte tenu du fait que l’évaluation ex-post des ALE est récente, qu’elle soit réalisée par la Commission ou le Parlement européen, il est difficile aujourd’hui d’en apprécier la portée sur la politique commerciale commune comme sur les autres politiques également susceptibles d’être impactées, en raison notamment des dispositions sociales et environnementales de ces accords, sans parler de celles relatives aux droits humains. Le développement de l’évaluation ex-post est toutefois de nature, à terme, à influencer la mise en œuvre de la politique commerciale, notamment parce qu’elle prépare la révision des accords de libre-échange existants.
Ainsi qu’il a été dit supra, les accords de libre-échange avec la Colombie et le Pérou, avec l’Amérique centrale et avec la Corée du sud ont tous été complétés par un règlement mettant en œuvre la clause de sauvegarde qu’ils contiennent (voir supra). Celle-ci autorise l’Union européenne (et, réciproquement, les pays concernés) à revenir sur les baisses de droits de douane consentis en cas d’importation massive d’un produit de nature à causer une menace ou un préjudice grave aux producteurs européens.
Si la Commission européenne doit, pour informer le Parlement et le Conseil, produire chaque année un rapport sur la mise en œuvre de ces ALE, dans ses dimensions institutionnelles et économiques, ce rapport est également l’occasion d’analyser plus précisément les importations européennes dans des secteurs sensibles tels que définis par ces mêmes règlements. Cette analyse est directement liée à la mise en œuvre éventuelle de la clause de sauvegarde.
C’est ainsi qu’en application du règlement n° 511/2011 précité, la Commission « suit l’évolution des statistiques d’importation et d’exportation des produits coréens dans les secteurs sensibles susceptibles d’être affectés par les ristournes de droits et coopère et échange des données régulièrement avec les États membres et l’industrie de l’Union ». Ces secteurs sensibles sont le textile, l’automobile et les produits électroniques. En effet, pour ouvrir une enquête pouvant conduire à remettre en cause les droits de douanes préférentiels dont disposent ces produits en application de l’ALE UE-Corée du sud, la Commission doit disposer d’éléments de preuve suffisants, « notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi ».
Non seulement la Commission suit les échanges de produits finis dans ces trois secteurs sensibles mais elle « accorde une attention particulière à toute augmentation des importations de produits finis sensibles provenant de Corée à destination de l’Union, lorsqu’une telle augmentation est due à une utilisation accrue de pièces ou de composants importés en Corée à partir de pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord de libre-échange avec l’Union et qui sont couverts par les ristournes et les exonérations de droits de douane ». L’objectif d’un tel
suivi est d’éviter le détournement de la règle d’origine par l’assemblage
en Corée du sud, à la seule fin de bénéficier des droits de douane préférentiels, de produits composés majoritairement de composants d’origine étrangère.
Alors que l’ALE UE-Corée du sud est en vigueur depuis le 1er juillet 2011, le suivi de la Commission européenne n’a pas détecté d’anomalie dans les exportations coréennes à destination de l’Union européenne.
Les rapports annuels sur la mise en œuvre des ALE UE-Amérique centrale et UE-Colombie/Pérou, quant à eux, analysent plus précisément les importations européennes de bananes fraîches. En effet, si pour une année civile donnée, les importations de bananes en provenance de chacun des pays couverts par ces ALE dépassent les seuils fixés par les règlements n° 19/2013 et n° 20/2013 précités, la Commission adopte « un acte d'exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée ».
Or, la Commission a constaté que les importations de bananes fraîches depuis le Pérou ont dépassé, en 2013 et en 2014, les volumes prévus par le règlement n° 19/2013. Cependant, compte tenu du fait que les bananes péruviennes ne représentent que 1,9 % du marché européen, que le niveau des prix n’a pas été modifié sur ce marché et qu’aucun effet négatif n’a été observé s’agissant des importations de pays tiers ou des régions ultrapériphériques, le droit de douane préférentiel dont bénéficient le Pérou pour ces produits en application de l’ALE n’a pas été suspendu.
Il convient de souligner que les clauses de sauvegarde fonctionnent dans les deux sens. L’Afrique du sud a ainsi annoncé, le 19 février 2016, avoir ouvert une enquête, préalable à une éventuelle mise en œuvre de la clause de sauvegarde de l’article 16 de l’ALE de 1996, suite à une augmentation importante (+ 34% en trois ans) des importations de poulets congelés depuis l’Union européenne.
ii. Un suivi qui pourrait, à terme, avoir des conséquences sur l’application elle-même des accords de libre-échange
L’article 3 du TUE stipule que « dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies ». L’un des moyens privilégiés par l’Union européenne pour promouvoir les droits humains est de subordonner la mise en œuvre d’un ALE – ou d’un autre accord – au respect par le pays tiers concerné des droits fondamentaux tels qu’ils figurent dans les différents instruments internationaux. C’est ainsi que, pour la première fois, les accords de Cotonou (2000) instituent une procédure de consultation si « une partie considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit ». Si ces consultations n’aboutissent pas ou en cas de refus d’ouvrir la procédure, des « mesures appropriées » peuvent être prises, allant jusqu’à la suspension de l’accord.
Les accords de libre-échange de nouvelle génération, comme l’ALE UE-Colombie/Pérou, font également le lien entre le respect des droits fondamentaux et le commerce. L’article 1er de cet ALE stipule ainsi que « le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des principes de l'État de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties. Le respect de ces principes constitue un élément essentiel du présent accord ». Par conséquent, « toute partie peut adopter immédiatement des mesures appropriées, conformément au droit international, en cas de violation par une autre partie des éléments essentiels visés » à cet article, même si la suspension n’est pas évoquée.
Ces accords de nouvelle génération vont toutefois plus loin que, par exemple, les Accords de Cotonou, puisqu’ils incluent eux-mêmes des dispositions relatives aux droits fondamentaux dits de « deuxième ou troisième génération » c’est-à-dire les droits sociaux et environnementaux et, en particulier la ratification de conventions internationales, en particulier celles de l’OIT ou le Protocole de Kyoto. Dès lors, la mise en œuvre de ces dispositions est une obligation pour le Pérou et la Colombie qui, comme pour les droits humains, est de nature à justifier que l’ALE puisse être suspendu si elles n’étaient pas correctement appliquées.
Il va de soi qu’une telle décision – radicale – ne saurait être prise qu’au terme d’un dialogue politique qui, du côté de l’Union européenne, devra s’appuyer sur une évaluation incontestable de la (non) mise en œuvre de la mesure concernée ou des violations reprochées au pays concerné. L’évaluation ex-post trouve ainsi son sens en justifiant d’éventuelles mesures prises par l’Union européenne en cas de non-application de ses dispositions, en particulier celles qui n’ont pas trait à la libéralisation des échanges, ces dernières étant généralement parfaitement appliquées.
Toutefois, l’évaluation ex-post n’aura une telle portée qu’à la condition que la Commission, chargée de la mise en œuvre des ALE, la lui donne. En effet, au-delà du constat qui pourrait être fait d’une éventuelle violation, encore
faut-il prendre la décision politique d’adopter les « mesures appropriées ».
Par conséquent, même si la suspension de l’ALE est prévue en cas de violation des droits fondamentaux, il reste à voir, dans les faits, quel degré de violation pourrait amener à sa mise à exécution, puisqu’aucun accord commercial n’a encore été suspendu sur ce fondement (19). La même question se pose pour la mise en œuvre des dispositions sociales et environnementales d’un ALE. Une fois encore, le recul manque pour savoir dans quelle mesure une non-exécution pourrait justifier une suspension qui, de manière générale, est une mesure radicale que l’Union européenne comme le pays concerné feront tout pour éviter.
Ainsi qu’il a été vu supra, la Commission européenne était peu encline à évaluer ex-ante l’impact d’un ALE sur les droits humains et ce peu d’empressement est de mauvais augure pour la prise en compte d’éventuelles violations. Le Parlement européen pourrait ainsi prendre le relais et non seulement faire sa propre évaluation mais également faire pression pour suspendre l’accord. Très récemment, un groupe de 63 députés européens a interpellé Mme Federica Mogherini, Haute représentante pour les affaires étrangères, exigeant la suspension de l’Accord d’association UE-Israël. C’est la première fois qu’autant de députés européens se prononcent pour des mesures aussi sévères contre Israël considérant ce dernier comme responsable de violations graves du droit international. Même si le Parlement européen n’a aucun pouvoir en matière de suspension ou d’exécution de l’accord, une telle pression est de nature à pousser la Commission à agir le cas échéant.
Si l’évaluation ex-post des accords de libre-échange sous la forme d’un suivi de leur application peut se justifier dans la perspective de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde ou d’une suspension, la Commission européenne lui donne une autre portée. En effet, comme la DG Trade l’a confirmé à vos rapporteurs, l’évaluation ex-post s’intègre dans le long processus visant à moderniser les ALE sur lesquels elle porte.
C’est particulièrement flagrant pour les deux seules évaluations ex-post réalisées à ce jour par la Commission européenne, dont l’une – celle de l’ALE avec le Mexique – est d’ailleurs toujours en cours. En effet, l’évaluation ex-post de l’Accord d’association UE-Chili (2002) a été publiée en mars 2012. Or, en novembre 2012 s’est tenue une réunion de haut niveau entre représentants chiliens et européens visant à explorer la voie d’une modernisation de cet Accord d’association, y compris son pilier « commerce ». Cette première réunion a été suivie de plusieurs autres et, mi-janvier 2016, une délégation d’experts chiliens était à Bruxelles afin d’examiner comment moderniser l’Accord d’association. L’intention est d’incorporer de nouveaux produits qui ne sont pas encore visés par l’Accord. À l’heure actuelle, environ 99 % des exportations du Chili vers l’UE sont exemptés de droits de douane, mais quelques produits agricoles et de pêche sont soumis à quotas. Comme l’a confirmé la DG Trade, l’évaluation ex-post du pilier « commerce » de l’Accord d’association s’intègre dans ce processus de modernisation.
Si la modernisation de l’ALE avec le Chili n’est pas encore officiellement lancée, les choses sont bien plus avancées avec le Mexique. En effet, dès janvier 2013, l’Union européenne et le Mexique ont décidé « d’explorer les options pour une modernisation complète de l’accord de partenariat économiques, de dialogue politique et de coopération […] En particulier le pilier commerce devra être modernisé d’une manière ambitieuse, et prendre en compte les accords de libre-échange conclus ou en cours de négociation ». Un comité mixte a été établi qui, après plusieurs réunions, a lancé une étude préliminaire explorant en détail les objectifs qu’une modernisation de l’accord devrait poursuivre. Cet exercice a été achevé pour le sommet UE-Mexique du
12 juin 2015 qui s’est conclu par la décision de lancer le processus d’ouverture des négociations. Une consultation publique a ainsi été organisée par la Commission le 18 juin 2015.
Or, dès décembre 2013, la DG Trade a lancé un appel d’offres pour la réalisation de deux études, l’une portant sur l’évaluation ex-post de l’accord de libre-échange avec le Mexique et l’autre sur l’évaluation ex-ante de la modernisation dudit accord. Les deux études d’impacts, confiées à un consultant extérieur, sont encore en cours puisque seul le rapport intérimaire a été publié à ce jour. De manière encore plus flagrante que pour le Chili, l’évaluation ex-post est ainsi directement liée à l’évaluation ex-ante et les deux visent à préparer l’ouverture de nouvelles négociations commerciales avec le Mexique.
En conclusion, l’évaluation ex-post est aujourd’hui essentiellement le fait de la Commission qui, en 2010, a pris la décision de compléter les études d’impact ex-ante par une analyse des effets réels des accords de libre-échange. Parce qu’elle est une innovation récente, il est encore difficile d’apprécier la portée de cette évaluation ex-post. Toutefois, considérant les deux évaluations ex-post réalisées à ce jour par la Commission européenne, il apparaît que celles-ci, comme les évaluations ex-ante, visent avant tout à préparer de nouvelles négociations portant sur la modernisation des ALE ainsi évalués.
B. L’ÉVALUATION EX-POST DES ALE SE HEURTE AUX MÊMES DIFFICULTÉS QUE L’ÉVALUATION EX-ANTE TOUT EN ILLUSTRANT LES LIMITES DE CELLE-CI
Les accords de libre-échange sont souvent présentés comme le moyen d’augmenter les échanges entre les pays concernés, lesquels sont considérés par la théorie économique, comme bénéfiques à leur économie. Par conséquent, l’évaluation ex-post des ALE apparaît a priori plus simple que l’évaluation ex-ante puisque contrairement à cette dernière, elle peut s’appuyer sur les flux commerciaux réels et leur évolution sur plusieurs années.
Toutefois, même si elle est nécessaire, c’est une erreur de croire que l’évaluation ex-post des ALE peut se limiter à la seule analyse de l’évolution des flux commerciaux. En effet, une hausse de ceux-ci suite à un ALE peut être l’effet d’autres facteurs, de même qu’une baisse aurait pu être bien plus forte sans ALE. Par conséquent, la modélisation économique est aussi utile pour l’évaluation ex-post que pour l’évaluation ex-ante car elle seule est susceptible d’isoler l’effet d’un ALE sur les flux commerciaux, toute chose égale par ailleurs. Cependant, pour utile qu’elle soit, la modélisation ex-post se heurte à des limites inhérentes déjà mises en évidence dans la première partie du présent rapport qui, en outre, compliquent considérablement la comparaison avec l’évaluation ex-ante (1). Pourtant, la Commission européenne a pu parfois écarter la modélisation afin de présenter un ALE sous un jour favorable, plus que les études d’impact ne le laissaient présager. C’est le cas de l’ALE UE-Corée du sud (2).
1. Parce qu’elle utilise aussi la modélisation, l’évaluation ex-post se heurte aux mêmes limites que l’évaluation ex-ante : le cas de l’accord UE-Chili
a. L’analyse des seuls flux commerciaux est insuffisante pour évaluer correctement l’impact d’un accord de libre-échange
L’accord d’association avec le Chili, signé le 18 novembre 2002, repose sur trois piliers : le dialogue politique, la coopération et le commerce. En vigueur depuis le 1er mars 2005, son pilier « commerce » est toutefois vigueur de manière provisoire dès le 1er février 2003.
Le pilier « commerce de l’accord d’association UE-Chili s’apparente aux ALE classiques, centré sur la réduction des barrières tarifaires, en particulier sur les biens. En outre il est très asymétrique puisqu’il concerne une économie de 15 millions d’habitants et une autre de 500 millions d’habitants. Le Chili était ainsi le 32ème partenaire commercial de l’UE alors que celle-ci était son 2ème partenaire. Enfin, la structure du commerce diffère puisque le Chili, riche en matières premières, exporte principalement celles-ci alors que les exportations de l’UE vers le Chili sont très diversifiées.
D’une manière générale, les barrières tarifaires dans le commerce des biens ont été quasiment toutes démantelées sur une période de dix ans. Etaient ainsi libéralisés, en 2013, 97 % du commerce bilatéral de biens. S’agissant des produits industriels, du côté européen, parmi les 74 % de biens industriels qui sont taxables (c’est-à-dire qui ne bénéficiaient pas de la clause de la nation la plus favorisée), 85 % ont été libéralisés immédiatement et les 15 % restants l’ont été dans les trois ans. Côté chilien, 94 % des produits ont été libéralisés immédiatement, 3 % cinq ans plus tard (notamment la céramique, le verre et les pièces détachés automobiles) et enfin encore 3 % sept ans plus tard (principalement les produits de l’industrie chimique). Par conséquent, depuis 2013, la totalité des produits industriels européens et chiliens peuvent être exportés sans droits de douane.
Les produits agricoles (incluant les produits agricoles transformés, la pêche et les produits de la pêche) présentent, comme souvent, des dispositions bien plus complexes que les produits industriels et font l’objet d’une moins grande libéralisation. Côté européen, parmi les 84 % de lignes tarifaires qui étaient taxables, 9 % seulement ont été libéralisées à l’entrée en vigueur de l’accord. 23 % l’ont été après une période de 4 ans et 22 % après 7 à 10 ans. C’est le cas en particulier pour les produits de la pêche, les légumes, les préparations de viande et de poissons, les préparations de légumes et de fruit et les boissons. Enfin, certains produits sont libéralisés dans la limite d’un quota alors que d’autres sont exclus de la libéralisation. Cette exclusion concerne 502 lignes tarifaires, soit 26 % des lignes tarifaires agricoles, en particulier dans les secteurs de la viande, du lait, des céréales et du sucre.
Côté chilien, 80 % des produits agricoles ont été immédiatement libéralisés. 5 %, principalement des produits à base de viande, le vin rouge, les spiritueux l’ont été après une période de cinq ans et 6 % après 10 ans, principalement la viande, certains légumes comme les pois, les céréales et les farines. 28 produits agricoles (dont les fromages, l’huile d’olive…), soit 2 % des lignes tarifaires, ont été libéralisés mais dans la limite d’un quota. Enfin, 105 produits sont exclus de la libéralisation, soit 7 % des lignes tarifaires agricoles, principalement le lait et les produits laitiers, les huiles végétales, les farines de blé et les filets de poissons.
L’accord d’association comporte également des dispositions relatives à la libéralisation du commerce des services, dans la lignée du GATS.
En revanche, s’agissant d’un accord de libre-échange d’ancienne génération, il ne comporte pas de dispositions relatives au développement durable ni aux droits humains, sociaux ou environnementaux.
La théorie économique est quasi-unanime à soutenir que les accords de libre-échange sont positifs pour les échanges. L’abaissement des droits de douane (comme la réduction des barrières non-tarifaires aux échanges) entraîne généralement une augmentation des flux commerciaux bilatéraux. C’est d’ailleurs ce que vos rapporteurs observent s’agissant des flux bilatéraux UE-Chili tels qu’ils sont retracés par Eurostat depuis 2002.
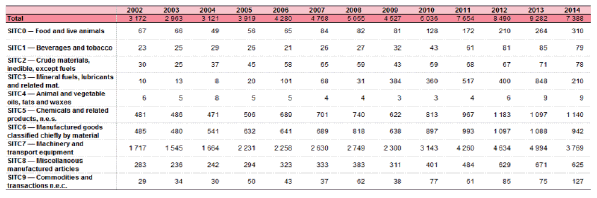
Comme le montre le tableau ci-dessous, qui retrace les principales exportations européennes à destination du Chili, celles-ci ont connu une forte croissance depuis 2002 puisqu’elles sont passées de 3,172 milliards d’euros à 7,388 milliards d’euros en 2014, soit une augmentation de 133 %. Plus précisément, on peut distinguer trois catégories de produits dont les exportations ont particulièrement progressé. La première, ce sont les produits agricoles. Les exportations de produits alimentaires et d’animaux vivants ont ainsi progressé de 309 % et les exportations de boissons et de tabac de 243 %. Ont en outre fortement augmenté les exportations de biens manufacturés, en particulier les équipements de transport (+ 120 %) qui représentent près de la moitié des exportations. Enfin, les exportations d’huiles minérales, fuels et lubrifiants ont atteint 210 millions d’euros en 2014 alors qu’elles étaient quasi-inexistantes en 2002.
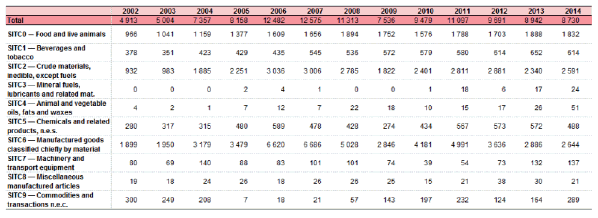
Le constat est similaire s’agissant des importations européennes du Chili, comme le montre le tableau ci-dessus. Elles ont également fortement augmenté mais dans une proportion moindre que les exportations européennes vers ce pays. Elles sont en effet passées de 4,913 milliards d’euros en 2002 à 8,730 milliards d’euros en 2014, soit une augmentation de 82,7 %. Ont particulièrement progressé les exportations de produits alimentaires et d’animaux vivants (+ 89 %), les matières premières (+ 178 %) ainsi que les huiles animales et végétales, graisses et cires, inexistantes en 2002 et atteignant désormais 51 millions d’euros. Toutefois, il convient de souligner les très fortes variations de ces importations pendant cette période. En effet, en 2007, elles ont atteint 12,575 milliards d’euros avant de décliner jusqu’en 2014. Ces variations s’expliquent, très logiquement, par les soubresauts du prix des matières premières, la catégorie SITC6 incluant les métaux non ferreux, dont le cuivre.
Par conséquent, la balance commerciale bilatérale (des biens) s’est progressivement rééquilibrée en faveur de l’Union européenne, comme le montre le graphique suivant :
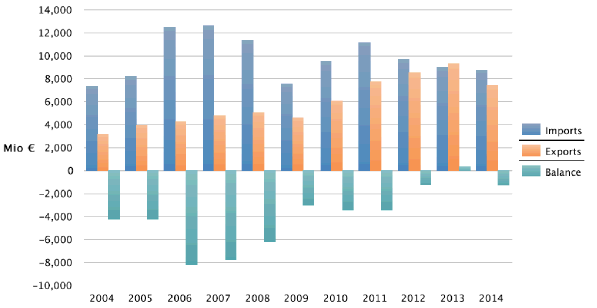
S’agissant des services, les données sont évidemment moins précises et actuelles mais néanmoins disponibles sur le site d’Eurostat. Il indique que les exportations européennes de services vers le Chili ont augmenté de 138 % depuis 2004, atteignant 3,2 milliards d’euros en 2012. Cette année-là, près de la moitié consistait en des exportations de services de transport, suivies par les assurances et autres services aux entreprises. Cette même année, les exportations chiliennes de services vers l’UE s’élevaient à 1,6 milliard d’euros, en hausse de 94 % par rapport à 2004, les services de transport représentant plus de la moitié de celles-ci, suivis par les télécommunications et les services financiers.
Par conséquent, la balance bilatérale du commerce des services est très favorable à l’Union européenne, celle-ci dégageant un excédent (en 2012) de 1,6 milliard d’euros, allant en s’accroissant.
Cependant ces chiffres publics, pour favorables qu’ils soient, ne prouvent rien en eux-mêmes s’agissant de l’impact de l’ALE UE-Chili et ce, pour plusieurs raisons. La première, d’ordre général, est qu’ils doivent être confrontés à l’évolution globale du commerce européen et chilien avec les autres pays. Si le commerce UE-Chili a progressé au même rythme, force serait alors de reconnaître que l’ALE n’a eu d’effet, encore qu’il soit possible d’affirmer que, sans ce dernier, le commerce bilatéral aurait augmenté plus lentement. De même, la baisse du commerce bilatéral en 2008-2009, imputable à la crise financière, aurait peut-être été plus forte sans l’ALE.
La deuxième raison tient à la caractéristique des exportations chiliennes. Celles-ci sont constituées, pour une large part, de cuivre (copper), comme le montre le graphique suivant :
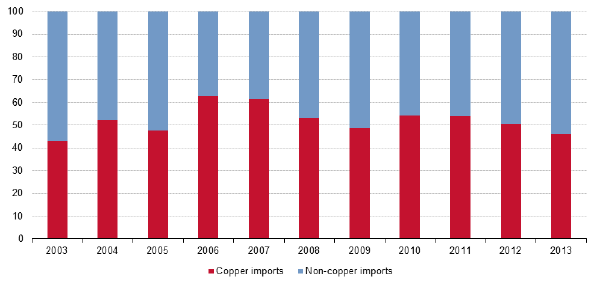
Par conséquent, toute variation dans le prix du cuivre impacte fortement l’évolution du commerce bilatéral. L’analyse de celui-ci doit donc faire abstraction de ces variations.
Enfin, afin de mesurer l’impact de l’ALE UE-Chili, il est nécessaire de distinguer entre les produits ayant été libéralisés et ceux qui ne l’ont pas été, ce qui implique d’analyser les évolutions, pour les biens du moins, ligne tarifaires par ligne tarifaire. L’analyse est évidemment bien plus compliquée pour les services puisque, ainsi qu’il a été dit à maintes reprises, ceux-ci ne font pas l’objet de barrières tarifaires mais, pour l’essentiel, de barrières non tarifaires. Relier une éventuelle augmentation des échanges de services à une réduction des barrières que, par ailleurs, il est difficile de mesurer, indépendamment d’autres facteurs plus larges, apparaît ainsi particulièrement ardu et, en tout état de cause, ne ressort pas des chiffres présentés supra.
En outre et surtout, la seule étude des flux commerciaux ne dit rien de l’impact macroéconomique de l’ALE sur l’économie en particulier sur la production, les revenus et le PIB.
L’accord d’association avec le Chili est le seul accord, avec l’ALE UE- Mexique, qui ait fait l’objet d’une véritable étude d’impact ex-post. Vos rapporteurs ont fait le choix d’analyser celle-ci car elle est exemplaire de ce qu’est, pour la Commission, le travail d’évaluation ex-post d’un ALE. Comme indiqué supra, cette étude, réalisée par un consultant indépendant (ITAQA), s’inspire fortement des SIA dans sa méthodologie tout en évaluant, comme ces dernières, à la fois les impacts économiques mais également sociaux et environnementaux de l’accord.
Le fait que la Commission ait recouru à un consultant extérieur pour évaluer l’impact de l’accord UE-Chili n’était pas motivé par le seul souci de l’impartialité dans l’évaluation ; comme pour la SIA, ce recours est nécessaire compte tenu de la complexité de l’analyse et de l’utilisation de la modélisation. Le consultant le dit d’ailleurs sans ambages : « l’analyse statistique des flux commerciaux fournit quelques éléments à propos de l’effet de l’accord entre l’Union européenne et le Chili. Pour autant, une approche plus structurée est nécessaire pour établir le lien de causalité ». En effet, il est nécessaire d’isoler les droits de douanes des autres déterminants des flux commerciaux, lesquels sont liés à des tendances spécifiques à chaque produit dans l’offre et la demande, tant au Chili que dans l’UE. Ces évolutions sont contrôlées par l’analyse, plutôt que des flux bilatéraux commerciaux eux-mêmes, de l’évolution au-delà de ce qu’on pourrait attendre en se basant sur les exportations et les importations de pays tiers. L’approche par les « écarts dans les différences » permet, selon le consultant, « une évaluation appropriée du lien entre la diminution des barrières tarifaires et le commerce bilatéral entre les parties ».
Le consultant utilise ainsi un modèle de gravité reposant sur une estimation des élasticités de substitution secteur par secteur, tant pour les importations chiliennes de l’UE que pour les importations européennes du Chili. Ce modèle, qui exclut par ailleurs le cuivre et les autres minerais, montre que « l’accord a eu un impact significatif sur le commerce bilatéral » :
– les élasticités de substitution entre les importations du Chili et celles des autres producteurs sont estimées à environ 10 en moyenne, suggérant qu’une baisse de 1 % des droits de douane se traduira par une augmentation de 10 % des importations en comparaison avec les autres producteurs ; des simulations simplifiées, qui ne prennent pas en compte les effets sur les prix, les revenus et les productions, et plus généralement ignorant les effets d’équilibre général, suggèrent que les importations européennes du Chili auraient été de 15 % inférieures en 2009 si le Chili avait simplement bénéficié du système SPG. Si le régime de la NPF avait été applicable, le niveau aurait été 20 % plus bas ;
– les élasticités de substitution entre les importations de différents producteurs sont plus importantes pour les importations chiliennes depuis l’Union européenne, avec une moyenne de 15. Par conséquent, l’impact de l’accord a été d’autant plus fort par rapport au contrefactuel de la clause NPF (les SPG ne s’appliquant évidemment pas aux importations européennes). C’est ainsi que, sans l’accord, les importations européennes du Chili auraient été 38 % inférieures au niveau observé en 2010.
Le même exercice a été fait s’agissant de l’impact de l’accord sur le commerce bilatéral de services. Cependant, la construction d’un contrefactuel via une équation de gravité est encore plus compliquée pour les services que pour les biens. En effet, tout en prenant en compte l’impact du GATS, le consultant a dû évaluer les engagements de libéralisation de l’Union et du Chili pour chaque secteur – alors même qu’ils étaient très larges et vagues, les mettre en rapport des évolutions observées du commerce bilatéral des services, et pallier à la faiblesse des statistiques dans nombre de secteurs. Par conséquent, le consultant avoue lui-même que son évaluation de l’impact de l’accord doit être considérée comme une « tentative », celle d’appliquer au commerce des services un modèle élaboré pour le commerce des biens.
Quels sont les résultats du modèle ? Le mieux est de citer in extenso l’étude : « les exportations européennes de services vers le Chili ont eu tendance à croître après l’entrée en vigueur de l’accord dans les secteurs pour lesquels les engagements de libéralisation étaient importants ; cependant, qu’il y ait un lien de causalité est incertain ».
Enfin, l’étude d’impact analyse les effets macroéconomiques et sectoriels de l’accord via un modèle d’équilibre général calculable mais uniquement pour l’économie chilienne. En effet, si l’Union européenne représente 22 % des exportations du Chili et 13 % de ses importations (en 2008), le Chili ne représente que 0,7 % des importations européennes et 0,4 % de ses exportations, rendant en pratique inutilisable un modèle EGC. Le consultant estime que l’accord ayant permis une forte augmentation des exportations chiliennes de produits agricoles et alimentaires, notamment du vin et des fruits, vers l’Union, la production nationale de ces produits s’est accrue, concentrant l’essentiel des effets positif de l’accord. En revanche, la concurrence accrue dans les secteurs industriels a eu des conséquences négatives pour la production chilienne. Globalement, le PIB chilien s’est accru de 0,05 % et le revenu national de 0,23 %. Cependant, le consultant attire l’attention sur le fait que son modèle ne prend pas en compte les mesures non-tarifaires pas plus que les effets indirects que sont, par exemple, les effets pro-concurrentiels ou les gains liés aux économies d’échelle.
En conclusion, l’étude met en avant un effet économique positif de l’accord UE-Chili. Toutefois, la quantification de cet effet se heurte à des difficultés méthodologiques quasiment insurmontables, d’ailleurs parfaitement admises par l’étude.
Accord d’ancienne génération, l’accord UE-Chili ne comporte pas de dispositions relatives aux droits sociaux et environnementaux. Pour autant, les seules dispositions relatives au commerce peuvent avoir un impact sur l’environnement et les conditions de travail. L’étude ex-post n’ignore pas ces enjeux et les a analysés au même titre que l’impact proprement économique de l’accord.
L’analyse de l’impact environnemental de l’accord repose à la fois sur un modèle d’équilibre général calculable et sur des entretiens avec les parties prenantes. Le modèle met en évidence le fait que l’accroissement des exportations de biens à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord implique à la fois une augmentation de la production chilienne des produits concernés mais également des changements sectoriels. Toutefois, l’étude souligne que « l’accord a eu un impact limité sur la croissance des secteurs qui polluent le plus », notamment les mines. En effet, la quasi-totalité des minerais bénéficiaient dès auparavant d’un accès libre au marché européen. L’accord n’a donc rien changé. De même pour les produits du bois chiliens, qui n’étaient pas frappés de droits de douane. En revanche, « l’accord a joué un rôle significatif dans la croissance des exportations chiliennes de saumon », lesquelles « sont sources de nombre d’externalités négatives comme la dissémination de germes, parasites et produits chimiques ».
L’agriculture fait l’objet d’une analyse plus approfondie, les produits agricoles et alimentaires chiliens étant, ainsi qu’on l’a indiqué, les principaux bénéficiaires de l’accord. « L’analyse de la décomposition de la production montre ainsi que l’accord a entraîné une augmentation limitée, quoique notable, dans l’utilisation des produits fertilisants. De plus grandes exportations de fruits et de vins ont ainsi pu conduire à une augmentation de l’usage des pesticides ». Cependant, l’étude nuance aussitôt ce constat. « Les règles strictes de l’Union, en particulier celles concernant les résidus de pesticides et le fait que l’agriculture d’exportation tende à réduire l’intensité de l’utilisation des pesticides suggère que l’accord a eu peu d’impact dans ce domaine ». À l’inverse, ces exportations peuvent avoir un effet positif en incitant les producteurs locaux à adopter des techniques plus « vertes » pour satisfaire aux normes européennes, adoption facilitée par l’augmentation des échanges de biens environnementaux dont le commerce a été libéralisé par l’accord.
L’étude analyse également les impacts sociaux de l’accord. Compte tenu de la différence de taille entre les économies européenne et chilienne, il est improbable que l’accord ait eu le moindre coût d’ajustement notable dans l’Union, si bien que l’étude se concentre exclusivement sur le Chili. Le modèle met en évidence des réallocations sectorielles de facteurs de production en raison de l’augmentation de la demande dans l’agriculture et les pêcheries, concomitante à une baisse de la demande dans certains secteurs industriels comme les biens d’équipement. Toutefois, « ces réallocations sont faibles comparées aux changements structurels rapides qu’a connus l’économie chilienne depuis 2003 ».
L’agriculture représente, une fois de plus, un cas à part. L’augmentation des exportations agricoles n’est pas neutre sur la taille et le type d’exploitation agricole au Chili. Les petites fermes dédiées à l’agriculture de subsistance
sont bien moins susceptibles de profiter de l’accord que les grandes
fermes modernes, en plus d’être confrontées à une nouvelle concurrence.
Par conséquent, il est possible que les inégalités de revenus dans le secteur agricole s’accroissent, avec cette nuance que le revenu moyen agricole augmentant, l’inégalité entre le secteur agricole et les autres secteurs diminue.
Enfin, d’une manière générale, l’étude note qu’il est « difficile d’isoler les conséquences de l’accord de celles résultant d’un mouvement global de libéralisation », rappelant que la modélisation ne peut que dégager certaines tendances et rien de plus.
2. Dans le cas de l’ALE UE-Corée du sud, la Commission a mis en avant ses bénéfices sans recourir à la modélisation
L’utilité de la modélisation pour évaluer de manière complète l’impact d’un ALE est incontestable. Cependant, sans attendre la réalisation d’une étude d’impact ex-post de l’ampleur de celle produite pour l’accord UE-Chili, la Commission s’est publiquement félicitée des bénéfices de l’ALE UE-Corée du sud, en se basant exclusivement sur l’analyse des flux commerciaux (a). Cependant, ce que la Commission ne dit pas, c’est que ces bénéfices n’avaient pas été forcément anticipés par les études d’impact préalables, ce qui doit conduire à s’interroger sur la pertinence de celle-ci (b).
a. Les bénéfices de l’ALE UE-Corée du sud ont été mis en évidence par le dernier rapport annuel de la Commission
Sans redire ce qui a déjà été dit supra, il est cependant utile de rappeler que l’accord de libre-échange avec la Corée du sud est le premier accord dit de « nouvelle génération » signé par l’Union européenne après la relance des négociations commerciales bilatérales en 2006. Entré en vigueur le 1er juillet 2011, l’ALE à proprement parler est complété par vingt-cinq annexes, trois protocoles et quatre mémorandums.
Le premier objet de cet ALE visait, classiquement, à réduire les droits de douane subsistant entre les deux parties. Ils ont ainsi été supprimés pour 98,7 % des lignes tarifaires sur une période de cinq ans et le seront sur la quasi- totalité d’entre elles au terme d’une période de 21 ans, les produits les plus tardivement libéralisés étant, sans surprise, les produits agricoles, en particulier côté coréen. Quelques produits agricoles, en nombre assez réduit, soit sont exclus de l’accord, soit ne verront pas les droits les frappant réduits ou font l’objet de traitements spécifiques, notamment de quotas (riz, certains produits de la pêche, divers fruits et légumes…).
À cette réduction des barrières tarifaires s’ajoute celle des barrières non tarifaires qui, selon les études d’impact préalables, sont généralement plus fortes que les barrières tarifaires et sont plus élevées en Corée du Sud que dans l’Union européenne dans la majorité des secteurs industriels – notamment le textile, l’habillement, la métallurgie, les machines et surtout l’automobile –, de même que dans les services en général. Si l’ALE lui-même comporte des dispositions générales quant à la suppression des « obstacles techniques au commerce », ce sont les annexes sectorielles 2-B à 2-E qui comportent des engagements concrets dans quatre secteurs industriels clés : les produits électroniques, l’automobile, les médicaments et équipements médicaux et les produits chimiques.
Ainsi, pour les automobiles, qui sont soumises à des réglementations techniques très détaillées, les deux parties devront, dans un certain nombre de domaines (sécurité, niveau de bruit, émissions de polluants…), considérer comme satisfaisant à leur propre réglementation les véhicules importés de l’autre partie qui sont conformes aux prescriptions des règlements internationaux établis dans le cadre du Forum mondial pour l’harmonisation des réglementations sur les véhicules, dit « WP 29 » : les véhicules importés n’auront donc plus à satisfaire des standards locaux parfois complexes et changeants, en particulier en Corée du Sud. Il est en outre prévu une harmonisation dans un délai de cinq ans de 29 autres réglementations coréennes sur les règlements du WP 29. Enfin, le WP 29 est formellement reconnu dans l’accord comme l’organe international de référence pour la normalisation dans l’automobile, ce qui globalement renforce la position de l’Europe dans les processus normatifs internationaux, puisqu’elle se réfère depuis longtemps aux normes du WP 29, par opposition à l’autre grand standard mondial en la matière, édicté par les États-Unis.
L’ALE comporte également des dispositions relatives à la libéralisation du commerce des services et corrélativement du droit d’établissement des entreprises de services. Les engagements pris par la Corée du sud – dont les services sont bien moins ouverts que ceux de l’Union européenne – dépassent largement ceux qu’elle avait consentis au sein de l’accord-cadre de 1996 et à l’OMC dans le cadre de l’accord sur les services (AGCS). On relève ainsi :
– dans les télécommunications, la possibilité pour les opérateurs européens de fournir en Corée du sud des services de transmission satellitaire de signaux de télévision et de radio et ce, sans avoir à conclure des partenariats avec des opérateurs locaux, ainsi que la possibilité de détenir la totalité du capital et des droits de vote d’un fournisseur de services de télécommunications (ces concessions vont au-delà de ce qui a été obtenu par l’UE dans les accords signés auparavant avec le Chili et le Mexique, par exemple) ;
– en matière de navigation maritime, la reconnaissance pour les entreprises européennes du droit d’établissement en Corée du sud et du droit d’y accéder aux infrastructures portuaires dans les mêmes conditions que les compagnies maritimes nationales ;
– le plein accès aux services de réseau (air, eau, énergie, déchets, adduction, traitement) ;
– un plus large accès au marché sud-coréen des services financiers ;
– s’agissant des services juridiques, la possibilité pour les cabinets d’avocats de I’UE d’établir des bureaux de représentation en Corée du Sud et d’y fournir des services de conseil juridique à condition que ces derniers ne traitent pas de droit coréen ; ultérieurement, la possibilité d’accords de coopération avec des cabinets sud-coréens, puis d’entreprises conjointes.
Les marchés publics sont également libéralisés. L’accord plurilatéral de l’OMC sur les marchés publics (AMP) s’applique à l’Union européenne depuis 1996 et à la Corée du sud depuis 1997, mais les engagements coréens dans ce cadre étaient réduits, car la Corée du Sud pouvait alors invoquer son statut d’économie en développement. L’ALE élargit les engagements réciproques à des secteurs qui n’étaient pas couverts par l’AMP : les concessions de travaux publics pour ce qui concerne l’UE, et les contrats de « construction-exploitation-transfert » (BOT) pour la Corée du sud, lesquels concernent des projets d’infrastructures tels que la construction de routes.
Les droits de propriété intellectuelle sont également protégés en application de l’ALE qui couvre notamment le copyright, les dessins et modèles et les brevets. Il va au-delà des dispositions de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Il dote ainsi les titulaires de droits de propriété intellectuelle de la possibilité de les faire respecter par des mesures aux frontières (saisie en douane). Il établit également des normes spécifiques de protection de certains droits de propriété intellectuelle qui sont conformes aux conceptions européennes et françaises
en la matière, par exemple la protection des œuvres pour une durée de 70 ans après la mort de l’auteur ou le droit à une rémunération équitable et unique pour les artistes interprètes. L’accord comprend également des engagements mutuels très précis quant à la protection des indications géographiques européennes.
Enfin, parce que l’ALE UE-Corée du sud est un accord de « nouvelle génération », il comporte des engagements sur le respect des normes sociales internationales. Il est notamment stipulé que « les parties réaffirment leur engagement à mettre effectivement en œuvre » les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) qu’elles ont ratifiées et « consentent des efforts continus et soutenus en vue de ratifier » les conventions de cette organisation. Des engagements similaires sont prévus en matière environnementale : en particulier, « les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et pratiques, des accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elles ont adhéré » ainsi que « leur engagement à réaliser l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto ».
ii. Les bénéfices pour l’Union de l’accord ont été largement mis en avant par la Commission européenne
La politique commerciale européenne traverse actuellement une zone de turbulence. En effet, ses orientations libérales sont ouvertement contestées. L’opportunité de signer l’AECG comme de poursuivre les négociations du PTCI est discutée au sein de la société civile mais également au niveau politique dans certains États-membres. C’est dans ce contexte que la Commission a publié, le
1er juillet 2016, un communiqué de presse faisant suite au rapport annuel sur la mise en œuvre de l’ALE, rendu public le 16 juin 2016. Parce qu’ils mettent en évidence les bénéfices que l’Union européenne retire de cet accord, ces documents visent incontestablement à soutenir la position de la Commission et à renforcer la légitimité de la politique commerciale commune.
Il est incontestable que le montant des échanges bilatéraux a fortement augmenté, d’une part, et qu’il s’est rééquilibré en faveur de l’Union européenne d’autre part. Les exportations européennes de biens vers la Corée
du Sud ont augmenté de 55 % par rapport aux 12 mois précédant l’entrée
en vigueur de l’ALE. De 30,9 milliards d’euros, elles sont passées à 47,3 milliards d’euros. Plus précisément, les exportations de produits partiellement ou
totalement libéralisés ont augmenté de 71 et 57 % respectivement alors
que les exportations de produits relevant de la clause NPF n’ont augmenté
que de 25 %. Cette augmentation a été bien plus forte que l’augmentation
des exportations européennes vers le reste du monde. Parallèlement, les importations de Corée du sud de produits partiellement ou totalement
libéralisés ont augmenté de 64 et 35 % respectivement alors que les
importations de produits relevant de la clause NPF ont, sur la même période, diminué de 29 %.
Au total, alors que le déficit commercial de l’Union (pour les biens) vis-à-vis de la Corée du sud s’établissait à 7,6 milliards d’euros pendant la période de douze moins précédant la mise en œuvre de l’ALE, l’Union a dégagé un excédent de 7,3 milliards d’euros pour la quatrième année de mise en œuvre de l’ALE.
Du point de vue sectoriel, ce sont surtout les exportations d’équipements de transports qui ont progressé (+ 134 %). Les exportations de véhicules à moteur ont ainsi augmenté de 206 % en valeur, passant de 2 à 6 milliards d’euros et,
en volume, de 74 600 unités à 210 900. À l’inverse les importations européennes d’équipements de transport coréens sont restées stables. S’agissant des seuls véhicules à moteur, toutefois, elles ont augmenté de 53 % en valeur, de 2,6 à
4 milliards d’euros. En revanche, en volume, elles n’ont progressé que de 10 %, de 300 000 à 339 000 unités. Par conséquent, les craintes que l’ALE avait suscitées à l’époque d’une invasion de voitures coréennes sur le marché européen ne se sont pas réalisées, bien au contraire. Par ailleurs, les importations de produits
de la chimie et de plastique ont fortement augmenté (+ 115 et + 59 % respectivement).
S’agissant des services, pour lesquels les statistiques ne sont pas aussi actualisées que pour les biens, les échanges sont également très favorables à l’Union européenne, comme le montre le tableau suivant :
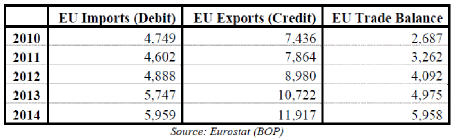
La Commissaire chargée du commerce, Mme Cecilia Malmström, s’est ainsi félicitée de ces résultats dans le communiqué précité, faisant le lien avec les négociations en cours : « les chiffres parlent d’eux-mêmes. Leur clarté devrait contribuer à convaincre ceux qui en doutent que l’Europe bénéficie largement de la libéralisation des échanges. Lorsque nos entreprises peuvent exporter plus facilement ou lorsque les sommes économisées sur les droits de douane peuvent être réinvesties dans leur développement, c’est la croissance européenne qui est soutenue. Cet anniversaire [de l’ALE UE-Corée du sud] nous donne de nombreuses raisons de relever nos manches et de conclure toutes les négociations commerciales en cours ».
b. Les bénéfices économiques de l’accord n’avaient pas été forcément anticipés par les études d’impact ex-ante
Ainsi qu’il a été dit supra, l’analyse des flux commerciaux bilatéraux donne quelques indications sur l’impact d’un ALE mais elle ne peut, à elle seule, déterminer si ce dernier a été favorable ou non à l’Union européenne. En effet, ces flux sont des données brutes, d’ailleurs présentées comme telles par la Commission dans son rapport annuel. Elle ne les accompagne ni d’une modélisation ni d’une mise en perspective qui aidera à isoler l’impact de l’ALE d’autres facteurs pouvant, eux aussi, expliquer de telles évolutions des flux commerciaux.
Le secteur automobile est ainsi exemplaire, avec d’autres (voir infra) de cette simplification à finalité politique. Le rapport annuel, on le rappelle, se félicite de la très forte croissance des exportations européennes de véhicules automobiles vers la Corée. Celles-ci ont en effet plus que triplé en valeur, passant de 2 à 6 milliards d’euros et, en volume, de 74 600 unités à 210 900. Dans le même temps, même si elles ont progressé de 53 % en valeur, les exportations coréennes de véhicules automobiles vers l’Union européenne n’ont augmenté que de 10 % en volume, à 339 000 unités. Par conséquent, lorsque l’Union enregistre un très fort déficit commercial avec la Corée du sud dans ce secteur, elle dégage désormais un excédent de plus de 2 milliards d’euros.
Vos rapporteurs se félicitent également de ce résultat, particulièrement favorable aux constructeurs automobiles européens. Pour autant, il doit être mis en rapport avec d’autres faits passés sous silence par la Commission.
Le premier, c’est que la faible augmentation des exportations coréennes vers l’Union européenne doit être relativisée par la forte augmentation de la production des constructeurs coréens en Europe. Ceux-ci ont en effet, dès avant l’entrée en vigueur de l’ALE et sans que ce dernier interrompe le mouvement, multiplié les usines dans l’Union européenne, en particulier dans les pays de l’Est. C’est pourquoi, selon les chiffres de l’association européenne des constructeurs automobiles, même si les importations de véhicules automobiles n’ont augmenté que de 39 000 unités, entre 2010 et 2015, le nombre de véhicules coréens immatriculés en Europe a augmenté de 220 000 et la part de marché de ces derniers est passée de 3,6 à 5,3 %. Ce fait n’enlève rien à la forte hausse des exportations européennes mais il nuance l’excédent commercial dégagé dans ce secteur, tout en mettant en lumière les stratégies des multinationales et la difficulté à la saisir par des faits bruts comme les flux commerciaux.
Le deuxième est inhérent à l’évaluation européenne des ALE. En effet, la Commission – et c’est somme toute logique – adopte un point de vue européen sur l’impact d’un ALE. Il a bénéficié ou pas à l’Union dans son ensemble. Les rapports annuels ne présentent que des données agrégées sans les désagréger par État-membre. Vos rapporteurs se sont ainsi intéressés aux exportations allemandes de véhicules automobiles vers la Corée et découvert qu’elles représentaient 73 % des véhicules importés dans ce pays (en 2014), tous constructeurs étrangers confondus (y compris donc les constructeurs américains ou japonais). Ce sont essentiellement les constructeurs allemands – haut de gamme – qui ont profité de l’accord. Quant aux autres, soit ils n’en ont pas ou peu profité, soit qu’ils ont opté pour d’autres stratégies, comme Renault qui a développé une filiale locale avec Samsung.
Enfin, d’une manière générale, la disparition du déficit commercial et l’apparition d’un excédent commercial tienne autant, sinon plus, de la stagnation des exportations coréennes sur le long terme que de la hausse des exportations européennes. Ainsi, si les premières ont progressé depuis 2011, c’est seulement en 2015 qu’elles ont retrouvé leur niveau de 2007. La croissance languissante de l’Union depuis la crise explique largement ce fait, dont il ne fut pas se réjouir. Par ailleurs et une fois de plus, l’analyse des flux commerciaux est incapable de saisir les stratégies de production des multinationales. Outre, l’automobile, un autre exemple est flagrant. Les importations européennes d’équipements de télécommunication coréens ont ainsi diminué de 28 % entre 2012 et 2015, non que les consommateurs européens soient moins enclins à les acheter mais en raison de la délocalisation de la production de Samsung (qui pèse à lui seul 20 % du PIB coréen) au Vietnam.
En conclusion, vos rapporteurs ne nient absolument pas l’impact positif de l’ALE mais appellent à être prudent quant à l’analyse des flux commerciaux.
ii. L’étude d’impact sur le développement durable n’avait pas saisi toutes les implications de l’ALE
Comme l’ensemble des accords de libre-échange, l’ALE UE-Corée du sud a fait l’objet d’une évaluation ex-ante sous la forme d’une étude d’impact initiale complétée par une étude d’impact sur le développement durable. Cette dernière, très complète, a retenu l’attention de vos rapporteurs.
Réalisée par IBM, l’étude repose, s’agissant de l’évaluation de l’impact économique, sur l’utilisation de modèles d’équilibre général et partiel, utilisés respectivement pour évaluer l’impact macroéconomique de l’ALE et les impacts sectoriels, en particulier sur le secteur automobile.
Du point de vue macroéconomique, l’étude constate que, quel que soit le scénario envisagé – accord limité ou ambitieux, l’impact de l’ALE sera modeste, dans tous les cas inférieur à 1 % du PIB, le pourcentage variant selon les élasticités d’Armington retenues. Ce qui est par ailleurs intéressant, c’est que la SIA synthétise les résultats des autres études qui ont été produites sur cet ALE.
Model |
Impact |
Impact | |
Pukyong (2006) |
GTAP Armington / Dynamic |
2.3 % |
- |
KIEP (2005) |
GTAP Armington |
2.0 % |
0 % |
Copenhagen Economics (2007) |
GTAP with Imperfect Competition |
2.4 % |
0 % |
SIA GTAP (2007) |
GTAP Armington |
0.2 % |
0.0 % |
SIA GTAP (2007) |
GTAP Adjusted Elasticities |
0.6 % |
0.1 % |
SIA Investment Model (2007) |
Econometric Panel Estimation |
2.1 % |
- |
Il ressort très clairement de ce tableau que toutes les études se retrouvent sur trois points : l’ALE sera bénéfique aux deux économies mais plus à l’économie coréenne qu’à l’économie européenne, compte tenu en particulier de l’asymétrie de taille entre les deux. Par ailleurs, l’impact sera faible, voire nul pour l’Union européenne. On relève cependant que les autres études sont plus optimistes que la SIA quant à l’impact de l’ALE sur l’économie coréenne. Toutefois, sans modélisation ex-post de l’impact de l’ALE, il est difficile de vérifier si ces prédictions se sont réalisées dans les faits mais au moins, le sens de toutes les études convergent.
En revanche, la SIA a largement échoué à estimer les impacts sectoriels potentiels de l’ALE, en particulier pour le secteur automobile qui, ainsi qu’on l’a vu, est l’un des principaux résultats mis en avant par la Commission dans son dernier rapport annuel.
En effet, sur la base d’une analyse microéconomique reposant sur un modèle d’équilibre partiel, l’étude élabore une base de référence, sans ALE UE-Corée du sud, à laquelle seront comparés deux impacts de l’ALE, l’un limité, l’autre fort. Pour l’Union européenne, l’étude tient compte du futur développement d’unités de production de Kia et de Hyundai en République Tchèque et en Slovaquie, dont la production respective de 300 000 et 200 000 unités est supposée se substituer en partie aux importations coréennes. Postulant des ventes de véhicules automobiles coréens à hauteur de 900 000 en 2010-2011, contre 740 000 en 2006, tous importés, les importations ne s’élèveront plus qu’à 400 000 à cette date, soit 340 000 de moins qu’en 2006. S’agissant du marché coréen, l’étude postule « un ralentissement dans la récente expansion des ventes de voitures européennes et un déclin de la part de marché des exportations européennes en Corée dans la proportion du total des importations automobiles coréennes ». Dans la base de référence envisagée, sans ALE UE-Corée du sud mais avec un accord de la Corée du sud avec les Etats-Unis et le Japon, les exportations européennes ne devraient plus progresser que de 2 000 unités par an.
Cette base de référence ayant été établie, le consultant a appliqué le modèle qui a abouti aux résultats suivants :
– dans le cas du scénario d’un impact fort, l’ALE faciliterait la poursuite d’une croissance forte des ventes de véhicules coréens en Europe à hauteur de 15 % par an, si bien qu’elles atteindraient 1,3 million en 2011, avec pour conséquence une augmentation de 400 000 unités des importations par rapport à la base de référence (900 000). Parallèlement, les exportations de véhicules européess en Corée devraient progresser de 6 000 unités par an (soit trois fois plus vite que sans ALE) ;
– dans le cas du scénario d’un impact limité, supposé le plus probable, l’ALE les ventes de véhicules coréens dans l’Union ne progresseraient que de 8 % par an, atteignant environ un million d’unités en 2010-2011. Par conséquent, les importations n’augmenteraient que de 100 000 par rapport à la base de référence. A l’inverse, les exportations européennes de véhicules à moteur vers la Corée du sud augmenteraient de 10 000 unités par an.
Ces analyses ne se sont pas révélées exactes. L’étude a largement surestimé le rythme de croissance des ventes de véhicules automobiles coréens sur le marché européen dont les immatriculations, en 2011, se sont établies à 694 000 unités, soit à peine plus que celles de 2006. Ce faisant, il est logique qu’il ait également surestimé l’augmentation des importations coréennes. À l’inverse, loin de connaître un « ralentissement dans la récente expansion des ventes de voitures européennes et un déclin de la part de marché des exportations européennes en Corée dans la proportion du total des importations automobiles coréennes », les exportations européennes de véhicules automobiles vers la Corée ont connu une progression très rapide. Selon les chiffres de l’association des constructeurs coréens (KAMA), la part des marques européennes dans les importations en Corée du sud est passée de 65,4 % en 2010 à 80,9 % en 2015.
Parmi l’ensemble des ALE actuellement en vigueur, seuls trois sont des accords de nouvelle génération : Corée du sud, Amérique centrale et Colombie/Pérou. Vos rapporteurs ont donc fait le choix de faire une évaluation de l’ALE UE-Colombie/Pérou. Ce choix a été dicté par les considérations suivantes :
– accord de nouvelle génération, il, comporte de nombreuses dispositions dans le domaine des droits humains, sociaux et environnementaux, qui sont propices à une évaluation sans modélisation, particulièrement importante pour ces pays qui ne les respectent pas forcément ;
– les controverses politiques lors de la ratification de cet accord par le Parlement européen, qui a obtenu que la Colombie et du Pérou présentent deux « feuilles de route » incluant des engagements supplémentaires dans le domaine des droits humains, sociaux et environnementaux ;
Vos rapporteurs sont en effet convaincus, d’une part, que l’évaluation sans modélisation a un intérêt, notamment pour les impacts non-économiques des accords, et que l’absence de recours à la modélisation ne doit pas servir d’excuse pour s’empêcher d’évaluer les impacts économiques, à condition toutefois de se rendre sur place, comme ils l’ont fait à Lima et Bogota En effet, par des rencontres avec des ONG, des universitaires, des entreprises, des membres du gouvernement et du Parlement, il est tout à fait possible de se faire une idée de l’impact de l’accord : ce sera une opinion, nécessairement subjective, mais pas plus que peut l’être une modélisation qui, comme on l’a vu, repose aussi sur la subjectivité du choix des paramètres
À la suite de la publication, par la Commission, de sa Communication « Une Europe compétitive dans une économie mondialisée », l’Union européenne a réorienté sa politique commerciale vers la signature d’accords de libre-échange bilatéraux. Ont ainsi été ouvertes, à partir de 2006, des négociations avec la Corée du sud, les pays d’Amérique centrale et, enfin, la Communauté andine (CAN) (20).
En 2006, la Communauté andine traversait une crise grave marquée par la sortie du Venezuela et par une opposition croissante entre, d’un côté, la Bolivie et l’Équateur nationalistes et étatistes et, de l’autre, une Colombie et un Pérou ouverts au libre-échange et au libéralisme économique. Ces deux pays avaient d’ailleurs, cette même année, signé un ALE avec les États-Unis, cause directe de la rupture avec le Venezuela. Comme l’ont constaté vos rapporteurs, tant le Pérou que la Colombie donnent désormais la priorité à l’Alliance du Pacifique (21) sur la CAN, décrédibilisée et sans leadership.
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté andine, dont les négociations ont été ouvertes en juin 2007, devait reposer sur trois piliers : le dialogue politique, la coopération pour le développement et les relations commerciales. Un tel accord allait donc bien au-delà des seules questions commerciales et était censé consolider les relations politiques entre les deux régions et, ainsi, renforcer la stabilité politique et économique des pays andins en favorisant l’intégration régionale. Toutefois, arguant de sa Constitution mais en réalité mécontente de l’orientation libre-échangiste de l’accord, la Bolivie s’est retirée des négociations, dès 2008, suivie par l’Équateur l’année suivante en raison, pour ce dernier, d’un contentieux sur le commerce des bananes, porté par l’Union européenne devant l’organe de règlement des différends de l'OMC.
Les négociations se sont néanmoins poursuivies avec les deux pays restants, la Colombie et le Pérou mais exclusivement sur les questions commerciales, s’achevant par un accord signé en mars 2011. Par conséquent, visant à l’origine un objectif très ambitieux, les négociations n’ont abouti qu’à un simple accord de libre-échange limité qui plus est à deux pays sur les quatre que compte la Communauté andine.
Cependant, bien qu’ayant quitté les négociations en 2009, l’Équateur a rapidement été rattrapé par une réalité juridique qui l’a obligé à reprendre les négociations. En effet, la réforme du Système des Préférences généralisées (SPG) mise en œuvre par l’Union européenne à compter du 1er janvier 2014 réserve aux seuls pays dont le revenu annuel par habitant est inférieur à 4 000 $ les facilités d’accès au marché européen. Dépassant ce seuil, l’Équateur aurait donc été confronté, dès décembre 2014, à une augmentation des droits de douane sur ses exportations à destination de l’Union européenne. Conscient de cette échéance, il a demandé à rouvrir les négociations qui se sont conclues très rapidement, en décembre 2014, par un protocole d’adhésion à l’ALE signé avec la Colombie et le Pérou, moyennant quelques dispositions spécifiques. En échange, le règlement n° 1384/2014 du 18 décembre 2014 maintient à l’Équateur le bénéfice des SPG jusqu’à la ratification du Protocole d’adhésion et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2016.
ii. Une approbation difficile, acquise après la présentation, par la Colombie et le Pérou, de « feuilles de route » complétant l’accord
Comme l’ensemble des ALE depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l’ALE UE-CAN devait être approuvé par le Parlement européen. Cette approbation a été précédée par une intense campagne d’ONG attirant l’attention sur les conséquences selon elles dommageables de cet accord pour les pays et les populations concernés. Les risques d’un tel accord étaient, selon elles, les suivants :
– saper le processus d'intégration de la région andine et limiter la capacité de ces pays à définir leur propre politique économique de développement ;
– renforcer le modèle extractiviste minier de la Colombie et du Pérou avec de lourdes conséquences en particulier pour les communautés indigènes (accaparements de terre et déplacements forcés) et pour l’environnement (pollution des eaux et des terres, destruction de la biodiversité…). La Colombie et le Pérou sont ainsi le théâtre de conflits sociaux et environnementaux de plus en plus nombreux, généralement sévèrement réprimés par les autorités et/ou des milices ;
– détruire l’agriculture vivrière en exposant les producteurs à la concurrence d’une agriculture européenne hautement compétitive (et subventionnée) et inciter, par la suppression des droits de douane européens, au développement de cultures d’exportations, à commencer par l’huile de palme, au détriment des forêts humides amazoniennes ;
– légitimer les gouvernements du Pérou et de Colombie, pays le plus dangereux au monde pour les syndicalistes, qui perpétuent un climat d'impunité face aux graves violations des droits humains commises dans ces pays.
Cette campagne a été efficace puisque, dans sa résolution du 13 juin 2012, le Parlement européen se déclare en substance insatisfait des dispositions relatives aux droits humains, sociaux et environnement dans l’accord. Par conséquent, il « prie les pays andins de veiller à l’élaboration d’une feuille de route transparente et contraignante pour les droits de l’homme, les droits du travail et les droits environnementaux dont l’objectif serait principalement de protéger les droits de l’homme, et de renforcer et d’améliorer les droits des syndicalistes et de sauvegarder l’environnement ». En pratique, cinq domaines d’action sont identifiés dans la résolution :
– l'application et la mise en œuvre de nouveaux actes législatifs et l'adoption de nouvelles mesures politiques qui garantissent la liberté d'association et le droit de négociation collective, sans lacunes, notamment pour les travailleurs du secteur informel, en particulier au travers de l'élimination du recours aux coopératives, aux pactes collectifs ou autres mesures qui ont pour finalité ou pour effet de priver les travailleurs de leurs droits syndicaux ou des bénéfices d'une relation de travail directe ;
– la réalisation d'inspections du travail strictes qui aboutissent à des sanctions en cas de discrimination, de licenciements injustifiés, d'intimidation ou de menaces à l'encontre de travailleurs ;
– l'introduction de mesures concrètes et mesurables visant à renforcer le dialogue social aux niveaux local et régional ainsi qu'à l'intérieur des entreprises ;
– la mise en place de mesures visant à garantir l'application efficace de la législation en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité, en particulier contre les effets négatifs de la déforestation et de l'extraction de matières premières ;
– l'adoption des mesures nécessaires pour mettre un terme à l'impunité, la réalisation d'enquêtes, la poursuite et la sanction au civil des principaux responsables, d'un point de vue tant intellectuel que moral, des crimes commis en Colombie.
Le Pérou comme la Colombie ayant présenté des « feuilles de route » satisfaisant à ces exigences, le Parlement européen a approuvé l’accord le 11 décembre 2012, permettant son entrée en vigueur provisoire dans l’attente de sa ratification par l’ensemble des États-membres. En effet, l’ALE UE-Colombie/Pérou, comme d’ailleurs les ALE UE-Corée du sud et UE-Amérique centrale, est un accord mixte, c’est-à-dire un accord comprenant des dispositions relevant à la fois de la compétence de l’Union européenne et des États-membres. Par conséquent, une ratification par l’ensemble des États-membres est nécessaire pour son entrée en vigueur complète, seules les dispositions relevant de la compétence européenne s’appliquant de manière provisoire.
En France, le projet de loi autorisant la ratification de cet ALE a été présenté à l’Assemblée nationale et le Sénat qui l’ont adopté fin 2015 sans susciter de débat particulier, le choix ayant été fait d’une adoption selon la procédure simplifiée (adoption sans débat en séance publique). En revanche, on relève une certaine mobilisation de la société civile en France. Une lettre a ainsi été envoyée à Matthias Fekl et aux parlementaires par un collectif d’ONG le 15 septembre 2015, les alertant « sur les conséquences dramatiques de ces accords pour les droits de l’Homme, les droits sociaux, les droits des peuples autochtones et des paysan-ne-s et les droits environnementaux dans ces pays ». Les arguments soulevés dans la lettre étaient globalement les mêmes que ceux avancés de la ratification par le Parlement européen.
L’accord de libre-échange de l’UE avec la Colombie et le Pérou est, comme tous les ALE de l’Union européenne signés depuis 2009, un accord de « nouvelle génération », c’est-à-dire qu’il ne se borne pas à la seule réduction des barrières tarifaires mais inclut également des dispositions relatives aux barrières non-tarifaires, aux droits de propriété intellectuelle, au développement durable ainsi que des dispositions institutionnelles.
Tant le Pérou que la Colombie bénéficiaient, lors de la signature de l’ALE en 2012, du Système des Préférences Généralisées (SPG) qui leur garantissaient un accès au marché européen sans droits de douane ni contingentement pour 66 % des lignes tarifaires. Pour les produits concernés, l’ALE n’a donc pas d’autre conséquence que de garantir à ces deux pays le maintien de l’avantage tarifaire qu’ils auraient perdu avec la réforme du Système (voir supra). En revanche, les exportateurs européens qui, par définition, ne profitent en rien du SPG, bénéficient directement de la réduction des barrières tarifaires mise en œuvre par l’ALE. Une étude du Parlement européen (22) montre ainsi que respectivement 90 % et 24 % de la valeur des exportations européennes en Colombie et au Pérou subissaient des droits de douane en 2012, allant de 5 à 94 % en Colombie et de 9 à 17 % au Pérou.
Cependant, afin de limiter les conséquences de l’ouverture de marchés péruviens et surtout colombiens jusqu’alors protégés, le calendrier du démantèlement tarifaire est à la fois complexe et très progressif. C’est ainsi que, si certains produits comme les vins feront l’objet d’une libéralisation totale et immédiate, tel n’est pas le cas pour de nombreux produits pour lesquels elle sera progressive :
– sur six ans pour les exportations de médicaments et vaccins au Pérou ;
– sur respectivement onze ans et six ans pour les exportations de papier ;
– sur onze ans pour les exportations de whisky en Colombie ;
– s’agissant des exportations européennes d’automobiles, aujourd’hui frappées d’un droit de douane de 35 % en Colombie, elles seront totalement libéralisées en huit ans. Pour les exportations européennes d’automobiles à destination du Pérou, qui subissent un droit de douane de 30 %, le démantèlement de ce dernier interviendra en six ans pour les cylindrées comprises entre 1600 et 300 cc et en 11 ans pour les autres.
En revanche, pour certains produits sensibles, l’Union européenne a imposé un contingentement aux importations en provenance du Pérou et de Colombie. C’est le cas par exemple pour le rhum, le sucre et les produits à base de sucre, la viande (bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille), les produits laitiers (lait, poudre de lait, yaourt, crème de lait, beurre, lactosérum et fromages), l’ail, le maïs doux, les champignons et l’amidon de manioc. Par ailleurs, les bananes font l’objet d’une réduction progressive des droits de douane jusqu’en 2020, assortie d’une clause de sauvegarde en cas de forte augmentation des exportations péruviennes et colombiennes (voir supra). Celle-ci est mesurée à partir d’un seuil de déclenchement – différent pour les deux pays – par ailleurs augmenté tous les ans jusqu’à sa disparition à la date précitée.
Inversement, le secteur du lait étant particulièrement sensible en Colombie, l’élimination totale des droits de douane sur les produits laitiers s’étalera sur quinze ans. En outre, certaines exportations européennes comme la poudre de lait sont contingentées et des clauses de sauvegarde sont prévues pour une durée maximale de dix-sept ans pour des produits comme le lait écrémé en poudre, le fromage et le lait pour nourrisson. Enfin, l’Union européenne soutient financièrement la modernisation du secteur laitier colombien. 30 millions d’euros seront ainsi été débloqués, sur six ans, afin d’améliorer sa compétitivité et sa durabilité.
Hors automobile, il convient de souligner l’effort fait par la Colombie en matière de libéralisation des importations de produits industriels. La Colombie a en effet éliminé 65 % des droits de douane applicables aux importations de produits industriels en provenance de l’Union européenne à l’entrée en vigueur de l’accord, en éliminera 20 % de plus sur les cinq années suivantes, et le reste entre sept et dix ans. À l’inverse, la quasi-totalité des droits de douane sur les exportations colombiennes de produits industriels sont éliminés dès l’entrée en vigueur de l’accord, ce qui a cependant peu de portée considérant la structure des exportations colombiennes.
De plus, comme l’indique à juste titre la Commission européenne, « la suppression des barrières tarifaires serait sans effet si subsistent des barrières techniques et réglementaires ». C’est pourquoi l’ALE comporte plusieurs chapitres relatifs aux procédures douanières, aux barrières techniques au commerce et, enfin, aux règles sanitaires et phytosanitaires. La portée de ces chapitres est cependant très limitée. En effet, au-delà des déclarations d’intention, la principale mesure qu’ils comportent est la notification préalable des nouvelles réglementations et l’obligation de fournir une réponse écrite aux demandes de l’autre partie. Leur mise en œuvre repose sur des sous-comités, instances de dialogue entre les deux parties et les différentes parties prenantes (voir infra).
L’ALE ouvre également, dans une certaine mesure, les marchés publics colombiens et péruviens les plus importants aux entreprises européennes, y compris au niveau local.
Enfin, l’ALE protège 92 indications géographiques européennes (parmi lesquelles 42 françaises dont le Champagne, le Roquefort et les vins de Bordeaux) sur les marchés colombiens et péruviens. La liste pourra être complétée dans le cadre du dialogue au sein du sous-comité chargé de la propriété intellectuelle (voir infra).
Accord de nouvelle génération, l’ALE ne se limite pas à des dispositions relatives au commerce. Il comporte en effet un titre IX dédié au développement durable dans ses dimensions sociale et environnementale. Il contient deux types de dispositions de portée différente :
– les dispositions relatives à la coopération. L’article 286 de l’accord liste ainsi une série de sujets en matière sociale et environnementale devant faire l’objet d’une coopération entre l’Union, d’une part, la Colombie et le Pérou, d’autre part. Sont notamment cités les conditions de travail, la biodiversité, la pêche et le changement climatique ;
– les dispositions plus contraignantes portant sur la mise en œuvre des normes internationales dans le domaine social et environnemental. C’est ainsi que les parties s’engagent à mettre effectivement en œuvre les droits reconnus dans les huit conventions fondamentales de l’OIT, à savoir la liberté d’association et le droit à la négociation collective, l’élimination de toutes les formes de travail forcé, l’interdiction du travail des enfants et l’élimination des discriminations en matière d’emploi. De même, sont citées un certain nombre de conventions environnementales multilatérales que les parties s’engagent à appliquer. Il convient de souligner que ces dispositions, comme l’ensemble du titre IX, sont exclues du mécanisme de règlement des différends.
Enfin, l’article 1er de l’ALE fait référence aux « principes démocratiques et droits fondamentaux de l’homme » dont la violation par la Colombie et le Pérou pourrait justifier une suspension de l’application de l’accord.
Le titre II de l’ALE institue un comité « Commerce » composé de représentants de l’UE, du Pérou et de la Colombie, et 8 sous-comités chargés, d’une manière générale, de superviser la mise en œuvre de l’ALE. Ces sous-comités sont :
– le sous-comité chargé des barrières techniques au commerce ;
– le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle ;
– le sous-comité chargé de l’agriculture ;
– le sous-comité chargé des marchés publics ;
– le sous-comité chargé des mesures SPS ;
– le sous-comité chargé du développement durable ;
– le sous-comité chargé des questions liées aux douanes, à la facilitation des échanges et aux règles d’origine ;
– le sous-comité chargé de l’accès au marché.
Le comité et les sous-comités se réunissent généralement une fois l’an. Leur activité fait l’objet d’une mention dans le rapport annuel de la Commission, même si les informations sur leur composition, leur fonctionnement ainsi que leurs travaux sont très succinctes.
Par ailleurs, l’Union européenne a institué un mécanisme interne de consultation à travers un « groupe consultatif interne », composé de représentants des syndicats, des entreprises et des ONG, qui se réunit au moins une fois par an à Bruxelles et dont le secrétariat est assuré par le Comité économique et social européen. Le groupe s’est réuni trois fois depuis l’entrée en vigueur de l’ALE et la dernière fois le 6 avril 2016.
2. Bien que globalement satisfaisante, la mise en œuvre de l’ALE pose la question de la portée des dispositions relatives aux droits humains, sociaux et environnementaux
a. Des premiers résultats satisfaisant sur le plan économique, malgré quelques difficultés de mise en œuvre
S’il est vrai que seules trois années se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur (provisoire) de l’ALE, il est toutefois possible de faire un premier bilan de ses effets. Eurostat a en effet récemment mis à jour les statistiques des échanges de biens entre l’UE et la Colombie, désormais disponibles de manière détaillée pour les années 2012 à 2015. En revanche, ce n’est pas le cas pour le commerce des services ainsi que pour l’investissement.
Les deux tableaux suivants mettent en évidence à la fois l’évolution globale des échanges bilatéraux de biens depuis 2005 (ainsi que la balance commerciale) et la décomposition de ceux-ci sur la période 2012-2015, incluant donc la dernière année précédant la mise en œuvre de l’ALE UE-CAN.
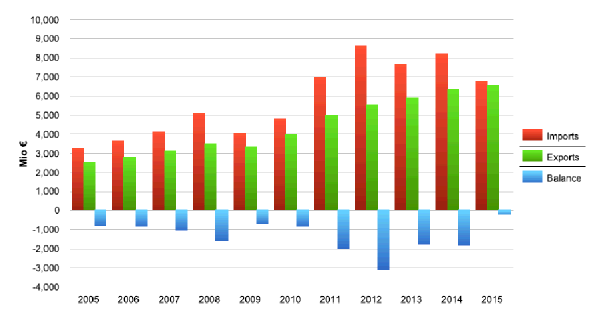
Il apparaît très clairement une réduction du déficit commercial de l’UE vis-à-vis de la Colombie découlant d’un mouvement de ciseau entre l’accroissement continu des exportations européennes et la réduction tendancielle, après une forte augmentation, des exportations colombiennes. Toutefois, il convient de souligner que l’augmentation des exportations européennes avait commencé bien avant l’entrée en vigueur de l’ALE.
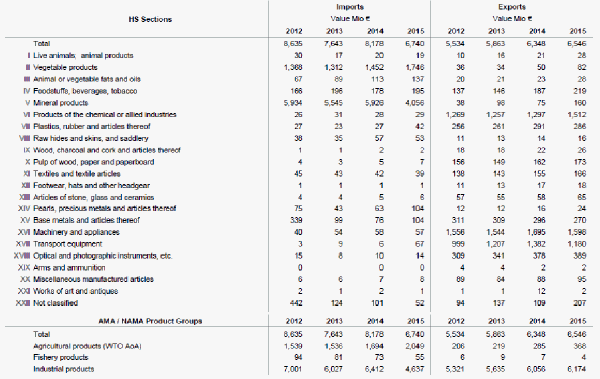
L’analyse décomposée (en valeur) des flux commerciaux met en évidence les évolutions suivantes qu’il est possible de croiser avec les rapports annuels de la Commission :
– une augmentation des exportations colombiennes et européennes de fruits et légumes et des exportations européennes de produits animaux, tabacs et boissons, cohérente avec l’abaissement des droits de douane. Au total, les exportations colombiennes de produits agricoles ont augmenté de 33 % et les exportations européennes de 78 %.
– une diminution des exportations colombiennes de minerais, cohérente cette fois avec la baisse continue, ces dernières années, du prix des matières premières sur les marchés mondiaux ;
– une augmentation des exportations européennes d’équipements de transport (voir infra).
Le déplacement de vos rapporteurs à Bogota a permis d’enrichir cette analyse des premiers effets de l’ALE au-delà des seules statistiques. D’une manière générale, cet accord est perçu positivement par le gouvernement colombien ainsi que par les premières intéressées : les entreprises colombiennes et les entreprises européennes installées en Colombie. L’accord a en effet permis à la Colombie de diversifier ses exportations au-delà de ses points forts traditionnels et, en particulier, des produits miniers. Trois exemples ont été cités, cohérents avec les statistiques précitées :
– les bananes, bien sûr, qui étaient exclues des PSG et qui, désormais, bénéficient d’une réduction progressive des droits de douane dans la limite d’un contingent ;
– les avocats, dont les exportations vers l’Union européenne ont augmenté de 225 % depuis l’entrée en vigueur de l’ALE ;
– les fleurs, avec cette précision que les entreprises exportatrices concernées ont développé des partenariats avec des familles productrices assurant à celles-ci un revenu plus important qu’auparavant.
Par ailleurs, il a été confirmé à vos rapporteurs que le soutien budgétaire européen de 30 millions d’euros au secteur laitier colombien a permis, dans une certaine mesure, de désamorcer les craintes que suscitait l’ALE.
S’agissant des entreprises européennes, celles-ci sont parfois installées de longue date en Colombie. C’est le cas de Renault, présent dans le pays depuis 47 ans et d’ailleurs considéré comme une marque locale. Il est vrai que Renault produit des automobiles en Colombie, employant directement 1 600 personnes et indirectement 10 000 autres. Cette entreprise a directement bénéficié de l’ALE et de la réduction des droits de douane sur les pièces détachées. En revanche, les droits de douane élevés protégeaient Renault de la concurrence européenne, lui assurant un duopole avec General Motors sur le marché colombien. Certes, la baisse sur dix ans de ces droits de douane sera favorable aux consommateurs colombiens mais exposera les constructeurs locaux à une nouvelle concurrence, les forçant à améliorer leur compétitivité, peut-être au détriment de l’emploi.
Une autre entreprise française, Sanofi, a fait part à vos rapporteurs du gain qu’elle retire de l’ALE. En effet, comme Renault, Sanofi produit en Colombie des produits pharmaceutiques mais à partir d’intrants importés de l’Union européenne et, à ce titre, frappés de droits de douane. Cependant, ce bénéfice de l’ALE est, selon elle, largement contrebalancé par l’instabilité dans la régulation du prix des médicaments.
Enfin, l’ALE avec l’Union européenne mais, d’une manière générale, le libre-échange, sont fondamentaux pour la Colombie dont les relations commerciales avec ses voisins sont difficiles. Historiquement le premier partenaire commercial de la Colombie, le Venezuela traverse une crise économique et politique majeure qui a entraîné la division par sept de ses échanges avec la Colombie. Quant à l’Équateur, certaines des mesures qu’il a prises sont considérées, côté colombien, comme des barrières techniques au commerce. Ces relations difficiles avec l’Équateur sont un symptôme, parmi d’autres, de l’état de faiblesse de la Communauté andine à laquelle ni les officiels, ni les entreprises ne semblent plus croire. De ce point de vue, l’ALE pourrait bien avoir aggravé la fracture idéologique au sein de la CAN (voir supra).
Pour les Péruviens interrogés par les médias, il apparaît que le principal effet de l’ALE a été la suppression des visas jusqu’à présent exigés pour pénétrer dans l’espace Schengen. Toutefois, cette mesure – très populaire – ne figurait pas dans l’ALE mais dans un autre accord UE-Pérou. L’ALE a toutefois eu des effets économiques, mis en évidence dans les deux tableaux ci-dessous portant à
la fois l’évolution globale des échanges bilatéraux de biens depuis 2005 (ainsi
que la balance commerciale) et la décomposition de ceux-ci sur la période
2012-2015. Ceux-ci apparaissent toutefois plus incertains que dans le cas de la Colombie, notamment en raison de la forte dévaluation du Peso.
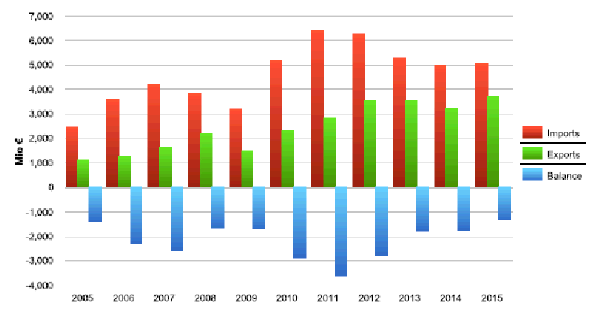
Comme pour la Colombie, la tendance générale est celle de la réduction du déficit de la balance commerciale de l’UE avec le Pérou mais cette réduction est le résultat, pour l’essentiel, de la baisse du montant des exportations péruviennes, elle-même liée à la baisse du prix des matières premières.
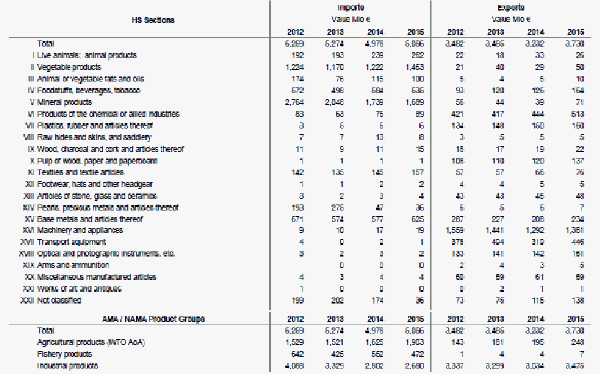
L’analyse décomposée (en valeur) des flux commerciaux bilatéraux met en évidence les évolutions suivantes qu’il est possible de croiser avec les rapports annuels de la Commission :
– comme pour la Colombie, on observe une augmentation des exportations péruviennes et européennes de fruits et légumes et des exportations européennes de produits animaux, tabacs et boissons, cohérente avec l’abaissement des droits de douane. Au total, les exportations péruviennes de produits agricoles ont augmenté de 25 % et les exportations européennes de 73 % ;
– une forte diminution des exportations péruviennes de minerais, cohérente cette fois avec la baisse continue du prix des matières premières sur les marchés mondiaux ;
– une hausse des exportations européennes d’équipements de transport.
S’agissant des bananes, qui est l’un des produits les plus sensibles de l’ALE, l’ALE ne semble pas avoir eu d’effet puisqu’en 2014, selon le rapport annuel de la Commission, les importations de bananes fraîches du Pérou ont diminué de 14 % par rapport à 2013, tout en restant supérieures au seuil de déclenchement de l’enquête de sauvegarde (qui a conclu à l’absence de tout effet sur le marché européen de la banane).
Lors des auditions à Lima, plusieurs interlocuteurs ont insisté sur la difficulté de mettre en évidence un impact réel de l’ALE, hors cas particuliers comme le quinoa. En effet, les exportations de quinoa ont été multipliées par quatre en trois ans, apportant des ressources bienvenues à des régions d’altitude défavorisées. Toutefois, que cette absence d’effet résulte d’un recul limité ou d’autres facteurs n’a jamais été très clair. Il est évident que l’effondrement du Peso a freiné les exportations européennes et contribué, avec la baisse du prix des matières premières, à la chute du commerce bilatéral. Mais peut-être cette chute aurait-elle été plus forte encore sans l’ALE, comme l’a souligné un économiste, a fortiori avec la perte programmée des SPG. Ainsi, la Chambre de commerce de Lima a insisté sur le fait que l’ALE a été bienvenu dans un contexte de ralentissement de l’économie mondiale tout en ayant permis au Pérou (comme la Colombie) de diversifier ses exportations.
Enfin, l’ALE pourrait fort bien avoir, à terme, ce qu’un universitaire auditionné a qualifié, d’ « effets invisibles », prenant pour exemple le droit de la concurrence. L’article 259 de l’accord stipule en effet que ne sont pas compatibles avec ses dispositions « les concentrations de sociétés qui entravent de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante ». Or, le Pérou n’avait pas de contrôle de concentration et, à l’été 2016, n’en a toujours pas. Cette absence est régulièrement dénoncée par les économistes et leurs critiques ont été relayées jusqu’au Parlement. S’il voit finalement le jour, le contrôle des concentrations pourrait avoir des effets considérables sur la structure de l’économie péruvienne qui ne seront peut-être pas reliés à l’ALE lui-même, bien que celui-ci aura apporté un argument fort en sa faveur, peut-être décisif.
D’une manière générale, l’impression de vos rapporteurs, appuyée par l’ensemble des auditions qu’ils ont menées, est celle de la bonne volonté du Pérou et de la Colombie dans la mise en œuvre de l’ALE. Si quelques difficultés ont pu être mises en évidence, celles-ci portent sur des points très précis, ne relèvent d’ailleurs pas forcément d’une action positive de ces deux États ni ne révèlent pas d’intention protectionniste de leur part.
Trois cas ont particulièrement intéressé vos rapporteurs. Le premier et le plus important porte sur les boissons spiritueuses. Tant la Colombie que le Pérou ont, en la matière, des pratiques qui ne sont pas conformes à l’ALE et auraient dû être modifiées. La Colombie discrimine ouvertement, sur le plan fiscal, les boissons importées des boissons produites localement. Toutefois, si rien n’a changé depuis 2013, la faute en incombe plus aux départements qu’au gouvernement colombien lui-même. En effet, ces collectivités locales disposant d’un monopole sur la vente d’alcools, elles en retirent d’importantes ressources, sans parler du fait certaines sont également productrices. Elles s’opposent donc fermement à toute réduction des taxes sur les spiritueux importés. Le relèvement des taxes sur les alcools locaux n’est pas non plus envisageable compte tenu de la contrebande importante dans ce domaine. Las d’attendre, l’Union européenne a demandé, le 13 janvier 2016, l'ouverture de consultations avec la Colombie sur cette différenciation fiscale, potentiellement contraire aux règles de l’OMC.
Toutefois, les choses semblent avancer puisqu’un projet de loi a été déposé au Parlement qui harmonise la taxation sur les boissons alcoolisées. Celle-ci serait désormais assise sur le degré d’alcool et sur le prix de vente, cette dernière composante étant prépondérante. Dans ces conditions, ce sont évidemment les spiritueux importés qui resteraient pénalisés en raison de leur prix plus élevé et, notamment les vins. Par ailleurs, les vins sont également confrontés à une réglementation contraignante puisqu’il est fait obligation aux distributeurs d’avoir un entrepôt dans chaque département, ce qui implique des coûts de transport plus élevés.
Au Pérou, la situation est différente et ne concerne qu’un seul produit, le Pisco. Alors que tous les alcools sont lourdement taxés, le Pisco est exonéré de toute taxe, considéré comme un bien culturel. Cet avantage du Pisco sur l’ensemble des autres boissons alcoolisées ne semble pas, pour le moment, devoir être remis en cause.
Le deuxième cas est celui de la réglementation colombienne relative aux camions, autrement appelée « chatarrizacion » ou mise au rebut. En effet, en Colombie, il n’est pas possible d’immatriculer un nouveau véhicule sans, dans le même temps, en détruire un autre âgé d’au moins 25 ans et ce, pour limiter le nombre de camions circulant sur les routes autant que la pollution. Il va de soi qu’un tel système constitue un obstacle majeur aux exportations européennes en contraignant fortement le marché.
Enfin, le troisième cas de mauvaise mise en œuvre du traité porte sur les mesures sanitaires et phyto-sanitaires au Pérou dans le domaine des produits laitiers et carnés. Les entreprises exportatrices européennes ont le plus grand mal à savoir quelles sont précisément les règles en la matière. Toutefois, il apparaît que ce problème n’est pas la conséquence d’une volonté protectionniste mais le résultat d’un dysfonctionnement administratif. En effet, l’application de ces règles relève de deux administrations différentes – agriculture et santé – qui ne coopèrent pas en raison de la mésentente de leurs dirigeants respectifs.
Au total, vos rapporteurs font un premier bilan relativement positif des trois années de mise en œuvre de l’ALE UE-Colombie/Pérou sur le plan économique. Les dispositions commerciales apparaissent, sauf cas particuliers, correctement appliquées par ces deux pays et ceux-ci ont retiré plusieurs bénéfices de l’accord, comme l’Union européenne. Il est toutefois difficile d’isoler les effets de l’ALE d’autres facteurs perturbant le commerce, que ce soit les variations de prix des matières premières ou celles du taux de change.
b. La question de la portée des dispositions relatives aux droits humains, sociaux et environnementaux dans les ALE
i. Les initiatives prises par la Colombie et le Pérou, tout en allant dans le bon sens, apparaissent encore insuffisantes
Le Pérou et la Colombie présentent le trait commun d’une situation en termes de droits humains, sociaux et environnementaux qui n’est pas satisfaisante : assassinat de syndicalistes en Colombie, travail des enfants au Pérou et dans tous les deux pays, déforestations à finalité agricole et projets miniers détruisant l’environnement, exploitant les travailleurs et mettant en péril les communautés locales. Cette situation est bien connue et régulièrement dénoncée par les ONG, voire des organisations internationales comme l’OIT.
L’étude d’impact sur le développement durable a montré que l’ALE, en favorisant les exportations colombiennes et péruviennes, en particulier dans le domaine agricole, ainsi que l’investissement européen, notamment dans le secteur minier, était susceptible d’aggraver encore cette situation. Les ONG, elles aussi, ont attiré l’attention sur les risques de l’ALE en matière de droits humains, sociaux et environnementaux (voir supra). Ces risques ne pouvaient donc être ignorés par la Commission qui, on le rappelle, utilise désormais ouvertement la politique commerciale afin de promouvoir le développement durable. La présence d’un titre IX dans l’ALE UE-Colombie/Pérou, centré sur le développement durable, est donc tout à fait logique de ce point de vue.
Les « feuilles de route », quant à elles, comportent des engagements supplémentaires pris par les gouvernements colombien et péruvien à la demande du Parlement européen. Extérieures à l’ALE, leur force contraignante est toutefois douteuse et d’ailleurs, la Commission européenne ne suit pas leur application. Le Parlement européen s’est cependant intéressé à celle-ci dans son étude précitée publiée en février 2016. Toutefois, ce travail d’évaluation, s’il a été commandé par la commission du commerce international (INTA), a été fait par la direction générale des politiques extérieures du Parlement européen et non pas des eurodéputés, pas plus qu’il n’a été formellement endossé, en tant que tel, par la commission INTA.
Le déplacement de vos rapporteurs à Lima et Bogota a permis d’apprécier in situ cette situation et les progrès mis en avant, lors de leur audition, par les officiels colombiens et péruviens.
Ces dernières années, le Pérou a adopté de nombreuses dispositions en faveur du développement durable que vos rapporteurs tiennent à saluer :
– en matière de protection de l’environnement : ont été institués
une agence du contrôle et de l’évaluation environnementale, un système national d’évaluation de l’impact environnemental et un système national de zones
de protection de la vie sauvage. Le Pérou a également adopté un plan
national d’action environnementale 2010-2021. Enfin, une loi a institué un moratoire de dix ans sur la culture d’OGM. Un projet de loi devait renforcer
les sanctions pour les délits environnementaux commis par les entreprises minières ;
– en matière de droits humains : le Pérou a créé un vice-ministre pour les droits humains, une direction générale des droits humains et de l’accès à la justice et un Conseil national pour les droits humains. Un plan national pour les droits humains 2012-2016 a été mis en œuvre. Enfin, le gouvernement soutient la Commission Vérité et réconciliation chargée d’indemniser les victimes de violences et de rechercher et punir les responsables de celles-ci ;
– en matière de droit du travail : les actions du Pérou concernent à la fois la lutte contre le travail des enfants (adoption d’une stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants 2012-2021), la lutte contre le travail forcé (plan national de lutte contre le travail forcé 2012-2016), le renforcement des moyens de l’inspection du travail (informatisation, aggravation des sanctions, augmentation du nombre d’inspecteurs…), l’application effective de la liberté d’association (y compris syndicale) reconnue par la constitution, et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises ;
– en matière de droits des communautés indigènes : le Pérou a ratifié en 1996 la convention n° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et adopté en 2011 la loi sur le droit des peuples indigènes à une consultation préalable ;
– en matière de participation de la société civile : le Pérou a établi plusieurs mécanismes pour permettre à la société civile de participer au processus d’élaboration des politiques publiques, sachant que cette participation est un droit reconnu par la constitution. Ont ainsi été institués, dans leur domaine respectif, plusieurs organismes de dialogue avec la société civile : le Conseil national pour les droits humains précité, le Conseil national pour la promotion du travail et de l’emploi, le Conseil national de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail et, enfin, le Conseil économique et social, en 2011.
Toutefois, l’audition de plusieurs ONG péruviennes oblige vos rapporteurs à nuancer ce tableau sur plusieurs points. En effet, ces dispositions prises par le Pérou l’ont été avec d’autres nettement moins favorables en particulier dans le domaine environnemental : abaissement des normes (notamment pour l’arsenic dans l’eau), affaiblissement des moyens des organes de surveillance environnementale, non-sanction des infractions et, d’une manière générale, priorité toujours donnée à l’investissement minier en Amazonie.
En outre, un réel problème, directement lié à la mise en œuvre de l’ALE, a été évoqué avec vos rapporteurs. Alors que celui-ci suppose la création, par le Pérou, d’une instance de dialogue avec la société civile, aucune n’a été spécifiquement créée, le gouvernement péruvien préférant utiliser les instances existantes. Toutefois, personne, y compris la Commission européenne, ne semble savoir réellement comment fonctionne ce dialogue et même s’il fonctionne. Les déclarations des ONG auditionnées à Lima laissent à penser que ce n’est pas le cas.
De même, la Colombie, dans le cadre de son « Plan d’action 2010-2014 sur les droits humains, sociaux et environnementaux », transmis en octobre 2012 afin de satisfaire à la demande du Parlement européen, a adopté de nombreuses mesures favorables à un meilleur respect de ces droits :
– des mesures en faveur des droits humains : loi sur les victimes et les restitutions de terre (2011), renforcement des moyens du bureau du procureur général pour combattre les violations des droits humains, incitation des entreprises à adopter volontairement une démarche responsable, réactivation du Comité interinstitutionnel sur les droits humains ;
– des mesures en faveur des syndicats et des travailleurs : renforcement du programme pour la protection des syndicalistes, volontarisme en matière d’investigations sur les crimes commis contre les syndicalistes, augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections, lutte contre les pratiques néfastes des entreprises en matière de sous-traitance et de négociations collectives amélioration du recouvrement des amendes… ;
– des mesures en faveur de la protection de l’environnement : réaffirmation de l’interdiction des projets miniers dans les réserves forestières, amélioration de la politique nationale en faveur de la biodiversité, mesures en faveur de l’eau, création du Conseil national de l’environnement… ;
Comme pour le Pérou, les rencontres de vos rapporteurs avec des représentants de la société civile colombienne aboutissent à nuancer sur plusieurs points les progrès enregistrés dans les domaines susmentionnés. Ainsi, les droits syndicaux continuent à être bafoués et des syndicalistes assassinés. De même, alors que certaines zones sont devenues des réserves protégées, des concessions minières ont continué à être octroyées et, plus généralement, des projets menés à bien sans considération de leurs impacts sur l’environnement et les communautés locales. Enfin, si le gouvernement colombien a bien institué une instance de dialogue avec la société civile, celle-ci rassemble surtout des représentants du monde de travail et peu d’associations actives dans le domaine de l’environnement.
Au final, le véritable problème n’est pas tant le cadre légal en matière de droits humains, sociaux et environnementaux, en amélioration constante, que l’application de ces nouvelles règles et la sanction de leur violation.
ii. L’ALE ne peut, à lui seul, améliorer la situation des droits humains, sociaux et environnementaux qui découlent de facteurs structurels dépassant largement le commerce
Le constat fait par vos rapporteurs de la mise en œuvre des dispositions relatives au développement durable est donc mitigé : de nombreuses mesures
ont été prises, allant dans le bon sens, mais leur application sur le terrain semble faire défaut. Ce constat soulève une question plus générale portant sur la portée de la présence des dispositions dans un ALE, question à laquelle l’ALE UE-Colombie/Pérou permet d’apporter des éléments de réponse.
Il est tout à fait vrai que la situation des droits humains, sociaux et environnementaux en Colombie et au Pérou n’était pas satisfaisante à l’époque, de même qu’il était possible que l’ALE aggrave celle-ci à la marge, notamment par des dommages supplémentaires à l’environnement. Cependant, les problèmes graves auxquels sont confrontés ces deux pays et leur impact sur le respect des droits susmentionnés sont pour l’essentiel structurels et dépassent largement les questions de développement économique et, a fortiori, le commerce international. En effet, c’est la guerre contre les FARC et le trafic de drogues qui sont la cause première des violations des droits humains en Colombie et l’ampleur du travail illégal qui empêche les travailleurs péruviens et colombiens de bénéficier de droits sociaux ; quant à la protection de l’environnement, elle est mise à mal par la persistance de la corruption dans ces pays et, plus généralement, la mauvaise gouvernance.
Compte tenu de ces causes structurelles, c’est à bon droit que les délégations de l’Union européenne rencontrées par vos rapporteurs appellent à être « modeste » dans l’évaluation de l’impact de l’ALE UE-Colombie/ Pérou sur le développement durable. En effet, cet accord, qui impose la signature des conventions de l’OIT, peut-il réellement améliorer la situation des travailleurs quand le travail illégal représente entre 50 et 70 % des emplois ? De même, peut-on espérer faire appliquer une législation environnementale ou sociale protectrice alors que la corruption est enracinée dans la vie politique, économique et administrative ? Les ONG l’ont d’ailleurs reconnu lors de leur audition. Souvent dénoncé comme l’un des principaux risques de l’ALE, le développement de projets miniers par des entreprises européennes et, à ce titre, soucieuses de leur image et soumises à des obligations de reporting extra-financier, représente ainsi une menace plus faible, à la fois pour les travailleurs et l’environnement, que les mines illégales au sein desquelles aucune règle n’est respectée. Enfin, faut-il blâmer l’État colombien d’être incapable, malgré un engagement réaffirmé dans le cadre de l’ALE, d’empêcher les assassinats de syndicalistes et de sanctionner leurs auteurs alors que la guerre civile, dans ce pays, a fait 260 000 morts depuis 1964, 45 000 disparus et 6 millions de déplacés ? (23)
Par conséquent, l’ALE s’est appliqué à une situation depuis longtemps dégradée sur le plan des droits humains, sociaux et environnement qu’il est hors de sa portée de changer. Les problèmes à régler relèvent en effet de vastes réformes politiques, sociales et économiques, à long terme, dépassant largement la question du commerce et du libre-échange avec l’Union. Dès lors, si les progrès apparaissent modestes, il faut se féliciter des résultats obtenus, d’autant plus que le titre IX, par la formulation de ses dispositions, n’a pas le caractère contraignant des dispositions commerciales de l’ALE.
En outre, vos rapporteurs ont observé que le lent mouvement vers une plus grande prise en compte des droits humains, sociaux et environnementaux avait débuté bien avant la signature de l’ALE. Comme l’a souligné le Défenseur du peuple à Lima (24), le Pérou a une politique active de signatures d’accords internationaux dans les domaines social et environnemental qui n’est aucunement liée à l’ALE. Elle remonte au moins à 1996 et la signature de la convention n° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes. En réalité, ce mouvement repose sur une demande profonde de la société péruvienne, comme de la société colombienne, en faveur d’une plus grande justice sociale et d’une amélioration des conditions de vie et de travail.
Dans ces conditions, s’il faut voir un impact de l’ALE, ce n’est pas tant comme moteur de l’amélioration des droits humains, sociaux et environnementaux que soutien parmi d’autres d’un mouvement qui le dépasse largement. L’une des personnalités auditionnées par vos rapporteurs a ainsi estimé que l’ALE UE-Colombie/Pérou permet de « consolider » a posteriori les avancées institutionnelles et juridiques en matière sociale et environnementale intervenues dans le pays. Cet « effet invisible » justifie le maintien de ces dispositions relatives au développement durable dans les ALE, dispositions qui illustrent par ailleurs les valeurs de l’Union dont celle-ci doit faire la promotion.
Pour la Commission toutefois, ces dispositions présentent un avantage politique évident que la modestie de leur portée réelle n’invalide pas. En effet, la politique commerciale européenne et le libre-échange d’une manière générale font l’objet d’une contestation croissante de la société civile en Europe, comme le montrent les débats concernant le PTCI. Ne pouvant plus compter sur les seuls bénéfices économiques (contestés) pour les défendre, c’est sur le développement durable que la Commission fait de plus en plus reposer la légitimité des négociations commerciales. Le risque est toutefois, comme pour l’évaluation ex-ante dont la fiabilité est remise en cause, que les avantages de ces dispositions finissent par apparaître largement surestimés.
La Commission s’est réunie le 28 septembre 2016, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information.
L’exposé des rapporteurs a été suivi d’un débat.
« M. Jacques Myard. C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de ce rapport qui, pour la première fois dans notre commission, s’intéresse à cette question d’importance qu’est l’évaluation des accords de libre-échange. J’ai particulièrement apprécié qu’il mette en évidence les « nobles incertitudes » du sport économique et, notamment, des modèles économiques utilisés. Pourtant, ce fait n’empêche pas les rapporteurs de qualifier le travail de la Commission de sérieux.
Sur cette question de l’évaluation des accords de libre-échange, et pour bien en montrer toute la complexité, je me rappelle une anecdote d’un collègue député européen. Un jour, il a voulu contrôler un projet d’accord que la Commission souhaitait être autorisée à conclure et lui a demandé de lui fournir l’ensemble des documents nécessaire. La Commission a obtempéré mais la masse considérable des documents, écrits dans un langage abscons, rendait en pratique le contrôle impossible.
Par ailleurs, il n’est pas fait mention, sauf erreur de ma part, de la Cour des comptes européenne. A-t-elle un rôle dans l’évaluation des accords de libre-échange ?
Les accords de « nouvelle génération », les rapporteurs l’ont dit, comprennent des dispositions relatives aux droits humains, sociaux et environnementaux. Cependant, je pose la question : si un accord devait être défavorable sur le plan du développement durable mais très favorable sur le plan du commerce, ne pas le signer ne serait-il pas, au final, néfaste à ces droits ? En effet, je suis convaincu pour ma part que l’ouverture au commerce d’Etats jusqu’alors fermés ne peut qu’améliorer la situation de l’ensemble de la société et contribuer à déstabiliser les régimes autoritaires.
Enfin, je m’interroge plus généralement sur ces accords de libre-échange. Reconnaissons-le : ce sont des usines à gaz qu’il est impossible ou presque d’évaluer. D’ailleurs, sont-ils si utiles lorsque l’on sait que le commerce mondial, bon an mal an, croît de 7 % en moyenne par an ? Au final, à ces accords gigantesque qui ont la prétention de tout régler dans le détail, nous pourrions préférer des accords sectoriels plus limités mais plus facilement maîtrisables.
La Présidente Danielle Auroi. Je remercie les rapporteurs pour la qualité de leur travail et souligne qu’effectivement, il y a dans l’évaluation des accords de libre-échange une sorte de « méthode Coué ». Lorsqu’on est convaincu que le libre-échange est favorable à la croissance et à l’emploi, on utilise des modèles dont on sait qu’ils confirmeront ce postulat. C’est pourquoi les développements du rapport consacrés aux modèles économiques alternatifs, comme celui utilisé par l’Université américaine de Tufts, sont tout à fait pertinents. Ce modèle a montré que le PTCI serait clairement défavorable à l’Union européenne, comme d’ailleurs l’AECG.
Ces accords de « nouvelle génération » vont bien au-delà du commerce et, comme les rapporteurs, je m’interroge également sur leur portée s’agissant du développement durable. Peut-être sont-ils les bons outils à cette fin, ou peut-être y en a-t-il d’autres, ou bien peut-être faudrait-il un mix.
Enfin, ce rapport insiste longuement sur l’échec du multilatéralisme, qui a ouvert la voie à la multiplication des accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux. On voit bien qui en sont les promoteurs : les Etats-Unis et l’Union européenne. Je pose donc la question : ne bénéficient-ils pas avant tout aux plus puissants et ne remettent-ils pas en cause la crédibilité de l’OMC ?
M. Yves Fromion. Je voudrais saluer à mon tour l’excellent travail de nos rapporteurs qui nous ouvre les yeux sur un certain nombre de dysfonctionnements peu connus de l’évaluation des accords de libre-échange par la Commission européenne. Il ne fait pas de doute que cette incapacité, certes relative, à évaluer de manière fiable l’impact des ALE, par ailleurs présentés comme une panacée, explique la suspicion qui entoure aujourd’hui la politique commerciale commune.
M. Joaquim Pueyo. La Cour des comptes européenne n’a pas un véritable rôle en matière d’évaluation ex-ante des accords de libre-échange même si elle a pu s’intéresser, comme nous l’avons fait, aux méthodes d’évaluation.
Je voudrais vraiment insister sur le fait que le travail d’évaluation réalisé par la Commission est sérieux, et qu’il n’est absolument pas dans notre intention de l’accabler de reproches. Ce travail est sérieux, donc, mais il l’est dans la limite des instruments dont elle dispose. Or, ceux-ci, et notamment la modélisation économique, se heurtent à des limites importantes qui, de notre point de vue, ne sont pas suffisamment soulignées.
Je suis pour ma part favorable à ces ALE de « nouvelle génération » qui incluent des dispositions relatives au développement durable et, en particulier aux droits humains. En effet, pour ne prendre qu’un exemple, le travail des enfants est une réalité dans certains pays avec lesquels l’Union a signé des accords. Je pense notamment au Pérou et à la Colombie. Lors de nos rencontres sur place avec des ONG, j’ai pu noter l’importance qu’elles accordaient à ces dispositions, même si elles en pointaient les insuffisances, notamment dans la mise en œuvre, et souhaitaient un contrôle plus efficace de la Commission sur celles-ci.
M. Hervé Gaymard. Les réponses aux questions ayant été apportées par mon co-rapporteur, je m’en tiendrais à des remarques personnelles. La question des avantages et des inconvénients du commerce international est vieille comme le monde et la discussion sans fin. Elle a marqué le Royaume-Uni au 19ème siècle en structurant la vie politique entre les partis libre-échangiste et protectionniste. En France également, après une période libre-échangiste sous le second Empire, qui s’est d’ailleurs révélée très bénéfique à notre développement économique, nous avons renoué avec le protectionnisme à la fin du siècle. La loi Méline de 1892, pour notre malheur, a reconstruit les barrières douanières et la France en a payé le prix jusque pendant l’entre-deux-guerres.
Deuxième remarque : le libre-échange n’est pas une religion qui apporte le lait et le miel partout, comme le soutiennent contre vents et marées ses thuriféraires. Il y a toujours eu des arguments d’autorité qui transformaient les critiques du commerce international en alliés objectifs du chômage et de la stagnation économique. J’ai moi-même subi ces pressions dans des négociations internationales. Des officines sont spécialisées dans ce travail de sape comme d’autres, comme le think tank Monagri, dans sa dénonciation. Bien au contraire, il faut être pragmatique et objectif lorsqu’on analyse ces questions et c’est ce que nous avons essayé d’être dans ce rapport.
Dernière remarque : s’agissant du multilatéralisme, évoqué par la présidente, c’est un sujet compliqué. Après les émeutes de Gênes et de Seattle, à la fin des années quatre-vingt-dix, le choix a été fait de lancer le cycle de Doha, qui devait être le cycle du développement . Cependant, la lourde machine de l’OMC s’est enrayée et je ne compte plus les fois où nous étions à la veille de conclure les négociations. Cette veille dure toujours et l’enlisement, constaté à Cancun en 2005, a motivé les Etats-Unis et l’Union européenne à relancer les négociations commerciales bilatérales et régionales.
Il est certain que la crédibilité de l’OMC est entamée. Pas dans sa fonction de règlement des différends, qui est intacte, mais dans celle d’enceinte de négociation. Parce qu’il faut l’unanimité pour parvenir à un accord, il est évident qu’il se trouvera toujours un pays pour le refuser, y compris pour les raisons les plus politiquement incorrectes. Je voudrais terminer sur une anecdote à ce propos. A Cancun, le Liban s’est ainsi déclaré favorable aux restitutions à l’exportation – que tout le monde voulait supprimer – car elles diminuent le prix des produits alimentaires sur les marchés mondiaux, ce qui est favorable aux pays importateurs comme le Liban. »
ANNEXE:
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS
Ø À Paris
– M. Charles-Henri Weymüller, Chef du bureau de la politique commerciale, stratégie et coordination, Direction générale du Trésor et de la politique économique, Ministère de l’économie et des finances
– MM. Jean Fouré et Houssein Guimbard, Économistes, Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII)
Ø À Bruxelles (5 avril 2016)
– M. Jean-Luc Demarty, Directeur général, Direction générale du Commerce, Commission européenne
– M. Etienne Bassot, directeur à la Direction générale des services de la recherche parlementaire, Mme Monika Nogaj, Chef d'unité (politiques externes), Mme Alexia Maniaki-Griva, Chef d'unité (évaluation de l'impact) Mme Laura Puccio, administratrice, M. Alexandre Stutzmann, directeur des commissions à la Direction générale des politiques externes de l’Union, M. Pekka Hakala, chef d'unité (département thématique des relations extérieures), M. Felix Lutz et Leon Peijnenburg, administrateurs au secrétariat de la commission INTA, Mme Susana Mendoca, administratrice au département des relations extérieures, Parlement européen
– M. Pierre Defraigne, Directeur exécutif de la Fondation Madariaga
– M. Yannick Jadot, Mme Tokia Saïfi et Mme Marielle de Sarnez, membres de la commission du Commerce international du Parlement européen
– M. Pierre Sellal, Représentant permanent auprès de l’Union européenne
Ø À Lima (22 au 24 mai 2016)
– M. Eduardo Vega, Défenseur du peuple et M. José Avila Herrera, Chef de l’Office national de dialogue et de durabilité
– M. Pierino Strucchi Lopez Raygada, avocat spécialisé dans le commerce et la concurrence, membre de la Commission anti-dumping péruvienne, ancien Directeur général d’INDECOPI, membre du Conseil municipal de Lima
– M. Carlos Posada, Directeur de l’Institut de prospective et du commerce extérieur de la Chambre de commerce de Lima
– Mme Ana Romero Cano, coordinatrice exécutive de la Red Peruana por una Globalizacion Equidad
– M. Gonzalo Zegarra, Directeur de Semana Económica, Ricardo Montero, Directeur de la rédaction de Gestión et Jimena de la Quinta, Responsable du supplément économique « Dia Uno » de El Comercio
– Mme Magali Silva, Ministre du Commerce extérieur
– M. Pedro Solano, Directeur exécutif de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Société péruvienne de droit de l’environnement)
– MM. Matias Jullian, directeur marketing de Pernod-Ricard, Fernando Chàves, Directeur du marketing et de la communication de Schneider, Ricardo Guevara, avocat et Président de la Chambre de commerce et d’industrie franco-péruvienne, et Jean-Yves Grall, responsable administration et finances de Perenco
Ø À Bogota (24-26 mai 2016)
– Mme Ana Paula Zacarias, Chef de la délégation de l’Union européenne en Colombie, M. Christoph Saurenbach, Chef de la section commerciale, M. Jean-Pierre de Meerler Sanchez, Attaché économique et commercial
– Mme Maria Paula Arenas, Directrice des relations commerciales au ministère du Commerce extérieur
– MM. Telesforo Pedraza Ortega, membre de la 1ère commission de la Chambre des représentants, Hernan Peganos Giraldo, Député de la région Caldas
– Mme Ana Milena Cortazar, directrice des relations internationales et des accords commerciaux de l’ANDI, principale organisation patronale de Colombie
– MM. Pablo Urrego, Secrétaire général de Renault Sofasa, Pierre-Yves Calloc’h, Directeur général de Pernod-Ricard Colombie, Maricio Botero et Said Murad, Directeur général et Responsable des Affaires publiques de Sanofi
– Mmes Vanessa Torres et Margarita Florez (Association Environnement et société), M. Enrique Daza (Centre d’études de travail), Mme Maria Goretti Esquivel, M. Andrea Bolivar (Association Solidarité en Colombie), M. Rafael Figueroa (Pensée et action sociale), M. Luis Miguel Morantes Alfonso (Confédération des travailleurs de Colombie)
– M. Eric Tremolada, Professeur à l’Université Externado, spécialiste en droit international et relations internationales, Directeur de la chaire Jean Monnet en droit de l’intégration comparée
1 () Dans le cas des ALE, c’est naturellement la DG Trade qui est en première ligne mais compte tenu de leur portée très large, la quasi-totalité des autres directions générales sont sollicitées.
2 () « How does ex-ante Impact assessment work in the EU ? » (février 2015).
3 () En effet, aux termes de l’article 207 §2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la procédure législative ordinaire est applicable à la définition de l’ensemble du cadre général et des mesures autonomes par lesquels la politique commerciale est mise en œuvre. C’est ainsi que le Parlement, notamment, adopte les règlements relatifs aux garanties accompagnant les accords commerciaux bilatéraux.
4 () L'ACTA a été négocié par l'UE et ses États membres, les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle Zélande, Singapour, la Corée du sud, et la Suisse, en vue d'améliorer la mise en œuvre des lois anti-contrefaçon à l'échelle internationale.
5 () Par exemple, dans le communiqué de presse du 30 septembre 2013 présentant l’étude d’impact du PTCI, la Commission écrit que celle-ci « est basée sur une analyse réalisée par le Centre for Economic Policy Research, un organisme de recherche européen leader et indépendant ».
6 () Non-tariff measures in EU-US trade and investment – An economic analysis (2009).
7 () R. Piermartini et R. Feth : « Demystifying modelling methods for trade policy» (2005).
8 () South Centre : « Analysis of the draft interim trade sustainability impact assessment of the EU-central América FTA » (mai 2009).
9 () On rappelle que le « handbook » révisé fait de nombreuses références à l’analyse de l’impact sur les droits humains et la démocratie, élevant celui-ci au même rang que les impacts économiques, sociaux et environnementaux.
10 () Les négociations avec le Mexique, en vue de modernisation l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération de 1997, ont été lancées le 30 mai 2016. Celles avec les Philippines ont quant à elles été ouvertes le 22 décembre 2015.
11 () L’AECG contient toujours un ISDS mais sous la forme d’une Cour bilatérale d’investissement.
12 () Andrea Mandel-Campbell, Foreign Investment Review Regimes : How Canada stacks up, 2008.
13 () Compete to win, 2000.
14 () The impact of TTIP : the underlying economic model and comparisons, octobre 2014.
15 () L’accord est entré en vigueur en mars 2013 pour le Pérou et en août 2013 pour la Colombie.
16 Il y a toutefois des exceptions, comme lorsqu’il décide de suspendre l'application d'un accord international, par exemple les Accords de Cotonou en 2010 en ce qui concerne le Zimbabwe.
17 () EU trade relations with Latin America : Results and challenges in implementing the EU-Colombia/Peru Trade Agreement (2016).
18 () The EU-Republic of Korea Free trade agreement : one year after its entry into force (2013).
19 () En revanche, les SPG dont bénéficiaient la Birmanie et la Biélorussie ont été suspendues.
20 () Instaurée par l’Accord de Carthagène en 1969, la Communauté andine est une communauté de quatre pays (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou) qui ont un objectif commun : favoriser l’intégration régionale en vue d’un développement intégral, équilibré et autonome. Ainsi elle garantit par exemple la liberté de circulation pour les habitants et les marchandises à l’intérieur de la région. Initialement, le Chili et le Venezuela étaient également membres, mais les deux États se sont retirés respectivement en 1976 et en 2006. À part les quatre pays membres, la Communauté andine compte aujourd’hui cinq pays associés (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Chili) et deux pays observateurs (Mexique et Panama).
21 () Créée en 2011, l’Alliance du Pacifique regroupe quatre pays d'Amérique latine : le Chili, la Colombie, le Pérou et le Mexique. Fonctionnant sur le mode intergouvernemental, elle vise à construire une zone économique intégrée pour atteindre progressivement la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes.
22 () European union : Trade agreement with Colombia and Peru (2012).
23 () Cette guerre n’a d’ailleurs pris fin, officiellement, qu’avec la signature par le président colombien et le chef suprême des FARC d’un cessez-le-feu définitif le 23 juin 2016 à La Havane. Toutefois, l’accord de paix a été rejeté par référendum le 2 octobre 2016, sans toutefois remettre en cause l’accord de cessez-le-feu précité.
24 () L’« Ombusdman » péruvien fut créé par la Constitution de 1993, en tant qu’organisme autonome visant à défendre les droits fondamentaux des citoyens ; vérifier l’accomplissement de leurs devoirs par l’administration publique ; juger l’efficacité des services publics sur l’ensemble du territoire national. Les thèmes sur lesquels il peut intervenir sont très variés. Il intervient, par exemple, sur la défense les droits des peuples indigènes, des handicapés, des femmes et des enfants, mais également sur le droit à la santé et à l’éducation, l’accès à la justice ou la défense de l’environnement. Le Défenseur du peuple ne dispose pas de pouvoirs de sanctions, mais il émet des recommandations destinées aux autorités et dispose de certaines prérogatives concernant l’élaboration des lois.