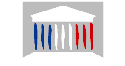______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1)
sur les négociations internationales relatives au changement climatique
ET PRÉSENTÉ
PAR MM. Bernard DEFLESSELLES, Jérôme LAMBERT et Arnaud LEROY,
Députés
——
(1) La composition de la commission figure au verso de la présente page.
(La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; M. Christophe CARESCHE, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; M. Philip CORDERY, Mme Sandrine DOUCET, MM. Arnaud LEROY, André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Kader ARIF, Philippe BIES, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, M. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Rémi PAUVROS, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY)
___
Pages
INTRODUCTION 9
PREMIÈRE PARTIE : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN ENJEU PROGRESSIVEMENT DEVENU INCONTOURNABLE 13
I. LE LONG CHEMIN VERS UN ACCORD CLIMATIQUE MONDIAL : DE RIO À COPENHAGUE 13
A. UN MOMENT FONDATEUR : LE SOMMET DE LA TERRE 13
1. La Déclaration de Rio 13
2. La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (la CCNUCC) 17
B. LA RECHERCHE D’UN RÉGIME CLIMATIQUE UNIVERSEL 20
1. Parvenir à un accord climatique mondial : le Protocole de Kyoto 20
a. Des objectifs chiffrés de réduction des émissions 20
b. Des mécanismes de flexibilité 20
c. La ratification et la mise en œuvre du Protocole de Kyoto ont souffert du défaut de grands pays développés 21
d. L’avancée incontestable du Protocole de Kyoto en matière de transparence 21
2. Copenhague, la remise en cause d’un modèle de négociation 22
a. Négocier l’après-2012 22
b. Des divergences irréconciliables entérinent l’échec à Copenhague 23
c. Un accord a minima 24
d. L’Accord de Copenhague, reflet de tendances géopolitiques de fond 24
II. LE CONSTAT PERSISTANT DU GIEC ET LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES 29
A. LE GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT 29
1. Une institution originelle conçue comme une interface entre les chercheurs et la sphère politique 29
2. Fonctionnement et missions du GIEC 29
a. Organisation de l’institution 29
b. Missions 30
3. Un constat persistant dont la certitude n’a cessé de croitre 32
B. LES ANALYSES ÉCONOMIQUES 33
1. Le choc du rapport Stern 33
a. Un rapport qui a fait date dans la prise en compte des conséquences économiques du réchauffement climatique 33
b. Des préconisations pour l’action publique en ligne avec les efforts actuels 34
2. Les conséquences économiques selon le rapport de l’OCDE de 2016 35
III. LA PRISE DE CONSCIENCE CROISSANTE DE LA RÉALITÉ DU CHANGEMENT CLIMATIQUE PAR L’OPINION PUBLIQUE MONDIALE 37
1. Un problème de définition pour un phénomène multi causal 37
2. La difficile évaluation chiffrée 39
3. Une absence de statut clair au regard du droit international 40
4. L’initiative Nansen et l’Agenda pour la protection des migrants climatiques 41
C. UNE MOBILISATION CROISSANTE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 42
DEUXIEME PARTIE : LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DU RÉGIME CLIMATIQUE MONDIAL DEPUIS L’ACCORD DE COPENHAGUE 43
I. UN OBJECTIF POUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET DES MOYENS POUR VÉRIFIER SA MISE EN œUVRE 43
A. L’OBJECTIF DE LIMITATION DES ÉMISSIONS 43
1. L’objectif du réchauffement maximum à ne pas dépasser 43
2. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 43
B. LE MRV 44
1. Obligations initiales 44
2. Une volonté d’inclusion de plus en plus large 45
3. Les trois dimensions du MRV 47
4. Les réelles avancées de la COP de Varsovie : un précédent précieux pour le MRV 48
II. LA RECHERCHE DES MOYENS DE FINANCEMENT APPROPRIÉS 49
A. LE FOISONNEMENT DES FINANCEMENTS 49
B. IMAGINER DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT 51
C. LA DIFFICULTÉ À MESURER LES FONDS ENGAGÉS POUR LE CLIMAT : LE RAPPORT CONTESTÉ DE L’OCDE 51
1. Une volonté d’accroitre la transparence du financement pour paver la voie à un accord à Paris 51
2. Les contestations nées des chiffres avancés par le rapport de l’OCDE 52
III. L’ACCOMPAGNEMENT POUR LA TRANSITION ET L’ADAPTATION 55
A. UNE NOTION DIFFICILE À DÉFINIR PRÉCISÉMENT 55
B. UNE INSTITUTIONNALISATION PROGRESSIVE 55
C. UNE PROBLÉMATIQUE QUI ACHOPPE ENCORE SUR LA QUESTION DU FINANCEMENT 56
IV. UN EXEMPLE D’INITIATIVE SECTORIELLE D’ATTÉNUATION : LA FORÊT 57
A. INCLURE LA LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION DANS LES POLITIQUES D'ATTÉNUATION 57
B. LE TOURNANT DE VARSOVIE 58
C. UN PROGRAMME QUI A FAIT L’OBJET DE SÉVÈRES CRITIQUES 59
TROISIÈME PARTIE : LA COP 22, CONFÉRENCE DE LA MISE EN ACTION DES DECISIONS DE LA COP 21 61
I. L’ACCORD DE PARIS : LA RECHERCHE D’UN CADRE UNIVERSEL POUR UN RÉGIME CLIMATIQUE MONDIAL PLUS INCLUSIF 61
A. UNE PRÉPARATION DE LONGUE HALEINE 61
1. La plateforme de Durban 61
2. La conférence de Lima : une répétition générale 62
3. La remise des contributions nationales 62
B. LA CONFÉRENCE DE PARIS : UN RENDEZ-VOUS HISTORIQUE 63
1. Un évènement diplomatique hors norme 63
2. Un accord attendu de longue date et qui marque une avancée incontestable dans les négociations climatiques 63
a. Un accord à vocation universelle, qui engage les pays le ratifiant 64
i. Architecture de l’Accord 64
ii. Un accord de portée mondiale 64
iii. L’Accord de Paris est bien un accord contraignant au sens du droit international 65
b. Une différenciation repensée pour un accord universel 66
i. La responsabilité commune mais différenciée 66
ii. Pour parvenir à un accord universel, l’Accord de Paris a aménagé le principe de différenciation : 67
c. La clarification de la question du financement 68
d. La place mieux définie de l’adaptation et de l’atténuation 69
e. Les pertes et préjudices : un mécanisme pris en compte mais qui reste à approfondir 70
II. L’UNION EUROPÉENNE MOINS VOLONTAIRE QUE PAR LE PASSÉ 71
1. L’Union européenne s’est longtemps voulue la bonne élève des négociations climatiques 71
2. Son rôle de modèle a pourtant été remis en cause après Copenhague 72
3. La réforme du marché des quotas et le partage de l’effort 73
a. La réforme de 2015 et la réforme structurelle en cours 73
b. Le partage de l’effort, un sujet épineux 74
4. Une solution sui generis pour la ratification 76
III. LES AUTRES PROCESSUS VISANT À LIMITER LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 79
A. LE PROTOCOLE DE MONTRÉAL 79
1. Un outil de protection de la couche d’ozone 79
a. Un cadre institutionnel pour réguler l’usage de certaines substances toxiques 79
b. Un ensemble d’obligations pour les États parties au Protocole de Montréal 80
2. Des amendements successifs pour renforcer le régime de protection 80
a. Depuis sa signature, le Protocole a été doublement modifié 80
b. L’amendement de Kigali en 2016 81
B. L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI) 82
IV. LA COP 22 DEVRA ENTÉRINER LES PROGRÈS DE L’ACCORD DE PARIS ET ALLER PLUS LOIN POUR ÊTRE LA CONFERENCE DE LA MISE EN ACTION 85
A. L’ACCORD DE PARIS A INCONTESTABLEMENT TÉMOIGNÉ D’UNE AVANCÉE DÉCISIVE DES NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES INTERNATIONALES 85
1. Un accord historique dont la ratification rapide prolonge le momentum 85
2. Une dynamique très positive 86
a. L’Accord de Paris est parvenu à emmener des acteurs traditionnellement réticents 86
b. Pour renforcer l’Accord de Paris, des initiatives intéressantes et l’inclusion de la société civile 86
i. L’Agenda global de l’Action 86
ii. Les championnes pour le climat 87
iii. Un exemple d’initiative dans le cadre de l’Agenda Global de l’Action : l’Initiative 4 pour 1000 87
B. POURTANT, « LE COMPTE N’Y EST PAS » 88
1. Les INDC étaient insuffisantes avant la COP 21, et les NDC le demeurent 88
2. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme 89
3. La contrainte est trop lâche et certains principes demeurent vagues 90
C. LA COP 22 DEVRA DONC ÊTRE LA CONFÉRENCE DE LA MISE EN ACTION, MAIS AUSSI DE L’APPROFONDISSEMENT 91
1. Faire de l’accord de Paris un accord robuste en prévoyant au mieux les prochaines étapes 91
2. Se concentrer sur la question stratégique du financement 94
CONCLUSION 97
TRAVAUX DE LA COMMISSION 99
ANNEXES 105
ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS 107
ANNEXE N° 2 : ACCORD DE PARIS 109
ANNEXE N° 3 : COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL DU 2 MARS 2016, L’APRÈS-PARIS: ÉVALUATION DES IMPLICATIONS DE L’ACCORD DE PARIS, 111
Mesdames, Messieurs,
L’année dernière, un pas historique a été franchi dans les négociations climatiques internationales. Pour la première fois depuis l’établissement en 1992 de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Climat, un accord rassemblant tous les pays a été adopté dans le consensus.
Ce succès indéniable de la Conférence de Paris est le résultat de plusieurs années de préparation, puisque dès la Conférence de Durban en 2011, un groupe de travail s’était mis en place à cet effet. À partir de la Plate-forme de Durban pour une action renforcée (l’ADP), chargée de définir les grandes lignes du fameux accord qui devait être adopté à Paris en décembre 2015 et entrer en vigueur en 2020, les experts sont parvenus à un projet de texte d’accord, socle des négociations à Paris.
Moins d’un an après son adoption le 12 décembre 2015 à l’issue de la COP 21, et quelques mois après la cérémonie de signature organisée à New York le 22 avril 2016, l’Accord de Paris a donc pu entrer en vigueur dès lors que le seuil des 55 pays émettant 55% des émissions avait été franchi. Il s’agit là d’un signe très positif, qui montre la volonté des États de prolonger l’élan donné à Paris, et d’une performance inédite. La ratification du Protocole de Kyoto avait en effet pris plusieurs années.
L’Union européenne a de son côté fait un effort particulier afin de ratifier l’Accord en amont de la COP suivante : accord mixte, il aurait dû être d’abord ratifié par l’ensemble des États-membres selon leurs procédures nationales avant de pouvoir l’être par l’Union en son nom propre. Certains pays étaient réticents à autoriser une ratification anticipée par l’Union, redoutant un précédent pour d’autres types de traités internationaux (notamment les traités commerciaux), mais le Conseil a finalement pu l’autoriser. L’absence de ratification par l’Union européenne aurait en effet constitué un symbole très négatif.
Après le vote positif du Parlement européen, l'Accord a donc pu être ratifié le 5 octobre 2016 avec sept de ses États membres, déclenchant son entrée en vigueur.
Après des années de négociations, de revirements et d’échecs, il faut donc saluer ce résultat, ainsi que la rapidité de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris.
Le caractère plus ou moins contraignant de l’Accord de Paris était l’un des grands enjeux des négociations : il est bien un accord contraignant au sens du droit international. Le mandat de 2011 le prévoyait, mais l’expérience passée avait montré la réticence des États, notamment les plus grands émetteurs de GES comme la Chine ou les États-Unis, à engager de cette façon leur souveraineté.
Le texte de l’Accord de Paris remplit les conditions pour constituer un texte contraignant. Il exige que chaque pays « [établisse], communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives […] et prenne des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions ». Il contient donc une obligation de « moyens » plutôt que de résultat : les pays doivent mettre en œuvre leurs contributions nationales. Grâce à deux instruments, les INDC (Intended Nationally Declined Contributions) et les NDC (Nationally Declined Contributions), le système créé par l’Accord de Paris instaure une chaine de suivi des objectifs annoncés par les États à la réalisation plus ou moins effective de ces objectifs.
Le principe de responsabilité commune mais différenciée a longtemps été l’un des piliers des négociations climatiques internationales. Son inconvénient majeur était toutefois qu’il fixait des listes de pays aux responsabilités différentes sans permettre la reconsidération de celles-ci à mesure des évolutions nationales.
Pour parvenir à un accord universel, l’Accord de Paris réaffirme le principe des responsabilités communes mais différenciées, à la lumière des « circonstances nationales », et y adjoint un principe de progression des efforts de tous, avec l’obligation des pays industrialisés de financer l’aide aux pays pauvres sur le climat, tandis que les pays en développement sont invités à contribuer sur une base volontaire.
Il prévoit des obligations pour les pays développés de prendre des engagements quantifiés et précis de réduction des émissions et encourage toutes les autres parties à prendre des mesures, pour une convergence des obligations. Enfin, il crée, en matière de transparence, un système permettant un suivi renforcé des engagements, avec des flexibilités pour les pays en développement.
Les pays développés devront divulguer dans le cadre de leurs rapports bisannuels des informations qualitatives et quantitatives sur les financements fournis et établir des projets provisionnels de financement en direction des pays en développement. Cette augmentation de la transparence devrait renforcer la confiance et encourager les pays récipiendaires à s’engager sur des projets de long terme.
L’engagement des 100 milliards de dollars par an est envisagé dans l’Accord de Paris comme un seuil minimal devant être revu à la hausse d’ici à 2025.
La discussion sur le futur des financements devra s’achever lors de la COP 24, avec plus de détails sur le périmètre et les règles de comptabilisation, notamment des flux privés. La COP 22 devra donc avancer sur ce sujet.
L’Accord de Paris instaure un système de rendez-vous quinquennaux pour insuffler une dynamique ambitieuse aux contributions remises par les États à ces échéances. La clause de rendez-vous créée par l’Accord fixe à 2020 la remise des prochaines contributions pour l’échéance 2030, puis tous les cinq ans ensuite.
Le seul élément qui aurait pu être renforcé est le lien entre les cycles et l’objectif de 2 °C. Il est seulement implicite : l’Accord souligne que les pays doivent parvenir au plafonnement puis réduire leurs émissions pour atteindre la neutralité des émissions après 2050, et établit que chaque NDC successive devra augmenter son ambition et correspondre au niveau d’ambition le plus élevé possible du pays, une ambition élevée étant évidemment nécessaire pour atteindre l’objectif de 2 °C.
Malgré tous les progrès permis par l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, et les perspectives optimistes, la trajectoire dessinée pour l’instant par les contributions remises, et le degré de contrainte véritable exercée par l’Accord de Paris, pourraient bien sérieusement limiter sa capacité à enrayer le changement climatique. Les récents développements internationaux engagent d’autant plus à une certaine prudence.
La synthèse réalisée à partir des contributions nationales prévues a montré que la somme des engagements ne permettait pas de respecter la limite de hausse de la température de 2°C. À l’heure actuelle, la somme de ces contributions prévoit plutôt une tendance à une augmentation de 3°C, voire plus. Même s’ils respectaient les objectifs, les États ne seraient donc pas en mesure contenir le réchauffement sous la barre de deux degrés, et encore moins de tendre à un réchauffement de 1.5°C comme le veut l’Accord de Paris.
Par ailleurs, un certain nombre d’engagements des pays les plus démunis dépendent entièrement de financements additionnels extérieurs, et sont donc soumis à une forte conditionnalité.
Le 7 septembre 2016, six scientifiques climatologues de renom, avec pour porte-parole Robert Watson, ancien président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ont publié avec l’ONG Universal Ecological Fund une tribune visant à alerter sur la rapidité de l’augmentation des températures, et la nécessité d’y faire face dans l’urgence. Ils soulignent qu’en 2015, les températures du globe avaient déjà connu une élévation de 1 °C par rapport au niveau d’avant la révolution industrielle.
Si la nature de l’Accord et le système de contrainte politique mis en place ont permis de rallier le plus grand nombre de pays, il est indéniable que l’Accord de Paris offre peu de garanties quant à la réalisation effective des objectifs fixés par les États. Le processus instauré s’appuie sur la valorisation des initiatives positives, sans qu’une revue négative des réalisations n’exerce réellement de conséquences dommageables pour les États, sauf en matière de capital politique.
En l’absence de sanctions, l’effectivité des obligations des États demeure donc relative en dépendant essentiellement de leur bonne volonté.
Il s’agit désormais de faire passer les engagements d’un texte énonçant des grands principes à une action véritable, et rythmée par des procédures de report et de vérification susceptibles de garantir une véritable transparence. En effet, le niveau d'exigence posé par l'Accord au niveau mondial (rester sous une augmentation de 2°C, tendre vers 1,5 et parvenir à la neutralité des émissions pour 2015) contraste, nous l'avons dit, avec la faiblesse des contraintes qui pèsent sur les États.
Ce paradoxe, qui mène à ce que la somme des contributions soit encore actuellement insuffisante pour atteindre les objectifs fixés, doit être prise en compte rapidement. Tout d'abord, la COP 22 doit être l'occasion pour les États de prendre acte de cette insuffisance et devrait les pousser à présenter rapidement des contributions plus ambitieuses, dès 2018.
Le traité doit s'appliquer à partir de 2020 et la révision des objectifs est prévue par le traité tous les cinq ans : il est toutefois impensable que les États restent inactifs dans la période préalable et que les objectifs trop limités avancés en 2016 ne soient pas modifiés avant 2025.
Au rythme constaté du réchauffement climatique, ces quelques années d'inaction ne sont pas un luxe que la communauté internationale peut s'accorder.
PREMIÈRE PARTIE : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN ENJEU PROGRESSIVEMENT DEVENU INCONTOURNABLE
Le sujet du changement climatique s'est progressivement affirmé comme l'un des cadres conceptuels majeurs de notre époque et comme un paramètre régissant le futur de la communauté humaine. La prise de conscience graduelle du grand public, a accompagné durant plusieurs décennies des cycles de négociations à la mécanique désormais bien huilée. Depuis plus de vingt ans se sont créés des enceintes, des rendez-vous et des notions qui caractérisent ce sujet devenu incontournable des relations internationales, avec ses jeux d'alliance, ses revirements et ses champions, dont les postures ne sont pour autant pas irrémédiablement gravées dans le marbre. S'il a été pensé comme le point de départ d'une nouvelle période pour les négociations climatiques, l'Accord de Paris est donc aussi l'aboutissement de longues années de discussions, de compromis et d'échecs.
Le sommet de Rio en 1992 est souvent considéré comme un moment fondateur des négociations climatiques internationales, car il établit la préoccupation environnementale dans le champ des relations multilatérales, notamment en introduisant le concept de « développement durable ». Moment initial d'une prise de conscience mondiale, le sommet intervient deux ans après le premier rapport des experts du GIEC. Il s'inscrit donc sur un fond de connaissance scientifique de plus en plus étayé et voit les nombreux chefs d'États et de gouvernement rassemblés prendre acte de ces éléments scientifiques et les convertir en une problématique politique.
La Déclaration de Rio (« Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ») est ainsi adoptée et établit vingt-sept principes qui ont constitué le socle d'une réflexion et d'une action future en faveur du climat.
DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement, Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les États, les secteurs clefs de la société et les peuples, Œuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement, Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance, Proclame ce qui suit : PRINCIPE 1 Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. PRINCIPE 2 Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. PRINCIPE 3 Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. PRINCIPE 4 Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. PRINCIPE 5 Tous les États et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde. PRINCIPE 6 La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays. PRINCIPE 7 Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent. PRINCIPE 8 Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées. PRINCIPE 9 Les États devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices. PRINCIPE 10 La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. PRINCIPE 11 Les États doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié. PRINCIPE 12 Les États devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international. PRINCIPE 13 Les États doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle. PRINCIPE 14 Les États devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres États de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme. PRINCIPE 15 Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. PRINCIPE 16 Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement. PRINCIPE 17 Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente. PRINCIPE 18 Les États doivent notifier immédiatement aux autres États toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les États sinistrés. PRINCIPE 19 Les États doivent prévenir suffisamment à l'avance les États susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces États rapidement et de bonne foi. PRINCIPE 20 Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. PRINCIPE 21 Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur. PRINCIPE 22 Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable. PRINCIPE 23 L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés. PRINCIPE 24 La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les États doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin. PRINCIPE 25 La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables. PRINCIPE 26 Les États doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies. PRINCIPE 27 Les États et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international |
Le sommet de Rio pose ainsi les jalons des progrès ultérieurs. C'est le cas avec la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), véritable matrice des négociations climatiques pour les décennies à venir, par 154 États ainsi que les membres de la Communauté européenne. Cette convention reconnaît trois grands principes : le principe de précaution, le principe des responsabilités communes mais différenciées et le principe du droit au développement.
La CCNUCC (Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques)
Aux termes de la Convention, les pays se répartissent en trois groupes auxquels sont rattachés des engagements différents : les Parties visées à l’annexe I, les Parties visées à l’annexe II et les Parties non visées à l’annexe I.
Les Parties visées à l’annexe I sont les pays industrialisés qui étaient membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1992, plus les pays en transition sur le plan économique (les Parties en transition), notamment la Fédération de Russie, les États baltes et plusieurs États d’Europe centrale et orientale. L’une des obligations propres aux Parties visées à l’annexe I est d’adopter des politiques et de prendre des mesures pour atténuer les changements climatiques en ramenant d’ici à l’an 2000 leurs émissions de gaz à effet de serre aux niveaux de 1990. Elles doivent ainsi montrer leur ferme détermination à lutter contre les changements climatiques. La Convention accorde aux Parties en transition une certaine souplesse dans le respect de leurs engagements, en raison des événements récents qui ont bouleversé leur économie et leur vie politique.
Les Parties visées à l’annexe II sont les membres de l’OCDE qui figurent à l’annexe I, sans les pays en transition sur le plan économique. Elles sont tenues de procurer des ressources financières afin que les pays en développement puissent mener des activités de réduction des émissions au titre de la Convention et s’adapter plus facilement aux effets des changements climatiques. Par ailleurs, ces Parties doivent prendre « toutes les mesures possibles » pour encourager la mise au point et le transfert de technologies respectueuses de l’environnement, au profit des pays en transition et des pays en développement. Les fonds procurés par les Parties visées à l’annexe II sont essentiellement acheminés par le biais du mécanisme financier de la Convention.
Enfin, les Parties non visées à l’annexe I, comme on les appelle couramment, sont pour la plupart des pays en développement. La liste complète des Parties à la Convention figure aux pages 23 et 24. La Convention reconnaît que certains groupes de pays sont particulièrement vulnérables aux effets préjudiciables des changements climatiques, par exemple les pays qui ont des zones côtières de faible élévation ou des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification. D’autres sont davantage menacés par l’impact que pourraient avoir les mesures de riposte, par exemple les pays dont l’économie est fortement tributaire des revenus de la production et du commerce de combustibles fossiles.
Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Il faut souligner que la Convention introduit des éléments qui modèlent encore la compréhension actuelle des négociations climatiques internationales. L'idée d'une responsabilité commune mais différenciée et de groupes de pays distincts selon leur responsabilité historique est aujourd'hui encore un prisme puissant, et les pays en développement y demeurent très attachés, car elle conditionne en partie l'aide dont ils peuvent bénéficier de la part des pays développés pour leurs efforts d'adaptation.
Cette conception repose sur l'idée que la situation actuelle est largement le résultat des siècles d’industrialisation dont ont bénéficié les pays occidentaux. Les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés n'ont longtemps fait l'objet d'aucun effort de réduction ou même de surveillance. Le stock de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère est donc pour grande partie le produit de cette histoire du développement économique passé, dont les pays émergents n'auraient en aucun cas profité (voire même, un développement dont ils auraient souffert puisqu'il s'est selon ces pays largement inscrit dans des relations inégalitaires et marquées par le passé de la colonisation). Les pays émergents ont donc marqué dès 1992 leur opposition à un système qui ne prendrait pas en compte cet héritage historique, et qui briderait la croissance à laquelle ils estimaient avoir désormais droit. Cette responsabilité différenciée n'empêche pas l'égalité des parties à la Convention, une égalité qui garantit une certaine audience aux petits pays qui sont souvent parmi les plus menacés (il en est ainsi des petits États insulaires par exemple).
L'entrée en vigueur de la CCNUCC intervient en 1994 et prévoit la tenue annuelle des Conférences des parties, les COP (la première se tient à Berlin en 1995), dont le mandat est déjà de parvenir à un accord climatique mondial contraignant.
Le mandat des premières sessions des Conférences des Parties est bien de parvenir à un accord climatique détaillant des objectifs plus précis que ceux contenus dans la CCNUCC, objectifs qui engendreraient des politiques publiques adaptées de la part des pays dits de l'Annexe I. En 1995, le second rapport du GIEC appuie les résultats du premier rapport publié cinq ans plus tôt quant à l'influence de l'activité humaine sur le climat. Au fil des rapports et jusqu'au dernier publié en 2013 et 2014, la certitude de l'impact anthropique sur le changement climatique ne cesse de s’accroître.
Les États sont d'autant plus incités à rechercher des engagements chiffrés que les éléments scientifiques confirment de plus en plus les conséquences de l'activité humaine sur le climat. Le Protocole de Kyoto établit une réduction à atteindre des émissions de gaz à effet de serre à 94,8% des niveaux enregistrés en 1990 grâce à des engagements juridiquement contraignants en termes de droit international. Pour l’Union européenne, cet objectif se traduit par une baisse totale de ses émissions de 8%. Les cibles maximales de chaque pays sont négociées au cas par cas ; elles ne reposent pas sur des critères objectifs tels que le nombre d’habitants du pays concerné ou les émissions liées à l’activité humaine de chacun de ses pays.
Pour accompagner ces objectifs de réduction des émissions, trois mécanismes de flexibilité sont introduits dans le Protocole :
• Le mécanisme d'échange de permis d'émissions (MEP): le Protocole de Kyoto devait mener à la création d'un marché de droits à émettre qui aurait permis la meilleure allocation coût/efficacité en matière de réduction des émissions. Ce type de mécanisme a ensuite vu le jour au sein de l'Union européenne, avec le Système d'échange de quotas d'émissions (le SEQE), mais n'a pas fait l'objet d'un véritable marché mondial ;
• Le mécanisme de développement propre (MDP): il s'agissait de concilier les besoins de financement des pays en développement pour réaliser des projets de développement soutenable, et la création d'une marge de manœuvre de droits à émettre pour les pays de l’Annexe I ;
• Le mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC): par ce mécanisme, les entreprises (publiques ou privées) investissent dans des « projets propres » au sein des pays industrialisés, à l’intérieur ou en dehors du territoire national, et obtiennent en retour des crédits d’émissions. Dans la pratique, ce mécanisme concernait avant tout le financement de projets dans les pays d’Europe de l’Est.
c. La ratification et la mise en œuvre du Protocole de Kyoto ont souffert du défaut de grands pays développés
La période d’engagement prévue pour le Protocole de Kyoto et la réduction de 5% des émissions de gaz à effet de serre de 39 pays développés par rapport à 1990 allait de 2008 à 2012. Pour entrer en vigueur, le protocole adopté à Kyoto devait être ratifié par 55% des pays signataires, et les pays de l’annexe I ayant ratifié le traité devaient couvrir 55% des émissions de CO2 de 1990. Ces deux conditions ont finalement été remplies avec la signature de la Russie en novembre 2004.
Toutefois, la décision des États-Unis, le plus gros pays émetteur de CO2, de ne pas ratifier le texte qu’ils avaient pourtant signé, ainsi que le retrait du Canada, ont pu apparaître comme des mises en cause sévères de l’engagement des pays développés. En outre, une fois le protocole adopté à Kyoto en 1997, les négociations sur la mise en œuvre de l’accord ont pris plusieurs années supplémentaires, et ce n’est que lors de la septième COP en 2001, que les Accords de Marrakech ont permis de boucler la négociation.
L’apport principal du Protocole de Kyoto, outre son caractère juridiquement contraignant, qui inaugure un régime de responsabilité internationale sanctionnée par un mécanisme d’incitation et de sanction (avec les organes de facilitation et d’exécution), est sans doute les progrès qu’il aura permis dans le suivi des objectifs de réduction. En effet, le Protocole a établi des règles précises d’inventaires et de méthodologie de mesure des émissions, il exige des pays développés qu’ils mettent en place des systèmes nationaux d’évaluation des émissions (article 5) et qu’ils soumettent à intervalle régulier des communications (article 7).
Après l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto le 16 février 2005, et au vu de la durée des discussions ayant mené à la conclusion du premier accord climatique de réduction des émissions, les Parties lancent rapidement les discussions quant à l’après-Kyoto. Il s’agit de réfléchir à la forme que pourrait prendre un accord qui succéderait à la première période d’engagement de 2008 à 2012.
Deux groupes de travail se mettent parallèlement en place. L’AWG KP, l’Ad Hoc Working Group on Kyoto Protocol, se constitue à Montréal en 2005 avec les pays ayant ratifié le Protocole de Kyoto, tandis que l’AWG LCA, l’Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action, regroupe les parties à la CCNUCC. Ces deux groupes de travail devaient faciliter les discussions pour parvenir à l’instauration d’un nouveau régime climatique mondial post-Kyoto. Pour le premier groupe, il s’agissait d’envisager une seconde période d’engagement du Protocole de Kyoto, tandis que le second groupe devait négocier un accord mondial regroupant tous les pays dans un effort concerté.
Parallèlement à la création de l’AWG LCA, en 2007, les États s’accordent dans le Plan d’action de Bali sur le calendrier et le format des négociations relatives au régime post-2012 : elles devaient aboutir lors de la quinzième COP, prévue en 2009 à Copenhague et inclure un certain nombre d’élément constitutifs incontournables. Il s’agissait notamment d’intégrer les pays en développement dans l’effort collectif, tout en respectant le principe d’une responsabilité commune mais différenciée.
Les quatre éléments constitutifs du Plan d’action de Bali 1. L’atténuation, avec : La mise en place d’engagements ou d’actions mesurables, rapportables et vérifiables par tous les pays développés, en assurant une comparabilité des efforts entre ces pays. En miroir, des actions par les PED, soutenues et rendues possibles par la technologie et le financement, d’une manière mesurable, rapportable et vérifiable (ces qualificatifs portant à la fois sur les actions et sur le couple technologie/financement). Une réflexion ouverte sur l’utilisation des terres, leur changement et la foresterie (UTCF), incluant des discussions sur la déforestation, la dégradation, la gestion durable et l’augmentation des stocks. Une ouverture sur les approches sectorielles coopératives et les actions spécifiques aux secteurs. D’autres références sont faites : aux approches de marché ; aux conséquences des actions d’atténuation (« mesures de riposte ») sur les pays tiers ; et à l’amélioration du rôle de catalyseur de la Convention. 2. L’adaptation, qui est au même niveau d’importance que l’atténuation. 3. Le développement et le transfert de technologies La technologie est présentée comme un bloc permettant de soutenir l’atténuation et l’adaptation. Les discussions devront notamment porter sur les mécanismes de transfert de technologie aux PED (pays en développement) et la coopération dans la recherche et le développement. 4. Le financement L’investissement et les flux financiers permettent eux aussi de soutenir l’atténuation et l’adaptation. Les discussions devront porter sur l’amélioration de l’accès aux ressources financières, les incitations pour les PED à mettre en œuvre de nouvelles actions d’atténuation, l’aide à l’adaptation, la mobilisation des financements publics et privés. Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer |
Les attentes sont élevées à la veille de la Conférence de Copenhague. De grands espoirs sont suscités par la présidence danoise, après que l’Union européenne a présenté en 2008 un paquet énergie – climat présenté comme ambitieux, et par l’arrivée de l’administration Obama, dont de nombreux acteurs espèrent qu’elle permettra de faire évoluer la position américaine.
La mobilisation citoyenne en amont de la Conférence, et la forte présence des organisations non gouvernementales pendant sa tenue, contribuent également à en faire un rendez-vous climatique mondial sans précédent. La variété des acteurs impliqués (qui pour les ONG ne se limitent plus aux organes spécialisés dans les questions climatiques) et la couverture médiatique inédite marquent un tournant dans la perception des enjeux climatiques par l’opinion publique mondiale.
Mais les négociations se sont déroulées dans un climat délétère de confusion et de tension et n’ont pas permis d’aboutir au texte contraignant espéré au début de la Conférence. La question de la responsabilité commune mais différenciée a cristallisé les crispations et entraîné un véritable bras de fer sino-américain. Alors que la Chine conditionnait son engagement à des objectifs chiffrés de réduction par tous les grands pays développés, au premier rang desquels les États-Unis, pour l’administration américaine, ce sont toutes les économies majeures, émergentes ou non, qui devaient participer à l’effort collectif. L’administration américaine insistait également sur la nécessité de mettre en place un système de vérification efficace et transparent.
La concomitance des deux voies de négociation de l’accord global, l’une sous le régime du Protocole de Kyoto, l’autre sous celui de la CCNUCC, a provoqué des blocages et in fine, l’échec de la Conférence de Copenhague. Plusieurs pays développés réclamaient en effet la fusion des deux voies, notamment afin d’impliquer les États-Unis qui n’étaient pas partie au Protocole, alors que les pays en développement s’opposaient à l’abandon du Protocole au motif qu’il constituait le seul instrument juridique contraignant existant.
Les deux voies de négociation évoquées ont abouti à des textes sur les différents sujets, mais leur longueur ainsi que la persistance des désaccords sur certaines des dispositions ont finalement conduit à les ignorer. La Conférence de Copenhague, véritable montagne diplomatique, a donc accouché d’une souris, un traité a minima, non contraignant et ne rassemblant que vingt-sept États.
Le plan d’action de Bali, qui devait mener à trouver un nouvel accord mondial, prévoyait l’établissement d’une « vision partagée » entre les pays pour éviter un réchauffement irréversible et dangereux. Si le seuil maximal d’augmentation de la température de la planète, fixé à 2°, a bien été affirmé dans l’Accord de Copenhague, le niveau de référence n’a pas été établi pour cette augmentation, et l’Accord ne faisait pas mention de moyens spécifiques pour y parvenir (que ce soit en termes d’objectif de réductions des émissions, de date pour le pic des émissions ou de concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère).
Concernant l’effort de réduction des émissions auquel les pays en développement avaient accepté de se soumettre après 2012 en contrepartie d’un soutien financier, l’accord reste là aussi évasif quant aux financements promis. En effet, des « financements précoces » (fast start) pour la période 2010/2012 sont annoncés pour un montant de 30 milliards, mais aucune indication n’est donnée concernant leur additionnalité par rapport aux objectifs de l’aide publique au développement, à l’allocation des financements, à leur nature ou aux canaux de distribution. La création d’un financement innovant pérenne, très attendue, n’a pas eu lieu, et la question des financements de long terme n’a pas fait l’objet de développements plus précis que l’évocation de la création d’un « Fonds vert pour le climat ».
Entre continuer la négociation dans le cadre du Protocole de Kyoto ou sous la Convention climat CCNUCC, l’Accord de Copenhague n’a finalement pas choisi. Cette absence de choix est toutefois révélatrice de glissements dans les négociations qui constituent des changements de long terme.
Tout d’abord, Copenhague marque la réelle montée en puissance dans les négociations des grands pays émergents, sans lesquels un accord ultérieur ne sera plus possible. Cela ne signifie pas que ces pays forment nécessairement un bloc uni. Le Brésil, la Chine et l’Inde occupent des positions spécifiques dans les négociations.
La Conférence de Copenhague entérine également la remise en cause du modèle descendant des accords internationaux sur le climat : il sera désormais difficilement concevable de s’accorder d’abord tous ensemble sur un objectif dont on déduirait ensuite les cibles à atteindre au niveau des États.
Face à l’impasse du modèle « top/down », c’est une logique « bottom/up » qui prendra la relève, l’objectif commun se faisant la somme des objectifs nationaux. Les États reprennent donc la main, parfois au sein de coalitions d’intérêt, tandis que la logique multilatérale de l’enceinte onusienne est mise en question. Dans le contexte de la crise économique qui déploie ses effets en 2009, on observe un phénomène de repli national.
|
Les coalitions de pays dans les négociations des Conférences des parties Chaque partie est représentée aux sessions de la Convention par une délégation nationale chargée de négocier au nom de son gouvernement. Même si le modèle onusien suit le principe d’« un pays, une voix », chaque pays, outre son groupe régional (au nombre de cinq : Afrique ; Asie et région du Pacifique ; Europe de l’Est et Europe centrale ; Amérique latine et Caraïbes ; Europe de l’Ouest et autres), appartient également à une, et parfois plusieurs, coalitions. - Union européenne (UE) L’Union européenne est elle-même une Partie à la Convention et au Protocole de Kyoto. Avec les 28 États membres, elle parle d’une seule voix lors des négociations climatiques. La présidence en 2015 était assurée par la Lettonie puis par le Luxembourg, auquel a succédé la Slovaquie. - Groupe de l’Ombrelle Le Groupe de l’Ombrelle constitue une coalition flexible de pays développés qui ne font pas partie de l’Union européenne et qui s’est formée dans le contexte des négociations sur les changements climatiques. Le groupe s’est toujours positionné contre un prolongement du Protocole de Kyoto. Bien qu’informel, il rassemble habituellement l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Fédération russe, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l’Ukraine et l’Islande. Ce groupe n’a pas de présidence officielle. - Groupe de l’Intégrité environnementale (GIE) Le GIE a été formé en 2000 par des membres de l’OCDE qui n’adhéraient pas aux positions adoptées par le groupe de l’Ombrelle, à savoir la Suisse, le Mexique et la Corée du Sud, qui ont ensuite été rejoint par Monaco et le Liechtenstein. - Groupe des 77 et de la Chine (G77+Chine) Le G77+Chine est composé de 133 pays en développement et de la Chine, celle-ci étant un membre associé plutôt qu’un membre à part entière, elle conserve sa singularité (d’où le « + »). Ce groupe porte ce nom parce qu’il rassemblait 77 pays lors de sa création en 1964. Lors des négociations sur les changements climatiques, les pays membres du G77+Chine adoptent parfois des positions divergentes, qu’ils défendent alors par le biais d’une autre coalition de négociation ou d’un groupe régional. La présidence en 2015 était assurée par l’Afrique du Sud et son ambassadrice Nozipho Mxakato-Diseko. Aujourd’hui, ce bloc représente près de 80 % de la population mondiale. Ces pays en voie de développement ont donc créé de nombreux petits groupes plus homogènes (AOSIS, PMA…). - Au sein du Groupe des 77 et de la Chine (G77+Chine) : – Le BASIC est un groupe de pays émergents formé par le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine. Il a été fondé en novembre 2009 pour définir une position commune avant la conférence de Copenhague. – Le Groupe arabe comprend vingt et une parties dont l’économie dépend largement du secteur de l’énergie fossile, surtout pétrolier. Ils insistent régulièrement sur le besoin de prendre en considération les impacts négatifs potentiels des actions de lutte contre le dérèglement climatique sur leur économie. Ses membres s’associent le plus souvent au G77+Chine ou au groupe des LMDC, auquel appartiennent également l’Arabie Saoudite, l’Irak, le Koweït ou le Qatar. Le groupe n’est pas formellement présidé par l’un de ses membres mais l’Arabie saoudite y joue un rôle clef. – L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) est à l’origine une organisation politique, sociale et économique qui vise à promouvoir la coopération dans ces domaines entre certains pays de l’Amérique latine et des Caraïbes et à fournir une alternative à la zone de libre-échange des Amériques promue par les États-Unis. L’ALBA constitue aussi, depuis 2010, une coalition de négociation avec un noyau de 11 pays dont le Venezuela, Cuba, la Bolivie, l’Équateur, le Nicaragua et Antigua-et-Barbuda. – L’Association indépendante d’Amérique latine et des Caraïbes (AILAC) a été créée à la suite de la COP de Doha en 2012 pour donner une nouvelle impulsion aux négociations. L’AILAC s’est détachée de l’ALBA en développant des positions plus centristes. Elle réunit sept pays – Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Panama, Paraguay et Pérou. – Les pays de l’Alliance des petits États insulaires (APEID et AOSIS en anglais) ont en commun leur grande vulnérabilité face aux changements climatiques, notamment la hausse du niveau de la mer. L’APEID fondée en 1990, est une coalition de quarante-trois pays à faible élévation côtière et de petites îles (1% de la population mondiale), particulièrement vulnérables à la montée du niveau de la mer. C’est l’ensemble des pays en première ligne face aux effets du changement climatique : Maldives, Haïti, Kiribati, Tuvalu… – Le Groupe Afrique rassemble cinquante-quatre pays du continent africain et fonctionne comme une véritable coalition s’exprimant régulièrement sur des sujets d’intérêt commun, comme l’adaptation, le transfert de capacités ou le financement. La présidence en 2015 est assurée par le Soudan. Les pays du groupe sont assez hétérogènes, et le Groupe Afrique se composant à la fois de PMA et de pays pétroliers ou charbonniers. – Le groupe des Pays les moins avancés (PMA) comporte quarante-huit pays en développement parmi les moins avancés (34 en Afrique, 13 en Asie et un dans les Caraïbes). Ces pays très peu émetteurs, défendent en commun leurs intérêts au sein des Nations unies, notamment en raison de leur grande vulnérabilité au dérèglement climatique et le besoin de recevoir des financements pour s’y adapter. . – La Coalition des États à forêts tropicales a pour but de faire reconnaître les efforts réalisés par les pays situés dans les bassins forestiers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation. Cette coalition inclut quarante pays issus des grands bassins forestiers : Afrique centrale, Asie du Sud-Est et Amazonie. – Le groupe des Pays en développement homodoxes sur le climat (LMDC pour Like Minded Developing Countries on Climate Change) est une coalition spontanée de vingt-quatre pays qui s’est créée durant la session de Bonn sur les changements climatiques de mai 2012. Elle fait partie du G77+Chine et vise à renforcer et unifier ce groupe. Elle est composée de plusieurs pays du monde arabe, de l’Inde, de la Chine, de plusieurs économies émergentes d’Asie et de certaines Parties actives de l’Amérique du Sud, notamment le Venezuela, la Bolivie et Cuba. Source : http://www.cop21.gouv.fr |
Enfin, autre phénomène très notable : l’irruption de la société civile dans l’enceinte même des négociations, ou plutôt tout à côté d’elles. Un des échecs majeurs de Copenhague est en effet de ne pas avoir su capitaliser l’immense mobilisation populaire, et d’avoir créé une frustration née de l’écart dramatique entre le nombre de participants au Klimaforum, d’initiatives présentées et la couverture médiatique inédite d’une part, et le texte final de l’Accord d’autre part.
1. Une institution originelle conçue comme une interface entre les chercheurs et la sphère politique
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), à la demande du G7. Reconnu par l’Assemblée générale des Nations unies la même année dans la résolution 43/53, le GIEC ne constitue ni un programme, ni un fonds, ni à proprement parler une nouvelle institution spécialisée des Nations unies.
Le GIEC est une organisation internationale originale, ouverte à tous les États-membres du PNUE et de l’OMM, soit la quasi-totalité des pays membres des Nations-Unies. Il se situe dans un entre-deux à la lisière du système onusien. Par conséquent, il ne dispose pas d’une direction entièrement autonome : le GIEC rend des comptes à l’OMM et au PNUE concernant l’avancée de ses travaux, et soumet ses délibérations au conseil d’administration du PNUE, au Conseil exécutif de l’OMM et, subséquemment, à l’Assemblée générale de l’ONU.
Son budget dépend d’un fonds spécifique (« IPCC Trust Fund ») auquel contribuent l’OMM et le PNUE. La CCNUCC et les États membres participent aujourd’hui aussi à son financement, sur une base volontaire. Son budget relativement modeste est de 5 millions d’euros.
Le protocole d’entente entre l’OMM et le PNUE créant le GIEC décrit son organisation.
Une Assemblée plénière rassemblant les représentants des 195 États, est chargée de la prise des décisions majeures, en particulier la détermination des grandes lignes des travaux futurs du GIEC et l’approbation des rapports d’évaluation. Elle se réunit tous les ans.
Le Bureau du GIEC, organe exécutif élu par l’Assemblée générale, conseillant cette dernière sur les aspects scientifiques et techniques de son travail ainsi que sur la gestion et l’administration de ces travaux, réunit le président du GIEC, les vice-présidents du GIEC, les co-présidents et vice-présidents des trois Groupes de travail.
Le Comité exécutif regroupe les mêmes membres que le Bureau, à l’exception des vice-présidents des Groupes de travail. Il s’assure de la coordination des travaux des Groupes de travail (et de l’Équipe spéciale) ainsi que des tâches urgentes entre les réunions de l’Assemblée plénière.
Le Secrétariat du GIEC comprend l’ensemble de son personnel permanent (soit treize personnes).
Le travail courant du GIEC est assuré par les Groupes de travail et l’Équipe spéciale ainsi que quatre Unités d’appui technique (une pour chaque Groupe de travail et une pour l’équipe spéciale) en charge de fournir un support scientifique, technique et organisationnel aux Groupes de travail et à l’Équipe spéciale.
Les groupes de travail sont chacun attachés à une dimension du changement climatique.
Le Groupe de travail I est en charge des « éléments scientifiques », c’est-à-dire des principes physiques du changement climatique et notamment de l’évaluation de l’influence humaine dans le réchauffement climatique.
La mission du Groupe de travail II porte sur l’étude des impacts liés aux changements climatiques, de l’adaptation et de la vulnérabilité.
Le Groupe de travail III s’occupe des stratégies d’atténuation du changement climatique. Enfin, l’Équipe spéciale réalise les inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre.
La mission du GIEC, réaffirmée par la résolution 48/53 de l’ONU, est triple :
- évaluer les travaux scientifiques disponibles concernant le changement climatique ;
- évaluer les impacts environnementaux et socio-économiques du changement climatique ;
- formuler des stratégies de réponse afin de répondre aux défis soulevés par le changement climatique.
Par conséquent, le GIEC ne produit ni travaux de recherche originaux, ni mesures climatiques : ses rapports consistent en des revues de la littérature scientifique existante et en une synthèse de l’état des connaissances sur le sujet du changement climatique. À ce titre, et comme le souligne François Gémenne dans son ouvrage « Géopolitique du climat (1) », il s’agit de l’un des plus grands corps scientifiques jamais constitués, puisque plus de 3500 chercheurs ont contribué à la confection du dernier rapport.
Pour répondre aux objectifs qui lui ont été assignés, le GIEC produit un ensemble de documents à échéances régulières :
- des rapports d’évaluation (le cinquième a été publié en 2013/2014) ;
- des rapports spéciaux portant sur des thèmes précis ;
- des rapports méthodologiques élaborant des méthodologies et des lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, nécessaire dans le cadre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto ;
- des documents produits par une « équipe spéciale » visant à mettre au point des méthodes de calcul des émissions et puits de gaz à effet de serre, afin de permettre la réalisation des inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Procédure d’adoption d’un rapport du GIEC: 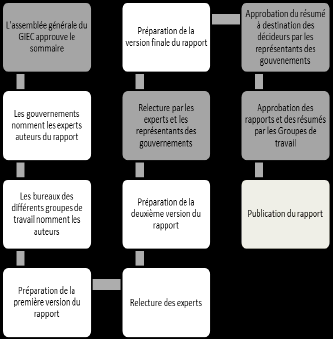 Gris : processus politique Blanc : processus scientifique Source : https://www.ipcc.ch/organization/organization_procedures.shtml |
Dans son plus récent rapport, dont la dernière partie a été publiée en 2014, le GIEC confirme les constats depuis longtemps posés par les scientifiques.
Le dérèglement climatique, causé par l’activité humaine, ne peut plus être contesté. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) récentes d’origine anthropique sont les plus élevées de l’histoire. Si elles se poursuivent au même rythme, cela produira un réchauffement additionnel et accroîtra les risques d’impacts sévères, incontournables et irréversibles. Le rapport de synthèse dit ainsi que « les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, qui ont augmenté depuis l’époque préindustrielle en raison essentiellement de la croissance économique et démographique, sont actuellement plus élevées que jamais, ce qui a entraîné des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Leurs effets, associés à ceux d’autres facteurs anthropiques, ont été détectés dans tout le système climatique et il est extrêmement probable qu’ils aient été la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. »
Pour le GIEC, il est désormais certain que la température de surface moyenne globale de la Terre a augmenté depuis qu'elle a commencé à être mesurée et enregistrée. Ce réchauffement a été d'environ 0,85 °C de 1880 à 2012 avec une augmentation d'environ 0,72 °C de 1951 à 2012. Chacune des trois dernières décennies a été successivement la plus chaude jamais enregistrée. Elles ont aussi très probablement (soit une probabilité de 90 à 100%) été les plus chaudes des 800 dernières années et probablement (soit une probabilité de 66 à 100%) les plus chaudes des 1400 dernières années, même si le taux de réchauffement au cours des quinze dernières années est plus faible que ce qu'il a été depuis les années 1950.
Les projections réalisées sur la base de tous les scénarios d’émissions considérés indiquent une augmentation de la température de surface au cours du XXIe siècle. Il est très probable que la fréquence et la durée des vagues de chaleur augmenteront et que les précipitations extrêmes vont devenir plus intenses et plus fréquentes dans de nombreuses régions. Les océans vont continuer de se réchauffer et de s’acidifier et le niveau moyen de la mer de s’élever.
Les températures de l'océan vont très probablement continuer à augmenter au cours du 21ème siècle. Dans certaines régions, le réchauffement projeté des océans d'ici la fin du siècle pourrait dépasser 0,5 °C à 2,5 °C dans les 100 premiers mètres et 0,3 °C à 0,7 ° C à une profondeur d'environ 1 km. Le niveau de la mer aussi pourrait continuer à augmenter de 0,26 à 0,81 mètre d'ici la fin du 21ème siècle. Il est pratiquement certain que l'élévation du niveau de la mer continuera au-delà de 2100, et se poursuivra ensuite pendant des siècles.
À partir de ces constats, le rapport de synthèse du GIEC laisse peu de doutes quant au potentiel destructeur des futures évolutions climatiques : « Si elles se poursuivent, les émissions de gaz à effet de serre provoqueront un réchauffement supplémentaire et une modification durable de toutes les composantes du système climatique, ce qui augmentera la probabilité de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour les populations et les écosystèmes. Pour limiter l’ampleur des changements climatiques, il faudrait réduire fortement et durablement les émissions de gaz à effet de serre, ce qui, avec l’adaptation, est susceptible de limiter les risques liés à ces changements. »
a. Un rapport qui a fait date dans la prise en compte des conséquences économiques du réchauffement climatique
La publication en 2006 par le Ministère des finances britannique de ce qui a depuis été plus connu sous le nom de « Rapport Stern » (Stern Review on Economics of Climate Change) constitue un tournant dans la façon de considérer les conséquences économiques du changement climatique. L’originalité du rapport réside dans la présentation parallèle des coûts engendrés par les dommages causés par le réchauffement climatique, et des coûts que nécessiterait un ensemble de politiques destiné à éviter ce même phénomène de réchauffement.
Cette étude affirme ainsi que les conséquences de l’inaction pourraient être 5 à 20 fois plus coûteuses que des mesures prises dès à présent pour prévenir le changement climatique : en effet, un investissement de 1 % du PIB mondial par an dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) permettrait d’éviter une perte économique comprise entre 5 % et 20 % du PIB mondial par an.
L’expertise déployée dans le rapport a été largement reconnue : fruit du travail de plusieurs dizaines de chercheurs de différentes nationalités, il a été coordonné par Nicholas Stern, alors Directeur du Budget et des Finances Publiques au Trésor britannique, Chef du service économique du gouvernement et conseiller spécial du Premier ministre sur l'économie du climat et les questions de développement. M. Stern avait précédemment occupé les fonctions de Chef économiste et Vice-Président du développement économique à la Banque mondiale. Le statut et l’expérience de Nicholas Stern, ainsi que le caractère collectif du travail réalisé pendant plus d’un an, ne font que renforcer l’image justifiée de condensé de la meilleure expertise scientifique et économique sur le climat.
La méthodologie utilisée dans le rapport a néanmoins pu être interrogée. Dans une publication de la direction générale du Trésor et de la politique économique du ministère de l’Économie, des Finances et de l’emploi de février 2008 (2), Joffrey Célestin-Urbain peut ainsi relever que l’hétérogénéité du calcul entre coûts des dommages constatés en l’absence d’action de la part des autorités et rapportés à la consommation par tête actuelle, d’une part, et coûts de l'action évalués de manière séparée et exprimés en proportion du PIB de 2050, d’autre part, entachent la rigueur dans la comparaison entre action et inaction.
Malgré les discussions méthodologiques suscitées par ce travail, et en partie même grâce à elles, le rapport Stern a contribué à mettre au premier plan le problème de l’efficacité des politiques publiques en matière climatique. En mobilisant une approche intertemporelle, il a également illustré avec éclat l’idée que notre préférence pour le présent (et donc l’inaction, qui nous parait moins couteuse) pourrait nous amener à supporter des coûts incroyablement plus élevés dans le futur.
Le rapport Stern établit un diagnostic et fournit un travail prospectif intéressant, permettant d’inscrire pleinement la problématique du réchauffement climatique dans le champ des questions de l’action publique. Au-delà du constat, il offre en outre des pistes de mesures à envisager pour enrayer les dommages prévisibles imputables au changement climatique.
Le prix du carbone devrait d’abord être fixé et valorisé par un système de taxes, de permis ou par la régulation. Cette préconisation, qui avait déjà été suivie avec la mise en place en Europe du marché de droits à émettre des gaz à effet de serre par exemple, devrait donc trouver une application élargie.
L’effort en faveur de la recherche publique et privée devrait être intensifié grâce, notamment, à des incitations financières, afin de favoriser les innovations susceptibles d’avoir un effet positif pour contrer le réchauffement climatique et ses dommages. Sur ces sujets, le rapport en appelle à une coopération internationale accrue, ainsi qu’à des transferts de technologie facilités en faveur des pays en développement. L’effort international de recherche et de développement devrait être multiplié par deux, et celui consacré aux technologies propres par cinq.
Tous les moyens d’abattement à moindre coût (soit des moyens de limiter l’effet de serre engendrant des coûts limités) devraient être favorisés, comme la lutte contre la déforestation. Les forêts représentent en effet un moyen de capter les gaz carbonique. C’est le sens du programme REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), qui a été doté lors de la COP de Varsovie d’un mécanisme de vérification destiné à accroître son efficacité.
L’aide en direction des pays en développement est évidemment centrale dans les préconisations du rapport Stern. La coopération internationale doit couvrir tous les aspects de la politique de réduction des émissions – la fixation des prix, la technologie et le démantèlement des obstacles au changement de comportement, de même que l’action sur les émissions issues de l’utilisation des sols. Elle doit, en outre, promouvoir et encourager l’adaptation. Il existe des possibilités considérables d’action maintenant, y compris dans des domaines offrant des bénéfices économiques immédiats (tels que l’efficacité énergétique et une réduction des dégagements de gaz) ainsi que dans des domaines où des programmes pilotes à grande échelle produiraient une expérience importante propre à guider les négociations futures. Dans les pays en développement, ces actions doivent être appuyées par des financements spécifiques auxquels contribueront les pays développés.
Dans un rapport de 2016 (3), l’OCDE tente de mesurer l’impact économique du changement climatique, dans la lignée du rapport Stern mais avec une méthodologie différente. Pour cela, le rapport présente une évaluation quantitative mondiale détaillée des dommages climatiques directs et indirects à travers un certain nombre d’impacts concrets: modifications du rendement des cultures, perte de terres et de capital due à l’élévation du niveau des océans, modification des prises de poissons, dommages matériels causés par les ouragans, modifications de la productivité du travail et des dépenses de santé imputables aux maladies et au stress thermique, modifications des flux touristiques et de la demande d’énergie pour le chauffage et le refroidissement.
Sans prétendre à l’exhaustivité, le travail de l’OCDE vise à appréhender les conséquences sur le produit intérieur brut d’un certain nombre d’effets néfastes du changement climatique qui semblent désormais avérés pour le futur.
Les résultats présentés par le rapport sont évidemment très inquiétants, puisque sans la mise en œuvre immédiate de mesures climatiques drastiques, les effets conjugués des différents impacts sur la croissance annuelle du PIB mondial pourraient s’élever de 1.0 % à 3.3 % d’ici à 2060, la projection centrale s’établissant à 2 %. Pour une élévation de la température de 6°C, la perte de PIB pourrait aller jusqu’à 4.4 % en 2060.
Avec une hausse des températures de 4°C par rapport aux niveaux préindustriels en 2100, la perte de PIB pourrait se situer entre 2% et 10% à la fin du siècle par rapport à un scénario « sans dommage ».
Parmi les impacts modélisés, les modifications concernant le rendement des cultures et la productivité du travail ont les conséquences les plus marquées, tandis que les dommages dus à l’élévation du niveau des océans sont progressivement plus graves après le milieu du siècle.
Pour vingt-cinq régions passées au crible de l’analyse de l’OCDE, vingt-trois connaissent des conséquences dommageables sur leur économie, et tout particulièrement en Asie et en Afrique plus vulnérables à la hausse des températures et à la chute des rendements dans l’agriculture.
Selon les conclusions de cette étude, des mesures d’atténuation ambitieuses pourraient aider les économies à diviser par deux les conséquences dommageables pour le PIB d’ici à 2060.
III. LA PRISE DE CONSCIENCE CROISSANTE DE LA RÉALITÉ DU CHANGEMENT CLIMATIQUE PAR L’OPINION PUBLIQUE MONDIALE
Ils ne sont pas les seuls effets du changement climatique, mais leur caractère spectaculaire leur donne une exposition médiatique particulière. Ils touchent de façon brutale des zones très habitées, et exposent indifféremment des populations de pays développés et non développés.
Comme l’indique le rapport de synthèse du GIEC de 2014 : « Des changements ont été constatés depuis 1950 environ en ce qui concerne bon nombre de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Certains de ces changements ont été attribués aux activités humaines, notamment la diminution des extrêmes de froid, l’augmentation des extrêmes de chaleur, la hausse des niveaux extrêmes de pleine mer et la multiplication des épisodes de fortes précipitations dans diverses régions. »
Ces « événements météorologiques extrêmes » ne peuvent être prévus par les modèles climatiques, du fait précisément de leur nature exceptionnelle.
La base de données spécialisée EM-DAT du Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes naturelles (CRED, pour « Centre for Research on the Epidemiology of Disasters » de l’université de Louvain) fait apparaître une croissance continue de ces phénomènes depuis le début de leur recensement. Elle en compte ainsi 377 pour 2015, contre 180 pour l’année 1985, seulement trente ans plus tôt.
Ces événements météorologiques sont d’autant plus dévastateurs qu’ils touchent des régions très peuplées, comme en Asie du Sud-est : la concentration démographique et la proximité des habitations de zones à risques (littoral, zones de failles sismiques) conduisent en effet à des répercussions particulièrement dramatiques.
L’apparition de l’objet d’étude que constituent les migrants climatiques remonte aux années 1970 pour le champ des études sur la sécurité internationale, et aux années 1980 pour le champ des études plus axées sur les questions énergétiques et environnementales.
Dès 1976, L. Brown utilise le terme d’ « environmental refugee » (4) et appelle à inclure le défi écologique dans les questions de sécurité internationale. Le déséquilibre entre ressources naturelles disponibles et besoins des populations, la dégradation de l’environnement sont pensés comme un prisme à travers lequel réfléchir de façon renouvelée les enjeux sécuritaires, les déplacements de population représentant, non un phénomène nouveau mais de nature à catalyser les conflits.
Dans le domaine des études environnementales, E. El Hinnawi, chercheur égyptien, spécialiste des questions environnementales et énergétiques et consultant auprès du Centre International pour l’environnement et le développement, rédige un rapport pour le Programme des Nations Unies pour l’Environnement en 1985 qui contribue à la médiatisation du le terme « refugiés environnementaux ».
Dès le milieu des années 1990, les deux analyses sont toutefois recoupées : c’est le cas dans un article célèbre de Norman Myers et Jennifer Kent.
La multiplicité des causes du phénomène est ici problématique : elles peuvent être structurelles, générant des effets de long terme qui rendent le retour des populations impossibles (comme dans le cas de l’assèchement d’un lac par exemple, ou de l’érosion de surfaces cultivables) ou brutales, avec des phénomènes climatique violents entrainent des destructions massives mais ne compromettant pas forcément l’habitat de façon irréversible (avec les ouragans ou les tsunamis).
Le chercheur François Gemenne (5) distingue trois vecteurs de flux migratoires dus aux changements climatiques : la multiplication des catastrophes naturelles, l’augmentation du niveau des mers et la raréfaction des ressources d’eau potable (le stress hydrique). Ces phénomènes distincts (mais qui peuvent se conjuguer sur des échelles temporelles concomitantes ou non) entrainent des réponses différentes des populations, et appellent en conséquence des réponses également différenciées de la part des pouvoirs publics.
Cette variété de causes rend problématique la définition de la migration environnementale, qui est le résultat de plusieurs motifs difficilement dissociables : le facteur environnemental est intimement lié au facteur économique, et peut être intriqué dans un motif politique lorsque le déséquilibre des ressources et des besoins en vient à générer des conflits (pour l’accès à l’eau par exemple).
Du fait de cette difficulté dans la définition d’un type de migration environnementale, les évaluations chiffrées sont l’objet de nombreuses controverses.
Chloé Anne Vassopoulos (6) distingue deux types d’approche. Il y aurait d’une part les maximalistes, dont les estimations des personnes concernées par les migrations climatiques se chiffrent en millions. Parmi ceux-ci, les spécialistes de l’environnement comme Norman Myers, qui donne en 1995 la prévision de 150 millions de migrants environnementaux à l’horizon 2050, et a depuis porté ce chiffre à 200 millions. Selon la chercheuse, la position de ces « maximalistes » n’est pas exempte de paradoxes, puisque l’objectif de leur discours alarmiste est d’alerter l’opinion publique des méfaits de la dégradation environnementale plutôt que de chercher à donner les clés d’une politique susceptible de répondre aux enjeux du nouvel objet cognitif qu’ils avaient pourtant contribué à identifier.
Pour le second type d’approche, Chloé Anne Vassopoulos parle de position « minimaliste », de la part des spécialistes des questions migratoires, plus réticents, devant un phénomène aux causes complexes – la migration – à singulariser le facteur environnemental.
À l’heure actuelle, il demeure ardu de proposer des évaluations chiffrées stables. Le PNUE prévoit 250 millions de réfugiés climatiques pour 2050. Selon le rapport annuel Global Estimates du Conseil norvégien pour les réfugiés, publié le 20 juillet 2015, 19,3 millions de personnes ont dû quitter leur domicile en 2014 à la suite de catastrophes naturelles. Les déplacements suite aux catastrophes naturelles sont en effet plus faciles à « tracer », et l’Internal Displacement Monitoring Centre de Genève donne le chiffre de 19.2 millions de personnes déplacées dans 113 pays en 2015, soit deux fois plus que le nombre de personnes ayant fui la violence et les conflits armés. Cela représente un total de 203.4 millions pour les huit dernières années, pour une moyenne de 25.4 millions d’individus par an.
La complexité des évaluations chiffrées, également relevée par les chercheurs Jacques Véron et Valérie Golaz de l’Institut national d’études démographiques (INED) (7), complique les projections des migrations futures et l’anticipation de leurs conséquences. Les deux chercheurs s’appuient sur les projections réalisées par le GIEC pour une élévation du niveau de la mer de 1 mètre à la fin du siècle et 3 mètres pour 2300 et les chiffres donnés par l’ONU pour affirmer que 60% des 450 aires urbaines de plus d’un million habitants, soit 900 millions d’habitants, seraient exposés à un risque naturel élevé.
La communauté scientifique est très divisée sur les termes à employer pour désigner ces phénomènes de migrations. Il est à prévoir que cette controverse ne tendra pas à s’apaiser, la problématique de l’accueil des migrants rencontrant de plus en plus souvent des opinions publiques crispées et des réponses politiques très limitées.
Pour certains les ayant employés très tôt, les termes de réfugiés climatiques se justifient dès lors que les migrants n’ont pas d’autre choix que de quitter leur lieu de vie : à ce titre, et au vu de la responsabilité historique des pays développés dans le changement climatique à l’origine du bouleversement de leurs conditions de vie, les migrants environnementaux auraient un droit inconditionnel à l’aide des pays développés.
Mais pour de nombreux chercheurs et défenseurs du droit d’asile, parler de « réfugiés climatiques » n’est rien moins qu’un « abus de langage » (8). En effet, la notion de « réfugié » telle qu’on la trouve dans la Convention de Genève de 1951 s’applique à des personnes ne pouvant pas bénéficier de la protection de leur pays, dès lors que c’est dans celui-ci que se pratiquent les persécutions dont ils sont victimes.
Pour les migrants environnementaux, le déplacement ne passe pas forcément par un franchissement de frontières : ils sont, dans le cas d’une migration interne, censés pouvoir bénéficier de la protection de leur État, selon les Principes directeurs relatifs aux déplacements internes tels qu’adoptés par les Nations Unies en 1998.
Le problème réside dans le fait que les États ne sont pas nécessairement armés pour répondre à ce type de défi, et cela, même dans les pays développés (il suffit de penser aux suites de l’ouragan Katrina en Louisiane aux États-Unis). C’est pourquoi la définition d’un véritable statut pour les migrants climatiques, voire un statut de réfugié, est régulièrement évoquée dans les instances internationales. Beaucoup de spécialistes s’accordent à dire que la révision de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 serait très délicate, et que dans un contexte de raidissement sur les questions migratoires, cette révision pourrait mener à des restrictions contreproductives pour le droit des réfugiés dans son ensemble.
Les aides apportées le sont donc souvent au coup par coup, dans le cas de catastrophes naturelles par exemple, par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, ou d’autres organisations internationales.
Un statut ad hoc pourrait être plus pertinent, d’autant plus que la problématique des migrants climatiques pose d’épineuses questions de respect de la souveraineté nationale.
C’est le sens de l’Initiative Nansen, un processus intergouvernemental pensé pour combler le déficit de protection et faire face aux défis du déplacement au-delà des frontières dans le contexte des catastrophes et des effets des changements climatiques. À travers leur paragraphe 14 (f), les Accords de Cancún lors de la seizième COP ont reconnu les déplacements, les migrations et la réinstallation planifiée suite aux changements climatiques comme un enjeu d’adaptation, et convenu de renforcer la compréhension et la coopération.
Suite à la Conférence Nansen d’Oslo (juin 2011) sur les changements climatiques et le déplacement et lors de la conférence ministérielle du HCR en décembre 2011, la Norvège et la Suisse se sont engagées à répondre au besoin d’une approche plus cohérente pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le contexte des catastrophes et des effets des changements climatiques.
Cet engagement a été salué par plusieurs États et a fourni la base de l’Initiative Nansen, lancée en 2012. En amont de la COP 21, le 13 octobre 2015, 110 États, réunis à Genève, ont adopté un « agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières en contexte de catastrophes et du changement climatique », cadre souple hors du système onusien qui constitue une solution originale dont il faudra suivre les évolutions à l’avenir.
L’Agenda pour la protection ne constitue pas à proprement parler un cadre international contraignant pour les pays l’ayant adopté, mais il permet d’édicter les grands principes à respecter dans les situations de migrations dues aux changements climatiques, et énonce un ensemble de bonnes pratiques à mettre en œuvre par les autorités, ainsi que les voies de la collaboration lorsque plusieurs États sont concernés.
Cet Agenda est le fruit de consultations et de réunions entre États pour identifier ces bonnes pratiques. En formulant des recommandations, il s’agit de renforcer les mesures préventives en établissant à l’échelle d’une région à risque des scénarios d’urgence pour les cas de catastrophe et en planifiant la relocalisation des populations qui seraient affectées.
La plateforme vise aussi à permettre d’accorder des visas de circulation des personnes venant des pays touchés par une catastrophe ou d’octroyer des permis de séjour temporaire, voire permanent lorsque le retour dans le pays d’origine est impossible. Il s’agit également d’élaborer des mesures pour maintenir les liens familiaux et culturels.
La visibilité des phénomènes climatiques extrêmes et la constitution progressive des réfugiés climatiques en problématique de politique publique comptent parmi l’ensemble de raisons motivant une implication grandissante de la société civile sur le terrain du changement climatique.
La capacité accrue des ONG à se faire entendre lors des Conférences annuelles, ou du moins la possibilité qui leur a été de plus en plus octroyée de se manifester et d’organiser des ateliers, des conférences et des évènements en parallèle au rituel onusien annuel de la rencontre des parties à la CCNUCC a renforcé leur visibilité. De nombreuses organisations ont au fil des ans acquis un savoir-faire dans la mise en place d’initiatives susceptibles de mobiliser le grand public, qui est venu s’ajouter à une connaissance scientifique précieuse des sujets du réchauffement climatique.
Cette représentation croissante lors des COP des ONG et de la société civile plus largement avait semblé connaître un saut quantitatif à Copenhague, avec plus de 800 ONG et plus de 20 000 participants (9) disposaient de badges (soit deux fois plus d’ONG et quatre fois plus de participants que l’année précédente en Pologne).
Au-delà des organisations non gouvernementales spécialisées ou non, la mobilisation des citoyens peut prendre des formes telles que la participation à des manifestations pour interpeller les décideurs politiques appelés à prendre part aux négociations climatiques, ou la mise en œuvre d’initiatives locales pour lutter contre le changement climatique. Le 21 septembre 2014, une marche pour le climat à New York avant le sommet des chefs d’États convoqué par Ban Ki-moon rassemblait près de 300 000 personnes, plus de trois fois l’affluence prévue.
Les enquêtes sur l’opinion publique mondiale reflètent cette préoccupation. La plus grande enquête réalisée à ce jour par le Pew Research Center (10) en mars 2015 révèle ainsi que la majorité des personnes interrogées dans les quarante pays sondés considèrent le changement climatique comme un sujet sérieux, et 72% de la population interrogée par le Pew Research Center se sent ainsi personnellement (très ou plutôt) concernée par le changement climatique.
DEUXIEME PARTIE : LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DU RÉGIME CLIMATIQUE MONDIAL DEPUIS L’ACCORD DE COPENHAGUE
À Copenhague, les vingt-sept pays ayant signé l’accord ont pris pour référence l’objectif de rester sous les 2°C de réchauffement de la température de la planète, objectif depuis longtemps préconisé par le GIEC, et qui avait déjà été adopté lors du Forum des économies majeures (composé de pays comptabilisant plus de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre) et du G8 en juillet 2009. Outre l’absence de référence (à l’inverse du rapport du GIEC, qui inscrit cet objectif en regard du niveau préindustriel de la température mondiale), l’Accord de Copenhague repoussait à la fin de 2010 la soumission des engagements des pays au Secrétariat de la Convention Climat.
L’objectif de contenir le réchauffement à 2°C était donc dans le cadre de ce rapport doublement insatisfaisant. D’une part car il ne précisait pas la référence à partir de laquelle calculer le réchauffement. D’autre part car il conduisait à écarter la demande de nombreux pays, notamment les pays africains ou les petits États insulaires, de parvenir à un objectif de 1.5°C, plus prudent au regard des effets potentiels du réchauffement.
À Cancún, la cible d’une augmentation maximum de 2°C a été actée par rapport à l’ère préindustrielle et intégrée dans le cadre de la Convention climat, avec la possibilité évoquée de revoir cet objectif pour parvenir à une augmentation maximum de 1.5°C.
Le Protocole de Kyoto visait à réduire d'au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 les émissions de six gaz à effet de serre : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et trois substituts des chlorofluorocarbones. La réduction devait être réalisée pour les trente-cinq pays industrialisés ayant souscrit au Protocole sur la période 2008/2012. Pour les pays industrialisés qui, comme les États-Unis, n’ont pas ratifié le Protocole, ce sont des engagements ultérieurs souscrits dans le cadre de la Convention climat qui s’appliquent, de façon moins contraignante puisque la Convention ne bénéficie pas d’un comité d’observance comme le Protocole.
Après l’échec de Copenhague à trouver un cadre susceptible de succéder en 2012 au Protocole de Kyoto, un certain nombre de pays se sont engagés à amender celui-ci pour le prolonger pour la période 2013/2020, dans ce que l’on a appelé l’Amendement de Doha. De cette façon, il était permis d’espérer qu’un accord succédant au Protocole de Kyoto soit conclu pour prendre la relève en 2020 et intégrer l’ensemble des pays, qu’ils appartiennent ou non au groupe de pays de l’Annexe I de la Convention climat de 1992.
Dans cette seconde période d’engagement, l’Union européenne s’est conjointement engagée avec l’Islande à réduire de 20% ses émissions d’ici à 2020 par rapport à 1990, l’amendement au Protocole de Kyoto laissant ouverte la possibilité de souscrire à des objectifs plus contraignants durant la période d’engagement. Cet engagement s’était déjà concrétisé pour l’Union européenne dans un Paquet climat adopté en décembre 2008, qui comprenait également les objectifs de parvenir à 20% d’énergies renouvelables et d’augmenter de 20% l’efficacité énergétique de l’Union. La seconde période de l’engagement de Kyoto s’applique pour l’Union européenne, la Croatie, l’Islande, la Norvège, la Suisse, l’Australie et huit autre pays industrialisés. Toutefois, de grands pays de l’Annexe I ont refusé de s’engager pour cette seconde période, notamment en raison de l’absence des États-Unis : Russie, Japon et Canada (qui est allé jusqu’à se retirer du Protocole de Kyoto), ce qui affaiblit la portée de l’Amendement de Doha, puisque ces trois pays représentaient 40% des émissions des pays de l’Annexe I.
La notion de MRV, pour Measures, Reporting and Verification, désigne le système de recensement et de vérification des données, censé permettre le contrôle du respect de leurs engagements par les pays.
Dès la Convention climat de 1992, les États de l’Annexe I se sont engagés à ramener en 2000 leur niveau d’émission de gaz à effet de serre au niveau de 1990, et à fournir des moyens financiers aux pays en transition et en voie de développement afin de les aider dans leurs actions d’adaptation. Progressivement, le système permettant de contrôler le respect de ces engagements s’est renforcé et étendu. Il faut noter qu’il a toujours existé sous la Convention, en prévoyant des obligations différenciées pour les pays selon le principe des responsabilités historiques elles-mêmes variables. Ce régime est toutefois devenu plus robuste et plus précis au cours des années.
Le premier engagement des Parties signataires de la Convention, figurant à l’article 4 de celle-ci, est de fournir à la Conférence des Parties des inventaires nationaux de leurs émissions et absorptions liées aux activités humaines de gaz à effet de serre ne figurant pas au protocole de Montréal. La Convention demande également que les Parties s’engagent à communiquer des informations relatives aux politiques et mesures adoptées, aux ressources financières consacrées aux pays en développement, à la recherche et à l’observation systématique. Il a été décidé à Buenos Aires que, pour les parties de l’Annexe I de la Convention, la périodicité de l’inventaire serait annuelle, et que celle de la communication nationale ne serait pas supérieure à cinq années. L’inventaire et la communication nationale doivent être établis selon les lignes directrices adoptées à la CCNUCC, qui s’appuient elles-mêmes, dans le cadre de l’inventaire, sur les méthodologies mises au point et régulièrement améliorées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Les informations fournies sont censées servir de base pour la planification et la mise en œuvre de mesures au niveau national et pour le suivi des impacts des mesures au niveau mondial.
La COP 8 de New Delhi, en 2002, a adopté des directives pour la préparation de Communications Nationales des parties non visées à l'Annexe I, afin d'aider les pays à satisfaire à leurs obligations de notification, de garantir la cohérence, la transparence, la comparabilité et la flexibilité des informations, de servir de directives politiques pour la mise en place d'un soutien financier et de permettre à la COP d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention.
Ces directives stipulent également que les communications doivent inclure des informations sur les lacunes, les contraintes, les besoins financiers et techniques et les besoins de capacités. Le Groupe Consultatif d’Experts (CGE) a été mandaté pour fournir du renforcement de capacités concernant la notification.
Le Groupe Consultatif d’Experts Le Groupe Consultatif d‘Experts (CGE) est composé de vingt-quatre experts désignés par des groupes régionaux: cinq de l’Afrique, cinq de l’Asie et le Pacifique, cinq de l’Amérique Latine et les Caraïbes, six des Parties de l’Annexe I, et trois des organisations intergouvernementales (UNDP, UNEP, GEF). Le CGE est censé fournir de l’assistance technique flexible et à long terme conformément aux problèmes et aux contraintes des pays en voie de développement afin d’améliorer leur capacités de notification, y inclus l‘élaboration des dispositions institutionnelles ainsi que l’établissement et l’entretien d’une équipe nationale technique qui sera responsable, de façon continue, de l’élaboration des Communications Nationales et des rapports biennaux actualisés (BUR), ceux-ci comprenant les inventaires des GES. Le CGE fournit du conseil technique sur: - l’accès aux sources de financement et aux sources de soutien technique pour la préparation de rapports, - l’intégration de considérations sur le changement climatique dans les politiques et actions pertinentes, - les leçons tirées et les bonnes pratiques dans la notification. Le CGE développe des matériaux pédagogiques et organise des ateliers pour les experts techniques désignés afin d’améliorer leurs capacités dans l’analyse et la préparation des rapports. Source : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh |
Le Protocole de Kyoto impose des obligations renforcées par rapport à celles de la Convention dans le domaine de la communication d’informations relatives aux activités des Parties en rapport avec le changement climatique.
Le plan d’action de Bali, adopté lors de la Conférence des parties de 2007, marque une évolution sensible en adoptant cette notion de MRV, qui conditionne le soutien financier par les pays développés à des projets d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, pourvu que soient présentés des actions nationales spécifiques (les « NAMA » de l’Accord de Copenhague, les « nationally appropriate mitigation actions »). Pour être reconnues dans de futurs accords climatiques internationaux, les actions d’atténuation des émissions devront donc désormais se conformer à ce triple critère de responsabilité (d’ « accountability ») : être mesurées, reportées et vérifiées.
De la même façon, les contributions financières des pays développés devront souscrire à ces objectifs de transparence. Ce cadre de reconnaissance a donc vocation à s’appliquer à tous les pays, que ce soit dans le cadre d’action d’atténuation ou d’adaptation (pour les pays développés comme pour les pays en développement) ou dans l’aide financière.
Cet effort pour faire du régime climatique un régime transparent est important pour créer la confiance nécessaire à une extension progressive des obligations de tous les pays. Lors de la Conférence de Cancún, ces dispositifs ont été précisés, avec l’obligation pour les pays développés de soumettre un rapport biennal contenant des informations relatives à leurs engagements d’atténuation mais aussi le détail des soutiens financier, technologique et en renforcement de capacité qu’ils ont accordé aux pays en développement. Une obligation symétrique est prévue pour les pays en développement, qui devront soumettre un rapport biennal contenant des informations relatives à leurs actions d’atténuation et au soutien financier, technologique et en renforcement de capacité reçu.
La Conférence prévoyait également la mise en place d’un processus d’évaluation et d’examen international (International Assessment and Review ou IAR) pour les pays développés, et d’un processus de consultation et d’analyse internationale (International Consultation and Analysis, ou IAC) pour les pays en développement, deux processus à définir lors des Conférences suivantes. Les Consultations et Analyses Internationales (ICA) permettront à une équipe d'experts de générer une analyse technique afin d’identifier les besoins en matière de renforcement de capacité et de faciliter le partage des points de vue. ICA est censé améliorer les systèmes nationaux de notification.
À Cancún, la Conférence des parties a décidé de créer un comité permanent chargé de l’aider à s’acquitter de ses fonctions relatives au mécanisme financier de la Convention, pour améliorer la cohérence et la coordination du financement des mesures prises pour faire face aux changements climatiques, rationaliser le mécanisme financier, mobiliser des ressources financières, ou encore mesurer, notifier et vérifier l’appui fourni aux pays en développement parties.
Le MRV doit donc se déployer dans trois dimensions :
Le MRV des émissions est un concept qui sert à mesurer, notifier et vérifier des données quantifiables sur les émissions au niveau national, régional et sectoriel : il favorise la responsabilisation nationale et fait l'objet de négociations continues. Disposer d'un système de MRV complet permet d’améliorer les bases d'informations et de surveiller les mesures d'atténuation afin de favoriser la planification, la mise en œuvre et la coordination nationales des activités d'atténuation individuelles, des mesures et des politiques ascendantes et des objectifs descendants.
Le MRV des émissions comprend l'identification et/ou la définition de responsabilités institutionnelles et de rôles clairement définis afin de garantir le flux régulier et la standardisation des informations pour toutes les entités qui produisent, notifient et vérifient les estimations de GES.
Le MRV des mesures d’atténuation, ou NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Measures) permet d’évaluer l’efficacité des mesures nationales prises par les pays. Il s’agit de notifier les données sur les économies d'émissions, les méthodes, les objectifs de durabilité, la couverture, les dispositifs institutionnels et les activités, sur la base de directives qualitatives et quantitatives sur la soumission des rapports biennaux actualisés (BUR pour Biennal Updates Reports).
Comme son nom l’indique, le MRV du soutien s’attache à retracer les efforts de soutien en direction des pays les moins avancés et en développement de la part des pays industrialisés. Ce MRV est stratégique car le suivi des aides financières peut avoir une grande influence sur la volonté des pays en développement d’engager des mesures d’atténuation, tout comme il met en jeu la crédibilité des engagements des pays développés et leur capacité à les respecter. L’augmentation de la transparence dans le MRV du soutien passe aussi par une présentation standardisée des aides de la part des bénéficiaires comme des donateurs.
Lors de la 19ème COP, à Varsovie, un système de MRV a été élaboré pour le secteur de la forêt, dans le cadre du programme REDD+. Cette avancée est particulièrement intéressante : les pays se sont mis d’accord sur un cadre commun et ambitieux conditionnant les financements dédiés à la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols et à la reforestation. Pour recevoir des financements REDD+, les pays devront soumettre leurs émissions forestières à un MRV rigoureux, cela aussi bien pour les financements dans le cadre de la Convention climat que pour ceux accordés dans un cadre bilatéral.
Pour la première fois, des pays en développement ont donc accepté un processus de MRV audité dans un cadre international et avec des règles proches de celles appliquées aux pays de l’annexe I. Cette avancée a également constitué un signal très positif sur le chemin d’un accord universel sur la réduction des émissions de GES, en créant un précédent de MRV et en ouvrant la voie à un possible MRV ultérieur sur les actions nationales d’atténuation (les NAMA).
La Convention climat de 1992 prévoyait déjà une assistance financière des pays développés en direction des pays en développement afin de mettre en œuvre ses objectifs. Un mécanisme financier est créé, dont la gestion est confiée au Fonds pour l’environnement mondial.
|
Le Fonds pour l’environnement mondial Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) réunit 182 pays en partenariat avec des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des acteurs du secteur privé. Il est depuis sa création en 1991 le principal instrument de financement de la lutte contre le changement climatique. Il sert de bras financier à des organisations engagées dans la lutte contre le changement climatique et gère plusieurs mécanismes financiers : • le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA), qui répond aux besoins spécifiques et immédiats de 49 pays en termes d’adaptation au changement climatique. La constitution du fonds repose sur des contributions librement consenties par les pays développés, qui sont ensuite allouées sous forme de subventions ; • le Fonds spécial pour les changements climatiques (FSCC). Les ressources de ce fonds sont allouées sous forme de subventions à des projets d’adaptation dans les pays en développement ; • le Fonds spécial de priorité stratégique pour l’adaptation (PSA), abondé par des fonds propres du FEM. Il finance des projets pilotes qui répondent à des besoins d’adaptation locaux et qui ont également des retombées positives sur l’environnement mondial ; • le Fonds d’adaptation, créé en 2001 pour financer des projets d’adaptation dans les pays en développement parties au Protocole de Kyoto, le précurseur en matière d’adaptation. Il lève des fonds auprès des États, mais aussi auprès d’acteurs privés. Source : Banque de France |
L’ancienne présidente du Fonds pour l’environnement mondial, Monique Barbut, notait dès 2009 qu’il existait plus de 200 fonds de financement pour des actions climatiques, de toutes dimensions, bilatéraux ou multilatéraux, et dont les frais de gestion absorbaient jusqu’à 10% des montants récoltés.
À côté du Fonds pour l’environnement mondial, existent les Climate Investment Funds gérés par la Banque mondiale et le Fonds d’adaptation du Protocole de Kyoto.
Les Climate Investment Funds représentent 8.3 milliards de dollars de financement et se décomposent en quatre programmes :
- le Fonds pour une technologie propre promeut le développement de technologies bas carbone grâce à des prêts concessionnels pour un montant de 5.6 milliards de dollars ;
- le programme pilote pour la résilience climatique, doté de 1.2 milliards de dollars, aide les gouvernements à intégrer la préoccupation climatique dans la planification des projets d’investissements publics ou publics/privés,
- le programme de soutien aux énergies renouvelables favorise leur déploiement dans les pays en développement avec une enveloppe de financement de 780 millions de dollars,
- le programme d’investissement pour les forêts soutient la prévention de la déforestation à hauteur de 775 millions de dollars dans le cadre de l’initiative REDD+.
Certaines annonces ont été faites en 2010 lors de la Conférence de Cancún afin de faire progresser l’efficacité du financement climatique. Un Comité permanent du financement a été créé afin d’assister les Conférences annuelles des parties dans le suivi des financements climatiques (le MRV du soutien évoqué plus haut). Cette assistance passe par la réalisation d’un rapport bisannuel, dont le premier est sorti en 2014.
Le Fonds vert pour le climat est né lors de la Conférence de Cancún en 2010 (COP16). Dirigé par un conseil de vingt-quatre membres issus de pays avancés et de pays en développement, il regroupe une série de mécanismes financiers. Le fonds a vocation à devenir le principal canal de distribution des financements publics pour le climat. Il a dépassé le cap des 10 milliards de dollars de capitalisation et a commencé à financer les premiers projets fin 2015.
Dans le cadre des accords de Copenhague et de Cancún, les pays développés se sont collectivement engagés à mobiliser des financements précoces (« fast start ») à hauteur de 30 milliards de dollars sur la période 2010-2012 pour lutter contre le changement climatique dans les pays en développement. L’Union européenne s’est engagée à contribuer de manière conséquente à cet effort en mobilisant 7.2 milliards d’euros de financements précoces sur 3 ans.
À l’issue de cette période, les pays développés se sont également engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an (soit environ 70 milliards d’euros) de financements publics et privés d’ici à 2020.
Le rapport du Groupe consultatif de haut niveau sur le financement du changement climatique (AGF), rendu public en novembre 2010, la même année que sa mise en place par le secrétaire général des Nations unies, offre une analyse objective et approfondie des différentes sources de financement pouvant contribuer à la mobilisation des 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. Le rapport démontre que cet objectif est un défi réalisable si l’on parvient à mobiliser une combinaison de sources de financement, publiques et privées, nationales et internationales, innovantes et traditionnelles. Cela supposerait notamment l’instauration d’un prix du carbone entre 20 et 25 dollars par tonne en 2020.
Parmi les sources publiques, le rapport souligne l’intérêt de mécanismes (taxe ou marché de permis) appliqués aux émissions de CO2 dans les secteurs maritime et aérien, ainsi que l’apport potentiel d’une taxe sur les transactions financières.
Le rapport démontre aussi le rôle significatif que les banques multilatérales de développement et les marchés carbone peuvent jouer afin d’améliorer l’effet de levier public sur les flux d’investissement du secteur privé. Il s’agit également d’aider à la transformation des économies en développement pour qu’elles adoptent des trajectoires de croissance moins émettrices de carbone.
La question du financement des actions d’adaptation et de d’atténuation est évidemment centrale dans les négociations. Pour les pays développés, il s’agit d’assumer leur responsabilité historique dans la dégradation du climat en aidant les pays en développement à éviter les mêmes écueils et à créer les moyens de prévenir les effets néfastes du changement climatique à l’avenir.
La mesure des fonds réellement consacrés au changement climatique et à l’aide des pays en développement est donc un sujet sensible, qui engage la crédibilité des promesses faites par les pays développés.
A la veille de la COP 21, il était essentiel de faire le point sur le financement climatique et l’objectif des 100 milliards de dollars par an. Dans le but d’informer les discussions internationales et de renforcer la transparence au sujet du financement climatique, les présidences sortante et entrante de la COP, à savoir le Pérou et la France, ont demandé à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’établir une estimation globale actualisée du financement mobilisé pour le climat et de donner une indication des progrès réalisés vers l’objectif de financement climatique défini dans le contexte de la CCNUCC.
Le rapport suit la définition opérationnelle recommandée par le Comité permanent du financement de la CCNUCC, et considère que le financement climatique englobe tous les apports financiers ayant expressément pour objectif de favoriser un développement sobre en carbone ou résilient face au changement climatique.
Selon ses estimations, le volume global du financement climatique public et privé mobilisé par les pays développés11 pour les pays en développement12 a atteint 61.8 milliards de dollars (USD) en 2014, contre 52.2 milliards USD en 2013, soit une moyenne de 57.0 milliards USD par an sur les deux années.
L’estimation totale est fondée sur les éléments suivants du financement public et privé :
- estimations provisoires du financement climatique bilatéral de source publique, établies d’après les chiffres que les Parties prévoient de communiquer à la CCNUCC ;
- financement climatique multilatéral de source publique apporté par les BMD et les principaux fonds climatiques, et pouvant être attribué aux pays développés ;
- crédits à l’exportation liés au climat bénéficiant d’un soutien public, essentiellement en faveur des énergies renouvelables ainsi que des montants supplémentaires par certaines Parties à la CCNUCC ;
- estimation préliminaire et partielle du financement privé mobilisé par la finance publique bilatérale et multilatérale, et pouvant être attribué aux pays développés.
L’estimation moyenne pour 2013-2014 comprend 40.7 milliards USD de financement public (71 % du total), 1.6 milliard USD de financement associé à des crédits à l’exportation (3 %) et une estimation annuelle de 14.7 milliards USD pour le financement privé mobilisé (26 %).
Si les représentants des pays développés se sont félicités du travail réalisé par l’OCDE pour accroître la transparence de la finance climat, des critiques ont néanmoins été adressées au rapport, particulièrement de la part des pays en développement, pour lesquels non seulement le compte des 100 milliards n’y était pas, mais les chiffres avancés par le rapport surestimaient largement les contributions financières réelles.
Le ministre de l’économie indien Shaktikanta Das a ainsi publié avant la COP 21 un document contestant la méthodologie employée par le rapport et les résultats présentés. Il reproche à l’OCDE de ne fournir que les chiffres agrégés, rendant impossibles les vérifications indépendantes par d’autres organes que l’OCDE, preuve d’une absence de transparence. En outre, il accuse l’organisation, souvent présentée comme un « club de riches » par les pays émergents, de ne pas avoir suffisamment consulté les pays en développement pour la réalisation du rapport.
Certaines organisations, comme le South Centre, organisation intergouvernementale de pays en développement, ont relayé ces critiques et regretté que la finance climat ne fasse pas l’objet d’une définition à la fois consensuelle et rigoureuse. Les ONG ont également attiré l’attention des décideurs, notamment à la veille de la COP 21 dans le contexte de la nécessité de créer un climat propice à un accord le plus large possible, sur les risques d’un « greenwashing » de la finance climat et du réétiquetage de prêts en financements non concessionnels. Le directeur du Réseau Action Climat, Wendel Trio, avait ainsi prévenu que ce « réétiquetage » des aides existantes ne suffirait pas à convaincre les nations en voie de développement d’accepter les propositions de la COP 21.
Les actions d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas les seules réponses de la communauté internationale au réchauffement climatique. Des actions d’adaptation coexistent, qui cherchent à minimiser les effets du réchauffement climatique sur les conditions de vie des populations. Les deux versants de l’action climatique sont complémentaires, bien qu’ils aient longtemps été (et continuent parfois d’être) pensés comme concurrents. L’adaptation pourrait en effet être considérée comme un aveu d’échec des politiques d’atténuation : faute d’avoir pu réduire le niveau des émissions et d’avoir pu enrayer le changement climatique, il ne resterait plus qu’à s’adapter pour survivre dans des conditions différentes et moins favorables.
Mais certains effets du changement climatique sont déjà perceptibles, et les pays en développement, souvent les premiers à en faire l’amère expérience, ont longtemps plaidé pour l’inclusion de l’adaptation comme une dimension prioritaire du régime climatique. À plus forte raison quand les actions d’adaptation peuvent également servir les objectifs de réduction des émissions, en promouvant un développement écologiquement plus responsable.
Pour des coalitions comme l’AOSIS (Alliance des petits États insulaires), l’adaptation n’est rien moins qu’une question de survie, la montée des eaux menaçant directement leurs rivages.
Progressivement, l’adaptation a donc été matérialisée dans les textes comme un objectif au même titre que l’atténuation, alors même qu’elle reste une notion mal définie. Selon la définition officielle donnée par le GIEC en 2007, l’adaptation consiste en l’ajustement des systèmes humains ou naturels confrontés à un environnement nouveau ou changeant.
Lors de la COP 7 à Marrakech en 2001, les Accords du même nom envisagent le financement de l’adaptation et les transferts de technologie réclamés de longue date par les pays en développement. Trois fonds précédemment évoqués (le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA), le Fonds spécial pour les changements climatiques (FSCC) et le Fonds d’adaptation) y sont mis en place.
Le Fonds des Pays les moins avancés a pour mission de financer les Programmes nationaux sur l’adaptation, qui doivent identifier les fragilités des pays les moins avancés et proposer des actions pour pallier ces vulnérabilités.
La question de l’adaptation n’a cessé depuis de connaitre une meilleure prise en compte dans les négociations, à défaut de toujours trouver une concrétisation véritable sur le terrain. La Déclaration de Dehli sur le Changement climatique et le développement durable lie à nouveau atténuation et adaptation en 2002, le Programme de travail de Nairobi de 2005 et la Feuille de route de Bali de 2013 mettent à nouveau l’accent sur la prééminence de la question de l’adaptation, et de son indispensable prise en compte par les pays développés pour espérer parvenir à un accord climatique global.
L’adaptation est devenue l’un des pôles de la réflexion et de l’action climatique, et constitue l’un des prolongements du débat sur le partage des responsabilités entre pays développés, pays en développement et pays les moins avancés.
Illustration de ce débat, la question de la gestion des fonds constitués pour soutenir les actions d’adaptations reste problématique. Comme le relève François Gemenne (13), l’accès au Fonds d’adaptation était considéré par les pays en développement comme de droit et direct, cette aide financière leur étant en quelque sorte due par les pays industrialisés.
Ceux-ci, en revanche, estimaient devoir conserver le contrôle sur la destination et l’utilisation de ce qu’ils considéraient comme des contributions volontaires. En dotant le conseil d’administration du Fonds (dans lequel ils étaient majoritaires) d’une personnalité juridique, les pays en développement ont pu s’assurer de son contrôle. L’approvisionnement décevant du Fonds par les pays industrialisés a toutefois rendu peu opérationnelle cette prise de contrôle plus ou moins forcée par les pays en développement.
L’une des avancées de l’accord a minima conclu à Copenhague était la décision de créer un Fonds vert pour le climat dont l’objectif serait de fournir chaque année 100 milliards de dollars aux pays en développement après 2020. L’origine privée ou publique de ces Fonds, et l’incapacité actuelle des pays développés à atteindre ce montant font toutefois peser sur cette initiative des doutes que la COP 22 aura pour tâche de dissiper, si toutefois les pays développés veulent pouvoir conserver une certaine crédibilité à leurs engagements.
Les mesures d'atténuation ne consistent pas seulement en la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il existe en effet des mécanismes naturels capables d'absorber une partie du carbone présent dans l'atmosphère afin d'assurer la régulation du climat. Sans l'activité humaine productrice de carbone supplémentaire, ces mécanismes suffisent à maintenir l'équilibre du système climatique. Au-delà de la réduction des émissions, favoriser, ou, à tout le moins, préserver cette régulation naturelle, représente donc l'un des enjeux du régime politique climatique actuel. Ces « puits de carbone » sont de plus en plus conçus comme des outils à part entière, d'autant plus qu'ils existent souvent dans des pays en développement, qui aimeraient être aidés dans cette mission de préservation. Parmi ces puits de carbone, les forêts jouent un rôle essentiel en captant le dioxyde de carbone lors du processus de photosynthèse. Les forêts couvrent 31% de la surface terrestre non occupée par les océans, mais sont constamment menacées par les besoins en terres agricoles des populations et par l'avancée de la déforestation.
Il est progressivement apparu dans le cadre des négociations climatiques que lutter contre la déforestation était un moyen relativement peu coûteux de conserver ces « puits de carbone », et plusieurs pays industrialisés ont beaucoup poussé pour que cette problématique soit mise sur l'agenda et dotée de moyens financiers afin d'aider les pays en développement à maintenir les espaces boisés, et particulièrement les forêts primaires. De plus, l'enjeu de l'atténuation des émissions (ou plutôt ici de leur captation) croisait alors celui de la préservation de la biodiversité, ce qui favorisait la prise en compte de la lutte contre la déforestation.
Dès le début des négociations climatiques, pour la CCNUCC puis le Protocole de Kyoto, cette question de la déforestation avait fait l'objet de réflexions, qui n'avaient pourtant pas abouti. Mais en 2005, un groupe de pays, la Coalition des Nations à forêts tropicales, mené par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Costa Rica, ont relancé les discussions en présentant un document, (« Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries: Approaches to Stimulate Action », abrégé en REDD) et en demandant à ce que la question soit inscrite au programme des discussions de la onzième COP.
Lors de la COP 13, le plan d'action de Bali a intégré le programme REDD après deux ans de négociations techniques et politiques, et appelé à « des approches de politique et des incitations positives sur les questions liées à la réduction des émissions de la déforestation et de la dégradation de la forêt dans les pays en voie de développement, et le rôle de la conservation, la gestion durable des forêts et l’amélioration du stock de carbone forêt dans les pays en voie de développement. »
Le support pour REDD s’est approfondi et élargi depuis Bali : le progrès réalisé quant au programme REDD était l’une des seules avancées au cours des discussions sur le climat à Copenhague en décembre 2009.
REDD ne consiste plus seulement depuis lors en un programme d'évitement de la déforestation, mais englobe également l'évitement de sa dégradation et l'objectif de sa gestion durable et de la reforestation : le programme a évolué vers ce qu'on appelle maintenant REDD-plus (« REDD+ »).
La conférence de Varsovie a donné lieu à six décisions qui organisent la façon dont la CCNUCC pourrait encadrer les actions REDD+.
Ces décisions définissent :
- les procédures à respecter pour obtenir des financements :
Pour obtenir des financements, les actions REDD+ devront être strictement mesurées, notifiées et vérifiées (Measured, Reported and Verified - MRV). Des informations précises sur les résultats annuels, les actions, les financements reçus et le rapport sur le respect des clauses de sauvegarde seront soumis tous les deux ans par les pays rejoignant le mécanisme et seront mis en ligne sur la plateforme REDD+ incluse dans le site internet de la CCNUCC.
- la coordination du financement :
La décision sur la coordination du support financier aux actions REDD+ invite les pays en développement à designer une entité nationale ou point focal de coordination. Ces derniers pourraient, de leur côté, désigner les entités qui recevront les paiements basés sur les résultats et veilleraient au partage des informations et des bonnes pratiques.
- les niveaux de référence soumis à une évaluation technique :
Les niveaux de référence soumis par les pays en développement seront soumis à une évaluation technique. Cette évaluation concernera les données, les procédures et les méthodologies appliquées par les pays dans la construction de leurs scénarios de référence et suivra des critères décrits dans les décisions de Varsovie. Elle sera conduite par des équipes de revues constituées par deux experts accrédités par la CCNUCC. Au-delà de l’évaluation, les équipes de revue devront suggérer des voies d’amélioration techniques et les besoins de renforcement de capacités.
- les règles de MRV des actions REDD+ :
Concernant le MRV des actions REDD+, les données utilisées, présentées tous les deux ans, devront être cohérentes avec celles qui ont été utilisées dans la construction des scénarios de référence. Elles seront vérifiées par une équipe de revue dans le cas où le pays-hôte souhaite être rémunéré pour ses actions REDD+. Ces exigences sont proches de celles existant pour les inventaires des émissions de gaz à effet de serre des pays développés.
- un système national de suivi des forêts mieux encadré :
Le MRV devra reposer sur un système national de suivi de forêts, encadré par une des décisions adoptées à Varsovie et conformément aux lignes directrices du GIEC.
Toutes ces décisions représentent une avancée importante dans la mise en oeuvre d’un mécanisme REDD+ à l’échelle mondiale : elles pourraient donner les moyens à la CCNUCC de devenir la référence mondiale en matière de MRV des actions REDD+.
Depuis les débuts de la négociation autour de l’initiative REDD, puis REDD+, des voix se sont élevées qui pointent des failles inhérentes au programme, et vont jusqu’à contester la logique sur laquelle il se base.
En effet, selon ses détracteurs, REDD+ entrainerait une marchandisation du rapport à la forêt et introduirait un glissement regrettable du pouvoir des populations locales vers des porteurs de projets qui leur sont étrangers. La question de la propriété et de la gouvernance des forêts se pose dès lors que celles-ci deviennent un bien public mondial en tant que puits de carbone. Les États sont partagés entre une certaine méfiance à l’égard de ce qui pourrait apparaître comme une remise en cause de leur souveraineté nationale, et la perspective de retirer des gains significatifs qui financeraient la prévention de la déforestation.
Certains États affichent des positions très défensives, comme la Bolivie, qui voit en ce programme une nouvelle forme de colonisation et d’appropriation des terres des pays en développement par les grandes puissances industrialisées par des chemins détournés. Les critiques ont été particulièrement virulentes en Amérique latine, où les populations indigènes ont conquis des droits spécifiques sur l’usage des forêts dont les mécanismes très techniques de REDD+ risqueraient de les déposséder.
Enfin, le problème dans un système rémunérant le risque évité (ici, des crédits sont alloués à la déforestation empêchée) est de voir les scenarii sur lesquels s’appuient les programmes gonfler la trajectoire prévue de déforestation. Comme l’explique le chercheur Alan Karsenty à Novethic (14) : « S'il existe de bons projets de conservation sur le terrain, le système génère une incitation perverse. En effet, un projet émet des crédits sur la base de sa contribution à la réduction des émissions de CO2 liées à la déforestation. Pour cela, des études préalables anticipent un niveau de déforestation future « business-as-usual », pour quantifier la baisse de la déforestation imputable au projet. Or, cette prévision est forcément arbitraire, tant les causes de la déforestation sont complexes et aléatoires. On voit ainsi des projets, pourtant certifiés par des vérificateurs indépendants, qui anticipent des niveaux de déforestation très élevés pour garantir leur réussite virtuelle. C'est le problème fondamental de ce mécanisme : il incite à prévoir le pire pour pouvoir ensuite prétendre l'avoir évité... ».
L’initiative REDD+ est soutenue par plusieurs programmes multilatéraux, ce qui ne simplifie ni la compréhension d’ensemble de l’action pour prévenir la déforestation, ni l’accès aux différentes aides et financements.
On compte ainsi :
- le programme UN – REDD composé du FAO (Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture), du PNUD (Programme des Nations-Unies pour le développement) et du PNUE (Programme des Nations-Unies pour l’environnement), qui fournit une assistance technique pour la conception et la mise en œuvre de programmes nationaux REDD+ ;
- le Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) de la Banque mondiale, doté de deux fonds abondés par des États ou des organismes non gouvernementaux, et qui fournit là aussi une assistance technique, mais aussi financière, aux pays désirant s’inscrire dans REDD+ ;
- le Programme pour l’investissement dans la forêt de la Banque mondiale, sous-division du Climate Investment Fund.
Mais les acteurs peuvent également être des ONG, des États, des organismes privés tels que des lobbys. L’éclatement de ces dispositifs, qui souvent disposent de schémas de gouvernance propres (collèges d’experts, assemblées générales, secrétariats) pose évidemment la question des pertes en ligne pour les financements pourvus, ainsi que celle d’une complexité qui, si elle peut être gage d’une certaine souplesse, ne peut qu’empêcher la plus grande transparence et la compréhension globale de REDD+.
I. L’ACCORD DE PARIS : LA RECHERCHE D’UN CADRE UNIVERSEL POUR UN RÉGIME CLIMATIQUE MONDIAL PLUS INCLUSIF
À Copenhague, les pays ont échoué à trouver un accord inclusif et contraignant pour succéder à la première période d'engagement du Protocole de Kyoto à partir de 2012, s'élargir aux pays restés en dehors du Protocole ou créer de nouvelles obligations pour les pays en développement.
En 2011, il était trop tard pour parvenir à un accord de cette nature susceptible d'être appliqué à la suite du Protocole de Kyoto. Les États ont donc décidé de poser de nouvelles fondations afin de parvenir à un accord à conclure au plus tard en 2015 et applicable à partir de 2020. Parallèlement le Protocole de Kyoto a été prolongé pour une seconde période d'engagement de 2013 à 2020.
La plateforme de Durban est le document adopté lors de la COP 17 fixant les grandes lignes de la négociation à venir et de l'Accord auquel parvenir : déclaration d'intention plutôt que texte programmatique, la plateforme restait assez vague quant à la forme du futur Accord, de façon à emmener un maximum de pays sur le chemin des discussions. La Conférence de Durban a dans son document final permis des progrès sur trois sujets : la poursuite du Protocole de Kyoto (concrétisé par l’Amendement de Doha adopté lors de la COP suivante), la mise en œuvre progressive du Fonds Vert dont la création avait été décidée à Copenhague et l'élaboration d'une procédure de négociation afin de parvenir à l'Accord universel espéré pour 2015.
Un groupe de travail spécifique, le groupe de travail ad hoc sur la Plateforme de Durban (Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action) l'ADP, s’est vu confier la mission de développer l'instrument juridique futur et s'est ensuite régulièrement réuni hors du cadre des COP entre la Conférence de Durban et la Conférence de Paris.
Le compromis de Durban a été critiqué pour son manque de clarté sur la nature juridiquement contraignante d’un accord futur. De plus, bien que la plateforme de Durban ne fasse pas référence au principe de la Convention des « responsabilités communes mais différenciées », sur lequel s’appuient depuis longtemps les pays en développement pour s’opposer à l’imposition d’engagements d’atténuation plus stricts les concernant, rien ne garantissait que ne revienne une différenciation dans la forme, le contenu et même la nature juridique des engagements s’appliquant aux deux groupes de pays.
Une dernière étape majeure a été franchie en 2014 à l’occasion de la conférence de Lima. Il été décidé que les parties communiqueraient une feuille de route présentant leur contribution nationale avant le début de la COP 21. Ces engagements, imaginés dès la COP de Varsovie en 2013 (dont les conclusions spécifiaient que ces contributions devaient être présentées « bien en amont » du futur accord), ont pris la forme des « INDC » (« Intended Nationally Determined Contribution »). Ils pouvaient inclure à la fois des objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, et les engagements volontaires des pays seraient définis par ceux-ci dans la logique bottom-up censée guider le nouvel accord.
L’un des grands enjeux en amont de la Conférence de Paris était la remise par les États de leurs INDC dans les temps, afin que la communauté internationale puisse disposer au moment des négociations d’une base reflétant les efforts que les différents pays seraient prêts à consentir. Au-delà de l’évaluation du caractère suffisant ou non de ces efforts, la question pouvait être de façon plus immédiate de permettre à certains pays disposant de moyens techniques et scientifiques moins développés de fournir cet effort d’analyse et de formalisation, ce qui n’allait pas nécessairement de soi. C’est pourquoi certains systèmes d’aide ont été mis en œuvre en amont, tels qu’un programme d’assistance technique doté d’un budget de 3.5 millions d’euros, mis en place par la France.
Les contributions ainsi proposées sont ensuite publiées sur le site de la CCNUCC afin de garantir la transparence des engagements. Le site de la diplomatie française présente également une carte interactive utile et intéressante, permettant pour chaque pays de consulter l’année de référence, les objectifs fixés ainsi que le texte de l’INDC et d’autres informations sur le pays. (15)
Bien que la propension des pays à présenter leur contribution nationale en amont de la Conférence des Paris a pu démontrer leur volonté de participation à l’effort collectif, et leur adhésion à un système élaboré sur la base de contributions émanant des États et non plus d’objectifs imposés, la synthèse des contributions réalisée par les nations-Unies avant la COP21 a illustré le caractère encore insuffisant des engagements.
Henri Waisman et Céline Ramstein, membres de l’IDDRI, (l’Institut du développement durable et des relations internationales), proposaient dès mars 2015 quatre critères pour juger de la valeur et de la pertinence des INDC :
- le renforcement ou non de l’ambition qu’elle présentait par rapport aux objectifs ex ante du pays ;
- la transparence dans la présentation des moyens envisagés pour atteindre les objectifs, permettant de juger de la crédibilité des engagements ;
- le lien avec les autres priorités politiques nationales et le souci de cohérence démontré par l’INDC ;
- la marge de progrès restant : les freins et leviers pour un accroissement futur de l’effort, dans une perspective dynamique pour les réévaluations (16).
Au vu de la disparité des INDC remises, et de la latitude laissée aux PMA et pays en développement, l’élaboration d’une telle grille de lecture pourrait être un outil utile dans la perspective de révisions régulières.
Les dimensions de la Conférence de Paris sont le reflet des attentes qui avaient été placées en elle. Avec plus de 25 000 personnes accréditées et présentes sur le site, les chiffres font de cette COP celle des records. Plus de 150 chefs d’État et de gouvernement du monde entier ont été accueillis par le Président de la République, le Secrétaire général des Nations unies et le Président de la COP 21 sur le site du Bourget le 30 novembre 2015. 117 ministres en charge des négociations internationales sur le climat ont fait le déplacement pour le segment ministériel en début de seconde semaine. Si la présence des chefs d’État et des ministres n’était pas nécessairement la promesse d’une réussite in fine, comme en avait témoigné la conférence de Copenhague, cette affluence témoignait néanmoins de l’implication et de la volonté de parvenir à l’Accord espéré.
2. Un accord attendu de longue date et qui marque une avancée incontestable dans les négociations climatiques
Les attentes à l’égard de l’Accord de Paris applicable à l’horizon 2030 étaient le produit du travail du groupe constitué à Durban : elles allaient aussi constituer l’étalon à l’aune duquel le succès de la COP 21 serait évalué.
Préambule |
Principes |
Art. 15 |
Mécanisme de facilitation de la mise en œuvre |
Art. 1 |
Définitions |
Art. 16 |
Gouvernance |
Art. 2 |
Objectifs |
Art. 17 |
Mandat du Secrétariat |
Art. 3 |
Engagements – CDN |
Art. 18 |
Organes subsidiaires |
Art. 4 |
Renforcement de l’ambition |
Art. 19 |
Directives aux organes subsidiaires |
Art. 5 |
Forêts |
Art. 20 |
Signature et ratification |
Art. 6 |
Nouveaux mécanismes pour le développement durable |
Art. 21 |
Entrée en vigueur |
Art. 7 |
Adaptation |
Art. 22 |
Amendements de l’Accord |
Art. 8 |
Pertes et préjudices |
Art. 23 |
Amendements des annexes |
Art. 9 |
Finance |
Art. 24 |
Règlement des différends |
Art. 10 |
Transferts de technologies |
Art. 25 |
Droit de vote |
Art. 11 |
Renforcement des capacités |
Art. 26 |
Dépositaire de l’Accord |
Art. 12 |
Éducation et sensibilisation |
Art. 27 |
Réserve à l'Accord |
Art. 13 |
Cadre de transparence |
Art. 28 |
Expiration |
Art. 14 |
Bilan mondial quinquennal |
Art. 29 |
Traduction |
Une dynamique très positive avait été amorcée en amont de la Conférence de Paris, et le rôle de la présidence péruvienne est à saluer dans cet élan. Lors de la COP 20 a en effet été adopté « L’Appel de Lima pour l’action climatique » – Lima Call for climate action – qui incluait, dans une annexe de 34 pages, les « éléments pour un texte de négociation », soit la base formelle de négociation pour l’accord de Paris 2015.
En effet, 188 pays avaient remis avant la fin de la Conférence de Paris leur contribution nationale (sur les 195 pays Parties à la CCNUCC), couvrant 98 % des émissions mondiales de GES, avec seulement six pays n’ayant pas remis leur INDC. Il faut également souligner que l’Accord de Paris a été adopté par consensus par 195 pays sans difficultés de procédure, reflétant le niveau d’acceptation mondiale très élevé des termes de l’accord.
Le caractère plus ou moins contraignant de l’Accord de Paris était l’un des grands enjeux des négociations. Le mandat de 2011 prévoyait en effet un accord juridiquement contraignant sur le changement climatique, mais l’expérience passée avait montré la réticence des États, notamment les plus grands émetteurs de GES comme la Chine ou les États-Unis, à engager de cette façon leur souveraineté. Les procédures de ratification internes pouvaient en outre à terme bloquer le processus de ratification, et empêcher en amont toute velléité d’engagement.
La conclusion d’un accord entre les deux pays mentionnés à l’automne 2014 avait déjà constitué un signe favorable de la disposition de la Chine et des États-Unis à progresser sur le chemin des négociations climatiques, même si les termes de cet accord demeuraient largement insuffisants au vu des latitudes d’émission qu’ils conservaient aux deux nations.
L’IDDRI distinguait avant la Conférence de Paris trois domaines dans lesquels des obligations contraignantes pourraient trouver à s’appliquer :
- la soumission des contributions nationales et la poursuite de mesures nationales visant à atteindre ces objectifs ;
- la révision régulière de ces objectifs ;
- la transparence sur la mise en œuvre des actions pour les atteindre.
Le texte de l’Accord remplit ces conditions. Il exige que chaque pays « [établisse], communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives […] et prenne des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions ». Comme le relèvent l’IDDRI et l’Institute for Climate Economics (I4CE), le texte contient donc une obligation de « moyens » plutôt que de résultat concernant les contributions nationales : les pays sont obligés de mettre en œuvre leurs contributions nationales, la NDC, plutôt que de réaliser ses objectifs finaux à la lettre. Grâce à deux instruments, les INDC (Intended Nationally Declined Contributions) et les NDC (Nationally Declined Contributions), le système créé par l’Accord de Paris instaure donc une chaine de suivi des objectifs annoncés par les États à la réalisation plus ou moins effective de ces objectifs.
On distingue, parmi les obligations que renferme l’Accord de Paris, des éléments à caractère contraignant et d’autres à caractère non contraignant.
Au nombre des éléments non contraignants, il y a principalement :
- le financement,
- la réduction des émissions.
Les aspects contraignants de l’Accord sont, entre autres :
- la communication périodique des contributions déterminées au niveau national (CDN) à intervalles de cinq ans,
- la transparence de l’action et du soutien.
Pour la révision régulière, l’Accord dispose dans son article 4.9 que les pays devront communiquer une NDC tous les cinq ans, en tenant compte d’un bilan mondial régulier. Les pays ont également l’obligation de rendre compte régulièrement des progrès réalisés en matière de mise en œuvre et de réalisation des NDC, et de se soumettre à un examen technique réalisé par des experts. Il est également important de noter que l’article 4.3 établit que les INDC suivantes représenteront une progression dans l’ambition et correspondront au niveau d’ambition du pays le plus élevé possible.
L’Accord de Paris est bien un traité au sens du droit international, selon la Convention de Vienne, dès lors qu’il fait l’objet d’une procédure de ratification interne engageant les pays signataires.
L’Accord de Paris avait pour ambition de revenir sur la différenciation opérée depuis la Convention cadre des Nations-Unies et le Protocole de Kyoto entre pays développés, pays en développement et pays les moins avancés, sans toutefois complètement l’abandonner.
Le principe de différenciation reposait sur l’idée d’une « responsabilité commune mais différenciée » eu égard à l’héritage légué par les pays développés en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit donc d’une prise en compte des conséquences historique du développement industriel des pays désormais les plus riches dans les phénomènes de réchauffement climatique. A ce principe, les pays en développement demeurent très attachés, car il justifie l’aide qu’ils sont susceptibles de recevoir dans leurs efforts d’adaptation et d’atténuation, notamment par le biais de subsides financiers ou de transferts de technologie.
Le principe de responsabilité commune mais différenciée a longtemps été l’un des piliers des négociations climatiques internationales, garant de leur équité. L’inconvénient majeur que présentait toutefois ce principe apparaissait dans l’établissement de listes de pays qui avaient le tort de fixer des situations nationales là où celles-ci étaient inévitablement appelées à évoluer à mesure que les pays se développaient.
Ainsi, seuls les pays dits de l’Annexe I étaient soumis à de véritables obligations de réduction des émissions (si tant est qu’ils avaient ratifié le Protocole de Kyoto), mais cette liste avait été fixée en 1992. Depuis, des acteurs comme la Chine, le Brésil ou l’Inde connaissaient un développement économique qui les conduisait (surtout la Chine) à émettre à leur tour des quantités de gaz à effet de serre qui posaient un véritable défi environnemental.
La question de la responsabilité commune mais différenciée revêtait donc un caractère très politique, certains pays en développement refusant d’être soumis à des plafonds démissions et accusant les pays développés de vouloir brider leur développement au risque de maintenir leur population dans la pauvreté. Cette position permettait à ces pays d’insister lors des négociations sur les responsabilités des pays développés en matière de financement du changement climatique.
ii. Pour parvenir à un accord universel, l’Accord de Paris a aménagé le principe de différenciation :
Sur la différenciation des engagements selon les situations des pays, l’Accord de Paris:
- réaffirme le principe des responsabilités communes mais différenciées à la lumière des circonstances nationales, conjugué à un principe de progression des efforts de tous ;
- fixe sur les financements une obligation aux pays industrialisés de financer l’aide aux pays pauvres sur le climat, tandis que les pays en développement sont invités à contribuer sur une base volontaire ;
- fixe des obligations pour les pays développés de prendre des engagements quantifiés et précis de réduction des émissions ;
- encourage toutes les autres parties à prendre des mesures, y compris en prenant des engagements quantifiés de limitation ou de réduction des émissions (convergence des obligations) ;
- crée, en matière de transparence, un système permettant le suivi des engagements, plus fort qu’auparavant, et avec des flexibilités pour les pays en développement.
Ainsi, on voit que la distinction de 1992 entre pays de l’Annexe I et pays dits « non-annexe I » a été balayée sans que toute distinction de disparaisse entre les parties. Comme le souligne l’I4CE (17), c’est une différenciation plus souple, organisée selon trois régimes, qui succède au régime climatique binaire tel qu’il existait depuis la CCNUUC.
Cette distinction binaire demeure pour l’atténuation, puisque les pays développés sont censés « montrer la voie », et sur les financements dont la direction Nord-Sud est toujours présente.
Des exceptions sont introduites pour certaines catégories de pays, qui conduisent à ramener les pays émergents au sein du régime « commun ». En effet, les obligations seront moins fortes pour les pays les moins avancés et les petits pays insulaires car ils contribuent peu aux émissions de gaz à effet de serre et sont dans une situation de plus forte vulnérabilité. Ces pays bénéficieront donc de contraintes moindres quant à la régularité de leurs communications nationales, et seront prioritaires pour l’accès à la finance concessionnelle.
Les conditions spécifiques à chaque pays (contexte national et capacités respectives) guideront la revue des communications nationales, dans un esprit de progressivité permettant à chaque pays, à la fois de formuler des objectifs adaptés et réalistes, mais également de s’inscrire dans une démarche positive d’amélioration.
En n’introduisant pas de nouveau système de différenciation de manière plus formelle, l’Accord de Paris tend donc vers un régime d’autodifférenciation, dans lequel les pays interprèteront eux-mêmes leurs obligations. Il reste à démontrer que la pression par les pairs sera insuffisante pour les entrainer à se fixer le plus haut niveau d’ambition de réduction des émissions.
Le financement de l’action climatique est depuis le début des négociations climatiques mondiales un point essentiel qui cristallise tensions et espoirs d’une action porteuse de réels changements. Depuis la Conférence de Cancún et la formalisation du projet de Fonds Vert imaginé à Copenhague, cette question avait pris un relief particulier, et la réussite de la mobilisation des 100 milliards par an à compter de 2020 a fait l’objet de nombreux débats.
Sur ce sujet également, des progrès très nets semblent avoir été accomplis par l’Accord de Paris. Les pays développés devront divulguer dans le cadre de leurs rapports bisannuels des informations qualitatives et quantitatives sur les financements fournis et établir des projets provisionnels de financement en direction des pays en développement. Cette augmentation de la transparence par le développement du MRV du soutien devrait, si elle est suivie d’effets en matière d’aide financière, être de nature à renforcer la confiance envers les pays développés et à encourager les pays récipiendaires de ces aides à s’engager sur des projets de long terme.
L’engagement des 100 milliards de dollars par an est envisagé dans l’Accord de Paris comme un seuil minimal devant être revu à la hausse d’ici à 2025.
La discussion sur le futur des financements devra s’achever lors de la COP24, avec plus de détails sur le périmètre et les règles de comptabilisation, notamment des flux privés.
Dans l’Accord de Paris, l’atténuation et l’adaptation sont reconnues comme complémentaires. L’adaptation pose des problèmes de définition opérationnelle et de mesure, il est donc difficile de lui fixer des objectifs à atteindre, mais l’Accord de Paris a le mérite d’en faire une question destinée à faire jeu égal avec l’atténuation. L’Accord prévoit également un Comité d’Adaptation mandaté pour étudier les méthodes d’évaluation des besoins. Un meilleur suivi des besoins et des actions semble la priorité à défaut de pouvoir fixer des objectifs mesurables.
En matière d’atténuation, l’Accord de Paris réaffirme l’objectif de Cancún de limiter le réchauffement de la température mondiale à moins de 2 °C et introduit celui de parvenir à une neutralité des émissions mondiales entre 2050 et 2100 (les émissions seraient à cet horizon totalement absorbées). L’objectif de maintenir l’augmentation de la température en-dessous de 1.5°C, depuis longtemps défendu par les pays insulaires et porté haut par la « coalition de l’ambition » menée par les Îles Marshall, est inclus dans l’Accord, ce qui là aussi constitue une avancée non négligeable.
L’Accord de Paris instaure un système de rendez-vous quinquennaux destiné à insuffler une dynamique ambitieuse aux contributions remises par les États à ces échéances. Pour 2015, les États ont donc remis leur INDC et fixé eux-mêmes les échéances des actions proposées. La clause de rendez-vous créée par l’Accord fixe à 2020 la remise des prochaines contributions pour l’échéance 2030, puis tous les cinq ans ensuite.
L’Accord oblige chaque pays à soumettre une NDC tous les cinq ans par la suite, et souligne que ces NDC ultérieures devront tenir compte du bilan mondial, réalisé tous les cinq ans, et des progrès collectifs. Il invite également les pays à « formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre ». Le seul élément qui aurait pu être renforcé est le lien entre les cycles et l’objectif de 2 °C. Il est seulement implicite : l’Accord souligne que les pays doivent parvenir au plafonnement puis réduire leurs émissions pour atteindre la neutralité des émissions après 2050, et établit que chaque NDC successive devra augmenter son ambition et correspondre au niveau d’ambition le plus élevé possible du pays, une ambition élevée étant évidemment nécessaire pour atteindre l’objectif de 2 °C.
La question des « pertes et préjudices » subis par les pays les plus vulnérables dès lors que les mesures d’atténuation adoptées n’auraient pas été suffisantes constitue un enjeu complexe et vecteur de friction dans les négociations, depuis plusieurs années. Lors de la COP 19 à Varsovie, un mécanisme dit de « pertes et préjudices » a été créé, afin de gérer les questions relatives aux pertes et dommages associés aux impacts des changements climatiques à long terme dans les pays en développement, qui sont particulièrement vulnérables à ce phénomène. La mise en œuvre provisoire du mécanisme a été confiée à un comité exécutif, qui rend compte à la COP. Le mécanisme a pour mission de faciliter l’échange d’information et de pratiques exemplaires relativement aux pertes et dommages causés par les changements climatiques, ainsi que de renforcer l’action et les activités d’appui, notamment en facilitant la mobilisation de fonds.
L’Accord de Paris reconnait non seulement la potentialité, mais aussi l’importance d’éviter et de réduire au minimum les pertes et préjudices ainsi que d’y remédier, en soulignant le rôle du développement durable dans la réduction des pertes et des préjudices. Il conserve également le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices et souligne qu’à l’avenir, il pourra être amélioré et renforcé.
Il exhorte les pays à la coopération et la facilitation sur la compréhension, l’action et l’appui en matière de pertes et de préjudices , et fait la liste de huit domaines potentiels, notamment les systèmes d’alerte précoce, la préparation aux situations d’urgence, la prise en compte des phénomènes qui se manifestent lentement, et la création d’un centre d’échange d’informations sur le transfert des risques.
L’Accord de Paris indique néanmoins clairement que l’article 8 qui décrit ce mécanisme de pertes et préjudices ne peut servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation.
L’Accord de Paris offre donc d’appréciables avancées, permises par la mobilisation de tous les acteurs présents. Lors de la Conférence de Paris, l’Union européenne a tenté de retrouver une place de premier choix dans les négociations climatiques. Sa position apparaît toutefois fragilisée par rapport aux débuts des négociations plus de vingt ans plus tôt : si l’Union a perdu depuis Copenhague son image de championne du climat, il faut pourtant reconnaître que ses efforts en matière de transition énergétique la placent encore à la tête du mouvement de lutte contre le réchauffement climatique.
Le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (le SEQE-UE) est le principal outil européen existant en vue d’atteindre l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne de 20% par rapport au niveau de 1990 d’ici 2020, tel qu’il avait été fixé à la suite de la ratification du Protocole de Kyoto.
Le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne fonctionne dans trente et un pays (les vingt-huit États membres de l'UE plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et concerne les émissions de plus de 11000 installations grandes consommatrices d'énergie (centrales électriques et industries) et des compagnies aériennes reliant les pays participants. Il couvre environ 45 % des émissions de gaz à effet de serre de l'UE.
Le SEQE-UE fonctionne selon le principe du plafonnement et des échanges : un plafond est fixé pour limiter le niveau total de certains gaz à effet de serre pouvant être émis par les installations couvertes par le système. Ce plafond va en diminuant dans le temps afin de faire baisser le niveau total des émissions.
Dans les limites de ce plafond, les entreprises reçoivent ou achètent des quotas d’émission qu’elles peuvent échanger sur le marché avec d'autres entreprises en fonction de leurs besoins. Elles peuvent également acheter un nombre limité de crédits internationaux dégagés par des projets de réduction des émissions dans le monde entier. C'est le plafonnement du nombre total de quotas disponibles qui garantit la valeur de ceux-ci.
À la fin de chaque année, chaque société doit restituer un nombre suffisant de quotas pour couvrir toutes ses émissions sous peine de lourdes amendes. Une entreprise qui a réduit ses émissions peut conserver l’excédent de quotas pour couvrir ses besoins futurs ou les vendre à une autre entreprise qui en aurait besoin. Le but est de favoriser la réduction des émissions là où cela est le plus intéressant économiquement. Le coût des émissions de carbone incite également à investir dans des technologies propres et sobres en carbone.
La première période du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre constituait une phase d’apprentissage, et a duré trois ans (2005-2007). Elle a été suivie par une seconde période de cinq ans (2008-2012). Pour la troisième période (2013-2020) un nouveau dispositif a été mis en place pour étendre le champ d’application du système et modifier les modalités d’allocation des quotas.
En octobre 2014, l’Union a adopté un nouveau cadre pour sa politique énergétique, avec pour ambition de disposer d’une véritable politique européenne de l’énergie capable d’engager les États membres sur la voie d’une véritable transition énergétique afin de respecter les engagements de l’Europe en termes de réduction des émissions. Le but était également, par la relance de la politique énergétique européenne, de parvenir à une union plus profonde sur ces sujets en dépit de la variété des mix énergétiques des États.
Les objectifs pour ce second paquet énergie-climat se déclinent en trois chiffres principaux :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990) ;
- porter la part des énergies renouvelables à au moins 27 % ;
- améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 %.
L'approche commune adoptée pour l’horizon 2030 contribue à apporter une sécurité juridique aux investisseurs et à coordonner les efforts consentis par les pays de l'Union européenne. Le cadre favorise les avancées vers la création d'une économie sobre en carbone et d'un système énergétique qui concilie quatre objectifs :
- garantir une énergie à un prix abordable à tous les consommateurs ;
- améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union ;
- réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie ;
- créer de nouvelles perspectives d'emplois et de croissance.
Après Kyoto, l’Europe était devenue une figure exemplaire d’union capable de souscrire à des engagements de lutte contre le réchauffement climatique et de les respecter. Comme le montrent Stefan C. Aykut et Amy Dahan (18), l’Union européenne a utilisé plusieurs leviers pour affirmer un rôle moteur lors des négociations climatiques. D’abord, elle a usé de son rôle d’hôte des Conférences climat, puisque 8 des 21 conférences tenues entre 1995 et 2015 l’ont été en Europe, parfois à des moments clé du processus de construction du régime climatique, ce qui lui a permis de peser sur l’orientation des discussions.
Les deux chercheurs évoquent également le « leadership » directionnel manifesté par l’Union, dès lors que pour promouvoir de nouveaux dispositifs techniques, politiques et/ou règlementaires, celle-ci se posait en exemple. Sa capacité à dépasser des positions nationales parfois fort divergentes (notamment du fait de la variété des stades de développement économique de ses membres ou de la diversité des bouquets énergétiques en présence) lui permettait de se poser en exemple à suivre pour une communauté internationale plus large.
Mais l’échec à Copenhague a contribué largement à ternir cette image de modèle. L’Union européenne n’est pas parvenue à défendre le Protocole de Kyoto et n’a pas pris la mesure de l’accroissement du rôle des grands émergents sur la scène internationale. En voulant à tout prix emmener le partenaire américain dans un accord pour succéder au Protocole de Kyoto, l’Europe a fini par se marginaliser et par assister à la conclusion d’un accord a minima, presque sans elle.
Aujourd’hui, si l’Europe semble avoir repris la main dans les négociations en parvenant à présenter son instrument de ratification dans les temps avant la COP 22, ce rôle reste fragile.
L’adoption du SEQE a pu être considérée comme un succès, dès lors que l’Union est parvenue à réduire ses émissions tout en faisant progresser son économie. Le PIB européen a ainsi augmenté de 48 % entre 1990 et 2014, alors que l'intensité de ses émissions (la quantité d'émissions nécessaire pour produire un euro de valeur économique) a diminué de près de moitié.
Toutefois, la Commission européenne reconnait que le SEQE a rencontré des difficultés liées à la surestimation du volume des émissions et à un nombre excessif de quotas offerts. Cette surabondance ajoutée à la baisse de la demande de quotas sous l’effet de la crise de 2008 a causé l’effondrement du prix du carbone sur les marchés d’échanges de quotas. Un gel des quotas (« backloading ») a été mis en place, visant à reporter la mise aux enchères de ces quotas, mais il ne s’agissait que d’une mesure de court terme.
La réforme nécessaire du marché européen du carbone a pris deux directions complémentaires. En 2015, un accord a débouché sur la prévision d’une « réserve de stabilité du marché » (MSR), qui sera créée en 2018 et effective à compter du 1er janvier 2019. En cas d’excédent de quotas sur le marché, des quotas seront ajoutés à la réserve et déduits des volumes à mettre aux enchères. Ils seront retirés de la réserve et mis aux enchères en cas de déficit des quotas en circulation. Les quotas gelés au titre du « backloading », et ceux non attribués entre 2013 et 2020 seront ajoutés à la réserve.
Une réforme plus profonde et structurelle est en cours et vise à faciliter l’objectif de diminution des émissions pour la période 2021/2030, en concordance avec les engagements souscrits pour l’Accord de Paris. Cette réforme dont le texte initial a été proposé par la Commission européenne le 15 juillet 2015, est, actuellement discutée au Conseil et dans la commission ENVI du Parlement européen. Elle devrait, si elle est mise en œuvre, accélérer la réduction du nombre de quotas (- 2.2 % par an à partir de 2021).
Diverses mesures visent à éviter la fuite de carbone :
- des quotas pour une cinquantaine de secteurs menacés de délocalisation ;
- un meilleur ciblage des installations bénéficiant d’allocations gratuites de quotas ;
- un assouplissement des règles permettant de mieux ajuster les allocations gratuites en fonction des données sur la production ;
- une actualisation des mesures de performance en matière d’émissions des installations industrielles.
Deux « mécanismes de soutien » sont à l’étude, afin de faciliter la transition de l’industrie et du secteur énergétique vers des technologies moins génératrices d’émissions :
- un « fonds pour l’innovation » visant à soutenir les investissements dans des technologies pionnières en matière d’énergie renouvelable, de stockage et de captage de carbone, et d’innovation faiblement émettrices de carbones dans les secteurs fortement demandeurs en énergie ;
- un « fonds pour la modernisation » visant à faciliter les initiatives conduites dans les moins riches des États membres visant à la modernisation du secteur de l'électricité et des systèmes d'énergie, et à de l'amélioration de l'efficacité énergétique.
La présidence slovaque de l’Union européenne espère parvenir à un accord au Conseil à la mi-décembre 2016, tandis que le Parlement européen pourrait adopter sa position en commission ENVI au début de ce même mois.
Les discussions au sein de l’Union européenne sur les priorités de chaque pays et leurs impacts sur les émissions de gaz à effet de serre ne se limitent pas aux divergences sur les choix de modèles énergétiques. Cette diversité des mix énergétiques peut évidemment poser problème dès lors que le choix du recours au charbon par exemple, a des conséquences non négligeables sur la performance environnementale de l’Union dans son ensemble.
Mais hors du secteur ETS (qui recouvre l’énergie et l’industrie), des divergences sont également apparues quant aux transports et à l’agriculture. Or, ce partage de l’effort est l’autre versant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’Union européenne, et conditionne donc également l’atteinte des objectifs que s’est fixé l’Union dans son INDC.
La Commission a déposé le 20 juillet 2016 une proposition de règlement visant à imposer des objectifs contraignants de réduction des émissions non couvertes par le SEQE (le système d’échange des quotas d’émissions).
Elle prévoit notamment une diminution de 30 % de ces émissions en 2030 par rapport aux niveaux de 2005, rendant obligatoires les objectifs du cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 décidés par le Conseil européen d’octobre 2014.
Ces objectifs sont modulés en fonction du PIB des États membres, et correspondent à une fourchette allant de zéro à 40 % de réduction des émissions.
Les mesures de flexibilités prévues par la décision de partage de l’effort de 2013 sont maintenues et complétées par deux autres mesures ayant un objectif similaire :
- les États pourront transférer des quotas du SEQE dans le système de partage de l’effort, à hauteur maximale de 100 millions de tonnes de CO2 ;
- Les États pourront (à hauteur maximale de 280 millions de tonnes de CO2) atteindre leurs objectifs de limitation des émissions en modifiant l’usage des terres. Ce point permet de reconnaître les moindres marges de manœuvre des États disposant d’un fort secteur agricole.
La proposition prévoit également qu’un suivi et une évaluation des progrès enregistrés soit réalisée par la Commission, et qu’en cas de non-respect des obligations, l’objectif de l’État pour l’année suivante soit augmenté de l’effort non réalisé, multiplié par 1.08.
Le texte a été soumis depuis quelques mois, mais les négociations promettent d’être longues, notamment car les pays ont peine à s’accorder sur des choix qui conditionnent leur modèle agricole. Certains pays moins favorisés réclament ainsi plus de souplesse dans l’application des mesures hors ETS, et le Conseil environnement d’octobre, durant lequel a pu pourtant être adoptée in extremis la décision de ratification, a mis en lumière ces divergences.
L’importance d’une rapide ratification se heurtait aux délais de certaines procédures nationales, et la ratification de l’Accord de Paris par l’Union européenne aura alimenté un suspens dont les différents acteurs ont longtemps craint qu’il ne débouche sur un échec, qui plus est dans une période déjà troublée par la mise à mal de la cohésion de l’Union avec l’annonce du futur départ du Royaume-Uni.
L’Accord de Paris étant un accord mixte, il aurait dû être d’abord ratifié par l’ensemble des États-membres selon leurs procédures nationales avant de pouvoir l’être par l’Union en son nom propre. Suite à la signature de l’Accord de Paris à New York par l’Union européenne et ses membres en avril 2016, le débat s’est concentré sur la possibilité d’une ratification anticipée par l’Union en dépit de l’inachèvement des processus internes des États de l’Union.
L’absence de ratification par l’Union aurait constitué un symbole très négatif, mais certains pays étaient réticents à autoriser une ratification anticipée, dont ils redoutaient qu’elle ne crée un précédent pour d’autres types de traités internationaux (notamment les traites commerciaux).
Chronologie de la participation de l’Union européenne à l’adoption de l’Accord de Paris 6 MARS 2015 L’Union transmet au secrétariat de la CCNUCC sa contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN/INDC). 18 SEPTEMBRE 2015 – CONSEIL ENVIRONNEMENT Le Conseil "Environnement" adopte des conclusions établissant la position de l'Union en vue de la conférence de Paris. Pour atteindre l’objectif d’un point culminant des émissions au plus tard en 2020, il faut selon ces conclusions qu'elles soient réduites, d'ici 2050, d'au moins 50 % par rapport aux niveaux de 1990 et qu'elles soient ramenées à un niveau proche de zéro ou inférieur au plus tard en 2100. 10 NOVEMBRE 2015 – CONSEIL AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES Dans ses conclusions, le Conseil "Affaires économiques et financières" souligne le rôle joué par le financement de la lutte contre le changement climatique en vue d'atteindre une trajectoire compatible avec l'objectif d'une limitation du réchauffement de la planète à moins de 2°C et de réaliser la transition vers des économies résilientes face au changement climatique, à faibles émissions de gaz à effet de serre et durables. Les ministres conviennent que des ressources importantes sont nécessaires pour aider les pays en développement à faire face comme il convient au changement climatique. 16 FEVRIER 2016 – CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES Le Conseil des affaires étrangères adopte des conclusions comprenant un plan d'action pour une diplomatie climatique en 2016, qui s'articule autour des trois grands axes suivants: faire de la lutte contre le changement climatique une priorité stratégique dans le cadre des dialogues diplomatiques, de la diplomatie publique et des instruments de politique extérieure; mettre en œuvre l'accord de Paris et les contributions prévues déterminées au niveau national, dans le contexte d'un développement à faibles émissions de carbone et résilient face au changement climatique; prendre en compte la relation entre le changement climatique, les ressources naturelles, la prospérité, la stabilité et les migrations. 17 ET 18 MARS 2016 – CONSEIL EUROPEEN Le Conseil européen souligne que l'Union européenne et ses États membres devaient être en mesure de ratifier l'Accord de Paris dans les meilleurs délais et à temps pour y être parties dès son entrée en vigueur. L'adaptation de la législation aux fins de la mise en œuvre du second paquet énergie climat doit constituer une priorité. 22 AVRIL 2016 – SIGNATURE DE L’ACCORD PAR L’UNION L'Union signe l'accord de Paris. Mme Sharon Dijksma, ministre de l'environnement des Pays-Bas et présidente du Conseil et M. Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne signent l'accord au nom de l'UE dans le cadre d'une cérémonie à haut niveau organisée à New York (États-Unis). 20 JUIN 2016 – CONSEIL ENVIRONNEMENT Le Conseil "Environnement" adopte une déclaration sur la ratification de l'Accord de Paris afin de donner un signal politique fort et clair quant à la volonté de l'Union de maintenir l'élan de Paris et d'œuvrer en faveur de l’entrée en vigueur rapide et de la mise en œuvre effective de l'Accord de Paris. 30 SEPTEMBRE 2016 – LE CONSEIL ENVIRONNEMENT AUTORISE LA RATIFICATION Le Conseil "Environnement" décide d'autoriser la ratification de l'accord au niveau de l'Union. Les États membres ratifieront l'accord soit conjointement avec l'UE s'ils ont achevé leurs procédures nationales, soit dès que possible lorsque cela sera le cas. Après l’autorisation du Parlement européen, la décision relative à la conclusion de l'accord sera formellement adoptée par le Conseil. L'Union pourra alors ratifier l'accord. 4 OCTOBRE 2016 – VOTE FAVORABLE DU PARLEMENT EUROPEEN ET ADOPTION DE LA DECISION DE RATIFICATION AU CONSEIL Les eurodéputés approuvent la ratification du texte à une très large majorité : 610 voix pour, 38 contre. Par conséquent, le Conseil peut adopter la décision de ratification. 5 OCTOBRE 2016 – RATIFICATION DE L’ACCORD Des représentants de la présidence du Conseil et de la Commission européenne déposent les instruments officiels de ratification auprès du secrétaire général des Nations unies, qui est le dépositaire de l’accord. L’Union ratifie officiellement l’Accord, avant que tous les membres l’aient ratifié. |
Le Protocole de Montréal est un outil majeur dans les dispositifs de lutte contre les pollutions atmosphériques, et joue un rôle essentiel dans la protection de la couche d’ozone.
Signé le 16 septembre 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1989, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone vise à imposer aux 197 parties (196 États signataires et l’Union européenne) l’arrêt de la production et de l’importation d’une centaine de substances chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone.
Le Protocole de Montréal prend la suite de la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d’ozone. Instance de dialogue, la Convention de Vienne a favorisé la coopération entre les parties en facilitant l’observation, la recherche et l’échange d’information sur les effets des activités humaines sur la couche d’ozone. Elle a notamment permis diverses rencontres ayant abouti à la signature du Protocole de Montréal, qui portait initialement sur certains CFC et halons.
On distingue six groupes principaux de substances visées par le Protocole, par ordre décroissant d’utilisation à la date de la conclusion de l’accord :
- les chlorofluorocarbones (CFC) ;
- les halons ;
- le tétrachlorure de carbone, mais cette substance ne produit que des émissions très faibles et n’est pas réglementée par le Protocole ;
- les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), dont l’utilisation comme produit de remplacement aux CFC (du fait de leur moindre effet destructif sur la couche d’ozone) est responsable de leur usage croissant ;
- le méthyle chloroforme ;
- le bromure de méthyle.
Le Protocole de Montréal repose sur un cadre institutionnel et des obligations imposées aux parties, dont la principale est de se réunir afin de passer en revue l’application du Protocole, de décider des ajustements ou réductions de la production ou de la consommation des substances réglementées et de dessiner des lignes directrices concernant la communication des informations par les parties.
Les parties doivent produire un rapport annuel concernant la production, l’importation et l’exportation des substances qu’elles se sont engagées à éliminer. Un Comité d’application est en charge de l’examen de ces rapports ainsi que de la procédure en cas de non-respect du Protocole par une partie. Il s’efforce de régler à l’amiable les questions de non-respect et peut librement décider des mesures à suivre. Ces mesures prennent la forme de plans d’actions comportant des objectifs et des délais précis.
Trois groupes d’évaluation produisent un rapport tous les quatre ans : le Groupe de l’évaluation scientifique, le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement et le Groupe de l’évaluation technique et économique.
La « situation particulière » des Parties, fondée sur leur niveau de développement est prise en compte, notamment par le biais d’une période de grâce (de 10 à 15 ans) différant le moment d’application des mesures de réglementation.
En outre, a été créé un Fonds multilatéral utilisant des contributions versées par les pays développés pour aider les pays en développement à remplir leurs objectifs dans les délais imposés.
Des ajustements des volumes de production et de consommation des substances réglementées ont été décidés par les Parties depuis la signature du Protocole.
Cinq amendements, résultant des découvertes scientifiques et des travaux des groupes d’évaluation, ont également visé à réglementer de nouveaux produits chimiques :
- l’amendement de Londres (1990) a élargi le champ des substances réglementées (incluant les autres CFC, le tétrachlorure de carbone, le méthylchloroforme), accéléré les délais de réduction de la production et de la consommation desdites substances, et, afin d’aider les pays en développement à respecter leurs obligations, a imposé aux pays développés des engagements en matière de transfert de technologie, et mis en place le Fonds multilatéral ;
- l’amendement de Copenhague (1992) a suivi la voie tracée à Londres en accélérant les délais d’arrêt de la production et de la consommation de plusieurs substances, en réglementant d’autres substances (bromure de méthyle, HCFC, HBFC) et en prenant diverses mesures limitant l’importation et l’exportation des substances réglementées ;
- l’amendement de Montréal (1997) a approfondi les mesures de restrictions à l’importation et l’exportation des substances visées par le Protocole ;
- l’amendement de Pékin (1999) a étendu le champ du Protocole et durci les obligations des Parties concernant d’autres substances ;
- l’amendement de Kigali (2016) a ajouté aux substances réglementées les hydrofluorocarbures (HFC), substance dont la production et la consommation est en hausse.
Le 15 octobre 2016 a été adopté par la Réunion des parties « l’amendement de Kigali ». Celui-ci ajoute aux substances réglementées les hydrofluorocarbures (HFC), substance dont la production et la consommation croît de 10 à 15 % par an sous le double effet de la demande croissante, dans les pays en développement, d’appareils de climatisation et de réfrigération et du remplacement des CFC et HCFC par les HFC.
L’objectif est de réduire de 80 à 85 % les niveaux de HFC constatés dans l’atmosphère d’ici à 2047.
Les parties ont pris des engagements différenciés selon leur niveau de développement :
- les pays développés se sont engagés à stabiliser la production et la consommation d’HFC d’ici 2018, et à la réduire de 10 % en 2019 par rapport aux niveaux de 2011-2013, afin de réduire la production et la consommation d’HFC à 15 % des niveaux de 2012 d’ici à 2036 ;
- un certain nombre de pays en développement (dont la Chine, le Brésil, l’ensemble des pays d’Afrique et divers pays d’Amérique du Sud) se sont engagés à stabiliser la production et la consommation d’HFC en 2024, à la diminuer à partir de 2029 pour atteindre 20 % des niveaux de 2021 en 2045 ;
- enfin, un troisième groupe de pays en développement (dont l’Inde, le Pakistan, l’Iran, l’Iraq et les pays du Golfe) ont décidé de limiter la production et la consommation d’HFC en 2028 et à commencer à la diminuer à partir de 2032 pour atteindre 15 % des niveaux de 2025 en 2045.
L’amendement de Kigali représente donc une avancée non négligeable dans la protection de la couche d’ozone.
Le Protocole de Kyoto, signé en 1997, a entériné la distinction entre trafic aérien domestique, dont la performance environnementale reste de la compétence nationale, et trafic aérien international, dont l’amélioration de la performance environnementale a été confiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’agence des Nations-Unis spécialisée en matière d’aviation. Le transport aérien international est en effet par nature un marché mondial, dont les émissions de CO2 ne peuvent être affectées à un État.
L’aviation civile représente environ 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui n’empêche pas l’ensemble du secteur du transport aérien de se mobiliser et d’apporter sa contribution à la lutte contre le changement climatique. Les États membres de l’OACI se sont fixé en 2010 un objectif de croissance neutre en carbone à partir de 2020 (Carbon Neutral Growth 2020 ou CNG2020). Lors de la 38ème assemblée de l’OACI en 2013, la résolution A38-18 sur la lutte contre le changement climatique a confirmé l’objectif CNG2020 et a décidé de l'élaboration d'un mécanisme mondial basé sur le marché de compensation des émissions de CO2 de l'aviation internationale (Global Market-Based Measures ou GMBM).
Les discussions au sein de l'OACI ont mené en octobre 2016 à la mise en place d’un nouveau régime mondial de mesures basées sur le marché (MBM) pour limiter les émissions de CO2 de l'aviation internationale.
Ce pas historique a été franchi lorsque l'Assemblée de l'OACI (39e session), réunie en séance plénière, est convenue de recommander l'adoption du texte final d'une résolution sur le régime de MBM.
Le Programme de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) de l'OACI est destiné à servir de complément au panier de mesures d'atténuation que la communauté du transport aérien s'emploie déjà à mettre au point pour réduire les émissions de CO2 de l'aviation internationale. Ce panier comprend des améliorations techniques et opérationnelles et des progrès dans la production et l'utilisation de carburants alternatifs durables pour l'aviation.
La mise en œuvre du CORSIA commencera par une phase pilote, de 2021 à 2023, suivie d'une première phase, de 2024 à 2026. La participation à ces deux phases sera volontaire. Pour la phase suivante, qui s'échelonnera de 2027 à 2035, tous les États seront à bord. Certaines exemptions ont été prévues pour les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement, les pays en développement sans littoral et les États à très faible niveau d'activité aéronautique internationale.
IV. LA COP 22 DEVRA ENTÉRINER LES PROGRÈS DE L’ACCORD DE PARIS ET ALLER PLUS LOIN POUR ÊTRE LA CONFERENCE DE LA MISE EN ACTION
A. L’ACCORD DE PARIS A INCONTESTABLEMENT TÉMOIGNÉ D’UNE AVANCÉE DÉCISIVE DES NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES INTERNATIONALES
Il faut souligner d’emblée que l’Accord de Paris est bien un accord historique : c’est en effet la première fois que la communauté internationale parvient à adopter de façon quasi universelle un accord contraignant sur le climat, en s’engageant pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d’œuvrer contre le réchauffement climatique. Dans ce sens, la Conférence de Paris a réussi là où celle de Copenhague avait échoué : établir un cadre international contraignant basé sur la participation volontaire du plus grand nombre des États, lesquels présentent des contributions détaillées de leurs engagements et s’inscrivent désormais dans une démarche de vérification et de révision régulière pour une exigence croissante.
Après des années de négociations, de revirements et d’échecs, il faut donc saluer ce résultat, ainsi que la rapidité de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris. Adopté à la fin de la Conférence de Paris, le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris l’a été par consensus. Il a ensuite été ouvert à la signature des États le 22 avril 2016 lors d’une cérémonie au siège de l’ONU à New York, à laquelle ont participé plus de 150 chefs d’États et de gouvernements.
L’entrée en vigueur étant prévue le trentième jour après la date à laquelle au moins 55 Parties à la CCNUCC produisant au total au moins 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre auraient déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. L’espoir était donc grand d’atteindre ce seuil avant le 7 octobre, et il l’a été.
La rapidité d’entrée en vigueur de l’Accord, moins d’un an après son adoption, est donc exceptionnelle : rappelons que la ratification du Protocole de Kyoto avait pris des années. Il faut donc capitaliser ce momentum politique pour faire de la COP 22 la Conférence de la mise en application et de l’approfondissement des engagements encore insuffisants des pays.
Le désir de renouveler le principe de différenciation afin d’impliquer les pays en développement jusqu’ici peu concernés par des impératifs de réduction des émissions, et le caractère juridiquement contraignant du futur Accord laissaient craindre un échec.
En effet, les pays en développement sont traditionnellement très attachés au principe de responsabilité commune mais différenciée, lequel justifie leur demande de soutien financier de la part des pays développés et fait largement porter sur ceux-ci la responsabilité morale du changement climatique. L’Accord de Paris, en conciliant le maintien de ce principe (couplé à la prise en compte des « circonstances nationales ») et l’extension des obligations de réductions à tous les pays, est parvenu à dépasser cet écueil.
Par ailleurs, de grands émetteurs comme les États-Unis ou la Chine ont par le passé montré leur attachement sourcilleux au respect de leur souveraineté nationale, d’une part, et au droit à un développement économique non restreint par des considérations environnementales d’autre part. L’accord conclu entre ces deux pays en 2014, par lequel la Chine s’engageait à restreindre ses émissions après 2030, tandis que les États-Unis souscrivaient à une réduction de 26 à 28% entre 2005 et 2025 avait déjà semblé un préambule encourageant pour leur participation ultérieure à l’Accord de Paris.
b. Pour renforcer l’Accord de Paris, des initiatives intéressantes et l’inclusion de la société civile
Au-delà des éléments qui étaient attendus dans l’Accord depuis les travaux du groupe de travail ad hoc constitué à Durban, certains éléments innovants devront être développés dans les années qui viennent afin de déployer toutes leurs potentialités.
Parmi ces innovations, l’Agenda de l’action ou Plan d’Action Lima-Paris lancé au Pérou lors de la COP20 a pour objectif de développer les actions et les engagements des acteurs non étatiques – villes, régions, entreprises, investisseurs, organisations de la société civile – qui contribueront à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et à l’adaptation, avant 2020 et sur le long terme.
La séquence du LPAA organisée du 1er au 8 décembre 2015 au Bourget a rencontré un vif succès. Au total, le Plan d’Actions Lima-Paris représente aujourd’hui plus d’une soixantaine de coalitions, rassemblant près de 10 000 acteurs issus de 180 pays, ainsi que 11000 engagements individuels enregistrés sur la plateforme électronique NAZCA, par plus de 2000 collectivités et plus de 2000 entreprises. La France s’est particulièrement investie dans un certain nombre d’initiatives en raison de leur caractère stratégique, qui feront l’objet d’une attention prioritaire pour 2016. Parmi celles-ci, on peut citer l’Initiative 4 pour 1000 (séquestration du carbone à travers des pratiques agricoles adaptées), le Réseau d’alerte météorologique (CREWS) ou encore, pour le transport électrique, Mobilize your city, avec une déclaration sur la mobilité électrique.
Il faudra en 2016 mieux définir à la fois la gouvernance et l’association des acteurs non étatiques afin de créer une cohérence plus grande encore avec l’action des pays dans le cadre de l’Accord.
La reconnaissance de l’action de la société civile est un donc un élément important, qui sera particulièrement porté dans ses développements ultérieurs par une nouvelle institution, les « champions pour le climat », nommés par les présidences des deux pays se passant le relai lors de la Conférence.
Afin de pérenniser la dynamique de l’Agenda des solutions au sein du processus de la CCNUCC, des Sommets de haut-niveau se tiendront une fois par an, pour lesquels les champions seront à la fois porteurs et facilitateurs. Ces deux éléments permettront de centraliser les actions coopératives multilatérales dans le cadre de la CCNUCC
iii. Un exemple d’initiative dans le cadre de l’Agenda Global de l’Action : l’Initiative 4 pour 1000
La journée « focus agriculture » du Plan d'Actions Lima-Paris, co-organisée le 1er décembre 2015 par la France et la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) a réuni 300 invités. A cette occasion, l'initiative « 4 pour 1000 » a été reconnue comme l'une des six initiatives du LPAA pour le secteur agricole.
L'initiative vise à montrer que l’agriculture, et en particulier les sols agricoles, peuvent jouer un rôle clé pour la sécurité alimentaire et le changement climatique. L’initiative invite pour cela tous les partenaires à faire connaître ou mettre en place les actions concrètes sur le stockage du carbone dans les sols et le type de pratiques pour y parvenir (agro-écologie, agroforesterie, agriculture de conservation, de gestion des paysages…).
L’ambition de l’initiative est d’inciter les acteurs à s’engager dans une transition vers une agriculture productive, hautement résiliente, fondée sur une gestion adaptée des terres et des sols, créatrice d’emplois et de revenus et ainsi porteuse de développement durable.
À l'occasion de son lancement officiel, la déclaration de soutien à l'initiative « 4 pour 1000 » a été signée par plus de cent parties prenantes.
Une première réunion des partenaires de l'initiative a été organisée le 28 avril à Meknès en marge du salon international de l'agriculture du Maroc, en présence de plusieurs ministres de l'agriculture (Espagne et pays africains notamment), d'organisations internationales et d'institutions de recherche. À cette occasion, le MAAF a présenté ses propositions pour la gouvernance de l'initiative et pour une feuille de route 2016.
La construction de l'initiative s'appuie sur les orientations stratégiques définies par la déclaration de Paris soutenue par les partenaires du projet : organiser l'initiative sur deux volets – « plateforme multi-acteurs » et « projet scientifique » – afin de construire un centre d'expertise virtuel donnant ainsi accès à un ensemble de données et de compétences ;
• favoriser la mise en place d'une plate-forme collaborative rassemblant l'ensemble des partenaires et facilitant le financement de projets concrets de recherche et de développement ;
• articuler l'initiative avec les autres initiatives existantes sur les sols, notamment le partenariat mondial pour les sols (GSP) de la FAO et la Convention Désertification ;
• assurer un cadre de redevabilité suffisant pour prévenir toute suspicion de « greenwashing » ou de mise en danger de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, au moyen d'un référentiel d'évaluation de projets et actions basé sur les principes et objectifs de l'initiative définis dans la déclaration de Paris.
Malgré tous les progrès permis par l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, et les perspectives optimistes que celle-ci a pu dessiner, il convient de relativiser ces résultats. En effet, la trajectoire dessinée pour l’instant par les contributions remises, ainsi que certaines questions structurelles quant à la contrainte véritable exercée par l’Accord de Paris, pourraient bien sérieusement limiter sa capacité à enrayer le changement climatique.
Avant la Conférence de Paris, une synthèse a été réalisée à partir de l’envoi par les États de leurs contributions nationales prévues. Il s’agissait d’évaluer quelle serait la réduction opérée les émissions de gaz à effet de serre au vu des engagements des pays. Cette synthèse a ensuite été actualisée à plusieurs reprises pour y inclure les INDC progressivement remises par les États.
Selon ces analyses successives, la somme des engagements ne permettait pas de respecter la limite de hausse de la température de 2°C, le plafond visé par le futur Accord de Paris. À l’heure actuelle, la somme de ces contributions prévoit plutôt une tendance à une augmentation de 3°C. Ainsi, même s’ils respectaient les objectifs, les États ne seraient pas en mesure, au vu de leurs engagements aujourd’hui, de contenir le réchauffement sous la barre de deux degrés, et encore moins de tendre à un réchauffement de 1.5°C comme le veut l’Accord de Paris.
Par ailleurs, un certain nombre d’engagements des pays les plus démunis dépendent entièrement de financements additionnels extérieurs, et sont donc soumis à une forte conditionnalité.
Le 7 septembre 2016, six scientifiques climatologues de renom, avec pour porte-parole Robert Watson, ancien président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ont publié avec l’ONG Universal Ecological Fund une tribune visant à alerter sur la rapidité de l’augmentation des températures, et la nécessité d’y faire face dans l’urgence.
«Le réchauffement se produit maintenant et beaucoup plus vite que prévu», insiste Robert Watson dans ce papier de sept pages intitulée « La vérité du changement climatique ». Pour demeurer sous les 2°C, les émissions globales de CO2 devront être nulles d'ici 2060 à 2075, rappellent ces scientifiques, un objectif qui paraît difficile à atteindre étant donné que 82% de toute l'énergie mondiale provient à l'heure actuelle de la combustion du pétrole (31%) du charbon (29%) et du gaz naturel (22%).
En synthétisant beaucoup de résultats scientifiques disponibles, les scientifiques soulignent qu’en 2015, les températures du globe avaient déjà connu une élévation de 1 °C par rapport au niveau d’avant la révolution industrielle, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), contre + 0,85 °C en 2012, soit une progression extrêmement rapide. Un réchauffement additionnel de 0.4 à 0.5 °C est anticipé, et les 1.5 °C pourraient être atteints d’ici le début des années 2030», alertent les climatologues. C’est donc bien la gravité et l’urgence du sujet qui seraient mal comprises.
Même dans l’enceinte de l’Union européenne, qui se présente pourtant comme une bonne élève du climat, certains chercheurs affirment que les efforts demeurent insuffisants, et que le rythme des réformes doit être largement accéléré.
Teresa Ribera, directrice de l’IDDRI et Thomas Spencer, directeur de programme Climat à l’IDDRI pouvaient ainsi affirmer récemment, après la publication du rapport « State of the Low-Carbon Energy Union: Assessing the EU’s Progress towards its 2030 and 2050 Climate Objectives » (19), que l’Union avait fait « des progrès considérables en matière de transformation de son système énergétique. Les émissions de carbone par unité de production d’électricité ont baissé de 22.9 % entre 2000 et 2014 ; en 2013, les logements de l’UE consommaient 21.2 % moins d’énergie par m2 qu’en 2000 ; les moyens de transport de voyageurs de l’UE consomment 8.7 % de carburant en moins. Il s’agit là de progrès réels et significatifs dans l’évolution des déterminants fondamentaux du système énergétique de l’UE ».
Toutefois, et toujours selon eux, l’Union était restée à la traine pour de nombreux indicateurs, ce qui ne lui permettrait pas de réaliser les objectifs de réduction d’émissions de 40 % d’ici 2030 et d’au moins 80 % d’ici 2050 : « même dans le secteur de l’électricité, où le développement des énergies renouvelables a été impressionnant, l’amélioration de l’intensité de carbone doit accélérer pour passer d’environ 1.8 % aux alentours de 3 % par an dans les dix prochaines années. Dans le secteur des transports, l’UE est en retard par rapport à ce qui est nécessaire, l’amélioration de l’intensité énergétique du transport de voyageurs n’étant que d’environ 0,8 % par an, quand elle devrait atteindre près de 1.8 % par an au cours de la prochaine décennie pour atteindre les objectifs de 2030 et de 2050. Dans l’industrie, une proportion trop élevée des évolutions découle des changements structurels induits par la crise et non du développement de technologies plus propres ».
Les chercheurs appelaient donc à ce qu’une politique climatique plus résolue voie le jour en Europe, notamment par le renforcement du système communautaire d’échanges de quotas d’émissions (ETS) afin de garantir qu’un prix du carbone fort et efficace devienne le facteur majeur influençant les prises de décision actuelles du secteur privé. La proposition de la Commission suggérant que les États membres fixent des objectifs pour les secteurs non couverts par l’ETS pourrait selon eux contribuer à remettre l’Union européenne sur les rails.
Si la nature de l’Accord et le système de contrainte politique mis en place ont permis de rallier le plus grand nombre de pays, il est indéniable que l’Accord de Paris offre peu de garanties quant à la réalisation effective des objectifs fixés par les États. Le processus instauré s’appuie sur la valorisation des initiatives positives, sans qu’une revue négative des réalisations n’exerce réellement de conséquences dommageables pour les États, sauf en matière de capital politique.
En l’absence de sanctions, l’effectivité des obligations des États demeure donc relative en dépendant essentiellement de leur bonne volonté. Comme le relève l’Institut I4CE, « la contrainte de l’Accord est moins juridique que politique. Les États qui ne remplissent pas leurs obligations s’exposent à la pression de ceux qui les remplissent et de la société civile – qui à terme, pourrait tenter de les faire valoir dans le cadre de décisions judiciaires nationales. »
Le Protocole de Kyoto disposait d’un mécanisme d’observance, et des sanctions avaient pu être un outil évoqué dans ce cadre, et pourtant, soit les États ont refusé de le ratifier (voire l’ont quitté, comme le Canada) le Protocole, soit ils ont peiné à atteindre leurs objectifs. En privilégiant une approche bottom-up reposant sur une obligation de moyens plutôt que de résultats, l’Accord de Paris prend le risque de rester lettre morte, même s’il conserve le mérite d’entrainer les États dans une dynamique positive d’effort partagé par tous.
En outre, l’affirmation de principes tels que celui de « justice climatique » ne suffit pas à masquer le flou qui demeure attaché à leur définition et aux implications pratiques qui en découlent.
Pour une grande partie des acteurs attachés à ce qu’un régime climatique efficace et durable soit né de l’Accord de Paris, il s’agit désormais de faire passer les engagements d’un texte énonçant des grands principes à une action véritable, et rythmée par des procédures de report et de vérification susceptibles de garantir une véritable transparence. En effet, le niveau d'exigence posé par l'Accord au niveau mondial (rester sous une augmentation de 2°C, tendre vers 1,5 et parvenir à la neutralité des émissions pour 2015) contraste, nous l'avons dit, avec la faiblesse des contraintes qui pèsent sur les États, contraintes qui restent de nature essentiellement politiques.
Ce paradoxe, qui mène à ce que la somme des contributions soit encore actuellement insuffisante pour atteindre les objectifs fixés, doit être pris en compte rapidement. Tout d'abord, la COP 22 doit être l'occasion pour les États de prendre acte de cette insuffisance et devrait les pousser à présenter rapidement des contributions plus ambitieuses, dès 2018. Le traité doit s'appliquer à partir de 2020 et la révision des objectifs est prévue par le traité tous les cinq ans : il est toutefois impensable que les États restent inactifs dans la période préalable et que les objectifs trop limités avancés en 2016 ne soient pas modifiés avant 2025. Au rythme constaté du réchauffement climatique, ces quelques années d'inactions ne sont pas un luxe que la communauté internationale peut s'accorder.
Les suites de l'Accord de Paris Les prochaines étapes pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris sont prévues par l'Accord lui-même, mais également par la Décision prise à l'issue de la COP21, qui n'a pas le statut de traité de l'Accord. De 2016 à 2020 : participation renforcée de haut niveau Le IV de la décision de la COP 21 est intitulé « Action renforcée avant 2020 ». Il comporte une série de mesures destinées à accroître les efforts d'atténuation et d'adaptation sans attendre l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris. Cela donnera lieu notamment à une évaluation en 2017 de ce processus, à une réunion de haut niveau parallèlement à chaque session de la COP de 201- à 2020 et à la désignation de "champions de haut niveau" (paragraphe 122). En 2017 : travaux du Comité de l'adaptation sur les activités des dispositifs institutionnels relatifs à l’adaptation mis en place au titre de la Convention de 1992 Aux termes de sa décision du 12 décembre 2015, la COP 21 "demande" au Comité de l’adaptation « D’examiner, en 2017, les activités des dispositifs institutionnels relatifs à l’adaptation mis en place au titre de la Convention en vue de déterminer comment améliorer, le cas échéant, la cohérence de leurs activités, de manière à répondre de façon adéquate aux besoins des Parties. » En 2018 : Rapport du GIEC La décision de la COP 21 précise que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) devra « présenter un rapport spécial en 2018 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre. » Entre maintenant et 2018 : dialogue de facilitation des Parties sur le plafonnement des émissions de GES La décision de la COP 21 ouvre un « dialogue de facilitation entre les Parties pour faire le point en 2018 des efforts collectifs déployés par les Parties en vue d’atteindre l’objectif à long terme énoncé au paragraphe 1 de l’article 4 de l’Accord [plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais) et d’éclairer l’établissement des contributions déterminées au niveau national conformément au paragraphe 8 de l’article 4 de l’Accord. » Novembre 2019 : examen par la COP des progrès accomplis par le Comité de Paris pour le renforcement des capacités La décision de la Cop 21 « Demande également à la Conférence des Parties d’examiner, à sa vingt-cinquième session (novembre 2019), les progrès accomplis par le Comité de Paris sur le renforcement des capacités, la nécessité d’une prolongation de son mandat, son efficacité et son renforcement, et de prendre toute décision qu’elle juge appropriée, afin d’adresser des recommandations à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, à sa première session, au sujet de l’amélioration des dispositifs institutionnels relatifs au renforcement des dispositifs institutionnels relatifs au renforcement des capacités en application du paragraphe 5 de l’article 8 de l’Accord. » D'ici à 2020 puis tous les cinq ans : communication des INDC avec un calendrier jusqu'à 2030 La décision de la COP 21 « Demande aux Parties dont la contribution prévue déterminée au niveau national soumise en application de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier jusqu’à 2030 à communiquer ou à actualiser d’ici à 2020 cette contribution et à le faire ensuite tous les cinq ans conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord. » D'ici à 2020, tous les ans : 100 milliards de dollars par an pour l'atténuation et l'adaptation Aux termes de la décision (et non de l'Accord) il est demandé « fermement » aux pays développés parties de « dégager ensemble 100 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 pour l’atténuation et l’adaptation tout en augmentant sensiblement le financement de l’adaptation par rapport aux niveaux actuels et de continuer à fournir un appui approprié en matière de technologies et de renforcement des capacités. » D'ici à 2020 : communication par les Parties de leurs stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme Aux termes de la décision du 12 décembre 2015, la COP 21 « Invite les Parties à communiquer, d’ici à 2020, au secrétariat leurs stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle conformément au paragraphe 19 de l’article 4 de l’Accord, et charge le secrétariat de publier sur le site Web de la Convention les stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre communiquées par les Parties. » Avant 2025 : nouvel objectif chiffré de financement à partir d'un niveau plancher de 100 milliards par an La décision de la COP 21 précise « avant 2025, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fixe un nouvel objectif chiffré collectif à partir d’un niveau plancher de 100 milliards de dollars par an, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement ». « Dans les meilleurs délais » : plafonnement des émissions de gaz à effet de serre / « au cours de la deuxième moitié du siècle » : équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre L'article 4 de l'Accord de Paris précise : « En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. » Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris : communication par les pays développés des informations sur l'appui aux pays en développement pour le financement de l'atténuation et de l'adaptation L'article 9 de l'Accord dispose : « Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l’appui fourni aux pays en développement parties et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris adoptera à sa première session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l’article 13. Les autres Parties sont invitées à faire de même. » En 2023 puis tous les cinq ans : bilan mondial de la mise en œuvre de l'Accord afin d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet du présent Accord et de ses buts à long terme L'article 14 de l'Accord dispose : « La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris procède à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite sauf si elle adopte une décision contraire. » Source : cabinet juridique Arnaud Gossement http://www.arnaudgossement.com/archive/2015/12/13/cop-21-les-prochaines-etapes-apres-l-adoption-de-l-accord-de-5730505.html |
Parmi les questions stratégiques centrales de la Conférence de Paris, le thème du financement est probablement celui dont la résolution a laissé pour l'instant le plus à désirer. Pourtant, il y va de la crédibilité des pays développés : la confiance nécessaire à la réussite sur le long terme de l'Accord de Paris passe par la tenue par les pays développés de leurs engagements vis-à-vis des pays en développement, et cela d'autant plus que les contributions nationales des pays les moins avancés s'appuient souvent pour leur mise en œuvre sur des aides financières extérieures.
Une vision positive consiste à noter que l'Accord de Paris mentionne désormais la nécessité de mesures d'adaptation, et que le traité pose les bases pour la mise en œuvre de canaux financiers pérennes. À Paris, les pays ont réitéré leur promesse de fournir 100 milliards de dollars par an d’ici 2020, et de fournir une feuille de route pour ces financements. À compter de 2025, ces derniers s’engagent à atteindre un objectif supérieur à ce niveau plancher (paragraphe 54 de la décision, l’article 9 de l’accord fixant le principe d’une progression des efforts par rapport aux efforts antérieurs). Une large gamme de sources de financements est envisagée dans l'Accord, en visant un équilibre entre atténuation et adaptation. Les pays développés devront communiquer tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif.
La feuille de route présentée en amont de la COP 22 s’appuie sur un travail d’analyse et de projection réalisé par l’OCDE qui permet notamment :
- d’établir qu’au moins 67 milliards de dollars de financements publics, de sources bilatérales et multilatérales, seront disponibles en 2020 : c’est une augmentation de 26 milliards de dollars comparés aux niveaux des années 2013-2014 ;
- d’indiquer que, si les effets de mobilisation de la finance climat privée par la finance climat publique sont identiques à ceux de 2013-2014, plus de 90 milliards de dollars de finance climat, publique et privée, devraient être mobilisés au total en 2020.
- quant au financement de l’adaptation, les financements publics qui y sont consacrés devraient doubler d’ici 2020 par rapport aux années 2013-2014.
L’Accord de Paris a été largement salué, et présenté comme une avancée historique dans la lutte contre le changement climatique. Il l’est sans conteste : entré en vigueur moins d’un an après son adoption par consensus à l’issue de la Conférence de Paris, il témoigne d’une réelle dynamique internationale en faveur d’une meilleure prise en compte de l’enjeu climatique. Cette prise de conscience des États, portée par l’opinion publique mondiale, relayée par les Organisations non gouvernementales, doit aujourd’hui dépasser le stade des déclarations d’intention. Pour cela, la COP 22 devra être l’occasion de préciser les objectifs et la mise en œuvre de l’Accord de Paris dans les années à venir : elle devra être la conférence de la mise en action.
À cette fin, les négociations devront avancer sur les conditions de la mise en œuvre et de la révision des objectifs nationaux, aujourd’hui encore insuffisants. Le cadre de transparence qui permettra de suivre les efforts entrepris par les États reste à préciser, ainsi que les financements pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés, à la fois à mettre en œuvre des politiques compatibles avec le respect de leurs engagements d’atténuation, mais également à mener d’indispensables actions d’adaptation.
La question du financement sera centrale pour la COP 22 : si l’Accord de Paris en dessine les grands principes, ceux-ci doivent à présent être déclinés de façon plus précise. Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le coût annuel de l’adaptation pourrait atteindre entre 140 et 300 milliards de dollars par an d’ici à 2030 dans les pays en développement. Le coût pour l’Afrique, à lui seul, pourrait atteindre 50 milliards dollars par an en 2050. Il est donc plus que temps de garantir la disponibilité des 100 milliards par an à partir de 2020, engagement promis de longue date, en impliquant la plus grande variété d’acteurs.
De nombreux points ont été esquissés par la Conférence de Paris, ou introduits dans l’Accord et doivent faire l’objet d’une réflexion plus approfondie et de développements plus concrets. Le mécanisme de pertes et dommage, la notion de justice climatique appellent de nouveaux travaux. La présentation et le suivi des contributions nationales ont vocation à suivre des règles harmonisées qui restent à définir. Le rôle de la société civile et des territoires, avec l’appui des nouvelles championnes pour le climat et dans le cadre de l’Agenda global de l’Action, de mieux en mieux reconnus, sont encore à approfondir.
Ainsi, l’Accord de Paris a posé de grands principes et initié un mouvement de convergence qui doit désormais être poursuivi et se traduire par des engagements concrets et supérieurs à ceux pris jusqu’à présent.
La Commission s’est réunie le 15 novembre, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, puis de M. William Dumas, doyen d’âge, pour examiner le présent rapport d’information.
L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.
« M. Joachim Pueyo. Merci tout d’abord aux rapporteurs. Votre rapport est excellent et très bien rédigé. En effet, un problème consiste en l’urgence qu’il y a à répondre au défi climatique et à relever une ambition mondiale. Je pense qu’un deuxième sujet m’interpelle : il s’agit de la prise de conscience de l’opinion publique. Il est important que cette dernière réalise que le changement climatique est en train de se produire, et entraine tout un ensemble de conséquences que nous observons dès à présent, au plan climatique ou de l’immigration, qui s’accélérera si les décisions prises lors de cette grande conférence internationale ne s’appliquent pas de manière concrète.
Ensuite, le fait que les États-Unis aient signé cet accord est fondamental. Ils ont en effet prévu de verser 3 milliards de dollars pour le Fonds Vert, ce qui est très important. Il est rassurant de constater que le responsable de la diplomatie américaine concernant ce sujet, M. Jonathan Pershing, est en poste jusqu’en 2020. J’ose espérer qu’il restera en poste jusqu’au moment prévu afin d’assurer une continuité de l’action américaine. Je pense d’ailleurs qu’accompagner en France un changement de gouvernement par une modification de la feuille de route serait une grossière erreur. Nous assisterons prochainement à un changement de gouvernement, peut-être un changement de majorité, mais j’ose espérer qu’il y aura une continuité dans une action supérieure, d’intérêt général.
M. Bernard Deflesselles, co-rapporteur. Concernant les États-Unis et Trump en particulier, ce dernier, lors de sa campagne électorale, s’est tout d’abord très clairement rangé parmi les climato-sceptiques. Rappelons tout de même qu’une grande partie du Congrès américain partage cette position. Jérôme Lambert et moi-même nous sommes plusieurs fois déplacés au Congrès lors des dernières années. Nous y avons rencontré des sénateurs et des représentants, des démocrates et des républicains, et nous ne pouvons pas affirmer avoir constaté un engouement extraordinaire pour la lutte contre le dérèglement climatique, loin s’en faut. Or, il ne vous aura pas échappé qu’avec l’élection de Donald Trump, les deux chambres du Congrès restent acquises aux Républicains, ce qui constitue un obstacle.
Ma deuxième observation est que lors de sa campagne, Trump a déclaré être climato-sceptique, a qualifié le réchauffement climatique d’invention chinoise visant à miner la compétitivité des entreprises américaines, s’est engagé à réaliser le projet d’achever l’oléoduc Keystone XL, à rouvrir les mines de charbon, etc.
Que fera-t-il maintenant ? Modifiera-t-il sa ligne ? Il avait même à un moment pensé dissoudre l’Agence nationale de l’environnement. Il s’agissait donc de propositions très fortes. Il avait par ailleurs annoncé vouloir sortir de l’Accord de Paris, et ne pas verser les contributions prévues.
Juridiquement, la situation est plus complexe : en théorie, l’Accord a été mis en œuvre et les États-Unis ne devraient pas pouvoir en sortir d’ici à 2020. Mais les États-Unis pourraient néanmoins sortir juridiquement de la CCNUCC, c’est-à-dire de la Convention des Nations Unies pour le changement climatique. Dans ce cas, les États-Unis pourraient ensuite sortir de l’Accord de Paris, un an après leur sortie de la CCNUCC. Il y a donc un risque. Peut-être que cela ne se produira pas, mais il ne s’agit pas d’un signal très positif.
Les États-Unis sont très partagés. Le Congrès est plutôt hostile : je me souviens des démocrates que nous avions rencontrés lorsqu’Obama était aux affaires, qu’on appelait les « blue dogs » et qui étaient contre l’accord.
M. Jérôme Lambert, co-rapporteur. Le Congrès américain est essentiellement, comme nous le savons tous, le représentant des lobbies. Il peut y avoir des lobbies écologistes représentant des associations importantes, mais leur poids est minime face aux lobbies charbonniers, pétroliers, etc.
M. Bernard Deflesselles, co-rapporteur. Ainsi même des élus démocrates, faisant partie de la majorité d’Obama, votaient contre les textes. Il s’agit donc d’un enjeu transpartisan. En revanche, à la différence du Congrès, certains États réalisent des choses extraordinaires. La Californie est à l’avant-garde, avec une politique environnementale tout à fait comparable et même supérieure à la nôtre. L’Amérique est donc un peu partagée en deux, mais l’élection de Trump peut peser sur cet accord.
M. Bruno Gollnisch, membre du Parlement européen. Il existe plusieurs sortes de climato-sceptiques : il y a ceux qui nient le réchauffement climatique, et il y a ceux, dont je me sens plus proche, qui admettent l’existence de ce réchauffement mais qui, malgré les conclusions du GIEC, ne sont pas absolument certain qu’il soit entièrement dû aux émissions de gaz à effet de serre. C’est un fait que dans l’histoire de notre univers, il y a eu des exemples d’épisodes de glaciation et de réchauffement climatique, qui ne devaient sans doute rien à l’activité humaine.
Je voudrais savoir si vous et les différentes instances internationales, et notamment la COP 22 de Marrakech, n’envisagez pas tout de même le scénario catastrophe, c’est-à-dire soit celui dans lequel, en dépit de nos efforts, le système de contrôle que nous avons mis en place échouerait car les États-Unis le rejetteraient, entrainant derrière eux la Chine, la Russie et l’Inde et rendant impuissante l’Europe occidentale, soit celui, qui me paraît rationnellement possible mais pas du tout certain, dans lequel l’ensemble des pays s’accorderaient à limiter leurs émissions de CO2 mais où cela ne suffirait pas à empêcher le réchauffement climatique.
Ce qui me frappe est que j’ai l’impression qu’il n’existe pas de réflexion à propos de ce qui pourrait arriver malgré tout de positif, afin d’aménager un réchauffement climatique. Il est certain que si le réchauffement climatique se poursuit, il engendrera vraisemblablement une catastrophe dans le Sahel, ainsi que dans un certain nombre de secteurs géographiques comparables, mais dans d’autres secteurs secteur comme par exemple en Sibérie, où le permafrost a commencé et va continuer à fondre, ce qui représente des inconvénients comme des dégagements de gaz naturel mais aussi des avantages : un certain nombre de terres deviendraient cultivables, la Route du Nord peut devenir praticable, etc. Peut-être y a-t-il un certain nombre de conséquences positives à envisager de la perspective de la poursuite, en dépit de tous les efforts des uns et des autres, du réchauffement climatique.
M. Jérôme Lambert, co-rapporteur. Ces sujets font l’objet de conférences et d’études très fouillées dans les milieux scientifiques. Tout d’abord, on ignore si l’activité humaine est la seule cause du réchauffement. Des causes naturelles peuvent exister, des cycles climatiques ont eu lieu. Peut-être assistons-nous justement à un cycle de refroidissement naturel, contrarié par l’activité humaine. Peut-être sommes-nous dans un cycle de réchauffement ou de neutralité, ce qui est possible.
En revanche, ce qui est certain, et tout le monde le sait, est que la proportion de dioxyde de carbone dans l’atmosphère ne cesse d’augmenter. Comme nous savons tous que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre, nous pouvons tous en déduire que si sa concentration dans l’atmosphère augmente, il existe forcément un effet de serre plus important. On ne peut donc nier l’impact de l’activité humaine, par l’augmentation de la part de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
M. Bernard Deflesselles, co-rapporteur. Sur ce sujet-là, nous avons vécu, Jérôme Lambert et moi-même une expérience intéressante il y a quelques années : dans le Nord de la Norvège, nous sommes allés voir les carottages de glace, invités par le gouvernement norvégien. Il s’agit d’une technique consistant à percer la calotte glaciaire et à en extraire des cheminées de glaces très hautes et de les analyser. Celle qui a été extraite devant nous datait d’il y a deux mille ans.
M. Jérôme Lambert, co-rapporteur. Certaines de ces études portent sur huit-cent mille ans.
M. Bernard Deflesselles, co-rapporteur. La question porte sur la vérification des niveaux de parties par million – les fameuses PPM – de dioxyde de carbone dans ces carottes glaciaires, c’est-à-dire la trace de ce dioxyde de carbone. Le résultat est qu’au moment où nous parlons, nous trouvons des concentrations de dioxyde de carbone s’élevant actuellement à 400 particules par million dans la calotte glaciaire. À l’époque de la Révolution Industrielle, c’est-à-dire en 1850, ces concentrations étaient de l’ordre de 250 PPM. On voit donc très bien qu’en 150 ans, il y a eu lieu une accélération des émissions de CO2 concomitante du développement industriel, c’est-à-dire de la mécanisation et à l’utilisation du pétrole, du gaz et du charbon.
Concernant le débat sur l’impact de l’activité humaine, le GIEC affirme dans ses études être sûr à 90 ou 95 % que l’activité humaine est en jeu dans le phénomène du réchauffement.
M. Jérôme Lambert, co-rapporteur. Sur la question de savoir s’il n’y aurait pas des aspects positifs au réchauffement : évidemment cela provoque déjà et va continuer à provoquer des bouleversements dans le monde. Le bouleversement de l’équilibre du monde serait-il un des aspects positifs du réchauffement climatique ? On peut se poser la question car lorsque les terres de Sibérie – qui en effet, lorsqu’elles se réchauffent, libèrent beaucoup de gaz à effet de serre – deviendraient des greniers à blé, il faudra se demander pour qui et comment ces terres seront exploitées. Comment feront les centaines de millions de gens qui vivent aujourd’hui sur des terres difficiles et qui deviendront impossible à habiter ? Ils iront en Sibérie, mais les Russes accepteront-ils des migrations de centaines de millions de gens ? Ces « aspects positifs » du réchauffement risquent d’entrainer des bouleversements très graves.
Des études affirment que lors de la dernière glaciation, que nos ancêtres ont pu connaître car il y avait des hommes sur Terre, il y a 20 000 à 30 000 ans, la température moyenne de globe était inférieure d’environ 2 à 4° C à la température moyenne d’aujourd’hui. Il s’agit d’une différence ridicule : si la glaciation qui a emmené la banquise à la hauteur du Danemark et les neiges éternelles à 800 mètres d’altitude en France correspondait à 3 ou 4° C en moins par rapport à la température actuelle, que provoqueraient 3 à 4° C en plus ? Cela est donc de nature à nous inquiéter fortement.
Je préfère éviter de me contenter des aspects positifs, alors que la Sibérie deviendrait un paradis, si les trois quarts ou la moitié du reste du monde devient un enfer.
M. Bruno Gollnisch. Bien entendu. Je me posais simplement la question de savoir s’il existait des études quant aux aménagements possibles.
M. William Dumas, président. En ce qui concerne les carottes glaciaires, je pense qu’il s’agit d’études fiables.
M. Bernard Deflesselles, co-rapporteur. De l’an zéro à 1850, la courbe des températures mondiales est plate, à quelques perturbations près causées par des éruptions volcaniques, et à partir de 1850 la courbe augmente de façon exponentielle.
M. Joachim Pueyo. Nous ne sommes pas des scientifiques, pas des experts ou des spécialistes, donc nous devons prendre appui sur les études, les experts et la communauté scientifique. C’est au politique d’en prendre connaissance et de mettre en place des politiques publiques, comme nous l’avons vu avec l’Accord de Paris. J’accorde donc plutôt ma confiance aux scientifiques et aux véritables experts, qui tout de même nous alertent sur ce changement climatique qui fait l’objet d’un consensus. En l’absence d’action forte, nous ne modifieront pas la tendance ascendante de la température mondiale. Il y a certes des cycles, comme on l’a vu autour de 1787 avec l’existence d’un petit cycle de refroidissement en France, ayant entraîné la disette, l’augmentation terrible du prix du blé, les famines, et ayant peut-être été l’une des causes de la Révolution française. Je pense donc qu’il y a une tendance qu’il faut prendre en compte.
M. Bernard Deflesselles, co-rapporteur. On n’a pas assez salué les scientifiques, car c’est leur travail qui a permis d’identifier le réchauffement climatique. Cela fait vingt ans que le GIEC publie des rapports. Or le GIEC est un réseau de plusieurs centaines, voire de plus de mille experts (glaciologues et spécialités connexes) au niveau mondial. Ils peuvent certes se tromper ou réaliser des modèles erronés, mais on observe tout de même une tendance lourde. On peut donc plutôt se fier à des scientifiques plutôt qu’à des hurluberlus – je crois qu’il n’y a pas d’autre terme.
Enfin, notre faiblesse est l’absence d’un accord juridiquement contraignant. Les feuilles de route engendrent des obligations déclaratives. Les Etats ont fait preuve de bonne volonté pour les présenter à la CCNUCC, mais ils ne sont pas tenus par ces obligations et par le résultat des contrôles. Il s’agit d’une obligation de moyen mais non de résultat. Il n’existe donc pas de contrôle à l’exception du MRV, tel que l’ONU le désigne, mais qui reste aléatoire, et aucune sanction n’est prévue .
Le Protocole de Kyoto fournit un exemple : il s’agissait d’un traité international signé et ratifié par une grande partie des pays, et qui énonçait l’objectif de diminuer de 4 % les émissions de gaz à effet de serre – objectif modeste. En définitive, ces émissions ont augmenté de 15 ou 18 % dans les pays signataires, car il n’existe pas suffisamment de contrainte ni de contrôle, et surtout pas assez de sanctions. C’est la faiblesse de cet accord, avec les questions monétaires, même si cela progresse.
M. William Dumas, président. Vous mentionniez la prise de conscience des populations. Or, j’étais aux États-Unis il y a un mois concernant la question du gaz de schiste. Je suis allé en Pennsylvanie, où il commence à y avoir une prise de conscience, mais cet Etat a largement soutenu Trump. Pourtant l’eau courante n’y est pas consommable, par exemple. En dépit des nuisances liées à l’activité minière, les gens étaient attachés aux recettes que cette dernière procurait. J’espère qu’à Marrakech, on assistera à un engagement des Etats.
M. Bernard Deflesselles, co-rapporteur. Il faut transformer l’essai et passer à l’acte. Pour cela il faut trouver le financement nécessaire et il faut réussir à modifier nos engagements pour rester sur une trajectoire nous conduisant à un réchauffement climatique limité à 2° C. »
ANNEXE N° 1 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS
Les rapporteurs tiennent à témoigner leur gratitude à l’ensemble des personnalités avec lesquelles ils se sont entretenus dans le cadre de la préparation de ce rapport d’information.
- M. Jérôme Brouillet, Chef du bureau « Environnement et agriculture », Direction générale du trésor, Ministère de l’économie et des finances,
- M. Cyril Rousseau, Sous-directeur « Affaires financières multilatérales et développement », Service des Affaires multilatérales et de développement, Direction générale du trésor, Ministère de l’économie et des finances,
- Mme Lucile Dufour, Responsable négociations internationales et développement, Réseau Action Climat - France
- Mme May Gicquel, Chef du bureau « Financement multilatéral du développement et du climat », Service des Affaires multilatérales et de développement, Direction générale du trésor, Ministère de l’économie et des finances,
- M. Paul Watkinson, Chef de l’équipe de négociation climat, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer.
Le texte de l’Accord de Paris peut être consulté dans sa version française ici : unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf
ANNEXE N° 3 : COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL DU 2 MARS 2016, L’APRÈS-PARIS: ÉVALUATION DES IMPLICATIONS DE L’ACCORD DE PARIS
1. INTRODUCTION
L’accord de Paris de 2015 marque un tournant historique dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Véritable bouffée d’air, il offre un dernier espoir de transmettre aux générations futures un monde plus stable, une planète plus saine, des sociétés plus justes et des économies plus prospères, et s’inscrit également dans le contexte du programme de développement durable à l’horizon 2030. Grâce à cet accord, une transition mondiale vers l’énergie propre va pouvoir être amorcée. Cette transition nécessitera des changements dans la manière de faire des affaires et d’investir, ainsi que des incitations dans tous les domaines d’action. Pour l’Union européenne (UE), cet événement ouvre d’importantes perspectives, notamment en matière d’emploi et de croissance. La transition stimulera l’investissement et l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables, ce qui devrait permettre à l’UE de s’imposer comme le chef de file mondial du secteur et favoriser une croissance accrue sur les marchés des biens et services européens, notamment en lien avec l’efficacité énergétique.
L’accord de Paris est le premier accord multilatéral sur le changement climatique englobant la quasi-totalité des émissions mondiales. Il s’agit d’un succès pour la planète et d’une confirmation de l’engagement de l’UE sur la voie d’une économie à faible intensité de carbone. Pour parvenir à cet accord, la stratégie de négociation de l’Union a été décisive. Forte de son expérience des mesures efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique et d’une longue tradition de négociation et de coopération internationale fondée sur des règles, l’UE a défendu un programme ambitieux. Elle a été la première grande économie à communiquer, le 6 mars 2015, son plan relatif au climat (c’est-à-dire les contributions prévues déterminées au niveau national ou «CPDN»), défini conformément au cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 adopté par le Conseil européen d’octobre 2014 et au programme de lutte contre le changement climatique planétaire après 2020 de la Commission européenne . L’UE s’est engagée à atteindre, d’ici à 2030, l’objectif ambitieux de réduire d’au moins 40 % ses émissions de gaz à effet de serre, dans tous les secteurs de l’économie. Cet objectif est fondé sur des projections globales qui sont conformes à l’ambition à moyen terme établie dans l’accord de Paris.
D’un bout à l’autre de la COP21, l’UE a fait preuve d’une très grande cohérence politique. Tous les ministres de l’UE présents à Paris ont montré qu’ils étaient prêts et déterminés à réussir. L’Union a agi comme une seule entité pour défendre sa position, telle qu’elle avait été arrêtée par le Conseil «Environnement». De ce fait, elle a pu s’exprimer d’une seule et même voix à tous les stades des négociations, un facteur qui s’est révélé essentiel pour le succès de la conférence de Paris. Enfin et surtout, la diplomatie climatique déployée par l’UE a permis à celle-ci de former avec ses partenaires une vaste coalition de pays développés et en développement favorables aux objectifs les plus ambitieux. Cette «coalition à niveau élevé d’ambition» a fortement contribué à imprimer une dynamique positive aux négociations et à persuader tous les grands pays émetteurs de s’associer à l’accord de Paris.
En outre, le contexte mondial a totalement changé depuis la conférence de Copenhague en 2009; la COP21 a donc suscité une mobilisation mondiale partant de la base, mêlant acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, entreprises, investisseurs, municipalités et société civile. La présidence française de la conférence sur le climat et les Nations unies méritent d’être saluées pour la dynamique positive qui a régné aussi bien en amont que lors de la COP21.
Pour que les engagements pris au titre de l’accord de Paris débouchent sur des actes, il importe de conserver cet élan et de faire preuve d’une volonté politique forte d’assurer la transition vers un monde résilient face au changement climatique et climatiquement neutre, d’une manière qui garantisse la justice sociale. Le dérèglement climatique devrait rester une priorité stratégique des instances internationales compétentes, notamment le G20 et le G7. À cet égard, l’Union continuera à jouer un rôle moteur sur le plan international et poursuivra ses actions de diplomatie climatique .
2. L’ACCORD DE PARIS — UN ACCORD MONDIAL
2.1. Principaux éléments de l’accord de Paris
L’accord de Paris définit un plan d’action mondial pour éviter les dangers liés au dérèglement climatique, ce qui suppose de parvenir à un pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais et d’atteindre la neutralité climatique dans la seconde moitié du siècle. Les principaux éléments de l’Accord sont les suivants:
• Il définit un objectif à long terme, à savoir créer des conditions propices au maintien du réchauffement de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en poursuivant les actions menées pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C. Ce dernier objectif indicatif a été fixé d’un commun accord pour inciter à davantage d’ambition, mais aussi pour tenir compte des préoccupations des pays les plus vulnérables, qui subissent déjà les conséquences du dérèglement climatique.
• Il signifie clairement à l’ensemble des parties prenantes, aux investisseurs, aux entreprises, à la société civile et aux décideurs politiques que la transition mondiale vers une énergie propre a été définitivement amorcée et que les combustibles fossiles doivent progressivement être abandonnés. Avec 189 plans nationaux sur le climat, couvrant environ 98 % des émissions totales, la lutte contre le réchauffement climatique est à présent devenue un vrai effort mondial. Avec la COP21, nous sommes passés de l’action de quelques-uns à l’action de tous.
• L’accord de Paris instaure un mécanisme dynamique permettant de dresser des bilans et d’ajuster à la hausse les ambitions au fil du temps. À partir de 2023, les parties se retrouveront ainsi tous les cinq ans pour un «bilan mondial», en vue d’examiner les progrès accomplis par rapport aux objectifs à long terme fixés dans l’Accord en matière de réduction des émissions, d’adaptation et d’appui (fourni et reçu).
• Les parties sont juridiquement tenues de prendre des mesures d’atténuation nationales pour atteindre les objectifs énoncés dans leur contribution.
• L’Accord prévoit un cadre de transparence et de reddition de comptes renforcé, comprenant la soumission biennale, par toutes les parties, de rapports d’inventaire des gaz à effet de serre et des informations nécessaires au suivi des progrès accomplis, un examen technique par des experts, un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des progrès accomplis par les parties, ainsi qu’un mécanisme destiné à faciliter la mise en œuvre et à promouvoir le respect des dispositions de l’Accord.
• Il prévoit également un dispositif de solidarité ambitieux, consistant en des mesures appropriées sur le financement de la lutte contre le réchauffement climatique et la prise en compte des besoins liés à l’adaptation aux pertes et préjudices dus aux effets négatifs du dérèglement climatique. Afin d’encourager l’élaboration de mesures d’adaptation, à titre individuel ou collectif, l’accord de Paris établit pour la première fois un objectif mondial visant le renforcement des capacités et de la résilience au changement climatique et la réduction de la vulnérabilité au climat. Sur le plan international, il invite les parties à coopérer davantage en échangeant leurs connaissances scientifiques en matière d’adaptation, ainsi que des informations sur les pratiques et les politiques.
2.2. Ratification et entrée en vigueur de l’accord de Paris
L’accord de Paris constitue une avancée majeure. L’UE continuera de jouer un rôle actif dans les négociations internationales sur le climat pour garantir que le niveau d’ambition visé dans cet accord se retrouve dans tous les éléments liés à sa mise en œuvre, notamment les dispositions détaillées en matière de transparence et de reddition de comptes, les mécanismes de développement durable et les mécanismes technologiques.
La prochaine étape immédiate est la signature de l’accord de Paris. Celui-ci sera ouvert à la signature le 22 avril 2016 à New York, et entrera en vigueur lorsqu’au moins 55 parties représentant au moins 55 % des émissions mondiales l’auront ratifié. Il est à espérer que la ratification et l’entrée en vigueur interviendront rapidement, car cela fournirait à tous les pays la sécurité juridique que l’Accord sera rapidement opérationnel. L’Union devrait être en mesure de ratifier l’accord de Paris dans les plus brefs délais.
2.3. Jalons intermédiaires dans le cadre de l’accord de Paris
L’accord de Paris prévoit un certain nombre de jalons intermédiaires. Les implications stratégiques précises de l’objectif des 1,5 °C doivent être clairement établies. Le 5e rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ne donne pas d’indications claires sur cet aspect, faute d’analyses scientifiques suffisantes. Pour remédier à cette situation, le GIEC a été invité à préparer un rapport spécial en 2018. L’UE contribuera aux travaux scientifiques qui seront menés à cette fin au niveau international. Elle devrait participer au premier «dialogue de facilitation», en 2018, pour faire le point des ambitions collectives et des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements souscrits. Elle participera de même au premier bilan mondial en 2023, qui sera l’occasion d’envisager des actions de plus en plus ambitieuses de toutes les parties après 2030. Dans ce contexte, l’UE est invitée, comme les autres parties, à communiquer, d’ici à 2020, ses stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle. Pour faciliter l’élaboration de ces stratégies, la Commission préparera une analyse approfondie des mutations intervenues dans le domaine économique et social, en vue d’alimenter les discussions politiques au Parlement européen, au Conseil et avec les parties prenantes.
3. MODALITÉS DE LA MISE EN œUVRE DE L’ACCORD DE PARIS PAR L’UNION
Le passage à une économie à faible intensité de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources suppose un véritable tournant au niveau technologique, énergétique, économique et financier et, en fin de compte, de la société tout entière. L’accord de Paris représente une opportunité de transformation économique, de création d’emplois et de croissance. C’est aussi un élément essentiel dans la réalisation des objectifs généraux de développement durable, mais aussi des priorités de l’UE en matière d’investissement, de compétitivité, d’économie circulaire, d’innovation et de transition énergétique. La mise en œuvre de l’accord de Paris ouvre des perspectives commerciales qui permettront à l’UE de conserver et d’exploiter son avantage de pionnière lorsqu’il s’agira de promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ou de développer d’autres technologies à faible intensité de carbone concurrentielles sur le marché mondial. Pour profiter pleinement de ces atouts, l’Union devra continuer à mener par son exemple et son action, en adoptant des mesures réglementaires destinées à réduire les émissions mais aussi en instaurant des conditions propices à une intensification des investissements publics et privés en faveur de l’innovation et de la modernisation dans tous les secteurs clés, tout en veillant à ce que les autres grandes économies continuent à tout mettre en œuvre pour respecter leurs engagements. La transition vers une économie à faible intensité de carbone doit être intelligemment menée, en tenant compte des différences entre les États membres du point de vue du bouquet énergétique comme de la structure économique. Cela suppose également d’anticiper et d’atténuer les effets sociétaux de cette transition dans des régions et des secteurs socioéconomiques bien définis.
3.1. Promouvoir des conditions propices à la transition vers une économie à faible intensité de carbone
La transition énergétique de l’UE
L’engagement de l’UE d’opérer une transition vers les énergies propres est irréversible et non négociable. L’Union de l’énergie vise prioritairement à «abandonner le modèle économique reposant sur les combustibles fossiles, dans lequel la question énergétique repose sur une approche centralisée, axée sur l’offre, qui s’appuie sur des technologies anciennes et des schémas commerciaux périmés [afin de] donner du poids aux consommateurs et (...) abandonner notre système fragmenté, caractérisé par l’absence de coordination des politiques nationales, les entraves au marché et les îlots énergétiques» . Le projet d’Union de l’énergie, dans toutes ses dimensions, fournit un cadre plus large qui permettra à l’UE d’instaurer des conditions propices à la transition énergétique. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la mise en œuvre intégrale des plans relatifs au climat devrait entraîner des investissements à hauteur de 13,5 billions d’USD dans l’efficacité énergétique et les technologies sobres en carbone entre 2015 et 2030, soit une moyenne annuelle de 840 milliards d’USD. Ces plans auront pour principal effet non seulement d’accroître les investissements, mais aussi de permettre un rééquilibrage de ces derniers entre les combustibles et les secteurs, de même qu’entre l’offre et la demande. À titre d’exemple, les fonds investis dans les énergies renouvelables seront près de trois fois supérieurs à ceux investis dans les centrales électriques à combustibles fossiles, tandis que les investissements dans l’efficacité énergétique (principalement dans les secteurs des transports et du bâtiment) devraient être proportionnellement équivalents à ceux réalisés dans d’autres branches du secteur de l’énergie.
Innovation et compétitivité
L’accord de Paris trace une trajectoire claire et ambitieuse en ce qui concerne l’innovation dans les technologies à faible intensité de carbone. En marge de la COP21, vingt États parmi les premières économies mondiales ont lancé une «Mission innovation» pour relancer l’innovation publique et privée dans les énergies propres, encourager la mise au point et le déploiement de technologies innovantes et diminuer les coûts. L’Union souhaite s’associer à cette initiative, sachant que le budget de l’UE consacré à la recherche liée aux technologies à faible intensité de carbone au titre du programme Horizon 2020 a déjà été doublé dans les faits pour la période 2014-2020, et que l’UE s’est engagée à investir 35 % au moins des ressources de ce programme dans des actions liées au climat. En outre, la future stratégie de l’Union de l’énergie en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité permettra d’exploiter les synergies entre l’innovation dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’économie circulaire, de l’industrie et du numérique. Il devrait en résulter une plus grande compétitivité des technologies européennes à faible intensité de carbone, actuelles et à venir.
Marchés de l’investissement et des capitaux
Afin d’accompagner la transition vers une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique et d’éviter le «verrouillage» des infrastructures à forte intensité d’émission et des actifs, il est essentiel de réorienter et d’accroître rapidement les investissements privés. Les fonds de l’UE joueront un rôle décisif dans la mobilisation des marchés. Le soutien aux investissements dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe, axé sur les mesures visant à lever les obstacles à l’investissement dans l’Union, ainsi que les possibilités de financement offertes par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), devraient favoriser la réduction des émissions et les investissements en faveur de l’efficacité énergétique dans le marché unique. Le plan d’investissement pour l’Europe affiche déjà un bilan prometteur dans ce domaine , et il n’a pas encore donné toute sa mesure. La Commission a lancé récemment le portail européen de projets d’investissement (EIPP) qui devrait bientôt être pleinement opérationnel. Ce dispositif vise à attirer des investisseurs dans des projets d’investissement viables et sains en Europe. Les acteurs du secteur de l’énergie sont encouragés à envoyer leurs propositions à l’EIPP, en vue de fournir aux investisseurs potentiels un aperçu le plus complet possible des projets. La Commission travaillera en priorité à accélérer l’assistance technique afin que les parties prenantes puissent mettre en place, en 2016, des dispositifs visant à regrouper des projets de moindre envergure dans le domaine de l’efficacité énergétique de façon à atteindre une masse critique. Ces dispositifs devraient offrir aux investisseurs des possibilités d’investissement plus intéressantes dans l’efficacité énergétique, et rendre les capitaux plus accessibles pour les plateformes et programmes d’efficacité énergétique nationaux, régionaux ou locaux. Ils incluront un renforcement de l’assistance à l’élaboration de projet et de l’assistance technique dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) mise sur pied par la Commission et la Banque européenne d’investissement pour aider les promoteurs publics à structurer leurs projets et pour promouvoir des dispositifs de financement comportant des conditions standards, notamment dans le domaine du bâtiment .
Les institutions financières sont des partenaires incontournables dans le processus de transition. Le bon fonctionnement des flux transfrontières de capitaux et l’existence de marchés des capitaux intégrés et durables sont aussi des conditions importantes pour permettre cette transition. À cet égard, les mesures déjà adoptées ou en cours d’élaboration dans le cadre de la mise en place d’une union des marchés des capitaux sont essentielles. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales, la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds vert pour le climat et d’autres institutions financières internationales comme la Banque mondiale, sans oublier les banques nationales de développement, ont un rôle utile à jouer pour assurer cette transition – à l’intérieur comme à l’extérieur du marché unique. Invité par le G20, en avril 2015, à examiner de quelles manières le secteur financier pourrait prendre en compte les questions climatiques, le Conseil de stabilité financière (CSF) a créé un groupe de travail sur la divulgation de données financières en rapport avec le climat, ayant pour mission d’aider les intervenants du marché à mieux comprendre les risques liés au dérèglement climatique et à mieux s’y préparer. Le G20 a récemment mis en place un groupe de réflexion chargé d’analyser les questions liées à la finance verte (GFSG). Au niveau européen, le comité européen du risque systémique a publié un rapport sur la transition vers une économie à faible intensité de carbone et les risques potentiels pour le secteur financier .
Tarification du carbone et subventions aux combustibles fossiles
La tarification du carbone est essentielle pour favoriser des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale dans le contexte de la transition. Elle peut prendre la forme d’échanges de quotas d’émission, comme dans l’UE, de prélèvements de taxes, ou d’autres instruments économiques et/ou fiscaux. L’Union devrait intensifier ses efforts pour partager avec les pays qui doivent commencer à taxer le carbone ses propres expériences en la matière. Elle continuera d’associer à ce processus des pays tels que la Chine et la Corée du Sud, qui mettent en place des systèmes d’échange de quotas d’émission, ainsi qu’un éventail plus large de pays, y compris les grandes économies qui sont en train de s’équiper en technologies fondées sur les énergies renouvelables et d’améliorer leurs politiques en matière d’efficacité énergétique. Bien que l’accord de Paris ait changé la donne de par son caractère mondial, le niveau d’effort prévu par chaque pays est variable, d’où un risque de désavantage concurrentiel pour les secteurs concernés si des conditions de concurrence inéquitables sont maintenues. La décision stratégique du Conseil européen visant à maintenir l’allocation gratuite de quotas après 2020 et les mesures proposées pour empêcher la fuite de carbone dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE permettent pour le moment une situation équilibrée, mais devraient être réexaminées au cours de la prochaine décennie.
Les perspectives en ce qui concerne la tarification du carbone et de l’énergie sont encore compliquées par les bas prix du pétrole actuellement. Dès lors, l’occasion se présente d’introduire la tarification du carbone mais aussi de supprimer les subventions en faveur des combustibles fossiles qui, selon l’Agence internationale de l’énergie, s’élevaient à 548 milliards d’USD au niveau mondial en 2013. Ces aides sont le principal obstacle à l’innovation dans les technologies propres, ainsi que l’ont reconnu le G20 et le G7 dans leurs appels à la suppression des subventions aux combustibles fossiles. Le rapport à paraître sur les prix et coûts de l’énergie dans l’UE examinera l’évolution de la situation à cet égard.
Rôle des villes, de la société civile et des partenaires sociaux
Catalyser les actions associant divers acteurs de la société civile – citoyens, consommateurs, partenaires sociaux, PME, jeunes pousses innovantes et industries compétitives à l’international – est une autre condition préalable à la transition. La conférence de Paris et le programme d’action Lima-Paris, une initiative conjointe de la présidence péruvienne de la COP20 et de la présidence française de la COP21, visent à réunir un nombre sans précédent d’acteurs non étatiques sur la scène mondiale en vue d’accélérer les actions de coopération à l’appui du nouvel accord. L’UE bénéficie d’une position unique pour intégrer la transition vers une économie à faible intensité de carbone dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernance.
Une grande partie des transformations à venir se produiront de facto dans les villes intelligentes et au sein des communautés urbaines. Les travaux menés au niveau des métropoles et les politiques urbaines seront donc intensifiés en 2016, notamment en ce qui concerne le soutien aux actions intégrées et globales mises en place par la Convention des maires et la création d’un «guichet unique» pour les autorités locales. Cela devrait permettre aux collectivités locales de mieux contribuer à la transition de l’UE vers un système à faible intensité de carbone et donner aux entreprises européennes l’occasion d’utiliser au niveau mondial leur avantage concurrentiel dans les technologies innovantes appliquées aux villes intelligentes.
Diplomatie climatique et action internationale
L’action dans le domaine climatique représente un enjeu de politique étrangère majeur, qui revêt des implications pour l’élaboration de la politique extérieure de l’UE en ce qui concerne, notamment, l’aide et la coopération au développement, les politiques de voisinage et d’élargissement, la coopération internationale dans le domaine scientifique et technologique, la diplomatie économique et la sécurité. Pour maintenir l’élan positif de la COP21, une mobilisation politique et diplomatique soutenue sera nécessaire au niveau mondial.
Ainsi qu’en a convenu le Conseil , en 2016 la diplomatie climatique devra être axée sur les points suivants: i) continuer à faire de la lutte contre le changement climatique une priorité stratégique, ii) soutenir la mise en œuvre de l’accord de Paris et des plans relatifs au climat et iii) accroître les efforts visant à prendre en compte la relation entre le climat, les ressources naturelles, y compris l’eau, la prospérité, la stabilité et les migrations.
En ce qui concerne le financement de la lutte contre le dérèglement climatique, l’UE et ses États membres sont résolus à intensifier la mobilisation de fonds destinés à l’action climatique dans le cadre de mesures d’atténuation efficaces et d’une mise en œuvre transparente, afin d’apporter leur contribution à l’objectif des pays développés consistant à mobiliser ensemble chaque année, d’ici à 2020, 100 milliards d’USD provenant d’une grande variété de sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris de nouvelles sources de financement. Les trajectoires d’aide au développement actuelles de l’UE contribueront en grande partie à ce que celle-ci atteigne sa part des 100 milliards d’USD visés. Dans le contexte du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, l’UE s’est engagée à ce que 20 % de son budget général soient alloués à des actions ou des projets en lien avec le climat. Dans le contexte des dépenses externes, cela représente le double du financement de la lutte contre le dérèglement climatique en faveur des pays en développement, et un montant qui pourrait atteindre 14 milliards d’EUR en dépenses en actions pour le climat. Une part croissante de ces ressources seront investies dans des mesures d’adaptation, de facilitation de l’innovation et de renforcement des capacités.
Afin d’aider les pays en développement à atteindre les objectifs de leurs plans relatifs au climat à partir de 2020, les programmes de soutien (comme l’Alliance mondiale contre le changement climatique+) seront consolidés. Dans ce contexte, il importe d’exploiter pleinement les synergies entre le programme d’action d’Addis-Abeba et le programme à l’horizon 2030 et ses objectifs pour le développement durable. C’est également dans cette optique que l’UE participe à l’initiative africaine pour les énergies renouvelables. Dans le cadre des politiques de voisinage et d’élargissement, l’Union poursuivra le dialogue politique avec ses pays partenaires et continuera de les soutenir. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des capacités.
Les négociations bilatérales et multilatérales en cours sur la libéralisation des échanges de biens et services verts devraient être accélérées afin de faciliter les actions menées au niveau mondial pour atténuer le changement climatique et ouvrir des débouchés commerciaux aux entreprises européennes. L’UE devrait en outre continuer à être la première promotrice de résultats ambitieux lors des négociations sur les émissions de gaz à effet de serre au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), ainsi que des négociations au titre du protocole de Montréal.
3.2. Le cadre réglementaire en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030
Après la conférence de Paris sur le climat, tous les pays devront traduire leurs engagements en mesures concrètes. En octobre 2014, le Conseil européen a établi le cadre d’action de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, qui fixe un objectif de réduction ambitieux d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 pour l’ensemble des secteurs de l’économie européenne, ainsi que des objectifs en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie d’au moins 27 % . L’accord de Paris entérine l’approche suivie par l’UE. La mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, tel qu’approuvé par le Conseil européen, fait figure de priorité pour donner suite à l’accord de Paris.
La Commission a déjà entamé ce processus en soumettant une proposition de révision du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), englobant 45 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Au cours des douze prochains mois, la Commission présentera les principales propositions législatives restantes pour mettre en œuvre, d’une manière équitable et financièrement avantageuse, le cadre réglementaire à l’horizon 2030 élaboré à l’échelon de l’UE, en veillant à laisser le maximum de latitude aux États membres et à atteindre le juste milieu entre les actions nationales et celles de l’UE. Pour la prochaine étape, la Commission travaille à l’élaboration de propositions législatives concernant une décision sur la répartition de l’effort et sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (secteur UTCATF). La Commission présentera également une proposition législative visant à mettre en place un mécanisme de gouvernance fiable et transparent et à simplifier les obligations en matière de planification et de rapports concernant les mesures prises dans le domaine de l’énergie et du climat pour l’après-2020.
En outre, la Commission proposera les mesures nécessaires en vue d’adapter le cadre réglementaire de l’UE pour placer l’efficacité énergétique au premier plan et promouvoir le rôle de l’Union en tant que leader mondial des énergies renouvelables, en adéquation avec les conclusions du Conseil européen d’octobre 2014. Il s’agira notamment de repenser le marché de l’énergie de façon à placer les consommateurs au centre du système énergétique, en faisant en sorte de satisfaire à la demande et de renforcer la souplesse du système. Par ailleurs, la Commission a déjà lancé cette année un train de mesures pour une sécurité énergétique durable, afin de relever sans délai les nouveaux défis en matière de sécurité de l’approvisionnement qu’entraîne l’évolution du contexte énergétique mondial.
4. CONCLUSION
Aussi bien en amont que lors de la conférence de Paris, l’UE a été au cœur de la «coalition à niveau élevé d’ambition» formée par des pays développés et en développement. Pour garantir la transition vers une économie à faible intensité de carbone, il est essentiel que l’UE maintienne la même ambition, sur le plan tant intérieur qu’international.
• L’accord de Paris devrait être signé et ratifié dans les meilleurs délais. La proposition de signature de cet accord est annexée à la présente communication.
• L’Union doit renforcer les conditions propices à la transition vers une économie à faible intensité de carbone en s’appuyant sur une panoplie de mesures, de cadres stratégiques et d’instruments interconnectés, tels qu’évoqués dans les dix priorités de la Commission Juncker – notamment le cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique.
• Il importe que l’élaboration du cadre d’action en matière d’énergie et de changement climatique à l’horizon 2030 soit achevée rapidement, conformément aux conclusions du Conseil européen d’octobre 2014. Les propositions législatives à venir devraient faire l’objet d’un examen accéléré par le Parlement européen et le Conseil.
• Toutes les parties devront être prêtes à participer pleinement aux processus de réexamen prévus au titre de l’accord de Paris, visant à garantir la réalisation de l’objectif de maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2 °C et la poursuite des efforts dans le sens d’une limitation à 1,5 °C.
1 () Géopolitique du climat, négociations, stratégies, impacts, François Gemenne, coll. Perspectives géopolitiques, Armand Colin, 2015.
2 () Conséquences économiques à long-terme du changement climatique, Lettre Trésor Eco n°30, février 2008, DGTPE.
3 () OCDE 2016 ? Les conséquences du changement climatique, Éditions OCDE, Paris.
4 () Brown L., Mcgrath P., Stokes B., “Twenty two dimensions of the population problem”, Worldwatch Paper, 5, Washington DC, Worldwatch Institute, 1976.
5 () Op.cit.
6 () Chloé Anne Vlassopoulos, « Des migrants environnementaux aux migrants climatiques : un enjeu définitionnel complexe », Cultures & Conflits 88 | hiver 2012, mis en ligne le 15 mars 2013.
7 () Jacques Véron et Valérie Golae, « Les migrations environnementales sont-elles mesurables ? », bulletin mensuel d’information de l’INED, numéro 522, mai 2015.
8 () Op. cit. p. 72.
9 () Gouverner le climat ? Vingt ans de négociations climatiques internationales, Stephan C. Aykut, Amy Dahan, Editions Sciences Po Les Presses, 2014.
10 () Global Concern about Climate Change, Broad Support for Limiting Emissions, Bruce Stokes, Richard Wike et Jill CarlePew Research Center, Novembre 2015.
11 Sont définis comme tels dans ce rapport les 24 Parties visées à l’Annexe II de la CCNUCC ainsi que les membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE qui ont demandé à participer à cet exercice
12 Soit les Parties non visées à l’Annexe I de la CCNUCC et/ou les destinataires admissibles à l’aide au développement (APD)
13 () Op. cit., p.152.
14 () « Déforestation: le mécanisme onusien REDD+ au centre des critique », interview d’Alan Karsenty, chercheur au CIRAD, 23 novembre 2013.
15 () http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-2015-cop21/les-contributions-nationales-pour-la-cop-21/article/la-carte-mondiale-des-contributions-nationales.
16 () Les INDC, nouveaux outils de coopération internationale pour le climat, Henri Waisman et Céline Ramstein, 26 mars 2015, IDRI.
17 () I4CE – Point Climat n°38 - COP 21 : un succès qui marque « la fin du commencement », Décembre 2015.
18 () Op. Cit.
19 () “State of the Low-Carbon Energy Union: Assessing the EU’s Progress towards its 2030 and 2050 Climate Objectives”, en partenariat avec 7 autres instituts de recherche dans 6 États membres : E3MLab/ICCS (Grèce) ; ENEA (Italie) ; UCL (Royaume-Uni) ; ENERDATA (France) ; Grenoble Applied Economics Lab (France) ; Wise-Europa (Pologne) ; Wuppertal Institut (Allemagne).