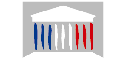______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2017.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1)
sur l’avenir de l’Union européenne,
ET PRÉSENTÉ
PAR Mme Danielle AUROI,
Députée
——
(1) La composition de la commission figure au verso de la présente page.
La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; M. Christophe CARESCHE, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; M. Philip CORDERY, Mme Sandrine DOUCET, MM. Arnaud LEROY, André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Kader ARIF, Philippe BIES, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, M. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Rémi PAUVROS, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY.
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. POUR RENOUER AVEC UN RÉCIT EUROPÉEN, L’URGENCE DE REDÉFINIR ENSEMBLE LE DESSEIN DE L’UNION 9
A. L’UNION DE L’ÉTAT DE DROIT ET DES DROITS FONDAMENTAUX 9
1. Résoudre le « dilemme de Copenhague » 9
2. Faire de l’Union une pionnière dans la définition de droits nouveaux 10
B. RÉAFFIRMER LA VOCATION PROTECTRICE DE L’UNION, DANS UN MONDE DÉSTABILISÉ ET DÉSTABILISANT 10
1. Assurer, en priorité, la sécurité de l’Union 11
2. Affirmer le rôle protecteur de l’Union dans la mondialisation : Vers « l’Europe-providence » ? 12
II. SE DONNER LES MOYENS DE RÉUSSIR L’EUROPE POLITIQUE 13
A. FOURNIR À L’UNION LES MOYENS DE SES AMBITIONS 13
1. Donner à l’Union une véritable capacité budgétaire 13
2. Poursuivre et renforcer les efforts d’investissement de l’Union 13
3. Faire de la lutte contre le dumping fiscal et l’évasion fiscale notre priorité pour financer les biens publics européens 13
B. ASSUMER LE DÉBAT SUR L’INTÉGRATION DIFFÉRENCIÉE 14
1. Former une « avant-garde » d’États membres en capacité de faire avancer l’Union 14
2. La zone euro, échelle naturelle de cette intégration renforcée 15
C. RENOUVELER EN PROFONDEUR LE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE DE L’UNION 16
Examen du rapport d’information 21
Audition de M. Enrico Letta, ancien Premier Ministre d’Italie, président de l’Institut Jacques Delors – Notre Europe 29
Audition de M. Luuk Van Middelaar, historien et philosophe, ancien membre du cabinet du président Herman Van Rompuy, auteur de « Le passage à l’Europe » 39
Audition de M. Christian Lequesne, ancien directeur du Centre d'études et de recherches internationales et professeur de science politique à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes 53
Audition de M. Jean-Claude Piris, ancien directeur général du service juridique du Conseil de l’Union européenne 61
Audition de M. Antoine Vauchez, directeur du Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS) 75
Audition de M. Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation Robert Schuman, chercheur associé à Sciences Po (CERI) et de M. Jean-François Jamet, enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris 87
Audition de M. Michel Theys, journaliste 103
Audition de M. Étienne Balibar, Professeur émérite à l’université de Paris-Ouest 117
Audition de Mme Daniela Schwarzer, directrice de l’institut de recherche de la DGAP (Institut allemand des relations internationales) 127
ANNEXE : CONCLUSIONS ADOPTÉES SUR L’AVENIR DE L’UNION EUROPÉENNE, EN PERSPECTIVE DU SOMMET DE BRATISLAVA 139
« Maintenant, sur une immense terrasse d’Elsinore, qui va de Bâle à Cologne, qui touche aux sables de Nieuport, aux marais de la Somme, aux craies de Champagne, aux granits d’Alsace, — l’Hamlet européen regarde des millions de spectres. (…) Son esprit affreusement clairvoyant contemple le passage de la guerre à la paix. Ce passage est plus obscur, plus dangereux que le passage de la paix à la guerre ; tous les peuples en sont troublés. »
Paul Valéry, 1919, La Crise de l’Esprit
Mesdames, Messieurs,
En juillet 2013, la commission des Affaires européennes a adopté un rapport intitulé « L’avenir de l’Europe : l’audace de la démocratie ». (1)
Moins d’un an avant les élections européennes de 2014, il affirmait que « si l’Europe continue sur cette pente, si nous demeurons figés à regarder l’Union abimer irrémédiablement son lien avec ses peuples, les pires démagogues confisqueront à leur profit un scrutin si crucial ». Nous avions malheureusement vu juste.
Ce rapport était fondé sur la conviction que le débat sur l’avenir de l’Europe ne pouvait plus être différé. Il plaidait pour la mise en œuvre d’un véritable gouvernement économique européen, préférable au fétichisme des chiffres, et pour la création de services publics européens – en premier lieu un service public de la transition énergétique et de l’environnement. Il dressait, enfin, des pistes pour l’approfondissement démocratique de l’Union.
Plus de trois ans après, le constat et les recommandations formulés par ce rapport sont toujours autant d’actualité. Pourquoi, alors, un nouveau rapport sur l’avenir de l’Union ?
Au cours de ces trois dernières années, l’Europe a changé, et le monde a changé.
Le rapport de 2013 était en grande partie une réponse à la crise économique, financière et des dettes souveraines que traversait l’Union. Aujourd’hui, cette crise n’est toujours pas derrière nous. Elle a laissé son empreinte : l’augmentation de la pauvreté, des inégalités, du chômage des jeunes. Par ailleurs, nous ne sommes pas à l’abri que l’Histoire se répète, car les progrès qui ont été faits pour renforcer l’Union économique et monétaire restent largement insuffisants.
Mais c’est désormais une autre crise européenne, la crise migratoire, qui divise l’Union et fait la Une des journaux.
Et, alors que des centaines de milliers de personnes cherchent désespérément à fuir la guerre, les persécutions, les impacts du changement climatique et pour certains à rejoindre l’Union européenne, un État membre a, pour la première fois, décidé d’en sortir. Le vote britannique du 23 juin 2016 constitue une rupture historique absolument majeure, malgré le rôle ambigu que jouait déjà le Royaume-Uni au sein de l’Union. L’Union européenne va s’engager dans les mois à venir dans un processus absolument inédit tant politiquement que juridiquement. L’un des pièges pour l’Union sera de ne pas jeter toutes ses forces dans ces négociations, qui seront forcément chronophages, et de continuer à avancer malgré elles.
Dans le même temps, les perspectives d’une adhésion de la Turquie à l’Union européenne, qui accueille près de trois millions de réfugiés, s’éloignent, tandis que les relations avec la Russie se tendent, notamment autour du conflit ukrainien. Ainsi, après des décennies d’élargissement continu, l’Union vit, pour la première fois, l’expérience du rétrécissement, au risque de se refermer sur elle-même.
En trois ans, le visage de l’Europe a donc profondément évolué. Mais c’est aussi son environnement géopolitique qui s’est transformé, marqué par la montée d’un nationalisme mortifère dans tout le monde occidental. L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis constitue le plus récent de ces bouleversements.
Dans ce contexte de grande instabilité et de succession de crises, il est difficile de penser l’avenir de la construction européenne de manière optimiste, malgré les succès qui ont jalonné ces dernières années – notamment l’accord de Paris sur le climat.
Pourtant, l’Union est plus que jamais nécessaire. Alors que l’instabilité règne et que la guerre gronde un peu partout à ses portes et dans le monde, l’Union européenne est et doit rester la garante de la paix. Comment faire entendre notre voix sans elle ? Alors que la régression démographique et même économique menace, l’Union est une promesse d’avenir face aux coups de boutoirs d’une mondialisation insuffisamment régulée sur son modèle social, face à l’épuisement de notre modèle économique et énergétique, face au rejet par un allié historique de nos valeurs les plus fondamentales. Il est clair que, désunis, nos États seront condamnés aux régressions de tous ordres et à l’impuissance.
Mais il ne suffit pas de dire que l’Union européenne est nécessaire. Il faut réfléchir à ce que pourrait être l’Union européenne de demain, et, surtout, à ce que nous voulons qu’elle soit. Or, l’Union manque aujourd’hui de souffle, d’idées, de volonté politique partagée, et les institutions européennes et les États membres, prisonniers de la gestion de crise et du court terme, peinent à imaginer ce que pourrait être l’Europe à moyen et long terme.
Pour permettre à la Représentation nationale de prendre du recul sur la situation actuelle, la commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale a organisé entre octobre 2016 et janvier 2017 un cycle d’auditions sur l’avenir de l’Union. L’objectif de ce cycle était d’entendre et de questionner des intellectuels et des chercheurs, représentant une pluralité de points de vue, parfois insuffisamment entendus dans le débat public européen.
Le présent rapport, enrichi par ces contributions, complète les précédents travaux de la commission des Affaires européennes sur l’avenir de l’Union, et notamment les conclusions adoptées en septembre 2016, en perspective du sommet de Bratislava (annexées au présent rapport), mais aussi ses travaux sur chacun des secteurs évoqués.
Il dresse des perspectives pour l’Union, à la fin de cette législature nationale et quelques semaines avant l’anniversaire du traité de Rome le 25 mars prochain, sommet au cours duquel de nouvelles propositions pourraient émerger, notamment sur la base du Livre blanc sur l’avenir de l’Union qui sera présenté par la Commission européenne.
De ce cycle d’auditions, il ressort une priorité qui a mis d’accord tous les intervenants que notre commission a entendus ces derniers mois : l’urgence de renouer avec un récit européen.
Avec la construction du marché unique et de l’Union économique et monétaire, l’économie a peu à peu occulté les autres dimensions du projet européen, l’appauvrissant d’autant. Ces deux projets incroyablement ambitieux ont réussi, mais le récit d’une Union porteuse de prospérité économique s’est brisé sur les récifs de la crise économique et financière. Comme l’a souligné Enrico Letta, ancien Premier ministre italien et président de l’Institut Jacques Delors en ouverture du cycle d’auditions sur l’avenir de l’Union européenne : « tout ce qui, dans la construction européenne, n’est pas l’euro et l’économie pure et simple est à l’arrêt depuis une quinzaine d’années. Il en résulte que, pour ses citoyens, l’Europe est devenue synonyme d’économie, de finance et d’euro. (Ainsi) laisser prospérer l’idée que l’Europe se concentre sur ces seuls volets, c’est permettre à des citoyens européens frappés par la crise économique, de trouver en l’Union un bouc émissaire tout désigné ».
Lors de son audition par la commission, Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation Robert Schuman, chercheur associé à Sciences Po (CERI) (2),a notamment souligné l’usure des récits européens plus spécifiquement nationaux qui ont, eux aussi, légitimé la construction européenne auprès de leurs opinions publiques : recherche d’une grandeur passée pour la France, d’une forme de « rédemption » pour l’Allemagne, « utilitarisme » pour les pays du Nord, « sublimation » permettant le passage rapide d’un système politique à un autre et d’un système économique à un autre pour les pays du Sud…
Face à la crise financière puis à la crise migratoire, ces récits européens nationaux ont, pour beaucoup, laissé la place à des récits « euro défiants », dénonçant le manque de solidarité, ou au contraire, rejetant toute solidarité.
Oui, sans aucun doute, l’Union peine manifestement à répondre aux défis qui se succèdent. Non, l’Union européenne n’est pas responsable des maux qui gangrènent aujourd’hui l’Europe. Mais, de par sa nature même, elle en amplifie certains. Comme l’a également souligné Thierry Chopin, « sur le plan économique, l’Union européenne est souvent perçue comme un cheval de Troie de la mondialisation. Sur le plan identitaire, la question de l’identité européenne n’a pas été prise en compte et, comme la nature, plus encore la nature politique, a horreur du vide, cet espace laissé vacant est occupé depuis un certain nombre d’années par les partis populistes et/ou extrémistes. Quant à la crise de la représentation politique, la défiance et la distance croissantes entre les citoyens et leurs représentants est démultipliée à l’échelle européenne, au moins par un effet de distance, et sans doute par le sentiment que les mécanismes de représentation politique sont beaucoup moins ancrés à l’échelle communautaire qu’à l’échelle nationale ».
C’est à ces défis, ô combien complexes, que nous devrons nous atteler collectivement pour préserver la construction européenne, et en définir une ligne d’horizon partagée, seule à même de bâtir collectivement un futur désirable, prospère, pour l’Europe et ses peuples dans leur diversité.
Notre objectif premier doit être de réaffirmer les valeurs de l’Union : la paix, la prospérité, la démocratie, le respect des droits fondamentaux. Ces droits sont notre héritage le plus précieux.
Jean-Claude Piris, lors de son audition par notre commission, rappelait que « ce sont nos valeurs qui nous distinguent, nous, Européens, des autres habitants de la planète, c’est notre conception de l’organisation de la vie en société. L’interdiction du port d’armes, l’interdiction de la torture, l’interdiction de la peine de mort, le droit à l’avortement ou au mariage homosexuel, la sécurité sociale pour tous, la protection des plus pauvres et la lutte contre les inégalités, la lutte contre le changement climatique font rarement débat en Europe occidentale ».
La solidarité, l’ouverture, la tolérance, doivent aujourd’hui être remises au cœur du projet européen, alors que ces valeurs sont aujourd’hui bafouées dans d’autres démocraties occidentales.
Pour cela, nous devrons trouver les conditions d’un dialogue politique apaisé sur la question du respect des droits fondamentaux, pour répondre au « dilemme de Copenhague » auquel est aujourd’hui confrontée l’Union.
En effet, alors que l’adhésion à l’Union est soumise à des critères exigeants, dont l’existence « d’institutions stables garantissant l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection », le contrôle s’exerçant par la suite sur le respect de ces critères par les États membres reste très mince. Le traité sur l’Union européenne prévoit certes à son article 7 un mécanisme ad hoc qui peut permettre de suspendre les droits de vote d’un État membre en cas de violation « grave et persistante » des valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, mais cette « arme nucléaire » est, politiquement, presque impossible à utiliser.
Des efforts importants ont été faits par la nouvelle Commission européenne dans ce domaine. Ainsi, dans une communication du 11 mars 2014, elle a proposé de pallier les difficultés des mécanismes existants en créant un nouveau cadre pour faire face aux violations systémiques de l’État de droit - et n’ayant donc pas vocation à répondre à des cas isolés de violation des droits fondamentaux ou d’erreur judiciaire. Cette nouvelle procédure en trois étapes (évaluation de la situation, recommandation sur l’État de droit, contrôle du suivi de cette recommandation), essentiellement fondée sur le dialogue, a été engagée pour la première fois en janvier 2016 à l’encontre de la Pologne. Elle n’a pas encore abouti.
Depuis décembre 2014, un dialogue politique annuel sur l’État de droit a également été instauré au sein du Conseil.
Il faudra aller plus loin. La piste d’un « semestre européen des droits de l’homme », proposée par le Parlement européen, mérite à cet égard toute notre attention. Une prochaine révision des traités pourrait également permettre de compléter l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union, qui prévoit déjà que la Commission européenne peut intenter une action à l’encontre d’un État membre qui aurait manqué à une obligation, afin de l’autoriser explicitement à intenter une action pour violation systématique des droits fondamentaux.
La mise en place de tels mécanismes nécessitera toutefois une forte volonté politique de la part des États membres. La Commission européenne ne peut pas porter, à elle seule, le poids politique de telles décisions.
L’Union doit également continuer à promouvoir une nouvelle génération de droits fondamentaux, adaptée à nos sociétés, et en premier lieu les droits liés à l’avènement du numérique. Dans un contexte où la sécurité est devenue une priorité, elle aura un rôle clé à jouer dans la préservation de l’équilibre entre sécurité et libertés.
Le Brexit a mis en exergue, entre autres choses, le besoin de protection qu’expriment aujourd’hui de matière très claire les citoyens européens.
Pour Luuk Von Middelaar, historien et philosophe, ancien membre du cabinet du président Herman Van Rompuy (3) ce diagnostic fait aujourd’hui l’objet d’un consensus dans toute l’Union européenne, même si ce besoin de protection a été ressenti par l’opinion et exprimé publiquement plus tôt en France qu’ailleurs : « il y a une dizaine d’années, aux Pays-Bas, le terme « protection », invoqué par M. Sarkozy dès 2007, voire plus tôt encore, était considéré comme une nouvelle blague des Français, impliquant des choses dont on ne voulait pas, en particulier le protectionnisme – les Pays-Bas sont, vous le savez, un pays commerçant. Aujourd’hui, la réaction n’est plus du tout la même, même dans les cercles libéraux : on prend en compte le fait que le curseur se déplace sur l’axe libertés-protection ».
Ce nouvel équilibre entre les libertés offertes par l’Union et la protection qu’elle devrait garantir est pourtant loin d’être évident, car elle a depuis toujours mis l’accent sur le premier volet, au détriment, parfois, des plus fragiles : « l’Union européenne ne sait faire, historiquement, qu’une seule chose : élargir le marché, créer de la liberté et de l’ouverture, abattre les frontières ».
Or, tous les citoyens européens n’ont pas pu profiter de ces libertés formidables offertes par la construction européenne – en premier lieu la liberté de circulation - qui ont avant tout changé le quotidien des citoyens les plus inclus et les plus mobiles.
Pour renouer plus largement avec ces citoyens exclus des bénéfices de l’Union, l’Europe doit porter de manière audible ce discours protecteur. À défaut, ceux-ci ne pourront que se retourner vers la Nation, creuset historique de cette fonction protectrice.
Alors que la paix garantie par la construction européenne semblait acquise, jamais les dangers qui menacent la Pax Europaea n’ont été si graves et concomitants. Pour faire face à ces nouvelles menaces, comme l’a souligné Jean-François Jamet, enseignant à Sciences Po. Paris(4), « l’Europe doit pouvoir porter un discours régalien (…) à un moment où les enjeux internationaux mettent en jeu la capacité collective des Européens à répondre à des transformations géopolitiques mondiales qui les affectent tous ».
C’est d’autant plus le cas que l’Alliance Atlantique apparaît aujourd’hui extrêmement fragilisée, et que l’État ayant le budget de défense le plus élevé d’Europe va quitter l’Union. Les Britanniques ont toujours eu une relation ambigüe à l’Europe de la défense, qui, pour eux, devait demeurer complémentaire et auxiliaire de l’OTAN, et se sont sans cesse opposés à son développement institutionnel : leur départ de l’Union, bien qu’il nous fragilise en termes capacitaires, pourrait constituer une opportunité pour enfin relancer l’Europe de la défense, à partir du concept d’autonomie stratégique européenne.
Toutes les possibilités prévues par le traité de Lisbonne doivent être engagées, et notamment la mise en œuvre de la coopération structurée permanente, et la mise en place d’un Fonds européen de défense.
Alors que, depuis trois ans, l’Allemagne conduit une réflexion stratégique poussée sur sa politique étrangère et de défense nationale, le couple franco-allemand devra être au cœur de cette réflexion.
Évidemment, l’heure est aussi au renforcement de la sécurité intérieure de l’Union, qui doit être unie dans la lutte contre le terrorisme. Pour cela, nous devons améliorer le fonctionnement de l’espace de sécurité et de justice, renforcer la coopération de nos services de police, donner des pouvoirs accrus à Europol et mettre en place dès que possible un parquet européen, dont la compétence serait étendue au terrorisme et à la lutte contre la criminalité transfrontière.
Un tel renforcement de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire et policière implique un très haut niveau de confiance mutuelle, notamment en matière de droits fondamentaux, et avec le développement d’une vision européenne commune de l’équilibre nécessaire entre sécurité et libertés.
L’Europe qui protège ne peut et ne doit pas se réduire à la défense et à la lutte contre le terrorisme : permettre à l’Union de porter un discours régalien, c’est aussi réaffirmer le rôle et le pouvoir régulateur et protecteur de la puissance publique.
L’Union doit porter, dans le monde comme chez elle, une certaine vision de la mondialisation, d’une mondialisation juste, redistributive, respectueuse de l’Humain et de l’environnement. Elle doit être pionnière dans la lutte contre l’évasion fiscale et contre les abus de certaines multinationales.
L’Europe qui protège, c’est aussi - et surtout - l’Europe sociale et l’Europe de l’environnement. L’Europe doit, à nouveau, améliorer le quotidien de ses habitants.
La commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale plaide depuis longtemps pour le développement de la dimension sociale de l’Union, à travers notamment ses travaux sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le renforcement de la garantie pour l’emploi des jeunes, la mise en place d’une assurance chômage européenne complémentaire des systèmes nationaux, le renforcement des règles en matière de détachement des travailleurs, la généralisation de salaires minimaux nationaux et leur convergence progressive, l’adoption d’un socle minimal des droits sociaux. Cette convergence pourrait passer par la mise en œuvre d’un « serpent » de convergence sociale, inspiré du serpent monétaire européen.
Enfin, protéger les citoyens, c’est également protéger l’environnement dans lequel ils vivent : il faut encore renforcer l’action de l’Union en matière de santé environnementale et de protection de la biodiversité. Il est également urgent d’instaurer une taxation carbone aux frontières de l’Union.
Pour gagner toutes ces batailles, l’Union aura besoin d’armes à la hauteur, et en premier lieu de capacités budgétaires réelles et propres.
Le budget dont l’Union dispose – moins de 1 % du PIB – ne peut absolument pas lui permettre de répondre à ses missions – renforcées par le traité de Lisbonne – et aux défis auxquels elle doit faire face aujourd’hui.
Pour cela, elle doit disposer de véritables ressources propres. La perspective du Brexit rend la réflexion sur ce sujet urgente, puisque le départ du Royaume-Uni amputera le budget européen de la contribution nette britannique : le montant à combler pourrait s’élever à environ dix milliards d’euros par an. Mais il offre aussi une occasion unique de supprimer tout mécanisme de « rabais ».
Le rapport du groupe de Haut niveau présidé par Mario Monti, publié en décembre 2016, évoque plusieurs pistes relatives à la création de telles ressources propres, parmi lesquelles une taxe carbone. La réussite de la mise en œuvre de la taxe sur les taxations financières, qui a fait l’objet d’un accord politique en octobre 2016, sera déterminante pour enclencher une dynamique en faveur de financements innovants.
Fin 2014, le montant total des investissements en Europe était de 15 % inférieur à celui de 2007, du fait du ralentissement de la croissance, ainsi que des politiques d’austérité budgétaire.
Le « plan Juncker » a constitué un pas important en direction d’une Europe de l’investissement et le début d’un changement de paradigme, mais il n’est toujours pas à la hauteur des enjeux. Il faut désormais passer à l’échelle supérieure, en doublant les financements accordés, et en donnant la priorité aux investissements dans la transition énergétique.
Cet effort doit aussi s’incarner en Afrique et au Moyen-Orient, à travers la mise en œuvre rapide du nouveau plan d’investissement extérieur européen, annoncé par la Commission européenne en septembre dernier.
3. Faire de la lutte contre le dumping fiscal et l’évasion fiscale notre priorité pour financer les biens publics européens
L’abri fiscal accordé au cœur même de notre maison commune aux multinationales par certains États membres est intolérable, et prive les pouvoirs publics européens de ressources précieuses. Suite aux scandales à répétition révélant au grand jour les avantages accordés par les États membres à des grandes multinationales, les citoyens attendent de l’Union une action ferme et visible dans ce domaine. La Commission européenne a agi courageusement en ce sens, et ses efforts doivent être poursuivis et soutenus.
L’Europe qui protège que votre rapporteure appelle de ses vœux sera plus forte à Vingt-Sept. Elle aurait été encore plus forte à Vingt-Huit. Mais sur certains sujets, sur lesquels l’Union peine aujourd’hui à avancer, il semble aujourd’hui inéluctable de former un noyau dur d’États voulant aller plus loin – l’Europe des avant-gardes.
Ces choix auront des implications très fortes sur nos institutions communes, qui fonctionnent actuellement sur le principe de la représentation de tous les membres de l’Union. Tout l’enjeu d’une telle évolution sera de concilier différenciation et préservation de l’unité, de la cohérence mais aussi de la lisibilité de l’Union.
Le débat sur « l’intégration différenciée » a été évoqué à de multiples reprises lors de ce cycle d’auditions. Ce n’est pas un débat nouveau : la France et l’Allemagne ont, à plusieurs moments de l’histoire européenne, porté cette idée. Dès 1994, Wolfgang Schäuble et Karl Lamers avançaient l’idée d’une « KernEuropa », à laquelle firent plus tard écho le discours du Président Jacques Chirac à Berlin en juin 2000 dans lequel il parle de « groupes pionniers », celui de Jacques Delors à Berlin en janvier 2001 sur « l'avant-garde en tant que moteur de l'intégration européenne », ou de Joschka Fischer, en mai 2000, déclarant que « la seule question sera alors de savoir, quand le moment sera venu, qui fera partie de cette avant-garde et si ce centre de gravité se formera au sein ou en dehors des traités ».
Le Brexit a rendu plus urgente encore cette réflexion fondamentale sur l’intégration différenciée : que répondre aux États ne souhaitant pas d’une « Union sans cesse plus étroite » ? La sortie de l’Union est-elle leur seule issue ?
Nous pouvions craindre que les négociations extrêmement difficiles qui s’annoncent avec le Royaume-Uni rendent ce sujet de l’intégration tabou, alors que l’unité des Vingt-Sept sera une clé de la réussite de ces négociations pour l’Union. Évidemment, l’Europe des « cercles concentriques » n’est pas exempte de risques de fragmentation et de division. Christian Lequesne, professeur à Sciences Po Paris (5), a rappelé à juste titre que toute la difficulté de parler de « cercles concentriques » sera de faire comprendre aux pays d’Europe centrale qu’ils ont vocation à faire partie de ce premier cercle. La peur de ne pas faire partie de ce « noyau dur » existe également dans certains pays du Sud, et il faudra être très vigilant pour ne pas créer de sentiment d’exclusion.
L’intégration différenciée sera certainement au cœur des débats lors du sommet de Rome le 25 mars prochain.
Dans leur contribution commune à ces débats, les États du Benelux ont clairement indiqué que « différentes voies d’intégration et de coopération renforcée pourraient fournir des réponses efficaces aux défis qui touchent les États membres de façon différente. Ces arrangements devraient être inclusifs et transparents, avec l’investissement le plus important possible des autres États membres et des institutions européennes ». La chancelière allemande a également acté l’inéluctabilité de cette intégration différenciée, en déclarant « qu’il y aura une Union européenne avec différentes vitesses et que tout le monde ne prendra pas part à chaque fois à toutes les étapes d’intégration ».
Il faudra faire œuvre de pédagogie pour montrer que cette idée d’une Europe différenciée n’a pas pour but d’exclure mais de permettre aux États membre de librement choisir leur mode de participation au projet européen. Il faudra toutefois être vigilant : comme l’a rappelé le Président de la République lors du sommet de la Valette le 3 février 2017, « L'Europe, ce n'est pas un tiroir-caisse, ce n'est pas un restaurant self-service où l’on vient chercher ce dont on a besoin ».
Le format le plus évident de cette intégration différenciée est évidemment la zone euro.
Comme l’a rappelé Mme Daniela Schwarzer (6), directrice de la DGAP (Institut allemand des relations internationales), « il existe de forts risques dans la zone euro, notamment dans le secteur bancaire, en Italie mais aussi en Allemagne. Nous devons nous préparer politiquement à une nouvelle phase de crise ».
Le rapport de nos collègues Philip Cordery et Arnaud Richard, adopté par la commission des Affaires européennes en novembre dernier (7), le soulignait très clairement : afin d’éviter de nouvelles crises économiques et d’augmenter la résilience de l’espace économique européen, il est nécessaire et urgent d’aller plus loin dans la consolidation de la zone euro.
Pour cela, il faudra accepter une forme d’intégration différenciée, au moins à court terme, et doter la zone euro d’un gouvernement économique. Le dialogue franco-allemand sur cette question doit être poursuivi : comme l’a souligné Mme Daniela Schwarzer, même si l’Allemagne a longtemps été réticente à ce renforcement de la gouvernance de l’Union économique et monétaire, craignant un découplage entre la zone euro et le marché intérieur, il existe aujourd’hui un consensus plus important sur la nécessité d’un cadre institutionnel spécifique à la zone euro.
Le saut qualitatif que votre rapporteure appelle de ses vœux ne peut se penser sans les citoyens et leurs représentants.
Comment créer l’Europe sociale, l’Europe fiscale, sans légitimité démocratique véritable ? La réflexion sur l’avenir de l’Union ne peut faire l’impasse sur la réforme des institutions.
À court terme, une réforme institutionnelle d’ampleur semble compromise. La temporalité dans laquelle nous nous inscrivons aujourd’hui est très loin d’être favorable à une réforme en profondeur des institutions européennes. Tous les intervenants auditionnés ont d’ailleurs exclu l’idée d’une révision des traités dans les trois ans à venir.
Cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir, pour la suite, aux principes et aux modalités de l’approfondissement démocratique de l’Union.
La multiplication des référendums sur l’Union - référendum britannique évidemment, mais aussi référendum danois du 3 décembre 2015 sur l’opt-out en matière de justice et de sécurité, référendum néerlandais du 6 avril 2016 sur l’accord d’adhésion avec l’Ukraine, référendum du 2 octobre 2016 en Hongrie sur la relocalisation des réfugiés – est un symptôme sans appel. En l’absence d’amélioration du processus démocratique européen, ce sont directement les peuples, par voie référendaire, qui s’approprieront cette fonction : le blocage institutionnel, face à cette confrontation des légitimités, sera inéluctable.
Prenons garde à ne pas nous focaliser sur le serpent de mer qu’est le déficit démocratique européen, et de le replacer dans un contexte plus global. Malheureusement, la démocratie représentative est en crise au niveau national également, et pas uniquement en Europe. Les chiffres le montrent : selon Eurostat, si un tiers – seulement – des Européens ont confiance dans l'Union européenne (33 %), cela reste davantage que la confiance qu’ils ont dans leurs institutions nationales - 28 % des Européens ont confiance dans leur parlement national et 27 % ont confiance dans leur gouvernement national.
La pleine implication des parlements nationaux dans le processus décisionnel européen sera l’une des clés de cet approfondissement démocratique.
La réponse à cet échec démocratique ne peut pas résider dans une théorie des « vases communicants », comme l’a souligné Etienne Balibar. (8) Le renforcement de la démocratie européenne ne peut pas se faire au détriment du renforcement de la démocratie nationale, et inversement. Ils doivent se conforter l’un l’autre.
Le contrôle de subsidiarité instauré par le traité de Lisbonne, s’il est une véritable avancée, trouve toutefois ses limites dans son caractère négatif, et est dans la pratique fréquemment détourné pour porter davantage sur le fond des textes que sur la question de la subsidiarité. Ce mécanisme devrait, en premier lieu, être étendu à un contrôle de proportionnalité, pendant logique du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité de Lisbonne.
Surtout, pour pallier les insuffisances du contrôle de subsidiarité, les parlements nationaux ont mis en place de manière informelle, depuis deux ans, un mécanisme de « carton vert » permettant à un nombre de parlements significatifs de proposer des amendements, de compléter « positivement » les textes européens, et même de proposer des idées de textes. Votre rapporteure a elle-même proposé un projet de « carton vert » sur la responsabilité sociétale des entreprises dans le droit européen, qui a été soutenu par onze autres parlements.
La formalisation juridique d’un tel instrument constituerait un pas important dans le sens du renforcement du rôle des Parlements nationaux et de leur contribution au débat européen.
Il faudra aller plus loin, sans pour autant se raccrocher à la chimère d’un « droit de veto » pour les parlements nationaux, qui condamnerait le système institutionnel de l’Union à aller de blocages en blocages, en confrontant en permanence deux sources de légitimité.
Garantir la pleine implication des parlements nationaux, interlocuteurs historiques et privilégiés des peuples, et principaux responsables à leurs yeux des politiques économiques menées, grâce à la mise en place d’une Chambre des Parlements nationaux, pourrait passer par la création d’un « Sénat » européen, réunissant des représentants des parlements nationaux.
A minima, un Congrès annuel, composé des membres du Parlement européen et de représentants des parlements nationaux, pour entendre le discours sur l’État de l’Union du président de la Commission européenne et débattre des priorités de l’Union, devrait être organisé.
Les enceintes intergouvernementales, au premier rang desquelles le Conseil européen, ont été considérablement renforcées au fil des crises.
Ces organes intergouvernementaux ne peuvent, par essence, définir et défendre l’intérêt général européen. Par ailleurs, leur fonctionnement échappe en grande partie au regard des citoyens.
Or, les citoyens doivent pouvoir identifier clairement les grandes propositions en débat et les responsables des politiques menées au niveau de l’Union.
L’Union doit donc puiser ses forces dans une Commission européenne rénovée, et dans une démocratie parlementaire renforcée.
Le nouveau président de la Commission européenne, conforté politiquement par la procédure du « Spitzenkandidat », a impulsé un souffle nouveau à une institution qui agonisait, en la recentrant sur des objectifs politiques clairs, et en la réorganisant autour de « pôles » de commissaires. Il importe désormais d’avancer vers la fusion des postes de président du Conseil européen et de président de la Commission européenne, que le traité de Lisbonne a choisi de ne pas interdire et dont notre commission s’est faite l’avocat au moment de la Convention sur l’avenir de l’Europe, sur l’impulsion de notre collègue Pierre Lequiller.
Le Parlement européen, quant à lui, doit être le cœur de la démocratie commune.
Seule l’émergence d’un vrai espace public européen, et donc d’une dramaturgie politique commune, peut permettre de donner au Parlement des Européens toute la place qu’il mérite.
Pour cela, il faudra, sans pour autant réformer les traités :
– créer une circonscription transnationale dans laquelle serait élue une part des députés européens ;
– consacrer la procédure des « Spitzenkandidaten », c’est-à-dire la désignation explicite par les partis de leurs candidats à la présidence de la Commission européenne en amont des élections – qui a constitué un progrès très important lors des élections européennes de 2014.
Dès lors que sa représentation l’affranchirait de la suspicion de promouvoir les intérêts nationaux, il pourrait être envisagé de lui donner, enfin, le droit d’initiative qui est aujourd’hui réservé à la seule Commission européenne.
L’Europe est aujourd’hui suspendue aux élections prévues en 2017, notamment françaises et allemandes. Il sera évidemment difficile d’amorcer des tournants majeurs avant l’automne de cette année. Ce serait toutefois une erreur de voir ces échéances électorales comme un obstacle. Elles ne sont qu’une des nombreuses et nécessaires étapes de la vie démocratique européenne. Comme le soulignait Enrico Letta, dans le contexte mouvant et – il faut le reconnaitre - difficile actuel, elles constituent aussi une opportunité : celle de mettre l’avenir de l’Union au cœur des débats politiques nationaux.
Parler de l’Union, oui, mais sans faire d’un « Bruxelles » abstrait un bouc émissaire parfois si pratique, comme c’est si souvent le cas dans nos débats politiques. C’est ce que la classe politique britannique a fait depuis des années : nous savons désormais où cela l’a mené. Cela impliquera également de rompre avec l’ambiguïté fondamentale qui subsiste entre nos élus et l’Europe, partagés entre un discours pro-européen sincère, et une grande frustration à l’idée d’être privés de certaines de leurs prérogatives. Fiers des avancées obtenues grâce à l’Europe, les mêmes sont prompts à la rendre responsable de tout ce qui ne va pas.
L’Union ne se construit pas sans partage de souveraineté. Ayons le courage de défendre une certaine idée de la construction européenne, pour être efficaces, ensemble, au service des peuples.
La Commission s’est réunie le 21 février 2017, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information.
La présidente Danielle Auroi. En juillet 2013, la commission des affaires européennes avait adopté un rapport intitulé « L’avenir de l’Europe : l’audace de la démocratie ».
Ce rapport était fondé sur la conviction que le débat sur l’avenir de l’Europe ne pouvait plus être différé. Il plaidait pour la mise en œuvre d’un véritable gouvernement économique européen, préférable au fétichisme des chiffres, et pour la création de services publics européens, en premier lieu un service public de la transition énergétique et de l’environnement. Il dressait, enfin, des pistes pour l’approfondissement démocratique de l’Union, grâce notamment à la création d’une Assemblée des peuples européens, constituée de représentants des parlements nationaux.
Plus de trois ans après, le constat et les recommandations formulés par ce rapport sont, pour moi, toujours autant d’actualité.
Pourquoi, alors, un nouveau rapport sur l’avenir de l’Union ?
Au cours de ces trois dernières années, l’Europe a changé, et le monde a changé.
Le rapport de 2013 était en grande partie une réponse à la crise économique, financière et des dettes souveraines que traversait l’Union. Aujourd’hui, cette crise n’est toujours pas derrière nous. Elle a laissé son empreinte : l’augmentation de la pauvreté, des inégalités, du chômage des jeunes. Cette empreinte peine à s’effacer.
Par ailleurs, nous ne sommes pas à l’abri que l’Histoire se répète, car les progrès qui ont été faits pour renforcer l’Union économique et monétaire restent largement insuffisants.
Mais c’est désormais une autre crise européenne, la crise migratoire, qui divise l’Union et fait la Une des journaux.
Pendant que des centaines de milliers de personnes cherchent désespérément à rejoindre l’Union européenne, un État membre a, pour la première fois, décidé d’en sortir. Le vote britannique du 23 juin 2016 constitue une rupture historique absolument majeure. Après des décennies d’élargissement continu, l’Union vit, pour la première fois, l’expérience du rétrécissement, et va s’engager dans les mois à venir dans un processus absolument inédit tant politiquement que juridiquement.
En trois ans, le visage de l’Europe a donc profondément changé. Mais c’est aussi son environnement géopolitique qui s’est transformé, marqué par la montée d’un nationalisme mortifère dans tout le monde occidental. L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis constitue le plus récent de ces bouleversements.
Dans ce contexte de grande instabilité et de succession de crises, il est donc difficile de penser l’avenir de la construction européenne de manière optimiste, malgré les succès qui ont jalonné ces dernières années – je pense notamment à l’accord de Paris sur le climat ou le Plan Juncker, même si les efforts d’investissement de l’Union doivent encore aller beaucoup plus loin.
Pourtant, l’Union est plus que jamais nécessaire. Comment faire entendre notre voix dans le monde sans elle, alors que l’Europe est condamnée à devenir un nain démographique ? Face à la déstabilisation sociale engendrée par une mondialisation insuffisamment régulée, face à l’épuisement de notre modèle économique et énergétique, face au rejet par un allié historique de nos valeurs les plus fondamentales, il est aujourd’hui clair que, désunis, nos États seront condamnés à rester impuissants.
Mais il ne suffit pas de dire que l’Union européenne est nécessaire. Il faut réfléchir à ce que pourrait être cette Union dès demain, et, surtout, à ce que nous voulons qu’elle soit. Or, l’Union manque aujourd’hui de souffle, d’idées, de visions, et les institutions européennes et les États membres, prisonniers de la gestion de crise et du court terme, peinent à imaginer ce que pourrait être l’Europe même dans dix ans.
Pour nous permettre de prendre du recul, j’ai souhaité que nous organisions entre octobre 2016 et janvier 2017 un cycle d’auditions sur l’avenir de l’Union. L’objectif de ce cycle n’était pas de répondre, mais d’écouter, de revisiter, parfois de bousculer et de déconstruire, pour ouvrir sur de nouveaux horizons. Nous avons ainsi entendu des intellectuels et des chercheurs, représentant une pluralité de points de vue, souvent insuffisamment entendus dans le débat public européen classique.
Le rapport que je vous propose, enrichi par les comptes rendus de nos différentes auditions qui y seront annexés, complète les précédents travaux de la commission des affaires européennes sur l’avenir de l’Union, et notamment les conclusions adoptées en septembre 2016. Il dresse des perspectives pour l’Union, à la fin de cette législature nationale et quelques semaines avant l’anniversaire du traité de Rome le 25 mars prochain, sommet au cours duquel de nouvelles propositions pourraient émerger.
De ce cycle d’auditions, il ressort une priorité qui aura mis d’accord tous les intervenants : l’urgence de renouer avec un récit européen. Avec la construction du marché unique et de l’Union économique et monétaire, l’économie est devenue le cœur du projet européen. Ces deux projets incroyablement ambitieux ont réussi, mais le récit d’une Union porteuse de prospérité économique s’est brisé sur les récifs de la crise économique et financière.
Thierry Chopin, lors de son audition, a également souligné l’usure des récits européens plus spécifiquement nationaux qui ont, eux aussi, légitimé la construction européenne auprès de leurs opinions publiques : recherche d’une grandeur passée pour la France, d’une forme de « rédemption » pour l’Allemagne, « utilitarisme » pour les pays du Nord, « sublimation » permettant le passage rapide d’un système politique à un autre et d’un système économique à un autre pour les pays du Sud…
Face à la crise financière puis à la crise migratoire, ces récits européens nationaux ont, pour beaucoup, laissé la place à des récits « euro défiants », chaque fois articulés autour du manque de solidarité, ou au contraire, du refus de cette solidarité.
Pour renouer avec ce récit européen, nous devons nous mettre d’accord, à nouveau, sur ce que nous attendons de l’Union.
Notre premier objectif doit être de réaffirmer les valeurs de l’Union : la paix, la démocratie, le respect des droits fondamentaux, alors que ces valeurs sont aujourd’hui bafouées dans d’autres démocraties occidentales. Nous devrons trouver les conditions d’un dialogue politique apaisé sur la question du respect des droits fondamentaux : un « semestre européen des droits de l’homme », mécanisme d’évaluation annuel du respect de la démocratie, de l’État de droit, et des droits fondamentaux, pourrait par exemple être mis en place, mais cela ne se fera pas sans heurts.
En deuxième lieu, notre priorité doit être de réaffirmer la vocation protectrice de l’Union, dans un monde déstabilisé et déstabilisant. Ce nouvel équilibre entre les libertés offertes par l’Union et la protection qu’elle devrait créer est pourtant loin d’être évident car elle a depuis toujours mis l’accent sur le premier volet, au détriment, parfois, des plus fragiles.
Alors que la paix garantie par la construction européenne semblait acquise, les dangers qui menacent aujourd’hui l’Union à l’extérieur comme à l’intérieur de ses frontières sont à la fois graves et concomitants. Comme l’a souligné Jean-François Jamet lors de son audition, « l’Europe doit pouvoir porter un discours régalien (…) à un moment où les enjeux internationaux mettent en jeu la capacité collective des Européens à répondre à des transformations géopolitiques mondiales qui les affectent tous ».
C’est d’autant plus le cas que l’Alliance Atlantique apparaît aujourd’hui très fragilisée. Le Brexit et l’évolution de la politique étrangère américaine doivent nous conduire à relancer l’Europe de la défense en priorité. Alors que, depuis trois ans, l’Allemagne conduit une réflexion stratégique poussée sur sa politique étrangère et de défense, le couple franco-allemand devra être au cœur de cette réflexion.
L’heure est aussi au renforcement de la sécurité intérieure de l’Union, qui doit être unie face à la lutte contre le terrorisme. Pour cela, nous devons améliorer le fonctionnement de l’espace de sécurité et de justice, et mettre en place dès que possible un parquet européen, dont la compétence serait étendue au terrorisme et à la lutte contre la criminalité transfrontière. Un tel renforcement de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire et policière ne sera possible qu’avec un très haut niveau de confiance mutuelle, notamment en matière de droits fondamentaux. Nous devons travailler à forger une vision européenne de l’équilibre nécessaire entre sécurité et liberté.
L’Europe qui protège ne peut pas et ne doit pas se réduire à la défense et à la lutte contre le terrorisme : permettre à l’Union de porter un discours régalien, c’est aussi réaffirmer le rôle et le pouvoir régulateur et protecteur de la puissance publique. L’Union doit porter, dans le monde comme chez elle, une certaine vision de la mondialisation, d’une mondialisation juste, redistributive, respectueuse de l’Humain et de l’environnement. Elle doit être pionnière dans la lutte contre l’évasion fiscale.
L’Europe qui protège, c’est aussi - et surtout - l’Europe sociale et l’Europe de l’environnement. Notre commission plaide depuis longtemps pour le développement de la dimension sociale de l’Union, à travers notamment l’adoption d’un socle minimal des droits sociaux, la coordination des systèmes de sécurité sociale, un renforcement de la garantie pour l’emploi des jeunes, la mise en place d’une assurance chômage européenne, complémentaire des systèmes nationaux, la généralisation de salaires minimaux nationaux et leur convergence progressive. Nous devons réfléchir à la mise en place d’un « serpent » de convergence fiscale et sociale, inspiré du serpent monétaire européen.
L’Europe peut, à nouveau, améliorer le quotidien de ses habitants. Elle se doit de protéger l’environnement dans lequel ils vivent : renforçons l’action de l’Union en matière de santé environnementale et de protection de la biodiversité. Mettons en place une taxation carbone aux frontières de l’Union.
S’interroger sur le « pourquoi » de la construction européenne est absolument fondamental. Mais nous devons aussi nous pencher sur le « comment ».
Pour gagner toutes ces batailles, l’Union aura besoin d’armes à la hauteur, et en premier lieu de véritables capacités budgétaires. Pour cela, elle devra disposer de véritables ressources propres. Le rapport du groupe de Haut niveau présidé par Mario Monti publié en décembre 2016 évoque plusieurs pistes relatives à la création de telles ressources propres, parmi lesquelles une taxe carbone.
L’Europe qui protège que j’appelle de mes vœux sera plus forte à Vingt-Sept. Elle aurait été encore plus forte à Vingt-Huit. Mais sur certains sujets, sur lesquels l’Union peine aujourd’hui à avancer, il semble aujourd’hui inéluctable de former un noyau-dur d’États voulant aller plus loin – l’Europe des avant-gardes. Ces choix auront des implications très fortes sur nos institutions communes, qui fonctionnent actuellement sur le principe de la représentation de tous les membres de l’Union.
Le débat sur « l’intégration différenciée » a été évoqué à de multiples reprises lors de ce cycle d’auditions.
Le Brexit a rendu plus urgente encore cette réflexion fondamentale sur l’intégration différenciée : que répondre aux États ne souhaitant pas d’une « Union sans cesse plus étroite » ? La sortie de l’Union est-elle leur seule issue ?
Nous pouvions craindre que les négociations extrêmement difficiles qui s’annoncent avec le Royaume-Uni rendent ce sujet de l’intégration tabou, alors que l’unité des Vingt-Sept sera une clé de la réussite de ces négociations pour l’Union. L’Europe des « cercles concentriques » n’est pas exempte de risques de fragmentation et de division. Christian Lequesne, lors de son audition, a rappelé à juste titre que toute la difficulté de parler de « cercles concentriques » sera de faire comprendre aux pays d’Europe centrale qu’ils ont vocation à faire partie de ce premier cercle. La peur de ne pas faire partie de ce « noyau dur » existe également dans certains pays du Sud, et il faudra être très vigilant pour ne pas créer de sentiment d’exclusion – je pense à nos amis grecs entre autres.
L’intégration différenciée sera certainement au cœur des débats lors du sommet de Rome le 25 mars prochain.
Dans leur contribution commune à ces débats, les États du Benelux ont clairement indiqué que « différentes voies d’intégration et de coopération renforcée pourraient fournir des réponses efficaces aux défis qui touchent les États membres de façon différente. Ces arrangements devraient être inclusifs et transparents, avec l’investissement le plus important possible des autres États membres et des institutions européennes ». La chancelière allemande a également acté l’inéluctabilité de cette intégration différenciée, en déclarant « qu’il y aura une Union européenne avec différentes vitesses et que tout le monde ne prendra pas part à chaque fois à toutes les étapes d’intégration ».
Le format le plus évident de cette intégration différenciée est évidemment la zone euro. Le rapport de MM. Cordery et Richard adopté par notre commission en novembre dernier le soulignait très clairement : afin d’éviter de nouvelles crises économiques et d’augmenter la résilience de l’espace économique européen, il est nécessaire et urgent d’aller plus loin dans la consolidation de la zone euro. Pour cela, il faudra accepter une forme d’intégration différenciée, au moins à court terme, et doter la zone euro d’un gouvernement économique. Le dialogue franco-allemand sur cette question doit être poursuivi : même si l’Allemagne a longtemps été réticente à ce renforcement de la gouvernance de l’UEM, il existe aujourd’hui outre-Rhin un consensus plus important sur la nécessité d’un cadre institutionnel spécifique à la zone euro.
Enfin, le saut qualitatif que nous souhaitons impose de renouveler en profondeur le fonctionnement démocratique de l’Union. L’Union politique ne peut se penser sans les citoyens et leurs représentants. C’est pourquoi cette réflexion sur l’avenir de l’Union ne peut faire l’impasse sur la réforme des institutions.
La temporalité dans laquelle nous nous inscrivons aujourd’hui est très loin d’être favorable à une réforme en profondeur des institutions européennes. Tous les intervenants auditionnés ont d’ailleurs exclu l’idée d’une révision des traités dans les trois ans à venir.
Cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir, pour la suite, aux modalités de l’approfondissement démocratique de l’Union. La multiplication des référendums sur l’Union - référendum britannique évidemment, mais aussi référendum danois sur l’opt-out en matière de justice et de sécurité, référendum néerlandais, l’accord d’adhésion avec l’Ukraine, référendum hongrois sur la relocalisation des réfugiés – est un symptôme sans appel. En l’absence d’amélioration du processus de légitimation démocratique, ce sont directement les peuples qui s’approprieront cette fonction.
Prenons soin de ne pas nous focaliser sur le serpent de mer qu’est le déficit démocratique européen, et de le replacer dans un contexte plus global. Malheureusement, la démocratie représentative se porte également mal au niveau national, et pas seulement en Europe.
La réponse à cet échec démocratique ne peut pas résider dans une théorie des « vases communicants », comme l’a souligné Etienne Balibar lors de son audition. Le renforcement de la démocratie européenne ne peut pas se faire au détriment du renforcement de la démocratie nationale, et inversement : les deux sont indispensables. La pleine implication des parlements nationaux dans le processus décisionnel européen sera l’une des clés du passage démocratique de l’Union.
L’Union doit donc puiser ses forces dans une démocratie parlementaire renforcée, et dans une Commission européenne rénovée.
En effet, nous devons nous battre pour améliorer et défendre la méthode communautaire. Les enceintes intergouvernementales, au premier rang desquelles le Conseil européen, ont été considérablement renforcées au fil des crises. Or, ces organes intergouvernementaux ne peuvent, par essence, définir et défendre l’intérêt général européen. Par ailleurs, leur fonctionnement échappe en grande partie au regard des citoyens.
L’Europe est aujourd’hui suspendue aux élections françaises et allemandes. Il sera évidemment difficile d’amorcer des tournants majeurs avant l’automne 2017. Ce serait toutefois une erreur de le voir comme un obstacle, et ces élections à venir sont aussi une opportunité : celle de mettre l’avenir de l’Union au cœur des débats politiques nationaux.
Audition de M. Enrico Letta, ancien Premier Ministre d’Italie, président de l’Institut Jacques Delors – Notre Europe
Compte rendu du mercredi 5 octobre 2016
Mme la présidente Danielle Auroi. Nous sommes heureux de recevoir M. Enrico Letta, que je remercie d’avoir eu la gentillesse de répondre à notre invitation. Nous démarrons avec vous, Monsieur le président, un cycle d’auditions sur l’avenir de l’Union. Ces auditions visent à nous aider à prendre du recul, dans une période extrêmement troublée, et à formuler des propositions.
Fin connaisseur des affaires européennes, Européen convaincu et engagé, vous êtes actuellement président de l’un des principaux think-tanks français qui réfléchit aux questions européennes, l’Institut Jacques Delors - Notre Europe. En Italie, vous avez été ministre pour les affaires communautaires entre 1998 et 1999, député européen de 2004 à 2006, président du Conseil en 2013 et 2014. Votre éclairage sur la situation actuelle est important dans une période où la configuration Paris-Rome-Berlin est de plus en plus présente – et, vous le savez, nous nous sommes battus depuis le début de la législature pour que Rome soit associée au couple franco-allemand – mais reste fragile, comme l’ont montré les critiques formulées par le Président du Conseil Matteo Renzi à l’issue du sommet de Bratislava, notamment sur le traitement de la question des réfugiés. Sans doute nous direz-vous quelques mots de l’euroscepticisme, qui monte dans la population italienne comme il est monté dans la population française.
Ma première question est provocatrice : trois mois après le référendum britannique, croyez-vous que l’on puisse encore sauver l’Union ? Plus précisément, pensez-vous que les décisions prises lors du sommet de Bratislava y contribueront, ou s’est-on limité à traiter de business as usual ?
Comment envisagez-vous la suite de la construction européenne ? Doit-elle se faire autour d’un noyau dur d’États voulant aller plus loin – « l’Europe des avant-gardes » ? Ne court-on pas le risque de créer une Europe « à la carte » ou au minimum à plusieurs vitesses ? Que pensez-vous de la proposition de la Fondation Bruegel, qui a fait beaucoup de bruit en suggérant un « partenariat continental » qui permettrait de formaliser une Union à deux vitesses ?
Quelle est votre appréciation sur l’évolution de la Pologne et la Hongrie et leurs liens avec les autres pays de l’Union, singulièrement au lendemain du référendum « raté » sur la politique européenne de répartition des réfugiés voulu par M. Viktor Orbán ? Quel jugement portez-vous sur l’état du moteur franco-allemand ?
Pensez-vous possible et, surtout, souhaitable de procéder à de nouvelles réformes institutionnelles à moyen terme, ou bien le nouveau souffle dont l’Union a si grand besoin doit-il s’obtenir par d’autres types de réformes ? Comment approfondir la démocratie et l’espace politique européens, et quel rôle donner aux Parlements nationaux dans ce cadre ? Peuvent-ils être un des éléments de la relance de l’Union européenne ? Enfin, l’Union s’est construite au lendemain des atrocités de la Deuxième guerre mondiale pour garantir l’amitié entre les peuples. Alors que les idées extrémistes se propagent et que la haine resurgit malheureusement dans presque tous les pays membres, pensez-vous qu’il y a un avenir pour l’idéal de paix que représentait l’Union européenne ?
M. Enrico Letta, ancien Premier ministre d’Italie, président de l’Institut Jacques Delors – Notre Europe. L’invitation que vous m’avez faite de venir partager avec vous quelques réflexions sur l’état de l’Europe et son avenir m’honore. Le fait que le centre de mes activités, à la présidence de l’Institut Jacques Delors et à l’École des affaires internationales de Sciences Po, soit désormais à Paris, me donne des perspectives variées sur les sujets que vous avez abordés.
Je fus membre du Parlement italien de 2001 à 2004 puis de 2006 à 2015, et député européen de 2004 à 2006. Ces deux expériences m’avaient déjà convaincu – et je le suis plus que jamais – que les assemblées parlementaires ont un rôle décisif à jouer dans la construction de l’Europe. Parce qu’elles en ont trop longtemps été tenues à l’écart, l’Union européenne, bâtie par les seuls gouvernements, souffre d’un grave problème de légitimité. Les parlements nationaux et le Parlement européen doivent travailler ensemble, dans une dynamique visant à démocratiser l’Union davantage encore et à rapprocher les peuples de la construction européenne. Pour avoir également participé au Conseil européen, je puis affirmer que ce n’est pas faire prendre la bonne voie à l’Europe que de donner aux gouvernements un rôle prédominant. Un rééquilibrage s’impose : c’est une condition essentielle de la relance de l’idée européenne, j’en ai la conviction profonde.
J’insiste sur la nécessité d’un travail commun. L’esprit de compétition et la méfiance réciproque qui affleurent trop souvent entre les parlements nationaux et le Parlement européen sont sans objet et doivent être éliminés absolument puisque les rôles sont différents mais complémentaires. Il faut en finir avec une situation telle que, le rôle des parlements nationaux dans la construction européenne n’étant pas assez marqué, ils n’y accordent depuis des décennies qu’une attention marginale. Vous aurez compris que, de mon point de vue, toute réflexion sur la relance de l’Union suppose, pour commencer, de revoir la place accordée aux parlements dans la construction européenne.
Cela me conduit à évoquer le désarroi des Européens et leur manque de confiance envers l’Union et même l’idée européenne. On ne saurait concevoir l’Union contre les citoyens mais partout la méfiance se manifeste, et parfois même le désespoir. Comment provoquer un sursaut de confiance ? Le Conseil européen de Lisbonne s’est engagé en faveur de l’Europe de la connaissance mais, pour les raisons objectives que sont le rejet du traité constitutionnel et la crise qui s’éternise depuis 2008, tout ce qui, dans la construction européenne, n’est pas l’euro et l’économie pure et simple est à l’arrêt depuis une quinzaine d’années. Il en résulte que, pour ses citoyens, l’Europe est devenue synonyme d’économie, de finance et d’euro. Ce tournant a changé la donne : on a oublié que l’Union n’est pas que cela. De plus, laisser prospérer l’idée que l’Europe se concentre sur ces seuls volets, c’est permettre à des citoyens européens frappés par la crise économique, parfois très durement – rappelons-nous que le taux de chômage des jeunes est monté jusqu’à 40 % en Italie, 50 % en Espagne, 60 % en Grèce ! – de trouver en l’Union un bouc émissaire tout désigné : si l’Europe c’est l’économie et la finance et que l’économie va si mal, il est normal de considérer qu’elle est responsable de tout.
Autant dire qu’il n’y aura pas de relance de l’idée européenne possible aussi longtemps que l’action de l’Union restera circonscrite à la finance, à l’économie et à l’euro, aussi longtemps que l’on ne redonnera pas du souffle aux idées qui ont sous-tendu sa création et dont l’importance est plus grande encore qu’il y a soixante ans. Nos pays doivent former un ensemble uni car c’est le seul moyen dont ils disposent pour pouvoir, demain, influencer la marche du monde. Outre cela, nous sommes confrontés, en matière de paix et de stabilité, à des défis qui appellent une réaction collective. Qu’il s’agisse de la sécurité, mise à mal par le terrorisme, ou de la gestion des migrations, il est évident que des réponses nationales ne suffiront pas à régler des problèmes supranationaux. Seule une réponse européenne concertée peut donner aux citoyens des raisons d’espérer.
Plusieurs raisons imposent donc de raffermir le projet européen. La première est que, dans le futur, le poids économique des grands pays, en Asie notamment, s’accroîtra encore. Ensemble, les pays membres de l’Union européenne auront la taille nécessaire pour négocier avec eux – une négociation que chaque pays européen pris isolément aurait bien du mal à conduire à son avantage. Il faut songer pour s’en convaincre que lorsque le G7 a été constitué, il comptait quatre pays européens ; si l’on s’avisait, dans quinze ans, de créer une instance à laquelle ne pourraient adhérer que les économies aux caractéristiques équivalentes à celles qui avaient été retenues en 1975, le « G7 nouveau » n’en compterait plus aucun… L’influence que l’on peut exercer dans le monde dépend du poids que l’on a, et le fait d’être rassemblés au sein d’une Union rendra les Européens plus forts dans le monde de demain. La COP21 a d’ailleurs démontré que l’Europe est forte et influente quand elle sait être unie.
La relance de l’Union est également nécessaire pour maintenir la paix et la stabilité d’une région du monde autour de laquelle les guerres s’amplifient, créant l’instabilité. Les réfugiés arrivant en Europe proviennent de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et des pays de la corne de l’Afrique, tous pays en guerre – et le problème libyen est encore devant nous. À cette situation, il convient de donner une réponse commune efficace ; jusqu’à présent, la réponse européenne n’a pas été à la hauteur du défi, ni pour la lutte contre le terrorisme ni pour la gestion de l’urgence migratoire.
Le problème de l’Union est d’ordre politique. Ses dirigeants doivent reprendre à leur compte les conceptions originelles des pères fondateurs et remettre de la chaleur là où il n’y a plus que froideur économique et financière. Ils doivent tenir compte des besoins de tous les Européens et non, seulement, de la frange cosmopolite des citoyens de l’Union polyglottes et voyageurs. Ceux-là ne sont en réalité qu’une minorité. Je le constate dans ma région, la Toscane, et dans ma ville, Pise. La très grande majorité des Pisans vivent principalement dans leur cité, ils ont besoin de certitudes et de sécurité ; ils attendent des institutions européennes qu’elles les leur donnent, non qu’elles leur apportent des réponses d’une grande froideur et souvent négatives.
Pour être franc, je n’ai pas décelé dans les décisions prises à Bratislava la hauteur de vue qui aurait pu faire espérer des solutions adéquates. J’ai été très frappé que le pays hôte ait signé avec les autres pays du groupe de Višegrad un document inconcevable à tous égards. La raison politique de ce geste est connue : c’est une tentative de récupération de certaines pulsions à l’œuvre au sein de la population. Mais, loin de régler le problème, c’est une excellente manière d’exacerber les incertitudes et de compliquer la situation. L’état d’esprit du groupe de Višegrad étant celui que l’on sait et la Slovaquie étant le pays organisateur, le sommet pouvait difficilement parvenir à un résultat plus encourageant. Il n’empêche que l’on n’ira pas très loin avec la feuille de route adoptée à Bratislava, puisqu’on y lit en filigrane l’idée politique parfaitement claire qu’en raison de la suite d’élections nationales à venir, rien ne doit changer avant septembre 2017. Or, c’est une bien mauvaise idée de penser que l’on peut ne rien faire pendant une année complète et se retrouver dans un an comme si de rien n’était, parce que l’on aura entre-temps résolu toutes les crises nationales par la magie des élections. Si l’on s’en tient à cette feuille de route, on se trouvera à cette date avec une Europe entièrement détricotée.
L’expérience que j’ai accumulée au cours des années passées me porte à considérer que les traités et les règles sont évidemment importants mais que la politique l’est plus encore. J’en donnerai pour exemple la modification de l’équilibre des pouvoirs qui a eu lieu au sein de l’Union européenne. Du temps de Jacques Delors et par la suite encore, la Commission européenne a toujours eu un rôle central. Le Conseil européen, devenu pendant la crise la salle des machines de l’Europe, s’est maintenant substitué à la Commission. Chacun sait que les traités donnent l’exclusivité de l’initiative législative à la Commission, et c’est le domaine dans lequel Jacques Delors et les Commissions passées ont obtenu les plus grands succès – ainsi d’Erasmus, ou du marché unique. Aujourd’hui, avant de prendre une initiative, la Commission attend le feu vert politique du Conseil européen, ou qu’il la saisisse ; c’est un changement complet. Le plus étrange est que les traités adoptés en 2012 ont conféré à la Commission un nouveau pouvoir qui, formellement, devrait la renforcer ; en réalité, rien n’est fait pour lui redonner du poids.
L’évolution future de l’Union européenne est un sujet éminemment politique, puisqu’elle dépendra des objectifs et des missions qui seront fixés à l’Union. De mon point de vue, sans qu’il soit besoin de modifier les traités pour le moment – ce qui serait très compliqué et, institutionnellement, presque impraticable –, il faudrait, au cours des prochains mois, définir quelques missions nouvelles pour l’Union, les porter clairement à la connaissance des peuples et, surtout, ne pas s’en tenir à les annoncer. Elles devront se traduire en pratique, qu’il s’agisse de la sécurité, du renforcement de l’union économique et monétaire (UEM) ou du travail des jeunes – toutes missions, à mon sens, essentielles.
Le domaine d’intervention principal est probablement celui de la sécurité. Les peuples d’Europe doivent pouvoir constater que des mesures concrètes sont prises. Ainsi, le corps européen de garde-frontières et garde-côtes dont la création a été décidée doit être installé et rendu opérationnel sans tarder, dans les trois mois à venir au plus, sans que l’on se limite à améliorer la coordination des forces existantes. Le nouveau corps doit cesser d’être une abstraction et commencer de surveiller étroitement les frontières extérieures de l’Union. Ainsi restaurera-t-on la confiance des citoyens des pays qui n’ont pas de frontières extérieures : ils constateront que le problème est géré comme il se doit, et ne considéreront plus, comme ils le font actuellement – ce qui mine les relations entre les pays méditerranéens et ceux du Nord de l’Union – que les autres pays ne font pas leur travail et laissent entrer sur le territoire de l’Union des migrants qui n’en ont pas le droit. Cette mission doit être partagée.
En matière de sécurité encore, j’observe qu’aussitôt après qu’un attentat a été commis, on annonce de grandes décisions et de nouvelles lois qui, les semaines passant, ne sont pas suivies d’effet. S’il est un domaine dans lequel il faut faire davantage à l’échelle européenne, c’est en matière de renseignement. Toutes les autorités nationales doivent manifester auprès de leurs services respectifs la volonté politique de partager réellement les informations, sinon l’Union ne pourra pas réagir efficacement et les citoyens d’Europe constateront que les terroristes sont hors contrôle.
D’autre part, dans un contexte caractérisé par le Brexit, la fragilité de l’économie grecque et la situation de certains établissements bancaires européens, l’euro peut être frappé par une nouvelle tempête, et rapidement. Or le toit de la maison n’est pas en état de supporter un nouveau choc. L’euro a été sauvé une première fois par M. Mario Draghi et la Banque centrale européenne (BCE), mais l’on ne peut demander à la BCE de faire plus. C’est pourquoi l’Institut Jacques Delors et la Fondation Bertelsmann ont présenté il y a quelques jours, dans un rapport conjoint, des propositions tendant à améliorer le mécanisme européen de stabilité et à renforcer l’union bancaire et la convergence. Ces mesures, qui peuvent être prises sans modifier les traités, sont indispensables pour que l’euro résiste si un ouragan se lève, ce qui est possible.
Enfin, on attend de l’Union européenne des initiatives visibles et fructueuses en faveur de l’emploi, singulièrement du travail des jeunes. L’Institut Jacques Delors a beaucoup travaillé à la création du programme Erasmus pro, conçu pour permettre à des apprentis d’acquérir une qualification professionnelle dans un autre pays de l’Union. Ce serait l’une de ces réalisations concrètes qui montrent aux citoyens que l’Union européenne est davantage qu’une froide machine uniquement destinée à vérifier que les déficits publics sont bien inférieurs à 3 % des PIB nationaux. Pourtant, on discute d’Erasmus pro depuis des mois au niveau européen sans aboutir à des décisions pratiques.
Mme la présidente Danielle Auroi. Je vous remercie, Monsieur le président. Je pense pouvoir dire que nous partageons vos propositions.
M. Joaquim Pueyo. Je souscris aux propos que vous tenez dans la tribune Plus forts ensemble – même à 27 ! récemment publiée sur le site internet de l’Institut Delors : l’Europe, qui n’est certes pas une menace, peut répondre à des menaces multiformes, au nombre desquelles l’agressivité de la Russie, dont l’action en Ukraine et en Syrie administre la preuve. Vous avez insisté sur la sécurité collective. De fait, la coopération structurée permanente prévue par le traité de Lisbonne n’étant toujours pas mise en œuvre, nous attendons des initiatives visant à renforcer la politique européenne de sécurité et de défense ; j’espère que la France, l’Italie et l’Allemagne en proposeront lors du sommet prévu en décembre. L’opération Sophia, conduite par la force navale de l’Union européenne-Méditerranée, dont le siège est à Rome, est entrée dans sa deuxième phase, qui vise à mieux surveiller les côtes libyennes et à former les garde-frontières de la Libye. Le dispositif existe et fonctionne : il faut l’expliquer aux Européens. Quelles nouvelles initiatives sont, selon vous, envisageables pour renforcer l’Europe de la défense et la sécurité collective, ce qui recréerait des liens entre l’opinion publique et l’Union européenne ? Tous les partis politiques, même s’ils sont conscients de ses faiblesses, doivent défendre l’Union au lieu de l’accuser de tous les maux. Peut-être ne sommes-nous pas assez vigilants à cet égard.
Mme Marietta Karamanli. Je me suis retrouvée, Monsieur le président, dans les propos que vous avez tenus ; nous devons transmettre ces messages, et privilégier l’action concrète. Jugez-vous concevable de renforcer le fédéralisme en Europe autour du noyau des pays fondateurs, comme il en est parfois question ? Quelles sont, selon vous, les limites d’une telle entreprise, et quelles en sont les perspectives ? Vous avez indiqué trois domaines d’action prioritaires, mais qu’en est-il des droits fondamentaux, des libertés individuelles, des droits sociaux et des valeurs qui ont fondé l’Union, dont celle de l’accueil des réfugiés politiques ? N’y aurait-il pas là matière à un nouvel élan propre à relancer la conscience européenne ?
M. Michel Piron. Vous avez déploré l’évolution des relations entre le Commission et le Conseil au bénéfice de ce dernier, mais vous avez aussi souligné la grande insuffisance du rôle alloué aux parlements. N’y a-t-il pas une contradiction à souhaiter que la Commission retrouve un rôle accru ? De qui la Commission exécute-t-elle les ordres ? Pour donner à l’Union européenne une nouvelle légitimité, comment mieux associer les parlements nationaux aux décisions et leur permettre de porter un message européen ?
Pour ce qui est de la gestion des migrations, est-on d’accord sur le principe de la mutualisation des moyens et de leur mise en œuvre ? Les points de vue sont-ils convergents à ce sujet ? On ne peut ignorer ce qui se passe dans le détroit de Messine et en Grèce depuis des années, mais l’on a le sentiment qu’une partie des pays d’Europe du Nord se sentent très peu concernés.
Pour la défense européenne, le départ du Royaume-Uni ne peut être sans conséquences.
Le taux très élevé de chômage des jeunes a provoqué des migrations internes massives vers les pays les plus prospères de l’Union, tels l’Allemagne. Or, ceux qui partent sont souvent les jeunes gens les mieux formés. N’y a-t-il pas là un grand risque d’appauvrissement pour leurs pays d’origine, et d’accroissement des divergences entre les États membres ?
Enfin, la crise européenne n’est-elle pas due aussi à la divergence croissante des pays européens, sur le plan économique mais peut-être aussi sur le plan politique ?
M. Philip Cordery. Comme vous, je pense qu’il faut accorder la première place aux préoccupations des citoyens relatives à la sécurité et à la situation des jeunes. Il faut, en effet, remettre de la chaleur dans une Europe trop froide, mais si l’Union connaît la montée des populismes, c’est aussi parce qu’elle est mal ficelée : elle a une politique monétaire mais pas de coordination budgétaire autre que punitive, et elle n’a ni politique industrielle, ni politiques salariale, fiscale et sociale convergentes. Voilà ce qui crée des déséquilibres – et on voit le lien, en Allemagne, entre cette question et la montée de l’AfD. Ne faut-il pas, en conséquence, accélérer l’approfondissement de l’union économique et monétaire, projet politique ? Il n’est pas contradictoire de renforcer la coopération européenne en matière de sécurité et en matière économique.
Pensez-vous qu’avec le Brexit l’Union européenne a franchi une étape et que le couple franco-allemand va se transformer en un trio franco-italo-allemand ? C’est une bonne nouvelle que l’Italie figure dans ce cercle mais, selon vous, sera-ce durable ? Faute de personnalités assez fortes pour faire de la Commission le véritable moteur de l’Union européenne, cela permettrait une plus grande diversité dans la gestion centrale de l’Union.
M. Arnaud Richard. Ne devrions-nous pas, avant toute chose, appliquer les règles que nous nous sommes données ? Je suis d’accord avec vous sur la stratégie des « petites victoires » – et, selon moi, le plan Juncker en est une : 18 mois à peine après sa mise en œuvre effective, son succès témoigne de la capacité de la Commission à appliquer efficacement un programme d’investissement.
En matière de contrôle des migrations, rien ne sera possible sans une politique d’asile commune. L’année dernière, 1,3 million de demandeurs d’asile sont entrés en Europe ; plusieurs centaines de milliers d’entre eux errent en l’Allemagne et dans les pays limitrophes, sans que l’on puisse régler leur sort faute d’une politique d’asile partagée.
S’agissant enfin du chômage des jeunes, l’Europe a déjà beaucoup fait, mais cela ne se sait pas. Ainsi, sans même parler du fonds européen pour la jeunesse du Conseil de l’Europe qui existe depuis de nombreuses années, l’Union européenne a créé en 2013 la garantie jeunesse, mais ce dispositif n’a pas véritablement fonctionné. Pourquoi est-on capable de mener rapidement une politique d’investissement volontariste efficace – le plan Juncker – alors que la garantie jeunesse a eu de bien faibles retombées après trois ans ?
M. Gilles Savary. Votre propos lucide m’a séduit ; de nouvelles missions sont nécessaires et il faut en effet essayer de faire bouger les choses en s’inscrivant dans les traités en vigueur. Le vrai problème est de parvenir à ce que l’Europe s’incarne. Ainsi, si l’Union crée un corps de garde-frontières, ceux qui le composent devront porter un uniforme européen, afin que les populations constatent que l’Union se fait effectivement. Nous devons nous employer à faire connaître les belles politiques européennes comme telles, sans que les gouvernements nationaux leur fassent écran, comme ils le font tous. Ainsi, en France, la « garantie jeune » est considérée comme une mesure française, sans que les crédits européens qui la financent soient évoqués.
À propos des politiques de l’Union, les perspectives financières et les règlements qui les précèdent créent de terribles rigidités. Ainsi, alors que la politique agricole commune pose problème, nous sommes incapables de la modifier en un septennat ! Le ciel pourrait nous tomber sur la tête que l’on nous dirait qu’un règlement nous interdit de bouger… Cela connote une impuissance européenne.
Je partage sans réserve votre avis : une reconquête politique est nécessaire. Pourquoi l’ensemble des think tanks européens ne mettent-ils pas tous les candidats aux élections sur le gril en les interrogeant sur leurs intentions relatives à l’avenir de l’Union ? Je suis désolé qu’en France des candidats aux élections racontent n’importe quelles inepties, dont les plus démagogiques, sans jamais devoir répondre publiquement à des interpellations critiques sur la manière dont ils entendent concrètement mettre en œuvre leur programme européen. Il faut redonner à l’Europe sa place dans le questionnement politique concret. Enfin, une Union politique demande une incarnation par des leaders de la stature d’un François Mitterrand ou d’un Willy Brandt. Notre seul leader est Mme Merkel, femme tout à fait respectable mais qui incarne la froide rigueur budgétaire.
M. Enrico Letta. La défense peut intéresser les citoyens européens. J’observe d’ailleurs que tous les candidats aux élections, en France, disent qu’il faut augmenter l’effort en cette matière. Convaincre les populations est difficile car cela signifie soit augmenter les impôts soit réallouer des moyens. En agissant ensemble, nous éviterions les chevauchements et doublons actuels ; il faut des spécialisations par pays. Et puis, quand la France intervient au Mali, elle le fait pour l’Europe, et cela doit être traité au niveau budgétaire de manière plus sensée et plus souple. Il en va de même quand Italie agit dans les eaux libyennes.
Le Brexit pose problème car s’il est impossible de tenir le Royaume-Uni à l’écart de la coopération en matière de défense, la négociation de l’accord de sortie sera très dure. Les Britanniques profiteront de leur rôle éminent dans la sécurité et la défense européennes pour chercher à en tirer avantage dans d’autres domaines. Il faudra être prudent.
Vous m’avez interrogé sur l’éventualité du renforcement du fédéralisme entre les pays fondateurs. Je suis de ceux qui pensent que si aucune initiative n’est prise par les pays membres de la zone euro, il ne se passera rien car, à Vingt-Sept, les blocages sont trop grands. C’est pourquoi les décisions prises à Bratislava ne m’ont pas convaincu : il n’a pas été question d’avancer à Dix-Neuf, mais toujours à Vingt-Sept. Cela s’explique par la volonté d’éviter d’autres épisodes tels que le Brexit, mais à Vingt-Sept, rien n’avancera.
Vous avez décrit très exactement ce qu’est l’UEM : une union qui, typographiquement, devrait s’écrire « union économique et Monétaire » tant le volet monétaire l’emporte sur le volet économique, alors qu’ils devraient être d’égale importance. On a considéré qu’ayant déjà fait beaucoup sur le plan monétaire, on ne pouvait faire plus, sans comprendre que sans union économique, l’union monétaire ne fonctionne pas. Voilà pourquoi, dans le rapport que nous avons présenté avec la Fondation Bertelsmann, nous plaidons vigoureusement en faveur du renforcement du volet économique de l’UEM.
En matière institutionnelle, j’ai apprécié la procédure des Spitzenkandidaten ; elle a évité que le Conseil européen choisisse seul le président de la Commission européenne et permis au Parlement européen de jouer un rôle important. Il importe de revoir les liens entre la Commission européenne, les parlements nationaux et le Parlement européen ; sinon, on en restera à la seule relation entre Commission et Conseil, dans laquelle le Conseil l’emporte. Or, je l’ai constaté, en dépit de son importance, le Conseil européen ne fonctionne pas parce qu’il ne décide pas : il est censé fixer des orientations communes, mais en réalité chacun de ses membres vise à transmettre un message à sa propre opinion publique nationale. Quelle est la différence entre une institution qui fonctionne, la BCE, et une autre qui ne fonctionne pas, le Conseil européen ? À la BCE, des décisions sont prises par le collège puis annoncées par son seul président au nom de tous. Au Conseil, des discussions ont lieu, quelques décisions d’orientation sont prises, puis a lieu la conférence de presse du président. Elle suscite un intérêt modéré des journalistes, qui assistent en masse aux conférences de presse concomitantes des dirigeants nationaux, lesquels s’attachent à détailler comment ils ont battu la Commission sur tel sujet ou tel autre. Les choses ne peuvent durer ainsi ; le sujet est essentiel.
Il a été question des migrations. En 2013, 366 migrants se sont noyés au large de Lampedusa. Cette tragédie a conduit l’Italie à mener une opération militaire de sauvetage en mer. Elle l’a fait seule car la solidarité européenne lui a manqué : il s’agissait, lui a-t-on dit, d’un problème italien. Mais lorsque les migrants sont entrés en Allemagne, le problème est devenu un problème européen… La convergence des politiques migratoires est essentielle. Cela appelle un corps de garde-côtes et de garde-frontières véritablement européen et un mécanisme de réinstallation des migrants au sein de l’Union.
Le plan Juncker a été un succès, et la proposition de doubler son montant initial doit être appliquée. En revanche, la garantie pour la jeunesse n’a pas été l’une de ces petites victoires que l’appelle de mes vœux. Le libellé même du dispositif est malheureux, car une appellation est toujours symbolique : si l’on prétend « garantir » aux jeunes un résultat et que le résultat escompté n’est pas là, on obtient l’effet inverse de l’effet recherché.
Enfin, je partage l’avis que les candidats à l’élection présidentielle devraient être tenus d’expliquer comment ils comptent appliquer leur programme européen. Nous ferons notre possible pour les interroger et publier leurs réponses, mais il faut pour cela que le circuit politico-médiatique le permette.
Mme la présidente Danielle Auroi. Je vous remercie, Monsieur le président, pour ces remarques pénétrantes.
Audition de M. Luuk Van Middelaar, historien et philosophe, ancien membre du cabinet du président Herman Van Rompuy, auteur de « Le passage à l’Europe »
Compte rendu du mercredi 12 octobre 2016
La présidente Danielle Auroi. Monsieur Van Middelaar, je vous remercie vivement, au nom de notre commission, d’avoir accepté notre invitation à participer à ce cycle d’auditions sur l’avenir de l’Union européenne. Il s’agit pour nous de prendre du recul dans une période troublée, notamment mais pas seulement par le Brexit. Votre regard d’historien et de philosophe, auquel s’ajoute une connaissance pratique des institutions, nous sera très utile dans cette démarche.
À la fin de votre ouvrage majeur, Le passage à l’Europe, paru en 2009, vous demandiez, de manière prémonitoire, ce qui se passerait si la population d’un État membre décidait vraiment, à la majorité, de sortir de l’Union européenne. Or la population du Royaume-Uni a vraiment décidé, à la majorité, de sortir de l’Union. Je vous retourne donc la question ! Que s’est-il passé à votre avis ? Comment inventer l’avenir de l’Europe, non plus à vingt-huit, mais à vingt-sept ? Le président Valéry Giscard d’Estaing a déclaré, en substance, qu’il n’y avait pas matière à négociations et que les Britanniques devaient sortir, un point c’est tout. Selon moi, les choses ne sont pas aussi simples : non seulement nous avons besoin des négociateurs désormais en place, mais nous devons nous poser des questions tous ensemble.
M. Enrico Letta, que nous avons auditionné dans ce même cadre la semaine dernière, nous a rappelé la rupture qu’avait constituée l’échec du traité constitutionnel en 2005. Nombre de vos réflexions portent sur la quête d’un « public européen ». Comment analysez-vous la profusion récente de référendums en Europe ? N’est-elle pas un signal de défiance vis-à-vis de la construction européenne ? Je pense notamment au référendum néerlandais sur l’accord d’association avec l’Ukraine, qui s’est soldé par une réponse négative, ou au référendum hongrois sur l’immigration, même si celui-ci n’a pas été un succès pour M. Orbán. Et je ne parle pas des nombreux référendums promis chez nous, en France, en cette période de précampagne présidentielle.
Dans Le passage à l’Europe, vous affirmiez qu’un État-providence européen était impensable. Qu’est-ce qu’un État-providence, de votre point de vue ? Au sein de cette commission, nous sommes attachés à l’État-providence et nous considérons que la perspective d’une « Europe qui protège » est sans doute la seule façon de réconcilier les citoyens avec la construction européenne. Que pensez-vous de cette approche ? Est-il possible d’être plus clair sur ce qu’est « une Europe qui protège » ? Peut-être pouvons-nous nous mettre d’accord sur la proposition suivante : le fait de ne plus parler d’ « État-providence » n’empêche pas de travailler à la protection des citoyens. Est-ce une question que vous envisagez ? Est-elle ou non pertinente selon vous ?
Comment envisagez-vous la suite de la construction européenne ? Doit-elle se faire autour d’un noyau dur d’États souhaitant progresser vers davantage d’intégration ? Il s’agirait, en quelque sorte, d’une « Europe des avant-gardes », mais il faudrait bien sûr, dans le même temps, maintenir une approche à vingt-sept. Ou bien, faut-il une Europe à plusieurs vitesses, avec, éventuellement, un noyau de référence, qui pourrait être la zone euro ? La semaine dernière, lors de mon déplacement à Bucarest, accompagnée notamment de Christophe Caresche, ici présent, nos collègues roumains nous ont fait part de l’amertume que suscite chez eux la volonté de relancer l’Union européenne en créant un Europe à deux vitesses, avec un premier cercle plus intégré que le second, dont ils feraient partie. Ils sont notamment très fâchés de ne pas pouvoir adhérer, pour le moment, à l’espace Schengen. Comment pouvons-nous répondre à cette apparente contradiction ? Peut-être existe-t-il un moyen de gérer l’Union européenne de façon plus souple tout en restant unis ?
En tant que conseiller du président du Conseil européen Herman Van Rompuy, vous avez été un témoin privilégié de l’évolution des institutions européennes depuis la crise financière. Quelles sont les mesures souhaitables et possibles pour réformer à moyen terme ces institutions ?
M. Luuk Van Middelaar, historien et philosophe, ancien membre du cabinet du président Herman Van Rompuy, auteur de Le passage à l’Europe. Je vous ferai d’abord part de mon analyse du référendum britannique et de sa signification pour les politiques européennes. Ce faisant, j’aborderai le thème de la protection. Je reviendrai de manière plus détaillée sur les aspects institutionnels après vos éventuelles questions, car il faut examiner, au préalable, le paysage politique du point de vue des électeurs.
Le Brexit est un événement sérieux, une rupture, que je comparerais volontiers à une amputation : l’Union européenne perd l’un de ses grands membres, ce qui est grave, mais ne devrait pas être mortel, à condition que l’on soigne correctement les plaies, c’est-à-dire que les vingt-sept parviennent à se ressouder en tant que corps unique.
Je ne considère pas le Brexit comme une chance, en tout cas à court terme. Certains disent : « Vivement que les Britanniques soient partis ; ils vont cesser de nous mettre des bâtons dans les roues ! » Je n’adhère pas à ce discours pour une raison très simple : les grandes crises qu’a traversées l’Union européenne depuis 2008, à savoir la crise de l’euro, la crise bancaire et la crise des réfugiés, n’ont strictement rien eu à voir avec le Royaume-Uni, qui ne faisait partie ni de l’union monétaire, ni de l’espace Schengen. L’absence des Britanniques ne va donc pas, tout d’un coup, comme par magie, aider à résoudre les problèmes qui existent entre les vingt-sept, par exemple entre Allemands et Français. Il faut se garder de nourrir des illusions de cette nature. Néanmoins, cela ne veut pas dire que l’on ne peut rien faire de cet événement important.
Je développerai mon analyse sur le Brexit en sept points.
Premier point : gardons bien à l’esprit que les électeurs britanniques ne sont pas devenus fous. La tendance est de dire que les Britanniques, isolés sur leur île, ont toujours été impertinents et obstinés, qu’ils ont été mystifiés par la presse, notamment celle de Rupert Murdoch, et que nous sommes entrés dans l’ère de la politique libérée des faits – fact-free politics –, phénomène que l’on observe aussi aux États-Unis avec Donald Trump. Peut-être tout cela a-t-il joué un peu dans le choix des électeurs britanniques, mais, selon moi, dans un pays libre tel que le Royaume-Uni, il n’est pas possible de convaincre 52 % de la population de voter contre son intérêt économique uniquement avec des mensonges et de la propagande. Cela veut dire que les électeurs britanniques ont exprimé autre chose à l’occasion de ce scrutin. Leur attitude peut apparaître parfaitement rationnelle si l’on élargit la perspective au-delà de l’économie au sens strict et du niveau du PIB.
Deuxième point : dès lors, le premier message de ce scrutin, c’est que la politique identitaire prime sur l’économie. C’est le slogan « take back control » – reprenez le contrôle – qui a fait gagner le non, car il a cristallisé à la fois les peurs et un désir de souveraineté et d’identité. On observe ce mouvement partout, aux États-Unis et en Europe, y compris en France et aux Pays-Bas. Pour une fois, les Britanniques ont été, en quelque sorte, à l’avant-garde, en marquant leur défiance envers la logique de la globalisation au sens large, envers le système de frontières et de marchés ouverts qui structure le monde américain et européen depuis 1945. En l’espèce, je ne dis rien d’original : je ne fais que replacer le scrutin britannique dans un cadre plus général.
Troisième point : la situation est grave pour l’Union européenne en tant que telle, car ce vote de défiance, ce cri du cœur lancé par les électeurs britanniques va directement à l’encontre de la doctrine bruxelloise – que je connais en effet de l’intérieur, madame la présidente – à deux égards. D’une part, depuis l’époque des pères fondateurs, l’Europe a toujours misé sur l’économie : le postulat était que, si l’on créait de l’interdépendance économique, les populations seraient reconnaissantes pour l’œuvre accomplie. À cela, les Britanniques ont répondu non à 52 % contre 48 %, en disant, en substance : « Le commerce, c’est bien, mais nous avons d’autres préoccupations qui ne sont pas pleinement prises en compte. » Ce vote constitue donc un défi fondamental pour l’Union européenne en tant que système politique. D’autre part, l’intégration était censée être un mouvement à sens unique, toujours vers l’avant, jamais vers l’arrière, avec une augmentation continue du nombre d’États membres – il est passé de six à vingt-huit – et l’attribution progressive de compétences et de pouvoirs supplémentaires aux institutions centrales. De ce point de vue aussi, le Brexit marque un coup d’arrêt.
Quatrième point : sur le champ de bataille électoral, la lutte oppose un centre au sens large et les extrêmes, c’est-à-dire des forces qui veulent maintenir, d’une façon ou d’une autre, le système ouvert de l’après-guerre, et des forces qui veulent, au contraire, l’attaquer, voire le détruire. À cet égard, le Brexit n’a été que le premier acte. D’autres rendez-vous électoraux sont devant nous, en particulier l’élection présidentielle française, qui sera observée de très près partout au sein de l’Union, en raison de ce qu’elle représente non seulement pour la France, mais aussi pour l’Europe dans son ensemble.
Si l’on adoptait une vision strictement bruxelloise, on pourrait considérer que seules comptent les élections européennes qui se tiennent tous les cinq ans, mais, de mon point de vue, l’Europe politique ne se limite pas à quelques kilomètres carrés à Bruxelles et à Strasbourg : elle comprend l’ensemble des systèmes politiques des États membres. En d’autres termes, les parlements nationaux participent à la gouvernance européenne. En réalité, de nombreuses élections « européennes » ont lieu chaque année : en 2017, il s’agira notamment des législatives aux Pays-Bas en mars, des scrutins nationaux en France au printemps et des élections fédérales en Allemagne en septembre.
Cinquième point : quelle réponse apporter à ce constat ? Je vous rejoins tout à fait, madame la présidente, sur la nécessité d’une « Europe qui protège » : c’est vraiment le cœur du débat. Il faut trouver un nouvel équilibre entre, d’une part, les libertés qu’offre ou crée l’Union européenne et, d’autre part, la protection ou l’ordre qu’elle devrait offrir ou créer. Or c’est loin d’être évident, car l’Union européenne ne sait faire, historiquement, qu’une seule chose : élargir le marché, créer de la liberté et de l’ouverture, abattre les frontières, instaurer un grand espace de mouvement pour tous les Européens. Cette politique agrée les entreprises, les étudiants – qui peuvent voyager grâce au programme Erasmus –, les personnes diplômées et aisées, bref, ceux que l’on peut appeler un peu crûment la « clientèle » de l’Union européenne. Jusqu’à récemment, cette clientèle avait toujours représenté plus de 50 % des votes, mais tel n’est plus le cas aujourd’hui. C’est le problème crucial.
À l’autre extrémité du spectre électoral, ainsi que nous l’avons constaté en France et aux Pays-Bas dès 2005, voire plus tôt encore, on trouve ceux qui n’apprécient guère les libertés que procure l’Union européenne, qui y voient non pas une chance, mais une menace, la raison d’une concurrence accrue sur le marché du travail, de l’arrivée de gens venus d’ailleurs, etc. On entend dire parfois que c’est « l’élite contre le peuple », mais c’est une ineptie : l’électorat se partageant en deux groupes à peu près égaux, il s’agit en réalité de deux peuples, avec deux visions du monde, deux systèmes de valeurs, deux choix politiques qui ne sont pas déterminées uniquement par la sociologie – on pourrait analyser en détail les résultats du scrutin britannique. Il y a, d’une part, ceux qui prônent l’ouverture et que le système institutionnel européen sert depuis toujours, par nature, et, d’autre part, ceux qui demandent à l’Europe une protection.
Ce besoin de protection a été ressenti par l’opinion et exprimé publiquement plus tôt en France qu’ailleurs. Il est désormais ressenti également dans d’autre pays. Il y a une dizaine d’années, aux Pays-Bas, le terme « protection », invoqué par M. Sarkozy dès 2007, voire plus tôt encore, était considéré comme une nouvelle blague des Français, impliquant des choses dont on ne voulait pas, en particulier le protectionnisme – les Pays-Bas sont, vous le savez, un pays commerçant. Aujourd’hui, la réaction n’est plus du tout la même, même dans les cercles libéraux : on prend en compte le fait que le curseur se déplace sur l’axe libertés-protection vers davantage de protection.
Selon moi, il est utile de mettre en avant l’opposition entre libertés et protection, car cela aide à parler franchement. À Bruxelles, comme chaque fois qu’il y a un échec, on a entendu des slogans vides de sens : il faut « faire mieux » – a better Europe – ; il faut être « grand sur les grands sujets et petit sur les petits sujets ». C’est du langage bureaucratique qui ne veut rien dire. A contrario, le dilemme entre libertés et protection implique de vrais choix, qui peuvent être douloureux, par exemple en matière commerciale. L’Union européenne a besoin, de manière vitale, de cette franchise et de cette sincérité dans le langage. Les gens ne supportent plus une certaine hypocrisie du langage officiel, qui ne correspond pas du tout à la réalité qu’ils vivent. En tant qu’ancienne plume du président du Conseil européen, je sais de quoi je parle.
Sixième point : que veut dire concrètement, pour les politiques européennes, déplacer le curseur sur l’axe libertés-protection vers davantage de protection ? Une Union européenne qui protège mieux, cela peut signifier deux choses : soit que l’Union produit un ordre ou offre une protection elle-même – elle peut le faire dans certains domaines, notamment en matière de sécurité intérieure ou extérieure, par exemple avec le corps de gardes-frontières européens ; soit que l’Union arrête de miner ou de détruire les systèmes de protection existants. Selon moi, c’est cette deuxième approche qu’il faut privilégier dans le domaine social, notamment pour tout ce qui touche à l’État-providence. Car le niveau de protection sociale varie considérablement d’un État membre à l’autre, et il va être difficile, voire impossible, de faire en sorte que tous les pays de l’Union atteignent le niveau existant en France ou au Danemark. Il faut faire attention aux vœux que l’on formule – be careful what you wish for – car, si la bonne fée les exauce, on peut se retrouver avec moins qu’au départ !
Le thème de la protection a été au cœur de la campagne référendaire au Royaume-Uni et, auparavant, au cœur de la négociation entre David Cameron et ses vingt-sept collègues. L’un des débats les plus âpres a porté sur les exceptions à la libre circulation des travailleurs que l’on pouvait ou non accorder. L’enjeu était de préserver le système de protection existant au Royaume-Uni. Le même débat existe concernant la directive sur les travailleurs détachés. Selon moi, il convient d’être très attentif à ces sujets, et il faut se garder de répondre immédiatement qu’il est impossible d’agir en la matière ou que cela va à l’encontre de la façon dont l’Union européenne a toujours agi.
Pour ma part, je trouve dommage que l’accord auxquels nous sommes parvenus avec les Britanniques lors du Conseil européen de février 2016 – que l’on avait intitulé « New Deal for UK » – ait été jeté à la poubelle avec le Brexit, certes conformément à ce qui était convenu. Nous aurions pu en retenir certains éléments pertinents pour d’autres systèmes d’État-providence, les garder dans notre boîte à outils commune, tout en modifiant, sans doute, leur forme juridique.
Septième point, pour finir : quelle politique – à distinguer des politiques – doit-on mener et quelle communication doit l’accompagner ?
Selon moi, la réponse sérieuse à l’amputation que constitue le Brexit, au défi presque existentiel qu’il représente pour l’Europe, c’est de regagner les électeurs du centre : il faut faire en sorte que 60 à 70 % des électeurs, et non pas seulement 48 %, se reconnaissent dans l’Union européenne. Cela implique de faire des choix politiques difficiles et, peut-être aussi, d’aller à l’encontre de certains intérêts bien établis. La principale réponse réside non pas dans un bricolage institutionnel, mais dans une action politique réelle, plus intense.
En complément, il est important d’améliorer la communication, même si cela doit être non pas le produit principal, mais le papier d’emballage. Il faut avant tout que ceux qui sont aux commandes, à savoir les vingt-sept dirigeants nationaux, assument mieux qu’aujourd’hui leurs choix en tant que choix européens, en considérant qu’ils font partie de cet ensemble.
M. Joaquim Pueyo. Je vous remercie, monsieur, pour votre intervention. Cela fait du bien d’entendre des Européens parler comme vous le faites.
Dans votre ouvrage Le passage à l’Europe, vous avez identifié trois sphères européennes : la première se rapporte aux États-nations ; la deuxième recoupe les institutions de l’Union ; la troisième, que vous avez appelée « sphère intermédiaire », renvoie notamment au Conseil européen.
La Commission européenne est fréquemment pointée du doigt, notamment en France, comme la source du ressentiment des citoyens envers l’Union. Elle est parfois dénoncée par les élus nationaux. On la juge généralement trop intégratrice. Pourtant, on oublie trop souvent de rappeler que les initiatives émanent du Conseil européen.
Depuis le Brexit, des voix se sont élevées en faveur d’une relance et d’une redynamisation du projet européen. Je suis convaincu que c’est nécessaire. Je m’interroge sur la possibilité d’une réforme du fonctionnement des institutions, en particulier du Conseil européen. Cependant, face à la réticence croissante des citoyens, y compris en France, relayée par certains partis politiques, il semble très compliqué d’avancer vers une réorganisation des pouvoirs aux dépens du Conseil européen. Selon vous, quelles sont les pistes qui pourraient être explorées afin de diminuer les blocages au sein de cet organe ?
On oublie parfois l’histoire des XIXe et XXe siècles. Il faudrait que nos concitoyens en aient une meilleure connaissance. En tout cas, certains sujets semblent de nature à recréer un lien entre les citoyens et l’Union européenne : la sécurité et la protection, que vous avez évoquées ; l’Europe de la défense, qu’il faut absolument relancer ; les politiques envers les jeunes, car nous devons travailler pour l’avenir. Quel est votre sentiment à cet égard ?
M. Michel Piron. Merci beaucoup, monsieur, pour votre exposé très stimulant.
Vous avez rappelé que l’Europe s’est construite essentiellement sur des convergences économiques depuis les pères fondateurs. Si ceux-ci ont en effet considéré que l’économie devait être le moteur de la construction européenne, peut-être faut-il néanmoins préciser qu’ils avaient un message et une vraie volonté politique : celle de constituer un espace de paix.
Vos propos sur le concept ambigu de protection sont très éclairants. La question de la protection relève de l’évidence lorsque l’on parle des frontières extérieures de l’Union européenne, à tout le moins en théorie car, en pratique, nous sommes bien loin d’être capables d’assumer cette protection, notamment par rapport à la question des migrants, sans même parler des tensions à ce sujet en Europe de l’est.
En ce qui concerne la protection à l’intérieur de l’Union européenne, il faut remettre en question la suppression des protections nationales, en particulier des systèmes nationaux de solidarité, car nous ne sommes pas en mesure, actuellement, de les remplacer par des systèmes européens de solidarité. Je ne prendrai qu’un seul exemple : la question des travailleurs détachés. Nous sommes confrontés à des situations inacceptables de travailleurs détachés qui ne sont pas déclarés. J’ai travaillé sur ce dossier avec deux de mes collègues et nous avons échoué : nous avons obtenu quelques petites améliorations en matière de contrôles ou encore de responsabilité des donneurs d’ordres par rapport aux sous-traitants, mais nous nous sommes aperçus progressivement que l’on était en réalité incapable de vérifier si les charges sociales étaient effectivement payées dans le pays d’origine – qu’il s’agisse de la Pologne, de la Hongrie ou de la Roumanie –, même à salaire direct égal. Rappelons que les charges sociales sont beaucoup plus élevées en France qu’ailleurs.
Sur des sujets tels que les travailleurs détachés, l’administration européenne n’a-t-elle pas tendance à pécher par prétention ou par vanité technocratique ? Comme toute administration, elle a eu la tentation de régler le problème sur le papier, en posant le principe que le salaire est payé dans le pays d’accueil, mais que les charges sociales sont payées dans le pays d’origine. Elle ne s’est guère souciée de l’applicabilité de ces mesures. Or, ainsi que je viens de l’indiquer, on est incapable de les mettre en œuvre. Dès lors, ne vaudrait-il pas mieux en rester à des règles que l’on est en mesure de faire respecter, à savoir le paiement du salaire et des charges sociales dans le pays où le salarié travaille, quitte à régler ensuite la question des retraites ? Quel est votre sentiment à propos de cette prétention bureaucratique européenne ?
M. Christophe Caresche. Les questions économiques sont encore très prégnantes dans les projets de refondation de l’Europe. Un certain nombre d’observateurs expliquent qu’il faudrait une intégration plus forte de la zone euro pour sortir de la crise actuelle. Or vous nous avez fait part d’une observation très importante : les peuples peuvent estimer que leur intérêt économique n’est pas supérieur à leur intérêt identitaire ou démocratique. Cela signifie qu’un certain nombre de pistes qui sont aujourd’hui sur la table risquent d’être vouées à l’échec si elles n’intègrent pas cette dimension.
D’autre part, vous suggérez que la solution est à rechercher plutôt dans un rééquilibrage entre le centre et la périphérie, entre les institutions européennes et les institutions nationales, que dans une intégration plus poussée, c’est-à-dire dans un nouveau transfert de compétences au niveau européen. Cette idée est, elle aussi, très importante, car on entend un discours selon lequel la crise serait liée au fait que l’Union n’est pas assez intégrée. Un certain nombre de projets sur la table partent d’ailleurs de ce postulat.
M. Bruno Gollnisch, député européen. Merci beaucoup, madame la présidente, d’avoir organisé ce débat très intéressant. Je regrette qu’il n’y ait pas davantage de mes collègues députés européens pour le suivre.
Je reconnais en M. Van Middelaar le digne successeur de Hugo de Groot alias Grotius, grand juriste et philosophe néerlandais. Et je n’oublie pas que l’abbé de Saint-Pierre, qui était non seulement un ecclésiastique, mais aussi un philosophe et un homme politique, a fait publier son Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe à Utrecht.
J’appartiens à une formation réputée eurosceptique, voire hostile à l’Union européenne, mais je me garderai de toute polémique.
Je voudrais revenir sur les concepts de protection et d’ouverture que vous avez utilisés et qui sont, selon moi, centraux. Je me demande si la crise actuelle de légitimité de l’Union européenne ne tient pas précisément à ce que la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, dogme de départ de l’Union, a été étendue au-delà de ses frontières. Cela provoque une double crise de légitimité. D’une part, ainsi que vous l’avez très bien montré, vis-à-vis de ceux qui sont attachés à la protection non seulement de leur identité, mais aussi de leurs régimes sociaux, de leur niveau de salaire et de leur niveau de vie. Ils estiment que l’ouverture des frontières de l’Europe à la concurrence de pays qui ne jouent pas selon les mêmes règles provoque les délocalisations, le chômage, une certaine forme de concurrence déloyale et un certain dumping social. D’autre part, cette crise de légitimité touche aussi, paradoxalement, les libéraux, ainsi que nous l’avons vu avec le Brexit : un certain nombre de Britanniques libéraux, voire ultralibéraux, se disent que l’on a plus tellement besoin de l’Europe pour commercer avec le reste du monde. À partir du moment où l’Union européenne est intégrée dans un ensemble beaucoup plus large, notamment via l’Organisation mondiale du commerce (OMC), quel est l’intérêt de l’interdépendance économique voulue par les pères fondateurs ou de la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, qui réalisait une certaine intégration dans ce que l’on appelait autrefois le « marché commun » ? En fin de compte, même ceux qui sont favorables à la mondialisation se demandent quelle est l’utilité d’un organisme régional, si c’est pour avoir un abaissement général des frontières économiques et une liberté globale des mouvements de capitaux.
Pour redonner de l’intérêt à l’Europe, ne faudrait-il pas, en faisant preuve d’un peu de modestie, en revenir à une direction par projets ? Paradoxalement, les réalisations européennes que l’on met généralement en avant, par exemple l’avion Airbus ou la fusée Ariane, ne se sont pas faites dans le cadre de l’Union européenne. Néanmoins, un certain nombre de projets menés à bien dans le cadre de l’Union rencontrent aux aussi l’adhésion, notamment le programme Erasmus, que vous avez évoqué. Nous pourrions développer des projets précis, chiffrés, quantifiables, dont les coûts et les avantages pourraient être comparés par les citoyens. Ne faudrait-il pas multiplier de tels projets communs dans le domaine de la recherche, de l’industrie ou des transports sans trop poursuivre l’intégration institutionnelle que nous avons connue jusqu’à présent ?
M. Arnaud Richard. C’est un plaisir et une chance de vous entendre ce matin, monsieur. On a l’impression que votre ouvrage est sorti cette année, alors qu’il a déjà quelques années ! Je vous sais aussi gré, alors que vous avez été collaborateur du président du Conseil européen, de ne pas utiliser tous ces acronymes et cette novlangue, qui est assez insupportable pour nos concitoyens.
La vision historique est inévitable lorsque l’on parle de l’Europe. Cependant, je reste un peu sur ma faim : compte tenu de l’analyse historique que vous venez de nous présenter, que va-t-il se passer ? Que pensez-vous du rapport des cinq présidents sur l’union économique et monétaire ? Selon vous, est-ce la piste qui va se dessiner pour les dix années à venir ? La politique des petits pas vers une plus grande intégration sera-t-elle porteuse ? Ou bien aurons-nous simplement un « bricolage institutionnel » – je reprends vos termes – qui ne suffira pas pour réaliser le grand dessein européen auquel nous aspirons tous ?
Vous avez évoqué la division qui existe au sein des peuples européens. Quelle place pour les peuples dans la construction européenne dans les années à venir ?
M. Jean-Luc Bleunven. J’ai organisé la semaine dernière, dans ma circonscription, une réunion sur les traités internationaux entre l’Union européenne et le reste du monde. Nous avons fait salle comble : plus de 200 personnes y ont participé. Un fonctionnaire européen brillant a expliqué la situation. Il en a pris « plein les carreaux » mais, lorsque l’on a sondé la majorité silencieuse après la réunion, on s’est aperçu qu’il avait convaincu de nombreuses personnes par son argumentaire.
Comme vous, je suis convaincu qu’il faut faire des choix politiques difficiles, mais ceux-ci auront du mal à être acceptés sur le terrain. Dès lors, ne faut-il pas revoir la façon de faire exister l’Europe ? Compte tenu du mode de désignation et de fonctionnement du Parlement européen, les députés européens ne sont pas présents sur le terrain et laissent les fonctionnaires européens parler en leur nom. Pour sortir de l’inertie, ne faut-il pas repenser le lien entre les populations et la représentation européenne ? Au fond, les choix ne sont pas forcément mauvais, c’est l’absence de pédagogie et la bureaucratie qui posent problème. Sans doute est-ce une solution un peu extrême et démagogique, mais, si l’on envoyait tous les fonctionnaires européens sur le terrain pendant deux ans, l’Europe aurait un autre visage ! L’avenir de l’Europe passe bien sûr par des choix difficiles, mais, surtout, par une reconnaissance démocratique. N’est-ce pas là le principal virage politique qu’il faut prendre ?
Mme Sandrine Doucet. Merci, monsieur, d’avoir exposé votre vision historique et dynamique, avec un certain optimisme, qui tranche avec le pessimisme et le déterminisme avec lesquels ces questions sont souvent traitées. Vous avez mis en lumière certains écueils, en particulier le fait que la construction européenne s’est faite sur la base d’un projet très conceptuel et élitiste. Vous avez d’ailleurs parlé de « clientèle » de l’Union européenne.
Le débat est actuellement exacerbé par la question de la frontière, non seulement par la question cruciale de l’appartenance à l’Union européenne, qui a été posée par le Brexit et que le Président de la République a évoquée devant le Parlement européen, mais aussi, d’une façon beaucoup plus problématique, triste et violente, par la question migratoire. Cette question de la frontière domine au détriment d’autres questions plus constructives, ayant trait notamment à la démocratie européenne. Comment faire pour redonner une identité à l’Europe ? On ne se sent jamais aussi Européen que lorsqu’on voyage en dehors de l’Europe, par exemple dans les pays émergents. Comment faire pour rendre l’Europe plus démocratique et plus accessible, notamment à la jeunesse, qui a besoin de se sentir profondément européenne ?
M. Yves Daniel. Les termes « libertés » et « protection », que vous avez employés, forment un grand écart dans la construction européenne, ce qui laisse la place à un projet très vaste. Ce qui importe, du point de vue du citoyen européen, sur le terrain, c’est que l’on construise une Europe citoyenne. Comment faire adhérer les citoyens au projet européen ? On ne peut pas construire une Europe sans citoyens ! Dans notre monde très rapide et médiatisé, marqué par l’individualisme et le repli sur soi, comment donner toute sa place au citoyen ? J’ai l’impression que l’Europe ressemble un peu à une bulle, qu’elle est engluée dans son fonctionnement quotidien, certains cherchant des protections, d’autres à protéger leurs libertés – on peut aussi lier les deux notions. Or, si l’on veut dépasser les clivages, notamment politiques, et avancer véritablement, il faut sans doute donner une autre dimension au projet européen. Selon moi, l’Europe doit acquérir une dimension mondiale : elle doit repartir d’éléments fondamentaux tels que la déclaration des droits de l’homme, être capable de se positionner dans les équilibres mondiaux et face aux conflits que nous connaissons, être capable de prendre de la hauteur et du recul. N’est-ce pas un aspect essentiel ?
La présidente Danielle Auroi. Vous avez sans doute remarqué comme nous que les premières mesures prises par Mme Theresa May au Royaume-Uni sont des mesures sociales, en particulier la relance de l’école publique. Cela va tout à fait dans le sens de ce que vous avez indiqué.
Pour compléter la remarque d’Yves Daniel sur l’Europe citoyenne, les parlements nationaux pourraient-ils avoir un rôle plus visible et plus concret que celui qu’ils ont eu au cours des dernières années ? La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC), au sein de laquelle les parlements nationaux et le Parlement européen se rencontrent régulièrement, évolue et fait des propositions. Les parlements nationaux ont été suffisamment nombreux pour adresser un « carton vert » à la Commission au sujet de la responsabilité sociale des entreprises vis-à-vis de leurs filiales et de leurs sous-traitants, au niveau européen comme au niveau national. Cela va dans le sens d’un renforcement de la transparence et des obligations de publication d’informations extra-financières, ainsi que d’une meilleure protection des travailleurs. Selon vous, est-ce une manière pertinente pour les représentants des citoyens de « passer à l’Europe » ?
M. Luuk Van Middelaar. Je vous remercie pour vos nombreuses questions et suggestions. Elles se rattachent, selon moi, à deux grands thèmes : d’une part, au volet institutionnel ; d’autre part, à la question du « public européen », du rapport aux citoyens, notamment aux jeunes.
Comment le système intentionnel européen peut-il évoluer ? Au vu de mon expérience et de mon analyse, le « saut fédéral » n’est pas une solution aux problèmes que traverse actuellement l’Europe. Il n’est, selon moi, ni possible ni souhaitable. Il faut partir des bases existantes, à savoir des institutions européennes à Bruxelles et des gouvernements des États membres, qui doivent agir ensemble en tant qu’Union. On ne peut pas se passer des États : dans tous les domaines autres que le marché, lorsqu’il faut agir, par exemple sauver une monnaie ou des banques, garder les frontières ou envoyer des hommes en Somalie, ce sont les État qui disposent des ressources nécessaires, notamment humaines et financières – ainsi, pour sauver les banques, il faut l’argent du contribuable. Il s’agit donc d’organiser l’action collective entre Bruxelles et les capitales. C’est cela, l’Europe.
Qu’est-ce que cela signifie plus concrètement ? Ainsi que vous l’avez relevé, monsieur Pueyo, il y a une tension naturelle entre la Commission et le Conseil européen. Chacune des deux institutions a son rôle : la Commission a le monopole de l’initiative ; le Conseil européen doit donner les grandes orientations stratégiques. Tout le monde comprend bien qu’il y a une zone grise entre les deux.
La Commission a toujours tiré sa force du fait qu’elle est, d’une part, un organe technocratique, doté des compétences que lui confèrent les traités, et qu’elle a, d’autre part, une vocation politique. Cette tension entre les deux faces de la Commission a toujours été utile et fructueuse. Cependant, depuis la crise de l’euro, elle s’est exacerbée au point de devenir presque intenable : la Commission a reçu de nouveaux pouvoirs de contrôle dans le domaine économique – on peut notamment penser à son rôle au sein de la troïka – et elle doit, dans le même temps, se montrer plus active politiquement. Dans la mesure où la Commission devient très politique, des voix s’élèvent, notamment en Allemagne, pour demander à ce qu’on lui retire ses compétences technocratiques. À mon avis, ce serait une erreur assez grave, car on affaiblirait le « bloc-moteur » de l’intégration sans savoir ce qui pourrait le remplacer. Cette tension entre les deux dimensions de la commission, politique et technocratique, doit être mieux gérée, y compris par les responsables politiques, pour éviter un éclatement.
On emploie parfois l’expression « exécutif européen » pour désigner la Commission européenne. Or cela prête à confusion, car la Commission n’est pas le « Gouvernement européen » : elle participe au pouvoir exécutif européen aux côtés du Conseil européen et de certaines formations du Conseil des ministres qui ont des fonctions exécutives – par exemple, le Conseil des affaires étrangères ou l’Eurogroupe, qui réunit les ministres des finances des États de la zone euro. En d’autres termes, l’exécutif européen est dispersé, et le Conseil européen en est le nœud principal. Il réunit, autour de son président – actuellement, M. Donald Tusk –, les vingt-huit chefs de l’exécutif des États membres et le président de la Commission, qui est, en quelque sorte, le chef de l’exécutif de la « sphère interne ». Il est très important que le président de la Commission soit membre du Conseil européen, car c’est en son sein que se prennent les grandes décisions. Selon moi, il faut organiser une meilleure coopération entre le Conseil européen et la Commission.
D’un point de vue plus prospectif, la Commission ne pourra pas devenir le Gouvernement européen, face à un Parlement unique qui s’exprimerait au nom de toute l’Europe. En effet, cela ne correspond pas du tout à ce qu’est l’Europe, à savoir une civilisation profondément plurielle, où les clivages politiques fondamentaux sont non pas ceux qui existent entre les partis – tel est le cas seulement à l’intérieur des États membres –, mais ceux qui existent entre les pays eux-mêmes, par exemple entre pays du Nord et du Sud, ou entre pays de l’Ouest et de l’Est. Dans un ordre politique donné, la politique doit servir à gérer les tensions. Au sein de l’Union européenne, on peut surmonter certaines tensions en améliorant l’organisation, mais il en existe qui sont insurmontables, qu’il faut tout de même gérer. Ainsi, un Français ne deviendra jamais un Allemand, et réciproquement. À titre personnel, j’en suis ravi pour les peuples allemand et français, mais aussi pour les petits peuples qui les entourent. La tension entre l’Allemagne et la France est beaucoup plus fondamentale que celle qui peut exister entre la gauche et la droite. Un système gouvernemental qui entend gérer ces tensions doit prendre en compte cette réalité, sans quoi il sera hors sol. Un parlement unique organisé selon des lignes partisanes ne peut pas le faire.
S’agissant d’une éventuelle intégration économique plus poussée, messieurs Caresche et Richard, tout le monde est conscient, en France comme dans le reste de l’Europe, qu’il y a aussi une question de calendrier : on n’avancera pas d’un pouce d’ici aux rendez-vous électoraux en France et Allemagne ; il ne faut s’attendre à rien de concret avant que soient en place, à Paris et à Berlin, de nouveaux gouvernements qui disposent du capital politique nécessaire pour faire des pas l’un vers l’autre, dans les deux sens. Pour avoir vu les choses de près entre 2010 et 2014, je peux vous dire que toutes les avancées réalisées pendant la crise de l’euro – l’union bancaire, l’action de la Banque centrale européenne – ont été des deals presque donnant-donnant, combinant deux principes : la responsabilité ou la discipline, chère aux pays du Nord, et la solidarité, chère aux pays du Sud. Pour ce qui est du rapport des cinq présidents, sans doute faudra-t-il faire des pas dans cette direction, mais il faut, au préalable, que le climat politique soit propice, que la confiance soit de retour entre Paris et Berlin.
J’en viens à la question du rapport aux citoyens. De mon point de vue, ainsi que je l’ai formulé en 2009 dans Le passage à l’Europe, l’enjeu, c’est de pouvoir dire « nous, les Européens », et non plus « eux à Bruxelles », « eux, les Allemands qui décident pour nous » ou encore « eux, les continentaux », comme on a pu l’entendre au Royaume-Uni.
Cela demande plusieurs éléments, que vous avez, pour beaucoup, mentionnés.
Cela demande d’abord un sens commun de l’histoire européenne, par distinction avec l’histoire du reste du monde. Ainsi, il apparaît légitime de construire entre nous, en tant qu’Européens, un espace économique et politique, qui n’aura pas nécessairement de prétention universelle ou mondiale. Même si les experts ont du mal à définir très précisément qui fait partie de l’Europe ou non, les Européens ressentent intuitivement qu’ils partagent non seulement un territoire, mais aussi une histoire très longue et une civilisation. On devrait le rappeler plus souvent, tant au sein de la société civile que dans les instances de responsabilité gouvernementale.
Cela demande ensuite de définir le territoire européen. Le caractère incertain de notre identité collective vient en partie de l’incertitude sur les frontières de l’Union européenne. Qui fait partie du club à nos côtés ? La Turquie ou l’Ukraine feront-elles un jour partie de notre Union ? Qu’est-ce que cela signifierait ? L’incertitude sur les frontières empêche une identité collective de cristalliser petit à petit, d’être nourrie par un récit sur ce que nous sommes. Tant que la porte restera ouverte, il sera très difficile de construire ce « nous ». Depuis le début de la construction européenne, il y a des habitudes acquises non seulement dans le domaine économique – je les ai évoquées –, mais aussi dans le domaine politique ou symbolique : nous avons du mal à dire non, à fermer la porte à quelqu’un, à dire « voilà qui nous sommes, et vous n’en faites pas partie ». Cela demande une vraie force politique et symbolique. Ce sont des questions que les populations se posent, notamment par rapport à la Turquie. Ces points d’interrogations ne devraient peut-être pas planer éternellement.
Enfin, il faut que ce « nous » puisse s’exprimer dans les institutions. À cet égard, je vous rejoins tout à fait, madame la présidente : il faut renforcer le rôle des parlements nationaux. Des pas sont faits dans cette direction, mais d’autres idées sont envisageables en la matière, notamment celles qui figuraient dans l’accord de février 2016 avec le Royaume-Uni. En tout cas, il faut continuer à frapper sur ce clou.
La multiplication des référendums, que vous avez évoquée en introduction, est un signe que, malheureusement, la représentation par les parlements nationaux ne fonctionne pas. Il y a un phénomène de cocotte-minute : c’est parce que les gens ne se sentent pas représentés par la voie parlementaire que l’on joue la carte du référendum. Certes, l’outil du référendum est détourné et exploité, mais il y a aussi un problème de fond.
Pour conclure, il faut renforcer le sentiment que nous avons une histoire commune. C’est uniquement sur cette base que nous pourrons affronter l’avenir en commun. Il faut continuer à faire de la pédagogie, mais l’histoire en marche fait, elle aussi, de la pédagogie, certes de façon parfois plus douloureuse : le sentiment qu’ont les 500 millions d’Européens de partager un espace commun qui est plus qu’un espace ira croissant avec la globalisation et la montée en puissance d’autres pays dans le monde. De même, le Brexit montrera aux Européens du continent ce que sont les coûts d’une sortie de l’Union et leur permettra de mesurer l’intensité de nos liens, qui ne sont pas uniquement d’ordre économique, mais aussi d’ordre politique.
Un mot personnel sur la France : votre pays, qui a toujours donné des impulsions au vivre-ensemble européen, pris des initiatives, apporté une énergie ou contribué à la définition des orientations, manque cruellement en ce moment en Europe. De ce fait, on parle beaucoup de la place de l’Allemagne. Mais, si celle-ci pèse, notamment du point de vue démographique et économique, elle ne donne pas toujours de direction. Dans le contexte actuel « post-Brexit », il est important que la France et les responsables politiques Français se saisissent à nouveau de leur rôle historique : animer l’Europe, identifier les grands intérêts stratégiques, convaincre l’Allemagne et les autres partenaires d’avancer ensemble. C’est crucial pour notre avenir commun.
La présidente Danielle Auroi. Je crois que nous partageons tous, ici, l’idée que vous venez d’exprimer en conclusion. Merci de souligner ainsi le rôle d’impulsion de la France dans le projet européen. Nous allons nous faire un devoir de le rappeler à notre tour. Cela nous conforte dans notre propre mission, non seulement auprès de nos collègues, mais aussi auprès de nos concitoyens.
Je vous remercie également pour votre ouvrage. L’analyse du partenariat franco-allemand que vous y développez notamment peut être éclairante pour nous tous.
J’espère que nous aurons l’occasion de vous entendre à nouveau dans quelques mois, pour voir si les choses avancent.
Audition de M. Christian Lequesne, ancien directeur du Centre d'études et de recherches internationales et professeur de science politique à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes
Compte rendu du mercredi 9 novembre 2016
La Présidente Danielle Auroi. Je vous remercie vivement d’avoir accepté notre invitation à participer à ce cycle d’auditions sur l’avenir de l’Europe. Nous sommes assez peu nombreux ce matin mais l’actualité politique américaine a sans doute conduit certains de nos collègues à veiller fort tard cette nuit.
Dans ce cycle d’auditions, où nous avons une démarche prospective, nous cherchons à connaitre l’analyse de professionnels éclairés sur l’Union européenne. Votre regard de chercheur enrichira notre réflexion, entamée autour d’échanges similaires avec Enrico Letta et Luuk Van Middelaar. C’est une occasion d’échanger librement, de prendre du recul, et de contribuer à tracer de nouvelles perspectives pour relancer l’Union.
Dans un récent article intitulé « Le Brexit n’est pas seulement une question britannique », vous avez écrit : « il faut bien qu’à un moment l’Europe retrouve le chemin de l’avenir en proposant un nouveau projet politique, par exemple autour d’une zone euro réformée ».
L’objectif de ce cycle d’auditions est justement de nourrir de tels projets !
Notre démarche suppose de réfléchir et d’échanger très librement. N’hésitez pas à dresser des perspectives ambitieuses, même si elles sont peu réalistes à court-terme : je crois que nous avons besoin aujourd’hui d’essayer de voir plus loin, de retrouver un sens, une perspective.
Vous avez également écrit sur l’intégration différenciée, et je sais que vous avez été auditionné par certains membres de notre commission sur le sujet.
À votre avis, doit-on envisager la suite de la construction européenne autour d’un noyau-dur d’États voulant aller plus loin ? – Une Europe des avant-gardes fait-elle sens ? Ne court-on pas le risque de créer une Europe « à la carte » ou « à deux vitesses » ? À ce titre, que pensez-vous de la contribution de la Fondation Bruegel proposant un « partenariat continental » qui permettrait de formaliser cette Union à deux vitesses ?
Dans un autre registre, quelle appréciation portez-vous sur l’évolution des liens entre la Pologne, la Hongrie et le reste de l’Union ? Comment peut-on renforcer la prise en compte des droits fondamentaux et de la démocratie au sein de l’Union ?
Et sur l’état du moteur franco-allemand ?
Pensez-vous qu’il est possible, et surtout souhaitable, de procéder à de nouvelles réformes institutionnelles à moyen-terme ? Ou le nouveau souffle dont l’Union a tant besoin doit-il passer par d’autres types de réformes ? La feuille de route issue du sommet de Bratislava vous paraît-elle à la hauteur de la nécessaire refondation de l’Union ?
Comment approfondir la démocratie européenne, l’« espace politique européen », et quel rôle pour les Parlements nationaux dans ce cadre ?
Je ne vais pas être plus longue, pour laisser le plus de temps possible au débat sachant que nous devons terminer vers 9h30 ou 35.
M. Christian Lequesne. Quand j’ai accepté cette invitation, je ne savais pas que j’interviendrai le matin même des résultats des élections présidentielles américaines ! Il est assez tentant de faire un lien entre l’élection de Donald Trump et le vote en faveur du Brexit en Grande-Bretagne. Dans les deux cas, il s’agit d’une réaction d’une partie de la population laissée pour compte des évolutions économiques de ces vingt dernières années et qui se mobilise contre cette perte de statut ou d’identité et qui cherche à « faire payer » les membres de « l’establishment ». Ce rejet des élites, des privilégiés coupés du peuple, Donald Trump et le parti UKIP l’ont largement instrumentalisé.
Il y a quelques années, les réformes libérales paraissaient un gage pour l’avenir mais en réalité ces réformes n’ont pas eu les effets bénéfiques attendus et n’ont pas favorisé l’émergence de nouvelles classes moyenne, bien au contraire. La revue « NewStatesman » a récemment titré : « The closing of the liberal mind » que l’on peut traduire par la fermeture à l’esprit libéral. Le libéralisme ne se limitait pas aux questions économiques il prônait aussi une société ouverte sur l’extérieur, multiculturelle, favorable aux libertés des personnes. Ces valeurs d’ouverture sont aujourd’hui rejetées.
Le Brexit intervient après une série de crises successives comme celles de 2008 ou de la zone euro mais grâce à des compromis, l’Union européenne avait réussi à franchir plusieurs étapes d’intégration. Le vote du Brexit ne correspond pas à une énième crise des partenaires européens, il risque de compromettre l’avenir même de la construction européenne qui est menacée d’un véritable délitement. Ce précédent renforce le sentiment anti européen et plusieurs États souhaitent à leur tour organiser des référendums comme au Pays Bas ou le part du peuple Danois ou encore le mouvement « cinque stelle » italien dont la contestation de la construction européenne est moins frontale.
Le premier ministre britannique a eu un discours très dur à Birmingham récemment mais elle s’adressait à des militants de son parti, alors qu’en réalité elle est bien consciente de la nécessité de faire des compromis pour trouver une solution de sortie qui fasse le moins de dommages possibles. La justice britannique a estimé que le Parlement devrait se prononcer sur la sortie de l’Union européenne, le Gouvernement britannique a fait appel de cette décision, ce qui prolonge de facto la période transitoire. Le Parlement sera sans doute partisan d’une négociation longue qui pourrait se prolonger au-delà des échéances des futures élections européennes et devrait inciter à un « soft Brexit » avec une possibilité de trouver un compromis pour que le pays puisse continuer à avoir accès au marché intérieur.
Ce compromis est -il possible, est-il souhaitable ? Que penser de la proposition de la Fondation Bruegel qui suggère d’admettre la notion de quotas qui viendrait remplacer la liberté de circulation des personnes ? N’est-il pas dangereux de toucher aux quatre libertés fondamentales qui constituent l’identité même de la construction européenne ? Les États membres doivent transformer cette crise du Brexit en une occasion pour refonder le modèle européen et faire de cette menace une occasion de sursaut.
L’Europe différenciée est-elle une solution face à la montée des eurosceptiques ? L’idée de créer des cercles concentriques avec des États plus ou moins intégrées dans la construction européenne est une idée déjà ancienne, la CDU l’avait déjà proposé en 1994. Certains États dans le cercle le plus extérieur, construiraient un libre marché intérieur, ce cercle pouvant associer la Grande Bretagne ainsi que certains États actuellement candidats. Ce cercle ressemblerait à l’actuel espace économique européen qui associe aujourd’hui la Norvège, l’Islande et le Lichtenstein. Les contributions de ces États seraient réduites par rapport à ceux appartenant au premier cercle qui eux seraient beaucoup plus intégrés et rassemblerait les États appartenant à la zone euro et ceux qui aspirent à y entrer.
Cette organisation nécessiterait une réforme institutionnelle pour modifier les mécanismes de prise de décision.
Il y a quelques années les pays d’Europe centrale avaient beaucoup d’empressement à rejoindre la zone euro alors qu’aujourd’hui, au contraire, la Pologne par exemple considère que sa monnaie nationale l’a protégée par rapport à l’effet récessif de l’euro. L’Union européenne n’est plus aujourd’hui perçue d’abord comme un grand marché. On lui demande d’être un facteur de protection et on voudrait lui conférer certains attributs régaliens comme la défense contre le terrorisme, la gestion efficace des frontières extérieures, certains parlant même de politique de défense.
La difficulté avec ce mécanisme des cercles concentriques est de faire comprendre aux pays de l’Europe centrale qu’ils ont vocation de faire partie du premier cercle. De plus, aucun progrès notable dans l’organisation de l’UE ne pourra intervenir avant les échéances électorales en France et en Allemagne. L’opinion publique ne peut se satisfaire de cette idée d’Europe différenciée car il manque un discours politique mobilisateur.
Depuis le non français au référendum sur le traité constitutionnel européen, les politiques ont tendance à occulter les questions européennes qui restent gérées entre spécialistes sans contrôle démocratique. Il faudrait au contraire repolitiser le débat, Mattéo Renzi l’a bien compris même si ses déclarations sont parfois un peu populistes. La réorganisation institutionnelle ne doit pas apparaitre comme une discussion entre experts. Elle doit être au service d’un projet d’avenir.
Trop longtemps les instances communautaires ont eu des positions réactives pour faire face aux crises comme ce fut encore le cas lors de la crise des réfugiés. Il faut changer de démarche et proposer un projet crédible qui aborde franchement les défis actuels. L’Union européenne doit s’interroger sur la possibilité de réguler les effets de la mondialisation alors que jusqu’à présent les opinions publiques considèrent que les politiques sont impuissants.
Ce doit être aussi l’occasion de bien expliquer que cette Europe différenciée n’est pas fondée sur une exclusion mais au contraire qu’elle permettra une intégration à un rythme spécifique à chacun pour permettre aux États membres de librement choisir leur mode de participation au projet européen.
Il faut aussi faire preuve de pédagogie pour faire comprendre l’originalité de la construction européenne qui n’est pas un projet libéral mais qui au contraire repose sur des mécanismes de régulation protecteurs comme dans la politique agricole commune ou la politique de cohésion des territoires. L’atout de l’Union européenne c’est justement d’être capable d’élaborer des compromis respectueux des intérêts de chaque État membre. Loin d’être une faiblesse cette capacité à élaborer des solutions de consensus est un véritable facteur de stabilité et de progrès.
M. Michel Piron. Merci beaucoup pour cet exposé qui soulève de nombreuses questions.
Votre introduction interrogeait des concepts fondamentaux, notamment la question de la gouvernance. La mondialisation soulève de plus en plus de questions et provoque de plus en plus de réactions voire de rejet, et ce qui vient de se passer aux États-Unis le montre. La mondialisation est-elle gouvernée ? Si oui, par qui ? Pour qui ? C’est la question des termes de l’échange. Je ne veux surtout pas tenir un discours bassement protectionniste, mais nous voyons bien, un peu partout, que les promoteurs et premiers gagnants de la mondialisation parlent au moins deux langues, sont les plus mobiles, les plus instruits. En revanche, il semblerait qu’il y a beaucoup de perdants, pas mobiles, pas instruits, qui sont donc demandeurs de proximité. Les termes de l’échange de la mondialisation ne participent-ils pas à l’énorme inquiétude actuelle ?
Vous employez le terme de désintégration s’agissant de l’Europe – je suis également très inquiet de ce risque -, mais le mot est-il bien choisi pour essayer de comprendre véritablement ce qui est en train de se passer ? N’y a-t-il pas au contraire une vraie demande de réintégration, notamment à l’intérieur de chaque pays, dans un modèle beaucoup plus fédéraliste, une demande de nouveaux repères dans cette gouvernance ? N’y a-t-il pas une contradiction entre un centralisme administratif manifeste en Europe et un fédéralisme politique beaucoup moins manifeste quand il s’agit de l’impuissance politique et encore une fois de la gouvernance ? Vous avez évoqué en des termes très intéressants le cas de M. Matteo Renzi, qui, à travers ce qu’il dit et que je ne partage pas toujours, semble combattre avant tout les administrations, plus que des politiques qui n’existeraient plus. Est-ce que l’on ne fait pas face à une exaspération démocratique contre une exagération administrative ? La question de l’échelle est probablement majeure : est-ce que la politique est capable de gouverner n’importe quelle échelle – nationale, européenne, mondiale ? -, ou se retrouve-t-elle contrainte, au-dessus d’une certaine taille, à s’en remettre à l’expertise administrative, en sacrifiant son essence, c’est-à-dire sa capacité à exprimer les demandes du peuple et à véritablement gouverner ? La politique est-elle condamnée à n’être plus qu’une relation à l’extérieur, à l’étranger, que ce soit par la voie diplomatique ou celle du conflit ? Finalement, peut-on encore faire de la politique dans le contexte d’aujourd’hui ?
M. William Dumas. Le résultat des élections américaines ce matin montre en effet qu’il y a une véritable exaspération de nos peuples. Je suis fils d’agriculteur, et élu du département du Gard : je sais à quel point l’Union européenne et ses aides ont permis la survie du Midi viticole ! Pourtant, quand je discute avec les jeunes agriculteurs de ma circonscription, je vois qu’ils pensent que l’Union européenne, c’est seulement des contraintes et des problèmes, ils ne se rendent pas compte que notre agriculture ne s’en serait jamais sortie sans elle. Les politiques sont sans doute tous responsables de cette situation, à force de faire de l’Europe un bouc émissaire et de ne pas prendre nos responsabilités.
M. Lequesne, je pense que vous avez totalement raison lorsque vous parlez des cercles concentriques et de la nécessité de se recentrer sur un noyau dur. Je pense que nous sommes allés trop vite dans l’élargissement de l’Union. Ce n’est plus possible de prendre des décisions à vingt-sept ou vingt-huit ! Les pays candidats à l’adhésion et les nouveaux entrants attendent que l’Union leur apporte la prospérité et une amélioration de leurs conditions de vie, mais l’idée d’une Europe de la paix et de la sécurité semble oubliée. Où est l’Europe de la défense ? La France est très isolée dans le maintien de la paix dans le monde. Où est la solidarité en Europe aujourd’hui ? Je pense que le Brexit n’est qu’un premier pas, et va donner des idées à d’autres.
Mme Nathalie Chabanne. Il y a des raisons d’être inquiets. Quand je regarde la carte électorale des États-Unis, ce qui me frappe avant tout, c’est l’importance du vote en faveur du futur président dans les zones rurales. Comme M. William Dumas, je suis élue d’un département rural, les Pyrénées-Atlantiques. Ce département a lui aussi a bénéficié de la politique agricole commune et des fonds structurels, et pourtant, nos citoyens ont le sentiment d’être des citoyens de « seconde zone ».
J’adhère à votre idée de noyau central, comme beaucoup de politiques, mais j’ai bien peur que ne nous puissions pas y faire adhérer la population. Ce que nos citoyens voient de l’Union européenne, c’est des contraintes, des déclarations à faire à n’en plus finir : un agriculteur de ma circonscription n’a pas pu toucher ses aides car il a fait sa déclaration avec dix minutes de retard, il n’avait pas internet depuis dix jours…
L’adhésion de la population est pourtant primordiale.
Est-ce que les institutions européennes étaient vraiment adaptées aux élargissements ? Même si nous mettons en place un noyau dur et plusieurs cercles, j’ai peur que le fonctionnement de nos institutions ne soit toujours pas le bon. Il y a un vrai problème de démocratie et l’Europe n’est pas lisible. Personne n’est capable d’expliquer simplement aux citoyens comment fonctionne l’Europe et comment sont prises les décisions ! Commission, Conseil, règlements, directives… C’est très compliqué pour tout le monde, ce qui est problématique !
Sur le Brexit, je pense que les conditions de la sortie du Royaume-Uni seront primordiales : je sais que je vais dire est dur, mais si le Royaume-Uni sort de l’Union européenne dans des conditions trop avantageuses, comment expliquera-t-on aux Français, aux Espagnols, aux Grecs, qui vivent les politiques décidées à Bruxelles soit comme des contraintes soit comme de l’austérité, que les Britanniques arrivent à obtenir ce qu’ils veulent ? Cela sera très compliqué.
La Présidente Danielle Auroi. Les citoyens ont l’impression, peut-être pas totalement à tort, que les élites politiques et administratives sont inféodées aux grands décideurs économiques, aux multinationales, aux paradis fiscaux. Si l’Union doit faire quelque chose, c’est aujourd’hui interroger une certaine forme de mondialisation. Le « noyau dur » que nous appelons de nos vœux doit se faire autour de la question sociale. Le social est au moins autant une priorité que la défense et la sécurité !
Le budget européen est devenu beaucoup trop faible et très dépendant des contributions des États. La taxe sur les transactions financières ne pourrait-elle pas être un petit signal positif et concret ?
M. Christian Lequesne. M. Piron, vous avez absolument raison de poser la question du gouvernement de la mondialisation. Mais je voudrais vous dire tout de suite que l’on emploie toujours le mot de gouvernance de la mondialisation et non pas de gouvernement de la mondialisation, et ce n’est pas pour rien : il n’y a probablement jamais eu de gouvernement de la mondialisation. Le gouvernement que nous connaissons et que nous acceptons comme légitime c’est le gouvernement des États. Mais l’Union européenne a été une des seules expériences d’un gouvernement qui dépasserait les États, et je pense que nous ne devons pas abandonner cette expérience. Je ne crois pas à un gouvernement mondial mais je crois à une forme de gouvernement européen, car il faut réguler les flux, réguler la mondialisation. Bien des populations pensent aujourd’hui que l’Europe est le cheval de Troie de la mondialisation, et il faut au contraire rappeler que l’Europe est l’un des moyens de réguler la mondialisation par les institutions.
Vous avez évoqué l’exaspération administrative, et vous avez raison, elle est présente dans de nombreuses démocraties occidentales. En même temps, je constate qu’aujourd’hui bien des gens veulent plus de redistribution, et cela passe quand même par une organisation administrative ! Il y a une contradiction entre ces demandes. Toutefois, dans le cadre spécifiquement français, il y a sans doute un problème particulier lié au fait que sous la Vème République, l’administration a constitué un fort vivier de recrutement du personnel politique. Les électeurs ont souvent le sentiment que les responsables politiques viennent essentiellement du monde administratif. Une plus grande diversité du personnel politique me semble en effet indispensable.
Sur la question des élargissements posée par M. Dumas et Mme Chabanne, je pense comme vous que l’on a élargi sans approfondissement préalable. Nous avons vraiment raté une occasion avec l’initiative Schauble-Lamers de 1994, qui disait justement qu’il fallait approfondir l’Union économique afin de préparer l’ouverture à la Grande Europe qui semblait inéluctable. Nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord sur l’approfondissement, mais nous avions des obligations morales envers les pays d’Europe centrale et orientale qui frappaient à la porte de l’Union et qui souhaitaient être réintégrés dans la famille démocratique : il était donc difficile de dire non aux élargissements, mais ce séquençage n’a pas été idéal.
Sur la question de l’Europe sociale, je vous aurai répondu il y a quelques années qu’au vu des différences entre les systèmes sociaux européens et entre les attentes des différents États membres, la construction d’une telle Europe sociale était difficile et probablement utopique. Mais aujourd’hui on sent tout de même que les demandes dans le domaine social, à la fois en termes de régulation et de redistribution, se rapprochent. Mais au préalable, il faudra bien réfléchir à la répartition des compétences entre le niveau social et le niveau national. Il faudra aussi un véritable budget européen, car nous n’avons pas construit l’Europe pour faire de la redistribution mais pour faire de la régulation ! Ce ne sera pas facile, car le contexte actuel n’est pas forcément favorable à l’augmentation des impôts…
M. Jean-Patrick Gille. On a longtemps pensé que l’Union économique induirait automatiquement et naturellement une harmonisation sociale et politique, mais on voit aujourd’hui que ce n’est pas le cas. Donc sur ces questions sociales, on en vient rapidement à penser qu’il faut un noyau dur si nous voulons y arriver car ce sera trop difficile à vingt-sept. Mais dès que l’on parle de noyau dur, on envoie un message de délitement de l’Europe ! Comment sortir de ce paradoxe ? Il faudrait sans doute avoir un discours plus clair autour de la convergence. C’est très net sur la question des travailleurs détachés. Parler de l’Europe à plusieurs vitesses, c’est aussi potentiellement tuer l’idée européenne et renoncer à la convergence. La seule réponse que l’on peut apporter aujourd’hui, c’est la convergence sociale.
La Présidente Danielle Auroi. D’ailleurs, les nouveaux entrants sont très inquiets de cette idée d’une Europe en plusieurs cercles.
M. Christian Lequesne. Comment penser le projet de la différenciation sans donner l’impression d’exclure des États membres et de créer une première et une deuxième classe ? Cette question est centrale. Je pense que le discours politique doit souligner que dans un tel système, tous les États auront vocation à rejoindre le noyau dur, même si ce n’est pas possible dans l’immédiat. Il faut aussi penser à tous les États qui ne veulent pas rejoindre ce noyau dur. La question que vous posez, vous la posez aussi à partir de votre expérience française, mais si on prend la Grande-Bretagne ou le Danemark, les électeurs sont dans une posture différente et rejettent notamment l’euro que nous considérons comme faisant partie du noyau dur. Ces électeurs veulent que l’on respecte leur choix de ne pas faire partie de la locomotive la plus rapide. Il faut dans le même temps rappeler qu’ils sont les bienvenus et que l’objectif est in fine que nous convergions tous ensemble. C’est à mon avis le seul moyen d’articuler un discours crédible sur cette question de la différenciation.
La Présidente Danielle Auroi. Je vous remercie d’avoir soulevé autant de nouvelles questions et de la qualité des débats que vous nous avez permis d’avoir.
Audition de M. Jean-Claude Piris, ancien directeur général du service juridique du Conseil de l’Union européenne
Compte rendu du mercredi 16 novembre 2016
La Présidente Danielle Auroi. Chers collègues, je suis ravie d’accueillir en votre nom M. Jean-Claude Piris, ancien directeur général du service juridique du Conseil de l’Union européenne.
Cher Monsieur, je vous remercie vivement d’avoir accepté notre invitation à participer à ce cycle d’auditions sur l’avenir de l’Europe, qui est l’occasion de tenir un propos libre, de prendre du recul et de tracer de nouvelles perspectives pour relancer l’Union.
En tant que directeur général du service juridique du Conseil – de 1988 à 2010 –, vous avez participé à la négociation des traités de Nice, Amsterdam, Maastricht et Lisbonne, ainsi qu’à celle du projet de Constitution qui, malheureusement, n’a pas été adopté. Votre grande expérience de la construction européenne nous apportera un éclairage précieux.
La tribune plutôt pessimiste que vous avez publiée au mois de septembre dernier, intitulée « Comment rendre l’Europe à nouveau populaire ? », nous a inquiétés. Vous considérez que « la transformation de la zone euro en un « noyau dur » de l’Union européenne, est devenue illusoire », qu’une révision des traités à moyen terme est exclue, que l’idée de se tourner vers les États fondateurs est obsolète et qu’une initiative franco-allemande importante paraît improbable à court terme. Dans ces conditions, comment serait-il encore possible de rendre l’Europe populaire ? Si sortir des traités actuellement en vigueur paraît difficile, que faire dans leur cadre pour renouer avec des opinions nationales de plus en plus eurosceptiques ?
Je souhaiterais aussi que nous revenions ensemble sur cette idée d’une Europe comportant un cercle plus fortement intégré et un second cercle, idée que les membres fondateurs ont longtemps promue, notamment les Pays-Bas, selon lesquels il faut refaire un « noyau dur », tandis qu’elle inquiéterait plutôt les derniers entrés, comme la Bulgarie ou la Roumanie, qui ne voudraient pas devenir des membres « de deuxième classe » de l’Union européenne. Quelles sont les possibilités ?
Plus généralement, comment approfondir la démocratie européenne, malgré tous les carcans ? Et comment mettre un terme à cette césure, que l’on retrouve aussi aux États-Unis, entre des « élites », qui seraient loin de tout, et un « peuple », qui n’aurait plus du tout l’oreille de ceux qui le gouvernent ? Est-ce encore possible ? Comment redonner un sens aux droits fondamentaux au sein de l’Union, voire en créer de nouveaux ? Et comment résoudre tous ces problèmes dans le contexte du Brexit, dont je sais que vous êtes un fin analyste ?
Naturellement, mes collègues trouveront encore d’autres questions, mais je vous remercie de nous éclairer sur ces points.
M. Jean-Claude Piris, ancien directeur général du service juridique du Conseil de l’Union européenne. Sachez tout d’abord que je suis très honoré, madame la présidente, de m’exprimer devant votre commission.
J’avais la réputation, au Conseil, d’être un optimiste et de souvent encourager les États membres à des changements de traité, mais votre propos est plutôt exact ; j’ai donc changé, je me suis adapté aux circonstances. Il y a à peu près six ans, j’ai écrit un petit livre dans lequel j’encourageais très vivement à avancer sur la voie d’un regroupement autour de la zone euro – ce petit livre, comme la plupart de mes autres ouvrages, n’a été publié qu’en anglais, tout simplement parce que les éditeurs français ne s’y sont pas intéressés, ce qui dit quelque chose de l’Europe.
Tout d’abord, je suis d’accord avec l’analyse qui prévaut, selon laquelle la situation de l’Union européenne est très grave – suivant les affaires européennes depuis vraiment très longtemps, je le dis en connaissance de cause. Pendant un demi-siècle, l’Union européenne a été synonyme de paix, de fin des divisions sur le continent, de démocratie, de droits de l’homme, de droits sociaux, de croissance économique, etc. N’oublions cependant pas qu’elle est très jeune. N’ayant que soixante ans, elle est très faible et un peu artificielle aux yeux des citoyens, alors que les États-nations sont, eux, vieux et forts. Cela ressort très vite en période de crise, avec des tentations de repli sur soi, de politiques dites « identitaires », des tentations nationalistes, populistes, etc. Pour beaucoup, aujourd’hui, la légitimité démocratique et les résultats de l’Union européenne sont insuffisants ; elle est vecteur de la mondialisation, source de chômage, d’immigration illégale, etc.
Dans un premier temps, je décrirai les multiples et graves crises qui affectent l’Europe. Ensuite, j’examinerai quelles réactions politiques sont possibles.
Au mois d’octobre 2013, m’exprimant, pour le début d’une nouvelle année universitaire, devant une université britannique, j’avais décrit les cinq crises – j’en avais fait le titre de mon exposé – qui, à mon avis, frappaient alors l’Europe : la crise économique structurelle ; la crise de la zone euro ; la crise politique des États occidentaux, que vous avez résumée, madame la présidente, notamment avec cette césure entre élites et peuples ; la crise politique de l’Union européenne en tant que telle, qui perdait déjà le soutien populaire ; la crise des relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Aucune de ces cinq crises n’est aujourd’hui résolue, mais d’autres s’y sont ajoutées.
La crise économique, la faible croissance et l’insuffisante compétitivité dépendent avant tout de chaque État membre et non de l’Union européenne directement. Certains réussissent bien, comme l’Allemagne et l’Autriche, ou, dans une moindre mesure, les Pays-Bas. Pour ceux qui ne réussissent pas, notamment les pays les moins compétitifs, les solutions impliqueraient de porter atteinte aux protections sociales, à l’État providence, etc. Vous savez combien c’est difficile sans l’appui des peuples – on le voit en Grèce –, d’autant que la mondialisation met déjà à mal nos protections sociales. En outre, ce serait contraire à nos valeurs fondamentales – les valeurs qui sous-tendent l’idéal européen seront le fil rouge de mon exposé.
Quant à la crise de la zone euro, nous en sommes toujours au même point. Les nombreuses mesures que nous avons prises constituent un progrès et ont stabilisé la situation. Néanmoins, elles laissent intactes les racines de la crise, qui tiennent à une asymétrie entre une politique monétaire centralisée et des politiques budgétaires, économiques, décentralisées au niveau des États membres. Quant à l’idée d’une solidarité au sein de la zone euro, les contribuables des pays créditeurs ne veulent pas subventionner sans fin ceux qui des pays débiteurs. Et, sur le plan politique, qui aurait une légitimité démocratique suffisante pour décider des budgets, des politiques économiques et sociales des États de la zone euro ? Ces questions demeurent sans réponse, et les risques n’ont pas disparu.
La crise de confiance politique, dont le scrutin du 8 novembre dernier aux États-Unis montre qu’elle ne sévit pas qu’en Europe, est marquée par la désespérance de beaucoup, la montée des populismes, la tentation de se refermer au monde. Prospérant sur les inégalités croissantes induites par la mondialisation, l’insuffisante réactivité des gouvernants et leurs faibles marges de manœuvre, elle affecte de nombreux États membres et menace les valeurs de l’Union européenne elle-même. Cependant, de ce point de vue, la situation n’est pas la même en Europe qu’aux États-Unis ou même au Royaume-Uni – j’y reviendrai.
Dans ce contexte, évidemment, l’Union européenne est le bouc émissaire parfait. Elle serait responsable des erreurs économiques des États membres, alors qu’au contraire elle essaie de les pousser à adopter des politiques économiques vertueuses. Elle serait responsable de la mondialisation, alors qu’au contraire elle peut aider à s’en protéger ou à en tirer profit. Elle serait responsable des inégalités, alors qu’elle n’a même pas les moyens, ni juridiques ni financiers, d’avoir une véritable politique sociale. Au plan de la légitimité, on critique sa complexité institutionnelle, une complexité bien réelle mais, je crois, inévitable. On critique la demi-réussite et donc le demi-échec du Parlement européen ; cela aussi me paraît inévitable, rien ne peut être parfait. On critique aussi l’insuffisante appropriation par les parlements nationaux du contrôle des actes législatifs de l’Union européenne et des activités de l’Union européenne ; de ce point de vue, si je puis me permettre, madame la présidente, des progrès sont effectivement possibles.
Beaucoup s’interrogent sur la raison d’être même de l’Union européenne. Quels sont ses buts ? A-t-elle encore un avenir ? Cela n’empêche pas les musiciens de continuer à jouer alors que le Titanic coule et de proposer des normes sur les grille-pains et les pommes de douche, comme l’a souligné M. Védrine, alors même que l’union bancaire n’est pas encore terminée et que nos frontières extérieures restent perméables.
La crise avec le Royaume-Uni, enfin, s’est résolue par le vote du 23 juin 2016 et le chaos politique et constitutionnel que connaît aujourd’hui ce pays, un chaos qui ne surprend guère, et de sombres perspectives pour l’économie britannique, pour la prochaine décennie, ou même, selon moi, une plus longue période, mais aussi par l’affaiblissement de l’Union européenne dans le monde. Certes, le Royaume-Uni est un cas à part, mais, après le référendum français de 2005 et le référendum aux Pays-Bas, le Brexit est un grave échec. Il montrera du moins combien il est difficile, coûteux et pénible, pour un État de l’Union européenne, de se retrouver seul.
À ces cinq crises non résolues se sont ajoutés d’autres problèmes : les dangers pour la sécurité intérieure et extérieure de l’Union européenne ; la crise migratoire ; les conséquences préoccupantes de ces phénomènes, avec, d’une part, pour la première fois depuis la création de l’Union européenne, des divisions graves et, d’autre part, le risque d’une remise en cause des fondements de l’Union européenne que sont ses valeurs et le principe de l’État de droit. Vous me permettrez de considérer, en tant que membre du Conseil d’État, juriste de l’Union européenne, que c’est là le cœur même de l’Union européenne
Pour la première fois, les dangers pour la sécurité intérieure et extérieure – en l’occurrence, le terrorisme, l’Ukraine, la Crimée – sont graves et concomitants. Comme dans d’autres cas, la responsabilité de l’Union européenne est mise en cause par certains : les actes de terrorisme seraient liés à la libre circulation des personnes et à Schengen, tandis que la politique russe serait liée à l’accord, pas encore entré en vigueur, entre l’Ukraine et l’Union européenne, etc. De plus, personne ne sait aujourd’hui quelle sera la politique extérieure et de défense du Président Trump.
La crise migratoire, pour sa part, a des causes structurelles, qui excèdent les seules violences en Syrie, en Irak, en Libye et ailleurs, et s’inscrit dans le long terme. La petite Europe – petite démographiquement parlant – reste riche et attirante pour ses voisins africains et orientaux, dont la croissance démographique est forte et la croissance économique insuffisante. Les réponses de l’Union européenne, peu convaincantes dans un premier temps, semblent aujourd’hui prendre forme. J’espère que cela s’améliorera encore, mais les frontières extérieures restent poreuses.
Ces problèmes, notamment la crise de la zone euro et la crise migratoire, ont créé de graves divisions entre États membres : Nord et Sud, créditeurs et débiteurs, Est et Ouest, anciens et nouveaux. Cette situation, inédite, est préoccupante parce qu’elle fait peser des risques pour les valeurs de l’Union européenne. N’oublions pas que la création de celle-ci s’est accompagnée d’une révolution juridique : pour la première fois, des États ont décidé de garantir que les engagements pris entre eux seraient appliqués. Cela s’accompagnait d’un contrôle exercé par des institutions indépendantes en mesure de leur infliger de très lourdes sanctions financières en cas de non-respect ou de mauvaise application du droit de l’Union européenne. C’est là le fondement même de l’Union européenne, de son marché intérieur, de sa crédibilité : des décisions sont prises, et appliquées par les États membres. Auparavant, les traités n’étaient pas toujours appliqués. Le respect de la règle de droit a, en somme, une valeur existentielle pour l’Union européenne.
Jusqu’à présent, les États jouent le jeu, et paient les amendes – il en a d’ailleurs été infligé de fortes à la France. Cependant, certains frémissements actuels me font un peu peur. Les décisions prises à la fin de l’année 2015 sur la répartition des réfugiés entre États ne sont ainsi pas appliquées ; un État membre a même organisé un référendum pour tenter de décider qu’elles ne le seraient jamais. Un deuxième, bien qu’encore membre, ne cache pas ses efforts pour tenter de négocier des accords commerciaux avec des pays tiers, alors que ce n’est pas permis – c’est là une compétence exclusive de l’Union européenne. Un troisième s’en prend à l’indépendance de ses propres institutions judiciaires. L’Union européenne ne pourra pas survivre si les États suivent cette voie, s’ils ne paient plus les amendes, s’ils n’appliquent plus le droit de l’Union européenne.
Mardi 8 novembre, l’élection de Donald Trump a montré que l’impensable pouvait arriver, que des valeurs apparemment communes aux États occidentaux pouvaient être brutalement remises en cause. L’Europe, ce n’est cependant pas les États-Unis. Ce sont nos valeurs qui nous distinguent, nous, Européens, des autres habitants de la planète, c’est notre conception de l’organisation de la vie en société. L’interdiction du port d’armes, l’interdiction de la torture, l’interdiction de la peine de mort, le droit à l’avortement ou au mariage homosexuel, la sécurité sociale pour tous, la protection des plus pauvres et la lutte contre les inégalités, la lutte contre le changement climatique font rarement débat en Europe occidentale. Et tout cela est aujourd’hui mis en cause aux États-Unis !
Des valeurs différentes se traduisent parfois en chiffres. Ainsi, aux États-Unis, le revenu médian et l’espérance de vie des cols-bleus, les ouvriers, sont aujourd’hui moindres qu’en l’an 2000, tandis que l’écart entre les 1 % les plus riches et les classes moyennes s’est creusé au point de devenir un gouffre. L’Union européenne ne connaît pas cette situation – et la France encore moins.
J’en viens aux réactions politiques possibles.
Les Européens en ont bien conscience, même les plus grands États ne peuvent relever seuls les défis de la mondialisation : la lutte contre la criminalité internationale et le terrorisme ; la protection de l’environnement et la maîtrise du changement climatique ; le contrôle des grands mouvements migratoires ; la résilience en cas de crise financière ; la puissance de négociation commerciale à l’échelle du globe face à des géants comme la Chine ou les États-Unis ; la défense, qui pourrait aujourd’hui être affectée par le désengagement américain. Les Européens le voient bien, mais ils sont aux prises, quotidiennement, avec certains problèmes : un chômage massif dans certains pays, y compris des pays membres de la zone euro, comme la Grèce et l’Espagne, avec un scandaleux taux de chômage des jeunes ; une croissance économique faible ; des inégalités qui se sont aggravées, quoique dans une moindre mesure qu’aux États-Unis ; une immigration illégale mal contrôlée.
Les gens disent que l’Union européenne, malgré des objectifs ambitieux en matière économique et d’immigration, a mal géré les crises et que les résultats sont mauvais. Cela explique le regain des réactions nationalistes ou identitaires, des tentations de repli sur soi. « Make America great again », « Britain first », « La France d’abord » sont des slogans attractifs en temps de crise, et il est très difficile de se mettre d’accord à vingt-huit sur les réponses appropriées non pas à une crise, mais à une multiplicité de crises. À l’époque de la politique de la chaise vide du Général de Gaulle, la crise était grave, mais le problème était circonscrit. Il en est allé de même lors de la plupart des crises européennes. La situation actuelle est différente.
Faut-il pour autant – c’est la première réaction politique possible - repenser complètement l’architecture, les fondations, les institutions et les buts de l’Union européenne ? À mon avis, ce serait une erreur ; c’est en outre politiquement infaisable. En effet, comme vous l’avez dit tout à l’heure, madame la présidente, et comme je l’ai écrit, une révision des traités paraît exclue à court ou à moyen terme – des politiciens néerlandais considèrent même que c’est exclu pour toujours, appréciation sans doute excessive. N’oublions pas qu’il faudrait l’unanimité, puis aller au bout des procédures de ratification, parfois référendaires, et de nombreux États refuseraient de partager leurs pouvoirs dans tous ces domaines sensibles pour résoudre la crise migratoire, la crise économique ou la crise de la zone euro. En outre, personne n’a trouvé par quel moyen miraculeux nous garantirions, le jour où nous aurions transféré ou mis en commun ces pouvoirs, la légitimité démocratique des décisions qui seraient prises – la levée des impôts, les prestations sociales, etc. Cela dit, nous avons besoin de l’Union européenne encore plus qu’il y a huit jours. Ne nous lançons donc pas dans des débats stériles qui ne nous apporteraient que de la division.
Une deuxième option, défendue à vrai dire essentiellement en France, serait de faire de la zone euro un noyau dur. J’y croyais tant que lorsque j’ai pris ma retraite de l’Union européenne j’ai consacré une année sabbatique, passée dans une université des États-Unis, à écrire un livre – « The Future of Europe : Towards a Two-Speed EU ? » – dans lequel je prône cette solution d’une Europe à deux vitesses, la zone euro devant être l’Europe qui avance le plus vite. J’ai décrit les moyens qui le permettaient, j’y croyais, mais je n’y crois plus. Un momentum existait peut-être en ce sens au plus fort de la crise, en 2010, mais cela n’a pas été politiquement possible, et, si jamais ce momentum a existé, il a disparu. Les Allemands ne sont pas prêts à une solidarité budgétaire, et se poseraient la question de la légitimité politique. En outre, les économies, les dettes publiques, les politiques fiscales et sociales, les politiques de défense – certains sont neutres – ou d’immigration et les ambitions européennes des dix-neuf États membres de la zone euro sont très hétérogènes. Je sais que le Président Giscard d’Estaing a défendu, il y a quelques jours, lors d’un colloque, à Bruxelles, l’idée d’un premier cercle comportant entre huit et douze membres, mais je ne crois plus à tout cela.
Une troisième option, celle d’une initiative franco-allemande, ne peut être envisagée avant les élections qui se tiendront dans les deux pays, entre mai et septembre 2017, et que savons-nous de ce qui serait possible ensuite ? Je n’ai pas de boule de cristal. Ce que je souhaite très vivement, car rien n’est possible sans cela, c’est une plus grande confiance, moins de divergences entre les politiques budgétaires et économiques, que nos deux pays parlent ensemble et qu’ils parviennent à des conclusions communes. Le moteur de l’Europe a toujours été là. Juridiquement, c’est possible. En toute matière qui n’est pas de la compétence exclusive de l’Union européenne, un rapprochement des politiques est possible à deux, trois, quatre, cinq – par exemple, un rapprochement des politiques fiscales, sociales, budgétaires, de défense, etc. Le problème est politique : veut-on le faire ? Et il faut garder en tête que ce serait un facteur de division avec les autres, avec ceux à qui ce rapprochement ne serait pas proposé. Certains États souffrent déjà de ne pas être membres de la zone euro. Il s’agirait plutôt de resserrer les rangs face à un possible désengagement américain.
Une quatrième option serait la création de deux cercles formés indépendamment de l’appartenance ou de la non-appartenance à la zone euro. Nous proposerions au Royaume-Uni et à d’autres, comme les États membres de l’Espace économique européen, qui viennent de l’Association européenne de libre-échange (AELE) – la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande, mais peut-être aussi comme Monaco, Andorre et Saint-Marin, avec lesquels l’Union européenne négocie un accord, de participer au marché intérieur, avec un droit de regard, ou même de décision, sur la législation concernée. Je pense que ce serait une très grave erreur. En plus, la liberté de circulation des personnes serait optionnelle, limitée par des mesures de sauvegarde. En pratique, c’est irréaliste : il n’est pas possible d’avoir deux degrés d’organes décisionnels. On sait combien les va-et-vient sont déjà nombreux non seulement entre Parlement et Conseil mais aussi à l’intérieur du Conseil – du Conseil des ministres au Comité des représentants permanents (COREPER), sans parler des centaines de groupes de travail qui préparent les travaux du COREPER. Les droits et avantages des membres de l’Union européenne doivent impérativement leur être réservés, pour des raisons surtout politiques mais aussi juridiques, et l’autonomie décisionnelle de l’Union doit être préservée. Le club doit se renforcer et se consolider, non pas se diluer.
Une cinquième option serait le protectionnisme : « Allons-y, faisons comme les États-Unis de M. Trump annoncent qu’ils vont faire ! » Je ne pense pas cela possible. Tout d’abord, cela ouvrirait une guerre commerciale, notamment avec la Chine. Ensuite, si la part du commerce extérieur dans la richesse des États-Unis est extrêmement faible, compte tenu de la force de leur marché intérieur, il n’en va pas de même pour nous, Européens, qui sommes bien plus dépendants du commerce extérieur. Une autarcie relative ne serait pas possible : nos produits de consommation courante seraient beaucoup plus chers, et nous ne pourrions plus vendre nos voitures, nos avions, etc. Je ne crois donc pas que cette voie nous soit ouverte. En revanche, nous pouvons être beaucoup plus attentifs à la protection sociale et à la protection de l’environnement lorsque l’Union européenne négocie des accords internationaux avec des pays tiers, et, oui, les mécanismes de redistribution de richesses qui protègent les perdants de la mondialisation ou prévoient des compensations peuvent être renforcés.
Après ces cinq options dont j’ai, grosso modo, dit qu’elles étaient impossibles, j’en viens à une sixième, la plus modeste et la plus réaliste : pas de grande réforme, naviguer au mieux dans le cadre actuel – en anglais, « muddling through » –, prendre des mesures concrètes, seulement dans les domaines essentiels et où il y a urgence. Pour la zone euro, je renvoie à la très intéressante contribution du think tank Bruegel. Tout n’est pas bon dans les récentes publications de celui-ci mais, en 2016, il a recommandé des actions juridiquement possibles, notamment la finalisation de l’union bancaire et d’autres mesures. Elles impliqueraient cependant un certain infléchissement de la politique allemande : une restructuration partielle des dettes, question que vient d’évoquer le Président Obama en Grèce, et une certaine relance économique, même si cela fait toujours peur en Europe – pas aux États-Unis. En matière d’immigration, les propositions sont bien connues et elles commencent maintenant à être timidement mises en œuvre, mais il faudrait y mettre beaucoup plus d’argent : il faut considérablement renforcer l’agence Frontex pour un contrôle efficace des frontières extérieures, un contrôle rapide des immigrants à leur arrivée, il faut réformer le système de Dublin, il faut lier notre politique étrangère, lier les politiques commerciale et d’aide économique de l’Union européenne aux résultats en matière d’émigration des pays qui bénéficient, il faut lutter contre les trafics de migrants, etc. En outre, un moratorium est souhaitable sur cette législation relative au marché intérieur qui donne lieu à ces articles de presse… Je sais qu’il est utile d’harmoniser les normes applicables aux tondeuses à gazon et aux aspirateurs, pour qu’ils consomment moins d’électricité, d’harmoniser les normes des pommes de douche, mais ce n’est pas le moment ; il faudrait une petite pause. Enfin, évitons de refaire, erreur fondamentale, des promesses non assorties des moyens budgétaires et juridiques nécessaires à leurs réalisations. Quand on adopte la Stratégie de Lisbonne, quand on adopte « Europe 2020 » sans prévoir un cheminement, des moyens juridiques et financiers, ce n’est pas sérieux – c’est même n’importe quoi.
J’en arrive à ma conclusion. De telles mesures suffiraient-elles à rétablir la confiance dans l’Union européenne et la popularité de celle-ci ? Elles seraient nécessaires, mais pas suffisantes, car l’Union européenne resterait opaque. Les gens ne savent pas quelles sont les limites de ses pouvoirs présents et futurs, ils ne savent pas où elle va, ni comment elle décide. Certes, pour l’instant, on ne peut pas modifier les traités, mais on peut faire preuve de pédagogie et changer les discours ambigus sur l’Europe. Plus de clarté permettrait plus de vérité, plus de passion, une plus forte capacité de toucher les émotions des Européens, cela permettrait de se fonder sur les valeurs européennes.
Une image floue n’inspire jamais confiance. Or c’est le flou et l’ambiguïté qui caractérisent aujourd’hui les finalités de l’Union européenne, tant sur l’évolution de ses frontières que sur ses pouvoirs. Pour regagner la confiance des citoyens, il faut leur parler simplement, et une vision politique claire est pour cela nécessaire au moins sur ces deux points : les pouvoirs de l’Union et la géographie de ses frontières.
Au plan géographique, quelles seront, sinon dans l’avenir lointain, du moins dans les dix ou quinze ans à venir, les frontières extérieures de l’Union européenne ? Le temps n’est-il pas venu de choisir entre, d’une part, une politique d’élargissement de l’Union, jusqu’ici été utilisée comme un outil de politique étrangère à la disposition des États membres, au prix d’un affaiblissement de l’Union européenne, de sa cohésion interne, de son efficacité et de sa compréhension par les citoyens, et, d’autre part, une Union européenne qui aide ses membres actuels et leurs peuples, qui renforce sa cohésion et sa solidarité internes, tout en aidant les autres pays tiers européens, sans pour autant leur promettre l’adhésion dans les dix ans ? L’Union européenne doit-elle s’élargir à toute l’Europe géographique, au risque de se diluer, voire d’être dans l’incapacité d’agir ?
Au plan des pouvoirs, les citoyens se demandent si l’on va vers les États-Unis d’Europe, si l’on est en train de construire un pays fédéral. Est-il possible de rassurer les uns et les autres en affirmant que l’Union européenne n’a pas pour but de devenir un État fédéral mais, plus modestement, d’aider à renforcer des souverainetés nationales souvent apparentes en les combinant pour les rendre plus effectives ? Il serait opportun de dire aussi qu’il y aura une intégration plus étroite de la zone euro, accompagnée d’une responsabilité conjointe des parlements nationaux dans les domaines économiques et budgétaires, que c’est souhaitable, que ce sera peut-être nécessaire. Et pourquoi ne pas confirmer en même temps qu’une grande partie des politiques ayant un impact direct, concret et quotidien sur les citoyens continueront à relever des États ?
Quelques mots de conclusion sur la France. J’ai tellement vécu à l’étranger que je suis Européen autant que Français. La responsabilité de la France est énorme, cruciale, essentielle. La France est au cœur de l’Europe. Sans un discours clair, une présence claire et proactive de la France, il n’y a pas d’Europe. Sans reprise des relations fraternelles avec les Allemands, l’Union est en danger. L’Union européenne a aidé la France à devenir une grande puissance. Je suis en effet convaincu que, sans l’Union européenne, notre pays ne serait pas dans la situation relativement bonne dans laquelle il se trouve comparé aux autres. Aujourd’hui, l’Union européenne a besoin de la France.
La Présidente Danielle Auroi. Par ailleurs, nous sommes en train de travailler, avec notre collègue Nathalie Chabanne, à une réflexion sur la transparence au sein des institutions européennes, et en particulier du Conseil, où l’opacité est sans doute la plus grande.
M. André Schneider. Merci, madame la présidente, de nous offrir cette occasion de débattre sur des questions de fond. Il est dommage que nous n’ayons pas toute la journée pour le faire.
J’ai cela en commun avec vous, monsieur Piris, que je suis optimiste de naissance. Étant également Alsacien de naissance, j’aime rappeler que, bien que nous ayons un régime concordataire, avant d’être baptisé je me suis fait inoculer le virus de l’Europe.
Vous vous êtes demandé si les politiques écoutaient les citoyens. Je pose la question inverse : les citoyens écoutent-ils encore les politiques ? Énormément d’Européens sont aujourd’hui désabusés, ce qui est beaucoup plus grave que d’être pour ou contre quelque chose.
La présidente m’a souvent confié des missions dans le domaine de l’énergie. Le troisième paquet européen, avec des régulateurs, le partage patrimonial, devait être merveilleux ; en réalité, cela ne fonctionne pas. Nous rêvons tous d’une forme de gouvernement européen mais pas d’une Europe fédérale qui réduise notre indépendance. La solution aux grands problèmes, chômage, affaires sociales, sont pour l’instant de la compétence stricte des pays membres, et les divergences sont très fortes. Vous avez parlé de gros écarts aux États-Unis. Tout n’est pas rose non plus en Allemagne, mais ils gèrent les choses différemment : quand quelque chose va mal chez nous, nous râlons fort et ne faisons rien, tandis qu’en Allemagne ils la ferment et ils bossent. Les attitudes sont différentes. Comment allons-nous nous en sortir ?
M. Bruno Gollnisch, député européen. Grâce à votre hospitalité, madame la présidente, je représente modestement ici ce que M. Piris a appelé la montée des populismes, mais je tiens à dire que je ne fais pas de l’Europe le bouc-émissaire de nos difficultés. Je pense même que c’est un peu l’inverse, que les échecs de l’Europe sont plutôt le reflet des carences de notre politique intérieure.
C’est au juriste que vous êtes, monsieur Piris, que je m’adresse. Vous avez, dans votre très stimulant exposé, souligné le fait que les traités européens avaient, ce qui est relativement inédit, des effets véritablement contraignants à l’égard des États membres. Je me demande si l’on n’est pas allé trop loin dans ce domaine. Certes, l’article 55 de notre Constitution donne aux traités une autorité supérieure à celle des lois internes françaises, mais, depuis l’arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation et l’arrêt Nicolo du Conseil d’État, le droit dérivé est lui aussi supérieur aux lois internes, même postérieures.
Or le droit dérivé est de plus en plus du droit dérivant. J’ai été pendant quinze ans membre de la Commission du Règlement ainsi que de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen et je dois dire, sans esprit de polémique, que c’est une expérience hallucinante. Nous discutions très fréquemment de la directive Y destinée à modifier la directive X. Au bout de trois ou quatre heures de débat, étant un peu provocateur par nature, je demandais à mes collègues s’ils avaient connaissance de la directive X ; ils ne la connaissaient pas, car les textes sont la plupart du temps introuvables. Le droit européen est très difficilement connaissable. On n’a jamais résolu, par exemple, le problème élémentaire de la codification. Si ce n’est pas connaissable par des experts, comment voulez-vous que le public n’y voie pas un fouillis qui s’impose à lui sans qu’il puisse y accéder le moins du monde, en contraste flagrant avec la clarté de notre code civil ?
M. Yves Daniel. Mon intervention sera le témoignage d’un député paysan. En tant que paysan, je trouve, en ce qui concerne la politique agricole, que l’on attend tout de l’Europe sans se poser la question de savoir ce que l’on peut apporter pour construire l’Europe.
Nous avons une Europe plutôt technique ; n’y a-t-il pas une panne de l’Europe citoyenne ? Sans adhésion citoyenne, comment construire l’Europe ? C’est selon moi une question fondamentale.
Enfin, vous avez évoqué la nécessité d’un projet. Ne devrions-nous pas en effet nous attacher bien plus à la construction de ce projet européen, au sens d’un projet de société ? Un tel projet ne peut se construire qu’à partir des jeunes et ne peut donc être fondé que sur un système d’éducation et de formation européen.
M. Charles de La Verpillière. Vous avez présenté six scénarios possibles pour l’avenir de l’Europe. Je pense qu’ils peuvent se ramener à trois.
Le premier, c’est le scénario catastrophe, celui du repli, du détricotage à partir d’un Brexit faisant tache d’huile, voire de l’éclatement. Je ne pense pas que ce soit le plus probable.
Le deuxième est l’inverse : l’approfondissement, la marche vers les États-Unis d’Europe et, pourquoi pas, la création à terme d’un État fédéral. Je n’y crois pas non plus. Je suis frappé de constater que nous vivons tous avec ce rêve que les parlements nationaux doivent jouer un rôle important à côté du Parlement européen. Or la légitimité démocratique ne se partage pas et, si approfondissement de l’Europe il y a, il faudra à un moment ou à un autre que les parlements nationaux s’effacent. Je ne dis pas que je le souhaite mais il y a une contradiction fondamentale, et nous faisons semblant de croire que nous pouvons y échapper.
Le troisième scénario, c’est, si l’on est optimiste, celui des petits pas ou, si l’on est pessimiste ou péjoratif, le scénario cahin-caha, avec des solutions par petites touches sur chacun des problèmes auxquels nous devons faire face, tels que la politique migratoire. L’Europe doit traiter ce problème mais elle pourrait être aussi le moteur de l’aide au développement. Si l’Europe a un grand chantier à ouvrir, c’est bien celui-là. C’est l’aide au développement qui réglera, ou en tout cas diminuera le problème des migrations.
M. William Dumas. Je suis heureux de voir de plus en plus de jeunes aux cérémonies du 11 novembre. L’Europe nous a apporté la paix, et l’on n’en parle jamais. Elle est beaucoup critiquée, sans voir ce qu’elle nous a apporté. Même les politiques ont tendance à en faire un bouc émissaire.
Le premier problème à résoudre en Europe est celui du chômage, qui est le principal facteur de la montée des populismes. Ce qui manque à l’Europe est une politique sociale plus adaptée – je pense notamment aux travailleurs détachés, une question qui pose de nombreux problèmes.
Je souhaite aussi que ce qui s’est passé le 8 novembre aux États-Unis nous fasse réagir. Si les États-Unis se désengagent de l’OTAN, il faudra que les pays européens prennent leur place et se mettent en première ligne. Il manque encore à l’Europe une véritable politique de défense. La France est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme et elle n’est pas du tout aidée par les autres pays européens.
La Présidente Danielle Auroi. Nous devons sans doute conduire une meilleure pédagogie sur le « paquet des valeurs » que vous avez rappelé. Est-il possible de faire-valoir la spécificité de ce « paquet des valeurs » européen, son progressisme, par rapport aux autres grands espaces mondiaux, nouveaux émergents ou États-Unis ?
M. Jean-Claude Piris. Les valeurs, madame la présidente, sont ce qui nous distingue, nous Européens, du reste du monde. Je voyage énormément, aux États-Unis, en Asie… Quand des Européens se retrouvent dans ces pays, ils comprennent qu’ils se distinguent et en quoi. La difficulté, pour l’Europe, c’est qu’il n’y a pas de demos, de communauté. Pour créer un début de communauté, ce sont les valeurs qui sont importantes. Nous les avons déjà. En revanche, pour être membre d’un club, il faut connaître les membres du club. Demandez aux Français. Qui connaît le nom des vingt-huit États membres ? Qui connaît le nom des dix-neuf pays dont la monnaie est l’euro ? Nous sommes à présent trop nombreux pour constituer un État fédéral. C’est une idée que l’on pouvait auparavant défendre, et que j’ai défendue dans ma jeunesse, mais qui n’est plus réalisable.
Ce n’est pas un hasard si c’est au Conseil que la transparence est la plus difficile. N’oubliez pas que les clivages à l’Union européenne ne sont pratiquement pas entre partis politiques, sauf peut-être avec le parti de M. Gollnisch, mais plutôt entre États. Au Conseil, nous sommes dans des négociations internationales en même temps que nous sommes législateur, et il est très difficile de tout mettre sur la table lors d’une négociation, alors que le droit doit être parfaitement transparent.
Quand nous adoptons une loi européenne, c’est une seule loi au lieu de vingt-huit, ce qui est tout de même beaucoup plus clair pour un opérateur économique. Quand j’étais au Conseil d’État, nous nous étions penchés sur la codification. C’est quelque chose d’extrêmement lourd et difficile ; il faut sans cesse remettre sur le métier. On procède donc plutôt à de la consolidation pour les praticiens, ce que l’Union européenne fait très bien, avec des instruments informatiques tels que Lexis.
Les citoyens ont de l’Union européenne une image floue, tentaculaire, anonyme, ils se demandent si les décisions sont prises par les fonctionnaires ou par les politiques. Ce ne sont évidemment pas les fonctionnaires qui prennent quelque loi que ce soit à l’Union européenne, vous le savez. C’est vrai que l’Union européenne a été un grand transfert des pouvoirs du législatif vers le pouvoir exécutif, car c’est l’exécutif qui contrôle ce qui est dit au nom de la France quand des lois sont adoptées au Conseil. C’est là que le rôle des parlements nationaux peut et doit être bien plus fort qu’il ne l’est aujourd’hui à l’exception de certains pays comme le Danemark, où le Folketing exerce un contrôle extrêmement tatillon sur le rôle de l’exécutif à Bruxelles. Je crois que les parlements nationaux devraient accroître leur contrôle sur les exécutifs, car si les exécutifs contrôlent leurs fonctionnaires à Bruxelles, ils ne sont pas contrôlés par le législatif et il y a une perte de démocratie à ce niveau.
Un choc mériterait d’être produit, celui que je recommandais dans ma conclusion : il faut affirmer que, pendant les dix ou quinze prochaines années, nous resterons à vingt-sept. Vous n’aurez jamais l’unanimité sur ce point au Conseil car les PECO veulent que leurs voisins de l’Est nous rejoignent, mais pour un élargissement il faut l’unanimité et, en France, un référendum ou une décision du Congrès. De même, sur l’État fédéral il faut dire la vérité aux gens : il n’y aura pas d’États-Unis d’Europe au sens des États-Unis d’Amérique, ce n’est pas possible à vingt-sept. Je pense que les prises de position de Guy Verhofstadt font plus de mal que de bien. En dehors de lui, je pense qu’il y aurait unanimité pour dire que nous ne sommes pas les États-Unis d’Europe, que nous essayons simplement de rendre des souverainetés, parfois purement apparentes, plus réelles. Nous avons, c’est vrai, à faire des petits pas fédéraux s’agissant de l’euro, mais cela ne signifie pas que nous aurons une Constitution commune.
La Présidente Danielle Auroi. Vous nous avez donné de l’espoir. Nous continuerons de travailler, avec d’autres auditions. Merci.
Audition de M. Antoine Vauchez, directeur du Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS)
Compte rendu du mercredi 30 novembre 2016
La Présidente Danielle Auroi. Chers collègues, je remercie vivement M. Antoine Vauchez d’avoir accepté notre invitation. Ce cycle d’auditions sur l’avenir de l’Europe est l’occasion de prendre du recul, et de contribuer à tracer de nouvelles perspectives pour relancer l’Union. Votre regard de chercheur, monsieur, enrichira notre réflexion, entamée autour d’échanges similaires avec des personnalités aussi variées que Enrico Letta, Luuk Van Middelaar, Christian Lequesne et Jean-Claude Piris.
Je commencerai par une question un peu provocatrice : cinq mois après le référendum britannique, croyez-vous que l’on peut encore sauver l’Union ?
Comment envisager la suite de la construction européenne ? Faut-il reparler, comme le font certains, en particulier les Néerlandais, d’un « noyau dur » d’États voulant aller plus loin, d’une Europe des avant-gardes ? Il ne s’agit pas non plus d’abandonner les autres. Les derniers entrés, comme la Roumanie ou la Bulgarie, s’inquiètent de la possibilité d’une Europe à plusieurs cercles.
Vous vous intéressez en particulier à la question du « déficit démocratique européen », au cœur des questions qui se posent actuellement, au cœur de notre réflexion. Comment la nouvelle démocratie européenne pourrait-elle se développer ? Et quel rôle pour les parlements nationaux dans ce cadre ?
Dans votre dernier ouvrage Démocratiser l’Europe, vous affirmez qu’« à trop espérer voir surgir à Bruxelles une démocratie “comme chez nous”, on a renoncé à saisir la singularité du modèle politique européen ». Lorsque j’étais membre du Parlement européen – cela remonte un peu, on négociait par exemple le traité de Maastricht –, j’ai beaucoup entendu en France que l’on voulait bien l’Europe, à condition que ce fût « la France en grand ». Il semble que vous fassiez à votre tour exactement la même réflexion. Comment donc convaincre nos concitoyens que l’Europe ne peut être une « France en grand », et comment convaincre les citoyens allemands que ce ne peut être « l’Allemagne en grand » ? Comment trouver d’autres formes ? Vous dites qu’il faut d’abord démocratiser les institutions « indépendantes » que sont la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la Banque centrale européenne (BCE) et, dans une moindre mesure, la Commission européenne, au rôle de plus en plus politique, mais comment faire ? Et comment envisager cette question au lendemain du référendum britannique ou, plus généralement, à l’heure de la multiplication des référendums ? Je songe notamment au référendum néerlandais sur l’accord d’association avec l’Ukraine.
Par ailleurs, pensez-vous souhaitable un véritable « gouvernement économique » – démocratique – de la zone euro ?
Enfin, la démocratie, c’est également le respect de l’État de droit. À cet égard, comment renforcer la prise en compte des droits fondamentaux au sein de l’Union ? Il semble que la situation ne soit pas idéale dans un certain nombre d’États à l’heure de la crise des réfugiés. Quelle appréciation portez-vous sur l’évolution de la Pologne, de la Hongrie et peut-être, demain, d’autres pays de l’Union européenne ?
N’hésitez pas à être aussi provocateur que vous le souhaitez. C’est ce qui nous aidera à réfléchir.
M. Antoine Vauchez, directeur du Centre européen de sociologie et de science politique (Centre national de la recherche scientifique). Madame la présidente, je vous remercie de votre invitation. J’en suis d’autant plus heureux que les travaux de sciences humaines et sociales restent souvent un peu à la marge du débat public sur l’Union européenne. Or, au moment où il faut peut-être repenser un peu, en prenant du recul, le projet européen et ouvrir des perspectives, même iconoclastes, on gagnerait à mobiliser davantage ce qui s’écrit dans les universités et dans les centres de recherche. Ce matériau offre effectivement les éléments d’un nouvel état des lieux et permet d’envisager les conditions dans lesquelles nous pourrions réorienter le projet européen.
Je partirai précisément d’un état des lieux, et des espoirs placés dans le traité de Lisbonne.
Initialement, celui-ci était conçu comme une sorte d’aboutissement, au terme de deux décennies de révision des traités européens. Le projet était finalement de construire, à l’échelon européen, un système démocratique complet. Il suffit d’en lire le texte pour s’en apercevoir. On a cherché à accroître considérablement les pouvoirs du Parlement européen, par toute une série de dispositions, on a créé des partis politiques européens, on a aussi renforcé le poids des élections européennes, pour qu’elles aient une bien plus forte influence sur la composition de la Commission européenne, notamment sur le choix du président de celle-ci.
Las ! En même temps que le traité de Lisbonne entrait en vigueur, la crise économique éclatait, et force est aujourd’hui de constater que ce projet de démocratisation par le haut inscrit dans les traités européens ne s’est pas réalisé. Pourtant, les enjeux proprement européens n’ont pas manqué, qui posaient les questions de la liberté de circulation, de l’accès aux droits sociaux, de la fraude fiscale, de l’accueil des réfugiés et des politiques d’austérité. Les promesses démocratiques du traité de Lisbonne ne me semblent donc pas avoir été tenues.
Le rôle du Parlement européen, sans doute parce que, dépourvu de l’initiative des lois, ce dernier ne peut peser sur l’agenda politique, est resté essentiellement consultatif. Le Parlement européen n’a pas participé à l’écriture des mémorandums, ni à la troïka, il est finalement demeuré dans un rôle assez secondaire. Les partis politiques européens, pour leur part, sont malheureusement restés muets face à la crise grecque et à la crise des réfugiés, renonçant à construire politiquement ces enjeux et laissant plutôt apparaître des conflits entre États, par exemple entre États créditeurs et États débiteurs. Quant au vote, la participation aux élections européennes a atteint, en 2014, des niveaux historiquement bas. Alors même que nous étions au cœur de la crise économique, les élections européennes n’ont pas constitué un scrutin à fort enjeu et n’ont pas mobilisé. Finalement, elles sont restées le scrutin de second ordre qu’elles ont malheureusement l’habitude d’être. À l’inverse, ce sont souvent des institutions indépendantes qui ont acquis une forme de leadership, notamment la BCE, à qui on a accordé en même temps qu’elle s’est arrogé une grande capacité d’influence.
Ce qui frappe aussi, c’est le rétrécissement de la base sociale et de la base politique sur lesquelles le projet européen peut s’appuyer, avec une forme de désinvestissement par rapport au projet européen. Les partis politiques ont naguère mobilisé un certain nombre de causes, comme l’Europe sociale, ou l’Union politique. Aujourd’hui, nous constatons que ces horizons mobilisateurs ont largement été abandonnés par ceux qui les soutenaient. Dans les années quatre-vingt et 90, un ensemble d’acteurs – hauts fonctionnaires, syndicats, partis politiques – portaient la cause de l’Europe sociale pour en faire une cause autonome par rapport à celle de la construction du marché ; aujourd’hui, il faut bien le dire, cette cause a été largement abandonnée. Au désinvestissement s’ajoute l’indifférence. Bien plus que l’euroscepticisme politique, sur lequel on s’arrête peut-être trop souvent, ce qui caractérise le rapport des citoyens ordinaires à l’Europe, c’est une forme d’indifférence des catégories populaires et des classes moyennes, dont je pense qu’elles sont aujourd’hui convaincues que cette histoire ne les concerne pas et, surtout, que les politiques eux-mêmes sont incapables d’orienter ce projet européen et, finalement, de produire une politique susceptible de les concerner directement. A résulté de ce désinvestissement et de cette indifférence un vide politique rapidement comblé par les partis populistes, bel et bien parvenus, eux, à imposer un agenda politique européen ou à cadrer les enjeux de la crise, en soulevant essentiellement la question de la renationalisation, par exemple par le refus, récemment, de la solidarité intra-européenne face à l’arrivée des migrants.
Après ce premier état des lieux, j’en viens aux causes. Pourquoi ces occasions manquées pour la démocratie européenne ? Nous pourrions en discuter longuement, mais je vois deux facteurs essentiels.
Premièrement, l’Europe ne parvient toujours pas à se frayer un chemin dans la politique nationale. Du moins ne se fraie-t-elle pas d’autre chemin que celui qui la fait apparaître comme un problème et la fait penser sur le mode de l’exit. Aujourd’hui, exception faite des outsiders du jeu politique, les hommes politiques, les partis politiques sont assez peu incités à se saisir de la question européenne, à entrer dans le fond des politiques publiques européennes, qui, certes, est sans doute d’accès difficile. Cela s’explique sans doute par le fait que la question européenne a toujours perturbé les clivages politiques, qu’elle a toujours été une sorte de risque pour les partis. Cela s’explique sans doute aussi par le fait que les journalistes et les éditorialistes tiennent pour acquis que le thème européen est en quelque sorte « invendable ». Sauf crise majeure, ce thème est donc tenu relativement à la marge du débat politique. Tout cela a laissé place aux appels au référendum, qui se multiplient, y compris en France, et n’offrent évidemment que des solutions nationales au problème. Cette politisation de la question européenne au niveau national ne dessine pas une alternative à l’intérieur du projet européen.
Deuxièmement, problème symétrique, la politique – j’entends par là la politique des partis – a bien du mal à entrer dans l’Union européenne, à trouver sa place à Bruxelles. Les institutions européennes – la Commission européenne, la Banque centrale, mais aussi, d’une certaine manière, et même si c’est paradoxal, le Parlement européen – sont réticentes à toute forme de politisation. C’est que la grande affaire européenne reste la construction du marché et de la zone euro, assez technique et portée par des institutions « indépendantes » : d’abord et avant tout, la Cour de justice et la Commission européenne, je veux dire la Commission européenne de la politique de la concurrence, la Commission européenne de la politique du marché unique ; plus récemment, la Banque centrale européenne. Dans une large mesure, ces institutions sont placées, historiquement, hors du champ démocratique : leur raison d’être n’est pas d’abord d’entrer dans un dialogue démocratique et politique, elle est de porter cet impératif de la construction du marché. C’est ainsi que la Commission européenne – on l’a vu dans la négociation du traité de libre-échange transatlantique – reste mal équipée pour engager un dialogue quand les discussions deviennent hautement politiques. Autre raison de cette faible politisation, le petit espace public qui a émergé à Bruxelles, à la périphérie de ces institutions, vise d’abord à peser sur ces règles du marché commun. Il s’est donc donné comme interlocuteur principal le monde des entreprises, des groupes d’intérêt et de leurs représentants, notamment les lobbyistes. Évidemment, ce petit espace public est lui aussi assez réticent à toute forme de politisation qui viendrait perturber le jeu de la construction des règles du marché du marché unique. Tout cela a aussi créé une proximité entre les institutions publiques européennes et le secteur privé, et une forme de brouillage, en partie entretenue par toute une série de réformes managériales de la fonction publique européenne dont l’effet se manifeste aussi dans un jeu de pantouflage au sommet de la commission – à la fois chez les très hauts fonctionnaires et chez les commissaires ; nous l’avons vu récemment, avec les cas de Neelie Kroes et José Manuel Barroso.
Voilà ce que j’appellerai le piège démocratique européen. D’un côté, nous avons un jeu national défensif, dont les référendums sont aujourd’hui la preuve, des référendums qui « politisent contre » le projet européen, non à l’intérieur de celui-ci. De l’autre côté de ce piège, de cet étau européen, il y a un jeu bruxellois dont la dynamique complexe reste essentiellement centrée sur l’écriture des règles du marché unique et son fonctionnement, moins sur la construction d’une offre politique susceptible d’intéresser ou de concerner les citoyens.
C’est à partir de cet entre-deux que je voudrais formuler quelques réflexions.
Premièrement, je ne crois pas que l’on puisse choisir un niveau contre un autre. Je pense par exemple, évidemment, aux réflexions qui ont suivi le Brexit. Je ne crois pas que l’on puisse renoncer à réfléchir aux moyens de faire émerger une politique européenne. Ce n’est pas en se repliant sur le national que l’on ferait disparaître cet échelon européen, que l’on ferait disparaître la force de ce qui s’est construit pendant six décennies autour de Bruxelles. Il faut accepter que la politique se loge et s’exerce quelque part entre les États membres et l’Union européenne, ni seulement d’un côté, ni seulement de l’autre.
Deuxièmement, dans le même ordre d’idées, le projet qui a précisément habité toutes ces révisions des traités, du traité de Maastricht au traité de Lisbonne, celui de construire une démocratie européenne indépendante, autonome, qui fonctionnerait à la manière de nos démocraties nationales, a, dans une certaine mesure, échoué. Les difficultés qui ont suivi l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en donnent d’une certaine manière la preuve.
Troisièmement, je ne crois pas qu’il faille réfléchir outre mesure à la question des institutions, à la réforme des traités. D’abord, nous les avons déjà beaucoup réformés. L’Europe a été un chantier institutionnel pendant vingt ans. Nous n’avons cessé de proposer un Meccano institutionnel assez sophistiqué, mais sans grand résultat il me semble. Par ailleurs, le thème de la réforme institutionnelle n’est guère mobilisateur au-delà de nos cercles en quelque sorte politiques, au-delà du cercle de l’ensemble de ceux qui s’intéressent à la politique et aux questions institutionnelles. Il ne saurait, à mon avis, permettre de reconstruire cette politique démocratique européenne.
Je terminerai en proposant trois pistes de réflexions.
Première piste, l’un des enjeux est de réinsérer ces institutions indépendantes – la CJUE, la BCE et, d’une certaine manière, la Commission européenne de la politique de la concurrence et du marché unique –, ces institutions au rôle très important, au rôle politique majeur, qui se veulent en quelque sorte les garantes du projet européen, dans un jeu démocratique qui leur permette de prendre en compte d’autres attentes sociales, d’entrer en dialogue avec d’autres intérêts sociaux. La CJUE et le directoire de la BCE pourraient ainsi être composés à la manière de la Cour constitutionnelle allemande, c’est-à-dire sur la base d’une représentation des différents courants, des différentes familles de pensée politiques, par exemple les courants et les familles de pensée représentés au Parlement européen. Il faudrait aussi renforcer considérablement le contrôle parlementaire – national ou européen – sur la BCE. Au Parlement européen, ce contrôle est pour le moins intermittent, puisqu’il ne s’exerce que sous la forme d’une audition trimestrielle. De manière assez paradoxale, ce ne sont pas les parlements qui contrôlent le plus la BCE, c’est la Cour constitutionnelle allemande, qui fait en quelque sorte figure de chambre d’appel.
Deuxième piste, il s’agit aussi de réinsuffler un esprit public aux institutions européennes. L’esprit public me semble avoir été mis à mal par des années de réforme managériale, sentiment exprimé par les fonctionnaires européens eux-mêmes, puisque certains d’entre eux, à la suite de l’annonce du pantouflage de José Manuel Barroso, ont lancé anonymement une pétition pour appeler au renforcement des règles encadrant le pantouflage, au renforcement d’un comité d’éthique aujourd’hui extrêmement faible. Cette pétition a tout de même recueilli 150 000 signatures.
Troisième et dernière piste, il faut essayer de mobiliser tous les leviers possibles pour faire émerger cette politique européenne, en se focalisant non pas sur les eurosceptiques, comme on le fait à mon avis trop souvent, mais sur les indifférents, sur l’ensemble de ceux qui, d’une certaine manière, se désintéressent aujourd’hui d’un projet européen en lequel ils ne voient pas une politique qui les concerne. Peut-être faut-il des campagnes politiques européennes concrètes, autour d’enjeux immédiats – je songe, par exemple, au travail de M. Guillaume Balas au Parlement européen sur la lutte contre le dumping social, ou à celui de votre commission, mesdames et messieurs les députés, sur le statut des travailleurs détachés. Bien sûr, dans cette politique européenne, les partis et les syndicats ont un rôle à jouer, s’ils acceptent de renouer avec ce rôle de formation qu’après tout leur financement public les engage à remplir, une formation aux questions européennes – tout le monde n’a pas fait des études de droit ou de science politique ni n’est forcément familier de la complexité des questions européennes. Les parlements nationaux doivent aussi animer, et peut-être susciter, ce débat européen – je songe au travail de votre commission autour des initiatives de « carton vert ».
La création de cette politique européenne, aujourd’hui tout à fait embryonnaire, c’est aussi, un peu, un combat culturel. Les universités et les centres de recherche ont aussi leur rôle à jouer et gagneraient à être mobilisés dans ces débats. Je vous remercie donc encore une fois de votre invitation.
M. Gilles Savary. Je voudrais surtout partager, en cette période extrêmement compliquée, quelques réflexions.
Nous avons finalement construit, au plan politique, une Europe quasi exclusivement coopérative, qu’on a un peu asservie juridiquement. La construction européenne s’est faite à côté du discours politique, elle s’est faite par les directives, par la mise en commun d’un espace juridique, pas d’un espace politique. L’espace politique reste fondamentalement national. Nous avons créé un poste de président du Conseil européen, et ledit président est devenu un modérateur, un négociateur, souvent de haut vol – MM. Van Rompuy et Tusk ont fait un travail remarquable –, mais ce n’est pas une voix pour l’Europe. Chaque chef d’État ou de gouvernement rentrant du Conseil européen se pose la question de ce qu’il va dire à son opinion publique nationale, de ce qu’il a envie de raconter ou d’occulter du Conseil européen. Nous sommes simplement au bout du bout de cette réalité, parce que la situation est moins euphorique que dans les années soixante-dix et qu’en période de tension nous cherchons des boucs émissaires, des responsables. D’une certaine manière, nous constatons que l’Europe politique n’a jamais existé, qu’elle était fondamentalement coopérative, qu’en fait de communauté c’était une fiction communautaire – pas tout à fait fictive, cependant, si l’on en croit le mal qu’ont les Britanniques à défaire les fils. Nous avons créé une Europe juridique, pas une Europe politique, une Europe fondamentalement coopérative parce qu’aucun des États membres, à commencer par ceux qui se prétendaient les plus européistes, en particulier la France, ne veut rien céder de sa souveraineté sur les sujets essentiels.
Vous parliez tout à l’heure d’un espace public qui avait été créé, mais il s’agissait encore d’espaces nationaux. L’Europe sociale, c’était l’Europe française. L’Europe de la défense, c’était l’Europe française – on nous donne de l’argent, et on appuie sur le bouton nucléaire. Cette ambiguïté nous apparaît aujourd’hui de manière éclatante, et elle est évidemment mortifère dans une période de souffrance des peuples et d’inquiétude face aux bouleversements du monde, alors que les populistes arment la peur et ont les outils de la peur : les référendums.
La première des fragilités sur laquelle nous devons nous interroger, c’est que, comme vous, je pense que l’on ne peut plus réformer les institutions. Ce n’est pas que ce n’est pas souhaitable, mais on ne le peut plus ; le premier qui essaye, redisjoncte. Je me demande cependant s’il ne faudrait pas un petit traité de démocratisation. Il peut très bien arriver que l’on nous demande en juin, par référendum, si nous souhaitons quitter l’Europe. Les choses peuvent aller très vite. Le Brexit n’est pas un accident de l’histoire mais résulte d’une certaine ambiance européenne. À ma grande surprise, les pays de l’Est, que j’ai beaucoup fréquentés sur la question des travailleurs détachés, sont plus européens, et plus inquiets, que nous. Pour eux, l’Europe c’est l’émancipation nationale, tandis que nous autres, vieux pays impériaux, pensons pouvoir nous suffire à nous-mêmes.
La question qui nous est aujourd’hui posée est celle de l’articulation entre les États nations et la construction européenne. Tout en étant fédéraliste, j’ai bien conscience que les nations sont susceptibles de faire disjoncter la construction européenne. Je me demande si nous ne pourrions pas avoir des procédures de ratification supranationales, telles qu’un référendum européen ou bien un Congrès associant le Parlement européen et les Parlements nationaux, avec des pondérations de voix. Cela supposerait une clarification des compétences car la procédure serait déclenchée pour les compétences exclusives. Les choses seraient ainsi relativement verrouillées par rapport aux alternances politiques.
S’agissant de l’ouverture d’un espace public, je ne suis pas entièrement d’accord avec vous : il n’y a pas que les entreprises. Le mandat de la Commission européenne porte certes sur le marché mais il faut bien reconnaître aussi qu’elle tricote ce qu’on lui a demandé de tricoter, et ce n’est pas demain la veille que cela se fera ailleurs, sauf sur les questions de sécurité et de frontières, si nous nous y prenons vite, pour reconstituer une légitimité européenne.
Mais n’oublions pas non plus les ONG : une grande partie de la politique européenne passe par elles. En France, on se bouche le nez devant les lobbies, mais c’est quand il s’agit de Total, car quand il s’agit d’Oxfam ou de Greenpeace on trouve que c’est bien, que c’est noble. Or les deux fonctionnent. Sur certains sujets, la réflexion est très avancée à Bruxelles. Sans Bruxelles, personne n’aurait travaillé sur la question des Roms, par exemple. Il faudrait réfléchir au moyen d’associer les lobbies de façon plus formelle et plus ouverte.
Cela suppose d’impliquer les syndicats. Ces derniers, aujourd’hui, n’ont aucune envie de tenir un discours européen. Alors que je m’occupe beaucoup des questions ferroviaires au Parlement, je n’entre dans aucun des dépôts de la SNCF car la CGT ne souhaite surtout pas que je dise à ses militants ce qui se passe, à savoir qu’ils sont en danger. Je pense qu’il faudrait l’effet d’entraînement que pourrait créer une nouvelle chambre, différente du Comité économique et social européen actuel ou du Conseil des communes et régions d’Europe.
Mme Sandrine Doucet. S’agissant de cette Europe des nations, plus forte que l’Europe que nous souhaiterions, l’actualité appelle une remarque. L’interprétation qui est faite du référendum italien est qu’une fois qu’il aura lieu cela tombera directement entre les mains de la BCE, pour gérer la crise financière qui serait induite par ce référendum. La question institutionnelle devient immédiatement une question économique ; on court-circuite complètement l’échelon national et l’apport possible, dans le débat européen, d’une Italie dotée de nouvelles institutions, ainsi que l’échelon du Parlement européen. Comment mieux établir la jonction entre les représentations nationales et les institutions européennes ? C’est le sujet de la démocratisation : ce qu’entend le grand public à la veille du référendum italien, c’est uniquement la question économique et financière.
S’agissant des lobbies, qu’a évoqués Gilles Savary, j’ai travaillé sur la question des mobilités et de la jeunesse européenne, et les organisations de jeunesse donnent clairement une vision plus vivifiante de l’Europe. Les jeunes nous disent qu’ils en ont assez des réformes s’adressant à des publics ciblés, jeunes chômeurs, précaires, étudiants – même s’il faut s’en occuper. Ils demandent aussi une politique globale de la jeunesse. C’est là un sujet qui permettrait de réconcilier le grand public avec la politique européenne.
Mme Marie-Louise Fort. Je ressens un manque de leadership au niveau européen. Nous avons une Europe technocratique et, dès lors, les populismes émergent. Le Brexit devrait nous faire réfléchir : les élites ne pensaient absolument pas qu’il pouvait se produire, et nous ne sommes pas à l’abri de connaître la même chose en France ou ailleurs.
Je pense que l’Europe doit devenir plus politique mais aussi que chacun de nos pays doit se doter de leaders. On ne peut fonctionner par le biais seulement des ONG ou des syndicats. Il se trouve que je prends souvent le train avec des syndicalistes de SUD, qui viennent de Bercy et se rendent dans ma circonscription, de la CGT et d’autres, et nous en discutons. Ils sont, comme l’a souligné M. Savary, dans le déni : ils savent ce qu’ils risquent mais ne veulent pas en parler. À la limite, nous non plus : la classe politique est sous le couvert des médias, qui ont tendance à sortir des phrases de leur contexte et à en faire des moralités comme à la fin d’une fable.
Je constate par exemple, sur la politique migratoire, très d’actualité en ce moment, que nous n’avons pas été capables d’avoir une vision commune. Il faut donc se demander comment retrouver du leadership. Je suis présidente d’agglomération : dans une agglomération, les communes doivent être respectées mais il faut en même temps une direction. C’est la même chose avec l’Europe et les nations. Or les Parlements nationaux n’ont guère d’influence, à défaut même de véritable pouvoir institutionnel.
La présidente Danielle Auroi. Nous sommes en train de démontrer à notre interlocuteur que, quelle que soit notre couleur politique, nous essayons de ramer dans le même sens.
Une chose à laquelle je trouve que l’on ne prête pas assez d’attention en France, c’est que les premières mesures post-Brexit prises par Mme May ont pour but de rétablir du service public en Grande-Bretagne, dans les écoles et les hôpitaux, au moment où nous voulons quant à nous finir de tuer le service public. L’Europe était donc bien vécue par les Anglais comme destructrice des services publics, même si le Brexit résulte aussi, semble-t-il, de l’appauvrissement des classes moyennes. Le fait que les classes moyennes, dans presque tous les « vieux pays », selon l’expression de Gilles Savary, de l’Union européenne se sentent fragilisées joue-t-il bien un rôle, selon vous, et est-ce à elles, en plus des classes populaires, auxquelles il faut parler ?
Il faut bien voir aussi ce qui se passe quand le Parlement européen essaye de jouer son rôle politique. Ainsi, quand il a récemment pris position sur la Turquie, le Conseil européen a répondu qu’il était scandaleux d’affirmer que la Turquie n’était pas démocratique, mais c’est en réalité parce qu’il ne faudrait surtout pas qu’ils laissent entrer les réfugiés chez nous.
De même, l’histoire wallonne sur le CETA : voilà des représentants des citoyens qui se posent des questions, demandent des précisions, et l’on fait pression jusqu’à ce qu’ils cèdent, parce que le Conseil – bien plus, me semble-t-il, que la Commission européenne – a décidé de passer outre. Chaque fois que les représentants des citoyens tentent de s’exprimer, on leur coupe les ailes. D’où l’intérêt de votre idée d’une réelle représentativité politique au sein de ces institutions.
Nous sommes en train de travailler sur la lutte contre les conflits d’intérêts et la transparence au niveau européen. Je voudrais bien que le même travail soit conduit en France, y compris sur les lobbies ! Ce n’est pas ici à l’Assemblée que j’ai le plus rencontré le MEDEF. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ayant été adoptée hier en nouvelle lecture, cela permettra de la porter au niveau européen.
Ce qui ressort de notre travail sur la transparence, c’est que, quelques cas étant désormais sur la table, on veut bien s’attaquer au problème au sein de la Commission européenne, mais le Conseil ne veut surtout pas que l’on se penche sur son manque de transparence, et le Parlement européen veut bien aussi toute la transparence souhaitable au sein de la Commission européenne mais surtout pas pour lui, alors qu’il y a justement de nombreux conflits d’intérêts en son sein. Nous avons des exemples précis, y compris d’eurodéputés français.
M. Antoine Vauchez. L’Europe a été construite sur la base d’un découplage entre un espace national conçu comme l’espace de la démocratie et du social – l’État-providence – et un espace européen pensé essentiellement comme celui de la modernisation des économies, du marché, et cela a conduit à une forme de déséquilibre. Les institutions européennes sont très bien équipées pour construire des marchés et les faire fonctionner mais très mal pour les contrôler. Par exemple, si la liberté des capitaux est une réalité, les questions fiscales se décident à l’unanimité. Ce déséquilibre devient de plus en plus intenable.
Par ailleurs, une série d’inflexions se sont produites, ces vingt dernières années, sur la manière dont le marché unique se construit. Alors qu’historiquement la méthode employée était celle de l’harmonisation, on est progressivement passé à la mise en concurrence des États, notamment au plan fiscal. En outre, alors que le projet européen était initialement indifférent au caractère privé ou public des entreprises, une préférence pour la privatisation a nettement prévalu. Les deux évolutions sont de nature à susciter des oppositions nouvelles à la construction européenne.
Le Conseil européen n’est pas exempt de problèmes. Chacun des représentants des Gouvernements sont contrôlés par leurs Parlements mais, collégialement, le Conseil reste dans un angle mort des contrôles. Le Parlement européen n’a aucune prise sur la politique conduite dans ce collège. C’est un problème car le Conseil prend certaines décisions à la majorité et certains États sont ainsi mis en minorité. De même, quand le Conseil évoque des questions à son niveau, il transfère véritablement des compétences au plan européen, car ces questions deviennent des questions de droit européen, et il est après coup bien plus difficile pour les États membres de s’engager de manière autonome dans ces domaines.
Malgré le fait que le président de la Commission européenne a été en partie choisi, en 2014, par le parti en tête, la situation n’a pas profondément changé. La politisation évoquée de la Commission Juncker est surtout de surface. La gestion est peut-être plus soucieuse des réalités politiques mais on ne peut dire que la politique de la concurrence ou du marché unique pourrait être facilement politisée. Wolfgang Schäuble a d’ailleurs averti que, si la politisation de la Commission européenne allait trop loin, l’Allemagne demanderait que la direction générale de la concurrence et la direction générale du marché intérieur en soient retirées et constituées en agence autonome.
La présidente Danielle Auroi. Merci. Notre volonté ici est que l’Europe existe davantage. Vous nous avez présenté des pistes pour interpeller nos citoyens et, parmi eux, la masse croissante des indifférents.
Audition de M. Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation Robert Schuman, chercheur associé à Sciences Po (CERI) et de M. Jean-François Jamet, enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris
Compte rendu du mercredi 14 décembre 2016
La présidente Danielle Auroi. Messieurs, je vous remercie d’avoir accepté notre invitation à participer à ce cycle d’auditions sur l’avenir de l’Europe.
Monsieur Thierry Chopin, vous êtes chercheur en sciences politiques, et actuellement le directeur des études de la Fondation Robert Schuman. Monsieur Jean-François Jamet, vous êtes économiste, spécialiste de l’économie européenne ; c’est à titre personnel que vous vous exprimez devant nous.
Vous avez récemment écrit, messieurs, plusieurs contributions à quatre mains pour la Fondation Robert Schuman, notamment « Après le référendum britannique, redéfinir les relations entre les “deux Europe” » et « L’avenir du projet européen ». Dans cette dernière, vous mettez en garde à la fois contre la tentation de repli sur le niveau national et contre celle « du statu quo qui consiste, dans le meilleur des cas, à consolider l’Union sous l’effet des différents chocs qui l’affectent mais sans réforme d’ensemble du système ». Mais les conditions sont-elles aujourd’hui réunies pour une réforme d’ensemble du système ? Et quelle est cette réforme que vous appelez de vos vœux ? Pouvez-vous nous aider à trouver des propositions qui auraient du sens ? Comment approfondir cette démocratie européenne, qui paraît très fragile aujourd’hui ? Comment approfondir l’« espace politique européen » ?
Quel rôle pour les Parlements nationaux dans ce cadre ? De plus en plus, malgré tout, les parlements nationaux se parlent entre eux, grâce à des outils traditionnels, comme la Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l’Union des parlements de l’Union européenne (COSAC), mais aussi grâce à cet article 13 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, qui leur a donné plus de visibilité. Plus récemment encore, en regard des « cartons jaunes », qui sont toujours des protestations des parlements, ont été proposés des « cartons verts », qui sont plutôt des propositions faites par les parlements nationaux au Parlement européen et à la Commission européenne. Le premier, émanant des Lords anglais – pour leur part désolés du Brexit –, portait sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le second, issu de notre commission des affaires européennes, porte sur la responsabilité sociale des multinationales par rapport à leurs filiales et à leurs sous-traitants.
Vous considérez qu’il pourrait être possible, avec le Brexit, de clarifier les relations entre les « deux Europe » : d’un côté, en faisant de l’Espace économique européen le cadre institutionnel pertinent pour la gestion du marché intérieur – cela paraît assez logique – et, de l’autre, en réalignant la zone euro avec l’Union européenne, ce qui formerait un noyau de pays qui veulent aller plus loin. Cependant, après Bratislava, où les vingt-sept ont réaffirmé leur souhait de travailler ensemble, des volontés de bloquer une relance spécifique de la zone euro pourraient se faire jour du côté de la Pologne et de la Hongrie. Cette bonne idée d’une zone euro plus avancée ne risquerait-elle donc pas, finalement, de créer de nouvelles divergences, sinon de nouvelles divisions ? Votre proposition me semble, par ailleurs, faire écho à la contribution de la fondation Bruegel – qui a fait beaucoup de bruit – proposant un « partenariat continental » qui permettrait de formaliser cette Union à deux vitesses. Nous songions pour notre part à quelque chose de plus souple qu’une telle Union à deux vitesses.
Enfin, comment renforcer les droits fondamentaux et lutter contre la montée des populismes et le repli national ? Comment conjuguer solidarité renouvelée, besoin de protection et exercice de la souveraineté réelle, au niveau de l’Union, à l’heure où Alep nous montre que l’Europe ne fait pas si bien que cela son travail, à l’heure où elle se referme, quoique pas totalement ?
M. Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation Robert Schuman. Merci beaucoup, madame la présidente, de cette invitation, qui nous honore. Dans un premier temps, je reviendrai sur un certain nombre d’éléments qui nous semblent caractéristiques de la situation européenne actuelle. Dans un deuxième temps, Jean-François Jamet fera une série de remarques plus centrées sur les conditions d’une réforme.
Je voudrais développer trois points distincts.
Le premier porte sur l’usure des récits et discours politiques qui ont justifié et légitimé jusqu’à une date récente la construction européenne aux yeux des citoyens. Après la réunification et la paix, la prospérité économique devait emporter l’adhésion des citoyens pour l’UE. L’économie est devenue le cœur du projet européen, avec le marché unique et l’euro comme projets structurants. Si l’Europe n’a jamais été aussi riche, ce discours « économique » s’est brisé sur la crise financière et économique et ses conséquences sociales et politiques.
Un phénomène est moins évoqué dans le débat public : l’usure d’un certain nombre de récits plus spécifiquement nationaux qui ont, eux aussi, légitimé la construction européenne, auprès des opinions publiques nationales. La construction européenne est en effet également le produit de logiques nationales porteuses de visions et d’intérêts spécifiques. Si la France recherchait à renouer le fil de sa grandeur passée et l’Allemagne sa « rédemption » après le nazisme, le Royaume-Uni et les pays du Nord de l’Europe se plaçaient dans une pure logique « utilitariste » d’optimisation de leurs intérêts nationaux. Enfin, les pays du Sud de l’Europe ainsi que les pays centre et est-européens étaient dans une logique de « sublimation » (passage rapide d’un système politique et économique à un autre : démocratie libérale et économie de marché).
Or, ces logiques nationales ont évolué. Pour le dire de manière un peu schématique, après sa réunification, et alors qu’elle a renoué avec des performances économiques qui lui confèrent de fait un leadership politique et économique sur la scène européenne, l’Allemagne s’inscrit-elle toujours dans une logique de « rédemption » ? De son côté, la France croit-elle encore en sa « réincarnation » à l’échelle européenne ? Avec la montée, dans les opinions publiques mais aussi chez les représentants politiques, de l’euroscepticisme - qu’il convient de distinguer d’une europhobie se manifestant par la volonté de quitter l’Union européenne -, ce n’est pas certain. Le Royaume-Uni est-il encore dans une logique d’optimisation de ses intérêts nationaux ? Sans doute dans une certaine mesure, mais le choix fait le 23 juin dernier montre que les logiques politiques qui ont été à l’œuvre dans la campagne référendaire au Royaume-Uni ne sont pas uniquement de nature utilitariste et ne se réduisent pas au seul arbitrage entre coûts et avantages – sur la base d’un tel raisonnement, les Britanniques auraient sans doute décidé de rester au sein de l’Union européenne. Quant aux pays du sud de l’Europe et aux pays d’Europe centrale et orientale, envisagent-ils de manière toujours aussi favorable leur adhésion à la construction européenne ? Rien n’est moins sûr. La montée de l’eurodéfiance s’explique dans les pays du Sud par la perception d’une solidarité insuffisante face aux crises : coût perçu comme disproportionné de l’ajustement économique et budgétaire demandé en contrepartie du soutien financier européen (Portugal, Grèce) mais aussi incapacité de l’UE à réguler les flux migratoires (Italie). Dans les pays du centre, du Nord et de l’est de l’UE, c’est au contraire le refus d’une solidarité excessive qui alimente l’euroscepticisme d’une partie de la population et certaines politiques gouvernementales, qu’il s’agisse des questions financières (Allemagne, Finlande) ou de la question des réfugiés (groupe de Visegrad). Dans certains cas, les mêmes pays qui demandent la solidarité sur un volet la refusent sur un autre. Le souverainisme accompagne également dans certains États l’émergence d’un populisme nationaliste autoritaire et « illibéral » (en Hongrie voire en Pologne).
Il nous semble important de prendre en considération cette dynamique des visions nationales pour comprendre la situation de l’Union européenne. Ces évolutions sont également structurantes pour l’avenir de l’Union européenne et un nouveau compromis doit être défini sur ces bases nouvelles si l’on veut consolider et renforcer l’unité des Européens face aux défis qui leur sont lancés.
Je souhaiterais consacrer ici une seconde série de remarques portant plus spécifiquement sur le Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni et les 27 États membres ont des intérêts communs dans les futures négociations (maintenir des relations économiques et politico-stratégiques étroites ; garantir les droits des citoyens britanniques résidant actuellement dans les autres États membres et vice-versa), des divergences existent : l’UE souligne que l’accès au marché unique est le corollaire des trois autres libertés et ne saurait en être dissocié tandis que le Royaume-Uni veut contrôler l’immigration européenne tout en gardant un accès au marché européen pour ses intérêts économiques et financiers. Cela pose en outre des problèmes de souveraineté car le marché unique est mis en œuvre par les institutions européennes dont le Royaume-Uni ne veut plus être membre. Il est alors difficile de trouver un modèle convenant aux deux parties.
Or, si les différents modèles existants sont connus – le modèle « norvégien » (le Royaume-Uni rejoint l’Espace économique européen) ; l’option « suisse » (négociations d’un ensemble d’accords bilatéraux) ; l’exemple « canadien » (négociation d’un accord de libre-échange) ; le modèle « turc » (négociation d’une union douanière) – aucun ne semble pleinement satisfaisant compte tenu des intérêts des parties prenantes. Dans ce contexte, une réforme de l’EEE est l’une des pistes envisageables. L’EEE, signé en 1992, permet d’étendre le marché intérieur aux États signataires de l’Association européenne de libre-échange. Dans ce cadre, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein (en plus des pays membres de l’UE) appliquent les quatre libertés et les règles européennes correspondantes et participent financièrement à certains programmes européens mais restent en dehors de la politique fiscale, commerciale et agricole/pêche. Une telle réforme de l’EEE pourrait avoir trois composantes principales. Premièrement, la gouvernance de l’EEE pourrait assurer une participation accrue des États de l’EEE qui ne sont pas membres de l’UE aux décisions concernant les politiques communes de l’EEE, en particulier la législation relative au marché intérieur. En contrepartie, cette réforme devrait assurer l’entrée en vigueur simultanée des textes applicables à l’ensemble des États membres de l’EEE de façon à éviter les décalages observés dans le passé. Elle devrait en outre garantir institutionnellement l’interprétation et l’application homogène de la législation commune. Troisièmement, le principe de la libre circulation des personnes ne doit pas être remis en cause mais une solution commune applicable dans l’ensemble de l’EEE devrait être recherchée pour répondre aux inquiétudes concernant l’impact social de la mobilité des travailleurs qui se sont exprimées au Royaume-Uni mais aussi dans d’autres États membres. Sur ce dernier point, la proposition de Bruegel que vous avez citée considère qu’il n’y a pas de lien fonctionnel entre le principe de libre circulation des personnes et la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Le problème est que cette proposition ne donne aucun argument à l’appui de cette thèse ; or, il semble a minima que les effets d’agglomération liés à l’intégration économique et financière peuvent être problématiques du point de vue économique et politique en l’absence de la libre circulation des personnes
La réforme de l’EEE que nous proposons aurait pour effet d’offrir une solution de compromis entre le Royaume-Uni et l’UE et de reconfigurer l’architecture institutionnelle en Europe autour de deux principaux niveaux d’intégration.
Le Royaume-Uni retrouverait sa souveraineté pour certaines politiques. Il continuerait néanmoins de participer au marché intérieur et d’appliquer les règles correspondantes qu’il continuerait de contribuer à déterminer. Il devrait contribuer au budget de l’UE mais uniquement pour les politiques qui lui sont applicables. La liberté de circulation des personnes serait préservée tout en développant le cadre réglementaire applicable à la mobilité des travailleurs.
Pour l’Union européenne, la liberté de circulation des personnes ne serait pas remise en cause et le compromis trouvé concernant la mobilité des travailleurs au sein de l’EEE s’appliquerait dans comme hors de l’UE, évitant l’impression que sortir de l’Union européenne permettrait d’obtenir un traitement préférentiel. D’autre part, la réforme de l’EEE offrirait un choix plus clair entre deux niveaux d’intégration, rendant moins probable une rupture complète qui serait déstabilisante économiquement et politiquement. À terme, il serait à nouveau envisageable d’observer une convergence entre l’Union européenne et l’Union économique et monétaire, ce qui pourrait faciliter le développement institutionnel de la zone euro, sans devoir recourir à des contorsions juridiques et à la création de structures ad hoc dans le cadre d’accords intergouvernementaux.
J’en viens à mon troisième point : la montée en puissance des populismes dans les États membres de l’UE dont l’impact est fort au niveau européen.
Depuis 25 ans, une lente mais profonde contestation monte au sein des démocraties occidentales où une partie de la population est de plus en plus défiante à l’égard du système politique. Ce phénomène s’est récemment cristallisé autour du Brexit (et de l’élection à la présidence américaine de Donald Trump). Les facteurs explicatifs de ces événements sont multiples : le déclassement économique et géographique des « perdants » de la mondialisation ; la crainte du déclassement ou de la stagnation des classes moyennes ; les évolutions démographiques et les bouleversements géopolitiques mondiaux entraînant des flux migratoires importants, des menaces sur la sécurité des Européens et un regain d’intérêt pour les questions d’identité. Tous ces facteurs convergent vers ce qui est vu aujourd’hui comme une crise des démocraties libérales.
En Europe, la rhétorique populiste alimente le succès de plateformes politiques eurosceptiques ou europhobes. Bien plus qu’un mot-valise, le populisme renvoie à une réalité politique et présente des caractéristiques générales connues qu’il faut rappeler pour que le débat s’engage sur des bases claires.
Tout d’abord, un « anti-élitisme », les « élites » étant accusées d’avoir trahi la volonté populaire, où le peuple est perçu comme un ensemble indivisible s’opposant aux corrompus, aux élites économiques (mais aussi médiatiques et intellectuelles) et aux étrangers. Cette vision holistique de la société est cependant discutable : d’un côté, les dirigeants politiques tenant ce discours anti-élitiste font souvent eux-mêmes partie des « élites », ce qui fait craindre que leur discours soit d’abord opportuniste ; d’un autre côté, les électeurs de l’ensemble des camps politiques ne sont pas limités aux « élites » (les 64 millions d’électeurs qui ont choisi de voter pour H. Clinton ne font pas toutes partie des « élites », ni les 16 millions de Britanniques ayant voté pour rester au sein de l’UE).
Ensuite, un « anti-pluralisme » par lequel les leaders populistes prétendent détenir le monopole de la représentation de la volonté du « vrai peuple ».
Enfin, les populismes renvoient à une tension problématique entre la souveraineté populaire et le principe libéral. Si la démocratie directe et le référendum sont des composantes importantes des démocraties modernes ces dernières reposent également sur institutions indépendantes et légitimes qui servent de contre-pouvoirs nécessaires.
En dépit de spécificités nationales, le développement des populismes en Europe converge vers un certain nombre d’éléments identifiables que l’on retrouve à des degrés divers dans les différents États membres concernés. Cela se traduit par l’inscription dans les agendas politiques nationaux de discours basés sur un protectionnisme économique, culturel et identitaire :
- renforcé par la crise économique de 2008, le populisme est lié au sentiment de déstabilisation économique et identitaire résultant de l’ouverture internationale de ces dernières décennies ;
- dans les économies prospères, le populisme peut s’inscrire sous une forme « patrimoniale » (selon l’expression de Dominique Reynié) où des sociétés de plus en plus âgées expriment des craintes « culturelles » liées à la transformation d’un environnement dans lequel elles ne se reconnaissent plus nécessairement ;
- le populisme européen est également l’illustration d’une crise de la représentation politique dans les démocraties modernes qui ne parvient pas à refléter les nouveaux clivages politiques des sociétés. Les électeurs sont lassés de l’alternance unique entre les partis traditionnels de droite et de gauche et se tournent vers les partis populistes qui apparaissent souvent comme la seule alternative possible.
Je ne pense pas que l’Union européenne soit l’origine, l’élément déclencheur, ou une condition d’existence de ces populismes, même si elle exacerbe et démultiplie chacun des trois facteurs que je viens de mentionner. Sur le plan économique, l’Union européenne est souvent perçue comme un cheval de Troie de la mondialisation. Sur le plan identitaire, la question de l’identité européenne n’a pas été prise en compte et, comme la nature, plus encore la nature politique, a horreur du vide, cet espace laissé vacant est occupé depuis un certain nombre d’années par les partis populistes et/ou extrémistes. Quant à la crise de la représentation politique, la défiance et la distance croissantes entre les citoyens et leurs représentants est démultipliée à l’échelle européenne, au moins par un effet de distance, et sans doute par le sentiment que les mécanismes de représentation politique sont beaucoup moins ancrés à l’échelle communautaire qu’à l’échelle nationale. La vie politique, au niveau de l’Union européenne, se réduit en effet de plus en plus à deux composantes : d’un côté, une composante relativement technocratique et, de l’autre, le jeu diplomatique entre chefs d’État et de gouvernement au sein du Conseil européen pour faire face aux crises. Entre les deux, finalement, quid des mécanismes de représentation politique au sens classique du terme, au niveau de l’Union européenne ? C’est cet espace qu’occupent les forces politiques populistes ou/ et extrémistes.
M. Jean-François Jamet, enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris. Quelles pistes envisager ? Ou du moins quelles formes de nouveau récit, de nouveau discours pour montrer que le projet européen peut, adapté, répondre aux exigences des citoyens ? Les attentes de ces derniers en termes de sécurité sont parfaitement légitimes et il faut y répondre. J’envisagerai successivement l’exigence de sécurité et d’identité et l’exigence économique – nombreux sont les Européens qui ont trop souffert de la crise.
Dans la période actuelle, l’Europe doit pouvoir porter un discours régalien. À défaut, le niveau européen n’a pas de réponse à apporter sur ces grands sujets, en particulier la sécurité, qui sont au cœur des préoccupations des citoyens. Ce projet d’une Europe régalienne nous semble avoir des justifications solides.
Tout d’abord, les enjeux internationaux mettent en jeu la capacité collective des Européens à répondre à des transformations géopolitiques mondiales qui les affectent tous : la question des flux migratoires et les enjeux de sécurité liés au terrorisme, mais aussi la lutte contre le réchauffement climatique et les négociations commerciales sont autant de questions qui engagent les intérêts collectifs des Européens. De ce point de vue, les sujets régaliens permettent de répondre à la question de l’identité, car les aborder permet généralement d’identifier un dedans et un dehors. Or l’identification d’un dehors peut permettre de renforcer la cohésion interne. La dynamique consécutive au référendum britannique l’illustre d’ailleurs : le fait que les vingt-sept aient à négocier avec ce qui sera à terme un pays tiers tend à les unir. En outre, les enquêtes réalisées à la suite du Brexit, de même que le résultat de l’élection présidentielle autrichienne, au terme d’une campagne où la question de l’appartenance à l’Union européenne a été centrale, suggèrent que les opinions publiques sont devenues plus favorables à la participation à cette Union.
Une deuxième justification de cette Europe régalienne nous vient de l’économie. L’un des fondements de la puissance régalienne est la capacité à lever l’impôt. Or l’érosion de celle-ci par l’évasion, la fraude ou l’optimisation fiscales est au cœur des débats. C’est aussi un enjeu de justice sociale. Le soutien très large dont la Commission européenne a bénéficié dans l’affaire Apple et les progrès rapides du Conseil et du Parlement quant à l’adoption d’un certain nombre d’initiatives en matière fiscale soulignent que la demande est forte dans ce domaine, et qu’il est possible d’aller de l’avant.
Ce récit, ce discours sur l’Europe régalienne peut permettre de déplacer le débat sur la souveraineté. Une Europe régalienne, c’est effectivement une Europe qui renforce la souveraineté de la puissance publique, que celle-ci s’exerce au niveau national ou au niveau européen. Et, selon notre modèle démocratique et libéral, tant l’Union européenne que les États nationaux ont pour justification de protéger la sécurité de leurs citoyens, leur sécurité physique mais aussi économique, tout en donnant le plus grand espace possible à la liberté individuelle. C’est cet équilibre qu’il faut trouver. Sur ces sujets régaliens, la France peut avoir une voix forte, compte tenu de sa puissance militaire et diplomatique, mais aussi de son expertise reconnue – notamment en matière fiscale –, et parce qu’elle bénéficie, à la suite des attaques terroristes dont elle fut la cible, de la solidarité européenne. Il nous semble, par ailleurs, que l’Allemagne est ouverte à des progrès sur ces sujets régaliens, qu’il s’agisse de la défense ou des questions fiscales. De plus, 82 % des Européens veulent une intervention plus importante de l’Union européenne dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi 75 % dans la lutte contre la fraude fiscale, 71 % dans la protection des frontières extérieures, 66 % en matière de sécurité et de défense. Il y a une vraie demande !
Je n’entrerai pas dans le détail des formes concrètes que peut prendre l’Europe régalienne, mais vous avez déjà mentionné, madame la présidente, des initiatives en cours, par exemple, en matière de défense, sur lesquelles le Conseil européen se penche à nouveau cette semaine. Sur la base de l’article 86(4) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, il serait aussi possible de créer un parquet européen compétent en matière de lutte contre le terrorisme – dans la mesure où celle-ci a une dimension transfrontalière, cela pourrait avoir du sens pour étendre les compétences d’Eurojust. Et si tous les États n’étaient pas prêts à faire ce pas, pour expérimenter et montrer la validité d’une telle approche, il serait possible de passer par une coopération renforcée.
J’en viens à la dimension économique. Il faut répondre aux doutes qui se sont exprimés pendant la crise sur la capacité de la zone euro à faire face aux crises, à les prévenir et à les surmonter, mais aussi sur sa capacité à prospérer, puisque c’est là l’une des promesses de la construction européenne.
Selon la règle de Tinbergen, il faut autant d’instruments indépendants les uns des autres que l’on se fixe d’objectifs de politique économique. Pour répondre à la crise, de nouveaux instruments ont été développés. La question est de savoir si nous avons maintenant tous les instruments à la fois pour répondre à la composante commune d’une crise et des enjeux économiques et pour faire face aux différences de situation qui peuvent se faire jour entre les États membres. Avec l’instauration, notamment, du mécanisme européen de stabilité, du fonds de résolution des crises bancaires, de la supervision bancaire européenne, en avons-nous fait assez ? Compte tenu de certaines fragilités persistantes, c’est l’une des questions que continuent de se poser les investisseurs, mais aussi les citoyens. Il me semble que le travail entrepris pour remédier à certaines fragilités financières mérite d’être poursuivi. Les instruments macroprudentiels, qui permettent de limiter la procyclicité bien connue des marchés financiers, doivent être développés car de nombreux risques pèsent sur la stabilité financière. Il faut sur ce point que l’échelon européen dispose de tous les instruments pour compléter les décisions nationales. Si la politique monétaire permet de faire face à la composante commune du cycle économique, les instruments macroprudentiels peuvent être ciblés sur des secteurs et sur des aires géographiques spécifiques si des divergences apparaissent.
En matière budgétaire, il convient de s’assurer que les bonnes incitations sont en place pour assurer que la politique budgétaire soit stabilisante et non déstabilisante. Il s’agit notamment pour cela de limiter le cercle vicieux entre risques bancaires et risques souverains tout en remédiant à la fragmentation financière. Le cadre réglementaire pourrait inciter à la constitution de portefeuilles diversifiés d’actifs souverains de la zone euro. La constitution de ces portefeuilles d’actifs diversifiés contribuerait à la fois à l’intégration financière et à la diversification des risques au sein de la zone euro. Dissocier les risques bancaires des risques souverains permettrait en outre de progresser plus facilement sur des projets de partage des risques financiers.
Par ailleurs, il n’y aura pas d’augmentation durable des revenus sans augmentation durable de la productivité. De ce point de vue, la question est de savoir si l’intégration économique bénéficie à l’ensemble de la population. La réaction à la mondialisation mais aussi à l’intégration économique européenne n’est pas toujours positive ; il existe un sentiment d’exclusion des bénéfices de cette intégration. Ce qui est crucial, pour que les territoires en bénéficient, c’est qu’ils soient intégrés dans les chaînes de valeur européennes. Les territoires qui profitent de l’intégration européenne – Toulouse, par exemple, en matière médicale ou aéronautique – sont ceux qui parviennent à utiliser les chaînes de valeur européennes. Pour cela, il est essentiel d’assurer que les structures économiques, nationales ou locales, et des investissements publics bien ciblés facilitent la participation à ces chaînes de valeur. Des pays comme la Slovaquie, bien intégrés dans des chaînes de valeur très compétitives comme le secteur automobile, ont clairement bénéficié de l’intégration économique et monétaire. Ces chaînes de valeur européennes sont un avantage dans la mondialisation, en termes de capacité à concurrencer d’autres grands ensembles économiques.
La question a également été posée d’une capacité budgétaire de la zone euro permettant de stabiliser les chocs macroéconomiques. Cette proposition se heurte néanmoins à la réticence des opinions européennes de se diriger vers un plus grand partage des risques qui fait craindre une « union de transferts ». Il semble plus probable que des instruments budgétaires communs seront acceptables si des besoins communs sont identifiés. De ce point de vue, il semble utile d’engager un débat sur les biens communs qui pourrait être gérés ensemble dans le cadre d’institutions communes. En lien avec ce que nous avons dit de la dimension régalienne, parmi les biens communs envisageables figurent l’investissement en R&D, dans les réseaux transfrontaliers et en matière de défense. Il est d’ailleurs notable que ces dépenses d’investissement sont généralement centralisées dans les États fédéraux.
Pour conclure, la question de la méthode est clairement indissociable de la volonté politique. Même s’il faut partir d’une volonté sincère d’évoluer à vingt-huit ou vingt-sept autant que faire se peut, force est de reconnaître – c’est l’histoire même de l’Union européenne – qu’il faut toujours apporter la preuve de la validité de certaines initiatives avant que certains souhaitent s’y joindre. Tous les États n’étaient pas présents dès le départ. C’est cette capacité d’initiative pour répondre de façon innovante aux attentes des citoyens qu’il faut développer, particulièrement dans les domaines régaliens, et il nous semble que sur ce point le dialogue franco-allemand a un rôle à jouer, ne serait-ce qu’en raison du poids des deux pays au sein de l’Union et plus encore dans la zone euro.
La dissonance entre la zone euro et le reste de l’Union, que vous avez évoquée, est aujourd’hui moins forte, me semble-t-il, en tout cas sur les sujets régaliens : il existe aussi une attente des pays hors zone euro sur ces sujets. Par ailleurs, après le Brexit, le chevauchement des deux est plus grand et il est donc peut-être devenu moins important de développer des instruments spécifiques à la zone euro. Enfin, il faut également être clair, quand on démarre des projets européens, sur le fait que l’on est prêt à les mener à terme car il n’y a rien de pire que de se retrouver au milieu du gué, à cause d’instruments qui ne sont pas à la hauteur, après avoir créé des attentes.
Un dernier point sur les parlements nationaux. Ceux-ci ont un rôle essentiel à jouer pour tous les instruments nationaux dont nous avons parlé. On continuera d’avoir besoin de ces instruments nationaux et les parlements ont un rôle à jouer pour les développer en adéquation avec les objectifs et pour veiller à leur utilisation stricte. Le Parlement européen a également un rôle de légitimation au plan européen. Une relation doit être nouée entre les deux niveaux. L’idée d’une approche qui ne soit pas seulement négative mais positive – vous avez évoqué, madame la présidente, le carton vert – est à promouvoir.
Thierry Chopin a parlé des contre-pouvoirs. Un lien intéressant peut être créé entre eux. La saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires est en France un contre-pouvoir important qui permet à une minorité au sein du Parlement d’exprimer des inquiétudes, protégeant ainsi les minorités contre ce qui pourrait être un risque d’abus de pouvoir de la majorité. Nous pourrions envisager de développer ce type d’instrument au niveau européen, avec la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne par une minorité de parlementaires européens ou un système similaire au carton vert. Il ne me semble pas nécessaire de modifier les traités pour cela ; un accord politique avec la Commission pourrait suffire.
M. André Schneider. Merci pour vos exposés très clairs. Je suis député de Strasbourg, une ville qui porte une part d’histoire, étant capitale européenne, et n’est pas toujours récompensée en retour.
Quand on adhère à un projet, c’est, en principe, que l’on adhère à son objet. On pourrait donc penser qu’en adhérant à l’Europe, l’ensemble des membres ont totalement pratiqué « l’innutrition », comme dirait Rabelais, des statuts et objectifs de l’Union. Or nous savons bien que ce n’est pas le cas. Les membres les plus récents, notamment, sont venus parce que l’Europe était la liberté mais aussi une association de pays de cocagne.
La plus belle caricature du Brexit que j’ai vue montre un Anglais sur le seuil d’une porte, à la manière d’un cambrioleur, avec un pied dans une direction et l’autre dans la direction opposée. On ne sait pas trop s’il entre ou s’il sort. C’est à la carte. Le Brexit va donner des idées à beaucoup de pays.
Vous avez parlé à juste titre du danger de la montée des populismes, auquel, en tant qu’Alsacien, je suis doublement sensible. Sans rien faire, les populistes progressent et je souhaite beaucoup de plaisir aux candidats pour expliquer à nos concitoyens que l’Europe n’est pas ce qu’ils pensent, un petit club fermé où nul n’a de prise. Notre présidente n’a pas ménagé sa peine pour faire comprendre à nos collègues de quoi il s’agissait mais je ne suis pas sûr qu’elle ait été toujours entendue. Je ne reviens pas sur les abattoirs de Munich ni sur les travailleurs détachés : les gens sont abreuvés de contre-exemples négatifs. L’Alsacien que je suis est totalement européen, comme la plupart de mes compatriotes.
La présidente Danielle Auroi. En écho à votre réflexion sur l’évolution des récits, je dois dire que je suis effrayée par l’idée de récit national qui commence dans plusieurs pays à ressembler à l’histoire officielle telle que nous avons pu en entendre parler il y a quelques années au sujet de certains pays d’Amérique latine. Je ne suis toutefois pas aussi inquiète qu’André Schneider au sujet du Brexit.
Vous avez parlé de l’idée de rédemption en Allemagne. Il y a deux ans, j’ai participé à une mission en Serbie avec nos homologues du Bundestag. Les Allemands s’opposaient à l’ouverture des négociations pour l’entrée de la Serbie dans l’Union européenne, sur le thème : « C’est vous, maintenant, les bourreaux, ce n’est plus nous. »
Le rejet de l’establishment est fort un peu partout, aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs. C’est l’entre-soi des politiciens qui est contesté. Les débats préélectoraux sont d’ailleurs de nature à renforcer ce sentiment. De même, tout ce qui reste obscur dans les grands traités internationaux du type du CETA (pour Comprehensive Economic and Trade Agreement) alimente le populisme. Mais les populismes ne sont pas tous les mêmes. Selon moi, le Mouvement 5 étoiles n’est pas la même chose que le Front national. On retrouve dans le premier des choses qui ressemblent au Front national mais aussi de nombreuses organisations non gouvernementales. Cette forme composite me semble gagner du terrain, comme Podemos en Espagne, même si c’est très différent. En Grèce, quoi que l’on puisse reprocher à Tsipras et à son équipe, Aube dorée est largement redescendue et continue de descendre, même si les Grecs connaissent encore des difficultés sociales importantes. Quelles sont vos réflexions à ce sujet ?
Je vous remercie pour les pistes que vous avez avancées. Nous allons les exploiter, en particulier sur l’aspect régalien. L’exemple de l’Autriche, plutôt inattendu, est encourageant car Alexander Van der Bellen n’a jamais varié son discours : « Nous sommes Européens, nous voulons rester Européens. » N’est-ce pas le moment de redire que l’Europe est la seule solution, dans un monde anxiogène pour les raisons de sécurité que vous avez évoquées mais aussi parce que la mondialisation laisse beaucoup de gens sur le bord du chemin ? La pauvreté a beaucoup augmenté ces dernières années, y compris en Allemagne. Peut-on donner les moyens d’espérer à cette Europe pauvre qui se sent rejetée ?
M. Thierry Chopin. Merci beaucoup de vos remarques et de vos questions. J’essaierai d’y répondre en mettant l’accent sur trois thèmes.
Premièrement, concernant le sentiment d’adhésion à l’Union européenne, il est intéressant de noter que, selon les enquêtes d’opinion post-Brexit, comme celle de la fondation Bertelsmann, le sentiment de confiance et d’adhésion à l’égard de l’Union européenne s’est accru dans les six grands pays membres, sauf en Espagne. L’étude ne porte pas sur l’Autriche mais ce qui est notable dans la campagne autrichienne, c’est qu’Alexander Van der Bellen a en effet tiré les leçons du référendum britannique en soulignant que, si son adversaire était élu, il organiserait un référendum sur la sortie de l’Autriche de l’Union européenne. Cela a pu jouer. L’effet de mémoire politique a sans doute aussi joué un rôle de verrou, encore aujourd’hui.
Je suis par ailleurs d’accord avec vous, Madame la Présidente, pour dire que l’Allemagne est encore en partie dans une logique de rédemption, mais je crois que cela a évolué. Elle est encore dans cette logique sur certains sujets, comme la crise des réfugiés : l’attitude d’Angela Merkel ne s’explique sans doute pas uniquement par des raisons liées à la démographie de l’Allemagne mais aussi par des raisons liées à son histoire. Dans le même temps, cette logique de rédemption a épuisé ses effets dans le domaine économique : à titre d’exemple, si l’Allemagne est depuis toujours un contributeur net au budget européen, et même un colosse budgétaire, c’est sans doute en partie en raison d’une logique de rachat, au double sens financier et éthique du terme ; pourtant, dans la période récente, du fait notamment de ses performances économiques et commerciales, il n’est pas certain que l’Allemagne soit encore dans cette logique en matière économique et financière.
De même, en matière de défense cette fois, cette logique semble évoluer comme en témoigne le livre blanc sur la défense de l’été 2016 et l’annonce récente par le gouvernement allemand du doublement des dépenses de défense, face au risque d’affaiblissement des liens transatlantiques annoncé par le nouveau président américain, et ce tout en rappelant les valeurs partagées qui fondent la solidarité occidentale. Même l’opinion publique semble évoluer dans le sens d’un engagement plus affirmé dans la gestion des enjeux de politique étrangère et de défense.
Deuxièmement, concernant la question des populismes, le rejet de l’establishment ou du « système » comporte au moins trois éléments importants : une demande de renouvellement, une demande d’efficacité dans les réponses apportées aux attentes des citoyens et une demande d’exemplarité. Sur ce dernier point, un des ressorts de la montée du populisme réside dans l’exaspération de nombreux citoyens face aux scandales financiers et fiscaux ainsi qu’aux affaires de corruption qui alimentent la critique de l’« anti-establishment » au cœur du discours populiste. Si l’on parvenait à lutter contre la corruption et à répondre à cette demande de respect de l’État de droit, une partie du problème serait résolue.
En outre, il existe en effet une diversité de mouvements populistes : d’un côté, les populistes et les extrémistes de tendance nationaliste développent une vision défensive et fermée des sociétés nationales européennes et prônent la fermeture des frontières à l’immigration et la limitation de la liberté de circulation ; de l’autre, les antilibéraux estiment que la construction européenne se fait selon une logique économique « néo-libérale » qui démantèle les systèmes sociaux nationaux et doit donc être combattue à ce titre ; enfin, certains courants rassemblent les deux précédents dans ce qui a pu être appelé le « souverainisme de gauche ». S’agissant du Mouvement 5 étoiles, dont vous avez parlé, celui-ci constitue en effet un exemple de mouvement populiste qui mêle des thèmes de gauche à des prises de position très à droite, notamment sur les migrants.
Lutter contre les populismes anti-européens suppose de porter un message politique clair sur ce qui peut fonder l’Europe et sa légitimité face aux défis actuels. La construction européenne a trouvé son sens pendant un demi-siècle en ancrant la paix et la démocratie sur le continent et en ouvrant aux entreprises européennes un marché domestique de taille comparable au marché américain. Il faut désormais lui apporter un prolongement politique et externe. L’Union doit se tourner vers un monde qui change rapidement, et s’adapter aux rapports de force politiques mondiaux en mutation. Dans cette perspective, ce que nous avons dit sur le projet d’une « Europe régalienne » répondant à la demande de protection en matière économique et sociale mais aussi en matière de sécurité pourrait être de nature à donner un contenu à ce projet.
Par ailleurs, il faut aussi organiser le débat public sur le renouvellement du projet européen en mettant en regard de manière claire les trois choix auxquels nous sommes confrontés.
D’abord, celui défendu par ceux tentés par le retour à l’« Europe d’avant » la construction européenne et le repli national. Un tel scénario pourrait paraître tentant pour de nombreux citoyens qui formulent une attente légitime de protection dès lors qu’il donne le sentiment de retrouver un sentiment de souveraineté dans les choix régaliens et de sécurité dans le cadre politique jugé le plus « naturel » et le plus protecteur : l’État national. Pourtant, cette option est extraordinairement risquée, à la fois économiquement et politiquement, avec la perspective d’une Europe fragmentée, divisée et affaiblie. En outre, il y a peu de chance que ce repli apporte plus de solutions que de nouveaux problèmes. En particulier, la renationalisation ne saurait apporter en elle-même la solution à des phénomènes qui dépassent les nations : elle n’arrêterait pas l’afflux des migrants, elle ne répondrait pas aux fragilités économiques, elle ne rendrait pas la politique plus éthique, elle ne mettrait pas un terme aux menaces terroristes.
Ensuite, celui du statu quo qui consiste, dans le meilleur des cas, à consolider l’Union sous l’effet des différents chocs qui l’affectent mais sans réforme d’ensemble du système. Ce serait une erreur, le statu quo n’étant pas une option viable à long terme et il serait donc illusoire de se contenter de consolider nos acquis. L’histoire montre que, dans un contexte de crise, un système politique peut finir par disparaître par peur de se réformer.
Enfin, renouveler le projet européen en répondant aux questions suivantes : quels sont les objectifs collectifs de l’Europe ? Quels sont les biens communs qui requièrent une action commune ? Dans le domaine économique, sous l’effet de la crise de la zone euro, les Européens ont découvert qu’un déficit grec était aussi un déficit européen ; et, au-delà de la monnaie, la stabilité financière s’est peu à peu imposée comme un bien commun à protéger dès lors que la crise de l’un de ses membres peut menacer la stabilité de l’ensemble de la zone euro. Mais, cette réflexion dépasse le seul champ économique ; par exemple, sous l’effet de la crise migratoire, les gouvernements et les opinions publiques ont aussi découvert qu’une frontière nationale, en Grèce ou en Italie, constituait un segment des frontières extérieures communes de l’UE, dont la protection est un enjeu commun pour tous les États membres. Ce questionnement concerne aussi les facteurs essentiels de la puissance comme les politiques de sécurité.
M. Jean-François Jamet. Vous avez bien présenté la question fondamentale : comment expliquer les bénéfices de l’Union à des citoyens qui se sentent exclus et pensent que les décideurs sont déconnectés de leurs préoccupations ? La première priorité est de retrouver le sens de ce qui nous rassemble. C’est la question des objectifs communs. Quels sont les objectifs que nous sommes prêts à partager ? Il a été question de la corruption : qui peut être contre la lutte contre la corruption ? Il a de même été question de terrorisme : qui peut être contre la lutte contre le terrorisme ? Qui ne voit pas la dimension transfrontalière du terrorisme actuel ? Qui ne reconnaît pas que les problèmes de corruption sont une source de désaffection vis-à-vis de la classe politique, dans maints pays et même au niveau européen, et que les problèmes d’évasion fiscale sont des facteurs de décrédibilisation de la classe politique ? Il est donc possible d’identifier des intérêts communs auxquels les citoyens puissent adhérer.
Il faut ensuite avoir des objets tangibles pour incarner ces objectifs communs. Un de ces biens communs le plus tangible est l’euro. En dépit des difficultés occasionnées par la crise économique, alors que la confiance dans les institutions nationales et européennes a très fortement décliné, le soutien à l’euro s’est maintenu à des niveaux très élevés dans toutes les opinions publiques. La raison en est qu’il s’agit d’un objet tangible qui développe des habitudes, un rapport affectif. C’est pourquoi renoncer à certains symboles européens serait un mauvais signe.
Le fait que la Commission européenne puisse tenir tête à Apple, un géant économique et financier, répond à une attente en matière fiscale et ne serait pas possible au niveau national. Cela parle aux citoyens. Lorsque le niveau européen a un pouvoir fort qui correspond à des objectifs partagés par les citoyens, ceux-ci ont plutôt tendance à soutenir une telle approche, même quand elle est perçue comme allant contre la souveraineté d’un État, puisqu’il s’agit en l’occurrence d’une aide d’État. J’ai mentionné l’idée d’un procureur européen pour la lutte contre le terrorisme. Les traités rendent possible d’étendre la compétence d’un parquet européen à d’autres dimensions de la criminalité transfrontalière. La corruption est mentionnée parmi ces dimensions. Ces réponses tangibles sont susceptibles de répondre à une partie de la critique de l’establishment.
Il existe un désir de renouvellement mais, quand vous accédez au pouvoir, vous entrez très vite dans l’establishment et la critique se retourne donc contre vous. La vision que nous portons est une vision traditionnelle au point de vue de la philosophie politique et qui attache une grande importance aux contre-pouvoirs. Or les décisions européennes sont souvent perçues comme un jeu diplomatique plutôt que démocratique. Les débats récents sur les négociations commerciales en ont donné un exemple. La voie que j’indiquais en termes de saisine peut précisément contribuer à un débat ouvert et au contrôle du respect des principes fondamentaux.
M. André Schneider. Je prends un exemple banal et concret. À Strasbourg, nous sommes envahis par des prostituées de l’Est. Ceux qui les exploitent sont dans des hôtels à Kehl, en Allemagne. Ils ont les papiers des filles, que des taxis conduisent sur leur lieu de travail. La réglementation en matière de proxénétisme n’est pas la même en France et en Allemagne. Nous avons toutes les nuisances et ils roulent carrosse de l’autre côté de la frontière. Nous avons dû retirer un viaduc entre deux quartiers, le pont Winston Churchill, en partie à cause de ce problème. Un procureur européen pourrait être la réponse sur des sujets très concrets de ce type.
M. Jean-François Jamet. C’est un exemple typique de criminalité transfrontalière. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et il faut reconnaître ces problèmes.
Un autre problème concret entre Strasbourg et Kehl, ce sont les flux de financement du terrorisme. Des initiatives ont été prises récemment car le financement du terrorisme n’est pas que national, et il est d’ailleurs très difficile de créer des murs pour ce type de financement. On en revient à la règle de Tinbergen dont j’ai parlé : il faut créer les instruments nécessaires lorsqu’ils n’existent pas au préalable.
M. André Schneider. Grâce à Mme la présidente, je suis souvent rapporteur sur les questions de l’énergie. Les pays qui financent les crimes horribles du terrorisme sont les mêmes devant lesquels nous nous prosternons pour avoir du pétrole à bon marché.
M. Jean-François Jamet. C’est un point sur lequel on peut expliquer les bénéfices de l’intégration européenne. Si, grâce aux instruments législatifs européens, nous avons la possibilité de réguler l’espace économique européen, nous sommes bien mieux armés que si les compétences législatives s’arrêtaient aux frontières nationales.
La présidente Danielle Auroi. Des collègues ont également remis un rapport sur le blanchiment dans le sport au niveau européen. Les exemples concrets ne manquent pas.
Je vous remercie de vos propositions. Quand nous aurons terminé notre cycle d’auditions, nous serons capables de redonner de l’espoir sur le fait que l’Europe est bien une maison partagée et que c’est même la maison partagée, celle qu’il va falloir continuer de construire et qui donne du sens, dans une période extrêmement difficile.
Compte rendu du mercredi 21 décembre 2016
La présidente Danielle Auroi. Je remercie M. Michel Theys d’être venu de Bruxelles pour cette audition sur l’avenir de l’Europe, de sorte que nous prenions du recul, dans une période très difficile, pour formuler des pistes de relance de la volonté européenne.
Vous êtes, monsieur Theys, un observateur de l’Union européenne depuis trente ans. Dans les éditoriaux très engagés que vous écrivez pour l’Agence Europe, vous inscrivez l’actualité européenne dans une perspective historique. Après l’événement historique, précisément, que fut le Brexit, que pensez-vous de la suite de la construction européenne ? Pouvons-nous la poursuivre autour d’un noyau dur souhaitant aller plus loin – une sorte d’Europe des avant-gardes qu’incarnerait la zone euro – ou faut-il accorder la priorité au maintien de l’Union des Vingt-Sept, comme le demandent ses membres les plus récents ? Ne court-on pas, dès lors, le risque de créer une Europe à deux vitesses, ce qui nuirait à sa lisibilité pour le citoyen ?
Vous proposez des analyses très lucides des freins que les États membres ont mis au partage de la souveraineté, pourtant nécessaire à l’efficacité de l’action publique, parce qu’il aurait entamé les prérogatives des États dans des domaines sensibles, notamment en matière sociale, fiscale, budgétaire, mais aussi de transition énergétique ou de politique étrangère. Hier, Jean Arthuis nous a présenté un jugement très sévère sur les États. Que pensez-vous de ces blocages ?
Enfin, les crises actuelles pourraient-elles susciter un sursaut, un renouveau de l’action commune ? À Bratislava, les Vingt-Sept ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble, par exemple dans le cadre du plan Juncker et du déploiement des gardes-frontières européens. De nombreuses difficultés persistent cependant, en particulier concernant la lutte contre le dumping fiscal et social, et le détachement des travailleurs ou encore l’opposition à l’harmonisation de l’impôt sur les sociétés. Pensez-vous qu’il soit possible et souhaitable de procéder à de nouvelles réformes institutionnelles à moyen terme ?
Quel est votre point de vue sur la multiplication des référendums, dont le Brexit est l’archétype ? Il semble de plus en plus que les référendums sont proposés à la carte, tel ou tel État s’emparant d’une question relative à la construction européenne, comme l’ont récemment fait les Pays-Bas au sujet de l’accord d’adhésion avec l’Ukraine, par exemple.
Quel regard portez-vous sur la démocratie européenne et l’espace public européen ? Quel rôle pourraient jouer les représentants des citoyens que sont les parlements – le Parlement européen et les parlements nationaux ?
Que pensez-vous du traitement de l’information sur l’Union européenne qui est fait à Bruxelles et dans les États membres par les journalistes eux-mêmes ? Si l’on estime souvent que les responsables politiques sont ambigus sur les questions européennes, n’en va-t-il pas de même des journalistes ? Vous avez constaté certaines dérives dans votre bulletin quotidien : la montée des nationalismes et des populismes de part et d’autre de l’Atlantique ; l’incapacité à faire avancer la construction européenne depuis vingt ans ; l’incapacité à faire rêver les jeunes ; le divorce croissant entre les « élites » et les « peuples ». Je vous pose à mon tour cette question, dont vous estimez qu’elle pourrait tout sauver : où avons-nous failli ? J’espère que l’examen lucide de nos erreurs nous aidera à repartir de l’avant et à replacer la construction de l’Union européenne au service d’une perspective politique et d’un espoir partagé, et au service de tous dans une mondialisation où l’Europe, si elle est unie, garde tout son rôle.
M. Michel Theys, journaliste. Je suis tout à la fois honoré et surpris de me trouver devant vous aujourd’hui. La seule raison valable qui justifie ma présence ici tient sans doute à ma longévité de journaliste européen : je couvre l’information européenne depuis trente-sept ans, ayant écrit mes premiers articles dans La Libre Belgique, sous la présidence danoise en 1978. Depuis, je n’ai plus cessé d’observer la manière dont l’Europe se construit. Si le journaliste a le devoir de cultiver l’objectivité, il lui arrive aussi, de temps à autre, d’écrire en italiques, c’est-à-dire de formuler des commentaires, voire des éditoriaux. C’est le privilège que j’ai depuis quelques mois à l’Agence Europe, où j’ai succédé aux deux monuments du journalisme européen que sont Emanuele Gazzo et Ferdinando Riccardi. Je vous livrerai donc mon point de vue personnel sur l’état de la construction européenne. Je ne vous dirai pas la vérité, mais ma vérité.
En trente-sept ans, l’Europe a énormément progressé. Lors du premier Conseil européen que j’ai couvert à Copenhague, en septembre 1978, on parlait de serpent monétaire et de système monétaire européen. J’ai eu quelques sueurs froides à la découverte de ce dossier, lorsque Léo Tindemans, qui était à l’époque le ministre des affaires étrangères belge, essayait de m’expliquer ce dont il s’agissait. Aux années de l’europessimisme et de l’euromorosité ont succédé les années Delors et le grand marché intérieur sans frontières, puis la procédure par étapes qui a conduit à la naissance de la monnaie unique, la lente gestation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et enfin l’extension géographique impressionnante et permanente – même si elle est sans doute interrompue – de l’Union.
Pourtant, avec le recul, il m’arrive de me demander si toutes ces avancées ont été une bonne chose pour la construction européenne. Qu’est-ce aujourd’hui que la zone euro ? C’est la crise des dettes souveraines, une politique d’austérité qui fait le miel des populistes, nationalistes et autres extrémistes, la mise à mal de l’approche communautaire au profit d’une approche intergouvernementale selon laquelle la raison, voire la loi du plus fort est toujours la meilleure. Qu’est-ce aujourd’hui que l’espace Schengen ? C’est le retour des frontières, voire des barbelés, face à la vague des réfugiés, le refus de la solidarité avec les États, comme l’Italie et la Grèce qui sont en première ligne, laissées presque seules pour gérer cette problématique humaine dramatique ; c’est aussi la remontée, un peu partout en Europe, de réflexes xénophobes, voire racistes, et la peur du terrorisme djihadiste – une peur légitime, comme en atteste l’attentat de Berlin, mais que les États membres ne se donnent pas les moyens d’attaquer ensemble de manière efficace.
Le marché unique est une autre avancée, mais c’est aussi un espace où les travailleurs de pays moins prospères viennent « voler » le travail d’autres Européens, où les États jouent la carte d’une concurrence fiscale presque éhontée entre eux pour attirer les entreprises, comme l’illustre l’affaire Apple qui en dit long sur la manière dont les États respectent leur devoir de loyauté à l’égard de leurs partenaires. Tous les gouvernements sont peu ou prou engagés dans une scandaleuse course au moins-disant fiscal. Enfin, c’est un espace que de nombreux citoyens européens perçoivent comme l’antichambre d’une mondialisation débridée au seul service des multinationales et de ce que l’on appelle « le 1 % » de l’humanité qui en bénéficie.
En clair, parce que les progrès de l’Union européenne ont été insuffisants et incomplets, il ne se passe plus un mois sans que l’Union soit contestée par un nombre croissant de citoyens. Pour des franges de plus en plus importantes de la population, le rêve européen est mort. C’est ce que l’essayiste belge Jean Cornil a parfaitement saisi en observant que l’actuel « désert des valeurs réanime la pulsion tribale, le repli sur des identités closes, la reféodalisation sur le terroir et la famille ». Ces phénomènes n’épargnent plus aucun État membre, pas même la France.
À bien y regarder, en effet, la démocratie est malade dans presque tous les États de l’Union. Toutes les démocraties semblent aujourd’hui atteintes d’un mal qui provoque l’insatisfaction sournoise et grandissante de leurs citoyens. Partout prévaut un temps de « fatigue démocratique », comme l’estime France Stratégie pour la France. Plus inquiétant encore, sur le plan des idées, il se produit une « colonisation culturelle des partis démocratiques classiques par les forces populistes et nationalistes », comme l’estime le professeur Sylvain Kahn. Les évêques français ont récemment estimé que « la crise de la politique est d’abord une crise de confiance envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt général ». C’est sans doute vrai sur le plan national, mais ce l’est bien davantage encore au niveau européen, car les citoyens sont tout simplement privés du droit d’y devenir le peuple souverain. Les nationalistes et les extrémistes en attestent on ne peut plus clairement : ils ne veulent pas que les citoyens aient voix au chapitre sur les questions européennes. En réalité, vingt-huit – et bientôt vingt-sept – démocraties nationales se coalisent pour empêcher qu’une démocratie européenne digne de ce nom ne voie le jour. Là est le problème majeur que nous connaissons aujourd’hui.
Sans doute m’objecterez-vous, et à raison, que le Parlement européen existe et qu’il est élu démocratiquement tous les cinq ans. Certes, mais ces élections prétendument européennes ne sont en réalité que des scrutins nationaux, et de seconde zone qui plus est ! Il n’existe pas de législation électorale commune. Surtout, les partis politiques n’accordent qu’une attention très relative à ces scrutins, lesquels passent de ce fait souvent inaperçus. En France, on peut même parler de démocratie confisquée, puisque les citoyens n’ont pas le droit d’élire qui ils veulent : sur la liste de leur choix, ils ne peuvent que valider l’ordre des candidats établi par le parti. C’est ce que j’appelle une « particratie » triomphante qui est un déni démocratique. Autrement dit, la parole des citoyens de l’Union européenne est confisquée par les partis politiques et par les dirigeants nationaux, qui s’expriment en leur nom sans leur demander leur avis. Partis et dirigeants nationaux instrumentalisent le projet européen, souvent au détriment des véritables intérêts des citoyens. En matière de lutte contre le terrorisme, par exemple, un FBI européen ne serait-il pas plus efficace que des polices nationales qui essaient de coopérer ?
Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a récemment décrété à propos des États-Unis d’Europe que « les peuples n’en veulent pas ». Qui le lui a dit ? Est-ce Marine Le Pen ? Theresa May ? Un autre souverainiste, qu’il soit de droite ou de gauche ? Sans doute. C’est la preuve que le discours politique traditionnel est pollué partout en Europe par les forces populistes et extrémistes. Ce sont elles qui donnent le la. Le citoyen européen, lui, n’a rien dit parce qu’on ne lui demande pas son avis ou alors de manière vicieuse, dans le cadre d’un référendum national qui, naturellement, ouvre grand la porte à un « non » – qui n’est pas un « non » au projet européen, mais au gouvernement national qui pose la question. Le référendum national sur un sujet européen est devenu un instrument de chantage permanent à la disposition des partis europhobes. Les partis démocratiques s’en accommodent parce qu’il leur permet de laisser entendre que décidément, non, le peuple ne veut pas des États-Unis d’Europe ou, du moins, d’une intégration plus poussée. En confisquant de la sorte la voix de tous les peuples de l’Union, les dirigeants nationaux se confèrent le droit de gérer l’Europe à leur guise, en fonction de leurs intérêts politiques personnels et non pas des intérêts bien compris de leurs concitoyens.
Les ministres incarnent cette confiscation de la parole des citoyens. Lors du vingtième anniversaire de la fondation Notre Europe, lancée par Jacques Delors, Manuel Valls a déclaré qu’il « faut dire non aux États-Unis d’Europe rêvés par Victor Hugo », et continuer à croire aux nations qui sont « un repère dans ce monde qui change si vite ». Jugez plutôt de la cohérence de son raisonnement : dans la foulée, l’ancien Premier ministre français a dû admettre que « bien sûr, face aux grandes nations qui émergent ou qui reviennent sur le devant de la scène mondiale, les Européens seront plus faibles sans une union puissante ». Le message est clair : pour de nombreux dirigeants nationaux, tout doit être sacrifié au culte de la souveraineté nationale, même au détriment des intérêts bien compris de leurs concitoyens.
Qui est le bénéficiaire de cette forme de hold-up dont sont victimes les citoyens européens ? Le monarque collectif qu’est devenu le Conseil européen. Deux personnalités politiques françaises pointent, elles aussi, un doigt accusateur sur cette institution – reconnue comme telle dans le traité de Lisbonne – et n’ont pas de mots assez durs pour stigmatiser la glissade antidémocratique dont se rendent coupables les chefs d’État et de gouvernement, ce qui est pour le moins paradoxal. Pour Sylvie Goulard, « par leurs hésitations et leurs arrangements opaques, ceux-là même qui devraient fortifier l’Europe sont devenus les artisans de son malheur », c’est-à-dire un « monarque absolu inefficace ». Et la députée européenne de conclure en ces termes : « En faisant main basse sur l’Europe, les dirigeants nationaux assoient leur pouvoir mais ne servent ni l’Europe ni l’intérêt national ». L’ancien député européen Jean-Louis Bourlanges n’est pas moins virulent lorsqu’il dénonce « les princes eurosceptiques qui nous gouvernent depuis vingt ans », tous coupables de s’être « ingéniés à court-circuiter le système communautaire » en redonnant vie au Congrès de Vienne sous la forme du Conseil européen, d’où la condamnation suivante : « Ce système primitif de réunion des dirigeants nationaux qui, dans sa forme la plus achevée, prend ses fausses décisions à l’unanimité, en dehors de toute préparation collective en amont, de toute association parlementaire en parallèle et de tout vrai contrôle juridictionnel en aval est l’absolue négation de celui que l’Union a reçu de ses fondateurs, un système qui combine le pouvoir d’initiative d’une institution commune, la Commission, la prise de décision des États à la majorité qualifiée, l’association pleine et entière d’une instance parlementaire élue au suffrage universel et le contrôle d’une juridiction impartiale et respectée », la Cour européenne de justice. Difficile de trouver procureur plus implacable ! Cela n’empêche pas certains responsables politiques français d’avoir récemment rêvé d’un Conseil européen doté d’une administration propre à son service afin de pouvoir se passer de la Commission, et même de rêver à un parlement renationalisé comme avant 1979. Où serait l’avancée ?
Le Conseil européen s’est révélé être une nuisance depuis qu’il est sorti de son rôle initial qui consistait à donner des impulsions et, parfois, à trancher des différends ministériels. Il est une nuisance, par exemple, parce qu’il a pris, sans en référer à personne, la décision de ne plus choisir le président de la Commission européenne que parmi ceux qui fréquentaient ce cénacle. Ainsi, il n’est désormais plus question d’un Jacques Delors à la présidence de la Commission, puisqu’il n’a pas été membre du Conseil. En revanche, nous avons droit à des Barroso et à la belle image qui en découle : des personnages falots qui acceptent de subir la loi du monarque absolu qu’est le Conseil européen. D’ailleurs, on peut se demander si les critiques détournées dont M. Juncker fait parfois l’objet dans certaines capitales ne traduisent pas le regret qu’il n’ait pas été choisi par le seul Conseil européen, mais aussi par la victoire du Parti populaire européen aux dernières élections européennes, puisqu’il est l’émanation fragile du souhait des citoyens.
Le Conseil est aussi une nuisance démocratique parce qu’au détour de la crise grecque, il s’est rendu coupable, selon le philosophe allemand Jürgen Habermas, d’un « évidement du processus démocratique », ayant consacré l’auto-habilitation des exécutifs sur le plan budgétaire dans une proportion jusqu’ici inconnue. Autrement dit, il s’agit d’un véritable coup d’État des exécutifs. Le contrôle des exécutifs européens est moindre qu’au Danemark ou au Royaume-Uni, par exemple. Quel chef d’État ou de gouvernement, proposant une décision au Conseil, est soumis à un véritable contrôle parlementaire ? Aucun.
Y a-t-il encore des raisons d’espérer ? J’aurais tendance à dire non s’il ne fallait pas tenir compte de cet enseignement prêté à Albert Einstein : on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré. En clair, on ne résoudra pas le problème existentiel de l’Union européenne si l’on ne prend pas la Bastille des temps modernes, le château de Versailles de la souveraineté nationale qu’est le Conseil européen. Je ne crois pas qu’une sortie par le haut puisse être le fait des responsables politiques nationaux qui instrumentalisent depuis longtemps l’Union en fonction de leurs intérêts et au rythme des oukases des forces populistes et extrémistes. Il faut changer de logiciel, en misant d’abord sur la société civile et en cessant de prêter trop d’attention aux bas instincts de l’opinion publique tels que les relaient les ténors populistes de droite et de gauche.
Ensuite, différentes pistes sont envisageables. Pour recréer la confiance, Emmanuel Macron a, par exemple, proposé d’organiser une convention démocratique pendant six mois ou un an dans les vingt-sept États de l’Union, afin de « réinterroger » – il serait plus exact de dire « interroger » – les gens sur ce qu’ils attendent, dans le but de construire un projet politique commun et non une somme illisible manipulée par tous. Ce serait, en effet, un pas dans la bonne direction. De même, les Verts européens proposent d’organiser une assemblée instituante européenne composée de citoyens tirés au sort, qui aurait pour mission de faire émerger l’idée d’une communauté de destin dont les membres se sentent redevables les uns vis-à-vis des autres ; c’est là aussi une piste intéressante.
Permettez-moi pour conclure d’apporter une modeste pierre à l’édifice de la construction européenne, indispensable si l’on ne veut pas que meure l’œuvre de Monnet et de Schuman. Je propose que soit convoquée une convention européenne où ne siègeraient que des jeunes de moins de trente-cinq ou quarante ans, à qui il appartiendrait de dire dans quelle Europe ils veulent demain vivre, travailler, aimer, car, après tout, ils sont les premiers intéressés par l’avenir de l’Europe. Voilà qui permettrait enfin d’entendre la voix des citoyens et de connaître leurs aspirations, et non celles de vingt-huit gouvernements nationaux agrippés à leur semblant de pouvoir.
M. Gilles Savary. Merci de cet exposé, extrêmement stimulant.
Je partage totalement votre diagnostic que le Conseil européen est devenu un obstacle. C’est le résultat d’une équivoque originelle de la construction européenne : à part un petit club d’intellectuels, aucun peuple ne s’est lancé dans la construction européenne pour le fédéralisme. Et nos discours politiques restent encore très imprégnés de l’idée que nous devons défendre les intérêts nationaux à Bruxelles. Il me semble que ce discours a malheureusement une grande légitimité.
De plus, les institutions communautaires ne sont pas aptes à gérer les crises qui, elles, donnent de la force au Conseil. Face aux crises, celle des subprimes ou celle des migrants, les peuples attendent des dirigeants européens des décisions extrêmement rapides : la Commission en est pratiquement incapable, et c’est pourquoi le Conseil est si puissant.
Si nous sommes d’accord sur le diagnostic, je vous fais remarquer que ce sont les institutions communautaires qui sont les plus impopulaires et les plus rejetées. Le bouc émissaire, c’est la Commission européenne – allez dans la campagne française, on vous parlera des fonctionnaires de Bruxelles. Discours entretenu par les eurosceptiques, direz-vous, mais alors, il n’y a que des eurosceptiques, car on l’entend jusque chez les sous-préfets. Même nos présidents de région les plus pro-européens expliquent que les procédures sont extrêmement compliquées et que les normes s’empilent. Si l’on convoque la démocratie, comme vous l’appelez de vos vœux, je ne suis pas sûr, donc, que vous ayez raison.
Comme vous, je pense que l’Europe est aujourd’hui en très grand danger. Institutionnellement, il n’est pas possible qu’un projet aussi puissant et nécessaire dépende des humeurs politiques conjoncturelles nationales, et soit laissé à la merci d’une alternance qui aurait promis la sortie de l’Europe ou un référendum sur la question. L’Europe est sur un volcan ; elle peut disjoncter tous les jours à la suite d’une campagne électorale. Il faudrait donc un traité de démocratisation de l’Union pour verrouiller les choses. Il n’est pas supportable que les Anglais, en disant « non », bousculent tous les autres peuples, voire qu’ils installent demain une zone franche fiscale nous mettant en difficulté.
Le cœur de nos institutions, c’est la souveraineté, et aujourd’hui, les peuples la réclament par le biais du référendum. Nous connaissons les ambiguïtés du référendum : Victor Hugo était hostile au plébiscite mis en place par Napoléon III, car il y voyait un outil du totalitarisme. C’en est un, mais pour certains citoyens très sincères, le référendum est aussi un outil de la démocratie directe. Un traité de démocratisation pourrait prévoir l’instauration d’un référendum européen sur les compétences totalement déléguées, que les États ne pourraient récupérer. Mais c’est un saut fédéral, et je suis convaincu qu’il n’est pas possible de le faire aujourd’hui. Si nous nous risquions à faire un référendum avec tous les Européens, je suis persuadé que l’Europe serait largement rejetée.
Nous ne sommes pas des Américains, nous n’avons pas construit le fédéralisme à partir d’une page blanche, dans des territoires déserts ou dont les habitants ont été massacrés. Nous avons des histoires nationales extrêmement fortes, qui continuent de nous hanter. Il n’est pas illogique, venant de quelque part, que nos cerveaux soient culturellement façonnés.
Je suis donc dubitatif s’agissant de votre vision édénique, dans laquelle les bons sont face aux méchants nationalistes qui défendent la souveraineté. Je ne crois pas, si l’on demandait aux peuples de voter sur l’Europe, que, de façon enchanteresse, le « oui » l’emporterait et dépasserait les nationalismes. Je le dis à regret, car je suis plutôt fédéraliste.
Aujourd’hui, il faudrait absolument un nouveau traité, mais nous sommes incapables de le mettre en place. Or c’est urgent, car les Anglais ont montré que l’Europe est prise en otage.
M. Bruno Gollnisch, député européen. Je suis un peu, ici, le représentant de ce que vous appelez les « pulsions tribales », le « repli des identités closes » ; un nationaliste, tout de même docteur en droit international, ce qui prouve un certain intérêt pour les questions internationales ; un xénophobe qui a été doyen d’une faculté où l’on enseignait vingt-sept langues étrangères à près de 3 000 étudiants ; un raciste qui a épousé une Japonaise ; un extrémiste qui n’a jamais rien fait d’autre que de se présenter pacifiquement au suffrage de ses compatriotes en bravant des difficultés parfois inouïes. Au-delà de mon bilan personnel, serait-il possible d’échapper à ces qualificatifs qui relèvent du poncif un peu fastidieux, pour ne pas dire de la technique du bouc émissaire que vous prétendez dénoncer par ailleurs ?
On peut croire, comme moi, qu’il existe une dérive d’une organisation internationale fondée sur la coopération très forte entre des pays très divers – la Suède n’est pas tout à fait identique au Portugal, les Pays-Bas ne sont pas l’Italie – mais qui partagent quand même un fond commun de civilisation. On peut également regretter que cette organisation internationale soit présentée, selon un point de vue encore minoritaire, comme un super-État qui prétend régir en direct tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, culturelle, sexuelle de 500 millions d’Européens. En quatre jours, à Strasbourg, on vote davantage de textes qu’en six mois à l’Assemblée nationale – je le sais, j’ai été membre des deux assemblées. A-t-on le droit de dire que cela pose un problème sans être taxé des épithètes dont vous avez usé ?
Peut-on considérer que la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux à l’intérieur d’un espace cohérent dans lequel les niveaux de vie et de protection sociale étaient à peu près les mêmes s’avère dévastatrice dès lors qu’elle est étendue progressivement à l’échelle du monde, comme c’est le cas ?
A-t-on le droit d’être critique sur l’institution européenne comme résultat de la fusion de trois institutions : la Communauté européenne du charbon et de l’acier, alors même qu’il n’y a plus ni charbon ni acier ; la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui n’est plus puisque l’Allemagne, à tort ou à raison, s’est désengagée du nucléaire ; la politique agricole commune, qui n’a pas empêché la disparition de quatre exploitations sur cinq ?
Si l’on a ces réserves et que l’on considère qu’il faut faire tout autre chose, comme une gestion par programmes avec des objectifs concrets, peut-on échapper à tous les poncifs que vous-même et beaucoup de partisans de cette intégration européenne utilisez régulièrement ?
Mme Nathalie Chabanne. Je voudrais essayer de voir l’Europe d’une manière un peu plus optimiste, et avoir votre avis sur l’Europe de demain et l’adhésion qu’elle suscite.
Je pense que les Français ont voté contre la Constitution européenne en 2005 parce que les traités et les institutions européennes n’étaient pas lisibles. Nos concitoyens ne savent pas qui, du Conseil, de la Commission ou du Parlement, prend quelles décisions. C’est un des graves défauts du traité de 2005, qui a entraîné le « non » des Français. Aujourd’hui, si un nouveau référendum était organisé, nous constaterions que le même défaut de lisibilité subsiste.
Nous n’avons pas su tirer les conséquences du rejet de 2005, et nous sommes même passés outre. Avec des institutions toujours pas lisibles, nous avons poursuivi sans cesse l’élargissement de l’Europe, et sans faire le moindre effort de pédagogie en direction des citoyens des nouveaux pays entrants ni de ceux des anciens États membres.
Nos concitoyens ne s’y retrouvant plus, le bouc émissaire le plus facile, c’est évidemment le fonctionnaire. Le dénigrement des fonctionnaires marche très bien au niveau national comme au niveau européen. Il est très facile de s’y engouffrer et de faire l’amalgame des différentes institutions. Avant d’envisager quoi que ce soit, il faut rétablir de la visibilité.
Lorsqu’on demande à nos concitoyens quels grands projets réalisés par l’Europe les ont marqués, ils répondent Erasmus. Ce programme fonctionne, en effet, très bien et a pris une ampleur considérable ; une grande majorité de jeunes en profite. Airbus groupe est également cité parmi les grandes réussites. Mais qu’avons-nous fait des autres projets ? En matière d’énergie, par exemple, pourquoi n’y a-t-il pas de projet européen pour créer un grand groupe dans le domaine énergétique, notamment dans les énergies renouvelables ? L’Europe est aussi en panne de projets d’investissements.
Enfin, puisque nous avons eu tort de vouloir élargir l’Union européenne sans clarifier les institutions, que pensez-vous d’une éventuelle adhésion de la Turquie, au regard du fonctionnement de nos institutions et de la situation géopolitique de l’Europe ?
La présidente Danielle Auroi. À l’instar de Gilles Savary, je partage votre constat sur le Conseil européen. Depuis le début, on traite le Conseil comme s’il s’agissait d’une seconde assemblée. Ne convient-il pas de clarifier cette ambiguïté laissant penser que lorsque tous les exécutifs se réunissent, ils forment une assemblée démocratique comme le Parlement européen ? Dire que l’Union européenne a un exécutif – la Commission – et deux législatifs – le Conseil et le Parlement – n’est-ce pas tromper le citoyen ? Tant que cela perdure, on laisse penser que seul l’intergouvernemental fonctionne.
Pour garder espoir, quelle porte de sortie peut-on imaginer ? En tant qu’écologiste, j’apprécie que vous voyiez dans l’assemblée instituante défendue par les Verts européens une idée à développer. Mais quelle que soit la solution retenue – convention démocratique ou assemblée instituante, sur un an, par tirage au sort et plutôt destiné aux moins de trente-cinq ans –, il faudra toujours une phase intermédiaire : la révision des traités. Comment faire ? Chaque fois que nous proposons des évolutions, comme le parlement de la zone euro, on nous oppose l’intouchabilité des traités.
Enfin, les politiques ont, certes, une grande part de responsabilité dans l’euroscepticisme ambiant, mais qu’en est-il de la responsabilité des journalistes ?
M. Michel Theys. M. Savary a parlé avec raison d’une équivoque originelle. Nous sommes aujourd’hui dans une Union européenne dont les compétences n’ont plus rien à voir avec celles de la CECA, tandis que l’état d’esprit de la population a changé. Pendant des dizaines d’années, la population a donné un accord tacite à la construction européenne, un consensus permissif. Pour différentes raisons, nous sommes sortis de ce cadre, et apparaît maintenant un nouvel acteur, certes dérangeant : le citoyen européen, qui dit que cette Europe ne lui plaît pas du tout. Et la seule manière qu’il a de se faire entendre, c’est de dire « non » lors d’un référendum ou de voter pour des formations protestataires. C’est le fond du problème, du moins l’un des problèmes majeurs auxquels est confrontée l’Union européenne aujourd’hui.
Je ne crois pas, monsieur Savary, que les institutions européennes soient plus impopulaires que les institutions nationales. La plupart des eurobaromètres font apparaître que les citoyens ont plus confiance dans les institutions européennes que dans les institutions nationales. D’un point de vue démocratique, c’est d’ailleurs catastrophique, mais c’est une constante relevée dans la plupart des États membres.
Vous craignez que l’Europe ne soit rejetée si l’on demandait aux citoyens européens de s’exprimer. C’est une épreuve de vérité que l’on doit affronter. Continuer dans le non-dit citoyen, laisser les gouvernements et les autorités politiques nationales gérer la boutique « Europe » sans l’assentiment des citoyens, c’est courir à la catastrophe.
Il faut trouver une formule nouvelle, sortir du cadre ancien. J’ai avancé quelques idées, qui ne sont pas totalement les miennes. La convention européenne qui a donné naissance au projet de constitution européenne rejeté par la France avait probablement réalisé un bon travail. Mais, encore une fois, n’y siégeaient que des politiques, dont beaucoup de parlementaires européens et nationaux – l’influence de ces derniers a été énorme. En définitive, ce fut une conférence intergouvernementale d’une autre forme qui a abouti à un accord qui n’était pas pleinement satisfaisant.
Vous avez raison, madame Chabanne, le traité constitutionnel n’était pas plus lisible que le traité de Lisbonne. Demander aux citoyens de prendre position, dans le cadre d’un référendum, sur un texte illisible, c’est un non-sens ! Ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre, une Constitution doit tenir en quelques pages exprimant les grands principes. Avoir imaginé que l’on pouvait demander aux citoyens français de s’exprimer sur le traité constitutionnel était une grande erreur.
Quel est le bon usage du référendum au sein de l’Union européenne ? Dans une Europe à vingt-huit, les Français et les Néerlandais avaient dit « non » au traité constitutionnel, alors que, quelques semaines auparavant, les citoyens espagnols, par la même voie du référendum, avaient dit « oui ». Pourquoi le « non » devrait-il l’emporter sur le « oui » ? D’un point de vue démocratique, c’est inacceptable, du moins cela pose un problème énorme de légitimité. Je rêve d’un référendum européen – je ne sais pas si c’est techniquement possible, car certaines constitutions nationales ne prévoient pas le référendum – par exemple, pour approuver la prochaine constitution européenne sans que l’unanimité des États soit forcément requise. Pour approuver la Constitution de Philadelphie, il fallait l’approbation des trois-quarts des États américains ; un quart aurait pu dire « non » que cela n’aurait pas prêté à conséquence. Demain, si un certain nombre de pays disait « non » à une constitution européenne, dans le cadre pleinement démocratique d’un appel aux citoyens à s’exprimer, cela clarifierait au moins la situation.
Je pense que permettre à un État d’organiser un référendum sur un sujet de dimension européenne est un travestissement du droit de veto sous les habits du vote populaire, mais il est tout aussi illégitime au regard de l’intégration que nous connaissons dans l’Union européenne aujourd’hui.
Monsieur Gollnisch, vous parlez de la dérive d’une organisation internationale axée sur la coopération. Je ne vous ferai pas l’injure de rappeler ce qui est écrit noir sur blanc dans la déclaration Schuman : le ministre français des affaires étrangères de l’époque avait bien déclaré qu’il s’agissait des premiers pas vers une fédération européenne. Je sais qu’en France, on n’aime pas trop se souvenir de Monnet et de Schuman, et que l’on préfère se référer à Charles de Gaulle, à qui l’on fait dire bien des choses. Dans la situation actuelle, je ne suis pas certain qu’il aurait souhaité continuer à travailler uniquement sur la base de la coopération. Gardons-nous de prêter des propos à des personnes qui ne sont plus là pour les contester.
Madame Chabanne, pouvions-nous faire autrement que d’élargir ? Je crois que, politiquement, notre responsabilité était d’ouvrir, d’une manière ou d’une autre, le cercle de l’Union européenne. Sans doute aurait-il fallu le faire par étapes, de manière beaucoup plus progressive. Mais fondamentalement, la responsabilité première incombe aux États membres de l’époque, qui n’ont pas voulu ou pu s’accorder sur la nécessité ou les modalités de l’approfondissement. Et la France porte une part de responsabilité.
Avec l’Allemagne, la France a une énorme responsabilité dans la construction européenne. Sans ces deux pays, rien ne peut se faire. Or, dans les moments décisifs de la construction européenne, la France a souvent eu tendance à freiner un maximum. Un des moments historiquement les plus forts, qui nous aurait permis de sortir par le haut ou du moins d’éviter les problèmes que nous connaissons aujourd’hui, s’est situé au début des années quatre-vingt-dix, lorsque l’Allemagne a proposé le passage vers une Europe plus intégrée. La France a refusé.
M. Gilles Savary. La France n’en a pas envie, tous partis politiques confondus.
M. Michel Theys. Mais est-ce la France politique ou la France des citoyens ? J’aimerais entendre la voix des citoyens français sur cette question qui ne leur a jamais été posée de cette manière.
L’Europe est instrumentalisée par les partis politiques nationaux, pas seulement en France, mais dans tous les pays. Bien souvent, elle est passée sous silence. À Bruxelles, lors des réunions des partis politiques – pourtant situés à trois stations de métro du quartier européen –, si un véritable débat sur un sujet européen se tient deux fois dans l’année, c’est une année faste ! Et bien souvent, c’est pour aborder un problème européen qui dérange, donc les propos tenus seront plutôt négatifs. Dans ce contexte, comment les citoyens pourraient-ils penser que l’Europe a des aspects positifs ?
Concernant la Turquie, j’étais un grand partisan de son intégration, mais aujourd’hui ce n’est plus du tout de mise. Les refus adressés à Ankara ont pu favoriser la montée en puissance d’un parti qui se révèle aujourd’hui conservateur et islamiste, alors qu’une partie de la Turquie était pleinement ouverte sur les valeurs européennes. Elle existe encore, mais elle est très minorisée. Au lieu d’aider cette frange de la population turque, notre attitude a fait le lit de ses adversaires. Aujourd’hui, la question ne se pose plus. Encore une fois, le Conseil européen a manqué de courage pour dire clairement à Ankara que tant que la Turquie ne répondrait pas aux critères de Copenhague, il ne serait pas possible d’aller plus loin.
Cette duplicité peut se comprendre en termes politiques : il ne faut pas fâcher Ankara alors que l’on a besoin de la Turquie pour régler le problème des réfugiés. Mais c’est assez médiocre, et cela brouille l’image de l’Europe aux yeux des citoyens qui ne peuvent pas comprendre ce genre de compromis boiteux.
Qui dit qu’on ne peut pas rouvrir les traités ?
M. Gilles Savary. Politiquement, aujourd’hui, c’est impossible.
M. Michel Theys. C’est ce que disent les gouvernements.
M. Gilles Savary. C’est le ressenti populaire. Nous sommes sur le terrain.
M. Michel Theys. L’eurobaromètre a été créé par un de vos compatriotes, Jacques-René Rabier, et j’en suis un fidèle lecteur depuis des années. Je vous assure que même maintenant, au plus fort de la crise dans laquelle est engluée l’Union européenne, si l’on se fie à ces sondages semestriels, les citoyens européens restent majoritairement en faveur d’une plus grande intégration. Mais on ne les entend pas, on n’entend que ceux qui vocifèrent contre la construction européenne.
Excusez-moi monsieur Gollnisch, ce n’est pas une attaque, il est tout à fait légitime que l’on défende tous les points de vue démocratiquement. Je dis simplement qu’il n’y a probablement qu’une minorité de citoyens qui s’opposent à une intégration plus poussée de l’Union européenne, et je ne pense pas que les dirigeants politiques soient tout à fait honnêtes dans leurs prises de positions. Même en Grande-Bretagne, 48 % des citoyens britanniques ont voté en faveur du maintien dans l’Union, et 52 % pour sortir. Si l’on refaisait le scrutin aujourd’hui, je pense que ce résultat serait inversé.
S’agissant du Conseil européen, il ne peut être assimilé à un Sénat, car il est aussi une branche de l’exécutif. Il faut donc changer les traités avant qu’il ne soit trop tard.
Enfin, je ne terminerai pas sans répondre à votre question sur le traitement de l’information par les journalistes. D’expérience, je peux vous dire que dans une rédaction, le journaliste en charge des questions européennes est considéré comme le vilain petit canard, qui travaille à des questions qui soi-disant n’intéressent pas le citoyen, et on ne fait appel à lui qu’en cas de problème. Tous nos médias, sauf quelques exceptions comme l’Agence Europe, restent tournés vers les pouvoirs nationaux, refusant de voir la dimension européenne, qui leur échappe pour différentes raisons. Effectivement, notre part de responsabilité, à nous journalistes, est engagée.
La présidente Danielle Auroi. En entendant votre conclusion, j’ai une pensée émue pour Jean Quatremer, qui fait partie des journalistes qui défendent l’Europe bec et ongles. Vous avez ouvert un certain nombre de champs, nous vous en remercions.
Compte rendu du mercredi 11 janvier 2017
La présidente Danielle Auroi. Chers collègues, nous commençons cette année 2017 sous les meilleurs auspices : avec la philosophie, en la personne d’Étienne Balibar, philosophe mais aussi intellectuel engagé.
Recueil de textes publiés entre 2010 et 2015, votre dernier ouvrage, monsieur, s’intitule L’Europe, crise et fin ? Son esprit est conforme à celui de ce cycle d’auditions, dans le cadre duquel nous interrogeons des intellectuels, des économistes, des responsables institutionnels, des représentants de la société civile, tous ceux qui peuvent nous donner des raisons de placer encore quelque espoir dans l’Union européenne. Après qu’un premier État membre a quitté l’Union européenne, est-ce un mouvement irréversible qui s’ouvre ? Vous appelez de vos vœux une nouvelle Union européenne, mais cela a-t-il encore du sens aujourd’hui ? L’Union peut-elle être transformée ou faut-il en passer par son implosion ? À cet égard, vous-même avez déjà comparé l’« exclusion intérieure » de la Grèce et l’« inclusion extérieure » du Royaume-Uni à laquelle pourra mener le Brexit.
Vous avez beaucoup travaillé sur les notions d’identité, de racisme et de frontières qui nous préoccupent aujourd’hui. Quelle analyse faites-vous donc de la montée des nationalismes dans l’Union européenne ? Est-elle aussi irréversible que les journaux nous le disent ? Dans un texte publié par Libération au mois de mars dernier, vous écriviez que « la crise des réfugiés signe l’échec du projet européen, de la solidarité et de la démocratie », en insistant sur la responsabilité de la France. Quelques mois plus tard, quel regard portez-vous sur l’évolution de la situation ? J’aimerais notamment que vous reveniez sur une idée que vous avez développée dans un autre article : cet afflux migratoire constituerait un nouvel élargissement de l’Union, non territorial mais démographique et politique – un élargissement de la définition même de l’Europe et de ses objectifs.
Vous avez réfléchi à la place de l’Union européenne dans le monde et à son rôle dans la mondialisation. Si, comme l’affirme Carl Schmitt, la politique est le lieu de la distinction entre « l’ami » et « l’ennemi », l’Europe ne manque-t-elle pas d’un ennemi commun à tous les États membres, qui permettrait un rassemblement au-delà des clivages culturels, linguistiques et historiques ?
Comment espérer encore ? Membres de la commission des affaires européennes, nous sommes des Européens convaincus, et nous pensons que l’Europe est le bon échelon pour continuer à construire la démocratie.
M. Étienne Balibar, professeur émérite à l’université de Paris-Ouest. Je vous remercie très vivement, madame la présidente, de l’honneur que vous me faites en m’invitant à contribuer, modestement, à vos travaux et à m’exprimer devant une partie de la représentation nationale. Merci, mesdames et messieurs les députés, de votre attention.
Vous n’imaginez sans doute pas, madame la présidente, que je dispose de réponses simples et définitives à aucune des questions que vous posez. Il est plusieurs façons de pratiquer la philosophie, que j’ai enseignée toute ma vie, et je n’oserai qualifier la mienne de « socratique », ce serait extraordinairement prétentieux – on comparait Socrate à une torpille qui paralyse ses interlocuteurs et les plonge dans l’embarras –, mais il est certain que je ne me suis pas arrangé avec l’âge : je tends de plus en plus à poser des questions qui permettent de débrouiller la complexité des problèmes plutôt qu’à apporter des réponses. Ce n’est pas forcément une qualité lorsqu’il est question d’affaires publiques urgentes…
J’ai lu avec un vif intérêt les comptes rendus des précédentes auditions. J’en ai été impressionné et me suis demandé si je pouvais fournir une contribution de la même qualité. Ce qui m’a frappé tout de suite, c’est que vous avez auditionné des experts de la question européenne : l’ancien président du Conseil des ministres italien et actuel président de la fondation Jacques Delors – Notre Europe Enrico Letta, mon collègue politologue Antoine Vauchez ou encore Luuk van Middelaar, l’ancienne plume du président du Conseil européen. C’est en tant que citoyen que la question européenne me paraît fondamentale, c’est pour cela que j’essaie d’apprendre, y compris de mes propres erreurs, et d’en dire quelque chose, mais je n’ai nullement la prétention de parler en tant qu’expert.
Au début du recueil que vous avez bien voulu citer, j’indique que je m’exprime en tant que citoyen européen de nationalité française. Certains y ont lu une renonciation provocatrice à la nationalité française au profit d’une autre, tandis que d’autres ont trouvé quelque peu utopique et virtuelle l’idée d’une citoyenneté européenne. De mon point de vue, non seulement il n’y a pas de contradiction entre la citoyenneté française et la citoyenneté européenne mais, dans la conjoncture historique présente, il nous faut absolument nous situer, constamment et simultanément, à ces deux niveaux complémentaires pour réfléchir aux problèmes de la démocratie ou à l’avenir des peuples européens. Certes, cela ne va pas sans difficultés ni, dans la transition historique que nous vivons, sans conflits d’intérêts ni tensions institutionnelles, mais cette situation est destinée à durer – peut-être indéfiniment. Comment peut-on encore se penser comme citoyen européen quand l’Europe s’effondre ou semble entrer dans une phase de désagrégation ? Je ne considère pas du tout la situation présente comme le fruit du hasard. C’est le point d’aboutissement d’une crise de très longue durée, dont les germes étaient peut-être dans les institutions européennes elles-mêmes, et nous sommes au pied du mur.
Cela étant, par principe, je considère que rien n’est acquis. Peut-être le principe est-il même plus vrai que jamais, si l’on veut bien tenir compte des derniers débats au Royaume-Uni ou des vues exprimées très récemment par Mme Merkel sur la question de savoir si le Brexit serait « doux » ou « dur ». Il est tout à fait prématuré de s’exprimer comme si le Royaume-Uni était déjà hors de l’Union : il est toujours dedans, quoique dans une position très étrange, qui se traduit en particulier par la limitation de ses droits ou de ses prérogatives d’État membre pour toute une série de questions politiques, une limitation « self-inflicted », dont on peut estimer qu’elle est le fait des Britanniques eux-mêmes et l’effet des réactions qu’ils ont provoquées. Juridiquement, le Royaume-Uni est toujours membre de l’Union européenne. Nous ne savons toujours pas quand ni comment il sortira de l’Union européenne. Nous ne savons même pas si le Royaume-Uni et le continent européen suivront ensuite des voies réellement divergentes – cela me paraît au contraire tout à fait improbable. Rien n’est fait, aucune négociation n’a encore eu lieu et les positions de principe arrêtées, notamment, au niveau du Conseil européen, sont plutôt, pour l’heure, des rodomontades.
Inévitablement, il en résultera une situation non seulement complexe mais probablement tendue et plus conflictuelle que jamais, mais sera-t-elle substantiellement différente de la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui la Grèce ? Alors que celle-ci est de plein droit membre de l’Union européenne, le ministre des finances grec est prié, lors de certaines négociations financières, de bien vouloir quitter la salle au moment où se décident, dans son dos et sur son dos, les formes de sa soumission à une espèce de diktat. Sur le plan financier, budgétaire et économique, aujourd’hui totalement intriqué avec le plan politique, et indissociable de celui-ci, la Grèce se trouve de facto dans une situation d’« exclusion intérieure », soumise à un régime de protectorat ou de souveraineté diminuée. Depuis le début de la crise grecque, qui n’était évidemment pas une crise purement et simplement grecque mais une crise du système financier européen tout entier, sont appliquées à la Grèce, pour régler le problème de sa dette, des procédures qui le sont depuis des décennies aux pays du tiers-monde par le Fonds monétaire international ou d’autres instances. Autant dire à la Grèce que si elle reste formellement membre de l’Union européenne, elle n’en est en réalité plus membre à part entière.
En lisant les comptes rendus des précédentes auditions, j’ai noté que la question d’une Europe à géométrie variable était l’objet de longues discussions ; vous-même, madame la présidente, posiez aux personnes auditionnées la question de savoir si elles envisageaient un recentrement de l’Europe sur un noyau dur et cohérent ou une union à géométrie variable. Mais prenons déjà acte de l’existence, dans les faits, de cette Europe à géométrie variable. Se superposent d’ores et déjà, sur différents plans – le plan judiciaire, le plan de la sécurité avec l’espace Schengen, le plan monétaire –, des structures qui ne se recouvrent pas complètement et ne font pas toujours bon ménage entre elles.
J’ai parlé d’effondrement. Nous répétons tellement que l’Europe connaît une très grave crise, mettant en cause son existence même, que l’énoncer encore une fois n’apporte guère au débat. Dans le livre que vous avez cité, j’emploie l’expression d’interregnum, que j’emprunte à Gramsci. Je m’en servirai à nouveau, pour désigner une situation paradoxale et d’une certaine façon intenable qui nous crée évidemment des responsabilités historiques : d’un côté, nous ne pouvons pas revenir en arrière, il y a de l’irréversible ; d’un autre, nous semblons ne pas pouvoir avancer, ne pas pouvoir inventer le nouveau. Ce que je viens de dire à propos du Brexit me semble illustrer l’idée de l’irréversible. Je peux évidemment me tromper mais le retour à l’ordre européen classique, tel qu’il a existé, par-delà des vicissitudes terribles et des transformations considérables, depuis l’émergence, au milieu du XVIIe siècle, du système des États-nations et du jus publicum europaeum, jusqu’au milieu du XXe siècle, avec l’affrontement des systèmes politiques, les deux guerres mondiales et la guerre froide, ce retour en arrière me paraît absolument impossible, même si, pour différentes raisons, nombre de nos compatriotes, voire une majorité de citoyens européens, se laissent persuader qu’il serait une solution.
Cette impossibilité ne tient pas tant à l’intrication croissante des sociétés européennes et aux liens toujours plus étroits entre les peuples européens qu’à la place des nations dans le monde d’aujourd’hui. La souveraineté économique ne peut plus s’inscrire dans le cadre des États-nations européens ; ce ne sont certes pas de toutes petites nations, ils sont de tailles diverses, mais ce ne sont pas non plus des Großmächte, comme disait encore Carl Schmitt, ni des espaces continentaux. L’idée selon laquelle, en renonçant à la construction européenne, les États européens amélioreraient leur situation économique, occuperaient une meilleure place dans la concurrence mondiale, pourraient valoriser le travail national ou retrouver une souveraineté monétaire me semble une mystification. L’Amérique de Trump ne parviendra pas à un tel résultat, nonobstant les prétentions du président élu, et les États européens, même ceux qui sont apparemment les plus puissants, y parviendraient encore moins. Cela rend d’autant plus grave le problème que créent la perte de légitimité de la construction européenne et la difficulté qu’il y a à inventer une structure post-nationale qui ne soit pas la fusion des nations ni leur incorporation à un ensemble bureaucratique ou idéologique qui les ferait disparaître, mais qui leur permette de se renforcer les unes les autres par la coopération et l’inévitable délégation de leurs intérêts communs à des instances de gouvernement et de représentation communes.
Cela m’amène à la crise du système politique européen. Pardonnez la généralité d’un propos peut-être insuffisamment technique, insuffisamment ancré dans les réalités concrètes, mais ce qui se passe aux États-Unis me conforte dans l’idée que les systèmes politiques démocratiques et républicains sont en crise partout, en particulier dans les grandes nations capitalistes développées – le problème des anciennes puissances socialistes est autre –, et ce pour différentes raisons, la « mondialisation » n’étant qu’un mot pour évoquer tout cela. Dans une intervention récente, j’ai d’ailleurs esquissé un parallèle entre le problème des États-Unis d’aujourd’hui, où j’enseigne une partie de l’année – sans que cela fasse de moi un expert –, et celui de l’Europe en tant que telle. Deux raisons à la crise de nos systèmes politiques sont plus particulièrement évidentes.
Tout d’abord, les systèmes de sécurité sociale sont en crise. Sans doute Alain Supiot serait-il l’interlocuteur idéal pour évoquer cette question, d’autant qu’il vient de rééditer son rapport sur l’Europe sociale. Pour ma part, j’ai soutenu l’idée que des pays comme la France, l’Allemagne ou les États-Unis d’après le New Deal avaient, sous des formes et à des degrés très divers, incorporé à la définition même de la citoyenneté une dimension sociale fondamentale. J’ai même parlé, pour provoquer les réactions, d’« État national social » : dans certains pays comme l’Italie, la Constitution met l’accent sur les droits sociaux. La cohésion nationale dépend effectivement, dans une très large mesure, du fait que les politiques sociales sont institutionnalisées, que ne règne pas entre concitoyens une concurrence sauvage et, évidemment, de politiques sociales conçues à l’échelle de la nation comme une sorte de contrat moral entre les citoyens. Or, dans le monde entier, ces systèmes de citoyenneté à la fois nationale et sociale, inscrits au cœur des institutions politiques, ont fait l’objet, en particulier depuis le thatchérisme, d’une tentative à bien des égards réussie de détricotage et de démantèlement, et la construction européenne n’a pas arrangé les choses.
Il ne serait pourtant pas impossible par principe que la citoyenneté européenne comporte une dimension sociale. Bien au contraire ! Du début des années 1970 au début des années 1990, la question de l’Europe sociale a constamment été mise sur le tapis. Évidemment, tout le monde n’avait pas le même point de vue, et l’Europe sociale avait aussi ses adversaires. En outre, la transposition des institutions fondamentales de la sécurité sociale du niveau national au niveau européen n’était pas évidente ; derrière la diversité des systèmes sociaux, bismarckiens ou beveridgiens par exemple, il y a des histoires différentes, et le modèle dont nous aurions besoin aujourd’hui n’est pas exactement celui qui a été construit à travers les luttes et les politiques du siècle dernier. Il aurait donc fallu inventer à l’échelle de l’Europe quelque chose de nouveau, ce qui n’avait rien de facile.
En cette matière, je rends un hommage mitigé à Jacques Delors. Pourquoi et comment a-t-il cédé sur l’Europe sociale, lui qui ne cessait de répéter que la construction européenne franchirait une étape décisive si l’on construisait d’un côté l’unité monétaire et de l’autre l’Europe sociale ? Nous avons construit l’unité monétaire et enterré l’Europe sociale ; c’est la conséquence des grands changements intervenus dans le monde à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Au fond, l’inscription dans le traité de Maastricht, dans des textes quasi constitutionnels, de la règle de la concurrence libre et non faussée signifiait que l’objectif de solidarité devait céder devant les impératifs du marché – je suis bien conscient que l’Allemagne et la France y ont poussé. Quand nous avons instauré l’euro et créé une Banque centrale européenne dont les objectifs de soutien à l’économie sont en deçà de ceux de la Réserve fédérale américaine, quand nous en sommes arrivés à la règle d’or budgétaire, dont j’aurai la charité de ne pas rappeler qu’elle a signé le destin de la présidence Hollande dès son premier jour, nous avons inscrit au cœur de la construction européenne l’antithèse même de l’idée d’Europe sociale, et érigé un obstacle apparemment insurmontable sur la voie de celle-ci.
D’une manière dont je conviens qu’elle est dangereuse, j’ai comparé l’Union européenne à l’Union soviétique, l’autre tentative de construction politique européenne supranationale du XXe siècle. Au cœur de la construction soviétique était le dogme idéologique de la planification économique autoritaire. Au cœur de la construction européenne est le dogme, image inversée du précédent, de la concurrence sauvage. Aussi longtemps que ce dogme ne sera pas remis en cause, la question de l’Europe sociale ne pourra être reposée ni donc résolue, et si elle ne peut être résolue, même partiellement, ou si les citoyens européens n’ont pas le sentiment que l’on tente de la résoudre, la crise de légitimité du système politique s’aggravera encore. Or avec elle vient ce que l’on nomme à tort – car on étiquette ainsi des éléments incompatibles entre eux – le populisme, qui est en réalité le retour de flamme extraordinairement violent du nationalisme, un phénomène qui contamine tout le monde.
La remise en question des institutions politiques tient aussi à ce que les frontières n’ont plus le statut qu’elles avaient précédemment. Je n’ai jamais été partisan de leur abolition. La question des frontières se pose au niveau national et au niveau communautaire, non seulement pour des raisons de sécurité évidentes que je ne conteste pas – même si je me méfie terriblement de l’idéologie sécuritaire, dont je crains qu’elle ne bouffe l’ensemble de l’équilibre institutionnel – mais aussi pour des raisons qui ont à voir avec la façon de gérer les flux de circulation dans l’intérêt des populations. Il faut trouver le bon équilibre entre la protection d’une part, la régulation ou la coopération internationale d’autre part, aux niveaux culturel et économique comme à d’autres niveaux. Là encore se pose un problème sur lequel nous butons et qui ne se présente pas en termes de « tout ou rien » – d’autant moins que l’on ne choisit pas les formes sous lesquelles il s’impose à nous, comme on le voit avec la crise des réfugiés et la situation à nos portes – mais sur lequel on ne peut fermer les yeux.
J’ai critiqué, dans mon ouvrage, le théorème des vases communicants. Je suis en effet convaincu que la crise des systèmes politiques qu’il nous faut affronter pour rester les citoyens actifs que nous voulons être n’est pas d’un côté nationale, d’un autre côté communautaire : elle est une. Ne soyons pas obnubilés par la crise des institutions européennes comme si les institutions nationales se portaient bien. La démocratie se porte très mal en Europe parce qu’elle n’a jamais été suffisamment prise au sérieux : les citoyens européens n’ont pas le sentiment de pouvoir se faire entendre au niveau communautaire, la délégation est beaucoup trop forte, les niveaux intermédiaires sont trop nombreux, le Parlement européen a trop peu de pouvoirs. Cela étant, la démocratie se porte très mal au niveau national également. L’un après l’autre, les États membres deviennent ingouvernables – et je crains que l’on assiste en France à la même chose que ce qui se passe en Italie ou au Royaume-Uni. Or, les peuples ingouvernables sont tentés par des solutions démagogiques ou extrémistes. Il faut donc soigner la démocratie en France en même temps qu’il faut construire la démocratie européenne ; ces exigences sont indissociables. On ne peut élever le niveau de contrôle parlementaire et citoyen des décisions politiques en appliquant le théorème des vases communicants : ou cela passera par la nation et elle regagnera en souveraineté mais alors les institutions européennes devront accepter de régresser, ou ce sera l’inverse. Je m’inquiète donc du résultat des élections à venir en Allemagne et en France. Elles prendront forme de test à ce sujet, mais elles risquent d’être source de déceptions supplémentaires car on persiste à dissocier les deux aspects du problème.
Si j’avais un vœu à formuler, ce serait que par-delà les appartenances politiques et les divergences idéologiques, nous placions l’avenir de l’Europe au centre du débat précédant les élections prévues en France et en Allemagne, que nous interpellions les candidats sur ce point et que nous acceptions que des citoyens d’autres pays européens qui partagent nos préoccupations aient droit à la parole chez nous pour formuler leurs propres attentes.
La présidente Danielle Auroi. Je vous remercie.
M. André Schneider. Le philosophe est donc aussi un mathématicien qui nous parle de géométrie variable et qui, surtout, nous invite à résoudre la quadrature du cercle… Je suis, comme vous, citoyen européen et d’autant plus européen qu’alsacien, mais je suis aussi farouchement cocardier.
On ne peut faire comme si les Britanniques n’étaient plus en Europe, nous avez-vous dit – mais y furent-ils jamais ?
Je me suis rendu en Grèce dans le cadre de la mission organisée par le bureau de notre commission. Nous avons étudié de manière approfondie la situation de nos amis grecs et leur avons apporté notre soutien dans la mesure de nos moyens. Mais la question souvent entendue à propos de la dette grecque est : « Qui paye ? », et, indépendamment de la nécessaire solidarité européenne dont nous sommes tous partisans, on ne peut empêcher que les citoyens européens se la posent.
Vous tenez l’appartenance à l’Europe pour irréversible tant il est difficile d’en sortir. Cette garantie me paraît très fragile au moment où la crise du système politique européen est ressentie partout. Pourtant, que serons-nous dans le monde de demain si les pays membres de l’Union ne s’accordent pas, enfin, en matière de politique étrangère, d’économie et de politique énergétique ? Mais, dans tous ces domaines, les prises de décision se heurtent à des considérations relatives à l’indépendance nationale et à la souveraineté des États. Le diagnostic étant posé, quelle est l’ordonnance ?
M. Christophe Caresche. Vous avez dit ne pas être un spécialiste de la mécanique européenne et c’est précisément ce qui nous intéresse car l’Union souffre des effets d’une autojustification permanente qui empêche la réflexion de prendre de la hauteur.
Vous avez justement souligné qu’en raison des échanges entre les pays membres, de leurs intérêts communs et de leur interdépendance, l’Europe continuera d’exister et que l’on ne reviendra pas à l’antérieur. Cependant, le projet européen – la création d’un espace supranational uni par des valeurs communes, projet affirmé depuis qu’a été décidée l’élection des parlementaires européens au suffrage universel direct, et dont l’apogée fut le projet de traité constitutionnel présenté en 2005 et rejeté par les Français – est extrêmement affaibli, comme la crise des migrants l’a montré sans équivoque : l’attitude des pays du groupe de Višegrad prouve que les sensibilités ne sont pas les mêmes en tous lieux.
La difficulté à unifier l’Europe autour de valeurs communes étant manifeste, ne faut-il pas faire le deuil d’un projet qui semble se poursuivre sur sa lancée comme continue de courir un canard sans tête ? J’ai cru à ce projet et je l’ai défendu, mais le temps n’est-il pas venu de tirer les enseignements nécessaires de l’échec du traité constitutionnel ? Ne faut-il pas revenir à ce qu’est l’Europe – un espace de coopération entre des États qui ont des intérêts communs et une monnaie commune – et repartir sur d’autres bases avec une ambition moindre mais plus réaliste ?
M. Yves Daniel. Vous avez plusieurs fois plaidé, monsieur Balibar, en faveur d’une Europe qui se fasse « médiateur évanouissant », expliquant qu’elle pouvait « contribuer de façon décisive, sinon à transformer le monde (…) du moins à en infléchir les évolutions annoncées, mais à la condition de « s’évanouir » à mesure que son intervention, ou sa médiation, se ferait plus déterminante : c’est-à-dire à la condition de se distinguer de plus en plus des images et des mythes de son « identité » enserrée par des frontières imaginaires ».
M. Étienne Balibar. Il faudrait ne jamais écrire ! (Sourires)
M. Yves Daniel. Dans cette perspective, vous insistez sur le rôle clef des intellectuels. Or, ils pâtissent du grave manque de crédibilité et de confiance qui touche les élites. Sans doute parce que je suis un député paysan, la philosophie me plaît beaucoup, mais je considère qu’au temps de la réflexion doit succéder celui de l’action. Je crains qu’en tournant en rond dans l’analyse nous ne laissions s’épuiser le temps si précieux dont nous disposons pour construire une Europe économique, sociale et de paix, tout en permettant à ceux qui s’opposent à la construction européenne de se mettre en ordre de marche. Comment créer les liens nécessaires à la fabrication de l’Europe que nous appelons de nos vœux ?
La présidente Danielle Auroi. Au contraire de M. Yves Daniel, je me demande si ce n’est pas faute d’avoir analysé autant que nous l’aurions dû ce qui était en cours au sein de l’Union européenne que nous en sommes arrivés à la situation actuelle.
M. Étienne Balibar. J’ai donc été courtoisement invité à m’extraire du jargon philosophique pour entrer dans la réalité, ce qui ne me déplaît pas. Différemment formulées, vos questions sont les mêmes : que faire, avec qui et comment ? Pour commencer, j’abandonnerai la notion de « médiateur évanouissant ». J’admets que cette référence allusive à un certain concept philosophique est peu compréhensible, sinon en contradiction avec ce que je souhaite : non pas que l’Union européenne s’évanouisse mais bien qu’elle s’affirme et se construise.
Vous invitez, monsieur Caresche, à ce que nous tirions les leçons de l’échec du traité constitutionnel en nous repliant sur une conception plus modeste de l’Europe. Mais jusqu’où entendez-vous vous replier ? Renoncer à ce qui est en effet la quadrature du cercle, c’est renoncer à l’idée que l’intérêt des peuples européens est d’inventer quelque chose qui n’a jamais existé dans l’histoire : une structure à la fois supranationale et démocratique, ce qui ne va pas de soi, les exemples impériaux le montrent, et qui combine la continuité des traditions nationales et la protection de certains intérêts de nos populations avec une entrée agissante et éventuellement offensive dans le champ irréversible de la mondialisation.
Si l’on renonce à l’idée que quelque chose peut être inventé et accepté, on ne peut décider seul où l’on s’arrêtera. La construction européenne s’est faite par étapes. Si rien ne sert de dire que le tournant du traité de Maastricht n’aurait pas dû être pris, il faut réfléchir de manière critique à ce qui a été fait. On constate alors que l’on a par ce texte abouti à une construction dans laquelle, paradoxalement, l’impératif de l’unité et de la supranationalité est affirmé – et, à l’occasion, imposé – mais qu’en réalité la logique à l’œuvre au sein de l’Union européenne est celle de la mondialisation : une concurrence internationale sans limites. Les fractures évidentes qui divisent l’Europe d’Est en Ouest et du Nord au Sud sont la conséquence d’une gouvernance européenne qui impose aux États membres de l’Union les règles régissant les relations économiques et financières internationales. Si l’on ne reprend pas les choses en main – ce qui pose la question de savoir qui y est prêt –, si l’on ne modifie pas ces relations, les fractures s’aggraveront inévitablement. Si vous voulez en rabattre au sujet de l’intégration européenne, je ne sais où vous vous arrêterez.
Le Royaume-Uni a-t-il réellement appartenu à l’Europe, m’a demandé M. Schneider ? Oui, mais pas à la manière de la France ou à celle de l’Italie ; il est d’ailleurs devenu évident qu’aucun pays n’est membre de l’Union de la même façon. Si l’on a permis que le Royaume-Uni ait un pied dans l’Union et un pied en dehors, singulièrement pour préserver les intérêts de la City, c’est parce que les Européens le voulaient – et qu’une partie d’entre eux continue peut-être de le souhaiter.
Qui paye la dette grecque ? Cette question a fait l’objet de manipulations au cours de la négociation avec la Grèce. La réticence de l’opinion publique à payer a été invoquée pour influencer les peuples et implanter dans l’esprit des citoyens européens l’idée que la restructuration de la dette grecque leur coûterait des sommes pharamineuses, ce qui est contestable puisque tout dépend des termes convenus et de la conjoncture économique.
Avec l’assentiment de fait – même s’il dit le contraire – de M. Michel Sapin, M. Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe, derrière lequel se tient toujours M. Wolfgang Schäuble, ministre allemand des finances, vient à nouveau de faire tomber le couperet en disant que le Mécanisme européen de stabilité suspendait l’allégement de court terme de la dette de la Grèce, au motif que son Premier ministre a annoncé des mesures en faveur des retraités très modestes. Certes, l’Union européenne paye en ce moment, mais qui paye-t-elle ? Les banques, puisque les citoyens grecs ne voient rien ou très peu du dispositif d’allégement de la dette publique, qui se traduit par un transfert permettant de régler les intérêts dus aux établissements bancaires. Je ne dis pas que les banques doivent périr mais qu’il faut savoir comment les risques sont gérés.
On crée des liens, monsieur Daniel, en rendant les liens désirables, en rehaussant d’un cran le niveau d’échanges, de circulation des idées, d’activation du débat politique à l’échelle européenne. J’ai pensé, il y a vingt ans, que se créerait, pour parler comme Jürgen Habermas, une sphère politique européenne, mais je n’avais pas l’illusion que ce serait facile. Non seulement cela passe par des intellectuels et par des représentants du peuple qui ont des intérêts de caste mais cela se heurte à des obstacles considérables dont le premier est celui de la langue, obstacles d’autant plus difficiles à surmonter que les systèmes éducatifs de nos pays ne donnent pas aux classes populaires les meilleurs moyens de le faire. Il faut donc des passeurs, des traducteurs… Aussi longtemps que le débat politique restera strictement clos dans l’espace national, on butera sur l’obstacle que vous signalez : non seulement nous ne trouverons pas de solutions aux problèmes qui se posent à nous mais la nécessité même de trouver des solutions ne sera pas perceptible à nos compatriotes et à nos concitoyens.
M. André Schneider. C’est à cette réflexion que notre présidente nous a invités sans relâche depuis cinq ans, et je l’en remercie.
La présidente Danielle Auroi. Je vous remercie à mon tour pour ces aimables propos et je remercie notre invité, qui nous a confortés dans l’idée que, tout en restant dans le concret, nous devons nous interroger. Parce que nous sommes persuadés que nous finirons par construire l’Union européenne, nous continuerons de vous lire et de vous écouter, monsieur Balibar.
Audition de Mme Daniela Schwarzer, directrice de l’institut de recherche de la DGAP (Institut allemand des relations internationales)
Compte rendu du mercredi 18 janvier 2017
La présidente Danielle Auroi. Merci, madame Schwarzer, de venir de Berlin pour participer à notre cycle d’auditions sur l’avenir de l’Union européenne. L’objectif de ces auditions est d’aider notre Commission, composée d’Européens convaincus, à formuler des propositions en cette période très troublée.
Nous avons auditionné des personnalités de plusieurs États membres, Enrico Letta, ancien Premier ministre d’Italie, Luuk van Middelaar, ancien conseiller du président Van Rompuy, Michel Theys, journaliste belge, ainsi que des Français.
Il nous a semblé indispensable de recueillir un point de vue d’outre-Rhin sur les affaires européennes, affaires que vous connaissez très bien puisque vous dirigez la DGAP, l’un des principaux think tanks dans le domaine, après avoir dirigé le bureau de Berlin du German Marshall Fund.
Nous souhaitons que vous partagiez avec nous vos perceptions sur l’état du moteur franco-allemand, les convergences et divergences de points de vue, surtout après les déclarations hier de Mme May.
Nous avons auditionné hier notre ministre de l’économie, Michel Sapin, avant le Conseil Écofin. Son hypothèse est que, depuis Bratislava, où les vingt-sept ont déclaré qu’ils souhaitaient rester ensemble, le Brexit permettrait peut-être de renforcer la logique de l’Union plutôt que de la casser. Dès lors, beaucoup d’entre nous qui avaient pensé à une Europe des avant-gardes se demandent si la priorité n’est pas dans l’immédiat de maintenir les vingt-sept États restants, avec peut-être une spécificité de la zone euro, en rassurant les pays entrés le plus récemment sur la volonté d’être ensemble. Quel est votre point de vue sur les risques d’une Europe à deux vitesses ? De même, quelle est votre analyse de l’influence du groupe de Visegrad ?
Comment analysez-vous la multiplication des référendums dans l’Union européenne ? Le Brexit en est certes l’exemple le plus dur, mais il y a eu aussi celui sur l’Ukraine aux Pays-Bas. Je me suis récemment rendue en Ukraine avec le président du groupe d’amitié France-Ukraine : les Ukrainiens sont très inquiets en raison de la volonté de la Russie de continuer à avancer ses pions, ce que l’élection de Donald Trump facilitera peut-être, mais aussi au sujet de la position de l’Union européenne.
Des réformes institutionnelles sont-elles nécessaires et, si oui, lesquelles et à quel rythme ? Quelle place les Parlements nationaux doivent-ils occuper dans l’approfondissement nécessaire d’une démocratie européenne ? Des élections se profilent en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. La question européenne devient, enfin, un enjeu central dans cette prochaine échéance chez nous. Est-ce la même chose en Allemagne ? La politique de M. Schäuble est-elle acceptée ou bien critiquée ?
Enfin, la COP 21 et la COP 22 ont suscité une certaine déception parmi les pays du Sud, mais la mise en œuvre a commencé. Le développement durable continue-t-il selon vous à être un ressort de l’Union européenne et ne pourrait-il pas être un élément de la relance ?
Mme Daniela Schwarzer, directrice de l’institut de recherche de la DGAP (Société allemande des relations internationales). Un échange franco-allemand sur les questions que vous venez d’évoquer est très important et j’observe avec satisfaction que des rencontres sont régulièrement organisées, notamment par votre ambassade à Berlin, pour nourrir cet échange. Ce sera d’autant plus important au cours de la présente année, dont je suis convaincue qu’elle sera décisive pour l’avenir de l’Europe. Je commencerai donc par justifier cette analyse, sur la base de trois éléments.
Vous avez, tout d’abord, évoqué le Brexit et le discours prononcé hier par Theresa May. Mme May reproche à l’Union européenne d’être responsable de beaucoup de choses au Royaume-Uni et dit que son pays peut à présent se libérer des contraintes. Elle a évoqué la réforme des écoles, la modernisation du pays, la démocratie : ces sujets n’ont à mon sens rien à voir avec l’intégration européenne. Ce faisant, elle nourrit cependant la position de ceux qui souhaitent affaiblir l’image de l’Union européenne, les partis populistes de droite et de gauche, et cela rendra d’autant plus difficile la position des partis modérés.
Le deuxième élément, c’est l’arrivée au pouvoir, le 20 janvier, d’un président américain qui ne semble pas penser qu’une Union européenne forte soit dans l’intérêt stratégique des États-Unis. Peut-être, dans le meilleur des cas, est-il simplement indifférent, mais sa position vis-à-vis du Royaume-Uni est un premier élément montrant qu’il cherche plutôt à diviser les Européens et à rendre les choses plus difficiles pour ceux qui sont en train de négocier l’avenir. De même, sa position sur la Russie, bien que nous ne la connaissions pas encore parfaitement, pourrait nourrir des tensions au sein de l’Union européenne.
Ayant travaillé pour une organisation américaine pendant quelques années et passé beaucoup de temps aux États-Unis, observant des débats sur l’Europe à Washington, je peux dire que nous avons tendance à sous-estimer l’influence positive que l’administration Obama a eue sur la cohésion de l’Europe. Si cette influence disparaît, la situation va devenir plus difficile au sein de l’Union. Cela rend la responsabilité de l’Allemagne et de la France – et d’autres grands pays mais surtout de ces deux-là – d’autant plus importante pour maintenir la cohésion européenne.
Troisième élément : les élections en France et en Allemagne. On dit souvent que l’on ne peut rien faire avant des élections mais, à partir d’octobre ou novembre, quand l’accord de coalition aura été négocié et le Gouvernement allemand établi, nous entrerons dans une période d’ouverture pour l’action politique, et nos pays ont la responsabilité de préparer des options dès maintenant. J’ai appris avec beaucoup de plaisir, dans votre invitation, que vous étiez en train de préparer un rapport, de même que le Sénat : il est très important de nourrir cette réflexion.
Il existe certes des risques politiques. En Allemagne, pour la première fois un parti populiste de droite a de fortes chances d’entrer au Parlement avec un groupe assez important de députés, les sondages indiquant de 12 à 14 % d’intentions de vote pour ce parti antieuropéen, xénophobe et anti-immigration. Il ne me semble pas envisageable que ce parti fasse partie du Gouvernement mais une entrée en nombre au Parlement changerait le contexte du discours. C’est la même chose en France, où l’impact du Front national sur les discussions européennes est réel.
Le contexte politique mondial est en train de changer. Le changement de pouvoir aux États-Unis impliquera sans doute aussi un changement dans la gouvernance mondiale. Certains propos du président Trump font en effet penser que les États-Unis ne seront plus l’ancrage de l’ordre mondial démocratique. C’est donc la responsabilité de l’Europe de reprendre, au moins en partie, ces fonctions de défense de l’ordre démocratique et de l’ouverture internationale.
J’en viens à vos questions. J’ai commencé d’évoquer le moteur franco-allemand. La coopération entre nos deux pays est très étroite et fonctionne au quotidien. Entre les Parlements comme entre les ministères, des liens ont été créés grâce au traité de l’Élysée et, à l’occasion de son anniversaire en 2003, ces liens administratifs et politiques ont été encore renforcés. Néanmoins, s’il n’y a pas d’accord politique au plus haut niveau, ces liens ne peuvent donner lieu à de grands projets politiques.
Je suis convaincue qu’il faut approfondir la coopération au sein de la zone euro. De nombreux progrès ont été réalisés depuis 2010 et la crise bancaire et de la dette qui a touché la Grèce et d’autres pays, remettant en question l’existence même de la monnaie unique : création du fonds de stabilisation et réforme des procédures de coordination des politiques économiques et fiscales. Nous avons besoin de davantage d’instruments de solidarité et de soutien au sein de l’union monétaire, et notamment d’éléments de politique budgétaire. En Allemagne, cette position n’est pas largement partagée car le point de vue prévaut que les éléments de solidarité représentent un risque s’il n’y a pas de mécanismes de contrôle suffisants. Un compromis franco-allemand sur le sujet doit donc intégrer ces deux éléments.
Pour parvenir à ce compromis, les politiques nationales doivent changer. Pour la France, je pense qu’il est très important que les réformes du système économique et social se poursuivent. C’est quelque chose qui est regardé de très près par le Gouvernement allemand car, pour justifier davantage d’intégrations, une certaine convergence est nécessaire. Du côté allemand, une réflexion au sujet des méfaits de la politique nationale sur l’économie européenne doit se faire jour. La situation budgétaire de l’Allemagne est en ce moment très saine et le pays devrait peut-être en profiter pour favoriser l’investissement et la croissance, tout en gardant son excellente compétitivité.
Si le dialogue sur ces sujets et sur une meilleure coordination entre les initiatives franco-allemandes, notamment en matière d’innovation, de productivité, de flexibilité, avance, nous aurons déjà résolu une bonne partie du problème de la zone euro, car les deux pays représentent 47 % du PIB de cette zone.
Il existe de forts risques dans la zone euro, notamment dans le secteur bancaire, en Italie mais aussi en Allemagne. Nous devons nous préparer politiquement à une nouvelle phase de crise. L’expérience depuis 2010 a montré qu’une étroite coordination franco-allemande était à cet égard très importante.
En ce qui concerne la sécurité, la défense, le renseignement, comme vous le savez, nous avons vécu un attentat à Berlin juste avant Noël, commis par l’État islamique. Une forte réaction politique avait déjà eu lieu en Allemagne à la suite des attentats en France et en Belgique. Le débat en Allemagne a avancé, notamment au sujet de notre structure fédérale de services de renseignement, mais aussi sur la coopération dans ces domaines.
L’Allemagne conduit depuis trois ans une réflexion stratégique sur sa politique étrangère, avec en particulier un Livre blanc sur la défense. Il en ressort une analyse de la nécessité pour l’Allemagne d’investir, mais aussi l’idée que le cadre européen, Union européenne et OTAN, est le cadre important en matière de défense : l’Allemagne continue de réfléchir à sa politique étrangère à travers le prisme de l’Union européenne. Le sujet de la politique de défense et des interventions militaires est, vous le savez, difficile en Allemagne, mais le Gouvernement a fait en sorte que ce débat ne soit pas conduit entre experts à Berlin mais que ce soit un débat national. À mon avis, l’Allemagne se prépare à jouer un rôle plus important. Il convient de trouver une stratégie commune entre nos deux pays.
La zone euro me semble constituer un noyau dur. Je ne pense pas que nous verrons bientôt une zone euro intégrant tous les États de l’Union européenne. La France a d’ailleurs souvent poussé à la création d’institutions exclusives à l’union monétaire, Eurogroupe et sommet de la zone euro, ce à quoi l’Allemagne a longtemps été réticente car elle craignait un découplage entre la zone euro et le marché intérieur, mais il existe aujourd’hui un consensus plus important sur le fait qu’une union monétaire a besoin d’un cadre propre de coordination politique.
L’avenir de l’union des vingt-sept États sera à mon avis plus différencié que ce que nous connaissons aujourd’hui : nous verrons des groupes de pays se mettre d’accord et coopérer sur certaines politiques. Cela se pratique déjà en matière de politique étrangère. Des efforts sont certes déployés pour renforcer une approche commune des vingt-sept États, avec la stratégie globale de Mme Mogherini et la réflexion sur la politique de défense, mais la réalité politique suggère que ce sont des petits groupes de pays qui avanceront sur des initiatives spécifiques. L’important, c’est que le cadre communautaire, les institutions à Bruxelles ne perdent pas davantage d’influence. L’image de ces institutions a souffert, résultat de la crise que nous vivons depuis des années mais aussi de la manière dont les Gouvernements interagissent avec ces institutions et dont les élites politiques en parlent. Il est nécessaire de recrédibiliser le cadre institutionnel à Bruxelles.
Cela me conduit à votre question sur les réformes du cadre institutionnel. Des réformes me semblent en effet nécessaires. Le Parlement européen devrait travailler sur les questions de la zone euro de manière plus visible. Je ne pense pas qu’il faille un Parlement propre pour la zone euro mais peut-être qu’une partie du Parlement européen pourrait travailler sur ces questions. Si l’intégration de la zone euro avance de la manière dont je l’ai décrite, il faudra un contrôle démocratique à l’échelle de la zone euro, surtout si l’on introduit des éléments de politique budgétaire.
Les Parlements nationaux ont un rôle important à jouer. Les mécanismes existants permettent déjà un contrôle mais l’agenda poursuivi est plutôt négatif : il s’agit souvent de s’assurer que l’Europe ne fait rien de mauvais. Il faut selon moi changer d’approche et réfléchir à la manière dont les Parlements pourraient jouer un rôle plus positif de définition des priorités. Beaucoup de travaux ont lieu au niveau national, vos réunions et vos rapports en témoignent, mais les contacts entre parlementaires doivent être renforcés, en partie de manière informelle car il n’y a pas encore de connaissance approfondie des questions qui sont importantes dans les autres pays. Ayant dirigé pendant deux ans un grand projet de rencontre entre parlementaires nationaux, avec un réseau de 120 parlementaires, je vois comment un dialogue moins formel peut nourrir la compréhension mutuelle et la réflexion sur l’avenir de l’Europe.
Le référendum est un instrument très risqué d’un point de vue politique. La plupart des pays ont opté pour des systèmes de démocratie représentative que je trouve adéquats pour des questions aussi complexes que l’avenir de l’Europe. Le contexte de communication politique a par ailleurs beaucoup changé ces dernières années, et, on l’a vu au cours des dernières élections américaines, la question de l’objectivité des médias, et notamment des réseaux sociaux, est posée. Avec un référendum comme celui sur l’Ukraine aux Pays-Bas, le risque est que les gens répondent en fait à une autre question et que l’opinion publique soit fortement manipulée avant le vote.
Je suis donc très prudente vis-à-vis de cet outil. Cependant, si nous décidons – bien que je ne le voie pas dans les trois prochaines années – une grande réforme du traité européen, il est évident que certains pays devront organiser un référendum, et il sera alors très difficile de ne pas en organiser dans les autres pays. Ce qui impliquerait un changement constitutionnel en Allemagne, où cet instrument n’existe pas.
La présidente Danielle Auroi. Merci pour ces propos très précis. Nos collègues souhaitent à présent vous poser quelques questions.
M. Marc Laffineur. Je partage, madame, beaucoup des propos que vous avez tenus.
Mme May, dans sa position, ne pouvait tenir un autre discours. Cela dit, si les Anglais ont dans les prochaines années une croissance supérieure à celle de l’Europe, d’autres pays voudront quitter l’Union. Il faut donc que nous soyons solidaires, et en même temps durs vis-à-vis des Anglais.
C’est bien évidemment par le couple franco-allemand que devra passer une reprise de l’Europe que nous espérons tous. La montée des nationalismes et de l’islamisme, les problèmes de l’Afrique et du Moyen-Orient, régions que nous devons aider, appellent des réponses communes. L’Europe ne peut se désintéresser de ces problèmes.
Il faut en outre que ces réponses soient apportées rapidement car il y a le feu. Vous me faites un peu peur quand vous dites ne pas voir de modification importante des traités dans les deux ou trois ans à venir, car, si cela n’a pas lieu dans ces délais, l’Europe est morte. C’est vraiment mon sentiment. Les élections française et allemande sont une opportunité et j’espère que ceux qui seront élus auront la force de prendre des initiatives.
S’il faut que la zone euro soit un noyau dur, rien ne changera. Je crois que le noyau dur est d’abord le couple franco-allemand, puis les pays des origines de l’Europe, le Benelux, l’Italie, et ensuite les autres, qui viendront si nous savons être attractifs. Mais un noyau dur au niveau de la zone euro serait tellement compliqué que nous ne ferions rien, et ce serait la dislocation assurée de l’Europe.
Enfin, pensez-vous que l’esprit fédéral avance ? Je suis fédéraliste et ne l’ai jamais autant été car la défense européenne est devenue plus fondamentale encore, les Américains manifestant un désintérêt, les nationalismes montant, la Russie donnant des signes inquiétants. Si nous voulons une défense commune, il faut un chef, car on ne peut pas réunir tous les premiers ministres pour prendre des décisions.
M. Gilles Savary. Merci, madame, votre exposé extrêmement précis nous éclaire grandement.
Au fil de l’année 2016, le risque d’une dislocation de l’Europe n’a cessé de croître. La situation est assez affolante si l’on en juge d’après les forces en jeu, extrêmement puissantes. Pour les populistes, comme d’une certaine manière pour Mme May, l’Union européenne est le bouc émissaire idéal dès lors qu’un problème se pose au sein de l’Europe. En France même, les difficultés rencontrées sont présentées, dans le cadre de la campagne électorale qui s’ouvre, comme le fait de l’Europe, non comme le témoignage de la nécessité de réformer le pays. C’est une pente extrêmement dangereuse : celle du moindre effort, celle de la facilité pour les peuples. Même des hommes politiques français insoupçonnables jusqu’à présent tiennent des discours aux tonalités national-populistes. C’est très préoccupant.
Par ailleurs, l’arrivée au pouvoir de M. Trump, qui ne s’embarrasse pas de nuances ni ne semble avoir un réel bagage géopolitique – à moins qu’il ne rompe délibérément avec une très longue histoire –, est quand même très inquiétante, notamment en raison de ce que l’on dit de ses rapports avec M. Poutine. L’Europe est en quelque sorte prise en étau.
Quant à la pression migratoire qui s’exerce au sud de l’Europe, elle tend à déstabiliser nos pays.
J’ai bien entendu ce que vous disiez tout à l’heure. Oui, il faut consolider la zone euro, oui, il faut consolider le marché intérieur, oui, il serait idéal de faire des traités… mais, dans le climat actuel, nous pourrions aussi en mourir, de réformer les traités, de faire des référendums ! Ne faudrait-il pas trouver des thématiques plus en phase avec l’air du temps, susceptibles de rassembler ? Depuis de nombreuses années, je fréquente un peu les pays de l’Est. Assez paradoxaux, ils semblent tout de même relativement attachés à l’Union européenne, et bien plus qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils y ont adhéré. Leur histoire les hante et, compte tenu de l’attitude de la Russie, ils ne quitteront pas l’Union avec autant de légèreté que nous pourrions le faire. D’un autre côté, ils nous posent des problèmes, parce qu’ils tiennent un discours très nationaliste – d’ailleurs, pour eux, l’Union, c’est la libération nationale.
Ne pensez-vous pas qu’une initiative de défense, puissante, s’imposerait ? C’est entendu, l’Allemagne a le leadership économique de l’Europe, mais la France pourrait assurer le leadership en matière de défense. Elle pourrait par exemple prendre l’initiative d’une conférence sur la défense et la sécurité en Europe. Cette proposition pourrait être entendue par l’Allemagne sans que cela blesse son amour-propre. Nous travaillerions également, évidemment, avec les pays du groupe de Visegrád.
Ne faudrait-il pas, en revanche, que nous nous montrions fermes sur d’autres sujets ? Je songe au fait que les valeurs européennes sont transgressées dans certains pays comme la Hongrie et la Pologne. Nous avons le bras qui tremble et les oppositions nationales, diverses, sont en très grande difficulté. Elles voient l’Europe laisser la main, par pusillanimité, à des gouvernements ultranationalistes toujours plus éloignés de ses valeurs.
M. Michel Piron. Merci beaucoup, madame, pour votre exposé, plein de lucidité et de sagesse, en même temps qu’il invite à s’interroger.
Sur le plan économique, on ne peut pas, aujourd’hui, ne pas faire le constat que la monnaie commune, dont j’étais un chaud partisan, a atteint ses limites, à tel point que les mêmes remèdes ne produisent pas les mêmes effets. C’est un immense problème que d’avoir une monnaie trop forte pour des pays du sud qui décrochent, peut-être faible pour des pays du Nord qui prospèrent – voyez ce qui se passe en Espagne, au Portugal ou en Italie. Si les ajustements monétaires d’hier se faisaient, certes, dans un certain désordre, ils sont désormais impossibles. Quant aux migrations internes à l’Europe, dont on parle peu, elles se font tout simplement au détriment des pays du Sud, notamment l’Italie et l’Espagne, dont les jeunes les mieux formés gagnent les pays du Nord. Cela pose quand même de graves questions sur le moyen et le long terme. J’aimerais votre sentiment – pour ma part, je n’ai pas de réponses.
Ma deuxième question concerne la défense. Pourquoi pas, effectivement, face au comportement, insolite, de M. Trump et à celui, malheureusement très assuré, de M. Poutine, une initiative forte, franco-allemande, ou franco-germano-italienne ?
Enfin, j’aimerais votre sentiment sur les cultures respectives de nos différents pays, qui imprègnent leurs rapports à l’économie, à la finance ou encore à la défense. C’est aussi pour cette raison que, de l’Europe du Nord à l’Europe du Sud, les mêmes remèdes ne produisent pas forcément les mêmes effets.
M. Christophe Caresche. Je reviens sur le couple franco-allemand et sur la question d’une éventuelle relance de l’Europe.
Tout d’abord, une certaine défiance me semble s’être installée, qui tient à des choix stratégiques d’insertion dans la mondialisation assez différents, qui se sont affirmés à partir des années 2000. Les choix stratégiques sont différents, les résultats aussi. Alors que la France et l’Allemagne étaient à peu près au même niveau au début des années 2000, aujourd’hui, parce que des choix ont été faits, notamment par M. Schröder, et parce que la crise de 2008 est passée par là, nos situations objectives respectives rendent le dialogue très difficile. Les Français s’imaginent que les Allemands veulent leur imposer un certain nombre de choses ; quant aux Allemands, ils doutent de notre crédibilité, de notre sérieux. Si je suis très favorable, intellectuellement, à une relance de l’Europe, je n’en pense pas moins que ce sera difficile. Cependant, deux éléments nouveaux peuvent changer la donne. D’une part, le Brexit, s’il ne fait pas plaisir aux responsables allemands, ramènera l’Europe sur un axe franco-allemand. D’autre part, ce qui se passe aux États-Unis devrait aussi pousser à l’unité des Européens.
Comment procéder ? Deux voies sont possibles.
L’une, que vous avez suggérée, madame, est celle d’une plus forte intégration, notamment dans le cadre de la zone euro, mais les positions respectives des uns et des autres restent très éloignées, ce sera très laborieux. Beaucoup a été fait, depuis 2008, mais ce fut difficile. Rappelez-vous le débat sur le pacte de stabilité, le débat sur le Mécanisme européen de stabilité, le débat sur la Grèce : tout cela ne s’est pas fait dans l’allégresse et la concorde ! Il sera donc très difficile, même si c’est nécessaire, d’aller vers une intégration plus forte, ne nous le cachons pas.
Je suis donc assez d’accord avec Gilles Savary lorsqu’il suggère de changer un peu de terrain. D’un certain point de vue, un terrain plus politique serait plus praticable. Et puis il y a cette autre idée, avancée par Hubert Védrine, d’une remise à plat, d’une « opération vérité » sur le fonctionnement et les compétences de l’Europe. Il suggère une conférence sur ces questions, pour que nous repartions du bon pied, pour en finir avec un discours de fuite en avant. C’est comme le vélo : si on arrête de pédaler, l’Europe tombe, mais ne faut-il pas s’arrêter pour faire le point et voir si nous ne pouvons pas continuer un peu différemment ?
La présidente Danielle Auroi. J’ajouterai mon grain de sel.
Une fois de plus, nous avons beaucoup parlé d’Europe économique, et guère d’autre chose. Je reprendrai, pour ma part, les propos très provocateurs du philosophe Étienne Balibar, précédente personnalité auditionnée dans le cadre de nos travaux : le jour où nous avons décidé de faire la concurrence libre et non faussée, nous avons renoncé à l’Europe sociale et déstructuré, en la déséquilibrant, la construction européenne. Êtes-vous d’accord avec cette analyse ? Et la question est-elle débattue en Allemagne ?
Je voudrais aller un peu plus loin sur l’Europe de la solidarité. Je souscris à l’idée d’une conférence de la défense et de la sécurité, avancée par mes collègues, mais pour faire quoi et pour qui ? Nous nous sommes trouvé un ennemi commun, l’État islamique, qui revendiquera bientôt le naufrage du Titanic, mais élaborer une défense commune, ce n’est pas simplement ériger des barrières, c’est aussi être solidaire des réfugiés climatiques de demain. Un milliard de personnes se déplaceront au cours des quinze prochaines années si la lutte contre le changement climatique ne prend pas plus de consistance. Ne pourrions-nous donc pas envisager un dispositif plus équilibré entre, d’une part, une Europe de la défense et, d’autre part, une Europe à la pointe de la lutte contre le changement climatique, solidaire d’un certain nombre de pays menacés, les uns, par la désertification et, les autres, par la montée des eaux. L’Europe n’aurait-elle pas ainsi un double champ pour reprendre une construction politique bien plus qu’économique ?
Et devons-nous conserver le système de Dublin et continuer de considérer que seules la Grèce et l’Italie sont concernées par la question des réfugiés ? Du coup, nous sommes obligés de passer sous les fourches caudines de M. Erdoğan… De même, au lendemain du discours de Mme May, je me demande si nous devons nous en tenir au traité du Touquet.
Quant au rôle des parlements nationaux, il tient largement à la procédure du « carton jaune », mais ils ont essayé de faire autre chose, avec le « carton vert », sur le gaspillage alimentaire et sur la responsabilité des multinationales par rapport à leurs filiales. Dans les deux cas, la Commission européenne a répondu que les directives traitaient déjà les problèmes soulevés. En somme, circulez, il n’y a rien à voir ! Une récente étude démontre pourtant, à rebours de la position de la Commission européenne, que le gaspillage alimentaire s’aggrave ; le travail ne se fait donc pas. Dès lors, n’y a-t-il pas matière à des ajustements, sinon une remise à plat des institutions ? Je ne suis pas favorable à une révision des traités à l’heure actuelle, mais le sujet ne mérite-t-il pas réflexion ?
M. Michel Piron. Je dois vous quitter pour une autre réunion de commission, mais je lirai, madame, vos réponses avec d’autant plus d’attention que votre culture du fédéralisme peut nous être d’un précieux secours pour éviter l’écueil de référendums hasardeux.
Mme Daniela Schwarzer. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, pour ces réactions extrêmement riches, qui m’incitent à la réflexion, indépendamment même du cadre de notre audition.
Qu’en est-il aujourd’hui de la zone euro ? Faut-il en faire le noyau dur de l’Europe ? Faut-il la réformer ? Selon moi, en l’absence de réforme, le risque d’éclatement de la zone euro est élevé. Il est extrêmement compliqué de trouver un compromis franco-allemand, mais c’est possible. Et si, au contraire, nous attendons, pourrons-nous, simultanément, développer les institutions et gérer une nouvelle crise ? C’est ainsi que les choses se passent depuis 2008. Selon moi, il serait préférable de retravailler tranquillement toutes ces questions extrêmement compliquées. Demandons-nous très sérieusement ce que nous risquerions à ne pas agir ! Une telle réflexion ne peut être publique. Pour ma part, j’entame des travaux lundi prochain avec les Allemands sur les scénarios de crise envisageables et le coût d’une préparation insuffisante.
Au moment de la crise, quand les tensions étaient très vives, l’avenir de la Grèce au sein de la zone euro a été l’objet, en Allemagne, d’importants débats. Nombreux étaient ceux qui estimaient que ce pays ne voulait pas coopérer et que la Grèce, comme l’Italie, ne pouvait vivre avec une monnaie forte et les structures mises en place ; c’est à la fois une question d’architecture et d’instruments et une question de volonté politique et de culture. Cette question du Grexit, à laquelle une réponse a été donnée en 2015, au niveau du Conseil européen, et qui était l’objet d’intenses échanges entre les gouvernements français et allemand, n’était pas seulement économique et financière, c’était aussi une question géopolitique. C'est un changement important, pour l’Allemagne, que celui qui l’a conduite à envisager la question de la cohérence et de l’existence de la zone euro, avec tous ses membres, d’une manière plus géopolitique.
Si nous n’agissons pas sur la zone euro, quel en serait le prix, en termes économiques, en termes de stabilité des pays membres susceptibles de la quitter mais aussi en termes géopolitiques et de crédibilité de l’Union européenne ? Le contexte politique est de plus en plus difficile. La meilleure option n’est-elle pas de retravailler pour que le système fonctionne ? Nous avons plus à perdre en renonçant à la monnaie unique, d’autant que la procédure de divorce serait très compliquée. La question n’en est pas moins légitime car, au bout de dix-sept ans de monnaie unique, les pays du sud de l’Europe ont des problèmes économiques et sociaux.
Cela m’amène à la question de l’Europe sociale. Je suis convaincue, personnellement, que nous devons avancer. Entre le chômage des jeunes et la migration des jeunes qualifiés des pays du Sud, nous ne sommes pas sur la voie d’une Europe plus équilibrée. Il nous faut donc y travailler, avec des instruments européens. Je l’ai dit tout à l’heure : la zone euro doit réfléchir davantage aux mécanismes et instruments de stabilisation – cela inclut un volet social. En Allemagne, les sociaux-démocrates se préoccupent de cette question, mais le débat doit mûrir. Ces considérations seront mieux entendues si nous montrons à quel point l’Allemagne profite de la situation en Europe et dans la zone euro, alors même que les citoyens allemands ont plutôt l’impression d’être tout le temps en train de payer pour les autres. Il y a là un décalage de perception sur lequel il faut travailler.
Effectivement, une initiative en matière de défense, proposée par la France et l’Allemagne, serait souhaitable, mais, dans ce domaine, c’est sans doute la France qui est le pays le plus fort, le plus crédible et le plus ambitieux. L’Allemagne n’en évolue pas moins, avec cette réflexion stratégique engagée par notre gouvernement, qui prépare le public et le parlement allemands à une prise de responsabilités plus importante. Cette évolution est plutôt positive, mais je suis d’accord avec vous : nous sommes toujours dans cette situation où le couple franco-allemand fonctionne parce qu’il y a un leader en matière économique et un leader en matière de politique de défense et de politique étrangère.
En Allemagne, nous ne parlons pas assez de l’Afrique. Il est donc bon que la France l'évoque dans le cadre du dialogue franco-allemand et au niveau européen. Entre le changement climatique, les conflits, l’instabilité politique, les problèmes de sécurité dans plusieurs régions d’Afrique, les migrations vers l’Europe risquent d’être plus nombreuses, et elles peuvent déstabiliser le continent africain lui-même. En Allemagne, cette question est sous-traitée ; la France peut apporter beaucoup de ce point de vue.
Quant à l’accord avec la Turquie, pays dont nous connaissons l’actualité, qu’advient-il si M. Erdoğan décide de s’en servir pour mettre la pression sur l’Union européenne ? Plus généralement, nous avons autour de nous des acteurs qui constatent les faiblesses de l’Union européenne et sont prêts à en jouer. Nous devons donc comprendre que notre cohérence interne et notre coopération politique sont plus importantes que jamais. Préparons-nous et évitons que nos faiblesses soient utilisées contre nous. Dans une situation politique extrêmement fragile, ne disons pas que c’est dans les deux ans ou jamais que l’Europe doit être renforcée, car certains acteurs essaieront de rendre impossible ce progrès politique dans les deux ans. Nos responsabilités sont plus grandes que nous ne le croyons.
Quant à nos cultures respectives, oui, la situation actuelle est perçue très différemment d’un pays à l’autre. Ainsi, en matière économique, la crise est toujours l’objet de deux récits différents, même au sein de la zone euro ; en Allemagne, je n’entends pas le même discours qu’à Paris. Si nos analyses sont différentes, nos réponses politiques le sont aussi, forcément. Cela s’explique par des intérêts économiques différents mais aussi par un contexte idéologique différent, une pensée économique tout à fait différente. Ayant travaillé en France et en Allemagne, ayant également beaucoup travaillé avec Britanniques et Américains, je mesure à quel point le simple fait de se rendre compte de ces différences suppose un énorme travail. J’en tire la conclusion qu’il faut commencer très jeune à développer une compréhension de l’autre. Les programmes d’échanges, entre étudiants mais pas seulement, méritent donc un engagement plus fort. Le modèle des écoles bilingues se développe en Allemagne, même dans le secteur public. Ne pas comprendre la langue de l’autre, c’est déjà un très grand obstacle, notamment sur la voie de l’accès à sa culture. Pour une compréhension profonde de l’autre, pour comprendre, par exemple, la place de l’État dans une société, il faut comprendre la langue, connaître la culture et l’histoire du pays. Nous devons donc investir davantage, construire des éléments de société européenne et former des citoyens européens pour qu’ils puissent participer dans ce système.
Quant au climat, madame la présidente, effectivement, l’Europe doit prendre davantage de responsabilités, surtout à l’heure de certains changements aux États-Unis. Le développement durable reste un sujet clé. Le débat, en Allemagne, est assez avancé, poussé par les Verts qui ont présenté tout un projet très intéressant, qui est à la fois un projet écologiste, une vision économique et un modèle de croissance et influence sensiblement la réflexion des autres partis. Il me paraît très positif que ceux-ci se soient saisis également de la question.
La présidente Danielle Auroi. Grâce à vous, nous avons abordé un certain nombre de questions supplémentaires et approfondi notre réflexion. Estimant nous aussi que ne pas agir serait dramatique, nous suivrons avec beaucoup d’intérêt vos travaux, notamment sur le coût que représenterait le fait de ne pas agir.
ANNEXE :
CONCLUSIONS ADOPTÉES
SUR L’AVENIR DE L’UNION EUROPÉENNE, EN PERSPECTIVE DU SOMMET DE BRATISLAVA
La commission des Affaires européennes,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu la déclaration « Plus d’intégration européenne : le chemin à parcourir » adoptée conjointement le 14 septembre 2015 par la présidente de la chambre des députés italienne, le président de l’Assemblée nationale, le président du Bundestag et le président de la chambre des députés du Luxembourg, et adoptée ensuite par treize autres présidents de parlements de l’Union européenne,
Vu l’accord de Paris sur le climat, du 12 décembre 2015,
Vu la résolution du Parlement européen sur la décision de quitter l’Union européenne à la suite du résultat du référendum au Royaume-Uni, du 28 juin 2016,
Vu la déclaration sur l’avenir de l’Europe des ministres des affaires étrangères du Triangle de Weimar, du 28 août 2016,
Considérant que la construction européenne a contribué de façon essentielle à la paix, la démocratie, la promotion des droits fondamentaux et la prospérité en Europe, et qu’elle reste la meilleure chance pour l’avenir des peuples européens et leur principal atout pour promouvoir, ensemble, une mondialisation respectueuse des humains, de leurs droits et de la planète ;
Considérant que, l’Union européenne étant fondée sur une aspiration collective au développement économique et social et à la paix, la construction d’une Europe sociale doit être une priorité ;
Considérant que l’action de l’Union européenne doit permettre d’atteindre de meilleurs résultats qu’au niveau national, par des partenariats et un dialogue renforcés ;
Considérant que, dans le contexte d’une grande instabilité et de la succession de crises de natures multiples (économiques, financières, sociales, démocratiques, environnementales, migratoires, …), internes et externes, la construction européenne souffre gravement et durablement, depuis plusieurs décennies, d’une absence de stratégie d’ensemble, de perspectives mobilisatrices, et d’un déficit de débat public et d’adhésion populaire,
Considérant qu’à défaut d’accord politique entre les États membres, le mouvement d’intégration est resté inachevé dans des domaines clés tels que la coordination des politiques économiques, la convergence des régimes sociaux, les contrôles aux frontières, malgré les propositions faites par la France en juillet 2015 d’approfondissement de la zone euro, qui, tout comme les tentatives de mise en place d’eurobonds en 2012, n’ont pu faire l’objet d’un consensus au sein des États membres, empêchant de fait toute sortie de la crise par le haut,
Considérant que les progrès sans commune mesure réalisés sous l’impulsion du Président de la République française depuis 2012, dans la direction d’un assouplissement de l’application du Pacte de stabilité et de la politique monétaire de la BCE, mais aussi à travers un plan d’investissement massif et une révision de la directive sur le détachement des travailleurs constituent des avancées importantes qu’il convient pérenniser et de renforcer,
Considérant que la crise des réfugiés a mis en lumière des fractures profondes et un manque patent de solidarité entre États membres, des difficultés importantes à mettre en œuvre les décisions prises par l’Union européenne, et a conduit à des remises en cause de la liberté de circulation des personnes, menaçant ainsi un des acquis majeurs de l’Union,
Considérant que l’essor des populismes et des nationalismes, à l’œuvre dans la plupart des États membres, constitue une menace directe tant pour l’Union européenne que pour la démocratie, les droits humains et la paix sur le continent,
Considérant que la confiance des citoyens envers les institutions européennes s’est fortement dégradée, mais que les enquêtes d’opinion montrent que l’attachement à l’appartenance à l’Union européenne reste majoritaire et qu’à ce titre les citoyens sont en attente d’une action forte de l’Union,
Considérant que le contrôle démocratique, la transparence du fonctionnement des institutions européennes et la responsabilité partagée et assumée des autorités sont le meilleur rempart contre la méfiance et la défiance vis-à-vis des institutions et des pouvoirs communautaires et de leurs représentants,
Considérant que les fragilités apparues à l’est et au sud des frontières de l’Union européenne impliquent de tout mettre en œuvre pour renforcer la résilience de l’Union européenne et la consolider comme un pôle de stabilité régionale et internationale,
Considérant par ailleurs que, dans un contexte de forte interdépendance, les États membres ne peuvent répondre avec efficacité, au seul niveau national, aux défis auxquels ils sont actuellement confrontés (gestion des migrations, lutte contre le terrorisme, relance de l’investissement et de l’emploi, politique étrangère, sécurité intérieure et extérieure, lutte contre le changement climatique, protection de l’environnement, sécurité énergétique, …)
Considérant que face aux menaces identifiées et qui entraînent pour la première fois dans l’histoire de l’Union un risque réel de dislocation, un sursaut politique de solidarité européenne est indispensable, pour redonner un sens et renouer la confiance en l’Union,
Considérant que ce sursaut pour une union renouvelée doit se manifester par un plan d’intégration renforcée, avec un cap politique clair et partagé, à travers des actions concrètes dans les domaines prioritaires – pour lesquels, dans une logique de subsidiarité, l’action de l’Union apporte une réelle valeur ajoutée – assorties d’un calendrier et des moyens nécessaires, notamment budgétaires,
Considérant que cette refondation démocratique et sociale doit être nourrie d’un dialogue étroit avec les citoyens européens, et porter sur les domaines pour lesquels ceux-ci sont prioritairement en attente d’une action efficace de l’Union,
Considérant que cette refondation doit comporter un approfondissement de la démocratie européenne, passant en particulier par un renforcement de sa dimension parlementaire, associant de façon complémentaire le Parlement européen et les parlements nationaux, dans leurs champs de compétences respectifs,
Considérant que le processus d’intégration ne peut qu’être différencié, pour que la volonté d’aller de l’avant de certains États membres ne soit pas entravée par ceux qui ne la partagent pas,
Considérant qu’il convient, au moins dans un premier temps, de privilégier les actions communes pouvant être conduites sans modification des traités,
Considérant que la France a, depuis le début de la construction européenne, une responsabilité et un rôle particulier en Europe, s’agissant notamment de sa capacité d’initiative, de proposition, au service de l’intérêt général européen, qu’elle doit pleinement assumer, afin d’être en capacité de convaincre et d’entraîner ses partenaires,
Considérant que ce rôle doit être assumé dans le cadre de la poursuite d’un dialogue étroit avec l’Allemagne, pour déboucher sur des propositions concrètes rapides, indépendamment des échéances électorales de l’année 2017,
Considérant que la France et l’Union européenne ont de longue date pris conscience de l’urgence des enjeux climatiques et se sont à ce titre fixées des objectifs ambitieux conciliant développement économique, innovation, justice sociale et faible empreinte carbone,
Considérant qu’à l’issue du référendum britannique du 23 juin 2016, et compte tenu des menaces de tous ordres pesant à l’heure actuelle sur l’Union européenne, la réflexion collective sur son avenir est activement relancée entre États membres, et qu’un sommet européen doit se réunir à ce propos à Bratislava le 16 septembre, à l’invitation de la présidence slovaque,
Considérant les propositions ambitieuses du Président de la République dans le cadre de son discours devant les Ambassadeurs appelant à la mise en place rapide d’un corps de gardes-frontières européens, le lancement d’une coopération structurée en matière de défense, le doublement du plan « Juncker » d’investissement, une véritable harmonisation sociale et fiscale, la création d’une capacité budgétaire de la zone euro et la possibilité pour tout jeune de bénéficier d’un programme de mobilité européen,
Considérant qu’il convient que les parlements nationaux participent à la réflexion engagée, notamment en indiquant les priorités politiques, dans le cadre d’une démarche d’ensemble, qu’ils souhaitent proposer à l’Union,
Affirme son attachement à poursuivre le processus d’« une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe », inscrit au préambule du traité de l’Union européenne ;
Approfondir la démocratie parlementaire européenne
Appelle à un approfondissement démocratique de l’Union, qui s’incarne notamment dans la formalisation de la capacité des parlements nationaux à être force de proposition législative au niveau européen (« cartons verts »), la mise en place d’un parlement de la zone Euro, apte à exercer un contrôle démocratique sur la gestion collective de la zone par les gouvernements, la confirmation institutionnelle de la prise en compte du résultat des élections européennes pour la désignation par le Conseil du président de la Commission européenne, l’organisation annuelle d’un Congrès, composé des membres du Parlement européen et de représentants des parlements nationaux, pour entendre le discours sur l’état de l’Union du président de la Commission européenne et débattre des priorités de l’Union ;
Renforcer l’intégration de la zone euro
Propose un renforcement de la gouvernance de la zone euro, outre la création d’un parlement de la zone euro, par l’institution d’une présidence stable de l’Eurogroupe, la mise en place d’un budget propre à l’Union Économique et Monétaire, au service de l’investissement et de l’emploi, et la mise en place progressive d’une expression unique des pays de la zone euro dans les organisations économiques et financières internationales ;
Soutenir les économies européennes par l’investissement et favoriser la convergence sociale et fiscale
Préconise un plan de convergence fiscale progressif, assorti éventuellement de coopérations renforcées, contribuant à une convergence des économies et des systèmes de protection sociale européens, et à la poursuite résolue de la lutte contre l’évasion fiscale, dans des conditions loyales de concurrence ;
Demande une prolongation du « plan d’Investissement pour l’Europe » au service de l’investissement, se traduisant par le doublement des financements de la première phase du plan, et donnant la priorité à la transition énergétique ;
Soutient l’achèvement rapide de l’union bancaire par la mise en place d’un système européen de garantie des dépôts ;
Développer les capacités budgétaires de l’Union
Considère que les capacités budgétaires de l’Union doivent être renforcées à l’occasion du débat à mi-parcours sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, pour s’adapter à la relance de l’Union, conforter la politique agricole commune et la politique de développement régional, en tant que principales politiques intégrées de l’Union porteuses de solidarité européenne, et décider par ailleurs la mise en place de véritables ressources propres, comme prévu par le traité sur le fonctionnement de l’Union (TFUE), notamment par l’instauration d’une taxe sur les transactions financières ;
Concrétiser l’Europe sociale
Demande un développement sensible de la dimension sociale de l’Union, à travers notamment l’adoption d’un socle minimal des droits sociaux, la coordination des systèmes de sécurité sociale, un renforcement de la Garantie pour l’emploi des jeunes, l’aboutissement rapide des négociations relatives au renforcement des règles sur le détachement des travailleurs, fondé sur le principe « à travail égal, salaire égal », la mise en place d’une assurance chômage européenne, complémentaire des systèmes nationaux, la généralisation de salaires minimaux nationaux dans tous les pays de l’Union et leur convergence progressive ;
Développer une politique migratoire commune et solidaire
Préconise une intégration renforcée des politiques migratoires, par la mise en place rapide d’un contrôle effectif des frontières extérieures communes, le rétablissement, en conséquence, de la liberté de circulation entre États membres, la mise en place de couloirs d’immigration légale sécurisés, une répartition des demandeurs d’asile équitable entre les États membres et la réforme du règlement de Dublin, prévoyant des règles communes en matière d’octroi de l’asile ;
Lutter ensemble contre le terrorisme
Demande un renforcement de l’action de l’Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme, par une action coordonnée dans le domaine de la prévention et la promotion de nos valeurs communes de paix, de tolérance et de solidarité, une coopération renforcée des polices, des pouvoirs accrus pour Europol et Eurojust, la mise en place rapide d’un parquet européen, dont la compétence serait étendue au terrorisme et à la lutte contre la criminalité transfrontière ;
Lutter contre le changement climatique, mettre en œuvre l’Union de l’énergie et protéger l’environnement
Considère que l’Union européenne doit maintenir sa position pionnière en matière de lutte contre le changement climatique, en ratifiant rapidement l’accord de Paris, en mettant en œuvre les engagements déjà pris en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de baisse de la demande et de développement des énergies renouvelables, en renforçant les objectifs fixés en matière d’efficacité énergétique et les actions engagées sur le prix du carbone, notamment en réformant rapidement le marché des droits d’émission de gaz à effet de serre ;
Demande la mise en place d’une taxation carbone aux frontières de l’Union et l’instauration d’un mécanisme de détermination d’un prix du carbone encadré au niveau international ;
Souhaite la concrétisation des priorités fixées dans le cadre de l’Union de l’énergie, notamment en matière de sécurité énergétique, à travers une intégration européenne renforcée des contrats d’approvisionnement et des réseaux ;
Soutient le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection de l’environnement, notamment de la santé environnementale et de la biodiversité, au niveau européen, comme au plan international ;
Approfondir l’action commune en matière d’éducation et de culture
Appelle à un renforcement des programmes d’échanges et de rencontres dans tous les domaines (sciences, technologie, langues, culture, …), pour que tous les Européens, et en particulier les jeunes, puissent participer à un programme de mobilité, favorisant ainsi les échanges, la compréhension mutuelle et le sentiment d’identité et de citoyenneté européennes ;
Appelle pour cela les États membres à s’engager en faveur de la création d’un véritable passeport européen pour la mobilité donnant à la possibilité à tout jeune à partir de quinze ans de faire un séjour à l’étranger à partir du collège, de s’engager dans le cadre d’un volontariat ou d’un service civique dans un autre pays de l’Union européenne et d’avoir accès, conformément au droit des États membres, à des dispositifs d’information, d’aide à la formation et à la recherche d’emplois en Europe ;
Estime nécessaire un développement de la politique culturelle de l’Union, par des initiatives concrètes, telles que l’année européenne du patrimoine culturel, en faveur de la création, de la promotion et de la diffusion des œuvres, propices à stimuler le partage d’une culture commune ;
Mettre en place une politique industrielle européenne
Souhaite la mise en place d’une stratégie industrielle européenne, co-élaborée avec les acteurs économiques et assise notamment sur une politique européenne de la recherche et de l’innovation renforcée, tant dans les domaines scientifiques que sociétaux, via des programmes communs de recherche ;
Agir efficacement dans le monde, au service de la sécurité, de la paix et du développement durable
Préconise un renforcement de l’action commune de l’Union dans le monde, au service de la sécurité, de la paix et du développement, dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne en matière de politique étrangère et de sécurité ;
Souhaite un renforcement de la politique de sécurité et de défense commune, reposant sur un livre blanc de la défense européenne, visant à la construction progressive de l’autonomie stratégique de l’Europe, en engageant toutes les possibilités prévues par le traité de Lisbonne, notamment la mise en œuvre de la coopération structurée permanente, la promotion du rôle de l’Agence européenne de Défense dans la coopération entre les États-membres, et le renforcement des financements possibles par le budget de l’Union des opérations militaires d’intérêt commun ;
Est favorable à une représentation commune de l’Union au sein des organisations internationales, permettant à l’Europe de parler d’une seule voix ;
Souhaite que la négociation des accords commerciaux entre l’Union européenne et ses partenaires associe en amont les parlements nationaux, soit menée de façon transparente et que les parlements les ratifient. Ces accords doivent être conclus dans le respect des préférences collectives des Européens en matière d’éthique, de travail, de santé, de sécurité environnementale et alimentaire, d’agriculture, de droits humains, de droits du vivant et de protection de la vie privée ;
Soutient par conséquent pleinement la demande de la France de mettre un terme aux négociations actuelles entre l’Union européenne et les États-Unis visant à l’établissement d’un partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement ;
Souhaite que la politique européenne en faveur du développement soit renforcée pour accompagner plus efficacement les pays défavorisés sur la voie du développement durable.
1 () Rapport d’information déposé par la commission des Affaires européennes sur l’approfondissement démocratique de l’union, et présenté par Mme Danielle Auroi, 25 juin 2013.
2 () Compte-rendu annexé au présent rapport.
3 () Compte-rendu annexé au présent rapport.
4 () Compte-rendu annexé au présent rapport.
5 () Compte-rendu annexé au présent rapport.
6 () Compte-rendu annexé au présent rapport.
7 () Rapport d’information déposé par la commission des Affaires européennes sur le renforcement de l’union économique et monétaire et présenté par MM. Philip Cordery et Arnaud Richard, 29 novembre 2016.
8 () Compte-rendu de l’audition annexé au présent rapport.